
Arthur Bernède
L’HOMME AU MASQUE DE FER
Éditions Jules Tallandier, 1930 (6 février 1931)
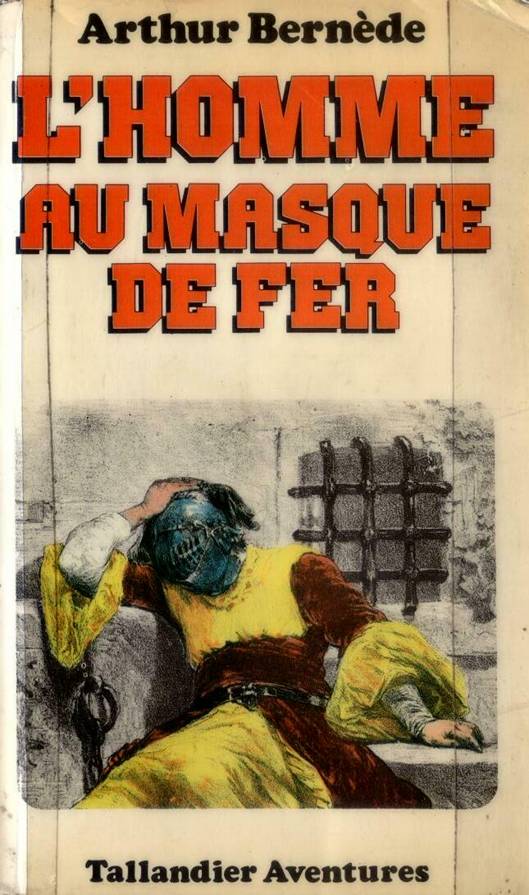
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/
Table des matières
PREMIÈRE PARTIE L’ENFANT DU MYSTÈRE
CHAPITRE PREMIER LA SURPRISE DU CARDINAL
CHAPITRE II LE CHEVALIER GASCON
CHAPITRE III LA DUCHESSE ET LE CHEVALIER
CHAPITRE IV À L’HOSTELLERIE DU « FAISAN D’OR »
DEUXIÈME PARTIE L’ÉPOPÉE DE LA HAINE
CHAPITRE PREMIER UN ORAGE PROVIDENTIEL
CHAPITRE II MARIE DE ROHAN PART POUR UN AGRÉABLE EXIL
CHAPITRE III UN ENVOYÉ DU CARDINAL
CHAPITRE IV LA PROMESSE DE CASTEL-RAJAC
TROISIÈME PARTIE LE PRISONNIER DE L’ÎLE SAINTE-MARGUERITE
CHAPITRE PREMIER LA VENGEANCE DE DURBEC
CHAPITRE II LE TEMPS DES PÉRILS
CHAPITRE III OÙ CASTEL-RAJAC PART EN CAMPAGNE
CHAPITRE V LA RUSE ET LA FORCE
À propos de cette édition électronique
PREMIÈRE PARTIE
L’ENFANT DU MYSTÈRE
CHAPITRE PREMIER
LA SURPRISE DU CARDINAL
À l’époque où commence cette histoire, c’est-à-dire au début du printemps de l’année 1637, le cardinal de Richelieu avait atteint l’apogée de sa puissance.
Déjà gravement atteint par la maladie qui devait quelques années plus tard le conduire au tombeau, on eût dit qu’il n’avait plus qu’à se reposer sur ses lauriers encore rouges du sang des victimes qu’il avait cru devoir immoler pour le triomphe de ses idées et de sa cause.
Il n’en était rien. Jamais encore le grand cardinal n’avait déployé, mais en secret cette fois, une activité plus fébrile ; car jamais encore, peut-être, aucun problème aussi troublant ne s’était posé à son esprit, sous la forme de cette question :
– Que va devenir la couronne de France ?
La reine Anne d’Autriche, en effet, n’avait pas encore donné d’héritier à la couronne. Or les médecins avaient déclaré qu’elle n’était point stérile et qu’elle était, au contraire, capable d’avoir de beaux et nombreux enfants.
C’était donc le roi, qu’il fallait rendre responsable de cette non-paternité qui préoccupait si vivement l’homme rouge, tant il redoutait, faute d’héritier direct de la couronne, de voir son ennemi le plus acharné, Gaston d’Orléans, succéder à son frère.
Richelieu avait beau imaginer les projets les plus divers, il ne trouvait aucune solution à un état de choses qui ne pouvait que se résoudre par sa propre perte, et par la ruine de toute sa politique.
Ce jour-là, Richelieu, suivant son habitude, se promenait, après son frugal repas de midi, dans les splendides jardins de sa résidence de Rueil située à deux lieues environ de Paris.
Toujours escorté de ses gardes, car, depuis qu’il avait failli, un soir, sur la route de Saint-Germain, être enlevé de vive force par un groupe de cavaliers masqués, Richelieu, même dans son parc, ne sortait jamais sans escorte, tant il craignait un nouveau coup de force de la part d’adversaires qui n’avaient point désarmé. Ses gardes le suivaient à une distance respectueuse, mais suffisante pour qu’ils pussent l’entourer à la moindre alerte.
Après s’être assis quelques instants sur un banc, à l’ombre de grands tilleuls qui étendaient au-dessus de son front l’ombre de leurs larges feuilles, vêtu comme toujours de son camail rouge, sur lequel tranchait la blancheur d’un large col en dentelles fermé par deux glands d’or et le bleu moiré du large ruban de la croix du Saint-Esprit, coiffé de la barrette, d’où s’échappaient ses longs cheveux grisonnants, le cardinal se leva pour continuer sa promenade méditative.
Il s’arrêta tout à coup et dit au capitaine de ses gardes, un reître au visage balafré, abrité par un large chapeau de feutre orné d’une immense plume rouge :
– Quel est ce gentilhomme qui s’avance là-bas ?
– Éminence, c’est M. de Durbec.
– C’est juste ! fit le cardinal, je ne l’avais pas reconnu. Décidément, ma vue baisse…
Et il soupira :
– Qu’il est donc pénible de vieillir, quand on aurait encore tant besoin de sa jeunesse !
M. de Durbec, gentilhomme de mise fort élégante, au profil aristocratique, au regard tout brûlant d’une flamme qui n’exprimait pas la bonté, s’immobilisa à quelques pas du cardinal et, s’inclinant devant le maître, il attendit que celui-ci lui donnât l’ordre d’approcher.
Richelieu le toisa un instant, comme s’il éprouvait envers ce personnage une méfiance doublée d’un certain mépris. Enfin, il l’invita de la main à s’avancer vers lui.
M. de Durbec obéit ; il allait adresser au cardinal un nouveau salut, quand celui-ci, d’un ton impérieux, lui dit :
– Sans doute, monsieur, pour vous être permis d’interrompre ma promenade, m’apportez-vous d’importantes nouvelles ?
– Oui, Éminence ! Des nouvelles que je ne puis communiquer à nul autre.
Le ministre secoua la tête et dit à son interlocuteur :
– Soit ! monsieur ! suivez-moi.
Il se dirigea vers un petit pavillon, au centre d’une pelouse fleurie. Il poussa une porte qui donnait accès à une pièce octogonale pauvrement décorée et uniquement meublée d’une table, d’un grand fauteuil et de quelques sièges.
Le cardinal fit passer devant lui M. de Durbec. Tandis que les gardes de son escorte entouraient le pavillon, Richelieu, refermant la porte, prit place dans le fauteuil et dit :
– Maintenant, monsieur, parlez !
– Éminence, conformément à la mission que vous m’aviez donnée de surveiller discrètement Sa Majesté la reine, j’ai établi autour du couvent du Val-de-Grâce, où Sa Majesté vient de se rendre pour y faire une retraite de plusieurs semaines, tout un réseau d’informateurs par lequel je viens d’apprendre que Sa Majesté ne se trouvait plus dans ce couvent.
Malgré toute sa maîtrise de lui-même, Richelieu ne put réprimer un tressaillement.
– Sa Majesté n’est plus au Val-de-Grâce ?
– Non, Éminence, elle en est partie depuis plusieurs jours avec la complicité de la mère abbesse qui, dans toute cette affaire, a joué un rôle des plus suspects.
D’un geste nerveux, Richelieu coupa la parole à M. de Durbec.
– Avez-vous pu connaître l’endroit où s’était retirée la reine ?
– Oui, Éminence ! Dans une gentilhommière qui se trouve à un quart de lieue du château de Chevreuse.
– Avez-vous pu découvrir le motif de cette fugue ?
– Oui, Éminence ! Sa Majesté est sur le point de devenir mère.
La foudre fût tombée aux pieds du cardinal qu’elle n’eût sans doute pas produit sur lui un effet aussi impressionnant.
D’un bond, il se leva et, les mains crispées sur les bras de son fauteuil, il s’exclama :
– Que me dites-vous là ?
– La vérité, Éminence.
Richelieu, qui devait avoir de bonnes raisons pour ne point mettre en doute la parole de son interlocuteur, reprit, comme s’il se parlait à lui-même :
– Il me paraît invraisemblable que depuis si longtemps la reine ait pu dissimuler sa grossesse aux yeux de tous… Je sais bien que, depuis quelque temps, elle se plaignait d’être malade et qu’elle évitait de paraître à toutes les réceptions de la Cour…
» Enfin, monsieur Durbec, continuez votre surveillance, tenez-moi au courant de tout ce qui se passera, tâchez de connaître les intentions de la reine au sujet de cet enfant mystérieux, et faites en sorte de savoir, dès qu’il sera venu au monde, à qui on l’aura confié et à quel endroit on l’aura conduit.
» Je n’ajouterai qu’un mot : vous êtes dépositaire, monsieur de Durbec, d’un des plus graves secrets qui aient jamais existé. Votre tête répond de votre silence.
– Votre Éminence peut compter entièrement sur moi. D’ailleurs, elle m’a mis assez souvent à l’épreuve pour qu’elle soit tranquille à ce sujet.
Richelieu regarda son émissaire s’éloigner et, lourdement, comme accablé, se laissa retomber sur son fauteuil.
De qui peut bien être cet enfant se demandait-il. Pour que la reine s’en aille accoucher aussi clandestinement, avec la complicité certaine de son amie la duchesse de Chevreuse, il faut qu’il lui soit impossible de faire accepter au roi la paternité de ce rejeton qui ne peut donc être que le fruit d’un adultère. Cherchons quel peut bien en être le père.
Le front du cardinal se plissa. Dans ses yeux flamba une lueur étrange ; un sourire indéfinissable entrouvrit ses lèvres minces et décolorées, puis un nom lui échappa :
– Mazarin !
Quel était donc cet homme sur lequel venait de se fixer la conviction du grand ministre ?
C’était un jeune Italien, très souple, très fin, fort élégant cavalier, à la voix chaude, insinuante, à l’esprit endiablé, à l’intelligence remarquable, que Richelieu avait remarqué quelque temps auparavant parmi les seigneurs étrangers qui réussissaient, grâce à leur adresse, à se faufiler en si grand nombre à la Cour de France.
Tout d’abord, il signore Mazarini n’avait guère plu au cardinal. Il trouvait qu’il se vantait un peu trop bruyamment de prouesses qu’il avait soi-disant accomplies en Italie, ainsi que des services plus ou moins illusoires que, dans ce pays, il avait rendus à la France. Richelieu avait d’abord eu l’impression que ce Mazarin n’était qu’un aventurier banal, capable de beaucoup plus de bruit que de besogne.
L’Italien ne s’était point tenu pour battu, car il était d’une opiniâtreté rare. Diplomate dans le fond de l’âme, il se dit qu’il ne pourrait rien s’il ne conquérait les bonnes grâces du cardinal. Il s’y employa de son mieux, évitant les moyens trop directs, prenant des chemins détournés, rendant çà et là de menus services, faisant parvenir à celui dont il faisait le siège des renseignements qui, sous leurs apparences insignifiantes, n’en étaient pas moins d’une qualité et d’une importance rares, si bien que Richelieu l’attacha à ses services, dans lesquels il ne tarda pas à se distinguer avec la discrétion, l’habileté, le doigté d’un véritable prestidigitateur de la politique.
Richelieu ne tarda point à s’apercevoir que Mazarin avait produit sur la reine Anne d’Autriche une impression considérable. N’ignorant point que la reine, si outrageusement délaissée par le roi Louis XIII, était au fond une grande amoureuse, l’homme rouge s’était vite persuadé qu’Anne d’Autriche était amoureuse du jeune Italien et, pour des motifs demeurés obscurs, au lieu de chercher à briser cette galante intrigue, l’avait favorisée, non point en l’encourageant d’une façon directe qui n’eût point manqué d’être choquante, mais en rendant chaque jour de plus en plus importante la situation qu’il avait faite à Mazarin auprès de lui.
Il n’avait pourtant pas prévu que cette liaison, qui lui permettait de se tenir au courant de tout ce qui se disait chez la reine, aboutirait au résultat que l’on venait de lui annoncer.
Maintenant que son premier mouvement de surprise était passé, il semblait non point s’en affliger, mais, au contraire, on eût dit qu’il s’en réjouissait intérieurement.
En effet, depuis longtemps, ses yeux n’avaient pas exprimé de satisfaction aussi vive ; ses traits tirés se détendaient et, chose qui ne lui était pas arrivée depuis déjà plusieurs années, il se mit à frotter l’une contre l’autre les paumes de ses mains longues et soignées.
– Allons, murmura-t-il, je crois que ce faquin de Mazarini est décidément appelé à jouer un rôle dans l’histoire de la France !
CHAPITRE II
LE CHEVALIER GASCON
Le même jour, vers sept heures du soir, la salle principale de l’hostellerie du Plat d’Étain, située au cœur du charmant village de Dampierre, était remplie d’une foule de voyageurs qui s’apprêtaient à faire honneur à la cuisine de maître Eustache Collin, dont la renommée s’était répandue à plusieurs lieues à la ronde.
Devant une cheminée dans laquelle flambait un grand feu de bois, maître Collin, énorme gaillard coiffé d’un bonnet blanc qui touchait presque au plafond, une louche à la main, imposant et quasi sacerdotal, surveillait les volailles dodues et déjà à moitié dorées qui rôtissaient au rythme régulier d’un colossal tournebroche.
Sa femme, dame Jeanne, encore plus corpulente que lui, s’agitait, suant, soufflant, et s’évertuant à placer de son mieux ses chalands qui, en attendant les meilleurs morceaux, se disputaient les meilleures places !
Tout son monde étant casé, elle se dirigeait vers son comptoir, afin d’y lamper le verre de vin clairet qu’elle avait si bien mérité, lorsqu’une voix juvénile s’éleva sur le seuil, claironnant avec un accent gascon plein de bonne humeur :
– Bonsoir, tout le monde !
Tous les yeux se dirigèrent vers le nouvel arrivant. C’était un beau garçon de vingt-cinq ans à peine, à la figure à la fois souriante et énergique, à la bouche bien dessinée sous une petite moustache, au menton volontaire que marquait à peine la virgule d’une barbichette. Ses yeux pétillants de malice, sans la moindre méchanceté, provoquaient immédiatement la sympathie, tant ils n’exprimaient qu’un désir de plaire à chacune et d’être bien avec tous.
Dame Jeanne répondit d’un ton cordial :
– Bonsoir, monsieur le cavalier.
Le nouvel arrivant, qui avait dû laisser sa monture à l’écurie, était botté, éperonné, son costume, formé d’un justaucorps, s’ouvrait sur une chemise en toile écrue. Son pantalon, serré à la taille par un ceinturon auquel était attachée une solide rapière, était d’un gris uniforme qu’il devait beaucoup plus à la poussière des chemins qu’à sa couleur naturelle.
La plantureuse hôtelière était beaucoup trop altérée pour pousser plus loin les politesses préliminaires, et elle continua à se diriger vers la bouteille, objet de ses légitimes désirs, ce qui ne parut nullement offusquer le beau jeune homme. Pénétrant dans la salle, il promena autour de lui un regard circulaire, cherchant un coin où il pourrait bien s’asseoir.
Comme il n’en trouvait point, il s’approcha d’un jeune gentilhomme de mise élégante, qui occupait seul une petite table placée près d’une fenêtre.
– Monsieur, fit le cavalier, se découvrant avec politesse, serais-je indiscret en vous demandant de bien vouloir me permettre de m’asseoir en face de vous ?
D’un air hautain, le gentilhomme répliquait :
– Je ne vous connais point, monsieur !
– Souffrez que je me présente : chevalier Gaëtan-Nompar-Francequin de Castel-Rajac.
Froidement, et répondant à peine au salut de son interlocuteur, l’homme interpellé ripostait avec un léger accent italien :
– Comte Julio Capeloni, de Florence.
– Un beau pays, déclarait Gaëtan, de plus en plus aimable. Je n’y suis jamais allé, mais j’ai ouï-dire par mon aïeul paternel, qui y avait quelque peu guerroyé, que Florence était une des plus belles villes du monde.
Ce compliment parut impressionner favorablement Capeloni, car il reprit :
– Moins belle que votre Paris, monsieur le chevalier, puisqu’il sait si bien attirer à lui les habitants des pays les plus reculés du monde.
– Monsieur le comte, reprenait Castel-Rajac, je crois qu’après cet échange de politesses, nous sommes destinés à nous entendre le mieux du monde. Voilà pourquoi je me permets de vous renouveler la demande que je viens d’avoir l’honneur de vous adresser… Voulez-vous m’accepter comme voisin de table ? Vous m’obligeriez infiniment, car je viens de faire vingt lieues à francs étriers… Je meurs de faim, je crève de soif, et cela doit suffire pour que vous ayez pitié de moi.
Gagné par l’entrain du jeune Gascon qui semblait incarner si richement toutes les qualités de sa race, Capeloni, d’un geste gracieux, l’invita à s’asseoir en face de lui.
Et, frappant sur la table, il lança sur le ton d’un familier de la maison :
– Hé là ! dame Jeanne, il vous arrive de province un jeune loup qui a les dents longues. Il s’agit de le rassasier au plus vite car, sans cela, il est capable de vous dévorer toute crue…
Dame Jeanne, qui avait eu le temps d’avaler non pas un, mais trois verres de vin, s’approcha aussitôt de son hôte, qui devait être un client important, car, tout de suite, elle dit avec un empressement qui n’était pas précisément dans ses habitudes :
– Que faut-il servir à ce monsieur ?
Immédiatement, Castel-Rajac répliquait :
– Tout ce que vous avez de meilleur.
Et, frappant sur sa ceinture, il ajouta :
– J’ai de quoi vous régler la dépense. Je viens de faire un héritage… celui d’un oncle qui m’a laissé… cent pistoles.
Rassurée, dame Jeanne s’en fut aussitôt donner ses ordres à l’une des jeunes servantes chargées de répartir la boisson et les vivres entre tous ces ventres affamés qu’il s’agissait de satisfaire. Moins de trois minutes après, devant un verre rempli d’un petit vouvray clair comme un rayon de soleil, Gaëtan-Nompar-Francequin de Castel-Rajac attaquait vigoureusement une énorme tranche de pâté en croûte.
L’Italien, qui en était déjà à la moitié de son repas, regardait le Gascon dévorer avec une expression de sympathie évidente.
– Alors, mon cher chevalier, fit-il au bout d’un instant, vous êtes venu uniquement à Paris dans le but d’y faire ripaille ?
– Oui et non ! éluda le jeune homme.
– Cela m’étonnait aussi qu’un gentilhomme de votre allure s’amusât à faire plus de cent cinquante lieues à cheval pour venir y manger et y boire quelques dizaines de pistoles !
– Mordious, vous avez raison ! approuvait l’excellent Gaëtan, qui vida d’un trait son verre de vin.
Le comte le remplit aussitôt et, élevant le sien, qu’il n’avait pas encore approché de ses lèvres, il dit :
– Chevalier, buvons à nos amours !
– Aux vôtres ! rectifia Gaëtan.
– Aux vôtres aussi, insista son voisin de table.
Avec une naïveté non feinte, le jeune cavalier s’exclamait :
– Ah ça ! comment avez-vous deviné que j’étais amoureux ?
– D’abord parce qu’à votre âge, et avec votre tournure, on l’est toujours.
– À mon âge, oui, mais… quant à ma tournure… je crois que, mon cher comte, vous me flattez un peu trop… Je ne suis qu’un gentilhomme campagnard qui, jusqu’alors, ayant toujours vécu au fond de sa province, ignore les grandes manières de la Cour et surtout l’art de parler aux femmes.
– Je suis sûr, au contraire, protestait l’Italien, que vous ne comptez plus vos succès !
– Là-bas, dans mon pays, auprès d’Agen, je reconnais que j’ai remporté quelques avantages…
– Et vous voulez augmenter, ou plutôt couronner la série de vos exploits en ajoutant à vos conquêtes de terroir celle d’une jolie Parisienne !
Toujours avec la même franchise, Gaëtan répliquait :
– C’est déjà fait, mon cher comte !
– Cela ne m’étonne pas. En amour comme en amitié, je vous crois capable de toutes les prouesses.
Et, tout en posant son coude sur la table et en remplissant pour la troisième fois le verre du beau Gascon, il ajouta :
– Racontez-moi l’histoire de cette conquête.
– Oh ! après tout, faisait Castel-Rajac, je puis bien le faire sans manquer aux lois de l’honneur, car, quand bien même le voudrais-je, il me serait impossible de vous révéler le nom de celle qui, pendant huit jours, m’a rendu le plus heureux des hommes.
L’Italien, qui semblait de plus en plus intéressé, conclut :
– L’aventure devient de plus en plus piquante, et j’ai hâte d’en connaître la suite.
Et, tout en mangeant, car Gaëtan-Nompar-Francequin méritait ce nom de loup affamé que lui avait donné son compagnon de souper, il reprit sur un ton de bonne humeur et de franchise :
– Quelques mots d’abord sur moi. Oh ! ce ne sera pas long, car je suis de ceux qui, à vingt-cinq ans, n’ont pas de bien longues histoires à conter. Je suis le fils unique du baron de Castel-Rajac, ancien page, puis écuyer de Sa Majesté Henri IV, et qui, depuis l’arrivée au pouvoir de Son Éminence le cardinal Richelieu, vit retiré dans son manoir, si tant est qu’on puisse appeler ainsi la pauvre maison à moitié en ruine qui, avec trois maigres fermes, quelques vignes, un étang et un bois de cinquante arpents constitue tout son patrimoine, destiné à devenir le mien, le plus tard possible, si Dieu daigne le vouloir !
» Ma mère passe son temps à s’occuper des soins de la maison, à prier dans l’église du village, à visiter les malheureux et à les soulager de ses soins les plus touchants, en même temps que de ses maigres aumônes. C’est donc vous dire que j’ai été élevé devant un horizon beaucoup trop étroit pour être tourmenté par des ambitions très vives.
» Dans mon enfance, cependant, émerveillé par les récits de mon aïeul, de mon père et de leurs compagnons d’armes, je rêvais d’être à mon tour soldat, officier, et de me battre pour accomplir, moi aussi, de vaillantes prouesses. J’avais, tout jeune, appris à monter à cheval avec un ancien écuyer du brave Crillon, et les armes avec un vieux maître qui vivait retiré dans notre pays et se targuait, à juste titre, d’avoir appris l’art de tuer son prochain aux plus illustres capitaines de ce temps. C’est ainsi que je devins un cavalier assez solide et un escrimeur, ma foi, tout aussi bon qu’un autre.
» Lorsque, ayant atteint ma dix-septième année, je fis part à mes parents de mon projet de m’enrôler dans les armées de Sa Majesté, mon père s’y opposa, sous prétexte que, n’ayant aucune protection à la Cour, quelle que fût ma valeur, je risquais fort de végéter dans les grades subalternes.
» Peut-être aurais-je passé outre à la volonté paternelle, mais je ne pus résister aux larmes de ma mère, qui m’adjura si tendrement de renoncer à mon projet, que je lui cédai et que je restai au pays, me contentant de guerroyer contre les chevreuils, les cerfs, les sangliers et les loups.
» Je vécus ainsi, non dans la joie, mais sans ennui, dépensant mes forces en courses, en galopades, en exercices de toutes sortes, jusqu’au jour où, sur la grande route d’Agen, j’eus l’occasion, une nuit, de dispenser un coup d’épée à trois ou quatre vauriens – je ne sais combien au juste – qui avaient eu l’audacieuse insolence de s’attaquer à un carrosse dans lequel se trouvait une jolie voyageuse évanouie.
– Voici le roman qui commence, souligna l’Italien.
Castel-Rajac, qui avait profité de cette interruption pour vider un nouveau verre de vin, reprenait :
– En effet ! Et quel roman ! Le cocher et les laquais de ma belle inconnue, qui avaient tous été plus ou moins blessés au cours d’une rencontre où ils ne paraissaient point avoir déployé des prodiges de valeur, se lamentaient, incapables de porter secours à leur maîtresse. Je me précipitai vers elle et je me demandais comment j’allais bien m’y prendre pour la ramener à la vie, lorsque ses yeux s’ouvrirent ! Mordious ! quels yeux !… à faire damner un évêque ! Me prenant sans doute pour l’un de ses agresseurs, elle me supplia, d’une voix que j’entendrai toujours :
» – Faites de moi ce que vous voudrez, mais laissez-moi la vie !
» – Madame, répondis-je à l’adorable créature, que sa frayeur rendait encore plus aguichante, croyez que je n’ai nullement l’intention d’abréger vos jours ; je ne demande, au contraire, qu’à vous servir. Je suis le chevalier de Castel-Rajac ; je dépose à vos pieds l’hommage de mon respect et de mon dévouement le plus absolu.
» La voyageuse, visiblement rassurée par ces paroles, répliqua :
» – Monsieur, je vous sais gré de votre attitude si courageuse. Je tiens donc à vous en exprimer tout de suite ma reconnaissance. Et puisque vous me l’offrez si galamment, puis-je vous demander de rallier mes gens et de me conduire jusqu’au village le plus rapproché, où je pourrai trouver un gîte ?
» Je ne pouvais qu’acquiescer à une telle requête.
» Je ne vous cacherai pas, mon cher comte, que j’étais déjà follement amoureux de mon exquise inconnue. Je fis donc ce qu’elle me demandait. Je ravivai le courage de ses serviteurs, je convainquis le cocher de reprendre ses chevaux en mains et les deux laquais de regagner leur place à l’arrière du carrosse, et, sautant en selle, je conduisis sans encombre mon adorable voyageuse jusqu’au village de Saint-Marcelin, situé à une demi-lieue de là, où il y avait une hostellerie qui, sans être aussi accueillante que celle-ci, n’en offrait pas moins un gîte convenable.
» Je réveillai les tenanciers que je connaissais, et qui s’empressèrent de mettre leur meilleure chambre à la disposition de la jeune femme dont la richesse de l’équipage ne pouvait que favorablement disposer les patrons du Faisan d’Or.
» Je l’aidai à descendre de carrosse. Lorsqu’elle posa sa main sur mon poignet, je sentis comme un frisson me parcourir. Alors, elle me regarda. J’en fus comme étourdi, grisé, car il venait d’allumer en moi un incendie aussi subit que dévorant et, dans un geste spontané et respectueux, je lui saisis la taille et l’attirai vers moi.
» À peine avais-je esquissé ce mouvement que je le regrettai : car j’étais persuadé que j’allais être repoussé ; mais il n’en fut rien… Elle me sourit, au contraire. Ah ! mordious ! ce sourire… Il acheva de m’affoler à un tel point que ma bouche s’approcha de la sienne et que nos lèvres s’unirent !
» Je dois dire, d’ailleurs, mon cher comte, quitte à passer pour un fat, que la charmante femme ne fit rien pour éviter ce baiser.
» Une minute après, je pénétrai avec elle dans l’hostellerie, et au moment où elle mettait le pied sur la première marche de l’escalier qui conduisait à sa chambre, elle se tourna vers moi et me dit à voix basse :
» – Allez m’attendre sous ma fenêtre, allez !
» Je crus que je rêvais. Il n’en était rien car, ayant obéi et m’étant rendu devant l’hostellerie, je n’attendis pas plus de cinq minutes pour voir, à la hauteur du premier étage, au-dessus d’une porte encadrée de pilastres, une baie vitrée s’ouvrir lentement et laisser apparaître, dans un rayon de lune, la tête blonde de mon inconnue.
» Elle se livra à une pantomime qui signifiait clairement : « Tâchez de venir me rejoindre sans que personne s’en aperçoive. » Ce soir-là, je me sentais de taille à escalader les murailles les plus hautes. Aussi, fût-ce pour moi un jeu d’enfant de grimper le long d’un des pilastres jusqu’à la baie derrière laquelle le bonheur semblait m’être promis.
» Mes prévisions se réalisèrent bien au-delà de mes espérances !
» Quelle était cette femme, me demandez-vous, n’est-ce pas ? Je ne saurais vous le dire, car non seulement elle refusa de me révéler son nom, mais elle me fit jurer de ne pas interroger ses serviteurs à ce sujet et de respecter son incognito.
» Nous dûmes nous séparer quand le soleil se leva. Je repartis par le même chemin et je rentrai chez moi, ravi de cette aventure à laquelle, cependant, je n’attachais pas une excessive importance. Mais je ne tardai pas à m’apercevoir qu’elle avait pris une place tellement importante dans ma vie, qu’elle allait la bouleverser de fond en comble.
» En effet, mon entrevue avec la mystérieuse femme avait laissé en moi une empreinte telle que, désormais, je ne rêvais plus qu’à elle, si bien que je tombai dans un état d’ennui et bientôt de chagrin tel que ma mère, sans se douter de la raison pour laquelle je me morfondais et dépérissais ainsi, fut la première à me conseiller de partir en voyage, afin de me distraire et de retrouver cette gaieté qui, ainsi qu’elle me le disait, mettait du soleil partout où je passais. »
L’Italien, qui semblait de plus en plus intéressé par l’histoire que le jeune Gascon narrait avec son impétuosité habituelle, demanda :
– Sans doute avez-vous cherché à retrouver la trace de votre belle inconnue ?
– Parbleu ! Si je lui avais promis sur l’honneur de ne point interroger ses gens, je n’avais point juré de me montrer aussi discret envers les hôteliers. Dès le lendemain, je me rendais à Saint-Marcelin, et j’interrogeai la patronne du Faisan d’Or, qui me déclara qu’à certains propos qu’elle avait surpris entre le cocher et l’un des laquais, leur maîtresse devait être une très grande dame de la Cour, qui, exilée par le cardinal de Richelieu, voyageait en nos lointaines provinces afin de tuer le temps, ou… pour tout autre motif !
» Ces renseignements ne suffirent point à ma curiosité, et je me mis à battre les environs et à m’informer de toute part.
» J’appris alors, monsieur le comte, la chose la plus extraordinaire, la plus inouïe, la plus invraisemblable… Ça, par exemple, je ne vous le dirai jamais.
– Et si je vous le disais, moi ? dit assez énigmatiquement l’Italien.
– Ah ça ! vous êtes donc sorcier ?
– Et qui sait ?
– Voyons un peu !
Se rapprochant de son interlocuteur et baissant discrètement la voix, Capeloni murmura :
– Marie de Rohan-Montbazon, duchesse de Chevreuse !
Gaëtan eut un sursaut, qui était un aveu. Et, littéralement ahuri, il reprit, avec un accent de savoureuse candeur :
– Ça, par exemple, je me demande comment vous avez pu… ?
Puis, se reprochant déjà d’en avoir trop dit, il voulut protester :
– Vous vous trompez, mon cher comte, ce n’est point…
D’un geste amical, l’Italien l’interrompit, tout en disant :
– Que diriez-vous si je vous conduisais près d’elle ?
Cette fois, entièrement désarmé, Castel-Rajac balbutia :
– Vous vous moquez de moi…
– Nullement, mon cher chevalier. Vous m’inspirez, au contraire, une très vive sympathie, et je vous rendrai d’autant plus volontiers le service de vous conduire près de la dame de vos pensées que je sais pertinemment que votre présence ne lui sera nullement désagréable.
– Comment, elle vous a dit !…
– Rien, mais je sais, par une mienne amie à laquelle elle ne cache rien, qu’elle a gardé de son aventure à l’hostellerie du Faisan d’Or un souvenir des plus agréables.
– Ah ! mon cher comte, s’écria Gaëtan, débordant d’enthousiasme, béni soit le ciel qui m’a fait vous rencontrer dans cette maison ! Sans vous, je crois que je n’eusse jamais osé aborder de front celle à qui, depuis près d’un an, je ne cesse de penser nuit et jour, à un tel point que, dès que j’ai su qu’elle était revenue dans ce pays, je n’ai eu de cesse de la revoir ! Et vous dites que vous pourriez me conduire jusqu’à elle ?
– Le plus facilement du monde.
– Ah ! mon cher comte, je vous en garderai une reconnaissance qui ne finira qu’avec moi-même.
– C’est pour moi un vif plaisir que d’obliger le si galant chevalier que vous êtes.
– Seul, sans votre secours, déclarait le jeune Gascon avec une teinte de mélancolie charmante, je n’aurais jamais osé reparaître devant elle et encore moins lui adresser la parole.
» Je me serais contenté de rôder aux alentours de son château, de m’efforcer d’apercevoir de loin son inoubliable silhouette, d’entendre l’écho de sa voix et de revivre en illusion l’heure unique du paradis que j’ai vécue près d’elle et qui s’est envolée de ma vie, sans espoir de retour. Grâce à vous, je puis espérer encore. Peut-être mieux, je vais la revoir de loin, lui parler, et qui sait, goûter encore la saveur de son baiser.
– Et pourquoi pas ? déclara gaiement l’Italien.
– Alors, quand aurai-je la joie que vous me promettez ?
– Dès ce soir !
– Est-ce possible ?
– J’en ai la conviction.
Bouillant d’impatience, le jeune Gascon s’écria :
– Alors, partons tout de suite.
– Si vous le voulez, accepta aussitôt le comte Capeloni, qui semblait disposé à favoriser de son mieux les ardeurs de son compagnon.
Déjà, celui-ci appelait la servante pour lui régler son repas, mais l’Italien l’arrêta, en disant :
– Souffrez que cela soit moi qui vous régale.
– Ah ! je n’en ferai rien, c’est moi, plutôt, qui veux…
– Je vous en prie, insista l’Italien, ne me privez pas de vous offrir votre souper. Grâce à vous, je viens de rencontrer sur ma route un vrai gentilhomme de France qui, je l’espère, ne va pas tarder à devenir mon ami.
– Il l’est déjà, déclarait Castel-Rajac avec élan.
L’Italien régla les deux repas et sortit avec Gaëtan dans la cour de l’hostellerie. Là, il dit à ce dernier :
– Veuillez m’attendre ici pendant une heure environ. Si, comme j’en suis persuadé, la duchesse consent à vous recevoir, je vous enverrai un émissaire qui vous conduira jusqu’à elle.
– Et si elle refuse ? interrogeait Gaëtan, déjà inquiet.
– Elle ne refusera pas, heureux coquin ! répondit l’Italien, en partant d’un franc éclat de rire !
CHAPITRE III
LA DUCHESSE ET LE CHEVALIER
Comme toujours, le cardinal de Richelieu avait été exactement renseigné. C’était bien dans une simple gentilhommière située aux alentours du château de Chevreuse, qu’Anne d’Autriche, sur le point d’être mère, était venue se cacher. Sa meilleure amie, la duchesse de Chevreuse, l’une des femmes les plus jolies et, à coup sûr, la plus intelligente et la plus spirituelle de son temps, lui avait ménagé cette retraite où toutes les précautions avaient été prises pour que l’événement se passât dans le plus grand mystère.
Il avait d’abord été convenu qu’en dehors d’elle et une sage-femme, qu’elle avait fait venir de Touraine et qui, par conséquent, ne connaissait point la future accouchée, nul n’approcherait la reine.
Anne d’Autriche, confinée dans une chambre située au premier étage, tout au fond d’un couloi roù nul n’avait le droit de s’aventurer, attendait, non sans angoisse, l’heure de la délivrance.
Ce soir-là, après avoir apporté elle-même à la reine son repas du soir et l’avoir réconfortée par quelques-unes de ces paroles affectueuses et enjouées dont elle avait le secret, la duchesse était descendue dans un modeste salon du rez-de-chaussée, d’où elle pouvait surveiller, à travers les fenêtres donnant sur un jardin, les allées et venues des rares domestiques de la maison.
Bientôt, il lui sembla entendre un bruit de pas sur le gravier. Elle ne se trompait pas. Moins de deux minutes après un laquais introduisit dans le salon le comte Capeloni qui, tout en saluant, dit à la duchesse :
– Je vous apporte, je crois, une nouvelle qui va doublement vous faire plaisir.
– Laquelle donc, monsieur de Mazarin ?
L’amant d’Anne d’Autriche répliqua aussitôt :
– J’ai trouvé l’homme qu’il nous faut et, cet homme, vous le connaissez !
– Son nom ?
– Le chevalier Gaëtan de Castel-Rajac !…
– Quelle est cette plaisanterie ? s’écria la belle Marie.
– Je ne plaisante pas, affirma l’Italien… J’ai soupé tout à l’heure avec ce gentilhomme et, ayant appris qu’il était venu ici pour vous retrouver…
– Il connaissait donc mon nom ? interrompit Mme de Chevreuse.
– Il n’a même pas été très long à le découvrir, car il ne manque ni de charme… ni de finesse.
Feignant un vif mécontentement, la duchesse s’écria :
– Alors, il a eu l’insolence de vous raconter…
– Il a été au contraire d’une discrétion admirable, affirma Mazarin. C’est moi qui lui ai tiré les vers du nez.
– Cela ne m’étonne pas de vous, déclara Marie, car vous seriez capable de faire parler une statue. Mais continuez.
– J’ai promis au chevalier de Castel-Rajac que vous le recevriez dans une heure.
– Monsieur de Mazarin, vous mettez le comble à vos impertinences.
– Madame la duchesse, ne soyez point courroucée, je vous en prie. Vous qui êtes la bonté, la générosité mêmes, vous ne pouvez décourager un amoureux qui vous est resté fidèle depuis de si longs mois et n’a pas hésité à quitter sa famille et à faire un voyage aussi hasardeux pour s’en venir tout simplement apercevoir de loin votre adorable silhouette. Et puis, laissez-moi vous le dire, bien que vous exerciez encore sur vos amis de si terribles ravages, je ne crois pas que vous ayez encore inspiré un amour aussi franc, aussi puissant que celui dont brûle pour vous ce jeune et intrépide Gascon. Je suis certain que vous lui demanderiez de sacrifier sa vie pour vous qu’il n’hésiterait pas une seconde à le faire.
– Je n’ai nullement cette intention, déclara Marie de Rohan.
– Vous ne seriez peut-être pas fâchée de rencontrer, pour vous accompagner au cours du voyage très périlleux que vous allez entreprendre, un cavalier dont vous avez déjà pu apprécier la bravoure, la loyauté et… le dévouement !
– Je vous comprends, déclara la duchesse, devenue pensive. Ce n’est peut-être point une mauvaise idée !
Et, d’un ton qui n’était pas exempt d’une certaine ironie, elle ajouta :
– Puisque vous, monsieur de Mazarin, vous ne pouvez pas m’accompagner !…
– Dieu sait si j’en suis désolé, s’écria l’Italien avec toutes les apparences de la sincérité. Mais vous n’ignorez pas que Sa Majesté la reine l’a interdit et qu’Elle tient absolument, en cas d’alerte toujours possible, que je sois auprès d’elle.
La belle Marie se taisait. Sans doute réfléchissait-elle à la proposition que venait de lui faire son interlocuteur car la charmante amie d’Anne d’Autriche avait conservé un excellent souvenir du bref et tendre moment qu’elle avait passé en compagnie de l’ardent Méridional.
Il ne lui en avait pas fallu davantage pour se rendre compte que si Castel-Rajac était un gentilhomme vaillant et sûr entre tous, il était aussi un de ces amants qu’il n’est point donné à une amoureuse de rencontrer souvent sur sa route.
Mazarin l’observait du coin de l’œil. On eût dit qu’il devinait toutes ses pensées ; car, à mesure que Mme de Chevreuse se plongeait dans ses réflexions, un sourire de satisfaction entrouvrait ses lèvres.
Redressant son joli front qu’encadraient ses cheveux blonds d’une auréole de boucles naturelles, Marie lança, sur un ton de parfaite bonne humeur :
– Décidément, monsieur de Mazarin, vous avez encore et toujours raison. Faites savoir au chevalier de Castel-Rajac que je l’attends.
L’Italien riposta aussitôt :
– Madame, il sera ici dans une demi-heure.
Et, s’inclinant avec grâce devant la charmante femme, il se retira aussitôt.
Demeurée seule, Mme de Chevreuse quitta le salon, remonta l’escalier et s’en fut doucement frapper à la porte de la chambre où se cachait Anne d’Autriche. L’huis s’entrebâilla doucement, laissant apercevoir seulement la tête de la sage-femme, qui ne quittait plus le chevet de la reine, dans l’attente d’un événement qui ne pouvait plus tarder. C’était une paysanne au visage énergique et intelligent, qui semblait avoir une claire conscience de sa valeur.
– Comment va mon amie ? interrogea à voix basse Marie de Rohan.
– Elle repose, répondit la sage-femme, en adoucissant son timbre qui n’était point sans rappeler celui d’un chantre de paroisse.
Et elle ajouta, avec l’air assuré de quelqu’un qui ne se trompe jamais :
– Ce sera pour cette nuit !
Sans rien ajouter, elle referma la porte au nez de la duchesse et cela semblait nettement signifier qu’elle entendait qu’on la laissât en paix.
Mme de Chevreuse n’hésita pas. Ce n’était ni le moment ni l’occasion de mécontenter cette femme persuadée qu’elle avait été appelée auprès d’une dame du monde désireuse de cacher à son mari une maternité dont il était impossible de rendre celui-ci responsable.
La situation demandait, en effet, une extrême prudence. Soulever le moindre incident, n’était-ce pas risquer de provoquer le plus effroyable scandale qu’ait jamais eu à enregistrer la Cour de France ?
La duchesse était trop fine mouche pour ne pas éviter, par tous les moyens, un esclandre qui eût à jamais déshonoré sa reine, sa meilleure amie, et lui eût peut-être coûté, à elle, la prison perpétuelle. Elle se contenta de songer :
« Si cette femme pouvait dire vrai ! Car plus vite l’enfant viendra au monde, plus tôt notre sécurité à tous sera assurée. »
Et, tout en descendant l’escalier, elle se prit à murmurer :
– Ce diable de Mazarin aurait mieux fait de rester en Italie !
Elle regagna le salon qui était maigrement éclairé par des bougies plantées dans des appliques en bronze doré fixées de chaque côté d’une vaste glace surmontant une haute cheminée. Poussée par un mouvement de coquetterie bien féminine, elle s’approcha du miroir et s’y regarda avec plus de sévérité que de complaisance. Cet examen fit envoler aussitôt les doutes qu’elle pouvait avoir sur son pouvoir de séduction.
Jamais, en effet, elle n’avait été plus séduisante.
– Allons, se dit-elle, mon jeune chevalier ne me trouvera pas changée à mon désavantage et, ainsi que le prétend Mazarin, je crois que je vais pouvoir en faire, non pas mon chevalier, mais mon esclave, car, moi, ayant tout à lui accorder, il n’aura rien à me refuser.
Une demi-heure après, ainsi que l’avait annoncé l’Italien, on frappait de nouveau à la porte du salon et Mazarin se présentait avec Castel-Rajac, qui, pendant le temps qu’il était resté à l’hostellerie de Dampierre, en avait profité pour faire un brin de toilette, s’épousseter, et réparer le désordre de ses vêtements et de son abondante chevelure noire.
Maintenant, toute hardiesse l’avait abandonné. Il n’était plus qu’un amoureux effaré de la bonne fortune inattendue qui lui tombait du ciel et, oubliant même de saluer la dame de ses pensées, il demeura immobile, pour une fois muet de saisissement.
Ses yeux clairs et ardents exprimaient de si tendres sentiments que, plus émue qu’elle ne voulût le paraître et désireuse de le mettre tout de suite à son aise, Mme de Chevreuse s’avança vers lui, et dit simplement :
– Est-il vrai, chevalier, que vous eussiez fait le voyage d’Agen jusqu’ici uniquement pour me revoir ?
– Oui, madame, répondit timidement le jeune Gascon, en cherchant des yeux le pseudo-comte Capeloni, qui, telle une ombre discrète, s’était déjà évanoui.
Affectant un ton de reproche, la duchesse poursuivit :
– Savez-vous, monsieur le chevalier, que vous avez agi envers moi avec une étourderie qui frise l’impertinence.
– Oh, madame !
– Et que je serais en droit de vous en vouloir vivement. Mais rassurez-vous, je vous pardonne. Car je ne vous cacherai point que, non seulement je ne vous avais pas complètement oublié, mais que j’ai éprouvé, en vous retrouvant, un plaisir non moins égal au regret que j’avais ressenti d’être obligée de vous quitter si promptement.
– Ah ! madame, s’écria Gaëtan, auquel ces quelques mots avaient suffi pour rendre tout son aplomb, vous ne pouvez vous imaginer à quel point je suis heureux de vous entendre me parler ainsi. Il me semble que je vis un rêve.
» Ah ! vous voir, vous entendre ! Certes, depuis l’an passé votre voix aux inflexions harmonieuses n’avait cessé de chanter à mes oreilles ; mais ce n’était qu’un souvenir, qu’une illusion, tandis que vous êtes là, près de moi ; il me suffirait d’étendre la main pour toucher la vôtre. Ah ! madame, je vous en prie, laissez-moi vous admirer, vous adorer en silence, car, vraiment, je suis incapable de trouver les mots qu’il faudrait pour vous exprimer mon amour… Je crois même qu’il n’en est pas sur terre…
Et, tout en disant, Castel-Rajac se pencha vers la duchesse qui, reconquise de nouveau par cette ardeur juvénile et si sincère, le contemplait, elle aussi, prête à s’abandonner de nouveau.
Tout à coup, le visage du jeune Gascon s’assombrit. Un pli d’amertume tordit sa bouche et un léger soupir gonfla sa poitrine.
– Qu’avez-vous ? interrogea Marie de Rohan.
– Je songe, hélas ! que mon rêve est éphémère et qu’il va bientôt se briser en éclats.
Tout en lui souriant, la duchesse lui dit doucement :
– Et si je vous donnais le moyen de le prolonger ?
– Pendant longtemps ?
– Plus longtemps, peut-être, que vous ne l’imaginez !
– Oh ! madame, vous seriez la plus généreuse…
– Écoutez-moi, mon ami… Bien que vous vous soyez montré à mon égard d’une indiscrétion que je reconnais, d’ailleurs, fort excusable…
– Madame, vous permettez ? interrompit le Gascon.
– Dites !
– Je vous avais juré de ne point interroger vos serviteurs, mais je ne vous avais nullement promis de ne point questionner les autres personnes qui étaient à même de me donner sur vous les renseignements que la passion que vous m’aviez inspirée me forçait à leur demander.
Tout en accentuant son sourire, Mme de Chevreuse poursuivit :
– Le gentilhomme qui vient de vous amener ici avait raison.
– Le comte Capeloni…
– Oui. Il me disait que vous étiez plein de finesse.
– Ce n’est pas ma faute. Dans tout l’Agenais, nous sommes ainsi.
– Ne vous en défendez pas, c’est une qualité de plus à votre actif et je suis la dernière à m’en plaindre. D’autant plus que vous survenez ici à un moment où j’ai besoin d’avoir à mes côtés un ami, un défenseur qui allie à un courage absolu une adresse sans égale.
– Madame, vous me faites peur, observa le Gascon.
– Pourquoi donc ?
– Un dévouement sans limites, j’en suis capable, surtout quand c’est vous qui me le demandez… Un courage absolu, mon Dieu, je ne voudrais pas avoir l’air de me vanter, mais, mordious ! je crois que je le possède. D’ailleurs, parmi les Gascons, c’est une qualité qui n’a rien d’exceptionnel. Nous sommes tous braves en naissant et on ne peut faire moins en grandissant de le devenir davantage ?
» Quant à l’adresse sans égale, ça, madame, je ne veux pas trop m’avancer. Il me suffit de vous dire que je ferai de mon mieux pour vous servir.
– J’en suis sûre, répondit la duchesse et voilà pourquoi je n’hésite plus un seul instant à vous révéler ce que j’attends de vous.
Le jeune Gascon était tellement empoigné par son interlocutrice et tellement désireux de ne point perdre la moindre parole qu’elle allait prononcer, qu’il s’avança encore vers Marie, jusqu’à la toucher.
– Mon cher chevalier, attaqua-t-elle, vous avez peut-être été surpris de constater que je vous recevais dans cette vieille maison…
– Pas du tout, protesta Gaëtan. L’amour n’adore-t-il pas le mystère ?
– Et même, souligna la duchesse, il l’ordonne, parfois… Mais ce n’est point là le vrai motif qui fait que nous nous sommes rencontrés ici. Une de mes amies a eu l’imprudence de se laisser conter fleurette par un galant pendant l’absence d’un mari parti pour un long voyage. Il en est résulté pour la pauvre femme des suites telles qu’il est absolument indispensable de les dissimuler à tous. Aussi est-elle venue se cacher dans cette maison qui m’appartient et où tout a été préparé de façon que personne n’y soupçonne sa présence.
Tout en baissant la voix, comme pour donner plus de poids à sa révélation, Mme de Chevreuse ajouta :
– L’enfant va naître cette nuit.
La figure de Castel-Rajac s’éclaira d’un franc sourire et, sur un ton plaisant, il s’écria :
– Ah ça ! madame, auriez-vous l’intention de m’en faire endosser la paternité ?
– Pas du tout, répliqua Mme de Chevreuse, en partageant la gaieté de son amoureux. Il s’agit seulement que vous m’aidiez à le faire disparaître…
– Mordious !
– Quand je dis « disparaître », j’emploie un terme impropre, car mon amie tient essentiellement à ce que cet enfant, qu’elle ne peut garder près d’elle, soit bien élevé, bien traité et n’ait surtout que de bons exemples sous les yeux.
– Très bien, approuvait le Gascon.
Marie de Rohan reprenait :
– Aussi, lorsque votre ami l’Italien…
– Le comte ?
– Oui, le comte, est venu m’annoncer qu’il avait soupé avec vous dans une hostellerie de Dampierre, tout de suite j’ai pensé que vous m’étiez envoyé par la Providence.
– Madame, déclarait Gaëtan, je ne demande pas mieux de faire pour ce petit tout ce qu’il dépendra de moi, puisque c’est vous qui me le demandez… Mais je ne puis, pourtant, être sa nourrice !
Tout en lui donnant une tape amicale sur la main, la duchesse, de plus en plus amusée, reprenait :
– Je ne vous le demande pas non plus ! Je désirerais plutôt que vous soyez son grand frère, et que, l’élevant à votre image, vous en fassiez, non pas un freluquet de Cour, mais un fier et beau gentilhomme, et que vous soyez toujours prêt à le défendre au cas où il serait menacé.
– Madame, dit Castel-Rajac, gravement, cette fois, la mission que vous me faites l’honneur de me confier est trop noble pour que je ne l’accepte pas sur-le-champ. Je me charge de l’enfant ! Je m’engage à tout mettre en œuvre pour qu’il soit un jour ce que vous désirez. Mais, par exemple, je me demande où et comment je vais l’emporter ?
– Écoutez-moi, demanda Mme de Chevreuse, devenue, elle aussi, très sérieuse. Dès que l’enfant sera venu au monde, nous partirons immédiatement pour votre pays.
– Nous partirons ! s’exclama le chevalier, en tressaillant d’allégresse.
– Oui, précisa la belle Marie. L’enfant, la femme qui doit lui donner le sein pendant le voyage, vous et moi.
– Dieu soit loué ! s’exclama le Gascon avec enthousiasme.
– Vous le remercierez encore bien davantage, insinua Mme de Chevreuse, lorsque je vous aurai dit que mon séjour dans votre pays est appelé à se prolonger assez longtemps pour que nous ayons l’occasion de nous rencontrer très souvent.
– Tous les jours, je l’espère…, déclara galamment Castel-Rajac.
Mme de Chevreuse, se redressant, dit d’un ton presque solennel qui contrastait avec ses précédentes allures si gentiment familières :
– Maintenant, chevalier, je me vois dans l’obligation d’exiger de vous un serment, celui de ne chercher jamais à savoir quel est l’enfant que je vous confie et pour lequel on vous fera parvenir chaque année une somme destinée à son entretien.
– Madame, répliqua Castel-Rajac, l’enfant, je l’accepte, mais, la somme, je la refuse. Moi, je ne fais pas les choses à moitié. Nous ne sommes pas riches, là-bas, mais on y vit bien et à peu de frais. Et puis, croyez-moi, si vous voulez qu’un jour cet enfant me ressemble, il ne faut pas qu’il soit élevé dans un luxe qui engendre fatalement la mollesse ; il faut, au contraire, qu’il soit trempé, comme nous le sommes tous, dans ce bain de soleil qui nous rend beaucoup plus riches en sang, en bravoure, en audace et en gaieté, que tous les louis d’or que pourrait contenir une galère royale.
– Je suis heureuse de vous entendre parler ainsi, s’écria Marie de Rohan.
– Je vous ai dit ce que je pensais.
– Décidément, nous sommes faits pour nous entendre.
Et, tout en enveloppant le jeune Gascon d’un regard plein d’amoureuse admiration, elle lui dit :
– Lorsque j’aurai appris à mon amie à qui je confie son enfant, ce sera pour elle un grand réconfort de le savoir entre vos mains.
– Ah ! madame, vous pourrez lui dire d’être bien tranquille et que je serai trop heureux, lorsqu’elle viendra l’embrasser, de lui prouver que je sais tenir une parole.
– Hélas ! mon ami, reprit Mme de Chevreuse, mon amie n’aura même pas cette consolation.
– Pourquoi ?
– Parce que… Mais, je vous en prie, ne m’interrogez pas, car je ne puis pas vous en dire davantage…
– Oui, c’est vrai…
Le regard comme illuminé par une flamme, Castel-Rajac, le front haut, s’écria :
– Chez nous, madame, quand on fait un serment, c’est toujours l’épée nue à la main.
Et, tirant sa rapière de son fourreau, il l’étendit en disant :
– Je jure de respecter le secret de cette mère, comme je jure d’être un frère pour son enfant.
Et, d’un geste large, il replaça sa lame dans le fourreau.
Alors, n’écoutant plus que son cœur qui, maintenant, ne battait plus que pour son beau chevalier, la duchesse de Chevreuse se jeta dans ses bras et tous deux échangèrent un long et ardent baiser.
CHAPITRE IV
À L’HOSTELLERIE DU « FAISAN D’OR »
Huit jours après ces événements, un carrosse couvert de poussière tiré par des chevaux ruisselant de sueur, s’arrêtait devant l’hostellerie du Faisan d’Or, gloire du village de Saint-Marcelin.
À l’une des portières se tenait le chevalier Gaëtan-Nompar-Francequin de Castel-Rajac. Sautant prestement de son cheval, il écarta l’un des rideaux du carrosse et aida la duchesse de Chevreuse à mettre pied à terre.
– Attendez là, dit-elle à une femme qui, restée assise dans le véhicule, portait sur ses genoux, enveloppé dans ses langes, un enfant de quelques jours.
Après avoir confié son cheval à un garçon d’écurie, le chevalier de Castel-Rajac et la duchesse entrèrent dans la cour de l’hostellerie, et Gaëtan qui n’avait jamais été d’aussi belle humeur fit une révérence comique à une servante qui balayait le sol, lui disant :
– Pourrais-je parler à la maîtresse de céans ?
La fille, éclatant de rire, déclara :
– Monsieur le chevalier est toujours farceur…
Et, clignant de l’œil vers la duchesse, elle ajouta :
– Surtout quand il est avec de belles dames.
Déjà Mme Lopion, la propriétaire du Faisan d’Or, qui avait reconnu la voix sonore du chevalier, s’avançait vers le seuil et lui disait :
– Vous voilà déjà revenu ? Votre voyage n’a pas été bien long.
Et reconnaissant la voyageuse inconnue qui avait séjourné une nuit dans son hôtel, elle fit, d’un air malicieux :
– Ah ! je comprends !
Gaëtan ne lui laissa pas le temps de développer sa pensée et, tout de suite, il la coupa :
– Je voudrais votre plus belle chambre pour Madame, et une autre…
– Pour vous ?
– Non, madame, pour une nourrice et son nourrisson !
– Tiens…, tiens, souligna la patronne avec un petit sourire polisson.
Au regard sévère que lui lança Castel-Rajac, elle jugea plus prudent de se mordre légèrement la langue, ainsi qu’elle le faisait chaque fois que celle-ci la démangeait par trop.
Ayant ainsi mis un frein à sa faconde, Mme Lopion reprit :
– J’ai ce que vous demandez, monsieur le chevalier.
Castel-Rajac retourna près du carrosse, en fit descendre la nourrice, qui portait avec précaution l’enfant mystérieux, et l’amena jusqu’à la porte de l’hostellerie.
Mme Lopion conduisit elle-même la duchesse jusqu’à la chambre qu’elle lui destinait et qui communiquait directement avec celle qui avait été dévolue à la nourrice.
L’enfant fit entendre un léger cri. La duchesse se mit à le bercer avec autant de douceur que s’il eût été son enfant. Mme Lopion s’était approchée et regardait le nourrisson qui, déjà calmé, s’était rendormi.
– C’est un garçon ? demanda-t-elle.
– Oui, répondit Marie de Rohan.
En glissant un coup d’œil malicieux dans la direction de Gaëtan, Mme Lopion ne put s’empêcher d’ajouter :
– Il ressemble déjà à son papa…
Le jeune Gascon allait protester…, mais, d’un signe rapide, Mme de Chevreuse le retint. Il lui convenait fort que Castel-Rajac endossât la paternité du rejeton d’Anne d’Autriche et de Mazarin, quitte à passer elle-même pour la maman…
Mais, pour se débarrasser de la présence de l’hôtelière, qu’elle commençait à trouver quelque peu encombrante, la duchesse reprit :
– Je meurs de faim. Aussi, je vous prie de bien vouloir donner les ordres nécessaires pour que l’on me prépare un repas que vous aurez l’obligeance de me faire servir dans cette chambre.
Mme Lopion, qui, décidément, ignorait l’art de la plus élémentaire discrétion, demanda :
– Faudra-t-il mettre aussi un couvert pour M. le chevalier ?
– Certainement ! répliqua Marie de Rohan, qui commençait à manifester une certaine nervosité.
– Allez, madame Lopion, allez…, ordonna Castel-Rajac.
Tandis que la tenancière s’éclipsait, la duchesse rendit l’enfant à sa nourrice qui l’emporta dans sa chambre.
Mme de Chevreuse dit alors à Gaëtan :
– Maintenant, ami, je puis bien vous le dire : depuis huit jours et huit nuits que nous avons quitté Chevreuse, voilà la première fois que je respire librement.
– Est-ce possible ? s’étonna le jeune Gascon. Sur l’honneur, je ne me suis pas aperçu un seul instant que vous fussiez inquiète…
– C’est parce qu’en même temps, murmura la duchesse, j’étais une femme divinement heureuse.
– Pour cette parole, laissez-moi vous prendre un baiser…
– Dix, si vous le voulez !
Longuement, ils s’étreignirent. Puis, se ressaisissant la première, Marie reprit :
– Écoutez, mon ami, nous avons à parler sérieusement, très sérieusement même.
Et, encore toute vibrante des caresses partagées, elle poursuivit :
– Que vous disais-je donc ?
– Que, pendant huit grands jours et huit longues nuits, vous aviez été très inquiète…
– C’est vrai ! Je craignais d’apercevoir derrière nous des cavaliers lancés à notre poursuite…
– Par qui donc ?
– Mais… par… le mari…
– Puisqu’il est en voyage !
– Je tremblais à la pensée qu’il ne fût revenu.
– N’étais-je point là pour les recevoir, lui… et ses gens ?
– C’est précisément ce qui me rassurait… Mais vous continuerez à veiller sur ce pauvre petit…
– Puisque je vous l’ai promis !
Et, avec un large sourire, Gaëtan s’écria :
– Il est donc si terrible, ce mari trompé ?
– Oui, plutôt ! déclara Mme de Chevreuse.
Et détournant brusquement la conversation, elle ajouta :
– Il me vient une idée. Tout à l’heure, je me suis aperçue, et vous avez dû le constater aussi, que cette hôtelière était convaincue que cet enfant était le nôtre !…
– Elle a fait mieux que de nous le laisser entendre.
– Je crois qu’à cause de vous, et surtout de vos parents, il serait peut-être bon de couper court à cette légende, et voilà ce que j’ai imaginé… Ce n’est pas extraordinaire, c’est somme toute assez vraisemblable. La morale et la religion vont y trouver leur compte à la fois.
» Que diriez-vous, mon cher Gaëtan, si nous racontions que nous avons trouvé cet enfant, de quelques jours à peine, abandonné sur la route ?
– Pour ma part, je n’y vois aucun inconvénient. Comme vous le dites si bien, cela est fort plausible.
– Nous l’aurions adopté en commun et, qui mieux est, nous prierions M. le curé du pays de bien vouloir, demain, par exemple, baptiser ce chérubin.
– De mieux en mieux, approuva Gaëtan. De cette façon, rien ne me sera plus facile que d’emmener ensuite le nourrisson et la nourrice jusque chez mes parents qui, certains de ne point abriter un bâtard de leur fils, ne lui en feront qu’un accueil plus favorable.
– Voulez-vous, aussitôt que nous aurons réparé nos forces, vous occuper de la cérémonie ?
– Avec le plus grand plaisir. Je suis au mieux avec le curé de cette paroisse. C’est un très digne homme et je suis sûr qu’il se montrera plus tard, envers notre pupille, aussi bon qu’il l’a été envers moi.
Mme Lopion, poussée par la curiosité, apportait elle-même un couvert complet qu’elle dressait sur une table tout en s’efforçant de lier de nouveau conversation avec la duchesse.
– Comme il est beau, ce petit ! Ah ! on voit bien qu’il a du sang d’aristocrate dans les veines.
– À quoi voyez-vous cela ? lança Castel-Rajac.
– À tout et à rien…
– Alors, si on vous disait que c’est le fils d’un charretier et d’une fille de cuisine ?…
– Je répondrais que c’est impossible.
– Vous n’en savez rien, madame Lopion, pas plus que Madame et moi…
– Comment… comment ?…
– Cet enfant, nous l’avons trouvé dans un fossé, près duquel nous étions assis pour permettre à nos chevaux de souffler.
– Que me racontez-vous là ?
En fronçant les sourcils, le jeune Gascon martelait :
– Ah ça ! madame Lopion, est-ce que vous ne savez pas que le chevalier de Castel-Rajac a pour principe de dire toujours la vérité ?
Réellement effrayée, l’aubergiste protesta.
– Ne vous fâchez pas, monsieur le chevalier. Je vous crois. Cet enfant a été trouvé dans un fossé. Cependant, vous ne m’empêcherez pas de vous dire qu’il est beau comme un ange et qu’il a plutôt l’air d’avoir dans les veines du sang de grand seigneur que de manant.
– Vous avez tout à fait raison, intervint la duchesse, que cette querelle paraissait amuser.
Une servante apportait une gibelote de lapin et, un instant après, les deux amants faisaient honneur au talent de M. Lopion qui, rivé à ses fourneaux, avait pour principe de se cantonner dans ses fonctions gastronomiques et de ne jamais se préoccuper de ce qui se passait hors de sa cuisine.
Pendant ce temps, un cavalier s’arrêtait devant l’hostellerie du Faisan d’Or et, après avoir laissé son cheval aux soins du garçon d’écurie, pénétrait dans la grande salle.
Allant droit à Mme Lopion, le cavalier lui lançait sur le ton d’un homme irrité :
– Le chevalier Gaëtan de Castel-Rajac est bien ici ?
– Pourquoi me demandez-vous cela ?
– Parce que je veux le voir, répliqua le gentilhomme d’un ton d’autorité qui contrastait singulièrement avec son visage avenant.
– Je ne sais pas si M. le chevalier est visible. M. le chevalier vient d’arriver d’un très long voyage. Il est en train de se restaurer… Je n’aurai garde de le déranger.
De plus en plus impérieux, le cavalier rugit :
– Vous allez immédiatement le prévenir que le comte Capeloni l’attend ici et qu’il a besoin de lui parler, toute affaire cessante.
Au regard que lui lança son interlocuteur, Mme Lopion comprit que toute résistance de sa part risquait de lui causer de réels ennuis, et elle remonta vers ses hôtes, tout en grommelant, non sans inquiétude, ce qui tendait à prouver que les affirmations du jeune Gascon ne l’avaient nullement convaincue :
« Pourvu que ce ne soit pas le mari ! »
– Excusez-moi de vous déranger, fit-elle en pénétrant dans la chambre, mais il y a en bas un gentilhomme qui désire parler à Monsieur le chevalier.
– Un gentilhomme, répétait Gaëtan. Vous a-t-il dit son nom ?
– Oui, mais je ne m’en souviens plus.
La duchesse intervint :
– Ne serait-ce point Capeloni ?
– C’est ça.
– Mordious !… s’écriait Castel-Rajac, tandis que la duchesse pâlissait légèrement.
» Dites au comte de Capeloni que je le rejoins.
– Ou plutôt non, ordonna la duchesse, priez-le de monter sur-le-champ.
Mme Lopion ne se le fit pas dire deux fois et s’en fut s’acquitter de sa mission avec tout le zèle dont elle était capable.
Demeuré seul avec la duchesse, Castel-Rajac remarqua la préoccupation répandue sur ses traits :
– Vous craignez qu’il se soit passé là-bas quelques fâcheux événements ?
– Je le crains.
– Le mari ?
– Nous allons tout savoir. Il est certain, pour que le comte soit venu nous rejoindre aussi rapidement…
Elle s’arrêta. On frappait à la porte. Mme Lopion faisait entrer dans la pièce M. de Mazarin, qui, s’inclinant devant la duchesse et tendant la main à Castel-Rajac, s’écria :
– Dieu soit loué, j’arrive à temps !
Le premier mot de Mme de Chevreuse fut :
– Et notre amie ?
Mazarin répliqua :
– Quand je l’ai quittée, il y a quatre jours environ, elle se portait aussi bien que possible, mais, depuis ce moment, j’ignore ce qui a pu se passer et je ne vous cacherai pas que je suis en proie aux plus vives angoisses.
Gênée par la présence de Castel-Rajac que, décemment, elle ne pouvait congédier, la duchesse interrogea :
– Le mari aurait-il vent de quelque chose ?
– Non ! déclara nettement Mazarin, en mettant aussitôt son langage et son attitude à l’unisson de ceux de Mme de Chevreuse. J’ai même acquis la certitude qu’il n’avait pas l’ombre d’un soupçon. Vous connaissez son indifférence conjugale. J’ai la conviction qu’en ce moment il ne pense nullement à son épouse et qu’il croit fermement celle-ci en train de prier le Seigneur. Mais il n’en est point de même de son… intendant…
À ces mots, la belle Marie de Rohan eut un mouvement de recul. L’intendant, n’était-ce pas Richelieu ? Mieux que personne, elle savait combien Anne d’Autriche avait à redouter de l’homme d’État qui l’exécrait, non seulement parce qu’elle avait toujours contrecarré sa politique, mais parce qu’elle avait un jour repoussé les offres amoureuses du cardinal qui s’était mis en tête de suppléer à l’insuffisance du roi et de donner un héritier à la couronne de France.
Aussi ne put-elle s’empêcher de souligner :
– Si l’intendant a découvert notre secret, tout est perdu.
Castel-Rajac commençait à bouillir d’impatience :
– Ah ça ! cet intendant est donc si puissant, pour qu’il vous inspire de pareilles craintes.
Et, tout en tourmentant la poignée de son épée, il ajouta :
– Que je sache seulement où il se loge et comment il se nomme, je me charge de lui passer mon épée au travers du corps, aussi facilement que maître Lopion met un dindon à son tournebroche.
Mazarin répliqua vivement :
– Mon cher chevalier, modérez vos ardeurs et renoncez à pourfendre ce faquin. Une telle équipée ne pourrait que provoquer un scandale qui compromettrait à tout jamais l’honneur d’une femme, que Mme la duchesse de Chevreuse et moi nous avons le devoir de défendre avec encore plus d’acharnement que vous.
– Je me tais, dit aussitôt le jeune Gascon, mais sachez que vous pouvez entièrement compter sur moi, en toute heure, en toute circonstance. J’ai juré de veiller sur l’enfant. N’est-ce pas le défendre que défendre aussi sa mère ?
– Quel brave cœur ! murmura Mme de Chevreuse, en enveloppant le jeune homme d’un regard plein de tendresse.
Puis, se tournant vers Mazarin :
– Mon cher comte, continuez, je vous en prie.
Mazarin déclara :
– Cet intendant, qui, depuis un certain temps, faisait espionner votre amie, a réussi à découvrir sa retraite et à acquérir la preuve de sa maternité clandestine. Mais, comme, de mon côté, je prévoyais que cet intendant cherchait à s’informer et qu’il était parfaitement capable de découvrir la vérité, je l’ai fait surveiller, moi aussi, et j’ai pu apprendre qu’il avait donné ordre de vous faire rechercher par des agents secrets et de vous faire arracher à n’importe quel prix, l’enfant que vous protégez.
– Cet intendant, intervint Gaëtan, m’a tout l’air de dépasser les limites. Mordious, est-il donc si puissant pour arriver à ses fins ?
– Hélas ! oui, déclara Mme de Chevreuse. Son maître est l’un des plus intimes amis du cardinal et celui-ci n’a rien à lui refuser. Je ne serais donc nullement surprise que Richelieu eût mis à sa disposition toutes les forces de sa police.
– Certainement, appuya Mazarin. Voilà pourquoi je me suis empressé de courir à francs étriers jusqu’à vous, afin de vous prévenir que vous eussiez à vous tenir sur vos gardes.
– Qu’ils y viennent ! clama le jeune Gascon.
– Soyez tranquille, appuya Mazarin, ils y viendront.
– Eh bien, foi de gentilhomme, je vous garantis qu’ils ne nous prendront pas le petit.
– Ils auront la force et le nombre, objecta l’Italien.
– Mais nous serons la ruse, répliqua le Gascon.
– À la bonne heure, approuva Mazarin. Il me plaît de vous entendre parler ainsi.
– Auriez-vous déjà trouvé un expédient ? interrogea Marie de Rohan.
– Oh ! bien mieux qu’un expédient… déclara Gaëtan. Et je crois que si les argousins de l’intendant viennent ici tenter l’aventure, ils s’en retourneront fortement déçus ; car je leur ménage une de ces petites farces, comme on sait en préparer dans ce pays.
– Quoi donc ? interrogea la duchesse.
Castel-Rajac s’en fut à pas de loup vers la porte. Brusquement, il l’ouvrit et il aperçut la silhouette de Mme Lopion qui fuyait dans l’ombre du couloir.
– L’aubergiste nous écoutait, fit-il. Je n’étais point sans m’en douter et j’ai bien fait de m’en assurer avant de continuer.
» Mais, ainsi que le dit le proverbe, un homme averti en vaut deux… et, comme j’ai tout lieu de penser qu’ici les murs ont des oreilles, permettez-moi maintenant de vous parler tout bas. Je crois que c’est encore le moyen pour qu’aucune indiscrétion ne soit commise. »
Mme de Chevreuse et Mazarin se rapprochèrent du chevalier qui leur murmura son projet. Celui-ci parut les satisfaire, car, à mesure que Gaëtan s’exprimait, leur visage prenait à tous deux une expression joyeuse.
Quand il eut terminé, la duchesse fit :
– Je trouve votre idée excellente. Qu’en pensez-vous, mon cher comte ?
– Je l’approuve entièrement et je suis convaincu qu’il était impossible de jouer un meilleur tour à ces gens et de se tirer avec une désinvolture plus élégante d’une histoire qui risquait d’avoir les plus redoutables conséquences.
Enchanté de l’accueil chaleureux que son projet venait de rencontrer, Castel-Rajac s’écria :
– En vertu de ce principe qu’il faut battre le fer quand il est chaud je veux vous demander la permission d’aller me livrer aux préparatifs que réclame l’exécution du plan que je viens de vous dévoiler.
– Allez, mon ami, s’écria la belle Marie. Laissez-moi vous dire auparavant que jamais je n’oublierai…
– Ne me remerciez pas, je vous en prie, interrompit le jeune Gascon qui semblait radieux de jouer un rôle aussi important dans cette équipée dont il ignorait totalement le véritable secret.
Et il ajouta, en adressant un petit salut à sa maîtresse :
– Croyez, chère madame, que, quoi qu’il arrive, c’est toujours moi qui serai votre humble et reconnaissant serviteur !
Et, après avoir touché la main que Mazarin lui tendait, il s’en fut, tout transporté de l’allégresse chevaleresque qui était en lui.
– Il est admirable, n’est-ce pas ? s’écria Mme de Chevreuse.
– Admirabilissime, surenchérit l’Italien. J’ai rarement rencontré sur ma route un gentilhomme doué de qualités aussi brillantes et aussi solides à la fois. Il a l’étoffé d’un chef.
Un peu rêveuse, la duchesse dit en souriant :
– Il sera peut-être un jour maréchal de France.
– Qui sait ? fit en écho le futur ministre de Louis XIV.
CHAPITRE V
UNE GASCONNADE
Gaëtan-Nompar-Francequin de Castel-Rajac avait quitté l’hôtel du Faisan d’Or et s’était dirigé vers le presbytère.
C’était une petite maison qui se dressait à l’entrée du pays, au milieu d’un grand jardin, aux allées bordées de buis, où s’épanouissaient, çà et là, dans un désordre pittoresque, de belles fleurs qui embaumaient les airs de leur parfum et parmi lesquelles bourdonnaient joyeusement les abeilles.
Après avoir poussé la petite barrière, Gaëtan longea l’allée principale, contourna la maison et s’en fut sur une petite terrasse ombragée de tilleuls d’où l’on découvrait un panorama magnifique sur la vallée de la Garonne.
Un vieux prêtre à cheveux blancs, un peu cassé par l’âge, le nez chevauché par une énorme paire de besicles, était en train d’émietter du pain, qu’il jetait aux moineaux. L’arrivée du chevalier fit envoler les gentils oiseaux et provoqua un mouvement d’humeur du vénérable prêtre qui se traduisit par ces mots :
– Ah ça ! qu’est-ce qui vient me déranger et faire peur ainsi à mes petits amis ?
– Excusez-moi, monsieur le curé, lança Castel-Rajac. Mais rassurez-vous, vos petits amis ne tarderont pas à revenir.
– Je ne me trompe pas, c’est bien toi, mon cher Gaëtan, s’exclama le prêtre.
Et, d’un ton un peu chagrin, il ajouta :
– Décidément, ma vue baisse de plus en plus, mon pauvre enfant ; je ne t’aurais pas reconnu ; j’ai bien peur que, d’ici peu, je ne devienne complètement aveugle.
Et, avec un accent de résignation il ajouta :
– Si le bon Dieu le veut, qu’il en soit ainsi. Mais ne nous attardons pas à ces pénibles pensées.
Après avoir serré affectueusement la main de son ancien élève, l’abbé Murat reprit :
– Je te croyais parti pour un long voyage.
– Mais oui, monsieur le curé. Malheureusement, il m’est arrivé en route un accident plutôt fâcheux.
– Aurais-tu été détroussé par des voleurs ?
– Non point, monsieur le curé.
– Alors ?
– J’ai commis un gros péché.
– Lequel ? grand Dieu ! s’effarait l’abbé Murat.
– Je suis papa !
– Seigneur, s’exclamait le vieux prêtre, en joignant les mains. Que me dis-tu là ? Père, tu es père… en dehors des saintes lois de l’Église !
– Oui, monsieur le curé.
– Ah ça ! tu as donc oublié un commandement de Dieu, qui dit : « Œuvre de chair accompliras, en mariage seulement ? »
– Hélas, oui, monsieur le curé, je l’ai complètement oublié.
– Malheureux !
– Mais je me repens amèrement.
Et, tout en affectant un chagrin qui, à tout autre que le bon vieux curé de Saint-Marcelin, aurait pu apparaître singulièrement exagéré, Gaëtan, qui avait soigneusement préparé son récit, poursuivit :
– Monsieur le curé, je ne suis pas venu seulement vous demander une absolution, mais je suis venu aussi vous prier de bien vouloir baptiser ce petit innocent dans le plus bref délai.
– Comment ? il est ici ?
– Oui, monsieur le curé, à l’hostellerie du Faisan d’Or.
– Et la mère ?
– Ah ! la mère, la pauvre, elle est morte en donnant le jour à cet enfant.
– Dieu ait pitié de son âme !
– Oh ! oui, monsieur le curé, car, en dehors de sa faute, c’était un ange et c’est moi le seul coupable.
En voyant ainsi son ancien disciple s’humilier, l’abbé Murat sentit toute son indignation se transformer en une pitié sans bornes.
– Où demeurait cette jeune personne ? demanda-t-il.
– Entre Agen et Marmande, et c’était pour la retrouver que j’avais raconté que je partais en voyage.
– Encore un mensonge de plus.
– Ah ! monsieur le curé, j’ai sur le dos un bien lourd fardeau de péchés.
– Elle avait de la famille ?
– Orpheline, monsieur le curé, déclara Gaëtan, qui jugeait utile de simplifier les choses, elle demeurait chez une de ses parentes qui, d’ailleurs, la rendait très malheureuse.
Le vieux prêtre réfléchit pendant un instant, puis il reprit :
– Est-ce que tes parents sont au courant de ce grand malheur ?
– Je ne leur en ai point parlé encore.
– Il faudra leur dire toute la vérité.
– C’était bien mon intention.
– Cela va bien amener du trouble dans leur existence.
– Certes, reconnaissait le chevalier, mon père va pousser des hauts cris, me maudire, je le crains… Maman va se lamenter et invoquer le bon Dieu, j’en suis sûr. Mais, quand ils verront le petit, tout rose, tout frais, tout mignon, ne demandant qu’à vivre, ah ! je les connais tous les deux, mon cher père et ma chère mère, ils seront immédiatement désarmés, ils se mettront à aimer ce petit bâtard de Castel-Rajac, tout autant que s’il eût été mon fils légitime. Monsieur le curé, je suis un grand coupable, je l’avoue, mais aidez-moi à faire de ce petit d’abord un bon chrétien, puis un bon chevalier.
De grosses larmes apparaissaient au bord des yeux de l’excellent prêtre qui reprit d’une voix tremblante d’émotion :
– Jésus a dit : laissez venir à moi les petits enfants. Je ne puis que me conformer à la parole du Divin Maître. Quand veux-tu, mon cher fils, que je baptise ton garçon ?
– Dès que vous le voudrez. Le temps d’aller chercher les deux témoins qui doivent signer sur le registre de la paroisse. Il est deux heures de l’après-midi, voulez-vous que, vers quatre heures, nous nous présentions à l’église ?
– À quatre heures moins le quart, je ferai donner le premier son de cloche. Auparavant, tu vas venir avec moi, à l’église, car il faut que je reçoive ta confession.
– Ah ! monsieur le curé, répliquait le jeune Gascon, vous venez de l’entendre et je ne pourrais, hélas ! que vous répéter les mêmes paroles. Ne suffirait-il pas que je m’agenouillasse devant vous, pour que vous traciez au-dessus de mon front le signe qui purifie ?
Le curé de Saint-Marcelin regarda son élève et pénitent avec un air de bonhomie affectueuse qui montrait que celui-ci l’avait déjà entièrement désarmé, puis il fit :
– Allons, qu’il en soit ainsi.
Tandis que le jeune Gascon se courbait devant lui, le digne ecclésiastique, à cent lieues de soupçonner que Gaëtan, pour sauver l’honneur d’une femme et assurer l’avenir d’un enfant aussi dangereusement exposé, s’était cru le droit de le berner, murmura les paroles sacramentelles, qui allaient laver l’intrépide chevalier d’un péché qu’il n’avait pas commis.
Se relevant, Castel-Rajac s’écria :
– Monsieur le curé, je ne puis que vous remercier du fond du cœur de votre bonté et de votre évangélique indulgence. Donc, à quatre heures précises, nous serons tous à l’église.
Il s’en fut, enchanté du succès qu’il venait de remporter, et il regagna prestement l’hostellerie du Faisan d’Or.
En franchissant le seuil, une exclamation de joie lui échappa : il venait d’apercevoir, attablé devant un pichet de vin frais et choquant cordialement le gobelet d’étain plein jusqu’au bord, deux gentilshommes aux allures de campagnards, l’un, un énorme gaillard taillé en hercule, aux moustaches et à la barbiche conquérantes, l’autre, mince, bien découplé, nerveux, et formant avec son compagnon le plus frappant des contrastes.
– Assignac, Laparède ! s’exclama Castel-Rajac de sa voix sonore.
Les deux buveurs se retournèrent et, apercevant Gaëtan qui s’avançait la main tendue, ils eurent simultanément un cri de joie.
L’énorme Assignac secoua le bras de Gaëtan avec une force capable de déraciner un jeune peuplier. Quant à M. de Laparède, il la serra avec toute la distinction d’un homme de cour.
Hector d’Assignac attaquait avec un gros rire qui faisait tressauter sa bedaine :
– Heureux coquin, joyeux drille, coureur de guilledou !
Il accompagnait chacune de ces épithètes d’un vigoureux coup du plat de la main sur ses cuisses monumentales.
– Qu’est-ce qu’il a, mon cher Henri ? demanda Castel-Rajac à M. de Laparède.
– Nous savons tout… déclara l’élégant Henri.
– Quoi, qu’est-ce que vous savez ?
– Que tu as ramené de voyage une fort jolie femme avec un délicieux poupon, et voilà pourquoi nous t’adressons nos félicitations les plus vives.
– Qui vous a raconté ça ? interrogea Castel-Rajac en feignant le mécontentement.
– Ah ! voilà !
– Cette bavarde de Mme Lopion !
Et, simulant la colère, le chevalier s’écria :
– Elle va me le payer cher, cette satanée commère.
Mais, se ravisant tout à coup, il fit :
– Après tout, non, car mon intention était bien, mes chers amis, de vous mettre au courant de l’aventure qui m’arrive. J’ai en effet ramené de voyage une fort jolie femme et un délicieux poupon, mais si je suis le père de cet enfant, la dame n’en est que la marraine… car, la vraie maman…
Gaëtan s’arrêta, comme pour donner plus d’importance à ces paroles, puis sur un ton grave et mystérieux :
– Au nom de l’honneur, je vous demande de ne point m’interroger à ce sujet.
– Nous serons discrets, affirma le colossal Hector.
– Nous nous tairons, enchaîna le très aimable Henri.
Castel-Rajac reprit :
– J’ai un autre service à vous demander.
– Lequel ? firent ensemble les deux amis.
– Tout à l’heure, je vais faire baptiser mon fils. Je ne puis pas vous demander à l’un ou à l’autre d’être son parrain, mais je vous prie de bien vouloir signer sur le livre de baptême.
– Très volontiers, acceptèrent les deux gentilshommes.
– Alors, rendez-vous à l’église à quatre heures précises.
– Nous y serons.
Ils échangèrent de nouvelles poignées de main et, tandis qu’Hector réclamait un nouveau pichet, Gaëtan rejoignit Mme de Chevreuse et Mazarin, qui avaient eu tout le loisir de s’entretenir d’une façon plus directe des événements qui venaient de se dérouler et de ceux dont ils attendaient la venue, non sans inquiétude.
La figure réjouie de Castel-Rajac les réconforta un peu.
– Tout va bien, annonça-t-il, tout s’est même passé admirablement. Mon bon vieux curé a été magnifique. Le baptême est fixé pour quatre heures. D’ici là, je vais avoir le temps de m’occuper du petit.
Et, se tournant vers Mazarin, il ajouta :
– Il est toujours bien entendu, mon cher comte, que vous lui servez de parrain ?
– Mais certainement.
Avec un éclair de joie dans le regard, le Gascon demanda :
– Cela ne vous contrarie pas trop que je me fasse passer pour le papa du petit ?
– Non, répliqua l’amant d’Anne d’Autriche, car je suis sûr que vous en ferez un vrai gentilhomme dont son véritable père ne pourra que s’enorgueillir un jour.
– Je m’en porte garant, affirma la duchesse.
– Je vous quitte pour aller prendre toutes mes dispositions, déclara Castel-Rajac.
Sans doute ménageait-il à ses adversaires futurs un nouveau tour de sa façon, car ses yeux pétillaient de malice.
*
* *
Ainsi que l’avait annoncé le bon curé de Saint-Marcelin, à quatre heures moins le quart, la cloche de l’église commença à tinter.
Dans le pays, le bruit s’était répandu que le chevalier Castel-Rajac allait faire baptiser son fils.
Cette nouvelle avait provoqué dans tout le village un mouvement de curiosité qui avait précipité vers l’église toutes les commères du pays.
Lorsque le cortège pénétra sous la voûte, tous les bancs étaient occupés. Précédée du bedeau, Mme de Chevreuse, qui portait elle-même sur un coussin enveloppé dans des flots de dentelles le précieux nourrisson, s’avançait, ayant à ses côtés le comte Capeloni ou plutôt M. de Mazarin.
Derrière eux, suivait le chevalier, plus vibrant que jamais et semblant défier à la fois du regard et du sourire tous ceux qui se seraient permis de blâmer sa conduite.
Il était escorté d’Hector d’Assignac, imposant et solennel, et d’Henri de Laparède, souple et désinvolte.
Après s’être agenouillés devant le maître-autel et avoir été bénis par le curé qui, assisté de deux enfants de chœur, s’était avancé vers eux, ils gagnèrent la chapelle latérale où se trouvaient les fonts baptismaux.
La cérémonie s’accomplit suivant le rite habituel, puis toujours précédé par le curé, le cortège se rendit à la sacristie ; le parrain, la marraine et les deux témoins apposèrent au-dessous de la déclaration de naissance et de baptême, qui était alors le seul acte officiel reconnu par la loi, leur signature et leur paraphe. Mazarin signa naturellement : comte de Capeloni et la duchesse : Antoinette de Lussac ; puis, le cortège regagna l’église qu’il traversa sur toute sa longueur.
En arrivant sous le porche, la duchesse de Chevreuse, qui portait toujours l’enfant sur son coussin, pâlit légèrement. Elle venait d’apercevoir, debout sur les marches de l’église, revêtus de leurs manteaux marqués d’une croix blanche, plusieurs gardes du cardinal qui la considéraient d’un air goguenard. Mazarin, qui s’en était aperçu, lui aussi, ne broncha pas et murmura à l’oreille de la duchesse :
– Ils sont arrivés, mais trop tard ; maintenant, nous n’avons plus rien à craindre.
– Qu’en savez-vous ? soupira Marie de Rohan.
– J’ai confiance en votre chevalier !
Quant à Castel-Rajac, il s’était contenté de toiser les gardes de Richelieu. Quand il passa près d’eux, il se retourna pour dire à haute voix à ses amis d’Assignac et de Laparède :
– Ah ça ! que viennent donc faire ces gens dans notre pays ?
Un des gardes, fort gaillard, à la figure farouche et à l’aspect peu engageant, allait répliquer au Gascon, mais un de ses compagnons lui posa la main sur l’épaule.
Gaëtan se retournant pour dévisager encore une fois ceux qu’il considérait comme ses ennemis, le garde dit à son camarade :
– Ce n’est pas le moment de provoquer un esclandre. Nous avons l’ordre d’agir promptement et sans tapage. Son Éminence ne nous pardonnerait pas de lui avoir désobéi. Laissons-les rentrer tranquillement à l’auberge.
Au même moment, deux hommes sortaient d’un des bas-côtés de l’église, dans l’ombre duquel ils s’étaient dissimulés. L’un, vêtu de velours noir, sur lequel tranchait la blancheur d’un col en toile blanche, n’était autre que M. de Durbec. L’autre portait l’uniforme du capitaine des gardes du cardinal. Il s’appelait le baron de Savières.
Le chevalier de Durbec fit :
– Tout est bien convenu. Vous avez bien saisi les instructions du cardinal ?
Le capitaine résuma :
– Il s’agit, d’abord, de nous emparer de l’enfant, puis d’emmener la duchesse au château de Montgiron où il faudra qu’elle s’explique sur son rôle dans cette affaire.
– Très bien, approuva Durbec. Je vous recommande, encore une fois, la prudence. Les gardes du corps dont elle est entourée ne sont pas nombreux, mais ils sont de taille à nous mener la vie dure. N’oubliez pas non plus que le cardinal tient essentiellement, et pour des raisons connues de lui seul, que M. de Mazarin ne soit ni molesté ni même inquiété. Quant aux autres, pas de quartier, telle est la consigne. Cela, mon cher capitaine, vous simplifiera singulièrement la tâche.
» Maintenant, vous allez immédiatement, avec vos hommes, simuler un départ. Vous aurez soin de dire à haute voix, à l’hostellerie du Faisan d’Or, que vous partez pour Toulouse préparer les appartements du cardinal qui doit se rendre prochainement dans cette ville. De cette façon, les méfiances de M. de Mazarin et de la duchesse de Chevreuse seront endormies et leur vigilance, ainsi que celle de leurs amis, ne pourront que s’en atténuer. »
Le capitaine fit un signe d’acquiescement, puis il ajouta :
– Nous pourrons donc, dès la nuit venue, nous livrer à une perquisition en règle à l’hostellerie.
Tandis que M. de Durbec quittait l’église par une petite porte qui donnait sur la campagne, le capitaine des gardes en sortait ostensiblement et, après avoir rallié ses hommes, il les entraîna jusqu’au Faisan d’Or où il leur dit à haute voix :
– Restaurez-vous copieusement, car nous allons faire cette nuit une rude étape.
Les gardes s’installèrent devant des tables inoccupées et se commandèrent un copieux repas.
Lorsqu’ils achevèrent leurs agapes, la nuit était venue. Un appel de trompettes retentit : c’était le signal du départ.
Tous se levèrent de table et regagnèrent la cour où leur chef, déjà en selle, les attendait. Enfourchant à leur tour leurs montures, ils gagnèrent aussitôt la grand-route de Toulouse, suivis du regard par Mazarin et Castel-Rajac qui dissimulés dans l’ombre, avaient assisté à leur départ.
Tous deux, en effet, avaient entendu dire par Mme Lopion que les gardes du cardinal partaient pour Toulouse, mais ils n’en avaient pas cru un mot, persuadés que ce n’était qu’une feinte et qu’ils n’allaient point tarder à revenir.
M. de Durbec en était donc pour sa ruse, d’ailleurs cousue de fil blanc. Plus que jamais, les deux alliés allaient se tenir sur leurs gardes.
Quelques instants après, ils étaient rejoints par Hector d’Assignac et Henri de Laparède, auxquels déjà Gaëtan avait raconté qu’on voulait lui voler son fils.
Cela avait suffi pour enflammer l’ardeur de ses deux amis, enchantés de se trouver mêlés à une aventure à la fois mystérieuse, galante et chevaleresque.
M. de Mazarin, tout en saisissant Gaëtan par le bras, lui dit :
– Je crois que cette nuit nous allons avoir à en découdre…
Le colossal Hector s’écria :
– À la bonne heure, moi, j’aime ça.
L’ardent et subtil Laparède ajouta :
– Nous allons montrer à ces gens de Paris de quel bois se chauffent les cadets de Gascogne.
– En attendant, proposa Castel-Rajac, si nous faisions une ronde autour de la maison… car il n’y a rien d’extraordinaire que ces drôles eussent laissé derrière eux quelques mouchards.
– Vous pouvez en être sûr, déclara M. de Mazarin.
Au premier abord, ils ne remarquèrent rien de suspect. La rue était déserte. Dans la cour, en dehors d’un valet d’écurie, qui aidait à descendre de sa monture un voyageur, aucune figure inquiétante ne se manifestait.
Il faut croire que les agents secrets de M. de Durbec possédaient l’art de se rendre invisibles, à moins que, fatigués de leur filature, ils eussent été souper.
Malgré cela, Castel-Rajac, qui n’était qu’à moitié rassuré, proposa à son ami de monter la garde à tour de rôle, afin de prévenir toute attaque imprévue.
Et, tirant son épée, tout en appuyant la pointe de son arme contre le sol :
– Maintenant, fit-il, ils peuvent venir, ils seront bien reçus.
Quant à Mazarin, Hector d’Assignac et Henri de Laparède, ils se firent ouvrir une chambre dont une des fenêtres, placée à l’angle de l’hostellerie, leur permettait de surveiller efficacement la rue.
Une heure passa, sans le moindre incident, lorsque le chevalier Gaëtan, qui avait l’oreille aux aguets, crut entendre derrière lui un bruit de pas très léger s’avançant dans sa direction.
Brusquement, il se retourna, l’épée en avant mais il n’eut pas le temps de faire un geste.
Subitement coiffé d’un sac en drap noir, empoigné par les bras, tiraillé par les jambes et jeté à terre en un clin d’œil, il se sentit ligoté, bâillonné et dans l’impossibilité d’opposer à ses assaillants la moindre résistance.
À l’intérieur de l’hostellerie, une autre scène se déroulait, non moins rapidement que celle que nous venons de décrire.
Le capitaine baron de Savières, après avoir fait irruption dans la salle à la tête de douze de ses gardes, escaladait rapidement l’escalier qui conduisait à la chambre occupée par Mme de Chevreuse et heurtait à la porte en disant :
– Ouvrez, au nom du roi !
À peine avait-il prononcé ces mots que Assignac et Laparède apparaissaient sur le palier. Ils allaient dégainer ; ils n’en eurent pas le temps. Les gardes du cardinal se précipitaient sur eux et les refoulaient dans leur chambre, les désarmaient et leur faisaient subir le même sort qu’à leur ami.
Quant à M. de Mazarin, il avait disparu.
Nous revenons à la duchesse de Chevreuse, qui s’était empressée d’obéir à l’injonction de M. de Savières et lui avait ouvert toute grande sa porte.
– Que voulez-vous de moi ? lui dit-elle, en dévisageant, d’un œil sévère, l’intrus qui se présentait à elle d’une façon aussi cavalière.
– Je suis le baron de Savières, capitaine des gardes de Son Éminence le cardinal de Richelieu.
– Je vous reconnais fort bien, monsieur, déclara la duchesse, et je ne suppose pas que vos fonctions vous donnent le droit de vous conduire d’une façon aussi peu chevaleresque.
– Madame la duchesse, riposta le capitaine avec beaucoup de calme, je suis chargé d’une mission que j’ai le devoir d’accomplir jusqu’au bout.
– Et qui consiste, sans doute, à vous emparer de ma personne ?
– Non, madame la duchesse, mais à vous prier de bien vouloir vous rendre jusqu’au château de Montgiron.
– Où je serai prisonnière ?
– Madame, je l’ignore. Je suis également chargé de vous demander de me remettre immédiatement un enfant que vous avez amené ici.
– Ah ! vraiment, ironisa la duchesse. Arrêter une femme et s’emparer d’un enfant est un double exploit qui ne m’étonne point de la part de celui qui vous envoie jusqu’ici, mais qui, véritablement, est indigne du gentilhomme et du soldat que vous êtes.
Savières eut un imperceptible frémissement. Le coup avait porté, mais il lui était impossible de reculer. Il se tut en se mordant les lèvres.
Profitant de cet avantage, Mme de Chevreuse, surprise de la carence de ses amis et craignant qu’ils ne fussent tombés dans quelque guet-apens, reprenait, pour gagner du temps :
– Je suis surprise, monsieur le capitaine, que votre maître n’ait pas plutôt choisi, pour remplir son exploit, un des nombreux espions qu’il entretient à sa solde.
Devinant la ruse de son interlocutrice, Savîères reprit :
– Je ne suis pas ici, madame la duchesse, pour discuter avec vous des raisons qui font agir M. le cardinal, pas plus que sur les moyens qu’il a cru devoir employer à votre égard ; je ne puis que vous répéter ce que je viens de vous dire, et je vous demande instamment de ne pas me contraindre à employer la force.
– Vous oseriez lever la main sur moi ?
– La plus noble dame de France, répliqua le capitaine, cesse de l’être lorsqu’elle conspire contre son roi !…
– Alors, s’écria Marie de Rohan en éclatant d’un rire forcé, je suis une conspiratrice. Décidément, monsieur le capitaine, vous êtes bien mal informé. J’ignore ce qu’on a pu vous conter à mon sujet, ou plutôt, je m’en doute. La vérité est tout autre. Vous avez simplement, uniquement, devant vous, une femme qui a juré de sauver à tout prix l’honneur d’une de ses amies. Maintenant, je n’ajouterai plus un mot.
Et, désignant d’un geste large la porte de la chambre voisine, elle fit :
– L’enfant est là. Auriez-vous le courage d’aller le prendre ?
Savières eut un instant d’hésitation, car Mme de Chevreuse lui avait parlé avec un tel accent d’indignation et de noblesse que, pour la première fois depuis qu’il était au service du cardinal, il se demandait si véritablement son maître ne lui avait pas ordonné de commettre une mauvaise action.
Cette pensée ne dura en lui que l’espace d’un éclair. Non point par crainte des représailles, car Savières était brave, et il était de ceux qui savent prendre leurs responsabilités, mais uniquement parce qu’il avait fait au cardinal le serment de lui obéir en tout et pour tout, même au péril de sa vie. Il se dirigea vers la porte de la chambre et l’ouvrit toute grande.
La pièce était à demi éclairée par la lueur d’une veilleuse placée près d’une petite table, à côté d’un grand lit qui n’était occupé par personne, et dont la couverture n’avait pas été défaite.
Au pied du lit, un berceau au rideau fermé attira l’attention du capitaine qui, en trois enjambées, le rejoignit. Soulevant les rideaux, il aperçut un enfant tourné sur le côté et qui semblait profondément endormi. Il s’en empara, le plaça sous son manteau et rejoignit la duchesse de Chevreuse, qui venait de réprimer un indéfinissable sourire.
– Maintenant, madame la duchesse, êtes-vous décidée à vous rendre au château de Montgiron ? Je tiens à vous dire que toute résistance est inutile, car mes gardes ont déjà mis à la raison trois des gentilshommes qui s’étaient constitués vos défenseurs. Quant au quatrième, c’est-à-dire M. de Mazarin, il a réussi à nous échapper ; mais je doute qu’à lui seul il soit de taille à nous mettre en déroute.
La duchesse pensa :
« Mon pauvre Gaëtan ! Pourvu qu’ils ne l’aient pas égorgé ainsi que ses amis. Enfin, Mazarin est libre ! Tout espoir n’est donc pas perdu de remporter une revanche sur nos ennemis. »
Et jugeant pour l’instant toute résistance inutile, elle reprit :
– Soit, monsieur le capitaine, je vous accompagne. Je ne vous demande qu’une grâce : rendez-moi cet enfant, car, nous autres femmes, savons beaucoup mieux les porter dans nos bras, et ce pauvre petit a grand besoin de ménagement.
Savières se laissa fléchir par cette requête et remit le nourrisson à la duchesse qui, l’enveloppant dans un des pans du manteau qu’elle avait jeté sur ses épaules, l’emporta tendrement contre sa poitrine, en disant :
– Heureusement qu’il ne s’est pas réveillé !
– Le fait est, déclara Savières, enchanté du succès de sa mission, que je n’ai pas encore vu un petit enfant dormir aussi profondément.
Quelques minutes après, Mme de Chevreuse, qui n’avait pas lâché son précieux fardeau, montait dans un carrosse, dans lequel deux gardes prirent place en face d’elle et, entourée d’une solide escorte que commandait le capitaine, le véhicule, traîné par quatre chevaux vigoureux, disparut bientôt dans la nuit.
M. de Mazarin, descendant alors de la cheminée dans laquelle il s’était réfugié, commença par aller délivrer Hector d’Assignac et Henri de Laparède et, après les avoir mis au courant des faits qui venaient de se dérouler, il descendit avec eux à la recherche du chevalier de Castel-Rajac.
Ils se heurtèrent aux époux Lopion qui, encore épouvantés, se livraient aux lamentations et aux imprécations les plus vives contre ceux qui les avaient troublés dans leur sommeil et risquaient de faire passer leur hostellerie pour une gargote mal famée et peu hospitalière.
Mazarin imposa silence à leurs criailleries. Tout de suite, il leur demanda :
– Avez-vous vu le chevalier de Castel-Rajac ?
– Non, monsieur, s’écriait l’aubergiste, et je ne tiens même pas à le revoir, car c’est bien de sa faute si, aujourd’hui, nous avons à subir tous ces désagréments.
– Assez de jérémiades, et donnez-nous tout de suite des lanternes, afin que nous puissions nous mettre à la recherche de notre ami.
Tout en grognant, Mme Lopion allait s’exécuter lorsque, les vêtements en désordre, les cheveux en broussailles, la chemise déchirée, Gaëtan de Castel-Rajac, qui avait réussi à se débarrasser des liens qui l’entouraient et à sortir du sac qui l’aveuglait, apparut, clamant d’une voix rauque :
– Les misérables viennent d’emmener la duchesse au château de Montgiron. Je les ai entendus partir. Leur capitaine leur donnait des ordres. Il faut absolument aller là-bas, leur arracher cette malheureuse ; sans cela elle est perdue.
Et, se tournant vers Mazarin, il ajouta :
– Pour que le cardinal s’acharne avec autant de cruauté sur cette femme et cet enfant, il faut…
Il n’acheva pas. M. de Mazarin, lui prenant la main, lui dit :
– Vous avez raison, mon cher chevalier, il faut à tout prix sauver la duchesse.
– Nous la sauverons !… fit le Gascon avec une énergie que l’on devinait sans limites.
CHAPITRE VI
ÉCHEC AU CARDINAL
Le château de Montgiron était situé à deux lieues du village de Saint-Marcelin.
Il faisait partie du domaine royal et, comme il se trouvait fort loin de la capitale, jamais encore aucun souverain ne l’avait honoré de sa visite. Il ne possédait, pour tout hôte, qu’un vieil officier qui en avait la garde et se donnait encore l’illusion d’être un chef, parce qu’il commandait à quelques gardes forestiers et à trois jardiniers chargés d’entretenir la forêt et les jardins qui s’étendaient autour du vieux manoir.
Ce vieillard qui répondait au nom de Jean-Noël-Hippolyte-Barbier de Pontlevoy, était un cardinaliste d’autant plus enragé qu’il devait cette agréable retraite à Richelieu, beaucoup plus désireux de se débarrasser d’un quémandeur qu’il rencontrait sans cesse dans ses antichambres, que de récompenser les services d’un brave mais obscur soldat qui n’avait jamais réussi qu’à récolter quelques blessures au service du roi.
M. de Durbec, muni d’un blanc-seing du cardinal, était donc devenu le maître de céans et avait déclaré à M. de Pontlevoy qu’il n’avait qu’à se conformer à ses instructions, c’est-à-dire à se tenir tranquille.
Le digne homme qui, au fond, ne demandait pas mieux, accéda aussitôt à la volonté que lui exprimait si énergiquement le mandataire du cardinal et, après avoir partagé le souper de ce dernier, il prit le sage parti de se retirer dans ses appartements, de se coucher dans son lit moelleux et de s’endormir avec la même sérénité que d’ordinaire, c’est-à-dire en homme qui a la conscience nette et la digestion facile.
Vers dix heures du soir, le capitaine des gardes pénétrait dans le salon où M. de Durbec attendait sa venue en dégustant un verre de vin d’Espagne. Il était accompagné de la duchesse de Chevreuse, qui portait dans ses bras l’enfant mystérieux.
M. de Durbec se leva et salua Mme de Chevreuse, qui ne daigna pas lui répondre.
M. de Savières attaqua :
– Mme la duchesse de Chevreuse a consenti à me suivre librement et à vous remettre, monsieur, l’enfant que j’étais chargé de lui réclamer.
Durbec ajouta, insistant particulièrement sur ces mots :
– De la part de Son Éminence le cardinal de Richelieu.
Sans ouvrir la bouche, la duchesse déposa sur la table l’enfant qu’elle tenait dans ses bras et qui semblait toujours reposer aussi profondément. Puis, impassible, elle attendit.
M. de Durbec écarta les voiles qui enveloppaient le nourrisson. Aussitôt, un cri de rage lui échappa :
– Madame, vous nous avez joués.
– Qu’est-ce à dire ? s’exclamait Marie de Rohan, d’un air hautain.
L’émissaire du cardinal, comprimant avec peine la rage qui s’était emparée de lui, scanda :
– Ce n’est pas un enfant, mais un mannequin.
– Vous me surprenez fort, dit ironiquement Mme de Chevreuse.
– Regardez, madame, et constatez vous-même.
– En effet, reconnut la duchesse, c’est bien un véritable mannequin que j’ai sous les yeux, et fort adroitement arrangé, n’est-ce pas, monsieur le capitaine des gardes, puisque vous-même, qui l’avez pris dans son berceau, vous ne vous êtes aperçu de rien ? Alors, comment voulez-vous, monsieur le représentant du cardinal, que moi, qui me trouvais dans une pièce voisine, j’aie pu me rendre compte de cette substitution ?
Les sourcils froncés, le regard mauvais, M. de Durbec attaqua d’un ton acerbe :
– Madame, je vous engage vivement…
Mais pressentant que l’explication allait être extrêmement importante et risquait fort de dévoiler, devant une tierce personne, des secrets que celle-ci n’avait pas à connaître, il ajouta :
– Monsieur le capitaine, je vous prie de vous retirer.
Le baron de Savières s’empressa de quitter la pièce, fort vexé du tour que l’on venait de lui jouer, et très inquiet des conséquences que pouvait avoir pour lui son manque de perspicacité.
Durbec lança à Mme de Chevreuse un regard de défi qui exprimait clairement :
– Et maintenant, à nous deux !
Mais la courageuse Marie de Rohan n’en parut nullement intimidée, et elle demeura debout à la même place, attendant vaillamment le choc de l’adversaire.
Celui-ci s’empara de la poupée et la jeta sur un meuble.
Puis, revenant vers la duchesse, il lui dit :
– Madame, désirez-vous que je vous communique le blanc-seing de Son Éminence ?
– C’est inutile. Les procédés dont vous avez usé envers moi suffisent à me révéler à la fois la nature des pouvoirs dont vous êtes investi et des intentions de celui qui vous les a conférés.
– Vous êtes donc irréductible, madame la duchesse ?
– Oui, monsieur, quand il s’agit de mon droit.
– Vous admettrez donc que je le sois aussi, lorsque j’ai à défendre celui du cardinal.
– Je ne vois pas, monsieur, en quoi le droit de votre maître est en jeu dans cette affaire.
– N’a-t-il pas le devoir de veiller, avant tout, sur l’honneur de Sa Majesté et sur la sécurité de l’État ? Mais nous ne sommes point ici, madame, pour parler politique, et je vous conseille de répondre catégoriquement à la question que je vais vous poser : Qu’est devenu l’enfant que vous avez fait baptiser cet après-midi dans l’église Saint-Marcelin ?
Avec un sang-froid qui semblait inaltérable, Mme de Chevreuse riposta :
– Demandez-le à son père !
– À M. de Mazarin ! coupa sèchement l’émissaire du cardinal.
– Vous faites erreur, monsieur, répliqua Marie de Rohan. M. de Mazarin n’est nullement le père de ce nouveau-né cause de ce litige. Il en est simplement le parrain, de même que j’en suis… la marraine.
– Alors, son père, quel est-il ?
– Le chevalier Gaëtan-Nompar-Francequin de Castel-Rajac.
– Quelle est cette plaisanterie ?
– Monsieur, vous êtes gentilhomme !
– Certes, et je m’en honore.
– Eh bien ! montrez-le, monsieur, d’abord en cessant de me parler sur un ton qui n’est point celui d’un homme de bonne compagnie, puis en vous abstenant désormais de mettre ma parole en doute.
« Décidément, se disait l’espion de Richelieu, cette femme est encore plus forte que je ne le pensais. Je crois que, pour avoir raison d’elle, je vais être obligé de me servir des grands moyens que j’ai ordre de n’employer qu’à la dernière extrémité. »
D’un ton volontairement radouci, il reprit :
– Croyez, madame, qu’il m’est fort désagréable, je dirai même fort pénible, d’être obligé de vous parler ainsi et de me montrer, envers vous, d’une rigueur qu’excuse cependant la situation, grave entre toutes, dans laquelle vous êtes placée. Sans doute allez-vous m’accuser encore de me montrer impoli et brutal envers vous. Mais nous en sommes arrivés à un point où il est de toute nécessité d’abattre nos cartes.
– Soit, monsieur, acquiesça la duchesse. Je pense que vous avez beaucoup d’atouts, mais je ne vous cacherai pas que j’en ai certains, moi aussi, qui sont fort capables de rivaliser avec les vôtres.
L’émissaire de Richelieu répliqua :
– Dans la nuit du 5 au 6 mai, Sa Majesté la reine Anne d’Autriche a accouché clandestinement d’un enfant du sexe masculin, dans une maison qui vous appartient et qui est située aux environs du château de Chevreuse. La reine vous a chargée de faire disparaître cet enfant. Dans ce but, vous avez eu recours à l’un de vos amis, le chevalier Gaëtan de Castel-Rajac et, tous deux, en compagnie d’une nourrice que vous aviez fait venir en secret de province, vous avez gagné ce pays, espérant ainsi mettre à l’abri de toutes poursuites l’enfant illégitime de la reine. Voilà pourquoi, madame, au nom de la Raison d’État, une dernière fois, je vous somme de nous restituer cet enfant ! Si vous acceptez, non seulement vous rentrerez en grâce immédiate auprès du cardinal, qui est décidé à vous combler de ses bienfaits et de ses faveurs, mais, en son nom, je prends l’engagement solennel que cet enfant sera élevé par les soins du cardinal avec tous les égards dus à son rang, sans que nul, cependant, ne puisse soupçonner quelles sont ses origines. Madame, j’attends votre réponse !
– Elle est fort simple, déclara la duchesse, sans se départir un seul instant de l’attitude qu’elle avait adoptée. Allez consulter le registre de la paroisse de Saint-Marcelin, et vous y verrez que cet enfant, que vous attribuez à la reine et à M. de Mazarin, est, en réalité, celui de Gaëtan de Castel-Rajac et d’une jeune fille des environs de Marmande, morte, ces jours derniers, en donnant le jour à son fils.
Redevenu nerveux, M. de Durbec s’écria :
– On peut écrire ce que l’on veut sur un registre de baptême.
– Je vous ferai observer, monsieur, que ces déclarations sont signées par Mme la duchesse de Chevreuse, M. de Mazarin, M. le chevalier de Castel-Rajac, M. le baron d’Assignac, M. le comte de Laparède. Donc, si nous avons fait une fausse déclaration, il faudra que vous nous poursuiviez en justice.
Durbec s’écria :
– Ne nous égarons pas en vains subterfuges. Voulez-vous, oui ou non, madame, me dire ce que vous avez fait de cet enfant ?
– Demandez-le à son père. Lui seul pourra vous renseigner à ce sujet.
– C’est votre dernier mot ?
– C’est mon dernier mot.
– En ce cas, madame, vous ne vous en prendrez qu’à vous seule des conséquences regrettables que vont avoir pour vous vos façons d’agir.
– Vous devriez savoir, monsieur, que je ne suis pas femme à me laisser intimider.
Cette fois, Durbec ne répondit rien. Il s’en fut simplement tirer sur le cordon d’une sonnette. L’un des panneaux de la porte s’ouvrit, et l’espion de Richelieu dit au garde qui se présenta :
– Prévenez votre capitaine que je désire lui parler.
Le garde salua et disparut. Durbec jeta un regard vers la duchesse qui n’avait pas bougé. Toujours debout, près de la table, en une attitude de sobre dignité, elle attendait la suite des événements avec la sérénité d’une femme qui vient de faire tout son devoir et qui est décidée à le remplir jusqu’au bout.
Un instant après, M. de Savières réapparut dans la pièce. Durbec lui dit, désignant Mme de Chevreuse :
– Veuillez, capitaine, considérer, à partir de ce moment, Mme la duchesse de Chevreuse comme votre prisonnière. Conduisez-la dans la chambre où elle doit demeurer enfermée, jusqu’à nouvel ordre, au secret le plus absolu.
Féru de discipline, le capitaine ne pouvait qu’obéir.
– Suivez-moi, madame, dit-il à Marie de Rohan qui, après avoir foudroyé Durbec d’un regard de mépris, s’en fut, guidée par M. de Savières, à travers les corridors sombres et déserts du vieux château de Montgiron.
Demeuré seul, l’émissaire de Richelieu grinça entre ses dents :
– Avant demain, j’aurai bien trouvé le moyen de faire parler cette maudite duchesse.
*
* *
Le premier mouvement de Gaëtan fut de se précipiter vers Montgiron, sans trop savoir comment il pourrait délivrer Mme de Chevreuse.
Cette impétuosité n’était guère dans les manières de Mazarin qui préférait la réflexion à l’action.
– Je crois, dit-il, qu’il serait beaucoup plus sage d’employer la ruse. En effet, si nous nous avisons d’occire une grande partie ou la totalité des gardes du cardinal, celui-ci ne nous le pardonnera pas et, à moins que nous prenions la décision de quitter par les moyens les plus rapides le doux pays de France, nous ne tarderons pas, malgré tous nos efforts, à tomber entre ses mains. Je crois le connaître assez bien pour pouvoir vous déclarer que, si nous lui infligions un pareil affront, il serait fort capable de nous envoyer un régiment à nos trousses, tandis que, si nous arrivions à pénétrer subrepticement dans le château, à découvrir l’endroit où est enfermée Mme de Chevreuse et à la faire s’évader sans attirer sur nous l’attention de ses geôliers, j’estime que nous aurons accompli une besogne beaucoup plus salutaire et beaucoup moins compromettante qu’en livrant une bataille rangée aux gardes du cardinal.
– Mais, objecta Castel-Rajac, comment ferons-nous pour pénétrer dans le château ?
– Est-il donc d’un accès si difficile ?
Gaëtan réfléchit un instant, puis il reprit :
– Je me souviens que, du côté de la forêt, il existe une petite porte plutôt vermoulue, par laquelle on doit pouvoir pénétrer aisément dans les communs.
– Bien. C’est plus qu’il nous en faut, déclara Mazarin, qui devait s’être déjà tracé dans l’esprit un plan beaucoup plus arrêté qu’il ne voulait bien le dire.
Et il reprit, d’un air entendu :
– En ce cas, messieurs, il ne nous reste plus qu’à monter à cheval et, afin d’éviter d’attirer l’attention des espions qui pourraient très bien rôder aux alentours, choisir des chemins de traverse que vous devez connaître mieux que personne.
» Une fois arrivés là-bas, par la porte, nous nous efforcerons de pénétrer dans la place que vient de nous indiquer M. de Castel-Rajac, et nous rechercherons alors le moyen d’exploiter ce premier avantage. »
Cinq minutes après, les quatre cavaliers chevauchaient sur un sentier étroit, entre deux haies drues et hautes. Gaëtan servait de guide.
Après avoir abouti à une sorte de piste à peine tracée qui longeait de vastes prairies bordées de peupliers ils atteignirent une forêt dans laquelle ils s’engagèrent et, protégés ainsi par les hautes futaies, ils arrivèrent à l’autre lisière d’où, à la clarté de la lune, ils aperçurent, se détachant sur un petit mamelon qui surmontait la Garonne, la silhouette du manoir de Montgiron.
Pour l’atteindre, il restait à peine un quart de lieue. Mazarin fit, toujours sur un ton de camaraderie :
– Je crois que nous ferions bien de laisser ici nos chevaux.
Les trois Gascons sautèrent en bas de leur monture. Utilisant fort habilement tous les replis de terrains, les fossés garnis de hautes fougères et les arbres qui se dressaient çà et là, ils atteignirent ainsi les fossés du château. Celui-ci ne présentait pour ainsi dire plus de défense. Quelques années auparavant, Richelieu, qui craignait toujours un retour offensif de la féodalité, l’avait fait entièrement démanteler. Les douves larges et profondes qui l’entouraient avaient été comblées.
D’un rapide coup d’œil, Mazarin se rendit compte de la situation et il murmura entre ses dents :
– Décidément, M. de Richelieu n’a pas prévu le bon tour qu’il va se jouer à lui-même.
Se tournant vers Gaëtan, il ajouta :
– Voulez-vous, mon cher chevalier, me conduire jusqu’à la porte que vous nous avez signalée tout à l’heure ?
– Très volontiers, mon cher comte.
Entouré des trois autres conjurés, Castel-Rajac contourna le château et, au pied d’une tour il désigna une petite excavation fermée par un simple pan de bois qui paraissait si peu résistant, qu’un simple coup d’épaule était capable d’en venir à bout.
– Allons, fit sobrement Mazarin.
Gaëtan, le premier, s’élança vers la porte, qui ne portait aucune serrure apparente. Il allait la heurter d’un coup de pied, lorsque Mazarin le retint en disant :
– Oh ! pas de bruit, surtout, mon cher. Voulez-vous me permettre ?
Docilement, Gaëtan s’effaça pour le laisser passer. Mazarin appuya de la paume de sa main droite sur la porte, qui résista. Elle était fermée à l’intérieur.
– Maintenant, dit-il à Castel-Rajac, poussez, mais très doucement.
Gaëtan s’exécuta. Un craquement se produisit.
Vivement, Mazarin avança la main et retint une planche au moment où, détachée de son cadre, elle allait choir sur le seuil. Il plongea son bras à l’intérieur, tâtonna un instant et, trouvant un loquet, il le fit glisser avec précaution.
La porte s’ouvrit en grinçant légèrement sur ses gonds rouillés. Mazarin s’avança. Il se trouvait dans un étroit réduit qui, par un soupirail, prenait jour sur la cour des communs, un petit escalier de pierre en forme de vis, donnant accès à l’étage supérieur. Après avoir recommandé à ses amis de faire le moins de bruit possible, Mazarin commença à gravir les marches et se trouva bientôt en face d’une porte qui, fort heureusement, était ouverte, ce qui prouvait que l’excellent Barbier de Pontlevoy, quelque peu amolli par les délices d’une oisive retraite, avait cessé de surveiller, même sommairement, les entrées et sorties du château dont il avait la garde.
Les quatre conjurés se trouvaient dans une cour étroite et obscure. Elle semblait complètement inhabitée et était entourée de bâtiments bas qui devaient autrefois former les écuries du château.
Au travers d’une grille délabrée, rouillée et demeurée ouverte, on apercevait une seconde cour, qui paraissait plus importante que celle-ci.
Mazarin, indiquant l’un des bâtiments aux trois Gascons, leur dit :
– Cachez-vous là, pendant que je vais en reconnaissance.
Tandis que, toujours dociles, Castel-Rajac, Assignac et Laparède se dissimulaient dans l’ombre, Mazarin, avec la souplesse d’un chat, se glissait jusque dans l’autre cour, d’où il pouvait examiner très attentivement les aîtres du château.
Le principal corps de logis formait l’un des côtés de la cour. À droite, la cuisine, le cellier. À gauche, un corps de garde, dans lequel quelques chandelles de résine achevaient de se consumer, et où régnait un profond silence.
Mazarin s’y faufila, et aperçut, étendus sur la planche d’un lit de camp et ronflant côte à côte à poings fermés, quatre des gardes du cardinal, dont les manteaux, les chapeaux et les épées étaient jetés pêle-mêle à leurs pieds.
Mazarin esquissa cet énigmatique sourire qui marquait chacune de ses joies intérieures puis, s’emparant des quatre chapeaux, des quatre manteaux et des quatre épées, il s’en fut à pas de loup les déposer dans la cuisine, légèrement éclairée, elle aussi, par quelques chandelles qui achevaient de se consumer dans leurs chandeliers.
Cela fait, il rejoignit les trois Gascons qui l’attendaient avec une fébrile impatience.
– Décidément, leur annonça-t-il, le destin nous est favorable. Je viens de surprendre dans un profond sommeil quatre gardes de Son Éminence, qui avaient cru bon de se dévêtir à moitié et de se désarmer tout à fait.
» Je me suis emparé de leurs défroques et de leurs épées. J’ai transporté le tout dans une cuisine, où nous serons à merveille pour endosser les uniformes de ces messieurs. »
Il les entraîna tous les trois jusqu’à la cuisine et, là, ils commencèrent à se déshabiller.
Déjà, Castel-Rajac et Laparède avaient mis bas leur justaucorps et, pleins d’ardeur et d’entrain, ils s’apprêtaient tous quatre à jouer consciencieusement leur rôle dans la tragi-comédie dont Mazarin était le metteur en scène, lorsque tout à coup, il leur sembla entendre un bruit de pas précipités sur les pavés de la cour.
Instinctivement, ils saisirent leurs épées. À peine venaient-ils de s’en emparer que huit gardes du cardinal se précipitaient dans la cuisine, l’épée à la main.
Cédant un moment au nombre, ils durent battre en retraite et se réfugier dans le cellier, où ils allaient trouver un champ plus facile pour se défendre.
– Quatre contre huit, s’écria Gaëtan d’une voix éclatante, c’est une bonne mesure.
Et il fonça sur ses adversaires, en mettant pour commencer deux à bas, tandis que, de leur côté, Mazarin, Assignac et Laparède en tuaient et en blessaient trois autres.
Les trois gardes qui étaient restés indemnes prirent le parti de rallier la cour et de donner l’alarme à ceux du corps de garde, qui se réveillèrent aussitôt et s’en vinrent à leur rescousse. Mais ils ne pouvaient pas être d’une grande utilité dans la bataille : ils étaient sans armes et encore tout alourdis de sommeil.
Castel-Rajac qui, d’emblée, avait repris le commandement de la bataille, profitant de la panique qui régnait parmi ses adversaires se précipita sur eux avec ses amis.
Au même moment, une fenêtre du château, qui se trouvait au premier étage, s’ouvrait, et une voix retentissait :
– Tenez bon ! Sus à ces bandits, à ces misérables, sus aux ennemis du cardinal !
C’était le capitaine de Savières qui encourageait ses hommes.
Mettant, lui aussi, l’épée en main, il se précipita à travers le vestibule, les couloirs, dégringola l’escalier et se précipita dans la cour.
Quand il arriva, les trois Gascons et l’Italien avaient achevé de mettre ses gardes à la raison. Tous jonchaient le sol, morts ou blessés. C’était un véritable carnage.
N’écoutant que son courage, M. de Savières voulut s’élancer sur les vainqueurs. Mais, du revers de son épée rouge de sang, Castel-Rajac, qui était décidément l’un des escrimeurs des plus redoutables qu’il fût possible d’imaginer, envoyait promener en l’air l’arme du capitaine, sur lequel se jetaient Assignac et Laparède, qui l’immobilisaient instantanément.
Castel-Rajac s’avançait vers Savières et, approchant son visage du sien, lui demandait, les yeux dans les yeux :
– Qu’avez-vous fait de Mme de Chevreuse ?
– Je n’ai pas à vous répondre, répliqua l’officier désarmé.
– Vous êtes notre prisonnier.
À peine le Gascon avait-il prononcé ces mots qu’un cri déchirant partait du château.
Castel-Rajac eut un grand sursaut : il lui sembla que c’était la duchesse qui appelait au secours.
Bondissant à l’intérieur, escaladant l’escalier quatre à quatre, il parvint jusqu’au troisième étage et se heurta à un homme vêtu de noir, l’épée à la main, qui semblait décidé à lui barrer le passage.
Le Gascon fonça sur lui.
Durbec – car c’était lui – essaya vainement de se mettre en garde et de parer cette foudroyante attaque. Lourdement, il retomba sur le sol, le corps traversé de part en part par la lame du chevalier.
Sautant par-dessus lui, Castel-Rajac franchit en quelques bonds les marches de l’escalier qui donnait accès au grenier et d’où continuaient à s’échapper les appels désespérés de Mme de Chevreuse.
Il se trouva devant une porte entrebâillée sur le seuil de laquelle, le dos tourné, se tenait un homme.
D’un coup de poing formidable, il l’écarta et, comme une trombe, il pénétra dans la pièce. Deux autres hommes s’apprêtaient à étrangler, à l’aide d’un lacet, la duchesse de Chevreuse, qui se débattait avec l’énergie du désespoir.
Lardés de grands coups d’épée, les deux bandits durent lâcher prise et, poursuivis par le Gascon, qui, d’un violent coup de botte, avait à demi écrasé la figure du troisième homme qui cherchait à se relever, ils s’élancèrent vers une lucarne qui donnait sur les toits. Mais, dans leur affolement, ils avaient mal pris leur élan et, glissant sur les tuiles, ils s’en furent s’aplatir sur les dalles de la cour à côté des autres victimes de la fureur gasconne.
Comme Mme de Chevreuse, brisée d’émotion, chancelait, Castel-Rajac dut la retenir dans ses bras ; mais, se ressaisissant, la vaillante femme s’écria :
– Non, je suis trop heureuse, maintenant, pour m’évanouir.
Gaëtan l’entraînait vers la sortie.
– La victoire est complète, disait-il, allons rejoindre nos amis !
Tout en tenant son épée d’une main et soutenant la marche de la duchesse de l’autre, il regagna la cour, sans remarquer que le corps du chevalier de Durbec n’était plus à l’endroit où il était tombé.
Rejoignant Mazarin, Assignac et Laparède, il leur annonça d’une voix triomphante :
– La chasse a été bonne. Il y a douze pièces au tableau !
M. d’Assignac lui désignait le baron de Savières, qui gisait, ligoté, sur le sol.
– Celui-là, fit-il, est encore en assez bon état.
Mazarin, qui s’était précipité vers Mme de Chevreuse, lui dit :
– Maintenant, il s’agit de vous mettre rapidement en sécurité, car, après ce qui vient de se passer ici, je ne réponds plus de la tête de personne.
– Le mieux, déclara Castel-Rajac, est de gagner le plus rapidement possible la frontière espagnole. Je crois que je ferais bien d’emmener aussi mon petit garçon. N’est-ce point votre avis, madame la duchesse ?
– Certes !
– Et vous, comte Capeloni ?
– Tout à fait.
Les quatre conspirateurs, qui entouraient la duchesse, quittèrent le château et rejoignirent leurs chevaux qui étaient restés dans la forêt. Bientôt, ils galopaient dans la direction de Saint-Marcelin, et le chevalier, qui tenait, doucement serrée contre sa poitrine, la belle Marie de Rohan qui se cramponnait à son cou, lui murmurait à l’oreille, entre deux phrases brûlantes d’amour :
– Je crois que votre amie sera contente de nous.
*
* *
Quelle ne fut pas la stupéfaction de l’excellent Barbier de Pontlevoy, lorsque, se réveillant le lendemain matin au chant du coq, suivant son habitude, après avoir revêtu ses chausses et son justaucorps, il commença son inspection quotidienne.
À la vue de tous ces cadavres alignés dans la cour et de tous ces blessés qui gisaient dans les communs, à l’endroit où ils avaient été frappés, il ne sut que s’écrier, en levant les bras au ciel :
– Mille millions de gargousses, est-ce que je rêve ou bien suis-je devenu fou ?
Et il appela, avec toute la force de ses poumons, les deux invalides qui constituaient avec lui la garnison de Montgiron :
– Passe-Poil et Sans-Plumet !
Ce ne fut qu’au bout de cinq minutes de vociférations stériles que Passe-Poil, tout en traînant sa jambe de bois, accourut à son appel.
– Monseigneur, s’écria-t-il, je respire, j’avais peur que vous eussiez été égorgé pendant votre sommeil.
– Ah ça ! que s’est-il donc passé ?
– Je n’en sais rien, monseigneur, Sans-Plumet et moi, nous avions profité de votre permission que nous avait value la présence au château des gardes de Son Éminence pour nous rendre jusqu’à la ville.
» Tout à l’heure, quand nous sommes rentrés, nous nous sommes trouvés en face d’un véritable carnage. Nous avons commencé par relever les blessés, les panser de notre mieux, puis nous avons découvert M. le capitaine de Savières ligoté et bâillonné au fond du fournil, où nous l’avons délivré.
– Et où est le capitaine ?
– Auprès de M. de Durbec, qui est grièvement blessé.
– Quelle aventure ! s’écria le brave homme, qui demanda aussitôt :
» Où avez-vous transporté M. de Durbec ?
– Dans la chambre d’honneur.
– J’y vais.
Tout essoufflé, bouleversé, suant déjà à grosses gouttes, le vieux soldat s’en fut retrouver Durbec, qui était étendu sur un lit et semblait souffrir cruellement de sa blessure. Le capitaine de Savières se trouvait à côté de lui, ainsi qu’un chirurgien que Sans-Plumet avait été quérir en toute hâte.
Le praticien venait de sonder la plaie et il déclara d’un air quelque peu hésitant :
– J’espère qu’aucune complication ne se produira, mais il faut bien compter trois semaines avant que vous puissiez vous remettre en route.
L’espion du cardinal eut une crispation du visage qui révélait l’impression fâcheuse que lui produisait ce pronostic. Mais Pontlevoy s’avançait en s’écriant :
– Vous me voyez furieux, affolé ! Je ne comprends rien, mais rien…
– Eh bien ! continuez, coupa Durbec, d’un ton sarcastique.
– Cependant, monsieur, permettez-moi, hasarda le colonel.
Durbec reprit :
– N’ayez aucune crainte quant aux responsabilités que vous avez encourues. Mon intention n’est nullement de rejeter sur vous l’odieux guet-apens qui a été tendu cette nuit à M. le capitaine de Savières et à ses gardes, ni de la tentative d’assassinat dont j’ai été l’objet.
» Soyez donc rassuré, monsieur le gouverneur, et n’ayez point souci de moi. Si Dieu le veut, je saurai bien me tirer d’affaire… et, s’il ne le veut pas, eh bien ! il sera fait selon sa volonté.
» Retournez à vos occupations habituelles et puissiez-vous dormir aussi bien la nuit prochaine que vous avez dormi la nuit dernière. »
Le vieil homme allait insister, mais, avec déférence, M. de Savières lui dit :
– Je crois, monsieur, que M. de Durbec a besoin de m’entretenir en particulier. Monsieur le chirurgien, à bientôt, n’est-ce pas ?
Le praticien répliqua :
– Demain matin, je viendrai renouveler le pansement.
Précédé de Sans-Plumet et flanqué de Pontlevoy, il descendit dans la cour, où il enfourcha sa maigre haridelle et il s’éloigna, tandis que le gouverneur, rouge, congestionné au point qu’on aurait pu redouter pour lui une apoplexie foudroyante, s’écriait, en tournant autour d’un puits qu’il semblait prendre à témoin de son désarroi :
– Je n’y comprends rien… rien… rien…
DEUXIÈME PARTIE
L’ÉPOPÉE DE LA HAINE
CHAPITRE PREMIER
UN ORAGE PROVIDENTIEL
Le coup d’épée envoyé par Castel-Rajac à Durbec était magistral, car le blessé dut rester alité plus de trois semaines avant de reprendre une vie normale et obtenir du praticien l’autorisation de se lever.
Mais pendant cette retraite forcée, la rancune qu’il éprouvait pour le chevalier gascon ne fit que croître, alimentée qu’elle était par le dépit qu’il éprouvait à s’être laissé vaincre par cet adversaire. Il se jura qu’il aurait sa revanche, sa vie entière devrait-elle y être consacrée.
Il lui tardait de pouvoir repartir, afin de mettre lui-même le cardinal de Richelieu au courant. Déjà, le baron de Savières avait dû lui raconter ce qui s’était passé au château de Montgiron. Mais Durbec connaissait le capitaine des gardes. C’était un rude soldat, qui ne saurait pas présenter l’histoire de façon que le ministre conçoive pour ses adversaires une de ces haines terribles qui ne désarment pas. Tandis que lui, Durbec, saurait y glisser quelques perfidies propres à exciter la colère du grand cardinal.
Enfin, ce jour tant attendu arriva. Après avoir visité sa blessure une dernière fois, le médecin qui le soignait lui déclara :
– Votre plaie est cicatrisée. Je crois que vous pourrez repartir lorsque vous le désirerez.
Il y avait longtemps que l’espion du cardinal attendait cette nouvelle. Aussi poussa-t-il un profond soupir de joie à cette annonce. Mais lorsque le brave Barbier de Pontlevoy apprit que son pensionnaire forcé allait repartir, il leva les bras au ciel :
– Je vous regretterai ! affirma-t-il. Avec qui donc vais-je pouvoir faire ma partie de piquet, désormais ?
– Bast ! répondit Durbec, qui se moquait bien de la partie de son amphitryon, vous engagerez l’un de vos hommes, ce brave Sans-Plumet, ou bien Passe-Poil, pour vous servir de partenaire !
Le lendemain matin, l’homme du cardinal put enfourcher le cheval que le gouverneur lui prêta. Et après un dernier échange de compliments, le cavalier piqua des deux vers la capitale, un peu étourdi par le grand air, mais complètement guéri.
Sa monture était excellente ; néanmoins, il lui semblait qu’elle piétinait. Il labourait les flancs de la pauvre bête, penché sur l’encolure. Toute sa vigueur lui était revenue. Le démon de la vengeance le portait en avant.
Enfin, après quatre jours de marche forcenée, il distingua les murs de la capitale ! Il poussa un soupir d’aise : dans deux heures, il serait auprès du cardinal-ministre.
Celui-ci était dans son cabinet de travail lorsque Durbec se fit annoncer. Il leva sa tête, que la maladie et les soucis creusaient, et répondit simplement, en reposant sa plume d’oie :
– Qu’il entre !
Quelques secondes plus tard, le personnage était introduit. Il s’avança d’un pas rapide vers Richelieu, puis, à quelques pas, s’immobilisa dans un profond salut, attendant que son maître veuille bien le questionner.
Celui-ci le considéra un instant, sans grande bienveillance. Il connaissait le Durbec depuis longtemps, et, s’il l’utilisait, ne pouvait guère concevoir de l’estime pour lui.
– Eh bien ! monsieur ! dit-il enfin, en lui faisant signe d’approcher, quelles nouvelles m’apportez-vous ?
– Votre Éminence doit les connaître déjà, répondit Durbec. M. de Savières a dû vous les communiquer…
– Vous devez vouloir parler de l’attaque, du château de Montgiron ?
– Oui, Éminence ! Suivant vos ordres, la duchesse de Chevreuse et l’enfant…
Richelieu l’interrompit.
– Je sais… je suis au courant… Avouez, monsieur, que vous n’avez pas eu le beau rôle ?
Le ton était sarcastique. Durbec blêmit de colère.
– Que votre Éminence daigne nous excuser ! Mais ces endiablés…
– Oui, oui… Ce fut là un joli coup de force ! Ces hommes sont étonnants…
– L’un d’eux, appelé Castel-Rajac, m’a pourfendu d’un coup d’épée qui m’a forcé à rester étendu plus de trois semaines, Votre Éminence… C’est pourquoi je n’ai pu venir vous rendre compte plus tôt de ma mission…
– Savières m’a conté… Je regrette le coup d’épée pour vous, mais il fallait prêter plus d’attention, monsieur de Durbec…
– Ah ! Monseigneur ! Sans eux, nous obtenions enfin la vérité sur l’enfant ! La duchesse et ses amis vous ont indignement joué. Monseigneur…
Une ombre de sourire erra l’espace d’une seconde sur les lèvres du grand cardinal.
– La poupée mise à la place du bébé… Je sais… Ces Gascons ont vraiment une imagination étonnante !
Durbec manqua étouffer de rage en voyant Richelieu dans cette disposition d’esprit. Attendre des cris de colère et des sanctions terribles, et ne voir qu’un calme presque indifférent était pour lui une surprise aussi désagréable que consternante.
– Que Votre Éminence m’excuse ! parvint-il à balbutier. Mais ne croyez-vous pas qu’en pourchassant sans pitié cette engeance…
Richelieu leva la main.
– Nenni, monsieur ! J’ai déjà eu plusieurs gardes tués dans cette aventure ; j’ai besoin de la vie de mes hommes et ne veux point les exposer inutilement. Vous avez été vaincus, reconnaissez-le loyalement. Tant pis ! Arrangez-vous seulement pour retrouver la piste de ce Castel-Rajac et de l’enfant.
– Monseigneur ! s’écria Durbec, tentant un dernier effort. Madame la duchesse s’est moquée de vous, et le signor Capeloni également ! Si vous ne sévissez pas, ils ne mettront plus de bornes à leur audace !
Le cardinal-ministre regarda son subordonné sévèrement.
– Depuis quand, monsieur, dois-je recevoir vos conseils sur la conduite que je dois tenir ? Allez et ne songez qu’à exécuter mes ordres !
Le chevalier sortit fou de rage en pensant au piètre résultat de son entrevue.
– Morbleu ! grommela-t-il en descendant les larges degrés de l’escalier du Palais-Royal. Puisque c’est ainsi je ne confierai à personne le soin d’assouvir ma vengeance.
Seulement Durbec avait moins d’envergure que le grand cardinal, et si celui-ci avait les bras assez longs pour étreindre à la fois tous ses adversaires, le chevalier ne pouvait songer qu’à Castel-Rajac. Mme de Chevreuse était trop grande dame pour qu’il osât s’attaquer à elle. Quant au signor Capeloni, il avait disparu.
Il prit pension dans une auberge qu’il connaissait bien, et décida de s’y établir quelque temps, afin de voir venir les événements.
En guise de représailles, le cardinal se contenta de prier la duchesse de s’éloigner de nouveau de la cour, qu’elle s’était empressée de rallier dès son retour de Gascogne, autant pour revoir son illustre amie que pour lui donner des nouvelles de l’enfant confié à sa garde.
La reine avait donc appris comment son fils, adopté par un gentilhomme aussi brave que loyal, serait élevé par ses soins et sous son nom.
Avant que le ministre ait pris la décision d’exiler une fois de plus Marie de Rohan, elle avait eu le temps de causer longuement avec Anne d’Autriche, et de lui prodiguer les plus judicieux conseils.
– Madame, lui dit-elle, alors que les deux femmes, dans le cabinet de la reine, causaient familièrement, tout ce qui s’est passé est bel et bon, mais cet enfant ne pourra régner un jour.
– Hélas ! ma mie ! je le sais ! répondit Anne d’Autriche, et c’est bien ce qui me désespère, car mes ennemis disent déjà qu’il serait préférable de me répudier si je ne puis donner d’enfant à la couronne de France.
La duchesse s’emporta.
– Voilà une plaisante histoire ! Si Sa Majesté voulait bien montrer plus… d’empressement… S’il y a un coupable, ce n’est certainement pas vous !
Les deux femmes ne purent retenir un éclat de rire en pensant au poupon resté en Gascogne.
– Richelieu me hait, reprit la reine, et serait heureux de me voir en disgrâce…
Marie de Rohan avait aussi de bonnes raisons pour ne point porter dans son cœur celui qu’on nommait « l’homme rouge. »
– C’est un être de ténèbres et d’intrigues…, reprit-elle pensivement. Madame, il faut absolument que vous donniez un héritier au roi…
– Mais comment, ma chère ? Tu sais que mon époux se targue d’être appelé « le Chaste »…
La duchesse eut un petit clin d’œil malicieux.
– Bah ! laissez-moi faire… Il faudra bien qu’il cède à la raison d’État !
Elle pencha sa jolie tête vers son amie, et, longtemps, les deux jeunes femmes complotèrent…
*
* *
À quelques jours de là, une grande chasse fut décidée dans la forêt de Saint-Germain.
Louis XIII était un passionné de ce divertissement. Toute la cour s’y rendit, et bien entendu, Anne d’Autriche, accompagnée de Mme de Chevreuse.
Toutes les deux montaient merveilleusement à cheval. La chasse déroula ses péripéties habituelles jusqu’au soir. Louis XIII, habituellement triste et perpétuellement ennuyé, se dérida et fut d’une humeur charmante toute la journée.
Lorsque le soir tomba, il se trouva isolé du gros de la troupe, dans un sentier écarté, avec M. de Senlis comme seul compagnon.
– Ma foi ! Monsieur, dit le roi en piquant des deux, j’ai l’impression que nous voici égarés.
– Et la nuit tombe, ce qui ne facilitera pas notre chemin, reprit M. de Senlis.
– Entendez-vous des sonneries de trompe ?
– Nullement, Majesté. Mais ce que je vois fort bien, ce sont de gros nuages noirs qui nous font présager un orage.
– Vous avez raison, palsambleu ! Pressons le pas, sinon, nous risquons d’être pris dans la tempête.
M. de Senlis jeta un regard vers les nuées qui accouraient de toutes parts, formant un épais rideau sombre, et un sourire malicieux souleva sa fine moustache.
– Par la barbe du Père Éternel ! murmura-t-il, si nous étions de connivence avec le Ciel, celui-ci ne pourrait se montrer plus propice !
Ils galopèrent un moment en silence. Mais toujours les arbres, les buissons… et le grand silence forestier.
– Allons ! fit le roi avec découragement, je crois qu’il nous faudra coucher ici !
– Attendez donc, Majesté… fit tout à coup Senlis, feignant de se reconnaître soudain. Il me semble que… mais oui…
– Que voulez-vous dire, Monsieur ?
– Si mes souvenirs sont exacts. Sire, nous nous trouvons tout près d’un pavillon de chasse, où du moins, nous pourrons nous reposer un peu et laisser passer l’orage…
– Ce serait parfait ! s’écria Louis. Où est donc ce bienheureux pavillon ?
La nuit était venue, complètement, et noire comme de l’encre.
– Il me semble que nous devons suivre ce chemin, Sire, et aussitôt passé le tournant, nous l’apercevrons, si toutefois le diable ne nous jette pas de la poix dans les yeux.
– Allons !
Ils se remirent en route. Dès le tournant franchi, une masse sombre se profila. Une lueur brillait à travers les vitres d’une fenêtre.
– Tiens ! s’écria Sentis, feignant l’étonnement. Je crois que quelqu’un s’est trouvé dans notre cas !
– Espérons que le premier occupant voudra bien nous donner l’hospitalité.
Senlis sauta à bas de son cheval et heurta l’huis du pommeau de son épée.
– Qui est là ? dit une voix de femme.
– Le Roi !
La porte s’ouvrit aussitôt, et la figure spirituelle de Marie de Rohan parut.
– Quoi, Madame la duchesse, c’est vous qui aviez choisi ce refuge ? s’écria Senlis.
– Je ne suis pas seule, monsieur le comte ! Sa Majesté est avec moi…
Anne d’Autriche parut à son tour.
– Madame, dit Senlis en s’inclinant profondément, Sa Majesté s’est égarée dans le bois avec moi, et fuyant l’orage, nous sommes venus jusqu’ici…
– Soyez les bienvenus ! dit gracieusement la reine. Nous allions précisément souper. Marie et moi… Voulez-vous partager notre modeste repas ?
Le dîner était délicat, la chère abondante et choisie, les vins généreux. Louis XIII, affamé par la longue course fournie, but et mangea avec l’entrain d’un vieux routier. Senlis et Mme de Chevreuse furent étincelants d’esprit. Anne d’Autriche leur donna la réplique. Ce fut un souper fin comme le roi n’en avait pas encore connu. Lui-même se sentait tout autre, dans cette atmosphère légère et pétillante comme le vin qu’on lui servait généreusement. Un grand feu de bois flambait dans la cheminée. Dehors, de larges gouttes de pluie claquaient sur le toit moussu…
Cependant, l’heure s’avançait. Au loin, les grondements de l’orage s’éloignaient. Senlis se leva.
– Sire, dit-il en s’inclinant, permettez-moi maintenant de prendre congé.
– Hé ! quoi ! Senlis, vous ne restez pas ? Vous allez vous perdre, mon pauvre ami !
Un imperceptible sourire erra sur ses lèvres.
– Ma bonne étoile me guidera. Sire ! Mais je dois avertir au château que vous avez trouvé refuge ici, avec Sa Majesté, sinon, on s’inquiétera…
Marie de Rohan s’inclina à son tour.
– Que Vos Majestés me donnent le même congé… Je regagne aussi Saint-Germain…
– Madame, dit le roi, je ne peux autoriser ce départ, la nuit, par ce temps exécrable… Attendez le jour ici…
Une lueur espiègle fit briller les yeux de la belle duchesse.
– Que Votre Majesté me pardonne ! Mais comme il n’y a céans qu’une seule couche…
Une rougeur soudaine parut sur les joues de Louis XIII tandis qu’un vif embarras se peignait sur son visage. Mais Marie ne lui laissa pas le temps de réfléchir.
– Je suis infiniment reconnaissante à Votre Majesté de sa sollicitude… Mais sous la protection de M. de Senlis, je ne risquerai rien…
– Allez donc, et que Dieu vous garde ! soupira le roi, peut-être moins fâché qu’il voulait le laisser paraître de ce tête-à-tête forcé.
La duchesse et le comte de Senlis remontèrent à cheval. Puis la porte du pavillon se referma sur le couple royal…
Les deux cavaliers piquèrent des deux malgré l’obscurité. Ce fut sans une hésitation que le gentilhomme s’orienta et se dirigea vers le château où la Cour avait élu domicile.
Lorsqu’ils furent en vue de la splendide terrasse qui domine toute la vallée de la Seine, ils ralentirent le train. La duchesse de Chevreuse se tourna vers son compagnon.
– Monsieur de Senlis, dit-elle, vous avez accompli votre rôle à la perfection. La reconnaissance de la reine et la mienne vous sont acquises…
– Ah ! Madame ! fit-il en se rapprochant de la jeune femme, serez-vous cette nuit plus cruelle que Sa Majesté pour notre Roi ?
Marie éclata de rire.
– Doucement, monsieur le comte ! La question de la postérité royale n’est pas en jeu entre nous, que je sache ! Nous en reparlerons…
Mais l’ordre du cardinal-ministre parvint à la duchesse de Chevreuse avant qu’elle ait eu le temps d’entamer un autre entretien à ce sujet avec son galant complice. Elle dut regagner ses terres, maudissant une fois de plus l’omnipotence de Richelieu.
Neuf mois plus tard, le héraut royal annonçait la naissance d’un enfant du sexe masculin du nom de Louis, et surnommé « Dieudonné » tant l’impatience et le désir de sa venue furent grands.
Depuis quelque temps déjà, M. de Senlis avait obtenu un brevet de colonel dans la garde royale, à l’instigation de la reine Anne d’Autriche…
CHAPITRE II
MARIE DE ROHAN PART POUR UN AGRÉABLE EXIL
Par un beau matin tout poudré de poussière d’or, un de ces matins parisiens où l’automne s’alanguit sur les berges de la Seine, le carrosse de la duchesse de Chevreuse quitta une nouvelle fois la capitale pour l’exil.
À vrai dire, la jeune femme n’était pas trop inquiète, elle savait bien que sa disgrâce ne serait pas éternelle, car sa royale amie emploierait toute son influence pour la faire revenir plus tôt.
L’escorte de la noble dame galopait autour d’elle, sans s’apercevoir que derrière, à une distance respectueuse, un cavalier, emmitouflé dans un manteau gris, suivait la même route. D’ailleurs, le chemin du Roi était à tout le monde, et ce voyageur ne pouvait leur inspirer aucun soupçon.
Apprenant le départ de Mme de Chevreuse, Durbec s’était dit qu’il n’aurait jamais meilleure occasion de retrouver la piste de Castel-Rajac et celle de l’enfant.
Sa haine couvait encore n’attendant qu’un hasard favorable pour s’assouvir. Il n’avait pas oublié le coup d’épée du chevalier.
Le voyage fut sans histoire. Trottant le jour, s’arrêtant la nuit, l’équipage de la duchesse, par étapes successives, ne tarda pas à gagner le village de Saint-Marcelin. On fit halte au Faisan d’Or.
Bien entendu, quelques instants après, Durbec, le plus discrètement possible, demandait à son tour une chambre.
Mais, à l’étonnement du chevalier, le lendemain, il n’y eut point d’ordre de départ.
– Ho ! ho ! grommela Durbec. Est-ce que par hasard, ma bonne étoile me favoriserait plus tôt que je ne le pense, et verrais-je arriver notre cher Gascon ?
Mme Lopion, la brave hôtelière, se souvenait bien de la dame qui accompagnait Castel-Rajac et l’enfant, lors de leur premier voyage. Elle ne vit pas sans défiance survenir la belle inconnue. La malheureuse aubergiste se rappelait encore l’incursion des gardes du cardinal et le beau tapage qui en était résulté.
Ses craintes ne furent pas diminuées, lorsqu’à la brune, elle vit arriver à francs étriers un cavalier dont le chapeau était rabattu sur les yeux, ce qui ne l’empêcha point de reconnaître Castel-Rajac !
– Bonne Sainte Mère ! murmura la bonne femme en se signant plusieurs fois. Pour sûr qu’il va y avoir encore du grabuge !
Marie de Rohan, dès qu’elle avait su son ordre d’exil, n’avait rien eu de plus pressé que d’envoyer un courrier en porter la nouvelle à son amant, qui s’était réfugié sur la frontière espagnole, au petit village de Bidarray, avec l’enfant et ses deux inséparables compagnons, Laparède et Assignac.
Il avait été convenu que le Gascon retrouverait sa maîtresse à Saint-Marcelin, et là, l’escorterait jusqu’à leur nouvelle résidence, afin qu’elle voie l’enfant et puisse, à son retour à Paris, en porter des nouvelles à la mère.
Les deux jeunes gens se retrouvèrent avec joie. Castel-Rajac était sincèrement épris de cette gracieuse femme, aussi spirituelle que jolie. Quant à la duchesse, elle s’était laissé prendre aux yeux noirs et à la mine conquérante du cadet de Gascogne, et ces retrouvailles allégeaient beaucoup pour elle les tristesses de l’exil.
Mais quelqu’un d’autre que la brave Mme Lopion avait aussi reconnu Castel-Rajac. C’était Durbec, à l’affût derrière la jalousie de sa chambre.
– C’est bien ce que je pensais ! murmura-t-il. Décidément, le sort me favorise ! J’espère que cette fois, le cardinal sera content !
Les deux amants étaient loin de se douter qu’ils étaient épiés et suivis de la sorte. Ils se livraient à toute la joie de s’être retrouvés sans arrière-pensée.
– Chère Marie ! dit Castel-Rajac en enveloppant d’un geste caressant l’épaule de sa maîtresse, quel profond bonheur est pour moi notre réunion ! Pardonnez-moi mon égoïsme, mais je bénis la rigueur du cardinal, qui, par votre disgrâce, vous a rapprochée de moi !
– Fi chevalier ! s’écria Marie en riant. Je devrais vous en vouloir pour cette parole ! Vous vous réjouissez de mon malheur !
– M’en voulez-vous vraiment beaucoup ? demanda tendrement le Gascon en se rapprochant encore de la duchesse.
Il la contemplait, et dans les yeux noirs du jeune homme brillait le feu d’une telle passion, que Mme de Chevreuse, troublée, balbutia :
– Comment puis-je vous en vouloir…
Elle n’acheva pas sa phrase. Castel-Rajac l’avait saisie et l’embrassait avec emportement.
Il la lâcha avec autant de brusquerie qu’il l’avait prise. La porte s’ouvrait, et Mme Lopion, qui apportait le dîner, entra.
– Excusez-moi…, commença la brave femme. J’ai frappé trois fois…
– Oui, oui, dit Marie… Cela n’a pas d’importance… Posez les plats…
L’aubergiste prépara la table, dans la chambre de Marie, où celle-ci avait prié qu’on la serve, et disparut comme une ombre.
Lorsqu’elle fut sortie, ils ne purent s’empêcher de rire.
– Pauvre femme ! dit Castel-Rajac. Elle semblait toute confuse. Bah ! je suis certain que cela ne l’empêche pas maintenant d’écouter à la porte…
Il se leva et, sur la pointe des pieds, ouvrit le battant.
– Oh ! monsieur le chevalier ! s’écria Mme Lopion, rouge comme le ruban qui ornait sa guimpe, j’allais justement vous demander si vous aviez encore besoin de mes services…
– Non, non, madame Lopion, rassurez-vous ! fit le Gascon qui riait sous cape. Vous nous avez apporté tout ce qu’il nous faut, et maintenant, nous ne désirons plus que la tranquillité…
Gaëtan vint de nouveau s’asseoir sur un petit tabouret, aux pieds de sa dame. Celle-ci passa sa main, blanche et fine, aux doigts parfumés, dans la chevelure du jeune homme.
– Çà, mon beau chevalier, fit-elle, badine, avez-vous un peu rêvé à moi ?
– Si j’ai rêvé à vous, capédédiou ! s’écria-t-il. Je peux dire, que nuit et jour, votre pensée ne m’a pas quitté…
Il s’arrêta pour baiser avec passion les mains qu’on lui abandonnait.
– Mon plus vif désir est de vous voir rester ici le plus longtemps possible… Vous verrez commet notre village est beau et pittoresque ! On croit habiter le bout du monde… Plus rien, que la nature devant soi… Vous oublierez Paris, duchesse !
Mme de Chevreuse eut un fugitif sourire.
– Je ne sais trop… Je n’ose vous le promettre… Des devoirs aussi m’attachent à la Cour, vous le savez bien…
Gaëtan se passa la main sur le front.
– Pardonnez-moi : je rêve encore ! je suis fou… Mais qu’importe ! Je vous ai pour quelques jours ; ce répit me semble si beau que j’ose à peine y croire… Laissez-moi l’illusion qu’il est éternel !
– Enfant ! murmura-t-elle.
– Marie… Je vous aime…
Elle retira son bras, dont il s’était emparé.
– Chut ! soyez sage ! Avant, parlez-moi d’Henry…
– Il est charmant… Il est confié à une nourrice basque, qui en prend soin comme si c’était son propre enfant. Vous serez fière de moi lorsque vous le verrez !
– Vous ressemble-t-il déjà ? interrogea-t-elle malicieusement.
Ils éclatèrent de rire.
– Ce serait bien là le miracle du Saint-Esprit ! s’écria Gaëtan. Non… Il ressemblerait plutôt… au signor Capeloni…
– Chut ! murmura la duchesse, effrayée, en mettant un doigt sur ses lèvres. Voilà une imprudente parole, chevalier !
Mme de Chevreuse ne croyait pas encore si bien dire. Car, derrière le vantail de la porte du couloir, un homme, courbé, tenait son oreille collée et ne perdait pas une syllabe de la conversation.
– Oh ! oh ! fit-il pour lui-même en se redressant. Voilà une indication intéressante ! Après tout, c’est bien possible ! Voyez-moi ce faquin de Mazarini !
Il se retira sur la pointe des pieds, laissant les amants à leur tête-à-tête. Il en savait assez pour ce soir-là.
Comme il l’avait prévu, dès le lendemain matin, on se remit en route, au grand soulagement de Mme Lopion, qui croyait à chaque instant voir surgir les gardes du cardinal-ministre et recommencer une bataille comme celle à laquelle elle avait déjà assisté.
Castel-Rajac chevauchait à côté du carrosse de sa bien-aimée, et tout en marchant, ils réussissaient à échanger quelques mots. Ils se sentaient l’un et l’autre parfaitement heureux. Jamais Richelieu n’avait imaginé, pour celle qu’il espérait punir, une pénitence aussi agréable !
Mais comme un rappel de l’homme rouge qui, de son aire, les surveillait encore, Durbec, derrière l’escorte, les suivait comme leur ombre, guidé par l’intérêt qui le liait au service du cardinal et par sa haine personnelle.
Bientôt, le paysage changea. Après la plaine de Gascogne, apparurent les premiers contreforts des montagnes pyrénéennes.
D’un geste, Castel-Rajac les montra à Marie.
– Voyez ! s’écria-t-il. C’est au milieu de cette nature sauvage que notre filleul est élevé. L’air des montagnes lui fera des muscles forts et un cœur intrépide…
Marie sourit.
– Dites aussi votre éducation et votre exemple, ami ! Je ne doute pas que notre cher Henry ne soit aussi un jour un gentilhomme accompli.
Lorsqu’ils arrivèrent à Bidarray, la jeune femme put se convaincre que le cadre était en effet idéal.
C’était un tout petit village, dominé par une vieille gentilhommière qui appartenait à une tante d’Hector d’Assignac, laquelle avait eu le bon esprit de mourir afin de laisser son manoir à son neveu.
Il était perché à l’avant d’un rocher faisant éperon, et dominant toute une verdoyante vallée, au fond de laquelle mugissait un torrent. Les maisons des paysans s’accrochaient au petit bonheur à la pierre, et les champs dégringolaient de terrasse en terrasse coupés çà et là de boqueteaux. Des troupeaux de chèvres faisaient tinter leurs clochettes ; par instant, l’aboi bref du chien qui les gardait se répercutait au loin dans le vallon. Le soleil peignait d’or les flancs de la montagne, et irradiait les vitres du vieux castel. En face, l’autre versant se teignait de pourpre et de violet comme une robe cardinalice. Très haut, dans le ciel, tournoyait un oiseau de proie… Et l’air était si pur, le ciel était si bleu, que Marie, suffoquée de plaisir, comprit maintenant pourquoi le jeune homme lui avait dit : « Vous oublierez Paris… »
Immobile, les narines frémissantes, la duchesse regardait ce prestigieux spectacle, ne pouvant s’en arracher. Il fallut que Gaëtan, doucement, lui murmure :
– Marie… Ne voulez-vous point voir le petit ?
La jeune femme tressaillit. Puis, s’arrachant à cette vision magique, elle se détourna.
– Vous avez raison, mon ami. Menez-moi vers lui !
Elle ne remonta point dans son carrosse, qu’elle avait quitté pour mieux contempler le splendide paysage. Elle voulut aller à pied jusqu’au château, dont la grande porte était ouverte à deux battants sur la cour intérieure.
– Prenez mon bras, ma chère Marie ! murmura Castel-Rajac.
Soutenant la jeune femme, dont les pieds délicats s’accommodaient mal des rudes galets des Pyrénées, ils arrivèrent au pont-levis et entrèrent dans la grande cour.
Des poules, des oies, picoraient, jusqu’entre les pattes d’un gros chien noir et feu, qui les laissait faire. Un homme s’avança à leur rencontre, et salua Marie jusqu’à terre. C’était Henri de Laparède.
– Où donc est monsieur d’Assignac ? interrogea gracieusement la duchesse.
Laparède eut un sourire.
– Par ma foi, madame, venez donc avec moi, si cela vous plaît ; je vous le montrerai…
Ils s’approchèrent du grand perron et le gravirent.
– Serait-il malade ? questionna Mme de Chevreuse, avec sollicitude, inquiète de ne pas avoir vu leur hôte.
– C’est, en tout cas, une maladie sans gravité, répondit Laparède.
Castel-Rajac devait savoir à quoi s’en tenir, car il souriait silencieusement.
Laparède ouvrit une porte.
Une nourrice était assise près d’un berceau. Dans celui-ci, un ravissant bébé riait aux anges. Et devant, le gros d’Assignac faisait mille pitreries pour distraire le fils adoptif de son ami…
CHAPITRE III
UN ENVOYÉ DU CARDINAL
Une fois Durbec fixé sur le gîte où s’étaient réfugiés le gentilhomme gascon et son fils adoptif, il fit demi-tour, n’ayant plus rien à faire dans les Pyrénées.
Tout en ruminant ses projets de vengeance, il brûlait les étapes et avalait les lieues, n’accordant à son cheval et à lui-même que le temps strictement indispensable au repos.
Un fer perdu par son cheval, et une légère boiterie qui en résulta le retarda un peu. Enfin, un beau matin, il franchit la barrière d’Enfer, et se trouva dans la capitale.
Onze heures sonnaient à Saint-Germain-l’Auxerrois, lorsqu’il demanda à être introduit auprès du premier ministre.
Hélas ! cette entrevue, comme les deux précédentes, ne devait lui réserver que des désillusions. Richelieu accueillit avec une satisfaction évidente les renseignements qu’il lui communiqua, mais ne manifesta en aucune façon l’intention de s’approprier l’enfant de la reine ou même d’intervenir d’une façon quelconque dans les affaires du Gascon.
Durbec, dépité, insinua quelques perfidies contre Castel-Rajac, tentant un ultime effort pour dresser contre lui la colère du prélat. Mais ce fut en vain. Bien au contraire, le ministre fronça les sourcils et le congédia sèchement.
Le chevalier sortit, en proie à une colère qui, pour être cachée, n’en était pas moins violente, et jura de se venger. Il n’avait que trop tardé à agir par lui-même.
Richelieu connaissait trop les hommes et le secret des âmes pour que la haine de celui qu’il employait lui échappât.
Dès que la porte se fut refermée sur son espion, le cardinal se plongea dans une profonde méditation.
Enfin, au bout d’un moment, il allongea sa main vers un cordon de sonnette. Un officier parut.
– Prévenez M. de Navailles que j’ai à lui parler immédiatement ! ordonna-t-il.
Quelques instants plus tard, le marquis de Navailles faisait son entrée.
C’était un des fidèles de Richelieu. Mais en même temps, c’était un des plus loyaux gentilshommes du royaume de France.
Il s’inclina profondément devant le cardinal et attendit ses ordres.
– Monsieur de Navailles, dit Richelieu, je connais vos mérites, et je veux aujourd’hui vous donner une preuve de confiance en vous chargeant d’une mission délicate entre toutes.
Navailles, un grand et fier gaillard, aux moustaches conquérantes et aux yeux gris d’acier, répliqua :
– Votre Éminence peut croire que je lui en suis profondément reconnaissant, et que je m’efforcerai d’accomplir de mon mieux ce qu’Elle daignera m’ordonner de faire…
– Avant, reprit Richelieu, qui se caressait le menton dans un geste machinal, je dois vous donner quelques mots d’explication préliminaire…
« Il existe dans les Pyrénées un petit village, du nom de Bidarray. C’est là que vous allez vous rendre… »
Navailles réprima un geste de surprise, mais ne dit rien.
– Dans ce village, continua le ministre, vit un jeune enfant, avec son père, le chevalier Gaëtan de Castel-Rajac, et deux autres gentilshommes : MM. d’Assignac et de Laparède… J’ai des raisons spéciales et très graves pour m’intéresser à ce bambin, et par contre-coup, au chevalier de Castel-Rajac. Il se pourrait qu’ils soient en butte à des attaques sournoises d’adversaires qu’ils ne soupçonnent pas… Vous allez donc, comme je vous l’ai déjà dit, partir pour ce village. Votre mission consistera à veiller sur la sécurité de ces deux personnes. Je ne veux pas qu’aucun mal leur arrive. Vous m’avez compris ?
Le marquis de Navailles s’inclina jusqu’à terre.
– J’ai compris, Éminence… Aucun mal ne leur arrivera.
– Merci, monsieur. Je sais que je peux compter sur vous.
– Jusqu’à la mort, Éminence !
– Allez, monsieur… Je vous remercie…
Le gentilhomme se retira, laissant Richelieu à ses réflexions.
Les révélations de Durbec ne faisaient que confirmer le cardinal dans la supposition que Mazarin était bien le père légitime de cet enfant.
Richelieu, bien que décidé à faire surveiller attentivement Castel-Rajac et son pupille, avait résolu, en même temps, que cette surveillance serait une protection contre certaines manœuvres occultes qu’il ne soupçonnait que trop.
En effet, Durbec, après son entrevue avec le cardinal, n’avait rien eu de plus pressé que de réenfourcher son cheval et de reprendre la route des Pyrénées.
Il était persuadé que le grand air lui porterait conseil, et qu’en route, il trouverait un plan pour se venger enfin de celui qu’il haïssait.
Un soir, comme il arrivait à l’auberge des Quatre-Frères, non loin de Bordeaux, il remarqua un cavalier d’élégante tournure qui mettait lui-même pied à terre devant l’auberge.
Lorsqu’il entra dans la grande salle, le cavalier était déjà installé devant une table, un pichet de vin du Bordelais devant lui, attendant paisiblement son dîner. Il se présentait de telle façon que Durbec ne put que très mal distinguer son visage, mais il lui sembla que cette silhouette lui était familière.
Ce voyageur n’était autre que le marquis de Navailles, qui se rendait à son poste, suivant les ordres reçus.
Mais si Durbec avait remarqué ce client sans pouvoir définir sa personnalité, Navailles, lui, n’avait pas hésité un instant :
– Morbleu ! pensa Navailles, intrigué, que vient-il faire dans ce pays, cet oiseau-là ? Aurait-il reçu une mission similaire ?
Mais à peine cette idée lui eut-elle traversé l’esprit qu’il la rejeta.
– Non ! non ! C’est impossible. Son Éminence m’a parlé « d’une mission d’honneur »… Il ne peut l’avoir confiée à ce traître !
Comme corollaire, une réflexion vint tout de suite se greffer sur sa première idée.
– Mais alors, s’il n’est pas en mission pour le cardinal, que vient-il donc faire par ici ?
Navailles avait l’esprit prompt. Il ne tarda pas à se souvenir de l’algarade qui avait mis aux prises, au château de Montgiron, les gardes de Richelieu et le chevalier gascon, pendant laquelle Durbec avait été blessé par Castel-Rajac en personne.
– Tiens… tiens… tiens ! fit lentement le marquis. Ceci m’ouvrirait de nouveaux horizons… Peut-être Son Éminence n’a-t-elle pas eu tort en supposant que la sécurité de ce gentilhomme et de son fils est assez gravement compromise. Car je crois cet individu capable de tout !
Lorsque Durbec descendit le lendemain matin, après une excellente nuit, et prêt à reprendre la route, il ne revit point l’inconnu qu’il avait remarqué la veille au soir. D’ailleurs, son souvenir même lui était passé de la tête.
Navailles après les soupçons qui l’avaient assailli la veille, n’avait pas attendu le réveil du chevalier pour prendre le large.
Aussi, dès l’aube, il avait fait seller son cheval et était parti au galop, espérant gagner une assez grande avance pour arriver à destination sans être rejoint par Durbec.
Il se rendait compte qu’il avait sur lui un avantage appréciable : il connaissait sa présence, et peut-être le but de son voyage, tandis que Durbec, lui, ignorait jusqu’à la mission dont Navailles était chargé.
Mais le marquis était trop rusé pour se présenter armé de pied en cap dans ce petit village. À la ville voisine, il laissa son cheval, acheta des habits modestes, et, vêtu comme un marchand, arriva à Bidarray.
On l’accueillit sans méfiance. Il en passait tellement ! Sans hésiter, Navailles se rendit au presbytère. C’était une vieille maison où vivait un brave curé presque aussi âgé qu’elle.
Sous couleur de lui proposer une pièce de drap et des almanachs, il réussit à le voir, et là, il lui révéla sa qualité, et pour quelle raison il était céans.
– Monsieur le curé, conclut-il, vous savez tout. Il me faut un gîte. Puis-je compter sur vous pour me l’accorder ?
– Mon cher enfant, répondit le vieux prêtre, il y a toujours eu ici une place pour le pauvre et l’errant. À plus forte raison lorsqu’il s’agit du service de Son Éminence le cardinal. Tout ce que j’ai ici est à vous, vous êtes chez vous !
Le bruit courut au village que le marchand était un vague neveu au curé de Bidarray. Il était naturel qu’il réside chez son parent quelque temps, après avoir pris la peine de monter jusqu’en ce pays perdu !
Tandis que ce petit complot s’arrangeait au presbytère, là-haut, à la gentilhommière, les trois Gascons et leur pupille filaient des jours sans histoire.
Marie de Chevreuse avait été s’établir dans le village voisin, et partageait son temps entre cette résidence champêtre et le logis où des amis fidèles l’hébergeaient, à Pau. Dès qu’elle était à la montagne, un petit berger partait vers Bidarray et remettait un message au chevalier gascon… Alors, le soir, à la brune, celui-ci se glissait jusqu’à l’humble demeure où la grande dame consentait à demeurer quelques jours pour l’amour de lui…
Puis, après trois ou quatre rencontres, et pour ne pas éveiller les soupçons, la duchesse retournait à Pau.
De la sorte, chacun était parfaitement heureux, et leur vie n’aurait été marquée par aucun événement, si la haine n’avait entrepris de démolir ce bonheur tranquille.
Durbec était arrivé lui aussi à Bidarray. Il n’avait pas eu besoin de se travestir pour donner le change, son allure le rendait semblable aux petits bourgeois des environs.
D’ailleurs, il menait la vie la plus discrète qui fût, ne sortant qu’à la nuit de la maison isolée où il avait trouvé gîte, afin de rôder autour de la gentilhommière où vivait son ennemi.
Ce fut ainsi qu’il surprit le manège du courrier, et vit, à différentes reprises, arriver, à toutes jambes, un petit berger, qui entra au château.
Il le fila, et ne fut pas long à se convaincre que chaque fois que le petit pâtre venait à Bidarray, Castel-Rajac, à la nuit, enveloppé d’un grand manteau, enfourchait son cheval et partait rejoindre sa bien-aimée à travers les défilés de la montagne.
Voilà qui pouvait être d’une grande utilité… Un accident est si vite arrivé, la nuit, dans ces parages !
Mais le triste personnage ne pensait point à exécuter lui-même sa sombre besogne. Il savait qu’en cas d’échec, il aurait risqué trop gros, et il entendait bien obtenir satisfaction avec le minimum de risques.
Durbec n’était pas un novice dans ces sortes d’expéditions. Il descendit un jour jusqu’à Pau…
*
* *
– Castel-Rajac ! On te demande, mon ami…
Le gros d’Assignac entra dans la bibliothèque où le Gascon lisait. Celui-ci se leva d’un bond et jeta son livre.
– Le berger ?
– Oui… fit Hector en clignant malicieusement de l’œil, car les deux compères savaient fort bien ce que signifiait pour leur compagnon l’arrivée du gamin.
Gaëtan n’avait même pas entendu la réponse. Il s’était élancé dans le vestibule, où l’enfant l’attendait.
– Monseigneur, dit-il, voici une missive pour vous…
– Merci ! Tiens ! attrape !
Le jeune homme lui lança sa bourse en voltige, que l’autre fit disparaître dans sa veste.
Le Gascon fit sauter le cachet, ne remarquant pas, dans sa hâte amoureuse, que celui-ci ne portait pas le sceau habituel de la duchesse…
La lettre ne contenait que ces mots :
« Ce soir ! »
Il ne songea pas non plus à s’étonner de la brièveté du message. Il était obsédé par l’idée qu’il allait enfin revoir sa belle maîtresse. Les périodes où elle était absente lui semblaient désespérément longues…
Lorsque la nuit tomba, Castel-Rajac, après avoir hâtivement avalé quelques bouchées, fit seller son cheval et se dirigea vers le petit bourg de Saint-Martin d’Arrossa, où était descendue Marie de Rohan.
Le chemin était assez difficile, car le sentier côtoyait par instants de profonds précipices.
Il en aurait fallu davantage pour faire reculer l’intrépide chevalier ! Il en avait suffisamment vu pour ne point redouter les embûches que pouvait réserver la montagne nocturne.
Cependant, cette fois-ci, il devait être à deux doigts d’y laisser sa vie…
Il venait de perdre Bidarray de vue, et il suivait l’étroit chemin qui reliait les deux villages, sifflotant avec insouciance, laissant flotter les brides du cheval, tout à son rêve que berçait encore une nuit idéale de pleine lune.
Soudain, d’une anfractuosité de roc, des hommes jaillirent.
Ce fut tellement inattendu que la monture du chevalier fit un brusque écart, et sans la poigne solide de celui qui le montait, ils roulaient tous les deux dans le gouffre.
– Capédédiou, mes drôles ! cria Castel-Rajac, mettant flamberge au poing, voilà une façon peu civile de souhaiter le bonsoir au voyageur !
Mais sans lui répondre, un grand escogriffe, qui semblait avoir pris la tête de l’attaque, s’écria, tourné vers les aigrefins :
– Sus ! Sus ! Jetez-le dans le vallon !
– Ouais ! ricana Gaëtan, faisant faire une demi-volte à son cheval, et s’adossant à la muraille rocheuse pour éviter d’être cerné. Vous pouvez toujours essayer, mais je doute que vous réussissiez !
– Malepeste ! hurla le grand diable, par mon nom de La Rapière, je veux le perdre si je n’ai pas tes os !
– Ho ! ho ! riposta le Gascon sans s’émouvoir. Voilà une outrecuidante prétention, mon ami ! J’ai grand peur que tu ne perdes ton élégant sobriquet, et peut-être même quelque chose de beaucoup plus précieux !
Ce disant, il allongea prestement le bras, et son épée alla trouer l’épaule du truand, qui poussa un hurlement de douleur et de rage.
Ce fut le signal de l’attaque.
Gaëtan, arc-bouté contre la paroi montagneuse, fit face à ses adversaires. Par deux fois, son épée rencontra un obstacle humain. Un des vide-goussets alla rouler dans l’abîme avec un grand cri. Un autre s’affaissa, la gorge traversée.
Ces deux disparitions, loin de ralentir l’audace des autres, les jetèrent en vociférant vers leur adversaire.
L’éclair bleu des lames rayait la nuit de rayons fulgurants, et le cliquetis de l’acier se répercutait au loin dans la vallée, éveillant d’étranges échos…
– En avant ! hurlait La Rapière, qui, bien que blessé, payait de sa personne.
– Mordiou ! grommela le Gascon en parant un coup d’épée et en attaquant aussitôt un adversaire plus entreprenant. Il faut que la récompense soit de taille pour leur inspirer un tel courage ! Serait-ce à Monsieur le Cardinal que je suis redevable de cette gracieuse attention ?
Il aurait pu le croire, car la qualité des ferrailleurs et leur nombre pouvaient en effet donner à penser que le prix payé était rondelet.
Castel-Rajac était un escrimeur hors ligne. Cependant, il devenait impossible de faire face à toute cette racaille. Ils étaient au moins douze contre lui.
– Sangdiou ! s’écria-t-il en éclatant de rire, je vois que Son Éminence ne mésestime pas mon courage ! Douze hommes pour me mettre à la raison ! Bravo !
– N’accusez pas Son Éminence ! répondit une voix forte, qui semblait jaillir des ténèbres. Ce n’est pas Monsieur de Richelieu qui vous a fait tomber dans ce lâche guet-apens, chevalier ! En garde, toi, là, sacripant, ou je te transperce !
Et, rapide comme la pensée, l’épée du marquis de Navailles, car c’était lui, pourfendait le premier misérable rencontré sur son chemin.
– Et d’un ! Courage, monsieur de Castel-Rajac ! Nous aurons raison de ces coquins !
– Sangdiou ! monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais ce dont je suis sûr c’est que j’ai affaire à un brave gentilhomme !
– Vous ne vous trompez pas, monsieur, répondit le nouveau venu en ferraillant comme un enragé. Je me nomme le marquis Gustave de Navailles.
– Capédédiou ! monsieur ! riposta le Gascon sans cesser de parer et d’attaquer furieusement. Voici un nom dont je me souviendrai, et j’espère pouvoir vous prouver ma reconnaissance, si cette graine de galère nous en donne loisir !
– Je m’en voudrais de laisser périr un aussi brave cavalier que vous ! Nous mourrons ensemble ou nous vaincrons ensemble, chevalier !
– Voilà qui est parlé ! Hé ! toi ! Ton compte est réglé !
Tout en parlant, il avait transpercé un autre coquin. Mais lui-même venait de recevoir un coup d’épée dans le bras gauche.
– Peuh ! ricana-t-il. Une égratignure ! Canailles, nous allons vous découper en lanières !
Sur cette hardie gasconnade, il se lança plus audacieusement que jamais au milieu de la mêlée. Son compagnon faisait merveille de son côté, tant et si bien que, malgré les promesses reçues et le coquet acompte déjà touché, les tire-laine finirent par s’enfuir sans demander leur reste, trouvant la besogne trop ardue.
Ils s’évanouirent dans les ténèbres tandis que les deux hommes se serraient énergiquement la main.
– Monsieur le marquis ! s’écria Castel-Rajac, sans vous, je ne sais trop comment cette aventure-là aurait tourné ! Ils avaient le nombre pour eux !
– Oui, sourit Navailles, mais nous avions la valeur pour nous !
Ils éclatèrent de rire, et se séparèrent. Navailles retournant à Bidarray, et Gaëtan continuant sa route vers Saint-Martin d’Arrossa.
Là, une étrange surprise l’attendait. Les volets étaient clos, les lumières éteintes, et à la fenêtre de la chambre qu’occupait ordinairement sa belle, le chevalier ne distingua nulle lueur.
Il allait mélancoliquement tourner bride, lorsqu’il vit surgir en courant sur le chemin le petit berger qui regagnait son gîte en galopant à perdre haleine. Il s’arrêta net en reconnaissant le chevalier et voulut faire demi-tour. Mais Castel-Rajac, sautant à bas de son cheval, eut tôt fait de le cueillir par le fond de sa culotte.
– Hé ! toi ! s’écria-t-il, viens donc ici, mon gars, que nous ayons deux mots d’explication !
Le gamin baissait le nez.
– Madame la duchesse n’est pas ici, n’est-ce pas ?
Pas de réponse.
Le Gascon tira une pièce d’or de sa bourse, lentement, et la fit miroiter sous les yeux du gamin ébloui.
– Tu l’auras si tu réponds ! Dans le cas contraire, tu recevras une volée de bois vert comme jamais tu n’en reçus !
Cette menace acheva de décider le berger.
– Non, Monseigneur ! pleurnicha-t-il.
– En ce cas, qui t’a chargé de porter ce mot ?
– Un cavalier. Monseigneur… un cavalier que je ne connais pas… Il m’a offert un écu pour la commission… J’ai accepté… Je ne savais pas…
– Hum ! Je ne suis pas si sûr que cela que ta conscience ne te reproche rien… Enfin ! Voilà ta pièce. Maintenant, ne t’avise plus de me jouer des tours pareils, sinon, je te transforme en pâté !
Le garçon se hâta de disparaître derrière un éboulis de rochers. Castel-Rajac, riant encore de son effroi, entendit le bruit des sabots claquant précipitamment sur le sol. Puis tout s’éteignit.
Le chevalier remonta à cheval et reprit le chemin de Bidarray, tout songeur. Il était clair que l’agression avait été voulue, préparée… Mais par qui ?
– Veillons ! conclut-il.
S’il avait été moins préoccupé de combattre et de se défendre, il aurait aperçu, précautionneusement abrité par une roche, un homme drapé dans une ample cape brune. Il vit l’intervention de Navailles, dont le visage était éclairé en plein par la lune. Il l’entendit se nommer au Gascon.
– Malédiction ! gronda-t-il, les dents serrées. L’homme de l’auberge ! L’envoyé du cardinal !
C’était pour lui la preuve tangible que Richelieu, loin de vouloir poursuivre le père adoptif et l’enfant de sa haine, cherchait au contraire à les protéger.
Durbec, malgré la rage qui l’étouffait, comprit qu’il avait tout à perdre et rien à gagner dans une lutte, même occulte, contre le premier ministre. Il regagna Pau par des chemins détournés.
Le lendemain matin, il reprenait la route de la capitale, abandonnant ses projets pour l’instant.
– Patience… murmura-t-il. Mon heure sonnera ! Alors…
CHAPITRE IV
LA PROMESSE DE CASTEL-RAJAC
Le temps passa. Les jours formèrent des mois, puis des années…
Castel-Rajac, ses deux amis et le bambin vivaient toujours dans leur village pyrénéen. Quelque temps, Navailles était resté dans la région. Puis, certain enfin que les protégés du cardinal ne couraient plus aucun risque, il avait rejoint Paris, non sans venir faire, de temps à autre, une incursion jusqu’à Bidarray. Il avait revu de la sorte le gentilhomme gascon et ses amis, et avait reçu, au vieux manoir, chaque fois un accueil aussi franc qu’enthousiaste. Mais il n’avait jamais dévoilé à Castel-Rajac la raison pour laquelle il revenait ainsi de temps à autre. Le marquis de Navailles était à la fois le plus loyal et le plus discret des serviteurs.
Puis ses visites s’espacèrent à mesure qu’il acquérait la certitude que ses amis n’avaient plus rien à craindre.
Peu de temps avant la dernière crise qui devait l’emporter, Richelieu partit pour Pau, espérant que le climat rétablirait sa santé chancelante.
Il se souvint alors que Pau n’est pas tellement éloigné de la Gascogne, et que dans cette province vivaient le chevalier de Castel-Rajac et son fils.
Le cardinal n’avait nullement été dupe de l’habile subterfuge employé par le défenseur de Mme de Chevreuse.
Le petit Henry resterait donc officiellement le fils de Castel-Rajac, alors que le premier ministre aurait donné sa tête à couper que le garçonnet était bien celui dont la reine avait accouché clandestinement, quatre ans auparavant.
Le cardinal envoya un de ses officiers auprès de Castel-Rajac, avec ordre de le ramener près de lui, ainsi que son fils.
Afin de donner toute sécurité à Gaëtan, l’émissaire du cardinal n’était autre que le marquis de Navailles. Il était porteur d’un sauf-conduit qui donnait toutes garanties à Castel-Rajac et à l’enfant.
Tout d’abord, le Gascon hésita. Il se dit :
– Si c’était un piège ?
Avec sa franchise habituelle, il ne se gêna nullement pour faire part de ses soupçons à M. de Navailles.
– Monsieur, lui dit-il, j’ai charge d’âme. Je respecte Son Éminence. Mais je ne puis oublier que j’ai été appelé à jouer vis-à-vis d’Elle un rôle qu’elle ne m’a peut-être pas encore pardonné…
– Chevalier, répondit le marquis de Navailles avec non moins de franchise, si cette invitation était un guet-apens, jamais Son Éminence n’aurait osé m’envoyer comme émissaire !
Cette fière réponse décida Castel-Rajac.
– Si vous le désirez, ajouta Navailles, je puis vous donner ma parole d’honneur que les intentions du cardinal sont pleines de bienveillance, et que vous n’avez à redouter aucune traîtrise.
– Monsieur le marquis, votre parole d’honneur est plus que suffisante ! Votre première réponse me satisfaisait déjà, et je suis prêt à partir avec mon fils quand il vous plaira !
Dès le lendemain, ils se mirent en route. Le petit Henry était alors un délicieux bambin de quatre ans, déjà solide et éveillé.
Richelieu les reçut dans une grande salle du château où était né Henri IV.
Déjà marqué par la mort, le visage amaigri, les mains osseuses et quasi squelettiques, l’œil toujours aussi lumineux, il semblait, au seuil du tombeau, plus grand encore qu’au sommet de sa vie.
Malgré son audace naturelle Gaëtan-Nompar-Francequin de Castel-Rajac se sentit tout à coup dominé par la majesté de celui qui, depuis tant d’années, était le véritable roi de France.
Au regard bienveillant que « l’homme rouge » lui adressa, et à l’appel affectueux de la main qu’il fit au petit Henry qui le contemplait d’un air un peu effarouché, mais respectueux, comme si, d’instinct, il devinait qu’il se trouvait en face d’une des plus grandes forces humaines qui eussent jamais existé, l’ami de la duchesse de Chevreuse comprit que M. de Navailles lui avait dit la vérité, et qu’il avait bien fait de ne point se dérober à l’appel du cardinal-ministre.
Celui-ci, d’une voix grave, lui dit :
– Monsieur le chevalier, si je vous ai mandé près de moi, ce n’est point dans un sentiment de curiosité, et encore moins de rancune ; c’est parce que je voulais, avant de mourir, avoir de votre bouche toute la vérité.
Et, attirant l’enfant près de lui, il les regarda successivement avec beaucoup d’attention, puis il reprit :
– Je voudrais vous parler seul un instant.
Gaëtan prit le petit par la main et, l’emmenant au bout d’une vaste salle, près d’une grande fenêtre qui donnait sur la cour d’honneur, il lui dit :
– Regarde tous ces cavaliers… regarde-les bien, afin d’être un jour comme eux !
L’enfant s’absorba dans la contemplation des officiers et des gardes qui cavalcadaient sur le pavé. Le Gascon revint alors vers Richelieu, qui se disait :
– Il n’est pas encore tranquille, puisqu’il n’a pas voulu emmener le petit hors de sa présence. Cela prouve qu’il est aussi prudent que brave et cela n’est point pour me déplaire.
Castel-Rajac, qui s’était approché de Richelieu, attendait, dans une attitude pleine de déférence, que celui-ci daignât lui adresser la parole. Après l’avoir considéré pendant un instant l’homme rouge reprit :
– Savez-vous, monsieur le chevalier, que vous avez été mêlé à une aventure qui aurait pu vous coûter la tête ?
– Je le sais, Éminence !
– Sans doute, vous êtes-vous étonné qu’après la tuerie du château de Montgiron, je n’eusse point songé à châtier ceux qui avaient massacré mes gardes ?
Avec sa netteté habituelle, Gaëtan répondait :
– J’ai supposé que Votre Éminence avait perdu ma trace, ainsi que celle de mes amis !
– Il n’en était rien, monsieur ! À peine un mois après votre rébellion, je connaissais le lieu de votre retraite, et si je vous ai épargné, c’est que j’ai appris que vous aviez agi en très bonne foi, et que si vous aviez pourfendu plusieurs de mes meilleurs soldats c’était uniquement pour tenir le serment d’honneur que vous aviez fait à la duchesse de Chevreuse, de défendre jusqu’à la mort l’enfant qu’elle vous avait confié.
Tout en s’inclinant légèrement, Gaëtan répondait :
– Je constate que Votre Éminence est admirablement renseignée !
– Maintenant, monsieur, j’ai une question très grave à vous poser. Elle est même la vraie raison pour laquelle je vous ai fait venir ici.
Tout en fixant dans les yeux le Gascon, qui soutint son regard avec la tranquille énergie d’une âme sincère, il dit :
– Connaissez-vous le père et la mère de cet enfant ?
Spontanément, l’amant de la belle Marie répliquait :
– Le père… je m’en doute un peu…
– Il est inutile de me dire que c’est vous, coupait Richelieu, car je ne vous croirais pas, bien que vous l’eussiez déclaré sur le registre de baptême de l’église de Saint-Marcelin. D’ailleurs, cela n’a que peu d’importance… Mais la mère… Connaissez-vous la mère, ou plutôt, le nom de la mère ?
– Non, Éminence…
– La duchesse de Chevreuse n’a jamais laissé échapper devant vous aucune parole qui fût de nature à éveiller vos soupçons ?
– Jamais, Éminence !
– Et vous, n’avez-vous même point cherché à pénétrer ce secret qui doit être d’importance, puisqu’on a fait autour de lui un si grand mystère ?
– Non, Éminence…
– Vous me le jurez ?
– Je vous le jure…
Le cardinal garda un moment le silence. Puis il reprit :
– Êtes-vous ambitieux, chevalier ?
Castel-Rajac sourit.
– Oh ! pas du tout ! J’aime mon pays, son soleil, ses paysages ; cette vie simple me suffit, et je ne demande ni la richesse, ni la gloire.
– Cependant, vous me paraissez doué de qualités telles qu’il est dommage de penser qu’elles demeureront stériles… Vous n’êtes guère fortuné, mais vous êtes de bonne souche. J’ai là, dans cette cassette, un brevet de colonel. Que diriez-vous si je le signais ?
Le chevalier s’inclina.
– Éminence, je serais pénétré envers vous de la plus profonde reconnaissance…
Et, avec finesse, il ajouta :
– Il va donc y avoir la guerre ?
Richelieu répliqua :
– Pourquoi me dites-vous cela ?
– Mais, Éminence, parce que s’il n’y a point de guerre, il n’y a pas lieu de me nommer colonel !
– Et s’il y a la guerre ?
– Eh ! mordiou, je me battrai en soldat !
Le grand cardinal dissimula un rapide sourire. Cette verve gasconne l’amusait. Il étendit la main pour saisir la cassette et mettre sa promesse à exécution. Mais le chevalier l’arrêta respectueusement.
– Pardonnez-moi, Éminence… Mais il existe un motif qui m’interdit l’honneur et la joie d’accepter l’immense faveur que vous daignez me proposer…
Le cardinal prit un air interrogatif.
Alors, Castel-Rajac, désignant le petit Henry qui continuait à regarder dans la cour les évolutions des cavaliers, fit, avec une profonde tendresse :
– Qui s’occuperait du petit ? Le confier à mes parents ? Car je suis célibataire et j’entends le rester. Ma pauvre maman est bien âgée et… je ne devrais point dire cela devant un prince de l’Église, elle est un peu trop dévote.
De nouveau, un sourire furtif courut sur les lèvres du grand cardinal.
Encouragé par cet accueil, Gaëtan continua :
– Le confier à des étrangers ? Je ne serais pas tranquille… Je préfère être à la fois son père nourricier et son éducateur, et quand je le vois déjà, si ardent et si beau, et puis quand je découvre dans sa petite âme, qui s’épanouit peu à peu, de belles promesses, j’ai l’impression, Éminence, que je suis en quelque sorte le gouverneur d’un prince charmant qu’une bonne fée aurait déposé devant ma porte !
À ces mots, qu’il prit pour une transparente allusion, Richelieu eut un imperceptible tressaillement, et son regard aigu fouilla celui du Gascon.
Mais celui-ci resta impassible. Il acheva, avec tendresse :
– Et puis, je l’aime tant !
– Autant que s’il était vraiment votre fils ?
– Il l’est, Éminence !
Le cardinal-ministre comprit qu’avec ce fin matois, il n’aurait jamais le dernier mot. Castel-Rajac savait-il ou ne savait-il pas la vérité ? À vrai dire, le gentilhomme, s’il se doutait que son pupille était d’illustre naissance, ne soupçonnait point encore son origine royale, et sa phrase de l’instant précédent était un effet du hasard. Mais Richelieu, sachant à qui il avait affaire, n’en était pas absolument certain.
Le prélat se recueillit quelques instants, cherchant une solution. Enfin, il prononça d’un air grave, méditatif :
– Eh bien ! gardez-le ! Mieux vaut qu’il soit entre vos mains que dans celles de bien d’autres ! Faites-en, ainsi que vous le proposez, un beau gentilhomme, dévoué à son roi et à son pays. C’est tout ce qui pouvait arriver de plus heureux à cet enfant. Mais je voudrais lui parler, à lui…
Castel-Rajac, enchanté de la tournure qu’avait prise l’entrevue, appelait déjà :
– Henry ! Henry, viens saluer Son Éminence…
L’enfant s’empressa d’accourir, et s’inclina gracieusement devant Richelieu, qui, tout en le contemplant avec une expression de douceur et de bonté que nul, peut-être encore ne lui avait connue, fit, en désignant le jeune chevalier qui s’efforçait de comprimer son émotion :
– Mon enfant, regarde bien ton père. C’est un vaillant gentilhomme qui ne peut que te donner de bons exemples. Aime-le sans cesse. Imite-le toujours. Et plus tard, quand tu seras grand, tu te souviendras que peu de temps avant qu’il ne s’en fût rendre ses comptes à Dieu, le cardinal de Richelieu ne t’a pas donné sa bénédiction, parce qu’on ne bénit pas un ange, mais a imprimé sur ton front un baiser affectueux.
Le cardinal approcha ses lèvres du front que lui tendait le fils de Mazarin et d’Anne d’Autriche. Puis, le contemplant encore, il murmura :
– Comme il ressemble à son frère !
Et tout à coup, il fit :
– Chevalier, vous pouvez vous retirer avec votre fils. Veillez sur lui, car il se peut qu’un jour, de graves dangers le menacent, et ce ne sera pas trop de votre épée pour les écarter de son chemin…
Castel-Rajac s’inclina profondément devant le premier ministre et sortit.
En emmenant l’enfant, les paroles prononcées au cours de cet entretien lui revinrent à la mémoire. Il songea :
– Pour que le cardinal m’ait parlé de la sorte, et témoigné en présence de cet enfant un trouble aussi profond, il faut que mon fils soit celui d’un bien grand personnage et d’une bien grande dame !
Comme il se faisait tard, le chevalier, ne voulant pas voyager de nuit, à cause du jeune Henry, auquel il voulait éviter les fatigues d’un déplacement nocturne, se décida à souper et à coucher dans la ville de Pau.
Ses moyens, plutôt restreints, ne lui permettaient de se rendre que dans une très modeste auberge.
C’était une hostellerie où se rencontrait un monde plutôt mélangé. Ce qui ne l’empêcha nullement de manger avec un superbe appétit, ainsi d’ailleurs que le petit Henry, qui, pendant tout le repas, se montra d’une grande gaieté.
Ce ne fut qu’à la fin du souper que ses yeux commencèrent à papilloter. Et Gaëtan, qui veillait sur lui avec autant de vigilance qu’une mère, l’emmena se coucher dans la chambre qu’il avait retenue au second étage de la maison.
Quand le petit fut dévêtu et endormi, comme il était trop tôt pour qu’il en fasse autant, Castel-Rajac descendit dans le jardin et s’en fut s’asseoir sur un banc, dans un bosquet, où il se mit à rêver à la jolie Marie de Rohan, devenue l’idole exclusive de sa vie.
Mais bientôt, son attention fut attirée par un murmure de voix assez rapproché.
– Mordiou ! pensa-t-il. Quels sont ceux qui prennent les arbres comme confidents ? C’est quelquefois une méthode dangereuse…
Il distingua plusieurs voix d’hommes. Il prêta l’oreille. Soudain, l’un d’eux prononça un nom qui le fit tressaillir.
– Sangdiou ! Serait-ce la Providence qui m’a guidé jusqu’ici ? fit-il entre ses dents.
Le chevalier n’avait plus envie de rire. Sans doute les paroles qu’il entendait étaient-elles de la plus haute gravité, car son visage revêtit une expression d’inquiétude assez vive.
Maintenant, il s’était levé, et, à pas de loup, prenant bien garde de ne point faire craquer sous ses semelles quelque brindille, il s’était approché autant qu’il l’avait pu du groupe dont il n’était séparé que par un simple buisson.
Retenant sa respiration, il écouta quelques instants de la sorte. Enfin, il se redressa lentement. Les personnages dont il venait de surprendre les propos s’éloignaient maintenant dans la direction de la ville.
Castel-Rajac les laissa partir. Après quoi, il remonta dans sa chambre.
Son fils d’adoption dormait d’un sommeil à la fois paisible et profond.
Alors, il boucla son ceinturon, enfonça son feutre sur sa tête, se drapa dans son manteau, et, d’un pas rapide, gagna le château de Pau.
Devant la grille, une ombre se dressa, croisa son arme devant lui.
– Qui vive ? fit une voix.
– Où est le chef de poste ?
– Qui êtes-vous ?
– Un gentilhomme qui veut être introduit immédiatement auprès de M. le capitaine des gardes de Son Éminence !
La sentinelle regarda d’un air défiant cet inconnu, puis devant l’insistance de Castel-Rajac qui s’écriait déjà qu’il allait entrer de gré ou de force, elle alla chercher l’officier de service.
Celui-ci comprit qu’il avait affaire à un gentilhomme. À la demande du Gascon, il s’inclina avec politesse, mais répondit que Son Éminence était partie pour Bordeaux depuis une demi-heure, et que le capitaine de ses gardes, M. le baron de Savières, l’accompagnait.
– Tiens ! philosopha Castel-Rajac, en souriant dans sa moustache, il s’en est fallu de peu que je me retrouve nez à nez avec ce sympathique capitaine…
Il laissa échapper un sonore juron gascon et gronda :
– Pourvu que je n’arrive pas trop tard !
– Que se passe-t-il donc ? interrogeait l’officier, déjà inquiet.
– Je viens de découvrir un complot qui a pour but d’assassiner le cardinal au cours de son retour à Paris !
L’officier eut un haut-le-corps.
– Est-ce possible !
– J’en suis sûr ! Aussi, il n’y a pas une minute à perdre ! Donnez-moi un cheval, un très bon cheval, et je réponds de tout !
Comme son interlocuteur le regardait avec une certaine méfiance, se demandant quel crédit il devait accorder à cet inconnu qui voulait réquisitionner un cheval appartenant au service de Son Éminence, Gaëtan s’exclama :
– Je suis le chevalier de Castel-Rajac, et tout le monde, dans le pays, vous affirmera que je dis toujours la vérité !
– Ça, c’est vrai ! dit un soldat en s’avançant.
– Tiens, c’est toi… Crève-Paillasse ! lançait le chevalier en reconnaissant un jeune paysan originaire de la localité pyrénéenne où il s’était retiré.
– Oui, monsieur le chevalier ! répondait le soldat. Il y a justement à l’écurie un pur-sang qui ne demande qu’à galoper un train d’enfer !
– Eh bien ! amène-le-moi vite ! commandait déjà l’amant de la duchesse de Chevreuse.
Mais l’officier de service intervenait à nouveau.
– Minute ! Il me faut d’autres garanties !
Castel-Rajac fronça les sourcils.
– Prenez garde, monsieur l’officier, s’écria-t-il. Vous assumez là une lourde responsabilité ! Chaque minute que vous me faites perdre risque de coûter la vie à Son Éminence ! Et s’il arrive malheur au cardinal de Richelieu, je ne manquerai point de dire très haut que c’est par votre faute !
Ce dernier argument dissipa les scrupules du militaire.
– Va chercher le cheval ! lança-t-il à Crève-Paillasse qui partit aussitôt.
Moins de cinq minutes après, Gaëtan sautait en selle et partait au triple galop sur la route de Bordeaux.
Crève-Paillasse avait dit vrai. Sa monture, une bête admirable, avait véritablement des ailes.
Castel-Rajac galopa environ pendant deux lieues à francs étriers. Puis, à un détour du chemin, il aperçut des lueurs de torches, en même temps que son ouïe, très fine, percevait un cliquetis d’armes, révélateur d’un proche combat.
– Sangdiou ! grommela-t-il. Est-ce que j’arriverais trop tard, déjà ?
En quelques bonds de sa monture, il arriva sur le théâtre de la lutte. Et il aperçut, entourant le carrosse du cardinal, une bande d’hommes masqués qui ferraillait contre les gardes de Son Éminence.
Il était hors de doute que l’escorte allait succomber sous le nombre, et qu’aussi valeureux que soit l’appui que le Gascon était décidé à leur donner, les conspirateurs ne pouvaient manquer d’avoir le dessus.
Mais Castel-Rajac, une fois de plus, allait leur prouver que l’esprit d’un Gascon est capable de triompher des pires situations.
Sautant à bas de son cheval, et profitant de ce que les combattants, acharnés dans une bataille sans merci n’avaient point remarqué sa présence, il grimpa sur un arbre, au pied duquel le carrosse était arrêté.
Il le fit si doucement et si prestement que personne ne s’aperçut de rien. Les gardes du cardinal combattaient en braves, mais visiblement, ils commençaient à faiblir, ce qui encourageait les sacripants à attaquer de plus belle.
– Il est temps d’intervenir, mordiou ! se dit le chevalier après avoir prudemment observé les phases de la lutte.
Il tira son épée, qu’il plaça entre ses dents. Puis, sans hésitation, il se laissa tomber sur la toiture du véhicule.
Le cardinal, effaré, mit la tête à la portière, persuadé que c’était un de ses ennemis qui allait l’égorger ; mais déjà, Castel-Rajac s’était dressé, et d’une voix vibrante, qui domina le tumulte, il clama :
– À moi, mes amis ! À bas les traîtres et vive le cardinal !
Les assaillants, surpris par ce renfort inopiné, levèrent la tête. Ils aperçurent le Gascon, debout sur le carrosse, brandissant son épée. Bondissant comme un diable, Gaëtan sauta sur le dos de l’adversaire le plus proche, qui s’étala aussitôt en poussant un cri d’agonie : l’épée l’avait traversé de part en part.
– En avant, en avant ! hurla Castel-Rajac derechef.
Et il se jeta avec furie au milieu de la mêlée.
Convaincus qu’une troupe importante arrivait au secours de Son Éminence, les conjurés eurent un mouvement d’hésitation, suivi d’un léger recul. Les gardes en profitèrent pour les contre-attaquer aussitôt avec succès. Castel-Rajac, sautant à la gorge d’un des conspirateurs qui le menaçait de son arme, roula avec lui à terre en hurlant :
– Sangdiou ! Je vais t’apprendre comment on étrangle les gens, en Gascogne !
Et il le fit avec un tel brio que les conspirateurs, persuadés qu’un renfort de plusieurs hommes venait de leur tomber sur le dos, s’empressèrent de rejoindre leurs chevaux, qu’ils avaient laissés à la lisière d’un champ voisin, et de s’enfuir dans une galopade effrénée.
Le capitaine des gardes, qui était bien en effet le baron de Savières, avait reconnu en son sauveur l’homme qui, quelques années auparavant, lui avait joué, au château de Montgiron, le tour que l’on n’a pas oublié. Il s’écria :
– Il est vraiment étrange, monsieur le chevalier, que ce soit à vous que je doive aujourd’hui la vie !
Mais déjà, une voix s’élevait du carrosse :
– N’est-ce point le chevalier de Castel-Rajac ?
– Mais oui, Éminence !
Et l’amant de Marie de Rohan, s’avançant vers l’homme d’État dit, tout en le saluant en grande cérémonie :
– Vous voyez, Éminence, qu’un bienfait n’est jamais perdu, puisque votre indulgence à mon égard me vaut l’honneur de vous délivrer aujourd’hui de ces misérables qui voulaient vous assassiner !
– Chevalier, dit le cardinal, vous n’aurez point obligé un ingrat. Je saurai vous récompenser…
– Votre Éminence l’a fait d’avance !
– Comment cela ?
– En me laissant mon fils, Éminence…
Puis, tout haut, il reprit :
– Ne nous attardons pas dans ces parages et évitons de donner à nos adversaires l’occasion d’un retour offensif. Je vais vous accompagner par des chemins détournés que je connais bien, jusqu’au bourg de Saint-Parens, où cantonne, en ce moment, un régiment de cavalerie qui se chargera d’assurer la sécurité de Votre Éminence.
Et retournant vers son cheval qui, sans doute exercé aux bruits de bataille, n’en avait paru nullement effrayé et s’était mis philosophiquement à arracher les pousses d’un jeune chêne, il remonta en selle et servit de guide à Richelieu et à ses soldats.
Après être arrivé sans encombre à Saint-Parens, Castel-Rajac prit congé du ministre. Celui-ci eut un mince sourire.
– Allons, chevalier, je crois que nous finirons par devenir de très bons amis ! dit-il.
– Je serai déjà heureux si Votre Éminence veut bien me considérer avec la bienveillance qu’Elle accorde à ses fidèles serviteurs ! riposta finement le Gascon en s’inclinant devant le tout-puissant prélat.
Celui-ci accentua son sourire.
– L’avenir ne m’inquiète nullement pour vous chevalier ! Vous êtes brave, loyal, chevaleresque, et ce qui ne gâte rien, vous avez de l’esprit. Vous deviendrez maréchal de France !
Ce fut sur cette prophétie pleine d’espérance que le jeune homme se retira.
Mais il n’en avait pas encore fini avec la reconnaissance que son geste avait provoquée. Dans la cour, au moment où il allait remonter à cheval, il vit s’avancer un homme vers lui. À la lueur d’une torche que tenait un soldat, il reconnut le capitaine de Savières.
– Chevalier, fit celui-ci en lui tendant une main large comme l’épaule d’un bœuf, je sais ce que nous vous devons tous, à commencer par Son Éminence Je ne sais pas comment notre cardinal pense s’acquitter. Mais moi, ce que je veux vous dire, c’est que, morbleu ! je suis votre ami, et si jamais vous avez besoin de moi, je serai là !
– Capitaine, répondit le Gascon en lui rendant sa poignée de main, je suis fier qu’un homme aussi brave que vous m’appelle son ami, et heureux d’avoir pu vous rendre ce léger service !
Puis, décidément réconcilié définitivement avec ses anciens ennemis, le jeune homme sauta sur son cheval et reprit la route de Pau à fond de train.
Il y arriva au petit matin. Son premier soin fut de ramener sa monture au château. L’officier de service s’y trouvait toujours. En quelques mots, Gaëtan lui narra ce qui s’était passé. L’autre manqua défaillir en pensant à la responsabilité qu’il avait failli encourir en refusant un cheval à cet inconnu. Castel-Rajac vit son trouble.
– Ne craignez rien, monsieur ! À l’heure actuelle, Son Éminence est saine et sauve, et le régiment de cavalerie de Saint-Parens, où je l’ai conduite, renforcera son escorte et la conduira jusqu’à Bordeaux !
Il ne tarda pas enfin à regagner l’auberge où il avait laissé le petit Henry. Il trouva celui-ci dormant toujours de son sommeil de chérubin et souriant aux anges. Castel-Rajac le considéra un instant avec attendrissement.
– Ah ! oui ! murmura-t-il. Je suis déjà payé au centuple de ce que j’ai fait pour le cardinal… Que serais-je devenu, sans cet enfant ?
CHAPITRE V
DURBEC RÉAPPARAÎT
Les jours qui suivirent s’écoulèrent sans histoire. Castel-Rajac et le bambin avaient regagné leur vieille gentilhommière, où les attendaient le gros d’Assignac et de Laparède.
Durbec semblait avoir disparu. À vrai dire, il attendait le moment propice, mais n’avait point encore abandonné ses projets de vengeance.
Il avait appris le fait d’armes que Castel-Rajac avait accompli en sauvant la vie du cardinal-ministre, et cette nouvelle l’avait rempli d’une sombre fureur. Il comprenait bien que maintenant, plus que jamais, le seul fait de porter la main sur le Gascon déchaînerait des représailles dont lui, Durbec, supporterait les conséquences. Aussi, avec un froid sourire, il s’était dit :
– Attendons !
Durbec n’était pas pressé. Il était sûr d’avoir son heure !
Moins d’un an après ces événements, Richelieu mourut. Et Louis XIII, comme s’il n’avait pu survivre à celui qui avait fait sa grandeur et sa puissance, le suivit dans la tombe à quelques mois de distance.
Anne d’Autriche, mère de Louis XIV, à peine âgé de cinq ans, fut nommée régente, pendant la minorité du roi. Son premier acte fut de nommer Mazarin premier ministre.
Peu de temps après, Castel-Rajac recevait la visite de Mme de Chevreuse.
Mais, cette fois, ce n’était pas seulement pour consacrer à son ami quelques rares instants de liberté qu’elle s’efforçait de conquérir sur ses obligations, mais pour lui annoncer que, désormais, il n’avait plus rien à craindre de personne au sujet du petit Henry.
– En quoi la mort de Sa Majesté et celle de Son Éminence le cardinal peuvent-elles changer le sort de cet enfant ? questionna le Gascon, peut-être faussement naïf. Je suis persuadé que Richelieu, depuis que j’ai eu l’occasion de lui sauver la vie, ne me voulait que du bien…
Mais Mme de Chevreuse n’était pas de celles que l’on prend sans vert.
– Certes, répliqua-t-elle avec vivacité. Mais le père véritable de ce bambin était un favori de Sa Majesté, et pour lui être agréable, le roi n’aurait pas hésité à sévir… Rappelez-vous que le cardinal lui-même le ménageait.
Puis, sans laisser à Gaëtan le temps de s’appesantir sur cette réponse, elle reprit :
– D’ailleurs, je suis heureuse de voir que vous aurez enfin une situation digne de vos mérites…
Castel-Rajac dressa l’oreille.
Marie de Chevreuse ouvrit une cassette, posée près d’elle, en tira un rouleau cacheté et le remit en souriant à son amant.
– Ceci est le brevet de lieutenant aux mousquetaires du Roi, dit-elle.
Un tressaillement de joie et d’orgueil secoua le jeune homme. Servir dans ce corps d’élite avait toujours été son ambition et son rêve.
– Et l’enfant ? interrogea-t-il pourtant.
– C’est à mon tour de m’en charger ! Mais soyez tranquille, mon cher Gaëtan, vous n’en serez pas longtemps séparé, et vous pourrez le voir chaque fois que vous le désirerez.
» Je vais l’installer dans cette maison de Chevreuse où il est né, et que j’ai fait restaurer entièrement pour lui. Sa mère tient en effet à ce qu’il demeure non loin d’elle. Mais il est bien entendu que pour lui et pour tous, vous resterez son père. Vous avez trop dignement conquis ce titre pour que personne ne songe à vous l’enlever. »
Castel-Rajac mit un genou en terre devant sa belle amie et lui baisa la main.
– Comment puis-je m’acquitter envers la gracieuse Providence qui m’accable sous ses bienfaits ? murmura-t-il tendrement.
La belle duchesse eut un sourire exquis, et comme Castel-Rajac avait déjà répondu au cardinal quelques mois plus tôt sur la route de Bordeaux, elle répliqua :
– Mais vous vous êtes déjà acquitté, mon ami !
Il attira son amie sur sa poitrine, et un baiser fervent vint récompenser cet aveu.
Une seule chose chagrinait Gaëtan en pensant à cette nouvelle et brillante situation qui l’attendait. L’enfant, il le verrait fréquemment… d’ailleurs, confié aux soins de la duchesse de Chevreuse, il était tranquille… Mais ses deux inséparables, Assignac et Laparède, avec lesquels il avait vécu de nombreuses et tranquilles années… Il allait falloir les quitter !
Cependant, il ne se tenait pas encore pour battu. Dès qu’il fut en possession de ses nouvelles fonctions, son premier soin fut d’aller rendre visite au nouveau premier ministre. Celui-ci le reçut d’une façon fort affable.
– Charmé de vous revoir, chevalier ! s’écria-t-il. Voici longtemps que je ne vous ai vu…
– Que Votre Éminence daigne m’excuser… J’avais, ainsi que vous le savez, des obligations précises qui m’absorbaient fort…
Mazarin eut un gracieux sourire.
– Nous ne les avons pas oubliées, chevalier, et je suis heureux de cette occasion pour vous remercier du zèle et du soin que vous avez mis à vous en acquitter…
– Éminence, cet enfant a fait mon bonheur… C’est moi qui serai éternellement reconnaissant à Mme la duchesse de Chevreuse d’avoir bien voulu faire appel à moi…
– Je suis heureux, chevalier, de voir qu’aujourd’hui, vos mérites vous ont fait accéder à une situation digne de vous.
– Ah ! soupira benoîtement le Gascon, j’ai fait de mon mieux pour élever cet enfant dans les principes les plus élevés. D’ailleurs, mes amis dévoués m’ont été dans cette tâche d’un précieux secours, et c’est aussi grâce à eux si, aujourd’hui, je peux affirmer que le petit Henry fera plus tard un gentilhomme accompli.
Mazarin avait dressé la tête.
– Vos amis ? Quels amis, chevalier.
– Mais MM. d’Assignac et de Laparède, deux braves et loyaux gentilshommes, que je regrette fort de savoir restés dans les Pyrénées.
– Il faut les faire venir à Paris ! Nous leur trouverons un emploi.
– Ah ! Éminence ! continua à soupirer le rusé chevalier. Il n’y a qu’une seule chose qui les comblerait, mais je ne sais…
– Dites toujours ! On verra si on peut satisfaire leur désir !
– Oh ! peu de chose ! Entrer comme mousquetaires dans le corps où je suis lieutenant.
– Hé ! monsieur le chevalier, savez-vous que les mousquetaires sont un corps d’élite ?
– Je le sais, Éminence !
– On n’accepte pas n’importe qui !
– Ah ! Éminence, mes amis sont des gentilshommes de bonne souche gasconne !
– Je n’en doute pas… Enfin monsieur de Castel-Rajac, je verrai… je tâcherai d’en toucher deux mots à Monsieur de Guissancourt, votre capitaine…
Le nouvel officier s’inclina jusqu’à terre et sortit, rayonnant. Il était certain d’avoir gagné la partie.
En effet, quelques jours plus tard, Assignac et Laparède, au fond de leur retraite méridionale, apprenaient, à leur vive joie, qu’ils étaient incorporés dans cette glorieuse phalange des mousquetaires, sous les ordres directs de leur ami, Gaëtan-Nompar-Francequin de Castel-Rajac. À cette nouvelle, ils commencèrent par tomber dans les bras l’un de l’autre. Puis, bondissant chacun vers leur appartement respectif, ils se mirent en devoir de préparer leur départ avec toute la célérité dont ils étaient capables.
Il y avait à peine une semaine qu’ils étaient arrivés à Paris, lorsque l’atmosphère politique commença à se gâter.
Le nouveau cardinal-ministre avait commencé par augmenter les charges que supportait le bon peuple de France, ce qui, du premier coup, ne l’avait point rendu populaire. Le Parlement prit le parti des mécontents. Or le Parlement représentait une puissance avec laquelle il fallait compter.
Il parla haut et fort. La réponse ne se fit pas attendre : le lendemain même, les chefs les plus populaires et les plus influents furent arrêtés. Carton, Blancmesnil et Broussel furent incarcérés.
Ce fut, de la part du rusé Italien, un pas de clerc. Le peuple, qui grognait ou chantait lorsqu’on l’accablait d’impôts, se révolta carrément. Des barricades s’élevèrent.
Anne d’Autriche, fort effrayée, manda en hâte son ministre auprès d’elle.
– Qu’allons-nous faire ? s’écria la régente. Voyez ce qui se passe…
– Madame, répondit le Florentin, lorsqu’on n’est pas les plus forts, il faut céder. Donnez l’ordre d’élargir les prisonniers, en feignant d’agir par clémence pure. Le peuple en saura gré à Votre Majesté, s’apaisera, et les messieurs du Parlement vous seront également reconnaissants de ce geste plein de mansuétude.
– Comment ? s’emporta la reine, dont l’orgueilleux sang espagnol se révoltait à l’idée des concessions. Ce seront donc les factieux qui auront raison ?
– Que non. Madame ! sourit l’Italien. Ce sera chacun son tour de chanter la canzonetta…
Cependant, le ministre avait vu juste. Dès que les parlementaires furent élargis, le peuple mua ses menaces en clameurs d’enthousiasme, voulut porter Broussel en triomphe, et cria vive la reine et vive le premier ministre. Un vent de popularité soufflait.
Il ne dura pas longtemps.
Mazarin était patient. Lorsqu’il crut favorable l’occasion, il agit.
Le prince de Condé était un de ces grands seigneurs turbulents, actifs, pleins de feu et de courage, qui ne demandent qu’à dépenser leur ardeur. Il pouvait devenir un ennemi dangereux, car il commandait les troupes et était fort populaire dans l’armée.
Mazarin, par des promesses, le gagna à la cause royale. Mais Condé n’était pas seul. Longueville, Conti, Beaufort, Elbeuf, s’estimèrent lésés par cette brusque faveur, et, faisant cause commune avec le Parlement qui n’avait point désarmé, ameutèrent si bien l’opinion qu’un beau matin, la situation devint tout à fait menaçante pour la Cour.
– Nous pendrons ce faquin de Mazarin ! affirmait-on tout haut.
Mazarin tenait à son cou ; la régente tenait à Mazarin, pour des raisons qui n’étaient pas toutes d’État.
Aussi fallut-il aviser sans retard. Le ministre fit mander tout de suite dans son cabinet le lieutenant de Castel-Rajac, dont il connaissait le dévouement à la cause royale, et qu’il savait aussi homme de bon conseil.
– Mordious, Éminence, répliqua vivement le Gascon lorsqu’il fut mis au courant de la situation, il n’y a pas à hésiter ! Il faut mettre en sûreté Sa Majesté la Régente et le jeune Roi ! Espérons que tout ceci se réduira à une échauffourée, mais on ne sait jamais jusqu’à quelles extrémités peuvent se porter tous ces excités !
– J’y avais pensé, chevalier ! Je vais conseiller à Sa Majesté de fuir à Saint-Germain, où elle attendra avec le roi son fils la fin de cette ridicule aventure… Car ce n’est qu’une aventure, n’est-ce pas, monsieur le chevalier ?
– Naturellement, Éminence !
– Puis-je compter sur vous pour escorter le carrosse royal et le faire parvenir coûte que coûte et sans risque jusqu’à Saint-Germain ?
Castel-Rajac étendit la main.
– Sur le nom que je porte, Éminence, il en sera ainsi !
– C’est bien ! La Cour se mettra donc sous la protection des mousquetaires que vous commandez, chevalier. Nous partirons aussitôt que possible, aujourd’hui même…
Deux heures plus tard, quatre carrosses, dans lesquels avaient pris place la Reine, le Dauphin, Mme de Chevreuse, quelques personnes de la suite et Mazarin, partaient au grand galop dans la direction de Saint-Germain, entourés par un détachement de mousquetaires dont Castel-Rajac avait pris la tête.
Il avait sous sa protection non seulement ce qui représentait la tête de la France, mais encore celle pour laquelle il avait un véritable culte : sa chère Marie.
Elle se trouvait dans la voiture de la reine. Gaëtan chevauchait avec d’Assignac d’un côté du carrosse ; le capitaine de Guissancourt occupait l’autre portière avec Laparède. Les autres mousquetaires galopaient à l’avant et à l’arrière.
Il y eut quelques murmures au passage du cortège. Quelqu’un hurla :
– Au feu, le Mazarin !
L’Italien, tout pâle, se rejeta au fond de la voiture.
– Eh ! mordiou, Éminence ! lui dit Castel-Rajac sans façon, ne vous montrez pas, ou je ne réponds plus de rien, moi !
Quelques exaltés firent mine de vouloir arrêter les chevaux. Mais le Gascon, à grands coups de plat d’épée, déblaya le chemin. Il clama :
– Gare, sangdiou ! la prochaine fois, ce sera avec le fil, que je frapperai !
Cette menace eut le don de faire refluer la foule immédiatement, et l’équipage, au grand galop de ses chevaux, passa sans encombre.
Ils arrivèrent sains et saufs au château. Là la Cour était en sûreté. L’orage s’apaiserait tout seul et, dans quelque temps, rien ne s’opposerait à un retour dans la capitale.
Pourtant, les choses durèrent plus longtemps que prévu.
– Cela ne peut continuer ainsi ! s’écria un jour la bouillante Autrichienne, alors qu’avec son amie inséparable, elles causaient des derniers événements qui les forçaient à rester à l’écart de la capitale. Il faut prendre un parti !
– Je n’en vois qu’un ! répondit la belle duchesse. Il faut appeler les Espagnols à notre aide !
Anne d’Autriche eut un haut-le-corps.
– C’est un parti dangereux !
– Mais nécessaire ! Les Espagnols ne vous refuseront certainement pas leur aide !
– Marie, il n’y faut pas compter ! Ce serait introduire l’ennemi en France !
– Que faire, lorsque vos propres amis vous trahissent ?
La reine hésita.
– Si nous déclenchons la guerre civile, les événements peuvent nous entraîner très loin…
– Anne ! préférez-vous rester éloignée de votre capitale longtemps encore ? Les factieux ont besoin d’une punition ! Les armées du roi d’Espagne sauront la leur donner !
– J’en parlerai au cardinal, dit enfin la Régente, partagée entre le désir de se montrer la plus forte dans ce duel engagé avec le Parlement et les mécontents, et la sagesse qui lui déconseillait une telle entreprise.
Mais lorsque Mazarin fut mis au courant de l’idée de la duchesse, il s’y montra catégoriquement opposé.
Certes, le Florentin avait bien des défauts ; il était cupide, avare et rusé, mais il était doué d’un grand bon sens, et soit attachement fidèle à la Régente et au petit Roi, soit parce que, devenu premier ministre, il sentait toute la responsabilité qui lui pesait aux épaules et entendait remplir sa tâche loyalement et au plus grand profit du peuple dont il avait la sauvegarde, il se refusa à entrer dans cette combinaison qui pouvait avoir pour la France les plus funestes et les plus dangereuses conséquences.
Le projet de la duchesse de Chevreuse fut donc repoussé et on n’en parla plus.
Pendant ce temps, Condé, qui avait pris la tête du mouvement insurrectionnel, s’occupait activement à lever des troupes dans le Midi. Il rencontra les troupes royales à Bléneau et les battit. Alors, il entra en maître dans Paris, à la grande fureur d’Anne d’Autriche.
Cependant, tous les maréchaux n’étaient pas hostiles à la royauté. Le brave Turenne se porta en hâte à la rencontre du prince victorieux. Parmi ses troupes se trouvait le régiment des mousquetaires, dont faisaient partie Castel-Rajac et ses deux amis.
Le choc eut lieu au faubourg Saint-Antoine. Et les troupes royales auraient été victorieuses, si la Grande Mademoiselle, fille de Gaston d’Orléans, n’avait fait tirer le canon de la Bastille sur l’armée régulière. Prise entre deux feux, celle-ci dut se retirer, à la grande fureur du Gascon et de ses compagnons.
– Sangdiou ! hurlait Castel-Rajac, est-ce donc que nous n’avons plus de sang dans les veines, que nous nous laissons battre comme des femmelettes, nous, les mousquetaires ?
Laparède, le voyant en cet état d’excitation, lui frappa amicalement sur l’épaule.
– Ce n’est pas ta faute, ni la nôtre, ni celle du corps où nous servons… La fatalité l’a voulu. Sois tranquille : quelque chose me dit que cela ne durera pas !
Cependant, en ces heures troubles, un personnage qui s’était fait un peu oublier pendant ces derniers temps reparut. C’était Durbec.
Après la bataille du faubourg Saint-Antoine, Condé s’était installé à Paris.
Durbec, avec sa souplesse coutumière, avait réussi à se glisser dans l’entourage du puissant du jour. Il tressaillit de joie lorsque, peu de temps après, un officier de la troupe de Condé lui dit :
– Monsieur le Prince a pris une excellente résolution : il va purger la capitale de tous les partisans du Mazarini… Il a déjà fait exécuter les bourgeois réfugiés à l’Hôtel de Ville…
À ces mots, Durbec tressaillit d’aise.
– C’est en effet un projet digne de l’énergie et de la volonté que montre Monseigneur à assainir la capitale et faire entendre raison à la Régente…
L’officier baissa un peu la voix.
– Le Mazarin n’en a plus pour longtemps… Monsieur le Prince se fera nommer ministre à sa place, et on obligera Sa Majesté à renvoyer son Italien à sa bonne ville de Florence, qu’il n’aurait jamais dû quitter !
– Dites-moi, mon cher, interrogea doucereusement Durbec, savez-vous les noms de ceux que Monseigneur compte supprimer de sa route ?
– Il m’en fit dresser la liste voici à peine deux heures !
– Quoi ! Serait-ce vous qui êtes chargé de nommer tous les suspects ?
– Je les note, en effet, car dès ce soir, ils seront exécutés… Ce sera une petite Saint-Barthélémy !
Il fit un geste.
– C’est triste… Mais peut-on faire autrement ?
– Certainement que non ! s’écria Durbec, et j’approuve Monseigneur de toutes mes forces… Lui seul, par sa naissance, son intelligence et son énergie, est digne d’administrer la France à la place de ce rustre d’Italien que la reine protège, on sait pourquoi ! Mais je pourrais peut-être vous donner une indication utile à ce sujet… Je connais personnellement trois individus, fort dangereux, entièrement dévoués à la cause de Mazarin, et qui devraient figurer en premier sur votre liste noire.
– S’il en est ainsi, ils y figurent sûrement ! affirma l’officier. Dites-moi leurs noms ?
– Il s’agit du chevalier de Castel-Rajac, Hector d’Assignac et Henri de Laparède !
– Non, je n’ai pas ces noms-là, c’est vrai, convint l’officier. Et vous dites que ce sont des fidèles du signor Mazarini ?
– Dites qu’ils se feraient tuer pour lui ! affirma l’espion.
– Que font-ils ? Où sont-ils ?
– Ils font partie du corps des mousquetaires du roi !
L’autre fit une grimace.
– Très dangereux… murmura-t-il.
– Très dangereux surtout pour Monseigneur. Ces hommes ont le diable au corps, mon cher ! Croyez-moi : n’hésitez pas !
– Ils sont probablement à Saint-Germain. Nous ne pouvons aller jusque-là ! Notre action se borne à la capitale !
– Ce soir, ils seront à Paris, ou presque : j’ai aussi ma police, et je sais qu’ils doivent coucher à l’auberge du Vieux-Bacchus, la première taverne sitôt passées les fortifications, en se dirigeant vers Vincennes !
– En ce cas, concéda l’officier, peut-être pourrons-nous agir, en effet. Je vous remercie du renseignement, j’espère que nous pourrons en débarrasser Monsieur le Prince…
Ils se séparèrent après s’être serré la main, et partirent chacun de leur côté : l’officier pour ajouter à sa liste le nom des trois gentilshommes gascons, et le chevalier de Durbec, jubilant et se frottant les mains, à l’idée que grâce à cet événement, il verrait enfin sa vengeance assouvie sans risque pour lui !
Les trois amis avaient bien formé le projet de passer la nuit dans l’auberge qu’il avait désignée au frondeur. La route était longue, du faubourg Saint-Antoine jusqu’à Saint-Germain ; et après avoir attendu quarante-huit heures afin de savoir s’il n’y aurait pas contre-attaque, ils avaient décidé de rentrer à la Cour en attendant les nouveaux événements. Mais, cette nuit encore, ils coucheraient au Vieux-Bacchus, qu’ils avaient élu comme gîte.
Tandis que les autres mousquetaires campaient avec l’armée royale, un peu plus loin, les trois Gascons avaient préféré une bonne table au menu incertain de la troupe.
De plus, la fille de l’aubergiste, une jolie fille de seize ans, assurait le service, ce qui n’était point fait pour déplaire aux convives, qui trouvaient le vin plus parfumé et la poularde plus dorée lorsque c’étaient les jolies mains de Guillemette qui les servaient.
La petite n’avait d’yeux que pour Gaëtan, tant et si bien que Laparède, mi-riant, mi-vexé de voir que tout le succès allait à son ami, s’écria :
– Tu perds ton temps, ma belle ! Notre ami n’aime que les blondes !
La jeune fille avait rougi jusqu’à sa chevelure, dont les boucles noires et lustrées cascadaient sur ses épaules, et s’éclipsa sans rien dire.
Enfin, lorsqu’ils eurent copieusement soupé, ils remontèrent dans leur chambre. Au passage, ils croisèrent Guillemette, et ses beaux yeux noirs se posèrent avec admiration sur le chevalier. Celui-ci s’en aperçut. Au passage, il lui tapota la joue.
– Tu sais, dit-il en souriant, une brune comme toi ferait oublier toutes les blondes !
Le naïf intérêt que la fillette témoignait pour lui l’avait à la fois touché et flatté, et il pensait que cette attention valait bien un compliment, même s’il n’en pensait pas le premier mot !
Paroles bienheureuses, qui allaient avoir sur les événements à venir une influence décisive !
Guillemette, oubliant l’heure, s’était mise à sa fenêtre, dissimulée par le feuillage d’un gros marronnier. Cette circonstance lui permit d’entrevoir une troupe de cavaliers qui s’approchait silencieusement. Devant l’auberge, ils mirent pied à terre.
La jeune fille, croyant qu’il s’agissait de voyageurs, allait descendre et s’informer de ce qu’ils désiraient, lorsque, soudain, un nom saisi au vol l’arrêta tout net :
– Vous êtes bien sûr, capitaine, que ce Castel-Rajac est lieutenant aux mousquetaires ?
– Mais oui ! Commencez par lui. Allez à sa chambre et dès qu’il ouvrira, frappez-le sans explications. Vous exécuterez ensuite ses deux compagnons.
L’homme qui avait parlé s’approcha de l’huis et heurta du poing, tandis que Guillemette cherchait un moyen de soustraire Gaëtan au danger qui le menaçait.
Comme, en bas, on cognait de nouveau, elle se pencha et cria :
– Qui va là ?
– Ouvrez !
– Je passe un cotillon et je descends !
– Dépêche-toi, la fille ! Nous sommes pressés !
Guillemette avait déjà quitté la fenêtre. Sans prendre le temps d’enfiler un jupon, pour la bonne raison qu’elle ne s’était pas encore déshabillée, elle courut à la chambre de Castel-Rajac et frappa de toutes ses forces.
– Monsieur ! Monsieur ! cria-t-elle d’une voix étouffée : Ouvrez ! Ouvrez vite !
Gaëtan, qui venait juste de s’endormir, s’éveilla en sursaut, bondit hors du lit et alla tirer le verrou.
– Que se passe-t-il ? s’écria-t-il, étonné.
– Il y a en bas une bande d’hommes armés qui demande à entrer… Ils viennent vous assassiner, vous et vos deux amis ! Fuyez !
– Mordiou ! On ne nous assassine pas comme cela, la belle ! s’écria le Gascon en courant éveiller ses deux compagnons.
Un conseil rapide fut tenu.
– Il faut montrer à ces coquins qu’on est capable de soutenir la lutte un contre dix ! affirma Gaëtan avec sa superbe intrépidité.
Mais Laparède, qui avait glissé un coup d’œil par la fente des volets, secoua la tête.
– Mon ami, il y a des moments où la fuite est une nécessité. Songe que tu as des responsabilités. Tu risques de te faire tuer sans profit. La reine compte sur toi ; les mousquetaires sont ses derniers fidèles…
– Fuir comme des lâches ? Jamais ! Guillemette, va ouvrir la porte !
– Partez, Monseigneur ! implora la jeune fille. Je les ai vus ; ils sont au moins trente ! Que voulez-vous faire contre cette troupe ? Sautez par la fenêtre de la chambre de votre ami ; elle donne dans le jardin. À droite, il y a l’écurie ; vous sortirez par la porte, au fond. Elle ouvre sur la campagne. Pendant ce temps, je les retiendrai avec des balivernes…
– Cette enfant a raison ! s’écria Assignac. Le courage est louable, mais la témérité, surtout quand on est chargé de responsabilités comme toi, est blâmable. Songe à Henry.
Le Gascon finit par se laisser persuader. Ils s’élancèrent dans le jardin au moment où le verrou tiré, une bande d’hommes armés envahissait l’auberge du Vieux-Bacchus…
CHAPITRE VI
LA DAME MASQUÉE
Une fois encore, grâce à la vigilance de la petite hôtelière, la vengeance du chevalier de Durbec avait échoué…
Tandis que les soldats de Condé fouillaient l’auberge, et que l’hôte, éveillé, levait les bras au ciel et gémissait en prenant à témoin tous les saints du paradis, les trois Gascons galopaient ventre à terre, contournant la capitale investie pour regagner Saint-Germain, où Castel-Rajac raconta cette agression à la duchesse de Chevreuse.
Celle-ci ne s’y trompa pas.
– C’est encore un coup de Durbec ! s’écria-t-elle. Il a profité des temps troublés que nous vivons pour lancer contre vous et vos amis les sbires des frondeurs…
– Malheur à lui si je me trouve un jour face à face avec ce fantoche malfaisant ! gronda Gaëtan. Je l’écraserai sans pitié !
Mais les événements subirent un tel revirement que bientôt, la Fronde devait se calmer d’elle-même, comme une mer agitée après la tempête.
L’injuste exécution des bourgeois et des partisans de Mazarin avait soulevé l’opinion publique. Le régime tyrannique, la période de terreur que le prince de Condé avait instituée à Paris ne tarda pas à lui aliéner les sympathies des habitants. Et ce furent les Parisiens eux-mêmes, ceux qui avaient crié le plus fort : « À bas Mazarin ! » et « Vive la Fronde ! » qui adressèrent une supplique à la Régente, afin de faire revenir la Cour à Paris.
Au reçu de cette délégation, Mazarin adressa à la Reine un sourire.
– Que vous disais-je. Madame ? murmura-t-il. Chacun son tour de chanter la canzonnetta !
Le régiment des mousquetaires revint donc, parmi les premiers, dans la capitale, escortant les carrosses de la Cour, au milieu des acclamations et des vivats. La Régente et Mazarin triomphaient.
La paix et l’ordre une fois rétablis, Castel-Rajac s’empressa de solliciter un congé auprès du capitaine de Guissancourt afin d’aller jusqu’à la gentilhommière où sous la garde d’une gouvernante, d’un intendant, et sous la surveillance d’un précepteur, le digne abbé Vertot, Henry était en train de devenir le plus charmant des garçonnets.
Ces jours de détente étaient pour le chevalier une halte délicieuse au milieu de la rude vie qu’il menait. L’enfant avait pour lui une vive tendresse, et c’était fête au logis lorsque le lieutenant des mousquetaires du Roi venait y passer quelques jours !
Cette fois-ci, comme les précédentes, il galopait allègrement sur la route blanche de poussière, en songeant qu’il allait revoir à la fois l’enfant de son cœur et la femme à laquelle il n’avait pas cessé de porter la tendresse la plus vive.
Bientôt, il vit se dessiner, à travers les hautes branches de la futaie, une grille qu’il connaissait bien. Celle-ci était ouverte. Probablement, l’attendait-on déjà.
Sans se faire annoncer, il entra, suivit l’allée sablée qui conduisait au perron.
Tout à coup, il s’arrêta, saisi, devant un tableau pour le moins imprévu !
Deux femmes étaient assises dans de grands fauteuils, sur la pelouse. L’une d’elles lui tournait presque le dos, et tenait le petit Henry sur ses genoux, en lui prodiguant mille baisers. Ce n’était pas la duchesse de Chevreuse, puisque celle-ci était la seconde personne qui regardait cette scène en souriant.
– Sangdiou ! murmura notre Gascon, interloqué, qui est cette femme ?
Juste à cet instant, celle-ci tourna la tête, sans voir le cavalier, toujours immobile. Gaëtan eut un haut-le-corps : il venait de reconnaître la reine Anne d’Autriche en personne !
L’exclamation de stupeur qu’il allait pousser s’étrangla dans sa gorge.
Fut-ce prescience ? À cet instant, la duchesse de Chevreuse aperçut le nouveau venu, que la surprise clouait sur place. Sans affectation, après avoirs échangé quelques mots avec sa royale amie, elle se dirigea vers le Gascon.
– On ne vous a pas vu, jeta-t-elle rapidement, à mi-voix. Cela vaut mieux. Cachez-vous vite dans la maison.
Castel-Rajac, qui avait toujours peur qu’on le prive de son pupille, se hâta d’obéir, et de suivre le conseil de sa très fine amie.
Il venait à peine de pénétrer dans le petit salon où se tenait d’habitude la duchesse, que celle-ci entra.
– Je pense, mon ami, dit-elle simplement, que l’heure est venue de tout vous révéler, puisqu’un hasard vous a fait surprendre la vérité.
– C’est exact. Madame ! répondit-il en baisant la main qu’on lui tendait. J’ai déjà été admis en présence du jeune roi, et j’avais déjà été frappé par l’extraordinaire ressemblance qui existait entre lui et l’enfant que j’ai reconnu pour le mien.
– Inutile de vous celer plus longtemps que ce sont les deux frères. Je pense que vous vous doutez également de l’extrême gravité de la situation qui en résulte pour notre filleul. Ce secret terrible, d’autres peuvent l’apprendre. Il ne peut en résulter que des malheurs. Heureusement, Mazarin est au pouvoir, et veillera autant qu’il le faudra sur la sécurité de cet enfant !
– Je comprends maintenant, dit pensivement le chevalier, la suprême adjuration du cardinal de Richelieu, lorsque je lui conduisis le petit Henry… « Veillez sur lui, m’a-t-il dit, car il se peut qu’un jour, de graves dangers le menacent… »
– Oui, dit Marie de Rohan, Richelieu, lui, en avait pris son parti. Mazarin est tout désigné pour veiller sur lui. Mais ensuite ? Ne cherchera-t-on pas à abuser de cette situation, à substituer, par exemple, un faux roi au vrai ? Ne cherchera-t-on pas à agir sur la reine grâce à ce secret qui serait un scandale s’il venait aux oreilles du peuple ? Pauvre enfant ! Sa jeune tête est déjà accablée sous le poids d’une bien grosse responsabilité !
– Soyez tranquille, ma chère Marie ! s’écria le Gascon. Pour ma part, je garderai jalousement cette découverte, et je n’en aurai que plus de zèle pour accomplir la tâche que vous avez bien voulu me confier !
Il attendit que la reine soit repartie pour sortir à son tour. Henry, en le voyant, se jeta à son cou avec les marques de la plus grande joie.
Ces quelques jours de congé passèrent comme l’éclair, puis le lieutenant dut rejoindre son poste.
Par ses fonctions mêmes, il était appelé à voir assez fréquemment le jeune roi. Et plus il le voyait, plus il était frappé par ce caprice de la nature qui avait donné aux deux frères un visage identique…
Quelque temps s’écoula. Castel-Rajac ne pensait plus guère à ce qu’il avait involontairement surpris dans le jardin de Mme de Chevreuse, lorsqu’un jour, il reçut un billet de sa belle amie :
« Soyez ce soir à minuit à la petite porte du Louvre, disait la missive. Et laissez-vous guider par la personne qui vous attendra. »
– Mordiou ! se dit le Gascon, intrigué. Voilà qui sent terriblement le mystère ! Cependant, je ne puis m’y tromper : il s’agit là de l’écriture de ma belle duchesse. On dirait à s’y méprendre un rendez-vous galant !
Quoi qu’il en soit, Gaëtan attendit le soir avec une certaine impatience. Il fit sa toilette avec un soin inaccoutumé. La lune brillait déjà haut dans le ciel, lorsqu’il arriva à la petite porte du Louvre où il lui était enjoint de se rendre.
D’abord, il ne vit rien. L’ombre était épaisse ; la lumière nocturne glissait seulement sur la Seine, et pailletait ses eaux d’argent.
Tout à coup, il sentit que quelqu’un lui saisissait la main. À son tour, il serra les doigts qui le tenaient, et reconnut une main de femme.
– Cordiou ! Madame, fit le jeune chevalier, qui êtes-vous et que me voulez-vous ?
Mais la femme, qui était masquée, et qu’un long capuchon noir enveloppait de la tête aux pieds, la rendant absolument méconnaissable, se contenta de poser un doigt sur ses lèvres en signe de silence, et le fit entrer par la petite porte qu’elle venait d’ouvrir.
Aucune sentinelle ne s’y tenait. Cette ouverture donnait directement sur les berges de la Seine.
À la suite l’un de l’autre, et dans l’obscurité la plus profonde, ils grimpèrent un escalier aux marches hautes et étroites. Puis ils suivirent un couloir interminable. Ils firent tant de tours et de détours que Castel-Rajac, intrigué, se demanda si, vraiment, cette promenade n’avait pas pour but de l’égarer.
Enfin, une portière fut soulevée. Gaëtan, ébloui, recula d’un pas.
Il se trouvait dans un somptueux boudoir. De grands candélabres de bronze où brûlaient des bougies roses et parfumées éclairaient la pièce brillamment.
Sur un divan, une femme, également masquée, et enveloppée aussi d’une mante noire, attendait.
– Approchez, monsieur de Castel-Rajac ! dit-elle d’une voix harmonieuse, à l’imperceptible accent, qui fit tressaillir le chevalier.
Il obéit, dominant son trouble. Celle qui l’avait amené s’assit dans un fauteuil.
La dame masquée le regardait fixement. À travers les trous du loup de velours, il voyait le feu de ses prunelles.
Un court silence régna. L’inconnue ne se pressait point d’entamer la conversation. De son côté, Castel-Rajac attendait respectueusement qu’on voulût bien l’interroger. Il avait cru, malgré les précautions prises, reconnaître une illustre voix. Il attendit, plein de déférence.
– Monsieur de Castel-Rajac, reprit la femme masquée, j’ai beaucoup entendu parler de vous, et le désir m’est venu de vous connaître. Je ne peux vous cacher que ce que j’ai ouï-dire à votre sujet était tout à votre louange.
– Madame, répondit le Gascon avec finesse, la personne qui vous a renseignée a témoigné d’une grande indulgence à mon égard, et je vous prie de l’assurer de toute ma reconnaissance.
– On m’a dit, monsieur, que vous étiez aussi chevaleresque que brave, et que, le cas échéant, vous n’hésitez pas à vous lancer dans les plus compromettantes aventures pour sauver l’honneur d’une femme…
– Ce que j’ai pu faire n’a rien d’extraordinaire, Madame, et tout gentilhomme de France l’eût fait avec joie comme moi je l’ai fait !
– Cette réponse est digne de votre modestie, chevalier… À propos : on m’a rapporté que vous aviez un fils ?
– Oui, Madame. Un charmant enfant, auquel je suis attaché profondément…
– Vous êtes marié ?
– Non, Madame.
– Une aventure ?
– Si vous voulez, Madame.
– Vous êtes discret, chevalier !
– Madame, l’honneur d’une femme en dépend. Cette raison doit être suffisante pour que je le sois…
– Je vous en félicite. Vous êtes bien tel qu’on me l’a dépeint ! À propos : puis-je connaître le nom de cette femme ?
– Je regrette. Madame, mais… même à vous, je ne puis le dire !
– Peut-être l’ignorez-vous ? lança l’inconnue avec hardiesse.
Castel-Rajac se redressa.
– Non, Madame, dit-il avec un respect infini. Je connais le nom de la mère de mon fils. Mais ce nom, je le garde dans mon cœur, et il faudra l’ouvrir pour l’y lire ! Sur mon épée, moi vivant, personne ne le saura !
Les yeux de l’inconnue brillèrent davantage. Castel-Rajac ne baissa pas les yeux.
Elle se leva.
– Chevalier de Castel-Rajac, dit-elle lentement, je ne sais ce que vous réserve l’avenir. Partez, maintenant. Mais avant, je veux vous dire ceci : veillez sur cet enfant, qui est le vôtre, avec le soin jaloux et la tendresse que vous lui avez toujours témoignés. Le cœur d’une mère n’est pas toujours assez fort pour préserver des embûches de la vie : il faut parfois un grand courage et un cœur fort pour les détourner. Je suis certaine que vous y parviendrez !
Elle sortit de la mante noire un bras et une main d’une blancheur et d’une forme admirables, et les tendit au chevalier, qui, mettant un genou en terre, y déposa respectueusement ses lèvres. Puis Castel-Rajac se releva.
– Madame, dit-il, je renouvelle devant vous le serment fait jadis : donner ma vie, s’il le faut, pour cet enfant et pour sa mère !
– Adieu, chevalier ! murmura la voix harmonieuse, aux inflexions un peu tristes. Je suis heureuse d’avoir fait la connaissance, ce soir, d’un parfait gentilhomme.
L’autre dame masquée se leva et ouvrit la porte. Le Gascon sortit, et, précédé par son guide muet, refit en sens inverse le chemin déjà parcouru pour venir.
Lorsqu’il se trouva devant la petite porte du Louvre, devant laquelle coulait le fleuve, il se tourna vers son guide anonyme. Sous le masque de velours, il vit se dessiner un malicieux sourire, et un regard brillant se posa sur lui.
– Marie ! murmura-t-il.
Et, sans attendre la réponse, persuadé qu’il s’agissait là de sa belle amie, il l’attira vers lui et posa ses lèvres avec fougue sur la jolie bouche souriante.
Alors, un frais éclat de rire retentit, et une voix inconnue lui répondit :
– Monsieur le chevalier de Castel-Rajac, vous êtes bien entreprenant… Je me nomme Gilberte, et je ne suis que la première camériste de… de celle que vous venez de voir !
Et laissant le Gascon encore tout ébaubi, elle lui ferma la porte au nez…
TROISIÈME PARTIE
LE PRISONNIER DE L’ÎLE SAINTE-MARGUERITE
CHAPITRE PREMIER
LA VENGEANCE DE DURBEC
Tant que vécut Mazarin, Castel-Rajac continua de s’acquitter de ses fonctions de lieutenant aux mousquetaires avec autant de brio que de loyauté, et de même que le fils de Mazarin lui avait voué une affection sans bornes, le fils de Louis XIII s’attacha à lui par les liens d’une réelle amitié. On eût dit que les deux fils de la même femme n’avaient pour lui qu’un même cœur.
Aussi se prit-il à les aimer autant l’un que l’autre. D’ailleurs, en grandissant, la ressemblance s’accentuait encore, et quand Gaëtan quittait Henry pour aller retrouver Louis, il lui semblait que c’était le même qu’il avait devant lui. Sauf peut-être qu’Henry avait plus de douceur et Louis plus de volonté. Le premier semblait être fait pour devenir un parfait gentilhomme, et l’autre, pour devenir un grand roi.
La belle duchesse de Chevreuse, tout en poursuivant sa vie de cour et s’acquittant de toutes les obligations mondaines que lui assignait son rang élevé, n’oubliait pas son ami. Une rencontre fortuite, le hasard d’un instant, avait suffi pour lier ces deux cœurs d’une indestructible amitié.
Gaëtan, dès qu’il pouvait avoir une permission, s’échappait pour rejoindre son cher Henry qui devenait un fier jouvenceau, habile aux armes et à l’équitation. Mme de Chevreuse s’arrangeait pour l’y rejoindre elle-même, et c’étaient quelques instants enchantés que Castel-Rajac passait au milieu des deux grandes affections de sa vie.
Hélas ! Il est écrit que jamais le bonheur complet ne peut être de ce monde !
La haine, la rancune, la basse envie n’avaient point désarmé. Le chevalier de Durbec veillait.
Tant que le cardinal Mazarin fut au pouvoir, il resta dans l’ombre. Il savait qu’il aurait affaire à trop forte partie, et que le chevalier de Castel-Rajac et son fils adoptif se trouveraient toujours hors de ses atteintes.
Mais, lorsque le jeune roi atteignit ses vingt ans, Mazarin mourut.
Cet événement affecta profondément le chevalier, et la duchesse elle-même, qui perdaient de la sorte un puissant allié. Certes, la reine Anne d’Autriche restait, et ferait l’impossible pour protéger la destinée de son fils aîné. Mais comme elle l’avait dit au Gascon lors de la mystérieuse et unique entrevue qu’ils eurent, quelques années auparavant, le cœur d’une mère n’est pas toujours assez fort pour préserver des embûches de la vie !
Au grand étonnement de la Cour et des princes, ce fut un roturier, le fils d’un marchand drapier, homme de confiance du cardinal, Jean-Baptiste Colbert, qui fut désigné par le moribond lui-même pour le remplacer…
Anne d’Autriche s’inclina. Elle connaissait la finesse de l’Italien, et savait que s’il lui recommandait ce garçon, c’est qu’il avait déjà su l’apprécier et distinguer en lui les qualités qui feraient de lui un premier ministre digne de continuer la grande tâche entreprise par Richelieu et son successeur.
Castel-Rajac et Marie de Rohan apprirent cette nomination avec une certaine appréhension, quoique sans crainte bien définie. Après tout, Colbert ignorait tout. Il suffisait de tenir le jeune Henry soigneusement en dehors de la Cour, et de l’entourage du jeune Roi.
Lorsque Durbec apprit la mort de Mazarin, et la nomination de Jean-Baptiste Colbert, une idée diabolique commença à germer dans sa cervelle.
Il y avait à peine quelques jours que Colbert était entré dans ses nouvelles fonctions, quand l’officier de service lui annonça un visiteur, qui attendait dans l’antichambre et insistait pour le voir, disant qu’il avait une communication de la plus haute importance à lui faire.
Le fils du marchand de drap de Reims était un petit maigrichon, qui n’avait ni beauté, ni distinction, ni fière allure. Mais son regard, son front, éclatants d’intelligence, laissaient deviner tout le génie que cette enveloppe d’apparence si ordinaire renfermait.
Il releva la tête à cette annonce, et, sans lâcher sa plume, ordonna :
– Faites entrer !
Deux minutes plus tard, le chevalier de Durbec, obséquieusement plié en deux, faisait son apparition.
Colbert le dévisagea. Du premier coup d’œil, il le classa : c’était un de ces hommes intelligents, mais prêts à tout, même aux plus viles besognes, pourvu qu’en échange, ils reçoivent profit ou récompense.
– Vous avez sollicité une entrevue. Monsieur, entama le ministre, en disant que vous aviez un secret important à me confier. Je vous écoute.
Le ton était poli, mais tenait à distance. Durbec accentua sa courbette.
– Monsieur, commença-t-il, je n’ai pas exagéré, car il s’agit d’un secret d’État, et qui peut un jour compromettre l’avenir de la dynastie…
Colbert ne put réprimer un tressaillement. Il crut d’abord à un complot espagnol ou autrichien, fomenté par quelques-uns des grands, et semblables à ceux que le cardinal de Richelieu avait déjà eu à réprimer.
– Parlez, Monsieur !
Durbec entra tout de go dans le vif du sujet.
– Saviez-vous, Monsieur, que Sa Majesté Anne d’Autriche a deux fils ?
Colbert parut stupéfait.
– Deux fils ?
– Deux fils, répéta Durbec, qui sentit tout de suite sa partie gagnée. Un, légitime, l’autre adultérin… Mais ce qui est grave, c’est que c’est l’illégitime qui est l’aîné… et que, circonstance aggravante, il ressemble à son frère notre jeune roi Louis, d’une façon impressionnante…
– Que dites-vous là ?
– La stricte vérité !
– Pour avancer une chose si grave, il faut que vous ayez des preuves !
– La meilleure est encore l’existence de cet enfant, qu’il vous est loisible de contrôler !
– Et le père ?
– Il est mort…
– Il y a longtemps ?
– Le jour où vous avez pris la place du cardinal, Monsieur.
– Quoi ! Voudriez-vous dire que Son Éminence…
Le visiteur fit un léger signe de tête.
Colbert sembla réfléchir profondément.
– Savez-vous que voilà de graves révélations ? dit-il enfin. J’espère que personne n’est au courant de cette naissance clandestine ?
– Quelques-uns, Monsieur.
– Vous les connaissez ?
– Mme la duchesse de Chevreuse…
– L’amie intime de Sa Majesté… C’est logique. Après ?
– Un chevalier gascon, actuellement lieutenant aux mousquetaires, M. de Castel-Rajac, qui n’a pas craint d’endosser la responsabilité de cette affaire en reconnaissant l’enfant.
– Morbleu ! C’est galant ! Il connaissait le nom des parents ?
– Non ; il ne les a appris, je crois, que dernièrement.
– Enfin, il sait lui aussi. Après ?
– La sage-femme qui a présidé à la naissance de l’enfant. Mais au fait non : je me souviens maintenant qu’elle a toujours ignoré la qualité de l’illustre malade.
– Elle sera à surveiller. Ensuite ?
– Il y a encore deux amis du chevalier de Castel-Rajac : MM. d’Assignac et de Laparède qui sont aussi intéressés dans cette aventure.
Colbert, au fur et à mesure, avait pris des notes et crayonné les noms.
– C’est tout, conclut Durbec, satisfait.
Le ministre parcourut rapidement sa liste.
– Somme toute, peu de personnes. Quatre en tout, une incertaine… Sont-elles capables de divulguer ce secret un jour ?
– Certainement non, répondit vivement l’interpellé, qui devina l’idée de son vis-à-vis.
– Je vous remercie, monsieur… Je saurai vous prouver ma reconnaissance en temps et lieu pour l’important service que vous venez de rendre à la couronne. Je vais réfléchir à tout ceci…
Il se leva, indiquant par là que l’entretien était terminé. Durbec salua et partit, cette fois triomphant d’une joie démoniaque. Il était sûr que sa dénonciation n’allait pas rester sans effet !
CHAPITRE II
LE TEMPS DES PÉRILS
À quelques jours de là, un cavalier, âgé de quarante à quarante-cinq ans environ, à la petite moustache grisonnante, droit en selle et cambré comme un jeune homme, galopait à toute allure sur la route qui conduisait de Paris à Saint-Germain.
Le chevalier de Castel-Rajac dut s’interrompre, car son cheval, fatigué par une course longue et rapide, venait de broncher. D’un énergique rappel de bride, le Gascon l’empêcha de tomber sur les genoux et le força à se redresser. Puis, silencieusement, il continua sa route.
Ce n’était plus avec l’entrain qu’il mettait autrefois que le gentilhomme allait rejoindre sa belle amie. Que s’était-il donc passé ? Quelle catastrophe avait bouleversé leur existence jusque-là si paisible ?
La veille même, ainsi qu’il le faisait presque journellement, Henry, devenu un charmant jeune homme de vingt-trois ans, à la fière allure et aux traits virils, avait manifesté le désir de monter à cheval.
Excellent écuyer, le fils de la reine Anne d’Autriche parcourait de longues distances, par champs et par bois, trouvant dans cet effort physique un dérivatif aux études plus ou moins austères qu’il poursuivait avec son précepteur.
Ce jour-là, précisément, le soleil brillait dans un ciel sans nuages. Il ferait bon dans la forêt. Le jeune homme sauta en selle et piqua des deux.
En quelques instants, il fut hors de vue du château de Chevreuse. Le village se trouvait à quelque distance. Il lui tourna carrément le dos, et se dirigea vers la forêt.
Ce fut enfin le couvert, les branches feuillues des grands arbres qui étaient pour lui des amis.
Il mit son cheval au trot, afin de pouvoir mieux jouir de la délicieuse fraîcheur du lieu. Un ramage d’oiseaux se faisait entendre, étourdissant ; une mousse épaisse, où les sabots de sa monture enfonçaient profondément, garnissait le sol d’un somptueux tapis naturel.
Tout à coup, sa bête fit un écart. Le jeune prince aperçut alors un homme couché au pied d’un chêne.
Henry avait bon cœur. Il crut le malheureux blessé, et s’approcha.
– Qu’avez-vous, brave homme ? questionna-t-il. Êtes-vous souffrant ? Puis-je quelque chose pour vous ?
– J’ai été attaqué par des bandits, geignit l’inconnu. Ils m’ont frappé…
Ému à l’idée que l’inconnu pouvait souffrir, et désirant lui porter remède, Henry mit pied à terre et s’approcha de l’homme afin de l’examiner.
Mais dès qu’il fut près de lui, le « blessé », se jetant aux jambes du cavalier, les emprisonna, l’empêchant de faire un pas. Au même instant, plusieurs individus sortaient de derrière les troncs d’arbres qui les dissimulaient et se précipitaient sur leur victime avant que celle-ci ait le temps de tirer son épée. Henry se trouva assailli, désarmé par cette bande de furieux.
Alors, deux hommes s’approchèrent. L’un d’eux était un gros homme, à l’aspect rude, mais franc. C’était M. de Saint-Mars, gouverneur de la forteresse de l’île Sainte-Marguerite, qui avait été mandé d’urgence à Paris. Il avait l’air peu satisfait et se tourna vers son compagnon pour lui exprimer son mécontentement.
– Voilà de la vilaine besogne, monsieur, et qui ne me plaît guère ! dit-il avec sa franchise d’ancien soldat. Cette attaque ressemble furieusement à un guet-apens. Je n’aime pas cela !
– C’est évidemment regrettable, mais nous n’avions pas le choix des moyens ! répliqua le chevalier de Durbec.
Il tenait à la main un engin bizarre. C’était un masque, mais un masque de fer, percé de deux trous pour les yeux, un autre pour le nez, un autre pour la bouche.
Cachant mal sa joie, il s’approcha rapidement du jeune homme toujours immobilisé, et lui appliqua cet engin sur le visage.
Henry eut beau clamer son indignation et sa fureur, le masque était mis et bouclé.
– Vous me rendrez raison de cette violence ! s’écria le fils adoptif du chevalier gascon. Pour quel motif me traitez-vous ainsi ?
– Monsieur, répondit Durbec avec une politesse exquise qui dissimulait mal son triomphe, nous avons des ordres et les exécutons !
– C’est indigne ! Je n’ai commis aucun crime !
– Nous ne pouvons vous donner aucune explication !
Cependant, le masque fermé, les soldats, tout en maintenant toujours énergiquement leur prisonnier, lui permirent de se relever. Ils le dirigèrent vers un carrosse qui attendait dans une allée parallèle, et l’y firent monter.
Aussitôt, on verrouilla soigneusement la portière, non sans que M. de Saint-Mars et Durbec lui-même soient montés tenir compagnie au prisonnier.
La voiture se mit en branle, entourée par l’escorte des cavaliers qui avaient accompli cet enlèvement et qui ne se doutaient nullement qu’ils emmenaient vers une captivité perpétuelle le frère illégitime de Sa Majesté Louis XIV.
L’équipage sortit de la forêt, et prit la route du sud. Ce fut un vrai voyage, car le carrosse dut traverser toute la France pour rejoindre l’île Sainte-Marguerite, qui paraissait offrir, tant par son isolement maritime que par les solides fortifications de son château, toutes les garanties de sécurité qu’exigeait la garde d’un prisonnier d’État.
Colbert avait donné l’ordre de tuer le jeune Henry s’il parvenait, chose d’ailleurs invraisemblable, à se débarrasser de son masque, et avait ordonné, néanmoins, de traiter l’homme au masque de fer avec les plus grands égards.
Aussi, pendant tout le voyage, fut-il, de la part de ses deux compagnons, l’objet des attentions les plus grandes.
Ce fut pourtant en vain que le jeune homme, à plusieurs reprises, tenta de savoir pourquoi il était victime de ce traitement aussi barbare qu’imprévu.
– Nous ne pouvons rien vous dire ! telle fut la réponse qu’il obtint.
– Cependant, on n’arrête pas les gens sans leur en fournir le motif ! gronda le jeune homme ! Et pourquoi ce masque ! Ôtez-le ! Il me gêne !
– Monsieur, répondit Durbec de sa voix doucereuse, ce que vous me demandez-là est tout à fait impossible ! Je dois même ajouter que si vous manifestez, au cours de ce voyage, la moindre envie de nous quitter, ou si vous cherchez à intéresser des étrangers à votre sort par une façon quelconque, nous n’hésiterons pas à vous tuer. Nous en avons reçu l’ordre formel !
Cependant, tandis que le carrosse fermé galopait ainsi sur la route de Marseille, emportant le fils de la reine vers une destination qu’il ne soupçonnait pas encore, d’autres événements se passaient au château de Chevreuse.
Le cheval d’Henry, habitué aux caprices de son maître, s’était mis tranquillement à brouter les jeunes pousses ; toutefois, lorsque Henry eut été transporté dans le carrosse et que celui-ci eut disparu au grand galop de ses quatre chevaux, la bête avait paru inquiète. Après avoir poussé deux ou trois hennissements d’appel, voyant que personne ne revenait, elle s’était décidée à reprendre tout doucement le chemin de l’écurie.
Lorsqu’on s’aperçut, à Chevreuse, que le cheval revenait seul, il y eut un moment d’affolement. Pour que sa monture revienne sans Henry, il fallait que celui-ci ait été victime d’un accident !
Le précepteur du jeune prince, l’abbé Vertot, dès que le jardinier vint le prévenir de ce qui se passait, ordonna des recherches, fort inquiet, et persuadé que son élève était victime d’une chute. À son idée, il devait être resté par là, évanoui sans doute, et privé de secours.
Il tint à se joindre lui-même aux chercheurs, malgré son âge. Il savait quelle responsabilité il avait, vis-à-vis de la duchesse et du chevalier de Castel-Rajac.
Mais ce fut en vain qu’ils parcoururent les champs et la forêt, qu’ils interrogèrent ceux qu’ils rencontrèrent. Nul ne put leur donner un renseignement.
Cependant, au moment où ils commençaient à désespérer de le trouver, ils avisèrent deux petites bergères qui se souvenaient parfaitement avoir vu Henry pénétrer dans le bois et qui purent même leur indiquer par quel chemin.
Les gens du château et l’abbé se dirigèrent aussitôt vers cet endroit. Il avait plu la nuit, et les traces de fer du cheval étaient aisément reconnaissables.
Ils arrivèrent de la sorte jusqu’au lieu de l’attentat. Le jardinier se pencha, examina les herbes, foulées, piétinées, et il s’exclama :
– Monsieur l’abbé, regardez donc ! Voici les roues d’un carrosse ! On dirait qu’il y a eu lutte !
Les indices étaient évidents. L’abbé essuya son front baigné de sueur.
– Que Dieu le protège ! murmura-t-il. Le malheureux enfant a été enlevé !
Ils revinrent au château en toute hâte. Au passage, les bergères, interrogées de nouveau, affirmèrent avoir remarqué un carrosse clos qui était sorti au grand galop de la forêt, entouré d’une escorte de soldats armés.
L’enlèvement se confirmait.
La petite troupe, consternée, rentra en grande hâte au château.
Dès qu’ils furent arrivés, l’abbé s’assit à son écritoire, traça un billet pour Castel-Rajac, le scella, et appela un domestique qu’il savait dévoué au chevalier :
– Colin, dit-il, cours à Paris sans perdre un instant. Tu remettras ce billet de toute urgence à M. le lieutenant de Castel-Rajac ! En ces circonstances, lui seul peut faire quelque chose !
Le valet, un jeune gars déluré, ne se fit pas répéter la commission.
Il fit si bien diligence qu’il arriva à Paris dans le minimum de temps. Il courut au Louvre, et demanda à parler d’urgence à M. le chevalier de Castel-Rajac.
Celui-ci accourut, pressentant un malheur.
Dès qu’il eut parcouru la missive, sa figure se crispa. Il proféra un sonore : « Mordiou ! » et courut chez M. de Guissancourt.
– Capitaine, dit-il d’une voix altérée, je vous prie de me donner congé tout de suite. Un événement grave vient de se passer chez moi, on me mande d’urgence.
– Allez, lieutenant, répondit l’officier, qui savait que Gaëtan ne solliciterait pas une permission durant son service sans un motif important.
Castel-Rajac ne se fit pas répéter l’invitation. Il courut chercher sa monture, et revint à francs étriers avec le jeune valet.
Dès qu’il fut arrivé, l’abbé Vertot lui confirma ce qu’il lui disait dans sa lettre, et les explications que Colin lui avait déjà fournies.
– Les misérables ! gronda-t-il en tortillant nerveusement sa moustache. Oh ! mais cela ne se passera pas ainsi ! je le sauverai ou je le vengerai !
Une seule chose importait avant tout : mettre la duchesse au courant.
Et c’était cette nouvelle que Gaëtan allait porter à Saint-Germain à Mme de Chevreuse.
CHAPITRE III
OÙ CASTEL-RAJAC PART EN CAMPAGNE
La duchesse de Chevreuse ne logeait pas au château de Saint-Germain, résidence principale de la cour. Elle avait préféré, afin de garder plus aisément cette liberté à laquelle elle tenait tant, demeurer dans un hôtel particulier de la ville où elle pouvait recevoir qui bon lui semblait.
Ce jour-là, après avoir rendu sa visite quotidienne à son amie la reine Anne d’Autriche, Marie de Rohan, qui avait conservé presque intégralement son éclatante beauté et entièrement son charme, son esprit et sa grâce, était rentrée chez elle et s’était retirée dans un petit boudoir où elle avait l’habitude d’écrire à ses amis.
Installée devant un petit bureau, elle avait adressé une première missive à l’une de ses cousines de province, lorsqu’on lui annonça que M. le lieutenant de Castel-Rajac sollicitait l’honneur d’être reçu par elle.
Surprise par cette visite à laquelle elle ne s’attendait guère et pressentant une catastrophe, elle donna l’ordre de faire entrer aussitôt le chevalier.
Dès que celui-ci parut sur le seuil, tout de suite, la duchesse, devinant la vérité, s’écria :
– Henry ! n’est-ce pas ?
– Disparu, fit simplement Gaëtan, dont la voix s’étrangla.
Tandis que Mme de Chevreuse s’effondrait sur un siège, le mousquetaire articula :
– Il a certainement été enlevé hier au cours d’une promenade, qu’il faisait en forêt.
S’efforçant de se ressaisir, Mme de Chevreuse reprit :
– Ce que je redoutais est arrivé. La ressemblance était trop frappante et c’est ce qui a perdu ce malheureux.
» Quand je pense, qu’hier encore, j’adjurais la reine d’éloigner Henry ! Il était fatal que sa ressemblance avec le roi attirât sur lui l’attention des gens.
» Tant que le cardinal de Mazarin a vécu, j’étais tranquille, je savais qu’il ne permettrait pas que l’on touchât à son fils et que sa toute-puissante sauvegarde mettait à l’abri ce malheureux jeune homme de tout attentat et même de toute persécution.
» Mais, Mazarin mort, il fallait bien s’attendre à ce que l’on cherchât à anéantir cette réplique vivante du roi ! Pourvu qu’ils ne l’aient pas assassiné. »
À ces mots, Gaëtan eut un frémissement de tout son être.
– S’il en était ainsi, s’écria-t-il, il serait bientôt vengé !
– Calmez-vous, mon ami, reprit la duchesse. Plus que jamais nous allons avoir besoin de toute notre présence d’esprit, de tout notre sang-froid, pour déjouer l’intrigue qui a coûté la liberté à notre cher Henry ; car, plus j’y songe, moins je crois que ses ennemis ont osé le tuer. Selon moi, ils se sont emparés de lui, l’ont emmené et l’ont enfermé dans une citadelle.
– Pourquoi ? Pourquoi ? interrogea Castel-Rajac, dont l’immense douleur se lisait sur le visage.
– Raison d’État, répliquait la duchesse.
– Raison d’État ?
– Oui. Certains ont pu redouter qu’une ressemblance aussi extraordinaire ne provoque un jour quelque coup d’éclat, en dressant tout à coup, en face du roi, un frère rival, dont les factieux, qui n’ont point désarmé, eussent fait leur chef.
– Voilà, s’écria le Gascon, une chose que je n’aurais jamais imaginée.
– C’est parce que, mon ami, déclara Mme de Chevreuse, vous vous êtes toujours tenu à l’écart de la politique et que vous êtes si droit, si franc et si loyal, que vous ne pouvez penser au mal.
– Milledious ! ragea le Gascon. Pouvoir passer mon épée au travers du corps de celui qui a conçu un tel forfait et des gredins qui l’ont exécuté !
– Prenez garde, ami, avertit la duchesse. Oui, prenez garde, car vous seriez obligé, peut-être, de frapper trop haut.
– Que voulez-vous dire ? s’exclama le père adoptif d’Henry.
– Pour l’instant, ne m’interrogez pas.
– Le roi, laissa échapper Gaëtan.
– Silence !
– Mais non, dit le Gascon, le roi… admettons qu’il eût appris la vérité, est incapable d’un acte de félonie.
– J’en suis convaincue, moi aussi, appuya Mme de Chevreuse.
– Alors, qui ?
– Vous connaissez Colbert ?
– Alors, vous croyez…
– Ce ne peut être que lui…
– Ce grimaud aux yeux torves et aux sourcils broussailleux…
– Qui a l’étoffe d’un grand ministre et qui ne tardera pas à le devenir.
» Vous allez voir, mon ami, que ce n’est point sur des impressions plus ou moins vagues que j’accuse Colbert d’avoir fait enlever le fils de Mazarin et d’Anne d’Autriche, le demi-frère de son roi, mais sur un fait précis, qui ne peut que renforcer ma conviction et décider la vôtre. »
Et la duchesse fit avec force :
– Ces jours derniers, j’ai vu sortir du cabinet de M. Colbert, un homme que vous connaissez bien et qui, comme vous et moi, est au courant du secret de la naissance d’Henry.
– M. de Durbec ?
– Oui !…
– Alors, il n’y a pas d’hésitation possible ! Marie, vous avez deviné la vérité. Je sais ce qu’il me reste à faire.
– Quoi donc ?
– Je vais aller de ce pas trouver M. de Durbec et le sommer de me dire ce qu’il a fait d’Henry.
– Il ne vous dira rien.
– Alors je le tuerai.
– Mauvais moyen, mon cher Gaëtan, car vous aurez détruit ainsi votre seule source d’information.
– Mais, bouillonna littéralement le Gascon, puisque vous prétendez qu’il ne dira rien !
– Oui, si vous employez la menace, pas, si vous employez la ruse. Au cours de votre existence, vous m’avez déjà souvent prouvé que vous saviez vous servir aussi adroitement de cette arme que vous utilisez vaillamment votre épée.
– Marie, comme toujours, vous avez raison. J’étais fou de douleur et de rage, mais n’est-ce pas effroyable de penser qu’on m’a volé mon fils ? Après vous, Marie, c’est l’être que j’aime le mieux au monde.
– Vous pouvez dire : avant moi, mon cher Gaëtan, je ne serai pas jalouse.
– Ah ! Marie, Marie, s’écriait Castel-Rajac en attirant sa maîtresse dans ses bras.
Puis, d’une voix redevenue toute vibrante d’énergie la plus magnifique, le chevalier s’écria :
– Ne pensons plus à nous. Ne songeons plus qu’à lui. Il me vient une idée.
– Dites ! s’écriait Marie de Rohan, qui avait toute confiance dans la fertilité d’invention du Gascon.
– Si je me déguisais de telle façon qu’il serait impossible à l’œil le plus exercé de me reconnaître et si je m’attachais à suivre M. de Durbec, ne pensez-vous pas que j’arriverais à surprendre certains renseignements qui nous mettraient sur la voie de la vérité ?
– J’en suis persuadée ! déclara la duchesse.
– Dès à présent, je vais me mettre en chasse, dit le chevalier. Je suis en congé pour huit jours. Il faudrait vraiment, si je n’arrivais pas dans ce délai à un bon résultat, que Dieu fût contre nous, et cela n’est pas possible.
La duchesse s’écria :
– Vous ne pouvez vous imaginer, mon ami, combien je suis heureuse de vous entendre parler ainsi.
Gravement, Castel-Rajac reprit :
– J’ai juré de défendre et, au besoin, de sauver Henry, je tiendrai mon serment jusqu’au bout.
– Allez, mon ami, encouragea la duchesse, car je devine que vous avez grande hâte d’entrer en campagne.
– Certes !
– Un mot, cependant.
– Je vous en prie.
– Faites que la reine n’apprenne pas la disparition d’Henry, car elle ne serait pas assez forte pour cacher sa douleur, et les manifestations auxquelles elle se livrerait ne pourraient que compromettre définitivement celui que nous voulons arracher à ses geôliers.
– Comptez sur moi, affirma Gaëtan. J’espère bien, d’ici peu, vous apporter la bonne nouvelle.
Et, après avoir serré tendrement son amie dans ses bras, il partit, tout son être tendu vers la délivrance de celui auquel il avait donné toute son âme.
Le généreux Gascon allait, cette fois, se heurter contre le néant.
M. de Durbec était introuvable.
Discrètement, Castel-Rajac s’informa de lui. On lui répondit qu’il avait été chargé d’une mission auprès du roi de Perse…
Et ce ne fut qu’au bout d’une longue année qu’il reparut à la Cour.
Deux soirs après, dans le grand parc qui s’étendait alors autour du château de Saint-Germain, le chevalier de Durbec, qui venait d’avoir un long entretien avec Colbert, se promenait pensivement dans une allée lorsque, tout à coup, il fut abordé par un individu, vêtu en laquais.
Sans prononcer une parole, l’individu présenta à M. de Durbec un bijou vulgaire, sorte de broche en argent, en forme d’éventail, attachée au bout d’une chaînette de métal.
M. de Durbec, tout en demeurant impassible, dit à mi-voix, afin de ne pas être entendu des quelques seigneurs qui se promenaient aux alentours :
– Suivez-moi à une distance de vingt pas, jusqu’à ce que je m’arrête. Alors, seulement, vous me rejoindrez.
Immédiatement, il se dirigea vers la terrasse qui s’élevait en bordure de la forêt. Il marcha jusqu’à ce qu’il n’aperçût plus autour de lui aucune ombre indiscrète, puis, il s’immobilisa à la lisière d’une allée.
Observant ses instructions, l’inconnu le rejoignit aussitôt. Durbec, qui semblait désireux de s’assurer d’une sécurité absolue, dit à l’homme :
– Allons encore un peu plus loin, cela sera plus prudent.
Ils s’enfoncèrent sous bois. Ils arrivèrent jusqu’à une clairière.
– Ici, nous serons tranquilles, fit M. de Durbec.
S’adressant au laquais, qui observait toujours envers lui une attitude déférente, il fit :
– Maintenant vous pouvez parler.
L’homme déclara :
– Je suis envoyé près de vous par M. de Saint-Mars, le gouverneur de l’île Sainte-Marguerite, qui m’a chargé de vous rendre compte du fait très grave qui vient de se passer là-bas.
» Échappant à la surveillance rigoureuse dont il est sans cesse l’objet, le prisonnier que vous savez a réussi à tracer quelques lignes de son écriture avec un couteau sur une assiette d’argent, et a jeté l’assiette par la fenêtre vers un bateau qui était presque au pied de la tour.
» Un pêcheur, à qui ce bateau appartenait, a ramassé l’assiette et l’a rapportée au gouverneur. Celui-ci, étonné, a demandé au pêcheur :
» – Avez-vous lu ce qui est écrit sur cette assiette ? Et quelqu’un l’a-t-il vue entre vos mains ?
» – Je ne sais pas lire, répondit le pêcheur, je viens de la trouver, personne ne l’a vue.
» M. de Saint-Mars a retenu cet homme jusqu’à ce qu’il fût bien informé qu’il ne l’avait jamais lue et que l’assiette n’avait été vue de personne.
» – Allez, lui dit-il, vous êtes bien heureux de ne pas savoir lire.
» En effet, voici les mots qui avaient été tracés sur l’assiette par le prisonnier :
» Que celui qui trouvera cet objet prévienne mon père que je suis prisonnier dans le château de l’île Sainte-Marguerite, et que je le supplie de venir me délivrer. – HENRY DE CASTEL-RAJAC.
» Conformément aux prescriptions qu’il avait reçues de la bouche même de M. de Colbert, M. le gouverneur m’a immédiatement ordonné de me rendre à Paris et de brûler les étapes, afin de vous rendre compte de cet incident et de vous demander de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures il devra prendre, désormais, à l’égard du prisonnier. »
M. de Durbec, que ces révélations semblaient vivement contrarier, réfléchit un instant, puis il dit :
– On lui a bien adapté ce masque de fer que j’avais imaginé ?
– Oui, monsieur.
– L’expérience a prouvé qu’il ne pouvait se l’enlever lui-même ?
– Absolument.
– Les ressorts d’acier qui lui laissent la liberté de manger avec le masque sur le visage fonctionnent normalement ?
– Oui, monsieur, mais, au cas où ils se détraqueraient, M. le gouverneur s’est procuré un masque absolument semblable à celui-ci et, de ce côté, aucune surprise n’est à craindre.
– Le prisonnier est toujours gardé au secret le plus absolu ?
– Oui, monsieur.
– Qui le sert ?
– Un homme tout à fait sûr. Un ancien pêcheur de la côte en qui nous pouvons avoir d’autant plus confiance qu’il sait très bien que s’il nous trahissait, il le paierait immédiatement de sa vie.
– Comment s’appelle cet individu ?
– Jean Martigues.
– Vous n’avez pas autre chose à me dire ?
– Non, monsieur, j’attends vos instructions.
– Je n’en ai pas à vous donner. L’affaire est assez importante pour que je les apporte moi-même à M. le gouverneur de Sainte-Marguerite. Je partirai dès demain.
– Les routes ne sont pas très sûres, et deux hommes déterminés valent mieux qu’un, si brave soit-il. Voulez-vous me permettre de vous accompagner ?
– J’accepte votre offre, déclara Durbec. Et, maintenant, séparons-nous, car il est inutile qu’on nous voie ensemble. Depuis mon retour, je me suis aperçu que j’étais filé par un espion, sans doute aux gages du chevalier de Castel-Rajac ; voilà pourquoi, ce soir, j’ai pris toutes les précautions en vue d’assurer à notre entretien le secret le plus absolu.
– Où vous trouverai-je, demain, monsieur ?
– En bas de la côte de Saint-Germain, devant l’auberge du Franc-Étrier.
– À quelle heure ?
– Au premier coup de l’Angélus du matin.
Ils s’éloignèrent sans rien ajouter. Lorsqu’ils furent à une certaine distance, dégringolant du chêne sous lequel avaient été tenus les propos que nous venons de rapporter, un homme sauta à terre.
C’était Gaëtan-Nompar-Francequin de Castel-Rajac.
Le chevalier, qui avait conservé toute l’agilité de sa jeunesse, avait, ce soir-là, réussi à pister son ennemi sans attirer sur lui son attention. Il l’avait vu s’engager sous bois avec l’émissaire de M. de Saint-Mars. Alors, il s’était faufilé jusqu’à l’un des arbres de la clairière, au centre duquel il avait réussi à parvenir et à s’installer, surprenant ainsi le secret que, depuis de longs mois, il brûlait de connaître.
Maintenant, il n’en demandait pas davantage. Pour lui, le principal était fait. Et, tout en regagnant le château de Saint-Germain, il se disait :
– Ah ! les misérables, ils ont osé mettre sur son beau visage un masque de fer. Eh bien ! non seulement je lui arracherai ce masque, à ce cher et noble enfant, mais je l’arracherai, lui aussi, à ses bourreaux !
CHAPITRE IV
LE FRÈRE DU ROI
L’homme au masque de fer s’était réfugié dans un silence non point de résignation, mais de dignité. Et il s’était efforcé d’éclaircir lui-même une énigme que M. de Durbec et M. de Saint-Mars ne voulaient pas lui expliquer.
Alors, il revécut par la pensée toutes les phases de son existence. Par un effort prodigieux de mémoire, le fils de Mazarin et d’Anne d’Autriche en arriva à reconstituer, jusque dans leurs plus petits détails, toutes ses années depuis qu’il avait l’âge de raison. Une fois en possession de tous les faits qui formaient sa vie, l’un domina tout : sa ressemblance avec le roi, qui ne lui avait pas échappé, et au sujet de laquelle, à plusieurs reprises, il avait interrogé son père, ou du moins celui qu’il croyait l’être.
Mais le chevalier lui avait toujours répondu : « C’est un effet du hasard. » Et Henry s’était toujours contenté de cette explication sommaire, qu’il estimait cependant décisive, tant il croyait l’homme qui l’avait élevé, incapable non pas du moindre mensonge, mais de la plus légère inexactitude.
Maintenant, un doute germait en lui avec une persistance sans cesse croissante, et il entrevoyait la vérité comme à travers une brume.
Se rappelant aussi des visites que lui avait faites, au cours des premières années où il se trouvait au manoir de Chevreuse, une dame qui lui parlait avec tant de douceur et le serrait tendrement dans ses bras, et qu’un jour il avait reconnu au milieu d’un brillant cortège pour la reine Anne d’Autriche, il en arrivait non plus à se demander : « Si elle était ma mère ! » Mais à se dire : « Je suis son fils ! »
Alors, le cœur de plus en plus serré, il songeait qu’en ce cas le chevalier de Castel-Rajac ne pouvait être son véritable père, car, en grandissant, bien que le chevalier ne lui eût fait aucune confidence et qu’il ne se fût jamais permis de lui adresser la moindre question indiscrète, Henry n’avait pas été sans se rendre compte des liens si puissants et si tendres qui unissaient la duchesse de Chevreuse à Castel-Rajac. Et, logiquement, sainement, il en concluait que le chevalier ne pouvait être que son père adoptif. Alors, quel était le véritable ? Ce ne pouvait être Louis XIII, puisque, en effet, Henry était né un an avant Louis XIV et, si sa légitimité n’avait pas été impossible à établir, il eût été proclamé héritier de la couronne.
Si donc on l’avait fait disparaître, si la reine, par l’intermédiaire de son amie Mme de Chevreuse l’avait confié au chevalier de Castel-Rajac et avait demandé à celui-ci de lui donner son nom et de lui servir de père, c’était parce qu’il fallait cacher à tout prix sa venue au monde, c’était parce qu’il était le fils de l’adultère !
S’expliquaient ainsi les paroles que Richelieu avait adressées à Castel-Rajac en prenant congé de lui dans la grande salle du château de Pau, paroles que lui, Henry, n’avait jamais oubliées, tant elles avaient laissé dans son esprit une impression ineffaçable.
À moins que son père ne le délivrât, et il en était sûr, il était condamné à vivre et à mourir dans son cachot.
Cette ressemblance l’avait à tout jamais perdu. Pourtant, Dieu sait qu’il n’avait jamais eu l’intention d’en tirer le moindre profit, et qu’il se trouvait heureux de la vie que son père lui avait faite. Il ne demandait qu’à suivre ses traces, à être un soldat comme lui, à verser son sang pour celui dont il était la réplique vivante, pour son frère que, même maintenant, au fond de sa misère, il ne demandait qu’à aimer, car il se disait :
– Il n’est pas possible que ce soit lui qui ait voulu cela. Sait-il même si j’existe ?
Et, avec une clairvoyance qui montrait combien il était resté maître de sa conscience et de ses esprits, il ajoutait :
– Ce sont ceux qui l’entourent qui ont dû se rendre coupables de ce forfait. Et pourquoi, grand Dieu ?… Pourquoi me craignent-ils ? Parce qu’ils ne me connaissent pas. Mais si je les voyais, je leur dirais qu’ils n’ont rien à redouter de moi, que je suis prêt à m’éloigner, que je n’ai aucune ambition et que, ne voulant pas être le témoignage vivant de la faute d’une mère, je suis prêt à m’en aller loin, très loin, et ne jamais reparaître.
C’était dans ces dispositions d’âme qu’Henry, un jour, plongé dans un mutisme dont rien ne semblait devoir le faire départir, après être arrivé à Cannes, avait franchi dans une barque, en compagnie de M. de Saint-Mars, de M. de Durbec et de son escorte, la faible distance qui sépare de la côte le délicieux petit archipel méditerranéen dont fait partie l’île Sainte-Marguerite.
Tout de suite, on l’avait conduit dans la prison qui lui était destinée.
Ce n’était pas à proprement parler un véritable cachot, mais plutôt une vaste salle qui avait servi, autrefois, de cabinet au gouverneur. Les murailles, dont on apercevait les grosses pierres, que ne recouvrait aucun enduit, étaient d’une épaisseur telle qu’elles semblaient à l’abri même de l’artillerie. Deux fenêtres assez larges et assez hautes, mais garnies de barreaux de fer d’une solidité à toute épreuve, donnaient sur la mer. Les meubles en bois, d’une simplicité presque rudimentaire : table, chaises, escabeaux, un lit garni d’une simple couverture de laine brune formaient tout l’ameublement.
M. de Saint-Mars présenta ensuite au prisonnier Jean Martigues, le pêcheur qui devait lui servir de valet.
Toujours sans prononcer un mot, Henry accueillit ces explications. On eût dit qu’il avait fait le vœu de ne plus prononcer une parole. Trois jours s’écoulèrent, pour lui monotones, interminables. Ne mangeant que le strict nécessaire, car on eût dit qu’une force intérieure le poussait à vivre, le fils de Mazarin et d’Anne d’Autriche usait son temps soit à lire les quelques livres que M. de Saint-Mars lui apportait lui-même, et lui reprenait, non sans avoir soigneusement vérifié s’il n’y manquait pas un feuillet, soit en passant de longues heures devant la fenêtre de son cachot à contempler la mer, tantôt plus bleue que le ciel, calme comme les eaux d’un lac italien, tantôt agitée, démontée et venant battre de ses vagues furieuses les rochers rougeâtres sur lesquels reposaient les murs de la citadelle.
Lorsque, longtemps, très longtemps après, – il y avait bien un an qu’il était ainsi captif, – par un beau jour de printemps où la mer et le ciel n’avaient jamais été d’un plus bel azur, où les rayons du soleil miroitaient sur les flots et où une brise légère gonflait les voiles qui sillonnaient l’horizon, un soupir d’espérance dilata sa poitrine.
Il venait d’apercevoir, en effet, passant tout près de lui, sur une barque de pêcheurs, trois hommes dans lesquels, bien qu’ils fussent habillés en matelots, il reconnut les silhouettes bien caractéristiques du chevalier de Castel-Rajac, de M. d’Assignac et de M. de Laparède.
Ignorant qu’on avait rapporté au gouverneur le plat qu’il avait lancé un jour à ce pêcheur à travers les barreaux de sa prison, il se figura que son appel avait dû parvenir jusqu’au chevalier et que, dès que celui-ci l’avait entendu, il était accouru le délivrer. Il ne douta pas un seul instant que celui-ci ne parvînt promptement à l’enlever à ses geôliers. Aussi se décida-t-il à attendre les événements qui se préparaient avec une confiance totale envers son sauveur.
Comme la barque passait une seconde fois encore plus près de l’île, la porte de son cachot s’ouvrit et livra passage à M. de Saint-Mars, que suivait Jean Martigues, apportant le repas du prisonnier. Henry quitta aussitôt la fenêtre et s’en fut s’asseoir devant sa table.
M. de Saint-Mars, qui avait renoncé à adresser la parole à Henry – car celui-ci avait continué à persister dans son mutisme, – se contenta de déposer devant lui un nouveau livre et de reprendre celui qu’il avait apporté quelques jours auparavant. Après s’être légèrement incliné, il s’en fut, laissant seul le captif et son serviteur.
Celui-ci, qui n’avait jamais parlé à Henry, pas plus que celui-ci, d’ailleurs, ne lui avait jamais fait entendre le son de sa voix, déposa sur la table un plateau qu’il tenait à la main. Il allait se retourner, comme il le faisait habituellement, dans l’un des angles de la pièce, lorsque, à sa grande surprise, d’un geste impérieux, le prisonnier le retint sur place.
– Mon ami, dit-il, veuillez prévenir M. le gouverneur que les ressorts de mon masque sont dérangés, et qu’il m’est absolument impossible de faire honneur au repas qu’il m’envoie.
Jean Martigues demeura un instant sidéré d’entendre cet homme muet jusqu’alors lui parler pour la première fois.
Se méprenant sur la cause de son attitude, Henry reprit :
– Vous ne m’avez donc pas compris, mon ami, ou bien avez-vous reçu des ordres tels que vous jugiez impossible de me rendre ce service ?
Martigues, qui était un sot, mais pas un mauvais homme, répondit :
– Monsieur, excusez-moi, je croyais que vous étiez privé de l’usage de la parole… Mais je vais prévenir tout de suite M. le gouverneur.
Et il ajouta, plein d’une pitié sincère :
– Ah ! si cela ne dépendait que de moi, il y a longtemps que je vous l’aurais enlevé, ce masque ! Ce doit être si dur de vivre là-dessous, surtout pour un homme jeune comme vous. Moi, je n’aurais jamais eu votre courage.
» Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais n’avoir jamais fait entendre aucune plainte et avoir gardé en vous toutes les douleurs que vous devez souffrir, ça prouve que vous avez beaucoup de courage ! »
À ces mots, Henry se sentit envahi d’une émotion indicible. C’était la première fois, depuis son enlèvement, qu’il entendait vibrer à ses oreilles une parole de compassion, et cela juste au moment où il venait d’acquérir la certitude que Gaëtan travaillait à sa délivrance avec ses amis.
Décidément, la Providence ne l’avait pas abandonné.
Jean Martigues reprenait :
– Excusez-moi, monsieur, je vais prévenir tout de suite M. le gouverneur.
Il s’en fut aussitôt.
Dès qu’Henry eut perçu le bruit des verrous et des chaînes qui indiquait que Martigues venait de l’enfermer, il se précipita vers la fenêtre, afin de revoir la barque qui portait ses futurs libérateurs.
Il l’aperçut, cette fois, à quelque distance de l’île. Elle rejoignait la côte dans la direction de Cannes.
Henry se dit :
« Ils sont venus simplement me dire qu’ils étaient là. Je les attends. »
Il retourna vers la table et, lorsque le gouverneur reparut, à son vif étonnement, il trouva son prisonnier en train de prendre son repas.
D’un ton pincé, il dit à son prisonnier :
– Or çà, monsieur, vous me faites mander pour que je vous change votre masque, mais je m’aperçois que celui-ci fonctionne à merveille.
M. de Saint-Mars, qui portait à la main un masque absolument pareil à celui qui dissimulait la figure du prisonnier, fit, d’un ton toujours acerbe, bien qu’empreint d’une certaine déférence :
– Je regrette, monsieur, que, pour une première fois que vous ayez daigné reprendre la parole, ce soit pour me causer un inutile dérangement.
Tout en reposant sur la table le verre qu’il s’apprêtait à porter à sa bouche, Henry répliqua d’un ton ferme :
– Monsieur le gouverneur, excusez-moi, mais ce mécanisme, qui s’était détraqué, vient de se rétablir de lui-même.
M. de Saint-Mars, qui ne pouvait moins faire que d’accepter cette explication fort plausible, reprit, cette fois, avec amabilité :
– Je ne puis que me féliciter de cet accident qui me permet de rompre un silence qui, jusqu’alors, m’a été profondément pénible.
– Monsieur le gouverneur, reprit Henry, j’ai pour principe de ne parler que lorsque j’ai quelque chose à dire… et, comme je n’avais rien à vous dire, je me taisais.
– Pourtant, objecta M. de Saint-Mars, je vous avais mis bien à votre aise, puisque je vous ai prévenu que, si vous aviez quelques réclamations à m’adresser, je les écouterais toujours avec bienveillance, et que je ferais en sorte de leur donner satisfaction dans le domaine du possible.
D’un ton ironique, le fils adoptif de Gaëtan reprenait :
– Monsieur le gouverneur, je n’aurais qu’une réclamation à vous faire, mais vous ne pourriez y donner suite.
– Dites toujours, fit M. de Saint-Mars.
– Ce serait de me rendre la liberté.
– Vous avez raison, monsieur, il ne faut point y compter.
– Alors, conclut Henry, il y a bien des chances, monsieur le gouverneur, pour que vous n’entendiez plus d’ici longtemps le son de ma voix.
Jugeant inutile d’insister, M. de Saint-Mars s’inclina. Le jeune homme, à travers les trous de son masque, lui jeta malgré lui un regard de défi. M. de Saint-Mars se retira, laissant le captif achever son déjeuner et savourer le beau rêve d’espoir qui mettait déjà du soleil dans son âme endeuillée.
*
* *
Le même soir, vers dix heures, dans une maison isolée située aux alentours de Cannes, à l’entrée de la route en lacets qui conduisait, à cette époque, jusqu’à la hauteur de Théoule, et un peu en arrière du village de La Napoule, un grave conciliabule était tenu entre Mme de Chevreuse et le chevalier Gaëtan.
Tous deux se trouvaient dans une pièce de faible dimension, assez sommairement meublée, dont la porte était fermée par un verrou à l’intérieur, et dont les deux fenêtres étaient recouvertes d’épaisses tentures.
M. de Castel-Rajac, qui avait vraiment très belle allure sous son costume d’officier de mousquetaires, se tenait debout, la main sur la garde de son épée, le regard énergique et le sourire aux lèvres.
Mme de Chevreuse, que l’assurance de son chevalier semblait rassurer, lui disait :
– Alors, vous êtes décidé à renouveler vos exploits du château de Montgiron ?
– Parfaitement ! répliqua le Gascon d’un air décidé.
– N’est-ce point vous mettre en rébellion directe contre le roi, auquel vous avez fait serment de fidélité ?
– C’est possible, mais, ma belle amie, j’avais fait, auparavant, un autre serment, celui de défendre, quoi qu’il arrive, envers et contre tout, mon fils d’adoption. C’est le seul qui compte, car, lorsque j’ai fait le second, je ne pouvais pas prévoir qu’il serait en contradiction avec le premier.
» Ma bonne foi est donc évidente. D’ailleurs, je ne serais nullement surpris que le roi, lorsqu’il saura la vérité, non seulement me pardonne d’avoir mis fin à une infamie commise en son nom et dont il ne pouvait avoir eu connaissance, mais que, lorsque je lui aurai dit et prouvé que son frère n’a aucunement l’intention de lui disputer une couronne à laquelle il n’a aucun droit, mais qu’il veut vivre dans son ombre comme le meilleur et le plus fidèle de ses sujets, Sa Majesté, qui nous a déjà tant donné de preuves de son intelligence et de sa noblesse d’âme, ne tende la main au fils de sa mère. »
Remarquant que Marie de Rohan ne semblait pas partager son optimisme, Castel-Rajac poursuivait :
– On dirait que vous êtes encore inquiète !
– Mais non !
– Mais si ! Vous effraierais-je avec ce projet qui, pourtant, me semble le seul réalisable, si nous voulons vraiment sauver Henry ?
– Non, répondit la duchesse avec fermeté, non, mon ami, vous ne me faites pas peur. Je vous admire, au contraire, de toutes mes forces, car votre loyauté est telle que vous la prêtez à tous avec une générosité imprudente. Voilà pourquoi, si je n’ai point peur de vous, j’ai peur pour vous, et cela me déchirerait le cœur s’il vous arrivait malheur au cours de cette si redoutable aventure.
» N’est-ce point moi qui en serais la cause, puisque c’est moi qui, jadis, vous ai amené cet enfant que, si généreusement et si noblement, vous avez pris sous votre sauvegarde ? »
Et, avec une profonde mélancolie, Mme de Chevreuse ajouta :
– Combien, aujourd’hui, je regrette d’avoir cédé aux instances de la reine.
– Ne dites pas cela, interrompit vivement Castel-Rajac. En agissant de la sorte, non seulement vous m’avez prouvé dans quelle estime vous me teniez, mais vous m’avez encore donné l’occasion d’accomplir un acte qui sera l’honneur et l’orgueil de ma vie : façonner un cœur, former une âme, créer de toutes pièces un vrai gentilhomme et lui forger de mes mains cette armure morale qui le met à l’abri de toutes les bassesses et de toutes les turpitudes de ce monde ! »
Comme des larmes apparaissaient dans les beaux yeux de la duchesse, Castel-Rajac s’avança vers elle et, l’attirant dans ses bras, il lui dit :
– Ne pleurez pas. Marie. Je le sens, je vaincrai et, bientôt, demain, cette nuit, peut-être, je vous ramènerai celui qu’on m’avait volé, je vous restituerai le dépôt que vous aviez remis entre mes mains et, après avoir mis en sûreté celui que je persiste et persisterai toujours à considérer comme mon fils, vous pourrez retourner près de votre amie et lui dire que, vous aussi, vous avez tenu votre serment.
– Ah ! mon ami, s’écria la duchesse en enlaçant Gaëtan, je vous devrai plus que la vie !
À peine avait-elle prononcé ces mots qu’une petite porte en tapisserie, qui se trouvait tout au fond de la pièce, s’ouvrit, livrant passage à une jeune femme fort élégante et d’une rare beauté.
C’était la comtesse de Lussey, une nièce de la duchesse de Chevreuse, à qui appartenait la maison où Marie de Rohan et Castel-Rajac avaient reçu la plus cordiale hospitalité.
Mme de Lussey avait pour la duchesse, sa marraine, une affection profonde, car elle lui devait la dot qui lui avait permis d’épouser un jeune seigneur méridional et charmant. Aussi avait-elle été enchantée en l’absence de son mari, appelé à Marseille pour affaires de famille, de lui ouvrir toute grande sa demeure.
Quoiqu’elle eût en sa nièce une confiance absolue, Mme de Chevreuse s’était bien gardé de communiquer à celle-ci le motif de son voyage en ces régions lointaines. Elle lui avait simplement laissé entendre qu’elle accomplissait une mission secrète en compagnie du lieutenant aux mousquetaires Gaëtan de Castel-Rajac. Mme de Lussey n’en avait pas demandé davantage.
Après avoir fait signe de la main à la duchesse et au chevalier de ne pas broncher et de garder le silence, elle s’avança jusqu’auprès d’eux et leur dit tout bas :
– Il y a une heure environ, un cavalier est arrivé ici. Il était porteur d’un ordre signé du roi, enjoignant quiconque de le recevoir et de l’héberger avec les honneurs d’un représentant de Sa Majesté. Il se nomme, ainsi que je l’ai lu sur son sauf-conduit, le baron Tiburce d’Espagnac. Il est d’ailleurs fort laid, suffisamment ridicule, et ne ressemble pas plus à un gentilhomme que le bedeau de ma paroisse ne ressemble au pape.
» Je dois vous dire qu’il m’a inspiré tout de suite la plus légitime méfiance. Maintenant, j’en suis certaine, ainsi que vous allez le voir, ce M. d’Espagnac est tout simplement un policier qui, à l’aide d’un faux blanc-seing, s’est introduit dans ma maison pour vous surveiller et tâcher de surprendre vos secrets.
» En effet, après m’avoir raconté qu’il était brisé de fatigue et qu’il désirait se reposer, il a prié qu’on le conduisît dans la chambre que je lui destinais.
» Tout d’abord, je lui ai demandé pourquoi il avait choisi ma maison de préférence à une autre. Il m’a déclaré que c’était uniquement parce qu’elle était la seule dans tout le pays où il avait remarqué de la lumière.
» Cette réponse, des plus saugrenues, et qui tendrait à prouver que ce jeune policier n’est pas d’une très grande finesse, a éveillé mes soupçons et je me suis promis, aussitôt, d’observer soigneusement le personnage.
» M’étant cachée derrière un paravent dans le couloir sur lequel donne sa chambre, je l’ai vu bientôt entrouvrir sa porte, se glisser dehors, son épée nue sous le bras, et gagner la salle à manger, qui communique avec le salon par cette porte. Je lui ai donné le temps de bien s’y installer. Alors, grimpant sur un escabeau et regardant à travers un petit carreau placé au-dessus de la porte de la salle à manger qui donne dans le vestibule, je l’ai vu, toujours son épée sous le bras et l’oreille collée contre cette porte, en train d’accomplir son ignoble métier de mouchard.
» Voilà pourquoi je me suis empressée de vous prévenir. »
Mme de Lussey avait parlé assez bas pour ne pas être entendue par l’indiscret espion, et assez distinctement, cependant, pour que ni sa marraine ni le chevalier ne perdissent une seule de ses paroles.
Lorsqu’elle eut terminé, Mme de Chevreuse la remercia d’un regard qui en disait plus long que tout un discours, puis, tout doucement, colla son oreille, non point contre la porte à deux battants, derrière laquelle elle supposait devoir se trouver encore le prétendu baron d’Espagnac, mais contre une autre petite porte basse qui, pratiquée dans la boiserie, se confondait avec elle, et dont l’espion ne pouvait soupçonner l’existence.
Elle écouta un instant. Un grincement très significatif du parquet l’éclaira sur la situation et, se tournant vers Castel-Rajac, d’un simple geste, elle lui indiqua la serrure de la porte à deux battants, tout en se livrant à une mimique des plus expressives, qui signifiait très clairement :
« Notre mouchard est là, et nous écoute ! »
Un malicieux sourire entrouvrit les lèvres du Gascon. Tirant son épée du fourreau, il en introduisit la pointe dans le trou de la serrure et, brusquement, il avança le bras.
De l’autre côté du battant, un cri perçant se fit entendre. Vite, Castel-Rajac ramena son épée vers lui. Quelques gouttes de sang en tachaient la pointe. Alors, il bondit sur la porte, repoussa le verrou, ouvrit l’un des panneaux et, l’épée au poing, se précipita dans la pièce en disant au policier qui, tout en se tenant en garde, rompait prudemment vers la sortie :
– Or ça, monsieur le faquin, que faites-vous ici ?
Effaré, le faux d’Espagnac continuait à rompre, mais le Gascon engageait son fer avec le sien et lui disait :
– Ne croyez pas, monsieur le drôle, que je vais avoir l’honneur de vous blesser une seconde fois. Je ne me bats qu’avec de vrais gentilshommes.
D’un coup sec, il désarma le mouchard, qui semblait n’avoir que des notions d’escrime fort approximatives. Et, l’empoignant aussitôt par le col de sa chemise il fit, en le secouant comme un prunier :
– Pauvre imbécile ! Je ne félicite pas ceux qui t’ont envoyé à mes trousses. Quand on veut remplir l’emploi de coquin, on commence par être moins bête.
Et, s’adressant à Mme de Lussey qui, avec Mme de Chevreuse, pénétrait dans la salle à manger il lui dit :
– Vous aviez raison, madame, cet homme est un mouchard ; mais il ne me suffit pas de lui avoir fait une estafilade qui va lui permettre, maintenant, de porter une boucle d’oreille. Je veux encore le mettre hors d’état de nuire, sans toutefois lui ôter la vie. Pouvez-vous m’indiquer, madame, un endroit où je pourrais l’enfermer, sans qu’il puisse s’évader ?
– Très facilement, chevalier, dans la cave !
D’Espagnac, qui s’appelait, en réalité, Pierre Motin, et était bien un agent de la police secrète que Colbert venait de réorganiser et de placer sous la direction de M. de Durbec, eut un mouvement d’effroi.
Castel-Rajac, qui le tenait toujours à la gorge, lui dit :
– Monsieur, estimez-vous donc heureux que je ne vous étrangle pas comme un poulet.
Et, se tournant vers la maîtresse de maison, il lui dit :
– Veuillez, madame, me fournir les moyens d’immobiliser ce drôle jusqu’à ce que nous n’ayons plus à redouter ses indiscrétions.
Mme de Lussey sortit aussitôt pour revenir quelques instants après avec une corde assez mince, mais très résistante, et un gros torchon de cuisine en toile grise.
Après avoir ligoté et bâillonné Pierre Motin, qui, en proie à une frayeur considérable, n’avait pas manifesté la moindre velléité de résistance, Castel-Rajac, conduit et éclairé par Mme de Lussey, emporta dans ses bras, aussi facilement qu’il l’eût fait d’un enfant, l’émissaire de M. de Durbec, saucissonné à un tel point qu’il ne pouvait ni proférer un cri ni esquisser le moindre geste. Après l’avoir enfermé dans une cave qui ne possédait pour toute ouverture qu’un soupirail garni de solides barreaux et qu’une porte en chêne fort épaisse et pourvue d’une serrure qui eût été digne de fermer un cachot de la Bastille ou… de l’île Sainte-Marguerite, Gaëtan remonta dans la salle à manger, où Mme de Chevreuse était restée seule.
Au même moment, un coup de sifflet aigu s’élevait au dehors. Aussitôt, Castel-Rajac dressa l’oreille et, comme un second coup succédait au premier, il fit entre ses dents :
– Le signal, tout va bien, je n’ai plus qu’à les rejoindre !
Se tournant vers Mme de Chevreuse et Mme de Lussey, il leur dit :
– Attendez-moi jusqu’au point du jour. Si, à ce moment, je ne suis pas revenu, c’est que…
Il s’arrêta, dominant l’émotion qui s’était subitement emparée de lui ; puis, reprenant instantanément toute sa belle énergie et sa merveilleuse bonne humeur, il s’écria en adressant à Mme de Chevreuse un sourire dans lequel il fit passer toute son âme :
– Mais je reviendrai !
CHAPITRE V
LA RUSE ET LA FORCE
En quelques enjambées rapides, Castel-Rajac avait rejoint le comte de Laparède qui l’attendait sur la route.
Laconiquement, il lui dit :
– Notre homme est là, sous la garde de notre ami d’Assignac. Nous ne lui avons rien dit encore, mais il a l’air d’un brave garçon, et je crois que nous allons pouvoir nous entendre avec lui.
Prenant son compagnon par le bras, il s’en fut avec lui dans la direction de La Napoule. Ils arrivèrent ainsi jusqu’à l’entrée du village et pénétrèrent par une petite porte donnant sur une cour obscure et déserte dans une salle basse, enfumée, où une vingtaine d’hommes, qui portaient tous l’uniforme des mousquetaires, étaient rassemblés.
À la vue de Castel-Rajac, tous se levèrent, saluant le lieutenant, qui leur répondit avec bienveillance, tout en glissant à l’oreille de Laparède :
– On dirait qu’ils sont vrais.
– Le fait est, murmura Laparède, que ces braves gens portent aussi bien l’uniforme que s’ils étaient des authentiques mousquetaires.
Castel-Rajac, guidé par Laparède, traversa la salle et s’arrêta devant une petite porte que poussa son ami. Il se trouva alors dans une sorte de réduit, occupé par d’Assignac et un second personnage qui n’était autre que Jean Martigues. Celui-ci semblait très troublé et même très effrayé.
Lorsqu’il aperçut M. de Castel-Rajac, il devint plus pâle encore et dirigea vers ce dernier un regard qui semblait implorer pitié.
– Rassurez-vous, mon ami, s’empressa de déclarer le Gascon, personne ici ne vous veut du mal, au contraire. Si mon ami d’Assignac ne vous a rien dit encore, c’est parce qu’il a préféré me laisser le soin de vous parler.
Et, tout en s’asseyant familièrement sur un escabeau en face de l’ancien pêcheur, il lui dit :
– Ce n’est pas une raison, parce que, pour vous amener ici, mes amis ont usé envers vous d’un procédé un peu brutal, pour que vous vous figuriez que nous souhaitons votre mort. Nous sommes ici pour assurer votre fortune.
– Vous plaisantez, monsieur, articula péniblement Martigues.
Le lieutenant aux mousquetaires fronça les sourcils :
– Sachez, fit-il d’un ton sévère, que je ne plaisante qu’avec les gens de ma qualité et que je le fais toujours avec esprit.
– Excusez-moi, monsieur, supplia le valet de l’homme au masque de fer. Je suis tellement ahuri par ce qui m’arrive… Pensez donc que, tout à l’heure, profitant d’une permission de la nuit que m’avait donnée M. le gouverneur de l’île Sainte-Marguerite, j’étais venu à terre pour…
– Embrasser votre bonne amie…
– Oui, oui… bégaya le pêcheur, pour… pour… c’est cela, monsieur, pour embrasser ma bonne amie, lorsque, tout à coup, dix hommes, que je n’avais point vus, parce qu’ils se cachaient derrière les rochers, se sont précipités sur moi, au moment où je sautais de ma barque, et m’ont amené ici en me menaçant si je poussais seulement un cri, de me faire jaillir les tripes hors du corps. J’en ai encore la chair de poule.
– Vous n’êtes donc pas brave ?
Naïvement, Martigues répliqua :
– Oh ! si, monsieur je suis toujours très brave, quand je sens que je suis le plus fort ! Mais que pouvais-je faire contre dix hommes aussi déterminés et armés de pistolets, d’épées, tandis que, moi, je n’avais que mes poings pour me défendre ?
» Ah ! miséricorde, j’ai bien cru que ma dernière heure était venue.
– Vous avez eu tort, coupa Castel-Rajac, qui mesurait son interlocuteur d’un regard qui signifiait clairement : « Toi, tu ne vas pas peser lourdement entre mes mains. »
Et, tout haut, il reprit :
– Maintenant, mon gaillard, à nous deux. J’ai l’habitude d’aller droit au but et de ne pas m’attarder inutilement en détours où l’on risque presque toujours de s’égarer. Voulez-vous gagner cinquante mille livres ?
– Cinquante mille livres ! répétait Martigues, en roulant des yeux effarés.
Le fond de sa nature honnête et naïve reprenant immédiatement le dessus, il s’écria :
– Quel crime allez-vous me demander de commettre contre une pareille somme ?
Avec un calme beaucoup plus impressionnant que la menace et la colère, Castel-Rajac se leva et, approchant son visage de celui du pêcheur, il lui dit :
– Regarde-moi bien en face et dis-moi, après ça, si j’ai l’air d’un bandit.
– Non, répliqua Martigues, vous avez l’air d’un honnête gentilhomme.
– Tu as raison de me juger ainsi, car je suis tel.
M. d’Assignac qui, avec M. de Laparède, avait assisté à cette scène, se leva à son tour et déclara de sa basse voix chantante :
– Et moi, qui le connais depuis toujours, je puis affirmer qu’il est l’officier le plus loyal de France.
Le pêcheur, qui n’avait pas besoin de ce témoignage pour accorder toute sa confiance au lieutenant de mousquetaires, reprenait :
– Alors, monsieur, si c’est une bonne action que vous me proposez, gardez votre argent pour vous, car, quand on fait le bien, on n’a pas besoin de récompense.
– Voilà une réponse qui me plaît, s’écria Gaëtan. Néanmoins, je maintiens mes offres, car, si tu veux bien nous aider à sauver un innocent, à délivrer un malheureux, j’entends que tu n’aies pas à supporter les conséquences d’une bonne action, qui, je ne te le cache pas, pourrait te coûter fort cher. Je veux te donner le moyen d’échapper à ceux qui seraient tentés de te chercher noise et de trouver un abri tranquille et sûr où tu pourras filer le parfait amour avec ta bonne amie.
– Ah ! monsieur, je crois deviner, fit le pêcheur. Vous me demandez, n’est-ce pas, que je vous aide à faire évader l’homme au masque de fer ?
– Tiens, tiens, s’écria gaiement le Gascon, tu es plus malin que je ne le pensais. Eh bien ! oui, c’est cela ! Sommes-nous d’accord ?
– Monsieur, reprit Martigues avec un accent plein de franchise, je ne demanderais pas mieux que de vous aider en cette entreprise, car ce prisonnier, que je suis chargé de servir, m’inspire une profonde pitié, et, chaque fois que je le vois avec ce masque sur la figure, l’envie me prend de le lui arracher ; mais il paraît que c’est impossible et que seul M. de Saint-Mars, le gouverneur, connaît le mécanisme secret qu’il faudrait faire fonctionner pour cela. Et puis, je ne suis qu’un pauvre hère !
» Ah ! tenez, il faut que je vous le dise, puisque vous vous intéressez tant à ce malheureux. Depuis un an qu’il est prisonnier à l’île Sainte-Marguerite, il n’avait pas encore desserré les lèvres ; et puis, aujourd’hui seulement, il s’est décidé à me dire quelques mots ! Rien qu’au son de sa voix, j’ai compris qu’il était jeune et qu’il devait être aussi bon que brave. Ah ! oui, il m’a parlé ; il m’a même appelé son ami !… Inutile de vous en dire davantage, tout ce que je pourrais faire pour lui, pour vous, je le ferais ! Mais, malheureusement, je le répète, mon aide ne peut pas vous être très efficace et je crains bien que vous ayez eu tort de compter sur moi.
Castel-Rajac, d’un ton bref, s’écria :
– Qu’en savez-vous ?
Martigues eut un signe évasif, mais déjà le Gascon interrogeait :
– De combien d’hommes se compose la garnison ?
– De vingt hommes !
– Ce sont de bons soldats ?
– Pas très. On s’ennuie beaucoup à Sainte-Marguerite, et ils n’attendent qu’une occasion de filer, surtout la nuit, et de gagner la terre afin d’y faire ripaille.
– Bien. Le gouverneur est-il sévère ?
– Très.
– Il ne badine pas avec la discipline ?
– Chaque fois qu’il prend un de ses hommes en faute, il le met au cachot pour vingt-quatre heures.
– De mieux en mieux, ponctua Gaëtan.
L’œil étincelant de malice, il continua :
– Je suppose que je pénètre avec quelques-uns de mes amis dans le château de Sainte-Marguerite.
– Ça, monsieur, c’est impossible.
– Impossible, riposta Castel-Rajac, c’est un mot qui n’est pas français, encore moins gascon.
» Je suppose donc que, par force ou par ruse, nous pénétrions dans la citadelle en nombre suffisant pour venir à bout de ceux qui l’occupent et que, fidèle à son devoir ainsi qu’il doit l’être, le gouverneur se refuse à me livrer son prisonnier, seriez-vous prêt à m’ouvrir les portes de son cachot ? »
Spontanément, le pêcheur répliqua :
– Oui, monsieur, si toutefois j’en avais la clef. Cette clef, je dois la remettre chaque soir à M. le gouverneur et j’ignore où celui-ci la cache.
– Il faut que tu la prennes, dans le plus bref délai. Tu vas donc retourner au château de Sainte-Marguerite et tu chercheras, par tous les moyens dont tu disposes, à découvrir l’endroit où M. de Saint-Mars serre cette clef. Ou plutôt, non, il me vient une idée lumineuse ; tout à l’heure, en rentrant, tu iras frapper à la chambre du gouverneur et tu lui diras qu’en rentrant au château tu es allé, comme toujours, écouter à la porte du prisonnier, que tu as entendu celui-ci se plaindre et que tu demandes au gouverneur de te donner le moyen de le secourir. Il te remettra la clef, tu la glisseras dans ta poche et tu la garderas jusqu’à ce que j’arrive, ce qui ne saurait tarder.
– Monsieur, je ne demande pas mieux de faire tout ce que vous me dites, mais je vous le répète, la citadelle est imprenable.
– Pas pour des Gascons !
Martigues, entièrement gagné à la cause de l’homme au masque de fer, s’écria :
– Ah ! si je pouvais seulement vous baisser le pont-levis et vous faire ouvrir la porte.
– Je te sais gré de tes excellentes intentions, déclara Castel-Rajac, mais, sur ce terrain, je n’ai pas besoin de ton concours. Contente-toi de me donner cette clef quand je te la réclamerai. Tu auras tes cinquante mille livres et tu pourras t’en aller filer en sécurité le parfait amour avec ta bonne amie.
» En attendant, voici une bourse qui contient vingt pistoles. Arrange-toi pour faire boire les soldats de la citadelle… Raconte-leur que tu as fait un héritage et que tu désires le fêter avec eux. Bref, arrange-toi pour que, vers dix heures, ils soient gris à rouler par terre…
» Allons, va mon gars. Maintenant, un bon conseil : tu ne me parais pas d’une bravoure excessive.
– Ah ! ça, monsieur, quand on n’a que sa peau comme fortune, on y tient.
– Évidemment, mais, une fois là-bas, ne t’avise pas de revenir sur la promesse que tu m’as faite et, quoi qu’il arrive, ne te laisse pas intimider et surtout ne me trahis pas.
Martigues releva la tête :
– Monsieur, fit-il, tout à l’heure, vous m’avez dit : « Regarde-moi en face et, après cela, dis-moi si j’ai l’air d’un bandit ? » Eh bien ! à mon tour, fixez-moi bien dans les yeux et dites-moi si j’ai l’air d’un traître ?
– Va, mon ami, fit Castel-Rajac, en lui donnant une tape sur l’épaule. Tu auras tes cinquante mille livres, quand je devrais aller couper les cornes et la queue du diable !
D’Assignac fit sortir le pêcheur par une porte dérobée, ce qui lui évita de traverser la salle où tous les hommes que Castel-Rajac avait recrutés dans les environs et costumés en mousquetaires continuaient à fumer et à boire du vin blanc. Resté seul avec son ami, Gaëtan lui dit :
– Nous avons eu la chance de tomber sur ce brave garçon. Il n’est certes pas doué d’une intelligence supérieure, mais, en tout cas, je suis certain qu’il nous est tout acquis et qu’il fera l’impossible pour me rendre le service que je lui ai demandé.
» Maintenant, mon bon Assignac et mon cher Laparède, prenons toutes les dispositions nécessaires.
– Nous t’écoutons.
– Parle !
Castel-Rajac développa :
– J’ai renoncé à ma première idée, qui consistait à prendre d’assaut la citadelle et à nous emparer de vive force du prisonnier. Cela, pour deux raisons. La première, c’est que, si décidés soyons-nous de vaincre, nous pouvons très bien subir une défaite, et la seconde est que nous nous mettrions en rébellion ouverte et à main armée contre l’autorité royale. Or je ne tiens ni à me placer dans un aussi mauvais cas, ni à y mettre mes amis, même pour la cause la plus noble et la plus juste.
» Tous ces gens que tu as recrutés, mon cher Laparède, et que tu as revêtus des uniformes de mousquetaires que nous avions apportés avec nous, vont donc nous attendre ici et nous servir tout simplement d’escorte jusqu’à la frontière italienne, où il a été convenu que nous conduirions notre cher Henry dès sa libération.
» Vous allez vous embarquer avec moi tous les deux et nous allons nous rendre à l’île Sainte-Marguerite.
» Hier, j’ai pu me rendre compte de la façon dont nous avions le plus de chances à pénétrer dans la place et cela nécessitera de la part de nous trois un peu de gymnastique ; mais nous avons bon pied, bon œil, bon muscle, bon nerf et surtout bon cœur. Je suis donc tranquille de ce côté, et si, comme je l’espère, notre homme de tout à l’heure exécute fidèlement mes instructions au cours de cette nuit, nous enlèverons Henry au nez de M. le gouverneur.
– Très bien, approuva Assignac, qui eût suivi son intrépide ami les yeux fermés jusqu’au bout du monde.
– Quand partons-nous ? demanda Laparède, qui professait une égale confiance envers Gaëtan.
– Dans une heure, répliqua Castel-Rajac. Il faut donner à notre complice le temps de griser les soldats de la garnison et de se faire remettre la clef du cachot par M. de Saint-Mars.
» Maintenant, suivez-moi, j’ai fait préparer par la brave femme qui tient cette auberge un petit souper qui achèvera de nous donner les forces dont nous aurons besoin.
– Il pense à tout, s’écria Assignac que la perspective d’une bonne chère, même relative, achevait d’épanouir.
Tous trois escaladèrent un escalier en forme d’échelle qui donnait au premier étage et disparurent par une porte qui se referma lourdement sur eux.
*
* *
Une heure après, une barque, pilotée par Castel-Rajac s’arrêtait dans une petite crique de l’île Sainte-Marguerite, presque au pied du château.
Après avoir abattu la voile et jeté l’ancre, il s’élança sur un rocher, suivi par ses deux compagnons habituels, qui avaient peut-être moins le pied marin que lui, mais n’en faisaient pas moins bonne figure sous les défroques de matelot qu’ils avaient endossées, ainsi que leur chef de file.
Favorisés par une nuit obscure, ils parvinrent à se faufiler jusqu’au pied du mur d’enceinte de la citadelle.
Castel-Rajac avait dû dresser un plan très net, très défini, car ce fut sans la moindre hésitation qu’il se dirigea vers un des saillants du fort que surplombait une plate-forme supportant un vieux canon de marine.
Cette plate-forme, protégée par des créneaux à mâchicoulis, se trouvait située à environ cinq mètres du roc.
Une fois en bas, Gaëtan s’empara d’une besace que d’Assignac portait sur le dos ; il l’ouvrit et en retira une corde à nœuds dont il enroula une des extrémités autour de son poignet ; puis il dit, toujours à d’Assignac :
– Mets-toi là, contre la muraille, et toi, Laparède, grimpe-lui sur les épaules.
Tous deux s’exécutèrent aussitôt. Avec la souplesse et l’agilité d’un acrobate professionnel, Gaëtan parvint à s’installer à son tour sur les épaules de Laparède. Sa tête dépassait le parapet, sur lequel il appuya ses deux mains, et, d’un seul bond, il se trouva sur la plate-forme auprès du canon, à la bouche duquel il assujettit solidement la corde à nœuds qu’il traînait après lui.
Tour à tour, Laparède et Assignac firent l’ascension de la corde et rejoignirent leur ami, qui leur dit à voix basse :
– Maintenant, il s’agit de s’orienter. Mais n’allons pas trop vite et flairons d’abord le vent. Surtout, imitez-moi dans tous les gestes et mouvements que je vais faire.
Il s’agenouilla et se mit à ramper le long du parapet dans la direction de la forteresse, qui élevait sa masse sombre à deux portées de fusil de là.
Arrivé au sommet de l’escalier de pierre qui donnait accès dans une première cour défendue par une muraille assez élevée et au milieu de laquelle se dressait la grille d’un portail d’une solidité qui semblait à toute épreuve, Castel-Rajac s’arrêta.
Dominant la muraille, il pouvait se rendre compte de tout ce qui se passait à l’intérieur de la cour. Tout d’abord, il ne vit rien, il n’entendit rien. Un calme absolu semblait régner à l’intérieur du château. Aucune lumière n’apparaissait derrière les fenêtres.
De même que lors de son équipée de Montgiron, le chevalier Gaëtan eut l’impression qu’il se trouvait aux abords d’un nouveau château de la Belle au bois dormant. Déjà, il songeait au moyen d’escalader ce nouvel obstacle qu’il n’avait pas été sans prévoir. Il n’y en avait qu’un seul, c’était de recommencer la même opération qu’il avait faite pour escalader l’enceinte de la citadelle.
Toujours à quatre pattes, et naturellement suivi de ses deux fidèles associés, il se mit à descendre l’escalier qui aboutissait à la grande porte grillée.
Comme il atteignait la dernière marche, il s’arrêta subitement. Il avait cru entendre, dans la cour, un léger bruit. Tapi dans l’ombre, il demeura immobile ainsi que ses camarades. Comme le bruit s’élevait de nouveau, plus rapproché, il saisit la poignée d’un coutelas qu’il portait accroché à sa ceinture, se préparant à supprimer, s’il en était besoin, l’indiscret qui avait le singulier aplomb de se mêler de ses affaires et la malencontreuse idée de venir se jeter dans ses jambes, ou plutôt dans ses bras.
Le regard tendu, l’oreille aux aguets, il vit bientôt une ombre s’approcher de la grille. Son cœur eut un joyeux battement. Le Gascon venait de reconnaître la silhouette de Jean Martigues. Il le laissa tranquillement ouvrir la porte à l’aide d’une clef énorme avec laquelle on aurait pu aisément assommer un bœuf, et, toujours sur les genoux, il s’avança vers lui, après avoir fait signe à ses amis de demeurer sur place.
Martigues, en apercevant cet homme qui rampait dans sa direction, eut un mouvement d’hésitation. Instantanément, Castel-Rajac se releva et lui dit simplement :
– Avez-vous la clef du cachot ?
Le pêcheur, l’air consterné, baissa la tête en disant :
– Non, je ne l’ai pas !
D’un geste brusque, Gaëtan le saisit par le revers de son veston.
Un mot lui échappa :
– Animal !
– Ne m’en voulez pas, murmura le pauvre diable, M. le gouverneur a voulu lui-même porter secours à M. l’homme au masque de fer et il est en ce moment avec lui dans son cachot.
– Mordious ! grommela le Gascon, en frappant du pied le sol.
Tout en dévisageant l’ancien pêcheur d’un air courroucé, il fit :
– Et les soldats ?
– Ah ! ceux-là, monsieur, ils ne vous gêneront pas beaucoup, car ils sont tous soûls comme des bourriques.
– Allons, ça va un peu mieux, respira Gaëtan.
Et, après avoir appelé ses amis qui n’avaient pas bougé de place et s’empressèrent de le rejoindre, de l’air décidé d’un homme qui vient de prendre une résolution dont rien ne pourrait le faire démordre, il dit à Martigues, qui n’avait plus un poil de sec :
– Maintenant, conduis-moi jusqu’au cachot du prisonnier.
– Mais, hésita le brave garçon, je viens de vous dire, monsieur, que M. le gouverneur s’y trouvait.
– Eh bien ! tant mieux.
– Mon Dieu, mon Dieu, gémit Martigues, pourvu qu’il ne vous arrive pas malheur !
– Ton gouverneur est donc si terrible que cela ?
– Ce n’est pas un méchant homme… mais…
– Allons, conduis-moi, ordonna le Gascon sur un ton qui n’admettait pas de réplique.
L’ancien pêcheur ne se le fit pas répéter une troisième fois.
– Suivez-moi, messieurs, fit-il.
Les trois Gascons emboîtèrent aussitôt le pas au valet, qui, après les avoir fait pénétrer à l’intérieur de la citadelle, les fit entrer dans un couloir obscur et désert où s’amorçait l’escalier qui conduisait aux cachots.
Castel-Rajac et ses amis aperçurent bien, dans la pénombre, ça et là, quelques corps étendus à terre. Ils ne s’en inquiétèrent point, car c’étaient ceux des soldats que leur guide avait copieusement grisés. Derrière lui, ils gravirent les marches et arrivèrent dans un autre couloir sur lequel donnaient plusieurs cachots.
Sans s’être donné le mot, ils se mirent à marcher sur la pointe des pieds, jusqu’au moment où Martigues s’arrêta devant la porte de la cellule où était enfermé le fils de Mazarin et d’Anne d’Autriche.
Un rai de lumière filtrait sous le vantail inférieur. Éclairé par le falot suspendu au centre du corridor, Martigues se retourna vers Gaëtan, lui demandant, d’un coup d’œil expressif, ce que maintenant il fallait faire.
Castel-Rajac, que rien ne semblait embarrasser, frappa lui-même un coup contre la porte.
– Qui va là ? fit la voix du gouverneur.
– Service du roi, répondit imperturbablement le lieutenant aux mousquetaires.
M. de Saint-Mars eut un sursaut de surprise. Comme il ne pouvait supposer un seul instant la vérité, d’autant plus qu’à plusieurs reprises il lui était arrivé d’être alerté en pleine nuit par des courriers chargés de venir inspecter la forteresse, M. de Saint-Mars s’en fut aussitôt ouvrir la porte. Un cri lui échappa.
Sous une poussée formidable, il se sentit projeté jusqu’au fond de la pièce.
C’était Castel-Rajac qui avait bondi sur lui et lui disait :
– Monsieur le gouverneur, je vous avertis qu’il est inutile de chercher à vous défendre et d’appeler vos hommes à votre secours. Pas un seul ne vous répondrait. Ils sont tous gris comme des Polonais…
Tandis que Laparède tenait en respect le gouverneur et que d’Assignac, telle une statue vivante, bouchait littéralement la porte de sa haute stature, Castel-Rajac se précipitait vers Henry qui, frémissant sous son masque d’acier, tendait vers lui ses bras, en criant :
– Mon père, mon père !
– Oui, mon fils, c’est moi, fit simplement le héros gascon.
Et il ajouta, avec sa verve habituelle :
– J’espère que je vais pouvoir te débarrasser promptement de ce saladier qui te cache la figure et que je vais pouvoir t’embrasser sur les deux joues. Mais, auparavant, j’ai quelques mots à dire à M. le gouverneur.
– Et moi, monsieur, répliqua M. de Saint-Mars avec dignité, je n’en ai qu’un seul. Je vous prie seulement d’ordonner à votre ami, qui me tient sous la menace de son pistolet, de me remettre immédiatement son arme, afin que je puisse immédiatement me brûler la cervelle.
– Qu’est-ce à dire, monsieur le gouverneur ? s’exclama Gaëtan.
– Monsieur, répliqua M. de Saint-Mars, vous venez m’enlever un prisonnier que j’avais juré sur l’honneur de garder toujours devers moi. Je suis gentilhomme, un gentilhomme n’a pas le droit de forfaire au serment qu’il a fait à son roi.
Cette vigoureuse apostrophe parut produire sur l’être chevaleresque entre tous qu’était Castel-Rajac une impression profonde.
– Monsieur le gouverneur, fit-il, je ne vous cacherai pas que le langage que vous venez de me tenir n’est pas sans me troubler. Et croyez que je serais désolé d’avoir votre mort sur la conscience. Mais, moi aussi, j’ai fait un serment, pas au roi, mais presque… oui… le serment de défendre ce jeune homme, victime de la plus effroyable des injustices. Ce serment, je l’ai toujours tenu et j’entends le tenir jusqu’au bout ! Mais peut-être existe-t-il un moyen d’arranger les choses ? Je vous assure que je ne demanderais pas mieux, mon cher gouverneur.
– Non, c’est impossible !
– Veuillez me suivre jusqu’auprès de cette fenêtre, insista le Gascon, car ce que j’ai à vous dire ne peut être entendu que de nous deux.
M. de Saint-Mars répondit :
– Soit !
Et il s’en fut rejoindre Castel-Rajac qui lui fit à l’oreille :
– Vous connaissez, monsieur le gouverneur, les raisons pour lesquelles le jeune homme a été condamné à la détention perpétuelle et à porter jusqu’à la fin de ses jours ce masque sur son visage.
– Oui, monsieur, répondit sans hésiter M. de Saint-Mars.
– Ne trouvez-vous pas que les gens qui ont ordonné un pareil supplice ont commis une infamie et que ceux qui s’en sont faits les complices se sont rendus coupables d’une lâcheté ?
– Monsieur, blêmit le gouverneur.
– Rentrez en vous-même, interrogez votre conscience, elle vous répondra que j’ai raison, et ne me parlez plus de serment que vous avez fait au roi, car cet argument, pour moi, n’est pas valable.
» Le roi, je crois le connaître assez, puisque je suis lieutenant à son régiment de mousquetaires, le roi est incapable d’avoir donné un pareil ordre. C’est son nouveau ministre, ce Colbert qui, pour faire du zèle, a consommé ce véritable crime et bien à tort, monsieur le gouverneur, car si je crois bien connaître le roi Louis XIV, je connais encore mieux son frère, puisque j’ai eu l’honneur et le bonheur d’être son père adoptif et que je l’ai élevé à l’ombre de mon honneur et de ma tendresse.
» Eh bien ! questionnez-le vous-même. Demandez-lui s’il a l’intention de conspirer contre Sa Majesté et de profiter d’une ressemblance voulue par un caprice de la nature pour semer le trouble et la discorde dans le royaume, oui, questionnez-le, et vous verrez ce qu’il vous répondra ! »
M. de Saint-Mars se taisait. Il était facile de deviner, au trouble de son visage, qu’un violent combat se livrait en lui et que le véritable gentilhomme qu’il était ne pouvait être que bouleversé par les paroles que venait de lui adresser le lieutenant aux mousquetaires.
Désireux d’en finir, Castel-Rajac appelait à haute voix :
– Henry !
L’homme au masque de fer s’approcha.
– Mon fils, reprit le Gascon avec un accent de grandeur incomparable, dis à M. le gouverneur ce que tu comptes faire dès que tu seras libre.
Henry répliqua d’une voix ferme et harmonieuse :
– Pendant les heures déjà si longues de ma captivité, j’ai longuement réfléchi à mon sort futur, au cas où les portes de ma prison viendraient à s’ouvrir. Ayant pénétré la raison pour laquelle j’ai été jeté dans ce cachot, j’ai pris envers moi-même l’engagement, si je retrouvais ma liberté, de m’en aller loin, très loin, et de ne jamais reparaître. Car, sachez-le, monsieur, je n’ai pas d’autre ambition que d’être un bon gentilhomme, et si, hélas ! par la volonté du destin, je ne puis l’être dans mon pays, il ne m’est pas impossible de m’y conduire comme tel dans un autre.
» Je vous donne donc ma parole d’honneur de ne jamais rien entreprendre ni contre le roi, que je respecte et que j’aime, mais encore contre tous ceux qui m’ont infligé un supplice auquel je n’ai résisté que parce que j’avais la foi, la certitude que l’homme admirable que vous voyez devant vous viendrait un jour, avec ses deux amis, ses deux frères, ses deux compagnons d’armes, m’arracher à ceux qui m’avaient volé à lui.
– Vous venez de l’entendre, monsieur le gouverneur, reprit Castel-Rajac, tandis qu’Assignac qui, décidément, avait la larme facile, se tamponnait les yeux avec la manche de sa chemise, et que Laparède tortillait nerveusement sa fine moustache.
M. de Saint-Mars déclara :
– Je vous crois tous les deux. Mais comment expliquer cette évasion ?
D’un ton fort conciliant, Castel-Rajac continua :
– Je comprends que vous songiez, mon cher gouverneur, à mettre à couvert votre responsabilité et à éviter les conséquences fâcheuses que pourrait avoir pour vous la disparition de votre captif. Mais je crois que j’ai trouvé le moyen de concilier vos intérêts avec les nôtres. Vous avez d’autres prisonniers, ici ?
– Deux seulement. L’un est un Espagnol fanatique qui avait tenté d’assassiner le cardinal de Mazarin.
– De celui-là, n’en parlons pas, coupa le Gascon. Voyons l’autre.
– C’est un gentilhomme, le comte de Marleffe.
– Le faux-monnayeur ! s’exclama Castel-Rajac.
– Lui-même !
– Quel âge ?
– Vingt-trois ans.
– Parfait !
– Mais ?…
– C’est bien simple. Après l’avoir fait passer pour mort, vous collerez sur la figure de ce bandit le masque de fer que vous avez mis à mon fils !
– Lieutenant, c’est impossible.
– Ah ! que je n’aime pas ce mot !
– Je vous assure que vous me demandez-la une chose que je ne puis exécuter.
– Pourquoi ?
– Si un envoyé de M. Colbert venait visiter le prisonnier et s’il l’interrogeait, M. de Marleffe ne manquerait pas de dire qui il est et de protester contre le traitement dont il est l’objet !
Castel-Rajac, qui ne s’embarrassait jamais de rien, répliqua avec une magnifique assurance :
– Qu’à cela ne tienne, monsieur le gouverneur. Vous direz au représentant de M. Colbert que votre prisonnier est devenu fou, ce qui, somme toute, n’aura rien d’invraisemblable et d’extraordinaire.
– Mais si cet envoyé exige que j’enlève le masque ?
– Et après ?
– Il s’apercevra tout de suite de la substitution.
– Mais non, mais non…
– Mais si.
– D’abord, mon cher gouverneur, vous n’enlèverez pas le masque.
– Pourquoi ?
– Parce que vous expliquerez à votre interlocuteur que l’artisan qui l’avait fabriqué est mort en emportant dans la tombe le secret du mécanisme qui permet de l’enlever. Mordious ! vous voyez que ce n’est pas bien difficile !
Entraîné par la verve du Gascon autant que par son désir de mettre fin à une situation dont le chevalier de Castel-Rajac venait de lui démontrer si éloquemment et si irréfutablement l’iniquité, M. de Saint-Mars avoua :
– Décidément, lieutenant, vous avez réponse à tout. Vous venez de me donner d’autant mieux le moyen de m’associer à une œuvre de réparation et de justice d’autant plus que j’ai confiance en votre discrétion, ainsi qu’en celle de celui que vous appelez votre fils et des deux témoins qui ont assisté à cette scène.
Laparède intervint :
– Vous pouvez, monsieur le gouverneur, compter sur mon silence.
– Et sur le mien, aussi, dit en écho le bon gros Assignac.
Et il ajouta avec bonhomie :
– Cela me sera d’autant plus facile que je vous avouerai franchement que je n’ai rien compris à cette équipée.
D’un air grave, M. de Saint-Mars continua :
– Lieutenant, tout sera fait selon votre désir. Je n’y mets qu’une condition et cela encore plus pour la sauvegarde de votre fils que pour la mienne. Je vous demande qu’il conserve sur son visage ce masque de fer jusqu’à ce qu’il ait franchi la frontière, car il se pourrait fort bien que des espions rôdassent sur la côte.
Tout en souriant, Castel-Rajac reprit :
– Mieux que personne, j’en suis certain, et voilà pourquoi je trouve votre précaution excellente. Deux objections, cependant.
– Dites !
– Si nous emportons le masque, comment ferez-vous pour le mettre ensuite sur la figure de votre faux monnayeur ?
– J’en ai un de rechange.
– Ah ! très bien. Mais ce n’est pas tout. Comment m’y prendrai-je pour débarrasser mon fils de celui-ci ?
– Je vais vous l’expliquer, répliqua M. de Saint-Mars.
Et, s’approchant d’Henry, il montra à Castel-Rajac, en dessous de la mentonnière, un trou pas plus grand que celui par lequel on réglait à cette époque les aiguilles d’une montre. Et, tirant de l’une des poches de son habit une petite clef, il l’introduisit dans l’ouverture.
Instantanément, le masque se sépara en deux et le visage pâle, amaigri, mais toujours plein de beauté juvénile du prisonnier, apparut aux yeux des assistants. Aussitôt, Gaëtan se précipita sur son fils d’adoption et fit claquer sur ses joues les deux baisers sonores qu’il lui avait promis.
M. de Saint-Mars donna au chevalier la clef avec laquelle il avait fait fonctionner le mécanisme secret du masque qu’il remit lui-même en place, tout en disant :
– Ne m’en voulez pas, monsieur, de prolonger encore un peu votre si cruelle épreuve, mais ce ne sont plus que quelques instants de patience ; et maintenant, adieu, monsieur, et que Dieu vous garde.
– Monsieur le gouverneur, répliqua l’homme au masque de fer avec un accent et une allure d’une dignité magnifique, je voudrais vous serrer la main.
Le gouverneur, très ému, tendit sa dextre au fils de Mazarin et d’Anne d’Autriche, qui, tout en l’étreignant, lui dit :
– Puisse, monsieur, l’acte d’humanité que vous venez d’accomplir vous valoir le bonheur dans ce monde et dans l’autre.
Castel-Rajac, tout frémissant de joie, s’écria :
– Monsieur le gouverneur, laissez-moi joindre mes remerciements à ceux de ce cher enfant. Désormais, vous êtes mon ami et, quand on est mon ami, on l’est bien, et je vous en donnerai d’ici peu la preuve… Attendez-vous à recevoir un avancement digne de vos mérites. Je ne serais pas surpris que, dans quelque temps, vous fussiez nommé gouverneur de la Bastille ! Je ne vous dis donc pas adieu, mais au revoir !
Après avoir échangé une chaleureuse poignée de main avec M. de Saint-Mars, Castel-Rajac, Henry et ses deux amis s’empressèrent de gagner le couloir où les attendait Martigues qui, dans l’ombre, avait assisté à toute cette scène à laquelle, d’ailleurs, pas plus qu’Assignac, il n’avait compris le moindre mot.
Le gouverneur, qui les avait accompagnés jusque dans la cour, leur dit :
– Mes soldats, ainsi que vous me l’aviez dit et que je l’ai constaté moi-même, sont abominablement ivres. Malgré cela, je crois qu’il serait imprudent de vous faire sortir par le corps de garde.
– Ne vous inquiétez pas de ceci, mon cher gouverneur, déclara Castel-Rajac, qui se sentait un cœur et des jarrets de vingt ans. Le chemin que nous avons pris pour monter ici nous servira également pour descendre.
M. de Saint-Mars rentra dans le château. Henry et les trois Gascons gravirent l’escalier de pierre, suivi par Jean Martigues, qui les rejoignit sur la plate-forme.
D’un ton humble et craintif, celui-ci demanda à Castel-Rajac :
– Bien que je n’aie pas tenu ma parole, vous n’allez tout de même pas m’abandonner, mon bon lieutenant.
– Non seulement nous ne t’abandonnerons pas s’écria le Gascon, en lui donnant une bourrade, mais tes cinquante mille livres que nous t’avons promises, tu les toucheras dès que nous serons revenus de conduire mon fils à la frontière !
Transporté d’allégresse et de reconnaissance, l’ancien pêcheur allait s’effondrer aux genoux du chevalier ; mais celui-ci, l’empoignant par le bras, lui disait avec toute la belle humeur dont il débordait :
– L’instant n’est pas propice aux effusions. Décampons !
Le premier, il descendit par la corde à nœuds, qui était restée attachée à la bouche du canon. Henry lui succéda ; puis ce furent, tour à tour, M. d’Assignac, Laparède et Jean Martigues, qui, dans son émoi, lâchant la corde avant d’arriver en bas, évita une chute qui aurait pu être dangereuse grâce au véritable matelas que lui présentait le bon gros Assignac en se renversant en arrière et en bombant sa poitrine.
Tous s’empressèrent de regagner la barque, de mettre la voile et, favorisés par un excellent vent du large, ils arrivèrent sans encombre à l’auberge où, fidèles à la consigne que leur avait donnée Castel-Rajac, les indigènes déguisés en mousquetaires attendaient son retour en continuant de vider la cave de la tenancière.
Tous ces gens avaient été racolés dans le pays par Assignac et Laparède qui, non seulement leur avaient versé d’avance une certaine somme, mais leur avaient encore promis une prime importante.
C’étaient tous des contrebandiers de la côte, entraînés aux plus périlleuses aventures et qui ne s’occupaient jamais de la mission dont ils étaient chargés que pour l’exécuter aveuglément, sans autre souci que celui des bénéfices qu’ils pouvaient en retirer.
Aussi ne s’étaient-ils nullement fait tirer l’oreille pour se laisser enrôler par les deux Gascons et manifestaient-ils pour la cause inconnue qu’ils étaient appelés à servir un enthousiasme qui progressait au fur et à mesure que le vin coulait dans leur gosier.
Lorsqu’ils virent reparaître celui qu’ils appelaient déjà leur grand chef, c’est-à-dire le chevalier de Castel-Rajac, ils se levèrent tous d’un même mouvement pour l’acclamer. Sans doute supportaient-ils mieux la boisson que les soldats de M. de Saint-Mars, car Gaëtan, qui n’était pas sans avoir quelque inquiétude à ce sujet, constata avec satisfaction qu’ils tenaient fort bien en équilibre sur leurs jambes.
Tout de suite, de sa belle voix, il lança :
– En selle !
Suivi par sa troupe de faux mousquetaires, il s’en fut dans une cour intérieure où une vingtaine de chevaux étaient attachés. Dans un coin, l’homme au masque de fer, enveloppé d’un long manteau, conversait avec les deux amis de son père adoptif.
Lestement, le lieutenant aux mousquetaires grimpa sur un joli cheval blanc qui piaffait d’impatience. Henry s’installa en croupe derrière lui et tous les autres personnages, y compris Jean Martigues, qui revenait en courant et tout essoufflé d’embrasser encore une fois sa bonne amie, sautèrent sur les autres montures et la cavalcade s’enfonça dans la nuit.
Lorsque Castel-Rajac et ses amis arrivèrent à la frontière italienne, il faisait grand jour. Le chevalier commença par faire régler sa troupe par Assignac et Laparède, promus aux fonctions d’officiers payeurs généraux. Il y ajouta même une gratification supplémentaire, ce qui lui valut des hourras qui menaçaient de se prolonger outre mesure ; mais Gaëtan, qui avait hâte de délivrer Henry de son masque de fer, se hâta de les interrompre d’un geste énergique et d’engager ses mousquetaires d’occasion à rallier Cannes dans le plus bref délai.
Ceux-ci ne se le firent pas dire deux fois, et, commandés par Assignac et Laparède, qui étaient chargés de récupérer leurs costumes et leurs armes, ils piquèrent des deux et s’en furent dans une sorte de galop d’allégresse.
Demeuré seul avec Henry, Castel-Rajac, qui semblait très ému, fit manœuvrer, avec la petite clef que lui avait remise M. de Saint-Mars le mécanisme secret du masque, qui s’entrouvrit aussitôt pour se diviser en deux parties et retomber lourdement sur le sol.
Sans prononcer un mot, les deux hommes s’étreignirent longuement.
Puis, Castel-Rajac dit :
– Mon fils… car, tu me permets bien de t’appeler encore ainsi ?
– Oui, mon père, et je vous le demande même en grâce.
– Je vais maintenant te dire la vérité sur ta naissance.
– Je la connais.
– Qui te l’a révélée ?
– Personne ! C’est de moi-même qu’a jailli la lumière. Mais mon père véritable, ce sera vous, toujours !
Et avec une nuance de mélancolie, dans laquelle n’entrait aucune amertume, il ajouta :
– Quant à ma mère, si vous la voyez, vous lui direz que je ne veux emporter d’elle que le souvenir des baisers qu’elle m’a donnés quand j’étais enfant. De même, que je suis trop respectueux des droits de mon frère le roi pour jamais me dresser contre lui, j’ai trop souci de l’honneur de la reine, notre mère, pour revendiquer auprès d’elle la place même obscure d’un enfant illégitime.
» Fort et fier des principes dans lesquels vous m’avez élevé, j’entends faire ma vie suivant les lignes que vous m’avez tracées, non pas en aventurier, mais en gentilhomme, et tout en m’engageant à ne jamais porter les armes contre mon pays, je veux consacrer tout ce que vous avez mis de bon en moi au service des nobles causes. Il n’en manque point sur cette terre. »
Et, ployant les genoux, il ajouta :
– Maintenant, bénissez-moi, mon père !
Castel-Rajac posa sa main robuste sur l’épaule d’Henry. Puis, il lui dit :
– Tu viens, mon enfant, de reconnaître au-delà de ce qu’il valait le bien que j’ai pu te faire. Oui, je te bénis de tout mon cœur affectueux, de toute mon âme dans laquelle tu ne cesseras de vivre et je te dis : sois le chevalier sans peur et sans reproche que tu m’annonces et Dieu, j’en suis sûr, t’en récompensera.
Le fils de Mazarin et d’Anne d’Autriche se releva et, d’un élan il se jeta entre les bras du valeureux Gascon. Ce fut une nouvelle étreinte, après laquelle Castel-Rajac dit à Henry :
– Voici une bourse bien garnie, qui va te permettre de gagner la ville de Gênes. Là, tu te rendras via Macelli, tu demanderas le signor Humberto Joffredi ; c’est lui qui est chargé de procéder à ton établissement qui doit être et sera celui d’un jeune gentilhomme riche et de bonne race.
– Père, je n’ai aucun désir d’argent.
– C’est la volonté de ceux qui t’aiment et tu n’as pas le droit de t’y soustraire. Tu choisiras toi-même le nom que tu veux porter.
– Ce sera le vôtre, père. Il n’en est pas un autre pour moi qui soit plus noble et plus sacré. J’espère que je m’en montrerai digne.
– Allons, au revoir, mon cher Henry.
– Oui, au revoir et à bientôt, n’est-ce pas ?
– Sois tranquille, je ferai tout pour me retrouver souvent avec toi !
Ils se serrèrent les mains vigoureusement. Henry se dirigea à pied vers un village dont on voyait les toits rouges se profiler sous le ciel bleu à travers les arbres. Castel-Rajac le regarda jusqu’à ce qu’il eût disparu. Comme un soupir douloureux lui échappait, il fit :
– Mordious, est-ce que, par hasard, je manquerais de courage ? Ce serait la première fois de ma vie.
Et, remontant en selle, il éperonna son cheval, tout en disant :
– Je crois que j’ai bien tenu mon serment ! Ma chère Marie va être contente !…
*
* *
Au milieu de sa joie, Castel-Rajac conservait cependant une certaine inquiétude. En effet, il était sans nouvelles de M. de Durbec et il se demandait ce que celui-ci avait bien pu devenir. Comme il se doutait qu’il manigançait dans l’ombre quelques sombres intrigues, et bien qu’il fût tout à fait tranquille au sujet d’Henry, il se demandait si cet oiseau de malheur n’allait pas s’apercevoir de la substitution du prisonnier et chercher noise à cet excellent gouverneur que le Gascon avait entraîné un peu malgré lui dans cette aventure.
Gaëtan était d’un tempérament trop généreux et trop chevaleresque, pour ne pas se préoccuper du mal qui pouvait arriver par sa faute à un homme qui lui avait rendu un aussi grand service.
Aussi, dès son arrivée à Cannes, après avoir été rendre compte à la duchesse de Chevreuse et à sa charmante nièce, Mme de Lussey, du succès de son entreprise et délivrer lui-même le mouchard qu’il avait enfermé dans la cave, Castel-Rajac s’était embarqué pour l’île Sainte-Marguerite, et, après avoir parlementé avec le sous-officier de garde qui, les yeux troubles et la bouche pâteuse, ne semblait pas entièrement remis de ses libations de la veille, il avait réussi à se faire introduire auprès de M. de Saint-Mars.
Ainsi que nous allons le voir, les pressentiments de Castel-Rajac étaient fondés. En effet, dès que le gouverneur l’aperçut, il s’écria :
– Vous, chevalier, c’est la Providence qui vous envoie ! Depuis votre départ, il s’est passé ici deux graves événements, qui vous placent, vous et moi, dans la posture la plus fâcheuse.
– Pas possible ? fit le Gascon avec toutes les apparences de la plus parfaite sécurité.
– Tout d’abord, M. de Marleffe s’est énergiquement refusé à se laisser adapter le masque de fer. Comme je ne pouvais mettre personne dans la confidence, il m’a donc été impossible à moi seul de le contraindre.
– N’ayez aucun souci à ce sujet, déclara Castel-Rajac. Laissez-moi faire et je vous garantis que, dans un quart d’heure, l’opération sera terminée.
– Il y a plus grave encore !
– Quoi donc ?
– Un émissaire de Colbert vient d’arriver.
– Est-ce que, par hasard, ce ne serait pas un certain M. de Durbec ?
– Lui-même !… Muni de pleins pouvoirs du ministre, il m’a déclaré qu’il voulait voir l’homme au masque de fer en secret et hors de toute présence. J’ai pu gagner du temps, en prétextant que mon prisonnier était gravement malade et qu’à la suite d’une nuit d’insomnie, j’avais dû lui administrer un narcotique sous l’action duquel il était encore plongé. Mais, déjà par trois fois, M. de Durbec m’a fait demander si l’homme au masque de fer était réveillé et je crains qu’il ne finisse par exiger que je lui ouvre la porte de son cachot.
Castel-Rajac eut un sourire plein de finesse et d’ironie. Puis, il demanda :
– Où se trouve M. de Durbec ?
– Dans la chambre dite du prince, qui est réservée aux visiteurs de marque.
– Voulez-vous m’y conduire, mon cher gouverneur ? Je vous assure que c’est indispensable.
– Cependant…
– Je vais vous rassurer d’un mot. Je vous donne ma parole que, lorsque j’en sortirai, M. de Durbec aura renoncé à son projet de visiter l’homme au masque de fer et se gardera même de vous poser aucune question au sujet de votre prisonnier.
Si formidable que lui apparût cette double assertion, M. de Saint-Mars n’adressa aucune objection à son interlocuteur, tant celui-ci, qu’il avait vu à l’œuvre, lui inspirait une confiance illimitée. Aussi s’empressa-t-il de le conduire dans la pièce que M. de Durbec, qui commençait à soupçonner que quelque chose de louche se passait dans le château, s’était mis à arpenter nerveusement.
Pour la quatrième fois, Durbec allait mander le gouverneur, lorsque la porte s’ouvrit toute grande. Le chef de la police secrète de M. Colbert reconnut, sous sa défroque de pêcheur, M. de Castel-Rajac qui, les mains derrière le dos, la figure resplendissante de bonne humeur, s’avançait vers lui, en disant :
– Ce cher monsieur de Durbec !…
La porte s’était refermée et le Gascon, qui continuait toujours à s’avancer vers son adversaire, les mains toujours derrière le dos, lui lançait :
– Comme on se retrouve ! C’était d’ailleurs fatal, car, mon cher de Durbec, depuis vingt-trois ans, nous avions un compte à régler. Avouez que je ne vous ai pas beaucoup tracassé. J’ai attendu mon heure, elle a sonné, allons-y !
– Ah çà ! monsieur, s’exclama Durbec, je ne comprends pas.
Castel-Rajac continua :
– Je sais bien qu’au bout de vingt-trois ans il est permis d’avoir des défaillances de mémoire. Eh bien, moi, je vais la rafraîchir, votre mémoire. L’affaire du château de Montgiron, vous vous rappelez ?…
– Oui, je me souviens… en effet, de cette nuit où, après avoir failli me tuer, vous avez massacré, vous et vos amis, une dizaine des gardes du cardinal.
Et, tout en plongeant ses yeux dans ceux de son interlocuteur, M. de Castel-Rajac martela :
– Et vous avez voulu faire assassiner lâchement la duchesse de Chevreuse !
Instinctivement, Durbec recula d’un pas. Castel-Rajac fit :
– Si je ne vous ai pas demandé raison plus tôt de cette infamie, c’est parce que, pour des raisons que vous n’avez pas à connaître, cela m’était interdit. Mais je m’étais bien promis que, tôt ou tard, vous me paieriez cette canaillerie et plusieurs autres sur lesquelles je n’ai besoin d’insister. Comme par exemple celle de vous acharner après un malheureux enfant qui n’a commis qu’un crime, celui de naître. Vous saisissez, n’est-ce pas, monsieur de Durbec ?
D’un geste brusque, l’ancien espion de Richelieu tirait son épée du fourreau. Mais Castel-Rajac, qui prévoyait ce mouvement, d’un bond se jeta de côté et, brandissant un couteau de chasse assez long qu’il cachait derrière lui, il s’écria :
– À nous deux, monsieur l’assassin !
Et, tout en fonçant sur son adversaire, il lui dit :
– Tu me croyais sans arme, bandit, mais tu vas voir si mon couteau ne vaut pas ton épée.
Après avoir paré le premier coup que Durbec cherchait à lui porter, Castel-Rajac, d’un coup sec d’une force irrésistible, le désarma. Et, d’une voix retentissante, il lui cria :
– Papillon de malheur, je vais te clouer à la muraille !
Mais, au moment où il allait transpercer la poitrine de l’espion, celui-ci s’écroula comme une masse sur le sol, où il demeura inanimé. Gaëtan se pencha vers lui et, constatant qu’il était mort, grommela :
– Mordious, le diable me l’a pris avant que j’aie eu le temps de l’occire !
Courant à la porte, il appela le gouverneur, qui était resté derrière la porte.
– Ce n’est pas moi, fit-il, qui l’ai mis à mal, c’est lui qui vient de mourir tout seul et probablement de peur. Voilà comment nous sommes, en Gascogne… Tandis qu’il refroidit, allons nous occuper de notre faux monnayeur !
Malgré le trouble dans lequel l’avaient plongé les nouveaux événements, M. de Saint-Mars, incapable de résister à la véritable tornade que créait autour de lui le bouillant Gascon, conduisit ce dernier jusqu’au cachot de M. de Marleffe. C’était une pièce humide, froide, obscure et véritablement infecte. Tout de suite, Castel-Rajac dit au prisonnier, qui était affalé sur un banc de pierre :
– Vous vous plaisez donc ici, monsieur ?
– Non ! protesta Marleffe. Je m’y déplais fort, au contraire.
– Vous trouvez donc la chère excellente ?
– Elle est exécrable.
– Les vins délicieux ?
– Je ne bois que de l’eau et encore est-elle saumâtre !
– Que diriez-vous si, tout à coup, on vous transportait dans une chambre confortable avec vue sur la mer, si on vous servait trois fois par jour un repas délectable et si M. le gouverneur du château de l’île Sainte-Marguerite mettait à votre disposition les meilleurs crus de sa cave ?
– Monsieur, répliqua le prisonnier, j’ignore qui vous êtes, mais je vous prie de ne pas vous moquer de moi. Je suis un malfaiteur, c’est vrai, mais j’expie cruellement mes crimes et vous devriez avoir pitié de moi.
Castel-Rajac reprit :
– Je ne me moque nullement de vous et je vous parle en toute sincérité. Il ne tient qu’à vous de passer de ce régime si dur auquel vous êtes assujetti à celui que je viens de vous décrire.
– Que dois-je faire pour cela ?
– Accepter qu’on vous applique sur le visage ce masque de fer que vous avez refusé de porter.
Et, s’adressant au gouverneur, qui était resté sur le seuil, il fit :
– Nous sommes bien d’accord, n’est-ce pas, mon cher gouverneur ?
– Entièrement d’accord.
– Et si je refuse ? dit Mariette.
Gaëtan, qui sentait la partie gagnée, insista :
– Vous êtes condamné à la détention perpétuelle. Eh bien, vous resterez toute votre existence dans ce cachot.
– Alors, j’accepte, se décida le prisonnier.
– J’ajouterai simplement, fit Gaëtan, que, lorsque vous recevrez la visite de personnes venues pour vous interroger, vous refuserez obstinément de leur répondre, quelles que soient ces personnes et les questions qu’elles pourront vous poser. Sinon, vous serez immédiatement renvoyé dans cet endroit d’où je me suis efforcé de vous faire sortir.
– C’est entendu, je me tairai, affirma le faux-monnayeur qui, maintenant, était prêt à tout pour reconquérir, à défaut de liberté, le bien-être qui allait lui rendre moins dure une captivité qui ne devait finir qu’avec lui-même.
Cinq minutes après, affublé du masque de fer qu’il devait garder jusqu’à sa dernière demeure, le faux-monnayeur était conduit par M. de Saint-Mars dans la chambre qu’occupait Henry et où il devait rester jusqu’au jour où M. de Saint-Mars, nommé gouverneur de la Bastille, ainsi que le lui avait prédit Castel-Rajac, emmena avec lui son prisonnier qui ne devait mourir qu’en 1706, dans cette prison d’État, emportant avec lui le secret de l’homme au masque de fer.
Nous ajouterons simplement que les deux Castel-Rajac se couvrirent l’un et l’autre de gloire, le père, en prenant part à toutes les grandes victoires de la première partie du règne de Louis XIV, et le fils en allant combattre les infidèles, nouveau croisé qui ajouta au nom de Castel-Rajac un lustre d’honneur et de gloire. Il revint en France en 1694, et Louis XIV auquel, après la mort d’Anne d’Autriche, Castel-Rajac, devenu maréchal de France, avait révélé toute la vérité, le nomma gouverneur de la province du Languedoc où il mourut très âgé, entouré de ses enfants et de ses petits-enfants, dont pas un seul ne se douta jamais qu’ils avaient du sang d’Anne d’Autriche dans les veines et que le Roi Soleil était leur oncle…
FIN