
Johann Wolfgang von Goethe
LE ROMAN DU RENARD
1794
Traduction par Jean-Jacques Porchat (1800 –1864)
Édition reproduite, Scripta Manent – 1929
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/
Table des matières
CHANT PREMIER

Pentecôte, l’aimable fête, était venue ; les champs et les bois étaient verts et fleuris ; sur les hauteurs et les collines, dans les bosquets et les buissons, les oiseaux, nouvellement éveillés, gazouillaient leurs joyeuses chansons ; chaque prairie se jonchait de fleurs dans les vallons embaumés ; le ciel serein, la terre diaprée, brillaient avec un air de fête.
Noble, le roi, assemble sa cour, et ses vassaux, convoqués, se hâtent d’accourir en grande pompe ; beaucoup de fiers personnages arrivent de toutes parts :
Lutke, la grue, et Markart, le geai, et tous les meilleurs. Car le roi veut tenir cour plénière avec tous ses barons. Il les fait convoquer tous ensemble, aussi bien les grands que les petits. Nul ne devait y manquer, et pourtant quelqu’un y manqua : ce fut Reineke, le renard, le fripon, qui, pour ses nombreux méfaits, s’abstint de paraître à la cour. Comme la mauvaise conscience craint le jour et la lumière, le renard craignait les seigneurs assemblés. Tous avaient à se plaindre : il les avait tous offensés, et il n’épargnait que Grimbert, le blaireau, le fils de son frère.
Ysengrin, le loup, fit sa plainte le premier. Accompagné de tous ses cousins et partisans, de tous ses amis, il se présenta devant le roi et fit sa déclaration juridique :
« Très-honoré seigneur et roi, entendez mes griefs. Vous êtes noble et grand et honorable ; vous faites à chacun justice et grâce : soyez donc aussi touché du dommage que Reineke, le renard, m’a fait souffrir avec grande honte ; mais, avant tout, ayez pitié de ma femme, qu’il a tant de fois outragée insolemment, et de mes enfants, qu’il a maltraités. Hélas ! il les a souillés d’immondices, d’ordures corrosives, tellement que j’en ai trois encore à la maison qui sont au martyre, dans une cruelle cécité. À la vérité, tout le crime est notoire depuis longtemps ; un jour était même fixé pour faire droit à ces plaintes. Il offrait de prêter serment ; mais bientôt il a changé de résolution, et s’est enfui au plus vite dans son fort. C’est là ce que savent trop bien toutes les personnes ici présentes à mes côtés. Seigneur, quatre semaines ne me suffiraient pas pour conter brièvement les souffrances que le drôle me prépare. Quand toute la toile de Gand, autant que l’on en fabrique, serait changée en parchemin, elle ne contiendrait pas tous ses mauvais tours, et je les passe sous silence. Mais le déshonneur de ma femme me dévore le cœur : je le vengerai, quoi qu’il puisse arriver. »
Quand Ysengrin eût parlé de la sorte, le cœur affligé, un petit chien, qui se nommait Wackerlos, s’avança et dit au roi, en français, comme quoi il était pauvre, et qu’il ne lui était resté rien qu’un petit morceau de saucisse dans un buisson dépouillé ; que cependant Reineke le lui avait pris. Le chat, en colère, s’élança et parut à son tour. Il dit :
« Noble maître, nul ne doit se plaindre des offenses du scélérat plus que le roi lui-même. Je vous le dis, il n’est personne dans cette assemblée, jeune ou vieux, à qui ce misérable ne cause plus de crainte que vous. Cependant la plainte de Wackerlos est futile. Il y a des années que l’affaire s’est passée. C’est à moi que la saucisse appartenait. J’aurais dû faire alors ma plainte. J’étais allé à la chasse. Sur mon chemin, je visitai un moulin pendant la nuit. La meunière dormait : je dérobai sans bruit une petite saucisse, je dois l’avouer. Si Wackerlos avait sur elle quelque droit, il le devait à mon industrie. »

La panthère dit à son tour :
« Que servent les paroles et les plaintes ? elles sont de peu d’effet : le mal est assez notoire. Reineke est un voleur, un meurtrier. Je puis l’affirmer hardiment. Les seigneurs le savent bien ; point d’attentats qu’il ne commette. Quand tous les nobles, quand l’auguste monarque lui-même, perdraient l’honneur et les biens, il s’en rirait, s’il y gagnait seulement un morceau de chapon gras. Sachez comme il maltraita hier Lampe, le lièvre. Le voici, le pauvret, qui n’a lésé personne. Reineke fit le dévot et voulait l’instruire en tout point brièvement, et de ce qui concerne l’office de chapelain. Ils s’assirent l’un devant l’autre et commencèrent le Credo. Mais Reineke ne put renoncer à ses anciennes ruses. Durant la paix de notre roi et le sauf-conduit, il saisit Lampe avec ses ongles et tirailla traîtreusement le brave homme. Je vins à passer sur la route et j’entendis leur chant, qui, à peine commencé, fut interrompu. Je prêtai l’oreille et je fus bien surpris ; mais, quand j’arrivai, je reconnus Reineke sur-le-champ. Il avait pris Lampe au collet, et lui aurait sans doute arraché la vie, si, par bonheur, je n’étais pas survenu. Le voilà. Considérez les blessures du brave homme, que nul ne songe à offenser. Si notre maître veut souffrir, seigneur, si vous voulez permettre que la paix du roi, sa lettre et son sauf-conduit soient insultés par un brigand, oh ! le roi et ses enfants entendront longtemps encore les reproches des gens qui aiment le droit et la justice. »

Ysengrin dit là-dessus :
« Il n’en sera pas autrement, et, par malheur, Reineke ne nous fera jamais rien de bon. Oh ! fût-il mort depuis longtemps ! Ce serait le mieux pour les gens paisibles. Mais, s’il est pardonné cette fois, il trompera bientôt avec audace tels qui s’en doutent le moins aujourd’hui. »
Alors le blaireau, neveu de Reineke, prit la parole et plaida hardiment en faveur de son oncle, quoique sa fausseté fût bien connue.
« Seigneur Ysengrin, dit-il, il est vieux et vrai le proverbe : À bouche ennemie jamais ne te fie. En vérité, mon oncle n’a pas non plus à se louer de vos paroles. Mais la chose vous est facile. S’il était à la cour, aussi bien que vous, et s’il jouissait de la faveur du roi, assurément vous auriez à vous repentir d’avoir parlé avec tant de malice, et renouvelé de vieilles histoires ; quant au mal que vous avez fait vous-même à Reineke, vous le passez sous silence. Et cependant plusieurs de nos messieurs savent comme vous aviez fait ensemble une alliance et promis tous les deux de vivre en camarades. Il faut que je conte la chose. Une fois, en hiver, il courut pour vous de grands dangers. Un voiturier, qui menait une charretée de poissons, passait sur la route. Vous en eûtes vent, et vous auriez, à tout prix, voulu manger de sa marchandise : par malheur, l’argent vous manquait. Alors vous persuadez mon oncle ; il se couche finement, comme mort, sur la route. C’était, par le ciel, une audacieuse entreprise ! Mais écoutez quels poissons il eut en partage ! Le voiturier approche, et voit mon oncle dans l’ornière. Il tire vite son coutelas pour lui assener un coup. Le rusé ne s’émeut pas, ne bouge pas, comme s’il était mort. Le voiturier le jette sur le chariot, et, d’avance, il se réjouit à l’idée de la fourrure. Voilà donc ce que mon oncle risqua pour Ysengrin. Le voiturier continua sa marche, et Reineke jeta des poissons à bas. Ysengrin accourut de loin sans bruit : il mangea les poissons. Reineke se lassa d’aller en voiture. Il se leva, sauta de la charrette, et voulut aussi manger sa part du butin. Mais Ysengrin avait tout dévoré ; il s’était bourré plus que de raison et faillit en crever. Il n’avait laissé que les arêtes, et il offrit les restes à son ami. Un autre tour encore ! Je vous en ferai de même un récit fidèle. Reineke savait que chez un paysan était pendu au croc un cochon gras, tué le jour même. Il en fit confidence au loup. Ils partent, décidés à partager fidèlement le gain et le danger. Mais la fatigue et le danger furent pour lui seul, car il grimpa à la fenêtre, et, à grand’peine, jeta au loup la proie commune. Par malheur, les chiens n’étaient pas loin, qui le flairèrent dans la maison et lui déchirèrent la peau bel et bien. Il s’échappa blessé, courut à la recherche d’Ysengrin, lui conta ses souffrances et réclama sa part. Ysengrin lui dit : « Je t’ai réservé un friand morceau. Mets-toi à l’ouvrage et me le dépèce de la bonne manière. Comme la graisse va te régaler ! » Et il apporta le morceau : c’était le bâton courbé auquel le boucher avait suspendu le cochon. L’excellent rôti, le loup glouton, injuste, l’avait dévoré. De colère, Reineke resta muet ; mais ce qu’il pensa, vous le pensez vous-mêmes. Ô roi, je vous assure que le loup a joué plus de cent tours pareils à mon oncle, toutefois je n’en dirai rien. Si Reineke lui-même est assigné, il se défendra mieux. Cependant, très gracieux roi, noble monarque, je dois le faire observer, vous avez entendu, et ces seigneurs ont entendu, comme le discours d’Ysengrin a follement blessé l’honneur de sa propre femme, qu’il devait protéger au péril de sa vie. En effet, il y a sept ans et plus, mon oncle donna une bonne part de son amour et de sa foi à la belle Giremonde. L’affaire eut lieu dans un bal de nuit. Ysengrin était en voyage. Je dis la chose comme je la sais. Elle s’est souvent prêtée à ses désirs, amicale et polie. Qu’y a-t-il de plus ! Elle n’a jamais fait de plainte ; elle vit et se porte bien : pourquoi fait-il tant de bruit ? S’il était sage, il ne dirait mot de l’affaire. Il n’y gagnera que la honte. Je passe à autre chose, poursuivit le blaireau. Voici l’histoire du lièvre ! Vide et frivole commérage ! Le maître ne devrait donc pas châtier l’élève, quand il est inattentif et inappliqué ? Si l’on ne pouvait punir les enfants, et si la légèreté, l’indocilité, avaient pleine carrière, comment élèverait-on la jeunesse ? Puis, Wackerlos se plaint d’avoir perdu en hiver une andouillette derrière un buisson. Il ferait mieux de souffrir son mal en silence, car, nous venons de l’apprendre, l’andouille était volée. Comme il vient, s’en va le bien. Et qui peut faire un crime à mon oncle d’avoir enlevé au voleur le bien volé ? Les gens nobles et de haute naissance doivent se montrer hostiles et redoutables aux voleurs. Et, s’il l’avait alors pendu, le cas serait excusable. Cependant il l’a laissé libre, par respect pour le roi, car il n’appartient qu’au roi d’infliger la peine de mort. Mais mon oncle doit s’attendre à peu de reconnaissance, si juste qu’il soit et opposé aux forfaits. Depuis que l’on a proclamé la paix du roi, nul ne s’observe comme lui. Il a changé de vie ; il ne mange qu’une fois le jour, il vit comme un ermite, il se mortifie, porte une haire sur la chair nue et s’abstient tout à fait, depuis longtemps, de gibier et de bêtes privées, comme hier encore me le disait une personne qui lui a fait visite. Il a quitté son château de Maupertuis, et se construit un ermitage pour demeure. Comme il est devenu maigre et pâle de faim, de soif et d’autres sévères pénitences, qu’il endure avec contrition, vous pourrez vous en convaincre vous-mêmes. En effet, que chacun l’accuse ici, quel tort cela peut-il lui faire ? Qu’il vienne seulement, il fera valoir son droit et confondra ses ennemis. »
Comme Grimbert achevait de parler, on fut bien surpris de voir paraître Henning, le coq, avec sa troupe. Sur un triste brancard était portée une poule sans cou et sans tête. C’était Grattepied, la meilleure des poules pondeuses. Hélas ! son sang coulait, et Reineke l’avait répandu ! On venait en informer le roi. Quand le vaillant Henning parut devant lui, dans l’attitude d’une affliction profonde, deux coqs, en deuil également, se présentèrent avec lui. L’un s’appelait Kreyant : il était impossible d’en trouver un meilleur de Hollande jusqu’en France. L’autre, qui pouvait soutenir avec lui la comparaison, s’appelait Kantart, vigoureux, hardi compagnon. Chacun d’eux portait un flambeau allumé ; ils étaient les frères de la dame égorgée. Leurs cris douloureux demandaient justice du meurtrier. Deux jeunes coqs portaient le brancard, et l’on pouvait entendre de loin leurs lamentations. Henning prit la parole :

« Très-honoré seigneur et roi, nous portons plainte pour un dommage irréparable. Considérez avec compassion le tort qui nous est fait, à mes enfants et à moi. Vous voyez ici l’ouvrage de Reineke. Lorsque l’hiver eut pris fin, que le feuillage et les fleurs nous appelèrent au plaisir, je me félicitais de voir ma famille passer avec moi les beaux jours dans la joie. Je comptais dix jeunes fils et quatorze filles, tous heureux de vivre. Ma femme, l’excellente poule, les avait élevés tous en un seul été. Tous étaient vigoureux et bien contents. Ils trouvaient leur nourriture journalière dans une place très sûre. La cour appartenait à de riches moines ; le mur nous défendait, et six grands chiens, vaillants commensaux du logis, chérissaient mes enfants et veillaient sur leur vie ; mais Reineke, le voleur, était fâché de nous voir couler en paix d’heureux jours et échapper à ses ruses. Sans cesse il rôdait, la nuit, autour de la muraille, et guettait par la porte. Les chiens le remarquèrent. Alors il lui fallut courir ! Enfin ils le saisirent une fois bel et bien et lui frottèrent la peau ; mais il s’échappa, et nous laissa quelque trêve. Écoutez maintenant : peu de temps après, il vint, habillé en ermite, et m’apporta une lettre scellée. Je reconnus votre sceau sur la lettre. Elle portait que vous aviez proclamé une solide paix chez les bêtes et les oiseaux ; et il m’annonça qu’il était devenu ermite ; qu’il avait fait des vœux sévères, pour expier les péchés dont il s’avouait coupable ; que personne n’avait donc plus rien à craindre de lui ; qu’il avait fait un vœu solennel de ne plus manger de viande jamais. Il me fit remarquer son froc, me montra son scapulaire. En outre, il me produisit un certificat, que le prieur lui avait donné, et, pour me rassurer davantage, sous le froc, une chemise de crin. Puis il s’en alla en disant : « Que Dieu, Notre Seigneur, vous tienne en sa garde ! J’ai encore beaucoup à faire aujourd’hui. J’ai à dire sexte et none et vêpres encore. » Il lisait en marchant et méditait beaucoup de mal ; il songeait à notre perte. Moi, d’un cœur joyeux, je rapportai bien vite à mes enfants l’heureuse nouvelle de votre lettre. Tous se réjouirent. Reineke s’étant fait ermite, nous n’avions plus aucun souci, aucune crainte : je sortis avec eux hors des murs, et nous jouissions tous de la liberté. Mais, hélas ! il nous en prit mal. Il était blotti traîtreusement dans les buissons : il s’élança et nous barra la porte. Il saisit le plus beau de mes fils et l’emporta. Et, une fois qu’il en eût tâté, plus de remède ; il faisait toujours de nouvelles tentatives. Ni les chasseurs ni les chiens ne purent nous défendre jour et nuit contre ses ruses. Il m’a ravi de la sorte presque tous mes enfants. De vingt je suis réduit à cinq. Il m’a volé tous les autres. Oh ! soyez touché de notre douleur amère. Hier il a tué ma fille. Les chiens ont sauvé le corps. Voyez, la voici. C’est lui qui l’a fait. Oh ! prenez la chose à cœur. »
Et le roi prononça ces paroles :
« Approchez, Grimbert, et voyez : voilà comme jeûne l’ermite ! voilà comme il fait pénitence ! mais, que je vive encore une année, et je l’en ferai sérieusement repentir. Au reste, que servent les paroles ? Écoutez, malheureux Henning : de tous les honneurs qui sont rendus aux morts, aucun ne manquera à votre fille. Je ferai chanter vigiles pour elle : je la ferai ensevelir avec de grands honneurs. Ensuite nous délibérerons avec ces messieurs sur le châtiment du meurtre. »
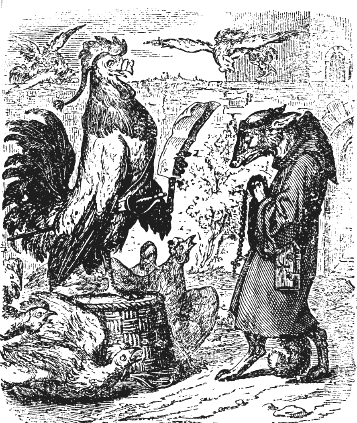
Alors le roi commanda que l’on chantât vigiles. L’assemblée entonna Domine placebo ; ils chantèrent tous les versets. Je pourrais même rapporter qui chanta les leçons et qui les répons ; mais ce serait trop de longueurs : j’aime mieux en rester là. Le corps fut couché dans une fosse, et l’on érigea dessus un beau marbre, poli comme le verre, taillé en carré, grand et massif, sur lequel se lisaient distinctement ces mots :
Grattepied,
fille d’Henning, le coq,
la meilleure des poules,
Pondit des œufs en grand nombre
et sut gratter la terre habilement.
Hélas ! elle est ici gisante,
ravie à sa famille
par le crime de Reineke.
Que tout l’univers apprenne
comme il a méchamment
et traitreusement agi
et que la morte soit pleurée.
Voilà ce qui fut gravé sur le tombeau. Cependant le roi fit convoquer les plus sages, afin de délibérer avec eux sur la manière de punir le crime, qu’on avait exposé si clairement devant lui et devant les seigneurs. Ils décidèrent enfin qu’on enverrait un messager au rusé malfaiteur, pour qu’il ne se dérobât par aucune raison, et pour le sommer de se présenter à la cour du roi, le premier jour où les seigneurs se réuniraient. Brun, l’ours, fut chargé du message. Le roi dit à Brun :
« Je vous ordonne, moi, votre sire, de remplir le message avec zèle. Cependant je vous conseille la prudence ; car Reineke est faux et méchant. Il emploiera toutes sortes de ruses ; il vous flattera ; il vous mentira, vous trompera de son mieux.
– Nenni-da ! reprit l’ours avec confiance. Soyez tranquille. S’il osait s’y jouer seulement, et se permettre de me faire la moindre insulte, je le jure par Dieu, qu’il veuille me punir, si je n’en fais de si terribles représailles, que Reineke ne puisse les endurer. »

CHANT DEUXIÈME

Ainsi donc Brun prit, avec un fier courage, le chemin de la montagne, à travers un désert qui était grand, long et large et sablonneux ; et, lorsqu’enfin il l’eût traversé, il arriva aux montagnes où Reineke avait coutume de chasser. La veille même, il s’était diverti dans ces lieux. L’ours avança jusqu’à Maupertuis, où Reineke avait de beaux bâtiments. De tous les châteaux et de tous les forts qui lui appartenaient en grand nombre, Maupertuis était le meilleur. Il y faisait sa résidence, aussitôt qu’il craignait quelque mal.
Brun arriva au château, et trouva la porte ordinaire solidement fermée. Il passa devant, et, après un moment de réflexion, il finit par crier :
« Monsieur mon oncle, êtes-vous à la maison ? Brun, l’ours, est arrivé ; il vient comme huissier du roi : car le roi a fait serment que vous devez comparaître à sa cour devant la justice. Je suis chargé de vous mander, afin que vous ne refusiez pas de soutenir vos droits et de rendre raison à chacun ; sinon il vous en coûtera la vie. Car, si vous faites défaut, vous êtes menacé de la roue et du gibet. Prenez donc le meilleur parti ; venez et suivez-moi. Autrement vous pourriez vous en mal trouver. »
Reineke entendit parfaitement ce discours, du commencement à la fin ; il restait tranquillement aux écoutes et se disait :
« Si je pouvais payer à ce lourdaud ses orgueilleuses paroles ! Il faut que je rêve à la chose. »
Là-dessus il passa au fond de sa demeure, dans les secrets réduits du château : car il était bâti avec beaucoup d’art. Il s’y trouvait des trous et des cavernes, avec cent corridors, étroits et longs, et diverses portes pour les fermer et les ouvrir, selon le moment et le besoin. Apprenait-il qu’on le cherchait, au sujet de quelque mauvaise action, il trouvait là le meilleur asile. Souvent aussi de pauvres bêtes s’étaient prises par simplicité dans ces méandres : bonne capture pour le brigand. Reineke avait entendu les paroles, mais il craignait sagement que d’autres personnes ne fussent en embuscade avec le messager. Quand il se fut assuré que l’ours était venu seul, le rusé compère sortit et dit :
« Mon très cher oncle, soyez le bienvenu ! pardonnez-moi, je disais vêpres, c’est pourquoi je vous ai fait attendre. Je vous remercie d’être venu : sans doute cela me sera utile à la cour. J’ose l’espérer. À toute heure, mon oncle, soyez le bienvenu ! En attendant, le blâme est pour celui qui vous a imposé ce voyage, car il est long et pénible. Ô ciel, comme vous avez chaud ! votre poil est mouillé et votre respiration haletante. Le puissant roi n’avait-il pas d’autre messager à m’envoyer que le noble seigneur qu’il honore le plus ? Mais j’y trouverai mon avantage. Je vous en prie, prêtez-moi votre assistance chez le roi, où l’on me calomnie indignement. Je me propose, malgré ma situation critique, de me rendre demain librement à la cour, et c’est toujours ma pensée. Aujourd’hui seulement, je suis trop accablé pour faire le voyage. J’ai, par malheur, trop mangé d’un mets qui ne me convient pas. J’en souffre de violentes douleurs. »

Brun, prenant la parole, lui dit :
« Quel était ce mets, notre oncle ? »
L’autre lui répondit :
« À quoi cela vous serait-il bon, si je vous le disais ? Je mène une misérable vie, mais je la souffre patiemment. Un pauvre homme n’est pas un comte. Et, quand il ne se trouve rien de mieux pour nous et les nôtres, il faut bien assouvir notre faim avec des rayons de miel, comme on peut toujours en trouver. Je ne les mange que par nécessité. À présent, je suis gonflé. J’ai avalé cette victuaille avec répugnance : comment pourrait-elle me profiter ? Si je pouvais toujours m’en abstenir, elle n’approcherait pas de mon palais.
– Eh ! monsieur mon oncle, qu’ai-je entendu ? répliqua Brun. Vous dédaignez le miel, que tant de monde recherche ? Le miel, je dois vous le dire, est le meilleur des mets, pour moi du moins. Oh ! procurez-moi du miel : vous n’aurez pas à vous en repentir. Je vous rendrai service à mon tour.
– Vous raillez, dit l’autre.
– Non, je vous le jure, répondit l’ours : j’ai parlé sérieusement.
– S’il en est ainsi, dit le rousseau, je puis vous servir : car il demeure au pied de la montagne un paysan, nommé Rusteviel. C’est lui qui a du miel !… Assurément, vous et toute votre race, vous n’en vîtes jamais en si grande abondance. »
Alors Brun sentit une convoitise immodérée de ce mets favori.
« Ô mon oncle, s’écria-t-il, menez-moi vite chez cet homme : je m’en souviendrai. Procurez-moi du miel, quand même je n’en aurais pas de quoi me rassasier.
– Allons, dit le renard ; le miel ne manquera pas. Aujourd’hui, je suis, il est vrai, mauvais piéton ; mais l’affection que je vous ai vouée depuis longtemps me rendra la marche moins pénible. Car je ne connais personne, parmi tous mes parents, que j’honore comme vous. Venez donc ! À votre tour, vous me servirez à la cour du roi, par-devant nos seigneurs juges, en sorte que je confonde la violence de mes ennemis et leurs accusations. Je prétends vous repaître de miel aujourd’hui, autant que vous pourrez en porter. »
Le fripon avait dans la pensée les coups de bâtons des paysans irrités. Reineke courut en avant, et Brun le suivit aveuglément.
« Si je réussis, se disait le renard, je te mènerai aujourd’hui dans un marché où tu trouveras du miel bien amer. »
Et ils arrivèrent à la ferme de Rusteviel. Cela rendit l’ours bien joyeux, mais sans cause, comme il arrive souvent aux fous de se tromper avec espérance.
Le soir était venu et Reineke savait qu’à cette heure, Rusteviel était d’ordinaire couché dans sa chambre. C’était un charpentier, un maître habile. Dans la cour se trouvait un tronc de chêne ; déjà, pour le diviser, il y avait enfoncé deux coins épais, et, par en haut, l’arbre était ouvert de près d’une aune. Reineke l’observa et il dit :
« Mon oncle, il se trouve dans cet arbre plus de miel que vous ne pensez. Fourrez dedans votre museau aussi avant que vous pourrez. Seulement je vous conseille de n’en pas prendre à l’excès, avec gourmandise : vous pourriez vous en mal trouver.
– Croyez-vous, dit l’ours, que je sois un glouton ? Nullement. La modération est bonne en toutes choses. »
Il se laissa donc enjôler, et il fourra sa tête dans la fente jusqu’aux oreilles, et aussi les pieds de devant. Reineke se mit à l’œuvre, et, à force de tirailler, il arracha les coins, et l’ours fut pris, la tête et les pieds étroitement serrés. Ni reproches, ni flatteries ne servirent de rien ; Brun avait assez à faire, quoique vigoureux et hardi : et voilà comme le neveu prit l’oncle au piège par adresse. L’ours hurlait et gémissait, et, avec les pieds de derrière, il grattait de fureur ; il fit tant de vacarme, que Rusteviel accourut. Le maître se demandait ce que ce pouvait être, et il apportait sa hache, afin qu’on le trouvât les armes à la main, si quelqu’un songeait à lui faire tort.
Cependant Brun se trouvait dans une grande angoisse : il était serré violemment dans la fente : il tirait et se démenait, rugissant de douleur. Mais, avec toute sa peine, il ne gagnait rien ; il croyait ne jamais sortir de là. Reineke en avait aussi la joyeuse assurance. Quand il vit Rusteviel s’avancer de loin, il cria :
« Brun, comment va-t-il ? Modérez-vous et ménagez le miel. Dites-moi, a-t-il bon goût ? Voici Rusteviel, qui veut vous régaler. Il vous apporte, après le repas, un petit coup à boire. Grand bien vous fasse ! »
Là-dessus Reineke s’en retourna à Maupertuis, le château. Rusteviel arriva, et, quand il aperçut l’ours, il courut appeler les paysans, qui buvaient encore ensemble au cabaret.
« Venez ! leur cria-t-il, un ours est pris dans ma cour : je dis la vérité. »
Ils le suivirent et coururent ; chacun s’arme à la hâte, aussi bien qu’il peut. L’un prend la fourche à la main, l’autre son râteau ; le troisième et le quatrième accourent armés de piques et de hoyaux ; le cinquième est muni d’un pieu ; le curé même et le sacristain arrivent avec leurs outils. Enfin la cuisinière du curé (Madame Jeanne, qui savait apprêter et cuire la bouillie de gruau comme personne) ne resta pas en arrière. Avec sa quenouille, auprès de laquelle elle avait été assise tout le jour, elle accourut, pour frotter la peau du malheureux ours. Dans sa détresse horrible, Brun entendait le vacarme croissant, et, par un effort violent, il arracha sa tête de la fente : mais la peau et les poils de la face, jusqu’aux oreilles, restèrent dans l’arbre. Non, il ne se vit jamais de bête plus à plaindre. Le sang lui coulait par-dessus les oreilles. Que lui servait-il d’avoir délivré sa tête ? Les pattes restaient prises dans le tronc. À force de tirer, il les dégage. Il était furieux et ne se connaissait plus : les ongles et la peau des pieds étaient demeurés dans la fente serrée. Hélas ! cela n’avait pas le goût de ce doux miel que Reineke lui avait fait espérer ; le voyage avait mal réussi ; Brun avait fait une course malheureuse. Sa barbe, ses pieds, ruisselaient de sang ; il ne pouvait se tenir debout : il ne pouvait ramper ni marcher. Et Rusteviel accourait pour le battre. Il fut assailli par tous ceux qui étaient venus avec le maître. Le tuer était leur désir. Le curé portait à la main un long bâton et le frappa de loin. L’ours se tournait avec peine de çà et de là ; la troupe le pressait, les uns par ici, avec des piques, les autres par là, avec des haches : le forgeron apportait tenailles et marteau : ceux-ci venaient avec des pelles, ceux-là avec des bêches ; ils frappaient sur l’ours et criaient, et frappaient tant que, saisi d’une douloureuse angoisse, il se roulait dans ses ordures. Tous le pressaient : nul ne restait en arrière. Schloppe, le bancal, Ludolphe, le camus, étaient les plus acharnés, et Gérold agitait dans ses mains crochues le fléau de bois : à ses côtés était son beau-frère Kucklerei, le gros : l’un et l’autre frappaient au mieux ; mais Quack et Madame Jeanne ne manquaient pas de faire leur devoir. Talke Lorden Quacks frappa de sa hotte le malheureux. Et ceux que nous nommons n’étaient pas les seuls : hommes et femmes accouraient en foule, et ils voulaient la vie de l’ours. Kucklerei criait plus que les autres. Il se croyait un personnage : car Madame Willigetrude, qui demeurait derrière la porte du village, était, on le savait, sa mère. Son père, on ne l’avait jamais connu : toutefois les paysans supposaient que le noir Sander, le faucheur, fier compagnon, quand il était seul, pourrait bien être son père. Les pierres volaient aussi comme grêle, menaçant de toutes parts Brun désespéré. Soudain le frère de Rusteviel s’élança en avant, et, d’un épais et long gourdin, il asséna un tel coup sur la tête de l’ours, qu’il n’y voyait et n’entendait plus : cependant il se relève de ce rude coup ; il se jette, furieux, au travers des femmes, qui chancellent, qui tombent et crient ; quelques-unes sont précipitées dans l’eau ; et l’eau était profonde. Le curé pousse un cri.

« Voyez, dit-il, Madame Jeanne, la cuisinière, nage là-bas, dans sa fourrure, et voici la quenouille ! Au secours, mes amis ! Je donne, en récompense, deux tonneaux de bière et force indulgences et pardons. »
Tous laissèrent l’ours comme mort, et coururent à l’eau après les femmes : on en tira cinq sur le bord. Tandis que les hommes étaient occupés sur la rive, l’ours, en sa grande détresse, se traîna dans l’eau, rugissant de l’effroyable douleur qu’il sentait. Il aimait mieux se noyer que de souffrir si honteusement les coups. Il n’avait jamais essayé de nager, et il espérait finir sur-le-champ sa vie. Contre son attente, il se sentit nager, et il fut heureusement porté par le courant. Tous les paysans le virent et s’écrièrent :
« Voilà qui sera pour nous une honte éternelle ! »
Ils étaient furieux ; ils maudissaient les femmes.
« Qu’elles auraient mieux fait de rester à la maison ! Voyez-vous à présent ? Il nage, il s’en va. »
Ils allèrent visiter la bille de chêne, et ils y trouvèrent encore la peau et le poil de la tête et des pieds. On en rit et l’on crie :
« Tu reviendras sans doute : nous gardons tes oreilles en gage. »
C’est ainsi qu’ils ajoutaient la raillerie au dommage ; mais il était joyeux d’avoir du moins échappé à sa perte. Il maudissait les paysans qui l’avaient battu : il gémissait de la douleur qu’il sentait aux pieds et aux oreilles ; il maudissait Reineke, qui l’avait trahi. En faisant ces imprécations, il nageait toujours ; la rivière, qui était grande et rapide, l’emporta, en peu de temps, presque une lieue plus bas. Alors il rampa sur le rivage même tout haletant. Jamais le soleil ne vit de bête plus tourmentée. Il ne croyait pas vivre jusqu’au lendemain ; il croyait mourir sur-le-champ et s’écriait :
« Ô Reineke, traître félon ! méchante créature ! »
Puis il pensait aux paysans qui l’avaient battu, il pensait à l’arbre, et maudissait les ruses de Reineke.
De son côté, le renard, après avoir, de propos délibéré, conduit son oncle au marché, pour lui procurer du miel, courut après les poules. Il connaissait l’endroit, et il en attrapa une : il courut, et traîna bien vite sa proie vers la rivière. Il la dévora aussitôt, et se hâta d’aller à ses affaires, en suivant toujours la rive. Il but de l’eau et se dit :
« Oh ! que je suis charmé d’avoir mené cet ours stupide à la métairie ! je gage que Rusteviel lui aura fait tâter sa hache. L’ours s’est toujours montré mon ennemi : j’ai pris ma revanche. Je l’ai toujours appelé mon oncle : maintenant il est resté mort à l’arbre, et je veux m’en réjouir tant que je vivrai. Il ne fera plus ni plaintes, ni dommage. »
Comme il se promène ainsi, il regarde en bas vers la rive et voit Brun qui se roule. Cela le blesse au cœur que l’ours ait échappé vivant.
« Rusteviel, s’écria-t-il, paresseux, grossier, bélître, tu dédaignes un pareil morceau, qui est gras, et de bon goût, que tant d’honnêtes gens désirent, et qui était si commodément tombé dans tes mains ! Mais l’honnête Brun t’a laissé un gage pour ton hospitalité. »
C’est ainsi qu’il se parlait à lui-même, lorsqu’il l’aperçut affligé, épuisé et sanglant. Enfin il lui cria :
« Monsieur mon oncle, je vous retrouve ici ? Avez-vous oublié quelque chose chez Rusteviel ? Dites-moi, je lui ferai savoir où vous êtes. Mais, s’il faut le dire, je crois que vous avez volé à cet homme beaucoup de miel, ou bien l’avez-vous honnêtement payé ? Comment les choses se sont-elles passées ? Hé ! comme vous voilà fait ! vous avez une piteuse mine ! le miel n’était-il pas de bon goût ? Il s’en trouve encore à vendre pour le même prix. Or çà, dites-moi vite, mon oncle, à quel ordre vous êtes-vous sitôt consacré, pour vous être mis à porter sur la tête une barrette rouge ? Êtes-vous abbé ? Assurément le barbier qui vous a tondu le crâne vous a coupé les oreilles : vous avez perdu votre toupet, à ce que je vois, et de plus la peau de vos joues et vos gants. Où donc les avez-vous laissés ? »
Voilà les propos railleurs que Brun dut s’entendre débiter, et, de douleur, il ne pouvait parler ni prendre un parti, ni se tirer d’affaire. Pour n’en pas entendre davantage, il se traîna derechef dans l’eau, et, emporté par le courant rapide, il aborda sur une rive basse. Là il se coucha, souffrant et misérable, et, poussant des cris plaintifs, il se dit à lui-même :
« Oh ! si l’un d’eux m’avait donné le coup de grâce ! je ne puis marcher, et je devrais achever mon voyage ; je devrais me rendre à la cour du roi, et je reste en chemin avec ignominie, par la méchante trahison de Reineke. Si j’en réchappe, certainement je t’en ferai repentir. »
Cependant il se leva avec effort, se traîna pendant quatre jours, avec d’horribles douleurs, et arriva enfin à la cour. Quand le roi vit l’ours dans sa détresse, il s’écria :
« Bon Dieu ! Est-ce Brun que je vois ? Pourquoi arrive-t-il si maltraité ? »
Et Brun répondit :
« Hélas ! elle est pitoyable la souffrance que vous voyez. Voilà comme Reineke, le scélérat, m’a outrageusement trahi. »
Alors le monarque irrité dit ces paroles :
« Certainement je veux punir le forfait sans miséricorde, Reineke oserait insulter un seigneur tel que Brun ! Oui, sur mon honneur, par ma couronne, je le jure, Reineke donnera à Brun toutes les satisfactions qu’il exigera. Si je ne tiens pas ma parole, je veux ne plus porter l’épée ; j’en fais le serment solennel. »
Et le roi ordonne que le conseil s’assemble, délibère et fixe sur-le-champ la peine de ces attentats. Tous furent d’avis que, si tel était le bon plaisir du roi, Reineke fût cité de nouveau, qu’il eût à comparaître, pour soutenir son droit contre la plainte et la réclamation. Hinze, le chat, pourrait porter le message à Reineke, parce qu’il était habile et prudent. Tel fut l’avis unanime.
Alors le roi rassembla autour de lui ses fidèles et il dit à Hinze :
« Rappelez-vous bien la volonté des seigneurs. Si Reineke se fait assigner une troisième fois, ce sera pour l’éternel dommage de lui-même et de toute sa race. S’il est sage, il viendra sans tarder. Faites-lui bien sa leçon. Il méprise les autres, mais il écoutera vos conseils. »
Le chat répondit :
« Que ce soit pour le gain ou le dommage, quand j’arriverai chez lui, comment devrai-je m’y prendre ? Faites ou ne faites pas, je m’en rapporte à vous, mais je serais d’avis qu’il vaudrait mieux envoyer tout autre que moi, car je suis bien petit. Brun, l’ours, est grand et fort, et il n’a pu le contraindre : de quelle manière en viendrai-je à bout ? Oh ! veuillez m’excuser.
– Vous ne me persuadez point, répondit le roi : on trouve maint petit homme plein d’une ruse et d’une sagesse étrangères à bien des grands. Sans avoir une taille de géant, vous êtes néanmoins savant et sage. »
Le chat obéit en disant :
« Que votre volonté soit faite ! si je puis voir en chemin un signe à main droite, mon voyage réussira. »

CHANT TROISIÈME

Hinze, le chat, n’avait fait encore qu’un bout de chemin, lorsqu’il aperçut de loin un oiseau de Saint-Martin, et il lui cria :
« Noble oiseau, salut ! oh ! tourne tes ailes et vole à ma droite ! »
L’oiseau vola et vint se percher à la gauche du chat, sur un arbre, pour chanter. Hinze fut très affligé : il croyait entendre son malheur. Cependant il reprit courage, comme font bien d’autres. Il continua son chemin vers Maupertuis. Là il trouva Reineke assis devant la maison. Il le salua et lui dit :
« Que le Dieu puissant et secourable vous donne le bonsoir ! Le roi menace votre vie, si vous refusez de me suivre à la cour, et il me charge en outre de vous dire : « Venez répondre en justice à vos accusateurs : autrement, votre famille en souffrira. »
Reineke répondit :
« Soyez le bienvenu, mon très cher neveu. Puisse Dieu vous bénir selon mes souhaits ! »
Or il ne pensait pas ainsi dans son traître cœur ; il méditait de nouvelles ruses : il voulait renvoyer à la cour le messager avec insulte. Appelant toujours le chat son neveu, il dit :
« Mon neveu, quel souper vous servirai-je ? On dort mieux quand on est rassasié. Que je sois aujourd’hui votre hôte, nous irons demain ensemble à la cour. Tel est mon avis. Je ne sais aucun de mes parents auquel je me fie plus volontiers. L’ours glouton était venu chez moi fièrement. Il est colère, il est fort, et, pour beaucoup, je n’aurais pas osé voyager à ses côtés. Mais vous entendez bien que j’irai volontiers avec vous. Nous partirons de bon matin. C’est ce qui me semble le plus à propos. »
Hinze répondit :
« Il vaudrait mieux nous rendre sur-le-champ à la cour, tels que nous voilà : la lune brille sur la bruyère, les chemins sont bons. »
Reineke répliqua :
« Je trouve qu’il est dangereux de voyager la nuit. Tel nous salue amicalement pendant le jour, qui, s’il nous rencontrait de nuit, pourrait bien nous faire un mauvais parti. »
Mais Hinze reprit la parole :
« Eh ! si je reste ici, mon neveu, apprenez-moi ce que nous mangerons. »
Reineke répondit :
« Nous vivons chétivement : cependant, si vous restez, je vous servirai des rayons de miel tout frais. Je choisirai les plus purs.

– Je ne mange jamais de ces choses-là, reprit le chat en murmurant. S’il ne se trouve rien à la maison, donnez-moi une souris. Rien de mieux pour me repaître : gardez le miel pour d’autres.
– Aimez-vous tant les souris ? dit Reineke. Parlez sérieusement : je puis vous en pourvoir. Mon voisin le curé a dans la cour une grange, où se trouvent des souris, plus qu’une charrette n’en pourrait emporter. J’entends le curé se plaindre qu’elles lui deviennent nuit et jour plus incommodes. »
Le chat dit étourdiment :
« Faites-moi l’amitié de me conduire chez les souris, car j’en fais plus de cas que du gibier et de tout au monde : c’est mon plus friand régal. »
Reineke répondit :
« Alors, en vérité, vous allez faire un festin magnifique. Puisque je sais ce que je peux vous offrir, ne perdons point de temps. »
Hinze le crut et le suivit. Ils arrivèrent à la grange du curé, à la muraille de terre. Reineke l’avait subtilement percée la veille, et, par le trou, il avait volé au curé dormant le meilleur de ses coqs. Le petit Martinet, le fils chéri du prêtre, voulant en tirer vengeance, avait fixé adroitement, devant l’ouverture, une corde avec un lacet. Il espérait venger ainsi son coq du voleur, s’il revenait. Reineke s’en doutait et y prit garde. Il dit :
« Mon cher neveu, glissez-vous dedans par l’ouverture. Je ferai la garde devant, tandis que vous chasserez aux souris. Vous les attraperez en masse dans l’obscurité. Oh ! entendez-vous comme elles sifflent gaiement ? Quand vous serez soûl, revenez, vous me trouverez ici. Il ne faut pas nous séparer ce soir, car nous partirons demain de bonne heure, et nous abrégerons la route par nos joyeux entretiens.
– Croyez-vous, dit le chat, qu’il soit bien sûr de se glisser là ? Les cafards ont quelquefois aussi de mauvaises pensées. »
Le fripon de renard lui répliqua :
« Qui sait ? Êtes-vous si peureux ? Retournons : ma petite femme vous fera un bon et honorable accueil ; elle vous apprêtera une nourriture succulente. Même sans souris, nous souperons gaiement. »
Mais Hinze, le chat, s’élança dans le trou. Les paroles moqueuses de Reineke le rendaient confus, et il tomba dans le lacet. C’est ainsi que les hôtes de Reineke trouvèrent chez lui un mauvais accueil.
Hinze, ayant senti la corde autour de son cou, tressaillit d’angoisse et se hâta de frayeur, car il s’était élancé violemment. La corde se serra. Il appela, d’une voix plaintive, Reineke, qui prêtait l’oreille hors du trou, se réjouissait avec malice, et dit ces mots à travers l’ouverture :
« Hinze, les souris sont-elles de votre goût ? Vous les trouvez, je pense, engraissées. Si seulement le petit Martin savait que vous mangez son gibier, certainement il vous apporterait de la moutarde. C’est un garçon poli. Est-ce qu’on chante de la sorte à la cour en mangeant ? Voilà une singulière musique ! Si je savais Ysengrin dans ce trou, comme je vous ai pris au piège, il me payerait tout le mal qu’il m’a fait. »
À ces mots Reineke passa son chemin. Mais il ne courait pas le pays pour piller seulement. Adultère, brigandage, assassinat, trahison, ne lui semblaient point des actions coupables : et il avait justement médité quelque chose de pareil. Il voulait faire visite à la belle Giremonde, dans un double dessein : d’abord il espérait apprendre d’elle de quoi Ysengrin l’accusait proprement : ensuite le fripon voulait retourner à ses anciens péchés. Ysengrin s’était rendu à la cour, et Reineke voulait en profiter. Qui doute en effet que l’amour de la louve pour l’infâme renard n’eût enflammé la colère du loup ? Reineke pénétra dans l’appartement de la femme, et ne la trouva pas à la maison.
« Dieu vous garde, mes beaux-fils ! » dit-il, ni plus ni moins.
Il fit aux petits un signe d’amitié et s’en alla à ses affaires. Le matin, Madame Giremonde étant revenue au point du jour :
« Personne n’est-il venu me demander ? dit-elle.
– Monsieur notre parrain Reineke ne fait que de sortir. Il désirait vous parler. Tous tels que nous sommes ici, il nous a qualifiés de beaux-fils.
– Il le payera, » s’écria Giremonde.
Et sur l’heure elle courut venger cette insolence. Elle savait où il avait coutume d’aller : elle l’atteignit et lui dit en colère :
« Quel est ce langage ? et quels propos injurieux avez-vous tenus sans conscience, en présence de mes enfants ? Vous en serez puni. »
Ainsi dit-elle en colère, et elle lui montrait un visage irrité. Elle le prit par la barbe : il sentit la force de ses dents, et se mit à courir, pour lui échapper. Elle le suivit lestement à la piste. Alors il se passa de singulières aventures.
Un château en ruine se trouvait dans le voisinage.
Tous deux le gagnèrent à pas précipités. La muraille d’une tour s’était fendue de vétusté. Reineke se glissa dans l’ouverture : il dut faire effort, parce que la crevasse était étroite. La louve, grande et forte comme elle était, fourra à la hâte sa tête dans la fente. Elle pressait, poussait, perçait, tirait et voulait suivre Reineke, et se prenait toujours plus avant, et ne pouvait avancer ni reculer. Quand Reineke vit la chose, il courut de l’autre côté, par un détour. Il vint et lui donna de l’ouvrage. Mais elle ne se faisait pas faute de paroles et lui criait avec insulte :
« Tu te conduis comme un vaurien, un voleur. »
Et Reineke lui répliqua :
« Si cela ne s’est jamais vu, cela se voit maintenant. »
On se fait peu d’honneur à ménager sa femme aux dépens des autres, comme Reineke faisait alors. Le méchant n’avait souci de rien. Lorsque enfin la louve se fût dégagée de la crevasse, Reineke était déjà loin et passait son chemin. Et la femme, qui avait prétendu se faire justice elle-même et défendre son honneur, l’avait doublement perdu.
Mais retournons à Hinze. Le pauvre malheureux, se sentant pris, poussa des cris lamentables, à la manière des chats. Le petit Martin l’entendit et sauta à bas de son lit :
« Dieu soit loué ! J’ai placé à la bonne heure le lacet devant l’ouverture ; le voleur est pris. Je pense qu’il va bien payer le coq. »
Ainsi dit Martinet triomphant, et il alluma vivement une chandelle (les gens dormaient dans la maison) ; il éveilla père et mère, et tous les valets, en s’écriant :
« Le renard est pris, allons lui faire son compte. »
Ils accoururent tous, grands et petits ; le curé lui-même se leva, se couvrit d’un petit manteau : sa cuisinière le précédait avec deux chandelles ; Martinet avait pris à la hâte un gourdin, et tomba sur le chat, lui en donna sur la peau, sur la tête, et lui arracha un œil. Tous frappaient sur le chat ; le curé accourut avec une fourche, et se flattait d’égorger le voleur. Hinze se crut mort : il s’élança, furieux et résolu, entre les jambes du prêtre, le mordit et l’égratigna dangereusement, outragea l’homme d’une façon terrible et vengea cruellement son œil. Le curé pousse des cris et tombe par terre sans connaissance. La cuisinière vocifère étourdiment que c’est le diable qui lui joue à elle-même ce méchant tour. Elle jure deux et trois fois qu’elle donnerait volontiers tout son petit avoir, pour que cet accident ne fût pas arrivé à son maître. Elle jura même que, si elle avait un monceau d’or, elle ne le regretterait pas, et qu’elle y renoncerait volontiers. C’est ainsi qu’elle déplorait la disgrâce de son maître et sa cruelle blessure. Enfin on le porta au lit, faisant beaucoup de plaintes : on laissa Hinze à la corde et on l’avait oublié.
Lorsque Hinze, le chat, se vit seul dans sa détresse, cruellement battu et grièvement blessé, si près de la mort, par amour de la vie, il saisit la corde et la mordit vivement.
« Pourrais-je, se disait-il, me délivrer peut-être de ce grand mal ? »
La chose lui réussit ; la corde rompit. Qu’il se sentit heureux ! Il se hâta de fuir le lieu où il avait tant souffert. Il s’élança vivement hors du trou, et prit en diligence le chemin de la cour du roi, où il arriva le lendemain. Il se faisait à lui-même des reproches amers.
« Voilà donc comme le diable devait triompher de toi par les artifices de Reineke, le méchant traître ! Quand tu reviendras avec ta honte, avec un œil perdu, et chargé de coups douloureux, quelle confusion pour toi ! »
La colère du roi fut extrême : il menaça le traître de la mort, sans rémission. Il fit assembler ses conseils. Ses barons, ses docteurs arrivèrent. Il demanda comment l’on pourrait enfin mettre en jugement le criminel, qui avait déjà fait tant de mal. Comme il s’élevait contre Reineke plaintes sur plaintes, Grimbert, le blaireau, prit la parole :
« Il peut se trouver aussi dans ce tribunal beaucoup de seigneurs mal disposés pour Reineke ; mais personne ne lèsera les droits de l’homme libre. Il faut le citer pour la troisième fois. Cela fait, s’il ne vient pas, la justice peut le déclarer coupable. »
Le roi répondit :
« Je crains que, de tous mes sujets, aucun ne veuille porter la troisième citation à ce perfide. Lequel a un œil de trop ? Qui aurait la témérité de risquer son corps et sa vie pour ce méchant traître ? de jouer le salut de ses membres, sans parvenir enfin à faire comparaître Reineke ? Je pense que personne ne voudra l’essayer. »
Le blaireau s’écria :
« Sire, si vous le demandez de moi, je m’acquitterai sur-le-champ du message, quoi qu’il puisse arriver. Voulez-vous m’envoyer d’office, ou bien irai-je comme si je me présentais de moi-même ? Vous n’avez qu’à commander. »
Le roi le chargea du message et lui dit :
« Allez donc. Vous avez entendu toutes les plaintes, et vous irez prudemment en besogne, car c’est un dangereux personnage. »
Grimbert répondit :
« Je veux faire une tentative, et j’espère enfin l’amener. »
Il se mit donc en chemin pour Maupertuis, le château. Il y trouva Reineke avec sa femme et ses enfants, et lui dit :
« Oncle Reineke, je vous salue ! vous êtes un habile et sage et savant homme ; nous sommes tous ébahis comme vous méprisez la citation du roi ; je dis, comme vous vous en moquez. Ne jugez-vous pas qu’il serait temps d’obéir ? Les accusations et les mauvais bruits se multiplient de tous côtés. Je vous le conseille, venez à la cour avec moi : tarder plus longtemps est inutile. On a fait au roi plaintes sur plaintes. Vous êtes cité aujourd’hui pour la troisième fois. Si vous ne comparaissez pas, on vous condamne. Alors le roi amènera ses vassaux pour vous bloquer, pour vous assiéger dans ce château de Maupertuis : et vous périrez corps et biens, avec votre femme et vos enfants. Vous n’échapperez pas au roi : le mieux est donc de me suivre à la cour. Vous ne manquerez pas de manœuvres habiles ; vous en avez de toutes prêtes, et vous saurez échapper. Car vous avez eu souvent avec la justice des affaires bien plus grandes que celle-ci, et vous en êtes toujours sorti heureusement, comme vos adversaires à leur confusion. »
Grimbert ayant cessé de parler, Reineke lui répondit :
« Mon oncle, vous me conseillez sagement de me présenter devant la cour pour défendre ma cause moi-même. J’espère que le roi me fera grâce. Il sait combien je lui rends de services, mais il sait aussi combien, pour cette raison, je suis haï des autres. Sans moi, la cour ne peut subsister. Et, je le sais d’avance, quand je serai dix fois plus coupable, aussitôt que je me montrerai à sa vue et que je lui parlerai, il sentira sa colère vaincue. Sans doute beaucoup de gens accompagnent le roi et siègent dans son conseil, cependant les choses ne vont jamais à son gré : ils ne trouvent, tous ensemble, aucune ressource, aucune idée. Chaque fois que la cour est convoquée, où que je sois, on remet la décision à mon jugement. Et, si le roi et les seigneurs se rassemblent, pour imaginer un sage expédient dans des affaires épineuses, il faut que Reineke le trouve. Beaucoup de gens m’en veulent du mal. Je dois les craindre : car ils ont juré ma mort, et les plus méchants sont justement réunis à la cour. C’est ce qui m’inquiète. Ils sont plus de dix et puissants : comment puis-je résister seul à tant de monde ? C’est pourquoi j’ai toujours temporisé. Cependant je trouve plus à propos de me rendre avec vous à la cour pour défendre ma cause. Cela me fera plus d’honneur que de précipiter, par mes lenteurs, ma femme et mes enfants dans la détresse et le danger. Nous serions tous perdus : le roi est trop puissant pour moi, et, quoi que ce fût, je devrais le faire aussitôt qu’il l’aurait commandé. Nous pouvons essayer de conclure peut-être un accommodement avec nos ennemis. »
Reineke dit ensuite :
« Ermeline, ma femme, gardez bien nos enfants (je vous le recommande), surtout Reinhart, le plus jeune de tous. Sa petite bouche est si joliment endentée ! j’espère qu’il sera toute l’image de son père. Voici encore Rossel, le fripon, qui ne m’est pas moins cher. Oh ! prenez soin de nos enfants pendant mon absence : j’en serai reconnaissant, si je reviens heureux et si vous m’avez obéi. »
Il partit donc avec Grimbert, son compagnon ; il laissa dame Ermeline avec ses deux fils et fit diligence. Il quittait la maison sans prendre conseil : la renarde en était affligée.
Les deux piétons n’avaient pas fait une petite lieue, que Reineke dit à Grimbert :
« Mon très cher oncle, mon digne ami, je vous le confesse, je tremble de crainte. Je ne puis me défaire de la pénible et alarmante pensée que je vais assurément au-devant de la mort. Tous mes nombreux péchés se représentent devant moi. Ah ! vous ne pouvez croire l’inquiétude que je sens. Laissez-moi me confesser. Écoutez-moi. Il n’y a pas d’autre prêtre dans le voisinage. Quand j’aurai déchargé mon cœur, je ne m’en présenterai pas devant mon roi avec plus de désavantage.
– Commencez, dit Grimbert, par confesser les vols et les brigandages, toutes les mauvaises trahisons et vos autres artifices ordinaires, sinon la confession ne pourra vous servir.
– Je le sais, répondit Reineke. Laissez-moi donc commencer, et m’écoutez attentivement.
« Confiteor tibi, pater et mater, que j’ai joué bien des mauvais tours à la loutre et au chat et à d’autres encore. Je l’avoue, et je me soumettrai volontiers à la pénitence.
– Parlez français, afin que je comprenne, dit le blaireau.
– En vérité, dit le renard, comment pourrais-je le nier ? je me suis rendu coupable envers tous les animaux qui vivent aujourd’hui. Mon oncle, l’ours, je l’ai pris dans l’arbre ; il en a eu la tête saignante, et il a reçu cent coups dc bâton. J’ai mené Hinze à la chasse des souris ; mais, pris au lacet, il a dû souffrir bien des maux, et il a perdu un œil. Henning se plaint aussi justement : je lui ai ravi ses enfants, grands et petits, selon que je les attrapais, et je m’en suis régalé. Je n’ai pas même épargné le roi : je lui ai joué hardiment de malins tours, et à la reine elle-même. Elle n’en prendra pas son parti de longtemps. Je dois le confesser encore, j’ai fait à Ysengrin, le loup, tous les outrages que j’ai pu. Tout dire, je n’en trouverais pas le temps. Je l’ai toujours appelé mon oncle, par plaisanterie : nous ne sommes point parents. Une fois, il y a bientôt six ans, il vint chez moi au couvent d’Elkmar, où je demeurais, et me demanda mon assistance, parce qu’il songeait, disait-il, à se faire moine. C’était, à son avis, un métier fait pour lui ; et il tira la cloche. Le son l’amusait tant ! J’attachai ses pieds de devant à la corde : il trouva cela fort bon, et, ainsi debout, il tirait et se divertissait, et semblait apprendre le métier de sonneur. Mais cet art devait tourner à sa honte, car il ne cessait de sonner comme un fou et un possédé. Les gens, effrayés, accoururent par tous les chemins, croyant qu’il était arrivé un grand malheur. Ils vinrent et le trouvèrent là, et, avant qu’il eût expliqué qu’il voulait embrasser l’état ecclésiastique, il fut presque assommé par la foule impétueuse. Cependant l’imbécile persista dans son projet, et me pria de lui procurer l’honneur de la tonsure. Je lui brûlai le poil sur le crâne, au point qu’il en eût la peau toute ridée. Voilà comme je lui ai ménagé force coups, force bastonnades, avec ignominie. Je lui appris à prendre des poissons, mais il s’en est mal trouvé. Un jour, il m’accompagnait dans le pays de Juliers : nous nous glissâmes chez un curé, le plus riche de la contrée. L’homme avait un cellier garni d’excellents jambons : il y gardait aussi des flèches de lard fort délicat, et, dans une auge, se trouvait de la viande fraîchement salée. Ysengrin finit par s’ouvrir avec les ongles, à travers le mur de pierre, un passage, où il pouvait se couler commodément. Je le poussai à la chose, et sa convoitise ne l’y poussait pas moins. Mais, au sein de l’abondance, il ne put se contraindre : il se gorgea outre mesure, et le trou, arrêtant de force son corps enflé, empêcha son retour. Ah ! comme il invectiva le trou perfide, qui l’avait laissé entrer affamé et qui lui refusait la sortie, étant rassasié ! Là-dessus, je fis un grand bruit dans le village, pour donner l’éveil aux gens et les mettre sur la trace du loup. Je courus chez le curé et le trouvai à table. On venait de lui servir un chapon gras, bien rôti. Je le happe et l’emporte. Le curé veut me poursuivre précipitamment et fait du vacarme : il heurte et renverse la table, avec les plats et les bouteilles. « Qu’on le frappe, qu’on l’assomme, qu’on le prenne, qu’on le tue ! » criait le prêtre furieux.

Mais il tomba, et rafraîchit sa colère dans une mare, qu’il n’avait pas aperçue sous ses pieds. Tout le monde accourait et criait : « Qu’on l’assomme ! » Je m’enfuis, ayant à mes trousses tout ce monde, qui voulait me faire le plus mauvais parti. Le curé criait plus fort que tous les autres. « Quel effronté voleur ! il a pris le chapon « sur ma table ! » Je courus en avant jusqu’au cellier : là je laissai, à regret, tomber la volaille par terre. Elle était devenue à la fin trop pesante pour moi. Ainsi la foule me perdit. Mais ils trouvèrent le chapon, et, quand le curé le releva, il aperçut le loup dans le cellier ; la foule aussi le vit. Le prêtre leur crie : « Ici, et qu’on le tue ! Un autre voleur, un loup, est tombé dans nos mains. S’il échappait, ce serait à notre honte, et certes, dans tout le pays de Juliers on rirait à nos dépens. » Le loup ne savait où il en était. Les coups, les atteintes douloureuses, lui pleuvaient sur le corps de toutes parts. Les gens criaient tous à plein gosier. Les autres paysans accoururent, et le laissèrent pour mort sur la place. De sa vie il n’avait souffert un plus grand mal. Si quelqu’un représentait l’aventure sur la toile, ce serait une chose étrange, de voir comme il paya au curé son lard et ses jambons. Ils le jetèrent à la rue, et le traînèrent à travers champs. Il n’avait plus apparence de vie. Il s’était sali : on le jeta avec dégoût hors du village. Il était gisant dans un fossé fangeux : car chacun le croyait mort. Il resta dans cette misérable défaillance, je ne sais combien de temps, avant qu’il eût le sentiment de sa détresse. Comment il finit par en échapper, je ne l’ai jamais su. Cependant il jura depuis (il peut y avoir une année) de me rester toujours fidèle et dévoué. Mais cela n’a pas duré longtemps. Et je pouvais deviner sans peine pourquoi il faisait ce serment : il aurait volontiers mangé une fois des poules tout son soûl. Afin de l’attraper comme il faut, je lui fis gravement la description d’une poutre, sur laquelle un coq venait, d’habitude, percher, le soir, avec sept poules ; puis je le menai sur la place en silence : il avait sonné minuit. Le volet de la fenêtre, appuyé d’une latte légère, était encore ouvert : je le savais.

Je fis semblant de vouloir entrer, mais je me pliai et je laissai l’oncle passer le premier. « Entrez sans gêne, lui dis-je. Si vous voulez réussir, soyez alerte. Il en vaut la peine : vous trouverez des poules grasses. » Il se glissa dedans avec précaution ; il tâtonnait doucement çà et là, et dit enfin avec colère : « Oh ! que vous me conduisez mal ! je ne trouve pas une plume de poule. » Je dis : « Celles qui se perchaient en avant, je les ai gobées moi-même : les autres sont perchées en arrière. Avancez, sans vous rebuter, et marchez avec précaution. » La poutre sur laquelle nous marchions était étroite, il faut le dire. Je le laissais avancer toujours, et me tenais en arrière ; je reculai jusqu’à la fenêtre et j’enlevai la cheville. Le volet se ferma et battit. Le loup tressaillit, il prit peur, et, tremblant, il tomba lourdement par terre de l’étroite solive. Les gens s’éveillèrent avec effroi. Ils dormaient auprès du feu. « Dites-moi, qu’est-il tombé par la fenêtre ici dedans ? » s’écria tout le monde. On se lève en sursaut ; on se hâte d’allumer la lampe. Ils trouvèrent le loup dans un coin, et le rossèrent et lui tannèrent la peau rudement. J’admire qu’il en soit réchappé. Je vous confesse encore que j’ai souvent visité en secret Mme Giremonde, et aussi ouvertement. Cela, j’aurais dû sans doute m’en abstenir. Plût au ciel que la chose ne fût jamais arrivée, car, tant qu’elle vivra, elle aura de la peine à digérer cet affront. À présent je vous ai confessé, autant que je puis m’en souvenir, tout ce qui pèse sur mon âme. Donnez-moi l’absolution, je vous en prie. Je subirai avec humilité la pénitence la plus dure que vous m’imposerez. »
Grimbert savait se conduire en pareille rencontre. Il rompit, au bord du chemin, une petite branche, et il dit : « Mon oncle, donnez-vous sur le dos trois coups de cette verge, et posez-la par terre, comme je vous le montre. Sautez ensuite trois fois par-dessus, puis baisez doucement la verge et montrez-vous obéissant. Telle est la pénitence que je vous impose : sur quoi je vous déclare exempt et affranchi de tous péchés et de toutes peines ; je vous pardonne, au nom du Seigneur, tout le mal que vous avez fait. »

Quand Reineke eût accompli de bon gré la pénitence, Grimbert lui dit :
« Mon oncle, faites paraître votre amendement par vos bonnes œuvres : récitez les psaumes ; visitez assidûment les églises, et jeûnez dans les jours prescrits. Indiquez sa route à qui vous la demande ; donnez aux pauvres volontiers, et jurez-moi de renoncer à la mauvaise vie, à tout vol et larcin, à la perfidie et à la criminelle séduction. Par cette conduite, il est certain que vous obtiendrez grâce. »
Reineke répondit :
« C’est ainsi que je veux me conduire : je le jure. »
La confession était accomplie, et ils poursuivirent leur chemin, pour se rendre à la cour du roi. Le pieux Grimbert et son compagnon traversaient de grasses et fertiles campagnes. Ils voyaient, à la droite du chemin, un monastère. Là des religieuses servaient le Seigneur soir et matin, et nourrissaient dans la cour beaucoup de poules et de coqs, avec maints beaux chapons, qui, après la pâture, se répandaient quelquefois hors des murs. Reineke avait coutume de les visiter souvent. Il dit à Grimbert :
« Notre plus court chemin passe le long de ce mur. »
C’est qu’il songeait aux poules, qui se promenaient en plein air. Il mena son confesseur de ce côté. Ils approchèrent des poules. Le fripon roulait les yeux de convoitise. Il trouvait surtout à son gré un coq jeune et gras, qui se promenait derrière les autres ; il ne le quittait pas des yeux ; il fondit par derrière sur lui : les plumes volèrent.
Mais Grimbert, courroucé, lui reprocha cette honteuse rechute.

« Pouvez-vous agir de la sorte, malheureux oncle, et voulez-vous déjà, pour un coq, retomber en faute, après vous être confessé ? Voilà un beau repentir ! »
Reineke répondit :
« Je l’ai fait par boutade, ô très cher oncle ; priez Dieu qu’il veuille, dans sa grâce, me pardonner ce péché. Je n’y reviendrai plus ; j’y renonce de bon cœur. »
Ils firent le tour du monastère pour gagner leur chemin. Ils devaient passer un étroit petit pont, et Reineke se retournait encore du côté des poules. Il faisait de vains efforts sur lui-même. On lui aurait coupé la tête, qu’il eût toujours volé après les poules, si violent était son désir.
Grimbert l’observait, et il s’écria :
« Mon neveu, où laissez-vous encore vos yeux se promener ? En vérité, vous êtes un odieux glouton ! »
Reineke répondit :
« Vous avez tort, monsieur mon oncle. Point de jugements précipités, et ne troublez pas mes prières. Laissez-moi dire un pater. Elles en ont besoin, toutes les âmes des poules et des oies que j’ai dérobées, par mon adresse, à ces nonnes, ces saintes femmes. »
Grimbert se tut, et Reineke ne détourna pas les yeux de dessus les poules, aussi longtemps qu’il put les voir. Enfin ils rejoignirent la bonne route, et ils approchèrent de la cour. Et, quand Reineke aperçut le château du roi, il fut troublé au fond du cœur, car il était gravement inculpé.
CHANT QUATRIÈME

Quand on eut appris à la cour que Reineke venait en effet, chacun se hâta de sortir pour le voir, les grands comme les petits. Bien peu étaient favorablement disposés ; presque tous avaient à se plaindre. Mais cela ne semblait à Reineke d’aucune conséquence. Telle était du moins sa contenance, lorsque, avec Grimbert, le blaireau, il s’avança d’un air gracieux et hardi, par la haute avenue. Il s’approcha, courageux et calme, comme s’il eût été le propre fils du roi, exempt et pur de tous péchés. Il se présenta même devant Noble, le roi, et se mêla dans le palais parmi les seigneurs. Il savait prendre un air tranquille.
« Auguste monarque, gracieux seigneur, dit-il d’abord, vous êtes noble et grand, le premier en honneur et en dignité ; c’est pourquoi je vous prie de m’entendre aujourd’hui loyalement. Votre majesté n’a jamais trouvé de serviteur plus fidèle que moi, je puis l’affirmer hardiment. Je sais beaucoup de gens à la cour qui m’en veulent pour cela. Je perdrais votre amitié, si les mensonges de mes ennemis vous paraissaient croyables, comme ils le désirent. Heureusement vous pesez ce que chacun vous débite ; vous écoutez l’accusé aussi bien que l’accusateur, et, s’ils ont beaucoup menti par derrière moi, je demeure tranquille dans cette pensée, que ma fidélité vous est assez connue et que c’est elle qui m’attire la persécution.
– Taisez-vous, dit le roi ; le babil et la flatterie ne servent de rien. Votre crime est manifeste, et la peine vous attend. Avez-vous observé la paix que j’ai imposée aux animaux ? que vous avez jurée ? Voici le coq : menteur et méchant larron que vous êtes, vous lui avez ravi ses enfants l’un après l’autre ; et l’affection que vous avez pour moi, vous prétendez, je crois, la prouver en insultant à ma grandeur et offensant mes sujets. Le pauvre Hinze a perdu la santé ; combien de temps, avant que l’ours blessé soit guéri de ses maux ! Mais je fais trêve aux reproches, car vos accusateurs sont ici en foule ; beaucoup de faits sont prouvés ; il vous serait difficile d’échapper.
– Gracieux seigneur, suis-je coupable pour cela ? répliqua Reineke. En puis-je mais, si Brun est revenu le crâne saignant ? Il s’est risqué, et il a voulu hardiment piller le miel de Rusteviel. Et, si les lourds paysans lui sont tombés sur le corps, certes il a les membres forts et vigoureux ; si ces gens le battaient et l’outrageaient, avant de se jeter à l’eau, il aurait dû, en robuste champion, tirer de l’outrage une juste vengeance ; et, si Hinze, le chat, que j’ai reçu honorablement et traité selon mon pouvoir, ne s’est pas abstenu de voler ; s’il s’est glissé, de nuit, dans la demeure du curé, malgré tous mes avis fidèles, et s’il y a souffert quelque mal, ai-je mérité d’être puni, parce qu’ils ont agi follement ? En vérité, ce serait un affront pour votre couronne royale. Cependant vous pouvez agir envers moi selon votre volonté, et, toute claire que la chose paraît, décider ce qu’il vous plaira, que ce soit pour mon salut, que ce soit pour ma perte. Si je dois être bouilli, rôti, aveuglé ou pendu ou décapité, ainsi soit-il ! Nous sommes tous en votre pouvoir, vous nous tenez dans vos mains. Vous êtes fort et puissant : comment le faible résisterait-il ? S’il vous plaît de me mettre à mort, ce sera pour vous assurément un petit avantage ; mais advienne que pourra, je me présente loyalement en justice. »
Alors Bellin le bélier s’écria :
« Le moment est venu : portons plainte. »
Et Ysengrin se présenta avec ses parents, Hinze, le chat, et Brun, l’ours, et des bêtes en foule. On vit encore l’âne Beaudouin, et Lampe le lièvre, Wackerlos le petit chien, et Ryn le dogue, la chèvre Metke, Hermen le bouc ; puis l’écureuil, la belette et l’hermine. Le bœuf et le cheval n’étaient pas non plus restés en arrière. Avec eux on vit les bêtes sauvages, comme le cerf et le chevreuil, et Bockert le castor, la martre, le lapin, le sanglier, et tous se pressaient à l’envi. Bartolt la cigogne, et Markart le geai, et Lutke la grue, vinrent à tire-d’ailes ; se présentèrent aussi, Tybbke le canard, Alheid l’oie, et d’autres encore, exposant leurs griefs. Henning, le triste coq, avec le peu d’enfants qui lui restaient, faisait des plaintes véhémentes ; il vint des oiseaux sans nombre et des bêtes aussi. Qui pourrait nommer cette multitude ? Tous, ils tombaient sur le renard ; ils espéraient publier ses crimes et contempler son supplice. Ils se pressaient devant le roi, avec des discours violents ; ils entassaient plainte sur plainte, et produisaient les histoires vieilles et nouvelles. On n’avait jamais entendu, en un jour d’audience, tant de plaintes devant le trône du roi. Reineke se tenait là tranquille, et savait se conduire avec beaucoup d’adresse. Car, s’il prenait la parole, ses discours pleins de grâce coulaient, pour sa justification, comme vérité pure, Il savait tout écarter et tout établir. Qui l’entendait était émerveillé et le croyait justifié. Il avait même des droits en sa faveur et bien des plaintes à faire. Mais enfin il se présenta, pour accuser Reineke, des gens honnêtes, véridiques, qui témoignèrent contre lui, et tous ses crimes se trouvèrent éclaircis. C’en était fait ; Car, dans le conseil du roi, l’on décida, d’une voix unanime, que Reineke, le renard, était passible de mort.
« Il faut le saisir, il faut l’enchaîner et le pendre par le cou, afin qu’il expie par une mort infâme ses graves attentats. »
Alors Reineke lui-même crut la partie perdue. Ses habiles paroles avaient eu peu d’effet. Le roi prononça la sentence. Quand l’effronté malfaiteur fut pris et enchaîné, sa fin lamentable plana devant ses yeux.
Lors donc qu’à teneur de la sentence et de la loi, Reineke fut mis aux fers, que ses ennemis s’ébranlèrent pour le mener promptement à la mort, ses amis furent consternés et douloureusement affligés : c’étaient Martin le singe, avec Grimbert et beaucoup de gens de la clique de Reineke. Ils avaient entendu le jugement avec chagrin, et ils étaient tous affligés plus qu’on ne l’aurait cru. Aussi Reineke était un des premiers barons, et maintenant on le voyait dépouillé de tous ses honneurs et dignités, et condamné à une mort infâme. Combien ce spectacle devait révolter ses parents ! Ils prirent tous ensemble congé du roi, et, tous tant qu’ils étaient, ils s’éloignèrent de la cour. Le roi fut affligé de voir que tant de chevaliers le quittaient. On voyait la foule des parents qui s’éloignaient, très mécontents de la mort de Reineke, Et le roi dit à un de ses confidents :
« Reineke est sans doute méchant, mais on devrait réfléchir que beaucoup de ses parents sont indispensables à la cour. »
Cependant Ysengrin, Brun et Hinze, le chat, faisaient diligence autour du prisonnier ; ils voulaient faire subir à leur ennemi la peine infâmante, comme le roi l’avait ordonné ; ils l’entraînaient à la hâte, et voyaient de loin le gibet, Alors le chat courroucé dit au loup :
« Rappelez-vous, seigneur Ysengrin, comme Reineke travailla de toutes ses forces, comme sa haine réussit à voir votre frère au gibet ; qu’il fut aise de l’accompagner ! Ne tardez pas à le payer selon son mérite. Et vous, seigneur Brun, il vous a outrageusement trahi ; il vous a perfidement livré, dans la cour de Rusteviel, à une troupe furieuse et grossière d’hommes et de femmes, aux coups, aux blessures et à la honte enfin, qui est connue en tous lieux. Prenez garde et tenez ferme. S’il nous échappait aujourd’hui, si son esprit et ses méchantes ruses le délivraient, jamais l’heure de la douce vengeance ne nous serait donnée. Hâtons-nous, et vengeons les maux qu’il a faits à tout le monde.
– Que servent les paroles ? dit Ysengrin. Trouvez-moi vite une bonne corde. Abrégeons son supplice. »
C’est ainsi qu’ils menaçaient le renard, et ils suivaient leur chemin. Reineke les écoutait en silence ; enfin il prit la parole :
« Puisque vous me haïssez si cruellement, et que vous demandez une vengeance mortelle, ne pouvez-vous en venir à bout ? Combien vous m’étonnez ! Hinze devrait savoir se procurer une bonne corde, car il en a fait l’épreuve, lorsqu’il a couru à la chasse des souris dans la maison du curé, d’où il ne s’est pas tiré avec honneur. Mais vous, Ysengrin, et vous, Brun, vous traînez violemment votre oncle à la mort, et vous croyez faire merveilles. »
Et le roi se leva, avec tous les seigneurs de la cour, pour voir exécuter la sentence. La reine se joignit au cortège, accompagnée de ses femmes. Derrière eux affluait la multitude des pauvres et des riches. Tous désiraient la mort de Reineke et voulaient en être témoins. Cependant Ysengrin, s’adressant à ses parents et à ses amis, les exhortait à serrer les rangs, et à veiller attentivement sur le renard enchaîné, car ils craignaient toujours que le rusé ne parvînt à se sauver. Le loup faisait des recommandations particulières à sa femme :
« Sur ta vie, prends garde ; aide à tenir le scélérat. S’il échappait, ce serait pour nous tous un affront sensible. »

Et il disait à Brun :
« Songez comme il s’est joué de vous. Vous pouvez maintenant lui payer tout avec usure. Hinze sait grimper ; à lui de nous attacher la corde là-haut. Tenez-le et assistez-moi, j’avance l’échelle. Quelques minutes encore, et c’en est fait de ce vaurien. »
Brun répondit :
« Placez seulement l’échelle, je le tiendrai bien.
– Voyez donc, lui dit Reineke, comme vous êtes pressé de mettre votre oncle à mort ! Vous devriez plutôt le protéger et le défendre, et, s’il était dans la détresse, avoir pitié de lui. Je demanderais grâce volontiers, mais de quoi cela me servirait-il ? Ysengrin me hait trop ; il ordonne même à sa femme de me tenir et de me fermer le chemin de la fuite. Si elle se rappelait le temps d’autrefois, assurément elle ne pourrait me nuire. Cependant, si je dois y passer, je voudrais que ce fût vite fait. Mon père aussi s’est vu dans cette affreuse extrémité, mais cela finit promptement. Moins de gens, il est vrai, l’accompagnèrent à la mort. Que si vous vouliez m’épargner plus longtemps, assurément la chose tournerait à votre honte.
– Entendez-vous, dit l’ours, comme le méchant parle avec insolence ? Qu’on le pende ! qu’on le pende ! Son heure est venue. »
Reineke se disait avec angoisse :
« Oh ! si, dans cette grande détresse, je pouvais vite imaginer quelque bon moyen, pour que le roi me fît grâce de la vie, et que ces trois ennemis furieux en éprouvassent honte et dommage ! Il nous faut tout considérer, et vienne à notre aide ce qui pourra servir ! Car il s’agit de mon cou ; la nécessité est pressante ; comment pourrai-je échapper ? Tous les maux s’amassent sur ma tête. Le roi est courroucé, mes amis sont partis et mes ennemis sont acharnés. Rarement j’ai fait quelque chose de bon ; à vrai dire, j’ai peu respecté la puissance du roi, la sagesse de ses conseils ; j’ai commis bien des crimes, et pourtant j’espérais détourner de moi ce malheur. Si seulement je pouvais obtenir la parole, certainement ces gens ne me pendraient pas. Je ne veux pas renoncer à l’espérance. »
Là-dessus il se tourna de l’échelle vers le peuple et s’écria :
« Je vois la mort devant mes yeux et je n’échapperai pas. Mais je vous adresse, à vous tous qui m’écoutez, une petite prière avant que je quitte ce monde. Je voudrais bien, pour la dernière fois, me confesser encore par-devant vous publiquement, en toute vérité, et reconnaître loyalement tout le mal que j’ai fait, afin qu’un autre ne soit pas acculé quelque jour de tel ou tel crime inconnu que j’ai commis en secret. Par là j’empêcherai encore quelques malheurs, et je puis espérer que Dieu m’en tiendra compte dans sa miséricorde. »
À ces paroles, beaucoup de gens furent touchés de compassion. Ils se dirent les uns aux autres :
« La prière est de peu de conséquence ; le délai qu’il demande est bien court. »
Ils intercédèrent auprès du roi, et le roi consentit.
Reineke se sentit le cœur un peu soulagé : il espérait une heureuse issue. Il profita sur-le-champ du répit qui lui était accordé et parla en ces termes :
« Que l’esprit du Seigneur me soit en aide ! Je ne vois personne dans cette grande assemblée, que je n’aie offensé de quelque manière. Je n’étais encore qu’un petit compagnon, et j’avais à peine appris à sucer la mamelle, que déjà je m’abandonnais à mes désirs parmi les jeunes agneaux et les chevrettes, qui se dispersaient en rase campagne à côté du troupeau ; j’écoutais trop volontiers les voix bêlantes ; je sentais l’envie d’une pâture délicate ; j’appris promptement à la connaître. Je mordis un agneau à le faire mourir ; je léchai le sang et lui trouvai un goût délicieux. Ensuite je tuai quatre des plus jeunes chevrettes et les mangeai, et je continuai à m’exercer de la sorte. Je n’épargnai ni les oiseaux, ni les poules, ni les canards, ni les oies, où que je les trouvasse, et j’ai enterré souvent dans le sable ce que j’avais égorgé, et qu’il ne me plaisait pas de manger tout à fait. Alors il m’arriva, un hiver, aux bords du Rhin, de faire la connaissance d’Ysengrin, qui était aux aguets derrière les arbres. D’abord il m’assura que j’étais de sa famille ; il sut même compter sur ses doigts les degrés de la parenté. Je me laissai persuader ; nous conclûmes une alliance, et nous nous jurâmes de voyager en fidèles compagnons. Je devais, hélas ! m’attirer par là bien des maux. Nous parcourûmes ensemble le pays. Il volait le gros, je volais le petit. Ce que nous avions attrapé devait nous être commun. Mais cela ne le fut pas comme l’équité le demandait : le loup partageait au gré de son caprice. Jamais je ne recevais la moitié. Il m’a fait bien pis. S’il avait dérobé un veau, enlevé un mouton, quand je le trouvais dans l’abondance, dévorant la chèvre qu’il venait d’égorger, tenant dans ses pattes un bouc couché à terre et palpitant, il ricanait à ma vue, prenait un air morose et me chassait en grondant. Ainsi ma part lui demeurait. Et voilà ce qui m’attendait toujours, si gros que fût le rôti. S’il nous arrivait même de prendre un bœuf ensemble, d’attraper une vache, aussitôt paraissaient sa femme et ses sept enfants, qui se ruaient sur la proie et m’écartaient du repas. Je ne pouvais obtenir une côte, qu’elle ne fût polie et rongée absolument. Il fallait me résigner à tout cela. Mais, Dieu merci, je ne souffrais pourtant pas de la faim : je me nourrissais en secret de mon magnifique trésor, de l’or et de l’argent que je garde cachés dans un lieu sûr. J’en ai en suffisance. Point de voiture qui pût l’emmener, quand elle y viendrait à sept reprises. »
Le roi, qui l’écoutait, entendant parler du trésor, se pencha en avant et lui dit :
« D’où vous est-il venu ? Expliquez-vous… Je veux dire le trésor. »
Reineke répondit :
« Je ne vous tairai point ce secret. À quoi pourrait-il me servir ? Je n’emporterai avec moi aucune de ces choses précieuses. Et, puisque vous l’ordonnez, je vous conterai tout. Il faut parler enfin ; pour aucune raison je ne voudrais, en vérité, cacher ce grand secret plus longtemps. Le trésor fut volé. Beaucoup de gens avaient conjuré, sire, de vous assassiner, et si, à la même heure, le trésor n’avait été subtilement dérobé, la chose était faite. Prenez-y garde, gracieux seigneur, car votre vie et votre salut tiennent à ce trésor. Et le vol qu’on en fit devint, hélas ! pour mon propre père la source de grandes calamités ; il en fut amené de bonne heure au triste passage, peut-être aux peines éternelles. Mais, monseigneur, cela est arrivé pour votre bien. »
La reine entendit avec saisissement ces paroles menaçantes, le mystère confus de l’assassinat médité sur son époux, de cette trahison, du trésor et de tout le reste.
« Reineke, s’écria-t-elle, songez que vous êtes en présence du grand voyage ; déchargez votre conscience avec repentir ; dites la pure vérité et parlez-moi clairement de l’assassinat. »
Le roi ajouta :
« Que chacun se taise. Reineke, descends, et viens (car la chose me concerne moi-même), viens plus près de moi, afin que je l’entende. »
À ces mots, Reineke se sentit rassuré ; il descendit l’échelle, au grand chagrin de ses ennemis ; il s’approcha du roi et de son épouse, qui lui demandèrent avec empressement comment les choses s’étaient passées.
Alors il se disposa à faire, sur nouveaux frais, de furieux mensonges.
« Si je pouvais, se dit-il, regagner la faveur du roi et de la reine, et si, par mes artifices, je parvenais en même temps à perdre les ennemis qui m’ont amené en face de la mort, cela me sauverait de tous dangers. Certainement ce serait pour moi un avantage inattendu ; mais, je le vois d’avance, il faut des mensonges, il en faut sans mesure. »
La reine interrogea de nouveau Reineke avec impatience.
« Sachons clairement comme la chose s’est passée. Dites-nous la vérité, veillez sur votre conscience, délivrez votre âme de ce fardeau. »
Reineke répondit :
« Je vous instruirai volontiers. Je vais mourir ; plus de moyen d’échapper. Si je voulais charger ma conscience à la fin de ma vie, encourir les peines éternelles, ce serait agir follement. Il vaut mieux que j’avoue, et si, par malheur, je dois accuser mes chers parents et mes amis, hélas ! je n’en puis mais : je suis menacé des tourments de l’enfer. »
Pendant cet entretien, le roi se sentait déjà le cœur oppressé. Il dit :
« Parles-tu selon la vérité ? »
Reineke répondit, en composant son visage :
« Certes, je suis un homme coupable ; cependant je dis la vérité, Que me servirait-il de vous mentir ? Je prononcerais moi-même ma condamnation éternelle. Vous le savez bien, il est résolu que je dois périr : je suis en face de la mort et je ne mentirai pas, car il n’est ni bien ni mal qui puisse me venir en aide. »
Reineke prononça ces paroles en tremblant ; il parut saisi de crainte, et la reine dit :
« J’ai pitié de son trouble, Monseigneur, je vous en prie, regardez-le avec miséricorde, et, songez-y bien, après son aveu, nous éviterons beaucoup de maux. Sachons, le plus tôt possible, le fond de l’histoire. Ordonnez à chacun de se taire, et laissez Reineke parler publiquement. »
Sur l’ordre du roi, toute l’assemblée fit silence, et Reineke prit la parole.
« Si tel est votre plaisir, monseigneur, apprenez ce que j’ai à vous dire. Bien que mon exposé se fasse sans plume et sans papier, il n’en sera pas moins exact et fidèle. Vous connaîtrez la conjuration, et je me propose de n’épargner personne. »

CHANT CINQUIÈME

Apprenez maintenant la ruse, et par quels détours le renard sut cacher de nouveau ses crimes et nuire à autrui. Il imagina des abîmes de mensonge ; il outragea son père au delà du tombeau ; il chargea de grandes calomnies le blaireau, son plus loyal ami, qui l’avait servi constamment ; il se permit tout pour donner créance à son récit, pour se venger de ses accusateurs.
« Monsieur mon père, dit-il, avait été assez heureux pour découvrir un jour, par des voies secrètes, le trésor du puissant roi Emmeric ; mais cette trouvaille lui fut peu profitable, car il s’enorgueillit de sa grande richesse, et dès lors il n’estima plus ses égaux ; il fit beaucoup trop peu de compte de ses compagnons ; il chercha des amis plus illustres ; il envoya Hinze, le chat, dans les sauvages Ardennes, pour chercher Brun, l’ours, auquel il devait promettre fidélité ; il devait l’inviter à passer en Flandre, où il deviendrait roi. Quand Brun eut fait lecture de la lettre, il sentit une grande joie. Courageux et hardi, il se rendit bien vite en Flandre, car il avait eu dès longtemps de pareils desseins. Il y trouva mon père, qui le vit avec joie, manda sur-le-champ Ysengrin et Grimbert, le sage, et ces quatre personnages traitèrent l’affaire ensemble. Mais le cinquième, qui les assistait, était Hinze, le chat, Là se trouve un petit village nommé Ifte, et c’est justement là, entre Ifte et Gand, qu’ils se concertèrent. Une nuit longue et ténébreuse enveloppa l’assemblée. Mon Dieu, ce ne fut pas le diable, ce fut mon père, qui les subjugua avec son or funeste. Ils résolurent la mort du roi ; ils se jurèrent une ferme, une éternelle alliance. Ainsi jurèrent tous les cinq sur la tête d’Ysengrin. Ils voulaient proclamer roi Brun, l’ours, et, sur le trône d’Aix-la-Chapelle, avec la couronne d’or, lui assurer l’empire solennellement. Si quelqu’un des amis ou des parents du roi voulait s’y opposer, mon père devait le persuader ou le corrompre, et, si cela ne réussissait pas, l’expulser sur-le-champ. Je vins à le savoir, parce que Grimbert, s’étant amusé à boire un matin, en était devenu babillard. L’imbécile conta tout le mystère à sa femme, en lui ordonnant de se taire. Il croyait la précaution suffisante ; mais, bientôt après, elle rencontra ma femme, qui dut lui promettre solennellement, par les noms des trois rois, lui jurer sur son honneur et sa foi, que, par amour ni par crainte, elle n’en dirait pas un petit mot à personne ; après quoi, elle lui découvrit toute l’affaire. Ma femme ne tint pas mieux sa promesse. Aussitôt qu’elle m’eût trouvé, elle me conta ce qu’elle avait appris, me donna un signe, auquel je reconnaîtrais aisément la vérité de ses discours. Ma situation n’en était que plus mauvaise : je me souvenais des grenouilles, dont le coassement était enfin parvenu dans le ciel aux oreilles du Seigneur, Elles voulaient avoir un roi, et voulaient vivre dans la contrainte, après avoir joui de la liberté dans toutes leurs provinces, Dieu les entendit, et leur envoya la cigogne, qui les poursuit constamment, et les déteste et ne leur laisse point de paix. Elle les traite sans pitié. Maintenant les folles se plaignent, mais, hélas ! c’est trop tard, car le roi les tient sous le joug. »
Reineke parlait à haute voix, devant toute l’assemblée ; tous les animaux entendaient ses paroles ; il poursuivit son discours en ces termes :

« Je craignais cela pour tout le monde. Il en serait arrivé de même. Monseigneur, je veillai pour vous, et j’espérais une meilleure récompense.
« Les intrigues de Brun, son naturel perfide, me sont connus ; je sais aussi de lui plus d’un méfait. Je craignais tout ce qu’il y a de pire. S’il devenait le maître, nous étions tous perdus. « Notre roi est de noble race et puissant et gracieux, me disais-je en silence ; ce serait un triste échange, d’élever sur le trône un ours, un méchant lourdaud. » Je rêvai à la chose quelques semaines, et cherchais à l’empêcher. Je compris, avant tout, que, si mon père restait maître de son trésor, il réunirait beaucoup de monde ; il gagnerait sûrement la partie, et le roi nous serait ravi. Alors mes pensées tendirent à découvrir le lieu où se trouvait le trésor, afin de le dérober secrètement. Si mon père, le vieux madré, se mettait en campagne ; s’il courait au bois, de jour ou de nuit, par la gelée ou le chaud, par le sec ou l’humide, j’étais à ses trousses, et je guettais sa marche. Un jour, j’étais couché, blotti dans la terre, cherchant et rêvant par quel moyen je pourrais découvrir le trésor, dont je savais tant de merveilles. Tout à coup j’aperçus mon père qui se glissait hors d’une fente ; il sortait d’entre les rochers et montait d’une profondeur. Je restai là immobile et caché. Il se croyait seul ; il jeta les yeux de tous côtés, et, ne voyant personne ni près ni loin, il commença son jeu. Il faut vous le faire connaître. Il recouvrait le trou avec du sable, et savait adroitement l’aplanir comme le sol d’alentour. Qui n’avait pas vu la chose ne pouvait le reconnaître.

Et, avant de s’éloigner, il savait balayer entièrement avec sa queue la place où ses pieds s’étaient posés, et il en fouillait la trace avec son museau. Voilà ce que m’apprit, ce jour-là, mon rusé de père, qui était passé maître en malices, fourberies et toute sorte de tours. Cela fait, il courut à ses affaires. Alors je me demandai si le magnifique trésor ne se trouvait point dans le voisinage. J’accourus, et m’étant mis à l’œuvre, j’eus bientôt ouvert la crevasse avec mes pattes ; je me traînai dedans avec curiosité. J’y trouvai de précieux trésors, de l’argent fin et de l’or vermeil en abondance. En vérité, le plus vieux de cette assemblée n’en a jamais tant vu. Je me mis à l’ouvrage avec ma femme ; nous portâmes, nous traînâmes, jour et nuit ; nous ne possédions ni charrettes, ni voitures ; il nous en coûta beaucoup de peine et de fatigues ; dame Ermeline les supporta fidèlement, et nous finîmes par emporter les joyaux à une place qui nous paraissait plus commode. Cependant mon père avait journellement des conférences avec ceux qui trahissaient notre roi. Ce qu’ils résolurent, vous le saurez et vous en frémirez. Brun et Ysengrin envoyèrent sans délai des lettres circulaires dans plusieurs provinces, pour engager des mercenaires. Ils n’avaient qu’à venir par troupes au plus vite ; Brun leur donnerait du service ; il voulait même bonnement payer d’avance les mercenaires. Mon père courut les provinces et produisit les lettres, comptant sur son trésor, qui dormait, croyait-il, en sûreté. Mais, c’était fait : avec tous ses compagnons, il aurait eu beau chercher, il n’aurait pas trouvé un denier. Il ne regretta aucune fatigue ; il courut, en diligence, tous les pays entre l’Elbe et le Rhin. Il avait trouvé et gagné bien des mercenaires : l’argent devait prêter aux paroles beaucoup de poids. Enfin l’été revint ; mon père rejoignit ses compagnons. Il eut bien des choses à conter sur ses peines, ses dangers et ses frayeurs, surtout, comme il avait failli perdre la vie devant les hauts manoirs de Saxe, où les chasseurs le poursuivaient journellement avec leurs chevaux et leurs chiens, si bien qu’il en avait à grand’peine sauvé sa peau. Là-dessus il produisit avec joie aux quatre félons la liste des camarades qu’il avait gagnés avec son or et ses promesses. Brun fut bien joyeux de cette nouvelle ; les cinq firent lecture ensemble du papier, qui portait : « Douze cents parents d’Ysengrin, gens audacieux, viendront, la gueule ouverte, les dents acérées ; en outre, les chats et les ours sont tous gagnés pour Brun ; tous les gloutons, tous les blaireaux de Saxe et de Thuringe se présentent. Mais ils demandent qu’on s’engage à leur payer d’avance un mois de solde, et promettent, de leur côté, d’être prêts au premier commandement. » Dieu soit béni à jamais, que j’aie déconcerté leurs desseins ! En effet, lorsqu’il eut tout disposé, mon père courut à travers champs et voulut revoir son trésor. Alors les angoisses commencèrent ; il fouilla et chercha ; plus il creusait, moins il trouvait ; la peine qu’il se donna fut inutile, comme son désespoir ; le trésor avait disparu ; il ne put le découvrir nulle part : et, de chagrin et de honte (que ce souvenir est pour moi nuit et jour un affreux tourment !) mon père se pendit. Voilà tout ce que j’ai fait pour empêcher le crime. Cela tourne mal pour moi maintenant, mais je ne dois pas m’en repentir. Cependant Ysengrin et Brun, les gloutons, siègent aux côtés du roi dans le conseil ; et toi, pauvre Reineke, comme on te remercie aujourd’hui d’avoir sacrifié ton propre père pour sauver le roi ! Où trouvera-t-on des gens qui se sacrifient eux-mêmes, uniquement pour prolonger votre vie ? »
Le roi et la reine avaient senti une grande envie d’acquérir le trésor ; ils se retirèrent à l’écart, et ils appelèrent Reineke, pour l’entretenir en particulier. Ils le questionnèrent vivement.
« Parlez, où gardez-vous le trésor ? Nous voudrions le savoir. »
Reineke répondit :
« Que me servirait-il de signaler ces richesses magnifiques au roi qui me condamne, puisqu’il aime mieux croire mes ennemis, les voleurs et les meurtriers, qui vous enveloppent de mensonges pour m’arracher la vie ?
– Non, répliqua la reine, non, il n’en sera pas ainsi. Mon seigneur vous laisse la vie et il oublie le passé. Il se surmonte et il n’est plus en colère. Mais, à l’avenir, agissez plus sagement, et soyez toujours le fidèle serviteur du roi. »
Reineke répondit :
« Noble dame, engagez le roi à m’assurer en votre présence qu’il me reçoit en grâce ; qu’il ne me garde aucun ressentiment de tous mes crimes et méfaits, et de tout le mécontentement que j’ai eu le malheur de lui causer, et certainement aucun roi ne possédera de nos jours une richesse pareille à celle qu’il acquerra par ma fidélité. Le trésor est grand. Je vous montrerai l’endroit : vous serez étonnés.
– Ne le croyez pas, repartit le roi : mais, s’il parle de vols, de mensonges et de brigandages, à la bonne heure, vous pouvez le croire : car, en vérité, il ne fut jamais de plus grand menteur. »
La reine reprit la parole :
« Certes, jusqu’à ce jour, sa conduite lui a valu peu de confiance ; cependant songez qu’il a inculpé cette fois son oncle le blaireau et son propre père et déclaré leurs crimes. S’il l’avait voulu, il pouvait les épargner ; il pouvait faire sur d’autres animaux de pareils contes. Il ne mentirait pas si follement.
– Si c’est votre avis, reprit le roi, et si vous pensez que ce soit le plus sage, pour qu’il n’en résulte pas un plus grand mal, je veux faire ce que vous désirez, je veux couvrir de ma grâce royale les crimes de Reineke et ses déportements. Je me fie encore à lui, mais pour la dernière fois. Qu’il s’en souvienne. Car, je le jure par ma couronne, s’il retombe à l’avenir dans le désordre et le mensonge, il s’en repentira éternellement. Tous les siens, quels qu’ils soient, ne fussent-ils ses parents qu’au dixième degré, en porteront la peine ; aucun ne m’échappera ; ils seront plongés dans le malheur, dans la honte et dans de terribles procès. »
Quand Reineke vit comme le roi changeait promptement de pensée, il prit courage et dit :
« Serais-je assez insensé, monseigneur, pour vous conter des histoires dont la vérité ne se pourrait démontrer dans peu de jours ? »
Et le roi crut ses paroles et lui pardonna tout, d’abord la trahison du père, puis ses propres méfaits.
Reineke en sentit une joie excessive. Bien à propos, il avait échappé à la puissance de ses ennemis et à sa destinée.
« Noble roi, gracieux seigneur, dit-il. Dieu veuille vous rendre et à votre épouse tout ce que vous faites pour moi, indigne ! Je m’en souviendrai, et j’en montrerai toujours une profonde reconnaissance. Car assurément il n’est personne sous le ciel, dans tous les pays et les royaumes, que je visse plus volontiers possesseur de ces merveilleuses richesses. Quelles grâces ne m’avez-vous pas faites ! En reconnaissance, je vous donne, de bon gré, le trésor du roi Emmeric, tel qu’il l’a possédé. Où il se trouve, je vais vous l’indiquer : je dirai la vérité. Écoutez-moi : à l’est de la Flandre est une plaine déserte, où se trouve un bocage isolé, qu’on appelle Husterlo : retenez bien ce nom ; ensuite il se trouve une fontaine du nom de Krekelborn, vous m’entendez, non loin du bocage. Pas un homme, pas une femme, ne viennent en ce lieu de toute l’année. Là ne séjournent que les hiboux et les chouettes, et c’est là que j’ai enfoui les trésors. L’endroit s’appelle Krekelborn : retenez bien cette indication et profitez-en. Allez-y vous-même avec votre épouse. Il n’y aurait personne d’assez sûr pour être envoyé comme messager, et la perte serait trop grande. Je n’oserais vous le conseiller. Il faut aller vous-même. Vous passerez devant Krekelborn, vous verrez ensuite deux jeunes bouleaux, et, prenez garde, l’un d’eux n’est pas loin de la fontaine. Allez, monseigneur, droit à ces bouleaux, car les trésors sont dessous. Grattez et fouillez : vous trouverez d’abord de la mousse sur les racines, puis vous découvrirez aussitôt les plus riches bijoux, en or, artistement travaillés ; vous trouverez aussi la couronne d’Emmeric. Si les désirs de l’ours avaient été satisfaits, c’est lui qui l’aurait portée. Avec cela vous verrez des joyaux, des pierres précieuses, des ouvrages en or. On n’en fait plus de pareils. Qui voudrait les payer ? Quand vous verrez toutes ces richesses assemblées, ô noble sire, je suis assuré que vous penserez à moi avec estime. « Reineke, honnête renard, direz-vous en vous-même, toi qui as si prudemment enfoui ces trésors sous la mousse, en quelque lieu que tu habites, oh ! sois toujours heureux ! »
Ainsi parla l’hypocrite, et le roi répondit :
« Vous m’accompagnerez. Comment pourrais-je en effet trouver seul la place ? J’ai bien ouï parler d’Aix, comme aussi de Lubeck et de Cologne et de Paris ; mais de ma vie je n’entendis une fois le nom de Husterlo, non plus que celui de Krekelborn. N’ai-je pas lieu de craindre que tu ne nous trompes et que tu n’inventes ces noms ? »
Reineke n’entendit pas avec plaisir ces paroles circonspectes du roi, et il dit :
« Je ne vous adresse pourtant pas loin d’ici, et ce n’est pas comme si vous aviez à chercher au bord du Jourdain. Pourquoi vous semblé-je suspect à présent ? Je maintiens ce que j’ai dit : tout près d’ici, en Flandre, on trouvera tout. Interrogeons quelques personnes : un autre pourra vous le garantir. Krekelborn ! Husterlo ! vous dis-je : ce sont là les noms. »
Là-dessus il appela Lampe, et Lampe hésitait et tremblait. Reineke s’écria :
« Venez sans crainte ; le roi vous demande. Il exige que vous disiez la vérité, au nom du serment et de l’hommage que vous lui avez prêté récemment. Indiquez donc, pour autant que vous le savez, où se trouvent Husterlo et Krekelborn ! Écoutons ! »
Lampe répondit :
« Je puis le dire. Ils se trouvent dans le désert : Krekelborn est près d’Husterlo. Les gens appellent Husterlo ce bocage où demeura longtemps Simonet le cambré, pour fabriquer de la fausse monnaie avec ses téméraires compagnons. J’ai beaucoup souffert en ce lieu de la faim et du froid, quand je fuyais en grande détresse devant Ryn, le chien. »
Reineke dit alors :
« Vous pouvez retourner auprès des autres. Vous avez suffisamment informé le roi. »
Et le roi dit à Reineke :
« Ne soyez pas fâché que j’aie été prompt, et que j’aie douté de vos paroles. Préparez-vous maintenant à me conduire sur la place. »

Reineke répondit :
« Que je m’estimerais heureux, s’il m’était permis d’accompagner aujourd’hui le roi et de le suivre en Flandre ! mais cela vous ferait tomber dans le péché. Tout honteux que j’en suis, il faut que je le dise, malgré toute mon envie de tenir encore la chose secrète. Il y a quelque temps, Ysengrin a pris l’habit de moine, non point pour servir le Seigneur, mais pour servir son ventre. Il dévorait, peut s’en faut, le couvent ; on lui servait à manger comme pour six. C’était toujours trop peu. Il me cria misère et famine. Enfin j’eus pitié de lui, le voyant maigre et malade. Je le tirai de là en ami fidèle : il est mon proche parent. Maintenant j’ai encouru pour cela l’excommunication du pape. Je voudrais bien sans retard, à votre connaissance et avec votre permission, pourvoir au salut de mon âme, et demain, au lever du soleil, me rendre à Rome en pèlerinage, pour chercher grâce et absolution, et, de là, passer outre-mer. Ainsi seront abolis tous mes péchés, et, quand je reviendrai chez nous, je pourrai marcher avec honneur à vos côtés. Mais, si je le faisais aujourd’hui, chacun dirait : « Comment le roi peut-il encore être en commerce avec Reineke, qu’il vient de condamner à mort, et qui, par dessus tout cela, est excommunié du pape ? » Monseigneur, vous voyez bien que nous ferons mieux de nous abstenir.
– Vraiment, répliqua le roi, je ne pouvais savoir cela. Si tu es excommunié, je serais blâmé de te mener avec moi. Lampe ou un autre pourra m’accompagner à la fontaine. Cependant, Reineke, je trouve utile et bon que tu cherches à te relever de l’excommunication. Je te donne la permission de partir demain matin ; je ne veux pas mettre obstacle à ton pèlerinage : car il me semble que vous voulez vous convertir du mal au bien. Dieu bénisse votre projet et vous permette d’accomplir votre voyage ! »

CHANT SIXIÈME

C’est ainsi que Reineke regagna la faveur du roi. Et le roi s’avança sur un lieu élevé, parla du haut de la roche, et commanda à tous les animaux de faire silence. Ils eurent l’ordre de s’asseoir sur le gazon, selon leur dignité et leur naissance. Reineke était debout à côté de la Reine. Le roi prononça ces paroles, avec beaucoup de gravité :
« Taisez-vous et m’écoutez, vous tous, oiseaux et bêtes, pauvres et riches ; écoutez-moi, petits et grands, mes barons, commensaux et courtisans. Reineke est ici en mon pouvoir ; on pensait tout à l’heure à le pendre, mais il a révélé à la cour tant de secrets, que je le crois, et qu’après mûre délibération, je lui redonne ma faveur. La reine, mon épouse, m’a aussi beaucoup prié pour lui, en sorte que je lui ai rendu ma bienveillance royale, que je l’ai complètement reçu en grâce, et le laisse en possession de la vie et de ses biens. Dès ce jour, ma paix le protège et le garantit. Soit donc ordonné à chacun, sous peine de la vie : vous devrez respecter en tous lieux Reineke et sa femme et ses enfants, où que vous les rencontriez, de jour ou de nuit. Je ne veux plus entendre de nouvelles plaintes sur les faits et gestes de Reineke. S’il a fait du mal, c’est chose passée. Il s’amendera et il y travaillera sans doute. Car, dès demain, il prendra le bâton et le sac ; il partira, pieux pèlerin, pour se rendre à Rome, et, de là, il passera la mer. Il n’en reviendra pas avant d’avoir obtenu pleine absolution de ses péchés. »
Là-dessus Hinze se tourna, en colère, vers Brun et Ysengrin :
« Voilà nos peines et nos travaux perdus ! s’écria-t-il. Oh ! fussé-je loin d’ici ! Si Reineke est rentré en faveur, il mettra en œuvre toutes les ruses pour nous détruire tous trois. J’ai perdu un œil : je crains pour l’autre.
– Le cas est difficile, dit Brun, je le vois. »
Ysengrin répliqua :
« La chose est étrange ! Allons droit au roi. »
Aussitôt il se présenta, tout chagrin, avec Brun, devant le roi et la reine. Ils parlèrent beaucoup contre Reineke ; ils parlèrent violemment. Le roi leur dit :
« Ne l’avez-vous pas entendu ? Je l’ai de nouveau reçu en grâce. »
Le roi parlait ainsi avec colère, et, à l’instant, il fit saisir, lier et garotter l’un et l’autre. Car il songeait à ce qu’il avait appris de Reineke et à leur trahison. Ainsi fut entièrement changée à cette heure la situation de Reineke. Il se tira d’affaire et ses accusateurs se virent confondus. Il sut même, par sa ruse, amener les choses au point qu’on enleva à l’ours un morceau de son cuir, d’un pied de long et un pied de large, afin de lui en faire un petit sac de voyage. Ainsi équipé, il avait assez l’air d’un pèlerin. Mais il pria la reine de lui faire avoir aussi des souliers et il dit :
« Vous me reconnaissez, cette fois, tout de bon, noble dame, pour votre pèlerin : aidez-moi donc à faire le voyage. Ysengrin a quatre bons souliers : l’équité voudrait qu’il m’en cédât une paire pour ma route. Faites, noble dame, que je les obtienne par mon seigneur le roi. Madame Giremonde pourrait bien aussi se passer d’une paire des siens : car, en bonne ménagère, elle reste le plus souvent dans sa chambre. »
La reine se montra favorable à cette requête.
« Ils peuvent bien, dit-elle gracieusement, se passer chacun d’une paire. »
Reineke la remercia et dit, avec une joyeuse révérence :
« Puisque j’obtiens encore quatre bons souliers, je ne veux pas tarder. Toutes les bonnes œuvres que je pourrai faire comme pèlerin, vous en aurez votre part certainement, vous et mon gracieux roi. Pendant le pèlerinage, nous sommes obligés de prier pour tous ceux qui nous ont jamais secourus. Que Dieu récompense votre charité ! »
Le seigneur Ysengrin perdit, en conséquence, ses souliers aux pieds de devant, jusqu’aux chevilles ; on n’épargna pas davantage Madame Giremonde : elle dut renoncer à ceux de derrière.
Ayant ainsi perdu tous deux la peau et les ongles des pieds, les misérables étaient gisants avec Brun et pensaient mourir, mais l’hypocrite avait gagné les souliers et le sac. Il survint et se moqua d’eux encore, surtout de la louve.
« Ma chère, ma bonne, lui disait-il, voyez comme vos souliers me vont bien ! j’espère aussi qu’ils seront de durée. Vous vous êtes donné beaucoup de peine pour me perdre ; j’ai fait de mon côté ce que j’ai pu, et cela m’a réussi. Si vous avez eu du plaisir, c’est enfin mon tour d’en avoir. Ainsi va le monde. On sait prendre son parti. Si je vais en voyage, je pourrai me souvenir chaque jour, avec reconnaissance, de mes chers parents : vous m’avez obligeamment fourni de souliers, et vous n’aurez pas à vous en repentir. Ce que je mériterai de pardons, je le partagerai avec vous : je vais les chercher à Rome et outre-mer. »
Madame Giremonde était couchée par terre, souffrant de grandes douleurs ; elle ne pouvait presque parler ; cependant elle fit un effort, et dit en soupirant :
« Pour nous punir de nos péchés, Dieu permet que tout vous réussisse. »
Ysengrin était gisant de son côté et gardait le silence avec Brun. Ils étaient tous deux assez misérables, enchaînés, blessés, et raillés par leur ennemi. Il ne manquait plus que Hinze, le chat : Reineke désirait fort lui jouer aussi quelque tour.
Le lendemain, l’hypocrite s’occupa d’abord à cirer les souliers que ses parents avaient perdus. Il courut se présenter au roi et lui dit :
« Votre serviteur est prêt à entreprendre le saint voyage : veuillez ordonner, par grâce, à votre chapelain de me bénir, afin que je parte d’ici avec confiance, et que ma sortie et mon entrée soient bénies. »
Ainsi dit-il. Le roi avait pour chapelain le bélier. C’était lui qui avait le soin de toutes les affaires ecclésiastiques. Le roi l’employait aussi comme secrétaire. On le nommait Bellin. Il le fit appeler et lui dit :
« Lisez-moi vite quelques saintes paroles en faveur de Reineke, que voici, pour le bénir dans le voyage qu’il médite. Il se rend à Rome et outre-mer. Attachez-lui le sac de voyage et mettez-lui le bourdon à la main. »
Bellin répliqua :
« Sire, vous avez, je crois, ouï dire que Reineke n’est pas relevé de l’excommunication, et j’aurais à souffrir un châtiment de mon évêque, qui l’apprendrait aisément et qui a le pouvoir de me punir. Mais je ne veux moi-même à Reineke ni bien ni mal. Si l’on pouvait arranger l’affaire, et si je ne devais essuyer aucun reproche de l’évêque, Mgr Ohnegrund, si le prieur, M. Losefund, ou le doyen Rapiamus, ne s’en fâchait point, je le bénirais volontiers, selon votre commandement. »
Le roi répliqua :
« Que signifient toutes ces chansons ? Vous nous débitez beaucoup de paroles, et je vois peu de choses derrière. Si vous ne me lisez rien, droit ou tortu, en faveur de Reineke, au diable qui m’en soucie ! Que m’importe l’évêque dans sa cathédrale ? Reineke fait le pèlerinage de Rome : voulez-vous l’empêcher ? »
Bellin se gratta derrière les oreilles avec inquiétude ; il craignait la colère de son roi, et se mit sur-le-champ à lire, dans son livre, pour le pèlerin, qui n’y faisait guère attention. Aussi cela eût-il, comme on pense, l’effet que cela pouvait avoir.
La bénédiction était achevée ; on lui donna ensuite le sac et le bourdon : le pèlerin était prêt. C’est ainsi qu’il feignait le saint voyage. Des larmes hypocrites coulaient sur les joues du scélérat, et lui baignaient la barbe, comme s’il avait senti le plus douloureux repentir. Sans doute aussi il était affligé de ne les avoir pas précipités dans le malheur tous tant qu’ils étaient, et de n’en avoir outragé que trois. Cependant il se leva et demanda en grâce que tous voulussent bien prier fidèlement pour lui du mieux qu’ils pourraient. Il se disposait donc à partir promptement. Il se sentait coupable et il avait lieu de craindre.
« Reineke, dit le roi, vous êtes bien pressé ! Pourquoi cela ?
– Qui fait une bonne entreprise ne doit jamais tarder, répliqua Reineke. Je vous demande congé ; l’heure est venue, monseigneur, laissez-moi partir.
– Je vous donne congé, » dit le roi.
Puis il ordonna à tous les seigneurs de la cour de cheminer quelque peu avec le faux pèlerin et de l’accompagner. Cependant Brun et Ysengrin étaient tous deux prisonniers, dans l’affliction et les douleurs.

Reineke avait donc regagné toute la faveur du roi, et il s’éloignait de la cour avec de grands honneurs. Il semblait partir avec le sac et le bourdon pour le Saint-Sépulcre, quoiqu’il n’y eût pas plus affaire qu’un bouleau dans Aix-la-Chapelle. Il avait dans l’esprit des projets tout différents. Il avait eu l’adresse de façonner pour son roi barbe de lin et nez de cire ; tous ses accusateurs durent l’accompagner à son départ et l’escorter avec honneur. Mais il ne pouvait renoncer à la ruse, et il dit encore, au moment de partir :
« Prenez garde, monseigneur, que les deux traîtres ne vous échappent, et tenez-les bien enchaînés en prison. S’ils étaient libres, ils ne renonceraient pas à leur criminelle entreprise. Votre vie est menacée, Sire, veuillez y songer. »
Il se mit donc en chemin, avec un maintien tranquille et dévot, avec un air candide, comme s’il n’avait fait autre chose de sa vie. Puis le roi revint à son palais, et tous les animaux le suivirent. Selon ses ordres, ils avaient d’abord accompagné Reineke à quelque distance, et le fripon avait témoigné tant d’angoisse et de tristesse, qu’il avait excité la compassion de maintes bonnes gens. Lampe, le lièvre, était surtout fort affligé.
« Il faut, cher Lampe, dit le fripon… Et faut-il nous séparer ?… Ah ! s’il vous plaisait aujourd’hui, et à Bellin, le bélier, de cheminer encore avec moi ! Votre société me ferait le plus grand bien. Vous êtes une agréable compagnie et d’honnêtes gens. Chacun ne dit que du bien de vous : cela me ferait honneur. Vous êtes ecclésiastiques et de sainte conduite ; vous vivez justement comme j’ai vécu étant ermite ; les plantes suffisent à votre nourriture ; vous apaisez votre faim avec des feuilles et de l’herbe, et ne vous souciez ni de pain ni de viande ni d’autres mets. »
Il sut donc abuser par ses louanges la faiblesse des deux personnages. Tous deux le suivirent dans sa demeure, et, quand ils virent le château de Maupertuis, Reineke dit au bélier :
« Restez dehors, Bellin, et régalez-vous à souhait de plantes et de gazon. Ces montagnes produisent en abondance des herbes salutaires et de bon goût. Je prends Lampe avec moi ; mais priez-le de consoler ma femme, qui déjà s’afflige, et qui sera au désespoir, quand elle apprendra que je m’en vais à Rome en pèlerinage. »

Le renard usait de douces paroles pour les tromper tous deux. Il fit entrer Lampe. Il trouva la triste renarde couchée avec ses petits, accablée d’inquiétude, car elle ne croyait plus que Reineke dût revenir de la cour. Maintenant elle le voyait avec le sac et le bourdon : cela lui parut étrange et elle dit :
« Reineke, mon ami, apprenez-moi donc ce qui vous est arrivé. Que vous a-t-on fait ? »
Et il répondit :
« J’étais déjà condamné, pris, enchaîné ; mais le roi s’est montré clément, il m’a délivré, et je suis parti comme pèlerin. Brun et Ysengrin sont demeurés pour gage. Ensuite le roi m’a donné Lampe en expiation, et nous pouvons en faire ce que nous voudrons, car le roi a fini par me dire pour ma gouverne : « C’est Lampe qui t’a trahi ! » Il a donc mérité un grave châtiment et il va me payer tout. »
Lampe entendit avec effroi ces paroles menaçantes ; il fut troublé, il voulut se sauver et il prit la fuite. Reineke lui ferma vite la porte ; le meurtrier saisit à la gorge l’infortuné, qui appelait au secours, avec des cris affreux.
« À l’aide, Bellin ! Je suis perdu ! Le pèlerin m’assassine ! »
Mais il ne cria pas longtemps ; Reineke lui eut bientôt déchiré la gorge. Et voilà comme il reçut son hôte.
« Venez, dit-il, et mangeons vite, car le lièvre est gras et de bon goût. En vérité, c’est la première fois qu’il est bon à quelque chose, le sot imbécile. Je l’avais juré dès longtemps. Voilà qui est fait. À présent le traître peut me dénoncer. »
Reineke se mit à l’œuvre avec sa femme et ses enfants. Ils se hâtèrent d’écorcher le lièvre et s’en régalèrent à plaisir. La renarde le trouvait exquis, et ne cessait de s’écrier :
« Grand merci au roi et à la reine ! Nous faisons, par leur grâce, un repas délicieux. Que Dieu les récompense !
– Mangez, mangez, dit Reineke. C’est bien assez pour cette fois. Nous sommes tous rassasiés, et je me propose d’en attraper davantage : ils finiront tous par me payer leur écot, ceux qui s’attaquent à Reineke et qui songent à lui faire tort. »
Dame Ermeline prit la parole :
« Je voudrais apprendre de vous comment vous êtes sorti d’affaire.
– Il me faudrait bien des heures, répondit-il, pour vous raconter comme j’ai subtilement tourné le roi, et comme je l’ai trompé lui et son épouse. Oui, je ne vous le cache pas, mon amitié avec le roi est fragile et ne subsistera pas longtemps. Quand il saura la vérité, il entrera dans une furieuse colère. S’il me tient de nouveau en son pouvoir, ni l’or ni l’argent ne pourront me sauver ; il me poursuivra certainement et tâchera de me prendre. Je ne puis attendre aucune grâce, je le sais parfaitement. Il ne manquera pas de me pendre. Il faut nous sauver. Fuyons en Souabe. Là nous ne serons connus de personne. Nous nous conformerons aux usages du pays. Le ciel nous aide ! C’est là qu’on trouve une douce nourriture et tous les biens en abondance : des coqs, des oies, des lièvres, des lapins, et le sucre, et les dattes, les figues, les raisins secs, et des oiseaux de toute sorte et de toute grandeur ; et, dans le pays, on cuit le pain au beurre et aux œufs ; l’eau est limpide et pure, l’air est agréable et serein ; il y a des poissons en abondance, qu’on appelle gallines, et d’autres qu’on nomme pullus et gallus et anas : qui pourrait les nommer tous ? Voilà des poissons à mon goût ! Je n’ai pas besoin de les pêcher dans l’eau profonde. C’était ma nourriture ordinaire, quand je menais ma vie d’ermite. Oui, ma petite femme, si nous voulons enfin jouir de la paix, partons, suivez-moi. Mais écoutez-moi bien : le roi m’a laissé échapper cette fois, parce que je lui ai débité d’étranges impostures. J’ai promis de lui livrer le trésor magnifique du roi Emmeric ; j’ai dit comme il se trouvait près de Krekelborn : quand ils iront le chercher, ils ne trouveront ni ceci ni cela ; ils fouilleront vainement la terre, et, quand le roi se verra trompé de la sorte, il sera horriblement furieux. Car, ce que j’ai imaginé de mensonges, avant d’échapper, vous pouvez vous le figurer. Vraiment, j’avais déjà la corde au cou. Je ne fus jamais dans un plus grand péril, ni plus cruellement tourmenté. Non, je ne souhaite pas de me revoir dans un pareil danger. Bref, quoi qu’il me puisse arriver, je ne me laisserai jamais persuader de retourner à la cour, pour me remettre au pouvoir du roi. Certes il me faudrait être bien habile pour tirer à grand’peine mon pouce de ses mâchoires. »
Madame Ermeline dit tristement :
« Que deviendrons-nous ? Nous serons étrangers et misérables dans tout autre pays. Ici nous avons tout à souhait. Vous êtes le maître de vos paysans. Et vous est-il si nécessaire de risquer une aventure ? En vérité, quitter le certain pour chercher l’incertain n’est ni sage ni glorieux. Nous vivons ici en sûreté. Combien le château n’est-il pas fort ? Quand le roi nous envahirait avec son armée, quand il occuperait la route avec ses forces, nous avons tant de portes dérobées, tant d’issues secrètes, que nous échapperons heureusement. Vous le savez mieux que moi, pourquoi faut-il que je le dise ? Avant de nous tenir par force dans ses mains, il aurait bien à faire. Cela ne m’inquiète point. Mais, que vous ayez juré de passer la mer, voilà ce qui m’afflige. Je me possède à peine. Comment cela finira-t-il ?
– Chère femme, ne vous affligez pas, répondit Reineke. Écoutez-moi et retenez bien ceci : mieux vaut jurer que pleurer. Voici ce que me dit une fois un sage au confessionnal : « Un serment forcé signifie peu de chose. » Cela ne m’arrête pas plus que la queue du chat. C’est le serment que je veux dire : vous m’entendez. Qu’il en soit comme vous avez dit : je reste à la maison. À vrai dire, j’ai peu de chose à espérer de Rome, et, quand j’en aurais fait dix fois le serment, je ne voudrais jamais voir Jérusalem. Je reste auprès de vous, et certes j’y serai plus à mon aise. Je ne trouverais pas ailleurs mieux que je n’ai. Si le roi veut me faire de la peine, il faut que je l’attende. Il est fort et trop puissant pour moi, mais je réussirai peut-être à l’attraper encore, à le coiffer du bonnet à grelots. Que je vive, et il trouvera pis qu’il ne cherche. J’en fais serment. »
Bellin, impatient, se mit à vociférer à la porte.
« Lampe, ne voulez-vous pas partir ? Venez donc. Il faut nous en aller. »
Reineke l’entendit crier, il accourut et dit :
« Mon ami, Lampe vous prie fort de l’excuser : il se divertit là-dedans avec madame sa tante. Vous voudrez bien, dit-il, le lui permettre. Prenez les devants à petits pas. Madame Ermeline ne le laissera pas aller de sitôt. De grâce, ne troublez pas leur plaisir. »
Bellin répondit :
« J’ai entendu crier : qu’était-ce donc ? J’ai entendu Lampe, il me criait : « Bellin, au secours ! au secours ! » Lui avez-vous fait quelque mal ? »
L’habile Reineke répondit :
« Écoutez donc : je parlais du pèlerinage dont j’ai fait le vœu ; ma femme en a été tout à fait désespérée ; une mortelle frayeur l’a saisie ; elle est tombée dans mes bras sans connaissance. À cette vue, Lampe a eu peur, et, dans son trouble, il s’est écrié : « Au secours, Bellin ! Bellin ! Oh ! ne tardez pas : certainement ma tante va mourir. »
– Tout ce que je sais, dit Bellin, c’est qu’il a poussé des cris d’angoisse.
– On ne lui a pas touché un poil, jura le menteur. J’aimerais mieux qu’il m’arrivât malheur à moi-même qu’à Lampe. Avez-vous entendu, ajouta Reineke, que le roi m’a demandé hier, quand je serais arrivé chez moi, de lui communiquer, dans quelques lettres, mes idées sur des affaires importantes ? Mon cher neveu, veuillez vous en charger. Elles sont toutes prêtes. Je dis dans ces lettres de belles choses, et je donne les avis les plus sages. Lampe s’est diverti à l’excès. J’avais du plaisir à l’entendre se rappeler avec sa tante de vieilles histoires. Comme ils jasaient ! Ils ne pouvaient finir. Ils ont bu et mangé et se sont réjouis, tandis que j’écrivais les lettres.
– Mon bon ami, dit Bellin, veuillez garder vos lettres : je n’ai pas une petite poche pour les mettre. Si je brisais les sceaux, je m’en trouverais fort mal.
– Je sais un bon remède, dit Reineke. Le sac que l’on m’a fait avec la peau de l’ours fera justement l’affaire. Il est épais et fort ; je mettrai les lettres dedans, et le roi vous donnera une bonne récompense ; il vous recevra avec honneur ; vous serez trois fois le bienvenu. »
Bellin, le bélier, crut tout cela. L’autre courut dans la maison, prit le sac et y fourra bien vite la tête de Lampe égorgé. Il songea en même temps au moyen d’empêcher le pauvre Bellin d’ouvrir la gibecière, et il dit, comme il sortait :
« Suspendez le sac à votre cou, et n’allez pas, mon neveu, prendre fantaisie de jeter les yeux sur les lettres : ce serait un fâcheux désir ; car je les ai soigneusement fermées, et vous ne devez pas y toucher. N’ouvrez pas même le sac. J’ai entrelacé les nœuds artistement, ainsi que j’en ai la coutume, dans les affaires importantes entre le prince et moi. S’il trouve les cordons entrelacés comme d’habitude, vous mériterez sa faveur et ses cadeaux, en qualité de messager fidèle. Même, aussitôt que vous verrez le roi, si vous voulez vous mettre encore auprès de lui en meilleure posture, faites-lui entendre que vous avez donné vos bons avis pour ces lettres ; que vous avez prêté secours à l’écrivain ; vous y gagnerez honneur et profit. »
Bellin fut ravi, et, dans sa joie, il s’élança de la place où il était, bondissant à droite et à gauche.
« Reineke, dit-il, mon neveu, mon seigneur, je vois à présent que vous m’aimez, que vous voulez me mettre en honneur. Cela me vaudra des louanges devant tous les seigneurs de la cour, d’avoir arrangé de si bonnes idées, de belles et charmantes paroles. Car, à la vérité, je ne sais pas écrire comme vous ; mais ils vont le croire, et c’est à vous seul que j’en serai redevable. C’est pour mon plus grand bien que je vous ai accompagné jusqu’ici. Maintenant, dites-moi, qu’en pensez-vous ? Lampe ne s’en vient-il pas à cette heure avec moi ?
– Non, m’entendez-vous ! dit le rusé. C’est encore impossible. Prenez l’avance doucement. Il vous suivra, aussitôt que je lui aurai confié et commandé certaines affaires d’importance.
– Dieu soit avec vous, dit Bellin, je vais donc partir. »
Et il fit diligence. Vers midi il arrivait à la cour.
Dès que le roi l’aperçut, et qu’en même temps, il remarqua le petit sac :
« Parlez, Bellin, dit-il, d’où venez-vous ? Où donc Reineke est-il resté ? Vous portez le sac de voyage : qu’est-ce que cela veut dire ?
– Monseigneur, dit Bellin, il m’a prié de vous apporter deux lettres. Nous les avons méditées ensemble. Vous trouverez les affaires les plus importantes subtilement traitées ; et, ce qu’elles renferment, je l’ai conseillé. Elles se trouvent dans le sac ; Reineke a serré les nœuds. »
Le roi fit appeler sur-le-champ le castor. C’était le notaire et le secrétaire royal. On le nommait Bokert. Son office était de lire devant le prince les lettres difficiles et importantes, car il savait plusieurs langues. Le roi fit aussi appeler Hinze, et voulut qu’il fût présent. Lors donc que Bokert eut délié le nœud aidé de Hinze, son confrère, il tira du sac, avec étonnement, la tête du lièvre assassiné, et s’écria :

« Voilà ce que j’appelle des lettres ! C’est fort singulier ! Qui les a écrites ? Qui peut expliquer cela ? C’est la tête de Lampe : nul ne peut la méconnaître. »
Le roi et la reine furent saisis de frayeur. Mais le roi dit, en baissant la tête :
« Ô Reineke, si je vous tenais encore ! »
Le roi et la reine éprouvaient une douleur extrême.
« Reineke m’a trompé ! s’écria le roi. Oh ! si je m’étais défié de ses infâmes mensonges ! »
En faisant ces cris, il paraissait troublé, et les autres animaux étaient confondus comme lui. Lupardus, proche parent du roi, prit la parole :
« Par ma foi, je ne vois pas pourquoi vous êtes si troublés, vous et la reine. Éloignez ces pensées. Prenez courage. Cela pourrait vous faire honte aux yeux de tout le monde. N’êtes-vous pas le maître ? Tous ceux qui sont ici vous doivent l’obéissance.
– Et justement ! reprit le roi, vous ne devez pas être surpris de mon chagrin. Je me suis, hélas ! fourvoyé. Car le traître m’a poussé, avec une ruse infâme, à punir mes amis. Brun et Ysengrin sont accablés d’ignominie, et je ne devrais pas en éprouver un vif repentir ? Cela ne me fait pas honneur, d’avoir si maltraité les premiers barons de ma cour, d’avoir donné tant de créance au menteur et d’avoir agi sans prévoyance. J’ai trop vite écouté ma femme ; elle s’est laissé séduire ; elle m’a prié et supplié pour lui. Oh ! que n’ai-je été plus ferme ! À présent, le repentir est tardif et tout conseil inutile.
– Sire, reprit Lupardus, écoutez ma prière : ne vous affligez pas plus longtemps. Le mal qui s’est fait peut se réparer. Donnez à l’ours, au loup, à la louve, le bélier en dédommagement. Car Bellin a confessé ouvertement et effrontément qu’il a conseillé la mort de Lampe. Il faut maintenant qu’il l’expie. Ensuite nous marcherons ensemble contre Reineke ; nous le prendrons, si nous pouvons, puis nous le pendrons bien vite. Si on lui donne la parole, il se sauvera par son bavardage et ne sera pas pendu. Non, je le sais parfaitement, ces gens se laisseront apaiser. »
Le roi entendit avec plaisir ces paroles, et dit à Lupardus :
« Votre avis me plaît. Allez donc sur-le-champ me quérir les deux barons. Je veux qu’ils reprennent avec honneur leur place à mes côtés dans le conseil. Convoquez tous les animaux qui se trouvaient à la cour : il faut qu’ils sachent tous comme Reineke a menti honteusement ; comme il s’est échappé, et comme ensuite, avec le secours de Bellin, il a tué Lampe. J’entends que chacun traite avec honneur l’ours et le loup, et, comme vous le conseillez, je donne à ces seigneurs, en expiation, le traître Bellin et ses parents à perpétuité. »
Lupardus fit diligence, jusqu’à ce qu’il eût trouvé les deux prisonniers, Brun et Ysengrin. Ils furent déliés, puis il leur dit :
« Apprenez de moi une bonne nouvelle. Je vous apporte de la part du roi, paix assurée et sauf-conduit. Entendez-moi, seigneurs : si le roi vous a fait du mal, il en a du regret ; il vous le fait savoir, et il désire que vous soyez contents : en expiation, vous recevrez Bellin avec sa race, et même avec tous ses parents à perpétuité. Sans autres façons, vous pouvez les assaillir, que vous les trouviez dans les bois, que vous les trouviez dans les champs ; ils vous sont tous livrés. Mon gracieux seigneur vous permet en outre de faire toute sorte de maux à Reineke, qui vous a trahis. Vous pouvez le poursuivre, lui, sa femme, ses enfants et tous ses parents, où que vous les trouviez : nul ne s’y oppose. Cette précieuse liberté, je vous l’annonce au nom du roi. Lui, et tous ceux qui régneront après lui, la maintiendront. Oubliez seulement ce qui vous est arrivé de fâcheux ; jurez de lui être dévoués et fidèles : vous le pouvez avec honneur. Jamais il ne vous fera plus aucun tort. Je vous le conseille, acceptez la proposition. »
Ainsi fut conclu l’accommodement. Le bélier dut le payer de sa vie, et depuis lors tous ses parents sont poursuivis sans cesse par la redoutable engeance d’Ysengrin. Ainsi commença la haine éternelle. Maintenant les loups continuent à sévir, sans pudeur et sans crainte, contre les agneaux et les moutons ; ils croient avoir la justice de leur côté ; leur courroux n’en épargne aucun ; ils ne se laissent jamais fléchir. Mais, en faveur de Brun et d’Ysengrin, et pour leur faire honneur, le roi tint sa cour douze jours de plus ; il voulait montrer publiquement combien il avait à cœur de satisfaire les barons.
CHANT SEPTIÈME

On vit alors la cour magnifiquement ordonnée et disposée ; maints chevaliers arrivèrent ; les quadrupèdes furent suivis d’innombrables oiseaux, et tous ensemble rendirent de grands honneurs à Brun et Ysengrin, qui oublièrent leurs souffrances. Ils se virent fêtés par la meilleure compagnie qui se fût jamais rassemblée. Trompettes et timbales résonnaient. Le bal de la cour fut du meilleur goût. On servit avec profusion ce que chacun pouvait désirer. Messagers sur messagers coururent le pays et convièrent les hôtes. Oiseaux et bêtes se mirent en chemin ; ils venaient par couples, voyageaient de jour et de nuit, et se hâtaient d’arriver. Mais Reineke, le renard, resta chez lui aux écoutes ; il n’avait pas dessein de se rendre à la cour, le faux pèlerin ; il attendait peu de merci. Le fripon ne trouvait pas de plus grand plaisir que d’exercer sa malice selon son vieil usage. On entendit à la cour les plus beaux chants ; on servait aux hôtes, en abondance, à boire et à manger ; on vit des tournois et des joutes ; chacun s’était rapproché des siens ; on dansait, on chantait, puis on entendait le sifflet par intervalles, on entendait le chalumeau. Le roi regardait, avec bienveillance, des fenêtres du salon ; il se plaisait à ce grand tumulte ; ses yeux en étaient réjouis.

Huit jours étaient passés ; le roi s’était mis à table avec ses premiers barons ; il était assis à côté de la reine, quand le lapin sanglant se présenta devant le roi, et lui dit tristement :
« Sire, sire, et vous tous, seigneurs, ayez pitié de moi : car vous avez rarement oui parler d’une trahison aussi perfide et d’actes aussi sanguinaires que ceux dont Reineke m’a rendu victime. Hier matin je le trouvai assis ; c’était vers six heures ; je passais sur la route devant Maupertuis, et je croyais aller mon chemin en paix. Vêtu en pèlerin, il était assis devant sa porte, et semblait lire ses prières du matin. Je voulais passer vite, pour me rendre à votre cour. Quand il me vit, il se leva soudain et vint à ma rencontre. Je crus qu’il voulait me saluer, mais il me saisit avec ses pattes en véritable assassin : je sentis ses ongles entre mes oreilles, et je crus, en vérité, avoir la tête arrachée : car ses ongles sont longs et pointus. Il me renversa par terre. Heureusement je me dégageai, et, comme je suis leste, je pus m’échapper. Il grondait après moi, et jura qu’il me trouverait : moi, sans répondre, je m’éloignai ; mais, hélas ! je lui ai laissé une de mes oreilles ; j’arrive la tête sanglante. Voyez, j’en rapporte quatre plaies. Vous jugerez avec quelle violence il m’a frappé. Il s’en est peu fallu que je ne sois resté sur la place. Songez maintenant au péril, songez à votre sauf-conduit ! Qui peut voyager, qui peut se rendre à votre cour, si le brigand occupe la route et insulte tout le monde ? »

Il finissait à peine, que Merkenau, la corneille bavarde, vint dire à son tour :
« Noble seigneur et gracieux roi, je vous apporte de tristes nouvelles. Je ne suis pas en état de parler beaucoup, étant saisie de douleur et d’angoisse, et je crains, à le faire, que mon cœur ne se brise, car il m’est arrivé aujourd’hui une chose lamentable. Ma femme Scharfenebbe et moi, nous passions ensemble ce matin. Reineke était gisant comme mort sur la bruyère, les yeux tournés, la bouche ouverte et la langue pendante. Je me mis à crier d’horreur ; il ne bougeait pas. Je criais et le plaignais, disant : « Ah ! ah ! hélas ! » et je recommençais mes plaintes. « Ah ! il est mort ! Que j’en suis affligé ! Que j’en suis désolé ! » Ma femme aussi se lamentait ; nous gémissions tous deux. Je tâtai le ventre et la tête ; ma femme s’avança de même, et s’approcha du museau, pour savoir si la respiration n’indiquerait point quelque vie ; mais elle observait en vain : nous en aurions juré tous deux. Or, écoutez le malheur !

Comme, dans sa tristesse, elle approchait, sans défiance, son bec de la gueule du scélérat, il l’observa, le traître, la saisit horriblement, et lui emporta la tête. Combien je fus effrayé, je ne veux pas le dire. « Oh ! malheur à moi ! oh ! malheur à moi ! » m’écriai-je. Il s’élança, et voulut aussi me happer. Je tressaillis et m’enfuis au plus vite. Si j’avais été moins agile, il m’aurait saisi tout de même. J’échappai à grand’peine aux pattes du meurtrier ; je volai sur un arbre. Oh ! je voudrais n’avoir pas sauvé ma triste vie. Je voyais ma femme sous les ongles du scélérat. Ah ! il eut bientôt mangé la pauvre bonne ! Il me semblait aussi glouton, aussi affamé, que s’il avait voulu en manger encore quelques-unes. Il n’a pas laissé le plus petit membre, pas le moindre osselet. Je n’ai rien vu d’aussi lamentable. Il partit, et moi, je ne pus m’empêcher de voler vers la place, la tristesse au cœur. Je ne trouvai que du sang et quelques plumes de ma femme. Je les apporte, comme preuve du crime. Hélas ! ayez pitié de moi, monseigneur. Si vous deviez cette fois épargner le traître, différer une juste vengeance, ne pas donner force à votre paix et votre sauf-conduit, on ferait là-dessus bien des discours qui pourraient vous déplaire. Car les gens disent : « Il est coupable du fait, celui qui a le pouvoir de punir et qui ne punit pas. Alors chacun fait le maître. Votre dignité en souffrirait : veuillez y songer. »
La cour avait entendu la plainte du bon lapin et celle de la corneille. Noble, le roi, entra en colère et s’écria :
« J’en fais serment par ma foi conjugale, je punirai ce forfait, et l’on s’en souviendra longtemps. Se moquer de mon sauf-conduit et de mes ordonnances ! Je ne veux pas le souffrir. Je me suis fié au scélérat et l’ai laissé échapper beaucoup trop aisément. Je l’ai même équipé en pèlerin, et l’ai vu partir d’ici comme se rendant à Rome. Que de choses le menteur ne nous a-t-il pas fait accroire ! Comme il a su gagner aisément l’intercession de la reine ! Elle m’a persuadé ; maintenant il est échappé. Mais je ne serai pas le dernier qui se soit repenti d’avoir suivi les conseils des femmes. Et, si nous laissons plus longtemps le scélérat courir impuni, c’est pour nous une honte. Il fut toujours un fripon et le sera toujours. Or, messieurs, délibérez ensemble sur les moyens de l’arrêter et de lui faire son procès. Si nous y mettons de la vigueur, la chose réussira. »
Ysengrin et Brun entendirent avec joie le discours du roi. « Nous serons enfin vengés, » se disaient-ils l’un et l’autre ; cependant ils n’osèrent prendre la parole : ils voyaient que le roi était troublé et irrité à l’excès. La reine dit enfin :
« Il ne faudrait pas, monseigneur, vous courroucer si violemment, ni jurer si aisément : votre dignité en est compromise et vos paroles en ont moins de poids. Nous ne voyons point encore la vérité dans tout son jour ; il faut commencer par entendre l’accusé. S’il était présent, tel qui parle contre Reineke resterait muet. Il faut toujours entendre les deux parties. Plus d’un téméraire porte plainte pour couvrir ses crimes. J’ai tenu Reineke pour habile et sage ; je ne songeais pas à mal et n’avais que votre intérêt devant les yeux, bien que les choses aient tourné autrement. Car ses conseils sont bons à suivre, si sa vie mérite quelque blâme. Il faut d’ailleurs bien considérer l’étroite alliance de sa race. La précipitation ne rend pas les choses meilleures, et, ce que vous résoudrez, vous finirez toujours par l’accomplir comme maître et souverain. »
Là-dessus Lupardus prit la parole :
« Vous écoutez tant d’avis, écoutez aussi celui-là que Reineke comparaisse, et, ce que vous résoudrez, qu’on l’exécute sur-le-champ. C’est là probablement ce que pensent tous les seigneurs, comme votre noble épouse. »
Ysengrin dit à son tour :
« Que chacun conseille pour le mieux. Seigneur Lupardus, écoutez-moi. Quand Reineke serait ici à cette heure, et quand il se disculperait de la double plainte que portent ces deux personnes, il me serait toujours facile de montrer qu’il a mérité de perdre la vie. Néanmoins, je passe tout sous silence, jusqu’à ce qu’il soit dans nos mains. Et avez-vous oublié comme il a trompé le roi avec le trésor, disant qu’il devait le trouver à Husterlo, près de Krekelborn, et autres grossiers mensonges ? Il a trompé tout le monde, et il nous a outragés, Brun et moi, mais j’y mettrai ma vie. Voilà comme le menteur se comporte sur la bruyère : il rôde, il pille, il tue. Si le roi et les seigneurs le trouvent bon, eh bien, que l’on procède ainsi. Cependant, s’il avait voulu tout de bon se rendre à la cour, il se serait présenté dès longtemps. Les messagers du roi ont couru le pays pour convier les hôtes, et il est resté chez lui. »
Là-dessus le roi prononça ces paroles :
« Pourquoi l’attendre longtemps ici ? Préparez-vous (telle est ma volonté), préparez-vous tous à me suivre dans six jours ; car, en vérité, je veux voir la fin de ces débats. Qu’en dites-vous, seigneurs ? Ne serait-il pas capable enfin de ruiner un pays ? Préparez-vous aussi bien que vous pourrez, et venez sous le harnois ; venez avec des arcs, des piques et toute sorte d’armes, et comportez-vous vaillamment ; et tous ceux que j’armerai chevaliers en campagne, qu’ils en portent le titre avec honneur. Nous assiégerons Maupertuis, le château. Nous verrons ce que Reineke renferme dans sa maison. »
À ces mots, tous s’écrièrent :
« Nous obéirons ! »
Le roi et ses guerriers songeaient donc à prendre d’assaut le château de Maupertuis, à punir le renard ; mais Grimbert, qui avait assisté au conseil, s’éloigna secrètement et courut chez Reineke pour lui annoncer la nouvelle. Il cheminait, le cœur affligé, faisant des plaintes à part lui, et disant :
« Hélas ! que deviendra mon oncle maintenant ? C’est avec raison que toute la famille te pleure, ô toi, le chef de toute la famille ! Quand tu plaidais notre cause devant la justice, nous étions tranquilles : personne ne pouvait tenir devant toi et ton adresse. »
En parlant ainsi, il atteignit le château, et il trouva Reineke assis en plein air. Il venait de prendre deux jeunes pigeons. Ils s’étaient risqués hors du nid pour essayer de voler ; mais leurs plumes étaient trop courtes : ils tombèrent, et ne furent pas en état de se relever, et Reineke les saisit, car il chassait souvent aux environs. Il vit de loin Grimbert approcher et l’attendit. Il le salua et lui dit ces mots :
« Mon neveu, soyez le bienvenu plus que toute autre personne de ma famille ! Pourquoi courez-vous si fort ? Vous êtes haletant ! M’apportez-vous quelque nouvelle ? »
Grimbert lui répondit :
« La nouvelle que je vous annonce n’est point rassurante. Vous le voyez, j’accours plein d’angoisse. Votre vie, vos biens, tout est perdu. J’ai vu la colère du roi. Il jure de vous arrêter et de vous faire subir une mort infâme. Il a ordonné à chacun de paraître ici en armes dans six jours, avec l’arc et l’épée, avec l’arquebuse et les chariots. Tout le monde vient vous assaillir : hâtez-vous de faire vos réflexions. Ysengrin et Brun sont de nouveau dans la confidence du roi, mieux que moi dans la vôtre, et l’on fait tout ce qu’ils veulent. Ysengrin vous proclame le plus affreux des meurtriers et des brigands, et, par ces discours, il anime le roi. Il sera maréchal ; vous verrez la chose dans peu de semaines. Le lapin est survenu, puis la corneille : ils ont fait contre vous de grandes plaintes ; et, si le roi vous prend cette fois, vous n’aurez pas longtemps à vivre ; j’ai lieu de le craindre.
– Voilà tout ? répliqua le renard. Tout cela ne m’inquiète pas le moins du monde. Quand le roi, avec tout son conseil, aurait promis et juré deux fois et trois fois, il me suffira de paraître pour triompher de tout. Ils délibèrent, ils délibèrent, et ne savent jamais toucher au but. Mon cher neveu, laissez aller la chose ; suivez-moi, et voyez ce que je vous servirai. Je viens d’attraper là des pigeons jeunes et gras. C’est toujours mon plus friand régal. Ils sont faciles à digérer ; on les avale tout doucement, et les petits os ont si bon goût ! Ils se fondent dans la bouche. C’est moitié lait, moitié sang. Cet aliment léger me convient, et ma femme a le même goût. Venez, elle nous fera un bon accueil. Mais ne lui dites pas pourquoi vous êtes venu : chaque bagatelle la saisit et l’inquiète. Demain, je vous suivrai à la cour. Là, mon cher neveu, vous me seconderez, j’espère, comme il convient entre parents.
– Je mets à votre service mes biens et ma vie, dit le blaireau. »
Et Reineke reprit :
« Je m’en souviendrai. Que je vive longtemps, et cela tournera à votre profit.
– Présentez-vous avec assurance devant les seigneurs, dit le blaireau, et soutenez au mieux votre cause ; ils vous écouteront. Lupardus a déjà opiné qu’on ne doit pas vous punir avant que vous vous soyez suffisamment défendu. La reine elle-même a partagé cet avis. Remarquez cette circonstance et tâchez de la mettre à profit.
– Soyez tranquille, dit Reineke, tout s’arrangera. Quand le monarque irrité m’aura entendu, il changera de sentiment, et je finirai par gagner mon procès. »
Alors ils entrèrent tous deux, et furent gracieusement reçus par la dame du logis. Elle servit tout ce qu’elle avait. On partagea les pigeons ; on les trouva succulents, et chacun en mangea sa part. Les convives ne furent pas rassasiés, et ils en auraient sans doute dévoré une demi-douzaine, s’ils les avaient eus.
Reineke dit au blaireau :
« Avouez, notre oncle, que j’ai des enfants délicieux et qui doivent plaire à chacun. Dites-moi comment vous plaisent Rossel et Reinhart, le petit. Ils multiplieront un jour notre race, et commencent peu à peu à se former. Ils font ma joie du matin jusqu’au soir. L’un prend une poule, l’autre attrape un poulet. Ils plongent aussi dans l’eau bravement, pour atteindre le canard et le vanneau. Je les enverrais volontiers à la chasse plus souvent encore, mais il faut que je leur enseigne avant tout la sagesse et la prévoyance ; comme ils doivent prudemment se garantir des pièges, des chasseurs et des chiens. Quand ils sauront bien se conduire, quand ils seront dressés comme il faut, ils iront chaque jour quérir et apporter de la nourriture, et rien ne manquera dans la maison, car ils marcheront sur mes traces et joueront de terribles tours. Si une fois ils se mettent à l’œuvre, les autres bêtes auront le dessous. L’ennemi se sentira pris à la gorge et ne se débattra pas longtemps. C’est la manière et le jeu de Reineke. Ils saisiront vivement et ne feront pas faux bond. C’est là, selon moi, l’essentiel.
– Cela fait honneur, dit Grimbert, et l’on peut se féliciter d’avoir des enfants tels qu’on les désire, qui s’accoutument de bonne heure au métier pour aider leurs parents. Je me réjouis sincèrement de les savoir de ma famille, et j’espère merveilles.
– Restons-en là pour aujourd’hui, reprit Reineke. Allons nous coucher, car nous sommes tous fatigués, et Grimbert surtout est accablé. »

Ils se couchèrent dans la salle, qui était jonchée abondamment de foin et de feuilles, et ils dormirent ensemble. Mais l’inquiétude tint Reineke éveillé. La chose lui semblait exiger de sages mesures, et le matin le trouva dans ses réflexions. Il se leva de sa couche et dit à sa femme :
« Ne vous affligez pas. Grimbert m’a prié de le suivre à la cour. Restez tranquillement à la maison. Si quelqu’un parle de moi, donnez aux choses le tour le plus favorable, et gardez le château : comme cela, tout ira bien pour nous. »
Madame Ermeline dit alors :
« Cela me semble étrange ! Vous osez retourner à la cour, où l’on est si mal disposé pour vous ! Êtes-vous forcé ? Je ne conçois pas cela. Songez au passé.
– Assurément, reprit Reineke, ce n’était pas une plaisanterie. Beaucoup de gens me voulaient du mal ; je me suis trouvé dans une grande détresse. Mais il se passe bien des choses sous le soleil. Contre toute apparence, on éprouve ceci et cela, et qui pense tenir une chose en est privé tout à coup. Laissez-moi donc aller. J’ai maintes choses à faire là-bas. Demeurez tranquille, je vous en prie, vous n’avez nul besoin de vous tourmenter. Attendez : vous me reverrez, ma chère, si du moins cela m’est possible, dans cinq ou six jours. »
À ces mots, il partit, accompagné de Grimbert, le blaireau.

CHANT HUITIÈME

Grimbert et Reineke marchaient ensemble à travers la bruyère, droit au château du roi, et Reineke disait :
« Quoi qu’il arrive, j’ai, cette fois, le pressentiment que le voyage aura une heureuse issue. Mon cher neveu, écoutez-moi : depuis que je vous ai fait ma dernière confession, je me suis de nouveau rendu coupable de péché. Écoutez le gros et le menu et ce que j’ai alors oublié.
« Je me suis procuré un bon morceau du corps de l’ours et de sa peau ; le loup et la louve m’ont cédé leurs souliers ; de la sorte j’ai satisfait mon petit ressentiment. Ce sont mes mensonges qui m’ont valu cela. J’ai su exciter la colère du roi, et, en outre, je l’ai affreusement trompé : car je lui ai fait un conte, et j’ai su inventer des trésors. Cela ne m’a pas suffi ; j’ai tué Lampe ; j’ai fourré dans un paquet la tête du mort, et j’en ai chargé Bellin. Le roi l’a regardé avec colère : il a dû payer l’écot. Pour le lapin, je l’ai pressé rudement derrière les oreilles, si bien qu’il a failli en perdre la vie, et j’ai eu regret de le voir échappé. Je dois avouer aussi que la corneille ne se plaint pas à tort : j’ai mangé sa petite femme, Madame Scharfenebbe. Voilà les péchés que j’ai commis depuis ma confession. Mais alors j’avais oublié une chose, une seule, et je veux la conter. Il faut vous dire une malice que j’ai faite. Je ne voudrais pas avoir pareille chose à souffrir. Je l’ai mise dans le temps sur le dos du loup. Nous cheminions ensemble entre Kackys et Elverdingen, et nous vîmes de loin une jument avec son poulain, l’un et l’autre noirs comme les corbeaux. Le poulain pouvait avoir quatre mois. Ysengrin était tourmenté de la faim, et il me fit cette prière : « Veuillez demander à la jument si elle nous vendrait son poulain et à quel prix. » Je me rendis auprès d’elle et je risquai la drôlerie. « Ma chère dame la jument, lui dis-je, le poulain est vôtre, je pense : le vendriez-vous peut-être ? Je voudrais bien le savoir. » Elle répondit : « Si vous le payez bien, je pourrai m’en dessaisir ; et la somme pour laquelle je consens à le vendre, vous pourrez la lire : elle est écrite sous mon pied de derrière. » Je devinai ce qu’elle voulait et je répliquai : « Je dois vous avouer que je ne sais guère lire et écrire, comme je voudrais. D’ailleurs je ne demande pas l’enfant pour moi-même. C’est Ysengrin qui voudrait proprement savoir vos conditions ; c’est lui qui m’envoie. – Faites-le venir, dit-elle ; il apprendra la chose. » J’allai vers Ysengrin, qui restait à sa place et m’attendait. « Voulez-vous faire un bon repas ? lui dis-je. Allez, la jument vous cédera le poulain ; le prix est marqué sous le pied de derrière… Je n’avais qu’à voir moi-même, a-t-elle dit ; mais, à mon vif chagrin, j’ai déjà manqué mainte aubaine, parce que je n’ai pas appris à lire et à écrire. Essayez, mon oncle, et voyez l’écriture : vous la comprendrez peut-être. » Ysengrin répondit : « Que ne lirais-je pas ? Je le trouverais étrange ! Je sais l’allemand, le latin, le welche et même le français : car j’ai fréquenté l’école à Erfurt, sous les habiles et les doctes ; j’ai formulé des questions et des sentences avec les maîtres en droit ; j’ai pris mes licences en forme ; et quelques écritures que l’on trouve, je puis les lire comme si ce fût mon nom. Aussi la chose ne peut-elle manquer aujourd’hui. Demeurez, je vais et je lirai l’écriture : nous verrons bien. Il alla et dit à la dame : « Combien le poulain ? Faites un prix raisonnable. » Elle répondit : « Vous n’avez qu’à lire la somme : elle est écrite sous mon pied de derrière. « Faites que je vois, reprit le loup. – C’est ce que je fais, » dit-elle. Puis elle leva le pied de dessus l’herbe. Il était nouvellement garni de six clous. Elle frappa juste et ne s’écarta pas d’un poil. Elle l’atteignit à la tête ; il tomba par terre tout de son long, étourdi, comme mort.

Mais elle s’enfuit au plus vite. Il resta longtemps ainsi gisant et blessé. Au bout d’une heure, il revint à lui et hurla comme un chien. Je m’approchai et lui dis : « Monsieur mon oncle, où est la jument ? Le poulain avait-il bon goût ? Vous vous êtes rassasié ; vous m’avez oublié. Ce n’est pas bien fait à vous ; c’est moi qui vous ai porté le message. Après le repas, il vous a plu de faire un petit sommeil. Que portait, dites-moi, l’écriture sous le pied ? Vous êtes un grand savant. – Ah ! répliqua-t-il, vous raillez encore ? Que j’ai été malheureux cette fois ! Une roche même serait attendrie. Oh ! cette jument aux longues jambes ! Que le bourreau le lui rende ! Le pied était garni de fer : voilà l’écriture ! Des clous neufs. J’en ai six blessures à la tête. Il faillit en perdre la vie. À présent j’ai tout confessé : cher neveu, pardonnez-moi mes mauvaises œuvres ! Comment les choses tourneront à la cour, c’est douteux ; mais j’ai déchargé ma conscience, et me suis purifié de péché. Dites-moi comment je puis me corriger, afin que j’obtienne grâce. »
Grimbert lui répondit :
« Je vous trouve encore sous le poids du péché ; mais les morts ne reviennent pas à la vie. Il vaudrait mieux sans doute qu’ils vécussent encore. Je veux donc, mon oncle, en considération de l’heure épouvantable, en considération de la mort prochaine qui vous menace, vous remettre vos péchés, comme serviteur du Seigneur : car on vous poursuit avec violence ; je crains tout ce qu’il y a de pire, et l’on vous reprochera avant tout la tête du lièvre. Ce fut une grande témérité, avouez-le, de provoquer le roi, et cela vous nuira plus que ne le pensait votre légèreté.
– Je n’y perdrai pas un poil, repartit le fripon, et, s’il faut vous le dire, c’est un talent tout particulier de savoir se tirer d’affaire dans le monde. On ne peut se garder aussi saintement que dans un cloître, vous le savez. Si quelqu’un fait commerce de miel, il se lèche de temps en temps les doigts. Lampe me séduisait fort ; il sautait par-ci par-là, me tournait devant les yeux ; son embonpoint me plut, et je mis à part l’amitié. Je voulais aussi peu de bien à Bellin. Ils ont le dommage ; j’ai le péché. Mais ils sont parfois si stupides, si lourds et si grossiers en toute affaire ! Devais-je faire tant de cérémonies ? Je m’y sentais peu disposé. Je m’étais sauvé de la cour avec angoisse, et leur enseignais une chose puis une autre : peine inutile ! cela n’avançait pas. Sans doute chacun devrait aimer le prochain, je dois en convenir ; cependant je les estimais peu, et mort est mort, vous le dites vous-mêmes. Parlons d’autre chose. Les temps sont dangereux. En effet, comment cela va-t-il du haut en bas ? Il ne faut pas causer : pourtant, nous autres, nous observons ce qui se passe, et nous faisons nos réflexions. Le roi lui-même vole aussi bien qu’un autre, nous le savons. Ce qu’il ne prend pas, il le laisse emporter aux ours et aux loups, et il croit que c’est juste. Il ne se trouve personne qui ose lui dire la vérité, si profond est le mal ; point de confesseur, point de chapelain. Ils se taisent ! Pourquoi cela ? Ils ont part aux profits, quand ils ne feraient qu’attraper une soutane. Que l’on vienne ensuite se plaindre : on gagnerait autant de happer l’air ; on tue le temps, et l’on ferait mieux de chercher de nouveaux profits. Car ce qui est perdu est perdu, et ce qu’une fois un puissant te ravit, tu ne le rattraperas plus ; on prête peu l’oreille à la plainte, et elle fatigue à la fin. Notre seigneur est le lion, et il tient pour conforme à sa dignité de tirer tout à lui. Il nous appelle d’ordinaire ses gens : en vérité, il semble que notre bien lui appartienne.
« Oserai-je le dire, mon oncle ? Le noble sire aime surtout les gens qui apportent, et qui savent danser comme il chante. On le voit clairement. Que l’ours et le loup soient rentrés au conseil, cela va nuire encore à bien des gens. Ils volent, ils pillent ; le roi les aime ; chacun le voit et se tait : on espère avoir son tour. Il s’en trouve ainsi plus de quatre aux côtés du roi ; distingués entre tous, ils sont les plus grands à la cour. Un pauvre diable, comme Reineke, attrape-t-il quelque poulet, aussitôt ils veulent tous fondre sur lui, le poursuivre et le prendre, et, à grand bruit, d’une voix unanime, ils le condamnent à mort. Les petits voleurs sont pendus sans façons ; les gros ont un grand privilège : ils gouvernent à leur gré le pays et les châteaux. Voyez-vous, mon oncle, lorsque j’observe ces choses et que je médite là-dessus, je joue aussi mon jeu, et me dis souvent à part moi : « Il faut que ce soit bien, puisque tant de gens le font ! » À la vérité, la conscience s’éveille aussi, et me montre de loin la colère et le jugement de Dieu : elle me fait considérer la fin ; le bien illégitime, si petit qu’il soit, il faut le restituer. Alors je sens dans mon cœur le repentir, mais cela ne dure pas longtemps. Eh ! que te sert d’être le meilleur ? Les meilleurs n’échappent pas aujourd’hui à la médisance du peuple. La foule sait parfaitement s’enquérir de chacun ; elle n’oublie guère personne ; elle découvre ceci et cela. Il y a peu de bien dans la société ; et, véritablement, peu de gens méritent d’avoir de bons et justes seigneurs ; car ils disent et ils chantent toujours, toujours le mal, et le bien que peuvent faire les seigneurs, grands et petits, ils le savent sans doute, mais ils s’en taisent ou n’en parlent que rarement. Cependant je trouve pire que tout le reste l’outrecuidance de l’aveugle erreur qui s’empare des hommes, que chacun, dans le délire de sa volonté passionnée, peut gouverner et juger le monde. Si chacun tenait du moins dans l’ordre sa femme et ses enfants, savait contenir d’insolents domestiques, pouvait être heureux sans bruit, dans une vie modeste, tandis que les fous dissipent leurs biens ! Mais comment le monde se pourrait-il amender ? Chacun se permet tout, et veut contraindre les autres par violence. Et voilà comme nous tombons toujours plus avant dans le mal. Calomnies, mensonges, trahisons, larcins, faux serments, meurtre et pillage, on n’entend plus parler d’autre chose ; des faux prophètes et des hypocrites trompent outrageusement les hommes. Voilà comme les gens passent leur vie, et, si l’on veut leur adresser des avis fidèles, ils prennent la chose à la légère et disent même : « Eh ! si le péché était grave et funeste, comme çà et là nous le prêchent maints docteurs, le curé éviterait lui-même le péché. » Ils s’excusent sur le mauvais exemple, et ressemblent tout à fait à la race des singes, qui, née pour imiter, parce qu’elle ne choisit ni ne pense, éprouve de sensibles maux. »
« Certes, messieurs du clergé devraient se mieux conduire. Ils pourraient faire bien des choses, à condition de les faire en secret. Mais ils ne nous ménagent point, nous autres laïques, et font tout ce qui leur plaît devant nos yeux, comme si nous étions frappés d’aveuglement. Cependant nous voyons trop clairement que les vœux de ces bons messieurs ne leur plaisent pas plus qu’ils ne sourient à l’ami coupable des œuvres mondaines. Car, au-delà des Alpes, les moines ont d’ordinaire une bonne amie ; et il n’en est pas moins dans nos provinces qui s’abandonnent au péché. On m’assure qu’ils ont des enfants comme les personnes mariées ; qu’ils se donnent beaucoup de mouvement pour les doter, et qu’ils les élèvent aux dignités. Ces enfants ne songent plus ensuite d’où ils sont venus ; ils ne cèdent le pas à personne ; ils passent fièrement, la tête haute, comme s’ils étaient de noble race, et restent persuadés que leur position est toute régulière. Avant ce temps, on ne faisait pas grand compte des enfants de prêtres ; maintenant on les qualifie tous de seigneurs et de dames. Certes l’argent peut tout faire. On trouve peu de principautés où les prêtres ne lèvent des péages et des impôts, et ne tiennent en usufruit des villages et des moulins. Ils corrompent le monde ; la paroisse apprend le mal, car on voit qu’ainsi fait le prêtre : alors tout le monde pèche, et un aveugle en détourne un autre du bien. Aussi, qui remarquerait les bonnes œuvres des prêtres pieux, et comme ils édifient la sainte Église par leur bon exemple ? Qui les imite dans sa vie ? On se fortifie dans le mal. Voilà ce qui se passe chez le peuple : comment le monde se pourrait-il amender ?
« Mais écoutez encore : quelqu’un est-il de naissance illégitime, il ne doit pas s’en émouvoir. Que peut-il faire à la chose ? Voici mon avis, écoutez-moi : si une telle personne se comporte avec humilité, et ne provoque pas les autres par une conduite vaine, on n’est point choqué, et l’on aurait tort si l’on causait de ces gens-là. La naissance ne nous rend pas nobles et bons ; elle ne peut non plus faire notre honte. C’est la vertu et le vice qui distinguent les hommes. Les ecclésiastiques bons et savants sont tenus, comme de raison, en grand honneur ; mais les mauvais donnent un mauvais exemple. Si un tel homme prêche la vertu, les laïques finissent par dire : « Il dit le bien et il fait le mal ; lequel faut-il choisir ? Il ne fait non plus aucun bien à l’Église. Il prêche à tout le monde : « Donnez de l’argent et bâtissez l’église. Je vous le conseille, mes amis, s’il vous plaît de mériter la grâce et le pardon. » Voilà comme il conclut son discours, et il donne peu de chose pour l’œuvre, ou même il ne donne rien du tout, et, s’il ne tenait qu’à lui, l’église tomberait en ruine. Il estime que la meilleure vie consiste à se vêtir d’habits précieux et à manger des morceaux friands. Et lorsqu’un homme s’inquiète ainsi outre mesure des choses mondaines, comment veut-il prier et chanter ? Les bons prêtres sont chaque jour, à chaque heure, occupés diligemment au service du Seigneur, et ils font le bien, ils sont utiles à la sainte Église ; ils savent, par un pieux exemple, conduire les laïques à la bonne porte sur le chemin du salut. Mais je connais aussi les frocards : ils crient et bavardent toujours pour l’apparence, et toujours ils cherchent les riches ; ils savent flatter les gens et n’aiment rien tant que la table. Si l’on convie l’un, l’autre vient aussi, et aux premiers s’en joignent encore deux ou trois. Et, dans le couvent, qui sait bien jaser est élevé en dignité : on le fait lecteur ou custode ou prieur. On laisse les autres de côté. Les plats sont servis de la manière la plus inégale : en effet les uns doivent chanter, officier, la nuit, dans le chœur, visiter les tombeaux ; les autres ont la bonne part et le loisir, et mangent les fins morceaux. Et les légats du pape, les abbés, les prieurs, les prélats, les béguines, les nonnes… c’est là qu’on aurait beaucoup à dire ! Partout la même chanson : « Donnez-moi le vôtre et laissez-moi le mien. » Il s’en trouve peu vraiment, il ne s’en trouve pas sept, qui, selon les règles de leur ordre, mènent une sainte vie. Et voilà comme l’état ecclésiastique est faible et chancelant.
– Oncle, dit le blaireau, je trouve que vous confessez surtout les péchés d’autrui. Qu’est-ce que vous y gagnerez ? Il me semble qu’il suffirait des vôtres. Et dites-moi, mon oncle, ce qui vous pousse à vous inquiéter du clergé, et de ceci et de cela ? Que chacun porte son fardeau, et que chacun dise et fasse voir comme il s’efforce de remplir les devoirs de son état : nul ne doit s’y soustraire, ni vieux, ni jeune, ni dans le monde ni dans le cloître. Mais vous discourez trop sur mille choses diverses, et vous pourriez à la fin m’induire en erreur. Vous savez parfaitement comme va le monde et comme tout est disposé : nul ne serait meilleur curé. Je viendrais, avec les autres ouailles, me confesser chez vous, pour entendre vos leçons, pour apprendre votre sagesse ; car, en vérité, il faut que je l’avoue, la plupart d’entre nous sont grossiers et stupides, et ils en auraient besoin. »
En discourant ainsi, ils s’étaient approchés de la cour du roi.
« Le sort en est jeté, » dit Reineke, en recueillant toute sa force.
Et ils rencontrèrent Martin, le singe, qui venait de se mettre en chemin pour se rendre à Rome. Il salua les deux voyageurs.
« Cher oncle, dit-il au renard, prenez courage. »
Là-dessus il lui fit des questions sur ceci, sur cela, quoique la chose lui fût connue.
« Ah ! que la fortune m’est contraire aujourd’hui ! reprit Reineke. Quelques voleurs m’ont de nouveau accusé ; ce sont tels et tels, entre autres la corneille et le lapin. L’un a perdu sa femme, à l’autre il manque une oreille. Cela ne m’inquiète guère ; si je pouvais seulement parler au roi en personne, tous deux le sentiraient. Mais ce qui me gêne le plus, c’est que je suis encore excommunié du pape. Et le prévôt du chapitre, qui est en crédit chez le roi, a plein pouvoir dans cette affaire. Et je me trouve excommunié pour l’amour d’Ysengrin, qui s’était fait moine un jour, et qui s’est enfui du couvent d’Elkmar, où il a demeuré. Il jurait qu’il ne pouvait pas vivre comme cela ; qu’on le tenait trop serré ; qu’il ne pouvait jeûner longtemps ni prier toujours. Alors je vins à son aide. J’en ai du regret, car il me calomnie maintenant auprès du roi, et cherche sans cesse à me nuire. Dois-je me rendre à Rome ? Mais dans quelle perplexité les miens seront-ils au logis ? Ysengrin ne manquera pas de leur nuire, où qu’il les trouve. Il y a tant de gens encore qui me veulent du mal, et qui s’en prendront aux miens ! Si j’étais relevé de l’excommunication, ma situation serait bien meilleure : je pourrais à mon aise tenter de nouveau la fortune à la cour. »
Martin répondit :
« Je puis vous aider ; cela se rencontre bien : je vais justement à Rome, et je vous y servirai avec adresse. Je ne vous laisserai pas opprimer. Comme secrétaire de l’évêque, je me flatte d’entendre la chose. Je ferai en sorte que l’on cite à Rome directement le prévôt du chapitre ; là je bataillerai contre lui. Laissez, mon oncle, je ferai marcher l’affaire et je saurai la conduire. Je fais exécuter la sentence ; vous obtenez certainement l’absolution ; je vous la rapporte. Vos ennemis n’auront qu’une fausse joie ; ils perdront en même temps leur argent et leur peine. Je connais le train des choses à Rome, et je sais ce qu’on doit faire et ne pas faire. Là M. Simon, mon oncle, est puissant et considéré ; il vient en aide aux bons payeurs. Et Schalkefund, voilà un seigneur ! Et le docteur Greifzu, et Wendemantel, et Losefund !… Ils sont tous mes amis. J’ai envoyé mon argent à l’avance : car, voyez-vous, là-bas, c’est ainsi qu’on se fait le mieux connaître. Ils parlent bien de citer, mais ce n’est que l’argent qu’ils veulent. Et, si tortueuse que soit l’affaire, je la redresse avec de bon argent. Apportez-vous de l’argent, vous trouvez de la faveur ; sitôt qu’il vous manque, les portes se ferment. Restez tranquille au pays, je me charge de votre affaire, je délierai le nœud. Allez sans crainte à la cour ; vous y trouverez Madame Ruckenau, mon épouse. Elle est aimée du roi, notre maître, et de la reine aussi ; elle a l’esprit vif et prompt ; elle sait parler sagement ; elle s’emploie volontiers pour les amis. Vous trouverez là beaucoup de parents. Ce n’est pas toujours un avantage d’avoir raison. Vous trouverez auprès d’elle deux sœurs et mes trois enfants et bien des gens encore de votre famille, prêts à vous servir, comme vous pourrez le souhaiter. Et, si l’on vous refusait justice, vous apprendriez ce que je puis. Que si l’on vous opprime, mandez-le-moi promptement. Je fais lancer l’excommunication sur le pays, sur le roi et tous les hommes, les femmes et les enfants. J’envoie un interdit : on ne pourra plus ni chanter, ni dire la messe, ni baptiser, ni ensevelir personne. Soyez tranquille, mon neveu : le pape est vieux et malade ; il ne s’occupe plus des affaires, on le respecte peu. À sa cour, tout le pouvoir est maintenant dans les mains du cardinal Ohnegenuge, jeune homme actif, ardent, prompt et résolu. Il aime une femme de ma connaissance. Elle lui portera une lettre. Ce qu’elle désire, elle sait parfaitement en venir à bout. Son secrétaire Jean Partey connaît aussi, au plus juste, les monnaies vieilles et nouvelles. Horchenau, son compère, est un courtisan ; Schleifenundwenden est notaire, bachelier in utroque, et, s’il exerce seulement encore une année, il sera accompli dans la pratique. Là se trouvent encore deux juges, qui s’appellent Moneta et Denarius. S’ils condamnent, c’est une chose dite. Voilà comme on pratique à Rome maintes ruses et finesses, dont le pape ne sait rien. Il faut se faire des amis. Par eux on pardonne les péchés et l’on relève les peuples de l’anathème. Reposez-vous là-dessus, mon digne oncle. Le roi sait depuis longtemps que je ne vous laisserai pas tomber. Je viendrai à bout de votre affaire : j’en ai le pouvoir. Il peut d’ailleurs songer que les singes et les renards ont beaucoup de parents, qui sont ses meilleurs conseillers, et cela vous servira certainement, quoi qu’il arrive. »
Reineke répondit :
« Cela me rassure beaucoup. Je vous en témoignerai ma reconnaissance, pourvu que j’en réchappe cette fois. »
Ils prirent congé l’un de l’autre. Reineke, sans autre escorte que Grimbert, le blaireau, se rendit à la cour du roi, où l’on était mal disposé pour lui.

CHANT NEUVIÈME

Reineke était arrivé à la cour ; il songeait à détourner les accusations qui le menaçaient : mais lorsqu’il vit assemblés ses nombreux ennemis, comme tous étaient là, et comme ils demandaient tous qu’on les vengeât et qu’on le punît de mort, le courage lui manqua ; il hésita. Cependant il passa tout droit avec audace au milieu des barons ; Grimbert s’avançait à ses côtés. Ils parvinrent au trône du roi, et Grimbert dit tout bas :
« Ne vous laissez pas intimider, Reineke. Songez que le poltron n’a pas le bonheur en partage ; l’audacieux cherche le danger et y prend plaisir : le danger l’aide à sortir d’embarras. »
Reineke répondit :
« Vous me dites la vérité ; je vous rends mille grâces pour ces précieux encouragements ; si je recouvre la liberté, je saurai les reconnaître. »
Il jeta les yeux autour de lui ; il se trouvait dans l’assemblée beaucoup de ses parents, mais peu de partisans : il avait souvent rendu à la plupart de mauvais services ; même parmi les loutres et les castors, parmi les grands et les petits, il avait exercé sa malice. Cependant il découvrit encore bon nombre d’amis dans la salle du roi.
Reineke s’agenouilla devant le trône et dit avec retenue :
« Dieu, à qui toutes choses sont connues, et qui demeure puissant en éternité, veuille vous garder toujours, mon seigneur et roi ; veuille garder aussi Madame la reine, et puisse-t-il vous donner à tous deux la sagesse et les bonnes pensées, afin que vous reconnaissiez avec discernement le juste et l’injuste ; car il règne aujourd’hui beaucoup de fausseté parmi les hommes ; beaucoup de gens paraissent au dehors ce qu’ils ne sont pas. Oh ! si chacun portait écrit sur le front ce qu’il pense, et si le roi le voyait, on reconnaîtrait que je ne mens pas et que je suis toujours prêt à vous servir. Il est vrai que les méchants m’accusent avec emportement ; ils voudraient me nuire et me ravir votre faveur, comme si j’en étais indigne. Mais je sais quel est, chez mon seigneur et roi, l’austère amour de la justice : nul ne pourrait l’induire à restreindre jamais la voie du droit, et sa volonté subsistera. »
Tout le monde approchait et se pressait ; chacun admirait l’audace de Reineke, chacun désirait l’entendre. Ses crimes étaient connus, comment voulait-il échapper ?
« Reineke, scélérat, dit le roi, pour cette fois, tes paroles effrontées ne te sauveront pas ; elles ne t’aideront pas plus longtemps à déguiser le mensonge et l’imposture : tu es arrivé au terme. Apparemment tu as montré comme tu m’es fidèle, dans ta conduite avec le lapin et la corneille ! Cela serait suffisant : mais tu exerces la trahison en tous lieux ; tes malices sont perfides et soudaines. Elles ne dureront pas plus longtemps : car la mesure est comble. Je ne m’arrêterai pas davantage aux remontrances. »
Reineke se dit à lui-même :
« Que vais-je devenir ? Oh ! si je pouvais seulement regagner ma demeure ! Où trouverai-je un moyen de défense ? Quoi qu’il arrive, il faut aller en avant ; essayons tout. Puissant roi, noble prince, dit-il, en élevant la voix, si vous estimez que j’ai mérité la mort, vous n’avez pas considéré la chose du bon côté. C’est pourquoi je vous prie de vouloir bien d’abord m’entendre. Je vous ai donné autrefois d’utiles conseils ; dans l’adversité, je suis demeuré auprès de vous, quand d’autres s’éloignaient, qui se placent maintenant entre vous et moi pour ma perte, et qui profitent de l’occasion, quand je suis éloigné. Noble sire, quand j’aurai parlé, vous pourrez terminer l’affaire. Si je suis trouvé coupable, assurément je dois en porter la peine, Vous avez peu songé à moi, tandis que j’ai fait, dans le pays, la garde la plus fidèle de nombreuses places et frontières. Pensez-vous que je fusse venu à la cour, si je me sentais coupable de grands ou de petits méfaits ? Je fuirais prudemment votre présence, et j’éviterais mes ennemis. Non certainement, tous les trésors du monde ne m’auraient pas induit à quitter mon château pour venir dans ces lieux. Là j’étais libre et sur mes terres ; mais je n’ai aucune mauvaise action sur la conscience, et c’est pourquoi je suis venu. Comme j’étais à faire la garde, mon oncle est venu m’apporter la nouvelle qu’il fallait me rendre à la cour. J’avais de nouveau réfléchi aux moyens de me soustraire à l’anathème : là-dessus Martin m’a fait beaucoup de promesses, et m’a juré solennellement qu’il me délivrerait de ce fardeau. « J’irai à Rome, m’a-t-il dit, et, dès ce moment, je prends toute l’affaire sur mes épaules. Allez seulement à la cour, vous serez relevé de l’anathème. » Voilà le conseil que Martin m’a donné. Il doit s’y connaître, car l’excellent évêque, Mgr Ohnegrund, l’emploie constamment. Voilà cinq années que Martin le sert dans les affaires juridiques. C’est ainsi que je suis venu, et je trouve plaintes sur plaintes. Le lapin, mauvais sujet, me calomnie ; eh bien, voici Reineke à présent : qu’il se produise devant mes yeux ! C’est chose facile d’accuser les absents, mais il faut entendre la partie adverse avant de juger. Ces imposteurs, sur ma foi, ils ont reçu de moi un bon accueil, la corneille comme le lapin. Avant-hier matin, au point du jour, le lapin vient à moi et me salue poliment. Je venais de m’asseoir devant mon château, et je lisais les prières du matin. Il m’annonça qu’il se rendait à la cour ; alors je lui dis : « Dieu vous accompagne ! » Là-dessus il dit en gémissant : « Oh ! que j’ai faim ! Que je suis fatigué ! » Je lui dis avec amitié : « Désirez-vous manger ? – J’accepte avec reconnaissance, » répliqua-t-iI. Moi, je dis : « Je vous donnerai de quoi volontiers. » Je l’emmenai donc, et lui servis avec empressement des cerises et du beurre. J’ai coutume de ne pas manger de viande le mercredi. Il se rassasia de pain, de beurre et de fruits. Mais mon fils, le plus jeune, s’approcha de la table, pour voir s’il n’était rien resté, car les enfants ont toujours bon appétit. Et le petit garçon happa quelque chose. Le lapin lui porta vivement un coup sur le museau : les dents et les lèvres en saignèrent. Reinhart, mon autre fils, vit la chose et prit le drôle à la gorge ; il joua son jeu et vengea son frère. Voilà ce qui s’est passé, ni plus ni moins. Je ne tardai guère, j’accourus, je punis les enfants, et je séparai, non sans peine, les combattants. S’il y a gagné quelque chose, qu’il le garde, car il avait mérité plus encore, et les jeunes lurons, si j’avais eu de mauvais desseins, l’auraient eu bientôt dépêché. Et voilà comme il me remercie ! Je lui ai, dit-il, arraché une oreille ? Il a joui de l’honneur, et il en a gardé une marque. Ensuite la corneille est venue chez moi, et s’est plainte d’avoir perdu sa femme, qui s’était, par malheur, étouffée en mangeant ; elle avait avalé un assez gros poisson avec toutes les arêtes. Où cela est arrivé, le mari le sait mieux que personne. Maintenant il vient dire que je l’ai tuée. Il l’a fait peut-être lui-même, et, si on lui faisait subir un interrogatoire sérieux, si j’osais le faire, peut-être parlerait-il autrement. Mais ils volent dans les airs plus haut que tous les sauts ne peuvent atteindre. Si désormais quelqu’un veut m’accuser de pareils délits, qu’il le fasse avec d’honnêtes et valables témoins. C’est ainsi qu’il convient d’agir avec les gens d’honneur. Jusque-là je devrais attendre. Que s’il ne s’en trouve point, il est un autre moyen. Me voici prêt à combattre. Que l’on fixe le jour et le lieu. Qu’il se présente un digne adversaire, mon égal en naissance ; que chacun soutienne son droit, et, qui en aura l’honneur, que l’honneur lui demeure. Telle fut la loi de tout temps, et je ne demande pas mieux. »
Tout le monde écoutait, et l’on était grandement surpris des paroles que Reineke avait si fièrement prononcées. La corneille et le lapin s’effrayèrent tous deux ; ils vidèrent la cour, et n’osèrent plus dire le moindre mot. Ils s’en allèrent, se disant l’un à l’autre :
« Il serait imprudent de plaider contre lui davantage. Nous aurions beau tout essayer, nous n’en viendrions pas à bout. Qui l’a vu ? Nous étions tout seuls avec le drôle : qui pourrait témoigner ? À la fin le dommage sera pour nous. Que le bourreau l’accommode pour tous ses crimes, et le récompense comme il l’a mérité ! Il veut combattre avec nous ? Nous pourrions nous en mal trouver. Non, ma foi, nous aimons mieux le laisser quitte, car nous le savons agile et menteur et méchant et perfide. En vérité, cinq, tels que nous, seraient trop peu contre lui : il nous faudrait le payer cher. »
Cependant Ysengrin et Brun étaient fort mécontents.
Ils virent avec déplaisir la corneille et le lapin se glisser hors de la cour. Le roi dit alors :
« Quelqu’un a-t-il encore des plaintes à faire ? qu’il vienne ; qu’on l’entende. Hier beaucoup de gens faisaient des menaces ; voici l’inculpé : où sont-ils ? »
Reineke prit la parole :
« Ainsi vont les choses ; on accuse, on inculpe celui-ci et celui-là ; mais, qu’il se présente, on reste chez soi. Le lapin et la corneille, méchants traîtres, auraient bien voulu m’infliger honte et dommage et châtiment : ils me demandent pardon, et je pardonne, puisque, à mon arrivée, ils rentrent en eux-mêmes et se retirent. Les ai-je assez confondus ! Vous voyez comme il est dangereux d’écouter les méchants calomniateurs de serviteurs éloignés. Ils faussent la justice et sont odieux aux honnêtes gens. C’est pour les autres seulement que je m’afflige : pour moi je m’en soucie peu.
– Écoute-moi, méchant traître, reprit le roi, qui t’a poussé, dis-moi, à tuer indignement Lampe, le fidèle, qui avait coutume de porter mes lettres ? N’avais-je pas pardonné tout le mal que tu avais jamais fait ? Tu as reçu de moi le sac de voyage et le bourdon ; tu étais équipé ; tu devais te rendre à Rome et passer la mer ; je t’avais tout accordé ; j’espérais ton amendement, et je vois, pour début, que tu as égorgé Lampe ! Bellin t’a servi de messager ; il a apporté la tête dans le sac, et a déclaré publiquement qu’il m’apportait des lettres que vous aviez méditées et écrites ensemble ; qu’il en avait conseillé la meilleure part. Et dans le sac s’est trouvée la tête, ni plus ni moins. C’est pour m’insulter que vous l’avez fait. J’ai retenu aussitôt Bellin pour gage ; il a perdu la vie : il s’agit de la tienne, maintenant. »
Reineke s’écria :
« Qu’entends-je ? Lampe est-il mort ? Et ne trouverai-je plus Bellin ? Que vais-je devenir ? Oh ! fussé-je mort ! Hélas ! avec eux je perds un trésor, un trésor de grand prix. Car je vous envoyais par eux des joyaux aussi beaux qu’on puisse en trouver sur la terre. Qui pouvait croire que le bélier tuerait Lampe et vous déroberait les trésors ? Qu’on se tienne sur ses gardes, où nul ne soupçonne la ruse et le danger ! »
Le roi, courroucé, n’entendit pas jusqu’au bout ce que disait Reineke ; il se retira dans son appartement, et il n’avait pas clairement saisi le discours du renard. Il songeait à le punir de mort. Il trouva justement la reine dans sa chambre avec Madame Ruckenau. La guenon était singulièrement chérie du roi et de la reine. Cela devait profiter à Reineke. Elle était instruite et sage et savait parler. Où qu’elle parût, chacun portait les yeux sur elle et l’honorait infiniment. Elle remarqua le chagrin du roi et dit avec réserve :

« Monseigneur, quand vous avez quelquefois prêté l’oreille à mes prières, vous ne vous en êtes jamais repenti, et vous m’avez pardonné mon audace, de vous faire entendre, quand vous étiez en colère, un mot d’avis tranquille. Cette fois encore, soyez disposé à m’entendre, car enfin il s’agit de ma propre race ! Qui peut renier les siens ? Quel qu’il soit, Reineke est mon parent, et, à ce qu’il me semble de sa conduite, je dois le déclarer franchement, puisqu’il se présente en justice, j’ai la meilleure opinion de sa cause. Son père, qui avait la faveur du vôtre, eût beaucoup à souffrir aussi des mauvaises langues et des fausses accusations ; mais il les confondait toujours. Aussitôt qu’on examinait l’affaire avec plus de soin, elle se trouvait claire. Les malins envieux cherchaient même à faire passer ses services pour des crimes. Comme cela, il se maintint sans cesse à la cour en plus grand crédit que Brun et Ysengrin ne s’y trouvent maintenant : car, pour eux, il serait à souhaiter qu’ils fussent capables aussi d’écarter tous les griefs qu’on élève souvent contre eux. Mais ils entendent peu de chose au droit : c’est ce que prouvent leurs conseils, c’est ce que prouve leur vie. »
Le roi répondit :
« Comment pouvez-vous être surprise que je sois irrité contre Reineke, le voleur, qui m’a tué Lampe naguère, qui m’a séduit Bellin, et qui, plus effronté que jamais, nie tout, et ose se vanter d’être un loyal et fidèle serviteur ; tandis que toutes les plaintes s’élèvent à la fois et ne prouvent que trop clairement qu’il viole mon sauf-conduit, et qu’il désole le pays et mes fidèles par ses vols, ses meurtres et ses brigandages ? Non, je ne le souffrirai pas plus longtemps. »
La guenon répondit :
« Assurément il n’est pas donné à beaucoup de gens d’agir sagement et de délibérer sagement dans toutes les occasions, et celui à qui cela réussit gagne la confiance : mais les envieux cherchent à lui faire tort en secret, et, s’ils deviennent nombreux, ils se produisent publiquement. Ainsi est-il arrivé plusieurs fois à Reineke : néanmoins ils ne vous feront pas oublier les sages conseils qu’il vous a donnés dans des cas où tout le monde restait muet. Vous le savez encore (l’aventure est récente), l’homme et le serpent se présentèrent devant vous, et nul ne savait démêler l’affaire : Reineke lui seul en trouva le moyen, et, ce jour-là, il fut loué de vous plus que tous les autres. »
Le roi répondit, après un moment de réflexion :
« Je me rappelle bien l’affaire, mais j’en ai oublié l’enchaînement : elle était embrouillée, il me semble. Si vous la savez encore, faites que je l’entende : cela me fera plaisir.
– Si monseigneur l’ordonne, répondit-elle, il sera satisfait. Voilà juste deux ans qu’un serpent vint faire devant vous, monseigneur, des plaintes violentes. Un paysan, un homme, que deux jugements avaient condamné, ne voulait pas se soumettre à la justice. Le reptile appela le paysan devant votre tribunal et rapporta le fait avec un flot de paroles véhémentes.
« Le serpent avait voulu se glisser par un trou dans la haie, et il s’était pris dans un lacet posé devant l’ouverture ; le lacet se serrait plus fort et le serpent y laissait la vie, quand, par bonheur, un passant survint, et le serpent cria avec angoisse :
« Aie pitié de moi et me délivre ! Laisse-toi fléchir ! »
L’homme répondit :
« Je veux te délivrer, car ta détresse me fait pitié : mais tu commenceras par me jurer que tu ne me feras point de mal. »
« Le serpent se déclara prêt ; il fit le serment le plus sacré, qu’il ne lèserait en aucune manière son libérateur, et ainsi l’homme le dégagea.
« Ils cheminèrent ensemble quelque temps, et le serpent sentit une faim cruelle ; il se jeta sur l’homme et voulait l’égorger, le dévorer. Le malheureux lui échappa avec frayeur, avec peine. « Voilà mon salaire ? Voilà ce que j’ai mérité ? s’écria-t-il, et n’as-tu pas fait le serment le plus sacré ? » Le serpent répondit : « La faim me tourmente ; je suis sans ressource, nécessité n’a point de loi : cela me justifie. » L’homme répliqua : « Épargne-moi seulement jusqu’à ce que nous trouvions des gens qui nous jugent avec impartialité. » Le reptile répondit : « Je prendrai patience jusque-là. »
« Ils passèrent plus loin et ils trouvèrent, de l’autre côté de l’eau, Pfluckebeutel, le corbeau, avec son fis, qu’on appelle Quackeler. Le serpent les appela et leur dit : « Venez et écoutez. » Le corbeau écouta l’histoire avec attention, et il jugea aussitôt qu’il fallait manger l’homme. Il espérait en attraper lui-même un morceau. Le serpent fut très joyeux. « À présent, j’ai gagné. Personne ne peut me blâmer. – Non, reprit l’homme, je n’ai pas complètement perdu. Un brigand devrait-il condamner à mort ! et un seul juge devrait-il statuer ? Je demande une nouvelle information, selon les voies du droit. Portons la cause devant quatre, devant dix juges, et entendons-les.
– Allons, » dit le serpent. Ils allèrent et ils rencontrèrent le loup et l’ours, et ils se réunirent tous ensemble. L’homme craignait tout maintenant, car il était dangereux de se trouver parmi les cinq personnages, parmi de tels compagnons. Il se voyait entouré du serpent, du loup, de l’ours et des corbeaux. Il était fort inquiet, car le loup et l’ours s’accordèrent bientôt à prononcer l’arrêt en ces termes : « Le serpent pouvait tuer l’homme ; la faim cruelle ne connaissait point de loi ; la nécessité déliait du serment. » Le voyageur fut saisi de souci et d’angoisse, car tous ensemble ils voulaient sa vie. Alors le serpent s’élança avec un sifflement furieux ; il vomit son venin contre l’homme, qui s’écarta avec frayeur. « Tu commets, s’écria-t-il, une grande injustice. Qui t’a fait maître de ma vie ? » Le reptile répondit : « Tu as entendu : les juges ont prononcé deux fois, et deux fois ils t’ont condamné ! » L’homme répliqua : « Ils volent et pillent eux-mêmes. Je les récuse ; allons au roi. Qu’il prononce, je me soumettrai. Si je perds, j’aurai encore assez de mal, toutefois je le supporterai. » Le loup et l’ours dirent avec moquerie : « Tu peux essayer, mais le serpent gagnera ; il ne peut demander mieux. » Ils pensaient que tous les seigneurs de la cour prononceraient comme eux. Ils se présentèrent donc hardiment ; ils amenèrent le voyageur, et devant vous parurent le serpent, le loup, l’ours et les corbeaux. Même le loup se présenta, lui troisième, avec deux enfants : l’un se nommait Eitelbauch et l’autre Nimmersatt. Ils lui donnaient tous deux beaucoup à faire ; ils étaient venus pour manger leur part. Car ils sont toujours affamés ; ils hurlaient alors, en votre présence, avec une insupportable grossièreté : vous interdîtes la cour à ces deux manants.
« L’homme invoqua votre grâce ; il rapporta comme le serpent méditait sa mort ; comme il avait oublié complètement le bienfait ; comme il se parjurait. L’homme implorait le salut. Le serpent convint du fait : « La force toute-puissante de la faim me fait violence ; elle ne connaît point de loi. » Monseigneur, vous fûtes embarrassé. La chose vous parut fort délicate et difficile à décider juridiquement. Il vous semblait dur de condamner ce bonhomme, qui s’était montré secourable. D’un autre côté, vous preniez en considération la faim outrageuse. Vous appelâtes vos conseillers. Par malheur, les avis de la plupart étaient défavorables à l’homme ; car ils désiraient le repas, et ils songeaient à aider le serpent. Vous envoyâtes des messagers à Reineke. Tous les autres tenaient force discours, et ne pouvaient décider la chose convenablement. Reineke vint, il entendit l’exposé du fait, vous le laissâtes maître de prononcer : ce qu’il statuerait ferait loi. Reineke dit, après mûre réflexion : « Je trouve, avant tout, nécessaire de visiter le lieu. Quand j’aurai vu le serpent lié comme l’a trouvé le paysan, le jugement sera facile à prononcer. » On lia de nouveau le serpent à la même place, de la même façon que le paysan l’avait trouvé dans la haie. Là-dessus Reineke dit : « Les voilà tous les deux replacés dans leur première situation ; aucun n’a gagné ni perdu. Maintenant le droit me semble s’expliquer de lui-même. Si cela plaît à l’homme, il délivrera encore une fois le serpent du lacet ; sinon, il le laissera pendu. Il peut librement, avec honneur, passer son chemin et aller à ses affaires. Le serpent s’étant montré infidèle après avoir reçu le bienfait, il est juste que l’homme puisse choisir. Tel est, à mon avis, le véritable esprit de la loi. Qui l’entendra mieux, nous le fasse connaître. » La sentence vous plut alors, comme à vos conseillers. Reineke fut loué. Le paysan vous remercia, et chacun vanta la sagesse de Reineke ; la reine elle-même lui donna des louanges. Il se dit alors bien des choses : Ysengrin et Brun seraient de meilleur emploi dans la guerre ; on les craignait tous deux au loin ; ils se trouvaient volontiers aux lieux où l’on dévorait tout. Ils étaient l’un et l’autre grands et forts et hardis, on ne pouvait le nier ; mais, dans le conseil, ils manquaient souvent de la sagesse nécessaire, étant trop accoutumés à se prévaloir de leur force. Cependant que l’on entre en campagne, et qu’on se mette à l’œuvre, cela marche fort mal. Il ne se peut voir personne de plus courageux au logis ; dehors ils se tiennent volontiers en embuscade. Qu’une fois on en vienne aux coups, on les reçoit aussi bien que les autres. Les ours et les loups dévastent le pays ; ils s’inquiètent peu de savoir à qui appartient la maison que la flamme dévore ; leur coutume ordinaire est de se chauffer au brasier, et ils n’ont pitié de personne, pourvu que leur gorge s’emplisse. On avale les œufs ; on laisse la coque aux misérables, et l’on croit toujours partager loyalement. Reineke, le renard, au contraire, et sa race ont de la sagesse et des ressources, et, s’il a fait quelque faute, monseigneur, il n’est pas de pierre. Mais vous n’aurez jamais un meilleur conseiller que lui. C’est pourquoi, pardonnez-lui, je vous en prie. »
Le roi répondit :
« Je veux y réfléchir. Le jugement fut prononcé comme vous dites : le serpent fut puni. N’importe, Reineke n’en est pas moins un fripon achevé. Comment pourrait-il se corriger ? Si l’on fait un accord avec lui, on finit par être trompé ; il se tire d’affaire avec une adresse que nul ne saurait égaler. L’ours et le loup et le chat, le lapin et la corneille, ne sont pas assez alertes pour lui ; il leur fait souffrir honte et dommage. À l’un, il attrape une oreille, à l’autre un œil ; il ôte la vie au troisième. En vérité, je ne sais comment vous pouvez parler en faveur de ce méchant et défendre sa cause.
– Monseigneur, répondit la guenon, je ne puis le dissimuler, sa race est noble et grande ; vous devez y songer. »
Alors le roi se leva et sortit : tous les courtisans étaient réunis et l’attendaient. Il vit dans l’assemblée beaucoup des plus proches parents de Reineke : ils étaient venus pour défendre leur cousin. Il serait difficile de les nommer. Il considéra cette grande famille, et, de l’autre côté, les ennemis de Reineke : la cour semblait se partager. Le roi prit la parole :
« Écoute-moi, Reineke : peux-tu te justifier du crime d’avoir mis à mort, avec le secours de Bellin, mon fidèle Lampe, et d’avoir, vous deux, téméraires, logé sa tête dans le sac, comme on ferait des lettres ? C’est pour m’insulter que vous l’avez fait. J’ai déjà puni l’un des coupables ; Bellin a expié son crime : attends-toi au même sort.
– Malheur à moi ! s’écria Reineke. Je voudrais être mort ! Veuillez m’entendre, et qu’on me traite selon mes mérites. Si je suis coupable, faites-moi mourir sur l’heure : je ne serai d’ailleurs jamais délivré d’angoisse et de souci ; c’en est fait, je suis perdu, car le traître Bellin m’a dérobé les plus grands trésors ; jamais créature mortelle n’en a vu de semblables. Hélas ! ils ont coûté la vie à Lampe. Je les avais confiés à tous deux, et voilà que Bellin a volé ces trésors ! Si pourtant l’on pouvait en découvrir la trace ! Mais je crains que personne ne les retrouve, et qu’ils ne soient perdus pour toujours. »
Là-dessus la guenon prit la parole.
« Pourquoi désespérer ? Pourvu qu’ils soient sur la terre, il reste encore de l’espérance. Tôt ou tard nous irons, et nous interrogerons diligemment laïques et clercs. Cependant faites-nous le détail de ces trésors. »
Reineke répondit :
« Ils étaient si précieux que nous ne les retrouverons jamais. Qui les tient, les garde assurément. Combien Madame Ermeline n’en sera-t-elle pas désolée ! Elle me le reprochera sans cesse ; car elle me déconseillait de remettre à ces deux personnages les précieux joyaux. Maintenant on forge des mensonges sur mon compte, et l’on vient m’accuser : mais je soutiendrai mon droit, j’attendrai mon arrêt, et, si je suis libéré, j’irai courir les pays et les royaumes ; je chercherai à recouvrer les trésors, dussé-je y perdre la vie. »

CHANT DIXIÈME

Ô mon roi, dit ensuite l’artificieux orateur, souffrez, très noble prince, que j’énumère, en présence de mes amis, tout ce qui vous était destiné par moi d’objets précieux. Bien que vous ne les ayez pas reçus, mon intention était cependant louable.
– Parle, répondit le roi, et parle en peu de mots.
– Le bonheur et l’honneur sont perdus. Vous saurez tout, dit tristement Reineke. Le premier de ces précieux joyaux était une bague. Je la donnai à Bellin, qui devait la remettre au roi. Cet anneau était agencé d’une merveilleuse manière ; il était d’or fin, et digne de briller dans le trésor de mon prince. Sur la face intérieure, qui est tournée vers le doigt, étaient gravées et fondues des lettres : c’étaient trois mots hébreux d’une signification toute particulière. Personne, dans nos contrées, n’expliquait aisément ces caractères ; maître Abryon de Trèves pouvait seul les lire. C’est un savant juif, qui sait toutes les langues, tous les dialectes qui sont parlés depuis le Poitou jusqu’à Lunebourg, et le juif a une connaissance particulière des herbes et des pierres.
« Quand je lui montrai l’anneau, il dit : « Des choses précieuses sont cachées là-dedans. Ces trois mots gravés furent rapportés du paradis par Seth, le pieux, lorsqu’il cherchait l’huile de miséricorde ; et qui porte à son doigt cet anneau est à l’abri de tous dangers : ni le tonnerre, ni l’éclair, ni la magie ne peuvent l’atteindre. » Le maître disait encore avoir lu que celui qui gardait la bague à son doigt ne pouvait geler par un froid rigoureux, et passerait certainement une tranquille vieillesse. Il se trouvait en dehors une pierre précieuse, une brillante escarboucle, qui éclairait la nuit, et faisait voir distinctement les objets. Cette pierre avait beaucoup de vertus : elle guérissait les malades ; qui la touchait se sentait libre de toute infirmité, de toute souffrance : la mort seule ne se laissait pas vaincre. Le maître signala encore d’admirables vertus de la pierre ; le possesseur voyage heureusement par tout pays ; ni l’eau, ni le feu ne lui peuvent nuire ; on ne saurait ni le prendre ni le surprendre, et il échappe à toutes les attaques de l’ennemi ; s’il regarde la pierre étant à jeun, il pourra triompher de cent adversaires, de plus encore ; la vertu de la pierre enlève leurs effets au poison et à tous les sucs malfaisants ; elle extirpe également la haine, et, si quelqu’un n’aime pas le possesseur, il se sentira bientôt changé. Qui pourrait énumérer toutes les vertus de cette pierre, que j’avais trouvée dans le trésor de mon père et que mon dessein était d’envoyer au roi ? Car je n’étais pas digne d’un si précieux anneau ; je le savais très bien. Il devait appartenir, me disais-je, à celui-là seul qui sera toujours le plus noble de tous. Notre bonheur et notre fortune ne reposent que sur lui, et j’espérais préserver sa vie de tout mal.
« Le bélier Bellin devait aussi offrir à la reine un peigne et un miroir, afin qu’elle se souvînt de moi. Je les avais un jour tirés, pour mon plaisir, du trésor de mon père. Il n’était point sur la terre de plus bel ouvrage. Oh ! que de fois ma femme les a-t-elle essayés et comme elle désirait les posséder ! Elle ne demandait rien de plus parmi tous les biens du monde, et c’était entre nous un sujet de dispute. Elle n’a jamais pu m’ébranler. J’envoyai, croyant bien faire, le peigne et le miroir à ma très honorée dame, la reine, qui m’a toujours comblé de biens et m’a préservé de malheur. Souvent elle a dit pour moi un petit mot favorable ; elle est noble, de haute naissance, parée de vertu, et son antique origine se manifeste en œuvres et en paroles. Elle était digne du peigne et du miroir. Hélas ! elle ne les a pas vus de ses yeux ; ils sont à jamais perdus.
« Parlons du peigne maintenant. L’artiste avait pris, pour le fabriquer, de l’os de panthère, débris de ce noble animal qui séjourne entre l’Inde et le paradis. Toutes les couleurs ornent sa fourrure, et de doux parfums se répandent partout où il s’avance. C’est pourquoi les animaux suivent si volontiers sa trace par tous les chemins ; car ils sont guéris par cette odeur ; ils le sentent et le déclarent tous. De ces ossements, le beau peigne était fabriqué avec beaucoup de travail : clair comme l’argent et d’une blancheur, d’une pureté inexprimable ; ce peigne avait une odeur plus douce que l’œillet et la cannelle. Quand l’animal vient à mourir, l’odeur passe dans tous les os, y demeure fixement et les empêche de se corrompre. Elle dissipe tous les miasmes et tous les poisons. On voyait en relief sur le dos du peigne les plus admirables figures, entrelacées avec d’élégants rameaux d’or, mêlés d’outremer et de corail. Dans le milieu était représentée artistement l’histoire de Pâris, le Troyen, qui, étant assis un jour près d’une fontaine, vit devant ses yeux trois femmes divines : on les nommait Junon, Pallas et Vénus. Elles commencèrent par disputer longtemps : car chacune voulait posséder la pomme, qui jusqu’alors leur avait appartenu en commun. Enfin elles convinrent que Pâris donnerait la pomme d’or à la plus belle : elle seule la posséderait. Le jeune homme les considérait avec une grande attention. Junon lui dit : « Si j’obtiens la pomme, si tu me déclares la plus belle, tu seras le plus riche des hommes. » Pallas dit à son tour : « Songes-y bien, donne-moi la pomme, et tu seras l’homme le plus puissant de la terre ; tout le monde te craindra ; ton nom sera proclamé par les amis et les ennemis. » Vénus prit la parole : « Que sert la puissance ? Que servent les trésors ? Le roi Priam n’est-il pas ton père ? Tes frères, Hector et les autres, ne sont-ils pas riches et puissants dans le pays ? Troie n’est-elle pas défendue par son armée, et n’avez-vous pas subjugué le pays d’alentour et les peuples lointains ? Si tu me déclares la plus belle, et, si tu m’adjuges la pomme, le plus magnifique trésor de la terre fera ton bonheur : ce trésor est une femme excellente, la plus belle de toutes, vertueuse, noble et sage. Qui pourrait la louer dignement ? Donne-moi la pomme, tu posséderas le trésor des trésors, l’épouse du roi grec, je veux dire Hélène, la belle. » Et il lui donna la pomme et la déclara la plus belle des trois. Elle l’aida en récompense à ravir la reine admirable, l’épouse de Ménélas : elle devint la sienne dans Troie. On voyait cette histoire en relief au milieu du champ, et, alentour, des écussons, avec des inscriptions ingénieuses. Chacun n’avait qu’à lire et il était au fait de la fable. Écoutez maintenant ce que j’ai à vous dire du miroir, où la place du verre était occupée par un béryl d’un grand éclat et d’une grande beauté. Tout s’y reflétait, la chose se fût-elle passée à des lieues de distance, et de jour ou de nuit. Et si quelqu’un avait un défaut à la figure, quel qu’il fût, une tache dans l’œil, il n’avait qu’à se regarder dans le miroir : à l’instant même disparaissaient tous ses défauts, toutes ses difformités étrangères. Est-ce merveille que je sois affligé d’avoir perdu ce miroir ? On avait pris pour le cadre un bois précieux, qu’on appelle Sethim, bois compacte et brillant, Nul insecte ne l’attaque : aussi est-il, on le comprend, beaucoup plus estimé que l’or : la seule ébène en approche. Avec ce bois, un artiste excellent fabriqua un jour, sous le roi Krompardès, un cheval doué d’une merveilleuse puissance. Il ne fallait qu’une heure, une heure sans plus, au cavalier pour faire cent milles. Je ne saurais maintenant conter à fond la chose, car il ne se vit jamais pareil cheval, depuis que le monde existe. Le cadre, dans toute sa largeur, d’un pied et demi, était orné d’élégantes ciselures, et, sous chaque figure, l’explication était inscrite en lettres d’or. Je vous conterai les histoires en peu de mots. La première était celle du cheval jaloux. Il voulut disputer avec un cerf le prix de la course ; mais il se vit dépassé, et il en eut un violent dépit. Il courut s’adresser à un berger et lui dit : « Tu feras une bonne prise, si tu veux me croire. Monte sur mon dos, je te porterai. Un cerf vient de se cacher dans la forêt : tu peux en faire ta proie. Tu vendras à grand prix la chair, la peau et le bois. Monte sur mon dos : nous le poursuivrons. – J’essayerai volontiers, » dit le berger, et il se mit à cheval : ils coururent. Ils découvrirent bientôt le cerf : ils suivirent sa trace vivement, et lui donnèrent la chasse. Il avait de l’avance ; le cheval n’en pouvait plus ; il dit à l’homme : « Descends un peu, je suis fatigué, j’ai besoin de repos. – Non vraiment, répliqua l’homme : tu m’obéiras, tu sentiras mes éperons. C’est toi-même qui m’as enseigné cette allure. » Et voilà comme le cavalier le dompta. C’est ainsi qu’il s’attire beaucoup de mal pour sa récompense, celui qui, pour nuire aux autres, s’impose à lui-même peine et tourment.

« Je vous dirai encore ce qui était sculpté sur le miroir. On voyait comme un âne et un chien étaient ensemble au service d’un riche. Le chien était naturellement le favori. Il prenait place à la table du maître, et mangeait avec lui chair et poisson ; même il reposait aussi sur les genoux du maître. L’âne Baudouin voyait le bonheur du chien, et il en devint triste en son cœur. Il se dit à part lui : « À quoi pense notre maître de faire tant de caresses à ce paresseux animal ? Le chien saute sur lui et lui lèche la barbe… Et moi, il faut que je travaille, et que je porte les sacs péniblement. Qu’il essaye une fois de faire avec cinq chiens, même avec dix, autant d’ouvrage en une année que j’en fais en un mois ! Et pourtant on lui sert les meilleurs morceaux, tandis qu’on me nourrit de paille ; on me laisse couché sur la terre dure ; et, en quelque lieu qu’on me pousse ou qu’on me monte, on se moque de moi. Je ne veux et je ne puis le souffrir plus longtemps ; je veux gagner aussi la faveur du maître. » Comme il parlait ainsi, le maître vint justement à passer. L’âne leva la queue, et se jeta sur l’homme en bondissant ; il criait et chantait et brayait de toute sa force ; il lui lécha la barbe, et voulut, à la manière du chien, se coller contre ses joues, et lui fit quelques bosses. Le maître, effrayé, s’écarta en criant : « Prenez-moi cet âne, et qu’on l’assomme. » Les valets accoururent, et les coups de bâton commencèrent à pleuvoir. On le chassa dans l’écurie, où il resta un âne. Il y en a beaucoup encore de son espèce, qui envient aux autres leur prospérité, et qui ne s’en trouvent pas mieux. Mais que l’un d’eux parvienne une fois à la richesse, cela va aussi bien que si le cochon mangeait la soupe avec la cuiller ; pas beaucoup mieux du moins. Que l’âne porte les sacs, qu’il couche sur la paille et se nourrisse de chardons. Si l’on veut le traiter autrement, il n’en reste pas moins ce qu’il était auparavant. Quand un âne parvient à l’empire, cela produit peu de bien. Ces gens cherchent leur avantage, mais ont-ils d’autre souci ? Il faut, mon roi, vous conter le reste : ne vous lassez pas de m’entendre. Sur le cadre du miroir se trouvait encore artistement ciselé et clairement représenté, comme mon père avait fait autrefois alliance avec Hinze, pour courir les aventures, et comme ils s’étaient juré tous deux solennellement de tenir ferme ensemble avec courage dans tous les dangers, et de partager chaque proie. Lorsqu’ils se furent mis en campagne, ils aperçurent, non loin de la route, des chasseurs et des chiens. Alors Hinze, le chat, se prit à dire : « Un bon expédient viendrait à propos, ce me semble. » Mon vieux répliqua : « Oui, le cas semble étrange, mais j’ai mon sac plein de bons expédients, et nous songerons à notre serment ; nous tiendrons ferme ensemble avec vaillance ; c’est toujours l’essentiel. » Hinze répliqua : « Quoi qu’il arrive, je sais toujours un moyen, et je vais l’employer. » Puis il s’élança lestement sur un arbre pour se sauver de la fureur des chiens, et voilà comme il laissa son oncle. Mon père était là dans l’angoisse ; les chasseurs arrivèrent ; Hinze lui dit : « Eh bien, mon oncle, comment cela va-t-il ? Ouvrez donc le sac ! S’il est plein d’expédients, faites-en usage à cette heure : le moment est venu. » Les chasseurs sonnèrent du cor, et s’appelèrent l’un l’autre. Mon père courut, les chiens coururent ; ils le suivirent en aboyant. Il suait d’angoisse et laissait échapper ses fumées en abondance. Il se trouva le plus léger, et il se déroba aux ennemis. Vous l’avez entendu, il fut trahi d’une manière infâme par son plus proche parent, auquel il s’était fié plus qu’à tout autre. Il y allait pour lui de la vie ; car les chiens étaient agiles, et, s’il ne s’était pas souvenu, en courant, d’une caverne, c’en était fait de lui. Il se glissa dedans, et les ennemis le perdirent. Il en est beaucoup encore de ces drôles, tels que Hinze se montra cette fois à mon père. Comment le pourrais-je aimer et honorer ? Je lui ai pardonné à demi, il est vrai, cependant il en reste encore quelque chose. Tout cela était ciselé sur le miroir, en images et en paroles.
« On y voyait encore une malice particulière du loup, et comme il est disposé à reconnaître le bien qu’il a reçu. Il trouva dans un pâturage un cheval, dont il ne restait plus que les os. Mais il avait grand’faim ; il les rongea gloutonnement, et un os pointu se plaça en travers de sa gorge. Le voilà dans l’angoisse ; son cas était fâcheux. Il envoya messagers sur messagers, pour appeler les médecins ; nul ne pouvait le secourir, bien qu’il promît à chacun une grande récompense. Enfin la grue se présenta, la barrette rouge sur la tête. Le malade la supplia : « Docteur, tirez-moi vite de ce péril ; je vous donne, si vous retirez l’os, tout ce que vous demanderez. » La grue, se fiant à ses paroles, introduisit son bec et sa tête dans le gosier du loup et retira l’os. « Malheur à moi, hurla le loup, tu me blesses ! Quelle douleur ! Que cela ne t’arrive plus ! Pour aujourd’hui, je te pardonne. D’un autre que toi, je ne l’aurais pas souffert patiemment. – Réjouissez-vous, repartit la grue, vous êtes guéri. Donnez-moi la récompense : je l’ai méritée, je vous ai secouru. Entendez-vous la folle ? dit le loup. J’ai le mal, elle demande la récompense ; elle oublie la grâce que je viens de lui faire ! N’ai-je pas laissé échapper sans dommage son bec et sa tête, que j’ai sentis dans ma gueule ? La friponne ne m’a-t-elle pas blessé ?

S’il est question de récompense, c’est moi-même, en vérité, qui pourrais d’abord en demander une. » C’est ainsi que les drôles ont coutume d’en user avec leurs serviteurs. Ces histoires, et bien d’autres, artistement sculptées, ornaient le cadre du miroir, ainsi que maint ornement gravé, mainte inscription en lettres d’or. Je ne me jugeais pas digne de ce précieux joyau ; je suis trop chétif : aussi je l’envoyais à Madame la reine. Je voulais lui témoigner par là, comme à son époux, mes sentiments respectueux. Mes enfants, les gentils garçons, s’affligèrent fort quand je livrai le miroir : ils avaient coutume de sauter et jouer devant la glace ; ils s’y regardaient volontiers ; ils regardaient leurs petites queues pendantes et riaient à leur petit museau. Hélas ! je ne m’attendais pas à la mort de l’honnête Lampe, quand je recommandai solennellement, à lui et à Bellin, sur leur parole et leur bonne foi, ces trésors ; je les tenais tous deux pour d’honnêtes gens ; je ne croyais pas avoir jamais eu de meilleurs amis. Que maudit soit le meurtrier ! Il faut que je sache qui peut cacher ces objets précieux. Aucun meurtrier ne reste caché. Quelqu’un dans cette assemblée peut-être saurait dire où les trésors sont restés et comment Lampe a été mis à mort.
« Mon gracieux seigneur, il se présente chaque jour devant vous tant d’affaires importantes, que vous ne pouvez tout vous rappeler ; mais peut-être vous souvient-il encore du service signalé que mon père rendit au vôtre à cette place. Votre père était malade : le mien lui sauva la vie. Et pourtant vous dites que ni moi ni mon père ne vous avons jamais fait aucun bien. Veuillez m’entendre jusqu’au bout. Soit dit avec votre permission, mon père vivait à la cour du vôtre en grande considération et dignité, comme habile médecin. Il savait observer avec discernement l’eau du malade ; il aidait à la nature ; si les yeux, si les nobles membres du sire éprouvaient quelque infirmité, il savait les guérir ; il connaissait les sels émétiques ; il s’entendait bien aussi à soigner les dents, et savait extraire, en se jouant, celles qui faisaient mal. Je me doute bien que vous l’avez oublié ; ce n’est pas merveille : vous n’aviez que trois ans. Dans ce temps-là, votre père se mit au lit, durant l’hiver, avec de grandes douleurs. Il fallait le lever et le porter. Il fit appeler tous les médecins d’ici à Rome, et tous l’abandonnèrent. Enfin il manda mon vieux père, qui se fit rendre compte du cas et observa la dangereuse maladie. Mon père en fut très affligé. « Monseigneur, dit-il, que je donnerais volontiers ma propre vie pour vous sauver ! Mais faites-moi voir de votre eau dans un verre. » Le roi se prêta aux désirs de mon père ; cependant il se plaignait qu’il allait toujours plus mal. On voyait représenté sur le miroir comme heureusement votre père guérit sur l’heure. Le mien dit avec réserve : « Si votre santé l’exige, résolvez-vous, sans balancer, à manger le foie d’un loup ; mais il faudrait qu’il eût au moins sept ans. Mangez-le-moi ; ne l’épargnez pas, car il y va de votre vie. Votre eau est comme du sang : décidez-vous bien vite. »

Le loup se trouvait dans l’assemblée, et il n’entendit pas la chose avec plaisir. Votre père dit là-dessus : « Vous l’avez entendu, seigneur loup : vous ne me refuserez pas votre foie pour ma guérison. » Le loup répondit : « Je n’ai pas cinq ans : quel bien peut-il vous faire ? – Vains discours ! repartit mon père. Cela ne doit pas nous arrêter. Je le connaîtrai tout de suite au foie. » Le loup fut traîné sur-le-champ à la cuisine, et le foie se trouva tel qu’il fallait. Votre père le mangea incontinent, et à la même heure il était délivré de toute maladie et de toute infirmité. Il ne manqua pas de témoigner à mon père sa reconnaissance. À la cour, chacun dut le qualifier de docteur ; on ne se permettait jamais d’y manquer ; il marchait constamment à la droite du roi. Votre père, je le sais fort bien, lui fit ensuite présent d’une agrafe d’or et d’une barrette rouge, qu’il portait devant tous les seigneurs, et tous le tinrent en grande considération. Mais, hélas ! les choses ont bien changé pour le fils, et l’on ne pense plus au mérite de son père. Tous les fripons les plus avides sont élevés en dignité ; on ne songe qu’à l’intérêt et au profit ; la justice et la sagesse sont en discrédit. Les valets deviennent de grands seigneurs, et d’ordinaire le pauvre doit en pâtir. Quand de telles gens ont la puissance, ils frappent en aveugles sur la foule ; ils ne se souviennent plus d’où ils sont venus ; ils songent à tirer leur avantage de tous les jeux : il s’en trouve beaucoup de cet acabit autour des grands. Ils n’écoutent aucune prière, si elle n’est pas d’abord accompagnée d’un riche cadeau ; et, quand ils assignent les gens, c’est pour leur dire : « Apportez, apportez une fois, deux fois, trois fois. » Ces loups voraces gardent volontiers pour eux les morceaux délicats, et, quand il s’agirait de sauver par un petit sacrifice la vie de leur maître, ils feraient difficulté. Le loup ne voulait pas renoncer à son foie pour le service du prince ! Et quel foie ! Je le dis franchement : quand vingt loups perdraient la vie, si celle du roi et de sa chère épouse était sauvée, le mal serait petit. Car une mauvaise semence, que peut-elle produire de bon ? Ce qui est arrivé dans votre enfance, vous l’avez oublié : mais je le sais parfaitement, comme si la chose était d’hier. L’événement était gravé sur le miroir : ainsi l’avait voulu mon père ; des pierreries et des rameaux d’or décoraient l’ouvrage. Je donnerais mes biens et ma vie pour savoir où trouver ce miroir.
– Reineke, dit le roi, j’ai compris tes discours ; j’ai entendu tes paroles et tous les récits que tu as faits. Si ton père était à notre cour un grand personnage, et s’il a fait tant de choses salutaires, il y a, je pense, de cela fort longtemps. Je ne m’en souviens pas et personne ne m’en a informé. Vos actions, au contraire, viennent souvent à mes oreilles ; vous êtes sans cesse au jeu, du moins je l’entends dire. Si l’on vous fait tort et que ce soient de vieilles histoires, je voudrais entendre une fois quelque chose de bon : c’est ce qui n’arrive guère.
– Sire, répliqua Reineke, je puis bien m’expliquer là-dessus devant vous, car la chose me concerne : je vous ai fait moi-même du bien. Ce n’est pas un reproche, Dieu m’en garde ! Je me reconnais obligé de faire pour vous tout ce qui est en mon pouvoir. Assurément vous n’avez pas oublié l’affaire. Je fus un jour assez heureux, avec Ysengrin, pour attraper à la chasse un pourceau : il criait, il périt sous nos morsures. Vous vîntes, faisant beaucoup de plaintes, et disant que votre femme arrivait sur vos pas, que, si quelqu’un voulait partager avec vous sa nourriture, ce serait pour vous et pour elle un réconfort. « Faites-moi part de votre capture, » disiez-vous alors. Ysengrin consentit, mais il murmurait dans sa barbe, de façon qu’on l’entendait à peine. De mon côté, je répondis : « Monseigneur, nous vous offrons volontiers les pourceaux, fussent-ils sans nombre. Parlez, qui doit faire le partage ? – Le loup, avez-vous répondu. Ysengrin en fut charmé. Il fit le partage sans pudeur et sans gêne, selon sa coutume, et vous servit justement un quartier, à votre épouse l’autre, et il se jeta sur la moitié, la dévora gloutonnement, et, avec les oreilles, il me donna seulement le museau et une moitié de poumon. Il garda tout le reste pour lui, vous l’avez vu. Il nous montra dans cette occasion peu de générosité. Vous le savez, mon roi. Vous eûtes bientôt mangé votre part, mais j’observai que vous n’aviez pas apaisé votre faim : Ysengrin seul ne voulait pas le voir ; il ne cessa de manger et mâcher, sans vous offrir la moindre chose. Alors vous lui portâtes derrière les oreilles un violent coup de patte, qui lui déchira la peau. Il s’enfuit, le crâne pelé et sanglant, avec des bosses à la tête, et hurlant de douleur. Et vous lui criâtes encore : « Reviens, apprends à rougir. Si tu fais de nouveau le partage, que je sois mieux servi, sinon je t’apprendrai ton devoir. Maintenant, va-t’en bien vite nous chercher encore de quoi manger. – Vous l’ordonnez, seigneur, vous dis-je. Je vais donc le suivre, et je suis sûr que je vous apporterai bientôt quelque proie. » Vous approuvâtes la chose. Ysengrin faisait alors une triste figure : il saignait, soupirait, gémissait : cependant je le fis marcher. Nous allâmes chasser ensemble ; nous prîmes un veau. Vous aimez ce gibier. Et quand nous l’apportâmes, il se trouva gras. Cela vous fit sourire, et vous dîtes à ma louange mainte parole amicale. J’étais, disiez-vous, excellent à mettre en campagne à l’heure du besoin, et vous me dîtes encore : « Partage le veau. » Je répondis : « Une moitié vous appartient et l’autre appartient à la reine. Ce qui se trouve dans le corps, comme le cœur, le foie et les poumons, revient de plein droit à vos enfants. Je prends les pieds, que j’aime à ronger, et le loup aura la tête, morceau délicat. » Après m’avoir entendu parler de la sorte, vous me dîtes : « Qui donc t’a instruit à partager ainsi, à la manière de la cour ? Je voudrais bien le savoir. » Je répondis : « Mon maître est proche : celui-ci, avec sa tête rouge, son crâne pelé et sanglant, m’a ouvert l’esprit. J’ai fort bien vu comme il a partagé le cochon ce matin, et j’ai appris à comprendre le fin d’un pareil partage. Veau ou cochon, je saurais m’en tirer aisément et je n’y manquerai pas. » Honte et dommage punirent le loup et sa convoitise. Ses pareils sont assez nombreux. Ils dévorent les fruits des riches domaines et les vassaux en même temps. Ils détruisent d’abord toute prospérité ; il ne faut espérer d’eux aucun ménagement, et malheur au pays qui nourrit de tels hôtes !
« Sire, je vous ai souvent témoigné mon respect. Tout ce que je possède et que je puis acquérir, je le consacre de bon cœur à vous et à notre reine ; que ce soit peu de chose ou beaucoup, vous en prendrez la plus grande part. Si vous songez au veau et au pourceau, vous reconnaîtrez la vérité et où se trouve la fidélité sans reproche. Ysengrin oserait-il peut-être se mesurer avec Reineke ? Mais, par malheur, le loup est en haute considération, comme grand prévôt, et il opprime tout le monde. Il ne veille pas trop à vos intérêts. Il sait avancer les siens à merveille. Et maintenant il prendra sans doute la parole avec Brun, et, ce que Reineke aura dit, on en fera peu de cas.
« Monseigneur, le fait est que l’on m’accuse, et je ne céderai pas, car je dois poursuivre l’affaire jusqu’au bout ; et voici ce que je dis : Est-il quelqu’un ici qui pense me convaincre ? Qu’il se présente avec des témoins ; qu’il s’attache constamment au fait, et qu’il mette en gage juridique son bien, ses oreilles, sa vie, pour le cas où il viendrait à perdre, et j’en fais autant de mon côté. Tel fut toujours l’usage. Qu’on l’observe encore, et que toute l’affaire, telle qu’elle sera exposée pour et contre, soit loyalement traitée et jugée : j’ose le demander.
– Quoi qu’il en soit, reprit le monarque, je ne veux et ne puis gêner les voies du droit ; je ne l’ai jamais souffert. Tu es gravement suspect, il est vrai, d’avoir pris part au meurtre de Lampe, le fidèle messager. Je l’aimais singulièrement, et sa perte m’a été sensible ; je fus troublé affreusement lorsqu’on tira, sous mes yeux, sa tête sanglante de ton sac. Bellin, le compagnon perfide, expia le crime sur-le-champ. Tu peux maintenant défendre ta cause en justice. Pour ce qui me regarde personnellement, je pardonne tout à Reineke, car il m’a témoigné son attachement dans mainte occasion dangereuse. Si quelqu’un avait à l’accuser encore, nous l’entendrons. Qu’il produise des témoins irréprochables, et qu’il porte contre Reineke une plainte régulière : il se présente en justice. »
Reineke prit la parole :
« Monseigneur, je vous rends grâce. Vous entendez chacun, et chacun jouit du bénéfice de la loi. Laissez-moi déclarer solennellement avec quelle tristesse je vis partir Bellin et Lampe. J’avais, je crois, le pressentiment de ce qui devait arriver à tous deux. Je les aimais tendrement. »
C’est ainsi que Reineke arrangeait habilement ses récits et ses paroles. Chacun le croyait. Il avait si agréablement décrit les trésors, il s’était comporté si gravement, qu’il semblait dire la vérité. On cherchait même à le consoler. C’est ainsi qu’il trompa le roi, à qui les trésors plaisaient. Il aurait bien voulu les posséder. Il dit à Reineke :
« Rassurez-vous, vous irez voyager, et vous chercherez de toutes parts à retrouver les objets perdus ; vous ferez votre possible. Si vous avez besoin de mon secours, il vous est assuré.
– Je suis reconnaissant de cette faveur, dit Reineke. Ces paroles me réconfortent et me donnent de l’espérance. Punir le meurtre et le brigandage est votre droit suprême. La chose est encore obscure pour moi, mais elle s’éclaircira. Je m’en occuperai avec la plus grande diligence ; je voyagerai sans relâche, de jour et de nuit, et je questionnerai tout le monde. Si je découvre où se trouvent les trésors, sans pouvoir les recouvrer moi-même ; si je suis trop faible, j’invoquerai votre secours. Vous me l’accorderez, et certainement la chose réussira. Que je produise heureusement les trésors devant vous, ma peine sera enfin récompensée et ma fidélité reconnue. »
Le roi entendit ces paroles avec plaisir, et donna en tout point son approbation à Reineke, qui avait si artistement arrangé ses mensonges. Tous les assistants le crurent aussi. Il pouvait de nouveau s’en aller et courir où bon lui semblerait et sans demander permission.
Alors Ysengrin ne put se contenir davantage, et il dit, en frémissant :
« Monseigneur, vous croyez donc encore le voleur qui vous a menti deux et trois fois ! Qui n’en serait pas étonné ? Ne voyez-vous pas que le scélérat vous trompe, et nous offense tous ? Il ne dit jamais la vérité, et il invente de frivoles mensonges. Mais je ne le laisse pas quitte si aisément. Il faut que je vous montre qu’il est un fourbe, un hypocrite. Je sais trois grands crimes qu’il a commis. Il n’échappera point, nous fallût-il combattre. On nous demande, il est vrai, des témoins : à quoi serviraient-ils ? S’ils étaient là, et s’ils parlaient et remplissaient l’audience de leurs témoignages, cela serait-il bon à quelque chose ? Il n’en ferait pas moins à sa fantaisie. Souvent on ne peut produire des témoins : le scélérat devrait-il pratiquer ses ruses après comme auparavant ? Qui donc ose parler ? Il joue à chacun quelque tour, et chacun craint le dommage. Vous et les vôtres, vous le sentirez aussi et tous ensemble. Aujourd’hui je prétends le tenir : qu’il ne branle ni ne recule, et qu’il plaide contre moi. Il n’a qu’à prendre garde à lui. »

CHANT ONZIÈME

Ysengrin le loup, porta sa plainte, et dit :
« Vous le reconnaîtrez, monseigneur, Reineke fut de tout temps un fripon, il le sera toujours, et il vient dire des choses infâmes, pour m’insulter moi et ma famille. C’est ainsi qu’il m’a toujours fait, et plus encore à ma femme, de sensibles outrages. Un jour, il l’engage à passer dans un étang, à travers le marécage : il lui avait promis qu’elle prendrait ce jour-là beaucoup de poissons. Elle n’avait qu’à plonger la queue dans l’eau et la laisser pendre : les poissons viendraient y mordre, et seraient pris. Elle ne pourrait, elle et trois autres, les manger tous. Elle s’avança donc, pataugeant et nageant, vers le bout, vers la bonde. En ce lieu, l’eau avait plus de profondeur, et Reineke dit à ma femme d’y laisser pendre sa queue. Vers le soir, le froid fut grand, et il commença de geler très fort, en sorte qu’elle ne pouvait presque plus y tenir, et bientôt sa queue fut prise dans la glace. Elle ne pouvait la remuer ; elle croyait que c’était la pesanteur des poissons, et qu’elle avait réussi. Reineke, l’infâme voleur, s’en aperçut, et, ce qu’il fit, je n’ose le dire. Il vint, hélas ! et lui fit violence. Il ne m’échappera pas ! Il faut qu’aujourd’hui même ce forfait coûte la vie à l’un de nous, tels que nous voilà : car il ne pourra se tirer d’affaire par son babil : je l’ai pris moi-même sur le fait. Le hasard m’amena vers la colline. J’entendis ma femme crier au secours. La pauvre dupe était prise dans la glace et ne pouvait résister à Reineke. Je vins et je dus tout voir de mes propres yeux. C’est un miracle vraiment que mon cœur n’ait pas éclaté. « Reineke, m’écriai-je, que fais-tu ? » Il m’entendit venir, et il prit la fuite. Je m’approchai tristement. Il me fallut marcher dans l’eau gelée, et j’eus beaucoup de peine à rompre la glace pour délivrer ma femme. Hélas ! la chose ne réussit pas heureusement. Elle tira violemment, et un bout de la queue resta pris dans la glace. Elle gémissait et poussait de grands cris : les paysans l’entendirent. Ils paraissent, ils nous découvrent, et s’appellent les uns les autres. Ils accourent, furieux, sur la digue, avec des pics et des haches ; les femmes viennent avec leurs quenouilles, et font un grand vacarme. « Prenez-les ! frappez ! tuez ! » Ainsi se criaient-ils les uns aux autres. Je ne sentis de ma vie une pareille angoisse. Giremonde dira les mêmes choses. Nous sauvâmes à peine notre vie. Nous courûmes : notre poil fumait. Un jeune garçon nous poursuivait, méchant drôle, armé d’un pic. Léger à la course, il nous en faisait sentir la pointe et nous pressait rudement. Si la nuit ne fût pas venue, nous y laissions la vie. Et les femmes criaient toujours, les sorcières, que nous avions mangé leurs agneaux. Elles nous auraient tués volontiers, et nous poursuivaient de leurs insultes et leurs injures. Mais nous revînmes de la campagne vers l’étang, et nous nous glissâmes vite entre les joncs. Les paysans n’osèrent pas nous poursuivre plus loin, parce que la nuit était devenue sombre. Ils retournèrent chez eux. Voilà comme, à grand’peine, nous échappâmes. Vous le voyez, sire, violence, meurtre et trahison, voilà les crimes dont il s’agit. Mon roi, vous les punirez sévèrement. »
L’accusation entendue, le roi dit :
« Qu’il soit statué juridiquement sur le cas, mais entendons Reineke. »
Reineke prit la parole :
« Si la chose se fût ainsi passée, elle me ferait peu d’honneur ; et Dieu me préserve qu’on la trouve telle qu’Ysengrin la raconte ! Je ne veux point nier que j’ai enseigné à Giremonde le moyen de prendre les poissons, et le meilleur chemin pour arriver à l’eau, et que je l’ai conduite à l’étang, Mais elle courut avec une ardeur si grande, dès qu’elle entendit parler de poisson, qu’elle en oublia la manière, la mesure et la leçon. Si elle demeura gelée dans la glace, c’est qu’elle était restée beaucoup trop longtemps assise : car, si elle avait retiré sa queue à propos, elle aurait pris assez de poisson pour un excellent repas. Une convoitise trop forte est toujours funeste. Si le cœur s’accoutume à l’intempérance, il doit éprouver beaucoup de privations. Qui a l’esprit avide vivra dans de continuels soucis : nul ne peut le rassasier. Madame Giremonde l’a éprouvé, lorsqu’elle était prise dans la glace. Maintenant elle me remercie mal de mes efforts. C’est ma récompense, pour l’avoir honnêtement aidée. Car je la poussais, et voulais, de toutes mes forces, la soulever : mais elle était trop pesante pour moi. C’est au milieu de ces efforts qu’Ysengrin me trouva, en passant le long du bord. Il s’arrêta et cria, et me chargea d’imprécations furieuses. J’eus peur, je l’avoue, à l’ouïe de ces bénédictions. Une fois, deux fois et trois fois, il vomit contre moi les plus horribles menaces ; il poussait des cris de fureur, et je me dis : « Va-t’en d’ici, et n’attends pas davantage. Mieux vaut courir que pourrir. » Mon affaire était faite, car, à ce moment, il m’aurait déchiré. Lorsqu’il arrive que deux chiens se mordent pour un os, il faut bien que l’un soit battu. Il me parut donc aussi que le meilleur était de céder à sa colère et à son sens égaré. Il était furieux et l’est encore : qui peut le nier ? Interrogez sa femme : qu’ai-je à faire avec ce menteur ? Aussitôt qu’il vit sa femme prise dans la glace, il blasphéma et invectiva, puis il vint et l’aida à s’en tirer. Si les paysans les poursuivirent, ce fut pour le mieux, car cela mit leur sang en mouvement, et ils cessèrent d’avoir froid. Que dirai-je encore ? C’est mal se conduire, de déshonorer sa propre femme par de semblables mensonges. Interrogez-la elle-même : la voici. S’il avait dit la vérité, elle n’aurait pas manqué de porter plainte elle-même. Cependant je demande une huitaine, pour conférer avec mes amis sur la réponse que je dois faire au loup et à sa plainte. »
Giremonde prit ensuite la parole :
« Il n’y a dans votre conduite et votre caractère que malice, nous le savons bien, et mensonge et tromperie, scélératesse, fourberie et insolence. Qui ajoute foi à vos discours insidieux en souffre toujours à la fin. Vous usez constamment de paroles fausses et ambiguës. J’en ai fait l’épreuve vers le puits. Car deux seaux y pendaient. Vous vous étiez placé dans l’un, sais-je pourquoi ? et vous étiez descendu au fond. Vous ne pouviez vous reguinder vous-même, et vous faisiez de grandes plaintes. Je vins au puits le matin, et je vous demandai qui vous avait mis là dedans. Vous me dîtes : « Venez vite, chère commère : je vous fais part volontiers de tous mes avantages. Mettez-vous dans le seau qui est là-haut, vous descendrez ici et vous mangerez du poisson autant qu’il vous plaira. » J’étais venue là pour mon malheur : je vous crus. Vous me jurâtes même que vous aviez mangé du poisson jusqu’à vous incommoder. Je me laissai séduire, folle que j’étais, et je me plaçai dans le seau. Il descendit, et l’autre remonta. Vous veniez à ma rencontre. Cela me parut singulier, et je vous en témoignai ma surprise. « Dites, comment cela se fait-il ? » Vous me répondîtes : « Haut et bas, ainsi va le monde, ainsi allons-nous. Tel est le cours des choses. Les uns sont abaissés et les autres élevés, selon le mérite de chacun. » Vous vous élancez du seau et vous partez bien vite. Moi, j’étais dans l’angoisse au fond du puits, où je dus attendre tout le jour et souffrir, le même soir, assez de coups avant de m’échapper. Quelques paysans vinrent au puits. Ils me remarquèrent. Tourmentée d’une faim cruelle, j’attendais dans la tristesse et l’angoisse ; j’étais dans un état pitoyable. L’un disait : « Vois-tu là-bas dans le seau l’ennemi qui mange nos moutons ? – Guinde-le en haut, répliqua l’autre : je me tiendrai prêt et le recevrai sur le bord. Il nous payera nos agneaux. » Mais, comme il m’accueillit, ce fut une pitié. Les coups me tombèrent sur le dos comme une grêle. Je n’avais pas vu de ma vie un plus triste jour, et j’échappai avec peine à la mort. »
Reineke réplique :
« Réfléchissez plus attentivement aux conséquences, et vous reconnaîtrez sans doute combien ces coups vous furent salutaires. Pour ce qui me regarde, j’aime mieux m’en passer, et, dans la circonstance, il fallait qu’un de nous deux reçût une volée : nous ne pouvions échapper tous deux. Si vous gardez souvenir de la chose, elle vous servira, et, à l’avenir, en pareil cas, vous n’écouterez personne aussi aisément. Le monde est plein de fourberie.
– Oui, répliqua le loup, qu’est-il besoin d’autres preuves ? Personne ne m’a fait plus de tort que ce méchant traître. Je n’ai pas encore conté comme un jour, en Saxe, il m’attira, parmi les singes, honte et dommage. Il me persuada de me glisser dans une caverne, et il savait d’avance qu’il m’en arriverait mal. Si je ne m’étais enfui promptement, j’y perdais les yeux et les oreilles. Il m’avait prévenu, avec des paroles trompeuses, que Madame sa tante se trouvait là-dedans. Il voulait dire la guenon. Il fut bien fâché, le drôle, de me voir échappé. Il m’avait envoyé perfidement dans ce repaire abominable : je crus que c’était l’enfer. »
Là-dessus Reineke dit, en présence de tous les seigneurs de la cour :
« Ysengrin parle confusément : il semble n’être pas entièrement dans son bon sens. S’il veut parler de la guenon, qu’il dise la chose clairement. Il y a deux ans et demi qu’il se rendit, avec grand étalage, en Saxe, où je le suivis. Cela est vrai, le reste est mensonge. Ce n’est point de singes, c’est de marmots, qu’il a parlé, et jamais je ne les reconnaîtrai pour mes parents. Martin, le singe, et Madame Ruckenau, sa femme, sont de ma famille ; je les honore, elle, comme ma tante, et lui, comme mon cousin. Il est notaire et versé dans la jurisprudence. Mais ce qu’Ysengrin dit de ces autres créatures est une insulte pour moi. Je n’ai rien à démêler avec elles ; elles ne furent jamais de ma famille, car elles ressemblent au diable d’enfer. Et, si j’appelai alors la vieille ma tante, je le fis de propos délibéré. Je n’y perdis rien, je l’avouerai volontiers ; elle me traita bien : autrement fût-elle crevée !
« Messieurs, veuillez m’entendre. Nous nous étions écartés du chemin ; nous passâmes derrière la montagne, et nous y remarquâmes une sombre caverne, longue et profonde. Ysengrin se trouva, comme d’ordinaire, malade de faim. Personne l’a-t-il jamais vu rassasié au point d’être satisfait ? Et je lui dis : « Il se trouve dans cette caverne assez de nourriture. Je ne doute pas que les habitants ne partagent avec nous volontiers ce qu’ils ont : nous arrivons à propos. » Ysengrin repartit : « Je vous attendrai, mon oncle, ici, sous l’arbre. Vous êtes, à tous égards, plus habile à faire de nouvelles connaissances, et, si l’on vous sert à manger, faites-le-moi savoir. » Le drôle voulut donc attendre d’abord, à mes risques, ce qui arriverait. J’entrai dans la caverne. Ce ne fut pas sans frissonner que je parcourus la longue et tortueuse galerie ; elle ne finissait pas. Mais ce que je trouvai ensuite, je ne voudrais pas, pour beaucoup d’or, le revoir de ma vie. Quel repaire d’affreuses bêtes, grandes et petites ! Et la mère encore !… Je crus que c’était le diable. Une grande et large gueule, garnie de longues, horribles dents ; des ongles longs aux mains et aux pieds, et une longue queue pendante. Je ne vis de mes jours quelque chose d’aussi effroyable. Ses noirs et misérables enfants étaient singulièrement bâtis, comme on dirait de jeunes fantômes. Elle me jeta un regard affreux. Je me dis : « Fussé-je hors d’ici ! » Elle était plus grande qu’Ysengrin lui-même, et quelques-uns de ses enfants presque de même taille.
« Je trouvai l’horrible engeance couchée sur le foin pourri, et barbouillée d’ordures jusqu’aux oreilles. Il régnait dans leur domicile une puanteur pire que la poix infernale. Pour dire la pure vérité, je me plaisais peu là-dedans ; car ils étaient nombreux, et je me voyais seul. Ils faisaient d’horribles grimaces. Alors je me recueillis et je cherchai un expédient. Je leur donnai le bonjour (ce n’était pas ma pensée), et je sus me présenter avec grâce et familiarité. Je qualifiai la vieille de madame ma tante, et appelai cousins les enfants. Les paroles ne me firent pas défaut. « Que le bon Dieu vous ménage de longs jours de bonheur ! Sont-ce là vos enfants ? En vérité, je ne devrais pas le demander. Comme ils me plaisent ! Ô ciel ! qu’ils sont éveillés ! Qu’ils sont jolis ! On les prendrait tous pour les fils du roi. Que je vous loue mille fois d’avoir accru notre race de ces dignes rejetons ! J’en ai une joie inconcevable. Je me trouve heureux d’avoir appris à connaître de pareils cousins ; car, dans les temps d’adversité, on a besoin de ses parents. » Quand je lui eus montré tant de politesse, quoique mes pensées fussent bien différentes, elle me fit les mêmes civilités ; elle m’appela son oncle et prit des airs d’intimité, si peu que la folle appartienne à ma famille. Mais il ne pouvait me nuire, pour cette fois, de l’appeler ma tante. En attendant, je suais d’angoisse des pieds à la tête. Pour elle, avec un air amical : « Reineke, me dit-elle, digne parent, soyez le très bien venu. Êtes-vous bien aussi ? Je vous serai obligée toute ma vie d’être venu chez moi. Vous inculquerez à l’avenir de sages pensées à mes enfants, afin qu’ils se fassent honneur. » Voilà comme ils me parlèrent. Je l’avais largement mérité par ce peu de mots, en l’appelant ma tante et en ménageant la vérité. Toutefois je me serais vu aussi volontiers en rase campagne ; mais elle ne me donna point congé, et elle dit : « Mon oncle, vous ne pouvez partir sans avoir pris quelque chose. Attendez, laissez-vous servir. » Elle apporta des mets en abondance. Je ne saurais, en vérité, les nommer tous à présent. Je me demandais, avec la plus grande surprise, comment ils avaient pu se procurer tout cela. Je mangeai du poisson, du chevreuil et d’autre bon gibier, que je trouvai d’une saveur exquise. Quand je fus rassasié, elle m’apporta encore une pièce de cerf, dont elle me chargea. Je devais la porter à ma famille. Là-dessus je pris congé fort poliment. « Reineke, dit-elle encore, venez me voir souvent. » J’aurais promis tout ce qu’elle aurait voulu. Je réussis à partir. L’odorat et la vue n’étaient pas flattés dans ce lieu. J’aurais presque voulu être mort. Je me hâtai de fuir, et courus bien vite, le long de la galerie, jusqu’à l’ouverture, au pied de l’arbre. Ysengrin s’y trouvait encore gisant et gémissant. Je lui dis : « Comment va, mon oncle ? – Pas bien, répondit-il ; je vais mourir de faim. » J’eus pitié de lui, et lui donnai le précieux rôti que j’avais apporté. Il le mangea de grand appétit. Il me fit alors beaucoup de remercîments : à présent, il ne s’en souvient plus. Lorsqu’il eut achevé, il me dit : « Apprenez-moi qui habite la caverne. Comment vous êtes-vous trouvé là-dedans ? Bien, ou mal ? » Je lui dis là-dessus la plus pure vérité ; je l’instruisis bien. Le nid était mauvais, mais il s’y trouvait beaucoup d’excellentes provisions. Du moment qu’il désirait en avoir sa part, il n’avait qu’à entrer hardiment, et, avant tout, se garder de dire la franche vérité. Afin que tout succède selon vos désirs, ménagez la vérité, lui répétai-je encore ; car, si quelqu’un l’a sans cesse à la bouche inconsidérément, il souffre la persécution, où qu’il se présente. Partout on le laisse en arrière ; les autres sont conviés. » Voilà comme je le congédiai : je l’exhortai, quoi qu’il trouvât, à dire de ces choses que chacun est bien aise d’entendre. De cette manière, il serait bien reçu. En cela, mon seigneur et roi, je lui parlai en bonne conscience : s’il fit ensuite le contraire, et s’il y attrapa quelque chose, qu’il le garde. Il devait me croire. Son poil est gris, il est vrai, mais c’est en vain qu’on cherche dessous la sagesse. Ses pareils n’estiment ni la prudence ni les fines pensées. Le prix de toute sagesse reste caché au peuple lourd et grossier. Je lui recommandai fidèlement de ménager, cette fois, la vérité. « Je sais bien moi-même ce qui convient, » me répondit-il fièrement, et il trotta dans la caverne. Il y trouva son affaire. Au fond était assise l’horrible femelle : il crut voir le diable devant lui ; et les enfants encore ! Il s’écria tout saisi : « Au secours ! Quelles bêtes abominables ! Ces créatures sont-elles vos enfants ? On les dirait, en vérité, de la bande infernale. Allez vite les noyer, c’est le mieux, afin que cette engeance ne se répande pas sur la terre. S’ils étaient miens, je les étranglerais. Vraiment, on pourrait s’en servir à prendre de jeunes diables : il suffirait de les lier, dans un marais, sur les roseaux, ces vilains et sales garnements ! Oui, on devrait les appeler singes de marais ; ils seraient bien nommés. » La mère répliqua vivement et dit en colère : « Quel diable nous envoie ce messager ? Qui vous pousse à venir nous insulter ici ? Et mes enfants, qu’ils soient beaux ou laids, qu’avez-vous à démêler avec eux ? Reineke, le renard, vient de nous quitter ; c’est un homme d’expérience, qui doit s’y connaître : il affirmait bien haut qu’il trouvait tous mes enfants jolis, bien élevés et de bonnes manières. Il se plaisait à les reconnaître avec joie pour ses parents. Il y a une heure qu’il nous assurait tout cela à cette place. S’ils ne vous plaisent pas comme à lui, personne ne vous a prié de venir. C’est là, Ysengrin, ce qu’il vous faut savoir. » Aussitôt il lui demanda de quoi manger et dit : « Apportez vite, sinon je vous aiderai à chercher. » À quoi bon en dire davantage ? Il se mit à l’œuvre, et voulut tâter de force aux provisions. Cela lui réussit mal ; car elle se jeta sur lui, le mordit, lui déchira le cuir avec les ongles, le griffa et le tirailla violemment. Les enfants firent de même ; ils le mordirent et l’égratignèrent horriblement. Il hurlait et criait, les joues sanglantes. Sans se défendre, il courut à toutes jambes vers l’entrée. Je le vis venir tout déchiré, dévisagé, avec des lambeaux de chair pendante, une oreille fendue et le nez sanglant. Ils lui avaient fait maintes blessures et laidement froissé la peau. Je lui dis, comme il sortait : « Avez-vous dit la vérité ? » Il me répondit : « Comme j’ai rencontré, j’ai parlé. La méchante sorcière m’a traité indignement. Je voudrais qu’elle fût ici dehors ; elle me le payerait cher. Qu’en pensez-vous, Reineke ? Avez-vous jamais vu des enfants pareils, si laids et si méchants ? Je le lui dis, et, dès ce moment, je ne trouvai plus grâce devant elle ; et j’ai mal passé mon temps dans ce trou. – Êtes-vous fou ? lui dis-je. Je vous avais donné des avis plus sages. Je vous salue de tout mon cœur, ma chère tante, deviez-vous dire. Comment allez-vous ? Comment se portent vos gentils, vos chers enfants ? Je me félicite fort de revoir mes grands et mes petits cousins. » Mais Ysengrin repartit : « Appeler tante cette femelle, et cousins ces vilains enfants ? Que le diable les emporte ! J’ai horreur d’une semblable parenté. Fi de cette abominable canaille ! Je ne les reverrai de ma vie. » C’est pour cela qu’il fut si mal traité. Maintenant, sire, jugez. Dit-il justement que je l’ai trahi ? Il peut le confesser : la chose n’est-elle pas arrivée comme je la rapporte ? »

Ysengrin repartit résolûment :
« Nous ne sortirons pas de ce procès avec des paroles. Que nous sert-il de quereller ? Le droit est toujours le droit, et qui l’a pour lui, c’est ce qu’on voit à la fin. Vous vous présentez fièrement, Reineke ; vous l’avez donc peut-être. Combattons l’un contre l’autre, l’affaire sera vidée. Vous savez dire beaucoup de choses : comme j’ai souffert d’une grande faim devant la demeure des singes, et comme vous m’avez alors fidèlement nourri. Je sais ce que vous voulez dire. Ce n’était qu’un os que vous m’apportâtes ; la chair, vous l’aviez sans doute mangée vous-même. Où que vous soyez, vous me raillez, et vous tenez effrontément des discours qui m’offensent. Par des mensonges infâmes, vous m’avez rendu suspect d’avoir médité une coupable conspiration contre le roi, et d’avoir désiré de lui ôter la vie. Vous, en revanche, vous lui parlez fastueusement de trésors… Il aurait de la peine à les trouver. Vous avez traité outrageusement ma femme, et vous me le payerez. Voilà de quoi je vous accuse. Je prétends combattre pour les offenses anciennes et nouvelles, et, je le répète, vous êtes un meurtrier, un traître, un voleur. Nous combattrons vie pour vie ; et que finissent les querelles et les injures ! Je vous jette le gant, comme le fait tout appelant en justice. Recevez-le en gage, et nous nous trouverons bientôt. Le roi l’a entendu, tous les seigneurs de même, j’espère qu’ils seront témoins du combat judiciaire. Vous n’échapperez pas que la chose ne soit enfin décidée, et nous verrons ! »
Reineke se dit à lui-même :
« Il y va de la fortune et de la vie. Il est grand et je suis petit, et, si j’essuyais cette fois un échec, toutes mes ruses m’auraient peu servi. Mais attendons l’événement ; car, lorsque j’y pense, j’ai l’avantage. Il a déjà perdu ses ongles de devant. Si le fou n’est pas devenu plus calme, il n’aura pas ce qu’il veut, quoi qu’il en puisse coûter. »
Là-dessus Reineke dit au loup :
« C’est vous-même, Ysengrin, que j’estime un traître, et les griefs dont vous prétendez me charger sont tous des mensonges, Voulez-vous combattre ? J’accepte le défi, et je ne branlerai pas. Il y a longtemps que je le désirais. Voici mon gant. »
Le roi reçut les gages, que les deux champions présentèrent hardiment, puis il parla en ces termes :
« Vous devez me donner caution que vous ne manquerez pas de vous présenter demain pour le combat, car je trouve de part et d’autre la cause embrouillée. Qui peut comprendre tous ces discours ? »
Brun, l’ours, et Hinze, le chat, se présentèrent sur-le-champ comme cautions d’Ysengrin ; et, pour Reineke, s’engagèrent de même son cousin Monèque, fils de Martin, le singe, et Grimbert.
« Reineke, dit là-dessus Madame Ruckenau, demeurez tranquille et de sang-froid. Votre oncle, mon mari, qui est maintenant à Rome, m’apprit un jour une prière que l’abbé de Schlouckauf avait composée, et qu’il donna par écrit à mon mari, auquel il voulait du bien. Cette prière, disait l’abbé, est salutaire pour les hommes qui vont au combat. Il faut la réciter à jeun, le matin, et l’on est exempt tout le jour d’accidents et de dangers, à l’abri de la mort, des souffrances et des blessures. » Rassurez-vous, mon neveu : demain matin, au bon moment, je veux la dire pour vous, et vous pourrez marcher sans crainte et sans inquiétude.
– Chère tante, dit le renard, je vous remercie de bon cœur. Je vous en témoignerai ma reconnaissance. Cependant la justice de ma cause et mon adresse devront m’aider plus encore que tout le reste. »
Les amis de Reineke restèrent assemblés toute la nuit, et ils dissipèrent ses inquiétudes par de joyeux entretiens. Madame Ruckenau fut plus attentive et plus empressée que tous les autres : elle fit bien vite tondre Reineke entre la tête et la queue, sur la poitrine et le ventre, et le fit frotter avec de la graisse et de l’huile. Reineke parut gras et rond, et en bon état. Ensuite elle dit :

« Écoutez-moi, et considérez bien ce que vous avez à faire. Écoutez les conseils d’amis intelligents ; rien n’est plus salutaire. Buvez largement, et gardez votre eau ; et demain, quand vous paraîtrez dans la lice, usez d’adresse : arrosez partout votre queue touffue, et tâchez d’en frapper l’adversaire. Si vous pouvez lui en frotter les yeux, rien de meilleur ; sa vue en sera troublée, ce qui vous viendra fort à propos et le gênera fort. Commencez aussi par prendre un air craintif, et à fuir contre le vent d’une course rapide. S’il vous poursuit, soulevez la poussière, afin de lui aveugler les yeux avec l’ordure et le sable ; puis, jetez-vous de côté, observez chaque mouvement, et, lorsqu’il se frottera les yeux, prenez votre avantage et mouillez-les encore avec l’eau corrosive, afin qu’il soit complètement aveuglé, qu’il ne sache plus où il en est, et que la victoire vous demeure. Mon cher neveu, prenez un peu de sommeil. Nous vous éveillerons quand il en sera temps. Mais, pour vous fortifier, je veux d’abord réciter, à votre intention, les saintes paroles dont je vous ai entretenu. »
Elle lui posa la main sur la tête et dit ces mots :
« Nekraest negibaul geid sum namteflih dnudna mein tedachs !
À présent, courage ! vous êtes préservé. »
L’oncle Grimbert dit la même chose, et puis ils le menèrent coucher. Il dormit tranquillement. Au lever du soleil, la loutre et le blaireau vinrent éveiller leur cousin. Ils le saluèrent amicalement et lui dirent :
« Préparez-vous bien. »
Puis la loutre lui présenta un jeune canard et lui dit :
« Mangez-le. J’ai bien sauté pour vous l’attraper, le long de la digue, près de Hunerbrot. Veuillez vous en régaler, mon cousin.
– Voilà de bonnes arrhes, repartit Reineke joyeux. Je ne dédaigne pas chose pareille. Que Dieu vous récompense d’avoir songé à moi ! »
Il se régala du canard et but un coup, puis il se rendit avec ses parents dans la lice, sablée, bien unie, où l’on devait combattre.

CHANT DOUZIÈME

Quand le roi vit Reineke, et comme il se présentait ras tondu dans le champ clos, frotté, sur tout le corps, d’huile et de graisse glissante, il fut pris d’un rire immodéré.
« Renard, qui donc t’a enseigné cela ? s’écria-t-il. On peut bien t’appeler Reineke, le renard ; tu es toujours le madré ; tu trouves partout quelque issue, et tu sais te tirer d’affaire. »
Reineke fit au roi une profonde révérence, une plus profonde encore à la reine, et il entra dans la lice avec des sauts joyeux. Le loup s’y trouvait déjà avec ses parents. Ils souhaitaient au renard une honteuse fin. Il entendit mainte parole colère et mainte menace. Cependant Lynx et Lupardus, les juges du camp, produisirent les choses saintes, et les deux combattants, le loup et le renard, jurèrent avec recueillement ce qu’ils maintenaient.
Ysengrin jura en termes violents, et avec des regards pleins de menace, que Reineke était un traître, un voleur, un meurtrier, et coupable de tous les crimes ; qu’il avait été pris en flagrant délit de violence et d’adultère ; qu’il était faux en toute chose ; que lui, loup, mettait, pour le soutenir, sa vie contre celle de son ennemi.
Reineke, de son côté, jura sur-le-champ qu’il ne se sentait coupable d’aucun de ces crimes ; qu’Ysengrin mentait comme toujours ; qu’il jurait faussement comme d’habitude, mais qu’il ne réussirait jamais à faire de ses mensonges des vérités, et cette fois moins que toute autre.
Et les juges du camp dirent alors :
« Que chacun fasse ce qu’il est tenu de faire, le droit s’ensuivra bientôt. »
Grands et petits quittèrent la lice, pour y laisser seuls les deux champions. La guenon se hâta de dire à voix basse :
« Rappelez-vous ce que je vous ai dit ; n’oubliez pas de suivre mes conseils. »
Reineke répondit gaiement :
« Cette bonne exhortation me fait marcher avec plus de courage. Soyez tranquille ; je n’oublierai pas dans ce moment l’audace et la ruse, par lesquelles j’ai échappé maints périls plus grands où j’étais souvent tombé, lorsque j’allais faire telle ou telle emplette qui ne sont pas payées jusqu’à ce jour, et que je risquais hardiment ma vie. Comment ne tiendrais-je pas maintenant contre le scélérat ? j’espère fermement le couvrir d’opprobre, lui et toute sa race, et faire honneur aux miens. Tous les mensonges qu’il dit, je vais les lui faire expier. »
Alors on laissa les deux champions dans la lice, et tous les regards se fixèrent sur eux avidement.

Ysengrin se montrait farouche et furieux : il allongea les pattes, il s’avança, la gueule ouverte, avec des sauts violents. Reineke, plus léger, échappa à son adversaire qui fondait sur lui, et mouilla vite de son eau corrosive sa queue touffue, et la traîna dans la poussière pour la remplir de sable. Ysengrin croyait déjà le tenir, quand le rusé lui donna sur les yeux un coup de sa queue, qui lui fit perdre la vue et l’ouïe. Ce n’était pas la première fois qu’il pratiquait cette ruse ; bien des animaux avaient déjà ressenti l’effet nuisible de l’eau mordante, C’est ainsi qu’il avait aveuglé les enfants d’Ysengrin, comme on l’a dit au début. Maintenant il songeait à marquer aussi le père. Lorsqu’il eut ainsi humecté les yeux de son adversaire, il s’élança de côté, se plaça au-dessus du vent, remua le sable, et chassa beaucoup de poussière dans les yeux du loup, qui se frottait et s’essuyait à la hâte, avec maladresse, et augmentait ses douleurs. Reineke savait, au contraire, manœuvrer habilement avec sa queue, pour frapper de nouveau son ennemi et l’aveugler complètement. Le loup s’en trouva fort mal. Le renard profita de son avantage : dès qu’il vit les yeux de son adversaire baignés de larmes douloureuses, il se mit en devoir de l’assaillir avec des bonds impétueux, avec des coups violents ; de l’égratigner et de le mordre, en continuant toujours de lui baigner les yeux. Le loup, à demi égaré, marchait à tâtons, et Reineke se moquait de lui plus hardiment, et disait :
« Sire loup, vous avez, je pense, avalé autrefois maint agneau innocent ; vous avez dévoré, dans votre vie, mainte bête irréprochable : j’espère qu’à l’avenir elles jouiront du repos. En tout cas, résolvez-vous à les laisser en paix, et recevez en récompense la bénédiction. Cette pénitence sera profitable à votre âme, surtout si vous attendez patiemment la fin. Pour cette fois, vous n’échapperez pas de mes mains. Vous devriez m’apaiser par vos prières ; je vous épargnerais volontiers, et je vous laisserais la vie. »
Reineke disait ces choses à la volée ; il avait saisi fortement son ennemi à la gorge ; et il espérait ainsi le vaincre. Mais Ysengrin, plus fort que lui, se secoua violemment, et, en deux coups, il se délivra. Reineke lui sauta au visage, le blessa grièvement et lui arracha un œil. Le sang lui coula le long du museau. Le renard s’écria :
« Voilà ce que je voulais ! J’ai réussi. »
Le loup sanglant se désespérait ; son œil perdu le rendait furieux ; oubliant ses blessures et ses douleurs, il se jeta sur Reineke et le coucha par terre. Le renard se trouvait en fâcheux état, et sa ruse lui servait de peu. Un de ses pieds de devant, dont il se servait comme de main, fut saisi vivement par Ysengrin, qui le tenait entre ses dents. Reineke était gisant, fort en peine ; il s’attendait sur l’heure à perdre sa main, et il avait mille pensées. Ysengrin lui murmura ces mots d’une voix sourde :
« Voleur, ton heure est venue. Rends-toi sur-le-champ, ou je te mets à mort pour tes actes perfides. Je vais te payer maintenant. Tu n’as pas gagné grand’chose à soulever de la poussière, à faire de l’eau, à te tondre le cuir, à te frotter de graisse. Malheur à toi ! Tu m’as fait bien du mal ; tu as menti contre moi ; tu m’as arraché un œil ; mais tu ne m’échapperas pas. Rends-toi, ou je mords ! »
Reineke se dit en lui-même :
« Cela va mal pour moi. Que dois-je faire ? Si je ne me rends pas, il me tue, et si je me rends, je suis déshonoré à jamais. Oui, je mérite mon châtiment, car je l’ai trop maltraité, trop gravement offensé. »
Là-dessus il essaya de douces paroles pour attendrir son ennemi.
« Cher oncle, lui dit-il, je me déclare avec joie votre vassal dès ce moment, avec tout ce que je possède. J’irai volontiers pour vous, comme pèlerin, au saint sépulcre, en terre sainte, dans toutes les églises, et j’en rapporterai des pardons en abondance. Ils serviront au bien de votre âme, et il en restera pour votre père et votre mère, afin qu’ils profitent aussi de ce bienfait dans la vie éternelle. Qui n’en a pas besoin ? Je vous honore, comme si vous étiez le pape, et je vous fais le serment le plus sacré d’être dès ce jour et pour jamais entièrement à vous avec tous mes parents. Tous ils vous serviront sans cesse. Je le jure. Ce que je ne promettrais pas au roi lui-même, je vous en fais hommage. Acceptez-le, et vous aurez un jour la souveraineté du pays. Tout ce que je sais attraper, je vous l’apporterai : oies, poules, canards et poissons, avant d’en manger moi-même la moindre part ; je vous laisserai toujours le choix, à vous, à votre femme et à vos enfants. Je veux en outre veiller assidûment sur votre vie : aucun mal ne vous atteindra. On me dit malicieux et vous êtes fort : nous pourrons donc accomplir ensemble de grandes choses. Si nous restons unis, l’un ayant la force, l’autre l’adresse, qui pourra nous vaincre ? Si nous combattons l’un contre l’autre, nous avons tort. Je ne l’aurais jamais fait, si j’avais pu convenablement éviter le combat. Vous m’avez défié, et l’honneur me faisait une loi de m’y résoudre. Mais je me suis conduit avec courtoisie, et, pendant le combat, je n’ai pas montré toute ma force. « Tu te feras un grand honneur, me disais-je, en épargnant ton oncle. » Si je vous avais haï, les choses seraient allées autrement. Vous avez souffert peu de mal, et si, par inadvertance, je vous ai blessé un œil, j’en suis affligé sincèrement. Mais j’ai une excellente ressource : je connais le moyen de vous guérir, et je vous le communiquerai : vous m’en ferez des remercîments. Quand même l’œil serait perdu, pourvu d’ailleurs que vous soyez guéri, ce sera toujours pour vous une facilité. Quand vous irez dormir, vous n’aurez à fermer qu’une fenêtre, tandis que nous autres nous devons en fermer deux. Pour vous apaiser, mes parents s’inclineront sur-le-champ devant vous ; sous les yeux du roi, en présence de cette assemblée, ma femme et mes enfants vous prieront et vous supplieront de me faire grâce et de me donner la vie. Ensuite je déclarerai publiquement que j’ai parlé contre la vérité, et que je vous ai outragé par des mensonges, que je vous ai trompé autant que j’ai pu. Je promets de jurer que je ne connais de vous aucun mal, et que je ne songerai plus à vous offenser de ma vie. Comment pourriez-vous jamais demander une plus grande expiation que celle à laquelle je suis prêt ? Si vous me mettez à mort, qu’est-ce que vous y gagnerez ? Vous avez toujours à craindre mes parents et mes amis. Au contraire, si vous m’épargnez, vous sortirez du champ clos avec honneur et gloire ; vous paraîtrez à chacun noble et sage : car personne ne peut s’élever plus haut que lorsqu’il pardonne. Une occasion pareille ne s’offrira pas à vous de sitôt : profitez-en ! Au reste, il m’est, à cette heure, tout à fait indifférent de vivre ou de mourir.
– Renard trompeur, répliqua le loup, que tu serais joyeux de m’échapper ! Mais, quand le monde serait d’or, et que tu me l’offrirais dans ta détresse, je ne te lâcherai pas. Tu m’as déjà fait tant de frivoles serments, perfide camarade ! Certainement, si je te laissais aller, je n’en aurais pas une coquille d’œuf. Je me soucie fort peu de tes parents. J’attendrai l’effet de leur puissance, et je porterai, je pense, assez facilement le poids de leur haine. Méchant, qui te plais à nuire, comme tu te moquerais de moi, si je te relâchais sur ta parole ! Qui ne te connaîtrais pas serais trompé. Tu m’as épargné, dis-tu, aujourd’hui, méchant voleur : et n’ai-je pas un œil pendant hors de la tête ? Scélérat, ne m’as-tu pas déchiré la peau en vingt endroits ? Et pouvais-je seulement reprendre haleine, quand tu avais l’avantage ? Ce serait agir follement de t’accorder, pour le dommage et l’opprobre, grâce et miséricorde. Traître, tu nous as causé, à moi et à ma femme, honte et préjudice : il t’en coûtera la vie. »
Ainsi disait le loup, Cependant le fripon avait porté son autre patte entre les cuisses de son adversaire : il le saisit par les parties sensibles, et le pressa, le tirailla cruellement… Je n’en dis pas davantage. Le loup se mit à crier et hurler pitoyablement, la gueule béante. Reineke retira vite la patte de ses dents, qui l’avaient serrée. Avec les deux pattes, il saisit le loup toujours plus fort ; il pinça, il tira. Le loup hurlait et criait avec une telle violence, qu’il commença de cracher le sang. De douleur, il suait par tout son corps ; il fientait d’angoisse. Le renard en fut bien joyeux : maintenant il espérait le vaincre. Il tenait toujours, avec les pattes et les dents, le loup, qui sentait de grandes souffrances, de grandes tortures. Il se jugeait perdu. Le sang coulait de sa tête, de ses yeux ; il tomba par terre, ne se connaissant plus. Le renard n’aurait pas donné ce moment pour tout l’or du monde. Il tenait toujours le loup serré, le traînait, le tirait, en sorte que tout le monde voyait sa détresse ; il pinçait, pressait, mordait, égratignait le malheureux, qui, poussant des hurlements sourds, se roulait dans la poussière et dans son ordure, avec des convulsions et des gestes étranges.
Ses amis poussaient des gémissements ; ils prièrent le roi d’arrêter le combat, si tel était son plaisir, et le roi répondit :
« Si vous le jugez tous convenable, si vous désirez tous qu’il en soit ainsi, je le veux bien. »
Et le roi commanda que les deux juges du camp, Lynx et Lupardus, se rendissent auprès des deux champions ; et ils entrèrent dans la lice, et, s’adressant à Reineke vainqueur, lui dirent que c’en était assez ; que le roi désirait arrêter le combat, et voir la lutte finie.
« Il demande, poursuivirent-ils, que vous lui abandonniez votre ennemi, que vous laissiez la vie au vaincu. Car, si l’un des adversaires était tué dans ce combat singulier, ce serait fâcheux pour chaque parti. Vous avez l’avantage ; petits et grands, tout le monde l’a vu. Les personnes les plus distinguées vous donnent elles-mêmes leur approbation : vous les avez gagnées pour toujours. »
Reineke répondit :
« Je leur en témoignerai ma reconnaissance. Je me soumets de bon cœur à la volonté du roi, et je fais avec plaisir ce qui convient. J’ai vaincu, et je ne souhaite pas avoir de ma vie un plus beau triomphe. Que le roi me permette seulement de consulter mes amis. »
Alors tous les amis de Reineke s’écrièrent :
« Il nous paraît bon d’accomplir sur-le-champ la volonté du roi. »
Et tous les parents du vainqueur, le blaireau, le singe, la loutre, le castor, accoururent par troupes auprès de lui. Au nombre de ses amis furent dès lors aussi la martre, la belette, l’hermine et l’écureuil, et beaucoup d’autres, qui l’avaient haï, qui ne voulaient pas autrefois articuler son nom, accoururent tous à lui. Il s’en trouva même qui l’avaient accusé jadis, et qui venaient comme parents, et amenaient leurs enfants et leurs femmes, grands, moyens, petits, et jusqu’aux tout petits : chacun le félicitait, le flattait et ne pouvait en finir.
Il en va toujours ainsi dans le monde. On dit à l’homme heureux : « Soyez longtemps en santé ! » Il trouve des amis en foule. Mais, s’il tombe dans la disgrâce, qu’il prenne patience ! C’est ce qui arriva dans cette conjoncture. Chacun voulait être le plus proche et se pavaner à côté du vainqueur. Les uns jouaient de la flûte, les autres chantaient, sonnaient de la trompette ou battaient des timbales. Les amis de Reineke lui disaient :

« Réjouissez-vous : vous avez relevé en ce moment vous et votre race. Nous étions fort affligés de vous voir succomber, mais la chance a tourné bientôt ; la pièce était excellente. »
Reineke répondit :
« J’ai réussi. »
Et il remercia ses partisans. Ils s’avancèrent ainsi en grand tumulte, et, à leur tête, Reineke, avec les juges du camp. Ils arrivèrent devant le trône du roi. Le vainqueur se mit à genoux. Le roi lui ordonna de se relever, et il dit en présence de tous les seigneurs :
« Vous avez bien défendu votre vie ; vous avez soutenu votre cause avec honneur : c’est pourquoi je vous déclare absous. Vous êtes exempt de toute peine. Je veux en conférer prochainement dans le conseil avec mes nobles serviteurs, aussitôt qu’Ysengrin sera guéri. Aujourd’hui je déclare l’affaire terminée.
– Monseigneur, répondit Reineke avec modestie, il est salutaire de suivre vos conseils. Vous le savez fort bien, quand je vins ici, beaucoup de gens m’accusaient. Ils mentaient, pour flatter le loup, mon puissant ennemi, qui voulait me perdre, qui me tenait presque en son pouvoir. Les autres criaient : « Crucifie-le. » Ils m’accusaient avec lui, uniquement pour me réduire à l’extrémité, pour lui complaire. Car ils pouvaient tous observer que le loup était mieux placé auprès de vous que moi ; et nul ne songeait à la fin, ni à ce que pouvait être la vérité. Je les compare à ces chiens qui avaient coutume de se tenir en foule devant la cuisine, espérant que le cuisinier, bien disposé, songerait aussi à leur jeter quelques os. Les chiens qui attendaient virent un de leurs camarades, qui avait dérobé au cuisinier un morceau de viande bouillie, et qui, pour son malheur, ne s’était pas enfui assez vite : car le cuisinier l’arrosa par derrière d’eau bouillante, et lui échauda la queue, Cependant il ne laissa pas tomber sa proie ; il se mêla parmi ses frères, qui se dirent entre eux : « Voyez comme le cuisinier le favorise plus que tous les autres ! Voyez quel excellent morceau il lui a donné ! » Et le chien répliqua : « Vous n’êtes pas bien au fait : vous me félicitez et me vantez par devant, où vous êtes séduits sans doute, à la vue de la chair succulente ; mais observez-moi par derrière, et déclarez-moi heureux, si vous ne changez pas d’avis. »

L’ayant considéré, ils le virent horriblement brûlé, les poils tombaient, la peau se ridait sur le corps. Ils furent saisis d’un frisson ; nul ne voulut approcher de la cuisine ; ils s’enfuirent et le laissèrent seul. Monseigneur, ce sont les gens avides que j’ai ici en vue. Aussi longtemps qu’ils sont puissants, chacun désire de les avoir pour amis ; on les voit à toute heure porter de la chair à la bouche ; qui ne s’accommode pas à leurs façons en doit pâtir ; il faut les louer sans cesse, si mal qu’ils agissent, et, par là, on ne fait que les affermir dans leur coupable conduite : ainsi fait toute personne qui ne considère pas la fin. Mais, le plus souvent, ces personnages sont punis, et leur puissance finit tristement. Personne ne les souffre plus ; les poils leur tombent du corps à droite et à gauche : je veux dire que les anciens amis, petits et grands, les abandonnent, les laissent dépouillés, comme tous les chiens quittèrent sur-le-champ leur camarade, quand ils virent son mal et la moitié de son corps outrageusement blessée. Monseigneur, vous m’entendez, on ne parlera jamais ainsi de Reineke : mes amis ne rougiront pas de moi. Je suis infiniment obligé à Votre Grâce, et, si seulement je pouvais toujours connaître votre volonté, je l’accomplirais avec joie.
– Beaucoup de paroles sont inutiles, répondit le roi. J’ai tout entendu et j’ai compris votre pensée. Je veux vous revoir, noble baron, vous revoir, comme autrefois, dans le conseil ; je vous fais un devoir de visiter à toute heure mon conseil secret ; je vous rétablis pleinement dans vos honneurs et votre crédit, et vous le mériterez, j’espère. Aidez-moi à tout conduire pour le mieux. Je ne puis me passer de vous à la cour, et, si vous unissez la vertu avec la sagesse, personne ne vous surpassera en dignité, et ne donnera des conseils et des directions plus habiles et plus sages. Je n’écouterai plus à l’avenir de plaintes contre vous. Vous parlerez toujours à ma place et vous agirez comme chancelier du royaume. Que mon sceau vous soit donc remis. Ce que vous ferez, ce que vous écrirez, restera fait et écrit. »

C’est ainsi que Reineke s’est élevé honnêtement à la plus haute faveur : on obéit à tout ce qu’il conseille et résout pour favoriser ou pour nuire.
Reineke remercia le roi et dit :
« Mon noble sire, vous me faites trop d’honneur : je veux le reconnaître, comme j’espère conserver le jugement. Vous en ferez l’expérience. »
Que devenait le loup sur ces entrefaites ? Quelques mots nous l’apprendront. Il était gisant dans la lice, blessé et maltraité.
Sa femme et ses amis accoururent ; Hinze, le chat, Brun, l’ours, et ses enfants, et sa séquelle, et ses parents, le placèrent, en gémissant, sur un brancard (on l’avait rembourré de foin pour tenir au chaud le malade) et l’emportèrent hors du champ clos. On examina les blessures : on en compta vingt-six.
Il vint des chirurgiens en nombre, qui le pansèrent sur-le-champ et lui firent prendre des élixirs. Tous ses membres étaient paralysés. Ils lui frottèrent aussi l’oreille avec des herbes ; il éternua violemment par devant et par derrière. Ils se disaient entre eux :
« Il faut le baigner et le frotter d’onguent. »
Ils consolaient comme cela le triste entourage du loup. Ils le mirent au lit avec grand soin. Il dormit, mais peu de temps ; il s’éveilla troublé et s’affligea ; la honte, la douleur, le poursuivaient ; il faisait de grands gémissements et semblait désespéré. Giremonde le veillait avec soin, le cœur dolent : elle songeait à sa grande perte. Agitée de peines diverses, elle pleurait sur elle, sur ses enfants et ses amis ; elle observait son mari souffrant. Il ne pouvait absolument se surmonter. La douleur le rendait furieux ; la douleur était grande et les suites déplorables.
Mais Reineke était fort satisfait ; il causait gaiement avec ses amis, et s’entendait vanter et louer. Il partit de là avec une fière assurance. Le gracieux roi le fit accompagner d’une escorte, et lui dit, avec bienveillance, en lui donnant congé :
« Revenez bientôt. »
Le renard se prosterna devant le trône et répondit :
« Je vous remercie de tout mon cœur, ainsi que ma gracieuse dame, et votre conseil, et les seigneurs. Que Dieu vous conserve, mon roi, pour vous combler de gloire ! Ce que vous ordonnerez, je le ferai avec joie. Je vous aime certainement, et je vous dois mon amour. Maintenant, si vous le permettez, je me dispose à me rendre chez moi, pour voir ma femme et mes enfants. Ils sont dans l’attente et le deuil.
– Allez, répondit le roi, et ne craignez plus rien. »
C’est ainsi que Reineke s’éloigna, après être parvenu à la plus haute faveur. Il en est beaucoup de son espèce, qui savent employer les mêmes artifices. Ils ne portent pas tous barbe rousse, mais ils sont en bonne position.
Reineke partit fièrement de la cour avec sa famille, avec quarante parents, qui mettaient en lui leur honneur et leur joie. Il s’avançait le premier, comme un seigneur ; les autres le suivaient. Il se montrait de joyeux courage ; sa queue s’était élargie. Il avait gagné la faveur du roi ; il était rentré au conseil, et songeait à la manière d’en tirer avantage.
« Ceux que j’aime s’en trouveront bien et mes amis en profiteront, se disait-il : la sagesse est plus à respecter que l’or. »
Accompagné de tous ses amis, il prit donc la route de Maupertuis, le château. Il témoigna sa reconnaissance à tous ceux qui l’avaient favorisé, qui étaient demeurés à ses côtés dans les temps difficiles. Il leur offrit ses services à son tour. Ils le quittèrent, et chacun rejoignit sa famille ; et lui, il trouva, dans sa demeure, sa femme Ermeline. Elle le salua avec joie ; elle lui demanda des nouvelles de sa fâcheuse affaire, et comment il avait encore échappé. Reineke répondit :
« Eh bien, j’ai réussi ! J’ai regagné la faveur du roi. J’assisterai au conseil comme autrefois, et cela tournera à l’honneur de toute notre race. Il m’a nommé, devant tout le monde, chancelier du royaume, et m’a remis le sceau. Tout ce que Reineke fera et écrira sera, pour toujours, bien fait et bien écrit. Que chacun en garde mémoire.
« J’ai fait au loup sa leçon en quelques minutes, et il ne m’accusera plus. Il est éborgné, blessé, et toute sa race couverte d’opprobre. Je l’ai marqué. Il ne sera désormais guère utile au monde. Nous avons combattu et je l’ai vaincu. Il aura même de la peine à se guérir. Eh ! que m’importe ? Je demeure son supérieur, comme celui de tous ses amis et ses partisans. »

La femme de Reineke éprouva beaucoup de joie. Leurs deux petits garçons sentirent aussi croître leur courage, en voyant l’élévation de leur père. Ils se disaient l’un à l’autre, gaiement :
« Nous allons passer d’heureux jours, honorés de tout le monde. Cependant nous songerons à fortifier notre château et à mener une vie joyeuse et tranquille. »
Reineke est maintenant très honoré.
Que chacun se convertisse promptement à la sagesse, évite le mal, honore la vertu ! C’est le sens de l’ouvrage, dans lequel le poète a mêlé la fable avec la vérité, afin que vous puissiez distinguer le mal du bien et priser la sagesse, et aussi pour que les acheteurs de ce livre apprennent tous les jours à connaître le train du monde. Car c’est ainsi qu’il est fait, ainsi qu’il restera.
Et voilà comme finit notre poème des faits et gestes de Reineke.
Veuille le Seigneur nous recevoir dans sa gloire éternelle ! Amen.
