
Paul d’Ivoi
LA CAPITAINE NILIA
Voyages excentriques – Volume VI
(1898)
Table des matières
PREMIÈRE PARTIE LE SECRET DE L’ANGLETERRE
CHAPITRE PREMIER UN FILS EN DEUX PERSONNES
CHAPITRE II UNE VOITURE MYSTÉRIEUSE
CHAPITRE III CONSEIL DE GUERRE
CHAPITRE IV JACK EST TIRÉ À HUE ET À DIA
CHAPITRE V L’ÎLE DE PYLAK (PHILOE)
CHAPITRE VI IDYLLE AVEC L’INVISIBLE
CHAPITRE VII LA MOUCHE SUR LE NEZ
CHAPITRE VIII OÙ HOPE DEVIENT SYNONYME DE « HOP ! »
CHAPITRE IX LE SIÈGE DU KARROVARKA
CHAPITRE XI LE TRÉSOR DES BAB-EL-ARBA
CHAPITRE XII LA FUITE AU DÉSERT
DEUXIÈME PARTIE LA GUERRE DE L’EAU
CHAPITRE PREMIER LE BAHR-EL-GHAZAL
CHAPITRE III TOURELLES D’ACIER, CŒURS DE DIAMANT
CHAPITRE IV LE PACTE DE TRAHISON
CHAPITRE V DEUX FRÈRES, DEUX PATRIES
CHAPITRE VIII LE SECRET DE L’ANGLETERRE.
CHAPITRE X COMBATS D’ERMENT ET D’EL MELAHIEH
CHAPITRE XI LA REVANCHE DE WATERLOO
À propos de cette édition électronique
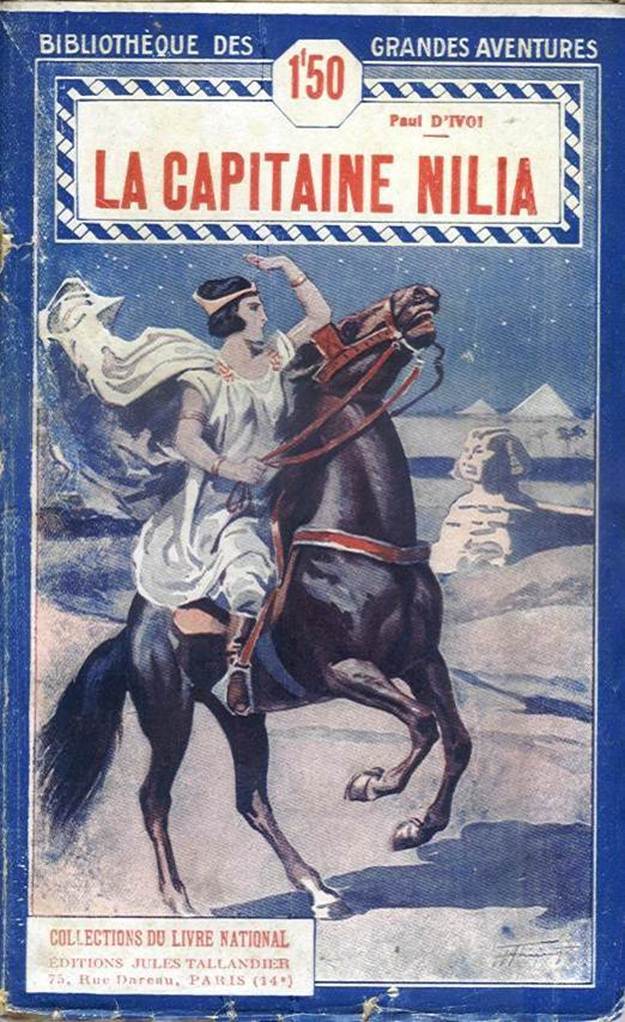
À
M. LE COMMANDANT J. MARCHAND
Mon Commandant, nous rêvons, l’un et l’autre, de victoires futures. J’ai écrit mon rêve. Laissez-moi vous le dédier comme un faible témoignage des sentiments de votre admirateur, de votre ami.
PAUL D’IVOI.
PREMIÈRE PARTIE
LE SECRET DE L’ANGLETERRE

CHAPITRE PREMIER
UN FILS EN DEUX PERSONNES
– Ah ! Jack ! Si j’avais la certitude que vous n’êtes pas mon fils, quel soufflet vous recevriez !
Cette étrange proposition était formulée par mistress Price, cuisinière en chef du Sirdar ou général anglais Lewis Biggun, commandant l’armée britannico-égyptienne chargée d’opprimer la vallée du Nil au profit des marchands de Londres.
Elle comptait quarante-cinq printemps, mistress Price et, signe d’une vocation culinaire bien caractérisée, elle était ronde, ronde comme un de ces « puddings » si appréciés par ses compatriotes.
Très douce d’humeur ordinairement, sa voix, ses gestes trahissaient à cette heure une irritation non contenue. Elle marchait à grands pas dans l’immense cuisine où se passait la scène. Sous sa démarche pesante, le carrelage blanc et noir gémissait et les innombrables casseroles de cuivre, accrochées à la muraille, tremblotaient avec un bruissement métallique du plus menaçant effet.
Deux jeunes gens d’une vingtaine d’années l’écoutaient. L’un grand, efflanqué, blond pâle, doué d’yeux bleus à reliefs d’acier, de grandes mains osseuses, de longs pieds étroits ; l’autre de taille moyenne, portant une fine moustache, noire comme ses cheveux ; le premier raide et gourmé, le teint blanc et rose des hommes du Nord ; le second souple et gracieux, la peau claire de ton, mais ayant cette matité particulière aux races nées dans les pays aimés du soleil.
– Oui, Jack, reprit la cuisinière en s’adressant à celui-ci. C’est indigne, antipatriotique d’oser soutenir, dans le « home » du général, que le cognac de France est préférable au wiskey du comté d’Essex. Mon sang anglais n’a fait qu’un tour, et je le répète, si j’avais eu l’assurance que vous n’êtes pas le fils né de moi…
Sa main distribua dans l’air une formidable gifle, complétant ainsi sa pensée. Jack eut un bon sourire.
– Moi, maman, je n’ai pas de doute. Je vous aime trop pour ne pas être votre enfant. Mais que cela ne vous arrête pas, et si le don d’une calotte doit vous rendre le calme, frappez, maman, voici ma joue.
À ces paroles empreintes de la plus affectueuse soumission, la colère de mistress Price tomba comme par enchantement. Elle vint au jeune homme, le pressa dans ses bras :
– Tu as raison, mon Jack, tu es meilleur que moi… tu es mon enfant, tu l’es… Ah ! câlin… va… je serais trop triste de voir en toi un étranger… Dire que tout petit, tu faisais déjà de moi tout ce que tu voulais.
Mais une voix sèche interrompit ses effusions.
– Voudriez-vous dire que je suis un intrus dans cette maison, ma mère ?
La pauvre femme s’arrêta net. Elle tourna les yeux vers le grand blond :
– Non, John, non. Toi aussi, tu es mon fils chéri.
Boudeur, l’interpellé répondit en appuyant sur les mots :
– Je ne puis pas être aussi votre fils. Vous n’êtes mère que de l’un de nous. Je suis ou ne suis pas, mais il m’est impossible d’accepter le partage.
– Oh ! John, fit Jack d’un ton de reproche. Notre mère…
– Ma mère, rectifia l’autre, ou votre mère… pas notre…
– Voyons, frère.
– Pas frère, je ne veux pas.
Un geste d’impatience échappa à Jack et, vivement :
– Que tu le veuilles ou non, il faut que nous soyons frères pour la tranquillité de celle qui nous a élevés, qui s’est dévouée à nous. Elle n’a donné le jour qu’à un de nous… Eh bien ! qu’en nous voyant unis dans une même tendresse pour elle, il lui semble que tous deux nous sommes ses enfants.
– Oui, oui, bégaya mistress Price en se laissant tomber sur une chaise.
Elle avait les yeux remplis de larmes.
D’un bond, Jack fut auprès d’elle, il s’agenouilla, lui prit les mains.
– Ne pleurez pas, bonne mère, ne pleurez pas. John comprendra. Il est jaloux, mais cela passera. Il n’a pas encore pu s’habituer… Songez qu’il y a huit jours à peine, le jour même où nous atteignîmes notre vingtième année, que vous nous avez dit le mystère planant sur notre parenté.
– Vous vous trompez, je ne comprendrai jamais, protesta rudement le blond jeune homme. Et pour commencer, je vous prie de ne pas confisquer ainsi les mains de ma mère.
– Prends-en une, John, et agenouille-toi comme moi.
– Je les veux toutes deux.
– C’est encore possible, frère. Tiens, je place mes mains sur les genoux de maman, elle va poser les siennes dedans et toi-même, tu les couvriras des tiennes. Comme cela, chacun de nous aura les deux mains de maman.
– Bon Jack, soupira mistress Price.
John frappa le sol d’un violent coup de talon.
– Bon Jack, joli Jack. Voilà tout ce que vous savez dire. Et cependant, il vous suffirait de nous regarder pour reconnaître votre fils. Mon père était, au physique et au moral, un bon Anglais comme moi… tandis que Jack est un Français de goûts et d’apparence…
Exprimer le dédain contenu dans ces derniers mots est impossible.
– Français, moi… !
Mais mistress Price interrompit Jack :
– Votre père, John, avait vécu longtemps en France, et il aimait beaucoup ce pays et ses usages.
– C’est pour cela, fit ironiquement le jeune homme, que Jack préfère le vin à l’eau, que tandis que j’apprenais la boxe nationale, il étudiait la « savate française », qu’il lit Victor Hugo plutôt que Milton, La Fontaine et Molière, plutôt que Shakespeare ou Sheridan, Alexandre Dumas plutôt que Walter Scott. Monsieur dédaigne le pudding, chante les louanges de la pâtisserie française… Tout à l’heure encore, il donnait le pas au cognac sur le wiskey. En politique, c’est la même chose. N’affirmait-il pas encore, l’autre soir, que notre occupation de l’Égypte, où nous sommes en ce moment, était un abus de la force.
– Ma foi, répliqua l’interpellé, si les Égyptiens envahissaient l’Angleterre, que dirais-tu ?
– Là, vous le voyez… comme si l’Angleterre et l’Égypte pouvaient être comparées… Enfin, pour conclure… je ressemble à mon père… je suis blond-saxon, comme lui n’est-ce pas ?
Tristement mistress Price secoua la tête.
– Je l’ai cru longtemps, dit-elle d’une voix faible, jusqu’à l’heure où nous dûmes entrer en service chez lord Camatogan de Grosvenor Square…
– Que signifient ces paroles ?
La cuisinière leva les yeux au ciel.
– Ceci… Quand j’épousai feu votre père, il était blond, ainsi que vous, John.
– Ah ! ah ! articula ce dernier d’un ton de triomphe.
– Attendez… Il était blond, grâce à une teinture connue… le Régénérateur de la chevelure Imperial Eaton. À vingt ans, le pauvre Price avait éprouvé une grande frayeur et ses cheveux avaient blanchi en une nuit. Il me l’avoua, lorsque nous dûmes entrer chez lord Camatogan… Ce seigneur ne voulait que des serviteurs bruns, les jugeant plus actifs. La place était bonne, Price n’hésita pas. Abandonnant l’Imperial Eaton, il usa du capillaire Victoria Windsor et devint noir, noir comme Jack.
Devant cette articulation, les frères demeurèrent un instant interdits, mais John se ressaisit presque aussitôt.
– Avant de se teindre, vous devez le savoir, mon père était ou blond ou brun ?
– Ni l’un ni l’autre… il était châtain.
Du coup, Jack se prit à rire, tandis que John, en proie à une véritable rage, fourrageait d’une main impatiente la toison d’or qui couvrait son crâne.
– Ainsi, gronda-t-il, la vérité ne peut être connue. Je serai condamné à demeurer toujours votre demi-fils, à me contenter de la demi-affection d’une moitié de mère. Non, cela ne sera pas. Par Satan, je saurai. Je veux tout ou rien, suivant la noble devise de la vieille Angleterre… Ma mère – et il appuya vigoureusement sur ces mots – lorsque vous nous avez adoptés tous deux… vous étiez troublée, bouleversée… Vous avez pu ne pas tenir compte d’une circonstance importante. Rassemblez vos souvenirs, et contez-nous de nouveau l’aventure néfaste qui dédoubla votre fils. Le voulez-vous ?
Mistress Price joignit les mains et, d’une voix mal assurée :
– Certes, je le veux, bien que mon cœur se déchire à la pensée de devoir choisir entre vous.
Elle s’assit d’un air accablé et lentement parla ainsi :
– En quittant lord Camatogan, votre père et moi passâmes au service de Lewis Biggun, aujourd’hui Sirdar, alors capitaine dans l’armée des Indes, en résidence à Bombay. À peine installée dans la ville hindoue, j’eus une grande peine et une grande joie. Votre père trépassa à la suite d’un accès de fièvre pernicieuse et je devins mère de l’un de vous.
La digne femme porta son mouchoir à ses yeux et reprit :
– Mais les tribus du Radjpoutana étaient en pleine révolte. Sir Biggun fut désigné pour faire partie d’une colonne envoyée contre eux, et moi, sa cuisinière, dont il appréciait fort les talents, je dus suivre l’armée avec les bagages et les provisions. Ah ! fit-elle, les cantines du capitaine étaient bien garnies et j’étais fière de ma cave et de mon office ambulants.
– Passons, passons, grommela John avec impatience.
– Soit, continua mistress Price d’un ton soumis. Celui de vous qui était mon fils alors – il avait deux mois – ne pouvait être exposé aux fatigues d’une longue campagne. Je lui cherchai une nourrice et l’installai à quelques kilomètres de la ville, au hameau d’Aghaabad, chez une veuve de la caste des potiers du nom d’Oriemi. Elle occupait la septième maison sur la route ; je la vois encore, avec sa cour pleine de fleurs, entourée d’un mur bas de pisé ; la cabane contenait deux pièces au sol de terre battue et aux murailles blanchies sur lesquelles un artiste naïf avait gravé à la pointe des versets des Védas, ces livres saints de l’Inde brahmanique.
– Pauvre mère, soupira doucement Jack en lui jetant les bras autour du cou.
John haussa les épaules, et presque durement :
– Continuez, je vous prie.
– Nous partîmes. Nous pensions être absents quelques semaines, la campagne dura deux ans. Enfin les armes anglaises courbèrent sous le devoir les rebelles du Radjpoutana et nous rentrâmes à Bombay, sir Biggun ayant conquis le grade de major. Là, une affreuse nouvelle m’attendait. La peste, ce fléau de l’Inde, avait ravagé la contrée. Les habitants épargnés avaient fui, désertant leurs demeures, cédant la place au mal… Mon enfant est mort, pensai-je, je n’ai plus de fils. Vite, je louai une petite voiture et, fouettant le cheval, je filai au grand trot vers Aghaabad.
Mistress Price se tut un instant, comme pour dominer son émotion.
– Ah ! mes chers enfants, quel spectacle. La campagne déserte, les herbes folles couvrant les champs naguère cultivés. De loin en loin, au bord de la route, un corps humain, pestiféré, que le mal avait terrassé là et que nul ne songeait à ensevelir. J’allais toujours, fermant les yeux, demi-folle d’épouvante, mais poussée en avant par une force irrésistible… Enfin j’aperçois le groupe de cabanes formant le hameau. J’entre dans la rue silencieuse, abandonnée. Comme impressionné par la solitude, le cheval a ralenti le pas. Il s’arrête de lui-même devant la septième maison. Ô joie ! le jardin est constellé de fleurs ; la porte de la cabane est ouverte… la veuve Oriemi doit être là. J’appelle. Rien. J’appelle encore, sentant mon angoisse revenir ; ma voix s’étrangle dans ma gorge… Personne ne répond. Alors je saute à terre, je pénètre dans la cour, je contourne un massif de lauriers en fleurs et je vois, étendue en travers du sentier, la face marbrée de taches noires, immobile, morte… la pauvre nourrice Oriemi. La peste avait passé par là.
» J’aurais dû m’évanouir devant un tel spectacle. Pas du tout, il semble que l’horreur de la situation stimule mon courage. Je franchis le cadavre d’un bond, je cours à la cabane, j’entre. La première pièce est vide, je la traverse… Dans la seconde, j’aperçois un lit d’enfant, dont l’épaisse moustiquaire est fermée. Je m’arrête un instant, je n’ose soulever l’étoffe qui me cache la couche. Que verrai-je, si je regarde ? Mon petit Jean, car il se nommait Jean, est-il mort comme Oriemi, comme tous ceux que j’ai rencontrés sur la route ? Peut-être,… mais peut-être aussi, il vit. Je pourrais l’emporter dans mes bras, le sauver… J’étends la main vers l’étoffe ; d’un geste brusque j’écarte le frêle obstacle, et je reste interdite, stupéfaite !
» Dans le lit sont deux enfants, de même taille, de même âge. Ils dorment, roses, souriants, bien portants, insoucieux de la peste qui fauche autour d’eux.
» Je ne réfléchis pas, je les prends tous deux dans mes bras. Ils ouvrent les yeux et tous deux me sourient. Et tout à coup, une terrible indécision m’envahit… Lequel est mon fils ? Lequel est mon Jean ? »
Mistress Price s’était dressée en prononçant ces dernières paroles… Ses regards humides se portaient alternativement sur John et sur Jack…
– Depuis vingt ans, termina-t-elle, j’attends la réponse à cette question. J’appris plus tard qu’une dame française était arrivée à Bombay, peu après mon départ pour le Radjpoutana. Elle avait confié son petit garçon à Oriemi, puis elle avait disparu et personne ne savait ce qu’elle était devenue.
» Que pouvais-je faire ? J’avais tremblé d’avoir à pleurer mon fils, la destinée généreuse, au lieu d’un, m’en rendait deux. Je vous réunis dans la même tendresse. Chacun de vous fut mon Jean, et puisqu’en anglais nous avons deux mots pour dire Jean : John et Jack, l’un de vous fut John, l’autre fut Jack ; toujours mon Jean bien-aimé en deux personnes. »
Jack se jeta au cou de l’excellente femme, tandis que John se retirait à l’écart, boudeur et pensif. Sans doute, le blond jeune homme se préparait à continuer la discussion, mais une sonnerie retentissante coupa court à ses dispositions belliqueuses.
– Le Sirdar appelle ! s’écria mistress Price.
Aussi vite que le lui permettait son embonpoint, elle se précipita hors de la cuisine.


CHAPITRE II
UNE VOITURE MYSTÉRIEUSE
Dans un grand salon, dont les hautes portes vitrées, découpées en trèfle donnaient sur le jardin, où les arbres d’Europe et les gommiers égyptiens étaient dominés par le fût élancé des palmiers, le Sirdar Lewis Biggun attendait.
Grand, osseux, le visage dur encadré de favoris blonds striés de fils d’argent, le commandant général de l’armée anglo-égyptienne se frottait les mains d’un air satisfait, en regardant, du coin de l’œil, un petit homme vautré dans un fauteuil à bascule.
Très laid, celui-ci, avec son crâne chauve, son visage terreux, son nez crochu surmonté de lunettes bleues. Et sale ! Une vieille redingote, irrémédiablement brouillée avec la brosse, couverte sur les épaules d’une couche de poussière grise ; un pantalon noir, usé à la place des genoux et agrémenté d’un petit travail de hachures qui indiquait chez son propriétaire l’habitude invétérée d’essuyer en cet endroit sa plume trop chargée d’encre ; des souliers lourds, jadis jaunes, maintenant sans forme et sans couleur, complétaient le costume peu galant du personnage. À terre, devant lui, il avait posé son chapeau, un haut-de-forme ébouriffé, roussi par un long usage.
Une porte s’ouvrit et mistress Price parut, s’efforçant vainement de donner à sa volumineuse personne la forme respectueuse d’un arc de cercle, attitude convenable de tout domestique bien stylé qui se présente devant son maître.
– Milord a bien voulu me sonner ? dit-elle, toujours inclinée.
– Oui, ma bonne Price. Je veux mettre votre dévouement à l’épreuve…
– Voilà vingt ans qu’il subit l’épreuve du feu devant mes fourneaux, Milord.
– Je le sais, Price, je le sais : vous êtes une bonne créature. Nous devions déjeuner dans deux heures…
– À midi moins sept minutes, suivant la coutume de Votre Honneur.
– Eh bien, aujourd’hui, je désire déroger à la coutume.
Du coup, la cuisinière se redressa brusquement et regarda le général d’un air ébahi.
– Déroger… ?
– Cela vous surprend, Price… Croyez que des raisons sérieuses seules me décident à avancer l’heure de mon repas… Mais le service de l’Angleterre avant tout… Au demeurant, vous devez avoir des viandes froides, un en-cas toujours prêt.
– J’ai l’en-cas, Milord.
– Bien. Vous allez le ranger dans des paniers avec quelques bouteilles choisies… De quoi substanter deux personnes…
Mais, se reprenant vivement :
– Non trois, – et il ajouta avec un sourire en se tournant vers l’homme à la redingote râpée : Car le docteur Gorgius Kaufmann, qui me fait l’honneur de s’asseoir à ma table, a de l’appétit pour deux…
La cuisinière s’inclina et, d’une voix timide :
– Pour trois, facile… mais dans des paniers… pourquoi ?
– Parce que je vous le demande, ma chère… Autre chose, vous avez vos deux fils avec vous ?
– Oui, Milord.
– Très bien. Vous leur ferez porter les paniers en question auprès de la voiture de sir Gorgius… dans la grande cour. Là, ils attendront mes ordres. Allez.
Mistress Price pivota sur les talons et disparut.
Alors, le Sirdar vint se planter devant son invité :
– Vous avez entendu ?
– Oui, général. Il était impossible de commander mieux… j’ai failli éclater de rire lorsque vous m’avez gratifié d’un appétit « pour deux ».
– Alors, vous êtes satisfait ? reprit lord Biggun sans se dérider.
– Entièrement.
– Eh bien, tâchez que je le sois également.
– Vous le serez, mon digne lord, vous le serez.
– Tant mieux ! Car si vous vous étiez joué de l’Angleterre en ma personne, votre qualité de savant ne vous sauverait pas. Une cour martiale et les douze balles d’un peloton d’exécution…
L’homme aux lunettes bleues ne sourcilla pas.
– Entendu, fit-il légèrement. Mais si mes services sont ce que j’ai promis… ?
– Je m’engage, au nom de Sa Gracieuse Majesté, à vous récompenser magnifiquement.
Gorgius grimaça un sourire.
– Alors, je suis tranquille.
Sans s’inquiéter davantage de son interlocuteur, le bizarre personnage tira de sa poche un carnet graisseux, et sur une page blanche se mit à aligner des chiffres.
Cependant mistress Price avait regagné sa cuisine. Elle empilait dans deux paniers d’osier : viandes froides, hors-d’œuvre variés, flacons de vins blancs et rouges, liqueurs, etc., tout en racontant à ses fils ce qu’elle appelait « la lubie » du général.
– Bizarre ! bizarre ! s’écria Jack. Que peut bien avoir en tête lord Biggun ?
Avec un haussement d’épaules, son frère ricana :
– Curiosité de Français, toujours…
Cette fois, Jack fronça le sourcil :
– Écoute, John, je vais te faire une proposition bien anglaise. Au lieu de nous quereller sans cesse, nous allons « boxer » une bonne fois, et ce sera fini.
Mais son interlocuteur secoua la tête.
– Avec votre boxe française ou chausson, je serais battu d’avance.
– N’est-ce que cela ? Je ne me servirai pas des pieds… les poings seuls…
– Cela ne me suffit pas. Vaincu, vous auriez la ressource de prendre votre revanche… je ne vous dominerais pas.
– Tu ne voudrais pas que je passe ma vie à tes genoux ?
– Pardon, je le voudrais ; mais cela étant impossible, je n’engagerai pas la lutte. Tous nos grands hommes, depuis Nelson, jusqu’à Kitchener en passant par Wellington, l’ont dit : Il ne faut combattre qu’avec la certitude de la victoire complète et définitive.
À cette réplique monumentale, Jack riposta par un sourire. Aussi bien, les paniers de victuailles étaient prêts, bondés jusqu’aux anses par la sollicitude exagérée de mistress Price.
Chacun des frères en prit un, mais John s’empressa de sortir à grands pas, pour éviter la compagnie de Jack.
Celui-ci le regarda avec une nuance de tristesse. Était-il possible que l’affection qui, depuis vingt ans, l’unissait à son frère, s’évanouît ainsi ? Certes John n’avait jamais péché par excès de tendresse ; toujours une grande retenue présidait à ses manifestations affectueuses ; mais cela pouvait être attribué à son caractère réservé, à son tempérament froid. Tandis qu’aujourd’hui, il montrait une véritable animosité. Pourquoi ? L’amour d’une mère est un trésor inestimable, mais il ne rend ni avare ni jaloux. Qu’elle soit aimée le plus possible, la chère mère, voilà ce que doit souhaiter le fils reconnaissant.

Bien que ces réflexions eussent ralenti son pas, Jack rejoignit son frère dans la cour de la villa et brusquement :
– T’es bête, John, dit-il en appuyant amicalement la main sur l’épaule de son interlocuteur… Je t’aime bien, j’aime bien notre mère. Acceptons franchement une situation que nous n’avons pas créée et serrons-nous la main.
Peut-être son accent communiqua-t-il sa vibration au cœur du jaloux, car John répondit :
– Je vous secouerai la main, Jack. Mais, moins superficiel que vous, je conserverai au dedans de moi une blessure.
Les jeunes gens échangèrent une cordiale poignée de mains, et Jack souriant :
– Ta blessure se cicatrisera, frère. Moi je n’en ai ressenti aucune, non pas que je sois superficiel, comme tu le prétends, mais parce que j’ai trop d’amitié pour toi… ; cela me rend incapable de mauvaises pensées. Vois-tu, il en est de l’affection comme d’un plantureux repas… Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois.
Changeant brusquement de ton, il poursuivit :
– À propos, où est donc la voiture du docteur Gorgius Kaufmann.
– Je n’en vois pas trace.
– Cependant, maman nous a bien dit : dans la cour ?
– Elle l’a dit.
– Alors… ?
La cour était déserte ; mistress Price avait dû se tromper. Mais soudain, sur le perron du corps de logis principal, parut un domestique à la livrée du Sirdar. C’était un Maltais, à la figure rusée.
– Eh ! s’exclama Jack, voici Rocko, il nous renseignera.
Et, s’avançant vers lui :
– Rocko, où est le carrosse du docteur Gorgius… ?
– Je suis envoyé pour vous y conduire, maître Jack.
– Parfait… nous vous suivons.
Les jeunes gens reprirent les paniers qu’ils avaient déposés à terre.
– Le véhicule a été amené dans la grande allée du jardin, poursuivit le Maltais, ordre du Sirdar. C’est un wagon bizarre… je me demande comment il est venu s’échouer ici ?
– Que voulez-vous exprimer ? interrogea aussitôt Jack, surpris de l’intonation du domestique.
– Ceci. Il me semble que j’ai déjà vu ce car étrange.
– Vrai… où cela ?
– Au milieu de la mer Méditerranée.
Quel que fût son flegme, John s’arrêta net, tout comme son frère.
– Un chariot au milieu de la mer ?… Quelle plaisanterie !
– Pas du tout. Ce char-là va sur l’eau aussi bien que sur terre.
– Rocko… vous vous moquez de nous ?
– Non, non, affirma le Maltais. Vous regarderez la voiture. Les roues d’arrière sont garnies de palettes qui s’appliquent normalement sur les rayons, mais peuvent se redresser perpendiculairement, de façon à devenir de véritables « aubes », lorsque l’appareil devient un bateau.
– C’est un chariot-barque, alors ?
– Parfaitement… et électrique encore.
– Mais ce docteur Gorgius est un grand inventeur !
Le domestique sourit, sa figure chafouine se plissa d’innombrables rides.
– Un habile homme seulement.

– Habile ? Que voulez-vous dire ?
Le Maltais lança autour de lui un regard soupçonneux, puis, baissant la voix :
– Vous savez que j’ai été matelot. J’étais à bord d’un bâtiment qui faisait le service entre Marseille, Brindisi et Alexandrie.
– Eh bien ?
– Dans un de nos voyages, nous recueillîmes une embarcation bizarre, montée par des Français et une jeune Grecque, propriétaire de l’appareil. Celle-ci avait nom Anacharsia Taxidi[1].
– Après. Que vient faire cette jeune Grecque… ?
– Dans mon histoire ?… attendez. Son bateau, qu’elle appelait un Karrovarka, c’est-à-dire un chariot-barque, fut mis à la remorque, tandis que les passagers montaient à bord du steamer ; or, la nuit suivante, le câble qui retenait l’embarcation fut coupé, et, au jour, le karrovarka avait disparu, ainsi qu’un passager de 3e classe, inscrit sous le nom de : Otto Skoppen.
À ce moment, les trois hommes, ayant contourné l’aile droite de la résidence, entraient dans le jardin, dont le sable doré s’écrasait sous leurs pas avec un léger grésillement. Rocko s’était tu.
– Qu’avez-vous ? interrogea Jack.
Il y eut comme une hésitation sur le visage du Maltais, mais brusquement l’homme sembla prendre son parti :
– J’ai, fit-il d’une voix faible comme un souffle, que dans le nouvel ami du Sirdar, le savant Gorgius Kaufmann, j’ai cru reconnaître Otto Skoppen, et que sa voiture ressemble au karrovarka comme un grain de blé ressemble à un autre grain de blé.
John eut un rugissement étouffé. De sa main libre, il empoigna rudement le domestique et le secouant :
– Oseriez-vous insinuer que l’ami du général en chef est un voleur ?
Sous son étreinte, le Maltais pâlit.
– Je n’insinue rien, mister John, mais lâchez-moi, car vous serrez comme un crabe.
Et, le jeune homme ayant obtempéré à la requête, Rocko se mit prestement hors de portée avant d’ajouter :
– Seulement je ne pense pas qu’il y ait deux voitures semblables sous la voûte céleste, et j’en suis pour ce que j’ai dit : Le karrovarka s’est promené au milieu de la Méditerranée.
On atteignait à ce moment la large allée centrale, qui partageait le jardin par la moitié et aboutissait à la porte à claire-voie, dont les bois rejointoyés par un menuisier fantaisiste reproduisaient les lignes étranges, sculptées, il y a 4.000 ans, sur les pylônes des temples d’Hathor. Ces imitations sont du reste fréquentes en Égypte, ce pays unique dont on peut dire :
« Rien ne change là-bas. Qu’un moderne s’y installe, et en peu de temps, son goût, sa pensée, sa raison deviendront le goût, la pensée, la raison des contemporains des pharaons Khéops ou Kléphrem. Le Nil nourricier absorbe l’originalité étrangère ; il impose à tous la même façon. Il n’est pas seulement le père de l’Égypte, il est son âme ; et c’est cette âme, respirée dans la corolle des lotus, dans les bouffées brûlantes du vent soufflant des déserts, cette âme entendue dans le rythme berceur des eaux, dans les mélopées traînantes des fellahs, vue dans les profondeurs bleues du ciel, où le soleil flamboie comme l’œil justicier d’Osiris ; c’est cette âme qui éteint l’âme du conquérant, qui la conquiert à son tour. Il semble que le sphinx éternel, si magistralement chanté par Georges Fragerolle, pétrit à son image les migrations successives du monde. »
Mais ni Jack ni son frère n’eurent à ce moment de semblables pensées. Sous leurs yeux, au milieu de l’allée, se dressait un véhicule étrange.
On eût dit un de ces longs wagons affectés au service des grands express européens, ou bien encore un bateau dont l’avant affectait la forme menaçante d’un éperon.
Fait de plaques de tôle boulonnées, il se présentait mystérieux et immobile, supporté par huit roues massives. Les six premières, de diamètre exigu, étaient évidemment des roues « porteuses » ; mais à l’arrière, deux cycles, de rayon triple de celui des autres, attiraient l’attention.
Ceux-ci ressemblaient à des « aubes » de steamer, dont les palettes, destinées à frapper l’eau, auraient été repliées suivant l’axe des rayons.
Rocko les désigna :
– Roues sur le sol ferme, nageoires sur l’eau. Plus je le regarde, plus je crois reconnaître le karrovarka dont je parlais tout à l’heure.
À ce moment d’ailleurs un nouvel incident empêcha les jeunes gens de répondre.
Sur la toiture du « car », lord Lewis Biggun et le docteur Gorgius se montrèrent. Ce dernier tenait à la main une chaînette terminée par un crochet. Il fit descendre le crampon de fer jusqu’il terre, et d’une voix sèche, ordonna :
– Accrochez les paniers.
Les jeunes gens obéirent. Aussitôt le docteur hissa les récipients d’osier sur la plate-forme et le Sirdar parla à son tour :
– Garçons, tenez-vous en sentinelle à vingt pas de cette voiture. Vous empêcherez quiconque d’approcher. Toi, Rocko, retourne à l’office. Je ne veux être dérangé sous aucun prétexte.
Et le Maltais s’étant éloigné, non sans avoir jeté un regard expressif aux fils de mistress Price, Jack alla se poster en avant du wagon vers la grille de l’avenue, tandis que John se rapprochait de la villa et s’asseyait flegmatiquement sur le sable. Toute son indifférence habituelle était revenue. Il la poussa même jusqu’à tourner le dos au « carrosse » du docteur.
Par contre, Jack continua à fixer des yeux effarés sur le monstre de métal. Il vit les paniers de provisions disparaître, sans doute par une trappe ménagée dans la plate-forme supérieure ; puis le Sirdar et son compagnon disparurent à leur tour. Le long des parois, des volets s’abattirent avec un claquement sec, démasquant de petites fenêtres carrées, placées malheureusement trop haut pour permettre aux indiscrets de plonger à l’intérieur du karrovarka. Puis tout demeura immobile, silencieux, comme mort, dans le jardin envahi par le calme brûlant du milieu du jour.
À l’ombre d’un catalpa, Jack se mordait les lèvres d’impatience et de curiosité.
Quelle idée avait le Sirdar, ce maître donné à l’Égypte par l’Angleterre, quelle idée avait-il de s’enfermer dans cette prison roulante pour déjeuner avec un docteur allemand ?
Pourquoi ces allures mystérieuses ? Pourquoi, non content des murailles de tôle qui l’isolaient du monde, le général avait-il placé les deux frères en sentinelles ?
Ce luxe de précautions indiquait clairement que des paroles d’une gravité exceptionnelle seraient prononcées ; des paroles que les tentures épaisses des appartements, les serrures de Birmingham, les verrous de Sheffield n’avaient pas paru suffisants à garder des oreilles toujours ouvertes autour d’un haut fonctionnaire.
Tout en enrageant de ne pouvoir deviner de quoi il retournait, Jack s’avoua, avec un sourire, que lord Biggun avait agi sagement en prenant de si minutieuses précautions. Lui-même, n’avait-il pas trouvé le moyen d’assister, invisible, à tous les conseils de l’état-major de l’armée anglo-égyptienne.
Oh ! pure curiosité ; jamais il n’avait dit à personne ce qu’il entendait ainsi ; mais un autre moins bien intentionné eût pu procéder de même. C’était si simple.
Au-dessus de la salle du conseil, sise dans la villa du Sirdar, étaient des greniers parfaitement aérés, où mistress Price, soucieuse de sa réputation, enfermait ses réserves de fruits, de conserves, etc.
Or Jack, très intrigué par les allées et venues qui suivaient les conseils, avait découvert l’excellente position topographique des greniers. À l’aide d’un vilebrequin, il avait percé le double plancher et, quand le général convoquait ses collaborateurs militaires, le jeune homme grimpait lestement à l’office improvisé par sa mère. Là, il se couchait par terre, et l’œil, appliqué au trou du plancher, il suivait, attentif aux délibérations de l’assemblée.
Aussi, lorsqu’un peu plus tard, les officiers d’état-major traversaient affairés les cours de la villa, avec un grand bruit de bottes et de sabres, Jack affectait un flegme aussi complet que son frère. Seulement il savait quelles dispositions venaient d’être prises pour maintenir la prépondérance britannique en Égypte.
Il faut ajouter que, tout en blâmant in petto certains procédés politiques, il se réjouissait, en bon Anglais, des succès de ses compatriotes.
En bon Anglais ! ces mots, qu’il s’était répétés souvent comme une excuse à sa curiosité, lui revinrent aux lèvres. En bon Anglais ! Était-il bien certain d’être Anglais ? Après l’histoire que lui avait contée sa mère, le matin même, pouvait-il affirmer ? Il résultait clairement de l’aventure que, soit John, soit lui-même était fils d’une Française. Si c’était lui… il serait mauvais Français en étant bon Anglais !
Mais il secoua bien vite cette pensée importune. Le devoir n’a cure des complications imaginées par les penseurs désireux de ne pas l’accomplir. Il est simple, il est un. Adopté, recueilli par la grande famille saxonne, Jack devait vivre et penser en Anglais ; si un jour même, il arrivait à la preuve de son origine gauloise, il ne pourrait se défendre de rester sympathique à sa première patrie.
– Et puis, je suis fou, conclut-il. Si j’étais Français, je n’aurais plus de mère. Non, non, pas de ces idées-là, soyons toujours Anglais pour conserver l’amour de la meilleure des mamans.
Cette décision ne lui rendit pas le calme.
Ayant opté pour la nationalité anglaise, Jack recommença à être tenaillé par la curiosité et son agacement se traduisit par cette phrase :
– Que diable le Sirdar peut-il faire dans ce karrovarka ?
Le plus subtil des espions n’aurait pu répondre à cette question du jeune homme. Les murailles de tôle du chariot élevaient une barrière qu’aucun œil humain n’était capable de percer.
Les rayons X eux-mêmes qui, plus adroits que les concierges et les magistrats, lisent les lettres sans les ouvrir ou sondent les cerveaux sans interrogatoire, se seraient brisés, impuissants, contre les épaisses plaques métalliques boulonnées.
Conclusion : Jack enragea consciencieusement pendant une grande heure.
Alors il vit reparaître sur le toit du car le Sirdar Biggun et le docteur Kaufmann. Une échelle articulée, dont les montants de nickel brillaient au soleil, se déroula jusqu’au sol.
Les deux hommes descendirent. L’échelle remonta automatiquement, les volets latéraux se refermèrent, et le général appelant de la main les fils de mistress Price, les congédia par ces paroles :
– Je vous remercie. Vous pouvez disposer de votre temps.
Puis il se dirigea vers le bâtiment principal de la villa, suivi par le savant allemand.
– Êtes-vous satisfait ? demanda au bout d’un moment ce dernier, en accompagnant sa question d’un sourire simiesque.
– Je ne sais encore, répondit lord Lewis Biggun.
– Comment vous ne savez, après ce que vous venez d’entendre ?
L’Anglais l’arrêta :
– Je ne serai fixé qu’après le conseil qui se tiendra ce soir. Là seulement je verrai si les affirmations étranges qui ont frappé mes oreilles se vérifient.
– Alors, vous voulez tenter l’expérience sur vos propres officiers ?
– Certainement. Que les renseignements fournis sur eux soient exacts, et je n’hésite plus à croire tout le reste.
De nouveau un sourire grimaça sur la face de Gorgius.
– Bon ! bon ! je suis tranquille. Jamais service de renseignements ne fut organisé comme celui que je vous apporte. Nilia conduira l’armée anglaise à la victoire !
Le Sirdar hocha la tête.
– Je le souhaite… Elle ferait en ce cas l’œuvre d’un grand capitaine et elle en mériterait le titre.
– Je l’accepte pour elle, s’écria l’Allemand, et comme vous je marche désormais sous la bannière de la capitaine Nilia !
Cependant Jack et John regagnaient les cuisines.
– Ah ! murmura le premier, je ne sais ce que je donnerais pour savoir ce qui s’est passé dans cette voiture de tôle.
John enveloppa son frère d’un regard dédaigneux.
– Moi, cela m’est égal… Le Sirdar agit pour le bien de l’Angleterre ; je n’ai pas besoin d’en savoir davantage.
Jack ne répliqua pas un mot.
Mais lorsqu’il eut déjeuné à son tour avec la bonne mistress Price, il sortit et surveilla attentivement les abords de la résidence.
Un pressentiment l’avertissait que la mystérieuse entrevue du Sirdar et du docteur allait avoir des conséquences sérieuses.
Il ne se trompait pas. Bientôt un remue-ménage insolite se produisit dans la villa. Les officiers d’état-major traversaient les salles d’un pas affairé, échangeaient des paroles brèves, se passaient des ordres.
Puis ils sortirent et s’élancèrent en courant dans diverses directions.
Jack arrêta l’un des Anglais au passage.
– Qu’y a-t-il donc ? demanda-t-il en affectant l’air ébahi d’un badaud curieux.

– Je ne sais, répondit l’officier sans s’arrêter. Conseil extraordinaire ce soir, à huit heures ; nous convoquons tous les chefs de corps.
Il était déjà loin. Jack du reste ne songea pas à le poursuivre.
– Conseil, à huit heures ; murmura-t-il ; je serai au grenier. John a beau dire : le Sirdar agit pour le bien de l’Angleterre… Parbleu ! j’en suis certain… mais je ne serai pas fâché de savoir quel bien il prépare à mon pays !
Et, s’arrêtant soudain :
– Mon pays… à moins qu’il ne le soit pas. – Il eut un geste de colère. – Ah ! reprit-il, quelle situation pour un jeune homme curieux ! Ne pas avoir même l’assurance d’être Anglais…, je suis dans la position de ce philosophe antique qui disait : Sur terre nous n’avons aucune certitude ; il ne faut pas affirmer : je vis ; mais seulement exprimer le doute par cette formule : je crois que je vis. Eh bien moi, je dois me contenter de déclarer : je crois que je suis Anglais !
Puis, avec un désespoir comique, Jack acheva :
– Encore les disciples du dit philosophe avaient la ressource d’abandonner son cours et d’émigrer aux conférences de ses concurrents, qui enseignaient d’autres formules : la souffrance, la pensée sont les caractéristiques de la vie ; je souffre, donc je vis ; je pense, donc j’existe. Je souffre, je pense et il m’est interdit de conclure : donc je suis Anglais !
Mais, avec l’insouciance de la jeunesse, il chassa bien vite ces pensées amères et s’en fut rejoindre mistress Price, qui, très gravement, annotait un de ces manuels, productions littéraires à l’usage des cuisines, que l’on désigne sous le nom générique de Parfaite cuisinière bourgeoise.
La bonne dame rectifiait des erreurs de l’auteur. Très éprise de son art, elle caressait en secret l’idée de publier une Cuisinière bourgeoise plus complète, plus parfaite que ses devancières.
Être cordon bleu ne lui suffisait plus ; il lui fallait tirer sur sa jambe courte et grosse le bas bleu des femmes écrivains. Elle rêvait de devenir la Sévigné, la Mme de Staël des fourneaux, la George Sand des casseroles, la baronne Staaffe de l’assaisonnement puéril et honnête.

CHAPITRE III
CONSEIL DE GUERRE
À sept heures et demie du soir, Jack, sous couleur d’aller faire une promenade dans les rues du Caire, s’esquiva adroitement.
Contournant les bâtiments de la villa, il gagna une porte bâtarde, par laquelle on descendait en cave les provisions de charbon et de boisson, nécessaires au chauffage intérieur et extérieur du personnel employé par lord Lewis Biggun.
De la cave, par un escalier de service, il parvint au grenier-office, dont il ferma soigneusement la porte, afin de n’être pas dérangé.
Sur des tablettes se voyaient des fruits, des terrines variées, rangés avec un ordre si parfait, en des alignements si impeccables que l’homme le plus ignorant des choses de l’armée aurait reconnu sans peine à ces signes qu’il se trouvait en présence de conserves militaires.
Indifférent à la belle ordonnance des provisions entassées par la prévoyance de mistress Price, Jack se dirigea sans bruit vers un angle du grenier où des sacs de grosse toile étaient empilés en tas.
Il en prit une demi-douzaine, les emporta au milieu de la salle et les disposa méthodiquement sur le plancher, de manière à former une couchette primitive. Ces préparatifs terminés, il s’étendit sur les sacs, évitant ainsi le contact désagréable du bois. Sans s’en douter, Jack était sybarite, et sa curiosité voulait avoir ses aises.
Dans la position qu’il avait adoptée, il avait le nez contre une lame du parquet, qu’il souleva avec précaution.
Au-dessous apparut un trou circulaire d’un centimètre de diamètre, percé ainsi qu’une lunette dans l’épaisseur du double plancher. Il approcha l’œil de l’ouverture.
Au-dessous de lui, il apercevait une grande salle rectangulaire aux murs blancs rehaussés de baguettes et de filets d’or. Occupant presque toute la longueur de la pièce s’allongeait une grande table, recouverte d’un tapis vert et entourée de chaises devant lesquelles des buvards, encriers, plumes étaient placés.
C’était la salle du conseil.
– Personne encore, fit Jack après une inspection rapide, je suis en avance.
Et sur cette réflexion, il se retourna paisiblement sur le dos. À quoi bon se fatiguer inutilement.
Son repos d’ailleurs fut de courte durée. Des pas sonores, des froissements d’acier lui apprirent que la séance allait commencer.
Vite il se remit en observation. Plusieurs officiers venaient d’entrer dans la salle du conseil. Jack les nomma successivement :
– Le major Archibald, du 22e Écossais. Toujours aussi gros, aussi rouge de cheveux et de teint. Le colonel Karrigan, le général de brigade Holson – deux échalas blonds, grands bras, longues jambes, et des dents…
Comment des dents pareilles peuvent-elles se caser dans une bouche humaine ? – Allons bon, le major général de l’artillerie, lord O’Land… très distingué, très élégant… pas Anglais d’allure ; il est vrai qu’il est Irlandais. Voici maintenant le commandant du génie Mac Cardiff, pommadé, frisé, parfumé, cherchant par tous les moyens possibles à ne pas avoir l’air militaire. Est-il drôle… il porte son sabre comme un parapluie.
Jack se tut un instant, puis il reprit avec surprise :
– Oh ! oh ! La réunion est sérieuse… Tous les chefs de service ont été convoqués. Je vois là sir Thomas Bird, chef du parc d’aérostation avec ses lunettes d’or, sa bonne figure de brave homme. Et sir Golder, organisateur des sections de pigeons voyageurs, de chiens de troupe affectés aux escadrons d’éclaireurs… Allons bon, il n’en manquera pas un : Monsieur Leister, commandant des régiments Cipayes, prêtés par le gouvernement hindou pour la garde de l’Égypte !
Le jeune homme se frotta les mains.
– La réunion sera curieuse. Ma foi, je ne donnerais pas ma place pour deux livres sterling.
Il s’interrompit.
Un nouveau personnage avait franchi le seuil de la salle, et, d’un pas lent, se dirigeait vers le fauteuil présidentiel.
– Lord Lewis Biggun, murmura Jack. La représentation va commencer.
Puis il demeura muet, concentrant toute son intelligence, toute son attention dans son regard.
Le Sirdar invita du geste ses subordonnés à s’asseoir. Lui-même resta debout, et le léger brouhaha, causé par les officiers s’installant à leurs places, s’étant éteint, il prit la parole.
– Messieurs, dit-il, je débuterai par la devise que tous nous avons au fond du cœur : England for ever.
– England for ever, répétèrent les assistants électrisés.
Biggun salua, puis poursuivit :
– England for ever – l’Angleterre pour toujours. – Cette formule signifie pour nous : abnégation, dévouement, sacrifice. Elle signifie aussi discrétion absolue. Nulle affection, nulle confiance ne justifierait une parole inconsidérée, à l’heure où la fortune de l’Angleterre dépend de la rapidité et surtout du secret de nos mouvements.
Jack retenait son haleine, tremblant de perdre un mot du chef suprême des troupes britanniques. Cette fois, sa curiosité serait largement récompensée. L’entrée en matière du Sirdar annonçait des événements graves.
Telle fut du reste la pensée des officiers, car tous fixèrent leurs regards sur le général.
– Vous avez compris, Messieurs. Un danger auprès duquel ceux que nous avons rencontrés dans le passé ne sont que des vétilles, un danger terrible, inouï, menace la puissance anglaise dans la vallée du Nil. Jadis les Français ont péri par milliers dans l’affreuse conjuration des Vêpres siciliennes ; aujourd’hui il faut sauver l’armée anglo-hindoue de Vêpres égyptiennes.
À cette déclaration, un frisson parcourut l’assemblée. Les officiers se levèrent d’un même mouvement, les yeux brillants. Tous étendirent la main vers le Sirdar.
– Ordonnez, général, nous sommes prêts.
Tous parlaient à la fois. Il y eut un instant de tumulte inexprimable, pendant lequel Jack, emporté par la grandeur de la scène, clama dans son grenier :
– Mort aux Égyptiens ! Hourra pour la vieille Angleterre !
Heureusement sa voix fut couverte par les cris des membres du conseil, sans cela il eût été infailliblement trahi par son enthousiasme intempestif. Il s’appliqua donc un vigoureux coup de poing sur la tête, s’appela in petto stupide canard, ce qui, chacun le sait, est l’une des plus grosses injures qu’un Saxon puisse appliquer à sa personne, et cet acte de justice sommaire accompli, il se remit à observer ses voisins de l’étage inférieur.
Lord Biggun avait réclamé le silence, et, comme par enchantement, ses auditeurs étaient devenus muets. Il reprit alors :
– Je vous ai réunis, Messieurs, pour vous soumettre le plan de campagne élaboré par moi, afin que chacun de vous, en ce qui le concerne, travaille à son exécution. Mais, avant de vous apprendre ce dont nous sommes menacés, avant de vous faire connaître les mesures qui nous donneront la victoire, je vous demanderai la permission d’ouvrir une parenthèse.
Tous s’inclinèrent en signe d’assentiment.
– Établis en Égypte, continua le général en chef, dans un pays pacifié en apparence, un pays auquel nos vaillants soldats ont rendu les provinces de l’Éthiopie et du Soudan, et le cours du Nil de Philoe à Khartoum et à Fachoda ; établis en Égypte, dis-je, vous vous êtes crus sur une terre amie, abritée sous le drapeau du Royaume-Uni. Vous êtes entrés en relations avec les habitants, les aidant de vos conseils, de votre savoir, de votre amitié, vous efforçant d’instruire ce peuple retardataire, d’élever sa civilisation jusqu’au niveau de celle qui honore l’Angleterre, pays élu par le destin pour marcher à la tête des nations.
Un murmure approbateur souligna cette dernière phrase, bien faite pour chatouiller agréablement des oreilles anglo-saxonnes.
– Bien loin de critiquer votre conduite, je l’approuve entièrement. Elle était sage, conforme aux traditions de notre race. Par malheur la duplicité des Orientaux a tenté de se servir contre nous de notre loyauté, de notre confiance.
– Voilà bien l’Orient, maugréa l’incorrigible Jack dans son grenier.
– Contre nous ? s’écrièrent de leur côté les officiers.
– Oui, Messieurs. Les Égyptiens vous ont fait bon accueil, ils ont répondu à vos avances par des protestations d’amitié. Fourberie ! Leur affection simulée n’avait qu’un but : se tenir au courant de tous nos projets pour les déjouer, les réduire à néant.
– Impossible… de braves gens… c’est une information d’espions aux abois, clama-t-on tout autour de la table du conseil.
Mais le Sirdar leva la main, les bouches se fermèrent, et, de sa voix calme, au timbre métallique, cette voix qui, sur un champ de bataille, dominait le crépitement de la fusillade, il dit :
– Tout à l’heure, nous verrons qui, de vous ou de moi, a raison. Je veux auparavant vous raconter certains détails qui vous sont personnels. Si vous les reconnaissez exacts, je vous prie de le déclarer loyalement. Par ces petites choses vous jugerez de la créance qu’il convient d’ajouter aux grandes : je les tiens toutes de la même source, du même service de renseignements.
Et, se tournant vers Mac Cardiff, le coquet commandant de l’arme du génie.
– Mac Cardiff, je commence par vous. Vous êtes très lié avec le marchand copte Kedmos, est-ce vrai ?
– Sans doute, répliqua l’interpellé. Mais notre amitié n’a rien de mystérieux, tout le Caire la connaît, et si les espions n’ont rien découvert de plus remarquable…
– Attendez, attendez, mon cher commandant. Le marchand Kedmos a une fille, adorablement jolie, que le peuple désigne sous le nom de El ahsan bint Asàfir, la plus jolie fille Asàfir. Les yeux noirs de miss Asàfir ont troublé la quiétude de votre cœur, et l’on vous fait espérer que bientôt elle vous sera fiancée.
– Cela non plus n’est un mystère pour personne, car, renonçant au voile des femmes égyptiennes, miss Asàfir s’est montrée à visage découvert, accompagnée par moi dans les jardins d’El-Esbekieh, au théâtre, partout.
Lord Lewis Biggun inclina la tête avec satisfaction.
– C’est bien ce que l’on m’avait dit. Jusqu’ici nous sommes d’accord. Je continue. Hier soir, vous fûtes invité à prendre le café chez Kedmos. Miss Asàfir fut plus gracieuse encore, que de coutume, et elle vous parla des Européens arrivés depuis peu au Caire. Est-ce vrai ?
Il y avait une nuance d’anxiété dans cette interrogation.
– Parfaitement, murmura le commandant Mac Cardiff avec une évidente surprise. Comment connaissez-vous ce détail ? Nous étions seuls, sir Kedmos, miss Asàfir et moi.
Le visage impassible du Sirdar se contracta légèrement, une lueur joyeuse passa dans ses yeux, et, d’une voix plus assurée, il reprit :
– Attendez, je répondrai plus tard à votre question. Votre charmante fiancée vous demanda ensuite si l’on n’annonçait pas la venue de nouveaux touristes ?
– C’est vrai.
– Vous lui déclarâtes qu’à votre connaissance ceux qu’elle avait nommés étaient les seuls qui eussent été signalés ?
– C’est encore vrai… By God ! qui donc nous espionnait ?
L’officier anglais s’était levé. Son attitude indiquait une sourde colère, mêlée d’un étonnement croissant.
– À un moment, continua imperturbablement le général en chef, sir Kedmos fut appelé hors de la pièce où vous étiez réunis. Alors vous vous approchâtes de miss Asàfir et vous lui glissâtes à l’oreille ces mots : Quand donc, chère Miss, consentirez-vous à fixer le jour de notre mariage ?
Du coup, Mac Cardiff prit un air ahuri.
– Cela est diabolique, grommela-t-il. Mais, par mes galons, le diable lui-même n’a pu entendre sa réponse, car moi-même je ne l’ai perçue qu’avec peine.
– Je vous demande pardon, fit Biggun en souriant. Miss Asàfir vous répondit gentiment : Ayez patience. Bientôt luira le jour où Asàfir n’aura plus rien à désirer.
Cette fois l’officier du génie demeura bouche bée, mais sa figure exprimait une stupéfaction si profonde que la parole devenait inutile.
Le général en chef rayonnait.
 – J’ajoute,
dit-il avec un accent triomphant, que votre gentille fiancée vous donna alors
une fleur de myosotis, que vous avez placée dans votre portefeuille, deuxième
pochette de gauche – où se trouve déjà un papier plié en quatre sur lequel est
inscrite cette note : « Faire lever les quatre jours de consigne du
sapeur Manuchon, qui a expliqué son absence à l’appel. »
– J’ajoute,
dit-il avec un accent triomphant, que votre gentille fiancée vous donna alors
une fleur de myosotis, que vous avez placée dans votre portefeuille, deuxième
pochette de gauche – où se trouve déjà un papier plié en quatre sur lequel est
inscrite cette note : « Faire lever les quatre jours de consigne du
sapeur Manuchon, qui a expliqué son absence à l’appel. »
D’un geste machinal, Mac Cardiff tira son portefeuille de sa poche. Il l’ouvrit, fouilla dans le compartiment indiqué, en fit sortir une fleur sèche et un papier plié en quatre qu’il développa.
– C’est le diable, répéta-t-il, après y avoir jeté les yeux. Moi-même, j’avais oublié l’existence de cette note.
Puis, cinglé par le murmure d’étonnement qui s’élevait parmi les membres du conseil, il gronda :
– Qui, qui donc s’est donné à tâche de pénétrer ainsi dans mes plus secrètes pensées ?
– Quelqu’un, articula nettement le Sirdar, dont le nom doit être vénéré par tout homme portant l’uniforme anglais. Quelqu’un qui épargnera à nos armes un effroyable désastre. Ce quelqu’un, que j’ai placé à la tête d’un service de renseignements indépendant, que nul d’entre vous ne devra chercher à connaître, ce quelqu’un a adopté un pseudonyme qui, écrit au bas d’un ordre quelconque, doit obtenir de tous une obéissance passive, immédiate, sans discussion.
– Et ce nom ? interrogèrent d’une seule voix les officiers.
– Ce nom ? redit en même temps Jack du haut de son observatoire.
– Le voici, Messieurs : la capitaine Nilia.
– Nilia ! clama Mac Cardiff.
– La capitaine ? s’exclamèrent les autres.
– Oui, Messieurs, oui, mes chers camarades, s’écria le Sirdar. La capitaine Nilia. Gravez ce nom dans votre mémoire, mais ne me demandez aucun autre éclaircissement, il m’est défendu de parler.
Puis, changeant brusquement de ton :
– Je vais vous donner d’autres preuves de… – il hésita, sourit et continua : – de la merveilleuse organisation de son service. Sauf M. le général de brigade Holson et M. le colonel Karrigan, vous avez tous le malheur, je parle au point de vue militaire, d’avoir des confidents. Ainsi vous, Archibald, major du 22e Écossais, n’avez rien de caché pour le Maltais Hallouf, un fort aimable homme qui vous oblige de sa bourse, mais qui, sous le prétexte plausible de surveiller son argent, se fait tenir au courant de vos plus légers déplacements.
Le major souffla, devint cramoisi et courba la tête.
– Vous, lord O’Land, distingué major général de notre artillerie, vous racontez tout à votre douce fille, miss Elena, laquelle, sans songer à mal, répète intégralement vos paroles à mistress Alvag, sa maîtresse de dessin, lavis, aquarelle, alliée à plusieurs familles de l’aristocratie égyptienne. Vous, sir Thomas Bird, chef de notre parc d’aérostation, vous confiez toutes vos pensées à votre digne épouse, vaillante compagne d’un loyal soldat, sans vous inquiéter de l’amitié qui l’unit à mistress Madaris, femme du riche propriétaire nubien. Ces dames sortent ensemble, font de longues promenades dans la voiture automobile que les Madaris ont achetée en France. Et comme mistress Bird a pour vous une tendresse sans bornes, et que mistress Madaris est la plus aimable des amies, ces dames parlent beaucoup de vous et de tout ce qui vous concerne.
Un malaise évident prenait les officiers interpellés.
– Enfin, termina le Sirdar, sir Golder, directeur des pigeonniers et chenils militaires, ainsi que mister Leister, commandant des régiments hindous, ont un faible pour les bons dîners largement arrosés, si bien que certains amis de table lisent dans leurs cerveaux, aussi clairement que si leurs boîtes crâniennes étaient de verre.
Un silence lourd succéda à cette dernière affirmation.
– Eh bien, Messieurs, reprit le général en chef d’une voix éclatante, avant d’aller plus loin, j’exige votre parole qu’à dater de cette heure vous supprimerez toute confidence ; messieurs Golder et Leister s’engageront en outre à se mettre au régime de l’eau pure… jusqu’au moment où tout danger aura disparu, ce qui, acheva-t-il d’un ton plus doux, ne tardera pas, je pense.
Toutes les mains s’étendirent, toutes les lèvres prononcèrent le serment :
– Sur mon honneur, je serai muet.
Dans son grenier, Jack s’amusait énormément. Les diverses divulgations sur la vie privée des officiers anglais l’avaient tellement réjoui, qu’il en oubliait de se demander quelle était cette mystérieuse capitaine Nilia, qui entendait les paroles susurrées à l’oreille, lisait les écrits enfermés dans des portefeuilles, interceptait les confidences d’un père à sa fille, d’un époux à sa femme, et trouvait encore le temps d’assister aux confessions bachiques des adeptes de la dive bouteille.
Lord Lewis Biggun avait reçu gravement le serment de ses subordonnés.
– Avec des hommes moins éprouvés que vous, Messieurs, dit-il, j’ajouterais que toute indiscrétion de l’un d’entre nous, signalée par le service Nilia, entraînera la peine de mort : mais la menace est inutile vis-à-vis d’officiers dévoués à Sa Gracieuse Majesté Britannique. J’arrive donc au cœur de la question en vous priant de m’accorder toute votre attention.
Alors seulement, le général en chef s’assit et, les coudes appuyés sur la table, il parla :
– Messieurs, aucun de vous n’ignore que, depuis quelques années, il s’est formé en Égypte une association secrète, dont le but est l’indépendance du pays et l’expulsion des Anglais, qui, sans compter ont dépensé des millions pour enrichir un peuple ingrat. Les affiliés à cette société ont pris le titre de Néo-Égyptiens. Ils ont la prétention de renouer la tradition glorieuse des antiques pharaons, et par suite, ils ont adopté comme signes de reconnaissance, de ralliement, les emblèmes sacrés de la vieille Égypte : scarabées, globes ailés, palettes de Phra, outre d’Osiris, buire de Sepkhel et croissants d’Isis.
– Une mascarade ! souligna ironiquement Mac Cardiff.
– Nous l’avons cru comme vous, mon cher camarade, et nous avons laissé faire. Que les Néo-Égyptiens s’amusent à ces pâles copies d’un passé disparu pour toujours, cela ne tire pas à conséquence ; on se bornait à les surveiller discrètement. Le président de la société, le chef de la conjuration était le prince Hador, ce vénérable vieillard qui prétend descendre en droite ligne des illustres guerriers, dont les exploits sont retracés sur les parois des galeries intérieures de la pyramide de Khéops.
– Cela lui assure une noblesse remontant à 4.000 ans au moins, railla le major Archibald.
– Précisément, mais cela ne lui donne aucune connaissance militaire. Ce vieillard fanatique était incapable de conduire les Égyptiens au combat, et les affiliés s’en rendaient bien compte, car dans toutes leurs séances, ils demandaient éperdument un chef.
– Ils n’en trouveront pas ! firent les officiers en riant de bon cœur.

Le Sirdar laissa s’éteindre leur hilarité, puis, avec une gravité dont tous furent impressionnés :
– L’amirauté l’a cru comme vous, Messieurs, et comme vous, elle se trompait.
Une exclamation de surprise ponctua cette déclaration.
– Ils ont un chef… quelque fellah en rupture de labourage.
– Non, Messieurs, un chef qui peut être dangereux. Un chef qui appartient à une race guerrière que, depuis des siècles, l’Angleterre trouve partout sur son passage, une race que nous avons pu vaincre parfois, mais jamais abattre, qui nous a fait perdre nos colonies américaines des États-Unis, qui nous menace dans l’Inde, au Canada, qui combat pour la gloire et non pour l’argent.
– Un Français ? murmurèrent les membres du conseil, en proie à une véritable stupeur.
– Vous l’avez dit, mes chers camarades, un Français.
Et rapidement :
– Hador avait une fille, Miss Lotia. Celle-ci, aveuglée par ce déraisonnable esprit d’indépendance qui s’étend ainsi qu’une lèpre sur le pays d’Égypte, a pris l’engagement d’être l’épouse de celui qui conduirait le peuple à la victoire. Les Français sont toujours imbus de ces idées surannées qu’ils appellent chevaleresques ; il était à prévoir qu’ils répondraient au gracieux appel de la jeune fille. Il y a quatre jours, l’un d’eux débarquait à six kilomètres à l’Ouest d’Alexandrie. Cette nuit, il est entré au Caire.
– Où est-il ? Courons l’arrêter, rugirent les officiers anglais en se levant avec précipitation.
– Il n’y a que cela à faire, se déclara dans le grenier Jack, de plus en plus attentif.
Mais lord Lewis Biggun leva la main ; le silence se rétablit aussitôt.
– Messieurs, dit-il froidement, permettez que j’achève ce que j’ai à vous confier. Ce Français, du nom de Robert Lavarède ([2]), est un garçon hardi qui a fait preuve d’une audace et d’un courage à toute épreuve. Miss Lotia l’accompagne. Et, comme si ce n’était pas assez d’un tel adversaire, Robert Lavarède amène avec lui un cousin, Armand Lavarède, que vous connaissez tous de nom ([3]). C’est le journaliste parisien qui naguère fit le tour du monde avec cinq sous pour toute fortune… C’est là un brevet d’énergie indiscutable.
– Il me semble qu’il a épousé une Anglaise ? objecta le général Holson.
– En effet, miss Aurett, aujourd’hui mistress Lavarède, est née à Baslett-Castle, dans le Sussex ; mais, depuis son mariage, elle est devenue Française de cœur, à tel point qu’elle a voulu faire partie de l’expédition dirigée contre nous.
– Humph ! grommelèrent les assistants. Quelle perversion ! Avoir l’honneur d’être Anglaise et donner son cœur à la France.
– Le fait est, murmura Jack à l’étage supérieur, que si elle est certaine d’être Anglaise, elle agit mal.
Puis par réflexion :
– Même si la certitude lui manque, elle devrait rester fidèle à la Grande-Bretagne. Est-ce que je trahis, moi ?
– Or, reprit le Sirdar, ces étrangers et leurs compagnes sont arrivés cette nuit au Caire. Ils sont descendus, écoutez cela Mac Cardiff, dans la maison de votre ami Kedmos, le père de votre fiancée Asàfir.
Puis, arrêtant le sourire sur les lèvres des assistants :
– Ne riez pas, Messieurs, car ce matin, à deux heures, alors que vous dormiez paisiblement, de nombreux conjurés vinrent saluer le nouveau chef. Parmi eux, on remarquait le Maltais Hallouf, banquier du major Archibald ; mister Alva, époux de la maîtresse de dessin de votre fille, lord O’Land ; le Nubien Madaris, dont l’automobile promène la digne femme de sir Thomas Bird ; enfin plusieurs compagnons de table de sir Golder et de mister Leister. Comprenez-vous que vos amis indigènes étaient tout simplement des espions attachés à vos pas par les conjurés ?
Personne ne répondit. Les officiers semblaient atterrés.
– Ces renseignements, dit alors le général en chef, vous expliquent le serment de silence que j’ai exigé de vous, au début de la séance. Maintenant je veux vous informer de ce que j’ai projeté pour étouffer dans l’œuf la révolte imminente.
Comme obéissant à un commandement, les membres du conseil se redressèrent, leurs regards convergeant sur le Sirdar.
Celui-ci continua lentement, détachant chaque syllabe. On eût dit qu’il voulait faire pénétrer plus profondément ses paroles dans le cerveau de ceux qui l’écoutaient.
– J’aurais pu faire arrêter Robert Lavarède et ses compagnons ; mais après ?… Ce gaillard se serait déclaré touriste… il se serait réclamé du consul de France. L’Europe, vous ne l’ignorez pas, a suivi d’un œil jaloux nos progrès en Égypte, les difficultés diplomatiques pourraient surgir, et nous serions, en fin de compte, obligés de relâcher notre prisonnier, faute de preuves suffisantes. Il faut donc que la rébellion ait un commencement d’exécution.
Le Sirdar fit une pause, puis poursuivit :
– La capitaine Nilia m’a fait savoir que Robert Lavarède, son cousin, mistress Aurett et miss Lotia se proposent de remonter le Nil dans la dahabieh – bateau de plaisance – du négociant Kedmos. Ils affecteront des allures de touristes et parviendront ainsi, sans éveiller notre défiance, ils le croient du moins, à l’île de Philoe au delà de la première cataracte du fleuve. Là, dans des souterrains découverts par les affiliés à la conjuration, ils se rencontreront avec les principaux chefs du mouvement. C’est là que nous ramasserons tous nos ennemis d’un seul coup de filet.
– Hip ! Hip ! Hurrah ! rugirent les officiers.
– Seulement, il est indispensable que nos ennemis ne soupçonnent pas nos intentions. Il s’agit de les tromper. Ces jours derniers, les Bédouins du désert Lybique se sont permis quelques incursions dans les fermes situées à la lisière de la zone cultivée. Je n’ai pas besoin de vous rappeler la topographie générale de l’Égypte ; c’est un couloir verdoyant au milieu de déserts. Au centre, le Nil ; sur chaque rive, une bande de terre de dix à vingt-cinq kilomètres de large où l’inondation se fait sentir ; au delà, les sables des déserts Arabique à l’Est, Lybique à l’Ouest. Nous formons une colonne expéditionnaire, composée seulement de régiments anglais ; nous nous enfonçons dans le désert, sous le prétexte d’aller châtier les Bédouins. À une journée de marche, nous tournons brusquement au Sud, et, nous déplaçant parallèlement au cours du fleuve, nous nous rabattons sur lui à hauteur de l’île de Philoe. Nos quatre canonnières, actuellement sur le Haut-Nil, vers Khartoum, descendront pendant ce temps sur l’île de Philoe et l’encadreront quand le moment sera venu.
– Mais, objecta O’Land, la marche dans le désert sera longue, pénible…
– Point. Nos troupes emprunteront le chemin de fer jusqu’à Fesim, à 60 milles – 100 kilomètres environ – de Philoe. C’est de ce côté que les Bédouins ont fait parler d’eux. De cette façon, la colonne passera quatre ou cinq jours dans le désert au plus.
– Mais la préparation de la colonne, la concentration des vivres, des munitions…
– Exigeront environ trois semaines. Dans un mois, nous serons à Philoe, c’est-à-dire précisément au moment fixé par les conjurés pour leur réunion.
Puis, tirant de son dolman plusieurs enveloppes cachetées, lord Biggun les jeta sur la table.
– Ces enveloppes renferment les ordres qui concernent chacun de vous. Prenez-les, Messieurs, et, après avoir lu, brûlez. Il ne faut laisser aucune indication à la portée des espions qui nous entourent.
Et tandis que les officiers se partageaient les enveloppes, le Sirdar conclut :
– Pour la dernière fois, l’Angleterre va avoir à lutter en Égypte ; car, je vous ai gardé la nouvelle pour la bonne bouche, à l’avenir aucun soulèvement ne sera plus possible.
Il baissa la voix pour ajouter :
– Une flotte de transports a pris la mer. Les navires portent des tourelles blindées qui seront installées de distance en distance sur les rives du Nil, d’Alexandrie à Fachoda. Ainsi nous garderons l’eau, qui est la vie de l’Égypte, et si les habitants montraient encore quelques velléités de rébellion, nos canons les rejetteraient dans le désert, où la faim, la soif les décimeraient.
» Allez, Messieurs. Ayons confiance. Haut les cœurs, et terminons, ainsi que nous avons commencé, par nous offrir corps et âme à la patrie anglaise dans ce cri : England for ever ! »
Avec enthousiasme, les officiers répétèrent ces paroles, et tous se séparèrent. Chacun allait travailler à l’organisation de la colonne chargée de l’arrestation, des patriotes qui avaient rêvé de faire libre la terre d’Égypte.

Quant à Jack, il replia soigneusement ses sacs de toile, les remit en place, réintégra dans son alvéole la latte du parquet qu’il avait soulevée, puis il sortit de la villa comme il y était entré.
Seulement une nouvelle préoccupation le tenait. Qui donc était la capitaine Nilia ?

CHAPITRE IV
JACK EST TIRÉ À HUE ET À DIA
– John et vous, Jack, j’ai besoin de vous.
– De nous, général ?
– De vous.
Telles sont les répliques qui s’échangèrent le lendemain de cette séance mémorable, entre le Sirdar et les fils de mistress Price.
De grand matin, le commandant en chef des troupes anglo-égyptiennes avait fait mander les jeunes gens, occupés, le blond John à déplorer son sort de fils incertain, le brun Jack à tourner à distance autour du karrovarka mystérieux, dont la masse métallique, toujours dressée dans le jardin, exerçait sur lui une véritable attraction hypnotique.
Ceux-ci s’étaient aussitôt rendus à son appel, et dans le grand salon où naguère le Sirdar conversait avec le docteur Gorgius Kaufmann, ils se tenaient debout devant lord Lewis Biggun.
– Messieurs, reprit l’officier, vous êtes dévoués à l’Angleterre ?
– Sans doute, répliquèrent ses interlocuteurs.
– La question n’exprime pas un doute, soyez-en certains. John et Jack Price ne peuvent être que de fidèles sujets de Sa Majesté. Si je vous ai appelés, c’est que je veux mettre votre loyalisme à l’épreuve.
– Nous sommes prêts.
Le Sirdar sourit avec bienveillance, et, après un temps :
– Des étrangers, des Français vont remonter le Nil jusqu’à Philoe, sur une dahabieh louée au marchand copte Kedmos. J’ai des raisons de faire surveiller ces gens, et c’est à vous que je veux confier cette opération.
Les deux frères échangèrent un regard. Celui de John disait la surprise ; celui de Jack une sorte d’ennui.
– La dahabieh dont je vous parle est amarrée au quai de Kars-el-Aïn, en face la maison Kedmos. Elle est mue par une machine à vapeur de cinquante chevaux et porte à l’occasion deux voiles triangulaires. Elle partira aujourd’hui même. Il faut qu’elle vous emporte à son bord.
Le ton du Sirdar n’admettait pas de réplique et cependant les deux Price murmurèrent :
– Comment pourra-t-il en être ainsi ?
– Je vais vous l’apprendre. Les locataires du bateau sont disposés à accepter quelques passagers, sans doute pour réduire leur dépense de location. Vous vous présenterez comme tels. Vous êtes deux gentlemen américains, John et Jack Log, voyageant pour votre agrément. Vous visitez l’Égypte, avant de parcourir l’Europe et de retourner à la Nouvelle-Orléans, votre cité natale. Vous paierez ce que l’on vous demandera.
Et, tendant aux jeunes gens deux portefeuilles d’apparence rebondie :
– Voici de quoi subvenir à vos dépenses. Chacun de ces carnets contient mille livres ; maintenant voici ce que j’attends de vous. Vous observerez tout ce qui se passera à bord de la Yalla, c’est le nom de la dahabieh, nom qui signifie : En avant ! Chaque soir, suivant l’usage, le bateau viendra s’amarrer le long des rives du fleuve. Vous descendrez à terre, et, vous promenant sans affectation, vous vous éloignerez quelque peu du bord, jusqu’à ce que vous rencontriez un homme qui vous dira : – La nuit est tiède. Vous répondrez : – Et remplie d’étoiles. – Bon présage, reprendra votre interlocuteur. – Je l’espère, achèverez-vous. Veuillez inscrire ces paroles.
Les jeunes gens obéirent et sur leurs calepins marquèrent, en bon anglais, les quatre lignes suivantes :
– The night is lukewarm.
– And starfull.
– A good omen !
– I hope so.
– Bien, fit alors le général. Après cela, vous rendrez compte à cet homme, quelle que soit sa couleur, quel que soit son costume, des incidents marquants de la journée. Pas d’écrits surtout ; votre rapport sera verbal, rien que verbal.
Et les fils Price s’étant inclinés :
– Allez, mes amis. Songez que cette mission d’apparence modeste peut avoir des conséquences incalculables, et surtout soyez prudents ; que vos compagnons de voyage ne soupçonnent pas la surveillance dont ils seront l’objet.
Sur ce, lord Lewis Biggun congédia John et Jack.
Ceux-ci s’empressèrent de revêtir des costumes de voyage, de boucler leurs valises, et, après avoir dit adieu à mistress Price, sans lui donner aucune explication, ce dont l’excellente femme pensa mourir de dépit, tous deux quittèrent la villa, située près du grand pont du Nil, à peu de distance du palais khédivial.
Par les boulevards Mars-El-Atika et Fun-El-Khalig, ils contournèrent le palais Kars-El-Dubbara, les jardins du consulat britannique, de la superbe résidence d’Ibrahim-Pacha, de la maison de la mère du khédive et du palais Kars-Ali, puis, se jetant dans la rue qui longe l’hôpital, ils atteignirent le quai de Kars-El-Aïn, sur lequel s’élevait la splendide demeure du riche Kedmos.
Devant la maison, un terre-plein, terminé par un escalier de granit, descendait jusqu’au fleuve.
Au bas des degrés était la dahabieh du copte, coquette sous sa peinture blanche, rehaussée de filets rouges et argentés, avec son avant très relevé comme celui des nefs antiques.
À l’arrière flottait un pavillon français.
La vue des trois couleurs causa à Jack une impression indéfinissable. Avec la rapidité de l’éclair, il songea qu’il allait mettre le pied en ennemi sur ce petit navire abrité sous un drapeau, qui était peut-être le sien, à lui. Le secret inconnu de sa nationalité le plaçait entre deux trahisons. Espionnant, il marchait contre la France, peut-être sa patrie ; n’espionnant pas, il nuisait à l’Angleterre qui, avec tout autant de droits, pouvait le réclamer comme un de ses citoyens.
Il regretta d’avoir accepté la mission offerte par le Sirdar. Mais il était trop tard. Le vin amer de la traîtrise était tiré ; il fallait le boire.
John, du reste, qu’aucun scrupule n’agitait, et qui en outre n’avait pas, comme son frère, assisté au conseil, s’avançait vers deux hommes qui causaient avec animation près de la coupée du bâtiment.
Tous deux, couverts d’élégants costumes de touristes, avaient cette expression de confiance aimable qui, du premier coup d’œil, fait reconnaître les Français à l’étranger. Tous deux portaient les cheveux courts, la moustache brune relevée en crocs, à la mousquetaire, de sorte que, leurs vêtements identiques aidant, ils arrivaient à une ressemblance approximative.
– Cousin Robert, disait l’un, dans deux heures, la Yalla larguera ses amarres et nous lancera dans la plus formidable aventure où des hommes aient été engagés. Es-tu bien décidé ?
Son interlocuteur eut un haut-le-corps.
– Tu es facétieux, cousin Armand. C’est au moment où tout est préparé, où la machine chauffe, où l’équipage est à son poste, que tu fais de ces questions-là. Ah çà, ne serais-tu plus un Lavarède voyageur et entreprenant ? Aurais-tu l’intention de renoncer à chasser les Anglais de ce pays qu’ils oppriment ?
Armand Lavarède éclata de rire :
– Moi… allons donc, un journaliste parisien est toujours en quête d’émotions nouvelles. Chasser le tigre au Bengale ou l’Anglais dans la vallée du Nil, c’est tout un. Où est mon fusil ?
– Alors pourquoi tes paroles ?
– Pourquoi ? cousin, mais parce que je te porte le plus vif intérêt.
– Merci.
– Tu vas te mettre sur les bras une affaire que le diable a embrouillée à plaisir ; tu soulèves des Égyptiens mal armés…
– Pardon, des armes nous arrivent par l’Abyssinie.
– Je veux bien ; cependant elles ne sont pas arrivées, tandis que les Anglais ont fusils, canons derniers modèles. Ils tiennent le Nil, c’est-à-dire la seule ligne d’approvisionnement. Bref ils ont tous les avantages. Encore une fois, cela m’est égal. La partie me semble même plus drôle ; mais toi, toi, tu risques ta vie dans cette affaire…
Robert bondit :
– Pas plus que toi.
– Erreur, moi je ne risque rien. Je suis de ces « chançards » qui passent entre les balles, et puis j’ai avec moi ma chère femme, ma bonne et courageuse Aurett ; et puis enfin, je ne suis pas le chef de l’insurrection, j’en suis l’historiographe, personnage respecté par les belligérants. J’enverrai des articles à mon journal. Je ne risque rien, que de m’amuser un peu.
Le journaliste semblait prendre plaisir à taquiner son cousin.
– Si tu es pris, continua-t-il, tu seras fusillé. Si tu es vainqueur, quelle sera la récompense de tes efforts ?
– La récompense, gronda Robert en piaffant d’impatience, sera la main de Lotia Hador.
– Une main pour jouer sa tête, cousin, les enjeux ne sont pas égaux.
– Tu m’ennuies.
– Parce que j’ai raison.
La discussion aurait pu durer longtemps si John ne l’avait interrompue.
– Pardon, dit-il en s’approchant, un mot.
Il n’avait même pas porté la main à son chapeau. Les Saxons en général ne saluent pas volontiers, et dans l’espèce, le jeune homme éprouvait un réel plaisir à manquer de politesse vis-à-vis de Français.
Jack, lui, se découvrit.
Armand Lavarède considéra les nouveaux venus. Il adressa un aimable salut à Jack, puis se tournant vers John en renfonçant son chapeau d’un coup de poing :
– Voyons votre mot.
– Mon frère Jack et moi John Log, de New-Orléans, États-Unis, visitons l’ancien monde. On nous dit la dahabieh Yalla en partance pour le Haut Nil et pouvant recevoir encore des passagers. Est-ce vrai ?
– Oui, auriez-vous l’intention d’embarquer ?
– Parfaitement, nous l’avons.
– Alors, veuillez voir le capitaine et vous entendre avec lui.
Les faux Américains sautèrent aussitôt sur le pont, tandis que Robert, se penchant à l’oreille de son cousin, murmurait :
– Parfait. Deux Américains. Voilà qui nous couvre à merveille. On ne peut suspecter un bateau qui accepte des touristes dès qu’ils se présentent.
Armand ne répondit pas. Il regardait la maison Kedmos, dont la porte venait de s’ouvrir, livrant passage à deux femmes charmantes, vêtues de blanc et coiffées de grands chapeaux de paille sur lesquels flottaient de longs voiles de gaze bleu-pâle.
La première était blonde. Ses cheveux aux tons d’or nimbaient d’une auréole son visage. Elle avait la carnation admirable des Anglaises qui se mêlent d’être jolies, et ses yeux bleus, allongés, exprimaient la gaieté et la douceur.
Sa compagne avait une chevelure plus foncée, le teint éclatant de cette matité dorée des femmes nées aux pays du soleil. Des yeux noirs, profonds, veloutés, complétaient un ensemble ravissant. C’était la beauté méridionale marchant aux côtés de la beauté du Nord. Elles s’avançaient gracieuses.
 Tout à
coup, un être bizarre, hétéroclite, sortit à son tour de la maison Kedmos, et,
faisant des bonds énormes, rejoignit les jeunes femmes, près desquelles il se
mit à marcher gravement en s’appuyant sur un solide gourdin.
Tout à
coup, un être bizarre, hétéroclite, sortit à son tour de la maison Kedmos, et,
faisant des bonds énormes, rejoignit les jeunes femmes, près desquelles il se
mit à marcher gravement en s’appuyant sur un solide gourdin.
C’était un orang-outang de grande taille, paré d’un habit rouge à longues basques et d’un chapeau à cornes dont il semblait très fier.
Les singes ont le goût de la toilette, et de même que nos esclaves de la parure, snobs, smarts ou autres, ils ont une préférence marquée pour les couleurs heurtées et les vêtements de forme bizarre.
– Hope ! appela Robert.
L’orang dressa la tête, et, avec des cabrioles joyeuses, courut vers le Français.
Il lui tendit la main avec une courtoisie qui eût fait honte à bien des hommes, puis il bondit les bras ouverts sur Armand, qui l’évita par un saut de côté et se mit en garde avec sa canne.
– Pas d’embrassades, Hope !… la main, la main seulement.
Et, tout en octroyant un vigoureux shake-hand au quadrumane, le journaliste s’écria avec une colère comique :
– Voilà le point noir du voyage. Ce satané orang, que nous avons ramené de Bornéo, s’est pris pour moi d’une affection gênante.
Les jeunes femmes arrivaient à ce moment près de lui, riant aux larmes. Il les menaça du doigt.
– Aurett, Lotia… Ne riez pas… Vous me déchirez le cœur.
– Faut recoudre cela, railla Robert, enchanté de prendre sa revanche.
– Encore un mot de cette force, cousin, riposta le journaliste, et nous allons en découdre.
– Recoudre, découdre, s’exclama la blonde Aurett, on se croirait chez la couturière. N’est-ce pas, Lotia ?
La brune fille des Hador inclina la tête, puis, s’avançant vers Robert, elle lui tendit la main à son tour.
– Robert, murmura-t-elle, l’heure sonne où vous allez commencer à vous dévouer à ma cause, à la cause du peuple égyptien. Je ne vous remercie pas, car je sais que votre âme et la mienne n’en font qu’une. Mais dans cet instant solennel, je tiens à vous dire ceci : Vainqueur, je serai votre épouse fidèle ; vaincu, je vous suivrai dans la mort. La fille des Hador sera votre compagne sur la terre ou dans les prairies azurées de l’infini.
Pour tous, sachant à quelle œuvre allaient s’attacher les fiancés, ces paroles de Lotia prenaient l’ampleur d’un serment dont rien ne la pourrait délier.
Mais Armand n’était pas de ceux qui s’abandonnent à l’émotion.
– Ne nous attendrissons pas, cousin, cousine. La campagne commence. Eh bien, permettez-moi d’emprunter une image au dialecte du pays. Je désire vous voir le regard clair et assuré de l’aigle, qui plane dans les nuées avant de fondre sur ses ennemis.
Puis, changeant de ton :
– Voilà, j’ai eu ma petite phrase à effet, je redeviens le Parisien sans façon et je vous dis : Amis, embarquons sans retard. Le moment est venu de filer vers Philoe.
Il offrit la main à Aurett pour passer de l’embarcadère sur la dahabieh. Une minute plus tard, les voyageurs, y compris l’orang-outang Hope, étaient installés sur le pont.
La sirène lança dans l’air son appel aigu, des volutes de fumée s’échappèrent des cheminées, et la Yalla, avec une vitesse croissante, gagna le milieu du bras du fleuve resserré entre la rive droite et l’île Boulak.
John et Jack, qui s’étaient facilement entendus avec le capitaine, avaient déjà pris possession des cabines ménagées à l’arrière. Ils reparurent sur le pont et furent présentés aux jeunes femmes.
Cette fois, John se montra poli. Son frère l’avait décidé à abandonner son attitude rogue, en lui faisant remarquer que le meilleur moyen de gagner la confiance de leurs compagnons de route était de se montrer aimable et empressé.
Jack avait pris une résolution. Il laisserait faire John et lui-même observerait une neutralité complète. De la sorte, l’Angleterre serait bien servie et il ne trahirait pas la France. Ainsi ses hésitations douloureuses ne se reproduiraient plus.
Bientôt, du reste, le singe Hope se chargea de le dérider.
Armand Lavarède avait dit vrai. L’animal lui avait voué une tendresse particulière. Il le suivait sans cesse, copiant ses mouvements avec la servilité grotesque de ses congénères. Le journaliste s’étant assis sur une chaise à bascule, le quadrumane alla en chercher une autre et s’y étendit en croisant l’une sur l’autre ses jambes velues, si bien que le Parisien agacé alla s’enfermer dans sa cabine, d’où il ne sortit plus jusqu’à l’heure où, glissant le long de l’île Roda, le petit steamer vint stopper en face du débarcadère de Giseh.
Conséquents avec leur rôle de touristes, les Français allaient visiter les ruines avoisinant le village et faire l’excursion des Pyramides.
Des ânes furent loués pour toute la caravane, et l’on se mit en route. On passa à El Tahbich, à Azivé.
Suivant l’usage, on fit halte à Mena-House-Hôtel, vaste caravansérail installé depuis 1889 au pied de la montée conduisant au plateau rocheux, sur lequel se dressent les pyramides ; puis, obliquant à gauche dans une rampe rapide, on parvint en face de l’énorme mausolée de Khéops, formé de 2.352.000 mètres cubes de pierre.
À leur droite, les voyageurs apercevaient les ruines de la nécropole des IVe et Ve dynasties, les masses imposantes des pyramides de Khléphrem et de Menkevurë ; à gauche, s’étalaient les tombeaux qui bordent le village kafi-arabe, et en avant le grand Sphinx, à la face mutilée, élevait sa masse étrange au-dessus des sables comme une sentinelle pétrifiée, abandonnée là par les gigantesques civilisations d’autrefois.
Du reste, les touristes eurent peu de temps à donner à l’admiration. Une foule de guides bédouins les entourèrent, offrant de les conduire, qui au sommet, qui à l’intérieur des pyramides. Celui-ci clamait :
– Pour le Sphinx ! Pour le Sphinx !
Un autre hurlait :
– Les Nécropoles ! les Nécropoles !
C’était un tohu-bohu, un hourvari assourdissants, et les voyageurs ne savaient vraiment auquel entendre.
Au milieu de la confusion, Jack sentit une main se poser sur son bras. Il se retourna. Un grand diable, au teint basané, portant une veste courte couleur cannelle et de larges pantalons blancs, s’était glissé auprès de lui.
– Prenez-moi pour guide, murmura celui-ci. La nuit est tiède.
Le jeune homme tressaillit. Son interlocuteur venait de prononcer la première phrase du signal convenu avec le Sirdar.
– Et pleine d’étoiles, répondit-il d’une voix mal assurée.
– Bon présage, continua l’homme.
– Je l’espère.
John s’était rapproché. Il avait entendu les dernières paroles et il inclina gravement la tête afin d’indiquer qu’il avait compris.
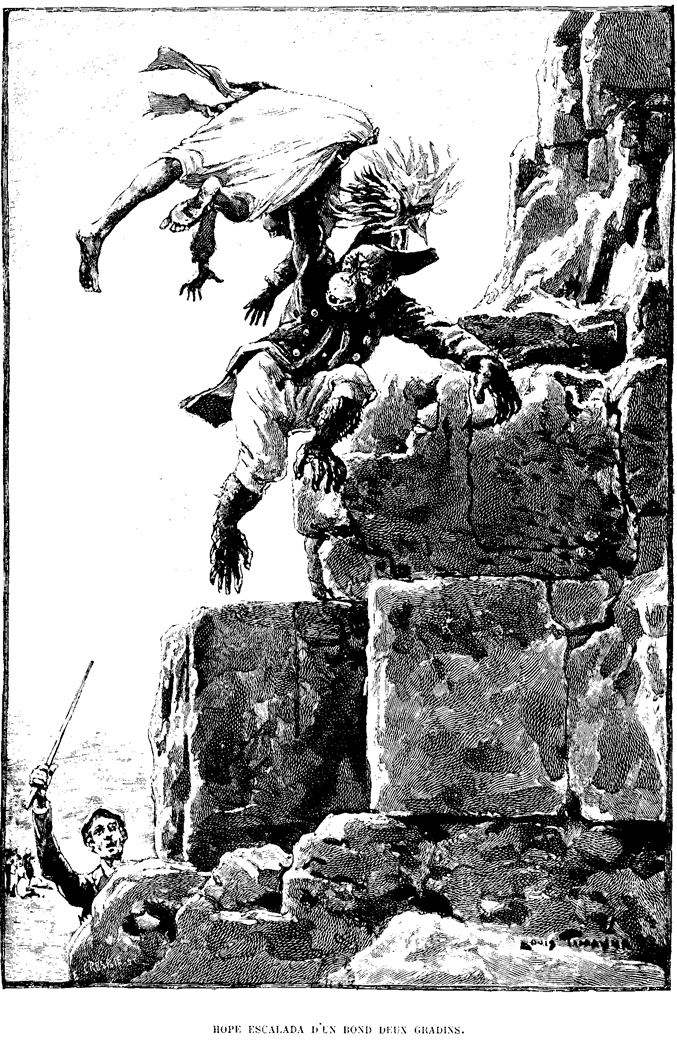
Cependant Armand Lavarède avait fait prix avec plusieurs Bédouins.
– Nous allons à la nécropole, cria-t-il aux faux Américains.
– Bien, bien, nous visiterons la pyramide de Khéops, répondirent ceux-ci.
Et, tandis que les Français s’éloignaient, l’Arabe qui avait parlé à Jack reprit :
– Venez.
Les deux frères le suivirent, contournèrent avec lui la grande pyramide, devenant ainsi invisibles pour les autres passagers de la Yalla, qui du reste ne s’occupaient point d’eux.
L’Arabe s’arrêta alors.
– Rapport, fit-il laconiquement.
John allait raconter ce qu’il avait vu à bord de la dahabieh, quand un incident nouveau arrêta la parole sur ses lèvres.
L’orang-outang Hope avait été du voyage. Il avait très sagement fait la route, juché sur un âne, et avait paru s’intéresser beaucoup au paysage.
Lorsque la caravane s’était fractionnée, le singe avait semblé hésiter sur la direction à suivre, puis brusquement, après avoir pris son chapeau par les deux cornes, ce qui chez lui sans doute était l’indice d’une réflexion profonde, il avait emboîté le pas aux fils de mistress Price.
Maintenant il venait de se dresser entre eux, et, passant ses bras velus sous ceux des jeunes gens, il avait tout à fait l’air de vouloir prendre part à la conversation.
Le premier mouvement de John fut de s’éloigner du quadrumane, mais sa vigueur ne pouvait entrer en comparaison avec celle de Hope. Il s’en rendit compte aussitôt.
– Ennuyeuse, cette bête, grommela-t-il, mais bah ! elle ne saurait comprendre !
Sur cette réflexion judicieuse, il narra dans ses moindres détails son admission comme passager à bord de la Yalla, donna les noms et prénoms des Français, d’Aurett, de Lotia.
Le guide écoutait. On sentait que les paroles de John seraient rapportées fidèlement.
Quand l’Anglais eut terminé, l’Arabe parla à son tour :
– Je me souviendrai de tout cela. Maintenant, voici une communication que je suis chargé de vous faire. Aux mots de ralliement convenus, le Sirdar désire que trois mots soient ajoutés.
– Trois mots ?
– Ceux-ci : La capitaine Nilia. Il faudra donc qu’à l’avenir ceux qui me succéderont prononcent ce nom.
John ouvrit des yeux démesurés.
– La capitaine Nilia, répéta-t-il, qu’est-ce que cela signifie ?
Jack, lui, fronça le sourcil. Depuis le départ, il avait oublié le personnage mystérieux que le général en chef avait désigné ainsi : la capitaine Nilia… et voilà que l’inconnue le poursuivait jusqu’au désert.
– Qu’est-ce que la capitaine Nilia ? demanda-t-il enfin avec une avide curiosité.
L’Arabe eut un haussement d’épaules.
– Je ne sais pas. Je rapporte ce qui m’a été confié, rien de plus, rien de moins. Je pense au surplus que c’est un simple mot de ralliement ne s’appliquant à personne.
Mais Jack secoua la tête. Il lui était impossible d’avouer qu’il avait assisté au conseil, où lord Lewis Biggun avait affirmé l’existence de la capitaine, et, avec mauvaise humeur, il fut obligé de refréner son désir d’interroger davantage.
– Adieu. Allah soit avec vous ! reprit le guide. Je retourne au Caire. Rappelez-vous : la capitaine Nilia.
Sans se douter de ce que sa recommandation empruntait d’ironie aux circonstances, l’Arabe salua ses interlocuteurs et fit mine de s’éloigner.
Mais Hope intervint.
L’instinct de l’orang l’avait-il averti que l’indigène tramait quelque chose contre ses maîtres, ou bien obéit-il simplement à une inspiration de son naturel facétieux, il serait difficile d’élucider ce point. Toujours est-il que, lâchant soudain les bras de John et de Jack, le singe bondit en avant, empoigna l’Arabe par le fond de sa culotte bouffante et l’éleva en l’air comme il eût fait d’un enfant.
La victime de cette brusque attaque poussa un cri de détresse. John et Jack se précipitèrent à son secours ; mais Hope ne les attendit pas. D’un saut il escalada deux gradins de la pyramide de Khéops.
Le tombeau du grand roi égyptien est formé, en effet, d’une série de gradins, épais d’un mètre environ qui, de la base au sommet, figurent un escalier géant.
Sans lâcher son prisonnier, l’orang gambadait sur les hauts degrés de pierre, faisant entendre une sorte de bourdonnement joyeux. Il semblait narguer les jeunes Anglais qui couraient le long du monument en l’appelant sur tous les tons.
Tout à coup, le quadrumane lança un cri perçant, sauta de marche en marche et alla déposer son prisonnier aux pieds de Lotia qui, sa visite à la nécropole terminée, revenait avec ses amis.
Au milieu de l’ahurissement causé par cette action, les deux frères rejoignirent leurs compagnons de voyage. Ils expliquèrent l’aventure et l’Arabe fut remis en liberté. Encore Armand, qui avait sur l’orang plus d’autorité qu’aucun autre, dût-il employer toute sa volonté pour empêcher Hope de poursuivre le malheureux guide.
Mais durant le reste de la promenade, le singe demeura sombre. De temps à autre il grinçait des dents et grognait sourdement. De toute évidence il était mécontent.
Au soir on rallia la rive du fleuve où la dahabieh stationnait.
Le lendemain on repartit.
Alors commença pour Jack une existence douloureuse au possible. Il ressentait pour Armand et Robert une sympathie irrésistible. Leur caractère, leur tournure d’esprit répondaient parfaitement à son caractère, à sa tournure d’esprit. Eux aussi semblaient attirés vers le jeune homme ; ils lui manifestaient en toute circonstance leurs bonnes dispositions, et, ravis de son attitude sans raideur, que la morgue de John soulignait encore, égayés par sa conversation primesautière, il leur arrivait de dire :
– Ah ! Sir Jack Log, vous êtes un Français d’Amérique.
Ou bien encore :
– On vous croirait Parisien de Paris.
Ces remarques bouleversaient le jeune homme. Est-ce que décidément il serait Français ? Est-ce que vraiment la bonne mistress Price ne serait pas sa mère ? Alors il regardait d’un air d’envie John, si Anglais d’allure, de tempérament, de flegme tranquille.
Puis des idées troublantes lui venaient. S’il était de race gauloise, combien horrible le métier qu’il faisait. Espionner des compatriotes au profit de l’Angleterre.
Il se déclarait qu’à la première halte il fuirait, prendrait le chemin de fer, établi le long du Nil et rentrerait au Caire.
À la halte, il n’en faisait rien. Alors, éloigné des Lavarède, il se sentait redevenir Anglais. Il avait un tel désir de rester le fils de mistress Price, cette humble cuisinière, si pleine de bonté et de tendresse, qu’il chassait bien loin tous ses doutes. Oui certes, il était Anglais et il avait raison de servir l’Angleterre, sa vraie patrie, sa seule patrie.
Avec une ardeur fébrile, il cherchait le messager annoncé par le Sirdar, et le messager se présentait toujours.
Tantôt c’était un Bédouin, tantôt un fonctionnaire turc. D’autres fois, c’était un paysan, une bouquetière, un aubergiste.
Et toujours ces gens murmuraient à son oreille les phrases de reconnaissance, suivies de ces mots : La capitaine Nilia ! qui le jetaient dans un autre ordre de préoccupations.
Sa curiosité était piquée au vif. Il eût donné sans regret une année de sa vie pour rencontrer l’être inconnu que désignait ce nom.
Entre ses angoisses de fils et l’agacement causé par le mystère qui l’entourait, Jack n’avait plus un instant de repos.
C’est ainsi qu’avec ses compagnons il visita les ruines antiques échelonnées dans la vallée du Nil. Les nécropoles de Zaouyret-El-Aryda, d’Abousir, de Sakkara, de Dahchou, les restes de Memphis, d’Hérakléopolis, les temples de Kheb, d’Abu-Kaun, Kynopolis, Antinoë, les grottes d’Artemidos, Girgeh, Abydos, Thèbes, Louqsor, Karnak.
Pendant un mois, Jack fut soumis à une cruelle torture morale, et ce lui fut une joie lorsque la dahabieh stoppa en face d’Assouan, en aval de la première cataracte du Nil.
Le lendemain, on atteindrait Philoe, l’île sacrée couverte de temples ruinés et de palmiers verdoyants, où le Sirdar avait décidé que les Français et les conspirateurs égyptiens seraient arrêtés.
Ce fut donc le cœur léger que le jeune homme sauta sur le débarcadère. Il eut un regard satisfait sur la rue du Nil, qui court parallèlement à la rive du fleuve, jolie, coquette, avec ses constructions gracieuses : le palais du gouvernement, le café khédivial, l’agence Cook, la poste et surtout l’hôtel monumental d’Assouan.
On devait dîner dans ce somptueux établissement. Les voyageurs, suivis par l’inévitable Hope, y entrèrent et se firent donner des chambres, afin de procéder à leur toilette avant de se mettre à table.
Or, John et Jack, en manches de chemise, se débarbouillaient dans cette onde niliaque, qui jadis servait aux ablutions des Pharaons, quand on gratta légèrement à leur porte.
Croyant à la venue d’un domestique, ils répondirent sans interrompre leur occupation aquatique :
– Entrez.
Leur supposition était juste. Un garçon d’hôtel se présenta ; mais ce garçon mit un doigt sur ses lèvres, referma la porte, donna un tour de clef et, s’approchant des Anglais, murmura :
– La capitaine Nilia… La nuit est tiède.
Comme chaque jour, le représentant du service de renseignements du Sirdar était exact au rendez-vous.
Les mots de ralliement échangés, cet homme parla d’une voix assourdie :
– Ce soir, vos compagnons de voyage vont chercher à se débarrasser de vous.
– Un crime ! grommela John avec un sursaut. Ces Français sont capables de tout !
Le serviteur sourit :
– Non, non, pas un crime…
– Quoi donc alors ?
– Un narcotique… une dose d’opium mélangée à votre boisson.
Les jeunes gens se regardèrent stupéfaits.
– Pourquoi nous endormir ?
– Pour que vous ne puissiez partir avec eux le matin. Ils comptent se rendre à Philoe, sans vous, et revenir vous prendre ensuite, comme si rien d’anormal ne s’était passé.
– Nous dormirons donc vingt-quatre heures ? grommela John.
– La dose est calculée pour cela… mais, je vous en prie, n’élevez pas la voix… les murs ont des oreilles.
Jack, brandissant sa serviette de toilette, marchait à grands pas dans la chambre.
– Je ne veux pas dormir, disait-il, je veux être de l’excursion à Philoe.
Et, s’arrêtant soudain devant le garçon d’hôtel :
– Comment avez-vous appris ce que vous nous racontez ?

– On m’a chargé de vous, prévenir. Un envoyé du général lord Lewis Biggun ; il m’a dit les phrases par lesquelles notre entretien a commencé, et m’a bien recommandé d’insister sur les mots : La capitaine Nilia. Il paraît que vous savez ce que cela signifie.
À cette affirmation malencontreuse, Jack trépigna. Ce n’était pas assez de le plonger jusqu’au cou dans un mystère impénétrable ; il fallait encore que l’on plaisantât son ignorance curieuse.
– Soyez donc paisible, lui conseilla John. Montrer tant d’impatience est indigne d’un véritable Anglais.
Puis, s’adressant au domestique qui attendait leur bon plaisir :
– Enfin, nous devons refuser de boire ?
– Non, Sir, non.
– Nous sommes donc condamnés au sommeil ?
– Pas davantage.
– Cette fois, je ne comprends plus…
Malgré ses prétentions au flegme, la voix de John trahissait une certaine nervosité.
– Je m’explique, Sir.
– Pour ma part, j’en serai enchanté.
– Voici. Les Français doivent croire que leur complot a réussi. Il est donc nécessaire qu’à leurs yeux vous ayez bu la décoction opiacée, et que vous simuliez une irrésistible envie de dormir.
– Si nous buvons, nous n’aurons pas besoin de simuler…
– Vous ne boirez pas.
– Alors comment croiront-ils… ?
– Je suis là pour vous le dire.
En faisant cette réponse, l’interlocuteur des jeunes gens dépliait avec précaution un journal que, jusque-là, il avait tenu sous son bras. Il en tira deux cravates blanches agrémentées à leur partie interne de minces sacs de caoutchouc ayant à peu près la dimension d’un fond de chapeau.
– Voilà, fit-il d’un air triomphant.
Comme les Anglais le considéraient d’un regard hébété :
– Examinez bien ces cravates, reprit le domestique. Elles ne se mettent pas tout à fait comme les autres. Le nœud se place sous le col rabattu, mais le sac de caoutchouc passe sous la chemise et devient invisible. Derrière la cravate, au lieu des attaches habituelles, se trouve un entonnoir aplati qui communique avec l’intérieur de la poche imperméable, pendant le dîner, vous n’aurez à vous inquiéter de rien, jusqu’au moment où on servira deux bouteilles de bourgogne à cachet jaune. Vos compagnons se verseront de l’une et vous offriront de l’autre. Acceptez ; seulement, au lieu d’absorber le vin, faites le couler tranquillement dans l’entonnoir. Il vous suffira ensuite de retirer cravate et pochette et le tour sera joué.
– Mais ils s’apercevront… commença Jack.
– Point ! Avant de descendre, vous allez faire une expérience là, devant votre glace, et vous n’aurez plus d’inquiétude. Veuillez vous habiller et me permettre de vous ajuster l’utile parure que je vous présente.
Un instant après, les deux frères, debout devant le miroir, s’exerçaient à faire passer de l’eau dans la bouche supplémentaire, dont le garçon d’hôtel venait de les gratifier. Ils constataient avec une satisfaction mêlée de surprise que rien ne décelait la supercherie.
Aussi, les réservoirs caoutchoutés remis à sec, ils allèrent rejoindre ceux qu’ils surveillaient, tout pénétrés de cette joie maligne que l’on éprouve au moment de jouer un bon tour à son adversaire.
Tout se passa comme l’avait annoncé le garçon d’hôtel. Décidément, la capitaine Nilia, puisque capitaine Nilia il y avait, dirigeait le plus merveilleux service d’espionnage qu’eût jamais possédé une armée européenne.
Les bouteilles de bourgogne, cachet jaune, firent leur apparition sur la table.
Avec une dextérité qui eut échappé à des yeux non prévenus, Armand Lavarède fit passer le contenu de l’une dans les verres de Robert, de Lotia, d’Aurett. Avec l’autre, il remplit les gobelets des deux Anglais.
John, très amusé par l’aventure, ne put retenir une de ces excellentes plaisanteries à froid, dont le peuple britannique a le secret. Il leva son verre et gracieusement :
– À la santé de nos aimables compagnons de voyage, dont, hélas ! nous devrons nous séparer bientôt, puisque le terme du voyage approche.
Et tandis que les Français leur faisaient raison, les gobelets des deux frères se vidèrent dans leurs cravates machinées.
– Le tour est joué, se dirent tous les assistants, avec des sens différents.
Un sourire éclaira toutes les physionomies, car la situation voulait que chacun pensât avoir trompé les autres.
Du reste, Jack et John tinrent leurs rôles en conscience. Leurs yeux papillotèrent, ils parurent réprimer avec peine des bâillements répétés. Enfin ils prétextèrent une fatigue invincible et se retirèrent.
Alors les Français laissèrent carrière à leur joie.
Plongés dans le sommeil lourd de l’opium, leurs compagnons de voyage ne les gêneraient pas.
De grand matin, laissant la Yalla à quai, on prendrait le chemin de fer de la rive droite du Nil. On arriverait ainsi à la gare de Philoe-Chellal, en face de l’île sacrée, et, traversant le bras du fleuve, on serait au rendez-vous fixé aux chefs de la conjuration, dont Robert allait devenir le chef.
À cette pensée, les visages étaient devenus graves. Lotia prit la main du jeune homme qui assumait cette lourde tâche de conduire les opprimés contre les conquérants anglais et, de sa voix douce :
– Robert, dit-elle. La patrie réclamait le dévouement de tous ses enfants. Moi, jeune fille, que mon sexe empêchait de courir au combat, j’ai voulu me sacrifier comme les autres. Les guerriers offrent leur existence, les mères, les épouses, les sœurs offrent en holocauste leurs fils, leurs époux, leurs frères. Sur l’autel de la liberté égyptienne, j’ai immolé ma liberté personnelle. Ma main sera au chef vainqueur.
Il inclina la tête, pensif.
– Mais, continua-t-elle, tandis qu’une rougeur pudique montait à ses joues, mon âme vous appartient et si les destins permettent que notre cause sainte triomphe, ce qui fut un serment patriotique deviendra la joie de mon cœur.
Très ému, Robert porta la main de Lotia à ses lèvres.
– Ma vie est à vous, Lotia, dit-il. Que ce soit sur cette terre, que ce soit au delà de la mort, dans le pays lointain des soleils d’or, je serai votre homme-lige, votre chose, plus que cela encore. J’emprunte une phrase aux ancêtres, eux dont les tendresses comme les haines étaient infinies, et je dis après ces chefs redoutables dont les événements me font aujourd’hui le successeur : Que mon bras se dessèche, que mon âme soit dans l’éternité exclue de la présence d’Osiris, mais que vos yeux ne se détournent jamais de moi. Ils sont mon espoir, ma force, mon courage, ma vie ; sans eux je deviendrais plus faible que l’arbuste privé de lumière.
Les yeux humides, le Français se laissait aller à sa tendre improvisation ; mais son cousin l’interrompit soudain :
– Mon cher, s’écria-t-il, tu entres en fonctions de généralissime. Souviens-toi que la victoire appartient aux troupes fraîches. Aussi fais sonner l’extinction des feux et allons nous coucher.
La gaieté du journaliste ramena le sourire sur les traits des assistants.
– La campagne commence bien. Nous avons dépisté les Anglais, endormi les Américains. Il ne reste plus qu’à remporter quelques victoires, enlever les canons, capturer les drapeaux et rejeter l’armée ennemie à la mer… ce n’est pas la peine d’en parler.
Puis, chantonnant la poésie douteuse dont les soldats accompagnent la sonnerie de l’extinction des feux :
Comme ça, l’ capitaine a dit
Éteignez chandelles, chandelles et bougies.
Armand Lavarède se leva et regagna sa chambre, imité par ses interlocuteurs.
Tous auraient été moins tranquilles, s’ils avaient pu glisser un regard indiscret dans la pièce où s’étaient enfermés John et Jack.
Ceux-ci, une fois seuls, avaient quitté leur air endormi.
– Eh bien, Jack ? avait demandé John.
– Eh bien, John ? avait répondu Jack, qui, après la mauvaise plaisanterie préméditée par les Français, s’était senti redevenir Anglais jusqu’au bout des ongles.
– Nous voici donc engourdis par les vapeurs de l’opium.
– Totalement engourdis.
– Cependant nous n’allons pas passer la nuit sur pied. Nos dignes amis de la Yalla quitteront l’hôtel d’Assouan au matin seulement.
– Mais si nous dormons, nous courrons le risque de nous éveiller trop tard.
– Point.
– Comment cela ?
John sourit d’un air de supériorité. Son frère, dont il ignorait les tergiversations intérieures, lui paraissait naïf, peu propre à assurer la victoire à la vieille Angleterre, tandis que lui-même… Aussi prit-il un ton protecteur pour répliquer :
– Les fenêtres de notre chambre donnent sur l’avenue du Nil ; donc personne ne peut sortir de l’hôtel sans passer dans notre champ d’observation.
– Juste !
– Eh bien ! Couchons nous à tour de rôle. L’un reposera ; l’autre, assis derrière la croisée, surveillera l’avenue.
– Très bien !
Mais Jack fronça soudain le sourcil :
– Alors nous les suivrons demain ?
– Parfaitement !
– Au matin, il y aura peu de monde au chemin de fer ; il sera très difficile de n’être pas reconnus.
– Erreur, car nous serons méconnaissables. J’oubliais de vous dire, Jack, que sur l’ordre du Sirdar et de la capitaine Nilia, cette brave femme que je ne connais pas, deux vêtements complets de cheiks bédouins ont été mis à notre disposition. Vestes soutachées, culottes bouffantes, bottes aux éperons de cuivre, larges manteaux à capuchon, rien n’y manque. Une fois costumés ainsi, ma… il se reprit avec une politesse affectée… notre mère elle-même serait incapable de nous deviner, donc…
– Habillons-nous à l’arabe et tirons au sort à qui veillera le premier.
En vingt minutes, les jeunes Anglais eurent changé de vêtements, et John, désigné à pile ou face, s’installa près de la fenêtre, tandis que Jack se jetait sur son lit, après avoir éteint la lumière.
Désormais pour l’observateur qui, du dehors, aurait examiné les fenêtres de la chambre des deux frères, les vitres obscures eussent donné l’impression d’une pièce dont les habitants s’abandonnaient au repos.
À deux heures du matin, John secoua son frère, qui le remplaça comme guetteur.
Jack regardait au dehors.
Sous ses yeux, de l’autre côté de la rue du Nil, était le débarcadère, où la Yalla était amarrée, au milieu d’autres embarcations ; au delà, s’étendait la nappe du fleuve, miroitante sous les rayons de la lune et bornée par la côte sombre de l’île Éléphantine, dominée par la tour du Nilomètre et par les ruines de l’antique ville qui lui a donné son nom.
Sur les fûts de colonnes, sur les arcades incomplètes sous lesquelles se pressait autrefois la foule des contemporains de Ménephta et de Moïse, Phœbé répandait sa lueur blanche ainsi qu’un suaire d’argent. En contemplant, du bourg moderne, la ville ancienne devenue nécropole, ayant la grandeur et la tristesse des tombeaux, Jack s’abandonna à une rêverie pleine de charme et de douleur.
Il oublia la mission dont il était chargé pour revivre les époques disparues. Il se vit en imagination au milieu du peuple grouillant dans les rues, sur les places d’Éléphantine, quarante siècles auparavant. Lui aussi portait la tunique de lin, le gorgerin d’or dont les anneaux cliquetants figuraient des scarabées sacrés aux élytres de malachite ; des bracelets enserraient ses poignets et ses chevilles ; sur le crâne, il portait la coiffe ronde dont les barbes rayées retombaient le long de ses joues, lui donnant l’apparence mystérieuse et grave des grands sphinx couchés aux confins du désert, aux portes des temples, dans les avenues désertes et désolées de Thèbes aux cent portes.
Une tendresse profonde chanta en lui pour ces hommes grandis, par le mirage du temps, à la taille de demi-dieux, et, par voie de conséquence, il en vint à admirer ces Égyptiens d’aujourd’hui, qui préparaient sous les auspices des ancêtres la guerre sainte de l’indépendance.
C’était lui qui allait ruiner leurs espérances, livrer leur chef aux Anglais. Lui, le fils d’une pauvre cuisinière, allait éteindre l’étoile radieuse des Pharaons.
Antithèse bien digne du siècle de la mécanique ; antithèse qui le remplissait à la fois d’orgueil, et de colère : d’orgueil, en constatant quelles conséquences grandioses aurait l’intervention d’un être chétif ; de colère contre lui-même qui, vil espion, poserait un pied brutal sur les splendeurs d’un rêve généreux conçu par un peuple opprimé.
Pour échapper à sa souffrance morale, il dut s’affirmer énergiquement sa qualité d’Anglais, son devoir de se vouer à la victoire de sa nation.
Du reste l’aube vint, jetant sa buée rose sur le paysage, chassant le fantastique qui naît des clartés lunaires. Les villages actuels, éparpillés sur le sol sacré de l’île Éléphantine, sortaient de l’ombre des vieux temples, défigurant de leur laideur vivante les beautés mortes du passé.
Et tout à coup, Jack tressaillit. Sur la chaussée de la rue du Nil, plusieurs personnes venaient d’apparaître, sortant de l’hôtel d’Assouan. C’étaient Robert, Armand et leurs charmantes compagnes.
Tous levèrent les yeux vers les fenêtres des jeunes Anglais, n’apercevant pas Jack caché par les rideaux, et s’éloignèrent en riant.
Du coup, le guetteur retrouva sa lucidité. La gaieté des Français l’avait atteint comme un soufflet. Le sens lui en était connu. Ils se moquaient de lui, de son frère. Serrant les poings, il gronda :
– Riez, riez… nous verrons bien qui rira le dernier.
Puis, courant à John qui dormait la bouche ouverte, avec une expression de parfaite béatitude, il le secoua en criant :
– Debout et en route… Ils viennent de quitter l’hôtel.
À ces paroles magiques, John bondit sur ses pieds. Précipitamment les deux frères jetèrent leurs manteaux sur leurs épaules, se coiffèrent des capuchons qui dissimulèrent leur visage et s’élancèrent à la poursuite de leurs adversaires.

CHAPITRE V
L’ÎLE DE PYLAK (PHILOE)
À la gare d’Assouan, placée à l’extrémité Sud de la bourgade, les fils de mistress Price rejoignirent les Français. Ceux-ci n’accordèrent aucune attention aux deux personnages qui, du fait de leur costume, semblaient être des chefs arabes d’une tribu nomade du désert.
Le train était formé, et quelques minutes plus tard un coup de sifflet annonçait le départ.
Pour vingt guirch (piastres – 5 fr. 20), John et Jack avaient pris deux billets de première classe et s’étaient installés dans un compartiment voisin de celui que Robert Lavarède occupait avec ses amis.
Par les portières ils regardèrent au passage les vestiges de monuments anciens, qui se dressent au milieu des sables et des rochers du désert arabique : obélisques, tombeaux, temples d’Aménophis II, d’Osiris. Plus loin la voir ferrée coupe le mur de briques, qui court parallèlement au fleuve, et, laissant à gauche un cimetière arabe ainsi que les restes d’un ancien fort, elle vient mourir à la petite gare terminus de Philoe-Chellal.
Les voyageurs, des touristes pour la plupart, descendirent de wagon et se répandirent sous les sycomores dont la rive du Nil est ombragée. À ce moment, un batelier s’approcha des Anglais.
– La capitaine Nilia, murmura-t-il ; la nuit est tiède.
Encore une fois, les mots de ralliement sonnaient aux oreilles des jeunes gens.
– Mon bateau est là, dit l’homme après l’échange des répliques convenues. Je vais vous passer de suite dans l’île, d’où il vous sera facile de surveiller ceux que vous suivez.
Avec un geste d’assentiment, Jack et John s’embarquèrent, et le canot s’éloigna aussitôt du rivage.
En ce point, le Nil se divise en quatre bras qui enserrent les îles de Philoe, de Rigé et d’El-Heissé. Ces deux dernières, plus grandes que Philoe, s’apercevaient au loin. Du côté du nord, le lit du fleuve était semé de blocs rocheux sur lesquels l’eau se brisait en bouillonnant… C’était l’entrée des rapides de la première cataracte qui s’étend de Philoe à Assouan.
Mais ce qui fixa les regards des deux frères, ce fut l’île de Philoe elle-même. Pylak, comme l’appelaient les anciens Égyptiens, la Bylak des Arabes, la Gésireh-El-Birbe des fellahs, île charmante consacrée à Isis, était devant eux. Ses rives, caressées par le courant bleu du Nil, émergeaient des eaux comme un support géant soutenant une forêt de pierres et d’arbres. Les fûts des colonnes, la succession rythmique des péristyles, se mêlaient aux troncs de palmiers, au fouillis des plantes grimpantes, des buissons chargés de fleurs. Philoe s’étalait sur les eaux ainsi qu’un jardin, où les splendeurs de la nature luttaient avec les magnificences créées par cent générations d’hommes.
Cependant le bateau faisait du chemin, et sa quille vint grincer sur le sable de la petite crique, au fond de laquelle se dressent les piliers décapités, qui soutenaient les voûtes de la triple porte de la vieille cité d’Isis.
Les jeunes gens débarquèrent et le batelier s’éloigna à force de rames.
Restés seuls, John et Jack regardèrent sur la rive qu’ils venaient de quitter. À l’ombre des grands sycomores, ceux qu’ils devaient livrer aux Anglais avaient installé une nappe, et ils déjeunaient avec la tranquillité de touristes auxquels les affres des conspirations sont inconnues.
L’heure d’agir était encore éloignée. Aussi Jack, que l’approche du moment décisif emplissait d’émotion, proposa-t-il de parcourir l’île pour tuer le temps.
Trois cents mètres de long sur cinquante de large, telles sont les dimensions de l’îlot auquel le Nil bleu fait une ceinture ; mais ce petit espace contient un fouillis de temples et de verdures unique au monde.
Franchissant la triple porte, les deux frères parcoururent successivement le temple d’Auguste, l’église copte, les vestiges de la cité, les temples d’Harendotes ; ils passèrent sous le portail d’Hadrien, eurent un regard pour le Nilomètre, traversèrent le grand sanctuaire d’Isis aux pylônes massifs, aux cours énormes, puis ce fut le tour des temples d’Esculape, d’Ar-Hes-Nofer, d’Hathor.
Enfin le soleil étant parvenu au zénith, les fils de mistress Price, accablés de chaleur, grisés d’architecture antique, se réfugièrent dans le kiosque, exquise construction érigée sur la rive Est de l’île, en face de la berge où vient mourir le chemin de fer d’Assouan à Philoe.
Les colonnes figurant des plantes, les décorations des murs, où l’on voit Trajan, Isis, Osiris, Horus Hiéracocéphale, font de ce kiosque une délicieuse retraite.
De plus, il offrait aux jeunes gens un poste d’observation excellent, car de ce point ils découvraient sur un large espace le rivage Est du Nil, et aucune barque ne pouvait amener des étrangers à Philoe sans qu’ils s’en aperçussent.
Du reste, là-bas, sous les sycomores, ils distinguaient le groupe formé par les Français et leurs compagnes. Vraiment ces « faux touristes » manifestaient peu d’empressement à se rendre au but de leur voyage. Assis autour de la nappe encore chargée des reliefs de leur repas, ils semblaient s’abandonner à la paresse berceuse des heures de sieste, oubliant devant le Nil, tapis liquide coulant avec une lente majesté, et les ruines superbes et la conjuration égyptienne.
Toutefois la vue de leur nappe fit froncer le sourcil à John.
– Ils ont déjeuné, eux, grommela-t-il, tandis que nous…
– Nous sommes à jeun, riposta Jack en riant. Bah ! nous déjeunerons demain.
Sa résignation accentua la mauvaise humeur de son frère.
– Vous en parlez à votre aise, Jack ; mais peut-être vous n’avez pas faim.
– Si, si, je t’assure que je prendrais volontiers quelque chose. Seulement comme le temps nous a manqué pour nous munir de provisions, je trompe mon estomac en lui promettant un repas plantureux pour demain.
– Ah ! gronda John avec impatience, un estomac anglais ne se paie pas de semblables raisons ; je ne veux pas rouvrir nos querelles, Jack, cependant permettez-moi de vous dire que votre réflexion ne serait pas déplacée dans la bouche d’un Français.
Ce fut par un sourire que Jack accueillit cette boutade.
– Les Français jeûnent donc gaiement ?
– Certes, comme tous les peuples non pratiques.
– Eh bien, John, le plus sage aujourd’hui est d’oublier que nous sommes pratiques… ou de nous en souvenir seulement pour pratiquer la philosophie de l’abstinence.
Soudain le jeune homme s’interrompit. Une voix inconnue venait de dire :
– La capitaine Nilia. La nuit est tiède.
Tout d’une pièce, les deux frères se retournèrent. À l’entrée du kiosque se tenait un nègre, drapé dans un burnous rouge et portant à la main un panier qu’il posa devant eux :
– Déjeunez, fit-il ; on savait que vous n’auriez pas de provisions.
– On savait ? se récria Jack. Quand donc ?
– Hier soir.
– Hier ?
– Sans doute, puisque c’est vers la dixième heure que l’on m’a ordonné de venir vous retrouver aujourd’hui avec des aliments.
– On vous a ordonné, dites-vous… Qui ?
– Un Soudanais comme moi. Il m’a remis de l’argent, puis il est parti en me disant : Obéis et tu seras récompensé. Songe d’ailleurs que la punition la plus cruelle suivrait ta désobéissance. Je ne sais rien de plus.
Évidemment le nègre n’avait pas reçu les confidences de la mystérieuse correspondante des jeunes gens. Jack en fut irrité, mais John, doué comme il l’avait déclaré lui-même d’un estomac pratique, retrouva, avec la certitude de se substanter, toute sa philosophie.
– La capitaine Nilia songe à nous réconforter, conclut-il, c’est le principal. Déjeunons.
Et il découvrit le panier.
Des viandes froides, des petits pains dorés, des bouteilles d’excellente ale de la fabrication Allsopp, apparurent à ses regards charmés. Sans discuter davantage, il se mit en devoir de faire honneur à ces mets offerts si à propos par une main inconnue.
Force fut à Jack de l’imiter, et bientôt un formidable bruit de mâchoires couvrit le clapotis murmurant des eaux.
Les ombres des générations disparues, qui errent sans doute dans les ruines de l’île sacrée, durent certainement reconnaître, qu’au moins en ce qui concerne l’appétit, la race anglaise a conservé les grandes traditions du passé.
Quand les frères eurent terminé, le nègre replaça vaisselle et débris dans le panier, salua et disparut.
Un regard sur la rive opposée du fleuve apprit aux agents de lord Lewis Biggun que les Français ne songeaient pas encore à gagner l’île. Nonchalamment étendus sur l’herbe, ceux-ci se livraient aux douceurs de la sieste, sans se préoccuper des touristes plus courageux, qui s’embarquaient en ce moment pour la visite aux ruines.
– Bon, fit John, je vais dormir.
– Dors, répondit Jack. Je veillerai.
Un instant plus tard, le blond John ronflait avec la satisfaction béate et musicale d’un homme que la faim ne tourmente pas.
Jack s’était approché du mur bas, qui court entre les colonnettes du kiosque. Accoudé sur la pierre, il promenait un regard vague autour de lui. Il rêvait à cette femme, dont le nom remplissait sa pensée : la capitaine Nilia.
Qui était-elle ? En quel lieu cachait-elle son existence ? Il avait peur de cet être étrange dont il subissait à toute heure la volonté, et il se sentait invinciblement attiré vers la capitaine.
Le Sirdar, l’Angleterre se noyaient dans la brume du rêve. C’était à Nilia seule qu’il obéissait. C’était pour elle seule qu’il était devenu espion, agent de traîtrise et de mensonge, pour elle qu’il servait sa patrie putative, qu’il trahissait sa patrie possible.
Et les rancœurs que lui causait le métier odieux auquel il se livrait, lui semblaient devoir être effacées, oubliées, s’il était admis à voir la capitaine, à lui parler.
Il éprouvait, de la connaître, l’impatience d’un fiancé qui attend la présentation officielle à la famille de la fiancée.
Sentiment bizarre, inexplicable. Il eût dû mépriser la directrice d’un service de renseignements, qui avait fait de lui un agent obscur de la police britannique, et il ressentait seulement une anxiété tendre, une affection troublante.

De temps à autre, des touristes traversaient le kiosque. Leurs voix, leurs réflexions ramenaient une seconde Jack à la réalité. Le jeune homme reprenait son rôle de guetteur, s’assurait d’un coup d’œil que le groupe des Lavarède n’avait pas changé de place, puis, les bruits éteints, les curieux éloignés, il se replongeait avec délices dans sa rêverie.
Cependant la journée poursuivait son cours. Le soleil s’abaissait vers l’horizon du désert Lybique, jetant sur le sable des traînées de pourpre. Les visiteurs de l’île s’étaient retirés un à un ; le bleu des eaux se fonçait, prenait un ton d’indigo.
Comme s’ils eussent attendu ce moment, les Français, demeurés seuls sur la rive, se levèrent.
Jack tressaillit. Ses imaginations s’envolèrent. L’heure de l’action allait arriver. Et soudain il remarqua, au milieu du courant, une embarcation qui semblait venir de l’île même.
Un homme la montait. Coiffé d’un tarbouch rouge, le torse couvert d’un maillot sombre qui laissait à nu ses bras cuivrés, il ramait tranquillement sans se presser, dirigeant sa barque vers le point où les Français attendaient.
Sans nul doute, c’était le passeur des conjurés.
Vite, Jack secoua son frère, le mit au courant de ce qu’il avait observé, et tous deux se glissèrent hors du kiosque afin d’être prêts à toute éventualité.
Blottis maintenant derrière des buissons odorants, ils surveillaient leurs ennemis.
Jack ne s’était pas trompé. Le bateau s’arrêta en face de l’endroit où les Français avaient séjourné. Robert Lavarède, Armand, Aurett, Lotia et le singe Hope y prirent place aussitôt.
Le rameur fit évoluer l’embarcation, qui glissa lentement sur l’eau, son avant pointé vers le sud de l’île de Philoe.
Au point vers lequel se dirigeaient les voyageurs, se dresse une colline qui s’avance en promontoire, où se brise le courant du fleuve.
Plus boisée que le reste de île, cette éminence offre un lieu de débarquement propice à ceux qui désirent ne pas attirer l’attention, et les conspirateurs pouvaient croire qu’ils aborderaient sans éveiller les soupçons.
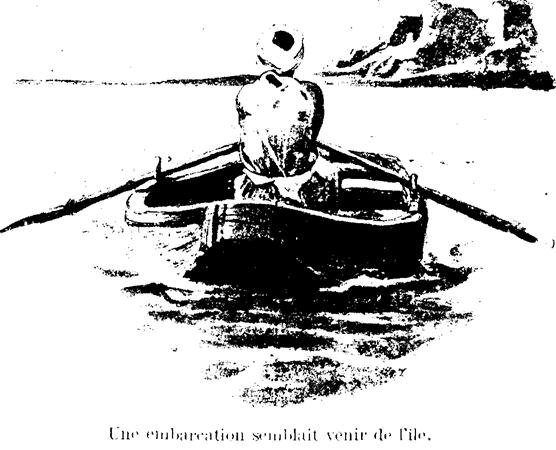
Mais ils avaient compté sans les fils de mistress Price.
Se coulant entre les buissons, les pierres éboulées, ainsi que des serpents, contournant les colonnades, les pylônes, ceux-ci gagnèrent la hauteur qui finit brusquement par une falaise d’une dizaine de mètres d’élévation.
La paroi verticale était semée d’arbustes, de flancs dont les racines s’étaient accrochées dans toutes les anfractuosités de la roche. Ces verdures formaient une sorte de dais au-dessus de l’eau qui ronge patiemment le pied de la falaise.
La barque approchait. Les jeunes gens distinguaient nettement les passagers. Le son de leurs voix parvenait jusqu’à eux. Puis le bateau contourna l’extrême pointe du promontoire, décrivit une courbe et disparut sous la voûte des flancs.
Aucun chemin ne permettait de gravir le rocher en cet endroit. Les voyageurs avaient donc l’intention d’avancer à l’abri des frondaisons et de prendre pied sur l’escalier qui accède du fleuve au temple d’Ar-Hes-Nofer, car c’était le point le plus proche où il fut possible de débarquer.
En vertu de cette conclusion, John et Jack, sans négliger les plus minutieuses précautions, se dirigèrent de ce côté.
Un bouquet de palmiers nains s’élevait à quelques pas de l’escalier. Ils s’y blottirent, attendant le passage de leurs ex-compagnons de la Yalla. Ils avaient l’intention de les suivre à la piste, d’épier tous leurs mouvements, afin d’en rendre compte au Sirdar.
Cinq minutes, puis dix s’écoulèrent sans que rien parût.
Une vague inquiétude envahit les jeunes gens. Est-ce que les Français auraient franchi l’escalier sans s’arrêter ? avaient-ils choisi comme but le portique de Nektanebos, ou bien encore les degrés du petit Nilomètre ?
Jack se rapprocha du rivage et explora du regard la surface du fleuve. Elle était déserte. Plus de falaise de ce côté, des berges basses et sablonneuses absolument découvertes. Un canot n’aurait pu se dissimuler.
Au risque de se trahir, les jeunes gens s’avancèrent jusqu’au bord de l’eau. Aucune barque ne se montra. On eût cru que l’embarcation des Français s’était dissipée en fumée.
Alors John et Jack se séparèrent. Ils parcoururent l’île dans tous les sens, inspectant les points qui se prêtaient à un débarquement ; mais ils se rejoignirent, après un tour complet, sans avoir relevé la moindre trace de leurs adversaires. Le canot était introuvable ainsi que ses passagers.
En fin de compte, Jack eut une lueur.
L’esquif s’était engouffré sous la voûte de feuillage qui cachait le pied de la falaise. Sans doute il y était resté, et les Français attendaient là, abrités des regards indiscrets, un signal convenu avec les conjurés.

Les jeunes gens revinrent à l’endroit où ils avaient cessé de voir leurs ennemis, et, s’aplatissant sur le sol, leurs têtes dépassant seules la crête du rocher, ils regardèrent au-dessous d’eux, pour surprendre les voyageurs lorsqu’ils sortiraient de leur cachette.
Ils se donnaient là une peine parfaitement inutile.
En effet la barque s’était coulée entre des flancs retombants et avait pénétré dans un petit bassin intérieur, resserré entre les tiges flexibles et le pied du rocher. Une coupure étroite, aux parois à pic, se découpait dans la paroi de la falaise.
Lentement le canot s’y était engagé, et brusquement les Français avaient été plongés dans une obscurité profonde. La coupée se transformait en tunnel. Loin dans l’ombre, en avant, une lueur tremblotait. On eût dit un phare éclairant la navigation souterraine.
– Le temple souterrain de Tépuraboë, murmura Lotia d’une voix assourdie.
– L’endroit, répondit Robert, d’où s’élèvera le cri de l’indépendance de l’Égypte. L’endroit d’où nous partirons à la conquête de la terre des Pharaons… et aussi de mon bonheur, ajouta-t-il en s’inclinant galamment devant la jeune fille.
Son cousin Armand ne parlait pas. Il regardait, écoutait, ému sans pouvoir préciser pourquoi. Le journaliste parisien avait le cœur serré en pénétrant dans le sanctuaire ignoré, où les patriotes s’étaient donné rendez-vous ; en sentant peser sur lui les voûtes qui, quarante siècles plus tôt, avaient retenti des psalmodies sacrées des prêtres d’Isis.
Un grincement, un choc léger se produisirent. Le bateau s’arrêta. Sa quille venait de s’engraver dans le sable.
Le rameur sauta sur une étroite corniche formant quai et aida les passagers à y prendre pied après lui.
Les mains tâtant la roche, tous se mirent en marche vers la clarté lointaine qu’ils avaient remarquée.
Au bout de cent pas, le guide les avertit que l’eau s’arrêtait là, et que désormais toute la longueur du corridor était praticable.
Sur du sable fin, moelleux comme un tapis, la petite troupe continua d’avancer. Le fanal qui les guidait augmentait d’intensité, piquant les parois du couloir d’étincelles brillantes.
Enfin, par une large baie, masquée en partie d’une tenture, les Français parvinrent à une vaste salle évidée dans le massif granitique, et dont le plafond cintré était soutenu par six colonnes massives.
Des lampes de cuivre l’éclairaient, dardant leurs rayons sur les murs couverts de peintures. Des bandelettes de fresques alternaient avec des lignes verticales d’inscriptions hiéroglyphiques.
Tout cela remonte à la grande époque égyptienne. Armand, Aurett s’arrêteraient bien devant ces merveilles d’un art disparu, mais le batelier ne le leur permet pas. Il s’avance vers une ouverture trapézoïdale, au linteau orné de deux cartouches, supportés par des femmes serrées dans des pagnes étroits et étendant ainsi que des ailes leurs bras garnis de plumes.
Il soulève une tenture. Les Européens ont un cri de surprise. Ils sont au seuil d’une salle immense dont la voûte peinte en bleu, décorée de palmettes d’or, s’arrondit en dôme à trente pieds du sol. Les murailles sont revêtues de peintures aux couleurs vives : globes symboliques ailés, cartouches royaux, serpents gonflant leurs gorges rouges, dieux à têtes d’animaux, scarabées prenant leur vol, Isis et Nephtis déployant leurs bras empennés ; tout l’olympe niliaque se presse là en une farandole éblouissante.
Des bancs sont alignés, chargés d’une assemblée silencieuse. Chefs fellahs, cheiks arabes, officiers de l’armée nationale égyptienne, derviches, ras abyssins, Nubiens aux visages d’ébène, guerriers des tribus nègres du Bahr-el-Ghazal, du Kordofan, du Bornou, du Ouadaï, délégués du pays Danakil, sont là, côte à côte. C’est un mélange bizarre de vestes brodées, de pagnes multicolores, de torses nus que l’on croirait taillés dans des blocs de basalte.
Et, devant ces hommes, représentants de l’Afrique niliaque, réunis par la haine de l’oppresseur anglais, se dresse une estrade supportant des fauteuils aux bois artistement fouillés, figurant des lions accroupis.
C’est vers ce point que les voyageurs sont poussés. Sans trop savoir comment. Robert se trouve assis sur le siège du milieu. À sa gauche, Lotia a déjà pris place. À sa droite se tient un vieillard à la longue barbe blanche.
– Mon père ! dit la jeune fille.
Celui-là est Yacoub Hador, l’âme de l’insurrection. Il l’a organisée dans l’ombre durant des années. Il a rassemblé tous les peuples du bassin du Nil, fait taire les rivalités, fondé l’unité de vues qui seule peut forcer la victoire. En dernier lieu, il a autorisé sa fille à se sacrifier à la cause égyptienne, à promettre sa main à celui qui osera assumer la responsabilité du commandement.
Doux sacrifice, puisque le cœur de Lotia est allé à Robert.
Un murmure s’est élevé à leur apparition, puis un grand silence se fait et le vieux Yacoub se lève.
– Frères, dit-il, la France, sœur d’Europe, héritière des grandes destinées de l’antique Égypte, nous a apporté la prospérité. C’est elle qui a inspiré les grands travaux qui nous avaient rendu la richesse. Une nation égoïste l’a supplantée, elle a occupé notre patrie, l’a traitée en pays conquis : c’est pourquoi nous sommes ici. Nous voulons redevenir libres ou bien arroser le sable du désert de notre sang. La semence sanglante n’est jamais inutile, elle prépare les moissons de guerriers, les hécatombes des oppresseurs.
– Vive l’Égypte libre ! clama l’assemblée électrisée.
– Oui, reprit le vieillard, vive l’Égypte libre ! Mais aussi : Vive le chef que le divin Osiris nous envoie ! Je vous disais tout à l’heure les bienfaits de la France ; c’est encore elle qui nous donne ce chef. Robert Lavarède, ici présent, consent à marcher à notre tête.
Et comme les assistants se levaient, brandissant leurs armes, Robert fit un geste. Comme par enchantement tout bruit cessa.
– Amis, s’écria le jeune homme, Lotia m’a guidé vers vous. Elle était aidée par l’un de vous, que je vois au pied de cette estrade.
Et, désignant un homme petit, sec, au teint de bronze, aux yeux noirs comme le jais, debout au premier rang des conjurés :
– Niari est son nom ; c’est Niari qui a été l’instrument de notre réunion ; qu’il soit honoré à l’égal d’Hador. Je lui ai juré de ne prendre aucun repos jusqu’au jour du triomphe de notre cause. Ce serment, je le réitère à vous tous, qui êtes accourus à l’appel de la patrie égyptienne.
Des acclamations frénétiques accueillirent ce morceau d’éloquence.
Armand debout derrière son cousin murmura :
– Mâtin, tu harangues la foule comme un professionnel.
Mais Robert continuait :
 – Jadis
un peuple d’Europe, attaqué par un ennemi dont les drapeaux enchaînaient la
victoire, se résolut aux derniers sacrifices pour conserver sa liberté. Il
ravagea ses champs, fit le désert autour de l’envahisseur, brûla ses cités, ses
villages. C’est en se ruinant elle-même, que la Russie a vaincu Napoléon l’invincible.
Français, moi qui sais quelle succession de malheurs a déchaînée sur ma patrie
cette épouvantable défaite, je suis obligé de rendre hommage au peuple russe.
Ce qu’il a fait, l’Égypte doit l’entreprendre aujourd’hui. Nos ennemis
s’assurent la possession du Nil, nourricier de sa vallée. Par la soif,
pensent-ils, ils courberont les populations sous leur joug. Eh bien, détournons
le fleuve, faisons sauter les digues d’irrigation et ne laissons aux
conquérants qu’une contrée déserte, stérile, desséchée, sur laquelle planeront
la désolation et la mort.
– Jadis
un peuple d’Europe, attaqué par un ennemi dont les drapeaux enchaînaient la
victoire, se résolut aux derniers sacrifices pour conserver sa liberté. Il
ravagea ses champs, fit le désert autour de l’envahisseur, brûla ses cités, ses
villages. C’est en se ruinant elle-même, que la Russie a vaincu Napoléon l’invincible.
Français, moi qui sais quelle succession de malheurs a déchaînée sur ma patrie
cette épouvantable défaite, je suis obligé de rendre hommage au peuple russe.
Ce qu’il a fait, l’Égypte doit l’entreprendre aujourd’hui. Nos ennemis
s’assurent la possession du Nil, nourricier de sa vallée. Par la soif,
pensent-ils, ils courberont les populations sous leur joug. Eh bien, détournons
le fleuve, faisons sauter les digues d’irrigation et ne laissons aux
conquérants qu’une contrée déserte, stérile, desséchée, sur laquelle planeront
la désolation et la mort.
Un rugissement sorti de mille poitrines ébranla l’atmosphère de la salle.
– Détournons le Nil ! Ruinons l’Égypte ! hurlaient les assistants.
Sur un geste du Français, les cris s’éteignirent.
– Amis, rentrez parmi vos frères, parmi ceux qui vous obéissent. Dans six semaines, à l’expiration du grand jeûne du Ramadan que tous quittent leurs demeures et se rassemblent vers Fashoda, après avoir détruit tout sur leur passage, afin d’empêcher la poursuite de nos ennemis. C’est là que je vous rejoindrai, c’est de là que nous fondrons sur les oppresseurs. Le noble Yacoub transmettra mes ordres à chacun de vous.
Des acclamations éclataient ainsi que des fanfares. Mais soudain un cri retentit, lugubre et désespéré :
– Frères. Les Anglais arrivent. Leurs troupes occupent les deux rives du Nil. Leurs canonnières encadrent l’île de Philoe !
Celui qui lançait ces paroles décourageantes était un noir, vêtu seulement d’un caleçon de cotonnade, et dont le corps nu ruisselait d’eau. D’un bond il fut sur l’estrade et d’une voix haletante :
– J’étais en faction sur la berge. Je les ai vus arriver. Caché dans les broussailles, j’ai entendu des officiers parler. Ils savent que vous êtes ici et veulent vous surprendre. Ils connaissent le passage de la falaise, et aussi celui qui débouche à la surface de l’île. Alors je me suis glissé dans l’eau, et je suis venu à la nage pour vous avertir.
Il y eut un moment de désordre inexprimable, mais Yacoub Hador se dressa, sa longue barbe blanche descendant sur sa poitrine ainsi que des rayons d’argent.
– Frères, cria-t-il, que chacun de vous emporte un banc, une tenture, une pièce de l’estrade. La trahison était prévue, et une ligne de retraite, inconnue de nos adversaires, est préparée.
En un instant chacun fut chargé, qui d’une planche, qui d’un fauteuil.
– Venez, ordonna encore le vieillard.
À sa suite tous passèrent dans la première salle qu’avaient traversée les voyageurs.
Yacoub se dirigea vers un angle, appuya la main sur le bec d’un ibis sacré, tracé sur la paroi en relief méplat, et soudain un pan de mur tourna sur lui-même, démasquant une ouverture béante.
Yacoub y entra le premier. À sa suite les conjurés s’y engouffrèrent ; puis l’entrée secrète se referma, et la crypte fut envahie par l’obscurité silencieuse que la réunion des conspirateurs avait un instant chassée.
Il était temps ; au loin, dans le couloir aboutissant au pied de la falaise, des pas lourds faisaient grincer le sable et des froissements d’acier passaient dans l’air.
C’étaient les soldats de lord Lewis Biggun qui envahissaient le temple souterrain.
La nuit venue, les troupes anglaises, ainsi que cela avait été arrêté au conseil de guerre s’étaient déployées sur les deux rives. Les canonnières avaient encadré l’île, sur laquelle des barques, réquisitionnées à cet effet, avaient transporté trois cents hommes du 22e Écossais, commandés par le général Lewis Biggun en personne et le major Archibald.
Du haut de leur observatoire, John et Jack avaient suivi tous ces mouvements.
Ils s’élancèrent à la rencontre du Sirdar et voulurent lui rendre compte de leur mission ; mais l’officier supérieur les interrompit en souriant :
– Je sais, je sais. Vous avez perdu de vue vos ex-compagnons, près de la falaise qui s’élève au sud de l’île.
– En effet, balbutia Jack stupéfait. Comment savez-vous cela, mon général ?
– Mon service de renseignements.
– La capitaine Nilia ?
– Elle-même.
Le jeune homme demeura muet, bouleversé. Cette Nilia l’obsédait, s’obstinant à le poursuivre en tous lieux, connaissant ses moindres démarches.
– Alors, fit-il au bout d’un instant, les rebelles sont toujours au même endroit ?
– Non, non ; il existe là un passage souterrain dans lequel ils se sont engagés, et où nous allons les suivre.
– C’est encore la capitaine qui… ?
– Vous l’avez dit. Mais assez causé. Mes Écossais ont tous effectué la traversée du fleuve, l’action va commencer. Je vous autorise à prendre place dans les chaloupes.
Pivotant sur ses talons, le Sirdar porta à ses lèvres un sifflet d’argent suspendu par une chaînette à l’une des boutonnières de son dolman, et il en tira un son prolongé.
Aussitôt les soldats, alignés sur la berge, chargèrent leurs armes, assujettirent leurs baïonnettes à l’extrémité du canon des fusils, et, se divisant en groupes de huit hommes, se réembarquèrent sur les bateaux qui les avaient amenés.
Lord Biggun, Archibald et les jeunes gens prirent place dans un canot. Les rameurs attendaient, les avirons levés.
Sur un signe du général, les palettes s’enfoncèrent dans l’eau, et l’embarcation s’éloigna de la rive, suivie par toute la flottille.
On contourna silencieusement le promontoire granitique formant l’extrémité Sud de l’île de Philoe. De même que les Français naguère, on s’engouffra sous la voûte sombre des broussailles accrochées à la paroi verticale du rocher, et soudain une large fissure se découpa dans la falaise.
– Voici l’entrée souterraine, murmura lord Biggun, comme se parlant à lui-même. Cette fois encore, Nilia ne m’a pas trompé.
Nilia ! Toujours Nilia ! Oubliant la réserve imposée en présence du généralissime des forces britanniques, Jack allait peut-être formuler une question indiscrète, mais il n’en eut pas le temps. Un clapotement bizarre retentit sur les eaux ; on eût dit le bruit des aubes d’un vapeur battant la surface du fleuve, et dans la nuit transparente, une masse sombre s’avança, évolua autour du canot et s’arrêta bord à bord avec lui.
Jack eut une exclamation de surprise. Il reconnaissait les parois de tôle du karrovarka. Ainsi que Rocko le lui avait affirmé autrefois, la voiture était devenue bateau. Sur le sommet, qui maintenant figurait le pont du singulier navire, une ombre sèche, grotesque, s’agitait. Le jeune homme devina le docteur Gorgius Kaufmann.
Lord Biggun l’avait reconnu également.
– Eh bien, docteur ? interrogea-t-il.
– Vous pouvez vous engager dans le souterrain, général. Vous ne rencontrerez pas de résistance.
– Tant mieux. J’étais inquiet de ne pas vous trouver au rendez-vous.
– Ah ! ne m’en veuillez pas. J’ignore pour quelle cause, mais la capitaine ne jouissait pas ce soir de sa lucidité habituelle.
– Vraiment ?
– Oui. J’ai eu du mal à obtenir les renseignements que je vous apporte.
– Doublement merci.
Sur ces mots, le Sirdar siffla de nouveau. Aussitôt les chaloupes s’avancèrent à la file. Chacune entrait dans la coupure du rocher, y déposait les soldats qu’elle contenait, puis ressortait pour faire place à une autre.
Jack était plongé dans les réflexions les plus absorbantes. Pour la millième fois, il se demandait quelle était cette capitaine Nilia, en qui le général Biggun avait une confiance suffisante pour lancer ses soldats dans un souterrain inexploré, propice aux embuscades, sur la simple affirmation que l’expédition ne rencontrerait pas de résistance.
Et ce docteur Kaufmann, qui servait d’intermédiaire entre le commandant en chef et l’inconnue ; il la connaissait donc, lui ? En l’interrogeant, peut-être obtiendrait-il quelques renseignements qui satisferaient sa curiosité. Qui sait même s’il n’apprendrait pas comment il la pourrait rencontrer. Voir la capitaine Nilia devenait pour lui une idée fixe, un besoin.
Cependant le débarquement se poursuivait. Les dernières chaloupes s’engouffrèrent dans le couloir sombre.
– À notre tour, dit gaiement lord Biggun.
Le canot s’enfonça dans la coupure du rocher, et, un instant plus tard, le général, le major Archibald et les deux frères étaient debout sur l’étroite corniche où Robert Lavarède et ses amis se trouvaient une heure auparavant.
Comme les Français ils parcoururent le long corridor, atteignirent la première salle aux six colonnes massives, puis la seconde dont la voûte bleue agrémentée de palmettes d’or montrait sa fraîche couleur, éclairée par des torches dont les Écossais s’étaient munis au départ.
Des couloirs partaient de ce point, serpentant à travers des failles de la montagne, aboutissant à d’autres pièces, se croisant en tous sens. Les soldats se livrèrent à une visite domiciliaire en règle dans le vieux temple d’Isis, mais aucun rebelle n’apparaissait.

Sur les murailles, les dieux peints ou sculptés, Ammon-Râ, Anubis, Atoum, Harmakhis, Hathor, Horus, Isis, Khnoum, Maat, Min, Nephthys, Osiris, Ptah, Sefkhet, Sekhmet, Sobk, Thooub, entourés, suivant les rites, de leur cortège d’ibis, de scarabées, de chiens, de crocodiles, semblaient, avec leurs visages immobiles, la raideur gracieuse de leurs corps, suivre ironiquement les recherches de ces envahisseurs outrecuidants, qui prétendaient dominer cette terre d’Égypte, où ils avaient régné jadis.
Les globes ailés, les soleils empennés, les cartouches agrémentés d’élytres se montraient un instant dans le vacillement de la flamme des torches, puis retombaient dans l’obscurité, donnant l’illusion du mouvement. On eût cru que cette volière mystique du passé s’animait et voletait, en une ronde silencieuse, autour des soldats dont le pied brutal profanait le sol consacré du temple.
Irrité de la disparition de ceux qu’il comptait surprendre, le Sirdar négligeait toute prudence.
Accompagné par le major Archibald, John et Jack, il parcourait impétueusement le labyrinthe souterrain. L’épée à la main, les dents serrées, menaçant comme le démon de l’extermination, il appelait les conspirateurs, les injuriait.
Mais seuls les échos de la crypte répondaient à sa voix.
De guerre lasse, il revint avec ses compagnons dans la salle où Robert avait harangué les conjurés.
Déjà la plupart des soldats y étaient réunis, découragés par l’inutilité de leurs recherches.
Leur allure penaude disait leur désappointement. Comme eux, le général se demanda s’il allait devoir quitter le sanctuaire de Tépuraboë sans avoir rien découvert.
C’était le ridicule, c’était une atteinte portée au prestige anglais. Le moyen de ne pas rire en effet de ce commandant en chef, mobilisant un corps d’armée pour aller visiter un temple souterrain.
– Nilia nous aurait-elle induits en erreur ? gronda-t-il avec une sourde colère.
Comme pour répondre à la question, le docteur Gorgius fit irruption dans la salle, sa redingote crasseuse flottant derrière lui.
– Général, s’écria-t-il, général.
– Ah ! c’est vous, grommela sèchement lord Biggun… Vous nous avez fait faire une jolie besogne…
Mais l’Allemand l’arrêta et, baissant la voix, pas assez pourtant pour que le major et les deux frères ne pussent l’entendre :
– La capitaine Nilia vient de me faire une communication importante.
Jack tressaillit de la tête aux pieds. Le docteur venait de la voir, de lui parler, à cette mystérieuse directrice de l’armée anglaise. Tout laid qu’il fût, il sembla au jeune homme qu’il apportait avec lui quelque chose d’elle, et il tendit les oreilles avec anxiété.
– Une communication ? fit dédaigneusement le Sirdar.
– Oui, général. Les conjurés étaient en ce lieu même tout à l’heure. Avertis de notre arrivée, ils ont fui par une issue que nous ignorions, car elle passe sous le fleuve et aboutit à deux kilomètres sur la rive droite, c’est-à-dire en arrière de la ligne de nos troupes.
– La belle avance de savoir cela maintenant !
– Attendez avant de maugréer. Les rebelles se sont dispersés. Quant aux Français, ils galopent à dos d’ânes vers Assouan. Ils rejoignent leur yacht, Yalla, à bord duquel il sera facile de les cueillir cette nuit même.
– Ah !
Le visage du généralissime s’était rasséréné.
– Où se trouve le passage dont vous parlez ?
– Venez, je vais vous le montrer.
À la suite du savant Allemand, lord Biggun et ses compagnons passèrent dans la première salle du temple. Gorgius s’avança sans hésiter vers l’angle où Yacoub Hador avait ouvert aux conspirateurs une voie de salut.
Il compta les hiéroglyphes gravés sur la paroi ; désignant enfin l’ibis que le vieillard avait touché de la main :
– Voyez cet oiseau, général. C’est un ibis, mais c’est aussi une serrure.
– Une serrure ?
– Appuyez sur le bec de ce volatile sacré et la porte s’ouvrira.
Intrigué, le Sirdar obéit, et soudain le pan de muraille glissa, laissant apercevoir l’entrée du couloir secret. Un instant, le lord parut vouloir s’y engager.
– À quoi bon ! dit-il.
Et, se tournant vers le major :
– Mon cher major, faites rassembler vos hommes. Ils rejoindront avec vous les régiments campés sur la rive droite. Vous ramènerez toutes les troupes au Caire par chemin de fer. Pour vous, Sir Gorgius, veuillez porter l’ordre à nos canonnières de descendre le fleuve et de capturer sans retard le yacht Yalla.
– Pourrai-je m’embarquer avec mon frère, sur l’une des canonnières ? demanda vivement Jack.
– Oui, sir Gorgius voudra bien remorquer votre canot.
Et, saluant les jeunes gens, Biggun se dirigea vers les soldats que le major Archibald groupait déjà suivant les ordres donnés.
Derrière l’Allemand, les fils de mistress Price reprirent le couloir conduisant à la fissure de la falaise.
Au bout de cent pas, Jack tira le savant par la manche.
– Docteur, fit-il d’un ton insinuant, vous avez donc vu la capitaine Nilia tout à l’heure ?
– Oui, répondit laconiquement l’interpellé.
– Ah ! ah ! et où cela, s’il vous plait ?
Gorgius se retourna, regarda son interlocuteur bien en face, et, d’un accent qui n’admettait pas de réplique :
– Je l’ai vue là où elle était, soyez-en sûr. Et maintenant faisons silence, car nous ne sommes pas ici pour bavarder.
Là-dessus, il se remit en marche, laissant Jack très vexé le maudire in petto.
Mais rien n’est tenace comme la curiosité. Parvenu à l’ouverture de la falaise, le jeune homme profita de l’instant où meinherr Kaufmann, grimpé sur le pont du karrovarka, y fixait la corde qui devait lui permettre de remorquer la barque où les deux frères s’étaient assis, et il demanda à voix fiasse à l’un des rameurs :
– Est-ce que le singulier bateau du docteur s’est éloigné pendant que nous étions dans le souterrain ?
– Non, dit l’homme.
– Ah ! alors quelqu’un est monté à son bord ?
– Non.
– Vous en êtes certain ?
– Aussi certain que de n’avoir pas mes yeux dans ma poche. Je n’ai pas bougé d’ici et j’ai examiné l’espèce d’embarcation en question, car jamais de ma vie je n’ai rencontré un navire de ce numéro-là.
Jack tendit une pièce de monnaie au batelier, qui la prit sans soupçonner ce qui lui valait cette générosité. Le brave garçon ne pouvait deviner que ses paroles avaient été un trait de lumière pour le curieux.
– Le karrovarka est demeuré en place, pensait ce dernier. Personne n’y est entré, et cependant le Gorgius a apporté une communication de la capitaine. Elle est donc à l’intérieur du bateau. Pour la voir, il s’agit d’y entrer. Cela ne sera pas commode certainement, car ce diable d’Allemand prend ses précautions ; mais bah ! j’espère bien y arriver tout de même. Après tout, j’ai déjà fait un grand pas, je sais où elle est.
Une secousse mit fin à son monologue. Le karrovarka s’ébranlait, ses roues d’arrière aux palettes mobiles frappaient l’eau avec régularité, et l’amarre tendue entraînait le canot.
En quelques minutes, on rejoignit une canonnière, embossée entre la pointe nord de l’île et le village de Chellal.
Les jeunes gens furent présentes par Gorgius au commandant du petit steamer, qui les accueillit gracieusement, et, le docteur étant repassé sur sa propre embarcation, le vapeur se mit en marche.
À toute vitesse, la canonnière contourna les îles de Kouosso et de Chellal, traversa le Nil dans toute sa largeur, et, se rapprochant de la rive gauche, se lança dans les rapides désignés sous le nom de première cataracte.
Debout sur le pont, John et Jack regardaient défiler les innombrables îlots qui obstruent le cours du fleuve. La canonnière Look bondissait sur les eaux écumantes, rasant les écueils de son bordage ; mais, guidée par la main ferme d’un pilote expérimenté, elle évitait en se jouant les obstacles accumulés sur sa route.

Comme une flèche, elle franchit l’étroit passage resserré entre les rochers de Red-flower et de Pretty-gate, se glissa dans le chenal qui sépare les îles rocheuses de Séchel et de Salong, puis, ralliant la rive droite, elle prolongea l’île Éléphantine et stoppa enfin vis-à-vis du débarcadère d’Assouan.
La Yalla était toujours amarrée à quai, et, dans les clartés nébuleuses de l’aube, sa coque blanche se détachait, élégante et fine, sur le fond sombre du « pier ».
Les jeunes gens regardaient le yacht coquet sur lequel ils avaient effectué la montée du Nil. Mais ils étaient agités de sentiments bien différents.
Pour John, c’était la joie du triomphe qui chantait en lui. Après un mois de réserve, de diplomatie, les ennemis de l’Angleterre allaient être capturés, et ce résultat serait dû en grande partie à son intervention.
Jack, au contraire, ressentait comme un remords. Le pavillon français flottant à l’arrière du gentil navire, ce pavillon dont l’étamine, mollement caressée par la brise, frôlait la surface de l’eau, allait s’abaisser sous la menace de canons anglais. Un trouble indéfinissable l’envahit, et il resta immobile, les regards invinciblement attirés par la Yalla, repris par un doute angoissant. Était-il Anglais ou Français ?
Cependant les autres canonnières britanniques arrivaient à leur tour, et bientôt la Yalla occupa le centre d’un demi-cercle formé de canons, dont les bouches menaçantes étaient pointées sur ses flancs.
Alors M. Blass, commandant le Look, s’avança vers les fils de mistress Price.
– Messieurs, dit-il, je vais aborder ce bateau rebelle. Je vous prie de vous tenir près de moi, afin de me désigner le chef de la conjuration égyptienne. Il importe surtout que celui-là ne puisse échapper.
– Volontiers, répondit John épanoui, volontiers. J’ai moi-même un petit compte à régler avec ce personnage, et je ne serai pas fâché de lui apprendre que j’ai coopéré à sa déconfiture. Jack et moi marcherons dans votre ombre.
Il saisissait en même temps le bras de son frère. Le plaisir d’écraser les Français le rendait presque expansif…, distrait aussi, car il ne s’aperçut pas que le bras de Jack tremblait.
En entendant l’ordre de M. Blass, le jeune homme avait pâli. Se retrouver en présence de ceux qu’il avait espionnés si longtemps, de ceux dont il avait volé la confiance, lui apparaissait comme une suprême honte.
Comment supporterait-il le regard méprisant des Français ? Ce regard, il le sentait déjà peser sur lui, implacable et vengeur. Déjà il entrevoyait le visage étonné, il entendait le murmure douloureux d’Aurett, de Lotia, de ces femmes charmantes dont la bonne grâce, l’affabilité, avaient fait de son voyage un enchantement.
D’avance il courbait la tête.
Mais un frémissement parcourut le steamer, annonçant que l’hélice se mettait en mouvement ; avec lenteur, le Look, s’avança vers le yacht. Un commandement bref retentit : Stop ! et le vapeur, courant sur son erre, vint s’arrêter le long de la Yalla.
Des matelots bondirent aussitôt sur le pont du léger navire, qu’ils fixèrent par des amarres à la canonnière, et M. Blass, suivi des deux frères et de plusieurs marins en armes, envahit le bâtiment du marchand copte Kedmos.
Au même instant, des cabines établies au centre du pont, Robert, Armand, Aurett et Lotia sortirent avec des exclamations de surprise.
Rentrés à bord depuis une heure, ils s’étaient jetés tout habillés sur leurs couchettes, et le bruit causé par la soudaine irruption de leurs ennemis les avait tirés de leur premier sommeil.
En une seconde, ils furent entourés, réduits à l’impuissance et poussés devant M. Blass.

CHAPITRE VI
IDYLLE AVEC L’INVISIBLE
– Saperlipopette ! s’écria Armand Lavarède, qui le premier avait repris son sang-froid. Est-ce l’usage des marins anglais de prendre d’assaut les yachts des touristes ?
– Taisez-vous, ordonna sèchement le commandant.
Le Parisien eut un haut-le-corps.
– Me taire, lorsqu’on trouble mon sommeil, celui de mes compagnes de voyage. N’espérez pas cela. Je veux me plaindre, crier… comme un putois encore.
Un haussement d’épaules de M. Blass arrêta les récriminations sur ses lèvres.
– Au nom de la Reine, je vous arrête, dit lentement ce dernier.
– Vous m’arrêtez ?
La stupéfaction du journaliste était évidente, mais elle ne dura pas longtemps.
L’officier fit un pas de côté, démasquant John et Jack, puis, s’adressant aux jeunes gens :
– Lequel de ces gentlemen est Robert Lavarède ?
– Celui-ci, répliqua John, en touchant du doigt la poitrine du fiancé de Lotia.
La jeune Égyptienne eut un cri douloureux en reconnaissant les deux frères.
– Vous, Messieurs ; des citoyens américains.
Ironiquement John l’interrompit :
– Plus Américains, ma jolie dame. De bons et loyaux Anglais, John et Jack Price, qui sont heureux d’avoir amené la prise des chefs de la conspiration égyptienne.
Il triomphait, lui, sans voir que son frère, dont le cœur battait à coups précipités, baissait la tête comme un coupable.
Aurett, Lotia eurent une exclamation étouffée ; une expression de désespoir couvrit leurs traits charmants. Dans une minute elles avaient mesuré l’étendue du désastre. La ligue des patriotes égyptiens était trahie. L’Angleterre serait sans pitié pour les Français audacieux, qui avaient rêvé de mener les fellahs à la victoire. Et elles, elles seraient séparées d’Armand, de Robert, ces hommes de cœur auxquels appartenait leur tendresse.
Armand essaya de protester encore.
– J’avoue, commença-t-il, ne pas très bien comprendre la relation qui existe entre nous et la conspiration dont vous parlez…
Mais la voix lente de M. Blass lui démontra aussitôt que toute négation était inutile.
– Sir Robert Lavarède, articula nettement l’Anglais, est le chef suprême des conjurés. Pour prix de son dévouement, il doit épouser miss Lotia Hador. Quant à sir Armand Lavarède, il est le lieutenant de son cousin. Il se vouait à la même cause, accompagné de son épouse légitime, mistress Aurett, née Murlyton, une Anglaise, que l’on s’étonne de voir au milieu des ennemis de l’Angleterre.
Il fit une pause et reprit :
– Cette nuit même, vous haranguiez les rebelles dans le temple souterrain de Tépuraboë. Avertis de l’approche des troupes britanniques, vous avez fui par un corridor qui passe dans le lit du Nil et aboutit sur la rive droite, en arrière du hameau d’El-Bab. À dos d’ânes, vous avez gagné Assouan et êtes remontés sur la Yalla, espérant ainsi tromper notre vigilance.
Si précis étaient les renseignements qu’aucun prisonnier ne trouva un mot à répondre. John, enchanté de voir ses adversaires accablés, se planta devant eux, les mains dans les poches :
– Eh ! eh ! Messieurs les Français, fit-il d’un ton narquois, vous voyez que de vrais Anglais, même après avoir absorbé un soporifique, dorment les yeux ouverts.
Il aurait continué, si un bruit étrange n’avait soudain détourné son attention. C’était un formidable grincement de dents qui se faisait entendre à deux pas de lui.
Les Anglais regardèrent de ce côté et demeurèrent saisis. L’orang-outang Hope était là, dressé sur ses pieds, frappant sa large poitrine de ses bras musculeux, dardant sur les marins des regards étincelants.
Après un geste de surprise, M. Blass se ressaisit et, d’une voix ferme, commanda :
– Apprêtez… armes !
Le cliquement sec des fusils lui répondit. Armand se précipita au-devant du singe.
– Ne tirez pas. Hope est un ami plus fidèle que d’autres – il regardait, en prononçant ces mots, Jack qui ne put s’empêcher de rougir. – Permettez qu’il nous suive et il ne fera de mal à personne.
Tout en parlant, il flattait de la main le singe qui s’apaisa aussitôt. M. Blass sourit.
– Mes instructions ne m’interdisent pas de vous accorder cette faveur. Veuillez passer avec cet animal sur ma canonnière. Je vous préviens seulement qu’à la moindre incartade de cet orang, je le fais abattre par mes matelots.
– Il ne bougera pas ; je vous remercie d’ailleurs de votre courtoisie. Dans un de nos voyages, nous avons capturé Hope à Bornéo, alors qu’il était tout petit. Il ne nous a jamais quittés depuis et il nous est très attaché. Maintenant, Monsieur, nous sommes à vos ordres.
Entre une double haie de marins, Robert, suivi de ses amis passa sur le Look ; Hope, dont la carrure athlétique démontrait qu’il était un échantillon vigoureux de sa race, réputée pour sa force extraordinaire, marchait après eux, tenant à distance respectueuse les hommes de l’équipage.
Aucun des matelots n’ignorait, en effet, que l’orang est un des plus effrayants adversaires qui se puissent rencontrer. Agile, doué d’une puissance musculaire presque fantastique, ce grand singe, fort doux quand il n’est pas attaqué, devient terrible en cas d’agression. Dix hommes ne l’effrayent pas, et, muni d’un gourdin, il vient aisément à bout d’un tigre. D’un coup de poing il troue comme un boulet la poitrine du chasseur.
Aussi les Anglais évitèrent-ils soigneusement de se mettre à portée de Hope, qui, en sa qualité de singe français, leur apparaissait tout naturellement comme un ennemi de la marine britannique.
Au moment de franchir la coupée, Armand s’arrêta un instant devant Jack éperdu, et, de façon à être entendu du jeune homme seulement, il murmura :
– Nous avions cru à votre amitié, Monsieur. Nous nous sommes trompés… mais, de votre côté, vous nous avez trompés. Je vous laisse le soin de juger lequel de nous mérite le mépris.
Et, laissant son interlocuteur écrasé, il mit le pied sur le pont du Look.
Là, M. Blass apprit à ses prisonniers que Robert serait enfermé dans une cabine, où des marins le garderaient à vue. Les autres captifs, moins importants au point de vue de la politique anglaise, jouiraient d’une liberté relative et seraient autorisés à se promener sur le pont.
La permission n’engageait pas beaucoup la responsabilité du commandant car il était de toute évidence qu’Armand et les femmes éplorées ne pourraient rien tenter contre la sécurité du petit navire.
Robert fut aussitôt conduit à sa prison, et ses amis allèrent tristement s’asseoir à l’avant.
De grosses larmes coulaient une à une sur les joues de Lotia.
– Du courage, lui dit doucement Aurett, émue par sa muette douleur.
– Du courage, je n’en ai plus. L’Angleterre est sans pitié. Robert gêne sa domination en Égypte ; on ne lui fera pas grâce, il mourra.
– Bon, interrompit le journaliste. Tant que l’on n’a pas rendu le dernier soupir, il y a lieu d’espérer. Si j’étais libre, je vous dirais : Robert sera sauvé. Mais je suis prisonnier comme lui, je ne puis rien dans cette situation fâcheuse. Je vais donc aviser à m’en tirer.
Et, comme Lotia secouait la tête :
– Vous n’êtes pas de notre pays, ma chère Lotia. Sans cela, vous sauriez que le mot « impossible », n’est pas français. J’espère du reste vous le prouver avant peu.
Déjà le journaliste, qui était bien, lui, de cette race insouciante et courageuse de France, avait retrouvé tout son calme. Par réflexion, le visage d’Aurett s’éclaircit ; elle tendit sa main mignonne à son mari.
– J’ai confiance, fit-elle tendrement, puisque vous ne désespérez pas.
Puis, enlaçant la jeune Égyptienne :
– Tout n’est pas perdu, soyez-en sûre, ma jolie Lotia. Armand l’affirme. Ah ! s’ils le connaissaient bien, je vous garantis que nos ennemis ne seraient pas étonnés que mon cœur soit devenu français.
Cependant le Look, ayant rallié les autres canonnières, demeurait immobile. Sur le pont, M. Blass se promenait de long en large, interrogeant du regard le chenal de l’île Éléphantine. Ses gestes exprimaient l’impatience.
Soudain sa face s’éclaira. À la surface des eaux venait d’apparaître un point noir qui s’avançait avec rapidité.
Jack, pensivement accoudé au bastingage d’arrière, avait aperçu également cet objet mobile et une rougeur ardente envahissait son visage.
Il venait de reconnaître le karrovarka du docteur Gorgius.
En une seconde, il oublia les paroles insultantes d’Armand, ses remords, sa honte, pour ne plus songer qu’à la capitaine Nilia, cette inconnue qu’il supposait enfermée dans les flancs du chariot-barque, et qui exerçait sur lui une attirance irrésistible.
Bientôt l’embarcation, poussée par les aubes de ses roues d’arrière, rejoignit la flottille anglaise. Sur la partie supérieure, lord Lewis Biggun et son inséparable ami le docteur Gorgius Kaufmann étaient debout l’un près de l’autre.
Leur bateau vint ranger le bordage du Look.
– Eh bien ? demanda le Sirdar à M. Blass qui se tenait à la coupée.
– L’arrestation est opérée, Milord général.
– Bien. Faites aux autres canonnières les signaux nécessaires pour qu’elles vous suivent et descendez le cours du fleuve. La halte de nuit aura lieu en face du village de Kom-Ombos. Nous regagnons le Caire, où il sera statué sur le sort des prisonniers. Surtout, veillez à ce que toute tentative d’évasion soit impossible.
Puis, adressant un geste amical aux fils de mistress Price :
– Je suis content de vous, jeunes gens. Je vous remercie de votre dévouement à l’Angleterre. En arrivant au Caire, vous aurez de mes nouvelles.
Paroles qui firent se redresser John ainsi qu’un coq de combat, tandis que Jack baissait la tête comme un boxeur vaincu.
Cependant des commandements brefs traversaient l’air :
– Go ahead ! go ahead !
Les cheminées des canonnières se couronnèrent d’un panache de fumée, et la flottille, le Look, en tête, contourna la pointe nord de l’île Éléphantine, commençant la descente du fleuve.
Le retour devait durer une huitaine. Aussi les bâtiments ne forcèrent pas de vitesse ; les hélices frappaient l’eau régulièrement à une allure modérée.
À midi, John et Jack « breakfastèrent » – car les Anglais breakfastent alors que les Français déjeunent – avec M. Blass, pris pour eux d’une considération particulière, depuis que le Sirdar leur avait adressé la parole. Le soir, ils dînèrent encore à sa table.
Les ombres de la nuit semaient leur cendre grise sur le paysage, quand les canonnières firent halte en face de Kom-Ombos. Elles s’alignèrent le long de la rive.
Jack salua avec joie le retour des ténèbres. La journée lui avait paru interminable. Sur le pont du petit navire, il croisait à chaque instant l’un des prisonniers, et, sous les regards méprisants de ses victimes, il baissait le front, sentant que ce mépris était mérité.
Vingt fois, il fut sur le point de se rendre auprès du commandant Blass, de le supplier d’enfermer Armand, Aurett, Lotia dans leurs cabines, tout comme Robert ; et chaque fois, au moment de parler, sa voix s’étrangla dans sa gorge.
Avoir été espion, cela suffisait. De quel droit se ferait-il bourreau ? De quel droit augmenterait-il les rigueurs de la captivité de ces Français, qui s’étaient montrés accueillants et aimables à son égard ?
Comme s’il eût deviné la nature des pensées du jeune homme, l’orang-outang Hope semblait rechercher sa compagnie. Le singulier animal, qui grinçait des dents lorsqu’un matelot s’approchait de lui, était venu, à plusieurs reprises, s’installer auprès de Jack, et ses yeux n’avaient rien de menaçant quand ils se fixaient sur lui.
D’abord gêné par cette sympathie soudaine, Jack s’y était bientôt accoutumé.
Il est vrai que les prisonniers, étonnés de la conduite de l’intelligent animal, le rappelaient bien vite :
– Hope ! ici.
L’orang obéissait, mais, à la première occasion, il retournait au fils de mistress Price.
La nuit venue, Jack, accoudé à l’arrière, considérait le paysage. Une brume légère montait de la surface du fleuve, phénomène rare en Égypte. Les contours des arbres, des maisons, des embarcations voisines, devenaient indistincts. Tout à coup un bruit d’aubes se fit entendre. Une masse noire émergea du brouillard, et le jeune homme reconnut le karrovarka du docteur Gorgius.
Le singulier véhicule aquatique se rapprocha successivement des différentes canonnières. On eût dit qu’il voulait les reconnaître. Enfin il arriva auprès du Look et stoppa juste en face de la coupée. Le panneau de la partie supérieure s’ouvrit ; le général en chef parut.
À l’aide d’une échelle métallique qui se déroula au dehors, lord Biggun atteignit le pont de la canonnière, prit par le bras le commandant Blass, lequel s’était précipité à sa rencontre, et l’entraîna dans sa cabine, dont la porte retomba sur les deux hommes.
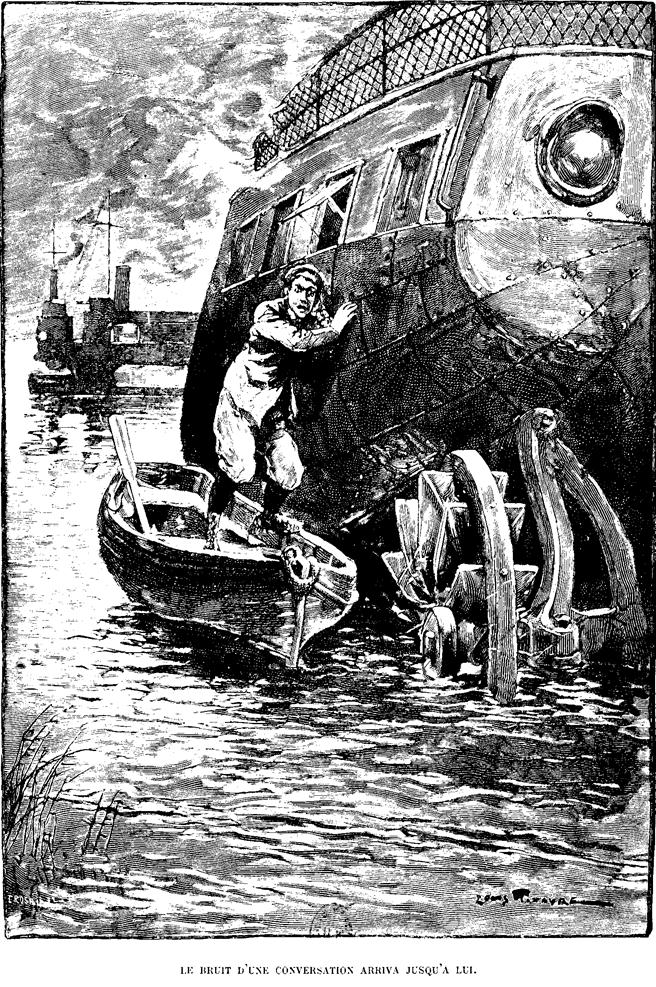
Brusquement tiré de ses réflexions par la venue du karrovarka, Jack avait quitté son poste à l’arrière.
Debout, près de la coupée, il examinait avec une curiosité ardente l’appareil qui, – il le pensait du moins – recelait en ses flancs la mystérieuse capitaine Nilia.
Mais les plaques de tôle boulonnées opposaient à ses regards un obstacle infranchissable. Les hublots percés dans le bordage étaient hermétiquement fermés. Aucun son, aucune lumière ne s’échappaient de ce sphinx métallique.
Longtemps, Jack resta là, pris d’une envie folle de bondir sur la bizarre embarcation, de se précipiter par l’écoutille ouverte. Peut-être allait-il succomber à la tentation, quand un coup de sifflet retentit.
Avec un claquement sec, le panneau du karrovarka s’abaissa, et le bateau lui-même, sous la poussée de ses palettes d’arrière, s’éloigna du Look.
Sans avoir conscience de son acte, le fils de mistress Price parcourut le pont de la canonnière, suivant la marche du boat. Celui-ci contourna l’arrière du navire et s’arrêta à quelques mètres, tout près de la berge.
Évidemment il passerait la nuit en cet endroit.
De nouveau Jack s’appuya au bastingage, les yeux rivés sur l’embarcation. À quoi songeait-il ? Il n’aurait pu le dire lui-même. Son corps demeurait sur le pont du Look, mais son âme était là-bas, près du bâtiment du docteur Gorgius. Elle errait, curieuse et troublée, autour de la barrière de tôle qui cachait la capitaine Nilia.
Les heures s’écoulèrent. L’extinction des lumières avait été sonnée à bord de la flottille anglaise. La bordée de quart seule était encore éveillée. Non loin de lui, le jeune homme apercevait la silhouette sombre d’un matelot, sentinelle vigilante dont les yeux vifs exploraient la nuit environnante.
Peu à peu cette silhouette devint moins précise. Le brouillard s’épaississait de plus en plus, noyant les objets sous son manteau opaque. Le karrovarka n’était plus visible, et pourtant Jack restait à la même place, ses regards obstinément fixés sur l’endroit où il savait être le bateau mystérieux.
Et tout à coup une impression étrange le pénétra. Il lui sembla ressentir un choc intérieur, il eut la perception nette, aiguë, que, du fond du karrovarka, Nilia l’appelait.
Hallucination sans nul doute ; mais la pensée de résister ne lui vint pas. Il voulut se rapprocher de l’inconnue, obéir à l’attraction inexplicable qu’il subissait. Sur le bastingage il se pencha, sans réfléchir, prêt à se laisser glisser à l’eau, emporté par le vertige tout comme le voyageur qui suit le feu follet dans les vases molles des tourbières, ou l’alpiniste que la voix des esprits de l’abîme entraîne au fond des précipices glacés.
Mais dans ce mouvement, il aperçut au-dessous de lui le canot de la canonnière. Amarrée à l’arrière, la barque se balançait, soulevée par l’onde paresseuse. Au fond de l’embarcation, les avirons étaient posés.
Jack eut un sourire satisfait. Sans bruit il se coula le long du bordage, prit pied dans le canot et détacha le filin d’amarre.
Puis, toujours avec d’infinies précautions, il fixa les rames sur les tolets et, plongeant les pales dans l’eau, dirigea la chaloupe vers le karrovarka.
En deux coups d’avirons, il perdit de vue la canonnière ; mais presque aussitôt la masse du bâtiment de Gorgius se montra à travers la brume.
Le cœur battant, Jack dirigea son esquif de ce côté. Il se rapprocha du bateau de métal, il en fit le tour, et brusquement stoppa à bâbord. Le volet de l’un des hublots était ouvert.
Jeter un coup d’œil à l’intérieur, telle fut l’idée du jeune homme. Il amena la barque contre le flanc du navire, se dressa debout sur le banc ; mais le hublot était trop élevé. À peine en atteignait-il le rebord en allongeant ses bras de toute leur longueur. Au risque de se trahir, Jack allait tenter de parvenir jusqu’à l’ouverture, quand le bruit d’une conversation arriva jusqu’à lui.
Deux personnes parlaient dans le bateau-char. L’une, à l’organe désagréable, autoritaire, que le curieux reconnut sans hésiter pour appartenir au docteur Gorgius Kaufmann ; l’autre, à la voix douce, triste, douloureuse.
– C’est elle ! murmura-t-il avec une émotion telle qu’il faillit tomber ; elle… Nilia !
Et les phrases suivantes frappèrent ses oreilles :
– Pourquoi ne reposez-vous pas encore ? grondait le docteur.
– Je ne sais, répondit la personne à laquelle il s’adressait. Il y a dans l’air quelque chose qui chasse le sommeil loin de moi.
– Quelle chose ?
– Je l’ignore. Est-ce qu’un orage nous menacerait ?
Avec colère le savant reprit :
– Depuis quelque temps déjà, je remarque en vous des distractions, des hésitations inaccoutumées. Prenez garde.
Un soupir profond fit frissonner Jack.
– Prendre garde à quoi ? gémit la voix de femme. Puis-je être plus malheureuse ? Captive dans cette prison roulante, n’ayant jamais la permission de sortir, de respirer ma part d’air pur, de m’exposer aux caresses des rayons du soleil, je bénirais la mort qui viendrait me délivrer.
Chaque mot frappait le cœur du jeune homme. Il écoutait, auditeur muet du drame poignant qui se déroulait derrière les murailles du karrovarka.
– Les esclaves se révoltent donc tous ! s’écria Gorgius. Est-ce que vraiment le contact de la terre d’Égypte ferait germer la rébellion ?
– Mes pieds n’ont pas foulé la terre dont vous parlez, répondit la femme, et je suis une révoltée bien peu à craindre. Mais c’est la dureté des maîtres qui enfante le désespoir des esclaves.
Puis brusquement, la voix vibrante :
– Pourquoi suis-je esclave ? Élevée parmi des bohémiens, sans être bohémienne, vous m’avez rencontrée. Vous avez donné de l’argent à celle qui m’avait élevée, et je suis devenue votre chose. Vous vous êtes arrogé le droit de me séquestrer, de me torturer sans cesse. Quelques pièces de monnaie ont suffi pour me plonger dans l’esclavage, pour me condamner aux larmes, à l’isolement. Est-ce donc là ce qui a été promis à l’humanité ?
Il y eut un silence et la femme poursuivit :
– Dans les grandes plaines d’Asie Mineure, alors que j’errais avec les bohémiens qui, eux au moins, me laissaient courir dans les prairies aux gazons verts, le chef, le vieil Okkar nous racontait une belle légende. Il nous disait : Bien loin vers l’Occident, il y a une puissante tribu, la tribu des Français. Un jour cette race guerrière s’est levée en masse, non pas pour piller les tribus voisines, mais pour délivrer les esclaves courbés sous le joug de maîtres barbares. Ils ont décidé que les peuples seraient les égaux des rois ; ils ont péri par milliers pour faire triompher cette cause juste, et ils l’ont imposée au monde. Maintenant le moindre des Français est libre ; il est heureux et fier. Ils ont une reine qu’ils aiment ; j’ai vu son portrait sur une médaille. C’est une jeune femme coiffée d’un bonnet comme les pêcheurs grecs de l’Archipel, on la nomme la reine République. Tous sont libres autour d’elle… je l’implore sans cesse, je l’appelle pour être libre à mon tour, mais elle ne répond pas. Peut-être ma voix est-elle trop faible, la reine des Français n’entend pas la pauvre captive.
De grosses larmes coulaient sur les joues de Jack sans qu’il y prît garde. Les lamentations de la prisonnière, née au milieu de l’Asie Mineure, ayant appris comme une merveilleuse légende l’histoire de la Révolution française, tout cela le bouleversait.
Mais de nouveau, l’organe de Gorgius s’éleva :
– Folies que tout cela, ma chère, folies. Voici ce que doit vous dicter la raison : Vous êtes en mon pouvoir, à ma discrétion. Ne cherchez jamais à m’échapper ; je vous rejoindrais bientôt et les plus cruels supplices vous seraient réservés. Plus d’hésitation non plus quand je vous interrogerai… j’exige que vous répondiez clairement, sans ambages. Le mensonge est une évasion morale qui me trouverait sans pitié.
Après une pause, l’Allemand conclut :
– Maintenant, reposez-vous, je le veux – et avec une ironie mordante – surtout ne comptez ni sur les Français, ni sur leur reine République pour vous délivrer. Ce que j’ai décidé s’accomplira, soyez en persuadée.
Les voix se turent. Jack perçut le battement léger d’une porte qui se refermait, puis plus rien. Il demeurait là, regardant le hublot ouvert, qui se découpait en noir sur la paroi du karrovarka.
– Nilia, murmura-t-il, Nilia, est-ce vous cette esclave sur qui je pleure ?
Il s’interrompit, secoué par un tremblement.
La femme invisible parlait encore et elle disait :
– Que t’importe, étranger ? C’est un Français qui doit me délivrer ; tu es Français, toi… mais tu as trahi ta patrie pour servir l’Angleterre.
Jack ferma les yeux, chancelant. Que de fois déjà il avait pensé : Je suis peut-être Français ; mon dévouement à la cause britannique est une trahison vis-à-vis de la France. Et l’être inconnu, enfermé dans le karrovarka, cet être vers lequel l’entraînait une inexplicable affinité, cet être substituait l’affirmation au doute :
– Tu es Français, toi ; mais tu as trahi ta patrie !
– Tu te repens, fit au bout d’un instant la douce voix… Qui sait si tu n’es pas, malgré tout, celui que j’attends. Répare le mal que tu as fait… Ordonne-moi de mentir à mes geôliers… Les Français auront besoin bientôt que je les aide d’un mensonge.
Comme il se taisait toujours, elle reprit avec plus de force :
– Ordonne que je leur mente. Ordonne, je sens que je t’obéirai.
Et, presque malgré lui, dominé par l’étrangeté de la scène, Jack bredouilla :
– Cache-leur la vérité.
– Merci, lui fut-il répondu. Maintenant pars. C’est au Caire seulement que nous nous verrons.
– Mais qui êtes-vous ? s’exclama le jeune homme retrouvant la parole, qui êtes-vous ?
– L’heure n’est pas venue… Au Caire seulement !… Au Caire !
La voix s’affaiblissait, comme si la personne qui parlait se fût éloignée. Le volet du hublot se referma, masquant l’ouverture, et Jack ne vit plus devant lui que la paroi lisse du bateau du docteur Gorgius.
Que faire, sinon retourner au Look ?
Le jeune homme se mit aux avirons, et, cinq minutes plus tard, il se hissait sur le pont de la canonnière, sans éveiller l’attention, grâce à l’épais rideau de brouillard.
Il y était à peine, que des cris, des pas précipités sonnant sur le plancher, parvinrent à ses oreilles. Curieusement il se porta en avant. Soudain une ombre émergea du brouillard, si rapidement qu’il ne put l’éviter. Un choc violent se produisit, et Jack roula à terre, tandis que l’apparition s’étalait de son côté sur le sol.
Avec un même grognement de colère, tous deux se relevèrent, firent un pas l’un vers l’autre et s’arrêtèrent stupéfaits.
– John ! murmura Jack.
– Jack ! s’écria John, car c’était à son frère même qu’il devait sa chute.
Puis, saisissant les mains de son interlocuteur, John poursuivit :
– Je vous cherchais avec inquiétude, Jack. Car, après la lettre reçue par lord Lewis Biggun, je craignais qu’il ne vous fût arrivé malheur.
– Quelle lettre ? interrogea l’interpellé.
– Quoi, ne le savez-vous pas ?
– Puisque je te le demande, John, c’est que je l’ignore.
– Où étiez-vous donc ?
– À l’arrière… je m’étais endormi.
Comme on le voit, Jack taisait la vérité. Il obéissait en cela à un sentiment de réserve indéfinissable. Sa rencontre avec la prisonnière de Kaufmann lui semblait devoir être tue, comme un secret ne lui appartenant pas.
– Vous dormiez… parfaitement ; cela explique tout, reprit John avec une volubilité qui contrastait avec son flegme habituel. Alors je vous mets au courant. Le Sirdar a trouvé, il y a dix minutes à peine, une lettre.
– A trouvé, dis-tu ? Quelqu’un l’a apportée… ?
– Évidemment, mais ce quelqu’un a négligé de se faire connaître. Du reste, en lisant la missive, le lord général a compris pourquoi.
– Qu’était-ce donc ?
– Une lettre de menaces.
– On a osé ?
– Il paraît. Bizarre était cette épître, écrite sans encre et sans plume.
– Ah çà ! c’est une charade que tu me proposes là ?
– Point. Avec une épingle, on avait piqué le papier, et la réunion des piqûres formait des lettres.
– Bon moyen de déguiser son écriture, remarqua Jack intéressé par le récit de son frère.
– Vous l’avez dit, reprit ce dernier. Et le correspondant inconnu du Sirdar a dû y songer, car il encourrait des peines sévères s’il était démasqué.
– Mais que contenait la missive ?
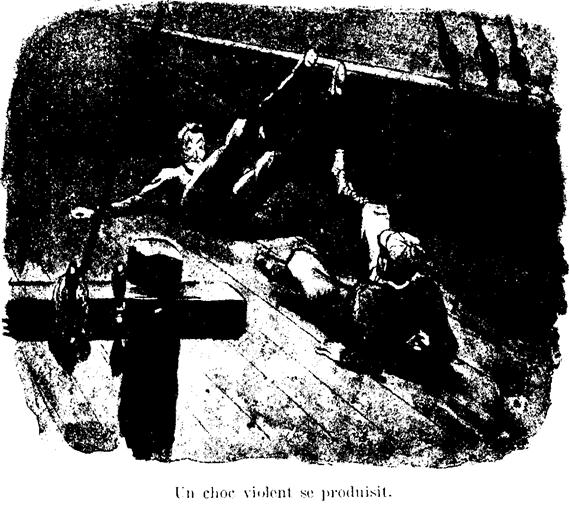
– J’y arrive. Lord Biggun me l’a communiquée, afin d’avoir mon impression – et, se rengorgeant, John ajouta : – Notre séjour auprès des damnés Français nous fait une situation à part ; on nous suppose bien mieux informés que nous ne le sommes en réalité.
– La lettre… la lettre…
– Toujours le même, Jack, toujours curieux, fit ironiquement Price le blond ; cependant je ne me jouerai pas de votre impatience. Je vais vous dire de mémoire ce que mes yeux ont lu.
Puis lentement il récita :
« Milord général. L’abus de la force engendre la colère. Sans motif, vous vous êtes arrogé le droit d’arrêter des touristes inoffensifs, appartenant à une nation dont l’Égypte conservera toujours le souvenir reconnaissant. Rendez-leur la liberté dès ce soir, ou bien l’Angleterre apprendra que les Égyptiens, amis fidèles, sont à l’occasion des ennemis à craindre. »
Le cœur de Jack battait à l’audition de ces paroles. La lutte entre Anglais et Africains commençait par ce cartel bizarre. Entre les lignes tracées par la pointe d’une épingle et la conversation que lui-même avait eue, un instant plus tôt, avec la captive inconnue du docteur Gorgius, il devinait une corrélation.
En se taisant, il prenait parti pour les adversaires de la puissance britannique ; il répudiait sa première patrie ; pour tout dire, il agissait en Français.
Son frère parlait toujours, il ne l’entendait plus. Une hallucination le prenait. Les flocons cotonneux du brouillard lui paraissaient s’agiter, se condenser en la forme de deux femmes : l’une, indistincte, drapée dans un voile qui dissimulait ses traits ; l’autre, plus précise reproduisant la silhouette de mistress Price.
Les apparitions se penchaient à son oreille :
– Tu es Français, disait la première. Suis le chemin indiqué par l’esclave Nilia.
– Tu es Anglais, reprenait l’autre. Sers le pays où tu as trouvé une mère.
Tout à coup il frissonna de la tête aux pieds. Un coup de sifflet aigu avait traversé l’espace, et John, se frottant les mains, s’était écrié :
– Bravo ! Le Sirdar appelle sir Gorgius Kaufmann, qui sert d’intermédiaire entre lui et les éclaireurs de la capitaine Nilia. Bientôt, je pense, on connaîtra le drôle qui s’est permis d’adresser au généralissime une lettre de menaces.
Nilia ! Pourquoi le frère de Jack prononçait-il ce nom, juste à cette heure ? Nilia, personnage double, capitaine ou esclave. Était-ce l’héroïne qui dirigeait les mouvements de l’armée d’occupation, ou bien la prisonnière gémissante, enfermée dans le karrovarka ? Était-ce celle qui avait guidé sa marche, prévoyant tout, devinant ses plus secrètes pensées… ou encore la femme désolée dont la voix douce vibrait toujours à son oreille :
– Tu es Français ; après tout, tu es peut-être celui que j’attends.
Et comme il luttait désespérément contre le trouble de son esprit, un clapotement courut sur la surface des eaux ; une masse sombre sortit de la brume, et le karrovarka vint ranger le flanc de la canonnière.
À la coupée, lord Lewis Biggun se tenait déjà. Au savant Allemand qui se dressa sur le pont de son embarcation, il tendit un papier avec ces simples mots :
– Reçu cette dépêche anonyme. Me trouver le nom et la retraite de son auteur.
Gorgius prit la missive, s’engouffra à l’intérieur du char flottant, et celui-ci, s’éloignant à toute vitesse, se perdit de nouveau dans le brouillard.
– Ce sera pour demain, murmura John, je vais dormir. Venez-vous, Jack ?
L’interpellé secoua la tête :
– Non. Tous ces événements ont chassé le sommeil loin de moi… Je resterai sur le pont.
– Comme vous voudrez ; bonsoir, frère.
– Bonsoir !
Se serrant la main, les jeunes gens se séparèrent. John regagna sa cabine, tandis que Jack s’accoudait au bastingage, le front appuyé sur ses mains. De nouveau, il se posait l’insoluble question :
– Qui est Nilia ?
Puis, comme un rayon de feu, un souvenir traversa son esprit. Au moment de le congédier, la prisonnière du docteur lui avait dit :
– Ordonnez-moi de mentir. Les Français auront bientôt besoin que je les aide d’un mensonge.
Et, cédant à un entraînement irrésistible, il avait répondu :
– Cachez la vérité.
Que signifiaient ces répliques inexpliquées ? Si Gorgius revenait sans rapporter la réponse attendue par le Sirdar, n’y aurait-il pas, dans ce fait, la preuve que Nilia et la captive étaient une seule et même personne ?
Mais alors lui, Jack, qui avait ordonné le mensonge, n’aurait-il pas travaillé en faveur des Français ? N’aurait-il pas trahi la cause britannique ?
Malgré la fraîcheur de la nuit, de grosses gouttes de sueur perlaient sur le front du jeune homme, tiraillé par son amour pour ses deux patries possibles. Et de fait, il faut convenir que la situation n’était pas ordinaire. De chaque côté de la Manche, des millions de patriotes adorent, soit la France, soit l’Angleterre ; mais se sentir patriote Anglo-Français, alors que Gaule et Grande-Bretagne ont des intérêts opposés, constitue un état pénible, un écartèlement moral, auquel Jack cherchait vainement à se soustraire.
Par moment, il voulait courir auprès de lord Biggun, lui raconter son excursion au karrovarka ; mais il chassait bientôt cette pensée, en songeant aux Français, ses anciens compagnons de voyage, peut-être ses compatriotes.
Et de nouveau ses angoisses le reprenaient.
Comment se serait terminée cette lutte intérieure ? Il est impossible de le prévoir. Par bonheur, il se produisit un incident qui mit fin aux irrésolutions de Jack.
Le karrovarka reparut.
Comme tout à l’heure, il stoppa juste en face de la coupée. Le docteur allemand sauta sur le pont du Look, courut au Sirdar, qui attendait immobile à quelques pas, et l’entraîna vers sa cabine. Mais le jeune homme, invisible dans l’ombre, perçut cependant ces mots :
– L’auteur de cette lettre est Yussef de Kom-Ombos. Inutile de chercher à le rejoindre, il a fui au désert avec sa famille et ses troupeaux.
Jack eut un profond soupir. Les éclaireurs de la capitaine Nilia avaient rempli leur tâche. Donc l’ordre exigé de lui n’avait pas été exécuté. En le donnant, il n’avait pas combattu les intérêts anglais.
Tranquillisé par cette constatation, il se décida à s’aller coucher. Déjà il se mettait en marche, mais il était écrit qu’il ne dormirait pas cette nuit. Un claquement métallique interrompit son mouvement commencé.
Ce bruit, il le reconnut sans hésiter ; c’était celui d’un mantelet des hublots du karrovarka.
Se penchant sur le bastingage, il examina d’un œil avide le flanc du bateau de tôle. Ses oreilles ne l’avaient pas trompé. L’un des volets s’était rabattu, et le hublot découpait son ouverture noire dans la surface polie.
Autour de lui Jack promena un regard inquiet. Personne n’était là. Sans doute les matelots, émus par le côté mystérieux de l’aventure arrivée à leur général, l’avaient suivi, attendant près de sa cabine le résultat de son entretien avec Gorgius Kaufmann.
Comme le fils de mistress Price se donnait cette explication, la voix de femme, déjà entendue une heure plus tôt, s’éleva :
– Tu as raison, disait-elle. Ils sont tous là-bas. J’ai menti comme tu l’as voulu. Ce n’est pas Yussef qui a écrit la lettre. C’est Armand Lavarède, prisonnier sur le Look. Il fait ce qui a été convenu avec Yacoub Hador. Je te dis la vérité, à toi, car tu garderas le secret. Tu es Français. Sers la France,… et, l’Égypte délivrée, tu auras deux mères.
– Quoi ! s’écria le jeune homme palpitant… Voulez-vous affirmer que ma mère, cette Française qui m’avait confié à la nourrice hindoue…
– Elle te pressera dans ses bras. Entre elle et la bonne mistress Price, tu vivras heureux, récompensé ainsi de ton dévouement à la cause des opprimés.
Bouleversé, les mains jointes, Jack voulait parler encore, interroger sa mystérieuse interlocutrice ; il n’en eut pas le temps.
– Ils reviennent, fit celle-ci. Je suis sûre de ta discrétion, je vois une mouche sur le nez du Sirdar.
Sur cette phrase incompréhensible, le panneau se referma brusquement.
Presque aussitôt des pas résonnèrent sur le pont du Look ; plusieurs personnes s’approchèrent, parmi lesquelles le jeune homme reconnut le général en chef et le docteur.
Ce dernier remonta à bord du karrovarka, adressa un geste d’adieu au Sirdar, puis rentra dans son appareil flottant qui se mit en marche.
Jack le regardait s’enfoncer dans le brouillard, quand une main s’appuya familièrement sur son épaule. Il se retourna et demeura interloqué. Le Sirdar était devant lui.
– Ah ! fit l’officier, c’est vous, mister Jack. Que diable faites-vous ici à pareille heure ?
– Je rêvais, balbutia le jeune homme.
– Aux événements de la soirée sans doute. Bah ! tout cela ne vaut pas qu’un bon Anglais veille. C’est une plaisanterie. Le drôle qui l’a commise s’est fait justice en fuyant au désert. Allez dormir, mon ami.
Un frisson parcourut le corps de Price le brun. Le Sirdar répétait l’explication mensongère apportée par Kaufmann. Il savait le mensonge, lui ; il en était la cause involontaire ; et, avec stupeur, il constata qu’il n’avait pas la moindre velléité d’éclairer lord Biggun.
Il le salua, respectueusement, alla s’enfermer dans sa cabine avec une célérité, que l’officier prit pour de l’obéissance.
Jack se jeta sur sa couchette, essaya de s’endormir. Tentative inutile. Un nouveau problème obsédait sa pensée.
Nilia, car c’était elle, il ne doutait plus, Nilia avait menti ; elle avait travesti les renseignements fournis par ses éclaireurs ; mais comment recevait-elle ces renseignements ? Lors de sa querelle avec l’Allemand, querelle à laquelle le fils de mistress Price assistait invisible, n’avait-elle pas déclaré qu’elle était captive, ne sortait jamais du karrovarka ?
Cela devenait de plus en plus incompréhensible.
Puis, au milieu des questions innombrables qui se pressaient dans le cerveau de Jack, et dont aucune ne recevait de réponse, revenait la phrase baroque sur laquelle s’était terminé l’entretien :
– Je vois une mouche sur le nez du Sirdar.
Quel était le sens caché de ces paroles ?
Bref, le jour survint sans que le curieux Jack eût goûté, une seule minute, les douceurs du repos.
De guerre lasse, il se leva et quitta la cabine, où John ronflait avec la quiétude d’une conscience pure. Mais en arrivant sur le pont, il eut un cri de surprise.
Tout l’équipage était rassemblé le long du bord du navire tourné vers le rivage. Les matelots discutaient avec animation, faisant de grands gestes. Jack se mêla aux groupes et comprit bientôt ce qui causait tout ce tumulte.
Avec le jour, le brouillard s’était dissipé. Sur la berge, solidement ligotés à des pieux solides, trois hommes, nus jusqu’à la ceinture, suppliaient désespérément qu’on les délivrât de leurs liens.
Et ces hommes suppliaient en anglais, avec un accent, des inflexions gutturales, qui ne pouvaient laisser aucun doute sur leur véritable nationalité. Ces gens ficelés, dans une position ridicule et pénible, étaient des citoyens de la Grande-Bretagne ; plus que cela, des soldats britanniques ainsi qu’en faisaient foi leurs pantalons d’ordonnance.
Malgré l’antagonisme qui existe entre les armées de terre et de mer, les matelots avaient senti que l’injure s’adressait à l’Angleterre même. Ils criaient, lançant des menaces aux auteurs de l’attentat commis sur les personnes sacrées de compatriotes.
M. Blass, prévenu, s’était précipité vers la cabine du Sirdar. Celui-ci rejoignait l’équipage exaspéré au moment de la venue de Jack.
Sur son ordre, plusieurs hommes sautèrent dans la chaloupe, gagnèrent le rivage et amenèrent à bord les victimes.
Mais là, l’indignation des assistants redoubla.
Les Anglais portaient au milieu de la poitrine un tatouage bleu, tout frais, à en juger par sa bordure sanguinolente ; et ce tatouage représentait un léopard expirant au-dessus d’une banderole sur laquelle on lisait :
– Qui triomphera du léopard anglais ?
L’allusion était transparente. Chacun sait que le léopard est l’emblème de l’Angleterre, comme l’alouette ou le cheval l’étaient des anciennes tribus gauloises, comme le coq l’est devenu, à la suite d’un jeu de mots, de la France moderne.
Le tatouage constituait donc bel et bien un acte de rébellion.
Interrogés, les malheureux ornés de cette parure anti-britannique ne purent fournir aucune explication.
Ils faisaient partie du poste d’observation établi à Kom-Ombos et fourni par le 7e régiment anglais.
La veille au soir, ayant obtenu la permission de minuit, ils avaient fait une partie de bateau sur le fleuve. À quelque distance de là, ils avaient rallié la rive et avaient soupé des provisions dont ils s’étaient munis au départ.
Après cela, ils ne se souvenaient plus de rien. Ils s’étaient endormis sans doute, et leur stupeur avait été grande, au réveil, de se trouver demi-nus, tatoués, et garrottés de façon malencontreuse.
– Il faut demander aux éclaireurs de Nilia, firent tout d’une voix les assistants, oubliant dans l’excès de leur colère, qu’en formulant cet avis, ils manquaient au respect hiérarchique dû au Sirdar.
Mais celui-ci ne releva même pas l’incorrection. Il était trop ému pour songer à la stricte observance des us et coutumes. Saisissant le sifflet d’argent suspendu à sa boutonnière par une chaînette, il en tira un son prolongé.
Le karrovarka, bien visible maintenant, stationnait à cinquante mètres du Look. Au signal du général, il glissa aussitôt sur les eaux et vint, comme la nuit précédente, s’arrêter en face de la coupée.
Gorgius se montra aussitôt à la partie supérieure de l’appareil. Mais, avant que lord Lewis Biggun l’eût interrogé :
– J’avais remarqué ces soldats qui vous occupent, dit-il. J’ai immédiatement signifié aux éclaireurs Nilia de me fournir les renseignements nécessaires. Les coupables sont des habitants de Kom-Ombos qui, leur coup fait, se sont enfoncés dans le désert.
– Encore ! gronda l’officier.
– Eh ! la configuration du pays indique tout naturellement à ces drôles leur ligne de retraite. À vingt kilomètres du fleuve, le désert commence et s’oppose à une poursuite efficace.
Jack, perdu dans le groupe des matelots attentifs, écoutait. Il lui semblait qu’une voix s’élevait à l’intérieur du karrovarka et que cette voix disait :
– J’ai menti, menti pour la seconde fois, d’après ton ordre.
Ce n’était point ses oreilles qui percevaient ces paroles… l’impression frappait directement son cerveau, lui causant un malaise indéfinissable, un tremblotement agaçant, analogue à celui qui secoue une personne tenant en mains les deux poignées d’une machine électrique.
Cependant le Sirdar, dominant son irritation, commandait :
– Que l’on donne des vêtements à ces hommes. On les reconduira ensuite à terre. Puis la flottille appareillera.
En un clin d’œil, ses ordres furent exécutés. Chacun des soldats, marqués au léopard, reçut une chemise, une vareuse de matelot, un béret ; ainsi équipés, fantassins par le pantalon, marins par la blouse, ils furent reconduits à terre et reprirent penauds le chemin du poste de Kom-Ombos.
Aussitôt un pavillon multicolore courut sur le mât du Look, et, en exécution du commandement ainsi transmis, les cheminées de toutes les canonnières se couronnèrent d’un panache de fumée, les hélices battirent l’eau, creusant des remous tourbillonnants, et la flottille britannique descendit le cours du fleuve. Pensif, Jack arpentait le pont de long en large, était las, au moral comme au physique, et sa pensée ne lui accordait aucun repos. Sans cesse les incidents de la nuit se représentaient à son esprit. Plus il allait, plus il était conquis par cette captive inconnue, dont il ignorait l’âge, la condition sociale, le visage même. Son âme était prise par une voix harmonieuse, de même que celle du voyageur oublieux de la fatigue de la route, des défiances de la nuit venue, lorsque le vent courant à travers les branches, éveille les harpes éoliennes des bois.
En regardant au dedans de lui-même, le jeune homme était effrayé. Il ne se reconnaissait plus.
Depuis de longues semaines, il se débattait en un doute pénible : Devait-il son dévouement à l’Angleterre ou à la France ? Maintenant le doute avait fui. D’heure en heure, il se sentait devenir Français. Il souriait au souvenir du traitement burlesque infligé aux trois soldats anglais.
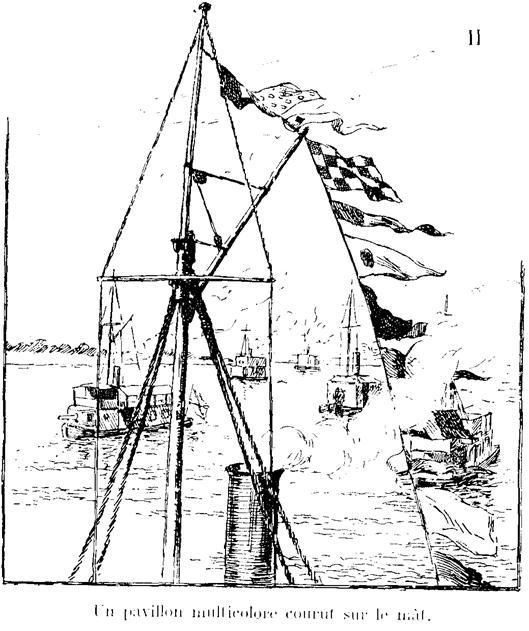
La veille encore, il eût épousé leur querelle ; aujourd’hui, l’aventure l’égayait. Avec stupeur il se demandait quelle puissance avait ainsi métamorphosé son être. Et tout, bas, avec une volupté ineffable, il murmurait :
– Nilia !
Puis son visage s’assombrissait :
– Mistress Price sera triste par ma faute, soupirait-il.
Sa phrase le faisait tressaillir :
– Je dis : mistress Price ; hier, j’aurais dit : ma mère.
Alors, par une transition naturelle, son esprit s’envolait à la recherche de sa mère véritable, de cette française ignorée, dont la prisonnière de l’Allemand Gorgius lui avait annoncé les baisers futurs.
Où était-elle ? En quels lieux pleurait-elle le fils qu’elle pensait sans doute à jamais perdu ?
Soudain le bruit d’une discussion le ramena à la réalité.
Il leva les yeux. Sans s’en apercevoir, il était arrivé près d’un groupe de plusieurs personnes. Il reconnut Armand Lavarède, Lotia, Aurett, flanqués de l’inévitable orang-outang Hope. Mais ceux-ci n’étaient pas seuls. John se tenait devant eux et, d’un ton plein de morgue, il parlait :
– Je devine la chose. Ces malheureux soldats ont été endormis, à l’aide du soporifique que vous nous aviez offert à l’hôtel d’Assouan. Cela réussit parfois. Mais vous auriez tort de triompher… Vos amis ont échappé à la punition qu’ils méritent. Après ? Vous, les chefs de l’insurrection, en êtes-vous moins entre nos mains ? Allez, allez, quoi que fassent les malheureux que vous avez exaltés, vous serez occis et la révolte ainsi décapitée ne saurait inquiéter l’Angleterre !
À ces cruelles paroles, Lotia se cacha la figure dans ses mains. Elle gémit :
– Robert ! C’est moi qui l’aurai entraîné à sa perte.
Mais Armand la forçant à montrer son visage :
– Ne pleurez pas, Lotia, fit-il. Nous ne sommes pas encore morts, aussi vrai que ce jeune Anglais est un mal appris.
Et comme John ouvrait la bouche pour répondre, le journaliste lui coupa la parole :
– Inutile de continuer, Monsieur. Votre petit discours nous a édifiés sur la supériorité de l’industrie anglaise, en matière de « pickles ».
– De pickles ? répéta Price le blond ahuri.
– Oui, Monsieur, de pickles… en français, nous prononçons : cornichons.
Les poings de John se serrèrent à cette conclusion inattendue. Pour Jack, il ne put retenir un éclat de rire qui attira l’attention sur lui.
– Tenez, reprit Armand en s’adressant à John. Voici votre frère ; il a coopéré comme vous à notre arrestation. Au moins, il a le bon goût de ne pas se glorifier d’une action qui, pour être inspirée par le patriotisme, n’en constitue pas moins une traîtrise.
Jack se sentit rougir. Les yeux des jeunes femmes pesaient sur lui comme un muet reproche. Un besoin de s’excuser, de s’expliquer l’envahissait, et son frère s’étant éloigné avec un haussement d’épaules dédaigneux, il saisit vivement le poignet de Lavarède :
– Je sais quel est l’auteur de la lettre reçue cette nuit par le Sirdar, prononça-t-il à voix basse.
Le Parisien sursauta :
– Vous savez ?
– Oui. Il se nomme Armand Lavarède… c’est vous !
Une expression d’indicible surprise couvrit le visage du prisonnier.
– Or, poursuivit le jeune homme, je connais ce détail depuis hier, et en ce moment, je suis encore seul à le connaître à bord.
Puis, avec un accent qui alla au cœur d’Armand :
– Ne parlez donc plus de traîtrise. Un jour, vous apprendrez mon histoire… J’étais Anglais, j’ai agi en Anglais… mais maintenant…
– Maintenant ?
– Je suis Français… mon parti est pris. Coûte que coûte, je serai Français.
M. Blass se montra à quelques pas. Jack se sépara aussitôt du Parisien, le laissant stupéfait de l’incompréhensible confidence qu’il venait de recevoir.
La journée s’écoula sans que Jack cherchât à se rapprocher des prisonniers. Il était gai, toute trace de préoccupation avait disparu chez lui. Son entretien avec Armand l’avait soulagé. Il avait pris l’engagement de servir la France, représentée en Égypte par les chefs de l’insurrection et, première récompense d’une décision virile, le calme lui était revenu.
Hope, avec l’admirable instinct de sa race, avait certainement compris qu’il s’était passé un fait favorable à ses maîtres. À maintes reprises, il s’installa auprès de Jack, et celui-ci remarqua, avec satisfaction, que les prisonniers ne rappelaient plus le singe comme autrefois.
Armand Lavarède avait donc cru à sa sincérité. Une entente tacite s’établissait entre lui et les adversaires déclarés de l’Angleterre. Cela lui fit plaisir.
Décidément son évolution marchait à pas de géant.
Le soir, la flottille s’arrêta le long de la rive gauche du Nil, en face de la bourgade d’Esnek, escale des bateaux de touristes et station du chemin de fer.
La nuit s’écoula paisiblement pour tout le monde à bord du Look. Au matin, par exemple, tout le personnel de la canonnière fut en l’air.
Le Sirdar, à son réveil, avait trouvé un papier glissé par une main inconnue sous la porte de sa cabine.
Ce papier, percé comme le précédent, de piqûres d’épingles, contenait cet avis laconique :
« Auprès de Keneh, s’élève une petite caserne fortifiée dont la garnison se monte à vingt-cinq hommes. Ce soir les “dessinateurs du léopard” opéreront en cet endroit. »
La missive disait vrai. Vingt-cinq soldats gardent la caserne, ou plus exactement le fortin de Keneh.
Comme une traînée de poudre, la nouvelle s’était répandue parmi l’équipage du Look, ranimant la colère des marins.
Ah çà ! ces damnés Égyptiens se moquaient des troupes britanniques ? On réclamait les éclaireurs Nilia en les invectivant un peu, il faut bien l’avouer.
Où étaient ces gens qui, depuis des semaines, renseignaient si merveilleusement les troupes britanniques et dont l’adresse se trouvait subitement en défaut ?
Ce revirement était humain. On n’inspire la confiance aux masses qu’à la condition de réussir toujours.
Mais le karrovarka ne se montrait pas à l’horizon. Sans doute, son propriétaire était retenu par une affaire plus pressante.
Et le Sirdar énervé, gagné par l’impatience de ses subordonnés, fut contraint de prendre une décision.
Après tout, les rebelles n’oseraient agir de vive force. Vingt-cinq soldats anglais mettraient en déroute toute l’infanterie égyptienne. Ce qu’il y avait à craindre, c’était une attaque par ruse comme celle dont, la veille, avaient été victimes les militaires tatoués.
Eh bien ! l’on veillerait, et, pour assurer la surveillance, lord Biggun en personne passerait la nuit au fortin de Keneh. Sa seule présence réduirait à néant les projets des révoltés.
Une acclamation accueillit l’annonce de cette résolution.
Les marins apaisés allèrent jusqu’à railler les insurgés, avec cette légèreté de plaisanterie qui caractérise le matelot anglais.
La flottille reprit la descente du fleuve, et, vers 4 heures du soir, atteignit la halte de Keneh.
À trois cents mètres de la rive, sur une colline peu élevée, on apercevait les ouvrages défendant l’approche du fortin.
Déjà la section qui devait accompagner le général à terre, avait pris place dans la chaloupe, quand Jack vint se planter devant le Sirdar.
– Que voulez-vous ? demanda celui-ci.
– Solliciter, pour moi et pour mon frère, la faveur de vous suivre au fort de Keneh.
– Pourquoi ?
– Parce que jusqu’à ce moment, nous avons été espions de l’Angleterre, et il nous serait agréable de la servir en soldats.
Un sourire passa sur le visage morose de l’officier.
– Venez, dit-il enfin. Je sais que je puis compter sur vous ; j’aurais donc mauvaise grâce à refuser ce que vous désirez.
Sur ces paroles, il descendit dans le canot ; John et Jack en firent autant, et l’embarcation, enlevée par les rameurs, franchit en une minute les quelques brasses qui séparaient le Look de la berge.
– Quel intérêt avons-nous à aller à Keneh ? questionna John pendant cette courte traversée. Le Sirdar étant là, il ne se produira rien de curieux. Seulement il fera veiller tout le monde, et nous gagnerons à votre idée une nuit sans sommeil.
– C’est bien possible, frère, riposta Jack. Mais s’il arrive quelque chose, je tiens à être présent pour voir.
– Alors c’est de la curiosité ?
– Je ne m’en défends pas.
– Toujours ce caractère français que je vous reproche.
Cette fois, Jack ne se fâcha pas de la boutade de Price le blond. Il eut un sourire énigmatique et murmura si bas que son interlocuteur ne put l’entendre.
– Bon John, va. Il a lu dans mon âme avant moi-même. Il s’irritait de mon caractère français, que dirait-il s’il devinait que mon cœur l’est devenu tout autant ?
Le bateau abordait. Interrompant son monologue, le jeune homme sauta sur le rivage. Suivant le Sirdar et le peloton de marins marchant en bon ordre, il se dirigea, comme John, vers la colline que dominait la redoute anglaise.

CHAPITRE VII
LA MOUCHE SUR LE NEZ
L’arrivée des canonnières avait été signalée. Toute la garnison du poste était sous les armes. Les vingt-quatre soldats, commandés par l’adjudant Ball, vingt-cinquième représentant de l’incomparable armée britannique, s’étaient formés sur deux rangs à l’entrée du fort.
Vraiment ces héros avaient bonne mine. Tous gras, luisants, bien nourris, ils démontraient jusqu’à l’évidence la qualité superfine des vivres de l’administration et le fonctionnement extra-incomparable de l’intendance.
Pour l’honneur de son grade, l’adjudant Ball s’était toujours gorgé de nourriture, afin d’être plus bedonnant, plus majestueux qu’aucun de ses subordonnés. Il avait réussi, et, complètement obèse, il étalait avec un légitime orgueil, un abdomen proéminent, admirable exemple d’esprit militaire.
Superbe, il trônait à la droite de sa troupe, la boucle de son ceinturon dans l’alignement du premier rang, et le côté opposé de son individu dans l’alignement postérieur du second. La venue du Sirdar le faisait rutiler. Adjudant, c’est-à-dire le premier parmi les sous-officiers, il avait l’ambition de passer sous-lieutenant. Son général remarquerait certainement que son épaisseur égalait celle de deux hommes. Quel droit à l’avancement pouvait entrer en lutte avec une pareille prédisposition à la supériorité hiérarchique ?
– Attention, dit-il, lorsque lord Biggun et son escorte parurent au sommet du plateau. Portez… armes !… Que l’on manœuvre avec ensemble, pour l’honneur de la vieille Angleterre.
Raides comme des piquets, les soldats exécutèrent le mouvement commandé. On eût dit une troupe d’automates.
Et le Sirdar n’étant plus qu’à vingt pas, Ball leva son sabre, et de sa voix grasse lança dans l’air :
– Présentez… armes !
Les fusils sonnèrent, frappés par des mains nerveuses ; devant le général, les vingt-cinq hommes demeurèrent immobiles, tel un peloton de statues.
– Faites poser l’arme au pied, ordonna lord Lewis Biggun.
– Portez… armes !… Reposez, armes ! clama l’adjudant. D’un même choc, les crosses s’abattirent sur le sol.
– Formez le cercle, reprit le Sirdar.
Puis, quand il fut entouré par la petite garnison du fortin de Keneh :
– En place, repos ! dit-il.
Aussitôt les soldats portèrent vivement la jambe droite en avant, en faisant glisser la main sur la bretelle de leur arme, démontrant ainsi que dans l’armée, le « repos » est encore un mouvement.
– Mes braves amis, commença alors le Sirdar, des fous ont rêvé d’arracher l’Égypte à la domination britannique, pour la replonger dans la barbarie dont nous l’avons tirée. Les chefs de cette ridicule équipée sont entre nos mains ; mais quelques drôles, des faquins sans importance, essaient d’impressionner nos valeureux soldats, comme si des cœurs anglais étaient accessibles à la crainte.
Un murmure approbatif parcourut les rangs et Biggun reprit avec un sourire :
– Avant-hier, les coquins ont capturé trois braves militaires. Ils ont tatoué sur leur poitrine le léopard britannique avec cette devise insolente : Qui triomphera du léopard ? Ils ont posé la question, sans trouver la réponse, car l’Angleterre est invincible ; ses flottes peuvent ruiner le commerce de tous les peuples, et dans ses îles défendues par l’Océan, elle est inattaquable.
– Hurrah ! dirent flegmatiquement les soldats.
– Vous avez compris, poursuivit le Sirdar. Comme tout citoyen anglais, chacun de vous se rend compte de l’invulnérabilité de la patrie. Ce que l’on tentera contre nous aboutira toujours à la confusion de nos ennemis. Toutefois, il importe d’arrêter nos adversaires dès le début, car les tracasseries les meilleures sont celles qui ont le moins de durée. Or, je suis averti que l’on se propose de renouveler cette nuit, sur la garnison de Keneh, la plaisanterie du léopard.
L’assistance roula des yeux furibonds.
– Aussi, conclut le général, je viens passer la nuit au milieu de vous. Les factionnaires auront leurs armes chargées… Quiconque approchera devra être impitoyablement fusillé !… Comme la veille est fatigante, j’ai décidé que chacun de vous recevrait ce soir double ration, une pinte de vin et un quart de gin.
– Hip ! Hip ! clamèrent les hommes avec un enthousiasme non dissimulé.
– Maintenant, rompez le cercle et rentrez à la redoute. Adjudant Ball, nous allons visiter l’ouvrage ; nous placerons les sentinelles ensemble.
Gonflé d’orgueil, ce dernier remit le commandement à un sergent qui emmena les soldats, puis dans une attitude aussi militaire que son abdomen le permettait, il attendit les ordres du généralissime.
L’ouvrage de Keneh est un simple poste fortifié. Au centre s’élève une construction carrée, faite de pierres meulières et qui sert de caserne. Tout autour existe une cour fermée par un mur crénelé, à l’extérieur duquel se creuse un fossé gazonné d’une profondeur de deux mètres. Avec du canon, le fortin serait enlevé en une demi-heure ; mais tel quel il pouvait impunément soutenir l’attaque d’une bande d’indigènes mal armés.
Lord Lewis Biggun parcourut la redoute, toujours flanqué de l’énorme Ball. Il visita les moindres recoins, s’assura que les caves contenant habillements, munitions, etc., étaient exactement closes. Enfin, il pénétra dans la chambrée, où s’alignaient les lits de vingt hommes et de deux caporaux, puis dans les salles affectées au sergent Richard, au sergent-major Tub et à l’adjudant Ball. Tout était en ordre. Le service était bien fait ; une surprise semblait impossible.
Néanmoins, le Sirdar décida que les sentinelles seraient doublées. Lui-même choisit les premières parmi les soldats les plus réputés pour leur stricte observance de la discipline.
Il les posta aux quatre angles du quadrilatère formé par la muraille crénelée, leur confia à voix basse le mot de passe : Kitchener et Khartoum, et revint s’installer dans la chambrée.
Vainement Ball tenta de faire accepter sa propre salle au Sirdar ; celui-ci voulut demeurer au milieu des soldats. Il jugeait bon de les avoir sous les yeux, de stimuler leur courage par sa présence ; car, malgré la légèreté apparente de son discours, il n’était pas sans inquiétude.
Les masses populaires sont plus impressionnées par une plaisanterie impunie que par un meurtre retentissant. On cesse de craindre ceux que l’on bafoue. Et l’idée saugrenue des rebelles, tatouant les militaires anglais, pouvait donner plus d’adhérents à la révolte que de sanglantes représailles.
Vers huit heures, on releva les factionnaires, mais, avant de les remplacer, lord Lewis Biggun fit distribuer les vivres et boisson qu’il avait promis à la garnison.
On leur fit bon accueil, point n’est besoin de le dire, et les nouvelles sentinelles rejoignirent leur poste de surveillance avec une satisfaction marquée.
Sur le contrôle de la compagnie, elles étaient portées ainsi qu’il suit :
Cobby, 23 ans, élève caporal, engagé volontaire. Degré d’instruction : sait lire, écrire et nager.
Dosson, 27 ans, élève caporal, engagé volontaire, ex-étudiant en droit. Degré d’instruction : sait lire et écrire, nage mal.
Folaff, 22 ans, soldat de première classe, engagé volontaire. Degré d’instruction : sait lire, écrit mal, nage un peu.
Gup, 21 ans, soldat de 2e classe, engagé volontaire. Degré d’instruction : sait lire et écrire, ne nage pas.
On remarquera que les quatre hommes étaient « engagés volontaires ». Les mêmes vocables eussent pu être appliqués à chacun des individus composant la garnison. En Angleterre, en effet, le recrutement s’opère de façon spéciale. Des sergents recruteurs parcourent le pays, s’arrêtent dans les auberges, offrent à boire aux jeunes gens, et, quand ils ont réussi à les griser, ils leur font signer un engagement, que la plupart maudissent lorsqu’ils ont repris leur sang-froid.
De la sorte, tout soldat anglais est un volontaire… involontaire.
Cobby et Dosson occupaient les angles du fortin les plus rapprochés de la rive du Nil, Folaff et Gup, les deux autres.
Dans la chambrée, l’adjudant Ball tenait le dé de la conversation. Persuadé que, de par son grade, lui incombait le devoir de charmer la veille du général en chef, il racontait avec une prolixité infatigable les détails de la vie journalière au poste de Keneh. C’était un flux de paroles constant qui eût pu se traduire par une courte phrase :
– La nuit suit le jour, mais qu’il fasse soleil ou lune, nous, nous ne faisons rien.
Assis sur des lits comme les autres, John et Jack écoutaient.
Le curieux Jack tournait fréquemment les yeux du côté de la porte, comme s’il se fût attendu à la voir s’ouvrir pour livrer passage aux ennemis annoncés par la missive reçue à bord du Look.
Et le souvenir de sa conversation avec Nilia se représentait à son esprit. Était-ce encore Armand Lavarède qui avait rédigé la lettre mystérieuse ? Et si cela était, comment savait-il ce que ses amis projetaient ? Par quel moyen ignoré restait-il en communication avec eux ?
Puis un frisson parcourait son échine.
Si les précautions prises par le Sirdar allaient faire échouer l’entreprise. Si les amis inconnus des Français étaient pris, qu’adviendrait-il ?
Le débit monotone de l’adjudant bourdonnait toujours à ses oreilles, comme un accompagnement sur lequel se détachait sa pensée. Il n’entendait plus les paroles, suivant le rêve qui l’entraînait irrésistiblement vers le karrovarka, prison de celle dont il était l’esclave sans la connaître.

De plus en plus il s’enfonça dans le songe. Les bruits extérieurs ne parvinrent plus jusqu’à lui. Il oublia l’endroit où il se trouvait, le pourquoi de sa présence. Il se vit en bateau sur le Nil.
Protégé par l’ombre, il amenait sa barque le long du char flottant du docteur Gorgius. Un hublot s’ouvrait, encadrant un délicieux visage de femme. C’était Nilia, mais Nilia souriante, les traits épanouis par une bouffée de gaieté intense. Et la jeune fille lui disait avec un inimitable accent de raillerie :
– La mouche sur le nez, la mouche… petit gage de ta grande fidélité.
Enfin toutes les images se brouillèrent. Il ne vit, ne pensa plus. Un manteau d’ombre l’enveloppa et il perdit la notion de l’existence.
Un choc brusque le tira de son engourdissement.
Il ouvrit les yeux, et regarda autour de lui. Il était étendu par terre entre deux lits. Au bout d’un moment, il comprit. Le sommeil l’avait vaincu et il était tombé. Une honte le saisit. Que dirait le général ?
Cependant le silence le rassura. Aucun bruit ne se faisait entendre dans la chambrée.
Ses compagnons étaient peut-être sortis, ou bien eux aussi dormaient.
Jack se souleva avec précaution. Par les croisées filtrait une lueur indécise ; c’était le jour. Le jeune homme se mit sur les genoux. Dans cette position, sa tête dépassait le niveau des lits, et un spectacle réjouissant frappa ses yeux.
Tous les soldats, allongés sur les couchettes, dormaient à poings fermés ; l’adjudant Ball, dont l’obèse personne s’élevait ainsi qu’une montagne, ronflait majestueusement, et de son nez bulbeux s’échappait parfois un gargouillis bizarre, analogue au bruit produit par un canard qui barbote.
Un peu plus loin, John rêvait tout haut. Les yeux clos, il invectivait un interlocuteur imaginaire :
– Non, je vous dis, cela est absurde. Pourquoi veiller au fort, quand nous pouvons reposer dans notre cabine.
Cela amusa Jack, ce dormeur qui se plaignait de veiller était véritablement folâtre.
Mais ce qui lui causa une stupéfaction profonde, ce fut de constater que le Sirdar lui-même n’avait pas résisté aux pavots du mythologique Morphée.
Sur un lit, la tête enfouie dans ses bras, le commandant en chef de l’armée d’occupation dormait comme l’adjudant, comme les sergents, comme les caporaux et les soldats.
Du coup, Jack se mit sur pied.
Avec la rapidité de l’éclair, il comprit quelle tempête soulèverait ce sommeil de tous, si lord Lewis Biggun venait à le constater ? Pour éviter à ces pauvres diables réprimandes et punitions, le jeune homme se mit en devoir de les rappeler à la réalité.
Commençant par les soldats, il les secoua, doucement d’abord, brutalement ensuite, et réussit à les ramener du pays des songes ; puis il passa aux gradés pour finir par l’adjudant Ball.
Un quart d’heure plus tard, la garnison était assise sur les couchettes, dans la même position que la veille au soir, et cinquante-quatre yeux – en comptant ceux de Jack et de son frère – se fixaient avec une expression goguenarde sur le Sirdar que, vu sa haute dignité, personne n’osait secouer.
Ball, très embarrassé, toussa fortement ; mais le bruit n’eut aucune action sur lord Biggun.
L’adjudant avait épuisé les suprêmes ressources de son imagination. Il regardait ses hommes, ses hommes le regardaient, et les yeux de tous disaient clairement :
– Si le Sirdar se réveille, il sera furieux de nous voir et nous mettra tous à la salle de police.
Plus désolé que les autres, Ball comprenait que ses chances d’avancement s’évanouiraient à jamais, ce qui du reste ne lui donnait pas la moindre idée. Par bonheur, Jack vint encore à son secours.
– Monsieur l’adjudant, dit-il, si vous vouliez emmener vos soldats à l’autre bout de la chambre, ils seraient masqués par le râtelier d’armes.
– Et le général ne les apercevrait pas en ouvrant les yeux, s’écria le gros personnage, radieux.
Mais, se ravisant aussitôt, il passa la main sur sa nuque grasse, avec une expression d’évident embarras :
– Seulement il voudra savoir pourquoi ils sont rassemblés là.
– Pour apprendre une chanson de marche, répondit Jack en riant. Je vais chanter ; ils reprendront en chœur. Le bruit réveillera sans doute lord Biggun et lui donnera du même coup l’explication désirée.
La large face de l’adjudant s’épanouit ; il serra à les briser les mains du jeune homme, et déambulant ainsi qu’un tonneau sur jambes, il entraîna ses subordonnés en arrière du râtelier d’armes.
Les ranger en cercle, placer Jack au centre, fut l’affaire d’un moment. John, lui-même, approuvant l’idée de son frère, qui lui paraissait pleine de respectability anglaise, s’était glissé parmi les fantassins.
Pour Price le brun, il semblait ravi. La situation l’amusait infiniment. Il leva le bras, dans un geste d’avertissement emprunté à la mimique des chefs d’orchestre, et d’une voix grave :
– Attention, c’est une chanson française ; mais je n’en connais pas d’autre. Elle est drôle d’ailleurs, car elle est faite à la louange du sac.
Et narquois il ajouta :
– La louange du sac. Il faut être Français pour avoir une idée pareille.
– All right ! opina John.
– Donc, garde à vous, et ensemble pour le dernier vers. Dignes militaires, oyez la chanson du sac.
Sur un rythme de marche, Jack commença :
C’est l’heure de tirer l’étape ;
Soldat, debout !… Au trot ! au trot !
Aux portes closes l’aube tape ;
Allons soldat, prends ton flingot !
Le clairon sonne sur la route :
Sous ton sac tu courbes le dos…
– Pour vaincre, te dis-tu sans doute,
On aurait assez des flingots.
Mais sur le sac est la gamelle,
Où l’on fera le bon fricot,
Et tu ne pourrais pas, sans elle,
Jusqu’au bout porter ton flingot.
Ce sac qui te brise la taille,
Te charge comme un bourriquot,
Fait le vainqueur dans la bataille.
Tout aussi bien que le flingot.
Tire le pied, courbe l’échine,
Tu joindras l’ennemi bientôt.
Alors, plus besoin de cantine,
Car la parole est au flingot.
Avec entrain, les soldats répétaient le quatrième vers de chaque strophe. L’ensemble laissait à désirer ; mais, s’il manquait de mélodie, il produisait un vacarme à réveiller un sourd.
Or, le Sirdar jouissait de la plénitude de ses facultés auditives. À la première reprise du chœur, il s’agita sur sa couchette ; puis il s’étira, ses paupières clignotèrent, et, la chanson achevée, il se trouva assis.
Un instant, il demeura immobile, très penaud d’avoir dormi, après avoir annoncé bruyamment qu’il venait au fort de Keneh pour assurer la veillée. Mais l’habitude du commandement lui suggéra la conduite à tenir. Il fallait payer d’audace, en imposer à ses subordonnés ; d’une voix forte, il appela :
– Adjudant Ball.
L’interpellé accourut aussitôt et se planta à quatre pas de son chef, les talons réunis et sur la même ligne, la pointe des pieds tournée en dehors, la tête droite, les épaules effacées, dans l’attitude martiale prévue par la théorie de l’école du soldat.
Sur un seul point il n’observa pas les règles prescrites par le précieux manuel. Celui-ci dit, en effet, que les regards du militaire doivent être fixés droit devant soi. Ball baissa modestement les paupières, dans la crainte que le général ne découvrît au fond de ses yeux une vague envie de rire.
– Adjudant Ball, reprit le Sirdar, que font vos hommes ?
– Ils apprennent une chanson de marche, mon général.
– Bien ! Bien ! Je n’avais pas fait attention, j’étais plongé dans mes réflexions, adjudant !
– Oui, général, répondit le gros homme avec une gravité qui démontrait l’empire absolu de la discipline sur ses muscles zygomatiques.
– Vous avez constaté comme moi, poursuivit lord Biggun, que les rebelles n’ont pas paru. Avec de semblables ennemis, il suffit d’un regard pour écarter le danger.
– Oui, mon général.
Ball était au supplice. Les pensées les plus hilares lui montaient au cerveau. Le Sirdar, qui avait passé la nuit les yeux fermés, et qui prétendait avoir dispersé les révoltés d’un regard, abusait véritablement de son grade pour faire accepter ses imaginations.
– Enfin, termina le généralissime, le jour est venu ; avec lui disparaît toute crainte de surprise. Allons interroger nos factionnaires.
– Oui, mon général, balbutia l’adjudant.
Cette proposition lui avait enlevé l’envie de rire. Les factionnaires ! Hélas ! on ne les avait pas relevés depuis la veille. C’étaient toujours les élèves caporaux Cobby et Dosson qui gardaient la face ouest du fortin ; c’étaient les soldats Folaff et Gup qui montaient la faction à l’est.
Si lord Biggun s’en apercevait, les punitions allaient pleuvoir, et Ball éperdu était bien forcé de s’avouer que la nuée crèverait d’abord sur lui.
Mais il n’y avait pas à répliquer.
Les yeux plus baissés que jamais, l’adjudant sortit de la chambrée derrière le Sirdar. À la distance réglementaire, il le suivit à travers la cour.
Dans son énorme poitrine, son cœur sautait et ses grosses jambes courtes fléchissaient.
Ce fut bien autre chose quand les deux hommes arrivèrent devant le premier factionnaire.
Cobby, car c’était lui, se trouvait dans une tenue invraisemblable.
Le torse nu, la culotte serrée à la taille, l’élève caporal n’avait pas entendu le bruit des pas de ses supérieurs. Penché au sommet du mur, il regardait en dehors, avec des mouvements de tête effarés.
– Qu’est-ce que cela ? gronda le Sirdar d’une voix irritée.
Au son de cet organe redouté, Ball courba la tête et Cobby se retourna d’un bond, prenant machinalement la position du soldat sans armes.
Mais il présentait sa poitrine aux regards de ses supérieurs, et ceux-ci aperçurent avec stupeur un tatouage bleu, figurant un léopard expirant au-dessus d’une banderole qui portait cette phrase :
– Qui triomphera du léopard britannique ?
L’effet fut foudroyant.
La gorge serrée par la colère, lord Biggun bredouilla :
– Encore le léopard.
Son doigt s’étendit, agité d’un tremblement, vers l’ironique tatouage.
– Comment êtes-vous orné de cette image séditieuse ?
Cobby ignorait bien certainement de quelle parure on l’avait agrémenté, car il baissa la tête pour regarder l’endroit désigné par le geste de son supérieur et demeura stupide devant la silhouette bleue du fauve héraldique.
Enfin le généralissime retrouva son sang-froid. D’un ton sévère, il interrogea :
– Vous avez dormi en faction. Vous vous êtes laissé surprendre. C’est un cas de conseil de guerre. Donnez le signalement de ceux qui vous ont ainsi accoutré.
Épouvanté par ces paroles, l’élève caporal eut un geste de découragement.
– Je n’ai vu personne.
– Mais enfin, on ne vous a pas tatoué à votre insu ?
– Je n’ai rien senti.
L’instinct de la conservation dominant son émoi, le malheureux soldat essaya de se défendre.
– Ce n’est pas ma faute. Il y a quelque diablerie là-dessous. Jamais je n’ai encouru une punition et je m’endors étant de garde. Bien sûr, ce n’est pas naturel.
Biggun le considérait. L’attitude de Cobby n’était pas celle d’un coupable. Ses notes le signalaient comme un excellent sujet, un militaire soucieux de ses devoirs. Et soudain le général se rappela que lui aussi avait dormi. Il lança un regard de travers à l’adjudant. Est-ce que toute la garnison aurait succombé au sommeil ?
Une lueur traversa sa pensée. Un narcotique peut-être avait été mêlé aux aliments des hommes. Il fallait arriver de la supposition à la certitude. Aussi sa voix s’adoucit et il questionna :
– Depuis quand êtes-vous en sentinelle, Cobby ?
L’interpellé rougit, pâlit, observa en dessous Ball qui se sentait défaillir ; puis, en hésitant :
– Je ne sais pas, mon général ; après ce qui s’est passé, je n’oserais plus rien affirmer… Seulement, si je puis exprimer ce que je crois être… à moins toutefois que ce ne soit un rêve…
– Dites, dites…
– Eh bien, voilà. Je me figure que j’ai été placé ici hier au soir, vers huit heures…, et, sur mon dévouement à Sa Gracieuse Majesté, je n’ai aucun souvenir d’avoir été relevé de faction.
La conviction du Sirdar était faite.
– Vous dormiez donc aussi, adjudant Ball ? fit-il lentement.
Le gros homme pensa s’effondrer.
– Peut-être, balbutia-t-il. Peut-être,… Votre Honneur… général… Vraiment tout cela est si étrange qu’à cette heure je ne suis plus certain d’être éveillé.
– Et vos subordonnés ?
– Oh ! sans aucun doute… répondit d’une voix indistincte le pauvre Ball, que cet interrogatoire mettait au supplice… Sans aucun doute… Si Cobby n’a pas été remplacé au bout des deux heures réglementaires, il y a tout lieu d’estimer qu’on l’a oublié, par suite de sommeil intempestif…, car les transmissions se font d’ordinaire avec une parfaite régularité.
– Oui, oui, ce doit être cela… Et le vin que la garnison a bu hier… d’où venait-il ?
– Apporté le matin même par le chaland de l’intendance chargé de ravitailler les postes.
– Eh bien, conclut lord Biggun, ce vin contenait un soporifique. Voilà pourquoi toute la garnison, sans exception, a fermé les yeux à l’heure même où nos ennemis devaient opérer.
– Permettez, hasarda l’adjudant rassuré par ces paroles… on ne pouvait prévoir que tous les hommes en boiraient.
– Si, ces drôles nous ont joués. Ils m’ont amené à venir au fort. Nos usages sont connus. La visite d’un officier général se traduit par une distribution de vivres à la troupe.
Puis, changeant de ton :
– Vous ne mentionnerez pas la chose au rapport. Vous prendrez dans la réserve de quoi habiller et armer cet homme… un bon spécial. Toutefois, la discipline doit être observée. Vous porterez à l’élève caporal Cobby quatre jours de salle de police pour s’être laissé tatouer.
Jamais punition ne causa pareil plaisir à un soldat.
Cobby, qui se voyait déjà traduit devant un conseil de guerre, condamné à plusieurs années de prison, releva la tête et, dardant sur son général des regards reconnaissants :
– Oh ! merci, merci… mon général ! Alors, c’est vrai ? Quatre jours, rien que quatre jours pour m’être laissé tatouer… ?
Mais subitement il s’arrêta. Sa figure exprima la surprise, et ses traits furent agités de petits frémissements comme s’il résistait avec peine à une formidable envie de rire ; enfin il s’esclaffa follement, frénétiquement, avec de grands éclats qui le secouaient tout entier.
C’était le fou rire au milieu duquel revenaient ces mots :
– Ah ! ah ! ah !… quatre jours… le tatouage ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça, c’est trouvé ! ah ! ah ! ah ! ah !
Le Sirdar le considérait, étonné.
– C’est la joie, c’est nerveux, expliqua Ball, craignant que lord Biggun ne se fâchât… Il a eu peur d’une punition terrible et maintenant…
– Oui, cela doit être… passons aux autres.
Et le général se dirigea vers l’angle opposé de l’enceinte crénelée.
Posté en arrière, l’adjudant gourmanda le soldat.
– On se contient devant ses supérieurs, by Devil… ! le soldat est tenu à l’impassibilité, par l’orteil de Satan… rentrez au poste.
Cobby riait de plus belle. Il voulait parler, expliquer ; mais cela lui était impossible. Reconnaissant que le langage articulé lui était interdit, il eut recours à la mimique et plaça le doigt sur son nez pendant que son hilarité redoublait.
Ce geste bizarre intrigua l’adjudant, mais il n’eut pas le loisir de prolonger l’entretien. Un appel du général en chef le contraignit à rejoindre ce dernier, tandis que le factionnaire traversait la cour au pas gymnastique pour rentrer à la chambrée.
Lord Biggun était debout devant la seconde sentinelle, l’élève caporal Dosson. Ainsi que Cobby, celui-ci apparaissait nu jusqu’à la ceinture, marqué sur la poitrine du léopard britannique. Ses armes, sa vareuse avaient disparu.
La même scène se renouvela. Ainsi que son camarade de faction, Dosson se vit infliger quatre jours de salle de police.
Seulement, où l’identité entre les deux scènes devint fantastique, ce fut à l’instant précis où le soldat, essayant d’exprimer sa gratitude de la clémence du général, fut pris du même fou rire que Cobby.
Cette fois, lord Biggun en marqua quelque mécontentement et quitta non sans brusquerie le joyeux factionnaire, immédiatement suivi par Ball, qui découvrait chez ses subordonnés des trésors de gaieté insoupçonnés jusqu’à ce jour.
Ce fut bien autre chose avec Folaff et Gup. Ce dernier s’égaya à ce point qu’il tomba par terre.
Jamais on n’avait tant ri au fortin de Keneh.
– Ils ont la salle de police gaie, grommelait lord Biggun. Après ça, on leur a peut-être fait prendre un narcotique hilarant.
Cette pensée, qu’il communiqua à l’adjudant Ball, parut se confirmer lorsqu’ils revinrent à la chambrée où les sentinelles étaient rentrées.
Bien avant d’entrer, leurs oreilles furent frappées par des rires inextinguibles. C’était un concert joyeux : les uns riaient en trombones dans les notes graves, les autres se livraient à des fioritures aiguës, aiguës comme des sons de petite flûte.
Leur entrée ne put apaiser cette folie générale.
En vain Ball clama de sa voix de stentor :
– À vos rangs !… fixe !
Au commandement, tous les hommes se placèrent bien au pied de leur lit, les talons réunis, le petit doigt sur la couture du pantalon ; mais les figures grimaçaient, se plissaient, passaient par toutes les contorsions burlesques de la joie, cherchant à se faire un masque grave. Comme tout le monde. John et Jack se gaudissaient.
– Un soporifique hilarant, bougonnait le Sirdar.
Pour la dixième fois, il répétait cette affirmation à l’adjudant, quand il vit celui-ci sourire.
Un soldat s’était penché au passage vers l’appendice auditif de Ball : il y avait laissé tomber quelques mots à voix basse, et le ventripotent personnage, gagné par la contagion, s’égayait à son tour.
– Comment… vous aussi… adjudant ? gronda le général en chef.
– Oui, non, bredouilla l’interpellé… croyez que je suis navré… mais c’est plus fort que moi…

Et pouf ! Comme une explosion de chaudière, son rire sonore éclata dans la salle. Ah ! cet adjudant, il faisait tout mieux que les autres. L’hilarité des soldats n’était que tristesse auprès de la sienne.
Ses yeux se fermaient, sa bouche s’ouvrait jusqu’aux oreilles, son ventre sautait, ses bras, ses jambes frétillaient, et son sabre, secoué par ce tremblement de son maître, heurtait ses talons avec un tintinnabulement de chapeau chinois.
Il n’y avait plus de gradés, plus de soldats, plus de discipline, plus de hiérarchie. Le rire était le souverain maître du fortin de Keneh.
Pour mettre fin à cette situation antimilitaire, lord Biggun prit le parti de quitter la salle.
– Je passe dans votre chambre, adjudant. J’y signerai les bons d’équipement et d’armement pour vos factionnaires.
Il sortit, se bouchant les oreilles pour ne plus entendre.
En face de lui se découpait dans le mur une porte, sur laquelle était clouée une étiquette de carton avec la mention « Adjudant ».
Il la poussa et pénétra dans une petite salle aux murs blanchis à la chaux. Un lit de fer, une table, une malle, quelques chaises composaient l’ameublement. Sur les parois s’étalaient des chromolithographies aux couleurs criardes.
Vis-à-vis de l’entrée, sur une planchette fixée à la muraille, étaient rangés cuvette, pot à eau, boîtes à savon, cosmétiques. C’était le lavabo de Ball. Au-dessus, une petite glace carrée se balançait à un clou doré.
Machinalement le Sirdar porta les yeux de ce côté. Le miroir lui renvoya son image.
– Hein ! fit-il en portant la main à son nez. Qu’avait-il donc vu ?
Une tache noire au bout de son bulbe nasal. Il frotta légèrement, puis plus fort ; l’impression persista. Alors il tira son mouchoir, l’humecta de salive et frictionna énergiquement l’endroit contaminé. Peine inutile. Son nez rougit et le point noir ne disparut point.
– Ah çà ! Qu’est-ce que j’ai là ?
Il se rapprocha du miroir, se pencha en avant, et il eut un cri ; cri de rage et de consternation.
Sur son nez, une main criminelle avait tatoué en bleu la forme gracieuse et ténue d’une mouche.
Un instant il resta sur place, comme atterré. La vérité éclatait à ses yeux ; maintenant il comprenait le fou rire de Cobby, de Dosson, de Folaff, de Gup.
– Quatre jours de salle de police pour s’être laissé tatouer.
Et en leur infligeant cette punition, il pointait vers eux son nez, son nez de général orné d’une mouche. Les soldats avaient évidemment pensé :
– Bon ! le général va être obligé de s’octroyer quatre jours, comme à nous.
Cela était ridicule. Si la chose s’ébruitait, il deviendrait la fable de l’Égypte entière. L’Amirauté ne pourrait plus le laisser à la tête de l’armée ; on le remplacerait. Sa situation serait perdue.
Il fallait obtenir le silence, rentrer au Caire, appeler un chirurgien ; au besoin supporter l’ablation du bout du nez, mais se séparer à tout prix de cette mouche.
Il appela Ball, et, l’adjudant accourant à sa voix, il lui montra sans une parole l’organe lésé.
Son interlocuteur courba la tête.
– Oui, général, c’est cela.
– Eh bien, fit alors le Sirdar, cela ne doit pas s’ébruiter. Pour vous, pour vos hommes, il y a de l’avancement, des faveurs de toute espèce, si le bruit de l’aventure ne sort pas de l’enceinte de Keneh.
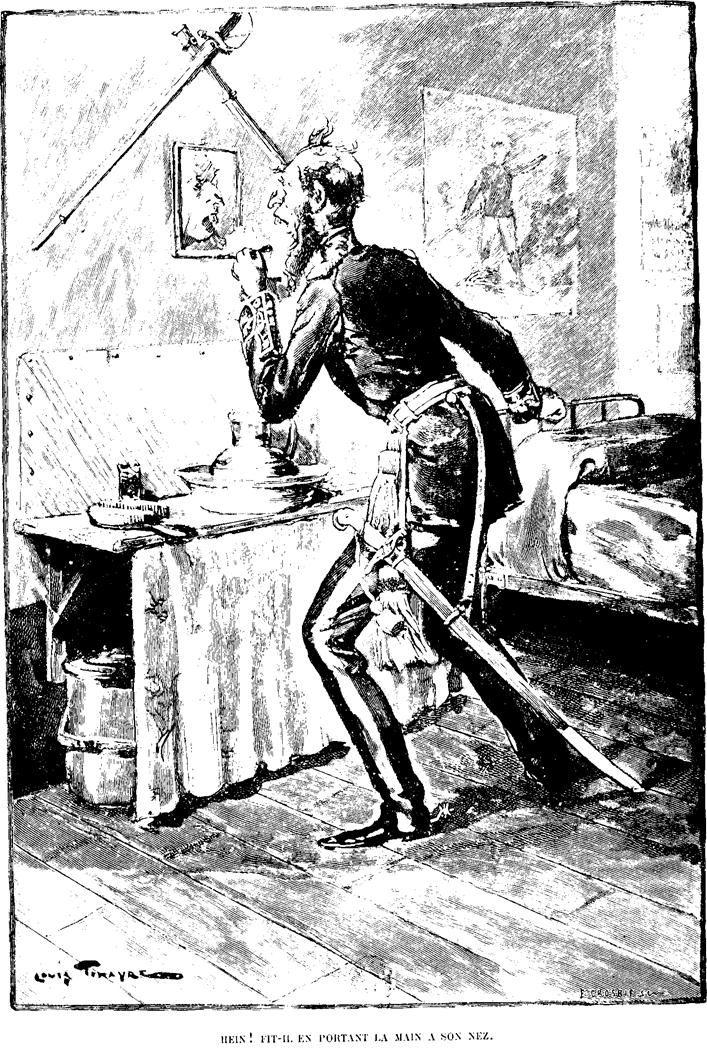
– Elle n’en sortira pas, mon général, promit Ball, ravi de la tournure de l’entretien.
– Bien ! je vais me mettre un bandeau sur le nez. Je prétexterai un furoncle. Au Caire je me ferai opérer. Souvenez-vous que le silence vous assure un ami ; mais que le moindre bavardage vous exposerait à toute ma sévérité.
L’adjudant s’inclina.
Cinq minutes plus tard, le Sirdar, la figure entourée de linges et suivi des frères Price, sortait sans bruit de la redoute.
Il descendait vers le fleuve.
John grommelait entre ses dents les plus affreuses menaces contre les bandits qui avaient osé tatouer l’Angleterre dans la personne de son représentant en Égypte.
Pour Jack, il pensait encore à Nilia, à cette inconnue qui, quarante-huit heures plus tôt, lui avait annoncé en termes sybilliques la mésaventure de lord Biggun :
– Je vois une mouche sur le nez du Sirdar !
Ainsi, chacun s’abandonnant à une préoccupation différente, les trois hommes arrivèrent à bord du Look.
Répondant à peine aux politesses du commandant de la canonnière, qui s’était précipité au-devant de lui pour le recevoir, le général s’enferma dans sa cabine.
Il pensait pouvoir respirer.
Hélas ! une dernière blessure lui était réservée.
Sur sa table était une enveloppe.
Il la prit et, à l’intérieur, trouva une feuille de papier piquée de coups d’épingles formant des lettres, des mots, des phrases. Il les lut en frémissant. Voici ce que disait l’épître :
« Milord général,
« Vous connaissez sans doute Le Lion et le Moucheron, cette fable de Jean de La Fontaine, auteur français ?
« Le Lion y est représenté vaincu par le Moucheron, adversaire insaisissable qui se rit de ses fureurs. Ce n’est point par pédantisme que je rappelle cet apologue, mais uniquement pour vous permettre de trouver la réponse à une question que vous semblez, croire insoluble.
« Qui triomphera du léopard britannique ? demande-t-on.
« Fort de l’autorité du grand La Fontaine, répliquons hardiment :
« C’est la mouche, la mouche du désert, déjà perchée sur votre auguste nez.
« Permettez-moi de me dire votre obéissant et de signer du mot de ralliement de l’Égypte entière.
« LIBERTÉ. »
C’en était trop.
Le Sirdar chancela sous le coup. Il s’affala sur un siège et pleura de rage. C’étaient les premières larmes anglaises qui coulaient dans la vallée du Nil, où la tyrannie britannique avait fait verser tant de pleurs.

CHAPITRE VIII
OÙ HOPE DEVIENT SYNONYME DE « HOP ! »
– Mais enfin, commandant, que sont exactement vos tourelles pivotantes ?
– Je vous l’expliquerai volontiers, Sir. Voici.
Et M. Blass tira de sa poche carnet et crayon.
Jack était auprès de lui. Depuis une heure, sur l’ordre du Sirdar, la canonnière avait repris à toute vapeur sa marche vers le Caire, et la rencontre de plusieurs chalands, pesamment chargés, avait amené de la part du curieux jeune homme une question, à laquelle l’officier de marine se mettait en devoir de répondre.
Hélés de la canonnière, les patrons des chalands avaient déclaré transporter des tourelles pivotantes destinées à la défense du Nil.
Plus loin, des terrassiers travaillaient déjà sur la rive du fleuve, creusant un vaste entonnoir.
Il n’en avait pas fallu davantage pour mettre Jack en grand émoi, et M. Blass, enchanté de parler des choses de la guerre, dessinait déjà sur une page de son calepin.
– Tenez, fit-il en traçant à grandes lignes le cours du Nil, voici le schéma de la défense. Ainsi que vous le savez, la zone cultivable et par conséquent habitable, près du delta, qui borde le fleuve, a une largeur de 50 kilomètres, laquelle se réduit, au-dessus du Caire à 20, puis à 15, puis à 10 kilomètres. De chaque côté, le désert forme une limite infranchissable.
– Conclusion, interrompit le fils de mistress Price, l’Égypte est une simple rue verdoyante, alimentée par les eaux du Nil.
– Juste ! Aussi, celui qui commande le Nil est le maître du pays. Eh bien ! l’Angleterre est en train de s’assurer la dite supériorité. Tout le long du fleuve, elle établit à cette heure des tourelles pivotantes. Nul ne pourra naviguer sans passer sous nos canons, et, s’il nous plaisait demain de refuser l’eau, c’est-à-dire la vie aux habitants, il suffirait d’un simple télégramme pour rendre les rives inabordables.
– Oui, je vois, je vois, murmura le jeune homme d’un ton pensif.
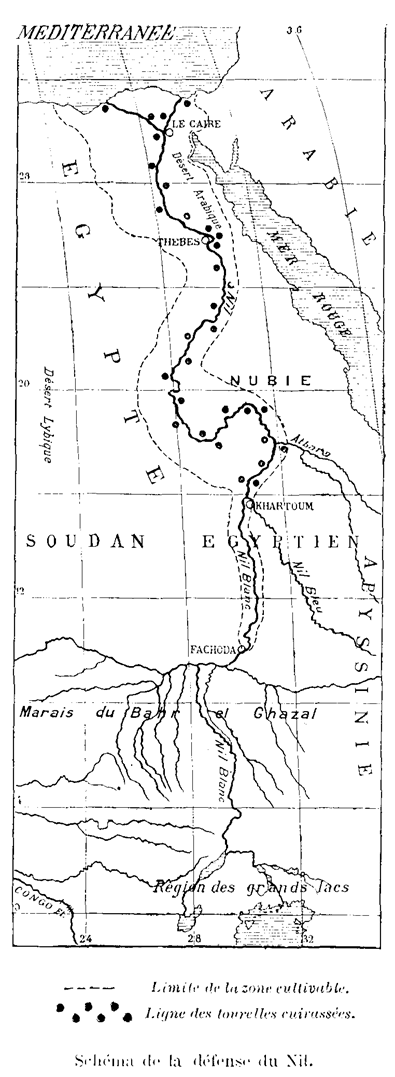
Lui qui désirait à présent le succès des Égyptiens, celui de leurs chefs français, se sentait douloureusement impressionné par la vue de la petite carte qu’il avait sous les yeux.
Il comprenait quelle situation formidable prenaient les Anglais, et il s’avouait qu’en ce pays étrange, protégé par la série ininterrompue des tourelles, il était insensé de tenter de les déloger.
Tout à sa démonstration, M. Blass ne remarqua pas son trouble et il poursuivit, dessinant à mesure :

– Maintenant, voyons un peu ce qu’est une tourelle. Tenez, voici le dôme d’acier, d’une épaisseur telle que les projectiles les plus puissants ne sauraient l’entamer. Ce dôme a cinq mètres de hauteur ; un axe d’une résistance à toute épreuve le traverse dans toute son élévation, et, par sa partie inférieure, il repose sur un godet d’acier. D’autre part la coupole s’appuie sur des « galets arrondis » qui roulent sur un rail circulaire. Ces quelques mots vous démontrent que la mobilité de l’appareil est assurée dans d’excellentes conditions. J’ajoute pour mémoire que la perfection des procédés de construction a permis de réduire les frottements au minimum.
– Bien, fit Jack, pour dire quelque chose.
– À la base, continua imperturbablement l’officier, le système est protégé par un sol factice de béton, au centre duquel est ménagée une chambre où se trouvent le ou les moteurs, la poudrière et les magasins de munitions. C’est la sécurité de l’ouvrage et c’est en même temps son point faible.
– Ah ! murmura son interlocuteur très intéressé par ces dernières paroles. Son point faible ? Comment cela ?
– Vous allez le comprendre de suite. Entre la paroi de la tourelle et le revêtement de béton, il existe un vide ; on aurait pu le réduire à quelques millimètres, mais on a prévu le cas où la petite forteresse devrait être ravitaillée, et l’on a pensé que, à l’abri du dôme, on pourrait, par cet intervalle, procéder à l’opération sous le feu de l’ennemi. À mon avis, cette conception est malheureuse, car elle a fait maintenir une imperfection dans un engin qui serait parfait sans cela.
Et comme Jack le regardait d’un air interrogateur :
– Vous ne saisissez pas. C’est simple pourtant. Par une nuit sombre, un mineur peut se glisser dans ce vide avec une charge de poudre ou de dynamite… et alors adieu la tourelle. Celui qui tentera l’entreprise y laissera certainement sa vie, mais une trouée dans la ligne de défense du fleuve serait fatale.
Puis souriant :
– Il est vrai que la chose ne serait pas facile à faire, attendu que de puissants réflecteurs, durant les ténèbres, éclairent le terrain à plusieurs kilomètres à la ronde ; mais enfin il y a un vice de construction.
– Bien petit, grommela le jeune homme non sans dépit.
– Oui, si petit qu’il en est négligeable. À présent, nous qui n’avons rien à craindre, glissons-nous dans ce couloir circulaire resserré entre la tourelle et le bloc de béton. Passons entre les galets de roulement. Nous voici sous le plancher inférieur. Au centre nous apercevons un mur, percé d’une ouverture obturée par une double porte d’acier. Ouvrons cette porte et entrons dans le réduit du moteur. Un système de transmission actionne l’axe. Autour de nous sont des salles blindées qui renferment les poudres et projectiles. À droite de l’axe, nous voyons au plafond une trappe ; à notre appel, le panneau se soulève, une échelle descend. Nous montons. Nous voici au premier étage de la tourelle. Deux canons seulement, mais des canons de 15 centimètres, lançant des obus de 12 à 1.500 kilogrammes, qui, en éclatant, couvrent de feu et de débris de métal une superficie de 1 hectare. Le long des parois, nous remarquerons des caisses de tôle d’apparence inoffensive. Ne nous y trompons pas cependant ; elles renferment des mitrailleuses qui, pour les tirs rapprochés, remplaceraient les canons. Chacune équivaut à deux cents fantassins armés du fusil à tir rapide.
Jack écoutait plein d’angoisse. Ces tourelles pivotantes lui apparaissaient comme des monstres formidables, prêts à broyer l’Égypte sous un ouragan de fer. Et dans la tourmente, il entrevoyait, avec un serrement de cœur, le drapeau tricolore noirci, troué, déchiré, flottant sous l’averse de feu comme une suprême et héroïque protestation des vaincus.
M. Blass allait toujours, incapable de deviner les pensées de son complaisant auditeur.
– Une seconde échelle va nous permettre d’accéder ou second étage. Là encore, canons et mitrailleuses, mais les pièces sont seulement de 300 millimètres.
Il poussa un soupir de satisfaction et, fermant son carnet :
– Telle est, grosso modo, cher Monsieur, la description des précieux engins dont l’Amirauté renforce l’armée d’occupation. Les tourelles seront distantes sur chaque rive de 3 kilomètres, mais elles alterneront, de telle sorte que toute la terre d’Égypte et de Nubie sera sous la menace permanente de feux croisés. Enfin, détail important, nos canonnières et embarcations de toute espèce, assurées de la libre navigation du fleuve, relieront les divers ouvrages entre eux.
À ce moment, on vint prévenir le commandant que lord Biggun le priait de le rejoindre dans sa cabine et l’aimable officier, s’excusant aussitôt, laissa Jack tout seul.
Le jeune homme était mélancolique.
– Ah ! murmura-t-il après un instant, que peut la mouche contre d’aussi formidables défenses ?
Réflexion qui démontrait qu’en son esprit les tourelles et les tatouages de Keneh se livraient bataille.
Du reste, il n’eut pas le temps de s’abstraire dans ses calculs de proportions ; M. Blass reparut sur le pont, affairé, bouleversé.
Il donna l’ordre de rallier la rive gauche, où se dressait la petite ville de Belianch, et, trouvant Jack sur son chemin, il lui prit le bras.
– Ah ! vous, cher Monsieur, enchanté de vous rencontrer. Vous êtes au courant, on peut causer avec vous… Le général… ! une mouche ! c’est inconcevable d’audace !
Il se retourna vivement avec un geste de terreur :
– Non… je me trompais… personne ne nous écoute. Que pensez-vous de l’incident ?…
Sans laisser à son interlocuteur le loisir de placer un mot, il poursuivit :
– Eh bien… heureusement que nos tourelles se construisent. Sans cela, je serais inquiet. Cela se gâte ! cela se gâte !
La canonnière rangeait la rive.
– Venez avec moi, demanda le commandant. Je me rends au télégraphe. Des dépêches à expédier, vous m’aiderez.
Et confidentiellement :
– Il n’y a pas d’indiscrétion, puisque vous n’ignorez rien.
Jack, on le sait, avait une propension naturelle à s’inquiéter de ce qui se passait autour de lui. Il ne se fit donc pas prier et suivit le digne M. Blass sur la passerelle jetée entre le bordage et la berge.
Côte à côte, les deux personnages cheminèrent vers le telegraph office reconnaissable au mât de signaux dont il était surmonté. L’officier racontait son entrevue avec le Sirdar.
– Je fus ahuri, lorsqu’il découvrit son nez… Cette mouche capricieusement posée sur le bulbe ; comme Anglais, j’étais mortellement blessé ; comme homme, j’avais une terrible envie de rire. Avec cela, la reproduction était parfaite. Ah ! ces Égyptiens ont véritablement conservé leur antique talent de sculpteurs.
La réflexion réjouit les interlocuteurs.
– Vous le voyez, reprit M. Blass, nous-mêmes ne pouvons éviter de nous divertir ; songez à l’effet produit par la divulgation de l’anecdote dans des milieux hostiles. Toute l’Angleterre en serait ridiculisée. Le Sirdar a raison, il faut au plus vite faire disparaître l’estampille que la rébellion a gravée sur sa protubérance nasale.
Il gonfla ses joues, se redressa, et, avec le noble orgueil d’un homme chargé d’une mission de confiance :
– C’est pour cela que nous allons télégraphier. Ordre à tous les chefs de poste des environs d’aviser sir Gorgius Kaufmann d’avoir à nous rejoindre cette nuit à Tahta. Le docteur est, paraît-il, un habile chirurgien. Il extirpera l’insecte. Dès demain, lord Biggun reparaîtra sur le pont. Cela est mieux ainsi, car, en se confinant dans sa cabine jusqu’au Caire, il donnerait prise aux plus fâcheuses suppositions.
De toute évidence, l’officier anglais se livrait. Le secret confié à sa discrétion l’étouffait. Jack lui était apparu comme un sauveur, auquel il avait le droit de confier ses impressions sans forfaire à l’honneur. Le jeune homme s’élevait à ses yeux à la hauteur d’une soupape de sûreté.
À l’office du télégraphe, Blass et Jack rédigèrent plusieurs dépêches ainsi conçues :
« À Monsieur le chef du poste de ***
« Ordre du Sirdar. Arrêter au passage l’embarcation du docteur Gorgius Kaufmann, dire de rallier la canonnière Look, à Tahta, au plus vite. »
L’employé préposé aux transmissions s’empressa. Il sauta sur son transmetteur, et le claquement sec de l’appareil accompagna la sortie des messagers du général en chef.
Une demi-heure s’était à peine écoulée, que Jack et son compagnon reprenaient pied sur le petit navire, qui aussitôt, comme obéissant à un signal invisible, se couronnait d’un panache de fumée et repartait à une vitesse uniformément accélérée.
M. Blass se rendit à la cabine de lord Biggun.
Jack demeura sur le pont.
L’émotion très réelle qu’il avait sentie dans les discours du commandant l’avait réconforté. Est-ce que vraiment la petite mouche avait autant d’importance qu’on lui en attribuait ?
Sans rire, l’officier avait dit :
– Heureusement les tourelles s’édifient ; sans cela la situation deviendrait grave.
Comme la cause paraissait minuscule auprès de l’effet produit !
Soudain, le jeune homme fut pris d’un désir irrésistible de voir Robert Lavarède, ce chef avéré des rebelles, au nom duquel agissaient les mystérieux adversaires d’Albion.
À pas lents, il se dirigea vers la cabine centrale, où le prisonnier était enfermé.
Deux matelots, armés de fusils, baïonnette au canon, se tenaient à chaque extrémité de la construction vitrée qui se dressait au milieu du pont, et, le front appuyé aux carreaux, le captif regardait au dehors défiler les rives du Nil qu’il avait rêvé de faire libres.
Quelles réflexions traversaient son esprit à cette heure ? Le découragement implantait-il ses serres aiguës dans son cerveau, ou bien conservait-il l’espoir ?
Jack s’était arrêté à quelques mètres du prisonnier dont le séparait l’obstacle transparent des vitres.
Celui-ci ne le voyait pas. Ses yeux se dirigeaient obstinément vers l’arrière du bâtiment. Le fils de mistress Price regarda de ce côté et il comprit.

Là-bas, trois personnes étaient assises. Armand Lavarède, Aurett, Lotia. C’était Lotia que Robert observait.
Et Price le brun fut saisi d’une vive émotion.
C’était charmé par les grands yeux noirs de la descendante des Hador, c’était pour obtenir sa main mignonne aux ongles roses que Robert avait entrepris son œuvre. Une folie généreuse l’avait emporté. Pour elle, pour elle seule, pour la douceur de son sourire, il avait conçu l’idée de délivrer le pays où elle avait vu le jour.
Comme cette situation ressemblait à la sienne !
Lui aussi était appelé vers une opprimée, cette Nilia encore inconnue. N’avait-il pas suffi que la voix pénétrante de celle-ci affirmât que lui, Jack, était français, pour qu’il souhaitât la réussite de la rébellion égyptienne, commandée par des gens de France ?
Avant, il frissonnait de tout son être à la pensée que la bonne mistress Price pouvait n’être pas sa mère. Maintenant cela le laissait calme. Nilia avait promis que plus tard il serait choyé par l’affection de deux mères.
À mesure qu’il réfléchissait, sa sympathie pour Robert augmentait.
Soudain le prisonnier tourna les yeux de son côté. Une expression dédaigneuse durcit ses traits ; Jack se sentit mal à l’aise. Il avait oublié que, pour le français, il était un espion, un fourbe auquel tous les tracas présents devaient être attribués.
Le besoin de s’excuser, de montrer son repentir, le domina, et, sans trop savoir ce qu’il faisait, il porta la main à son chapeau, se découvrit, s’inclina respectueusement.
Quelque chose comme un étonnement palpita dans le regard du captif. Il ne comprenait pas l’attitude nouvelle de Jack, et ce dernier se demandait comment rendre intelligible son état d’esprit, sans parvenir à combiner une mimique appropriée.
Le langage du geste, que d’aimables plaisantins ont appelé la langue universelle, est le plus obscur des dialectes. Au théâtre seulement, grâce à une convention acceptée par tous, certains mouvements représentent certaines idées, mais dans la vie il en va tout autrement.
Supposez, par exemple, un jeune homme ayant à exprimer que son plus cher désir est d’être uni en mariage à une jeune fille. S’il place, comme au spectacle, ses mains croisées sur son épigastre, il y a de fortes chances pour que l’on soupçonne, non pas un tendre battement de son cœur, mais bien l’angoisse d’un estomac dyspeptique.
Or, l’émoi de Jack était beaucoup plus difficile à mimer que le trouble d’un fiancé.
Donc, le jeune homme se creusait, vainement la cervelle, quand une main velue se posa sur son bras. L’orang-outang Hope s’était approché sans bruit, toujours digne avec son habit rouge et son chapeau à cornes.
Il ouvrait une bouche formidable, faisait de petits yeux rieurs, montrant ainsi ses dispositions amicales. À dire vrai, il souriait autant qu’un orang peut sourire.
Le bizarre animal sembla deviner la situation des deux hommes. Il prit son chapeau à deux mains, salua Robert, puis, se recoiffant, il revint à Jack et passa affectueusement son bras autour du cou du jeune homme, reproduisant ainsi, de façon bouffonne, le groupe célèbre de Castor et Pollux.
Robert se dérida et derrière les carreaux sa figure s’épanouit.
Le singe alors entraîna Price le brun, l’emmenant vers l’arrière ; tout doucement, mais avec une force irrésistible, il le poussa au milieu du groupe formé par Armand et ses compagnes.
Jack se laissait faire.
Stupéfait, il constatait que Hope avait trouvé la mimique susceptible d’éclairer le prisonnier.
En le voyant parmi ses amis, Robert se dirait sans doute qu’il s’était produit un malentendu, que l’étranger, en bons termes avec Armand, n’était pas, ne pouvait être un traître.
Docilement il s’assit dans un rocking-chair.
– Hope ! Hope ! s’écria, sévèrement Lotia, que signifie cela ?
– Ne le grondez pas, s’empressa de répondre Jack, il m’a amené où je voulais aller.
Ses interlocuteurs le regardèrent d’un air surpris.
– Oui, reprit-il après s’être assuré qu’aucun homme de l’équipage du Look n’était à portée de l’entendre, depuis plusieurs jours, je désirais vous parler. J’hésitais, ma résolution n’était pas prise. Aujourd’hui, mon indécision a pris fin. Voici mon histoire, vous me direz, après m’avoir entendu, si je dois espérer rentrer dans votre confiance.
Ce préambule amena ses auditeurs à un état voisin de la stupeur. Pourtant le journaliste parisien murmura :
– Parlez, nous écoutons.
En phrases rapides, Jack narra ses premières années. Il dit la confidence étrange de mistress Price, le trouble moral qui en résulta pour lui. Pris entre deux devoirs, auquel obéirait-il ? Tout d’abord, entraîné par son affection filiale, par sa gratitude pour la nation anglaise à laquelle appartenait celle qu’il voulait continuer à croire sa mère, il avait ressenti un mécontentement contre les intrus français venant inquiéter la puissance britannique en Égypte.
Il avait accepté sans trop de peine son rôle d’espion. Mais, en arrivant près de la Yalla, il avait vu flottant à l’arrière le pavillon aux trois couleurs.
Quelle émotion soudaine l’avait saisi devant ce drapeau qui représentait la patrie possible !
De nouveau il avait été tiraillé entre le désir de servir l’Angleterre et celui de ne pas desservir la France. Les événements marchèrent en dépit de lui, et lorsque les cousins Lavarède, leurs gentilles compagnes de voyage furent arrêtés, les éloges que lui décerna le général en chef, lui causèrent plus de chagrin que de plaisir.
Il parlait sans que l’on songeât à l’interrompre. Dans les yeux de Lotia, d’Aurett, Jack lisait la pitié.
Évidemment elles le plaignaient. Cette souffrance aiguë de l’homme affligé de deux patries rivales, leur apparaissait intolérable, au-dessus des forces d’un garçon de vingt ans.
Encouragé ainsi, le jeune homme poursuivait.
Sans nommer Nilia, il déclara qu’une influence mystérieuse le portait vers la France.
Il eût voulu rester neutre dans le conflit qui se préparait. À son grand regret, il avait coopéré à l’arrestation des chefs de la révolte. Il serait heureux de les aider à reconquérir la liberté.
Après, il se retirerait du théâtre de la lutte : car l’idée de combattre contre l’Angleterre, sa patrie de fait, ou contre la France, sa patrie de sentiment, le remplissait d’une angoisse insoutenable.
Armand Lavarède fixait sur lui ses yeux vifs ; il semblait le regarder jusqu’au fond de l’âme.
Enfin il sourit et, comme hésitant encore :
– C’est pour cela que vous n’avez pas divulgué le nom du correspondant du Sirdar ?
– Oui, oui.
– Je n’avais pas compris tout d’abord, maintenant tout est clair.
Et, tendant la main à Price le brun :
– Je vous crois.
Le jeune homme ferma les yeux, étreint par une émotion indicible. Ces trois mots : Je vous crois, lui semblèrent être le Sésame qui lui donnait entrée dans la grande famille française. Son évolution était consacrée. Désormais il s’éloignerait sans cesse du peuple britannique, son peuple durant de longues années, pour marcher, soldat volontaire et troublé, au drapeau tricolore, emblème héroïque, incomparable, aux plis alourdis par la gloire des armes de la République et de Napoléon, si grand, même aujourd’hui que la défaite a mis à sa hampe une cravate de deuil, que le pavillon d’aucune nation n’est son égal.
Mais le journaliste ne lui permit pas de s’abandonner à ses impressions. Reprenant le ton de camaraderie qui avait charmé Jack pendant la montée du Nil à bord de la Yalla :
– Mon cher Monsieur Jack Price, dit-il,… car je pense que tel est votre véritable nom ?
– Vous pensez droit.
– Mon cher Monsieur Price donc, vous exprimiez à l’instant le désir de voir libres ceux que vos anciens compatriotes ont faits prisonniers.
Et vivement :
– Excusez la forme de ma question. Je n’ai aucune intention désobligeante ; mais votre situation est telle qu’il est horriblement difficile de la traduire.
– Je le conçois, répliqua Jack. Je suis si peu blessé par vos paroles, que je réponds à votre question : Oui, je voudrais vous voir délivrés.
Aurett et Lotia échangèrent un regard.
Le fils de mistress Price l’intercepta au passage et, baissant la voix :
– Vous avez une idée, je le vois. Ayez confiance en moi, je vous en prie. Accordez-moi la faveur de vous venir en aide s’il est possible.
Puis d’un ton suppliant :
– Mesdames, dites un mot pour moi… Faites que je me débarrasse du remords qui m’oppresse, que je répare le mal que j’ai fait !
Il y avait tant de prière, tant de douleur dans son accent, qu’Armand Lavarède n’hésita plus :
– Vous le voulez, dit-il, eh bien, c’est à un ami que je me confie.
– Oui, certes, un ami véritable.
– Ce soir, la canonnière Look passera la nuit près de Tahta.
– C’est exact.
– Tahta est un village sans importance, environné de bois d’acacias qui bordent le fleuve.
– En effet.
– Les berges, continua le Parisien, sont à pic ; si bien que le steamer pourra presque accoster. Eh bien, j’ai l’intention de profiter de la disposition des lieux pour m’évader.
Le visage de Jack exprima la joie.
– Vous pouvez m’être d’un grand secours.
– Je suis prêt.
– Déclarez, en nous quittant, que vous avez fait votre paix avec nous. Vous nous avez trompés, vous nous avez persuadés que vous n’étiez pour rien dans notre arrestation.
Et narquois, le journaliste ajouta :
– Les Français sont si bêtes, du moins aux yeux des Anglais, que l’on vous croira sans difficulté… En vous rapprochant de nous, vous avez voulu être à même de nous surveiller plus étroitement.
– Mais en quoi cela facilite-t-il vos projets ? questionna le jeune homme étonné.
– Attendez. Lorsque l’on vous verra près de nous, on sera sans inquiétude, et l’on ne guettera pas.
– Je comprends.
– J’en étais sûr. Alors ce soir, vous nous rejoindrez ici, bien ostensiblement.
– Oui.
– Et nous aurons quelques chances de plus de mettre nos adversaires en défaut.
– Vous fuirez.
– Naturellement.
– On m’accusera de complicité.
– Accompagnez-nous.
À cette proposition, Jack se dressa brusquement avec un geste de dénégation.
– Non, cela est impossible.
Les assistants le considérèrent avec étonnement.
– Pourquoi ? demanda le journaliste, dont les veux exprimaient un vague soupçon.
– Pourquoi ?
Price le brun parut embarrassé. Fuir, c’était se séparer de Nilia, renoncer à l’espérance de la voir, de lui parler, de lui faire partager le sentiment tendre qui avait grandi en lui.
Cette pensée avait traversé son cerveau ainsi qu’un trait de feu, et, comme malgré lui, il murmura ce nom si doux :
– Nilia !
Armand entendit, les jeunes femmes aussi.
Aurett, compagne dévouée du Parisien. Lotia dont le cœur était tout plein de l’image de Robert, devinèrent le secret du jeune homme. Un même sourire indulgent distendit leurs lèvres. D’un même regard, elles prièrent Armand de trouver une solution qui ne désespérât pas l’allié s’offrant aux prisonniers.
Lavarède s’inclina, et tranquillement :
– Nous vous ligoterons, vous bâillonnerons, de telle sorte qu’il ne viendra à personne, la pensée de vous considérer comme notre complice.
Les couleurs reparurent aux joues de Jack. Il secoua la main du Français avec une gratitude qui eût désarticulé un bras moins solidement attaché.
– C’est cela ! C’est cela ! Voilà ce qui s’appelle une idée !
Puis, se levant :
– Je vais de ce pas commencer à jouer mon rôle.
Et, avec une grimace :
– Je vous ai menti jadis, je suis entraîné à mentir à mes anciens amis. Dire que je n’aime rien tant que la vérité. Décidément mon existence est plutôt bizarre.
Plaisante dans la forme, la réflexion trahissait une souffrance. Les jeunes femmes tendirent leurs mains à Jack.
Il les prit, les tint un moment dans les siennes. Il sembla, réconforté par cette marque de sympathie et, relevant la tête d’un air déridé :
– Allons, fit-il, à l’ouvrage !
Un rayon joyeux brilla dans ses yeux.
– Monsieur Lavarède, continua-t-il, je pense qu’en la circonstance, un Parisien comme vous dirait : J’ouvre un atelier de réparation… En Anglais d’hier, j’ajouterai : Je l’ouvre de grand cœur.
Sur ce, il pivota sur ses talons et se dirigea vers le commandant Blass qui, ayant rendu compte de sa mission à lord Biggun, se montrait de nouveau sur le pont.
– Eh ! Eh ! fit celui-ci d’un air goguenard, vous semblez être en bons termes avec nos prisonniers, je vous suivais des yeux à l’instant…
– Et vous vous étonniez, sans doute ? interrompit Jack sans se déconcerter.
– Je l’avoue.
– Je le conçois. Je m’étonne moi-même du succès de ma tentative.
– Quelle tentative ?
Price le brun se pencha à l’oreille de son interlocuteur :
– Je les ai persuadés que mon frère seul était responsable de leur mésaventure. Moi-même, ai-je affirmé, j’ai tout fait pour contrecarrer ses projets.
M. Blass se passa la main sur le crâne, exprimant par ce geste combien la confidence du jeune homme lui paraissait énigmatique. Enfin il se décida à questionner :
– Pourquoi ces déclarations si peu conformes à la vérité ?
– Pour entrer dans leur confiance, commandant. Des incidents se sont produits, ces jours derniers, qui m’intriguent au suprême degré. Je ne serais pas fâché d’apprendre adroitement les tenants et aboutissants de la conspiration des tatoueurs.
– Admirable pensée ! s’écria l’officier, dont le visage s’épanouit… Ont-ils semblé croire votre petit conte ?
– Ils n’ont pas douté un instant de sa véracité.
Et, se rappelant la réflexion d’Armand : les Français sont si bêtes aux yeux des Anglais… Jack ajouta avec une ironie si légère qu’elle glissa inaperçue :
– Les Français, peuple de sentiment. Tout disposés à se confier à l’homme qui leur promet amitié…
La bouche du commandant s’ouvrit, laissant apercevoir deux formidables rangées de dents jaunes, déchaussées, admirable spécimen des « râteliers anglo-saxons ».
– Très juste ! Très juste !… Je vous félicite, cher Monsieur, vous connaissez parfaitement cette nation superficielle et vaniteuse. Nous autres, Anglais, jouerons toujours les Français par-dessous la jambe.
Puis, tendant la main à Jack, que la plaisanterie commençait à amuser :
– Secouez la main, avec moi, fit-il d’un ton plein de cordialité. Votre plan est adroit, il réussira. Je donnerai des ordres pour que l’on ne trouble pas vos conversations avec ces stupides naïfs oiseaux français. Je veux vous aider à capter leurs secrets.
Le digne officier s’interrompit pour montrer John, qui se promenait sur le pont d’un air flâneur et ennuyé.
– Contez donc la chose à votre frère. Il semble peu réjoui par la navigation. Votre récit le distraira.
Un instant plus tard, les deux fils de mistress Price étaient accoudés sur le bastingage. Jack parlait, John riait.
Quand Price le brun se tut, Price le blond, dépouillant son flegme coutumier, s’écria :
– Tenez, Jack, il faut que je dise toute ma pensée. Souvent je vous ai critiqué ; mais cette fois, je vous approuve pleinement. Vous avez fait preuve d’une initiative, d’une hardiesse d’exécution bien anglaises.
Un éclair moqueur étincela dans les yeux de Jack, une rapide contraction de ses traits trahit son effort pour ne pas s’abandonner à la gaieté. Vraiment, la réflexion de John était intempestive. Il choisissait l’heure précise, où son frère agissait en faveur de la cause française, pour le déclarer doué de toutes les vertus britanniques.
Et soudain son visage s’assombrit. Une buée humide voila son regard. Il venait de songer, qu’à cette heure même, commençait à se creuser l’abîme qui le séparerait fatalement de John,… et de mistress Price, la femme excellente et dévouée, chez laquelle, depuis vingt ans, il avait trouvé la tendresse d’une bonne mère.
Pour dissimuler sa mélancolie, Jack s’absorba dans la contemplation des rives du Nil.
Elles offraient l’apparence d’une animation inaccoutumée.
Partout des chariots roulaient pesamment, chargés de madriers, de plaques d’acier, de pièces de fer aux formes étranges.
Les berges étaient comme un immense chantier ininterrompu. Ici, des terrassiers creusaient le sol ; plus loin, des mécaniciens dressaient les pivots de tourelles tournantes. À mesure que la canonnière se rapprochait du Caire, les travaux apparaissaient plus avancés, dénotant la prodigieuse activité que mettait la Grande-Bretagne à enserrer le grand fleuve dans un réseau de métal.
Avant quinze jours, un mois au plus, le jeune homme le constatait avec tristesse, une ligne de canons garderait le Nil, d’Alexandrie à Ondourman. Sur plus de 1.000 kilomètres de longueur, une batterie monstre, auprès de laquelle les plus formidables défenses connues seraient de simples jouets enfantins, tiendrait sept millions de fellahs courbés sous la menace de ses canons.
De nouveau il se demandait ce que ses nouveaux amis, une fois libres, pourraient faire contre ce prodigieux armement. Devant l’énormité des travaux entrepris, il en arrivait à se dire :
– Sont-ce donc les Anglais que le destin a désignés pour recevoir l’héritage des Pharaons ? Jadis les rois de Memphis, de Thèbes construisaient des pyramides, des temples géants. Qu’est-ce que tout cela auprès d’une forteresse couvrant soudainement un espace de mille lieues ?
Attristé il considérait les ouvriers partout à la tâche, jetant sur les rives un grouillement de fourmilière humaine.
Et les chalands s’alignaient le long des berges ; des grues puissantes dressaient leurs bras massifs au voisinage des ruines du passé ; des wagonnets roulaient sur des voies provisoires. C’était un bouleversement, une renaissance du travail dans toute la vallée niliaque ; c’était comme une gigantesque apothéose du fer, écrasant, avec sa force irrésistible, les antiques constructions de pierre.
Incessamment des trains de bateaux croisaient le Look. Mariniers, ouvriers, ingénieurs, saluaient au passage la canonnière portant à la poupe le pavillon du Royaume Uni de Grande-Bretagne, ce pavillon qui, sur tous les points du monde, flotte comme l’image de la tyrannie avide d’une nation de marchands.
Les îles normandes, Gibraltar, Malte, Chypre, l’Égypte, la Nubie, le Soudan, le Cap, la côte des Somalis, Sierra-Leone, les bouches du Niger, Périm, Aden, l’Inde avec ses deux cent millions d’habitants, les îles Mélanésiennes, Polynésiennes, Micronésiennes, l’Australie et ses dépendances, la Guyane, le Yucatan, les Antilles, Terre-Neuve, le Canada disent la puissance des négociants de Londres, Birmingham, Manchester ; et là-bas, rocher perdu à l’ouest du golfe de Guinée, l’îlot lugubre de Sainte-Hélène proclame la victoire du mercantilisme sur le rêve de gloire.
Ici, sous les yeux de Price le brun, la réalité pratique de l’acier éclipsait, avec son arrogance brutale, le songe merveilleux des sectateurs disparus d’Osiris.
Le soleil, œil de flamme ouvert sur les révolutions humaines, microscopiques mouvements sans écho dans le domaine de l’infini, le soleil descendait vers l’horizon, quand le Look vint s’amarrer à quelques centaines de mètres en aval de Tahta, le long de la rive boisée en ce point.
Jack constata que les renseignements d’Armand étaient exacts.
Des acacias centenaires se penchaient sur l’eau, dressant leurs troncs rugueux au bord même de la berge coupée verticalement, comme au couteau, par le courant du fleuve.
C’était comme un mur verdoyant, un fouillis inextricable d’arbres et de buissons, à deux mètres duquel la canonnière avait trouvé un fond suffisant.
– Deux mètres, un saut possible pour un homme agile, pensa le fils de mistress Price.
Et sa pensée revenant aux prisonniers, il reconnut que l’évasion projetée avait des chances de réussir.
À l’heure du dîner, il se croisa avec le journaliste. Celui-ci, sans s’arrêter, murmura en passant près de lui :
– Après le repas, à l’arrière, je compte sur vous.
Jack répondit par un signe de tête.
Avec son frère il se mit à table ; mais chose curieuse, il semblait que les deux Price eussent changé de nature. Le taciturne John bavardait, et le bavard Jack gardait un silence obstiné, ce qui, du reste, faisait parfaitement l’affaire de son interlocuteur.
Au vrai, le jeune homme était ému. L’approche de l’instant décisif, de l’instant où, de par sa complicité avec le Parisien, il allait rejeter définitivement sa qualité d’Anglais : l’approche de ce moment lui causait une émotion profonde.
Non qu’il hésitât, bien avant cette heure, il avait prononcé l’alea jacta est, abandon de soi-même à la fatalité : mais le fait de passer du raisonnement à l’action, de l’idée platonique au geste, ne va pas sans un grand trouble.
Jack était bouleversé. Il ne voyait plus clair dans son esprit, où un seul penser se présentait, avec un entêtement cruel : réparer le mal qu’il avait fait aux chefs de la conspiration égyptienne. Le dîner s’acheva.
Les deux frères revinrent ensemble sur le pont. D’un coup d’œil, Price le brun s’assura que les Français n’étaient pas encore à l’arrière du navire. Cela lui fit plaisir ; il avait quelques minutes de répit. Lassé par le combat intérieur dont son cœur était le théâtre, il s’appuya lourdement sur le bastingage, percevant, sans en comprendre la signification, les paroles que John ne ménageait pas.
Price le blond était atteint, ce soir-là, d’une véritable intempérance de langue. Il chantait les louanges de l’Angleterre, du Sirdar, de l’armée, de la flotte, de Jack et généralement de tout ce qui, par origine, par hasard, par goût ou par violence, faisait partie du monde britannique. Sa satisfaction le poussait au dithyrambe. Il prenait à témoin de ses fanfaronnades les étoiles planant au-dessus de la terre comme un essaim de lucioles.
Jack, machinalement, leva les yeux, et, à travers les larmes qui les emplissaient, il crut voir les astres s’animer, devenir des mouches à feu décrivant une immense farandole sur le fond indigo du ciel. Cette scintillante armée semblait monter de l’horizon du nord, de la ligne où la terre d’Égypte se confondait avec la voûte céleste. Un frisson le secoua tout entier, et avec un émoi inspiré, il murmura pour lui-même :
– C’est l’armée des mouches du désert. Plus haut que les tourelles, plus vite que les obus, elles volent à l’assaut des retranchements derrière lesquels s’abrite le léopard anglais.
Un clapotement régulier le rappela à lui-même. Ses regards se portèrent sur le fleuve et il demeura saisi.
À cent mètres à peine, apparaissait une masse sombre glissant rapidement sur les eaux.
Il reconnut le karrovarka. Que venait-il faire là ? Brusquement, il se souvint de sa course au télégraphe en compagnie de M. Blass.

Le docteur Gorgius Kaufmann répondait à l’appel envoyé dans tous les sens sur le réseau des fils électriques.
Comme il était absorbé par la contemplation de l’étrange bateau où respirait celle qu’il supposait être Nilia, une voix résonna à son oreille.
Il fit face au causeur. C’était le commandant du Look en personne.
– Messieurs, disait-il aux deux frères, lord Lewis Biggun vous prie de vous rendre dans sa cabine.
– Nous, chez le Sirdar ? s’écrièrent-ils en même temps.
– Plus bas, plus bas, reprit vivement l’officier en appuyant un doigt sur ses lèvres. La mésaventure du général doit rester secrète, ainsi que l’opération qu’il va demander au docteur de pratiquer.
– Ah ! oui, la mouche sur le nez.
– Justement. Il vous appelle, vous qui êtes au courant et dont la discrétion lui est connue, pour vous mettre aux ordres de sir Gorgius.
– Nous serons donc les aides de ce personnage ?
– Précisément.
Il n’y avait qu’à obéir. Les jeunes gens suivirent M. Blass, qui les introduisit dans la cabine où le Sirdar attendait.
À la vue des fils de mistress Price, lord Biggun eut un sourire et, adoucissant l’expression sévère de sa physionomie :
– Mes amis, dit-il, j’ai reçu une blessure d’amour-propre que le scalpel va guérir. Le chirurgien a besoin d’aides. J’ai compté sur vous qui, bien que jeunes, avez donné à la cause britannique des preuves indiscutables de dévouement et en qui j’ai toute confiance.
Jack salua, incapable de répondre. La mouche était pour lui indissolublement unie à l’idée de l’indépendance égyptienne, et le généralissime affirmait que l’on allait extirper l’insecte, dont la présence ridiculisait son auguste nez.
L’opération était-elle un présage ?
Mais John, étranger aux perplexités de son frère, prit la parole :
– Nous sommes honorés de vous assister dans la circonstance, Milord général… et, quant à votre confiance, j’ose dire que vous en avez fait un bon placement.
Le grand maître de l’armée d’occupation, hocha la tête.
– J’en suis certain, fit-il seulement, et je saurai me souvenir.
– Remember, conclut John.
Ce mot augmenta l’émoi de Jack. Admirateur de la littérature française, il avait lu les Trois Mousquetaires, Vingt ans après, le Vicomte de Bragelonne, et à sa mémoire se représentait la scène tragique, immortalisée par Alexandre Dumas, où Charles 1er, à l’heure de porter sa tête royale sur l’échafaud, prononce ces trois syllabes, si éloquentes dans leur concision :
– Remember ! souviens-toi !
Et ces héros si français, pleins de faconde et de générosité, d’Artagnan, Athos, Porthos, Aramis se dressèrent devant lui. Ah ! les fils de Gaule n’avaient pas dégénéré. Jadis, les mousquetaires n’avaient pas craint de lutter contre le peuple anglais tout entier, aujourd’hui les Lavarède venaient, sur le sol égyptien, continuer la lutte héréditaire du Coq Chante-clair contre la griffe rapace du Léopard.
Soudain ses terreurs s’évanouirent ; une fanfare guerrière sonna en lui. Il se reprocha sa faiblesse. Oui certes, la Mouche du désert, livrée à ses propres forces, serait écrasée ; seulement elle avait l’allié par excellence, le Coq des Arvernes, des Bellovaques, des Senones, des Parigii, l’oiseau vantard, mais courageux jusqu’à la témérité, dont le cocorico narquois effraie ceux-là même qui eussent triomphé de l’Aigle.
Cocorico, cri de guerre et de confiance ! Cocorico qui dit : Courage aux épris de liberté, courage aux vaincus d’hier !
Cocorico, sonnerie de clairons qui brave l’adversité ! Cocorico, appel ironique et vibrant qui clame aux oreilles surprises du monde : La Gaule est toujours vivante ; ses fils sont restés les mêmes qu’au temps de Vercingétorix : emportés, prompts aux querelles intestines, mais toujours prêts à faire face à l’ennemi, à mourir en chantant.
Cocorico, c’est la vieille France partant aux croisades pour une idée ! Cocorico, c’est la nation rénovée par la tourmente de 89 ; c’est le peuple se levant en masse pour convertir l’humanité à la liberté, à l’égalité, à la fraternité.
Cocorico, ce sont les penseurs de demain, ceux pour qui croissent les moissons semées par les ancêtres.
Destinée étrange ! Incompréhensible enchaînement des choses, c’est cocorico, clameur de combat, qui convie les hommes à la bonté, à la justice, à la paix.
Voilà ce que pensa Jack en regardant le Sirdar. L’orgueil français venait de naître chez ce jeune homme élevé en Anglais.
Un coup discret fut frappé à la porte de la cabine. Sur un signe du général, M. Blass ouvrit. Le docteur Gorgius parut.
Derrière ses lunettes, ses yeux pétillaient, faisant le tour de la cabine. Puis, sans manifester le moindre étonnement, Kaufmann se planta devant lord Biggun et paisiblement :
– Vous m’avez appelé, dit-il, me voici.
Un imperceptible mouvement de dépit contracta le visage du généralissime.
– Vous ignorez pourquoi j’ai désiré vous voir, fit l’officier avec une nuance de sarcasme.
Mais l’Allemand haussa, les épaules :
– Pas le moins du monde, je sais comme toujours.
– Vraiment ? Prouvez.
– À l’instant. Une question cependant. Je puis parler devant ces messieurs ?
– Vous le pouvez.
Gorgius esquissa un petit salut, fouilla, dans les poches de sa redingote graisseuse, et, montrant un étui de cuir noir, rougi par un long usage :
– Voici ma trousse ; s’il vous plait de présenter le nez à mon bistouri, nous aurons facilement raison de l’insecte qui vous taquine.
La réponse était claire. Vivement, le Sirdar demanda :
– C’est votre service de renseignements qui…
– Qui m’a avisé, répliqua l’Allemand, sans qu’un muscle de son visage tressaillît. Vous l’avez dit, toujours la capitaine Nilia.
– Et vous a-t-on nommé également les auteurs de l’attentat commis sur ma personne ?
– Sans doute, sans doute ; des fellahs de Keneh.
– En fuite ?
– Réfugiés au désert.
Arrêtant un geste de dépit de lord Biggun, le docteur continua :
– On penserait que ces drôles obéissent à un mot d’ordre. Leur coup fait, ils s’enfoncent dans les solitudes sablonneuses. Où vont-ils ? Vers quel point de concentration portent-ils leurs pas ? Impossible de le découvrir. Toutefois, l’on doit reconnaître que leur tactique est bonne. Nos soldats ne sauraient les poursuivre dans les immenses plaines arides qui s’étendent entre le Nil et la mer Rouge, non plus que dans celles du désert Lybique.
– C’est de cela que j’enrage, gronda le Sirdar, car l’impunité accroît leur audace.
– Oui, oui, leur audace grandit, continua Gorgius en haussant philosophiquement les épaules.
Il ouvrit en même temps sa trousse de chirurgien.
– Aussi ne perdons pas une minute. Faisons disparaître la trace de leurs méfaits… Nous filerons ensuite à toute vapeur vers le Caire, et nous presserons l’Amirauté d’ordonner l’exécution des Français qui se sont mis à la tête du mouvement. Peut-être les indigènes se figurent-ils que l’Angleterre n’osera pas frapper ces aventuriers. Eux morts, une terreur salutaire étouffera les dernières velléités de rébellion.
Tout en parlant, le vilain personnage étalait ses outils sur la table. Il désigna les fils de mistress Price de la main :
– Ces jeunes gens consentiront-ils à m’aider ?
– Bien certainement, fit John ; nous ne sommes ici que pour cela.
– Parfait ! alors, veuillez descendre à la machine et me rapporter une carafe d’eau ayant bouilli.
John sortit aussitôt.
– Quant à vous, reprit l’Allemand en se tournant vers Jack, prenez un mouchoir. Vous l’imbiberez de chloroforme, et vous le tiendrez sous les narines de Milord-général.
Il déposa sur la table un flacon contenant le puissant anesthésique, qu’il avait tiré d’une des poches de sa redingote.
– Quoi ? se récria le Sirdar, prétendez-vous m’endormir ?

– Cela vaut mieux. L’opération est douloureuse et un faux mouvement aurait des conséquences désagréables.
– Mais je suis un soldat et non une femmelette…
– D’accord. Seulement, vous êtes aussi le commandant en chef de l’armée anglo-égyptienne. Il importe à votre prestige de faire disparaître toute trace de la mauvaise plaisanterie en question. Or, je ne puis répondre d’arriver à ce résultat si votre immobilité n’est pas absolue.
– On ne verra plus rien ?
– Non, pas même une cicatrice. L’opération est double : enlever le tatouage et remplacer le fragment de chair découpé par une greffe prise sur votre bras. Ce n’est absolument rien à exécuter, à la condition qu’aucun geste intempestif ne trouble l’opérateur.
– Endormez-moi donc, consentit lord Biggun, qui se dépouilla de son veston et alla s’étendre sur sa couchette. John rentrait avec une carafe d’eau.
– Commençons, dit le savant d’un ton d’autorité.
Saisissant le flacon de chloroforme, il en imbiba un mouchoir et le passa à Jack.
– Allez ! ordonna-t-il.
Tandis que le jeune homme appliquait cette compresse sur le nez du patient, Gorgius prenait dans ses mains maigres le poignet de ce dernier et consultait le pouls.
L’effet de l’anesthésique ne se fit pas attendre. Une légère rougeur monta aux joues du Sirdar, ses yeux tournèrent lentement, puis il demeura immobile.
L’Allemand se frotta les mains.
– Un beau sang… sommeil calme… pas de soubresauts nerveux. Le lord a bien le tempérament d’un chef d’armée. Cela va marcher comme sur des roulettes.
Aussitôt il se mit à l’œuvre, découpa sur le bras de Biggun un fragment de peau, pansa la légère blessure ; après quoi il approcha son bistouri du nez de son client.
Jack suivait les phases de l’opération avec impatience.
Il songeait qu’à cet instant peut-être Lavarède et ses gracieuses amies l’attendaient à l’arrière du Look. Ils s’étonnaient certainement de ne pas le voir ; le soupçon pénétrerait en eux s’il tardait.
L’idée qu’ils pouvaient croire à une trahison de sa part lui devint insupportable. Sans se rendre compte qu’il parlait à haute voix, il s’écria :
– Il faut que je sorte.
– Bon, grommela l’Allemand, l’opération vous impressionne, défaut d’habitude. Tenez, c’est fini. Je n’ai plus besoin de vous. Monsieur John, vous restez, vous ?
Price le blond eut un rire moqueur.
– Tant que vous l’exigerez ; je n’ai pas de nerfs comme mon frère. Il est vraiment sensible ainsi qu’une jeune dame. Allez, allez, Jack, Monsieur le docteur vous octroie licence de vous retirer.
Peindre l’air protecteur dont ces paroles furent prononcées est impossible. Jack du reste ne s’en offusqua point.
Ravi de l’erreur de ses interlocuteurs, il s’empressa de se glisser dehors. Sur le pont, il regarda autour de lui.
La nuit était sereine et la lune répandait sur le fleuve sa clarté argentée. La lumière de Phœbé agaça Price le brun. Il avait bien besoin de briller, cet astre mort ! Avec ses rayons froids, n’allait-il pas rendre impossible l’évasion des prisonniers ?
Maugréant, Jack se dirigea vers l’arrière, avec la démarche nonchalante d’un flâneur.
Il aperçut bientôt ceux qu’il cherchait.
Armand était penché au-dessus du gouvernail. Il semblait expliquer quelque chose. Debout auprès de lui, Aurett et Lotia écoutaient ; et à deux pas du groupe, l’orang-outang, les bras croisés derrière le dos, regardait en l’air, fixant de ses yeux vifs la cime des acacias ondulant sous la caresse d’une faible brise.
Un murmure de satisfaction accueillit la venue du jeune homme.
Le journaliste lui tendit la main, imité aussitôt par ses compagnes, puis à voix basse :
– Vous avez été retenu ? questionna-t-il.
– Oui, chez le Sirdar.
– Se douterait-il de quelque chose ? reprit Armand avec une pointe d’inquiétude.
– Non, rassurez-vous. Un médecin le débarrasse de la mouche dont vos… amis l’ont orné.
Un éclat de rire, vite comprimé, écarta les lèvres des captifs, puis le Parisien, redevenu sérieux, grommela :
– L’instant serait favorable. Malheureusement nous nous heurtons à une difficulté imprévue.
Le cœur de Jack battit plus rapidement.
– Une difficulté… Vous renoncez à vous évader ?
Ce fut Aurett qui répondit :
– Non, mais mon mari fuira seul. Le bordage de ce bateau est à environ deux mètres de la terre. Lui, peut franchir cette distance d’un saut : Lotia et moi n’y arriverions jamais…
– Et, acheva Armand, je ne saurais me décider à vous abandonner.
La jeune femme lui mit la main sur les lèvres.
– Il faut que vous partiez. Pour la cause que vous avez embrassée, pour le salut de votre cousin, il le faut. Lotia et moi ne courons aucun danger. Vous et Robert seuls êtes en péril ; c’est avoir pitié de nous, c’est prouver votre tendresse que de vous mettre hors d’atteinte.
– Voilà qui est parler en femme courageuse, conclut Jack. Obéissez, Sir Lavarède. Ces jeunes dames d’ailleurs ne seront pas isolées ; je vous promets de veiller sur elles.
– Soit donc, consentit le journaliste en serrant les mains de Price le brun, je ne m’appartiens plus depuis le jour où j’ai mis le pied sur cette terre égyptienne. Libre, je pourrai tenter l’impossible pour délivrer Robert, pour rendre aux patriotes le chef qu’ils ont choisi… Mister Jack, je vous confie ce que j’ai de plus cher au monde.
– C’est un ami qui reçoit ce précieux dépôt, répondit gravement le jeune homme.
– Je le crois. Et maintenant hâtons-nous. J’ai des cordes, un bâillon. Je vais vous ficeler, vous mettre dans l’impossibilité de pousser un cri. Dix minutes après mon départ, vous vous dégagerez du bâillon que je place en conséquence et vous appellerez à l’aide.
– Dix minutes seulement ?
– Des alliés m’attendent près d’ici. Mais pressons, pressons.
En un instant Jack, qui s’y prêtait de bonne grâce, fut garrotté ; un foulard fut appliqué sur ses lèvres.
Personne n’avait bougé aux alentours. Les prévisions du journaliste se vérifiaient. L’équipage, sachant le fils de mistress Price auprès des captifs, jugeait inutile de se fatiguer par une surveillance pénible.
Armand inspecta les environs d’un rapide coup d’œil. Rien de suspect n’apparut. Alors il tendit les bras à Aurett qui s’y jeta.
Durant quelques secondes, les époux restèrent ainsi, s’avouant dans une muette étreinte les angoisses de la séparation, puis la jeune femme repoussa Lavarède.
– Allez, mon ami, dit-elle, allez ; mon cœur est avec vous.
Lotia à son tour échangea un baiser fraternel avec celui qui allait partir. Et soudain, comme s’il sentait le besoin de brusquer la situation, Armand, après un dernier geste d’adieu, prit son élan, posa le pied sur le bastingage, et se lançant en avant, franchit l’espace qui le séparait de la rive ; il s’engouffra ainsi qu’un projectile dans le fourré où il disparut.
Des froissements de feuilles seuls eussent pu trahir le fugitif, mais ce bruit se confondit avec le clapotement de l’eau, le bruissement du vent dans les branches et le silence se fit.
Aucun matelot, aucun ennemi n’avait été mis en éveil.
Lotia, Aurett échangèrent un long regard troublé par les larmes qu’elles ne cherchaient plus à retenir. Elles eurent un soupir douloureux.
Elles se préparaient à regagner leur cabine, laissant Jack seul, libre de continuer tout à l’heure la comédie dont la première scène venait de s’accomplir.
À ce moment, le singe Hope se dressa entre elles.
Avec une attention soutenue, l’animal avait suivi de son regard intelligent tous les mouvements de ses maîtres. Quand Armand avait bondi, il avait été sur le point de s’élancer après lui, puis il s’était ravisé, avait pris une attitude réfléchie, comme s’il cherchait la signification réelle de l’événement.
Le cerveau des quadrumanes est le siège de raisonnements ignorés. Hope avait dû comprendre la situation, car, avant que Lotia et Aurett eussent pu deviner son intention, il saisit chacune d’elles sous un de ses longs bras et d’un bond prodigieux il atteignit, avec son double fardeau, les arbres de la rive.
De ses pieds aux pouces opposables, il se cramponna, une seconde, à une branche ; la tête en bas, il se balança, décrivit une nouvelle trajectoire et se perdit dans les feuillages.
L’orang venait d’accomplir ce que Lavarède avait jugé impraticable. Il avait assuré l’évasion des deux femmes.

Stupéfait, ahuri par ce dénouement inattendu, Jack restait à la même place, oubliant son rôle.
Il ne sentait plus ses liens. Sur les quatre prisonniers, trois étaient libres maintenant. Avec un bonheur inouï, ils avaient trompé la vigilance de leurs ennemis.
Les Égyptiens avaient récupéré l’un de leurs chefs. La rébellion désormais avait une tête,… et quelle tête, intelligente, ouverte aux hardis projets, capable de déjouer tous les plans des stratèges britanniques par l’imprévu de ses combinaisons.
Ah ! il songeait bien aux tourelles tournantes à présent. Le facteur principal de la victoire lui apparaissait dans la valeur morale du commandement, et en cela il ne se trompait pas. Les remparts de pierre, les forts d’acier, les canons géants aux effrayants projectiles, tous ces instruments de destruction sont un appoint dans la lutte ; mais c’est la valeur morale seule qui conduit au triomphe.
Et puis Jack admirait la chance de ses nouveaux alliés. Une difficulté semblait s’opposer à la fuite de tous ; un singe, un animal privé de raison, diraient les braves gens qui ne raisonnent jamais, avait réduit l’obstacle à néant.

Cependant les minutes s’écoulaient ; le jeune homme jugea qu’il lui était loisible d’appeler à l’aide.
De quelques mouvements de tête, il fit glisser son bâillon et lança dans l’air un cri retentissant :
– À moi ! Au secours !
Sa voix résonna lugubrement dans la nuit, faisant frissonner les matelots de quart. Des pas lourds retentirent, des interjections étonnées, des interrogations, bientôt plusieurs marins parvinrent à l’endroit où Jack gisait, étroitement ligoté.
– Déliez-moi, gémit Price le brun. Les bandits m’ont attaché.
La stupeur des dignes Anglais ne connut plus de bornes. Ils se regardèrent, roulèrent des yeux éperdus.
– Quels bandits ? By God ! Il n’y a pas l’ombre d’un bandit à bord.
– Défaites ces cordes, clamait cependant Jack. Il faut prévenir le général sans retard. Les Français se sont évadés !
Du coup les hommes sursautèrent. Les uns retirèrent à grand’peine le fils de mistress Price du lacis compliqué des filins qui entouraient ses membres ; les autres coururent aviser l’officier de quart et le commandant.
M. Blass, bouleversé par leurs paroles, essaya vainement d’obtenir d’eux quelques détails. Ils ne purent lui en donner et pour cause. Force fut à l’officier de marine de se rendre auprès de Jack.
Il le trouva, en apparence du moins, encore tout étourdi de l’aventure, regardant d’un air hébété les cordes et le bâillon jetés sur le pont à ses pieds.
Aux questions de M. Blass, le jeune homme répondit cependant avec une certaine clarté.
Il conversait avec les Français, raconta-t-il, quand tout à coup le singe s’était jeté sur lui, probablement à l’instigation de ses maîtres. Ceux-ci avaient profité de la surprise de leur victime pour la réduire à l’impuissance.
Après quoi, ils avaient sauté de la canonnière sur le rivage.
– Comment… ils sont partis, bien partis ? clama le commandant en se prenant la tête à deux mains.
– Oui, oui, là… à travers les arbres.
– Et ces dames ont sauté aussi ?
– Je les ai vues.
– Ah ! gronda M. Blass avec rage, ces femmes de France n’ont aucune réserve. Elles font des cabrioles que nos ladies laissent aux seuls clowns.
Puis son inquiétude reprenant le dessus :
– Que va dire milord Biggun ? Un général mécontent est un voisin désagréable, et le diable Béelzébuth est plus noir que le charbonnier.
– Il faut se lancer à leur poursuite, proposa Jack, enchanté de la tournure que prenaient les événements.
– Sans ordres, impossible.
– Allons en demander à Son Honneur le Sirdar.
– Évidemment, il n’y a pas autre chose à faire, déclara l’officier d’un ton lamentable : quand on est tombé sur le dos, on doit tenter de se retourner… C’est égal, je paierais volontiers dix bouteilles de porto-wine, pour avoir une autre commission à faire.
Jack se dit que le commandant n’avait pas tort. La rage du généralissime serait effroyable, et la mauvaise humeur d’un supérieur, capable de vous octroyer soixante jours de prison, ou d’obtenir votre radiation des tableaux d’avancement, est une manifestation de sentiments à éviter.
Il suivit donc M. Blass à contre-cœur, un peu inquiet des suites de son équipée.
Mais ce qui se produisit dans la cabine du Sirdar fut très différent de ce qu’il redoutait.
Lord Biggun, auquel Gorgius Kaufmann achevait de bander le nez, supporta la nouvelle avec un sang-froid admirable.
Regardant l’Allemand, il dit d’un ton énigmatique :
– Docteur, informez-vous, je vous prie. Nous rejoindrons les fugitifs.
Jack sentit un frisson parcourir son corps. Il devinait ce qui allait se passer. Gorgius rentrerait dans son karrovarka, et par un moyen mystérieux, incompréhensible, il se renseignerait.
Si Armand et ses compagnes étaient repris ?
Un trouble douloureux l’envahit. L’inexplicable se dressait de nouveau devant lui, l’inexplicable auquel Nilia était mêlée. Son cœur et son cerveau souffraient ensemble. Comme un bourdonnement, il entendit la voix du Sirdar prononcer ces mots :
– Vous pouvez vous retirer, Messieurs.
D’un pas automatique, il quitta la cabine. Devant lui marchait le docteur, telle une ombre falote et grotesque. Il le suivit, traversa dans ses traces le pont de la canonnière.
À la coupée, il s’arrêta, tandis que l’Allemand escaladait le char flottant, se dressait un instant sur la plate-forme supérieure, se profilait sur le ciel ainsi qu’un gnome malfaisant, et disparaissait à l’intérieur.
Une ardente prière monta aux lèvres du jeune homme. Il priait qui ? Il n’eût su le dire ; mais à la créature inconnue qui, du fond du karrovarka lui avait dit naguère : Ordonne que je mente, les Français auront besoin du mensonge ; à cette créature il s’adressait :
– Ô toi, que mes yeux n’ont point rencontrée, toi dont j’ignore l’âme et le visage, mais en qui je crois, ne trahis pas ceux qui ont brisé leurs fers.
À qui lui eût demandé d’expliquer sa pensée, il eût certainement répondu :
– J’en suis incapable, je ne comprends pas moi-même. Je m’agite aveuglément dans l’étrange, dans l’inexprimable.
Il obéissait à un instinct ; poussé par cet être intime qui double notre intelligence, et que notre raison, dont nous sommes si fiers, subit, tout en qualifiant dédaigneusement ses manifestations de pressentiments ridicules ou de rêves ineptes.
Rien ne répondit à ce muet appel. Les volets des hublots demeurèrent fermés. Jack ressentit de ce silence une tristesse.
Sans se l’avouer, il avait espéré que la douce voix, entendue déjà, passerait dans l’air, apporterait à son oreille les paroles de confiance :
– Ne t’inquiète pas. La vérité ne sera pas dévoilée.
Soudainement accablé, il appuya ses coudes sur le bastingage et enfouit son visage dans ses mains.
Un quart d’heure s’écoula sans qu’il effectuât un mouvement, puis un froissement métallique lui fit lever la tête. L’échelle articulée du karrovarka se déroulait, et Gorgius Kaufmann posait le pied sur le premier échelon pour repasser sur le pont du Look.
Le docteur l’aperçut ; ses sourcils se froncèrent et, de son organe désagréable, il demanda :
– Que faites-vous là ?
– Je songe aux prisonniers évadés, murmura Price le brun, gêné par la question.
L’Allemand eut un ricanement :
– Et vous déplorez de les avoir laissés fuir… ?
Puis, sans attendre la réponse :
– Vous avez raison, car ils sont loin maintenant. Des chameaux de course tout sellés les attendaient. Ils gagnent le désert à toute vitesse, impossible de les rattraper.
Un soupir dégonfla la poitrine de Jack. Ses vœux étaient exaucés. Et, retrouvant sa lucidité, il s’écria en affectant un chagrin qu’il était loin d’éprouver :
– Je ne m’en consolerai jamais… Seulement, une chose me surprend ; comment avez-vous pu apprendre tout cela dans votre bateau ?
Derrière ses lunettes bleues, les yeux de Gorgius flamboyèrent, mais l’éclair s’éteignit aussitôt.
– Un appareil de mon invention me tient en communication avec les éclaireurs Nilia.
– Ah ! vraiment. Une communication électrique ?
– Peut-être !
– Une sorte de télégraphe sans fils, système Ducretet ou Marconi ?
– Oui, prononça rudement Kaufmann.
Il tourna le dos à son interlocuteur, se dirigeant à grands pas vers la cabine du Sirdar.
Son hideux visage grimaçait, strié d’innombrables rides. Il monologuait en marchant.
– Très curieux, ce garçon… S’intéresse trop à mon karrovarka… Il a tort… Otto Skoppen n’était pas endurant et Gorgius ne l’est pas davantage… Je vais aviser Biggun… Il sera bon de se défier de cet indiscret… Oui certes, mes secrets appartiennent à moi seul… Je ne permettrai pas qu’on lève le voile dont je les entoure… Non, je ne le permettrai pas.
Son accent menaçait, et Jack eût ressenti une sombre inquiétude s’il avait pu entendre le savant.
Mais il ne se souvenait déjà plus de l’existence de l’Allemand.
À peine celui-ci s’était-il éloigné, qu’un volet de hublot s’était abattu, et que par l’ouverture ainsi démasquée, s’était élevée la voix de Nilia, cette voix douce et mélancolique, dont le son faisait vibrer tout l’être de Price le brun.
– Sois rassuré, disait-elle. Les fugitifs sont sauvés. Tu les reverras au Caire.
Et avec une intonation impossible à rendre :
– Au Caire, où je serai délivrée tout en restant enfermée dans le karrovarka.
Il y eut un silence. Jack joignit les mains :
– Qui que tu sois, femme ou esprit, parle, parle encore.
Un rire perlé répondit :
– Je cherchais des papiers qu’il faut que tu aies en ta possession, reprit l’organe musical de l’inconnue. Il est nécessaire que tu n’ignores rien de la construction de mon char flottant. Je vais te donner les plans. Étudie-les sans en parler à personne, à personne, entends-tu bien ?
– Je me tairai, promit-il.
– Je le vois, tu garderas le secret.
Et, avec un accent de prière :
– Garde-le bien. Que nul ne soupçonne ta science. Si cela arrivait à leurs oreilles, nous serions séparés pour toujours. Pour toujours, répéta-t-elle, et le bonheur de la réunion serait impossible.
L’inflexion de la voix mystérieuse changea encore :
– J’attache le petit paquet avec une faveur. Nul ne t’observe… ?
Il regarda autour de lui. Il était seul, masqué du reste du navire par les cheminées de la machine.
– Non, je ne vois personne.
– Je le sais, prends ceci et cache-le à tous les yeux.
Un objet blanc jaillit de l’ouverture sombre du hublot, décrivit une courbe dans l’espace, et vint tomber aux pieds de Jack. Se baisser, ramasser un paquet de feuillets liés d’une faveur rose fut l’affaire d’un moment.
– Bien, reprit la voix en s’affaiblissant, comme si l’interlocutrice de Price le brun s’éloignait. Étudie, étudie… nous nous verrons au Caire, si tu en as le désir… Au revoir !… Au revoir !
Un claquement sec, une vibration sonore des plaques métalliques formant le chariot-barque, et tout se tut. L’obturateur du hublot s’était refermé. Jack était seul, avec dans les mains les papiers qui lui étaient parvenus de si singulière façon.
Une curiosité aiguë envahit le jeune homme. Ce que ses doigts impatients froissaient, c’était le plan du karrovarka. En y jetant les yeux, il connaîtrait l’appareil dont son esprit s’était si souvent préoccupé.
Soudain, il eut un geste rageur.
Où pourrait-il prendre connaissance de l’envoi de Nilia ?
Dans sa cabine ? Non, John s’y trouvait, et il ne manquerait pas de s’enquérir de l’objet des méditations de son frère.
Lui faudrait-il donc attendre l’arrivée au Caire ? Cela, il le sentait, serait au-dessus de ses forces.
Alors, où aller ? Où se dissimuler ?
Il parcourait lentement le pont, et tout à coup, un sourire satisfait distendit ses lèvres. Jack avait trouvé.
Une partie du bateau échappait aux regards indiscrets. La pointe extrême d’avant. Pourquoi n’irait-il pas là, à la naissance du mât de beaupré ? La lune brillait radieuse au ciel, versant sur la terre une lumière suffisante pour lire.
Rapidement, Price le brun parcourrait les documents qu’il pressait sur sa poitrine. Il se ferait une idée générale de la prison de Nilia, une idée suffisante pour avoir la patience de remettre à l’arrivée au Caire un examen plus approfondi.
Se contraignant à ne pas accélérer son allure, il gagna l’avant du Look, se glissa à l’extrême pointe de la proue, dont l’arête aiguë descendait au-dessous de lui en pente douce jusqu’à la surface de l’eau.
Il dénoua le lien fragile qui enserrait les papiers, déplia ceux-ci et les contempla d’un regard avide. Il eut peine à retenir un cri de joie. Nilia ne l’avait pas trompé. Sous ses yeux s’étalaient des plans, clairs et précis, dont la lecture lui apparaissait aisée.
– Bon, murmura-t-il, celui-ci représente une coupe longitudinale du karrovarka. L’intérieur est partagé en trois pièces, celle d’avant contenant le moteur, l’appareil de direction et le fanal destiné à éclairer la route en cas de voyage de nuit. Au-dessous, quatrième compartiment… à quoi sert-il ? Ah ! oui, je vois, c’est là que se mettent les vivres et les réserves productrices d’électricité.

Il prit une autre feuille.
– Qu’est ceci ? La plan de la trappe de la plate-forme supérieure, avec la façon de l’ouvrir du dedans et du dehors… je comprends… un boulon mobile. On appuie, un jeu de leviers produit le déclanchement des verrous de fermeture. Le boulon intérieur est sur la paroi de droite. Le boulon extérieur est à l’arrière, à peu près au milieu de l’essieu des roues motrices.
Un troisième plan fut déplié.
– Ceci figure la manœuvre de l’échelle mobile.
Prestement, le jeune homme replia les feuilles, les glissa dans la poche de son veston et, avec une joie délirante :
– Maintenant je sais, je sais. Je verrai Nilia au Caire, si j’en ai le désir, a-t-elle dit. Alors je la verrai sûrement, car je suis prêt à donner ma vie pour me trouver en sa présence, pour lui avouer ce qui gonfle mon cœur à le faire éclater.
Et se penchant en avant, il murmura tout bas en regardant l’eau qui coulait lentement :
– Génies mystérieux du Nil, recevez le secret qui m’oppresse. Mon âme est à Nilia, à Nilia !
Son exaltation aidant, il lui sembla que des chuchotements, des palpitations d’ailes passaient dans l’atmosphère et il continua :
– Ils m’ont entendu. Ils vont lui porter l’aveu de ma tendresse.
Or, à ce moment précis, Gorgius Kaufmann, enfermé dans la cabine du Sirdar, exprimait sa mauvaise humeur, causée par des questions indiscrètes de Jack, et lord Biggun lui répondait en souriant :
– N’ayez crainte, docteur. Ce garçon ne poussera pas ses recherches plus loin. Au Caire, notre voiture sera placée dans la grande allée du jardin. Deux factionnaires la garderont nuit et jour, et les cachots de la citadelle s’ouvriraient pour quiconque chercherait à s’approcher du karrovarka !
Comme on le voit, la visite, que Jack projetait de faire à Nilia, allait être entourée de difficultés et de dangers qu’il ne prévoyait pas.

CHAPITRE IX
LE SIÈGE DU KARROVARKA
– Ah ! mes enfants ! Je vous revois !
Tel fut le cri par lequel la bonne mistress Price accueillit l’entrée de ses fils dans la cuisine de la Résidence.
La canonnière Look venait d’arriver au Caire. À peine amarrée dans le canal Ismaïlien, les jeunes gens avaient pris congé du commandant Blass, s’étaient élancés sur le quai et d’une course avaient gagné la villa du Sirdar.
À leur vue, mistress Price, qui tenait une casserole de cuivre, la lâcha de saisissement, et, tandis que le récipient roulait avec fracas sur les dalles, elle ouvrait les bras en répétant :
– Ah ! mes enfants ! Ah ! mes enfants !
Toute sa grosse personne tremblait d’aise et d’émotion.
Les frères, impressionnés eux-mêmes, se jetèrent au cou de l’excellente femme et durant un instant ce fut un bruit de baisers, d’exclamations joyeuses.
Enfin la cuisinière, à demi-étouffée par ces effusions, éloigna un peu les jeunes gens ; elle les contempla d’un air ravi.
– Vous avez bonne mine, mes fils, mes Jean bien aimés… Le soleil vous a un peu brunis, mais cela vous va bien… Décidément, j’ai de beaux garçons… et de braves garçons aussi…
Elle les ramena à elle, prit leurs têtes, les appuya sur chacune de ses épaules, et, avec orgueil :
– Je dis braves… parce que, après votre départ, on m’a raconté quelle périlleuse mission vous aviez acceptée… allez, vous m’avez fait passer plus d’une mauvaise nuit… Des cauchemars à n’en plus finir… Je voyais des sphinx vous poursuivre pour vous dévorer… à présent tout est fini, terminé, réglé… Mes enfants sont venus à bout des rebelles, ils ont livré à l’Angleterre les chefs, ces terribles Français. Je suis fière de vous. Seulement, quand on a fait ses preuves, on a le droit de rester tranquille. Plus jamais vous ne me quitterez, plus jamais.
De nouveau elle les couvrait de baisers, sans remarquer l’étrange effet que ses paroles produisaient sur Jack. Le jeune homme était à la torture.
– Elle m’aime comme la plus tendre des mères, se disait-il, et elle n’est pas ma mère. Elle me félicite d’avoir été fidèle à l’Angleterre et je ne le suis plus.
L’abîme s’ouvrait devant lui, le séparant à chaque minute davantage de celle qu’il ne pouvait se déshabituer d’appeler de ce nom si doux, le plus doux qu’il soit donné à l’homme de prononcer : Maman.
Maman, appel de l’enfant heureux ou triste, symbole des tendresses infinies, du dévouement sans bornes. Maman, dont les deux syllabes se retrouvent sur les lèvres du soldat mourant, comme si elles représentaient l’adieu à toutes les joies de la vie.
Mistress Price parlait toujours.
– J’ai su, mon Jack, que l’un des coquins s’est évadé, te laissant ficelé, bâillonné, ressemblant plus à un saucisson d’Édimbourg qu’à un homme. Quelle angoisse ! Il aurait pu te tuer, ce scélérat ! Mais le grand chef est notre prisonnier ; il paiera pour tout le monde. Je compte bien qu’on ne lui fera pas grâce, et qu’il sera fusillé pour lui apprendre à vivre.
John rit franchement de la locution baroque de sa mère. Jack conserva un visage grave. Sans le savoir, mistress Price venait d’aviver ses remords. Robert Lavarède était sous le coup d’une condamnation capitale, par sa faute, à lui. Français, car sa conviction était absolue, Français, il avait mené à sa perte le vaillant fils de France qui s’était rendu à l’appel d’un peuple opprimé.
Mais la cuisinière n’observait rien.
– Il faut que je vous demande quelque chose.
– Quoi donc, mère ? répliqua John.
– Vous avez entendu parler de la capitaine Nilia ?
– Je crois bien, à tout instant ce nom revenait à nos oreilles.
– C’est une personne bien remarquable, n’est-ce pas ?
John gonfla ses joues en signe d’admiration :
– Tout à fait remarquable. Elle a organisé un service de renseignements, tel que la police anglaise, qui est réputée à juste titre pour la première du monde, semble à peine à l’état embryonnaire.
– Ah ! Ah ! vraiment, cela est ainsi. Je suis charmée de l’entendre de ta bouche. Et comment est-elle, cette capitaine ? jolie, jeune ?
Price le blond haussa les épaules, étendit les bras à droite et à gauche.
– Je l’ignore, chère mère.
– Cela signifie-t-il que tu ne l’as pas vue ?
– Naturellement.
– Et Jack ? reprit la cuisinière d’un ton curieux.
– Ne l’a pas plus rencontrée que moi.
La grosse dame eut une moue peu satisfaite.
– Mais enfin, vous avez bien quelques données sur elle ?
– Pas la moindre.
– Cela est impossible. Vous viviez aux côtés du Sirdar et…
John interrompit sa mère.
– Je parierais volontiers que le Sirdar ne la connaît pas non plus.
– Que me contes-tu là, clama mistress Price ? Le général en chef sait tout…
– Et, continua son interlocuteur, c’est même ce mystère que je trouve le plus joli dans son service d’éclaireurs. Personne n’a contemplé son visage, personne n’est fixé sur sa tournure, son apparence, son caractère, et cependant son action s’étend partout ; ses agents sont toujours là où ils doivent être.
– Extraordinaire ! conclut la mère, extraordinaire !
Il y eut un silence. Chacun songeait à ce qui venait d’être dit. De son côté, Jack pensait qu’il était plus avancé que les autres, lui qui avait entendu la voix troublante de la mystérieuse capitaine.
– Au fond, tout cela m’est indifférent, déclara enfin mistress Price. Vous m’êtes rendus, voilà le principal. Aujourd’hui, je veux fêter le retour de lord Lewis Biggun par un dîner succulent. Je serai tenue à mes fourneaux ; allez vous promener, amusez-vous. Quand on a accompli son devoir, il est bon de s’accorder du plaisir. Allez, allez, jeunesse, et revenez-moi avec un appétit sérieux.
John prit le bras de son frère.
– Obéissons à notre mère, Jack. Pour ma part, je ne serai pas fâché de parcourir le Caire en flâneur.
– Ah ! s’écria joyeusement mistress Price, je vois avec bonheur que vos querelles d’autrefois sont terminées.
– Absolument, affirma Price le blond. Jack a agi en digne Anglais. Alors j’ai fait un effort sur moi-même, et je me suis dit : Puisqu’il faut que ma… notre mère ait deux fils, je veux devenir le frère de Jack.
Un brouillard monta aux yeux de ce dernier.
John, qui lui refusait l’affection fraternelle, alors qu’il était Anglais de cœur, la lui offrait à présent que son âme s’était donnée à la France. En serrant la main tendue de son frère, il avait l’impression qu’il dérobait sa tendresse.
Cependant tous deux sortirent et s’engagèrent dans les rues du Caire. La foule bigarrée, les âniers, les magasins, les jardins prenaient pour eux des aspects nouveaux. Ils étaient dans la disposition d’esprit du voyageur qui rentre chez lui après une longue absence ; les êtres, les objets, les spectacles connus semblaient leur sourire, leur souhaiter la bienvenue.
La promenade leur parut délicieuse. John débitait, sans rien perdre de son flegme, des plaisanteries entremêlées de paroles affectueuses à l’adresse de son frère, et Jack répondait, oubliant ses préoccupations, gagné par la cordialité de son interlocuteur.
Et puis, à chaque coin de rue, les jeunes gens rencontraient des soldats, des sous-officiers de connaissance ; c’étaient alors des poignées de mains, des félicitations, car la belle conduite des fils Price n’était un secret pour aucun militaire.
Des officiers mêmes, déposant un moment leur masque hautain et gourmé, se détournaient de leur chemin pour aborder John et Jack. Ils pressaient à les broyer les doigts des héros du jour, daignaient les complimenter.
Et John « poitrinait », fier d’une telle réception ; il gourmandait Jack qui, au milieu de cette apothéose, restait pensif, comme indifférent au concert flatteur exécuté sur leur passage.
Bref, vers six heures, dans d’excellentes dispositions pour faire honneur au dîner de mistress Price, les frères reprirent le chemin de la Résidence. Pour abréger la route, ils eurent l’idée de traverser le jardin, où naguère ils avaient été placés en sentinelles, lors de la première visite du Sirdar au karrovarka.
Ils atteignirent la porte de bois à claire-voie ; mais là, une surprise désagréable attendait Jack.
Sur les piliers dans lesquels les gonds étaient scellés, s’étalaient des affiches ainsi conçues :
AVIS
« Il est absolument interdit de circuler dans l’allée centrale des jardins de la Résidence. Des factionnaires sont chargés de veiller à l’exécution de cette prescription, avec ordre de faire usage de leurs armes contre tout contrevenant. Cinq années de forteresse, ou la mort suivant le cas, puniraient les infractions au présent avis.
« Pour le Sirdar et par autorisation :
« Le chef d’État-major
« ADAMS. »
Après avoir lu, les deux frères se regardèrent.
– Qu’est-ce que cela signifie ? murmura Jack.
John exprima du geste sa parfaite ignorance, puis, entraînant Price le brun vers une petite porte basse, trouant la muraille quelques mètres plus loin :
– Bah ! l’affiche interdit seulement l’avenue centrale, nous passerons par les allées latérales ; cela ne nous retardera guère.
– Sans doute ! Sans doute !… Je ne serais pas fâché de comprendre pourtant.
Réflexion qui fit sourire John.
– À quoi bon ? La seule chose intéressante à cette heure est de dîner. J’ai l’estomac dans les talons. Venez, Jack, venez… la curiosité n’est qu’un appétit moral, cela peut attendre.
Ce disant, il poussait le battant de la petite porte et pénétrait dans le jardin.
Bon gré, mal gré, son frère le suivit dans un étroit sentier que les arbres recouvraient d’un dais de verdure.

À dix mètres d’eux, sur la droite, courait parallèlement l’avenue interdite que Jack apercevait parfois à travers une trouée.
Elle semblait déserte. Tout à coup, le jeune homme s’arrêta avec un léger cri de surprise. À peu près au centre de l’avenue, un rond-point avait été ménagé, où se croisaient à angle droit les allées principales du parc en miniature. Des massifs épais l’environnaient, mais, en traversant l’allée qui coupait perpendiculairement le sentier dans lequel il était engagé, Jack avait remarqué, au milieu du rond-point une masse que les derniers rayons du soleil teintaient de reflets rouges.
Il avait reconnu l’objet. C’était le karrovarka du docteur Gorgius, la prison de Nilia. Et de chaque côté se promenaient, d’un pas régulier, le fusil sur l’épaule, des factionnaires anglais.
L’avis affiché à l’entrée du jardin s’expliquait. Le Sirdar avait voulu défendre aux indiscrets l’approche du chariot-barque ; cette constatation venait de déchirer le cœur de Jack.
Nilia ne lui avait-elle pas dit :
– Nous nous verrons au Caire.
Comment tiendrait-elle sa promesse, comment Jack parviendrait-il jusqu’à elle, si l’appareil du docteur était surveillé, gardé, avec le même soin qu’une poudrière ?
– Qu’avez-vous ? questionna John, surpris de l’attitude de son frère.
Sa voix rappela Price le brun à lui-même. Avec effort, il répondit :
– Rien, rien. Je trouvais simplement bizarre d’obliger de pauvres soldats à monter la faction autour de cet énorme car ; il n’a véritablement pas l’air de vouloir s’envoler.
– Vous avez raison ; mais, je vous en conjure, ayez pitié de ma fringale et hâtons le pas.
Il fallait que John eût bien faim pour être de l’avis de son frère. Celui-ci n’insista pas et les jeunes gens reprirent leur marche.
Le jardin traversé, ils contournaient les bâtiments de la villa, quand Jack s’arrêta derechef.
Le long d’un pan de muraille, des fusils s’alignaient en faisceaux. Une vingtaine de soldats, commandés par un sous-officier, jouaient aux cartes, fumaient ou somnolaient. Tous étaient en tenue de service.
Quelques autres s’apercevaient dans une salle du rez-de-chaussée, dont la porte était ouverte.
– Tiens ! s’exclama Jack en dévisageant le sous-officier, le sergent Bates ! Bonsoir, sergent, bonsoir. Que diantre faites-vous là ?
– Vous le voyez… service à la Résidence.
– On a donc créé un poste, car avant mon départ…
– Il n’existait pas… vous dites vrai… Il est prévu de ce jour même, nous l’étrennons. Une corvée de plus pour la garnison.
– Venez-vous, Jack ? cria John que la faim talonnait décidément.
– Oui, oui, de suite.
Et, revenant au sergent Bates :
– À quoi sert votre présence ici ?
– Je ne sais pas, la consigne est de placer des factionnaires autour de la voiture du docteur Kaufmann, de n’en laisser approcher personne…, au besoin faire feu sur les curieux. Il doit y avoir un trésor dans ce wagon !
Jack inclina la tête sans répondre et rejoignit son frère. Oui, le karrovarka contenait un trésor : Nilia ! Et des baïonnettes anglaises se dressaient autour d’elle, la séparant de Price le brun.
Il était devenu sombre, et les premières paroles de mistress Price augmentèrent encore son souci.
Tendrement elle embrassa ses fils, puis d’un ton de triomphe :
– Mon Jack, on va te venger de ces niais de Français qui t’ont ligoté comme un malfaiteur.
– Me venger ? fit-il avec le pressentiment d’un nouveau malheur.
– Oui, le nommé Robert Lavarède vient d’être enfermé à la Citadelle.
Le jeune homme frissonna. Que de fois il avait contemplé les épaisses murailles de cette prison. De la place du sultan Hassan ou de la place de Mohammed-Ali, il lui était arrivé souvent de jeter ses regards sur la masse imposante des constructions, dont l’ensemble forme la citadelle, et il se disait alors :
– Ceux qui sont captifs là doivent renoncer à l’espoir d’en sortir.
La même phrase se représentait à son esprit. Robert à la citadelle, l’espérance de le sauver s’évanouissait. Et le remords de la trahison s’implantait dans le cerveau de Jack ainsi qu’un coin d’acier.
Mistress Price ne voyait rien. Toute à sa rancune maternelle, elle continuait :
– Ce coquin peut se préparer à mourir.
– À mourir ? répéta comme malgré lui le jeune homme.
– Certes. Le Sirdar a câblé, aujourd’hui même, à l’Amirauté pour demander des ordres.
Jack respira :
– On condamnera le Français à quelques mois d’emprisonnement.
– Ne croyez pas cela, reprit vivement la cuisinière. L’Amirauté conclura dans le sens indiqué par lord Biggun.
– Quelles sont donc les conclusions du lord ?
– Les seules sages, en la situation actuelle.
– Mais encore ?
– Vous ne devinez pas. C’est clair pourtant. Le chef des rebelles est entre nos mains. Le seul moyen de mettre fin à l’agitation, c’est…
– C’est ?
– La mort.
À cette réplique lugubre, Jack chancela. Pour un peu, il eût éclaté en sanglots, et il lui fallut un énergique effort de volonté pour conserver une apparence insouciante.
La mort de Robert le séparerait de Nilia, plus encore que la vigilance des soldats anglais ; car il n’en pouvait douter, l’inconnue s’intéressait aux Français ; ses vœux étaient pour leur succès. N’éprouverait-elle pas de l’horreur pour lui, pour lui qui aurait causé le trépas de Robert et la ruine de ses projets ?
Ces idées ne devaient plus le quitter. Pendant une quinzaine, la vie de Jack fut un enfer.
Autour de lui, tous les Anglais triomphaient, exultaient, à commencer par John et mistress Price.
Les officiers, sous-officiers, caporaux, soldats, négociants, marquaient au jeune homme une estime particulière. À tout instant on le félicitait précisément de l’exploit qui causait ses remords.
C’était intolérable.

Avec cela, ses nuits s’écoulaient sans que le sommeil vînt le visiter. Il se levait alors, s’habillait, gagnait sans bruit le jardin, et se glissant avec l’adresse d’un sauvage à travers les buissons, il se tapissait contre terre aux environs du rond-point servant de garage au karrovarka.
Toujours les factionnaires en défendaient l’approche, religieusement relevés par le poste établi en permanence dans la villa.
Oh ! ce poste, remplacé chaque matin aux sons du clairon ; comme Jack eût voulu l’envoyer à cent pieds sous terre. Ce poste, c’était l’ennemi. Sans lui, il eût pu pénétrer dans le chariot du docteur Gorgius. Un jeu d’enfant que pareille expédition pour qui connaissait le secret de la fermeture du panneau supérieur.
Il tremblait à la pensée de son entrée dans l’étrange véhicule. Nilia, Nilia dont le souvenir l’obsédait, Nilia vivait entre ses murailles de tôle. Il la verrait, lui parlerait, lui dirait ses angoisses, si deux soldats, baïonnette au canon, n’avaient constamment monté la garde autour de la prison de l’inconnue.
Puis des nouvelles circulaient dont il se sentait horripilé. La ligne des tourelles pivotantes s’étendait jusqu’à Philoe, jusqu’à Ouady-Alfa, jusqu’à Berber, jusqu’à Khartoum, s’allongeant incessamment comme un serpent d’acier.
Après cela, c’était l’Amirauté britannique qui, penchant tout d’abord pour la clémence à l’égard de Robert Lavarède, se laissait persuader peu à peu de la nécessité d’une répression éclatante par les rapports de lord Lewis Biggun.
On prévoyait déjà l’instant rapproché où l’ordre du jugement sommaire et de la fusillade parviendrait au Caire.
Les membres du tribunal militaire, le régiment qui fournirait le peloton d’exécution, étaient désignés, et l’on raillait le Français vaincu, et chaque plaisanterie éveillait un écho douloureux dans le cœur de Jack.
Le jeune homme était désolé et furieux. Il accusait tout le monde de sa tristesse, injuriant in petto Armand Lavarède, voire même les jolies Aurett et Lotia. À quoi les fugitifs employaient-ils leur liberté ? Avaient-ils donc abandonné leur ami à son malheureux sort ?
Or, dans l’après-midi du quinzième jour, Jack, sombre et las, était assis dans la cuisine. Mistress Price, profitant de ce que le Sirdar dînait en ville le soir, était allée se promener avec John. La brave dame voulait, elle aussi, se repaître de l’encens que l’Angleterre reconnaissante brûlait sous le nez de ses fils.
Prétextant une migraine, Jack avait évité la promenade. Devant les fourneaux allumés, il surveillait le percolateur, vaste récipient de cuivre, dans lequel infusait le thé destiné aux soldats de garde. Dans son exaltation patriotique, la cuisinière du généralissime avait, en effet, sollicité et obtenu la faveur de préparer la boisson aromatique des dignes garçons préposés à la surveillance du karrovarka.
Les militaires ne s’en plaignaient pas. Jamais l’ordinaire ne leur avait fourni pareil thé. Des feuilles de choix, récoltées en Chine par des jeunes filles aux mains gantées, des feuilles destinées à la consommation particulière du Fils du Ciel, et dont, par courtoisie spéciale, l’ambassadeur britannique à Pékin avait pu détourner une cargaison, que fraternellement il s’était empressé de partager avec les gouverneurs des grandes colonies, l’Égypte étant comprise dans le nombre.
Mais Jack ne manifestait pas pour ce thé le respect auquel il avait droit. À cheval sur une chaise, le dos tourné au percolateur, il cherchait, comme les jours précédents, le moyen introuvable de joindre Nilia.
C’était en elle qu’il mettait son ultime espoir. L’aborder, être conseillé par elle, lui apparaissait comme le terme de ses perplexités. Il lui eût été impossible de dire pourquoi il pensait de la sorte, mais ce qui est certain, c’est qu’il se cramponnait à son idée, avec l’obstination d’un naufragé accroché à une épave.
Une toux sonore le fit sursauter.
– Hum ! Hum !
Il leva les yeux. Sur le seuil se tenait un homme replet, à la face joyeuse, aux yeux noirs, aux lèvres sensuelles. Le nouveau venu portait l’uniforme des médecins militaires.
– Sir Bigfat ! s’écria le jeune homme en le reconnaissant.
– Lui-même, répliqua le personnage. Et avec cela, votre santé est bonne ?
– Excellente, Monsieur le major, mais vous-même… ?
– Ma santé ne chancelle pas, mon jeune ami. Les fonctions s’accomplissent régulièrement, et je ne me reconnais aucun symptôme morbide. Je pense que mon individu est un champ impropre à la culture des microbes.
Sir Bigfat rit bruyamment de sa plaisanterie, et, clignant de la paupière avec une évidente intention de finesse :
– Écoutez ici, mon digne brave garçon. Ne pourrais-je présenter mes hommages à votre respectable mère ?
Jack secoua la tête.
– Quoi, ne serait-elle pas visible ?
– Hélas non, Monsieur le major.
– Souffrante… alitée peut-être… ?
– Non, non, rassurez-vous. Elle est simplement en promenade avec mon frère John.
Durant cinq secondes, le visage du médecin prit une expression grave. Enfin Bigfat gonfla ses joues et laissa tomber ces mots :
– Pouh ! Peuh ! Très fâcheux, très fâcheux en vérité.
Mais, le sourire revenant sur ses lèvres :
– Bah ! je causerai avec vous. Je veux que vous deveniez mon allié.
Et traînant une chaise auprès de celle de Jack, il s’assit, souffla avant de reprendre d’une voix insouciante :
– Mon cher aimable garçon, sans doute votre honorable mère vous a entretenu de la proposition convenable et pratique que je lui ai faite.
Malgré ses soucis, le jeune homme ne put s’empêcher de sourire.
– Oui. Monsieur le major, oui, ma mère m’a appris que pendant mon absence, vous aviez bien voulu lui parler mariage.
– C’est cela même, s’exclama le gros homme en se frottant les mains, c’est cela même en vérité. Vous êtes intelligent, vous allez comprendre que ma requête tient compte des intérêts de tous et présente de nombreux avantages sur la situation actuelle.
Le major fouilla dans sa poche, en sortit une tabatière, l’ouvrit, y puisa entre le pouce et l’index une pincée de tabac dont il se barbouilla le nez, et continua lentement :
– Si je vous disais que mes idées conjugales émanent d’une tendresse passionnée, vous ne me croiriez pas. Ce motif sentimental suppose une folle tête de jeune homme ; grâce aux années, je suis rassis, et je n’obéis plus à des raisons aussi illusoires.
Jack inclina la tête pour cacher ses traits, sur lesquels une hilarité montante faisait courir de petits frissons.
– Non, poursuivit imperturbablement le médecin militaire, je n’ai pour mistress Price aucun sentiment tendre. Elle est trop raisonnable d’ailleurs pour penser le contraire, car sa face de pleine lune et sa conformation générale qui, tout respect gardé, rappelle celle d’une barrique, ne sont point des avantages extérieurs auxquels le cœur se puisse laisser prendre.
Et Jack serrant les lèvres pour ne pas éclater, sir Bigfat parut prendre son silence pour un acquiescement à ses affirmations.
– Donc, dit-il d’un air satisfait de lui-même, donc je ne songe point à épouser mistress Price à cause de ses attraits périssables, mais uniquement en raison de l’estime que je professe pour ses talents culinaires.
– Ah ! ah ! réussit à prononcer son interlocuteur.
– Tout simplement, mon excellent véritable ami ; je suis amateur de bonne chère ; j’ai, comme nous disons dans la Faculté, le bacille-virgule des gourmets. D’autre part, mistress Price, sans cesse à ses fourneaux, me paraît atteinte de ce mal spécial, désigné sous le nom d’anémie des cuisiniers. C’est, vous ne l’ignorez pas, une raréfaction des globules rouges causée par l’ingestion dans l’économie des vapeurs de charbon. C’est une intoxication. Vous entrevoyez l’association. Devenue mon épouse, mistress Price confectionnera d’excellents mets pour mon microbe gourmand, et, de mon côté, je rétablirai sa santé par un régime approprié.
D’un ton pathétique, le major termina :
– Il me semble que l’affaire est bien présentée ainsi, et je crois que votre affection filiale vous incitera à faire ressortir aux yeux de votre respectable mère tout ce que la combinaison aurait d’avantageux.
Jack avait complètement oublié ses tracas. La bizarrerie de cette demande en mariage expliquait assez son défaut de mémoire. Garder son sérieux devant l’étrange soupirant était véritablement chose difficile, exigeant une tension de tous les nerfs.
Pour sir Bigfat, incapable de comprendre le ridicule de sa démarche, il demanda après un silence :
– Eh bien ! Voyons, sans inutile flatterie, n’êtes-vous pas gagné à ma cause ?
Se pinçant avec rage pour rester grave, Jack hocha la tête :
– Qui ne serait gagné ?
Cette réponse fit faire un bond de joie à son interlocuteur.
– Alors, mon admirable garçon, vous parlerez en ma faveur ?…
– N’en doutez pas, Monsieur le major.
– Touchez là, noble ami, s’exclama Bigfat en secouant la main du jeune homme. Je n’oublierai point cela, et je souhaite de vous voir attraper le choléra ou la peste pour vous soigner avec le plus entier dévouement.
– Je vous suis obligé, bredouilla Jack, égayé encore par ce souhait peu ordinaire.
– Cela n’en vaut vraiment pas la peine, riposta sérieusement le médecin sans discerner l’ironie. Passons à autre chose. Nous sommes amis et je veux user de vous comme d’un ami.
Puis, saisissant un paquet soigneusement ficelé qu’il avait posé, lors de son arrivée, sur la table de la cuisine :
– Je vous prie, mon cher digne garçon, de remettre ceci à votre aimable femme de mère lorsqu’elle reviendra ; c’est un présent de prétendu.
Jack le regarda avec une nuance d’étonnement.
– Oh ! poursuivit Bigfat, un fiancé envoie généralement des fleurs à celle qui occupe ses pensées. Les fleurs, présent ridicule, cela se fane si vite. Le bouquet est bon tout au plus pour les gens de votre âge, chez lesquels la sentimentalité impose silence à la raison. Moi je suis pour les cadeaux utiles.
Il dépliait le papier dont le paquet était enveloppé. Gravement, il en tira plusieurs flacons.
– Voyez-vous, expliqua-t-il, le secret du bonheur est médical. On est heureux lorsque la fâcheuse constipation ne sévit pas sur votre individu. Ces fioles contiennent de quoi la mettre en déroute. Voici de la magnésie, de l’eau-de-vie allemande, du calomel, de la rhubarbe, et cætera. Avec cela, on a le teint frais et le cœur joyeux. Dites bien à votre respectable ascendante que c’est le médecin et le soupirant qui lui offrent ceci, comme preuve de la sollicitude que leur inspire sa précieuse santé.
Et comme son interlocuteur se mordait les lèvres, pour ne pas succomber à l’hilarité que provoquait en lui ce cocasse présent de fiançailles, le major ajouta :
– Le tact le plus parfait a présidé à mon choix ; ces fioles sont objets sans valeur, tels qu’une honnête femme en peut accepter sans craindre de se compromettre.
Sur ce, Bigfat se leva et conclut d’un petit air ému des plus réjouissant :
– Elle est remplie de raison, elle usera de ces excellentes choses avec modération, et mes flacons la forceront à penser à moi,… pendant longtemps, car il y a là de quoi bouleverser le tube digestif d’une demi-compagnie d’infanterie.
Il serra à la briser la main de Jack. Après quoi, il sortit majestueusement, en citoyen qui vient de mener à bien une tâche difficile.
Il ne se doutait certes pas de l’effet inattendu que ses dernières paroles avaient produit sur l’esprit de Price le brun.
– Bouleverser le tube digestif d’une demi-compagnie d’infanterie !
Ces mots martelaient le crâne du jeune homme. Brusquement, il s’était rappelé les épidémies de dysenterie, qui parfois s’abattent, en Afrique, sur les troupes coloniales. Alors une armée serait à la merci d’un adversaire acclimaté.
Plus de discipline, plus de surveillance. Les soldats affaiblis, abrutis par la maladie, deviennent impropres à tout service.
Il se souvint que, deux ans auparavant, un fanatique avait pu faire sauter une poudrière, dont les factionnaires s’étaient écartés sous l’empire d’une nécessité plus forte que la discipline, plus puissante que les vertus militaires.
Pourquoi ne créerait-il pas une épidémie factice, à la faveur de laquelle il pénétrerait dans le karrovarka du docteur Gorgius Kaufmann ?
Ses yeux se fixèrent sur le percolateur où bouillait le thé, qui serait distribué le soir aux soldats du poste affecté à la garde du chariot.
Il s’en approcha, se recula comme pris d’une hésitation, revint à la table où s’alignaient les flacons apportés par Bigfat.
Les étiquettes imprimées dansaient devant ses regards. Pas un des purgatifs usuels ne manquait à l’appel.
– Calomel, murmura Jack, magnésie, rhubarbe, eau-de-vie allemande… Non, je ne puis pas faire une aussi mauvaise farce à ces pauvres soldats.
Mais aussitôt, il songea à Nilia :
– Si pourtant cela me permettait de la voir. Qui sait ce qui peut sortir de notre entrevue. Le salut de Robert Lavarède peut-être. La vie d’un homme en échange de quelques coliques pour des tiers.
 Tenant
l’un des flacons, sur lequel se lisait l’indication : Magnésie, il
retourna près du percolateur.
Tenant
l’un des flacons, sur lequel se lisait l’indication : Magnésie, il
retourna près du percolateur.
– Bah ! la magnésie est une purgation douce.
Décidé par cet argument, Jack souleva le couvercle de cuivre du récipient, et, d’un geste brusque, versa la fiole dans le liquide bouillonnant.
Mais une réflexion le fit pâlir.
– C’est bien doux, la magnésie… et puis il y en avait bien peu pour une si grande théière. J’ai une occasion unique de voir miss Nilia… si je la laisse échapper, elle ne se représentera plus… Sir Robert sera fusillé… Ma foi, tant pis !
Tout en monologuant, il avait couru à la table et avait ramassé tous les flacons. La rhubarbe rejoignit la magnésie.
Toujours poursuivi par la peur que les Anglais résistassent à sa mixture, il envoya le contenu de la fiole de calomel se mélanger au reste.
Puis une griserie le prit, et tous les purgatifs passèrent de leurs récipients dans le percolateur.
Il finissait par rire de son atroce cuisine.
– Je pense, murmura-t-il, que le thé sera rafraîchissant ; à cette heure, c’est un véritable syndicat de purgations, un meeting général, où toutes sont représentées.
Brusquement il songea qu’à sa prochaine visite, Bigfat ne manquerait pas de parler de son cadeau.
– Diable ! Je ne puis remettre à ma mère les bouteilles vides…
À tout prix il fallait éviter que l’on soupçonnât son action. Deux minutes de réflexion et un cri de joie s’échappa de ses lèvres :
– C’est admirable, fit-il, je cache mon larcin ; je transforme la pharmacie du docteur en denrées inoffensives.
Bondissant vers les tiroirs qui contenaient les divers ingrédients indispensables à une cuisinière qui se respecte, il remplaça magnésie et calomel par de la farine. La rhubarbe devint de la cassonade ; à l’eau-de-vie allemande il substitua du kirsch, et, les flacons rebouchés avec soin, il les empaqueta, ficela le colis, puis se rejeta sur sa chaise.
Il était temps. Mistress Price et John rentrèrent presque aussitôt.
D’une voix tremblante, car il lui restait de son opération culinaire une certaine émotion, Jack raconta son entrevue avec le médecin militaire.
John, décidément devenu gai, rit aux larmes en déployant le présent du prétendu, et, s’appuyant sur ce que sa mère n’avait point l’intention de se remarier, que par conséquent elle n’avait pas à se purger pour prouver à Bigfat une affection absente, il vida consciencieusement les flacons dans la caisse aux ordures ménagères.
Du coup, sa gaieté gagna Jack. Son frère venait de faire disparaître ses dernières inquiétudes.
On dîna de bon appétit.
Vers huit heures, trois soldats, commandés de corvée, vinrent « toucher le thé » pour le poste, et lorsqu’ils partirent, emportant l’horrible liquide confectionné par Price le brun, celui-ci prétextant un retour offensif de la migraine, embrassa sa mère, serra la main de John et regagna sa chambre, située tout à l’extrémité du bâtiment des cuisines.
Pour l’atteindre, il fallait passer par l’extérieur. Un jardinet, faisant suite au parc de la Résidence, étendait ses parterres et ses massifs jusqu’auprès des murailles, laissant une allée large de deux mètres.
Une fois là, Jack regarda autour de lui. Tout était silencieux. Aucune brise ne troublait l’atmosphère. Sur les choses planait l’apaisement muet des nuits africaines.
Mais Jack, à cette heure, n’observait pas en poète. Ce qu’il souhaitait ardemment, c’était de se rendre compte de l’effet produit par son thé baroque sur le poste de garde.
Pour cela, il était nécessaire de se glisser à travers les buissons jusqu’à l’endroit d’où l’on découvrait la partie de la villa mise à la disposition des soldats.
Un nouveau regard circulaire convainquit Price le brun que personne n’était à proximité.
D’un bond, il franchit une corbeille fleurie et se jeta dans l’ombre formée par une touffe de hauts dahlias.
Puis, évitant avec soin les surfaces éclairées par la lune, il rampa, tel un saurien géant, à travers les méandres du petit jardin anglais.
Bientôt il arriva en face du poste. Un rempart de verdure l’en séparait seul, et, écartant les branches, il coula un œil curieux par cette fenêtre improvisée.
La porte était grande ouverte. Un apercevait la salle éclairée au moyen de lampes fumeuses.
Les soldats, assis sur des bancs autour d’une table rectangulaire, buvaient le thé que leurs camarades venaient de rapporter de la cuisine.
Ils devisaient avec de grands éclats de voix, riant lourdement de plaisanteries épaisses.
– Aoh ! clama l’un, je propose un hurrah pour le thé du général, voilà un thé qui ne ressemble pas à celui de la caserne.
– Adopté ! s’écrièrent les autres.
Et tous ensemble, avec l’accent le plus guttural qui put sortir de leurs gosiers britanniques, hurlèrent :
– Hurrah ! Hurrah ! pour le thé du Sirdar !
Décidément les purgatifs, qui bouleversent si profondément les humains, semblaient n’avoir altéré en rien les qualités de la boisson favorite des Anglo-Saxons.
Cette première constatation satisfit Jack.
Son opération culinaire ne serait pas découverte. Il ne restait plus à élucider qu’une question brûlante :
– Le cadeau du médecin major, si dextrement détourné de sa destination primitive, aurait-il l’effet espéré par le fils de mistress Price ?
Anxieux, le cœur palpitant, Jack attendit.
Bientôt un mouvement se produisit.
Le sergent, chef du poste, s’était levé et, appelant deux soldats :
– Bear et Wolf, prenez vos armes, c’est votre tour de faction.
Les interpellés s’équipèrent aussitôt. Précédés par le sous-officier, ils sortirent pour se rendre auprès du karrovarka. Ils contournèrent l’angle de la villa et disparurent. Cinq minutes se passèrent, puis le sergent revint, ramenant les sentinelles que leurs camarades avaient remplacées.
Les nouveaux venus déposèrent bien vite leur harnachement et prirent place à table. Ils se versèrent du thé, en avalèrent gloutonnement deux ou trois verres, comme s’ils eussent voulu rattraper le temps perdu.
– Très étonnant ! fit l’un. Ce thé a un goût prodigieusement original.
– Original, mais excellent, répondit l’autre.
– N’est-ce pas ? dirent en chœur les autres militaires.
Par malheur, Jack n’avait aucun amour-propre de cuisinier ; sans cela il se fût délecté de cet éloge unanime accordé à sa mixture. Soudain il se pencha en avant, très intéressé cette fois. Le chef du poste s’était avancé sur le seuil de la porte. Son visage exprimait une vague inquiétude ; des contractions légères passaient sur sa face.
Puis ses mains se posèrent instinctivement sur son épigastre, elles descendirent, descendirent, étreignant sa ceinture, puis son abdomen. Enfin le brave sous-officier lança un retentissant :
– By God !
Il se retourna vers ses hommes, ajouta d’une voix pleine d’angoisse :
– Je reviens.
Et, à toutes jambes, il se précipita dans la cour, s’engouffra dans l’ombre qui en remplissait le fond, disparut comme s’il s’était évanoui en fumée.

Le succès de la ruse de Jack s’était fait attendre. Il allait devenir foudroyant.
Un soldat suivit presque aussitôt son supérieur, puis un deuxième, un troisième…
Price le brun jugea inutile de rester plus longtemps à son poste d’observation. Le thé, allié fidèle, donnait aux Anglais assez d’occupation ; les factionnaires placés près du karrovarka éprouvaient sûrement les mêmes émotions que leurs camarades ; l’heure était venue de tenter l’assaut de la prison de Nilia.
Quittant le jardinet, le jeune homme s’enfonça dans le parc.
Bientôt il atteignit le rond-point, dont le centre était occupé par le chariot du docteur Gorgius.
Un factionnaire était absent, et comme Jack considérait l’autre, cet autre qui s’interposait encore entre lui et le but de son expédition, il le vit poser son fusil à terre et s’élancer dans les massifs, avec des gestes éplorés qu’on eût dit être une imitation badine des mouvements exécutés un instant auparavant par le sergent.
Plus de sentinelles. La diversion espérée avait pleinement réussi ; il s’agissait d’en profiter.
Se courbant vers la terre, s’efforçant d’être masqué par la masse du karrovarka, Price le brun parvint sans encombre à se faufiler sous la caisse du véhicule.
C’était là, il s’en souvenait bien, entre les deux roues motrices, que se trouvait le boulon mobile déterminant de l’extérieur l’ouverture de la trappe d’entrée.
D’une main tremblante, il tâtonna un instant… puis il étouffa avec peine une exclamation de triomphe. Un déclic s’était fait entendre. Le chemin était libre, il n’y avait plus qu’à escalader le monstre de tôle.
Les factionnaires restaient invisibles. Le thé, admirable auxiliaire, luttait pour le fils de mistress Price.
Celui-ci sortit de sa cachette. Devant lui, l’échelle articulée balayait le sol de son extrémité inférieure. Elle s’était déroulée en même temps que le panneau jouait.
Légèrement Jack grimpa, prit pied sur la plate-forme du car. Une ouverture rectangulaire dessinait ses lignes géométriques. Jack se pencha pour examiner l’intérieur. Tout était noir.
– Tant pis, dit-il, en avant.
Ramenant l’échelle, il la fit glisser dans le karrovarka, et, s’accrochant aux montants, il descendit.
Vivement il courut à la paroi de droite, passa sa main sur l’alignement des boulons, trouva celui qui, de l’intérieur, actionnait la trappe.
Celle-ci se referma et un frou-frou métallique avertit le jeune homme que l’échelle s’enroulait automatiquement.
Un moment, il demeura là, haletant, en proie à une émotion indicible. Il était dans la place. Il allait voir Nilia.
Voir ! Le mot prononcé tout bas le fit sourire. Il était environné par une obscurité opaque.
Dans une cave, dans une pièce quelconque, on a beau fermer les volets, condamner les ouvertures, il pénètre toujours un peu de lumière. Les ténèbres ne sont que relatives. Mais la carapace métallique du karrovarka réalisait la clôture hermétique, produisait la nuit absolue.
Price le brun se ressaisit bien vite.
Il avait gravé dans sa mémoire les moindres détails du plan du chariot-barque. Il savait qu’au milieu de la cloison perpendiculaire aux flancs du wagon devait se rencontrer une porte, donnant accès dans le second compartiment.
Les mains tendues en avant pour ne pas se heurter contre un obstacle, il atteignit cette cloison. Ses doigts interrogèrent la surface polie et rencontrèrent bientôt une rainure dont la longueur lui indiqua la nature.
La porte derrière laquelle Nilia apparaîtrait était devant lui.
Ici encore un boulon mobile déterminait l’ouverture.
Un instant Jack le chercha vainement, puis son cœur cessa soudain de battre. Sous une poussée légère, un boulon s’était enfoncé dans la tôle ; un claquement imperceptible avait retenti dans le silence, et, sur la paroi noire se découpait une ligne lumineuse affectant la forme d’un L renversé.
La porte était entr’ouverte. La minute attendue depuis de longues semaines allait sonner.

CHAPITRE X
UN SPHINX
Le sentiment de Jack à ce moment décisif n’eut rien d’héroïque. Comme le patient parvenu sur le seuil du dentiste qui doit lui extirper la dent dont il souffre, Price le brun eut envie de se sauver.
Il lui fallut un effort terrible pour faire tourner le battant sur ses gonds.
Et dans l’encadrement il resta stupéfait, éperdu.
Le second compartiment du karrovarka, éclairé par une lampe électrique appliquée à la muraille métallique, affectait la forme d’un rectangle peu allongé. À hauteur d’homme, des hublots circulaires, obturés au dehors par des volets, s’alignaient ainsi que de gros yeux sans regard.
Sur le plancher s’allongeaient, de chaque côté, deux grands coffres formant banquettes, mais ni hublots, ni coffres n’arrêtèrent l’attention du jeune homme.
Près d’une planchette mobile fixée à la paroi, une femme était assise.
Elle tournait le dos au visiteur. Elle n’avait rien entendu, absorbée dans la lecture d’un livre ouvert devant elle.
Retenant son haleine, Jack la considéra longuement.
Elle était jeune indubitablement. Son cou blanc, ses cheveux châtains, dans lesquels la lumière piquait des tons d’or, la courbe gracieuse de ses épaules le démontraient clairement. Mais quel étrange et délicieux costume emprisonnait son corps !
C’était une longue tunique blanche tombant autour d’elle en plis lourds, rattachée sur les épaules par de larges agrafes d’or. Les bras de l’inconnue, délicieusement modelés comme ceux de la Diane de Gabies, étaient nus, et, posée sur le livre, une de ses mains, fine, aux doigts fuselés, apparaissait à Jack.
Qu’allait-il faire ? Qu’allait-il dire ? Il n’en savait certes rien. Devant le tableau offert soudainement à ses yeux, ses pensées s’étaient confondues dans le plus inextricable chaos.
Nilia était là, tout près de lui.
Il pouvait lui parler, lui dire les douces choses qu’il pensait depuis le jour où son existence lui avait été révélée.
Mais il était entré comme un voleur. Sa voix ne l’effraierait-elle pas ?
S’il se taisait, ne serait-il pas découvert quand même. Elle se retournerait sûrement, le verrait,… et alors comment se ferait-il pardonner ?
Trop loyal pour demeurer longtemps dans cette position fausse, Jack se décida à brusquer le dénouement. À mi-voix il murmura :
– Mademoiselle Nilia !
La jeune fille ne bougea pas. Plus fort, il redit :
– Mademoiselle Nilia !
Cette fois, l’inconnue tressaillit. Elle releva vivement la tête, regarda du côté de Jack, et, avec un cri d’effroi se dressa sur ses pieds.
Jack étendit les mains dans une attitude suppliante. Pour un peu il se fût agenouillé.
C’est que, jamais dans ses rêves, il n’avait soupçonné Nilia aussi belle.
Il est impossible de rendre le charme de ce front pur, que la chevelure dotait d’un diadème plus riche qu’une couronne royale, de ces yeux verts, profonds comme l’océan dont ils avaient la teinte, de ce nez délicat, de ces lèvres entr’ouvertes, sous l’incarnat desquelles brillaient les dents nacrées. Centuplant la poésie de ce visage adorable, une teinte de mélancolie le recouvrait, tel un léger brouillard à la surface d’un lac aux eaux limpides.
Non, non, Price le brun n’avait point rêvé cela. Il était venu, désireux d’adresser la parole à une mortelle, et c’était une divinité qui lui apparaissait ; une divinité que l’on eût dit éclose dans le cerveau des inimitables statuaires de la Grèce antique !
Il voulut s’expliquer, mais la voix s’étrangla dans sa gorge, et il resta comme pétrifié, les bras tendus en avant dans la pose humble et pieuse des fidèles d’Osiris, dont les bas-reliefs des temples égyptiens ont conservé le souvenir jusqu’à nous.
Nilia s’était rassurée. Le geste, le visage franc du visiteur lui avaient fait comprendre que celui-ci n’était pas un ennemi.
Elle fixait sur lui un regard étonné, interrogateur, et comme il continuait à garder le silence, elle demanda :
– Qui êtes-vous ?
Il frissonna, secoué jusqu’au fond de l’être par l’organe de la jeune fille. La voix, il reconnaissait la voix qui, du fond du karrovarka, lui avait ordonné naguère de se ranger aux côtés des Français.
Doucement, il répondit :
– Je suis. Jack, Jack Price. J’ai étudié les plans de ce wagon, et je suis venu parce que je souffre, parce que mon espoir est en vous.
Le visage de son interlocutrice exprima un étonnement croissant.
– Jack Price, répéta-t-elle lentement, paraissant cherchez dans sa mémoire. Jack Price… Je ne me souviens pas.
À cette déclaration, il sursauta, douloureusement impressionné.
– Vous ne vous souvenez pas ? gémit-il.
Il y avait tant de souffrance dans son accent, que Nilia reprit avec bienveillance :
– Cela paraît vous surprendre. Excusez une prisonnière. Depuis si longtemps je suis captive, que je me figure n’avoir jamais été libre. L’esclave n’a pas à se rappeler le passé, car elle ne peut avoir que des souvenirs tristes. Pourtant je sens que vous n’êtes pas animé de mauvaises intentions à mon égard ; aidez ma mémoire… Dites… où vous ai-je vu ?
La situation devenait embarrassante. Que signifiait cela ? Jack n’avait aucun doute. Il était devant celle qui lui avait parlé autrefois, et celle-ci ne se souvenait pas. Tout préoccupé, il répliqua cependant :
– Nous ne nous sommes jamais vus.
Elle ouvrit de grands yeux stupéfaits.
– Mais alors, comment puis-je savoir votre nom ?
– Comme je sais le vôtre : Nilia. N’est-ce point ainsi que vous vous appelez ?
– Si, si, fit-elle, c’est ainsi que l’on me désigne.
Et pensive :
– Est-ce mon nom véritable ? je l’ignore… mais toujours on m’a nommée ainsi…
– Même chez les bohémiens ? s’écria Jack, se souvenant à propos de ce qu’il avait entendu à bord du Look.
Elle joignit les mains avec stupeur.
– Vous connaissez aussi cela ?
– Mais oui, reprit-il, recouvrant toute sa lucidité. Les bohémiens qui, sans doute, vous avaient volée alors que vous étiez enfant, car vous n’êtes pas de cette race errante ?
– Je ne sais, soupira-t-elle, je ne sais… mais je pense que vous ne vous trompez pas.
– Et ces misérables vous ont vendue comme esclave à un homme plus misérable qu’eux, au docteur Gorgius Kaufmann.
Elle inclina la tête, mais, la relevant vivement, le regard questionneur :
– Qui vous a appris ces choses ? Qui ?… Qui ?…
– Vous-même.
– Moi ?
Son étonnement était tellement sincère que Jack en fut un instant démonté. Il se domina pourtant, et vite, en phrases hachées, il raconta leurs conversations ; elle, invisible, dans ce karrovarka, où il avait voulu entrer ; lui, au dehors, les yeux fixés sur le hublot noir d’où s’échappait la musique de sa voix.
Il dit l’incident de la mouche, le don des plans du chariot-barque, le rendez-vous au Caire.
Pour finir, il narra son imagination du jour même. Le poste de garde, les factionnaires aux prises avec le thé original de sa composition.
Nilia écoutait. Son adorable visage trahissait la stupéfaction. Quand le jeune homme se tut, elle murmura d’un ton vague, douloureux :
– Je ne me souviens de rien.
– De rien ? fit-il tristement.
– De rien, répéta-t-elle.
Ses sourcils se froncèrent, un pli de réflexion barra son front pur.
– Une part de ma vie m’échappe donc, reprit-elle comme se parlant à elle-même ? Celui-ci dit vrai, j’en suis certaine. J’ai prononcé les paroles qu’il vient de rappeler… et je n’en ai conservé aucun souvenir. Ainsi que mon corps, ma pensée est prisonnière ; un voile sombre pèse sur mon esprit. Je ne vois pas. Je ne vois pas.

Son accent était découragé. C’était une plainte déchirante qui coulait de ses lèvres. Jack lui prit les mains. Elle ne fit pas un effort pour les dégager.
– Prisonnière, vous l’êtes encore, Mademoiselle Nilia, s’écria-t-il fougueusement ; mais si vous voulez avoir confiance en moi, vous serez bientôt libre.
Un rayon joyeux scintilla dans les yeux de la charmante créature.
– Libre !
– Oui, nous allons sortir de ce wagon maudit… je vous conduirai en ville, dans une maison amie : je préparerai tout pour que vous puissiez gagner l’Europe… Je vous accompagnerai pour vous défendre, pour…
Il allait avouer le secret de son cœur.
Elle l’interrompit :
– Non, gémit-elle avec épouvante, cela ne saurait être.
– Pourquoi ?
– Il nous rejoindrait, il me reprendrait… et vous, vous… ! Il vous condamnerait aux plus atroces supplices. Cet homme est le génie du mal. Ce qu’il veut se réalise. Comme dans un livre, il lit dans la pensée de ceux qui l’approchent. Non, non… le premier qui m’ait témoigné quelque sympathie pour mon malheur ne doit pas périr, victime de sa bonté.
Jack ouvrait la bouche pour insister, quand un déclic métallique parvint à ses oreilles.
Nilia aussi avait entendu. Une pâleur livide rouvrit ses traits ; ses yeux exprimèrent la terreur poussée à son paroxysme. Elle balbutia :
– C’est lui qui vient. Il va vous trouver ici… Perdu ! vous êtes perdu !
– Bon, s’il est seul… nous verrons bien.
– Oh ! vous ne le connaissez pas. Nulle force ne résiste à sa puissance diabolique. Devant lui, vous vous courberiez comme un enfant. Non… ne cherchez pas la lutte… cachez-vous… cachez-vous.
La chose était plus facile à dire qu’à exécuter.
Dans le compartiment aucun meuble, en dehors des coffres-banquettes.
Et Nilia redisait éperdue :
– Cachez-vous ! cachez-vous ! Il monte… le voici sur la plate-forme… il ramène l’échelle.
Sa figure semblait métamorphosée. L’œil était devenu fixe, le masque, immobile, comme pétrifié.
Effrayé par sa surexcitation, Jack souleva le couvercle de l’un des coffres. Longue de deux mètres, large de quatre-vingts centimètres, la caisse pouvait contenir sans peine un homme.
– Calmez-vous, Mademoiselle Nilia, fit-il en se glissant dans cette cachette improvisée, je disparais.
Déjà il s’étendait au fond, soutenant le couvercle de la main. Elle se tourna vers lui, et avec l’accent de la prière :
– Ordonnez que je mente, que je mente, que je mente !
À cette demande, Jack se souleva. Déjà Nilia lui avait adressé la même requête… elle ne se le rappelait pas, et maintenant elle recommençait. Quel vertige bouleversait donc sa pensée ?
Mais il n’eut pas le loisir de formuler une question.
D’un bond, la captive fut sur lui, le repoussa au fond du coffre et rabattit le couvercle en chuchotant d’une voix entrecoupée :
– Il descend… il va entrer… disparaissez.
Il était temps en effet.
La porte de communication avec le premier compartiment s’ouvrit et Gorgius Kaufmann entra.
Sa redingote était un peu plus sale qu’autrefois, ses souliers plus éculés. Sa face simiesque, parcheminée, que les lunettes bleues semblaient percer de deux trous d’ombre, était grave.
Il vint à Nilia et la saisit par les poignets.
* *
*
Blotti dans son coffre, Jack songeait. Les détails de son entrevue avec la prisonnière se représentaient à son esprit.
Quel mystère nouveau venait-il de rencontrer ?
Nilia déclarait croire au récit qu’il lui avait fait, et elle affirmait en même temps n’avoir conservé aucun souvenir du passé.
Puis à l’instant même, elle lui avait crié comme autrefois :
– Ordonnez que je mente.
Cela était étrange en vérité.
Toutefois, obéissant comme toujours à l’attraction que la jeune fille exerçait sur lui, attraction décuplée depuis qu’il l’avait vue, Price le brun murmura :
– Il faut mentir puisque vous le voulez. Mentez, Nilia, mentez.
Au même moment, la voix de Gorgius parvint jusqu’à lui.
– Tu vois ? disait l’Allemand.
Et l’organe de Nilia s’éleva à son tour.
– Oui, je vois.
– Où est Robert Lavarède ? reprit Kaufmann.
– À la citadelle.
– Je le sais. Mais dans quel cachot l’a-t-on enfermé ?
Il sembla à Jack que la jeune fille enflait sa voix pour répliquer :
– Cachot 131, celui que l’on désigne sous le nom de « salon des squelettes ».
– Que fait le prisonnier ?
– Il dort.
Dans sa caisse, Jack se dit tout bas :
– Cachot 131… Salon des squelettes… Voilà un renseignement précieux.
Puis brusquement :
– Je comprends tout. C’est Nilia qui doit être chargée de la surveillance des appareils d’électricité sans fils, qui mettent le karrovarka en communication avec les agents du docteur. Sans cela, comment pourrait-elle répondre aux questions que lui adresse ce misérable ?
Et, satisfait de cette explication qui, ainsi qu’il le reconnut plus tard, n’était pas la véritable, il écouta de nouveau. Nilia parlait :
– J’ai dit que le captif était dans la citadelle, cela n’est pas. Son cachot souterrain s’étend en dehors des murailles, sous le jardin d’un rentier avare, mister Bobinow. Cet homme, dont la grande préoccupation est d’économiser, a acheté sa maison, dont personne ne voulait, car il est triste de vivre dans un endroit où la vue est bornée par les murs sombres d’une prison.
– Diable ! grommela Gorgius.
– Oh ! Mister Robert ne s’échappera pas. Deux mètres de terre sont accumulés sur la voûte de sa geôle.
– Bobinow… jardin, répéta Jack dans son coffre.
– Et, poursuivit la jeune fille, on se doute si peu de cette particularité, que, juste au-dessus du cachot, s’élève un piédestal de briques, supportant un vase de fonte. Les anciens propriétaires remplissaient celui-ci de fleurs ; mais mister Bobinow a trouvé cette dépense inutile.
– Vase de fonte, fit encore Price le brun.
Il enrageait de ne pouvoir apercevoir les causeurs ; mais il lui fallait en prendre son parti. Il était déjà bien joli d’être renseigné en quelques minutes, mieux qu’il ne l’avait été depuis un mois.
Et sa curiosité satisfaite aidant, il en arriva à sourire de l’aventure. Après tout, le coffre était spacieux ; le couvercle ne joignant pas hermétiquement, l’air respirable s’y renouvelait facilement.
– Assez, fit l’Allemand d’un ton rude, coupant ainsi la parole à son interlocutrice. Je ne te demande pas de si longs discours. Borne-toi à répondre à mes questions.
Tandis que le cœur de son invisible auditeur se serrait en constatant la brutalité avec laquelle la jeune fille était traitée, Gorgius reprit :
– Espère-t-il que ses amis le délivreront, ce beau Robert ?
– Non, fit nettement Nilia.
– Alors, il est découragé ?
– Non, dit-elle encore.
– Comment cela ?
– Il pense que les preuves accumulées contre lui ne sont pas assez probantes ; il croit qu’il bénéficiera d’une mesure de clémence.
Le rire chevrotant du docteur fit frissonner. Jack dans sa cachette.
– Une mesure de clémence ! Ma foi ! Un peloton d’exécution peut être considéré ainsi, car il abrège le séjour du condamné dans cette vallée de larmes.
Mais, changeant de ton :
– Et son cousin, Armand Lavarède ?
L’interrogation bouleversa Price le brun. Si Nilia allait trahir Armand, tout serait bien perdu. Lui-même aurait à se reprocher le trépas, non plus d’un seul, mais de deux Français.
Sans avoir conscience de son geste, il joignit les mains :
– Nilia, Nilia… Ne lui apprends pas la vérité.
Il se tut, angoissé ; la jeune fille parlait.
– Armand Lavarède, son épouse Aurett et la jeune Lotia Hador sont en marche vers le Caire.
– Vers le Caire ? clama Kaufmann, alors ils sont à nous.
Avec peine, Jack retint un cri de désespoir. En dépit de sa prière, Nilia trahissait ses amis.
– Eh quand arriveront-ils ? bredouilla le docteur, impatient de savoir.
– Après-demain, à trois heures de l’après-midi, ils seront sur la place Runneleh, près de la fontaine qui en occupe le centre. Ils seront vêtus en Arabes, les femmes voilées. Vous les reconnaîtrez à ce que l’homme portera à la main une badine, dont la poignée d’or figure un sphinx dressé.
– Et nous les prendrons ? rugit l’Allemand, dis ? nous les prendrons ?
– Oui, si vous êtes là à l’heure dite.
– Bah ! s’ils nous échappaient à la place Runneleh, nous les retrouverions bien après, où ont-ils l’intention de se rendre ?
– Je ne sais pas.
– Il faut le savoir. Cherche, interroge, vois.
L’accent du docteur était sec, cassant, autoritaire.
Il y eut un silence, puis Nilia murmura :
– Je cherche, mais je n’aperçois rien.
– Je veux que tu voies.
– J’essaie… impossible… il y a un brouillard.
– Par le diable, tu verras… Dusses-tu en mourir.
Un silence encore, et la jeune fille s’écria d’une voix gémissante :
– Assez… cela me fait mal, mal… Vous demandez ce qui ne peut pas être.
Elle souffrait, ce hideux Gorgius la martyrisait. Oubliant toute prudence, Jack s’arc-bouta sur les genoux, prêta bondir hors du coffre.
Mais il n’acheva pas le mouvement commencé. L’Allemand monologuait :
– Oui… je me heurte à une de ces résistances inexplicables… Ah ! la science, la science ! Combien elle est incomplète… Enfin le résultat est beau déjà… Après-demain, trois heures, place Runneleh ; nous serons exacts. Il faut prévenir le Sirdar à l’instant même, arrêter toutes nos dispositions.
Il termina soudain :
– Repose-toi, Nilia, et oublie.

Après ces paroles, Jack n’entendit plus rien. Au bout d’une minute, il lui sembla percevoir le déclic de la trappe.
Doutant encore, il n’osait faire un mouvement. Brusquement, le couvercle du coffre se souleva. Craignant une surprise, Price le brun bondit sur ses pieds ; mais il se rassura aussitôt. C’était Nilia qui venait le délivrer.
De nouveau, ils étaient seuls dans le compartiment, Gorgius avait disparu.
Il tendit les mains vers la jeune fille, mais elle ne parut pas voir le geste.
D’une voix basse, monotone, elle dit :
– J’ai menti… J’ai menti… Ce n’est pas après-demain, c’est demain qu’Armand Lavarède sera, à trois heures, sur la place Runneleh. Sois-y, toi-même, avertis-le, dis-lui où est située la prison de son cousin… et maintenant pars, pars sans perdre un instant, l’ennemi reviendra… il ne faut pas qu’il te surprenne, va, va…
– Mais vous ? supplia Jack, vous laisserai-je ici ?
– Ne te préoccupe pas de moi. C’est Robert qu’il faut sauver d’abord. Si tu réussis, ramène-le dans cette forteresse roulante.
Un cri s’échappa des lèvres du fils de mistress Price…
– Oui, je le ferai, j’enlèverai du même coup aux Anglais et cette formidable machine et leurs victimes.
Elle ne le laissa pas développer sa pensée. Le poussant vers la porte, elle répéta :
– Pars, pars, le danger est sur toi.
Ce fut elle qui fit manœuvrer la trappe, et Jack dominé, ne comprenant pas le changement qui s’était produit dans l’aspect de son interlocutrice, escalada l’échelle de métal et se hissa sur le toit du karrovarka.
Mais là, il s’aplatit contre les plaques de tôle. Il avait peur d’apercevoir un des factionnaires à son poste.
Son émotion fut de courte durée. La chance qui avait favorisé son entreprise ne lui fit pas défaut. Aucun factionnaire n’était visible, il avait donc grand espoir de passer sans être signalé.
Sans perdre une seconde, Jack se laissa glisser à terre, fit jouer la fermeture du panneau mobile, fila à toutes jambes, traversa le rond-point et s’engouffra dans les sentiers sombres du jardin.
Un quart d’heure plus tard, il s’enfermait dans sa chambre et se glissait voluptueusement dans son lit.
Il n’avait rencontré personne sur sa route.
Tout d’abord, il pensa qu’il ne dormirait pas. Les idées cavalcadaient dans sa tête ; mais l’acuité même de ses sensations détermina une fatigue nerveuse telle qu’il perdit bien vite la conscience des choses.
À l’aube, il se leva frais et dispos. L’anxiété qui le tourmentait depuis son retour au Caire s’était dissipée.
Il allait agir. Le jour même, à trois heures, sur la place Runneleh, il rencontrerait Armand Lavarède. Les moindres paroles de Nilia étaient gravées dans son cerveau. Le journaliste serait reconnaissable à sa badine surmontée d’un sphinx dressé.
Que résulterait-il de cette entrevue ? Jack ne s’en inquiétait pas. Le point important pour lui était de ne plus se trouver isolé, d’avoir des alliés, actifs, entreprenants, audacieux, pour tenter n’importe quoi en faveur de Robert.
Toute la matinée, il fut en mouvement, entrant, sortant, au grand désespoir de mistress Price, à qui ses allées et venues donnaient le vertige.
Il déjeuna vite et mal. Enfin, vers deux heures après midi, alors que tous les Européens faisaient la sieste, il quitta la villa, et, tournant le dos au Nil, se dirigea vers la citadelle, au pied de laquelle s’étend la petite place Runneleh.

La chaleur était écrasante. Sous la pesée d’un soleil de plomb, la ville, si animée aux heures tempérées, semblait endormie. Du ciel tombait une lumière blanche, crue, aveuglante, que le sol renvoyait avec des réverbérations de métal en fusion. Le long des murs, au-dessus desquels apparaissaient les coupoles des mosquées, les flèches des minarets, les belvédères des palais, s’étendait une ligne d’ombre bleue, transparente.
Le loin en loin, des jardins jetaient une note sombre dans cette orgie de clarté ; plus haut que les acacias, les sycomores, les gommiers, les figuiers aux feuilles digitées, s’élançait le fût écaillé des palmiers, dominé par un éventail verdoyant. Aucun souffle n’agitait l’air, et les feuillages immobiles, figés, avaient l’apparence de découpures métalliques.
Dans les rues, personne, sauf quelques portefaix de race nubienne ou soudanaise, seuls assez audacieux pour affronter l’ardeur du jour. Sur leur peau noire la sueur ruisselait, et ils allaient lentement, d’une démarche lourde, leurs yeux inexpressifs se portant à droite et à gauche.
Sur le rebord des terrasses retentissait par moments un claquement bref de mandibules, dont le bruit sec troublait le silence de la sieste. Et, au haut des murailles, sur une corniche, Jack apercevait un ibis, perché sur une patte et découpant sa silhouette grêle sur le fond cru du ciel.
Le jeune homme avançait cependant, oppressé par la température torride. Il traversa le canal El-Khalig sur les quais duquel les mariniers, certains de n’être pas dérangés, dormaient à poings fermés. Il longea les jardins d’El-Mahmidtyeh, parcourut plusieurs rues, et, contournant enfin les mosquées du Sultan Hassan et d’El Mahmidtyeh, il déboucha sur la place Runneleh, toute pleine du murmure de la fontaine établie à son centre.
Price le brun consulta sa montre. Elle marquait deux heures quarante-cinq minutes. Il était en avance, et pour échapper aux rayons dévorants du soleil, il alla se réfugier dans la zone d’ombre, étendue comme un tapis bleuâtre devant la façade de la mosquée du Sultan Hassan.
En face de lui se dressait la porte d’Asab (Bab-El-Asab), qui donne accès à l’ouest dans le fouillis de constructions, dont l’ensemble forme la citadelle.
Il adressa à la forteresse un regard de défi. Avec l’aide d’Armand, il lui arracherait son prisonnier. De quelle façon arriverait-il à ce résultat, il n’en avait cure.
D’heure en heure, le jeune homme devenait plus Français ; le mot impossible s’effaçait de son vocabulaire, et les difficultés lui semblaient vaincues d’avance.
Dire que la veille encore il était découragé ! Il avait suffi, pour le métamorphoser, d’une conversation inexplicable avec Nilia, la captive étrange qui dirigeait le service de renseignements du docteur Gorgius Kaufmann. Maintenant qu’il l’avait vue, Jack était définitivement à elle. N’avait-elle point tout ce qui est nécessaire pour enchaîner un cœur de vingt ans : la beauté, le malheur, le mystère, trois auréoles, alors qu’une seule eût été suffisante.
Les minutes coulaient, berçant le rêve de Price le brun. Soudain il tressaillit. Trois personnes s’avançaient sur la place.
Un homme et deux femmes : lui, drapé dans le long burnous des Arabes ; elles, couvertes du haïc, la face voilée strictement selon les prescriptions du Coran.
Tous trois s’approchèrent de la fontaine. Ils s’arrêtèrent en voyant Jack qui, sans réfléchir, accourait au-devant d’eux.
Avec un mouvement surpris, l’Arabe leva la main droite. Cette main tenait une badine et les rayons du soleil en firent étinceler la poignée d’or.
Le fils de mistress Price lança un cri étouffé. Il venait de reconnaître le sphinx debout.
Et sans préambule, sans explication, il saisit les doigts du chef, les serra énergiquement en disant :
– Bonjour, Sir Armand Lavarède.
Puis, se tournant vers les jeunes femmes, dont il n’apercevait que les yeux, bleus chez l’une, noirs chez l’autre, il s’inclina devant la première, puis devant la seconde, en ajoutant :
– Bonjour, Mistress Aurett ; bonjour, Miss Lotia !
S’il avait cherché à produire un effet, il eut pu se féliciter. Ses auditeurs restèrent abasourdis.
Ils se croyaient, sous leur déguisement, à l’abri des regards indiscrets. Eux qui, depuis leur évasion, avaient voyagé sans cesse à la limite du désert, aidés par des affiliés à la conspiration, lesquels leur assuraient des abris, des vivres, des montures ; eux qui, depuis quinze jours, attendaient à quelques kilomètres de la ville que la surveillance militaire se relâchât, ils étaient reconnus, démasqués, dès leurs premiers pas dans la capitale égyptienne. Et cela, non pas par un policier expert en son métier, mais par un jeune homme que son éducation n’avait nullement préparé à découvrir des Européens sous le costume arabe.
Jack comprit ce qui se passait en leur esprit et vite il s’expliqua.
Il dit ses craintes pour la vie de Robert. Sans parler de l’attraction exercée sur lui par Nilia, il raconta le mystère planant sur le karrovarka, ses tentatives pour y pénétrer, son succès de la veille et les renseignements précieux qu’il avait rapportés de son expédition.
Armand l’écoutait avec attention.
Quand il eut fini, le journaliste lui serra la main et lentement :
– Comment cette miss Nilia est-elle aussi bien informée ? Voilà ce qu’il faudra savoir ; car il y a là un danger terrible pour l’œuvre de l’émancipation de l’Égypte.
– Vous n’y avez donc pas renoncé ? s’écria Jack.
– Pas le moins du monde. Si nous sommes au Caire, c’est pour essayer de lui rendre son chef, actuellement interné à la citadelle.
– Vraiment ?
– Nous auriez-vous soupçonnés d’abandonner… ?
– Non, non, s’empressa de répondre Price le brun, mais j’ai une prière à vous adresser.
– Parlez.
– Eh bien ! – et la poitrine du jeune homme se soulevait avec effort – C’est par ma faute que sir Robert est enfermé, par ma faute que la mort plane sur sa tête… Laissez-moi me réhabiliter à mes propres yeux… employez-moi à sa délivrance… accordez-moi la faveur du poste le plus périlleux.
Il joignait les mains ; tout son être exprimait l’ardeur du dévouement. Les regards des jeunes femmes se posèrent sur lui avec une ineffable douceur, et Armand, touché par ce repentir si vrai, murmura :
– Il sera fait selon vos désirs.
– Oh ! merci, merci…
– D’ailleurs vous arrivez à point, continua le journaliste reprenant son ton badin. Je parle bien l’anglais, mais j’ai un accent que distinguerait une oreille exercée, tandis que vous…
– Alors vous acceptez décidément mes services ?
– Certes !
– En ce cas, éloignons-nous de cette place. On ne vous y guettera que demain, je le sais… Cependant je ne suis pas tranquille ; je tremble qu’un espion ne signale votre présence. Vous avez un refuge dans la ville ?
– Vous le pensez bien.
– Oui, oui… Allez-y sans tarder… Je ne vous demande pas où il se trouve, car je n’ai pas mérité encore votre confiance entière.
Lavarède lui empoigna la main et la secoua vigoureusement.
– C’est là ce qui vous trompe, ami Price… Comme preuve, je vous apprends que nous nous retirons dans la seule maison où les Anglais n’auront pas l’idée de venir nous chercher, parce qu’elle est trop compromise…
– Chez le marchand copte Kedmos ?
– Justement ! Ah ! mon ami, vous comprenez à demi-mot…
– Comme un Français, acheva Jack d’une voix tremblante.
Puis changeant de ton :
– Mais venez, venez… je ne serai tranquille que lorsque je vous saurai en sûreté.
Vingt minutes s’étaient à peine écoulées que le souhait du fils de mistress Price était réalisé. Armand et ses gracieuses compagnes, enfermés dans les appartements les plus reculés de l’habitation du copte, se trouvaient à l’abri des regards fureteurs de la police anglaise.
Il avait été convenu entre Jack et ses nouveaux alliés qu’ils se reverraient le lendemain, et qu’ils arrêteraient leur plan de campagne.
Le cœur léger, Price le brun revint à la villa du Sirdar.
Une animation inaccoutumée y régnait. Des officiers entraient et sortaient incessamment. Un grand nombre de négociants, appartenant à la colonie anglaise, se pressaient aux abords de la Résidence, et sur tous les visages se lisait la joie.
Que se passait-il donc ?
Inquiet, car la gaieté d’un ennemi est toujours le présage d’un malheur, Jack courut à la cuisine.
Mistress Price gourmandait trois aides… Les fourneaux flambaient, les casseroles s’alignaient sur le feu, remplissant les oreilles de bruissements, de ronflements, de sifflements. Le parfum des épices chargeait l’air.
– Qu’y a-t-il, mère, demanda le jeune homme. Que signifient ces préparatifs ?
La grosse dame interrompit un instant la confection d’une sauce, et, la figure épanouie dans un large sourire :
– C’est toi, Jack ? Ah ! bien… D’où sors-tu donc ?
– Je viens de me promener.
– Et tu n’as rien entendu dire ?
– Ma foi non.
La cuisinière leva les bras au ciel.
– Est-il possible ? Comment, tous les Anglais se réjouissent ; le spectre de la révolte s’envole en fumée, et mon Jack ne partage pas notre ravissement, il ignore…
– Tout, murmura Price le brun d’une voix éteinte.
Son cœur se serrait. Il avait le pressentiment d’un malheur.
– Alors, poursuivit la bonne dame sans remarquer l’altération des traits de son interlocuteur, je raconte. Des nouvelles importantes sont arrivées d’Angleterre.
– Ah ! fit-il, pâlissant.
– Oui. Le Sirdar est félicité chaudement. On lui alloue une récompense de cent mille livres sterling. Il est promu au plus haut grade de tous les ordres britanniques… Ce soir, il donne un dîner aux chefs des différents services de l’armée… et sais-tu ce qu’il m’a dit, en me recommandant de me surpasser ?
– Non, balbutia Jack avec effort.
– Il m’a dit, cet excellent général, un cœur d’or, un véritable cœur anglais !… Il m’a dit : Le docteur Gorgius Kaufmann, qui a été l’intermédiaire fidèle entre moi et les éclaireurs Nilia, sera assis à ma droite. Après-demain, il en sera de même, au banquet que la colonie anglaise du Caire préparé en mon honneur. Mais je n’oublie pas vos fils. Envoyez-les-moi demain matin ; ils recevront la juste récompense de leur loyalisme.
Une récompense ! Jack crispa sa main sur le dossier d’une chaise pour se soutenir. Ses jambes flageolaient. Une immense lassitude du rôle double que les circonstances lui avaient imposé, l’accablait à cette heure.
Mais mistress Price, toute à sa satisfaction, ne voyait rien. Elle parlait sans s’arrêter, disant son contentement d’Anglaise, son plaisir orgueilleux de mère, fière de ses enfants :
– Oui, sans doute, vous recevrez, John et toi, des certificats de civisme… Je les ferai encadrer et les placerai bien en vue, afin que nul n’en ignore… Et puis, et puis, il y a autre chose… Vous serez vengés de ces bandits qui vous ont versé un narcotique… Un narcotique, est-ce bien sûr, c’était peut-être du poison… Un sommeil dont on ne se réveille pas. Des gens comme ceux-là sont capables de tout. Quand on fait la guerre au Royaume-Uni, on n’en est pas à un crime près.
Dans son bavardage, Jack n’avait entendu qu’un mot : Vengé.
– Que dites-vous, ma mère ?… Comment serons-nous vengés ?
Elle s’arrêta net, regarda son fils, après quoi elle s’éclata de rire.
– C’est vrai ! J’oublie le principal. Apprends donc que l’Amirauté s’est rendue aux raisons de lord Biggun. Robert Lavarède est accusé du crime de haute trahison. Un conseil de guerre qui le jugera est convoqué pour après-demain, et la sentence sera exécutée dans les vingt-quatre heures.
Cette fois, Jack devint livide.
La nouvelle l’accablait. Toutes ses espérances culbutaient d’un seul coup. Comment sauver Robert maintenant ?
Heureusement, un marmiton avertit mistress Price que le beef-steak and rhubarb pie – pâté de bifteck et de rhubarbe – réclamait ses soins. Elle vola aussitôt vers la casserole où se confectionnait cette mixture nationale anglaise, laissant ainsi au jeune homme le temps de se remettre.
Sans cet incident, son émotion l’eût trahi. Dans sa tête, les idées tourbillonnaient ainsi que les feuilles sèches au vent d’orage. Éperdu, il se répétait :
– Que faire ? Que faire ?
Et il se répondait avec découragement :
– Rien ! rien !
Robert était-il donc perdu sans retour ? Lui, Jack, porterait-il toute sa vie le poids écrasant du remords ?
Il lui devint insupportable de rester seul en face de sa pensée, et, sans réfléchir à l’imprudence de sa démarche, il profita des préoccupations culinaires de mistress Price pour sortir de la cuisine, quitter la villa et retourner en toute hâte à la demeure de Kedmos.
Il y fut reçu sans difficulté, conduit auprès d’Armand Lavarède qui, assis devant une table, sur laquelle était déployé un plan, semblait l’étudier avec attention.
– Déjà vous ? fit le Parisien non sans surprise. Nous ne devions nous revoir que demain.
– C’est que j’ai appris des choses graves, répliqua le jeune homme haletant.
– Des choses graves ?
– Oui, l’Amirauté se décide à frapper sir Robert…
Le visage d’Armand était devenu soucieux ; il s’éclaira à ces dernières paroles.
– Ah ! bon ! bon ! ce n’est que cela ?
– Que cela ? s’écria Jack… Vous ignorez qu’un conseil de guerre sera réuni après-demain.
– Pardon, j’en suis informé.
– Que votre cousin sera certainement condamné à mort et exécuté le lendemain de grand matin.
– Pardon, j’ai aussi été avisé de cela.
Price le brun considéra le Français avec stupeur.
– Vous me dites cela tranquillement.
– Oui. Qu’importe en effet que Robert soit condamné à mort, si, la veille de son exécution, il fausse compagnie à ses geôliers.
– La veille ?
Les traits de Jack disaient l’ahurissement.
– La veille ? fit-il de nouveau.
Un fugitif sourire écarta les lèvres du journaliste.
– Oui bien, la veille ; nous comptons quelques alliés en ville et déjà j’étais averti.
Et, montrant le plan qu’il étudiait à l’arrivée du jeune homme :
– Voici un levé topographique de la colline et des bâtiments de la citadelle. Remarquez qu’à l’Est, près de la porte de Gebel, des constructions privées sont accolées à la muraille d’enceinte.
Puis, apposant le doigt sur un point :
– L’une de ces constructions est la propriété de mister Bobinow, sous le jardin duquel s’avance le cachot de Robert.
Comme Jack allait s’exclamer, le Parisien l’arrêta du geste.
– Attendez. Mister Bobinow attend la venue d’un cousin, que sa famille expédie, à son adresse, de Volverry, petite bourgade du comté de Lancastre en Angleterre. Les parents espèrent que de ce voyage, résultera un hymen entre ce garçon et miss Déborah Bobinow, vieille fille, sèche, laide, romanesque et tout aussi avare que son père. Vous ne comprenez pas ?
– Ma foi non.
– C’est pourtant bien simple. Albaram Coster, c’est le nom du fiancé, arrivé hier soir à Alexandrie, a été enlevé par nos amis. Il est actuellement captif dans une maison de campagne, en aval de Boulaq, où il est gardé par des hommes sûrs.
– À quoi cela sert-il ?
– À ceci. Demain, sir Jack Price, auquel je parle en ce moment et que je crois désormais dévoué à notre cause, prétextera un voyage dans le Delta ; il annoncera une absence de courte durée. Puis il viendra me rejoindre ici. Je lui donnerai mes instructions, et c’est lui qui se présentera chez mister Bobinow sous le nom d’Albaram Coster.
– Ah ! je saisis.
Mais, par réflexion, Price le brun ajouta :
– Seulement Bobinow ne reconnaîtra pas son cousin.
– Que cela ne vous tourmente pas. Albaram avait six ans, lorsque le vieil avare quitta l’Angleterre ; ils ne se sont jamais revus depuis.
– Alors tout est pour le mieux. Que devrai-je faire ?
– Je vous le dirai demain. Pour l’heure, occupez-vous de boucler votre valise… ne la chargez pas inutilement, car pour votre expédition, on vous en remettra une autre, celle d’Albaram Coster que vous allez représenter.
Les inquiétudes de Jack avaient disparu. Il riait maintenant, enchanté de la substitution. Curieusement, prouvant ainsi sa confiance revenue :
– Et sir Robert libre, où irons-nous ?
– Vous le saurez en temps utile. J’ai aussi songé à cela, soyez-en persuadé.
Le Parisien s’était levé en prononçant ces dernières paroles ; il tendit la main à son interlocuteur.
– Allons, au revoir…, et surtout plus de nervosité. Je compte sur vous, comptez sur moi.
Réconforté par cet entretien, Jack revint à la villa Biggun. Mistress Price éperdue courait de ses casseroles à la porte de sa cuisine, appelant son fils, dont la brusque disparition l’avait remplie d’inquiétude.
– Mon Jack, disait-elle, mélangeant dans son discours et l’angoisse maternelle et les préoccupations gastronomiques, mon Jack… Encore un peu de clous de girofle dans ce pâté… Où peut-il être ?… Avec un soupçon de laurier… Mon cœur est sur des charbons ardents… Salez donc ce rôti.
Elle eut un cri en voyant rentrer Price le brun.
– Sain et sauf sans blessures ? d’où viens-tu, mon enfant ?
Et, sans lui laisser le temps de se reconnaître :
– J’étais inquiète… par ces temps troublés, un malheur est si vite arrivé… Dans la casserole numéro 1, glapit-elle, comme un marmiton soulevait le couvercle de l’un des récipients… Numéro 1, étourdi ! – et, revenant à Jack : – Tu devrais me prévenir. Je te parlais tout à l’heure. Tout à coup, je me retourne, tu n’étais plus là.
Puis, se souvenant de sa première question :
– Où as-tu porté tes pas ?
Le jeune homme embrassa tendrement l’excellente créature.
– Je me promenais, mère, répondit-il évasivement.
– Tu te promenais, malheureux ; comme si tu ne t’étais pas suffisamment promené tout l’après-midi. Encore un joli coup que tu as fait là. Sortir par la grande chaleur. Tu me rappelles ton père alors que nous étions fiancés ; mais lui avait une excuse, notre mariage prochain, tandis que toi, toi…
Elle s’arrêta subitement, comme frappée par ses paroles.
– Mais, reprit-elle, est-ce que… ? Cela serait bien possible… Je me souviens à présent : ton air absorbé depuis quelque temps, tes tristesses sans cause, tes joies sans raison… Jack ! Jack ! la fleur d’hyménée ne s’épanouirait-elle pas dans ton cœur ?
La question troubla Price le brun. Une buée rose monta à ses joues. Ah ! oui, la fleur d’hyménée s’épanouissait. Les dernières semaines écoulées avaient passé pour lui comme un rêve. Nilia ! Nilia ! nom délicieux dont la mélodie chantait en lui ! Mais à la question de sa mère, il ne pouvait répondre. Que dirait-elle, la digne cuisinière anglaise en apprenant que son fils s’était donné corps et âme aux ennemis de l’Angleterre ? Assurément elle aurait un coup de sang !
Pour éviter pareil malheur, Jack se tut.
Mais son émotion n’avait pas échappé à son interlocutrice.
– Ah ! s’exclama-t-elle, j’ai deviné juste… mon fils flirte ; mon fils a un petit cœur sucré ([4]), et il me le cachait. Est-elle jolie au moins ?
– Aucune n’est aussi jolie, murmura distraitement le jeune homme.
– Tu avoues, car, il n’y a pas à dire, c’est un aveu. Tu me la présenteras dès demain.
Présenter celle dont son esprit s’occupait sans cesse, l’idée parut bouffonne à Jack. Un sourire éclaira son visage, et soudain il se frappa le front. Ne devait-il pas s’absenter pour tenir sa partie dans l’exécution du plan élaboré par Armand Lavarède ?
Le prétexte était trouvé, mistress Price elle-même venait de le lui fournir.
– Tu me la présenteras, répéta la cuisinière.
– Oui, mais pas demain.
– Pourquoi ?
– Parce que je dois auparavant faire un petit voyage.
– Un voyage ? se récria son interlocutrice.
– Oui, pour me faire agréer par sa famille, ou du moins pour savoir si elle autorise un flirt.
– Un voyage, une séparation.
– Deux ou trois jours au plus.
– Loin ?
– Non… à Alexandrie, affirma Jack prenant au hasard le premier nom de ville qui se présenta à son esprit.
Comme mistress Price allait encore interroger :
– Ne me demandez plus rien, ma mère, je ne pourrais vous répondre. Je partirai demain afin d’être plus tôt de retour, et, acheva-t-il avec une pointe d’émotion, alors vous saurez tout.
Des larmes montèrent à ses yeux. Il les refoula avec peine. Le sort en était jeté ; il allait se séparer à jamais de celle qui, pendant vingt années, avait été pour lui la plus tendre des mères. L’excursion à Alexandrie deviendrait une expédition longue, longue, dont nul ne pouvait prévoir la durée.
Il se jeta au cou de la bonne femme. Elle ne comprit pas le motif de cette effusion, et doucement, le pressant sur sa poitrine elle dit :
– Oui, oui, Jack, mon Jack, je veux que tu sois heureux. Pars, mon enfant, mais reviens-moi vite, car je suis trop triste lorsque je ne te vois point.
Elle ne savait pas que chacune de ses paroles atteignait Price le brun au cœur. Quel chagrin il allait causer à cette créature dévouée, dont la vie lui avait été consacrée. Combien le devoir lui apparut austère et douloureux.
Pour servir la cause française, la sienne désormais, il lui fallait d’abord agir avec la plus noire ingratitude envers sa mère adoptive.
Par bonheur, la cloche du dîner sonna. En une seconde, mistress Price redevint l’artiste culinaire que la maman avait un instant remplacée, et Jack eut le loisir de se remettre.
Tenue par les nécessités du service, la cuisinière ne put se mettre à table avant dix heures. John avait dîné, lui ; mais Jack attendit la pauvre femme. Il resta auprès d’elle le plus tard possible ; c’était la dernière soirée qu’il passerait avec elle ; à partir du lendemain il se lancerait dans l’inconnu.
Et elle, reconnaissante de cette tendresse qu’elle lisait dans ses yeux, elle le remerciait naïvement d’avoir reculé son repas pour lui tenir compagnie.
Un moment même, elle en arriva à dire :
– Toujours tu as été comme cela, attentif et gentil. Vois-tu, mon Jack, nous sommes seuls, John s’est couché ; je puis bien exprimer toute ma pensée. Eh bien ! Si un jour, la Française, mère de l’un de vous, venait me réclamer son fils, je souhaiterais que ce ne fût pas toi.
Pas lui ! Ironie de l’affection. La bonne dame préférait l’enfant qui se séparait d’elle volontairement, attiré, sans pouvoir résister, par les plis tricolores du drapeau de Gaule.
Enfin l’heure de dormir vint. Jack embrassa longuement sa mère adoptive, puis il se retira.
Dans sa chambre, il éclata en sanglots.
Au début de la lutte, ce petit Français de fraîche date offrait à sa nouvelle patrie le tribut de larmes d’un cœur aimant et loyal, et certes, si les âmes des guerriers morts pour la vieille Gaule ont licence d’errer près de ceux qui vont s’immoler pour elle, ces larmes durent réjouir les ancêtres. La France comptait un brave soldat de plus.
Dès huit heures du matin, John fit irruption dans la chambre de son frère.
– Encore au lit, paresseux, cria-t-il. Vous avez donc oublié que le Sirdar nous reçoit. Allons, habillez-vous… Surtout faites hâte.
Sans un mot, Jack obéit à l’injonction.
Ma foi oui, il avait totalement perdu le souvenir de l’audience offerte par lord Biggun.
Il lui était bien égal d’être félicité de son loyalisme passé à l’égard d’Albion, à présent que son amour, son dévouement étaient tout entiers à la France.
L’entrevue annoncée serait un ennui, rien de plus.
Bientôt il fut prêt et descendit à la cuisine, où son frère l’attendait en dévorant des rôties beurrées arrosées de thé.
– Vous arrivez bien, fit celui-ci la bouche pleine, le général en chef nous invite à nous rendre sans retard auprès de lui. Je crois, Jack, que vous agirez sagement en remettant à plus tard votre déjeuner matinal.
Le conseil donné, il engloutit d’un trait le contenu de sa tasse et, prenant son chapeau :
– Vous venez ?
– Certainement, John.
– Alors, en route !
Les deux frères parvinrent bientôt au perron d’honneur. On les attendait, car un officier d’ordonnance les introduisit aussitôt dans le bureau où le Sirdar se tenait d’ordinaire.
Celui-ci se leva à leur vue, leur tendit la main, honneur rare ; après quoi, sans préambule, il parla ainsi :
– John et Jack Price, la Reine a été informée par mes soins des services dont l’Angleterre vous est redevable. Sa Gracieuse Majesté a tenu à ce que la récompense fût à hauteur de votre dévouement, et elle vous a conféré une distinction réservée habituellement aux chefs d’État. J’ai nommé l’ordre impérial et royal de la Jarretière.
– Oh ! firent les deux jeunes gens avec des intonations différentes.
– J’ajoute que, pour ma part, cette décision me cause une grande joie. Comme preuve, j’ai tenu à vous remettre, moi-même, les insignes de l’ordre.
Il tendait en même temps à ses auditeurs des écrins ouverts, où se voyaient la jarretière bleue qui se porte à la jambe gauche, et la médaille avec l’image de saint Georges terrassant le dragon sous la devise : Honni soit qui mal y pense !
Chez les fils de mistress Price, ces objets produisirent un véritable ahurissement.
Pour le comprendre, il faut savoir ce que représente pour les Anglais l’ordre de la Jarretière. Fondé en 1319 par Édouard III, roi d’Angleterre, à la suite de la victoire de Crécy, il compte vingt-six membres seulement. Son nom vient du mot de ralliement adopté par l’armée britannique à Crécy : Garter, jarretière.
Vingt-six chevaliers, pas davantage. Le chiffre des élus indique la valeur de la distinction.
Désormais John et Jack marchaient de pair avec les premiers du Royaume-Uni.
Price le blond, tremblant d’émotion, Jack, avec une vague envie de rire, reçurent les écrins, prononcèrent quelques formules de remerciement, serrèrent de nouveau les mains du Sirdar et reprirent le chemin de la cuisine.
Seulement Price le brun se disait à part lui :
– Décidément, malgré leurs tourelles pivotantes, malgré leur armée, malgré tout, les Anglais ont rudement peur de l’insurrection égyptienne. Nous octroyer la Jarretière pour avoir fait capturer les chefs du mouvement démontre plus d’épouvante encore que de reconnaissance. Allons ! Allons ! que Robert soit libre et nous verrons.
Peindre les transports de mistress Price, quand ses fils lui racontèrent leur promotion dans l’ordre vénéré, est impossible. C’étaient des cris, des onomatopées, des exclamations. La grosse personne riait, pleurait, embrassait les jeunes gens, louait le Sirdar, la Reine, le tout en même temps.
Séance tenante, elle fixa les médailles sur la poitrine de John et de Jack. Le ruban-jarretière ne se porte qu’avec la culotte et les bas de soie ; ce fut pourtant tout juste si la cuisinière consentit à ne pas le coudre sur la jambe gauche du pantalon de chacun des nouveaux chevaliers.
Elle était heureuse, la pauvre femme, bien heureuse, ne soupçonnant pas les tristesses prochaines.
Mais Jack se souvenait que ce jour-là, à trois heures, le docteur Gorgius Kaufmann et les policiers, certainement mis à sa disposition, cerneraient la place Runneleh pour capturer Armand Lavarède, Aurett et Lotia.
Il savait bien que Nilia avait menti à son maître, que les chasseurs d’hommes rentreraient bredouille ; cependant il voulut se donner le spectacle de leur déconvenue.
Il annonça à sa mère adoptive qu’une impérieuse nécessité l’appelait en ville, et la cuisinière, croyant que le désir de rencontrer sa fiancée tenait seul le jeune homme, ne le dissuada pas.
– Va, va, dit-elle en riant ; sois gai, content, c’est tout ce que je désire. Je ferai ta valise pendant ton absence. Donc ne te presse pas. Tu n’auras qu’à dîner et à gagner la gare pour l’heure du train… je comprends tout… même pour peu de temps, c’est pénible de faire ses adieux aux grands yeux que l’on trouve les plus jolis du monde.
Et le long baiser que Jack, bouleversé par cette bonté constante, lui donna, elle le crut motivé par la gratitude d’un futur épris. Si elle avait pu lire dans l’âme du jeune homme, elle y eût vu un émoi terrible. Jack avait failli pleurer en l’entendant promettre de préparer, de ses propres mains, la valise de l’enfant prodigue qui, peut-être, ne reviendrait jamais.
Attristé par ses réflexions, Price le brun gagna cependant la place Runneleh.
Elle était déserte comme la veille. Il s’en étonna, mais, en regardant avec plus d’attention, il s’aperçut que les portes des maisons en bordure, celles des mosquées étaient entr’ouvertes. Il distingua même, dans l’ombre des vestibules, des formes humaines immobiles, de fugitifs scintillements d’acier.
Les hommes de Gorgius se trouvaient à leur poste. La place était cernée.
Sa pensée se reporta sur Nilia.
Quelle tempête retentirait à l’intérieur du karrovarka, lorsque l’Allemand, après une inutile faction, y rentrerait sans ramener les prisonniers escomptés.
Combien ses paroles seraient brutales, ses reproches effroyables pour la jeune fille. En songeant à cela, Jack serra les poings ; puis il s’apaisa tout à coup.
Robert délivré, il rendrait la liberté à l’adorable prisonnière.
Possédé d’une hâte subite, Price le brun quitta la place Runneleh. Il se rendit sans tarder à la demeure de Kedmos, annonça à Armand Lavarède que, le soir même, il se mettrait à sa disposition.
Après quoi, il revint à la villa Biggun. Il voulait passer ses dernières heures auprès de sa mère adoptive.
Celle-ci avait déjà préparé la valise, la couverture de voyage de Jack. Elle était enchantée que son fils s’occupât de son établissement matrimonial.
Elle le félicita, s’étendit longuement sur les joies du ménage, disant avec des sourires, des clignements d’yeux, qui prouvaient à quel point elle avait conservé le souvenir d’un passé lointain, le bonheur de l’union de deux êtres, liés par un commun dévouement.
Et lui, la regardait, mélancolique ; sa gaieté lui faisait mal.
Il comprenait à cette heure combien grande était son affection pour la brave femme.
Cependant les heures couraient rapides sur le cadran de l’horloge ; le jour baissait.
– Il te reste cinquante-cinq minutes avant le départ du train ; tu vas manger un morceau, conseilla la cuisinière.
Avec la manie de précaution si touchante, qui caractérise les vraies mères, elle ajouta :
– Du reste, tu arriveras à Alexandrie vers dix heures. Les hôtels ne seront pas fermés et tu pourras souper, si tu en éprouves le besoin… Je ne te demande pas d’explications, mais si tu n’as pas pris d’autres dispositions, suis mon conseil. Descends à l’hôtel Khédivial, à l’angle des rues de Chérif-Pacha et de Rosette ; tu y seras très bien. Maison fort convenable… ne songe pas à des petites économies dans ta situation… Un chevalier de la Jarretière ne doit pas fréquenter les maisons secondaires.
Lui prenant la tête à deux mains, elle l’embrassa tendrement.
– Car mon Jack est chevalier de la Jarretière, l’un des vingt-six… Je pense que ta future est fière de toi, et que sa famille te recevra à bras ouverts. Comme disent les Arabes, un fiancé tel que toi ne se trouve pas sous le pied d’un dromadaire.
Price le brun ne répondait pas, cruellement déchiré par ces paroles où vibrait la plus profonde tendresse maternelle.
Machinalement il mangea, se laissa servir.
Par moments, il portait ses regards sur l’horloge, dont les aiguilles lui semblaient marcher avec une vitesse inaccoutumée.
Mistress Price le remarqua, mais elle se méprit sur la cause de sa préoccupation.
– Oui, oui, je le vois bien, tu es inquiet. Tu te demandes si tu seras bien reçu. En pareil cas, on se fait toujours des réflexions ridicules. Va, mon Jack, ne crains rien, une mère doit être heureuse de donner sa fille à un garçon comme toi ; car tu es un gentil garçon et un bon garçon… ; cela je suis prête à le jurer : jamais tu ne m’as causé une peine sérieuse.
Puis tout à coup, avec un cri :
– Mais il te reste un quart d’heure à peine. Il ne faut pas manquer le train. J’ai l’air de te chasser, mais c’est que je suis pressée de la voir, celle que mon Jack a distinguée. Vite, vite, en route.
En parlant, elle lui plaçait sa couverture de voyage sur l’épaule, lui mettait sa valise dans les mains.

– Au revoir, mon enfant. Dis adieu à ton frère. Il voulait t’accompagner, mais je l’en ai dissuadé. On viendra peut-être à la gare pour t’encourager ; il ne faut pas gêner ceux qui rêvent de bonheur et d’hyménée.
Elle le poussait vers la porte. John serrait cordialement la main de son frère.
Une grosse larme roula lentement sur la joue de ce dernier.
– Allons bon, tu pleures, s’écria mistress Price bouleversée, tu pleures.
Jack sentit qu’il allait se trahir. Il se raidit contre l’émotion qui l’étreignait ; parvint à sourire :
– Oh ! ce n’est pas une marque de tristesse, c’est…
– Je sais, je sais, interrompit-elle ; on est fiancé, on est nerveux… Allons, un baiser, mon chéri, et séparons-nous.
Oui ! il fallait brusquer le départ ; la scène excédait ses forces, Jack en avait conscience. Dans une étreinte éperdue, il pressa sur sa poitrine la digne femme, puis il s’élança au dehors en criant :
– Au revoir !
Au revoir !…, locution qui exprime l’espoir du retour. Au revoir ! cela lui serra le cœur, car tout bas il murmurait : Adieu !
Le sort en était jeté, il se lançait à corps perdu dans la révolte égyptienne. Néo-Français, il sortait pour toujours de la grande famille anglaise, où il avait rencontré toutes les affections de sa jeunesse.
Désormais Jack serait seul ; mère, frère, amis, considéreraient comme un renégat, un transfuge, celui qui avait obéi à un amour plus puissant, plus grandiose que tous les autres, à l’amour enfermé dans ce mot : Patrie !

CHAPITRE XI
LE TRÉSOR DES BAB-EL-ARBA
– C’est drôle… j’ai décidément le caractère français. À l’idée de faire une bonne farce, je me sens tout réjoui. Pourtant je risque ma liberté, et je ne suis pas certain d’agir en citoyen honorable… Bah ! marchons.
Et Jack fit retomber lourdement le marteau de fonte qui ornait la porte de la demeure de mister Bobinow. Il avait passé la nuit dans l’habitation Kedmos, reçu les instructions d’Armand Lavarède, troqué sa valise contre celle d’Albaram Coster, et maintenant il allait pénétrer chez mister Bobinow pour exécuter le plan audacieux, conçu par ses nouveaux amis en vue de délivrer Robert.
Trois minutes s’écoulèrent, puis un grand bruit de clefs se fit entendre à l’intérieur. On tira des verrous, des chaînes se détendirent avec un cliquetis lugubre.
– Peste ! murmura le jeune homme, les renseignements sont exacts. Bobinow est un avare et un avare rempli de prudence.
Enfin la porte s’entr’ouvrit ; dans l’entre-bâillement un long nez pointu, aux arêtes vives, recouvert d’une peau parcheminée, s’avança, menaçant comme un fer de hallebarde.
– Que voulez-vous ? demanda la personne à qui appartenait cet appendice, auprès duquel l’appareil nasal de Cyrano lui-même eût paru camard.
– Je suis Albaram Coster, répliqua gravement Jack, et j’arrive en droite ligne de Volverry, dans le Lancastre, Angleterre, pour embrasser mon digne oncle Bobinow et ma suave cousine Déborah.
Une exclamation étouffée accueillit ces paroles. Une dernière chaîne tomba, et la porte s’ouvrit au large, démasquant la plus bizarre apparition que l’on puisse rêver.
Son nez était déjà connu du visiteur ; mais ce nez pyramidal, hétéroclite, était vraiment la digne avant-garde de la cousine Déborah, car la vieille fille avait ouvert en personne.
Ce nez pointait sous un front bas surmonté de cheveux roux, raides comme des fils de laiton. De chaque côté, deux yeux bruns, enfoncés dans les orbites, faisaient sans doute mauvais ménage, car ils s’obstinaient à regarder dans des directions opposées, victimes d’un strabisme divergent exagéré.
La bouche était un poème. Les lèvres minces, séparées comme par un coup de sabre, découvraient en se disjoignant des dents jaunes, déchaussées.
Et tout cela supporté par un cou maigre, des épaules étroites où pendaient mélancoliquement des bras décharnés, véritables pattes d’insecte ; un corps dont un fourreau de parapluie eût épousé sans peine la forme rectiligne.
Malgré cette apparence peu flatteuse, Jack devina du premier coup d’œil que Déborah n’était pas dépourvue de coquetterie. Dans la broussaille de ses cheveux, une rose était piquée. Des dentelles ornaient sa robe de soie, des bracelets brimbalaient à ses poignets, et ses pieds, longs, longs, longs, minces, minces, minces, étaient chaussés de souliers de satin.
Sans nul doute, la vieille fille se croyait jolie. Erreur commune parmi les femmes laides, lesquelles doivent toutes avoir, on ne sait comment, des miroirs aimables et galants, qui réfléchissent pour elles seules, en traits charmants, leurs visages brouillés avec la beauté. Cela expliquerait que les laiderons soient plus riches en prétentions que les plus belles d’entre leurs compagnes.
Jack débuta par un coup de maître dans la comédie qu’il venait jouer chez Bobinow.
Il joignit les mains, leva les yeux au ciel, puis, les abaissant sur Déborah avec une expression d’admiration :
– Pays fortuné, dit-il, pays aimé des dieux, où ce sont les fleurs qui ouvrent la porte au voyageur.

Et comme la vieille fille, troublée par ce madrigal, louchait affreusement avec l’intention de décocher au visiteur une œillade assassine, Jack lui prit la main et la porta galamment à ses lèvres.
Déborah pensa s’évanouir. Une rougeur monta à sa face safranée, donnant, par la superposition des couleurs, un délicieux ton orangé. De l’air le plus aimable, elle balbutia :
– Entrez, entrez, cousin Albaram Coster ; mon père vous attendait de jour en jour ; il sera très heureux de vous voir.
Jack ne se fit pas répéter l’invitation. Il pénétra dans le vestibule, tandis que sa pseudo-cousine replaçait verrous et chaînes, puis, guidé par elle, il laissa à sa droite le salon aux housses décolorées, la salle à manger sombre et triste, et, par une porte vitrée, entra dans le jardin, au fond duquel se dressait, noir et menaçant, le mur de la citadelle.
Enveloppé dans une robe de chambre aux couleurs fanées, coiffé d’un bonnet grec graisseux, un homme sec, voûté, dont le visage ridé offrait une ressemblance bizarre avec le faciès d’un oiseau de proie, lisait, assis sur un banc vermoulu, un journal dont la malpropreté indiquait qu’il avait passé dans de nombreuses mains. C’était mister Bobinow.
Ce journal trahissait l’avarice du bonhomme.
Il trouvait les quotidiens trop coûteux, et, pour connaître les nouvelles tout en économisant ses deniers, il s’était arrangé avec un aubergiste de la ville, qui, moyennant une faible rétribution, lui envoyait les feuilles publiques lorsque ses clients les avaient lues.
À la vue de Jack, Bobinow se leva et l’enveloppa d’un regard inquisiteur.
– C’est Albaram Coster, dit miss Déborah.
– Ah ! ah ! c’est vous, mon garçon, fit l’avare d’une voix cassée, c’est vous ; votre père, mon cousin, m’a annoncé votre voyage. Je pensais qu’en arrivant à Alexandrie, vous m’enverriez une dépêche télégraphique.
– J’y ai bien songé, répondit Jack avec le plus grand sérieux, mais…
– Mais… ?
– J’ai réfléchi. Un télégramme revient à six pence (0 fr. 60) ; vous vous seriez cru obligé de m’envoyer chercher à la gare, encore des frais. Il m’a paru préférable d’éviter ces dépenses inutiles. J’ai une langue, n’est-ce pas ? Une fois au Caire, me suis-je dit, je demanderai mon chemin ; je trouverai la maison de mon cousin, et cela ne coûtera rien. Ne m’approuvez-vous pas ?
S’il l’approuvait ! Le visage de Bobinow s’était épanoui en écoutant le visiteur. Il lui secoua cordialement les mains :
– Très bien, mon garçon, je vois que vous avez été élevé dans les bons principes… Cela ne me surprend pas. C’est par l’économie judicieuse que l’on sort de la misère. Votre père a fait fortune ainsi.
– Il a amassé 2.000 livres (50.000 francs) de rentes.
L’avare leva les bras au ciel, puis, s’adressant à sa fille :
– Tu entends, Déborah ? Deux mille livres ! Le futur héritier de cet argent songe à ne pas dépenser inutilement une somme de six pence. Voilà ce qui peut s’appeler une éducation solide.
Et devenant expansif :
– Vous m’allez, mon garçon, vous m’allez tout à fait. Entre nous, j’avais peur de rencontrer en vous un de ces jeunes prodigues… Car la jeunesse actuelle est prodigue, elle jette l’argent par les fenêtres, absolument comme si c’était de la poussière. Je me disais : Le père est riche, le fils doit avoir des habitudes de dépense.
Le faux Albaram réussit à conserver son air grave.

– Dépenser, grommela-t-il dédaigneusement, le beau plaisir. Est-il vraiment une chose qui vaille l’or qu’elle coûte ?
Cette fois, mister Bobinow laissa éclater son enthousiasme. D’un bond, dont ses vieilles jambes n’eussent pas paru capables, il se jeta au cou de son pseudo-cousin.
– Voilà une parole sage, que l’on devrait graver dans l’esprit des jeunes gens. Décidément, j’ai eu la main heureuse le jour où j’ai écrit à votre père : Envoyez votre garçon ; je ne promets rien quant au mariage, car ma fille est un trésor, une ménagère hors ligne ; mais enfin on peut toujours voir.
Puis, se reculant un peu :
– Eh bien ! je vous le dis en confidence, la première impression est excellente. Bien des godelureaux se sont présentés déjà ; on sait que j’ai amassé sou à sou une aisance convenable ; mais tous ces galants rêvaient de croquer mes écus. Or, ce que je veux, c’est un gendre raisonnable, qui augmente le capital que je lui laisserai. Il est trop triste de songer que les économies de toute une existence seront dissipées en quelques années par un niais.
Il s’attendrissait :
– Notez que Déborah est une perle. Croiriez-vous qu’avec un shilling (1 fr. 25) elle nous fait vivre tous les deux. Et nous nous nourrissons bien, vous savez. Oh ! pas de ces plats compliqués où la chimie des cuisiniers joue un rôle capital. Non, non, cela est mauvais à la santé, et la goutte s’installe à la table des gourmands… Mais nous avons de bon pain, d’excellentes pommes de terre, de la salade rafraîchissante et stomachique. Deux fois par semaine au moins, le bouillon et le bœuf réjouissent notre palais. Que faut-il de plus au sage ?
Jack écarquillait les yeux, se livrait à la mimique la plus admirative.
– Étrange, s’écria-t-il, c’est absolument là l’ordinaire de la maison de mon père ; nous y ajoutons seulement les œufs de nos poules.
Il s’arrêta inquiet. Les traits de Bobinow s’étaient rembrunis.
– Les œufs de vos poules, dit sévèrement l’avare. C’est une erreur cela, je l’écrirai à votre père. Les œufs, ça ne se mange pas, ça se vend.
– Vous ne m’avez pas laissé achever, s’empressa de continuer Jack ; nous vendons nos œufs, mais parfois il s’en trouve dont la coquille est brisée… une maladresse des poules… ceux-là, nous en faisons notre nourriture.
À cette explication, le mécontentement de mister Bobinow se dissipa. Il murmura :
– Bien, bien, je n’avais pas compris. Cela m’étonnait aussi de la part d’un homme aussi intelligent !… Manger ses œufs… mais je serais dix fois millionnaire que je ne ferais pas cela.
Jack n’était pas gourmand, toutefois il eut peine à ne pas faire la grimace. Il allait manger tout le jour chez l’avare, et véritablement les satisfactions gastronomiques paraissaient devoir faire complètement défaut.
À ce moment même, comme si elle avait deviné sa pensée, Déborah éleva la voix :
– Mon père, dit-elle, je sors… Notre déjeuner, prévu pour deux, serait peut-être un peu court maintenant que mon cousin Albaram est là.
– Sans doute ! Sans doute ! grommela Bobinow… mais pas de dépenses… Il est accoutumé à notre ordinaire… Un excès le rendrait malade.
– Soyez tranquille, père.
Et elle rentra dans la maison, après avoir incendié le jeune homme de son regard le plus tendrement loucheur.
Price le brun était seul avec le vieux thésauriseur.
Tout à coup, il poussa un cri qui fit sursauter son compagnon.
– Ah ! voilà qui est curieux… vraiment ! Pour une chose curieuse, c’est une chose curieuse !
Ses mains s’étendaient vers un massif d’arbustes placé en arrière du banc sur lequel l’avare avait déposé son journal.
– Quoi donc ? qu’est-ce qui est curieux ? interrogea Bobinow, en suivant du regard la direction indiquée par le geste de son hôte.
– Là, là… ces buissons.
– Ça… ce sont des acacias nains… on en trouve à foison au bord du Nil. Il suffit de les transplanter… pas cher, pas cher.
Mais Jack continuait ses mouvements stupéfaits.
– Non, vous n’y êtes pas, mon cousin. Ce qui m’étonne, c’est la forme, l’arrangement de ces arbustes.
– Le goût habituel de Déborah.
– Pas encore cela.
Et, détachant nettement chaque syllabe :
– Ce qui me surprend en face de ce buisson, c’est que je l’ai déjà vu.
– Hein ? clama Bobinow,… déjà vu ?… Vous jetez bien certainement votre cervelle hors de votre tête, car jamais vous n’êtes entré dans ce jardin.
Jack sourit aimablement.
– Aussi n’est-ce pas ici que je l’ai aperçu.
– Et où donc, s’il vous plaît ?
– Avant-hier, mon cousin, dans la cabine que j’occupais à bord du steamer qui me transporta en Égypte.
À cette réplique, au moins bizarre, l’avare recula prudemment, mettant le banc entre son interlocuteur et lui. Évidemment il avait des craintes pour la raison de son pseudo-parent.
Celui-ci le devina, et se mit à rire de bon cœur.
– Vous errez, mon cousin, je ne suis pas fou. Vous allez comprendre. Dans ma cabine, je dormais et mon sommeil a été troublé par un rêve qui m’a fort impressionné.
– Un rêve maintenant.
– Le plus beau qu’un homme puisse faire. J’étais en face d’une cascade de millions.
– De millions ? répéta le vieux soudainement intéressé.
Les yeux brillants de convoitise, il se rapprocha.
– Mais que faisaient ces acacias dans votre rêve ?
– C’est ce que je vous expliquerai, si vous le permettez.
– Allez, allez, Albaram. Je vous écoute. Il n’y a que les nigauds qui se moquent des songes. Ce sont le plus souvent des avertissements envoyés par nos amis de l’au-delà.
Une expression ironique mais fugitive passa sur les traits de Jack.
Il se conformait au plan tracé par Armand Lavarède, et il constatait avec plaisir que son auditeur était bien tel que le journaliste le lui avait dépeint.
Jusque-là une vague inquiétude de faire fausse route avait paralysé sa verve ; à présent, avec la confiance, il retrouvait tous ses moyens.
– Donc, je commence. Ainsi que je vous l’ai dit, vénéré cousin, je m’étais enfermé dans ma cabine et m’étais jeté sur ma couchette. Je m’endormis de suite. Combien de temps demeurai-je sans conscience, cela je ne saurais le dire ; mais tout à coup il me sembla que mes yeux s’ouvraient et qu’une grande clarté remplissait la petite pièce.
– Bien, parfait, souligna Bobinow, qui écoutait avec une attention flatteuse pour le conteur.
– Un homme était debout au pied de mon lit. Je le reconnus. C’était Elias Coster, le propre frère de mon père, décédé depuis six ans.
– Je me souviens, je me souviens, interrompit l’avare ; j’ai reçu à l’époque une lettre de faire part ; j’ai même remarqué à ce sujet que cette correspondance aurait pu être économisée, puisque je n’étais en état, ni de ressusciter le défunt, ni de le conduire à sa dernière demeure.
– Très juste, opina le pseudo-Albaram, flattant sans vergogne la manie de celui qu’il désirait jouer. Je poursuis. Mon oncle Elias me salua de la main puis de la grosse voix rude que je n’avais pas oubliée, il me dit : Neveu, vous allez bientôt marcher sur un trésor d’une valeur incalculable… je suis venu pour vous indiquer le moyen de vous en emparer. Cela n’a pas été commode, les barrières qui séparent la vie terrestre de l’au-delà ne s’ouvrent pas facilement ; mais on sait que j’ai toujours eu l’esprit de famille et on m’a laissé passer.
Le jeune homme fit une pause, comme si l’émotion le dominait.
– Après ? après ? questionna rageusement mister Bobinow. Vous aviez raison, Albaram, un rêve où il y a un trésor, cela doit porter bonheur.
– Attendez, le plus curieux est ce qui me reste à vous apprendre. Le spectre s’approcha et dit encore : Venez avec moi, il faut que vos yeux se familiarisent avec ces choses. Sa main glacée entoura mon poignet, et j’eus le sentiment qu’il m’emportait à travers les airs avec la vitesse de l’éclair.
Ici Jack s’arrêta encore. La physionomie de l’avare le poussait à l’hilarité. Il buvait littéralement les paroles de son interlocuteur, tel un goujon gobant l’appât du pêcheur. Le mot « trésor » l’avait ébloui ; il était prêt à croire les plus invraisemblables folies.
Le jeune homme domina pourtant son intempestive gaieté et, d’un ton pénétré :
– Notre course cessa brusquement. Je regardai autour de moi. Mon oncle Elias était là, et de la main il me montrait quelque chose en avant. Je fixai les yeux sur le point désigné, et je constatai que nous nous trouvions dans un jardin, en face de nous, avec un massif d’arbustes absolument semblable à celui qui tout à l’heure m’a fait pousser un cri d’étonnement.
– Il vous avait donc guidé jusqu’à ma maison ?
– Cela, je ne saurais l’affirmer, cousin ; car enfin un fourré peut ressembler à un autre fourré ;… mais laissez-moi achever. Le spectre me fit alors signe de le suivre. Nous contournâmes le massif, et derrière, savez-vous ce que je vis ?
– Non.
– Un piédestal en briques supportant un gros vase de fonte.
– Brique… fonte… bégaya l’avare, les yeux hors de la tête… Cela est surnaturel, prodigieux… apocalyptique.
– Qu’avez-vous donc ? questionna Jack d’un air innocent.
– Ce que j’ai ?… vous le demandez ?… Ah ! Albaram, il n’y a plus de doute… c’est chez moi que vous vous êtes promené en rêve.
Et comme Price le brun affectait de ne pas comprendre, Bobinow l’entraîna au-delà du fourré d’acacias en criant avec une exaltation croissante :
– Venez voir… Venez voir… cela est admirable !
De l’autre côté, au milieu d’un petit rond-point que trois grands arbres recouvraient d’une voûte de feuillage, se dressait un vase de fonte sur un socle de briques verdies par les mousses.
Il le savait bien, Jack, puisqu’il utilisait les confidences de Nilia. Mais son pseudo-cousin ne put s’en douter, car le jeune homme se prit à rire, à se frotter les mains, à hocher la tête de façon à exprimer une surprise voisine de l’ahurissement.
– Eh bien, fit anxieusement l’avare, le reconnaissez-vous ?
– Cela tient du prodige, cousin, déclama Price le brun ; voilà exactement le vase que j’ai vu.
– Les buissons, le vase, reprit son interlocuteur dont le corps maigre frétillait… et le trésor ?
– Le trésor…
Jack parut hésiter… puis lentement, regardant Bobinow bien en face :
– Si je vous indique la cachette, cousin, nous partageons.
L’avare eut un haut-le-corps, mais, se ravisant :
– Eh bien oui… après tout, je pense que vous épouserez ma fille… nous partagerons, seulement je ne lui donnerai pas de dot.
– Permettez…
– C’est à prendre ou à laisser. Réfléchissez d’ailleurs que son argent sera en bonnes mains… il vous reviendra un jour, augmenté… par conséquent…

– Topez-là, conclut Price le brun, je m’en rapporte à votre gérance ; c’est, je crois, la plus grande marque de respect que je puisse donner au père de ma fiancée.
Le compliment flatta l’avare. Il tendit les mains à Jack.
– Vous êtes celui que j’aurais choisi entre tous, mon garçon, entre tous, entendez-vous. Avec votre nature, l’argent sera en sûreté… et ma fille sera heureuse, car c’est un présent du ciel qu’un mari qui ne se complaît pas aux folles largesses.
Son ton changea bien vite, et, se penchant avidement vers le faux Albaram Coster, il demanda :
– Et ce trésor ?
– J’achève donc mon récit, beau-père, s’écria le jeune homme en étouffant avec peine une lancinante envie de rire. Mon oncle Elias me montra le piédestal et prononça ces mots : Au-dessous, deux mètres de terre à creuser, puis une voûte de pierre à percer. Tu pénétreras ainsi dans un caveau où, jadis, la tribu des Bab-el-Arba a enfoui ses richesses. Donne-moi ta main, je veux te montrer cet amoncellement de choses précieuses. De nouveau, sa main mit un bracelet de glace à mon poignet. Le sol s’ouvrit sous nos pieds, et nous nous trouvâmes dans une salle souterraine. Des coffres étaient rangés à l’entour. L’oncle Elias les ouvrit.
Et, feignant un enthousiasme sans bornes, Price le brun bredouilla en trépignant :
– Remplis d’or, de pierres précieuses, de ciselures d’un prix inestimable… et cela dansait devant mes yeux, cela roulait comme un fleuve, avec des tintements métalliques à bouleverser l’esprit le plus solide.
– Et, et… ? pria Bobinow, dont les yeux semblaient prêts à jaillir de leurs orbites, dont le visage s’était couvert d’une teinte cramoisie.
– Et je me réveillai dans ma cabine, acheva paisiblement le pseudo Albaram. Ce rêve me tourmentait depuis. Je pensais : L’oncle Elias n’a oublié qu’un détail, c’est d’indiquer en quel pays est enterré le trésor. Aussi jugez de ma stupéfaction, de mon trouble…
– En reconnaissant mes acacias, mon vase, mon piédestal… interrompit l’avare en gesticulant. Je ressens cela, croyez-le bien… Ah ! nous sommes du même sang, allez : et nous vibrons aux mêmes choses… Voyons, à présent, que comptez-vous faire ?
Jack baissa les yeux. Il avait amené son hôte où il le voulait. Sous ses pieds était le cachot de Robert Lavarède, ce cachot qu’il fallait ouvrir au captif pour l’Égypte, pour la France.
Puis, la voix agitée d’un léger tremblement, il étendit la main vers le sol avec ce seul mot :
– Creuser.
Non, jamais harangue d’un général à ses troupes, jamais discours d’un grand orateur ne souleva un enthousiasme comparable à celui que Bobinow ressentit à ce moment.
– Creuser, répéta-t-il, creuser. C’est beau comme l’antique… J’ai des bêches. Nous allons nous y mettre de suite.
Mais Jack calma son impatience.
– Pas maintenant… Le jour, on nous verrait peut-être… le soir, à l’abri du voile de la nuit…
– C’est vrai… c’est vrai. Quelle sagesse dans votre jeune cerveau, Albaram ! Là, le cœur sur la main, vous me convenez de plus en plus.
Bobinow se tut brusquement. La silhouette de Déborah apparaissait sur le seuil de la maison.
– Oh ! fit-il après un silence… c’est ma fille. Elle nous aidera. Sérieuse est sa nature et l’on peut se confier à elle.
Il fallait que l’avare eût une foi solide en sa descendante, pour admettre la possibilité de la mettre en tiers dans un secret d’argent. La vieille fille s’approcha d’un air embarrassé.
– Mon père, dit-elle d’un ton hésitant, pour fêter l’arrivée de mon cousin, j’ai cru devoir agrémenter un peu notre ordinaire.
Bobinow fit une grimace.
– Qu’est-ce à dire ?
– Oh ! je n’ai pas dépensé davantage. Des bruits d’insurrection courent le pays, les négociants sont effrayés, et ils ont baissé leurs prix, afin de se défaire de leurs marchandises.
– Bon, bon, si c’est comme cela.
– Si bien, acheva Déborah avec un regard tendre, triomphant et louche à l’adresse de son pseudo-cousin, que nous aurons à déjeuner des radis, un morceau de lard froid, des pommes de terre en robe de chambre, du fromage de Chester et de l’ale mousseuse.
– Au même prix que nos repas habituels ? insista l’avare défiant.
– Au même prix, mon père.
– Un festin… Lucullus dîne chez Lucullus.
– Grâce aux bruits de révolte.
– C’est admirable. Dire qu’il se trouve des gens pour maugréer contre les révolutions, mais c’est la vie à bon marché, c’est la chère plantureuse mise à la portée des bourses modestes. Tu as bien manœuvré, ma fille chérie, et je suis content de toi. C’est une satisfaction de recevoir luxueusement un ami, un gendre, sans accroître ses débours.
– Un gendre ? soupira la vieille fille, prise d’une émotion visible.
– Je l’ai dit… je le maintiens. Albaram Coster est digne d’entrer dans notre famille.
Jack dut se tenir à quatre pour conserver la gravité que commandait la circonstance, d’autant plus que le visage baroque de Déborah avait revêtu une expression sentimentale de l’effet le plus réjouissant.
Ce fut bien pis encore lorsque l’on regagna le logis. La pauvre créature demeura en arrière avec Price le brun, et, minaudant, elle murmura à voix basse :
– Cousin Albaram, j’ai caché la vérité à mon père ; pour vous offrir de bons repas, j’ai pris sur mes économies de jeune fille.
L’avarice des habitants de cette maison atteignait décidément des hauteurs épiques ; Homère lui-même n’eût pas dédaigné de chanter des Harpagons de cette taille.
Mais le pseudo-Coster s’inclina, hypocritement, et répondit d’un ton pénétré :
– Je me souviendrai de cela, cousine Déborah ! Moi aussi, j’ai mes économies ; je les emploierai à embellir vos jours.
Ce dont elle pensa s’évanouir de plaisir.
Le repas fut particulièrement joyeux. Boire de l’ale, pour le père et la fille soumis habituellement au régime de l’eau, constituait une véritable débauche. Après le premier verre, ils se mirent à bavarder. Bobinow raconta le rêve de son hôte, enflamma l’imagination de Déborah en lui dépeignant les coffres débordant d’or et de pierreries, dont l’existence lui semblait certaine.
Telle était la bonne humeur de l’avare qu’il offrit deux fois des radis au faux Albaram, aménité dont jamais il n’eût eu la pensée en d’autres temps.
Jack avait fini par prendre son parti de l’aventure. Les convives l’amusaient maintenant. Le déjeuner terminé, comme Bobinow, se pourléchant les lèvres, disait :
– Ah ! c’est bon, un repas copieux, c’est bon ; mais il serait détestable de manger ainsi tous les jours. La pâle gastralgie ne tarderait pas à tourmenter notre estomac de ses ongles acérés.
Price le brun se leva de table.
– Cousin, cousine, fit-il, si vous le permettez, je vais aller dormir.
– Dormir ? se récria l’avare. Un garçon robuste ne dort pas au milieu du jour.
– Pardon. Toute la nuit prochaine nous fouillerons la terre. Or, qui veut aller loin ménage sa monture…, l’économie de mouvement est bien souvent une économie d’argent.
– Vous avez raison, Albaram, toujours raison, clama Bobinow persuadé par ce raisonnement. Je n’aurais pas cru, à mon âge, avoir besoin des leçons d’une jeune tête comme la vôtre. Nous vous imiterons ; je ne saurais vous octroyer une preuve plus grande de considération.
Scandant les mots, comme pour graver en son esprit une maxime aussi belle, il poursuivit en dodelinant de la tête ainsi qu’un poète bercé par la cadence d’un vers harmonieux :
– L’économie de mouvement est bien souvent une économie d’argent… Ah ! Albaram Coster, votre père peut être fier d’un tel fils… économe de tout, même de ses gestes… Allez… vous êtes grand comme le monde.
Cinq minutes plus tard, Jack s’enfermait dans la chambre qui lui avait été désignée ; mais il ne se jeta pas sur le lit disloqué, au couvre-pieds déteint, qui en faisait le plus bel ornement.
Il s’assit devant un petit guéridon, respectable à force de vétusté, dont le placage d’acajou avait cédé en maint endroit sous l’action du temps, et il se mit à écrire la lettre que voici :
À Mistress Price, villa Biggun – Le Caire (Égypte).
« Ma mère,
« Quoi que vous pensiez de ma conduite, laissez-moi vous donner ce nom si doux ; mon cœur n’en saurait trouver d’autre.
« Pourquoi je vous écris, je n’en sais rien, car je ne vous persuaderai point, j’en ai la certitude : et pourtant, je donnerais dix ans de ma vie pour que vous conserviez votre tendresse à celui dont les circonstances ont fait un ennemi de l’Angleterre.
« Un ennemi, ai-je dit ; je me trompe. Je ne puis être l’ennemi d’un pays où vous vivez, vous la mère tendre, dévouée, toujours bien aimée du plus malheureux des fils.
« Mes douleurs ont commencé le jour où vous nous avez conté, à John et à moi, le mystère de notre existence. L’un de nous était Français d’origine. John n’a pas hésité. Tout de suite, il s’est senti Anglais de la tête aux pieds. Moi, j’ai été pris par le doute. Peut-être, dans mon désir de vivre près de vous, ma mère, aurais-je agi toujours en fils de la Grande-Bretagne ; mais les événements en ont décidé autrement.
« Lorsque le Sirdar nous chargea de surveiller les chefs de la conjuration, il ne se doutait pas qu’il allait doter la France d’un soldat de plus. C’est cependant ce qui est arrivé.
« En me trouvant en face du drapeau aux trois couleurs, un bouleversement s’est produit en moi, et depuis, mon trouble s’est accru, accru sans cesse, jusqu’à l’heure où j’ai considéré comme une trahison de continuer à recevoir l’hospitalité anglaise, alors que mon âme était toute à la France.
« Pardonnez-moi. C’est l’honneur qui me pousse à sortir d’une situation horriblement fausse ; je lui obéis, le cœur déchiré. Ah ! pourquoi, ma mère et ma patrie sont-elles de côtés opposés ? Pourquoi ne puis-je les confondre dans un même amour ? Pourquoi dois-je m’éloigner de l’une pour obéir à l’appel de l’autre ?
« Au-dessus du bonheur, mère… vous me l’avez toujours dit, il faut placer le devoir… Il ordonne aujourd’hui… je vais à lui, pleurant sur vous, pleurant sur moi. Conservez-moi votre tendresse, et plaignez celui qui sera toujours votre fils.
« JACK. »
« P. S. – Je n’ose plus signer Price, ce nom que votre bonté m’avait prêté. En dépouillant le nom qui ne m’appartient pas, mais que je vénérerai toujours, je fais acte de probité… elle est cruelle, la probité, en m’obligeant d’élargir l’abîme que la patrie a jeté entre nous. Je vous aime, mère, alors même que vous me maudiriez. »
Les larmes glissaient lentement sur les joues de Jack, venant se perdre dans sa fine moustache brune. Il posa la plume sur la table.
– Robert libre, murmura-t-il tristement ; je jetterai cette lettre au premier bureau de poste, et je chercherai une retraite d’où je puisse veiller sur Nilia. Après… Oh ! après, j’irai où le hasard me portera.
Puis, se levant avec brusquerie :
– Maintenant il faut agir, je m’apitoierai ensuite sur mon sort.
Il plia la missive, la mit sous enveloppe et la glissa dans sa poche. Un instant encore il parut réfléchir. Enfin il secoua la tête.
– La soirée sera rude… prenons un peu de repos.
Et, le sourire refleurissant sur ses lèvres :
– L’économie de mouvement est une économie d’argent, fit-il à haute voix.
Comme surpris, il s’arrêta pour reprendre presque aussitôt :
– Ah ! Français, Français que je suis ! Il n’y a pas de tristesse qui puisse m’empêcher de plaisanter.
Sur le lit, il se coucha et ferma les yeux.
Dormit-il ? Ses pensées le tinrent-elles éveillé ? Peut-être l’un et l’autre. Toujours est-il que, vers cinq heures, il descendit au salon, l’air reposé, satisfait, le regard brillant de décision.
Bobinow et Déborah l’y attendaient, lisant un journal.
– Eh ! eh ! cousin Albaram, s’écria cordialement l’avare, voici des nouvelles fraîches. Le gouverneur désire que chacun apprenne comment l’Angleterre punit les rebelles ; il fait distribuer gratuitement les gazettes… Encore un bienfait des révolutions !
Il tendait en même temps la feuille au jeune homme.
Celui-ci y jeta les yeux et se sentit pâlir.
En manchette s’étalait, en gros caractères, le sous-titre suivant :
CONSEIL DE GUERRE – CONDAMNATION À MORT
Il avait compris. Ce jour même, à deux heures, Robert Lavarède avait comparu devant le tribunal militaire. Il était condamné. Le lendemain, à l’aube, la sentence devait être exécutée.
Quelques heures seulement lui restaient, à lui, Jack, pour essayer d’arracher le chef de l’insurrection à la vindicte anglaise.
Il fut sur le point de courir au jardin, de commencer de suite la fouille du sol, mais par bonheur la réflexion apaisa sa nervosité. Pour réussir, il avait besoin de tout son sang-froid. La moindre faute ferait naître le soupçon dans l’esprit de l’avare.
Aussi, se dominant, il réussit à dire :
– Cela est juste ! Cela apprendra aux Français à venir troubler les colonies anglaises.
– Parfaitement, appuya Bobinow. Au surplus, toutes ces choses ne nous intéressent pas. Je pense, Albaram, que nous avons les mêmes préoccupations.
– Les mêmes, cousin. J’attends la nuit avec impatience.
– Comme moi, c’est bien ce que je croyais. J’ai lu ce procès pour passer le temps.
– Je n’en doute pas.
– Cependant, insinua la diaphane Déborah, ce Français m’a étonné. Il a été très courageux. Je ne me serais jamais figuré qu’un homme appartenant à une nation décadente pût montrer autant de courage.
Elle ne vit pas le mauvais regard que Jack lui lança.
– Et vous, cousin Albaram, aviez-vous idée qu’un personnage né en France… ?
Le jeune homme ne la laissa pas achever.
– Une exception, fit-il avec effort, une exception bien certainement. Et encore il faudrait être assuré que le journal raconte bien la vérité.
Jack étouffait de colère. Pour un peu, il eût volontiers étranglé le père et la fille ; mais l’avare, avec un à-propos dont il n’eut pas conscience, détourna la conversation.
– Cinq heures et demie, grommela-t-il. Le temps ne court vraiment pas. Nous allons souper… puis nous mettrons les bêches en état. Ah ! que la nuit tarde à venir.
Affirmation que Price le brun approuva du geste.
On se rendit dans la salle à manger, où l’on soupa des reliefs du déjeuner ; puis d’une armoire, Bobinow sortit trois bêches rouillées.
– Pourquoi trois ? questionna le faux Albaram.
– Parce que je travaillerai aussi, répliqua Déborah. Il ferait beau voir que je me croisasse les bras, lorsque vous peinerez pour nous faire riches.
De nouveau, Jack la regarda de travers, ce dont elle ne s’aperçut pas, ayant l’habitude invétérée du strabisme.
Et, pour rompre les chiens, il examina les bêches.
En les voyant couvertes de rouille, il avait craint que leur solidité ne laissât à désirer. Non, c’étaient des outils solides, sur lesquels l’oxydation n’avait pas mordu profondément.
Personne n’avait plus envie de parler. Chacun, mû par un sentiment différent, suivait les progrès de la chute du jour.
Tantôt l’un, tantôt l’autre allait à la fenêtre, interrogeait le ciel et revenait s’asseoir.
Lentement, la voûte azurée se fonçait.
– Le crépuscule ! bredouilla enfin l’avare d’une voix émue. Déborah, fixez tous les volets. Il faut que la maison soit hermétiquement close.
La vieille fille se précipita ; mais Jack, aussi prompt qu’elle, lui évita la moitié de la peine.
Elle l’en remercia en baissant pudiquement les yeux. Le pauvre laideron prenait pour une attention ce qui était seulement le résultat de l’impatience anxieuse du pseudo-Albaram.
Puis chacun s’arma d’une bêche et gagna le jardin.
Une teinte grise s’épandait sur toutes choses. La haute muraille de la citadelle se noyait d’ombre.
– Commençons-nous ? demanda l’avare à voix basse.
– Oui, cousin, il me semble que nous pouvons nous hasarder.
– Enfin !
Comme des ombres, les trois personnages se glissèrent jusqu’au rond-point qu’ornait le vase de fonte.
Là, c’était la nuit noire, car le dôme de feuillage qui recouvrait la place épaississait les ténèbres.

– Où faut-il creuser ? reprit Bobinow.
– À droite du piédestal.
– Bien, à l’ouvrage !
Et les trois bêches s’enfoncèrent dans le sol.
À partir de ce moment, les travailleurs fouillèrent la terre sans relâche. Quelque ardeur que mit Jack à ce labeur, il constata que ses compagnons déployaient une activité supérieure à la sienne. Ces êtres maigres, que l’on eût crus sans force, puisaient dans leur amour de l’or une vigueur surhumaine.
Le trou, long de six pieds, large de trois, s’approfondissait rapidement, et sur ses bords s’amoncelait la terre extraite par les terrassiers improvisés.
En deux heures, chose incroyable, on avait atteint la profondeur de 1 mètre 80 centimètres.
À ce moment, la bêche de Jack heurta un corps dur avec un froissement métallique.
Les travailleurs s’arrêtèrent net.
– La voûte annoncée !… la voûte ! bégaya Bobinow d’une voix frémissante.
– La voûte ! redit Déborah.
– La voûte ! répéta Jack, aussi ému qu’eux-mêmes, bien que pour une raison différente.
Mais cet arrêt fut de courte durée. Avec une âpreté nouvelle, l’avare se remit au labeur. La voûte rencontrée, il ne doutait plus de l’existence du trésor des Bab-el-Arba.
Bientôt la pierre apparut ; le fond de l’excavation fut déblayé.
Affolé, Bobinow s’était baissé ; il tâtait de la main les aspérités des moellons.
– Oui, oui, fit-il, c’est bien cela… Une voûte…, et solide encore. Il nous faudrait des pics pour attaquer cela.
Soudain il se frappa le front.
– Des pics, mais j’en ai tout un lot ; j’ai acheté cela autrefois à un ouvrier qui retournait en Europe ; un pauvre diable destiné à connaître la misère toute la vie… il m’a cédé cela au poids du fer.
L’avare riait en se rappelant ce marché avantageux ; rendu agile par la cupidité, il sortit de l’excavation, s’élança à toutes jambes vers la maison et revint peu après, chargé de plusieurs pics.
Sans prendre le temps de respirer, il s’arma de l’une des lourdes tiges de fer et attaqua la voûte.
Jack dut modérer son enthousiasme.
– Prenez garde. Nous sommes tout près du mur de la citadelle. Inutile de faire pareil bruit pour avertir le personnel que nous travaillons. Voyez-vous, cousin, que l’on nous surprenne, et que nous soyons obligés de payer à l’État la part de notre trouvaille prévue par la loi.
– Je suis fou, avoua Bobinow, fou, et, je le dis sans honte, si vous n’étiez là pour me conseiller, cousin Albaram, je me perdrais à force d’imprudence.
Et, broyant dans ses mains sèches celles du jeune homme :
– Quelle tête vous avez, mon cher garçon ! quelle tête ! À deux pas d’un trésor, vous demeurez aussi calme que si l’or était du charbon.
Jack ne répondit pas.
Avec précaution, il enfonçait un pic dans l’interstice de deux pierres de la voûte. Par petits mouvements, il pulvérisait le ciment jointif. Le père et la fille, comprenant aussitôt, l’imitèrent consciencieusement.
En peu de temps, plusieurs pierres furent descellées. Elles occupaient une surface telle, qu’une fois enlevées, elles laisseraient libre une ouverture suffisante pour qu’un homme y pût passer.
Il fallut des efforts inouïs pour arracher de son alvéole l’une des masses calcaires ; mais ce premier résultat obtenu, la besogne avança rapidement. À onze heures précises – Jack et ses compagnons le constatèrent en entendant sonner la grosse horloge dont la générosité britannique a doté la citadelle, – à onze heures, la première assise de pierres était enlevée.
Selon toute probabilité, il en restait une seule à percer.
Or, comme Jack recommençait la manœuvre qui avait si bien réussi tout à l’heure, un coup sourd retentit du côté de la maison.
Les trois personnages tressaillirent, échangeant des regards inquiets.
Un second coup plus violent ébranla l’air.
– C’est le marteau de la porte d’entrée ! balbutia Déborah d’une voix tremblante.
– Le marteau, reprit Bobinow… quelqu’un… une visite…
Jack pâlit. Une visite ! Un importun allait-il faire échouer sa tentative, à l’instant même où il croyait atteindre le succès ? Un troisième choc se produisit. Price le brun eut un grondement de rage.
– Au diable ! le nigaud va ameuter tout le quartier.
Puis, obéissant à une inspiration subite :
– Restez là, ordonna-t-il à ses pseudo-cousins… je vais éloigner l’importun.
Et, sans écouter leur réponse, il bondit à travers le jardin.
Il s’engouffra dans la maison au moment où, pour la quatrième fois le marteau ébranlait la porte.
Il s’élança en avant, ouvrit le judas percé au milieu du battant, et, d’une voix terrible, demanda :
– Qui va là ?
Un organe timide répondit :
– C’est moi je me suis échappé du lazaret où l’on enferme les voyageurs arrivant d’Europe…
– Allez au diable, vous et votre lazaret.
– Mais vous ne pouvez me laisser sans asile dans une ville que je ne connais pas, supplia-t-on du dehors… Je suis votre cousin, le jeune Albaram Coster.
Jack frissonna de la tête aux pieds. Celui dont il avait emprunté le nom était là, de l’autre côté de la porte… Vraisemblablement, il avait trompé la surveillance des gardiens attachés à sa personne par Armand Lavarède.
S’il entrait dans la maison, tout se découvrait et Robert était perdu.
Déjà dans le jardin, le sable criait sous les pas des avares, inquiets de l’absence de leur compagnon. Il n’y avait pas une seconde à perdre.
Du ton le plus menaçant qu’il pût prendre, Jack rugit :
– On ne se présente pas dans une maison honnête, la nuit venue. Passez votre chemin, sinon…
– Mon cousin !… gémit le visiteur.

– J’ai mon fusil… je vous tiens en joue. Disparaissez, ou je tire… Attention, je compte. Un… deux…
Le bruit d’une fuite précipitée parvint aux oreilles de Price le brun. Il était temps. Déborah faisait irruption dans le vestibule.
– Qu’est-ce ? fit-elle avec un trémolo dans la voix… vous vous querelliez… ?
– Non, non ; un drôle qui prétendait nous forcer à lui accorder l’hospitalité. Je l’ai menacé d’une balle et il s’est sauvé… Rassurez-vous, ma charmante cousine, et retournons à notre travail.
Ma charmante cousine ! La vieille fille chancela sous ces douces paroles ; elle oublia tout le reste, pour suivre docilement le premier homme qui eût eu l’idée bizarre de la nommer : charmante.
À Bobinow, Price le brun donna la même explication : un rôdeur qu’il avait renvoyé de belle façon !… et il reprit son épieu.
Le forage de la voûte recommença.
La pensée du trésor voisin obscurcissait l’intelligence des avares. En toute autre circonstance, l’histoire forgée par leur pseudo-cousin les eût étonnés ; mais là, dans ce trou, au fond duquel ils voyaient par avance s’amonceler le métal-roi, ils n’avaient plus la liberté de réfléchir, de raisonner, de discerner la vérité du mensonge.
Minuit ! la voûte est crevée. Un trou noir s’ouvre devant les travailleurs dont le front ruisselle de sueur.
Jack n’est pas moins ému que ses compagnons. Il se penche vers l’ouverture béante, il tend l’oreille. Aucun bruit. Est-ce que le prisonnier aurait été conduit dans un autre cachot ?
Rien ne décèle sa présence. Le silence et la nuit règnent en maîtres dans la fosse sombre.
Le jeune homme ne peut contenir son impatience.
– Une corde, dit-il haletant, une corde… je vais descendre.
Bobinow ne proteste pas ; il trouve juste que le faux Albaram soit le premier à contempler le trésor qu’il suppose être là.
Il a tout prévu. Un rouleau de cordages est déposé sur le sol du jardin. Il le prend, attache une extrémité du cordeau au milieu d’un épieu, place celui-ci en travers du trou creusé au sommet de la voûte.
Jack le remercie du geste ; il se couche à terre, saisit la corde à deux mains et se laisse glisser dans l’obscurité.
Ses pieds touchent le fond. Soudain ses poignets sont saisis comme dans des étaux.
– Pas un cri ! murmure une voix à son oreille ; c’est moi, Robert. Armand m’a fait prévenir de ce qui se préparait par un guichetier indigène. Vite… Appelez vos compagnons.
– Ce sont des ennemis.
– Je le sais, mais tout est préparé… Appelez-les, vite, vite… je tremble qu’une ronde ne nous surprenne.
Et Jack, dominé, emporté par la situation, s’écrie :
– Cousin Bobinow… le trésor ! le trésor !…
Il n’a pas besoin d’ajouter autre chose ; un corps passe aussitôt par la brèche de la voûte… l’avare descend comme un véritable gymnasiarque.
Il arrive au fond du cachot ; mais il n’a pas le loisir de poser une question. Un bâillon s’applique sur ses lèvres… il est jeté à terre, sent des fines cordelettes s’enrouler autour de ses chevilles, de ses poignets. Tout mouvement lui devient impossible, et, dans cet état, il est posé sur une méchante paillasse, lit sommaire des prisonniers dans la cellule 131.
Et Robert, qui l’a ainsi ficelé, revient à Jack.
– Montons.
Le jeune homme hésite.

– Là-haut, nous allons trouver la fille de cet homme.
– Peu importe… hâtons-nous… passez le premier.
L’accent de Lavarède est sans réplique. Price le brun obéit. Il grimpe avec l’agilité d’un chat.
Le voilà dans le jardin. Déborah se suspend à son bras.
– Eh bien !… vous avez vu ?… Votre rêve était véridique ?
Il n’a pas la peine de répondre. À son tour, Robert vient de bondir hors de la voûte éventrée. Plus rapide que l’éclair, il bâillonne la vieille fille demi-morte de peur. Il lui passe sous les bras la corde qui a facilité son ascension et la descend dans le cachot. Puis il lance dans les buissons cordeau et pic.
– En route !
Ainsi que des voleurs, le captif et son sauveur traversent le jardin au pas de course, entrent dans la maison, tirent les verrous, détachent les chaînes qui garnissent la porte.
Celle-ci s’ouvre. Ils sont dehors, libres.
Soudain une forme humaine se dresse devant eux. Qu’est-ce ? Voudrait-on les arrêter. Non. L’inconnu parle, ils le reconnaissent. C’est Armand Lavarède qui les attendait là pour les conduire vers la cachette qu’il a préparée.
– Ne parlons pas, dit-il, jouons des jambes ; c’est la grande éloquence des fugitifs.
Et il prêche d’exemple.
À sa suite, Robert et. Jack contournent la citadelle, traversent la place Runneleh, s’engagent dans les ruelles du Caire. Ils débouchent devant l’entrée du parc, de la villa Biggun.
En reconnaissant l’endroit, Jack s’arrête interdit ; mais Armand et Robert l’entraînent, avec ce seul mot :
– Venez.
Les voici entrés dans le parc. Ils atteignent le rond-point où le karrovarka repose sa lourde masse.
Jack se demande s’il rêve. Deux factionnaires anglais se promènent, le fusil sur l’épaule. Ils n’ont pas l’air de voir les nouveaux venus qui cependant ne se cachent point.
Nouvelle surprise. Deux femmes sortent d’un massif. Elles approchent. C’est Aurett, c’est Lotia, qui pressent les mains d’Armand, de Robert, de Jack. Et le journaliste se penche vers Price le brun.
– Ouvrez le panneau du karrovarka, puisque vous connaissez la manœuvre.
– Ouvrir… ?
– Oui, c’est là une voiture commode ; nous allons l’emmener, et du même coup priver les Anglais de leurs appareils de communication avec les éclaireurs Nilia.
Le jeune homme étouffe un cri de joie. Nilia aussi sera sauvée, elle échappera à la tyrannie du docteur Gorgius Kaufmann. Il appuie sur le ressort extérieur. L’échelle articulée se détend. L’escalade a lieu.
Trois minutes s’écoulent. Le rond-point est désert. Tous se sont engouffrés dans les flancs du karrovarka, dont l’échelle est rentrée, la trappe close.
Seuls les factionnaires anglais continuent leur promenade.
À l’intérieur, Jack guide ses compagnons.
Dans le second compartiment, Nilia est seule. Elle a une exclamation de frayeur à la vue de tout ce monde, mais Jack les présente :
– Des amis. Nous allons vous emmener loin de ceux qui vous tiennent captive. Vous serez libre au milieu de gens prêts à sacrifier leur vie pour la liberté.
Elle le reconnaît, se calme.
– Partons sans perdre une minute, dit, Armand. Il faut être loin quand on s’apercevra de notre départ.
L’appareil de direction est dans le premier compartiment ; tous y passent.
Il y a là un clavier avec des boutons sur lesquels sont inscrits des indications : Stop… Go ahead… Right… Left… Arrêtez… En avant… À droite… À gauche. Un hublot rond permet d’observer la route à parcourir.
– En avant ! s’écrie le journaliste en appuyant sur le bouton correspondant à ce mouvement.
Le karrovarka ne bouge pas. Armand appuie, appuie encore. Même immobilité. Qu’y a-t-il donc ? Tous se regardent avec inquiétude. Les visages sont pâles, les respirations haletantes.
Pour obliger la voiture à se mettre en marche, il existe sans doute un secret, et ce secret, tous l’ignorent.
Nilia, interrogée, ne sait pas. Armand insiste ; alors des larmes perlent le long des cils de la jeune fille.
– Je ne suis rien qu’une esclave captive et désolée, dit-elle. Je ne comprends pas que vous me questionniez. Est-ce que le docteur a jamais songé à me confier les mystères de cette voiture de fer.
Évidemment elle dit la vérité. Sa vie dans cette étroite prison est inexplicable. Bah ! on cherchera plus tard le mot de l’énigme. Pour l’instant, les minutes sont précieuses. Il faut partir, partir à tout prix. Ce serait absurde d’échouer au port, de se faire reprendre dans ce wagon, conquis à force d’adresse et de courage.
Mais toutes les tentatives sont vaincs. Rageusement, Armand frappe le clavier de direction. Peine perdue ; la lourde masse ne s’ébranle pas.
Soudain un bruit passe dans l’air, c’est un déclic métallique. Tous frissonnent.
– C’est lui, le docteur ! balbutie Nilia.
Et, se voilant la face de ses mains tremblantes :
– Il va se venger… se venger… plus d’espoir… !

CHAPITRE XII
LA FUITE AU DÉSERT
Tandis que Jack et ses amis travaillaient à l’évasion de Robert, lord Lewis Biggun, commandant les forces anglo-égyptiennes, présidait le banquet donné en son honneur par la colonie britannique du Caire.
Dans les luxueux salons de l’hôtel Shepheard – Shepheard’s hotel – d’immenses tables étaient dressées, ornées de fleurs multicolores, dont les parfums capiteux se mêlaient aux senteurs des condiments, artistement mélangés dans des sauces savantes, des mets inédits.
Tout ce que la ville comptait de notabilités commerciales, industrielles, financières, se mêlait, dans cette solennité, aux jurisconsultes, journalistes officiels et autres.
La joie rayonnait sur tous les visages ; les conversations se croisaient en fusées rieuses.
Tous ces Anglo-Saxons exultaient. Non seulement l’Égypte était courbée plus que jamais sous le joug, par la capture du chef avéré de la conjuration des patriotes, mais on allait infliger à la France, à l’ennemie héréditaire, un affront nouveau, en fusillant l’un de ses enfants.
Des noms passaient dans l’air, chers aux oreilles anglaises, attristants pour des Français : Fashoda, Bahr-el-Ghazal, commandant Marchand.
Évidemment, les assistants commentaient ironiquement la convention anglo-française signée au début de l’année 1899 pour le partage de l’Afrique septentrionale et centrale.
La mort prochaine de Robert Lavarède redonnait une pointe d’actualité à ces souvenirs du passé.
Marchand, ce héros, dont tous les peuples avaient admiré la marche audacieuse à travers le Congo, les fourrés de l’Oubanghi, les marécages du Bahr-el-Ghazal ; Marchand qui, sous la formidable menace de la marine anglaise, trois fois supérieure, en nombre et en tonnage, aux flottes de France, avait dû abaisser le drapeau tricolore hissé par lui à Fashoda ; Marchand, dont l’odyssée, en des temps plus héroïques, eût exalté la Muse des poètes et des musiciens, n’était pour ces Saxons triomphants qu’un vaincu ; son nom, jeté dans le brouhaha, était une raillerie pour la République, rien de plus.
Ce seul fait donne une idée du diapason auquel était montée l’outrecuidante vanité des membres de la réunion.
Aussi, lorsqu’au champagne, lord Biggun porta un toast-speech, les applaudissements retentirent frénétiques, ininterrompus, permettant à peine de percevoir quelques lambeaux de phrases :
– L’empire des mers… la toute-puissante Angleterre… Justes revendications… politique de coups d’épingles… Les Anglo-Saxons doivent être les maîtres du monde… civilisation… humanité… progrès.
Qu’importaient du reste les paroles ? Les assistants ne savaient-ils pas que le Sirdar glorifiait la patrie anglaise, les commerçants anglais, les soldats britanniques, tout ce qui avait l’honneur d’être sous la domination du royaume insulaire. De même qu’autrefois les Romains disaient la Ville, en parlant de Rome, de même les sujets de Sa Gracieuse Majesté diraient volontiers l’Île pour désigner leur pays, et le généralissime ne pouvait pas manquer d’être à l’unisson de ses compatriotes.
Les discours se succédèrent jusqu’à minuit. Alors on passa dans la salle de bal splendidement décorée d’étendards, de trophées d’armes et de fleurs.
Sur un socle de bois peint, un buste, exécuté par un sculpteur local, représentait lord Lewis Biggun, le front ceint de lauriers.
Car les Anglais, qui reprochent au bon peuple de France ses exagérations, en ont à l’occasion qui défient toute concurrence, de même que leurs caoutchoucs, gâteaux secs et cotonnades.
Un orchestre attaqua aussitôt de God save the Queen, que l’on écouta debout, et, l’hymne national achevé, les musiciens passèrent, sans transition, à une gigue entraînante.
Les virtuoses de cette danse se démenaient à qui mieux mieux, quand une jeune dame, ayant un instant fui le bruit sur la terrasse de l’hôtel, revint annoncer que les réjouissances avaient gagné la ville. Au loin, sur le plateau qui supporte la citadelle, on tirait un feu d’artifice.
La terrasse fut aussitôt envahie. Là-bas, en effet, des fusées traversaient la nuit, s’épanouissant en gerbes brillantes, se déployant au-dessus de la cité comme un gigantesque bouquet de feu.
Le Sirdar lui-même s’était joint aux curieux, satisfait de cette manifestation pyrotechnique inattendue.
Un domestique s’approcha de lui et tendit à Son Excellence une carte. Lord Biggun y jeta les yeux : il lut avec surprise :
Colonel ACHATES GARFIELD
commandant la citadelle du Caire
désire entretenir d’URGENCE le lord Généralissime.
Le mot « d’urgence » était souligné. Il fallait un motif grave pour que le colonel Garfield vînt troubler le Sirdar au milieu de la fête donnée en son honneur.
Aussi, sans hésiter, celui-ci demanda :
– Où est cet officier ?
– Dans un cabinet particulier, avec deux autres personnes qui l’accompagnent.
– Bien, conduis-moi.
Un instant plus tard, le général, s’étant glissé sans attirer l’attention hors de la salle de bal, pénétrait dans un petit salon dont il refermait la porte derrière lui.
Trois personnes étaient déjà dans la pièce : le colonel, et les victimes de Jack : Bobinow, sa fille Déborah.
– Qu’y a-t-il ? interrogea Biggun après les avoir enveloppés d’un regard.
Le commandant répondit d’une voix assourdie :
– Une grave nouvelle.
– Mais encore ?
– Le Français s’est évadé cette nuit.
Une rougeur ardente couvrit le visage du Sirdar.
– Le Français, répéta-t-il d’un ton rauque, vous ne voulez pas parler de ce Robert Lavarède… ?
– Hélas ! si… général.
– Lui ?… Mais vous en répondiez sur votre tête, colonel ?
– Aussi, déclara l’officier avec une soumission admirable, je vous apporte ma tête, mon général, bien qu’il n’y ait en rien de ma faute.
Garfield était un vieil officier, réputé pour sa valeur dans toute l’armée. Le Sirdar le savait bien. Évidemment il n’était pas coupable de négligence. Mais alors comment le chef des rebelles avait-il pu s’évader ?…
– La citadelle passe cependant pour une prison sûre… Voyons… expliquez-vous, Garfield… Tâchons de voir clair dans cette aventure, et de reprendre le fugitif, avant que le bruit de son évasion se soit répandu.
Le sang-froid, la décision, qui avaient fait placer lord Biggun à la tête de l’armée d’occupation, reparaissaient. Un instant il s’était départi de son calme, mais il était redevenu presque aussitôt le chef impassible, en qui tous avaient confiance.
– Il y a vingt minutes, fit brièvement l’interpellé, une ronde a pénétré dans le cachot 131, où avait été enfermé le prisonnier. Celui-ci avait disparu et, à sa place, se trouvaient ces personnes, ligotées, bâillonnées, à demi asphyxiées.
Il désignait Bobinow et Déborah.
Sans qu’il fût besoin de les questionner, les avares relatèrent leurs tribulations : le conte du trésor des Bab-el-Arba, car c’était un affreux conte, ils n’en doutaient plus et pour cause ; – puis le long travail de la nuit, la découverte de la voûte de pierre, les efforts surhumains pour la percer… et tout cela, tout cela pour faire le jeu des ennemis de l’Angleterre.
Déborah semblait plus furieuse que son père. La sèche et vieille fille était leurrée non seulement dans ses espérances cupides, mais encore dans ses projets matrimoniaux. Elle avait trouvé Jack gentil garçon, elle avait caressé le doux rêve de l’enchaîner par le mariage… Cruelle était sa déception.
Lord Biggun écoutait pensif. De toute évidence ces gens avaient été les complices inconscients des rebelles. L’acteur principal lui échappait… C’était un inconnu, cet Albaram Coster. Mais pourquoi ce garçon, un bon Anglais, avait-il fait tout exprès le voyage pour duper son cousin Bobinow ?
Il y avait là une chose incompréhensible… à moins que ce nom ne fût un déguisement.
Mais oui, la vérité apparaissait. Les révoltés avaient appris la venue d’Albaram… elle favorisait leurs projets, ils s’en étaient servis pour introduire l’un d’eux dans la place.
Ces réflexions se succédèrent avec la rapidité de l’éclair dans l’esprit du Sirdar.
L’important, à cette heure, était d’agir d’une façon foudroyante, de gagner le fugitif de vitesse, de faire en sorte que l’évasion et la capture du prisonnier fussent révélées ensemble au public.
Ceci posé, le général ordonna à Bobinow et à sa fille d’aller l’attendre à la villa Biggun ; Garfield mettrait sur pied la police, tandis que lui-même lancerait les régiments anglais sur la piste de Robert.
Le docteur Gorgius, mandé aussitôt, fut chargé de courir au karrovarka et d’obtenir du service Nilia les renseignements nécessaires à l’arrestation de Lavarède.
Et, laissant le bal, les invités qui dansaient sans soupçonner la gravité des circonstances, lord Biggun quitta l’hôtel Shepheard et courut lui-même chez les commandants des différents services de l’armée.
Une première désillusion l’attendait là. Les logis du major Archibald, du colonel Karrigan, du général Holson, du chef de l’artillerie O’Land, du maître du génie Mac Cardiff, de sir Thomas Beard, de Golder, de Leister étaient clos. Aux appels réitérés de Biggun, aux coups furieux dont il ébranla les portes, des serviteurs affairés accoururent. Tous répondirent la même chose :
– Leurs maîtres étaient sortis pour fêter le triomphe de l’Angleterre. Sans doute, ils ne tarderaient pas à rentrer.
À tous, le Sirdar donna la même consigne : prier les officiers de se rendre sans retard, dès leur retour, à la villa Biggun.
Enrageant de ce contretemps, il revint lui-même à son habitation. Qu’eût-il dit s’il avait appris qu’aucun de ceux qu’il espérait bientôt voir n’avait quitté son logis. À cette heure, tous dormaient d’un sommeil profond, lourd, invincible, causé par les soporifiques dont leurs serviteurs indigènes avaient assaisonné leurs mets ?
Qu’eût-il dit, s’il fût revenu sur ses pas, en constatant, qu’aussitôt après son départ, ces serviteurs avaient quitté les demeures des officiers, en avaient soigneusement refermé les issues et s’étaient élancés dans les rues sombres et étroites de la vieille ville ?
C’était comme un mot d’ordre auquel tous obéissaient.
Lord Biggun ne soupçonna même pas cela. À grands pas, il regagnait la villa.
Il y pénétra par la porte du parc. Il voulait passer près du karrovarka. Il interrogerait Gorgius Kaufmann ; ce serait du temps de gagné. Chaque minute augmentait les chances de Robert fugitif, diminuait celles du généralissime.
La nécessité de faire vite s’imposait.
Mais, en arrivant au rond-point, où stationnait auparavant le chariot de l’Allemand, le général se frotta les yeux.
Le karrovarka avait disparu.
Biggun chercha les factionnaires préposés à sa garde. Ils n’étaient plus là.
Alors il s’abandonna à la colère, frappa du pied, invectiva la terre et le ciel. Gorgius serait mis aux fers, le poste de garde passerait en conseil de guerre, les officiers supérieurs seraient dégradés.
L’écho répétait ses imprécations en modulations ironiques.
Le Sirdar eut honte de son emportement. La vertu primordiale d’un commandant de troupes est le calme. C’est par là seulement que l’on domine les masses… Le calme en effet suppose la certitude ; l’irritation donne au contraire l’idée de l’indécision, de la volonté hésitante et troublée.
À pas lents, pour donner à son sang bouillonnant le loisir de reprendre son cours normal, lord Biggun se dirigea vers les bâtiments de la villa.
Il ne se figurait point qu’à cet instant même, le karrovarka roulait à toute électricité sur la route qui longe le Nil, au sud du Caire.
Gorgius, venu pour interroger Nilia, son intermédiaire avec les agents de son service de renseignements, était tombé au milieu des Français qui avaient envahi sa demeure roulante.
Saisi par Armand et Jack, il s’était résigné, sous une menace de mort, à indiquer le levier caché qui déterminait la mise en mouvement de l’appareil. Et le chariot-barque était parti.
Les sentinelles anglaises s’étaient alors dépouillées de leurs vêtements militaires. De la tunique britannique avaient surgi des Égyptiens au teint de bronze, lesquels, couverts seulement d’un caleçon et d’une blouse de toile, s’étaient élancés par les rues emportant leurs armes.
Voilà pourquoi le généralissime avait cherché vainement factionnaires et wagon au rond-point du parc.
Mais les surprises devaient se succéder dru ce soir-là.
Dans son bureau-salon, lord Biggun rencontra Bobinow et l’éplorée Déborah, flanqués d’un grand garçon rougeaud, à l’air effaré, que le commissaire central de police en personne avait amené en cet endroit.
– Le nommé Albaram Coster, fit gravement le fonctionnaire. On l’a arrêté cette nuit, comme il vaguait par la cité. Averti tout à l’heure seulement, j’ai pris sur moi de vous l’amener sans retard.
– Ce n’est pas lui qui nous a bernés, clamèrent en duo Bobinow et sa fille. Ce n’est pas ce pauvre garçon.
– Bien certainement non, ce n’est pas moi, déclara Albaram ; je crois même que l’un s’est joué de moi-même plus que de personne. Je débarque à Boulaq ; des gens très polis m’invitent à les suivre. J’obéis. On m’enferme dans une maison. C’est, me dit-on, un lazaret où les voyageurs sont internés pendant vingt-quatre heures, afin de ne pas propager les épidémies extérieures. Je proteste, on me verrouille. Au soir, je parviens à sauter par la fenêtre… les sports athlétiques m’ont rendu habile à tous les exercices du corps. Je m’enquiers auprès des passants ; on m’indique la demeure du cousin Bobinow. J’y vais, je heurte à la porte. Une voix terrible me crie : Passez au large ou je vous tue comme un lapin. Toute insistance de ma part eut été déplacée… je m’enfuis… Des agents de police me prennent pour un voleur. Ils m’arrêtent et me mènent en prison. Enfin l’on me tire de mon cachot. J’arrive ici… une femme, à l’audition de mon nom me saute à la figure et me griffe, tandis qu’un homme me bourre de coups de poings. C’étaient mon cousin Bobinow et ma cousine Déborah. Nous nous sommes expliqués après. Ils m’ont affirmé que j’étais victime d’un malentendu, que leurs brutalités ne s’adressaient pas à moi ; cependant j’ai le visage écorché, le dos meurtri, et je trouve que dans la capitale de l’Égypte on a une façon peu avenante d’accueillir les étrangers.
Albaram avait parlé tout d’une haleine, sans que le Sirdar songeât à l’interrompre. Ainsi il ne s’était pas trompé ; un ami des Français avait pris la place de l’infortuné Coster.
Le plan des adversaires d’Albion se déroulait nettement devant les yeux du lord. On avait séquestré Albaram, pour laisser les coudées franches à son sosie… mais celui-ci, quel était-il ?
Comme il réfléchissait, des clameurs retentirent dans la maison. Le Sirdar sursauta.
– Qu’est-ce encore ? fit-il à haute voix.
La porte s’ouvrit, brutalement poussée, et plusieurs officiers d’ordonnance entrèrent pâles, bouleversés.
– Général, crièrent-ils… les hommes de garde…
– Eh bien, quoi… les hommes de garde ?
– Morts…
– Morts… ? Vous êtes fous.
– Non, tous, tous, assassinés. Le poste ruisselle de sang.
Un lourd silence succéda à l’énoncé de cette funèbre nouvelle.
Le commandant en chef avait chancelé. Son regard s’était voilé, comme si son énergie était vaincue par l’audace de ce crime commis dans sa propre maison.
Et tout à coup un frisson secoua tous les soldats réunis dans la salle.
Au loin un son de cloche venait de vibrer dans l’atmosphère… Il se renouvela, s’enfla, jetant aux échos les notes lugubres du tocsin.
– Le tocsin ! murmurèrent les assistants avec une angoisse douloureuse.
Dans une autre direction, le tocsin retentit encore, puis une troisième, une quatrième cloche lancèrent leur plainte bourdonnante.
– Que se passe-t-il donc ? bégaya le Sirdar, bouleversé par ces glas qui semblaient partir de tous les coins de la ville.
Il ouvrit une fenêtre, se pencha au dehors.
Les sons devinrent plus clairs ; chacun des gémissements du bronze des cloches s’engouffrait dans la salle, faisant frissonner les officiers, le commissaire, les pseudo-cousins de Jack.
Puis la voix perçante des muezzins tomba, nasillarde et mystique, du haut des minarets élancés.
Eux aussi criaient les paroles d’alarme. Muezzins musulmans, ou cloches catholiques exprimaient la même pensée de terreur, le même danger, d’autant plus terrible qu’il était inconnu.
À son tour, la campagne environnante paraît s’animer. Des détonations violentes éclatent de toutes parts. Des éclairs rouges traversent la nuit. Quel cataclysme frappe donc la terre d’Égypte ?
Puis des ombres affolées envahissent le parc.
Ce sont des soldats éperdus. Des cavaliers, dont les chevaux ne sont plus en état de faire campagne, car des mains invisibles leur ont coupé les jarrets ; des artilleurs dont les pièces de canon ont été enclouées ; des fantassins auxquels on a volé leurs cartouches.
Tous se lamentent, appellent le général pour qu’il les rassure, qu’il les reforme, qu’il les conduise à l’ennemi dont ils se sentent entourés.
Et le tocsin s’affaiblit, s’éteint ; la voix des muezzins se tait. Seules les explosions continuent, mais elles s’éloignent, s’éloignent encore.
Pétrifié, les pieds cloués au sol, les cheveux hérissés, le Sirdar se croit le centre d’un cauchemar immense, d’une hallucination géante.
Il est dominé par quelque chose qu’il ne comprend pas, mais qu’il devine grandiose, tout-puissant, irrésistible.
 Il a
raison. Au signal donné par le feu d’artifice tiré sur la colline de la
citadelle, ce feu qu’il a pensé allumé à la gloire de l’Angleterre, tous les
indigènes sont sortis de leurs maisons. Marchands coptes, prêtres musulmans,
Nubiens fétichistes, Soudanais, Abyssins, fellahs se sont mis en marche à
travers la ville, suivis de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs serviteurs.
Ils ont gagné la campagne, et maintenant, sur les routes, les chemins, les
sentiers c’est un fourmillement de gens. Tous se dirigent vers le désert.
Derrière eux, des mines préparées à l’avance sautent, ouvrant dans le sol des
cratères, qui projettent vers le ciel, dans un épanouissement flamboyant, des
quartiers de rocs, des arbres, des débris de toute espèce.
Il a
raison. Au signal donné par le feu d’artifice tiré sur la colline de la
citadelle, ce feu qu’il a pensé allumé à la gloire de l’Angleterre, tous les
indigènes sont sortis de leurs maisons. Marchands coptes, prêtres musulmans,
Nubiens fétichistes, Soudanais, Abyssins, fellahs se sont mis en marche à
travers la ville, suivis de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs serviteurs.
Ils ont gagné la campagne, et maintenant, sur les routes, les chemins, les
sentiers c’est un fourmillement de gens. Tous se dirigent vers le désert.
Derrière eux, des mines préparées à l’avance sautent, ouvrant dans le sol des
cratères, qui projettent vers le ciel, dans un épanouissement flamboyant, des
quartiers de rocs, des arbres, des débris de toute espèce.
Ce sont les digues, les canaux d’irrigation qui s’écroulent, qui se comblent !
Et c’est ainsi tout le long du Nil, du Caire à Khartoum.
Des feux, allumés sur les sommets de la chaîne Lybique, ont annoncé au peuple égyptien que les patriotes ont reconquis leur chef, que l’heure de la lutte suprême va sonner.
Sur une étendue de 1.500 kilomètres, les citadins quittent les villes ; les paysans délaissent leurs chaumières ; les bateliers s’éloignent de leurs bateaux amarrés aux berges de sable doré.
C’est l’exode en masse des opprimés. Ils veulent être libres ou périr. L’Angleterre a occupé l’Égypte ; qu’elle la garde dévastée, stérile, son réseau d’irrigation détruit ; qu’elle la garde sans habitants ; qu’elle fasse tourner dans le vide les formidables pièces de ses tourelles pivotantes. L’âme égyptienne s’en va avec son peuple dans les solitudes où l’appelle le chef choisi par tous.
Et comme le Sirdar écoute encore, du fond de l’obscurité, protectrice des bandes fugitives, arrive comme une mélodie guerrière.
Il prête l’oreille et, avec une stupeur terrifiée, il reconnaît la chanson martiale qui l’a tiré du sommeil au fortin de Keneh, alors que la mouche, cette mouche du désert dont il a peur à présent, avait été tatouée sur sa face.
Il lui semble entendre la dernière strophe :
Tire le pied, courbe l’échine,
Tu joindras l’ennemi bientôt.
Alors, plus besoin de cantine,
Car la parole est au flingot.
Ils sont là-bas, ses ennemis, ceux de l’Angleterre, et il ne peut les atteindre. Le Sirdar se tourne vers ses officiers, aussi bouleversés que lui-même. Il veut leur parler, leur rendre le courage ; mais la voix s’étrangle dans sa gorge, les idées se brouillent dans son cerveau, et il réussit seulement à prononcer un mot, un mot qui sonne plus lugubre, plus menaçant encore que le chant de marche des ennemis :
– Malheur !
La lutte sans merci allait commencer.
FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.
DEUXIÈME PARTIE
LA GUERRE DE L’EAU

CHAPITRE PREMIER
LE BAHR-EL-GHAZAL
Un immense marécage s’étend à perte de vue, sur un territoire vaste comme la France, constamment inondé par le Nil Blanc venu des grands lacs africains et par le lacis serré de rivières qui forment le Bahr-el-Ghazal.
Le sol est plat. Aucune pente. Les eaux y séjournent, hésitant longuement avant de choisir leur route.
Elles ont pris le chemin du Nord. Elles auraient pu tout aussi bien se déverser dans le Congo et venir se perdre dans les îlots verts de l’Atlantique, au lieu d’aller se noyer dans la vague bleue de la Méditerranée.
Alors, l’Égypte, insuffisamment arrosée, n’aurait pas eu son histoire grandiose. Elle eût été la fausse continuation du Sahara, nourrissant à grand’peine de rares tribus de Bédouins nomades.
Aujourd’hui encore, l’Égypte est à la merci de quelques milliers de travailleurs qui, en peu de semaines, rejetteraient la masse énorme des eaux amenées par le Nil Blanc et le Bahr-el-Ghazal dans l’impétueux Congo.
C’est pour cela que l’Angleterre a voulu Fashoda, pour cela qu’elle a étendu sa domination jusqu’aux grands lacs, remontant sur plus de 5.000 kilomètres le cours berceur du fleuve sacré.
Pour le grand peuple mercantile, l’Égypte est un coffre-fort bondé de richesses ; le marais du centre africain en est la clef. Tout naturellement Albion l’a voulu prendre.
Le pays a une valeur politique, rien de plus. Il faudrait sacrifier des millions d’existences humaines, et de l’or par milliards, pour l’assainir. Cela ne saurait rapporter aucun bénéfice, mais c’est le réservoir qui nourrit et féconde les champs des fellahs. Cette eau qui dort là est la fortune, la vie même de l’Égypte.
Triste pays. Partout des lagunes, des canaux s’embranchant à l’infini ; ceux-ci, encombrés d’herbes aquatiques, de roseaux, de bambous hauts de six et sept mètres ; ceux-là, sans végétation, étalant, sous les rayons torrides du soleil, leur surface immobile aux tons plombés.
Des îlots solides, sablonneux ou calcaires, que borde une frange de vase, émergent, tantôt agglomérés en archipels, tantôt séparés par de véritables lacs. C’est là que les crocodiles, les hippopotames, les buffles aux cornes recourbées, se reposent en maîtres absolus de la région désolée, gardée contre les empiétements de l’homme par la fièvre pestilentielle.
C’est dans ce dédale que l’héroïque commandant Marchand guida naguère ses compagnons.
C’est là que Robert Lavarède vit maintenant avec son cousin Armand, avec Aurett, Lotia, Nilia, Jack et tous ceux qui ont fui l’Égypte, par haine de l’oppresseur.
Sur une étroite langue de terre qu’entourent de tous côtés des canaux resserrés eux-mêmes entre d’innombrables îlots, le chef de la révolte égyptienne et ses amis sont campés.
Robert et Armand sont debout à la pointe extrême du sol ferme, ils regardent le spectacle qui se déroule sous leurs yeux.
Il est curieux.
Le marécage offre l’aspect affairé d’une fourmilière humaine.
Des radeaux, des pirogues à fond plat, très relevées de l’avant, le sillonnent incessamment. Ces embarcations sont chargées de noirs, de blancs, de guerriers dont la peau présente toutes les couleurs revêtues par l’humanité africaine.
Tous sont munis d’outils : bêches, pioches, pics, pelles ; les uns de fabrication européenne, les autres, plus grossiers de forme, dus à l’industrie locale.
Ce sont les équipes de travailleurs qui vont relever celles dont la tâche quotidienne est achevée.
En cinq semaines, sous l’impulsion du patriotisme, du désir de la liberté, ces hommes ont accompli un labeur de géants.
Un immense barrage a arrêté les eaux du Nil Blanc et du Bahr-el-Ghazal, les a fait refluer sur le plateau central, à l’autre extrémité duquel cent mille soldats de Robert leur ont creusé des écoulements vers le Congo.
Parmi les barques et les planchers flottants, des hommes glissent rapidement à la surface des canaux. Ceux-ci ont aux pieds des raquettes assez semblables à celles dont se servent les Scandinaves pour marcher sur la neige. Seulement ces appareils sont agrémentés d’une chambre à air, analogue aux pneumatiques des bicyclettes, qui repose sur l’eau.
– C’est admirable, ces « souliers à eau », remarque Armand Lavarède désignant du doigt un des coureurs qui en sont pourvus. Le miracle de l’homme marchant sur l’élément liquide est réalisé…
– Grâce aux recherches de M. Aubry, répondit son cousin ; de cet inventeur tenace, qui, en dépit des railleries dont les ignorants ne sont jamais avares, a poursuivi ses expériences sur les côtes de la Manche et a réussi à démontrer que, même par une forte houle, son appareil permettait de se maintenir aisément à la surface de l’eau.
– Hourra pour Aubry ! Nous, nous sommes des croyants… à preuve que…
– Les souliers à eau nous rendent de grands services dans ce pays aquatique. Sans eux, nous aurions été fort empêtrés.
– Enfin, le plus fort est fait. Dans huit jours, le Nil Blanc, le Bahr-el-Ghazal ne couleront plus vers le nord. Si l’empereur Ménélik, ainsi qu’il l’a promis, détourne de son côté le Nil Bleu, de façon à le rejeter dans l’océan Indien, le pays deviendra inhabitable de Fashoda à Berber. C’est-à-dire que les Anglais devront reculer de plus de mille kilomètres, sans avoir livré bataille. Un pareil succès aura sur nos soldats un effet moral considérable. De plus, en éloignant le moment de la rencontre décisive, j’augmente la cohésion, la discipline de nos troupes. Je n’avais, il y a deux mois, qu’une cohue formée de tous les peuples de la vallée du Nil. Seuls les régiments égyptiens avaient une organisation militaire. Grâce à eux, j’ai pu former des cadres solides, et maintenant les Nubiens, les Derviches, les Congolais, tous enfin, comprennent les avantages des formations européennes. Quelques semaines encore, et tu verras ce que peuvent faire ces soldats du continent noir. Les armes nous arrivent sans cesse. Toute notre infanterie va être munie de fusils… l’artillerie laisse à désirer, mais bah ! les Anglais ont des canons, nous les prendrons.
Le Français relevait fièrement la tête en parlant ainsi. Il n’était plus le touriste souriant et paisible. Avec les grands devoirs acceptés, il s’était élevé au-dessus de lui-même, il était devenu le généralissime songeant à tout.
Mais Armand, lui, n’avait pas changé ; il était demeuré le journaliste parisien railleur et insouciant.
À l’affirmation de son cousin, il éclata de rire.
– Tu les prendras, les canons, si tu arrives jusqu’à eux… moi aussi, j’en prendrai… Par exemple, je ne vois pas comment nous les atteindrons.
Et Robert l’interrogeant du regard :
– Ma foi, tu transformes les rives du Nil en désert. Les Anglais, privés d’eau doivent se retirer, c’est parfait. Mais toi, comment les poursuivras-tu avec le million d’hommes rassemblés autour de toi ? L’eau manque pour eux comme pour nos ennemis.
– Tu te trompes, elle ne manquera pas pour nous.
À cette réplique inattendue, Armand laissa échapper un geste de surprise.
– Parbleu, maugréa-t-il, c’est plus fort que de présenter une vessie pour une lanterne, tu retires l’eau et elle ne te manque pas ?
Agacé par le sourire de son cousin, il reprit :
– Tu vas m’expliquer cela.
Mais Robert secoua la tête.
– Non. Demain nous partirons en expédition et tu verras par toi-même.
– De la discrétion…
– Un général doit en avoir à revendre.
Le Parisien éclata de rire.
– Ah çà ! tu te prends pour un général sérieux !
Son hilarité cessa comme par enchantement. Le fiancé de Lotia était devenu grave. Ses yeux dardaient sur son interlocuteur un regard plein d’une autorité étrange.
– Je pourrais te répondre que tout Français est un soldat dont le sac contient les étoiles du généralat… cela ne te convaincrait pas peut-être. Aussi ajouterai-je qu’ici je ne combats pas seulement avec mon esprit, mais avec mon cœur.
Et doucement, avec une conviction pénétrante :
– Depuis que nous avons quitté le Caire dans le karrovarka, depuis que nous avons abandonné le docteur Gorgius Kaufmann à quelques kilomètres de la ville, j’ai beaucoup réfléchi. J’étais un peu effrayé du rôle grandiose que m’imposaient les circonstances. Moi, ancien caissier de la maison Brice et Molbec, fabrique d’instruments d’optique, devenu commandant de centaines de mille hommes ; un petit employé chargé de balayer devant lui les troupes du plus puissant des peuples civilisés. Heureusement les exemples historiques m’ont rendu la confiance. Si la France est grande parmi les nations, c’est à son cœur, prêt à battre pour les nobles idées, à son cœur seul qu’elle le doit.
Du coup, le journaliste eut un haut-le-corps.
– Oh ! oh ! Voilà du nouveau !…
– Tu doutes, écoute donc. La France est envahie, les armées anglaises attaquent de toutes parts la monarchie chancelante. Un effort encore et le nom français est rayé de l’histoire. Alors apparaît Jeanne d’Arc, la bonne Lorraine. Rend-elle nos gentilshommes plus lettrés, leur apporte-t-elle des connaissances militaires plus étendues. Point. Elle exalte leur cœur, voilà tout. Elle leur dit : Je marcherai en avant avec ma bannière, suivez-moi. Les Anglais victorieux sont refoulés, anéantis, dispersés. La France est sauvée parce qu’elle a aimé l’humble héroïne qui a offert « tout le sang de son cœur pour le triomphe des opprimés ». Toujours, aux heures dangereuses, il en est de même ; une figure de femme est là, bonne ou mauvaise, faisant palpiter de tendresse ou de haine l’âme française. Te citerai-je encore Jeanne Hachette de Beauvais, Suzanne Didier, la fermière lorraine de Villedieu qui, en 1870, permet, au prix de sa vie, à nos soldats d’échapper à l’ennemi. Tu les connais comme moi. À mon tour, j’ai Lotia. C’est elle, c’est sa foi dans le succès qui ont transformé ton cousin en général. Sous le regard de ses grands yeux, une révolution s’est opérée dans mon esprit. France et Lotia, devise sainte et tendre, m’a fait donner tout ce qu’il y avait de volonté, de dévouement en mon être. Demeuré à Paris, je n’aurais jamais soupçonné de quoi j’étais capable. Le devoir est venu, il m’a pris par la main ; et soudain mon horizon s’est élargi… la carte du bassin du Nil s’est animée, j’ai compris dans un éblouissement quelles ressources de guerre la nature mettait à ma disposition, je me suis découvert des trésors d’imagination militaire… Une fois de plus le cœur français a fait un général.
Cela était dit si simplement, qu’Armand se sentit ému. Il tendit la main à son interlocuteur.
– Alors tu as résolu la question de l’eau ?
– Oui.
– Et tu me mettras à même de partager ta confiance ?
– Nous partirons demain.
– Bien. En attendant, retournons auprès de nos amis.
Les deux cousins abandonnèrent leur poste d’observation et revinrent vers le milieu de l’îlot.
Près d’une vaste tente circulaire, Aurett, Lotia et Nilia étaient assises. Jack, installé en face d’elles, discourait avec animation, au grand plaisir apparent de Hope, qui imitait ses moindres gestes.

Sans doute, la discussion était vive, car les chefs de l’insurrection purent approcher du groupe sans être remarqués.
– Parfaitement, disait Price le Brun, la race anglaise m’a fourni une bonne mère, des amis dévoués ; elle m’a octroyé l’instruction. Je serais un ingrat si je portais les armes contre elle.
– Alors, interrompit malicieusement Lotia, que faites-vous ici ? Je suis le drapeau français qui flotte sur la tente du général.
– Et quand ce drapeau marchera à la rencontre des troupes britanniques ?
– Je le suivrai encore.
Les jeunes femmes sourirent, et la fiancée de Robert, décidément en veine de taquinerie, demanda :
– Vous combattrez donc vos anciens… compatriotes ?
Mais Jack secoua la tête :
– Point du tout. Mon devoir est d’accompagner l’étendard tricolore et de lui faire un rempart de ma poitrine. Cela je puis l’exécuter sans frapper l’ennemi, auquel je suis attaché par les liens de la reconnaissance. Pour toute arme, j’aurai une badine. Ainsi, j’espère, je satisferai à l’honneur. J’offrirai ma vie par patriotisme, et je ne chercherai pas à la défendre, par gratitude.
Il s’arrêta interdit.
Robert s’était avancé et, lui appuyant affectueusement la main sur l’épaule, avait dit d’un ton grave :
– Bien, Sir Jack, vous avez parlé en homme de cœur et vous agirez en tout comme vous le jugerez convenable.
Puis doucement :
– Je suis heureux de vous voir parmi nous, – et se tournant vers Armand : – Encore une recrue à l’appui de mes dires ; nous en sommes redevables à mademoiselle Nilia.
La jeune fille rougit. Elle esquissa un geste de dénégation, mais Robert ajouta vivement :
– Ne vous défendez pas… Il est entendu que, tout comme nous, vous ne comprenez rien aux récits de notre ami Jack. De vos conversations avec lui, vous n’avez conservé aucun souvenir. Il y a là un mystère que nous éclaircirons un jour.
– En tout cas, fit Aurett en souriant, Nilia n’a pas à se plaindre de l’aventure. Elle est libre…
– Et, s’écria la jeune fille avec effusion, j’ai trouvé en vous la plus aimante, comme la plus jolie des amies. Il y a deux mois, j’étais une véritable sauvage, ignorante de tout. Vous avez pris à tâche de faire de moi une femme. Vous m’enseignez ce que je ne sais pas. Il me semble qu’au sortir d’un horrible cauchemar, je me promène dans un rêve fleuri.
Aurett lui saisit les deux mains.
– Le seul qui soit digne de vous, Nilia.
– Et rêve est le mot juste, ajouta Armand, car le paysage réel est plutôt désolé.
L’ex-captive de Kaufmann secoua sa jolie tête.
– Vous ne connaissez pas la longue captivité, sans cela vous comprendriez que rien ne saurait me paraître laid. Le grand ciel bleu, les eaux dormantes où le soleil pique des passementeries d’or, les hauts bambous jaunes et verts, tout cela me ravit, m’enchante… et vous êtes tous si bons pour moi.
Elle est émue en parlant ainsi. Ses doux yeux sont voilés par un brouillard humide.
Et Robert lui tend la main.
– C’est égal. Miss Nilia, une petite distraction n’est pas à dédaigner. Demain, nous partirons tous en expédition. La dernière promenade à travers les marais. Après cela nous n’aurons plus qu’à marcher contre les oppresseurs de l’Égypte.
– Où irons-nous ? demanda curieusement la jeune fille.
– À Tamboura, le premier poste que naguère le commandant Marchand établit sur le Soueh, l’un des innombrables cours d’eau qui forment ces marécages du Bahr-el-Ghazal.
– Pourquoi ?
– Oh ! ce n’est pas afin de visiter le poste. Dès longtemps, il a été abandonné ; mais nous y verrons… des potiers.
– Des potiers ?
Robert a un long regard pour Lotia, qui sourit.
– Cela vous intéressera, n’en demandez pas davantage.
Puis, changeant de ton :
– À propos. Vous ne vous doutez certainement pas que, sur les bords de l’îlot où nous campons en ce moment, le capitaine Baratier, l’héroïque compagnon de Marchand, faillit périr.
– Ici ? se récrièrent les jeunes femmes, se levant à demi.
– Ici même.
– Comment ?
– Je vais vous le conter.
Et, après une pause, moyen habituel des narrateurs soucieux de fixer l’attention :
– Baratier était parti du fort Desaix, sur le Soueh, pour reconnaître les marais jusqu’au Nil. Son but était de jalonner la route que devait suivre le gros de la mission Congo-Nil. Dans un boat, un bateau plat, avec quelques tirailleurs soudanais et pagayeurs noirs, il allait sur ce désert d’herbes, de bambous, de roseaux. La faim le tourmentait ainsi que ses compagnons.
– Braves gens ! grommela Armand.
– Qui dit le contraire ? poursuivit Robert. Donc, ils arrivent en ce point, là… le long de l’îlot. Au milieu du canal, un hippopotame s’ébrouait. Un hippopotame, c’est-à-dire mille à douze cents kilogrammes de viande !… Quelle tentation pour des affamés ! Aussi, vlan !… un coup de feu part. L’animal blessé a un soubresaut, puis, fou de douleur et de rage, il se rue sur le bateau, implante ses dents solides dans le bordage et secoue furieusement l’embarcation. Baratier était debout à ce moment. La violence du choc lui fit perdre l’équilibre. Il tombe à l’eau. Oh ! rassurez-vous, il a pied… mais le fond est formé de vase molle dans laquelle il enfonce. Il tend les bras pour se retenir, s’accrocher à quelque chose. À sa portée, se trouve un tronc d’arbre ; il s’y cramponne. Horreur ! cela remue… l’arbre est un crocodile qui dormait. Par bonheur, un tirailleur qui s’est glissé jusqu’auprès de l’hippopotame, lui loge une balle dans le crâne… la détonation effraie le saurien qui s’enfuit, et Baratier peut remonter à bord du boat. C’est ici, ou nous sommes assis, que fut dépecé et dévoré en grande partie l’hippopotame occis dans ces circonstances émouvantes.
La conversation devint générale. Tous avaient présents à la mémoire des épisodes de la marche prodigieuse (7.500 kilomètres) accomplie par la mission Marchand à travers le continent noir, de Loango, sur l’Atlantique, à Brazzaville, Bangui, Zemio, N’Booma, Tamboura, Fort-Desaix, Fashoda, Harrar et Djibouti sur l’océan Indien.
Tous se souvenaient de la formidable comédie guerrière, à l’aide de laquelle l’Angleterre avait amené la France à abandonner les territoires conquis pour elle par cette poignée de héros : Marchand, Baratier, Germain, Mangin, Gouly, de Prat, Monis, Largeau, Émily, Landesson, accompagnés par deux cents Sénégalais-Soudanais, nos frères noirs, dont le courage et le dévouement sont au-dessus de tout éloge.
Ils éprouvaient une émotion poignante en songeant que, instruments de la justice immanente, ils allaient, eux, essayer de venger la défaite infligée à la mission Marchand.
La ruse britannique avait voulu vaincre les Français afin de s’approprier la vallée du Nil ; aujourd’hui, d’autres Français étaient venus ; ils avaient ravagé cette vallée, entraîné les habitants à leur suite, engagé une guerre sans merci pour chasser les conquérants.
Leurs pensées ainsi déviées, ni le curieux journaliste, ni la gracieuse Nilia ne songèrent plus à interroger Robert au sujet des mystérieux potiers dont il avait parlé.
Au soir, des sons de trompe retentirent sur les lagunes.
C’était le signal invitant les travailleurs au repos.
Le campement nocturne fut dressé ; les blancs se glissèrent sous d’épaisses moustiquaires, car des légions de maringouins, altérés de sang, s’élevaient en un nuage bourdonnant, au-dessus des roseaux.
Puis le jour reparut.
De nouveau, les trompes sonnèrent le réveil, et le marécage se peupla de pirogues et de coureurs munis des aqua-raquettes.
Déjà Robert Lavarède était debout.
Un bateau à fond plat, auquel ses extrémités très relevées donnaient un air de gondole, attendait le long de l’îlot.
Les rameurs étaient à leur poste.
Bientôt Aurett, Lotia, Nilia sortirent de leur tente, roses et souriantes comme l’aurore, alors qu’à son réveil, elle fait glisser ses rideaux de buée matinale.
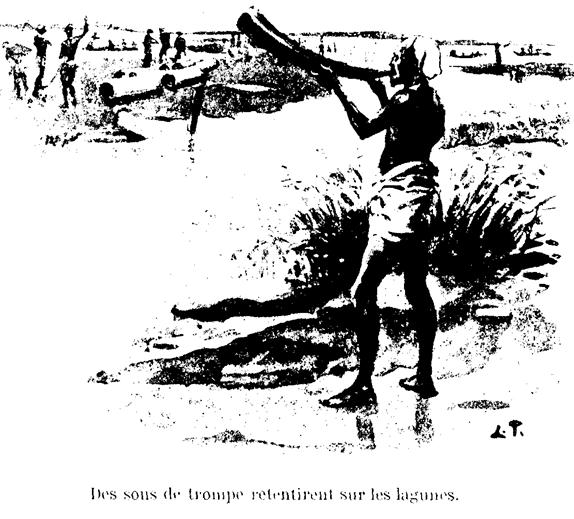
Armand, Jack et l’inévitable Hope les rejoignirent bientôt. Sur un ordre de Robert, tout le monde prit place dans l’embarcation qui emporta ses passagers à toute vitesse.
Durant cinq jours, on navigua ainsi, traversant des canaux, des marigots des lacs, campant la nuit sur des îlots de vase sèche ou de sable ; mais sans être arrêté jamais par les barrages herbeux, contre lesquels, jadis, la mission Marchand avait eu à lutter si péniblement.
C’est que depuis trois mois, un million d’hommes avaient travaillé à assurer des voies faciles dans le désert d’eau.
Partout on rencontrait des équipes de noirs, commandées par des soldats, qui faisaient autrefois partie des troupes égyptiennes.
Partout, les Français le constataient avec une profonde satisfaction, régnait une discipline sévère.
L’armée de la liberté serait bientôt en état de prendre l’offensive.
Ainsi on gagna la rivière Soueh et l’on remonta jusqu’à Tamboura.
Tout le long de la route, la pirogue des voyageurs avait croisé des chalands pesamment chargés, et, comme Armand s’était demandé à haute voix, – façon adroite d’obtenir une réponse, sans paraître la solliciter – à quels transports pouvaient bien se livrer tous ces bateaux, Robert avait répliqué :
– Tu verras.
Phrase qui horripilait son cousin, car rien n’est plus fâcheux, on en conviendra, que d’être curieux et de ne pouvoir satisfaire sa curiosité.
À Tamboura, une surprise attendait les compagnons du général Robert, fiancé de Lotia.
Un véritable port sec avait été établi sur les deux rives du Soueh.
De nombreux chalands étaient amarrés en face, et une fourmilière de noirs les chargeaient, au moyen de ponts volants établis entre les bateaux et la berge.
Mais ce fut la nature même du chargement qui intrigua le plus vivement Armand.
D’énormes cylindres de poterie s’amoncelaient dans les ports secs, et c’était cela qu’on entassait dans les flancs des chalands.
L’approvisionnement d’ailleurs était incessamment renouvelé. Du haut Soueh arrivaient des radeaux ; de l’intérieur des terres venaient des chariots tirés par des buffles, des chameaux, voire même des éléphants.
Et tous ces véhicules, radeaux ou charrettes, apportaient des cylindres de terre vernissée.
– Ah çà ! s’écria le journaliste, incapable de se taire plus longtemps, tu as donc transformé le Centre Africain en une immense poterie ?
Robert inclina gravement la tête.
– Tu l’as dit, cousin.
– Alors… ?

– Toutes les peuplades, du Bahr-el-Ghazal au M’Bomou, à I’Oubanghi, au Congo, fabriquent à cette heure des cylindres semblables à ceux que tu vois ici.
Du coup, Armand se prit la tête à deux mains.
– Que veux-tu faire de cela, malheureux ?
– L’arme la plus terrible qui puisse être forgée contre l’Angleterre.
Le Parisien eut un air ébahi.
– Le diable me torde le col, si je comprends à quoi servira cette artillerie de faïence !
– Cependant, toi-même as posé le problème il y a quelques jours.
Et lentement :
– N’as-tu pas reconnu que, dans la guerre imminente, la victoire appartiendra à celui qui pourra s’assurer l’eau nécessaire à l’alimentation de ses troupes.
– Si… mais…
– Attends. J’ai privé mes adversaires du précieux liquide en détournant le Nil Blanc, le Sobat, le Bahr-el-Ghazal vers le Congo. Mais actuellement une corvée de deux cent mille hommes creuse de profondes tranchées le long de l’ancien lit du fleuve des Pharaons. Ils ajustent ces tuyaux de faïence les uns au bout des autres… Armand se frappa le front.
– J’y suis. Une extrémité de cette canalisation plonge dans l’immense lac que nous venons de traverser… l’autre…
– Précédera mon armée. À chaque étape, mes hommes trouveront de vastes réservoirs remplis d’eau incessamment renouvelée. J’ai calculé le débit nécessaire, les déperditions inévitables, et, je puis l’affirmer sans crainte de me tromper, l’armée des patriotes africains ne connaîtra pas la soif.
Du coup, Armand serra les mains de son cousin.
– Mon cher Robert… tu es bien un Lavarède, toi. La guerre en ce pays est, avant tout, la guerre de l’eau. Tu as résolu le problème. Je t’admire et te félicite.
Et les deux cousins, après un shake-hand cordial, parcoururent les chantiers.
C’était vrai. L’eau, ce liquide incolore, inodore, insipide, selon la description des manuels de chimie, l’eau allait devenir l’agent principal de la victoire.
L’armée, privée de ce fluide composé d’hydrogène et d’oxygène (H2O) était acculée à la mort ou à la retraite précipitée.
Employant tous les bras disponibles, Robert avait ouvert la campagne par un coup de maître, plus fécond en résultats que dix batailles heureuses. Il avait assuré à ses troupes l’immense supériorité de l’approvisionnement d’eau.
Du reste, les semaines écoulées n’avaient pas été perdues au point de vue purement militaire.
Des convois d’armes, de munitions étaient arrivés incessamment par l’Abyssinie, et maintenant, presque tous les noirs rangés sous le drapeau égyptien étaient munis d’excellents fusils dont le maniement leur était devenu familier.
La discipline avait aussi été établie parmi cette cohue de nations soulevées contre l’Angleterre.
On allait être prêt à engager la suprême lutte.
Durant huit jours, les cousins et leurs compagnons restèrent à Tamboura, surveillant la manutention des conduites de terre vernissée, recevant la visite des chefs des environs.
Dès longtemps, les Chillouks du Moudirieh de Fashoda, ceux-là mêmes qui avaient si résolument pris autrefois le parti du commandant Marchand ; dès longtemps, ces Chillouks, à la seule nouvelle qu’un Français se mettait à la tête d’une expédition hostile à l’Angleterre, avaient embrassé la cause des patriotes.
Partout la haine, semée dans le Centre Africain par les procédés barbares, les exactions des agents anglais, portait ses fruits.
Tous ne comprenaient pas également bien le but de l’entreprise ; mais pour tous, il était clair que des Français et des Anglais allaient en venir aux mains.
Or, pour les Africains, France signifie bonté, Angleterre représente l’idée de rapine et de meurtre.
Et tout naturellement ils venaient à la France, avec ce dévouement naïf des peuples enfants que la douceur conquiert plus sûrement que la violence.
Le neuvième jour, Robert annonça à ses amis que le moment du départ était venu.
On se porterait sur le Nil, au-delà de Fashoda, dans les vastes plaines où, suivant un ordre transmis partout, les contingents égyptiens et noirs devaient se concentrer.
Ce fut un instant d’indicible émotion.
La campagne s’ouvrait enfin, la lutte sans merci dont l’enjeu était l’indépendance de la vallée du Nil, s’engagerait à bref délai.
Graves et recueillis, tous s’embarquèrent sur le bateau qui les avait amenés.
Lotia, Aurett, Nilia songeuses, Jack troublé à la pensée de se trouver bientôt en face de ses anciens amis, les soldats d’Angleterre, Robert et Armand avec une impatience fiévreuse, s’abandonnaient à la course rapide de leur embarcation, que de noirs pagayeurs faisaient voler sur l’eau ainsi qu’une flèche.
Seul, le singe Hope conservait une attitude paisible.
Pendant le séjour à Tamboura, un nègre Dinka, pris de vénération pour le grand singe porteur d’un habit rouge, lui avait appris à fumer… et l’orang, charmé par sa nouvelle science, grillait des cigarettes, s’enveloppait d’un nuage de fumée plus opaque que celui dont se voilait Jupiter, au dire des poètes qui fréquentèrent chez ce dieu de la Fable.
D’après les instructions du généralissime, la pirogue ne suivit point pour le retour les canaux parcourus à l’aller.
Trop de chalands étaient en marche. On serait certainement arrêté par des encombrements, et Robert avait hâte d’atteindre le point de concentration de son armée.
Aussi l’embarcation se lança dans des canaux latéraux libres d’obstacles.
Or, vers la fin du troisième jour de navigation, on aborda sur un îlot de sable qui émergeait au centre d’un lac assez spacieux.
La pirogue fut amarrée. On dressa les tentes et bientôt tout le monde s’endormit profondément.
Un réveil désagréable les attendait.
Un coup de feu tira les voyageurs de leur repos. Tous furent sur pied en un instant et se précipitèrent hors de leurs abris de toile.
Mais là, ils s’arrêtèrent stupéfaits.
À dix pas d’eux un cercle de monstres les entourait.
Les crocodiles, troublés dans tout le Bahr-el-Ghazal par l’invasion soudaine des troupes de Robert, s’étaient réfugiés dans les parties les moins fréquentées des marécages.
Sans le savoir, les voyageurs s’étaient engagés dans la région où pullulaient ces ennemis de nouvelle espèce, d’autant plus dangereux que leur agglomération même les condamnait à la disette.
Timides encore, ils n’avaient pas osé attaquer, mais des centaines de gueules ouvertes, qui se refermaient parfois avec un claquement impatient, disaient que les horribles sauriens ne tarderaient pas à se ruer sur cette petite troupe.
C’était pour eux une proie assurée.
Leur nombre grandissait sans cesse.
À chaque instant, des corps aux écailles brunes sortaient de l’eau, rampaient sur le sable.
Et le cercle se rétrécissait peu à peu.
Il ne fallait pas songer à regagner la pirogue en se frayant un passage au milieu des crocodiles.
Inévitablement un ou plusieurs des passagers eussent été saisis par les formidables mâchoires ouvertes sur eux.
Et comme les jeunes femmes s’enlaçaient, ne pouvant se défendre d’une cruelle angoisse, la voix de Robert s’éleva dans le silence.
– Que personne ne bouge. Aussitôt que j’aurai franchi la ligne des crocodiles, gagnez la pirogue. Embarquez et gouvernez de façon à me rejoindre.
Que voulait-il dire ?
Tous le comprirent… trop tard pour s’opposer à l’action du courageux Français.
Nanti de l’appareil d’Aubry, les pieds chaussés des aqua-raquettes, la ceinture emprisonnée par l’appareil de soutien, Robert s’était élancé en avant, un revolver à chaque main.
À bout portant, il déchargeait ses armes dans les gueules avides.
Le bruit des détonations, les gémissements des animaux blessés jetèrent le trouble parmi les assaillants.
Ils s’écartèrent devant l’ennemi qui fondait sur eux.
Sans perdre un moment, Robert s’élance, gagne le rivage et, sautant sur l’eau, se met à patiner à toute vitesse.
Il va, tourne, vire, évoluant avec aisance au milieu des crocodiles qui nagent à fleur d’eau, attirés de tous les points de l’horizon par la curée prochaine.
Ceux-ci pivotent sur eux-mêmes et le poursuivent.
Les sauriens, demeurés à terre obéissent à l’instinct d’imitation, inné chez tous les animaux qui vivent par troupes.
Précipitamment ils regagnent le lac, augmentant le nombre de ceux qui chassent Robert.
L’îlot est déblayé ; les abords de la pirogue sont libres.
Mais personne ne songe à profiter du dévouement du Français. Tous sont stupéfaits. La rapidité avec laquelle l’événement s’est produit les a pétrifiés. Ils regardent la poursuite, la meute de crocodiles nageant dans les traces de l’homme qui glisse, tel un patineur à la surface du lac.
Un faux mouvement, une chute, et Robert est perdu.
Le premier, Armand reprend son sang-froid.
– À la pirogue ! ordonne-t-il.
Son accent rend à ses compagnons la conscience de la situation.
Il faut, sans tarder, obéir aux instructions du « général pour l’Égypte ». Son salut dépend de la vélocité de la course de la pirogue.
Car il ne pourra soutenir longtemps la chasse ; ses forces s’épuiseront… et alors…
Vite, on se presse, on se place dans l’embarcation ; les blancs à l’arrière, les pagayeurs à leur poste.
– En avant ! crie le journaliste d’une voix étranglée.
Et les pagaies frappent l’eau, et la pirogue file, file.
De loin Robert indique de la main la direction à suivre.
Pour lui, il semble s’éloigner d’abord de la ligne tracée à l’embarcation.
Il semble ralentir sa marche.
– Est-il fatigué ? se demandent avec angoisse ses amis, qui assistent éperdus à cet étrange spectacle.
Non, il a seulement voulu amener les crocodiles à se masser. Ils sont à dix mètres de lui, formant un bataillon serré.
Alors il repart, et soudain sa direction change, s’infléchit par une large courbe vers la pirogue.
Braves aqua-raquettes. Quel admirable instrument !
Robert patine avec rage. Il laisse loin en arrière les crocodiles trompés par son adroite manœuvre.
Il est sauvé.
Non. Un cri d’épouvante sort de toutes les lèvres.
En voulant éviter une masse d’herbes flottantes, le Français a tourné trop brusquement.
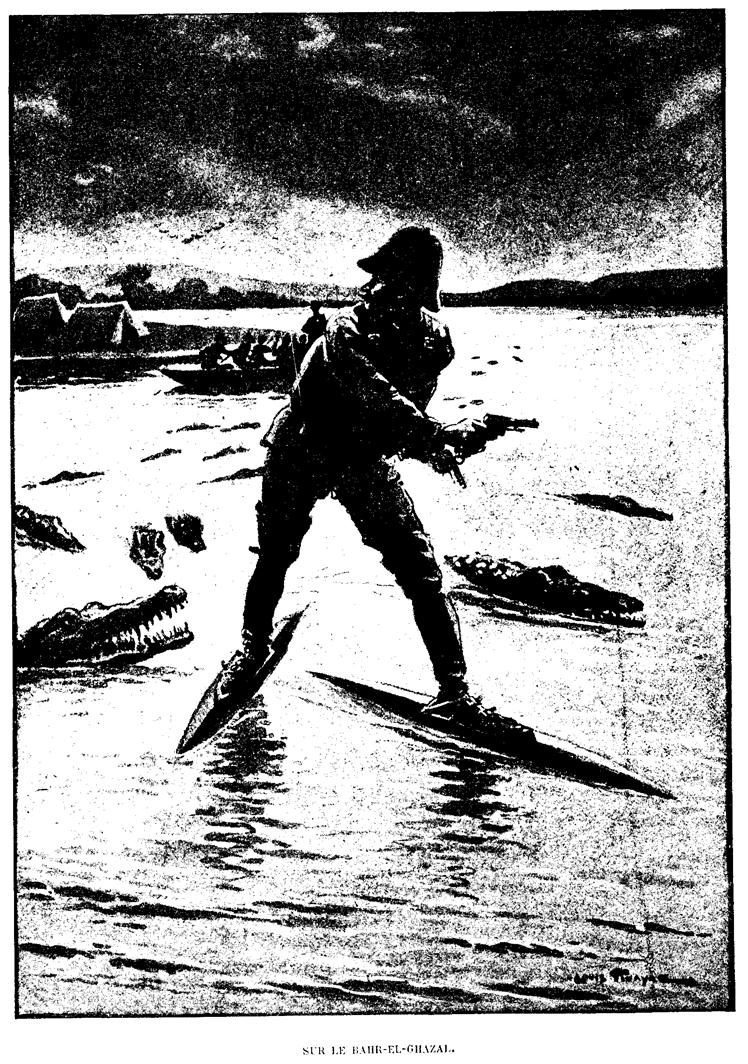
Il chancelle, il tombe et un énorme saurien venu sournoisement à sa rencontre se précipite sur lui, la gueule ouverte.
Lotia se renverse dans les bras d’Aurett avec un gémissement éperdu.
Mais presque aussitôt, les pagayeurs lancent vers le ciel une clameur de triomphe.
Ce qui devait perdre Robert le sauve.
D’un mouvement de côté, il a évité le crocodile. Il s’est cramponné à la dure cuirasse du saurien, et, fort de ce point d’appui, il s’est remis en équilibre.
Il repart.
Il approche de la pirogue, il l’atteint, il s’y laisse tomber.
Et, les pagayeurs déployant toutes leurs forces, on perd de vue en quelques minutes la bande affamée et déçue des crocodiles.
Alors ce sont des effusions. Tous serrent la main du brave Français qui vient de risquer sa vie pour protéger ses amis.
Lotia, les yeux baignés de larmes, l’a fait asseoir auprès d’elle, elle appuie sa tête sur son épaule, et elle le regarde, toute tremblante encore, sans prononcer une parole.
Pareille émotion ne devait pas se renouveler pendant la traversée du Bahr-el-Ghazal.
Le vingt-septième jour, on atteignait les confins de la zone navigable.
Des méharis, ou chameaux de course, attendaient les voyageurs.
Le long du Nil, maintenant asséché, la caravane s’arrêtait.
On traversait le pays Chillouk, on s’arrêtait une nuit à Fashoda, la petite bourgade où jadis le drapeau français, planté par Marchand, avait été abattu.
De nouveau les trois couleurs y flottaient au-dessus du pavillon d’Égypte. Et le voyage continuait.
Maintenant tout le pays était en mouvement, sur toutes les routes, dans les plaines, dans les vallons, on rencontrait des détachements en armes. Cavalerie, infanterie, sous la conduite de leurs cadres égyptiens, marchaient en bon ordre.
Robert, reconnu au passage, était salué de frénétiques acclamations.

Et quand il saluait, Hope, perché sur un chameau, ôtait gravement son bicorne.
Mais les noirs ne riaient pas. Ils se montraient l’orang avec un respect évident.
Pour eux, le singe devenait un sorcier, une sorte de grigri animé, pour tout dire le fétiche de l’année de l’Indépendance. Enfin, le trente-cinquième jour après leur départ de Tamboura, Robert et ses amis parvinrent à Roueh, où l’on avait décidé d’établir le quartier général.
À perte de vue s’étendait le campement des patriotes, et dans de vastes réservoirs, les tuyaux de terre dont Robert avait ordonné la fabrication déversaient à flots l’eau prise à cinq cents kilomètres en arrière dans le Bahr-el-Ghazal, à présent affluent du Congo.
Et dans l’ancien lit du Nil, on n’apercevait plus que quelques flaques d’eau croupissante, entourées de bancs de sable ou de vase desséchée, déjà craquelée par le soleil.

CHAPITRE II
CHEZ L’ENNEMI
À cinq kilomètres au sud de Khartoum, la vieille cité Mahdiste qu’a détrônée Ondourman, ville nouvelle crée à l’Ouest du Nil, deux tourelles pivotantes se dressaient, chacune sur une rive du fleuve.
Elles étaient, ces deux tourelles aux lourds canons, les sentinelles avancées de l’immense chaîne de forts d’acier, dont l’Angleterre avait bordé le cours d’eau du Caire à Khartoum.
Elles portaient, celle de la rive droite, le numéro 1 ; celle de la rive gauche, le numéro 2.
Or, dans la seconde, un jeune lieutenant d’artillerie, sanglé dans son dolman de toile blanche, un binocle d’or sur le nez, était assis devant une petite table, sur laquelle s’étalait un échiquier, toutes pièces disposées sur le damier.
Et l’officier considérait les échecs avec une attention soutenue, touchant successivement de la main, le roi, la reine, les fous, les cavaliers, les tours ou les simples pions.
Ce joueur solitaire était le baronnet Timy Logdale, fils unique d’un membre de la chambre des Lords, orgueil de l’annuaire du Peerage and Baronetage, armorial vénéré de l’aristocratie anglaise.
Atteint d’une myopie telle que, selon l’expression britannique, il n’eût pas aperçu un yard de boudin au bout de son nez le jeune Timy Logdale était aussi impropre que possible au métier militaire.
Toutefois, vu sa haute naissance, sa grande fortune, et surtout l’usage constant dans sa famille de débuter dans la carrière des armes, il avait été bombardé d’emblée lieutenant au corps royal de l’artillerie.
Bien plus, on lui avait confié le commandement de la tourelle n° 2, afin de pouvoir, en raison de ses services d’avant-garde, lui donner un avancement rapide.
Dans l’armée anglaise, en effet, on prend volontiers les titres nobiliaires pour des titres à l’avancement.
Depuis près de trois mois, Timy Logdale occupait sa tourelle ; sans conviction il attendait la venue de l’armée des rebelles… sans conviction, disons-nous, car il lui paraissait invraisemblable que ces faquins osassent attaquer les forces britanniques.
Il avait divisé les artilleurs, placés sous ses ordres, en fractions chargées à tour de rôle d’explorer les plaines étalées à perte de vue sur les deux rives du fleuve.
Aussi répétait-il volontiers :
– Les rebelles ne nous surprendront jamais. Nous les apercevrons à six kilomètres de distance.
Phrase bien présomptueuse de la part d’un myope qui, malgré son pince-nez, distinguait difficilement dans son assiette une tranche de roastbeef d’un artichaut à la poivrade.
Ces dispositions arrêtées, lord Timy Logdale s’était ennuyé.
Heureusement la communication téléphonique avait été établie avec les tourelles voisines, et un beau jour Timy avait téléphoné au commandant de la tourelle n° 1.
– Allô ! Allô ! le lieutenant Braddock.
C’était le nom de l’officier commandant, un vieux dur à cuire, sorti du rang et qui, après vingt-cinq années de service, quinze campagnes, onze blessures, avait décroché sur le tard ses deux galons.
Logdale reçut aussitôt la réponse suivante qui l’étonna quelque peu :
– Pas mal et vous… ? J’ai une légère fluxion ; sauf cela, je suis satisfait.
Et la conversation s’engagea en ces termes :
LOGDALE. – J’ai une proposition à vous faire.
BRADDOCK. – Vous avez bien raison. Une chaleur d’étuve.
LOGDALE. – Savez-vous jouer aux échecs ?
BRADDOCK. – Avec les moustiques, c’est complet.
LOGDALE. – Voulez-vous dire que ce jeu vous déplaît ?
BRADDOCK. – Moi, j’ai le cuir tanné… Vous verrez que tous les moucherons iront chez vous.
Le jeune lord se passa la main sur le front. Est-ce que son collègue de la tourelle n° 1 serait devenu fou ?
Il se remit pourtant à l’appareil et cria de toutes ses forces :
– Acceptez-vous un défi aux échecs ?
Ce à quoi Braddock répliqua :
– Fi ! fi ! Échec n’est pas un mot anglais. La victoire est assurée.
Évidemment il y avait quelque chose d’anormal. Logdale se décida donc à envoyer un de ses artilleurs à la tourelle n° 1, et le soldat rapporta des renseignements qui expliquèrent l’incohérence du dialogue téléphonique.
Braddock était sourd comme un pot, mais sous aucun prétexte il ne consentait à l’avouer.
Un sous-officier de sa compagnie lui servait habituellement de secrétaire, le remplaçait au téléphone et lui communiquait à mesure sténographiquement les paroles prononcées.
Ce gradé était absent au moment où le lord avait parlé sur la plaquette vibrante.
De là le brouillamini.
Maintenant tout était arrangé, le match d’échecs accepté. Dès le lendemain à huit heures, chacun des officiers devrait s’installer devant son échiquier, et l’on s’avertirait par téléphone des coups joués.
La partie, commencée un mois plus tôt, continuait toujours.
Logdale, après de longues réflexions, déplaça l’un de ses fous.

Puis il courut au téléphone.
– Allô !… allô !
– ! !…
– Fou, sur troisième case, septième rangée… échec à la reine.
– ! !…
Il vint se rasseoir et attendit.
Trois heures s’écoulèrent. La sonnerie d’appel résonna fiévreusement, et, s’étant appliqué les oreillons, le lieutenant entendit :
– Cavalier de droite prend fou…, reine libre.
Il eut un cri, regarda l’échiquier du coin de l’œil, s’assura qu’il avait bien commis la faute de placer son « fou » à portée des coups du « cavalier » de son adversaire, et, avec un geste de dépit :
– Bien joué, mon cher collègue… je ne suis pas en veine ce matin. Au surplus, il est tard, allons déjeuner. Nous reprendrons ce soir à quatre heures, après la sieste.
On lui répondit :
– Entendu.
Sur ce, lord Timy Logdale quitta le rez-de-chaussée de la tourelle n° 2, accéda par une échelle d’acier au sous-sol, puis, se glissant entre la coupole d’acier et son alvéole de béton, il se trouva sur les glacis (si toutefois on peut donner ce nom au terrain environnant le fort mobile).
Au nord, il apercevait la masse des constructions de Khartoum, et tout à l’entour des tentes, des baraquements provisoires couvrant la plaine.
C’était le camp de l’armée anglaise, rassemblée en cet endroit par le sirdar Lewis Biggun, pour arrêter, bien loin au sud de l’Égypte, les bandes rebelles qui, d’après les renseignements fournis par les espions expédiés dans toutes les directions, s’étaient concentrées au milieu des immenses marécages du Bahr-el-Ghazal.
Là, on avait perdu leurs traces, et il était probable que les peuples soulevés par ces Français maudits, Robert et Armand, s’étaient enlisés dans le sol mouvant, les eaux bourbeuses du marécage centre-africain.
Ceux qui avaient échappé à l’engloutissement devaient errer dans ce désert liquide, mourant de faim, sans ressources, sans espoir.
Évidemment la cause anglaise triomphait sans combat.
Telles étaient les appréciations optimistes que le Sirdar échangeait en ce moment même avec le docteur Gorgius Kaufmann.
Celui-ci hochait la tête, d’un air peu convaincu.
Un pareil désastre serait connu. Les nouvelles se transmettent en Afrique avec une incroyable rapidité.
La disparition d’une armée de près d’un million d’hommes aurait jeté un frisson d’angoisse sur tout le continent noir. Or, rien de semblable ne s’était manifesté.
– En ce cas, grommela Lewis Biggun impatienté par les arguments du docteur, vous supposez que ces drôles vivent dans l’abondance.
– Je n’en sais rien, Milord général ; mais je m’attends à les voir paraître au moment où nous les attendrons le moins.
Le Sirdar haussa les épaules.
– S’ils étaient en état d’attaquer, pensez-vous qu’ils n’auraient pas engagé les hostilités, depuis plus de deux mois que nous sommes ici ?
– C’est précisément leur inaction qui m’inquiète.
– Et pourquoi, je vous prie ? fit ironiquement le généralissime.
Kaufmann leva les yeux au ciel :
– Je ne saurais m’expliquer là-dessus. Mais j’estime que si les rebelles ne bougent pas, ils ont leurs raisons. J’ai vu pendant deux heures à peine leur chef, ce Robert Lavarède, qui m’a enlevé avec mon karrovarka et cette misérable Nilia, et qui, à dix kilomètres du Caire, m’a déposé sans cérémonie au bord de la route… Eh bien…
– Eh bien ?
– Cet homme-là est dangereux. Souvenez-vous de la fuite en masse des habitants de la vallée du Nil. Cela était préparé de longue date. Chaque famille savait par quelle route elle marcherait. Et nous n’avons rien soupçonné, rien deviné. Aujourd’hui, j’ai grand’peur qu’il en soit de même. Quelque chose se prépare, et, nous en aurons conscience à l’heure seulement ou le danger se présentera à l’improviste.
Cette fois, le Sirdar ne répondit pas.
L’inquiétude vague avouée par le savant allemand, il la ressentait aussi.
Les ennemis semblaient s’être évanouis en fumée. Nulle part dans ce pays déserté par les indigènes, on n’obtenait le moindre indice.
Que préparaient donc les rebelles ?
Pourquoi cette horripilante immobilité ? où se cachaient-ils ? Où travaillaient-ils à un artifice mystérieux ? Quelle arme forgeaient-ils contre l’Angleterre ?
En passant, lord Timy Logdale distingua confusément la silhouette des deux hommes. Comme ils ne bougeaient pas, le lieutenant myope les prit pour un bloc de rocher, et il continua allègrement son chemin, sans se douter qu’il venait de croiser son général.
Il se rendit au mess, déjeuna copieusement, but quelques coupes de champagne (détail à noter : il n’aimait pas ce vin, mais il lui semblait décent, convenable et de bon ton d’en arroser chacun de ses repas… Noblesse oblige, n’est-ce pas ?), puis satisfait de son sort, il se leva, ne se heurta que deux ou trois fois à des chaises, tentes ou baraquements qu’il n’avait pas vus sur son passage, et regagna la tourelle.
Une fois rentré dans la batterie du rez-de-chaussée, Logdale se disposa à faire la sieste, mais il eut beau chercher, il ne rencontra nulle part le matelas que son ordonnance étendait sur un lit de fer afin que le noble lord y pût étendre ses membres fatigués.
Surpris, Timy appela, mit en mouvement les sonneries électriques qui reliaient les divers compartiments de la coupole, et finalement l’artilleur coupable de négligence fit irruption dans la batterie.
– Mon lieutenant, commença-t-il, excusez-moi…
– All right ! je vous excuserai quand vous aurez disposé mon matelas.
– À l’instant, reprit le soldat en s’empressant d’obéir.
Mais le lord grommela :
– Que faisiez-vous donc ?
– Ah ! mon lieutenant, j’étais avec les camarades, je regardais le Nil.
– Vous êtes admirable. Sachez, mon garçon, que vous êtes ici, non pour regarder, mais pour garder le Nil.
Satisfait de son jeu de mots, Timy daigna sourire.
– Je sais bien qu’il faut le garder, murmura l’artilleur, seulement…
Le lord dressa l’oreille.
– Seulement quoi ?
– Dam, je voulais dire que si cela continue, on pourra nous relever de faction.
– Nous relever ?
– Parce que nous n’aurons plus rien à garder.
Que signifiaient ces paroles ? Le lord se demanda si, par hasard, son ordonnance ne se serait pas livré à des libations exagérées. Il le questionna pourtant.
– Expliquez-vous.
– Mon lieutenant n’est donc pas au courant ?
– Probablement, puisque je vous interroge.
– Que mon lieutenant ne se fâche pas… je réponds. Le Nil, figurez-vous… n’a pas moitié autant d’eau qu’avant-hier.
– Pas moitié ?
– Et ça diminue tout le temps… avec une rapidité effrayante. D’ici à la fin de la semaine, il n’y aura plus d’eau.
– Plus d’eau !
Brusquement Timy Logdale éclata de rire. Parbleu oui, son interlocuteur était ivre.
Plus d’eau dans le Nil ! Voilà une idée qui ne viendrait jamais à un homme à jeun.
Aussi riposta-t-il gaiement :
– Bah ! Bah ! garçon. Si l’eau manque, cela ne vous gênera pas ; vous me semblez préférer le gin pur.
Et, sans laisser au soldat le loisir de répondre, il le poussa doucement dehors.
– Allez-vous reposer, mon brave, allez… et mettez un peu d’eau dans vos rêves ; tout le monde s’en trouvera mieux.
Toujours riant, Timy acheva de dresser sa couchette et s’y étendit voluptueusement.
– Admirable, celle idée d’ivrogne ! monologuait-il. Admirable ! Plus d’eau dans le Nil !… Comment ce pauvre diable s’est-il pris de boisson aujourd’hui ? Voyons, quelle fête est marquée au calendrier… ?

Il se releva, regarda l’almanach collé sur la muraille de tôle, puis, revenant se coucher :
– Saint Lewis… saint Louis… C’est pour cela. Il y a des quantités de Louis dans l’armée… à commencer par le Sirdar, Lewis Biggun… Mon colonel aussi, et le major… et mon collègue de la tourelle 1… Lewis Braddock… Mes artilleurs ont pris la Saint-Louis pour la Sainte-Barbe… Après tout, cela n’a pas d’importance… Après la sieste, il n’y paraîtra plus.
Le lord ferma les yeux et, succombant à la chaleur lourde du milieu du jour, il ne tarda pas à s’endormir.
Il était immobile sur sa couchette ; de petites gouttes de sueur perlaient sur son front, et de ses lèvres entr’ouvertes sous l’accent circonflexe de la moustache blonde, s’échappait sa respiration régulière.
Sans doute il serait demeuré longtemps au pays des songes, si la sonnerie d’appel du téléphone n’avait pas tinté rageusement. Logdale bondit sur ses pieds.
– Allons, bon !… l’appareil… qu’y a-t-il encore ?
Et, se penchant sur la planchette :
– Allô… Allô… Qui est là ?
Le long du fil, ces mots parvinrent à son oreille :
– C’est moi… Lewis Braddock.
– Ah ! oui, Lewis, répéta Timy avec un sourire, en se souvenant tout à coup des réflexions qu’il avait faites au moment de s’endormir.
Mais, revenant bien vite à la conversation :
– Vous êtes en avance, mon cher Braddock. La partie ne reprend qu’à quatre heures.
– Il s’agit bien de cela.
– De quoi donc alors ?
– Du Nil.
Le myope lieutenant eut un haut-le-corps.
Du Nil ? Ah çà, est-ce que Braddock allait rééditer la sotte plaisanterie de l’ordonnance ?
Est-ce que la Saint-Louis sévirait même parmi les officiers ?
Cela serait trop drôle, et, se dominant pour contenir son hilarité, Logdale demanda :
– Causons du Nil.
– C’est très grave.
– Je m’en rapporte à vous, mon cher ami.
– L’eau baisse…
– L’eau baisse… Ça y est ! clama le lord en riant aux larmes.
Mais sa gaieté, transmise à son interlocuteur par les vibrations de l’appareil, ne fut pas goûtée de Braddock, qui reprit d’un ton rogue :
– Cela vous amuse ?
– Énormément.
– Entre nous, il n’y a pas de quoi.
– Bon ! Je ne vais pas pleurer pour quelques gouttes d’eau. Il en restera toujours assez pour le thé.
Un juron résonna, lancé par les poumons vigoureux du commandant de la tourelle n° 1.
– Malheureux ! Vous plaisantez !
– Toujours, riposta Logdale, dont la joie croissait de minute en minute.
– Vous ne réfléchissez donc pas. Plus d’eau ; plus moyen pour nos chalands de nous approvisionner ; plus moyen pour notre armée de conserver ses positions. C’est la retraite, c’est l’abaissement du pavillon anglais…
Timy s’était un peu écarté du téléphone. Braddock se fâchait. Il ne fallait pas blesser ce brave camarade, ce partenaire courageux du match d’échecs. Et, à part lui, le jeune officier se disait :
– Curieuse, cette hallucination commune à deux buveurs… Après cela, l’un l’a probablement communiquée à l’autre… Et il raisonne sérieusement son ivresse, ce bon Braddock. Le ravitaillement, le pavillon anglais… tout y passe… Seulement il ne va pas me tenir au téléphone jusqu’à la fin de la sieste. Je préfère dormir, moi.
Sur cette affirmation, Logdale se pencha sur la planchette :
– Désolé, cher ami. On me commande de service… Au revoir.
Sans attendre la réponse, il raccrocha les oreillons et se rejeta sur sa couchette.
Mais il était écrit que Timy ne reposerait pas ce jour-là.
Depuis dix minutes à peine il avait adopté la position horizontale, et il commençait à s’enfoncer dans un délicieux engourdissement précurseur du sommeil, quand un soldat fit irruption dans la batterie.
– Mon lieutenant ! Mon lieutenant !
L’officier sursauta et, d’un air rogue :
– Quoi encore ?… Va-t-on me dévider tout l’écheveau du diable pour m’empêcher de dormir ?
– Le ballon-éclaireur, mon lieutenant.
– Le ballon ! Logdale se leva.
– Eh bien ! quoi ? le ballon ?
– Il plane au-dessus de la tourelle, mon lieutenant. C’est le Victoria, celui que dirige sir Thomas Bird, le chef du parc d’aérostation.
– Après ?… qu’il plane, cela m’est égal.
– C’est qu’il fait les signaux réglementaires.
– Pour…
– Pour communiquer avec le commandant de la tourelle n° 2. C’est vous, mon lieutenant, et…
L’officier proféra entre ses dents une malédiction. Mais il se précipita vers l’échelle d’acier qui conduisait à la batterie supérieure. Puis, ce premier étage gravi, il escalada, sans reprendre haleine, l’échelle accédant au sommet de la coupole, fit jouer les ressorts qui assuraient la fermeture de la trappe ménagée dans le dôme et bondit sur la surface extérieure du fort de métal.
Un instant, il demeura immobile, aveuglé par les rayons éblouissants du soleil, suffoqué par la température, que la comparaison avec la fraîcheur relative des batteries rendait plus violente.
Après quoi, il se retourna vers l’artilleur qui l’avait suivi.
– Où est le Victoria ?
– Juste au-dessus de nous, mon lieutenant.
Logdale leva le nez, oubliant qu’il était myope à prendre, à dix pas un éléphant pour un King’s Charles.
Naturellement il n’aperçut pas l’aérostat. Tout aussi naturellement, suivant en cela l’usage des gens à courte vue, il accusa les autres de son infirmité.
– La peste soit de ce ballon invisible ; n’aurait-on pu lui donner une couleur qui le fasse distinguer de loin ?
L’artilleur l’interrompit.
– Mon lieutenant, le téléphone descend.
– Quel téléphone ?
– Celui de l’aérostat. Mister Bird a sans doute à s’entretenir avec vous.
En effet, des « oreillons-parleurs » se balançaient au dessus de la tête de Logdale, au bout d’un fil mince et résistant qui aboutissait à la nacelle.
Comme on le voit, le ballon-éclaireur de l’armée anglaise était muni des derniers perfectionnements.
Avec l’aide de son subordonné, le lord s’empara desdits oreillons et la conversation s’engagea.
– Allô… allô…
– Je vous écoute.
– Lord Timy Logdale.
– C’est bien moi.
– Votre tourelle est-elle approvisionnée d’eau ?
– Suivant le règlement, j’en ai pour huit jours.
– C’est trop peu. Commandez une corvée. Remplissez la citerne. Il faut que vous vous assuriez du liquide pour deux mois.
– Eh ! le Nil n’est-il pas là ?
– Ne comptez pas sur le fleuve.
La réplique stupéfia le lord.
– Comment ? Comment ? balbutia-t-il.
– Il baisse d’une façon inquiétante. Ce n’est plus qu’un ruisseau. Si cela se prolonge, demain il n’y aura plus d’eau.
– Plus d’eau !
Oubliant qu’il téléphonait à un supérieur, Timy murmura :
– C’est trop fort, j’ai vu fêter la Saint-Louis, mais jamais comme cela.
– Vous dites ? interrogea-t-on de la nacelle.
Rappelé au sentiment des convenances, l’officier reprit :
– Je dis que cela est incroyable.
– Cela est pourtant. Lâchez maintenant les oreillons. Je remonte et vais prévenir les chefs des tourelles voisines.
– Au revoir, Sir Bird.
– Au revoir, Lord Logdale.
Le jeune homme desserra les doigts, et les appareils téléphoniques remontèrent aussitôt.
Sur la coupole, Timy demeurait absolument abasourdi.
– Le Nil à sec ! C’est une mauvaise plaisanterie. Bien certainement, tous ces gens ont la berlue.
Puis par réflexion :
– Au fait ! je m’en rendrai compte moi-même. Si l’on a voulu rire à mes dépens, la joie sera moins grande que si je commandais une corvée d’eau.
Ceci dit, il rentra dans sa tourelle, descendit au sous-sol, et cinq minutes plus tard, toujours suivi par son fidèle artilleur, il marchait vers la berge du fleuve.
Quoi qu’il en pensât, ni Braddock, ni Bird ne s’étaient livrés à une facétie very humbug.
Le lit du Nil, réduit des deux tiers, étalait au soleil ses fonds de sable et de vase, sur lesquels rampaient, effarés, des crocodiles surpris par la subite baisse des eaux.

De loin en loin, un trou plus profond, un de ces creux comme on en rencontre dans toute rivière, formait un petit lac que l’ardeur du jour aurait bientôt fait disparaître.
Cela était étrange et terrifiant, ce cours d’eau se transformant, à vue d’œil, en ravin desséché.
Mais Logdale ne voyait rien.
Déjà engagé dans le lit du Nil, il se croyait encore sur la rive.
Il allait, ce myope qui ne voulait pas avouer son état, avec une telle absence de précautions qu’il se jeta tout droit dans l’un des trous semés comme des chausse-trapes sur son chemin et… pouf !… il disparut dans l’eau.
L’artilleur se précipita aussitôt et réussit à le ramener sur le sol ferme, mais dans quel état. Trempé jusqu’aux os, les bottes enduites de vase.
Et, malgré sa situation critique, le lieutenant, avec un entêtement bien anglais, s’écria, dès qu’il fut en état de parler :
– Plus d’eau dans le Nil… ! Ils sont fous… Je sais bien à présent qu’il y en a en quantité suffisante.
Puis, dédaignant de s’occuper davantage d’une question tranchée par lui dans le sens de l’affirmative, il reprit le chemin de la tourelle, afin d’échanger ses vêtements ruisselants contre une tenue sèche.
* *
*
Cependant, dans le camp, la baisse du Nil produisait un émoi indescriptible.
Les fantassins, cavaliers, artilleurs, méharistes, se pressaient sur les rives suivant les progrès de l’assèchement.
Le fleuve, large d’un kilomètre, huit jours plus tôt, n’était plus aujourd’hui qu’un ruisseau d’une cinquantaine de mètres.
Et d’heure en heure, ce filet d’eau s’amincissait, se resserrait.
Quel phénomène étrange s’accomplissait donc ? Chez tous, il y avait de la terreur devant ce prodige inexpliqué.
Dans sa tente, lord Lewis Biggun, entouré de son état-major, discutait avec Gorgius Kaufmann.
– Pour moi, disait l’Allemand, les rebelles ont détourné le cours du Nil. Cela seul peut amener la baisse effrayante que nous constatons.
– Dans quel but ?
– Facile à comprendre. Ils nous imposent la retraite sans combat. Si braves que soient les soldats anglais, ils ne sauraient lutter contre la soif.
Les officiers l’écoutaient, la tête penchée, l’air pensif.
– Soit. C’est la soif pour nous, gronda le Sirdar : seulement, si votre hypothèse est juste, Sir Kaufmann, les révoltés souffriront les mêmes maux. Nous devrons nous reporter vers le nord, mais il leur sera impossible de nous poursuivre.
L’Allemand ayant opiné du geste :
– En ce cas, continua Biggun, je ne comprends pas bien l’avantage de la manœuvre.
La déduction était logique. Le généralissime ne pouvait soupçonner la gigantesque canalisation préparée par Robert Lavarède. En eût-il eu l’idée d’ailleurs, qu’il l’aurait déclarée irréalisable, car le chef anglais était loin de croire à l’importance réelle du soulèvement.
Avec l’indifférence britannique pour les peuples asservis, il ne lui était pas venu à l’idée que tout le continent noir, tyrannisé par les agents anglo-saxons, apporterait son concours à l’insurrection nilotique. Aussi, après un silence, il poursuivit :
– J’estime que, profitant de la saison, les rebelles ont établi un barrage qui rejette le Nil dans une dépression du désert. Cela est pour nous effrayer ; mais cela ne peut nous priver d’eau que pendant peu de jours ; la dépression remplie, le fleuve reprendra son cours.
Et, levant la main pour commander l’attention :
– Je suis certain que l’armée de ces drôles est à peu de distance. Elle attend notre retraite pour clamer victoire. Eh bien ! nous ne lui donnerons pas cette satisfaction. Que les régiments s’approvisionnent d’eau. Pendant ce temps, notre cavalerie se portera en avant vers le sud. Coûte que coûte, il faut reconnaître la position de l’ennemi.
Il s’arrêta encore avant de conclure :
– Par malheur, notre service d’aérostation a été fort négligé ; nous n’avons pas appliqué les progrès réalisés en France notamment par le commandant Renard. Nos ballons ne sont pas dirigeables ; sans cela, je n’imposerais pas aux hommes et aux chevaux les fatigues d’une reconnaissance lointaine mais, vous serez tous de mon avis, il faut travailler avec, les outils que l’on possède.
Un murmure approbateur accueillit ces paroles.
Biggun sourit et, saluant à la ronde :
– Allez. Messieurs. Notre cavalerie partira ce soir-même.
Les officiers se répandirent aussitôt dans le camp. Des sonneries de trompettes retentirent de tous côtés. Les régiments de cavalerie se rassemblèrent, reçurent vivres et munitions. À quatre heures tous étaient prêts au départ.
Monté sur un grand cheval roux, le Sirdar passa rapidement devant le front des troupes, adressa quelques mots aux officiers supérieurs, puis leva son sabre. Aussitôt, les commandements se croisèrent dans l’air. Les escadrons s’ébranlèrent et bientôt toute la cavalerie s’éparpilla dans la plaine.
Les diverses fractions, marchant en bon ordre, donnaient une impression de force dont les troupes, un instant émues par l’assèchement du Nil, furent pénétrées. La confiance reparut, éclairant toutes les physionomies. Que pourraient les bandes rebelles, mal armées, sans discipline, contre ces régiments qui s’avançaient ainsi qu’une muraille animée ?
Ils seraient chassés, anéantis et le drapeau de la vieille Angleterre, couronné de nouveaux lauriers, flotterait triomphant et superbe sur la vallée du Nil définitivement conquise.
Toute la nuit, les escadrons marchèrent vers le sud.
Au matin, ils campèrent près de la bourgade d’El-Salayak.
Nulle part on n’avait aperçu la moindre trace de l’ennemi, et les soldats plaisantaient leurs adversaires invisibles. Comme dans la « pantalonnade » londonnienne, ils disaient :
– Les Égyptiens sont braves.
– Très braves, mais ainsi que le crabe…
– Ils vont à l’ennemi à reculons.
– Hip ! Hurrah pour ces héros !
Les officiers eux-mêmes, gagnés par la bonne humeur de leurs soldats, aiguisaient des épigrammes acérées à l’adresse de l’armée des patriotes.
Sans doute, le vent du désert ne porta point ces fines ironies aux oreilles de ceux qui en étaient l’objet, car rien ne se montra à l’horizon.
Par exemple, le fleuve, que côtoyait la cavalerie britannique, continuait à baisser.
Après l’ardeur du jour, à l’heure où les régiments reprirent la marche en avant, le Nil était devenu un simple ruisseau de trois à quatre mètres de large, où l’on avait grand’peine à se mouiller les genoux.
Partout, des troupes de crocodiles se traînaient sur la vase, cherchant vainement l’eau disparue, et dans le ciel tourbillonnaient des bandes d’ibis, trahissant leur effarement par des cris aigus, discordants.
– Par le diable, remarqua un jeune homme revêtu d’un costume civil mais armé jusqu’aux dents, qui chevauchait auprès d’un capitaine, par le diable, je crains que notre armée ne soit obligée de rétrograder jusqu’à Khartoum même, où le Nil Bleu apporte les eaux des hauts plateaux abyssins, car le Nil Blanc me semble désormais voué à la sécheresse la plus absolue.
– Bah ! Sir Price, répliqua son interlocuteur, quelques milles de plus ou de moins ne font rien à l’affaire.
Le civil leva les yeux au ciel, montrant son visage que jusqu’alors le casque de toile avait masqué en partie.
C’était John Price.
Au reçu de la lettre, confectionnée par Jack dans le logis de mister Bobinow, John s’était senti envahi par une vertueuse colère.
Aux larmes de mistress Price désolée, bien plus de perdre l’un de ses fils que de le savoir passé à l’ennemi, il avait répondu par les plus terribles menaces.
Il avait obtenu de marcher « libre volontaire » avec l’armée anglaise, et il avait juré au Sirdar que son frère, félon et rebelle, ne périrait que de sa main.
Tout ce qu’il y avait de saxon en lui se révoltait à cette pensée qu’un chevalier de la Jarretière, un homme honoré par la bonté de sa souveraine de la plus haute distinction britannique, avait pu trahir.
Car il n’admettait pas les subtilités sentimentales, à l’aide desquelles Jack avait pu se croire autorisé à courir au pavillon de France.
Être né Anglais et avoir été élevé en Angleterre, c’était tout un pour lui ; et il lui apparaissait comme une faute impardonnable contre le goût, la conscience, la raison, de renoncer à être sujet de la Grande-Bretagne, alors que l’on pouvait l’être sans contestation.
– Moi-même, grommelait-il, je commençais à l’accepter pour frère. Il a trahi à la fois son pays et mon affection.
Cependant la route se poursuivait sans incident.
Les éclaireurs ne rencontraient aucune trace des ennemis. Sur leur passage, les champs stériles, les rares villages abandonnés disaient que, là aussi, le mot d’ordre avait été jeté, ce mot d’ordre auquel l’Égypte et la Nubie avaient obéi.
Au matin, le camp fut établi un peu en arrière de la petite ville d’El-Douarm.
L’agglomération avait été fouillée avec soin ; mais les cases vides, les maisons blanches aux portes ouvertes, les mosquées surmontées de minarets élancés, ne contenaient aucun habitant, aucun marabout, aucun fidèle.
Ici comme ailleurs la solitude s’était faite devant les conquérants.
Et le Nil avait disparu.
Le ruisselet de la veille s’était évanoui. Partout le lit du grand fleuve était à sec, parsemé de flaques où grouillaient les sauriens affolés, et qui bientôt allaient s’évaporer sous les rayons brûlants du soleil.
Quel cataclysme avait donc tari le fleuve qui, depuis les origines de l’histoire avait apporté sans discontinuer les ondes des grands lacs à la Méditerranée ?
John, cette fois, se sentait aiguillonné par la plus lancinante curiosité.
À tout instant, il émettait une hypothèse que les officiers britanniques réduisaient bientôt à néant.
La cause lui échappait, mais l’effet n’était pas niable. Le fleuve s’était transformé en un simple ravin de sable.
Cependant, le jeune homme déjeuna de fort bon appétit. Après quoi, il se réfugia sous sa tente, afin de se livrer aux douceurs d’une sieste bien nécessaire après une nuit passée à cheval.
Il dormait à poings fermés, quand un vacarme assourdissant le fit brusquement bondir sur ses pieds.
Partout les trompettes sonnaient. Il reconnut le boute-selle.
En même temps la terre était ébranlée par des milliers de sabots… Des appels, des commandements s’entrecroisaient.
– Qu’y a-t-il donc ? bredouilla le fils de mistress Price.
Il s’élança hors de sa tente et demeura stupéfait. Tout le camp était en mouvement. Les escadrons se formaient en bataille, les chevaux hennissaient. Il arrêta au passage un soldat.
– Que se passe-t-il ?
– L’ennemi, répondit seulement l’interpellé, qui continua son chemin, sans ralentir sa course. L’ennemi !
Le mot surprit John. Depuis deux jours, on s’était tant moqué de l’ennemi, que vraiment il paraissait invraisemblable de le rencontrer.
Puis le jeune homme se prit à rire. On allait lui frotter les côtes à cet ennemi ; on terminerait la campagne en un tour de main.
Pour lui, il chercherait Jack dans la mêlée. Il fallait, pour l’honneur des Price, qu’il étendit le traître à ses pieds.
À cette pensée, son visage était devenu sombre, ses sourcils s’étaient froncés.
Il se précipita vers l’endroit où il avait entravé son cheval, sella la pauvre bête et sauta en selle.
Cinq minutes plus tard, il se portait sur le flanc de l’un des escadrons de première ligne.
La vaste plaine, déserte le matin, s’était subitement peuplée. Du fond île l’horizon s’avançait une nuée de cavaliers.
Et devant ces masses profondes, les régiments anglais semblaient un îlot à l’assaut duquel monte l’océan.
Tous les hommes avaient chargé leurs mousquetons. Ils les tenaient de la main droite, la crosse appuyée sur la cuisse, attendant que les insurgés arrivassent à bonne portée pour commencer le feu.
Mais le visage des officiers exprimait l’étonnement, une sorte d’inquiétude vague.

Les cavaliers du désert ne poussaient pas de cris, ne fondaient pas sur les troupes britanniques en fantasia hurlante, suivant la coutume qui a coûté si cher aux bandes derviches.
Non, ils marchaient silencieux, en bon ordre, ainsi que des troupes européennes.
Et les colonels, commandants, capitaines, se demandaient quelle volonté avait pu les plier à cette stricte discipline.
Est-ce que vraiment les Français, un instant captifs sur la canonnière Look, avaient eu assez d’autorité pour transformer un troupeau de révoltés en une armée régulière ?
Leur cœur battait avec force à cette question, car la partie allait changer de face.
Les soldats anglais avaient pensé rencontrer une cohue, comme la foule Mahdiste, massacrée naguère à Ondourman par lord Kitchener, des hordes se ruant en désordre sur les bataillons alignés, et qui, fauchées par le tir des fusils à répétition, n’avaient jamais pu approcher à plus de quatre cents mètres.
Cela n’était pas dangereux. Cela assurait de la gloire à bon marché.
Mais des troupes disciplinées, c’était une autre affaire. Plus d’un, parmi les officiers, se sentit parcouru par un petit frisson. Leur arrogance venait de subir un choc, et le triomphe ne leur paraissait plus aussi certain.
Cependant la cavalerie de Robert se rapprochait.
Le Français, lui-même, entouré par Armand, Lotia, Aurett, qui avaient énergiquement refusé de l’abandonner, se tenait au milieu de ses escadrons.
Un peu en arrière, Hope, juché sur un grand cheval noir, son habit rouge sur le dos, son bicorne en bataille, regardait curieusement.
Plus loin, Jack aussi observait. Fidèle à sa promesse de ne pas combattre contre le pays où il avait grandi, le jeune homme n’avait pour toute arme qu’un parasol blanc.
Soudain, un crépitement strident déchira l’air.
Les cavaliers anglais avaient tiré.
Des balles sifflèrent, quelques patriotes vidèrent les arçons. Robert se retourna, couvrant Lotia d’un regard éperdu. Mais elle poussa son cheval près de lui, et, l’air inspiré, personnification de l’âme égyptienne, elle dit :
– Va. Il faut vaincre ou mourir ensemble.
Il sembla que ses paroles galvanisaient le Français. Toute trace de trouble disparut en lui, et, levant son sabre, il lança un commandement bref.
Un coup de tonnerre suivit. Les soldats à leur tour avaient fait parler la poudre.
Et, avec stupeur, les Anglais qui pensaient se mesurer avec des adversaires mal armés, virent les balles s’enfoncer dans leurs rangs.
Les officiers comprirent que la situation était grave, que seul, un coup d’audace pouvait faire pencher la balance en leur faveur, et brusquement, en une seule masse, les escadrons s’élancèrent.
Le choc fut irrésistible. Devant cette trombe d’hommes et de chevaux, les cohortes égyptiennes fléchirent, se disloquèrent. Chevauchée de la mort, la cavalerie anglaise passa, chassant devant elle les bandes éperdues.
À pied, au milieu de la mêlée, car son cheval venait de s’abattre, la tête trouée d’une balle, Jack se tenait, son parapluie à la main. Autour de sa personne passaient des éclairs d’acier.
Soudain, il eut un cri.
En face de lui, à pied comme lui, John s’était dressé.
Lui aussi avait eu son cheval tué, et brandissant un sabre à la lame rougie il frappait, frappait comme le bûcheron légendaire du trépas.
À la vue de Jack, il eut un rugissement et se rua sur lui, le sabre levé.
Jack ne fit pas un mouvement.
Son calme réagit sur son pseudo-frère. Celui-ci s’arrêta.
– Défends-toi, gronda-t-il.
Son interlocuteur lui montra son parasol.
– Tu as jeté tes armes ? reprit John avec un souverain mépris.
Jack secoua la tête.
– Je suis venu au combat comme je suis à présent.
– Avec un en-cas ?
– Oui. Français, j’ai rallié mon drapeau, je lui ai offert ma vie ; mais j’ai juré de ne jamais porter les armes contre le pays qui, durant vingt années, a été ma patrie. J’en suis heureux à cette heure, car je suis assuré de ne pas te nuire, à toi, John, que j’aime toujours ainsi qu’un frère.
John bondit à ces paroles.
– Moi, le frère d’un traître… ?
– Traître, tu sais bien que non.
– Je te hais. Je veux te tuer.
– Eh bien, frappe…
Jack avait croisé les bras sur sa poitrine. Il regardait son ex-frère bien en face.
– Frappe, répéta-t-il doucement. Nous aurons ainsi fait notre devoir tous les deux. Je serai mort pour mon drapeau, tu auras vengé le tien.
Un instant John parut hésiter, puis tout à coup, il tourna le dos à son frère, abattit, d’un coup de sabre, un noir qui se défendait contre un soldat anglais et se perdit dans la mêlée.
Jack eut un triste sourire.
– Pauvre John, murmura-t-il, il m’aime bien tout de même.
Mais un cri terrible, surhumain, effroyable, l’arracha à ses pensées.
Les escadrons anglais se repliaient à toute bride, en désordre. Ils fuyaient maintenant, écrasant tout sur leur passage.

Il était impossible de les éviter. Ils arrivaient avec la rapidité de la tempête.
Jack se souvint en l’espace d’un éclair qu’en pareil cas la seule chance de salut est de se jeter à terre. Les chevaux guidés par leur instinct sautent par-dessus l’homme étendu. Et il s’aplatit sur le sol, immobile, respirant à peine. Une trombe passa au-dessus de lui, avec des cris, des hennissements aigus, des cliquetis d’armes. Puis il se retrouva là, sans blessures.
Il se souleva, regarda au loin. Il lui sembla distinguer confusément dans la poussière, la silhouette de l’orang-outang galopant à la suite des escadrons anglais.
Il ne se trompait pas.
Lors de la charge impétueuse des régiments britanniques, Hope avait été séparé de ses maîtres. Un cavalier lui avait fendu la joue d’un coup de sabre. Alors, rendu furieux par la douleur, possédé, comme ses congénères en pareil cas, du désir de se venger, le singe avait sauté à terre, avait arraché un palmier de la grosseur du bras, puis, remontant sur son cheval, s’était précipité à la poursuite des Anglais.
Brandissant son palmier comme une massue, il avait foncé dans les rangs britanniques, abattant tout autour de lui. Sa brusque intervention avait eu un résultat inattendu. Les cavaliers noirs qui fuyaient dans toutes les directions, s’étaient soudainement arrêtés.
Le singe, ce fétiche vivant, combattait pour eux. Dans leurs cervelles naïves avait germé l’idée que la victoire était dès lors assurée.
Et ce que les exhortations de Robert, d’Armand, de Lotia qui se multipliaient vainement, n’avaient pu faire, l’action de Hope l’accomplit. Les cavaliers africains s’élancèrent dans les traces de l’orang. Surpris par cette attaque, au moment où ils croyaient déjà avoir bataille gagnée, les Anglais fléchissent à leur tour.
La vue de l’orang, sanglant, grimaçant, horrible, qui semble mener les noirs au combat, jette l’épouvante parmi eux.
Utilisant ce revirement inespéré, Robert, Armand, rallient leurs troupes et se jettent sur le flanc de la cavalerie anglaise.
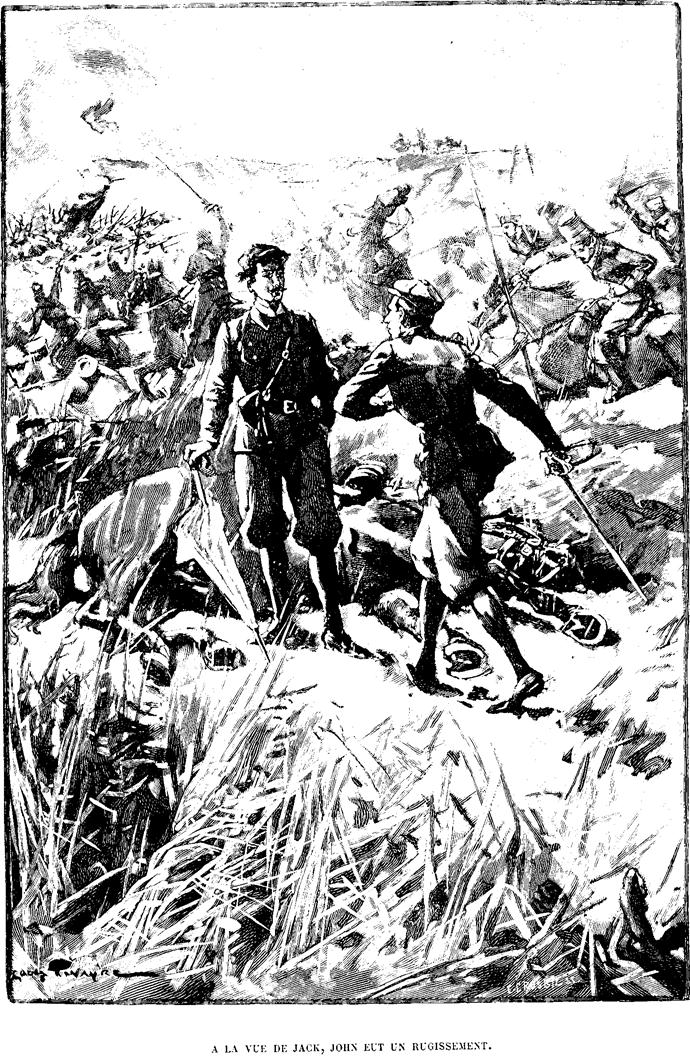
Alors le désordre se met dans les régiments britanniques. Enserrés dans un cercle d’ennemis, ils veulent échapper à l’étreinte, ils tournent bride. Mais il est trop tard.
Disloqués, divisés en vingt groupes différents, la retraite devient une déroute.
Une moitié à peine des effectifs arrive au campement, mais les hommes ne s’y arrêtent pas. Ils galopent éperdument vers le nord. C’est ce qui les sauve, car les noirs, en présence des tentes, des cantines, obéissent à leur avidité.
Ils abandonnent la poursuite pour le pillage.
Et l’un d’eux, le chef Mazouga, commandant la cavalerie du pays Chillouk, dépendant du Moudirieh de Fashoda, est fait prisonnier par une section britannique, qui l’entraîne au triple galop vers Khartoum.
Tandis que Robert et ses amis se félicitent de leur victoire ; que leurs soldats exultent, que des griots-troubadours soudanais chantent, au milieu d’eux, les vertus des braves tombés dans le combat, les débris de la cavalerie anglaise se perdent au loin, à l’horizon du nord.
Les cavaliers éperonnent leurs chevaux haletants, dont les flancs saignent.
En vingt-quatre heures, ils atteignent le camp, apportant la nouvelle de la défaite.
Et là, ils apprennent avec stupeur que l’armée anglaise tout entière va battre en retraite.
À leur départ, le Nil Blanc seul était tari ; à présent, le Nil Bleu descendu des massifs abyssins et qui se réunit au premier à Khartoum même, le Nil Bleu s’assèche à son tour.
Fidèles à l’alliance contractée avec Robert Lavarède, les sujets de Ménélik ont détourné le fleuve au sortir du lac Tuna. Ils l’ont dirigé vers les rivières Gallas, l’Aouach et le Tilleton, et maintenant le Nil Bleu roule ses flots clairs, à travers le désert Danakil. Dans quelques jours, il se jettera à la mer dans la baie française de Tadjourah, non loin de ce Djibouti, où le commandant Marchand, chassé de Fashoda par la cupidité britannique, s’embarqua jadis, désolé, sur le croiseur D’Assas qui devait le ramener en France.

CHAPITRE III
TOURELLES D’ACIER, CŒURS DE DIAMANT
Boum !… Boum !
Les grosses pièces des tourelles commandées par Timy Logdale et Braddock tonnaient sans interruption.
Comme d’énormes toupies, les coupoles d’acier tournaient incessamment sur elles-mêmes et lançaient au loin leurs obus géants qui, explosant au contact du sol, y creusaient des entonnoirs de cinq à six mètres de profondeur.
Tandis que l’armée anglaise, aiguillonnée par la soif, se repliait sur la Basse-Égypte, les tourelles arrêtaient l’armée des insurgés.
Elles étaient imprenables, pensaient les officiers britanniques.
Approvisionnées pour plus de deux mois, leur résistance donnerait aux Anglo-Saxons le loisir d’amener en Égypte toute l’armée hindoue et d’engager la lutte suprême dans des conditions de nombre et de position telles que la révolte serait infailliblement brisée.
Et les canons grondaient, semblant jeter un défi aux cohortes africaines qui les entouraient.
L’armée de Robert s’était en effet portée en avant, après la déroute du corps de cavalerie britannique.
Mais devant l’obstacle créé par la prudence saxonne, elle avait dû suspendre son mouvement.
À présent, dans un petit vallon, défilé des vues de l’ennemi, Robert et ses compagnons tenaient conseil.
– Il faut enlever ces tourelles, déclara nettement le jeune homme. Les premières tombées entre nos mains rendront moins acharnée la résistance des autres.
Armand inclina la tête.
– Sans doute ! sans doute ! Mais cela se prend moins facilement qu’un verre de bière. Qu’en pensez-vous, ami Jack ?
Il se tournait en même temps vers l’ex-fils de mistress Price qui, armé de son inévitable parasol, assistait au conseil. Celui-ci eut un sourire.
– Ne vous ai-je pas dit déjà que les coupoles ont un point faible ?
– Si, en effet.
– L’espace trop large qui existe entre l’alvéole de béton et le revêtement d’acier des coupoles.
– … Espace qui permettrait de se glisser dans le sous-sol et d’y disposer une mine.
– Justement.
– Par malheur, ce n’est là qu’une défectuosité théorique, reprit le journaliste après un silence.
– Théorique ? se récrièrent les assistants.
– Évidemment, car il est impossible d’approcher des tourelles. Le jour, elles dominent la plaine nue, sans un vallonnement, sans un abri. La nuit, par le fait de leurs projections électriques, elles s’aperçoivent à peine de la disparition du soleil.
La constatation était juste. Tous le reconnurent et courbèrent le front.
Tous, sauf Robert qui, depuis un instant, s’était plongé dans la contemplation d’un levé topographique qu’il avait tiré de sa poche. Brusquement il se dressa et d’une voix vibrante :
– Vous vous trompez, fit-il, il existe un chemin par lequel on peut arriver de nuit à cent mètres des tourelles sans être vu. Une fois là, on n’a presque plus rien à craindre, car les Anglais explorent surtout le terrain à grande distance, et les faisceaux lumineux de leurs foyers électriques laissent dans l’ombre la partie du sol immédiatement voisine des tourelles.
Tous écoutaient la bouche entrouverte, les yeux fixés sur le général insurgé.
– Le lit asséché du Nil, voilà le chemin qu’il faut suivre, poursuivit Robert. Il forme un creux suffisant. Il est certain qu’en longeant la rive gauche, on échapperait aux vues de la tourelle située sur cette rive ; de même, en côtoyant la berge de droite, on ne serait pas aperçu de la coupole placée de ce côté.
– Bravo ! s’écria Lotia en frappant ses mains l’une contre l’autre.
– Bon, fit Armand, il n’y a qu’un petit inconvénient.
– Lequel ?
– Celui-ci. Les tourelles sont édifiées, l’une à droite, l’autre à gauche du fleuve. De sorte que la troupe, invisible pour celle-ci ou celle-là, est exposée aux vues de l’autre.
– Oh ! interrompit Jack, les berges sont bordées de roseaux, au milieu desquels on peut se glisser.
– Sans doute ! mais ces roseaux ne forment pas une ligne continue. Il y a des espaces découverts à traverser. Or, les tourelles sont reliées par le téléphone, et, comme pour faire sauter l’une de ces forteresses de métal, on ne peut envoyer qu’une troupe peu nombreuse, la garnison avertie l’attendra tranquillement et l’exterminera aussitôt qu’elle se hasardera sur les cent derniers mètres que Robert signalait tout à l’heure.
– Donc, fit la voix tranquille de Jack, il convient d’abord de supprimer la communication téléphonique. Cela est facile ; les Anglais n’avaient pas prévu le dessèchement du Nil ; aussi le fil conducteur a-t-il été tout simplement immergé, et maintenant, il doit encore reposer sur le fond du lit, seulement il n’est plus masqué par sept ou huit mètres d’eau.
Puis il se tut un instant, comme pour donner à ses paroles le temps de pénétrer dans l’esprit de ses auditeurs, et il acheva lentement :
– La nuit prochaine, si vous voulez me confier trois ou quatre hommes munis des explosifs nécessaires, je les guiderai… je couperai le fil téléphonique, à l’instant même où ils seront sur le point d’agir. Plus tôt, la chose serait dangereuse, car les Anglais, s’apercevant de l’interruption de la communication, en rechercheraient la cause.
Toutes les mains se tendirent vers Jack. Mais Armand, incorrigible railleur, s’écria :
– Vous tenez mal vos serments.
– Moi ?
– Vous-même. N’avez-vous pas juré de ne combattre jamais vos anciens compatriotes ?
– Si. Je ne combattrai pas.
– Pardon. Poser une mine…
– C’est combattre en effet ; mais je me bornerai, sans armes, à guider vos mineurs. J’ai dit que je ne frapperais jamais moi-même et je tiendrai parole.
Et comme les assistants se taisaient, Jack ajouta doucement :
– Ceux qui s’introduiront dans le sous-sol devront agir vite. L’emploi des torpilles portatives, qui vous sont arrivées par la voie allemande, est indiqué. Il s’écoule quelques secondes entre le moment où elles sont actionnées et celui où elles font explosion. Les mineurs seront donc forcément englobés dans le désastre. En y allant, moi, non combattant, j’économise à notre cause un soldat. Voilà pourquoi je me propose.
Une émotion intense accueillit ces paroles.
Avant qu’elle eût pu se dissiper, Nilia, qui jusque-là avait assisté en silence à la discussion, se leva vivement.
– Jack, dit-elle, vous m’expliquerez ce qu’il y a à faire et je conduirai les hommes envoyés contre la seconde tourelle, cela économisera encore un soldat.
– Nilia ! se récrièrent Aurett et Lotia.
Mais la jeune fille leur imposa silence du geste.
– Laissez-moi me dévouer pour la liberté, j’ai été si longtemps captive.
Il est impossible de peindre l’expression inspirée de son visage, la douceur de sa voix. La courageuse enfant se sacrifiait sans phrases, entraînée, à son insu, par l’affection croissante qu’elle portait à Jack.
Celui-ci voulut faire une observation.
Nilia l’arrêta.
– Nous réussirons, murmura-t-elle, les yeux noyés dans le vague ; nous réussirons et nous reviendrons… La mort n’est pas sur nous.
Puis elle tressaillit et, comme au sortir d’un rêve, elle bégaya :
– Cette nuit, les deux premières tourelles anglaises seront détruites. Ne perdons pas notre temps en discussions inutiles.
Et, s’inclinant devant Robert :
– Général, acheva-t-elle, désignez ceux qui nous accompagneront.
Tel est l’ascendant de l’héroïsme que personne ne protesta.
Suivi de ses amis, Robert se rendit au campement du corps du génie, qu’il avait constitué avec les éléments provenant de l’ancienne armée égyptienne.
Sans entrer dans des explications oiseuses, il demanda six volontaires qui iraient la nuit suivante, sous les ordres de Jack et de Nilia, faire sauter les tourelles 1 et 2.
Cinquante se présentèrent aussitôt.
Avant de choisir, Robert crut devoir avertir les hommes du danger de l’expédition.
– Ceux qui iront là-bas, dit-il, doivent faire le sacrifice de leur vie.
L’enthousiasme n’en fut pas diminué. Les postulants à la mort crièrent tous :
– Moi ! moi !
Ah ! les braves gens ! Dans leur amour de la liberté, ils puisaient le courage sans bornes que les mercenaires ne connaissent pas.
On demandait six hommes pour les envoyer au trépas, tous réclamaient comme une faveur d’être de ce peloton de condamnés.
Il fallut tirer au sort pour ne pas désespérer ceux qui resteraient.
Et les six hommes choisis s’éloignèrent de leurs camarades, avec la mine joyeuse de gens se rendant à une fête.
Robert les conduisit lui-même au parc de munitions.
Ses amis suivaient, palpitant dans cette atmosphère héroïque. La confiance en l’avenir avait gagné tout le monde. On vaincrait, puisque tous, chefs et soldats, narguaient la mort.
Au parc, Robert fit apporter six torpilles portatives.
Ce sont des boîtes de cinquante centimètres de côté sur quinze d’épaisseur. Chacune était munie d’une poignée et de crampons courts et pointus.
Sur la face supérieure, sous un verre, rond comme un grand verre de montre, se voyait un bouton semblable à celui d’une sonnerie électrique.
On les déposa à terre devant les hommes.
– Savez-vous vous servir de ceci ? demanda le fiancé de Lotia.
– Non, répondirent-ils d’une seule voix.
– Bien, alors écoutez-moi.
Et tous ayant formé le cercle autour de lui, Robert poursuivit :
– Dans chacune de ces boîtes sont enfermés quarante à cinquante kilogrammes de mélinite ou d’une substance analogue.
– Diable ! grommela Armand, très dangereuses ces boîtes !
– Oui. Avec cela on fait sauter un bastion. Je reprends mon explication. Le bouton que vous apercevez à la partie supérieure est mis à l’abri d’une pression par une lentille de verre qui, le moment venu, tourne sur une charnière comme le couvercle d’un coffret. Grâce aux crampons, on fixe la torpille sur un mur, on ouvre le boîtier de verre et l’on appuie fortement sur le bouton. Après quoi, il faut fuir à toutes jambes. On a dix secondes pour se mettre à l’abri.
Le visage des Égyptiens demeura impassible.
Une simple inclination de tête démontra que les soldats avaient compris.
– Le mécanisme de l’appareil est simple, continua Robert. Le bouton poussé enflamme une amorce de sulfate d’antimoine, et celle-ci met le feu à un mélange fusant enfermé dans un tube de verre. Le mélange brûle à raison de trois millimètres par seconde et le tube a trente millimètres de long, d’où un écart de dix secondes entre l’instant où l’on actionne le bouton et celui de l’explosion.
De nouveau les hommes inclinèrent la tête.
– Vous avez compris ?
– Oui, firent-ils.
– Divisez-vous en deux groupes.
Trois des soldais firent aussitôt un pas à gauche, laissant ainsi un espace vide entre eux et leurs compagnons.
Robert désigna successivement les deux fractions.
– Vous, vous obéirez à sir Jack, ici présent, qui, le moment venu, vous dira ce que j’attends de votre courage… Vous, vous suivrez miss Nilia, ici présente.
Aucun geste de surprise n’accueillit ces mots. En d’autres temps, les Égyptiens se fussent étonnés d’être commandés par une jeune fille ; mais dans cette guerre étrange où toutes les forces vives de la vallée nilotique s’étaient rassemblées contre l’oppresseur, le dévouement des femmes ne surprenait pas plus que celui des hommes.
L’espoir de la liberté enflammait tous les cœurs, et les distinctions de sexe ou de costume avaient disparu.
Le chef donnait l’autorité à une jeune fille, à une enfant ; c’est qu’elle en était digne. On lui obéirait aveuglément.
– À la nuit, rassemblement ici, dit encore Robert. Jusque-là, vous êtes libres, rompez.
Et les soldats s’éloignèrent.
Pour Nilia, elle vint à Jack, lui prit le bras et doucement :
– Venez, Sir Jack, il faut m’apprendre ce que je devrai faire de ces torpilles et de ces hommes ?
Jack se laissa entraîner par elle, en proie à un trouble indicible. S’il avait osé, il se fût jeté à ses genoux ; il l’aurait conjurée de ne pas s’exposer au péril terrible vers lequel elle marchait en souriant.
Mais de quel droit la prierait-il ainsi ?
En le faisant, ne crierait-il pas sa tendresse, à cette exquise enfant qui l’ignorait ?
Aveuglement de l’affection, il ne voyait pas que, chaque jour, l’âme de Nilia s’unissait plus étroitement à la sienne.
Pudeur des sentiments vrais, il craignait de l’offenser en disant le rêve si doux qui palpitait en lui.
Et froidement il lui expliqua le but de l’expédition, la façon dont elle devait être conduite.
Elle écoutait, ses grands yeux fixés sur les lèvres de Jack, comme si elle percevait ainsi la forme des mots prononcés.
Elle l’interrompait parfois, se faisant répéter les choses ; formulant des « pourquoi » auxquels il répondait sans se lasser.
Quand ils revinrent au vallon où Robert avait établi son quartier général, Nilia put dire à Lotia et à Aurett qui, angoissées par la séparation prochaine, s’empressaient autour d’elle :
– Je crois que je ferai bien sauter la tourelle n° 1, cela n’a pas l’air très difficile.
– Ah ! s’écria Aurett avec un vague sourire, vous avez choisi le n° 1.
– Oui, murmura-t-elle.
Et, si bas que son interlocutrice ne l’entendit pas, elle ajouta :
– Je crois que le pire danger sera là… et je voudrais qu’il fût sauvé.
On dîna tristement.
Toujours la canonnade anglaise continuait contre les tirailleurs insurgés qui, rampant dans la plaine, envoyaient des volées de balles contre les tourelles.
On ne se faisait pas grand mal de part et d’autre ; mais, pour empêcher les tirailleurs d’approcher davantage, les artilleurs anglais étaient contraints de couvrir le terrain d’une pluie d’obus.
C’était là un succès relatif pour les assaillants. Grande était la dépense de projectiles, et comme la garnison des coupoles ne pourrait plus se ravitailler, il était certain qu’à ce feu-là, elle aurait bientôt épuisé ses munitions.
Pour faciliter l’expédition projetée, Robert fit renforcer les chaînes de tirailleurs.
La fusillade redoubla, devenant gênante pour les soldats anglais enfermés dans les tourelles, car les insurgés avaient peu à peu réglé leur tir et réussissaient maintenant à lancer des volées de balles dans les embrasures, lorsque celles-ci, entraînées par le mouvement général de rotation, se présentaient de leur côté.
La nuit vint.
Pas aussi sombre que l’auraient désiré les Français. La lune, à son dernier quartier, croissant d’Isis ou Serpe des Druides, laissait tomber sur la terre sa lueur nacrée.
Cependant, Jack et Nilia, suivis des six soldats égyptiens désignés le matin, ces derniers chargés des torpilles portatives et de légères échelles de bambou, descendirent vers le lit du fleuve, au-delà d’un coude brusque qui les masquait des tourelles.
Les hauts roseaux, encore verts, bordaient la berge, indiquant l’endroit où, quelques jours plus tôt, coulaient les eaux du Nil.
Là, on dit adieu à ceux qui restaient au camp. Successivement Jack et Nilia échangèrent une accolade émue avec Robert, Armand ; Aurett et Lotia elles-mêmes embrassèrent leurs courageux amis.
Puis Nilia, avec trois Égyptiens, traversa le lit du fleuve dans toute sa largeur et disparut dans le fouillis de plantes aquatiques qui bordaient la rive droite.
L’expédition commençait.
Brusquement Jack, resté avec ses trois hommes, sur la rive gauche, se mit en marche.
Ses soldats n’avaient pas bougé.
Ils attendirent dix minutes environ, ainsi qu’il leur en avait donné l’ordre, puis, comme des reptiles, ils se glissèrent à leur tour dans les roseaux, après avoir poussé un cri prolongé, aux modulations bizarres, auquel répondit un appel éloigné en tout semblable.
C’était un signal.
À cet instant même, la petite troupe de Nilia, jusque-là tapie dans les herbes de la rive droite, se mettait en mouvement.

À un kilomètre en avant des siens, Jack allait le plus rapidement possible. Tantôt courbé derrière une haie de bambous, il courait presque ; tantôt il rampait pour traverser les espaces découverts.
Il apercevait la masse sombre, crachant des éclairs, de la tourelle n° 1, celle-là même que Nilia allait attaquer.
Parfois les projections lumineuses, lancées par la coupole d’acier l’enveloppaient.
Alors il se couchait à terre et demeurait immobile.
Le rayon électrique passé, il repartait.
Des pensées multiples se heurtaient dans son cerveau.
Il allait mourir, cela ne faisait aucun doute pour lui, et Nilia aussi allait entrer dans l’inconnu.
Cela ne lui faisait pas peur, mais lui apparaissait comme une imagination fiévreuse du délire.
Leur dévouement commun était tel qu’un mariage in extremis.
Fiancés pour l’au-delà, ils marchaient d’un pas égal vers le sacrifice, et leur sang versé les ferait rois de l’espace, en teignant de pourpre leur parure nuptiale.
Français ! Ah oui ! bien Français vraiment, ce Jack, pour avoir, à l’heure du péril, ce songe mystique et cruel.
Français enthousiaste, entrant dans la mort comme les autres dans une salle de fête, sacrifiant son bonheur, sa tendresse à ces mots vides de sens pour les nations pratiques et terre-à-terre : Liberté ! Indépendance !
Il approchait du but.
À présent, les faisceaux lumineux de la tourelle n° 1 n’arrêtaient plus sa marche. Ils passaient au-dessus de sa tête, explorant le terrain bien loin en arrière.
Jack pouvait courir.
Il ne s’en fit pas faute, et, haletant, essoufflé, il s’arrêta enfin derrière un bloc de rocher, dont la masse brune trouait le sable dont le fond du lit du fleuve était couvert.
Là, il se trouvait juste à hauteur des tourelles.
Mais il ne se reposa pas longtemps. S’il était parti, seul, en avant, c’était pour couper le fil téléphonique, au moyen duquel étaient reliés les deux monstres de métal, extrême pointe de la ligne formidable de tourelles tournantes dressées le long du Nil par le génie anglais.
Ce fil, il s’en souvenait, avait été simplement plongé dans le fleuve, à l’heure où l’eau, coulant à pleins bords, semblait pour lui une protection suffisante.
Maintenant il devait reposer sur le sable.
Le jeune homme regarda autour de lui.
Il s’attendait à découvrir bientôt une ligne noire coupant le lit d’un bord à l’autre. Rien de semblable ne lui apparut.
Il eut une exclamation désappointée.
Comment le fil était-il devenu invisible ? Est-ce que les Anglais auraient eu l’idée de l’enterrer ?
Ce serait un désastre, s’il en était ainsi.
La recherche trop longue et trop difficile devrait être abandonnée. Les tourelles resteraient en communication, et les chances des assaillants diminueraient dans une proportion considérable.
Tout à coup, il se frappa le front.
Non, les Anglais n’avaient pas enterré leur fil téléphonique, mais le fleuve lui-même avait déposé, sur le conducteur immergé depuis deux mois, une couche de limon.
Voilà pourquoi Jack ne voyait rien.
Une tranchée peu profonde avait été creusée dans le sol des berges et, arrivés au niveau des eaux, les Anglais s’en étaient remis à elles de cacher leur communication.
Dès lors, pour retrouver le fil, il suffisait de tracer avec un couteau une ligne, profonde d’un ou de deux centimètres, parallèle au rivage. Fatalement on rencontrerait l’objet cherché.
Avec une rapidité que les circonstances rendaient indispensable, Jack se mit à la besogne.
Rampant, se traînant sur les coudes et les genoux, il commença son travail.
Dix, vingt, trente mètres furent ainsi « prospectés » à la pointe du couteau.
Jack sentait ruisseler sur lui une sueur d’angoisse.
Est-ce que ses calculs étaient faux ? Est-ce que le dépôt limoneux du Nil avait atteint une hauteur plus considérable ?
Fallait-il renoncer à priver l’ennemi du précieux secours du téléphone ?
Déjà les trois hommes porte-torpilles avaient rejoint le brave garçon.
Sur l’autre rive, Nilia et ses soldats allaient agir…
Et rageusement Jack fouillait toujours le sol.
Enfin ! Il étouffe un cri de triomphe. Un dernier coup de la lame tranchante a mis à nu le boudin de gutta-percha qui entoure le fil téléphonique.
En un instant, les cisailles dont le jeune homme s’est muni se sont refermées à plusieurs reprises.
La communication est coupée.
Il est temps.
Là-bas, sur la pente de la berge, éclairée par la lune, des points noirs se meuvent.
Nilia et ses compagnons vont remplir leur tâche.
Une idée folle traverse l’esprit de Jack.
Il faut qu’à la même seconde, les tourelles 1 et 2 sautent ; qu’à la même seconde, Nilia et lui meurent pour la liberté, qu’à la même seconde l’explosion formidable projette leurs âmes dans l’infini.
Et, se tournant vers les Égyptiens immobiles, aussi calmes que si leur existence n’était pas en jeu, il leur montre la pente douce de la rive gauche et murmure :
– En avant !
* *
*
Le lieutenant Braddock était monté au second étage de la tourelle n° 1.

Il avait relevé le mantelet d’acier qui obturait une étroite meurtrière ménagée dans la paroi, et, à l’aide d’une lorgnette, inspectait la plaine que parcouraient incessamment les faisceaux électriques.
Le vieil officier ressentait une vague inquiétude.
Depuis un quart d’heure, le feu des tirailleurs ennemis s’était éteint, l’artillerie des coupoles s’était tue, et le grand silence de la nuit, succédant au fracas assourdissant du combat, était bien fait pour impressionner.
Pourquoi les insurgés ne tiraient-ils plus ?
Préparaient-ils une attaque de vive force ?
Cela aurait été de la folie.
Les bataillons seraient venus se briser contre le blindage d’acier des forts pivotants.
Cependant, par mesure de précaution, le lieutenant donna ordre de mettre en batterie les mitrailleuses dont les tourelles étaient munies en vue des combats à distance rapprochée.
Il téléphona à Logdale de prendre la même précaution, puis, un peu rassuré, il revint à son observatoire.
La plaine était déserte.
Soudain Braddock se frotta les yeux.
En face de lui, sur la rive gauche, à cinquante mètres à peine de la tourelle n° 2, il avait cru apercevoir quelque chose en mouvement.
Il courut à l’homme chargé de la manœuvre du fanal électrique, lui ordonna de diriger le rayon lumineux sur ce point.
Et, reprenant sa lorgnette, il eut un cri.
Quatre hommes rampaient vers la tourelle 2…
Surpris par la lumière, ils bondirent en avant, atteignirent les revêtements de béton et disparurent.
À son tour, Braddock s’élança vers le téléphone. Il voulait prévenir son collègue Logdale.
Mais il eut beau marteler la sonnerie, rien ne répondit.
* *
*
L’officier anglais avait bien vu.
Jack et ses trois hommes étaient parvenus sans encombre à quelques mètres de la tourelle commandée par Timy Logdale.
Lorsque le faisceau lumineux avait été projeté sur eux, le jeune homme, comprenant que sa petite troupe était découverte, n’avait pas hésité.
Se dressant brusquement, il avait commandé :
– Au pas de course.
Trente secondes plus tard, les quatre insurgés se laissaient glisser le long de leurs échelles dans l’interstice existant entre les fondations de béton et le dôme d’acier de la tourelle.
Se coulant entre les galets-roulettes de métal, sur lesquels s’appuie le fort dans son mouvement circulaire, ils se trouvaient dans le sous-sol.
Devant eux était le mur bétonné qui enfermait le réduit central, contenant les vivres, munitions et le moteur.
Jack le désigna du doigt.
D’un même mouvement, les Égyptiens s’approchèrent, tâtonnèrent un instant et fixèrent à la paroi les torpilles portatives.
– Ouvrez ! commanda encore le jeune homme.
Les couvercles de verre, protégeant les boutons percuteurs, tournèrent sur leurs charnières.
– Attention, reprit le courageux Jack. Quand je dirai : allez ! vous frapperez ensemble, et aussitôt sauve qui peut. Que personne ne s’occupe de son voisin.
Ses subordonnés indiquèrent d’un signe de tête qu’ils avaient compris.
Chacun était debout devant sa torpille, prêt à frapper.
– Allez ! s’écria le jeune homme.
Les trois poings s’abattirent avec un bruit sourd sur les boutons, et, comme des ombres, les Égyptiens se précipitèrent vers les échelles.
Jack les suivait.
Dix secondes pour échapper, c’est-à-dire rien.
L’échelle, vers laquelle il s’était dirigé, tomba, il dut la ramasser. Ce fut un retard de quelques secondes, mais cela suffit.
Il posait à peine le pied sur le rebord extérieur de béton, quand une explosion effroyable se produisit.
Une gerbe de flammes jaillit du sol, projetant tourelle, canons, murs bétonnés dans l’espace.
Enlevé de terre, Jack se sentit emporté dans un vent enflammé.
– Nilia ! cria-t-il.
Et il perdit la conscience des choses.
Quand il revint à lui, il éprouva une sensation de froid et d’humidité.
Encore tout étourdi du choc effrayant qu’il venait de subir, il ouvrit les yeux, et, à travers un brouillard, il lui sembla distinguer le doux visage de Nilia penché sur lui.
Il fit un effort, parvint à bégayer :
– C’est la mort !… partir ensemble… douce mort.
Et de nouveau, il s’évanouit.

Jack avait bien vu.
Comment Nilia se trouvait-elle là ?
Oh ! d’une façon bien simple. Lorsqu’elle avait commencé, avec ses soldats, l’escalade de la berge accédant à la tourelle n° 1, les Égyptiens l’avaient arrêtée un peu avant d’atteindre la crête.
– Tu n’as pas besoin d’aller plus loin, avaient-ils dit. Attends ici.
Elle s’était défendue. Elle aussi voulait risquer sa vie.
Mais ces hommes, étreints par une invincible pitié, s’étaient juré de la sauver malgré elle.
– Si tu n’obéis pas, déclarèrent-ils, nous rentrons au camp.
La jeune fille avait dû céder.
Elle s’était accroupie sur le sol. De son corsage elle avait tiré un couteau nubien, et, doucement elle avait murmuré :
– On peut toujours mourir quand on le veut.
Les yeux fixés sur la tourelle 2, dont la coupole se profilait sur l’autre rive, elle attendit.
Et soudain, deux détonations dont rien ne peut donner l’idée, se confondirent en une seule.
Le sol oscilla, comme secoué par un tremblement de terre. Une clarté aveuglante illumina la plaine, et, sur le fond du ciel subitement rougi passèrent des choses noires projetées en tous sens.
Nilia, chassée par un souffle impétueux, moitié portée, moitié courant, vint tomber au milieu du lit du fleuve.
Autour d’elle des chocs violents ébranlaient le terrain. Des morceaux de fonte, d’acier, des canons tordus, des pierres, des débris sans nom, s’abattaient après avoir décrit dans l’air une trajectoire élevée.
Puis tout s’apaisa. C’était fini. La jeune fille n’avait aucune blessure. Le vent de mort avait passé autour d’elle sans l’atteindre.
Chancelante, elle se leva. Elle voulait courir là-bas, à cette tourelle où sans doute Jack avait trouvé la mort.
Soudain elle s’arrêta avec un cri de détresse, si déchirant que nul ne l’aurait cru sorti d’une poitrine humaine.
À deux pas d’elle s’étalait une flaque d’eau, un trou que le soleil n’avait pas encore desséché.
Et sous l’eau, éclairé par la lune, Nilia venait d’apercevoir le corps d’un homme. De suite elle l’avait reconnu. C’était Jack.
D’un bond elle fut dans le lagon, ayant de l’eau jusqu’au cou. Elle parvint à saisir Jack, à le tirer sur le sable sec.
Elle le frictionna, lui prodiguant des soins, disant les paroles qui montaient de son cœur.
– Reviens à toi. Ma vie est liée à ta présence. Oh ! je ne parlerai jamais. La pauvre enfant, élevée par des bohémiens, ne doit pas embarrasser ton existence. Mais que je puisse te voir, entendre ta voix.
Elle se tut brusquement. Jack avait fait un mouvement.
Ses lèvres s’étaient desserrées, laissant échapper un long soupir.
Il vivait.
Oui, le jeune homme vivait, miraculeusement sauvé. Jeté au loin par la violence de l’explosion, il était tombé par bonheur dans un des rares lagons encore visibles sur le fond aride du fleuve. L’eau avait amorti le choc.

Il vivait.
Et sa tête inerte reposait sur les genoux de Nilia, qui le regardait de ses grands yeux mouillés de larmes.
Ils étaient là, dans la nuit, entre les rives fumantes, sous le ciel plein d’étoiles, tous deux jeunes, tous deux venant de proclamer, dans une explosion effrayante, leur amour commun de la liberté.
Et cependant, lorsque Jack reprit enfin la notion de l’existence, aucun des deux ne parla. Ni lui, ni elle, ne fit l’aveu si doux :
– En allant au trépas, c’est ton nom que j’avais sur les lèvres, ton image que j’avais dans le cœur.
Ils se turent, baissant leurs paupières pour cacher les larmes joyeuses qui obscurcissaient leurs regards en se retrouvant réunis, en se voyant sauvés. Bientôt d’ailleurs, les berges désertes s’animèrent.
Avec des cris de triomphe qui montaient jusqu’au ciel, les soldats de Robert accouraient.
Ils se rassemblaient autour des entonnoirs que l’explosion avait creusés à l’endroit où se dressaient orgueilleusement les tourelles.
C’était chez eux un véritable délire.
Le premier chaînon de l’immense retranchement anglais était brisé. Sans canons, les insurgés avaient vaincu cette fois encore.
Sur le passage de Robert et de ses amis, les Égyptiens poussaient des acclamations frénétiques ; les noirs se prosternaient ; les derviches du Darfour et du Kordofan les proclamaient Mahdis ou prophètes, désignés par Allah et Mahomet pour rejeter les habits rouges à la mer.
C’était une clameur, un tumulte indescriptibles, affolés. C’était la joie exubérante de peuples trop longtemps asservis, qui se sentaient renaître à l’indépendance.
Et dans la foule, Robert s’avançait pensif, Lotia appuyée à son bras.
L’ivresse de la victoire était gâtée par une tristesse.
Le triomphe coûtait cher à leur cœur.
Jack, Nilia, ces êtres bons et dévoués, auxquels ils avaient donné leur affection, avaient sans doute payé de leur vie le succès dont toute l’armée était en liesse.
Ils gisaient en lambeaux, déchiquetés, méconnaissables, parmi les débris de toute sorte épars aux alentours.
Deux des Égyptiens porte-torpilles étaient seuls revenus.
Aux questions qui leur avaient été adressées, touchant leurs compagnons, ils avaient répondu, avec l’indifférence fataliste des Orientaux :
– Au Paradis de Mahomet, certainement. Ils sont heureux. Pour nous, notre départ n’était pas encore écrit.
– Pauvre Jack ! gémirent Robert et Armand.
– Pauvre Nilia ! dirent Aurett et Lotia.
Et soudain tous se taisent.
Un murmure confus court sur la multitude. Il grossit, s’enfle, éclate en cris de fête.
Qu’est-ce donc ?
Les rangs pressés des noirs s’écartent et Jack apparaît, soutenu par Nilia.
Ceux que l’on pleurait déjà sont vivants.
Les cousins, leurs compagnes se précipitent. Ce sont des poignées de mains, des félicitations émues.
Et puis des interrogations anxieuses.
Mais Nilia fait remarquer que, tout comme elle, Jack est couvert de vêtements mouillés. La fraîcheur de la nuit les fait grelotter tous deux.
Alors Aurett et Lotia les entraînent vers le camp. Il ne faut pas que la pleurésie ou la fluxion de poitrine frappent ceux que la dynamite a épargnés.
Et Robert, demeuré seul avec Armand, s’écrie :
– Allons. La victoire n’est pas chèrement achetée. Il faut songer à l’annoncer à nos différents corps d’armée.
– L’annoncer ? Tu vas envoyer des courriers.
– À quoi bon. J’ai les signaux de feu.
Armand se gratta la tête.
– Je connais cela. Des brasiers allumés sur les hauteurs. Toutes les populations sauvages se servent de ce moyen de communication. Mais cela est bien rudimentaire, et je ne vois pas comment on peut transmettre ainsi une dépêche tant soit peu compliquée.
– J’ai un peu perfectionné l’appareil, répliqua paisiblement Robert.
– Toi ?
– Oui. Avant d’être général, j’ai occupé, à Paris, les fonctions de caissier chez MM. Brice et Molbec, de Paris, fabricants d’instruments d’optique.
– Et… ?
– Suis-moi, tu verras de tes yeux ce qui, si je ne me trompe, est encore de l’optique.
Avec un geste rageur, le journaliste consentit.
Décidément le hasard s’amusait à mettre la patience de ce curieux à de rudes épreuves.
Près de Robert, il traversa la plaine, gagna les hauteurs situées à l’Ouest, derniers contreforts de la chaîne Lybique.
Après une escalade fatigante, tous deux parvinrent sur un étroit plateau rocheux, qui dominait de quelques centaines de mètres le pays environnant.
À sa grande surprise, Armand aperçut là plusieurs soldats égyptiens, assis autour d’une sorte de fourneau, fait de pierres superposées, dans lequel flambaient des brindilles de bois sec.
Tous se levèrent et saluèrent militairement.
– Mes signaleurs, expliqua Robert.
– Tes signaleurs ?
– Oui, j’ai organisé un corps spécial, sur le modèle de ce qui existe dans les armées européennes. Les communications par feux, au lieu d’être abandonnées au premier noir venu, sont confiées à des hommes qu’une instruction particulière a préparés à ce service.
Puis, changeant brusquement de ton :
– À propos. Connais-tu les appareils dont on se sert en France pour les signaux lumineux ?
Une moue du journaliste avoua son ignorance.
– Non, en ce cas un mot d’explication est nécessaire.
– Je t’écoute avec recueillement, cousin. Chaque jour tu m’étonnes davantage. Toi, jadis, si casanier, si bourgeoisement encroûté, tu te révèles tout à coup général. J’assiste à la transformation d’une chrysalide en papillon.
Robert l’interrompit vivement.
– Pas papillon du tout. Cet insecte frivole promène sa course capricieuse de fleur en Heur. Tandis que moi, je marche, les yeux fixés sur une seule étoile, qui a nom…
– Lotia. Inutile de le dire. Eh bien je supprime le papillon. Tu voles vers une étoile terrestre ; je t’appellerai donc luciole ou mouche à feu. Jamais du reste ce sobriquet n’aura été aussi justifié qu’en ce moment.

Et coupant court à une riposte de son interlocuteur :
– Maintenant, détaille-moi le télégraphe lumineux.
– Soit donc, sempiternel railleur. Tu sais sans doute que les études de l’ingénieur Weiller, inventeur du phoroscope, ou transporteur de la vision, ont servi de point de départ à la construction des lanternes utilisées pour les communications optiques.
– Il me semble que j’ai entendu parler de cela.
– Bien. Figure-toi une lanterne à six faces, ayant la forme d’un dé à jouer.
– Jusqu’à présent, je suis facilement ta démonstration.
– Cinq faces sont opaques. La sixième seule est percée d’un cercle qu’obture un verre.
– Toujours très clair.
– À l’intérieur un foyer électrique très puissant. Si on l’actionne, le faisceau lumineux traverse le disque de verre et se propage au loin.
– Donnant une projection électrique analogue à celles dont nous régalaient les tourelles mises à mal par nos braves amis, acheva Armand Lavarède avec un sourire. À présent, il reste à interrompre cette lumière, suivant des conventions données, absolument comme le télégraphiste, assis devant l’appareil Morse, interrompt ou rétablit le courant. Alors le veilleur, placé à distance du foyer lumineux, lit la dépêche et peut la transmettre à son tour.
Robert ne parut pas faire attention à l’ironie contenue dans ces paroles.
Il était insensible aux boutades de son cousin ; trop de responsabilités pesaient sur lui. Aussi reprit-il gravement :
– On aurait pu, à l’aide de courants alternatifs, éteindre et l’allumer le foyer électrique. On a préféré le maintenir fixe, et obtenir à l’aide d’un verre de coloration rouge, se mouvant de façon à masquer à volonté l’ouverture de la lanterne, des alternances de feux rouges et blancs ; les premiers représentant les intervalles entre les lettres ou mots figurés par les seconds.
Il se tut soudain. Armand venait de laisser échapper un grand éclat de rire et, son cousin l’interrogeant du regard :
– Pardonne-moi. Mais je m’aperçois d’une chose qui a bien sa petite importance dans l’espèce…
– C’est…
– Que tu connais admirablement la théorie ; pour passer à la pratique, il ne te manque que… que la lanterne.
Et ses rires redoublèrent. Robert haussa les épaules.
– Tu te trompes encore, cousin.
– Tu as une lanterne ? se récria le journaliste saisi.
– Oui, ou du moins un appareil qui en tient lieu.
– Où cela ?
– Ce fourneau, que tu as remarqué en arrivant sur ce plateau. Il est fermé de toutes parts, sauf du côté qui regarde le sud.
– Oui, eh bien ?
– Eh bien, mon bon ami, avec une natte de palmier, manœuvrée par deux hommes, on masque le feu. Cela remplace le verre rouge, dont je parlais tout à l’heure, et nous permet d’arriver au même résultat que le signaleur électrique.
Il se reprit bien vite :
– J’ai tort de dire au même résultat, car la portée du rayon lumineux et son intensité sont beaucoup moindres. Mais en ce pays, la chose a peu d’importance.
Du coup, Armand serra les mains de son cousin.
– Je te répète que je t’admire, mon cher Robert. Tu es la gloire des Lavarède. Mais je chanterai tes louanges plus tard. Il s’agit d’apprendre à tous tes soldats le succès remporté cette nuit. Veille à cela, tu recevras mes félicitations ensuite.
Sans attendre cette invitation, le général insurgé avait déjà parlé à voix basse au sous-officier, chef du poste de signaleurs. Les soldats s’étaient précipités, avaient rejeté du bois dans le foyer. Deux d’entre eux, placés de chaque côté, maintenant en l’air une natte de fibres de palmier tressées.
– Allez ! ordonna Robert.
Aussitôt la natte descendit, pour remonter ensuite et redescendre encore.
Et dans la nuit, au loin, une lumière s’alluma, qui parut et disparut presque en même temps que le foyer était ou non voilé.
Le poste auquel on transmettait la dépêche répétait les signes afin d’éviter toute erreur.
– Que disent-ils ainsi ? questionna le journaliste, après avoir regardé un moment en silence.
– Ceci, cousin : « Enlevé cette nuit les deux premières tourelles anglaises, tué une centaine de soldats à l’ennemi. Perdu quatre hommes… »
– Bravo ! on jurerait une dépêche officielle. « Tué cent personnes, quatre morts seulement de notre côté. »
– Seulement, répondit gravement Robert, la différence entre les dépêches auxquelles tu fais allusion et les nôtres est que nous ne déclarons rien de contraire à la vérité. Jamais je ne consentirai à tromper ceux qui marchent sous mes ordres.
La communication était terminée. La nouvelle de la victoire courait maintenant en lignes de feux sur toutes les crêtes, portant partout la confiance et l’allégresse.
Et à cette heure même, les Anglais, démoralisés par la destruction des tourelles 1 et 2 qu’ils avaient crues imprenables, évacuaient les coupoles voisines, se repliant précipitamment sur Berber, où venait d’arriver le gros de l’armée.
Ils abandonnaient tourelles, canons, munitions, bagages. Les « grilles », affectées à la correspondance secrète de l’armée, étaient oubliées avec les coffres contenant la solde des troupes.
Et le lendemain, Robert pouvait porter toute son armée en avant, sans rencontrer de résistance. Le soir, au campement, il montrait triomphalement les « grilles » de l’ennemi.
Désormais les dépêches interceptées pourraient être lues sans difficulté.
La campagne s’ouvrait sous les meilleurs auspices.

CHAPITRE IV
LE PACTE DE TRAHISON
Qu’est-ce qu’une grille ?
Une grille est une feuille de carton ou de métal ; on la divise en carrés ainsi qu’un damier, puis à son gré on évide les uns tandis que les autres sont laissés pleins.
Ceci fait, si l’on applique celle plaquette sur un papier, il n’y aura de découvertes que les parties correspondant aux surfaces évidées de la grille.
A-t-on une dépêche secrète à envoyer, on trace une lettre dans chacun des carrés découpés. On enlève la grille et l’on remplit tous les blancs de lettres choisies au hasard.
Veut-on relire ? On replace la grille dont les pleins cachent les caractères inutiles, et dont les vides laissent apparaître ceux qui ont une signification.
Telle est la théorie, aussi simple que possible, des grilles dans les armées ; dans la diplomatie, on la complique à l’infini.
Mais ces quelques lignes suffiront à faire comprendre de quelle importance est pour un général le secret des grilles employées pour ses communications avec ses subordonnés, et quelle portée la divulgation du découpage peut avoir aux yeux d’un ennemi.
Aussi lord Lewis Biggun était-il sombre.
Enfermé dans une des maisons de Berber, dont les croisées s’ouvraient sur le Nil, sans eau ici comme à Khartoum, il avait consigné sa porte.
Certes, en apprenant la fuite des garnisons des tourelles, la capture par les insurgés de leurs approvisionnements, il avait senti s’allumer en lui une terrible colère. Mais quand les fugitifs durent avouer l’abandon des grilles, des correspondances confiées à leur garde, la rage du Sirdar ne connut plus de bornes.
Il ordonna sans tarder la substitution de grilles nouvelles aux anciennes. Cela n’était qu’un palliatif. Les rebelles liraient les papiers tombés entre leurs mains ; ils seraient ainsi mis au courant des efforts désespérés de l’Angleterre qui, à ce moment, mobilisait son armée des Indes, affrétait tous ses navires, pour jeter trois cent mille Cipayes sur l’Égypte.
Bien certainement ces Français maudits qui dirigeaient le mouvement feraient leur profit de ces renseignements.
En cela il ne se trompait pas.
Or, seul dans sa chambre, il marchait de long en large, tel un fauve en cage.
Lui, lui, un général anglais devait battre en retraite devant une cohue de noirs commandés par des Français.
Oh ! cette race abominable de Gaulois, de Gallo-Romains ; cette race que, depuis tant d’années, les gazettes britanniques et allemandes représentaient comme déchue, agonisante, elle vivait donc quand même.
Qu’étaient ces deux hommes qui détruisaient sa cavalerie, enlevaient ses forteresses ? Un journaliste parisien, un ex-employé de commerce, deux citoyens obscurs de la République française.
Et ces hommes avaient soulevé toutes les populations de la vallée du Nil ; ces hommes traînaient à leur suite des centaines de mille noirs qui bivouaquaient tranquillement dans les régions d’où la soif chassait l’armée anglaise.
Ah ! il se souvenait de ce toast porté naguère par le commandant Marchand :
– À la revanche de Fashoda !
Toute l’Angleterre avait été secouée par un immense éclat de rire. La revanche de la France, cela était bouffon au possible.
Et cette chose ridicule, incroyable se produisait.
Il fallait à tout prix arrêter le mouvement, vaincre cette horde de rebelles. C’était la vie même de l’Angleterre qui était en jeu.
Chassée d’Égypte, elle le serait de partout. Hindous, Australiens, Canadiens réclameraient aussitôt leur autonomie. La puissance factice de la Grande-Bretagne s’écroulerait. Le colosse aux pieds d’argile serait précipité dans la poussière.
Et à l’esprit troublé du Sirdar se représentait la prédiction de Gladstone, le Great old man, disant à ses ambitieux successeurs :

– Prenez garde d’étendre outre mesure votre empire. En établissant notre autorité sur tant de peuples, vous augmentez sans cesse le nombre de nos ennemis. Hors d’état de faire face à tous à la fois, notre grandeur est à la merci d’une défaite.
Sa rêverie douloureuse fut troublée par un bruit retentissant.
Une pierre venait d’être jetée du dehors, et les carreaux de l’une des fenêtres, éclatant en mille pièces, tombaient avec fracas sur le plancher.
Que signifiait cela ?
La mutinerie se mettait-elle déjà parmi les troupes britanniques ?
Lord Biggun courut à la fenêtre et regarda.
Dans la rue, il aperçut Gorgius Kaufmann.
L’Allemand lui adressa un bonjour amical et cria :
– J’emploie la violence pour forcer votre, porte, général ; vous m’excuserez si vous consentez à m’accorder quelques minutes.
Le ton du docteur était si assuré, que le Sirdar n’hésita pas. Il se pencha à la croisée, héla le factionnaire qui gardait l’entrée de la maison :
– Laissez passer, ordonna-t-il.
Le soldat présenta les armes et Gorgius s’engouffra sous le vestibule. Un instant plus tard, il pénétrait dans la chambre où se tenait le général. Sans précautions, négligeant même les formules d’usuelle politesse :
– Sirdar, commença-t-il, je viens vous communiquer le résultat de réflexions sérieuses.
– Les vôtres sont sérieuses, fit Biggun avec une teinte de mélancolie, les miennes sont tristes. Cependant je vous écoute.
L’Allemand s’inclina.
– Général, reprit-il, si ces maudits français, Robert et Armand Lavarède avaient su, depuis un mois, que l’Angleterre mobilise son armée des Indes pour la jeter sur les côtes de la mer Rouge et prendre les rebelles en flanc, il est certain qu’ils auraient enjoint à leurs alliés d’Abyssinie d’envoyer des troupes pour empêcher un débarquement.
Lord Lewis Biggun hocha tristement la tête.
– Ils n’ignorent plus rien maintenant. Ils ont enlevé la correspondance.
– De l’armée, oui, oui. Mais avant ce malheur… réparable.
– Réparable, dites-vous ?
– Oui… mais procédons avec ordre. Avant ce malheur, ils n’étaient pas au courant… est-ce votre avis ?
– Sans doute.
– Donc, continua triomphalement Gorgius, ils n’ont pas découvert le secret de Nilia.
Un tressaillement secoua le Sirdar.
– C’est vrai, murmura-t-il.
– Et par conséquent, conclut l’Allemand, si nous leur dressions un piège bien conditionné, ils y pourraient tomber.
Biggun avait relevé la tête ; ses yeux interrogeaient avidement le petit homme crasseux.
– Et ce piège… ?
– Attendez, attendez, Lord généralissime. À mon sens, la force des rebelles réside entièrement dans l’intelligence… il faut dire le mot, si désagréable à prononcer qu’il soit alors qu’il s’applique à des ennemis… à l’intelligence des français qui les commandent.
– Cela est de toute évidence.
– Bien. La révolte tomberait d’elle-même, si elle était privée de ses chefs.
– Oui, mais le moyen ?
– Je vous l’apporte.
Il y eut un silence. Les deux hommes se regardaient. Gorgius restait souriant, tandis que le Sirdar fronçait anxieusement les sourcils.
– Et bien ? fit ce dernier d’une voix sourde.
Kaufmann se pencha à son oreille, et, baissant la voix :
– Ils ont capturé les grilles et les correspondances de l’armée ; c’est de cela qu’ils doivent périr.
Et comme Biggun esquissait un geste de surprise :
– Il suffit de faire tomber entre leurs mains une dépêche écrite au moyen de l’une des anciennes grilles.
– Je ne comprends pas.
– Aussi je m’explique. Les Abyssins représentent un contingent de deux cent mille guerriers, bien armés, à peu près disciplinés ; un tel appoint n’est pas à dédaigner.
– Non.
– Que les Français supposent un instant chez les ras (chefs abyssins) l’intention de se désintéresser de la lutte, et ils laisseront leur armée, qui n’a rien à craindre de nous en ce moment, pour courir auprès des hésitants et ranimer leur ardeur.
– Tout cela, est certain, mais ne nous délivrera pas des Lavarède que l’enfer confonde.
– Pardon, pardon…
– Dites votre pensée.
– Je ne suis ici que pour cela, général.
Et, scandant les mots :
– Aux lieu et place des troupes d’Abyssinie, les Français, désireux de marcher aussi rapidement que possible, ayant par suite, une faible escorte, trouveront un ou deux régiments anglais, que nous aurons envoyés au rendez-vous.
Le Sirdar poussa un véritable rugissement.
– Vous avez raison, docteur. C’est la vengeance que vous m’apportez là…
– Ne me remerciez pas, je venge ma propre injure. Ils m’ont volé Nilia, je les hais.
Le grand et svelte officier anglais, le savant voûté et malpropre s’étaient pris les mains, et ils demeuraient en face l’un de l’autre, une même expression de cruauté dans les yeux.
Soudain Biggun demanda :
– À qui enverrons-nous le courrier que l’ennemi doit intercepter ?
– Au général Holson qui, avec ses escadrons de méharistes (troupes montées sur des chameaux de course), opère à l’ouest dans le désert, et nous renseigne sur les mouvements des rebelles.
– Mais un courrier peut facilement éviter l’armée des noirs.
– S’il n’est pas décidé à se faire prendre.
Le Sirdar parut embarrassé.
– C’est donc un homme qu’il faut mettre au courant ?
Un imperceptible sourire passa sur les lèvres de Gorgius, mais l’Allemand reprit aussitôt toute sa gravité.
– Il le faut, en effet, car cet homme doit être décidé à mourir. Pour tromper l’ennemi, il est indispensable que le messager se défende jusqu’à la dernière extrémité.
– Cela est vrai, reprit tristement Biggun. Mais qui choisir dans mon armée démoralisée par des défaites inattendues ?
– Qui ? Un homme qui donnera son existence avec joie.
– Je n’en vois pas, docteur.
– Vous regardez donc mal, général ?
Et lentement Kaufmann prononça :
– John Price.
Le lord frissonna.
– Lui… le fils de cette pauvre mère déjà si cruellement éprouvée !
– En Angleterre, riposta sèchement Gorgius, il y a dix mille mères qui attendent, anxieuses, des nouvelles de leurs fils, confiés au Sirdar Lewis Biggun.
La remarque cingla le général.
– Vous avez raison, docteur. Une mère doit être sacrifiée à dix mille ; mais pourquoi frapper justement cette bonne Price. Son fils Jack est passé à l’ennemi, n’est-ce pas suffisant ?
– Je ne m’inquiète pas de savoir si cela suffit. Je pense seulement que la trahison de Jack a bouleversé John, et que ce dernier se dévouera avec joie pour effacer le déshonneur jeté sur son nom.
Et comme le Sirdar gardait le silence, l’Allemand reprit :
– Lors des derniers combats de cavalerie, au plus fort de la mêlée, John a rencontré Jack sans armes. Il l’a épargné, et je l’entendais hier encore s’accuser de sa faiblesse : J’ai été lâche, disait-il, la mort seule aurait effacé la honte.
Puis cyniquement :
– Voyez-vous, général, quand on a un homme de cœur sous la main, il faut se hâter d’en user. Après tout, qu’est l’existence de Jack auprès du triomphe de l’Angleterre ? Rien, n’est-ce pas ?
– Non, rien, répéta le Sirdar dominant sa passagère émotion. Mais par réflexion :
– Autre chose encore.
– Parlez, général.
– Il serait bon que les révoltés fussent prévenus de l’envoi du courrier, afin que celui-ci ne fût pas obligé de commettre quelque imprudence pour attirer l’attention.
– Ils le seront.
Du coup, le lord, en dépit de son flegme britannique, eut une exclamation de surprise.
– Ah çà, vous avez songé à tout !
– Le procédé scientifique, mon général.
– Et comment comptez-vous prévenir les rebelles ?
– De la façon la plus simple. En faisant évader le chef noir que nos cavaliers ont fait prisonnier en avant de Khartoum.
– Ce Mazouga ?
– Lui-même. Vous voudrez bien donner l’ordre que personne ne s’oppose à mes manœuvres.
– Avec plaisir, vous n’en doutez pas.
– Ce Mazouga, mon général, est enfermé dans l’ancienne habitation du gouverneur de Berber. Je me présente à lui, sous un déguisement, je suis un Français, je le sauve en lui contant qu’il se trame quelque chose contre ses amis, qu’un messager va partir incessamment vers le général Holson, je l’aide à fuir, et la farce est jouée.
Vraiment le Sirdar considérait l’Allemand avec admiration.
Ce petit homme laid, maigre, chétif, lui apparaissait grandi.
Et de fait, Gorgius avait bien les qualités de méthode de sa race. Il ne se mettait en mouvement qu’après avoir assuré, autant que possible, le succès de son opération.
Il faut savoir rendre justice surtout à ses adversaires.
Ma foi, la visite du docteur avait arraché lord Biggun à ses sombres pensées. L’espérance avait rallumé dans son cœur cette petite veilleuse dont la flamme tremblotante guide et éclaire l’homme dans les heures difficiles.
Tous deux se séparèrent dans les meilleurs termes, et, selon sa promesse, le Sirdar expédia aussitôt au palais des anciens gouverneurs, transformé en prison, l’ordre de ne s’opposer en rien aux agissements de Gorgius.
Le soir même, l’Allemand, sans lunettes cette fois, mais drapé dans un burnous, et portant sous le bras un paquet volumineux, pénétrait dans la cellule du chef Mazouga.
Le noir était morose.
Habitué à la liberté, aux larges horizons africains, il manquait d’air dans l’étroit espace où il était enfermé.
Et puis, il avait peur.
Peur, oui vraiment. L’Anglais est exécré par toutes les populations du continent noir, et dans les légendes colportées de village en village, joue le rôle terrifiant de la tarasque dans le midi de la France, du loup-garou dans le centre, des feux follets et des farfadets dans le nord et dans l’ouest.
L’Anglais, c’est l’ennemi qui tue et pille ; plus que cela, c’est le marchand d’esclaves qui emmène en gémissante théorie les prisonniers de guerre vers les pays inconnus d’où l’on ne revient jamais.
Aussi Mazouga craignait-il quelque traitement d’une barbarie raffinée.
Il sursauta quand Gorgius entra.
D’instinct, il recula dans un angle de la pièce, ramassé sur lui-même ainsi que le fauve prêt à bondir.
Mais il frissonna de la tête aux pieds en entendant le visiteur prononcer ces paroles :
– Mazouga tremble… il a tort… je suis du pays de ses chefs, Robert et Armand Lavarède, et je suis ici pour le sauver.
Le chef ne bougea pas cependant.
N’était-ce point là une ruse pour éteindre sa défiance, pour le livrer sans défense à des soldats cachés au dehors et prêts à se ruer sur lui ? Mais Gorgius reprit :
– Mazouga se tait… il doute de mes paroles et cependant il sera heureux de se retrouver sur son cheval, libre au milieu des vastes plaines, où ses soldats l’appellent vainement.
Un profond soupir s’échappa des lèvres du noir.

– Eh bien, ce désir, je pourrais, moi, le transformer en réalité.
Avec angoisse, le chef considérait son interlocuteur.
Évidemment un combat se livrait en lui. Devait-il croire cet étranger qui lui parlait de liberté ? Tout à coup il grommela :
– Qui es-tu ?
Sans hésiter, Kaufmann répondit :
– Un Français, je te l’ai dit.
– Un Français ? Comment sers-tu alors dans l’armée anglaise ?
– J’étais kodja (secrétaire) d’un riche négociant. La fièvre me clouait au lit quand les habitants d’Égypte se sont enfuis au désert. Les habits rouges m’ont trouvé là et m’ont enrôlé comme scribe de l’état-major.
– Et tu as accepté ?
– Oui. Une réflexion m’était venue. Ma nouvelle situation me permettrait peut-être de rendre service à des insurgés prisonniers. Cette pensée était raisonnable, puisque en ce jour, je viens t’offrir la liberté.
Le noir courba le front.
Les derniers mots du docteur avaient porté. Comment suspecter un homme qui déclarait n’être resté parmi les soldats britanniques que pour aider les captifs et qui, sans paraître s’inquiéter des risques de l’aventure, proposait de coopérer à l’évasion du chef.
– Quand fuirons-nous ? murmura enfin le noir, en baissant la voix.
– Cette nuit.
– Cette nuit ? Cela est-il possible ?
– Oui, car j’ai tout préparé.
Et, se rapprochant du chef, Gorgius expliqua :
– Les gardiens sont de mes amis. J’ai profité de la fête de l’un d’eux, pour organiser un festin. Le vin, la bière, les liqueurs les ont endormis. Seuls, dans la prison, nous avons les yeux ouverts.
Il dépliait en même temps le paquet dont il s’était muni, et en tirait un burnous.
– Voici un manteau que tu jetteras sur tes épaules. Je te conduirai hors de la ville en un endroit où un cheval t’attend.
Les yeux de Mazouga pétillèrent.
– Un cheval ? répéta-t-il.
– Oui, cela te plaît ?
– Beaucoup. Je te remercie.
– À quoi bon. Français, j’agis pour le mieux en faveur de ceux qui se sont rassemblés à l’appel de mes compatriotes.
Puis changeant de ton :
– Es-tu prêt ?
– Je le suis, fit le nègre en s’enveloppant du burnous.
– En ce cas, en route !
Mais Mazouga arrêta Gorgius qui déjà se dirigeait vers la porte.
– Moi parti, que feras-tu ?
– Je reviendrai ici et je feindrai de dormir comme les autres. De cette façon, nul ne me soupçonnera.
– Pourquoi ne pas fuir avec moi ?
– Ma fuite inquiéterait les Anglais, car je sais beaucoup de choses.
– Qu’importe ?
– Il importe beaucoup. Au reste, je t’expliquerai tout en route. Hâtons-nous seulement car nos instants sont comptés.
Mazouga n’hésita plus.
Cinq minutes après, il se trouvait dans la rue avec son compagnon.
En passant devant le poste de garde, il avait pu constater que les geôliers dormaient, qui sur une chaise, qui à terre, autour d’une table sur laquelle s’alignait un bataillon respectable de bouteilles.
Il est vrai qu’une fois le chef nègre disparu, les dormeurs se relevèrent vivement et rangèrent en un clin d’œil flacons, chaises et mobilier.
Le tableau d’orgie aperçu par le prisonnier fugitif était une simple mise en scène disposée par Kaufmann.
L’Allemand entraînait le fugitif à travers les rues de Berber.
– Écoute, dit-il, tout en marchant. On prépare quelque chose contre les tiens.
– Quoi ?
– Je ne sais, mais je puis te donner le moyen de l’apprendre.
– Parle, Mazouga écoute.
Gorgius parut se consulter, puis vivement :
– D’ici deux ou trois jours, on doit expédier un messager au général Holson qui commande les méharistes anglais.
– Ceux qui sont à l’ouest et que notre cavalerie n’a pu joindre.
– Ceux-là mêmes. Sans doute on leur enjoint une attaque contre vous. Pour en être assuré, il vous faudrait intercepter la dépêche…
– Dont le courrier est chargé… Que j’arrive auprès de mes amis et ce sera fait.
– Je le souhaite. Souviens-toi seulement que le messager suivra une ligne qui passe au nord des campements de ton armée.
– Je me le rappellerai.
– Bien.

Les deux hommes arrivaient aux remparts en ruines qui ceignent la ville. Des soldats gardaient la porte que les fugitifs devaient franchir, Gorgius s’avança et donna le mot d’ordre.
– Passez, grommela un sergent, furieux en apparence d’être arraché à son premier sommeil.
Et, avec une joie très réelle chez Mazouga, habilement simulée chez le docteur, les deux personnages s’élancèrent dans la plaine.
À quatre ou cinq cents mètres, se dressait un petit bois de palmiers. Ce fut vers le fourré que se dirigea Gorgius.
Bientôt, l’Allemand et le noir furent sous les arbres.
Les troncs serrés les cachèrent à tous les yeux, et après quelques détours ils débouchèrent dans une clairière où un superbe cheval noir paissait, sa longe enroulée autour de la tige d’un dattier.
Le docteur désigna l’animal.
– Ton coursier.
Un rire silencieux distendit les lèvres épaisses du chef africain. Il s’approcha du cheval, le considéra, puis, détachant la longe, il sauta en selle d’un bond.
– Va droit devant toi, dit alors Kaufmann. Tu atteindras la lisière du bois, et la plaine sans limites s’étendra sous tes yeux.
Et, retenant le guerrier impatient :
– Il se peut que tu rencontres des patrouilles anglaises. Voici les mots de passe et de ralliement : Welcome, Wellington. Il te suffira de les dire pour n’être pas inquiété.
Le chef noir tendit la main au docteur.
– Mazouga n’oubliera jamais. Voici l’anneau d’or de son poignet ; mets-le au tien, et si tu tombes au pouvoir des Africains, montre-le. Tous le connaissent ; aucun ne se permettra de toucher un cheveu de ta tête.
Sur ces paroles, il éperonna son cheval qui bondit entre les troncs d’arbres et cessa bientôt d’être visible.
Un étrange sourire éclaira le visage de Gorgius.
– Le bracelet d’or ! murmura-t-il. Eh ! Eh ! on ne sait jamais comment finit une guerre. Peut-être que ce bijou, inutile aujourd’hui, me servira plus tard.
Et, haussant, les épaules :
– Allons assurer Lewis Biggun que tout s’est, accompli sans encombre. Après tout, je souhaite son succès. L’Angleterre est riche ; elle récompense royalement ses serviteurs. Il est agréable d’être payé de ses peines.
Ce disant, il reprit le chemin de la ville. Bientôt il franchissait l’une des portes de l’enceinte et se dirigeait à grands pas vers l’habitation du Sirdar.
Celui-ci n’avait pas perdu son temps.
Il s’était rendu de son côté au pavillon, où mistress Price, attachée comme par le passé à la maison du généralissime, avait installé ses cuisines.
La brave femme se trouvait toute seule avec John.
Suivant sa coutume, depuis le départ de Jack, elle se lamentait sur son sort.
Et John répondait pour la centième fois :
– Pourquoi regretter le fugitif ? N’a-t-il pas déclaré lui-même qu’il n’était pas votre fils ?
Ce à quoi la pauvre Price répliquait :
– Ah ! son cœur lui a peut-être permis d’oublier qu’il fut mon fils. Le mien, hélas, est moins accommodant, je me souviens que j’ai été sa mère.
Sublime et naïf aveu que les lèvres d’une maman pouvaient seules laisser échapper.
Toute à sa plainte, mistress Price tournait le dos à la porte.
Elle ne vit pas le Sirdar paraître sur le seuil, faire un signe d’appel à John et s’éloigner aussitôt.
En l’apercevant, le lord avait ressenti comme une honte de ce qu’il venait faire en ce lieu.
N’allait-il pas priver la créature dévouée à son service du dernier enfant qui lui restât ?
Mais les raisonnements de Gorgius Kaufmann résonnaient encore à son oreille.
Pour une mère, il n’en fallait pas sacrifier dix-mille.
John avait compris son geste. Au bout d’un instant, il sortit sans affectation et rejoignit Lewis Biggun, qui s’était arrêté à quelques pas, caché par un massif de buissons et de palmiers nains.
Le jeune homme s’inclina profondément.
– Vous m’avez appelé, général ?
– Oui, monsieur le chevalier de la Jarretière.
Ce titre, que le lord lui appliquait pour la première fois, surprit John. Pris par une vague inquiétude, il considéra son interlocuteur.
Ce dernier demeura impassible. Mais d’une voix lente il poursuivit :
– Le malheur est entré dans votre logis le jour où votre pseudo-frère en est sorti.
John courba le front.
– C’est vrai ! murmura-t-il… le malheur et la honte. En toute occasion, j’ai fait de mon mieux pour effacer la tache que ce malheureux renégat a jetée sur nous ; mais je sens bien qu’il faudrait davantage. Sa voix s’assourdit.

– Le sang seul efface. Le sang !… Et je n’ai pas eu le courage de frapper, quand je me suis trouvé en face de lui. Le souvenir du passé a paralysé ma volonté, engourdi mon bras. Il vit, j’ai horreur de savoir qu’il respire… je sens pourtant que je serais aussi faible s’il se présentait de nouveau à mes yeux.
Il y avait un désespoir profond dans l’accent du jeune homme. John n’était plus l’Anglais flegmatique d’autrefois. La souffrance l’avait en quelque sorte grandi, jeté hors de lui-même.
Il venait de l’avouer. Toujours il aimerait ce frère, aujourd’hui renégat de la cause britannique.
– Et, reprit d’un ton hésitant le Sirdar, croyez-vous qu’il ne peut se rencontrer des circonstances telles que tout soit réparé par un dévouement entier, absolu ?
John tressaillit. Ses yeux bleus se fixèrent avec une expression avide sur Lewis Biggun.
– Pensez-vous qu’il y en ait vraiment, général ?
– Oui.
– Vous en prévoyez, peut-être ?
– Vous devinez juste.
Le jeune Anglais joignit ses mains, les serrant à les briser.
– Une occasion de prouver irréfutablement mon loyalisme ? demanda-t-il.
– Oui.
– Que faut-il faire… ? parlez, mon général, parlez ; je vous en supplie.
Mais le Sirdar se tut. Au moment d’expliquer ce qu’il attendait du fils de mistress Price, il hésitait.
Ordonner de mourir à cet adolescent qui l’interrogeait, qui palpitait là sous ses yeux de courage et d’abnégation, cela lui paraissait monstrueux.
Certes, dans le combat, au milieu du crépitement de la fusillade, du grondement de l’artillerie, il n’avait jamais éprouvé la moindre émotion en lançant les régiments dans la fournaise.
Mais ici, il n’avait pas la griserie de la poudre, l’excuse de la nécessité. Pourquoi choisissait-il ce garçon entre tous pour l’envoyer au trépas ?
Son silence impressionna John.
– Vous ne répondez pas, mon général ; on dirait que vous craignez de parler. La mission est dangereuse, sans doute ?
L’officier fit oui du geste.
– Très dangereuse, n’est-ce pas ?
Même signe.
– On est à peu près certain de périr ?
Les lèvres du Sirdar se desserrèrent pour livrer passage à ces mots qui sonnèrent ainsi qu’un glas :
– Tout à fait certain… Il faut mourir.
Mais cet arrêt ne troubla pas son interlocuteur.
Un triste sourire éclaira la physionomie de Price le blond, et, avec une héroïque simplicité :
– Je suis prêt, mon général. Le sang, disais-je, tout à l’heure, efface la forfaiture. Mon sang est aussi propre à cela qu’un autre. Je n’ai pas su tuer le coupable Jack ; mais je saurai mourir moi-même.
Il ferma les yeux un moment, murmura si bas que son interlocuteur ne le comprit pas :
– Pauvre mère !
Puis, relevant ses paupières, dardant sur le lord un regard aigu :
– Que faut-il faire ?
Biggun n’hésita plus. Son émotion fit place au désir de la victoire prochaine, de l’écrasement des ennemis de la puissance britannique en Afrique.
Rapidement il mit John au courant.
Ce dernier écoutait, le visage rayonnant d’enthousiasme.
Grâce à la ruse imaginée par le docteur Gorgius, les Français se sépareraient de leurs troupes, ils tomberaient dans une embuscade préparée par les soins du Sirdar.
La révolte serait décapitée.
Privées de leurs chefs, les cohortes noires, recrutées chez cent peuples divers, n’auraient plus de cohésion.
Des rivalités, des divergences de vues ne tarderaient pas à disloquer l’énorme instrument de guerre façonné par Robert Lavarède.
Ce serait le désordre, l’indiscipline, l’écrasement en détail de la multitude, devant laquelle avaient reculé les régiments anglais.
Il est vrai que, pour arriver à ce résultat, lui, John, devait donner sa vie.
Il partirait seul, à travers le désert, porteur de la dépêche mensongère destinée à tromper les Français.
Il irait un jour, deux jours, interrogeant l’horizon d’un regard anxieux, s’attendant à tout instant à voir apparaître les cavaliers noirs, les derniers humains qu’il lui serait permis de contempler, car ses yeux se fermeraient ensuite pour toujours.
Et il fuirait devant eux. Les détonations sèches de son revolver claqueraient dans le silence de la solitude.
Il tuerait quelques-uns des assaillants.
Puis il serait rejoint… et tout serait fini.
Mais que lui importait ? Le sacrifice de son existence ne lui coûtait pas. Trop grande avait été la souffrance depuis la fuite de Jack. L’affection, l’orgueil anglo-saxon, la honte s’étaient partagé son cœur.
Et la pensée de mourir, de s’endormir du sommeil sans rêves, lui apparaissait douce.
Quand les deux hommes se séparèrent, ils étaient d’accord.
Jack attendrait l’ordre de partir. Le général lui ferait préparer en secret un cheval et des armes.
Car le brave garçon voulait éviter les adieux douloureux de mistress Price.
Il sentait que devant les larmes de la bonne créature, il serait sans force, sans volonté.
Comment aurait-il pu lui dire :
– Embrasse-moi pour la dernière fois, je marche au devant de la mort. Avant une semaine, les grands gypaètes du Nil décriront de larges cercles autour de mon cadavre. Donne ton dernier baiser, mère, à l’enfant que les rapaces déchireront.
Pensif, lord Lewis Biggun rentra chez lui. Et dans la salle qui lui servait de cabinet de travail, il attendit. Vers onze heures. Gorgius Kaufmann se présenta, et, lui tendant la main :
– Mazouga galope vers les siens.
Du geste le Sirdar approuva.
– Et vous ? interrogea encore le docteur.
– John Price partira.
Le rire faux de l’Allemand ponctua la phrase. Puis, redevenant grave :
– Alors, général, préparons la dépêche qui nous vengera. Il faut que John Price quitte Berber dès demain.

CHAPITRE V
DEUX FRÈRES, DEUX PATRIES
Mazouga galopait à travers la plaine.
Ainsi qu’un oiseau, son cheval franchissait les dunes, les vallonnements. À deux reprises, le noir avait été arrêté par des patrouilles de cavalerie, mais il lui avait suffi de prononcer :
– Welcome, Wellington.
Et on lui avait permis de poursuivre son chemin.
À présent, Mazouga avait dépassé la limite de la zone explorée par les détachements anglais. Il était dans le désert.
Libre ! Libre enfin ! Et dans sa joie, le chef pressait de ses talons les flancs de sa monture qui précipitait sa course en foulées éperdues.
Il pensait à ses guerriers qu’il allait revoir, à la guerre qui continuerait ; et puis son souvenir se reportait sur son sauveur ; ce Français mystérieux, demeuré au service des Anglais afin de les trahir à l’occasion.
Maintenant le noir constatait que dans la préoccupation de l’évasion, il avait négligé même de s’informer du nom de l’inconnu.
Il n’y avait pas songé une minute.
Que faisait cela au surplus ? Un nom est seulement un mot, la liberté était un fait, et il se sentait libre.
Vers l’aube cependant, quel que fut son désir d’aller de l’avant, Mazouga dut faire halte.
Son cheval n’en pouvait plus. Haletant, les flancs couverts d’écume, l’animal tremblait sur ses jambes.
Par bonheur, à peu de distance, le noir découvrit un puits, qu’ombrageaient une dizaine de dattiers.
C’était l’ombre, la nourriture et la boisson, c’est-à-dire le confortable au désert.
Tout le jour, cheval et cavalier se reposèrent en cet endroit.
À la nuit ils repartirent.
Les rives du Nil autrefois verdoyantes étaient devenues, depuis la disparition de l’eau, d’une aridité désolée, et lentement, le sable impalpable des solitudes, transporté par le vent, commençait à combler le lit où, durant tant de siècles, avait coulé, triomphant et majestueux, le plus noble fleuve du monde.
Dans deux ans au plus, le sol serait nivelé. Le voyageur curieux des récits antiques chercherait vainement l’emplacement qu’occupait le Nil.
Ces idées passaient dans le cerveau de Mazouga. Il s’en étonnait, n’ayant jamais pensé à de pareilles choses.
Il continuait pourtant.
Qu’avait-il fallu pour changer la face d’une immense contrée ? Presque rien. Deux hommes venus d’un pays d’Europe. Ceux-là avaient su détourner les eaux que les noirs croyaient devoir couler éternellement dans la même direction.
Son admiration pour les « Francs » augmentait encore. Il était heureux de rapporter des renseignements peut-être précieux.
Et les kilomètres succédaient aux kilomètres. De loin en loin des coupoles grisâtres se dessinaient au haut des berges. C’étaient des tourelles tournantes abandonnées par l’ennemi. Mazouga alors se dressait sur ses étriers et lançait dans la nuit une clameur sauvage.
Vers deux heures du matin, il rencontra enfin des hommes de l’armée insurgée.
C’étaient les corps d’armée affectés à la canalisation hydraulique.
Des régiments creusaient sur les deux rives de profondes tranchées ; d’autres venaient ensuite, qui assujettissaient les cylindres de terre, incessamment expédiés du centre africain ; une troisième section enfin comblait les trous, et bientôt l’eau puisée à deux mille kilomètres de là, dans l’inépuisable réservoir du Bahr-el-Ghazal, coulait, abondante et claire, dans des bassins fouillés pour la recevoir.
C’est ainsi que ces pionniers marquaient les étapes de l’armée à travers le désert aride, que le Nil n’arrosait plus de ses ondes bienfaisantes.
Mazouga pressa son cheval.
Une heure encore de course folle, et il fut arrêté par les grand’gardes des patriotes.
On le croyait mort.
Son retour provoqua une joie débordante. À sa demande, on le conduisit à la tente de Robert Lavarède.
Celui-ci dormait.
Brusquement tiré de son sommeil, il fit appeler auprès de lui Armand et Jack.
Et devant les trois hommes, le chef noir raconta son odyssée.
Il dit sa captivité, ses transes, l’apparition de son sauveur mystérieux. Il n’omit rien.
Une dépêche importante devait être envoyée par le Sirdar au général Holson, commandant le corps des méharistes anglais.
Que contenait la missive ? Son protecteur inconnu n’avait pu le lui apprendre, mais il lui avait fourni le moyen d’intercepter le courrier.
Pour finir, Mazouga revendiqua l’honneur de conduire la reconnaissance de cavalerie qui arrêterait le messager.
Armand, Robert avaient écouté sans mot dire.
Une surprise s’était peinte sur leurs traits. Quel était ce Français, qui, à Berber, avait risqué ses jours peut-être, sa liberté sûrement, pour favoriser l’évasion du noir Mazouga ?
Pas un instant, il ne leur vint à l’esprit que ce « compatriote » fût l’Allemand Gorgius Kaufmann.
Au demeurant, l’on ne risquait pas grand’chose à envoyer quelques escadrons au-devant du courrier annoncé.
À sa grande joie, le nègre reçut le commandement de cette troupe, que vint grossir un volontaire.
Ce volontaire était Jack.
Durant le récit de l’évadé, le jeune homme avait ressenti une angoisse inexplicable. Un désir invincible de faire partie de l’expédition l’avait pris, et, comme Mazouga allait se retirer, Jack s’était tourné, suppliant, vers Robert Lavarède :
– Général, permettez que je suive la reconnaissance.
– Vous ? demanda le Français, sans cacher son étonnement ; pourquoi cette fantaisie ?
– Je ne saurais l’expliquer, mais une voix intime me crie : Va… et je vous conjure de ne pas me refuser.
Robert lui tendit, la main :
– Vous êtes libre, mon ami. Le ciel me préserve de m’opposer à vos désirs. Vous accompagnerez Mazouga.
– Merci, général.
Et, après un silence :
– Quand partirons-nous ?
– Demain soir, ou plutôt ce soir, car il est trois heures du matin.
– Ce soir donc, je serai prêt.
Sur ces paroles, on se sépara. Chacun des Européens regagna sa tente, tandis que Mazouga rejoignait sa tribu, et se livrait, avec les siens, en signe de joie, à des danses désordonnées.
Il avait passé la nuit à cheval, mais les nègres sont ainsi faits. Ils oublient la fatigue quand se présente une occasion de s’amuser.
La journée parut interminable à Jack.
Sur lui pesait une tristesse. Ni les douces paroles de Nilia, ni les exhortations amicales d’Aurett et de Lotia ne parvinrent à le distraire.
Hope lui-même n’amena pas le sourire sur ses lèvres.
Et cependant l’orang-outang avait l’allure la plus réjouissante.
Dès le début, ce grand singe, vêtu d’un habit rouge et coiffé d’un bicorne, avait exercé une curieuse fascination sur les nègres naïfs et crédules.
Mais depuis sa charge de cavalerie, où, se ruant aveuglément à la poursuite du soldat anglais qui l’avait blessé, il avait entraîné les insurgés au combat, le digne Hope était devenu pour les Africains un objet de vénération.
Il était le fétiche, le grigri vivant.
Les griots (poètes noirs) avaient célébré sa vaillance en innombrables strophes.
Les soldats nègres le saluaient au passage.
Et, l’instinct d’imitation des quadrumanes aidant, Hope répondait gravement à ces marques de respect.
Il se promenait dans le camp, portant sa main velue à son bicorne, tel un général inspecteur au milieu d’une armée civilisée.
Bref, les noirs, modifiant le proverbe en sa faveur, disaient :
– Lui, malin, pas parler pour travailler ; mais lui très bon tout de même : lui combattre pour donner la victoire aux pauvres nègres.
Quoi qu’il en soit, Jack demeura morose.
À la nuit seulement, il parut s’animer.
Il choisit un excellent cheval et, sans armes, selon son habitude, il se mêla aux guerriers qui devaient suivre le chef Mazouga.
La petite troupe partit.
Elle franchit la ligne des grand’gardes, laissa en arrière les régiments affectés aux conduites d’eau et s’enfonça dans le désert.
La nuit était tiède.

L’infini chapelet d’étoiles arrondissait ses contours sinueux sur la voûte sombre du ciel, et versait sur le sol doré de la plaine une clarté bleuâtre.
Aucune humidité ne diminuait la transparence de l’air. Dans la nuit lumineuse, on voyait au loin les moindres reliefs se profiler avec une surprenante netteté.
Au premier rang des cavaliers, se tenait Jack.
Penché sur sa selle, le cou tendu, il regardait en avant.
Ses yeux fixes, son visage contracté exprimaient une souffrance poignante.
Et par moments, il se demandait pourquoi cette anxiété, pourquoi cette douleur inexplicable.
On allait rencontrer un courrier anglais ; il mourrait.
La belle affaire que la mort d’un homme, dans cette guerre sans merci, où tant de milliers d’humains seraient couchés sur la terre rougie de sang.
Jack se gourmandait alors. Pourquoi cette nervosité soudaine ? Mais il ne trouvait aucune réponse plausible.
Et le bruit des sabots frappant le sol desséché martelait son oreille avec une insupportable régularité.
À l’aube, le détachement arriva près du puits où Mazouga s’était reposé l’avant-veille.
Les chevaux furent dessellés, libres de vaguer aux alentours pour y chercher l’herbe rare que le voisinage de l’eau avait fait sortir du sable.
Quant aux hommes, ils s’étendirent à l’ombre des palmiers et dormirent pendant que, flamboyant, le soleil accomplissait sa course journalière.
La chaleur torride du milieu du jour s’atténua, s’atténua encore.
L’astre ardent disparut sous l’horizon empourpré dans un rayonnement d’incendie.
La brise fraîche du soir se mit à souffler paresseusement, légère, indécise comme la respiration d’une houri qui s’éveille à demi, après la longue sieste.
Aussitôt Mazouga donna le signal du départ :
– En route !
Dix minutes plus tard, les cavaliers égyptiens étaient en selle. En bon ordre, la petite troupe reprenait la route du nord. Tous les yeux fouillaient l’espace, car le chef avait dit :
– Attention. Nous approchons de la ligne que doit suivre le courrier des Anglais.
Pas de danger que le messager passât inaperçu.
Les regards de flamme sondaient les moindres replis de terrain. On n’allait plus en rang. Le détachement s’était développé en une longue chaîne, barrière humaine que l’envoyé anglais ne réussirait certainement pas à franchir.
Le sol s’élève en pente douce.
On gravit une de ces dunes de sable dont le simoun bossue la surface du désert.
On atteint le sommet. Faible est la hauteur ; vingt ou trente mètres peut-être, mais cela suffit pour élargir notablement le cercle de la vision.
Tout à coup, Jack frissonne jusqu’au fond de son être.
Un murmure léger a couru tout le long de la ligne de cavaliers. Les mains se sont étendues, désignant un point mobile vers le nord.
Ce point, qui glisse rapide sur la plaine sablonneuse, c’est un homme qu’un cheval emporte au galop.
– C’est le messager.
– Oui, oui, c’est lui.
Tels sont les cris des soldats de Mazouga.
Et celui-ci, levant son sabre, lance de sa voix rude, qui résonne dans le silence ainsi qu’un beuglement de taureau :
– Au galop !
* *
*
Les Égyptiens ne se sont pas trompés.
L’homme isolé est bien le courrier du Sirdar Lewis Biggun.
C’est John, John qui, pour retrouver l’honneur qu’il croit terni par la conduite de son ex-frère, s’apprête à jouer la suprême comédie, dont son trépas sera le dénouement.
Il a quitté Berber, la veille. Il a passé sa dernière soirée auprès de sa mère, la pauvre mistress Price qui n’a rien soupçonné de ses projets.
Il lui a dit bonsoir, comme tous les jours. Il a échangé avec elle le baiser accoutumé, l’habituel :
– Good night ! (bonne nuit).
Elle s’est enfermée dans sa chambre, paisible, tranquille, et, sans se douter que ses lèvres ne se poseront plus sur le front de John, elle s’est endormie en murmurant :
– Pourvu que cette guerre finisse vite. Je prierai tant le Sirdar, qu’il obtiendra la grâce de Jack. Et de nouveau, je vivrai heureuse entre mes deux enfants.
Tandis que ses yeux se ferment, John Price quitte la maison à pas de loup.
Il se glisse à travers les rues sombres de Berber, il atteint la place Osman-Digma.
Là, un soldat anglais tient un cheval en main. Auprès de lui se tient un officier d’état-major.
Celui-ci serre la main de John. Il lui remet une enveloppe cachetée.
– La dépêche, dit-il.
– Bien.
– Le général compte absolument sur vous.
– Il le peut. Ce qu’il exige sera rigoureusement accompli.
– Allez donc !
D’un bond, John est sur le dos du coursier. Il s’assure que les revolvers d’ordonnance sont dans les fontes. Il glisse sa missive dans sa poche, salue l’officier et rend la main.
Sa monture prend le petit trot.
Ainsi il sort de la ville. Jusqu’aux limites du camp britannique, John conserve la même allure.
Mais quand il a laissé en arrière les divers échelons qui veillent à la sûreté de l’armée, il enfonce ses éperons dans le ventre de son cheval.
La mort est là-bas qui l’attend ; il ne veut pas la joindre à pas lents. Il faut courir, courir toujours plus vite, afin de gagner plus tôt l’instant où il s’endormira du grand sommeil, où il tombera pour ne plus se relever, drapé dans son honneur enfin reconquis.
Une pensée à sa mère qui le pleurera, un pardon à celui que si longtemps il a appelé son frère, et puis il galope éperdument, tout entier à son sacrifice héroïque, duquel doit sortir le triomphe des armes anglaises.
Il va, escaladant les dunes, dévalant les pentes avec une effrayante vélocité.
Sa monture, gagnée par la griserie de la vitesse, vole sur le sable, bondit par dessus les aloès épineux, franchit les champs où le drinn clairsemé croit sur le terrain calciné.
Bête et cavalier vont la poitrine haletante, les yeux rivés sur l’horizon ; effrayante chevauchée vers la mort.
Et soudain John arrête brusquement son cheval qui plie sur ses jarrets.
Là-bas, en avant, il a aperçu, au sommet d’une dune, se découpant sur le ciel, une longue rangée de cavaliers.
Il a une minute d’indécision.
S’il tournait bride, s’il se dirigeait sur Berber, il échapperait certainement à ses ennemis, car ce sont là ceux qui doivent le tuer, comme l’a décidé l’organisateur de la victoire de l’Angleterre.
Mais alors, la dépêche ne tomberait pas aux mains des français ; la défaite irrémédiable planerait sur les régiments britanniques.
Non. Il a promis de périr, il périra.
Au lieu de revenir vers le nord, il lance son cheval vers l’est, comme pour tourner l’obstacle vivant qui se dresse devant lui.
Le vent lui apporte l’écho affaibli des hurlements des Égyptiens. Eux aussi l’ont vu.

Allons ! Un coup d’éperons rageur ! En avant pour l’ultime course ! Qu’elle soit bien disputée ; qu’elle soit meurtrière pour les insurgés.
La chaîne des cavaliers de Mazouga a exécuté une conversion. Maintenant elle galope face à l’est, coupant John de la route de Berber.
Le salut n’est plus possible ; mais il faut, le Sirdar l’a dit, que les poursuivants croient que le courrier a tout fait pour leur échapper.
La monture de John, les flancs incessamment labourés par les pointes des éperons, s’emballe avec des hennissements de douleur.
 Quatre ou
cinq kilomètres sont franchis à une allure désordonnée, puis le souffle
commence à manquer au pauvre animal. Ses flancs palpitent lamentablement, et
l’air s’engouffre avec un rauquement sinistre dans ses naseaux dilatés.
Quatre ou
cinq kilomètres sont franchis à une allure désordonnée, puis le souffle
commence à manquer au pauvre animal. Ses flancs palpitent lamentablement, et
l’air s’engouffre avec un rauquement sinistre dans ses naseaux dilatés.
La dernière scène du drame est proche.
La troupe de Mazouga a bientôt cessé de se mouvoir avec ordre. Le chef noir, Jack, quelques guerriers mieux montés que les autres ont pris l’avance, suivis à cinq ou six cents mètres par le gros du détachement.
Jack est terrifié.
Il a reconnu le fugitif…
C’est John ! John ! qui galope là-bas. Le courrier est son frère d’autrefois.
Oh ! il faut le sauver à tout prix.
Et lui aussi éperonne follement son cheval.
Le voici en avant de tous les cavaliers noirs.
– John ! crie-t-il, d’une voix étranglée par l’angoisse, John !
Mais le jeune Anglais ne l’entend pas, ou feint de ne pas le comprendre.
Il se retourne, lève le bras. Une détonation retentit. Aux oreilles de Jack siffle une balle, qui va frapper un noir à dix pas derrière lui.
Le cavalier vide les arçons.
Des hurlements sauvages retentissent, des coups de feu éclatent.
– John ! répète Price le brun, John !
Enlevant son cheval dans un effort désespéré, il gagne encore quelques mètres sur le fugitif.
Ah ! s’il pouvait l’atteindre.
Mais soudain, sa monture se dérobe sous lui. La bête a buté des deux pieds de devant sur une extumescence du terrain. Elle roule sur le sol ; projetant le jeune homme à dix pas.
Étourdi par la violence du choc, Jack se relève cependant, tant est grande sa volonté de protéger son frère.
Une masse de cavaliers passe auprès de lui comme un ouragan.
Il les appelle, leur ordonne de s’arrêter.
Aucun ne détourne la tête.
Alors il court… mais que peut un piéton, quand les coursiers excités galopent à toute bride.
Il sent son impuissance. Il lève désespérément les mains vers le ciel.
De nouveau des détonations crépitent.
Jack a la perception confuse de noirs se renversant comme dans un brouillard, il assiste à la fin de la poursuite.
Le cheval de John est blessé, à bout de forces. Il tombe. Il y a une mêlée, un tourbillonnement, puis un cri de triomphe.
Et, chancelant, l’esprit endolori comme après un horrible cauchemar, Jack se traîne péniblement vers l’endroit où s’est arrêtée la course furibonde.
Il approche.
Déjà Mazouga brandit une enveloppe cachetée.
Jack va toujours.
Sur le sable jaune, gît une masse sombre.
Il se penche. Il regarde.
C’est John ; mais John a les yeux clos, la bouche entr’ouverte par le suprême défi, et de son crâne fendu coule lentement un sang vermeil mêlé à des débris de cervelle.
C’est un cri d’agonie qui s’échappe des lèvres de Jack.
Ses jarrets fléchissent. Il s’affaisse sur le cadavre, l’étreint de ses bras ; sans avoir conscience de ses paroles, il gémit d’une voix brisée, qui pleure dans le grand silence du désert :
– John ! frère John ! réveille-toi, réveille-toi !

CHAPITRE VI
LES LIONS
Sous la tente de Robert, tous ses amis étaient rassemblés : Armand, impatient et curieux ; Aurett, Lotia et Nilia regardant, avec compassion, Jack qui lui aussi se trouvait là.
Le jeune homme était sombre, les sourcils froncés.
Son désespoir avait été effrayant.
Sur le corps de son frère, il avait perdu connaissance et Mazouga avait ramené au camp, sur le cheval d’un de ses guerriers tués pendant la poursuite, John mort et Jack privé de sentiment.
Quand celui-ci était revenu à lui-même, ses amis l’entouraient.
Ils avaient voulu lui prodiguer les consolations, mais, dès les premières paroles, il les avait arrêtés.
– Je n’ai plus de tristesse, avait-il dit. Désormais je vis pour venger John. C’est à cause de moi, à cause de ma tendresse pour votre cause, qu’il s’est chargé de la mission qui a causé sa mort. Cela, j’en suis sûr. Et les Anglais ont accepté. Ils n’ont pas craint de briser le cœur de l’infortunée mère qui me pleurait déjà. C’était un soldat, un officier qui aurait dû être désigné pour la périlleuse expédition. On a préféré risquer l’existence d’un pauvre garçon qui n’appartenait pas à l’armée. Ce soir, nous ensevelirons John. Ne parlons plus de lui. Je saurai me souvenir… Avez-vous lu la dépêche enlevée à mon frère ?
Tous se regardèrent, déchirés par l’expression de froide résolution empreinte sur les traits de Jack.
En quelques heures, la douleur avait métamorphosé le jeune homme. Son visage s’était accentué et un feu sombre brillait dans ses yeux.
– Avez-vous lu la dépêche ? répéta-t-il.
– Non, répondit enfin Robert.
– Eh bien ! lisons-la. Peut-être y trouverons-nous : vous, le moyen de vaincre ; moi, celui de me venger.
Dominé, Robert tira la missive de sa poche.
– La voici, dit-il. Et lentement il lut :
Adafrou-mètre l’abyas-soleil-noe
arablotusir-an-la-cape-tuer-deux
dè-Asiert-Rjinla-ruche-or-quai
yté-avoine-ehRioble-artiste-ainsi
shigi-boat-tri-armes natron-Joë
trahit-cartitivre-crin-noir-asalunocrd.
– Qu’est-ce que cela signifie ? demanda Aurett.
Ce fut Jack qui répondit :
– Nous allons le chercher. Vous n’ignorez pas que l’on peut correspondre, soit au moyen de mots convenus, dont le sens réel est connu seulement des intéressés, soit au moyen de grilles.
– Sans doute.
– Pour déterminer de quelle façon ont procédé nos ennemis – il appuya fortement sur ce dernier vocable – comptons les lettres. Si le total est le résultat de la multiplication de deux nombres permettant de former un carré ou un rectangle, il y aura dix à parier contre un que nous avons affaire à une missive grillée, auquel cas nous chercherons parmi les grilles capturées récemment si l’une s’applique à notre papier.
– Et si aucune ne répond à notre attente ?
– Alors, nous tâcherons de nous en passer et de séparer les lettres inutiles de celles qui concourent au sens de la dépêche. Nous y arriverons. J’ai vu procéder des officiers d’ordonnance du Sirdar… quand j’étais Anglais.
Et avec mélancolie, Jack ajouta :
– Je ne me doutais pas alors que j’acquérais des connaissances qui serviraient un jour à la France et à l’Égypte.
Mais secouant la tête, il prit son carnet et traça des chiffres sur une page blanche. Au bout de cinq minutes, il s’arrêta.

– La missive contient 168 lettres. D’après les probabilités, 168 est le résultat de 12 multiplié par 14, ou inversement de 14 multiplié par 12, ce que j’écris ici :
168 = 12 x 14 = 14 x 12
Nous envisagerons successivement les deux hypothèses.
– Pardon, interrompit Lotia, mais j’en vois une troisième.
– Laquelle ?
– Celle-ci : 168 = 16,8 x 10.
– Elle est inacceptable.
– Parce que ?
– Parce qu’une grille se décompose toujours en carrés complets. L’un de ses côtés ne peut donc contenir une fraction.
– Pourtant, remarqua Robert, il existe des grilles de forme irrégulière.
– Vous avez raison. Il en est en cercle, en ellipse, en pentagone, en polygones réguliers ou irréguliers, mais ces figures baroques sont réservées à la correspondance diplomatique. Dans la pratique militaire habituelle on s’en tient au carré et au rectangle. C’est déjà suffisamment compliqué. Mais ne bavardons pas, travaillons. Voyons, je dispose les lettres suivant l’hypothèse d’un rectangle de 14 de haut sur 12 de large.
Et sur son carnet, Jack traça le rectangle ci-dessous.
Puis, dans chacun des petits carrés, il inscrivit l’une des lettres de la dépêche.
Il obtint ainsi :
– Maintenant, reprit Jack, essayons les grilles.
Armand lui passa aussitôt une boîte couverte de chagrin noir, à l’intérieur de laquelle des grilles d’aluminium étaient alignées dans des compartiments ménagés pour les recevoir.
Mais aucune ne répondit à son attente.
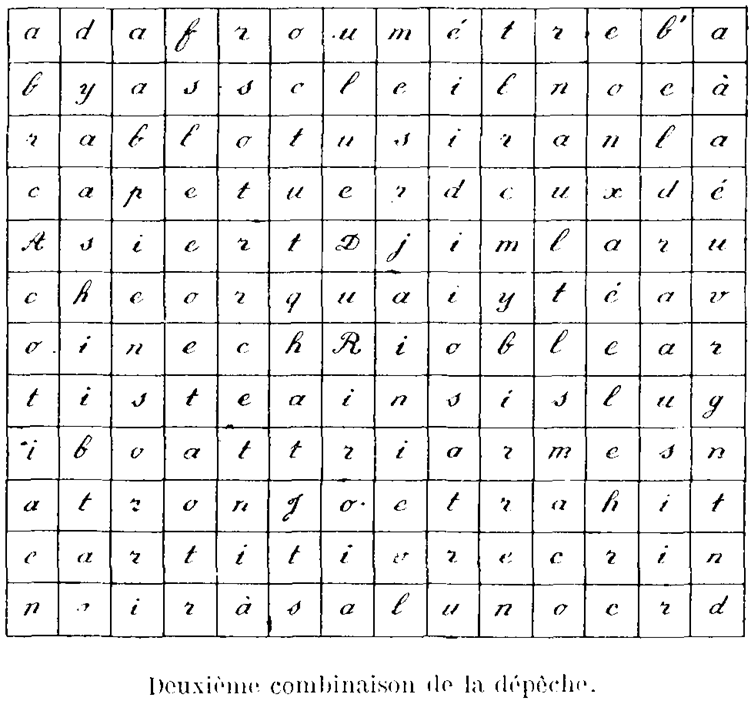
Les lettres, laissées à découvert, après l’application des plaques, ne formaient aucun sens.
Et, comme les jeunes femmes poussaient un soupir, Price le brun leur sourit doucement :
– On ne rencontre pas de suite la solution juste.
Ce disant, il mettait à part l’une des grilles.
– Tenez, voici une plaque de 14 sur 12. J’ai comme une vague idée qu’elle va nous donner la clef du mystère. Je dispose mes lettres autrement. Nous verrons bien.
Paisiblement, il choisit une nouvelle feuille blanche et dessina un carré comportant, cette fois, 14 cases dans le sens de la largeur et 12 seulement dans celui de la hauteur. Sans un mouvement d’impatience, il y inscrivit derechef les lettres de la dépêche interceptée, ce qui lui donna la figure ci-dessous.
Puis, saisissant la « grille » mise de côté un moment auparavant, il la plaça sur la feuille, qui présenta alors l’aspect que voici :

À peine y eut-il jeté les yeux, qu’il poussa un cri de joie. Il lisait, il lisait couramment.
Debout maintenant, il prononçait lentement, afin que chaque syllabe pénétrât bien l’esprit de ses auditeurs :
Armée abyssine à Abousin
Peur du désert. Marcherait avec Robert.
Sans lui, battra en retraite.
Attirer noirs au nord.
– Abousin, se récria Armand, qu’est-ce que cela ?
– C’est, répliqua Robert, une bourgade frontière de l’Abyssinie, à cinq ou six journées de marche à l’est.
– Et l’armée des braves montagnards noirs est là ?
– La dépêche l’affirme.
Il y eut un silence que Lotia rompit.
– Pourquoi veut-on nous attirer vers le nord ?
– Pour augmenter la distance qui nous sépare des troupes abyssines et empêcher notre jonction avec elles. C’est cent mille guerriers valeureux, bien armés, dont les Anglais seraient enchantés de nous priver.
Soudain la conversation fut interrompue. Un officier égyptien pénétra sous la tente.
– Général, fit-il en saluant Robert, un habitant de Berber est là qui demande à être introduit sans retard auprès de vous.
Le Français consulta ses amis du regard et vivement :
– Amenez-le.
Un instant plus tard, l’officier reparaissait conduisant un Berberin, drapé dans un large burnous bleu et noir.
– Tu arrives de Berber ? interrogea le fiancé de Lotia.
– À franc étrier.
– Quelle nouvelle grave m’apportes-tu donc ?
– Celle-ci. L’armée anglaise a évacué Berber. Toutes les troupes sont en mouvement vers le nord.
Les yeux des Européens exprimèrent la même pensée.
– Vers le nord… La manœuvre annoncée dans la dépêche. Ils pensent que nous allons les suivre et nous éloigner ainsi des Abyssins.
Mais Robert reprit l’entretien.
– Quand a commencé le mouvement de retraite ?
– Je ne saurais le dire exactement, déclara le Berberin. Je suis un des dix habitants que le sort a désignés pour rester dans la ville, alors que tous les autres se joignaient à tes guerriers. Or, les Anglais étendaient leurs cantonnements bien loin en arrière de Berber. Quand les plus éloignés ont-ils marqué leur marche vers le Nord, je l’ignore ; mais les régiments campés à proximité de la cité se sont retirés hier matin. Dès qu’ils ont été à quelque distance, j’ai sellé mon cheval et je suis venu.
Puis avec une simplicité pleine de grandeur, le Berberin conclut :
– Notre ville est évacuée. Plus besoin d’habitants pour la garder et surveiller les opérations de l’ennemi. Je demande à être incorporé dans un de tes corps de cavalerie. J’ai obéi fidèlement aux ordres qui m’avaient été donnés ; maintenant je désire combattre.
Robert serra la main au messager.
– Qu’il soit fait selon tes vœux.
Et, s’adressant à l’officier égyptien qui avait assisté à toute la scène :
– Conduisez ce brave au 7e régiment de cavalerie kordofane pour y être incorporé.
Le Berberin croisa ses bras sur sa poitrine en signe de remerciement et sortit avec l’Égyptien.
Restés seuls, les Français et leurs amis s’écrièrent :
– La dépêche est exacte. Le mouvement rétrograde de l’armée du Sirdar le démontre.
Et Armand, traduisant la pensée de tous :
– Qu’allons-nous faire ?
Du regard il interrogeait son cousin. Celui-ci murmura :
– Nous n’avons rien à craindre des troupes britanniques à cette heure. Il importe donc de nous assurer le concours des Abyssins.
– Sans doute.
– Ces derniers – je me reporte au message – craignent la traversée du désert. Avec moi, ils marcheraient. Je vais donc les rejoindre.
– Toi ?
– Moi-même.
– Je t’accompagne, cousin.
– Non.
– Comment non ! Ah, je voudrais bien voir que tu me laisses ici…
Robert sourit à cette exclamation du journaliste.
– Tu le verras, mon cher Armand. En mon absence, il faut bien que quelqu’un commande à ma place. Je ne saurais compter pour cela sur l’un des chefs indigènes.
– C’est vrai…
– Tu seras mon lieutenant général.
– Oh ! alors, je ne dis plus rien, s’écria Armand. Lieutenant général, cela me va. À mon départ de France, je n’aurais jamais espéré un avancement si rapide.
Et, saluant Aurett :
– Madame la lieutenante générale, ajouta-t-il, il est onze heures. J’estime que nous devons à notre grade de déjeuner.
La plaisanterie amena le sourire sur toutes les lèvres. En somme, la nouvelle reculade de l’armée britannique équivalait pour les insurgés à une victoire.
Seul, Jack demeura sombre.
Durant le déjeuner, il supplia Robert de l’emmener avec lui à la rencontre des troupes abyssines.
Le Français y consentit.
Alors la douce voix de Nilia s’éleva.
– Et moi, ne m’emmènerez-vous pas ?
Mais Robert repoussa la requête de la jeune fille. À quoi bon l’exposer aux fatigues de la traversée du désert ?
Non, il partirait avec Jack et quelques méharistes. Pendant son absence, les insurgés occuperaient Berber et les tourelles tournantes du voisinage.
Lotia prêterait son appui moral à Armand, et Nilia demeurerait auprès d’Aurett.
L’ancienne esclave de Gorgius n’insista pas. On la crut persuadée, et, le repas achevé, on s’occupa de préparer le voyage.

Des courriers, expédiés aux chefs des différents corps d’armée, leur apprirent que Robert se rendait au-devant des renforts envoyés des plateaux abyssins, qu’Armand Lavarède était nommé lieutenant général.
Cela fait, l’escorte du Français fut choisie : vingt guerriers arabes, montés sur des méharis rapides, accoutumés aux longues courses dans les solitudes sahariennes.
La journée s’écoula dans ces apprêts.
Au soir, Robert et Jack dirent adieu à leurs compagnons.
Deux méharis de selle portant quatre jours de vivres leur avaient été réservés.
On ne les avait pas chargés d’eau parce que les oasis, échelonnées sur la route, fourniraient le précieux liquide.
Les animaux s’agenouillèrent ; les jeunes gens se hissèrent sur leur dos, puis, suivis des vingt Arabes d’escorte, ils s’élancèrent vers l’est, laissant en arrière ceux qui, depuis les marécages du Bahr-el-Ghazal, marchaient dans leurs traces avec le plus aveugle dévouement.
Toute la nuit les chameaux coururent à cette allure étrange qui donne au cavalier novice l’illusion d’être sur un navire ballotté par la tempête.
La bande blanche d’aube paraissait à l’horizon, quand la petite troupe s’arrêta dans une oasis minuscule, mesurant à peine cent mètres carrés de superficie.
Mais toute petite qu’elle était, elle donnait assez d’ombre pour abriter les voyageurs durant le jour, et le ruisselet, autour duquel elle s’était formée, contenait de l’eau en quantité suffisante pour abreuver montures et cavaliers.
On s’installa donc sous les arbres ; mais à peine avait-on placé les sentinelles, qu’une alerte se produisit.
Au loin, dans la clarté grandissante du jour se profilaient les silhouettes de deux méharis lancés à toute vitesse.
Ils suivaient la route parcourue un peu plus tôt par le détachement. Venaient-ils donc du camp, et, en ce cas, quel incident grave avait motivé l’envoi de ces courriers qui, pour rejoindre les voyageurs à ce moment, avaient dû quitter l’armée bien peu de temps après leur départ.
Robert et Jack se portèrent à la lisière du petit bois.
Les méharis approchaient. On distinguait la forme de leurs cavaliers enveloppés dans leurs burnous blancs.
Peu d’instants après, les animaux s’arrêtaient en face des deux Européens.
Le premier méhariste écarta les plis du burnous qui voilait son visage et montra les traits charmants de Nilia.
– Nilia ! s’écria Robert.
– Nilia ! redit Jack.
Elle sourit.
– Aidez-moi à descendre, fit-elle.
– Mais que venez-vous faire ici ?
– Vous accompagner. Vous l’avez défendu, je le sais bien, et au ton de votre refus, j’ai compris que je ne devais pas insister. Alors j’ai acheté, grâce à la bonté de mistress Aurett, un méhari, et quand vous êtes partis, je vous ai suivis, en me disant : Ils seront bien forcés de me garder avec eux, s’ils ne veulent pas m’abandonner dans le désert, où je mourrais certainement.
Que répondre à la douce enfant qui, pour ne pas quitter ses amis, pour partager leurs fatigues, n’avait pas craint de s’aventurer, seule, la nuit, dans les plaines désolées du désert Arabique ?
– Et celui-ci, quel est-il ? interrogea Robert, en désignant le second personnage immobile sur sa monture.
Nilia sourit, mais elle n’eut pas le loisir de répondre.
L’individu en cause se dressa brusquement sur le dos du chameau, et, avec une pirouette des plus réjouissante, se laissa glisser à terre.
Dans son mouvement, son burnous s’accrocha à la selle, et, tel un papillon s’élançant de l’enveloppe terne de la chrysalide, Hope apparut dans son habit rouge, ouvrant sa large bouche jusqu’aux oreilles, comme s’il riait aux éclats de l’aventure.
– Hope ! murmurèrent les jeunes gens.
Et, tandis que l’orang leur secouait vigoureusement les mains, Nilia dit lentement :
– J’étais déjà à quelque distance du camp, lorsque j’ai entendu le bruit du trot du coursier de Hope. J’ai eu peur d’abord ; mais ce brave singe m’a rejoint, et il semblait si joyeux que je me suis sentie rassurée. Il avait deviné sans doute que je venais vers vous…
Puis, avec un accent indéfinissable :
– Moi, je ne puis vous être d’aucun secours ; mais Hope est un grand guerrier, toute l’armée le reconnaît. J’espère que vous me recevrez dans la caravane par-dessus le marché.
Il n’y avait qu’à accepter la jolie recrue et à porter de 22 à 24 l’effectif de la troupe.
C’est ce que firent, Robert en maugréant, Jack avec une émotion profonde dont la cause réelle lui échappa.
Il lui sembla que la venue de Nilia apaisait la douleur dont son cœur était déchiré, depuis l’instant terrible où il avait vu John tomber sous les coups des guerriers de Mazouga.
Comme la rosée ranimant la fleur expirante, la voix de la jeune fille apportait à l’âme endolorie du pauvre garçon sa fraîcheur consolatrice.
Robert lui-même ne tarda pas à subir la douce influence de l’ancienne esclave de Gorgius Kaufmann, et la journée s’acheva presque gaiement.
Rien ne troubla le sommeil des voyageurs.
Au soir, les méharis s’étant longuement abreuvés, on reprit la route vers l’est.
L’étape était plus longue que celle de la veille.
Avec cela, un vent assez fort soulevait le sable impalpable du désert en épais tourbillons.
Les poussières pénétraient dans les yeux, les oreilles, le nez des voyageurs, leur causant une intolérable souffrance.
Mais on avançait quand même.
Robert ne voulait pas perdre une heure.
Il avait hâte d’atteindre le mont Abousin, où il pensait rencontrer l’armée abyssine, et il demeurait insensible aux réflexions de ses compagnons, aux gémissements plaintifs des méharis.
Vers minuit, du reste, le vent tomba et la marche continua plus aisément.
Les premières lueurs de l’aube teintèrent d’or pâle la surface de la plaine de sable, dont les dunes s’étendaient à perte de vue en vagues jaunâtres.

À l’horizon, une masse sombre apparut.
– L’oasis ! dit seulement Robert.
Et, comme s’ils avaient compris, les chameaux allongèrent le trot.
Rapidement la distance diminua.
Vers six heures, on n’était plus qu’à deux cents mètres de la lisière du petit bois que la présence d’une source avait fait jaillir du sol calciné.
Tout à coup, les chameaux s’arrêtèrent, tremblant sur leurs jambes, tendant le cou vers les arbres avec une évidente inquiétude.
– Qu’y a-t-il donc ? questionna Lotia.
Personne ne répondit.
Robert, Jack, les soldats d’escorte regardaient, cherchant à deviner quel danger inconnu avait effrayé leurs montures.
Et soudain, un rugissement sonore éclata dans l’air ainsi qu’une fanfare.
– Le lion !
Tous les indigènes avaient frissonné, secoués par cette terreur superstitieuse que « le Seigneur à la grosse tête » inspire aux populations noires. Nilia eut un petit cri d’effroi.
Mais presque aussitôt, un second rugissement partit d’un autre point du fourré, puis un troisième, un quatrième.
Enfin un effrayant concert de rauquements, tantôt graves, tantôt aigus, passa sur la plaine ainsi que le souffle d’une tempête.
Puis les broussailles s’écartèrent. Des corps fauves s’allongèrent sur le sable.
Les voyageurs avaient en face d’eux une trentaine de lions.
Comment ces animaux se trouvaient-ils rassemblés dans l’oasis ? On ne saurait le dire.
Sans doute le dessèchement du Nil, la dérivation de ses affluents qui avaient bouleversé le régime des eaux dans l’immense bassin du fleuve égyptien, avaient contraint les carnassiers eux aussi à émigrer.
Ils étaient parvenus à l’oasis, avaient dévoré en quelques jours les gazelles qui l’habitaient, et maintenant, les entrailles tenaillées par la faim, ils gardaient la source.
La caravane altérée ne pourrait apaiser sa soif.
Elle devrait camper au milieu des dunes, sous le soleil torride du jour.
Est-ce qu’elle allait être arrêtée ici ? Devrait-elle revenir sur ses pas ? renoncer à joindre les troupes abyssines ?
Sombre devant ce revers dont les conséquences pouvaient être incalculables, Robert se demandait si, malgré le danger, il n’allait pas ordonner d’attaquer la bande des lions, quand Hope, qui depuis un moment, avait porté sa main velue à sa bouche, ce qui, chez lui, était l’indice d’une réflexion profonde, bondit vers le général des insurgés.
Sa patte velue fouilla les poches du vêtement du jeune homme.
Et, avant que celui-ci, stupéfait, eût pu songer à punir le singe de sa familiarité intempestive, Hope se mettait hors de portée, brandissant, avec un grognement de triomphe, une boîte d’allumettes.
Puis, précipitant ses mouvements, l’orang sauta en croupe de l’un des cavaliers dont le chameau portait un solide pic de fer, instrument de fouille dont on s’était muni au départ.
En un instant, il eut détaché cette barre lourde de vingt kilos, et, la maniant ainsi qu’un jonc, il s’élança dans la direction de l’oasis.
– Que fait-il ? il va se faire dévorer, s’écria Robert.
Mais Nilia secoua la tête.
– Non, non, il va nous sauver.
– Comment ?
– Je ne sais pas. Seulement je pense que les nègres ont raison. Hope a une intelligence plus grande qu’on ne saurait le croire. Il a certainement une idée.
Sans doute, le singe avait une idée ; mais jusqu’à présent elle semblait être uniquement de s’offrir en repas aux fauves gardiens de l’oasis.
Il se rapprochait d’eux à grandes enjambées.
Les lions, étonnés, le regardaient.
Mais déjà quelques-uns s’irritaient de l’audace de cet être hétéroclite, ressemblant à un singe et portant un habit rouge ainsi qu’un homme.
Des rauquements sortaient des gueules ouvertes. Les féroces animaux se battaient les flancs de leur queue, avec une telle force que le retentissement des coups parvenait jusqu’aux voyageurs.
Hope avançait toujours.
Bientôt il fut à vingt pas des lions.
Ces derniers se rasèrent, prêts à bondir.
Ils n’en eurent pas le temps.

Soudain Hope fit un saut, énorme, retomba presque sur les ennemis les plus rapprochés, distribua à droite et à gauche quelques coups de son pic et disparut dans les broussailles.
Des hurlements sauvages répondirent à cette attaque. Deux lions, la colonne vertébrale brisée, restèrent étendus sur le sol. Quant aux autres, ils s’engouffrèrent sous le couvert.
Durant un moment, les cris, les rugissements se croisèrent, puis le silence se fit, troublé seulement de temps à autre par un grondement impatient.
– Hope est perché sur un arbre, dit un des indigènes de l’escorte.
– Tu crois ? demanda vivement Robert, plus ému qu’il ne voulait le paraître.
– Oui, général. Les lions ne rugissent pas comme au moment d’un combat ; ils cernent sans doute leur adversaire.
– Il faut le délivrer.
– Ordonne, nous obéirons, car la mort du Capitaine-Singe serait un grand malheur pour notre armée.
Naïvement, le soldat exprimait la pensée des insurgés, pour lesquels Hope était devenu, depuis le combat de cavalerie, une sorte de fétiche animé.
Délivrer l’orang était plus facile à dire qu’à faire, et, lorsqu’il s’agit de donner des ordres, Robert s’en aperçut bien.
Il tint conseil avec Jack et Nilia.
Mais aucun ne trouva une solution acceptable. Certes, il était possible de s’élancer dans le bois, d’engager un corps à corps avec les fauves ; mais vingt hommes contre un nombre supérieur de lions ne devaient pas espérer la victoire.
L’assaut aboutirait infailliblement à la mort de tous les membres de la caravane.
Et le jeune homme se désolait, quand l’un des cavaliers s’approcha :
– Général.
– Quoi donc ?
– Voulez-vous regarder le bois.
– Oui… eh bien ?
– Ne voyez-vous rien, là, à droite ?
Lavarède fixa ses yeux sur le point indiqué. Après une minute, il murmura :
– De la fumée.
– Justement, général.
– Il y aurait là, malgré le voisinage des lions, un campement ? Mais le soldat secoua la tête.
– Non, non, pas un campement…
– Quoi alors ?… Cette fumée…
– Hope.
– Hope ?
Le nom du singe avait fait tressaillir le Français. Que signifiaient les paroles de son interlocuteur ? Celui-ci reprit :
– Hope… pris les allumettes du général.
– Oui… après ?
– Hope met le feu aux buissons.
– Le feu ?
– Pour chasser les lions. Les lions ont peur du feu.
Les Européens eurent une exclamation stupéfaite.
Quoi ? le singe aurait songé à cela. Il aurait fait ce raisonnement compliqué :
– Les lions effrayés par le feu s’enfuiront et dégageront les abords de la source !
Cela leur paraissait invraisemblable.
C’est qu’ils ignoraient les remarquables preuves d’intelligence données par les grands quadrumanes : orangs, chimpanzés, gorilles, lesquels construisent des huttes aussi bien agencées que celles des noirs et parviennent à allumer du feu, faculté que, durant des siècles, on a cru appartenir à l’homme seul.
Dès lors, on pouvait tout admettre de la part de Hope, dont l’intellect naturel avait été développé par son contact continuel avec Robert et ses amis.
Du reste, l’événement ne tarda pas à démontrer que la supposition du soldat était juste.
La fumée s’épaissit, enveloppant le bois de nuages. Puis des éclairs rougeâtres traversèrent le brouillard, des crépitements éclatèrent, auxquels répondirent des rugissements éperdus.
Enfin, comme une trombe, l’armée des lions bondit dans le désert, fuyant sans s’arrêter, sans prendre garde aux voyageurs.
Leur faim, leur férocité étaient oubliées, et les terribles bêtes ne songeaient plus qu’à s’en aller loin, bien loin du brasier allumé par l’orang-outang.
Et derrière eux, Hope s’élança hors du bois, dont les branches, les feuillages se tordaient dans les flammes.
Sautant, dansant, il revint vers ses maîtres, les yeux brillants de malice, la face épanouie.
Et les soldats saluèrent.
Vraiment leur admiration pour l’animal ne semblait plus ridicule.
En pareille circonstance, quel homme aurait fait mieux ?
Une heure après, toute la caravane était installée autour de la source.
L’incendie avait déblayé là une large clairière ; il continuait à étendre ses ravages, à dévorer les ombrages de l’oasis.
Mais le détachement avait de l’eau en abondance. Une des rives du ruisseau, respectée par la flamme, donnait aux voyageurs fatigués l’ombre épaisse et les mousses moelleuses.
Les animaux paissaient, tout réjouis de cette aubaine après la longue marche dans le sable.
Et Hope, assis, les pieds dans l’eau, buvait à petites gorgées, en clignant des yeux comme un fin connaisseur dégustant l’excellente bouteille qu’il est lui-même allé chercher derrière les fagots.
Quant aux insurgés, ils préparèrent le repas et offrirent les meilleurs morceaux au singe, qui les accepta gravement.
Sans doute, il avait conscience d’avoir mérité cette distribution gastronomique.

CHAPITRE VII
LE PARLEMENTAIRE
– En avant !
Ce commandement retentit à l’heure où la lune, ainsi qu’un pierrot curieux, élevait sa face pâle au-dessus de la crête de l’horizon.
Et la caravane se remit en route.
Après une demi-heure, elle avait perdu de vue l’oasis ; de nouveau, elle trottait à travers les dunes du désert.
Tantôt on ralentissait l’allure pour escalader des mamelons couverts de cactus épineux ; tantôt, au contraire, on accélérait la marche lorsque l’on rencontrait de larges espaces, où les tiges espacées du drinn (sorte de graminée des sables) jetaient leur couleur rouillée.
Au matin, on atteignit le puits désigné comme point de halte.
Mais là, une déception cruelle attendait les voyageurs.
Les quelques palmiers qui ombrageaient la source avaient été brûlés, et le puits comblé était rempli d’une boue épaisse.
Tous se regardèrent.
Qui avait fait cela ?
Puis Robert sourit. Sans doute des espions anglais, les mêmes qui avaient renseigné le Sirdar sur les mouvements des Abyssins. Des espions, pensa-t-il, s’étaient aventurés de ce côté. Pour les arrêter, les nomades n’avaient rien trouvé de mieux que de supprimer le puits.
Les voyageurs n’avaient pas à craindre la soif, car, à la halte précédente, ils avaient eu la sage précaution de s’approvisionner d’eau.
Mais ils eussent été heureux de camper à l’ombre des arbres pour passer la journée.
Le hasard ne le permettait pas. Il fallait bien prendre son parti de la situation.
On dressa les tentes, sous lesquelles chacun se glissa.
Déjà, malgré l’heure matinale, la chaleur était intense.
Les méharis, agenouillés sur le sable, leur long cou étendu sur le sol, renâclaient bruyamment, annonçant ainsi une journée torride.
Leur instinct ne les trompait pas.

Ce fut un supplice de passer les heures de clarté. Sous les tentes, les voyageurs haletaient dans une atmosphère embrasée.
Nilia seule ne semblait pas souffrir.
Elle s’était couchée sur son burnous, à l’entrée de la tente de Jack, et ses grands yeux ouverts se fixaient sur le jeune homme.
On eût dit que la pensée mystérieuse qui occupait son esprit la rendait insensible à la température.
Cependant la nuit vint, apportant avec elle la fraîcheur.
Ranimés par la brise du soir, tous se relevèrent.
Malgré leur lassitude, les hommes replièrent les tentes, en chargèrent les chameaux et l’on repartit.
Hélas, le gîte d’étape suivant devait leur être aussi pénible.
Là encore le puits était comblé, les arbres brûlés.
Il fallut supporter une journée de chaleur épouvantable.
Mais la caravane apercevait au loin la silhouette capricieuse de rochers déchiquetés !
Elle approchait d’Abousin. Les montagnes marquaient la limite du désert, le commencement de l’empire de Ménélik.
On s’y engagerait après une dernière étape. Les fatigues de la route seraient oubliées.
En effet, le lendemain à l’aube, la petite troupe, après avoir franchi les premiers contreforts des Alpes Abyssines, établit son camp sur un mamelon parsemé de quelques arbres, et où chantait un filet d’eau.
L’endroit était bien choisi pour résister à une attaque. Un sentier, un seul, serpentait à l’ouest entre les rochers escarpés. Dans un tel passage, dix hommes résolus eussent arrêté une armée.
À l’est, le plateau se terminait brusquement par une falaise à pic, dont le pied disparaissait dans l’ombre noire d’un étroit ravin, d’où montait le mugissement d’un torrent.
De l’ombre, de l’eau, un peu d’herbe, c’était plus qu’il n’en fallait pour réjouir le détachement.
En quelques minutes, le camp fut dressé. Les hommes installèrent sous les arbres des foyers improvisés, afin de préparer le repas. Les méharis s’allongèrent près du ruisseau, le nez dans l’eau, et burent lentement comme s’ils dégustaient le frais liquide.
Et tout à coup, au milieu de la quiétude générale, un cri rauque retentit. Tous regardèrent dans la direction d’où venait le son.
Debout sur une pointe de granit, Hope se livrait à la plus extraordinaire pantomime.
Il roulait des yeux furibonds, étendait ses bras velus avec des gestes de menace, se frappait la poitrine, grinçait des dents.
Que se passait-il donc ?
Poussés par une sourde inquiétude, Robert et Jack coururent à l’endroit où gesticulait l’orang. Une même exclamation de stupeur leur échappa.
Tout autour de la hauteur qui supportait le campement, des cavaliers anglais se montraient.
Déjà des sentinelles, soutenues par des petits postes, gardaient les abords du sentier accédant au plateau.
Les voyageurs étaient cernés.
Les hommes de l’escorte regardaient de loin. À l’attitude de leur chef, ils comprirent qu’il se produisait un incident grave.
Ils s’approchèrent un à un, et sur toutes les physionomies se peignit la même rage impuissante.
Les Anglais étaient partout. On pouvait évaluer à deux régiments la force qui bloquait le général insurgé et ses vingt-deux compagnons.
Mais les assiégés n’eurent pas le loisir de s’apitoyer sur leur sort. Un nouveau malheur s’abattit sur eux.
Les méharis donnèrent tout à coup des signes d’inquiétude, puis ils se dressèrent brusquement, balançant leurs cous ainsi que des pendules.
Après quoi, ils se prirent à trotter en cercle, accélérant leur allure, arrivant peu à peu à un galop furieux, éperdu.
Ils tordaient leurs corps difformes comme sous l’empire d’une intolérable souffrance, s’enlevaient des quatre pieds en bonds désordonnés.

Les insurgés n’osaient approcher des animaux affolés, pris de vertige. Avec stupeur, ils les virent un à un s’élancer vers la falaise de l’est et bondir dans le vide. Que signifiait cela ?
Et comme tous, stupéfaits, les pieds rivés au sol, s’interrogeaient du regard, une sonnerie de trompette résonna dans la plaine.
Robert se tourna de ce côté.
Un officier anglais était arrêté au bas de la sente. À deux pas de lui, un cavalier élevait en l’air une lance, à l’extrémité de laquelle flottait un drapeau blanc.
En arrière, quatre soldats britanniques se tenaient immobiles, le mousqueton appuyé sur la cuisse.
– Un parlementaire, murmura Lavarède.
– Il faut le recevoir, fit impétueusement Jack. Au pis aller, nous apprendrons toujours comment ces gens nous ont tendu le piège où nous sommes tombés.
– C’est vrai. Allez au devant de lui, Jack. Vous lui banderez les yeux, n’est-ce pas. Précaution inutile, car notre situation leur est connue sans aucun doute. Enfin, observons les règles de la guerre. Allez.
Jack s’inclina et s’engagea sur le sentier en lacet.
Bientôt il eut rejoint l’officier anglais.
C’était un jeune homme, à la physionomie douce.
– Je désire entretenir le général Robert Lavarède, dit-il, lorsque Price le brun fut à portée de sa voix.
Jack tressaillit.
Les Anglais savaient donc la présence du Français en ce lieu. Tout à coup, la lumière se fit dans son esprit.
– Ils ont préparé ce guet-à-pens pour priver les patriotes de leur chef, murmura-t-il.
Et, affectant l’étonnement :
– Si vous tenez à parler au général, fit-il, c’est sur les rives du Nil qu’il vous faudra vous rendre.
L’officier sourit :
– Vous avez raison de répondre ainsi. Mais n’espérez point me tromper. Nos renseignements sont exacts. De plus, tout à l’heure, à l’aide d’une longue-vue, j’ai parfaitement reconnu celui que je viens de nommer.
Il étendit la main vers le rocher où se tenaient encore Robert et l’orang-outang.
– Tenez, le voici, là, avec son singe domestique. Vous étiez à l’instant auprès de lui.
C’était net, précis. Évidemment des espions avaient suivi la caravane. Jack s’écria :
– S’il vous plaît de vous laisser bander les yeux, Monsieur, je vous guiderai vers mes compagnons.
– Faites, Monsieur.
Un instant plus tard, Jack ayant attaché un mouchoir sur les yeux du parlementaire, aidait ce dernier à gravir le chemin malaisé conduisant au plateau.
Quand tous deux parvinrent au sommet, ils trouvèrent les insurgés rangés en cercle autour de Robert.
Sur un signe du général, Jack débarrassa l’Anglais de son bandeau.

Le jeune officier promena autour de lui un regard curieux, puis, s’adressant à Lavarède, sans la moindre hésitation :
– Monsieur le général Robert Lavarède ?
– C’est moi, répondit le Français.
– Permettez que je me présente.
Et, lentement, le parlementaire ajouta :
– Sir Henry Lowrence.
Les deux hommes eurent une inclination raide, et Henry Lowrence reprit :
– C’est un sentiment d’humanité qui a poussé le général Holson, commandant des forces qui vous entourent, à m’envoyer vers vous.
– Le général Holson est trop bon.
L’Anglais ne parut pas remarquer l’ironie contenue dans ces paroles. Il poursuivit :
– Vous êtes cernés par des troupes cinquante fois supérieures en nombre. Vous avez des vivres pour vingt-quatre heures. L’eau du ruisseau ne peut étancher votre soif, car elle a été empoisonnée. Vous avez vu l’effet qu’elle peut produire, par la mort de vos méharis.
Un sourire dédaigneux contracta la figure de Robert.
– Ah ! fit-il d’un ton méprisant, les Anglais empoisonnent les fontaines. C’est là un moyen peu digne d’une nation civilisée.
Le parlementaire rougit légèrement.
– Certes, répliqua-t-il, le procédé est blâmable ; mais il a son excuse dans la gravité des circonstances.
– En France, nous n’apprécions pas de même.
– Au surplus, continua l’Anglais sans tenir compte de l’interruption, nous agissons en ennemis loyaux, puisque nous vous prévenons. Si nous désirions votre trépas, il nous eût suffi d’attendre. Vous auriez bu sans nul doute, et ce soir, le plateau où nous nous trouvons n’eût plus porté que des cadavres.
– Oh ! murmura une voix douce, ceci est infâme.
C’était Nilia, qui n’avait pu retenir une exclamation d’horreur.
Henry Lowrence regarda la jeune fille, puis, reprenant son discours :
– Sir Robert Lavarède, citoyen d’une nation avec laquelle l’Angleterre vit en paix, vous êtes venu en ce pays soulever les populations contre nous. Il serait de notre droit strict de vous mettre à mort. Mais chez le peuple britannique, on n’est jamais sourd à la voix de l’humanité. Rendez-vous. Vous serez mis en prison, traité le plus doucement possible, jusqu’au jour où la rébellion sera vaincue. Après cela, vous et vos compagnons serez remis en liberté.
Le chef insurgé haussa les épaules.
– J’aime mieux mourir libre et honoré.
– Réfléchissez. Ma proposition est dictée par l’admiration inspirée à tous par votre énergie et votre courage.
– Votre admiration grandira encore en voyant à quel point je méprise la mort.
Il y eut un silence.
– Mais vous condamnez tous ceux qui vous entourent, insista Henri Lowrence.
– Je le sais, et je suis certain de leur approbation.
Robert se tournait en même temps vers ses soldats.
– Vous avez entendu. Vous plait-il d’être prisonniers des Anglais ?
– Non, répondirent les guerriers d’une seule voix.
– Vous le voyez, Monsieur, reprit le Français, tous préfèrent la mort.
L’Anglais fit une dernière tentative et, désignant Nilia :
– Oui, votre courage est grand et je le salue ; cependant vous oubliez qu’il est parmi vous une jeune fille, presque une enfant, à qui vous imposerez une longue et cruelle agonie.
– Ah ! s’écria Jack avec impétuosité… vous avez raison… et si l’humanité vous guide, comme vous le prétendez, sauvez-la.
Il n’acheva pas. Nilia s’était précipitée vers lui, elle se cramponnait à son bras.
– Non, non, gémit-elle d’une voix déchirante. Ne me rendez pas aux ennemis, laissez-moi partager votre sort. Je bénirai la mort qui m’emportera avec vous, mes amis.
Jack allait insister, mais Robert ne le permit pas.
– Vous avez compris, Monsieur, dit-il au parlementaire. Retournez auprès de ceux qui vous ont envoyé. Apprenez-leur ce que vous avez vu et rapportez-leur mes paroles : ce plateau nous restera jusqu’à la mort.
L’officier ouvrit la bouche pour répondre. Sur un signe de Lavarède, Price le brun lui rejeta le bandeau sur les yeux, et, le saisissant par les poignets, le ramena vers le sentier descendant à la plaine.

CHAPITRE VIII
LE SECRET DE L’ANGLETERRE.
Depuis trois jours, Robert et ses compagnons campaient sur le plateau.
Les vivres manquaient depuis la veille. Depuis la veille, les malheureux avaient épuisé les dernières gouttes d’eau contenues dans leurs outres.
La soif les torturait.
Aucune souffrance n’est comparable à celle-là. La faim abat l’individu, réduit sa sensibilité nerveuse ; la soif au contraire semble l’exaspérer.
Les hommes se traînaient péniblement, interrogeant l’horizon du regard, avec l’espoir insensé qu’ils verraient accourir les troupes abyssines annoncées dans la dépêche saisie naguère sur le cadavre de John.
Robert, lui, ne conservait aucune illusion.
Il avait compris le piège tendu par ses ennemis.
– Ah ! gronda soudain Jack, qui se tenait près de lui. Les Abyssins ne doivent pas être loin ; il faudrait sortir d’ici, les avertir…
– Sortir d’ici ? murmura Lavarède, et comment ?
Entraînant le jeune homme vers le rebord de l’escarpement, il lui en fit faire le tour.
– Voyez. Partout les Anglais ont établi des postes qui s’appuient les uns sur les autres ; au moindre mouvement, on aurait un régiment sur les bras.
– Alors vous ne voulez rien tenter ?
– Oh ! reprit tristement Robert, au lieu de mourir lentement de soif, nous pouvons ce soir attaquer l’ennemi. Nous nous ferons tuer en combattant : mais pour passer, nous ne passerons pas.
– Et Nilia ? questionna Jack d’une voix tremblante.
Robert haussa les épaules.
Que pouvait-il répondre ? La malheureuse jeune fille n’était-elle pas condamnée comme lui, comme ses soldats ?
Cependant Price le brun alla annoncer aux hommes de l’escorte que, la nuit venue, on essaierait de se frayer un passage à travers les troupes assiégeantes.
La nouvelle fut accueillie avec joie.
Mourir pour mourir, ne valait-il pas mieux tomber en se vengeant, en entraînant dans la tombe quelques-uns de ces Anglais abhorrés !
Puis, ce soin rempli, Jack revint auprès de Nilia.
Celle-ci était assise sur un bloc de rocher, au bord du ruisselet, dont les ondes claires, empoisonnées par l’ennemi, chantaient sur les cailloux. C’était un murmure d’une ironie poignante pour ceux qui étaient là, étreints par la soif, et auxquels il était interdit de se désaltérer.
Le regard vague, la pensée lointaine, Nilia rêvait.
Elle tressaillit à l’approche de Jack. Ses doux yeux se fixèrent sur lui avec une expression désolée.
Ses lèvres s’agitèrent comme si elle voulait parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche pâlie par la souffrance.
Lui, les regards humides, s’agenouilla devant elle.
– Nilia, dit-il, ce soir nous tenterons une sortie. Il est probable que nous périrons tous…
Elle l’interrompit :
– Tous, alors c’est bien.
– Ah ! reprit-il avec feu. Vous ne vous plaignez pas, vous ne formulez aucun reproche.
– De quel droit le ferais-je ? C’est de ma propre volonté que je vous ai rejoint. N’aviez-vous pas refusé de m’associer aux dangers de l’expédition ?
Puis, avec une autorité étrange :
– Ce soir, je marcherai auprès de vous. Si nous sommes vaincus, ainsi que vous le craignez, tuez-moi. Ma seule terreur est de tomber vivante aux mains des Anglais.
Et, comme il ne répondait pas :
– Jurez de faire ce que je demande et je serai bien heureuse.
Jack tremblait sous son clair regard de martyre.
– Jurez, répéta la jeune fille.
Alors il se produisit un bouleversement dans l’esprit de Price le brun.
Jusqu’à ce jour, il avait caché la tendresse immense qu’il ressentait pour cette enfant mystérieuse et bonne ; subitement sa réserve fondit, les douces paroles d’aveu s’échappèrent de ses lèvres.
– Pardonnez-moi, pardonnez-moi… Nilia. Je suis sans force, sans courage. Pourquoi est-ce ainsi ? Je ne voulais pas vous dévoiler le secret… je voulais attendre la victoire, la paix, la délivrance d’un peuple… et alors seulement vous dire le rêve qui, durant la longue guerre, durant les marches sous le soleil de feu ou dans les nuits étoilées, le rêve dont mon âme était bercée.
Il s’arrêta haletant.
Nilia le considérait, la face immobile, les regards troublés.
Et lui, fixant les yeux sur ceux de son interlocutrice, reprit avec une émotion croissante :
– La mort est là… elle nous attend. Le grand inconnu s’ouvre devant nous. Je ne veux pas que vous mouriez sans avoir la suprême joie de vous savoir aimée. J’ai rêvé, Nilia, d’être l’époux tendre, dévoué. Oh ! je ne suis pas digne de tant de bonheur, puisque le destin lui-même s’y oppose ; mais j’avais espéré que vous, doux ange, vous seriez indulgente à mon cœur.
Jack se tut brusquement.
Toute pâle, Nilia s’était légèrement renversée en arrière, et elle demeurait immobile, adossée au rocher, les yeux clos. On eût pensé qu’elle donnait.
Le jeune homme eut un cri éperdu. Il saisit les mains de son interlocutrice et, se penchant vers elle, frémissant, désolé, croyant lui avoir déplu :
– Nilia… pardonnez… Je vous ai blessée… Qu’avez-vous ? Qu’avez-vous ?
Elle répondit d’une voix étrange, monotone, cette voix qu’il avait entendue naguère dans le karrovarka :
– Interroge-moi… je te dirai la vérité… Mon être t’obéit comme il obéissait naguère à Gorgius Kaufmann.
– Que voulez-vous dire ? balbutia Jack effaré.
– Que Kaufmann m’avait achetée comme esclave, afin de me soumettre au sommeil hypnotique. Il profitait de ma faculté de double vue pour renseigner le Sirdar, capter sa confiance, obtenir honneurs et argent.
– Et maintenant ?
– Maintenant, mon âme est allée à toi. Commande et j’obéirai. Interroge et je répondrai.
Le jeune homme se prit le front à deux mains. L’imprévu de la scène le bouleversait. Elle reprit :
– Interroge… Interroge… Le salut est possible… Ordonne que je voie.
Et, comme malgré lui, dominé par la situation, il murmura :
– Vois, je le veux.
En instant, le visage de Nilia exprima l’effort, puis un sourire se joua sur sa bouche…
– Je vois, fit-elle.
– Que voyez-vous ?
– Une armée de soldats noirs. Ils sont à un jour de marche à l’est. Ils ont des fusils à tir rapide, des canons.
– À une journée de marche… ?
– Oui, ce sont des guerriers d’Abyssinie, commandés par le ras Makonnen.
Tristement, Jack secoua la tête.
– Si près, gémit-il, et trop loin.
– Non, répondit la jeune fille.
Ce monosyllabe fit sursauter Price le brun.
– Comment non… ?
– Nous les rejoindrons demain.
– Nous ?
– Oui.
– Mais comment ? comment ? Parlez, Nilia, parlez, je vous en prie.
Il avait de nouveau saisi les mains de sa compagne.
Elle eut un faible cri :
– Non, pas ainsi, vous me faites mal. Questionnez doucement… Mon âme est à vous, je vous l’ai affirmé… Croyez-moi.
Il desserra son étreinte et, plus doucement :
– Nous pouvons donc échapper aux Anglais ?
– Nous le pouvons.
– Quand cela ?
– Quand la nuit couvrira la terre.
– Mais par quel chemin ?
– Par la falaise qui borne le plateau à l’est.
– Par la falaise ? répéta Jack, mais cela est impossible. Un mur de rochers à pic de plus de deux cents pieds.
Nilia secoua la tête.
– À cinq ou six mètres au-dessous de la crête existe une caverne.
– Une caverne ?
– Avec les cordes, les courroies, on descendra les hommes.
– Et puis… ? Et puis… ? demanda Price, piétinant d’impatience anxieuse.
La jeune fille poursuivit paisiblement :
– Les eaux ont creusé le rocher. Dans la grotte s’ouvre un couloir sinueux qui aboutit bien loin d’ici dans la montagne. Fatigante, périlleuse même est la route, mais je vois le camp abyssin. Nous y sommes tous, tous.
Elle se tut un instant, puis d’une voix faible :
– Je suis fatiguée. Réveille-moi. Désormais je suis ta chose. Quand tu voudras savoir ce qui se passe au loin, tu prendras mes mains dans les tiennes, tu me diras : Dors…, je dormirai et je verrai.
Obéissant encore à l’étrange créature, Jack murmura :
– Réveillez-vous.
Les paupières de la jeune fille battirent, elle se redressa lentement et, abaissant son regard caressant sur Price :
– Vous me disiez que vous aviez rêvé d’être mon mari. Soyez béni d’avoir prononcé ces paroles, car la pauvre esclave que je suis devient la plus heureuse des femmes ; moi aussi j’avais songé à ma vie entière consacrée à vous.
Elle reprenait la conversation où le sommeil magnétique l’avait interrompue. De tout ce qui s’était passé durant ce sommeil, elle ne se souvenait pas.
Et Jack, radieux maintenant, Jack possesseur du secret qui avait fait un instant la force de l’Angleterre, Jack courut à Robert et lui fit part de la scène qui venait d’avoir lieu.
Sans retard, le Français se rendit au bord de la falaise.
Se penchant au-dessus du vide, il examina soigneusement la paroi brisée du rocher.
Et bientôt, étouffant un cri de triomphe, il se releva.
À peu près au centre de la muraille granitique, il avait distingué une fissure noire.
Nilia avait donc dit vrai, au moins en ce qui concernait la caverne. Si, pour le surplus, ses affirmations se vérifiaient, les voyageurs étaient sauvés.
Il fallait attendre la nuit pour s’assurer du fait.
Les yeux des factionnaires anglais étaient rivés sur le plateau, et bien certainement ils eussent été intrigués, si l’un des assiégés, suspendu à l’extrémité d’une corde, avait été promené le long de la paroi de la falaise.
Attendre était nécessaire.

Mais combien pénible fut la journée !
Engourdis par la chaleur, suppliciés par la soif, la gorge sèche, l’estomac contracté, les insurgés ressentaient en outre les tortures de l’espérance anxieuse.
Ils se couchaient à l’ombre, se bouchant les oreilles pour ne pas entendre le murmure ironique de l’eau, qui les attirait irrésistiblement.
Parfois l’un des soldats, exaspéré par la douleur, saisissait son fusil, ajustait les Anglais campés à quatre cents mètres à peine.
Mais toujours Robert, Jack se dressaient près de l’homme.
Avec de bonnes paroles, ils l’apaisaient, l’amenaient à renoncer à son idée vengeresse.
Il importait à tout prix de ne pas inquiéter les assiégeants.
Cependant le soleil poursuivait sa carrière. Lentement il s’abaissait vers l’horizon, teintant de pourpre les sables d’or.
Les assiégés s’étaient mis sur leur séant.
Ils regardaient l’astre radieux descendre lentement, descendre encore.
Une sorte de frémissement les secouait. Bientôt, ils allaient pouvoir contrôler les assertions de Nilia ; bientôt ils sauraient si, oui ou non, ils étaient condamnés à périr.
Les minutes s’écoulèrent une à une ; le rapide crépuscule des régions intertropicales assombrit le paysage, puis la nuit vint.
Alors, une activité fébrile s’empara des hôtes du plateau.
Sans que Robert en eût donné l’ordre, tous se levèrent, se rassemblèrent au bord de l’abîme.
Le Français ne songea pas à s’en plaindre.
– Mes amis, dit-il, vous avez des cordes. Attachez-en plusieurs bout à bout, puis sir Jack, ici présent, sera suspendu dans le vide et ira reconnaître l’anfractuosité qui, peut-être, nous permettra de fuir.
– Moi ? protesta Price le brun, pourquoi pas vous ?
– Parce que le chef doit passer le dernier dans une retraite.
Et, comme le jeune homme se préparait à insister :
– Silence, fit Robert, et obéissez.
Son accent n’admettait pas de réplique. Jack se soumit. Il se laissa passer sous les bras une corde retenue par un nœud coulant. La tresse de chanvre fut enroulée autour d’un rocher qui émergeait de la surface du plateau, et deux hommes en saisirent l’extrémité libre. Ces préparatifs terminés, Lavarède commanda :
– Allez.
Sans hésiter, Jack s’approcha du rebord de l’escarpement ; il se coucha sur le sol et, se cramponnant des deux mains, il fit glisser lentement son corps dans le vide.
Les soldats tendirent la corde.
L’instant était solennel. Une émotion violente serrait le cœur des assistants. Cet homme, se balançant au-dessus du gouffre, allait peut-être trouver la mort au lieu de la voie de salut annoncée.
Et Nilia, tremblante, debout auprès du groupe, murmurait de vagues paroles de supplication.
– Filez le cordage, cria Jack.
Les hommes chargés de la manœuvre s’arc-boutèrent sur leurs jambes, leurs mains se crispèrent sur la terre, et le jeune homme, cessant de se soutenir, disparut lentement.
Quelques secondes s’écoulèrent.
La corde glissait avec un bruissement.
Soudain la voix de Jack monta de l’abîme.
– Halte ! tenez bon. L’entrée de la caverne est en retrait, je suis obligé de me balancer pour l’atteindre.
Une minute encore, puis la corde se détendit et ces paroles parvinrent aux oreilles des insurgés :
– J’y suis. Il y a un couloir. Tout est vrai… Venez.
Un grondement de joie, vite étouffé, s’échappa de toutes les poitrines.
Avec une hâte angoissée, Nilia fut à son tour descendue le long de la falaise, puis, un à un, les insurgés rejoignirent Jack.
Les derniers voulurent céder le pas à Robert, mais celui-ci refusa net.
Il restait seul sur le plateau.
Alors il ramena la corde à lui, en réunit les deux extrémités flottantes par un nœud solide et, en ayant ainsi formé un vaste anneau, il le passa autour du rocher qui jusqu’à ce moment avait servi de point d’appui.
Cela fait, il promena un regard sur la plaine que les feux des bivouacs piquaient de clartés dansantes. Après quoi, il vint près de l’abîme, empoigna le cordage à deux mains et se laissa glisser.
Un instant plus tard, il se trouvait au milieu de ses compagnons sur une étroite plate-forme.
En arrière, le rocher se creusait, et tout au fond on apercevait l’entrée d’un boyau noir qui semblait se perdre dans l’intérieur de la montagne.
Avant toute chose, le Français dénoua la corde qui lui avait servi à opérer sa périlleuse descente et il la ramena à lui.
De la sorte, rien n’indiquerait à l’ennemi par quel chemin les assiégés s’étaient échappés.
Il songeait à tout, ce bourgeois de France, dont les circonstances avaient fait un général.
On alluma des torches, et Lavarède marchant le premier cette fois, toute la troupe s’engouffra dans le couloir.

Celui-ci, assez large d’abord, ne tarde pas à se resserrer. Le plafond s’abaisse, les parois se rapprochent. Ce n’est plus une galerie, c’est un boyau dans lequel les fugitifs se glissent sur les mains et sur les genoux, parfois même à plat ventre.
Puis le passage s’interrompt soudain.
Un puits aux murailles perpendiculaires s’ouvre sous les pieds des insurgés.
De nouveau, la corde permet à tous d’atteindre le fond.
Et le corridor continue, suivant des rampes rapides sur lesquelles on a peine à conserver son équilibre.
On descend, on descend encore. Robert calcule approximativement qu’il a dû arriver au niveau de la plaine, mais la pente ne diminue pas. Il semble qu’elle s’enfonce jusqu’au centre de la terre.
Un nouvel obstacle se présente. La galerie est inondée. De la voûte tombent incessamment de larges gouttes d’eau qui se mêlent, avec un bruit d’averse, à la nappe inférieure.
Sans doute, on passe ici sous le lit du torrent qui coule au pied de la falaise.
Il faut avancer pourtant. On entre dans l’eau. La profondeur augmente peu à peu. Le niveau monte des chevilles aux genoux.
Maintenant les hommes en ont jusqu’à la ceinture.
Jack a chargé Nilia sur ses épaules. Il marche avec précaution, interrogeant anxieusement la surface du canal souterrain. Est-ce que la nappe liquide va arrêter les fugitifs, rendre inutiles tous les efforts précédents ?
L’eau baigne sa poitrine.
Quelques pas encore et il faudra revenir en arrière.
Non. Le terrain se relève brusquement. Le sol ferme apparaît… La galerie s’étend asséchée devant les insurgés.
Une heure encore, ils vont ainsi grelottant dans leurs vêtements mouillés et puis Robert, qui tient la tête, fait halte avec un cri étouffé.
Par une ouverture irrégulière il aperçoit les étoiles.
Il se précipite.
Le passage débouche dans une étroite vallée enserrée par des massifs granitiques. Une sente à peine indiquée escalade les hauteurs, bordée de nopals, contournant les blocs rocheux amoncelés par les caprices de la nature.
C’est la route de la montagne abyssine, celle qui doit conduire les fugitifs auprès de leurs alliés.
Une joie délirante envahit les soldats. Un ruisseau coule tout près. Ils y courent. Ils boivent à longs traits. Après les tortures de la soif, il y a comme une griserie à absorber l’onde fraîche.
Et, ranimés par cette copieuse libation, retrouvant toute leur énergie, les fugitifs gravissent la montagne, traversent des plateaux déchiquetés par les convulsions volcaniques, redescendent dans des ravins, remontent encore sur des crêtes. Ils sont brisés, moulus, exténués ; ils marchent toujours. Un espoir les soutient : celui de rencontrer les Abyssins, leurs alliés.
Et, comme l’aube vient, un camp se montre à leurs yeux.
Des cavaliers accourent à leur rencontre.
Ce sont les soldats du ras Makonnen.
– Qui êtes-vous ? d’où venez-vous ?
– Je suis Robert Lavarède, généralissime des patriotes du Nil.
Ces répliques sont le signal d’une fantasia échevelée. Les cavaliers galopent en cercle autour du détachement, déchargent leurs armes en l’air, poussent des hurrahs frénétiques.
En un instant le camp tout entier s’agite.
Infanterie, artillerie sont rassemblés et le ras Makonnen lui-même s’avance à la rencontre de Robert.
On se complimente, on s’explique.
La fourberie des Anglais s’étale au grand jour.
Jamais les Abyssins n’ont eu l’intention de rejoindre le gros de l’armée des insurgés. Ils ont été trop occupés pour cela.
Ils ont détourné le Nil Bleu et l’Atbara, incendié les oasis du désert Arabique.
Les troupes de Makonnen sont en réserve. Les autres corps abyssins sont échelonnés le long de la mer Rouge, empêchant le débarquement des renforts britanniques expédiés de l’Inde.
Des régiments arabes ont poussé jusqu’au canal de Suez, l’ont obstrué après avoir massacré les garnisons anglaises.
Lewis Biggun ne communique plus avec son pays que par Alexandrie.
Dire la joie de Robert, de ses compagnons, en apprenant ces heureuses nouvelles, est impossible.
La veille, ils croyaient tout perdu ; aujourd’hui, ils voient que l’heure du suprême effort est proche, et qu’ils le pourront tenter avec de grandes chances de succès.
Aussi ont-ils hâte de retourner sur le Nil.
Ils s’accordent seulement vingt-quatre heures de repos, pendant lesquelles une division se rend au rocher qui a failli devenir le tombeau du Français.
Cette troupe arrive trop tard.
Les méharistes britanniques ont levé le siège. Sans doute ils se sont aperçus de la fuite de leurs ennemis, et maintenant ils galopent éperdument à travers le désert, allant porter au Sirdar la nouvelle de leur nouvel échec.

CHAPITRE IX
SWEET HEART
Mable Ashton était blonde, pâle, mince. Elle avait des yeux bleus rêveurs, un joli nez, une bouche mignonne.
Son front seul déparait ce gracieux assemblage. Il était bas et étroit, ce qui n’empêchait pas les jeunes lieutenants de l’armée britannique de déclarer la gentille miss intelligente au possible.
Il est vrai qu’elle était fille du baronnet colonel Ashton, lequel jouissait d’un revenu de cent mille livres sterling (2.500.000 francs). En Angleterre, plus que partout ailleurs, on est réputé intelligent quand on y met le prix.
Au demeurant, miss Mable apparaissait à l’observateur comme un de ces charmants produits de l’éducation britannique, faits de nullité élégante.
Signes particuliers : la jeune personne était foncièrement romanesque et considérait l’Angleterre comme le premier pays du monde.
À la nouvelle du soulèvement nilotique, elle avait quitté Londres, avait rejoint son père.
Aux reproches de ce dernier elle avait répondu :
– Une guerre contre ces Africains sera une simple marche militaire. Il est bon que la fille d’un officier supérieur assiste à ces choses.
On juge de sa colère après les premiers revers de l’armée anglaise.
Mable écumait.
Elle ne trouvait pas d’épithètes assez dures pour flétrir, comme il convenait, la conduite de lord Lewis Biggun.
Battre en retraite devant un ramassis de noirs sans discipline, conduits par un Français, quelle honte !
Et si on lui faisait observer que l’on reculait, non devant les nègres, mais devant la soif, elle répliquait sans hésiter :
– Est-ce que la question de l’eau a une importance lorsque l’on va au feu ?
Avec rage elle avait vu abandonner Khartoum, Berber, Abou-Hamed, Dongola, Ouady-Halfa.
Elle avait pleuré en voyant les Anglais détruire les tourelles tournantes, dont l’édification leur avait coûté tant de millions.
Et l’armée rétrogradait toujours.
Elle ne s’arrêterait, disait-on, qu’aux environs des ruines de Thèbes. Là, en effet, il y avait encore de l’eau.
Une dépression du lit du fleuve avait transformé son cours inférieur, de Thèbes à la mer, en un lac d’eau stagnante.
C’était là que se jouerait la dernière partie. Assurés contre la soif, les Anglais ne doutaient pas de la victoire.
Mais telles étaient les clabauderies de Mable que, pour se débarrasser de la jeune fille, qui incessamment lui rendait visite et lui soumettait les plans de campagne les plus extravagants, le Sirdar confia au colonel Ashton la défense des retranchements dont on avait couvert l’île de Philoe, avec l’ordre confidentiel de les évacuer aussitôt que serait signalé l’ennemi.
Du coup, miss Ashton triompha.
Son père au moins n’avait pas sa part de la honte qui couvrait les armes anglaises.
On lui attribuait un poste d’honneur.
Et le colonel, riant dans sa barbe, dut essuyer ses effusions interminables.
Avec deux cents hommes il occupa l’île, qui se dressait maintenant, ainsi qu’une colline, au milieu du lit desséché du Nil.
Chaque jour des reconnaissances furent envoyées en avant, afin de signaler l’avant-garde de l’ennemi.
L’une des patrouilles rapporta un renseignement précieux. À deux kilomètres environ vers le sud, une source jaillissait dans le sein même du fleuve, au milieu d’un épais massif de roseaux.
La découverte du filet d’eau avait été amenée par la présence en ce lieu d’une nuée d’oiseaux, flamants, ibis, etc., dont les soldats avaient tué un certain nombre.
Mable écouta ce rapport sans sourciller.
Mais le lendemain matin, alors que son père dormait encore, elle se glissa hors de l’abri qui lui avait été dressé parmi les ruines de l’île, ruines auxquelles elle n’avait pas daigné accorder un regard.
– L’antique Égypte, disait-elle volontiers, manquait de goût. Ses monuments n’avaient pas l’air anglais.
Ce matin donc, elle portait un délicieux costume de chasse, jupe courte, petite veste, le tout de piqué blanc.
Sur son épaule s’appuyait une mignonne carabine.
Sans hésiter, avec cette liberté d’allures qui caractérise la jeune Anglaise, elle alla trouver le lieutenant Danye, un grand garçon, aux cheveux filasse, dont les yeux bleu faïence exprimaient une admiration sans bornes pour la fille du colonel… et peut-être aussi pour sa dot.
– Bonjour, Danye, dit-elle en souriant.
– Bonjour, Miss.
– Je vais chasser près de la source.
– C’est imprudent, Miss. On ne sait où sont les rebelles, et d’un instant à l’autre leurs têtes de colonnes peuvent se montrer.
– J’ai réfléchi à cela, Danye, et c’est pour cette cause que vous me voyez ici.
– Ah !
– J’ai pensé que vous m’accompagneriez.
Le visage du lieutenant exprima le ravissement. La millionnaire Mable le conviait à une promenade en tête-à-tête. Est-ce que, décidément, elle songerait à lui accorder sa main dans un avenir plus ou moins rapproché ?
– Je vous accompagnerai certainement, balbutia-t-il enfin.
– Alors, ma sortie n’est plus imprudente ?
– Je veillerai sur vous, comme sur un joyau précieux que vous me paraissez être.
Mable sourit.
– Avec un officier anglais, il n’y a rien à craindre. Mais dépêchez-vous, je vous prie.
En cinq minutes, Danye fut prêt à partir.
Tous deux gagnèrent l’extrémité sud de l’île, descendirent la pente qui conduisait au fond du lit desséché du Nil et s’éloignèrent.
Mable regardait son compagnon du coin de l’œil.
L’officier ne manifestait aucune inquiétude. Il rayonnait d’orgueil. Miss Ashton avait choisi entre tous pour l’accompagner, lui, pauvre lieutenant sans fortune.
Et il se berçait de rêves matrimoniaux.
Car, on le sait, la jeune Anglaise qui pense à se marier se promène avec celui qui lui semble le plus digne de faire son bonheur.
Elle va aux courses, au théâtre, à la campagne avec lui ; elle l’étudie, et, après quelques semaines d’observation, elle le déclare « bon » ou « mauvais » pour marier elle-même.
Et le jeune homme soumis à cette épreuve est le Sweet heart, le cœur sucré, jusqu’à l’heure où il devient, soit époux, soit soupirant évincé.
Danye exultait. Il était « cœur sucré ».
– Mon père nous grondera certainement au retour, fit lentement Mable.
Le lieutenant eut un sourire.
– Grondé pour vous, je serai très content.
– Ah ! soupira-t-elle.
Puis brusquement :
– Il nous appellera imprudents, mais je pense que ce reproche est un véritable éloge.
– Moi aussi, acquiesça Danye, pour dire quelque chose.
Elle lui serra la main.
– Vous aussi, cela me fait plaisir. Je trouve que les Anglais, et mon père lui-même, se sont montrés trop prudents durant cette guerre ; c’est leur prudence qui a amené le succès des rebelles.
– Oui, oui, cela est ainsi.
Le jeune homme n’en croyait rien ; seulement il s’affirmait avec raison qu’il ne faut jamais contrarier une fillette millionnaire dont on convoite la main.
On a toujours le loisir de se rattraper après le mariage.
Mable Ashton manquait d’expérience ; elle estima son interlocuteur sincère et, doucement :
– Je suis lasse, voyez-vous, des gens prudents.
– Eh bien, reposez-vous, dit-il niaisement.
Elle se méprit au sens de ses paroles :
– Vous n’êtes pas prudent, vous, Danye ?
– Non.
– À la bonne heure. Tenez, je vais vous faire un aveu.
– Mon cœur ouvre ses deux oreilles.
– Je me suis promis…
Mable hésita un instant.
– Vous avez promis ? interrogea-t-il.
– Que ma main appartiendrait seulement à un homme téméraire.
– Ah !
Il y avait une nuance de désappointement dans cette exclamation, car le lieutenant n’était point un audacieux.
Sans fortune, il avait embrassé la carrière militaire pour vivre et son rêve était tout de confort et de tranquillité.
Mais encore une fois, on ne contrarie pas une millionnaire.
– Vous avez tout à fait raison, appuya-t-il.
– Je le crois. Ainsi tenez, Danye…
Elle s’interrompit encore.
– Parlez, parlez.
– Je le veux bien. Vous, Danye, j’ai lu dans vos yeux.
– Vous avez lu… ?
– Des choses fort aimables pour moi. Il est possible que j’épouse un officier dépourvu de fortune ; cela dépendra uniquement de lui.
Le cœur de Danye battit à se rompre.
– Je suis prêt à tenter l’impossible, bégaya le grand garçon tremblant d’une émotion véritable.
– J’en suis certaine.
– Ordonnez.
– Volontiers. Ce matin, par exemple, vous n’avez pas hésité à me suivre. Je suis très contente de vous.
– Oh !… une pareille faveur…
– Attendez… Il faut continuer. Il faut être un héros pour justifier mon choix aux yeux du monde.
– Je serai le héros, s’écria le lieutenant, après s’être assuré d’un regard circulaire qu’aucun danger n’apparaissait aux environs.
– Vous le jurez ? fit-elle ravie.
– Je le jure.
– Très bien. L’ennemi va nous joindre prochainement ; je ne veux pas vous demander des choses trop difficiles. Prenez seulement un ou deux canons, autant de drapeaux et une cinquantaine de prisonniers, et je viens à vous, et je mets ma main dans la vôtre, et je vous dis : voulez-vous marier moi ?
– Deux canons, deux drapeaux, cinquante prisonniers, répéta l’officier ahuri.
– Oui… Vous le voyez, je ne suis pas exigeante.
– Cela est vrai, réussit à prononcer Danye… Si chaque soldat anglais en faisait autant, il ne resterait plus de rebelles.
– Telle est ma pensée, conclut gravement Mable. Maintenant je vous ai ouvert mon cœur, songeons à notre chasse.
Les promeneurs arrivaient en effet aux abords de la source.
Cela se reconnaissait, à l’humidité du sol, à la couleur verte des roseaux qui se dressaient devant les jeunes gens.
Autre indice. Les oiseaux, chassés de partout par la brusque disparition des eaux, s’étaient réunis par milliers en ce point favorisé.

Ils s’élevaient en nuages épais, tournoyaient dans l’air avec des cris aigus, ou bien s’abattaient par bandes sur le terrain humide.
Un ruisselet bientôt absorbé par le sable ou pompé par le soleil coulait pendant quelques centaines de mètres dans le lit du fleuve.
C’était sur ses bords que se pressaient les volatiles.
– En chasse ! avait dit Mable.
Et presque aussitôt, avec une dextérité qui prouvait sa longue habitude de ce sport, elle fit glisser son arme, portée jusqu’à ce moment à la bretelle.
Elle épaula, appuya sur la gâchette et fit feu.
Un concert assourdissant répondit à la détonation. En une seule masse les oiseaux s’élevèrent, mais une douzaine d’entre eux restèrent sur place, les uns tués, les autres blessés.
La petite miss lança aux échos un hourra joyeux.
Elle se précipita pour ramasser ses victimes et Danye s’élança sur ses traces.
Mais dans leur hâte, ils ne remarquèrent pas que le sol était vaseux, et tout à coup, ils s’enfoncèrent jusqu’à mi-corps dans une flaque de boue, sur la surface à peine sèche de laquelle ils avaient imprudemment posé les pieds.
À grand’peine, ils parvinrent à regagner le sol ferme.
Mais dans quel état !
Couverts d’une vase verdâtre dont le parfum n’avait rien d’agréable.
– Oh ! s’écria Mable avec colère, cela est ennuyeux d’une façon inexprimable.
– Yes, bredouilla Danye, d’un air piteux.
– Mon père triomphera de nous voir rentrer dans cet équipage.
– Bien certainement il triomphera, Miss.
Puis soudain le lieutenant se frappa le front.
– Non, peut-être…
– Peut-être quoi ?
– Il serait possible de lui cacher l’accident.
– Comment cela ?
– La source.
Elle trépigna.
– Si vous parlez par énigmes, comment pourrai-je jamais vous comprendre.
– Je m’explique, Miss, je m’explique. Rien ne vous empêche de laver vos vêtements…
– Les laver… parfait.
Mais la jeune fille rougit.
– Pour les laver… il faut les retirer.
– Sans doute…
– Cela serait shocking, dans notre situation.
L’officier leva les mains vers le ciel.
– Ah ! Miss, vous ne saisissez pas ma résolution.
Et, désignant le fourré impénétrable des roseaux :
– Vous vous retirerez là, Miss, ainsi que dans une cabine de bains de mer. Vous jetterez vos vêtements par-dessus ce rempart de verdure, et si vous le permettez, je ferai office de blanchisseur. Avec le soleil brûlant, dans une heure le dommage sera réparé.
Les yeux de la jeune fille brillèrent de reconnaissance.
– Ah ! Danye, fit-elle, vous êtes véritablement un compagnon précieux. Soyez assuré que je n’oublierai jamais que vous avez lavé pour moi.
Sur cette promesse, peu ordinaire entre fiancés, elle se dirigea vers les roseaux, laissant après elle une traînée de vase.
Un instant après, elle écartait les tiges serrées des plantes et disparaissait.
Deux minutes s’écoulèrent, puis la jupe et le corsage de chasse de miss Mable, lancés d’une main sûre par la jeune Anglaise accoutumée au noble jeu du lawn-tennis, passèrent par-dessus la barrière de roseaux et vinrent tomber aux pieds du lieutenant.
– Je reçois votre petite expédition, déclama-t-il, je me rends au lavoir.
Et, ramassant les vêtements de la « chère miss », Danye se dirigea vers le ruisseau.
Mais il n’avait pas fait dix pas qu’il s’arrêtait brusquement.
Un cri éperdu venait, de retentir. C’était la voix de Mable.
L’officier se précipita vers le massif de roseaux qui servait d’abri à sa compagne ; il n’eut pas le temps de l’atteindre.
Les plantes vertes s’écartèrent sous un effort violent, et Mable Ashton parut, poussée par un monstre velu, à l’aspect menaçant.
Stupéfait, Danye regarda.
Qu’était cela ?
Presque aussitôt il reconnut un singe. Oui, un singe… un orang-outang de haute taille, et, pour tout dire, notre vieille connaissance Hope en personne.
Comment se trouvait-il là ?
De la façon la plus simple.
Après leur rencontre avec les Abyssins, Robert Lavarède et ses compagnons étaient retournés en toute hâte au camp des insurgés. Les régiments chargés de construire la canalisation d’eau avaient travaillé en leur absence, et les troupes noires purent avancer rapidement vers le nord.
Nulle part elles ne rencontrèrent de résistance.
C’est ainsi que les détachements d’avant-garde étaient arrivés, la nuit, précédente, en vue de Philoe et s’étaient dissimulés dans une dépression du terrain.
Hope, toujours fantaisiste, était parti à l’aventure.
De loin il avait aperçu Danye et Mable. Il s’était tapi dans la roselière, attendant le moment de se montrer.
Car, dans son cerveau simiesque une idée avait germé. Très intelligent, on l’a remarqué à plusieurs reprises, l’orang semblait avoir une aptitude particulière pour les choses de la guerre.
La remarque d’ailleurs s’applique à tous ses congénères ; les naturalistes l’ont maintes fois constaté, et le major Freeboom, de l’armée coloniale hollandaise, n’a pas craint de préconiser le dressage « d’orangs de guerre » qui, d’après lui, rendraient des services bien plus considérables que les « chiens de guerre ».
Quoi qu’il en soit, Hope patrouillait pour son compte.
Le hasard avait voulu que Mable s’abritât précisément à quelques pas de l’endroit où il s’était caché.
Or, tandis qu’elle dépouillait ses vêtements souillés de boue, le singe avait dextrement pris sa carabine de chasse, et, certain désormais de n’avoir plus rien à redouter, il avait bondi auprès d’elle.
De là le cri d’épouvante de la jeune Anglaise.
Elle n’eut pas d’ailleurs le loisir de se reconnaître. Brusquement poussée par Hope, elle se trouva hors de la ceinture de roseaux, face à face avec Danye.
Face à face avec un lieutenant, alors qu’elle était seulement vêtue de son cache-corset et d’un petit jupon blanc.
Jamais miss de bonne famille ne s’était présentée ainsi devant un gentleman.
Aussi, oubliant tout le reste, pour songer seulement à ce que sa tenue avait d’incorrect, elle ordonna, avec ce délicieux accent britannique que tous connaissent :
– Ritornez-vo, Sir Danye. Ritornez-vo… Il était tute à fait improper de me rigàrder dans ce costioume.
Et, comme l’officier médusé ne bougeait pas :
– Ritornez-vo, je dis ainsi. Si vous ritornez pas, je refiouse de marier vo.
La dot de la jolie enfant passa devant les yeux du lieutenant. Il eut comme un éblouissement et… il obéit.
La large bouche de Hope s’ouvrit toute grande ; ses yeux pétillèrent de malice. Vraiment on eût cru que l’orang riait.
Mais tout en se délectant de la scène, il ne perdait pas de vue sa sûreté. À peine l’officier eut-il cessé de le regarder qu’il sauta auprès de lui, lui enleva son fusil avec une force irrésistible, et, brandissant les armes de ses ennemis, il exécuta une danse de sa composition du plus réjouissant effet.
Danye crut le moment opportun.
Courant vers Mable, totalement démontée par cette étrange péripétie d’une partie de chasse, il lui prit la main et l’entraîna rapidement vers l’île de Philoe, dont la masse, couronnée de ruines et de retranchements, se dressait à deux kilomètres à peine.
Hélas ! cette inspiration n’était pas heureuse.
Hope suivit les fugitifs en gambadant.
Il poussait des grognements sourds, grinçait des dents, portant à son paroxysme la terreur des jeunes Anglais.
Et Mable essoufflée, sentant ses jambes plier sous elle, obéissant à ce besoin instinctif de tant de gens d’accuser toujours quelqu’un de leur malheur, maugréait d’une voix sifflante :
– Vo avez engadgé vo-même à être un héros, Danye.
– Oui, j’ai fait ainsi.
– Eh bien, je propose à votre amitié un exchange.
– Dites votre désir.
– Ma main deviendra votre possession, si vo renoncez à capturer les canons, drapeaux et prisonniers dont je parlais tantôt.
– Oh ! je renonce, déclara très sincèrement l’officier.
– Cela est droit, mais en exchange…
– En exchange ?
– Il faut prendre ce singe qui nous oblige à courir ainsi, et le ramener enchaîné au fort.

À cette proposition saugrenue, Danye s’arrêta net.
Mais il repartit aussitôt avec un cri de douleur. Hope, que la course amusait sans doute, venait de stimuler son ardeur par un vigoureux coup de crosse dans les jambes.
Et, haletant, surmené, l’officier bégaya :
– Comment voulez-vo que je devienne maître de cette bête enragée ?
– Je ne sais pas, répliqua la blanche miss d’un ton piqué, ce n’est pas le lot d’une jeune fille bien élevée de captiourer les orangs-outangs.
– Les officiers de Sa Majesté n’ont pas non plus cette coutume.
– En ce cas, vo n’êtes pas le héros que je souhaite rencontrer.
Danye eut un gémissement.
– Je ne marierai pas vo-même. Vo refuser la chose première que je demande à votre tendresse, une chose bien plus petite que celles que vo aviez promises. Je raye votre nom de mon carnet de flirt. Vo n’êtes plus Sweet-heart. Je vo dégrade de mon estime matrimoniale.
Et sur cet arrêt, accueilli par le lieutenant avec un véritable désespoir, Mable se tut, refusant désormais d’ouvrir la bouche.
Peut-être cette réserve provenait-elle tout simplement de son éducation sportive. Ses professeurs de gymnastique avaient dû lui redire souvent :
– Pour courir longuement, il faut fermer la bouche et respirer uniquement par le nez ; sinon on est bientôt arrêté par un point de côté.
Toujours est-il que les deux victimes de Hope continuèrent à trotter silencieusement côte à côte.
On approchait de Philoe.
Sur les remparts, une agitation de fourmilière se remarquait.
Les soldats du colonel Ashton avaient aperçu les fugitifs, poursuivis par le grand singe.
Le colonel averti était accouru.
Tout d’abord il avait donné l’ordre d’ouvrir le feu sur l’animal, mais immédiatement il avait rapporté ce commandement.
Il était impossible d’atteindre l’orang, sans risquer de frapper Mable et son compagnon.
Et puis ce diable de singe paraissait admirablement comprendre le danger ; il se couvrait littéralement de ses prisonniers.
Bien plus, à trente mètres des retranchements, il les arrêta net et, appuyant sur leurs épaules les fusils qu’il n’avait pas lâchés, il fit feu.
Criblés de grains de plomb, les soldats anglais, bouleversés par l’audace de l’étrange animal, furent pris de panique.
Un sauve qui peut général se produisit.
Hope eut un grondement de joie. Il abandonna ses prisonniers, s’élança vers l’île, escalada l’escarpement, les talus du retranchement.
Le colonel Ashton, qui cherchait à rallier ses hommes, se trouva devant lui. D’un coup de crosse, le singe l’étendit sur le sol et se rua sur les Anglais.
Ceux-ci ne l’attendirent pas.
Ce fut une course effrénée à travers l’île, dont la garnison fut bientôt précipitée dans l’ancien lit du fleuve, où chacun galopa à perdre haleine sans s’inquiéter des autres.
Les soldats jetaient leurs armes pour fuir plus vite.
Et quand les premières colonnes insurgées arrivèrent, elles trouvèrent Hope se promenant majestueusement dans l’île sacrée qu’il avait emportée à lui seul.
Danye et Mable étaient assis mélancoliquement sur un mur en ruines ; car le singe ne leur avait pas permis de rejoindre leurs compatriotes.
Voilà comment miss Mable fut faite prisonnière en cache-corset et petit jupon blanc ; comment les salons londonniens la déclarèrent « déchue de sa considération », parce qu’il est inconvenant d’être emmenée en captivité dans une tenue aussi peu correcte, et comment enfin, dans la crainte de rester fille, elle épousa Danye, bien qu’il ne fût pas un héros.

Le ménage du reste fut exécrable, ce qui n’est pas pour surprendre, car il était écrit que la vallée du Nil serait fatale à tout ce qui portait un nom anglais.

CHAPITRE X
COMBATS D’ERMENT ET D’EL MELAHIEH
– Dites, Nilia, dites ce que nous devons savoir et pardonnez-moi de vous imposer cette fatigue.
Ainsi parla Jack d’une voix suppliante. Il était debout devant Nilia dont il tenait les mains. La jeune fille se trouvait assise dans un fauteuil pliant, et ses paupières closes disaient qu’elle dormait de cet étrange sommeil que peuplait, non le rêve, mais la vision des choses réelles de l’avenir.
L’aventure arrivée près d’Abousin avait été une révélation pour Lavarède et ses amis.
Ils avaient compris le mystérieux pouvoir dont jouissait jadis le docteur Gorgius Kaufmann.
Les éclaireurs Nilia étaient un mythe. Il suffisait à l’Allemand de plonger son esclave dans le sommeil magnétique pour savoir ce qu’il lui importait de connaître.
Et Jack avait hérité de ce pouvoir.
Or, d’après les renseignements recueillis, Robert avait appris que l’armée anglaise s’était fortifiée sur les hauteurs de la chaîne Lybique, qui enserrent de leurs murailles de granit la vallée merveilleuse, où s’élevait jadis la ville superbe, Thèbes aux cent portes.
Là en effet elle avait retrouvé de l’eau.
De Thèbes à la mer, la pente du Nil est insensible ; bien plus, le fond se creuse en une sorte de cuvette, et les bras du Delta ensablés avaient suspendu le débit du fleuve.
Un grand lac était né de cette disposition du terrain.
Lord Biggun avait profité aussitôt de cet heureux incident et avait résolu d’attendre les insurgés à Thèbes même.
Sur les hauteurs de la chaîne Lybique, où les tombes des peuples disparus creusent leurs alvéoles sombres, donnant aux rochers l’apparence d’un rayon de miel, le Sirdar s’était formidablement retranché.
Des divisions avaient fortifié les villages de Karnak, de Louqsor. D’autres enfin, plus au sud, occupaient les villages d’Erment et d’El-Melahieh.
Celles-ci étaient chargées d’arrêter l’ennemi le plus longtemps possible, afin de permettre au généralissime de terminer l’ensemble de ses retranchements.
Coupée de l’extrême Orient par la destruction du canal de Suez et le soulèvement des Abyssins, l’Angleterre avait éprouvé un long frisson d’angoisse, puis elle s’était ressaisie.
Un effort géant avait été fait.
Grâce à « la presse », ce système d’enrôlements volontaires, de nombreux bataillons avaient étés formés dans la mère patrie, et des vaisseaux amenaient incessamment à Alexandrie infanterie, cavalerie, artillerie.
Tous ces renforts remontaient par chemin de fer jusqu’à Thèbes, grossissant l’armée de Lewis Biggun.
La confiance était revenue aux soldats avec la possibilité de boire, et le Sirdar n’avait pas craint de dire, à l’issue d’un lunch d’officiers :
– Les champs de Thèbes seront le Waterloo des rebelles.
Ceux-ci sentaient bien que l’affaire allait être chaude. Aussi, désireux d’augmenter ses chances de victoire, Robert avait-il demandé à Jack d’essayer encore de son mystérieux pouvoir sur Nilia, ce pouvoir qui, sur les roches d’Abousin, avait sauvé le commandant en chef des patriotes.
Et Jack s’était approché de Nilia.
– Nilia, lui dit-il, il s’est produit, à Abousin, alors que les méharistes anglais nous enveloppaient, un fait dont on ne vous a point parlé depuis, de peur de vous inquiéter.
– Lequel ? demanda-t-elle.
– Celui-ci… J’étais désespéré, à la pensée que vous alliez mourir. L’aveu jusque-là enfermé dans mon cœur, s’est échappé malgré moi de mes lèvres.
Elle rougit.
– Je me souviens, fit-elle à voix basse.
– Oui, vous vous souvenez. Mon âme, toute à vous depuis le premier jour où j’ai entendu votre voix, mon âme a chanté le cantique de tendresse. Vous avez connu le rêve caressé tout bas.
Le jeune homme s’arrêta soudain et, changeant de ton :
– Mais ce n’est point là ce que je veux dire. Au milieu de notre conversation, vous vous êtes soudain endormie.
Un instant Nilia parut chercher dans sa mémoire, enfin elle murmura :
– Cela doit être, puisque vous l’affirmez.
– Vous ne vous rappelez pas ?
– Non.
Robert présent à l’entretien se pencha à l’oreille de Price le brun.
– Il en est toujours ainsi dans les expériences de magnétisme. Le sujet, c’est-à-dire la personne endormie, ne conserve aucun souvenir de ce qui se passe entre le moment où elle s’endort et celui de son réveil.
Le jeune homme inclina la tête, et, regardant doucement Nilia :
– Je veux vous apprendre ce que vous ignorez. Vous dormiez d’un étrange sommeil. Vous m’ordonnâtes de vous interroger, et, les yeux clos, vous m’apprîtes l’existence de la caverne et du couloir souterrain, qui nous ont permis d’échapper aux régiments britanniques.
– Cela ne se peut, j’ignorais…
– En dormant, Nilia, vous savez ce que vous ignorez durant la veille.
Et, comme elle le considérait avec une expression d’étonnement indicible :
– Je veux que vous connaissiez la vérité, reprit-il. Gorgius Kaufmann est un savant. Il vous acheta jadis, sans doute parce qu’il avait reconnu en vous l’aptitude à obéir à la suggestion magnétique. À sa volonté vous tombiez dans le sommeil. Il vous questionnait alors, apprenait ainsi ce qu’il désirait savoir et renseignait le généralissime Lewis Biggun. C’est ainsi que, sans vous en douter, vous avez amené la capture de nos amis Robert et Armand Lavarède à Philoe.
Nilia avait pâli. Elle se tordit les mains en un geste d’éloquent désespoir.
– Ai-je fait cela ?
– Attendez avant de vous désoler, douce et bonne enfant ; plus tard… vous aviez certainement deviné en rêve le tendre dévouement qui me portait vers vous ; vous avez menti au médecin allemand. Vous m’avez fourni les moyens de délivrer les captifs, vous avez rendu leurs chefs à la révolte.
Le visage de la jeune fille s’éclaira.
– Et puis… ? dit-elle.
– Et puis, moi, j’ai hérité du pouvoir de votre ancien tyran. À Abousin, sous mon regard, vous avez dormi et vous nous avez indiqué le chemin du salut.
Elle lui prit vivement les mains.
– S’il en est ainsi, je suis heureuse, bien heureuse.
Jack la considéra d’un air attendri.
– Et maintenant, Nilia, ma fiancée, j’ai à vous adresser une prière.
– Oh ! gazouilla-t-elle doucement, dites un ordre. Vous êtes le maître que j’ai librement choisi.
– Chère Nilia… je répète, une prière.
Son accent grave impressionna la jeune fille. Elle balbutia :
– Qu’y a-t-il donc ?
– L’heure de la dernière lutte va sonner. Il faut la victoire à l’Indépendance.
– Je la souhaite de tout mon cœur.
– Il faut plus encore, il faut nous aider à l’obtenir.
– Vous aider ?
– Oui, en permettant que je provoque chez vous le sommeil magnétique, afin que votre esprit erre au milieu des troupes britanniques et nous apprenne ce qu’elles préparent.
Nilia n’eut pas une hésitation. Avec l’adorable confiance de celles qui croient :
– Je suis prête, dit-elle.
Une larme perla le long des cils de Jack.
– Attendez.
– Pourquoi ?
– Parce que j’ai encore quelque chose à vous dire.
Et lentement, comme pour donner plus de poids à ses paroles :
– Je dois vous prévenir, Nilia, qu’en consentant à vous prêter à cette expérience, vous aliénez votre liberté, car à l’avenir il vous deviendra impossible de résister à ma volonté.
Elle eut un divin sourire.
– Tant mieux. C’est là mon plus cher désir.
Il se taisait, ému par ce don complet d’une âme.
– N’avez-vous donc pas compris que j’ai rêvé, moi, fille d’Orient, de me fondre dans celui qui sera mon maître, d’avoir un cœur qui ne soit que le prolongement du sien. Et c’est cela que vous me proposez… Merci, ami… ordonnez-moi de dormir.
Elle s’assit, et fixa ses grands yeux sur ceux de Jack.
Deux minutes s’étaient à peine écoulées que ses paupières battirent. Puis elles devinrent immobiles, et de cette voix monotone qu’elle avait durant le sommeil, Nilia prononça :
– Je dors.
Price le brun se tourna vers Robert.
– Interrogez, général.
Le Français inclina la tête.
– Positions de l’armée anglaise. Où est le gros des troupes ? Où aura lieu le combat décisif ?
Un instant, la dormeuse garda le silence, puis ses lèvres s’agitèrent :
– Divisions à El-Melahieh, à Erment.
– Pourquoi défendre ces points sans importance ?
– Pour gagner du temps.
– Bien, après ?
– Deux divisions à Karnak et à Louqsor. Le gros de l’armée est massé sur les hauteurs de la rive gauche, en avant de la vallée des Rois.
– En avant de la vallée de Biban-el-Molouk ?
– Oui.
Et, joignant les mains, Nilia continua avec une sorte de terreur :
– Que de retranchements ! Toutes les crêtes sont hérissées de canons. Cela est imprenable.
Les deux hommes tressaillirent à cette affirmation. Mais Nilia parut se rassurer.
– Si, si, les anciens Égyptiens ont préparé la voie à leurs descendants. Il y a une route souterraine, la route des tombes qui permettrait de prendre l’ennemi à revers… comment l’atteindre… ?
Elle réfléchit un instant.
– Où commence cette route ? demanda impatiemment Robert.
– À un kilomètre à peine des rochers occupés par les Anglais… Elle est ignorée encore, parce que Phasipharmès, le pharaon aux pensées étranges, a voulu qu’elle demeurât inviolée. Sur l’entrée – une large dalle – on a construit le pylône du temple d’Asasif. Pour pénétrer dans les galeries du sépulcre, il faut abattre ce pylône.
– Cette sépulture royale a donc deux issues ? fit encore le Français. Cela est contraire aux coutumes égyptiennes.

Nilia secoua la tête.
– Non, une seule. C’est vous qui devrez creuser l’autre.
Et vite :
– Cela sera aisé. Les Troglodytes, ces ouvriers des ténèbres qui, il y a 1.000 ans, fouillaient dans le granit les demeures souterraines des rois, ont attaqué le rocher sur le plateau même qu’occupent aujourd’hui les Anglais. Un autre souverain dort auprès de Phasipharmès, et les salles dorées qui précèdent celles des sarcophages ne sont séparées que par un mur d’une épaisseur d’un mètre.
Puis, s’arrêtant une minute, elle reprit :
– Le sort de la bataille est dans la possession du pylône du temple d’Asasif. Bien des hommes périront autour de cette masse de pierre. Il y a une fumée aveuglante, des ombres qui s’agitent au milieu des flammes… Qui sont les vainqueurs ? je ne vois pas, je ne vois pas.
Le visage de la jeune fille exprimait la souffrance.
– Assez ! assez ! murmura Jack, bouleversé par ce spectacle.
– Oui, assez, consentit le général insurgé. Réveillez-la… Je sais où est la clef de la bataille, j’irai la prendre.
Et il sortit, laissant Price le brun réveiller doucement sa fiancée. Celle-ci, à peine les yeux ouverts, demanda :
– Que me disiez-vous donc tout à l’heure ? que vous désiriez produire en moi un sommeil factice et m’interroger ?
– Sans doute.
– Faites-le donc.
Comme toujours, elle ne se souvenait de rien.
– C’est fait, déclara Jack.
– Quoi ? est-ce vrai ?
– Oui.
– Et j’ai parlé.
– Ainsi qu’un ange que vous êtes, Nilia.
– Et mes paroles étaient intéressantes.
– Intéressantes à ce point qu’elles décideront peut-être du salut de l’Égypte.
Elle frappa joyeusement ses mains l’une contre l’autre.
– Alors je suis contente.
Puis, se rapprochant de son interlocuteur :
– Ne déclariez-vous pas tout à l’heure qu’en recevant le sommeil de vous, je renonçais à mon libre arbitre.
– Si, mais j’ajoute maintenant que jamais je ne renouvellerai l’expérience sans votre permission expresse, je vous le jure.
Elle l’interrompit.
– Non, non, ne jurez pas cela. Je veux être ainsi, ne pouvoir avoir d’autre volonté que la vôtre, aimer ce que vous aimez, haïr ce qui vous déplaît.
– Mais c’est la captivité morale…
Nilia eut un délicieux sourire :
– Être captive de son affection, c’est la liberté d’aimer.
* *
*
Le soir même, l’armée insurgée s’ébranlait.
Un million d’hommes marchait vers le nord, et le désert tremblait sous les pas de cette masse de guerriers.
Tout le jour des cavaliers avaient galopé à travers plaines et collines, portant des ordres aux chefs des différents corps d’armée.
Sur les fils du télégraphe, établi par les soins de Robert, en arrière des troupes, des dépêches avaient volé, annonçant aux peuples africains la prise de Philoe, nouvelle victoire à ajouter aux précédentes.
Et maintenant commençaient les dernières étapes, celles qui allaient jeter les patriotes d’Afrique sur les oppresseurs britanniques.
Robert, Armand se multipliaient, et Lotia, grave et sereine, chevauchait entre Aurett et Nilia, auxquelles elle disait les joies du triomphe prochain.
Elle était fière de la tendresse de Robert, de ce Français obscur qui, pour la mériter, avait soulevé vingt nations, et qui, maintenant, marchait à la tête de ses hordes disciplinées, comme un de ces conquérants barbares dont l’histoire a conservé les noms : Tamerlan, Gengis-Khan.
Aurett l’écoutait pensive. La jolie Anglaise était un peu effrayée de l’énergie sauvage de la fille des Hador. Quant à Nilia, elle souriait. Élevée par des bohémiens d’Asie Mineure, accoutumée à errer sans contrainte dans les vastes plaines de la Mésopotamie, elle comprenait Lotia bien mieux que mistress Aurett.
Ce qui ne l’empêchait pas du reste d’aimer tendrement cette dernière, de l’interroger sans cesse, afin d’apprendre ce qu’elle ignorait encore et de devenir digne « d’épouser Jack ».
* *
*
Dans les villages d’Erment et d’El-Melahieh, les Anglais se préparaient à la résistance.
Le général Holson en personne avait pris le commandement des troupes sacrifiées… Sacrifiées ! le mot est juste.
Car, le chef le sait bien, ses hommes et lui doivent se faire tuer pour donner au Sirdar le temps d’achever les formidables retranchements, sur lesquels il espère que se brisera l’effort des insurgés.
Holson a divisé ses troupes en deux parts, dont l’une occupe le village d’El-Melahieh.
Lui-même, avec le reste, se fortifie dans le bourg d’Erment.
Ainsi, il commande le passage, et les armées africaines devront s’emparer de ces postes avancés, avant de se répandre dans la plaine de Thèbes.
Le général a sous ses ordres trois régiments d’infanterie et cinquante-quatre pièces d’artillerie.
Erment s’élève au sommet d’un monticule qui domine la vallée de soixante à quatre-vingts mètres.
Ses maisons blanches occupent tout le plateau. Pour un ennemi dépourvu de canons, c’est une véritable forteresse.
Sur les pentes s’étaient des jardins enclos de murs ou de haies vives. Holson y a jeté deux compagnies en tirailleurs.
Chaque homme porte sur lui trois cents cartouches, et les parcs de munitions peuvent en fournir autant.
Tout a été prévu. Dans les haies on a pratiqué des brèches, qui assurent aux tirailleurs des cheminements faciles.
Des créneaux ont été percés dans les murailles des maisons.
À droite et à gauche du village, les batteries, abritées par des épaulements de terre, ont pris position, prêtes à couvrir de projectiles les plaines environnantes.
L’ennemi peut venir, il sera bien reçu.
Les Anglais sont graves, résolus à faire leur devoir.
Ils n’ont plus les attitudes fanfaronnes d’antan. Les désastres successifs qui les ont atteints, leur ont fait comprendre la valeur de ces noirs et de ces fellahs qu’ils méprisaient naguère.
Mais ils ont confiance en l’étoile de leur patrie.
– Hurrah pour la vieille Angleterre ! et mourons pour elle ! pensent-ils.
Ce matin là, le général Holson déjeunait, lorsque des cavaliers, envoyés en reconnaissance, vinrent lui annoncer que les insurgés approchaient.
Le détachement avait eu une escarmouche avec les noirs, et plusieurs hommes étaient tombés pour ne plus se relever.
Interrompant son repas, Holson sortit aussitôt, traversa la place dont le quartier général occupait l’une des faces et pénétra dans la mosquée d’Ali, située de l’autre côté.
Il s’engagea dans l’escalier tournant du minaret et se trouva bientôt sur la plate-forme, d’où les muezzins, aux époques de tranquillité, criaient les heures du jour.
Il s’accouda sur la balustrade de pierre ouvragée et regarda au loin.
Ses éclaireurs ne l’avaient pas trompé.
Les rebelles avançaient en masses profondes.
Une première colonne suivait l’ancienne rive droite du Nil, montant sur El-Melahieh.
Une seconde, précédée par un rideau de cavalerie, semblait avoir Erment pour objectif.
Puis, dans le lit même du Nil, une foule immense grouillait.
Le général eut un geste de découragement rageur.
– C’est une inondation, murmura-t-il, comment arrêter cette marée montante !

Puis, se ressaisissant soudain :
– Nous pouvons toujours en tuer beaucoup avant de succomber. Tuons donc.
Et, comme pour ponctuer cette phrase, une explosion ébranla l’atmosphère.
L’un des canons anglais venait de cracher son obus sur les soldats de Robert.
Le projectile éclata au milieu des chevaux, renversant plusieurs cavaliers, mais les autres ne ralentirent pas leur allure.
Seulement les colonnes d’infanterie s’arrêtèrent et, se disloquant soudain, avec une rapidité, une précision qui stupéfièrent Holson, elles s’éparpillèrent en ordre dispersé.
– Mais ces coquins manœuvrent comme des Européens, grommela le général. Est-il possible qu’en quelques mois, ces damnés Français, ces Lavarèdes maudits les aient dressés à ce point ?
Il se tut pour regarder encore.
Les formations de combat qui s’étalaient sous ses yeux, ainsi que des indications de cartes stratégiques, lui apparaissaient incompréhensibles. Dans les armées d’Europe, en effet, l’ordre dispensé comprend :
1° une chaîne de tirailleurs plus ou moins dense ;
2° des soutiens ;
3° des réserves ;
Ceux des derniers échelons en ordre serré.
Ici, rien de semblable.
Les rebelles s’étaient formés en une série de chaînes de tirailleurs, échelonnées à cinquante mètres d’intervalle.
Ainsi disposés, ils échappaient aux terribles feux de salve, qui, avec les armes à tir rapide, fauchent une troupe ainsi qu’un champ d’épis mûrs.
Et du même coup, ils privaient les Anglais de l’un des principaux avantages de leur armement supérieur.
– Par l’orteil de Satan, gronda Holson, ces gens sont véritablement inspirés par le diable.
Une seconde inquiétude le prenait. Est-ce que ses soldats et lui même allaient succomber sans pouvoir rendre au Sirdar le suprême service qu’il attendait d’eux : arrêter l’adversaire durant de longues journées.
Mourir ne l’effrayait pas, mais mourir trop tôt lui semblait la chose la plus pénible du monde.
Et il regardait toujours, ne pouvant rien de plus que ce qu’il avait préparé pour entraver la marche de l’armée des patriotes nilotiques.
Cependant les cavaliers s’étaient égaillés dans la plaine. Ils galopaient en poussant des cris de défi, que le vent apportait affaiblis aux oreilles des soldats anglais.
Quelques-uns poussaient des pointes vers la colline d’Erment, s’enfuyant à toute vitesse lorsque l’un des tirailleurs saxons leur envoyait une balle.
Parfois le cavalier tombait.
Un autre le remplaçait aussitôt.
Évidemment ils avaient ordre de reconnaître la position, et ils s’y conformaient avec une audace extraordinaire.
– Le courage fanatique des Derviches, murmura Holson, mais endigué par une stricte discipline. Décidément nous nous trompions en croyant avoir à faire à un troupeau de barbares. Il faut que lord Biggun en soit avisé. Une surprise de ce genre aurait des conséquences terribles.
Sur ce le général arracha une feuille de son carnet et traça d’une main nerveuse les lignes suivantes :
« Troupes rebelles admirablement disciplinées. Tenez compte de ce fait. Nous allons mourir après avoir résisté le plus longtemps possible… Ce sera peu auprès de ce que nous espérions… Hâtez-vous, hâtez-vous. D’un instant à l’autre, vous aurez l’ennemi sur les bras. Puissiez-vous ne pas éprouver la surprise douloureuse qui me fait vous envoyer ce message. »
Il redescendit de la tourelle, rentra chez lui, renferma le billet dans une enveloppe qu’il cacheta avec soin, puis, appelant son officier d’ordonnance :
– À Thèbes, lui dit-il, sans perdre une minute. Crevez votre cheval, mais ne vous arrêtez pas.
Et comme son interlocuteur le regardait, effaré par son accent, par sa voix rauque :
– Allez donc, ajouta-t-il, chaque seconde perdue est une défaite pour l’armée anglaise.
L’officier n’en demanda pas davantage.
Il bondit vers son cheval, entravé à quelques pas, sauta en selle et partit au galop.
De sa fenêtre, Holson le suivit des yeux. Il le vit dévaler comme une trombe la pente de la colline d’Erment, puis filer dans la plaine, ainsi qu’un oiseau noir rasant le sol.
Il était temps.
Les éclaireurs insurgés commençaient à s’étendre sur les flancs de la position anglaise. Ils allaient la cerner, la séparer pour toujours de l’armée britannique.
Aucun de ceux qui gardaient Erment ne franchirait la ligne d’investissement, et de ces régiments pleins de courage, il ne resterait, dans un avenir prochain, que des morts.
Le mouvement des cavaliers de Robert condamnait tous ceux qui occupaient Erment.
Et là-bas, à l’est, autour d’El-Melahieh, la même manœuvre s’opérait, avec-la même précision.
Holson avait toujours cru à la victoire définitive de l’Angleterre ; à cette heure, sa confiance l’abandonna.
Mais le général n’était pas de ceux qui se courbent sous le découragement.
Quelque désespérée que fut la partie, il ferait tout son devoir.
Et soudain il eut une nouvelle et désagréable surprise.
La cavalerie ennemie avait formé un immense fer à cheval qui entourait les villages d’EI-Melahieh et d’Erment à l’ouest, au nord et à l’est.
Au sud, maintenant, les tirailleurs insurgés s’avançaient, fermant le cercle d’investissement.
Mais ils ne marchaient pas en rangs, ils ne se déplaçaient pas debout suivant la règle usitée dans les armées européennes.
Comme cela, même en ordre dispersé, les canons Maxim, les mitrailleuses, les fusils à tir rapide eussent fait de nombreuses victimes.
Non. Robert avait compris que, n’ayant pas de canons, il lui fallait compenser cette infériorité par une tactique telle que les batteries anglaises fussent rendues inutiles.
Il avait cherché et trouvé un mode d’attaque conforme au programme et aux habitudes des noirs.
Les chaînes de tirailleurs s’avançaient en rampant.
Étendus sur le sol, s’aidant des coudes et des genoux, les insurgés approchaient lentement mais sûrement.
En vain les Anglais éparpillés dans les jardins faisaient un feu d’enfer ; le résultat de cette fusillade était nul.
On sait combien il est difficile d’atteindre des hommes couchés sur le sol.
Et la chaîne avançait toujours.
Bientôt les noirs répondirent aux feux des soldats du général Holson.
Sur toute la surface de la plaine la fusillade crépita.
Tout à coup un juron échappa à Holson.
– Ils nous attaquent de partout à la fois !
C’était vrai !
Insensiblement la première ligne de tirailleurs s’était étendue à droite et à gauche, elle se repliait peu à peu autour de la colline d’Erment.
Il était impossible d’arrêter cette armée insaisissable.
Et les noirs, avec des cris de joie, se rapprochent de plus en plus.
Les voici au pied de la colline. Ils sautent de mur en mur, de haie en haie ; ils chassent devant eux les tirailleurs anglais.
Tout autour de l’éminence, les détonations se succèdent sans interruption. Des centaines de combats singuliers s’engagent.
Les soldats anglais sont dignes de leur vieille réputation. Ils défendent le terrain pied à pied.
Héroïsme inutile ; les insurgés montent, montent toujours.
Brusquement, une immense clameur fait frissonner les régiments britanniques barricadés dans le village.
Une nuée de corps noirs se dressent dans les verdures.
L’ordre d’assaut vient d’être donné. Tous courent maintenant.
– Feu partout ! commandent les officiers du général Holson.
Leurs hommes n’ont pas attendu cet ordre. Ils ont compris que si leurs coups ne brisent pas l’élan des insurgés, ils sont perdus.
Ils tirent, tirent sans interruption, sans prendre le temps de viser.
Mais les assaillants montent toujours.
En arrière, ils laissent des quantités énormes de morts et de blessés. Qu’importe, les vides sont comblés aussitôt. Des renforts incessants accourent, entraînant ceux qui seraient tentés d’hésiter.
Les noirs sont contre les murs des premières maisons.
Ils ne cherchent pas, selon l’usage, à détruire les barricades, les portes, à pénétrer dans le village par les points faibles.
À quoi bon !
Des artificiers égyptiens ont pénétré à leur suite dans les jardins, et maintenant ils se glissent en avant des tireurs, appliquent sur les murs crénelés ces terribles torpilles portatives qui ont pulvérisé naguère les forts de Khartoum.
Puis ils se rejettent en arrière, s’aplatissent sur le sol.
Une explosion épouvantable se produit. De la terre s’élancent des jets de flammes. Les maisons chancellent, s’abattent sur les Anglais qui les occupent.
La brèche est faite.
En dix endroits autour du village, il a été procédé de même, et de tous côtés les insurgés, comme un torrent furieux, pénètrent dans Erment.
C’en est fait !
En trois heures, les troupes de Robert ont enlevé les postes avancés qui auraient dû les retenir huit jours.
Ce n’est plus un combat, c’est un massacre.
On s’égorge partout, dans les maisons, dans les rues.
Les noirs ne font pas de quartier, les Anglais n’en demandent point.
Du sang, partout du sang, partout des rugissements de menace, des râles d’agonie, des cliquetis d’acier.
Holson, à la tête d’une compagnie, a réussi à se frayer un passage à travers les rangs des vainqueurs.
Il s’est enfermé avec deux cents hommes dans la mosquée.
Et de là, il couvre le village de projectiles, tenant sa promesse jusqu’au bout : tuer le plus possible d’ennemis avant de mourir.
Alors sur la place apparaît un parlementaire que précède un homme agitant un fanion blanc.
Holson ordonne de suspendre le feu. L’un des officiers présents se porte au devant du parlementaire, lui bande les yeux et l’introduit devant le général.
Celui-ci examine l’envoyé des vainqueurs et, d’un ton sec :
– Vous n’êtes pas Africain, Monsieur ?
L’autre sourit et, avec la plus extrême politesse :
– Non, Monsieur, je suis Français ; mon nom est Armand Lavarède, et je suis le cousin du généralissime dont les troupes ont aujourd’hui rencontré les vôtres.
 – Français,
gronde Holson, je ne vous félicite pas.
– Français,
gronde Holson, je ne vous félicite pas.
– Oh ! répond Armand avec insouciance, je ne suis pas venu pour chercher des éloges, mais pour en apporter.
– En apporter… ?
– À vous-même, général, et aux braves gens qui vous entourent. Vous avez fait magnifiquement votre devoir.
– Soyez assuré que nous continuerons, commence l’Anglais d’un ton rogue.
Mais le Parisien l’interrompt.
– Pardon, pardon, vous errez.
– Que voulez-vous dire ?
– Ceci. Vous étiez chargé d’arrêter notre armée, afin de donner au Sirdar Lewis Biggun le temps de prendre ses dispositions de combat. Votre devoir était de défendre votre poste jusqu’à la dernière extrémité.
– Eh bien ?
– Eh bien, mais c’est fait. Regardez au loin. El Melahieh brûle, Erment ne contient plus d’Anglais vivants en dehors de votre petite troupe. Vous admettrez bien, je pense, que nos troupes passeront sans difficulté pour continuer leur route vers le nord ?
Et, comme Holson inclinait légèrement la tête en signe d’adhésion, le journaliste poursuivit :
– Supposons que vous résistiez dans cette mosquée. Vous êtes deux cents. Nous laissons pour vous réduire un millier d’hommes, ce qui ne nous gêne pas le moins du monde, et nous marchons sur Thèbes. Votre résistance ne peut donc servir à rien.
– Permettez…
– Je veux dire qu’elle n’aura d’autre résultat que de faire tuer, sans aucune nécessité deux cents soldats dont l’Angleterre peut être fière. Une pareille opération est-elle bien dans les attributions d’un officier tel que vous ?
Holson rougit légèrement. Armand avait touché juste ; c’est le remords d’un officier d’avoir conduit au trépas, sans nécessité, les soldats placés sous ses ordres.
Doucement, Lavarède reprit :
– Alors, je me suis tenu ce langage…
Il fit une pause et poursuivit :
– Voilà des braves gens. Leur général les aime sûrement. Si on lui proposait de les emmener où il le voudra avec armes et bagages, je pense que cela lui serait agréable.
À cette proposition généreuse, énoncée avec toute la simplicité possible, Holson, ses officiers, ses soldats furent secoués par un frisson joyeux. Et, comme le général allait répondre :
– Réfléchissez, fit encore le Français ; un refus précipité gâterait tout, sans nulle utilité, je me permets de le répéter.
Il y eut un silence. Puis, d’une voix sourde, le général anglais laissa tomber ces paroles :
– Vous avez raison, je n’ai pas le droit de priver l’Angleterre de ces braves.
Et, avec effort :
– J’accepte, Monsieur, et je vous remercie.
Armand salua.
– Si vous voulez me suivre, je vous accompagnerai moi-même jusqu’au-delà de nos lignes.
Dix minutes plus tard, la petite troupe sortait en bon ordre de la mosquée.
Selon sa promesse, le journaliste marchait en tête, auprès de Holson, et les noirs aux armes sanglantes, ruisselants de sueur, se rangeaient pour laisser passer les seuls survivants des divisions anglaises.
Le général regardait tout cela d’un air sombre.
– Oui, fit-il, à un instant où la foule des vainqueurs était plus épaisse, la discipline existe. Pas un cri, pas une menace ne s’élève contre nous. Une armée d’Europe n’aurait pas une attitude plus correcte.
Le Parisien avait entendu.
– Cette phrase louangeuse serait très sensible à mon cousin Robert, qui a réalisé la transformation que vous constatez.
Holson le considéra avec étonnement.
Il avait parlé haut sans en avoir conscience.
Et, entraîné par le regard loyal de son interlocuteur :
– Ah ! fit-il, pourquoi la France et l’Angleterre n’ont-elles pas marché de concert en Égypte ?
– Un mot suffirait à la réponse, dit Armand.
– Un mot, lequel ?
– Fashoda, général.
Holson tressaillit. Il courba le front et continua sa route en silence. La colonne atteignait à ce moment le campement des régiments de cavalerie. Elle le traversa sans encombre.
Elle parvint aux grand’gardes, aux vedettes.
Là, le Parisien s’arrêta.
– Le chemin est libre devant vous, général, je vais vous dire au revoir.
– Au revoir ?
– Sans doute. Il est probable que nous nous retrouverons dans la plaine de Thèbes.
Le général eut un triste sourire.
– Non, nous ne nous retrouverons pas.
Puis, appelant du geste un capitaine :
– Lorriley, lui dit-il, vous êtes le plus ancien de votre grade. Prenez le commandement de la troupe et ralliez l’armée. Vous apprendrez au Sirdar le désastre qui nous a frappés.
– Mais vous, général ?
– Moi, je reste ici… Allez, je veux qu’il en soit ainsi.
L’officier n’insista pas davantage.
D’une voix forte, il commanda :
– En avant, marche.
Et les survivants du combat d’Erment s’éloignèrent.
Holson les suivait des yeux. Debout auprès de lui, Armand n’osait lui demander la raison de son étrange conduite.
Il sentait que le général avait pris une résolution irrévocable.
Quand les Anglais eurent disparu derrière des dunes de sable, l’Anglais se retourna vers l’aimable Français.
– Monsieur, prononça-t-il lentement, je vous remercie encore pour votre générosité à l’égard de vaincus. Mais hélas ! il n’était pas en votre pouvoir d’effacer la honte que la défaite a jetée sur mon nom.
– La honte ? permettez…
– Je devais arrêter votre marche durant plusieurs jours. Je n’ai tenu que quelques heures. Le résultat de cet écart peut être désastreux pour mon pays. Je ne suis pas seulement battu, je suis déshonoré.
– Allons donc ! s’écria le journaliste.
Il n’eut pas le loisir d’en dire davantage.

D’un mouvement rapide, le général avait saisi son revolver d’ordonnance et en avait appuyé le canon sur son front.
– Je me fais justice, murmura-t-il en appuyant sur la gâchette.
Le son de sa voix s’éteignit dans une détonation sèche.
Un instant encore il demeura debout, puis il s’abattit tout d’une pièce. La balle lui avait traversé le crâne.
Ainsi périt le général Holson, qui était certainement l’un des meilleurs officiers de l’armée anglaise.

CHAPITRE XI
LA REVANCHE DE WATERLOO
– Au revoir, cousin Armand.
– Au revoir, cousin Robert.
– Et vive l’Égypte libre !
– L’Égypte, si tu veux ; mais moi, Armand Lavarède, en combattant les Anglais, je n’ai aux lèvres qu’un seul cri : Vive la France !
Les deux cousins échangeaient ces répliques un peu en arrière des collines qui bordent au sud le Birket-Habou, l’ancien lac sacré de Thèbes.
Car les armées ennemies étaient en présence, et la dernière partie du duel gigantesque entrepris par les Français contre la toute-puissante Albion allait se dérouler sur l’emplacement où Thèbes, l’Oph des Égyptiens, dressait, il y a 1.000 ans, ses temples grandioses et ses orgueilleux palais.
Par une étroite ravine creusée dans le flanc de la hauteur, Robert et Armand apercevaient le Nil qui, en cet endroit avait conservé une certaine quantité d’eau.
Sur la rive droite, les villages de Louqsor et de Karnak, enserrés entre la berge du fleuve et le canal de Karnak, se miraient dans l’onde stagnante.
Plus à l’est, au delà du canal, se profilaient les ruines de Thèbes, dites de Karnak.
Sur la rive gauche s’étendait la plaine verdoyante, parsemée de bois, de jardins, au milieu desquels, forêt de pierre perdue dans la forêt verte, se montraient les colosses de Memnon, les colonnades de Kars-el-Agouz, de Médinet Habou, l’Asasif, le Ramesséum, les temples de Touthmosis III, de Sethos Ier, les tombeaux des reines, Kourna.
Au delà de Karnak, comme au delà de Kourna, l’horizon était barré par de hautes falaises granitiques aux flancs percés de trous nombreux. C’était là qu’aux temps lointains, venaient s’entasser, enduites de bitume, les momies des classes pauvres, tandis que les riches, les fonctionnaires, les souverains, après avoir macéré dans des bains d’essences précieuses, étaient couchés dans de véritables palais souterrains forés à prix d’or dans la masse rocheuse.
Mais ce n’étaient pas les souvenirs du passé qui préoccupaient les deux français.
Leur inquiétude était toute moderne.
Sur les falaises, les Anglais s’étaient retranchés, occupant une position inabordable, et si, par malheur, les prédictions de Nilia ne se vérifiaient pas, la bataille décisive prête à s’engager serait perdue.
Robert cependant avait pris toutes les dispositions utiles.
Pour que les monstrueuses batteries des deux rives nilotiques ne se soutinssent pas, il avait résolu de livrer en même temps deux combats.
Son armée avait été divisée en deux tronçons ; l’un, restant sous ses ordres, opérerait sur la rive gauche ; l’autre avait franchi le fleuve et s’était déployé à l’est des ruines de Karnak, menaçant à la fois les villages de Louqsor et de Karnak fortifiés par les troupes britanniques.
Armand avait été nommé général de cette seconde armée.
Et les cousins se serraient la main avant de rejoindre leurs postes respectifs et de tenter la fortune des batailles.
– Vive la France ! avait dit Armand.
– Vive la France ! répéta une douce voix.
C’était Aurett, équipée en guerre, qui avait déclaré qu’elle ne quitterait pas son mari d’une semelle.
Lotia de même s’était engagée à suivre Robert partout.
Pour Jack et Nilia, présents à l’entretien, ils n’avaient rien dit. Un regard leur avait suffi pour comprendre qu’ils vaincraient ou mourraient ensemble.
– Au revoir !
– Au revoir !
Et Armand, éperonnant son cheval, s’éloigna au grand trot, précédant de quelques pas seulement sa vaillante compagne. Alors Robert regarda Lotia.
– Lotia, murmura-t-il, l’heure est venue.
Elle inclina gravement la tête.
– Ce soir, l’Égypte sera libre ou je serai mort. En tous cas, dites-vous que Robert Lavarède aura vécu, ou sera tombé parmi les soldats vaincus, pour vous, pour vous seule.
Elle l’écoutait, toute pâle.
– Je ne me dirai pas cela, interrompit-elle.
– Pourquoi ?
– Parce que, moi Lotia l’Égyptienne, je serai faite libre par vous, ou bien je vous accompagnerai dans le trépas. Ne vous souvenez-vous pas que je l’ai promis autrefois.
Le Français lui prit la main, la porta à ses lèvres et brusquement :
– Soit, donc ! Et maintenant efforçons-nous de vaincre.
À ce moment même un roulement formidable passa dans l’air, et les crêtes des falaises de la rive gauche se couvrirent d’un nuage de fumée.
L’artillerie anglaise envoyait sa première salve aux troupes africaines commandées par Armand Lavarède.
* *
*
Le journaliste en effet venait d’attaquer.
Six régiments de highlanders et d’infanterie légère avaient été installés dans les ruines de Karnak. Une attaque de ce côté devait donc se heurter à ce premier obstacle, puis au canal de Karnak et enfin au village du même nom, appuyé et soutenu par celui de Louqsor.
En somme, trois lignes de défenses successives défendant les abords du Nil.
De plus une batterie de cent canons avait pris position sur les falaises qui dominent la plaine de Karnak, donnant ainsi au front britannique la forme d’un V extrêmement ouvert. Comme les ailes étaient couvertes par la configuration du terrain même, la formation était extrêmement dangereuse pour l’assaillant.
Armand avait examiné la plaine.
Le sol descendait d’abord en pente douce, puis se relevait insensiblement vers les ruines, formant un petit ravin.
– Après tout, dit-il, la situation n’est pas mauvaise. Quant à ces coquines de pièces de campagne perchées là-haut, nous avons appris, à Erment et à El-Melahieh, comment on s’en moque.
Sur ce, il leva son sabre.
Un murmure confus s’éleva. Les régiments s’éparpillèrent, et bientôt les Africains furent formés sur plusieurs chaînes de tirailleurs se suivant à faible intervalle.
– En avant !
Les noirs dessinèrent leur mouvement et les batteries britanniques s’embrasèrent.
Tout alla bien d’abord.
Les chaînes progressaient, gagnant peu à peu dans la direction des ruines, d’où les régiments anglais faisaient un feu d’enfer.
Autour d’Armand les balles sifflaient.
– Aurett, supplia-t-il, éloignez-vous.
La jeune femme sourit doucement.
– Où vous irez, j’irai.
– Vous n’entendez donc pas ?
– Si, mais je pense ne pas être plus en danger que vous-même.
Une larme perla sous les paupières du journaliste. Il vint à la courageuse Aurett, la pressa sur son cœur, et, la repoussant :
– Soit donc ! la victoire ou la mort ensemble.
À une demi-heure d’intervalle, il répétait, sans le savoir, le même serment que son cousin et Lotia.
Les tirailleurs étaient arrivés au bas de la pente. Ils rampaient au fond du ravin.
Tout à coup Armand eut un cri de rage.
Le vallon se terminait par un coude brusque, et à ce moment même des hussards, masqués jusque-là par l’éperon de la hauteur, venaient d’apparaître, fonçant à toute vitesse sur les insurgés.
Les tirailleurs, surpris par cette brusque attaque de flanc, se relevèrent vivement, cherchant à remonter la pente pour se reformer.
Ils n’en eurent pas le temps.
En l’espace d’un éclair, la charge fut sur eux.
Il y eut un instant de confusion épouvantable. Hommes, chevaux, luttaient pêle-mêle, et les hussards frappaient sans relâche, abattant à chaque coup un patriote.
Mais ce succès fut de courte durée.
Armand rallia les troupes les plus proches, les forma en carrés et une grêle de balles s’abattit sur les cavaliers.
Leur tour était venu de souffrir.
Les deux tiers des cavaliers restèrent sur le sol. Les autres, poursuivis par une fusillade nourrie, parvinrent à rentrer dans la retraite d’où ils étaient sortis, laissant encore en arrière une chaîne de cadavres.
Au demeurant, les hussards avaient rempli leur mission ; la première ligne de tirailleurs était anéantie ; les autres avaient rétrogradé, et tout le terrain conquis jusque-là par les insurgés était perdu.
– Recommençons, murmura simplement Lavarède.
Et de nouveau les chaînes rampantes se mirent en marche.
Seulement les escouades des ailes surveillaient avec soin le terrain afin que l’on ne fût plus surpris comme tout à l’heure.
Cette fois le ravin fut franchi sans obstacle.
On se rapprochait des ruines, malgré la nappe de balles qui s’en échappait incessamment.
Maintenant l’artillerie anglaise ne tirait plus.
Elle avait peur d’atteindre les troupes engagées avec l’ennemi.
Les noirs atteignirent la limite des ruines.
Alors le corps à corps commença.
Les highlanders s’étaient barricadés dans les cours des temples, derrière les pylônes, les statues, les sphinx, les monolithes.
Chaque pierre exigeait un siège particulier.
Partout on combattait.
Mais la supériorité numérique des noirs était telle que bientôt les Anglais furent repoussés jusqu’à l’extrémité ouest des vestiges de Thèbes.
Deux compagnies se firent massacrer pour assurer la retraite des régiments décimés, et ceux-ci, franchissant le pont jeté sur le canal de Karnak, prirent position sur l’autre rive.
Il était 11 heures du matin. La bataille durait depuis 5 heures.
Il y eut alors un temps d’arrêt.
Seules les batteries des falaises tonnaient, couvrant de leurs projectiles le champ de ruines.
Les obus arrivaient en ronflant, écornaient les chapiteaux, émiettaient les colonnes, ajoutant leur destruction brutale à la patiente destruction du temps.
Et soudain une détonation, dont la violence couvrit un moment tous les autres bruits, ébranla l’atmosphère.
Un panache de flammes s’éleva au-dessus du canal.
Les highlanders venaient de faire sauter le pont, détruisant ainsi toute communication entre les deux rives.
Et comme pour répondre à ce défi, la fusillade se ralluma avec une extraordinaire intensité.
Tout le long des ruines, des éclairs brillèrent.
Et presque aussitôt, une ligne de tirailleurs rampants quitta l’abri des vénérables temples pour se glisser vers le canal.
Le feu de leurs camarades n’avait d’autre but que d’appuyer ce mouvement.
À son tour la berge du canal s’embrasa.
Les highlanders tiraient à toute vitesse, sans comprendre cependant où les insurgés voulaient en venir.
Le pont enlevé, on ne pouvait songer à traverser le canal de vive force.
C’était raisonner en Européens.
Les Africains avançaient lentement, mais, à mesure qu’ils se rapprochaient de l’obstacle, leur ligne s’étendait à droite et à gauche. Les extrémités étaient à hauteur des villages de Louqsor et de Karnak, quand elles s’arrêtèrent sur la berge Est de la profonde coupure emplie d’eau stagnante.
Alors le feu reprit avec une nouvelle intensité.
Tout à coup, un tirailleur sur deux se leva brusquement, tandis que son voisin continuait à charger, à tirer sans s’arrêter.
Deux mille corps noirs décrivirent une courbe dans le vide et tombèrent dans l’eau au milieu d’un immense éclaboussement.
Un cri de stupeur s’éleva des rangs anglais. Les soldats se dressèrent pour fusiller les nageurs, mais quelques-uns seulement eurent le loisir d’accomplir leur dessein.
Le plus grand nombre, fauchés par les projectiles des insurgés demeurés sur la rive, tombèrent à leur poste.
Alors, chez les survivants se produisit un même découragement. En dépit des exhortations de leurs officiers, ces hommes démoralisés ne résistèrent pas à l’attaque furieuse des insurgés et bientôt les soldats d’Armand furent maîtres du canal.
À ce moment, Lavarède et Aurett se trouvaient défilés des feux de l’artillerie derrière un énorme pan de mur, fait de cubes de granit de quatre mètres d’épaisseur.
– Ah ! fit la jeune femme anéantie, je suis heureuse, car tout à l’heure, j’avais bien peur.
– Peur ? répéta le journaliste en souriant.
– Oui, peur.
– Mais vous ne m’avez pas quitté d’une semelle, chère amie, et si l’un de nous a tremblé, je vous assure que c’est moi pour vous.
– Comme moi pour vous, fit-elle d’une voix émue.
– Chère Aurett !
– Mon cher mari !
Brusquement ce dialogue affectueux fut interrompu.
Un bourdonnement effrayant passa dans l’air, puis il y eut une détonation assourdissante, une pluie de sable et de pierrailles.
Armand et sa femme avaient été jetés à terre par la violence du « vent » du projectile monstre qui venait d’éclater près d’eux.
Le Parisien se releva tout étourdi.
Il courut à Aurett.
– Je n’ai rien, murmura-t-elle aussitôt, mais qu’est-ce que cela ?
– Ce que c’est ? La foudre m’écrase, si je m’en doute.
– Voyez, voyez donc ce que cela a fait.
Armand tourna ses regards vers l’endroit que lui désignait la jeune femme.
Il eut une exclamation de surprise.
En avant de lui, un instant auparavant, il y avait un amas de pierres éboulées, au-dessus duquel se dressait un fût de colonne.
Maintenant tout avait disparu.
À la place des décombres, un trou circulaire, béant, creusait sa forme d’entonnoir sur un diamètre de sept à huit mètres.
– Qu’est-ce que c’est que ça ? grommela le journaliste tout interloqué. Quels diables d’obus nous envoient-ils là ?
Un officier de l’ancienne armée régulière égyptienne passa.
– Eh ! lieutenant, appela Armand. L’interpellé s’approcha.
– Pourriez-vous me dire ce qui vient de tomber là ?
L’Égyptien considéra l’entonnoir, puis tranquillement :
– Un obus torpille.
– Un obus torpille ? vous plaisantez. Ce sont des canons pneumatiques qui lancent ces projectiles et leur portée est très courte.
– C’était ainsi autrefois.
– Autrefois ?

– Oui, mais les Anglais ont trouvé le moyen de projeter ces dangereux obus au moyen de canons ordinaires. Celui qui nous occupe vient des falaises du nord ; la direction de l’explosion l’indique, et il y a bien six kilomètres d’ici. Du reste vous allez pouvoir vous assurer de l’exactitude de mes affirmations, car les torpilles vont par troupes.
Comme pour donner raison au lieutenant, des grondements ébranlèrent l’atmosphère, puis une série d’explosions effrayantes.
– Mais ils vont tout culbuter ici ! s’exclama Armand.
– C’est probable.
– Une heure de ce jeu-là, et les ruines de Thèbes, qui ont résisté à la destruction depuis quatre mille ans, n’existeront plus qu’à l’état de souvenir.
Et, reprenant son ton plaisant habituel :
– Ma chère Aurett, dit-il, nous nous sommes suffisamment reposés ; continuons notre promenade. Allons visiter le village de Louqsor.
Après un silence, il acheva :
– J’aime mieux les balles des fantassins que ces mines ambulantes. Une balle tue son homme, c’est vrai ; mais enfin on retrouve un cadavre, tandis que les torpilles, brrrrou !
Il sortit de son abri.
À dix pas, adossés au mur, les officiers formant son état-major attendaient.
– En avant ! il s’agit d’emporter Louqsor, clama le journaliste.
En un instant tous furent autour de lui.
– Que les troupes de réserve passent le canal en amont du village ; elles l’attaqueront par le sud, tandis que nos régiments déjà engagés le prendront par le flanc est. Et toujours la même tactique, des tirailleurs rampants. On perd moitié moins de monde. Allez et que l’attaque soit prompte.
Lui-même s’élança vers les soldats demeurés en observation le long du canal. Aurett le suivit, disant comme lui :
– En avant ! Que cette tuerie s’achève vite et que je cesse de trembler pour lui.
* *
*
Pendant ce temps, que faisait Robert ?
Accompagné par Lotia, Jack, Nilia et quelques officiers de son état-major, le Français s’était porté sur un mamelon d’où il pouvait embrasser l’ensemble du champ de bataille.
À ses pieds s’étendaient les Memnonia, avec leurs temples détruits, à demi-enfouis dans la verdure des bois de palmiers et de sycomores.
Au loin, les falaises qui enserrent la vallée des Rois se dressaient comme une fortification géante, que couronnait l’artillerie anglaise.
À mille mètres à peine de ce redoutable escarpement, les ruines du temple d’Asasif, parmi les éboulements duquel se dressait intact un pylône trapu.
Robert le montra à Jack.
– C’est ce pylône qu’il s’agit de démolir pour mettre à jour l’entrée de la sépulture royale de Phasipharmès, si toutefois mademoiselle Nilia ne s’est pas trompée.
La jeune fille murmura :
– Il vous est facile de vous en assurer.
– Et comment ?
– Priez sir Jack de m’endormir et de me faire confirmer mes premières réponses… mieux encore, ajouta-t-elle, ne me réveillez plus ensuite et ordonnez que je vous guide.
Le Français fit un signe d’acquiescement.
Et Price le brun, se plaçant devant Nilia, murmura doucement :
– Dormez, ma douce fiancée.
Cinquante secondes et elle dort.

– Où est l’entrée du tombeau ? demande alors Robert.
– Sous le pylône du temple d’Asasif.
– Et cette sépulture communique presque… ?
– Avec une autre tombe dont la porte est sur le plateau, près de la vallée des Rois.
Les deux hommes échangèrent un regard.
– Toujours la même chose, remarqua Jack.
– Oui, mais cela ne m’avance pas.
– Pourquoi ?
– J’admets l’existence des demeures funèbres dont parle mademoiselle Nilia.
– Alors… ?
– Pour que cette connaissance me soit utile, il faut que j’y introduise des soldats, qui, apparaissant à l’improviste sur le plateau, sèmeront le désordre parmi nos ennemis.
– Sans doute.
– Eh bien, quel moyen d’arriver là avec des forces suffisantes sans être vu, car tout est là. Pour surprendre, il ne faut pas que les Anglais nous aperçoivent.
Robert s’interrompit soudain.
– Je suis simple… c’est tout indiqué.
Et, appelant près de lui les officiers d’état-major, il leur parla à voix basse.
Tous sautèrent sur leurs chevaux et s’éparpillèrent dans toutes les directions.
– Qu’allez-vous faire ?
– Incendier la plaine des Memnonia.
– Incendier ?
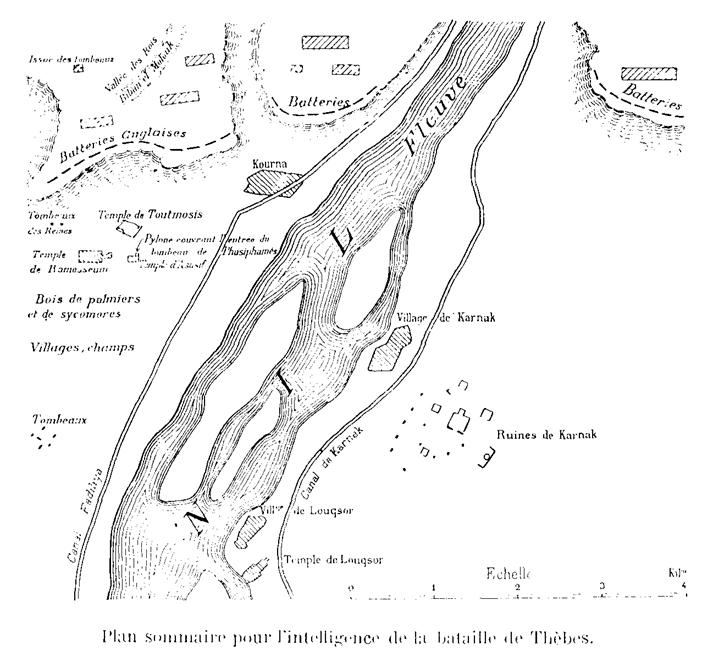
– Oui… Pas de fumée sans feu, dit un proverbe français que j’ai retourné pour m’en servir : Pas de feu sans fumée.
– Je ne comprends pas.
– Qui dit fumée, dit brouillard ; qui dit brouillard exprime la possibilité d’agir sans avoir sur soi les yeux de ses adversaires.
– Ah ! s’écria Jack, j’ai saisi. Bravo !
Cependant la plaine s’animait.
Des bataillons noirs se montraient, se déployant en tirailleurs suivant leur tactique habituelle.
Au pied de la colline où se trouvaient les Français, mais masqués des vues de l’ennemi, deux régiments d’infanterie égyptienne se groupaient l’arme au pied.
Les colonels gravirent l’éminence et s’arrêtèrent à quelques pas de Lavarède.
– Approchez, Messieurs.
Ils obéirent.
– Messieurs, reprit le général insurgé, je crois savoir qu’il existe sous le pylône d’Asasif l’entrée d’un souterrain qui aboutit sur le plateau occupé par l’ennemi.
Malgré la discipline, les officiers ne purent retenir une exclamation :
– Oh !
Robert sourit.
– Je vois que vous sentez tout le prix du renseignement. Je vais moi-même reconnaître le passage, et si, ce que j’espère, il est tel que je le pense, je compte sur vos régiments pour me suivre au milieu des batteries anglaises.
Le visage des Égyptiens s’illumina.
– Merci, général, firent les deux hommes d’une même voix.
– Ne me remerciez pas, Messieurs. L’honneur d’assurer la victoire vous appartenait, à vous, fils de l’Égypte, à vous qui, plus que les autres encore, avez souffert de la tyrannie britannique.
Puis il leur tendit les mains.
– Un coup de sifflet aigu, accompagné du beuglement de la corne du chef derviche Saknassam vous indiquera le moment de gagner le souterrain.
Et, devinant l’objection prête à monter à leurs lèvres :
– Observez ce qui va se passer ; vous comprendrez pourquoi les Anglais ne soupçonneront pas votre mouvement.
À ce moment, une cinquantaine d’hommes armés de pics, de pioches, de leviers, d’échelles s’engageaient sur la rampe de la hauteur, montant vers le général.
– Ceux qui vont ouvrir la porte, dit Robert en les désignant.
Il leur fit signe d’arrêter à mi-pente, et cet ordre exécuté, il reporta ses regards sur la plaine.
Les tirailleurs rampants avançaient comme d’énormes insectes noirs.
Les Anglais avaient ouvert le feu, et les balles, les obus tombaient autour d’eux.
Parfois un homme était broyé par la chute d’un projectile, mais en somme cet accident fâcheux se produisait assez rarement.
Et la chaîne progressait toujours.
Bientôt les tirailleurs atteignirent les ruines d’Asasif ; ils les dépassèrent, se défilant du tir ennemi en utilisant les bouquets de bois épars dans la plaine.
Durant quelques instants, tous disparurent sous le couvert, puis se montrèrent de nouveau battant en retraite.
– Que signifie cela ? s’écria Jack, furieux de cette reculade inexplicable.
Robert lui appuya la main sur l’épaule.
– Attendez, Sir Jack ; dans un moment, vous saurez de quelle mission ces braves gens étaient chargés, et vous reconnaîtrez que, l’ayant remplie, ils ont… je ne dirai pas le droit, mais le devoir de se replier.
Jack voulait interroger encore, le Français lui désigna la plaine.
– Regardez !
Un phénomène bizarre se produisait.
Au-dessus des panaches verts des palmiers, des frondaisons des sycomores, des vapeurs bleues montaient.
Transparentes d’abord, elles s’épaississaient peu à peu, se transformaient en nuages d’épaisse fumée.
Robert regarda les colonels.
– Messieurs, dit-il, attendez ici le signal. Vous voyez que tout à l’heure la fumée sera assez épaisse pour dissimuler notre marche à travers la plaine.
Puis, appelant Jack et Lotia :
– Venez, ma douce fiancée, venez, mon ami. Allons attaquer le pylône qui masque le chemin de la victoire.
Un instant après, tous trois, suivis par l’inconsciente Nilia, avaient rejoint les travailleurs arrêtés à mi-côte, et la petite troupe descendait vers la plaine se dirigeant vers Asasif.
Nulle précaution n’était nécessaire pour dissimuler la marche de la colonne. Les bois auxquels les tirailleurs avaient mis le feu, flambaient avec des pétillements, des sifflements.
Du brasier se dégageaient d’épaisses vapeurs qui étendaient un rideau impénétrable entre les armées adverses.
Une demi-heure encore et tous sont rassemblés dans l’enceinte du temple d’Asasif.
Les fellahs attaquent le pylône formé de cubes de pierres entassés et cimentés.
La première assise, la seconde roulent à terre.
Tout à coup des sifflements se font entendre en tous sens ; un fellah pousse un cri, étend les bras et tombe la figure ensanglantée.
Ce sont les Anglais qui, ne pouvant rien contre l’incendie qui roule ses flocons de fumée sur la plaine, craignent une surprise de l’ennemi et exécutent des feux de salve.
À chaque instant, des nappes de projectiles passent. Mais le travail ne se ralentit pas. Ceux qui tombent sont aussitôt remplacés. Et le pylône s’abaisse, s’abaisse encore.
Bientôt Robert saura si le souterrain cherché existe.
Et dans la fumée aveuglante, au milieu du gémissement aigu des arbres se tordant sous la morsure du feu, du bruit mat des balles s’aplatissant sur les pierres, les hommes se hâtent, agitant leurs leviers, leurs pics, marteaux, pioches, avec des allures d’ombres.
Toujours la fusillade crépite.
Les Anglais se livrent à d’incessants feux de salve et les projectiles filent dans l’air en volées.
Le pylône diminue à vue d’œil.
L’une après l’autre, les assises de granit ont cédé sous l’effort des travailleurs.
Ceux-ci attaquent la dernière.
Alors Robert quitte l’abri où il attendait avec Jack, Lotia Hador et Nilia. Du geste, il défend à ses compagnons de le suivre et se rapproche de ses soldats.
Trois pierres énormes obstruaient encore l’endroit où devait se trouver l’entrée de la tombe royale.
Des leviers furent glissés sous les blocs, et lentement, lentement, ceux-ci se déplacèrent.
Robert eut un cri.
Son angoisse, ses doutes s’étaient envolés brusquement, car sous les dalles de granit venait d’apparaître l’entrée d’un tombeau que jamais les chercheurs de trésors n’avaient soupçonné en cet endroit.
Phasipharmès, ce pharaon mystérieux dont Champollion, le grand déchiffreur d’hiéroglyphes, avait signalé l’existence problématique après la lecture de certains cartouches ; Phasipharmès avait bien régné sur Thèbes.
Des raisons inconnues l’avaient décidé à faire creuser sa sépulture dans le sous-sol de la plaine, au lieu de la faire fouiller dans les flancs de la chaîne Lybique, suivant l’usage de ses prédécesseurs.
Raisons inconnues, disons-nous. Non, la raison éclatait aux regards des soldats de l’indépendance. Le destin avait inspiré le pharaon, mort trente-cinq siècles auparavant. Le destin avait décidé que l’ancêtre préparerait ainsi la victoire des descendants de ses sujets opprimés par l’Angleterre.
Une sorte de portique se dessinait sur le sol, encadré par deux piliers couplés, aux chapiteaux supportant des têtes d’apis contournant leurs cornes pour figurer le croissant isiaque.
À la partie supérieure s’étalait un cartouche emblématique avec le disque jaune du soleil, le Scarabée sacré, la divinité à tête de bélier, Isis, Nephtis et Horus, ces dieux symboliques de la naissance, de la vie, de la mort, agenouillés dans la pose de l’étonnement mystique, les reins serrés dans un pagne étroit.
Un mur de briques figurait la porte. Il céda bientôt sous les coups de pic et démasqua une dalle de granit rose.
Un cachet d’argile la scellait, portant la formule du colchyte, ou entrepreneur de demeures funèbres, qui avait fermé le tombeau.
– Nilia a dit vrai, s’écria Robert d’une voix frémissante. Je crois maintenant au triomphe de nos armes.
– Et de notre tendresse, répondit doucement Lotia, tandis que Jack, les yeux démesurément ouverts, regardait Nilia toujours endormie, avec une expression indéfinissable.
Cependant les fellahs, excités par ce premier succès, attaquaient la dalle de pierre, dernier obstacle qui fermait le dédale de la sépulture.
En la faisant sortir de son alvéole, ils mirent à nu de nombreuses figurines de terre émaillée bleue ou verte, statuettes funéraires qui, chez les anciens Égyptiens, tenaient lieu des couronnes que nous déposons dans nos nécropoles.
Chacun en prit une, et la cacha sous ses vêtements.
Pour ces modernes, arrivant en dépit de tous les dangers, au seuil de l’indépendance, ces restes d’un art à jamais éteint prenaient la valeur de fétiches. Il y avait une sorte de piété à choisir comme amulettes les offrandes funéraires des ancêtres, dont les corps, enduits de natron, dormaient peut-être l’ultime sommeil dans les grottes funèbres de la chaîne Lybique.
Une bouffée d’air lourd, brûlant, s’échappa de l’ouverture comme le souffle embrasé qui sort de la gueule d’un four.
La lumière vague, bleutée par la fumée de l’incendie, laissa apercevoir les marches hautes et raides d’un escalier qui s’enfonçait dans le sol. Sur les murailles brillaient des enluminures, des hiéroglyphes alignés en rangs verticaux comme les caractères de l’écriture chinoise.

– Le signal ! ordonna Robert d’une voix tremblante.
En sifflement aigu, le beuglement déchirant d’une corne passèrent aussitôt dans l’air, et de tous les points de la plaine, les mêmes sons s’élevèrent, comme si des échos brusquement éveillés avaient renvoyé au chef le signal annonçant le succès.
Mais Lavarède ne voulut pas perdre de temps.
Il entendait, au loin, la canonnade effrénée qui se déchaînait sur la rive droite du Nil.
C’était l’instant où Armand attaquait les retranchements, établis le long du canal de Karnak, abrité ainsi que ses gens par les ruines éparses dans la plaine. Là aussi la vieille Égypte prêtait le concours de ses indestructibles monuments aux soldats de l’Égypte nouvelle.
– En avant ! clama Robert.
Des torches furent allumées, le Français allait s’engager dans l’escalier ; mais Jack l’arrêta et, désignant Nilia :
– C’est elle notre guide. Il faut qu’elle passe la première.
Sans répondre, Lavarède s’effaça ; Price le brun fit un signe ; sa jolie fiancée s’approcha d’un pas automatique.
– Voyez-vous ? demanda Jack.
– Oui, je vois.
– Pouvez-vous nous guider ?
– Je le puis.
– Allez donc, nous vous suivons.
La jeune fille se mit à descendre lentement ; tous s’élancèrent après elle.
Déjà du fond de la plaine accouraient des masses sombres à peine perceptibles dans la fumée.
C’étaient les régiments qui allaient s’engager dans le chemin souterrain.
Les torches grésillaient, brûlant avec peine dans l’air épais du corridor.
Jack, Robert, Lotia, haletaient ; seule, Nilia marchait, insensible en apparence à la chaleur étouffante de cette route ignorée si longtemps sous la surface embrasée de la plaine.
Le couloir s’enfonçait suivant une horizontale parfaite, dans la direction des hauteurs occupées par les Anglais.
Après deux cents mètres environ, les voyageurs furent arrêtés par une porte de pierre, scellée comme la première d’un cachet d’argile et surmontée du globe ailé.
Quelques coups de pioche eurent raison de cette barrière, et un nouveau couloir s’étendit devant les compagnons de Nilia.
La galerie était en pente douce ; sans doute elle suivait l’inclinaison de la plaine dont la surface se relevait insensiblement aux abords de la chaîne Lybique.
De chaque côté, sur les parois couvertes d’un ton uniformément bleu, se déroulait une procession de figurines emblématiques aux couleurs vives. La lueur des torches les animait un instant, au passage, puis elles semblaient s’engloutir dans l’obscurité. Plus loin, le Chacal sacré, étendu sur le ventre, faisait face à une femme coiffée de la mitre et étendant le bras sur un globe ailé, dans un geste protecteur.
Robert estima que l’on avait ainsi parcouru quatre cents mètres.
Alors la déclivité du corridor s’accentua. On montait avec peine une rampe établie sous une inclinaison de trente-cinq degrés.
Les représentations picturales des murs se modifiaient.
Maintenant elles figuraient des hommes, des femmes en adoration devant le vert scarabée sacré ou devant le serpent bleu symbolique. Le fond uni était de couleur émeraude.
Soudain Nilia s’arrêta et appuya la main sur la paroi de droite.
– Qu’est-ce ? interrogea Jack qui la suivait.
– Il faut creuser là, répondit la jeune fille.
– Creuser ? pourquoi ne pas continuer le couloir ?
– Il finit en impasse à cent mètres d’ici. Derrière ce mur une galerie est ménagée qui nous conduira où nous voulons aller.
Poussé par la curiosité, Price le brun voulut s’assurer que sa fiancée ne se trompait pas. Il s’élança en avant. Cent mètres plus loin, ainsi que l’avait annoncé la jeune fille, il fut arrêté par un mur compact de granit.
Oh ! il n’éprouva point d’émotion à la pensée du mort dont il allait troubler le repos.
Que lui importait le pharaon ?
À cette heure même, un ouragan de feu balayait la plaine occupée par ses troupes et semait des cadavres sur le sol.
Non, son émoi provenait de ce que Nilia avait promis. La salle du sarcophage devait communiquer avec un autre dédale funéraire, accédant sur le plateau occupé par les soldats anglais.
Si cela était ainsi, le triomphe de l’Indépendance était assuré.
Dans le cas contraire, il faudrait sonner la retraite, car la position britannique était imprenable autrement que par surprise.
Et le cœur du généralissime battait à se rompre.
En vain il se disait :
– Nilia ne s’est pas trompée. Jusqu’à présent toutes ses indications se sont vérifiées à la lettre.

Le sentiment de la terrible responsabilité qui pesait sur lui, la pensée de ce million d’hommes accourus à sa voix, depuis le centre de l’Afrique jusqu’à Thèbes, de cette multitude attendant de lui la victoire, l’étreignait, semant le doute dans son esprit.
Mais Nilia, toujours de son allure raide, automatique, traversait la salle dorée – c’est ainsi que l’on désigne l’antichambre de la pièce souterraine où repose le sarcophage, – franchissait une porte trapézoïdale et pénétrait dans la chambre de la momie.
Comme malgré eux, Robert, Lotia, Jack la suivirent.
Un instant ils s’arrêtèrent, pris d’un soudain respect pour ce sanctuaire de la mort.
Sous la lumière des torches, les peintures éclataient en vigueur. Les verts, les blancs, les rouges, les bleus se détachaient sur un vernis d’or. La voûte, s’arrondissant en dôme à une hauteur de dix mètres, était colorée en bleu et rehaussée de palmettes jaunes.
Au milieu de la salle, le sarcophage se dressait, énorme bloc de basalte noir creusé d’innombrables figurines. Près des angles étaient posés, sur des supports de bois, des vases d’albâtre, dont les goulots représentaient Amset à la tête humaine, Hapi, Semmout et Kebné, aux chefs de chien, de chacal et d’épervier.
Et à la tête du sarcophage une statue d’Osiris semblait veiller sur le sommeil du défunt.
Nilia avait parcouru la pièce souterraine dans toute sa longueur.
Elle s’arrêta derrière l’effigie d’Osiris et, montrant le mur où le globe ailé déployait ses ailes azurées :
– Piochez là.
Sans hésiter, les hommes obéirent.
Dans la crypte, silencieuse depuis des milliers d’années, retentirent les vibrations des pics heurtant le rocher.
Deux heures s’écoulèrent ainsi.
Maintenant le souterrain était rempli de soldats.
À la faveur des fumées de l’incendie qui ravageait la plaine des Memnonia, des régiments d’élite avaient gagné l’entrée mise à jour par la destruction du pylône ; les hommes s’empilaient dans les couloirs, dans les salles.
Ils se montraient les sculptures ornant les murs, et, avec un respect religieux, ils considéraient les Ibis, Apis, scarabées, globes ailés.
Il était étrange en effet que ces révoltés qui avaient jadis adopté, comme signes de ralliement, les emblèmes de la vieille Égypte, fussent protégés, au milieu de la lutte suprême, par ce souterrain aux murailles constellées des figures que les habitants d’Oph adoraient.
C’était une sorte de communion avec les ancêtres. Aucun ne parvenait à exprimer sa pensée, et cependant tous comprenaient qu’à cette heure, un lien mystérieux rattachait le présent au passé.
Durant des siècles, des oppresseurs divers, Romains, Arabes, Turcs, Anglais avaient régné sur la vallée nilotique, courbant sous le joug les descendants des fiers conquérants du monde noir, heurtant d’un pied dédaigneux les ruines, témoins désolés des grandeurs disparues.
Pourtant la minute fixée par le destin avait sonné. Tel le phénix renaissant de ses cendres, l’Égypte allait ressusciter de la poussière des temples ; la liberté allait jaillir de la servitude.
Les mains tremblantes suivaient sur le granit les contours des dessins sacrés, creusés par le ciseau des sculpteurs oubliés, et les soldats armés de fusils souriaient à l’effigie des guerriers aux pagnes blancs, brandissant la lance, ou bandant l’arc de corne.
Dans la salle du sarcophage, les mineurs travaillaient toujours.
Pour Robert, pour Jack, pour Lotia, il n’y avait plus de doute ; la niche que le fer enfonçait dans le roc, aboutissait à une cavité.
La résonnance des coups le démontrait surabondamment.
Nilia avait dit vrai.
Son sommeil mystérieux était peuplé, non de rêves, mais de réalités.
Alors que son corps semblait privé de volonté, son esprit veillait, et, libre comme l’oiseau, il franchissait les espaces d’un coup d’aile, voyait à travers les murailles, lisait même les pages obscures du livre de l’avenir.
Elle avait promis la victoire, si l’on parvenait dans la tombe inviolée du pharaon Phasipharmès.
La tombe était bondée de combattants ; donc on vaincrait.
Soudain Jack regarda la jeune fille.
Immobile, adossée au mur, on eût dit une statue.
Il lui prit la main et, baissant la voix :
– Nilia, murmura-t-il, m’entendez-vous ?
Sans que son visage exprimât la moindre sensation, elle répondit :
– Oui.
– Puis-je vous interroger ?
– Oui, ou plutôt ne prenez pas cette peine. Ordonnez seulement que je voie dans votre pensée.
Price le brun eut un tressaillement.
– Le saurez-vous vraiment ?
– Essayez.
– Eh bien, Nilia, répondez à la question qui vient de naître en mon esprit.
Une minute, la jeune fille garda le silence, puis lentement :
– Vous désirez savoir si mistress Price ouvrira ses bras d’Anglaise à Jack le Français ?
– Oui, fit-il impressionné par cette divination extraordinaire, oui, c’est cela.
– Elle vous aime toujours comme son fils.
– Vraiment ?
– Mais, pour la sauver, il ne faudra pas perdre un instant.
Jack frissonna.
– La sauver ? dites-vous. Elle est donc en danger ?
– Elle le sera.
– Comment ? Comment ? Parlez.
– Écoutez donc.
Et la jeune fille raconta :
– Le trésor de l’année a été confié à mistress Price. Il est enfermé dans un camion qui est censé contenir les bagages du Sirdar.
– Pourquoi ?
– Une précaution de Lewis Biggun, qui n’était pas très sûr des auxiliaires à lui envoyés par la métropole.
– Ah ! mais le danger ?…
– Il viendra d’un homme en qui lord Biggun a toute confiance.
– Et cet homme ?
– A nom Gorgius Kaufmann.
– Lui !
Le cœur du brave garçon s’était mis à battre avec violence.
– Lui, répéta-t-il, il doit donc faire souffrir tout ce que j’aime. Vous, Nilia, fûtes sa victime ; maintenant ma mère adoptive…
Elle dit sourdement :
– Vous oubliez votre frère John.
– John ? bégaya Price le brun sans comprendre.
– Oui, votre frère, mort en portant le message qui faillit être si fatal à Robert Lavarède et à nous-mêmes.
– En quoi l’Allemand est-il mêlé à cela ?
– C’est lui qui a désigné au Sirdar, John…
– Désigné ?… Ah ! je vous en conjure, expliquez-vous.
– Il fallait un courrier décidé à mourir. Une dépêche arrachée à un mort n’inspire pas de défiance… Gorgius a dit à lord Biggun : Chargez John Price de cette mission ; il consentira volontiers à donner sa vie pour l’Angleterre.
Une sueur froide perlait sur le front de Jack.
– Ainsi, balbutia-t-il, c’est lui qui a condamné mon frère ?
– C’est lui.
– Oh ! je le vengerai.
– Oui, mais il sera nécessaire d’aller vite, sans cela mistress Price, elle aussi, succombera.
– J’irai…
– Il suffira de vous emparer du cheval noir.
– Du cheval noir… ?
– Il passera à votre portée.
Et soudain le visage de la jeune fille se contracta.
– Ne questionnez plus… ordonnez que ma pensée revienne ici,… le spectacle est horrible… du sang, des hurlements de mort,… je souffre…
Au moment où Jack profondément troublé prononçait l’ordre sollicité, un cri de triomphe s’éleva du groupe des travailleurs.

Le passage était pratiqué.
Un fellah l’avait franchi, et, à la clarté de sa torche, on apercevait une vaste salle, en tout semblable à celle où l’on se trouvait.
C’était la même voûte peinte en bleu, rehaussée de palmettes d’or ; un sarcophage de basalte dressait aussi là sa masse sombre encadrée par des vases d’albâtre.
Ainsi que l’avait annoncé Nilia, l’entrée du tombeau voisin était forcée.
Un silence profond régnait parmi les assistants. Tous s’étaient penchés en avant, l’oreille tendue.
Un bruit sourd parvenait jusqu’à eux.
Et Robert poussa une exclamation :
– Le canon !
Oui, c’était le roulement de la canonnade qui résonnait ainsi qu’un tonnerre lointain.
– L’issue pressentie par Nilia existe, s’écria Robert. C’est ainsi que le fracas de la bataille nous arrive… En avant donc, mes amis, en avant !
Le premier, il bondit par l’étroit passage et tous le suivirent.
De nouveau, le général insurgé et ses compagnons parcoururent des corridors aux parois couvertes de figures d’hommes, d’animaux, de bandes d’hiéroglyphes.
À mesure que l’on avançait, le fracas de la bataille grandissait.
Enfin un escalier raide se présenta devant Lavarède.
On devait être tout près de la sortie du tombeau, car le grondement de l’artillerie devenait assourdissant.
L’air était ébranlé comme par un souffle de tempête.
– Attention ! commanda le Français.
Et l’avertissement passant de bouche en bouche, le jeune homme mit le pied sur la première marche.
Lotia venait après lui, puis Jack et Nilia.
Cent quatre-vingts degrés furent franchis en silence. Alors Robert s’arrêta.
Une lumière pâle tombait d’en haut.
– Attendez, un instant, fit Lavarède d’une voix si basse qu’on l’entendait à peine ; je vais reconnaître les environs.
Rapide, il escalada les dernières marches.
Bientôt sa tête dépassa le niveau du sol. Il regarda avidement.
En arrière s’ouvrait, comme une tranchée gigantesque, le ravin escarpé de Biban-el-Molouk, dernier séjour autrefois des souverains de Thèbes, que l’on appelait pour cette raison la vallée des Rois.
En avant, un rempart de rochers arrêtait la vue.
Avec des précautions infinies, le Français se glissa dehors.
Courbé en deux, tressaillant au moindre bruit, il gagna la barrière de rochers, la contourna et soudain, par une percée, il aperçut l’ennemi.
Sous ses yeux s’étendait le plateau fortifié, à la limite duquel deux cents pièces de canon faisaient rage.
Entre les batteries et son poste d’observation, les réserves anglaises, massées, l’arme au pied, attendaient le moment de l’assaut pour entrer en ligne.
Pas un ne regardait dans la direction de Biban-el-Molouk.
Ils se croyaient couverts de ce côté par le terrain même. Les pentes en effet, au Nord et à l’Ouest sont impraticables.
Aussi tous avaient les yeux fixés sur la plaine des Memnonia, d’où l’attaque devait se produire.
Bien vite, Robert revint en arrière.
Il atteignit l’orifice du souterrain, et, se penchant, il cria :
– En avant !
Un instant plus tard, Lotia était auprès de lui, suivie aussitôt par Jack et par Nilia, toujours plongée dans le sommeil hypnotique.
Puis un à un, se hâtant, les soldats apparurent.
Du geste, Robert leur désignait les rochers, et tous se rangeaient derrière cet abri naturel.
Le Français ressentait une émotion terrible.
Si la présence de ses guerriers sur le plateau était découverte avant que tous fussent rassemblés, le succès de l’expédition pouvait être compromis.
Mais rien ne justifia ses craintes.
Les deux régiments furent groupés sans encombre.
L’instant d’agir était venu.
Alors le jeune homme murmura quelques mots à voix basse, qui furent transmis de proche en proche.
Et lentement, avec précaution, les Égyptiens fixèrent leurs baïonnettes au bout du canon des fusils.
– Lotia, Nilia, commanda Robert, demeurez ici, je le veux.
Puis, s’adressant au colonel de l’un des régiments :
– Escaladez ces blocs de granit et ouvrez le feu sur les réserves qui occupent la partie du plateau voisine du Nil. Empêchez-les ainsi de venir renforcer leurs camarades que nous allons attaquer.
Et, l’ordre s’exécutant en silence, il alla se placer à la tête du second régiment :
– Amis, dit-il, souvenez-vous tous des injures que les Anglais vous ont fait subir et vengez-vous.
Tous les yeux lancèrent des éclairs et brusquement la troupe se mit en marche.
Guidée par Robert, elle gagna la droite de l’amoncellement granitique, et dépassa son abri.
À cent mètres à peine apparaissaient les lignes anglaises.
– Feu de salve ! gronda Lavarède.
Trois mille fusils s’abaissèrent. Un coup de tonnerre, fait de trois mille détonations, déchira l’air. Une pluie de balles s’abattit sur les réserves anglaises, couchant des centaines de morts les uns sur les autres.
Et, dominant tous les bruits, ainsi qu’un appel de clairons, la voix de Robert s’éleva :
– À la baïonnette !
Comme des loups, les Égyptiens s’élancèrent ; le sol trembla sous le choc des pieds le frappant avec rage. Trente secondes, et les cent mètres sont franchis, et les baïonnettes acérées percent les habits rouges.
À l’autre extrémité du plateau, lord Lewis Biggun, debout sur les épaulements de ses batteries, explorait la plaine à l’aide d’une longue-vue.
Près de lui, Gorgius Kaufmann regardait aussi.
– Rien, je ne vois rien, dit enfin le Sirdar.
– Cependant, remarqua l’Allemand, l’incendie tire à sa fin, la fumée se dissipe.
– Justement… aussi je m’étonne de ne constater aucun mouvement des troupes rebelles.
– Bon ! si vous ne voyez rien, c’est qu’il n’y a rien.
Le lord eut un geste d’impatience.
– C’est précisément ce qui m’inquiète.
– Comment ?
– Les coquins sont commandés par des aventuriers déterminés, nous en avons eu malheureusement trop de preuves.
– Cela est indiscutable.
– Or, si ces gens ont ordonné l’incendie, s’ils ont noyé les Memnonia sous un brouillard de fumée, c’est qu’ils voulaient nous cacher une manœuvre quelconque.
– Le croyez-vous ?
– J’en suis certain, Sir Kaufmann.
– Soit ! admettons cela.
– Ah ! gronda le Sirdar, vous ne comprenez donc pas que, pour parer les coups de l’ennemi, il faut savoir d’où ils partiront.
– Si, si, je sais cela.
– Alors pourquoi questionner ?… Je ne vois rien, vous ai-je dit, donc le péril peut être tout proche, il peut nous surprendre d’un instant à l’autre.
Les yeux du généralissime parcoururent le plateau.
– J’ai pris toutes les dispositions que commandait la prudence ; je ne saurais rien faire de plus.
Il se tut tout à coup.
Son regard venait de rencontrer la ligne égyptienne brusquement sortie de l’abri des rochers.
– Qu’est-ce que cela ? à quelle manœuvre s’amuse-t-on là-bas ?
Il croyait voir des soldats de son armée.
– Qui commande cette troupe ?
Il éleva sa lorgnette, mais il n’eut pas le temps d’appliquer l’instrument sur son œil.
Le feu de salve, ordonné par Robert, crépita ; puis l’attaque furieuse à la baïonnette se dessina.
Un véritable rugissement s’échappa des lèvres du Sirdar.
– Les rebelles ! les rebelles ! hurla-t-il d’une voix déchirante, voilà ce que cachait l’incendie.
Et laissant là Gorgius Kaufmann abasourdi, il se précipita vers la colonne anglaise la plus proche.
– En avant ! En avant pour l’Angleterre, écrasons ces misérables.
Mais une nappe de balles passe, renversant ses hommes, creusant de larges trouées dans les rangs.
Le régiment embusqué dans les rochers commence le feu.
La position est intenable ; lord Lewis Biggun le sent bien, mais il veut lutter jusqu’au bout.
Il enlève ses hommes, les entraîne au pas de course à l’attaque du retranchement de granit, mais le feu meurtrier des Égyptiens brise l’élan. La colonne tourbillonne, s’arrête, recule.
Trois fois, le Sirdar revient à la charge ; trois fois il est repoussé.
Le combat à la baïonnette continue cependant. Un instant surpris, les Anglais ont constaté leur énorme supériorité numérique. Ils se sont reformés, ils combattent, baïonnette contre baïonnette.
En vain Robert est au premier rang, s’enfonçant avec un entêtement héroïque dans les rangs britanniques, ses soldats n’avancent pas. Un effort encore de l’ennemi et ils reculent.
La bataille sera-t-elle donc perdue ?
Non, des renforts arrivent aux insurgés.
Escaladant les rampes du plateau, sortant du conduit souterrain des tombeaux, des noirs paraissent de toutes parts.
Les artilleurs sont tués sur leurs pièces.
La canonnade diminue, s’éteint.
Une mêlée grandiose s’engage sur le plateau.
Refoulé, repoussé jusqu’à l’arête qui domine le Nil, Lewis Biggun, conservant toute son énergie au milieu du désastre, a formé en carrés les débris de son armée.
Comme un mur, ses soldats résistent à toutes les attaques.
Ah ! les Anglais sont bien les dignes fils des compagnons de Wellington.
Comme à Waterloo, leurs carrés fondent, se réduisent, mais ne se laissent pas entamer.
Héroïsme vain !
La victoire n’est plus douteuse.
Les patriotes triomphent.
Les batteries anglaises ont été déplacées, maintenant elles tonnent contre les batteries établies sur la rive droite du Nil, lesquelles sont en contre-bas de plus de vingt mètres.
Et devant ce désastre, devant cet anéantissement de la puissance anglaise en Afrique, Robert se sent pris de pitié pour ces régiments qui combattent encore, non plus avec l’espoir de triompher, mais avec la volonté de bien mourir.
Sur son ordre, les insurgés s’écartent. Lui-même, précédé d’un fanion blanc, s’approche du carré, au centre duquel se tient Lewis Biggun monté sur son cheval noir.
Il appelle le Sirdar.
– Général, rendez-vous !
Il n’obtient pas de réponse.
– Rendez-vous, général. La victoire vous échappe aujourd’hui ; ne condamnez pas à périr les braves gens groupés autour de vous.
Même silence.
Pour la troisième fois, Robert prie :
– Rendez-vous !
Alors, Biggun se dresse sur ses étriers, et hautain, rageur, il crie sa haine, son entêtement invincible de lutter jusqu’au bout, dans ce mot trivial que la situation fait héroïque :
– Flûte ?
Ironie des choses ; dans cette revanche de Waterloo, comme les journaux anglais qualifièrent la bataille de Thèbes, rien ne devait manquer, pas même l’épisode des régiments mourant plutôt que de se rendre. Biggun devait plagier Cambronne.
Robert s’était retiré.
Le combat avait repris acharné, sans merci.
La nuit venait, et le grand silence des nécropoles succédait à la tempête des colères humaines.
Cent mille cavaliers venaient d’être lancés à la poursuite des quelques centaines de fuyards qui survivaient seuls à l’armée anglaise anéantie.
Le Sirdar était mort. Une balle l’avait renversé, et son cheval affolé s’était enfui au galop pour venir s’arrêter à quelques pas de Jack.
À sa vue, le jeune homme s’était souvenu des paroles de Nilia. D’un bond, il avait saisi la bride de l’animal, avait sauté en selle, et, gagnant l’endroit où Nilia attendait, il avait hissé la jeune fille devant lui ; puis doucement :
– Où est mistress Price ?… Où est Kaufmann ?
Elle répondit :
– À Keneh. Il faut que nous y soyons dans une heure.
Jack piqua le cheval de la pointe de son sabre, et le coursier, hennissant de douleur, partit à toute vitesse vers le Nord, emportant comme une plume son double fardeau.

CHAPITRE XII
LE TRIOMPHE
En voyant la partie perdue, Gorgius Kaufmann avait contourné le plateau, s’était engagé sur un sentier étroit allant au Nil, puis, une fois au bord du fleuve, il s’était dirigé à grands pas vers Keneh.
C’est dans cette bourgade que mistress Price attendait l’issue de la bataille.
L’excellente femme avait ordre, en cas de défaite, d’atteler deux vigoureux chevaux au fourgon contenant le trésor de l’année et de partir à fond de train vers le Nord.
Le Sirdar avait voulu qu’en toute occurrence l’argent au moins fût sauvé.
La cuisinière attendait donc, pensive.
Soudain un bruit de pas précipités parvint jusqu’à elle. La porte s’ouvrit violemment et Gorgius haletant parut sur le seuil.
– Ah ! Sir Kaufmann, s’exclama la digne femme, vous m’avez fait peur.
– Je n’ai malheureusement pas le loisir de m’excuser. Lord Biggun m’envoie vers vous…
– Lord Biggun !
– La bataille est perdue.
– Perdue !… Ah ! moi qui espérais voir anéantir ces rebelles jusqu’au dernier.
Mistress Price se reprit vivement :
– Non, non, pas jusqu’au dernier… Jack, le pauvre enfant est parmi eux… Et ils sont vainqueurs, ils ont triomphé de Lewis Biggun, le meilleur général de Sa Majesté… Comment cela s’est-il passé ?
L’Allemand haussa les épaules.
– Il s’agit bien de bavarder. Avez-vous oublié les ordres du Sirdar ?
– Quels ordres ?
– Ceux qui concernent le fourgon.
La cuisinière leva les mains au ciel.
– Par ma foi, je n’y songeais plus.
– Vite, attelez les chevaux.
– J’y cours.
– Je pars avec vous. Lord Biggun a pensé que, peut-être, vous seriez émotionnée et que vous auriez besoin d’aide.
– Il pense à tout, murmura-t-elle avec reconnaissance, à tout.
Et elle se précipita dehors en criant :
– Je ne vous demande que dix minutes.
Resté seul, Gorgius examina les êtres.
La grosse Price avait élu domicile dans une petite maison située en dehors du bourg de Keneh.
Un jardin entourait le logis, l’isolant des propriétés les plus voisines. Il sourit méchamment en constatant cela.
– Bon ! grommela-t-il entre ses dents, personne ne me dérangera.
Et d’une voix sourde :
– Le fourgon contient un million de livres (25.000.000 de francs). L’Angleterre est battue, mais il est juste que je sois payé des services que j’ai rendus.
Il se tut. Mistress Price venait de rentrer.
– C’est fait. Les chevaux et la voiture attendent dans la cour. Je monte prendre ma valise… je la tenais toujours prête, suivant les instructions de ce pauvre général.
Kaufmann l’interrompit :
– Hâtez-vous, les minutes sont précieuses.
Puis, d’un ton indifférent :
– À propos, qui tient les chevaux ?
La cuisinière se prit à rire.
– Personne, donc. Vous devinez bien qu’avec un fourgon pareil ; moins il y a de monde autour, mieux il est gardé.
– Alors vous êtes seule dans cette maison ? insista Gorgius.
– Seule, je me tue à vous le dire.
La voix de la pauvre femme s’étrangla dans sa gorge.
Certain que personne ne la pourrait secourir, l’Allemand avait bondi sur elle, l’avait jetée à terre d’un croc en jambe habile, et maintenant il levait sur sa victime un couteau affilé.
– Grâce ! supplia-t-elle !
– Grâce, allons donc. Tu sais le secret de l’or, et je veux être seul à le connaître.
La main armée du couteau s’abaissa rapidement.
Mistress Price poussa un gémissement et ferma les yeux.
Mais, à sa profonde stupéfaction, elle ne ressentit aucune douleur.
Ah çà ! le docteur avait donc pitié d’elle. Sans doute il hésitait à la frapper. Encouragée par cette pensée, elle souleva ses paupières et resta bouche béante devant le spectacle qui s’offrit à ses yeux.
À terre gisait Gorgius, avec son propre couteau enfoncé dans la poitrine.
Et là, à deux pas, auprès d’une jolie miss, si jolie que mistress Price crut n’en avoir jamais vue de semblable, se tenait Jack, l’enfant prodigue, Jack le fils toujours bien-aimé.
D’un geste instinctif, elle lui ouvrit les bras.
– Jack ! mon Jack !
Le jeune homme s’y précipita.
– Ma mère, ma bonne mère, vous m’aimez encore ?
– Tu le demandes, ingrat. Mais je ne veux pas te gronder, je suis trop heureuse de te revoir. Tu es vainqueur, avec tes amis les Français, m’a-t-on dit ; c’est pour cela que tu reviens…
Jack l’embrassa encore.
– Je suis accouru, mère, pour empêcher ce misérable – il désigna le corps de Gorgius – de vous assassiner.
– C’est toi qui m’as sauvée.
– Oui… Il était temps. Déjà il levait le bras pour frapper. J’ai bondi sur lui ; je lui ai saisi la main, et je l’ai forcé à se poignarder lui-même.
Les effusions recommencèrent alors.
Et tout à coup, la cuisinière, regardant son fils adoptif bien en face :
– Et cette jeune fille qui t’accompagne ?
– C’est miss Nilia, celle que je souhaite d’avoir pour femme ?
* *
*
Un mois plus tard, la ville du Caire était en liesse.
Le mariage de Robert et de Lotia, devenus les souverains du pays qu’ils avaient délivré, avait été célébré le matin même avec une pompe extraordinaire.
Des envoyés de tous les monarques d’Europe avaient assisté à la cérémonie.

Tous les princes avaient tenu à se faire représenter, car l’extermination de l’armée du Sirdar avait marqué la fin du cauchemar que l’Angleterre, colosse aux pieds d’argile, avait si longtemps imposé au monde.
La parole du clairvoyant Gladstone s’était réalisée.
– Nous sommes à la merci d’une défaite, avait dit le Great Old Man.
Et la défaite était venue, et l’empire britannique s’était désagrégé.
Une formidable révolte avait soulevé l’Inde. En huit jours, tous les Anglais avaient été massacrés.
L’Australie, le Cap, le Canada, déclinant les traités de fédération qui les unissaient à la Grande-Bretagne, s’étaient déclarés indépendants.
Les noirs des territoires du Niger, de Sierra Leone, s’étaient soulevés, avaient incendié les comptoirs des marchands anglais, et avaient sollicité le protectorat de la France.
De la grandeur d’antan, il ne restait plus rien qu’un souvenir… désagréable à la plupart des hommes.
On juge de la joie populaire.
Sur le passage de Robert, de Lotia, escortés d’Armand et d’Aurett radieux, de Jack et de Nilia pensifs et recueillis, eux qui venaient d’être unis en même temps que leurs amis, sur leur passage éclataient les manifestations d’un enthousiasme indescriptible, qui augmentait encore à la vue de Hope, promenant orgueilleusement son uniforme neuf. Le brave singe avait été à la peine, à présent il était à l’honneur.
Et les acclamations allaient leur train. Partout c’étaient des vivats qui montaient jusqu’au ciel.
Des fanatiques semaient des fleurs sous le pas des chevaux attelés aux carrosses de gala.
Mais où la joie devint du délire, ce fut lorsqu’un héraut, richement costumé, annonça qu’au lendemain de la victoire de Thèbes, le généralissime Robert Lavarède, aujourd’hui Robert Ier d’Égypte, avait fait jouer le télégraphe installé par l’armée insurgée durant sa longue marche vers le nord.
Le roi, car Robert l’était, le roi avait enjoint aux populations du Bahr-el-Ghazal et du Nil Blanc de détruire les barrages qui avaient rejeté ces fleuves dans le Congo.
Et en ce jour même, comme don de joyeux avènement, les eaux des grands lacs rejoignaient les eaux stagnantes encore à Thèbes.
L’eau allait de nouveau inonder l’Égypte, lui rendre sa fertilité, lui permettre de renouer ses traditions glorieuses.
D’un autre côté, par un sentiment de gratitude, l’assemblée des citoyens de la terre libre d’Égypte avait voté le don des contrées du Bahr-el-Ghazal et du Soueh au héros qui en avait autrefois opéré la reconnaissance et avait ainsi facilité la tâche des insurgés.
Le commandant Marchand recevait en toute propriété ces vastes territoires jadis explorés par lui, et Fashoda, ce bourg où il avait lutté et souffert, lui était attribué comme capitale.
Les Égyptiens effaçaient noblement les injures des Anglais.
Le soir, en rentrant dans le splendide appartement qui lui avait été réservé dans l’ancien palais khédivial, Jack dit à Nilia :
– Ma chère femme, il ne manque plus qu’une chose à mon honneur ; connaître ma véritable mère et vivre comme vous me l’avez promis un jour entre trois femmes bien-aimées : vous, Nilia, et mes deux mamans.
Elle le considéra tristement :
– Ami, répondit-elle, il sera inutile de recourir cette fois au pouvoir étrange que vous avez sur moi.
– Parce que… ?
– Parce que le portefeuille de Gorgius Kaufmann trouvé par moi sur son cadavre contient le renseignement que vous désirez.
Il tressaillit ; le ton de la jeune femme était douloureux, presque plaintif.
– Ma mère est morte ? murmura-t-il.
– Non, elle vit, mais…
– Mais quoi donc ? parlez.
– Elle vit malheureuse et méprisée. Depuis vingt ans elle a été condamnée aux mines au Brésil pour un vol de diamants.
– Ma mère, voleuse… ?
– Non, un vol qu’elle n’avait pas commis… un vol dont l’auteur était Kaufmann… la preuve existe, toujours dans ce portefeuille.
– Lui, toujours lui… ?
Jack tremblait de tous ses membres. Nilia vint à lui et doucement :
– Demain, vous lirez la triste histoire de celle qu’une arrestation injuste sépara de vous. Demain, vous déciderez ce que nous devons faire. Votre épouse vous suivra, partagera vos souffrances et vos joies.
Puis suppliante :
– Mais aujourd’hui, premier jour de notre union, il ne faut pas de larmes. La tradition des bohémiens prétend que toutes les journées du mariage se modèlent sur la première. Cela est faux peut-être, mais peut-être aussi est-ce vrai. Ne pleurons pas.
Et Jack trouva la force de sourire pour ne pas inquiéter la douce et courageuse enfant.
