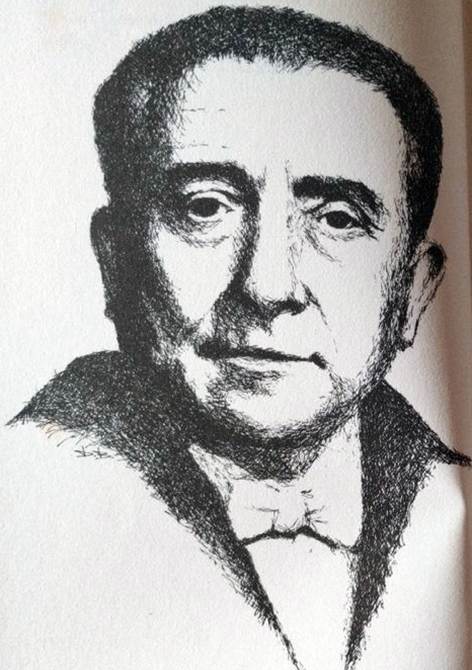
LE SOLEIL DE MINUIT
1930
Car elle était princesse, et, maintenant, qu’est-elle ?
Nul ne l’oserait dire et n’ose le savoir.
A. de Vigny
À LÉOPOLD MARCHAND
I
M. Mauconseil, directeur général de l’arsenal de Moukden, consulta sa montre. Dix heures moins dix. Il se remit à travailler.
Le bureau de son cabinet était encombré de dossiers qu’il annotait méticuleusement, au crayon rouge. Des épures multicolores couvraient les murs crépis à la chaux. Des portraits les ornaient aussi. D’abord, aux places d’honneur, ceux de deux chefs militaires d’inégale valeur, le maréchal Foch, et le maréchal Tchang-Tso-Lin, gouverneur de Mandchourie, commandant en chef des troupes des trois provinces de l’Est. Venaient ensuite les effigies des colonels de Bange, Rimailho, Sainte-Claire-Deville. Cinq polytechniciens, en comptant M. Mauconseil.
À côté du téléphone, une éphéméride de vaste dimension indiquait la date du vendredi 19 mars 1926, jour choisi par la destinée pour le commencement de cette histoire.
Le cabinet du directeur général s’éclairait par deux larges baies sans rideaux. Celle de droite s’ouvrait sur l’une des cours de l’arsenal, toute grouillante de coolies et d’ouvriers roulant des wagonnets, transportant des pièces de fer. À travers les vitres de l’autre, on apercevait, surmontées de vols de corbeaux, les murailles terreuses de la citadelle de Moukden, ainsi qu’un pan de la vieille cité mandchoue… Une rivière grise coulait à l’horizon, dans la plaine jaune et désolée. Le ciel bistre était obscurci par de lourds floconnements de nuages et de fumées.
M. Mauconseil prit sur sa table un télégramme ouvert, et le relut avec soin. Ayant de nouveau regardé sa montre, il donna quelques marques d’impatience. Deux heures vingt ! Et le rapport, alors ? Il sonna.
Un Chinois en jaquette parut sur le seuil.
— Monsieur Siu, n’avez-vous pas vu M. Schmidt ?
— Non, Excellence, dit M. Siu, qui s’inclina très bas.
— Voulez-vous l’envoyer chercher ? Il doit être au laboratoire d’essais des mitrailleuses.
M. Siu n’eut pas le temps d’exécuter cet ordre. M. Schmidt entrait.
M. Schmidt, directeur des services administratifs de l’Arsenal, était d’une quinzaine d’années plus jeune que M. Mauconseil. Il s’appliquait à paraître moins que son âge. Il y réussissait assez bien. Il y avait deux ans qu’il était à Moukden, où il était arrivé en même temps que son directeur général, lorsque Tchang-Tso-Lin avait fait appel à des ingénieurs français pour diriger le puissant arsenal dont le dictateur mandchou venait de décider la construction. En octobre 1925, son collègue, M. Fontanille, directeur des services techniques de l’Arsenal, et polytechnicien comme MM. Schmidt et Mauconseil, avait dû regagner la France, à la suite d’une congestion pulmonaire contractée en chassant l’oie sauvage, sur le Yalou. Le directeur général avait réclamé à Paris un remplaçant, qui n’était pas encore arrivé. En attendant, c’était M. Schmidt qui assurait les services techniques de l’Arsenal. La charge était lourde. Il n’en manifestait cependant pas trop d’humeur, car il avait un heureux caractère. Ses succès féminins étaient notoires à Moukden. M. Mauconseil avait cinquante-huit ans ; M. Schmidt quarante, peut-être. L’un appartenait au genre sévère ; l’autre au genre mondain.
— Excusez mon retard, mon cher directeur, dit M. Schmidt, quand le Chinois se fut éclipsé.
— Cela n’a pas d’importance, fit sans conviction M. Mauconseil. Rien de nouveau ?
— Non, rien. Ou, du moins, pas grand-chose.
— Tout va bien, alors ?
— En France, dit M. Schmidt, je n’hésiterais pas à vous répondre : « Tout va mal. » Mais pour ici, oui, tout va bien. À peu près.
M. Mauconseil fronça les sourcils.
— Vos paroles me donnent le droit de conclure que nous serons à jour le 15 mai, n’est-ce pas ?
M. Schmidt prit un air étonné.
— Le 15 mai ? Je ne saisis pas… Qu’est-ce qu’il y a, le 15 mai ?
— Comment, qu’est-ce qu’il y a ? Vous pourriez, peut-être, mon cher, relire de temps à autre le cahier des charges. Le 15 mai, nous devons livrer aux troupes mandchoues six batteries de 120 court, plus deux cents mitrailleuses. Pas plus tard qu’hier, j’ai reçu la visite du général Yang-Yu-Ting, chef d’État-major du maréchal. Au cours de la conversation que nous avons eue, il n’a pas manqué de faire allusion à notre engagement.
— Vraiment, dit M. Schmidt, vraiment, pas plus tard qu’hier soir, vous avez causé avec le général Yang-Yu-Ting. Eh bien, mon cher directeur, j’espère que vous en avez profité pour lui poser deux ou trois petites questions ?
— Des questions, moi ? Quelles questions ?
— Primo, jusqu’à quelle date le maréchal entend-il garder en prison le camarade Ivanov, directeur du réseau Est du Transsibérien ?
— Ivanov est arrêté ?
— Depuis avant-hier, ainsi que j’ai l’honneur de vous l’apprendre. Ce n’est pas à nous de discuter les raisons que peut avoir Tchang-Tso-Lin de faire coffrer un haut fonctionnaire soviétique. Mais les résultats sont là : désorganisation des deux tiers du réseau, où tout ce qu’il y a d’employés bolcheviks s’est mis aussitôt en grève. Les approvisionnements en minerais que nous attendions du Chantoung et du Tche-Li sont suspendus sine die.
M. Mauconseil frappa la table du poing.
— La grève sur les deux tiers du réseau ! Nos approvisionnements suspendus ! Et vous me dites qu’il n’y a rien de nouveau ?
— J’ai spécifié : peu de chose, répliqua M. Schmidt, bonhomme. D’ailleurs, attendez, ce n’est pas tout.
— Quoi encore ?
— Deux marteaux-pilons ont été trouvés ce matin inutilisables. Avaries au tiroir de distribution du premier ; rupture du levier de commande du second. On s’occupe de les remettre en état. Mais il y en a pour trois solides journées de travail.
— Accident ou sabotage ?
— Sabotage, à n’en pas douter, articula aimablement M. Schmidt.
M. Mauconseil avait décroché son appareil téléphonique.
— Je préviens immédiatement la Place. Une enquête s’impose, et des sanctions…
M. Schmidt l’arrêta du geste.
— Je vous supplie de n’en rien faire, pour l’instant du moins, monsieur le directeur. Au lieu de déclencher les rigueurs des autorités, il serait préférable, à mon humble avis, de les tempérer.
— Qu’entendez-vous par là ?
— Voici : sept de nos ouvriers indigènes, qui comptaient comme par hasard parmi nos meilleurs ajusteurs, manquent depuis trois jours à l’appel. Renseignements pris, cinq sont en train de moisir dans les cachots du maréchal. Pour les deux autres, c’est plus grave : ils ont eu maille à partir avec la patrouille, et tout de suite après, avec le coupe-tête du bourreau de service. Je ne conteste pas leurs torts probables : tapage nocturne, rixes, et peut-être un peu de pillage. Le maréchal veut que l’ordre règne dans Moukden, c’est très bien. Mais avant de procéder à des emprisonnements et à des exécutions sommaires, je crois néanmoins que sa police aurait intérêt à vérifier si elle n’a pas affaire à des gens inscrits sur les rôles de l’arsenal.
M. Mauconseil leva les bras au ciel.
— Quel pays ! Le travail, dans de telles conditions, devient impossible.
— Il est à la vérité beaucoup plus difficile qu’en France. Mais je pense que c’est pour ce motif que nos appointements sont de beaucoup plus élevés.
Le directeur général regarda de travers son collaborateur.
— Votre résignation vous honore, dit-il aigrement. Je dois en conclure, n’est-ce pas, que tout sera prêt le 15 mai ?
— Oh ! mais non, dit M. Schmidt, oh ! mais non.
— Pourtant, nous avons formellement promis…
— Qu’y puis-je, mon cher directeur ! Laissez-moi d’abord vous rappeler que l’engagement dont il s’agit remonte au 1er octobre. À cette époque, M. Fontanille assurait encore les services techniques. Depuis, il y a eu sa maladie, son départ. À Paris, on a mis trois mois à lui donner un successeur, qui n’est point encore arrivé. Pendant ce temps j’ai été à toutes les sauces, mais cela n’a guère avancé la besogne. Il est de mon devoir de vous avertir que si M. Forestier n’est pas là le 15 avril, je déclinerai toute responsabilité.
— Rassurez-vous, dit M. Mauconseil.
Il venait de prendre sur son bureau la dépêche qu’il lisait un moment auparavant, et la tendait à Schmidt.
Le visage de celui-ci s’éclaira.
— Demain ! Forestier arrive demain matin ! Comment se fait-il ?…
— Lisez donc. Il a quitté à Shangaï le paquebot des Messageries Maritimes pour prendre, le jour même, le courrier japonais.
— C’est gentil à lui, dit Schmidt, il pouvait rester à Shangaï le temps de l’escale. Il a compris qu’ici nous étions dans le pétrin. Il a brûlé les étapes. C’est gentil à lui.
— C’est tout naturel, trancha M. Mauconseil.
Au-dehors, des sifflements de sirènes appelaient les ouvriers aux réfectoires. M. Mauconseil tournait et retournait entre ses doigts le télégramme de Forestier. Il semblait hésiter à poser une question. Finalement, il se décida.
— Mon cher ami, j’ai quelque chose à vous demander.
— Je vous en prie, monsieur le directeur.
— Je voudrais que vous me répétiez, de façon aussi précise que possible, ce que vous savez de M. Forestier.
Schmidt réprima un sourire. C’était la vingtième fois, depuis la nomination du successeur de M. Fontanille, que cette phrase revenait sur les lèvres de M. Mauconseil. Mais il avait bon caractère. En outre, la nouvelle de l’arrivée de Forestier l’avait mis d’excellente humeur. Il s’exécuta donc, de la meilleure grâce du monde.
— Ce que je sais de lui se ramène à bien peu de chose, monsieur le directeur.
— Dites toujours. Il est de votre promotion, je crois ?
— Oui.
— Cela doit lui faire environ quarante-cinq ans. Il est ridicule de n’avoir pas ici l’annuaire de l’École.
— Forestier doit avoir au moins deux ans de plus que moi, dit Schmidt, qui ne plaisantait pas avec les détails susceptibles de le vieillir.
— Il a dirigé, si je ne me trompe, une usine en Russie.
— Oui, monsieur le directeur. Au sortir de l’École, il a d’abord été ingénieur des Mines. C’est à ce titre qu’il a été placé à la tête d’une usine dans un des gouvernements de l’Oural. Il est rentré pour la Guerre, a fait campagne comme capitaine d’artillerie, a très vite été blessé. On l’a renvoyé à son usine, où il a fabriqué des munitions pour l’armée russe. Ce n’était pas la besogne qui manquait, vous le savez. La Révolution l’a surpris là-bas. Il n’a réussi à regagner la France qu’un ou deux ans après l’armistice.
— Ce sont des années qui n’ont pas dû être drôles pour lui ?
— Pas très drôles, évidemment.
Un instant, les deux hommes gardèrent le silence. M. Mauconseil cherchait parmi ses dossiers quelque chose qu’il finit par trouver : un fascicule à couverture bleu sombre.
— Précisément, je lisais ces jours-ci un article paru sous la signature de M. Forestier dans la Revue Métallurgique. Un article de premier ordre, vous entendez, de premier ordre. Forestier y traite cette question si mal connue des aciers à l’uranium. Vous n’ignorez pas que c’est l’Amérique qui a réussi jusqu’à présent à détenir le secret de la fabrication de ces aciers. Eh bien, pour qui sait lire entre les lignes, ce sacré Forestier paraît avoir soulevé un coin du voile. Il se garde naturellement de le crier sur les toits.
— Il n’a jamais passé pour très bavard, murmura Schmidt.
— Il a raison. Il a fichtrement raison. Dans un métier comme le nôtre, surtout ici, la discrétion est la première des qualités. J’espère que M. Forestier en a d’autres.
— Dans son usine russe, il avait, à ce qu’on dit, réussi à merveille, fit Schmidt, dont la politesse cachait mal une furieuse envie de s’en aller.
— Parfait. Il connaît donc les conditions très spéciales du travail dans les pays arriérés. Il est habitué à se tirer d’affaire avec un personnel de fortune. Autant de garanties ! Nous n’aurons, j’en suis sûr, qu’à nous louer de sa collaboration.
— Sans doute…
Schmidt s’était levé. Mais M. Mauconseil l’invita aussitôt à se rasseoir.
— Parfait. Et y a-t-il longtemps que vous n’avez rencontré M. Forestier ?
— Mon Dieu, n’est-ce pas, il va y avoir deux ans que je suis ici…
— Je sais, je sais, mais avant ?
— La dernière fois, dit Schmidt, résigné, c’était trois ou quatre mois avant mon départ de France, à un banquet d’ingénieurs.
— À un banquet, fit M. Mauconseil, voilà qui m’intéresse tout particulièrement.
— Des gens qui le connaissaient mieux que moi s’étonnèrent même de le voir là, car il n’a pas la réputation de raffoler de ce genre de réjouissances.
— Ah ! Ah ! Et pouvez-vous me dire, cher ami, si vous n’avez rien constaté de particulier, au cours de ce banquet ?
— Je ne saisis pas très bien…
— Oui, quelque chose, dans l’attitude, les manières, la façon d’être de M. Forestier.
Schmidt regarda froidement son chef.
— Monsieur le directeur général, dit-il avec lenteur, vous gagneriez peut-être à me faire davantage confiance.
M. Mauconseil s’agita, parut gêné.
— Excusez-moi, dit-il, excusez-moi. Vous avez raison. Mais ce dont j’ai à vous entretenir est si délicat. Il me faut compter absolument sur votre discrétion. Enfin, voici de quoi il s’agit. Comme suite à la dépêche qui nous a annoncé la nomination à Moukden de M. Forestier, j’ai reçu de Paris, il y a quelques jours, à son sujet une lettre fort importante. On y vantait ses qualités de dévouement, d’initiative, d’intelligence… De magnifiques éloges, vraiment. Seule, dans ce concert, une petite discordance. Il paraîtrait – votre parole d’honneur, n’est-ce pas ? – il paraîtrait donc que notre collègue aurait une fâcheuse tendance à s’adonner à la boisson.
Schmidt sursauta.
— On accueille donc dans nos dossiers des ragots semblables ? dit-il.
M. Mauconseil eut l’air de plus en plus gêné.
— Exceptionnellement, mon cher, exceptionnellement. Mais enfin mettez-vous à notre place. Nous avons besoin d’être renseignés, que diable ! Ici surtout, je dois être mis en garde. Pensez-y, un vice, un défaut de ce genre ! N’est-ce pas monstrueux ? Un polytechnicien qui boit !
— Si c’est vrai, concéda Schmidt, ce n’est pas en effet très reluisant. Tout de même, monsieur le directeur, il se peut aussi que ce soit une calomnie. Et puis, sapristi, il y a boire et boire. Tenez, en ce qui me concerne, je suis bien obligé de reconnaître qu’à l’occasion un cocktail, une bouteille de champagne sont loin de me faire peur.
— Hélas ! soupira M. Mauconseil, je ne souhaite qu’une chose, que Forestier ne boive pas plus que vous, car c’est vous qui êtes en train de vous calomnier, mon bon ami. Mais il s’agit d’envisager le pire. Admettons un instant que cette accusation soit fondée. Vous qui allez passer vos journées avec Forestier, habiter la même maison que lui, vous serez le premier à en avoir la preuve. Je ne vous demande certes alors rien qui puisse ressembler à de la délation. Usez simplement de toute votre influence sur votre camarade… C’est pour nous une question de prestige. Entourés d’étrangers comme nous le sommes…
Schmidt ricana.
— Les étrangers ? Parlons-en ! Toutes les nations sont représentées au Grand Cercle de Moukden. Ai-je besoin de vous apprendre que chaque soir que le bon Dieu fait, bien avant minuit, Anglais, Russes, Américains sont soûls comme des Polonais. Avec nous, il n’y a que les Japonais qui se tiennent… et encore !
— Raison de plus, dit avec force M. Mauconseil, raison de plus. Mais j’ai pleine confiance en vous, en votre doigté. Vous saurez ne faire appel à mon autorité qu’en dernier ressort…
Schmidt hochait la tête. Il paraissait assez ennuyé.
— J’entends bien, fit-il. Tout ça, c’est très joli. S’il y a cependant un fond de vrai dans cette histoire, j’assume tout de même là une fichue responsabilité.
— Je vous en exprime d’avance ma gratitude, répliqua dignement M. Mauconseil. Voyons, il est l’heure d’aller déjeuner. Tout est-il prêt pour recevoir M. Forestier ?
— Tout, non. Nous ne l’attendions pas si tôt.
— Eh bien, prenez votre après-midi pour veiller vous-même aux derniers détails de son installation. Qu’il ait tout de suite une impression agréable. Le train de Dalny arrive demain matin à sept heures et demie. Serez-vous à la gare ?
— Naturellement, dit Schmidt, j’y serai.
Les années précédentes avaient vu la déconfiture de la Banque Industrielle de Chine. À Moukden, la succursale de cette banque était installée à la lisière de la ville indigène, dans un bel immeuble, tout neuf et déjà délabré. Les bureaux, fermés et déserts, occupaient le rez-de-chaussée. Le premier étage était réservé à l’aimable fonctionnaire qui présidait avec une placidité résignée à la liquidation des affaires. Schmidt et M. Fontanille avaient trouvé asile au second étage, faveur sans prix dans une ville où il a toujours été quasi impossible de découvrir un logement à peu près correct.
C’était naturellement à M. Forestier qu’allaient échoir les deux pièces laissées vacantes à cet étage par le départ de son prédécesseur.
La nuit tombait. Il faisait froid. Assisté de deux boys, Schmidt avait vaqué tout l’après-midi à la mise en état de l’appartement de son collègue. L’heure n’était pas encore venue où il aurait à s’habiller pour dîner au Cercle, selon son habitude. Il ouvrit la fenêtre et alluma une cigarette.
L’énorme cité s’étendait devant lui, obscure, muette. À l’horizon, le noir rideau du ciel se soulevait sur une espèce de fournaise écarlate : l’arsenal continuait fiévreusement à pourvoir la vieille Asie barbare des bienfaits les plus perfectionnés de la civilisation européenne.
Quel immense silence hostile ! Il n’était rompu de loin en loin que par les hurlements des chiens déterreurs de cadavres. Un bruit de pas vaguement cadencé naquit, une patrouille passa. La lune poussiéreuse fit reluire des baïonnettes. Schmidt entrevit les casquettes plates des miliciens, leurs capotes roulées en fer à cheval. Une manière de géant fermait la marche. Celui-là n’avait pas d’armes, – seulement, sous le bras, une longue gaine de soie rouge… Le bourreau et son coupe-tête ! La justice du maréchal Tchang-Tso-Lin veillait.
Schmidt était trop familiarisé avec ce genre de spectacle pour y attacher quelque importance. Sa pensée allait surtout à l’homme qu’il attendrait, le lendemain, au train de Dalny. Ce pauvre Forestier ! Un brave garçon, mais de combien piètre apparence ! Un torse étroit, une myopie exagérée, des cheveux blonds, clairsemés et fades. Ah ! ce ne seraient pas ses bonnes fortunes, à celui-là, qui porteraient ombrage aux lovelaces de Moukden.
— Tel qu’il est, il aura du moins un mérite, celui de m’alléger de la moitié de ma besogne.
Cette perspective n’était pas pour déplaire à Schmidt. Il se mit à siffloter.
Un vent âpre soufflait, un vent qui venait du Nord, un vent qui, passant au-dessus des cimetières, arrivait tout chargé de cette odeur de charnier qui est le parfum national de la Chine. L’ingénieur ferma la fenêtre, fit jouer le commutateur électrique. Son smoking était préparé. Sur un guéridon, le boy avait disposé le seau à glace, le gobelet à cocktails, trois ou quatre bouteilles, dont une de gin, une de vermouth. Schmidt songea de nouveau à Forestier, au vice qu’on lui prêtait, de façon si inattendue. Il rit.
— Me voilà métamorphosé en bonne d’enfant, maintenant ! C’est égal, ils exagèrent un peu, à Paris. Qu’est-ce qu’il doit y avoir dans mon dossier, alors !
Ce dossier, il l’imaginait avec complaisance, tout bourré des détails de ses succès féminins.
C’était là, en effet, ainsi qu’il a été dit plus haut, le faible de M. Raymond Schmidt, ancien élève de l’École Polytechnique, directeur des services administratifs de l’arsenal de Moukden.
II
Le vent d’ouest chassait sur Moukden d’épais tourbillons d’un sable rougeâtre qui aveuglait les gens, encrassait les automobiles, faisait cligner les yeux des énormes chameaux à fourrure, venus en lente caravane du fin fond des déserts de Gobi. Debout à la fenêtre de sa chambre, Schmidt contemplait la morne descente du crépuscule en tapotant rêveusement la vitre. Dans la pièce voisine, il entendait les allées et venues de Forestier qui achevait son installation. Schmidt lui avait offert de l’aider. « Ce n’est pas la peine », avait-il répondu doucement. Son collègue n’avait pas insisté. Ne s’étant pas quittés un seul instant de la journée, et avec la perspective de se retrouver au repas du soir, ils aspiraient l’un et l’autre à quelques minutes de solitude.
Assez noctambule, moins par goût peut-être que par désir de soigner sa réputation de viveur, Schmidt avait eu à faire un effort pour se trouver le matin à la gare, à l’heure de l’arrivée du train. Un peu avant midi, il avait conduit Forestier à l’usine, où ils avaient été reçus par M. Mauconseil. Le directeur général s’était montré affable à souhait, et solennel. On était un samedi ; le régime de la semaine anglaise étant appliqué à l’Arsenal, la visite des services avait été renvoyée au lundi. Mais, sous couleur de mettre au courant son subordonné, M. Mauconseil, bien entendu, n’avait pas laissé perdre une telle occasion de se lancer dans une petite improvisation historico-économique. Il avait parlé de la situation en Chine, et particulièrement en Mandchourie, des intrigues des étrangers, de celles de Tchang-Tso-Lin et de son entourage. Actuellement, les affaires de la France étaient à Moukden en excellente posture, grâce à la grande firme industrielle qui avait su se faire octroyer la construction et la régie de l’Arsenal. À la fierté légitime qu’avaient le droit d’en concevoir les dirigeants de l’Arsenal en question correspondaient nécessairement une série de devoirs que M. Mauconseil énuméra avec éloquence. Il n’y avait rien dans son homélie que Schmidt n’eût entendu mille et mille fois. Multipliant les signes d’approbation qui lui permettaient de voiler sa parfaite indifférence, il s’était donc occupé surtout d’observer à la dérobée son nouveau collègue. Piètre sujet d’investigations ! Forestier écoutait sans mot dire, l’air recueilli, essuyant à tout bout de champ les verres de son lorgnon. De temps en temps il redressait, par un mouvement brusque, ses épaules qui recommençaient presque aussitôt à se voûter. Le visage était marbré aux pommettes d’une teinte rose de mauvais aloi. Les yeux étaient sans éclat. Forestier était bien entendu vêtu d’une jaquette. On songeait invinciblement à sa mise en bière, dans cette jaquette-là.
— Le jour où nous l’avons réexpédié, Fontanille avait meilleure mine, pensa Schmidt.
Au cercle, durant le déjeuner, les deux hommes avaient causé uniquement métier. La conversation de Forestier n’était pas sans charme. Sur les questions qui l’intéressaient, il était doué d’une certaine éloquence naturelle. Mais dès que Schmidt essayait de lui faire abandonner le terrain professionnel, il avait un sourire pâle, comme pour signifier à la fois son indifférence et son incompétence. Il ne répondait plus que par monosyllabes. Schmidt avait commandé du vin du Rhin. Son invité en but à peine. Il refusa café et liqueurs. Au début du repas, il avait repoussé avec une espèce d’horreur le verre de vodka que son hôte avait fait placer sournoisement devant lui.
— Eh bien, s’était dit Schmidt, voilà qui va me permettre de rassurer le père Mauconseil. C’est égal, parmi les gens qui rédigent nos notes, il y a de rudes imbéciles, ou de beaux saligauds.
Néanmoins, étant méfiant de nature, il estima qu’il y avait lieu d’attendre les quelques jours qui permettraient à son opinion de devenir définitive.
Les chambres des deux ingénieurs s’ouvraient sur un corridor commun. Il y avait un moment que tout bruit avait cessé dans celle de Forestier. Schmidt s’en vint frapper à sa porte.
— Je ne te dérange pas ?
— Tu plaisantes… Entre donc.
L’électricité était allumée chez Forestier. Il était assis à son bureau, déjà en train de travailler. Sa fenêtre était restée ouverte.
— Brr, fit Schmidt, tu n’es pas frileux.
— J’aime l’air ; mais si ça te gêne…
Il y avait quelque chose qui sonnait faux dans ce tutoiement auquel les astreignaient, pour le reste de leur vie, deux années passées, vingt ans plus tôt, à Polytechnique, deux années pendant lesquelles ils ne s’étaient pas peut-être en tout adressé dix fois la parole.
Forestier alla vers la fenêtre, dans l’intention de la fermer.
— Non, non, laisse, dit Schmidt. Moi aussi, j’aime l’air. Mais quand il est pur, autant que possible. À Moukden, moitié sable, moitié charbon, voilà sa formule. On est obligé d’aller respirer ailleurs. Aimes-tu la chasse ?
— Je m’y suis essayé, pendant la guerre, et les années qui ont suivi, moins par goût, je l’avoue, que par nécessité. En Russie, où je me trouvais, c’était un moyen pour ne pas mourir de faim. Mais mes efforts n’ont pas eu beaucoup de succès. J’étais fortement handicapé, à cause de ceci, tu comprends ?
Il souriait, en montrant son lorgnon, dont il était en train, comme par hasard, d’essuyer les verres. Schmidt sourit aussi. Il eût préféré, dans une battue, ne pas être le voisin immédiat de Forestier.
— Adroit ou pas, on refait toujours sa provision d’oxygène, dit-il. Pour moi, c’est une habitude. Chaque samedi, en compagnie de deux ou trois amis, je prends le train. Nous allons à l’affût, au bord du Yalou. Nous revenons complètement retapés. Et nous ravitaillons le Cercle en gibier, ce qui n’est pas non plus négligeable.
— Chaque samedi, fit Forestier. Alors, aujourd’hui, c’est à cause de moi que tu n’auras pas pu… Je m’excuse…
— Laisse donc. Cela n’a pas d’importance. D’ailleurs, mon compagnon ordinaire, notre consul ici, n’était pas libre. Nous en serons quittes pour aller demain matin tirer les canards sur la rivière. L’air y est moins pur, il y a moins de gibier, mais ça a l’avantage de n’être qu’à deux verstes de la ville.
— Deux verstes ? Ce sont les mesures russes qui sont employées à Moukden ?
— Oh ! fit Schmidt, j’aurais dit aussi bien une lieue, ou deux milles. Moukden, vois-tu, c’est la Société des Nations, la tour de Babel, la cour des Miracles. Il y a le rouble, le yen, la livre, le dollar américain, qui vaut actuellement près de trente francs, le dollar chinois qui en vaut dix-sept. N’empêche que ce dollar-là arrive tout de même à faire une assez jolie fortune, lorsque, comme le petit père Tchang-Tso-Lin, on a réussi à en garer une centaine de millions.
— Cent millions ! dit Forestier. Un milliard sept cents millions de francs ! Avec cela, on n’est pas à plaindre. Dis-moi donc…
Il s’arrêta devant la question qu’il voulait poser. Schmidt, occupé à passer l’inspection de l’appartement, ne l’écoutait plus. Il lisait les titres des volumes qui composaient la petite bibliothèque de son collègue. Étalés sur une table, des dossiers verts, bleus, roses, retinrent son attention. Chacun portait le nom d’un acier spécial, avec sa destination : aciers au nickel chromé (plaques pare-balles) ; aciers au molybdène (obus) ; aciers au vanadium (autos et trains blindés) ; aciers à l’uranium (canons)… quel contraste entre cette terminologie homicide et l’aspect inoffensif de ce petit homme voué par sa destinée à la confection des pires engins de mort ! Schmidt, si superficiel pourtant, ne put faire autrement que d’en être frappé.
— Bravo, dit-il enfin, bravo ! Chaque chose est déjà à sa place. Tu n’as pas perdu ton temps.
— Le boy m’a aidé, dit Forestier. Il m’a paru plein de qualités.
— Il n’en manque pas. Mais il n’a qu’un défaut.
— Lequel ?
Schmidt avait parlé trop vite. Maintenant, il ne pouvait plus reculer.
— Il… il va un peu fort sur la bouteille.
— Ah ! il boit, dit Forestier. C’est un défaut, en effet.
— Il y en a de plus graves, dit Schmidt.
— Oh ! évidemment, fit Forestier.
Le vent s’était levé. De brèves rafales de sable pénétraient dans la chambre. Forestier se décida à fermer la fenêtre.
— Si tu as besoin de quelque chose, reprit Schmidt, qui s’était tu un moment, ne va pas faire de façons avec moi. Moukden n’est pas riche en ressources. Mais j’y suis déjà depuis deux ans. Je sais m’y débrouiller. À ta disposition.
— Tu es bien gentil, mais je crois que j’ai tout ce qu’il me faut. À la vérité, je ne comptais pas trouver un logement aussi agréable. Dis donc…
Il hésitait. C’était la question de tout à l’heure que de nouveau il n’osait poser.
— Écoute : le loyer, il doit être élevé ? La vie est chère à Moukden, hein ?
— Elle n’est pas précisément bon marché. Mais, pour le loyer, ne t’inquiète pas. Nous sommes les hôtes de la banque. Trois cents francs par mois, une bagatelle. Partout ailleurs, ici, tu en aurais eu pour dix fois plus.
— En effet, c’est une chance, dit Forestier, rasséréné.
Il ajouta, baissant la voix.
— Par contre, je pense que le prix de la pension, au Cercle…
Le chiffre que donna Schmidt le fit légèrement tressaillir.
— Il n’est pas surprenant que dans un pays pareil, avec le change… Dis-moi, crois-tu qu’on consentirait à me faire un prix de demi-pension, seulement pour le repas du matin ?
— Bien sûr. Le Cercle a des habitués qui n’y prennent qu’un repas par jour. Par exemple, c’est le dîner qu’ils choisissent tous. Le travail de la journée est achevé. On éprouve le besoin de se délasser. Au Cercle, il y a de la musique. Je te conseille de faire comme eux.
Forestier demeurait perplexe.
— C’est que le soir, justement, j’aime bien rentrer chez moi. Je n’ai d’ailleurs à cette heure-là plus beaucoup d’appétit. Le boy pourra peut-être me faire cuire quelque chose ?…
— Oh ! tu n’auras pas de difficulté à t’arranger avec lui, dit Schmidt, qui n’insista plus.
— Je te remercie. Je m’en veux de t’importuner avec ces détails. Mais ils sont pour moi de première importance. Pourquoi ne pas te l’avouer franchement ? Je ne suis pas venu à Moukden avec l’intention d’y dépenser tout ce que je gagnerai. J’entends faire des économies.
Il inclina un peu la tête.
— J’ai une famille, tu comprends.
— Je comprends, dit Schmidt.
Cette conversation commençait à l’agacer prodigieusement. Mais il n’eut qu’à songer, lui qui avait craint d’avoir tout le temps Forestier sur le dos, qu’il en serait débarrassé chaque soir, à l’heure où l’existence devenait réellement sympathique. Cette perspective le rendit aimable.
— Confidence pour confidence, continua-t-il en riant, je n’ai pas encore trouvé à Moukden le moyen de faire des économies, moi. Mais enfin, avec les traitements que nous avons ici, il est certain que quelqu’un qui sort peu, qui n’a pas à compter avec les différences de bridge, les notes du bar, le champagne et les accessoires du Casino où il nous arrive parfois d’aller terminer nos soirées…
Forestier eut un sourire discret. Si de tels plaisirs, personnellement, ne lui disaient rien, il ne se reconnaissait sans doute pas le droit d’en dégoûter les autres.
— Eh bien, celui-là, acheva Schmidt, il est certain qu’il peut arriver à mettre, bon an mal an, une centaine de mille francs de côté.
— Cela m’arrangerait joliment, murmura Forestier.
— À présent, dit Schmidt, il est non moins certain que tu ne t’amuseras pas beaucoup.
Forestier eut un geste vague.
— De temps en temps, je t’accompagnerai à la chasse, si tu le permets, murmura-t-il.
Au milieu de sa table de travail, il y avait une photographie dans un cadre de peluche réséda. Le regard de Schmidt était posé sur elle. Forestier s’en aperçut.
— Ma famille, expliqua-t-il.
— Je vois, fit Schmidt.
Il était mal à son aise. Il cherchait à dire quelque chose, quelque chose qui ressemblerait à un compliment, tout au moins une formule de politesse. Il n’y réussissait pas.
Forestier prit le cadre et le lui tendit :
— Ma femme, ma femme et mes enfants.
— Je vois, répéta Schmidt.
Que trouver de plus, en effet, devant l’image de ces pauvres êtres ! La femme de Forestier était assise sur une chaise, au premier plan d’un paysage rococo. Elle serrait contre elle deux garçonnets de dix à douze ans. Trois visages ingrats, suppliants, comme apeurés.
Par-dessus l’épaule de Schmidt, Forestier regardait la photographie. Schmidt sentait ce regard. Il sentait aussi combien un tel silence, en se prolongeant, devenait pénible. Et il continuait à ne pas trouver la force de parler.
— Les bambins ont l’air bien intelligents, finit-il par dire.
Forestier lui lança un coup d’œil de reconnaissance.
— Sous ce rapport, nous n’avons pas à nous plaindre. C’est plutôt leur santé qui nous donnerait du souci, à leur mère et à moi. Ma femme non plus n’est pas très forte. Les années de guerre l’ont bien éprouvée.
— Tout le temps que tu as été retenu en Russie, elle n’a pas dû recevoir de tes nouvelles, hasarda Schmidt.
— Justement.
Il reprit :
— J’ai eu d’abord la pensée de les amener ici tous les trois. J’y ai vite renoncé. Ce n’était pas pratique. Il nous aurait été difficile de réaliser des économies. À quoi cela m’eût-il servi, alors, de m’expatrier ? Et puis, mes fils sont déjà grands. La photo que tu vois remonte à trois ans. Aujourd’hui, Claude a seize ans, Guy quatorze. Il y a leurs études qu’il ne faut pas interrompre. Ils suivent les cours du Collège Chaptal. Nous nous sommes résignés à nous séparer une fois de plus. Mais ma femme a eu du chagrin, beaucoup de chagrin… Tu comprends ?
— Je comprends, dit Schmidt.
Il se sentait envahi par une tristesse insupportable. Forestier en eut-il l’intuition ? Il lui enleva le cadre des mains, le reposa sur le bureau. Puis, enveloppant d’un long regard le pitoyable groupe :
— Les enfants, répéta-t-il tout bas, les enfants !
À sept heures et demie, ils quittèrent la Banque pour se rendre au Cercle. Schmidt avait exigé de Forestier que ce soir il fût son hôte. « Ce n’est pas la peine de t’habiller. Le jour de ton arrivée, tout le monde trouvera naturel que tu sois venu comme tu es. » Mais Forestier avait tenu à passer son smoking, un smoking un peu démodé, un peu fripé, préférable cependant à sa jaquette noire. Schmidt en poussa un soupir de soulagement.
— Tu as eu raison, dit-il, quand ils pénétrèrent dans le hall du Cercle. J’aperçois le père Mauconseil. À cheval comme il l’est sur l’étiquette…
L’assistance était nombreuse et variée. Ils retrouvèrent quelques compatriotes : le consul de France, des officiers attachés au centre d’aviation du maréchal, deux ou trois gros courtiers. Le reste était composé d’étrangers : Anglais, Américains, Russes, Chinois, Japonais. Le service était fait par des maîtres d’hôtel mandchous, en longues tuniques de soie bleu fumée.
— Je te préviens que nous dînerons avec le major Matsui, aide de camp du général Motono, qui commande la division japonaise d’occupation, avait dit Schmidt durant le trajet. Je l’ai invité la semaine dernière. Je ne pouvais pas le décommander. D’ailleurs, il t’intéressera beaucoup. Il est artilleur. Il a fait campagne chez nous, à l’état major de la 5e armée. Pour des raisons que je t’expliquerai, c’est quelqu’un avec qui il nous faut être en bons termes.
Baissant la voix, Schmidt avait précisé alors les attributions de l’aide de camp du général Motono. Dans cette monstrueuse Moukden de 1926, où la corruption, l’espionnage, la prostitution entremêlaient à l’envi leurs ténébreux rameaux, il exerçait des fonctions mystérieuses, facilitées par la connaissance approfondie de six ou sept langues.
— Le chef de la police de Tchang-Tso-Lin, Li-Kong-Siang, l’homme le plus redouté de la Mandchourie après le maréchal, n’est qu’un pantin entre les mains de Matsui.
Celui-ci les attendait au bar, visage de buis, souriant et fermé. Très élégant, il n’avait eu garde d’oublier à son smoking la rosette de la Légion d’honneur. Schmidt poussait devant lui son compagnon. Après l’horreur lépreuse des quartiers qu’ils venaient de traverser, Forestier était ébloui par ces lumières, ce luxe imprévu, ces uniformes… Juchées sur les tabourets du bar, leurs chalumeaux plongeant dans des gobelets de liqueurs multicolores, des femmes aussi étaient là, pour la plupart des femmes d’officiers de l’ex-armée czariste. Après avoir tenu leur bout de rôle dans les sanglantes aventures de Koltchak, de Hungern ou de Semenov, leurs maris servaient, avec le fatalisme de la race, dans l’armée de Tchang-Tso-Lin. Presque toutes étaient belles. Leurs bras, leur gorge se couvraient d’émeraudes et de rubis qui, véritables, eussent valu des fortunes… les répliques, sans doute, des pierres qu’au temps de la Sainte Russie, elles avaient vraiment portées.
— Mesdames, dit Schmidt avec désinvolture, je vous amène un oiseau rare, oui, un Français qui parle votre langue. Toi, si j’ai un conseil à te donner, c’est de ne pas faire ici l’éloge des bolchevicks. Mais soyez tranquilles : il n’a pas eu, si je ne m’abuse, assez à se louer d’eux pour que j’aie des craintes sérieuses à ce sujet.
La table où prirent place le major Matsui et les deux ingénieurs était dressée à côté de celle de M. Mauconseil, qui dînait lui-même en compagnie du colonel Veraguine, commandant le régiment de la Garde mandchoue, et du général Kobayashi, chef de la deuxième brigade d’infanterie japonaise.
Le repas, de part et d’autre, fut gai. Forestier s’était déridé. Il écoutait avec une attention passionnée le major Matsui qui évoquait ses souvenirs de la guerre russo-japonaise. Schmidt faisait des mots, assez haut pour être entendu de ses belles voisines, avec qui il échangeait des sourires complices.
Lorsqu’on se leva, M. Mauconseil le prit à part.
— Je tiens à vous dire que je suis ravi. Votre collègue m’a produit ce matin la meilleure impression. C’est un garçon de premier ordre. Je crois maintenant que nous pouvons être en repos, pour la livraison du 15 mai.
— Je le crois aussi.
— Voilà qui me tire une rude épine du pied. Je suis ravi, ravi. Quant à la petite chose, vous savez, la crainte que je vous exprimais hier…
— Je ne vous comprends pas, fit Schmidt, raide.
— Eh oui, voyons…
Il lui dit quelques mots à l’oreille. Schmidt haussa les épaules.
— Il me semble, dit-il sèchement, que je n’ai pas à vous rassurer sous ce rapport. Pendant tout le dîner, j’ai cru m’apercevoir que vous ne nous perdiez pas de vue. Vous avez donc pu vous rendre compte que qui vous savez n’a pas bu, en tout et pour tout, un verre de vin.
Il murmura, riant sous cape :
— Tout le monde ne pourrait peut-être pas en dire autant.
— Je m’en suis rendu compte, fit précipitamment M. Mauconseil, qui paraissait en effet un peu congestionné. Tout va bien, donc, tout va très bien. À lundi, cher ami. Je vous attends tous deux. Nous procéderons à l’installation de ce brave, de cet excellent Forestier. À propos, réservez l’un et l’autre votre soirée de samedi. Je suis heureux de vous apprendre que nous avons l’honneur d’être invités ce jour-là chez le maréchal.
— Quelle scie ! grommela Schmidt, quand son directeur général l’eut quitté. Ma partie de chasse de la semaine prochaine qui est encore à l’eau !
Il alla retrouver au bar Forestier et le major Matsui.
— Il est à peine onze heures et demie, dit le Japonais. Vous accepterez bien une bouteille de champagne au Midnight Sun, n’est-ce pas ?
Schmidt hocha la tête :
— Vous savez, mon cher commandant, que je n’ai pas pour habitude de me faire prier. Mais aujourd’hui, à cause de mon ami… Il a voyage toute la nuit en chemin de fer. Il doit avoir besoin de repos.
Il s’était lui-même levé de bonne heure, et se sentait assez fatigué.
Tel fut, au cours de cette première journée, l’emploi du temps de M. Charles Forestier, ancien élève de l’École Polytechnique, directeur technique de l’Arsenal de Moukden.
III
Et toujours cette poussière rougeâtre, que semblaient déverser d’inépuisables sources suspendues dans le firmament. En dépit du froid, très vif encore pour la saison, on en éprouvait une sensation d’étouffement. Une triste lune de cuivre glissait avec lenteur derrière ce rideau sablonneux, et venait par moments s’ébrécher à l’un des créneaux biscornus de la citadelle. Des appels rauques retentirent, suivis du choc sourd de crosses de fusil sur le pavé. Une porte cochère s’ouvrit, découpant un rectangle lumineux dans la face noire du palais. C’étaient les convives du maréchal qui se retiraient.
Une dizaine d’automobiles attendaient au-dehors, devant le poste de garde. Elles avaient sur leurs capots, éclairés par les lanternes sourdes de soldats qui allaient et venaient, de petits pavillons indiquant la nationalité de leurs propriétaires. Ceux-ci prirent congé les uns des autres. Le major Matsui monta dans l’automobile de M. Mauconseil, ainsi que Schmidt et que Forestier. Le directeur général de l’Arsenal avait donné à ses deux collaborateurs rendez-vous au Cercle, avant le dîner. Ils y avaient rencontré Matsui, invité lui aussi chez Tchang-Tso-Lin. M. Mauconseil lui ayant offert une place dans sa limousine, il avait accepté et renvoyé son chauffeur.
Maintenant, ils filaient à toute vitesse à travers l’immense cité déserte. Ils se taisaient.
— Soirée des plus agréables, dit enfin M. Mauconseil. N’est-ce pas, commandant ? N’est-ce pas, Messieurs ?
— Des plus agréables, dit placidement le Japonais.
— Des plus agréables, mais pas des plus nutritives, grogna Schmidt.
M. Mauconseil lui lança un regard de reproche.
— Je ne vous comprends pas. Le maréchal a été charmant.
— Il ne s’agit pas de Tchang-Tso-Lin, mais des plats qu’il nous a servis. Je commence à en avoir assez des œufs faisandés, du potage aux ailerons de requin, et des champignons du Seu-Tchouen à la crème vanille.
— Vous êtes injuste, Schmidt. N’êtes-vous pas de mon avis, commandant ?
— Monsieur le directeur, dit Matsui, ce n’est évidemment pas à moi de faire le procès de la cuisine asiatique. J’oserai vous avouer néanmoins que je n’ai l’intention de me coucher qu’après avoir essayé de découvrir dans Moukden une aile de poulet ou une tranche de rosbif.
— Vraiment, fit M. Mauconseil, rêveur. Eh bien, tenez, comme c’est étrange : à vous entendre parler de la sorte, il me semble qu’à moi aussi il me vient un certain appétit.
L’automobile avait franchi les limites de la ville chinoise. Elle s’engageait sur le chemin de la Gare, à côté de laquelle était située la maison du major Matsui.
— Monsieur le directeur général, dit hypocritement Schmidt, nous ne voulons pas vous astreindre à nous ramener jusque chez nous les uns et les autres. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par vous déposer, et vous nous autoriserez à garder la voiture…
Parlant ainsi, il poussait légèrement du genou le genou de Matsui.
— Jamais de la vie, protesta M. Mauconseil, outré rien qu’à la pensée d’un tel manque de savoir-vivre, jamais de la vie ! Je vous raccompagnerai tous les trois. C’est la moindre des choses. Il n’est pas tard, d’ailleurs. À peine dix heures et demie…
— Vous êtes trop aimable, monsieur le directeur, dit le Japonais qui avait compris l’appel de Schmidt. Mais ce n’est pas la peine d’aller jusque chez moi. Voulez-vous avoir simplement la bonté de me laisser au Cercle. C’est encore là que je trouverai le plus aisément de quoi corriger l’exotisme un peu agressif des sauces du maréchal.
Schmidt n’eut garde de manquer l’occasion qu’il avait ainsi provoquée.
— Si vous le permettez, mon cher directeur, je resterai avec le commandant.
— Entendu, dit M. Mauconseil.
L’automobile fut bientôt devant la porte du Cercle. Ses quatre occupants descendirent. Il y eut alors de part et d’autre une seconde d’hésitation. Schmidt et Matsui attendaient que M. Mauconseil prît congé d’eux. Mais il tardait à le faire.
— Vous êtes là pour longtemps ? demanda-t-il enfin.
Matsui garda le silence. Forestier, naturellement, se taisait. Il n’avait pas la direction des opérations.
Ce fut à Schmidt qu’échut la responsabilité de répondre.
— Pour longtemps, non, mon cher directeur. Notre ami Matsui désire se restaurer un peu. Et, de mon côté, ainsi que je vous le disais tout à l’heure…
— Parfait, dit M. Mauconseil, puisqu’il ne s’agit que de quelques instants, je resterai avec vous. Car, moi aussi, j’ai faim décidément.
Schmidt lança à Matsui un coup d’œil de détresse. Le Japonais riait sous cape. Il devinait qu’il n’était pas dans les projets de l’ingénieur d’achever la soirée dans une compagnie aussi solennelle.
— Vous êtes mes invités, comme il convient, reprit M. Mauconseil. Entrons. Venez, Forestier.
— Monsieur le directeur, dit Schmidt, qui tentait de se raccrocher à une dernière branche de salut, je crois que… Forestier n’osera sans doute pas vous l’avouer…
— Quoi donc ?
— Il a l’habitude de travailler chaque nuit très tard. Il se lève le matin de très bonne heure. Sans doute préfère-t-il rentrer.
— Eh bien, pour une fois, il fera une exception, n’est-ce pas, Forestier ? Mon cher ami, mieux que personne, je suis au courant de l’effort que vous fournissez. Je suis heureux de vous en exprimer publiquement ma gratitude. Non, non, ne protestez pas. Je sais, je sais. Mais enfin, trop est trop, mon cher. Il faut de temps en temps se distraire un peu, que diable ! C’est votre chef qui vous le dit. Allons, venez.
— À vos ordres, monsieur le directeur général, murmura Forestier.
Ils s’assirent devant des assiettes de viandes froides et deux bouteilles de champagne. M. Mauconseil emplit lui-même les coupes, tout en continuant à faire le panégyrique de Forestier.
— Je dois me rendre cette justice : il ne m’a pas fallu longtemps pour savoir à qui j’avais affaire. Dès que j’ai vu M. Forestier…
— Et même sans doute avant de l’avoir vu, susurra M. Schmidt.
— Quoi ?
— Rien.
— Je poursuis : dès que j’ai vu M. Forestier, j’ai compris que j’avais enfin sous la main l’homme qu’il me fallait, qui m’avait fait défaut jusqu’à présent. Ceci n’est pas une critique à votre adresse, Schmidt.
— J’en suis persuadé, monsieur le directeur.
— Et vous avez raison. Je connais vos qualités. Je suis le premier à les apprécier. Celles de Forestier sont d’un ordre différent, d’un ordre qui… un ordre que… je m’entends. Mais que cette soirée est donc agréable ! Mon cher Forestier, croyez-en ma vieille expérience, il faut savoir s’amuser un peu, à l’occasion. Buvez, Schmidt. Buvez, commandant. Buvez, Forestier. Encore une fois, vous êtes mes invités, Messieurs.
Ils choquèrent leurs coupes. Forestier reposa la sienne intacte sur la table. M. Mauconseil ne s’en aperçut pas.
À part eux, la salle ne contenait plus que deux officiers russes, qui achevaient une partie d’écarté, et un Anglais apoplectique, somnolant entre les bras d’un fauteuil de cuir vaste comme une baignoire. Les laquais mandchous s’étaient arrêtés d’aller et de venir. Collés comme de gigantesques chauves-souris contre les murailles, ils surveillaient les commutateurs électriques, attendant l’instant où ils auraient le droit de plonger le hall dans l’ombre.
M. Mauconseil soliloquait toujours. Matsui l’écoutait avec son éternel sourire poli et glacé. Les lèvres de Schmidt se crispaient légèrement. Il tirait sa montre, multipliant à la dérobée des signes que le Japonais, ironique et impassible, s’obstinait à ne pas voir. La même expression de déférente lassitude continuait à régner sur le visage souffreteux de Forestier.
Étonné par le silence dans lequel tombait maintenant chacune de ses paroles, M. Mauconseil se décida lui aussi à regarder sa montre.
— Il va probablement être l’heure… Fichtre, minuit moins le quart ! Allons, allons, les meilleures choses doivent avoir une fin… Cette fois-ci, il est grand temps que je vous reconduise.
Le manège de Schmidt, en cette minute, devint une chose bien curieuse à observer. Matsui n’en perdait pas un détail. Il connaissait les habitudes de l’ingénieur, et savait qu’il n’avait pas mis dans ses projets de se coucher si tôt. Comment allait-il s’y prendre pour se débarrasser de M. Mauconseil et de ses prévenances obstinées ? L’instant était décisif, car tous quatre, ils étaient debout, en train de revêtir leurs pardessus, qu’un des laquais mandchous venait d’apporter, avec une hâte mal dissimulée. Matsui était aux aguets du moindre geste de Schmidt. Il le vit sourire. Il comprit qu’il avait gagné.
— Eh bien, messieurs ? fit M. Mauconseil.
— Mon cher directeur, commença Schmidt, alors, de sa voix la plus douce, nous avons une petite requête à vous présenter.
— Une requête ?
— Mais oui. Nous avons été vos invités ce soir. À présent, vous poussez l’amabilité jusqu’à vouloir nous raccompagner chez nous. Souffrez que nous vous prouvions auparavant notre gratitude. Acceptez de prendre avec nous une dernière bouteille de champagne. Une soirée passée en votre compagnie est une aubaine si rare qu’il ne faut pas nous en vouloir, si nous désirons prolonger celle-ci.
M. Mauconseil hésitait, à la fois surpris et charmé. D’une part, il était flatté, et le champagne l’avait mis en train. D’autre part, l’heure était si avancée !…
— Il est bien tard, objecta-t-il sans conviction.
— Faites-nous ce plaisir, insista Schmidt.
— Le Cercle est sur le point de fermer…
— Rien ne nous force à rester au Cercle.
Séduit par le tour cocasse qu’il voyait prendre aux choses, Matsui vint à la rescousse.
— Je joins mes instances à celles de M. Schmidt, monsieur le directeur.
— Vous êtes trop aimable, commandant. Mais, encore une fois, il est tard. Et il faudrait savoir où aller…
— Il me semble que le Midnight Sun…
M. Mauconseil eut un haut-le-corps.
— Cet endroit, où il paraît que vous passez toutes vos nuits ? fit-il, se tournant vers Schmidt.
— Plaît-il ?
— C’est ce qu’on dit, du moins.
— Oh ! fit Schmidt avec philosophie, vous savez, mon cher directeur, on dit tant de choses. Tant qu’on ne les consigne pas par écrit dans les dossiers des pauvres diables !…
M. Mauconseil lui coupa précipitamment la parole.
— Je ne demande pas mieux que de vous suivre. Mais enfin, au préalable, je désirerais savoir, être certain… Commandant, comprenez ma perplexité : un homme de mon âge, de ma situation, peut-il sans inconvénient, selon vous, être vu dans un… établissement de ce genre ?
— Personnellement…, commença Matsui.
— On m’a dit que c’était un endroit à femmes.
— Incontestablement, dit Schmidt. Vous commencerez par y retrouver toutes nos belles amies du Cercle.
— Ce n’est pas celles-là dont je parle.
Schmidt prit un air offusqué.
— Cher Matsui, il vous est aisé de rassurer d’un mot notre directeur et de lui dire qu’un homme de l’âge, de l’importance du général Motono, ne serait pas un des plus fidèles habitués de cette maison si elle n’était pas des plus correctes.
— Vraiment, fit M. Mauconseil, le général Motono ?… Dans ces conditions, évidemment…
Il était visible qu’il ne demandait qu’à voir lever ses derniers scrupules. Sa curiosité était excitée au plus haut point. Mais il croyait devoir paraître hésiter encore.
— Forestier, que vous en semble ?
— Il est de notre avis, dit Schmidt. Allons, voilà qui est entendu. Partons, nous empêchons ces braves serviteurs de s’aller coucher.
L’automobile de M. Mauconseil les attendait au bas du perron. Ils ne la prirent point, sur les instances de Schmidt : « Dix minutes à peine. Le vent était à peu près tombé. Ce serait un véritable plaisir d’aller à pied. » L’ingénieur tenait surtout à recevoir les compliments de Matsui, qui fermait avec lui la marche. Encore que le tour que prenait l’aventure ne fût pas sans l’amuser, celui-ci ne les lui prodigua que modérément, un peu froissé peut-être d’avoir vu abuser de la sorte du nom de son chef. Le général Motono, gouverneur de Moukden, un familier du Midnight Sun ! En réalité, ce haut dignitaire n’avait guère franchi qu’à deux ou trois reprises les portes de l’établissement en question. Et Matsui avait les meilleures raisons du monde pour savoir qu’il n’y avait jamais été conduit par un goût particulier de la bagatelle.
M. Mauconseil, son bras passé sous celui de Forestier, continuait à discourir avec animation.
— Eh bien, cher ami, que dites-vous de cette soirée ? Vous ne pensiez pas qu’à Moukden l’on s’amusât de la sorte. Moi-même, tout à l’heure, chez le maréchal, me serais-je douté ! Mais il faut bien prendre un peu de bon temps. Soyez tranquille, vous me trouverez, lundi matin, dans mon cabinet, fidèle au poste. Entre nous, en attendant, j’aime autant que demain soit dimanche. Sacré Schmidt ! Oh ! mais, oh ! mais, je n’en suis pas à mon coup d’essai, vous savez. Sacré Schmidt ! Il croit m’étonner en nous entraînant où il nous entraîne. C’est lui qui va être surpris. Car je suis d’une génération où l’on savait ce que c’est que de s’amuser. Votre génération, à vous, a ses qualités, mais elle est morose. Comme elle est morose ! Nous, c’était autre chose. Tenez, un petit fait, entre cent, entre mille, entre dix mille. C’était en 1889, l’année de l’Exposition. Je venais d’entrer à l’École, numéro 7. J’en suis sorti avec le numéro 9, c’est entendu, mais huit jours avant l’examen j’avais perdu ma mère, ma pauvre mère. Des émotions de ce genre excusent bien un recul de deux places, n’est-il pas vrai ? Il ne faut pas craindre de faire entrer de temps en temps en ligne de compte le coefficient sentimental. J’en reviens à l’année de l’Exposition. Eh bien, cette année-là, savez-vous ce que nous avons fait, moi et mon ami Marivon, le fils du professeur de mécanique rationnelle et appliquée ? On organisait un festival au profit de l’Orphelinat de l’École. Moi et Marivon, nous pariâmes que nous obtiendrions le concours de la délicieuse Vivette Grandier, l’étoile des Folies-Bergère. Nous nous rendîmes tous les deux dans sa loge, en matinée. Quelle belle, quelle superbe fille ! Et quelle loge ! Pleine de fleurs et de bronzes de chez Barbedienne ! Je passe sur les détails. Qu’il vous suffise de savoir que quand nous ressortîmes, j’emportais son acceptation, et sa photographie dédicacée. Un exemple entre cent mille, encore une fois, mais qui doit suffire à vous démontrer qu’un familier des Folies-Bergère a peu de chances de se sentir dépaysé dans un café-concert de Moukden.
Il buta, manqua de tomber. Forestier le retint avec déférence.
— Merci ! Je vous remercie. Pas trop de champagne, à présent. Forestier, mon cher ami, mon enfant, vous veillerez à ce que ce sacré Schmidt, ce damné Matsui ne commandent pas trop de champagne. Ah ! et puis autre chose. J’aurai certainement un jour l’occasion de vous présenter Mme Mauconseil, de même que j’espère bien moi aussi avoir l’avantage de connaître Mme Forestier. Ce jour-là, pas un mot à ma femme, naturellement. De mon côté, je m’engage… À propos, où donc est Schmidt ? Il ne faut pas que j’oublie de lui faire la même recommandation.
Les précautions auxquelles il s’astreignait d’ores et déjà, en dépit du champagne et de douze mille lieues de distance, pour que Mme Mauconseil, dans son bel appartement de la rue de Prony, et Mme Forestier, dans son petit cinquième de la rue Tourlaque, ne fussent pas instruites des fredaines de leurs maris, ces précautions étaient incontestablement tout à l’honneur de l’esprit méticuleux de M. Mauconseil.
— Schmidt ! Eh bien, Schmidt ?
— Nous arrivons, nous arrivons, monsieur le directeur.
Ils avaient parcouru un peu plus de la moitié du trajet. La grande automobile de M. Mauconseil suivait respectueusement, à vingt pas en arrière. Abandonnant l’avenue plantée de hautes maisons en briques qu’ils avaient descendue depuis leur sortie du Cercle, ils tournèrent à gauche, prirent une voie plus étroite. Le froid augmentait. La nuit était sombre. De rares étoiles piquaient de trous imperceptibles le satin jaune du ciel mandchou.
M. Mauconseil parlait toujours. Forestier écoutait, s’efforçant de ne pas se laisser distraire par les chuchotements de Schmidt et de Matsui. La rue, jusqu’alors à peu près déserte, s’animait à présent d’une étrange vie nocturne. Des femmes en manteau de soirée, des hommes en habit, le col de la pelisse relevé, marchaient au milieu de la chaussée, parlant très fort, paraissant ivres. Des ombres silencieuses rasaient furtivement les murailles. De temps en temps, une porte s’entrouvrait, livrant au regard quelque mystérieuse salle fuligineuse, d’où sortait une odeur âcre et écœurante, semblable à celle du chocolat brûlé. Un phonographe jouait un air chinois, atrocement aigre et plaintif. Des trous obscurs, latéralement, béaient, amorçant des ruelles dans les ténèbres desquelles on avait les meilleures raisons du monde de ne pas s’engager. Des phonographes encore. Des rires sourds. Des appels voilés. Un étonnant mélange de barbarie raffinée et de civilisation louche.
Machinalement, le directeur général et Forestier ralentirent le pas pour attendre leurs compagnons.
— Quelle drôle de ville que Moukden, n’est-ce pas, commandant ? murmura M. Mauconseil.
Le major Matsui hocha la tête.
— Peu de chose à côté de Kharbine, oui, peu de chose, se borna-t-il à répondre.
Ils franchirent encore une cinquantaine de mètres. L’enthousiasme de M. Mauconseil semblait diminuer, être sur le point de l’abandonner.
— Dites-moi, Schmidt, si c’est encore loin, nous pourrions bien monter dans l’auto…
— Nous arrivons, mon cher directeur, nous arrivons.
Effectivement, ayant dépassé un coude de la rue, ils se trouvaient soudain en présence d’un vaste bâtiment flambant d’ampoules électriques multicolores. Quantité d’automobiles se pressaient là, qui s’écartèrent, sur un ordre sec du major Matsui, pour faire place à la limousine de M. Mauconseil.
— Eh bien, fit celui-ci, vous n’avez pas besoin d’être en uniforme, vous, au moins, pour être obéi. Mais c’est qu’il y a l’air d’avoir un monde fou. Je n’en reviens pas.
— Je vous avais prévenu, dit Schmidt, rayonnant. L’endroit le plus sélect de Moukden. Vous allez voir ! Vous allez voir !
Ils atteignirent sans trop de bousculade le seuil de ce bizarre paradis. Déjà un petit monsieur chauve et replet, sanglé dans un smoking impeccable, multipliait devant Matsui force courbettes. En cet instant, un scrupule vint à Schmidt, de la façon la plus inattendue. Il aperçut en pleine lumière le visage de Forestier. Il se sentit envahir par un inexprimable malaise.
— Monsieur le directeur, dit-il, se mettant tout à coup à chercher ses mots, notre ami est habitué à se coucher de bonne heure. Peut-être conviendrait-il… oui, il vaudrait sans doute mieux le laisser rentrer chez lui. Votre automobile pourrait le reconduire… Elle reviendrait ensuite vous chercher.
M. Mauconseil leva les bras au ciel.
— Mais naturellement, dit-il, impatienté. En voilà des histoires. Forestier, mon cher, à entendre Schmidt, on dirait que c’est moi qui vous ai traîné de force ici. Rentrez, si le cœur vous en dit, rentrez.
Une seconde, Forestier parut hésiter. Puis sa timidité reprit le dessus. Il sourit faiblement.
— Pas du tout, monsieur le directeur, pas du tout. Je suis trop heureux, au contraire…
— Bravo ! voilà qui est parlé ! s’exclama M. Mauconseil, décidément très en forme. Eh bien, nous sommes d’accord, je pense.
— Soit, dit Schmidt.
Et ils entrèrent.
IV
Les marques de déférence prodiguées au major Matsui par le directeur du music-hall où ces messieurs venaient de pénétrer dépassaient de beaucoup les égards auxquels peut prétendre un client ordinaire. Elles évoquaient bien plutôt l’attitude d’un subalterne vis-à-vis d’un chef redouté.
M. Sevastopoulo, le directeur en question, n’en réunissait pas moins toutes les vertus du négociant le plus habile. Dès l’origine, il n’avait pas manqué de souligner le caractère nettement international de son entreprise. Ici, tout le monde en avait pour son amour-propre patriotique, en même temps que pour son argent. La décoration extérieure de l’établissement figurait, en manière d’enseigne, grâce à un judicieux éclairage électrique, les pavillons japonais et mandchou. À droite et à gauche, des ampoules d’un bleu criard proclamaient, dans les langues des deux nations européennes qui se disputaient à Moukden la suprématie, la raison sociale de cette estimable exploitation. Midnight Sun, Soleil de Minuit : les habitués du lieu usaient indifféremment, à l’occasion, de chacun de ces vocables.
— Monsieur le commandant, messieurs, que Vos Excellences veuillent bien se donner la peine !… C’est pour moi un immense honneur !… La représentation vient à peine de commencer. Nous avons ce soir des débuts véritablement sensationnels.
Les lieux de plaisir ont tous sans doute le même cachet sinistre. Mais ils constituent une vaccine dont il faut posséder le certificat, et leur condamnation n’est recevable que de la part de qui en a la pratique. Était-ce le cas de Forestier ? Non, probablement. Du moins, en l’occurrence, il avait le bon goût de se taire, de ne point paraître choqué. Il était doué du sens des convenances, et aussi de celui de la hiérarchie. La présence de son chef le couvrait.
M. Sevastopoulo conduisit ses hôtes à la loge d’honneur, une sorte de box poisseux que meublaient des fauteuils d’osier disposés autour d’une table de marbre. Il veilla à leur installation, tint à déboucher lui-même les bouteilles de champagne commandées par le major Matsui. Et il se retira, répétant avec un bon sourire :
— La représentation vient à peine de commencer.
Il était minuit et demi environ, et cependant M. Sevastopoulo ne mentait guère. Tel avait été en effet son trait de génie, lorsque, deux ans auparavant, il avait fondé ce Soleil de Minuit, depuis lors de plus en plus prospère : il avait posé en principe qu’il est préférable dans la vie de faire attendre que de débuter prématurément. La clientèle de choix se montre toujours reconnaissante envers qui ne la brusque point. Et qu’importe, je vous le demande, qu’un spectacle ne se termine pas avant deux heures du matin si cette prolongation a pour conséquence un accroissement du chiffre d’affaires. À partir d’un certain moment, la consommation du champagne cesse d’être arithmétique pour devenir géométrique. Et les pauvres filles que la maison paie, avec Dieu sait quelle parcimonie, finissent elles-mêmes par y trouver leur compte. Plus la nuit avance, plus le consommateur recule devant la perspective de la terminer seul. M. Sevastopoulo n’ignorait rien de tous ces détails de son métier. Sa réussite était morale, méritée.
La scène représentait un salon Louis XV. Une jeune femme, soulevée par un enthousiasme relatif, était en train d’y achever son tour de chant. Deux projecteurs, l’un blanc, l’autre rouge, de leurs feux entremêlés, sculptaient avec violence ses bras, ses épaules, sa gorge bleutée. Quand elle disparut, sans espoir de retour, accompagnée d’applaudissements discrets, un grand silence naquit dans la salle et la lumière – une dure lumière – surgit.
— Très amusant, dit M. Mauconseil, qui tenait à paraître à la page. Et quel est le nom de cette aimable personne ?
— Nastasia, je crois, répondit Schmidt, négligemment. N’est-ce pas, Matsui ?
— Oui, fit le Japonais, Nastasia. D’ailleurs, vous le savez aussi bien que moi.
C’était l’entracte. En dépit de l’éclairage revenu, la loge où ils se trouvaient demeurait sombre. Schmidt et Matsui, insidieusement, avaient placé Forestier et M. Mauconseil au premier rang. Eux-mêmes demeuraient au fond, côte à côte, formant ainsi le centre de ce petit bataillon sacré.
Le directeur général lorgnait l’assistance.
— Je ne vois pas le général Motono.
— C’est jouer de malheur, dit Schmidt. Il n’y a pas plus assidu que lui. Par contre, vous pouvez constater la présence de toutes nos amies du Cercle.
Elles étaient là, en effet, les belles dames russes, les femmes des mercenaires de Tchang-Tso-Lin. Elles occupaient les loges qui s’arrondissaient en fer à cheval autour de la salle. Cette salle n’était qu’un vaste café. D’autres femmes, les « artistes » de la maison, allaient et venaient de table en table, à l’affût des bouteilles de champagne à faire ouvrir, s’asseyant quelques instants, repartant lorsque ces bouteilles tiraient à leur fin, et qu’il paraissait peu vraisemblable qu’on en commandât d’autres.
M. Mauconseil jubilait. Forestier laissait traîner sur cet ensemble son triste regard mal éveillé d’oiseau de nuit.
— Dites-moi, savez-vous que parmi ces enfants, il en est de tout à fait appétissantes ? Schmidt, sacré farceur, je parie, hein, que vous connaissez leurs noms à toutes. Comment s’appelle celle-ci, la grande, avec une robe rose et or ?
— Liouba. Elle a fini de chanter. C’est dommage. Vous l’auriez entendue. Elle n’est pas sans talent.
— Et l’autre, là-bas, la brune, qui passe le long des loges ?
— Katia, une danseuse, une brave fille.
— Katia… Tiens, elle s’arrête devant une baignoire. Mais, ma parole, c’est à la femme du colonel Pétrof qu’elle parle. Comment Mme Pétrof peut-elle !…
Schmidt haussa doucement les épaules.
— Russe, elle est Russe comme elle, monsieur le directeur. Femmes du monde ou prostituées, toutes, ici, sont Russes. Elles ont assisté à trop de bouleversements pour avoir encore de l’orgueil ou de l’humilité. Et Katia n’envie point la colonelle Pétrof, et la colonelle Pétrof ne méprise pas Katia. Un tour de roue de la fortune et l’une – elles le savent toutes deux fort bien – peut du jour au lendemain se trouver à la place de l’autre.
M. Mauconseil eut une moue.
— Hum ! Je veux bien, moi. Après tout, ça regarde le colonel Pétrof. Il a d’ailleurs l’air de trouver cela naturel. C’est égal, je ne me vois pas autorisant Mme Mauconseil… Qu’en pensez-vous, Forestier ?
— Forestier a vécu en Russie, dit Schmidt. Je présume qu’il est blasé.
Le directeur général n’insista pas. Il était occupé à suivre avec un extraordinaire intérêt chacun des gestes de la danseuse.
— Elle a fini de causer avec les Pétrof. Bon, elle vient de notre côté. C’est vraiment une superbe fille.
— On peut l’inviter à prendre une coupe de champagne, dit le major Matsui.
— Vous croyez qu’elle acceptera ?
Schmidt sourit.
— Pauvre petite ! Hep, Katia.
Elle s’approcha, faisant onduler ses épaules nues.
— Viens t’asseoir avec nous.
— Je veux bien, dit-elle, mais vous êtes quatre. Je vais aller chercher quelques-unes de mes amies.
— Qui vas-tu nous amener ?
— Nastasia, par exemple.
— Va pour Nastasia. Elle est bête, mais gentille. Qui, encore ?
— Vera, si vous voulez.
— Non, pas Vera. Il n’y aurait plus moyen de placer un mot.
— Milena, alors ?
— Milena, qu’est-ce que c’est que ça ?
— Une nouvelle. Elle a débuté hier.
— Elle est jolie ?
Matsui prit la parole.
— Elle est jolie. Oui, va chercher Milena.
Katia eut la même révérence respectueuse que M. Sevastopoulo.
— À vos ordres, commandant, murmura-t-elle.
— Qui est cette Milena ? demanda Schmidt, lorsque Katia s’en fut allée.
Matsui eut un geste vague.
— Arrivée il y a trois jours…
— D’où cela ?
— De Kharbine, bien entendu.
— Pourquoi, bien entendu ? fit M. Mauconseil.
— Parce que c’est ainsi, dit avec lenteur le Japonais. Toutes, les Nastasia, les Katia, les Milena, toutes elles viennent de Kharbine, en attendant d’y retourner.
M. Sevastopoulo passait. Matsui le héla.
— Faites apporter des chaises. Nous avons invité trois de vos pensionnaires. Veillez à ne pas faire relever trop tôt le rideau. Qu’elles puissent boire en paix leur champagne.
— Voilà Katia qui revient, dit M. Mauconseil, toujours aux aguets.
— En effet, dit Matsui, et elle ramène Nastasia et Milena. Constatez que je ne vous ai pas trompé. Elle n’est pas mal, cette Milena. À présent, on ne peut pas dire, évidemment, qu’elle ait très bon genre.
Un garçon apportait les chaises réclamées.
— Qu’est-ce qu’il y a ? dit Schmidt à Forestier, qui s’était levé.
Depuis un moment déjà, Schmidt avait cessé d’intervenir dans la conversation. Il se sentait repris par l’étrange inquiétude qui l’avait assailli tout à l’heure sur le seuil du Soleil de Minuit. Il lui semblait qu’il était en train de commettre une mauvaise action. Il avait beau se répéter qu’il n’avait eu, en tout ceci, d’autre idée que de jouer un bon tour à M. Mauconseil, de se moquer agréablement de lui, de lui ôter une fois pour toutes le droit de s’ériger en censeur des incartades d’autrui, il ne parvenait pas néanmoins à se rassurer, à retrouver sa gaîté. Il éprouvait de plus en plus la sensation désagréable du chasseur qui atteint une victime autre que celle qu’il a visée. La brusquerie avec laquelle Forestier venait de repousser son fauteuil acheva de mettre le comble à ce malaise.
— Qu’est-ce que tu as ? répéta-t-il.
Le calme de la réponse qu’il obtint le rassura.
— Ce que j’ai ? dit Forestier, rien. Je voudrais simplement changer de place avec toi. Pour mes débuts ici, j’aime autant ne pas être trop en vue. Tant que nous étions seuls, cela pouvait aller. Mais maintenant…
— Il a raison, fit M. Mauconseil. Forestier a parfaitement raison. Schmidt, donnez-lui votre fauteuil. Je prierai moi-même le commandant de me céder le sien.
Katia et ses compagnes pénétraient dans la loge. Matsui leur en fit les honneurs. Ils se trouvèrent alors placés de la sorte : d’abord, Schmidt ; puis, dans la partie la plus reculée, Forestier et M. Mauconseil, qui eut à sa droite la jolie Katia. Nastasia et Milena s’assirent l’une à gauche de Schmidt, l’autre à droite de Matsui.
— Et maintenant, nous allons porter un toast à la nouvelle étoile du Soleil de Minuit. À la santé de Mlle Milena.
Ces dames rirent à cette galanterie astronomique. Milena choqua son verre à celui de Schmidt, de M. Mauconseil et de Matsui. Elle dut se hausser légèrement pour atteindre le verre de Forestier, qui était séparé d’elle par toute la longueur de la table.
— Approchez-vous un peu, voyons, lui dit-elle. Vous êtes tout dans le noir.
— Elle est gentille, hein ? murmura Katia à M. Mauconseil.
En même temps, elle appuyait son bras sur le bras du directeur général, qui eut soudain contre sa joue la chevelure parfumée de la jeune femme.
— Et moi, comment me trouvez-vous ?
— Exquise, bégaya le pauvre homme, confondu.
Katia était menue et petite, avec des cheveux noirs ébouriffés. Natasia, très mince, elle aussi, portait une robe de satin mauve ornée de perles vertes. Plus âgée que ses compagnes, Mlle Milena pouvait avoir une trentaine d’années. Il était difficile de savoir si elle avait été brune ou blonde. Sa chevelure violemment oxygénée se teintait de reflets métalliques, qui donnaient à ses traits une sorte de dureté artificielle. Elle était vêtue d’une tunique ponceau, soutachée de broderies géorgiennes. Ces broderies, qui avaient dû être très belles, s’effilochaient à présent lamentablement. Le visage trop fardé était marqué de précoces flétrissures. Les tics des paupières, des lèvres, des narines révélaient l’abus des veilles et, sans doute aussi, des stupéfiants.
M. Mauconseil, de plus en plus impressionné par Katia, l’entourait de flatteuses prévenances. Schmidt parlait bas à Nastasia. Milena, à lentes gorgées, buvait son champagne. L’œil glacé de Matsui s’était fixé sur elle et ne la quittait plus.
Elle finit par en témoigner de l’impatience.
— Qu’avez-vous à me regarder ainsi ?
— J’ai bien le droit de te trouver jolie, répondit-il avec ironie.
Elle fronça les sourcils.
— Peut-être. En tout cas, ce droit-là ne vous en donne pas un autre : celui de me tutoyer.
— Oh ! oh ! fit le Japonais, susceptible, à ce que je vois ! Dis-moi : tu es danseuse, j’espère ?
— Non, chanteuse. Pourquoi ?
— Pourquoi ? Pour rien. Parce que je crois que tu aurais eu intérêt à être danseuse, voilà tout.
Le visage de la jeune femme s’empourpra. Sa voix, cette voix qui venait d’être si durement raillée, se fit plus rauque encore.
— J’ai eu une angine cet hiver, commença-t-elle.
Et elle allait continuer par une impertinence.
Mais juste en cet instant ses yeux rencontrèrent ceux de Katia. L’inquiétude qu’elle y lut lui fit comprendre que son interlocuteur était de ceux qu’il est prudent de ménager. Elle se tut, baissa la tête.
Ce manège n’avait pas échappé à Matsui. Il sourit.
— Ah ! tu as eu une angine, fit-il bonhomme. Eh ! mais, c’est une chose qui se soigne, qui se soigne même fort bien avec du champagne. Schmidt, les bouteilles sont à côté de vous et vous nous laissez mourir de soif ! Vous êtes inqualifiable, mon cher.
Interrompu dans sa cour à Nastasia, Schmidt emplit les verres d’assez mauvaise grâce. Arrivé à celui de Forestier, il constata que, pour la première fois de la soirée, il était vide. Il le remplit comme les autres.
— Excellences, ayez la bonté de ne pas m’en vouloir…
Un crâne rose venait de surgir au-dessus de la cloison de la loge. C’était M. Sevastopoulo qui esquissait une tentative pour rentrer en possession de ses pensionnaires.
— Laissez-nous tranquilles, dit Matsui. D’ailleurs, vous n’avez pas besoin de toutes ces dames à la fois.
— Je suis au regret, commandant. Mais que Votre Excellence consente à consulter le programme. La seconde partie du spectacle débute par une pantomime à laquelle participe toute la troupe.
— Il a raison. Il nous faut le temps de nous habiller, dit Nastasia, qui s’était levée.
— Bon, bon. Une dernière bouteille, alors. Trinquez avec nous, seigneur Sevastopoulo. Et quel est le titre de cette pantomime ?
— Trop d’honneur, Excellence. Le titre de la pantomime ? Comme au temps de Tsarskoïe ; quelque chose de très spirituel, avec une mise en scène réglée par votre serviteur. Vos Excellences pourront se rendre compte que rien n’a été épargné pour que ma fidèle clientèle soit satisfaite.
Si pénibles que puissent être certaines exhibitions, il eût été malaisé d’en découvrir une qui dépassât en morne bassesse : Comme au temps de Tsarskoïe.
— Ah ! voilà Katia, s’était écrié M. Mauconseil, emporté par l’orgueil du néophyte à qui il arrive pour la première fois de voir entrer en scène la belle qui lui a accordé ses faveurs.
Et il avait ajouté, avec un étonnement un peu effarouché :
— Tiens ! Elle est habillée en homme.
— Nastasia aussi, et Liouba, et Milena, toutes sont habillées en hommes, dit Schmidt. Qu’est-ce que c’est encore que cette stupidité qu’on va nous servir !
Matsui mit un doigt sur ses lèvres.
— Chut. Regardez.
L’auteur de Comme au temps de Tsarskoïe ne s’était vraiment pas mis en frais d’imagination. Le décor continuait à être le salon Louis XV de tout à l’heure. Quant à l’action, sa simplicité égalait celle du drame antique. Les chanteuses et les danseuses du Soleil de Minuit, au nombre de douze, toutes déguisées en cosaques, se tenaient sur un rang, au garde-à-vous. Un treizième personnage faisait alors son entrée, le comique de la troupe, habillé bouffonnement en général russe. Il passait l’inspection de ses soldats, et chaque fois qu’il avait le dos tourné, ceux-ci en profitaient, à tour de rôle, pour lui décocher au bas des reins un magnifique coup de botte.
Schmidt, Matsui, Forestier, M. Mauconseil se taisaient. Ils étaient à peu près les seuls à se confiner dans ce silence réprobateur. Les loges, le parterre paraissaient en joie. Chaque coup de pied allongé au pitre était salué par des applaudissements de plus en plus nourris. – Tout de même !… finit par murmurer M. Mauconseil (Dieu sait pourtant s’il eût été heureux de contribuer, par ses acclamations, au triomphe de sa chère Katia !). Tout de même, il y a ici des officiers russes. Comment permettent-ils…
Le major Matsui haussa doucement les épaules.
— Hélas ! Ce sont eux qui rient le plus fort, monsieur le directeur.
— C’est pourtant vrai, fit Schmidt. Drôle de peuple. Par contre, il y a aussi des officiers japonais dans la salle. Voyez : leur attitude, à eux, est absolument correcte.
— Parbleu, dit M. Mauconseil. Ils n’ont pas lieu, eux, d’être mécontents.
— Ils n’ont pas lieu non plus d’être très flattés, répliqua Matsui.
— Et pourquoi ?
— On n’a pas intérêt à voir abaisser un ennemi vaincu, dit le Japonais. Car c’est la victoire remportée sur lui qui risque, du même coup, d’être atteinte, diminuée.
M. Mauconseil le regarda, interloqué.
— Je ne saisis pas, je ne saisis pas très bien. C’est tout de même vous qui êtes les maîtres, à Moukden. Si un spectacle comme celui-ci vous désoblige, pourquoi ne le faites-vous pas cesser ?
— Pourquoi ? dit Matsui.
On put croire qu’il allait parler. Il n’en fut rien.
Ce fut alors que Schmidt intervint.
— Monsieur le directeur, vous embarrassez peut-être notre ami. Songez qu’il peut fort bien ne pas avoir le droit de donner certaines explications. Tout au plus sans doute pourrait-il vous répondre qu’il est d’usage, à la guerre, non de boucher les postes d’écoute, mais de les entretenir.
M. Mauconseil ouvrit de grands yeux.
— À la guerre ? Nous ne sommes plus à la guerre.
— C’est une opinion que vous modifieriez probablement, s’il vous arrivait un jour de passer par Kharbine, dit Matsui.
— Encore Kharbine !
— J’y suis passé, moi, à Kharbine, fit Schmidt. C’était il y a deux ans, en venant ici. J’y suis resté trois jours, à attendre la correspondance du Transsibérien. Quelle ville !
M. Mauconseil allait questionner. Matsui l’arrêta du geste.
— Quelle ville, dites-vous ? Quelle impression vous a-t-elle laissée, cette ville ?
Schmidt cherchait ses mots.
— Quelle impression ? Mon Dieu, comment expliquer ! Le mystère, le brouillard, le silence hostile. Chaque passant que l’on croise a l’air d’un fantôme, de son double. Il ne doit guère y avoir d’endroit où l’on puisse plus aisément se fondre, disparaître comme une fumée, sans qu’on sache jamais, jamais ce que vous êtes devenu. Mais pourquoi m’interroger ? Nous n’aurions eu qu’à mettre sur ce chapitre nos petites amies de tout à l’heure…
Matsui secoua la tête.
— Elles n’auraient pas parlé.
— Ou je suis le dernier des imbéciles, interrompit M. Mauconseil, qui commençait à s’énerver, ou toutes vos allusions, vos réticences, signifient que les allées et venues de ces demoiselles entre Kharbine et Moukden, loin d’être interdites, sont favorisées par certains gouvernements, dans le but intéressé d’être renseignés sur les intrigues de ses adversaires.
Et comme Matsui esquissait une protestation :
— Non, évidemment, vous n’avez rien dit de tout cela. Mais je l’ai compris. Eh bien, laissez-moi vous avouer que je reste sceptique sur la valeur des services que sont capables de rendre de pauvres filles comme celles qui étaient assises avec nous il y a un instant.
Le major Matsui regarda M. Mauconseil. Il semblait réfléchir. Puis il sourit, alluma une cigarette.
— Il faut tout de même que je vous raconte une histoire, dit-il.
V
Il sembla à Schmidt qu’un soupir venait du fond de la loge : Forestier, sans doute, qui bâillait.
— Le malheureux, pensa-t-il, quelle corvée pour lui ! Il n’ose pas donner le signal du départ. Quand cet abruti de père Mauconseil en aura-t-il donc assez !
Il se pencha vers son collègue.
— Tu te rases, hein, pauvre vieux ? Il n’y en a plus pour bien longtemps, va.
— Reste-t-il du champagne ? demanda Forestier.
— Tiens, tiens, se dit Schmidt.
Une bouteille demeurait à demi pleine. Il la lui tendit.
— Voilà. Tu as raison : rien comme cela pour vous réveiller.
Et il cessa de s’occuper de lui, car la pantomime avait pris fin, et Milena, qui en était à sa deuxième chanson, l’intéressait tout de même plus que Forestier.
À cette distance, il ne distinguait que mal les traits de la jeune femme. Il apercevait seulement sa face blanche de poudre, pareille à un blême masque de Pierrot, les trous noirs des yeux, la coupure sanglante de la bouche. Milena chantait sans art, sans conviction, sans dons physiques. Mais la fêlure même de sa voix, ses inflexions sourdes, l’espèce d’arrogance douloureuse avec laquelle elle paraissait insister sur ses défaillances au lieu de tenter de les voiler, tout cela était en train d’agir sur Schmidt avec une force singulière. Une bouffée de chaleur lui monta au visage. Un frisson trouble lui parcourut le corps.
— Pourvu qu’elle ne s’en aille pas tout de suite, murmura-t-il. Le temps de semer les petits camarades, et je rapplique au Soleil de Minuit.
Cependant Matsui, qui avait terminé sa cigarette, s’était mis à parler.
— L’histoire à laquelle je fais allusion, dit-il, j’ai le droit, de vous la raconter, car elle n’est pas inédite. M. Schmidt la connaît, et ce n’est pas de moi qu’il la tient. Je serai bref. Il y a un an environ, toujours à Kharbine, le consul d’une grande puissance vint à se douter que le consul d’une autre grande puissance avait mis dans son jeu – à prix d’argent, bien entendu – un haut fonctionnaire d’une troisième grande puissance. D’où rupture d’équilibre dans la lutte quotidienne, nécessité d’acquérir au plus vite une certitude, afin d’agir en conséquence. Tout le problème se ramenait à l’existence d’un chèque, dont il fallait se procurer immédiatement la photographie, – je dis immédiatement, parce que ces objets-là, n’est-ce pas, n’ont pas coutume de s’éterniser entre des mains percées. Voilà les prémisses. Elles sont simples. Le dénouement l’est plus encore. Au bout de trois jours, l’agent de la première puissance était en possession de la photographie. Eh bien ça, qu’on le veuille ou non, c’est du travail.
— Que s’était-il passé ?
— Rien que de très naturel. À Kharbine, il y a, comme de juste, un café-concert dans le genre de celui-ci. Le haut fonctionnaire en question y vint, avec le chèque dans son portefeuille. Cette nuit-là, il ne rentra pas seul chez lui, vous comprenez ?
— J’ai compris, fit pudiquement M. Mauconseil, j’ai compris. C’est égal, je pose en principe qu’il y a là un cas – comment dirais-je ? – exceptionnel.
— Pas si exceptionnel que cela, répliqua Matsui. En voulez-vous la preuve ? Mais approchez-vous, alors, car, cette fois, l’exemple que j’ai à vous citer est d’ordre strictement confidentiel.
Assez intrigué par des façons qui n’étaient guère dans les habitudes du Japonais, Schmidt ne perdait pas un détail de cette scène. Où sa surprise ne connut plus de bornes, ce fut quand il vit M. Mauconseil devenir soudain écarlate et manifester le plus profond effarement.
— Comment, vous avez entendu ?…
— J’ai entendu, et je m’en excuse, monsieur le directeur général, disait Matsui. Mais calmez-vous, je vous en prie.
— Vous avez entendu !… Mais ça n’avait aucun rapport, mon cher ami. Une phrase en l’air !… Une politesse, une simple politesse. Faut-il vous en donner ma parole ? Pas une minute, je n’ai eu la pensée… Encore une fois, ça n’a aucun rapport.
— Calmez-vous, calmez-vous, répétait Matsui. Aucun rapport, vous n’avez même pas besoin de le dire, mon cher directeur. Je serais vraiment désolé. Vous voyez néanmoins, dans des pays comme ceux-ci, la prudence qu’il faut avoir.
— Je le sais, je ne le sais que trop. C’est ce que je ne cesse de répéter à Schmidt. Vous êtes témoin que ce soir ce n’est pas moi qui ai insisté pour venir ici. Ah ! avant qu’on m’y reprenne… D’ailleurs, quelle heure est-il ? Il doit être temps de partir. Deux heures moins le quart ? Quel scandale ! Debout, Schmidt ! Debout, Forestier ! Allons-nous-en.
— Qu’est-ce qu’il a ! grogna Schmidt. Mon cher directeur, reprit-il sur le ton le plus affable, il est vraiment trop tard pour vous imposer la peine de nous raccompagner à l’autre bout de la ville. L’automobile du major Matsui doit être là, et…
— Je vois ce que c’est, cria M. Mauconseil, hors de lui, vous voulez rester encore dans cette boîte. À votre aise ! Grand bien vous fasse ! Vous, du moins, venez, Forestier.
Il lui avait saisi le bras. Forestier se dégagea d’un geste brusque, et, sans un mot d’excuse :
— Je reste avec ces messieurs, dit-il.
— En voilà bien d’une autre, murmura Schmidt, au comble de l’étonnement.
M. Mauconseil parti, Matsui se mit à rire.
— Qu’avez-vous ? dit Schmidt, assez nerveusement.
— Ce que j’ai ? Vous n’avez donc pas vu la retraite précipitée de votre directeur ?
— Eh bien ?
— C’est mon œuvre.
— Votre œuvre ! Comment vous y êtes-vous pris ?
Les petits yeux de l’officier pétillèrent.
— Ah ! voilà. Vous étiez trop occupé tout à l’heure à murmurer des choses à l’oreille de Mlle Nastasia. Vous ne pouviez entendre celles que, de son côté, il murmurait à l’oreille de Mlle Katia. J’entendais, moi.
— Et qu’avez-vous entendu ?
— Vous me croirez si vous voulez. Il insistait auprès de cette jeune personne pour qu’elle vienne le voir à l’Arsenal. Il lui promettait de lui montrer, entre autres choses, les hauts fourneaux et de lui expliquer les différences qu’il y a entre le système Cowper et le système Whitwell.
— Non ?
— Si !
— Bigre, fit Schmidt, abasourdi, voyez-moi ça ! Le petit noceur ! Et alors ?
— Alors, venant tout de suite après, mes histoires d’espionnage, de secrets d’État ravis par des courtisanes n’ont pas manqué d’obtenir l’effet que vous savez.
— Le malheureux, dit Schmidt. Il s’est cru déjà en conseil de guerre. Très drôle, en vérité, très drôle. Mais à y bien réfléchir, vous avez fait là un joli coup. Désormais, il ne va plus vivre qu’avec l’idée que si je fréquente le Soleil de Minuit, c’est pour bazarder à Liouba et à Nastasia la formule des aciers au titane et au zirconium. Félicitations ! Enfin, peu importe, il est parti. Quel crampon !
En toute autre circonstance, Schmidt eût ri de bien meilleur cœur du tour joué à M. Mauconseil. Mais il y avait l’attitude de Forestier, qui l’emplissait d’une inquiétude grandissante, lui donnait de plus en plus l’impression de se mouvoir dans un monde hostile, inattendu. Tout à l’heure, parlant de son passage à Kharbine, c’était cette impression que, moitié sciemment, moitié à son insu, il avait évoquée. Un motif d’ordre plus personnel augmentait sa mauvaise humeur. Quelques instants plus tôt, quand il avait formé le projet de revenir au Soleil de Minuit, il avait escompté le départ de M. Mauconseil et de Forestier. Ce dernier demeurant, la réussite de son projet devenait fort aléatoire.
Pourquoi diable Forestier restait-il ? Que signifiait cette obstination de la part de quelqu’un qui, deux heures auparavant, tombait littéralement de sommeil ? Il y avait là un mystère que Schmidt ne se résignait pas à ne pas percer.
— Tu es fatigué, commença-t-il. Tu n’as guère l’habitude de ce genre de distractions…
— Qui te dit que je n’en ai pas l’habitude !
Le ton de Forestier était sec, hargneux presque. Schmidt regarda Matsui. Il était impossible que ce dernier n’eût pas remarqué que leur compagnon n’était point dans son état normal.
Le spectacle était terminé. De nouveau, chanteuses et danseuses refluaient dans la salle.
— En invitons-nous deux ou trois à prendre une dernière coupe ? proposa Matsui, pour rompre un silence qui devenait gênant.
Il ajouta :
— Les mêmes, ou d’autres ?
— Les mêmes, tant qu’à faire, dit Schmidt.
La proposition lui convenait. Il allait pouvoir prévenir Milena, la prier de l’attendre.
Derechef, il avait compté sans Forestier.
— Non, fit celui-ci, ni les mêmes, ni d’autres.
Il avait frappé sur la table. Il parlait avec une autorité insoupçonnée : l’effet de la boisson, sans doute.
— Alors, rentrons, dit Schmidt, qui commençait à se fâcher.
Mais l’entêtement de Forestier ne faisait que croître.
— Pas avant que je vous aie rendu vos politesses. Vous m’avez offert à boire toute la soirée. À mon tour, maintenant.
Pour le coup, Schmidt n’y tint plus.
— Il s’agit tout de même de t’expliquer. Tu ne veux pas rester ici ; tu ne veux pas rentrer… Qu’est-ce que tu veux ?
— Boire, fit l’autre, boire, mais pas ici. Ce n’est pas très compliqué, je pense.
— À l’heure qu’il est, tout est fermé.
— Tout ? Je te fais le pari que non.
— Es-tu fou ? Qu’est-ce que cela signifie ?
L’exaspération gagnait Schmidt. Matsui, par contre, n’avait jamais paru plus calme, ni plus attentif.
Ce fut vers lui que Forestier se tourna.
— Commandant, me permettez-vous de vous poser une question ?
— Je vous en prie.
— Où l’on joue, on boit aussi, n’est-ce pas ?
— D’ordinaire, oui.
— Très bien. Alors, c’est à vous que je vais proposer un pari, le pari que vient de refuser Schmidt, ce sacré Schmidt. Entre nous, il est beaucoup plus popote qu’on ne se le figure, ce brave Schmidt. Mais revenons à nos moutons. Si l’on joue, on boit, avons-nous dit. Or, à deux pas d’ici, je parie qu’il y a un endroit où l’on joue au baccara. Tenez-vous le pari ?
— Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? fit Schmidt, vexé et furieux. Et comment sais-tu qu’il y a à côté d’ici un endroit où l’on joue au baccara ?
— Ça, mon petit, c’est mon secret, dit Forestier, se frottant les mains, et j’ajoute que ça ne te regarde pas. C’est au commandant que j’en ai. Commandant, tenez-vous le pari ?
Le major Matsui secoua la tête.
— Je ne tiens pas le pari, dit-il lentement, pesant ses mots, avec une gravité qui paracheva la stupéfaction de Schmidt. Oui, le lieu dont vous parlez existe. Si je ne tiens pas le pari, c’est parce qu’il n’est pas très difficile de deviner qu’à côté d’un endroit comme celui-ci doit se trouver nécessairement un tripot.
Forestier rit de plus belle.
— Non, évidemment, major Matsui, ce n’est pas très difficile. Qu’à cela ne tienne, je vais vous proposer une devinette moins enfantine, plus digne de vous. Savez-vous qui nous allons trouver, dans ce tripot ?
— M. Mauconseil, peut-être, grogna Schmidt.
— Non, pas M. Mauconseil. D’abord, toi, tais-toi. Ce n’est pas à toi que j’en ai. C’est au major Matsui, qui est si au courant de tout ce qui se passe à Moukden, et que ce serait un vrai bonheur de voir pris en défaut par un profane, un nouveau venu, qui n’a pas mis les pieds dehors, depuis une semaine qu’il est ici.
— En voilà assez, dit Schmidt, violemment, rentrons. Cette scène devient ridicule.
Matsui lui coupa la parole.
— Monsieur, dit-il à Forestier, venez. Je suis prêt à vous conduire là où vous désirez aller.
Ils étaient tous les trois sur le seuil de la loge. Forestier, titubant un peu, passa le premier.
Schmidt en profita pour saisir le bras de Matsui.
— Je ne vous comprends pas, murmura-t-il, non, je ne vous comprends pas. En l’état où il est, accepter de le conduire dans ce bouge ! Je n’y suis allé qu’une fois, et vraiment…
— Monsieur Schmidt, répondit froidement le Japonais, toutes mes excuses. Mais les convenances cessent pour moi là où commence mon métier.
Dans la rue, Matsui prit la tête. Parvenu à une impasse toute noire, il s’arrêta.
— C’est ici, fit-il à voix basse.
— Entrons donc, dit Forestier.
— Une minute, dit le Japonais. Qui allons-nous, d’après vous, trouver ici ?
— Bravo ! Le pari marche, alors ? Écoutez-moi donc. Nous allons bientôt être en présence d’un vieux monsieur très bien, très digne ; un vieux monsieur en redingote, avec des favoris à l’Alexandre II. Êtes-vous satisfait ?
Matsui secoua la tête.
— Je connais à Moukden une demi-douzaine d’émigrés russes à qui correspond ce signalement.
— Oui-da, ricana Forestier. Mais vous ne me laissez même pas le temps de passer aux signes distinctifs. Lorsque j’aurai ajouté que mon vieux monsieur à moi, en place de main droite, a un crochet de fer, qui ne le gêne en rien pour donner les cartes et, plus souvent qu’à son tour, abattre neuf, vous n’en exigerez pas davantage, je suppose. Le pari est-il tenu, oui ou non ?
— Il l’est, dit Matsui, brièvement.
— Tonnerre de tonnerre, fit Schmidt, entrons.
Ils se trouvaient maintenant à l’entrée d’une longue pièce obscure. Quelques ampoules électriques, aux verres mal essuyés, y déversaient un lamentable éclairage de quinquets.
Derrière eux, un petit Chinois obséquieux, en smoking jaunâtre, venait de refermer la porte, après s’être incliné profondément devant Matsui. La salle était meublée, au centre, d’une table rectangulaire, recouverte d’un tapis nauséabond. Dans les encoignures, il y avait des guéridons chargés de bouteilles, de verres à demi vides. De consommateurs, point. Ils se pressaient, assis ou debout, autour de la grande table, où l’on jouait.
On jouait. Sordide partie, à cause de la sordide assistance. Il paraissait invraisemblable qu’aucun de ces joueurs eût jamais connu la lumière du soleil. Il y avait là des yankees suspects, de mauvais Anglais, des Chinois bouffis, un Coréen tout blanc, des ruffians de tous les pays, de tous les mondes. À chaque carte retournée, un frisson, une rumeur patibulaire courait.
Appuyé à la muraille, Schmidt contemplait ce spectacle avec écœurement. Matsui ne quittait pas des yeux Forestier.
— Eh bien, lui dit-il, après une minute d’attente, il me semble que vous avez perdu.
Forestier parut sortir d’un rêve.
— C’est ce qui vous trompe, répliqua-t-il doucement. Voilà mon homme, major Matsui. J’ai gagné.
S’étant un peu déplacés vers la gauche Schmidt et Matsui regardèrent. Le personnage ainsi désigné pouvait avoir une soixantaine d’années, mais les ravages imprimés sur sa face faisaient qu’il en accusait beaucoup plus : dix, vingt, trente ans de plus, peut-être… on ne savait pas. Le visage pourtant n’avait pas dû être sans noblesse, à peu près comme la redingote avachie qui vêtait le malheureux et dont les pans traînaient sur le plancher gras n’avait pas dû être sans élégance.
C’était à lui précisément de donner les cartes. Il se pencha pour les prendre, et l’expression qu’il eut en cet instant fut tragique à voir.
— Huit !
Il abattit son jeu. Un bruit métallique retentit. Le crochet de fer qui lui tenait lieu de main venait de heurter la table.
— Matsui, murmura Schmidt avec épouvante, Matsui, pour Dieu, attention !
Trop tard ! Forestier leur avait échappé. Il était déjà auprès du vieillard. Agrippant son épaule, il le contraignit à se retourner.
— Eh bien, vieille fripouille, toujours solide au poste ! On ne reconnaît donc plus les petits camarades ?
Surpris dans le compte de son gain, l’autre s’était soulevé. Il considérait Forestier avec un ahurissement, une hébétude impossibles à décrire.
— Eh mais, parvint-il à dire enfin, remuant péniblement sa langue pâteuse, je ne me trompe pas, c’est Charlie, ce cher Charlie ! Il y avait longtemps qu’on ne s’était vu, petit frère. Tu viens pour la partie, hein ?
Ce qui se passa alors fut très rapide. Deux soufflets résonnèrent sur les joues du vieux gentilhomme à favoris, tandis que l’assistance entière se dressait, dans un vacarme étonnant de chaises renversées, de blasphèmes, de menaces. Les joueurs, instantanément redevenus frères, se ruaient sur les intrus coupables de troubler leur affreuse folie.
Et voici que presque au même instant la mêlée glapissante fut scindée en deux groupes. D’un côté les assaillants, de l’autre les trois assaillis. Au milieu, deux gigantesques garçons de bar, surgis l’on ne savait d’où, à coups de pied, à coups de poing, se mettaient en devoir de rappeler à l’ordre ces larves, les repoussant, les chassant à l’autre bout de la pièce. Courbé jusqu’à terre devant Matsui se tenait le petit Chinois obséquieux, les bras en croix sur la poitrine. Ici aussi, la discipline japonaise était à la hauteur de sa tâche.
Le major Matsui eut un sourire.
— J’ai perdu, dit-il. Nous n’avons plus rien à faire ici, messieurs.
Son automobile les attendait dans l’impasse. Ils y poussèrent rapidement Forestier. Durant le trajet de retour, pas une parole ne fut prononcée.
Au moment de se quitter, devant l’immeuble de la banque de Chine, Schmidt et Matsui échangèrent quelques mots à voix basse.
— Excusez-nous ; excusez-le, dit Schmidt en désignant Forestier affalé sur les coussins de la voiture. Il n’a pas l’habitude de sortir. Il est ivre.
— Je le crois avec vous. Mais je crois qu’une ivresse aussi sagace est une bien curieuse ivresse, se borna à répondre Matsui.
Il reprit :
— À votre disposition, si je peux lui être de quelque utilité.
— Merci, dit Schmidt. Pour le moment, il n’a besoin que d’une chose, de son lit.
— Pour le moment, sans doute, fit le Japonais. Mais demain, mais un jour… Peut-on savoir !
Après avoir conduit Forestier dans sa chambre, Schmidt gagna la sienne et se coucha, rompu et navré.
— C’est la faute de ce crétin de père Mauconseil, ne cessait-il de se répéter. Tout de même, dans quel pays nous entraîne le désir imbécile de gagner quatre sous de plus ! Hors de chez eux, décidément, les Français ne font que des bêtises.
Il avait espéré s’endormir tout de suite. Il ne le put. Le triste vent de la nuit pleurait de façon lugubre dans les persiennes. Il faisait plus froid. L’aube allait naître. Bientôt sa lueur blême rôderait contre les carreaux. Et soudain Schmidt frémit longuement. Une lueur autre que celle qu’il attendait venait de poindre. C’était une mince raie jaune, surgie dans l’obscurité, tout près, au bas de la porte de la chambre. Quelqu’un était là.
Schmidt se dressa sur son séant.
— Qu’est-ce que c’est ?
Rien ne répondit. Rien ne bougea.
— Qui est là ? répéta l’ingénieur.
Alors, silencieusement, avec une lenteur effrayante, la porte s’ouvrit. Forestier apparut, hagard, en chemise, un bougeoir à la main.
— Que veux-tu ? dit Schmidt.
Et Forestier, dans un sanglot, lui répondit :
— À boire !
VI
Sans doute Schmidt n’eût pas souhaité voir revenir dans sa vie plusieurs journées aussi fertiles en émotions que ce dernier dimanche de mars 1926, qu’il passa à peu près tout entier au chevet de son camarade.
Tiré de son lit avant l’aube par l’entrée de Forestier chez lui, il ne devait plus ce jour-là, ni la nuit suivante, se recoucher. Et quelles lamentables péripéties ! Cela avait débuté par un quasi corps à corps entre les deux hommes, l’un poursuivi par l’idée fixe de mettre la main sur le champagne, les alcools que l’autre avait dans sa chambre, et celui-ci luttant pour l’en empêcher. Ce ne fut pas sans peine que Schmidt, beaucoup plus robuste cependant, réussit à maîtriser l’espèce de dément frénétique qu’était devenu Forestier. « Heureusement, se disait-il, tout en se colletant avec le forcené, heureusement que c’est la nuit, et qu’il n’y a personne pour assister à une telle scène ! » Daï, le boy, ne logeait pas là. Quant au fonctionnaire de la banque dont ils étaient les hôtes, il habitait au rez-de-chaussée. Il n’avait pas pu entendre.
Lorsque, dompté enfin, Forestier s’était abattu sur le plancher, Schmidt avait dû le transporter dans sa chambre, le coucher, puis essayer de le raisonner, de calmer l’effrayante crise de larmes qui avait succédé aux transports d’une folie presque furieuse. Oui, quelle nuit, vraiment ! Vers six heures du matin, Forestier s’était un peu apaisé. Schmidt en avait profité pour aller à la cuisine, où il entendait Daï remuer les ustensiles du petit déjeuner. Il l’avait aussitôt envoyé faire des courses, dans la crainte qu’il ne fût là, au cas où le scandale de tout à l’heure recommencerait.
Il se prépara du thé, en but deux ou trois tasses, et revint s’asseoir auprès du lit de Forestier. C’était la première fois, depuis bientôt trois heures, qu’il avait le loisir de mettre un peu d’ordre dans ses pensées.
— Eh bien, se répétait-il, en voilà un qui m’a joliment mis dedans, et qui n’a pas volé les appréciations qu’il a, paraît-il, dans son dossier. C’est égal, de quelle mouche s’est-il trouvé piqué ?
Il se souvenait du champagne refusé par Forestier pendant toute la première partie de la soirée, puis de son insistance subite pour boire. Entre ces deux instants, qu’est-ce qui avait bien pu se passer ? Schmidt avait beau se prendre le front à deux mains, il n’arrivait pas à se rappeler, à comprendre. Les événements de cette nuit fantastique le confondaient.
Forestier dormait d’un mauvais sommeil tout secoué de cauchemars. Il gémissait comme un enfant, ânonnait des noms, des mots sans suite. Schmidt s’efforçait de saisir un de ces mots, un de ces noms. Peine perdue. La chambre, la veille encore si pleine d’ordre – il n’y avait même pas douze heures que Schmidt y était venu prévenir Forestier que l’automobile de M. Mauconseil les attendait en bas – cette chambre avait maintenant des aspects de chaos. Schmidt se leva, rangea du mieux qu’il put le smoking, le faux col, les bottines, toute la pauvre défroque de soirée de son camarade. Des dossiers avaient glissé à terre, ainsi que le fameux cadre en peluche, la photographie de la famille de Forestier. Il les ramassa consciencieusement. La vitre du cadre était brisée. La mine de la femme, des deux petits garçons, lui parut plus mélancolique, plus morne encore que la première fois.
— Pauvre femme, pauvres gosses, murmura-t-il. Ils n’ont pas dû être à la noce tous les jours. Je comprends maintenant la tête qu’ils font. Ils sont chouettes, quand ils s’y mettent, les hommes mariés. Mais tout cela ne me dit pas pourquoi Forestier a calotté ce vieux chenapan.
Vers midi, il prit quelque nourriture. Le boy était de retour. Il ne le laissa pas s’éterniser dans l’appartement. Il le chargea de porter à des gens chez qui il devait dîner une lettre les prévenant que se sentant un peu fatigué, il ne sortirait pas de la journée. Forestier, qui dormait toujours, paraissait plus paisible. Schmidt s’installa dans un fauteuil, et, brisé par l’insomnie, s’assoupit à son tour. Au fond, comme la plupart des gens qui font profession de cynisme, ce n’était pas un méchant homme que ce Schmidt. Mais la très réelle commisération que lui inspirait Forestier, il eût été navré qu’elle fût mise au compte d’une certaine bonté naturelle. Il ne lui voulait d’autre explication que l’esprit de corps, qui commandait que tout fût fait pour éviter qu’un polytechnicien pût être vu dans l’état où se trouvait présentement son infortuné compagnon.
Quand il se réveilla, la pâle lumière orange dont la fenêtre était baignée annonçait l’approche du crépuscule. Son regard chercha immédiatement Forestier. Lui aussi, il ne dormait plus. Immobile, il fixait sur Schmidt des yeux suppliants.
— Comment te sens-tu ?
— Mieux, beaucoup mieux.
— Tu n’as besoin de rien ?
— Je voudrais boire.
Schmidt eut un haut-le-corps.
— Ah non, mon vieux. Assez plaisanté, hein ?
— De la tisane, de l’eau, ce que tu voudras, mais boire, balbutia l’autre.
— Comme ça, c’est différent, dit Schmidt, rasséréné. Attends-moi une minute.
Il sortit, et revint porteur d’un pichet empli de thé léger.
Forestier but avidement.
— Merci, dit-il, quand il eut fini.
Il prit la main de Schmidt, et la serra avec effusion.
— Merci, reprit-il. Je n’oublierai point que tu as été bon pour moi. C’est de cela que je n’ai pas l’habitude.
Un tremblement le parcourut.
— Et laisse-moi aussi te demander pardon.
Schmidt se taisait. D’une part, sa pitié l’incitait à détourner la conversation. D’autre part, évidemment, il n’eût pas été fâché de savoir, de provoquer certaines confidences.
Forestier prit ce silence pour un blâme. Sa voix se fit plus humble encore.
— Pardonne-moi. Ce n’est pas tout à fait ma faute, vois-tu.
— Ce n’est pas la mienne non plus, dit Schmidt, qui, se rappelant ses pressentiments de la veille, n’était cependant point si rassuré que cela sur son innocence.
Forestier eut un geste désespéré.
— Pardonne-moi. Je n’ai plus été mon maître, tu comprends. Je voulais voir seulement, voir s’il était là. Je m’étais bien juré de me contenir. Et puis, quand je l’ai eu tout près, en face de moi, j’ai eu beau faire, ça a été plus fort que moi.
— De qui parles-tu ?
— De qui je parle ? Tu le sais bien : de ce misérable.
— Qui ? Ce vieux débris à qui tu as administré une paire de gifles ?
— C’est vrai, je l’ai giflé ! Eh bien, je ne le regrette pas. Un misérable, tu m’entends ! Il n’y a rien de plus bas au monde que cet homme-là. C’est à cause de lui que, pendant toute une année, j’ai été comme tu m’as vu hier, et je sais maintenant que ce n’est peut-être pas fini. Il a failli me perdre, après l’avoir perdue, elle, irrémédiablement.
— Qui, elle ?
Les yeux de Forestier, déjà agrandis par la fièvre, s’ouvrirent davantage encore.
— Comment qui ? Tu ne sais pas de qui il s’agit ? Tu n’as donc pas compris ?
— Comment diable veux-tu que je comprenne.
— C’est vrai, mon Dieu ! Tu ne pouvais pas comprendre… tu ne pouvais pas deviner. Quelle horreur !
De grosses larmes coulaient sur ses joues.
— Mon Dieu, comme tu as dû, comme tu dois encore me mépriser. Tu n’avais pas compris ! Mais cette chose, alors, tu sais, ce que je veux dire, oui, ma folie d’hier soir, mon ivresse enfin, à quoi as-tu pu l’attribuer ? Sur le compte de quoi l’as-tu mise ?
— Voyons, voyons, ne te monte pas la tête. Je n’ai pas attaché à tout cela plus d’importance qu’il convenait, dit Schmidt.
Devant la surexcitation croissante de Forestier, il ne voulait pas paraître avoir pris au tragique les événements de la nuit précédente.
— Parole d’honneur, continua-t-il, j’ai pensé : il y a sans doute longtemps que ce brave Forestier n’a dû boire de champagne, voilà tout. Un verre de trop, parfois, suffit… Calme-toi, voyons, calme-toi.
Forestier secoua la tête.
— Non, non, gémit-il, je ne veux pas que tu me méprises. Pour cela, il faut que tu saches, que je te raconte…
— Écoute, dit Schmidt, tu me raconteras tout ce que tu voudras, mais à une condition, encore une fois : c’est que tu sois calme.
— Je le suis déjà beaucoup plus. Je le serai tout à fait quand j’aurai parlé. Tu ne peux pas m’en empêcher. Je suis sûr que cela me fera du bien.
Schmidt s’était levé.
— Tu me quittes, dit Forestier avec angoisse.
— Mais non, mais non, je vais être là tout de suite. Par exemple, il ne faut pas continuer à t’agiter ainsi, sinon, je m’habille, et je m’en vais dîner au Cercle.
Il revint dans la cuisine. Il voulait se débarrasser définitivement du boy, qu’il avait l’impression d’entendre rôder dans l’appartement, aux aguets de ce qui pouvait se passer d’insolite. Quand il fut de retour dans la chambre, la nuit était tout à fait tombée. Il fit jouer le commutateur électrique.
— Là, maintenant, je suis à toi. Dis-moi tout ce que tu as à me dire.
Forestier avait porté la main à ses paupières.
— Est-ce que la lumière te fait mal ?
— Ce n’est pas qu’elle me fasse mal, murmura Forestier. Je vais t’expliquer. Pour les choses que j’ai à te dire, j’aime mieux être dans l’obscurité.
Résigné à lui passer autant de fantaisies qu’à un enfant, Schmidt s’installa stoïquement dans un fauteuil, après avoir pris soin du moins de choisir le plus confortable.
— Qui sait pour combien de temps je suis là, se disait-il. Charmante journée ! Demain, à l’Arsenal je serai dans un joli état.
Il songea aussi que, pour comble d’agrément, il lui faudrait trouver une excuse correcte à Forestier, qui ne serait certainement pas capable de reprendre son service de deux ou trois jours. Puis, il réfléchit qu’il était bien bon de se faire tant de souci. Étant donné sa propre conduite, M. Mauconseil n’avait plus guère le droit de se montrer exigeant sur le choix de cette excuse. Au fond, dans l’aventure en question, il était le seul, lui, Schmidt, à avoir conservé une attitude décente. Cette idée ne fut pas pour lui déplaire. Elle achevait de le convaincre de la supériorité, sous tous les rapports, des célibataires.
D’une voix éteinte, monotone, comme s’il se fût agi d’une confidence qu’il se serait faite à lui-même, Forestier, cependant, s’était mis à parler.
— Sapristi, pensa Schmidt, qui n’avait d’abord écouté que d’une oreille, on dirait qu’il commence par le commencement, le bougre. Et c’est que ça n’a pas l’air d’être particulièrement folichon, ce qu’il tient à me raconter. À Dieu vat ! Si je m’endors, il le verra bien, et j’espère qu’il n’aura tout de même pas le toupet de s’en formaliser.
Mais ses craintes, à cet égard, furent vaines. Chacune des minutes de cette nuit, au fur et à mesure de leur venue, allait le trouver plus attentif, plus éveillé que la précédente.
Le récit de Forestier ne fut pourtant, à l’origine, qu’une espèce de monologue morne.
— Toute ma vie, disait-il, aussi loin que mon souvenir remonte, toute ma vie je n’ai cessé de travailler. À cinq ans mes parents étaient fiers de moi, parce que je connaissais ma table de multiplication. Si j’avais pu savoir de quel prix je devais payer les éloges qu’on m’adressait alors ! Le dimanche après-midi, on habillait mes sœurs. Elles allaient se promener avec mon père et ma mère. Au retour, ils faisaient une halte chez le pâtissier. On me rapportait un chou à la crème, qu’on venait déposer en grand mystère sur la table où j’étais resté à faire mes devoirs, à préparer mes compositions. Mon père était conducteur des ponts et chaussées. En quittant son bureau, il venait me chercher parfois à la porte du lycée. Il s’entretenait avec les professeurs. « Si votre gamin continue à travailler de la sorte, lui confiaient ceux-ci, il pourra fort bien se présenter un jour avec des chances à l’École normale supérieure, ou à Polytechnique. » Nous habitions une ville du Nord, une ville noyée dans la fumée des charbonnages. Le paysage était si triste que je n’avais qu’à coller mon front une seconde à la fenêtre de ma chambre pour revenir aussitôt à ma table de travail. Un ciel de suie ; des passants invisibles sous leurs parapluies ; la devanture morose d’un estaminet ; les murailles rébarbatives d’une caserne, d’où s’échappaient, à des heures désespérément fixes, de lugubres sonneries de clairon : réveil, visite, appel, extinction des feux… Mais, quand celle-ci avait sonné, ma lampe, à moi, restait longtemps allumée encore. Et pourtant, je n’étais pas malheureux. Pour l’être, il faut pouvoir comparer ; il faut savoir que d’autres sont heureux.
Il soupira profondément.
— Veux-tu que je te fasse une confidence ? poursuivit-il. Je n’ai pas assez vécu, connu la vie, si tu préfères. Tout le mal est venu de là. Du premier coup, j’ai trébuché contre un obstacle qu’un autre que moi, toi par exemple, aurait aisément surmonté. Tu as toujours eu de la fortune, n’est-ce pas ?
— Hum ! fit Schmidt, surpris, choqué même de cette bizarre prise à partie, pas grand-chose.
— Mais encore ?
— Une vingtaine de mille francs de rente. Avant la guerre, cela pouvait compter. Maintenant, ça ne vaut plus même la peine qu’on en parle.
— C’est justement à la période qui a précédé la guerre que je fais allusion, dit Forestier. C’est de nos communes années de Polytechnique qu’il s’agit. Les élèves d’une même promotion, on a coutume de les diviser en bon et en mauvais. Il est, hélas ! une autre classification, plus brutale, sinon plus équitable. Il y a ceux qui ont de l’argent, et puis les autres. Je n’ignore pas que, par la suite, le travail, la valeur personnelle, la chance, un tas d’autres facteurs peuvent intervenir, modifier, ratifier le classement en question. Mais qui dira jamais assez l’importance de ce handicap initial ?
— Tu exagères, dit Schmidt, assez mollement. Si je n’avais pas disposé, moi, à cette époque, de quelque argent de poche, je crois que j’aurais travaillé davantage. Certaines bêtises en tout cas m’eussent été évitées…
Forestier l’interrompit avec douceur.
— Ces bêtises-la, ne les regrette pas. Tu les aurais, il y a neuf chances sur dix, commises plus tard. Et les bêtises d’un homme mûr ont une autre gravité, crois-moi, que les bêtises des jeunes gens. C’est l’expérience qui m’a appris à quel point tu avais été favorisé par rapport à moi. Au temps de notre jeunesse, j’étais presque persuadé du contraire. Je mettais une espèce de ferveur à bénir ce manque d’argent qui m’obligeait, les jours de fête, à rester à l’École, ou à y rentrer après une brève promenade au Luxembourg. Souviens-toi d’un de ces dimanches. C’était en 1903, vers la fin d’avril. Tu m’avais offert l’apéritif à la terrasse d’un café du carrefour Médicis. Une amie à toi vint t’y rejoindre. Je la vois encore. C’était une jeune femme blonde, avec un vaste chapeau cloche comme on les portait alors. Te souviens-tu ?
— C’est drôle, murmura Schmidt, rêveur. Je me rappelle le jour, le lieu, la circonstance, tout. Et je ne me la rappelle pas, elle.
— Ni elle, ni beaucoup d’autres, sans doute, dit âprement Forestier. Vous autres, les riches, vous avez pu tout de suite avoir des maîtresses, et ce sont elles, c’est leur nombre qui vous ont sauvés. Nous, les pauvres, pour parvenir à posséder une femme, nous n’avons eu la plupart du temps d’autre moyen que de l’épouser. De là ces lamentables unions prématurées, que guettent, à la première occasion, les pires catastrophes.
— Tu n’as pas le droit de parler ainsi. Tu aimes ta femme, dit Schmidt, sur un ton de reproche.
— Je l’aime, bien sûr, je l’aime, répliqua Forestier qui recommençait à s’exalter. Et puis après ? Tu me fais rire. Aimer, qu’est-ce que cela signifie ? je te le demande. Tu sursauterais, je pense, si, en chimie, tu m’entendais employer au hasard les termes de la nomenclature. Mais, du moment que c’est l’univers autrement complexe du sentiment qui est en jeu, tu te contentes de cet unique, ce ridicule mot : l’amour. En voilà un qui a bon dos ! Il s’applique à tout, il couvre tout, il explique tout, depuis les tumultes les plus mystérieux de la chair et du sang jusqu’à la gratitude que l’on a pour la compagne qui prépare votre café au lait et raccommode vos chaussettes, ou le respect que vous inspire la mère de vos enfants. Cette femme, cette passante que tu as oubliée, je me la rappelle, moi, car elle a pris dans mon souvenir la valeur d’un symbole. Vous discutiez tous les deux de l’endroit où vous iriez déjeuner. Tu vois si ma mémoire est fidèle. Elle finit par choisir un restaurant de Bougival. Tu m’invitas même, par gentillesse, à vous accompagner. Que le ciel était bleu, qu’il faisait beau, mon Dieu ! Je trouvai un prétexte pour ne pas accepter, le prétexte de ceux qui savent qu’un apéritif, ils peuvent le rendre, tandis qu’un déjeuner, ça ne leur est pas aussi commode. Vous partis, je regagnai la vieille rue Descartes et me plongeai avec une ardeur mystique dans mes cahiers. Encore une fois, je ne souffrais point. Je trouvais cette différence de ton sort et du mien toute naturelle. J’avais une confiance naïve dans l’avenir pour l’effacer. Mais l’avenir n’efface jamais rien ; il aggrave. Si j’avais souffert, si je m’étais insurgé, j’aurais peut-être été sauvé. Je n’aurais pas été celui qui prend tout au sérieux, et croit sa destinée engagée pour toujours par le sourire de la première femme qui passe. Cette femme, sans doute, elle peut ne jamais passer. Alors, tout est bien, et l’on arrive sans secousses au terme de son existence, en s’imaginant que le bonheur, c’est cette monotonie, ce néant, ce vide. La terre est peuplée d’infortunés de ce genre, qui se figurent que rien ne leur manque. Mais que l’événement qu’ils n’attendaient pas vienne à se produire, qu’ils aient, à sa lueur, la soudaine révélation qu’il y a tout de même autre chose, une chose qu’ils ont failli ne pas connaître, les voilà alors avec l’impression qu’ils ont été bernés. Le réveil est épouvantable, tu peux m’en croire. Ma vie, à moi, semblait bien réunir toutes les conditions pour ne jamais être bouleversée par quelque chose de semblable. Je ne soupçonnais même pas que cela pût exister. Mais on ne peut, n’est-ce pas, se défier de l’inconnu, ni calculer l’imprévisible. Il y a eu la guerre. La guerre a apporté à de pauvres hommes qui se croyaient heureux la terrible révélation du contraire. J’ai été de ces victimes-là. Je t’ai promis d’être calme. Je crains de t’ennuyer, à la longue, avec mes divagations…
Schmidt secoua la tête.
— Continue, dit-il gravement.
VII
Les yeux de Schmidt commençaient à se faire aux ténèbres environnantes. Contre les carreaux de la fenêtre, il entendait le crissement aigu du sable rabattu par le vent.
Sans s’en apercevoir, il avait rapproché son fauteuil du lit. C’était une curieuse chose que l’émotion avec laquelle il se remémorait à présent les deux années qu’ils avaient passées ensemble à Polytechnique. Jamais Forestier n’y avait eu la réputation d’un garçon très communicatif. Depuis une semaine qu’il était à Moukden, c’est à peine s’ils avaient échangé quelques mots en dehors du service. Et, tout à coup, ce brusque besoin de parler ! Schmidt ne pouvait s’empêcher de songer à la gravité des motifs qui avaient pu décider son ami à rompre ainsi ses habitudes de silence.
— Qu’as-tu su exactement de ma vie, depuis notre sortie de l’École ? demanda Forestier, après une pause.
— Pourquoi cette question ? dit Schmidt.
— Rassure-toi : ce n’est pas un piège que je te tends. Je n’ai d’autre but que d’éviter les détails fastidieux. Je ne veux pas risquer de te raconter des faits au courant desquels il est possible que tu sois déjà.
— Je n’en sais pas beaucoup plus sur toi que sur la plupart de nos camarades. Tu as d’abord été ingénieur des mines. Puis, tu es entré dans l’industrie privée. La société à laquelle tu appartenais t’a envoyé en Russie. Tu as regagné la France au moment de la guerre. Tu as été blessé. Tu es revenu là-bas en 1915. Tu y es resté jusqu’après l’armistice. Voilà. Ah ! j’oubliais : je sais aussi que tu es marié, et que tu as deux enfants.
— C’est tout ?
— Oui, c’est tout.
— Est-ce que tu n’as jamais eu l’occasion d’aller en Russie, d’y séjourner ?
— Jamais.
— Bien, dit Forestier. Approche-toi un peu plus, veux-tu ?
Sa voix était maintenant étrangement calme. Mais sa main, qui serrait plus fort celle de Schmidt, brûlait.
— Ce fut en 1912, commença-t-il, que je cessai d’être au service de l’État. Je n’aurais pas mieux demandé que d’y demeurer. Mon peu d’ambition, mon goût de la stabilité, tout concourait à faire de moi un fonctionnaire. Mais je n’étais déjà plus mon maître. J’avais des charges. Quelques années auparavant, je m’étais marié. J’avais épousé une de mes cousines, genre d’union, penseras-tu, sans doute, plus à la louange de mon esprit de famille qu’à celle de mon imagination.
Notre second fils venait de naître. Une opération qu’avait dû subir ma femme nous avait coûté très cher, avait absorbé toutes mes petites disponibilités. Si les grandes aventures ont généralement des dénouements médiocres, à l’inverse, on trouve bien des fois d’humbles circonstances comme celles-ci à la base des plus graves bouleversements.
Un an plus tôt, j’avais refusé dans l’industrie privée une situation fort intéressante. Il m’eût fallu m’expatrier. Après la naissance de mon second petit garçon, la maladie de ma femme, il ne me fut plus permis d’hésiter. Je pris mes informations. Le poste qu’on m’avait proposé n’était plus vacant. Mais les affaires montées par la société qui m’avait pressenti étaient en train de prendre une extension énorme. On envisageait la création prochaine de nouveaux emplois. Seulement, il me fallait tout de suite poser ma candidature. C’est ce que je fis. J’obtins un congé de trois ans, pour convenances personnelles. Tu connais certainement la société en question : L’Union Métallurgique de Saône-et-Loire. Je me mis aussitôt à sa disposition.
Cette société, spécialisée dans la production du matériel d’artillerie, avait doublé rapidement son capital, à la suite de grosses commandes passées par les puissances balkaniques. Sa réputation était devenue telle que le gouvernement russe, à son tour, par l’intermédiaire du nôtre, était entré en rapports avec elle. Il ne s’agissait primitivement que de livraison de matériel fabriqué en France. Mais, très vite, l’affaire s’amplifia. Les dirigeants de la société, séduits par l’idée de la fabrication sur place, s’appliquèrent aux moyens de la réaliser. Je n’ai pas besoin d’insister sur les avantages de la combinaison : suppression des frais et des difficultés de transport, mainmise financière sur un des territoires du monde les plus riches en minerais de toutes sortes. Inutile de te dire, en effet, qu’on ne s’engageait pas au hasard, et que le choix de la région où devaient s’élever nos usines était l’œuvre d’experts qui avaient étudié la question de longue date, et qui n’étaient pas précisément des enfants.
Tout marcha au début comme sur des roulettes. Avec les Russes, tant qu’il ne s’agit que de projets, de promesses, on s’entend toujours. Les choses ne se compliquent qu’au moment où les engagements doivent être tenus. Et ce qu’il y a alors de plus déprimant, c’est qu’on n’a même pas la ressource de leur en vouloir, de suspecter leur bonne foi, qui continue à rester entière.
Je te donnerai, si besoin est, au cours de mon récit, des détails complémentaires sur notre cahier des charges, sur les clauses du contrat qui unissait sous le contrôle tout naturel de l’État français, notre société et le gouvernement impérial. Pour l’instant, qu’il te suffise de savoir qu’au début de 1913, après un court stage au siège social pour me mettre au courant et entrer en contact avec le haut personnel administratif de l’entreprise, je partais pour la Russie. Ma femme, remise depuis peu, m’accompagna à la gare, avec les deux enfants. Nous pleurâmes bien l’un et l’autre, je te le jure, cette fois-là, en nous quittant.
Arrivé là-bas, j’eus l’heureuse surprise de trouver les travaux de premier établissement beaucoup plus avancés qu’on ne se l’imaginait à Paris. Les ateliers étaient construits ; la plupart des machines se trouvaient déjà en place, ne demandant qu’à fonctionner. Quant aux matières premières, étant donné l’endroit choisi, elles étaient bien entendu à pied d’œuvre. Le directeur général, auprès de qui on me détachait en qualité d’adjoint, n’avait pas boudé à la besogne. Il était de ceux qui promettent peu et font beaucoup. Son nom te dira sûrement quelque chose : Dumanoir, un ancien ingénieur des mines, lui aussi. Chef de bataillon du génie dans la réserve, il devait rentrer en France en août 1914, en même temps que moi, pour se faire tuer bêtement, dès les premières semaines de la guerre, à un poste où le premier venu l’aurait aussi bien remplacé. Sa mort aura eu sur ma vie une influence capitale.
La concession qui nous avait été octroyée était située sur le versant asiatique de l’Oural, dans le gouvernement d’Orenbourg, district de Tcheliabinsk, à une demi-lieue environ d’une ville de six mille habitants, du nom de Novo-Petrovsk.
C’était une cité assez coquette, avec ses maisons de bois à balustrade, son Kremlin, la coupole pourpre et or de son église, son bazar où, vers l’époque de la foire d’Irbit, campaient des caravanes tartares venues de Semipalatinsk, de Merv et de Bokhara. L’atmosphère était alors toute chargée d’étranges senteurs orientales. Par Novo-Petrovsk passe – passait, plutôt – la grande allée de bouleaux que Catherine II fit planter de Nijni-Novgorod aux provinces minières. Une rivière, la Mouravia, affluent de l’Ischim, lui-même affluent de l’Irtich, l’arrose, et fournissait de mon temps du poisson en abondance, et de qualité excellente. La ville est adossée aux contreforts de l’Oural qui, dans cette région, atteignent de douze à quinze cents mètres d’altitude. Elle est située à distance égale de Tcheliabinsk et de Troïtsk sur le tronçon du Transsibérien qui unit ces deux villes et se prolonge, par-delà Troïtsk, jusqu’à Orsk et à Gouriev, qui est un port fortifié du même gouvernement, au nord de la Caspienne. Je m’excuse d’insister si longuement sur Novo-Petrovsk, mais j’y ai vécu quatre années de mon existence et la plupart des événements dont j’ai à te parler ont eu cet endroit pour décor.
Un des premiers soins de notre directeur, à son arrivée, un an auparavant, avait été de faire construire deux kilomètres de voie ferrée, destinés à relier à la gare de Novo-Petrovsk l’emplacement où s’élevait l’usine. Cette précaution lui avait permis de gagner beaucoup de temps, dans un pays où, d’ordinaire, les communications sont interminables, et de réaliser, dans un délai relativement court, le transport des matériaux qu’il ne lui avait pas été possible de se procurer sur place. La main-d’œuvre non plus ne lui avait pas manqué, grâce au concours des autorités locales ; il avait recruté des Kirghizes, des Turkmènes, des Chinois de Kachgarie, qui sont les meilleurs remueurs de terre que l’on connaisse. L’élite de nos ouvriers se composait d’Allemands sans lesquels nous n’eussions pu rien faire. Ce n’était pas une chose excellente quant aux secrets de fabrication. Mais dans la vie, il y a toujours du pour et du contre.
Au début de mai 1913, l’installation était donc déjà presque terminée. Les ateliers, les magasins, les bâtiments annexes s’étageaient au flanc d’une montagne couverte de sapins dans sa partie supérieure, dans sa partie basse de bouleaux et autres arbres à feuilles tombantes. Un torrent qui bordait notre territoire, et se jetait, cinq cents mètres plus loin, dans la Mouravia, fournissait l’énergie électrique, nous dispensant de recourir à l’usine de Novo-Petrovsk dont les turbines étaient sans cesse en réparation. Les habitations du personnel étaient prêtes. Le directeur technique, le chef de la comptabilité et moi, nous avions pour notre part un chalet spacieux, élevé au bord du torrent, en un coin de la concession qu’on s’était gardé de déboiser. Bien que le printemps fût cette année particulièrement précoce, il y avait encore des écharpes de neige immaculée au pied des mélèzes, dans les creux des vallonnements exposés au nord. Le murmure des eaux courantes se mêlait toute la nuit au murmure du vent dans les arbres. Le jour, de la fenêtre de ma chambre, j’apercevais à ma droite les noires sapinières qui dévalaient du faîte de la montagne, et, devant moi, l’immense steppe sibérienne, dont les hautes herbes argentées ondulaient à perte de vue.
J’étais heureux. J’avais une triple raison de l’être. D’abord, j’étais logé avec un confort dont je n’avais encore jamais bénéficié. Ensuite, n’ayant ni l’envie, ni les occasions de faire des dépenses, j’étais rassuré sur le sort des miens, à qui je pouvais envoyer chaque mois la moitié de mon traitement, le reste demeurant entre mes mains pour y constituer, en très peu de temps, une réserve des plus rassurantes. Ma tâche, enfin, me passionnait. Déjà l’ère de la production était ouverte, et les premiers résultats obtenus nous valaient, d’un côté, les félicitations de notre société, de l’autre, celles de l’état-major russe. Théoriquement, nous travaillions sous la tutelle des services de l’artillerie impériale, qui s’exerçait par l’intermédiaire du gouverneur d’Orenbourg, le général prince Ordonov. Le général Ordonov avait accompli toute sa carrière dans la cavalerie. C’était un parfait gentilhomme et un brave officier, mais sa compétence en matière de canons semblait assez restreinte. Ses inspections – il y en eut trois en un an – revêtaient plutôt le caractère de visites mondaines. Escorté d’aides de camp aux uniformes éblouissants, il traversait rapidement les ateliers, ne se perdait pas en vaines demandes d’explications, distribuait à tous des compliments et de bonnes paroles, réclamait un jour de congé et des gratifications pour les ouvriers, et passait, pour finir, dans notre salle à manger, où l’attendait un champagne dont il se déclarait plus satisfait que de tout le reste.
Lorsque, rappelés en France par la mobilisation, nous nous arrêtâmes à Orenbourg, où nous devions prendre le train pour gagner Moscou par Samara, il nous reçut magnifiquement et nous convia à une grande parade guerrière, avec défilé des troupes de la garnison, charges de cosaques, tirs réels d’artillerie. Ce dernier numéro du programme fut le moins bien exécuté, par suite d’une distraction des servants qui, ayant à présenter une batterie de 75 en action, s’étaient fait suivre au polygone de caissons d’obus de 155. La bonne humeur du prince Ordonov ne s’en trouva pas compromise le moins du monde : « À Berlin ! cria-t-il, tandis que notre train s’ébranlait. Je vous y retiens tous à dîner avant six semaines. » De tous les occupants du wagon qui nous emportait, notre directeur était le seul peut-être à ne point partager cet optimisme. Non qu’il ne fût pas confiant dans l’issue de la guerre. Mais il laissait son usine aux mains de techniciens russes. De tout le personnel français, il ne restait à Novo-Petrovsk que notre chef comptable, dispensé par son âge du devoir militaire. L’avant-veille, avait eu lieu la remise des services. Elle s’était effectuée dans un enthousiasme qui n’était pas parvenu à dissiper les sombres pressentiments de M. Dumanoir. « Dans quel état retrouverons-nous tout cela ? », n’avait-il cessé de murmurer, en jetant un dernier regard sur son œuvre. Ce genre d’épreuve devait pourtant lui être épargné. C’était à moi, à moi seul, qu’était réservé le douloureux privilège de comprendre ce qu’il avait voulu dire.
Je ne souhaite pas à quelqu’un qui aime tant soit peu son métier de connaître les affres par lesquelles je passai au cours des six premiers mois qui suivirent mon retour à Novo-Petrovsk. La blessure que j’avais reçue en 1914 m’avait tenu une année entière éloigné du front. Je m’apprêtais à rejoindre mon corps, lorsque je fus convoqué au siège de la société. Là me fut notifiée une décision du ministère de la Guerre qui me plaçait, d’accord avec le gouvernement russe, à la tête de notre usine de l’Oural. On était à peu près sans nouvelles de celle-ci ; depuis trois mois, on n’avait pas eu une seule lettre de notre chef comptable, et son dernier rapport, pour qui savait lire entre les lignes, avait paru assez alarmant. L’ordre était formel. Sans me faire illusion sur la valeur de l’avancement que je recevais de la sorte, je partis. Je me souviendrai toujours de mon arrivée après trois semaines du plus démoralisant des voyages. Il était onze heures du soir, en plein hiver. Ce fut à grand-peine que je trouvai, dans la ville endormie sous la neige, une voiture pour franchir les deux kilomètres qui me séparaient de l’usine. Non, le pauvre Dumanoir ne s’était pas trompé. Dans quel état je la retrouvais, mon Dieu !
À la fin de 1916, j’avais réussi néanmoins à remettre à peu près tout sur pied. La fabrication des canons avait été, bien entendu, interrompue. Nous nous consacrions uniquement à celle des munitions, dont l’offensive engagée par Broussilov entraînait une consommation gigantesque. L’usine, pendant mon absence, avait été militarisée. Il me fallut d’abord, sous la menace réitérée de ma démission, obtenir qu’on me débarrassât des ingénieurs et des officiers russes qui nous avaient succédé, et dont la nullité n’avait d’égale que l’apathie ; j’en reçus d’autres, qui ne valurent guère mieux.
Comme ouvriers, pas un spécialiste : des soldats réformés, des condamnés, des prisonniers de guerre. Au milieu de ce troupeau, moi, seul Français. La première chose, en effet, que j’avais apprise en arrivant à Novo-Petrovsk, avait été la raison du silence de notre chef comptable. Il était mort plusieurs mois auparavant, et personne à l’usine n’avait pris la peine d’informer qui que ce fût de son décès.
Tant de tourments, de fatigues, de labeur pour rien, tu m’entends, pour rien ! J’en ai encore la nausée au cœur. Mon usine était devenue le microcosme où j’assistais à la décomposition de la Russie. Désastres militaires, avènement de Kerensky, coup d’État bolcheviste, tout cela se manifestait pour moi de la même façon ; tout cela m’était annoncé, non par les journaux ou des nouvelles qui n’arrivaient plus, mais par des défections de plus en plus fréquentes dans mon personnel. Les gradés furent loin d’être les derniers à s’éclipser. Ils avaient été précédés dans leur désertion par la plus grande partie des ouvriers russes. Les prisonniers suivirent ; les uns, comme les Allemands, que la révolution et la paix rendaient libres ; les autres, comme les Tchécoslovaques, qui s’en allèrent par petits paquets, sans qu’à la fin je cherchasse même à les retenir. Le jour où le dernier de mes hauts fourneaux s’éteignit, je n’éprouvai pas de souffrance particulière. Il y avait longtemps que je m’y attendais. J’avais tenu du mieux que j’avais pu Paris au courant des événements, répété que ma présence n’était plus là-bas d’aucune utilité, réclamé mon rappel… Chaque fois on avait répondu en insistant pour que je restasse. Chose plus grave, on ajoutait qu’on me laissait juge du moment où je devrais mettre la clef sous la porte, en admettant qu’il y eût encore une clef et une porte dans un pays que je sentais sombrer avec une vitesse vertigineuse dans le chaos. Celles de ces instructions qui réussissaient à me parvenir avaient subi des retards de deux et trois mois et ne correspondaient plus que de très loin à une réalité sans cesse aggravée. Si j’étais rentré en France, personne n’eût été en droit de me faire grief de ma décision. Tout autre que moi, probablement, serait parti, et aurait bien fait de partir. Captif de mes vains scrupules, je restai.
Je restai, et je dirais sans doute que cette époque fut la plus lugubre de ma vie, s’il n’y avait eu celle qui est venue ensuite. Je restai, et si j’insiste sur les raisons parfaitement honorables qui m’y décidèrent, c’est que je ne devais plus avoir, un peu plus tard, pour demeurer, que des raisons déshonorantes. Je restai, et le jour ne fut pas long à venir où je me trouvai seul, parmi les bâtiments de l’usine désertée. Je dis seul, car je ne puis compter pour grand-chose trois pauvres domestiques tartares qui s’étaient attachés à moi, les deux premiers je ne sais trop pourquoi, car je n’avais jamais eu à leur égard de bontés particulières, le dernier parce que je l’avais arraché, un an auparavant, à un ivrogne de contremaître qui l’avait fait attacher nu jusqu’à la ceinture, au tronc d’un sapin.
Tels sont les pauvres diables qui m’ont aidé, armés jusqu’aux dents, durant les semaines les plus menaçantes, à tenir en respect les pillards de l’émeute et des grands chemins, à sauvegarder les intérêts des actionnaires d’une entreprise où je n’avais pas un centime. J’avais fait filer, dès que les choses m’avaient paru se gâter, tous les fonds dont j’étais responsable, ne conservant, outre ce qui m’appartenait, qu’une centaine de mille francs, pour parer aux nécessités immédiates d’une reprise éventuelle des affaires. Cet argent-là, bien entendu, je ne l’avais pas laissé dans le coffre-fort de l’usine. Autant eût valu publier à son de trompe, sur la grand-place de Novo-Petrovsk, où il se trouvait. Je m’étais ingénié à découvrir pour lui une cachette sûre, ainsi d’ailleurs que pour le champagne et les liqueurs que mes techniciens n’avaient pas eu le temps de boire avant leur désertion, car le vin, l’alcool, dans ce pays enfantin et tragique, autant et plus que l’argent, rendent les hommes fous et traîtres. Je sais, je sais, il y a un troisième fléau : le jeu. N’aie pas peur. Nous en reparlerons bientôt.
Je juge vain et au-dessus de mes forces de te dépeindre ce qui arriva pendant cet hiver de 1917-1918, la désorganisation, le retour à la barbarie d’une contrée que j’avais connue travailleuse et prospère, sans que, d’ailleurs, à l’origine, la paix de ce pays ait été particulièrement menacée. Trop éloigné des centres révolutionnaires, il ne devait être que plus tard tiré de force de son sommeil. Sa population n’était pas mûre pour placer tout de go Karl Marx au nombre de ses icônes. Les premiers émissaires du nouveau régime y furent reçus à coups de fourche et de fusil. Leur retraite précipitée raya Novo-Petrovsk du reste de l’univers. Le chemin de fer n’y arrivait plus. Les rames de wagons, les locomotives demeurées dans la gare disparaissaient petit à petit sous la neige, prenaient figure de tumulus informes.
Cet engourdissement qui gagnait le monde extérieur n’était rien auprès de celui qui, dans le même temps, commença à s’emparer de moi. Au début, je me rendais quotidiennement à Novo-Petrovsk. Puis, je n’y allai plus qu’une ou deux fois par semaine. Puis, plus du tout. Le jour vint où je ne sortis plus de la concession, où je n’eus même plus la force de me soustraire au spectacle de la désagrégation de mon usine. De tous les rouages de cette merveille industrielle dont j’avais été si fier, seul l’éclairage fonctionnait encore. Sous le dôme obscur des sapins, les ampoules électriques continuaient à briller, solitaires, semblables à des halos de triste féerie. Le soir où je les laissai s’éteindre, je poussai le soupir de soulagement de celui qui a trop lutté. Tout disparut dans la grande nuit hivernale. Il n’y eut plus que la lumière de la lune pour éclairer ce décor glacial, ces bâtiments abandonnés, ce torrent à demi figé dans sa course, ces bosquets de bouleaux blanchâtres qui me donnaient, quand il m’arrivait de me promener parmi eux, l’impression d’errer au milieu d’une forêt d’ossements.
Au pied de ma véranda, la route de Novo-Pétrovsk passait, déserte. Cette route, que j’avais connue grouillante des allées et venues de près de deux mille ouvriers, je la contemplais silencieusement, des journées entières. Je ne pouvais certes me douter que l’heure n’était plus éloignée où j’allais y voir s’avancer à petits pas, dans le plus baroque appareil, ma pitoyable destinée.
VIII
Forestier s’arrêta brusquement. Une sonnerie venait de retentir dans le corridor.
— Quelqu’un ?
— Non, dit Schmidt, le téléphone.
— C’est pour toi. Va voir.
— Inutile. Je n’attends rien. Continue.
— Va tout de même. Qui peut savoir ?
Il priait et ordonnait à la fois. Le drôle d’homme ! Schmidt se leva.
— Soit. Je reviens tout de suite.
— Eh bien ? fit Forestier, quand l’autre fut de retour.
— Rien d’important, dit Schmidt.
— C’était le major Matsui, n’est-ce pas ? Il voulait avoir de mes nouvelles.
— Non, oui… c’est-à-dire… Je devais dîner ce soir chez des amis avec Matsui. Il voulait savoir s’il devait venir me chercher en auto, comme il fait d’ordinaire. Mais je lui ai dit que je ne sortais pas.
— Et il en a profité pour te demander comment j’allais ?
— C’était la moindre des choses. Veux-tu boire ?
— Volontiers.
Il vida lentement la tasse de thé que lui tendait à tâtons son camarade.
— Je ne t’ennuie pas, au moins, avec mon histoire ?
— Tu plaisantes, voyons.
Schmidt s’efforçait de ne paraître que poli. Il ne voulait pas s’avouer que la curiosité qu’il venait effectivement de sentir dans le coup de téléphone du Japonais, avait décuplé la sienne.
— Le comble serait que, dès hier, il eût deviné ce que je ne saisis pas encore, pensa-t-il, se remémorant certaines phrases, certains silences de Matsui.
Forestier, cependant, s’était remis à parler.
— Un jour de 1918 – l’été approchait de sa fin, et des nuages blancs passaient dans le ciel bleu pâle – un événement quasi miraculeux se produisit.
J’étais en train de prendre mon repas de midi dans cette salle à manger qui avait connu les grandes réceptions du général Ordonov, lorsqu’un ronflement de moteur, suivi de l’appel d’une trompe d’automobile, se fit entendre.
Le Tartare qui me servait avait bondi au-dehors. Je n’eus pas moi-même le temps de sortir qu’il était déjà de retour. Il dansait et chantait.
— Qu’y a-t-il ?
— Monsieur le directeur, c’est Georges.
— Qui, Georges ?
— Monsieur le directeur ne se souvient pas ?
J’avais beau fouiller dans ma mémoire, je ne réussissais pas à y découvrir qui était ce Georges. Je n’y parvins pas davantage quand il fut devant moi.
Introduit par les Tartares, je vis entrer un homme d’une trentaine d’années, engoncé dans une capote de lieutenant de l’armée russe, mais avec des détails de costume, des insignes, des écussons que je ne connaissais pas. Georges eut le bon goût de ne pas différer les éclaircissements que mon attitude un peu sur le qui-vive exigeait de lui. Ex-sous-officier dans l’armée autrichienne, prisonnier de guerre, il avait été pendant deux ans employé à l’usine. Il était parti l’un des premiers, à la faveur de l’anarchie commençante. Je t’ai dit tout à l’heure que je n’avais eu ni le pouvoir, ni la volonté de m’opposer à ce genre d’exode. Maintenant, il était de retour, sous un uniforme, m’expliqua-t-il, qui n’était pas un déguisement. Je congédiai les Tartares, et, l’ayant fait asseoir, je l’écoutai. Ce qu’il avait à me dire, ainsi que tu vas le voir, était loin d’être dénué d’intérêt.
Né aux environs de Prague, Georges était Tchèque, et, comme tel, il ne nourrissait qu’une sympathie modérée pour les Autrichiens qui l’avaient enrôlé dans leur armée, pour les Allemands qui avaient contraint l’Autriche à entrer en guerre, pour les Russes dont il n’avait pas eu beaucoup à se louer durant sa captivité. Sa bonne étoile l’avait fait affecter à notre usine, et il gardait un excellent souvenir du temps qu’il y avait passé. Il s’exprimait avec un enjouement, un air de franchise qui me conquirent vite, trop heureux que j’étais, par ailleurs, de cette aubaine inattendue. Je ne le laissai pas entrer davantage dans la voie des explications. Il y avait bien six mois que je n’avais mis les pieds dans la cachette aux liqueurs. J’y descendis tout exprès pour lui, en remontai une bouteille prise au hasard, et nous causâmes.
Il me mit au courant des plus récentes nouvelles de la guerre. Je ne savais plus rien des opérations sur le front occidental, ni des progrès de la révolution en Russie. Georges satisfit du mieux qu’il put ma légitime curiosité. Il termina son petit exposé en m’apprenant la récente formation, en Ukraine, sous les auspices de l’Angleterre et de la France, de légions tchécoslovaques, destinées à seconder les efforts de l’Entente et à lutter contre les bolchevicks.
Cette dernière information ne me surprit qu’à demi. Je savais qu’un tel projet était nourri depuis longtemps par les Alliés. Je n’avais qu’à me souvenir de toute la série de circulaires par lesquelles le gouvernement français, alors que l’usine fonctionnait encore, me prescrivait de traiter avec des ménagements particuliers les prisonniers d’origine tchèque que je pouvais avoir sous mes ordres. Il m’avait été à cette époque d’autant moins difficile d’appliquer ces instructions, que je n’avais qu’à me louer de ces prisonniers-là. Depuis, les ponts avaient été coupés entre Novo-Petrovsk et le monde civilisé. Je n’avais eu aucun moyen d’apprendre que le fameux projet en question était devenu une réalité.
Pour l’instant, la nouvelle armée était en train de procéder à l’organisation du front de l’Oural, dont elle avait la défense contre les troupes rouges. Le général tchèque Syrovy, commandant en chef, avait son quartier général à Tcheliabinsk. Afin d’établir la liaison avec Orsk et Orenbourg, demeurés aux mains des Russes blancs, sous les ordres de l’ataman Doutov, Novo-Petrovsk allait servir de base d’opérations à un régiment tchécoslovaque. L’arrivée du colonel Gregor, placé à la tête de ce régiment, était annoncée pour le surlendemain.
— Sachant que je connais le pays, dit Georges, le colonel Gregor m’a pris comme officier d’ordonnance et m’a envoyé en éclaireur. C’est un homme d’une grande politesse, avec qui vous vous entendrez fort bien. Je suis à Novo-Petrovsk depuis ce matin. Vous voyez que je n’ai pas trop tardé à vous rendre visite.
Ses galons tout neufs le rendaient optimiste.
— Nous en avons vu de rudes, en Ukraine et en Sibérie, continua-t-il. Mais à présent, tout va bien marcher. Je constate avec plaisir que l’usine n’a pas trop souffert. D’ici un mois, elle aura rallumé ses fourneaux. Nous n’étions pas de trop mauvais ouvriers, n’est-ce pas, quand nous servions ici comme prisonniers. Songez donc à ce que vous êtes en droit d’attendre de nous, maintenant que c’est pour notre liberté, pour notre idéal, que nous allons nous mettre à l’œuvre.
J’aurais eu d’autant plus mauvaise grâce à douter de ces paroles, que j’étais naturellement enchanté de la tournure inespérée que prenaient les événements. Je crus bon, néanmoins, de ne pas m’abandonner tout de suite à un enthousiasme peut-être imprudent, de faire quelques réserves.
— Je m’attendais plutôt, évidemment, à l’arrivée des bolcheviks qu’à la vôtre, fis-je. C’est vous dire assez que ma surprise est des plus agréables. Pour ce qui est de l’usine, je ne demanderais pas mieux que de la mettre à votre disposition. Vous comprendrez néanmoins que je désire connaître les intentions de mon gouvernement de façon un peu précise. Il ne faut pas oublier, en outre, que si je suis resté ici, c’est aussi pour sauvegarder les intérêts de la société que je représente. Dans ces conditions…
Mais Georges me coupa la parole.
— Cinq minutes de discussion avec le colonel Gregor auront tôt fait d’arranger tout cela. Il a les documents qu’il lui faut pour lever vos scrupules, pour vous prouver que nous sommes appelés, vous et nous, à mener le même combat. À présent, monsieur le directeur, je vais vous demander une grâce. Autorisez-moi à me promener un peu dans la concession. Si vous saviez la joie qu’il peut y avoir à parcourir, homme libre, les endroits où l’on a vécu prisonnier !
Le lendemain matin, à la première heure, de nouveaux appels de trompe résonnant devant la porte de l’usine vinrent nous convaincre, mes Tartares et moi, que l’ère de l’isolement était bien close. Le commandant militaire de Novo-Petrovsk était arrivé dans la nuit, en avance d’un jour sur son itinéraire. Il désirait s’entretenir avec moi le plus tôt possible. Si mes occupations m’en laissaient le loisir, je n’avais qu’à monter aussitôt dans l’automobile qu’il m’envoyait. Sinon, j’indiquerais à quel moment je désirais qu’on revînt me chercher.
— Mes occupations me laissent libre, dis-je avec dignité au chauffeur qui me transmettait cette courtoise invitation.
En traversant la ville, je fus favorablement impressionné par le spectacle de soldats tchécoslovaques déjà attelés à des travaux de voierie. D’autres travaillaient avec ardeur au déblaiement de la gare. Nombre de boutiques avaient rouvert leurs portes. Nous croisâmes un bataillon qui défilait dans un ordre excellent, musique en tête, escorté d’enfants gambadant et poussant des cris de joie.
Je fus immédiatement introduit auprès du colonel Gregor.
C’était un homme de belle prestance, âgé tout au plus de quarante-cinq ans, mais à qui des cheveux presque tout blancs en faisaient paraître soixante. Il était grand, bâti en force. Mais, par instants, ce corps robuste semblait se tasser. Une expression de découragement, de lassitude infinie envahissait ce visage altier et volontaire… Quoiqu’elle m’eût frappé dès ce premier contact, il ne m’était pas possible de soupçonner alors les véritables motifs d’une mélancolie que les soucis du métier et les vicissitudes de la guerre me parurent suffire à justifier pour le moment.
Son officier d’ordonnance ne s’était pas trop avancé en affirmant que je m’entendrais très vite avec le colonel Gregor. En moins d’un quart d’heure, il avait levé toutes mes hésitations. Les dépêches du gouvernement français dont il était porteur ne laissaient aucun doute sur le caractère absolu de la collaboration que j’étais tenu de prêter à nos nouveaux alliés. Quand même j’y eusse répugné, ce qui n’était pas le cas, je n’avais plus, en présence d’ordres aussi péremptoires, qu’à mettre mon usine à la disposition du commandement tchécoslovaque, et qu’à m’y mettre également.
— Je tâcherai donc de faire de bonne besogne, dis-je, pour peu que vous m’en fournissiez les moyens.
— Je m’efforcerai moi-même de vous les fournir. Pour commencer, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je serai heureux de visiter l’usine le plus tôt possible.
— Aujourd’hui même, si vous voulez.
— Parfait, et vous me ferez ensuite l’honneur de dîner avec moi, n’est-ce pas ?
— Volontiers.
— Par exemple, dit-il en souriant, il ne faudra pas vous montrer trop difficile. La science de mon cuisinier est fort modeste, et je crains en outre qu’arrivé seulement de ce matin à Novo-Petrovsk…
Je souris aussi.
— J’ai passé dans ce pays par trop de traverses pour avoir conservé le droit de me montrer très exigeant. Néanmoins, mon colonel, je crois que, pour le premier jour, il serait bon de procéder de façon différente. Mon installation n’est certes pas fameuse, mais elle date de plusieurs années, et, comme telle, elle est certainement supérieure à la vôtre. Ce soir, c’est vous qui accepterez mon hospitalité.
— Soit, dit-il, et de grand cœur. Je serai donc là-haut vers six heures, afin que nous ayons le temps de faire notre tournée avant la tombée de la nuit.
Il fut exact au rendez-vous, et nous commençâmes aussitôt notre randonnée à travers les bâtiments de l’usine. La perspective de voir celle-ci sortir enfin de son sommeil avait secoué ma propre torpeur. Je multipliais les détails, les explications que le colonel Gregor écoutait avec une gravité réfléchie. Son arme d’origine étant l’infanterie, les questions relevant du domaine des industries de guerre lui demeuraient naturellement assez étrangères. Mais il était d’esprit ouvert, avait du bon sens, savait questionner à propos. Il n’y avait que lorsque l’expression dont j’ai parlé réapparaissait sur son visage que ces qualités se trouvaient comme suspendues. Deux ou trois fois, à la façon dont il me fit répéter, en s’excusant, un renseignement que je venais de lui donner, je compris que ce n’était pas son intelligence qui devait être mise en cause, mais son attention.
À sept heures et demie, nous en avions terminé avec l’usine, je le ramenai au chalet, dans la salle à manger où le couvert était dressé, sous la dansante clarté de quatre chandelles de résine.
— Excusez cet éclairage de fortune. Mais ainsi que je vous le disais tout à l’heure, en moins d’une semaine, pour peu que j’aie la main-d’œuvre indispensable, l’électricité peut être rétablie.
Il faut reconnaître que mes Tartares avaient bien fait les choses. Ce fut moi qui recueillis les éloges qui leur étaient dus.
— Je n’ai pas tous les jours l’occasion de m’asseoir devant un dîner semblable, dit le colonel Gregor.
En quelques phrases, évitant avec soin de se mettre en valeur, il me raconta alors ce qu’avait été son existence depuis 1914 : la guerre, qu’il avait faite comme capitaine dans l’armée autrichienne ; sa captivité en Russie ; la formation des légions tchécoslovaques ; puis la lutte – lutte qu’on devinait pleine d’épisodes atroces – contre les bolcheviks, en Ukraine, en Sibérie…
— Je crois, dit-il, en manière de conclusion, avoir perdu pour bien longtemps l’habitude de dormir dans un lit une nuit entière.
— Ma vie non plus n’a pas toujours été ici couleur de rose, fis-je. Mais, pour ce qui est du confort, j’aurais, certes, mauvaise grâce à me plaindre.
Sur ce, je lui proposai tout naturellement de clore son inspection par la visite du chalet.
— Vous le voyez, ce ne sont pas les lits qui manquent, lui dis-je, quand j’eus fini de lui faire faire le tour des appartements inhabités.
Il ne répondit pas. Son rêve morne l’avait repris. Je l’observais attentivement et vis passer soudain dans son regard quelque chose que je crus être une lueur de convoitise.
— À votre disposition, dis-je alors. Tant que vous n’aurez rien trouvé de convenable à Novo-Petrovsk, vous n’avez qu’à vous installer ici, vous et cinq ou six de vos collaborateurs.
Il me regarda de façon étrange.
— Vous êtes trop aimable, dit-il lentement. Nous finirons bien par nous arranger à Novo-Petrovsk. Pour le temps, d’ailleurs, que je suis appelé à y rester ! Avec le front que j’ai à surveiller, je coucherai sans doute surtout dans mon automobile, ou dans mon wagon. Néanmoins, je retiens votre offre, et il peut arriver que, soit pour moi, soit pour…
— Soit pour vous, soit pour qui vous voudrez, fis-je. Et songez que c’est encore moi qui serai votre obligé. Mes Tartares sont bien gentils, mais une année passée uniquement en leur compagnie, croyez-moi, c’est plutôt sévère.
— Merci !
Il me serra la main avec effusion, une effusion qui, je l’avoue, ne laissa pas de me surprendre quelque peu. Ma proposition, vu les circonstances, n’était-elle pas toute naturelle ?
Une pause suivit cette question que Forestier, par-delà huit années, semblait encore se poser à lui-même. Et Schmidt l’entendit qui murmurait : « Mon Dieu ! »
— Qu’as-tu ?
— Rien. Ou plutôt si : je pense à quelque chose. C’est que toujours, toujours, toujours, c’est nous qui sommes les artisans des catastrophes qui nous accablent. C’est nous, toujours, aveuglément, qui provoquons notre destin.
— Que veux-tu dire ?
— Ce que je veux dire ? Oh ! c’est bien simple. Je veux dire que, ce dîner terminé, rien ne m’obligeait à faire faire au colonel Gregor cette chose que rien ne justifiait, qui n’avait ni rime ni raison, cet imbécile tour du propriétaire. À partir de ce moment, ç’a été fini. L’avalanche n’a plus eu qu’à rouler.
— Je ne comprends pas, dit Schmidt, haletant, et qui ne craignait à la vérité que de commencer à comprendre.
Il reprit :
— Explique-toi !
— M’expliquer ! dit Forestier, dans un sanglot. En aurai-je le courage, à présent que le moment en est venu ?
Il y eut quelques minutes de silence, un silence qui rendit autour d’eux les ténèbres plus épaisses, un silence que Schmidt, tendu pourtant de tout son être vers ce qui allait suivre, n’aurait rompu pour rien au monde…
Et Forestier continua son récit.
— Contrairement à ce que nous avions espéré, l’activité de l’usine était loin de reprendre. Il n’y allait pas de ma faute. Que pouvais-je faire, avec la quarantaine d’éclopés qu’on avait mis à ma disposition. C’était tout juste si j’avais réussi à rétablir le fonctionnement de la machinerie électrique. On m’annonçait sans cesse l’arrivée d’un personnel spécialisé, que je ne voyais jamais venir. Le haut commandement tchécoslovaque, lui non plus, ne pouvait être tenu pour responsable de cette carence. Disposant d’effectifs très réduits pour organiser l’immense front dont il avait la charge, il n’osait point opérer sur des unités appelées d’un moment à l’autre à combattre les prélèvements qu’eût nécessités un agencement tant soit peu sérieux des services de l’arrière. Je n’avais donc même pas la ressource de me plaindre au colonel Gregor d’un tel état de choses. D’ailleurs, depuis l’occupation du pays par ses troupes, les occasions que j’avais eues de m’entretenir avec lui avaient été extrêmement rares. Il était bien venu, à diverses reprises, déjeuner ou dîner au chalet ; il y avait même couché deux fois, mais toujours seul, n’amenant jamais avec lui ses officiers d’ordonnance. J’avais pris le parti de ne plus lui renouveler l’offre que je lui avais faite lors de sa première visite, et il fallut un événement des plus imprévus pour que la chaleur avec laquelle il m’avait alors remercié me revînt en mémoire.
Lentement, les beaux jours finissaient. Peu à peu, la neige recouvrit les pentes de la montagne et descendit jusque dans la plaine. Prisonnières désormais pour six mois de leur gangue de glace, les eaux interrompirent leur chanson. Ce fut sur ces entrefaites que je reçus un billet du colonel Gregor. Il ne manquait jamais de s’annoncer ainsi. Mais, cette fois, ce n’était pas de lui qu’il s’agissait.
Il y avait bien trois semaines que je ne l’avais vu. Je savais seulement qu’il était en inspection dans la partie la plus excentrique de son secteur, vers le sud, du côté d’Orenbourg. Sa lettre me parlait d’un certain général prince Irénéïef, gentilhomme russe envers qui il me disait avoir contracté une dette de reconnaissance durant sa captivité. Aujourd’hui, le général Irénéïef, chassé de ses terres par la révolution, et trop âgé pour reprendre du service, s’était réfugié dans la région de son pays occupée par les Tchécoslovaques. Le colonel Gregor m’annonçait le passage prochain à Novo-Petrovsk de cet émigré de marque. Il me priait de le faire bénéficier d’une hospitalité dont il gardait, quant à lui, le regret de n’avoir pu profiter plus souvent.
Il n’y avait dans le ton de cette requête rien de nature à me mettre en garde contre quoi que ce fût. La réponse que je confiai au vaguemestre qui m’apportait la lettre du colonel Gregor fut donc celle que tout autre que moi aurait faite à ma place. J’y assurais le colonel de ma joie à lui être agréable, ainsi que des égards avec lesquels ne manquerait pas d’être accueilli son ancien protecteur devenu maintenant son protégé.
Huit jours environ s’écoulèrent, durant lesquels, continuant à me croiser les bras, j’attendis avec la plus parfaite indifférence le bon plaisir de mon hôte inconnu. Puis, vers la fin d’un après-midi, comme j’étais accoudé au balcon de ma véranda, regardant mélancoliquement la fumée bleuâtre d’une petite locomotive qui se hâtait à travers la steppe, le plus abracadabrant des spectacles s’offrit à mes yeux tout à coup.
La route de Novo-Petrovsk, à cent mètres de l’usine, faisait un coude. À ce coude venait d’apparaître une automobile comme je n’en avais pas vu depuis bien longtemps, comme on n’aurait plus chance d’en rencontrer que dans les expositions rétrospectives. Ce vénérable véhicule, ressemblant déjà par tant de traits à la roulotte d’une famille de bohémiens, avait encore ceci de commun avec elle qu’il répugnait, pour aller de l’avant, aux procédés strictement mécaniques. Évitant de son mieux les fondrières neigeuses, un équipage de six chevaux, conduits par deux soldats, l’amenait vers moi avec une sage lenteur.
Ce cortège étonnant parvint ainsi jusque sous mes fenêtres, devant la grande porte de l’usine. L’automobile alors s’arrêta. Il en sortit un grand vieillard enveloppé dans une houppelande de fourrure. Galamment, il se retourna, et, procédant avec autant de cérémonie que s’il se fût trouvé à la portière d’un carrosse, il tendit son bras à une jeune femme, qui sauta prestement sur le sol.
IX
Forestier se recueillit une minute.
— C’est ce que je te disais en commençant, reprit-il : sans doute, si j’avais connu, si j’avais aimé d’autres femmes, je ne serais pas devenu fou de celle-ci, la première fois, tu m’entends, qu’elle m’apparut.
Des gens prétendent que c’est impossible. Je ne sais pas. Je n’ai que mon exemple, à moi. Évidemment, pour qu’une telle chose ait lieu, il faut tout un concours de circonstances. Je crois avoir assez bien résumé celles qui ont présidé à mon égarement. À Paris, en temps ordinaire, auprès de ma femme, de mes pauvres petits garçons, dans mon foyer, ce qui est arrivé ne se serait peut-être pas produit, – et encore, je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est que là-bas, retranché du reste du monde, privé de leurs tristes nouvelles, j’étais une proie toute marquée. Quand je la vis, je l’aimai tout de suite. Mais ce ne fut pas tout de suite que je compris que je l’aimais.
Mes souvenirs sont fidèles : ce que je ressentis à cette soudaine irruption dans mon existence, ce fut d’abord un mélange de surprise et de mauvaise humeur. La mauvaise humeur était assez explicable. J’en voulais au colonel Gregor de m’avoir laissé ignorer que c’était non pas un seul, mais deux hôtes qu’il m’imposait. Et s’il ne se fût agi que d’hommes ! Mais une femme ! C’était le complet bouleversement de mes habitudes ! Et pour combien de temps ? Je n’avais pas, là-dessus, la plus petite précision. Je constatais que la discrétion du colonel à mon égard s’était transformée tout à coup en une bien curieuse désinvolture. Quant à ma surprise, elle était, on l’avouera, plutôt justifiée par la façon dont ces deux intrus venaient de se présenter à moi.
Me portant à la rencontre des nouveaux arrivants, j’étais en train de descendre mon escalier avec une hâte relative, lorsqu’un fracas d’imprécations vint accélérer mon allure. C’était le vieillard à la houppelande qui dévidait à mes Tartares abasourdis un splendide chapelet d’injures. M’ayant aperçu, ce fut tout juste s’il ne tourna point contre moi sa colère.
— Monsieur Forestier, je présume ? Bon. Ici, le général prince Ephrem Fedorovitch Irénéïef, ex-premier aide de camp de Sa Majesté le Czar Alexandre III. Par les saintes icônes, par les mânes de la grande Catherine, par la main que j’ai offerte en holocauste à ma patrie bien-aimée, vous ne pouvez pas arguer, monsieur, que vous n’étiez pas informé de mon arrivée. Alors, que signifie, je vous le demande, une réception semblable ? À qui entend-on manquer de respect ? Je sais, je sais, il est toujours loisible d’ergoter, d’accuser, pour se disculper, ses serviteurs. Tel maître, tels valets, monsieur. Non, non, plus un mot, je ne le souffrirai pas. Au reste, si vous tenez absolument à faire éclater votre bonne foi, donnez donc sur-le-champ des ordres à ces trois imbéciles. Dites-leur qu’au lieu de me contempler comme une bête curieuse, ils feraient mieux d’aider les braves soldats que voici à décharger nos bagages. Dites-le, dites-leur, monsieur.
Brièvement, je donnai les instructions nécessaires. À la sécheresse de ma voix, il dut comprendre qu’il avait un peu exagéré, car la sienne se fit tout sucre et tout miel.
— Excusez l’énervement du voyage. Nous roulons ainsi depuis des jours et des nuits. Et par-dessus le marché, il a fallu, à la dernière étape avant Novo-Petrovsk, cette ridicule avarie au moteur de notre limousine. Une voiture qui s’était toujours si bien comportée ! L’impératrice Maria Feodorovna, que Dieu continue à l’avoir en sa sainte garde, avait coutume de faire à son sujet un mot charmant : « De même, disait-elle, que le Czar n’a jamais connu sujet plus loyal qu’Ephrem Fedorovitch, de même la Czarine n’a jamais connu meilleure automobile que la sienne. » C’est même ce compliment, adressé à l’auto que voici vers 1910, qui m’a empêché de la changer, ou seulement de la faire carrosser à neuf. Comme disait l’impératrice, vieillesse est synonyme de loyalisme. Vive le Czar ! Vive la Sainte Russie ! Ah ! mais ! Ah ! mais ! La plaisanterie sur tout ce qu’on veut, mais pas sur les principes. Le colonel Gregor a dû vous en avertir. Cher colonel Gregor ! Avec quelle amitié il parle de vous ! Je vous le dis, Armide Ephremovna vous le dira. N’est-il pas vrai, Armide ? Mais quel être impardonnable je fais ! Les déplorables événements que nous traversons suffiraient-ils donc à transformer un prince en moujik sous le rapport de la plus élémentaire politesse ? Je m’aperçois que je ne vous ai même pas présenté à ma fille. Ah ! mais ! Ah ! mais ! Voilà qui mérite d’être tout de suite réparé. – Monsieur Forestier. – La princesse Irénéïef.
Je serrai maladroitement la petite main gantée que me tendait la jeune fille. Le col de son manteau de fourrure relevé ne laissait entrevoir que la partie supérieure de son visage : un front très pur, de grands yeux clairs, qui souriaient.
— Vous devez être bien fatiguée, balbutiai-je, mademoiselle. Permettez-moi de vous conduire chez vous.
— Chez vous, s’extasia le général, chez vous ! La voilà bien, l’admirable, l’éternelle politesse française ! Nous vous suivons, cher monsieur Forestier. Non, cependant, emmenez la princesse. Moi, je tiens à serrer la main aux braves tringlots qui nous ont aidés à parvenir jusqu’à vous. Je veux également leur laisser un petit souvenir. Cinquante roubles, c’est la moindre des choses, n’est-il pas vrai ? Personne n’a jamais obligé en vain le prince Irénéïef. Allons, bon ! Quelle contrariété ! Rien que des billets de mille roubles dans mon portefeuille !
Je tirai le mien.
— Voici deux billets de cinquante roubles, mon général.
— Merci. N’oubliez pas de me faire penser à vous restituer cette bagatelle. Conduisez Armide Ephremovna dans ses appartements. Je vais m’occuper de nos bagages. Non, non, n’insistez pas pour me décharger de ce soin. C’est une besogne qu’il m’est impossible de confier à personne. J’ai dans mes malles trop de documents secrets, de papiers d’une importance capitale. Vous saisissez ? On n’a pas été impunément pendant vingt années le dépositaire des pensées du maître du monde. Laissez-moi faire. Dans un quart d’heure, je vous aurai rejoints.
Si j’avais pu prévoir que la chambre que j’avais donné l’ordre huit jours plus tôt de préparer dût être destinée à une femme, j’aurais, certes, veillé davantage à son arrangement. Telle quelle, elle n’eut pas cependant l’air de déplaire à la princesse Irénéïef. Son visage s’éclaira. Elle poussa le soupir de ceux qui ont longtemps marché, et pour qui luit soudain la perspective d’un peu de repos.
— Je serai bien, ici, murmura-t-elle.
Elle s’était mise en devoir de se débarrasser de son manteau de fourrure. Une des agrafes résistait. La princesse Irénéïef eut un geste d’impatience. Jamais je n’aurais songé à lui proposer mon aide sans l’invitation involontaire que je lus dans son regard.
Il me fallut du temps, des précautions, pour venir à bout de l’agrafe récalcitrante. La doublure du manteau était en assez mauvais état. L’étoffe menaçait de céder…
J’ai toujours été bien novice dans l’art de dissimuler mes impressions. Celle que j’étais en train de ressentir ne dut pas échapper à la princesse Irénéïef. Elle rougit légèrement.
— C’est un vieux, très vieux manteau, dit-elle tout bas. Mais, n’est-ce pas, vous comprenez, pour le voyage…
— Évidemment, répétai-je, pour le voyage !…
Nous demeurions debout, l’un en face de l’autre, elle les yeux baissés, moi incapable de trouver la phrase, le mot qui m’eût permis de battre en retraite, de la débarrasser de ma présence. La chambre n’était plus éclairée que par les derniers reflets du jour qui traînaient sur la plaine neigeuse. Je ne sais combien de temps encore je serais resté là, figé dans cette posture ridicule, si je n’avais entendu soudain, au rez-de-chaussée, la voix sonore du général qui m’appelait.
— Excusez-moi de vous avoir fait attendre, lui dis-je. Je veillais à l’installation de Mlle Irénéïef.
— La princesse, mon ami, dites la princesse. Ça ne coûte pas plus cher, et c’est tellement plus correct. Eh bien, est-elle satisfaite, la chère enfant ?
— Elle ne m’a point paru mécontente. J’ai dû lui donner la chambre qui vous était réservée, le colonel Gregor ne m’ayant avisé que de votre seule venue. Vous allez donc me permettre, maintenant, de m’occuper de vous.
— Inutile, je suis installé. J’ai choisi une chambre, au hasard, la dernière, à droite, au bout de la véranda. J’y ai fait monter mes bagages.
La chambre en question était précisément celle que je lui destinais. Il y avait néanmoins de sa part un certain sans-gêne à préjuger ainsi mes intentions.
— Vous avez alors tout ce qu’il vous faut ? demandai-je assez froidement.
— Tout ? Heu ! Nous verrons, au fur et à mesure. Dites-moi, quelles sont les heures des repas, ici ?
— À votre gré, et au gré de la princesse.
— À merveille ! Voilà qui est parlé. Dans ces conditions, donnez donc tout de suite les ordres pour qu’on nous apporte le thé. À propos, étant donné l’heure tardive de notre arrivée, vous m’accorderez bien, n’est-ce pas, pour le premier soir, l’autorisation de rester comme je suis, de ne pas me mettre en habit ?
Je le regardai avec quelque stupeur. Il n’eut point l’air fâché de l’effet obtenu.
Un quart d’heure plus tard, nous étions réunis tous deux dans la salle à manger. Armide Ephremovna, qu’on était allé prévenir, s’était déclarée un peu fatiguée. Elle avait exprimé le désir que le thé lui fût servi dans sa chambre.
La conversation sitôt engagée, je pus constater que le général avait su mettre à profit le court moment que j’avais passé auprès de sa fille pour opérer un recensement en règle des ressources de la maison.
— Ça ira, ça pourra aller, conclut-il. Il manque évidemment bien des petites choses. Mais nous ne sommes pas difficiles. Nous savons tenir compte des circonstances. Lorsque toutes ces horreurs auront pris fin, quand la révolution sera jugulée, vous viendrez nous voir, à Irénéïevka, et j’aurai plaisir à vous apprendre ce que doit être une hospitalité digne de ce nom. Un exemple entre mille : votre thé est buvable, mais avouez qu’il ne perdrait rien à être relevé par certains condiments.
— Je vous demande pardon, dis-je. Je m’aperçois, en effet, que mes serviteurs ont oublié les petits gâteaux.
Il haussa les épaules.
— Les petits gâteaux ? Poussière. Qui vous parle de petits gâteaux ? Non, non, il s’agit d’autre chose.
J’écarquillai les yeux. Il sourit, mit un doigt sur les lèvres.
— Tout à l’heure, continua-t-il avec mystère, absolument par hasard, j’ai traversé l’office. Quelque chose a attiré mon attention. Oui, sur une étagère, une bouteille de rhum, d’assez bonne marque, ma foi. Malheureusement, elle était vide, ou tout comme…
Pour le coup, j’avais compris. Je me levai.
— Ayez la bonté de m’attendre un instant, dis-je.
— Je vous accompagne, fit résolument le général.
— Je vous en prie, ne vous dérangez pas.
— Mais si, mais si, voyons, c’est la moindre des choses.
Il m’avait emboîté le pas, avec une décision qui rendait de ma part toute résistance inutile.
Résigné, j’allai prendre dans le corridor une lanterne que j’allumai. La cachette aux spiritueux se trouvait au sous-sol, et l’escalier qui y conduisait était des plus obscurs.
Ayant ouvert la porte et franchi le seuil du caveau, j’élevai la lanterne. Lentement, les ténèbres se dissipèrent. Derrière moi, Ephrem Fedorovitch eut une exclamation. Ce qu’il venait d’entrevoir dépassait certainement ses espérances.
— Oh ! mais, oh ! mais, qu’est ceci, s’il vous plaît ? Du champagne, parole d’honneur !
— Oui, fis-je modestement, quelques bouteilles de champagne.
— Quelques bouteilles, dites-vous ? Ah ! mon cher Forestier, mon brave ami, mes plus sincères, mes plus affectueuses félicitations.
M’ayant arraché la lanterne des mains, il en promenait la lumière sur les alvéoles poussiéreux, tout en poussant une série de grognements admiratifs.
— Quatre, cinq rangées de casiers ! Six casiers à la rangée ! Et combien de bouteilles dans chacun d’eux ? Huit, seize, vingt-quatre, trente-deux bouteilles ! Dieu est bon. Louange à lui, à lui seul !
Je crois que je n’assisterai plus de longtemps à un inventaire opéré dans de telles conditions de précision et de rapidité. J’étais tout ensemble amusé de la joie enfantine du vieillard, flatté des louanges dont il ne cessait de m’accabler, et, pour être franc, en proie aussi à une vague inquiétude.
— Et des liqueurs, à présent, voilà des liqueurs. Mais c’en est une bénédiction ! Peste, mon enfant, on ne s’ennuie pas chez vous. Et là, dans le coin, qu’est-ce que j’aperçois ? Par les saints apôtres Cyrille et Méthode, de jolis, de mignons, d’adorables flacons de vin du Rhin ! Et ici, je reconnais la délicate silhouette des bordeaux, et celle, plus majestueuse, des bourgognes. Mais c’est un trésor, mon ami, que vous possédez ! Il s’agit de veiller sur lui. Vous allez me faire la promesse de ne jamais laisser pénétrer ici qui que ce soit.
— Soyez tranquille à cet égard, fis-je. C’est moi qui ai la clef de ce caveau. Et personne n’y est jamais entré, n’y entrera qu’avec mon assentiment.
Il ne m’écoutait pas. M’ayant rendu ma lanterne, il avait cessé de s’abîmer dans une vaine contemplation. L’action, chez lui, était nettement en train de devenir la sœur du rêve, et même sa sœur aînée. J’entendais dans les casiers le grincement des bouteilles remuées, et aussi un tintement bizarre, un bruit de verre heurté par du fer, le fer du crochet qui tenait lieu de main droite au général Irénéïef.
— Deux, trois bouteilles de champagne ! Mettons-en quatre, pas une de plus. Mon cher Forestier, il faut me comprendre. Appelés à vivre sous le même toit, nous avons intérêt à nous connaître, à nous apprécier dans le plus bref délai possible. Or, rien comme un vin, des vins généreux, mon ami, pour aider l’amitié à brûler les étapes. Dès le premier soir, je veux être à même d’estimer vos vertus, comme je veux que vous soyez fixé sur celles d’Ephrem Fedorovitch Irénéïef, ataman de Podolie, commandeur de l’ordre de Sainte-Olga, chevalier sans peur et sans reproche. Remettez-vous-en à moi. Mais qu’est-ce encore ? Du madère, dirait-on. Parfaitement, du madère. Mânes de Paskiewicz et de Baratinski, en avant pour le madère. Voilà qui peut aller. Et Dieu te garde, ami de mon cœur, d’oublier de fermer la porte.
Ce n’était pas mon intention, en effet, non plus que de confier à cet enthousiaste gentilhomme le secret de l’endroit où j’avais coutume de cacher la clef du caveau.
— Par file à droite, marche !
— Voulez-vous que je vous aide, mon général ?
Il ne daigna pas répondre. Jamais manchot, sans doute, ne fut doué d’une telle dextérité pour déménager un nombre aussi respectable de bouteilles. Le général Irénéïef trouvait le moyen d’en faire tenir six sous son bras intact, et trois sous son bras mutilé.
À présent, il les considérait avec amour, disposées en quinconce, sur la grande table de la salle à manger.
— Comme Armide va être contente ! Elle n’a d’autre joie dans la vie que ce qui peut arriver d’heureux à son papa bien-aimé.
Ce qu’il y avait de plus curieux, en l’espèce, c’était que sur ce point, tout au moins, Ephrem Fedorovitch ne mentait pas.
Jusqu’à ce jour, chaque fois que j’avais eu des invités, j’avais à peu près réussi à ne pas goûter au champagne que j’étais tenu de leur offrir. Je me bornais à tremper courtoisement les lèvres dans mon verre. Avec le prince Irénéïef, impossible de tricher de la sorte. Il poussa des cris d’orfraie quand il s’aperçut que je tentais de me dérober à mon devoir.
— Qu’un tel fait vienne à se reproduire, affirma-t-il avec dignité, et je fais atteler immédiatement mon automobile. Nous ne resterons pas une minute de plus sous votre toit.
Les deux tringlots tchécoslovaques ayant regagné Novo-Petrovsk, je ne craignais pas de voir le général mettre sa menace à exécution. Je crus devoir, néanmoins, lui obéir. Je l’aidai tant bien que mal à vider la première bouteille qu’il ouvrit, se servant de son crochet de fer comme du plus expéditif tire-bouchon. Pour les suivantes, il ne songea d’ailleurs plus à exiger ma collaboration.
L’après-midi passa tout entier de la sorte, sans qu’il me fût possible d’en distraire la moindre parcelle au profit de mes occupations. Il faut croire que le temps ne dut pas me paraître trop long, car j’accueillis avec un mouvement de surprise le Tartare de service, qui venait me murmurer à l’oreille qu’il avait besoin de la table pour mettre le couvert.
Il était un peu plus de sept heures lorsqu’un léger bruit de pas retentit dans le corridor. Armide Ephremovna pénétra dans la salle à manger.
Je me levai pour la recevoir. Elle me serra gentiment la main.
— Armide, cria le général, qui était demeuré assis au coin de la cheminée, occupé à déboucher la bouteille de madère, viens embrasser ton père, mon enfant. J’ai à t’apprendre que je suis ravi. Notre hôte est le plus aimable des hôtes, et ton ami Étienne s’est conduit comme un beau cachottier.
Je compris qu’il s’agissait du colonel Gregor, et qu’Ephrem Fedorovitch lui en voulait de n’avoir pas été prévenu par ses soins des richesses de ma cave. Sans doute le colonel avait-il eu ses raisons, s’était-il dit que les richesses en question seraient toujours connues assez tôt. Par contre, je n’arrivais pas à saisir le motif pour lequel il n’avait pas cru, dans sa lettre, devoir faire allusion à l’existence d’Armide.
— Bah ! pensai-je, à quoi bon me mettre martel en tête. L’avenir se chargera de m’expliquer tout cela.
Il devait s’en charger, en effet.
Durant tout le repas, le général ne s’arrêta point de tenir les propos les plus extraordinaires, si extra-ordinaires que je ne pus m’empêcher de trouver qu’il faisait un peu trop bon marché de mon érudition. Sans prétendre posséder des lumières particulières sur l’histoire de la Russie, j’en savais assez cependant pour ne point ignorer que Mac-Mahon n’avait pas été fait prisonnier à Malakoff, que le vainqueur de Plewna n’était pas Barclay de Tolly, et qu’Ephrem Fedorovitch était tout de même trop jeune pour avoir perdu sa main droite au siège de Sébastopol, à plus forte raison pour avoir recueilli à la Moskowa le dernier soupir du général prince Bagration.
Ma stupéfaction, à l’entendre divaguer ainsi, provenait beaucoup moins, d’ailleurs, des sornettes d’Ephrem Fedorovitch que de l’attitude de sa fille. Il y avait plus que du respect dans la façon dont Armide l’écoutait. Il y avait de l’admiration. J’ai pu, à son sujet, commencer par me tromper sur bien des choses… Pas sur celle-là. J’ai percé du premier coup le secret de la princesse Irénéïef. J’ai saisi le ressort qui la dirigeait dans la vie, son but, sa raison d’être. J’ai eu, au premier contact, la révélation de sa ferveur passionnée, de son asservissement total à ce père déconcertant, dont je ne pouvais deviner, de prime abord, qu’il était avant tout un père indigne.
La jalousie est le symptôme irréfutable de l’amour. J’exagérerais en proclamant que dès cette soirée, à voir Armide en extase devant ce vieillard moins extravagant, je l’ai su depuis, qu’habile à se servir de son extravagance, je mentirais si j’affirmais que j’ai senti la jalousie envahir mon cœur. J’étais encore maître de moi. Je m’efforçai de comprendre. Tout au plus, peut-être, ai-je éprouvé le léger dépit si naturel chez l’homme à qui l’on ne prête aucune attention. « C’est égal, elle pourrait bien me remercier un peu mieux, me disais-je. Puisqu’elle a l’air de tant aimer ce vieux fou, elle serait correcte en l’excusant des bouteilles qu’il a bues, en l’empêchant d’en boire d’autres… Mais non ! Elle le regarde comme on regarde un amant. Profitons donc de son indifférence pour l’observer elle-même. Essayons, sans qu’elle s’en doute, de savoir ce qui se passe sous ce petit front têtu, en admettant qu’il s’y passe quelque chose… » Je serais bien en peine, ce soir, d’analyser l’espèce d’allégresse trouble que me procurait cette muette contemplation. Je me souviens seulement que je sentais mon cœur se gonfler de façon étrange, rien qu’à l’idée que cette inconnue allait reposer dans la même maison que moi, que c’était le même vent que nous allions l’un et l’autre entendre toute la nuit dans les arbres, la même lune qui allait éclairer nos deux chambres, que ce serait le même paysage qui s’offrirait le lendemain à notre réveil. Entre elle et moi, l’univers me semblait soudain tissé de liens irrésistibles. Prisonnier d’une aussi subite fascination, un autre ne manquerait pas de la justifier par la louange de la beauté d’Armide. Il ne laisserait point perdre une telle occasion de célébrer cette beauté avec complaisance. Il vanterait ces yeux vert pâle, ce corps souple indolent, la nostalgie charnelle incluse dans chacun de ses gestes, tout, enfin, tout ce par quoi j’ai souffert, tout ce par quoi j’ai été vaincu, tout ce que j’ai aimé, avant de parvenir à le mépriser et à le haïr. Oui, voilà ce qu’un autre ferait. Moi, je n’oserai même pas. Ce n’est point la séduction d’une femme qui est ici en cause. Il s’agit du malheur d’un pauvre homme, de mon malheur, de ma dégradation.
Vers neuf heures, il me fallut interrompre le récit de la mirifique manière dont le général avait, aux régates de Cronstadt, rivé son clou à l’empereur Guillaume. Le couvre-feu sonnait dans l’usine. Mon personnel était habitué à me voir chaque soir présent à cette heure-là, pour l’appel.
Je ne restai absent que quelques minutes. En revenant, je traversai l’office. Mes Tartares s’y tenaient rassemblés. Les braves garçons étaient en train de commenter sans enthousiasme les événements de la journée.
De retour dans la salle à manger, je trouvai Armide et son père attablés à une partie de cartes.
— Prenez place, ami Forestier, cria le général à tue-tête, prenez place. Il y a de l’argent à gagner. Je n’ai jamais eu une guigne pareille. La petite vient de me faire capot trois fois d’affilée. Mais vous connaissez le piquet, j’espère ?
— Ni le piquet, ni aucun autre jeu, dis-je en riant.
— Par le saint Synode, qu’est-ce qu’il faut entendre ! Eh bien, vous apprendrez. Armide vous apprendra. Elle joue comme une déesse. Les cartes, croyez-moi, rien de pareil pour charmer les longues soirées d’hiver. Non, non, je n’admets pas d’excuse. Asseyez-vous ! Vous verrez : vous me remercierez tout le reste de votre vie.
Le misérable ! Le reste de ma vie, je le passerai à le maudire.
X
À mesure que Forestier avançait dans son récit, sa voix devenait tantôt plus âpre, tantôt plus poignante. Cette voix ouvrait à Schmidt les portes d’un sombre univers inexploré. Des mortels mystères de l’amour, il comprenait qu’il n’avait jusqu’à présent connu que les simulacres. Et c’était ce petit homme myope et chauve, cet humble fonctionnaire étriqué qui lui apportait la révélation de son ignorance ! Avoir souffert, le pauvre Schmidt se rendait compte que c’était tout simplement ce qui lui avait manqué jusqu’alors.
Au-dessus du toit, la lune devait avoir tourné ; la chambre était maintenant emplie de sa clarté jaune. La main de Forestier pendait, inerte, le long des draps. Schmidt se saisit de cette main.
— Je t’écoute. Continue.
— Ah ! dit l’autre avec un soupir de soulagement, je sais enfin que tu m’as compris, que je vais pouvoir tout te dire, des choses que j’ai évité de m’avouer à moi, même à moi, tu m’entends !
Il fit un effort, réussit à se mettre sur son séant.
— Une semaine environ après l’installation d’Armide et de son père, nous reçûmes la visite du colonel Gregor. Mes hôtes devaient être au courant de sa venue, car ils n’en marquèrent aucune surprise. Il arriva un matin, alors qu’ils étaient encore couchés. L’automobile qui l’amenait était couverte de boue. Elle repartit aussitôt pour Novo-Petrovsk, emportant ses deux officiers d’ordonnance.
Je remarquai que le colonel avait à la main son nécessaire de voyage.
— Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, dit-il, je coucherai ici cette nuit.
— Ne vous l’ai-je pas offert bien souvent ?
— D’accord. Mais, à présent, vous avez des invités…
— Il reste des chambres disponibles, Dieu merci ! Voulez-vous que nous allions choisir la vôtre ?
— Je vous remercie. Cela ne presse pas.
Il me parlait avec un sourire un peu emprunté. Dans la salle à manger, où je le conduisis, je lui demandai des nouvelles des opérations militaires. Il me fournit force détails, tant de détails même qu’on eût dit qu’il tenait à détourner la conversation, à retarder l’instant où il serait contraint d’aborder un autre sujet.
Il dut, en fin de compte, s’y résoudre.
— Est-ce que je n’ai pas abusé de votre obligeance, en vous demandant de consentir à recevoir le général Irénéïef et sa fille ?
Sa lettre, je l’ai dit, ne faisait allusion qu’au général. Mais il n’y avait peut-être eu là de sa part qu’un oubli. C’était du moins ce dont j’essayais de me convaincre, malgré la visible gêne de mon interlocuteur. D’ailleurs, quelle que pût être l’explication de son silence à propos d’Armide, je ne songeais plus guère, à l’heure actuelle, à m’en formaliser. Les nouveaux venus avaient le mérite de rompre la monotonie par trop insupportable de mon existence. Je leur en avais, somme toute, de la gratitude ainsi qu’au colonel Gregor. Par contre, j’éprouvais un incontestable agacement à être si peu renseigné sur eux. L’occasion de compléter ma documentation m’était offerte. Je me gardai de la laisser passer.
— La princesse Irénéïef est tout à fait charmante, me bornai-je à répondre, estimant que cette phrase suffirait à entraîner le colonel sur la voie des confidences.
— Charmante, en effet, dit-il. Je présume qu’elle doit être encore dans sa chambre ?
— Il est à peine dix heures. Elle ne descend d’ordinaire que pour le déjeuner. Elle se couche assez tard.
Il eut un geste qui voulait dire : je sais, je sais.
— Quant à son père, continuai-je, c’est évidemment un original.
— Évidemment. Mais c’est aussi un excellent homme. Il a été parfait pour moi. Il m’est impossible de l’oublier. C’est pourquoi je vous ai une reconnaissance infinie… Ils doivent être bien heureux, chez vous, après les épreuves qu’ils ont traversées.
— Ils n’ont pas l’air de se plaindre. Avec les ressources que vous savez, je fais ce que je peux pour leur être agréable. J’y réussirai sans doute mieux quand je les connaîtrai davantage. Je ne tiens pas, toutefois, à être indiscret. La princesse est pleine de réserve. Ce n’est pas moi qui songerai à l’en blâmer. Quant au général, il est beaucoup plus communicatif. Mais ses propos ne sont pas toujours exempts d’une certaine incohérence.
— Oui, c’est un vieux soldat. Il se grise aisément de paroles.
— Hum ! De paroles…
Mes yeux, involontairement, s’étaient dirigés vers un endroit de la salle où se trouvaient alignées un nombre respectable de bouteilles vides. Le colonel Gregor les aperçut. Il rougit légèrement.
— Oui, oui, je sais. Un vieux soldat ! Il faut l’excuser. Il y a deux ans, quand j’ai été reçu chez lui, il n’était pas ainsi, je vous le jure. Depuis, n’est-ce pas, les malheurs de sa patrie, sa propre ruine… Il faut l’excuser. Et puis l’affection qu’il a pour sa fille est une chose si touchante. L’essentiel, cependant, est qu’il ne vous dérange pas. J’y veillerai. J’ai de l’influence sur lui, vous verrez. Et s’il y a, par hasard, quelque petite observation à lui faire…
Son regard, à la lettre, m’implorait. J’eus pitié de lui.
— Vraiment, mon colonel, ne vous mettez pas en peine. Je suis navré de vous avoir parlé de la sorte. Le général Irénéïef est le plus aimable des compagnons, et je vous donne ma parole que ces petites incartades ne sont rien à côté de la joie que j’éprouve, grâce à vous, à ne plus être seul ici.
Il eut ce soupir particulier aux gens qui vous savent gré de ne point leur dévoiler tout le fond de votre pensée.
Je voulus lui rendre service en modifiant le cours de notre entretien.
— J’ai reçu, dis-je, voilà quelques jours, une communication bizarre de Tcheliabinsk. On me mandait de votre Grand Quartier Général que, des soldats mis à ma disposition, deux parts allaient être faites. Ceux qui seraient reconnus valides retourneraient au front. On évacuerait les autres sur Omsk et Vladivostock.
— C’est exact. Je suis même chargé de prendre les mesures nécessaires pour que la décision dont il s’agit entre en vigueur le plus tôt possible.
— Très bien. Personnellement, je n’y vois aucun inconvénient. Mais l’usine ? Il ne me restera que des prisonniers pour la faire marcher. Vous ne vous figurez pas, peut-être que j’y réussirai ?
Il eut un geste d’impuissance.
— De mieux en mieux, dis-je. Dans ces conditions, on ne s’étonnera pas, j’espère, si je me range au seul parti qui s’impose : laisser s’éteindre les hauts fourneaux, – ils en ont l’habitude, – et monter sur la première locomotive venue, tant qu’il y en a encore en partance. Je ne suis resté ici que trop longtemps. Je n’ai plus rien à y faire.
Son regard, de nouveau, devint suppliant.
— Attendez quelques jours. Peut-être la situation va-t-elle s’améliorer.
— Vous me disiez, il y a un instant, que tout allait de mal en pis et que, sous peu, à moins d’un miracle, le front de l’Oural serait crevé par les bolcheviks.
— Ce miracle peut se produire. Tout n’est pas à ce point compromis. Et puis, ne m’avez-vous pas déclaré vous-même lors de notre première entrevue, que si vous étiez resté ici, c’était moins pour coopérer à la fabrication du matériel de guerre que pour essayer de sauvegarder les intérêts de votre Compagnie.
— On peut changer d’avis, dis-je d’un air maussade. La résistance humaine a des limites. Je ne m’engage à rien. La Compagnie dont vous parlez m’a d’ailleurs laissé juge du moment où j’estimerai qu’il n’y a plus rien à tenter.
Nous gardâmes quelques minutes un silence qui accroissait sans cesse l’embarras du colonel Gregor.
Sur ces entrefaites, un de mes valets tartares, porteur d’un plateau, passa dans le corridor.
— Le petit déjeuner du général Irénéïef, sans doute ? dit le colonel.
— Non, le général a changé son menu. En place de thé, on lui monte chaque matin une bouteille de graves. Ceci, c’est le déjeuner d’Armide Ephremovna.
— Elle est donc réveillée ?
— Vous le voyez.
— Mon devoir, alors, dit-il précipitamment, est d’aller lui présenter mes hommages.
Il emboîta le pas du Tartare, me laissant seul, et quelque peu abasourdi.
Jamais je ne m’étais senti d’humeur aussi exécrable. Je commençais à avoir la sensation que je jouais un rôle ridicule. Le reste de la matinée, je le passai, gourmandant les ouvriers, à errer au hasard à travers les bâtiments de l’usine en détresse.
Au repas de midi, il me fut permis d’apprécier la valeur de l’influence que le colonel Gregor se targuait d’avoir sur le général.
— Charmante réunion de famille, déclara celui-ci, quand nous fûmes réunis tous les quatre dans la salle à manger. C’est moi qui ordonne, c’est moi qui place. Armide, en face de moi, ma fille bien-aimée. Je ne prétends pas usurper, mon astre, tes fonctions de maîtresse de maison. Mais pour ce qui est du respect de l’étiquette, fais confiance à ton père. Je m’installe donc dans ce fauteuil, du côté de la cheminée. Dos au feu, ventre à table, ainsi qu’il sied. Attention, vous autres ! Étienne, à la droite de la princesse. Charlie à sa gauche. Vous y êtes ? Un, deux, trois, rran ! Asseyez-vous !
— Charlie ! dit le colonel Gregor, dont les pauvres yeux s’évertuaient à me mendier un sourire, peste ! On vous appelle déjà par votre prénom.
— On vous appelle bien Étienne, fis-je d’un air rogue.
— Silence !
C’était le général qui se levait.
— Silence, messieurs ! clama-t-il, tandis qu’un des Tartares, affolé, emportait en toute hâte les débris de l’assiette qu’Ephrem Fedorovitch venait de briser en y assenant un coup de son crochet de fer. Que pas un mot ne soit prononcé en ma présence avant que les toasts aient été portés. Telle est la coutume vénérable, la coutume du glorieux régiment Preobrajenski, dont j’ai eu l’honneur de défendre tout seul, à Traktir, l’invincible étendard contre six mille Pandours et quatre-vingt-dix mille Polonais. Debout, Charlie ! Debout, Étienne ! Tu peux demeurer assise, Armide. Tel est, ô ma toute belle, le gracieux privilège de ton sexe.
Bon gré mal gré, nous nous levâmes. Le général braquait déjà vers le plafond sa coupe pleine.
— Premier toast. Pour Dieu ! Le toast de l’âme. Je bois à Dieu tout-puissant, créateur du Ciel et de la Terre, et à Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur… Répétez, Étienne ! Répétez, Charlie ! Vous n’êtes juifs ni l’un ni l’autre, que je sache, tonnerre de tonnerre !
Au bout de mon verre tendu, j’avais une joie mauvaise à considérer le colonel Gregor. Il était blême.
— … Pour juger les vivants et les morts. Je bois au Saint-Esprit, la sainte Église… aïe, orthodoxe pour moi ; catholique pour vous, Charlie ; hussite pour le colonel ; la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle… Rrran ! Fermez le ban ! Vos verres, messieurs, videz vos verres. J’aime autant vous prévenir que je considérerai comme un ennemi personnel de la très sainte Trinité, c’est-à-dire comme le mien, celui qui ne videra pas son verre.
Ces verres, comme bien on pense, n’étaient pas emplis d’eau pure. Je vidai cependant le mien d’un trait, moins pour obéir au général, que pour décupler les remords du colonel Gregor, qui savait que, livré à moi-même, je ne buvais jamais.
— À merveille ! Tout le monde est-il prêt ? Bon ! Deuxième toast. Pour le Czar ! Je bois aux grands empereurs rassembleurs de la terre russe, aux Romanovs. À Michel Fedorovitch, d’abord, fondateur de la dynastie ; à l’impératrice Elizabeth Prokovievna, la panthère aux yeux de gazelle ; à…
Il les nomma tous, successivement, avec leurs épouses. Quand je pus me rasseoir, lui ayant tenu tête jusqu’au dernier, à coups de rasades, pour marquer de plus en plus ma réprobation au colonel Gregor, mes jambes me refusaient légèrement leur office.
Durant ce grotesque repas, vexé et furieux, je ne prononçai pas une seule parole. Le général, tout à ses bouteilles et à ses rodomontades, ne s’en aperçut même pas. Par contre, le colonel Gregor était au supplice. J’opposais un silence méprisant aux humbles tentatives qu’il risquait pour me faire entrer dans la conversation. Je restais le nez piqué dans mon assiette, buvant seulement, buvant pour que le colonel pût bien se pénétrer de toute l’étendue de sa responsabilité. Une seule fois, ayant cru sentir peser sur mon cœur un poids dont il n’avait pas l’habitude, je levai les yeux pour les abaisser aussitôt. Je venais d’apercevoir les yeux d’Armide. Avec une fixité singulière, elle me regardait.
Au dessert, sous un prétexte quelconque, je sortis et montai dans ma chambre. Là, les coudes sur mon bureau, je me mis à songer.
Il avait neigé toute la matinée. Il ne neigeait plus. Pas un nuage au ciel dépoli, où la nuit allait bientôt naître. Une pâle lumière sans ombres flottait sur l’univers silencieux. Contre ma fenêtre, un grand mélèze noir étendait un de ses rameaux saupoudré de poussière blanche. À travers la steppe, un train fuyait vers l’horizon. Je le regardai jusqu’au moment où je ne l’aperçus plus. J’étais envahi par une tristesse affreuse. Que faisais-je là, perdu au fond de ce monde désolé, de cette usine quasi morte ? Une soudaine révolte me secoua.
— Dès demain, me dis-je, je préparerai mes paquets. Moi parti, ils pourront bien faire tout ce qu’ils voudront.
Un bruit léger interrompit mes réflexions. On avait frappé à la porte. Sans que j’eusse eu le temps de répondre, cette porte s’ouvrit, la princesse Irénéïef entra.
— Vous, murmurai-je, vous, ici !
— Chut, fit-elle. J’aime autant qu’on ne le sache pas.
Je n’avais pas bougé de mon fauteuil. Ce fut Armide qui vint à moi.
— Vous ici, répétai-je, pourquoi ?
Elle me dévisageait avec la même insistance que tout à l’heure.
— Vous étiez fâché, dit-elle, enfin. J’ai voulu en savoir la raison.
Le curieux être ! Il me semblait la voir pour la première fois. Elle était vêtue de la même robe que les autres jours, et pourtant cette robe aussi, c’était la première fois, me semblait-il, que je la voyais. Une robe de drap noir, toute simple, mais brodée, sur le devant, de losanges verts et roses, à la mode géorgienne. Ses boucles, coupées très court, barraient son cou nu de leur ligne blonde. Ses yeux profonds, ses yeux glacés, pareils à des aigues-marines, brillaient dans la caverne bombée de la frange.
Durement, elle répéta :
— Pourquoi êtes-vous fâché ? Nous sommes ici, chez vous. Je ne peux pas admettre que vous soyez fâché.
Je me taisais. Sa voix, à elle, s’étrangla.
— Est-ce à cause de mon père ?
— Non.
— Ah ! fit-elle, l’air songeur.
Et elle cessa de me questionner.
Sur le bureau, il y avait une photographie des miens. Pas celle que j’ai ici. Une plus ancienne, mais dans le même cadre. Elle s’en empara.
— Qui est-ce ?
— Ma femme, ma femme et mes fils.
— Ah ! fit-elle encore, reposant le cadre sur le bureau.
Et elle revint à son idée.
— Je suis heureuse de savoir que vous n’avez rien contre mon père. Il peut être ennuyeux. Il a ses fantaisies. Promettez-moi. Jurez-moi de les lui passer. Je vous en aurai tant, tant de reconnaissance.
Elle était tout contre moi. Sa mince gorge se gonflait sous les losanges verts et roses. Une folle envie de pleurer s’empara de moi.
— Votre père ! Mon Dieu, comme vous l’aimez !
Elle me lança un regard sombre.
— C’est mon père, dit-elle, farouche.
— À votre tour, murmurai-je, jurez-moi que vous n’avez jamais aimé que lui.
Elle tressaillit.
— On ne fait pas tout ce qu’on veut dans la vie, se borna-t-elle à répondre.
— Que feriez-vous, si vous pouviez faire ce que vous voulez ?
Elle haussa les épaules.
— La drôle de question ! Ce que je ferais ? Est-ce que je sais ? Rien, probablement. Non, rien. Mais, excusez-moi. Je sais ce que je voulais savoir. Merci. Je m’en vais.
J’étais debout, lui barrant le chemin de la porte.
— Eh bien, qu’avez-vous ? fit-elle. Laissez-moi.
— Armide Ephremovna, dis-je d’une voix tremblante.
— Quoi ?
— Armide Ephremovna, voulez-vous me permettre de vous embrasser la main ?
— M’embrasser la main ? dit-elle.
Et son étonnement semblait signifier : « Quoi, c’est tout ? C’est là tout ce que vous désirez ! »
— M’embrasser la main ! Savez-vous qu’on n’embrasse pas la main d’une jeune fille ?
Elle eut un rire douloureux.
— Allons, puisque vous avez l’air de tant y tenir, la voilà tout de même !
Le colonel Gregor ne repartit ni le lendemain, ni le jour qui suivit, ni l’autre. Il fallut pour qu’il s’y décidât une dépêche apportée à franc étrier par un de ses officiers d’ordonnance, en l’espèce mon ami Georges. Nous étions à table quand on la lui remit. À sa lecture, il pâlit un peu.
— Rien de grave ? demanda le général.
— Non. Il va falloir tout de même que je vous quitte. Pardonnez-moi.
Et il monta précipitamment dans sa chambre pour boucler sa valise.
— Qu’y a-t-il ? demandai-je à Georges, sitôt que j’eus réussi à le prendre à part.
Il eut une moue.
— Le colonel n’aurait pas dû agir de la sorte, dit-il avec la sévérité qu’ont les subalternes pour les moindres fautes de leurs chefs. Il ne nous a même pas prévenus qu’il était ici. Tout cela finira mal.
— Mais la dépêche ?
— Chut ! les troupes rouges attaquent à fond sur Orenbourg. Une de nos divisions a cédé.
Quelques minutes plus tard, le colonel Gregor nous quitta. Malgré ses efforts pour paraître calme, il n’était pas très difficile de sentir en lui le regret de ce qui s’achève, mêlé à l’angoisse de ce qui va venir.
Au repas du soir, la princesse Irénéïef se montra plus gaie que de coutume. Elle eut pour moi mille prévenances. Je croyais rêver. Jamais je n’avais été à pareille fête. Où était-elle, ma pauvre résolution de ces jours derniers, de fuir au plus tôt Novo-Petrovsk !
Vers neuf heures, Armide se leva.
— Je suis fatiguée, dit-elle. Restez avec mon père. Faites-lui sa partie de piquet. Vous serez gentil.
— Bien volontiers, fis-je avec empressement.
Elle sourit, et, en sortant, mit un doigt sur ses lèvres ; le même geste que si elle avait voulu m’envoyer un baiser.
À peine nous eut-elle quittés que je vis le général extirper de sa poche un volumineux portefeuille.
— Mon enfant, dit-il, tout en battant les cartes, j’ai des excuses à vous adresser. Mon Dieu, oui. Ces jours-ci, je n’avais pas de monnaie. Vous m’avez fait quelques petites avances. Cela ne peut plus durer ainsi. Voilà un billet de cinq cents roubles. Arrangez ça.
— Mon général…
— Non, non ! J’y tiens absolument. Vous n’avez pas l’air de savoir qui est le prince Irénéïef. Bon, bon ! Au travail, maintenant. Ah ! que je vous dise d’abord quelque chose. Mon cher Charlie, ce n’est pas vous faire un compliment, mais, depuis huit jours, vous avez réalisé au piquet des progrès extraordinaires. Vous jouez à l’heure actuelle mieux que moi. Aussi, à partir de ce soir, j’estime que nous pouvons commencer à intéresser un peu la partie.
XI
Schmidt, sans savoir pourquoi, comprit que son camarade approchait du point culminant de ses confidences.
— Il m’arrive une chose étrange, dit Forestier. J’ai tout préparé, tout mis en ordre. J’ai été aussi prodigue que l’on peut l’être de détails. Et voilà que j’éprouve, à présent que je touche au but, une répugnance invincible à aller de l’avant. Je suis comme un bateleur qui a procédé au montage méticuleux des tréteaux sur lesquels il va se produire et qui, maintenant qu’ils sont en place, hésite soudain à y monter. Cette gêne, d’où vient-elle ? De la honte, sans doute, que je ressens à étaler ainsi, pour la première fois, les secrets de mon cœur. Et aussi de ma crainte de t’importuner, de te paraître ridicule… Tu dois être si riche en souvenirs de cette sorte.
— Rassure-toi, murmura Schmidt, évasivement.
La vérité était qu’il ne s’était jamais senti aussi pauvre.
— Je te remercie de m’encourager, reprit Forestier. Tu comprends que ce n’est pas un vain besoin d’ostentation qui me pousse. Je tiens d’abord à t’expliquer ce qui, dans ma conduite de la nuit dernière, a dû te paraître inexcusable. Il y a ensuite, plus impérieux que tout, mon désir de me prouver que je n’ai plus rien à craindre, que je suis guéri, bien guéri. Je ne promènerais pas impunément ainsi, n’est-ce pas, mes mains sur ma blessure, si cette blessure n’était pas fermée, bien fermée ?
Sa voix eut une courte défaillance. Schmidt lui tendit le bol de tisane. Il en but une gorgée, et continua.
— Chaque soir, donc, de par la volonté de sa fille, j’étais astreint à jouer aux cartes avec le général Irénéïef. Cette insupportable corvée se prolongeait souvent au-delà de minuit. Les événements qui devaient m’en affranchir se produisirent heureusement plus tôt que je n’eusse osé l’espérer.
Après une semaine de durs combats, l’avance des bolcheviks, qui avaient dépassé Orenbourg, était momentanément enrayée. Mais cette ville demeurait en leur pouvoir. Novo-Petrovsk, du coup, se trouva envahi par une nuée de réfugiés, qui doublèrent presque sa population normale. Le général estima qu’il y avait là pour les grandes âmes matière à se manifester. Il décida d’aller porter à ces infortunés des paroles de réconfort.
— Je me dois à mes compatriotes. En 1523, lors de la peste qui dévasta Tchernigof, mon aïeul Alexandre Irénéïef déchira ses habits, se couvrit d’un cilice, et partit à pied à travers les campagnes pour consoler les veuves, adopter les orphelins, et fermer les yeux des moribonds. Ainsi ferai-je. Non, non, Charlie, n’essayez pas de me dissuader. Vous ne réussiriez qu’à me désobliger.
Les discrètes objections que j’avais soulevées n’étaient, inutile de le dire, que pour la forme. Le général nous quitta tout de suite après le déjeuner. Il ne rentra que vers deux heures du matin, pleurant à chaudes larmes, proclamant qu’il n’avait jamais encore contemplé le spectacle de tant de souffrances alliées à tant de dignité. Il repartit le lendemain et les jours suivants, revenant chaque fois un peu plus ivre que la veille. Armide ne paraissait pas prendre au tragique ces manifestations insolites de la philanthropie paternelle. J’aurais eu donc moi-même mauvaise grâce à m’en formaliser. Je trouvais d’ailleurs trop mon compte à ce nouvel état de choses. D’abord, il y avait les maudites parties de cartes dont j’étais débarrassé : mon porte-monnaie se reposait, ainsi que mes bouteilles. Et puis, avantage que je plaçais avant tous les autres, chaque journée m’offrit maintenant de multiples occasions de rester seul en tête-à-tête avec la princesse Irénéïef.
Sans chercher, quant à elle, bien entendu, à provoquer ces occasions, elle ne faisait rien non plus pour les éviter, de sorte qu’insensiblement nous en arrivâmes à passer ensemble tous nos après-midi, toutes nos soirées. Ma timidité convenait à merveille à sa nonchalance. Rien moins que prodigue de ses secrets, quelquefois, cependant, elle avait des mots, des silences qui trouaient subitement d’une lumière déchirante les nuages orageux accumulés sur son passé. Je me souviens, entre autres journées, de celle où elle me pria de la suivre dans sa chambre. Il s’agissait d’examiner une des fenêtres, dont les battants légèrement disjoints laissaient pénétrer un peu de bise. Depuis son arrivée, je n’étais pas encore entré dans cette chambre. J’ignorais le contenu des deux malles que mes Tartares y avaient montées. À présent, je savais, mon Dieu ! Ces fourrures défraîchies, cette garniture de toilette d’un vermeil suspect, ces sorties de bal aux ors corrodés, ces chaussures de soie poussiéreuse, toute cette clinquante misère, en un raccourci morne et brutal, m’initiait à la destinée d’Armide, à son mystère désemparant, désordonné. Ce n’était même pas de la compassion qui m’étreignait. C’était quelque chose comme une affreuse lassitude, la conviction qu’il est des pentes qui ne sauraient être remontées. Elle, de son côté, était trop fine pour n’avoir pas aussitôt deviné ce qui se passait en moi, car elle eut le sourire agressif de ceux qui n’admettent pas d’être plaints, qui se font une arme orgueilleuse de leur détresse, la retournent contre les imprudents ainsi qu’un poignard. Sur la table, au centre de la pièce, il y avait une pile d’écrins de velours. Lentement, impitoyablement, elle les ouvrit, les uns après les autres, tous, pour que je pusse bien constater que, tous, ils étaient vides. À l’intérieur, leur peluche fanée gardait encore la forme des pierreries qui y avaient jadis dormi. Quand Armide eut refermé le dernier, elle me jeta un regard de défi.
— Voilà ! dit-elle.
Voilà ! À ce bref, à ce lugubre mot, quelle autre signification attacher que celle-ci : « Vous voyez, vous ne pourrez pas vous plaindre d’avoir été pris en traître. C’est sans illusion sur ce que vous pouvez faire pour moi que je me livre à vous. Je vous découvre toute l’étendue de ma déchéance pour que vous sachiez bien qu’elle est irréparable, pour que vous ne vous imaginiez pas que vous êtes de taille à y remédier. Ce n’est pas un petit ingénieur de quatre sous, décidé et destiné à demeurer honnête, qui fera jamais réintégrer ces écrins aux perles et aux saphirs qui s’en sont envolés. Limitez donc vos ambitions. Ne cherchez à vous acquitter que de ce dont vous êtes capable : les soins de la maison, le livre des comptes, la réparation de cette fenêtre. Et pour le reste, épargnez-moi l’outrage de votre stérile pitié. »
Au flanc de la montagne ravinée, les premières fleurs avaient fait leur apparition. C’étaient de minces œillets d’un mauve pâle, au parfum à la fois amer et doux, qui surgissaient en une nuit au pied des sapins, entre les flaques de neige durcie. J’allais les cueillir de bonne heure, quand Armide n’était pas encore levée. Je les assemblais en humbles gerbes, que je déposais à sa place, sur la table de la salle à manger. Elle me remerciait d’un sourire qui détendait une seconde son visage taciturne. Elle les emportait dans sa chambre. Il lui arrivait d’en agrafer quelques-uns à sa robe, lorsqu’elle descendait, le soir, pour le dîner. Nous achevions nos journées au coin du feu, assis, immobiles et muets, l’un en face de l’autre. Parfois, tout en remuant pensivement du bout des pincettes les cendres de la cheminée, elle se mettait à chanter, à murmurer plutôt, quelque vieil air monotone, que sa voix un peu sourde peuplait d’inflexions désolées. Puis elle se taisait avec brusquerie, comme si de ces autres cendres, elle craignait de voir surgir, à l’appel de son incantation, des choses qui devaient rester mortes. Un soir, un seul soir, devant la prière peut-être plus instante de mon regard, elle se départit de son mutisme.
— Ce sont de vieux airs de chez nous, des airs avec lesquels ma nourrice me berçait jadis, alors que la vie s’offrait aussi charmante qu’une route bleue et rose à la petite princesse Irénéïef… Car – et elle me regarda bien en face –, je suis tout de même la princesse Irénéïef. Je sais que cela n’a plus guère d’importance. Je le dis, cependant, parce que je me figure qu’à l’entendre répéter trop souvent vous avez peut-être fini par ne plus le croire.
Elle répéta : « La princesse Irénéïef ! » Et elle eut le même rire que le jour où elle m’avait dit : « Une jeune fille ! On n’embrasse pas la main d’une jeune fille ! »
Ce fut tout, l’unique confidence qu’elle m’ait jamais faite, l’unique allusion à son père qui m’ait prouvé qu’elle était sans illusion sur lui malgré son farouche attachement, malgré sa volonté, en dépit de tout, de continuer toujours à l’absoudre. Quand, vers minuit, elle se leva pour regagner sa chambre, elle laissa sa main dans la mienne plus longtemps que de coutume. Peut-être pressentait-elle d’ores et déjà que l’instant n’était plus éloigné où elle allait avoir à recourir à moi.
Couché tout de suite après l’avoir quittée, je dus cette nuit-là céder presque aussitôt au sommeil. J’ignorais depuis combien de temps je pouvais dormir, lorsque le rêve qui m’assiégeait se précisa de façon singulière. Il s’y mêlait le bruit d’une course dans l’escalier, des éclats de voix, parmi lesquelles il me sembla en discerner deux : celle d’un de mes Tartares, celle d’Armide. Une troisième voix m’était inconnue.
— Qu’il se lève ! Va lui dire qu’il se lève immédiatement.
— Qu’y a-t-il ? fis-je, débouchant, à peine vêtu, dans le corridor du rez-de-chaussée.
Armide m’accueillit par un cri de joie. Elle avait son manteau de voyage. On eût pu croire qu’elle ne s’était pas couchée.
— Quelle heure est-il ?
— Je ne sais pas. Deux heures, deux heures et demie. Venez, venez vite.
— Mais qu’y a-t-il, répétais-je, m’adressant au Tartare.
Frottant avec ahurissement ses yeux gonflés, le pauvre diable me désignait une espèce de moujik hirsute, qui demeurait sur le seuil de la porte, tenant à la main une drôle de casquette à galons.
— Cet homme arrive de Novo-Petrovsk, m’explique Armide. Il se passe là-bas des choses atroces. Pour l’amour de Dieu, dépêchons-nous.
Elle m’entraîna dans la salle à manger, où le Tartare venait de faire de la lumière. Son égarement m’épouvantait.
— Encore une fois, de quoi s’agit-il ? Votre père… ?
— Mon père, oui, naturellement. De quoi voulez-vous qu’il s’agisse ?
Évidemment, ma question était stupide. Et sa réponse, à elle, signifiait : « Quel souci, autre que celui de mon père, pourrait me mettre dans cet état ? »
Elle me tendait un billet chiffonné.
— Lisez, dit-elle, trépignant d’impatience.
J’obéis, abasourdi. Ayant lu, je rendis le papier à Armide.
— Eh bien ?
— Eh bien, mais… je ne comprends pas. Votre père écrit qu’il a besoin de vingt-cinq mille roubles. Comme cela, tout de suite ! Une pareille somme ! Qu’est-ce qu’il peut bien vouloir en faire ? Il a joué ? Il a perdu ?
Elle me regarda avec un indicible mépris.
— S’il avait gagné, il est probable qu’il ne nous aurait pas envoyé un messager, à seule fin de nous en porter la nouvelle. Mais lisez donc ! Pour rester à ce point insensible, il faut que vous n’ayez pas tout lu.
— J’ai tout lu. Il dit qu’il est gardé à vue, et que s’il n’a pas la somme d’ici une heure, les pires éventualités sont à craindre pour lui. J’avoue ne pas très bien saisir… Mon Dieu, qu’avez-vous ?
Elle chancelait. J’eus tout juste le temps de la retenir dans mes bras.
— Que voulez-vous que nous fassions ?
— Partir, partir tout de suite. L’homme qui a porté la lettre a une automobile.
— Partir, dis-je. Et l’argent, vous l’avez ?
Elle me repoussa avec violence. Je crus voir une lionne en furie.
— L’argent ! Si je l’avais, est-ce que vous croyez que j’aurais seulement pensé à vous ?
— Ah ! fis-je, sentant à mon tour la colère me gagner, eh bien ! puisque c’est ainsi, j’aime autant vous prévenir que je ne l’ai pas, moi non plus.
— Tu ne l’as pas ?
Elle marchait sur moi. Je reculai. Et soudain, elle éclata en sanglots, s’accrocha à mon cou.
— Tu ne l’as pas ? Ce n’est pas possible. Emprunte-le, prends-le. Vingt-cinq mille roubles ! À quoi cela servirait-il d’être un homme, un homme comme toi, si on n’était pas capable de trouver vingt-cinq mille roubles ! Tu ne comprends donc pas que tu me fais mourir ! Dépêche-toi ! Vingt-cinq mille roubles ! Tu verras comme tu seras récompensé.
Ses larmes m’inondaient la joue.
— Armide, balbutiai-je, Armide !
Ce fut tout ce que je parvins à dire. Ses lèvres venaient de clore les miennes par un baiser, un baiser comme j’ignorais qu’il pût y en avoir.
— Attendez-moi, ici, dis-je, résolument.
La clef du caveau où j’avais dissimulé la cassette qui contenait mon argent et celui de l’usine, cette clef se trouvait elle-même dissimulée dans une fente du manteau de la cheminée. Mes doigts tremblants tâtaient la paroi obscure. Armide suivait chacun de mes gestes de ses yeux hagards.
— Que faites-vous ?
— Attendez-moi. Je reviens.
… Cinq mille, dix, vingt, vingt-cinq mille roubles. À la lueur de ma lanterne, je comptais les liasses de billets de banque, les recomptais. Plus de soixante mille francs ! Quinze bourses d’études à Polytechnique, la vie de dix familles françaises honorables, pendant un an, avant la guerre !…
Armide me guettait en haut de l’escalier.
— L’argent ?
— Je l’ai. Venez vite.
C’était moi, maintenant, qui avais le plus de hâte. Ayant jeté sur mes épaules un pardessus, je la poussai dans l’automobile. Durant tout le trajet, elle ne cessa de m’embrasser avec emportement. Et moi, je me rendais compte que, dans son affolement, elle n’avait pas eu le temps de s’habiller, et que, sous sa fourrure, elle était nue.
Les récents événements : prise d’Orenbourg par les bolcheviks, exode des populations des districts envahis – avaient apporté à Novo-Petrovsk une sorte de vie active, et qui, en tout cas, n’était point du meilleur aloi. Malgré l’heure où nous arrivâmes, il y avait encore des fenêtres éclairées. Les rues latérales résonnaient de jurons, de bruits de rixes. Je ne reconnaissais plus cette ville, il y avait quelques semaines encore calme, paisible, presque endormie.
En temps ordinaire, je savais bien ce que j’aurais fait. Je me serais rendu directement au Quartier Général, et là, réveillant, à défaut du colonel Gregor, un de ses officiers d’ordonnance, je l’aurais mis au courant de l’aventure de mon hôte. Mais ce qui était possible un mois auparavant était devenu irréalisable. Il ne restait plus à Novo-Petrovsk un seul homme de l’armée tchécoslovaque. Tous étaient au front, à lutter contre la poussée des troupes rouges. Le commandement et la police de la place avaient été confiés à un détachement de Russes blancs. Je n’avais eu jusqu’à ce jour aucun rapport avec les nouveaux venus, et il me répugnait de débuter par une requête sur la nature de laquelle je n’étais pas fixé, mais dont j’avais les meilleures raisons du monde de penser qu’elle n’était pas très honorable.
D’ailleurs, il était trop tard. L’homme qui nous conduisait venait d’arrêter son automobile. Nous étions arrivés.
Je distinguai un immeuble d’aspect quelconque, devant lequel j’aurai pu passer dix fois sans deviner qu’un tripot était installé là. Deux individus, qui portaient la même casquette que notre cicerone – à n’en pas douter, le personnel de l’établissement – défendaient l’accès de la porte. Armide avait déjà engagé avec eux une violente discussion.
— Que disent-ils ?
— Ils prétendent m’empêcher d’entrer.
— Cela est mieux ainsi. Demeurez dans l’automobile, ordonnai-je. Vous n’avez rien à faire dans un lieu pareil.
Et, sans tarder davantage, je m’engageai en trébuchant dans les ténèbres de l’escalier.
Les tripots se ressemblent tous. Celui-là était pareil à l’endroit, où nous sommes allés hier. À présent, n’est-ce pas, ma frénésie de la nuit dernière commence à devenir excusable, compréhensible.
Tout de suite, en entrant, je vis le général, et j’avoue qu’en une circonstance différente je me serais bien gardé de protester contre le spectacle qui s’offrait à moi. À la vérité, le confident de l’empereur Alexandre III était dans un assez piteux appareil. Dépouillé de sa cérémonieuse redingote, il était assis devant la cheminée, sur une chaise au dossier de laquelle on lui avait lié les bras. Deux robustes gaillards le surveillaient, matraque au poing.
— Hello, Charlie, s’écria-t-il en m’apercevant. Ah ! mon brave ami, je savais bien que vous n’abandonneriez pas dans l’adversité un vieux camarade de combat. Messieurs, je suis heureux de vous présenter le comte Charles Forestier, une des personnalités françaises les plus en vue, mon répondant.
Je jetai un coup d’œil rapide sur l’assistance. À part deux ou trois têtes sujettes à caution, il ne me paraissait y avoir là, à l’encontre de ce à quoi je m’attendais, que de braves gens : paysans cossus, bourgeois aisés, marchands de provinces de l’Est au costume mi-européen, mi-asiatique. L’un d’eux se détacha du cercle qu’ils formaient dans le fond de la salle, autour du général garrotté.
— Que signifie cette grotesque mise en scène ? fis-je, sans lui laisser le temps de prendre la parole.
L’interpellé sourit.
— Colonel Rikof, dit-il, avec beaucoup de bonne grâce, ex-officier de l’armée Ewert. Nous voyons tout de suite, monsieur, à qui nous avons affaire. Je vous en supplie donc, en notre nom à tous, de ne pas nous en vouloir pour le dérangement que nous vous avons imposé. C’est moins notre faute que celle de ce vieux scélérat. Débiteur envers nous depuis plusieurs jours d’une somme qui a fini par atteindre vingt mille roubles. – et non pas vingt-cinq mille, comme il vous le dit dans sa lettre, – nous avons accepté à plusieurs reprises de lui renouveler le délai d’usage de quarante-huit heures. Malheureusement pour lui, nous avons eu ce soir un nouveau partenaire, un partenaire qui le connaît depuis plus longtemps que nous. Monsieur que voici – et il désigna un gros bonhomme tout déconfit – honorable négociant de Samara, a été escroqué deux fois, dans des circonstances identiques, par votre protégé, dont nous vous exprimons mille regrets qu’il soit en même temps notre compatriote. Sur cette révélation, nous nous sommes constitués en chambre ardente, et le verdict suivant a été rendu à l’unanimité. Si nous sommes payés, tout va bien, et nous vous restituons immédiatement ce joli merle. Si nous ne le sommes point, nous vous le rendrons tout de même, bien entendu, mais pas avant de lui avoir infligé une petite fessée, et modifié de façon un peu pittoresque la taille de ses beaux favoris, dont il paraît si fier.
— Voilà l’argent, dis-je sèchement.
J’aurais, certes, éprouvé plus que de la joie à ne pas troubler le cours de cette trop débonnaire justice. Mais, d’autre part, j’avais la certitude qu’Armide ne me le pardonnerait jamais.
Le colonel Rikof feuilletait les liasses de billets que je venais de lancer sur la table.
— Il y a cinq mille roubles de trop. Les voici, monsieur, à moins que vous ne préfériez que je les remette à votre ami. Quant à vous, Excellence, vous êtes libre.
Et il fit au général une révérence goguenarde.
Pour regagner l’usine, je laissai à Armide et à son père – celui-ci tout de même assez penaud – les places à l’intérieur de l’automobile, et m’assis à côté du chauffeur. Dès que nous fûmes arrivés, sans leur adresser la parole, ni à l’un, ni à l’autre, je montai dans ma chambre. Je cherchai à tâtons le lit défait, et me couchai.
Les émotions, l’énervement chassent le sommeil. Quelle heure était-il ? Cinq heures, peut-être. Je ne savais pas. Je ne savais rien. J’étais incapable d’une pensée, d’un mot, d’un geste. Lorsque j’entendis ma porte s’ouvrir, je ne bougeai pas, je ne parlai pas. J’étais sûr cependant d’entrevoir une ombre, une ombre qui glissait vers moi avec douceur…
— Me voici, me dit cette ombre. Pousse-toi. La princesse Irénéïef sait payer.
XII
— Qu’y a-t-il ? dit Schmidt, inquiet de ne plus entendre la voix de son ami.
— Ce bruit, demanda Forestier, prêtant l’oreille, qu’est-ce que c’est ?
— Ah ! ce bruit ? Rien. Un enterrement.
— Un enterrement ! Quelle heure est-il donc ?
— Je vais te le dire. Minuit. Déjà !
— Minuit, seulement ! Il me semble que je parle depuis toujours. Quelle drôle de chose : on enterre donc les gens la nuit, ici ?
— C’est l’usage chinois, répondit Schmidt. S’il n’y avait pas cette odieuse musique, je le trouverais très recommandable.
— Ouvre la fenêtre, murmura Forestier. Je veux entendre.
— Tu auras froid.
— Non, ouvre.
Schmidt obéit, repoussa les doubles battants. Une bouffée d’air glacé pénétra dans la chambre, en même temps que le bruit se faisait tout à coup plus distinct.
C’était une aigre cacophonie qui grandissait, un lugubre pas relevé, tout en barbares discordances, un pot pourri de crécelles, de flûtes, de tambourins. Cela s’approchait, s’approchait… L’instant n’allait plus tarder où le sauvage orchestre passerait devant la maison.
— Que fais-tu ? dit Schmidt.
— Je veux voir, répondit Forestier.
Il s’était levé. Schmidt lui jeta sur le dos une couverture, et l’accompagna jusqu’à la fenêtre à l’appui de laquelle, tous les deux, ils s’accoudèrent.
La lune était en train de vagabonder derrière une épaisse muraille de nuages fauves. À travers leurs interstices filtrait néanmoins assez de lumière pour qu’on pût discerner les traits essentiels du cortège. Il y avait là une cinquantaine d’indigènes. Les hommes étaient au milieu. À droite et à gauche des femmes aux voiles sombres traînaient par la main des petits enfants trébuchants. Enveloppé d’un linceul de soie rouge et juché sur les épaules de quatre porteurs, le cercueil avançait en tanguant, ainsi qu’une barque sanglante ballottée au gré des flots.
Ils passèrent, très vite, sans une lamentation, sans un murmure. La funèbre ritournelle décrût, devint imperceptible, s’éteignit.
— Il y a donc un cimetière, dans les environs ? demanda Forestier.
— Un cimetière ! fit Schmidt. Tu en as de bonnes. Le cimetière, c’est toute la Chine. Le cercueil que tu viens d’apercevoir, ils sont en train de le balancer dans quelque terrain vague. Là-dessus : adieu, grand-papa ! Bien du plaisir avec les charognards. Un cimetière ! Je te les montrerai quelque jour, si ça t’intéresse, ces immenses étendues de boue jaune, parsemées de cercueils éventrés, abandonnés à même le sol. On ne peut rien rêver de mieux, comme dégoûtation. Et dire qu’on va, sans plus tarder, leur coller le bulletin de vote, à ces lascars. Tiens, sens-moi donc ça, plutôt !
Brusquement, le vent venait d’avoir une saute. Il soufflait à présent du nord. Une affreuse odeur leur parvenait, fade, écœurante, nauséabonde. Schmidt saisit le bras de Forestier.
— Laisse-moi fermer la fenêtre. Allons, rentre. À quoi penses-tu ?
— À quoi je pense ! répéta Forestier.
Le son de cette voix était si poignant que Schmidt aussitôt regretta de l’avoir questionné de la sorte.
— À quoi veux-tu que je pense ? Je pense qu’en ce moment il est minuit, que je n’aurais qu’à m’habiller, à descendre, et qu’en une demi-heure de marche, je serais là-bas… Tu sais, n’est-ce pas, où je veux dire ? Mais n’aie pas peur, je n’irai pas. Quand un homme a parlé de son mal avec autant de sérénité que je viens de le faire, on peut bien admettre qu’il est guéri, n’est-il pas vrai ?
— Assurément, déclara Schmidt, beaucoup moins convaincu qu’il n’eût voulu le paraître. Allons, ne restons pas ici, à respirer cette puanteur. Viens te recoucher.
— Au point où j’en suis de mon histoire, dit Forestier après un silence qui avait duré plus longtemps que tous les autres, y aurait-il un inconvénient sérieux à ce que je m’arrête, à ce que je la laisse ainsi, inachevée. Je ne pense pas, car je vois bien que tu as maintenant tout deviné. Je continuerai, pourtant, j’irai jusqu’au bout. Je sens que j’aurais, comprends-tu, conquis de façon trop facile ton absolution, si tu me l’accordais sans avoir eu connaissance des tristes détails qu’il me reste encore à t’apprendre.
Le matin qui suivit cette nuit de Novo-Petrovsk je me levai de meilleure heure que d’habitude, et partis au hasard à travers la montagne. Il y avait dans toute la nature quelque chose qui annonçait la prochaine venue du printemps. Certaines parties de la steppe, d’où la neige avait disparu, étaient d’un beige délicat, qu’allait bientôt recouvrir la pâle verdure des hautes herbes. Le soleil montait avec lenteur au-dessus des sapins, dont il faisait étinceler les branches couvertes de givre. Mais je n’avais pas besoin de ce soleil pour que le paysage m’apparût transfiguré. J’allais, aspirant à pleins poumons le vent glacé des cimes, franchissant d’un bond les minces ruisselets, faisant fuir devant moi à tire d’aile des perdrix blanches effarouchées, des pics-verts au vol haletant, de pesantes bartavelles brunes. Tout m’était un sujet d’émerveillement. Mon cœur débordait de félicité, d’enthousiasme, de gratitude. Je visitai tous les endroits de la forêt où je savais que je pourrais cueillir des œillets mauves, si bien que lorsque je me décidai à reprendre le chemin de l’usine, mes bras pressaient contre moi un bouquet dix fois plus ample que ceux que j’avais rapportés auparavant.
Je consultai ma montre. Il était à peine dix heures. Les deux heures qui me séparaient de celle du déjeuner me parurent autant de siècles. Je me rendais compte que j’avais vécu jusqu’à ce jour ignorant ce que c’était que d’attendre, de désirer quelque chose. À onze heures et demie, mon impatience atteignait son paroxysme. Le général survint à point pour m’aider à la tromper.
Ne pouvant déjà savoir – je me l’imaginais, du moins – que j’étais, ce matin-là, décidé non seulement à ne lui adresser aucun reproche, mais encore à lui passer ses exigences les plus saugrenues, les plus extravagantes, il opéra dans la salle à manger une entrée pleine de circonspection. Sa méfiance fut d’ailleurs de courte durée. Une demi-douzaine de bouteilles artistement disposées sur la table eurent vite raison de ses craintes, et l’avertirent qu’il pouvait réserver pour une autre occasion la comédie qu’il s’était sans doute promis de me jouer.
— Oh ! Oh ! fit-il, des fleurs, une tarte, des vins de choix ! Qu’y a-t-il donc ? Serait-ce votre fête, mon cher Charlie ? Dans ce cas, vous m’excuserez de ne pas vous l’avoir souhaitée. Mais votre calendrier romain est tellement arbitraire !…
— Admettons que ce soit ma fête, mon général, dis-je gaiement. Je voudrais bien connaître votre avis sur ce cru-là.
Il me regarda en dessous. Je ne sais si mon allégresse l’étonnait. En tout cas, il s’abstint de m’en demander la raison.
— Accédons à votre désir, et voyons ce vin, dit-il, très digne. Mon jeune ami, c’est du tokay, tout simplement. Vous ne m’entendrez jamais médire du tokay. C’est un vin que j’envoyais autrefois, par paniers entiers, à la comtesse Strogonof, femme du général-gouverneur de la forteresse Pierre et Paul, qui était – chut ! – alors ma maîtresse. Heureux souvenirs ! Époque exquise ! Il y avait encore une vraie Russie, de vrais gentilshommes. Un verre de tokay à jeun, mon enfant, rien de tel pour vous décaper les papilles de la langue.
Il m’allongea un coup de coude.
— Mais, dites-moi donc, c’est que, vous-même, vous m’avez l’air de commencer à savoir apprécier ce qui est bon.
Je rougis. S’il avait souhaité voir mon entrain tomber subitement, il n’eût sans doute rien trouvé de mieux à me dire. Mais il ne pouvait imaginer que ce qu’il prenait pour un compliment équivalût à mes yeux au plus tragique des blâmes, un blâme qui n’avait même pas le mérite de l’originalité, car je ne savais, hélas ! que trop bien à quel point sa constatation était exacte. Seulement, jusqu’à cette minute, j’avais tout fait pour nier l’évidence. Maintenant, la chose m’était devenue impossible. Nous ne nous décidons à reconnaître le bien-fondé d’un avertissement que lorsque c’est une autre voix que celle de notre conscience qui nous l’adresse.
En l’espèce, bien malgré lui, le général venait de me contraindre à y voir clair. Sa remarque me prouvait que d’autres s’apercevaient de ce que je me refusais encore à admettre. Un changement s’était produit en moi, que je ne pouvais plus contester. Appelons les choses par leur nom : boire ne m’inspirait plus la même répulsion qu’autrefois. Pour reprendre l’avilissante formule de cet ivrogne, « je commençais à savoir apprécier ce qui était bon ». Qui était responsable de cette honte ? Lui, sans doute. C’était à mon corps défendant, poussé par lui, que je m’étais mis à goûter à ce champagne, à ces alcools dans lesquels, auparavant, je ne trempais jamais les lèvres. Oui, mais, depuis tantôt deux mois que la plupart du temps il n’était plus là, qu’il nous délaissait pour les tripots de Novo-Petrovsk, était-ce lui qui m’avait forcé à descendre de plus en plus fréquemment à la cave, pour en remonter une de ces bouteilles devant lesquelles il m’arrivait, à présent, de m’attabler, solitaire ? J’ai parlé tout à l’heure des aveux qui me restaient à faire. Voilà le premier, et, je pense, le moins honorable.
— Eh bien, Charlie, qu’y a-t-il ? On ne trinque plus avec son vieil ami ?
Je lui jetai un regard de haine et vidai mon verre d’un trait. Ses yeux clignotèrent. Il crut à un retour offensif des souvenirs de la nuit précédente, et dut se dire qu’il valait mieux sans plus tarder liquider ce léger malentendu.
— À propos, Charlie, j’ai à vous remercier pour hier. Non, non, ne protestez pas. Je tiens à vous rendre hommage. Vous fûtes parfait, mon cher. Je sais bien que la chose n’a pas d’autre importance. Avouez cependant que ces jeunes gens ont des façons… De braves garçons, tout de même. J’ai peut-être eu tort de vouloir conserver parmi eux mon incognito. Vous admettez en effet qu’il m’eût suffi de me nommer : général prince Irénéïef, pour voir rentrer aussitôt sous terre tous ces rats musqués. Encore une fois, incident banal. Ce que j’en dis, Charlie, n’est pas pour rabaisser le service que vous m’avez rendu. À charge de revanche, mon bon ami. J’insiste simplement pour que vous ne vous figuriez pas qu’il y a eu de ma part faute lourde, bévue tactique, selon l’expression de mon maître Kouropatkine. Que voulez-vous, le coup sur lequel j’ai tenu le paroli ne se représente pas trois fois dans toute une vie. Que je me retrouve dans le même cas, j’agirai encore comme j’ai agi. Passez-moi les cartes, que je vous fasse juge. Là ! Écoutez bien. J’avais donc la banque. Bon. Je donne, après avoir réclamé l’égalité des tableaux, naturellement. « Carte », me demande-t-on à droite. « Carte », me demande-t-on à gauche. De mieux en mieux. Je regarde mon jeu : un roi et un cinq. Rien à dire. Je donne à droite : une bûche. Je donne à gauche : une autre bûche. Admirable ! La situation est claire, n’est-ce pas ? Bon. Qu’est-ce que vous auriez fait, à ma place ?
— Je me serais fait sauter la cervelle, dis-je, brutalement.
Il me regarda d’un air de reproche.
— Oh ! On ne peut pas causer sérieusement avec vous, Charlie. Ce n’est pas gentil. Je ne manquerai pas de raconter à Armide la manière dont vous me parlez. Elle en aura de la peine, beaucoup de peine. Car elle vous aime beaucoup, Charlie, oui, beaucoup. C’est moi, son père, qui vous l’affirme. Précisément, la voici.
Et le colonel Gregor ? On ne le voyait plus que de loin en loin. Il devait avoir des difficultés de plus en plus grandes à disposer de son temps. Coupant routes et chemins, transformant la plaine sibérienne en un océan marécageux, la fonte des neiges faisait cependant subir un temps d’arrêt aux opérations militaires. Le colonel eût dû s’en trouver plus libre. C’était le contraire qui semblait se produire. Les rares fois où il vint nous rendre visite, il ne passa jamais plus de quarante-huit heures parmi nous. Il arrivait, annonçait qu’il était là pour trois ou quatre jours, et repartait le lendemain, voire le jour même, un peu à la façon d’une bête traquée.
La vérité m’oblige à reconnaître que l’accueil qui lui était fait ne devait guère l’inciter à prolonger son séjour. Je ne parle pas de moi, à qui il inspirait, à chacun de ses brefs passages, une pitié qui croissait sans cesse, et sur la nature de laquelle j’aurais donné beaucoup pour être éclairé. Quant au général, il n’était presque jamais là. Ainsi qu’il sera dit plus loin, il n’avait pas tardé à profiter de ma faiblesse pour reprendre à Novo-Petrovsk le cours habituel de ses honteux exploits. Lorsque, d’aventure, il venait à se rencontrer avec le colonel, ce dernier n’avait certes aucun motif d’en éprouver une satisfaction particulière. Tantôt Ephrem Fedorovitch le traitait avec autant de désinvolture qu’un enfant, tantôt il le réquisitionnait pour un mystérieux conciliabule d’où sa victime ne ressortait que le visage décomposé, avec, à la lèvre, un pli d’indicible amertume. Mais c’était surtout l’attitude d’Armide qui était pour moi une énigme. Quand le colonel était là, on ne la voyait plus qu’aux heures des repas, pendant lesquels elle n’ouvrait pas la bouche. Elle passait le reste de ses journées enfermée à clef dans sa chambre. On devine ce qu’étaient les miennes, en tête-à-tête avec ce malheureux, qui ne parvenait pas, malgré ses efforts, à dissimuler sa douleur.
Bouleversé par ce spectacle, je ne pus un jour m’empêcher d’en parler à Armide. Elle haussa les épaules et se borna à répondre avec une nuance d’ironie que j’étais bien la dernière personne de laquelle elle eût pu penser recevoir un tel reproche. Le soir du même jour, vers cinq heures, le colonel repartit. Elle ne descendit même pas lui serrer la main.
— Voulez-vous que je la fasse prévenir ? lui dis-je, alors que le moteur de son automobile ronflait déjà.
— Ce n’est pas la peine, répondit-il doucement. Elle ne viendra pas.
Il me prit la main.
— Monsieur, je n’ai jamais eu qu’à me louer de vous. Je ne voudrais pas que vous conserviez de moi un trop mauvais souvenir, quels que soient les torts que j’ai pu avoir.
C’était mon tour de ne pouvoir cacher mon trouble.
— Des torts, vraiment, je ne comprends pas…, murmurai-je.
— Un jour, dit-il, vous comprendrez. Ce jour-là, promettez-moi de ne pas trop m’en vouloir. Faites-moi encore une autre promesse, voulez-vous ? Dans un mois, deux au plus tard, les bolcheviks seront ici. Qui peut prévoir ce qui se passera alors ! N’attendez pas ce moment-là. Allez-vous-en. Et, si vous pouvez, emmenez-la. Emmenez-la !
Les larmes lui brisaient la voix. Il sauta dans sa voiture, qui partit à toute vitesse.
Je ne devais jamais revoir le colonel Gregor.
Il ne s’était pas trompé, en tout cas, dans ses prévisions. M’étant rendu, peu de jours après, à Novo-Petrovsk, pour essayer d’arranger, à prix d’argent comme toujours, une frasque inarrangeable du général, j’y vis, j’y entendis des choses qui m’auraient fait frémir, s’il n’y avait eu longtemps que ma dernière illusion s’était envolée sur la façon dont se terminerait, dans les provinces de l’Oural, la lutte entre Blancs et Rouges. Les troupes tchécoslovaques, les seules organisées, les seules disciplinées, avaient définitivement évacué la région. Elles s’étaient regroupées à trois cents kilomètres au nord-est, vers Tcheliabinsk, où se trouvait encore leur Grand Quartier Général. Désormais, la défense de Novo-Petrovsk n’était plus assurée que par des troupes blanches, avec des états-majors en proie à la plus complète anarchie. C’était l’absolue certitude que, dès que la fin de la mauvaise saison permettrait aux bolcheviks de reprendre leur offensive, tout par ici s’écroulerait.
Il peut y avoir une scandaleuse contradiction dans ce que je vais dire. Cette période-là a été certainement la plus dégradante de ma vie. Or, même en m’appliquant de mon mieux à la répudier, je m’aperçois qu’aujourd’hui encore, je n’y parviens pas. Et pourtant, durant ces deux mois, quelle monstrueuse existence a été celle de l’étrange trio que nous formions, dans cette usine abandonnée sur laquelle la catastrophe allait bientôt fondre. Il n’est point question de l’indignité d’Ephrem Fedorovitch. Il se montrait, maintenant, sans contrainte, tel qu’il avait dû être toute sa vie, et voilà tout. Je parle de mon indignité, à moi, qui en étais arrivé, pour toucher ma sinistre et belle récompense, non plus seulement à trouver naturel de conserver cette racaille sous mon toit, mais à le courtiser, à rire de ses facéties, à flatter ses plus ignobles manies, à boire avec lui, parfois jusqu’à en rouler sous la table, à puiser, pour un gouffre sans cesse agrandi, d’abord dans l’argent des miens, ensuite dans la réserve de l’usine. Au commencement, j’avais eu quelques sursauts. Je me souviens de scènes d’une violence inouïe, où je lui avais craché tout le dégoût qu’il m’inspirait, doublé de celui que j’éprouvais pour moi. Mais Armide paraissait, glacée et sereine… Et deux minutes plus tard, j’étais à la cave, en train de rafler les billets de banque et les bouteilles pour Ephrem Fedorovitch.
Contre elle aussi, au début, cependant, j’avais essayé de m’insurger. Puisqu’il eût été fou d’espérer qu’elle s’en détachât, je l’avais suppliée de tenter de faire entendre raison à son père, de m’aider dans ma lutte contre ce calamiteux personnage. « C’est mon père, répondait-elle, butée. Je regrette de constater que nous n’avons pas la même conception de la famille. » Quel soufflet pour moi, qui n’écrivais même plus à la mienne ! Le jour où j’appris qu’Ephrem Fedorovitch était retourné à son tripot de Novo-Petrovsk, qu’Armide l’avait su, qu’elle n’avait rien fait pour l’en empêcher, je me mis à trembler de terreur et de colère. « Si vous croyez que la vie est drôle pour lui, ici », se contenta-t-elle de me répondre. « Mais c’est épouvantable ! De nouveau il va jouer, il va perdre. » Elle eut son haussement d’épaules coutumier ; son sourire évoqua le tacite et triste marché qui l’avait mise dans mes bras. « Il perdra. Que veux-tu que j’y fasse ? C’est mon père, n’est-ce pas ? D’ailleurs, si tu m’aimais comme tu me le dis, tu ne devrais pas autant redouter cette perspective. »
Et elle avait allumé une cigarette.
« Si tu m’aimais comme tu me le dis… » J’entends d’ici la question : « Et elle, t’a-t-elle seulement dit une fois qu’elle t’aimait ? » Ah ! qu’on me laisse rire. Elle était bien trop orgueilleuse pour me mentir. Et, si facile à abuser qu’il soit, qui pourrait donc croire que Charles Forestier ait pu songer une minute à être aimé de la princesse Irénéïef. « Alors ? » Alors, c’est simple. Tout en étant guéri d’elle, tout en ayant sur elle les plus cruelles lucidités du monde, je ne renie pas ma dette à son égard. Alors, je trouve qu’il est déjà bien beau qu’une femme comme elle ait consenti à se laisser aimer d’un homme comme moi. Il est déjà bien beau qu’il ait apprit à son contact des choses que sans elle il n’aurait jamais connues ; des choses qui ne figurent, certes, ni sur les programmes de Polytechnique, ni sur ceux de Normale, ni d’aucune autre école ; des choses qu’il faut sans doute acheter de son argent, de son sommeil, de ses peines, de ses larmes, au besoin de son sang et de son honneur, mais dont tout homme, vraiment homme, s’il est franc, ne trouvera jamais qu’il les a payées assez cher.
Les jours passèrent. Un matin que j’étais à mon bureau, suivant d’un œil indifférent à travers la steppe le ruban des rails sur lesquels j’avais vu disparaître, il y avait déjà près d’un mois, la dernière locomotive, je dressai l’oreille. Les vitres de la croisée venaient de vibrer de façon bizarre.
Au même instant, Ephrem Fedorovitch faisait irruption dans ma chambre.
— Avez-vous entendu, Charlie ?
— Quoi ?
— Parbleu ! Votre fenêtre est fermée.
Il l’ouvrit.
— Là ! Et maintenant, entendez-vous ?
— Oui, dis-je, le canon. C’est un bruit que vous connaissez, je pense ?
— Je le connais… Bien sûr. Il m’a bercé. Tout de même, Charlie…
— Tout de même quoi ?
— Ça prouve que ces fils de porcs ont encore lâché du terrain.
Je lui fis observer sèchement que ceux dont il parlait avec cette légèreté étaient ses compatriotes.
— Bien sûr, bien sûr, répliqua-t-il. Mais comme ce sont également des compatriotes à moi qui attaquent, ça rend à mon jugement toute son indépendance.
— Eh bien, alors de quoi vous plaignez-vous ? Laissez-moi travailler tranquille, dis-je agacé.
Je venais en outre d’avoir la sensation que, le cas échéant, Ephrem Fedorovitch n’hésiterait pas à mettre froidement dans sa poche le drapeau qu’il avait défendu, à Traktir, contre un nombre impressionnant de Pandours et de Polonais.
Le lendemain matin, à la première heure, une puissante automobile militaire fit halte devant l’usine, et l’on me monta aussitôt une enveloppe cachetée.
J’étais invité à me rendre de toute urgence, pour affaire grave, au Grand Quartier Général tchécoslovaque, à Tcheliabinsk.
XIII
— Où vas-tu ? demanda Armide.
La lettre que je venais de recevoir n’avait aucun caractère confidentiel. Je la lui tendis.
— De quoi s’agit-il ?
— Je l’ignore, dis-je ; moi-même assez intrigué.
— Tu n’as rien à voir avec les Tchécoslovaques. Ils n’ont pas d’ordre à te donner.
— Il s’agit peut-être d’un conseil.
— Et si tu allais ne pas revenir ?
Je haussai les épaules.
— Je serai de retour dans trois jours, au plus tard.
Je procédai rapidement à mes préparatifs. Armide suivait chacun de mes mouvements avec une certaine anxiété. Il y avait dans tout cela quelque chose d’insolite qui, visiblement, la tourmentait.
— À bientôt, lui dis-je, quand je fus prêt. Vous n’aurez, durant mon absence, qu’à donner vos ordres aux Tartares. Ah ! j’ai fait monter de la cave du vin et des liqueurs pour votre père. Tâchez de l’empêcher de tout boire le premier jour.
— Vous n’avez pas assez confiance en moi pour me laisser la clef, dit-elle, railleusement.
— Oh ! fis-je, pas d’hypocrisie. Ephrem Fedorovitch n’aurait qu’à vous la demander pour que vous la lui remettiez immédiatement. Il est votre père, n’est-il pas vrai ?
Elle se mordit les lèvres.
— Bien répondu, dit-elle, avec un sourire.
En raison de l’état exécrable des routes, nous ne pûmes franchir dans la journée les trois cents kilomètres qui séparent Novo-Petrovsk de Tcheliabinsk. Nous couchâmes dans une ferme abandonnée. La canonnade avait repris. On l’entendait beaucoup plus distinctement que la veille.
— A-t-on des nouvelles du front ? demandai-je au chauffeur.
Il hocha la tête d’un air soucieux, et ne répondit pas.
Repartis le lendemain à l’aube, nous arrivâmes sans encombre, vers midi, à Tcheliabinsk.
Une activité fiévreuse régnait dans la ville. Tout le monde avait l’air de faire ses paquets. Des estafettes parcouraient les rues encombrées de camions et de charrettes. La gare regorgeait de matériel que l’on hissait hâtivement sur les fourgons.
— Que peut-on me vouloir ? pensai-je, sentant l’inquiétude me gagner de plus en plus.
Mon chauffeur me conduisit directement au Quartier Général. Dans l’antichambre, je tombai sur un officier plus affairé que tous les autres. C’était Georges.
— Vous ici ! s’écria-t-il.
— J’arrive à l’instant. Je suis convoqué par le général Sladky, chef d’État-major, lui dis-je, heureux de rencontrer enfin une figure de connaissance.
— Le général Sladky ? Vous ne le verrez pas, aujourd’hui du moins.
— Comment, je ne le verrai pas ? Voici sa lettre.
— Oui, mais elle est datée d’avant-hier. Depuis, les événements ont marché. Le général Sladky a quitté Tcheliabinsk hier soir. Il est en train d’inspecter nos premières lignes, à quarante kilomètres au nord-ouest. Il ne sera pas rentré avant demain. Je pars même à l’instant, pour lui communiquer ces dépêches qui viennent d’arriver.
— Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? dis-je, commençant à m’énerver. On me convoque sans un mot d’explication. Je fais trois cents kilomètres par des chemins infernaux. Et, quand j’arrive, je ne trouve personne pour me recevoir. C’est d’une incorrection…
— Vous êtes tout de même mieux ici qu’à Novo-Petrovsk, dit Georges, croyez-moi.
— Novo-Petrovsk ! J’ai bien envie d’y retourner tout de suite.
— Ah ! ça, fit-il, c’est une autre affaire.
— Comment ?
— Je dis que ce ne serait peut-être pas une entreprise de tout repos. Vous ignorez donc que les bolcheviks attaquent sur l’ensemble du front. Il est permis d’être sceptique sur la solidité de la résistance qui va leur être opposée. Nous, nous nous préparons, tout bonnement, à évacuer le pays. Ce n’est pas malheureux. Il y a assez longtemps qu’on nous berne. Que Rouges et Blancs se débrouillent entre eux. Quant à Novo-Petrovsk, il y a bien des chances pour que l’ennemi s’en soit emparé avant la fin de la semaine.
Je le regardai, atterré.
— Mais alors, raison de plus. Il faut que je reparte tout de suite, balbutiai-je.
— Vous n’y pensez pas, dit Georges. D’abord, essayez donc. À moins d’aller à pied… Et puis, si l’on vous a fait venir, c’est tout de même qu’on a besoin de vous, ici.
— On ne le dirait pas, à la façon dont on m’accueille, fis-je. C’est inconcevable.
Juste au même instant, un planton s’approcha de moi. Il était chargé de me prévenir que j’étais attendu par le commandant Zeyer.
— Le commandant Zeyer, qui est-ce ?
— L’adjoint du général Sladky. Il doit être au courant de ce que l’on vous veut.
Je m’apprêtais à suivre le planton. Mais Georges me retint par la manche.
— Eh bien, fit-il à voix basse, est-ce que je me trompais, lorsque je vous prédisais que tout cela finirait mal ?
— De quoi parlez-vous ?
— Vous ne savez pas ? C’est vrai, comment sauriez-vous !
Il baissa la voix davantage encore :
— Il est arrêté.
— Qui ?
— Le colonel Gregor.
— Le… ?
— Oui, depuis trois jours, à la forteresse, en prévention de Conseil de Guerre.
— Le colonel Gregor ! Ce n’est pas possible. Qu’est-ce que vous me racontez là ? fis-je avec épouvante.
Georges allait répondre. Mais je le vis soudain se figer au garde-à-vous. Un officier supérieur venait d’apparaître sur le seuil de l’une des portes qui donnaient sur l’antichambre. C’était le commandant Zeyer qui s’impatientait.
— Pas un mot, eut le temps de me souffler Georges, pas un mot de tout cela au commandant. Attendez qu’il vous en parle.
Le commandant Zeyer était un petit homme courtaud, aux traits énergiques. Il me fit asseoir. Tout en affectant de ranger des papiers sur son bureau, il examinait mon visage bouleversé.
— Monsieur Forestier, dit-il enfin, je dois d’abord vous remercier de la rapidité avec laquelle vous vous êtes rendu à notre appel. Le général Sladky vous prie de l’excuser. Il sera là à la fin de la journée, demain matin au plus tard. Il m’a laissé ses instructions. Je suis donc en mesure de vous expliquer ce que nous attendons de vous, – ce que nous attendions, plutôt.
Il marqua une pause, désireux sans doute de me voir le questionner. Son espoir fut déçu.
— Oui, continua-t-il, les événements, en se précipitant, ont rendu sans objet l’entretien que nous désirions avoir avec vous. Nous ne regrettons pourtant pas de vous avoir fait venir à Tcheliabinsk, bien au contraire.
Et il eut la même phrase que Georges : « Vous êtes mieux ici que là-bas. »
— Les nouvelles sont si mauvaises que cela ? murmurai-je.
Le commandant Zeyer était occupé à tailler un crayon.
— Les nouvelles ? Peuh !… Je vous répondrais qu’elles sont déplorables, si, en ce qui nous concerne, nous n’étions pas fondés à considérer comme un avantage tout ce qui peut hâter la fin de l’aventure dans laquelle nous sommes engagés depuis deux ans. À l’heure actuelle, nous touchons à cette fin. Nous sommes autorisés à nous replier sur Vladivostock, la mer, puis notre patrie. Nous allons faire de notre mieux pour que cette retraite ait lieu dans les meilleures conditions, et ne rien laisser à l’ennemi du matériel et des approvisionnements dont nous disposons. Nous ne voulons pas compliquer la tâche des troupes blanches qui vont continuer la lutte sans nous. Elles ont déjà suffisamment de fil à retordre. Bon ; je pense que vous commencez à comprendre.
— Pas encore très bien.
— C’est simple. Prévoyant comme imminente la chute de Novo-Petrovsk, notre commandement s’est souvenu de votre usine, des stocks qui y demeurent entreposés. Seule leur destruction pourrait empêcher les bolcheviks de mettre la main dessus. Nous vous avons convoqué pour vous en parler. Malheureusement, il est trop tard.
— Pourquoi ?
— Parce que l’avance rouge s’est développée avec une vitesse inattendue.
— Novo-Petrovsk est tombé ?
— Non, que je sache. Mais, dans trois jours, ce sera chose faite. Que voulez-vous, nous ne pouvions prévoir une débâcle aussi rapide des troupes blanches. Nous n’avons rien à nous reprocher. Et nous avons au moins la consolation de vous avoir rendu service. Vous êtes ici chez vous. Je suis chargé de veiller à votre installation, en attendant qu’un coupé puisse vous être réservé dans un des premiers trains – un des derniers serait plus exact – en partance pour Omsk.
Je m’étais levé en tremblant.
— Je vous remercie mille fois, mon commandant. Mais mon devoir s’oppose à ce que je profite de votre offre. Il me faut rentrer à Novo-Petrovsk.
— Rentrer à Novo-Petrovsk, répéta le commandant Zeyer avec une surprise qui ne paraissait pas feinte. Mais c’est impossible.
— Il le faut.
— Encore une fois, même si l’on pouvait mettre une automobile à votre disposition, à quoi cela vous avancerait-il ? Vous ne réussiriez qu’à vous jeter dans la gueule du loup.
— J’ai la responsabilité de mon usine. J’y ai de l’argent, des documents…
Il secoua la tête.
— Monsieur, permettez-moi de vous dire que le général Sladky n’était pas sans avoir prévu une résistance qui, certes, vous honore, mais dont vous reconnaîtrez avec moi la vanité. Vous ne reviendrez pas à Novo-Petrovsk : primo, parce que vous ne trouverez plus personne pour vous y conduire ; secundo, parce que, au besoin, nous vous en empêcherons. Dans ces conditions, votre responsabilité est absolument à couvert. Nous serons là pour affirmer que vous avez fait votre devoir, tout votre devoir, chose qu’en France personne ne s’avisera d’ailleurs de contester.
Mon trouble était à son comble. Incapable de réfuter de tels arguments, je sentais que j’allais avoir à dévoiler le seul motif qui me poussait à regagner l’usine. Du même coup, j’étais contraint de m’avouer que je n’avais eu qu’un but en me rendant à Tcheliabinsk : chercher à assurer, le cas échéant, le salut d’Armide.
Le commandant Zeyer avait posé son crayon. Ses petits yeux perçants ne me quittaient plus.
— Vous êtes convaincu, j’espère ?
Je dus faire un violent effort pour venir à bout des contractions de ma gorge.
— Mon commandant, je vois qu’il me faut vous mettre au courant de toute la situation. Je n’eusse pas mieux demandé que de rester ici. Mais j’ai à l’usine des hôtes, deux hôtes. Il ne m’est pas possible de les abandonner de la sorte.
Le commandant Zeyer m’écoutait avec une attention qui me rendit un peu d’espoir.
— Je pense que vous comprenez, que le général Sladky comprendra…
— Oh ! fit-il. Il fallait me dire cela tout de suite. Évidemment, quel cas de conscience ! Deux hôtes ?
— Oui, un vieillard et une jeune fille.
— Des Français, sans doute ?
— Non, mon commandant. Des Russes.
— Ah ! des Russes. Hum ! Ils seront encore plus exposés… Et puis-je savoir leurs noms ?
— Le général Irénéïef et sa fille.
Le commandant Zeyer s’était, levé à son tour.
— Monsieur Forestier, dit-il, martelant ses mots, me regardant bien en face, vous m’avez beaucoup parlé de votre devoir. Je vais, moi, vous parler du nôtre. Non seulement le général Sladky ne fera rien, vous m’entendez bien, rien, mais encore il interdira de tenter quoi que ce soit en faveur des deux aventuriers en question.
Je dus, je m’en souviens très nettement, m’adosser à la muraille pour ne pas tomber.
— Monsieur, balbutiai-je, les personnes dont il s’agit, j’ai eu l’honneur de vous le dire, sont mes hôtes. En conséquence, c’est à moi que de telles paroles…
— Vos hôtes ? fit-il, plus brutalement encore. C’est à mourir de rire. Depuis quand les connaissez-vous ? Comment les avez-vous connus ?
Il s’aperçut que je chancelais.
— Allons, asseyez-vous. Si vous pouviez vous voir ! Vous êtes blanc comme une serviette. Pardonnez-moi de vous parler comme je le fais, mais comment n’avez-vous pas compris qu’ici nous étions au courant de tout, hélas ! oui, de tout ?
Il répéta :
— Asseyez-vous ! Encore une fois, nous savons tout, sans doute des choses que vous ignorez, car autrement vous n’auriez tout de même pas eu l’inconscience de tenter de nous apitoyer sur le sort de ces scélérats.
— Mon commandant !…
— Oh ! je vous en prie, pas d’indignation. Je n’ai pas le cœur à mâcher mes mots. Dites-moi, vous avez entendu parler du colonel Gregor, n’est-ce pas ?
J’inclinai la tête.
— Eh bien, savez-vous ce qu’il lui est arrivé, ces jours-ci, au colonel Gregor, pour s’être toqué d’une… ?
Je poussai un cri si douloureux qu’il s’arrêta net. Ses yeux s’emplirent de stupeur, et j’entendis, je devinai plutôt qu’il murmurait :
— Lui aussi !
— Cela va-t-il mieux ? demanda au bout de quelques instants, d’une voix devenue presque douce, le commandant Zeyer.
— Je vous en supplie, dis-je, parlez-moi, je veux savoir.
Il hocha la tête.
— Vous ne m’en voudrez pas ?
— Non, au contraire.
— Oh ! au contraire, c’est beaucoup dire. Enfin, allons-y. Vous êtes un homme, après tout, tonnerre ! Eh bien, il y avait une fois un autre homme qui s’appelait le colonel Gregor. Nul ne peut mieux que moi vous dire ce qu’il était : la bonté, la bravoure, l’honneur ; une femme, la sienne, là-bas, à Prague, qui l’adorait. Tout cela réduit à rien, soufflé, balayé ! Et par qui, pour qui, mon Dieu ! Ah ! la garce !
Ses poings se crispèrent.
— Cela a commencé il y a un peu plus de deux ans, en Ukraine. J’étais là ; j’ai vu comment ils ont opéré. Ah ! je vous jure que ça a été du beau travail de la part de ces deux gredins… Lui, je ne vous ferai pas l’affront de vous tracer son portrait. Vous connaissez cette boue. Et elle ? Elle, c’est pis encore. Lorsque nous sommes partis, que nos régiments se sont formés sur l’Oural, j’ai cru que mon ami échappait à leurs griffes. Songez à notre rage en apprenant qu’ils l’avaient suivi, qu’il en était à ce degré d’aberration d’installer sous votre toit sa maîtresse ! Dois-je continuer ?
— Oui.
— D’ailleurs, vous vous doutez du reste. Ces gens-là, qui sait ce qu’ils lui ont coûté ! Il avait un peu de fortune. Ils la lui ont mangée. Et puis, et puis… on va vite, dans cette voie. Ah ! quand je pense que si nous avions évacué ce sale pays trois mois plus tôt, Gregor eût peut-être été sauvé !… Tandis qu’aujourd’hui… Un colonel gouverneur de district, en temps de guerre, ça a de l’argent à sa disposition, beaucoup d’argent. Sa caisse n’est inspectée que rarement, trop rarement. Oui, mais elle finit toujours par l’être. Ce qui devait arriver a eu lieu. Quelle horreur !
— Quand doit-il être jugé ? demandai-je.
— Après-demain.
— Et… il sera condamné ?
Le commandant Zeyer promena sur moi son œil sombre.
— Gardez cela pour vous, dit-il, vous qui avez pu l’apprécier, qui avez couru peut-être le même péril que lui : non, le colonel Gregor ne sera pas condamné. Pourquoi ? Parce que c’est un brave et parce que nous, ses camarades, nous avons obtenu qu’on lui laissât son revolver ! Voilà ! Venez, maintenant.
Nous gravîmes en silence un escalier, traversâmes un corridor. S’effaçant, le commandant Zeyer me fit entrer dans une chambre meublée militairement. Sur une chaise, à côté du lit, il y avait mon sac de voyage.
— Vous logez ici, dit-il. Il y a un train qui part pour Omsk demain. On s’arrangera pour vous y trouver une place.
Sur un ton qu’il voulait bourru, mais où je sentis percer l’émotion, il ajouta :
— Après cette conversation, je n’ai pas besoin de vous enfermer à clef, n’est-ce pas ?
C’était pourtant ce qu’il aurait dû faire.
Je ne le savais pas encore moi-même ; je ne le savais pas davantage quand, vers six heures du soir, je quittai ma chambre et m’en allai au hasard à travers la ville, sans autre but, je le jure, que de prendre l’air. J’errai dans cette ville que je ne connaissais pas, et me trouvai bientôt sur une place entourée de maisons de briques. Au centre était un square où jouaient des enfants. Les premières lumières s’allumaient en même temps que les premières étoiles. C’était un de ces crépuscules blancs de Sibérie, où la nuit et le jour se fondent en une clarté qui semble venir de la tombe.
Trois hommes causaient sur le banc où je m’assis. J’écoutai, inconsciemment, leur conversation. Je compris que c’étaient deux cochers et un chauffeur. Leurs voitures s’alignaient, en station, le long du trottoir : deux fiacres si vieux qu’ils semblaient perdre leurs entrailles, et une automobile tellement rafistolée qu’il eût été puéril de chercher à en identifier la marque.
Ces braves gens commentaient de leur point de vue les événements de la journée. Les cochers avaient fait quelques courses, mais le chauffeur n’avait pas encore étrenné.
— Qui me prendra, à cette heure ? geignait-il.
Qui ? Mais parbleu, moi !
— Mène-moi du côté de la gare, ordonnai-je.
Nous n’avions pas roulé deux minutes que je lui frappai sur l’épaule. Il se retourna.
— Qu’est-ce que tu dirais si je te demandais de me conduire à Taïka ?
Taïka est une localité située à environ cent kilomètres de Tcheliabinsk, sur la route de Novo-Petrovsk.
— À Taïka !
Il hésitait ; il était partagé entre la crainte que lui inspirait cette proposition d’un inconnu et le désir de ne pas laisser échapper une telle affaire.
— Oui, mais il faudrait me donner trois cents roubles.
— Les voilà.
Nous sortîmes de Tcheliabinsk sans avoir eu maille à partir avec une seule patrouille. On arrête les espions, mais on n’a jamais empêché les fous d’aller jusqu’au bout de leur folie.
Nous fûmes à Taïka un peu avant minuit.
— Continue.
Après une brève discussion, décidé par l’appât du gain, et aussi par la vue du revolver disposé bien ostensiblement près de moi, sur la banquette, le chauffeur obéit.
Le jour commençait à poindre lorsque la petite automobile s’arrêta. Alors, le bruit du moteur ayant cessé, nous entendîmes celui du canon. Le canon, quand aura-t-il fini de résonner à la surface de la terre ?
— Je n’ai plus d’essence, fit piteusement mon conducteur.
Et il se mit à se lamenter.
— Ne pleure pas, dis-je à ce pauvre diable. Voici trois mille roubles. C’est deux fois le prix de ta misérable boîte à sardines. À présent, bonne chance !
Je descendis et m’en allai sur la route, sans me retourner. Une cinquantaine de kilomètres devaient me séparer encore de Novo-Petrovsk.
Je marchai toute la journée, toute la nuit, insoucieux de ce que je ferais quand je serais en présence d’Armide. La tuer ? La prendre dans mes bras ? Peut-être. La revoir, en tout cas, la revoir ! Il y avait des instants où cette perspective m’obsédait si fort que je me mettais à courir.
Vers le Sud, le canon tonnait maintenant avec violence. Comme la nuit tombait, brusquement, il se tut. Et, plus que ce bruit, ce silence me fit frissonner.
Lorsque l’aube se leva de nouveau, je n’étais plus qu’à deux lieues de Novo-Petrovsk. Quittant la route, je pris alors par le sous-bois. Les mousses alentour étaient toutes fleuries d’œillets pâles…
Il y avait juste trois jours que j’en étais parti quand m’apparurent les bâtiments de l’usine, sur laquelle, dans l’air frais du matin, flottait doucement le drapeau rouge.
XIV
— Eh bien, est-ce que cette plaisanterie va durer encore longtemps ?
L’homme à qui je parlais ainsi secoua la tête. C’était bien la trentième fois que je lui posais cette question. Il y avait toujours répondu de la même manière.
Voilà plus d’une semaine que j’étais emprisonné à Novo-Petrovsk et tenu au secret sans avoir subi l’ombre d’un interrogatoire. On attendait, paraît-il, l’arrivée du camarade Tcheressensky, commissaire de l’armée de l’Oural, et celle du camarade Kraemer, délégué de la Commission extraordinaire de Moscou.
Ces messieurs n’avaient pas l’air de se presser.
Je procède à l’exposé rapide de ce qui m’était advenu depuis mon retour de Tcheliabinsk. Novo-Petrovsk avait été occupé presque sans combat, la veille de ce jour, par les troupes rouges. J’avais trouvé l’usine entre les mains de soldats qui n’étaient plus ceux qui y étaient entrés les premiers. Même s’ils y avaient consenti, ils eussent donc été incapables de me fournir le moindre renseignement sur ce qui s’était passé alors. Pas plus que les gens, je n’avais eu le loisir d’interroger les lieux. L’officier qui commandait le détachement cantonné à l’usine s’était empressé de se débarrasser de ce visiteur suspect. Sans plus tarder, quatre hommes, baïonnette au canon, m’avaient conduit à Novo-Petrovsk. La vieille prison étant déjà pleine à craquer, j’avais eu la chance d’être incarcéré dans un des locaux de l’école d’Arts et Métiers. La vérité m’oblige à dire que je n’avais été l’objet d’aucun mauvais traitement. On ne m’avait pas fouillé. J’étais par contre soumis à une surveillance de tous les instants. Deux sentinelles montaient la garde, l’une devant ma porte, l’autre à ma fenêtre, qui s’ouvrait sur le préau de l’école. Elles ne me quittaient pas d’une semelle durant la demi-heure de promenade que j’accomplissais journellement dans ce préau.
Grâce à l’argent qu’on m’avait laissé, j’étais néanmoins parvenu à amadouer quelque peu le geôlier taciturne qui entrait chez moi, matin et soir, pour m’apporter mes repas. S’il m’avait été impossible d’obtenir de lui des renseignements sur le sort qui m’attendait, en revanche, j’avais pu, à force de supplications, le décider à s’enquérir de celui d’Armide. Les résultats de son enquête auprès de ses collègues de la prison n’avaient guère été rassurants. Un homme et une femme du nom d’Irénéïef avaient bien figuré sur les registres d’écrou, mais ils avaient quitté très vite leur cellule ; il n’avait pu savoir ce qu’ils étaient devenus. Je frémis, car certaines paroles échangées entre mes sentinelles m’avaient appris que les exécutions avaient déjà commencé.
Je ne devais d’ailleurs pas tarder à recueillir un supplément d’informations, de nature, celles-là, à transformer en tout autre sentiment l’angoisse qui n’avait cessé de m’assiéger jusqu’alors.
Le matin du douzième jour de ma détention, ayant su, toujours par les conversations des sentinelles, que les camarades Kraemer et Tcheressensky étaient bel et bien à Novo-Petrovsk, qu’ils y étaient arrivés le lendemain même de la prise de la ville, je me mis du coup en colère. La prolongation de mon emprisonnement ne se justifiait plus par l’absence de juges. J’exigeai donc de l’encre, du papier, et m’attelai à la composition d’une solide zaïavlenie. Aux gens qui n’ont pas connu les douceurs des geôles russes, j’apprendrai qu’on entend par ce mot la réclamation dans laquelle un détenu énumère les raisons qu’il croit avoir de récupérer son indépendance.
J’étais en train de procéder à une seconde rédaction de ma requête, la première m’ayant paru contenir des formules trop cavalières, quand ma porte fut ouverte avec brusquerie. Elle se referma de même, le temps de pousser un gros homme qui s’en vint choir sur l’unique chaise de la pièce, où il demeura, s’épongeant le front, tout abasourdi.
Jusqu’à ce jour, j’avais bénéficié du régime de l’isolement. Mais j’étais averti par mon gardien que, les arrestations se multipliant, cet état de choses risquait fort de ne plus durer. Je n’en considérai pas moins sans bienveillance l’intrus qui troublait ainsi ma paix. J’eus immédiatement l’impression que j’avais vu cette tête-là quelque part. Mais où ? C’était ce que je n’arrivais pas à me rappeler.
Lui, de son côté, m’examinait de ses yeux ronds, avec insistance. Et soudain il poussa une exclamation.
— Ah ! Monsieur, quel hasard ! Et quelle chance aussi pour moi, j’espère !
— Comment ? Vous ! fis-je presque en même temps.
Je venais à mon tour de le reconnaître. Mon homme n’était autre que le négociant de Samara, celui-là même dont le témoignage, au cours d’une nuit fertile en péripéties de toutes sortes, avait occasionné certains ennuis à Ephrem Fedorovitch.
— Pourquoi êtes-vous ici ?
— Ah ! fit-il, piteusement, même pas pour raisons politiques. Pour délit de droit commun, sous l’inculpation d’escroquerie, vous m’entendez, monsieur, d’escroquerie !
— Oh ! oh ! Et que vous reproche-t-on ? En quoi, en tout cas, le fait de m’avoir retrouvé peut-il être une chance pour vous ?
— Vous allez voir. Il y a deux jours, j’ai eu la malencontreuse idée d’aller faire une petite partie de baccara, au cercle que vous connaissez…
— Quoi, fis-je avec une moue, les bolcheviks n’ont pas commencé par fermer cette caverne ?
Ses yeux s’arrondirent encore. Pourquoi les bolcheviks auraient-ils fermé son cercle ?
— Je continue, dit-il. Savez-vous qui j’ai rencontré là ?
— Comment voulez-vous que je le devine ?
— Eh bien, le vieux forban dont vous avez eu la bonté de régler la dette.
— Quoi ? fis-je, me sentant subitement devenir livide. Il est donc en liberté ?
— S’il est en liberté ! Non seulement il est libre, mais c’est à lui que je dois de ne plus l’être, moi. Non seulement il est libre, mais encore il est, paraît-il, tout-puissant auprès des maîtres de l’heure. C’est sur la plainte qu’il a eu l’aplomb de déposer contre moi qu’on vient de me coffrer, après m’avoir confisqué tout mon argent. Et le fonctionnaire qui m’a notifié mon arrestation ne s’est pas fait faute de me déclarer que mon compte était bon, étant donné la personnalité de mon accusateur. N’y a-t-il pas de quoi rire ? Mais, cher monsieur, ça ne se passera pas ainsi, n’est-ce pas ? Vous serez là, le moment venu, pour me défendre, pour affirmer…
Je ne l’écoutais plus. Je m’étais bien trompé, si j’avais pu croire, à Tcheliabinsk, toucher le fond du désespoir, de la haine, de la jalousie, c’est-à-dire, hélas ! de l’amour… Qu’était-ce en comparaison de ce que j’éprouvais à présent. Ainsi le colonel Gregor était roulé dans le linceul rougi du sang de son crâne fracassé ; moi, dans ma grotesque prison, j’étais promis peut-être à un sort identique… Et elle, pendant ce temps, entre les bras de qui souriait-elle, la misérable, au salut de laquelle lui, moi, combien d’autres sans doute, nous n’avions songé qu’à nous sacrifier ? Ah ! je n’avais pas beaucoup à réfléchir pour être fixé sur l’origine et la nature de l’influence dont pouvait actuellement disposer Ephrem Fedorovitch !
Forestier, qui venait de parler tout d’une traite, s’arrêta. Un soupir s’élevait dans la chambre obscure.
— Qu’as-tu ? demanda-t-il à son tour.
— Rien, dit Schmidt. Ou plutôt, si. Je songe aux hommes, aux pauvres hommes comme moi, dont la vie a été semblable à une montagne. Ils y ont cheminé allègrement, depuis leur naissance, dans le brouillard. Et il leur a fallu une brusque éclaircie pour s’apercevoir des affreux précipices qu’ils ont côtoyés.
C’était sa voix maintenant qui était brisée, tandis que celle de l’autre ne cessait de gagner en force.
— Ainsi, reprit Forestier, il ne m’était plus possible à présent de continuer à me mentir. Je savais désormais ce qu’était Armide : la triste monnaie, la monnaie toujours renouvelée avec laquelle son ignoble père soldait ses tirages à cinq, son champagne, sa vodka… Et pourtant, je m’obstinais encore. J’appelais désir de me venger ce qui n’était que monstrueux besoin de la revoir.
La revoir ! Pour y arriver, reconquérir ma liberté le plus tôt possible ! Ce ne serait évidemment pas, le moment venu, en criant à mes juges ce que je pensais d’eux, ce que j’avais sur le cœur, que j’obtiendrais ce résultat. Oui, mais, ces juges, encore fallait-il qu’ils daignassent me convoquer.
Ma requête produisit, plus vite que je n’eusse osé l’espérer, l’effet que j’attendais d’elle. Le lendemain, vers trois heures de l’après-midi, on frappa violemment à ma porte. Un sous-officier et deux soldats, armés jusqu’aux dents, me firent monter dans une automobile qui nous déposa devant le Quartier Général. Cinq minutes plus tard, j’étais introduit dans la grande salle des délibérations.
C’était dans cette même salle que j’avais été reçu, cinq ans auparavant, avec quel faste par le général gouverneur. À une époque toute récente, j’y avais conversé maintes fois avec le colonel Gregor. Si changée que je m’attendisse à la trouver, je n’en eus pas moins un léger mouvement de recul devant l’aspect que les vainqueurs avaient réussi, en quelques jours, à lui donner.
Au lieu des brillants aides de camp du général Ordonov, au lieu des corrects officiers tchécoslovaques, j’avais maintenant en face de moi une cinquantaine d’individus relevant des types les plus hétérogènes, revêtus des nippes les plus hétéroclites. Impossible, bien entendu, de distinguer les civils des militaires, ni les soldats de leurs chefs. Presque tous étaient en bras de chemise. Tout ce monde, à l’envi, pérorait, fumait, crachait. Les uns transportaient d’une table à l’autre des monceaux de paperasses qui s’écroulaient soudain. D’autres les ramassaient en vrac pour les réempiler au petit bonheur. Deux jeunes penseurs, pareils à des hérissons à lunettes, tapaient avec frénésie sur leurs machines à écrire. Un soldat surveillait l’eau qui bouillait dans un samovar. Un autre, nu jusqu’à la ceinture, lavait sa chemise dans une soupière. Une demi-douzaine de citoyens hirsutes cassaient la croûte sur un bureau Louis XV. Le fond de la salle était occupé par une vaste table, de l’autre côté de laquelle étaient rangés trois fauteuils vides, qui attendaient apparemment les membres du tribunal. On avait oublié à la muraille un immense portrait équestre de Nicolas II, dont le visage était lacéré de coups de baïonnette. L’auteur de cet exploit n’avait même pas pris la peine de retirer l’échelle qui lui avait permis de l’accomplir.
De la cage de l’escalier montait un tintamarre de marmites et de bouteilles, allié à un opiniâtre parfum de lessive et de rata.
J’étais là depuis un quart d’heure sans que personne m’eût prêté la moindre attention, lorsqu’un calme relatif s’établit. Les hérissons dactylographes mirent une sourdine à leurs mitrailleuses. Les sentinelles rectifièrent la position. Les soldats entre qui j’étais assis se levèrent, me faisant signe de les imiter.
Une porte venait de s’ouvrir, livrant passage à un groupe de six personnes, deux officiers et quatre civils. Les officiers gagnèrent chacun l’une des extrémités de la grande table et demeurèrent là, debout, au port d’arme, attitude qu’ils conservèrent durant toute la séance. Trois des civils s’installèrent dans les fauteuils. Le quatrième, une espèce de géant roux et frisé, qui roulait les épaules en marchant, fit le tour de la salle, avant de venir s’asseoir derrière celui de ses collègues qui occupait le fauteuil du milieu.
— Je désirerais obtenir un peu moins de bruit, dit ce dernier. Est-ce dans les choses possibles ?
Le géant roux, vers qui il s’était retourné, eut un geste d’indifférence.
— Vous n’avez qu’à faire évacuer la salle.
— Ce n’est pas réglementaire.
— Pas réglementaire ? En voilà des histoires !
Il s’était dressé.
— Holà ! fit-il d’une voix de tonnerre. J’aperçois ici un tas de propres à rien qui feraient mieux d’être à leur travail. Que je n’aie pas à le répéter deux fois !
Quelques murmures coururent.
— Hein ? Qu’est-ce que c’est ?
Il avait fait un pas en avant, et, ses deux énormes poings appuyés sur la table, il promenait sur l’assistance un œil menaçant.
— Je compte jusqu’à dix. Un… deux… trois…
Ce fut aussitôt une ruée vers les portes. La terrible voix n’avait pas annoncé huit qu’il ne restait plus que les juges, les officiers, les sentinelles, un petit bossu en veston d’alpaga, et moi, naturellement.
— Neuf… dix. Et voilà. Parfait ! Tiens, il y en a encore un ! Qu’est-ce que tu fais là, toi ? Veux-tu que je te flanque par la fenêtre ?
Le petit bossu ainsi interpellé se mit à trembler de tous ses membres.
— Camarade Tcheressensky, bredouilla-t-il, je suis le greffier.
— Ah ! tu es le greffier. Idiot ! Que ne le disais-tu ? Reste, alors. Eh bien, camarade Kraemer, êtes-vous satisfait ?
— Je vous remercie, dit l’homme qui présidait.
— Bon. Vous allez donc pouvoir commencer. Je n’ai pas l’intention de moisir ici. J’ai autre chose à faire, moi.
— Votre présence n’est en aucune façon indispensable, répondit sèchement le camarade Kraemer.
Ils échangèrent un regard dénué d’aménité. Je compris qu’il ne devait pas être commode d’être à la fois l’ami du camarade Tcheressensky, commissaire du peuple à l’armée de l’Oural, et celui du camarade Isaac Kraemer, délégué de la Commission extraordinaire.
Quels pouvaient être les motifs d’un désaccord qui ne craignait point de se manifester ainsi en public ? Quelque conflit d’attributions, sans doute. Chef responsable des troupes de l’Oural, Tcheressensky était tout-puissant à Novo-Petrovsk. Il ne devait pas y voir d’un très bon œil la présence d’Isaac Kraemer, délégué par la fameuse Commission extraordinaire à l’expédition de la justice, mais dont le rôle occulte s’étendait probablement beaucoup plus loin. On ne pouvait d’ailleurs imaginer deux personnages physiquement plus dissemblables. J’ai esquissé un rapide portrait du camarade Tcheressensky. Né dans les forêts de Courlande, ancien bûcheron, il s’était, paraît-il, conduit en héros en 1914, sous-officier à l’armée de Rennenkampf. Taillé en hercule, beau parleur, les journées d’octobre l’avaient mis en lumière. Isaac Kraemer, petit homme au type sémite plus que prononcé, en face de son formidable collègue faisait figure d’intellectuel. L’un et l’autre, ils représentaient à merveille la double physionomie de la Révolution russe. Je ne savais ce qu’il y avait de plus redoutable, de la musculature de Tcheressensky, ou du rachitisme de Kraemer.
— Faites approcher le prévenu, ordonna ce dernier, tandis que le greffier entamait la lecture d’un document interminable, l’acte d’accusation.
Tcheressensky ne cessait de donner des marques d’impatience.
— Eh bien, la cause est entendue, j’espère, fit-il, quand le bossu eut terminé.
Kraemer ne sourcilla pas.
— Reconnaissez-vous la matérialité des faits ? me demanda-t-il, s’appliquant à employer le jargon juridique.
Tcheressensky goguenarda.
— Ce serait la première fois qu’un accusé serait d’accord avec ses accusateurs, dit-il.
Il s’était levé, et allait et venait, comme un ours en cage.
— J’ai la responsabilité de l’instruction. Permettez-moi de la conduire à ma guise, dit Kraemer.
Il me répéta sa question.
— J’aurais un certain nombre d’observations à faire, répondis-je.
— Je vous écoute.
Je dus différer ma réponse. Tcheressensky, de nouveau, intervenait. Debout derrière le greffier, il appuyait au dossier de sa chaise ses puissantes mains couvertes de taches de son, ces mains que le souvenir de la répression de Kiew entourait d’une légende sanglante. Trente, quarante malheureux décapités ! Ce jour-là, l’ex-bûcheron avait repris la hache de sa jeunesse. C’était la méthode de Pierre le Grand. En Russie, les dirigeants, sous tous les régimes, n’ont jamais détesté mettre la main à la pâte.
— Quoi, gronda-t-il, que discuteriez-vous ? Que vous avez fabriqué des armes destinées à la contre-révolution ? Que vous avez servi les plans des Tchécoslovaques, des émigrés ?
Je le considérai sans mot dire. Il était véritablement effrayant. Sa veste, sa chemise ouvertes laissaient voir les poils touffus de sa poitrine qui luisaient au soleil comme une toison d’or. Il avait à son annulaire une émeraude d’une beauté parfaite. Au cours de quelle tragique nuit, au doigt de quelle victime égorgée cette pierre splendide avait-elle été ravie ?
— Répondez donc ! fit-il.
— À qui faut-il que je réponde ? demandai-je placidement.
— À moi, s’il vous plaît, dit Kraemer.
— Bien. Je dirai donc : premièrement, que si j’ai fabriqué des armes, comme c’est mon métier, je l’ai fait par ordre de mes chefs hiérarchiques. L’usage des nations civilisées s’oppose à ce que soit retenu contre un soldat le fait d’avoir obéi. Deuxièmement, que l’ordre en question me prescrivait de mettre ces armes à la disposition des troupes tchécoslovaques…
— Vous ne vous en êtes pas tenu là. Vous nous avez espionnés pour leur compte, dit Tcheressensky.
— C’est faux.
— Quoi, hurla-t-il, allez-vous nier qu’il y a exactement quinze jours, une automobile militaire est venue vous prendre pour vous conduire à Tcheliabinsk, d’où vous êtes revenu trois jours après ? Pourquoi revenir ici, où vous n’aviez plus rien à faire, si ce n’était pour la besogne que je viens de dire ?
Il se tourna vers Kraemer.
— Camarade, répliqua Kraemer, imperturbable, je vous ai déjà prié de ne pas vous substituer à moi, dans l’interrogatoire de l’accusé.
Tcheressensky devint pourpre.
— Camarade Kraemer, fit-il lentement, on saura à la Commission extraordinaire comment vous vous arrangez pour mettre des bâtons dans les roues de la justice du peuple.
— On saura bien autre chose, à la Commission extraordinaire, dit Kraemer. Accusé, continuez.
— Troisièmement, on me reproche d’avoir entretenu des rapports avec les émigrés. Le moyen de faire autrement. Suis-je le seul, même dans cette salle ?
J’avais parlé sans aucune arrière-pensée. J’augurais même assez mal de la faiblesse de ma réponse. Quelle ne fut pas ma stupéfaction devant l’effet qu’elle produisit. Un silence de mort régna. Tous les yeux se fixèrent à terre. Seul, Isaac Kraemer s’était redressé. Il observait curieusement Tcheressensky.
Celui-ci avait bondi vers moi. Mes deux gardes s’écartèrent avec épouvante.
— Chien ! Fils de chien ! Qu’a-t-il dit ?
Tout ce que je pouvais avoir de courage, j’étais en train de le rassembler pour ne pas défaillir devant ce colosse en fureur. Je le sentais sur le point de m’écraser, et ma pensée, pourtant, n’avait jamais été plus lucide ; et soudain la rage que je lisais dans ses yeux bleus désorbités me fut la plus nette des révélations. Les détails sur mes rapports avec les Tchécoslovaques, la date exacte de mon voyage à Tcheliabinsk, tout, je comprenais tout ; et la mise en liberté d’Ephrem Fedorovitch et de sa fille, et la terreur que ma réplique avait semée dans cette assistance, la cause de l’aversion de ce monstre pour moi, de la mienne pour lui, tout, tout enfin… Donc, « lui aussi ! » comme disait le commandant Zeyer. C’était donc sur ce hideux poitrail velu qu’elle reposait présentement, la divine tête d’Armide ! C’en était trop, je n’avais plus peur. Aux regards de haine folle que me jetait Tcheressensky, je ripostai par un regard où il y avait plus de haine encore.
Cependant, Isaac Kraemer avait fait un signe. Les deux officiers, sans enthousiasme, s’interposaient.
Tcheressensky s’était ressaisi.
— Je vous demande pardon, camarade Kraemer, dit-il avec un sourire mielleux, d’une voix qu’il s’efforçait de rendre impassible, je ne suis pas encore habitué à votre façon de rendre la justice. Sans rancune, n’est-ce pas ? Croyez bien que, tout de même, à Moscou, on saura…
— On saura ce qu’on saura, fit Kraemer. En attendant, l’affaire est mise en délibéré. Soldat, emmenez le prévenu.
Tcheressensky avait déjà quitté la salle, en refermant violemment la porte.
Je passai entre mes gardes devant Isaac Kraemer.
— Tenez-vous donc tant que cela à vous faire fusiller ? me dit-il.
XV
— Eh bien, comment vous en êtes-vous sorti ?
C’était mon compagnon d’infortune, l’indigène de Samara, qui saluait ainsi mon retour. Étendu de tout son long sur mon lit – sur notre lit, plutôt – il était absorbé dans une réussite.
— Vous le voyez, je ne suis pas encore mort.
— Je le savais, dit-il. Je viens de vous tirer les cartes. Je peux même vous annoncer qu’il y a dans votre jeu un homme brun, ou un homme de loi, qui vous veut du bien. À propos, avez-vous pu toucher à ces messieurs un mot de mon affaire ?
Je dus lui avouer qu’étant donné le tour qu’avait pris mon entrevue avec eux, une intervention en sa faveur ne m’eût point paru opportune.
— D’ailleurs, ajoutai-je, à quoi bon m’interroger ? Les cartes ont bien dû vous l’apprendre.
— Oh ! oh ! dit-il, c’est qu’on ne les force pas comme cela à parler. Les cartes sont le livre du diable. Prenons donc notre mal en patience. En attendant, voulez-vous faire une petite partie de piquet ?
J’eus un haut-le-corps.
— Ah ! non ! Merci.
— Pourquoi ? Rien de tel, cependant, pour…
— Pour charmer les longues soirées d’hiver. Oui, je sais. On me l’a déjà dit.
— Alors, vous m’accorderez bien le plaisir de boire avec moi quelque chose de frais ?
Il s’était baissé et avait ramené de dessous le lit un flacon de vodka.
— Où avez-vous déniché cette bouteille ?
— Ce sont mes camarades du Cercle qui se sont débrouillés pour me la faire passer, ainsi que les cartes. Vous savez, entre joueurs, on ne s’oublie pas.
— Celui qui vous a fait enfermer ne vous a pas oublié, en effet, dis-je.
J’acceptai quand même son offre. J’avais besoin de ne plus penser, de m’abrutir.
— Vous ne voulez pas dîner ? demanda-t-il un peu plus tard, après que le geôlier fut venu nous apporter notre frugale pitance.
— Je n’ai pas faim. Je vous cède ma part. Donnez-moi en échange un autre verre de votre tord-boyaux.
Ce marché n’eut pas l’air de lui déplaire. Il me fit d’ailleurs bonne mesure. Ayant bu un second, puis un troisième verre de vodka, je m’allongeai sur le lit, tourné vers la muraille, avec l’espoir de profiter du temps où je serais sous l’influence de l’alcool pour m’endormir.
— Qu’y a-t-il encore ?
J’ouvris les yeux. La chambre était pleine de ténèbres. Quelqu’un m’avait saisi par le bras et me secouait.
— Chut, murmura le gentilhomme de Samara, écoutez.
— Je n’entends rien.
— C’est que vous êtes mal réveillé… On parle, derrière la porte. À deux reprises, on a prononcé votre nom.
— Mon nom ?
— J’en suis sûr.
Au même instant, une clef tourna dans la serrure. Un pinceau de lumière s’abattit sur le parquet, puis s’en vint frapper la face pétrifiée de mon voisin.
— Imbécile, dit une voix brève. Tu t’es trompé. Ce n’est pas lui.
— Je ne me trompe pas, camarade délégué, murmura une voix tremblante, la voix de notre geôlier. Ils sont deux enfermés ici. Le vôtre doit dormir. Tenez, le voilà.
Ce fut mon tour de recevoir en pleine figure le pinceau lumineux.
— C’est bien lui, dit la première voix, que je venais de reconnaître pour celle d’Isaac Kraemer.
Je m’étais dressé sur mon séant.
— Ne vous dérangez pas, fit Kraemer.
Il se tourna vers le geôlier, et lui désignant le négociant de Samara.
— Enferme-moi cet homme dans un autre cachot. Tu ne reviendras que quand je t’appellerai. Eh ! n’emporte pas la lanterne.
Poussant devant lui le malheureux marchand, notre gardien s’en fut, et je restai seul avec Kraemer.
Le délégué de la Commission extraordinaire s’était mis en devoir de dévisser légèrement le sommet de la lanterne. Son éclair brutal fit place à une faible lueur qui se répandit avec lenteur à travers la pièce. Je m’étais assis au bord du lit. Kraemer avait pris place en face de moi, sur la chaise. Je n’apercevais que sa silhouette voûtée et obscure. Il s’était arrangé pour voir constamment mon visage, tandis qu’il m’était à peu près impossible de distinguer le sien.
— Vous m’avez reconnu ? demanda-t-il, après quelques instants de silence.
— Oui.
— J’avais donné des ordres pour que vous fussiez seul ici. Je constate qu’il n’en a pas été tenu compte. Qui est l’homme qui est enfermé avec vous ?
— Un marchand inoffensif, arrêté de la façon la plus arbitraire.
— J’ai entendu dire cela de tous les gens arrêtés.
— Jugez vous-même.
Et je lui expliquai en deux mots le cas du négociant de Samara.
Il m’écouta avec la plus grande attention.
— Il vaut mieux, dans votre intérêt, que vous n’ayez pas pris sa défense à l’audience de cet après-midi, fit-il, quand j’eus terminé. Vous y avez déjà commis assez d’imprudences. Demain, je convoquerai ce détenu. Si ce que vous venez de me rapporter est exact, il sera relâché.
Sa voix était plus douce.
— Est-ce tout ? Personnellement, n’avez-vous rien à me demander pour vous ?
— J’ai exposé mes desiderata dans une requête que je me suis permis de vous adresser hier.
— À moi ?
— À vous et au citoyen Tcheressensky. J’ignorais et j’ignore encore la façon dont sont délimitées vos attributions respectives. Je me figurais qu’en tout état de cause cette requête serait jointe à mon dossier.
— On ne me l’a pas communiquée.
— Cela vous étonnerait-il outre mesure ?
Il eut l’air de ne pas avoir entendu.
— Qu’y avait-il, dans votre requête ?
— J’y développais le système de défense qui, cet après-midi, a donné lieu aux incidents que vous savez.
— Finalement, que réclamez-vous ?
— Ma mise en liberté. Je crois y avoir droit.
— Votre mise en liberté ? dit Isaac Kraemer. J’imagine que, si vous l’obtenez, vous en profiterez pour quitter Novo-Petrovsk, et rentrer le plus tôt possible dans votre patrie.
Je ne répondis pas.
— Vous vous taisez ? reprit-il. C’est ennuyeux, très ennuyeux. Ne sentez-vous pas qu’en demeurant ici, ne fût-ce que quelques jours, vous donneriez un poids singulier aux accusations qui viennent d’être portées contre vous ?
— J’avais cru comprendre, fis-je, que vous voyiez assez clair dans le jeu de celui qui a formulé contre moi les accusations dont il s’agit.
— Il n’est pas question de lui, répliqua-t-il, mais de vous. Pour le reste, soyez sans crainte. La Révolution saura frapper, si haut placés qu’ils soient, ceux qui, par le scandale de leur exemple, risquent de la discréditer.
Il était difficile d’affirmer de façon plus nette que le camarade Tcheressensky n’en avait plus pour très longtemps à oublier ses devoirs entre des bras que je connaissais bien.
— Allons, me dis-je, encore un, décidément, à qui elle aura porté bonheur !
Il semblait que, sur sa chaise, le corps d’Isaac Kraemer se fût ratatiné davantage. On eût dit un ressort bandé, prêt à se détendre. Il n’en attendait que l’occasion, occasion que mon mutisme s’obstinait à ne pas lui fournir.
— Eh bien, fit-il, en désespoir de cause, avec une certaine irritation, vous n’êtes guère curieux de votre sort. Cette liberté que vous sollicitiez hier, y tiendriez-vous moins, aujourd’hui ?
Je continuais à me taire.
— À quoi songez-vous donc ?
— Vous désirez le savoir ? Je songe que vous ne vous seriez pas dérangé si une décision à mon égard n’était déjà prise. Et cette décision, quelle qu’elle soit, je songe aussi qu’un homme tel que je vous imagine, on ne la lui fera pas changer. Alors, à quoi bon me perdre en interrogations, en supplications inutiles ?
— C’est raisonner juste, dit-il. Écoutez-moi donc. Ma tâche ici va être terminée. Demain soir, je prends le train pour Moscou.
Et il ajouta, scandant chacun de ses mots :
— Je vous emmène avec moi.
— À Moscou ?
— Oui. Vous ne me demandez pas pourquoi ?
— Je me figure qu’il est dans votre intention de me l’apprendre.
Je sentis que, de plus en plus, il s’impatientait. Mon indifférence, réelle ou feinte, lui coupait ses effets.
— Je pourrais vous faire deux réponses, dit-il ; ou bien qu’une affaire comme la vôtre, qui dépasse votre personnalité pour se relier à des questions de politique générale, ne peut être jugée utilement qu’à Moscou, devant la Commission extraordinaire ; ou bien que je vous fais quitter cette ville parce que, moi parti, votre vie n’y resterait pas très longtemps sauve. De ces deux mobiles également plausibles, tâchez de trouver celui qui me guide.
— À Moscou ! répétai-je, ne pensant même pas à lui répondre, qu’y fera-t-on de moi ?
— Si mon avis prévaut, ainsi qu’il est vraisemblable, un arrêté d’expulsion sera pris contre vous. On vous conduira sous bonne garde à la frontière polonaise. De là, en quarante-huit heures, vous serez à Paris. Vous ne me remerciez pas ? Cette perspective n’aurait-elle point l’heur de vous plaire ?
Il eut un ricanement.
— Pour ne rien vous cacher, je l’avais deviné, dit-il.
— Qu’aviez-vous deviné ? demandai-je pensivement.
Je le vis s’agiter comme une araignée sombre. Il se leva, vint vers moi.
— C’est très simple, fit-il sur un ton que la colère commençait à faire trembler. J’ai deviné que, sorti de prison, vous vous entêteriez à demeurer ici. N’avez-vous pas honte ? Un homme comme vous ! Un abaissement pareil ! Passe encore pour la brute qui a failli vous étrangler cet après-midi ! Mais vous ! vous !
— Que signifient vos paroles ? balbutiai-je.
— Je vous les expliquerai bien volontiers, puisque vous faites semblant de ne pas comprendre.
Il y avait dans son attitude, le timbre de sa voix, une passion concentrée qui en eût imposé à l’adversaire le plus flegmatique. Moi, je lui prêtais à peine attention. Je ne songeais qu’à une chose : le lendemain, à moins d’un miracle, j’aurais, pour toujours, quitté Novo-Petrovsk.
— Votre nom est bien Charles Forestier ? demanda Kraemer.
— Oui, dis-je docilement, m’attendant à une seconde édition de mon interrogatoire.
— Si je vous pose cette question, reprit-il, c’est pour avoir lu, aux environs de 1912, dans une publication scientifique, la Revue de physique et de chimie, je crois, un article intitulé : Des divers modes d’élimination du soufre dans le grillage des pyrites. Si ma mémoire est bonne, cet article était signé Charles Forestier. Était-il de vous ?
— Votre mémoire est excellente, fis-je, passablement interloqué. L’article dont il s’agit est bien de moi. Mais comment diable avez-vous pu lire cela ?
À son tour, il ne répondit pas. Je le sentais jouir de ma surprise, qui était immense. Qu’un travail aussi ancien, d’un caractère purement technique, fût connu d’un petit juif bolchevik, il m’eût fallu une belle dose de vanité pour trouver la chose naturelle. En attendant, Isaac Kraemer avait réussi à intervertir les rôles. C’était moi, maintenant, qui le questionnais avec insistance.
— Vous avez eu un motif particulier de vous intéresser à ce problème ?
— Fe2 O3 + 4SO2, dit-il négligemment. Non, pas à celui-là plutôt qu’à un autre.
Je le regardai avec stupéfaction. C’était la formule qui servait de base à mon étude qu’il venait de citer.
— Vous êtes ingénieur, sans doute ?
— Ingénieur !…
Il répéta ce mot avec un petit rire, un petit rire plein d’amertume.
— En tout cas, c’est à Paris que vous avez étudié. Je ne vois pas dans quelle autre ville un article comme celui-là aurait pu vous tomber sous les yeux.
— Étudié ?… fit-il avec lenteur. À Paris ?… Oui, à Paris.
Et il se tut.
Quel silence impressionnant, interminable, un silence troublé seulement par le va-et-vient de la sentinelle sous le préau, l’aboiement d’un chien dans la nuit !… Lorsque la voix de mon interlocuteur s’éleva de nouveau, je ne pus qu’avec peine la reconnaître. Sa brièveté, sa sécheresse avaient disparu. Elle était devenue une espèce de mélodie sourde.
— Avant-hier, dit Kraemer, je me suis fait apporter de l’usine votre dossier. Il n’y avait que peu de renseignements. Assez cependant pour me permettre de voir que vous avez passé par l’École Polytechnique. À quelle époque étiez-vous à Polytechnique ?
— De 1901 à 1903, répondis-je, trop intrigué pour ne pas le suivre désormais sur tous les terrains où il aurait la fantaisie de m’entraîner.
— De 1901 à 1903, répéta-t-il, rêveusement. Eh bien, alors, au cours de ces années-là, peut-être vous est-il arrivé de croiser, rue Descartes, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, un petit garçon qui ne payait pas beaucoup de mine, je vous assure. Il se hâtait, honteusement, le long des vieilles murailles. Chaque fois qu’il rencontrait l’un d’entre vous, il s’arrêtait, il se retournait. Il contemplait ce bicorne, ce pantalon à bande rouge, cette capote noire galonnée d’or. Vous ou vos camarades, si vous aviez eu seulement l’idée de prêter attention à lui, que de choses vous auriez pu lire dans le regard de ce petit garçon-là !
— Vous habitiez dans ce quartier ?
— Rue Laplace, à deux pas, chez un vieux Juif qui me faisait gagner ma vie en me donnant à coudre des visières de casquettes. Le tambour, qui réglait vos heures de travail, réglait les miennes aussi. Seulement, n’est-ce pas, ce travail n’était pas le même. Ce que j’ai pu vous envier, durant les années que j’ai vécu là !
Baissant la voix, il murmura :
— Vous envier, et vous haïr !
Ses épaules étroites étaient toutes secouées de sombres frissons.
— Oui, vous haïr. Le contraste était trop violent ; l’injustice était trop criante. Je pleurais, je pleurais de rage, en enfonçant mon poinçon dans le cuir bouilli. Je ne cessais de me répéter : « Pourquoi eux, et pas moi ! Ils ne sont pas les plus intelligents. Aucun d’entre eux n’apporte au travail plus d’ardeur que j’y apporterais. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? » Oui, pourquoi ? Aujourd’hui que je vous ai pardonné – je suis bien en train de le prouver, n’est-ce pas – je continue à me poser cette question. Mais je m’arrête, j’en aurais trop à dire. Comprenez-vous du moins, à présent, la chance que vous avez eue, le bonheur qui a été le vôtre ? Comprenez-vous aussi ma stupeur, mon écœurement, quand je vous vois renier, oublier ce que vous êtes, ce que vous représentez, faire bon marché d’un trésor que j’eusse, moi, payé de la moitié de mon sang ? À l’aberration d’un Tcheressensky, on peut à la rigueur trouver des excuses. Mais à la vôtre !…
Et avec un accent de reproche indicible, il répéta :
— N’avez-vous pas honte ?
Je ne dormis pas le reste de la nuit. Petit à petit, je vis le jour naître et grandir dans ma chambre. À combien de lieues serais-je, le lendemain, quand ce même soleil se lèverait ?
Lorsque le geôlier m’apporta mon repas, il m’apprit que le négociant de Samara avait été remis en liberté. Isaac Kraemer tenait ses promesses. Tout était fini.
— N’y a-t-il pas d’ordres, à mon sujet ?
— On doit venir vous chercher à la fin de l’après-midi.
Il était effectivement près de six heures quand j’entendis de nouveau ma porte s’ouvrir. Deux gardes rouges parurent sur le seuil, deux géants de Lettonie, aux crânes ovales. Ils me firent signe de les suivre.
Isaac Kraemer nous attendait dans une limousine grise, devant la porte de l’École.
— Asseyez-vous à côté de moi, dit-il.
Les gardes rouges s’installèrent sur les strapontins, en face de nous. Pas un de mes mouvements ne leur échappait. Ils avaient leur revolver à la ceinture. On ne devait pas avoir à leur donner deux fois l’ordre de s’en servir.
C’était une soirée de printemps, une soirée d’une douceur étrange, toute remplie d’hirondelles. Les gens prenaient le frais devant leurs maisons. Nous croisions des patrouilles que des enfants escortaient, avec des cris et des gambades : les mêmes enfants, les mêmes cris qu’un an auparavant, pour les patrouilles tchécoslovaques !
L’automobile descendait à vive allure la rue principale de Novo-Petrovsk, au bout de laquelle il y a la gare. À un croisement, notre chauffeur dut s’arrêter. Une compagnie d’infanterie achevait de défiler.
Presque en même temps, d’une rue latérale, surgissait une autre limousine, conduite également par un soldat, mais plus confortable que la nôtre ; elle vint se ranger près de nous, attendant elle aussi la fin du défilé. Une seule personne l’occupait… Une femme, Armide.
Vingt secondes, trente tout au plus, les deux voitures demeurèrent ainsi, l’une contre l’autre, à se toucher. Je ne dis pas un mot, je ne fis pas un geste pour attirer l’attention d’Armide. Je la regardais, simplement. Je la regardais… C’était tout.
Au fond de la limousine de Tcheressensky, son bras droit passé dans une des embrasses de cuir, elle aussi, elle était immobile. Elle avait sa robe à losanges verts et roses, et un petit chapeau en plumes de martin-pêcheur, que je lui avais vu bien souvent. Avec ses sourcils légèrement froncés, qui accentuaient la dureté de son visage, on ne pouvait pas dire qu’elle eût l’air bien gai, la pauvre enfant !
Juste au moment où, reprenant leurs routes – ces routes qui allaient nous séparer pour toujours, – les automobiles s’ébranlèrent, elle tourna légèrement la tête. Elle m’aperçut.
Je ne sais pas ce que je fis, à ce moment-là. Je crois que, malgré tout, je lui souris. Elle aussi, elle me sourit, un sourire auquel j’ai trouvé depuis, chaque fois que je l’ai évoqué, un sens nouveau, de nouvelles nuances, – un pauvre sourire, en tout cas, empreint de Dieu sait quelle lassitude !
Et puis, sans cesser de sourire, de me regarder, elle eut, plus poignant que tout, son léger haussement d’épaules. « Tu le vois, signifiait ce geste, bien plus distinctement que des paroles, tu le vois, je t’avais prévenu : On ne fait pas ce que l’on veut, dans la vie. »
Et puis… et puis, ce fut tout. Ni Kraemer, ni les soldats ne s’étaient aperçus de rien.
À la gare, je fus conduit dans un réduit solidement cadenassé.
— Nous partons dans trois quarts d’heure, dit Kraemer. Je reviendrai vous chercher ici. J’ai des papiers à signer. Si vous avez besoin de quelque chose, vous n’avez qu’à…
Brusquement, il s’interrompit. Il y avait des larmes dans mes yeux. Il dut les remarquer. Les siens brillèrent d’un éclat sombre. Ses mâchoires se contractèrent.
— Ne le perdez pas de vue un seul instant, dit-il aux soldats. Et, s’il bouge, ligotez-le.
L’ombre tombait lorsque le train, s’étirant avec lenteur, sortit de la gare. J’étais entre mes deux gardiens, prostré sur la banquette. Isaac Kraemer avait pris place dans le compartiment voisin du nôtre, avec son secrétaire, qui l’avait rejoint.
Quand je sentis que la locomotive commençait à prendre de la vitesse, je n’y pus tenir. Je me levai. Deux mains s’agrippèrent à mes bras, me contraignant à me rasseoir.
— Laissez-moi, dis-je, aux soldats, je vous en supplie. Tenez-moi, si vous voulez, mais que je puisse regarder !
Ma voix était si pitoyable que les colosses en furent émus. Ils me permirent de m’approcher de la portière. Je collai mon front à la vitre, et je restai là, debout, longtemps, à voir s’éteindre, une à une, dans l’obscurité, les tristes lumières de Novo-Petrovsk.
XVI
Parvenu au terme de son récit, Forestier était tombé dans une sorte de torpeur morne. Une heure, peut-être, s’écoula pendant laquelle Schmidt, retenant son souffle, demeura immobile dans son fauteuil, où l’approche de l’aube le faisait grelotter. Puis, il entendit la respiration de son ami qui devenait plus régulière. Forestier avait fini par s’endormir.
Schmidt alors se leva. Sur la pointe des pieds, il gagna le couloir en tâtonnant. Il rentra dans sa chambre. Il lui semblait qu’il l’avait quittée depuis des siècles.
Ayant fait jouer l’électricité, il se regarda dans un miroir. Il tressaillit : il était blême. On ne passe pas impunément une nuit entière avec des fantômes.
Il consulta sa montre. Quatre heures ! Il pensa un instant se coucher. Puis il abandonna cette idée, ayant la certitude qu’il lui serait impossible de fermer l’œil.
Il ouvrit la fenêtre, s’y accouda et se mit à fumer des cigarettes.
— Je vais être gentil, aujourd’hui, à l’Arsenal, ne cessait-il de se répéter. Quelle histoire, tout de même ! C’est cet idiot de père Mauconseil qui est responsable. Qu’est-ce qu’il lui a pris de se coller comme cela à nous ? Sans lui, Forestier n’aurait jamais mis les pieds dans ce bastringue, et tout ce qui s’en est suivi n’aurait pas eu lieu.
Cependant, le jour naissait. Les murailles de la vieille ville commençaient à se découper sur le ciel orange. La rue, peu à peu, s’animait. Animation muette, défilé silencieux de cette inquiétante foule chinoise qui circule et se hâte sans desserrer les dents. Une caravane de chameaux à fourrure passa, puis ce fut le tour d’un troupeau de soldats mal réveillés qui se rendaient à l’exercice. Le vent agitait les mousses poussiéreuses germées dans les interstices d’un bizarre monument thibétain, sur le parvis duquel s’épouillaient des lépreux et des aveugles. Schmidt considérait sans bienveillance tout cet authentique exotisme. Dans les débuts, il avait pu l’intéresser ; maintenant, il ne lui inspirait plus qu’indifférence et que dégoût.
— Mes collègues de France sont moins bêtes que moi, grogna-t-il. On m’y reprendra, à venir m’enterrer parmi ces magots.
Et il se mit à compter sur ses doigts tous les jours qui le séparaient encore de celui où il tirerait à Tchang-Tso-Lin sa révérence.
Lorsqu’il se fut rasé, qu’il eut pris son bain, il se sentit d’humeur moins maussade. À huit heures, il était habillé, prêt à partir pour l’Arsenal.
— On ne dira pas que je ne donne pas le bon exemple, se dit-il. C’est égal, je ne suis pas mécontent à l’idée de la trompette que va faire ce matin le vieux Mauconseil. Cette aventure a cela de bon, c’est que, d’un mois, il n’osera plus m’assommer avec des détails de service. Mais, j’y pense, il ne faut pas que je sorte avant d’avoir vu comment va l’autre.
Et il pénétra avec précaution dans la chambre de Forestier.
— Qu’y a-t-il ? murmura la voix plaintive de celui-ci.
— Rien, rien. Te sens-tu mieux ?
— Oui. Quelle heure est-il ? Huit heures… Je vais me lever.
— Écoute, dit Schmidt, tu vas avoir l’obligeance de m’obéir. Tu resteras ici aujourd’hui, à te reposer. Daï a des ordres. Tu sonneras quand tu auras besoin de lui.
— Mais l’Arsenal ? J’ai rendez-vous à onze heures, au laboratoire d’essais, avec le directeur.
— Encore une fois, laisse-moi tranquille. J’irai à ta place, au laboratoire. Et s’il a le malheur de dire quelque chose, le directeur, je t’assure qu’il trouvera quelqu’un pour lui répondre. Au revoir, et tâche de dormir.
— Je te remercie, dit humblement Forestier.
Schmidt était déjà dans l’escalier lorsqu’il se ravisa. Revenant sur ses pas, il décrocha le téléphone.
— Allô, allô. C’est vous, Matsui ? Ici, Schmidt.
— J’avais reconnu votre voix, cher ami.
— Dites-moi, Matsui, j’ai absolument besoin de vous parler le plus tôt possible.
— Venez quand vous voudrez. J’ai du travail. Je ne sors pas de chez moi.
— Vers midi, cela vous va-t-il ?
— À midi, entendu. Vous déjeunerez avec moi ?
— Non, j’ai moi-même beaucoup à faire.
— All right. À midi, alors.
L’arrivée de Schmidt à l’Arsenal provoqua un étonnement respectueux parmi le petit personnel. On n’était pas habitué à le voir de si bon matin.
— Eh bien, monsieur Siu, rien de cassé, j’espère ? demanda-t-il au secrétaire privé de M. Mauconseil.
M. Siu répondit cérémonieusement que tout allait bien.
— Le directeur n’est pas encore là ?
— M. le directeur général a téléphoné qu’il ne viendrait pas aujourd’hui, dit le Chinois en présentant une lettre à Schmidt.
— Je m’en doutais, murmura celui-ci, tout en parcourant le billet par lequel M. Mauconseil le prévenait en termes assez embarrassés qu’une forte migraine l’obligeait à rester chez lui. Décidément, il n’y a que moi à être dehors, ce matin. Pauvre vieux, voilà ce que c’est que de vouloir faire le petit fou. Il ne porte pas très bien la toile, le cher et digne homme. Encore un qui aurait besoin des leçons de cet excellent général Irénéïef !
Il rit, et, tout de suite, il eut honte de sa gaieté.
— C’est une chance que Matsui ne soit pas absent de Moukden, conclut-il.
À l’heure convenue, il était chez le Japonais.
Ayant pris ses dispositions pour ne pas sortir de la journée, le major Matsui n’avait aucune raison de revêtir la livrée européenne. Il reçut Schmidt en kimono.
— Mon cher, nos amis ont été un peu inquiets, hier, quand vous vous êtes décommandé. Ce n’est pas dans vos habitudes. Étiez-vous souffrant ? Non, tant mieux. Sachez, en tout cas, que vous nous avez beaucoup manqué.
Il observait son visiteur avec une négligence feinte. On ne pouvait cacher grand-chose au major Matsui. D’ailleurs, Schmidt n’était pas venu dans ce but.
— Quelle agréable soirée nous avons passée avant-hier, continua Matsui, agréable et pleine d’imprévu ! Jamais votre directeur général ne m’avait paru aussi en train. Et M. Forestier, quel charmant homme ! Il m’a gagné un pari. Figurez-vous qu’en nous quittant je me suis aperçu que nous n’avions oublié qu’une chose : fixer l’enjeu.
— Je vais sans doute vous fournir une occasion de vous libérer envers lui, dit Schmidt.
Et il lui fit un résumé rapide de la situation.
Le front incliné, le menton engoncé dans l’échancrure de la robe, les mains croisées dans les embouchures des manches flottantes, le Japonais écoutait, imperturbable. Il eût fallu une aventure beaucoup plus extraordinaire pour que le major Matsui manifestât une surprise quelconque.
— Que pensez-vous de tout cela ? demanda Schmidt en terminant.
— Que voulez-vous que j’en pense ? Que les Français sont tous les mêmes. Et celui-là, pourtant, on lui aurait donné, comme vous dites, le bon Dieu sans confession.
Il tendit à Schmidt un coffret de cigarettes.
— Je suis heureux, par exemple, de ne pas m’être trompé. J’ai eu tout de suite, rappelez-vous, l’impression qu’elle n’était pas la première venue, cette petite Milena. À présent, puis-je savoir ce que vous attendez de moi ? Je ne pense pas que vous vous soyez dérangé à seule fin de me conter une anecdote amoureuse. Non, ne prenez pas de ces cigarettes à bout doré. Les autres, à bout de liège, sont préférables.
— Je suis venu tout simplement, répondit Schmidt, vous dire que je ne serai tranquille au sujet de Forestier que lorsque j’aurai la certitude qu’il ne peut plus rencontrer cet affreux couple.
— Je partage assez ce point de vue. Alors ?
— Alors, j’ai pensé qu’il ne devait pas vous être très difficile de réexpédier à Kharbine, discrètement, des gens qui en viennent.
— Ce n’est que cela ? fit Matsui.
— Comment, ce n’est que cela ? Qu’est-ce que vous vous figuriez donc que j’allais vous demander ?
— Je ne sais pas, moi. Une mesure plus radicale. Mais si Kharbine vous suffit, va pour Kharbine. Voyons. Procédons avec méthode. Nous sommes aujourd’hui le lundi 29. Je vous préviens qu’il n’y a pas de train avant le vendredi 2 avril, onze heures du soir.
— C’est tout ce qu’il faut.
— Bon. Entendu. Ravi de pouvoir vous être agréable. Une autre cigarette ?
Il tira une bouffée de la sienne, et suivant d’un regard vague la fumée qui était en train de se dissoudre :
— Kharbine, murmura-t-il, évidemment, c’est comme ceci !
Schmidt avait mis dans ses projets de revenir déjeuner chez lui. Mais il y avait dans la perspective d’un nouveau tête-à-tête avec Forestier quelque chose qui, pour le moment, lui parut au-dessus de ses forces.
Il se rendit donc au Cercle, où il se fit servir un repas sommaire, qu’il expédia sans aucun appétit.
De retour à l’Arsenal, il trouva sur son bureau un télégramme arrivé pendant son absence. Cette dépêche était adressée à M. Mauconseil. M. Siu, conscient de ses prérogatives, l’avait ouverte. Schmidt le sonna.
— Vous avez vu cela ? Notre agent de Dalny nous prie de lui téléphoner. Demandez-le-moi d’urgence. Qu’est-ce qu’il peut bien y avoir encore ?
— J’ai déjà téléphoné, dit M. Siu.
— Ah ! très bien. De quoi s’agit-il ?
— Le Taki-Maru est arrivé cette nuit à Dalny.
Le Taki-Maru était un cargo faisant la navette entre la Mandchourie et le Japon, pour le compte de l’Arsenal de Moukden, qu’il approvisionnait de matériel en provenance des usines de Kobé et d’Osaka.
— Qu’est-ce qu’il lui prend, au Taki-Maru ? fit Schmidt. Nous ne l’attendions pas avant le début d’avril.
— Il a essuyé une tempête en Mer Jaune.
— Ah ! Et c’est parce qu’il a essuyé une tempête en Mer Jaune qu’il arrive au moins de quatre jours en avance ? Monsieur Siu, vous me feriez plaisir en éclairant un peu votre lanterne.
— Le mauvais temps l’a contraint à ne pas relâcher à Tsing-Tao, où il devait s’arrêter deux jours. C’est pour cela qu’il est en avance, expliqua placidement M. Siu.
— Alors, je comprends. C’est tout ce qu’il avait à dire, notre agent de Dalny ?
— Non, monsieur le directeur. Il tenait surtout à nous prévenir que plusieurs caisses de la cargaison qui nous était destinée lui ont paru avariées par la mer. Il s’est refusé en conséquence à en prendre livraison.
— Il a bien fait. Prenez le téléphone, et demandez-moi M. le directeur général.
— J’ai déjà téléphoné à M. le directeur général.
— Qu’a-t-il dit ?
— M. le directeur général a exprimé le désir que MM. Schmidt et Forestier s’entendent, afin qu’un de ces Messieurs parte le plus tôt possible pour Dalny, où il assistera à l’ouverture des caisses suspectes.
— Charmant ! maugréa Schmidt, lâchant un juron qui, on verra plus loin pourquoi, était d’ailleurs de pure forme. C’est encore moi qui vais écoper. Allons, il est admis une fois pour toutes que le fait d’être marié dispense de toutes les corvées. Inclinons-nous. Monsieur Siu, vous allez me rendre deux services. D’abord, vous téléphonerez à la gare, et vous me retiendrez un sleeping pour ce soir, express de Dalny, dix-neuf heures quarante. Ensuite, vous avertirez M. le directeur général que j’aurai l’honneur de passer chez lui à la fin de l’après-midi, pour recevoir ses instructions et prendre de ses nouvelles. Sur ce, j’aime autant vous dire que je vous laisse la responsabilité de toute la boutique, et que je vais me promener.
La mauvaise humeur qu’il simulait disparut dès qu’il eut franchi la porte de l’Arsenal. La vérité était qu’un voyage à Dalny n’était pas pour lui déplaire. Un de ses amis, vice-consul des États-Unis à Moukden, venait de recevoir de l’avancement et d’être nommé dans ce port. Or, le diplomate en question était pourvu d’une femme délicieuse, et la malignité publique accusait cette aimable blonde d’avoir consenti, au profit de Schmidt, des dérogations répétées à la doctrine de Monroë.
C’était le jour des coups de téléphone. Du Cercle, où il fit halte en quittant l’Arsenal, Schmidt demanda la communication avec Dalny. Quand il sortit de la cabine, il emportait l’agréable assurance qu’il n’aurait pas à s’égarer dans un lit d’hôtel.
Il ne s’éternisa pas chez son directeur général, – tout juste le temps de constater que M. Mauconseil avait perdu beaucoup de sa superbe.
— Une petite indisposition de rien du tout, mon cher ami. Cela ne vaut même plus la peine d’en parler. Mais qu’est-ce que vient de m’apprendre M. Siu ? Ce brave Forestier, lui aussi, s’est trouvé fatigué ? Dites-lui surtout qu’il prenne tout le temps qu’il lui faudra pour se rétablir. Je serai demain matin à l’Arsenal. Je vous remplacerai tous les deux.
— Il y sera certainement aussi, Monsieur le directeur général. À l’heure actuelle, il doit être sur pied.
Schmidt trouva effectivement Forestier levé. Assis à son bureau, il travaillait. Les deux hommes échangèrent un regard plein de gêne.
— Comment es-tu ?
— Bien, vraiment.
— Je pars tout à l’heure, dit Schmidt avec une fausse désinvolture. Oui, figure-toi, une histoire ridicule. Je suis obligé d’aller à Dalny, réceptionner du matériel. Je serai de retour dans deux ou trois jours. D’ici là, ne te fatigue pas. Je viens de voir le directeur général, il me charge de te faire la même recommandation.
— Vous êtes bien bons tous les deux, dit Forestier. Mais soyez tranquilles. Je me sens de force à revenir dès demain à l’Arsenal.
À sept heures, le boy vint avertir Schmidt que l’automobile qui devait le conduire à la gare l’attendait.
— Allons, au revoir.
— Au revoir.
Schmidt passa à Dalny quelques journées enchanteresses. Ces sortes de joie sont généralement gâtées par la perspective de la séparation. Pas une minute cette pensée ne vint assombrir sa gaîté à lui, non plus que celle de sa sympathique hôtesse. S’il lui arriva une ou deux fois, bien par hasard, de songer aux lugubres confidences de Forestier, ce ne fut que pour en tirer la seule conclusion qui, à son avis, s’imposait. « Y a-t-il tout de même, se disait-il, en secouant un gobelet à cocktails, des gens qui ont le génie de se compliquer l’existence, de tout prendre au tragique. » Il avait d’ailleurs le droit de raisonner ainsi. Sa conscience était nette. Cinq minutes avant son départ pour Dalny, n’avait-il pas téléphoné à Matsui afin de lui rappeler sa promesse, précaution bien superflue pour qui connaissait la ponctualité du Japonais. Non, sous ce rapport, il pouvait être pleinement en repos. Le 2 avril, quand il se décida à quitter sa lady, une dépêche qu’on lui remit sur le quai de la gare acheva de le tranquilliser. Elle contenait ces simples mots : « Colis partiront ce soir comme convenu. Stop. Tout va bien. Stop. Pensées choisies. Stop. Matsui. »
Le train qui le ramenait eut du retard et n’arriva que le lendemain matin vers dix heures. Schmidt se souvint qu’on était un samedi, jour où l’Arsenal fermait à midi. Il décida donc de s’y rendre directement. D’ailleurs, il avait bien dormi. Il n’éprouvait aucune fatigue ; à peine le remords d’avoir un peu trop tiré sur la corde.
— Comment, vous voilà, cher ami ? Déjà ! fit le directeur général avec un bon sourire.
Déjà ! C’est presque toujours par cette irritante formule que sont accueillis les gens qui redoutent d’avoir indûment prolongé leur absence. Ah ! si Schmidt avait su !… Il ne pouvait pourtant pas repartir.
— J’aurais pu rentrer un jour plus tôt, fit-il hypocritement. Mais j’ai tenu à ce que là-bas tout fût en ordre. Les dégâts ne sont pas aussi graves que notre agent se l’était imaginé. À part un lot de bielles et de clapets de réglage que j’ai dû refuser, j’ai accepté le stock.
— À merveille ! Et quand tout cela va-t-il nous arriver ?
— Mardi ou mercredi matin, j’espère. Mon ami le consul des États-Unis, qui est l’obligeance même, a consenti à surveiller les détails du chargement sur les fourgons. Peut-être serait-il correct de l’en remercier dans une lettre officielle ?
— Rien de plus juste, dit M. Mauconseil. Je prends note. Tous mes compliments, cher ami. Vous pouvez aller goûter un repos bien gagné. Ah ! nous avons séance de la commission des comptes lundi à quatre heures. N’oubliez pas, en rentrant chez vous, d’en aviser Forestier.
Schmidt, qui allait sortir, s’arrêta sur le seuil de la porte.
— Forestier ? Il n’est pas à l’Arsenal ?
— Non ! Il est toujours un peu fatigué.
— Comment, il n’a pas repris son service, depuis mon départ ?
— Mais si, mais si. Il a été là tous les jours, le brave garçon, et je vous assure qu’il en a abattu, de la besogne. C’est seulement hier après-midi que le voyant un peu las, un peu pâle, je l’ai invité paternellement à aller prendre l’air. J’ai eu toutes les peines du monde à l’y décider.
— Et, à partir de ce moment, vous ne l’avez plus revu ?
— Non. Ce matin, je pensais qu’il me téléphonerait. Je n’ai pas voulu l’attaquer, par discrétion. Je vais tout de même le demander… Mais qu’avez-vous ?
Schmidt venait de se dresser tout d’une pièce. La catastrophe était là. Il la sentait.
— Donnez-moi le téléphone, fit-il, arrachant l’appareil au directeur général.
— Monsieur Schmidt, fit M. Mauconseil avec dignité, il est des moments, en vérité, où vos façons… Mon Dieu, mais qu’avez-vous ?
— Laissez-moi, dit Schmidt, le bousculant. Allô, la Banque industrielle ! Allô. Tonnerre, on ne répond pas ! Allô ! allô ! Ah ! le voilà. C’est toi, Forestier ? Non, ce n’est pas lui. C’est toi, Daï ? M. Forestier… Comment, qu’est-ce que tu dis ? Tu n’es pas fou ? Pas couché ici, cette nuit ?… Parti, hier soir, avec deux valises ?… Parti ? Parti ! Ah, voilà ce que j’aurais dû prévoir !… Idiot, idiot, idiot que je suis !… Malheur ! malheur !
Se couvrant les yeux de ses mains, il s’effondra dans un fauteuil.
L’inquiétude de M. Mauconseil était devenue de l’ahurissement, puis de l’épouvante.
— Parti ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Je vous en prie, mon cher Schmidt, expliquez-vous, expliquez-moi. Parti, eh bien ! qu’y a-t-il de mal à cela ? Il a voulu profiter de la semaine anglaise. Il sera allé faire une petite excursion aux environs. Il y a de si jolis endroits. Mais parlez, rassurez-moi. Il sera là lundi matin. Il va revenir, Schmidt, je vous jure qu’il va revenir.
— Non, dit Schmidt d’une voix lente, secouant la tête, non, vous m’entendez. Il est parti, et il ne reviendra jamais… jamais.
— Pourquoi ne reviendra-t-il pas ?
— Parce qu’il est parti avec elle… avec elle, si vous voulez savoir…
Par phrases hachées, il lui dit tout, tout ce qui pouvait aider l’autre à comprendre.
M. Mauconseil se taisait. Ses joues livides étaient marbrées de plaques violettes. Et soudain il leva les bras au ciel et se répandit en un brusque flot de lamentations.
— Mais c’est horrible ! Mais c’est monstrueux ! Mais c’est abject ! M’avoir fait ça, à moi ! Un scandale pareil ! Comment arriver à empêcher, à étouffer… Ah ! qu’on ne vienne pas me dire que je n’avais pas tout prévu, que je ne m’étais pas méfié… Ah ! les notes confidentielles, dans les dossiers, elles servent tout de même à quelque chose. Schmidt, c’est votre faute. Je vous avais assez prévenu, n’est-ce pas ? Vous n’aviez qu’à être sur vos gardes. C’est votre faute.
— Hein ? fit Schmidt.
Il s’était levé.
— Ma faute ?
Saisissant le Directeur général par les revers de sa jaquette, il était en train de le secouer comme un prunier.
— Ma faute, dites-vous ? Eh bien, moi, je vais vous dire autre chose, espèce de vieux ramolli. C’est votre faute, à vous. Qui est-ce qui l’a contraint l’autre nuit à nous accompagner, alors qu’il crevait d’envie d’aller se coucher ? Qui est-ce qui l’a traîné de force dans ce bouge ? Qui est-ce qui l’a obligé à boire ? Ah ! ça vous va bien, je vous le jure, ça vous réussit de vouloir faire le joli cœur. Pour une fois que vous risquez votre nez dehors, vous nous avez mis dans de beaux draps. Le malheureux ! Le malheureux !
— Schmidt, cria M. Mauconseil, où allez-vous ?
— Je ne sais pas, fit Schmidt, avec un geste égaré. Fichez-moi la paix. Je ne sais pas.
En chancelant, il gagnait la porte.
— Schmidt, mon enfant, du calme. Tout n’est peut-être pas perdu.
— Fichez-moi la paix, vous dis-je. Tout est perdu. Tout est perdu.
Il était déjà dans l’escalier, dont il descendait pesamment les marches, tandis qu’au-dessus de lui M. Mauconseil, affalé sur la rampe, s’obstinait à le rappeler, répétant sans fin en larmoyant la même prière, comme s’il n’y avait pas eu de péril plus pressant :
— Schmidt, mon petit Schmidt, je vous en supplie, n’est-ce pas ? Quoi qu’il arrive, pas un mot à Mme Mauconseil.
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
https://groups.google.com/g/ebooksgratuits
Adresse du site web du groupe :
https://www.ebooksgratuits.com/
—
Avril 2025
—
— Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : BrussLimat, YvetteT, PatriceC, ChristineN, Coolmicro.
— Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
— Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l’original. Nous rappelons que c’est un travail d’amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.