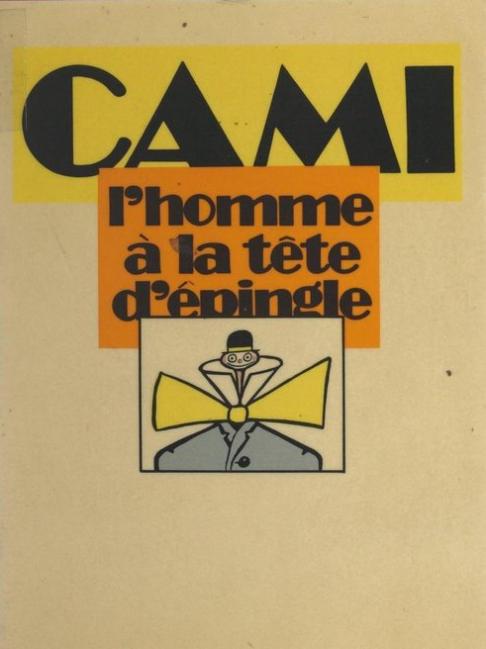
Pierre-Henri Cami
L’HOMME À LA TÊTE D’ÉPINGLE
(1914)
LES DRAMES DE LA VIE COURANTE
UN MARI TIMIDE
ou
LE DISCOURS IMPRÉVU
PREMIER TABLEAU
Entre amants.
La scène représente une garçonnière.
M. EDMOND, seul. — Depuis vingt ans je suis l’amant de la femme de mon meilleur ami. Marié moi-même, j’ai loué cette garçonnière, où vient me rejoindre à jour fixe l’épouse coupable. Mais la voici.
L’ÉPOUSE COUPABLE, entrant. — Bonne nouvelle. Mon mari est mort.
M. EDMOND. — Le pauvre homme ne nous gênait pas. Sa confiance en nous était sans bornes. Jamais il ne se douta de rien.
L’ÉPOUSE COUPABLE. — Jamais. Timide et sans volonté, mon mari n’aurait pas osé me soupçonner. En ta qualité de vieil ami, il te faudra, cher amant, prononcer quelques paroles émues le jour de son enterrement.
M. EDMOND. — Oui. Quelques paroles émues le jour de son enterrement.
DEUXIÈME TABLEAU
La vengeance d’un timide.
La scène représente un cimetière.
M. EDMOND, achevant son discours devant la tombe. — Adieu ! cher ami. Dors en paix ! La mort implacable te fauche à l’âge de cinquante-neuf ans : le ciel compte un ange de plus ! Adieu !
CHŒUR DES ASSISTANTS. — M. Edmond a bien parlé. Mais que veut dire ceci ? On place devant la tombe un écran de cinéma et un phonographe.
LE NOTAIRE DU DÉFUNT. — Ce sont les dernières volontés du défunt que je fais exécuter. Que personne ne parte. Le défunt va prononcer un discours.
CHŒUR DES ASSISTANTS. — Un discours ?
LE NOTAIRE DU DÉFUNT. — Oui. Quelque temps avant sa mort, mon client eut l’idée de prononcer le discours que vous allez entendre, devant un appareil phono-cinématographique. Il me chargea ensuite de faire exécuter la projection de ce film parlant le jour de son enterrement. (Il fait un signe à l’opérateur du cinéma. L’image animée du défunt apparaît sur l’écran, tel qu’il était de son vivant. Il est en redingote noire, gants blancs et chapeau haut de forme à la main.)
LE DÉFUNT CINÉMATOGRAPHIÉ, gesticulant sur l’écran. Voix du phonographe. — Mesdames, messieurs. Vous êtes sans doute surpris de voir un défunt prendre la parole le jour de son enterrement. Ce n’est pas l’usage. Je le sais. Mais j’ai profité des progrès de la science pour venir prononcer un petit discours sur ma tombe et vous révéler le secret de ma vie. Je fus, durant toute mon existence, d’une extraordinaire timidité. Je n’ai jamais osé élever la voix devant ma femme. J’avais peur des scènes. La misérable en profita pour me tromper avec mon meilleur ami, avec M. Edmond, ici présent. Ma folle timidité m’empêcha de dire à ma femme et à son amant ce que je pensais de leur conduite. Je dissimulai ma douleur pendant vingt ans. Mais lorsque je sentis ma fin prochaine, l’idée vengeresse du discours posthume germa soudain dans mon cerveau. Grâce à l’appareil phono-cinématographique, je pus facilement mettre mon idée à exécution. Ah ! j’avais été timide toute ma vie ! Eh bien, on verrait après ma mort si je ne dirais pas son fait à M. Edmond ! Ah ! de mon vivant je n’avais jamais osé élever la voix ! Ça va changer, à présent ! Aujourd’hui, que je suis décédé, je n’ai plus aucune raison d’être timide, je ne crains plus les scènes, et rien ne peut m’empêcher de crier : « Monsieur Edmond, vous avez agi avec moi comme un saligaud !!! »
M. EDMOND, interloqué. — Mais… mais…
LE DÉFUNT CINÉMATOGRAPHIÉ. — Comment ! Vous n’avez pas eu honte, monsieur Edmond, de prononcer un discours sur ma tombe, vous qui, depuis plus de vingt ans, me faites cocu ! Ah ! monsieur Edmond, vous vous imaginiez que j’ignorais votre lâche trahison ? Non. Je me rappelle les moindres détails. Exemple : ma femme tomba amoureuse de vous le premier jour où je vous ai amené dîner à la maison. Après le dîner, rappelez-vous, monsieur Edmond, vous avez chanté une chansonnette grivoise dont le refrain était celui-ci. (Le phonographe chante :)
Elle a un grain d’beauté, Clara.
Mais où ça ? Mais où ça ?
Au même endroit que Margoton.
Mais où donc ? Mais où donc ?
À la mêm’ plac’ que ma Zouzou.
Oui, mais où ?
M. EDMOND. — C’est scandaleux ! Arrêtez la projection ! Arrêtez le phonographe ! Si le défunt ne se respecte pas, qu’il respecte au moins l’endroit où nous sommes.
LE DÉFUNT CINÉMATOGRAPHIÉ. — Et maintenant, je vais vous quitter pour toujours, cher monsieur Edmond. Mais, avant de partir, je tiens à vous dire ceci : Votre femme, votre propre femme, cher don Juan, vous trompe depuis de longues années avec un sacristain ; votre fille aînée fait les délices d’un chasseur d’Afrique et votre cadette n’a plus rien à refuser au répugnant vieillard du cinquième. Quant à votre bonne…
(M. Edmond s’élance, défonce l’écran et s’écroule, anéanti.)
RIDEAU
UN CHASSEUR OBSTINÉ
PREMIER TABLEAU
Meeting de locataires.
La scène représente une loge de concierge.
PREMIER LOCATAIRE TRANQUILLE ET MÉCONTENT. — Messieurs, nous sommes tous réunis dans cette loge pour protester contre les chasses à courre en appartement données par le locataire du quatrième étage de l’immeuble que nous habitons.
DEUXIÈME LOCATAIRE TRANQUILLE ET MÉCONTENT. — C’est un vacarme infernal toute la journée : galopades échevelées, meubles renversés, sonneries de cor de chasse.
TROISIÈME LOCATAIRE TRANQUILLE ET MÉCONTENT. — Ce chasseur du quatrième étage n’est qu’un sinistre plaisantin.
LE CONCIERGE DE L’IMMEUBLE. — Non. Ce n’est pas un plaisantin. C’est un aristocrate ruiné. Jadis, il possédait de nombreuses terres sur lesquelles il chassait avec passion. Depuis ses revers de fortune, il vit dans cet appartement du quatrième étage, en compagnie d’un vieux serviteur dévoué, qui lui sert de gibier volontaire.
LES LOCATAIRES TRANQUILLES ET MÉCONTENTS, en chœur. — De gibier volontaire ?
LE CONCIERGE DE L’IMMEUBLE. — Oui. Cet obstiné chasseur n’a pu se résigner à se priver de son passe-temps favori. Son vieux serviteur pousse le dévouement jusqu’à se laisser poursuivre à travers l’appartement comme un véritable cerf.
QUATRIÈME LOCATAIRE TRANQUILLE ET MÉCONTENT. — Ce locataire du quatrième étage ne doit pas jouir de la plénitude de ses facultés mentales.
LE CONCIERGE DE L’IMMEUBLE. — Non. Je sais de source certaine que cet aristocrate ruiné fut subitement frappé de folie en apprenant la mort de Louis XVI, qu’on lui avait toujours soigneusement cachée.
CINQUIÈME LOCATAIRE TRANQUILLE ET MÉCONTENT. — Tout cela est fort touchant, mais nous ne pouvons supporter plus longtemps pareil charivari dans la maison. Tenez, l’entendez-vous ? Son maudit cor de chasse fait trembler les vitres de l’immeuble.
SIXIÈME LOCATAIRE TRANQUILLE ET MÉCONTENT. — Ces aristocrates se croient tout permis ! Moi, messieurs, qui ne suis qu’un modeste cloueur de choucroutes…
LES LOCATAIRES TRANQUILLES ET MÉCONTENTS, en chœur. — Cloueur de choucroutes ?
SIXIÈME LOCATAIRE TRANQUILLE ET MÉCONTENT. — Oui. C’est mon métier. Je plante des clous de girofle dans les choucroutes pour le compte d’une grande fabrique. Moi, dis-je, qui ne suis qu’un prolétaire, un simple ouvrier, pour ne pas troubler la tranquillité de mes voisins, je plante mes clous de girofle avec un marteau en feutre mou.
LES LOCATAIRES TRANQUILLES ET MÉCONTENTS, en chœur. — Brave et discret travailleur !
SEPTIÈME LOCATAIRE TRANQUILLE ET MÉCONTENT. — L’heure est venue de prendre des décisions énergiques pour faire cesser les chasses à courre du quatrième étage.
UN LOCATAIRE ASTUCIEUX. — Messieurs, j’ai trouvé le moyen de nous débarrasser de ce chasseur obstiné. J’ai réussi à gagner sa confiance. Je suis invité à sa chasse de demain. Je compte lui jouer un tour de ma façon qui le guérira pour toujours de chasser en appartement et de sonner du cor. Patientez jusqu’à demain.
DEUXIÈME TABLEAU
La chasse à courre.
La scène représente l’appartement du chasseur obstiné.
LE SERVITEUR DÉVOUÉ, introduisant le Locataire astucieux. — Entrez, monsieur. Mon maître vous attend pour le lancer du cerf.
LE LOCATAIRE ASTUCIEUX. — Le lancer du cerf ?
LE SERVITEUR DÉVOUÉ. — Oui. Comme chaque matin, je vais m’attacher le portemanteau en cornes de cerf. (Avec un sourire mélancolique.) Je l’attache sur ma tête et cela donne à mon pauvre maître l’illusion de ses chasses d’antan. Mais le voici qui vient.
LE CHASSEUR OBSTINÉ. — Vous voilà exact au rendez-vous de chasse. Je vais sonner le lancer du cerf. (Il sonne de toutes ses forces dans son cor. Le Serviteur dévoué attache le portemanteau sur sa tête et s’élance en bondissant, à travers l’appartement). Et maintenant, il s’agit de forcer l’animal. En chasse ! En chasse ! Taïaut ! Taïaut ! (Il s’élance avec le Locataire astucieux sur les traces du serviteur à bois de cerf.)
LE LOCATAIRE ASTUCIEUX. — Voilà déjà deux heures que nous galopons à la poursuite de votre cerf domestique. Je suis à bout de souffle.
LE CHASSEUR OBSTINÉ. — Patience ! Nous le rattrapons ! Tenez, regardez ! L’animal passe l’eau.
LE LOCATAIRE ASTUCIEUX. — Passe l’eau ?
LE CHASSEUR OBSTINÉ. — Oui. Il vient de franchir le bol rempli d’eau qui simule la rivière. Nous le rattrapons. Il est traqué. Taïaut ! Taïaut !
LE LOCATAIRE ASTUCIEUX. — Il s’accule contre la table de nuit.
LE CHASSEUR OBSTINÉ. — Il est aux abois.
LE SERVITEUR DÉVOUÉ. — Ah ! mon Dieu ! Voici le moment de l’hallali et j’ai oublié de prendre mon roman-feuilleton. Je cours le chercher. Je reviens.
LE LOCATAIRE ASTUCIEUX. — Son roman-feuilleton ?
LE CHASSEUR OBSTINÉ. — Oui. Dès qu’il est traqué, mon serviteur dévoué lit rapidement un passage de roman-feuilleton qui le fait toujours pleurer à chaudes larmes. De cette façon l’illusion est parfaite. Il me semble voir couler les larmes d’un cerf aux abois.
LE SERVITEUR DÉVOUÉ, accourant. — Me voici, messieurs, me voici ! (Il se remet à sa place, lit son passage de roman-feuilleton et éclate en sanglots.)
LE CHASSEUR OBSTINÉ. — Je sonne l’hallali. (Il souffle dans son cor de chasse.)
LE LOCATAIRE ASTUCIEUX, ironique. — Vous pouvez sonner à votre aise. Afin de vous donner une leçon et pour que vous cessiez vos ridicules chasses à courre, j’ai profité d’un moment d’inattention de votre part pour enduire l’embouchure de votre cor de chasse d’une colle qui colle même le fer. Vous avez beau tirer et faire des efforts désespérés pour enlever votre instrument de vos lèvres, ça tient, ça tient bien. Adieu ! (Il sort.)
TROISIÈME TABLEAU
Délivré.
Même décor.
LE SERVITEUR DÉVOUÉ. — Depuis de longues heures je m’épuise en vains efforts pour arracher le cor de chasse des lèvres de mon maître. J’entends derrière la porte les éclats de rire ironiques des locataires de l’immeuble.
LES LOCATAIRES, derrière la porte. — Nous savourons notre vengeance. Tu t’épuises en efforts superflus, serviteur dévoué. Tu ne réussiras pas à délivrer ton maître.
LE SERVITEUR DÉVOUÉ. — Je ne réussirai pas ? C’est ce que nous allons voir. Patience, mon maître, je reviens. J’ai une idée ! (Il s’élance hors de l’appartement.)
LES LOCATAIRES. — Le Serviteur dévoué descend quatre à quatre l’escalier. Où court-il ? Est-il las de sa lutte contre le cor de chasse ? Abandonnerait-il son maître ?
LE SERVITEUR DÉVOUÉ, revenant. — Non, je n’abandonne pas mon maître, messieurs. Je vais le délivrer grâce à cette boîte que je viens d’acheter. (Il ouvre la boîte et, avec son contenu, frotte le cor de chasse.)
LES LOCATAIRES. — Que diable met-il sur le cor de chasse ?
LE SERVITEUR DÉVOUÉ. — Du coricide.
LES LOCATAIRES. — Du coricide ?
LE SERVITEUR DÉVOUÉ. — Oui. Du coricide, qui fait tomber les cors instantanément. (Il enlève le cor des lèvres de son maître.)
RIDEAU
LA DOT DE L’ORPHELINE
PREMIER ACTE
Cœur de chiffonnier.
La scène représente une cabane de chiffonniers.
LE VIEUX CHIFFONNIER, à son fils. — La pauvre fille que nous avons trouvée évanouie dans la neige et que nous venons de transporter dans notre modeste cabane revient de son évanouissement.
L’ORPHELINE. — Où suis-je ? Ah ! je devine, braves gens ! Vous m’avez ramassée dans la petite rue déserte où le Vicomte-décavé me chloroforma !
LE FILS DU CHIFFONNIER. — Vous chloroforma ?
L’ORPHELINE. — Oui. Le misérable s’est emparé du sachet que je portais attaché autour du cou, et qui renferme l’huître que me légua mon père avant de mourir.
LES DEUX CHIFFONNIERS, ensemble. — L’huître ?
L’ORPHELINE. — Oui. Une huître perlière. C’est toute une histoire. Écoutez : Il y a de cela bien longtemps, un ancêtre de mon père s’apprêtait à gober une huître, quand il aperçut, à l’intérieur des coquilles, une perle magnifique. Déjà sa main fébrile allait saisir la précieuse perle, lorsque l’huître se referma brusquement. Tous ses efforts pour rouvrir cette huître furent inutiles. Il ne fallait pas songer à la briser, car la perle eût été pulvérisée par le choc. L’ancêtre de mon père vécut toute sa misérable existence à côté de cette huître, qui renfermait une fortune, mais qu’il ne pouvait ouvrir. Le pauvre diable mourut indigent et légua, par testament, son huître perlière au grand-père de mon père, qui, lui non plus, ne parvint pas à l’ouvrir, et la laissa, après sa mort, à son fils, c’est-à-dire au père de mon père. Celui-ci ne fut guère plus heureux que les autres. Il mourut dans la misère et mon père devint l’héritier de l’huître fatale. C’est alors que le Vicomte-décavé, ayant appris l’histoire de l’huître perlière, me demanda en mariage, dans l’espoir d’arriver à bout de l’huître maudite. Je refusai ma main à ce noble cupide. Le Vicomte-décavé s’en alla furieux, en jurant qu’il aurait l’huître par tous les moyens. Mon pauvre père mourut quelque temps après. Avant de mourir, il me remit l’huître perlière : « Voici ta dot, ma chère enfant, me dit-il ; à présent, je peux mourir tranquille. » Après avoir enterré mon pauvre père et cousu l’huître dans un sachet que j’attachai autour de mon cou, je partis de la mansarde paternelle. Sans un sou, j’errais par la ville, lorsque, cette nuit, le Vicomte-décavé, qui me guettait dans l’ombre, me chloroforma dans la petite rue déserte et me déroba l’huître perlière. Grâce à vous, braves chiffonniers, je ne suis pas morte de froid sous la neige. Merci, oh ! merci ! (Elle éclate en sanglots.)
LE FILS DU CHIFFONNIER. — Ne pleurez pas, mademoiselle. S’il fut un cœur d’aristocrate assez lâche pour dépouiller l’orpheline sans défense, il y aura, je vous le jure, un cœur de chiffonnier assez noble pour rapporter l’huître volée à l’orpheline !
DEUXIÈME ACTE
Face à face.
La scène représente un souterrain.
LE VICOMTE-DÉCAVÉ. — Voilà déjà trois ans que j’ai dérobé l’huître de l’orpheline. Je n’ai pu encore réussir à ouvrir cette huître fatale. Toutes les nuits, je descends dans ce souterrain et, loin des regards indiscrets, je fais de terribles efforts pour disjoindre les valves de ce mollusque lamellibranche. Mais, ne perdons pas de temps ; recommençons notre pénible travail.
LE FILS DU CHIFFONNIER, surgissant. — À nous deux, monsieur le vicomte ! Enfin ! après trois ans de patientes recherches, j’ai découvert votre mystérieuse retraite ! À nous deux !
LE VICOMTE-DÉCAVÉ, hautain. — Sais-tu bien à qui tu parles, maroufle ?
LE FILS DU CHIFFONNIER. — Ah ! pas d’insultes, monsieur le vicomte ! À cette heure, les distances sociales sont abolies et, dans ce souterrain, il n’y a plus que deux hommes face à face : un honnête chiffonnier et un misérable ! Et, sachez-le bien, monsieur le vicomte, l’honnête chiffonnier ne troquerait pas sa hotte contre votre blason déshonoré ! Allons, trêve de paroles inutiles ; rendez-moi l’huître de l’orpheline !
LE VICOMTE-DÉCAVÉ, payant d’audace. — Cette huître m’appartient !
LE FILS DU CHIFFONNIER. — Vous en avez menti, monsieur le vicomte ! Ce précieux mollusque renferme la dot de l’orpheline. D’ailleurs, cette photographie achèvera de vous confondre. (Il lui montre une photographie.)
LE VICOMTE-DÉCAVÉ. — Malheur ! La photographie de l’huître ! Je suis perdu !
LE FILS DU CHIFFONNIER. — Oui, la photographie de l’huître, que l’orpheline m’a confiée pour guider mes recherches.
LE VICOMTE-DÉCAVÉ. — Allons, la partie est perdue. Suicidons-nous ! (Il se suicide.)
LE FILS DU CHIFFONNIER, emportant l’huître. — Et, maintenant, courons rapporter sa dot à l’orpheline !
TROISIÈME ACTE
Le bonheur retrouvé.
La scène représente la cabane des chiffonniers.
LE FILS DU CHIFFONNIER. — Pauvre chère orpheline ! Le jour où je vous ai rapporté l’huître perlière, vous m’avez promis de devenir ma femme lorsque j’aurai réussi à ouvrir ses maudites coquilles.
L’ORPHELINE. — Oui. Ce jour-là, nous serons heureux ! Mais voilà déjà six mois que l’huître est ici et vous n’avez pas encore réussi. C’est à désespérer !
LE FILS DU CHIFFONNIER. — Hélas ! mon pauvre père est mort à la suite du terrible effort qu’il fit pour essayer d’ouvrir l’huître homicide ! Quant à moi, je cherche vainement un moyen ; je ne trouve pas. Depuis dix jours, je ne dors pas, pour trouver une idée. J’y renonce. Je n’en peux plus ! (Regardant l’huître, posée sur la table.) Ah ! huître maudite ! Tu portes malheur à tous ceux qui t’approchent !
L’ORPHELINE. — Oh ! miracle ! Regardez : l’huître s’ouvre toute grande ! La précieuse perle apparaît entre les deux valves ! Nous sommes riches ! Mais comment ce miracle s’est-il accompli ?
LE FILS DU CHIFFONNIER. — Ce n’est pas un miracle. Je comprends tout. Terrassé par l’insomnie, je viens, sauf votre respect, de bâiller à plusieurs reprises. Le bâillement, sauf votre respect, est contagieux. L’huître n’a pu résister et ses valves se sont ouvertes en un bâillement providentiel.
RIDEAU
L’APRÈS-MIDI D’UN SAXOPHONE
PREMIER ACTE
La matinée.
La scène représente la chambre du Saxophone.
LE CONFIDENT DU SAXOPHONE. — J’envie ton sort, cher Saxophone : ton physique avantageux et ton talent de musicien te rendent irrésistible auprès des belles.
L’IRRÉSISTIBLE SAXOPHONE. — C’est pourtant par hasard que je devins musicien. Mes parents me destinaient au commerce. Ils me donnèrent un professeur de comptabilité. Mais celui-ci, étant sourd, ne comprit pas, et me donna des leçons de saxophone. Lorsqu’on s’aperçut de son erreur, il était trop tard. J’étais un musicien accompli.
LE CONFIDENT. — Étranges surprises de la destinée.
L’IRRÉSISTIBLE SAXOPHONE. — Fou de désespoir, mon père se teignit les cheveux en vert et mourut quelque temps après, tué par le ridicule.
LE CONFIDENT. — Pauvre père !
L’IRRÉSISTIBLE SAXOPHONE. — La secousse fut tellement terrible pour ma pauvre mère qu’elle changea de sexe en vingt-quatre heures et s’engagea dans la légion étrangère.
LE CONFIDENT. — Pauvre mère !
L’IRRÉSISTIBLE SAXOPHONE. — Mais je m’attarde à remuer ces souvenirs de famille. Pensons plutôt au rendez-vous d’amour que m’a fixé la femme de mon tailleur. C’est une créature romanesque et passionnée. Elle me donne ses rendez-vous d’amour à la campagne pour évoquer l’époque des nymphes et des faunes.
LE CONFIDENT. — Le mari ne se doute de rien ?
L’IRRÉSISTIBLE SAXOPHONE. — Non. Pourtant, depuis quelques jours, son regard me paraît plus oblique que d’habitude. Il doit venir ce matin me livrer un nouveau complet jaquette. On sonne. C’est lui. (Il va ouvrir.)
LE TAILLEUR AU REGARD OBLIQUE. — Voici votre complet jaquette que je vous apporte.
L’IRRÉSISTIBLE SAXOPHONE. — Merci. Je l’étrennerai cet après-midi.
LE TAILLEUR AU REGARD OBLIQUE, à part. — Raille, maudit Saxophone ! Ma vengeance est prête. En te livrant ce costume, c’est la mort elle-même que je t’apporte sous la forme d’un complet jaquette. (Il sort.)
DEUXIÈME ACTE
L’après-midi.
La scène représente un bois ensoleillé.
LA FEMME DU TAILLEUR. — J’attends mon amant dans ce bois ensoleillé. Il me semble être une nymphe guettant l’arrivée d’un saxophone.
L’IRRÉSISTIBLE SAXOPHONE. — Me voici.
LA FEMME DU TAILLEUR. — Ne perdons pas de temps. À nous les étreintes primitives en des gestes harmonieux qui ne déplacent pas les lignes !
L’IRRÉSISTIBLE SAXOPHONE. — N’étreignez pas mon complet jaquette : il est neuf.
LA FEMME DU TAILLEUR. — Je sais. Mon mari l’a confectionné lui-même très soigneusement. Mais le feu de mon désir appelle l’enlacement immédiat. (Elle enlace son amant. Aussitôt, une explosion formidable retentit. L’irrésistible Saxophone éclate comme un bouquet de feu d’artifice.)
LE TAILLEUR AU REGARD OBLIQUE, surgissant du fourré. — Ma vengeance est éclatante !
LA FEMME DU TAILLEUR, d’une voix faible. — Ah ! misérable ! Mon amant vient de faire explosion, me blessant mortellement de ses éclats. Je devine là-dessous quelque ténébreuse machination de votre part.
LE TAILLEUR AU REGARD OBLIQUE. — Oui. J’avais tout calculé : c’est le feu de vos désirs qui a provoqué l’explosion fatale. Vous aviez le feu au corps, et le complet que j’ai confectionné à votre amant était en fulmicoton, autrement dit en coton-poudre. Comprenez-vous maintenant pourquoi votre Saxophone a éclaté ?
RIDEAU
LA FILLE DU PAUVRE ACROBATE
ou
UNE CURE ÉCONOMIQUE
PREMIER ACTE
La consultation.
La scène représente le cabinet de consultation du bon Docteur.
LE BON DOCTEUR. — C’est aujourd’hui le jour de ma consultation gratuite. (Au Domestique bienveillant.) Faites entrer les pauvres gens.
LE DOMESTIQUE BIENVEILLANT. — Entrez, pauvres misérables !
L’ACROBATE INDIGENT, entrant. — Bon Docteur, je suis acrobate de mon métier. Ma fille que voici, et pour laquelle je viens vous consulter, exerçait la profession de « dompteuse en escalier ».
LE BON DOCTEUR. — Dompteuse en escalier ?
L’ACROBATE INDIGENT. — Oui ! J’avais acheté, en solde, un vieux lion, aveugle et timide, mais je n’avais pas assez d’argent pour acheter une cage. C’est alors que j’eus l’idée de donner des représentations de maison en maison.
LE BON DOCTEUR. — De maison en maison ?
L’ACROBATE INDIGENT. — Oui ! Nous demandions au concierge la permission de donner une séance de domptage dans la cage de l’escalier. Tous les locataires, penchés sur la rampe, assistaient à la représentation et nous lançaient des gros sous. Ah ! c’était le bon temps !
LE BON DOCTEUR. — Du courage ! Continuez.
L’ACROBATE INDIGENT. — Hélas ! un jour – distraction fatale ! – ma fille fit entrer le lion dans une cage d’ascenseur. L’appareil descendait. Ma fille put se sauver, mais notre pauvre lion fut littéralement aplati et transformé en descente de lit.
LE BON DOCTEUR. — Tout cela est bien malheureux, mais je ne vois pas jusqu’ici…
L’ACROBATE INDIGENT. — Vous allez voir. Depuis la fin tragique de son lion, ma pauvre fille est devenue neurasthénique. Elle s’est mise à lire et à relire l’unique volume qui compose notre modeste bibliothèque. À force de lire toujours ce même livre, la pauvre enfant est devenue poitrinaire.
LE BON DOCTEUR. — Poitrinaire ? Parce qu’elle lisait toujours ce même livre ? Quel était donc ce roman ?
L’ACROBATE INDIGENT. — La Dame aux camélias. Alors, par contagion, vous comprenez…
LE BON DOCTEUR. — Je comprends. Je vais ausculter la jeune « dompteuse en escalier ». (Il l’ausculte.) Vous aviez raison, votre fille est en excellente voie de tuberculose.
L’ACROBATE INDIGENT. — Que faire pour la sauver ?
LE BON DOCTEUR. — Il n’y a qu’un moyen. Partez pour la Côte d’Azur.
L’ACROBATE INDIGENT. — Hélas ! Je n’ai pas d’argent. Je suis un pauvre acrobate, qui gagne misérablement sa vie sur les places publiques. Ah ! ma pauvre enfant est perdue, bien perdue ! (Il sort avec sa fille.)
DEUXIÈME ACTE
Pour sauver sa fille.
La scène représente une place publique.
L’ACROBATE INDIGENT. — Mon tapis est posé sur cette place publique. Ma barre fixe est dressée. L’heure est venue de prendre mon tambour et d’attirer les badauds par de joyeux roulements. Faute d’argent, je n’ai plus de maquillage pour rougir mon nez de Paillasse. Mais j’ai une idée. Femme, fais-moi passer une pince à linge. (Il se pince le nez avec la pince à linge.) Là, maintenant, mon nez oui rouge à souhait. (Des larmes de douleur jaillissent de ses yeux.) Surmontons notre douleur pour amuser la populace. Ris donc. Paillasse !
LA FEMME DE L’ACROBATE INDIGENT. — La pluie commence à tomber. Personne ne s’arrête pour assister à ton travail sur barre fixe.
L’ACROBATE INDIGENT. — Notre pauvre enfant tousse lamentablement. Dire qu’il lui faudrait le grand air et le soleil ! Oh ! quelle idée !
LA FEMME DE L’ACROBATE INDIGENT. — Parle !
L’ACROBATE INDIGENT. — Je vais sauver notre fille. (À sa fille.) Viens, chère enfant. Prends ton ombrelle et assieds-toi sur ce pliant devant la barre fixe.
LA FILLE DE L’ACROBATE INDIGENT. — Oui, père ! (Elle prend son ombrelle et s’assied sur le pliant.)
L’ACROBATE INDIGENT. — Bien. Le docteur a dit qu’il fallait du soleil ; alors, je grimpe sur ma barre fixe et j’exécute…
LA FEMME DE L’ACROBATE INDIGENT. — Quoi ?
L’ACROBATE INDIGENT. — Le grand soleil ! (Il tourne rapidement sur la barre fixe.)
LA FEMME DE L’ACROBATE INDIGENT, enthousiasmée. — Le grand soleil ! Mon enfant, ouvre ton ombrelle !
TROISIÈME ACTE
La folie d’un père.
La scène représente une place publique.
LA FEMME DE L’ACROBATE INDIGENT. — Voilà déjà trois mois que mon mari fait le « grand soleil », deux heures pur jour, pour guérir notre fille.
LA FILLE DE L’ACROBATE INDIGENT. — Je suis presque guérie ; je ne tousse déjà plus.
L’ACROBATE INDIGENT. — La cure a déjà produit de merveilleux résultats. Mais voici l’heure de ton bain de soleil. Je monte sur ma barre fixe.
LA FILLE DE L’ACROBATE INDIGENT. — Je m’installe comme d’habitude sur mon pliant avec mon ombrelle ouverte.
L’ACROBATE INDIGENT. — Ne t’approche pas trop. Tu sais bien que, l’autre jour, j’ai failli te blesser en tournant.
LA FEMME DE L’ACROBATE INDIGENT. — Ton père a raison. Tu pourrais attraper un « coup de soleil ».
(L’Acrobate indigent exécute le « grand soleil ».)
LA FEMME DE L’ACROBATE INDIGENT. — Voilà plus de trois heures que mon mari tourne vertigineusement sur sa barre fixe. Nous l’appelons en vain. Il ne s’arrête pas… Les badauds accourent de toutes parts.
LA FILLE DE L’ACROBATE INDIGENT, à la foule. — Mon père a perdu la raison ! Arrêtez-le ! Mais qui donc l’arrêtera ?
L’AGENT JOSUÉ, fendant la foule. — Moi !
(L’agent Josué arrête le soleil.)
RIDEAU
CONSCIENCE D’AIGUILLEUR
Drame du devoir accompli.
PREMIER TABLEAU
Noble labeur !
La scène représente une voie ferrée.
PREMIER ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — Ainsi que nous le faisons chaque jour depuis sept ans, nous venons nous asseoir sur le talus de la voie ferrée pour admirer le travail de l’Aiguilleur chauve.
DEUXIÈME ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — Son travail a augmenté d’intérêt depuis que la Compagnie des chemins de fer l’a obligé, par mesure d’économie, à se peindre le crâne en rouge pour remplacer le disque avertisseur.
TROISIÈME ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — Si la voie n’est pas libre, il lui suffit de baisser la tête pour que les mécaniciens aperçoivent son crâne-disque, éclairé la nuit par une petite veilleuse. Mais le voici. Il sort de sa maison, située en face de la voie ferrée, et se dirige vers son aiguille.
L’AIGUILLEUR-DISQUE, arrivant. — Me voici à mon poste. Il est sept heures et demie du matin. Le rapide intérimaire va passer. La main posée sur mon aiguille, le regard interrogeant l’horizon, j’attends. Conscience, devoir, abnégation, telle est la devise de l’aiguilleur.
PREMIER ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — J’aperçois arrivant au grand trot, sur la voie ferrée, la carriole qui précède de quelques minutes le rapide intérimaire pour vérifier si les passages à niveau ont leurs barrières fermées.
DEUXIÈME ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — Cette sage précaution évite bien des accidents.
TROISIÈME ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — La carriole s’avance entre les rails. Elle passe devant nous. Le conducteur agite sa cloche d’alarme pour annoncer l’arrivée du rapide intérimaire.
PREMIER ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — Et voici le rapide lui-même. Comme chaque jour, il s’arrête à deux cents mètres de l’aiguilleur.
DEUXIÈME ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — Oui, à cause du mécanicien. Son extrême myopie l’oblige à descendre de locomotive pour venir tâter le crâne-disque de l’Aiguilleur, afin de reconnaître si la voie est libre.
TROISIÈME ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — Voilà qui est fait. Le mécanicien remonte sur sa machine. Le rapide intérimaire passe. Il est passé.
L’AIGUILLEUR-DISQUE. — Il est huit heures. Le prochain train ne passera qu’à quinze heures trente-sept. Mais une minute d’inattention peut provoquer d’irréparables catastrophes. Conscient de ma responsabilité, je pose de nouveau la main sur mon aiguille et, le regard scrutant l’horizon, j’attends le passage du train de quinze heures trente-sept. Conscience, devoir, abnégation, telle est la devise de l’aiguilleur. Attendons.
DEUXIÈME TABLEAU
Supplice d’aiguilleur !
Même décor.
PREMIER ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — Nous n’admirerons jamais assez ce consciencieux Aiguilleur qui, la main sur son aiguille, attend dès huit heures du matin le passage du train de quinze heures trente-sept.
UNE VOIX TERRIFIÉE, hurlant. — Au secours ! À l’assassin !
DEUXIÈME ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — Ciel ! ce cri part de la maison de l’Aiguilleur, située en face de la voie ferrée.
LA VOIX TERRIFIÉE. — Au secours, Bernard !
TROISIÈME ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — Plus de doute ! La voix appelle Bernard, et Bernard, c’est le prénom de l’Aiguilleur.
PREMIER ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — C’est sûrement sa femme que l’on assassine !
DEUXIÈME ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — Observons la conduite de ce modeste Aiguilleur. Abandonnera-t-il son poste pour voler au secours de sa femme ?
TROISIÈME ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — Non ! Admirez son héroïsme. Il ne déserte pas son poste. Sa main ne lâche pas l’aiguille. Ses yeux restent fixés vers l’horizon.
LA VOIX TERRIFIÉE. — À l’assassin ! Bernard, tu as le temps de voler à mon secours. D’après l’horaire officiel, le prochain train ne passe qu’à quinze heures trente-sept.
Il n’est que huit heures et demie. Tu as donc exactement sept heures sept minutes avant le passage du train. Tu peux sans crainte abandonner ton poste et me secourir.
PREMIER ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR, inquiet. — L’Aiguilleur va-t-il faiblir ? Une bataille terrible doit se livrer dans son âme.
DEUXIÈME ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — Il se raidit dans sa douleur. Sa figure reste impassible. Il ne quitte pas l’aiguille.
TROISIÈME ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — Esclave du devoir, il reste sourd à la voix qui l’implore. Quel horrible supplice que le sien. Mais, chut ! la voix se fait entendre de nouveau.
LA VOIX TERRIFIÉE. — Au secours, Bernard ! Je te répète que tu as plus de temps qu’il n’en faut pour me secourir. Je viens de reconsulter l’indicateur et… (La Voix terrifiée s’arrête brusquement.)
PREMIER ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — Ce silence soudain ne me fait présager rien de bon.
DEUXIÈME ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — La pauvre femme doit avoir succombé sous les coups de ses assassins.
TROISIÈME ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — L’Aiguilleur n’a pas bougé. Sa main ne tremble même pas sur l’aiguille prête à la manœuvre. Son œil interroge l’horizon.
PREMIER ADMIRATEUR DE L’AIGUILLEUR. — Je n’y peux plus tenir. Il faut que je crie toute mon admiration à ce héros de l’aiguille.
DEUXIÈME ET TROISIÈME ADMIRATEURS DE L’AIGUILLEUR. — Oui. Félicitons tous ensemble cet homme, grand parmi les grands.
LES TROIS ADMIRATEURS DE L’AIGUILLEUR, ensemble. — Nous nous inclinons, chapeau bas, devant toi, sublime Aiguilleur, qui viens de laisser assassiner ta femme sans rien dire, pour ne pas abandonner ton poste.
L’AIGUILLEUR-DISQUE. — Ce n’est pas ma femme. Il y aura trois ans, viennent les prunes, qu’elle s’est enfuie avec un serre-frein.
LES TROIS ADMIRATEURS DE L’AIGUILLEUR. — Mais alors, quelle est cette femme que l’on vient d’assassiner dans ta maison, héroïque Aiguilleur ?
L’AIGUILLEUR-DISQUE. — Ma belle-mère. Conscience, devoir, abnégation, telle est la devise de l’aiguilleur.
RIDEAU
LA BELLE FROMAGÈRE
PREMIER ACTE
Le fromager-parfumeur.
La scène représente la fromagerie.
LE FROMAGER-PARFUMEUR. — Depuis que j’ai trouvé le moyen de parfumer mes fromages sans en altérer le goût, notre chiffre d’affaires augmente de jour en jour.
LA BELLE FROMAGÈRE. — Oui, cher époux, ton invention a bouleversé le monde de la fromagerie. Grâce à ton merveilleux procédé, nos fromages peuvent rivaliser comme parfum avec les fleurs les plus odorantes de nos jardins. Ton « camembert-muguet-printemps » a recueilli les suffrages les plus délicats.
LE FROMAGER-PARFUMEUR, avec orgueil. — Mon « livarot-rose-trémière » est également très apprécié, ainsi que mon « roquefort-soupir de ma mie » et mon « parmesan aux violettes de Parme ». Ah ! chère épouse, ces fromages parfumés feront notre fortune, comme ils ont déjà fait notre bonheur.
LA BELLE FROMAGÈRE, rougissant. — C’est vrai, ce sont eux qui firent éclore notre amour. Voilà juste six mois aujourd’hui qu’en me faisant visiter ta fromagerie, tu m’offris galamment un « gruyère-brise d’avril ». Tout émue, je respirai avec délices son doux parfum, et quelques minutes plus tard nous échangions nos premiers aveux.
LE FROMAGER-PARFUMEUR. — À propos de gruyère, femme adorée, n’oublie pas de livrer ce matin au châtelain de la colline l’énorme bloc de gruyère qu’il nous a commandé.
LA BELLE FROMAGÈRE. — Non, cher époux, je ne veux pas pénétrer au château de la colline. Depuis déjà longtemps, le châtelain me regarde avec des yeux luisants de convoitise. Toutes ses commandes de gigantesques fromages ne sont que des prétextes pour m’attirer au château. Il est préférable que tu fasses toi-même la livraison. D’ailleurs, ma voiture est remplie de « camembert-muguet-printemps » que je vais transporter à la gare du village.
LE FROMAGER-PARFUMEUR. — Pars donc, chère épouse, je livrerai moi-même l’énorme gruyère au château cet après-midi.
LA BELLE FROMAGÈRE, à part. — C’est étrange ! Mon cœur est rempli de sombres pressentiments. (Secouant la tête.) Bah ! imaginations que tout cela ! (Elle monte dans sa voiture et fouette le cheval.) Hue ! Maurice ! Hue !
DEUXIÈME ACTE
Le guet-apens.
La scène représente la route.
LA BELLE FROMAGÈRE. — Me voici au pied de la côte qui conduit au sommet de la colline. Comme d’habitude, par bonté pour mon cheval Maurice, je lui fais tourner le dos à la côte que nous allons gravir, et pousser la voiture à reculons. De cette façon, Maurice a l’illusion de descendre la côte au lieu de la monter. (La voiture commence à monter la côte à reculons.) Oh ! la terrible journée de chaleur ! Le soleil, implacable, projette ses rayons ardents sur la route poudreuse. Mais, Dieu soit loué ! nous arrivons au sommet de la colline. Ciel ! Quel est ce choc imprévu ? Ma voiture se renverse brusquement et je suis projetée sur le sol avec tous mes fromages ! Mais que vois-je ? Le châtelain de la colline surgit d’un fourré et se dirige sur moi en toute hâte. Je comprends tout. C’est un guet-apens ! Le misérable connaissait mon habitude de faire monter la voiture à reculons. C’est lui qui a creusé le trou dans lequel ma voiture a versé. Impossible de fuir. Que faire ? Comment avertir mon mari ? Dans quelques secondes l’infâme châtelain m’aura enlevée dans ses bras musclés. Oh ! quelle idée ! (Elle arrache rapidement une feuille de son carnet de comptes, écrit quelques mots, plie la feuille et la jette sur le sol.) Et maintenant, à la grâce de Dieu !
TROISIÈME ACTE
Les yeux qui fixent.
La scène représente une chambre du château.
LA BELLE FROMAGÈRE. — Voilà déjà de longues heures que je suis prisonnière dans cette chambre du château. J’ai repoussé victorieusement le premier assaut du châtelain de la colline. Mais j’entends des pas. C’est lui !
LE CHÂTELAIN DE LA COLLINE, entrant. — Oui, c’est moi. Et cette fois, belle fromagère, tu n’échapperas pas à mon baiser fiévreux.
LA BELLE FROMAGÈRE. — Ciel ! Fuyons ! Oh ! bonheur ! Cette porte est ouverte !
LE CHÂTELAIN DE LA COLLINE, la poursuivant. — Ta fuite est inutile, belle fromagère, ce corridor que tu traverses en courant conduit aux caves du château.
LA BELLE FROMAGÈRE. — Redoublons de vitesse. Qui sait ? Par les caves, peut-être pourrai-je fuir. (Elle arrive dans les caves.) Malédiction ! Pas d’issues ! Ah ! je suis perdue !
LE CHÂTELAIN DE LA COLLINE, ironique. — Te voilà bien avancée, la belle ! M’obliger à te poursuivre jusque dans la cave aux fromages. Car c’est ici, ma jolie, que je conserve tous les fromages que j’avais achetés dans l’espoir de t’attirer un jour au château. Cette ruse n’ayant point réussi, j’ai dû employer les grands moyens.
LA BELLE FROMAGÈRE. — Infâme ! Mon mari me vengera !
LE CHÂTELAIN DE LA COLLINE. — Ton mari ne se doute de rien. Il m’a fait livrer cet après-midi ce gigantesque gruyère que j’avais commandé, il y a quelques jours, dans l’espoir de te séduire par l’importance de mes achats. Mais trêve de discours. Ma force aura bientôt raison de ta résistance. Rien ne pourra te soustraire à… (S’arrêtant soudain.) Oh !… là ! là ! Que vois-je ? C’est fou ! Je rêve. Les yeux du gruyère me fixent… me fixent terriblement !
LA BELLE FROMAGÈRE. — Il devient fou. Seigneur, protégez-moi !
LE CHÂTELAIN DE LA COLLINE, hagard. — Ah ! j’ai peur ! j’ai peur ! Le gruyère a bougé ! Ses yeux lancent des éclairs ! Il bouge… Oh ! je rêve !
LE FROMAGER-PARFUMEUR, surgissant de l’énorme bloc de gruyère. — Non, tu ne rêves pas, misérable ! Mes yeux remplis d’une juste colère te fixaient à travers les trous de ce fromage.
LA BELLE FROMAGÈRE, s’élançant dans les bras de son mari. — Toi ! C’est toi !
LE FROMAGER-PARFUMEUR. — Oui, c’est moi, prévenu par ton billet désespéré.
LA BELLE FROMAGÈRE. — Quoi ? Ce que j’avais prévu est donc arrivé ? Les fromages renversés sur la route, et sur lesquels j’avais lancé à tout hasard mon billet avertisseur, l’ont transporté jusqu’à toi ?
LE FROMAGER-PARFUMEUR. — Oui. Grâce à la Providence et surtout à l’ardent soleil, les fromages, surchauffés, descendirent rapidement la colline. J’étais sur le seuil de notre maison lorsque je les vis arriver. Ah ! les braves camemberts ! Comme leur marche était rapide ! On aurait dit qu’ils devinaient l’importance du billet qu’ils transportaient. Dès que j’eus pris connaissance du billet m’annonçant le guet-apens du châtelain, j’eus l’idée, pour pénétrer au château, de creuser l’énorme bloc de gruyère que je devais livrer et de m’y cacher, afin de surgir au moment précis où tout espoir semblerait perdu. Tout a parfaitement réussi. Viens, femme, sortons de ce lieu maudit. (Se tournant vers le châtelain.) Quant à vous, triste personnage, remerciez Satan, votre ami, que je sois arrivé à temps, car, autrement, j’en atteste le ciel, le monde des vivants compterait un cadavre de plus !
RIDEAU
UNE MAÎTRESSE FEMME
PREMIER TABLEAU
Déménagement tragique.
La scène représente un appartement.
LE MARI. — C’est une fameuse idée que j’ai eue de découper tout notre mobilier en petits morceaux, comme un jeu de patience. Cela nous permet de déménager discrètement à l’approche du terme. En plusieurs voyages, j’ai transporté ce matin presque tous nos meubles dans le nouvel appartement que nous allons habiter.
LA MAÎTRESSE FEMME. — La concierge ne s’est aperçue de rien ?
LE MARI. — De rien. Tu sais bien que les morceaux de notre mobilier-puzzle ne sont pas plus grands que des morceaux de sucre. Ils se dissimulent facilement dans les poches. La concierge m’a vu sortir. Elle ne se doutait pas que j’emportais dans les poches de mon pardessus notre lit et la table de la salle à manger.
LA MAÎTRESSE FEMME. — Avouez que ce n’est pas une existence ! Vous n’êtes qu’un paresseux ! Vous feriez mieux de travailler pour payer vos termes au lieu de déformer vos poches en déménageant notre mobilier.
LE MARI. — Paresseux, moi ! Ah ! ne blasphémez pas, madame. Songez que dans chaque nouvel appartement que nous habitons, je passe près de deux mois et demi à reconstituer notre mobilier-puzzle. Paresseux ! À peine ai-je remonté tous les meubles qu’il faut songer à les démonter pour déménager à nouveau ! Paresseux !
LA MAÎTRESSE FEMME. — Ne bavardez pas tant et travaillez ! il vous reste encore à déboîter les 17.625 morceaux de l’armoire à glace et les 5.452 morceaux de la table de nuit.
LE MARI. — Je n’ai pas de temps à perdre. (À l’aide d’une pince à sucre il enlève un à un les morceaux qui composent l’armoire à glace.) Tout est démonté.
LA MAÎTRESSE FEMME. — Bien. J’enveloppe l’armoire à glace dans ce vieux journal. (Elle compte les morceaux avant de faire le paquet.) 17.625. Le compte y est. Mettez, comme d’habitude, la table de nuit dans votre pardessus et partons.
LE MARI. — Partons ! (En empochant la table de nuit, il laisse tomber quelques morceaux.)
LA MAÎTRESSE FEMME. — Ramassez, maladroit ! Vous n’avez jamais rien su faire de vos onze doigts.
LE MARI. — Raillez, madame ! Est-ce ma faute si la nature m’a gratifié d’un doigt supplémentaire ?
LA MAÎTRESSE FEMME. — Taisez-vous, orgueilleux ! Pour avoir un doigt de plus que les autres, vous n’en êtes que plus paresseux.
LE MARI. — Mais…
LA MAÎTRESSE FEMME, avec mépris. — Taisez-vous, tête d’épingle !
LE MARI, bondissant. — Tête d’épingle ! Cette insulte, vous le savez, a le don de m’énerver au suprême degré. (Il s’élance sur sa femme, lui serre le nez avec un casse-noisettes et lui ferme la bouche avec la pince à sucre. La maîtresse Femme tombe étouffée.)
LE MARI, reprenant son sang-froid. — On ne devrait jamais se mettre en colère. Tâchons de réparer ce mouvement de mauvaise humeur. (Il prend une scie et coupe sa femme en morceaux. Il enveloppe ensuite les morceaux dans un journal.) Il s’agit maintenant de disperser les morceaux de ma pauvre femme dans différents quartiers déserts. C’est la méthode classique. Et il n’y a rien de tel que le classique. (Il va pour sortir.) Ah ! j’oubliais le paquet contenant l’armoire à glace. Un rien me fait perdre la tête. (Avec le paquet renfermant sa femme, dans la main droite, le paquet contenant l’armoire à glace, dans la main gauche, et sa table de nuit dans les poches de son pardessus, il quitte l’appartement.)
DEUXIÈME TABLEAU
Le remords.
La scène représente un quartier désert. Il fait nuit.
LE MARI. — Je viens de lancer quelques morceaux de ma pauvre femme dans le fossé des fortifications. Pour me donner du courage, j’ai déjà bu beaucoup d’alcool. Entrons dans ce cabaret pour boire… boire encore… boire toujours ! (En titubant, il en ressort deux minutes plus tard.) Allons jeter les derniers morceaux de ma pauvre femme dans ce terrain vague. (Il lance les derniers morceaux dans le terrain vague.) Ma lugubre besogne est terminée. Regagnons notre nouvel appartement. Je sens déjà le remords envahir mon âme et glacer mon cœur. C’est assez naturel, en somme.
(Il part, tenant toujours à la main le paquet contenant l’armoire à glace.)
TROISIÈME TABLEAU
Douce compagne.
La scène représente le nouvel appartement.
LE MARI, entrant. — Me voici dans le nouvel appartement. Le jour va se lever. Je peux commencer à reconstituer le mobilier. Dans ce paquet se trouvent les morceaux de l’armoire à glace. (Il commence à emboîter les morceaux les uns dans les autres.) Ma main tremble, ma vue est obscurcie. J’ai sans doute trop bu… trop bu… trop bu… (Il continue à emboîter.) Mon travail touche à sa fin. Il ne me reste plus que trois morceaux à emboîter. Je travaille machinalement… sans voir… par habitude. J’ai bu… trop bu… Là ! Voilà le dernier morceau ! L’armoire à glace est reconstituée !
LA MAÎTRESSE FEMME. — Faut-il que tu sois saoul pour me prendre pour une armoire à glace !
LE MARI, subitement dégrisé. — Ciel ! ma femme ! Je comprends tout ! Après le crime, j’ai bu pour me donner du courage. Alors je me suis trompé de paquet ! J’ai jeté les morceaux de l’armoire à glace et je viens de reconstituer ma femme !
LA MAÎTRESSE FEMME, d’une voix terrible. — Comment ! vous avez jeté les morceaux de l’armoire à glace ! Ah ! je le disais bien que vous n’étiez bon à rien ! Mais il faut que vous soyez le dernier des hommes et le premier des ivrognes pour semer dans les rues une armoire à glace en chêne, imitation bois blanc !
LE MARI. — Mais…
LA MAÎTRESSE FEMME, au paroxysme de la colère. — Taisez-vous ! Si vous n’aviez pas bu, cela ne serait pas arrivé ! Vous ne vous seriez pas trompé de paquet !
RIDEAU
L’ENFANT DE L’IVROGNE
ou
LE PETIT JUSTICIER
PREMIER ACTE
Pauvre mère ! Pauvre enfant !
La scène représente un pauvre logis.
LE BON PETIT ENFANT, seul — Après avoir travaillé sans repos toute la semaine, ma pauvre mère est allée livrer sept mille dessous-de-bras à sa maison de confection. Pendant ce temps, mon père indigne s’enivre dans les cabarets de la cité.
LA PAUVRE MÈRE, entrant. — Me voici de retour. Cher bon petit enfant, sur mon maigre salaire j’ai prélevé quelques sous pour t’acheter ce modeste jouet.
LE BON PETIT ENFANT, prenant le jouet. — Oh ! c’est une bergerie avec un petit berger, une petite bergère, des petits moutons enrubannés de rose, et des petits arbres verts montés sur rondelles de bois !
LA PAUVRE MÈRE. — C’est aujourd’hui samedi, ton père indigne va rentrer plus ivre que d’habitude. Les coups vont pleuvoir dans le triste logis !
LE BON PETIT ENFANT. — Ah ! si j’avais sept ou huit ans, tu verrais, mère, comme je te délivrerais promptement de ton bourreau. J’ai lu sur les journaux dans lesquels tu enveloppes ton ouvrage, les exploits héroïques de ces bons enfants qui brûlent la cervelle de leur père pour protéger leur mère, ou qui poignardent leur mère pour libérer leur père. L’exemple de ces petits justiciers me hante jour et nuit. Mais hélas ! je n’ai que six ans et demi : un revolver serait encore trop lourd pour mes frêles mains d’enfant.
LA PAUVRE MÈRE. — Cher petit ! Résignons-nous. Subissons sans nous plaindre les injures et les coups de ton père indigne. Couche-toi. Je passe dans la pièce à côté pour coudre des dessous-de-bras toute la nuit. (Elle passe dans la chambre à côté.)
LE BON PETIT ENFANT, seul — Des pas titubants se font entendre dans l’escalier. C’est mon père indigne. Il va vouloir, comme d’habitude, pénétrer dans la chambre où ma mère travaille pour l’assommer à coups de brodequins. Oh ! non ! cela n’a que trop duré ! Je vais la défendre, moi !
DEUXIÈME ACTE
Une brute.
Même décor.
LE PÈRE INDIGNE, entrant en titubant. — Où est la mère ?
LE BON PETIT ENFANT. — Mère travaille dans la pièce à côté pour gagner notre pain quotidien. (Le père indigne se dirige vers la chambre où travaille la mère. Le bon petit enfant, les bras étendus, lui barre le chemin.) Père indigne, tu ne passeras pas !
LE PÈRE INDIGNE. — Je ne passerai pas, insecte ?
LE BON PETIT ENFANT. — Non ! Bats-moi puisque tu es méchant, mais ne brutalise pas petite mère.
LE PÈRE INDIGNE, battant son fils. — Tiens ! tiens ! tiens ! (Apercevant la petite bergerie.) Des brebis ? Des brebis chez moi ! Tiens ! voilà ce que j’en fais, moi, des brebis ! (Il piétine la bergerie.)
LE BON PETIT ENFANT, les larmes aux yeux. — Ma pauvre bergerie ! (À part, avec joie.) Ô bonheur ! Mon père indigne, fatigué de piétiner ma bergerie, vient de s’étaler sur le lit. Il dort déjà d’un profond sommeil de brute. Mère ne sera pas battue ce soir. Oh ! quand trouverai-je l’idée qui la délivrera définitivement ? Quand ? Cherchons.
LE PÈRE INDIGNE, rêvant à haute voix. — Des brebis chez moi ?… Des brebis !…
TROISIÈME ACTE
Une idée d’enfant.
Même décor. Une heure après.
LE BON PETIT ENFANT. — Mon père indigne dort toujours. L’orage terrible qui vient d’éclater ne l’a pas réveillé. Le tonnerre gronde formidablement et ma pauvre mère coud des dessous-de-bras dans la pièce à côté. Ah ! quelle nuit terrible pour un enfant de six ans et demi ! Depuis une heure je cherche le moyen de délivrer ma mère du bourreau qui la martyrise.
LE PÈRE INDIGNE, rêvant à haute voix. — Des brebis ?… Des brebis chez moi !…
LE BON PETIT ENFANT. — Le monstre rêve tout haut. Oh ! mes pauvres petits moutons ! À la lueur d’un éclair j’aperçois ma petite bergerie, que mon père indigne piétina sans pitié. Seul, un pauvre petit arbre a échappé au massacre. (Il le ramasse.) Oh ! serait-ce une indication de la Providence ? Une idée subite vient de traverser mon cerveau d’enfant. Je viens de trouver un moyen pour nous délivrer de la présence de ce père et mari indigne. Marchons tout doucement et posons le petit arbre de ma bergerie sur le front de mon père endormi. (Il place le petit arbre debout sur le front de l’ivrogne.) J’ai lu dans un livre scolaire que la foudre tue les personnes qui s’abritent sous un arbre pendant l’orage. Éloignons-nous. (Il s’éloigne. Un coup de tonnerre formidable retentit. La foudre tombe sur le petit arbre et foudroie le Père indigne.)
LA PAUVRE MÈRE, accourant. — Ciel ! Que se passe-t-il ?
LE BON PETIT ENFANT. — Mère, sois heureuse ! Papa est carbonisé !
RIDEAU
VENGEANCE DE SOUFFLEUR
Drame de mœurs théâtrales.
ACTE PREMIER
Jalousie.
La scène représente le logement du Souffleur vindicatif.
LA FORTE CHANTEUSE, seule. — Une forte chanteuse ne devrait jamais épouser un souffleur. J’en fais la cruelle expérience. Mais voici mon mari, le Souffleur vindicatif.
LE SOUFFLEUR VINDICATIF, entrant. — Madame, vous me trompez avec la « basse chantante » du casino. Je me vengerai. (D’une voix sinistre.) Souvenez-vous du baryton arthritique de Périgueux !
LA FORTE CHANTEUSE. — Affreux souvenir ! Je crois revivre encore cette tragique soirée : le baryton arthritique disparaissant dans le trou du souffleur ! Misérable ! Je m’en souviens. Oh ! l’atroce vision ! Le baryton arthritique s’avançait pour chanter son grand air, lorsque, machinalement, son regard se porta sur votre trou de souffleur. Aussitôt, il pâlit atrocement, essaya vainement de se rejeter en arrière, puis disparut la tête la première dans le trou béant pour aller s’écraser dans les « dessous ».
LE SOUFFLEUR VINDICATIF. — J’avais tout calculé. Pour que votre amant soit pris de vertige, j’avais collé dans mon trou de souffleur un petit panorama des Alpes et placé devant le trou une pancarte avec ces mots : « Précipice sans fond ». Le baryton arthritique ne put résister à l’attirance de mon précipice artificiel.
LA FORTE CHANTEUSE. — Infâme ! Un cadavre ne vous suffit pas ! Vous voulez aujourd’hui vous venger de mon nouvel amant, la basse chantante du casino ?
LE SOUFFLEUR VINDICATIF, d’une voix sombre. — Oui.
LA FORTE CHANTEUSE. — Comment ?
LE SOUFFLEUR VINDICATIF. — Je ne suis pas encore fixé. Mais je trouverai.
ACTE DEUXIÈME
Les figurants mécontents.
La scène représente un café.
LE SOUFFLEUR VINDICATIF, entrant. — Qu’avez-vous, camarades figurants ? Vos visages sont tristes.
PREMIER FIGURANT DÉCOURAGÉ. — Nous venons de répéter le rôle du « fleuve limpide » dans l’opéra que l’on joue ce soir au casino. Mais le directeur n’est pas content.
DEUXIÈME FIGURANT DÉCOURAGÉ. — Il dit que la toile peinte sous laquelle nous nous agitons pour imiter les ondulations de l’eau ne donne pas l’illusion d’un véritable fleuve.
TROISIÈME FIGURANT DÉCOURAGÉ. — Il nous reproche de ne pas agiter la toile du fleuve avec assez de naturel.
QUATRIÈME FIGURANT DÉCOURAGÉ. — Et ce soir, à la représentation, si le mouvement du fleuve n’est pas l’image de la réalité, il nous infligera une forte amende.
LE SOUFFLEUR VINDICATIF, à part. — Oh ! quelle idée ! Je tiens ma vengeance ! (Haut !) Ne désespérez pas. Je vais vous donner le moyen de jouer le rôle du « fleuve limpide » aussi vrai que nature.
TOUS LES FIGURANTS DÉCOURAGÉS. — Que faut-il faire ?
LE SOUFFLEUR VINDICATIF. — Vous laisser hypnotiser.
TOUS LES FIGURANTS DÉCOURAGÉS. — L’heure est mal choisie pour plaisanter, camarade.
LE SOUFFLEUR VINDICATIF. — Je ne plaisante pas. Avant d’être souffleur, j’exerçais la profession d’hypnotiseur. Je vais vous endormir et vous suggérer que vous formez à vous tous un véritable fleuve. Grâce à cette suggestion, je peux vous assurer la perfection absolue dans votre imitation des flots. Vous jouerez nature.
TOUS LES FIGURANTS DÉCOURAGÉS. — Soit ! Nous acceptons.
LE SOUFFLEUR VINDICATIF. — Passons dans l’arrière-boutique.
ACTE TROISIÈME
La représentation interrompue.
La scène représente le théâtre du Casino de la Plage.
LE DIRECTEUR. — La représentation est commencée. Le rideau va se lever sur le deuxième acte. (Aux figurants placés sous la toile du fleuve.) Soyez nature. Je vous le répète, je veux que l’illusion soit parfaite. Imitez les ondulations de l’eau en sautillant sous la toile peinte.
LE RÉGISSEUR. — Je frappe les trois coups. Le rideau se lève.
PREMIER SPECTATEUR EN DÉLIRE. — Merveilleux tableau ! Nous allons entendre la célèbre « basse chantante » engagée à prix d’or.
DEUXIÈME SPECTATEUR EN DÉLIRE. — C’est un artiste unique au monde. Sa voix est si prodigieusement basse qu’il chante sans qu’on entende le moindre son.
TROISIÈME SPECTATEUR EN DÉLIRE. — Mais le voici. Dans la gondole qui s’avance sur le « fleuve limpide », il chante une barcarolle. Seuls les mouvements de sa bouche indiquent qu’il est en train de chanter.
QUATRIÈME SPECTATEUR EN DÉLIRE. — On entendrait une mouche voler. Sa voix est encore plus basse que la dernière fois. Quel artiste !
LE SOUFFLEUR VINDICATIF, dans son trou. — Jouis de ton triomphe, basse maudite ! Ma vengeance approche.
LES SPECTATEURS EN DÉLIRE. — Ciel ! Que se passe-t-il ? Le fleuve de toile se sauve à travers les coulisses, emportant avec lui la « basse chantante » dans sa gondole !
LE RÉGISSEUR, aux figurants. — Arrêtez, malheureux ! Où courez-vous ?
LE DIRECTEUR. — Malédiction ! Le fleuve sort du théâtre par la porte des artistes ! Il traverse la plage en courant. La malheureuse basse chantante dans sa gondole, pousse des cris désespérés !
LES SPECTATEURS EN DÉLIRE, se précipitant sur la plage. — C’est horrible ! les figurants portant le fleuve de toile se précipitent dans la mer ! La basse chantante est engloutie avec eux !
LA FORTE CHANTEUSE, au Souffleur vindicatif. — C’est toi, misérable, qui as préparé cette tragédie ? Je le devine ! Je reconnais ta manière !
LE SOUFFLEUR VINDICATIF. — Oui. Je me suis vengé de ton amant, la basse chantante ! J’avais préparé sa noyade.
LE DIRECTEUR. — Comment cela ?
LE SOUFFLEUR VINDICATIF. — J’ai hypnotisé les figurants. Je leur ai suggéré qu’ils étaient un fleuve véritable. Alors, naturellement, ils sont allés se jeter à la mer, comme tous les fleuves.
RIDEAU
LES DRAMES DE LA DESTINÉE
PREMIER ACTE
L’horoscope.
La scène représente la chambre de l’extra-lucide.
MIARKA L’EXTRA-LUCIDE. — Assise entre mon hibou empaillé et mon corbeau apprivoisé, un chat noir sur les genoux et la main posée sur une tête de mort, j’attends les consultants.
LE MONSIEUR PRÉVOYANT DE L’AVENIR, entrant. — Bonjour. Quel sera mon destin ?
MIARKA L’EXTRA-LUCIDE. — Pour dévoiler l’avenir, il faut que je dorme. (Elle se couche dans un berceau.) Bercez-moi tout doucement.
LE MONSIEUR PRÉVOYANT DE L’AVENIR, la berçant. — Dormez-vous, Miarka l’extra-lucide ?
MIARKA L’EXTRA-LUCIDE. — Pas encore. Je vais me chanter une berceuse mystique. (Elle chante.)
Do, fais dodo,
Ré, mi, fa, sol, la, si, do,
Au doux chant des uppercuts,
Ré, mi, fa, sol, la, si, ut !
LE MONSIEUR PRÉVOYANT DE L’AVENIR. — Dormez-vous, Miarka l’extra-lucide ?
MIARKA L’EXTRA-LUCIDE. — Profondément.
LE MONSIEUR PRÉVOYANT DE L’AVENIR. — Quelle sera ma destinée ?
MIARKA L’EXTRA-LUCIDE. — Vous mourrez d’un accident de chemin de fer.
DEUXIÈME ACTE
La destinée.
La scène représente une rue.
LE MONSIEUR PRÉVOYANT DE L’AVENIR, à son ami. — Il y a dix ans de cela, une voyante m’avait prédit que je mourrais d’un accident de chemin de fer. J’ai pris mes précautions. Depuis ce jour, je ne suis jamais monté dans un train. J’ai supprimé également mon train de maison. Je peux donc sans crainte envisager l’avenir et me moquer de la prédiction fatale.
L’AMI RASSURANT. — Nul n’échappe à sa destinée.
LE MONSIEUR PRÉVOYANT DE L’AVENIR. — Mais me voici arrivé devant ma maison.
L’AMI RASSURANT. — Penché à la fenêtre du cinquième étage, ton fils t’appelle joyeusement.
LE JOYEUX FILS, penché à la fenêtre. — Père ! Père ! Regarde le beau jouet qu’un monsieur qui connaît maman m’a acheté ! (Il brandit son jouet et le laisse tomber dans la rue.)
LE MONSIEUR PRÉVOYANT DE L’AVENIR, s’écroulant. — Ciel ! Ce jouet en tombant m’a défoncé le crâne ! Je meurs ! (À l’ami rassurant.) Tu vois, Miarka l’extra-lucide s’était trompée. Je ne meurs pas d’un accident de chemin de fer.
L’AMI RASSURANT, lui montrant le jouet. — Regarde : c’est une locomotive. Nul n’échappe à sa destinée !
RIDEAU
UN BEAU RÔLE !
Drame de la vie théâtrale
PREMIER ACTE
Un véritable artiste.
La scène représente une chambre.
LE VIEUX FIGURANT GLABRE, entrant avec son fils. — Femme, bonne nouvelle !
LE FILS RESPECTUEUX ET ARTISTE D’AVENIR. — Bonne nouvelle, mère ! Le directeur du Théâtre-Historique m’a confié un rôle important dans le prochain drame : Napoléon ou vingt ans sous la mitraille !
LA FEMME DU VIEUX FIGURANT GLABRE. — C’est-il Dieu possible ! Un rôle ? Un véritable rôle parlé ?
LE FILS RESPECTUEUX ET ARTISTE D’AVENIR. — Oui, mère. Oh ! je suis heureux ! Le rêve de ma vie va enfin se réaliser ! J’arriverai ! Je le sens !
LA FEMME DU VIEUX FIGURANT GLABRE, émue. — Cher enfant ! Mais quel rôle joueras-tu dans Napoléon ou vingt ans sous la mitraille ?
LE FILS RESPECTUEUX ET ARTISTE D’AVENIR, lui tendant un rouleau de papier. — Voilà mon rôle, mère.
LA FEMME DU VIEUX FIGURANT GLABRE, lisant. — Rôle du général Cambronne.
LE FILS RESPECTUEUX ET ARTISTE D’AVENIR. — Le rôle n’est pas long. Il n’a qu’un mot. Mais c’est un rôle à effet !
LA FEMME DU VIEUX FIGURANT GLABRE, regardant le rôle avec émotion. — Le mot historique est moulé en belles lettres de ronde ! (S’essuyant les yeux.) Oh ! c’est trop de bonheur ! La joie m’étouffe !
LE VIEUX FIGURANT GLABRE. — Oui, c’est là une brillante création qui peut mettre notre cher fils en vedette. Je lui ferai travailler son rôle. Mes conseils lui seront précieux.
LE FILS RESPECTUEUX ET ARTISTE D’AVENIR. — Oui, cher père. Je veux, à partir d’aujourd’hui, travailler sans relâche ce rôle que l’on m’a confié, je veux le fouiller, le creuser, l’analyser, en rechercher toutes les intentions cachées.
LE VIEUX FIGURANT GLABRE. — Bravo ! Voilà qui est parler en véritable artiste !
DEUXIÈME ACTE
L’étude d’un rôle.
La scène représente la chambre du Fils respectueux.
LE VIEUX FIGURANT GLABRE, entrant. — Cher fils, depuis quinze jours que le rôle du général Cambronne te fut distribué, tu travailles jour et nuit devant ton armoire à glace. Tu te surmènes. Prends quelques instants de repos.
LE FILS RESPECTUEUX ET ARTISTE D’AVENIR. — Non, père. Je ne suis pas encore arrivé à trouver l’intonation idéale.
LE VIEUX FIGURANT GLABRE. — Tu es trop difficile pour toi-même, cher enfant. Je t’assure que, ce matin, tu as lancé ton « mot de Cambronne » d’une façon sublime. Ta pauvre mère en avait les larmes aux yeux.
LE FILS RESPECTUEUX ET ARTISTE D’AVENIR. — Non, père. Je sens que je peux faire mieux. Je n’ai pas encore donné ma mesure. Permets que je continue l’étude de mon rôle. Il y a mille façons de prononcer le mot légendaire. Mais quelle est la meilleure ? Quel était l’état d’esprit de Cambronne au moment où il répondit aux ennemis le mot qui l’a immortalisé ? A-t-il répondu avec colère, comme ceci : « M… ! », ou bien avec ironie, comme cela : « M… ! » ou bien avec éclat : « M… ! », ou avec dédain : « M… ! », ou avec désespoir : « M… ! »
LE VIEUX FIGURANT GLABRE, les larmes aux yeux. — C’est sublime !
LE CONCIERGE, entrant. — Voici votre congé que je vous apporte.
LE FILS RESPECTUEUX ET ARTISTE D’AVENIR. — Notre congé ?
LE CONCIERGE. — Oui. Les locataires de l’immeuble ont fait parvenir une pétition au propriétaire. Voilà quinze jours que vous hurlez à tue-tête et sans interruption le mot le plus ordurier de la langue française !
LE FILS RESPECTUEUX ET ARTISTE D’AVENIR, avec dignité. Et le plus héroïque, monsieur ! (Le concierge sort.) Et maintenant, reprenons l’étude de notre rôle. (Il se campe de nouveau devant l’armoire à glace.) Voyons, dois-je lancer le mot d’un air martial : « M… ! », avec rage : « M… ! », avec esprit : « M… ! », ou bien… (Il continue l’étude du rôle.)
TROISIÈME ACTE
Waterloo.
La scène représente la plaine de Waterloo.
LE FILS RESPECTUEUX ET ARTISTE D’AVENIR. — Pour bien me mettre dans la peau de mon personnage, je viens poursuivre l’étude de mon rôle dans la plaine de Waterloo où fut prononcé le mot historique.
LE GUIDE. — Voilà l’endroit où le général Cambronne résista héroïquement, au milieu du dernier carré.
LE FILS RESPECTUEUX ET ARTISTE D’AVENIR. — Oh ! je sens qu’ici je vais trouver l’intonation véritable, l’intonation qui remuera les foules. Je me sens inspiré ! (Il bombe le torse et tend le poing vers un ennemi imaginaire, hurlant :) « M… ! ». Oh ! oui, c’est bien ça ! Voilà l’intonation juste ! L’ombre de Cambronne m’inspire ! (Il lance à travers la morne plaine une formidable série de « mots de Cambronne ». – Le Guide épouvanté prend la fuite.)
QUATRIÈME ACTE
Au pied levé.
La scène représente les coulisses du Théâtre-Historique le soir de la représentation.
LE RÉGISSEUR AFFOLÉ, accourant. — Que faire ? Que faire ? L’acteur chargé du rôle de l’officier anglais, atteint subitement d’une crampe à la langue, ne peut jouer son rôle !
LE DIRECTEUR. — Ne nous affolons pas. Le rôle de l’officier anglais est des plus courts. Il consiste simplement à crier, avec l’accent anglais : « Braves Français, rendez-vous ! » Il faut trouver un remplaçant. Mais j’y pense : le vieux figurant glabre pourra jouer le rôle au pied levé. Courez l’avertir et qu’on lui fasse endosser l’uniforme de l’officier anglais. Courez !
CINQUIÈME ACTE
Fatalité !
La scène représente la scène du Théâtre-Historique.
CHŒUR DES SPECTATEURS. — Le rideau vient de se lever sur le cinquième acte. Voici le dernier carré de la vieille garde cerné par l’ennemi. Écoutons !
LE VIEUX FIGURANT GLABRE, EN OFFICIER ANGLAIS, criant. — Braves Français, rendez-vous ! (Cambronne ne répond rien.)
CHŒUR DES SPECTATEURS. — Oh ! stupeur ! Pourquoi Cambronne ne répond-il pas : « M… ! » ?
LE VIEUX FIGURANT GLABRE, EN OFFICIER ANGLAIS, répétant. — Braves Français, rendez-vous ! (Cambronne reste muet.)
CHŒUR DES SPECTATEURS. — Sifflons et conspuons cet acteur qui a oublié son rôle de Cambronne ! (Vacarme épouvantable. Le rideau se baisse.)
LE DIRECTEUR, se précipitant vers le général Cambronne. — Mais, vous êtes fou ! Pourquoi n’avez-vous pas lancé la réplique fameuse ?
L’AUTEUR. — Oui, pourquoi ? C’était le mot sur lequel je comptais pour assurer le succès de mon drame ! Pourquoi n’avez-vous pas répondu le mot légendaire à l’acteur qui jouait l’officier anglais ? Pourquoi ?
LE FILS RESPECTUEUX ET ARTISTE D’AVENIR. — Non, je ne pouvais pas lui répondre ça ! C’est mon père !
RIDEAU
CARNAVAL TRAGIQUE
PREMIER TABLEAU
Entre amants.
La scène représente une chambre.
LA FEMME ADULTÈRE. — Mon mari est parti en voyage. C’est aujourd’hui mardi gras. J’attends mon amant, qui doit me conduire au bal masqué.
L’AMANT TORÉADOR, entrant. — Chère femme adultère, me voici, déguisé en toréador, comme c’était convenu. Nous allons passer ensemble une inoubliable journée.
LA FEMME ADULTÈRE. — Oh ! comme tu es beau sous ce costume de soie et d’or ! Ton lorgnon et ta barbe en fer à cheval ajoutent un je ne sais quoi de distingué à ton déguisement. Pendant que j’achève de m’habiller en Andalouse, chante-moi, cher amant, une chanson évocatrice du beau pays dont nous portons les costumes.
L’AMANT TORÉADOR, chantant d’une voix chaude :
Connaissez-vous Carmencita ?
Alza !
L’Espagnole aux yeux andalous ?
Alzou !
Elle aimait un toréador,
Alzor !
Le célèbre Concombrita,
Alza !
Un jour, avant la corrida,
Alza !
La belle offrit à son amant,
Alzan !
Un long cil de ses grands yeux noirs,
Alzoir !
Pour le garder en souvenir,
Alzir !
Concombrita, dans la plaza,
Alza !
S’apprête à mater le taureau,
Alzo !
Quand soudain il pousse un grand cri,
Alzi !
Des cornes il a senti le choc,
Alzoc !
Mais le cil de Carmencita,
Alza !
Qu’il portait noué sur son cœur,
Alzeur !
A fait dévier le coup fatal,
Alzal !
Et sauvé la « prima spada »,
Alza !
LA FEMME ADULTÈRE. — Oh ! cette chanson me trouble profondément ! Mais ne perdons pas de temps. Je jette coquettement ma mantille sur mes épaules. Et maintenant, il ne nous reste plus qu’à traverser le jardin pour sortir de la maison et nous rendre au bal masqué. Partons.
DEUXIÈME TABLEAU
L’honneur du mari.
La scène représente le jardin.
L’AMANT TORÉADOR. — Étroitement enlacés, nous nous dirigeons vers la porte du jardin. Mais, écoute, quel est ce bruit ?
LA FEMME ADULTÈRE. — Sans doute le mugissement du vent dans les arbres du jardin.
L’AMANT TORÉADOR. — Non, non, écoute. Ce mugissement n’est pas celui du vent. On dirait le mugissement d’un taureau.
LA FEMME ADULTÈRE. — J’ai peur ! J’ai peur !
L’AMANT TORÉADOR. — Affreuse vision ! Regarde ! Là, derrière ce buisson, une tête de taureau vient de surgir ! Mais que vois-je ? Ce n’est pas un véritable taureau. C’est un homme, dont la tête est recouverte d’un cartonnage de carnaval représentant une tête de taureau.
LA FEMME ADULTÈRE. — Ciel ! C’est mon mari ! Je reconnais son complet jaquette et ses brodequins. Nous sommes perdus !
LE MARI À TÊTE DE TAUREAU EN CARTON-PÂTE, après avoir poussé un terrible mugissement. — Oui, c’est moi ! Moi, qui viens venger mon honneur outragé ! Il y a quelque temps, ayant intercepté une lettre de votre amant, madame, je sus que vous formiez le projet de vous déguiser le jour du mardi gras, vous en Andalouse, et votre amant en toréador. Mon idée de vengeance était trouvée. Je fis spécialement un voyage en Espagne pour étudier, dans les arènes, la façon dont les taureaux de combat donnent le coup de corne. Dès mon retour, j’achetai la tête de taureau on carton-pâte qui recouvre mon visage, et je m’exerçai secrètement, tous les jours, à éventrer des mannequins à grands coups de cornes. Car, ne l’ignorez pas, monsieur le toréador, ces cornes qui vont avoir le plaisir de vous transpercer sont véritables.
LA FEMME ADULTÈRE. — Oh ! l’atroce vengeance ! Pitié !
LE MARI À TÊTE DE TAUREAU EN CARTON-PÂTE. — Pas de pitié ! Allons, beau toréador, attends le taureau sans trembler !
LA FEMME ADULTÈRE. — Défends-toi, cher amant ! Regarde : mon mari, tel un taureau furieux, gratte le sol de ses pieds. Il s’apprête à bondir… Il bondit ! Ah ! horreur !
L’AMANT TORÉADOR, lancé en l’air d’un terrible coup de corne. — Je meurs !
LE MARI À TÊTE DE TAUREAU EN CARTON-PÂTE, le recevant sur ses cornes. — Je suis vengé ! (Il pousse un mugissement de satisfaction.)
LA FEMME ADULTÈRE, devenant subitement folle. — Oh ! les cornes ! les cornes du mari sont rouges ! – Chantant d’une voix égarée :
Connaissez-vous Carmencita ?
Alza !
Elle aimait un toréador !
LE MARI À TÊTE DE TAUREAU EN CARTON-PÂTE, d’une voix sinistre. — Il en est mort !
RIDEAU
LE VENTRILOQUE JALOUX
PREMIER TABLEAU
Intérieur de ventriloque.
La scène représente le logis du Ventriloque.
LE VENTRILOQUE JALOUX. — La femme que je viens d’épouser, et que voilà, est sourde-muette.
L’AMI DE TOUT REPOS. — Sourde-muette ?
LE VENTRILOQUE JALOUX. — Oui. Je l’ai choisie sourde-muette parce que je suis terriblement jaloux. Son infirmité l’empêche d’écouter les propos galants et d’y répondre.
L’AMI DE TOUT REPOS. — Bonne idée.
LE VENTRILOQUE JALOUX. — Pour plus de sécurité, je ne laisse aucun homme pénétrer chez moi. Vous êtes une exception. Grâce à votre laideur proverbiale, vous êtes pour moi un ami de tout repos.
L’AMI DE TOUT REPOS, ému. — La femme d’un ami est sacrée pour moi. Mais ne vous ennuyez-vous point à vivre avec une femme qui ne parle jamais ?
LE VENTRILOQUE JALOUX. — Elle parle quand je veux.
L’AMI DE TOUT REPOS. — Elle parle ?
LE VENTRILOQUE JALOUX. — Oui. Vous n’ignorez pas que je suis ventriloque et que je fais parler des mannequins dans les théâtres ?
L’AMI DE TOUT REPOS. — Je ne l’ignore pas.
LE VENTRILOQUE JALOUX. — Je me sers du même procédé pour converser avec ma femme. Je lui parle de ma voix naturelle et…
L’AMI DE TOUT REPOS, comprenant. — Et de votre voix de ventriloque vous faites répondre madame votre épouse ? C’est admirable !
LE VENTRILOQUE JALOUX. — Oui. Nous nous entendons très bien. Vous allez en juger. (À sa femme.) M’aimez-vous, chère âme ?
L’ÉPOUSE SOURDE-MUETTE, voix du ventriloque. — Vous êtes mon lion superbe et généreux.
L’AMI DE TOUT REPOS. — L’illusion est parfaite. On dirait que c’est votre épouse qui parle. Vous avez trouvé le secret du bonheur conjugal.
LE CONCIERGE PUDIBOND, frappant et entrant. — Ventriloque, voilà votre congé.
LE VENTRILOQUE JALOUX. — Mon congé ? Pourquoi ?
LE CONCIERGE PUDIBOND. — Parce que chaque nuit votre femme pousse des cris qui effarouchent la pudeur de mes locataires. Salut. (Il sort.)
L’AMI DE TOUT REPOS. — Que veut dire ceci ?
LE VENTRILOQUE JALOUX. — C’est ma faute. Toutes les nuits, par un sot amour-propre, je me plais, avec ma voix de ventriloque, à pousser de formidables cris de volupté qui semblent sortir des lèvres de ma femme. Mon orgueil de mari en est flatté.
L’AMI DE TOUT REPOS, gêné. — Je vais prendre congé de vous.
LE VENTRILOQUE JALOUX. — Je vous accompagne. (À sa femme.) Je sors, mon amie.
L’ÉPOUSE SOURDE-MUETTE, voix du ventriloque. — Reviens vite, mon idole. J’ai soif de tes baisers, mon mari, mon amour, mon amant !
L’AMI DE TOUT REPOS, convaincu. — Le bonheur habite sous ce toit. (Il sort avec le Ventriloque jaloux.)
DEUXIÈME TABLEAU
Flagrant délit.
La scène représente l’escalier de la maison du Ventriloque.
LE VENTRILOQUE JALOUX. — Je viens d’accompagner mon ami de tout repos. Je monte mon escalier pour regagner mon domicile. Ciel ! Qu’entends-je ? Des bruits de baisers à l’intérieur de mon logis ! Regardons par le trou de la serrure. Enfer ! Que vois-je ! Antony, le cousin sourd-muet de ma femme, en conversation criminelle avec elle ! J’aurais dû me méfier. Les sourds-muets se comprennent par gestes. Il m’est impossible d’assister plus longtemps à cette horrible mimique. Enfonçons la porte et châtions les coupables. (Il enfonce la porte et pénètre dans le logis.) Femme adultère, tu vas mourir ! (Il sort un revolver de sa poche.) Ah ! j’oubliais ! Une femme, même surprise en flagrant délit, proclame toujours son innocence. Avec ma voix de ventriloque, je peux lui donner cette suprême joie.
L’ÉPOUSE SOURDE-MUETTE, voix du ventriloque. — Je te jure que je suis innocente.
LE VENTRILOQUE JALOUX. — Meurs ! Impudente menteuse ! (Il la tue.) Et maintenant, à ton tour, Antony le sourd-muet. (Il le vise.) Non, ne le tuons pas ! Il me vient une idée. Je vais me venger plus effroyablement. Enfermons à clé l’amant de ma femme et courons chercher le commissaire.
TROISIÈME TABLEAU
Vengeance de ventriloque.
La scène représente le logis du Ventriloque.
LE VENTRILOQUE JALOUX. — Monsieur le commissaire, ma femme vient d’être assassinée. (Désignant Antony le muet.) Et voici l’assassin !
LE COMMISSAIRE. — Vous entendez l’accusation. Qu’avez-vous à répondre ?
LE VENTRILOQUE JALOUX, à part. — Voilà ma vengeance ! Antony est sourd-muet, il ne peut pas répondre ; mais, avec ma voix de ventriloque, je vais répondre à sa place et le perdre.
LE COMMISSAIRE, à Antony le sourd-muet. — Allons, répondez ! Est-ce vous qui avez tué cette malheureuse femme ?
ANTONY LE SOURD-MUET, voix du ventriloque. — Oui. Elle me résistait, je l’ai assassinée !
(On arrête Antony le sourd-muet.)
RIDEAU
PAUVRE DOMPTEUR
ou
ADVERSITÉ ET MÉNAGERIE
PREMIER ACTE
Le calvaire d’un dompteur.
La scène représente l’intérieur de la cage centrale.
LE VIEUX DOMPTEUR, à sa femme. — Depuis deux nuits, nous couchons dans la cage centrale pendant que notre cher vieux lion malade repose sur notre lit, dans la roulotte.
LA FEMME DU VIEUX DOMPTEUR, essuyant une larme. — Pauvre Romulus ! Lui mort, il ne nous restera plus, de notre vieille ménagerie, que des cages vides.
LE VIEUX DOMPTEUR. — C’est vrai. Depuis quelques mois, la fatalité s’acharne après nous. La série noire commença le jour où je faillis être dévoré par les innombrables puces qui s’élancèrent brusquement des crinières de mes lions, sur mon visage. Je dus m’aliter quelques jours et je pris pour me remplacer un dompteur nègre, sans travail. Ce malheureux, qui crevait littéralement de faim, ne fut pas plus tôt entré dans la cage des fauves qu’il s’élança d’un bond sur ma pauvre lionne Sultane et se mit à la dévorer à belles dents. On eut toutes les peines du monde à lui faire lâcher prise en le piquant avec des lances chauffées à blanc. D’ailleurs, il était trop tard : Sultane était morte. J’appris quelque temps après que mon dompteur nègre n’était nullement dompteur, mais anthropophage forain, sans travail.
LA FEMME DU VIEUX DOMPTEUR. — Hélas ! ce n’était que le commencement de nos malheurs. Quelques jours plus tard, complètement guéri de tes morsures de puces, tu recommenças à dompter. Mais un soir, au lieu d’ouvrir la gueule du lion pour y plonger bravement la tête – oh ! fatale distraction ! – c’est toi qui ouvris ta bouche toute grande en essayant d’y faire pénétrer la tête du pauvre lion terrorisé.
LE VIEUX DOMPTEUR. — Cet instant d’étourderie fut chèrement payé par la mort de notre lion. Le malheureux animal eut une telle frayeur en me voyant ouvrir la bouche qu’il en contracta une maladie de cœur et devint subitement aphone. Il vécut quelque temps encore, mais c’est toi, chère compagne, qui, dans les coulisses, t’épuisais à rugir pour lui, à l’aide d’un verre de lampe, pendant les représentations. Après la mort du lion cardiaque, une terrible épidémie de rougeole dispersa mes derniers pensionnaires.
LA FEMME DU VIEUX DOMPTEUR. — C’est alors que, ruinés, désespérés, nous résolûmes d’en finir avec l’existence. Déjà le réchaud de charbon de bois était allumé dans la cage centrale lorsque notre fidèle caniche Prosper se mit à pousser un aboiement effroyable, qui ressemblait à s’y méprendre au rugissement d’un lion. Nous n’en pouvions croire nos oreilles, lorsque le brave animal recommença son rugissement en nous fixant de ses bons yeux malicieux.
LE VIEUX DOMPTEUR. — Ah ! le fidèle caniche ! Nous devinâmes sans peine ce qu’il voulait nous faire comprendre. « Ne vous découragez pas, mes bons maîtres, avait-il l’air de nous dire ; tout n’est pas perdu. Regardez-moi : je suis tondu en lion et suis arrivé, à force de patience, à imiter le rugissement de cet animal à la perfection. Que me manque-t-il pour remplacer le roi du désert dans votre ménagerie ? Un peu d’embonpoint ! La belle affaire ! Engraissez-moi, et vous pourrez bientôt m’exhiber comme un véritable lion. »
LA FEMME DU VIEUX DOMPTEUR. — Oui, voilà ce que nous lisions dans les yeux expressifs de Prosper. Nous reprîmes courage et, à partir de ce jour, nous nous mîmes à gaver Prosper, tel un jeune canard. À l’aide d’un entonnoir spécial, nous lui faisions absorber, toutes les deux heures, d’énormes quantités de nourriture. Au bout d’un mois de « gavage », Prosper avait atteint la grosseur d’un jeune lion. Mais ses yeux semblaient nous dire : « Encore ! encore ! mes bons maîtres ; je ne suis pas encore tout à fait à point. »
LE VIEUX DOMPTEUR. — Enfin, après deux mois d’efforts sublimes, l’héroïque Prosper put facilement passer pour un lion. Après l’avoir teint en jaune et baptisé Romulus, je l’installai dans une cage et, grâce à lui, nous pûmes rouvrir notre ménagerie.
LA FEMME DU VIEUX DOMPTEUR. — Pendant six mois, Prosper-Romulus a joué son rôle de lion sans défaillance. Mais, hélas ! voilà deux jours qu’il agonise, épuisé par son terrible effort. Le pauvre animal grelotte de fièvre dans notre lit, où nous l’avons couché pour le réchauffer.
LE VIEUX DOMPTEUR. — Tout espoir est perdu. (On entend un aboiement.) Tiens, entends, le pauvre animal n’a même plus la force de rugir. Courons à son chevet, courons.
DEUXIÈME ACTE
Les cambrioleurs.
La scène représente l’intérieur de la roulotte.
LE VIEUX DOMPTEUR. — Oh ! l’affreuse nuit ! Prosper-Romulus vient de mourir ! Nous veillons tristement notre vieux serviteur.
LA FEMME DU VIEUX DOMPTEUR. — Écoute ! Je ne me trompe pas. On dirait que l’on essaie d’ouvrir la porte.
LE VIEUX DOMPTEUR. — Bah ! Qu’importe ! Hélas ! Nous n’avons pas à craindre les cambrioleurs.
CHŒUR DES CAMBRIOLEURS SENSIBLES, ouvrant la porte. — Oh ! quel navrant spectacle s’offre à notre vue.
LE VIEUX DOMPTEUR, avec mélancolie. — Entrez ! (Montrant le cadavre de Prosper-Romulus.) Nous ne possédions rien que ce vieil ami. Dieu vient de nous le reprendre. Faites ce que vous voudrez.
PREMIER CAMBRIOLEUR SENSIBLE. — Oh ! malgré moi, mes yeux sinistres se mouillent de larmes.
DEUXIÈME CAMBRIOLEUR SENSIBLE. — La douleur règne en ces lieux. Retirons-nous respectueusement.
TROISIÈME CAMBRIOLEUR SENSIBLE. — Excusez-nous… On ne savait pas… On vous croyait riches…
LE VIEUX DOMPTEUR. — Riches ! Oh ! dérision. Mon dernier lion est mort et mes cages sont vides.
PREMIER CAMBRIOLEUR SENSIBLE. — Quoi ! Il ne vous reste plus un seul fauve ?
LE VIEUX DOMPTEUR. — Plus un seul.
CHŒUR DES CAMBRIOLEURS SENSIBLES. — Oh ! l’affreuse détresse ! Que faire, pour venir en aide à ces malheureux ?
PREMIER CAMBRIOLEUR SENSIBLE. — Oh ! quelle idée ! Sèche tes pleurs, vieux dompteur. Demain, tu pourras donner une grande représentation. Demain, grâce à mon idée, le public envahira ta vieille ménagerie. À demain ! (Il sort avec les autres cambrioleurs sensibles.)
TROISIÈME ACTE
Braves cœurs, va !
La scène représente la ménagerie, le lendemain.
LE PREMIER CAMBRIOLEUR SENSIBLE, arrivant. — Fidèle à ma promesse nocturne, me voici. Je viens poser devant votre ménagerie l’affiche composée par mes soins et qui, ce soir, attirera la foule dans votre établissement.
LE VIEUX DOMPTEUR. — Que voulez-vous dire ? Mais je n’ai plus de fauves !
LE PREMIER CAMBRIOLEUR SENSIBLE. — Vous en aurez : j’ai décidé quelques-uns de mes collègues à venir s’exhiber ce soir dans votre cage centrale. D’ailleurs, voici l’affiche. (Il pose l’affiche devant la ménagerie. Sur cette affiche on peut lire) :
GRANDE MÉNAGERIE RÉALISTE
CE SOIR :
GRANDE REPRÉSENTATION DE CHARITÉ
Avec le gracieux concours de MM.
Le Tigre du Sébasto,
Le Lion de Ménilmuche,
Le Chacal de la Bastoche,
L’Ours gris du Montparno,
La Panthère des Batignolles,
Le Léopard du Panthéon,
Etc., etc.
LE VIEUX DOMPTEUR, les yeux remplis de larmes. — Braves cœurs, va !
RIDEAU
LES DRAMES LÉGENDAIRES
NOËL ! NOËL !
Veillée en trois contes.
PREMIER CONTE
Sans-Noël !
La scène se passe devant une grande cheminée où flambent les bûches de Noël.
PREMIER GRAND-PÈRE CONTEUR, aux veilleurs assis autour de la cheminée. — Je vais, selon l’usage, vous raconter une histoire : l’Histoire du petit Sans-Noël.
CHŒUR DES ENFANTS ATTENTIFS. — Pourquoi qu’on l’appelait Sans-Noël ?
PREMIER GRAND-PÈRE CONTEUR. — Parce qu’il n’avait jamais rien trouvé dans sa cheminée le jour de Noël.
CHŒUR DES ENFANTS ATTENTIFS. — Il était peut-être méchant ?
PREMIER GRAND-PÈRE CONTEUR. — Non, il était très sage, au contraire. Il avait six ans et demi, et c’était vraiment le modèle des enfants de six ans et demi. Il était tellement sage, que tous les ans on organisait une exposition du petit garçon modèle, pour l’édification des autres enfants du village. Sa tenue était donnée en exemple à dix lieues à la ronde. Il ne rongeait jamais ses ongles comme les autres enfants.
CHŒUR DES ENFANTS ATTENTIFS. — Est-ce possible, Premier Grand-Père conteur ?
PREMIER GRAND-PÈRE CONTEUR. — Oui, Sans-Noël ne rongeait jamais ses ongles, mais comme c’était un bon petit cœur, il les donnait à ronger à ceux de ses camarades qui avaient ce vilain défaut. Bref, c’était le modèle des enfants modèles.
CHŒUR DES ENFANTS ATTENTIFS. — Mais, pourquoi qu’il n’avait jamais de Noël, alors ? Il était pauvre, peut-être, Premier Grand-Père conteur ?
PREMIER GRAND-PÈRE CONTEUR. — On ne put éclaircir ce mystère que plus tard, après bien des années de réflexions et de recherches ; le petit Sans-Noël ne trouvait jamais rien le jour de Noël parce qu’il ne pouvait pas mettre ses souliers dans la cheminée.
CHŒUR DES ENFANTS ATTENTIFS. — Pourquoi qu’il ne mettait pas ses souliers dans la cheminée ?
PREMIER GRAND-PÈRE CONTEUR. — Parce qu’il était cul-de-jatte de naissance.
DEUXIÈME CONTE
Le bonhomme de neige.
Même décor.
CHŒUR DES ENFANTS ATTENTIFS. — À toi, Deuxième Grand-Père conteur, raconte-nous ton histoire, selon l’usage.
DEUXIÈME GRAND-PÈRE CONTEUR. — Je vais vous raconter l’histoire du bonhomme de neige : il y avait une fois un père et une mère qui avaient beaucoup d’enfants. Heureusement pour eux, les parents de ces nombreux enfants étaient riches. Ils habitaient une jolie villa à la campagne. Un jour, la veille de Noël, le jardin de la villa était couvert de neige. Tous les enfants résolurent de faire un bonhomme de neige. Quand il fut terminé, ils lui plantèrent dans la bouche une pipe de leur père, et posèrent sur sa tête un vieux chapeau haut de forme trouvé dans le grenier.
CHŒUR DES ENFANTS ATTENTIFS. — Pourquoi qu’ils lui avaient mis un chapeau, au bonhomme de neige, Deuxième Grand-Père conteur ?
DEUXIÈME GRAND-PÈRE CONTEUR. — Probablement à cause de l’humidité. Bref, les enfants s’amusèrent toute la journée avec le bonhomme de neige. Aussi, le soir, il eut beaucoup de chagrin, en voyant ses petits amis rentrer dans la villa pour se coucher. « Enfin, se dit-il, une nuit est bien vite passée. Demain, les petits enfants reviendront s’amuser avec moi. » Puis le brave bonhomme de neige s’endormit sous le ciel étoilé de Noël. Il dormait à peine depuis une demi-heure, lorsqu’il se réveilla en sursaut : « Ça sent le brûlé ! dit-il. » Alors, ouvrant les yeux, il s’aperçut qu’un commencement d’incendie se déclarait dans un petit hangar situé près de la villa.
CHŒUR DES ENFANTS ATTENTIFS. — Pauvres petits enfants ! Ils ont été tous brûlés, Deuxième Grand-Père conteur ?
DEUXIÈME GRAND-PÈRE CONTEUR. — Non, grâce au dévouement du brave bonhomme de neige, ils furent tous sauvés. En voyant le danger que couraient ses petits amis, le bonhomme de neige s’élança vers la flamme qui couvait dans le hangar et, courageusement, se coucha dessus. Alors, il se mit à fondre, à fondre, et transformé en eau il éteignit rapidement le feu. Le lendemain, quand les petits enfants revinrent jouer dans le jardin, ils ne trouvèrent plus le bonhomme de neige. Seule, une petite flaque d’eau dans le hangar témoignait de son héroïsme. Mais personne n’y fit attention, et on accusa le chien.
CHŒUR DES ENFANTS ATTENTIFS, des larmes dans la voix. — Pauvre bonhomme de neige !
TROISIÈME CONTE
L’arbre de Noël.
Même décor.
LA FILLETTE SANS GRAND-PÈRE, aux autres enfants. — Vos deux grands-pères ont raconté des histoires. Mon grand-père aussi m’en racontait lorsqu’il était encore de ce monde. Pour le remplacer, mes parents m’ont acheté un grand-père conteur automatique. Le voici.
(Elle pose sur une chaise devant la cheminée un mannequin automatique représentant un grand-père.)
CHŒUR DES ENFANTS ATTENTIFS. — Il va nous raconter une histoire, ton grand-père conteur automatique ?
LA FILLETTE SANS GRAND-PÈRE. — Oui, il suffit pour cela de le monter comme une pendule. (Elle monte à l’aide d’une clé le grand-père conteur automatique.)
LE GRAND-PÈRE CONTEUR AUTOMATIQUE. — Je vais vous raconter l’histoire de « l’arbre de Noël ». Elle sera courte, car mon mécanisme ne me donne la parole que pendant dix minutes : il y avait une fois un vieux marquis issu de la plus haute noblesse. Étant complètement ruiné, il habitait une misérable mansarde avec ses six petits enfants. Un soir de Noël, n’ayant pour toute fortune qu’une cinquantaine de centimes, il acheta pour sa petite famille quelques jouets bon marché.
— C’est un arbre de Noël que nous voudrions, s’écrièrent tous ses petits enfants, lorsqu’il leur apporta les modestes jouets.
— Un arbre de Noël ! murmura le père. Hélas ! je n’ai plus d’argent pour satisfaire le désir de ces chers innocents.
Ses yeux erraient lamentablement sur le pauvre logis aux murs dénudés. Tout à coup, il aperçut le seul ornement suspendu à la cloison.
— J’ai trouvé, s’écria le vieux marquis. Vous allez avoir votre arbre de Noël !
Fou de joie, il décrocha d’une main fébrile le tableau suspendu au mur, et y attacha à l’aide d’épingles les jouets qu’il venait d’acheter.
Puis il alluma une douzaine d’allumettes-bougies et les planta dans le tableau. Alors, tous les enfants poussèrent des cris joyeux en apercevant l’objet de leur désir brillamment illuminé. Le vieux marquis venait d’improviser un arbre de Noël avec l’arbre généalogique de son illustre famille.
RIDEAU
À ma chère fille Jeannette
LE PETIT CHAPERON VERT
Drame pour les petits.
PREMIER ACTE
Coïncidences tragiques.
La scène représente l’intérieur d’une maison.
LE PÈRE DU PETIT CHAPERON VERT. — Nous habitons la maison où logeait autrefois le célèbre Petit Chaperon rouge, qui fut mangé par le loup.
LA MÈRE DU PETIT CHAPERON VERT. — Étrange coïncidence : notre ravissante petite fille porte avec tant de grâce un petit chapeau vert qu’on l’appelle partout : le Petit Chaperon vert.
LE PÈRE DU PETIT CHAPERON VERT. — Coïncidence plus extraordinaire encore : la mère-grand de notre petite fille demeure au village voisin, comme jadis celle du Petit Chaperon rouge, et pour aller chez elle, il faut traverser la forêt prochaine.
LA MÈRE DU PETIT CHAPERON VERT. — Ne dit-on pas aussi que le fameux loup qui dévora le Petit Chaperon rouge et sa mère-grand rôde toujours dans la forêt ?
LE PÈRE DU PETIT CHAPERON VERT. — Oui, toutes ces coïncidences sont particulièrement troublantes.
LA MÈRE DU PETIT CHAPERON VERT. — D’autant plus troublantes qu’aujourd’hui même j’ai fait cuire des galettes et…
LE PÈRE DU PETIT CHAPERON VERT, pâlissant. — Des galettes ! C’est affreux ! Ah ! je devine la suite ! Tu vas envoyer notre fille le Petit Chaperon vert porter à sa mère-grand une galette ?
LA MÈRE DU PETIT CHAPERON VERT. — Oui, une galette et un petit pot de beurre.
LE PÈRE DU PETIT CHAPERON VERT.— Un petit pot de beurre ! C’est horrible ! Ce sont là d’extraordinaires et tragiques coïncidences ! Mais, chut ! voici le Petit Chaperon vert qui revient de l’école.
LA MÈRE DU PETIT CHAPERON VERT, au Petit Chaperon vert. — Va voir comment se porte ta mère-grand. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre.
LE PETIT CHAPERON VERT, joyeusement. — Tiens, comme le Petit Chaperon rouge !
LA MÈRE DU PETIT CHAPERON VERT, avec anxiété. — Comme le Petit Chaperon rouge ! Oh ! mon cœur est rempli de sombres pressentiments. Dois-je la laisser partir ?
LE PETIT CHAPERON VERT. — Ne craignez rien, chers parents. Le Petit Chaperon vert est plus rusé que le Petit Chaperon rouge. Si par hasard je trouve le loup dans le lit de mère-grand, il ne pourra pas me dévorer. J’ai une idée. (Elle part.)
DEUXIÈME ACTE
La ruse du Petit Chaperon vert.
La scène représente l’intérieur de la maison de la mère-grand.
LE LOUP QUI MANGEA JADIS LE PETIT CHAPERON ROUGE, couché dans le lit. — Dès que j’ai aperçu le Petit Chaperon vert se diriger vers la maison de sa mère-grand, j’ai opéré de la même manière qu’autrefois pour le Petit Chaperon rouge. Je suis arrivé le premier chez la mère-grand. J’ai dévoré rapidement cette vieille dame, j’ai pris sa place dans le lit et j’attends le Petit Chaperon vert, qui ne va pas tarder à heurter à la porte.
LE PETIT CHAPERON VERT, frappant à la porte. — C’est votre fille le Petit Chaperon vert qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre.
LE LOUP QUI MANGEA JADIS LE PETIT CHAPERON ROUGE, adoucissant sa voix. — Tirez la chevillette et la bobinette cherra. (Le Petit Chaperon vert entre.) — Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche, et viens te coucher auprès de moi.
LE PETIT CHAPERON VERT, à part. — Ciel ! C’est le loup ! Je reconnais la même phrase qu’il prononça jadis pour attirer le Petit Chaperon rouge dans son lit. Le misérable est en train de digérer mère-grand, mais grâce à mon idée, il lui sera impossible de me dévorer.
LE LOUP QUI MANGEA JADIS LE PETIT CHAPERON ROUGE. — Eh bien, viens-tu te coucher, mon enfant ?
LE PETIT CHAPERON VERT, se couchant près du loup. — Me voilà. Oh ! mère-grand, que vous avez de grands bras ?
LE LOUP QUI MANGEA JADIS LE PETIT CHAPERON ROUGE. — C’est pour mieux t’embrasser, mon enfant.
LE PETIT CHAPERON VERT. — Mère-grand, que vous avez de grandes jambes !
LE LOUP QUI MANGEA JADIS LE PETIT CHAPERON ROUGE. — C’est pour mieux courir, mon enfant.
LE PETIT CHAPERON VERT. — Mère-grand, que vous avez de grandes oreilles !
LE LOUP QUI MANGEA JADIS LE PETIT CHAPERON ROUGE. — C’est pour mieux t’écouter, mon enfant.
LE PETIT CHAPERON VERT. — Mère-grand, que vous avez de grands yeux !
LE LOUP QUI MANGEA JADIS LE PETIT CHAPERON ROUGE. — C’est pour mieux te voir, mon enfant ! (À part.) Apprêtons-nous !
LE PETIT CHAPERON VERT. — Mère-grand, que vous avez de grands bras !
LE LOUP QUI MANGEA JADIS LE PETIT CHAPERON ROUGE, interloqué. — Mais tu l’as déjà dit, mon enfant.
LE PETIT CHAPERON VERT, continuant. — Mère-grand, que vous avez de grandes jambes !
LE LOUP QUI MANGEA JADIS LE PETIT CHAPERON ROUGE. — Mais tu répètes toujours la même chose ! Voyons, il y a autre chose à demander, par exemple (Insinuant.) : mère-grand, que vous avez de grandes…
LE PETIT CHAPERON VERT. — … de grandes oreilles !
LE LOUP QUI MANGEA JADIS LE PETIT CHAPERON ROUGE. — Mais non, de grandes… de grandes… (Très insinuant.) ça commence par un d.
LE PETIT CHAPERON VERT. — … de grandes jambes !
LE LOUP QUI MANGEA JADIS LE PETIT CHAPERON ROUGE, sautant du lit. — Enfer et damnation !!! Ce Petit Chaperon vert se joue de moi ! Cette rusée petite fille s’obstine à ne pas dire : « Mère-grand, que vous avez de grandes dents ! » Alors, naturellement, je ne peux pas sauter sur elle et lui répondre : « C’est pour te manger ! » (Avec un soupir de regret.) Ah ! où sont les enfants naïfs et faciles à dévorer d’autrefois ? (Il sort, furieux.)
RIDEAU
LE FILS DE ROMÉO
ou
L’ENFANT DE LA HAINE
PREMIER ACTE
Haines de races.
La scène représente le cabinet de travail de Capulet.
LE VÉNÉRABLE CAPULET. — En vain j’interroge en mes ardentes veilles les archives de ma noble famille. Impossible de découvrir l’origine de la haine séculaire des Capulets pour les Montaigus, et réciproquement, des Montaigus pour les Capulets.
LE SECRÉTAIRE DE CAPULET. — Je viens de compulser le dernier parchemin. Je ne trouve rien.
LE VÉNÉRABLE CAPULET. — Tant pis. J’aurais pourtant été curieux de connaître l’origine de ma haine farouche pour les Montaigus. Mais voici ma fille Juliette qui pénètre dans mon cabinet.
JULIETTE CAPULET. — Père, je viens vous confier le secret de mon âme : j’aime Roméo, fils des Montaigus. Il m’aime. Mariez-nous.
LE VÉNÉRABLE CAPULET. — Purgatoire ! Toi épouser le fils de mon ennemi héréditaire ! Que mes yeux changent d’orbites si je donne jamais mon consentement. J’ai dit.
DEUXIÈME ACTE
Le narcotique.
La scène représente le balcon de Juliette.
ROMÉO. — Minuit. Me voici devant la maison de Juliette. L’armoire à glace est attachée à son balcon. C’est le signal. Je peux monter. Plaçons cette vulgaire échelle de jardinier contre le mur et montons accrocher ma poétique échelle de soie au balcon de Juliette. (Il monte et accroche l’échelle de soie au balcon.) Maintenant, redescendons, enlevons la vulgaire échelle de jardinier et montons définitivement par la poétique échelle de soie. (Il remonte.)
JULIETTE. — Cher Roméo, pour cause de haine héréditaire, mon père refuse son consentement.
ROMÉO. — Mes parents sont également inflexibles. La haine séculaire qui divise nos deux familles fait notre malheur.
JULIETTE. — Nous n’avons plus qu’à mourir.
ROMÉO. — Non, chère Juliette. J’ai consulté un vieil ermite de mes amis. Il m’a donné un narcotique de sa composition.
JULIETTE. — Je ne comprends pas.
ROMÉO. — Tu vas comprendre. Ce narcotique que nous allons boire nous donnera l’apparence de la mort et nous endormira pour une soixantaine d’années. À notre réveil, la colère de nos parents sera sans doute calmée. Nous pourrons nous aimer en toute sécurité.
JULIETTE. — Mais, cher Roméo, si je calcule bien, comme nous avons dix-huit ans aujourd’hui, à notre réveil nous serons âgés de soixante-dix-huit ans ?
ROMÉO. — Oui. Mais ce merveilleux narcotique conserve la jeunesse. Nous nous réveillerons dans soixante ans aussi jeunes qu’à présent.
JULIETTE. — C’est merveilleux. Buvons. Mais auparavant déposons sur la cheminée cette lettre dans laquelle nous demandons à être ensevelis ensemble. Buvons !
ROMÉO. — Buvons ! (Ils boivent et s’endorment.)
TROISIÈME ACTE
Soixante ans après.
La scène représente une chambre.
ROMÉO. — Tout s’est bien passé. Nous avons dormi soixante ans sous l’influence du narcotique. Hier soir, vers sept heures un quart, nous nous sommes réveillés et nous avons pu quitter notre caveau de famille sans attirer l’attention.
JULIETTE. — Nous sommes aussi jeunes et aussi beaux que le jour de notre mort artificielle.
ROMÉO. — Nous allons pouvoir nous aimer librement. Tous nos parents sont morts depuis longtemps. Les Capulets et les Montaigus ont fini par se massacrer jusqu’au dernier. Nous sommes les seuls descendants des deux familles ennemies.
JULIETTE. — Non, cher Roméo, car je vais être mère.
ROMÉO. — Mère ?
JULIETTE. — Oui. J’avais oublié de te prévenir : avant de prendre le narcotique, j’étais déjà enceinte de tes œuvres.
ROMÉO. — C’est insensé ! Mais alors, tu es enceinte de soixante ans ?
JULIETTE. — Oui. Je ne pouvais mettre mon enfant au monde pendant ma léthargie.
ROMÉO. — C’est vrai, puisque tu dormais. Mais il n’y a pas de temps à perdre. Je cours chercher un médecin.
QUATRIÈME ACTE
L’enfant de la haine.
Même décor.
ROMÉO. — C’est assez curieux. Juliette vient de mettre au monde un enfant de cinquante-neuf ans. Ce cher innocent m’intimide avec sa longue barbe grise. Mais le voici qui vient dans les bras de sa nourrice.
LE FILS DE ROMÉO ET JULIETTE. — Mon père, soyez maudit. Ma mère vient de m’apprendre l’histoire du narcotique. Grâce à votre ridicule invention, j’ai langui, triste et solitaire, dans mon obscure retraite, sans pouvoir vivre ma vie. Grâce à votre amour égoïste, j’arrive au monde à l’âge où l’on est près d’en sortir, et, suprême ironie, j’ai l’air d’être le grand-père de mes propres parents.
ROMÉO. — Pardon ! mon fils ! Pardon !
LE FILS DE ROMÉO ET JULIETTE. — Non. Soyez maudit ! Comprimé pendant cinquante-neuf ans dans le sein de ma mère, je n’ai pu me développer normalement. Seules les rides de mon front se sont creusées d’année en année. Seule ma barbe a poussé et blanchi. Soyez maudit pour infliger à un sexagénaire l’humiliation de se voir emmailloter dans des langes de nouveau-né.
ROMÉO. — Je t’aime malgré tout. Tu es mon fils ! mon sang ! Le sang des Montaigus !
LE FILS DE ROMÉO ET JULIETTE, hurlant. — Montaigu ! Il a dit Montaigu ! Ce nom seul me fait bouillir de colère ! Je me sens pris d’une irrésistible envie de carnage ! Tue ! Tue ! Sus aux Montaigus. (Il fait tournoyer son biberon et le lance sur Roméo)
ROMÉO, s’écroulant. — Mon fils, tu m’as tué ! Je vais mourir dans quelques minutes.
JULIETTE, accourant. — Ciel ! Que se passe-t-il ?
ROMÉO. — Je vais mourir, chère Juliette Capulet.
LE FILS DE ROMÉO ET JULIETTE, hurlant. — Capulet ! J’ai bien entendu ! Capulet ! Ce nom me fait subitement bouillir de colère. Tue ! Tue ! Sus aux Capulets ! (Il étrangle Juliette.)
JULIETTE. — Je vais mourir.
LA NOURRICE. — Qu’avez-vous fait, vilain garçon ?
ROMÉO, d’une voix faible. — L’approche de la mort me donne une grande lucidité. Nous mourons victimes de notre fatal amour. Notre fils a par toi du sang des Capulets dans les veines. Il n’a pu supporter la vue d’un Montaigu. La haine de race s’est réveillée en lui. C’est pour cela qu’il m’a tué. (Il meurt.)
JULIETTE, d’une voix faible. — Fatalité ! L’enfant possède aussi par Roméo du sang des Montaigus dans les veines. Il m’a étranglée par haine des Capulets. (Elle meurt.)
LE FILS DE ROMÉO ET JULIETTE, hurlant. — C’est horrible ! Les sangs ennemis des Capulets et des Montaigus se combattent en moi ! Sus aux Capulets ! Sus aux Montaigus ! (Il prend un couteau dans chaque main.) Mort aux Capulets ! (Il se perce le côté droit.) Mort aux Montaigus ! (Il se perce le côté gauche et tombe mort.)
LA NOURRICE. — Fatalité ! Fatalité !
RIDEAU
CONTES DE LA DILIGENCE
PROLOGUE
Le vieux postillon.
La scène représente une cour d’auberge.
LE TOURISTE MODERNE, à sa femme. — Nous sommes en panne dans cette vieille auberge.
L’AUBERGISTE. — Pendant que votre chauffeur répare l’auto, je ne saurais trop vous engager à pénétrer dans cette vieille diligence que vous apercevez dans la cour de l’auberge.
LE TOURISTE MODERNE. — Pourquoi ?
L’AUBERGISTE. — Pour écouter les contes du vieux postillon. Je vais vous expliquer. C’est le dernier postillon. Il est vieux, vieux, très vieux. Il a plus de cent ans. Alors, par charité je le laisse vivre dans sa vieille diligence. Moyennant un léger supplément, les personnes qui s’arrêtent à l’auberge peuvent pénétrer dans la vieille diligence, où le centenaire-postillon leur raconte des histoires du bon vieux temps. C’est très curieux. Le vieux conteur a conservé son classique costume de postillon. C’est très pittoresque. Entrez. (Il ouvre la portière de la vieille diligence.)
LES TOURISTES MODERNES. — C’est très pittoresque. Entrons. (Ils entrent dans la vieille diligence.)
PREMIER CONTE DU POSTILLON
La mouche du coche.
La scène représente l’intérieur de la vieille diligence.
LES TOURISTES MODERNES. — Nous sommes assis sur la banquette poussiéreuse de la vieille diligence. Le vieux postillon fait claquer son fouet pour annoncer qu’il va prendre la parole.
LE VIEUX POSTILLON, faisant claquer son fouet. — Clic ! Clac ! Premier conte : La Mouche du coche. Cette mouche était vraiment extraordinaire. Elle appartenait à une sorte de vieux mendiant qui passait pour un peu fou dans le pays. Ce vieux mendiant, que l’on surnommait le père La Mouche, à cause de l’insecte qu’il portait toujours dans une petite cage, venait s’installer tous les matins au bas de la côte qui conduisait au village. Ah ! c’était une rude côte que cette côte ! La terreur des postillons ! Un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, comme disait le fabuliste. Aussi, lorsque la diligence arrivait au pied de la côte, les postillons apercevaient avec joie le vieux père La Mouche et sa fidèle compagne enfermée dans sa petite cage.
LES TOURISTES MODERNES. — Pourquoi les postillons apercevaient-ils avec joie le vieux père La Mouche et sa fidèle compagne enfermée dans sa petite cage ?
LE VIEUX POSTILLON. — Parce que le père La Mouche, s’inspirant de la célèbre fable du bon La Fontaine, avait patiemment dressé son intelligente mouche. Dès qu’une diligence s’apprêtait à monter la côte, le père La Mouche criait d’une voix sonore : « Voici la véritable mouche du coche ! Celle qui tira d’affaire le fameux coche dont parle le fabuliste ! On loue la mouche pour la montée ! Demandez la véritable mouche du coche ! »
» Sans hésiter nous tendions quelques sous au père La Mouche, celui-ci ouvrait la porte de la petite cage, et son extraordinaire petite mouche s’élançait en bourdonnant sur les chevaux. Piquant l’un, piquant l’autre, nous excitant nous-mêmes par ses bourdonnements, la courageuse mouche vous faisait grimper la diligence en moins de temps qu’il n’en faut pour le raconter.
» Tous les postillons la connaissaient, cette brave mouche, et jamais une diligence ne gravit la côte du village sans réclamer son concours.
» Hélas ! La malheureuse périt d’une façon tragique : son maître ayant laissé sur sa table un livre des fables de La Fontaine, la fidèle mouche se mit à courir sur le livre ouvert. Mais, ô fatalité ! le livre était justement ouvert à la fable le Coche et la Mouche. Lorsqu’elle eut achevé la lecture de la fable, la pauvre mouche sentit son petit cœur se serrer douloureusement. Elle, qui se donnait tant de mal pour faire monter les diligences, être ainsi ridiculisée dans cette fable ! La pauvrette ne put supporter un tel affront et résolut de se suicider.
» Lorsque le vieux père La Mouche rentra, il aperçut sur la page de son livre ouvert cette simple phrase, écrite en véritables pattes de mouches : « C’est trop d’injustice ! » Il chercha partout sa mouche fidèle, mais ne la trouva point. Quelques mois plus tard, comme il trempait sa plume d’oie dans son vieil encrier de corne, le père La Mouche retira le cadavre de sa petite compagne, qui n’avait pas pu survivre à la calomnie. »
DERNIER CONTE DU POSTILLON
Le repas de l’ogre.
Même décor.
LE VIEUX POSTILLON, faisant claquer son fouet. — Clic ! clac ! Dernier conte : Le Repas de l’ogre.
» Il y avait une fois un ogre qui vivait très retiré dans une sombre forêt, en compagnie de sa femme l’ogresse. C’était, comme tous les ogres d’ailleurs, un géant de la grande espèce. Il adorait la chair fraîche et vous avalait un couple de bûcherons comme qui badine. Un soir, en parcourant la sombre forêt, il vit arriver sur la route une diligence remplie de voyageurs.
» Tel un enfant brisant un jouet d’un coup de pied, l’ogre, d’un léger coup de bottes de sept lieues, fit chavirer la diligence dans le fossé, et s’emparant des voyageurs affolés, il en garnit ses poches et regagna sa caverne.
» — Femme, dit-il en entrant, j’apporte le dîner. Mets le couvert.
» Docile, sa femme plaça sur la table la gigantesque assiette de l’ogre, son grand couteau et son énorme fourchette. L’ogre se mit à table. Dans son assiette, tels de véritables lilliputiens, gigotaient éperdument les voyageurs de la diligence.
» Un moine qui lisait son bréviaire fut embroché d’un coup de fourchette implacable et avalé le premier. Puis successivement un vieux colonel, un gros commerçant, une veuve grassouillette, un gendarme et tous les voyageurs sans exception furent avalés par l’ogre affamé et par l’ogresse. L’ogre avait observé pour son repas l’ordre hiérarchique. Ayant croqué les voyageurs en premier, il s’attaqua, pour terminer son repas, aux malheureux postillons ! D’un dernier coup de fourchette, il lança les trois postillons dans sa bouche. Déjà il s’apprêtait à les broyer sous ses dents formidables lorsqu’une grosse plaisanterie de sa femme le fit éclater de rire. Sa bouche s’ouvrit soudain et sous l’irrésistible poussée de ce rire formidable, les malheureux postillons, tout humides de salive, furent projetés de la bouche de l’ogre sur le visage de l’ogresse.
» — Dégoûtant personnage ! s’écria celle-ci en s’essuyant la face, avec ta manie de rire la bouche pleine, tu m’as lancé des postillons en plein visage !
» Et voilà l’origine de l’expression populaire « lancer des postillons ou postillonner ». Voilà.
RIDEAU
LES DRAMES DE L’HISTOIRE
LA FIANCÉE DU FAUCONNIER
PREMIER ACTE
L’odieux madrigal.
La scène représente la maison de la Fiancée du Fauconnier.
LA FIANCÉE DU FAUCONNIER, à sa fenêtre. — Ainsi qu’il le fait tous les jours en se rendant à sa fauconnerie, mon fiancé va bientôt passer devant ma maison. J’entends déjà sa joyeuse chanson qu’il lance à pleine voix aux échos du vallon.
VOIX DU JOYEUX FAUCONNIER, chantant.
Ni le gendarme en sa gendarmerie,
Ni le berger dedans sa bergerie,
Ni chaudronnier dans sa chaudronnerie,
Ni coconnier dans sa coconnerie,
Ne sont plus gais, je vous le certifie,
Qu’un fauconnier dans sa fauconnerie !
Qu’un fauconnier dans sa fauconnerie !
LA FIANCÉE DU FAUCONNIER. — Comme il est gai ! Vais-je lui apprendre la fâcheuse nouvelle ? Mais le voici.
LE JOYEUX FAUCONNIER, entrant dans la maison. — Chère fiancée ! (Ils échangent de doux baisers.) Par saint Hubert ! comme tu es pâle aujourd’hui ! Mais, je ne me trompe pas, tes beaux yeux ont pleuré ?
LA FIANCÉE DU FAUCONNIER. — Hélas ! oui, cher fauconnier bien-aimé, et voici le motif de mon chagrin : Depuis longtemps déjà, le « Gentilhomme sans scrupules » qui habite le château voisin brûle pour moi d’une luxurieuse flamme. Hier, il m’a fait parvenir cet odieux madrigal. Lis, cher fiancé. (Elle lui tend le madrigal.)
LE JOYEUX FAUCONNIER, lisant. — L’Oiseau que je voudrais chasser…
J’ai chassé dans ma vie
D’étranges animaux,
Des carnassiers, des amphibies,
Des crustacés, des marsupiaux,
Des primates, des lémuriens
Et même des proboscidiens.
Mais à présent, ma toute belle,
Je voudrais chasser un oiseau !…
Un doux oiseau, un tendre oiseau !…
…
Donnez-moi le permis, cruelle !
LA FIANCÉE DU FAUCONNIER, rougissant. — Oh ! l’odieux madrigal !
LE JOYEUX FAUCONNIER, avec rage. — Oui, l’odieux madrigal ! Le machiavélique sous-entendu ! L’infernale versification à double sens ! Mais rassure-toi, chère fiancée, jamais, moi vivant, le Gentilhomme sans scrupules n’osera chasser le tendre oiseau auquel il fait allusion ! À bientôt ! Je regagne ma fauconnerie.
DEUXIÈME ACTE
La fiancée enlevée.
La scène représente la fauconnerie.
LE JOYEUX FAUCONNIER, chantant dans la fauconnerie.
Ni l’hostelier dans son hostellerie,
Ni le porcher dedans sa porcherie,
Ni pâtissier dans sa pâtisserie,
Ni pétardier dans sa pétarderie,
Ne sont plus gais, je vous le certifie,
Qu’un fauconnier dans sa fauconnerie !
Qu’un fauconnier dans sa fauconnerie !
(Parlant.) Certes, je peux le dire sans me vanter, je suis le roi des fauconniers, et nul ne peut rivaliser avec moi dans l’art de la fauconnerie ! Avec moi, faucons et fauconneaux apprennent rapidement à chasser les différentes espèces d’oiseaux, à planer, à fondre sur le gibier et à rapporter. Mais que vois-je ? La vieille servante de ma chère fiancée franchit le seuil de la fauconnerie et s’élance vers moi en faisant des gestes désespérés.
LA VIEILLE SERVANTE. — Ah ! l’affreuse nouvelle ! Accourez, cher fauconnier, votre fiancée vient d’être enlevée par le Gentilhomme sans scrupules ! Au galop de son cheval, le misérable l’a emportée vers son château ! Il va la cacher dans quelque endroit secret et jamais peut-être ne retrouverons-nous votre chère fiancée !
LE JOYEUX FAUCONNIER. — Nous la retrouverons ! Il me vient une fameuse idée ! (Il prend son faucon favori et le place sur son poing.)
LA VIEILLE SERVANTE. — Pourquoi vous embarrasser d’un faucon ?
LE JOYEUX FAUCONNIER. — Il le faut ! Courons ! J’ai mon idée !
TROISIÈME ACTE
L’idée du fauconnier.
La scène représente l’intérieur d’un pavillon de chasse.
LE GENTILHOMME SANS SCRUPULES, à la fiancée du fauconnier. — Ici, dans ce pavillon de chasse, je vais pouvoir abuser de vous en toute sécurité.
LA FIANCÉE DU FAUCONNIER. — Infâme ! Mon fiancé me vengera !
LE GENTILHOMME SANS SCRUPULES, ricanant. — Ton fiancé, ma belle, doit battre le pays pour te retrouver, mais avant qu’il ne découvre ce pavillon de chasse, bâti dans cet endroit désert, j’aurai le temps d’assouvir mon ardente passion.
LA FIANCÉE DU FAUCONNIER. — Horreur ! le misérable s’avance vers moi ! Ses yeux luisent d’une lubrique convoitise ! Ses mains se tendent vers moi dans un but inavouable !
LE GENTILHOMME SANS SCRUPULES, s’approchant de plus en plus. — Dans trois minutes au plus tard, que restera-t-il de la chaste fiancée du fauconnier ? (Tressaillant.) Hein ? Quel est ce bruit ? Qui frappe aux vitres de la fenêtre ?
LA FIANCÉE DU FAUCONNIER. — Oh ! Que veut dire cela ? C’est le faucon favori de mon cher fiancé qui frappe à coups de bec contre la fenêtre.
VOIX DU JOYEUX FAUCONNIER. — Courage ! chère fiancée ! Me voici ! (La porte du pavillon de chasse vole en éclats. Le Joyeux Fauconnier se précipite à l’intérieur.)
LE GENTILHOMME SANS SCRUPULES. — Je suis perdu !
LE JOYEUX FAUCONNIER. — Meurs donc, infâme ! (Il le pourfend.)
LA FIANCÉE DU FAUCONNIER. — Sauvée !
LE JOYEUX FAUCONNIER. — Oui, sauvée, grâce à mon fidèle faucon de chasse.
LA FIANCÉE DU FAUCONNIER. — Grâce à ton fidèle faucon ?
LE JOYEUX FAUCONNIER. — Oui. Dès que j’ai appris ton enlèvement, sachant que le Gentilhomme sans scrupules en voulait à ton honneur, j’eus l’ingénieuse idée de lancer mon fidèle faucon chasseur au-dessus des terres de ton infâme ravisseur. Commences-tu à comprendre ?
LA FIANCÉE DU FAUCONNIER. — Non, cher fiancé.
LE JOYEUX FAUCONNIER. — C’est pourtant bien simple. Dès que j’eus lâché mon faucon, celui-ci se mit à planer un instant au-dessus des terres de ton ravisseur pour chercher une proie. Soudain, ses yeux perçants aperçurent, à travers la fenêtre du pavillon de chasse, le charmant oiseau que poursuivait l’infâme gentilhomme, le tendre oiseau prêt à s’envoler à tout jamais ! Alors, rapide comme la foudre, mon faucon s’élança vers la fenêtre pour fondre sur l’oiseau qu’il avait aperçu, m’indiquant ainsi l’endroit où ton honneur était en péril. Voilà !
RIDEAU
LA CROISADE
PREMIER TABLEAU
Le départ des Croisés.
La scène se passe devant un château.
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS. — Nous faisons partie de la Croisade organisée par Godefroy de Bouillon. Dans dix minutes nous partons pour la Palestine. Dépêchez-vous, Croisé, mon voisin.
LE CROISÉ-PRUDENT, à la fenêtre de son château. — Le temps d’enlever les portes de mon château et je suis à vous.
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS. — Enlever les portes de votre château ?
LE CROISÉ-PRUDENT. — Oui. À cause des voleurs. Pendant mon absence, on pourrait s’introduire au château en fracturant les portes. Je les emporte en Palestine avec moi. De cette façon, impossible de crocheter les serrures et de pénétrer ici.
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS. — C’est ingénieux.
LE CROISÉ-PRUDENT. — Simple précaution. (Il enlève les deux portes de son château.) Là, voici les deux portes enlevées. Je les attache sur mon fidèle destrier. Et maintenant, en route ! Je pars tranquille.
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS. — En route ! Partons pour la Syrie !
DEUXIÈME TABLEAU
La périlleuse mission.
La scène se passe devant Jérusalem.
GODEFROY DE BOUILLON, aux Croisés. — Nous voici devant Jérusalem. Les Sarrasins vont s’élancer sur nous d’une minute à l’autre.
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS. — Seigneur Godefroy de Bouillon, les Infidèles préparent leur repas de midi. Nous n’avons pas à craindre de surprise pour l’instant.
LE CROISÉ-PRUDENT. — S’ils préparent leur déjeuner, nous allons gagner la bataille, car il me vient une fameuse idée.
GODEFROY DE BOUILLON. — Parle !
LE CROISÉ-PRUDENT. — Vous n’ignorez pas, Croisés mes frères, que j’ai emporté avec moi, par crainte des voleurs, les portes de mon château ?
LES CROISÉS. — Nous ne l’ignorons pas.
GODEFROY DE BOUILLON. — Tu as même payé, avant ton départ, l’impôt des « Portes et Croisés ».
LE CROISÉ-PRUDENT. — Eh bien, avec une seule de mes portes, je me charge de vous faire gagner la bataille.
GODEFROY DE BOUILLON. — Gagner la bataille ?
LE CROISÉ-PRUDENT. — Je demande seulement un Croisé de bonne volonté pour une périlleuse mission.
LE JEUNE Et BEAU DUNOIS. — Présent !
LE CROISÉ-PRUDENT. — Bien. Prenez dans la pharmacie de notre ambulance une seringue du plus fort calibre, remplissez-la d’huile de ricin et allez décharger votre arme, sans qu’ils s’en aperçoivent, dans le ragoût que préparent les Sarrasins. (Le Jeune et Beau Dunois court vers l’ambulance.)
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS, revenant avec une énorme seringue. — Je suis prêt.
LE CROISÉ-PRUDENT. — Elle est chargée ?
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS. — Oui.
LE CROISÉ-PRUDENT. — Alors, vous pouvez partir. Nous allons attirer l’attention des Sarrasins en poussant des cris séditieux. Vous profiterez de l’instant où ils tourneront la tête dans notre direction pour accomplir votre périlleuse mission. (Le Jeune et Beau Dunois, sa seringue entre les dents, rampe vers le camp des Infidèles. Les Croisés poussent, à pleins poumons, des cris séditieux. Les Sarrasins, surpris par ce vacarme, tournent curieusement leurs têtes vers le camp des Croisés. Le Jeune et Beau Dunois vise rapidement et décharge sa seringue d’huile de ricin, à bout portant, dans le ragoût ennemi. Il revient ensuite, en rampant à toutes jambes, vers ses compagnons d’armes.)
LE CROISÉ-PRUDENT, après avoir dressé et calé une de ses portes sur le sol. — Et maintenant, grâce à cette porte, nous pouvons considérer la bataille comme gagnée !
TROISIÈME TABLEAU
La bataille.
Même décor. Plus la porte dressée sur le sol.
GODEFROY DE BOUILLON. — Les Infidèles achèvent leur repas.
LE CROISÉ-PRUDENT. — Seigneur Godefroy de Bouillon, il faut qu’une moitié de l’armée s’élance sus aux Sarrasins et les rabatte vers nous. L’autre moitié s’embusquera derrière ma porte.
GODEFROY DE BOUILLON, aux Croisés. — Apprêtez vos masses d’armes et vos épées à triple tranchant, et sus aux Sarrasins ! (La moitié de l’armée s’élance vers le camp ennemi. L’autre moitié s’embusque derrière la porte.)
LE CROISÉ-PRUDENT, derrière la porte. — Le combat est engagé. Les Sarrasins surpris sont refoulés de notre côté.
GODEFROY DE BOUILLON. — Ils tiennent leur lance d’une main et leur ventre de l’autre.
LE CROISÉ-PRUDENT. — Leurs visages expriment une terrible angoisse. Tout va bien.
UN SARRASIN, hurlant en patois sarrasin. — Tbhskwf ! (Il aperçoit la porte, l’ouvre précipitamment, la referme sur lui et se fait assommer de l’autre côté par les Croisés embusqués.)
UN AUTRE SARRASIN, hurlant. — Tbhskwf ! (Il aperçoit la porte, l’ouvre précipitamment, la referme sur lui et se fait assommer de l’autre côté comme le premier Sarrasin. Les uns après les autres, tous les Sarrasins franchissent la fatale porte et sont tués de la même manière.)
LES CROISÉS. — Victoire !
GODEFROY DE BOUILLON. — Nous expliqueras-tu, maintenant, pourquoi tous les Sarrasins se sont fait égorger les uns après les autres en franchissant le seuil de cette porte ?
LE CROISÉ-PRUDENT. — Parce que la purge faisait son effet, et que j’avais posé sur la porte un écriteau avec ces lettres magiques : W.-C.
QUATRIÈME TABLEAU
L’entrée triomphante à Jérusalem.
Le décor représente Jérusalem inondée par les feux du soleil couchant.
GODEFROY DE BOUILLON. — J’entre triomphalement dans Jérusalem !
LES CROISÉS. — Nous entrons triomphalement dans Jérusalem !
LES HIÉROSOLYMITAINS, avec rage. — Ils entrent triomphalement dans Jérusalem !
CINQUIÈME TABLEAU
Séquestrés dans le désert.
La scène représente un désert brûlant.
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS. — Huit jours après notre entrée triomphale dans Jérusalem, nous avons été, tous les deux, attirés dans un guet-apens, faits prisonniers et séquestrés dans ce désert brûlant.
LE CROISÉ-PRUDENT. — Le soleil va devenir notre bourreau.
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS. — La température est très élevée. Pour moi, j’attends la mort comme une délivrance.
LE CROISÉ-PRUDENT. — Ne vous lamentez pas, Jeune et Beau Dunois. Je vais essayer de trouver une idée pour nous tirer de ce mauvais pas. (Il se plonge la tête dans le sable pour réfléchir plus profondément et la ressort quelques minutes après.) J’ai trouvé !
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS. — Une idée ?
LE CROISÉ-PRUDENT. — Oui, une idée. (Avec joie.) Quel bonheur que les Sarrasins, en nous abandonnant dans ce désert brûlant, ne m’aient pas dépouillé de mes portes.
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS. — Pourquoi ?
LE CROISÉ-PRUDENT. — Parce que ces portes vont nous sauver encore une fois.
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS. — Je ne comprends pas.
LE CROISÉ-PRUDENT. — Vous allez comprendre. (Il prend les deux portes et les pose debout dans le sable, l’une en face de l’autre, à quelques mètres de distance.)
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS. — Que faites-vous ?
LE CROISÉ-PRUDENT, ouvrant les deux portes placées face à face. — J’établis un courant d’air. Mettons-nous entre ces deux portes.
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS. — Quel air frais ! On respire enfin !
LE CROISÉ-PRUDENT. — Grâce à mes portes nous pouvons quitter ce désert et regagner notre patrie à petites journées. Dès que nous aurons trop chaud, nous rétablirons le courant d’air. (Après s’être suffisamment aérés, ils prennent les portes et se mettent en marche.)
SIXIÈME TABLEAU
Le retour des Croisés.
La scène représente le château du premier tableau.
LE CROISÉ-PRUDENT. — Nous revenons de Palestine. (Apercevant son château.) Mais, voici mon château, si je ne me trompe ? Remettons d’abord les portes pour pouvoir ouvrir et entrer. (Il remet les portes, ouvre et entre, suivi du Jeune et Beau Dunois.) Ciel ! on a dévalisé mon château pendant mon absence ! Les voleurs ont tout enlevé !
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS, intrigué. — Comment ont-ils pu pénétrer céans ?
LE CROISÉ-PRUDENT. — Je me le demande. Ce n’est pas en fracturant les portes, puisque je les ai emportées avec moi en Palestine.
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS. — Ces voleurs modernes sont véritablement ingénieux. Mais, j’y pense ! Ils ont dû passer par la fenêtre.
LE CROISÉ-PRUDENT. — C’est juste. J’aurais dû prévoir. Mais qu’avez-vous, Jeune et Beau Dunois ? Vous pâlissez à vue d’œil. Seriez-vous malade ?
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS. — Permettez que je me retire dans mon château. Je vais m’aliter.
LE CROISÉ-PRUDENT. — Vous aliter ?
LE JEUNE ET BEAU DUNOIS. — Oui. J’ai sûrement attrapé un chaud et froid dans le désert brûlant avec vos satanés courants d’air !
RIDEAU
L’HOMME AU MASQUE DE FER
Drame de la Mi-Carême.
PREMIER ACTE
Gouverneur et prisonnier.
La scène représente un cachot de la Bastille.
L’HOMME AU MASQUE DE FER. — À cause de la ressemblance de ma démarche avec la sienne, le roi Louis XIV m’a fait river un masque de fer et jeter à la Bastille pour que l’on ne me confonde pas avec lui. Inutile d’ajouter que je ne cherche qu’une occasion pour m’évader.
LE GOUVERNEUR DE LA BASTILLE. — J’apprends, monsieur, que vous avez essayé d’acheter votre geôlier pour qu’il favorise vos plans d’évasion. Afin d’éviter que cela se renouvelle, à partir d’aujourd’hui vous aurez un geôlier manchot.
L’HOMME AU MASQUE DE FER. — Un geôlier manchot ?
LE GOUVERNEUR DE LA BASTILLE. — Oui. De cette façon, il ne pourra prêter la main à vos projets d’évasion. (Il sort.)
DEUXIÈME ACTE
Préparatifs d’évasion.
Même décor, le lendemain.
L’HOMME AU MASQUE DE FER. — Grâce à mon geôlier manchot qui ne peut fermer les portes, j’ai réussi, ce matin, à sortir de la Bastille, pour acheter une lime. J’ai pu regagner ensuite mon cachot sans être aperçu. Mon plan d’évasion est complètement terminé. Je quitterai mon cachot dans un mois, c’est-à-dire le jour de la mi-carême. C’est le seul jour où je puisse passer inaperçu avec mon masque de fer.
LE GOUVERNEUR DE LA BASTILLE, entrant. — Monsieur, votre geôlier manchot vient de me remettre une lettre dans laquelle vous me demandez l’autorisation de jouer du trombone à coulisse dans votre cachot.
L’HOMME AU MASQUE DE FER. — Oui. Cela me distrairait.
LE GOUVERNEUR DE LA BASTILLE. — Je vous accorde la permission de jouer du trombone à coulisse ; mais, deux heures par jour seulement pour ne pas incommoder les autres prisonniers.
L’HOMME AU MASQUE DE FER. — Votre amabilité m’encourage à solliciter de vous une autre faveur.
LE GOUVERNEUR DE LA BASTILLE. — Parlez.
L’HOMME AU MASQUE DE FER. — Je désirerais avoir dans mon cachot un filet à papillons.
LE GOUVERNEUR DE LA BASTILLE. — Un filet à papillons ?
L’HOMME AU MASQUE DE FER. — Oui. Je m’ennuie terriblement. Ce filet me servira à chasser de mon esprit les papillons noirs.
LE GOUVERNEUR DE LA BASTILLE. — Accordé. Le geôlier manchot vous portera tout à l’heure entre ses dents le filet à papillons et le trombone à coulisse. (Il sort.)
L’HOMME AU MASQUE DE FER. — Une lime, un trombone à coulisse et un filet à papillons, c’est tout ce qu’il me faut pour quitter la Bastille, le jour de la mi-carême.
TROISIÈME ACTE
Musique de cachot.
Même décor.
L’HOMME AU MASQUE DE FER. — Le geôlier manchot vient de m’apporter le trombone à coulisse et le filet à papillons. À l’œuvre ! (Il attache sa lime à la coulisse du trombone et place celle-ci contre l’un des barreaux de la fenêtre. Il joue ensuite un air entraînant en imprimant à la coulisse du trombone le mouvement de va-et-vient qui caractérise cet instrument. Le trombone-lime entame le fer.) La musique du trombone empêche d’entendre le grincement de la lime. Le geôlier manchot ne se doutera de rien. C’est merveilleux ! En jouant du trombone deux heures par jour, les barreaux de ma prison seront sciés pour la mi-carême. Mais ne perdons pas de temps. (Il continue à jouer du trombone-lime.)
QUATRIÈME ACTE
L’évasion.
Même décor.
L’HOMME AU MASQUE DE FER. — Salut ! jour de délivrance ! Salut ! mi-carême ! Voilà trente jours que je lime les barreaux de mon cachot avec mon trombone à coulisse. Aujourd’hui, la besogne est terminée. Je peux m’évader. Mon cachot est situé à soixante-dix pieds au-dessus du sol. Mais j’ai tout prévu : grâce à mon filet à papillons, je peux sauter sans risque dans le vide. (Il saute en tenant le filet à papillons dans la main droite. Arrivé à deux mètres du sol, il place le filet sous lui et tombe dedans.) Je viens d’employer le procédé classique des acrobates qui placent un filet au-dessous d’eux pour ne pas se blesser en tombant. (Il se mêle à la foule des masques de la mi-carême et part, sans être remarqué, dans une direction inconnue.)
RIDEAU
LES DRAMES DU PALAIS BORGIA
PREMIER ACTE
Lucrèce Borgia.
La scène représente une salle du palais Borgia.
LA SINISTRE CONFIDENTE. — C’est donc vrai, chère Lucrèce, le chaste gentilhomme refuse votre amour ?
LUCRÈCE BORGIA. — Oui. Rien n’y fait. Ni supplications ni menaces. (Grinçant des dents.) Le chaste gentilhomme veut rester fidèle à sa fiancée, la pure et divine Lorenza. Mais le voici qui vient. Je vais essayer une suprême tentative de séduction. S’il refuse encore mon amour, ah ! par la sainte Madone ! malheur à lui !
LE CHASTE GENTILHOMME, s’inclinant. — Vous m’avez mandé près de vous, madame ?
LUCRÈCE BORGIA. — Oui. (Elle le fixe avec des yeux brillants de passion contenue.)
LE CHASTE GENTILHOMME. — Ah ! je vous en supplie, madame, ne me regardez pas ainsi. Il est de telles œillades qu’un chaste gentilhomme ne peut supporter sans rougir !
LUCRÈCE BORGIA, d’une voix rauque. — Enfer ! Tu me résistes encore ! Apprends donc qu’on ne dédaigne pas impunément l’amour de Lucrèce Borgia ! Holà ! mes hommes d’armes ! Que l’on s’empare sur-le-champ du chaste gentilhomme et qu’on l’enferme en lieu sûr. (Les gardes s’emparent du chaste gentilhomme.)
LE CHASTE GENTILHOMME. — Tu peux m’emprisonner, Lucrèce, tu n’auras pas mon amour ! Je n’aimerai jamais que ma pure et divine Lorenza ! (On l’entraîne.)
LUCRÈCE BORGIA. — Oh ! rage ! Je veux me venger horriblement du mépris de cet homme. (À un capitaine.) Dès ce soir, je veux que la pure et divine Lorenza soit prisonnière au palais. (À la sinistre Confidente.) Viens, ma sinistre confidente. Suis-moi. Allons préparer ma vengeance.
LA SINISTRE CONFIDENTE. — Où allons-nous ?
LUCRÈCE BORGIA, d’une voix sombre. — Dans les souterrains du palais : chez Angélico l’Écorcheur ! Viens.
DEUXIÈME ACTE
L’écorcheur.
La scène représente le laboratoire de l’Écorcheur.
ANGÉLICO L’ÉCORCHEUR. — La nuit doit bientôt tomber à la surface de la terre. Ici, dans les souterrains du palais Borgia, je vis dans une nuit éternelle, une nuit de sépulcre. Ah ! la terrible et lugubre besogne que la mienne ! Âme damnée de Lucrèce Borgia, j’écorche vifs les amants qui ont cessé de lui plaire. Comme de simples lapins, je les dépouille adroitement de leur peau ! Tragique caprice de femme ! Lucrèce ne veut pas que les peaux qu’elle honora de ses baisers puissent être embrassées par d’autres femmes. De temps en temps, elle descend dans mon laboratoire et, mélancoliquement, vient contempler les peaux de ses anciens amants, admirablement conservées grâce à mes merveilleux onguents. Quant aux malheureux écorchés vifs, ils gémissent lugubrement dans les cachots du souterrain, en réclamant leur peau d’une voix plaintive. Mais j’entends des pas. Qui peut venir à cette heure ?
LUCRÈCE BORGIA, entrant. — Angélico, cette nuit, mes hommes d’armes conduiront ici une jeune fille. (Avec un sourire sinistre.) Tu sais ce que tu dois faire des personnes que je t’envoie ?
ANGÉLICO L’ÉCORCHEUR. — Je sais.
LUCRÈCE BORGIA. — Bien. Mais ce n’est pas tout. Lorsque tu l’auras écorchée vive, voici ce que je t’ordonne de faire. (Elle lui parle à voix basse.)
ANGÉLICO L’ÉCORCHEUR, tressaillant. — J’obéirai.
UNE VOIX PLAINTIVE, dans le souterrain. — Ma peau ! Rendez-moi ma peau !
UNE AUTRE VOIX PLAINTIVE. — Ma peau ! Ma peau ! Je veux ma peau !
LA SINISTRE CONFIDENTE. — Oh ! ces voix !
LUCRÈCE BORGIA. — Ce n’est rien. Ce sont les écorchés. Remontons. Et toi, Angélico, exécute fidèlement mes ordres. Adieu ! (Elles sortent.)
TROISIÈME ACTE
L’amour plus fort que la haine.
La scène représente une salle du palais Borgia.
LA SINISTRE CONFIDENTE. — Voilà huit jours que la pure et divine Lorenza a été enlevée par vos gardes et remise entre les mains d’Angélico l’Écorcheur.
LUCRÈCE BORGIA. — Ma vengeance est prête. Voici le chaste gentilhomme que j’ai fait quérir dans son cachot pour lui réserver une douce surprise. (Au chaste Gentilhomme.) Je suis touchée de ton amour sincère pour la pure et divine Lorenza. Je te rends la liberté. Mais pour que la fête soit complète, j’ai fait venir ta fiancée afin que tu puisses la serrer plus tôt dans tes bras. (Aux gardes.) Faites entrer la pure et divine Lorenza.
LE CHASTE GENTILHOMME. — Oh ! joie ! (Des gardes font entrer un vieux soldat à tête d’ivrogne et à longue barbe.)
LUCRÈCE BORGIA, désignant le vieux soldat à face d’ivrogne. — Tiens, chaste Gentilhomme, embrasse ta fiancée !
LE CHASTE GENTILHOMME. — Que signifie cette plaisanterie, madame ?
LUCRÈCE BORGIA. — Ce n’est pas une plaisanterie. Tu as devant toi ta fiancée, la pure et divine Lorenza. Pour me venger de ton dédain, j’ai fait enlever ta fiancée et je l’ai confiée aux bons soins de mon fidèle Angélico. Sur mon ordre, il a dépouillé de sa peau satinée la pure et divine Lorenza. Puis il a remplacé la peau de ta fiancée par celle d’un vieux soldat, que j’ai fait écorcher vif pour la circonstance.
LE CHASTE GENTILHOMME. — Horreur ! Ce n’est pas possible !
LA PURE ET DIVINE LORENZA, d’une voix triste. — Hélas ! oui, c’est moi, cher fiancé.
LE CHASTE GENTILHOMME. — Toi ! c’est toi ! chère Lorenza ! Ne crains rien. Malgré l’horrible vengeance de Borgia, je t’aime toujours ! Qu’importe le physique, c’est ton âme que j’adore !
LA PURE ET DIVINE LORENZA. — Non, cher fiancé, je ne suis plus digne de toi. Regarde ce visage grotesque.
LE CHASTE GENTILHOMME. — Je ne vois que mon amour !
LA PURE ET DIVINE LORENZA. — Regarde ce nez rougi par l’intempérance !
LE CHASTE GENTILHOMME. — Je ne vois que mon amour !
LA PURE ET DIVINE LORENZA. — Regarde cette longue barbe poivre et sel !
LE CHASTE GENTILHOMME. — Je ne vois que mon amour !
LA PURE ET DIVINE LORENZA. — Oh ! c’est trop de bonheur ! Quoi, tu peux m’aimer encore ?
LE CHASTE GENTILHOMME. — Je t’adore ! Ah ! Lucrèce Borgia, tu ne triomphes pas ! Notre amour est plus fort que ta haine !
LUCRÈCE BORGIA, rageusement. — Partez ! Partez !
LE CHASTE GENTILHOMME. — Oui, partons ! Viens, ma Lorenza ! Loin des regards indiscrets, nous pourrons vivre encore de bien douces minutes ! Mais pour éviter le scandale, devant le monde, je t’appellerai grand-père ! Viens, ma Lorenza. (Ils sortent, enlacés.)
RIDEAU
LE PARFUMEUR DE LA REINE
PREMIER ACTE
Le parfum qui tue.
La scène représente la chambre de René le Florentin.
CATHERINE DE MÉDICIS, entrant. — Eh bien, René, mon fidèle parfumeur, as-tu trouvé le poison subtil qui doit me débarrasser de l’homme que je poursuis de ma haine, du Capitaine des Pétardiers du roi ?
RENÉ LE FLORENTIN, d’une voix sombre. — Je l’ai trouvé : un quart de goutte du poison renfermé dans cet alambic suffit pour foudroyer qui le respire.
CATHERINE DE MÉDICIS. — Parfait. Tu verseras quelques gouttes de ce poison sur un bouquet de fleurs que tu feras parvenir au Capitaine des Pétardiers du roi.
RENÉ LE FLORENTIN. — Ce bouquet ne semblera-t-il pas suspect au Pétardier ?
CATHERINE DE MÉDICIS. — Non. Mon fils Henri III a l’habitude d’envoyer des bouquets aux gentilshommes qu’il veut élever à la dignité de « mignons ». Le Capitaine des Pétardiers sera flatté. Il respirera sans méfiance le parfum des fleurs, le parfum qui tue. Adieu, René.
DEUXIÈME ACTE
Le bouquet.
La scène représente une salle du palais du Louvre.
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — Je sais de source certaine que la reine mère a juré ma mort. Selon son habitude, en pareil cas, elle va m’envoyer un bouquet empoisonné.
L’AMI DU PÉTARDIER. — Il vous suffira de jeter le bouquet sans le sentir, pour éviter l’empoisonnement.
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — Impossible. La reine mère est rusée. Elle va me faire offrir ce bouquet devant tout le monde. Si je ne le sentais pas, j’aurais l’air d’avoir peur. Je le sentirai !
L’AMI DU PÉTARDIER. — Mais alors, vous êtes un homme mort ! Justement, un laquais s’avance à travers la foule des courtisans. Il porte un bouquet d’une main et de l’autre se bouche hermétiquement les narines.
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — C’est sûrement le bouquet empoisonné.
LE LAQUAIS, tendant le bouquet au Capitaine. — Voici.
L’AMI DU PÉTARDIER. — Que faites-vous, Capitaine ? Vous respirez ces fleurs empoisonnées ?
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — Oui. Je ne crains rien. En prévision de cet envoi de fleurs, je me promène depuis hier avec quatre livres de glace pilée sur le crâne. Regardez. (Il soulève son casque.)
L’AMI DU PÉTARDIER. — C’est vrai. Mais je ne comprends pas…
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — Vous allez comprendre : la fraîcheur de cette glace pilée posée sur ma tête m’a donné un formidable rhume de cerveau. Je peux respirer sans crainte le bouquet de la reine mère. Son parfum mortel reste impuissant devant mon rhume de cerveau. Je ne le sens pas.
CATHERINE DE MÉDICIS, dissimulée derrière une tapisserie. — Ce premier moyen a parfaitement échoué. Courons chez René le Florentin. Par la Madone ! ce Pétardier saura ce qu’il en coûte de se jouer de la reine mère.
TROISIÈME ACTE
Un bienfait n’est jamais perdu.
La scène représente la chambre du Capitaine des Pétardiers.
LE VALET INQUIET. — Je tremble qu’il n’arrive malheur à mon maître. Voilà deux jours qu’il a reçu le bouquet empoisonné. Quelles ténébreuses machinations préparent en collaboration la reine mère et son maudit parfumeur René le Florentin ? Le diable seul peut le savoir. Mais voici mon maître.
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS, entrant avec un chat sur les bras. — J’ai trouvé ce petit chat abandonné. Je l’adopte, et dès aujourd’hui je le baptise : David. (Il pose le chat à terre.)
LE VALET INQUIET. — Vous avez eu raison, Capitaine, de recueillir cette petite bête : un bienfait n’est jamais perdu.
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — Laisse-moi seul. J’attends une belle Inconnue qui me doit venir voir céans.
LE VALET INQUIET. — Méfiez-vous, Capitaine. N’est-ce point un nouveau piège de la reine mère ?
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — Tu ne vois que piège partout ! Mais j’aperçois la belle Inconnue qui monte l’escalier. Va ! (Le Valet inquiet sort.) Entrez, belle Inconnue.
LA BELLE INCONNUE. — Bonjour, beau Capitaine.
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — Oh ! comme vos lèvres sont magnifiquement rouges ! Jamais, foi de Pétardier, je ne vis lèvres plus vermeilles. Je brûle du désir d’y déposer un chaste baiser.
LA BELLE INCONNUE, baissant les yeux. — Je veux bien que vous m’embrassiez sur la bouche.
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — Ciel ! le chat que j’ai recueilli s’avance sur la belle Inconnue et lui mord les lèvres à pleines dents ! Mais, que vois-je ! C’étaient de fausses lèvres collées sur les véritables. Le chat les tire à lui. Elles se décollent complètement. L’animal, affamé, les dévore avec avidité. Que veut dire ceci ? Parlez, belle Inconnue.
LA BELLE INCONNUE. — Pitié ! Je ne suis qu’un instrument entre les mains de la reine mère.
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — La reine mère ?
LA BELLE INCONNUE. — Oui. Je suis chambrière de Catherine de Médicis. Sur son ordre, René le Florentin m’a collé de fausses lèvres en mou de veau.
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — En mou de veau ! Ah ! Je comprends maintenant pourquoi David s’est élancé sur vos lèvres.
LA BELLE INCONNUE. — Ce n’est pas tout. Ce mou de veau… oh ! c’est horrible !
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — Parlez ! Ce mou de veau ?…
LA BELLE INCONNUE. — Ce mou de veau était empoisonné !
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — Misérable ! Voilà pourquoi vous vouliez que je vous embrasse sur la bouche ! Vos lèvres en mou de veau s’offraient à moi pour un baiser de mort !
LE VALET INQUIET, accourant. — Que se passe-t-il ? Ciel ! le petit chat est mort !
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — Pauvre David ! Grâce à lui, je viens d’échapper au poison du Florentin.
LE VALET INQUIET. — Je vous l’avais bien dit, Capitaine : un bienfait n’est jamais perdu.
QUATRIÈME ACTE
Sombres projets.
La scène représente la chambre de René le Florentin.
CATHERINE DE MÉDICIS. — Le Pétardier nous échappe encore une fois. Qu’imaginer pour arriver à l’empoisonner ? Sa méfiance est éveillée. Il ne mange et ne boit plus rien qui ne soit au préalable goûté par son grand-père. Depuis l’affaire des lèvres en mou de veau, le Capitaine est aussi prudent qu’un serpent.
RENÉ LE FLORENTIN, bondissant. — Un serpent ! La voilà, l’idée ! Il faut faire piquer le Pétardier par un serpent.
CATHERINE DE MÉDICIS. — Oui. Mais possèdes-tu un reptile céans ?
RENÉ LE FLORENTIN. — Non. Mais j’ai dans mon laboratoire une énorme peau de cobra capello. Maigre comme je suis, il me sera facile de me glisser dans cette peau de serpent pour aller piquer le Pétardier.
CATHERINE DE MÉDICIS. — Deviens-tu fol, René ? Ta morsure n’est pas venimeuse ?
RENÉ LE FLORENTIN. — Non. Mais je vais me fabriquer deux crochets à venin artificiels semblables à ceux des reptiles. Je tremperai l’extrémité de ces crochets dans mon plus mortel poison, et que ma barbe s’envole si je ne deviens pas aussi dangereux qu’un scorpion !
CATHERINE DE MÉDICIS. — Merveilleuse idée !
RENÉ LE FLORENTIN. — Dès demain, habillé de ma peau de cobra et les crochets aux dents, je m’embusque dans le jardin du Pétardier.
CINQUIÈME ACTE
Serpent et Pétardier.
La scène représente le jardin du Capitaine des Pétardiers.
RENÉ LE FLORENTIN, dans une peau de cobra. — Serré et mal à l’aise dans cette peau de cobra capello, j’attends, dissimulé dans ce massif de fleurs, que le Pétardier descende au jardin. Mais le voici.
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — Par cette tiède matinée de juillet, il est doux de faire à petits pas le tour de son jardin. Mais que vois-je ? Un énorme serpent dans ce massif de fleurs ! Il s’avance vers moi en rampant. Que faire ?
RENÉ LE FLORENTIN, à part. — Dans quelques secondes mes crochets à venin artificiel que je serre entre mes dents piqueront mortellement le Pétardier.
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — Oh ! quelle idée ! Je me souviens d’une mélopée arabe que chantent les charmeurs de serpents pour se rendre maîtres des reptiles. (Il chante en arabe.)
You ! You ! You ! You ! You ! You ! You !
You ! (bis).
You ! You ! You ! You ! You ! You ! You !
You ! (ter).
RENÉ LE FLORENTIN, à part. — Malheur ! Je suis tellement dans la peau de mon rôle de serpent que cette étrange chanson me trouble malgré moi. Cette mélopée bizarre me charme petit à petit.
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — Le cobra capello s’arrête pour écouter. Continuons le deuxième couplet. (Il chante.)
You ! You ! You ! You ! You ! You ! You !
You ! (bis).
You ! You ! You ! You ! You ! You ! You !
You ! (ter).
RENÉ LE FLORENTIN, à part. — Ma volonté s’engourdit. Je deviens complètement inoffensif. Mon corps se balance de droite à gauche en suivant la cadence de la musique. Malédiction, je suis charmé.
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — Le monstre est charmé. Il ne bouge plus. Passons-lui notre épée à travers le corps. (Il transperce le serpent.)
RENÉ LE FLORENTIN, hurlant. — Je suis touché ! Je meurs !
LE CAPITAINE DES PÉTARDIERS. — La voix de René le Florentin. Ah ! j’aurais dû m’en douter. C’était donc lui qui se dissimulait dans cette peau de serpent !
RENÉ LE FLORENTIN. — Oui. Je ne suis pas un véritable serpent. (D’une voix de plus en plus faible.) Ne… me… conservez… pas… dans… un… bocal… d’eau… de… vie… (Il meurt.)
RIDEAU
LES NUITS DE LA TOUR DE NESLE
PREMIER ACTE
L’auberge du « Noyé frisé ».
La scène représente l’intérieur de l’auberge.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — J’entre dans l’auberge du « Noyé frisé » située sur les bords de la Seine. Tiens ! j’aperçois mon ami le Jongleur de Notre-Dame !
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Oui, c’est moi, ruiné, désespéré.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Parle.
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — On m’a volé les boules en buis bénit avec lesquelles je jonglais devant Notre-Dame. N’étant pas assez riche pour acheter d’autres boules, je dois me contenter maintenant de jongler avec des difficultés. Le public n’apprécie pas ce travail. Il passe indifférent, sans me lancer la moindre obole.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Comme toi je fus victime d’un vol infâme. On m’a dérobé dernièrement ma superbe collection d’escargots savants.
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Quoi ! les merveilleux escargots que tu montrais dans les foires ? Les escargots dressés qui formaient toutes les lettres de l’alphabet en s’alignant les uns à côté des autres sur un tableau noir ?
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Oui. Tous mes chers mollusques gastéropodes m’ont été volés. Depuis je suis dans la misère. Buvons pour oublier.
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Buvons. Voici le crépuscule. À travers la fenêtre de l’auberge du « Noyé frisé » on aperçoit la tour de Nesle rougie par les rayons du soleil couchant.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Oui. La tour est rouge ce soir, rouge comme du sang.
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Comme le sang qui coule chaque nuit entre ses murs épais.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN, baissant la voix. — On dit que la reine Marguerite de Bourgogne et ses deux sœurs Jeanne et Blanche attirent toutes les nuits de beaux jeunes hommes dans cette tour.
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME, à voix basse. — Oui. Mais jamais aucun n’est revenu.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Je braverais bien tous les dangers du monde pour passer une nuit à la tour !
LE RACOLEUR DE LA REINE, sortant de l’ombre. — Je peux satisfaire votre désir. Si votre ami le Jongleur de Notre-Dame veut vous accompagner, je vais vous conduire à la tour de Nesle.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — J’accepte. Viens-tu, camarade Jongleur ?
LE RACOLEUR DE LA REINE, insinuant. — Venez donc : Plus on est de fous, plus on rit !
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Soit ! (À part.) Avec Risque-tout-le-Baladin, je ne crains rien. Il trouvera toujours un moyen pour nous tirer d’affaire.
LE RACOLEUR DE LA REINE. — Partons. Mon bateau est amarré sur la berge. Venez.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN, vidant son verre. — À nos amours !
LE RACOLEUR DE LA REINE. — Et maintenant…
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Et maintenant…
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Et maintenant, à la tour de Nesle.
DEUXIÈME ACTE
Une orgie à la tour.
La scène représente la « Chambre des Orgies » de la tour de Nesle. Cet acte ayant été interdit par la censure à cause de son dialogue lubrique, l’auteur prie ses fidèles lecteurs de l’excuser s’il remplace les répliques de ses personnages par des points de suppositions.
MARGUERITE DE BOURGOGNE, d’une voix passionnée. — …
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN, d’une voix passionnée. — …
JEANNE ET BLANCHE DE BOURGOGNE, de deux voix passionnées. — …
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME, d’une voix fatiguée. — …
(L’orgie se continue dans la nuit.)
TROISIÈME ACTE
Après l’orgie.
Même décor.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — L’orgie est terminée. Marguerite de Bourgogne et ses deux sœurs viennent de nous quitter. Quelles heures inoubliables pour un pauvre baladin !
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Ce silence de mort qui succède brusquement aux joyeux cris de l’orgie ne me dit rien qui vaille.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — On n’entend que le sinistre clapotis de la Seine contre les murs de la tour.
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — On vient. J’ai peur.
LE RACOLEUR DE LA REINE, entrant. — Suivez-moi, je vais vous reconduire hors de la tour.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Suivons-le. (Ils se lèvent pour suivre le Racoleur de la Reine.)
LE RACOLEUR DE LA REINE, pressant un bouton en ricanant. — Vous voilà rendus !
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Ciel ! Le plancher cède sous nos pas ! Nous tombons dans une oubliette !
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Il n’y a pas de doute possible. Nous tombons dans une oubliette ! (Ils tombent dans l’oubliette.)
LA VOIX DU VEILLEUR DE NUIT, dans le lointain. — Il est minuit ! Gens qui dormez, dormez en paix ! Gens qui veillez, priez pour les trépassés !
QUATRIÈME ACTE
Les escargots de Bourgogne.
La scène représente une oubliette.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Nous voilà tombés dans l’oubliette !
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Impossible de rien distinguer dans cette nuit de sépulcre. Je ne peux même pas voir si je suis tombé assis ou debout.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Oh ! une idée ! Mets ta figure à portée de mon bras. Pan ! je t’envoie un magistral coup de poing en plein visage.
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Aïe ! Je vois trente-six chandelles !
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Parfait ! Avec ta dextérité de jongleur, saisis rapidement une de ces trente-six chandelles et nous aurons de la lumière.
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Fameuse idée ! (Il saisit au vol une des trente-six chandelles.) À présent on y voit clair.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Oh ! regarde ! Nous sommes entourés d’escargots !
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — De nombreux squelettes humains jonchent le sol ! Je comprends tout ! La sinistre Marguerite fait dévorer ses amants d’une nuit par de féroces escargots de Bourgogne. Nous sommes perdus ! Ils avancent vers nous en bavant.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Ces escargots me rappellent ceux qui me furent dérobés. Mais je ne me trompe pas ! C’est lui ! Je le reconnais ! C’est Achille !
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Achille ?
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Oui. C’était le nom de mon plus intelligent colimaçon. Mais oui, plus de doute ! Il me fixe de ses yeux expressifs. Ses cornes s’agitent joyeusement ! Il m’a reconnu ! Mais alors ce sont peut-être mes anciens pensionnaires ? Est-ce vous, chers compagnons ? Est-ce vous, chers mollusques gastéropodes ?
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Regarde ! Tous les escargots rampent contre le mur de l’oubliette ! Ils se placent les uns derrière les autres et forment des lettres ! Plus de doute ! ce sont tes escargots savants !
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Oui, ce sont eux ! Lis la phrase qu’ils ont formée en se groupant avec intelligence.
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME, lisant. — C’EST NOUS !
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Braves mollusques ! Je vous retrouve !
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Chut ! Entends la voix du veilleur de nuit dans le lointain. Nous allons savoir l’heure.
LA VOIX PÂTEUSE DU VEILLEUR DE NUIT, dans le lointain. — Il est deux heures ou six heures environ. Je ne suis pas fixé. Mais de toute façon, gens qui dormez, dormez en paix ; gens qui veillez, priez pour les trépassés.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — C’est bien l’heure que je pensais. Nous n’avons pas de temps à perdre pour sortir d’ici.
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Sortir d’ici ? Deviens-tu fou ?
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Non. Nous allons sortir d’ici par cette lucarne qui donne sur la Seine.
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Mais cette lucarne est à plus de 7 pieds de hauteur. Nous ne pourrons pas l’atteindre.
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — Nous pourrons l’atteindre en faisant exécuter à mes anciens pensionnaires l’exercice qui faisait toujours l’admiration des spectateurs.
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. — Quel exercice ?
RISQUE-TOUT-LE-BALADIN. — L’escalier en colimaçon. (Il siffle. À ce signal les escargots forment rapidement un « escalier en colimaçons » qui atteint la lucarne.) Et maintenant, nous n’avons plus qu’à monter cet escalier improvisé pour atteindre la lucarne, plonger dans la Seine, et nous sauver à la nage. (Ils grimpent quatre à quatre « l’escalier en colimaçons » et se sauvent.)
LA VOIX PÂTEUSE DU VEILLEUR DE NUIT, dans le lointain. — Il est sept heures du matin, ou midi moins le quart environ. Je ne suis pas fixé. Mais de toute façon, gens qui dormez, dormez en paix ; gens qui veillez, priez pour les trépassés !
RIDEAU
LE PRISONNIER DE PLESSIS-LEZ-TOURS
PREMIER ACTE
Les cages du roi.
La scène représente les souterrains de Plessis-lez-Tours.
LOUIS XI. — Nous venons de descendre l’escalier de 223 marches qui conduit aux souterrains de mon château de Plessis-lez-Tours. Accompagné de mon fidèle prévôt Tristan l’Hermite, et de mon barbier de confiance, Olivier Le Daim, je viens faire ma visite bi-hebdomadaire à mes prisonniers.
TRISTAN L’HERMITE. — Ce fut une heureuse idée que vous eûtes, Sire, de faire enfermer tous vos ennemis dans de petites cages de fer.
LOUIS XI. — Petites ! tu l’as dit, mon compère ! Les prisonniers sont obligés de se tenir courbés en deux dans leurs étroites prisons. Je vais savourer ma vengeance. Commençons notre visite par la cage n° 1.
LE PRISONNIER DE LA CAGE N° 1. — Sire ! je proteste contre la conduite odieuse de notre geôlier. Hier, il a suspendu à la fenêtre de sa chambre la cage où je suis enfermé.
LOUIS XI. — Est-ce vrai, geôlier mon compère ?
LE GEÔLIER-OISELEUR. — Votre Majesté m’excusera ; mais je suis un ancien oiseleur. C’est par distraction, croyant prendre une cage à serins, que j’ai accroché la cage du prisonnier à ma fenêtre.
LOUIS XI. — Tâche d’être moins distrait à l’avenir.
LE PRISONNIER DE LA CAGE N° 1. — Ce n’est pas tout Sire ; ce geôlier nous traite absolument comme des oiseaux. En guise de repas, il ne nous sert que du mouron. De plus, il nous oblige à siffler toute la journée pour se donner l’illusion d’être encore dans sa boutique d’oiseleur.
LE GEÔLIER-OISELEUR. — Que Votre Majesté daigne me pardonner. Je fais mon possible pour me distraire dans ces souterrains. Ces prisonniers enfermés dans de petites cages me rappellent mon ancienne profession. Avec eux, j’ai créé une véritable volière. Je possède déjà un serin, un merle et un cardinal.
LOUIS XI. — Un serin ?
LE GEÔLIER-OISELEUR. — Oui. Le prisonnier de la cage n° 2, qui est atteint de jaunisse.
LOUIS XI. — Et le merle ?
LE GEÔLIER-OISELEUR. — Dans la cage n° 3. Sire, c’est un nègre.
LOUIS XI. — Et le cardinal ?
LE GEÔLIER-OISELEUR. — C’est le prisonnier de la cage n° 5, le cardinal La Balue.
LOUIS XI, s’approchant de la cage de La Balue. — Ah ! La Balue ! La Balue ! mon ami ! pour te punir d’avoir été plus rebelle qu’un Klepte, je te ferai une nuit si noire et si longue qu’il te faudra un effort de mémoire pour te rappeler l’éclat du soleil et la clarté du jour !
OLIVIER LE DAIM. — Quelle est cette lumière dans la cage n° 7 ?
LE GEÔLIER-OISELEUR. — Je vais vous expliquer, monseigneur : c’est la cage de l’homme-torpille.
LOUIS XI. — Ah ! oui, ce forain, homme-torpille, que des anarchistes lancèrent contre les murailles de Plessis-lez-Tours, croyant ainsi faire sauter mon château ?
OLIVIER LE DAIM. — Oui. Mais pourquoi sa cage est-elle éclairée ?
LE GEÔLIER-OISELEUR. — C’est une invention du prisonnier. Il adore la lecture, et pour pouvoir dévorer les ouvrages de son auteur favori, Denis d’Halicarnasse, il a trouvé le moyen d’éclairer sa cage.
LOUIS XI. — Comment cela, compère ?
LE GEÔLIER-OISELEUR. — Cet homme-torpille s’est frotté avec force les paumes des mains contre les barreaux de sa cage.
LOUIS XI. — Pourquoi ?
LE GEÔLIER-OISELEUR. — Pour avoir des ampoules. Son corps étant une véritable pile, l’homme-torpille se trouve ainsi en possession de petites ampoules électriques.
LOUIS XI. — Par Laban ! Malgré l’anachronisme, voilà qui est bien trouvé ! J’en parlerai à Commines, pour qu’il note cela dans ses Mémoires. Mais quel est ce nouveau prisonnier de la cage centrale ?
TRISTAN L’HERMITE. — C’est un baladin qui s’est permis d’écrire une revue intitulée : « Plessis-les-Tourtes », dans laquelle il plaisantait les fétiches, médailles et amulettes que Votre Majesté porte à son chapeau.
LOUIS XI. — À quelles plaisanteries s’est livré ce manant ?
TRISTAN L’HERMITE. — Il a déclaré dans un insolent couplet que vos amulettes n’étaient pas de la régie.
LOUIS XI. — Je lui pardonne l’injure. Mais pour expier ce jeu de mots trop facile, qu’il reste dans cette cage jusqu’à la fin de ses jours. Puisse son exemple servir de leçon aux revuistes d’aujourd’hui et de l’avenir. Voilà ma visite terminée. Les barreaux des cages sont solides. Pas à craindre d’évasion. Tout va bien. Remontons.
(Il part, suivi de Tristan l’Hermite et d’Olivier Le Daim.)
LE PRISONNIER DE LA CAGE CENTRALE, entre ses dents. — Si j’avais seulement un pot de peinture rouge, mon évasion ne serait plus qu’une question d’heures !
DEUXIÈME ACTE
Le stratagème.
Même décor.
LE GEÔLIER-OISELEUR. — J’ai déjà un serin, un merle et un cardinal dans ma volière improvisée. En quoi vais-je transformer le nouveau prisonnier de la cage centrale ? (Haut.) Sais-tu siffler, prisonnier de la cage centrale ?
LE PRISONNIER DE LA CAGE CENTRALE, à part. — Ce geôlier-oiseleur est complètement fou, mais, en flattant sa manie ridicule, je vais peut-être pouvoir me procurer un pot de peinture rouge, et mon évasion ne sera plus qu’une question d’heures. (Haut.) Je sais siffler comme un rouge-gorge.
LE GEÔLIER-OISELEUR. — Comme un rouge-gorge ? Cet oiseau ferait bien dans ma volière. Malheureusement, tu ne donnes pas l’illusion d’un rouge-gorge.
LE PRISONNIER DE LA CAGE CENTRALE. — Il serait pourtant facile de me transformer en rouge-gorge.
LE GEÔLIER-OISELEUR. — Comment ? Parle, prisonnier de la cage centrale.
LE PRISONNIER DE LA CAGE CENTRALE. — En me peignant la gorge en rouge vif. (À part.) Mon Dieu ! faites que ma ruse réussisse !
LE GEÔLIER-OISELEUR. — Quelle idée ! En effet, c’est très simple ! Je vais t’apporter un pot de peinture rouge et tu te transformeras toi-même en rouge-gorge. (Il sort et revient avec un pot de peinture rouge qu’il donne au prisonnier de la cage centrale.)
LE PRISONNIER DE LA CAGE CENTRALE. — Merci.
LE GEÔLIER-OISELEUR. — Je monte me coucher. Peins-toi la gorge tout à loisir. Demain, je jugerai de l’effet. Bonne nuit. (Il part.)
LE PRISONNIER DE LA CAGE CENTRALE. — Maintenant que j’ai mon pot de peinture rouge, mon évasion n’est plus qu’une question d’heures.
TROISIÈME ACTE
La foi qui sauve.
Même décor.
LE PRISONNIER DE LA CAGE CENTRALE. — Minuit vient de sonner au beffroi de Plessis-lez-Tours. Tout dort dans ce sinistre château, je peux commencer sans crainte mes préparatifs d’évasion. Grâce à mon pot de peinture rouge, mon évasion n’est plus maintenant qu’une question de minutes ! À l’ouvrage ! (Il prend le pinceau et peint en rouge les barreaux de sa cage.) Voilà qui est fait ! Les barreaux de ma cage sont rouges. Il ne me reste plus qu’à les tordre de ma main vigoureuse. Le fer rouge est facilement malléable. J’ai toujours entendu dire que les forgerons pliaient le fer à volonté lorsqu’il était rouge. Allons ! un petit effort, et je suis sauvé ! (Avec cette foi qui soulève les montagnes, il tord les barreaux de la cage et se fait un passage par lequel il quitte la cage centrale.) Sauvé !
(Tel l’autruche, il sort du souterrain la tête cachée sous son bras afin de passer inaperçu.)
RIDEAU
LA TOUR « PRENDS GARDE »
PREMIER ACTE
Châtelaine et troubadour.
La scène représente la façade d’un château.
L’ARDENTE CHÂTELAINE, à la fenêtre. — Depuis que mon époux, le Châtelain ombrageux, est parti à la guerre, mon cœur languit d’amour.
LA SERVANTE PRUDENTE. — Patientez, chère maîtresse. Rappelez-vous qu’il est de tradition dans la famille du Châtelain ombrageux de précipiter la femme adultère du haut de la tour « Prends Garde ».
L’ARDENTE CHÂTELAINE. — Je sais. Pour effrayer leurs femmes, tous les ancêtres de mon époux leur montraient cette tour en criant : « Prends garde ! »
LA SERVANTE PRUDENTE. — C’est pour cette raison qu’on la surnomma la tour « Prends Garde ».
L’ARDENTE CHÂTELAINE. — Mais tu oublies, servante prudente, que la tour « Prends Garde » s’est écroulée, lors de la dernière guerre.
LA SERVANTE PRUDENTE. — C’est vrai ; je me rappelle : le Châtelain ombrageux, votre époux, avait enfermé des prisonniers dans le souterrain de la tour « Prends Garde ». Une terrible épidémie de danse de Saint-Guy se déclara chez les prisonniers. Comme ils étaient à l’étroit dans le souterrain, leurs tremblements perpétuels provoquèrent un tremblement de terre et la tour « Prends Garde » s’écroula.
L’ARDENTE CHÂTELAINE. — Je peux donc, sans crainte, tromper le Châtelain ombrageux. Il ne pourra pas, selon la tradition de sa noble famille, me précipiter du haut de la tour, puisqu’elle n’existe plus. Justement un joyeux troubadour s’arrête sous ma fenêtre pour chanter sa chanson d’amour. (Au troubadour.) Monte, gentil troubadour ; viens me chanter, céans, ta chanson d’amour.
LA SERVANTE PRUDENTE. — Quelle imprudence !
LE VEILLEUR DU CHÂTEAU, annonçant. — Un troubadour monte !
DEUXIÈME ACTE
La chanson interrompue.
La scène représente la chambre de la Châtelaine.
L’ARDENTE CHÂTELAINE. — Cher troubadour, les sept couplets de ta chanson d’amour m’on fait passer de bien douces minutes !
L’INGÉNIEUX TROUBADOUR. — Chut ! J’entends un bruit de bottes !
L’ARDENTE CHÂTELAINE. — C’est mon mari ! Nous sommes perdus !
LE CHÂTELAIN OMBRAGEUX, surgissant. — Par saint Jean-Pied-de-Port ! J’arrive à temps. Tremblez, madame ! Je vais, selon l’antique tradition de ma famille, vous précipiter du haut de la tour « Prends Garde » !
L’ARDENTE CHÂTELAINE. — Vous oubliez qu’elle est démolie !
LE CHÂTELAIN OMBRAGEUX. — Je vais la faire reconstruire. Je repars, demain, pour la guerre. À mon retour, la tour sera rebâtie et je vengerai mon honneur outragé. Quant à toi, troubadour de malheur, suis-moi. Je vais t’enfermer dans un cachot où tu pourras, tout à loisir, composer tes chansons d’amour !
TROISIÈME ACTE
L’évasion.
La scène représente un cachot.
L’INGÉNIEUX TROUBADOUR. — Le Châtelain ombrageux vient de m’enfermer dans ce sinistre cachot, situé à deux cents pieds au-dessus du sol. Naturellement, je cherche un moyen d’évasion. J’ai entendu dire que la première chose à faire était de scier les barreaux de sa prison. Mais avec quoi scier les barreaux qui garnissent cette lucarne ? Oh ! quelle idée ! Chantons tout près des barreaux de fer une chanson-scie. (Il chante.)
C’étaient trois jeunes pages,
Jeunes pages du roi.
C’étaient trois jeunes pages,
Page un, page deux, page trois !
Vinrent trois autres pages,
Portant la fleur de lis.
Ça faisait donc six pages,
Page quatre, page cinq, page six !
Vinrent encor trois pages,
Tout habillés de neuf.
Ça faisait donc neuf pages,
Page sept, page huit, page neuf !
(Il continue à chanter jusqu’à deux cent vingt pages. À ce moment, les barreaux tombent complètement sciés par la chanson-scie.) — Et maintenant, qu’imaginer pour descendre le long du mur du château ? Je ne trouve pas. Je suis courbatu. Ce cachot est si petit que je suis obligé de me courber en deux pour rester debout. Cette position incommode m’engourdit les membres. J’ai des fourmis dans les jambes. Oh ! mais, la voilà, l’idée ! Par bonheur, j’ai, dans ma poche, le flacon de colle qui me sert à recoller ma voix lorsque je la casse en chantant trop fort. Sans perdre une seconde, collons sur mon dos les milliers de fourmis que j’ai dans les jambes. Voilà qui est fait. Maintenant, je me laisse glisser hors de la lucarne. J’applique mes reins contre le mur du château et les fourmis collées sur mon dos me descendent rapidement le long des murailles à pic. Je touche terre ! Sauvé ! Merci, mon Dieu ! Ah ! Châtelain ombrageux, tu as donné l’ordre de rebâtir la tour pour te venger de ta femme dès ton retour de la guerre. Eh bien, moi, l’ingénieux Troubadour, je jure d’empêcher ta vengeance et de sauver l’ardente Châtelaine !
QUATRIÈME ACTE
L’impossible vengeance.
La scène représente la tour « Prends Garde » reconstruite.
LE CHÂTELAIN OMBRAGEUX. — Me voici revenu de la guerre, madame, montons au sommet de la tour « Prends Garde », reconstruite pendant mon absence. Selon la tradition de ma noble famille, je vais vous précipiter du haut de la tour !
L’ARDENTE CHÂTELAINE. — Grâce !
LE CHÂTELAIN OMBRAGEUX. — Non. Montons. (Ils montent.) Nous voici arrivés. Enfin, je vais pouvoir satisfaire ma vengeance ! Dans deux minutes, au plus tard, votre corps de femme adultère ira s’écraser au pied de la tour. (Il se penche et regarde le bas de la tour.) Oh ! mais, que vois-je ? C’est insensé ! Il m’est matériellement impossible de précipiter ma femme du haut de cette tour ! Je suis joué ! Je suis joué ! (Il tombe mort, étranglé de rage.)
L’INGÉNIEUX TROUBADOUR, accourant. — Sauvée ! Grâce à ma ruse !
L’ARDENTE CHÂTELAINE. — Quelle ruse ?
L’INGÉNIEUX TROUBADOUR. — Pour vous sauver, je me suis substitué à l’architecte qui devait rebâtir la tour et j’ai fait construire une tour à l’envers.
L’ARDENTE CHÂTELAINE. — Une tour à l’envers ?
L’INGÉNIEUX TROUBADOUR. — Oui. Une tour dont le haut se trouve placé en bas et le bas en haut. D’ailleurs, regardez.
L’ARDENTE CHÂTELAINE. — C’est vrai. Les créneaux de la tour s’enfoncent dans la terre.
L’INGÉNIEUX TROUBADOUR. — Votre mari est mort de rage en voyant qu’il lui était impossible de vous jeter du haut de la tour, puisque, grâce à mon ingénieuse construction, le haut de la tour se trouve prudemment placé en bas.
RIDEAU
HAINE D’AMOUR
PREMIER ACTE
La botte secrète.
La scène représente la forêt de Saint-Germain sous Louis XV.
L’ÉPOUSE DU LOYAL CHEVALIER. — Cher loyal Chevalier, par cette chaude journée de juin 1757, je suis heureuse de me promener à ton bras, dans la forêt de Saint-Germain. Voilà déjà deux mois que nous sommes mariés secrètement pour échapper aux poursuites de l’implacable Ferrailleur.
LE LOYAL CHEVALIER. — Oui, cet implacable Ferrailleur était mon rival d’amour. Ah ! pourquoi m’empêchas-tu de mesurer ma rapière à la longueur de la sienne ?
L’ÉPOUSE DU LOYAL CHEVALIER. — Parce que l’implacable Ferrailleur connaît une terrible botte secrète. Parce que tout homme qui se bat avec lui est un homme mort.
LE LOYAL CHEVALIER. — Je sais. Le misérable a connu jadis le chevalier de Lagardère, qui lui apprit la célèbre botte de Nevers, le fameux coup de pointe foudroyant entre les deux yeux. Qu’importe ! J’aurais tout bravé pour combattre mon rival d’amour.
L’IMPLACABLE FERRAILLEUR, surgissant d’un fourré. — Il ne tient qu’à toi, chevalier de malheur, de braver sur-le-champ ma terrible botte secrète. En garde !
L’ÉPOUSE DU LOYAL CHEVALIER. — Vous ne vous battrez pas !
LE LOYAL CHEVALIER, l’écartant doucement. — Il le faut ! (Dégainant.) En garde !
L’IMPLACABLE FERRAILLEUR, ricanant. — Attention, chevalier, je prépare ma botte secrète. Ma rapière décrit dans l’air un demi-cercle flamboyant, et vlan ! ma pointe transperce ton front entre les deux yeux.
LE LOYAL CHEVALIER. — Je tombe mort ! (Il tombe mort.)
L’IMPLACABLE FERRAILLEUR, à l’Épouse du loyal Chevalier. — Et maintenant, rien ne pourra t’empêcher d’être à moi.
L’ÉPOUSE DU LOYAL CHEVALIER. — Arrière assassin ! Vous avez tué mon loyal Chevalier, mais son amour survit en moi, car je porte en mon sein l’enfant qui le vengera un jour.
L’IMPLACABLE FERRAILLEUR, écumant. — Un enfant ! Un enfant du loyal Chevalier ! Par l’enfer ! Mieux vaudrait pour lui ne jamais voir le jour ! car il me vient une idée de vengeance à faire trembler Belzébuth lui-même !
DEUXIÈME ACTE
Parmi les monstres.
La scène représente un « musée des Horreurs ».
LE DIRECTEUR DU MUSÉE, à sa femme. — J’attends l’implacable Ferrailleur, qui doit venir ici à la nuit close.
LA FEMME DU DIRECTEUR DU MUSÉE. — L’implacable Ferrailleur ?
LE DIRECTEUR DU MUSÉE. — C’est un noble seigneur, dont je fus le fidèle valet à l’époque où je n’avais pas encore entrepris l’exhibition de monstres de toutes sortes.
LA FEMME DU DIRECTEUR DU MUSÉE. — Que te veut-il.
LE DIRECTEUR DU MUSÉE. — Je l’ignore. Mais j’entends des pas. On heurte à la porte. C’est lui. Femme, laisse-nous. (Ouvrant à l’implacable Ferrailleur.) — Entrez, monseigneur.
L’IMPLACABLE FERRAILLEUR, d’une voix sombre. — Écoute ! Es-tu toujours le sinistre individu bon à tout faire que j’ai connu jadis ?
LE DIRECTEUR DU MUSÉE. — Toujours.
L’IMPLACABLE FERRAILLEUR. — Parfait. Pour la réalisation d’une sombre vengeance, j’ai besoin du monstre le plus hideux de ta collection.
LE DIRECTEUR DU MUSÉE. — Monseigneur tombe bien. Je possède en ce moment un lot de monstres des plus intéressants. Nous avons : l’hydrocéphale à museau de rat et à pied d’alouette ; le quadruple goitreux des Vosges à bec de corbin ; l’homme à la tête d’épingle ; le cyclope à torse de homard et à pattes de mouche ; l’adolescent à la tête de poule et aux quatorze genoux ; le monstre à figure de rhétorique ; le bébé à face de diplodocus, et, pour terminer, le vieillard à doubles mamelles de bique et à taille de guêpe.
L’IMPLACABLE FERRAILLEUR. — Voici donc ce que tu vas faire, si tu veux gagner cette bourse remplie d’or. Dès que les douze coups de minuit sonneront au beffroi de l’église voisine, tu te dirigeras avec un de tes monstres vers la petite maison solitaire habitée par la veuve du loyal Chevalier.
LE DIRECTEUR DU MUSÉE. — Je connais la maison.
L’IMPLACABLE FERRAILLEUR. — La chambre à coucher, éclairée par une petite veilleuse, est située au rez-de-chaussée et donne sur la rue. Il faut que ton monstre ouvre brusquement la fenêtre de cette chambre et passe sa tête à l’intérieur en hurlant : « Coucou ! me voilà ! » (Ricanant.) Je compte beaucoup sur cette apparition imprévue pour que la veuve du loyal Chevalier, qui se trouve dans un état intéressant, donne le jour à un petit monstre digne de ton musée. Voilà, ou je me trompe fort, une fameuse idée de vengeance.
LE DIRECTEUR DU MUSÉE. — Fameuse !
TROISIÈME ACTE
Le vengeur.
La scène représente la forêt de Saint-Germain, vingt ans après.
L’IMPLACABLE FERRAILLEUR. — Ah ! je me suis bien vengé du dédain de cette femme ! Grâce à mon plan diabolique, elle a mis au monde, il y a vingt ans, un enfant monstre. Depuis sa naissance, elle l’a soigneusement caché à tous les yeux. Je n’ai jamais eu la satisfaction de voir le visage de ce jeune monstre. (Ricanant.) Ça doit être un beau jeune homme, à présent ! Mais j’entends des pas. Un Inconnu au feutre rabattu sur les yeux s’avance de mon côté. Une femme voilée l’accompagne.
LA FEMME VOILÉE, désignant l’implacable Ferrailleur à l’Inconnu. — Voici l’homme qui a tué ton père. Venge-le.
L’INCONNU, tirant son épée. — En garde, misérable !
L’IMPLACABLE FERRAILLEUR. — Par Satan ! Je m’en doutais. C’est la veuve du loyal Chevalier et son fils. Eh bien, soit ! Après le père, l’enfant ! Grâce à ma botte secrète, cela sera bientôt fait. (Il dégaine.)
L’INCONNU, enlevant son feutre. — En garde !
L’IMPLACABLE FERRAILLEUR, apercevant la tête de l’Inconnu. — Oh ! l’horrible tête de monstre ! Malédiction ! Ma botte secrète devient impossible à exécuter. Je suis perdu !
L’INCONNU. — Oui, perdu. (Il le transperce.)
L’IMPLACABLE FERRAILLEUR, s’écroulant. — Je meurs.
L’INCONNU, se penchant sur lui. — Grâce à vous, misérable, je suis venu au monde avec une tête de monstre, mais la Providence veillait, puisque c’est aussi grâce à mon physique monstrueux que j’ai pu braver votre botte secrète et venger mon père.
LA FEMME VOILÉE. — Oui. Le monstre qui vint passer sa tête à la fenêtre de ma chambre et crier : « Coucou ! me voilà ! » était un cyclope. Fortement impressionnée par cette apparition, je mis au monde un petit cyclope, un enfant n’ayant qu’un œil au milieu du front.
L’IMPLACABLE FERRAILLEUR. — Enfer ! C’est parce qu’il n’a qu’un œil au milieu du front que je n’ai pu placer ma botte secrète et lui planter ma rapière entre les deux yeux ! (Il meurt.)
RIDEAU
L’ENLÈVEMENT DE LA MARQUISE
Drame galant.
PREMIER TABLEAU
Préparatifs.
La scène représente un cabinet de toilette.
LA MARQUISE. — Soubrette, prépare mes plus beaux atours. Ce soir je me fais enlever par le Vicomte au nez busqué.
LA SOUBRETTE CONFIDENTE. — Enlever ?
LA MARQUISE. — Oui. Une litière m’attendra cette nuit derrière le mur du jardin. Mais ne perdons pas de temps. Selon la mode de notre époque, pose sur mon visage quelques mouches en taffetas noir.
LA SOUBRETTE CONFIDENTE, posant les mouches. — Une au bord des lèvres, une sur la joue et une dernière au menton.
LE MARQUIS, entrant. — Bonjour, marquise. Chut ! ne bougez pas. (Il lance à toute volée sa main sur la joue de la marquise.)
LA MARQUISE. — Aïe ! marquis !
LE MARQUIS. — Raté ! Je voulais attraper ces mouches posées sur votre joli visage.
LA MARQUISE. — Encore votre stupide plaisanterie ! Depuis que les mouches sont à la mode vous n’avez pu passer un seul jour sans vous livrer à ce brutal amusement.
LE MARQUIS. — J’avoue que cela me fait toujours rire.
LA MARQUISE, entre ses dents. — Rira bien qui rira le dernier. (Elle sort.)
LE MARQUIS, seul. — Ah ! marquise ! j’ai tout entendu ! Je connais votre projet de fuite avec le Vicomte au nez busqué. Mais, jarnidieu ! je compte vous jouer un tour de ma façon !
DEUXIÈME TABLEAU
L’enlèvement.
La scène représente la route devant le château.
LA MARQUISE. — Il fait nuit, tout dort au château. Je viens de sortir par la petite porte du jardin. Mais voici mon amant le Vicomte au nez busqué qui s’élance à ma rencontre.
LE VICOMTE AU NEZ BUSQUÉ. — Vite, marquise, par ici. Une litière nous attend sur la route.
LA MARQUISE. — C’est une attention délicate, vicomte, d’avoir choisi une litière pour notre voyage. Ces sortes de véhicules sont plus doux que les carrosses les mieux suspendus.
LE VICOMTE AU NEZ BUSQUÉ. — Munie d’une paire de brancards à l’avant et d’une paire de brancards à l’arrière, la litière est une véritable « chaise à porteurs », dont les porteurs sont des chevaux.
LA MARQUISE. — Mais, vicomte, je vois bien la litière ; mais où sont les chevaux ?
LE VICOMTE AU NEZ BUSQUÉ. — Justement, les voici qui viennent. Je les avais fait dételer et cacher sous un peuplier, pour ne pas attirer l’attention. Montez, marquise ! (Au postillon.) Attelle, drôle, et partons sans tarder. (Il monte dans la litière.)
LA MARQUISE, dans la litière. — C’est charmant. On se croirait dans un grand lit.
LE VICOMTE AU NEZ BUSQUÉ. — Pour que l’illusion soit complète, fermons les rideaux, marquise. Demain matin, après toute une nuit d’amoureux transports, nous les rouvrirons, et nous serons tout joyeux de nous trouver loin de votre marquis de mari.
LA MARQUISE, rougissante. — Fermons les rideaux, vicomte !
TROISIÈME TABLEAU
La désagréable surprise.
La scène se passe dans l’intérieur de la litière.
LA MARQUISE. — Le jour pénètre à travers les rideaux de la litière. Quelle nuit de rêve ! La douce chanson des baisers accompagnée par le galop sonore des chevaux !
LE VICOMTE AU NEZ BUSQUÉ. — À cette heure nous devons être loin de votre mari. Nous approchons de la douce retraite que je vous ai préparée pour vous mieux chérir.
LA MARQUISE. — Nous approchons du doux nid d’amour. Mais ouvrons les rideaux pour jouir du paysage matinal.
LE VICOMTE AU NEZ BUSQUÉ. — Ouvrons les rideaux pour jouir du paysage matinal. (Il ouvre les rideaux.) Ah ! que vois-je !
LA MARQUISE. — Qu’y a-t-il ?
LE VICOMTE AU NEZ BUSQUÉ. — Regardez ! Nous sommes toujours devant votre château. Nous n’avons pas changé de place depuis hier soir !
LA MARQUISE. — C’est incompréhensible !… Ciel ! mon mari qui sort du château et qui s’avance vers nous en ricanant. Nous sommes perdus !
LE MARQUIS. — Avez-vous fait un bon voyage, marquise ?
LE VICOMTE AU NEZ BUSQUÉ. — Tudieu ! marquis, m’expliquerez-vous ?
LE MARQUIS. — Vous expliquer pourquoi votre enlèvement a piteusement échoué ! C’est bien simple. J’avais acheté le postillon de votre litière. Selon mes ordres, il a attelé le cheval « avant » de la litière, face au cheval « arrière ». Les deux chevaux sont partis au galop, mais comme ils allaient chacun dans un sens opposé, ils ont fait du galop sur place toute la nuit. Comprenez-vous maintenant pourquoi votre litière a fait autant de chemin qu’une cathédrale ?
RIDEAU
LES FANTÔMES DE LA BASTILLE
Drame du 14 juillet.
PREMIER TABLEAU
Les pas qui s’approchent.
La scène représente la Colonne de la Bastille, de nos jours.
LE VISITEUR DE LA COLONNE. — Nous voici au sommet de la Colonne commémorative, élevée sur l’emplacement de l’ancienne prison d’État.
L’AUTRE VISITEUR DE LA COLONNE. — Oui. En bons citoyens nous avons choisi le jour du 14 juillet pour visiter la Colonne de la Bastille.
LE GARDIEN DE LA COLONNE. — Messieurs, vous voilà rendus dans votre cachot. Dieu protège le roi ! (Il ferme à clef la porte de la plate-forme et redescend.)
LE VISITEUR DE LA COLONNE. — Ce gardien est devenu subitement fou. Il se prend pour un geôlier de l’ancienne Bastille et nous enferme sur la plate-forme de la Colonne.
L’AUTRE VISITEUR DE LA COLONNE. — Il est sans doute pris de boisson. Dès qu’il sera dégrisé, il remontera nous délivrer. Patientons ! (Ils patientent.)
LE VISITEUR DE LA COLONNE, consultant sa montre. — Voilà plus de six heures que nous patientons. Le gardien ne remonte pas. Il faut nous résigner à rester ici toute la nuit.
L’AUTRE VISITEUR DE LA COLONNE. — Cette plate-forme est lugubre. Minuit sonne ! Écoutez ! On dirait qu’on marche dans l’escalier.
LE VISITEUR DE LA COLONNE. — C’est le vent.
L’AUTRE VISITEUR DE LA COLONNE. — Le vent qui souffle à travers la Colonne me rendra fou !
LE VISITEUR DE LA COLONNE. — Non, ce n’est pas le vent. Les pas se rapprochent. J’ai peur ! Qui va là ?
DES VOIX DANS LA COLONNE. — Nous !
LES DEUX VISITEURS DE LA COLONNE. — Qui, vous ?
DES VOIX DANS LA COLONNE. — Nous : les Fantômes de la Bastille !
DEUXIÈME TABLEAU
Les fantômes vont parler.
Même décor.
LE VISITEUR DE LA COLONNE. — Nos craintes se sont dissipées. Les Fantômes de la Bastille sont charmants. Ils se réunissent dans cette colonne commémorative pour évoquer leurs souvenirs d’antan.
L’AUTRE VISITEUR DE LA COLONNE. — Ce sont les fantômes d’anciens prisonniers de la Bastille. Ils nous ont promis de nous raconter chacun leur histoire.
LE VISITEUR DE LA COLONNE. — Le Premier Fantôme de la Bastille commence son récit. Écoutons-le.
L’AUTRE VISITEUR DE LA COLONNE. — Écoutons-le.
TROISIÈME TABLEAU
Le Premier Fantôme parle.
Même décor.
LE PREMIER FANTÔME. — À l’époque où commence mon récit, j’étais prisonnier à la Bastille. Le cachot où j’étais enfermé était rempli de rats. J’avais beau chanter d’une voix enrouée pour leur faire croire que j’avais un chat dans la gorge, rien ne les effrayait. Leur présence me suggéra bientôt un plan d’évasion. Je demandai à travailler dans mon cachot. On me donna des talons à peindre.
LES DEUX VISITEURS DE LA COLONNE. — Des talons à peindre ?
LE PREMIER FANTÔME. — Oui. C’était le travail que l’on donnait aux prisonniers à cette époque. Les fameux talons rouges se peignaient dans les prisons. On me porta un cent de talons et une boîte de couleurs. C’était tout ce que je désirais. Sans perdre de temps, je me mis à peindre un énorme fromage sur le mur de mon cachot. Dès qu’il fut terminé, les innombrables rats qui me tenaient compagnie se précipitèrent dessus et se mirent à ronger tous à la fois mon fromage peint. Deux heures plus tard le mur de mon cachot était percé, trois heures après j’étais libre, et le jour suivant j’étais repris.
LES DEUX VISITEURS DE LA COLONNE. — Repris ?
LE PREMIER FANTÔME. — Oui. Par ma faute. À peine libre, je commis l’imprudence d’envoyer mon adresse au gouverneur de la Bastille.
LES DEUX VISITEURS DE LA COLONNE. — Votre adresse ? Pourquoi ?
LE PREMIER FANTÔME. — Pour qu’il fasse suivre ma correspondance.
LES DEUX VISITEURS DE LA COLONNE. — Fatale imprudence !
QUATRIÈME TABLEAU
Le Deuxième Fantôme parle.
Même décor.
LE DEUXIÈME FANTÔME. — Moi, messieurs, j’avais résolu de m’évader de la Bastille en me déguisant en tour.
LES DEUX VISITEURS DE LA COLONNE. — En tour ?
LE DEUXIÈME FANTÔME. — Oui. Les tours étaient nombreuses à la Bastille. Sous ce déguisement, je pensais pouvoir sortir sans être remarqué. Trompant la surveillance de mon geôlier, je découpai dans un vieux morceau de carton des créneaux semblables à ceux d’une tour. Le soir même, mon gardien ayant laissé la porte de mon cachot ouverte…
LES DEUX VISITEURS DE LA COLONNE. — Ouverte ?
LE DEUXIÈME FANTÔME. — Oui, pour aérer. Je collai en toute hâte les créneaux sur ma tête et, m’enveloppant d’un manteau couleur muraille, je sortis de mon cachot. À peine avais-je fait quelques pas dans la cour qu’une sentinelle se dirigea de mon côté.
LES DEUX VISITEURS DE LA COLONNE. — Vous étiez perdu ?
LE DEUXIÈME FANTÔME. — Non. La sentinelle m’avait pris pour la tour du Nord et venait prendre sa faction à mes pieds. La nuit était sombre. La sentinelle tournait autour de moi en marquant le pas. Soudain, le factionnaire s’arrêta, s’approcha de mon manteau couleur muraille et… je me sentis subitement mouillé. « Cochon ! » m’écriai-je. Mon cri d’indignation devait m’être fatal. Le jour se levait. Mon stratagème fut découvert. On me reconduisit dans mon cachot, que l’on ferma à clef pour me punir.
CINQUIÈME TABLEAU
Le Troisième et Dernier Fantôme parle.
Même décor.
LE TROISIÈME ET DERNIER FANTÔME. — Mon histoire est certainement la plus lamentable. J’étais depuis de longues années à la Bastille et jamais, même en cherchant bien, je n’avais pu trouver un moyen d’évasion. Fils naturel d’un crétin des Alpes et d’une femme-chèvre, mon cerveau ne me permettait pas d’échafauder des plans trop compliqués. Enfin, après vingt-trois ans de détention et d’efforts cérébraux, je réussis à trouver une idée d’évasion. Je résolus de la mettre aussitôt à exécution. Hélas ! comme je m’apprêtais à fuir, une foule bruyante fit irruption dans mon cachot. « Citoyen ! tu es libre ! me cria-t-on, nous venons de prendre la Bastille ! »
LES DEUX VISITEURS DE LA COLONNE. — Nous comprenons. Ce jour-là était le 14 juillet 1789. Le peuple souverain venait de prendre la Bastille.
LE TROISIÈME ET DERNIER FANTÔME. — Oui. Je n’avais pas de chance ! Avoir cherché plus de vingt ans le moyen de fuir et être délivré juste le jour où j’avais enfin trouvé une idée d’évasion !
LES DEUX VISITEURS DE LA COLONNE. — Non, ce n’était vraiment pas de chance ! (Le jour se lève. Les Fantômes disparaissent. Le gardien, dégrisé, délivre les deux Visiteurs de la Colonne.)
RIDEAU
LE TRÉSOR DE L’ÉMIGRÉ
PREMIER ACTE
La mort du marquis.
La scène représente une chambre en Angleterre.
LE MARQUIS ÉMIGRÉ, sur son lit d’agonie. — Approche mon brave Hyacinthe, approche serviteur modèle. Dans quelques minutes j’aurai rendu ma belle âme à Dieu. Mais auparavant je vais te confier mes dernières volontés. Écoute attentivement. Il y va de l’avenir de mon fils âgé de dix-sept ans qui sanglote dans la chambre voisine.
HYACINTHE À LA COURTE MÉMOIRE. — J’écoute attentivement.
LE MARQUIS ÉMIGRÉ. — Nous avons émigré en 93, lorsque la Terreur éclata en France. Depuis, nous habitons l’Angleterre. Au moment d’émigrer, je ne pus me résoudre à laisser, aux mains des révolutionnaires, les terres que m’avaient léguées mes aïeux. Par bateaux spéciaux, je fis transporter en Angleterre les innombrables charrettes de terre qui composaient mes domaines. Les arbres de ma vaste forêt soigneusement déracinés émigrèrent également avec la terre dans laquelle ils étaient plantés depuis des siècles. Aujourd’hui, la Révolution est terminée en France. Dès que je serai mort, tu regagneras notre patrie avec mon pauvre enfant et vous irez habiter notre vieux château. Mon homme d’affaires t’expédiera toutes nos terres qui sont déposées dans une grande banque de Londres. Dès que nos terres auront repris leurs anciennes places dans notre beau pays de France et que la vaste forêt sera replantée, tu iras déterrer au pied du 77e chêne séculaire, le trésor que tu m’aidas à enfouir avant notre émigration. Tu t’en souviens, mon brave Hyacinthe ?
HYACINTHE À LA COURTE MÉMOIRE. — Monsieur le marquis m’excusera, mais je ne me souviens de rien. Hélas ! ce n’est pas sans raison que l’on m’a surnommé Hyacinthe à la courte mémoire.
LE MARQUIS ÉMIGRÉ. — C’est vrai. J’oubliais que tu manques complètement de mémoire. Mais… alors ? Comment te rappelleras-tu qu’un trésor est enfoui dans la forêt ? Ah ! quelle idée ! Donne-moi le coffret qui se trouve dans l’armoire. (Hyacinthe obéit.) Là, maintenant, fais un nœud à ton mouchoir.
HYACINTHE À LA COURTE MÉMOIRE. — Le nœud est fait.
LE MARQUIS ÉMIGRÉ. — Dépose ton mouchoir dans ce coffret. Donne un tour de clé. À ton retour en France, dès que la vaste forêt aura repris son ancienne place, il te suffira d’ouvrir ce coffret et de regarder le nœud de ton mouchoir pour te rappeler qu’un trésor est enterré au pied du 77e chêne séculaire. Ce trésor assurera l’avenir de mon pauvre enfant. Adieu ! Je meurs !
L’ODIEUX PERSONNAGE, dissimulé sous le lit. — Je connais à présent le secret du marquis émigré. D’ici peu, son trésor m’appartiendra ! À nous deux, monsieur Hyacinthe !
DEUXIÈME ACTE
Le coffret.
La scène représente une chambre dans un château.
HYACINTHE À LA COURTE MÉMOIRE. — Voilà déjà deux mois que nous sommes en France et que nous habitons le château de vos ancêtres. Les terres que feu monsieur le marquis votre père avait emportées avec lui lors de son émigration ont repris leurs places habituelles. La vaste forêt est presque complètement réinstallée. On replante aujourd’hui le dernier arbre.
LE FILS DE L’ÉMIGRÉ. — Le lendemain de la mort de mon pauvre père, tu me donnas à garder un coffret en me priant de l’ouvrir devant toi le jour où la vaste forêt serait remise en place. Ce coffret renferme, m’as-tu dit, un objet dont la vue doit te rappeler subitement une chose de la plus haute importance pour mon avenir.
HYACINTHE À LA COURTE MÉMOIRE. — Mon faible cerveau ne se souvient de rien. Mais l’objet renfermé dans ce coffret va certainement ranimer ma mémoire.
LE FILS DE L’ÉMIGRÉ, prenant le coffret. — J’ouvre le coffret. (Il l’ouvre.) Regarde Hyacinthe. Le mouchoir qui se trouve dans ce coffret te rappelle-t-il quelque chose ?
HYACINTHE À LA COURTE MÉMOIRE. — C’est horrible ! Ce mouchoir ne me rappelle rien… rien ! (Il tombe évanoui.)
LE FILS DE L’ÉMIGRÉ. — Courons chercher du secours ! (Il sort.)
L’ODIEUX PERSONNAGE, sortant de derrière une tapisserie. — Ma ruse a parfaitement réussi. J’avais défait le nœud du mouchoir enfermé dans le coffret. Ne voyant pas de nœud à son mouchoir, Hyacinthe n’a pu se rappeler l’existence du trésor de l’émigré. Et maintenant, sans craindre d’être dérangé, allons déterrer le trésor au pied du 77e chêne séculaire de la vaste forêt. (Il sort.)
TROISIÈME ACTE
« Hyacinthe, tu vas mourir ! »
Même décor.
HYACINTHE À LA COURTE MÉMOIRE. — Je reviens de mon évanouissement. Le mouchoir enfermé dans le coffret n’a pas réussi à ranimer mes souvenirs. Mais, dans l’intérêt de mon jeune maître, il faut que je me rappelle. Il le faut ! Ah ! quelle idée !
LE FILS DE L’ÉMIGRÉ. — Parle !
HYACINTHE À LA COURTE MÉMOIRE. — Vite, tirez votre épée, monsieur le marquis, et appuyez-en la pointe sur ma gorge en criant : « Hyacinthe, tu vas mourir ! »
LE FILS DE L’ÉMIGRÉ. — Après avoir perdu la mémoire, perdrais-tu la raison ?
HYACINTHE À LA COURTE MÉMOIRE. — Non. Faites ce que je vous demande, mon jeune maître, et nous sommes sauvés.
LE FILS DE L’ÉMIGRÉ. — Soit ! (Il appuie la pointe de son épée sur la gorge de Hyacinthe.) Hyacinthe, tu vas mourir !
HYACINTHE À LA COURTE MÉMOIRE. — Oh ! merveille ! Je me rappelle tout ! Un trésor est enfoui au pied du 77e chêne séculaire de la vaste forêt. Courons le déterrer, c’est l’héritage de monsieur votre père !
LE FILS DE L’ÉMIGRÉ. — Mais comment as-tu retrouvé la mémoire ?
HYACINTHE À LA COURTE MÉMOIRE. — Je vous expliquerai ça plus tard. Courons !
QUATRIÈME ACTE
Le trésor retrouvé.
La scène représente la vaste forêt.
HYACINTHE À LA COURTE MÉMOIRE. — Nous approchons. Mais que vois-je ? Un inconnu creuse la terre au pied du chêne séculaire ?
LE FILS DE L’ÉMIGRÉ. — Arrête, misérable ! (Il transperce de son épée l’odieux Personnage.)
HYACINTHE À LA COURTE MÉMOIRE. — Je comprends tout. Cet homme avait surpris notre secret.
L’ODIEUX PERSONNAGE, ricanant. — Oui, serviteur maudit, c’est moi qui ai dénoué le mouchoir du coffret ! (Il meurt.)
HYACINTHE À LA COURTE MÉMOIRE. — Voilà donc pourquoi je ne pouvais pas me rappeler ! Nous sommes arrivés à temps ! Le bandit s’apprêtait à emporter le trésor que monsieur votre père et moi avions enterré jadis au pied de cet arbre.
LE FILS DE L’ÉMIGRÉ. — Mais pourquoi tout à l’heure m’as-tu fait appuyer la pointe de mon épée sur ta gorge, et crier : « Hyacinthe, tu vas mourir ! » ?
HYACINTHE À LA COURTE MÉMOIRE. — C’était afin de voir défiler devant mes yeux toute mon existence.
LE FILS DE L’ÉMIGRÉ. — Je ne comprends pas.
HYACINTHE À LA COURTE MÉMOIRE. — Vous allez comprendre : Vous n’ignorez pas qu’à l’approche de la mort l’homme voit défiler en quelques secondes toute son existence devant ses yeux. Votre menace de mort m’a fait revoir instantanément tous mes moindres faits et gestes depuis ma naissance jusqu’à ce jour. Bref, parmi toutes ces visions rapides, je me suis revu avec feu M. le marquis, votre père, en train de cacher le trésor au pied de l’arbre séculaire. C’était tout ce que je désirais savoir. Deux minutes après nous étions ici, l’odieux Personnage était châtié et nous avions retrouvé le trésor de l’Émigré.
RIDEAU
LES DRAMES MONDIAUX
GRAND-DUC ET MARCHAND DE COCO
Drame de la steppe.
PREMIER ACTE
Perfide conseil.
La scène représente les steppes glacées de Russie.
LE MARCHAND DE COCO, à sa fille. — Tout bien réfléchi, c’est une mauvaise idée que j’ai eue de venir vendre du « coco » dans les steppes glacées de l’empire des tsars.
LA FILLE DU MARCHAND DE COCO. — Cher père, cette funeste idée vous fut inspirée par votre plus terrible concurrent parisien.
LE MARCHAND DE COCO. — C’est vrai. Pour n’avoir plus à redouter ma concurrence, le misérable me conseilla de partir, en m’affirmant qu’il y avait une fortune à gagner dans ce pays. Et nous voici parcourant ces mornes steppes avec un traîneau à trois chevaux sur lequel est posé un gigantesque tonneau contenant 12 000 litres de « coco ». Malheureusement, je n’avais pas réfléchi, avant notre départ, que le « coco » frais n’était pas la boisson rêvée pour ces pays froids.
LA FILLE DU MARCHAND DE COCO. — Aussi, lorsque, attiré par votre joyeux cri : « À la fraîche ! Qui veut boire ! », un cosaque surgit à l’horizon et vint goûter un verre de « coco », nous eûmes beaucoup de mal à calmer sa colère, quand il s’aperçut que notre boisson glaçait ses entrailles au lieu de les réchauffer.
LE MARCHAND DE COCO. — Averti par cette première expérience, j’eus l’idée de placer sous mon tonneau de fer un énorme réchaud qui conserve brûlant mon bon jus de réglisse. Hélas ! rien n’y fait ! Les affaires vont mal ! Poursuivons notre triste chemin ! (Hurlant dans son porte-voix.) Coco bouillant ! Bon coco bouillant ! Qui veut boire ?…
DEUXIÈME ACTE
La menace.
La scène représente les steppes glacées.
LE GRAND-DUC. — Je me promène à cheval à travers les steppes glacées. Mais qu’entends-je ? Un cri mystérieux traverse l’espace.
LA VOIX DU MARCHAND DE COCO. — Coco bouillant ! Bon coco bouillant !
LE GRAND-DUC, apercevant la fille du marchand de coco. — Oh ! oh ! la belle enfant ! (Il caresse le menton de la jeune fille.)
LE MARCHAND DE COCO, repoussant le bras du Grand-duc. — Halte-là !
LE GRAND-DUC. — Fils de chien ! Tu oses me toucher ! Sais-tu bien qui je suis ?
LE MARCHAND DE COCO. — Non ! Mais fussiez-vous le Petit Père lui-même, apprenez que la fille d’un marchand de coco doit être respectée à l’égal d’une princesse du sang !
LE GRAND-DUC, écumant de rage. — Fils de taupe ! C’est ce que nous allons voir ! Je veux ta fille ! Et pour assouvir mon caprice d’un instant, je vais la faire enlever par mes cosaques à roulette ! (Il s’éloigne au galop.)
LE MARCHAND DE COCO, à sa fille. — Oh ! fuyons ! car ce sont de farouches et rapides patineurs que les cosaques à roulettes ! Fuyons !
TROISIÈME ACTE
Mortel coco !
La scène représente les steppes glacées.
LE MARCHAND DE COCO. — Malédiction ! Placés l’un derrière l’autre, à la file indienne, trente cosaques montés sur patins à roulettes se dirigent vers nous à toute vitesse !
LA FILLE DU MARCHAND DE COCO. — Entendez leurs cris sauvages ! Bientôt ils nous auront rattrapés et m’emporteront vers le déshonneur !
LE MARCHAND DE COCO. — Non, ma fille ! Arrêtons les chevaux et attendons les cosaques de pied ferme. J’ai une idée ! (Il arrête son traîneau.)
LA FILLE DU MARCHAND DE COCO. — Père ! père ! que faites-vous ?
LE MARCHAND DE COCO, grimpant sur le tonneau de coco. — Vite ! Fais-moi passer l’énorme seringue qui me sert à puiser le coco dans le tonneau pour servir les clients.
LA FILLE DU MARCHAND DE COCO, lui tendant la seringue. — Voilà… Ciel ! les cosaques à roulettes ne sont plus qu’à deux cent sept mètres environ ! Nous sommes perdus !
LE MARCHAND DE COCO. — Non ! Rapidement, je remplis ma seringue de coco chaud, j’épaule, je vise, et pan ! Regarde, ma fille !
LA FILLE DU MARCHAND DE COCO. — Oh ! miracle ! Les trente cosaques qui arrivaient à la file indienne tombent transpercés les uns derrière les autres, par le terrible jet de coco ! Oh ! l’horrible brochette humaine ! Qu’est-ce que cela veut dire, père ?
LE MARCHAND DE COCO. — Cela veut dire que, grâce au froid terrible, le coco s’est instantanément congelé en sortant de ma seringue. Le jet puissant, transformé en une immense flèche de glace, a transpercé de part en part l’un derrière l’autre les trente cosaques à roulettes.
LA FILLE DU MARCHAND DE COCO. — Nous sommes sauvés ! Mais retournons en France et quittons ce pays où le marchand de coco est obligé, pour se défendre, de transformer sa paisible boisson en arme meurtrière : en coco qui tue !
RIDEAU
LE BRIGAND MUET DE LA CALABRE
PREMIER TABLEAU
Carrière brisée.
La scène représente la maison du Brigand.
LA FEMME DU BRIGAND. — Mon mari, le Brigand de la Calabre, est devenu subitement muet. Au cours d’une conversation, un de ses amis lui coupa brutalement la parole !
LA FILLE DU BRIGAND. — Pauvre père !
LA FEMME DU BRIGAND. — Qu’allons-nous devenir ? Sa carrière de brigand est brisée. À présent qu’il est muet, il ne pourra plus attaquer les voyageurs dans la forêt.
LA FILLE DU BRIGAND. — Pourquoi, mère ?
LA FEMME DU BRIGAND. — Parce qu’il ne pourra plus crier : « La bourse ou la vie ! »
LA FILLE DU BRIGAND. — C’est vrai !
LA FEMME DU BRIGAND. — S’il ne prononce pas cette phrase classique, aucun voyageur ne se doutera que ton père est un brigand de la Calabre.
LA FILLE DU BRIGAND. — Ils ne s’en douteront pas et ne lui tendront pas leur bourse en tremblant. Mais il me vient une idée ; je cours jusqu’à la ville voisine et je reviens. Grâce à moi, mon pauvre père pourra continuer son métier dans notre chère forêt. (Elle sort.)
DEUXIÈME TABLEAU
Une idée pratique.
Même décor.
LA FILLE DU BRIGAND, entrant. — Cher père, soyez heureux. Malgré votre infirmité, vous allez pouvoir retourner à vos occupations : prenez ce phonographe que je viens d’acheter à la ville voisine.
LE BRIGAND MUET DE LA CALABRE, en lui-même. — Un phonographe ?
LA FILLE DU BRIGAND. — Il est muni d’un rouleau sur lequel j’ai fait enregistrer votre phrase professionnelle : « La bourse ou la vie ! » À l’approche des voyageurs, vous ferez marcher l’appareil, qui parlera à votre place.
LE BRIGAND MUET DE LA CALABRE, en lui-même. — Quelle bonne idée ! (Il embrasse sa fille.) Chère petite créature, grâce à son ingéniosité, je vais pouvoir continuer l’exercice de ma profession. Allons, ne perdons pas de temps, partons dans la forêt prochaine.
LA FEMME DU BRIGAND. — Je lis dans ton regard que tu cherches ton escopette et ton parapluie. Les voici.
LA FILLE DU BRIGAND. — Père, prenez cette table pour poser le phonographe et n’oubliez pas votre pliant. Au revoir, père. Bonne chance. (Le Brigand muet de la Calabre sort, tenant dans ses bras le phonographe, la table, le pliant, l’escopette et le parapluie.)
TROISIÈME TABLEAU
La bourse ou la vie !
La scène représente la grand-route qui traverse la forêt.
LE BRIGAND MUET DE LA CALABRE, en lui-même. — Depuis plus de sept heures je suis installé au bord de la route ; je tiens mon parapluie ouvert au-dessus de ma tête, car il pleut sans discontinuer. Mon phonographe est posé sur la table, mon escopette est fixée sur mes genoux et je suis assis sur mon pliant. Nul voyageur n’est encore passé. Mais, je ne me trompe pas. En voici un qui se dirige de mon côté. Il approche. Faisons jouer le phonographe.
LE PHONOGRAPHE, criant. — « La bourse ou la vie ! » « La bourse ou la vie ! » « La bourse ou la vie ! »
LE VOYAGEUR, apercevant le phonographe. — Tiens, un phonographe. (Au Brigand muet de la Calabre.) Pauvre mendiant, vous faites jouer inutilement votre phonographe ; je suis sourd. Prenez quand même ce sou que je vous donne par charité, pauvre misérable. (Il lui donne un sou et s’éloigne tranquillement.)
LE BRIGAND MUET DE LA CALABRE, en lui-même, avec amertume. — Voilà bien ma chance. Après plus de sept heures d’attente sous une pluie torrentielle, je tombe sur un voyageur qui me prend pour un mendiant et qui me donne un sou par charité. Il est vrai qu’il était sourd. Il ne pouvait se douter que je suis un brigand puisqu’il n’entendait pas le phonographe crier : « La bourse ou la vie ! » (Chargé de son matériel, il regagne tristement sa demeure.)
RIDEAU
LES DRAMES DU TYROL
PREMIER ACTE
Rivaux d’amour.
La scène représente un chalet tyrolien.
LA BELLE TYROLIENNE. — Voici l’heure où mon fiancé, le Berger tyrolien passe devant mon chalet pour conduire ses moutons sur les hauts sommets. J’entends des pas. Ce doit être lui ! Non ! ce n’est pas lui !… C’est le Pâtre du Sanatorium, qui m’aime et que je n’aime pas.
LE PÂTRE DU SANATORIUM. — Avez-vous réfléchi, belle Tyrolienne ? Voulez-vous devenir ma femme ?
LA BELLE TYROLIENNE. — Non, j’aime le Berger tyrolien !
LE PÂTRE DU SANATORIUM. — Folie ! Aimer ce jeune berger sans fortune ! Ma situation est, certes, plus brillante que la sienne. Songez que je suis le Pâtre du Sanatorium !
LA BELLE TYROLIENNE. — Je sais. Vous êtes chargé de mener paître sur les sommets les pensionnaires végétariens du Sanatorium.
LE PÂTRE DU SANATORIUM. — Oui, et tous les riches végétariens que je mène aux pâturages me donnent de magnifiques pourboires. Ah ! je peux le dire sans me vanter : je suis ce qu’on appelle un riche parti !
LA BELLE TYROLIENNE. — J’aime le Berger tyrolien. Mais le voici qui vient. De sa voix puissante, il chante sa tyrolienne favorite.
LE PÂTRE DU SANATORIUM, d’une voix farouche. — Je me retire. (Il s’éloigne rapidement.)
LE BERGER TYROLIEN, arrivant en chantant :
Si j’étais Espagnol
Je chanterais l’Espa-â-gne !
Mais je suis du Tyrol,
Je chante mes monta-â-gnes !
Redressant mon torse nerveux
Je chante ce refrain joyeux :
Trou, la, la, trou, la, la, itou !
Trou, la, la, trou, la, la, iti !
Trou, la, la, trou, la, la, itou !
Trou, la, la, trou, la, la, iti !
La, iti !
LA BELLE TYROLIENNE. — Cher Berger, ta voix gutturale remue jusqu’au plus profond de mon être.
LE BERGER TYROLIEN. — Chère belle Tyrolienne ! Bientôt tu seras ma femme !
LA BELLE TYROLIENNE. — Prends ce bouquet de lierre cueilli à ton intention. C’est l’emblème de la fidélité.
LE BERGER TYROLIEN. — Oh ! merci. (Il serre le bouquet sur sa poitrine.) À ce soir, belle Tyrolienne ! (Il s’éloigne avec son troupeau.)
LE PÂTRE DU SANATORIUM, dissimulé derrière un arbre. — Ah ! maudit Berger ! J’ai comme un pressentiment que tu ne redescendras plus de la montagne !
DEUXIÈME ACTE
Le gouffre sans fond.
La scène représente le sommet de la montagne.
LE BERGER TYROLIEN. — Mes moutons paissent dans les pâturages qui bordent le « gouffre sans fond ». Je rêve à ma belle Tyrolienne. Mais j’entends des pas. Quelqu’un monte le sentier escarpé.
LE PÂTRE DU SANATORIUM. — Bonjour, camarade Berger. Je me rends au Sanatorium. (Doucereux.) Tu devrais m’imiter, l’ami, et venir te placer au Sanatorium pour garder les riches végétariens.
LE BERGER TYROLIEN, avec dignité. — J’aime mieux garder mes moutons !
LE PÂTRE DU SANATORIUM. — À ton aise ! (D’une voix mielleuse.) Je suis en avance. Veux-tu, pour nous divertir un moment, que nous fassions une partie de colin-maillard ?
LE BERGER TYROLIEN. — Soit ! (Il se laisse bander les yeux et court à l’aveuglette pour attraper le Pâtre du Sanatorium.) Où donc es-tu, camarade Pâtre ?
LE PÂTRE DU SANATORIUM. — Par ici, tout droit, un peu plus loin ! Là !
LE BERGER TYROLIEN. — Ciel ! Je tombe ! (Il disparaît dans le gouffre sans fond.)
LE PÂTRE DU SANATORIUM. — Ma ruse a parfaitement réussi. Mon rival a disparu dans l’abîme. Et maintenant, aussi vrai que je ne m’appelle pas Léonard, la belle Tyrolienne m’appartiendra !
TROISIÈME ACTE
Le mort qui chante.
La scène représente le chalet de la belle Tyrolienne.
LA BELLE TYROLIENNE. — Vingt ans déjà ! Vingt ans que mon fiancé, le Berger tyrolien, a disparu dans la montagne. (Une larme coule lentement sur sa joue.) La nuit vient. L’orage gronde au loin. Rentrons dans mon triste chalet.
LE PÂTRE DU SANATORIUM, surgissant dans l’ombre. — Oui, rentrons. (Il la pousse dans le chalet.) Il faut que je vous parle. Je ne peux plus attendre. Le feu du désir me consume petit à petit depuis vingt ans ! Une dernière fois, voulez-vous devenir ma femme ?
LA BELLE TYROLIENNE. — J’aime le Berger tyrolien !
LE PÂTRE DU SANATORIUM. — Mais puisqu’il a disparu ! Puisqu’il est sûrement mort dans la montagne !
LA BELLE TYROLIENNE. — J’ai le pressentiment qu’il reviendra un jour. Je l’attendrai.
LE PÂTRE DU SANATORIUM. — À la fin, c’en est trop ! La patience a des limites ! Nous sommes seuls ! Rien ne pourra te soustraire à mon baiser de feu !
LA VOIX DU BERGER TYROLIEN, dans le lointain.
Si j’étais Espagnol
Je chanterais l’Espa-â-gne !
Mais je suis du Tyrol,
Je chante mes monta-â-gnes !
Redressant mon torse nerveux
Je chante ce refrain joyeux.
LE PÂTRE DU SANATORIUM. — Cette voix ! Je deviens fou !
LA VOIX DU BERGER TYROLIEN, au loin :
Trou, la, la, itou !
LA BELLE TYROLIENNE. — Cette voix ! C’est lui !
LA VOIX DU BERGER TYROLIEN, se rapprochant :
Trou, la, la, iti !
LE PÂTRE DU SANATORIUM. — Je rêve ! Ce n’est pas possible. Non ! Les morts ne chantent pas de tyroliennes !
LA VOIX DU BERGER TYROLIEN, se rapprochant de plus en plus :
Trou, la, iti, la, la !
Trou, la, iti, la, la !
La, i, la, i, la, i, la,
La, iti !
LA BELLE TYROLIENNE. — Oh ! c’est lui ! c’est lui ! Au secours, mon bien-aimé !
LE BERGER TYROLIEN, entrant. — J’arrive à temps !
LE PÂTRE DU SANATORIUM. — Lui ! Lui ! (Il tombe mort de peur.)
LE BERGER TYROLIEN. — Que Dieu lui pardonne. C’est lui qui m’avait précipité dans le gouffre sans fond.
LA BELLE TYROLIENNE. — Ciel ! Depuis vingt ans dans ce précipice ?
LE BERGER TYROLIEN. — Oui. Et c’est grâce à toi, chère bien-aimée, que j’ai réussi à me sauver.
LA BELLE TYROLIENNE. — Grâce à moi ?
LE BERGER TYROLIEN. — Oui. Par un heureux hasard, le fond du gouffre était couvert d’un épais tapis de neige. Je ne me fis pas de mal en tombant. Mais qu’allais-je devenir dans ce précipice, à plus de 2 000 mètres de profondeur ?
LA BELLE TYROLIENNE. — Qu’allais-tu devenir ?
LE BERGER TYROLIEN. — Je me le demandai avec inquiétude lorsque ma main rencontra, sous mon veston, le bouquet de lierre que tu m’avais donné en gage de fidélité. L’idée qui devait me sauver germa subitement dans mon cerveau. Sans perdre une seconde, je plantai ton modeste lierre au fond du précipice. Au bout de quelques jours, le lierre avait déjà poussé et ses racines commençaient à grimper le long des parois du précipice. Sans hésiter, j’entrelaçai mes jambes et mon corps avec le lierre vigoureux qui, tel un ascenseur, me montait avec lui à mesure qu’il grimpait. Me nourrissant d’escargots, qui abondaient sur le rocher, et me désaltérant grâce au torrent qui passait à côté de moi, je pus résister aux fatigues de ma terrible ascension. Enfin, après vingt ans de ce terrible voyage, mon lierre-ascenseur atteignit les bords du gouffre. Sauvé ! J’étais sauvé, et ramené vers toi par la petite plante, emblème de fidélité.
RIDEAU
L’EMPALÉ
Drame turc.
PREMIER TABLEAU
Avant l’exécution.
PREMIER SPECTATEUR IMPATIENT. — L’heure approche. C’est à sept heures que l’on doit empaler le condamné à mort.
DEUXIÈME SPECTATEUR IMPATIENT. — J’aperçois le Juge et le Bourreau qui se dirigent de notre côté.
LE JUGE, au Bourreau. — Sept heures moins le quart. Le condamné n’est pas encore arrivé.
LE BOURREAU. — Il n’est pas en retard. Je ne lui ai donné rendez-vous que pour sept heures.
LE JUGE. — Espérons qu’il ne nous fera pas trop attendre. On a peut-être eu tort de lui accorder sa liberté provisoire après sa condamnation à mort.
LE BOURREAU. — Il était difficile de ne pas lui accorder cette grâce. C’était son dernier vœu. En attendant qu’il arrive, je vais toujours dresser le pal. (Avec ses aides, il plante l’appareil de supplice.)
LE JUGE, consultant sa montre. — Ça y est, il ne viendra pas ! Il est sept heures.
LE BOURREAU. — Il a encore le quart d’heure de grâce. Attendons.
LE JUGE, consultant sa montre. — Sept heures dix. Il est inutile d’attendre plus longtemps.
LE BOURREAU. — Le voilà. Il arrive en auto-taxi.
LE JUGE, au condamné. — Vous arrivez juste. Une minute de plus, vous ne trouviez personne.
LE CONDAMNÉ À MORT. — Excusez-moi. J’ai pris une auto pour arriver plus vite. Mais ne bavardons pas et rattrapons le temps perdu. Que faut-il faire ?
LE BOURREAU, aimable. — C’est bien simple. Vous allez vous asseoir sur cette pointe de fer.
LE CONDAMNÉ À MORT. — Sur ce paratonnerre ?
LE BOURREAU. — Oui.
LE CONDAMNÉ À MORT. — N’y a-t-il pas danger d’être frappé par la foudre ?
LE BOURREAU. — Non. D’ailleurs, le temps n’est pas à l’orage. Prenez donc la peine de vous asseoir.
(Le condamné s’assied sur le pal.)
DEUXIÈME TABLEAU
L’empalé souriant.
LE JUGE, consultant sa montre. — Voilà deux heures que le condamné à mort est empalé. Il n’a pas l’air de vouloir mourir.
LE BOURREAU. — Son visage est souriant. Je n’y comprends rien. Il est pourtant bien empalé de bas en haut. La pointe du pal ressort par la bouche. C’est extraordinaire !
PREMIER ET DEUXIÈME SPECTATEURS IMPATIENTS. — C’est extraordinaire, en effet.
LE JUGE. — Le plus ennuyeux, c’est que j’ai du monde à déjeuner. Si l’empalé ne se décide pas à terminer cette plaisanterie de mauvais goût, je vais être en retard.
LE BOURREAU. — La pluie se met de la partie. Nous allons être trempés.
PREMIER SPECTATEUR IMPATIENT. — La patience a des limites. Je rentre chez moi.
DEUXIÈME SPECTATEUR IMPATIENT. — Ce condamné met évidemment de la mauvaise volonté. Je rentre également.
(Le Juge et le Bourreau restent seuls près de l’Empalé souriant.)
TROISIÈME TABLEAU
Et toujours le sourire !
LE JUGE, consultant sa montre. — Deux heures de l’après-midi. J’ai dû envoyer un message à mes invités pour les prier de m’excuser. Cet Empalé a toujours l’œil vif et le sourire !
LE BOURREAU. — De ma vie de bourreau je n’ai vu chose pareille !
LE JUGE. — Nous sommes trempés comme des éponges ! Il faut en finir. (Bas, au Bourreau.) Je vais essayer d’effrayer le condamné. (Haut, à l’Empalé.) Alors, vous vous moquez de la justice ! Savez-vous qu’un condamné à mort qui s’obstine à ne pas mourir est passible des travaux forcés à perpétuité ?
LE BOURREAU. — La menace n’a pas l’air de l’effrayer. Il sourit toujours !
LE JUGE, hors de lui, hurlant. — Enfin, me direz-vous pourquoi vous vous obstinez à vivre en dépit des lois et de la logique ?
LE BOURREAU. — C’est peut-être le Diable ?
LE CONDAMNÉ, se décidant à parler. — Non, je ne suis pas le Diable : je suis un ancien avaleur de sabres. Alors, vous comprenez, j’ai l’habitude !
RIDEAU
L’EUNUQUE DE ZANZIBAR
Drame galant.
PREMIER ACTE
Ali et Fathma.
La scène représente une forêt de bambous près de Zanzibar.
ALI. — Chère Fathma, nous voici comme chaque jour, réunis dans la forêt de bambous.
FATHMA-LA-BLONDE. — Oui, cher Ali, nous sommes assis sur le vieux banc qui sert de rendez-vous à tous les amants de Zanzibar. Cher vieux banc ! Chante-moi, mon Ali, chante-moi la mélancolique chanson que le poète composa en son honneur.
ALI, chantant :
Sous les grands bambous il est un vieux banc,
En bouts de bambous un vieux bout de banc,
You ! You !
De tous les amants c’est le rendez-vous,
Le vieux bout de banc en bouts de bambous !
You !
FATHMA-LA-BLONDE. — Oh ! comme cette mélopée me rend triste !
ALI. — Tes yeux sont noyés de larmes ! Oh ! chère Fathma, ne me caches-tu rien ? Toi qui seras bientôt ma femme, n’hésite pas à me confier le chagrin de ton âme.
FATHMA-LA-BLONDE. — Hélas ! cher Ali, mon cœur est rempli de sinistres pressentiments. Je sais de source certaine que le sultan de Zanzibar a remarqué ma divine beauté. Il veut me faire enlever pour m’enfermer dans son harem.
ALI. — Ne crains rien, chère Fathma. Si le sultan de Zanzibar te séquestre dans son harem, Ali saura toujours te délivrer.
FATHMA-LA-BLONDE. — Oh ! regarde, cher Ali : une bande d’hommes à figures sinistres se dirige de notre côté. Ils viennent sans doute pour m’enlever. Fuyons !
ALI. — Reste, chère Fathma. Quant à moi, je fuis rapidement. Je dois rester libre pour te délivrer bientôt. Courage ! (Il fuit rapidement.)
LES HOMMES SINISTRES. — Enlevons Fathma-la-Blonde, et transportons-la dans le harem de notre maître, le sultan de Zanzibar. Enlevons ! (Ils enlèvent Fathma-la-Blonde.)
DEUXIÈME ACTE
Le gardien du harem.
La scène représente le harem du sultan.
FATHMA-LA-BLONDE. — Voilà déjà trois mois que je suis prisonnière dans le harem du sultan. Ali oublierait-il sa promesse ? Ali ne viendra-t-il pas me délivrer ? Mais, un eunuque s’approche de moi. Sans doute, vient-il me chercher pour me conduire auprès de son maître.
L’EUNUQUE, à voix basse. — C’est moi, chère Fathma, c’est moi, ton fiancé Ali, déguisé en eunuque pour te sauver. Cette nuit, dès que le harem sera endormi, nous fuirons. Chut ! À ce soir ! (Il s’éloigne.)
TROISIÈME ACTE
On ne pense pas à tout !
La scène représente la campagne de Zanzibar.
ALI. — Chère Fathma, nous venons de quitter le harem. Grâce à ma ruse, te voilà sauvée !
FATHMA-LA-BLONDE. — Merci, cher Ali. Pour te prouver ma reconnaissance, je ne veux pas retarder plus longtemps notre mutuel bonheur. Sous ce clair de lune oriental, mon corps se donne à toi ! Prends-le.
ALI, avec tristesse. — Impossible, chère Fathma. Pour te délivrer du harem, j’ai dû me faire eunuque.
FATHMA-LA-BLONDE. — Qu’entends-je ? Quoi, ce costume n’est pas déguisement ? Tu es véritablement eunuque ?
ALI. — Il n’y avait pas moyen de faire autrement pour pénétrer dans le harem et te délivrer. Ma ruse a parfaitement réussi.
FATHMA-LA-BLONDE. — Oh ! la fatale ruse ! Pourquoi m’avoir délivrée puisque nous ne pourrons jamais nous aimer ?
ALI. — C’est vrai. Je n’avais pas réfléchi. Par Allah ! suis-je distrait tout de même !
RIDEAU
FATAL HYMEN
PREMIER ACTE
Amour brisé.
La scène représente une mansarde.
LE POÈTE DE LA MANSARDE. — Oh ! douleur ! Contrainte par sa famille, l’ingénue que j’aime et qui m’adore va se marier avec un riche et jeune fat ! Notre beau rêve d’amour est brisé !
LE GRAND-PÈRE MUSE. — Oui. Si ses cruels parents avaient consenti à votre union, c’est elle qui m’aurait remplacé dans le rôle de muse que tu me fais jouer auprès de toi afin de te faciliter l’inspiration.
LE POÈTE DE LA MANSARDE, avec un douloureux sourire. — C’est vrai, pauvre grand-père. Voilà déjà de longs mois que, vêtu de gazes légères et le crâne couvert d’une blonde perruque de femme, vous voulez bien me donner l’illusion d’avoir à mes côtés la muse indispensable au poète.
LE GRAND-PÈRE MUSE. — Ne pleure plus, ô poète ! et prends ton luth ! Souviens-toi que tu dois livrer cet après-midi ton poème à la grande maison de sardines à l’huile Curnonsko.
LE POÈTE DE LA MANSARDE. — Soit ! Au travail ! (Il écrit.)
Ah ! si j’étais sardine à l’huile,
Baronne, je le dis bien haut,
Je n’élirais mon domicile
Que dans la boîte Curnonsko !
L’INGÉNIEUSE INGÉNUE, entrant. — Ô cher Poète de la mansarde, mes parents sont inflexibles ! Ils veulent que j’épouse le riche et jeune Fat. Soit ! J’obéirai.
LE POÈTE DE LA MANSARDE. — Ô cruelle !
L’INGÉNIEUSE INGÉNUE. — Mais sèche tes larmes, ô mon poète ! J’ai une idée. Mon hymen sera de courte durée, et dans huit mois au plus tard, nous pourrons nous aimer librement. J’ai mon idée. Mais, pour que mon plan réussisse, il faut que mon hymen soit célébré au Groenland. Ô mon poète, à bientôt. (Elle sort.)
DEUXIÈME ACTE
Le consentement.
La scène représente un appartement riche.
LE PÈRE DE L’INGÉNUE, à sa femme. — Eh bien, madame, notre fille est-elle enfin décidée à épouser le riche et jeune Fat ? A-t-elle renoncé à son misérable poète de la mansarde ?
LA MÈRE DE L’INGÉNUE. — Oui, mon ami. Mais la voici qui s’avance.
L’INGÉNIEUSE INGÉNUE. — Mon père, je renonce à contrecarrer plus longtemps votre volonté. J’accepte de devenir la femme du riche et jeune Fat.
LE PÈRE DE L’INGÉNUE. — Bravo ! Enfin, vous voilà redevenue raisonnable, ma fille.
LA SOUBRETTE, annonçant. — Le riche et jeune Fat !
LE PÈRE DE L’INGÉNUE. — Bonne nouvelle, riche et jeune Fat. Surmontant enfin toute répulsion, ma fille consent à vous accorder sa main.
LE RICHE ET JEUNE FAT. — Oh ! bonheur sans mélange !
L’INGÉNIEUSE INGÉNUE. — Oui, riche et jeune Fat, je consens à devenir votre femme, mais à une condition, c’est que le mariage sera célébré au Groenland.
TROISIÈME ACTE
L’amour qui tue.
La scène représente la mansarde du Poète.
LE GRAND-PÈRE MUSE. — Poète, prends ton luth ! Il te faut chanter aujourd’hui le Coricide des tsars et les Nouilles suprêmes.
LE POÈTE DE LA MANSARDE. — Non, Grand-père muse ; aujourd’hui, j’ai beau te contempler de mes yeux rêveurs, l’inspiration ne vient pas. Je pense à celle qui, depuis huit mois déjà, est partie au Groenland pour épouser le riche et jeune Fat. Ah ! je souffre !
LE GRAND-PÈRE MUSE. — Espère, ô poète ! Ta chère Ingénue t’a promis de revenir.
L’INGÉNIEUSE INGÉNUE, entrant. — Victoire ! ô mon poète ! Je te reviens libre et plus amoureuse que jamais. Mes parents consentent enfin à notre union.
LE POÈTE DE LA MANSARDE. — Mais… votre mari, le riche et jeune Fat ?
L’INGÉNIEUSE INGÉNUE. — Mort !
LE POÈTE DE LA MANSARDE. — Ciel ! Un crime ?
L’INGÉNIEUSE INGÉNUE. — Non, mon poète ! Mais l’amour me rendit ingénieuse et me donna la merveilleuse idée d’aller me marier au Groenland.
LE POÈTE DE LA MANSARDE. — Mais, enfin, pourquoi au Groenland ? Pourquoi ?
L’INGÉNIEUSE INGÉNUE, baissant les yeux. — Parce que dans ces régions polaires la nuit dure six mois. Notre nuit de noces a donc duré six mois. Mon mari ne put résister à cette terrible épreuve. Il en est mort. Comprends-tu maintenant, ô mon poète, pourquoi j’ai voulu me marier au Groenland ?
RIDEAU
LES DRAMES DE LA TERRE ET DE LA MER
LES DRAMES DE LA MER
ACTE PREMIER
Appareillage.
La scène représente le pont d’un navire.
L’ÉLEVEUR EXPORTATEUR, au capitaine. — Votre navire, le Plat d’Ésaü, ainsi baptisé à cause de sa mâture, va transporter en Chine ma cargaison d’araignées comestibles dont les Chinois sont friands. Prenez-en bien soin, capitaine du Plat d’Ésaü.
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Comptez sur moi, mon cher Éleveur exportateur.
L’ÉLEVEUR EXPORTATEUR. — J’ai fait ranger d’un côté de la cale les araignées comestibles et, de l’autre côté, les araignées de chasse ou araignées susceptibles, c’est-à-dire celles qui prennent tout de suite la mouche. Les Chinois en raffolent. Avez-vous beaucoup de passagers pour cette traversée, capitaine du Plat d’Ésaü ?
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Six, comme d’habitude : la stabilité de mon navire ne me permet pas d’en embarquer davantage. Encore ai-je fait afficher un avis défendant d’éternuer à bord. Il faut si peu de chose pour déplacer l’équilibre de mon cher vaisseau. Mais trêve de bavardage, l’heure d’appareiller est arrivée.
L’ÉLEVEUR EXPORTATEUR, quittant le bord. — Je regagne la terre. Au revoir ! Bonne traversée, capitaine du Plat d’Ésaü. (Il part.)
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Je vais donner définitivement le signal du départ. (Il crie dans son porte-voix.) Gonflez les voiles !
CHŒUR DES SIX PASSAGERS, surpris. — Gonfler les voiles ?
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Oui. Mes voiles se gonflent au gaz comme les ballons. De cette façon, je n’ai pas à m’inquiéter du vent. Qu’il souffle ou non, mon cher vaisseau, ayant toujours ses voiles gonflées, file rapidement sur les flots azurés. (Il crie dans son porte-voix.) : « Hissez les surprises à l’extrémité des mâts ! »
CHŒUR DES SIX PASSAGERS. — Avons-nous bien entendu ? A-t-il dit : « Hissez les surprises à l’extrémité des mâts ! » ?
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — C’est une idée à moi : Pour stimuler l’ardeur de mes matelots, j’ai transformé les mâts de mon cher navire en mâts de cocagne. Je fais accrocher à leurs extrémités des paquets-surprises contenant des chiques stérilisées, des pipes en celluloïd, etc., etc. Grâce à ce procédé, mes gabiers sont encouragés à grimper à la mâture.
CHŒUR DES SIX PASSAGERS. — Excellente idée !
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ », dans son porte-voix. — Levez l’ancre ! Couvrez-la de sa housse à cause de la poussière, et à Dieu vat !
(Le « Plat d’Ésaü » prend la mer.)
ACTE DEUXIÈME
L’accident.
La scène représente le pont du « Plat d’Ésaü ».
CHŒUR DES SIX PASSAGERS. — Depuis que le Plat d’Ésaü a quitté le port, tout va bien. À part la défense d’éternuer et l’obligation de se tenir immobile au milieu du pont pour ne pas faire basculer le navire, tout va pour le mieux.
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — J’ai oublié de vous prévenir qu’en cas de danger la sonnette d’alarme se trouve placée dans la poche droite de mon veston.
LE DEUXIÈME PASSAGER. — À quoi sert cette sonnette d’alarme ?
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Voici : dès qu’une violente tempête est déchaînée, si les passagers ont quelque motif sérieux d’être inquiets, ils agitent la sonnette d’alarme. Immédiatement prévenu, j’accours, et je leur lis les « Conseils aux noyés » par le quartier-maître honoraire Gus-Bofa. Vous voyez que les passagers n’ont rien à craindre sur le Plat d’Ésaü.
CHŒUR DES SIX PASSAGERS. — C’est merveilleux !
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ », agitant la sonnette d’alarme. — Tonnerre de Brest ! les voiles prennent feu ! (On entend une formidable explosion.) Les voiles gonflées au gaz viennent de sauter ! Tonnerre de Bois-Colombes ! qui a mis le feu ?
LE DEUXIÈME PASSAGER. — Sapristi ! C’est moi sans le faire exprès !
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Comment, vous ?
LE DEUXIÈME PASSAGER. — Oui. Mon front est affligé d’une énorme loupe. Les rayons du soleil, en passant à travers, ont mis le feu aux voiles.
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Nous sommes perdus ! Le Plat d’Ésaü est immobilisé à présent ! Sans voiles il ne peut plus avancer !
LE PREMIER PASSAGER, proposant timidement. — On pourrait peut-être descendre et pousser par-derrière.
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ », haussant les épaules. — On voit que vous n’avez aucune notion sérieuse de navigation. (À part.) Relevons le courage de ces malheureux par quelques paroles réconfortantes. (Il prend son porte-voix et hurle :) À moins d’un miracle improbable, nous sommes condamnés à mourir de faim au milieu de l’Océan. Mais, tonnerre de Clichy-Levallois ! courage ! Ne désespérons pas !
ACTE TROISIÈME
La faim.
Même décor.
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Voilà plus de quinze jours que le Plat d’Ésaü est immobilisé au milieu de l’Océan. Les provisions de bouche sont épuisées. Mes passagers sont déprimés. J’ai beau placer tous les soirs une araignée de la cargaison sur le pont en criant : « Araignée du soir… Espoir ! » rien ne ranime le courage de mes passagers.
CHŒUR DES PASSAGERS. — Nous avons faim !
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Un seul des passagers ne se plaint pas. C’est étrange ! (Au passager qui ne se plaint pas.) Vous n’avez donc pas faim, vous ?
LE PASSAGER PRÉVOYANT DE L’AVENIR. — Avant de partir j’ai prévu tous les risques d’un voyage au long cours. J’ai pris mes précautions.
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Quelles précautions ?
LE PASSAGER PRÉVOYANT DE L’AVENIR. — Un habile chirurgien a remplacé mon estomac par un estomac d’autruche. De cette façon, je peux me nourrir avec n’importe quel objet. Par exemple cette sonnette (Il prend et avale la sonnette d’alarme.) calmera ma faim quelques instants.
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Mille sabords ! C’est la sonnette d’alarme !
LE PASSAGER PRÉVOYANT DE L’AVENIR. — Excusez-moi. Je ne recommencerai plus.
LE PREMIER PASSAGER, bondissant. — Je devine à présent où sont passés mes brodequins à talons bottier que je cherche inutilement depuis deux jours. Monsieur en a sans doute fait ses choux gras ! (Avec colère, hurlant.) Il a les talons dans l’estomac !
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Calmez-vous, premier Passager.
LE PREMIER PASSAGER. — Parbleu ! vous pouvez être calme, vous, capitaine ! Vous gardez ce qui reste de vivres pour votre consommation personnelle.
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Le règlement ordonne au capitaine de quitter son vaisseau le dernier.
LE TROISIÈME PASSAGER. — Vous aurez donc l’affreux courage de nous voir tous partir vers l’autre monde sans partager les vivres qui restent.
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Je partirai le dernier. C’est mon devoir.
LE PREMIER PASSAGER. — Il faut trouver une solution. Puisqu’il nous est impossible d’avaler comme Monsieur (Il désigne le passager-autruche.) des sonnettes, des brodequins et autres camelotes, je propose de tirer à la courte-paille pour savoir qui sera mangé.
LE PASSAGER PRÉVOYANT DE L’AVENIR. — Vous m’excuserez de ne pas m’associer à vos jeux. J’ai horreur des jeux de hasard.
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Tonnerre de Brest ! Votre jeu est impossible. Il n’y a pas un seul brin de paille à bord.
CHŒUR DES PASSAGERS. — Comment faire ?
LE MATELOT ANGOISSÉ, accourant. — Capitaine ! Mathurin, le gabier boiteux, vient d’être victime d’un horrible accident ! Il vient d’avoir les deux jambes coupées ! Nous achevions une partie de cartes dans la cale, lorsque Mathurin commit l’imprudence de poser ses jambes sur la table au moment où j’abattais ma carte pour « couper ». Un cri d’horreur partit de toutes nos poitrines ! Trop tard ! Mathurin était cul-de-jatte pour le reste de ses jours ! Ses deux jambes, coupées par mon « atout maître », gisaient inanimées, sur le sol.
LE PREMIER PASSAGER, joyeusement. — Mais, j’y pense ! Puisque Mathurin, le gabier, était boiteux, ses deux jambes coupées sont d’inégale longueur et vont nous servir pour tirer à la courte-jambe.
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Parfait ! Qu’on apporte sur le pont les jambes de Mathurin. (On apporte les jambes dans un sac. Les passagers et les matelots tirent à la cour te-jambe. Le sort désigne un vieux marin breton.)
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Le sort a désigné « le Petit-Mousse ».
CHŒUR DES PASSAGERS. — C’est ce vieillard, presque centenaire, que vous appelez « le Petit-Mousse » ?
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Oui. Il est mousse depuis l’âge de douze ans. Son intelligence ne lui permit jamais de dépasser ce grade. Je le conserve à bord par charité. Il porte plus que son âge. Il n’a que quatre-vingt-seize ans.
LE PETIT-MOUSSE, se précipitant à genoux. — Au nom de la Paimpolaise qui m’attend au pays breton, accordez-moi jusqu’à demain matin avant de me manger. Si, d’ici là, je n’ai pas trouvé le moyen de faire repartir le Plat d’Ésaü, vous pourrez toujours m’accommoder à votre goût.
CHŒUR DES PASSAGERS, après délibération. — Soit. Par égard pour la Paimpolaise qui l’attend au pays breton, le dîner est renvoyé à demain.
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Messieurs, j’ai donné l’ordre au maître coq de faire un plat d’abattis avec les jambes de Mathurin le gabier boiteux.
LE PASSAGER PRÉVOYANT DE L’AVENIR, sautant joyeusement. — Bravo, capitaine !
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ ». — Ne remuez donc pas comme ça ! Avec votre sonnette dans l’estomac vous faites un vacarme étourdissant ! C’est insupportable !
LE MAÎTRE COQ, annonçant. — Les jambes de Mathurin sont servies ! (Les passagers passent dans la salle à manger.)
ACTE QUATRIÈME
Sauvés !
Même décor. Le lendemain matin.
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ », montant sur le pont. — Tonnerre de n’importe où ! Que vois-je ? Le bateau marche ! Vite, sonnons les passagers sur le pont ! Sapristi ! C’est le passager-autruche qui a ma sonnette dans l’estomac ! Ah ! une idée ! (Il s’élance dans la cabine du passager-autruche, le porte sur le pont et l’agite frénétiquement. La sonnette se fait entendre dans l’estomac.)
LES PASSAGERS, accourant. — Qu’y a-t-il ? Ah ! que voyons-nous ! Le Plat d’Ésaü est en marche ! Il a des voiles !
LE PETIT-MOUSSE. — Nous sommes sauvés ! et je ne serai pas mangé ! Cette nuit j’ai lâché toute la cargaison des 75 000 araignées à travers la mâture. En quelques heures, elles ont tissé ces immenses toiles qui, avec l’aide du vent, font avancer le Plat d’Ésaü.
CHŒUR DES PASSAGERS. — Vive le Petit-Mousse nonagénaire et inventif !
LE CAPITAINE DU « PLAT D’ÉSAÜ », d’une voix émue, au Petit-Mousse. — Je te nomme matelot ! (Suffoqué de bonheur, le Petit-Mousse avale sa chique et tombe mort.)
RIDEAU
RÉCITS DE CHASSE
PROLOGUE
Le retour des chasseurs.
La scène représente une salle d’auberge.
L’AUBERGISTE CORDIAL. — La nuit tombe. Les chasseurs ne vont pas tarder à rentrer avec leurs gibecières remplies de pendules.
LE VOYAGEUR ÉTONNÉ. — De pendules ?
L’AUBERGISTE CORDIAL. — Oui. Depuis qu’en France on coupe tous les arbres des forêts, les oiseaux ont disparu. Le gouvernement, pour ne pas mécontenter les chasseurs-électeurs, fait accrocher des « pendules-coucous » sur les arbres qui restent encore debout.
LE VOYAGEUR ÉTONNÉ. — C’est-il Dieu possible ?
L’AUBERGISTE CORDIAL. — Oui. Grâce à ce stratagème, les chasseurs conservent l’illusion de la chasse. Ils attendent patiemment que les pendules sonnent les heures ou les demies, et, dès que le coucou fait son apparition, ils tirent sur le petit oiseau mécanique.
LES CHASSEURS DE PENDULES, arrivant. — Par saint Hubert ! la journée fut bonne ! Cinquante-sept pendules au tableau de chasse ! Mais nous sommes trempés.
L’AUBERGISTE CORDIAL. — Le feu pétille joyeusement dans la vieille cheminée de l’auberge. L’omelette fumante est servie. Les bouteilles poudreuses attendent derrière les fagots. À table !
PREMIER RÉCIT DE CHASSE
La chasse au gorille.
L’AUBERGISTE CORDIAL, à sa femme. — Les chasseurs de pendules ont terminé leur repas. Plusieurs ont déjà raconté leurs souvenirs de chasse.
LA FEMME DE L’AUBERGISTE CORDIAL. — Mais le troisième Chasseur de pendules va prendre la parole. Écoutons.
LE TROISIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — À l’époque où commence mon récit, ma femme se trouvait dans un état intéressant. Douée d’un tempérament vigoureux, elle n’eut aucune des envies singulières qui caractérisent les femmes dans cet état. Plus nerveux que ma femme, et très impressionné par ma prochaine paternité, je fus pris subitement d’une irrésistible envie de chasser le gorille. Je courus chez le docteur et lui expliquai mon cas. « Partez sans tarder, me dit-il, il y va du physique de votre enfant. » Le soir même, je partis pour le petit village africain où je possédais un vieil oncle nègre.
LES CHASSEURS DE PENDULES. — Un vieil oncle nègre ?
LE TROISIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — Oui. Le pauvre homme s’était fait naturaliser nègre à la suite de chagrins intimes. Dès que je lui eus expliqué le but de mon voyage, mon vieil oncle nègre s’écria : « Tu viens chasser le gorille ? Fameuse idée ! Je vais profiter de l’occasion pour expérimenter un nouveau procédé de chasse que j’ai inventé. – Un nouveau procédé de chasse au gorille ? – Oui, mon neveu, un procédé enfantin, basé sur l’instinct d’imitation de ces stupides animaux. » Le lendemain, armés de deux carabines, nous partîmes à la chasse. À peine avions-nous pénétré dans la forêt qu’un énorme gorille s’avança vers nous en grinçant des dents.
LA FEMME DE L’AUBERGISTE CORDIAL. — C’est affreux !
LES CHASSEURS DE PENDULES. — Chut !
LE TROISIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — « C’est un gorille ! », s’écria mon oncle, après avoir examiné l’animal à travers une loupe. Puis, sans hésiter, il lança sa carabine dans la direction du monstre qui la saisit au vol et l’examina avec curiosité. « Et maintenant, mon neveu, donne-moi ta carabine et regarde. » Je tendis ma carabine à mon oncle nègre. « Mon procédé est simple et facile, dit-il en souriant. Regarde bien : Je place le canon de la carabine dans ma bouche et le gorille, par instinct d’imitation, fait le même geste avec la carabine que je lui ai lancée. Il me suffit maintenant de presser sur la gâchette pour que cet idiot de gorille en fasse autant. » Mon oncle pressa sur la gâchette. Le coup partit. Le malheureux s’écroula à mes pieds. Une seconde détonation retentit aussitôt. Le gorille imitateur venait de se faire sauter également la cervelle. J’étais émerveillé. Alors mon oncle nègre se tourna vers moi dans un dernier effort : « Eh bien, mon neveu, murmura-t-il, quand je te disais que ces animaux sont vraiment stupides ! » Puis il éclata de rire, se ferma pieusement les yeux de ses propres mains et ne bougea plus. Il était mort.
L’AUBERGISTE CORDIAL, enthousiasmé. — Ah ! monsieur ! c’était un rude chasseur que votre oncle nègre !
LES CHASSEURS DE PENDULES, émus. — Oui, un rude chasseur… rude chasseur.
DEUXIÈME RÉCIT DE CHASSE
La mouche chasseresse.
LE SEPTIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — Puisque c’est à mon tour de parler, je vais vous conter l’histoire de Denise, la mouche chasseresse.
LES CHASSEURS DE PENDULES. — Écoutons l’histoire de Denise, la mouche chasseresse.
LE SEPTIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — C’était par un chaud après-midi de printemps. Je longeais gaiement la rivière de mon pays natal lorsque j’aperçus, au milieu du courant, une mouche qui se noyait. Sans hésiter, je plongeai dans la rivière et parvins, après mille difficultés, à ramener la pauvre bête sur la rive. Quelques tractions rythmiques de la langue lui firent rapidement reprendre ses sens. Alors, après l’avoir étendue au soleil pour qu’elle séchât, je poursuivis mon chemin.
LA FEMME DE L’AUBERGISTE CORDIAL. — Digne jeune homme.
LE SEPTIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — Je marchais depuis quelques minutes, lorsque des pas se firent entendre derrière moi. Je me retournai brusquement. C’était la mouche qui me suivait.
LES CHASSEURS DE PENDULES. — La mouche ?
LE SEPTIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — Oui. La pauvre bête, reconnaissante, ne voulait plus me quitter. Elle me suivit jusque chez moi. Je n’eus pas le courage de la chasser.
LA FEMME DE L’AUBERGISTE CORDIAL. — Digne jeune homme.
LE SEPTIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — Malheureusement, j’avais chez moi, à cette époque, un petit moineau apprivoisé. Le lendemain de son arrivée, la mouche, à qui j’avais donné le nom de Denise, fut avalée par mon moineau. J’étais désespéré. Mais quelle fut ma stupeur lorsque je vis Denise reparaître, quelques secondes plus tard, par le côté opposé au bec de l’oiseau. Émerveillé par ce spectacle imprévu, je voulus mettre une seconde fois l’intelligence de ma mouche à l’épreuve. Je la fis avaler une deuxième fois par mon oiseau. Quelques secondes plus tard, Denise ressortait du côté opposé. Dix fois, vingt fois, je renouvelai cette expérience, et chaque fois ma mouche recommença son effarante prouesse. C’est alors qu’une idée merveilleuse traversa mon cerveau et que je résolus de chasser à l’aide de cette remarquable mouche. Je continuai son entraînement pendant un mois, la faisant avaler plusieurs fois par jour par mon moineau apprivoisé. Enfin, la jugeant suffisamment préparée, un matin je partis à la chasse avec ma mouche et une énorme bobine de fil.
LES CHASSEURS DE PENDULES. — Une bobine de fil ?
LE SEPTIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — Oui. Arrivé en pleine campagne, j’attachai mon fil à la troisième patte de Denise. Puis je lui fis prendre son vol. Tel un enfant qui lance un cerf-volant, à mesure que Denise s’éloignait, je déroulais le fil de ma bobine. Bientôt ce que j’avais prévu arriva. Le premier oiseau qui aperçut ma mouche chasseresse fondit sur elle, ouvrit le bec et l’avala. Grâce à son entraînement, Denise, sans perdre la tête, continua son chemin à travers l’appareil digestif de l’oiseau et ressortit, quelques secondes après, de l’autre côté du volatile. Le fil que j’avais attaché à la patte de Denise avait naturellement traversé avec elle le corps de l’oiseau. Celui-ci était maintenant enfilé comme une perle. Ma mouche chasseresse continuait son vol. Un nouvel oiseau fondit sur elle et subit le même sort que le premier. Puis successivement des centaines et des milliers d’oiseaux avalèrent Denise et vinrent s’ajouter à mon fil comme d’innombrables grains de chapelet. Quand vint le soir, cette gigantesque brochette, que j’avais toutes les peines du monde à retenir, s’étendait à perte de vue à travers la campagne. Je mis près de deux jours à désenfiler tout ce gibier. Et voilà, messieurs, l’histoire de Denise la mouche chasseresse.
LES CHASSEURS DE PENDULES. — Possédez-vous toujours cette remarquable bête ?
LE SEPTIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — Non. La pauvrette avait trop présumé de ses forces. Elle mourut quelques jours après cette merveilleuse chasse. Je la fis embaumer. Quand vous viendrez chez moi, vous pourrez la voir. Sous un globe, elle est le principal ornement de ma salle à manger.
TROISIÈME RÉCIT DE CHASSE
La tortue fatale.
ONZIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — Connaissez-vous la tragique histoire des sept culs-de-jatte, chasseurs de tortue ?
CHŒUR DES CHASSEURS DE PENDULES. — Non, nous ne connaissons pas la tragique histoire des sept culs-de-jatte, chasseurs de tortue.
ONZIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — Écoutez donc : Ces sept culs-de-jatte, chasseurs passionnés, avaient imaginé une chasse à courre de tout repos. Tous les dimanches, dès l’ouverture de la chasse, les sept culs-de-jatte, le torse serré dans la classique tunique rouge et le chef coiffé de la casquette traditionnelle, se réunissaient pour chasser à courre une tortue.
CHŒUR DES CHASSEURS DE PENDULES. — Une tortue ?
ONZIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — Oui. Le piqueur allait placer la tortue à trois cent mètres devant les chasseurs et, prenant son cor, sonnait le « lancer ». Aussitôt les sept culs-de-jatte chasseurs s’élançaient à la poursuite de la tortue en hurlant : « Taïaut ! Taïaut ! » Vingt minutes après, la tortue était « forcée », les culs-de-jatte sonnaient l’hallali, puis, après un simulacre de mise à mort, la tortue était replacée dans sa boîte jusqu’au dimanche suivant. Ces paisibles chasses auraient pu durer longtemps encore, si un événement imprévu n’était venu en interrompre le cours.
Ce dimanche-là, au moment du « lancer », les sept culs-de-jatte virent avec stupéfaction la tortue partir à fond de train à travers la campagne.
CHŒUR DES CHASSEURS DE PENDULES. — À fond de train ?
ONZIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — Oui. La tortue, dont ils apercevaient la carapace à quelque cent mètres devant eux, la tortue filait à une allure vertigineuse. Ne comprenant rien à cet extraordinaire phénomène, mais piqués d’amour-propre et ne voulant pas abandonner la chasse, les sept culs-de-jatte redoublèrent de vitesse pour rattraper la tortue fantastique. Ce fut une poursuite effrénée à travers la plaine. Les petites voitures des culs-de-jattes roulaient follement. Soudain, butant dans une ornière, un des culs-de-jatte fut projeté contre un arbre et se fendit le crâne. Les autres ne s’arrêtèrent pas. Tous n’avaient qu’une idée : rattraper la tortue, revenir vainqueurs de cette chasse imprévue.
Là-bas, bien loin devant eux, la tortue galopait toujours éperdument.
Un deuxième cul-de-jatte tomba, épuisé par le terrible effort, puis un troisième, un quatrième et un cinquième s’écroulèrent à leur tour. Le soleil se couchait à l’horizon. Seuls les deux derniers culs-de-jatte continuaient la fatale poursuite. La lune éclairait à présent les plaines et les vallons que les deux chasseurs franchissaient avec rapidité. L’avant-dernier chasseur tomba pour ne plus se relever. Alors le dernier cul-de-jatte eut une seconde de découragement, mais, tout à coup, son œil, fixé sur la diabolique tortue, s’éclaira d’une lueur d’espoir.
— Encore un effort ! s’écria-t-il, la tortue semble épuisée à son tour ! Je gagne du terrain ! La bête est forcée, et dans quelques minutes je pourrai sonner l’hallali !
En effet, la distance diminuait rapidement entre le chasseur et la tortue. Enfin, dans un dernier et terrible effort, l’héroïque cul-de-jatte put rejoindre l’animal fatal. D’une main fébrile, il saisit la tortue mystérieuse, et aussitôt il comprit tout, il comprit pourquoi la tortue galopait d’une aussi extraordinaire façon :
Le piqueur chargé de lancer la tortue avait cru faire une excellente plaisanterie en plaçant un lièvre dans une carapace de tortue.
CHŒUR DES CHASSEURS DE PENDULES. — Stupide plaisanterie qui causa la mort de six braves culs-de-jatte.
ONZIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — Le septième mourut également. On le retrouva étendu à côté du fatal lièvre-tortue. Quant au piqueur facétieux, les remords l’ont rendu fou. Et je peux bien vous l’avouer, messieurs, le piqueur, c’était moi.
QUATRIÈME RÉCIT DE CHASSE
Un chasseur d’éléphants.
QUATORZIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — La vocation du fameux chasseur d’éléphants dont je vais vous conter l’histoire se dessina de bonne heure. Dès l’âge de sept ans, ayant appris dans les romans d’aventures la confection des pièges à éléphants, il creusait dans le jardin familial de grands trous profonds qu’il recouvrait soigneusement de feuillage. Son père, son oncle et son grand-père tombaient dans ces pièges, et cela procurait à l’enfant l’illusion parfaite de la chasse à l’éléphant.
CHŒUR DES CHASSEURS DE PENDULES. — L’illusion parfaite ?
QUATORZIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — Oui ; le père, l’oncle et le grand-père portaient des pantalons à pattes d’éléphant.
Mais ce fut lorsqu’il entendit pour la première fois la fameuse scie populaire : « Un éléphant se balançait sur une toile d’araignée. Deux éléphants se balançaient… etc., etc. » que la vocation de l’enfant s’affirma irrésistible. Une idée germa instantanément dans son jeune cerveau : « Quand je serai grand, s’écria-t-il, j’irai chasser les éléphants avec des toiles d’araignée ! »
CHŒUR DES CHASSEURS DE PENDULES. — Avec des toiles d’araignées ?
QUATORZIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — Oui. Quelques années plus tard, devenu grand, notre chasseur s’embarqua pour le pays des éléphants. Dès son arrivée, il tendit, entre les arbres de la forêt africaine, d’énormes toiles d’araignées en fil de fer qu’il avait apportées avec lui. Les éléphants, ne se méfiant pas de ces toiles qu’ils prenaient pour de véritables toiles d’araignées (dans ces pays, les araignées tissent de gigantesques toiles), les éléphants, dis-je, essayaient de passer à travers.
Aussitôt, grâce à un système de son invention, le chasseur, embusqué au sommet d’un arbre, envoyait dans les toiles métalliques un courant électrique qui foudroyait l’éléphant empêtré dans les fils. Au bout d’un an de cette chasse à la toile d’araignée, le grand chasseur, riche et glorieux, revint en France.
CHŒUR DES CHASSEURS DE PENDULES. — Jusqu’à présent, nous ne voyons rien d’extraordinaire dans ce récit.
QUATORZIÈME CHASSEUR DE PENDULES. — En effet. Mais ce fut après le départ du chasseur d’éléphants qu’un phénomène extraordinaire se produisit : les malheureux éléphants, terrorisés depuis un an par les terribles toiles d’araignée électriques, n’osaient plus traverser les véritables toiles d’araignées, croyant qu’elles possédaient le même pouvoir meurtrier.
Leur terreur était si grande que, lorsque par hasard un éléphant traversait une toile d’araignée, le pauvre pachyderme, brusquement immobilisé par la peur, s’arrêtait au milieu de la toile et restait là, incapable de bouger, comme une simple mouche. Peu à peu, les araignées, voyant les éléphants encombrer leurs toiles, s’enhardirent et se mirent à sucer le sang des pachydermes pétrifiés d’effroi.
Et pendant longtemps les naturels du pays virent avec stupeur les araignées dédaigner les mouches et se régaler d’éléphants.
CINQUIÈME ET DERNIER RÉCIT DE CHASSE
La chasse au saladier.
DERNIER CHASSEUR DE PENDULES. — À cette époque, j’étais parti en Afrique pour chasser le rhinocéros avec un saladier.
CHŒUR DES CHASSEURS DE PENDULES. — Avec un saladier ?
DERNIER CHASSEUR DE PENDULES. — Oui. C’était une idée à moi. Vous savez tous que le rhinocéros possède une peau extrêmement dure. Les balles, au lieu de pénétrer, rebondissent sur cette peau comme des pelotes basques sur un fronton. Seuls les yeux du monstre sont vulnérables. Aussi est-ce toujours l’œil du rhinocéros que le chasseur doit viser pour abattre l’animal.
CHŒUR DES CHASSEURS DE PENDULES. — Oui, mais l’œil du rhinocéros est minuscule et fort difficile à atteindre.
DERNIER CHASSEUR DE PENDULES. — C’est juste. Mais grâce à mon saladier un enfant de six ans n’aurait pu manquer l’œil du rhinocéros. Dès que j’avais découvert la retraite d’un rhinocéros, je posais dans le voisinage de sa cachette un énorme saladier rempli de fruits, d’herbes et de branches feuillues, dont ces animaux sont friands. Puis je m’embusquais à quelques pas, prêt à tirer. Bientôt le rhinocéros, attiré par l’odeur de son plat favori, s’avançait vers le saladier, qui contenait, n’oubliez pas ce détail important, une quantité de nourriture suffisante pour rassasier six rhinocéros d’appétit ordinaire. En apercevant le saladier, le rhinocéros s’élançait et commençait à dévorer gloutonnement. Au bout d’un instant, ses petits yeux se dilataient lentement, puis s’agrandissaient, s’agrandissaient dans d’extraordinaires proportions.
CHŒUR DES CHASSEURS DE PENDULES. — Pourquoi donc ?
DERNIER CHASSEUR DE PENDULES. — Ils s’agrandissaient parce qu’à la vue de cet énorme saladier le rhinocéros s’était élancé avec voracité, croyant en dévorer facilement tout le contenu. Mais bientôt l’animal rassasié ne pouvait terminer l’énorme quantité de nourriture entassée dans le saladier. Il voulait essayer d’avaler encore, mais en vain : il avait les yeux plus grands que le ventre.
C’est à l’instant précis où j’avais amené le rhinocéros à avoir les yeux plus grands que le ventre que je visais rapidement l’œil de l’animal. Cet œil plus grand que le ventre était pour moi une cible immanquable. Le rhinocéros, blessé à mort, s’écroulait sur le sol africain.
Et voilà, messieurs, voilà comment j’ai chassé le rhinocéros avec un saladier. Voilà !
RIDEAU
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
https://groups.google.com/g/ebooksgratuits
Adresse du site web du groupe :
https://www.ebooksgratuits.com/
—
Mai 2025
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : YvetteT, PatriceC, MichelT, Coolmicro
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.