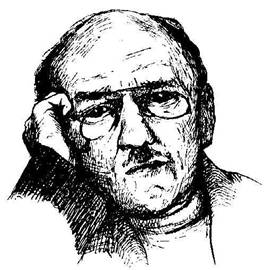Georges Eekhoud
LA NOUVELLE CARTHAGE
(1888)
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » - http://www.ebooksgratuits.com/
Table des matières
DEUXIÈME PARTIE : FREDDY BÉJARD
TROISIÈME PARTIE : LAURENT PARIDAEL
PREMIÈRE PARTIE : RÉGINA
I. LE JARDIN
M. Guillaume Dobouziez régla les funérailles de Jacques Paridael de façon à mériter l'approbation de son monde et l'admiration des petites gens. « Cela s'appelle bien faire les choses ! » ne pouvait manquer d'opiner la galerie. Il n'aurait pas exigé mieux pour lui-même : service de deuxième classe (mais, hormis les croque-morts, qui s'y connaît assez pour discerner la nuance entre la première qualité et la suivante ?) ; messe en plain-chant ; pas d'absoute (inutile de prolonger ces cérémonies crispantes pour les intéressés et fastidieuses pour les indifférents) ; autant de mètres de tentures noires larmées et frangées de blanc ; autant de livres de cire jaune.
De son vivant, feu Paridael n'aurait jamais espéré pareilles obsèques, le pauvre diable !
Quarante-cinq ans, droit, mais grisonnant déjà, nerveux et sec, compassé, sanglé militairement dans sa redingote, le ruban rouge à la boutonnière, M. Guillaume Dobouziez marchait derrière le petit Laurent, son pupille, unique enfant du défunt, plongé dans une douleur aiguë et hystérique.
Laurent n'avait cessé de sangloter depuis la mortuaire. Il fut plus pitoyable encore à l'église. Les regrets sonnés au clocher et surtout les tintements saccadés de la clochette du chœur imprimaient des secousses convulsives à tout son petit être.
Cette affliction ostensible impatienta même le cousin Guillaume, ancien officier, un dur à cuire, ennemi de l'exagération.
– Allons, Laurent, tiens-toi, sapristi !… Sois raisonnable !… Lève-toi !… Assieds-toi !… Marche ! ne cessait-il de lui dire à mi-voix.
Peine perdue. À chaque instant le petit compromettait, par des hurlements et des gesticulations, l'irréprochable ordonnance du cérémonial. Et cela quand on faisait tant d'honneur à son papa !
Avant que le convoi funèbre se fût mis en marche, M. Dobouziez, en homme songeant à tout, avait remis à son pupille une pièce de vingt francs, une autre de cinq, et une autre de vingt sous. La première était pour le plateau de l'offrande ; le reste pour les quêteurs. Mais cet enfant, décidément aussi gauche qu'il en avait l'air, s'embrouilla dans la répartition de ses aumônes et donna, contrairement à l'usage, la pièce d'or au représentant des pauvres, les cinq francs au marguillier, et les vingt sous au curé.
Il faillit sauter dans la fosse, au cimetière, en répandant sur le cercueil cette pelletée de terre jaune et fétide qui s'éboule avec un bruit si lugubre !
Enfin, on le mit en voiture, au grand soulagement du tuteur, et la clarence à deux chevaux regagna rapidement l'usine et l'hôtel des Dobouziez situés dans un faubourg en dehors des fortifications.
Au dîner de famille, on parla d'affaires, sans s'attarder à l'événement du matin et en n'accordant qu'une attention maussade à Laurent placé entre sa grand'tante et M. Dobouziez.' Celui-ci ne lui adressa la parole que pour l'exhorter au devoir, à la sagesse et à la raison, trois mots bien abstraits, pour ce garçon venant à peine de faire sa première communion.
La bonne grand'tante de l'orphelin eût bien voulu compatir plus tendrement à sa peine, mais elle craignait d'être taxée de faiblesse par les maîtres de la maison et de le desservir auprès d'eux. Elle l'engagea même à rencogner ses larmes de peur que ce désespoir prolongé ne parût désobligeant à ceux qui allaient désormais lui tenir lieu de père et de mère. Mais à onze ans, on manque de tact, et les injonctions, à voix basse, de la brave dame ne faisaient que provoquer des recrudescences de pleurs.
À travers le brouillard voilant ses prunelles, Laurent, craintif et pantelant comme un oiselet déniché, examinait les convives à la dérobée.
Mme Dobouziez, la cousine Lydie, trônait en face de son mari. C'était une nabote nouée, jaune, ratatinée comme un pruneau, aux cheveux noirs et luisants, coiffée en bandeaux qui lui cachaient le front et rejoignaient d'épais et sombres sourcils ombrageant de gros yeux, noirs aussi, glauques, et à fleur de tête. Presque pas de visage ; des traits hommasses, les lèvres minces et décolorées, le nez camard et du poil sous la narine. Une voix gutturale et désagréable, rappelant le cri de la pintade. Cœur sec et rassis plutôt qu'absent ; des éclaira de bonté, mais jamais de délicatesse ; esprit terre à terre et borné.
Guillaume Dobouziez, brillant capitaine du génie, l'avait épousée pour son argent. La dot de cette fille de bonnetiers bruxellois retirés des affaires, lui servit, lorsqu'il donna sa démission, à édifier son usine et à poser le premier jalon d'une rapide fortune.
Le regard de Laurent s'arrêtait avec plus de complaisance, et même avec un certain plaisir sur Régina ou Gina, seule enfant des Dobouziez, d'une couple d'années l'aînée du petit Paridael, une brunette élancée et nerveuse, avec d'expressifs yeux noirs, d'abondants cheveux bouclés, le visage d'un irréprochable ovale, le nez aquilin aux ailes frétillantes, la bouche mutine et volontaire, le menton marqué d'une délicieuse fossette, le teint rosé et mat aux transparences de camée. Jamais Laurent n'avait vu aussi jolie petite fille.
Cependant il n'osait la regarder longtemps en face ou soutenir le feu de ses prunelles malicieuses, À ses turbulences d'enfant espiègle et gâtée se mêlait un peu de la solennité et de la superbe du cousin Dobouziez. Et déjà quelque chose de dédaigneux et d'indiciblement narquois plissait par moments ses lèvres innocentes et altérait le timbre de son rire ingénu.
Elle éblouissait Laurent, elle lui imposait comme un personnage. Il en avait vaguement peur. Surtout qu'à deux ou trois reprises elle le dévisagea avec persistance, en accompagnant cet examen d'un sourire plein de condescendance et de supériorité.
Consciente aussi de l'effet favorable qu'elle produisait sur le gamin, elle se montrait plus remuante et capricieuse que d'habitude ; elle se mêlait à la conversation, mangeait en pignochant, ne savait que faire pour accaparer l'attention. Sa mère ne parvenait pas à la calmer et, répugnant à des gronderies qui lui eussent attiré la rancune de ce petit démon, dirigeait des regards de détresse vers Dobouziez.
Celui-ci résistait le plus longtemps possible aux sommations désespérées de son épouse.
Enfin, il intervenait. Sourde aux remontrances de sa mère, Gina se rendait, momentanément, d'un petit air de martyre, des plus amusants, aux bénignes injonctions de son père. En faveur de Gina, le chef de la famille se départait de sa raideur. Il devait même se faire violence pour ne pas répondre aux agaceries de sa mignonne ; il ne la reprenait qu'à son corps défendant. Et quelle douceur inaccoutumée dans cette voix et dans ces yeux ! Intonations et regards rappelaient à Laurent l'accent et le sourire de Jacques Paridael. À tel point que Lorki, c'est ainsi que l'appelait le doux absent, reconnaissait à peine, dans le cousin Dobouziez semonçant sa petite Gina, le même éducateur rigide qui lui avait recommandé à lui, tout à l'heure, durant la douloureuse cérémonie, de faire ceci, puis cela, et tant de choses qu'il ne savait à laquelle entendre. Et toutes ces instructions formulées d'un ton si bref, si péremptoire !
N'importe, si son cœur d'enfant se serra à ce rapprochement, le Lorki d'hier, le Laurent d'aujourd'hui, n'en voulut pas à sa petite cousine d'être ainsi préférée. Elle était par trop ravissante ! Ah, s'il se fût agi d'un autre enfant, d'un garçon comme lui par exemple, l'orphelin eût ressenti, à l'extrême, cette révélation de l'étendue de sa perte ; il en eût éprouvé non seulement de la consternation et du désespoir, mais encore du dépit et de la haine ; il fût devenu mauvais pour le prochain privilégié ; l'injustice de son propre sort l'eût révolté.
Mais Gina lui apparaissait à la façon des princesses et des fées radieuses des contes, et il était naturel que le bon Dieu se montrât plus clément envers des créatures d'une essence si supérieure !
La petite fée ne tenait plus en place.
– Allez jouer, les enfants ! lui dit son père en faisant signe à Laurent de la suivre.
Gina l'entraîna au jardin.
C'était un enclos tracé régulièrement comme un courtil de paysan, entouré de murs crépis à la chaux sur lesquels s'écartelaient des espaliers ; à la fois légumier, verger et jardin d'agrément, aussi vaste qu'un parc, mais n'offrant ni pelouses vallonnées, ni futaies ombreuses.
Il y avait cependant une curiosité dans ce jardin : une sorte de tourelle en briques rouges adossée à un monticule, au pied de laquelle stagnait une petite nappe d'eau, et qui servait d'habitacle à deux couples de canards. Des sentiers en colimaçon convergeaient an sommet de la colline d'où l'on dominait l'étang et le jardin. Cette bizarre fabrique s'appelait pompeusement « le Labyrinthe. »
Gina en fit les honneurs à Laurent.
Avec des gestes de cicérone affairé, elle lui désignait les objets. Elle le prenait avec lui sur un ton protecteur :
– Prends garde de ne pas tomber à l'eau ! … Maman ne veut pas qu'on cueille les framboises ! Elle riait de sa gaucherie. À deux ou trois phrases peu élégantes qui sentaient leur patois, elle le corrigea. Laurent, peu causeur, devint encore plus taciturne. Sa timidité croissait ; il s'en voulait d'être ridicule devant elle.
Ce jour-là, Gina portait son uniforme de pensionnaire : une robe grise garnie de soie bleue. Elle raconta à son compagnon, qui ne se lassait pas de l'entendre, les particularités de son pensionnat de religieuses à Malines ; elle le régala même de quelques caricatures de sa façon ; contrefit, par des grimaces et des contorsions, certaines des bonnes sœurs. La révérende mère louchait ; sœur Véronique, la lingère, parlait du nez ; sœur Hubertine s'endormait et ronflait à l'étude du soir.
Le chapitre des infirmités et des défauts de ses maîtresses la mettant en verve, elle prit plaisir à embarrasser son interlocuteur : « Est-il vrai que ton père était un simple commis ? … Il n'y avait qu'une petite porte et qu'un étage à votre maison ? … Pourquoi donc que vous n'êtes jamais venus nous voir ? … Ainsi nous sommes cousins… C'est drôle, tu ne trouves pas… Paridael, c'est du flamand cela ? … Tu connais Athanase et Gaston, les fils de M. Saint-Fardier, l'associé de papa ? En voilà des gaillards ! Ils montent à cheval et ne portent plus de casquettes… Ce n'est pas comme toi … Papa m'avait dit que tu ressemblais à un petit paysan, avec tes joues, rouges, tes grandes dents et tes cheveux plats … Qui donc t'a coiffé ainsi ? Oui, papa a raison, tu ressembles bien à un de ces petits paysans qui servent la messe, ici ! »
Elle s'acharnait sur Laurent avec une malice implacable. Chaque mot lui allait au cœur. Plus rouge que jamais, il s'efforçait de rire, comme au portrait des bonnes sœurs, et ne trouvait rien à lui répondre.
Il aurait tant voulu prouver à cette railleuse qu'on peut porter une blouse taillée comme un sac, une culotte à la fois trop longue et trop large, faite pour durer deux ans et godant, aux genoux, au point de vous donner la démarche d'un cagneux ; une collerette empesée d'où la tête pouparde et penaude du sujet émerge comme celle d'un saint Jean-Baptiste après la décollation ; une casquette de premier communiant dont le crêpe de deuil dissimulait mal les passementeries extravagantes, les macarons de jais et de velours, les boucles inutiles, les glands encombrants ; qu'on peut dire vêtu comme un fils de fermier et ne pas être plus niais et plus bouché qu'un Gaston ou qu'un Athanase Saint-Fardier.
La bonne Siska n'était pas un tailleur modèle, tant s'en faut, mais du moins ne ménageait-elle pas l'étoffe ! Puis, Jacques Paridael trouvait si bien ainsi son petit Laurent ! Le jour de la première communion, le cher homme lui avait encore dit en l'embrassant : « Tu es beau comme un prince, mon Lorki ! » Et c'était le même costume de fête qu'il vêtait à présent, à part le crêpe garnissant sa casquette composite et remplaçant à son bras droit le glorieux ruban de moire blanche frangé d'argent…
La taquine eut un bon mouvement. En parcourant les parterres, elle cueillit une reine-marguerite aux pétales ponceau, au cœur doré : « Tiens, paysan, fit-elle, passe cette fleur à ta boutonnière ! » Paysan, tant qu'elle voudrait ! Il lui pardonnait. Cette fleur piquée dans sa blouse noire était le premier sourire illuminant son deuil. Plus impuissant encore à exprimer, par des mots, sa joie que son amertume, s'il l'avait osé, il eût fléchi le genou devant la petite Dobouziez et lui aurait baisé la main comme il avait vu faire à des chevaliers empanachés, dans un volume du Journal pour Tous qu'on feuilletait autrefois, chez lui, les dimanches d'hiver, en croquant des marrons grillés…
Régina gambadait déjà à l'autre bout du jardin, sans attendre les remerciements de Laurent.
Il eut un remords de s'être laissé apprivoiser si vite et, farouche, arracha la fleur réjouie. Mais au lieu de la jeter, il la serra dévotement dans sa poche. Et, demeurée l'écart, il songea à la maison paternelle. Elle était vide et mise en location. Le chien, le brave Lion avait été abandonné au voisin de bonne volonté qui consentit à en débarrasser la mortuaire ! Siska, ses gages payés, s'en était allée à son tour. Que faisait-elle à présent ? La reverrait-il encore ? Lorki ne lui avait pas dit adieu ce matin. Il revoyait sa figure à l'église, tout au fond, sous le jubé, sa bonne figure aussi gonflée, aussi défaite que la sienne.
On sortait ; il avait dû passer, talonné par le cousin Guillaume, alors qu'il aurait tant voulu sauter au cou de l'excellente créature. Dans la voiture, il avait timidement hasardé cette demande : « Où allons-nous, cousin ? – Mais à la fabriqué, pardienne ! Où veux-tu que nous allions ? » On n'irait donc plus à la maison ! Il n'insista point, le petit ; il ne demanda même pas à prendre congé de sa bonne ! Devenait-il dur et fier, déjà ? Oh, que non ! Il n'était que timide, dépaysé ! M. Dobouziez le rabrouerait s'il mentionnait des gens si peu distingués que Siska…
Lasse de l'appeler, Gina se décida à retourner auprès du rêveur. Elle lui secoua le bras : « Mais tu es sourd… Viens, que je le montre les brugnons. Ce sont les fruits de maman. Félicité les compte chaque matin… Il y en a douze… N'y touche pas… » Elle ne remarqua point que Laurent avait jeté la fleur. Cette indifférence de la petite fée ragaillardit le paysan, et pourtant, au fond, il eût préféré qu'elle s'informât de ce qu'était devenu son présent.
Il s'étourdit, se laissa mener par Gina. Ils jouèrent à des jeux garçonniers. Pour lui plaire, il fit des culbutes, jeta des cris sauvages, se roula dans l'herbe et le gravier, souilla ses beaux habits, et la poussière marbra de crasse ses joues humides de sueur et de larmes.
– Oh, la drôle de tête ! s'exclama la fillette.
Elle trempa un coin de son mouchoir dans le bassin et essaya de débarbouiller Laurent. Mais elle riait trop et ne parvenait qu'à le maculer davantage.
Il se laissait faire, heureux de ses soins dérisoires. La perfide lui dessinait des arabesques sur le visage, si bien qu'il avait l'air d'un peau-rouge tatoué.
Pendant cette opération, une voix aigre se mit à glapir :
– Mademoiselle, Monsieur vous prie de rentrer… Le monde va partir… Et vous, venez, par ici. Il est temps de se coucher. Demain on retourne à la pension. C'est assez de vacances comme ça !
Mais à l'aspect du jeune Paridael, Félicité, la redoutable Félicité, la servante de confiance se récria comme devant le diable : « Fi ! l'horreur d'enfant ! »
Elle était venue le prendre au collège, la veille, et devait l'y reconduire. Acariâtre, bougonne, servile, rouée, flattant l'orgueil de ses maîtres en s'assimilant leurs défauts, elle devinait d'emblée le pied sur lequel l'enfant serait traité dans la maison. La cousine Lydie se déchargeait sur cette vilaine servante de l'entretien et de la surveillance de l'intrus.
L'imprudent Paridael venait de ménager à Félicité un magnifique début dans son rôle de gouvernante. La harpie n'eut garde de négliger cette aubaine. Elle donna libre carrière à ses aimables sentiments.
Gina, continuant de pouffer, abandonna son compagnon aux bourrades et aux criailleries de la servante, et rentra en courant dans le salon, pressée de raconter la farce à ses parents et à la société.
Laurent avait fait un mouvement pour rejoindre l'espiègle, mais Félicité ne le lâchait pas. Elle le poussa vers l'escalier et lui fit d'ailleurs une telle peinture des dispositions de M. et Mme Dobouziez pour les petits gorets de son espèce, qu'il se hâta, terrifié, de gagner la mansarde où on le logeait et de se blottir dans ses draps.
Félicité l'avait pincé et taloché. Il fut stoïque, ne cria point, s'en tint à quatre devant la mégère.
Le dénouement orageux de la journée fit diversion au deuil de l'orphelin. Les émotions, la fatigue, le plein air lui procurèrent un lourd sommeil visité de rêves où des images contradictoires se matèrent dans une sarabande fantastique. Armée d'une baguette de fée, la rieuse Gina conduisait la danse, livrait et arrachait tour a tour le patient aux entreprises d'une vieille sorcière incarnée en Félicité. À l'arrière-plan, les fantômes doux et pâles de son père et de Siska, du mort et de l'absente, lut tendaient les bras. Il s'élançait, mais M. Dobouziez le saisissait au passage avec un ironique : « Halte-là, galopin ! » Des cloches sonnaient ; Paridael jetait la reine-marguerite, présent de Gina, dans le plateau de l'offrande. La fleur tombait avec un bruit de pièce d'or accompagné du rire guilleret de la petite cousine, et ce bruit mettait en fuite les larves moqueuses, mais aussi les pitoyables visions…
Et telle fut l'initiation de Laurent Paridael à sa nouvelle vie de famille…
II. LE « MOULIN DE PIERRE »
À sa deuxième visite, et à celles qui suivirent, lorsque les vacances le renvoyaient chez ces tuteurs, Laurent ne se trouva pas plus acclimaté que le premier jour. Il avait toujours l'air de tomber de la lune et de prendre de la place.
On n'attendait pas qu'il eût déposé sa valise pour s'informer de la durée de son congé et on se préoccupait plus de l'état de son trousseau que de sa personne. Accueil sans effusion : la cousine Lydie lui tendait machinalement sa joue citronneuse ; Gina semblait l'avoir oublié depuis la dernière fois ; quant au cousin Guillaume, il n'entendait pas qu'on le dérangeât de sa besogne pour si peu de chose que l'arrivée de ce polisson, il le verrait bien assez tôt au prochain repas. « Ah ! te voilà, toi ! Deviens-tu sage ? … Apprends-tu mieux ? » Toujours les mêmes questions posées d'un air de doute, jamais d'encouragement. Si Laurent rapportait des prix, voyez le guignon ! c'étaient ceux précisément auxquels M. Dobouziez n'attachait aucune importance.
À table, les yeux ronds de la cousine Lydie, implacablement braqués sur lui, semblaient lui reprocher l'appétit de ses douze ans. Vrai, elle faisait choir le verre de ses doigts et les morceaux de sa fourchette. Ces accidents ne valaient pas toujours à Laurent l'épithète de maladroit, mais la cousine avait une moue méprisante qui disait assez clairement sa pensée. Cette moue n'était rien cependant, comparée au sourire persifleur de l'impeccable Gina.
Le cousin Guillaume qu'il fallait quérir plusieurs fois avant de se mettre à table, arrivait enfin, le front chargé de préoccupations, la tête à une invention nouvelle, supputant les résultats, calculant le rendement probable de l'un ou l'autre perfectionnement, le cerveau bourré d'équations.
Avec sa femme, M. Dobouziez parlait affaires, et elle s'y entendait admirablement, lui répondait en se servant de barbares mots techniques qui eussent emporté la bouche de plus d'un homme du métier.
M. Dobouziez ne cessait de chiffrer et ne se déridait que pour admirer et cajoler sa fillette. De plus en plus Laurent constatait l'entente absolue et idolâtre régnant entre ces deux êtres. Si l'industriel s'humanisait en s'occupant d'elle, réciproquement Gina abandonnait, avec son père, ses airs de supériorité, son petit ton détaché et avantageux. M. Dobouziez prévenait ses désirs, satisfaisait ses moindres caprices, la défendait même contre sa mère. Avec Gina, lui, l'homme positif et pratique, s'amusait de futilités.
À chaque vacance, Laurent trouvait sa petite cousine plus belle, mais aussi plus distante. Ses parents l'avaient retirée de pension. Des maîtres habiles et. mondains la préparèrent à sa destinée d'opulente héritière.
Devenant trop grande fille, trop demoiselle pour s'amuser avec ce gamin ; elle recevait ou visitait des amies de son âge. Les petites Vanderling, filles du plus célèbre avocat de la ville, de blondes et vives caillettes étaient à la fois ses compagnes d'études et de plaisirs. Et si, par exception, faute d'autre partenaire, Gina s'oubliait au point de jouer avec le Paysan, Mme Lydie trouvait aussitôt un prétexte pour interrompre cette récréation. Elle envoyait Félicité avertir Mademoiselle de l'arrivée de l'un ou l'autre professeur, ou bien Madame emmenait Mademoiselle a la ville, ou bien la couturière lui apportait une robe à essayer, ou il était l'heure de se mettre au piano. Convenablement stylée, le plus souvent Félicité prévenait les intentions de sa maîtresse et s'acquittait de ce genre de consigne avec un zèle des plus louable. Laurent n'avait qu'à se distraire comme il pourrait.
La fabrique prospérait au point que chaque année les installations nouvelles : hangars, ateliers, magasins, empiétaient sur les jardins entourant l'habitation. Laurent ne constata pas sans regret la disparition du Labyrinthe avec sa tour, son bassin et ses canards : cette horreur lui était devenue chère à cause de Gina.
La maison aussi s'annexait une partie du jardin. En vue de la prochaine entrée dans le monde de leur fille, les Dobouziez édifiaient un véritable palais, présentant une enfilade de salons décorés et meublés par les fournisseurs des gens de la haute volée. Le cousin Guillaume semblait présider à ces embellissements, mais il s'en rapportait toujours au choix et au goût de la fillette. Il avait déjà ménagé à l'enfant gâtée un délicieux appartement de jeune fille : deux pièces, argent et bleu, qui eussent fait les délices d'une petite maîtresse.
L'appartement du jeune Paridael changeait de physionomie comme le reste. Sa mansarde sous les toits revêtait un aspect de plus en plus provisoire. Il semblait qu'on l'eût affectée de mauvaise grâce au logement du collégien. Félicité ne l'avait déblayée que juste assez pour y placer un lit de sangle.
Ce grenier ne suffisant plus à remiser les vieilleries provenant de l'ancien ameublement de la maison, plutôt que d'encombrer de ce bric-à-brac les mansardes des domestiques, la maîtresse-servante le transportait dans le réduit de Laurent. Elle y mettait tant de zèle que l'enfant voyait le moment où il lui faudrait émigrer sur le palier. Au fond il n'était pas fâché de cet investissement. Converti en capharnaüm, son gîte lui ménageait des imprévus charmants. Il s'établissait entre l'orphelin délaissé et les objets ayant cessé de plaire une certaine sympathie provenant de la similitude de leurs conditions. Mais il suffit que Laurent s'amusât avec ces vieilleries pour que l'aimable factotum les tînt autant que possible hors de sa portée. Pour dénicher ses trésors et dissimuler ses trouvailles, le galopin déployait de vraies ruses de contrebandier.
Dans cette mansarde s'entassaient pour la plus grande joie du jeune réfractaire, les livres jugés trop frivoles par M. Dobouziez. Fruit défendu comme les framboises et les brugnons du jardin ! Les souris en avaient déjà grignoté les tranches poudreuses et Laurent se délectait de ce que les voraces bestioles voulaient bien lui laisser de cette littérature. Souvent, il s'absorbait tellement dans sa lecture qu'il en oubliait toute précaution. Marchant sur la pointe des pieds pour ne pas lui donner l'éveil, Félicité venait le relancer dans son asile. Si elle ne le prenait pas en flagrant délit de lecture prohibée, la diablesse s'apercevait qu'il avait bouleversé les rayons et provoqué des éboulements. C'était alors des piailleries de pie-grièche, des giries de suppliciée qui finissaient par ameuter Mme Lydie.
Une fois on le pinça en train de lire Paul et Virginie.
– Un mauvais livre ! … Vous feriez mieux d'étudier vos arithmétiques ! promulgua sa tutrice. Et M. Dobouziez ratifia l'appréciation de sa moitié en ajoutant que ce garnement précoce, trop grand liseur et bayeur aux chimères, ne ferait jamais rien de bon, resterait toute sa vie un pauvre diable comme Jacques Paridael. Un bayeur aux chimères ! Quel mépris le cousin coulait dans ce mot.
Les soirs d'hiver, Laurent se réjouissait de regagner au plus tôt sa chère mansarde. En bas, dans la salle à manger où on le retenait après le dîner, il se sentait importun et gêneur. Que ne l’envoyait-on coucher alors ! S'il réprimait l'envie de s'étirer, s'il bâillait, s'il détachait les yeux de ses livres de classe avant que dix heures, l'heure sacramentelle, n'eût sonné à la pendule, la cousine Lydie roulait ses yeux ronds et Gina se rengorgeait, affectait d'être plus éveillée que jamais, raillait la torpeur du gamin.
Même pendant la journée, après l'une ou l'autre remontrance, Laurent courait se réfugier sous les toits.
Privé de livres, il soulevait la fenêtre en tabatière, montait sur une chaise et regardait s'étendre la banlieue.
Les rouges et basses maisons faubouriennes s'agglutinaient en îlots compacts. La ville grandissante, ayant crevé sa ceinture de remparts, menaçait et guignait les ravières d'alentour. Les rues étaient déjà tracées au cordeau à travers les cultures. Les trottoirs bordaient des terrains exploités jusqu'à la dernière minute par le paysan exproprié. Du milieu des moissons émergeait au bout d'un piquet, comme un épouvantail à moineaux, un écriteau portant cette sentence : Terrain à bâtir. Et, véritables éclaireurs, sentinelles avancées de cette armée de bâtisses urbaines, les estaminets prenaient les coins des voies nouvelles et toisaient, du haut de leurs façades banales, à plusieurs étages, neuves et déjà d'aspect sordide, les chaumes trapus et ramassés semblant implorer la clémence des envahisseurs. Rien de crispant et de suggestif comme la rencontre de la cité et de la campagne. Elles se livraient de véritables combats d'avant-postes.
La mine pléthorique, contrainte, sournoise de ce paysage offusqué par des talus de fortifications : des portes crénelées, sombres comme des tunnels, écrasées sous des terre-pleins, des murailles percées de meurtrières, des casernes dont les clairons plaintifs répondaient à la cloche de l'usine.
Trois moulins à vent, épars dans la plaine, tournaient à pleine volée, jouissaient de leur reste en attendant de partager le sort d'un quatrième moulin dont la maçonnerie dominait piteusement le blocus auquel le soumettait un tènement de bicoques ouvrières, et à qui ces assiégeants de mine parasite et d'allure canaille, quelque chose comme des oiseleurs ivres, avaient coupé les ailes !
Laurent compatissait au pauvre moulin démantelé, sans toutefois parvenir à détester la population des ruelles qui l'étreignait, tape-durs et vauriens déterminés, héros de faits divers sinistres, race obsédante que la police n'osait pas toujours relancer dans ses repaires. « Ces meuniers du moulin de pierre » comptaient parmi les plus renforcés ruffians de l'écume métropolitaine. Les rôdeurs de quais et les requins d'eau douce, plus connus sous le nom de runners, sortaient presque tous de ces parages.
Mais, même en dehors de cette nichée d'irréguliers et de mauvais garçons que Laurent apprendrait à connaître de plus près, le reste de cette population moitié urbaine, moitié rurale, la gent laborieuse et traitable suffisait pour intriguer et préoccuper le spéculatif enfant. D'ailleurs, ces meuniers, très montés de ton, déteignaient fatalement sur leur voisinage ; ils pimentaient, entérinaient de mouture populacière et poivrée ces transfuges du village, valets de ferme tournés en gâcheurs de plâtre et en débardeurs, ou réciproquement ces pseudo-campagnards, artisans devenus maraîchers, ouvrières de fabrique converties en laitières. En grattant l’abatteur on retrouvait le vacher, le garçon boucher avait été pâtre. Étranges métis, farouches et fanatiques comme au village, cyniques et frondeurs comme à la ville, à la fois hargneux et expansifs, truculents et lascifs, religieux et politiques, croyants au fond, blasphémateurs à la surface, patauds et fûtes, patriotes exclusifs, communiers chauvins, leur caractère hybride et mal défini, leur complexion musclée, charnue et sanguine, flattait peut-être dès cette époque le barbare affiné, la brute vibrante et complexe que serait Paridael…
Longtemps ces affinités dormirent en lui, vagues, instinctives, à l'état latent.
Debout sur sa chaise, devant la topique étendue de banlieue, il se saturait pour ainsi dire de nostalgie et ne s'arrachait à sa morbide contemplation que sur le point d'éclater ; et alors, tombant à genoux, ou se roulant sur sa couchette, il éjaculait en fontaines lacrymales tous ces navrements et ces rancœurs accumulées. Et le bruit guilleret des moulins, clair et détaché comme le rire de Gina, et le grondement de l'usine, bougon et rogue comme une semonce de Félicité, accompagnaient et stimulaient la chute lente et copieuse de ses pleurs, – tièdes et énervantes averses d'un avril compromis. Et cette berceuse narquoise et bourrelante semblait répéter : « Encore !… Encore !… Encore !… »
III. LA FABRIQUE
Félicité finit par fermer à clef, pendant le jour, la mansarde du solitaire et l'envoyer jouer au jardin. Celui-ci avait été réduit d'emprise en emprise aux dimensions d'un préau. Des fenêtres de la maison les yeux de l'espionne pouvaient en fouiller les moindres recoins. Aussi, las de cette surveillance, le gamin incursionna sur le territoire même de l'usine.
Les quinze cents têtes de la fabrique se courbaient sous un règlement d'une sévérité draconienne. C'étaient pour le moindre manquement des amendes, des retenues de salaire, des expulsions contre lesquelles il n'y avait pas d'appel. Une justice stricte. Pas d'iniquité, mais une discipline casernière, un code de pénalités mal proportionnées aux offenses, une balance toujours penchée du côté des maîtres.
Saint-Fardier, un gros homme à tête de cabotin, olivâtre, lippeux et crépu comme un quarteron, parcourait, à certains jours, la fabrique, en menant un train d'enfer. Il hurlait, roulait des yeux de basilic, battait des bras, faisait claquer les portes, chassait comme un bolide d'une salle dans l'autre. Au passage de cette trombe s'amoncelaient la détresse et la désolation. Par mitraille les peines pleuvaient sur la population ahurie. La moindre peccadille entraînait le renvoi du meilleur et du plus ancien des aides, Saint-Fardier se montrait aussi cassant avec les surveillants qu'avec le dernier des apprentis. On aurait même dit que s'il lui arrivait de mesurer ses coups et de distinguer ses victimes, c'était pour frapper de préférence les vieux serviteurs, ceux qu'aucune punition n'avait encore atteints ou qui travaillaient à l'usine depuis sa fondation. Les ouvriers l'avaient surnommé le Pacha, tant à cause de son arbitraire que de sa paillardise.
Dobouziez, aussi entier, aussi autoritaire que son associé, était moins démonstratif, plus renfermé. Lui était le juge, l'autre l'exécuteur. Au fond. Dobouziez, ce taupin bien élevé, jaugeait à sa valeur son ignare et grossier partenaire qu'un riche mariage avait mis en possession d'un capital égal à celui de son associé. Le mathématicien s'estimait heureux d'employer ce gueulard, cet homme de poigne, aux extrémités répugnant à sa nature fine et tempérée.
On avait remarqué que les coupes sombres opérées dans l'important personnel coïncidaient généralement avec une baisse de l'article fabriqué ou une hausse de la matière première.
Cependant Dobouziez devait refréner le zèle de son associé qui, stimulé encore par une affection hépatique, se livrait à des proscriptions dignes d'un Marius.
Industriel très cupide, mais non moins sage, Dobouziez qui admettait l'exploitation du prolétaire, réprouvait à l'égal d'utopies et d'excentricités poétiques toute barbarie inutile et toute cruauté compromettante, Il assimilait ses travailleurs à des êtres d'une espèce inférieure, à des brutes de rapport qu'il ménageait dans son propre intérêt. C'était un positiviste frigide, une parfaite machine à gagner de l'argent, sans vibration inopportune, sans velléités sentimentales, ne déviant pas d'un millième de seconde. Chez lui rien d'imprévu. Sa conscience représentait un superbe sextant, un admirable instrument de précision. S'il était vertueux, c'était par dignité, par aversion pour les choses irrégulières, le scandale, le tapage, et aussi parce qu'il avait vérifié sur la vie humaine que la ligne droite est, en somme, le chemin le plus court d'un point à un autre. Vertu d'ordre purement abstrait.
S'il désapprouvait les éclats de son trop bouillant acolyte, c'était au nom de l'équilibre, du bel ordre ; par respect pour l'alignement ; le niveau normal, pour sauver les apparences et préserver la symétrie.
En se promenant dans la fabrique, ce qui lui arrivait à de très rares occasions, par exemple lorsqu'il s'agissait d'expérimenter ou d'appliquer une invention nouvelle, – il s'étonnait parfois de l'absence d'une figure à laquelle il s'était habitué.
– Tiens ! disait-il à son compère, je ne vois plus le vieux Jef ?
– Nettoyé ! répondait Saint-Fardier, d'un geste tranchant comme un couperet.
– Et pourquoi cela ? objectait Dobouzier. Un ouvrier qui nous servait depuis vingt ans !
– Peuh !… Il buvait… Il était devenu malpropre, négligent ! Quoi !
– En vérité ? Et son remplaçant ?
– Un solide manœuvre qui ne touche que le quart de ce que nous coûtait cet invalide.
Et Saint-Fardier clignait malicieusement de l’œil, épiant un sourire d'intelligence sur le visage de son associé, mais l'autre augure ne se déridait pas et sans désapprouver, non plus, ce renvoi, rompait les chiens, d'un air indifférent.
Certes, il fallait à ces ouvriers une forte dose de philosophie et de patience pour endurer sans se rebiffer la superbe, les mépris, les rigueurs, l'arbitraire des patrons armés contre eux d'une légalité inique !
Et que d'accidents, d'infirmités, de mortuaires aggravant le sort de ces ilotes ! La nature de l'industrie même enchérissait sur la malveillance des industriels.
Laurent qui visitait l'usine dans tous ses organes, qui suivait les œuvres multiples que nécessite la confection des bougies depuis le traitement des fétides matières organiques, graisses de bœufs et de moutons, d'où se sépare, non sans peine, la stéarine blanche et entaillée, jusqu'à l'empaquetage, la mise en caisse et le chargement sur les camions, – Laurent ne tarda pas à attribuer une influence occulte, fatidique et perverse au milieu même, à cet appareil, à cet outillage où se trouvaient appliqués tous les perfectionnements de la mécanique et les récentes inventions de la chimie.
Il descendait dans les chambres de chauffe, louvoyait dans les salles des machines, passait des cuves où l'on épure la matière brute en la fondant et en la refondant encore, aux presses où, dépouillée de substances viles, comprimée en des peaux de bêtes, elle se solidifie à nouveau.
Au nombre des ateliers où se trituraient les graisses, le plus mal famé était celui des acréolines, substance incolore et volatile dont les vapeurs corrosives s'attaquaient aux yeux des préparateurs. Les patients avaient beau se relayer toutes les douze heures et prendre de temps en temps un congé pour neutraliser les effets du poison, à la longue l'odieuse essence déjouait leurs précautions et leur crevait les prunelles.
C'était comme si la Nature, l'éternel sphynx furieux de s'être laissé ravir ses secrets, se vengeait sur ces infimes auxiliaires des défaites que lui infligeaient les savants.
Plus expéditive que les vapeurs corrodantes, mais aussi lâche, aussi sournoise, la force dynamique cache son jeu et, ne parvenant pas toujours à se venger en bloc, par une explosion, des hommes qui l'ont asservie, guette et atteint, une à une, ses victimes. Le danger n'est pas à l'endroit où la machine en pleine activité gronde, mugit, trépigne, met en trépidation les épaisses cages de maçonnerie, dans lesquelles sa masse d'acier, de cuivre et de fonte, plonge jusqu'à mi-corps, comme un géant emmuré vif. Ses rugissements tiennent en éveil la vigilance de ses gardiens. Et même prêt à se libérer de ses entraves, à éclater, à tout faire sauter autour de lui, le monstre est trahi par son flotteur d'alarme et la vapeur accumulée s'échappe inoffensive par les soupapes de sûreté. Mais, c'est loin du générateur, des volants et des bielles que la machine conspire contre ses servants. De simples rubans de cuir se détachent de la masse principale, comme les longs bras d'un poulpe, et, par des trous pratiqués dans les parois, actionnent les appareils tributaires. Ces bandes sans fin se bobinent et se débobinent avec une grâce et une légèreté éloignant toute idée de sévices et d'agressions. Elles vont si vite qu'elles en semblent immobiles. Il y a même des moments qu'on ne les voit plus. Elles s'échappent, s'envolent, retournent à leurs point de départ, repartent sans se lasser, accomplissent des milliers de fois la même opération, évoluent en faisant à peine plus de bruit qu'un battement d'ailes ou le ronron d'une chatte câline, et lorsqu'on s'en approche leur souffle vous effleure tiède et zéphyréen.
À la longue l'ouvrier qui les entretient et les surveille ne se défie pas plus de leurs atteintes que le dompteur ne suspecte l'apparente longanimité de ses félins. Aux intervalles de la besogne, elles le bercent, l'induisent en rêverie ; ainsi, murmures de l'eau et nasillements de rouet. Mais chattes veloureuses sont panthères à l'affût. Toujours d'aguets, dissimulées elles profiteront de l'assoupissement, d'une simple détente, d'un furtif nonchaloir, d'un geste indolent du manœuvre, du besoin qu'il éprouvera de s'adosser, de s'étirer en évaguant…
Elles profiteront même de son débraillé. Une chemise bouffante, une blouse lâche, un faux pli leur suffira. Maîtresses d'un bout de vêtement, les courroies de transmission, adhésives ventouses, les chaînes sans fin, tentacules préhensiles, tirent sur l'étoffe et, avant qu'elle se déchire, l'aspirent, la ramènent à eux ; et le pauvre diable à sa suite. Vainement il se débat. Le vertige l'entraîne. Un hurlement de détresse s'est étranglé dans sa gorge. Les tortionnaires épuisent sur ce patient la série des supplices obsolètes. Il est étendu sur les roues, épiauté, scalpé, charcuté, dépecé, projeté membre à membre, à des mètres de là comme la pierre d'une fronde, ou exprimé comme un citron, entre les engrenages qui aspergent de sang, de cervelle et de moelles les équipes ameutées, mais impuissantes. Rarissime l'holocauste racheté au minotaure ivre de représailles ! S'il en réchappe, c'est avec un membre de moins, un bras réduit en bouillie, une jambe fracturée en vingt endroits. Mort pour le travail, vivant dérisoire !
Courir sus à la tueuse ? Arrêter le mouvement ? L'homme est estropié ou expédié avant qu'on ait seulement eu le temps de s'apercevoir de l'inégal corps à corps.
Laurent assimila aux pires engins de torture et aux plus maléfiques élixirs des inquisiteurs les merveilles tant vantées de la physique et de la chimie industrielles ; il ne vit plus que les revers de cette prospérité manufacturière dont Gina, de son côté, n'apercevait que la face radieuse et brillante. Il devina les mensonges de ce mot Progrès constamment publié par les bourgeois ; les impostures de cette société soi-disant fraternelle et égalitaire, fondée sur un tiers état plus rapace et plus dénaturé que les maîtres féodaux. Et, dès ce moment, une pitié profonde, une affection instinctive et absorbante, une sympathie quasi maternelle, presque amoureuse, dont les expansions côtoieraient l'hystérie, le prit, au tréfond, des entrailles, pour l'immense légion des parias, à commencer par ceux de ses entours, les braves journaliers de l'usine Dobouziez appartenant précisément à cette excentrique et même interlope plèbe faubourienne grouillant autour du « Moulin de pierre » ; il prit à jamais le parti de ces lurons délurés et si savoureusement pétris, peinant avec tant de crânerie et bravant chaque jour la maladie, les vénéfices[1], les mutilations, les outils formidables qui se retournaient contre eux, sans perdre, un instant leurs manières rudes et libres, leur familiarité dont le ragoût excusait l'indécence.
Avec eux, le gamin devenait communicatif. Lorsqu'il les rencontrait, noircis, en sueur, haletants, et qu'ils lui tiraient leur casquette, il s'enhardissait à les accoster et à les interroger. Après les petites persécutions à mots couverts, les ironies, les réticences et les tortures sourdes subies dans les salons de ses tuteurs, il lui semblait inhaler des bouffées d'air vif et agreste au sortir d'une serre chaude peuplée de plantes forcées et de senteurs qui entêtent. Il en vint à se considérer comme le solidaire de ces infimes. Sa faiblesse opprimée communiait avec leur force passive. Il se conciliait ces chauffeurs, machinistes, chargeurs, manœuvres. Eux répondaient aux avances touchantes de cet enfant rebuté, moralement négligé, méconnu, sevré de tendresse familiale, dont les larbins et la valetaille, cette lie de la plèbe, prenant exemple sur Félicité, parlaient en haussant les épaules, comme d'une charge pour la maison, comme d'un « quart de monsieur ».
IV. LE ROBINSON SUISSE
– Dussé-je vivre jusqu'à la fin du monde, racontait à Laurent le machiniste, ancien cavalier de l'armée, en train de fourbir, d'astiquer ou plutôt de bouchonner le monstre métallique de la force de trois cents chevaux-vapeur que je n'oublierai jamais cette scène ! … Oui, monsieur, la rosse que voici exécuta de jolie besogne ce jour-là ! … Aussi, au lieu de la panser comme à présent, suis-je souvent tenté d'en faire autant de morceaux qu'elle en fit de mon bénin camarade ! … Dire qu'il n'avait pas encore tiré au sort, mon chauffeur ! Et robuste, et sain qu'il était le blond « Frisé ». Pas une tare. En voilà un conscrit que le conseil de milice n'eût pas réformé ! … Il était tellement bien fait, qu'un de ces messieurs de l'Académie l'a sculpté en marbre blanc, comme les « postures » du Parc, – des idoles, m'a-t-on affirmé ! Peut-être cette ressemblance avec les faux dieux lui a-t-elle porté malheur !… C'est égal, il aurait pu se promener nu comme nos premiers parents sans choquer la pudeur de personne… Eh bien, ce n'est pas en dix, c'est en cent morceaux que la machine découpa ce chrétien… Lorsqu'il s'agit d'ensevelir ces tronçons rassemblés à grand'-peine, je commençai avec deux autres hommes de bonne volonté, – je vous assure qu'il en fallait ! – par avaler coup sur coup, cinq dés à coudre de pur genièvre… Nous roulâmes, comme chair à saucisses dans une crépine, cette charcuterie humaine dans une demi-douzaine de draps de lit, sacrifiés en rechignant par Mlle Félicité… Et ce n'était pas encore assez de ces six larges linceuls : au sixième le sang giclait encore à travers la toile !
Tandis que cette narration si évocative dans sa candeur barbare irritait péniblement les nerfs du jeune Paridael, il s'entendait appeler par une grosse voix, qui essayait de se faire toute menue.
– Hé, monsieur Laurent… monsieur Lorki… Lorki ! On ne lui donnait plus ce petit nom depuis la maison paternelle. Il se retourna non sans angoisse, s'attendant à voir surgir un revenant. Et quelle ne fut sa joie en reconnaissant le particulier trapu, basané, à l'œil brun clignotant, à la barbiche annelée.
– Vincent ! s'écria-t-il, pâle d'émotion… Vous ici !
– À vos ordres, monsieur Lorki !… Mais remettez-vous. On dirait, ma parole, que je vous ai fait peur… Je suis contremaître de la « coulerie »… Vous savez, l'atelier des femmes…
Cette coulerie était précisément le seul quartier de l'usine où Laurent ne se fût pas encore aventuré. Les faubouriennes, plus effrontées, plus tapageuses, moins endurantes même que leurs compagnons, ne laissaient pas de l'intimider. Souvent, de son lit, le soir, Laurent entendait sonner la cloche de délivrance. Aux femmes on rendait la volée, un quart d'heure avant les hommes. C'était aussitôt, vers la porte charretière, une trépignée, une galopade, un vacarme de pouliches débridées. Au dehors, cependant, elles lambinaient, traînaient la semelle. La cloche tintait de nouveau. Les hommes détalaient à leur tour, plus lourdement, mais en se ralliant d'une voix moins aigre. Et, après quelques instants, au bout de la rue, s'élevaient, confondues, des clameurs de femmes violentées et de galants bourrus. Laurent en gagnait la chair de poule. « Ah, les cruels, voilà qu'ils les empoignent ! » L'innocent ne comprenait rien encore à ces jurons, à ces rires saccadés dégénérant en giries. Le hourvari tournait des coins de ruelles, s'étranglait au fond des culs-de-sac, s'éparpillait peu à. peu dans les méandres des impasses, jusqu'à ce que la banlieue retombât dans un silence morne et sournois, complice de la ténèbre propice aux embuscades, et aux accouplements, – dans la nuit saoûle et lubrique autour du Moulin de pierre.
Le lendemain, celles qui avaient glapi et clamé à vous fendre l'âme, paraissaient enjouées, alertes, encore plus émancipées ; et dans les halles du rez-de-chaussée, les mâles glorieux, repus, contents d'eux-mêmes, se heurtaient le coude d'un air de connivence, échangeaient des clins d’œil, claquaient de la langue avec gourmandise.
À quelles mystérieuses prouesses faisaient-ils donc allusion, ces paroissiens truculents ?
– Comment, vous ne connaissez pas la coulerie ! se récriait Vincent Tilbak. Mais c'est le coin le plus curieux de la fabrique. Il faut voir mon équipage à l'œuvre ! De vraie abeilles !…
Ce Tilbak était un marin, pays de la bonne Siska.
Jadis, après un voyage au long cours, à peine débarqué, vite, il mettait le cap sur la maison des Paridael. Ses hardes de gros bleu embaumaient le goudron, le varech, le brome, la marine, toutes les senteurs du large, et de son être même émanait un parfum non moins viril et loyal. Pour achever de se faire bien venir, il avait toujours les poches pleines de curiosités de l'océan et des antipodes : coquillages carnés, fruits musqués pour Laurent ; et pour Siska une étoffe de l'Extrême-Orient, un bijou de Japonaise, une amulette d'anthropophage. Tilbak racontait ses aventures, et tel était le plaisir que Laurent prenait à ces récits que lorsque le narrateur épuisait son répertoire d'histoires véridiques, il lui fallait en inventer de fabuleuses. Et gare s'il s'avisait de les abréger ou d'en altérer un détail ! Laurent n'admettait pas les variantes et se rappelait, implacablement, la version primitive. Heureusement pour le complaisant rapsode, il arrivait au petit tyran, malgré sa vigilance et sa curiosité, de céder au sommeil. Siska le mettait coucher dans un cabinet à côté de la chambre de Monsieur. Alors les deux pays, débarrassés de ce témoin aimé, mais parfois gênant, pouvaient se parler d'autre chose que de naufrages, de baleines, d'ours blancs et de cannibales.
Une fois qu'ils le croyaient bien endormi, avant que Siska l'eût porté au premier, Laurent se réveilla à moitié au bruit d'un baiser sonore et tout à fait à celui d'une claque non moins généreusement appliquée. Le baiser était l'œuvre de Vincent, la gifle celle de Siska. Digne Vincent ! Laurent intervint dans la querelle et réconcilia les deux amis avant de se rendormir pour de bon. D'autres fois cette mauvaise Siska chicanait le débonnaire à propos de l'âcre tabac qui la faisait tousser, disait-elle, et qui empestait la maison. Il fallait voir la tête contrite et suppliante, à la fois radieuse et penaude de la « culotte de goudron », comme l'appelait Siska.
Et c'est ce Vincent-là, ce prestigieux Vincent dont le béret, la vareuse bouffante au large collet rabattu et les grandes bottes l'éblouissaient au point de lui donner envie de s'embarquer comme mousse avec lui, que le jeune Paridael revoyait ce matin, en prosaïque habit de terrien, dans l'étouffante usine du cousin Dobouziez ! Comment cela se faisait-il ?
Malgré sa passion pour la Grande Tasse et les aventures dangereuses, mais si ennoblissantes, contribuant à dilater le cœur et à en éloigner les spéculations mesquines et viles, Tilbak s'était résigné pour l'amour de Siska à dépouiller les bragues goudronnées, le jersey de laine bleue, le surott ou zuidwester de toile cirée, et à reprendre pied sur le plancher des vaches. Les pays s'étaient mariés. De leurs économies ils s'achetèrent un petit fonds de victuaillier de navire et s'établirent dans le quartier des Bateliers, près du Port. Siska s'occupait de la boutique, et Vincent venait d'entrer comme contremaître chez M. Dobouziez, sur la recommandation de son ancien capitaine, très porté pour le brave gabier.
– Et Siska ? demandait continuellement le petit Paridael.
– De plus en plus fraîche et jolie, monsieur Lorki, monsieur Laurent, veux-je dire, car vous êtes un homme à présent… Comme elle serait heureuse de vous voir ! Il ne se passe pas de jour sans qu'elle me parle de vous… Depuis les trois semaines que je navigue ici, elle m'a demandé au moins mille fois si je ne vous voyais pas, si je ne savais pas ce que vous deveniez, quelle mine avait son Lorki, car, sauf respect, elle continue de vous appeler du nom qu'on vous donnait chez feu votre cher papa. Mais, dame ! je ne savais auprès de qui m'informer… Les bourgeois d'ici ont – excusez ma franchise – quelque chose qui vous ôte l'envie de leur adresser la parole… Vrai, il n'a pas l'air commode, le capitaine Dobouziez. Et l'autre donc ! Un vrai prévôt ! Mais vous voilà, dites-moi bien vite ce qu'il me faut raconter à Siska. Et à quand votre visite ?
Et le brave brunet, toujours carré, toujours franc et amène comme aux bons jours, un peu plus barbu, un peu moins halé, les oreilles encore percées d'anneaux d'argent, croyait devoir se récrier sur la bonne mine du jeune Paridael, quoique celui-ci n'eût plus son air épanoui et insouciant d'autrefois. Mais en ce moment sa joie de retrouver Vincent était si grande qu'un rayon passager dissipait les ombres de sa physionomie prématurément songeuse.
– Je ne sors jamais seul, répondit-il, avec un gros soupir, à la dernière demande de son ami… Le cousin trouve que c'est temps perdu et que ces visites me distrairaient de mes études… Les études ! Le cousin ne voit que cela…
– Vrai. Là ! C'est dommage ! dit Vincent, lui-même un peu défrisé. Mais si c'est pour votre bien, Siska en prendra son parti. De sorte que nous devenons un vrai savant, hein, monsieur Lorki ?
Que le gamin eût voulu sauter au coup du matelot et le charger de baisers pour son excellente Siska ? Mais entre ces murs de l'usine malfaisante, à proximité de ces bureaux où régnait le majestueux cousin, non loin des lieux hantés par la terrible Félicité et la moqueuse Gina, le collégien se sentait mal à l'aise, gêné, contraint, refoulait ses expansions. Et il éprouvait aussi quelque remords en songeant que depuis les funérailles de son père il ne s'était pas informé une seule fois de la fidèle Siska.
Vincent devinait l'embarras du petit. À l'âge de Laurent on déguise mal ses sentiments, et Vincent lut bien des peines dans ce visage sérieux, dans cette voix un peu rauque, et surtout dans ces regards arrêtés avec une véritable ferveur sur le cher commensal du foyer paternel. Et comme des larmes menaçaient de voiler ces grands yeux nostalgiques :
– Allons, allons, monsieur Lorki ! fit l’ex-marin en empoignant les mains du gamin dans les siennes et en les secouant à plusieurs reprises. Pas de cela, nom d'une chique ! Hé, hisse ! N'amenons point les voiles ! … Au moins viendrez-vous me relancer là-haut sur le pont où je suis de quart. Je vous attends… À présent, je file mon nœud, car j'entends le porte-voix du père La Garcette, autrement dit le Pacha… La bourrasque approche… En haut le monde !
La coulerie, une halle immense entourée d'une plateforme, située au premier étage du bâtiment principal, occupait trois cents ouvrières, pour la plupart de fraîches, potelées et turbulentes filles, sanguines, peu vergogneuses, la bouche rieuse et gourmande, les yeux hardis, la langue bien pendue, uniformément et proprement vêtues d'une jupe de « baie » bleue, d'un caraco de colonnette, de bas de couleur, la chevelure tordue en chignon et ramassée sous un petit bonnet blanc et tuyauté dont les brides leur tombaient dans le dos. Employées à mettre la dernière main aux bougies sortant du moule, à les lustrer, à les empaqueter, jouant, qui du rouloir, qui du taille-mèche, elles se pressaient autour de deux à trois rangées de tables et de polissoires, et les bougies passaient d'un appareil à l'autre, se rapprochant, à chaque manipulation, du type achevé destiné à garnir lustres et girandoles. Comme il faisait très chaud au-dessus des machines à vapeur et que les « couleuses » mettaient de l'entrain à la besogne, beaucoup, pour respirer plus à l'aise, entr'ouvraient leur corsage et se découvraient la gorge, bravant les amendes que le brave Tilbak leur infligeait à contre-cœur et seulement quand, suivant son expression pittoresque, ces dames carguaient jusqu'à leurs dernières voiles. Elles se réfléchissaient avec leurs métiers dans le parquet constamment ciré par les déchets de stéarine et glissant comme celui du « Pélican », du « Miroir » et du « Cuivre », les bastringues favoris de ces donzelles. Le soir, de nombreuses lampes avivaient encore ce miroitement et cette multiplication qui, ajoutés au brouhaha des potinages et au ronflement des machines, étourdissaient et aveuglaient Laurent chaque fois qu'il débouchait dans l'atelier. Ce qui achevait de le troubler, c'étaient tous ces minois relevés et tournés de son côté. Très rouge et très gauche, se raidissant, il s'engageait entre les longues tablées et gagnait, à pas mesurés pour ne pas s'étaler sur le carreau, le fond de la salle où Vincent Tilbak trônait dans une sorte de chaire qu'il appelait sa dunette.
Là, sous la protection de son ami, le gamin reprenait bientôt confiance. Il osait soutenir l'inquisition de ce millier de prunelles claires ou sombres, répondait au sourire de tous ces visages allumés aux pommettes, s'enhardissait jusqu'à s'approcher des polisseuses et à suivre la manœuvre des mains roses aussi satinées que la stéarine même.
Un jour Tilbak lui demanda s'il aimait encore tant les histoires, « Oh, plus que jamais ! » s'exclama Laurent. Le matelot retira de dessous sa veste deux volumes qui lui bosselaient la poitrine, et les remit au collégien. C'était le Robinson suisse « Acceptez ces livres en souvenir de Siska et de Vincent ! dit le brave marin. Je les héritai d'un timonier qui mourut de la fièvre jaune, aux Antilles… Moi je ne sais pas lire, monsieur Lorki ; à neuf ans je gardais les vaches avec Siska et j'étais mousse à douze ans. »
Laurent ne prévoyait pas les conséquences de ce présent. Cette espionne de Félicité eut bientôt déniché les deux pauvres volumes si bien cachés au fond de la malle du collégien. Il ne les avait pas encore lus en entier. Outrageusement dépareillés, les bouquins interlopes dégageaient cette odeur de cale et de tabagie qui imprègne avec obstination le quintelage des gens de mer, et, soupçonneuse comme les gabelous, Félicité se douta bien qu'ils ne provenaient pas de la bibliothèque hermétiquement close depuis les vacances dernières. Le débraillé peuple et le fumet d'aventure de ce Robinson suisse contribuèrent à exciter l'indignation et l'horreur de Félicité. Les âmes de sa sorte se montrent d'autant plus dures et plus orgueilleuses aux humbles qu'elles voudraient donner le change sur leur propre extraction. Elle se livra à une véritable procédure de juge retors. Laurent subit interrogatoire sur interrogatoire, et comme il s'obstinait dans son refus de nommer le donateur de ces livres, elle remit ceux-ci au cousin Dobouziez. Appelé devant son tuteur, Laurent refusa de répondre à ses sommations. Il fut privé de dessert, mis au pain sec, enfermé dans une chambre noire : on ne lui arracha pas une parole de plus. Dénoncer Tilbak ! Il se fût plutôt fait moudre jusqu'à la dernière fibre dans les engrenages de la machine tueuse d'hommes. En attendant le moment de partager le sort du blond Frisé, il commença par braver le père La Garcette que Dobouziez, à bout de moyens d'intimidation, s'était décidé à appeler à la rescousse.
Le Pacha avait déculotté le gamin avec une truculence de frère fouettard, et lui maintenait la tête entre les genoux sans que Laurent daignât proférer la moindre plainte. Déjà l'exécuteur levait la canne pour fesser le rebelle, lorsque Dobouziez, pris d'un scrupule ou choqué par ce spectacle plus digne d'une chiourne que d'un milieu de respectables industriels, arrêta le bras de son associé.
– Je viens de trouver un meilleur moyen de casser votre mauvaise tête ! déclara-il à Laurent que Félicité ramenait dans sa cellule. Vous partirez demain pour Saint-Hubert, où les parents enferment, avec les précoces voleurs, les polissons de votre espèce !
Laurent se dit que prison pour prison, autant valait celle où il n'aurait plus Félicité pour geôlier.
Cependant Tilbak, inquiet de ne plus voir son jeune ami, interrogeait, ce jour même, les domestiques, et ayant été mis au courant de ce qui se passait, il demanda aussitôt à parler à M. Dobouziez pour une affaire urgente.
Assis devant son bureau, le dos tourné à la porte, l'usinier, qui venait de condamner son pupille, avait retrouvé son calme et travaillait avec son habituelle lucidité d'esprit. Tilbak se présenta la casquette à la main et quitta ses gros souliers par déférence pour le riche tapis de Tournai. Dobouziez tourna à peine la tête de son côté et sans lever les yeux de l'épure déployée devant lui :
– Approchez !… Que me voulez-vous ?
– Faites excuse, monsieur, mais c'est moi qui ai donné à M. Laurent les livres qui vous mettent si fort en colère contre lui…
– Ah, c'est vous ! fit simplement Dobouziez ; et pressant le bouton de la sonnerie électrique placée à portée de sa main :
– Réclamez, je vous prie, à Mlle Félicité les objets confisqués à M. Paridael ! ordonna-t-il au saute-ruisseau qui était accouru de la chambre voisine.
Les pièces à conviction ayant été apportées, l'industriel se leva d'un air ennuyé, considéra quelque temps, avec dégoût, ces piteux bouquins, comme s'ils lui représentaient une étoile de mer ou quelque autre gluant et gélatineux habitant des vagues, et n'ayant pas de pincettes pour y toucher, fit signe à Tilbak de reprendre son bien.
– Désormais vous vous dispenserez de fourrer pareilles niaiseries entre les mains de mon pupille…
– C'est entendu, monsieur, et soyez certain que si j'avais prévu les désagréments que ces bouquins attireraient au cher petiot, je me serais bien gardé de les lui remettre… Mais je vous en prie, pardonnez-lui… Il n'y a pas eu de sa faute… C'était moi le coupable…
M. Dobouziez, visiblement agacé par cette intercession, tourna le dos à l'importun, se rassit et, remplissant méthodiquement d'encre de Chine l'intervalle des branches de son tireligne, se mil en devoir de continuer son dessin.
– Écoutez-moi, patron, insistait Tilbak, après avoir toussé pour attirer l'attention du grand chef, votre protégé n'est pas un garnement… On vous trompe sur son compte… Ma femme le connaît mieux, allez ! Elle pourrait vous dire ce qu'il vaut !… Songez-vous sérieusement à l'enfermer avec des voleurs ?… Capitaine, j'en appelle à votre honneur, à vos sentiments d'ancien militaire, il est impossible que vous condamniez ce loyal enfant parce qu'il a refusé de faire le Judas !… Oui… le Judas !
À ce défi lancé avec chaleur, M. Dobouziez sursauta, se souleva à moitié de sa chaise et, plus blanc que d'habitude, tendit le bras vers la porte, d'un geste si péremptoire, et en dardant un regard si acéré au brave Tilbak, que celui-ci, craignant de desservir Paridael en insistant, se décida à rentrer dans ses souliers et à sortir en portant sommairement la main à sa casquette.
La médiation de Tilbak donna-t-elle à réfléchir au sage Dobouziez ? Encore une fois l'homme modéré craignait-il le retentissement que cet acte d'extrême rigueur aurait dans le public ? Laurent échappa à la prison de Saint-Hubert. Seulement, aux nombreuses interdictions qui pesaient déjà sur lui, son tuteur ajouta celle de circuler dans l'usine et de frayer avec les ouvriers.
– Comme s'il n'était déjà pas assez mal élevé et commun comme cela ! se récriait Félicité, chargée de tenir la bride plus courte que jamais à cet enfant dénaturé.
– Gare à toi, paysan, si je te repince encore à rôder dans les ateliers ! disait Saint-Fardier en accompagnant cette menace d'un moulinet de sa canne.
Avec cela que Laurent eût reculé devant les risques d'une fessée ! Il essaya plus d'une fois d'enfreindre la défense et de revoir Tilbak, pour le remercier et protester de son affection fidèle, mais on n'oubliait plus la clef sur la porte de communication entre le jardin et la fabrique, et la date de la rentrée au pensionnat arriva avant qu'il eût trouvé l'occasion d'escalader le mur pour relancer le contremaître.
Aux vacances suivantes, Félicité apprit à Laurent, en guise de bienvenue, que son matelot n'avait plus fait long feu à la fabrique après l'affaire du Robinson suisse. Particulièrement désigné à la mauvaise humeur et aux tracasseries de Saint-Fardier, à la longue le bonhomme, très endurant, très stoïque, s'était rebiffé et le satrape, qui ne cherchait qu'un prétexte pour le renvoyer, ne manqua pas l'occasion.
Tout bouleversé à cette nouvelle, Laurent se mit à la recherche de Gina, comptant bien l'intéresser au sort de Tilbak et des siens, car ils avaient des enfants, les pauvres !
Durant le drame qui venait de se dénouer par le renvoi du contremaître, Gina avait affecté une suprême indifférence à ce qui se passait. Loin de chercher à excuser la prétendue faute de Vincent Tilbak, elle n'avait pas même intercédé en faveur de Laurent. Au contraire, depuis qu'elle savait les relations de son cousin avec des « gens du commun » elle enchérissait de froideur et de dédain, s'abstenant même de lui parler du scandale qui mettait la maison sens dessus dessous. Durant la quarantaine du gamin, à qui Tilbak et ses vilains livres avaient sans doute donné la peste, la fière petite demoiselle ne s'informa pas une seule fois de lui. Et lorsqu'il fut rendu à la circulation, c'est à peine si elle daigna le reconnaître.
Et, pourtant, Laurent se faisait illusion sur le caractère de sa cousine. Il imputait cette sécheresse et cette insensibilité à l'éducation. Comment aurait-elle pu s'intéresser à ces ouvriers, à ces gens dont elle ne soupçonnait que vaguement l'existence ? Jamais elle ne se trouvait en contact avec eux, et elle en entendait parler, par ses parents, comme d'un quatrième règne de la nature, un outil, un minéral animé moins intéressant que les plantes et plus dangereux que les brutes.
Gina se trouvait seule dans la salle à manger, en train d'arroser les jacinthes fleurissant la tablette des fenêtres. Enhardi par l'affection qu'il portait à Vincent, Laurent l'aborda et lui dit sans préambule :
– Gina, cousine Gina, oh, demandez à votre père de rendre sa place à Vincent Tilbak…
– Vincent ? fit-elle, en continuant de soigner ses fleurs aristocratiques… je ne connais pas Vincent Tilbak…
– Le contremaître de la « coulerie », à qui M. Saint-Fardier a donné congé…
– Ah ! Je sais à présent qui tu veux dire… Le « Robinson Suisse », l'individu qui nous a mis en colère contre toi ! … Tu n'as pas honte de parler encore de ce joli sujet… Pour sûr que je me garderai de rappeler seulement son nom à mon père !
Et, avec une moue scandalisée, Gina passa dans une autre chambre où elle se mit à fredonner l'ariette à la mode. Laurent demeura tout pantois, les regards arrêtés machinalement sur les jolies jacinthes droites et coquettes auxquelles Gina se montrait si secourable. Il nourrit un instant l'envie de ravager ces fleurs, persuadé qu'il était à présent, d'avoir pris éternellement en grippe son inhumaine amie.
V. LE FOSSÉ
Ces vacances-là passèrent comme les autres, avec cette seule différence que dans la grande maison meublée à neuf, Laurent fut encore plus négligé et plus abandonné à lui-même que d'habitude. Il en arrivait à envier le sort des vieux meubles mis au rancart et voués au repos dans l'ombre et la poussière des greniers. Du moins s'ils avaient cessé de plaire ne leur imposait-on pas d'humiliants contacts avec leurs successeurs, tandis que lui, qui n'avait jamais plu, continuait pourtant de figurer comme une disparate, un repoussoir chagrin dans cet assortiment de bibelots cossus et de plantes frileuses. Il se sentait de plus en plus déplacé dans ce milieu riche et exclusif. En attendant qu'il eût le droit, la liberté de s'en aller retrouver d'autres disgraciés parmi ses semblables, il lui tardait de regagner la nuit, dans son coin de resserre, sous les toits, les objets répudiés et bannis.
Et pourtant, aussi mornes et longues que lui paraissaient ces vacances, à peine retourné au collège il se surprenait à les regretter pour l'amour même des heures maussades.
De son séjour chez ses tuteurs, c'étaient précisément les circonstances mélancoliques qu'il se rappelait avec le plus de complaisance et de la fabrique, c'étaient aussi les objets les moins gracieux, les moins aimables, frustes ou rêches, qui le hantaient pendant l'étude ou l'insomnie. En aversion des jacinthes qui lui symbolisaient la dureté de sa belle cousine pour les pauvres gens, il eût collectionné des bouquets fanés et des fleurs rustiques. Aux coûteux brugnons réservés à Mme Lydie, il préférait une pomme sure, craquant sous la dent.
De même il gardait dans les narines l'odeur rien moins que suave de la fabrique, surtout cette odeur du fossé bornant l'immense enclos et dans lequel se déchargeaient les résidus butyreux, les acides pestilentiels, provenant de l'épuration du suif. Ce relent onctueux et gras, relevé d'exhalaisons pouacres, le poursuivait continuellement à la pension, avec l'opiniâtreté d'un refrain canaille. Cette odeur était corrélative de la population ouvrière, des pauvres gens aveuglés par l'acréoline, déchiquetés par les machines à vapeur, proscrits par Saint-Fardier ; elle disait à Laurent la coulerie et ses femmes dépoitraillées, Tilbak et l'aventure du Robinson suisse ; elle lui suggérait l'excentrique banlieue, la nuit saoûle et lubrique autour du Moulin de pierre.
Lorsqu'il remettait le pied sur le pavé de sa ville natale, c'était par ce fossé que le domaine de Gina s'annonçait à lui. De tout ce qui appartenait et vivait à la fabrique, ce fossé seul venait à sa rencontre de très loin, le prenait même à la descente du train, le saluait avec un certain empressement, bien avant que le collégien eût vu poindre au-dessus des rideaux d'arbres, des toits et des moulins du faubourg, les hautes cheminées rouges et rigides, agitant leurs panaches fuligineux en signe de dérisoire bienvenue. Il était aussi le dernier, ce fossé corrompu, à lui donner la conduite, le jour du départ, comme un chien galeux et perdu qui se traîne sur les pas d'un promeneur pitoyable.
La surface sombre, striée de couleurs morbides, l'égout affreux s'écoulait à ciel ouvert, tout le long de la voie lépreuse conduisant à l'usine. Il mettait comme une lenteur insolente à regagner le bras de rivière dont il déshonorait les eaux. Les riverains, toutes petites gens, dépendant de la puissante fabrique, murmuraient à part eux, mais n'osaient se plaindre trop haut. Forts de cette résignation les patrons ajournaient la grosse dépense que représenterait le voûtement de ce cloaque. Une épidémie de choléra qui éclata en plein mois d'août leur donna cependant à réfléchir. Amorcé et stimulé par les miasmes du fossé, le fléau éprouvait les parages de l'usine plus cruellement que n'importe quel autre quartier de l'agglomération. Les faubouriens tombaient comme des mouches. Quoique les survivants craignissent d'attirer la famine en protestant ouvertement contre la peste, les Dobouziez crurent devoir amadouer la population, sourdement montée contre eux, et répandirent les secours parmi les familles des cholériques. Mais ces largesses presque forcées se faisaient sans bonne grâce, sans tact, sans cette commisération qui rehausse le bienfait et distinguera toujours l'évangélique charité de la philanthropie de commande. C'était la touchante Félicité qu'on avait chargée de la distribution des aumônes. Occupé de ce côté, le factotum surveilla Laurent de moins près et celui-ci en profita pour prendre quelquefois la clef des champs.
Un soir opaque et cuivreux, il regagnait d'un pas délibéré les parages de l'usine. En s'engageant dans la longue rue ouvrière éclairée sordidement, de loin en loin, par une lanterne fumeuse accrochée à un bras de potence, son attention très affilée, plus subtile encore qu'à l'ordinaire, fut intriguée par un murmure continu, un bourdonnement traînard et dolent. Il crut d'abord à un concert de grenouilles, mais il songea aussitôt que jamais bestiole vivante ne hantait la vase du fossé. À mesure qu'il avançait ces bruits devenaient plus distincts. Au tournant de la rue, près d'un carrefour proche de la fabrique, il en eut l'explication.
Au fond d'une petite niche à console, ornant l'angle de deux rues, trônait à la mode anversoise une madone en bois peint à laquelle une centaine de petits cierges et de chandelles de suif formaient un nimbe éblouissant. La totale obscurité du reste de la voie rendait cette illumination partielle d'autant plus fantastique. Au pied du tabernacle étincelant devant lequel ne brûlait, en temps ordinaire, qu'une modique veilleuse, sous ce naïf simulacre de l'Assomption, si bas que les languettes de feu, dardées, avec un imperceptible frisson, dans la nuit immobile et suffocante, parvenaient à peine à rayonner jusque-là, grouillait, se massait, prosternée, la foule des pauvresses du quartier, en mantes noires et en béguins blancs, défilant des rosaires, marmottant des litanies avec ces voix dolentes ou cassées des indigents qui racontent leurs traverses. Elles s'étaient cotisées pour l'offrande de ce luminaire dans l'espoir de conjurer par l'intercession de sa mère le Dieu qui déchaîne et retient à son gré les plaies dévorantes…
Il était à prévoir que l'illumination ne durerait pas aussi longtemps que les psalmodies. L'auréole se piquait déjà de taches noires. Et chaque fois qu'un cierge menaçait de s'éteindre, les suppliantes redoublaient de prières, se lamentaient plus haut et plus vite. Sans doute les âmes bien aimées d'un frère, d'un époux, d'un enfant correspondaient à ces flammes agonisantes. Celles-ci cesseraient de frémir en même temps que les moribonds achèveraient de râler. C'étaient comme autant de derniers soupirs qui soufflaient une à une ces lueurs tremblotantes. Et les ténèbres s'épaississaient chargées des mortuaires de la journée.
À quelques pas se dressait la fabrique plus noire encore que cette ombre, semblable au temple d'une divinité malfaisante. Surcroît de calamité : à cette heure équivoque le terrible fossé, plus effervescent encore que de coutume, neutralisait par ses effluves homicides l'encens de ces prières et l'eau bénite de ces pleurs.
Pour renforcer cette impression d'angoisse et de désespoir, il parut à Laurent, dont les yeux scrutaient le visage souriant de la petite Madone, que ce visage reproduisait le masque impérieux et trop régulier de sa cousine Gina. Se pouvait-il que pour faire avorter ces dévotions, le génie de l'usine Dobouziez se fût substitué à la Reine du Ciel ? Justement les pauvres mères, les épouses, les sœurs, les filles, les bambines et les aïeules entonnaient à la suite du vicaire en surplis, dirigeant leur neuvaine, un pressant et lamentable Regina Cœli !
Laurent n'en pouvait plus douter. Il reconnaissait cette moue avantageuse, ce regard hautain et moqueur. Il aurait même juré qu'un souffle s'échappait des lèvres de la fausse Madone et qu'elle prenait un sournois plaisir à éteindre elle-même les derniers lumignons !
Le collégien fut tenté de se jeter entre l'idole et la foule et de leur crier : – Arrêtez ! Vous vous abusez cruellement, ô pauvresses, mes sœurs ! Celle que vous invoquez, c'est l'autre Reine, l'aussi belle, mais la plus impitoyable ! … Arrêtez ! c'est Régina, la Nymphe du Fossé, la fleur du cloaque ; il l'enrichit, il la fait saine et superbe ; et vous elle vous empoisonne ; et vous, elle vous tue !
Mais le cantique se fondit subitement dans une explosion de sanglots. Aucun cierge ne brûlait plus. La petite Madone se dérobait aux regards conjurateurs de ces humbles femmes. Le dernier cholérique venait d'expirer.
VI. LE COSTUME NEUF
Cet hiver Mlle Dobouziez entrerait dans le monde. Les journées se passaient en courses et en emplettes. Gina se faisait confectionner de coûteuses et raffinées toilettes. La mère, qui allait être forcée de la chaperonner et de l'accompagner, se sentait un regain de coquetterie. Elle entendit s'habiller comme une jeunesse, porter des couleurs claires, assortir ses robes et ses coiffures à celles de sa fille. Poussant à l'excès l'amour des fleurs artificielles et des rubans tapageurs, elle mettait sens dessus dessous les magasins de la modiste, déroulait tous les rubans, déballait tous les cartons d'oiseaux empaillés, se trempait comme dans un bain de coques, de brides, de marabouts et de plumes d'autruches. Si Régina n'eût point été là pour prendre à part la fournisseuse, au moment de sortir et lui décommander à l'oreille, une partie des agréments choisis par la bonne dame, elle eût arboré ses chapeaux de quoi garnir les vases d'un maître-autel de cathédrale ou enrichir un musée de botanique et d'ornithologie. Ce n'était pas sans luttes et sans peines que Gina, très sensible au ridicule, parvenait à élaguer de quelques arbustes la pépinière que Mme Dobouziez se proposait d'offrir à l'admiration du grand monde commerçant.
Gina révélait déjà des impatiences de femme, montrait des velléités d'émancipation. Pour le milieu où elle les produirait, ses toilettes de jeune fille manquaient un peu de modestie – comme s'exprime la pruderie provinciale – mais elles possédaient tant de cachet et Gina les portait avec une allure si crâne et si souveraine ! Laurent se sentait de plus en plus fasciné par la radieuse héritière et cela sans démêler encore si le sentiment qu'il éprouvait à son égard était de l'envie ou de l’amour.
Il arrivait un moment où la perspective de distractions et de succès nouveaux enfiévrait Gina et la rendait plus communicative, plus aimable avec son entourage. Gagné par cet entrain, cette humeur conciliante et réjouie, Laurent lui-même demeurait quelquefois auprès d'elle. Quand il se renfrognait dans son coin elle l'appelait, lui racontait ses projets, le nombre d'invitations qu'on lancerait pour le premier bal, lui montrait ses emplettes, daignait le consulter sur la nuance ou le chiffonnage d'une étoffe, sur le choix d'une bague : « Voyons, approche, paysan ! Montre que tu as du goût ! » Elle lui décochait cette épithète de paysan avec une rondeur qui enlevait sa portée désobligeante au sobriquet. Cette embellie familiale durerait-elle ? Laurent en profitait comme le vagabond transi se réchauffe béatement au coin d'un âtre hospitalier, oubliant que dans une heure, il lui faudra reprendre sa course à travers la neige et le gel.
Lorsque Laurent assistait dans le vestibule et jusque sous le porche de l'allée cochère au départ de ces dames, Gina acceptait ses attentions, consentait à prendre de sa main la sortie de bal, l'éventail, l'ombrelle. Il la voyait monter prestement en voiture, relever d'un geste adorable le fouillis coquet de ses jupes : « Viens-tu, mère ? … Bonjour, paysan ! » La cousine Lydie se hissait, essoufflée ; le marchepied criait sous son poids et la caisse de la voiture penchait de son côté.
Enfin, avec un soupir, elle s'installait. Nerveuse, la menotte gantée de Gina abaissait la glace du coupé ; le portier, casquette à la main, écartait les vantaux de l'entrée et saluait ces dames… Elle était partie !…
Il fallut songer aussi au trousseau du jeune Paridael qu'on allait envoyer loin du pays dans un collège international, d'où il ne reviendrait qu'après avoir terminé ses études.
La cousine Lydie et l'inévitable Félicité se livrèrent à des fouilles dans la garde-robe de M. Dobouziez. Avec une minutie d'archéologue elles inspectèrent, pièce par pièce, les nippes que « Monsieur » ne portait plus, se les repassant de main en main, pesant, tâtant, se concertant. Amadouée aussi par l'atmosphère de fête emplissant la maison, Mme Dobouziez se déclarait prête à sacrifier, pour la faire ajuster à la taille de son pupille, par un petit tailleur du faubourg, une redingote presque neuve ou une culotte, plutôt démodée qu'usée, de son époux.
Mais Félicité trouvait toujours les vêtements beaucoup trop beaux pour un garçon si négligent sur ses effets : « Vrai, madame, les sabots, la blouse, la casquette et la culotte en cuir de nos ouvriers lui conviendraient mieux. »
La cousine Lydie arrachait presque, par serment, à l'heureux Paridael, la promesse de bien ménager ces habillements. C'était des « bien sûr ? » et des « tu le corrigeras, n'est-ce pas ? » comme si on lui eût confié la tunique sans couture du Sauveur. À tel point que devant la lourde responsabilité qu'il endosserait en même temps que la défroque du cousin, Laurent eût préféré revêtir, en effet, les bardes inusables et commodes des manœuvres, ses amis.
Il ne restait plus qu'à disposer de certaine culotte à carreaux verts et bleus, une horreur que le cousin lui-même, peu exigeant sur le chapitre de la toilette, avait répudiée dès la troisième épreuve.
Félicité guignait ces bragues désastreuses pour les revendre au fripier. Chaque pièce d'habillement dévolue à l'orphelin diminuait d'autant le profit du factotum à qui revenait autrefois 1a dépouille des maîtres. Cette circonstance n'était pas étrangère à l'animosité qu'elle entretenait à l'égard de Laurent. Celui-ci, cependant, lui aurait volontiers cédé toute la garde-robe du cousin, et surtout ce désastreux pantalon épinard et indigo ; mais il n'osait témoigner ouvertement sa répugnance, la cousine Lydie s'étant mis en tête de lui causer une grande joie.
En ce moment Régina qui cherchait sa mère se présenta sur le palier des combles.
– Oh ! le cauchemar ! fit-elle ; j'espère bien, maman, que tu ne vas pas faire porter cette friperie à Laurent ? C'est pour le coup que le paysan mériterait son nom.
Et, prise d'un bon mouvement fraternel, Gina ayant examiné le tas de vieilleries destinées à son cousin, déclara qu'il y avait là de quoi lui tailler quelques vêtements de fatigue, mais rien dont on pût retirer un costume habillé : « Viens-nous-en, mère, dit-elle ; j'ai deux courses à faire en ville, et, en passant, nous verrons les fournisseurs d'Athanase et Gaston Saint-Fardier. Ils trouveront bien moyen de décrasser un peu ce bonhomme ; allons, arrive, toi ! »
Pas moyen de résister à Gina. Félicité dévora son dépit et se consola de l'insolite faveur témoignée par la capricieuse et hautaine jeune fille à ce maudit gamin, en s'adjugeant sans répugnance le terrible pantalon bicolore.
C'était la première fois que Laurent accompagnait ses cousines en voiture. Assis à côté du cocher, que la surprise avait failli précipiter de son siège au moment où Laurent s'y juchait, il se retournait de temps en temps pour montrer à Gina un visage qu'il savait moins maussade que de coutume et la remercier par ce rayonnement inusité. Il comptait donc enfin pour quelque chose dans la famille Dobouziez ! Cette subite rentrée en grâce faillit le rendre vaniteux. Il se sentait venir au cœur un peu de morgue et il regardait les piétons du haut de sa grandeur. Sous l'impression du moment il oubliait les dédains et les affronts essuyés auparavant ; la dureté de Gina et de ses parents pour Tilbak ; il se rappelait non sans remords les blasphèmes qu'il avait proférés contre la « Nymphe du Fossé », ce sinistre soir de neuvaine quand régnait le choléra.
Ah ! les cholériques, les blessés, les parias étaient loin ! Il ne les reniait pas, mais il ne s'en inquiétait plus… Il était prêt à reconnaître sans peine et sans réserve les bienfaits de son tuteur, à trouver très affectueuse la cousine Lydie, à mettre la férocité du Pacha sur le compte de sa maladie de foie. Il n'en voulait même plus autant à la malicieuse Félicité.
Charmante matinée de conciliation ! Il faisait beau, les rues semblaient en fête, les dames dont les équipages croisaient la Victoria des cousines Dobouziez comprenaient presque le petit Paridael dans les saluts échangés avec celles-ci.
On arrêta tour à tour chez le tailleur, le chemisier, le bottier, le chapelier des jeunes Saint-Fardier, ces arbitres de suprême élégance… Le tailleur prit mesure à Paridael d'un complet dont Gina choisit l'étoffe, la plus chère et la plus riche, naturellement, malgré les protestations de Mme Lydie qui commençait à trouver ruineuse la sollicitude de sa fille pour le petit parent pauvre. À quelles prodigalités la fantasque Gina n'allait-elle pas l'obliger avant de rentrer ? À tout instant la tutrice économe consultait sa montre : « Gina, l'heure du déjeuner… Ton père nous attend ! » Mais Gina s'était mis en tête de s'occuper à son tour de la toilette de son cousin, et elle apportait dans l'exécution de son dessein sa hâte, sa pétulance habituelle. Quand elle avait décidé quelque chose, elle n'admettait ni retard, ni réflexion. « Sur l'heure ou jamais ! » eût-elle pu adopter pour devise.
Chez le chemisier, outre six chemises de fine toile commandées à la mesure de son protégé, elle acheta une couple de délicieuses cravates. Chez le chapelier il échangea son feutre râpé contre un couvre-chef irréprochable et chaussa aussi chez le bottier des bottines faites à son pied. Il garda au corps les chaussures et le chapeau neufs. C'était un commencement de métamorphose. Chez la gantière Gina remarqua pour la première fois qu'il avait les attaches fines, la main et le pied petits. Elle se réjouissait de la métamorphose graduelle du gamin.
– Vois donc, maman, il n'a plus l'air aussi rustre. Il est presque bien, n'est-ce pas ?
Ce « presque » gâtait un peu le bonheur de Laurent ; mais il pouvait espérer que lorsqu'il serait habillé de neuf des pieds à la tête, Gina le trouverait tout à fait présentable.
Illusion, leurre, mirages, cette journée n'en fut pas moins une des meilleures que Laurent eût rencontrées. Comme Gina donnait le ton, tout le monde à la fabrique, même le cousin Guillaume, même l'inconciliable Félicité faisait meilleur visage au collégien et ne le morigénait pas aussi souvent.
– Mademoiselle a l'air de jouer encore à la poupée ! se contenta de dire en a parte la hargneuse créature, lorsque Gina fit tourner et retourner Laurent pour le montrer au cousin Guillaume.
Il faut croire que le jeu amusa la jeune fille, car le tailleur ayant livré les vêtements neufs de Laurent la veille d'une excursion par eau à Hémixem, où les Dobouziez avaient leur « campagne », elle demanda que le gamin fût de la partie. Comme il devait partir le lendemain pour l'étranger, les parents se prêtèrent à cette nouvelle fantaisie de Gina, à condition qu'il s'en rendit digne par des prodiges d'application et de sagesse.
Décidément Laurent sentait ses dernières préventions se dissiper. Age privilégié du pardon des injures, où la moindre attention compense dans la mémoire de l'enfant des années de désaffection et d'indifférence !
VII. HÉMIXEM
Heureux Laurent ! Il eût fallu le voir sur l'embarcadère des paquebots, exultant dans ses vêtements neufs, portant haut la tête, se mêlant aux invités avec un sentiment de confiance et d'égalité inéprouvé jusqu'alors. Il y avait au moins trente personnes de la partie. Dames et demoiselles en fraîches et claires toilettes de villégiature ; cavaliers en négligé élégant : chapeau de paille et pantalon de piqué. Non seulement Laurent était aussi bien mis que ceux-ci, mais il était même mieux mis, trop correctement peut-être, et les deux jeunes Saint-Fardier, deux freluquets de dix-huit et vingt ans, habillés tout de flanelle blanche, à qui Gina le présenta comme un petit sauvage réputé incorrigible, mais en passe de s'apprivoiser, le toisèrent en échangeant avec la jeune fille un sourire d'intelligence qui eût peut-être défrisé, le candide Paridael en tout autre moment. Ce sourire disait clairement l'anomalie de sa toilette de ville.
Athanase et Gaston, inséparables, toujours habillés de même, deux doigts de la même main ou plutôt deux asperges de la même botte. Fluets, pâlots, l'air malsain, ils prétextaient la sensibilité de leurs amygdales pour exagérer la largeur de leurs carcans et s'emmitoufler périodiquement le cou.
La veuve Saint-Fardier, leur grand'mère, maîtresse d'un gentilhomme podagre et quasi gâteux, le capta si bien qu'il contraignit son enfant unique, une douce et filiale créature, à se mésallier avec le fils de sa concubine. On attribuait à l'inconduite du Pacha l'affliction morale et aussi le mystérieux et incurable mal qui avaient prématurément emporté la jeune dame Saint-Fardier. Athanase et Gaston tenaient de leur mère des traits agréables, une distinction native, mais ils n'étaient guère plus intelligents que le baron La Bellone, leur aïeul, et les débordements paternels les avaient marqués de ces stigmates qu'effaçaient les rois de France.
Pour Saint-Fardier ces piteux rejetons constituaient un blâme, un remords vivant. Il les prit en horreur dès leur berceau, mais sa répugnance l'emportant sur la haine, jamais il n'osa les battre. Il les tenait à distance, les confiait à des étrangers ou les abandonnait à eux-mêmes, les bourrait d'argent de poche, les faisait voyager, cela afin de les voir le moins possible. Ils finirent par vivre de leur côté, comme lui du sien, par prendre leurs repas et par loger au dehors, par le traiter comme un simple banquier, et même par ne plus avoir affaire qu'au caissier de la fabrique. Ce ne fut pas de sa faute s'ils ne tournèrent pas en affreux gredins et s'ils ne représentèrent que des viveurs infatués de leur personne, mais pas méchants. Au reste, ils rendaient à leur père mépris pour dégoût. Malgré leur idiotie, ils ne pouvaient lui pardonner ce qu'ils avaient vaguement appris sur la fin de leur mère. Les allures de maquignon du Pacha les faisaient rougir. Ils évitaient de parler de lui, fréquentaient chez des patriciens en se recommandant du nom de leur mère, et se faisant appeler Saint-Fardier de La Bellone.
À la fois blasés et candides, poupins et ridés, jeunets et caducs, leur aspect rappelait à Laurent la mise qu'il avait lui-même le jour des Saints-Innocents, lorsque la bonne Siska lui grimait le visage et le déguisait en vieillard.
Mais les jeunes Saint-Fardier n'arrêtèrent pas longtemps l'attention de Laurent.
La cloche sonnait le départ ; on avait retiré la passerelle, la machine s'étirait les membres, et tout le monde, empressé de se rendre à bord, se casait de son mieux sur le pont à l'avant, tendu d'une toile pour protéger les passagers de première classe contre les ardeurs indiscrètes du soleil d'août.
Le temps servait à souhait les excursionnistes. Pas un nuage dans le ciel d'un bleu éteint de turquoise.
Le large fleuve olivâtre et blond avait son aspect dominical. Vers le Nord, en rade et dans les bassins, les grands navires de commerce, voiliers et vapeurs reposaient, délaissés par le gros de leurs équipages. Manœuvre et manéage[2] étaient suspendus. Les brigades de débardeurs chômaient. C'est tout au plus si on achevait de charger un navire devant gagner la mer dans l'après-midi. Il n'y avait d'autre mouvement sur le fleuve que celui des embarcations de plaisance, des canots de « balade », des yachts d'amateurs et de sportsmen, gréés et taillés pour la course, et des paquebots offrant aux désœuvrés de la petite bourgeoisie des traversées à prix réduit vers les principaux villages riverains.
Des « sociétés » entières, endimanchées, accompagnées de fanfares s'embarquaient à bord de ces petits vapeurs. Une grosse gaîté bourrue et démonstrative, une hâte, une fièvre émoustillait tout ce peuple émancipé, cette légion de navigateurs d'occasion, de marins novices. Les familles se ralliaient sur le rivage avec des exclamations à propos de bagages oubliés dans un estaminet. Et les orphéons s'enlevaient en pas redoublés allègres, après le coup de canon du départ, tandis que l'un ou l'autre paquebot, démarré, quittait la rive et virait majestueusement, avant de gagner le milieu du courant.
Le yacht à vapeur sur lequel étaient montés les Dobouziez et leurs invités appartenait à M. Béjard, gros armateur et négociant de la ville, un des hommes les plus importants de sa caste. Il avait mis son élégant et spacieux bateau à la disposition des Dobouziez et accepté en échange leur invitation à la partie de campagne.
Le yacht leva l'ancre, à la grande et candide joie de Laurent.
L'Escaut ! Comme le gamin le retrouvait avec émotion ! Encore une ancienne et bonne connaissance du vivant de son père ! Combien de fois ne s'étaient-ils pas promenés, les deux Paridael, sur les quais plantés de grands arbres, en faisant halte de temps en temps dans une ce ces « herberges » tellement achalandées, le dimanche après-midi, que la porte ne suffisant pas à l'afflux des consommateurs, ils pénétraient par les fenêtres en gravissant un petit escalier portatif appliqué contre le mur au dehors. Là, si on trouvait moyen de s'attabler, qu'il faisait bon suivre le mouvement des flâneurs sur la rive et les voiles sur l'eau ! Quelle douce fraîcheur à la tombée du jour ! Que d'années écoulées maintenant sans avoir revu ce fleuve tant aimé ! …
Mais c'est la première fois que Laurent navigue et les impressions nouvelles amortissent ses regrets.
Le vapeur, après avoir tourné une couple de fois sur lui-même, avec la coquetterie d'un oiseau qui essaie ses ailes avant de prendre son essor, a trouvé sa voie et s'éloigne délibérément, sous la pression accélérée de la vapeur. Le panorama de la grande ville se développe d'abord dans toute sa longueur et accuse ensuite les proportions audacieuses et grandioses de ses monuments. C'est comme si elle sortait de terre : les arbres des quais élancent tours cimes feuillues, puis les toits des maisons dépassent la futaie ; les vaisseaux des églises, surgissant à leur tour derrière l'alignement des hautes habitations, regardent même par-dessus les toitures des entrepôts, des marchés, des halles historiques ; puis plus haut, toujours plus haut, tours, donjons, campaniles, pointent, montent, semblent vouloir escalader le ciel, jusqu'au moment où tous s'arrêtent vaincus, essoufflés, sauf la flèche glorieuse de la cathédrale. Celle-là seule continue son ascension, laissant loin en arrière les faîtes les plus altiers. Encore ! Encore ! À son tour elle abandonne la partie. Elle surplombe la ville, elle plane sur la contrée. Il l'emporte suffisamment sur ses rivaux, le beffroi aérien et dentelé, si haut qu'on ne voit plus que lui à présent. Anvers s'est éclipsé derrière un coude du fleuve ; la tour par excellence marque comme un phare superbe l'emplacement de la puissante métropole. Et Laurent contemple la tour de Notre-Dame jusqu'à ce qu'elle se fonde, lentement, dans les lointains si lointains que l'horizon bleu en pâlit.
Alors le dévot passager regarde la campagne : polders argileux, briqueteries rougeoyant parmi les digues verdoyantes ; villas blanches encadrées de rideaux d'arbres, auxquelles de vastes pelouses, dévalant doucement jusqu'à la rive, ménagent la perspective du fleuve. Mais, plus encore que le reste, l'Escaut même impressionne le collégien. Il s'en remplit le cœur par les yeux, par le nez, par les oreilles avec l'avidité d'un proscrit à la veillé de l'exil, il fait provision de tableaux qui seront ses mirages et ses rêves de là-bas durant combien de lendemains !
Accoudé au parapet, à l'arrière, il s'amusait du remous écumeux causé par la machine foulant les vagues paresseuses, d'un vol de mouettes s'abattant sur l'eau et s'appelant d'un cri aigre, des chalands lourds et pansus avec lesquels le yacht se croisait, des voiles qui marquaient comme des points de repère dans la profondeur du tableau. Puis Laurent revenait à son entourage : au mouvement sur le pont, à la manœuvre exécutée par trois ou quatre marins de fière mine triés parmi les plus robustes des équipages de M. Béjard – car, fondateur d'une double ligne de navigation entre Anvers et Melbourne et Anvers et Batavia, le propriétaire du yacht possédait des bâtiments autrement sérieux que cette embarcation joujou.
– Vous voyez cette rouche ! disait justement Béjard à Mlle Dobouziez, non loin de Laurent, en lui indiquant des chantiers établis sur la rive droite. Pardon, mademoiselle, rouche est un mot technique qui veut dire la carcasse d'un navire en construction… Elle vous représente l'embryon de ce qui deviendra un bâtiment de neuf cents tonnes agencé et outillé comme cela ne s'est jamais vu, la perle de notre flotte marchande et qui s'appellera Régina, si vous voulez bien nous faire l'honneur, dans un an, d'en être la marraine.
Et il s'inclina galamment.
– Dans un an ! Nous avons le temps d'en parler, monsieur Béjard… Puis, ne me trouvez-vous pas un tantinet fluette et pensionnaire pour tenir sur les fonts baptismaux un poupon de la corpulence de votre nouveau vaisseau : un navire de neuf cents tonnes ! Et moi qui ne pèse pas même un tonnelet ! Car je me suis fait peser l'autre jour à la fabrique, comme un simple tourteau de stéarine. Songez donc, s'il arrivait malheur à mon filleul !
– Oh, dit Béjard avec un ricanement de joueur à coup sûr, il n'arrive jamais malheur aux bâtiments, de la Croix du Sud… Tous naissent sous une bonne étoile… Puis, ils sont assurés…
– C'est égal, répartit Gina, j'ai mon amour-propre de marraine, et toutes les assurances du monde ne me dédommageraient pas du chagrin que j'éprouverais en sachant mon gros filleul englouti au fond de la mer, en aller au royaume des madrépores… Pardon, je vous rends votre rouche de tout à l'heure… Et rieuse, elle courut se mêler à un groupe voisin où jacassaient ses amies, les petites Vanderling.
En entendant la voix claire de Gina, Laurent s'était tourné du côté des interlocuteurs.
Il dévisageait attentivement le propriétaire du yacht.
Béjard avait, outre l’air orgueilleux, distant et protecteur, commun à la majorité des gros négociants d'Anvers, quelque chose de fuyant dans le regard et de sourd dans la voix. Quarante-cinq ans, la taille moyenne, sec et noueux ; la peau jaunâtre, presque séreuse, le nez crochu, la barbe longue et rousse, les cheveux châtains rejetés en arrière, les lèvres minces, les yeux gris, le front bombé, l'oreille contournée ; tel l'homme au physique. Dans son allure et sa physionomie régnaient à la fois la cautèle du juif moisi derrière le comptoir d'une gasse sordide de Francfort ou d'une laan d'Amsterdam, et l'audace de l'aventurier qui a écumé les mers et opéré au grand jour et au grand air dans les pays vagues. Mais ce mélange de forfanterie et d'urbanité mielleuse, crispait par son atroce discordance. Chez cet être l'expression était mixte et disparate ; les yeux éteints démentaient la parole cassante ou, réciproquement, la voix sourde et larmoyante contredisait l'éclair dur et malicieux des prunelles grises. Avec cela, correct, homme de savoir-vivre, causeur facile, hôte prodigue, amphytrion royal.
Dans le monde on ne l'aimait pas, mais on le recherchait assidûment ; on le craignait et pourtant c'était à qui s'effacerait pour le mettre en avant. Par sa fortune, son activité, son entregent il avait conquis un réel ascendant, une prépondérance capitale non seulement dans le domaine des affaires, mais il était en train de se tailler un rôle dans la politique et même dans ce qui s'entreprenait à Anvers sous couleur d'art et de littérature. Il affichait la plus complète tolérance, prônait les idées larges, se disait cosmopolite, libre-échangiste, utilitaire, jurait par Cobden et Guizot, affectait, en affaires des allures de yankee, mais sorti de l'atmosphère du négoce, exagérait en société l'étiquette, la tenue, le genre des parfaits gentlemen anglais.
Il s'en fallait cependant que l'origine du personnage et de sa fortune, que son passé cadrât avec son prestige actuel. Des histoires véridiques, mais étranges et inquiétantes comme des légendes, couraient sur son compte. Avec un flegme et une sérénité parfaite il venait d'attirer l'attention de Gina sur le chantier Fulton. Et pourtant la vue seule de ces lieux eût dû le navrer ou du moins le rappeler à plus de modestie, mêlés qu'ils étaient à de déplorables pages de sa vie.
Autrefois, il y avait des années de cela, son père était directeur de ces mêmes chantiers lorsque les abus inouïs, les actes monstrueux qui s'y commettaient vinrent au grand jour.
Cédant on ne sait à quelle perversion de la fantaisie, assez rare chez les gens du peuple, les ouvriers du chantier s'amusaient à martyriser leurs jeunes apprentis, en les menaçant de tortures plus atroces encore et même du trépas, s'ils s'avisaient de divulguer, ces abominables pratiques. Les souffre-douleur, terrorisés comme les fags des anciens collèges anglais, ne parvenaient à échapper à ces cruautés qu'en abandonnant à leurs bourreaux le gros de leur salaire. À la fin pourtant l'affaire transpira : Le scandale fut immense.
La bande des tortionnaires dénia devant le tribunal et, tant que dura leur procès, un extraordinaire déploiement de gendarmes et de militaires eut peine à les protéger contre d'expéditives représailles populaires, surtout contre la fureur des femmes tournées en Euménides, dont les ongles les auraient réduits en charpie. C'est aussi que les débats avaient révélé des mystères abominables : simulacres de crucifiement, flagellations en masse, noyades consommées jusqu'à la dernière extrémité, ébauches d'auto-da-fé. Des enfants enterrés des heures jusqu'au cou ; d'autres obligés de manger des choses dégoûtantes ; d'autres encore forcés de se battre quoiqu'ils n'entretinssent aucune animosité.
La justice écarta toute présomption de complicité directe de M. Béjard père avec ses subalternes, mais la négligence et l'incurie du directeur ressortirent d'une façon accablante. La compagnie l'ayant cassé aux gages, la conscience publique ne se déclara pas encore satisfaite et, confondant le père Béjard avec les brimeurs condamnés aux travaux, forcés, elle lui fit quitter la ville. Une circonstance établie par toutes les dépositions contribua à cet ostracisme. Le fils du directeur disgracié, alors un collégien d'une quinzaine d'années, avait présidé plus d'une fois à ces spectacles et, au dire des acteurs, en y prenant un certain plaisir. Peu s'en fallut que dans son effervescence l'auditoire ne réclamât l'emprisonnement du sournois potache qui s'était bien gardé de dénoncer à son père ceux qui lui procuraient de si palpitantes récréations.
Après, vingt-cinq ans on apprit que le fils Béjard revenait dans sa ville natale. Son père s'était enrichi au Texas et lui avait laissé des plantations importantes de riz et de cannes à sucre, des domaines immenses comme un royaume, cultivés par une armée de noirs. À la veille de la guerre de sécession, Freddy Béjard liquida une partie de ses biens et en plaça le produit sur les principales banques d'Europe. Il resta pourtant en Amérique au début de la campagne, moins par solidarité avec les esclavagistes que pour défendre le reste de ses propriétés. Il fit le coup de feu, en guérillero, dans la prairie, contre les hommes du Nord. Enfin, après la pacification, plusieurs fois, millionnaire malgré de grosses pertes, il rentra à Anvers, songeant peut-être à venger son nom des éclaboussures et des tares du passé.
Voilà ce qu'on savait de plus clair sur Béjard et ses commencements, et c'est ce qu'il en avouait lui-même, avec une certaine jactance, dans ses moments de belle humeur.
Son faste de nabab, les magnifiques entreprises par lesquelles il collaborait1 à la prospérité extérieure de sa ville natale, lui ouvrirent toutes les portes, du moins celles du monde, assez mêlé, des négociants, car l'aristocratie et l'autochtone bourgeoisie patricienne le tinrent en aussi piètre considération que le menu peuple.
Si les flatteurs du succès, admirateurs des « malins » et des élus de la chance, les brasseurs d'affaires, les spéculateurs s'inclinant devant le million d’où qu'il provienne, oublièrent ou enterrèrent le passé, les castes plus essentiellement locales, la population stable, les Anversois de vieille roche se remémoraient, eux, les scandales anciens et vouaient à Freddy Béjard un mépris et une antipathie invétérée.
De plus, les récits qui avaient passé l'océan ajoutaient des torts plus récents à la compromettante affaire du chantier Fulton.
Ainsi, on alla jusqu'à prétendre qu'enragé de la victoire des Américains du Nord dont la campagne abolitionniste entamait sa fortune, loin de rendre, après la conclusion de la paix, la liberté à ses esclaves, il les avait vendus à un négrier espagnol des Antilles, et que c'était même pour avoir éludé ainsi les décrets du vainqueur qu'il dut quitter sa seconde patrie. D'après une autre version, plutôt que de se conformer au décret d'affranchissement des noirs, il avait abattu les siens jusqu'au dernier.
Les commerçants traitaient toutes ces histoires de contes de vieille femme inventés par les envieux et les adversaires politiques du parvenu. M. Dobouziez, lui-même, sans s'éprendre pour Béjard d'une sympathie qu'il n'entrait d'ailleurs pas dans ses habitudes de prodiguer, ne pouvait admettre qu'on rendît l'entreprenant et courageux armateur responsable d'une faute ou plutôt d'un accident expié assez durement par son père. Saint-Fardier, lui, éprouvait pour ce hardi bougre de Béjard une admiration de connaisseur, il ambitionnait même de lui servir de limier féroce et fidèle, car il tenait de ces blood hounds au moyen desquels tes planteurs traquent leurs nègres fugitifs. Au fond il s'impatientait des scrupules du correct Dobouziez ; son véritable associé eût été Béjard.
Laurent n'avait jamais vu celui-ci ; il ignorait ce qui se racontait sur son compte. Et pourtant un malaise indicible s'empara de lui en présence de cet homme. Il eut un pressentiment douloureux, son cœur se contracta, et lorsqu'il se détourna de l'armateur pour reprendre sa contemplation du paysage, les rives lui parurent dégager une fatidique tristesse.
Au moment où le chantier Fulton allait disparaître derrière un tournant de l'Escaut, l'appareil compliqué des charpentes entourant la rouche du navire en construction revêtit l'apparence d'un énorme squelette auquel adhéraient ça et là des lambeaux de chair ; et de vêtements, calcinés. Mais cette illusion sinistre ne dura qu'une seconde et le charme d'autres sites rassura l'humeur, momentanément troublée, de Paridael.
Lorsqu'elle se produisit il n'attacha aucune importance à cette hallucination, mais par la suite il devait se là rappeler quand elle intervint avec un redoublement d'horreur à l'instant le plus tragique de sa vie.
On s'était dispensé de présenter Laurent au propriétaire du yacht. Béjard jeta plusieurs fois un regard aigu et méfiant à ce gamin un peu embarrassé, de ses vêtements tout neufs et qui, se tenant à l'écart, contemplait avec obstination la nature flamande trop plane et trop peu accidentée au gré des touristes de profession. L'armateur s'était même informé de cet intrus, prêt à stopper et à le faire déposera terre :
– Laissez, lui dirent les élégants Saint-Fardier en riant de sa méprise, c'est un petit parent pauvre des Dobouziez… On l'expédie demain à l'étranger et c'est sans doute là ce qui le rend si taciturne.
– Compris ! fit Béjard ne prétendant point, par cette exclamation, pénétrer la nature des impressions de l'orphelin, mais approuver simplement l'isolement dans lequel on le laissait. Et rassuré sur l'identité de cette non-valeur, il cessa de s'en occuper.
Dans l'ordre des probabilités, le petit passager de l'arrière ne possédait aucun titre à l'attention du Crésus. Et pourtant s'il avait prévu le rôle décisif que cette non-valeur jouerait dans son existence ! Les autres passagers renseignés sur Laurent dans des termes aussi indifférents ne lui accordèrent guère plus d'attention. Il ne s'apercevait pas de ce dédain aujourd'hui. Il se réjouissait de pouvoir s'imprégner, à son aise, des effluves du terroir aimé.
La cousine Lydie, en robe vert d'eau garnie de lierre, comme une tonnelle ambulante, s'essoufflait à morigéner la valetaille qui accompagnait la société avec des bourriches de provisions. Le cousin Guillaume conférait avec Béjard, Saint-Fardier et l’éminent avocat Vanderling. Si ces hommes graves faisaient à l'Escaut l'honneur de le regarder ; c'était pour invoquer les avantages qu'une société de capitalistes retirerait d'une fabrique d'allumettes chimiques ou d'un magasin de guanos établi sur ses rives.
Régina, vêtue de mousseline rose thé, la tête bouclée coiffée d'un large chapeau de paille retroussé à la Lamballe, formait le centre et l'âme d'un cercle de jeunes filles qu'elle amusait par de piquantes remarques sur le groupe des jeunes gens au milieu desquels trônaient les frères Saint-Fardier. Ceux-ci s'approchaient parfois des rieuses et leur débitaient quelque déplorable galanterie. Les petites Vanderling, deux blondes caillettes, potelées et fort affriolantes, leur avaient, comme ils disaient, « tapé dans l'œil».
Le yacht accosta d'une façon irréprochable au pied du débarcadère d'Hémixem. À terre, le programme s'accomplit sans accroc. Pendant la promenade, les excursionnistes s'informaient principalement du nom des propriétaires des villas et des châteaux. Les jeunes gens estimaient la contenance des écuries ; les jeunes filles se récriaient devant les beaux cygnes si blancs et aussi devant les roses si roses. Et comme toute la troupe s'arrêtait avec quelque respect devant une grille dorée au bout d'une avenue seigneuriale, à travers laquelle on apercevait, au delà d'une pelouse, un bijou de pavillon renaissance :
– Oui, c'est très beau, fit Béjard, qui les rejoignait avec Dupoissy, son inséparable… Au baron de Waerlant… Très chic, en vérité… mais grevé aux trois quarts… On aurait la bicoque pour cinquante mille francs en sus des hypothèques qui montent bien à cent mille francs… Avis aux amateurs.
– Juste châtiment d'un aristocrate fainéant et libertin ! approuva Dupoissy d'une voix nasillarde de chantre d'office funèbre.
Ces chiffres douchèrent l'admiration de ces gens bien élevés, prétendant tous à une position solide. Ils se hâtaient de poursuivre leur chemin, avec une moue choquée, honteux de leur condescendance envers cet immeuble, un peu comme si le propriétaire aux abois allait déboucher d'un quinconce et leur emprunter de l'argent.
Après une heure de marche sous la coupole bleue où viraient des alouettes tirelirantes, parmi les champs où le regain faisait parfum de toutes ses meules, sans oser se l'avouer, tous commençaient à en avoir assez de ce vert, de ce bleu, de ces fermes closes et de ces domaines dont ils ne connaissaient pas les habitants. On fit halte dans un petit bois de sapins, le seul de la région, un malheureux bosquet artificiel, planté là tout exprès par le propriétaire, premier commis des Dobouziez, un garçon comprenant les « plaisirs de la campagne » et les « déjeuners sur l'herbe ». Or, tous les villégiateurs s'accordent à proclamer qu'il n'y a pas de déjeuner sur l'herbe sans un petit bois. On avait longé de superbes avenues de hêtres et de chênes généreusement ombragées, tout indiquées pour une halte. Mais il fallait un bois, ce bois fût-il minable et pouilleux !
Les ombrelles de. ces dames suppléèrent l'ombre avare des conifères. On déballa les provisions, on mangea froid et on but chaud, l'ingénieux appareil à frapper le Champagne ayant refusé tout service, comme c'est le cas de la plupart des appareils perfectionnés. Le déjeuner fut très gai cependant, et on ne manqua pas de sujets de conversation, grâce au maudit appareil et à la chaleur. Les chenilles et les coléoptères qui tombaient dans les assiettes et dans le cou des demoiselles permettaient à Gaston et Athanase Saint-Fardier d'écheniller Angèle et Cora Vanderling, près desquelles ils s'étaient faufilés et dont la coquetterie les engluait bel et bien.
Une compagnie de petits paysans revenant de la grand'messe, regagnaient leur hameau au pas accéléré. D'abord défiants, timides, les jeannots s'arrêtèrent, puis, après s'être concertés, rouges comme des gorges de dindons, ils approchèrent, l'un poussant l'autre, et on chavira dans le tablier des filles et les poches des sarreaux[3] des garçons, le reste des pâtés de viande, des sandwichs, les os mal déchiquetés et les carcasses des volailles, et comme ils se retiraient, on les rappela pour leur loger sous les bras les flacons à peine entamés.
Cet intermède divertit les promeneurs jusqu'au moment de gagner la campagne des Dobouziez. Le cousin Guillaume, bon marcheur, aurait voulu revenir au point de départ par un chemin plus long. Ses hôtes désirèrent savoir d'abord s'il y avait plus d'ombre de ce côté et autre chose à voir que des champs et des arbres.
Mais comme, en cherchant bien, M. Dobouziez ne se rappelait point d'autre « curiosité », dans cette direction ; qu'une brûlerie abandonnée et que le dépôt militaire de Saint-Bernard, la majorité préféra rebrousser par le chemin le plus court, au risque de se buter au baron sans le sou.
Rentrés, en attendant l'heure du dîner, les dames montèrent s'épousseter et se rafraîchir, et les hommes visitèrent « la propriété ».
Au dîner, servi de manière à satisfaire les gens réfractaires à la gastronomie pastorale, on fut unanime à célébrer le déjeuner sous bois, et les jeûneurs, lestés à présent, feignirent de s'étonner de leur appétit. Il est vrai que la promenade, l'air vif…
On prit le café sur le perron. Béjard conduisit Gina au piano et la pria de chanter. Laurent descendit au jardin, séduit par la soirée délicieuse, la brise de l'Escaut, les exhalaisons nocturnes des bosquets, le sensuel et capiteux silence que lutinait le cri-cri des grillons et que berçait le vol oblique et velouté des chauves-souris, effarouchées par la présence exceptionnelle des maîtres de cette campagne délaissée.
La voix de Gina lui arriva claire et perlée, au fond du parc anglais. Elle chanta la valse de Roméo et Juliette, de Gounod, divinement ; l'interprète fut supérieure au morceau. Elle lui donna la sincérité qui lui manquait, elle le virtuosa à plaisir. Elle parodia cette valse frelatée, en exagéra le rythme à tel point qu'on aurait pu la danser. Laurent trouvait que Gina se montrait trop la femme de cette valse : la femme du vide, du tourbillon, du vertige, de la curiosité, du changement de place. Sans avoir lu Shakespeare, Laurent détestait ce clinquant musical et trouvait ces roucoulades déplacées : ce chant trop gai, trop rieur, d'une vivacité et d'un éclat insolent, devenait, pis qu'un air de bravoure, un air de bravade.
Les auditeurs, Béjard, les Saint-Fardier en tête, applaudirent et bissèrent. Laurent, à son tour, tâcha d'arriver jusqu'à la belle cantatrice pour lui faire ses adieux. Le train devait emporter le potache le lendemain à la première heure. Il avait tant de choses à dire à sa cousine ! Il tenait à la remercier pour les bontés de cette dernière semaine ; à lui demander un souvenir de loin en loin. Il ne put que balbutier un simple adieu. Elle lui abandonna négligemment le bout des doigts, ne se tourna pas même vers lui, continuant d'escarmoucher avec M. Béjard. Laurent désespérait d'attirer son attention et d'obtenir d'elle un mot, une parole douce à retenir, quand elle lui jeta avec un sang-froid, un à-propos, une présence d'esprit vraiment atroce un : « Bonsoir, Laurent ; soyez sage et surtout étudiez bien ! »
M. Dobouziez n'eût pas mieux dit !
VIII. DANS LE MONDE
Régina entre dans le monde. Six cents invitations ont été lancées ; deux cents de plus qu'au dernier bal chez le gouverneur de la province ! Il n'est plus question en ville que du grand événement qui se prépare. Si Mme Van Belt rencontre Mme Van Bilt, après les salutations d'usage elles abordent le grave sujet de conversation. Elles s'informent réciproquement des toilettes que porteront leurs demoiselles. Mme Van Bal rêve d'éclipser Mme Van Bol, et Mme Van Bul se réjouit de parler de la fête à son amie Mme Van Brul, qui n'a pas été invitée, par oubli sans doute. Mme Van Brand, également omise, prétend avoir remercié, quoique n'ayant pas reçu le moindre carton. Mais toutes sont friandes de détails et lorsqu'elles n'en obtiennent pas de leurs amies, elles tâchent de tirer les vers du nez aux fournisseurs. Fleuristes, traiteurs, confiseurs : les Dobouziez ont tout monopolisé, tout retenu. « Il n'y en a plus que pour eux », comme disent les Saint-Fardier. Les autres clients renoncent à se faire servir. Même les plus huppés, s'ils insistent, s'attirent cette réponse : « Impossible, madame, car ce jour-là nous avons le bal chez les Dobouziez ! » Le traiteur Balduyn, chargé de l'organisation du buffet et du souper, prépare des prodiges. Toutes les banquettes des tapissiers et entrepreneurs de fêtes ont été mises en réquisition. Mais rien n'égale le coup de feu chez les couturières. À Bruxelles même on coupe, on taille, on coud, on ajuste, on ourle, on brode, on chiffonne des kilomètres d'étoffe en prévision de cette inauguration de la saison mondaine anversoise. Ce que ces intéressantes tailleuses ont à subir de mauvaise humeur, d'énervement, de caprices et d'exigences de la part de leurs belles clientes, leur sera compté dans le paradis, et, en attendant, en gros billets de mille francs sur cette terre.
Ceux qui donnent la fête ne sont pas moins enfiévrés que ceux qui y sont priés. Félicité n'a jamais été plus désagréable. Elle exerce son autorité tyrannique sur le renfort de domestiques et d'ouvriers chargés des préparatifs, Mme Dobouziez ne tient plus en place ; son embonpoint croissant la désolait : grâce à ce remue-ménage et à cette gymnastique, elle perdra quelques livres. Gina et le cousin Guillaume se montrent les plus raisonnables. Ils ont arrêté, à deux, la liste des invités. Gina est radieuse, le mal qu'on se donne pour elle et autour d'elle la flatte et l'exalte encore à ses propres yeux ; de temps en temps elle daigne approuver.
Ce bal, ce bal monstre défraie même les conversations des commis de la maison, et il n'est pas jusqu'aux ouvriers de la fabrique qui n'en parlent aux heures de trêve, en buvant leur café froid et en retirant le « briquet » de leur musette. Ces braves gens ne savent pas au juste ce qui va se passer, mais, depuis quelques jours, c'est sous le porche de l'entrée une telle procession de tapissières, de cartons, de bottes, de caisses, que les natures les moins badaudes sont distraites de leur labeur.
Heureusement, Laurent est en pension, car il ne trouverait plus place dans sa mansarde !
Une invitation est parvenue aux trois premiers commis : au teneur de livres, – l'homme des plaisirs de la campagne ! – au caissier et au correspondant. Cela flatte la corporation des plumitifs, et le saute-ruisseau lui-même ressent quelque orgueil de la faveur échue à ses supérieurs hiérarchiques. Ces trois élus représenteront leurs collègues. Entre les heures de besogne, quand on sait Dobouziez dans la maison, ces messieurs discutent sérieusement des points d'étiquette, de convenances, de tenue. Les trois privilégiés consultent d'abord leurs camarades sur la rédaction de la lettre à envoyer à M. et Mme Dobouziez. Faut-il l'adresser à Madame ou à Monsieur ? D'accord sur cette formule, il s'agit de s'entendre sur d'autres points d'étiquette. Les gants seront-ils paille ou gris perle ? Mettra-t-on une fleur à la boutonnière ? Faut-il oui ou non parfumer son mouchoir ? Le saute-ruisseau ayant parlé de patchouli comme d'un bouquet très aristocratique, a soulevé un tel haro, que, depuis, il n'ose plus risquer une remarque. Et après ? Fait-on une visite ? Et à quel moment ? « Oh, après, nous verrons ! » dit le caissier, l'ami des champs, l'homme au petit bois de sapins.
C'est la veille… c'est le jour… c'est le soir même de la fête. Le parquet ciré, les lustres allumés ; les larbins, en mollets, à leur poste. À neuf heures, dans la rue tortueuse et mal pavée conduisant à la fabrique, se risque un premier équipage, puis un second, puis il se forme une véritable file. On dirait d'un Longchamps nocturne.
Le vilain fossé stagnant que, le choléra passé, ses maîtres ne songent plus à combler, ne fut jamais côtoyé par cavalcade pareille. Dans son ahurissement, il en oublie d'empoisonner l'air hivernal.
Les commères, leurs poupons sur les bras, s'amusent au seuil de leurs masures, à voir défiler les voitures et s'efforcent vainement de discerner au passage, dans l'ombre, derrière les glaces embuées, les belles dames blotties dans ces chambrettes roulantes. Mais les pauvresses n'aperçoivent que les feux des lanternes, le miroitement des harnais, l’éclair d'une gourmette, un galon d'or au chapeau d'un cocher. Les bêtes hennissent et envoient dans la nuit leur haleine blanche. La petite Madone du carrefour, réduite pour tout luminaire à une vacillante veilleuse, a l'air aussi pauvre, aussi humble que son peuple de béats.
La fabrique ne chôme pas, cependant. La brigade de nuit a remplacé les travailleurs du jour et s'occupe d'alimenter les fourneaux, car les matières ne peuvent refroidir. Pendant que vos maîtres s'amusent, trimez et suez, braves prolos !
En descendant de voiture sous le porche, les invités emmitouflés ont un moment, devant eux, au fond de la vaste cour noire, la vision des murailles usinières et entendent le mugissement sourd des machines assoupies, mais non endormies, et une odeur dégraisse intrigue leurs narines. Mais déjà la grande porte vitrée n'ouvre sur le vestibule encombré de fleurs et d'arbrisseaux et les bouches à chaleur leur envoient dès l’entrée de tièdes et caressantes bouffées.
Les trois messieurs du bureau sont arrivés les premiers. Sous les armes, dès l'après-midi, ils ont loué, à frais communs, un beau coupé de remise, quoique la fabrique se trouve à un quart d'heure seulement de leur logis. Il s'agit de représenter dignement le bureau. Ils laissent leurs paletots au vestiaire, très confus des prévenances que leur témoignent des messieurs, les favoris en côtelettes, mis comme des invités. Il faut même que les huissiers insistent avant que les trois amis consentent à accepter leurs bons services.
Mme Dobouziez, qui achevait sa toilette, s'empresse de descendre au salon. Un larbin annonce le trio et l'introduit. La dame fait un mouvement pour se porter à la rencontre de ces arrivants trop exacts. Leurs noms ne lui disent rien, mais dès qu'ils se sont présentés comme trois des colonnes de la maison Dobouziez et Cie, le sourire accueillant de Mme Dobouziez se pince visiblement. Elle condescend pourtant à rassurer les commis sur l'état de sa santé ; ils s'inclinent et s'inclinent encore pour exprimer leur satisfaction. Sont-ils enchantés d'apprendre que la patronne n'a jamais joui d'une santé plus florissante, hein !
À ce moment de la conversation, Mme Dobouziez prétexte un ordre à donner et s'excuse. Elle remonte pour ajouter une rose et une pluie d'or à sa coiffure, décidément trop simplifiée par Régina.
Cependant le monde, le vrai monde s'amène. Mme Dobouziez répète à satiété une des trois ou quatre formules de bienvenue congruentes au rang de ses invités.
Il y a M. le gouverneur de la province, M. le bourgmestre et Mme la bourgmestre d'Anvers, M. le commandant de place et Mme la commandante de place, M. le général commandant de la province et Mme la générale, M. le président du tribunal de première instance et Mme la présidente, M. le colonel de la garde civique et Mme la colonelle, les grades supérieurs de l'armée, mais surtout M. du Million et Mme du Million et ces jeunes MM. du Million et ces demoiselles du Million, avec particule allemande, flamande, française ou même sans particule, tous les Van du commerce, tous les Von de la banque, des Janssens, des Verbist, des Meyers, des Stevens, des Peeters en masse. Et des youtres ! Tous les prophètes et les chefs de tribus du Vieux Testament ! Tout ce qui porte un nom négociable, un nom escomptable à la banque ; le gros marchand de tableaux coudoie l'usurier déguisé, le parvenu du jour se prélasse à côté du failli de demain. Chaque invité pourrait justifier de vingt-cinq mille francs de rente ou de deux cents mille livres d'affaires. Judicieuse et sagace proportion. Si les noms clamés par l'huissier se ressemblent, les liens d'identité sont encore plus notoires chez les personnages. Mêmes habits noirs, même cravates blanches, mêmes claques. Mêmes physionomies aussi, car la similitude des professions, le culte commun de l'argent, leur donne un certain air de famille. Les stigmates de labeurs et de préoccupations identiques font se ressembler les apoplectiques et les secs, les gras et les maigres. Il y a des faces épaisses imperturbables et solennelles, contentes d'elles-mêmes, plus fermées que le coffre-fort de leurs possesseurs ; il y a des têtes inquiètes et futées, mobiles, des têtes de coulissiers, des têtes de limiers de finances, d'enfants de chœur qui se gavent des restes des plantureuses hétacombes dévorées par les grands prêtres de Mercure. Des nez pincés à l'arête, des yeux qui clignent, des regards qui se dérobent. Ces gens ont la tentation mal réprimée de se gratter le menton comme lorsqu'ils méditent une affaire et un bon coup ; des bouches sensuelles, le rictus vaguement sardonique, la patte d'oie, les tempes dégarnies, des bijoux massifs et consistants à leurs doigts courts et gros et à leurs ventres de pontifes. Ceux qui vivent généralement au fond de leurs bureaux ont le visage plus pâle ; d'autres, remuants et voyageurs, gardent sur eux le hâle de la mer et du plein air.
Malgré leur habit uniforme, on les distingue à certains tics : ce jeune agent de change, embarrassé de ses bras ballants, manipule son carnet de bal comme son carnet de bordereaux ; ce courtier en marchandises cherche dans ses poches des sachets d'échantillons ; les doigts de cet industriel marchand de laine se portent magnétiquement vers l'étoffe des portières et des banquettes. Quelques-uns de ces riches poussent la hauteur et la superbe jusqu'à la monomanie. Le vieux Brullekens ne touchera jamais à une pièce de monnaie, or, argent ou billon, sans qu'au préalable celle-ci ait été polie, nettoyée, décapée de manière à ne plus accuser la moindre trace de crasse. Un larbin s'échine chaque jour à fourbir, à astiquer l'argent mignon de Monsieur. De préférence il s'en tient aux pièces nouvellement frappées et collectionne les billets fraîchement sortis de la Banque.
Son voisin De Zater ne tendra jamais sa main dégantée à qui que ce soit, pas même à ses enfants, et s'il lui arrive de polluer par inadvertance sa droite aristocratique à la main nue d'un de ses semblables, il n'aura plus de repos avant de l'avoir lavée.
Tous sont savants dans les arcanes du commerce, dans les trucs et les escamotages qui font passer l’argent des autres dans leurs propres coffres, comme en vertu de ces phénomènes d'endosmose constatés par les physiciens ; tous pratiquent la duperie et le vol légal ; tous sont experts on finasseries, en accommodements avec le droit strict, en l'art d'éluder le code. Riches, mais insatiables, ils voudraient être plus riches encore. Les plus jeunes, leurs héritiers, ont déjà l'air fatigué par les soucis et les veilles précoces. Ils ont des fronts vieillots de viveurs mornes excédés de calculs autant que de plaisirs. Quoiqu'ils soient dans le monde, leurs yeux se scrutent et s'interrogent, leurs regards s'escriment comme s'il s'agissait de jouer au plus fin et de « mettre l'autre dedans ». La pratique du mensonge et du commandement, l'habitude de tout déprécier, de tout marchander, l'instinct cupide et cauteleux enveloppe leur personne d'une température de lièvre ; ils refrènent a peine leur brusquerie sous des démonstrations de politesse ; leur bienséance est convulsive ; leur poignée de main semble tâter le pouls à votre fortune, et leurs doigts ont des flexions douces, sournoises, d'étrangleurs placides qui tordent le col à des volailles grasses. Et chez les tout jeunes, les blancs-becs, les freluquets, on sent la timidité et l'humiliation de novices beaucoup plus ennuyés de ne pas encore gagner d'argent que de ne pas en dépenser à leur guise.
Il existe autant de monotonie ou de ressemblance professionnelle chez les femmes. Seulement la variété du plumage déguise et masque les préoccupations collectives. De grosses mamans boudinent dans leur corset trop lacé, des matrones bilieuses semblent sortir d'un long jeûne quoique le prix des cabochons incendiant leurs lobes suffirait pour nourrir durant deux ans une cinquantaine de ménages pauvres. Quant aux jeunes filles, on en frôle de longues, de maigres, de précoces, de naïves, de sveltes, de potelées, de blondes, de brunes, de sentimentales, de rieuses, de mijaurées. Elles ont les sens affinés, mais les sentiments étroits. Pour éclipser leurs amies, ces dames déploieront, dans leurs relations mondaines, autant de machiavélisme que leurs pères, frères et maris, pour « rouler » leurs concurrents… Leur conversation ? De la plus gazetière banalité.
Les salons s'étant remplis, Régina, que la couturière, la femme de chambre, le coiffeur et Félicité sont parvenus à parer, vient de faire son entrée au bras de son père. Parmi tous ces hommes graves, ses pairs et ses égaux, M. Dobouziez parait le plus jeune et le moins rébarbatif, du moins ce soir, tant son contentement paternel éclaire son visage généralement soucieux. Toutefois, en présentant sa fille, de groupe en groupe, son enivrement ne l'empêche pas de respecter la hiérarchie administrative ou financière de ses invités.
L’apparition de Gina provoque un murmure et des chuchotements approbateurs. C'est pour le coup que Laurent serait ébloui. Dans sa robe de mousseline et de gaze blanches, semée de minuscules pois d'argent, du muguet et du myosotis à l'épaulette et dans les cheveux ; sa beauté régulière aux lignes irréprochables se drape avec des mouvements, des flexions, une harmonie de gestes et de contours qui feraient damner un sculpteur. Ces grands yeux noirs, ces lèvres rouges et humides, ce visage de médaillon antique, ce galbe taillé dans une agate d'un rose mourant, qu'entourent d'une auréole d'insurrection les torsades de son opulente chevelure, couronnent les proportions admirables, le modelé délicieux de son col et de ses épaules.
Cependant, les petits crayons coquets ont fini de courir sur le bristol satiné des carnets de bal ; les bulles enfants se montrent l'une à l'autre, en chuchotant, la liste de leurs engagements et se jalousent en secret d'y retrouver le même nom, et se rassurent en le rencontrant moins souvent sur le carnet de la petite amie.
MM. Saint-Fardier jeunes sont très demandés. Ils tutoient tous les hommes et sont amoureux de toutes les jeunes filles. Mais ce sont tout de même les petites Vanderling qui leur « tapent le plus dans l'œil ». La bouche et le gilet en cœur, ils ont fait provision de mots qu'ils cherchent à placer. « C'est presque aussi bien que le dernier bal chez le comte d'Hamberville ! » daignent-ils dire de la soirée.
M. Saint-Fardier, père, mal à l'aise dans son habit, pérore et gesticule comme s'il entreprenait les ouvriers de la fabrique.
Angèle et Cora portent avec une désinvolture presque garçonnière des toilettes ébouriffantes et à effet, composées par leur mère, Mme Vanderling, fille d'un gros ébéniste du faubourg Saint-Antoine, à Paris, et qui professe pour la province et le négoce un dédain des plus aristocratiques. Elle n'admire que Gaston et Athanase Saint-Fardier de la Bellone, du moins élevés à Paris, ceux-là ! et depuis que ces muscadins ont paru distinguer ses filles, elle pousse résolument Angèle et Cora de leur côté. Provocantes, capiteuses, stylées par la Parisienne, – c'est ainsi qu'on surnomme Mme Vanderling – une maîtresse-femme, une matrone rouée comme une procureuse, les petites ne laissent plus de répit à leurs deux poursuivants et c'est presque le gibier qui traque le chasseur. Leur père, l'éminent Vanderling, un fort premier rôle des grandes représentations tribunalices, abandonne à sa femme le soin de pourvoir les deux fillettes et, retiré dans le petit salon de jeu, raconte, entre deux parties de whist, le crime passionnel dont il aura à défendre l'auteur. « Ah ! une affaire d'incontestable ragoût, du Lord Byron, quoi ! Lara ou le Corsaire transporté dans la vie réelle ! » fait-il en passant la main dans sa longue barbe d'apôtre avec un geste que lui apprit un vétéran du barreau français exilé à Anvers sous l'Empire.
Voici M. Freddy Béjard, accompagné de M. Dupoissy, son familier, son ombre, son homme de paille, disent les méchantes langues. M. Dupoissy est la planète qui ne reçoit de chaleur et de lumière que du soleil Béjard. Ce qu'il est, il le doit au puissant armateur. Les commerçants seraient assez embarrassés de déterminer la partie dont s'occupe Éloi Dupoissy. Fait-il – c'est l'expression consacrée – dans les grains, les cafés, les sucres ? Il « fait » dans tout et dans rien. Accostez Dupoissy. S'il est seul, après deux minutes, il s'informera, d'un air inquiet, de son maître Béjard. À la suite de son protecteur, il est parvenu à se faufiler partout. Ce sous-ordre ne répugne à aucune des commissions dont le charge l'omnipotent armateur. Il méprise les gens avec qui Béjard ne fraie point, exagère sa morgue, fait siennes ses opinions. Doucereux, gnangnan, prudhommesque, poisseux, lorsque Éloi Dupoissy ouvre la bouche ; on dirait d'une carpe mélomane qui se donne le la pour chanter une ode de Béranger. Venu de Sedan, il se fait passer pour négociant en laine. Caractéristique : il parle du petit pays qui l'héberge sur ce ton de protection indulgente si crispant chez les Gaudissarts de la grande nation. Il se croit chez lui comme Tartufe chez Orgon, se mêle de tout, découvre les gloires locales, fulmine des anathèmes littéraires, envoie des articles aux journaux.
En France, pays de centralisation à outrance, le drainage des valeurs, vers Paris, est formidable. Fatalement il n'existe province plus plate et plus mesquine que la province française et c'est de cette province-là que le Dupoissy s'est exilé pour initier les Anversois à la vie intellectuelle et contribuer à leur rénovation morale. Terrible tare pour un homme de société, un mondain aussi répandu : M. Dupoissy empoisonne de la bouche, au point que Mme Vanderling, la Parisienne, traitant de très haut ce Français de la frontière, veut qu'il ait avalé un rat mort.
Il a beau combattre ces effluences pestilentielles par une forte consommation de menthe, de cachou et d'autres masticatoires, la puanteur se combine à ces timides arômes, mais, pour les dominer, et elle n'en devient que plus abominable.
Dupoissy ne dansera pas, mais pendant que son patron polke, non sans souplesse de jarret, avec Mlle Dobouziez, il vante auprès de la galerie le pouvoir de Terpsichore et avec des mines confites et gourmandes de calicot obèse, il se rappelle son jeune temps. Et il parle dévotement du beau couple formé par M. Béjard et Régina ; cela lui évoque, entre autres allégories neuves, la Beauté activant l'essor du Génie. De pareils efforts poétiques l'altèrent et l'affament ; aussi profite-t-il de l'absence du maître pour faire de fréquentes visites au buffet et mettre l'embargo sur tous les rafraîchissements et comestibles en circulation.
Le bal s'anime de danse en danse. Les trois commis présentés à quelques jeunes filles, peu riches, de fonctionnaires envers qui les Dobouziez ont des obligations, s'acquittent consciencieusement de leur tâche, et ces jeunes personnes, étant aussi jolies et plus aimables que les héritières opulentes, les plumitifs s'estiment aussi heureux que les Béjard, les Saint-Fardier et les Dupoissy. L'empressement de Béjard auprès de Mlle Dobouziez ne laisse pas de préoccuper les mères, qui convoitent l'armateur pour leurs filles ou la fille du gros industriel pour leurs fils.
Mais qui aurait jamais prévu pareille chose, le danseur distingué par Gina à ce bal mémorable est le négociant en grains Théodore Bergmans, ou Door den Borg, comme l'appellent familièrement ses amis, autant dire toute la population.
Door Bergmans fait même exception, par sa largeur de vues et son élévation d'esprit, sur ce « marché » égoïste et tardigrade. Il est jeune, vingt-cinq ans à peine, encore ne les paraît-il pas. À la fois nerveux et sanguin, la stature d'un mortel fait pour exercer le commandement, dépassant de plus d'une tôle les hommes les plus grands de l'assemblée ; les cheveux d'un blond de lin légèrement ondulés, plantés drus et droits au-dessus d'un large front, les yeux à la fois très doux et très pénétrants, enfoncés sous l'arcade sourcilière, les prunelles de ce bleu presque violet qui s'avive ou pâlit à l'action des pensées comme une nappe d'eau sous le jeu des nuages ; le nez busqué, insensiblement aquilin, la bouche fine, vaguement railleuse, ombragée d'une moustache, de jeune reître, au menton la barbiche des portraits de Frans Hals ; la voix vibrante et chaude, au timbre insinuant, aux flexions magnétiques qui remuent l'âme des masses et établissent dès les premières paroles le courant sympathique dans les foules, une de ces voix fatales qui subjuguent et suggestionnent, tellement musicales que la signification des paroles émises ne rentre qu'en seconde ligne de compte. Fils d'un infime mareyeur – vendant même plus d'anguilles que de harengs et de marée – de la ruelle des Crabes, les bromures et les iodes, les émanations de sauvagine saturant la boutique souterraine de son bonhomme de père, contribuèrent sans doute à doter le jeune Door de cette complexion saine et appétissante caractérisant les poissonniers et les pêcheurs adolescents. À l'école primaire, où ses parents l'envoyèrent sur les conseils de clients frappés par l'intelligence et la vivacité du gamin, il eut une conduite détestable, mais remporta tous les prix. Il excellait surtout dans les exercices de mémoire et de composition, déclamait comme un acteur. Conduit au théâtre flamand, il se passionna pour la langue néerlandaise, la seule langue des petites gens. À quinze ans il fit jouer une pièce de sa façon au Pœsjenellekelder, guignol établi dans la cave de la vieille Halle-à-la-Viande et où vient se divertir la jeunesse de ce quartier de bateliers et de marchands de moules. Au sortir de l'école communale il ne poursuivit pas ses études, il en savait assez pour se perfectionner sans le secours des maîtres. Attelé au métier paternel, il augmenta la chalandise par son bagout, sa belle humeur, son esprit acéré, sa faconde goguenarde. Dans la petite bourgeoisie florissaient alors, et encore de notre temps, les « sociétés » de tout genre, politiques, musicales, colombophiles, etc. Bergmans, qui exerçait déjà un ascendant irrésistible sur ses condisciples, n'eut qu'à se présenter dans une de ces associations pour être porté d'emblée à la présidence. Dès ce moment la politique le requérait, mais une politique large, essentiellement inspirée des besoins du peuple et spécialement adaptée au caractère, aux mœurs, aux conditions du terroir et de la race. Il prit l'initiative d'un grand mouvement de rénovation nationale, dans lequel la vraie jeunesse se jeta à sa suite. Mais les hautes visées ne le détournaient pas du soin de son avenir matériel. La fortune lui était favorable. Il plut au vieux Daelmans-Deynze, cet Anversois de vieille roche, qui lui avança le capital nécessaire pour étendre son commerce. Délaissant la poissonnerie, le jeune Bergmans, après un stage profitable chez son protecteur, se lança dans le grand négoce, notamment dans les affaires en grains. Il devint riche sans que sa fortune nuisît à sa popularité. Il resta l'idole des petits tout en s'imposant à l'estime des gros bonnets et traita de puissance à puissance avec les plus superbes des oligarques. Il prit la tète du parti démocratique et national.
Sans remplir encore de mandat, il représentait, à la vérité, une force plus réelle que celle des députés ou des édiles, élus par un corps d'électeurs restreint, et vaguement pourris d'influences exotiques. C'était en un mot un de ces hommes pour qui ses partisans, soit la majorité de la population autochtone et vraiment anversoise, se fussent jetés dans le feu, – un tribun, un ruwaert. Il avait l'esprit si droit, si lucide, tant de bon sens, une si grande aménité, que les plus délicats lui pardonnaient ses légers défauts, par exemple sa forfanterie, ses gasconnades, sa partialité pour le clinquant et un léger prosaïsme, une certaine trivialité dans le langage. Le populaire ne l'en chérissait même que mieux, car il reconnaissait ses propres tares dans celles de son élu.
Ce tribun violent et souvent brutal devenait, dans le monde, un parfait causeur. Il parlait le français avec un accent assez prononcé, en traînant les syllabes et en y introduisant une profusion d'images, un coloris imprévu. Il exprimait son admiration aux femmes dans des termes souvent un peu francs, mais dont ces bourgeoises, excédées de conventions et de banalités, goûtaient la saveur rare tout en feignant de s'en effaroucher, de donner sur les ongles au panégyriste et de le reprendre. Bergmans avait le barbarisme heureux et la licence toujours piquante.
Au bal, chez les Dobouziez, il ne démentit point sa flatteuse réputation de boute-en-train et de. charmeur. Naturellement, son attention pour Gina. fut grande. Il la voyait pour la première fois. Sous cette beauté fière, qui flattait son goût des nobles lignes, du sang généreux, des chairs bien modelées, il devina un caractère plus original et plus intéressant que celui des autres héritières. De son côté, Gina n'avait pas manqué de lui réserver une des danses tant convoitées. La physionomie ouverte et avenante de Bergmans, l'aisance et le naturel de ses allures, impressionnèrent cette fière jeune fille qui rencontrait pour la première fois un jeune homme digne de fixer son attention. En dehors de la correction et de la nouveauté de leur toilette, depuis longtemps Gina ne trouvait rien à apprécier chez les Saint-Fardier. Aussi ne songea-t-elle pas un instant à disputer l'un d'eux à ses petites intimes Angèle et Cora. Quant au cousin Laurent Paridael, ce balourd, ce sauvage ne pouvait prétendre tout au plus qu'à sa protection.
Pendant la danse, Mlle Dobouziez engagea avec Bergmans une de ces escarmouches spirituelles dans lesquelles elle excellai ; mais cette fois elle trouva à qui parler ; le tribun parait les coups avec autant d'adresse que de courtoisie. À quelques reprises il riposta, mais comme à regret, en montrant le désir qu'il avait de ménager sa pétulante antagoniste. Plusieurs fois dans le cours de la soirée, on les vit ensemble. Même lorsqu'elle dansait avec d'autres, Gina tâchait de se rapprocher des groupes où se trouvait Bergmans et se mêlait à la conversation. L'intérêt qu'elle lui portait n'allait pas sans un peu de dépit contre ce garçon du peuple, ce révolutionnaire, cette sorte d'intrus qui se permettait d'avoir à la fois plus de figure et plus de conversation que tous les potentats du commerce. Au lieu de lui savoir gré de la modération qu'il mettait à se défendre contre ses épigrammes, elle fut humiliée d'avoir été épargnée, d'autant plus qu'au premier engagement elle avait reconnu sa supériorité. Dans chacun des traits renvoyés, à contre-cœur, par le jeune homme, il avait mis comme une révérence galante. Il piquait un madrigal à la pointe de ses épigrammes. Sentiment indéfinissable chez Gina. Admiration ou dépit ? Peut-être de l'aversion ; peut-être aussi de la sympathie. À un moment, se sentant trop faible, elle appela à la rescousse l'armateur Béjard, reconnu pour un des dialecticiens serrés de son monde. Elle offrait à Bergmans l'occasion de confondre un des êtres qu'il rendait responsable de la déchéance morale de sa ville natale.
Le tribun fut acerbe ; il démoucheta ses fleurets ; toutefois il demeura homme du monde, respecta la neutralité du salon où il était reçu, ne s'oublia pas, tenant surtout à mériter l'estime de Régina.
Le Béjard, agacé par la modération de Bergmans, ferrailla maladroitement, devint presque grossier. Pourtant, aucun de ces deux hommes ne toucha en apparence aux choses que chacun avait sur le cœur ; mais ils se mesuraient, se cherchant les côtés vulnérables ; se disant, d'une façon détournée et comme par allégories, leurs animosités, et leurs dissentiments, et leurs incompatibilités, et leurs instincts contraires. Béjard n'était pas dupe, du tact et de l'esprit conciliant de son adversaire. Ils lui révélaient une force, un talent, un caractère plus redoutable encore que ceux qu'il avait appris à connaître dans les réunions publiques. Le tribun se doublait donc d'un politique ? Béjard n'admettait pas que cette idole du peuple, ce fanatique de nationalisme, prît tant de plaisir que les autres voulussent bien se l'imaginer à ces réunions frivoles, à ces conversations, où tant de choses devaient se dire et se faire à l’encontre de ses convictions.
Mais c'est que Béjard devinait aussi en quelle aversion Bergmans tenait les gens de son espèce. Pourtant la belle humeur ironique et l'aisance du tribun augmentaient à mesure que l'autre bafouillait.
Béjard finit par s'éclipser. Gina souffrit du succès de Bergmans ; c'était bien impertinent à lui, petit oracle de carrefour, d'avoir raison contre un augure que M. Dobouziez prisait tant.
Gina rencontra plusieurs fois cet hiver, le tribun dans le monde. Elle continua de lui témoigner un peu plus d'égards qu'aux autres ; le traita en camarade, mais sans que rien dans sa conduite pût lui faire croire qu'elle le préférait. Aux petites Vanderling qui la taquinaient au sujet de son entente avec ce rouge : « Bast ! il m'amuse ! » faisait-elle.
Personne n'attachait, d'ailleurs, d'importance à cette camaraderie.
Bergmans attiré impérieusement par le charme de Gina se faisait violence pour ne pas lui parler de ses sentiments. La solidarité de caste et d'intérêts, la communauté de sentiments et d'aspirations qu'il savait exister entre Béjard et les parents de Gina le désolaient.
Plusieurs fois il fut sur le point de faire sa déclaration. Entre temps Gina mettait à courir les bals une ardeur, une fièvre si inquiétante que M. Dobouziez dut la supplier de prendre du repos et de ménager sa santé. Elle fut la reine de la saison, la plus fêtée, la plus adulée, la plus intrépide.
Partout Bergmans et Gina se traitaient avec une familiarité affectée, essayant de se donner l'un à l'autre le change sur leurs pudeurs et leurs pensées intimes. Et tous deux s'en voulaient de cette amitié de parade, de ces expansions frivoles, de ce flirtage, sous lequel germait un sentiment profond et attendri.
– Je ne tire pas à conséquence ! se disait Door Bergmans, aussi petit garçon qu'Hercule aux pieds d'Omphale. Elle me considère comme un plaisantin un peu plus en verve que les autres, voilà tout ! Devine-t-elle seulement la fascination qu'elle exerce sur moi ? … Que ne suis-je plus riche encore, ou que n'est-elle pauvre et née dans un autre monde ? Depuis longtemps j'aurais demandé sa main…
Régina ne souffrait pas moins. Elle avait dû finir par se l'avouer à elle-même, elle aimait cet « anarchiste », elle, la fille bien née, l'héritière du nom des Dobouziez… Jamais elle n'eût osé parler à son père de pareille préférence.
Elle en voulait pourtant à Bergmans de ne pas deviner ce qui se passait en elle.
IX. « LA GINA »
Grand branle-bas aujourd'hui au chantier des constructeurs de navires Fulton et Cie. On va procéder au lancement d'un nouveau navire achevé pour le compte de la Croix du Sud, la ligne de navigation entre Anvers et l'Australie. La cérémonie est annoncée pour onze heures. Les derniers préparatifs s'achèvent. Comme un papillon immense, longtemps serré dans sa chrysalide, le navire, complètement formé, a été dégagé de son enveloppe de charpentes.
Le chantier est orné de mâts, de portiques, disparaissant sous une profusion de « signaux », de pavillons, d'oriflammes de toutes les couleurs et de toutes les nationalités, parmi lesquels domine le drapeau rouge, jaune et noir de la Belgique. D'ingénieux monogrammes rapprochent les noms du navire, de son constructeur, de son armateur : Gina, Fulton, Béjard. Ici figurent le millésime de l'inauguration et celui de l'achèvement du travail.
Près du navire se dresse une tribune, tendue de toile à voile que le vent humide secoue par moments d'une façon assez rageuse.
Non loin de l'eau repose, comme une baleine échouée, l'immense bâtiment. La puissante carcasse, étalonnée, fraîchement peinte en noir et rouge, À la poupe, en lettres d'or, dans une sorte de cartouche sculpté, figurant une sirène, on lit ce mot : Gina.
Dès le matin, le chantier se garnit de curieux. Les invités munis de cartes prennent place sur les gradins de la tribune. Au premier rang, des fauteuils en velours d'Utrecht attendent les autorités, la marraine et sa famille. Les badauds de peu d'importance et les ouvriers se placent au petit bonheur à proximité du rivage et du bateau.
Il fait un soleil glorieux comme celui qui brillait il y a près d'un an, lors de l'excursion à Hémixem. Tout ce qui a la prétention de donner le ton, de régir l'esprit, la mode et la politique, se retrouve là comme par hasard. Ils se prélassent, les gens qui comptent : les Saint-Fardier, les Vanderling, les Brullekens, les De Zater, les Fuchskop, nombre de Verhulst, de Verbist, de Peeters et de Janssens, tous les Von et les Van de l'autre fois ; toujours les mêmes.
Le Dupoissy est radieux et se donne de l'importance comme s'il était à la fois auteur, propriétaire et capitaine du navire.
Les dames chiffonnent des toilettes charmantes, pleines d'intentions. Angèle et Cora Vanderling minaudent à côté de leurs fiancés, les jeunes Saint-Fardier, qui étalent un élégant négligé bleu à boutons d'or, jouant l'uniforme des officiers de marine.
Door Bergmans aussi est de la fête, accompagné de ses amis, le peintre réaliste Willem Marbol et le musicien Rombaut de Vyveloy.
Cependant, tout est prêt. L'équipage se réunit sur le pont du navire, selon l'usage. Les matelots, endimanchés et astiqués, francs et débonnaires gaillards, rappelleraient à Laurent, s'il était de la partie, son brave Vincent Tilbak. Un peu embarrassés de leurs membres, on dirait que cette façon de parader sur un navire encore à terre n'est pas de leur goût. Mêlés à l'équipage, des badauds ont voulu se donner l'émotion de descendre avec le navire. Le patelin Dupoissy voudrait bien se joindre à ceux-ci, mais ses fonctions délicates l'attachent au rivage. En attendant l'arrivée du maître, c'est lui qui se charge de recevoir le monde, de caser les dames sous la tente, et aussi de faire l'office de commissaire et de déloger, au besoin, les profanes. Il a conscience de son importance, le radieux Dupoissy. Voyez-le conduire, près du bateau, les demoiselles Vanderling et leur expliquer, avec des termes techniques, le détail de la construction. Il leur confie aussi, d'un petit air mystérieux, qu'il a préparé quelques vers « bien sentis ».
Pour se défaire du fâcheux raseur, le rédacteur du grand journal commercial a promis de les intercaler dans le compte rendu.
Plusieurs équipes des travailleurs les plus vigoureux et les plus décoratifs du chantier attendent, à portée du navire, le moment de lui donner la liberté complète. Il ne manque plus que les autorités et les principaux acteurs, les premiers rôles de la cérémonie qui se prépare. Au dehors du chantier, sur les quais, en aval du fleuve vers la ville, des milliers de curieux refoulés des installations Fulton, où l'on s'entasse à s'étouffer, sont postés pour prendre leur part du spectacle, se piètent avec un tumulte d'attente, un brouhaha d'endimanchement.
Attention ! Dupoissy, un mouchoir attaché au bout de la canne, a donné un signal, comme le starter aux courses.
Des artilleurs improvisés, dissimulés, derrière les hangars, font partir des bottes. Le canon ! se dit la foule en se trémoussant dans un délicieux frisson d'attente. Les jeunes Saint-Fardier plaisantent Angèle et Cora qui ont sursauté.
Un orphéon entonne la Brabançonne.
– Ils arrivent ! ils arrivent !
Ils arrivent en effet. Descendant de voiture, voici le bourgmestre, le parrain du navire, donnant le bras à la marraine, Mlle Dobouziez, éblouissante dans une toilette de gaze et de soie rose ; puis M. Béjard menant la maman Dobouziez, plus fleurie, plus feuillue et plus emplumée que jamais, surtout que Gina a renoncé à contrarier son innocente manie. Derrière, vient M. Dobouziez conduisant la femme du constructeur. Le populaire, contenu à grand'peine par la police, aux abords de l'enclos réservé, s'émerveille naïvement devant la beauté de Mlle Dobouziez. Il a acclamé Door den Berg, mais il fait entendre des grognements au passage de Béjard. Et il se trouve, dans plus d'un groupe de cette cohue de bonnes gens et même sur les banquettes de la tribune, des narrateurs pour établir un rapprochement entre la cérémonie brillante qui se passe aujourd'hui, au chantier Fulton, et les atrocités qui s'y commettaient il y a vingt-cinq ans, sous la responsabilité de Béjard, le père, et avec la complicité de Freddy Béjard, le futur armateur. Mais les huées mal contenues et les murmures se noient dans l'allégresse moutonnière et la jubilation badaude. Lorsque le cortège imposant a gagné ses places, nouveau coup de canon. La musique va repartir, mais Dupoissy fait un signe furieux pour lui imposer silence. Et se plantant devant la tribune, sur la berge, à quelques pas. du navire, il tire de sa poche un papier à faveur rose, le déplie, tousse, s'incline, dégoise de sa voix de chevreau sevré avant terme une kyrielle d'alexandrins rances, que personne n'écoute d'ailleurs. De temps en temps, entré les conversations, on en saisit un hémistiche : « Vaisseau fils de la terre – conquérant de l'onde – sur la plage lointaine – va saluer pour nous – poindre à l'horizon des eaux… symbole de nos lois… royaume d'Amphitrite… »
– Que de chevilles ! Vous verrez qu'il n'en ratera pas une ! murmure Mme Vanderling à l'oreille de Gaston Saint-Fardier, c'est un véritable almanach des Muses que ce bonhomme-là !…
Il a fini. Quelques bravos discrets. Des « Pas mal ! pas mal ! » proférés à demi-voix ; des « ouf ! » de soulagement chez la plupart des auditeurs. Enfin se prépare la phase véritablement émouvante. La musique joue l'air de Grétry « Où peut-on dire mieux », M. Fulton, le constructeur, court donner un ordre à ses ouvriers.
Sous la puissance des coups de bélier et du coinçonnage destiné à le soulever, l'immense bâtiment, immobile jusqu'à présent, commence à se mouvoir insensiblement. Tous les yeux suivent, non sans anxiété, les efforts de la robuste théorie d'ouvriers massés sous l'avant du navire, et l'étayant de ce côté, armés de barres d'anspect afin de le faire glisser plus rapidement sur la coulisse. Pieux, ventrières, étançons sont tombés, les dernières accores ont sauté.
Cependant Béjard a conduit Mlle Dobouziez près de l'amarre. Prenant une élégante hachette au manche garni de peluche, effilée comme un rasoir, il l'offre à la marraine et l'invite à rompre d'un coup sec le dernier câble de retenue. La belle Gina, si adroite, s'y prend mal, elle attaque le chanvre, mais l'épais tressis tient bon. Elle frappe une fois, deux fois, s'impatiente, ses lèvres profèrent un petit claquement irrité. Le silence de la foule est tel que les spectateurs haletants, retenant leur souffle, perçoivent ce mutin accès de mauvaise humeur de l'enfant gâtée. Les loustics rient.
– Mauvais présage pour le navire ! se disent les marins.
– Et pour la marraine ! ajoutent des regardants.
Comme Mlle Dobousiez n'en finit pas, Béjard s'impatiente à son tour, reprend l'outil récalcitrant et cette fois, d'un coup ferme et nerveux, il tranche la corde.
La masse énorme crie sur ses ais, se met lentement en branle et dévale majestueusement vers son domaine définitif.
Moment pathétique. Qu'y a-t-il pourtant là pour faire battre tous ces cœurs, non seulement les simples, mais encore les plus vains et les plus fermés, plus difficiles à émouvoir que l'énorme colosse même ?
En gagnant le fleuve, le navire auquel s'est communiqué une vie étrange, continue de crier et de rugir. Rien de majestueux comme cette rumeur prolongée dont retentissent les flancs de la Gina. Certains chevaux hennissent ainsi de plaisir et de fierté, au moment où l'homme met à l'épreuve leur vigueur et leur vitesse. Puis, brusquement, d'un trait, il franchit, comme un plongeur impatient, la distance qui le séparait encore de la nappe ondoyante et il s'enfonce avec fracas dans l'Escaut que son entrée fait tressaillir et qui semble écarter, pour le recevoir, ses masses écumantes.
Alors, la rumeur du navire ayant cessé, de la foule s'élèvent des hourrahs ! formidables et prolongés. La musique déchaîne de nouvelles et entraînantes fanfares, les salves reprennent, un immense drapeau tricolore est hissé au sommet du grand mât. L'équipage de la Gina éclate à son tour en cris de jubilation, et ses passagers pour rire, convaincus de leur importance, agitent mouchoirs et chapeaux.
Bientôt le navire se prélasse au milieu du fleuve, et vire gracieusement, avec une dignité et une aisance de triomphateur. Ce n'est plus la masse lourde, rébarbative et un peu piteuse qu'on admirait tout à l'heure, de confiance, car un navire hors de l'eau a toujours l'air d'une épave, mais depuis qu'il est entré dans son élément, il s'est allégé et animé. Voilà même qu'on met sa machine en mouvement, ses lourdes hélices battent l'eau, la fumée s'échappe par sa cheminée énorme. Son formidable organisme fonctionne, ses muscles de fer et d'acier s'agitent, il gronde, il respire, il souffle, il vit. Et les hourrahs parlent de plus belle. Cependant, à terre, sous la tente, l'agent de M. Fulton faisait circuler des coupes de Champagne et des biscuits, les hommes trinquaient avec bonhomie, en affectant de la rondeur et de l'expansion, à la fortune de la Gina. Tous s'empressaient autour de la belle marraine afin de lui exprimer leurs vœux pour son brillant filleul. Gina portait le verre à ses lèvres et saluait à chaque toast, avec un sourire fin et digne. Les petites Vanderling buvaient en conscience ; serrées de près par leurs fiancés, elles affectaient d'être chatouillées, se renversaient à faire craquer leur canezou, en riant comme de petites folles, blanches, grassouillettes, le menton charnu, les lèvres très rouges, les yeux pleins de science amoureuse.
Béjard redoublait de prévenances et d'attentions auprès de Gina.
– Vous voilà attachée à ma fortune, mademoiselle, disait-il, non sans intention. Dans cette Gina qui m'appartient et qui fera honneur à son nom, je n'en doute pas, je me plairai à retrouver quelque chose de votre personne. D'ailleurs, les Anglais, nos maîtres en commerce, ont fait aux vaisseaux l'honneur de les assimiler à la femme. Pour eux tous les objets sont indifféremment du genre neutre. Les navires seuls appartiennent au beau sexe…
– Je me sens assez petite fille à côté de cette imposante matrone ! répondit Gina en riant. Et j'ai peine à croire que je l'ai tenue sur les fonts baptismaux ; c'est plutôt elle qui semble m'accorder son patronage… Et ceci explique mon émotion de tout à l'heure… Ah ! vrai, j'ai senti l'aplomb m'abandonner…
M. Dobouziez, mis en veine de générosité par le succès de sa fille, toujours soucieux de suivre l'usage et de ne pas lésiner dans les circonstances publiques, avait fait appeler le contremaître.
– Tenez, dit-il, en lui remettant cinq louis, voici les dragées du baptême ! Partagez-les entre vos hommes et qu'ils les fassent fondre à leur soif.
– Quelle idée ! grommela Saint-Fardier père à l'oreille de Béjard. Les brutes ne tiennent déjà plus sur leurs jambes ! C'est moi qui leur en ficherais des pourboires ! Il faut voir comme je les dégrise le lundi, à la fabrique !
Après avoir exécuté quelques voltes et manœuvres, pour se montrer sous tous ses avantages au monde connaisseur et élégant qui assistait à ses premiers ébats, la Gina redoubla de vitesse, et s'en fut, délibérément, vers la rade, réjouir d'autres spectateurs. Une place lui avait été aménagée, à quai, en attendant qu'elle complétât son outillage, son équipement et qu'elle prit son premier chargement de marchandises et de passagers. Il était convenu, entre l'armateur et le capitaine, qu'elle gagnerait la mer dans huit jours.
Dupoissy, assez mortifié du peu de succès de ses vers, s'était approché de l'eau et, la coupe remplie de Champagne, posté à l'extrémité de l'appareil même d'où s'était élancé le navire, il interpella les autres personnes de la compagnie, de l'air d'un escamoteur sur le point d'exécuter un nouveau tour : – Attention !
Tout le monde tourna les yeux de ce côté. Le Sédanais avait sifflé verre sur verre, lorsqu'on ne s'occupait pas de lui et, désaltéré, même un peu gris, il se rappelait le mariage du Doge et de l'Adriatique et les antiques libations des païens à l'Océan pour se rendre propices Neptune et Amphitrite.
– Que ce nectar de Bacchus répandu dans le royaume des ondes assure à la glorieuse Gina la clémence des éléments !
Il dit et se pencha un peu, chercha une attitude noble, en se tenant sur une jambe, et versa le Roederer dans le fleuve. Mais le gros homme faillit l'y suivre ; si Bergmans ne l'avait retenu par les basques de son habit, il piquait une tête. On applaudit et on pouffa.
– Bon, voilà notre barde qui va se plonger dans le Permesse ! ricanait la Parisienne.
– Prenez garde, monsieur, les dieux anciens, le vieil Escaut, ne semblent pas goûter votre parodie de leurs rites ! dit le tribun à Dupoissy.
– Ah oui, je suis un profane, un étranger, n'est-ce pas ? répliqua avec dépit le pseudo-marchand de laines, au lieu de remercier son sauveteur. Il n'appartient qu'aux Anversois pur sang de ressusciter les antiques religions !
– Je ne vous le fais pas dire ! ajouta Bergmans, en riant.
On se séparait ; les invités regagnaient leurs voitures. Les ouvriers, nantis du pourboire, acclamaient, avec plus de conviction qu'à l'arrivée, les importants personnages. L'après-midi il devait y avoir grand bal au chantier pour tout le personnel ; on mettrait quelques tonneaux en perce. En exécutant les préparatifs de cette nouvelle partie du programme quelques-uns des compagnons fringuaient. Friands d'observation, Marbol et son ami Rombaut se promettaient de revenir l'après-midi avec Bergmans.
– Et vous, se hasarda de dire celui-ci à Régina, n'assisterez-vous pas aux ébats de ces braves gens ; à cette joie qui sera un peu votre œuvre ?
Elle eut une moue dégoûtée.
– Fi ! répondit-elle, je n'en aurai garde. C'est bon pour des démocrates de votre espèce. Vous vous entendriez parfaitement avec Laurent.
– Qui ça, Laurent ?
– Un cousin, très éloigné, – au propre et au figuré, car il est en ce moment en pension à quelque cent lieues d'ici… qui accorde, comme vous, de l'importance à ce monde commun… Mais il n'a pas même comme votre ami Marbol l'excuse de les peindre et de s'en faire de l'argent, ou, comme vous la perspective de devenir président de la République et Ville libre d'Anvers.
Elle ne se rappelait Paridael que pour établir un rapprochement désobligeant, du moins dans sa pensée, entre Bergmans et le collégien. Elle en voulait un peu au tribun de ce qu'il ne se fût pas assez occupé d'elle pendant cette cérémonie et l'eût laissée tout le temps avec Béjard.
– Décidément, pensait Door, des abîmes d'opinions et de sentiments nous séparent ! Je ferai l'impossible pour les combler… Elle est assez intelligente et je lui crois au fond beaucoup de droiture ; si elle m'aimait, je l'aurais vite intéressée à mon œuvre, au but de ma vie. Je m'en ferais une alliée. Si elle m'aimait ! Car malgré sa hauteur et ses dédains, et sa soumission aux préjugés, je persiste à la trouver déplacée dans son monde. Elle vaut ou vaudra mieux que ses parents. Il doit y avoir place en elle pour de généreux mouvements et des pensées supérieures… Sa beauté et son instinct contredisent son éducation… Que ne puis-je la disputer à ces épouseurs richissimes qui rôdent autour d'elle ! …
X. L’ORANGERIE
Une année s'écoula encore. Le jeune Paridael obtint enfin de retourner quelques semaines au pays. Dobouziez lui fit passer un examen sommaire duquel il résulta que ce gamin s'ingéniait plus que jamais à « mordre » aux branches dont le tuteur faisait le moins de cas ou qu'il les étudiait à un point de vue tout opposé aux intentions de cet homme pratique.
Ainsi, au lieu d'apprendre des langues modernes ce que doit en savoir un bon correspondant commercial, il s'était bourré la tête de billevesées littéraires.
– Je vous le demande ! comme s'il n'existait pas assez de sornettes en langue française ! se récriait le cousin Guillaume.
Laurent était devenu un grand rougeaud aux cheveux plats, d'une santé canaille de manœuvre ; mais sous ces dehors trop matériels, sa physionomie épaisse et maussade, ce pataud cachait une complexion impressionnable à l'excès, un intense besoin de tendresse, une imagination exaltée, un tempérament passionné, un cœur altéré de justice. Son apathie extérieure, compliquée d'une insurmontable timidité et d'une élocution lente et embarrassée, entravait et contrariait des sons, d'une acuité presque morbide, des nerfs vibrants et hypéresthésiques. Sous sa torpeur couvaient de véritables laves, des fermentations de nostalgies et de désirs.
Dès sa plus tendre enfance il avait présenté quelque chose de différent, d'incompatible, qui avait inquiété ses parents pour son avenir. Le pressentiment des épreuves que lui réservait le monde leur rendait plus cher encore ce rejeton à la fois disgracié et élu. Mais en dehors de ces bien-aimés à qui la promiscuité du sang et de la chair révélait les mérites du sujet, peu d'êtres devaient l'apprécier. Il n'y avait pas à dire, le gamin déconcertait l'observation immédiate, rebutait les avances banales, ne payait pas de mine. Alors qu'il débordait de sentiments et de pensées, ou bien une pudeur, une fausse honte l'empêchait de les exprimer, ou bien, voulût-il les traduire, ce qu'il en disait prenait un air grimaçant outré, et dépassait le but imposé par la norme et les convenances.
Laurent serait fatalement incompris. Les meilleurs et les plus pénétrants se méprenaient sur son compte ou s'alarmaient de ses enthousiasmes débridés, de ses raisonnements poussés à l'extrême. Il se livrait à des démonstrations intempestives auxquelles succédaient de brusques abattements. Des sorties exaltées s'étranglaient net dans la gorge et finissaient par un inintelligible, rauque et presque animal grognement, comme si son âme jalouse eût vivement rappelé, à l'intérieur, cette volée d'incendiaires captifs ou comme si lui-même eut désespéré de se faire comprendre et reculé devant l'inouïsme de ses effusions. Tels, parfois, la pantominie et les vagissements du sourd-muet sur le point de parler. Ses impressions et ses impulsions le congestionnaient.
En pension, il ne se fit que de rares camarades. On l'eut pris pour souffre-douleur si ses poings de maroufle n'eussent tenu les brimeurs en respect.
La mort prématurée des siens contribua non pas à le dégoûter de la vie, mais à la lui faire comprendre à sa façon, aimer pour d'autres motifs, voir par d'autres yeux, prendre à rebours des codes, des morales et des conventions. Il devint de plus en plus taciturne. Son apparente inertie représentait celle d'une bouteille de Leyde saturée de fluide à en éclater. Souffrant, toujours tendu, pléthorique, ses instincts se dédommageraient de la longue contrainte, il se débonderait d'un seul coup, s'assouvirait sans mesure, se perdrait à tout jamais, mais en s'étant vengé de la vie. Capable de tous les dévouements, de toutes les délicatesses, mais aussi de tous les fanatismes, dans certains cas il aurait réhabilité le vice et apologié le crime ; il fût devenu suivant les circonstances un martyr ou un assassin ; peut-être les deux à la fois.
À l'un de ces dîners de demi-apparat, fréquents à présent chez ses tuteurs, le jeune Paridael fit la connaissance de Door Bergmans. L'air franc, la prestance, l'allure ouverte, les bons procédés du tribun apprivoisèrent le jeune sauvage. Jamais les habitués de la maison ne faisaient attention au petit parent pauvre. Gina plaisanta Bergmans ; « Vous vous rappelez ma prédiction le jour du lancement du navire ? – Parfaitement, répondit Door. Et je vous avouerai que si c'est là le garçon auquel vous faisiez allusion, il m'intéresse au superlatif. Les quelques mots que je lui ai arrachés révèlent une nature bien au-dessus de l'ordinaire !
Gina parut ne point prendre cet éloge au sérieux, mais, depuis, elle condescendit à s'entretenir plus fréquemment avec son cousin.
Cependant le mariage de Gina ne se décidait pas aussi facilement que M. Dobouziez avait pu le supposer. Quantité d'obstacles surgissaient contre l'établissement de l'héritière, toute millionnaire et ravissante qu'elle fût. Les prétendants redoutaient son caractère tranchant et impérieux et aussi son goût du faste. Les adulateurs ne manquaient pas. C'était autour d'elle une nuée de courtisans, un assaut perpétuel de flirtage et de galanterie, mais aucun prétendant ne se présentait.
Cora et Angèle Vanderling, plus jeunes que Gina, venaient d'épouser Athanase et Gaston Saint-Fardier. Elles importunaient leur amie de confidences d'alcôve et lui vantaient les libertés que procure l'existence conjugale. Elles menaient toutes deux leurs lymphatiques maris par le bout du nez et se gênaient moins que jamais pour coqueter avec les galants. Saint-Fardier père, enchanté de se débarrasser de ses fils, leur avait obtenu à l'un un bureau d'agent de change, à l'autre une position de « dispacheur » ou expert en avaries. Vanderling, de son côté, avait très décemment doté ses fillettes. Les deux jeunes ménages menaient fort grand train, et les appétissantes blondines, d'une beauté de plus en plus radieuse et épanouie, s'abandonnaient à tous leurs caprices et à tous leurs penchants.
Avec Bergmans, Béjard demeurait le plus assidu visiteur des Dobouziez. Laurent, qui savait aujourd'hui les antécédents de l'armateur, ne lui cachait pas son aversion. Enclin à un vague swedenborgisme, il s'expliquait à présent le moment d'hallucination qu'il avait eu, autrefois, sur l'Escaut, lors de l'excursion à Hémixem. À Laurent, Freddy Béjard semblait exhaler les corrosives vapeurs des acréolines, incorporer aussi les machines tueuses d'hommes, amputeuses de saine et florissante main-d'œuvre. Aussi combien Laurent souffrait de voir ce satellite sinistre et néfaste graviter incessamment dans l'orbite de la radieuse Gina. Béjard avait l'intuition du sentiment qu'il inspirait au collégien et s'amusait à l'agacer, mais à distance, prudemment, comme on fait à un chien de garde qui pourrait se détacher :
– Ma parole, disait-il souvent à Gina, c'est qu'il n'a pas l'air rassurant, du tout notre jeune maroufle ! Voyez donc de quels yeux d'assassin il nous couve ? Ne lui arrive-t-il pas de mordre ? À votre place je le musellerais !
Disons à la louange de Gina que si l'éloge du petit sauvage par Bergmans ne laissait pas de l'agacer, elle était néanmoins tentée de prendre le parti de son cousin contre les sarcasmes de Béjard.
Laurent se rapprochait d'autant plus de Bergmans qu'il le savait compétiteur de Béjard. Il avait entendu le tribun parler en public et, profondément séduit par son éloquence imagée et savoureuse, il n'était plus seulement son ami, mais encore son partisan. Pourtant, par degrés, un sentiment de jalousie s'emparait de lui. Lequel ? Si vague qu'il n'aurait su dire au juste s'il était jaloux de Gina ou de Bergmans ?
Une plaisanterie inoffensive du tribun faite devant Régina le blessait. Il tournait alors le dos à son ami, le boudait durant des jours, se montrait plus atrabilaire encore avec lui qu'avec les autres.
– Qu'a donc encore une fois notre petit cousin ? demandait Bergmans.
Mais au contraire de Béjard qui se divertissait de ces accès d'humeur, Bergmans se rapprochait du pauvret, le grondait doucement avec tant de vraie bonté que l'enfant finissait par se rapprivoiser et par lui demander pardon de ses lubies.
Depuis la puberté, son sentiment capricieux et indéfini pour la jeune fille s'était exaspéré d'énervantes postulations charnelles. L'âge ingrat rendait son caractère encore plus impressionnable. Les exigences du tempérament s'impatientaient de sa réserve et de sa timidité natives.
À la pension, alors qu'il courait ses quinze ans, il lui était arrivé de défaillir comme une fillette aux effluves trop vifs des jardins printaniers. Les lutineries du renouveau, les bouffées des crépuscules orageux, ces lourdes brises d'avant la pluie, qui s'abattent dans les hautes herbes et semblent s'y panier, trop ivres pour pouvoir reprendre leur essor, l'atmosphère des solstices d'été et de l'équinoxe d'automne chatouillaient Paridael comme le contact de bouches invisibles.
En ces moments la création entière l'embrassait et, démoralisé, hors de lui, il aurait voulu lui rendre caresse pour caresse ! Que ne pouvait-il étreindre dans un spasme de totale possession les grands arbres qui le frôlaient de leurs branches, les meules de foin auxquelles il s'adossait, et toutes les ambiances parfumées et attendries ! Il lui tardait de s'absorber à jamais dans la nature en fermentation ! Ne vivre qu'une saison, mais vivre la vie de cette saison ! Quelle mélancolie bénigne, quelle délicieuse angoisse, quel renoncement de son être, quelle morbidesse déjà posthume ! Un jour le timbre si particulier d'un alto lui avait arraché des larmes. Ce son veloureux et grave, sombre et opulent comme un manteau nocturne ou un sous-bois automnal, il le retrouvait, à présent dans la voix de sa cousine. Il assimilait le despotisme de cette voix à la vertu des nuits insolites, ne procurant que de dérisoires sommeils, nuits propices aux cauchemars, aux conjurations et aux attentats – les nuits du Moulin de pierre !
Il ne cessait pas, croyait-il, d'en vouloir sincèrement à Gina ; il la jugeait avec plus de sévérité et de rancune que jamais. Et pourtant l’idée qu'elle n'agréait personne lui causait une certaine joie. Non seulement il se réjouissait du dédain et de la malice avec lesquels elle traitait Béjard, mais il était presque heureux lorsqu'elle taquinait et rebutait Bergmans. En apparence elle n'encourageait pas plus l'un que l'autre. « La mauvaise ! » se disait Laurent avec une artificielle et laborieuse indignation. « À la place de Door je lui répondrais de la belle façon ! »
Ombrageux comme il l'était, il remarqua un jour l'intonation tendre et presque passionnée qu'elle mit dans quelques paroles sans conséquence adressées au tribun. Il en fut tellement troublé que, demeuré seul avec elle, il osa lui dire à brûle-pourpoint : « Et pourquoi n'épouseriez-vous pas M. Bergmans, ma cousine ? » Elle éclata de rire et le regarda dans le blanc des yeux. « Moi, épouser un partageux comme lui, devenir la citoyenne Bergmans ? » s'écria-t-elle avec un accent de sincérité auquel Laurent se laissa prendre.
Tout en protestant contre ses paroles, au fond il en était ravi. Elles le rassurèrent à tel point qu'il feignit de reprocher à Bergmans ses hésitations et ses lenteurs. Il rusait sans préméditation, d'instinct ; indigné de ses propres diplomaties, furieux de voir tous les mouvements d'une conscience droite et probe contrariés et paralysés dans les rets de sensorielles duplicités. S'il servait ostensiblement son ami Bergmans, c'était malgré le cri de sa chair.
– Me marier, moi ? Demander la main de Mlle Dobouziez ! Tu plaisantes, fiston ! » se récria Bergmans à la perspective que venait de lui suggérer, non sans anxiété, le jeune Paridael. « Qui diable t'a logé cette idée dans la caboche ? D'abord cette femme est trop riche pour moi… Et comme l'autre le pressait : « À te dire vrai, je l'aime et me suis fait une délicieuse habitude de sa présence ! Si elle m'avait encouragé le moins du monde, peut-être aurais-je osé m'en ouvrir au père Dobouziez… Mais ce que tu viens de m'évoquer est un avertissement… D'autres que toi auront remarqué mon assiduité… Il est temps que je cesse de compromettre ta cousine. »
– Quel dommage ! fit Laurent. Vous sembliez faits l'un pour l'autre. » Et malgré cette conviction très légitime, le paradoxal enfant eut peine à contenir sa jubilation et à ne pas sauter au cou de Bergmans. Il se fit pourtant violence au point de combattre et de discuter les scrupules de son ami. En songeant que si Bergmans cessait de venir à la fabrique il n'aurait plus l'occasion de le voir, il lui arriva même de l'exhorter sans arrière-pensée, car il chérissait réellement ce prestigieux garçon.
Quant à Béjard, Laurent était certain que Gina ne l'accepterait, jamais pour époux. Non seulement l'armateur aurait pu être le père de la jeune fille, mais le correct et irréprochable Dobouziez portait à Béjard une estime purement professionnelle qui n'allait pas jusqu'à l'oubli des petites peccadilles que ce poursuivant avait sur la conscience. Il l'eût pris plus facilement pour associé que pour gendre.
Fidèle à sa résolution, le tribun fréquenta moins régulièrement la maison et, après un mois de ces visites de plus en plus espacées, il les cessa complètement.
Laurent respirait, à la fois heureux et navré, presque heureux malgré lui, malgré ses remords. Mais il n'était pas à bout d'angoisses.
Gina, la coquette et maligne Gina qui semblait avoir fait si peu de cas des hommages de Bergmans, parut très affectée de ne plus le voir. Ces regrets, cette préoccupation devinrent même tellement apparents que la lumière se fit enfin en l'esprit de Laurent.
– Elle m'a menti, elle l'aime ! se dit le jeune homme. Et la déchirante torture que lui causa cette découverte lui arracha à lui-même l'aveu de son amour désespéré pour l'orgueilleuse Régina.
Il fut atterré, car du même coup il pressentit qu'elle ne l'aimerait jamais.
Alors, il était de son devoir de rapprocher les deux amants. Il aurait même déjà dû prévenir la jeune fille de l'affection que lui portait le tribun. S'il se taisait à présent il se conduirait en fourbe. D'un mot il aurait pu consoler sa cousine et combler de bonheur son ami Bergmans. Bourrelé de remords, il se garda bien de prononcer ce mot. Il endurait un martyre inouï. – Vas-tu parler enfin ? lui criait sa conscience. – Non, non ! Grâce ! Pitié ! gémissait sa chair. – Rappelle Bergmans au plus vite ! – Je ne le puis, j'expirerais plutôt… – Misérable, mais je te le répète, elle ne t'aimera jamais ! – N'importe, elle ne sera à personne ! – Bergmans est ton ami ! – Je le hais ! – Assassin, Gina se meurt ! – Plutôt que de les rapprocher je les tuerais tous deux !
En effet Gina se mourait. En la voyant maigrir, s'étioler, si triste, si faible, si tranquille et si douce, ne riant, ne raillant presque plus, indifférente à tout ce qui la distrayait autrefois, Laurent fut cent fois sur le point de lui confier ce qu'il savait des sentiments de Bergmans. La langue lui brûlait comme à un muet qu'un mot soulagerait et que l'impitoyable nature empêche de prononcer ce mot. Cent fois aussi, au moment d'écrire à Door, il laissa tomber la plume. Il eût préféré signer son arrêt de mort.
Parti pour Odessa, Bergmans avait envoyé des bords de la Mer Noire deux ou trois lettres commerciales pour empêcher que l'on commentât son éclipse prolongée.
La douleur des Dobouziez était telle qu'ils ne remarquèrent pas la figure convulsée et les allures bizarres de leur pupille.
Laurent qui ne se sentait décidément point la force de parler à Gina prit un soir la résolution de tout raconter le lendemain au père. « Elle ne m'aimera jamais ! se répétait-il à la façon des stoïciens raffinant sur les tortures pour s'y rendre insensibles. Et moi, suis-je bien certain de lui porter de l'amour ? N'est-ce point l'envie qui m'aveugle et qui, parce que je suis morose et déshérité, me rend hostile au bonheur des autres ? » Malgré tous les efforts qu'il fit pour se persuader de ces prétendues erreurs, en présence de M. Dobouziez il ne trouva plus une parole et toute sa grandeur d'âme sombra dans les abîmes de son amour.
Il était allé s'asseoir aux côtés de la malade, dans l'orangerie, parmi ces fleurs capiteuses et perverses dont elle persistait à s'entourer. Depuis sa maladie elle s'habituait à la présence et aux soins de Laurent comme à ceux d'un garde-malade. Généralement il lui faisait la lecture et elle prenait un plaisir de petite-maîtresse à le reprendre. Ce matin il bredouillait et bafouillait outrageusement : « Mais qu'avez-vous donc, Laurent ? fit-elle, je ne comprends plus un mot de ce que vous lisez. »
Il déposa le livre sur la table et saisissant ses mains amaigries : « Régina, balbutia-t-il, il faut que je vous apprenne quelque chose de grave, oh, de très grave… » Il s'arrêta, la regarda dans les yeux, devint très rouge. Il allait prononcer le nom de Door Bergmans, de nouveau ce nom ne passa point la gorge. Sans ajouter un mot, entraîné par une impulsion irrésistible, pris d'une sorte de vertige, il ne put que tomber à genoux et couvrir de baisers et de pleurs les mains que Gina confuse et même effrayée essayait de retirer. Agacé et excité par l'aversion qu'elle lui témoignait, loin de la lâcher, il se rapprocha d'elle et l'attira brutalement à lui. Gina jeta un cri perçant auquel accourut la providentielle Félicité :
– De mieux en mieux ! glapit le factotum en jetant les bras au ciel.
Laurent lâcha prise, sortit en courant, les poings serrés, furieux comme s'il avait été trahi et écrasé au moment de tenir une victoire. Sur-le-champ la servante fit son rapport à ses maîtres et le même jour, avant que les vacances n'eussent expiré, M. Dobouziez renvoyait Laurent au collège.
De là, le coupable tout penaud et au regret de sa violence, très inquiet des conséquences qu'elle avait eues pour Gina, écrivit lettre sur lettre demandant des nouvelles. Personne ne lui répondait. Il se faisait horreur. Sans doute Gina allait au plus mal. L'aggravation de son état n'était-elle pas due à l'émotion qu'il lui avait causée ? Peut-être était-elle à l'agonie, peut-être était-elle morte ? À la fin, n'y tenant plus il s'enfuit du pensionnat et tomba comme une bombe à la fabrique. Le télégraphe avait déjà mis la maison au courant de sa fugue. La première personne qu'il rencontra fut le terrible Saint-Fardier.
– Ah ! vous voilà, vaurien ! s'écria celui-ci, et il fit mine de vouloir lui tirer les oreilles.
– Je vous en supplie, monsieur, s'écria. Laurent, dites-moi comment va ma cousine Régina…
– Mme Béjard se porte d'autant mieux qu'elle n'aura plus rien de commun avec un polisson de votre espèce…
Madame Béjard ! Laurent n'entendit que ces doux mots et demeura hébété, tellement que Saint-Fardier l'ayant pris au collet, il ne songea même pas à se défendre. Dobouziez intervint en ce moment : « Laissez, dit-il, à son associé, je vais en finir avec ce gredin ! » Et, à Laurent : « Vous, suivez-moi dans mon bureau ! »
Le jeune homme obéit machinalement,
– Voilà cent francs ! lui dit Dobouziez. Tous les premiers du mois on vous en enverra autant. Cette somme représente le revenu du modique capital que vous laissa votre père… Tirez-vous d'affaire à présent… Bonne chance… Ah ! une recommandation encore… Il ne faut plus compter sur aucun membre de la famille… Toutes nos portes vous sont fermées… Cette inqualifiable équipée vous met au ban des vôtres. Au revoir… Je ne vous retiens plus…
– La cousine Gina n'est pas devenue Mme Béjard, n'est-ce pas ? hasarda Laurent entendant à peine l'excommunication majeure fulminée contre lui.
– Mme Béjard n'est plus votre cousine. Allons, prenez votre argent… Et tâchez que je n'entende jamais parler de vous !…
Laurent s'arrêta sur le seuil de la porte. Déjà M. Dobouziez s'était rassis devant sa table de travail et allait se remettre à la besogne comme si rien de grave ne s'était passé, comme s'il venait simplement de régler son compte à un commis congédié.
Cette attitude froissa Laurent et le rappela au sentiment de la situation. Depuis quelques secondes il se noyait, il abjurait la vie ; à présent il remontait a la surface :
– Eh bien, soit, pensa-t-il, autant nous séparer comme ça.
Il sortit. Dans la rue une gaîté nerveuse s'empara de lui, par réaction. N'était-il pas libre, émancipé, son propre maître ? Plus de collège, plus de contrôle, plus de tutelle. Et surtout plus de remords, plus de jalousie, plus même d'amour. Mme Béjard, croyait-il en ce moment, le détachait à tout jamais de Gina. Il répudiait sa cousine comme il eût rejeté loin de lui une fleur polluée par une limace.
– Dire que ces Dobouziez croient me punir en renonçant à s'occuper de moi ! se répétait le jeune exalté. Et cette brute de Saint-Fardier ! Si je n'avais pas été assommé par cette nouvelle… je l'étranglais net.
En longeant le fossé dé la fabrique : « Tu as beau parler, eau graisseuse, eau putride ! C'est le passé, mon passé, qui croupit au fond de ta vase huileuse… C'est un cadavre, c'est ma chrysalide que tu détiens. Ta nymphe est devenue Mme Béjard ! Cloaque pour cloaque, ô fossé de malheur, tu me parais moins dégoûtant que certains mariages ! »
DEUXIÈME PARTIE : FREDDY BÉJARD
I. LE PORT
Portant haut la tête, bombant la poitrine, Laurent s'engageait d'une allure de conquérant, dans sa ville natale. Il lui fallait aviser au plus pressé : choisir un logement. Le quartier marchand, au cœur de la cité, le requérait avant tous les autres.
Il retint un appartement au second étage d'une de ces pittoresques maisons à façades de bois, à pignons espagnols, du Marché-au-Lait, rue étroite et passante, encombrée du matin au soir de véhicules de toutes sortes, camions et fardiers des corporations ouvrières, charrettes et banneaux de maraîchers.
Les fenêtres de Laurent prenaient vue, par-dessus les bicoques d'en face, sur les jardins du pléban de la cathédrale. L'immense vaisseau gothique dépassait la futaie. Quelques corneilles voletaient en croassant autour du faîte de l'église.
C'est à Notre-Dame qu'on avait tenu Laurent sur les fonts baptismaux, et justement le carillon, le cher carillon, l'âme mélodieuse de la tour, qui l'avait bercé durant ses premières années quand il jouait aux osselets ou à la marelle, devant la porte, avec les polissons du voisinage, se mit à égrener les notes d'une vieille ballade flamande que Siska chantait autrefois :
Au bord d'un rivelet rapide
Se lamentait une blanche jeune fille.
Laurent résolut d'aller retrouver sur-le-champ cette féale amie.
Une nouvelle commotion l'attendait au Port en face du grand fleuve. Il déboucha place du Bourg, à l'endroit où le quai s'élargit et pousse une pointe dans la rade. De l'extrémité de ce promontoire la vue était magnifique.
En aval et en amont l'Escaut déroulait avec une quiétude majestueuse ses superbes masses de flots. On le voyait dessiner une courbe vers le nord-ouest, fuir, se contourner, poursuivre, virer de nouveau, comme s'il voulait rebrousser chemin pour saluer encore la métropole souveraine, la perle des cités rencontrées depuis sa source, et comme s'il s'en éloignait à regret.
À l'horizon, des voiles fuyaient vers la mer, des cheminées de steamers déployaient, sur le gris laiteux et perlé du ciel, de longues banderoles moutonnantes, pareils à des exilés qui agitent leurs mouchoirs, en signe d'adieu, aussi longtemps qu'ils sont en vue des rives aimées. Des mouettes éparpillaient des vols d'ailes blanches sur la nappe verdâtre et blonde, aux dégradations si douces et si subtiles qu'elles désoleront éternellement les marinistes.
Le soleil se couchait lentement ; lui aussi ne se décidait pas à s'éloigner de ces rives. Ses rougeurs d'incendie, sabrées de larges bandes d'or, mettaient à la crête des vagues comme de lumineuses gouttelettes de sang. C'était à perte de vue, le long des pilotis, des quais plantés d'arbres, puis des digues herbeuses du Polder, un papillotement, un scintillement de pierreries animées.
Des barques de pêcheurs regagnaient les canaux de refuge et les bassins de batelage. De flegmatiques péniches se laissaient pousser, à vau l'eau, si lentement qu'elles en paraissaient immobiles et comme pâmées aux caresses titillantes de cette eau pleine de flamme, chargée de fluide comme une fourrure de félin.
Les voiles blanches devenaient roses. Les contours des bateaux, le ventre et les flancs des carènes étaient très arrêtés à cette heure. Et, par instants, sur la toile des chaloupes se détachaient noires, agrandies, prenant on ne sait quelle autorité fatidique, quelle valeur supraterrestre de nobles silhouettes de marins tirant sur une amarre ou transplantant un mât.
À droite, aux confins de la zone des habitations, s'enfonçaient profondément vers l'intérieur, comme à la suite d'une victoire du fleuve sur la terre, d'immenses carrés qui étaient des bassins, puis encore des bassins d'où s'élançaient en cépées compactes des milliers de mâts compliqués, aux gréements croisés de vergues. Et dans cette forêt de mâts, musoirs, passerelles, sas, écluses, cales sèches ménageaient des clairières, des échappées sur l'horizon.
En certain point des bassins, l'encombrement était tel que, vus de loin, mâtures et cordages des navires accotés semblaient s'enchevêtrer, se croiser, et évoquaient des filets aux mailles si serrées, qu'ils en offusquaient le rideau d'éther opalin où piquait quelque étoile hâtive et faisaient rêver de toiles tissées par des mygales fabuleuses, où les fanaux multicolores et les constellations d'argent viendraient se prendre comme des lucioles et des lampyres.
Prête à se reposer, la ruche commerçante se hâtait, redoublait d'activité, désireuse de finir sa tâche quotidienne. À des recrudescences de vacarme succédaient de subites accalmies. Les pics des calfats cessaient de battre les coques avariées ; les chaînes des grues des cabestans interrompaient leurs grincements ; un vapeur en train de geindre et de renâcler se taisait ; les cris d'attaque, les mélopées rythmiques des débardeurs et des marins attelés à des manœuvres collectives, tarissaient subitement.
Et ces alternatives de silence et de tumulte s'étendant simultanément sur tous les points de la ville laborieuse, donnaient l'idée du soupir d'ahan dans lequel se soulèverait et s'abaisserait une poitrine de Titan.
Dans l'infini brouhaha, Laurent discernait des appellations gutturales, rauques ou stridentes, aussi fignolées que les mélancoliques sonneries de la caserne, tristes comme la force qui se plaint.
Et après chaque phrase du chœur humain retentissait un bruit plus matériel ; des ballots s'éboulaient à fond de cale, des poutrelles de fer tombaient et rebondissaient sur le dallage des quais.
En reportant ses regards, du fleuve sur la rive, Laurent aperçut une équipe de travailleurs réunissant leurs forces, pour mouvoir quelque arbre géant, de la famille des cèdres et des baobabs, expédié de l'Amérique. Leur façon de faire la chaîne, de se grouper, de se buter à ce bloc inerte, de jouer des épaules, des reins, de la croupe, auraient fait pâlir et paraître mièvres les bas-reliefs des temps héroïques.
Mais une odeur véhémente et compliquée, où se fondaient sueurs, épices, peaux de bêtes, fruits, goudron, varech, cafés, herbages, et qu'exaspérait la chaleur, montait à la tête du contemplatif, comme un bouquet supérieur, l'encens agréable au dieu du commerce. Ce parfum, taquinant ses narines, sensibilisait ses autres sens.
Le carillon se remit à chanter. Planant au-dessus de l'eau, il parut à Laurent plus doux, plus tendre encore, lubrifié par une mystérieuse onction.
Les mouettes viraient, leur essor oblique prenait l'air en écharpe. Elles s'approchaient, s'éloignaient, revenaient encore, se livraient à une chorégraphie réglée par les rites élémentaires ; tour a tour attirées, par l'eau, la terre et le ciel, jusqu'au moment où ces trois maîtres de l'espace s'embrasaient dans un même bain d'humide et grasse lumière vespérale…
À ce dernier prestige, Laurent se détourna, ébloui, perdant pied, attiré vers l'abîme. Il regarda de nouveau l'équipe du baobab ; puis avisa, plus rapproché de lui, un lourd camion attelé d'un cheval énorme, et le voiturier, attendant, à côté, que l'on chargeât son véhicule. Et sur la planche entre le char et le navire, le va-et-vient cadencé des plastiques débardeurs encapuchonnés, ployant le cou, mais non le torse, sous le faix, la croupe pleine modelée sur la poupe même du navire ; les jarrets musclés fléchissant très peu à chaque pas ; asseyant d'une main la charge sur les omoplates, l'autre poing sur la hanche. Des dieux !
Une pyramide de ballots s'éleva graduellement sur te fardier. Le croc de la grue hydraulique ne cessait de fouiller et de mordre les flancs du transatlantique et d'en retirer des monceaux de marchandises.
Non loin de là, opération contraire, au lieu de rider le ventre du vapeur, on le gavait sans relâche ; du charbon tombait dans ses soutes, des sacs et des caisses s'engouffraient dans les profondeurs insatiables de sa cale. Et ses pourvoyeurs suaient à grosses gouttes sans parvenir encore à apaiser sa fringale.
Ces manœuvres de force accomplies par une élite d'hommes suggéraient à l'observateur la grandeur et l'omnipotence de sa ville natale. Mais elles ne laissaient pas de l'effrayer, de l'intimider.
En ce moment où, enthousiaste, vierge de projets, il demandait de l'intimité, des avances, des effusions aux pierres mêmes de la cité, cet accueil au bord de la rade le froissait par son trop grand éclat.
– Serais-je encore une fois repoussé et tenu à distance ? se demandait l'orphelin.
Et voilà que, dans son appareil glorieux, Anvers lui incarna, à son tour, une non moins hautaine et triomphale créature.
Se rendant un soir au théâtre, en grand apparat, sa cousine Gina était tellement éblouissante qu'une impulsion inéluctable le précipita vers elle comme un violent. Mais la radieuse jeune fille prévint ce mouvement d'adoration. Elle se rajusta, écarta, d'un geste distant, le candide idolâtre comme une poussière malpropre, et de sa voix désespérément égale, sans joie, sans même cette lueur de satisfaction que tout hommage, partit-il d'un bas-fond, appelle sur le visage de la femme, elle lui dit : « Mais, laisse-donc, gros benêt, tu vas chiffonner mes volants ! »
Oui, sa ville trop belle, trop riche, ce berceau trop vaste pour son nourrisson en imposa ce soir à Laurent.
– Va-t-elle aussi m'écarter, comme un rebut, un indigne ? se demandait-il avec angoisse.
Mais comme si l'adorable ville, moins dure, moins cruelle que l'autre, eût lu la détresse du déclassé et tenu à ce que rien ne gâtât l'ivresse de son émancipation, avant que son cœur se fût serré complètement, le ciel enflammé amortissait son éclat trop acerbe et, du même coup, l'eau dans laquelle on semblait avoir fondu des rubis retrouvait son apparence normale. L'atmosphère crépusculaire redevint fluide et tendre ; les flots s'ouatèrent d'une brume légère, à l'horizon il n'y eut plus que des rappels roses de l'embrasement furieux qui avait effarouché Paridael.
Ce fut une véritable détente. La ville lui serait donc meilleure, plus pitoyable !
Même les mouvements des débardeurs lui parurent moins surhumains, moins hiératiques. Les ouvriers sur le point de cesser le labeur se surprenaient à respirer et à souffler comme de simples mortels, les bras ballants ou croisés, ou se frottant le front du revers de la manche. Laurent les trouvait tout aussi beaux comme cela, et meilleurs. Au moment de rentrer, de se baigner dans l'intimité du ménage, ils souriaient, anonchalis d'avance, et une langueur leur descendait des reins aux jambes, et leurs étreintes cherchaient des objets moins rugueux et moins inertes.
Laurent remettait pied dans la réalité.
II. LA CASQUETTE
À la recherche du logis des Tilbak, il s'était engagé dans le quartier des Bateliers.
On commençait à allumer les réverbères, lorsqu'il avisa une petite boutique portant pour enseigne : À la Noix de Coco, à l'étalage de laquelle s'amoncelaient les objets les plus disparates ; lunettes et boussoles marines, coffres de matelots, chapeaux goudronnés, casquettes de grosse laine, paquets de tabacs anglais et américain enveloppés de papier jaune, tablettes de cavendish ou rôles de tabac à chiquer, canifs, crayons, flacons de parfum, savon de Windsor.
Quelque chose lui disait que c'était là le logis de sa chère Siska. Il n'eut plus de doute en avisant, dans la boutique, une femme occupée à ranger les articles déplacés. Elle tournait le dos à Laurent, et comme la pièce n'était pas encore éclairée, il distinguait à peine sa silhouette, mais avant qu'elle lui eût montré son visage, il l'avait reconnue. Elle alluma les quinquets. Il la voyait en face. C'était la même bonne figure ouverte d'autrefois ; elle avait encore ses bandeaux de cheveux crespelés, un peu grisonnants à présent, où les doigts du gamin s'embarrassaient et qu'il tirait sans pitié. Il demeurait en arrêt devant l'étalage, de l'air d'une pratique qui fait son choix et, comme la rue était plus sombre que la boutique, Siska avait plus de peine à le distinguer. De temps en temps, tout en vaquant à la toilette de son magasin, elle lançait au quidam hésitant un regard à la dérobée. Cela ne mordait donc pas ? Que fallait-il pour l'amorcer ? Pauvre femme ! Laurent se demandait si elle vendait beaucoup de ces articles ?
Siska, ne comptant plus sur ce client, allait se retirer dans une chambrette au fond du magasin. En poussant la porte, il fit tinter une sonnette, elle se ravisa et vint à lui, avec cet empressement et ce sourire engageant des marchands devant l'acheteur.
De l’air le plus grave, Laurent lui demanda à essayer des casquettes. Elle le dévisagea, tâchant de juger, d'après le reste de son ajustement, quelle coiffure lui agréerait. Cet examen rapide lui donna sans doute une idée assez haute de l'élégance de Paridael, car elle lui montra ce qu'elle « tenait » de plus cher dans ce genre d'articles, des casquettes marines de fantaisie comme en portent les passagers huppés. Mais Laurent demanda à voir des casquettes de paysan, de roulier, d'arrimeur, et feignit de jeter son dévolu sur d'énormes bourrelets en laine brune, à visière et à pompon.
Siska le considéra rapidement, avec méfiance. Un excentrique, pour sûr ! ou quelque sujet ayant de bonnes raisons pour se déguiser en dehors du temps de carnaval ! Rien de propre en somme. Et elle mit le comble à la joie malicieuse de Laurent – qui épiait son manège du coin de l’œil, et sans oser la regarder en face de peur de se trahir – en enlevant rapidement le trousseau de clefs laissé sur le tiroir. Laurent eut l'occasion de se rappeler, par la suite, cette velléité de mascarade et cette fantaisie pour la coiffure plébéienne.
Gardant sur la tête un des spécimens les plus tapageurs de l'assortiment, coiffure rogue qui eût fait les délices d'un rôdeur de quai, il lui en demanda le prix. Elle eut alors un air de consternation si amusant, si sincère, qu'il ne parvenait plus à se contenir. Tandis qu'elle lui rendait la monnaie sur un billet de vingt francs, avec la hâte de quelqu'un qui voudrait se débarrasser au plus vite d'un client louche, lui, au contraire, prenait son temps, n'en finissait pas de se mirer et d'ajuster son emplette de la manière la plus impudente et la plus dégagée.
Enfin, les poings sur les hanches il se campa, falot, devant la marchande et la dévisagea obstinément… Et comme, intriguée par ce regard, la bonne femme changeait de couleur, retrouvant dans ses jeux une expression bien connue, Laurent lui sauta brusquement au cou. Avec un cri, elle lui avait déjà ouvert les bras.
– C'est moi, Siska ! Moi, Laurent Paridael… votre Lorki…
– Lorki !…, monsieur Laurent ! Est-il Dieu possible ! s'exclama la bonne âme.
Elle le lâchait et se reculait pour l'admirer, l'étreignait de nouveau, rouge de plaisir et de confusion, et ne cessait de se récrier : « Voyez-vous ce vilain farceur ! ce gamin qui me bernait avec tant de sérieux ! »
Cependant, aux exclamations de Siska, Vincent était accouru, pas moins agréablement surpris que sa femme. Ils poussèrent Laurent par les épaules, dans leur petite chambre de ménage.
Ce réduit ressemblait furieusement à une cabine. Le jour, une fenêtre aussi étroite qu'une meurtrière y répandait une lumière glauque comme sous-marine. Ses industrieux occupants résolvaient chaque jour le problème d'y faire tenir le plus possible d'êtres et d'objets. Pas un pouce d'espace qui y fût perdu. Cette chambre était enduite d'une couleur brune, jouant l'acajou, ornée de quelques gravures représentant des scènes de voyage ; il y avait sur la cheminée un trois-mâts en miniature, voguant à toutes voiles, chef-d'œuvre confectionné par Tilbak, et quelques-uns de ces grands coquillages dans lesquels, en les appliquant contre l'oreille, on entend mugir l’Océan.
Laurent se trouva mis en présence d'une kyrielle d'enfants de tout âge. On lui présenta d'abord Henriette, une accorte ménagère. Un visage ovale, allongé sans disgrâce, des yeux bleus étonnamment doux, pour ainsi dire lactés, des boucles blondes, une physionomie reposée et confiante ; toute la personne embaumait la candeur primordiale et la foncière pureté.
L'existence pour Siska de cette adolescente héritière ne laissait pas d'intriguer Laurent. Devinant qu'il supputait les années écoulées depuis leur mariage, Vincent profila d'une sortie de la fillette pour lui dire à l'oreille, avec un coup de coude et le bon rire franc et luron, et le clin d'œil dont l'homme du peuple accompagne généralement ses gaillardises :
– Dame ! monsieur Laurent ! Lorsque Siska vous avait mis coucher, il nous fallait bien passer le temps… La mijaurée ne m'allongeait des claques et ne me tenait à distance que devant vous.
Et Laurent se rappela certaine maladie mystérieuse de la servante, et aussi avec quelle joie et quelle bonté Jacques Paridael la vit revenir après une villégiature d'un mois.
Après Henriette venait Félix, un membru noiraud de quatorze ans ressemblant au père, et que Door Bergmans avait engagé comme saute-ruisseau et « garçon de courses », puis Pierket, un délicieux garçonnet de douze ans, aux cheveux blonds comme sa mère et sa grande sœur, mais avec les vifs yeux bruns et le teint un peu ambré de son père et de Félix ; et Lusse, une bambine de six ans à peine – la miniature de sa mère.
Que de confidences et d'épanchements ! Laurent raconta aux Tilbak ce qui s'était passé depuis le renvoi de Vincent, mais une pudeur l'empêcha de parler de Gina. Il n'était pas sûr de la détester autant qu'il l'aurait voulu. Ne venait-il pas de l'évoquer au bord de l'Escaut ?
Sollicité par son élément favori, mais forcé de renoncer à la navigation hauturière et même au cabotage, Vincent cumulait les fonctions de marinier, passeur et conducteur d'allèges ; il conduisait aussi jusqu'au bas de la rivière, les « commis de rivière », envoyés parles trafiquants à la rencontre des navires signalés au pilotage.
– Et vous, qu'allez-vous devenir ? demanda Vincent avec cette rondeur des dévouements qu'on ne pourrait jamais taxer d'indiscrétion.
Le jeune homme l'ignorait lui-même. Il n'avait rien à attendre des gens de sa famille, et ses cent francs eussent-ils représenté une rente suffisante, qu'il n'était pas d'âge à paresser.
– Si je vous ai bien compris, reprit le mari de Siska, vous préféreriez à un emploi sédentaire une besogne qui vous permettrait d'aller et venir et de vous donner du mouvement. Je tiens peut-être votre affaire. Un chef de « Nation » de mes camarades a besoin d'un employé qui l'aide dans ses calculs et dans la surveillance de la besogne, au chantier et à l'entrepôt. Faut-il lui parler ?
Laurent ne demandait pas mieux ; il fut convenu qu'il reviendrait prendre des nouvelles le lendemain.
III. RUCHES ET GUÊPIERS
Maître Jean Vingerhout engagea, sur-le-champ, le jeune homme recommandé par son ami Vincent Tilbak, Jean était un joyeux vivant, râblé, solide, cadet de notables fermiers des Polders les alluvions de l'Escaut, lequel, fatigué de cultiver à perte, avait acheté, avec le produit de son héritage, une part d'actionnaire dans une « Nation ».
Les « Nations », corporations ouvrières rappelant les anciennes gildes flamandes, se partagent l'entreprise du chargement, du déchargement, de l'arrimage, du camionnage et de l'emmagasinement des marchandises ; elles forment dans la cité moderne une puissance avec laquelle doit compter le clan des forts commerçants de la place, car, coalisées, elles disposent d'une armée de compagnons peu formalistes capables d'entraîner une stagnation complète du trafic et de tenir en échec le pouvoir du Magistrat. Là, du moins on sauvegarderait les droits des enfants du terroir ; jamais l'immigré ne supplanterait l'aborigène de la contrée anversoise comme baes, c'est-à-dire maître, ou même comme simple compagnon.
L'« Amérique », la plus ancienne et la plus riche de ces nations, au service de laquelle venait d'entrer Laurent, écrémait la main-d'œuvre, disposait des plus beaux chevaux, possédait des installations modèles et un outillage perfectionné. Chariots, harnais, grues, bâches, cordeaux, bannes, poulies et balances n'avaient point leurs pareils chez les corporations rivales. Depuis Hoboken jusqu'à Austruweel et à Merxem on ne rencontrait que ses diligentes équipes. Ses poseurs et ses mesureurs transbordaient le grain importé sur des allèges d'une contenance invariable ; ses portefaix juchaient les sacs et les ballots sur leurs épaules et les rangeaient à quai ou les guindaient sur les fardiers ; ses débardeurs déposaient sur la rive des planches, poutres et grumes en réunissant les produits de la même essence.
Trop habitués à ouvrer de leurs dix doigts pour s'escrimer du crayon et de la plume, c'était Laurent qui, sur la présentation de leur collègue Vingerhout, le syndic des chefs ou baes, était chargé de leur besogne de bureau et aussi du soin de contrôler, à l'entrée ou à la sortie des docks, les chiffres renseignés par les peseurs et mesureurs d'autres corporations.
Un négociant en café, client de l'Amérique, a-t-il repris une partie de denrées à un confrère, Laurent reçoit le stock des mains de la nation concurrente avec laquelle a traité le vendeur. Il en a souvent pour une journée de posage sur le quai en pleine cohue, sous les ardeurs du soleil ou par la pluie et la gelée. Mais il s'absorbe en la tâche. Des centaines de balles poinçonnées et numérotées depuis la première jusqu'à la dernière défilent devant lui. Il additionne des colonnes de chiffres tout en surveillant du coin de l'œil le jeu de la balance. Car gare aux erreurs ! Si le preneur ne trouvait pas son compte, c'est l'Amérique qu'il tiendrait responsable de l'écart, à moins que Laurent n'eût constaté que le préjudice émanait du vendeur et de ses ouvriers.
Plusieurs fois il eut à surveiller les expéditions de l'usine Dobouziez, et ce n'était pas sans émotion qu'il avisait les caisses blanches balafrées au pinceau noir du sacramentel D. B. Z.
Mais il n'éprouvait pas le moindre regret de son changement de position. Au contraire. Il se réjouissait de servir ces patrons sans morgue, ces baes d'un abord si réconfortant, au lieu de pâtir dans un bureau morose à la solde d'un Béjard ou d'un autre arrogant parvenu. Devant la rade et les bassins remplis de navires, ce mouvement ininterrompu des entrées et des sorties, ces dégorgements ou ces engloutissements de cargaisons, ce va-et-vient entre les entrepôts flottants et les docks du rivage, cet éboulement continu des marchandises sur le quai et au fond des cales, le commerce ne lui paraissait plus une abstraction, mais un organisme tangible et grandiose.
Souvent Laurent assistait à la réunion des baes, le soir, dans une brasserie du Port. Fardiers et camions sont remisés sous les hangars, mangeoires remplies, litières renouvelées. Les chevaux broient le picotin, le comptable a fermé ses registres, les vastes bâtiments ne logent plus d'autre compagnon que le garde-écurie, et les grosses portes massives, vraies portes de forteresse, protègent la fortune de l'Amérique contre les coups de mains des ribleurs et des larrons.
Les bruyantes assemblées, l'épique déboutonnage, les croustilleux ou tonitruants propos, alors, à l’« herberge » habituelle ! Tudieu ! ces rudes chefs de corporation, ces baes à peine mieux équarris que leurs subalternes, en lâchent de carabinées qui renverseraient, comme ils en conviennent eux-mêmes, un paysan de son cheval ! Il fait beau les voir se nettoyer la bouche d'une gorgée en conséquence, après une gaillardise énorme entre toutes qui les fait se trémousser sur leurs escabeaux et communiquer à la table, à l'armée des demi-litres et aux carreaux des fenêtres une trépidation comparable à celle que provoquent pendant le jour les cahotements sur le pavé d'un de leurs formidables attelages.
Laurent sortait de ces conférences abasourdi, assommé, un peu asphyxié, comme si on l'avait regoulé de forts quartiers de viande ou même exposé comme un jambon à des fumigations prolongées. Et en présence de ces tourmentes d'humeur pléthorique comment taxer d'exagération l'exubérance sanguine et la licence presque animale des coloristes du passé !
En temps de presse, lorsque les salariés à demeure, l'effectif stationnant, aux heures de la reprise du travail, devant les locaux de l'Amérique, ne suffisait pas à l'abondance de la peine, il arriva à Laurent d'accompagner son maître Jan Vingerhout au Coin des Paresseux, le carrefour voisin de la Maison Hanséatique, ainsi appelé parce que s'y tenait la Bourse des chômeurs perpétuels. Bien typiques les scènes d'embauchage et de recrutement auxquelles il assista ! La première fois Laurent ne comprenait pas que baes Jan, ayant seulement besoin d'un renfort de cinq hommes, s'était embarrassé d'une vingtaine de ces maroufles, assurément fort valides, même bâtis pour fournir des travaux de géant, mais n'exerçant jamais leur musculature que dans des altercations de pochard et mêlant trop d'alcool à leur sang riche.
– Attendez ! lui dit, en riant, le baes, qui connaissait son monde.
Après des transactions saugrenues, les drôles acceptaient enfin le marché et se mettaient en route, mais comme à leur corps défendant et en poussant, chaque fois qu'ils mettaient un pied devant l'autre, des soupirs à fendre l'âme.
Arrivés à une vingtaine de mètres de leur lieu de stationnement, l'un ou l'autre de ces lazzaroni du Nord, s'arrêtait net et déclarait ne plus pouvoir avancer si on ne lui administrait un cordial à base d'alcool.
Vingerhout faisant la sourde oreille, le soiffard se traînait non sans maugréer à sa suite, quitte à formuler la même déclaration quelques pas plus loin. Quoique deux autres recrues eussent appuyé la supplique du camarade par un suggestif claquement de langue et des gestes dignes de Tantale, le recruteur n'entendait pas plus que la première fois.
Au troisième débit de liqueurs, autant dire à la sixième maison, le patient s'avoua vaincu et, avec un juron de désespoir, déserta la compagnie pour s'approcher du zinc plus irrésistible que l'aimant. Ses deux partisans se traîneront jusqu'à l'assommoir suivant, mais là, après une suprême, mais vaine sommation à l'embaucheur. ils reprirent leurs libations au dieu Genièvre.
Laurent commença à comprendre pourquoi Vingerhout avait forcé le contingent.
– Ces trois-là sont des ivrognes et des lendores[4] patentés ! lui dit le baes. Je ne les engage plus que par acquit de conscience, persuadé qu'ils me lâcheront à l'un des premiers tournants du quai. Encore ne suis-je pas sûr des autres !
Jan avait raison de se méfier de leur force de caractère. Le chantier vers lequel il tendait étant situé à près d'un kilomètre de là, quelques défections se produisirent encore, l'une pratique débauchant l'autre, si bien qu'à l'arrivée à pied d’œuvre il ne restait à Vingerhout que les dix bras dont il avait besoin.
– Estimons-nous heureux que ceux-ci ne nous soient pas glissés entre les doigts à la dernière minute, ce qui nous aurait forcé de retourner à leur vivier et d'y recommencer la pêche ! conclut le Poldérien philosophe sans épiloguer autrement sur cet édifiant épisode. Et pour reconnaître leur relative complaisance, il leur paya une tournée du mirifique genièvre.
Laurent apprit à connaître des gaillards, plus originaux encore que ces clampins, en accompagnant Vincent Tilbak qui conduisait, en chaloupe, l'un ou l'autre commis de rivière, à la rencontre d'un arrivage. L'amarre détachée, le rameur ne pouvait d'abord que godiller, pour sortir du bassin de batelage et de la rade sans heurter les chalands et les navires à l'ancre. L'yole passait entre deux vaisseaux dont les œuvres mortes semblaient de somnolentes baleines ayant pour prunelles les fanaux clignotants. Puis Tilbak jouait allègrement de l'aviron. Un silence intermittent, plus majestueux que le calme absolu, planait sur la terre et le ciel. Laurent prêtait l'oreille au grincement des taquets frictionnés par les rames, à l'égouttement de l'eau des palettes, au clapotis dans la cale. Parfois un « qui vive » partait d'une patache de la douane en quête de smoglers. Le nom et la voix de Tilbak apprivoisaient les gabelous. Au Doel les nuits se passaient, suivant la saison et la température, dans la salle commune de la frugale auberge, cassine en bois goudronné, ou à la belle étoile, sur l'herbe de la Digue.
On y rencontrait une engeance interlope, d'industrieux amphibies que Laurent avait le loisir de détailler : courtiers marrons, estafettes de mercantis, drogmans de mauvais lieux, ou, à des échelons inférieurs encore, pilotins réfractaires, garçons de cambuse en congé forcé, rôdeurs de quai, gibier de la correctionnelle, fretin des pénitenciers, généralement désignés sous l'appellation de runners. Des adolescents imberbes, de dégourdis bouts d'hommes, noctambules comme des matous, insinuants comme des filles : asticots des pêcheries en eau trouble.
– N'ayez peur, monsieur Lorki, disait Tilbak, se méprenant sur la stupeur de Laurent devant ce bivac d'interlopes.
À la vérité Paridael celait une curiosité plus que partiale, sous une contrainte et une répugnance assez plausibles. Ils chiquaient, pipaient, sifflaient le rogomme, poissaient des cartes, se portaient des gageures incongrues et mêlaient à leur argot bourguignon flamand des termes d'une langue verte cosmopolite, des éructations de slang. Le lucre, la ruse, la colère et le vice chiffonnaient les frimousses très avenantes à la pénombre des larges visières marines ou des cheveux frisottant sous les bérets, et la lumière rembrandtesque du bouge, le fuyant clair de lune, le petit jour cuivreux du dehors, un petit jour de guillotinade, leur prêtaient une équivoque de plus.
Le brave Tilbak, qu'ils respectaient au point de céder le passage à son client, leur gardait rancune depuis sa vie de matelot.
– En voilà qui s'entendent à gruger les gens de mer ! disait-il. Ah ! ce qu'ils m'ont fait sacrer, ces gouins-là ! Les tentations, les boniments, qu'il m'a fallu subir, lorsqu'ils s'abattaient sur le pont comme une nuée de poissons volants. Heureusement j'avais l'âme trop férue de Siska pour me laisser prendre à leurs amorces. Ils en étaient pour leurs distributions de prix courants et d'échantillons. Je n'aurais eu garde de leur engager mon prêt, ma chair et mon salut. Mais c'est égal, j'étais content de mettre le pied sur le plancher des vaches, pour échapper à leurs hameçons. Je vous le dis, monsieur Laurent, ces runners sont les vrais suppôts des sept péchés capitaux !…
Vincent Tilbak aurait dû remarquer que, loin de partager son animadversion, Laurent scrutait les jeunes runners avec une complaisance indue.
Un jour il laissa même entendre à son mentor les affinités qu'il se découvrait avec ces mauvais petits bougres[5].
À cette ouverture la physionomie de l'honnête Tilbak exprima une si touchante consternation, que l'étourdi s'empressa de renier ces sympathies déplacées et déclara, non sans rougir, qu'il avait simplement voulu badiner. Des instincts d’irrégulier et de réfractaire couvaient en lui. De là, sans qu'il parvînt à se les expliquer, les postulations sourdes, l'énervante angoisse, la curiosité lancinante, le navrèrent jaloux et apitoyé, à la fois craintif et tendre, qui le travaillaient devant le farouche Moulin de pierre, le repaire, mais aussi l'asile des êtres asymétriques.
La vie laborieuse et salubre qu'il menait avec de droits et probes gaillards de la trempe de Jean Vingerhout, l'amitié de Vincent et Siska, mais plus encore l'influence balsamique d'Henriette devaient reculer l'éclosion de ces germes morbides. Laurent était devenu le commensal régulier des Tilbak. Une confiance fraternelle ne tarda pas à s'établir entre Henriette et lui. Jamais il ne s'était trouvé plus à l'aise, plus rassuré, plus charmé, vis-à-vis d'une personne de l'autre sexe. Il semblait qu'il la connût de longue date. Ils avaient dû grandir ensemble. Le soir, Laurent aidait les enfants, Pierket et Lusse, à écrire leurs devoirs et à étudier leurs leçons. La sœur aînée vaquant aux soins du ménage, allant et venant par la chambre, admirait la science du jeune homme. Après le souper, il faisait la lecture à toute la famille ou les instruisait en causant. Henriette l'écoutait avec une ferveur non exempte de malaise. Lorsqu'il parlait des événements de ce monde et de la condition de l'humanité, la jeune fille était bien plus impressionnée par l'exaltation, l'amertume, la fièvre, la révolte que trahissaient les propos du jeune homme, que par le sens même de ses objurgations. Avec cette seconde vue des aimantes âmes féminines, elle le devinait foncièrement triste et troublé, et plus il montrait de sollicitude pour les malheureux, les souffrants, et surtout les égarés, plus elle le chérissait lui-même, plus elle s'absorbait candidement en lui, pressentant qu'entre tous les misérables, celui-ci avait le plus grandement besoin de charité.
D'ailleurs, auprès d'elle le cours de ses idées ne tardait pas à reprendre une pente moins tourmentée. Sous la caresse tutélaire de ces grands yeux bleus arrêtés ingénument sur lui, il ne s'apercevait plus que de la quiétude présente, des ambiances loyales et des sourires de la vie. Il cessait de chercher midi à quatorze heures, imposait silence à ses orageuses spéculations.
Autrefois, à la Fabrique, les prunelles de Gina lui injectaient sous le derme une liqueur traîtresse ; il ne se possédait plus, devenait mauvais, rêvait un bouleversement et des représailles, une jacquerie, une révolte servile, après laquelle il se fût attribué, pour part de butin, l'orgueilleuse et méprisante patricienne et lui eût imposé les outrages de son incendiaire désir. C'était même autant par rancune contre Gina que par haine des dirigeants et des capitalistes qu'il était retourné vers les exploités. Il allait descendre jusqu'aux parias subversifs, lorsqu'il avait rencontré les prolétaires résignés. Il devint une sorte d'ouvrier dilettante. La sagesse, la placidité, la belle humeur, la philosophie de ses nouveaux entours, surtout la bonté et le charme d'Henriette, endormirent ses rancunes, ses griefs, le rendirent accommodant et presque opportuniste. L'image de Gina pâlissait.
IV. LA CANTATE
En flânant sur les quais, Door Bergmans aperçut un particulier dont la mine l'intrigua. Il eut un sursaut d'étonnement. « Je me trompe ! » se dit-il en poursuivant sa route. Mais après quelques pas il rebroussa chemin et, reconnaissant bel et bien Laurent Paridael, il marcha droit à lui la main tendue.
Laurent, en train de surveiller un chargement de balles de riz entrepris par 1' « Amérique », se troubla un peu, fit même le mouvement de se dérober, mais apprivoisé par l'abord affectueux et simple du tribun, abandonna, momentanément son poste et se laissa entraîner non loin de là. Mis au courant, Bergmans railla doucement la fantaisie qui l’avait poussé à entrer comme marqueur dans une Nation et à servir les débardeurs. Que ne s'était-il adressé plutôt à lui ? Il lui offrit même sur-le-champ, dans ses bureaux, une place plus digne de son savoir et plus compatible avec son éducation. Mais, à la surprise de plus en plus grande du tribun, Laurent refusa d'abandonner sa nouvelle profession. Il décrivit même en termes si enthousiastes, avec un tel lyrisme, son nouveau milieu et ses nouveaux partenaires, qu'il justifia presque son étrange vocation et que Bergmans crut ne plus devoir insister. Il s'abstint de nommer Gina. Mis complètement à l’aise, Laurent accueillit avec empressement la proposition de se réunir de temps en temps Bergmans et lui, avec Marbol et Vyvéloy.
Le peintre Marbol, un petit homme sec, tout nerfs, cachait, sous une apparence anémique et friable de souffreteux, une énergie, une persévérance extraordinaire. Depuis une couple d'années, il s'était acquis quelque notoriété en peignant ce qu'il voyait autour de lui. Seul dans cette grande ville littéralement infestée de rapins, de colorieurs en chambre, dans cet ancien foyer d'art presque totalement éteint, nécropole plutôt que métropole, – il commençait à exploiter le plein air, la rue, le décor, le type local. En quittant, avec un certain éclat, à la veille des concours de Rome, l'antique académie fondée par Teniers et les savoureux naturistes du dix-septième siècle, mais tombée à présent sous la direction de faux artistes, peintres aussi timides que maîtres intolérants, le jeune homme s'était mis à dos la clique officielle, les marchands, les amateurs, les critiques, les fonctionnaires, aussi bien ceux qui procurent le pain que ceux qui débitent la renommée.
Peindre Anvers, sa vie propre, son Port, son fleuve, ses marins ses portefaix, ses plébéiennes luxuriantes, ses enfants incarnadins et potelés que Rubens, autrefois, avait jugés assez plastiques et assez appétissants pour en peupler ses paradis et ses olympes, peindre cette magnifique pousse humaine dans son mode, son costume, son ambiance, avec le scrupuleux et fervent souci de ses mœurs spéciales, sans négliger aucune des corrélations qui l'accentuent et la caractérisent, interpréter l'âme même de la cité rubénienne avec une sympathie poussée jusqu'à l'assimilation. Quel programme, quel objectif ! C'était bien là pour ces fabricants et ces acheteurs de poupées et de mannequins, le fait d’un fou, d'un excentrique, d'un casseur de vitres !
Un tableau de Marbol, destiné à une exposition internationale de l'étranger et soumis auparavant au jugement de ses concitoyens, fit partir ceux-ci d'un immense éclat de rire, et lui valut des condoléances ironiques ou de fielleux et méprisants silences. Ce tableau représentait les Débardeurs au repos.
À midi, sur un fardier dételé, voisin du Dock, trois ouvriers étaient couchés : l'un ventre en l'air, les jambes un peu écartées, la tête reposant, entre les bras repliés, dans les mains jointes derrière la nuque ; la physionomie basanée, rude, mais belle, sommeillait à demi, les paupières un peu relevées montraient ses prunelles noires et veloureuses. Les deux autres dockers s'allongeaient à plat ventre ; le fond de culotte cuireux et comme boucané bridait leur croupe protubérante dont elle accusait les méplats, et, le buste un peu relevé, le menton dans les poings calleux, appuyés sur leurs coudes, ils tournaient le dos au spectateur, montrant la tête crépue, des oreilles écartées, les puissantes attaches du cou, le dos râblé à l'envi, et béaient à un coin de la rade chatoyant entre des cépées de mâts.
À Paris ce fut autour de cette toile audacieuse, une guerre d'ateliers, des polémiques féroces : depuis des années on n'avait plus bataillé ainsi. Marbol se conquit autant d'admirateurs que d'ennemis, ce qui est la bonne mesure. Un des gros marchands de la chaussée d'Antin ayant acquis cette composition scandaleuse, ceux d'Anvers en frémirent de rage et de stupeur. Quel honnête homme eût consenti à s'embarrasser de ce portrait de trois manœuvres déguenillés et dépoitraillés, mal vêtus, mal rasés, trop charnus, de cuir trop épais, de poings et de jarrets inquiétants ? Pour dire sa pleine horreur, M. Dupoissy avait écrit que ce tableau dégageait une odeur de suée, de hareng saur et d'oignon ; qu'il sentait la crapule.
Arriva une nouvelle exposition à Paris ; Marbol y prit part avec un tableau non moins audacieux que le premier, et, à la stupéfaction redoublée des clans hostiles ou timorés, les jurés lui décernèrent la grande médaille.
Si les bonzes de la peinture se renfermèrent vis-à-vis du jeune novateur dans leur attitude malveillante, ces succès, bientôt ratifiés à Munich, Vienne et Londres, donnèrent à réfléchir aux amateurs et aux collectionneurs de la haute société anversoise. On ne pouvait le nier ; le gaillard réussissait. S'il n'y avait eu pour leur prouver sa supériorité que ce qu'on appelle la gloire : des articles de gazettes, des applaudissements de crève-de-faim chez qui plus l'estomac manque d'aliments, plus la tête se nourrit de chimères, ces gens positifs eussent continué de hausser les épaules et de dire « raca » à ce tapageur, ce brouillon. Mais du moment que, comme eux-mêmes, il se mettait à palper des écus, son cas devenait intéressant.
– Heu ! Heu ! Drôle de goût, pour sûr ! Peinture peu meublante, tableaux à ne pas avoir chez soi…, du moins dans un salon où se tiennent des dames… Mais un malin, pourtant, un compère adroit, après tout… Il n'avait pas si mal combiné son plan. Puis qu'importe s'il fait de la peinture à ne pas prendre avec des pincettes, nous recevons bien à la maison ce brave Vanderzeepen, alors que chacun sait que le digne homme a gagné ses deux cents maisons, son hôtel de la Place de Meir et son château de Borsbeek, au moyen de la ferme des vidanges… Comme Vanderzeepen, ce monsieur Marbol a trouvé la pierre philosophale ; sauf respect, il fait de l'or avec de la merde !
Les préventions tombèrent. Les matadors de la finance commencèrent à saluer le pelé, le galeux d'autrefois ; risquèrent même de citer son nom devant leurs pudiques épouses, ce qui eût paru d'une inconvenance énorme quelques mois auparavant. Ne pouvant décemment prôner cette peinture pétroleuse et anarchiste, on affecta de priser l'habileté, le génie, commerçant de ce Marbol qui endossait si facilement ses croûtes désagréables, ses épouvantails à moineaux, à des gogos parisiens, à des Yankees facétieux ou aux Anglais, friands, comme on sait, de scènes monstrueuses et excentriques.
Le musicien Rombaut de Vyvéloy, l'autre ami de Door Bergmans, rappelait, avec sa haute taille, sa coupe robuste, son masque léonin, sa crinière abondante, sa complexion sanguine, la figure du maître des dieux dans Jupiter et Mercure chez Philémon et Baucis, de Jordaens. C'était, sinon un païen, du moins un « Renaissant » que ce Brabançon. Rien, ni au physique, ni au moral, des types émaciés, blafards et béats, des primitifs à la Memlinck et à la Van Eyck. Il avait converti au panthéisme l'oratorio chrétien du vieux Bach.
L'art fougueux et essentiellement plastique de Vyvéloy devait impressionner plus profondément encore Laurent Paridael que les peintures à tendances hardies, mais à réalisation un peu molle et un peu frigide, pas assez vibrante, – comme il le constata de plus en plus par la suite – de son ami Marbol.
Cette année-là, Anvers inaugura les fêtes du troisième centenaire de la naissance de Rubens par une cantate de Rombaut de Vyvéloy, exécutée le soir en plein air sur la Place Verte. Laurent ne manqua pas de se rendre à cette cérémonie.
Près de la statue du grand Pierre-Paul, les chœurs et l'orchestre occupent une tribune à gradins, disposée en arc de cercle au centre duquel trône le compositeur. Le square, ceint de cordeaux, est ménagé aux bourgeois. Le peuple s'écrasant alentour respecte la démarcation et les rues convergentes ont beau vomir de nouvelles cohues, cette multitude effrayante parait plus digne et plus recueillie encore que les spectateurs privilégiés et moins séditieuse que la déplaisante police et les encombrants gendarmes à cheval. Pas une contestation, pas un murmure. Depuis des heures, ouvriers et petites gens piétinent philosophiquement sur place, sans rien perdre de leur belle humeur et de leur sérénité. Quel fluide réduit au silence ces langues frondeuses, ces caboches turbulentes ? Les bras se croisent placidement sur les poitrines haletant de curiosité. Pressentent-ils, ces Anversois de souche robuste, mais infime, la splendeur, unique de la fête qui se prépare, pour qu'ils y préludent avec cette onction ? Les poupons sur les bras des ménagères s'abstiennent de vagir et les chiens de rue circulent entre cette compacte plantation de jambes sans se faire molester par les gavroches, leurs tourmenteurs naturels.
Et dans cet imposant et magnétique silence, au-dessus de cette mer étale, aux vagues, figées, sur laquelle l'ombre bleue qui descend doucement, pleine de caresses, met une paix, une solennité de plus, tombèrent tout à coup de la plus haute galerie de la tour, où les yeux essayaient en vain de discerner les hérauts d'armes, quelques martiaux éclats de trompettes a l’unisson. Et les soprani des Villes sœurs – Gand et Bruges – hélèrent et acclamèrent à plusieurs reprises la Métropole. Leurs vivats de plus en plus chauds et stridents, étaient suivis chaque fois des appels un peu rauques de l'aérienne fanfare. Après ce dialogue le carillon se mit à tintinnabuler : d'abord lentement et en sourdine comme une couvée qui s'éveille à l'aube dans la rosée des taillis ; puis s'animant, élevant la voix, lançant à la volée une pluie d'accords de jubilation. Un ensoleillement. Alors l'orchestre et les chœurs entrèrent en lice. Et ce fut l'apothéose de la Richesse et des Arts.
Le poète vanta le Grand Marché dans des strophes à l'emporte-pièce, par de sonores et hyperboliques lieux communs auxquels la mise en scène, l'extase de la foule, la musique de Vyvéloy prêtaient une portée sublime. Les cinq parties du monde venaient saluer Anvers, toutes les nations du globe lui payaient humblement tribut, et comme s'il ne suffisait pas des temps modernes et du moyen âge pour frayer à l'orgueilleuse cité sa voie triomphale, la cantate remontait à l'antiquité et engageait pour massiers et licteurs les quarante siècles des pyramides. Tout, l'univers et le temps, la géographie et l'histoire, l’infini et l'éternité, se rapportait, dans cette œuvre, à la ville de Rubens. Et en fermant les yeux, on s'imaginait voir défiler un majestueux cortège devant le trône du peintre triomphal par excellence…
Quand ce fut fini, quand les musiques de la garnison ouvrant la retraite aux flambeaux reprirent, en marche, le thème principal de la cantate, Laurent pincé jusqu'aux moelles, les fibres travaillées par on ne sait quel contagieux enthousiasme, momentanément dépossédé de son moi, emboîta le pas aux soldats, et s'ébranla avec la foule aussi suggestionnée, aussi surexcitée que lui, et, dans laquelle, exceptionnellement, bourgeois et ouvriers, confondus, bras dessus bras dessous, entonnaient à l'unisson à pleins poumons, le chant dithyrambique.
Infatigable, Laurent parcourut tout l'itinéraire tracé au cortège.
L'escorte ondoyante avait beau se renouveler, se relayer à chaque carrefour, l'exalté ne parvenait pas à la quitter. Cette musique de Vyvéloy l'eût conduit au bout du monde. Alors que d'autres se blasaient sur l'héroïsme de cette promenade aux lumières et s'éclipsaient par les rues latérales, lui se sentait de plus en plus d'intrépidité aux jambes et de flammé au cœur. D'ailleurs d'antres manifestants remplaçaient ceux qui faisaient défection et la physionomie du cortège variait avec les quartiers qu'il traversait. Le long de la rade et des bassins, Laurent sentit le coude à des matelots et à des débardeurs ; au cœur de la cité, il se mêla aux garçons de magasin et aux filles de boutique ; sur les boulevards de la ville neuve il se retrouva avec des fils de famille et des commis de « firmes » souveraines ; enfin, dans les dédales du quartier Saint-André, habitacles des claquedents et des va-nu-pieds, des gaillardes en cheveux lui prirent familièrement le bras et de fauves voyous, peut-être des runners, l'emportèrent dans leur farandole. Tout à Anvers, tout à Rubens. Laurent n'entendait que la cantate, il en était rempli et saturé. Il reconduisit les musiques jusqu'à l'étape finale, triste et presque déçu lorsque les canonniers, étant descendus de cheval, soufflèrent les lanternes vénitiennes accrochées à leurs lances de bois et étouffèrent sous leurs bottes les dernières torches de résine.
V. L’ÉLECTION
– Ah ! ville superbe, ville riche, mais ville égoïste, ville de loups si âpres à la curée qu'ils se dévorent entre eux lorsqu'il n'y a plus de moutons à tondre jusqu'aux os. Ville selon le cœur de la loi de Darwin, Ville, féconde mais marâtre. Avec ta corruption hypocrite, ton tape-à-l'œil, ta licence, ton opulence, tes instincts cupides, ta haine du pauvre, ta peur des mercenaires ; tu m'évoques Carthage… N'avez-vous pas été frappés, vous autres, du préjugé qu'ils entretiennent, ici, contre le soldat ? Même les Anversois qui ont de leurs garçons à l'armée, sont impitoyables et féroces à l'égard des troupiers. Nulle part en Belgique on n'entend parler de ces terribles bagarres entre militaires et bourgeois ; de ces guets-apens où des assommeurs tombent dessus au permissionnaire ivre, regagnant la caserne faubourienne ou le fort perdu à l'extrémité de la banlieue [6]…
Qui avons-nous à la tête d'Anvers ? Des magistrats vaniteux, sots, gonflés comme des suffètes. Leur dernier trait, Bergmans, le connais-tu, leur dernier trait ?
Un jour, n'ayant plus rien à démolir et à rebâtir, chose qui a toujours ennuyé des magistrats communaux, ils décrètent de supprimer la Tour Bleue, un des derniers spécimens, en Europe, de l'architecture militaire du quatorzième siècle. Tout ce que la ville compte encore d'artistes et de connaisseurs ici s'émeut, proteste, envoie à la « Régence », des pétitions… Devant cette opposition, que font nos augures ? Ils daignent consulter l'expert par excellence, Viollet-Le-Duc. Cet archéologue conclut avec tous les artistes en faveur du maintien de la vieille bastille. Voyez-vous cet original qui se permet d'être d’un autre avis que ces marchands omnisapients ? Aussi n'ont-ils rien de plus pressé que de raser, sans autre forme de procès, la vénérable relique…
Et pourtant, ville sublime. Tu as raison, Rombaut, de vanter son charme indéfinissable, qui clôt la bouche à ses détracteurs. Nous ne pouvons lui en vouloir de s'être donnée à cette engeance de ploutocrates. Nous l'aimons comme une femme lascive et coquette, comme une courtisane perfide et adorable. Et ses parias même ne consentent pas à la maudire !
C’était au cabaret de la Croix Blanche, sur la Plaine du Bourg, Laurent Paridael qui déblatérait ainsi devant Bergmans, Rombaut et Marbol.
– Bon, voilà le jeune servant des dockers qui prend le mors au dents ! dit Vyvéloy. Et tout cela parce qu'il a trouvé que dans ma cantate je faisais trop large la part du chauvinisme, aux dépens des communiers de Bruges et de Gand… Parbleu ! On comprend l'esprit de clocher, quand ce clocher est la flèche de Notre-Dame !
– Absolument, approuva Bergmans. D'ailleurs, Anvers se relèvera moralement aussi. Elle secouera le joug qui la dégrade. Elle sera rendue à ses vrais enfants. Tu le verras, Paridael, l'insubordination gagne les masses opprimées. Je te promets du neuf pour bientôt. Un souffle d'émancipation et de jeunesse a traversé la foule ; il y a mieux ici qu'une riche et superbe ville ; il y a un peuple non moins intéressant qui commence à regimber contre des mandataires qui le desservent et le compromettent.
La prédiction de Bergmans ne tarda pas à se réaliser. Depuis longtemps il y avait de l'électricité dans l'air.
La véhémente cantate de Vyvéloy ne contribua pas dans une faible mesure à ce réveil de la population.
Les riches, en prenant l'initiative d'un jubilé de Rubens, ne s'attendaient pas à provoquer cette fermentation.
Il arriva que les peintres delà Renaissance évoquèrent les pasteurs d'hommes, de ce seizième siècle, les Guillaume le Taciturne, les Marnix de Sainte-Aldegonde. On exhuma pour s'en parer ce quolibet insultant jeté aux patriotes de l'époque de Charles-Quint et de Philippe II, ce nom de gueux dont les vaillants ancêtres aussi s'étaient enorgueillis comme d'un titre honorifique.
La noblesse, momifiée, désintéressée de tout, et de plus ultramontaine, se réjouit peut-être des désagréments que le courant nouveau préparait aux parvenus, mais n'osa patronner un parti placé sous le vocable et le drapeau des adversaires victorieux de la catholique Espagne.
L'effervescence régnait surtout dans le peuple des travailleurs du Port.
Des conflits isolés avaient déjà éclaté entre Béjard et les « Nations». Ce furent d'abord des tiraillements à propos d'un mémoire à payer par l'armateur à l'Amérique. L'armateur refusait toujours de régler son compte, lorsque arriva de Riga un bateau-grenier avec chargement à la consignation du payeur récalcitrant.
Béjard s'adressa, pour le déchargement de ces marchandises, à une Nation rivale de sa créancière, mais dans de pareilles circonstances, les corporations font cause commune et la Nation sollicitée refusa l'entreprise à moins que le négociant ne s'acquittât d'abord envers leurs concurrents.
Il s'adressa à une troisième, à une quatrième Nation, partout il se buta au même refus.
Entêté et furieux, il fit venir des dockers de Flessingue, le port de mer le plus proche. Les débardeurs anversois jetèrent plusieurs Hollandais dans les bassins et les en retirèrent à demi noyés pour les y replonger encore, si bien que tous reprirent le même jour le train pour leur patrie, en jurant bien qu'on ne les repincerait plus à venir contrecarrer, dans leurs grèves, ces Anversois expéditifs. De fait, lorsque ces manœuvriers aussi placides que vigoureux s'avisaient de devenir méchants, ils le devenaient à la façon des félins.
Béjard, en apprenant la désertion des Hollandais après le traitement qui leur avait été infligé, écumait de colère et jurait de se venger tôt ou tard de Vingerhout et de ces insolentes Nations. Mais comme, entre temps, son blé menaçait de pourrir à fond de cale, il céda aux prétentions des débardeurs.
À quelque temps de là l'occasion se présenta pour lui de rouvrir les hostilités contre cette plèbe par trop séditieuse. On venait d'inventer aux États-Unis, des « élévateurs », appareils tenant à la fois lieu de grues, d'allèges et de compteurs, dont l'adoption pour le déchargement des grains, devait fatalement supprimer une grande partie de la main-d'œuvre et entraîner par conséquent la ruine de nombreux compagnons de nations.
Aussi l'agitation fut grande parmi le peuple quand il apprit que Béjard avait préconisé, dans les conseils de la Régence, l'acquisition de semblables engins.
Le soir où en séance des magistrats municipaux la proposition de Béjard devait être mise aux voix, baes, doyens, compagnons, convoqués par Jan Vingerhout se massaient de manière à représenter une armée compacte et formidable, sur la Grand'Place, devant l'Hôtel de Ville. En costume de travail, les manches retroussées, leurs biceps à nu, ils attendent là, terriblement résolus, poings sur les hanches, le nez en l'air, les yeux braqués vers les fenêtres illuminées. L'air goguenard, pipe aux dents, radieux comme s'il s'agissait d'aller à la danse, Jan Vingerhout circule de groupe en groupe pour donner la consigne à ses hommes. Quoiqu'il n'ait pas besoin de secrétaire pour la besogne de ce soir, il s'est fait accompagner du jeune Paridael enchanté de la petite explosion qui menace l'odieux Béjard.
– Nous allons rire, mon garçon, fait Jan en se frottant les mains, de manière à faire craquer les os de ses phalanges.
Siska a retenu, non sans peine, son homme à la maison.
Quelques badauds de mine suspecte, du genre des jeunes runners du Doel, s'approchent aussi des solides compagnons, mais Jan n'entend pas s'embarrasser d'alliés compromettants. Il les récuse sans trop les rabrouer toutefois. Les braves gens suffiront à la besogne.
Les policiers ont essayé de disperser les rassemblements, mais ils n'insistaient pas devant la façon très digne et très explicite dans son calme dont les accueillent les mutins.
Une rue assez longue, le Canal au Sucre, sépare la Grand’Place de l'Escaut, mais deux cents mètres ne représentent pas une distance pour ces gaillards, et les argousins, de futés gringalets, ne seraient pas lourds à porter jusqu'à l'eau.
Que vont-ils faire ? se demandent les policiers, alarmés par cette inertie, par l'air résolu et vaguement ironique de ces débardeurs. Les musards du Coin des Paresseux ne sont pas plus offensifs, en attendant le baes qui les abreuve. À ceux qui les interrogent, les travailleurs répondent par certain vade retro aussi bref, qu'énergique, intraduisible dans un autre idiome que ce terrible flamand, et auquel la façon de le faire sonner ajoute une éloquente saveur.
Les croisées de l'aile gauche, au deuxième étage de l'antique Hôtel de ville, sont illuminées. Il parait qu'on délibère encore. Le vote est imminent ; tous, ces gens s'entendent comme marchands en foire.
Neuf heures sonnent. Au dernier coup, voilà que, sur un coup de sifflet de Vingerhout, simultanément les compagnons se penchent, et flegmatiquement, se mettent en devoir de déchausser les pavés, devant eux. Ils vont même vite en besogne, si vite que les alguazils s'essoufflent inutilement à vouloir les en empêcher.
Et alors, Jan Vingerhout, pour montrer comment s'emmanche la partie, envoie adroitement un pavé dans une des fenêtres du Conseil. D'autres bras s'élèvent, chaque bras tient son pavé avec la fermeté d'une catapulte. Mais à un signe de Vingerhout, les hommes remettent leur charge par terre :
– Tout doux, il suffira peut-être d'un simple avertissement.
En effet, un huissier accourt sur la place, essoufflé et avisant Vingerhout, lui dit que ces messieurs du Conseil ajournent leur décision.
– Que restent-ils fagoter alors ? demande Vingerhout, toujours sollicité par les croisées illuminées.
Au fond, ce terrible Vingerhout est un malin compère, mais un bon compère ; il connaît les aîtres de l'Hôtel de ville, il savait que le pavé lancé tomberait dans un espace vide de la salle. Mais il n'avoue cela qu'à Laurent.
Les croisées rentrent dans l'ombre. Bourgmestre, échevins, conseillers sortent du palais communal, penauds, entourés de leur nuée de policiers ; on a mis en réquisition la gendarmerie et la grand'garde, on a télégraphié aux commandants des casernes, Béjard a même voulu demander des secours à Bruxelles. Mais les Nations jugent suffisant le résultat de leur petite manifestation, et, abandonnant leurs pavés, se dispersent lentement, comme de bons géants qu'ils sont, en se contentant d'envoyer une huée bien significative aux conseillers, surtout à M. Béjard, qui a cru très sérieusement qu'on allait le traiter comme le diacre Etienne.
Intimidé, le Conseil décide sagement d'enterrer la question par trop brûlante jusqu'après les élections pour le renouvellement des Chambres législatives.
Bergmans ayant pris nettement parti pour les débardeurs et s'étant porté candidat contre Freddy Béjard, les baes des corporations embrassèrent chaleureusement sa cause. Laurent était entré dans une société d'exaltés de son âge, la Jeune Garde des Gueux, recrutée parmi les apprentis et les fils de petits employés.
À mesure qu'elle avançait, la période électorale s'exaspérait. Les riches, maîtres des journaux, se livraient à une débauche d'affiches tirant l'œil, multicolores, énormes, de brochures, de pamphlets, imprimés en grosses lettres.
L'agitation se propageait dans les classes inférieures.
– Qu'importe ! rageait Béjard, ces maroufles ne sont pas électeurs. Je serai élu tout de même.
En effet, la plupart des « censitaires » en tenaient pour les riches. Mais ceux-ci, craignant que l'impopularité de Béjard ne compromît le reste de leur liste, essayèrent d'obtenir, de l'armateur qu'il remît sa candidature à des temps meilleurs. Il refusa net. Il attendait depuis trop longtemps ; on lui devait ce siège pour le dédommager des longs et précieux services rendus à l'oligarchie. Ils n'insistèrent point. D'ailleurs, il les tenait. Mille secrets compromettants, mille cadavres existaient entre eux et lui. Ses doigts crochus de marchand d'ébène tenaient l'honneur et la fortune de ses collègues. Puis ce diable d'homme possédait le génie de l'organisation, au point de se rendre indispensable. Lui seul savait mener une campagne électorale et faire manœuvrer les cohortes de boutiquiers en chatouillant leurs intérêts. Sans son concours, autant se déclarer vaincu d'avance.
Peu scrupuleux, quant aux moyens, ses suppôts multipliaient les tournées dans les cabarets, et les visites à domicile. Ils avaient mission de voir les boutiquiers gênés, de leur promettre des fonds ou des clients. Aux plus défiants, on alla jusqu'à remettre une moitié de billet de banque, l'autre moitié devant leur être délivrée le soir même du scrutin, si le directeur de la Croix du Sud l'emportait.
D'autres employés de son imposante administration électorale, compliquée et nombreuse comme un ministère, confectionnaient des billets de vote marqués, destinés aux électeurs suspects ; d'autres encore se livraient à des calculs de probabilités, à la répartition du corps électoral en bon, mauvais et douteux. Les prévisions donnaient au moins un millier de voix de majorité au Béjard. Il continuait pourtant d'en acheter, répandant à pleines mains l'argent de l'association, puisant même dans sa propre caisse. Pour réussir il se serait ruiné.
Ses courtiers travaillaient l'imagination des campagnards de l'arrondissement, gens orthodoxes comme la noblesse et, de plus, superstitieux. Ignorant l'histoire, ces ruraux prenaient au pied de la lettre le nom de gueux. Le moindre petit terrien entretenu dans ses terreurs par les récits des vieux, aux veillées, se voyait déjà mis au pillage, battu et incendié comme sous les cosaques, et, par anticipation, la plante des pieds lui cuisait. Pas souvent qu'il voterait pour des grille-pieds et des chauffeurs. Au village, les courtiers colportaient naturellement, sur Bergmans et les siens, des fables monstrueuses, des calomnies extravagantes, d'un placement difficile à la ville, mais qui passaient auprès de ces rustauds, comme articles d'évangile.
Door den Berg n'avait à opposer à ces menées que son caractère, son talent, sa valeur personnelle, ses convictions chaudes, son éloquence de tribun, sa figure avenante ; dans la bataille à coups de journaux, d'affiches et de brochures, il avait le dessous ; en revanche, dans les réunions publiques, autrement dites métingues, où se discutaient les mérites des candidats, il tenait le bon bout. D'ailleurs, il fallait être inféodé au clan de Béjard, pour prendre encore au sérieux sa prose et son éloquence, ou plutôt celles de Dupoissy, car c'était son familier qui lui confectionnait ses discours et ses articles.
Rien d'écœurant comme ces tartines humanitaires, collections de lieux communs dignes des pires gazettes départementales, ramassis de clichés, aphorismes creux, mots redondants et sans ressort, rhétorique si basse et si déclamatoire que les mots même semblent refuser de couvrir plus longtemps ces mensonges et ces saletés.
L'avant-veille du scrutin, il y eut un grand métingue aux Variétés, immense salle de danse où les parades politiques alternaient avec les mascarades des jours gras.
Pour la première fois depuis des années qu'il régalait les gobets et ses créatures de harangues doctrinaires prononcées toujours de la même voix nasarde et monocorde, Béjard y fut hué d'importance : on ne le laissa même pas achever.
La salle houleuse, électrisée par une copieuse philippique de Bergmans, se porta comme une terrible marée à l'assaut du bureau, sur l'estrade, en passant par-dessus la cage de l'orchestre, renversa la table, foula aux pieds et mit en loques le tapis vert, inonda le parquet de l'eau des carafes destinées aux orateurs, fit sonner à coup de bottes la cloche du président et peu s'en fallut qu'on n'écharpât les organisateurs du métingue.
Heureusement, en voyant approcher le cyclone, ces gens prudents avaient battu en retraite, patrons et candidats réunis, et cédé la place au peuple.
Il se leva enfin, le jour des élections, un jour gris d'octobre ! Dès le matin, les tambours de la garde civique battant l'appel des électeurs, la ville s'animait d'une vie extraordinaire qui n'était pas l'activité quotidienne, l'affairement des commis et des commerçants, le camionnage et le trafic. Des électeurs endimanchés sortaient de chez eux, montrant sous le tuyau de poêle la physionomie grave, un peu pincée, de citoyens conscients de leur dignité. Ils gagnaient, le bulletin à la main, d'un pas rapide, les bureaux électoraux : bâtiments d'écoles, foyers de théâtres et autres édifices publics.
De jeunes gandins, fils de riches, exhibaient à la boutonnière une cocarde orange, couleur du parti, réquisitionnaient les voilures de place pour charroyer les électeurs impotents, malades ou indifférents. Ils se donnaient de l'importance, consultaient leurs listes, s'abordaient avec des raines mystérieuses, mordillaient le crayon qui allait leur servir à « pointer » les électeurs. Des omnibus étaient allés prendre très tôt dans les bourgades éloignées les électeurs ruraux, ils rentraient en ville avec leur chargement humain. Ébaubis, rouges, les paysans se groupaient par paroisses ; et des soutanes noires allaient de l'un à l'autre de ces sarraux bleus pour leur faire quelque recommandation et contrôler leurs billets de vote. Des groupes se formaient devant les portes des bureaux. On lisait les affiches encore humides, où l'un ou l'autre des candidats dénonçait une « manœuvre de la dernière heure » de ses adversaires et lançait une suprême proclamation, laconique et à l'emporte-pièce. Presque tous ces manifestes commençaient par « Électeurs, on vous trompe ». Des marchands aboyaient les journaux fraîchement parus. De chaque côté de la porte se tenait un voyou, porteur d'un écriteau engageant à voter pour l'une ou l'autre liste. De groupe en groupe, de cocarde bleue à rosette orange, s'échangeaient des regards de défi ; des gens généralement inoffensifs prenaient un air terrible, et des mains tourmentaient fiévreusement le pommeau de leurs cannes… On causait beaucoup, mais à voix basse, comme des conspirateurs.
Cependant, chaque bureau étant pourvu d'un président et de deux « scrutateurs », les opérations du vote commençaient. À l'appel de leurs noms, dans l'ordre alphabétique, les votants se frayaient un passage à travers l'attroupement, passaient derrière une cloison, se présentaient devant les trois hommes graves. Ceux-ci siégeaient derrière la table, recouverte du traditionnel tapis vert et supportant une vilaine caisse noire et cubique, pompeusement qualifiée d'urne. L'électeur promenait un instant sous le nez soupçonneux et binocle du président son bulletin plié en quatre et timbré aux armes de la ville, et le laissait choir dans l'urne fendue comme un tronc, une tire-lire ou une boite à lettres. Il y en avait que cette simple action impressionnait terriblement ; ils perdaient contenance, laissaient tomber leur canne, se confondaient en salamalecs et s'obstinaient à vouloir loger leur papier dans l'encrier du scrutateur.
À la cloison, du côté de la salle d'attente, s'étalaient les listes électorales ; des myopes s'y collaient le nez et des doigts sales s'y promenaient comme sur l'horaire affiché dans les gares. Il puait le chien mouillé et le bout de cigare éteint, dans cette salle de classe où traînaient aussi des relents d'écoliers pauvres et de cuistres mangeurs de charcuterie.
Il y avait des abstentions. Des « jeunes gardes » des deux partis, de faction à l'entrée, reconnaissaient leurs hommes et envoyaient des voitures prendre, en prévision du contre-appel, les manquants de leur bord. La kyrielle des noms, la procession des votants se déroulaient, lamentables. Des incidents en relevaient de loin en loin la monotonie. Un quidam omis ou rayé se fâchait ; des homonymes se présentaient l'un pour l'autre ; on persistait à appeler des morts qu'on aurait absolument voulu voir voter, en revanche on tentait de persuader à des vivants qu'ils n'étaient plus de ce monde.
Au sortir de l'isoloir leur expression béate et soulagée, leur air guilleret aurait donné à supposer qu'ils s'étaient isolés pour d'autres motifs.
Les opérations du vote, appel et contre-appel, duraient jusqu'à midi, puis commençait le dépouillement. On ne savait rien, mais on supputait les résultats. « Peu d'abstentions ! »
Les cocardes oranges se plaignaient à la fois de l'affluence des blouses, des gens gantés et des tricornes ; en revanche, les bleus s'inquiétaient du contingent extraordinaire de baes de Nations, de petits-commerçants et d'officiers patriotes.
Personne ne rentrait chez soi ; tous mangeaient mal dans les tavernes bourrées de consommateurs, et la fièvre, l'anxiété séchant les gosiers, ils s'enivraient à la fois de bière et de paroles.
On commençait à se masser, le nez en l'air, sur la Grand-Place devant le local de l’» Association », le club de Béjard et des riches, où viendraient s'encadrer tout à l'heure, entre les châssis des huit fenêtres du premier, les résultats des vingt-six bureaux ; et aussi au port, devant l'estaminet de la Croix Blanche, où se réunissaient les « Nationalistes », partisans de Bergmans.
Une pluie fine trempait les badauds, mais la curiosité les rendait stoïques. Des camelots continuaient de glapir l'article du jour, les cocardes bleues ou oranges.
Il y avait de l'orage et de la menace dans la foule nerveuse et taciturne, grossie à présent de beaucoup d'ouvriers, de petits employés, d'étudiants, ne payant pas le cens. Enragés de ne pas avoir pu donner leur voix à Door den Berg, ils nourrissaient au fond de leur cœur un violent désir de manifester d'une autre façon leurs préférences.
Aussi, à présent, les cocardes bleues dominaient, dans la foule. Les ouvriers les piquaient à leur gilet de laine. Des rixes avaient éclaté dans la matinée, aux abords des bureaux ou votaient les campagnards. Aussi, intimidés par les regards de haine que leur jetaient les compagnons des bassins, les sarraux s'empressaient-ils, leur voix donnée selon le cœur de leur curé, de regrimper en toute hâte sur les impériales et de mettre des lieues de polders ou de bruyères entre eux et les remparts de la métropole.
Les affiliés s'entassaient dans les salons mêmes de l'Association, où siégeaient, attendant les résultats, les chefs et les candidats du parti. La voix métallique et acerbe de Béjard dominait le bourdonnement des colloques ; Dupoissy, bénisseur et inspiré ; M. Saint-Fardier, turbulent, agressif, parlant de se débarrasser à coups de fusil de ce Bergmans et de tout ce sale peuple ; M. Dobouziez, sobre de paroles, vieilli, l'air soucieux, peu mêlé à la politique active et maugréant à part lui, contre l'ambition coûteuse de son gendre ; enfin les jeunes Saint-Fardier, bâillant à se démantibuler la mâchoire, regardaient, en tapotant les vitres, le populaire s'amasser sur la place.
À la Croix Blanche, Door n'avait pas assez de ses mains pour presser toutes celles qui tenaient à secouer les siennes. L'affection, l'exubérance, la sincérité de ces natures frustes et droites le touchaient vivement.
Laurent, les Tilbak, Jan Vingerhout, Marbol et Vyvéloy ne restaient pas en place, sortaient, allaient aux informations, couraient au bureau central où se faisait le dépouillement général.
Les premiers résultats, favorables tour à tour à Béjard et à Bergmans étaient accueillis, par des huées à l'Association, par des vivats à la Croix Blanche, ou réciproquement. Mais les manifestations de rassemblée des riches trouvaient chaque fois un écho contradictoire sur la Place. Ainsi, l'affichage aux fenêtres de l'Association, des chiffres de majorité attribués à Béjard fit partir des applaudissements timides promptement étouffés sous des grognements et des sifflets ; le contraire se produisait lorsque la chance avait favorisé « notre Door ».
Quelque temps les suffrages se balancèrent. La majorité des censitaires de la ville se déclaraient pour le tribun. Déjà la foule, dans la rue et à la Croix Blanche, se trémoussait d'allégresse ; on se donnait l'accolade, on félicitait Bergmans. Paridael voulait même qu'on arborât le drapeau des gueux, orange, blanc et bleu, avec les deux mains fraternellement enlacées, les mains amputées et écartelées sur l'écusson d'Anvers. Bergmans, moins optimiste, eut de la peine à empêcher ses amis de triompher trop tôt. Il avait raison de se défier. Nos enthousiastes comptaient sans les campagnes. Non seulement les bureaux ruraux comblèrent rapidement l'écart des voix entre les deux listes, mais le total de ces suffrages campagnards grossissant, s'enflant toujours, engloutit comme une stupide marée, submergea sous ses flots les légitimes espérances de la majorité des citadins.
VI. TROUBLES
Ce fut d'abord de la consternation, ensuite de la rage, qui s'emparèrent de la population anversoise, à l'issue définitive de la lutte. Les riches l'emportaient, mais avec le concours de la corruption et de la bêtise. Les campagnards avaient opposé leur veto à la volonté de la grande ville. Les vainqueurs, qui ne pouvaient se dissimuler l'aloi équivoque de ce triomphe, commirent la faute de vouloir le célébrer et, assez penauds, intérieurement, ils payèrent d'audace, affectèrent de la jubilation et déterminèrent, chez la foule, par leurs bravades et leurs défis grimaçants, l'explosion des sentiments hostiles qu'elle contenait, à grand'peine, depuis le matin. Toutefois ils n'osèrent pas se montrer au balcon de leur club où les appelait ironiquement la fourmilière, la houle de têtes convulsées, pâles et blêmes de dépit, ou rouges et échauffées, rictus sardoniques, lèvres pincées, yeux qui rencognent des larmes de rage.
Cinq heures. La nuit est tombée. Les riches regagnent leurs hôtels de la ville neuve, en se glissant timidement a travers la foule qui continua de stationner sur le forum.
Tous restent là angoissés, ne sachant a quoi se résoudre, les poings fermés, certains que « cela ne se passera pas ainsi », mais ignorant comment « cela se passera ».
En prévision des troubles, le bourgmestre a consigné la garde civique, les postes sont doublés, la gendarmerie est sous les armes.
Bergmans traversant la place a été reconnu, acclamé, porté en triomphe. Il se dérobe comme il peut à ces ovations : depuis le matin, il exhorte au calme et à la résignation tous ceux qui l'approchent : « Nous vaincrons la fois prochaine ! »
Le drapeau orange flottant au balcon de l'Association nargue et exaspère ses amis. Dans les premiers moments, après la nouvelle de la défaite, la consternation des vaincus a permis aux riches d'arborer impunément leur pavillon.
Tout à coup une poussée se produit. Paridael et ses camarades de la « Jeune Garde des Gueux », travaillant des coudes, sont parvenus jusqu'au Club.
Porté sur les épaules de Jan Vingerhout, Laurent, leste comme un singe, s'aidant des pieds et des mains, s'accrochant aux moindres saillies, parvient jusqu'au balcon, l'escalade, empoigne la hampe, essaie de la dégainer, finit par s'y suspendre, en tirant sur l'étoffe : on entend un craquement, le bois se brise…
La foule jette un cri d'anxiété.
Le drapeau est conquis, mais le hardi conquérant s'abat dans le vide avec son trophée. Il se serait rompu le cou sur le pavé si le vigilant et solide Vingerhout n'eût été là. Notre hercule reçoit son ami dans ses bras, sans fléchir sur ses jarrets, comme il attraperait à la volée une balle de riz ou un sac de céréales. Puis il le dépose tranquillement à terre avec un juron approbateur. Le jeune gars, remis sur ses jambes, agite son drapeau au-dessus des têtes. D'orageuses acclamations éclatent et se prolongent. Des agents de police tentent de prendre Laurent au collet. Des centaines de mains, à commencer par la poigne de Vingerhout, le dégagent, bousculent les flics et les réduisent à l'impuissance.
Les jeunes gens prennent la tête d'une colonne immense qui s'ébranle après trois bordées de sifflets envoyées au balcon dégarni, en chantant à pleins poumons l’Hymne des Gueux, composé par Vyvéloy, ou bien un refrain flamand, improvisé en l'honneur de leur chef.
Mais au loin, une musique entonne l'air du parti des riches. D'où peut partir ce défi ? Un frisson électrique parcourt l'immense cortège.
Sus aux téméraires ! Et de traverser au pas gymnastique la place de Meir.
Au tournant de cette place, à l'endroit où elle s'étrangle, en boyau, les Gueux tombent sur une bande de jeunes manifestants à cocardes bleues, accompagnés d'un orphéon et de torches. Avec une clameur terrible, ils s'abattent sur ces provocateurs. En un rien de temps, les torches sont arrachées des mains des porteurs, la grosse caisse trouée d'un coup de gourdin, la bande balayée, culbutée, sans que les assaillis aient opposé la moindre résistance.
Et quand le gros et la queue de la colonne débouchent à leur tour a l'endroit où vient d'avoir lieu la bagarre, les fuyards sont déjà loin.
Cependant les Gueux apprennent que dans la ville neuve, au boulevard Léopold, les riches, se croyant à l'abri des atteintes populaires, ont pavoisé et illuminé leurs façades.
– Chez Béjard ! braillent les manifestants. Depuis la place de Meir, la manifestation revêt un caractère sinistre. Les rangs des ouvriers, des débardeurs et des petits bourgeois se sont éclaircis, pour faire place à une traînée de gaillards sans vergogne. Ceux-ci ne chantent plus l'Hymne des gueux, mais ils hurlent des refrains incendiaires.
En route, avenue des Arts, un runner jette un pavé à travers la porte de l'hôtel Saint-Fardier, dont les fenêtres sont garnies de lampions. Les vitres volent en éclats. En agitant un rideau de soie, le vent le rapproche de la flamme des lampions ; l'étoffe prend feu. La foule féroce se trémousse et acclame l'incendie, ce complice inattendu.
– C'est cela. Faisons flamber la cambuse !
Mais un peloton de gendarmes, la police et une compagnie de gardes civiques les empêchent de pousser cette plaisanterie jusqu'au bout.
Tandis qu'une partie de la colonne s'attarde et donne du fil à retordre aux gendarmes, les autres en profitent pour déboucher au boulevard Léopold par des rues latérales, presque en face de l'hôtel Béjard.
– À bas Béjard !… À bas le marchand d'âmes ! … À bas le négrier !… À bas le tourmenteur d'enfants !…
Des explosions de cris sanguinaires affrontent la demeure de l'oligarque. A-t-il eu vent de ce qui se préparait, mais Béjard, l'étranger, l'élu des paysans s'est abstenu d'illuminer.
Les volets du rez-de-chaussée sont clos et il semble qu'il n'y ait pas de lumière a l'intérieur.
Mais cette discrétion ne désarme pas les manifestants. Ils se sont rués comme des fous sur la maison maudite. Les rôdeurs et les vagabonds, composant à présent le gros du cortège, excellent surtout dans les démolitions. Les volets fendus sont arrachés des fenêtres, les glaces mises en pièces.
– À mort ! À mort ! hurlent les émeutiers.
Confiant le drapeau à son fidèle Vingerhout, Paridael s'interpose et veut les empêcher de se jeter dans la maison, car subitement toute sa pensée est retournée à la femme de l'impopulaire armateur, à sa cousine Gina. Qu'on écharpe et qu'on pende Béjard, il ne s'en soucie guère, qu'on ne laisse plus pierre sur pierre de la maison, et il s'associera volontiers aux démolisseurs, mais il donnerait jusqu'à sa dernière goutte de sang pour épargner une frayeur et une émotion à Mme Béjard !
Ah ! misérable, comment n'a-t-il pas prévu plus tôt ce danger !
Il appelle Vingerhout à l'aide. Mais ils sont débordés. Impossible d'endiguer la masse des furieux. Il n'y a plus qu'à les suivre, ou mieux à les précéder dans la maison, afin de porter secours à la jeune femme. Laurent saute par une croisée dans le selon. Déjà une nuée de forcenés s'y démènent comme des épileptiques, brisent les bibelots et les meubles, déchirent les rideaux, décrochent les cadres, percent et trouent les coussins, arrachent les tentures et les réduisent en charpie, jettent les débris dans la rue, saccagent, dégradent tout ce qui leur tombe sous la main.
Laurent les a devancés dans la pièce voisine ; elle est obscure et déserte. Il pénètre dans un troisième salon : personne ; dans la salle à manger : personne encore ; il fouille l'orangerie, la serre, sans rencontrer âme qui vive.
Cependant les autres le suivent. Fatigués de tout casser, ils voudraient faire son affaire à Béjard ! Laurent se lance dans le vestibule, avise l'escalier, le monte quatre à quatre.
Il atteint le palier du premier étage, pénètre dans les chambres à coucher, dans un cabinet de toilette, inspecte une autre pièce. Personne. Il appelle : « Gina ! Gina ! » Pas l'ombre de Gina. Il continue ses perquisitions, fouille tous les coins, ouvre les placards et les armoires, regarde sous les lits. Toujours rien. Elle n'est pas dans les mansardes, elle n'est pas dans le grenier. En descendant, désespéré, il se cogne aux meneurs qui lui réclament Béjard. Pour un peu ils accuseraient Paridael d'avoir fait échapper son ennemi. Heureusement Vingerhout survient à temps pour l'arracher de leurs mains.
Cependant, au dehors le tumulte augmente, Laurent descend au jardin, visite les écuries, sans plus de succès.
Enfin, il se résout à quitter cette maison déserte. Dans la rue, où des centaines de badauds, mêlés aux émeutiers, assistent avec une curiosité béate au sac de cette demeure luxueuse, il apprend par les domestiques de Béjard que leurs maîtres dînent chez Mme Athanase Saint-Fardier. Rassuré, il s'éloigne du théâtre de la saturnale, lorsque des battues furieuses résonnent dans le lointain.
– La garde civique à cheval ! Sauve qui peut !
Pillards et destructeurs interrompent leur besogne.
Le demi-escadron approche au galop. Arrivé à une centaine de mètres de la cohue, le capitaine, Van Frans, le banquier, ami de la famille Dobouziez, commande halte.
Tous riches et fils de riches, cavaliers de parade, montés sur des bêtes de race, fiers de leur bel uniforme vert sombre, de leur tunique à boutons d'argent et à brandebourgs noirs, de leur pantalon à bande amaranthe, de leur talpak d'astrakan à chausse rouge et à gland d'argent. Leurs montures ont des chabraques assorties à l'uniforme, aux coins desquelles sont brodés des clairons d'argent, et le manteau d'ordonnance enroulé sur le devant de la selle.
Pâles, l’air ému, les yeux brillants, ils font caracoler et piaffer leurs chevaux. Comme ils se sont arrêtés, les mutins s'enhardissent et leur lancent des moqueries : soldats de carton ! polichinelles ! cavaliers des dimanches ! Laurent reconnaît Athanase et Gaston Saint-Fardier, et entend le premier, qui pousse son cheval en avant, dire à Van Frans : « Chargerons-nous bientôt ces voyous, commandant ? » En passant avenue des Arts, les deux frères ont aperçu les dégâts causés à la maison paternelle, et ils brûlent d'impatience de venger cet affront.
Jusqu'à présent, le service de cet escadron d'honneur avait été une récréation, un simple sport, un prétexte à promenades et à excursions, à parties de campagne. Ce n'était pas de leur faute, à ces jolis dilettanti de l'uniforme, si cette gueusaille les obligeait de se prendre au tragique.
– Sabre… clair !… commande Van Frans d'une voix un peu émue. Et les lames vierges, tirées du fourreau avec un bruissement métallique, mettent une flamme livide au point ganté de chaque cavalier.
Il n'en faut pas plus pour que la panique gagne la bande des émeutiers. La masse fonce en avant et se jette, à droite et à gauche, dans les rues latérales. Les plus hardis courent se garer sur le trottoir d'en face ou entre les arbres de l'avenue.
– Chargez ! commande alors seulement Van Frans… En avant !
Et l'escadron part au grandissime galop ; étriers et fourreaux s'entrechoquent, le pavé s'incendie comme une enclume.
Après avoir dépassé les rassemblements et feint de donner la chasse aux fuyards, les cavaliers font halte, demi-tour et chargent une seconde fois dans la direction opposée.
La police achevait de disperser les derniers rassemblements et, en nombre à présent, opérait des arrestations, pinçait les meneurs.
Pourchassés de ce côté, les plus acharnés se résignaient à aller manifester ailleurs.
En tournant le coin d'une rue, Laurent se trouva nez à nez avec Régina. La nouvelle des émeutes venait de surprendre les Béjard à table, et tandis que le mari se rendait à l'Hôtel de ville pour se concerter avec ses amis, Gina, malgré les efforts pour la retenir, était sortie seule, curieuse de constater l'impopularité de l'élu.
Laurent la prit par le bras : – Venez, Régina… Vous ne pouvez rentrer chez vous ; votre hôtel est une ruine, la rue même est mauvaise pour vous… Retournez plutôt chez votre père…
Elle vit qu'il portait à la casquette les couleurs des partisans de Bergmans :
– Vous faites cause commune avec eux ; vous étiez de la petite expédition chez moi… Vrai, Laurent, il ne vous manquait plus que cela… C'est du propre !
– Ce n'est pas le moment de récriminer et de me dire des choses désagréables ! fit Paridael avec un aplomb qu'il n'avait jamais eu de la vie en lui parlant. Venez-vous ?
Frappée par son air de résolution, matée, elle se laissa entraîner et prit même son bras… Il la fit monter dans la première voiture qu'ils rencontrèrent, jeta au cocher l'adresse de M. Dobouziez et s'assit en face d'elle, sans qu'elle eût risqué une observation.
– Excusez-moi, dit-il. Je ne vous quitterai que lorsque je vous saurai en lieu sûr.
Elle ne répondit pas. Ils ne desserrèrent plus les dents.
Les genoux de Laurent frôlaient ceux de la jeune femme ; leurs pieds se rencontrèrent, elle se retirait avec des soubresauts effarouchés et se rencognait dans le fond de la voiture ou affectait de regarder par la portière. Laurent retenait sa respiration pour mieux écouter la sienne ; il aurait voulu que ce trajet durât toujours… Tous deux songeaient à la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés. Elle gagnait peur : lui se sentait redevenir l'amoureux d'autrefois.
Ils croisaient des runners ivres, brandissant des gourdins au bout desquels étaient attachés des lambeaux d'étoffes arrachés aux meubles et aux tentures des hôtels dévastés. À chaque réverbère, Laurent avait la rapide vision de la jeune femme. L'alarme qu'il causait à sa cousine le chagrinait atrocement. Il lui serait donc toujours un sujet d'aversion et d'épouvante ! Arrivé à la fabrique, il descendit le premier et lui offrit la main. Elle mit pied à terre sans son aide et lui dit, par politesse : «Vous n'entrez pas ? »
– Vous savez bien que votre père a juré de ne plus me recevoir…
– C'est vrai. Je n'y pensais plus… Au fait, je vous dois des remerciements, n'est-ce pas ? M. Béjard compte des ennemis chevaleresques…
– De grâce, ne raillons pas, cousine… Si vous saviez combien vos sarcasmes sont injustes ?… Croyez plutôt à mon inaltérable dévouement et à ma profonde… admiration pour vous.
– Vous parlez comme une fin de lettre ! fit-elle, avec une tendance à reprendre son ancien ton persifleur, mais cette pointe manquait de belle humeur et de sincérité. « C'est égal… Encore une fois, merci. » Et elle entra dans la maison.
VII. GENDRE ET BEAU-PÈRE
M. Freddy Béjard, nouveau député, donne à ses amis politiques le grand dîner retardé par le sac de son hôtel et l'effervescence populaire.
L'émeute n'a pas duré. Dès le lendemain, les bons bourgeois, que le tumulte de la nuit empêchait de dormir et faisait trembler dans leurs lits, prenaient comme but de promenade les principales maisons ravagées par la populace. Comme les riches ne manquent pas d'imputer ces actes de sauvagerie à Bergmans, malgré les protestations et les désaveux énergiques de celui-ci, M. Freddy Béjard bénéficie de l'indignation des gens rassis et timorés.
Les gazettes persécutées par M. Dupoissy publient durant des semaines des considérations de « l'ordre le plus élevé », sur « l'hydre de la guerre civile » et le « spectre de l'anarchie », si bien que nombre de bons Anversois, détestant Béjard et les étrangers et portés pour Bergmans, craindraient, en continuant d'appuyer celui-ci, de provoquer de nouveaux désordres.
Comme il incombait à la ville de dédommager les victimes des démagogues, M. Béjard n'a rien perdu non plus de ce côté-là, et en a profité pour grossir l'évaluation des dégâts.
De sorte que c'est dans un hôtel repeint et meublé à neuf, plus cossu que jamais, où rien ne porte trace de la visite des runners, que M. le député traite ses féaux et amis ; ses collègues du « banc » d'Anvers au Parlement, ses égaux, les riches : Dobouziez, Vanderling, Saint-Fardier père, les deux jeunes couples Saint-Fardier, Van Frans et autres Van, les Peeters, les Willems, les Janssens, sans oublier l'indispensable Dupoissy.
La belle Mme Béjard préside à ce dîner : plus en beauté que jamais. On l'accable de compliments et de félicitations et Dupoissy ne peut lever son verre sans s'incliner galamment du côté de Mme la représentante.
À la vérité, Mme Béjard est profondément malheureuse.
Ce mari, qu'elle n'a jamais aimé, elle le déteste et le méprise à présent. Il y a longtemps que leur ménage est devenu un enfer : mais par fierté, devant le monde, elle se fait violence et parvient à « représenter » de manière à tromper les malveillants et les indiscrets.
Elle sait que son mari entretient une Anglaise du corps de ballet ; une grande fille commune et triviale, qui jure comme un caporal-instructeur, fume des cigarettes à s'en brûler le bout des doigts et boit le gin au litre.
Honnête et droite, orgueilleuse, mais d'un caractère répugnant aux actions malpropres, Gina a dû subir les confidences cyniques de cet homme. Les infamies de la vie privée ou publique des gens de son monde lui ont été révélées par cet ambitieux. Et, d'un coup, elle a vu clair dans cette société si brillante au dehors ; et elle a compris l'intransigeance de Bergmans, elle l'en a aimé davantage allant jusqu'à épouser au fond du cœur, elle, la fière Gina, la cause de ce révolutionnaire, de ce roi des poissardes, comme l'appelle le député Béjard.
Et pendant les troubles, lorsqu'elle rencontra Laurent Paridael, si elle s'était montrée distante et railleuse c'était par habitude, par une sorte de pudeur, par une dernière fausse honte qui l'empêchait de paraître convertie à des sentiments de générosité qu'elle avait méprisés et blâmés chez lui.
En réalité, lors de l'élection, elle forma des vœux ardents pour Bergmans et maudit le succès de son mari. À telle enseigne que le sac de leur maison avait même répondu ce soir de furie populaire à son état d'énervement, de dépit et de déconvenue. C'est qu'elle appartient, à présent, à Bergmans, qu'elle est sienne de pensées et de sentiments. Mais comme elle ne sera jamais son épouse elle tiendra jusqu'à la mort ces sentiments renfermés au plus profond de son cœur. Elle ne vit plus que pour son fils, un enfant d'un an qui lui ressemble ; et pour son père, à elle, le seul riche qu'elle aime et qu'elle estime encore. Les petites tentatrices, Angèle et Cora, continuent de perdre leur peines en voulant lui inculquer leur philosophie spéciale.
Prendre la vie comme une perpétuelle partie de plaisir, ne se forger aucune chimère, s'attacher modérément de façon à se détacher facilement, profiler de la jeunesse et du sourire des occasions ; fermer les yeux aux choses tristes ou maussades, à la bonne heure. Voyez-les à ce dîner, appétissantes, décolletées, la chair heureuse, rire et bruire comme des plantes vivaces aux souffles conquérants de l'été ; piailler, caqueter, agacer leurs voisins et se lancer, par moments, d'un côté à l'autre de la table, des regards de connivence. Bien naïve leur amie Gina d'héberger des diables bleus et des papillons noirs !
Mme Béjard, souffrant d'une migraine atroce, préside, avec un tact irréprochable, ce dîner qui n'en finit pas.
Combien elle voudrait relever les vilenies dont, pour flatter le maître de la maison, ses familiers, Dupoissy en tête, saupoudrent la renommée de Bergmans.
– Oh ! très drôle, très fin… Avez-vous entendu ?
Et le Sedanais s'empresse de répéter, à mots discrets, à Gina la petite malpropreté. Si elle n'y applaudit pas, du moins lui faut-il approuver du sourire, d'une flexion de tête.
Béjard s'essaie à son rôle nouveau. Il disserte et papote à l'envi avec ses collègues, jargonne comme eux, rapports, enquêtes, commissions, budgets.
M. Dobouziez parle encore moins que d'habitude. Savoir sa fille malheureuse, l'a vieilli, et elle a beau faire bonne figure et affecter du contentement, il l'aime trop pour ne pas deviner ce qu'elle lui cache. Veuf depuis un an, ses cheveux ont blanchi, sa poitrine ne se bombe plus si fièrement qu'autrefois, et son chef autoritaire s'incline. Il faut croire que quelques-uns de ses problèmes sont restés sans solution ou que l'algébriste a trouvé des résultats incompatibles ?
Au dessert, on prie Mme la représentante de chanter. Régina a encore sa belle voix, cette voix puissante et souple de la soirée d'Hémixem, mais enrichie aussi de cette expression, de cette mélancolie, de ce charme de maturité qu'a revêtu sa physionomie autrefois trop sereine. Et ce n'est plus la valse capricante de Roméo qu'elle gazouille aujourd'hui, c'est une mélodie large et passionnée de Schubert, l’Adieu.
Assis dans un coin, à l'écart, M. Dobouziez est suspendu aux lèvres de sa fille, lorsqu'une main se pose sur son épaule. Il sursaute. Et Béjard, à mi-voix :
– Passons un moment dans mon cabinet, beau-père, j'ai un mot à vous dire…
L'industriel, un peu désappointé d'être arraché à une des seules distractions qui lui restent encore, suit son gendre, frappé par l'étrange intonation de la voix du député.
Installés l'un en face de l'autre devant le bureau, Béjard ouvre un tiroir, furette dans un casier, tend à Dobouziez une liasse de papiers.
– Veuillez prendre connaissance de ces lettres !
Il se renverse dans son fauteuil, ses doigts tambourinent les coussinets de cuir, tandis que ses yeux suivent sur la physionomie de Dobouziez les impressions de la lecture.
Le visage de l'industriel se décompose ; il pâlit, sa bouche se plisse convulsivement, tout à coup il s'interrompt.
– Me direz-vous ce que cela signifie ? fait-il en regardant son gendre avec plus d'angoisse que de courroux.
– Tout simplement que je suis ruiné et qu'on proclamera ma faillite avant un mois, avant quinze jours peut-être, à moins que vous ne veniez à mon aide…
– À votre aide ! » Et Dobouziez se cabre. « Mais malheureux, je me suis déjà enfoncé, pour vous, dans des difficultés dont je ne sais comment sortir !… Et en ce moment même le désastre qui vous frappe m’englobe… Vous êtes fou, ou bien impudent, de compter encore sur moi ! »
– Il faudra pourtant que vous vous exécutiez, monsieur… Ou bien préfèreriez-vous passer pour le beau-père d'un homme insolvable, d'un failli ? … Mais vous n'avez pas fini de lire ces lettres… Je vous en prie, continuez… Vous verrez que la chose mérite tout au moins réflexion… Avouez que ce n'est pas de ma faute. La débâcle de Smithson et C°, à New-York, une banque si solide ! Qui pouvait prévoir cela ? … Ces mines de cuivre, de Sgreveness, dont les actions viennent de tomber à vingt, au-dessous du pair, ce n'est pas moi pourtant qui vous les ai vantées. Soyez de bonne foi et rappelez-vous votre confiance en ce petit ingénieur, votre camarade du génie, qui vint vous proposer l'affaire…
– Taisez-vous, interrompt Dobouziez… Ah, taisez-vous ! Ces spéculations effrénées sur les cafés, qui ont englouti, en moins de quatre jours, la totalité de la dot de votre femme ! Dites, est-ce moi aussi qui vous les ai conseillées ? Et ce jeu sur les fonds publics, auquel vous employez votre Dupoissy ? Croyez-vous les gens qui fréquentent la Bourse assez bêtes pour supposer un seul instant que les cent mille et les deux cent mille francs de différences payés par ce mérinos, qui n'a jamais possédé de laine pour son compte, que celle que porte sa tête cafarde, soient sortis de ses propres coffres ? Et pour comble voilà que ce pied-plat qui lèche l'empreinte de vos talons est tout doucement en train de vous lâcher. Il faudrait entendre comme il vous traite en votre absence ! Vous dégoûtez jusqu'à ce paltoquet. En Bourse il ne se gène pas pour dire haut ce qu'il pense de votre nouvelle… industrie, celte agence d'émigration qui pourrait bien vous valoir des démêlés avec la justice. Fi donc !
– Monsieur ! fit Béjard en sursautant, Dupoissy est un calomniateur que je ferai traîner en prison !
Mais sans prendre garde à l'interruption, Dobouziez continuait :
– Quelle dégringolade ! Tomber jusqu'à devenir trafiquant en chair blanche. Vraiment, c'est à croire aux fables qu'on raconte sur vous. D'abord la traite des noirs, ensuite celle des blancs : c'est dans l'ordre ! Parole d'honneur, je ne sais qui préférer d'un négrier ou d'un agent d'émigration. Vous n'avez pas même eu la pudeur de donner un autre nom à la Gina, le navire qui emporte aujourd'hui tous ces misérables à Buenos-Ayres ! Et votre politique, est-ce moi peut-être, qui puise dans votre caisse les pièces d'or et les billets de banque à l'aide desquels vous vous êtes fait élire député… Je ne vous rappellerai pas avec quel enthousiasme et quelle sincérité…
Et terrible, retrouvant son beau port de tête d'autrefois et son ton souverain et acerbe, Dobouziez jetait à la face de son gendre cette hottée de griefs…
– Et comme si cela ne suffisait pas, reprit-il, non content de vous ruiner sottement, de disposer avec une légèreté criminelle du bien de votre femme et de votre enfant, vous rendez Gina malheureuse ; vous ne la sacrifiez pas seulement à vos ambitions politiques, mais vous avez des maîtresses…, il vous faut entretenir des actrices… Sous prétexte que cela pose un homme, ça ! Ce n'est pas tout. Les lupanars du Riet-Dyck n'ont pas de client plus assidu et plus prodigue que le député Béjard ! Ah, tenez, si je m'écoutais, dès ce soir, je reprendrais Gina chez moi avec son enfant, et je vous laisserais grimacer vos grands airs de représentant, devant votre coffre-fort vide et votre crédit épuisé…
– Votre fille ! Parlons-en de votre fille ! ricana Béjard qui tirait et mordillait rageusement ses favoris roux. Vous ne comptez donc pour rien les exigences et les fantaisies de Madame ? Fichtre ! il m'a bien fallu recourir aux spéculations et à des industries lucratives, pour faire face à son luxe de lorette. Mes bénéfices d'armateur n'y auraient pas suffi… Mais, c'était à prévoir, après la jolie éducation que vous lui avez donnée !…
– Que ne me la laissiez-vous, alors ? fit Dobouziez. Si j'étais heureux et fier, moi, de la voir bien mise, rayonnante, entourée d'objets coûteux et à son goût ? Ah, si je n'avais eu à solder que ses frais de toilette, qu'à la pourvoir de distractions, de bijoux, de bibelots, je ne serais pas aussi bas, entendez-vous, monsieur, que depuis qu'il m'a fallu intervenir dans les frais de votre sport politique, et couvrir de ma signature vos sottes et extravagantes entreprises. Vrai, ne me parlez pas de ce qu'elle m'a coûté ; des gaspilleurs et des faiseurs de votre espèce ne me tiennent pas quitte à si bon compte, ils m'enlèveraient jusqu'à l'honneur…
Et Dobouziez se laissa tomber, épuisé, dans un fauteuil.
Béjard avait écouté presque tout le temps, en se promenant de long en large, et en opposant une sorte de sifflement aux vérités les plus cinglantes.
Au-dessus, dans les salons, la voix de Mme Béjard continuait de résonner, profonde et mélancolique. Et cette voix remuait l'industriel jusqu'au plus profond des entrailles. Car, si Dobouziez souffrait dans sa probité et sa prudence de négociant de s'être mépris à ce point sur la vertu commerciale de son gendre, il s'en voulait surtout d'avoir exposé le repos, la fortune et l'honneur de sa fille aux risques et aux accidents de pareille association.
Dobouziez avait songé au divorce, mais il y avait l'enfant, et la mère craignait d'en être séparée. En invoquant les difficultés de sa propre situation, le fabricant n'exagérait pas. À des années de prospérité, succédaient un marasme et une accalmie prolongée. Depuis longtemps, l'usine fabriquait à perte ; elle n'occupait plus que la moitié de son personnel d'autrefois… Dobouziez s'était saigné à blanc, dix fois, pour remettre à flot les affaires de Béjard. La suspension de paiements de la maison américaine notifiée à Béjard, l'atteignait aussi. Comment ferait-il face à cette nouvelle complication ? Il ne pourrait se tirer d'affaire lui-même qu'en hypothéquant la fabrique et ses propriétés.
Mais pouvait-il laisser mettre en faillite le mari de sa fille, le père de son petit-fils et filleul ?
Béjard l'attendait à ce silence. Il l'avait laissé se débattre et expectorer sa bile, il lisait sur le visage contracté du vieillard les pensées qui se combattaient en lui. Lorsqu'il jugea le moment venu de reprendre le débat, il recourut à son ton doucereux de juif qui ruse :
– Trêve de récriminations, beau-père, dit-il. Et nous nous jetterions durant des heures nos torts réels ou prétendus à la tête, que cela ne changerait rien à la situation. Parlons peu, parlons bien. Rien n'est désespéré, que diable ! Bien entendu si vous ne vous obstinez point à me plonger vous-même dans le bourbier où je me sens enfoncer. J'ai calculé sur cette feuille – et vous pourrez l'emporter pour vérifier, à loisir, à tête plus reposée, l'exactitude de mes chiffres – que ma dette et mes obligations s'élèvent à deux millions de francs… De grâce, plus de secousses électriques, n'est-ce pas ?… Que j'achève au moins de vous exposer la situation… J'ai de quoi, en caisse, faire face aux quatre premières échéances, représentant près de huit cent mille francs. Cela nous mène jusqu'au premier du mois prochain…
– Et alors ?
– Alors je compte sur vous…
– Vous comptez sérieusement que je vous procure plus d'un million ?
– On ne peut plus sérieusement.
Le même mortel et crispant silence, pendant que Gina chantait là-haut, en s'accompagnant, les nobles mélodies des classiques allemands. Dobouziez se prend le front à deux mains, l'étreint comme s'il voulait en exprimer la cervelle, puis il le lâche brusquement, se lève, ferme les poings, et sans s'ouvrir autrement auprès de Béjard d'une résolution extrême qu'il vient de prendre, il lui dit :
– Laissez-moi quinze jours pour aviser… et ne vous empêtrez pas davantage d'ici là…
L'autre comprend que le beau-père le sauve, et marche vers lui, la main tendue, confit en douceâtres formules de gratitude…
Mais Dobouziez se recule, porte vivement les mains derrière le dos :
– Inutile !… Si vous êtes réellement capable de quelque reconnaissance, c'est à Gina et à l'enfant que vous la devrez… S'ils n'étaient pas en cause !…
Et il n'achève pas ; Béjard ne manquant pas d'entendement n'insiste plus.
Tous deux remontent dans les salons et feignent de poursuivre une conversation indifférente.
M. Dobouziez va se retirer. Gina l'accompagne dans le vestibule et l'aide à endosser sa pelisse, puis, elle lui tend le front. Dobouziez y appuie longuement les lèvres, lui prend la tête dans les mains, la contemple avec orgueil et tendresse :
– Serais-tu heureuse, mignonne, de demeurer encore avec moi ?
– Tu le demandes !
– Eh bien, si tu te montres bien raisonnable, surtout si tu reprends un peu de ta gaieté d'autrefois, je m'arrangerai pour venir m'installer chez toi… Mais garde-moi le secret de ce dessein. Bonsoir, petite…
VIII. DAELMANS-DEYNZE
À rentrée d'une des rues riveraines du Marché-aux-Chevaux, où des hôtels un peu froids, habités par des patriciens, voisinent, comme en rechignant, avec des bureaux et des magasins de négociants, théâtre d'un va-et-vient continuel de ruche prospère, – court, sur une quarantaine de mètres, un mur bistré, effrité par deux siècles au moins, mais assez massif pour subsister durant de longues périodes encore.
Au milieu, une grande porte charretière s'ouvre sur une vaste cour fermée de trois côtés par des constructions remontant à l'époque des archiducs Albert et Isabelle, mais qui ont subi, depuis, des aménagements et des restaurations en rapport avec leurs destinées modernes.
Un des solides vantaux noirs étale une large plaque de cuivre, consciencieusement astiquée, sur laquelle on lit en gros caractères : J.-B. Daelmans-Deynze et Gie. Le graveur voulait ajouter : denrées coloniales. Mais a quoi bon ? lui avait-on fait observer. Comme deux et deux font quatre, il est avéré, à Anvers, que Daelmans-Deynze, les seuls Daelmans Deynze, sont commerçants en denrées coloniales, de père en fils, en remontant jusqu'à la domination autrichienne, peut-être jusqu'aux splendeurs de la Hanse.
Si l'on s'engage sous la porte, profonde comme un tunnel de fortifications, et qu'on débouche dans la cour, on avise d'abord un petit vieillard alerte, quoique obèse, rouge de teint, monté sur de petites jambes minces et torses, arc-boutées plus que de nécessité, mais qui sont en mouvement perpétuel. C'est Pietje le portier. Pietje de kromme – le cagneux – comme l'appellent irrévérencieusement les commis et les journaliers de la maison, sans que Pietje s'en offusque. Aussitôt qu'il vous aura aperçu, il ôtera sa casquette de drap noir à visière vernie et, si vous, demandez le patron, le chef de la firme, il vous dira, suivant l'heure de la journée : « Au fond, dans la maison, s'il vous plaît, monsieur », ou bien : « à droite, sur son bureau, pour vous servir… »
La cour, pavée de solides pierres bleues, s'encombre généralement de sacs, de caisses, de tonnes, de futailles, de dames-jeanne, d'outres et de paniers de toutes couleurs et dimensions.
Mais Pietje, jouissant de votre surprise candide, vous apprendra que ceci ne vous représente qu'un dépôt infime, un stock d'échantillons.
C'est à l'entrepôt Saint-Félix, ou dans les docks, aux Vieux-Bassins, que vous en verriez des marchandises importées ou exportées par Daelmans-Deynze !
De lourds chariots, attelés de ces énormes chevaux de « Nations » aux croupes rondes et luisantes, attendent, dans la rue, qu'on les charge ou qu'on les allège. M. Van Liere, le magasinier, en veston, fluet, rasé de près, l'œil douanier, le crayon et le calepin à la main, prend des notes, aligne des chiffres, remplit les formules, empoigne des lettres de voiture, parcourt les factures, saute parfois, agile comme un écureuil, sur le monceau des marchandises dont il constate la condition en poussant des cris et des interpellations, gourmandant ses aides, pressant les charretiers dans une langue aussi inintelligible que du sanscrit pour qui n'est pas initié aux mystères des denrées coloniales.
Les débardeurs, de grands diables, taillés comme des dieux antiques, avec leur tablier de cuir, leurs bras nus où les muscles s'enroulent comme les fibres d'un câble, rouges, empressés, soulèvent, avec un « han ! » d'entrain, les lourds ballots et, le poids assis sur leurs épaules, ne semblent plus supporter qu'un faix de plumes. Le charretier en blouse bleue, en culotte de velours brun à côtes, le feutre rond déformé et déteint par les pluies, son court fouet à large corde sous le bras, écoute respectueusement les observations de M. Van Liere.
– Minus, dérangez-vous un peu ! Laissez passer monsieur, dit ce potentat avec un sourire de condescendance, en comprenant, d'un coup d’œil, l'embarras de votre situation alors que vous enjambez les sacs et les caisses sans savoir comment cette gymnastique finira.
Un des colosses déplace, comme d'un revers de sa main calleuse, un des barils persécuteurs et avec un « Merci » de naufragé recueilli, vous poussez, enfin, dans l'angle du mur de la rue et du corps de bâtiment à droite, une porte vitrée sur laquelle se lit le mot : Bureaux.
Mais vous n'entrez encore que dans l'antichambre.
Une nouvelle poussée. Courage ! La porte capitonnée de cuir à l'intérieur glisse sans bruit. Vingt plumes infatigables grincent sur le papier épais des registres ou frôlent la soie des copies de lettres ; vingt pupitres adossés, deux à deux, se prolongent à la file sur toute la longueur du bureau éclairé du côté de la cour par six hautes fenêtres ; vingt commis juchés sur un nombre égal de tabourets, les manches en lustrine aux bras, le nez penché sur la tâche, semblent ne pas s'être aperçus de votre intrusion. Vous toussez, n'osant recourir à une interpellation directe… – Artie étrangère ? M'sieur ?… – Correspondance ? Caisse ?… L'article corinthes… Dattes… Pruneaux… Huile d'olive ?… vous demandent machinalement, sans même vous dévisager, les ministres de ces départements divers, jusqu'à épuisement de la liste. – Non ! dites-vous au moins imposant de ce personnel… un jeune homme à l'air doux et novice, saute-ruisseau, vêtu de chausses trop courtes pour son long corps, ses bras en steeple-chase continuel avec la manche de sa veste battant de la longueur d'une main, d'un poignet, d'une partie d'avant-bras, l'étoffe poussive. – Non ! dites-vous, je désirerais parler à M. Daelmans… – Daelmans-Deynze ! rectifie le jeune homme effaré… M. Daelmans-Deynze… la porte du fond devant vous… Permettez que je vous précède… Il peut être occupé… Votre nom, monsieur ?…
Enfin, la dernière formalité étant remplie, vous avancez, longeant la file des pupitres, passant pour ainsi dire en revue, et de profil, les vingt commis gros ou maigres, chlorotiques ou couperosés, lymphatiques ou sanguins, blonds ou noirs, variant de soixante à dix-huit-ans – l'âge du jeune homme effaré – mais tous également préoccupés, tous profondément dédaigneux du motif profane qui vous amène, vous, simple observateur, artiste, travailleur intermittent, dans ce milieu d'activité incessante, un des sanctuaires de dilection du Mercure aux pieds ailés.
Et c'est à peine si M. Lynen, le vieux caissier, a relevé vers vous son front chauve et ses lunettes d'or, et si M. Bietermans, son second en importance, le correspondant pour les langues étrangères, a campé pour vous lorgner un instant, son pince-nez japonais sur son nez au busc diplomatique.
Mais ces comparses comptent-ils encore lorsque vous êtes en face du chef suprême de la « firme » ? – Entrez, a-t-il dit de sa voix sonore. Il est là devant vos yeux, cet homme solide comme un pilier, un pilier qui soutient sur ses épaules une des maisons-mères d'Anvers. Il vous a dévisagé de ses yeux bleuâtres, gris et clairs ; cela sans impertinence ; d'un seul regard il vous jauge aussi rapidement son homme qu'il combinera une affaire en Bourse ; il a non seulement le compas, mais la sonde dans l'œil ; il devinera de quel bois vous vous chauffez, et éprouvera, avec une certitude aussi infaillible que la pierre de touche, si c'est de l'or pur ou du doublé que porte votre mine.
Un terrible homme pour les consciences véreuses, les financiers de hasard, que Daelmans-Deynze ! Mais un ami de bon conseil, un aimable protecteur, un appui intègre que Daelmans-Deynze pour les honnêtes gens, et vous en êtes, car c'est avec empressement ; qu'il vous a tendu sa large main et qu'il a serré la vôtre.
La plume derrière l'oreille, la bouche souriante, la physionomie ouverte et cordiale, il vous écoute, scandant vos phrases de politesse de « très bien ! » obligeants, en homme sachant qu'on s'intéresse à ce qui le concerne. Sa santé ? Vous vous informez de sa santé. Pourrait-on porter plus gaillardement ses cinquante-cinq ans ! Ses cheveux correctement taillés et distribués des deux côtés de la tête par une raie irréprochable, grisonnent quelque peu, mais ne désertent pas ce noble crâne ; ils lui feront plus tard une auréole blanche et donneront un attrait nouveau à ce visage sympathique. Les longs favoris, bruns, que sa main tortille machinalement, s'entremêlent ; aussi de fils blancs, mais ils ont grand air, tels qu'ils sont. Et ce front, y découvre-t-on la moindre ride ; et ce teint rose, n'est-il pas le teint par excellence, le teint de l'homme sans fiel, au tempérament bien équilibré, aussi foin de la phtisie que de l'apoplexie ?… Il ne porte même pas de lunettes, Daelmans-Deynze. Un binocle en or est suspendu à un cordon. Simple coquetterie ! il lui rend aussi peu de services que le paquet de breloques attaché à sa chaîne de montre. Son costume est sobre et correct. Le drap très noir et le linge très blanc, voilà son seul luxe en matière de toilette. Grand, large d'épaules, il se tient droit comme un I, ou plutôt, comme nous l'avons dit, un pilier, un pilier sur lequel reposent les intérêts d'une des plus anciennes maisons d'Anvers.
Digne Daelmans-Deynze ! À la rue, ce sont des coups de chapeau à chaque pas. Depuis les écoliers qui se rendent en classe, jusqu'aux ouvriers en bourgeron, tous lui tirent la casquette. Et jusqu'au vieux et hautain baron Van der Dorpen, son voisin, qui le salue, souvent le premier, d'un amical « Bonjour, monsieur Daelmans »… C'est que son écusson de marchand n'a jamais été entaché. Réclamez-vous de cette connaissance et pas une porte ne vous sera fermée dans la grande ville d'affaires, depuis la Tête de Grue jusqu'à Austruweel.
Dans les cas litigieux, c'est lui que les parties consultent de préférence avant de se rendre chez l'avocat. Combien de fois son arbitrage n'a-t-il pas détourné des procès ruineux et son intermédiaire, sa garantie, des faillites désastreuses. Vous vous informez de sa femme ?… Elle se porte très bien, grâce a Dieu, Mme Daelmans… Je vous conduirai auprès d'elle… Vous déjeunerez avec nous, n'est-ce pas ?… En attendant, nous prendrons un verre de Sherry.
Il vous met sa large main sur l'épaule en signe de possession ; vous êtes son homme, quoi que vous fassiez. On ne refuse pas, d'ailleurs, une si cordiale invitation. Il pourrait vous conduire directement du bureau dans la maison par la petite porte dérobée, mais il a encore quelques ordres à donner à MM. Bietermans et Lynen. – Une lettre de notre correspondant de Londres ? dit Bietermans en se levant. Ah ! De Mordnunt-Hackey… Très bien… Très bien… ! L'affaire des sucres, sans doute… Écrivez-lui, je vous prie, que nous maintenons nos conditions… Messieurs, je vous salue… Qui fait la Bourse aujourd'hui ? Vous, Torfs ? N'oubliez pas alors de voir M. Berwoets… Excusez-moi, mon ami… Là, je suis à vous…
Ô l'aimable homme que Daelmans-Deynze !
Ces ordres étaient donnés sur un ton paternel qui lui faisait des auxiliaires fanatiques de son peuple d'employés.
Une remarque à faire, et ce n'était pas là une des moindres causes de la popularité de Daelmans à Anvers, c'est que la firme n'occupait que des commis et des ouvriers flamands et surtout anversois, alors que la plupart des grosses maisons accordaient, au contraire, la préférence aux Allemands.
Le digne sinjoor ne voulait même pas accepter les étrangers comme volontaires, il ne reculait pas devant une augmentation de frais pour donner du pain aux « gars d'Anvers », aux jongens van Antwerpen, comme il disait, heureux d'en être, de ces gars d'Anvers.
Les autres négociants trouvaient originale cette façon d'agir. Le banquier rhénan Fuchskopf haussait les épaules et disait à ses compatriotes résidant à Anvers : « Ce ger Taelman vé té la boézie ! », mais le digne Flamand « faisait bien et laissait dire », et les Tilbak parlaient avec attendrissement du patriotisme du millionnaire du Marché-aux-Chevaux, et Vincent faisait miroiter aux yeux de son petit Pierket, bon écolier, cette perspective : « Toi, tu entreras un jour chez Daelmans-Deynze. »
Il vous a entraîné au fond de la cour dans la maison dont la façade antique est tapissée d'un lierre pour le moins contemporain de la bâtisse. À gauche, en face du bureau, sont les écuries et la remise. On gravit quatre marches, on pousse la grande porte vitrée précédée d'une marquise.
– Joséphine ! voici un ressuscité…
Et une bonne tape dans le dos, de la main de votre hôte, vous met en présence de Mme Daelmans.
Celle-ci, qui travaillait à un ouvrage au crochet, jette une exclamation de surprise et s'extasie sur l'heureuse inspiration à laquelle on doit votre visite.
Si le mari a bonne mine et l'abord sympathique, que dire de sa « dame » ? Le type par excellence de la ménagère anversoise, soigneuse, proprette et diligente.
Elle a quarante ans, Mme Daelmans. Des bandeaux bien lisses de cheveux noirs encadrent un visage réjoui, où brillent deux yeux bruns affectueux et où sourient des lèvres maternelles. Les joues sont fournies et colorées comme la chair d'une pomme mûrissante.
Elle est petite, la bonne dame, et se plaint de devenir trop épaisse. Cependant, ce n'est pas la paresse qui est cause de cette corpulence. Levée dès l'aube, elle est toujours sur pied, active et remuante comme une fourmi. Elle préside à toutes les opérations du ménage, avoue-t-elle, mais ce qu’elle ne dit pas, c'est qu'elle met elle-même la main à toutes les besognes. Rien ne marche assez vite à son gré. Elle en remontre à sa cuisinière dans l'art de bouillir le pot au feu, et au domestique dans celui d'épousseter les meubles. Elle court de l'étage au rez-de-chaussée. À peine a-t-elle l'envie de s'asseoir et mis la main sur le journal ou le : tricot entamé, que lui vient une inquiétude sur le sort du ragoût qui mijote dans la casserole, ou de la provision de poires du cellier : Lise aura fait trop grand feu et Pier négligé de retourner les fruits qui commençaient à se piquer d'un côté. Avec cela pas d'humeur ; la bonne dame est vigilante sans être tatillonne. Elle fera largement l'aumône aux pauvres de la paroisse, mais ne tolérera pas qu'on perde un morceau de pain, petit comme le doigt.
Aussi comme elle est tenue, la vieille maison de Daelmans-Deynze ! Dans la grande chambre où l’on vous a introduit, vous ne serez pas frappé par un luxe de la dernière heure, un mobilier flambant neuf, des peintures auxquelles un décorateur à la mode vient de donner un coup de pinceau hâtif. Non, c'est l'intérieur cossu et simple dont vous avez rêvé en voyant les maîtres. Ces meubles ne sont pas les compagnons d'un jour achetés par un caprice et remplacés par une lubie, ce sont de solides canapés, de massifs fauteuils en acajou, style empire, garnis de velours pistache. On en renouvelle les coussins avec, un soin jaloux ; on polit consciencieusement le bois séculaire ; on les entretient comme de vieux serviteurs de la maison : on ne les remplacera jamais.
La dorure des glaces, des cadres et du lustre a perdu, depuis longtemps, le luisant de la fabrique, et les couleurs de l'épais tapis de Smyrne ont été mangées par le soleil, mais les vieux portraits de famille gagnent en intimité et en poésie patriarcale dans ces médaillons de vieil or, et le tapis laineux a dépouillé ses couleurs criardes ; ses bouquets éclatants ont pris lès tons harmonieux et apaisés d'un feuillage de septembre. Il y a bien des années que ces grands vases d'albâtre occupent les quatre encoignures de la vaste pièce ; que ce cuir de Cordoue revêt les parois ; que la table ronde en palissandre trône au milieu de la salle, que la pendule à sujet, au timbre vibrant et argentin, sonne les heures entre les candélabres de bronze à dix branches. Mais ces vieilleries ont grand air ; ce sont les reliques des pénates. Et les housses ajourées, œuvre du crochet diligent de la bonne dame Daelmans, prennent sur ces coussins de velours sombre des plis sévères et charmants de nappe d'autel.
C'est devant ce Daelmans-Deynze que Guillaume Dobouziez se présente, le lendemain du dîner politique chez M. Freddy Béjard.
Ces deux hommes, camarades de collège, s'estimaient beaucoup et se fréquentaient assidûment il y a des années ; et c'est le luxe trop ostensible, le train de maison tapageur et surtout les relations remuantes et cosmopolites de l’industriel qui ont éloigné M. Daelmans d'un confrère dont il apprécie les connaissances solides, l'application et la probité. Autrefois même, il fut sérieusement question entre eux d'une association commerciale. Daelmans comptait mettre ses capitaux dans la fabrique. Mais c'était à l'époque de la pleine prospérité de cette industrie et Dobouziez préférait en demeurer propriétaire principal. Aujourd'hui il vient proposer humblement au négociant de reprendre ses actions.
Daelmans-Deynze sait depuis longtemps que l'usine périclite, il n'ignore pas moins les sacrifices auxquels se résigna Dobouziez pour établir sa fille et venir en aide à Béjard ; il pourrait manifester à son interlocuteur un certain étonnement devant une pareille proposition, et ravaler l'objet offert afin de l'obtenir à des conditions léonines ; mais Daelmans-Deynze y met plus de discrétion et moins de rouerie. Au fond, il ne nourrit pas grande envie de s'embarrasser d'une affaire nouvelle par ce temps de crise et de stagnation, mais il a deviné, dès les premiers mots de l'entretien, voire par la démarche même à laquelle s'est décidé Dobouziez, que celui-ci se trouve dans des difficultés atroces, et Daelmans appartient à la classe de plus en plus restreinte de commerçants qui s'entraident. Non, admirez le tact avec lequel M. Daelmans débat les conditions de la reprise. Afin de mettre M. Dobouziez à l'aise, il ne feint aucune surprise, il ne prend pas ce ton de compassion qui offenserait si cruellement un homme de la trempe du fabricant ; il ne lui insinue même pas que s'il consent a racheter la fabrique, de la main à la main, c'est uniquement pour obliger un ami dans la détresse. Pas une récrimination, pas un reproche, aucun air de supériorité !
Oh ! le brave Daelmans-Deynze ! Et ces bons sentiments ne l'empêchent pas d'examiner et de discuter longuement l'affaire. Il entend concilier son intérêt et sa générosité ; il veut bien obliger un ami, mais à condition de ne pas s'obérer soi-même. Quoi de plus équitable ? C'est à la fois strictement commercial et largement humain. Cependant ils vont conclure.
Reste un point que ni l'un ni l'autre n'osent aborder. Il faut bien s'en expliquer cependant ; tous deux l'ont au cœur. Mais Dobouziez est si fier et Daelmans si délicat ! Enfin, Daelmans se décide à prendre, comme il dit, le taureau par les cornes :
– Et, sans indiscrétion, monsieur Dobouziez, que comptez-vous faire à présent ?
L'autre hésite à répondre. Il n'ose pas exprimer ce qu'il souhaiterait.
– Écoutez, reprend M. Daelmans, voua accueillerez mes ouvertures comme voua l'entendrez et il est convenu d'avance que vous me les pardonnez, au cas où elles vous paraîtraient inacceptables… Voici. La fabrique changeant de propriétaire, il serait désastreux qu'elle perdit du même coup son directeur… Vous me comprenez ? Je dirai même que cette éventualité suffirait pour faire hésiter l'acquéreur. Des capitaux se remplacent, monsieur Dobouziez, l'argent se gagne, se perd – se gaspille, allait-il dire, mais il se retint – se regagne. Mais ce qui se trouve et ce qui se remplace difficilement, c'est un homme de talent, un homme instruit, actif, expérimenté, un homme du métier… C'est pourquoi je vous demande, monsieur Dobouziez, si vous verriez quelque inconvénient à demeurer à la tête d'une industrie que vous avez édifiée et que vous seul pouvez maintenir et perfectionner… Nous comprenons-nous ?
S'ils se comprenaient ! Ils ne pouvaient mieux se rencontrer. C'était précisément la solution qu'espérait M. Dobouziez.
Entre gens si honnêtes et si droits, on convint avec tout autant de facilité du chiffre des appointements du directeur ; sauf ratification par Saint-Fardier et les petits actionnaires : une simple formalité. Il va sans dire que M. Daelmans mit vos appointements à un chiffre très respectable. Il voulait même que le directeur continuât d'occuper la somptueuse maison attenante à la fabrique. Mais le père esseulé désirait retourner auprès de son enfant.
Ah ! personne comme Daelmans-Deynze n'aurait pu adoucir à Dobouziez l'amertume et l'humiliation de ce sacrifice ! Qui s'imaginerait pareille délicatesse et pareilles nuances de procédés chez cet homme de négoce ! Dobouziez dut se l'avouer au fond de son cœur si blindé, si fier, si peu accessible aux émotions. Et, au moment de prendre congé de M. Daelmans – son patron – comme il articulait quelque correcte formule de remerciements, il sentit se fondre brusquement comme des glaçons dans sa poitrine, et, se ravisant, se précipita dans les bras de son ami, son sauveur.
– Courage ! lui dit l'autre avec sa simplicité et sa rondeur habituelles.
IX. LA BOURSE
Une heure ! l'heure réglementaire de l'ouverture de la Bourse sonne à l'horloge, dernier vestige de l'ancien édifice incendié, à la diligente horloge qui, lorsque les flammes la serraient de près et avaient tout dévoré autour d'elle, s'obstinait, servante féale, à mourir au champ du devoir en donnant l'heure officielle à la ville marchande[7]…
Une heure ! Dépêchez, retardataires ! Expédiez votre lunch, n'en faites qu'une bouchée, hommes d'affaires, hommes d'argent ! Joueurs de dominos, d'autres combinaisons vous réclament ! Achevez de siroter votre café, de sabler la fine champagne. Plantez là le journal pourtant si concis et rédigé, en nègre, à votre intention. Réglez et filez, ou gare l'amende.
Une heure ! Ils affluent de tous les points de la ville et de la Cité. Riches d'aujourd'hui, riches de demain et aussi riches de la veille, qui s'évertuent et luttent contre la débâcle, millionnaires dont l'herbe a fait du foin qu'ils engrangent dans leurs bottes, ou encore millionnaires dont le foin a flambé comme un simple feu de paille !
Va, cours, vole – parfois dans les deux sens du verbe – misérable suppôt de la Fortune ! La roue tourne, accroche-toi à ses rais, essaie d'en régler le mouvement ! Voyez-les se bousculer, se passer sur le corps, pour agripper la roue fatale, pour s'y cramponner avec l'opiniâtreté des rapaces ; aujourd'hui au-dessus, demain en dessous ! La roue tourne et tourne, et l'essieu grince et craque… Et ses craquements ont de sinistres échos : Krach !
Depuis le matin, boursiers, boursicotiers, vont et viennent, se croisent dans les rues, affairés, fiévreux, sans s'arrêter, échangeant à peine un bonjour sec comme le tic-tac de leur chronomètre : Time is money ! Avant la soirée les meilleurs amis ne se reconnaissent plus. To buy or not to buy ? That is the question ! monologue le sordide Hamlet du commerce. Il n'envisage plus l'univers qu'au point de vue de l'offre et de la demande. Produire ou consommer : tout est là !
Une heure ! Allons, que la meute avide de curée s'engorge par les quatre portes de l'élégant palais. Avec ses voûtés magnifiques, décorées d'attributs, de symboles et d'écussons de tous les pays, sous ses nervures de fer, contournées en arceaux, ce monument d'un gothique panaché de réminiscences mauresques et byzantines, mi-partie aryen, mi-partie sémite, présente un compromis bien, digne de ce temple du dieu Commerce, par excellence le dieu furtif et versatile.
Les rites commencent. Le bourdonnement sourd des incantations s'élève parfois jusqu'au brouhaha. Debout, chapeau sur la tête comme à la synagogue, les fidèles s'entassent et jabotent. Et, graduellement l'atmosphère se vicie. On distingue à peine les métaux et les couleurs des peintures murales ; les élégants rinceaux se noient dans un brouillard d'haleines et de fumées opaques ! Le pouacre encens ! Les têtes ont l'air détachées du corps ! et flottent au-dessus des vagues.
À première vue, en tombant dans cette assemblée, on songe aux conventicules et aux sabbats. Jamais grenouillère altérée ne coassa avec pareil ensemble pour demander la pluie. Mais ces batraciens-ci réclament force pluie d'or.
Peu à peu, on parvient à démêler les uns des autres ces groupes de gens d'affaires et de mercantis.
Voici le coin des gros négociants se rendant encore à 1a Bourse par habitude. Ils traitent les affaires en affectant de parler d'autre chose, ou se déchargent de ces soucis sur quelque coadjuteur qui, de temps en temps, s'approche du patron pour prendre le mot d'ordre, la consigne. Ainsi le plénipotentiaire consulte le potentat. Là trônent, pontifient, les mages billionnaires, les grands prêtres. Piliers mêmes du négoce, aussi solides que les colonnes de leurs temples. Colonnes philistines, hélas, contre lesquelles l'honnête Samson ne prévaudrait jamais ! Commettants, propriétaires, armateurs, courtiers de navires, banquiers, se prélassent dans leur importance, mains en poches ou sur le dos, et parlent peu, et parlent' d'or – au propre et au figuré. Ploutocrates ventripotents, augures redoutables, leurs oracles sybillins entament ou rehaussent le crédit du faiseur subalterne. Un mot de leur bouche vous enrichit ou vous ruine. Les girouettes de la chance tournent à leur haleine. De leur fantaisie dépendent les fluctuations du marché universel. Ce sont leurs lunes qui règlent ces marées. Avec leurs affiliés des autres grands ports, ils sont de force à livrer, le pauvre monde à la famine et à la guerre.
Successeurs des Fugger et des Salviati, de ces Hanséates hautains qu'un cortège de hérauts et de musiciens richement costumés précédait chaque jour à l'heure de la Bourse, ils trafiquent des empires et des peuples comme d'une simple partie de riz ou de café ; mais, s'ils leur arrive encore de prêter de l'argent aux rois, moins fastueux et moins artistes que ces Focker légendaires, ils ne jetteraient plus aux flammes d'un foyer, alimenté de cannelle la créance d'un César, leur débiteur considérable, mais leur hôte glorifié ! Les autres étaient des patriciens, ceux-ci ne sont que des ; parvenus.
Spéculateurs à la hausse et à la baisse consultent comme un infaillible baromètre les rides de leurs fronts, le pli de leur bouche et la couleur de leur regard. Ils sont les vicaires de la divinité que symbolise la pièce de cent sous.
Ainsi, lorsqu'un interlocuteur candide se méprend jusqu'à parler au juif rhénan Fuchskopf, d'un noble caractère, d'un génie, d'un saint médiocrement pourvu de ducats ou jusqu'à solliciter l'appui de cet Iscariote en faveur d'une infortune digne d'émouvoir tout mortel à figure plus ou moins humaine, l'affreux pressureur, le marchand d'urnes, le fournisseur de souliers sans semelles aux massacrés des récentes guerres, l'actionnaire insatiable que les bouilleurs brûlés par le grisou, affamés par la grève ou fusillés par la troupe ont maudit en agonisant, le youtre tire de son porte-monnaie un luisant écu de cinq francs et au lieu de le consacrer à une exceptionnelle aumône, le passe à deux ou trois reprises sous le nez du solliciteur, puis le presse amoureusement entre ses doigts crochus et moites comme des ventouses, l'approche même de ses lèvres comme s'il baisait une patène et, fléchissant à moitié le genou, adresse cette intraduisible oraison au fétiche :
Ach lieber Christ !
Wodu nicht bist
Ist lauter Schweinerei !
Puis, ricanant, remet l'hostie dans son gousset et jouit de la déconvenue du malencontreux intercesseur et de l'approbation de ses courtisans et complices.
Autrement loquaces et remuants que les bonzes de la finance et du négoce se révèlent les agents de change. Pimpants, astiqués, ils toupillent, virevoltent, s'empressent, s'insinuent, s'interposent, butinent l'or en papillonnant. Ce sont les danseurs sacrés, et leur pantomime fait partie des incantations.
De locomotion moins vertigineuse, serrés dans des habits plus sombres et de coupe plus roide, circulent les trafiquants en fonds publics, bricolant des liasses d'actions négligemment roulées dans des fardes ou de vieilles gazettes, et griffonnant leurs bordereaux sur le dos d'un client secourable.
Couverts de complets de fatigue, les commissionnaires en marchandises entreposent force sachets d'échantillons, au fond de leurs poches.
Celui-ci pile dans la paume de la main une fève de Chéribon et en fait subodorer l'arôme à l'épicier qu'il capte et circonvient.
Celui-là vous persuade de la supériorité de son tabac, Kentucky ou Maryland, et finirait par endosser la récolte au preneur timoré qui n'en demande qu'un boucaut.
À chaque spécialité, à chaque article son coin, sa dalle fixe. On ne se figure pas l’ordre régnant dans cette apparente pétaudière, le nombre des démarcations, des classements, des subdivisions. Raffineurs, distillateurs, importateurs de pétroles ou de guanos, facteurs en douanes, assureurs occupent, du premier janvier au trente-et-un décembre, sans empiéter sur le domaine du voisin, les quelques pieds carrés assignés à leur partie. Un colin-maillard habitué de la Bourse, retrouverait sans peine, au milieu de cette fourmilière, le quidam dont il a besoin.
Le sujet des conversations, l'objet débattu varie de pas en pas. Des quirateurs ou propriétaires collectifs d'un navire discutent avec les affréteurs les clauses d'une charte-partie. Un entrepositaire baragouine cédules et warrants. L'air retentit de mots exotiques et barbares : cent weights, primage, emprunt à la grosse aventure. Il est question de crimes spéciaux prévus par des codes exclusifs. Un armateur se plaint de barateries commises par ses capitaines. Ailleurs s'évalue un total de droits de navigation. Un expéditeur confère avec son subrécargue. Des dispacheurs règlent un compte d'avaries.
Casquette à la main, un doyen de « nation » offre ses services à un importateur de bœufs vivants de la Plata et à un autre qui reçoit en conserves le bétail du même pays. Un officier de la douane taxe de fraude et d'irrégularités les baes d'une « nation», qui mettent en cause, de leur côté, le négociant entrepositaire.
Le long du pourtour, sous les galeries, règnent des files de hauts pupitres d’où dégringolent pour s'y rejucher aussitôt après, comme atteints de vertige, des calculateurs ; chiffres faits hommes, s'égosillant à glapir les côtes que les reporters de moniteurs financiers consignent hâtivement sur leurs tablettes.
Que de manœuvres pour arriver à ce but : l’argent. Tel a l’air taciturne, presque funèbre, parle affaires avec componction ; tel autre traite Mercure par-dessous la jambe et entremêle son boniment de facéties de rapin.
Des bateliers, patrons de beurts et de chalands, le visage briqueté, les oreilles ornées d'anneaux d'argent, se tiennent à part, près des portes et, se balançant tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, crachent, chiquent, pipent, graillonnent en attendant le noliseur. Des capitaines anglais en bisbille, élèvent la voix comme pour commander l'abordage et crispent désagréablement un conciliabule de jeunes beaux et de vieux bellâtres, mutinés de spéculateurs qui, non loin de là, se chuchotent la chronique scandaleuse, dénombrent leurs bonnes fortunes de la veille, dévoilent les mystères de l'alcôve, et les secrets du comptoir, lient des parties fines pour la soirée et farcissent de potins de boudoirs et de coulisses l'aride rituel commercial :
– Avec leurs goddam ils feraient goddamner un saint ! déclare le plus spirituel des deux jeunes Saint-Fardier, visant les loups de mer tapageurs, et il se retire sur ce mot. Son frère l'accompagne, aussi radieux que si le mot était de lui. On leur donne le temps de s'éloigner ; puis le cercle se rapproche :
– Elles vont bien leurs petites femmes ! En voilà qui font goddamner leurs maris ? Athanase n'a rien à envier à Gaston ; leur ressemblance est plus grande que jamais. On se demande lequel est le plus sganarellisé des deux ; Connaissez-vous le dernier patito de Cora ?
– Notre grand Frédéric Barberousse !
– Non, au rancart le robin ! En ce moment le képi supplante la loque.
– Un képi de l'armée belge…
– Ou à peu près…
– Autant dire un garde civique…
– Eurêka !
– Connais pas…
– Cet excellent Pascal qui n'entend pas le grec.
– Van Dam, le consul de Grèce ? Mais il n'est pas de la garde civique.
– Qui te dit le contraire ! Ô Pascal… agneau ! C'est Von Frans, parbleu !
– Et c'est là tout ce que vous savez ? intervient un nouveau venu, De Zater, l'homme toujours ganté. Quel vieux neuf ! Voici bien d'autre nanan : Lucrèce, l'imprenable Lucrèce…
– Eh bien ?
– … a fini par imiter ses petites folles de cousines…
– Avec qui ?
– Avec le nouvel associé de son mari ; le senor Vera-Pinto, un Chilien, un Fuégien ou un Patagon, je ne sais au juste…
– Comment ! Le rastaquouère avec qui Freddy Béjard entreprend les transports d'émigrants en Argentine et qui lui a proposé l'opération des cartouches… Messieurs, cette coïncidence ne vous entrouvre-t-elle pas des horizons nouveaux, comme on dit au Palais ?
– Tu ne prétends pas que le mari soit de connivence avec la femme : ils se détestent trop pour cela.
– Peuh ! L'intérêt les rapproche…
– Voilà donc leur débâcle doublement conjurée. Car, vous n'ignorez pas, je suppose, que le papa Dobouziez vend sa part dans l'exploitation de la fabrique et jusqu'à sa maison… Hé, Tolmoch, combien font les métalliques ?
– Que cornez-vous là ? Le père Dobouziez, ce rigide matois, ce « tirez-vous de là comme vous pourrez ! » se sacrifier pour un autre ! pour un Béjard !
– Ah ça, vous tombez donc tous de la lune… On ne parle que de cette liquidation depuis ce matin, sur le tramway, au port, dans les bureaux…
– Daelmans-Deynze devient propriétaire de l'usine. Le père Saint-Fardier aussi abandonne la fabrication des bougies. Il lâche le beau-père pour commanditer le gendre. Saint-Fardier remplacera Dupoissy, qui manquait de poigne, au bureau des enrôlements pour l'Amérique et c'est lui qui s'occupera de l'emménagement des navires. Il y a des milliers et des milliers de francs à gagner. On annonce le prochain départ de la Gina avec une cargaison de cinq cents têtes.
– Au lieu de bois d'ébène voilà que Béjard se met à vendre de l'ivoire ! conclut finement De Zater.
– À propos, De Maes, je vous prends vos consolidés à terme…
– Dobouziez consent à rester comme directeur aux appointements d'un ministre, m'affirmait à l'instant le caissier de la fabrique.
– Deux mots, monsieur de Zater, au sujet des huiles : faut-il acheter ou vendre ?
– Vendre ! Que vous êtes jeune, Tobiel : télégraphiez sans retard à Marseille et emparez-vous de tout ce qui reste encore sur le marché…
– Ecco l'opération des cafés ; j'expédie par le Feldmarschall deux cents balles Java à Brand Frères, de Hambourg, et, en même temps, je charge mon commissionnaire d'acheter avec le produit une partie de cuirs…
– Messieurs, j'ai bien l'honneur… De Zater, je suis le vôtre… Vous parliez du grand désintéressement de Dobouziez…
– Non, cela me passe. On n'est pas honnête à ce point.
– Honnête ! ricane Brullekens, de maniaque qui fait décaper chaque matin son argent de poche ; c'est un autre mot, que vous diriez, vous, hé. ! Fuchskopf ?
– Ce Taelmans-Teince, engore un orichinal, un •ardiste… Dummes Zeug ! Lauter Schweinerei ! Bettlern ! Oui, té mentiants !
– Toujours explicites ces Teutons !… Mais, De Zater, pour en revenir à Lucrèce et à son rastaquouère…
– Qu'est-ce donc cette affaire de cartouches ?
– Pour le moins, un vol de grand chemin…
– Pas mal ! Mais je mets « cartouches » au pluriel et sans majuscule.
– Eh bien, voici : Béjard, l’unique Béjard, lui, toujours lui, vient d'acheter au dernier dictateur chilien, par l'entremise du senor Vera-Pinto et de compte à demi avec celui-ci, un solde de cinquante millions de cartouches, mises hors d'usage par suite de la réforme de l'armement. Il paraît que la digne paire d'amis s'est acquis ces munitions de rebut pour une croûte de pain… Or, ce malin de Béjard compte revendre séparément la poudre, le fulminate, le plomb et le cuivre qu'il retirera de ces cartouches, et réaliser de ce chef le joli bénéfice de plus de cinq cents pour cent…
– Une opération de génie ! opinèrent avec autant d'admiration que d'envie tous ces monteurs de coups constamment a l'affût des occasions de faire fortune du jour au lendemain. Jamais ils n'auraient trouvé ce moyen-là, si simple, pourtant. Vrai, ce Béjard pouvait être une canaille, mais il était diantrement fort, et leur maître à tous !
– Toutefois, des difficultés se présentent, continua Brullekens. Le tout n'est pas d'amener jusqu'ici ce lot colossal de cartouches ; il s'agit de se mettre en règle avec la douane, puis d'obtenir de la Ville l'autorisation de décharger ces redoutables produits, représentant une affaire de deux cents à deux cent cinquante mille kilos de poudre, c'est-à-dire plus qu'il n'en faudrait pour faire sauter Anvers et son camp retranché… La Régence hésite d'autant plus à assumer une grave responsabilité dans celte litigieuse affaire, que Bergmans, le vigilant agitateur, l'inconciliable ennemi de Béjard, ayant eu vent des manigances de celui-ci, ne cesse d'intimider notre Magistrat et d'exciter contre Béjard et sa mirifique entreprise les terreurs et la colère des portefaix du port qui n'ont pas encore oublié l'affaire des « élévateurs ». Aussi impopulaire qu'il soit, Béjard pare quelque peu les assauts du bouillant tribun en faisant miroiter aux yeux de cette population riveraine, généralement besogneuse, la perspective du travail facile et lucratif que leur procurera son industrie.
« À la Ville, il promet d'extraire tous les jours mille kilos de poudre des cartouches, de manière à en finir au bout de neuf mois. De plus, il s'engage à fournir toutes les garanties et à se conformer à telles mesures de précaution que lui imposera l'autorité. Et vous verrez, – au fond, je le souhaite, car l'affaire est trop sublime ! – que ce diable d'homme aura raison des obstacles qu'on lui suscite et qu'il se moquera une fois de plus, de la ville, de la province, du gouvernement, des foudres de Bergmans et même du vox populi ! »
Un mouvement qui se produisait de groupe en groupe vers l'entrée occidentale de la Bourse, jusqu'au quartier des coulissiers et des tripoteurs en effets publics, interrompit cet édifiant colloque. Les éclats d'une aigre contestation dominaient les psalmodies coutumières. La poussée et le vacarme devinrent tels que l'opulent Verbist, suprême amiral d'une flotte marchande de vingt navires, daigna s'enquérir auprès de son commis de la cause de cette perturbation.
– Claesaens, que signifie…
– Un escogriffe qu'on somme de payer ses différences, monsieur. Une triste espèce, à ce qu'on m'assure !
La face bouffie et adipeuse, blafarde comme un astre hydropique, sourit lugubrement, les épaules eurent un sinistre haussement et, en spectateur blasé sur ce genre d'exécutions et qui n'en était plus à compter les banqueroutes de ses contemporains, Verbist ne s'informa même pas du nom de l'agioteur indélicat, mais continua de se curer les dents le plus confortablement du monde.
C'était pourtant le bénin, le suave, l'unique Dupoissy que l'on prenait si vivement à partie. Le hasard voulait que le Sedanais s'abîmât sans retour le jour même où Béjard, son maître, son patron, doublait victorieusement le cap de la ruine.
La fréquentation de Béjard lui avait donné foi dans sa propre étoile. Ce satellite s'était cru planète. Ce volatile s'était pris pour un aigle et avait voulu voler de ses ailes. Le jour où les bruits de l'imminente déconfiture de Béjard commencèrent à circuler, le prudent Dupoissy le lâcha avec la désinvolture d'un laquais. D'ailleurs Béjard, mis au courant des trahisons de ce gluant personnage, n'avait rien fait pour le retenir.
Au temps de la prospérité de Béjard, Dupoissy s'était assuré de fortes commissions et lui qui n'avait jamais possédé un sou vaillant, dans sa patrie ou ailleurs, se trouva un moment à la tête d'un capital fort sérieux. Au lieu de s'établir et de se livrer, par exemple, au Commerce des laines et des draps, « parties » dans lesquelles il se proclamait d'une compétence sans égale, il risqua tout son avoir dans des opérations aléatoires et de longue haleine. Tant que Béjard fut là, le tripoteur profitait de ses conseils et quittait la partie, sinon sans profit, du moins sans perte désastreuse. Mais, abandonné à sa propre initiative, il se fit complètement ratiboiser. Il en était arrivé à négliger les précautions les plus élémentaires ; c'est à peine s'il s'enquérait de l'état du marché. Persuadé de son génie, il spéculait indifféremment sur les changes, les métaux, les effets publics et les marchandises. Quelque temps il parvint à faire escompter ses effets et à continuer ses « marchés fermes » ; puis, l'un après l'autre, les banquiers lui coupèrent le crédit ; enfin, à part quelques pigeons que dupait sa mine confite et onctueuse, son accent papelard, son fleur de respectability, et qui, sur la foi de ses jérémiades, le considéraient comme une victime de Béjard, il n'y eut plus pour lui livrer leur signature que des flibustiers aussi mal cotés que lui.
Il paya même cher la longanimité dont il bénéficia tout un temps.
C'était précisément, à la Bourse, jour de grande liquidation. Le faiseur, à bout d'expédients, avait passé la matinée à battre les guichets de la place, sans trouver à emprunter quarante sous. Cela ne l'empêcha point de se présenter en Bourse, comme d'habitude, luisant, bichonné, bénisseur, tendant à tous ses mains chattemiteuses et feignant de ne pas s'apercevoir des rebuffades et des affronts. Avisant un de ses contractants sur lequel il avait tiré à boulets rouges, il l'aborda, la bouche en cœur et se mit à l'entretenir d'une voix doucereuse et avec des gestes enveloppeurs, d'une opération superlificoquentieuse (il aimait ce mot) qui devait les enrichir tous les deux.
Il tombait mal cette fois.
– Je ne demande pas mieux que de traiter de nouveau avec vous, lui répondit le marchand, mais, auparavant, si vous voulez bien, nous liquiderons cette petite affaire de la Rente française. Vous savez ce que je veux dire… Voilà, trois mois que vous ajournez le règlement de cette bagatelle…
Dupoissy ne cessa pas de sourire et se récria :
– Comment donc ! Mais volontiers, cher ami. Et même à la minute… Justement j'allais vous prier de passer ce soir chez moi… Si je vous parlais de cette nouvelle affaire, c'est parce qu'elle se rattache étroitement à celle que nous savons terminée ; si étroitement, que nous pourrons les combiner je dirai, même les fusionner…
– Pardon ! interrompit l'autre, il ne s'agit pas de tout cela. En voilà assez de vos combinaisons continues. Avant de m'embarquer avec vous dans d'autres entreprises, je désire connaître enfin la couleur de votre argent…
– Monsieur Vlarding ! fit Dupoissy, jouer l'homme irréprochable outragé dans ses sentiments. Monsieur Vlarding, mon bon ami !
– Ta ta ta ! Il n'y a pas de Vlarding et de bon ami qui tiennent ! Vous allez me payer recta deux mille francs en échange du reçu que voici…
– Mais, mon vieil ami, pareils procédés de votre part, après tant d'années de mutuelle confiance…
– Trêve de protestations ! Je ne vous dis que ce mot : pagare, pagare !
– Lorsque je vous répète que je n'ai pas cet argent sur moi ! gémit Dupoissy à voix basse, et en pressant le bras de son interlocuteur. De grâce, calmez-vous… on nous écoute !
On commençait, en effet, à faire cercle autour d'eux. À l'ordinaire badauderie se joignait une curiosité maligne, attente d'une bagarre.
Mais plus Dupoissy essayait d'amadouer Vlarding, plus celui-ci criait :
– Pour la dernière fois, monsieur Dupoissy, êtes-vous disposé à me solder les deux mille francs ?
– Quand je les aurai ! laissa échapper le malheureux Dupoissy, perdant décidément la tramontane.
Vlarding bondit comme un chien flâtré.
– Comment dites-vous cela ? cria-t-il dans le visage du débiteur insolvable.
D'autres dupes faisaient chorus, à présent, avec Vlarding. C'était à qui réclamerait son dû.
– Payera ! Payera pas ! chantait la galerie, sur l'air des lampions, en se trémoussant, en trépignant de joie féroce.
– Messieurs, mes bons messieurs, laissez-moi sortir, je vous en conjure ! Je suis citoyen français, messieurs, j'en appelle au consul de mon pays… Messieurs, c'est une indignité…
– As-tu fini ? goguenardaient les jeunes Saint-Fardier. Haro sur le déserteur ! Haro sur l'homme de Sedan ! Ferme ta cassolette ! À la porte, Badinguet !
Mais les créanciers s'échauffaient et le menaçaient du poing, du parapluie et de la canne. Vlarding venait de lui abattre le chapeau de la tête.
– Non, non ! Pas de violence ! intercédait hypocritement la majorité des assistants. Faisons durer le plaisir.
Tremblant de peur, hagard, livide, la sueur et la pommade fondue lui découlant du front et des oreilles, le gros homme ne bougeait plus. Il embaumait à outrance. Mais moins heureux que le putois, son odeur ne tenait pas ses ennemis à distance. Comment aurait-il échappé à leur coalition ! La consigne avait été donnée. On ne le frapperait pas ; on se bornerait à le bousculer. Le jeu avait des règles consacrées par de nombreux précédents. Plus d'un boursier malhonnête avait été exécuté de la sorte. Les mains enfoncées dans leurs poches, les bourreaux ne jouaient que des coudes, des genoux ou des reins. Ainsi les vagues ballottent et roulent longtemps le naufragé, et le harcèlent de toutes parts, et se le renvoient l'une à l'autre, en lui faisant le moins de mal possible.
Dupoissy était bien un homme à la mer !
Il virait de droite et de gauche, louvoyait quelque temps dans un même sens, puis courait des bordées fantastiques. À peine un flot de tortionnaires l'avait-il projeté dans une direction, qu'un autre flot le ramenait à son point de départ. D'autres fois il restait immobile, broyé entre deux courants de même force, presque réduit en bouillie, aux trois quarts époumoné. Les questionnaires les plus rapprochés de lui risquaient de partager, son sort.
– Arrêtez ! Pas si fort ! criaient-ils à leurs camarades.
Une joie carnassière se repaissait de sa détresse. Un unique sentiment de cruauté confondait ces centaines de boursicotiers s'acharnant sur un joueur maladroit, ainsi que des collégiens sur leur souffre-douleur. Et, comme toujours les plus véreux, les plus obérés, prenaient à cette brimade la part la plus féroce.
Les millionnaires podagres se faisaient représenter à cette fête par leurs héritiers et leurs commis.
La police se tenait discrètement en observation. Tant qu'on n'endommageait pas la peau du patient et qu'on se bornait à le bousculer, elle n'avait pas mission d'intervenir. La tradition, autorisait les négociants assemblés à châtier, dans cette mesure, le spéculateur de mauvaise foi.
Entre les arcades du premier, étage, accoudés à la travée du promenoir, penchés sur cette véritable arène, les petits porteurs de dépêches jubilaient non sans éprouver quelque stupeur à la vue de ces personnages barbus et généralement compassés, s'émancipant comme des vauriens de leur âge, et l'envie leur démangeait de descendre dans la piste pour participer à ce sport de haut goût. Mais outre que les placides « gardes-ville » ne leur auraient pas assuré les mêmes immunités qu'aux boursiers, à la tangue un sentiment de terreur et de pitié entrait dans l'âme des gamins : ils regardaient encore, les yeux écarquillés, mais ils avaient cessé de rire.
Les rudes bateliers, si prompts à se colleter, demeuraient stupéfaits devant ce déchaînement de furie chez tous ces «chics messieurs», et ils en oubliaient de tirer des bouffées de leur brûle-gueule ou même de mordre leur chique.
Aucun des anciens amis du Sedanais, aucun, des amphitryons qui le recevaient autrefois à leur table, n'accourait à sa rescousse. Les plus humains, voyants la tournure critique que prenait l’altercation entre Dupoissy et ses créanciers, s'étaient prudemment esquivés, de peur d'être mêlés à l'esclandre ou pour s'épargner la vue de ces scènes pénibles.
Pendant, la tempête, une barque de pêche essaie d'enfiler le goulet du port. L'esquif a beau calculer son élan chaque fois la barre l'entraîne à la dérive ou menace de le briser contre les estacades. La tourmente humaine leurrait ainsi le pitoyable Sedanais et ne le rapprochait d'une des portes de salut que pour le rejeter à l'intérieur, et cela parfois en risquant de le fracasser contre les piliers.
Comme après bien des affres et bien des péripéties, une formidable impulsion le dirigeait pour la vingtième fois vers la sortie, un retardaire venant de la rue poussa la porte capitonnée.
– Tenez la porte ouverte, Béjard ! mugit en s'épongeant Saint-Fardier père, qui s'était passionné pour ce jeu comme un étudiant d'Oxford à un match de foot-ball.
Ganté de frais, la taille prise dans un pardessus de coupe irréprochable, la boutonnière fleurie, plus superbe, plus maître de lui, plus dominateur que jamais, Béjard devina la situation, et n'ayant plus rien de commun avec son ancienne créature, tenant surtout à affirmer qu'il la répudiait sans merci, notre homme se prêta avec empressement à ce que la cohue attendait de lui.
S'effaçant contre la muraille, il tint la porte entrebâillée pour livrer passage à la victime. Son visage s'éclairait d'une joie satanique. Vrai, il était propre à présent, le patelin lâcheur ! De son côté, Dupoissy reconnut son ancien associé. Se voir ainsi houspillé devant lui ! C'était là le coup de grâce, le suprême opprobre ! Franchement il ne méritait pas ce surcroît d'ignominie ! Il concentra tout ce qui lui restait de ressort, de flamme, d'énergie vitale, pour lancer au triomphateur un regard d'atroce rancune, quelque chose comme une imprécation muette. Le crapaud doit avoir de ces regards sous le sabot d'un maroufle. Béjard ne broncha pas sous ce fluide vindicatif. Rien n'était, au contraire, plus flatteur pour lui. Au moment où une dernière ruée accélérait l'essor du Sedanais et où il filait avec la véhémence d'un projectile devant le député Béjard, celui-ci lui fit une révérence profonde de tabellion qui reconduit un visiteur considérable.
Le Dupoissy alla rouler comme un ballot avarié sur le pavé entre les deux trottoirs. Béjard le vit se ramasser, s'épousseter et se traîner, en longeant les murailles, avec des façons de limace.
Puis, lent et correct, sans s'occuper davantage de cette épave, le grand homme laissa retomber la porte et entra dans le temple où l'attendaient les félicitations et les hommages d'une tourbe prête à le traiter comme Dupoissy le jour où la Fortune cesserait de l'élire si manifestement pour son favori.
TROISIÈME PARTIE : LAURENT PARIDAEL
I. LE PATRIMOINE
Laurent venait d'atteindre sa majorité et le directeur de la fabrique l'invita par lettre strictement polie à passer par ses bureaux. Laurent retrouva son tuteur comme il l’avait quitté quatre ans auparavant, du moins quant à l'allure, à la tenue et à l'abord. Son masque impassible et lisse était un peu ridé, ses cheveux avaient blanchi et il levait moins haut son front autoritaire. Sur le bureau déshonoré il y a des années par le malencontreux Robinson Suisse s'étalaient à présent une liasse de banknotes et une feuille de papier couverte de chiffres alignés en colonne.
L'industriel, toujours à la besogne, répondit à peine au : « Bonjour, cousin ! » que Laurent essayait de rendre aussi soumis, aussi affectueux que possible.
– Veuillez prendre connaissance de ce tableau et vérifier l'exactitude des calculs. Ceci vous représente mes comptes de tutelle : d'un côté vos revenus, de l'autre les frais de votre entretien et de votre éducation… Vous m'accorderez que je me suis abstenu autant que possible d'ébrécher votre petit capital. Lorsque vous aurez examiné ce travail, je vous prie, si vous l'approuvez, de signer ici… Vous pourrez emporter un double de cette pièce…
Laurent fit un mouvement pour saisir la plume et signer de confiance.
M. Dobouziez lui arrêta le bras, et de sa voix égale : « Pas de cela !… Vous me désobligeriez… Lisez d'abord. »
Quoi qu'il en eût, Laurent s'assit devant le pupitre et fit mine de revoir attentivement le détail des opérations. En attendant, son tuteur lui tournait le dos et regardait par la fenêtre, en tambourinant les vitres.
Laurent n'osa pas couper trop vite court à ce simulacre de vérification. Il attendit cinq minutes ; puis se risqua à appeler l'attention de son parent :
– C'est parfait, cousin !
Et il se hâta de signer de son mieux ce tableau dressé avec tant de netteté et de minutie.
M. Dobouziez se rapprocha du pupitre, passa le buvard sur la pièce approuvée et la serra dans un tiroir.
– Bon. Il vous revient donc trente-deux mille huit cents francs. Voyez là, si vous trouvez votre compte.
Pris a la fois de dépit et de chagrin, Laurent empochait, pêle-mêle, les billets et les espèces.
– Comptez d'abord ! arrêta M. Dobouziez.
Le jeune-homme obéit de nouveau, compta même à haute voix, puis, suffoquant, avant d'être arrivé à bout de sa numération, repoussa, d'un mouvement brusque, billets et numéraire entassés…
– Eh bien ? Y a-t-il erreur ?
Le féroce honnête homme !
Laurent aurait voulu lui dire : « Gardez cet argent, tuteur… Placez-le vous-même… Je n'en ai pas besoin ; je le dépenserai, il m'échappera, car il ne me connaît pas… Tandis que vous êtes homme à le manier et à en user comme il convient… »
Mais il craignit que le superbe Dobouziez, habitué à jouer avec des millions, ne prît pour une insultante familiarité l'offre de ce capital dérisoire…, l'héritage de feu Paridael, ce pauvre commis…
Et pourtant, comme le fils Paridael eût prêté et même donné de bon cœur les économies du commis défunt à ce patron de la veille, devenu commis à son tour.
– Dépêchons ! répéta M. Dobouziez d'un ton glacial après avoir consulté son chronomètre.
Force fut à Laurent de prendre son bien. Il s'attardait encore en regagnant la porte : « Permettez-moi au moins, cousin, de vous remercier et de vous demander… » balbutia-t-il, poussant la conciliation jusqu'à se repentir de ses torts involontaires et à se reprocher l'antipathie qu'il avait inspirée, malgré lui, à ce sage.
– C'est bien ! c'est bien !
Et le geste et la physionomie imperturbables de Dobouziez continuaient de lui répéter : « J'ai fait mon devoir et n'ai besoin de la gratitude de personne ! »
Les opérations étaient exactes. Le patrimoine avait été géré d'une manière irréprochable. Le résultat était prévu. Tout était prévu !
Ah ! il ne se doutait pas, le rationnel Dobouziez, de la façon hétéroclite dont l'orphelin lui témoignerait bientôt sa reconnaissance ! Il oubliait, le parfait calculateur, que certains problèmes ont plusieurs solutions. Sinon, il aurait peut-être rappelé le jeune homme qu'il congédiait si catégoriquement et lui aurait dit : «Soit, malheureux enfant, laisse-moi ton petit pécule et surtout ne te crois jamais notre obligé, le débiteur de Gina et de son père, le vengeur fatidique de ma fille… »
Laurent ne se doutait pas, en ce moment, de ce qui devait arriver et, cependant, il se sentait monter au cœur une sourde et opaque tristesse. Avant de se rendre à la fabrique, il s'était réjoui à l'idée de devenir son propre maître, de toucher un vrai capital, presque une fortune !… Et à présent qu'il tenait ces billets et cet or, ils lui brûlaient la poche et l'inquiétaient comme s'ils ne lui eussent pas appartenu. Vrai, un voleur n'eût pas été plus soucieux que ce propriétaire.
Il était autrement confiant et dispos lorsqu'il s'était séparé, la dernière fois, de son tuteur. Que d'illusions et que d'espérances alors ! Avec les cent francs qu'il palpait mensuellement, il se croyait le plus riche des mortels et à présent que son avoir se chiffrait par milliers de francs, il n'avait jamais lié aussi embarrassé de sa personne, aussi indécis, aussi mal dans son assiette.
Arrivé dans la rue, le Fossé lui sembla effluer des miasmes prophétiques : le Fossé lui-même se tournait contre lui ! Paridael flairait d'occultes menaces dans ces émanations, mais sans parvenir à déchiffrer ces vagues présages. En attendant, sa mauvaise humeur retournait sur l'usinier :
– Quelle banquise ! marmonnait-il outragé dans ses fibres aimantes. Il m'a reçu comme le dernier des coupables. À la fin, si je ne m'étais contenu, je lui aurais jeté ce sale argent au visage… ce sale argent !
Et se sentant très seul, très abandonné, prenant peur de lui-même, redoutant ce premier tête-à-tête avec sa pesante fortune, afin de secouer ses pensées noires, l'idée lui vint de se rendre chez les Tilbak.
L'autre fois aussi, cette visite avait été la première après son départ de la fabrique. Aussitôt, reprenant possession de lui-même, aux trois quarts rasséréné, il pressa le pas. En marchant, il se représentait d'avance le vivifiant et salubre milieu où il allait se retremper.
Depuis quelque temps, il avait négligé ses bons amis. Des scrupules honorables étaient cause de cette apparente indifférence. Henriette ne semblait plus la même son égard : non pas que son affection pour lui eût diminué, bien au contraire ! mais quelque chose de fébrile et de contraint se mêlait maintenant à sa parole et, sans y mettre la moindre fatuité, le jeune homme se croyait, de la part de la jeune fille, l'objet d'un sentiment plus vif qu'une amitié fraternelle. Or, incapable d'oublier la superbe Gina, Laurent craignait d'alimenter cette passion à laquelle il ne voyait point d'issue, car il se fût tué avant d'abuser de la confiance que Vincent et Siska plaçaient en lui.
Mais comme il cheminait aujourd'hui vers la Noix de Coco et qu'une réaction bienfaisante s'opérait dans son esprit, l'image d'Henriette lui apparut plus douce, plus touchante que jamais, et, à cette évocation, il éprouva ou du moins s'excita à éprouver pour la jeune fille une inclination moins quiète et moins platonique que par le passé. Qu'avait-il erré si longtemps ! Il tenait le bonheur sous la main. Il ne pouvait mieux inaugurer sa vie nouvelle et rompre avec ses anciennes attaches qu'en épousant la saine et honnête enfant des Tilbak.
L'état dans lequel l'avait plongé son entrevue avec Dobouziez contribua à accélérer cette résolution. Rien ne lui parut plus raisonnable et plus réalisable. Le consentement des parents lui était acquis d'avance. On publierait aussitôt les bans.
En caressant ces perspectives matrimoniales, il arriva à la Noix de Coco et, traversant la boutique, entra directement, en familier, dans la chambre du fond. Il trouva tous les membres de la famille réunis, mais fut frappé par leurs mines allongées et chagrines. Avant qu'il eût eu le temps de leur demander une explication, Vincent l'entraîna dans la pièce de devant et, après une quinte de toux nerveuse, lui dit d'une voix engorgée :
– C'est décidé, monsieur Lorki, nous émigrons, nous partons pour Buenos-Ayres…
Laurent crut s'effondrer.
– Mais, mon brave Vincent, vous perdez la tête…
– Nullement, c'est tout à fait sérieux. Ce matin j'ai pris moi-même mon passage chez M. Béjard, au quai Sainte-Aldegonde. Je vais m'embarquer… J'ai même touché la prime… Voilà des mois que ce projet me trottait par la caboche. Il n'y a plus rien à entreprendre ici pour nous. Le commerce des bousingots et des casquettes ne va plus. Le biscuit se fait rare.
« On a gâté le métier. Avec ces runners qui accaparent le marin dès l'embouchure de l'Escaut et l'entraînent, ivre et abruti, au fond de leurs cavernes où ils le plument et l'écorchent jusqu'à la moelle, le petit boutiquier doit renoncer à la lutte… À moins de compagnonner avec eux, recourir à leurs pratiques, de leur disputer la proie à coups de poing et de couteau ! Autant m'engager tout de suite dans une bande de francs voleurs !
« D'autre part l'invention des allèges à vapeur me force de vendre mon batelet pour du bois à brûler… Et, pour nous achever, voilà que nos fils ne trouvent plus à se placer… Nos grands chefs de maisons n'engagent que des volontaires allemands. Les mieux, disposés pour leurs pauvres concitoyens, notamment M. Daelmans-Deynze et M. Bergmans, sont assaillis de demandes et ont embauché déjà plus du double d'employés nécessaires ! Par une faveur spéciale ils ont bien voulu se charger de notre Félix. Encore parlent-ils de l'envoyer à Hambourg : dans une de leurs maisons succursales. Il faudrait pouvoir attendre qu'une place devint vacante pour notre Pierket. Mais d'ici là, nous avons le temps de nous serrer le ventre… Vous le voyez, c'est la fin. Anvers ne veut plus de nous. Aussi avons-nous pris le parti de nous en aller tous. Et, s'il nous faut crever, du moins aurons-nous vaillamment tenté jusqu'au dernier effort pour vivre !… »
Et Tilbak refoula par un terrible juron l'émotion qui l'étranglait.
– Non, non, s'écria Laurent, en ; lui donnant des tapes dans le dos, pour le réconforter : Vous ne partirez pas, mon brave Vincent. Et je bénis doublement l'inspiration qui m'amène ici ! Depuis ce matin je suis riche, mon excellent gaillard ! Je possède largement de quoi vous venir en aide à vous et aux vôtres. C’est plus de trente mille francs que je tiens à votre disposition, mon très cher. Vous n'avez jamais douté de moi, je suppose. Eh bien, alors ! Allons qu'on cesse de se lamenter… Mais avant de retrouver Siska et vos enfants, laissez-moi compléter ma démarche L'argent qu'il vous répugnerait peut-être de tenir d'un ami, vous serez obligé de l'accepter d'un fils, oui, d'un fils – Siska ne m'a-t-elle pas toujours considéré comme son aîné ? – ou, si vous l'aimez mieux, de votre gendre… Vincent, accordez-moi la main de votre fille Henriette !
Tilbak lui appuya les mains sur les épaules et le regarda au fond des yeux :
– Merci, monsieur Laurent. Votre offre généreuse ne nous touche pas moins profondément que votre demande, mais nous ne pouvons y donner suite… Il y a longtemps que ma femme a lu dans le cœur de notre fille et qu'elle combat le sentiment déraisonnable qui s'y est logé ; Pour ne rien vous cacher, cet amour est même une des causes de notre départ… Tous, ici, nous avons besoin de changer d'air…
« Je vous le dis, à vous aussi monsieur Laurent, ce mariage est impossible. Même si j'y avais consenti, ma femme s'y serait opposée de toutes ses forces. Vous ne connaissez pas encore notre Siska. Elle entretient sur le devoir des idées peut-être très singulières, mais certes très arrêtées. Du moment qu'elle a dit : ceci est blanc et cela noir, vous auriez beau la prêcher, vous ne l'en feriez plus démordre… Savez-vous qu'elle croirait manquer à la mémoire des chers morts vos parents, si jamais elle autorisait une alliance entre sa famille et la vôtre… Vous êtes jeune, monsieur Laurent, vous possédez un gentil avoir, on vous a donné l'instruction, des parents riches vous laisseront peut-être leur fortune… et vous ferez un parti digne de cette fortune, de cette éducation et de votre nom : un parti répondant aux vues que vos pauvres chers morts, eux-mêmes, auraient entretenues concernant votre avenir… Voyez-vous votre opulente famille reprocher à notre Siska de vous avoir endossé sa fille et la considérer comme une intrigante, une misérable intruse…
– Vincent ! s'écria Laurent en lui fermant la bouche… Soyez raisonnable, Vincent… Je me moque bien de ma noble famille… Vrai, pour ce qu'il m'en reste, il serait absurde de me contraindre… Vous finiriez, en me parlant ainsi, par me la faire haïr !… Que n'assistiez-vous tout à l'heure à l'accueil que m'a fait ce Dobouziez ! L'âge et les mécomptes l'ont rendu plus pisse-froid que jamais… Je ne suis plus des leurs. Je me demande même si je l'ai jamais été ! Je ne leur dois rien. Nos derniers liens sont brisés… Et c'est à ces parents qui me renient, que je sacrifierais mes affections !… Allons, votre refus n'est pas sérieux… Siska sera plus raisonnable que vous…
– Inutile ! monsieur Laurent. Sachez même que si ma femme avait prévu cette amourette, jamais elle ne vous aurai attiré ici… Épargnez-lui la peine de devoir encore accentuer mon refus…
– Soit, dit Laurent. Mais si mes visites vous importunent, si un faux point d'honneur, oui, je dis bien, tant pis si vous vous fâchez ! vous interdit de m'agréer pour gendre, moi qui comptais si loyalement rendre heureuse votre Henriette ! du moins rien ne vous empoche de m'accepter pour créancier et, désormais, il est inutile d'émigrer…
– Merci encore, monsieur Laurent, mais nous n'avons besoin de rien… Pour tout vous dire, Jan Vingerhout, le baes de 1’ « Amérique », votre ami, nous accompagne… Il a réalisé son dernier sou et lui aussi va tenter la fortune dans une autre Amérique…
– Ah ! je devine ! s'écria Paridael, C'est à lui que vous donnez Henriette…
– Eh bien, oui !… Jan est un brave garçon de notre condition, que vous, tout le premier, avez apprécié… Et j'aurai même à vous demander une grâce, monsieur Paridael… Jamais notre ami ne s'est douté de l'amour d'Henriette pour vous… Oh, faites qu'il ignore toujours le caprice extravagant de notre fillette…
– C'en est trop ! interrompit Laurent. Ne vous faut-il pas que j'entre dans vos plans jusqu'à me faire haïr de votre fille ?
Et intérieurement il se disait : « Trop pauvre pour Gina, trop riche pour Henriette ! » Puis, donnant libre cours à son amertume :
– Vrai, mon cher Tilbak, vous êtes tous les mêmes à Anvers… Vous ravalez tout à une question de gros sous. Mon digne cousin Dobouziez vous approuverait sans réserves… Les liens du cœur, les sympathies ne comptent pas. Tout s'efface devant des considérations de boutique. L'or seul rapproche ou divise. Ah ! tenez, tous, tant que vous êtes, avez une tirelire à la place du cœur ! Vous-mêmes, les Tilbak, que je considérais comme les miens, vous ne valez pas mieux que le reste !… Et je suis destiné à vivre toujours seul, et toujours incompris… Éternel déclassé, créature d'exception, nulle part je ne rencontrerai des pairs, des semblables, des vivants de ma trempe !…
Et, en proie à une crise nerveuse qui couvait depuis le matin, le corps tendu et secoué par ces émotions réitérées, il s'affala sur une chaise et serait à fondre en larmes comme un enfant.
Cependant Siska, attirée par les éclats des voix, avait, entrouvert la porte et entendu la fin de cette conversation. Elle s'approcha du jeune homme et essaya de le calmer par de maternelles paroles :
– Méchant enfant ! Parler ainsi de nous ! Écoutez-moi, mon cher Laurent, et ne vous fâchez pas. Nous nous expliquerons encore une fois sur toutes ces choses avant notre départ, mais pas aujourd'hui. Vous êtes trop exalté. Qui sait ? Peut-être vous ouvrirai-je les yeux sur l'état de vos propres sentiments !
Un peu intimidé par le ton solennel dont la maîtresse femme prononça ces quelques mots, Laurent se contint et, après une conversation indifférente, rentra dans la pièce de derrière et prit, avec assez de calme, congé de la famille.
À quelques jours de là, Paridael retourna chez les Tilbak. Siska s'occupait vaillamment des préparatifs du départ. Laurent lui ayant demandé l'explication promise, elle interrompit son travail, et coulant un regard inquisiteur jusqu'au fond des yeux du jeune homme :
– Ce que j'avais à vous dire, Laurent, dit-elle, c'est simplement que vous n'avez jamais aimé Henriette.
Laurent essaya de protester, mais comme les yeux clairs et fermes de la digne femme continuaient de scruter les siens, il rougit et baissa même la tête.
– Et cela parce que vous en aimez une autre ! poursuivit Siska. Je vous dirai même quelle est cette autre : votre cousine Gina, devenue Mme Béjard… Vous ne le nierez pas. Croyiez-vous donc pouvoir me cacher ce secret ? Votre trouble lorsqu'on parlait de Mme Béjard ; votre affectation, à vous, de ne jamais en parler, l'aurait révélé à des devineresses moins adroites que moi. Oui, Henriette elle-même a su de quel côté tendait votre réel amour… Certes, vous chérissez notre enfant… Sous l'impulsion de vos sentiments généreux vous seriez prêt à épouser la petite. Mais au fond, vous auriez continué de préférer l'autre. Son souvenir se serait placé entre Henriette et vous. Et ni vous ni votre femme n'auriez rencontré le bonheur que vous méritez tous deux… Aussitôt que ma fille a soupçonné votre passion pour Mme Béjard, j'ai achevé de lui dessiller complètement les yeux et suis parvenue à la guérir de son amour pour vous… Ah, il le fallait ! Je mentirais en disant que la guérison a été facile… Laurent, si vous me jurez que vous aimez réellement Henriette et qu'elle est à la fois la préférée de votre cœur et de votre chair, je suis encore proie à vous la donner ! En agissant autrement, je serais deux fois mauvaise mère…
Pour toute réponse, le gars sauta au cou de sa clairvoyante amie et lui confessa longuement ses peines et ses postulations contradictoires.
II. LES ÉMIGRANTS
Béjard, Saint-Fardier et Vera-Pinto avaient bien choisi leur moment pour faire le trafic de la viande blanche, de l'ivoire comme disait De Zater. Il y avait gros à gagner par ce vilain commerce. C'était dans leurs étroits bureaux un défilé, une procession continuelle. Saint-Fardier trônait, et faisait marcher à la baguette ces hordes, ces tribus de pauvres diables. C'était lui qui envoyait les recruteurs battre et drainer le pays.
Originaire de l'Irlande, l'émigration gagna la Russie, l'Allemagne, puis le Nord de la France. Des milliers d'étrangers s'étaient déjà expatriés, avant que cette fièvre se fût inoculée aux Belges. D'abord la contagion se mit parmi les ouvriers du Borinage et du pays de Charleroi, houilleurs que leur dur et servile travail souterrain empêche à peine de mourir, cyclopes déchus, placés entre l'intolérance des meneurs et la dureté des capitalistes, énervés par le chômage et les grèves, et, lorsque le grisou les épargne, achevés par les balles des soldats.
Et, après avoir dépeuplé la Wallonie, la rage de l'expatriation ébranla les Flandres. Tisserands et filateurs gantois, les poumons obstrués par le ploc, plièrent bagage et passèrent en Amérique comme, il y a des siècles, leurs ancêtres s'étaient transportés en Angleterre.
Enfin, l'impulsion se communiqua au pays d'Anvers.
Longtemps les dockers, peinant au rivage même, d'où s'éloignaient, parqués comme des ouailles, de pleines cargaisons de proscrits, résistèrent à l'entraînement général. Méfiants, sceptiques, ils ne se souciaient point d'engraisser, de leurs carcasses, les terres d'où nous viennent les guanos fameux, après avoir cédé leur dernier liard aux agences d'émigration, qu'ils voyaient prospérer et gonfler autour d'eux, comme des sangsues gorgées du sang des vieux locatis.
Auparavant, le départ d'un paysan ou d'un ouvrier stupéfiait tout le quartier ou toute la paroisse. On le considérait comme un coup de tête, une apostasie, l'acte d'un être dénaturé. Il n'y avait, de loin en loin, que les mauvais journaliers, les valets de ferme renvoyés de partout, la racaille, qui, ne sachant plus à quels baes louer leurs bras, finissaient, sous l'influence d'une dernière ribote, par se vendre au racoleur de volontaires pour l'armée des Indes hollandaises.
Mais voilà que l'expatriation entrait dans les mœurs des bons sujets. Par centaines, urbains et ruraux, des bords de l'Escaut ou des dunes ou des garigues de la Campine, terrassiers du Polder, lieurs de balais de la Bruyère, fuyaient le pays comme pourchassés par les flots d'une inondation occulte.
L'inquiétude du toit familier, le doute de la bonté patriale, une impatience de nomades, un instinctif besoin de déplacement, pénétraient et rongeaient les écarts lointains.
Les mêmes pionniers qui n'auraient jamais, au grand jamais, consenti à échanger leur servage aussi ingrat, aussi pénible qu'il fût, contre une lucrative besogne dans la cité, subissaient du jour au lendemain le vertige de l'exode et s'expatriaient en masse.
Combien pourtant, de ces terriens invétérés, leurs entrailles presque jumelles de la dure, plus dure chez eux que partout ailleurs, subissant avec une volupté de fanatique les réactions sournoises du climat et de l'atmosphère, leurs soubassements charnus adhérant aux labours fauves comme leurs grègues, avaient souffert autrefois d'âpre nostalgie, lorsque la conscription les transplantait brutalement au milieu du brouhaha et du tourbillon urbain, les dépouillait de leur trousse de laboureur pour leur faire endosser la livrée du milicien et les détenait dans ses casernes putrides, loin des balsamiques landes natales, ou les jetait à certains jours, mornes, ahuris, sur le pavé semé d'embûches ! Quelle détresse, quelles aspirations vers le misérable là-bas ! Que d'heures à ruminer des riens de souvenirs !
Ah ! les retours furtifs du soldat au pays ; les minutes exactement supputées, la route brûlée comme par un fugitif.
Le congé d'un jour, la courte sortie utilisée pour passer une heure, rien qu'une heure, au foyer natal, les apparitions inopinées, en nage, pantelant, essoufflé comme un batteur d'estrade qui aurait fait un mauvais coup ; seulement le temps d'aller et de repartir, de toucher pied au terroir de ses exclusives délices, d'embrasser les anciens et la promise, de respirer l'odeur des brûlis dans l'émolliente humidité du crépuscule !
Et, à présent, ces mêmes rustauds endurcis se voyant acculés dans une alternative sinistre, consentent, remplis d'une poignante et farouche résolution, à se laisser amputer de leur patrie !
Longtemps leurs âmes féales ont résisté. Tant qu'ils parvinrent à partager, entre les leurs, la croûte de pain noir et l'écuellée de pommes de terre, ils se sont roidis, le ventre serré, butés dans leur attachement au pays, comme les chrétiens dans leur foi ; mais, du jour où les femmes, les petits mêmes n'eurent plus rien à se mettre sous la dent, oh ! leur sombre héroïsme a fléchi, et un matin ils se sont décidés à l'exil, comme on se résigne au suicide.
C'en est fait. La maisonnée vide le chaume patrimonial ; son chef renonce aux terres affermées, vend le bétail, les chevaux, les attelages, les instruments de culture !…
La défaite des plus tenaces partisans du terroir, des meilleurs, parmi les blousiers, ébranle, affole le reste de la population ; la panique se propage de clocher en clocher.
Des fermiers qui auraient pu tenir bon quelques années encore et résister à la crise, prennent peur, emboîtent le pas à leurs valets et aux meurt-de-faim. Ils se sont rappelés tant de leurs voisins et des plus argenteux, qui avaient toujours espéré, qui s'étaient évertués contre les épreuves redoublées, contre la chronique détresse, jusqu'à ce que l'insuffisance des récoltes, encore aggravée par la concurrence des greniers transatlantiques, les eût réduits sur leurs vieux jours, à prendre, service dans la ferme même où ils avaient commandé.
Les prévoyants emportaient leur outillage et leurs bêtes de labour. Ils allaient bravement à ces pays fertiles, à ces terres promises, à ces eldorados, à ces contrées de cocagne, mystérieux royaumes de quelque prêtre Jean, Amériques croulantes de blés et de fruits, dont les produits, bétail gras, viandes savoureuses, blés prolifiques, inondaient, par delà les océans, les marchés de l'Europe, confondaient et submergeaient la faune et la flore dérisoires arrachées à nos pâturages et à nos guérets épuisés. Non, plutôt que d'attendre le coup de grâce, colons de l'Europe caduque passeraient au continent pléthorique.
Et, pour achever la déroute et transformer en nomades ces ruraux réputés indéracinables, des embaucheurs à la langue bien pendue, adroits et insinuants, se rendaient de bourgade en bourgade, visitaient les cabarets aux jours de vente et d'assemblées et profitaient de la prostration et du déboire dès pauvres gars les soirs de dimanche, les lendemains de kermesses pour effréner leurs cervelles dans de troublants mirages de prospérité. Afin de mieux écouter le tentateur, au mielleux bagout, à la clinquante loquèle, les vachers en garouage, les faneurs calleux et poupards, bouche bée, regards extatiques, laissaient s'éteindre leur pipe de terre. Le fluide de la merveillosité traversait leur derme hâlé et luisant, chatouillait jusqu'aux moelles leurs fibres ingénues, stupéfiait leur sens matois, et les tenait haletants, suspendus aux lèvres du drôle d'où partaient en feu d'artifice, des descriptions plus éblouissantes, plus enluminées que les chromos de la balle du mercier et le paravent du marchand de complaintes.
Une nuée de ces maquignons recrutés parmi des procureurs de bas étage s'était abattue sur le pays comme des chacals sur un champ de bataille. Ils avaient des allures louches, des façons familières, des dégingandements de mauvais camelots qui' eussent dû mettre en défiance des âmes moins simples.
Ainsi, ils examinaient les manouvriers de fière mine, les inspectaient des pieds jusqu'à là tête avec une persistance presque gênante, allant même jusqu'à leur passer la main sur les bras et les cuisses, les palpant, les attouchant, les éprouvant comme on fait au bétail et à la volaille, les jours de marché ; leur prenant le menton comme s'il s'agissait de vérifier l'âge en bouche d'un poulain ; encore un peu ils auraient invité ces simples à se déshabiller pour les ausculter et les visiter plus à l'aise. Sur les marchés de bois d'ébène les négriers ne se comportent pas autrement avec les noirs. Ils manœuvraient surtout autour des jeunes gens vigoureux, captaient leur confiance, gouailleurs, paternes, plaisantins comme des chirurgiens militaires présidant au conseil de révision.
Ces embaucheurs, transfuges des campagnes ou efflanqués de barrière, rompus aux besognes malpropres, s'entendent à allumer les convoitises dans ces cœurs primitifs, mais complexes ; attisent ce vague besoin de jouissance qui dort au fond des brutes ; amorcent ces illettrés, les chauffent, les malaxent au moral comme au physique.
Circonvenus, ravis comme dans un rêve, nos rustauds hument le mielleux discours, se prêtent aux insidieuses caresses ; jamais on ne leur en a tant dit, jamais témoignages aussi flatteurs ne les ont réhaussés à leurs propres yeux, les patauds ! Imprégnés de tiédeur, ils se laissent faire, deviennent la chose lige de leurs magnétiseurs et ne bougent plus de peur que cette douceur, ce long énervement ne cessent ! Et tout à l'heure, le recruteur n'aura qu'à tirer son filet pour y tenir la copieuse et florissante recrue.
Ah ! ils ne sont pas dégoûtés, les entrepreneurs d'émigration ! Après avoir opéré dans le reste de l'Europe et drainé des races prolifiques, mais dégénérées, voici qu'ils jettent leur dévolu sur le meilleur sang des Flandres, sur de solides et fermes gaillards, patients et laborieux comme leurs chevaux. « Il nous faut cent mille Belges et nous les aurons dans six mois ! » ont déclaré Béjard, Saint-Fardier et Véra-Pinto. Et leurs racoleurs à gages de se mettre à l'œuvre. Hardi, les imposteurs ! À la curée, les vampires ! La commission vaut la peine qu'on se dérange. C'est quinze à vingt francs, suivant sa qualité, pour chaque tête de Flamand livrée à l'expéditeur de viande humaine.
Mais ils se gardent bien d'avouer leurs profits, les rabatteurs et les traqueurs subalternes. À les entendre, ce sont les plus désintéressés des apôtres, de purs philanthropes, particulièrement dévoués aux campagnards.
Les boniments ruissellent d'or et de soleil. Les courtiers en mensonges promènent leurs écoutants par les possessions promises ; des jardins paradisiaques et des palais de féerie. L'ardeur et la lumière des tropiques embrasent et illuminent tout à coup les horizons mélancoliques de ces visionnaires : un écran magique dans une chambre obscure. Les blés mûrs couronnés d'épis aussi gros que leurs tignasses blondes, lèvent leurs gerbes à hauteur des toits ; les arbres ploient sous des citrouilles qui sont des pommes. Ces sablons rapportent du tabac ; des ruisseaux de lait irriguent les novales ; des potagers montent doucement vers le ciel plus bleu que la robe des congréganistes, filles de Marie ; et cette pourpre subitement avivée et scintillante qui drape, à perte de vue, les flancs de ces coteaux infinis, n'est plus, celle de vos bruyères, ô mes épais buveurs de bière, mais celles de vos vignobles, ô futurs broyeurs de raisins.
Parfois le charmeur s'interrompt, autant pour reprendre haleine que pour donner aux simples, qu'il accable de ses promesses, le temps de savourer et de humer ces évocations parfumées.
Il vante ensuite la bonté de la température, la clémence du climat, l'éternel sourire des saisons, et aucun hiver, aucun ouragan pour déconcerter les prévisions du cultivateur et pour confondre ses récoltes.
Là, le travail est un délassement ; pas de propriétaire, pas de maître, pas de soucis ; ni servitude, ni même de redevance.
Tour à tour badin et attendri, l'imposteur enivre absolument son auditoire. À la pompe d'un descriptif forain, aux hyperboles d'un dentiste, le suppôt des marchands d'âmes mêle des lazzis de carrefour ; il saupoudre son éloquence des grosses épices du luron en sabots ; il flatte les faiblesses, émoustille la sensualité brutale, appâte la gloutonnerie charnelle de ces amoureux sans vergogne, leur fait entrevoir des proies complaisantes, des victimes très pitoyables à leur afflux de sève, à leurs dégorgements d'humeur, à leurs frénésies, exaspérées par des continences prolongées et des effusions contrariées. Les maroufles s'affriolent, la gorge sèche, ou se trémoussent, aux images croustilleuses, harcelés, déniaisés par le vice subtil et piquant de ce drôle, de ce ribaud pervers et squammeux comme les sirènes.
Enfin, pour frapper un dernier coup, l'entremetteur propose de lire des lettres d'aventuriers qui ont fait fortune là-bas : Ah ! elles sont authentiques comme l'Évangile, ces épîtres ! Vérifiez plutôt, vous l'instituteur qui savez lire ! Voyez les cachets et les empreintes de l'enveloppe les noms de bureaux de poste escales… Et ces timbres, ces « petites têtes » comme vous les appelez, ne réfléchissent point les traits de notre roi « Liapol ». Lisez vous-même, hé ! le maître d'école ?… Vous voyez bien que je neveux pas leur en faire accroire. Voici mes dires écrits noir sur blanc !
Dans ces lettres les éloges fluent, grossiers, dictés d'Europe ou élaborés dans les facendas des pourvoyeurs de là-bas. Le compérage désabuserait des écoutants plus lettrés. « Oui, garçons, je repars moi-même dans quelques jours… Voyons, qu'on se décide qui de vous m'accompagne ? Aussi vrai qu'il y a un Dieu, je ne parviendrais plus à me réhabituer à notre pauvre petite Europe.
Et le drille facétieux les presse, les capte, les englue. Parfois, pour mieux appuyer ses discours, il fait rouler, avec une feinte négligence une poignée d'or sur la table poissée par les culs de verres. Ce sont des monnaies étrangères, énormes. Là-bas on ne paie qu'en or et en pièces grandes comme nos misérables cinq francs en argent. Au tintement des piastres, les prunelles du petit vacher lancent des flammes de conquistador : sa maritorne commande à des centaines de servantes, ne vêt que des dentelles et se vautre dans la couette.
Rentrés chez eux, les gars ruminent ces images, ils n'en dorment pas ou les revoient en rêve. Les maris discutent sur l'oreiller avec leurs ménagères ; d'abord bougonnes et réfractaires, peu à peu celles-ci se laissent convaincre et éblouir.
Aux champs devant le ciel maussade, au milieu du navrement de la plaine, en éventrant la terre qui leur parait plus récalcitrante que jamais, le mirage revient les hanter, et, lâches à la peine, les coudes et le menton appuyés sur la paume de la houe, ou en sifflant indolemment ses bœufs, le laboureur se remémore les pays fabuleux et songe aux promesses de l'embaucheur.
Et cet or que l'allumeur manipulait ! Un seul de ces disques jaunes représente plus du triple des blancs écus, joints, bout à bout, qu'il gagne chez son base…
Et voilà pourquoi, par ce matin de janvier, les flancs de la Gina – ce grand navire naguère si coquet, à présent radoubé plus d'une fois et uniformément peint en noir comme un cercueil de pauvre – devraient être élastiques pour loger toute la viande humaine qu'on y enfourne, tous ces parias à qui des thaumaturges astucieux évoquent, dans les brouillards plombés de l'Escaut, l'éblouissement du lointain Pactole.
Cependant les deux camions de la Nation d'Amérique, réquisitionnés par Jan Vingerhout, débouchent sur le quai. Pour lui faire honneur, on y a attelé deux couples de ces chevaux de Furnes, énormes palefrois d'épopée, de ces majestueux travailleurs à l'allure lente et délibérée, dont le pas égal et solennel aurait raison du trot d'un coursier. Jamais les fières bêtes n'avaient charroyé d'aussi légères et d'aussi pitoyables marchandises ; les bagages s'amoncellent, mais ne pèsent pas lourd. À telle enseigne que pour ne pas humilier les puissants chevaux, les émigrants aussi ont pris place sur ces fardiers.
Parmi l'éboulement, le pêle-mêle des caisses blanches clouées, ficelées à la diable, des sacs éventrés, des piètres trousseaux noués dans des foulards •de cotonnade, se prélassent, des groupes de jeunes émigrants de Lillo, Brasschaet, Santvliet, Pulderbosch et Viersel.
Quelques-uns, fanfarons, pleins de jactance, riaient, fringuaient et clamaient, interpellaient les curieux, semblaient exulter. En réalité, ils s'efforçaient de se donner le change à eux-mêmes, de se déprendre de leur idée fixe, bourrelante comme un remords. Même, sous prétexte de réconforter leurs compagnons d’une contenance moins faraude, d'allure, moins exubérante, ils leurs allongeaient de grandes bourrades dans le dos. Au nombre de ces villageois on en comptait un ou deux tout au plus dont cette joie désordonnée et démonstrative fût sincère. Les autres s'étaient montés le coup. Mais, puisque le sort en était jeté et qu'ils ne pouvaient plus se raviser ou se dédire, à mesure que les fumées des illusions se dissipaient et que la conscience patriale se réveillait dans leur fressure, pour se donner du cœur ils entonnaient force rasades d'alcool comme le jour du tirage au sort.
Les yeux fous, les pommettes rouges, à la fois endimanchés et débraillés, on les eût pris à première vue pour ces jeunes valets et servantes qui, à la saint Pierre et Paul, se font trimbaler, dès l'aube jusqu'au soir, dans des charrettes bâchées de feuillage et de fleurs[8].
Mais la plupart étaient silencieux et apathiques, abîmés dans des réflexions. Si, gagnés par la frénésie de leurs voisins, ils se mettaient d'aventure à battre quelques entrechats et à graillonner un refrain de kermesse, le « Nous irons au pays des roses », des Rozenlands de la saint Pierre et Paul, ou « Nous arrivons de Tord-le-Cou », des Gansrijders[9] du mardi gras, les notes s'étranglaient bien vite dans leur gorge et ils retombaient dans leur méditation.
En avance sur la marche du navire il arrivait aussi que leur pensée planât là-bas, par-dessus l’immensité des espaces voués aux flots et aux nuages, vers les côtes lointaines où les attendaient les patries nouvelles ; ou bien leur esprit retournait en arrière et les ramenait au village natal, quitté la veille, à l'ombre du clocher d'ardoises dont la voix mélancolique ne les exhorterait plus à la résignation ! Ô ces cloches qui soulevaient autrefois les guérilleros en sarreau contre les étrangers régicides [10] et qui n'avaient pas de tocsin assez éloquent, à présent, pour refouler l'invasion de la Faim ! En souvenir, les transfuges déjà repentis se transportaient sous le chaume de leur précaire héritage ; parmi les cultures péniblement assolées et gagnées après tant de luttes sur les folles bruyères (adorables ennemies ! tant maudites, mais déjà tant regrettées) ; ou encore, au bord de ces venues et de ces meers, où ils pochaient les grenouilles en gardant leurs vaches maigres ; ou bien autour des feux de scaddes[11], combattant de leur arôme résineux la moiteur paludéenne des soirées d'octobre.
Ô le doux hameau où ils ne remettraient plus jamais les pieds, où ils n'iraient même pas dormir leur dernier et meilleur somme en terre deux fois sainte à côté des réfractaires d'autrefois !
Laurent lisait l'arrière-pensée de ces braillards. Sa compassion pour les Tilbak s'étendait à leurs compagnons. Entre mille épisodes poignants un surtout l'émut pour la vie et sembla condenser la détresse et le navrement de ce prologue de l'exil.
Au moins une trentaine de ménages de Willeghem, bourgade de l'extrême frontière septentrionale, s'étaient accordés pour quitter ensemble leur misérable pays. Ceux-là n'avaient point pris place sur les camions, mais, un peu après l'arrivée du gros des émigrants flamands, ils se présentèrent en bon ordre, comme dans un cortège de festival. Soucieux de faire bonne figure, de se distinguer de la cohue, désirant qu'on dise après leur départ : « Les plus crânes étaient ceux de Willeghem. »
Les jeunes hommes venaient d'abord, puis les femmes avec leurs enfants, puis les jeunes filles et enfin les vieillards. Quelques mères allaitaient encore leur dernier-né. Combien d'aïeules, s'appuyant sur des béquilles et comptant sur un renouveau, sur une mystérieuse jouvence, devaient s'éteindre en route, et, cousues dans un sac lesté de sable, basculées sur une planche, se verraient destinées à nourrir les poissons ! Des hommes faits, en nippes de terrassiers, vêtus de gros velours côtelé, avaient la pioche et la houe sur l'épaule et le bissac et la gourde au flanc. Des couvreurs et des briquetiers allaient appareiller pour des pays où l'on ignore la tuile et la brique.
Une jeune fille, l'air d'une innocente, moufflarde et radieuse, emportait un tarin dans une cage.
En tête marchait la fanfare du village, bannière déployée.
Fanfare et drapeau émigraient aussi. Les musiciens pouvaient hardiment emporter leurs instruments et leur drapeau, car il ne resterait personne à Willeghem pour faire encore partie de l'orphéon.
Laurent avisa, marchant à côté du porte-drapeau, un ecclésiastique à cheveux blancs, le prêtre de la bourgade. Malgré son grand âge, le pasteur avait tenu à conduire ses paroissiens jusqu'à bord, comme il les accompagnait jadis chaque année au pèlerinage de Montaigu[12]. L'avaient-ils priée et conjurée, la bonne Vierge de Montaigu, depuis des années que durait la crise ! Pourquoi, patronne de la Campine et du Hageland, restais-tu sourde à ce cri de détresse ? Au lieu de remonter, comme aux temps légendaires, les fleuves limoneux du pays, dans des barques sans pilotes et sans mariniers, pour atterrir aux rivages élus par leur divin caprice et s'y faire édifier de miraculeux sanctuaires, les madones désertaient donc, à présent, leurs séculaires reposoirs et avaient redescendu les premières les mêmes cours d'eau qui les conduisirent autrefois, des continents inconnus, au cœur des Flandres. Pourtant les simples de la plaine flamande t'avaient édifié une basilique sur un des seuls monts de leur pays, autant afin qu'on vît de très loin resplendir la coupole étoilée de ton temple de miséricorde que pour te rapprocher de ton Ciel. Vierge inconstante, donnais-tu toi-même l'exemple de l'émigration à tous ces nostalgiques des pauvres landes de l'Escaut ?…
Mais, ce soir, après avoir vu disparaître le navire au tournant du fleuve et se confondre les spirales de fumée avec les brumes du polder, lui, le bon pasteur, regagnerait à pas lents le bercail, triste comme un berger qui vient de livrer lui-même au redoutable inconnu la moitié du troupeau marqué d'une croix rouge par le toucheur.
Si, pourtant, les hauts et nobles propriétaires, hobereaux et baronnets, avaient consenti à diminuer un peu les fermages, ces fanatiques du terroir n'auraient pas dû s'en aller ! Ils seraient bien avancés, les beaux sires, le jour où il n'y aurait plus de bras pour défricher leurs onéreux domaines !
Quelques-uns des émigrants de Willeghem portaient à la casquette une brindille de bruyère ; d'autres avaient attaché une brassée de la fleur symbolique au bout de leurs bâtons, au manche de leurs outils, et les plus fervents emportaient, puérilité touchante ! tassée dans une cassette ou cousue dans des sachets, en manière de scapulaire, une poignée du sable natal.
Ingénument, non pour récriminer contre la patrie mauvaise nourricière, mais pour lui témoigner une dernière et filiale attention, ces pacants arboraient leur costume national, leurs nippes les plus locales et les plus caractéristiques ; les hommes, leurs bouffantes et hautes casquettes de moire, leurs bragues de pilou et de dimitte, leurs sarreaux d'une coupe et d'une teinte si spéciales, de ce bleu foncé tirant sur le gris ardoisé de leur ciel et qui permet de distinguer à leur blaude les paysans do Nord de ceux du Midi ; – les femmes : leurs coiffes de dentelles à larges ailes qu'un ruban à ramages attache au chignon, et ces chapeaux bizarres, en cône tronqué, qui n'ont d'équivalent en aucune autre contrée de la terre.
Au moment de délaisser la terre natale, c'était comme s'ils songeaient à la célébrer et à s'en oindre d'une manière indélébile. Même ils parlaient à haute voix, mettant une certaine ostentation à faire rouler les syllabes grasses et empâtées de leur dialecte ; ils tenaient à en faire répercuter les diphtongues dans l'atmosphère d'origine.
Mais ils trouvèrent encore moyen d'accentuer l'inconsciente et tendre ironie de leurs démonstrations.
Arrivés sous le hangar, avant de s'engager sur la passerelle du navire chauffant pour le départ, les gars de la tête firent halte et volte-face, tournés vers la tour d'Anvers, et, embouchant leurs cuivres, drapeau levé, attaquèrent – et non sans couacs et sans détonations, comme si leurs instruments s'étranglaient de sanglots – l'air national, par excellence, l’Où peut-on être mieux du Liégeois Grétry, la douce et simple mélodie qui rapproche par les accents du plus noble langage, les Flamands et les Wallons, fils de la même Belgique, tempéraments dissemblables, mais non ennemis, quoi qu'en puissent penser les politiques. Aussi les bouilleurs borains massés sur le pont portèrent mains tendues au-devant des Flamins.
Tels se réconcilient et s'embrassent deux orphelins au lit de mort de leur mère.
Les conjectures vraiment pathétiques de cette dernière aubade au pays déterminèrent chez Laurent un afflux de pensées. Il entendait rauquer dans cet hymne attendri, scandé et modulé d'une façon si bellement barbare, par ces bannis si affectifs, toutes les expansions refoulées et tous les désenchantements de sa vie. Cette scène devait lui rendre plus cher que jamais le monde des opprimés et des méconnus.
Qu'il était loin déjà le jour d'insouciance de l'excursion à Hémixem et loin aussi le jour de son retour à Anvers et de sa longue contemplation des rives du fleuve bien-aimé !
Par ce dimanche ensoleillé, l'air vibrait aussi de fanfares, mais aucune de ces phalanges rurales n'avait quitté la rive pour ne plus la revoir !
L'arrivée des Tilbak et de Jan Vingerhout porta l'exaltation de Laurent à son paroxysme. Il tressaillit comme un somnambule lorsque le maître débardeur lui toucha l'épaule. Il avait la poitrine trop gonflée pour parler, mais sa contenance, sa physionomie convulsée, leur exprimaient mieux que des protestations le monde d'angoisses qu'il ressentait.
Il embrassa Siska et Vincent, hésita un moment, puis, consultant du regard le brave Jan Vingerhout, il appliqua un long et fraternel baiser au front d'Henriette, serra contre sa poitrine l'ancien baes de la Nation d'Amérique, et, prenant les mains d'Henriette, il les mit dans celles de son mari, et les tint pressées entre les siennes, comme pour s'unir à eux dans cette étreinte quasi sacramentelle.
Puis sentant l'émotion lui nouer la gorge, il n'eut que le temps de se tourner vers Lusse et Pierket qui lui tendaient leurs mains et leurs lèvres. Et, sous les larmes que Laurent ne parvenait plus à retenir, Pierket, qui adorait son grand ami, éclata en sanglots et se suspendit à son cou comme s'il voulait l'entraîner avec eux par delà les mers.
Aussi cette lugubre et ironique coïncidence qui faisait s'embarquer Henriette et les siens à bord de la Gina, avait par trop étreint le cœur de Paridael. Il reconnaissait le mauvais génie de Béjard et de sa femme. Cette Gina lui ravissait Henriette et tous ceux qu'il aimait !
D'autres corrélations bizarres et inattendues se présentèrent encore. Ce village de Willeghem qui émigrait en masse, était précisément celui de Vincent et de Siska. Comme ils l'avaient quitté enfants, ils ne reconnaissaient personne. Mais en interrogeant ce monde ils retrouvèrent quelques noms, démêlèrent des traits de famille dans les physionomies, finirent par se découvrir des cousins. Ces reconnaissances eurent ceci de bon qu'elles étourdirent et dissipèrent un peu les partants. Jan Vingerhout dit en riant : « Willeghem sera donc au complet, là-bas ! Et nous fonderons une nouvelle colonie à laquelle nous donnerons le nom, du cher village ! Vive le Nouveau-Willeghem ! »
Et tous de faire chorus.
Mais d'autres camarades que les paysans accaparaient l'attention des Tilbak. La Nation d'Amérique au grand complet : doyens, baes, compagnons, voituriers, mesureurs, arrimeurs, gardes-écuries, chargeurs, routeurs, et même nombre de chefs des autres corporations avaient fait escorte au digne Jan, au mieux voulu de leurs chefs et de leurs compères. Que d'efforts dépensés par ces braves gens pour le retenir ! Car, s'il prétextait le dégoût du métier, l'envie de voir du pays, la dureté des temps, au fond, les plus perspicaces savaient que le digne garçon, compromis comme principal meneur dans les derniers troubles, craignait, en demeurant à leur tête, d'attirer sur ses amis le mauvais gré des riches et de nuire aux intérêts de leur gilde.
Dans la masse des dockers se trouvaient jusqu'aux musards du « Coin des Paresseux » de ces cogne-fêtu taillés en athlètes, aussi rogues qu'indolents, au demeurant les meilleurs bougres, qui avaient si souvent désarmé Jan Vingerhout par leur flegme superbe, lorsqu'ils ne le faisaient pas endêver par leur inertie et leur désertion devant le labeur. Ces baguenaudiers se bousculaient pour broyer affectueusement les mains du partant dans leurs crocs énormes ; et, dérogeant à leurs habitudes de pure représentation, ils aidaient même à transborder les colis.
Les détaillants voisins de la Noix de Coco se pressaient, de leur côté, autour des Tilbak. La population maritime et ouvrière du port et des bassins s'associait toute entière à cette manifestation de regret et de sympathie. Dans la cohue, Laurent crut même reconnaître quelques jeunes runners valant peut-être mieux que leur réputation et tenant, eux aussi, à témoigner de leur sympathie pour ces braves gens.
Ces démonstrations apportèrent une heureuse diversion aux adieux, en étourdissant ceux qui en étaient l'objet. Les ouvriers des quais, sains et joyeux gaillards, ne mâchant de noir que leur chique de tabac, affectaient bien une gaîté un peu forcée, ou exagéraient leur humeur drolatique, se mettaient l'esprit à la torture pour trouver des saillies de haute graisse, mais plus d'un se mouchait avec trop de fracas ou se frottait le visage du revers de sa manche, alors qu'il n'y avait pourtant point la moindre sueur à essuyer.
Jan Vingerhout ne se laissait pas démonter non plus ; ferré sur la réplique, il parvenait encore à gonfler les plus grosses bourdes, et, fidèle jusqu'au bout à sa réputation de boute-en-train des « Nations », se livrait à une débauche d'aphorismes et de monostiques stupéfiants, où pantalonnait et pétardait l'esprit du père Cats et d'Ulenspiegel.
À toute force il lui fallut prendre encore quelques verres avec les copains, à l'estaminet le plus proche. Paridael n'avait pas pu refuser non plus les politesses de ses dignes patrons et camarades. Et, devant le comptoir, où les tournées se succédaient au feu roulant des gaillardises, aux bordées de jurons, aux. francs coups de poing sur les tables, Laurent aurait encore pu se croire au « local », après le travail, les soirs de reddition de comptes. Quelques-uns de ces débardeurs apportaient des souvenirs à leur Jan, celui-ci une pipe, celui-là une blague à tabac, qui une rémige de frégate. Un de ces braves avait même eu l'idée de remettre du papier à lettres de trois couleurs à Vingerhout. Il s'agissait de dérouter les interceptions et le cabinet noir des facenderos. Lorsque Jan écrirait sur du papier blanc, ce serait signe que les choses allaient bien, le rosé signifierait condition précaire, mais supportable, enfin le vert indiquerait une profonde détresse. Et cela en dépit de ce que la lettre contiendrait d'optimiste et de rassurant.
L'heure pressait. Laurent s'éclipsa pour aller installer les femmes, avec Tilbak, dans l'entrepont de la Gina. On fit d'abord quelque difficulté de recevoir Laurent à bord. L'accès des aménagements d'émigrants était strictement interdit aux curieux, et pour cause. Une fois sur le bateau il était même défendu aux voyageurs de retourner à terre, sous peine de perdre leur place et même l'argent de leur passage. Toutefois, grâce à l'obligeance d'un gabier, avec lequel Tilbak avait été amateloté jadis, il fut permis Paridael d'inspecter le nouveau domicile de ses amis.
La Gina contenait plus de six cents lits de camp en bois blanc, ou plutôt des châssis mal varlopés, tendus d'une sangle, couplés et superposés par groupes de douze dans les entreponts. La literie de cos branles consistait en un sac bourré de paille fétide, dont un pourceau n'eût pas même voulu pour litière, vrai réceptacle de la vermine.
Malgré le long aérage il régnait dans ces couloirs une odeur indéfinissable d'hôpital mal tenu, mélange de bouteilles et de faguenas. Que serait ce plus tard, lorsque toutes ces épaves humaines s'y encaqueraient, les haillons et les corps exsudant autant de miasmes qu'un grouillement de fauves ; surtout pendant les gros temps, lorsqu'on ferme les écoutilles.
Les règlements prescrivaient de séparer les sexes a bord et d'éloigner autant que possible des adultes les enfants en bas âge. Mais Béjard et consorts n'étant pas hommes à tenir compte de ces prescriptions, on ne les observait qu'en vue du port.
Avant même de gagner la mer, on bouleversait tous ces arrangements ; on n'empêchait plus la promiscuité ; on recevait en fraude un surcroît de passagers que des embarcations interlopes amenaient de la rive pendant la nuit. Runners et smoglers n'avaient pas de client plus précieux que Béjard et Cie.
Les cambuses étaient fournies de lard, de viande fumée, de biscuits de mer, de bière, de café, de thé, « en quantité plus que suffisante pour le double de la durée du voyage », renseignaient les prospectus, la dernière œuvre littéraire de Dupoissy, l'homme des impostures et des charlataneries. À la vérité c'est à peine si l'aiguade suffirait ! On rationnait les malheureux comme une garnison assiégée. Chaque passager recevait une petite gamelle en fer blanc ressemblant à celle des troupiers. La distribution des vivres se faisait deux fois par jour ; les aliments mesurés à la livre, les liquides au bon juron, litre spécial et réduit en usage sur les bateaux. Naturellement un froid perçant régnait sans cesse dans les entreponts, les vents coulis y prodiguaient les rhumes sans toutefois balayer l'odeur invétérée.
Et c'est la qu'allaient devoir gîter la bonne Siska et la chère Henriette.
– Bast ! disait Tilbak en voyant la mine déconfite de Laurent. La traversée n'est pas longue. Et j'en ai vu bien d'autres !
Ils remontèrent sur le pont. Laurent remarqua quelques box en bois, contenant onze chevaux de labour, l'écurie de quelqu'un de ces fermiers aisés affolés par la crise et s'expatriant avant la ruine. À voir ces installations, autant eût valu jeter les bêtes à l'Escaut. Leurs propriétaires étaient bien naïfs s'ils s'imaginaient qu'elles supporteraient la traversée dans ces conditions. Les exploiteurs s'arrangeraient de façon à les leur faire céder à bas prix. L'entretien de ces chevaux coûterait gros à leurs possesseurs et à la longue ils en retireraient a peine le prix de la peau. Au-dessus de ces écuries sommaires, sans le moindre auvent, dans des caisses de bois blanc s'entassaient le foin, la paille et l'avoine.
Cependant l'ivoire s'amoncelait un peu à la diable. Le pont revêtait l'apparence d'un bivac de fugitifs, d'un campement de bohémiens. En frôlant ces parias de toutes les contrées, apportant on ne sait quelle couleur et quelle odeur spéciale dans leurs bardes, Laurent remarqua qu'ils étaient vêtus très légèrement et que beaucoup claquaient déjà des dents et tremblaient de la lèvre. Un des agents de Béjard passait entre leurs groupes et pour les réconforter disait que ce froid ne durerait que quelques jours. Une fois passé le golfe de Gascogne, commencerait l'été perpétuel. L'agent n'ajoutait pas qu'entre l'Afrique et les côtes du Brésil les passagers cuiraient au point de ne pouvoir se tenir sur le pont, et que la calenture, le délire furieux, emporterait quelques-uns de ceux qui auraient tenu tête à la fièvre paludéenne. Il leur cachait surtout les horreurs de ta traversée, l'arbitraire et la brutalité qui les attendaient au débarquement et les misères sans nombre à endurer en ces milieux incompatibles.
– Il est temps de repasser la planche, car on démarre, camarade ! vint dire obligeamment le gabier à Paridael.
Le sifflet strident de la machine alternant avec des rauquements de bête féroce, appelait longuement les retardataires. Laurent s'arracha aux effusions de ses amis et regagna le quai.
Comme si ce n'eût pas encore été assez de détresse et d'horreur, un incident lamentable se produisit à la dernière minute.
Un misérable, dépenaillé, à la fois jaune et livide, les yeux hagards, les cheveux en désordre, sous l'empire d'une violente excitation alcoolique, entraînait de force vers l'embarcadère du navire en partance, une pauvre femme, de mine honnête, mais non moins ravagée, maigre, couverte de haillons moins sordides, mais tout aussi usés, qui résistait, se débattait, criait, deux pauvres mômes accrochés à ses jupes. Sans doute la malheureuse mère n'entendait pas suivre son ivrogne de mari en Amérique et estimait comme plus atroce que la faim endurée au pays natal, l'exil loin de toute connaissance amie, de tout visage et de tout objet familier, dans des parages où rien ne la consolerait de l'ignominie et de la crapule de son époux.
Écœurés par cette scène, Laurent avec quelques baes et compagnons de Nations, eurent bientôt délivré la mère et les enfants. Tandis que les uns conduisaient la pauvre femme, presque morte d'inanition, dans une auberge riveraine, les autres emmenaient le mauvais sujet vers la Gina, et d'une bourrade vous l'embarquaient plus rapidement qu'il n'eût voulu, en le projetant par delà la passerelle au risque de le précipiter dans le fleuve.
Le soûlard, hébété, sembla se résigner à son divorce inattendu ; d'ailleurs la communication avec la rive venait d'être rompue. Sans plus se soucier des siens, il s'approcha du bordage et les assistants le virent retirer de la poche de son paletot crasseux une bouteille de genièvre encore à moitié pleine.
– Voyez, bredouillait-il en titubant et en brandissant la bouteille au-dessus de sa tête, voici tout ce qui me reste ; dans ce flacon s'est fondu le dernier argent que je possédais encore… Et, tenez, je bois cette gorgée d'adieu à la Belgique !
Et portant la bouteille à ses lèvres, il la vida d'un seul trait ; puis il la jeta de toutes ses forces contre le mur du quai, de manière à en éparpiller les éclats dans le fleuve. Et avec un rire idiot, il hurla :
– Evviva l'America !
Cependant les matelots ramenaient à eux et enroulaient les amarres détachées des bornes de pierre, l'hélice commençait à patiner les vagues, sur la dunette le capitaine hurlait les ordres répétés a l'avant et à l'arrière et transmis par un mousse, au moyen d'un porte-voix, aux hommes de la chambre de chauffe ; manœuvré par le timonier à la barre, le navire vira lentement de bord et un bouillonnement de vaguilles lécha les flancs de la Gina.
À un choc de la manœuvre, l'arsouille venait de s'écrouler comme une masse aux pieds de ses compagnons de route.
Laurent détourna les yeux vers des personnages plus sympathiques.
La fanfare de Willeghem agita son drapeau de velours à broderies et à crépines d'or, et reprit l’Où peut-on être mieux, que les Borains, rapprochés des Campinois, chantaient en chœur.
Dans le papillotement des têtes échauffées ou blêmes, Laurent finit par ne plus voir que le groupe des Tilbak. Jusqu'à la dernière heure il avait songé à prendre passage, sans rien leur dire, à bord de la Gina, pour partager leur sort et affronter l'inconnu avec eux ; seule la crainte de désobliger Vincent et Siska, de rouvrir une blessure fraîchement cicatrisée au cœur de leur fille, et de porter ombrage à l'honnête Vingerhout, en un mot, de leur être un perpétuel objet de contrainte et de gêne, le retint à Anvers.
Puis, un vague aimant l'empêchait de dire adieu à sa cité : il entretenait le pressentiment d'un devoir fatal à remplir, d'un rôle indispensable à jouer. Il ne savait lesquels. Main sans se rendre compte des intentions que le destin avait sur lui, il attendrait son heure.
Sur la Gina, les noëls, les hourrahs, un fracas, un tumulte d'appellations dominaient les accords mêmes de la fanfare. On répondait ferme, à cœur et a poumons non moins dilatés, de la cohue massée sur le quai. Le navire et le rivage se donnaient la réplique, faisaient assaut de verve, de crânerie, de vaillance. Les casquettes volaient en l'air, des mouchoirs de couleur s'agitaient comme des pavillons bariolés les jours où les vaisseaux font parade.
Des femmes qui avaient l'air de rire et de pleurer à la fois, soulevaient leurs enfants sur leurs bras. Et plus le navire s'éloignait, plus les gestes devenaient frénétiques. Il semblait que les bras s'allongeassent désespérément pour s'étreindre et se reprendre encore par-dessus les flots séparateurs.
À cause de son énorme tirant d'eau et de sa cargaison plus que complète, le navire resta longtemps en vue des regardants. Laurent en profita pour courir un peu plus loin à l'extrémité de la Tête de Grue, à l'entrée des bassins, afin de pouvoir suivre le bâtiment jusqu'au moment où il tournerait. Henriette était déjà descendue dans l'entrepont avec Jan Vingerhout. Siska et Pierket continuaient à lui envoyer des baisers ; il entendit la voix mâle et copieuse de Vincent lui lancer une dernière injonction à la force d'âme.
Mais, à chaque tour de l'hélice, Laurent se sentait perdre un peu de sa sécurité et de sa confiance. L’Où peut-on être mieux s'éloignait, s'éteignait, comme un murmure.
C'est de ce même promontoire que Paridael avait assisté, quelques années auparavant, à la féerie du soleil couchant sur l'Escaut. Aujourd'hui, il faisait gris, brumeux et trouble ; au lieu de pierreries le fleuve roulait du limon ; les levées du Polder étalaient des gazons jaunis ; la tristesse de la saison concertait avec celle des êtres. Le carillon lui parut plus sourd, et les mouettes d'autrefois, les prêtresses hiératiques et accueillantes, criaient, vociféraient comme autant de sibylles de malheur.
Lorsque la masse du bâtiment eut disparu derrière le coude de la rive de Flandre, Laurent continua de regarder la cheminée, un clocher ambulant pointé par-dessus les digues ; puis graduellement, ce ne fut plus qu'une ligne noire, et enfin, la dernière banderole de fumée se confondit avec la désolation de la brume de janvier.
Quand une petite pluie insidieuse et glaciale eu tiré le jeune homme de son hypnotisme, il constata qu'il n'était pas seul en observation a l'extrémité de ce promontoire.
Le curé de Willeghem cherchait encore à discerner le sillage et le remous de la Gina. Deux grosses larmes descendaient lentement de ses joues et il traçait dans l'air un lent signe de croix. Mais le vol éparpillé des oiseaux de mer avec des giries de sorcières qui se hèlent, semblait parodier ce doux geste professionnel aux quatre coins de l'horizon. Crispé par leurs sarcasmes, Laurent se retourna vers la ville. Un bruit de pioches et d'écroulement se mêlait au grincement des grues du port, au fracas des marchandises jetées à fond de cale, à la retombée du pic des calfats.
En vue d'élargir les quais on avait décrété la démolition des vieux quartiers de la ville et voici que l'abattage commençait. Déjà des pans de mur gisaient en gravats, au coin des carrefours ; des masures ouvertes, éventrées, amputées de leurs pignons, montraient leurs carcasses de briques sanguinolentes auxquelles pendillaient, comme des lambeaux de chair et des lanières de peaux, de tristes tentures. On aurait dit de ces carcasses de bête accrochées à l'étal des bouchers.
Çà et là les brèches pratiquées dans les flots de vénérables bicoques antérieures à la domination espagnole, dans ces maisons branlantes et vermoulues, rapprochées comme de vieilles frileuses, ouvraient une échappée sur des constructions plus reculées encore, démasquaient des vestiges de donjons millénaires, mettaient à jour les burgs romans ou même romains des premiers âges de la ville.
Sur une partie de l'alignement des quais à rectifier, les nobles arbres sous lesquels les deux Paridael s'étaient si souvent promenés avaient déjà disparu.
Non seulement la glorieuse Carthage rejetait son surcroît de population, exilait sa plèbe, mais, non contente de déloger ses parias, elle démolissait et sapait leurs habitacles. Elle se comportait comme une parvenue qui rebâtit, et transforme de fond en comble une noble et vieille résidence seigneuriale ; mettant au rancart ou détruisant les reliques et les vestiges d'un passé glorieux, et remplaçant les ornements pittoresques et de bon aloi par une toilette tapageuse, un luxe flambant neuf et une élégance improvisée.
La nouvelle des attentats et des vandalismes auxquels se livraient les Riches imbéciles sur sa ville natale, avait chagriné Laurent au point de l'éloigner du théâtre des démolitions dont les progrès l'eussent trop vivement affligé.
Le hasard voulait qu'il fût témoin de ces dévastations le jour même où il venait d'assister au départ de ses amis. Le contraste entre l'activité des quais et les ruines qui commençaient à border le fleuve n'était pas de nature à le consoler.
À l'heure où les tombereaux emportaient les gravats, les plâtrés, les matériaux des maisons démolies pour les conduire vers de lointaines décharges, La Gina enlevait aussi comme autant de matériaux hors d'usage, de non-valeurs, de parasites encombrants, les ouvriers sans travail, les paysans sans terre, les démolis, les rafalés, les pauvres diables de la glèbe et des métiers !
Pour beaucoup de gens du peuple et d'Anversois de vieille roche, c'était comme si le superbe Escaut répudiait sa première épouse. Il remplaçait l'ancienne Anvers par une marâtre apportant des agences, des modes nouvelles, une langue étrangère favorable a l'éclosion d'autres mœurs. Elle éloignait peu à peu les enfants du premier lit, proscrivait brutalement les descendants de la souche primitive, pour attirer à elle d'arrogants bâtards, pour y substituer dans les faveurs paternelles une population de métis, d'interlopes et de juifs.
Même il était question, dans les conseils de la Régence, de démolir le Steen, le vieux château, tout comme ils avaient démoli la Tour-Bleue et la porte Saint-Georges. En vérité, ils avaient un peu anéanti, malgré eux, l'admirable arc de triomphe. Ces bons gâteux ne s'étaient-ils pas avisés de déplacer cette porte en en numérotant les quartiers, bloc par bloc, comme dans un jeu de patience. Seulement, nos aigles avaient compté sans le travail des siècles, et à ce jeu d'architectes tombés en enfance, quel ne fut leur ahurissement de voir s'effriter les moellons vénérables entre leurs doigts profanateurs !
Ah ! il était temps que les Tilbak se fussent expatriés. Autant valait partir que d'assister à ces dégâts et à ces spoliations. Ceux qui reviendraient courraient grand risque de ne plus reconnaître leur patrie.
Les démolisseurs avaient déjà renversé les tènements avancés du savoureux quartier des Bateliers. Des terrassiers commençaient à combler le vieux canal Saint-Pierre.
Laurent s'enfonça plus avant dans la ville, errant finalement dans les ruelles menacées, et accordant à ces murailles agonisantes une part de la sympathie et de la mansuétude éprouvées pour les expulsés.
Et sous leurs pignons échancrés, ces façades, endeuillies avaient l'émotion de visages humains, des physionomies solennelles de moribondes, et les fenêtres à croisillons, les vitrages glauques, pleuraient comme des yeux d'aveugles, et çà et là, dans la lointaine et discordante musique d'un bouge, sanglotait le dernier Où peut-on être mieux ? de la fanfare de Willeghem.
III. LE RIET-DIJK
Au nombre des quartiers sur le point de disparaître se trouvait le Riet-Dijk : une venelle étroite s'étranglant derrière la bordure des maisons du quai de l'Escaut, aboutissant d'un côté à une façon de canal, bassin de batelage et garage de barques, de l'autre, à une artère plus large et plus longue, le Fossé-du-Bourg.
Riet-Dijk et Fossé-du-Bourg agglomèrent les lupanars. C'est le « coin de joie », le Blijden Hoek des anciennes chroniques. Dans la ruelle, les maisons galantes hautement tarifées ; dans la rue large, les gros numéros pour les fortunes modiques et précaires. Chaque caste, chaque catégorie de chalands trouve, en cet endroit, le bordel congruent : riches, officiers de marine, matelots, soldats.
Les uns joignent au confort et à l'élégance modernes le luxe des anciennes « étuves » et des maisons de baigneurs, bateaux de fleurs où le vice se complique, se raffine, se prolonge. Dans les autres, sommaires, primitifs, on cherche moins le plaisir que le soulagement ; les gaillards copieux, que congestionnent les continences prolongées, y dépensent leurs longues épargnes des nuits de chambrée et d'entrepont sans s'attarder aux fioritures et aux bagatelles de la porte, sans entraînement préparatoire, sans qu'il faille recourir aux émoustillants et aux aphrodisiaques. Ces bouges subalternes sont aux premiers ce que sont les bons débits de liqueurs où le soiffard se tient debout et siffle rapidement son vitriol sur le zinc, aux cafés où l'épicurien s'éternise et sirote, en gourmet, des élixirs parfumés.
Les soirs, harpes, accordéons et violons crincrinent et graillonnent à l'envi dans ce béguinage de l'ordre des hospitalières par excellence, et intriguent et attirent de très loin le passant ou le voyageur. Mélodies précipitées, rythmes canailles, auxquels se mêlent comme des sanglades et des coups de garcette, des éclats de fanfare et de fifre : musique raccrocheuse.
C'est, à la rue, le long des rez-de-chaussée illuminés, un va-et-vient de kermesse, une flâne polissonne, une badauderie dégingandée.
C’est, à l'intérieur, un entrain de concert et de bal. Des ombres des deux sexes passent et repassent devant les carreaux mats garnis de rideaux rouges. Sur presque chaque seuil, une femme vêtue de blanc, penchée, tête à l'affût, épie, des deux côtés de la rue, l'approche des clients et leur adresse de pressantes invites. Matelots ou soldats déambulent par coteries, bras dessus, bras dessous, déjà éméchés. Parfois ils s'arrêtent pour se concerter et se cotiser. Faut-il entrer ? Ils retournent leurs poches jusqu'à ce que, affriandé par un dernier boniment de la marchande d'amour, tantôt l'un, tantôt l'autre donne l'exemple. Le gros de la bande suit à la file indienne, les hardis poussant les timorés. Ceux-ci, des recrues, miliciens de la dernière levée, conscrits campagnards, fiancés novices et croyants que leur curé met en garde contre les sirènes de la ville, courbent l'échine, rient faux, un peu anxieux, rouges jusque derrière les oreilles[13]. Ceux-là, crânes, esbrouffeurs, durs à cuir, remplaçants déniaisés, galants assidus et parfois rétribués de ces belles-de-nuit, poussent résolument la porte du bouge. Et l'escouade s'engloutit dans le salon violemment éclairé, retentissant de baisers, de claques et d'algarades, de graillements, de bourrées de locmans et de refrains de pioupious.
D'autres, courts de quibus sinon de désirs, baguenaudent et, pour se venger de la débine, se gaussent des appareilleuses en leur faisant des propositions saugrenues.
À l'entrée du Riet-Dijk, la circulation devient difficile. Les escouades de trôleurs et de ribauds se multiplient. Outrageusement fardées, vêtues de la liliale tunique des vierges, les filles complaisantes se balancent au bras de leurs seigneurs de hasard. Les gros numéros, à droite et à gauche, se succèdent de plus en plus vastes et luxueux, de mieux en mieux achalandés. De chapelles ils se font temples. Aquariums dorés que hantent les sages Ulysses du commerce et leurs précoces Télémaques, desservis par des sirènes et des Calypsos très consolables ; bien différents des viviers squammeux où se dégorgent les marins pléthoriques. Maisons célèbres, universelles ; enseignes désormais historiques : chez Mme Jamar on vantait la « grotte », chef-d'œuvre peu orthodoxe de l'entrepreneur des grottes de Lourdes ; chez Mme Schmidt on appréciait le mystère, l'incognito garanti par des entrées particulières donnant accès à de petits salons aménagés comme des tricliniums ; Mme Charles se recommandait par le cosmopolitisme de son personnel, un service irréprochable, et surtout les facilités de paiement ; le Palais de Cristal monopolisait les délicieuses et neuves Anglaises ; au ; Palais des Fleurs florissaient les méridionales ardentes et jusqu'à des bayadères de l'Extrême-Orient, créoles lascives, mulâtresses volcaniques, quarteronnes capiteuses et serpentines, négresses aléacées.
Les façades, hautes comme des casernes, croisent les feux de leurs fenêtres. Des vestibules pompéiens, dallés de mosaïque, ornés de fontaines et de canéphores, claironnent les surprises de l'intérieur. Derrière de hautes glaces sans tain ; incrustées de symboles et d'emblèmes, sous les lambris polychromes à l'égal des oratoires byzantins où les cinabres, les sinoples et les ors affolants, vacarment et explosent à l'éclat des girandoles, le passant devine les stades de la débauche, depuis les baisers colombins et les pelotages allumeurs sur les divans de velours rouge, jusqu'aux possessions intimes dans les chambrettes des combles, grillées comme des cellules de non-nains.
Ce quartier se saturait d'un composé d'odeurs indéfinissables où l’on retrouvait, à travers les exhalaisons du varech, de la sauvagine et du goudron, les senteurs du musc et des pommades. Et les fenêtres ouvertes des alcôves dégageaient, à travers leurs carreaux, les miasmes du rut, forts et contagieux.
À mesure que la nuit avançait, les femmes, plus provocantes, entraînaient, presque de force, les récalcitrants et les temporisateurs. Des hourvaris accidentaient le brouhaha de la cohue. Et toujours dominaient le raclement des guitares barcarollantes, les pizzicati chatouilleurs des mandolines, les grasses et catégoriques bourrées des musicos, et par moments des cliquetis de verres, des rires rauques, des détonations de Champagne.
Jusqu'à onze heures, les pensionnaires de ces lupanars avaient la permission de circuler, à tour de rôle, dans le quartier et même d'aller danser au Waux-Hall et au Frascati, deux salles de bal du Fossé-du-Bourg.
Passé cette heure, couvre-feu partiel, ne vaguaient plus que les habitués sérieux sur qui, peu à peu, les bouges tiraient définitivement leur huis. Les crincrins s'assoupissaient aussi. Bientôt on n'entendait plus que la lamentation du fleuve à marée haute, les vagues battant les pilotis des embarcadères et les giries intermittentes d'un vapeur tisonné dans sa chambre de chauffe, en prévision du départ matinal.
C'était l'heure des parties en catimini, des priapées hypocrites, des conjonctions honteuses. Noctambules, collet relevé, chapeau renfoncé sur les yeux, se glissaient le long des maisons jaunes et tambourinaient de maçonniques signaux aux portes secrètes des impasses.
Toute régalade, toute assemblée se terminait par un pèlerinage au Riet-Dijk. Les étrangers s'y faisaient conduire le soir, après avoir visité, le jour, l'hôtel de l'imprimeur Plantin-Moretus et les Rubens de la Cathédrale. Les orateurs des banquets, y portaient leurs derniers toasts.
Les hauts et les bas de ce quartier original concordaient avec les fluctuations du commerce de la métropole. La période de la guerre franco-allemande représenta l'âge d'or, l'apogée du Riet-Dijk. Jamais ne s'improvisèrent tant de fortunes et ne surgirent parvenus aussi pressés de jouir.
Les contemporains se redirent, en attendant que la légende les eût immortalisées, les lupercales célébrées dans ces temples par des nababs sournois et d'aspect rassis. À certains jours fastes, les familiers appelaient à la rescousse, réquisitionnaient tout le personnel par une habitude de spéculateurs accaparant tout le stock d'un marché.
Ils se complaisaient en inventions croustilleuses, en tableaux vivants, en simulacres de sadisme, en chorégraphies et pantomimes ultra-scabreuses ; prenaient plaisir au travail des lesbiennes, mettaient aux prises l'éléphantesque Pâquerette et la fluette et poitrinaire Lucie.
On composait des sujets d'invraisemblables fontaines ; saoules de Champagne, les nymphes finissaient par s'en asperger et consacraient le vin guilleret aux ablutions les plus intimes.
Béjard le négrier et Saint-Fardier le Pacha organisèrent dans les salonnets multicolores de Mme Schmidt, surtout dans la chambre rouge, célèbre par son lit de Boule, à coulisses et à rallonges, véritable lit de société, des orgies renouvelées à la fois des mièvreries phéniciennes et des exubérances romaines.
Dans ces occasions, le Dupoissy, l'homme à tout faire, remplissait les fonctions platoniques de régisseur. C'était lui qui s'abouchait avec Mme Adèle, la gouvernante, débattait le programme et réglait l'addition. Pendant que se déroulaient les allégories de plus en plus corsées de ces « masques » dignes d'un Ben Johnson atteint de satyriasis, le glabre factotum, la mine d'un accompagnateur de beuglant, tenait le piano et tapotait des saltarelles de cirque. À chaque pause, les actrices nues ou habillées de longs bas et de loups noirs, gueusaient l'approbation des détraqués béats et, à quatre pattes comme des minets, frottaient leur chair moite et poudrederizée aux funèbres habits noirs.
Telle était la prestigieuse renommée de ces bordels, que pendant les journées de carnaval les honnestes dames des clients réguliers, se rendaient, en domino, dans ces ruches diligentes – aux heures de chômage s'entend – et inspectaient, sous la conduite du patron et de la patronne, les cellules douillettes et capitonnées, dorées comme des reliquaires, les lits machinés et jusqu'aux peintures érotiques se repliant comme des tableaux d'autel.
Et, s'il fallait en croire les médisances des petites amies, Mmes Saint-Fardier n'avaient pas été des dernières à mettre à une si extravagante épreuve la complaisance et la docilité de leurs maris.
Laurent devint un visiteur assidu de ce quartier. Il s'y déphosphorait les moelles, sans parvenir à déloger de son cerveau l'obsession de Gina. Au moment des spasmes, l'image tantalisante s'interposait entre sa vénale amoureuse et ses postulations toujours leurrées.
– Oh, la cruelle incompatibilité ! se disait-il. Les atroces chassés-croisés ! Les êtres épris, à en perdre la tête et la vie, des êtres qui, aimant ailleurs, les éluderont éternellement !… L'amitié raisonnable offerte comme l'éponge dérisoire du Golgotha à la soif du frénétique ! Les ferveurs et les délicatesses de l'amour se fanant à la suite dès possessions brutales !
Au Riet-Dijk, des types curieux, des composés interlopes de la civilisation faisandée de la Nouvelle Carthage, lui ménageaient de pessimistes sujets d'observations. Après des nuits blanches, il assistait à la toilette de ces dames, surprenait leur trac, leur instinctive terreur à la visite imminente du médecin : il notait en revanche leur familiarité, presque de femme à femme, avec l'androgyne garçon coiffeur.
Plus que les autres commensaux ou fournisseurs de ces parcs aux biches l'intéressait Gay le Dalmate. Cet industrieux célibataire, commis à cent cinquante francs par mois, chez un courtier de navires, touchait annuellement quinze a vingt mille francs de commission, dans les principales maisons du Riet-Dijk. Il amenait aux numéros recommandables les capitaines auxquels les courtiers, ses patrons, l'attachaient comme guide et drogman, durant leur séjour à Anvers. Gay parlait toutes les langues, même les patois, les idiomes des pays vagues, jusqu'à l'argot des populaces reculées. Gay apportait une probité très appréciée dans ses transactions délicates. Jamais d'erreurs dans sa comptabilité. Lorsqu'il passait, de trimestre en trimestre chez les patrons de gros numéros pour percevoir les tantièmes convenus, ces négociants payaient de confiance leur éveillé et intelligent rabatteur. Gay acceptait à ces occasions, un verre de vin, de liqueur, pour boire à Madame, à Monsieur et à leurs pensionnaires.
La discrétion de Gay était proverbiale. Avec ses petits favoris rouges, son large sourire, sa tenue proprette, ses manières affables, Gay ne comptait même pas d'envieux parmi ses collègues. On lui appliquait respectueusement l'adage anglais : The right man in the right place : l'homme digne de sa place, la place digne de l'homme.
Un mois après le départ des émigrants, Paridael fut accosté un matin sur la Plaine Falcon par le bonhomme Gay, qui tout affairé, tout haletant, lui jeta cette effroyable nouvelle en pleine poitrine :
– La Gina a péri corps et biens en vue des côtes du Brésil !… C'est affiché au Bureau Véritas…
Et le Dalmate passa, sans se retourner, anxieux d'informer de ce sinistre le plus grand nombre de curieux ; ne se doutant pas un instant du coup qu'il venait de porter à Paridael.
Celui-ci chancela, ferma les yeux et finit par s'affaler sur le seuil d'une porte, ses jambes refusant de le soutenir plus longtemps. Les syllabes des paroles fatales sonnaient le glas à ses oreilles. Lorsqu'il eut repris quelque peu connaissance : « Le sang me sera monté au cerveau. L'apoplexie m'avertit ! » se dit-il. « J'ai eu un moment de délire pendant lequel j'aurai cru entendre raconter cette… horreur. Ces choses-là n'arrivent point ! » Mais il se rappelait trop nettement la voix, l'accent exotique de Gay ; puis, en écarquillant les yeux, et en scrutant la perspective des Docks, ne vit-il pas s'éloigner là-bas, le Dalmate, de son pas sautillant.
Laurent se traîna jusqu'au quai Saint Aldégonde où étaient les bureaux de Béjard, Saint-Fardier et Co. En tournant le Coin des Paresseux il constata que même les indéracinables et insouciants journaliers s'étaient transportés plus loin, pour aller aux nouvelles. Le digne Jan Vingerhout était populaire jusque dans ce monde de flemmards invétérés. Et ils le savaient à bord de cette Gina de malheur !
L'air de douloureuse commisération de ces maroufles ameutés sur le quai et mêlés à la foule devant l'agence d'émigration, prépara Laurent aux plus sinistres nouvelles. Un faible espoir continuait pourtant de trembloter dans les brusques ténèbres de son âme. Ce n'aurait pas été la première fois que des navires renseignés comme perdus revinssent au port où on les pleurait !
Paridael fendit le rassemblement de débardeurs, de matelots et de femmes éplorées que rapprochait une commune douleur, rassemblement que rendait encore plus tragique la présence de plusieurs minables familles d'émigrants, désignées pour le prochain départ, peut-être marquées pour le prochain naufrage ! Des lamentations, des sanglots s'élevaient par intermittences au-dessus du sombre et suffocant silence.
Laurent parvint à se faufiler jusque devant les guichets du bureau :
– Est-ce vrai, monsieur, ce qu'on… raconte en ville ?…
Il balbutiait à chaque mot et affectait des intonations dubitatives.
– Eh oui !… Combien de fois faudra-t-il vous le répéter ?… Autant de crève-de-faim en moins !… À présent, fichez-nous la paix !
À ces mots abominables que seul un Saint-Fardier était capable de prononcer, Paridael se rua contre la cloison dans laquelle étaient ménagés les guichets.
La porte condamnée s'abattit à l'intérieur.
Laurent la suivit, empoigna avec une frénésie de fauve affamé l'individu qui venait de parler et qui n'était autre que l'ancien associé du cousin Guillaume.
Le Pacha avait toujours eu l'âme d'un garde-chiourme ou d'un commandeur d'esclaves et l'ex-négrier Béjard avait trouvé en lui la brute implacable dont il avait besoin pour enfourner et expédier prestement la marchandise humaine.
Sans l'intervention des magasiniers et des commis qui l'arrachèrent à son agresseur, le vilain homme fût certes resté mort sur le carreau. L'autre l'avait à moitié étranglé, et dans chacun de ses poings crispés il tenait une des côtelettes poivre et sel du maquignon d’âmes.
Tandis que plusieurs employés maîtrisaient Laurent dont la rage n'était pas encore assouvie, leurs camarades avaient fait passer le blessé, fou de peur, dans le cabinet de Béjard, d'où il ne cessait de geindre et d'appeler la police.
Les paroles provocantes et dénaturées de Saint-Fardier avaient été entendues par d'autres que Laurent et, mise au courant de ce qui se passait, la foule au dehors partageait son indignation et eût mis en pièces le policier qui se fût avisé de l'arrêter. Elle menaçait même, de déloger les associés de leur repaire et d'en faire expéditive justice. Aussi Béjard, entendant le tonnerre des huées et les sommations du populaire, jugea prudent de pousser Laurent dans la rue et de le rendre à ses terribles amis. Puis à la faveur de la diversion que produisait la réapparition de l'otage, Béjard fit rapidement fermer la porte derrière lui. Donnant congé à ses hommes pour le reste de la journée, il entraîna le piteux Saint-Fardier, par une porte de derrière, dans une ruelle déserte bornée d'entrepôts et de magasins, d'où ils gagnèrent, non sans louvoyer en évitant les quais et les voies trop passantes, leurs hôtels de la ville nouvelle.
– Nous repincerons ce voyou ! disait en cheminant Béjard à Saint-Fardier qui tamponnait de son mouchoir ses bajoues ensanglantées par une trop brusque épilation. Il ne fallait pas songer à le coffrer. Il ne faut même pas y songer d'ici à longtemps, mon vieux, car on n'a déjà fait que trop de bruit à propos de ce petit sinistre et il ne serait pas bon que la justice regardât de trop près à nos affaires… Attendons que toute cette canaille ait fini de crier ! S'ils continuent à aboyer comme ce matin, ils seront égosillés avant ce soir ! Alors nous réglerons son compte à ce maître Laurent…
« En somme, l'affaire n'est pas mauvaise pour nous ! (ici l'exécrable trafiquant s'oublia jusqu'à se frotter les mains)… Le navire n'en avait plus pour longtemps. Les rats l'avaient déjà quitté tant l'eau pénétrait dans la cale. Un vieux sabot que l'assurance nous paiera le double de ce qu'il valait encore !… Et si nous perdons les primes versées d'avance à quelques émigrants vigoureux et florissants, comme ce Vingerhout – tu te rappelles, le suppôt de Bergmans, le meneur de l'émeute des élévateurs. Le voilà ad patres ! – en revanche nous empochons les primes d'assurances des noyés de l'équipage… Il y a largement compensation !…»
L'armateur rentra dîner comme si rien ne s'était passé. Gina lui trouva une physionomie vilainement joviale et trigaude. Au dessert, tandis qu'il pelait méticuleusement une succulente calebasse et qu'il se versait un verre de vieux bordeaux, avec des précautions de dégustateur, il lui annonça d'un ton à peine circonstanciel, l'effroyable et total sinistre du navire qu'elle avait baptisé.
Sans prendre garde à la pâleur qui envahissait le visage de sa femme, il entra dans des détails, supputa le nombre des morts. Elle voulut le faire taire ; il insistait et il poussa même le sardonisme jusqu'à lui évoquer le lancement au chantier Fulton. Alors, prête à se trouver mal, elle quitta la table et se réfugia dans ses appartements où elle songea au mauvais présage que, lors de la mise à l'eau du navire, certains, assistants avaient vu dans la maladresse et les hésitations de la marraine…
Laurent, après s'être dérobé aux étreintes de la foule qui le questionnait pour en savoir plus long, courut tête nue – il avait négligé de ramasser sa casquette après la lutte – sans rien voir, sans rien entendre, jusqu'à sa pauvre mansarde et, se vautrant sur son lit, comme autrefois chez les Dobouziez, sous les combles, parvint à se débarrasser des larmes que la fureur avait refluées sous sa poitrine. Il ne s'interrompait de sangloter que pour redire ces noms : Jan !… Vincent… Siska… Henriette… Pierket !…
Depuis, il ne s'écoula plus un jour sans qu'il se fredonnât meurtrièrement à lui-même, comme on s'inoculerait un très doux, mais très redoutable poison, l’Où peut-on être mieux ? de la fanfare de Willeghem.
Sans se douter de la transformation qui s'opérait en son altière cousine, Laurent confondit désormais les deux Gina, la femme et le navire : jalouse, troublante et maléfique, c'était Mme Béjard qui, pour lui tuer sa bonne et sainte Henriette, avait voué le navire, son filleul, au naufrage. Et dire qu'il s'était repris un moment à aimer cette Régina ; le soir de l'élection de Béjard ! À présent, il se flattait bien de l'exécrer toujours…
Son culte pour les chers morts se confondit bientôt, en haine de la société oligarque, non seulement avec l'affection qu'il portait aux simples ouvriers, mais avec une sympathie extrême pour les plus rafalés, les plus honnis, voire les plus socialement déchus des misérables. Il allait enfin donner carrière à ce besoin d'anarchie qui fermentait en lui depuis sa plus tendre enfance, qui le travaillait jusqu'aux moelles, qui tordait ses moindres fibres amatives.
C'est vers les réprouvés terrestres que s'orienterait son immense nostalgie de communion et de tendresse.
IV. CONTUMACE
Laurent commença par se loger au fin fond de Borgerhout près d'une coupure de chemin de fer, non loin d'une voie d'évitement sur laquelle ne roulaient que des convois de marchandises. C'était un coin de la suggestive région observée, autrefois, de la mansarde chez les Dobouziez. L'agglomération citadine y dégénérait en une banlieue équivoque, clairsemée de maisons comme si leurs tènements s'étaient mis à la débandade, cabarets à tous usages, fourrières, chantiers de marbriers, de figuristes et d'équarisseurs. De la suie aux murs, de l'herbe entre les pavés. Pour monuments : un gazomètre dont l’énorme cloche en fer s'élevait ou s'abaissait dans sa cage de maçonnerie armée de bras articulés : un abattoir vers lequel des toucheurs poussaient leurs troupeaux sans méfiance, puis une caserne despotique engouffrant des victimes non moins passives, tous édifices d'un rouge sale, d'un rouge de stigmates sanguinolents.
D'heure en heure le sifflet des locomotives, la corne du garde-barrière et la cloche de l'usine se donnaient la réplique, ou les clairons des conscrits, pitoyables se mariaient aux râles des ouailles. Jusqu'aux remparts des fortifications les terrains vagues alternaient avec des préaux où quêtaient des chiens gratteleux ; des jardins embryonnaires amenaient à de fades chalets fourvoyés dans cette zone rébarbative comme un joli cœur dans un repaire de marlous.
Les petits chiffonniers avaient raclé depuis longtemps le goudron et défoncé ou disjoint les planches des palissades. Munis de profonds sacs en rapatelle, ils escaladaient, chaque matin, la cloison, après avoir exploré du regard l'enclave abandonnée. Trifouillant du crochet et des pattes, ils exultaient lorsque, parmi les drilles, ils rencontraient une peau de charogne. Ils se disputaient cette trouvaille comme une pépite d'or ou l'arrachaient aux roquets qui décaniliaient en grondant.
Les péripéties de cette cueillette firent longtemps la seule distraction des matins de Paridael. Puis il avisa des sujets d'étude plus relevés.
Autour du garde-barrière, un beau brin de mâle, brunet et trapu, dont la physionomie loyale tranchait sur la grimace et les convulsions de cette banlieue et de ces rogues indigènes, tournait, depuis quelque-temps, une particulière potelée à souhait, blonde et radieuse comme une emblavure, la carnation rose un peu fouettée de roux, mais des lèvres si rouges et si friandes et des yeux si enjôleurs !… Ses frais atours de camériste huppée ; ses jolis bonnets blancs et ses tabliers sans macule apprirent immédiatement à Paridael qu'elle était étrangère à ces parages. Sans doute, au hasard d'une flânerie, elle avait passé par ici et remarqué le gars de bonne mine. Elle n'était pas la première qu'eussent intriguée les prunelles couleur de café noir, la tignasse frisottée et l'air sérieux, mais non maussade, du costaud. Il avait, en outre, une façon militaire, tout bonnement irrésistible, de planter son képi, et sa veste de velours lui prenait la taille comme un dolman ! Voisines et pas seulement les plus proches ne passaient leur chemin qu'à regret en guignant le zélé manœuvre. Les plus hardies lui faisaient des avances, ne se gênaient pas pour lui dire leur caprice tout en semblant gouailler, et barbelaient d'une convoiteuse œillade le lardon qu'elles lui décochaient.
La ligne étant peu importante, ce bien-voulu cumulait les fonctions de garde-barrière et d'aiguilleur. Même l'entretien du palier lui incombait comme à un simple homme d'équipe. Les évaporées le trouvaient toujours occupé. Sourd à leurs agaceries, un peu fier peut-être et les jugeant trop libres et trop trivales, il enchérissait sur son labeur, et lorsqu'il avait fini de sonner de la corne, de présenter, de dérouler et de planter son drapeau, d'ouvrir et de fermer la barrière, il s'empressait de brouetter le ballast, de recharger la voie et d'huiler les aiguilles.
La soubrette aux blancs bonnets ne se laissa pas rebuter par ces façons dédaigneuses ou farouches. Plus mignonne et de meilleur genre que les commères du quartier, à la fois plus discrète et plus affriolante, doucement elle apprivoisa le sauvage. Il commença par se redresser lorsqu'il peinait, plié en deux, sur le railway, et par soulever légèrement sa casquette pour répondre à son bonjour ; la semaine d'après il venait à elle, un peu benêt, en rougissant, pour lui parler de la pluie ; la fois suivante, accoudé à la barrière il lui contait des balivernes qu'elle humait comme paroles d'évangile. On eût dit que, pour les importuner, les trains tapageurs défilaient en plus grand nombre ce jour-là. Mais elle attendait que le jeune homme accomplît ses multiples corvées, suivait ses mouvements, ravie de ses allures aisées, et ils reprenaient, ensuite, la causerie interrompue…
La conjonction graduelle de ces deux simples amusa beaucoup Laurent Paridael, conquis par leurs ragoûtants types de brun et de blonde, si harmonieusement assortis.
Auparavant il avait lié connaissance avec le garde ; aux heures de trêve, il lui offrait des cigares, lui payait la goutte et se faisait expliquer les particularités du métier. Il le complimenta sur sa conquête, et lorsqu'il les trouvait ensemble, d'un clin d’œil il l'interrogeait sur les progrès de leur liaison, et le rire un peu confus et l'œil émerilloné du galant lui répondaient éloquemment. Quant à la soubrette, elle était tellement occupée à reluquer son élu 'qu'elle ne s'apercevait pas de ces signaux d'intelligence et de l'intérêt que Paridael portait à leurs amours. Cette félicité des autres, cette idylle de deux êtres jeunes et beaux, béatifiait et suppliciait à la fois le fantasque Paridael, l'amant méconnu de Gina.
Cependant les amoureux ne se possédaient plus de désir. Elle finit par aller le relancer dans sa maisonnette de bois les nuits qu'il était de service. Un soir d'hiver qu'il ventait et neigeait, par la porte entrouverte, Laurent les vit blottis frileusement dans un coin, la fille sur les genoux du garçon. Il n'y avait pas de lumière, mais le rougeoiement du poêle de fonte trahissait l'accouplement de leurs deux silhouettes.
Une bordée tirée de l'autre côté de la ville éloigna Laurent de ses protégés. En s'en retournant, il fut assez surpris de ne voir le jeune homme ni sur la voie, ni dans la logette. S'il se le rappelait bien, c'était pourtant cette semaine que le gars prenait le service de jour. Était-il malade ? L'avait-on remplacé ? Paridael s'inquiéta de cette absence insolite comme si le pauvre diable lui eût tenu au cœur par les liens d'une amitié de longue date. Ce fut bien pis lorsqu'à la nuit tombante, un autre que le personnage attendu vint relever l'ouvrier de garde. Cédant encore une fois à sa timidité, à cette pudeur qu'il mettait dans ses moindres sympathies, il n'osa pas s'informer du déserteur. D'ailleurs Laurent ignorait son nom. Il lui eût fallu donner un signalement, entrer dans des explications, et il s'imaginait que sa démarche paraîtrait étrange. Il rentra donc, mais la pensée de l'absent le tenailla toute la nuit, et la corne, soufflée par un autre, appelait au secours et sonnait l'alarme.
Le lendemain, le garde n'étant pas à son poste, Laurent se décida à aborder son remplaçant.
Il apprit alors un funeste épilogue.
En dépit des règlements, sous la menace des amendes ou d'une mise à pied, au risque d'être surpris par l'inspecteur en tournée, l'amoureux ne quittait plus sa maîtresse. Or, une nuit, ils étaient si bien enlacés, tellement éperdus, lèvres contre lèvres, qu'il n'eut ni la force, ni même la présence d'esprit de suspendre ces délices pour signaler un train et barrer le passage. Peut-être comptait-il aussi sur la solitude et l'abandon absolus de la route à cette heure indue ? Un terrible gloussement de détresse suivi d'une volée de jurons l'avait arraché à son extase. Lorsqu'il se précipita sur l'entrevoie, le train venait de stopper à quelques mètres de son poste après avoir écrabouilllé un vieux couple lamentable.
Certain de devoir payer chèrement sa négligence, le coupable n'avait pas attendu le résultat de l'enquête, mais s'était sauvé pendant que robins et gendarmes instrumentaient contre lui. Il avait d'autant mieux fait de redouter les sévérités de la Justice, que les deux valétudinaires supprimés pendant cette veillée d'amour étaient de richissimes grigous et que leurs hypocrites héritiers devaient bien à leur mémoire de poursuivre sans merci l'instrument de leur massacre, alors même qu'au fond de l'âme ils bénissaient probablement l'intéressant homicide.
La néfaste amoureuse disparut en même temps que son possédé et personne n'ouït où ils se cachaient. Jamais Laurent ne les revit. Mais, depuis cette aventure fatale, chaque fois que rauquait la corne d'un garde-barrière ou qu'il apercevait la cuve noire d'un gazomètre surplombant une hargneuse étendue faubourienne, qu'il lui arrivait de respirer l'âcreté du coke, – surgissaient aussitôt les jeunes gens accoudés à la barrière, lui, hâlé comme un faune, habillé de pilou mordoré, la corne de cuivre suspendue en sautoir à un bandereau de laine rouge ; elle, blonde, rose, prête à défaillir et, avec sa cornette et son tablier blanchissimes, appétissante comme le couvert d'un festin[14].
Pour secouer ses regrets de la disparition du garde-barrière, il changea momentanément de pénates et battit en explorateur cette campagne anversoise que le souvenir des émigrants ruraux lui rendait chère. Willeghem devint même pour lui comme un but de pèlerinage.
D'ailleurs, sans le quitter, sans cesser d'en fouler le sol et d'en respirer l'atmosphère, Laurent ressentait pour son pays la dévotion meurtrière, le voluptueux martyre de l'exilé. Il voyait, il percevait les moindres objets du terroir avec une intensité sensorielle que connaissent ceux-là seuls qui reviennent après une longue absence ou qui partent pour toujours ; ceux qui ressuscitent ou qui meurent. C'est seulement au rivage natal que les trois règnes de la nature se paraient de cette fraîcheur, de cette jeunesse, de cet attrait, de ce renouveau éternel.
Sa piété fervente s'étendait des êtres besogneux et des quartiers excentriques de la grande ville, au sol gâcheux ou aride, au ciel hallucinant, aux blousiers taciturnes de la contrée, à ces steppes de la Campine que le touriste redoute comme le remords.
Affrontant ouragans et giboulées, il se promenait par tous les temps.
En pleine bruine automnale, il tomba souvent en arrêt devant un porte-blaude, arpentant la glèbe à larges enjambées et l'ensemençant d'un geste rythmique et copieux. L'été, un faucheur aiguisant gravement sa faux sur l'enclumette, le faisait demeurer sur place, comme un fidèle devant un épisode symbolique de l'office divin. Il élisait entre tous le village voisin de Willeghem où cette apparition s'était produite, retournait souvent se promener de ce côté, mais, subissant toujours cette vague pudeur, n'osait rien pour se rapprocher du sculptural paysan.
On le pénétrait encore, à la moindre odeur de purin, ce soir d'avril où un rustaud trimbalait sa tinette et aspergeait, à pleines écopes, les soles en gésine. Le mépris de ce villageois pour le printemps attendri et chatouilleur, le flegme de ce fessu maroufle, à la pulpe mûre, aux cheveux filasse, en vaquant d'un pas appuyé à sa besogne utile, mais inélégante, le violent contraste du substantiel pataud avec la mièvrerie ambiante, conquéraient d'emblée Laurent Paridael et, du même coup, le décor avrilien, l'énervement de l'équinoxe, la langueur à laquelle Laurent inclinait, la présence dont il venait de jouir, lui parut insipide et frelatée comme une berquinade. Il n'avait plus de sens que pour ce jeune cultivateur. Ce même rural accosté par Laurent, cessait un instant de triturer le compost et de stimuler la glèbe, et narrait épanoui, simplard, en se grattant l'oreille : « Oui, tel que vous me voyez, monsieur, à quatre garçons du hameau nous fîmes notre première communion le jour même où nous tombions au sort ! »
Et cette coïncidence du sacrement balsamique avec la brutale conscription ne se délogea jamais du cerveau de Laurent, et lui fut inséparable d'un mélange d'encens pascal et de pouacre purée, comme de l'odeur même du jour où ce fait exceptionnel lui fut raconté.
À cette impression se rattachait intimement celle d'une matinée passée dans la noue avec une horde de vachers et de vachères. Un grand sécheron de fille garçonnière commandait la bande déguenillée et surveillait la cuisson des pattes de grenouilles pour raccommodement desquelles la générale réquisitionnait le beurre de toutes les tartines du clan. Les menottes alertes entassaient sous la casserole, comme au bivac, bois mort et fouées. Le rissolement du fricot semblait un artificiel frisselis de feuilles.
Paridael s'ébaudissait ce jour-là en sauvageon, en primitif ; il en avait même oublié son deuil et sa rancœur, mais en moins d'un instant cette rare gaieté tomba : un des petiots, saoulé de genièvre par un mauvais charretier, dormait le long de la haie ; on avait beau le secouer, il ronflait, baveux, abruti comme un alcoolique ; les chenilles velues provoquaient un frisson sous son derme rugueux, et les taons rageurs et moites qui faisaient s'ébrouer et ruer là-bas une compagnie de poulains, arrachaient de temps en temps au dormeur une gouttelette de sang, couleur de mûre écrasée, et un vagissement qui criait vengeance au ciel.
D'autres fois, Paridael remontait ou descendait les longs et droits canaux flamands, à bord d'un bateau d'intérieur. Il vivait la vie des gabariers, partageait leurs repas, dormait dans leurs cabines proprettes et mignonnes comme un boudoir de poupée, prêtait un coup de main à ses hôtes, mais s'éternisait, les trois quarts du temps, dans un rien-faire absolu, goûtait le délice de se morfondre, et de glisser, au fil de l'eau, sans bouger et d'être, à son tour, la chose immobile, passive, irresponsable, devant laquelle processionnaient les saules, génufléchissaient les oseraies, s'attroupaient des villages, se piétaient des clochers. Et les manœuvres, toujours les mêmes, répétées, aux diverses étapes, dans des sas construits sur l'unique modèle, les haltes en attendant l'éclusée, les bateaux du trait s'alignant, s'accotant dans la retenue, tandis que l'éclusier actionne les vannes, et que les carènes descendent avec le niveau qui baisse ! Et les mêmes colloques geignards s'engageant, de pont à pont, entre les ménagères !
Parfois dans la dolente ritournelle s'introduit une modulation imprévue.
Sitôt le bâclage opéré, un des aides profite du relais pour sauter à terre, déchausse une motte de gazon, au moyen de sa jambette, et, regagnant le chaland, se met en devoir de tasser cette herbe vive dans la cage de l’inséparable alouette. Sensible à cette attention, l’aimable captif accueille le régal par une vocalise étourdissante. Mais à cette allégresse intempestive, le vieux patron qui, ne pouvant venir à bout d’une manœuvre, bougonne et tempête depuis une minute, en réclamant son auxiliaire, l’avise à l’arrière du bateau et le relance au moment même où il refermait précipitamment la cage. Ah ! le fainéant ! À lui cette bourrade, à lui ce coup de pied ! Le déserteur pare la torgniole, embourse la ruade, pirouette stoïquement sur lui-même, sans une plainte, sans une riposte. Sa large bouche tressaille nerveusement, il rougit sous le hâle, mais ses grands yeux ne s’humectent pas. Ce qui le désarme, c’est moins la joie de l’oiselet que le regard affectueux et apitoyé que lui adresse la batelière, leur patronne et leur mie ! Ah ! pour se concilier la chère femme, il encourra volontiers les brutalités du patron ! Il se moque autant de la rage du mari que des aboiements du cabot. Parbleu, le servile roquet tient pour le baes, tandis que l’alouette est à la bazine !
Et le voilà, sans rancune, qui se remet à l’œuvre ! Lui aussi y va de sa chanson ! Hardi le petiot ! Les vannes se rouvrent, le toueur repêche la chaîne sans fin, et d’un bord à l’autre les aides-bateliers assujettissent et se passent les amarres.
Les bateaux s’émeuvent, reprennent la file. Lentement, tout droit, vers le Rupel, le trait dévale.
Laurent vaguait aussi, en malle-poste, par les campagnes si lointaines et pourtant si proches ! Entre Beveren et Calloo, dans le pays de Waes, on percevait le bruit rythmique des fléaux battant l’airée. Le conducteur retint ses chevaux. Une fille, un peu dépoitraillée, luisante comme la pomme du pays, accourt, grimpe le talus de la chaussée, à temps pour attraper un paquet que lui jette le postillon. D’un mouvement sec, elle fait sauter le cachet ; hésite au moment de déplier la lettre, puis se décide à en prendre connaissance.
Pas un muscle de son visage ne bouge ; mais Laurent croit entendre panteler son cœur. Et les batteurs immobiles, torses nus, le coutil bridant leurs cuisses – deux bronzes rosâtres dans le clair-obscur de la grange, – baignés d’une sueur plus volatile que liquide, – les batteurs attendaient aussi la nouvelle avec une certaine solennité. Une lettre de notre Jan, son frère, le « fils de la maison » ou de mon Frans, le promis, soldat à Anvers ? A-t-il eu la main malheureuse dans une bagarre, agonise-t-il à l’hôpital militaire, la lettre vient-elle de la prison de Vilvorde ? Laurent se pose ces questions. Il brûle d’interroger la jeune paysanne. Elle rentre dans la ferme. Il attendra toujours la réponse. La diligence poursuit sa course. Les grelots dindrelindent railleusement au collier des chevaux, le fouet claque sans vergogne, il fait fastidieusement chaud, une de ces chaleurs de plein jour qui nous porteraient à maudire le soleil et à regretter l’hiver. La cloche de Calloo sonne son midi mélancolique, l’heure si longue à sonner semble dire la cloche !… Les grillons se râpent rageusement les élytres. Et Laurent va toujours, toujours, vers un but qu’il s’est donné au hasard… Mais toujours, toujours, demain, après, fatalement, l’unique ferme du voyage, la pataude angoissée et les deux gars, moitié nus, jouant le bronze… Car sa seconde vue avertit le passant que la nouvelle est mauvaise. Il voudrait rebrousser chemin, consoler la belle terrienne ; il se sent capable de veiller, avec eux, l’ombre du mort. C’en est fait. Loin, bien loin déjà, il ne repassera de la vie par cette route. Mais il tient un souvenir de plus pour lui étreindre le cœur par les chaleurs suffocantes des canicules. Le tintement d’une cloche de village, la pâmoison des mouches dans le coup de soleil, les grillons grinçant des ailes, lui reprochent toujours l’image de gens qu’il aurait pu plaindre et aimer…
Ainsi, quantité de scènes indifférentes pour le vulgaire et pour les observateurs de métier, un visage entrevu, un passant coudoyé, un regard intercepté, une allure topique, laissaient d’ineffaçables traces dans sa vie. Il entretenait de bourrelants regrets de compagnons d’une courte traite, de rencontres sans conséquence ; inconsolable des bifurcations de chemin que la destinée impose aux voyageurs les mieux assortis.
De continuelles nostalgies le labouraient. Il lui prenait des envies lancinantes de conjurer coûte que coûte des visions fugaces ; il appétait ces apparitions bienvoulues et, dans sa mémoire, les souvenirs sympathiques se bonifiaient, se corsaient comme un vin généreux.
Une douce et noble figure de peuple, un grand gars basané, aux profonds yeux scrutateurs, penché à la portière d’une caisse de troisième, dans un train qui croisait le sien. Et il n’en fallait pas davantage à Laurent pour se rattacher cet être qu’il ne reverrait plus. Il savourerait dans l’éternité cette minute trop rapide ; rien ne s’éventerait de l’atmosphère de ce moment : c’était près d’un viaduc et dans l’air ondoyaient une odeur d’eau stagnante et une chanson de haleur. Effluence boueuse, triste mélopée encadraient la noblesse suprême de l’attitude et les grands yeux affectifs de l’inconnu…[15]
Pareils incidents devenaient pour Laurent des tableaux très poussés, d’une couleur magnétique, d’une pâte ragoûtante, mais avec, en plus, le parfum, la musique, le symbole, et ce je ne sais quoi qui différencie des autres les êtres et les objets élus. Quels chefs-d’œuvre, se disait-il, si on parvenait à rendre ces tableaux comme il les revoyait et les ruminait, lui, en fermant les yeux !
Celui-ci encore :
Un valet de ferme rentrait à l’écurie ses chevaux dételés, mais non dépouillés du harnais. L’avant-train des bêtes s’engageait déjà dans l’ombre, les croupes seules luisaient au clair-obscur sous la porte charretière. Dehors, le palonnier aux poings, le domestique, un gaillard râblé, d’une carre superbe, en manches de chemise, vu de dos, obliquait et se penchait un peu vers la droite, dans l’action de retenir les animaux trop impatients. On aurait entendu le hiu ho ! du paroissien, ou son claquement de langue flatteur, ou son juron impératif, mais on gardait, avant tout, le dessin de son geste, tant cette impulsion du corps était trouvée, unique, inséparable du personnage, harmonieuse et comme sublimée.
Avec le rappel mental de ce geste, Laurent reconstituait la scène dans ses détails accessoires. À la vérité, elle résidait tout entière dans ce mouvement qu’il avait essayé de représenter à Marbol.
Désespérant de se faire comprendre, il entraîna de force le peintre, devant la ferme où s’était produit ce geste capital. Ils se tinrent à l’affût vers le soir, mais, après avoir vainement guetté le modèle, Laurent s’informa de lui auprès des gens de la ferme.
C’est à peine si ces rustauds reconnurent leur pareil, ou du moins un des leurs, au portrait exalté qu’il traça du personnage.
– Ouais ! Le « Frisotté » finit par dire une des servantes avec une indifférence hypocrite, – car elle avait dû connaître de très près et apprécier à l’œuvre de chair ce fier compagnon de travail, – notre bazine l’a congédié il y a huit jours, et nous ne savons pas où il est allé se louer.
– Avoir mime pareil sous les yeux et le mettre à la porte ! clama Laurent avec une indignation à laquelle cette matérielle valetaille ne comprit rien.
Marbol tenta de persuader à son ami qu’ils retrouveraient bien la même attitude, le même coup de rein professionnel chez d’autres sujets de l’espèce du drôle éconduit. Et, en effet, pour flatter la manie de Paridael et le consoler de cette déplorable éclipse, ils assistèrent à la rentrée de quelques équipages de cultivateurs. Mais, au moment attendu, l’encolure, l’habitude du corps, la dégaine de ces marauds n’était qu’une parodie, une pâle contrefaçon, un à peu près maladroit, un piteux synonyme de la posture de Witte Sus. Marbol s’en serait contenté et avait même tiré son calepin de sa poche afin de crayonner ce période caractéristique de la manœuvre, mais Laurent ne lui laissa pas entamer le croquis et, comme Marbol le plaisantait sur son exclusivisme, il répondit avec conviction :
– Ris tant que tu voudras, mon cher. Mais sache bien que pour assurer à mes yeux la volupté, la caresse de cette attitude du jeune pataud, j’irais jusqu’à me faire cultivateur ; oui uniquement, afin de prendre le gaillard à mon service. C’est peut-être un fort mauvais sujet, un caractère intraitable, un serviteur malhonnête, mais, fût-il ivrogne, paillard et voleur, je lui pardonnerais ses vices comme simples peccadilles à raison de sa plastique supérieure… Celui-ci et les autres que nous avons observés ne manquent pas de galbe, je t’accorde que leurs mouvements sont identiques. Bref, c’est la même recette, le même consommé : il n’y manque que le savouret.
– Eh bien, il est heureux que tu ne saches dans quelle cuisine ce savouret, comme tu l’appelles, est allé relever le potage !…
– Oui, car je serais capable de l’engager sur l’heure.
Et comme Marbol ricanait de plus belle.
– Oh ! tais-toi, supplia son ami. Si tu étais vraiment artiste, tu comprendrais cela !
Et en retournant, abattu, renfrogné, il ne desserra plus les dents, de toute la route.
Peu à peu l’équilibre, l’eucrasie, le bon sens, la saine raison de Bergmans lui déplurent. Il se blasait sur ses amis. Il allait maintenant jusqu’à trouver son inséparable triumvirat, trop tiède, trop prudent. Au peintre il reprochait l’épaisseur, l’opacité de ses vues, son manque de curiosité et d’inquisition. La santé exubérante, les luxuriances, l’épanouissement, l’optimisme du génie de Vyvéloy ne lui procuraient plus les jouissances d’autrefois.
Ses sorties amusaient beaucoup son petit cercle. Ils traitaient leur censeur en enfant gâté et le ménageaient comme un cher convalescent. Leur bonté protectrice, leur mansuétude, leur indulgence, loin de calmer Laurent, achevaient de le mettre hors de lui et, ne parvenant pas à entamer leur sérénité, il leur brûlait la politesse, quitte à venir les retrouver quelques jours après. Les autres ne lui gardaient aucune rancune, et lui passaient ses incartades et ses propos passionnés comme autant de paradoxes et de sophismes d’un grand cœur.
Mais, hanté par ses idées biscornues, Laurent rêvait d’y conformer sa conduite. Le moment arrivait où il dépouillerait ses derniers préjugés et enfreindrait les conventions sociales. Ses allures excentriques lassèrent enfin la tolérance de ses intimes et, en personnages ayant une situation à garder devant le monde, ils risquèrent quelques observations. Un jour, ils l’avaient rencontré en compagnie d’une couple de drilles assurément fort pittoresques, rôdeurs de quai, mauvais journaliers, modelés et nippés à souhait, mais d’une originalité par trop outrée, à qui, pourtant, de la meilleure foi du monde, il se flattait de les présenter. S’étant dérobés en toute hâte à cette compromettante accointance, ils furent taxés durement de philistinisme.
Cette fois Bergmans riposta sèchement. Paridael leur en demandait trop, à la longue ! La plaisanterie tournait à l’aigre. S’intéresser au peuple qui travaille et qui souffre : rien de plus équitable. Mais se passionner pour les sacripants, frayer avec les irréguliers et la racaille, c’était se conduire en excentrique, pour ne pas dire plus ! Puis s’adoucissant, Bergmans tenta de montrer au dévoyé l’abîme vers lequel il glissait ; il lui reprocha son désœuvrement, sa vie à part, ses chimères, s’offrit même de le placer chez Daelmans-Deynze[16].
Paridael refusa net. La plus légère dépendance, le moindre contrôle lui répugnaient comme une chaîne.
Quelquefois, sensible à une parole émue il promettait de se ranger ; il ferait un effort et se contenterait de l’existence commune aux gens rassis ou du moins plus posés ; mais ces sages résolutions l’abandonnaient au premier froissement que lui causaient la platitude et la méconnaissance bourgeoises.
Les pronostics du cousin Dobouziez pesaient sur lui comme une malédiction ; cet homme positif et clairvoyant avait scruté l’avenir de ce parent exceptionnel.
Laurent en arrivait à se souhaiter irresponsable, à envier les internés criminels ou fous, que ne ronge plus le souci du pain quotidien et de la lutte pour l’existence. Sa bonté évangélique, une bonté hystérique comme celle des franciscains d’Assise, s’effrénait et le poussait aux dernières conséquences du panthéisme. Fataliste, il se croyait prédestiné ; sans ressort, sans foi, sans but, il souhaitait mourir et se replonger dans le grand tout, comme une pièce ratée que le fondeur remet au creuset. Après l’éparpillement de ses atomes et la diffusion de ses éléments, l’éternel chimiste les combinerait une autre fois avec plus de profit pour la création.
La visite que Laurent fit, au plus fort de cette crise, à une maison pénitentiaire, exaspéra ces délétères nostalgies :
« Des malades, des inconscients, des malheureux ! » plaidait-il, au retour de cette excursion, devant le tribun, le peintre et le musicien. « Les bayeurs, les effarés, les éblouis, les éperdus, aux grands yeux visionnaires qui ne comprennent rien au monde et à la vie, au Code et à la morale, – des faibles, des pas-de-chance, moutons toujours tondus, instruments passifs, dupes qui coudoyèrent toutes les scélératesses et demeurèrent candides comme des enfants ; débonnaires qui ne tueraient pas une mouche quoique des escarpes les aient associés à leurs entreprises ; viciés, mais non vicieux, souffre-douleur autant que souffre-plaisir…[17]
– Parlerais-tu pour toi ? interrompit Marbol.
– Un artiste, toi ! fulmina Paridael sans répondre à cette pointe. Qu’as-tu souffert pour ton art, que lui as-tu sacrifié ? C’est là-bas que j’en ai rencontré un, d’artiste ! Et un vrai, et un sincère va !… Après m’avoir promené d’atelier en atelier, le directeur me fit entrer dans une forge modèle. Figurez-vous une triple rangée d’enclumes, autant de soufflets rythmant à leur haleine éolienne la danse rouge des flammes ; une centaine d’hommes, le poitrail et le ventre protégés par le tablier de cuir raide comme une armure, pileux, hirsutes, noircis, formidables, leurs bras nus aux muscles saillants battant allègrement du marteau ; un tonnerre et une température de cratère en éruption ; une affolante dissolution de limaille dans la sueur humaine ; des éclairs de coupelle alternant avec des girandes de feu ; et, s’éclaboussant d’étincelles, des torses comparables à celui du Vatican.
À part ses dimensions énormes et son appareil plus nombreux, rien ne distinguait cependant cette forge de celles que nous avons rencontrées ; les forgerons robustes et magnifiques ressemblaient à tous les forgerons du monde. L’activité, la fièvre, l’émulation régnant dans ce hall immense étaient ni plus ni moins édifiantes que celles d’un atelier de travailleurs libres, et on eût stupéfait maint criminaliste, versé dans la science de Gall et de Lavater, en lui révélant les tares et les incompatibilités de ces athlètes de mine surhumaine.
En passant entre les files d’enclumes, un des frappeurs surtout me conquit par ses dehors : c’était un gaillard chenu, bien découplé, d’une physionomie douce et pensive, d’au plus trente ans. Le directeur m’avait montré dans ses salons d’admirables objets en fer battu rappelant ou plutôt perpétuant les exquises ferronneries du Moyen-Âge et de la Renaissance.
« Voici me dit-il, l’auteur de ces morceaux ! » et au marteleur qui ne cessait de corroyer le métal en ignition : « Karel, ce Monsieur a bien voulu trouver quelque mérite à vos menus ouvrages. – Non pas quelque mérite, mais le plus grand mérite ! rectifiai-je avec empressement. Ces grillages de fenêtre, ce foyer, ces torchères, cette rampe d’escalier sont tout bonnement superbes, et je vous en félicite de grand cœur ! » À l’accent convaincu, à l’expression catégorique de mes louanges, le visage sérieux du colon s’illumina d’un pâle sourire, ses prunelles orageuses irradièrent ; il me remercia d’une voix douce et pénétrée, mais sourire, intonations et regards étaient tellement poignants que si j’avais insisté, et pressé sur la même fibre, l’expression de la gratitude du pauvre diable se fût résolue, sans doute, dans les larmes et les sanglots. Du coup, je me sentis encore plus bouleversé que lui et après avoir touché furtivement sa main calleuse, je m’éloignai rapidement, la gorge serrée et un brouillard devant les yeux.
« Figurez-vous, me dit mon pilote, lorsque nous fûmes sortis et tandis que je me détournais pour lui cacher mon trouble, que j’avais très avantageusement placé ce gaillard-là chez le maréchal du village. Il gagnait un honnête salaire et son baes le traitait avec force ménagements. D’ailleurs, j’avais pu recommander le sujet en toute confiance. Il avait fallu des afflictions infinies, la mort des siens, foudroyés pendant la dernière épidémie de typhus, pour le réduire au désespoir, à l’ivrognerie, à la misère et le faire échouer au seuil du Dépôt. Je me flattais de l’avoir réconcilié avec la vie et avec la société. Eh bien, ne s’est-il pas avisé de quitter brusquement ses patrons et de venir sonner à notre porte. Amené devant moi, il m’a supplié de le reprendre. Vous ne devineriez jamais sous quel prétexte ? Cet original trouvait en dessous de sa dignité de louer ses bras à un forgeron de village qui les employait à des travaux grossiers et il s’estimait beaucoup plus heureux de s’appliquer comme réclusionnaire, au Dépôt, parmi des rafalés, à des ouvrages de choix, à des travaux d’art du genre de ceux qu’on entreprend ici. Naturellement, je refusai de me prêter à cette singulière fantaisie et croyant lui avoir démontré l’absurdité de sa préférence, je l’éconduisis en lui promettant de lui chercher un atelier plus digne de son talent. Il n’objecta rien à mes raisons, sembla se soumettre, mais il me dit au revoir d’un ton sarcastique, tout à fait contraire à sa nature. Deux mois après cette entrevue, il me revenait mais, cette fois, escorté par les gendarmes, avec la fourgonnée quotidienne de canapsas que nous adresse l’autorité judiciaire ; il se faisait admettre non plus par faveur, mais de droit, bel et bien nanti, en manière de lettre d’introduction, d’une patente d’incorrigible pied-poudreux. Et lorsqu’il a eu purgé sa peine, pour lui épargner des récidives, j’ai consenti à le garder. Seulement ne répétez pas cette histoire, car, si elle arrivait aux oreilles du ministre, ma complaisance serait peut-être sévèrement jugée. Et pourtant ma conscience m’approuve ! Le moyen d’en agir autrement avec ce diable d’aristocrate ? » Le croirez-vous, loin de le blâmer, je félicitai sincèrement ce fonctionnaire compréhensif et lui sus gré de ses bontés pour un des seuls complets artistes, un des vrais aristocrates, – c’était le mot – que j’eusse rencontrés… Oh ! rassieds-toi Marbol, et toi aussi Bergmans, je n’ai pas fini… Notre promenade s’acheva dans un mutisme lourd de pensées. Je me reprochais ma pusillanimité à l’égard de celui qui était resté dans la forge. J’aurais dû sauter au cou de cette victime des maldonnes sociales et lui crier : « Moi je te comprends, orgueilleux misérable ! Combien ton apparente partialité est plausible ! Je partage ta prédilection pour cet asile où tu te livres sans entrave à la fantaisie créatrice, où celui qui te paie ne met pas aux prises ta conscience et ton intérêt. Combien d’artistes ne t’arrivent pas à la cheville ! Puis, mon brave, je te devine un caractère trop impressionnable pour qu’il te fût possible de te rapatrier avec la géométrique humanité. Une première défaillance te mettait au ban des mortels ostensiblement vertueux. Un faux pas t’aliénait à jamais ces austères équilibristes. Tu préfères à cette société hypocrite et rectiligne tes pairs étranges, tes compagnons de bagne. Tu vis sans mortification, tu produis à ta guise ! Ce pain que tu manges, aucun compétiteur ne te l’arrachera ; encore moins le voles-tu à ton frère dans la détresse. Plus de lutte pour l’existence, cette lutte qui finit par déteindre sur l’artiste. Pas de marchand, pas de parades, pas de public. Autour de toi de pauvres êtres qui, sans mieux comprendre nécessairement ton œuvre que les connaisseurs patentés, excusent et respectent ton art, ton vice, ton vice rare parce que tu ne songes pas non plus à leur faire un grief de leur subversive originalité ». Après cette apologie du rafalé et de l’insoumis, une terrible discussion s’engagea entre Laurent et ses compagnons, quoique ceux-ci eussent tout fait pour rompre les chiens. Ces scènes se renouvelèrent, arrachant chaque fois un lambeau à l’ancienne intimité, et Laurent finit par ne plus voir ses féaux d’autrefois.
Il se replongea plus avant dans les quartiers extrêmes illustrés par les amours du garde-barrière ; pratiqua les repaires de la limite urbaine, les coupe-gorge du Pothoek et du Doelhof, les ruelles obliques du Moulin-de-Pierre et du Zurenborg, dont la vue lui pénétrait le cœur, lorsqu’il était enfant, et lui inspirait une curiosité mêlée d’angoisse et une pitié malsaine, cette zone excentrique, à l’est de la ville, véritable vestibule des Dépôts, salles d’attente des Maisons centrales, grouillantes maladreries morales.
Il battit aussi l’immense région des Bassins, commençant devant l’ancien Palais des Hanséates, dégarni de son campanile et de l’aigle impériale, et présentant une succession ininterrompue de réservoirs quadrangulaires, énormes et solides comme ces arènes inondées servant aux naumachies des Césars. Cependant les navires y affluaient en masses si compactes que, plus d’une fois, Paridael traversa ces docks, à pied sec, comme sur un pont de bateaux. Sans trêve on en creusait d’autres plus profonds et plus vastes encore. À peine inaugurés, ils se trouvaient insuffisants pour les flottes marchandes qui s’y rencontraient des cinq parties du monde, et, derechef, la métropole, glorieuse Messaline du négoce, insatiable et inassouvie, s’élargissait les flancs pour mieux recevoir ces arches d’abondance et, toujours stimulée, luttait d’expansion et de vigueur avec ses copieux tributaires[18].
Et sans cesse une armée de terrassiers du Polder s’évertuait à creuser, pour la reine de l’Escaut, un lit à la taille de ses amants.
Mais si elles étaient exigeantes, du moins ces amours étaient fécondes.
Le long des quais, alentour de chaque bassin, se déployait un appareil de grues et de chèvres actionnées par les forces de l’eau et de la vapeur et desservies par des théories de débardeurs herculéens. Inquiétantes à l’égal des engins de balistique et de ces machines de siège, inventées autrefois par Giambelli, l’Archimède anversois, pour couler et fracasser les galions de Farnèse, leur bras démesuré brandi comme une menace perpétuelle vers le ciel, elles n’arrachaient plus les navires à leur élément, mais après avoir plongé, comme un poing armé du forceps, leurs crocs d’acier au tréfonds des cales, elles en guindaient, sans trop grincer des chaînes et des dents, les cargaisons recélées dans ces entrailles éternellement en gésine.
Communiquant avec les docks et avec la rade par de puissantes écluses pourvues de passerelles et de ponts tournants s’alignaient les cales sèches, ainsi qu’un hôpital attenant à une maternité. Là se ravitaillaient les vaisseaux malades ou blessés. Une nuée d’opérateurs, calfats, peintres, étoupeurs, entreprenaient la carène avariée, l’écorchaient, l’adoubaient, la blindaient, la suiffaient, la peignaient à neuf ; et la rumeur des percussions, des maillets et des pics, couvrait les giries des cabestans, le sifflet des sirènes et le fracas du portage.
Puis, après l’hôpital, la fourrière, la morgue. Des champs incultes où des carcasses de navires, couchées sur le flanc, lézardées, rongées de varech, lépreuses, la mine d’incurables, de baleines échouées, attendaient qu’on les déchirât ou achevaient de pourrir comme une charogne parmi les détritus et les menues épaves. La Gina ne serait-elle pas venue échouer en cet endroit ? Parfois Laurent tentait de reconnaître ces planches de rebut.
Puis il poursuivait encore. Il tournait les entrepôts de matières inflammables. Des magasins de pétrole et de naphte s’immergeaient comme des îlots dans des bas-fonds marécageux. Ici s’arrêtait, pour le quart d’heure, l’industrie de la grande ville. Barrant l’entrée de la campagne, vers Austruweel, régnaient les glacis de la vieille citadelle du Nord, forteresse de rebut, boulevard encombrant et démodé, épouvantail déchu, poulailler chétif dont la ville utilitaire venait d’obtenir la cession et qu’elle s’empresserait de saper pour la convertir, comme ses autres annexions, en darses, en docks, en hangars, en cales sèches. Ah ! que ne pouvait-elle en agir de même avec tous ces retranchements et ces remparts dont on s’obstinait à l’entourer ! Car la cité, essentiellement marchande, subit à contre-cœur son rôle de place forte, quoiqu’elle y ait été prédestinée dès l’origine, par ce burg romain, son berceau, dont on voit encore aujourd’hui les vestiges et d’où la poésie spoliée et travestie guette son chevalier, comme, aux premiers jours, Elsa de Brabant, marquise d’Anvers, conjurait l’apparition de Lohengrin, son vicaire, dans le sillage éblouissant du cygne fatidique.
Gardant au cœur un dernier scrupule filial, au lieu d’abattre le vénérable donjon, Anvers se contente de le bafouer en le flanquant de deux promenoirs aussi mesquins que des praticables d’opéra-comique.
Mais elle n’userait même pas de ces contestables égards envers les bastilles plus récentes.
Elle maudit comme une détestable servitude l’enceinte de fortifications que ses princes ne consentent à démolir de siècle en siècle que pour les transporter plus loin et les rendre inexpugnables.
La Pucelle d’Anvers, plus hautaine que belliqueuse, foulerait volontiers aux pieds la couronne crénelée dont on la coiffa de force.
L’histoire ne laisse pas de justifier la répugnance de la métropole pour cette toilette guerrière. Au lieu de la préserver, ces murailles et ces remparts attirèrent de tout temps sur elle les pires fléaux. Assiégée durant des mois, bombardée, puis forcée, envahie, pillée, saccagée, mise à feu et à sang, dévastée de fond en comble par les soldatesques étrangères, notamment lors de cette Furie espagnole, si bien nommée, elle faillit ne plus en réchapper, ne jamais se relever de ses cendres et disparaître avec sa fortune. Mais grâce à son fidèle Escaut, qui lui tient lieu à la fois de Pactole et de Jouvence, elle renaît chaque fois plus belle, plus désirable et recouvre même au décuple sa prospérité ravie. À mesure pourtant qu’elle s’enrichit, elle devient hargneuse et égoïste. Pressentirait-elle de nouveaux sinistres ? Elle étale un luxe si insolent et tant de misères l’environnent ! Et plus son commerce fleurit, plus s’invétère sa haine contre ces fortifications néfastes, qui contrarient non seulement son essor, mais la désignent, en cas de guerre, pour théâtre des luttes désespérées et des effondrements suprêmes.
Continuellement les remparts chargés de canons, les casernes bourrées de soldats, évoquent le spectre de la ruine et de la mort, à ces Crésus aussi arrogants que poltrons. Et la ville en arrive à envelopper dans la même animadversion les bastions qui l’étranglent et la garnison oisive et parasite qui semble insulter à son activité et dont elle conteste jusqu’au courage patriotique. Ainsi Carthage exécra jadis ses mercenaires.
La manière dont se recrute l’armée ne contribue pas à la relever aux yeux de ces oligarques. Elle ne se compose, en majeure partie, que de pauvres diables ou de vauriens ; de conscrits ou de volontaires avec prime. Or les millionnaires, élevés dans le culte de l’argent, n’établissent guère de différence entre un indigent et un vagabond. L’armée tient à bon droit la garnison d’Anvers pour la plus inhospitalière. Les troupiers relégués dans ce milieu antipathique présentent bientôt une physionomie entreprise et contrainte. À la rue, instinctivement, ils s’effacent et cèdent le haut du pavé au bourgeois. Ils portent non pas l’uniforme du guerrier, mais la livrée du paria. Au lieu de représenter une armée, d’émaner du patriotisme d’un peuple, d’incarner le meilleur de son sang et de sa jeunesse, ils ont conscience de leur rôle de mortes-payes.
Les Anversois confondent ces soldats du pays neutre avec les indigents secourus par la bienfaisance publique, avec les pensionnaires des orphelinats et des hospices[19].
Et, par une étrange anomalie, le préjugé du bourgeois d’Anvers contre le soldat, aveugle les gens du peuple, ceux-là même qui risquent de devoir servir ou qui ont servi, les pères dont les garçons étaient ou deviendront soldats.
Il ne s’agit plus d’une haine de castes, mais d’une véritable incompatibilité de mœurs, d’une rancune historique dont l’Anversois hérite comme d’une tradition inhérente à l’air qu’il respire et au lait qu’il a tété.
Dans les guinguettes, les ouvrières refusent souvent de danser avec les soldats. Ailleurs, aux yeux des belles, la tenue revêt le galant d’une crânerie irrésistible ; ici elle tare le cavalier le plus fringant. Lorsqu’ils se sentent en nombre, les soldats rebutés ne digèrent pas l’affront, mais piqués au vif, élèvent la voix, prennent l’offensive, mettent le bal sens dessus dessous, tirent le bancal ou la latte, et se vengent du mépris de leurs donzelles sur les gindres et les garçons bouchers. Presque chaque semaine des bagarres éclatent entre pékins et soldats ; surtout dans ces tènements obliques, avoisinant les casernes de Berchem et de Borgerhout. Cette inimitié entre le civil et le militaire sévit même hors de l’enceinte fortifiée, dans la campagne des environs d’Anvers. Malheur au traînard qui regagne seul, le soir, un des forts avancés. Les ruraux apostés tombent sur lui, le criblent de coups, l’assomment, le traînent sur le pavé. Ces guets-apens appellent de terribles représailles. À la suivante sortie les frères d’armes de la victime descendent en force dans le village et s’ils ne parviennent pas à mettre la main sur les coupables, envahissent le premier cabaret venu, brisent le mobilier, cassent les verres, défoncent le tonneau, écharpent les buveurs, abusent des femmes. Il arrive que des rues entières de Berchem sont livrées aux excès de cette soudrille. À leur approche, les habitants se claquemurent. Ivres de rage et d’alcool, les forcenés enfoncent leurs sabres à travers portes et volets et ne laissent plus vitre entière dans les châssis.
Le lendemain le colonel aura beau consigner le régiment dans ses casernes et interdire ensuite à ses hommes de hanter les estaminets de la région, après ces camisades la haine continue de couver, latente et sourde, et à la première rencontre éclatent de nouvelles et meurtrières conflagrations.
Naturellement Laurent prenait, dans la plupart des cas, le parti des soldats, poussés à bout, contre leurs antagonistes, les farauds et les tape-dur du Moulin de pierre.
Il se conciliait surtout les nouveaux venus, les novices, les plus dépaysées et les plus rebutées des recrues. Car celles-ci subissaient non seulement les avanies des bourgeois, mais servaient encore de bardot aux anciens du régiment. Souffre-douleurs d’autres souffre-douleurs, c’étaient pour la plupart des terriens poupards et massifs littéralement déracinés de leurs villages campinois.
Laurent suivait les pauvres claudes dès ces grises après-midi de tirage au sort et de conseil de milice, où, crottés jusqu’aux reins, ils gambillaient et beuglaient par la brume et la fange des rues, la casquette renouée de papillotes et de rubans de feu, l’air fallacieusement faraud d’aumailles primées aux comices agricoles, les yeux humides et perdus, bras dessus bras dessous, outrageusement éméchés, battant de désordonnés « en avant deux » de quadrilles. Ce spectacle lui retournait l’âme.
Puis il se représentait ces fanfarons d’allégresse, les premiers jours, à la caserne : Des instructeurs choisis parmi les plus braques, souvent parmi des remplaçants, injuriaient, brusquaient, molestaient ces patauds abalourdis au point de ne plus distinguer leur droite de leur gauche, de ne plus articuler leur nom ou celui de leur paroisse. Et les brimades atroces et dégoûtantes dans les chambrées ! Puis, les trôleries, à vau-de-rue, dans leur uniforme neuf ; par coteries de pays ; frileusement rapprochés comme des poussins de la même couvée ; les haltes béates devant les étalages et les tréteaux, leur marche dodelinante, leurs enjambées et leurs déhanchements rustauds, leur mine vaguement inquiète et suppliante de chien perdu ; le puéril travestissement guerrier s’adaptant mal à ces rudes manieurs d’outils et soulignant le contraste entre leur membrure terrible et leurs ronds et placides visages.
Peut-être, samaritain renforcé, Laurent préférait-il encore au troupier soumis et passif, les déserteurs, les réfractaires, et jusqu’aux dégradés mis au ban de l’armée et affligés de la cartouche jaune.
En commémoration de la poignante énigme posée entre Beveren et Calloo, il hébergea et recéla durant plus d’une semaine, le temps de dépister les gendarmes et de lui recueillir le viatique nécessaire pour passer à l’étranger, un évadé de la correction, un pauvre diable de disciplinaire, conscrit inoffensif et ahuri, condamné, pour une vétille, à croupir, jeune et brave comme il était, dans les caponnières d’un fort marécageux et à se tordre sous l’arbitraire d’un officier en disgrâce. À l’heure de la corvée, le pionnier avait chaviré la brouette, jeté loin la pioche et pris la fuite sous les yeux du piquet de garde qui le couchait en joue. Il avoua même à Laurent qu’il comptait moins regagner la liberté que recevoir le coup de grâce. Et comme tous ces fusils partirent sans le toucher, le débonnaire crut toujours que la maladresse des sentinelles, de ses frères les paysans, avait été de la miséricorde.
V. LES « RUNNERS »
Laurent se rapprocha même de ces écumeurs de rivière, squales d’eau douce, voyous ou runners que l’honnête Tilbak tenait à distance, modèles que le peintre Marbol répudiait comme trop faisandés.
Engeance topique entre toutes, la plupart voient le jour ou ce qui en tient lieu, dans les ruelles batelières, au fond d’une boutique de mareyeur ou sous le toit d’une herberge cosmopolite. Impasses, culs-de-sac où la marmaille grouille et pullule tellement, qu’on croirait les marchands d’anguilles et de moules aussi prolifiques que leurs marchandises. Les fièvres paludéennes et les contagions balaient ces morveux par portées entières, les lourds chariots des Nations en rouent au moins une couple chaque semaine ; le lendemain, ils foisonnent en rassemblements aussi compacts que la veille. Toutefois, les unions légitimes des pêcheurs et des poissonniers ne suffiraient pas à encrasser de ce varech humain le pavé de ces habitacles. Des amours aussi passagères et aussi capricieuses que celles des plantes, président à la propagation de l’espèce. Tels fils de servante blonde, comme la blonde Germanie, héritèrent du teint citronneux et des sourcils noirs de leur père, le timonier italien échoué une nuit chez le logeur allemand, baes de cette Gretchen. Ces boulots de complexion apparemment septentrionale proviennent du croisement furtif d’un lamaneur hollandais et de la pensionnaire d’une posada espagnole[20].
L’atmosphère fiévreuse et vénale de la rade émancipe de bonne heure cette progéniture de matelots et de filles. Ils se vengeront de leurs trente-six pères en écorchant et en juivant de leur mieux les pauvres diables de marins.
L’ambigu de leur métier complique l’indéterminé de leur origine. Leur existence s’écoule au fil des vastes nappes fluviales. À force de les emplir de visions lubrifiantes, l’eau communique sa vertu, son aimant pervers, à leurs prunelles. Musculeux et pourtant dégagés, futés mais intrépides, adroits comme des bravi florentins, ces métis participent des nixes à la voix insinuante, aux quenottes voraces, aux griffes affilées. Ils parlent, comme d’intuition, une dizaine de langues, autant de dialectes, et chacun avec l’accent local ou plutôt en relevant celui-ci d’une pointe canaille, d’un timbre parodiste et argotique dont ils pimentent même leur propre patois et auquel on les reconnaît entre leurs congénères des autres grands ports.
Mâtinés, échappés de toutes les races, leurs disparates s’harmonisent, s’amalgament de manière à composer une physionomie autochtone, très arrêtée, à les marquer d’une estampille sans analogue, d’un indélébile et vigoureux cachet de terroir.
Laurent prisait fort leur élégance féline, leur indolence affectée. Cette variété de la plèbe anversoise quintessenciait les vices et les perfections mêmes de la grande ville.
À la longue, Paridael contractait leurs habitudes de corps, leurs déhanchements, leur élocution lente et farcie. Le fumet violent de ces dessous de métropole florissante condimentait sa vie, longtemps insipide. Il s’adaptait à ses entours. Certains jours il se culottait, comme les « capons du rivage », de dimittes boucanées et de pilous rogneux, ouvrait sur la blouse courte du débardeur le vieux paletot à basques flottantes, se coiffait de la casquette marine à visière impudente, du piriforme ballon de soie cher aux blatiers ruraux, d’un pétase picaresque ou même d’une simple natte à figues croustilleusement pétrie.
Dans cette tenue topique il se débraillait, se dépoitraillait, roulait des hanches, frétillait de la langue, traînaillait des savates, entrechoquait les sabots. Adossé au mur d’un hangar, la joue fluxionnée d’une chique, les bras nus, il se caressait les biceps avec des coquetteries de tombeur forain ou, la main à la braguette, rajustait d’un geste cynique ses chausses toujours tombantes, ou tourmentait le fond de ses poches et, en quête de gredineries, béait, musait des heures, au va-et-vient des passants.
Les jeux de mains ne lui répugnaient plus ; il se complaisait dans les ruées sur un camarade en défaut, subissait ou distribuait les fessées au hasard des turlupinades, provoquait et entretenait les culbutes, croupes par-dessus têtes, se prêtait aux privautés, aux apostrophes risquées. Au sortir de ces tournois on l’eût pris pour le boueux ou le tombelier qu’il venait de vautrer dans la voirie.
Durant le jour runners et louffers déambulaient le plus souvent chacun de son côté. Allongés sur une pile de ballots, sur un camion lège, au comble d’un tas de planches, ou encore au fond d’un bachot, ils ne dormaient que d’un œil. Vers la brune il y avait de subits branle-bas, ils convergeaient de flair et d’instinct aux mêmes stationnements. Tassés à croupetons, semblables à une tribu de champignons germés en commun par une nuit humide et ténébreuse, ils tenaient de véritables sabbats, ruminaient quelque pillerie, liaient des parties de maraude, se proposaient aussi de brutales gageures, enchérissaient de turpitudes, épouvantaient par leurs gueulées et leurs tortillements les guenuches qui louvoyaient dans leurs parages.
Un essaim de mauvaises mouches, de cantharides invisibles semblait piquer simultanément la tapée licencieuse et c’était alors, jusqu’au potron-minet, le long du fleuve et des canaux, sous les hangars, parmi les marchandises amoncelées, des courses de dératés, des ruses de guérilleros, des randonnées furieuses, des picorages furtifs, des flibusteries formidables ameutant et consternant gabelous et policiers.
S’il ne passait pas la nuit au dehors, il gîtait avec les insubordonnés de tout poil dans les pouilleries du Schelleke, du Coude Tortu, de l’Impasse du Glaive et de la Montagne d’Or. Encore lui fallait-il acquitter d’avance les deux sous de la nuitée. Il tirebouchonnait au gré d’un escalier charbonneux et vermoulu jusqu’au galetas garni de sordides literies suspendues à la façon des branles. Les habitués du lieu s’allongeaient au petit bonheur, le plus souvent tout habillés, sans prendre garde aux coucheurs voisins, âges et sexes confondus, dos à dos, ventre à ventre, tête-bêche, grouilleux, incontinents. Cette promiscuité déterminait des accouplements presque inconscients et somnambuliques, des méprises amoureuses, parfois aussi des prises de possession poivrées de carnage, des scènes de jalousie et de rivalité se prolongeant jusqu’au chant du coq. Et par ces nuits chargées d’ozone, les désirs crépitaient à fleur de peau comme les feux-follets sur la tourbière. Laurent entendait bruire et chuchoter les lèvres haletantes. Des marchés se débattaient autour de lui, de fatales initiations se consommaient à la faveur des ténèbres. Où commençait la réalité, où finissait le cauchemar ? Les noctambules se renversaient, battaient des bras et des jambes, se ramassaient dans des postures de jugement dernier ou de chute des anges, jusqu’à ce qu’au plus fort de la tourmente générale, d’inoubliables giries, une clameur plus atroce, plus stridente que les autres, arrachât, en sursaut, cette chambrée de complices à leur enfer anticipé[21].
La police patrouillait chaque nuit dans ces cloaques dont l’atmosphère eût jugulé un cureur d’égouts. De loin en loin elle opérait une coupe sombre, mais procédait chaque nuit à un émondage partiel.
Précédé du baes, le policier promenait le rayon de la lanterne sourde sous le nez des dormeurs. Son choix fait, il secouait le récidiviste, l’invitait presque cordialement à se lever, à se vêtir, et ne sortait qu’après lui. L’homme obéissait, morne, grognonnant avec des allures d’ours muselé. Cette formalité se renouvelait si souvent que les autres ouvraient à peine un œil, ou après avoir salué d’un « bon voyage » gouailleur le camarade et son acolyte se rendormaient sans accorder d’autre attention à cette cueillette. Demain arriverait leur tour ! Puis il y a des mortes-saisons pour leur métier comme pour les autres ! Et, en temps de chômage, autant couler ses jours au Dépôt ou rue des Béguines !…
À la pointe du jour, le logeur se présentait au seuil du dortoir et après s’être gargarisé d’une toux et d’un crachat, il clamait d’une voix professionnelle, un peu nasarde de commissaire-priseur procédant à une adjudication :
« Debout, les garçons !… Un… Deux… Trois !… »
Puis, sans autre sommation, il détendait brusquement les sangles soutenant les paillasses, et, au risque de défoncer les planches moisies, la masse des coucheurs s’abattait brutalement sur le parquet.
Habitué des audiences de la correctionnelle, s'éternisant des heures parmi les récidivistes et les apprentis larrons, qu'affriolaient des débats consacrés aux exploits de leurs copains, se complaisant dans le contact des guenilles imprégnées de senteurs aventurières, Paridael dut à des miracles de n'être pas impliqué lui-même dans l'une ou l'autre affaire de ces détrousseurs terrorisant la banlieue.
Il connaissait plus d'un affilié de ces bandes célèbres établies dans les hameaux borgnes aux confins des faubourgs populeux : au Stuivenberg, au Doelhof, au Roggeveld, au Kerkeveld. Les policiers le ménageaient et le tenaient pour un original, un toqué, un fou inoffensif. Ils le veillaient plus qu'ils ne le surveillaient malgré ses éhontés compagnonnages avec la crème des repris de justice : le Hareng, le Sans-Cul, Fleur d'Égout.
Lui aussi avait été gratifié d'un sobriquet. Ce n'était pas le premier : autrefois, dans son monde, Béjard, Saint-Fardier, Félicité et même Régina affectant de ne voir que la carnation trop montée de son visage l'avaient appelé le « Paysan ». La populace avec laquelle il s'emboîtait à présent, remarqua plutôt la blancheur et la petitesse de ses mains, la cambrure de ses pieds de femme, la finesse de ses attaches ; et pour les receleuses mamelues, pour les rogues escarpes, aux larges poignes, aux pesantes fondations, il fut le Jonker, le Hobereau.
Comment arriva-t-il à se faire chérir par tous ces apaches, alors qu'on aurait pu s'attendre plutôt à le trouver un matin saigné, étripé dans une arrière-cour de tapis-franc ou à le voir retirer de la vase des Bassins, le ventre déjà grouillant d'anguilles ?
Il excitait au contraire dans ces bas-fonds une sorte de respect superstitieux et de déférente sympathie. Ils lui avaient d'ailleurs tendu des goures dont il sortit à l'honneur de sa discrétion. L'esprit de contumace rapprochait ce déclassé de ces hors-la-loi.
Pour flatter et chatouiller leur instinct de combativité, pincer leur fibre frondeuse, exalter leur muscularité sanguine, aux heures de cagnardise il leur raconta ses lectures, transposa Shakespeare à leur intention : Othello, Macbeth, Hamlet, le roi Lear, mais surtout ceux de la guerre des Deux Roses, Rois et Reines des périodes expiatoires, fauves tigrés de stupre et d’héroïsme.
Plus d'une fois au sortir de ces lectures, réveillé par l'approbation véhémente, le pantellement de ces corps de gladiateurs, le fluide de ces âmes irresponsables comme la nature même, il lui semblait que son rêve venait de s'épancher dans la réalité.
C'est parmi les plus jeunes de ces runners que les colombophiles recrutaient leurs coureurs les dimanches de concours. Il arriva à Laurent de faire partie des relais et, serrant entre les dents les coins de la musette contenant le pigeon victorieux, de s'élancer pieds nus, les jarrets élastiques comme ceux d'un héros de la palestre.
Il découvrit le photographe chargé par la justice de perpétuer l’image des criminels à l’issue de leur procès et se fendit d’une épreuve de la collection intégrale. Il s’absorbait avec une joie amère dans la contemplation de cette galerie de trouble-bourgeois bien patentés et les comparait, sans prévention, au bronze, au marbre, même à la chair des mortels augustes. À défaut des lettres d’or illustrant les monuments de la reconnaissance civique, le nom du condamné éclatait en caractères blancs sur la poitrine de chaque photographie. Cette inscription semblait pilorier et tatouer au fer rouge jusqu’à la pauvre effigie du sujet. Au revers de la carte figuraient le signalement, le sobriquet, le lieu de naissance, le numéro du dossier et l’objet de la prévention.
Laurent s’amusait des leurres et des trompe-l’œil des physionomies. Certains masques de satyres eussent convenu au plus vénéré des notables et au plus chaste des puceaux.
À la suite du viol d’une demoiselle de rayon par six paysans de la banlieue, il s’attabla souvent au cabaret banal d’où les garnements s’étaient rués pour s’assouvir. Il affectionnait la chaussée de mine délabrée avec ses ravières, ses fourrés galeux, ses roidillons, sa bordure d’arbres grêles, écorcés et entaillés sans doute par les mêmes touche-à-tout qui devaient s’acharner à l’occasion sur une victime moins passive.
Grâce à son album de célébrités patibulaires il reconnut un des héros de cette équipée, en un goujat de dix-huit ans condamné par la Cour d’assises, puis libéré en vertu du droit régalien. Si la photographie très ressemblante de cet échappé de centrale, une de celles auxquelles Paridael revenait obstinément, l’avait déconcerté par la candeur presque séraphique des traits, combien plus inoffensif et plus avenant encore lui apparut le cachotier en chair et en os ! Rien de sinistre ou même de suspect dans l’enseigne de cette âme. Un petit paysan, rose et propret, charnu, la taille dégagée, de grands yeux bleus, pâles et limpides, les joues légèrement duvetées, le nez assez gros, les narines relevées, la bouche mutine, des cheveux blonds, fins et plats, régulièrement séparés par une raie sur le côté – une mèche rebelle, un épi se hérissant au-dessus de l’oreille ; – habillé d’une veste et d’une culotte de velvétine roussâtre à côtes, de sabots de vacher, un foulard rouge, noué comme une corde, autour du cou : la dégaîne d’un enfant de chœur surpris à voler des pommes.
Laurent lui payait chope et se faisait raconter les stades du crime, savourant le contraste entre la scabreuse aventure et l’air ingénu du ravisseur. Cette voix douce et dolente de pénitent au confessionnal, lui faisait venir, à certains moments, la chair de poule. Le curieux bonhomme entrait sans une angoisse, sans un rétrécissement de la gorge, dans les détails les plus croustilleux, comme s’il récitait une autre complainte que la sienne, et concluait ainsi :
« Le plus étrange c’est que la partie étant jouée, nous n’osions plus nous quitter, les camarades et moi. Et cependant leur voix me faisait mal… Willeki ayant proposé de retourner, là-bas, achever la malheureuse pour lui clore à jamais le bec, je m’escampai à toutes jambes… Un chien hurlait à la mort : « C’est le spits de Lamme Taplaar » me disais-je à moi-même… Au loin, entre les arbres, et par-dessus la plaine, le gaz de la ville dessinait un immense dôme d’église lumineuse dans le ciel noir. Et cette pensée de la ville trop proche ne suscitait en moi aucune peur des gendarmes. Il tombait une pluie fine. J’avais la tête en feu, mes tempes battaient ; je gardais dans les narines, dans mes frusques, j’emportais au bout des doigts une odeur de carne et de boucherie qui m’écœurait comme le fumet de la mangeaille après une ventrée. Je dormis très bien cette nuit, en rêvant de la grande église blanche dans le ciel…[22] »
Les hasards de la naissance, de l’éducation et du costume autant que les inconséquences de la nature, offraient à Paridael des comparaisons de décourageante philosophie.
Devant une bâtisse il s’indignait en voyant de plastiques et décoratifs adolescents s’éreinter, se déhancher, se déjeter, à faire office de plâtriers et d’aide-maçons pour ériger un palais à quelque suffète podagre. Le propriétaire conférait flegmatiquement avec l’architecte ou l’entrepreneur obséquieux, sans accorder la moindre attention à ces manœuvres qui s’arc-boutaient, ahanaient et tiraient la langue sous la charge. Mais autant le richard suait la morgue, bête et empotée, se montrait grotesque et vulgaire, autant ces artisans, même foulés et strapassés, déployaient de naturel et de vaillance, se moulaient bien dans leurs hardes grossières et dégageaient de fluide affectif.
Et Laurent se représentait le valet de maçon élevé à la façon des riches, vêtu en masher ou en swell anglais, entraîné aux saines et eurythmiques fatigues du sport ; et la supériorité du rustaud ainsi transformé sur les jeunes Saint-Fardier et les gringalets de leur anémique et friable entourage. Souvent la fantaisie lui prit de vider sa bourse entre les mains d’un apprenti et de lui dire : « Imbécile, vis, ménage tes forces, entretiens ta jeunesse, préserve ta belle mine, paresse, rêve, aime, abandonne-toi ! »
Dès son enfance, chez les Dobouziez, il réprouvait les arts insalubres, les travaux trop durs et trop exclusifs, les manœuvres ne mettant en action qu’un seul côté du corps, les opérations exigeant un invariable coup de rein ou d’épaule, l’effort implacablement réclamé des mêmes agents musculaires. Il maudissait les ateliers créateurs de monstres, usines, hauts–fourneaux, charbonnages, où se déflorent, s’effeuillent et se dégradent les jeunes pousses humaines. Et il entretenait des utopies, rêvait un renouveau franchement païen où refleurirait, libre et absolu, le culte du nu, l’adoration des formes ressenties et des chairs dévoilées. Que ne pouvait-il s’entourer d’affranchis du travail, d’une cour de plastiques figures humaines ! Au lieu de statues et de tableaux il eût collectionné ou plutôt sélectionné des chefs-d’œuvre vivants. Et dans son enthousiasme pour la beauté physique il blasphémait cette parole de la Genèse : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Ladrerie morale et difformité corporelle n’avaient pas d’autre origine. La loi de Darwin confirmait celle de Jéhovah.
Puis, par une étrange contradiction, il convenait du charme impérieux et tragique de ce temps. Les contemporains offraient une beauté caractériste et psychique, sinon aussi régulière infiniment plus pittoresque et même plus sculpturale que celle des générations révolues. Il conciliait alors les deux genres de beautés, associait le nu du passé et le costume du présent, modernisait l’antique, créait des Antinoüs en tricot de chaloupier, des Vénus nippées comme des cigarières, des Bacchantes en trieuses de café et en balayeuses, des Hercule en garçons bouchers et en forts de la minque. Mercure s’incarnait dans un runner aux reins cambrés et aux mollets fuselés comme ceux du bronze de Jean de Bologne ; Apollon endossait l’uniforme du cavalier ; Bacchus tireur de vin se doublait d’un incorrigible buffeteur. Une équipe de terrassiers évoluant parmi les étrésillons, une coterie de paveurs, coudés et rebondis, au-dessus d’une bordure de route, lui rappelaient des théories de discoboles s’exerçant dans la palestre, et depuis son retour aux rives de l’Escaut, il ne se figurait point bas-relief d’une orchestique supérieure au mouvement d’une brigade des « Nations ».
Dimanches et lundis Paridael dansait, jusqu’à l’aube, dans les bastringues des faubourgs dramatisés par les frottées entre blouses et uniformes, ou dans les musicos du quartier des bateliers où se trémoussaient les runners et gens de mer.
Et quelles danses alors ! Quelles loures, quelles bourrées, quels hornpipes vertigineux accompagnés d’un triangle, d’une clarinette et d’un accordéon ! La crapule éjouie de ces égrillards aux contorsions figurées, aux soubresauts trides, aux déhanchements balourds, aux énervants et galvaniques tricotages des jarrets et des talons.
Une crevasse dans le soufflet de l’accordéon détermine une lamentable fuite de mélodie et, à chaque appel de la note perforée, le son s’échappe avec un couac de moribond…
À la pause, entre deux reprises, tandis que les couples se promènent et acquittent, dans la main du « tenancier », leur redevance pour ces toupillements, l’arrosoir d’un garçon de salle abat la poussière en dessinant des festons humides sur le plancher.
Puis les clarinettes repartent, les danseurs appellent du pied, et souliers et sabots se remettent à trépigner.
Des barboteuses cinquantenaires, les pommettes allumées, daignent fringuer avec des apprentis-calfats luisants de courée et de galipot, la culotte enfoncée dans leurs bas, qui se frottent goulûment à ces opulentes matrones décolletées et vêtues de percaline et de satin d’Écosse.
Dans la galerie du pourtour, les marsouins en belle humeur, les mousses émerillonnés, les pêcheurs fleurant le brome et le fiel de poisson, s’attablent, pintent, et font boire à leur verre les femmes qui circulent, et les attirent à eux, et les calent sur leurs cuisses, despotiquement.
Les gens de mer se rencontrent avec les bateliers, les patrons de beurts et leurs « garçons de cahute », moins basanés, moins gercés, plus roses, plus poupards, les oreilles écartées de la tête et percées de bélières d’argent.
Dans le tourbillon de la poussière, des halenées, des sueurs et des tabacs âcres et noirs comme la tourbe, les formes des danseurs sombrent ou émergent par fragments. Casquettes, bérets, suroîts ou zuidwesters goudronnés, chignons à boucles, affleurent à la surface du lourd nuage. À la faveur d’une éclaircie, lorsque l’entrée ou la sortie d’un couple ventile momentanément la place, on perçoit aussi les jerseys bleus bridant comme des maillots, des vareuses à large collet, des tailles décolletées et mamelues, des culottes collantes, un moutonnement de croupes et de fesses, un ballonnement de jupes courtes, de grandes bottes de pêche, des bas bien tendus montrant entre les mailles assez lâches le rosé d’un mollet plus ou moins ferme. C’est un carambolage de têtes rapprochées ; les lèvres claquent, appétées ; les yeux s’amorcent de câlines irradiations ; il y a des sourires de langueur, des rires chatouillés, des accolades initiales, de magnétiques flexions de genoux, des spasmes mal réprimés…
Le lendemain de ces sauteries féroces, Paridael, avide d’air respirable, rejoignait au Doel la tribu de ses camarades, les écumeurs de rivière.
La quarantaine fonctionne au Doel. Le canot du service accoste tous les navires remontant l’Escaut, le docteur prend connaissance des papiers du bord et des lettres de santé, et les bâtiments arrivant d’Orient ou d’Espagne, où le choléra règne à la façon d’un roi du Dahomey, sont forcés de larguer et de s’arrêter ici durant huit jours, à hauteur de l’ancien fort Frédéric.
Déjà cinq vapeurs stationnent immobiles, comme de mornes Léviathans, les feux éteints, la vapeur renversée, la cheminée dépouillée de son long panache de fumée. Ils arborent le sinistre pavillon jaune, qui les retranche provisoirement du monde social, et le seul qui tienne à distance jusqu’aux runners, si difficiles à épouvanter pourtant.
Mais ce n’est que partie remise, et il suffira que les navires infectés ou seulement en observation purgent la quarantaine et ramènent le drapeau soufré pour que la nuée des sinjoors qui les guette avidement, comme un chat guigne, de loin, un oiselet auquel il ne peut mettre la patte, et rendus encore plus âpres à la curée par ce long ajournement, s’abattent sur eux, avec l’inéluctable arbitraire d’un nouveau fléau.
D’ici là, pour se tenir en haleine les runners jetteront leur dévolu sur le Dolphin, un grand trois-mâts australien arrivant des Indes hollandaises et de l’Indo-Chine. Un bateau-pilote profitant de la marée haute, le remorque depuis Flessingue vers Anvers et il passera devant le Doel à trois heures de l’après-midi.
En attendant que les mâts du vaisseau promis pointent, du côté de Bats, par-dessus les Polders, nos ruffians se répandent sur la digue herbeuse derrière laquelle se tasse en contre-bas, le placide village qu’ils terrorisent pareils à une descente de Normands en l’an mille.
Leur présence au Doel prête un charme malsain de plus à l’atmosphère de lazaret planant depuis un mois autour de ce nid de crânes bateliers à l’épreuve de toute épidémie. Ô le cimetière de pêcheurs et de naufragés où l’on enfouit récemment quatre cholériques !
Les doyens de la rapace confrérie, les routiers, des gaillards pileux, terribles, aquilins, se mêlent à leurs dignes apprentis. Sous la large visière de leur casquette ceux-ci représentent des têtes bretaudées, ou crépues, polissonnes, étrangement avenantes mais vicieuses, déflorées par les coups de garcette et la crapule. Transfuges de marins, pseudo-navigateurs, quelques-uns mal remis des excès d’une nuit blanche, roupillent, croupe en l’air, les mains jointes dans la nuque. D’autres couchés sur le ventre, redressés à mi-corps sur les coudes, le menton dans les paumes : position de sphinx aposté ou de vigie malfaisante.
Cillant et clignant de l’œil, ils conjurent l’horizon et semblent fasciner jusqu’à les immobiliser les steamers pavoisés de jaune.
Parfois, pour tromper leur impatience, les runners se remettent sur leurs pieds, bâillent, s’étirent, ploient et écartent les jambes, esquissent lentement et comme à regret des feintes de lutteur, traînent quelques pas, puis se rafalent et retombent peu à peu dans leur immobilité expectante.
Il y en a de remuants et de turbulents, qui, semblables aux guêpes, taquinent et assaillent les dormeurs, ou qui barbotent, pieds nus, dans la vase et en sortent chaussés d’un noir cothurne.
Mais l’une des vedettes signale le voilier ! Trêve de paresse et de baguenaude ! À la vue de leur proie, ne songeant plus qu’à la curée, ils enjambent les dormeurs, dévalent vers la petite crique où sont garées leurs pirogues, embarquent leurs appeaux et leurs provisions, ramassent les avirons et se mettent en devoir de démarrer. Opération critique, car la passe est étroite, les embarcations se touchent et dans son égoïsme ombrageux chacun voudrait partir avant les autres. Tous s’ébranlent, se démènent à la fois, aucun ne prétend céder le pas à son voisin, au concurrent.
De là des criailleries, des invectives et des bousculades. Pour arriver beau premier le runner coulerait sans vergogne non seulement le canot du camarade, mais le camarade lui-même. D’ailleurs, il n’y a plus de camaraderie qui tienne, l’instinct du lucre reprend le dessus ; et les complices qui piquaient tout à l’heure au même plat et buvaient à la même bouteille, se dévisagent à présent d’un air torve, prêts à s’entre-déchiqueter.
Mais, profitant de ce chamaillis qui menace de tourner en un engagement naval, voilà qu’un canot, puis un second, puis un autre encore, montés par des gaillards plus avisés, se sont doucement coulés entre les antagonistes et, narquois, boutent allègrement au large.
À cette vue, les querelleurs suspendent les hostilités et le gros de la flottille se détache de la rive.
Les retardataires nagent à toutes rames, silencieux, remplis d’angoisse, dévorant leur haine envieuse, résolus à l’emporter coûte que coûte sur leurs compétiteurs, ruminant chape-chute et coups de Jarnac. Ils manœuvrent si bien qu’ils rejoignent leurs avant-coureurs.
Et à présent ils marchent de conserve, une force égale, une même énergie, semble les animer ; aucune équipe ne gagnera notablement sur la masse. Leur respiration haletante s’accorde avec le rythme de leur nage ; ils se penchent et se renversent spasmodiquement, les tolets gémissent à chaque coup d’aviron, et l’eau dégouttant des palettes promène à travers la nappe glauque un ruissellement d’escarboucles.
Du bâtiment, point de mire de cette passionnante régate, on a vu s’avancer leur flottille, qui semblait de loin, tant elle se tient compacte et serrée, un banc de poissons migrateurs. Le monde se presse sur le pont. Le capitaine et son équipage suspectent et flairent en ces rameurs endiablés les émissaires des mercantis et des pourvoyeurs du port.
Le chef, qui n’en est pas à sa première rencontre avec ces landsharks, ces requins d’eau douce, change de couleur et se met à sacrer comme un diable. Les matelots, eux, quoique ayant ample sujet de rancune contre cette race, affectent bien quelque humeur, mais ne grommellent que du bout des lèvres ; ils rient plutôt sous cape et s’émoustillent à l’idée des plaisirs usurairement payés mais si copieux et si intenses que leur procureront ces entremetteurs.
À une encablure du vaisseau, les canotiers de la tête hèlent le capitaine, un Anglais congestionné qui accueille leurs ouvertures par une recrudescence d’imprécations et les menace même, s’ils ne décampent au plus vite, de les canarder comme une compagnie de halbrans. Mais les runners, incomparables louvoyeurs, possèdent leur code maritime. Ils en tournent aussi adroitement les pénalités qu’ils esquivent les rapides et les hauts-fonds de l’Escaut. Pures rodomontades que les sommations de l’Anglais ! Il se garderait bien de s’attirer une vilaine affaire. Aucune loi belge ne l’arme contre l’investissement de son navire par les commis de victuaillers.
Aussi, forts de la connivence légale, les sacripants affectent d’autant plus de pateline conciliation, que le rageur leur lance, à défaut d’autre mitraille, les plus gros projectiles de son arsenal de gueulées. Les damned son of a whore ! alternent avec les bloody son of a bitch !
Sur ces entrefaites, les autres équipes, lâchant les rames pour se servir de harpons, s’accrochent à l’arrière, grimpent le long des œuvres mortes, jouent des pieds et des mains, et foulent le pont avant que le capitaine ne soit arrivé à bout de son chapelet d’imprécations.
L’équipage n’exécute plus ou n’écoute que mollement les voix. À dire vrai les matelots pactisent avec les envahisseurs. L’approche du port amollit ces grands gaillards, la discipline se relâche ; ils sont puérils et distraits comme des collégiens à la veille des vacances. Depuis les bouches de l’Escaut, dans le vent moins âpre qui souffle de la terre, ces internés hument le bouquet des libertés prochaines et reniflent bruyamment, les effluves des haras hospitaliers.
Loin d’en vouloir à ces nautoniers cauteleux qui ne se jettent à leur cou que pour les écorcher de nouveau en exploitant leurs fringales et leurs pléthores, ces bonnes pâtes les accueillent comme les annonciateurs des prochaines bâfrées et des imminentes débondes.
Pas moins de trente canots, chacun monté par deux ou trois runners, adhèrent à la carcasse du Dolphin avec l’inéluctable opiniâtreté des pieuvres. Tandis que les matelots organisant un simulacre de résistance, refoulent mollement l’invasion à bâbord, on les déborde à tribord. Repoussés de la poupe, les pendards se jettent à la proue ou, se portant à la fois sur un seul point, ils se font la courte échelle. L’un grimpe sur les épaules ou s’assied sur la tête d’un gaillard qui pèse de tout son poids sur les omoplates d’un troisième. Le dernier arrivé supporte à son tour la charge d’un autre compère sur lequel viendra s’en jucher un cinquième, et ainsi de suite. Les patients du dessous geignent, soufflent, renâclent, demandent qu’on se dépêche, n’en peuvent plus, ceux du dessus s’esclaffent et batifolent ; les talons menacent de défoncer les mâchoires, les mains se cramponnent aux tignasses, les nippes se déchirent avec un craquement, les croupes offusquent et éborgnent les visages, et ainsi agglutinés, culbutés les uns sur les autres, ils rappellent ces francs lurons de kermesse, qui s’échafaudent et se superposent jusqu’à ce que le plus haut perché puisse décrocher au profit de tous, les prix d’un inaccessible mât de cocagne. À chaque oscillation du navire qui continue de filer son nœud, cette pyramide humaine menace de s’écrouler dans le fleuve ; le frêle batelet sur lequel repose tout l’édifice, risque vingt fois de chavirer avec sa cargaison.
La témérité des runners confond le capitaine lui-même et son mépris pour cette racaille se transforme en l’admiration indicible que tout Anglo-Saxon éprouve pour les casse-cou.
Courage ! une poussée encore et les voilà maîtres de la place !
Après l’abordage il s’agit de lotir le butin. Partage délicat, car pour vingt à trente chrétiens montant le navire, on compte près d’une centaine de rapaces. Harcelé, tiré à quatre, interpellé dans toutes les langues et de tous les côtés à la fois, le matelot ne sait auquel entendre. Le pont revêt l’aspect d’une Bourse de commerce. De groupe à groupe se débat la valeur représentée par chaque tête de l’équipage. Les vétérans intimident les faibles et les novices ; les politiques s’efforcent d’évincer les béjaunes. Quelques runners lâchent pied. Mais la plupart se le disputant en vigueur et en astuce, les conférences s’animent et tournent en colloques. On montre les dents, des poings se ferment, renards redeviennent loups. Les altercations du rivage se renouvellent ; envenimées par l’ajournement, cette fois les querelles se videront pour de bon. Il suffira d’un corps à corps isolé pour amener une bagarre générale. Ils se daubent, se prennent à la gorge, se terrassent, s’agrippent comme des dogues, jouent de la griffe et même du croc, et s’ils craignent le dessous recourent aux feintes déloyales, aux coups félons.
Les marins se gardent bien d’intervenir dans ces passes d’armes dont ils représentent l’enjeu. D’ailleurs, eux-mêmes ont la tête trop près du bonnet pour contrarier ces règlements de compte. Ils font cercle, passifs, affriolés, jugeant des coups. Leurs dépouilles appartiendront aux vainqueurs. Ces convoitises féroces déchaînées chez les mercantis, flattent peut-être les grands enfants prodigues, résolus à fondre jusqu’à leur dernier jaunet dans n’importe quelle fournaise. Un œil poché, une lèvre fendue, une dent déchaussée, quelques contusions et quelques estafilades décident de la victoire. Terrassés, le genou du vainqueur pesant sur leur poitrine, beaucoup se rendent avant d’avoir été mis hors de combat. Ils regagnent piteusement leurs barques et battent en retraite vers le Doel, à moins que, de loin, ils ne s’obstinent à escorter le Dolphin et à poursuivre de huées leurs heureux compétiteurs.
À présent, ceux-ci s’amadouent, rentrent les griffes, étanchent le sang de leurs égratignures, réparent les ruines et les brèches de leur accoutrement, et sous le boucanier, héroïque à ses heures, reparaît le trafiquant sordide, le roué de comptoir.
Ils se rabattent sur les matelots comme, après une bataille décisive entre deux fourmilières, les triomphateurs s’empressent d’emporter et de traire les gros pucerons des vaincus.
Paniers de victuailles, rouleaux de tabac, caisses de cigares, tablettes de cavendish, et surtout tonnelets de liquide, bières, gins, whiskeys, tisanes gazeuses jouant le champagne, bordeaux plus ou moins frelatés ou alcoolisés, pimentés à emporter la mâchoire d’un bœuf, émergent, surgissent, comme par enchantement, des mystérieuses cachettes où les avaient dissimulés les belligérants. Le champ de bataille se résout en un champ de foire et le carnage en un bivac. Les bouchons sautent, les bondes perforent les tonnelets. Robinets de tourner, pintes et verres de se remplir, et les marins de répondre aux avances des insinuants capteurs. Les débagouleurs se font chattemiteux et presque mignards.
Les officiers se contentent de veiller à l’exécution des manœuvres indispensables et pour plus de sûreté mettent eux-mêmes la main à la besogne. Et graduellement l’ambiante langueur les gagne :
– Oh ! se déprendre au plus vite du morne et rigide devoir, dépouiller le sacerdoce avec l’uniforme, s’humaniser ; oui, même s’animaliser… En attendant, pourquoi ne pas tâter des rafraîchissements que ces gueux nous apportent ! Voilà trois semaines que, sous prétexte de brandy, le steward ne nous sert plus que de la ripopée et l’estomac répugne au biscuit de mer, aux conserves et aux salaisons.
Ainsi monologuent les officiers en arpentant le pont. L’austère capitaine lui-même se sent plus faible et plus indulgent que de coutume.
Un runner devine ce trouble, car il s’approche du commandant et, avec un geste câlin, en lui versant une rasade de mixture mousseuse : « Un verre de champagne, mon capitaine ! ». Le capitaine dévisage l’effronté, prêt à lui tirer les oreilles, mais le juron courroucé expire entre les poils de sa moustache grise, il ébauche à peine un rictus sourcilleux, et, tantalisé, accepte le verre, le siffle d’un trait, claque des lèvres et le tend au jeune échanson, non pour le rendre mais bien pour qu’il le lui remplisse.
Ce drôle dégourdi qui vient de l’induire si victorieusement en tentation ne laisse pas d’intriguer le capitaine, presbytérien rigide et quelque peu puritain. Il a la taille d’un jeune mousse, la mine d’une fillette, et pourtant la hanche plus fournie et les reins plus cambrés, plus modelés, que les autres lurons de sa volée. Comme la plupart de ses pareils, celui-ci porte un déguisement d’aspirant de marine. « Où diable cette confrérie de fieffés bandits a-t-elle déniché d’aussi gentilles recrues ? » marronne le respectable capitaine, et, plus sollicité qu’il ne se l’avoue par l’expression agaçante de l’échanson, il s’éloigne en maugréant, lorsque le soi-disant runner lui jette les bras autour du cou et lui révèle son double travestissement.
– Damnation ! clame le commandant, en voyant mille lucioles, c’est qu’ils finiront par nous amener tout leur sacré b…
– À vos ordres mon capitaine !
Et railleusement, elle lui désigne les lieutenants lutinés par des runners auprès de qui ces officiers, bons connaisseurs, ne tardent pas à partager l’agréable méprise de leur commandant.
Cependant, la présence de ces femmes à bord, active et irrite l’appétence des matelots et leur fait paraître séculaire la demi-heure qui les sépare des quais anversois. Et l’ivresse aidant, nos simples suspectent encore d’autres supercheries et menacent de confondre avec les quatre midship-women, les polissons imberbes, qui les accablent de chatteries. Pourquoi ceux-là aussi ne seraient-ils pas des nonnains d’un couvent de joie ? Illusion d’autant plus plausible, que dans ce monde équivoque, les filles corrodent leur gentillesse et leur amabilité natives, à la forfanterie, à l’abord rogue et à la parole enrouée des pilotins en rupture de hune, tout comme les mousses de cette marine de ribleurs recourent pour duper les matelots réguliers à des effusions et à des jolivetés quasi féminines. Si l’orgie et la traversée se prolongeaient de scabreux quiproquos résulteraient des obsessions du runner et de l’abrutissement du marin.
Le Dolphin entre en rade.
À un dernier méandre du fleuve, le panorama d’Anvers s’étale dans sa majestueuse et grandiose splendeur. Sur une longueur de plus d’une lieue, la ville présente aux regards des arrivants un front imposant de hangars, de halles, de monuments, de tours et de clochetons, que domine la flèche de Notre-Dame. Ce phare de bon conseil prémunit les voyageurs contre les embûches et les dédales de perdition qui s’enroulent au pied de la cathédrale, comme le serpent se repliait à l’ombre de l’arbre de vie. Le crépuscule rosit le monument admirable, flamboie dans les dentelles de la pierre, et, en même temps qu’à sa nichée de corneilles le beffroi donne la volée aux notes de son carillon…
Mais le marin du Dolphin ne lève plus les yeux à cette hauteur et n’entend même plus la voix des cloches vespérales. Pourquoi, la flèche altière ne s’apercevait-elle pas des bouches de l’Escaut et le bourdon si sonore n’a-t-il pas résonné jusqu’au Doel ? Les émissaires du diable prirent les devants sur les messagers des cieux. Même lorsqu’il se trouve en présence de ces bons génies, il n’aura d’oreilles que pour les boniments des courtiers et de regards que pour les ruelles obliques dont les fenêtres rougeoient comme des fanaux de malheur.
Aussi dès que le matelot met pied à terre, les runners l’acheminent sans peine vers les dispensaires clandestins où le publicain s’associe à la prostituée pour le détenir et pour le gruger. Celle-ci s’attaque à ses moelles ; celui-là le soulage de son vaillant. La fille va l’énerver ; puis le procureur le plumera sans résistance.
Afin de le livrer pieds et poings liés à leur maître, les runners lui avancent une partie de son gage et le déterminent ensuite à confier à ses hôtes la poignée d’or amassée au prix d’un travail pénible comme un supplice. Désormais, il ne s’appartient plus.
Il ne s’arrache des bras de la gouine que pour ivrogner avec le ruffian.
On l’empêtre de toutes sortes d’emplettes de pacotille qu’on lui endosse à des prix exorbitants. Il paie dix et vingt fois leur valeur, pour en faire présent à son entourage, à ceux-là même qui viennent de les lui coller, des flacons d’outrageuses essences, des basses parfumeries, des colifichets criards, des miroirs en écaille, de la coutellerie anglaise, des bagues en similor, du clinquant, des rassades avec lesquelles les civilisateurs ne parviendraient même plus à éblouir les Cafres et les Sioux. Jamais il ne sort seul, jamais il ne franchit les confins de la région excentrique.
Le long du jour il s’accoude au comptoir de la salle commune. Les parois se tapissent de pancartes : matous de l’Old Tom Gin, triangles rouges du pale-ale, bruns losanges du stout. Les chromolithographies sentimentales des Christmas Numbers alternent avec les épilepsies des Police News, de même que, sur le dressoir, les sirops et les élixirs à goût de pommade voisinent avec les alcools corrosifs.
Pour obtenir le droit de contempler perpétuellement la créature dévolue à ses tendresses, il ingurgite tous les poisons de l’étalage. Peu à peu, sous l’influence de ses libations, elle lui semble revêtir l’apparence d’une madone trônant sur un reposoir, les bouffées de la pipe embaument l’encens, le dressoir joue le retable, les liqueurs composent des sujets de vitrail, et les oraisons jaculatoires ne dégagent pas la ferveur des discours qu’il tient à cette drôlesse. Alors, un rire moqueur lui rend le sentiment de l’endroit où il se trouve et de la déesse qu’il invoque.
Si son ivresse tourne exceptionnellement en frénésie, s’il tapage et se démène un brin, ces accès ne durent qu’un moment.
La gaupe est même chargée de les provoquer par sa coquetterie, car non seulement on porte largement la casse en compte au jaloux, mais afin de se faire pardonner ses incartades, celui-ci ne se montre que plus coulant, que plus malléable. Pour reconquérir sa boudeuse maîtresse il n’est pas de folie qu’il ne commette, de dispendieuse fantaisie à laquelle il ne se livre.
Chaque matin le dépositaire lui remet un louis sur son capital et chaque soir le flambard a consciencieusement dépensé cet argent mignon. Il paie recta, comme s’il possédait la pistole volante ou la bourse de Fortunatus.
Aussi, son ébahissement, le jour où le publicain lui présente un mémoire établissant qu’il doit à son hôte près du double de ce qu’il croyait posséder encore. Cette fois le pigeon se regimbe et va cogner pour de bon, mais en prévision du grabuge le logeur a stipendié ses satellites ordinaires qui maîtrisent le récalcitrant. On le menace aussi de la police maritime, mystérieuse juridiction inconnue de ce simple et qu’il s’imagine draconienne comme un Saint-Office. Un énorme abattement succède à ses velléités de révolte. Plutôt que d’aller en prison il engagera sa carcasse.
Ici commence la phase la plus douloureuse de la traite du matelot :
Le juif de Venise ne prenait au débiteur insolvable qu’une livre de sa chair, les Shylocks anversois dépècent et charcutent moralement le mauvais payeur en l’impliquant dans une série de forfaitures : ils le contraignent de déserter, lui procurent un nouveau contrat de louage, font main basse sur l’avance qu’on lui paie ; le forcent de signer un deuxième engagement, raflent une deuxième fois la prime ; l’embauchent de nouveau, retournent de nouveau ses poches, et répètent ce jeu jusqu’à ce que l’autorité consulaire s’émeuve et se prépare à sévir.
Ils l’ont exprimé comme une orange. À les en croire il ne leur aurait pas encore rendu ce qu’il leur doit. Mais il devient compromettant, il s’agit de s’en défaire. C’est seulement de crainte qu’il ne parle et ne les fasse pincer avec lui que les trafiquants le recèlent dans un taudion en dehors des fortifications.
Enfin, ils brocantent une dernière fois la pauvre marchandise humaine tant grevée, à un capitaine peu scrupuleux et, par une nuit ténébreuse, le runner, toujours prêt aux missions risquées, le même runner qui l’enivrait et le cajolait sur le Dolphin, charge le contumax sur une allège, dissimulée en aval du port, et le conduit clandestinement à bord de l’interlope.
À peine retourné à son élément, à son rude labeur, le matelot ne pense plus aux vicissitudes du dernier mouillage. Le souvenir des récentes abjections se fond au souffle rédempteur du large.
Si bien qu’après des circumnavigations prolongées, le pauvre diable tout prêt à recommencer sa désastreuse expérience, s’adonnera corps et âme, aux mauvais messies des rives de l’Escaut.
En somme, il n’y a encore que ces pressureurs pour lui offrir les délassements absolus !
Aux escales des antipodes sous ces climats véhéments, dans ces terres de feu peuplées d’êtres à pulpe citronneuse, de femmes reptiliennes et d’hommes efféminés, auprès de ces populations jaunes et félines comme leurs fièvres, les Européens refoulent leurs postulations charnelles, ou ne se prêtent au soulagement qu’avec la répugnance d’un apoplectique qui se fait tirer une palette de sang.
Ou bien ils affrontent le lupanar comme un danger, en se montant le coup, avec des allures de bravache, et, pressés d’en finir, mènent les débauches féroces à travers les fumées de l’opium. Une flore capiteuse et entêtante, les épices, les venins et l’incandescence de l’atmosphère les fouettent, les emballent, et les précipitent tout d’un bloc vers des voluptés cuisantes suivies de stupeurs et de remords…
Âmes enfantines et mystiques ne goûtant pas le plaisir sans une sourdine d’intimité et de ferveur, ils associent à leurs nostalgies amoureuses les doux météores, les fraîches nuaisons des mers germaniques : la température lénifiante des côtes occidentales, les brises viriles et réconfortantes, même la cordialité bourrue des grains et la brusquerie des sautes de vent succédant à l’énervante caresse alizéenne ; le sourire discret et attendri du septentrion, les harmonieux rideaux de nuages tirés enfin sur le rayonnement implacable, et surtout le baiser quasi lustral du premier brouillard…
En revanche, ils se reprochent leur commerce avec les païennes comme un rite sacrilège.
Et jamais ils ne se reporteront à ces attentats sans que surgisse aussi le cauchemar des tourmentes de typhons et de cyclones durant lesquelles d’occultes prêtresses de Sivah, avec des sifflements et des torsions de tarasques, ne semblent pomper l’huile bouillante de la mer que pour y substituer les laves telluriennes et les métaux en fusion du firmament…
VI. CARNAVAL
Le cousinage de Laurent Paridael avec les couches dangereuses ou indigentes de la population, n'allait évidemment pas sans une prodigalité effrénée. On aurait dit que pour mieux ressembler à ses entours, il lui tardait de se trouver sans sous ni maille. Le vague dégoût mêlé de terreur qu'il conçut pour l'argent le jour même de sa majorité, à peine était-il entré en possession de son pécule, n'avait fait qu'augmenter depuis son explication avec les Tilbak.
Comme à 1' « Or du Rhin » dans la tétralogie wagnérienne, il attribuait au capital une vertu maligne et lénifère, cause de toutes les calamités humaines, et il rapportait aussi ses afflictions personnelles. N'était-ce pas l'argent qui le séparait à la fois de Régina et d'Henriette ? Cet argent qui n'avait même pu lui rendre le grand service de retenir à Anvers ses chers amis de la Noix de Coco !
Cependant, du train dont il maltraitait son avoir, il en aurait raison en moins d'une année.
Après le départ des émigrants et sa brouille avec Bergmans, aucun contrôle, aucune exhortation ne l'arrêtait plus. Il éprouvait de la volupté à se défaire de ces écus abhorrés, à les rouler dans la boue ou à les répandre dans les milieux faméliques où ils consentent rarement à briller. Il affichait autant de mépris pour ce levier du monde moderne que les négociants lui vouaient de respect et d'idolâtrie.
Il inventait force extravagances afin de scandaliser une bourgeoisie essentiellement timorée et pudibonde, au point que sa dissipation ostensible outrageait comme un sacrilège et un blasphème les thésauriseurs et même tous les gens d'ordre. On lui eût pardonné ses autres travers, son encanaillement à vif et à cru, sa lutte ouverte contre la société, mais ses grugeries féroces lui méritèrent l'anathème des esprits les plus tolérants.
Ne s'avisait-il, pas en plein jour, ayant trop bien déjeuné, de s'engager, avec ses convives peu accointables, le créat et le piqueur d'un manège en faillite non moins éméchés que lui, par les rues les plus passantes afin de croiser les gens d'affaires se rendant à la Bourse ! Par surcroît de provocation, à quelques pas devant l'édifiant trio, marchait le chasseur du restaurant, portant dans chaque bras, en guise d'enseigne et de bannière, une bouteille du meilleur Champagne. En cet appareil les trois noceurs entreprenaient l'ascension de la Haute tour, et, parvenus à la dernière galerie, au-dessus du carillon et de la chambre des cloches, sifflaient glorieusement le vin mousseux et lançaient ensuite les flacons sur la place au risque de lapider les cochers des fiacres stationnant au pied du monument.
C'était aussi des tournées d'alcool payées à tous les débardeurs desservant un quai. De faction au comptoir du liquoriste, Paridael empêchait celui-ci d'accepter la quincaille des consommateurs, au fur et à mesure qu'ils s'amenaient à la file, par coteries entières, s'avertissant l'un l'autre de l'aubaine qui les attendait au bon coin.
Et maintes fois des bordées interminables tirées avec des équipages au long cours ou des compagnies de troupiers, des gobelotages de bouge en bouge, des pèlerinages aux sanctuaires d'amour, le tout accidenté de batteries et de démêlés avec la police.
Mais on découvrait un mobile généreux au fond de ses plus grands excès : besoin d'expansion, protection des faibles, charité déguisée, compassion sans limites, bonheur de procurer quelque douceur et quelques bons moments à des infimes. Il semblait, qu'en se livrant à un carnage aussi fantastique de louis et de banknotes, le bourreau d'argent voulût mettre plus à l’aise les gueux qu'il obligeait et légitimer leur éventuel manque de mémoire. En cotant si bas ce qu'il éparpillait autour de lui, il tenait les donataires quittes de toute reconnaissance. Aux pauvres diables qui se confondaient en remerciements : « Prenez toujours, disait-il… Empochez-moi cela et trêve de bénédictions… Autant vous qu'un autre… Il ne me serait tout de même rien resté de cet argent ce soir ! »
Ses charités paraissaient intempestives et désordonnées comme des fugues et des frasques. Non seulement il avait protégé la fuite et la désertion d'un disciplinaire, mais il racheta plusieurs matelots à leurs vampires, rapatria des émigrants, hébergea des repris de justice.
Tout un hiver, un hiver terrible, durant lequel l'Escaut fût bâclé par les glaçons, il visita les ménages des journaliers et des manœuvres. Il se donnait pour un anonyme délégué des bureaux de bienfaisance, vidait ses poches sur un coin de meuble ou de cheminée et avant que les crève-la-faim eussent eu le temps de vérifier l'importance du secours, il s'éclipsait, dégringolait les escaliers comme s'il eût dévalisé et pillé ces paupériens.
Il n'oublia jamais, entre autres escales de son périple de miséricorde, cette mansarde où vagissaient une portée d'enfançons d'un à cinq ans, dans une caisse matelassée de copeaux, litière trop fétide pour un clapier. Il semblait, à entendre leurs plaintes, à voir leurs convulsions, que la faim même se penchât au-dessus d'eux et que ses ongles, fouillant leur décharnure, les écorchât comme le râteau d'une âpre glaneuse râcle les guérets surmoissonnés.
Acculé dans un coin, à l'autre bout du galetas, le plus loin possible de leur agonie, le père, le veuf, un musclé et râblé portefaix des Bassins, dont la disette n'était point parvenue encore à fondre la chair, à tarir le sang et la sève, ruminait sans doute la destruction prompte et violente de sa force inutile.
D'un rugissement suprême, d'un geste fulgurant qui ne souffrait pas de réplique, le malheureux enjoignit à l'intrus de le débarrasser de sa présence, mais les giries de plus en plus pitoyables des petits étaient bien autrement impérieuses que l'attitude comminatoire du père, et stimulé, presque sûr d'être occis, mais ne voulant pas survivre à ces innocents, Laurent marcha vers le désespéré et lui tendit une pièce de vingt francs.
Elle était plus aveuglante que le soleil, car le colosse ne put en supporter l'éclat et se détourna vers le mur, à la façon d'un enfant honteux et boudeur, en portant la main à ses yeux picotés jusqu'aux larmes ! Elle était donc si pesante que, Laurent l'ayant glissée dans son autre main, les doigts formidables la laissèrent échapper !
Cet or sonnait comme un angelus, un message de la Providence, car la glaneuse abominable abandonna cette maigre râtelée d'épis humains et la plainte s'apaisa !
Et, subitement, en furieux, en forcené, l'homme jeta les bras au cou de Paridael et coucha sa bonne tête plébéienne sur l'épaule du déclassé. Et Paridael, broyé contre cette large et houleuse poitrine, toute pantelante de sanglots, arrosé par ces chaudes larmes de reconnaissance, non moins éperdu que l'ouvrier même, se pâmait transporté au sein des béatitudes infinies et croyait arrivée l'heure de l'assomption promise aux élus du Sauveur ! Et jamais il n'avait vécu d'une vie aussi intense et ne s'était trouvé pourtant si voisin de la mort !
Cela ne l'empêcha pas, au sortir de cette conjonction pathétique, de consacrer, le soir même, à ses débauches, une partie de l'or réhabilité et de se rejeter à corps perdu dans la crapule.
Il se distingua particulièrement pendant le carnaval de ce même hiver calamiteux. D'ailleurs, de mémoire d'Anversois, jamais les Jours Gras ne déchaînèrent tant de licence, ne furent célébrés avec éclat pareil. On lirait prétexte de la misère et de la détresse pour multiplier les fêtes et les sauteries au profit des pauvres. Le peuple lui-même s'étourdit, chôma doublement, chercha dans une passagère ivresse et dans l'abrutissement un dérivatif à la réalité sinistre, fêta comme un Décaméron de dépenaillés ce carnaval exceptionnel qui, au lieu de précéder le carême, tombait en une saison d'abstinence absolue non prévue par l'Église et que n'auraient jamais osé imposer les plus féroces mandements de la Curie.
Ne se procurant plus de quoi manger, les pauvres diables trouvaient du moins assez pour boire. Outre que l'alcool coûte moins que le pain, il trompe les fringales, endort les tiraillements de l'estomac. Le malheureux met plus de temps à cuver l'âpre et rogue genièvre qu'à digérer une dérisoire bouchée de pain. Et les fumées de la liqueur, lourdes et denses comme les spleenétiques brouillards du pays, se dissipent plus lentement que le sang nouveau ne se refroidit dans les veines. Elles procurent l'ivresse farouche et brutale au cours de laquelle les organes stupéfiés ne réclament aucun aliment et les instincts dorment comme des reptiles en estivation.
Durant trois nuits, le théâtre des Variétés, réunissant en une halle immense l'enfilade de ses quatre vastes salles, grouilla de rutilante cohue, flamboya de girandoles, résonna de musique féroce et de trépignements endiablés. Il y régnait un coude à coude, un tohu-tohu, une confusion de toutes les castes presque aussi grande que sur le trottoir. Dames et lorettes, patronnes et demoiselles de magasins, frisottes et prostituées se trémoussaient dans les mêmes quadrilles. Les dominos de soie et de satin frôlaient d'horribles cagoules de louage. Aux pauses, tandis que les gandins en habit, transfuges des sauteries fashionables, entraînaient dans les petits salons latéraux une maîtresse pour laquelle ils venaient de lâcher une fiancée, et lui payaient la classique douzaine de « Zélande » arrosées de Roederer, les caveaux sous la redoute, convertis en une gargantuesque rôtisserie, en un souterrain royaume de Gambrinus, requéraient les couples et les écots moins huppés qui s'y empiffraient, au milieu des fortes exhalaisons des pipes, de saucisses bouillies, et s'inondaient d'une mousseuse bière blanche de Louvain, Champagne populaire, peu capiteuse, par exemple, ne montant pas à la tête, mais curant la vessie sans impressionner autrement l'organisme.
Vers le matin, à l'heure des derniers cancans, ces cryptes, ces hypogées du temple de Momus présentaient l'aspect lugubre d'une communauté de troglodytes assommés par des incantations trop fortes.
Tant que dura le carnaval, Laurent mit un point d'honneur à ne point voir son lit, à ne point quitter son pierrot fripé.
Le carnaval des rues ne le sollicita pas moins que les caravanes nocturnes. Ballant les artères dévolues à la circulation des mascarades, il fut partout où le tapage était le plus étourdissant, la mêlée la plus effervescente. Les éclats des trompes et des crécelles se répercutaient de carrefour en carrefour ou des vessies de porc gonflées et brandies en manière de massues s'abattaient avec un bruit mat sur le dos des passants. Des chie-en-lit, fallacieux pêcheurs, aggravant encore la bousculade, tendaient, en guise d'hameçon, au bout de leur ligne, une miche enduite de mêlasse, que des gamins aussi frétillants et voraces que des ablettes s'évertuaient à happer, en ne parvenant qu'à se poisser le visage. Mais Paridael se passionnait surtout pour la guerre des pepernotes, la véritable originalité du carnaval anversois. Il convertit une grosse partie de ses derniers écus en sachets de ces « noix de poivre », confetti du Nord, grêlons cubiques pétris de farine et d'épices, durs comme des cailloux, débités par les boulangers et avec lesquels s'engagent, depuis l'après-midi jusqu'à la brune, de chaudes batailles rangées entre les dames peuplant les croisées et les balcons et les galants postés dans la rue, ou entre les voiturées du « cours » et les piétons qui les passent en revue.
L'après-midi du mardi gras, Laurent reconnut dans l'embrasure d'une fenêtre de l’Hôtel Saint-Antoine, louée a un taux formidable pour la circonstance, Mmes Béjard, Falk, Lesly, et les deux petites Saint-Fardier.
Il n'avait plus revu sa cousine depuis le sas de l'hôtel Béjard, et il s'étonna de n'éprouver, à l'aspect de Gina tant idolâtrée, que du dépit et une sorte de rancune. Il lui en voulait, pour ainsi dire, de l'avoir aimée. Sa vie orageuse, la misère et la désolation des parias auxquels il venait de se frotter, n'étaient pas étrangères a ce revirement.
Mais la catastrophe de la Gina avait compliqué cette antipathie d'une sorte de terreur et d'aversion superstitieuses. La Nymphe du Fossé, le mauvais génie de l'usine Dobouziez, exerçait à présent son influence lénifère sur toute la cité. Elle empoisonnait l'Escaut et irritait l'Océan.
La vague tristesse que reflétait le visage de la jeune femme, la part très molle qu'elle prenait à la guerre des pepernotes, la nonchalance avec laquelle elle se défendait, eussent sans doute autre fois attendri et désarmé le dévot Paridael.
Il n'est même pas dit qu'en un autre moment il n'eût retrouvé, pour l’altière idole, quelque chose de sa religion première, mais il se trouvait dans un de ces jours, de plus en plus fréquents, d'humeur rêche et d'âcre irascibilité, dans un de ces états d'âme où, gorgé, saturé de rancœur, on nourrit l'envie de casser quelque bibelot précieux, de détériorer une œuvre dont la symétrie, l'immuable sérénité insulte à la détresse générale ; conjonctures critiques où l'on irait même jusqu'à chagriner et bourreler de toutes manières la personne la plus aimée.
Il trouva piquant de se joindre au bataillon de freluquets qui, stationnant sur le trottoir en face de l'hôtel, de manière à bien se mettre en évidence, rendaient hommage aux jeunes dames en leur décochant languissamment du bout de leurs doigts gantés un pepernote, pas plus d'un à la fois et pas trop dur. Parmi ces beaux messieurs se trouvaient les deux Saint-Fardier, von Frans, le fringant capitaine des gardes civiques à cheval, Diltmayr, le grand drapier et marchand de laines verviétois et un personnage basané, de mine exotique, exhibant une cravate rouge et des gants patte de canard, que Laurent voyait pour la première fois.
Agacé par le flegme et les airs blasés de Mme Béjard autant que par la piaffe et les petites manières des gandins, il résolut de ne pas la ménager, se promit même de lasser sa patience, de la harceler, de la forcer à se retirer de la scène. Fouillant dans les poches profondes de sa blouse, il se mit à diriger de pleines poignées de pepernotes vers la belle impassible. Ce fut une continuelle volée de mitraille. Les projectiles lancés de plus en plus fort visaient toujours Mme Béjard et de préférence au visage.
Après un furtif examen de ce pierrot débraillé, elle affecta longtemps de ne point lui prêter d'autre attention. Puis, devant l'impétuosité et l'acharnement de l'agression, elle abaissa à deux ou trois reprises un regard dédaigneux vers le quidam et se mit à caqueter de l'air le plus détaché du monde avec ses compagnes.
Cette attitude ne fit qu'exciter Laurent. Il ne garda plus la moindre mesure. Elle s'occuperait de lui ou viderait la place. À présent, il tapait comme un furieux.
Regardé de travers, dès le début, par la clique fashionable à laquelle il prêtait un renfort intempestif, ces messieurs de plus en plus indisposés contre ce carême-prenant avaient renoncé au jeu, récusant et désavouant un partenaire si loqueteux.
Autour d'eux, au contraire, on s'amusait beaucoup de cette balistique endiablée. Le populaire était prêt à prendre contre les galantins le parti de cet intrus, qui se réclamait de lui par ses allures et ses dehors. C'était un peu à leur bassesse, à leur abjection collective que la patricienne opposait ses dédains de plus en plus irritants.
Un moment on vit sourdre des gouttelettes de sang le long d'une écorchure produite à la joue de Gina par la chevrotine de Paridael. Elle détourna à peine la tête, esquissa une moue dégoûtée et loin d'honorer d'une riposte cet adversaire discourtois, elle dirigea, machinalement, une poignée de pepernotes d'un tout autre côté de la place.
– Assez ! crièrent les gommeux, faisant mine de s'interposer. Assez, le voyou !
Mais des compagnons de rude encolure se calèrent entre Paridael, et ceux qui le menaçaient, en s'exclamant : « Bien touché, le bougre ! Hardi !… Laissez faire !… C'est carnaval !… Franc jeu ! Franc jeu ! »
Paridael n'entendit ni les uns, ni les autres. Enfiévré par cet exercice comme un sportman briguant l'un ou l'autre record, il n'avait de regards et d'attention que pour Régina. Il la cinglait, la criblait d'une réelle animosité. Son bras nerveux faisait l'office d'une fronde et manœuvrait avec autant de violence que de précision.
Dans la chaleur du tir, chaque volée le rapprochait d'elle, l'élan de son bras l'emportait à la suite de la mitraille, il lui semblait que ses doigts s'allongeassent jusqu'à toucher aux joues de la jeune femme et c'étaient ses ongles qui lui déchiraient l'épiderme !
Gina, non moins entêtée, s'obstinait à lut servir de cible, ne bronchait pas, demeurait souriante, ne daignait même pas se protéger le visage de ses mains.
Elle n'avait pas reconnu Laurent, mais elle prenait plaisir à exaspérer, à pousser à bout ce truculent maroufle, bien résolue à ne pas démentir un instant sa force d'âme sous les regards hostiles de la populace.
Laurent en était arrivé à ce degré de rage férine où, commencé en badinage, un jeu de main dégénère en massacre. Faute d'autres munitions, il lui aurait lancé des cailloux, il l'aurait lapidée. Les bonbons semblaient durcir sous la pression de ses mains nerveuses, et tel était le silence anxieux de la foule qu'on les entendait battre les vitres, la muraille et même le visage de Gina.
À la fin, ce visage fut en sang. De force, Angèle et Cora firent rentrer Régina dans la pièce et rapprochèrent, derrière elle, les battants de la porte-fenêtre.
Alors d'une dernière poignée de pepernotes, Laurent étoila une des glaces derrière laquelle apparaissait la courageuse femme.
Puis haletant, harassé comme après une corvée, aussi insoucieux des grondements et des murmures de réprobation que sa brutalité soulevait chez les gens biens mis, que des applaudissements et des rires affriolés de la plèbe, il se perdit dans la foule, gagna en toute hâte une rue latérale, à l'écart de la tourmente et du grouillement : et là, pris de remords et de honte, son ancienne idolâtrie réagissant subitement contre son esclandre sacrilège, il eut une crise de larmes qui brouillèrent son maquillage et le firent ressembler au « petit sauvage » barbouillé par Gina, il y a vingt ans, dans le jardin de la fabrique.
Un rassemblement qui s'était insensiblement formé autour de ce pierrot larmoyant le rappela si catégoriquement à son rôle de masque éhonté et braillard, que les badauds purent s'imaginer qu'il avait pleuré pour rire.
Vers le soir, il alla relancer quelques pauvres diables figurants et figurantes d'un théâtre en déconfiture, qu'il entraîna dîner chez Casti, le restaurateur à la mode. Ce serait sa dernière bombance ! Quoi qu'il entreprit pour s'étourdir et se monter le coup, il manqua d'entrain. Au lieu de le lénifier, le vin ne fit que l'endolorir. D'ailleurs, il était harassé de fatigue. Il s'assoupit au milieu du repas, tandis qu'autour de lui, les autres dévoraient et lampaient en silence.
Moitié rêves, moitié rêveries, certains paysages lui revenaient comme un douceâtre déboire. Le passé, la vie perdue soufflait par bouffées chargées de moisissure, de parfum ranci, de remeugle écœurant, et, en cette brise rétrospective et intermittente, roulaient les scabreuses ritournelles ouïes tous ces soirs dans les cabarets interlopes. L'inutilité de ses jours défilait devant Laurent en une procession macabre, une traînée de gilles et de pierrots malades, nigaudant, zézayant, frileux et plaintifs, que des accès salaces électrisaient et qui se torsionnaient et se mêlaient dans des danses lascives comme le spasme même…
Comme il s'endormait pour de bon, indifférent aux caresses reconnaissantes et presque canines d'une fille, il sursauta au bruit d'une explication assez vive à l'entrée de l'escalier, suivi de pas dans l'escalier, puis dans le corridor, qui se rapprochèrent du cabinet où soupait Laurent, mais s'arrêtèrent devant le numéro voisin.
– Ouvrez ! Au nom de la loi ! commanda une voix grave, aux intonations brutalement professionnelles, celle d'un commissaire de police.
Laurent revenu complètement à lui, dégrisé en un clin d’œil, enjoint à ses compagnons de faire silène, en même temps qu'il colle l'oreille a la cloison, séparant les deux pièces.
Des cris, un tohu-tohu, de la casse, une fenêtre qu'on ouvre, mais pas de réponse. Puis le fracas de la porte qu'on a fait sauter.
Insurgé d'instinct contre toute autorité, prêt à prendre le parti des noceurs, contre la police, Laurent s'est précipité au dehors, et, par-dessus les épaules du commissaire arrêté sur le seuil du salon, celles de Béjard, d'Athanase et de Gaston, il aperçoit à sa consternation, Angèle et Cora, blotties chacune dans un angle de la chambre et s'efforçant de dissimuler dans les plis d'un rideau de fenêtre, la simplicité païenne de leur toilette. Non loin d'elles, cherchant à prendre une contenance, un air digne et résolu, incompatible, pourtant, avec leur ajustement aussi sommaire que celui de leurs belles, se campent le svelte von Frans, le gros Ditmayr et aussi – bien reconnaissable quoiqu'il n'ait pas plus gardé que le reste, sa cravate rouge et ses gants patte de canard – le rastaquouère basané à qui Laurent apprit cet après-midi à lancer les pepernotes.
Les maris sont peut-être plus atterrés, plus éplafourdis encore que les galants ; c'est du moins le cas pour les deux jeunes Saint-Fardier. Le commissaire lui-même manque d'assurance et s'embarrasse dans sa procédure.
Mais le côté baroque de cette scène moderniste ne frappe point Laurent ; il n'envisage et ne suppute que les conséquences de cet éclat.
La présence de Béjard eût d'ailleurs suffi pour lui ôter toute envie de rire. Seul, le vilain apôtre semble à son aise. On croirait même que ce scandale le réjouit. Dans tous les cas, il est homme à l'avoir fomenté d'abord pour le faire éclater à point voulu. Qui sait de quelle noire scélératesse il compliquera ce déplorable esclandre ?
Lui seul a pénétré dans la pièce. Il va de la table à la fenêtre, remue la vaisselle, le couvert, furette dans les coins, montre une effrayante présence d'esprit, dirige les perquisitions, signale au commissaire les « pièces à conviction » pousse l'impudence jusqu'à froisser et fouiller les vêtements éparpillés sur les meubles, et, sans se soucier de la présence des malheureuses adultères, trouve même la force de plaisanter :
– Il y avait six couverts !… Un des oiseaux, non, une des oiselles, s'est envolée par la fenêtre, en s'aidant d'un rideau, arraché, comme vous voyez… C'était plus fort qu'une partie carrée, une partie presque cubique… Quel dommage ! J'aurais bien voulu voir la fugitive. Gageons que c'était la plus jolie !
Il mit dans ces dernières paroles une intention tellement perfide, il laissa percer dans cette réticence un si diabolique sous-entendu, qu'un jour sinistre traversa l'esprit de Laurent et que le jeune homme s'élança vers Béjard en le traitant de lâche.
L'autre se contenta de toiser ce masque mal embouché et poursuivit aussitôt ses investigations, mais la violente sortie de Paridael rappela enfin le commissaire à son rôle.
– Hé ! vous, le pierrot ?… Qu'on décampe, et presto ! Vous n'avez rien à faire ici ! dit-il en prenant Laurent par le bras et en le poussant dehors ; puis se tournant vers Béjard et les deux maris : « Je crois les faits suffisamment établis, monsieur Béjard, et superflu de prolonger cette situation délicate. Nous pourrions donc nous retirer. »
Après avoir toussoté, il ajouta d'un ton contraint, comme si la pudeur l'eût empêché de s'adresser directement à des coupables si court vêtus : « Ces dames et ces messieurs auront la bonté de nous, rejoindre au commissariat pour les petites formalités qu'il nous reste à remplir ! »
Laurent, contre son ordinaire, a jugé inutile de se rebiffer. Il retrouvera le commissaire ! Béjard ne perd rien à attendre !
Pour le moment, un autre soin incombe à Laurent.
Coupable ou non, il faut que Gina soit avertie de ce qui vient de se passer et de la façon dont Béjard l'a désignée… Laurent se précipite dans la rue, comme un perdu, hèle un cocher, saute dans le fiacre :
– À l'hôtel Béjard !
Il arrache la sonnette, bouscule le concierge, s'introduit pour ainsi dire avec effraction dans une pièce éclairée.
Gina fait un grand cri en reconnaissant d'abord son pierrot de l'après-midi, et immédiatement après, sous cet accoutrement déshonoré, sous un reste de maquillage, son cousin Laurent Paridael.
Il la prend brutalement par la main : « Un oui ou un non, Gina, étiez-vous ce soir au restaurant Casti ? »
– Moi ! Mais de quel cabanon vous êtes-vous échappé ?
Il lui raconte, tout d’une haleine, le scandale auquel il vient d'assister.
– Le misérable, s'écrie-t-elle en apprenant le rôle joué par Béjard dans cette scabreuse aventure. « Je ne suis pas sortie ce soir. Ma parole ne vous suffit pas ? Tenez, les cachets de la poste sur cette lettre recommandée établissent que celle-ci m'a été remise' il y a une heure environ. Je finissais d'y répondre, lorsque vous avez fait irruption ici, et vous accorderez qu'il m'a bien fallu une heure pour remplir ces quatre pages d'une écriture aussi serrée que la mienne. »
Pour être édifié, Laurent n'avait pas besoin d'une preuve irrécusable ; tout, dans Gina, proclamait l'innocence ; son maintien reposé, sa toilette d'intérieur, sa coiffure disposée pour la nuit, le son de sa voix, l'expression honnête de ses yeux, jusqu'au parfum tiède et calme que dégageait sa personne.
– Pardonnez-moi, ma cousine, d'avoir douté un instant de vous… Pardonnez-moi surtout ma conduite de tout à l'heure…
– J'avais déjà oublié cette bagatelle… Ah ! Laurent, c'est plutôt moi qui devrais te demander pardon ! N'étais-je pas cruelle à l'égard de tout le monde, mais surtout au tien, mon bon Laurent !… Sois-moi pitoyable. J'ai bien besoin, à présent, qu'on m'épargne. J'expie durement ma coquetterie…
« Depuis longtemps tu détestes Béjard, n'est-ce pas ? Tu ne le haïras jamais assez. C'est notre ennemi à tous, c'est la bête malfaisante par excellence… Tu sais, le naufrage de la Gina. Eh bien, c'est horrible à dire, mais j'ai la conviction que le misérable prévoyait ce désastre, que celui-ci entrait même dans ses spéculations. Oui, il savait le navire incapable de tenir plus longtemps la mer… »
– Non ! Oh, non ! Ne dis pas cela. Béjard était un ange ! il y a deux secondes ! Béjard était bon comme Jésus !… Il savait cela, il voulait cette noyade ! Dieu ! Dieu ! Dieu ! Oh non !… hurlait Laurent en se prenant la tête à deux mains, en se bouchant les oreilles.
– Oui, je jurerais sur mon âme qu'il le savait. Il se méfie de moi. Il sent que je le devine, il me craint. Il a peur que je ne parle. Je sais aussi qu'il a voulu, avec le vieux Saint-Fardier, te faire enfermer comme fou. Sans mon père, on te colloquait. Fou ! On le deviendrait au milieu d'un pareil monde. C'est miracle que j'aie conservé la raison. Je jurerais que le complot de ce soir a été tramé par lui, avec Vera-Pinto, le Chilien que tu as remarqué cet après-midi dans la rue et revu chez Casti.
Et Gina raconta à Paridael que, depuis son arrivée à Anvers, cet exotique la poursuivait de ses assiduités. Plusieurs fois elle l'avait éconduit, mais il revenait toujours à la charge, encouragé, aussi incroyable que cela parût, par Béjard même auprès de qui il avait remplacé Dupoissy. Il avait, certes, l'âme encore plus basse et plus noire que le Sedanais, et Gina n'augurait rien de bon de ce que les deux associés tripotaient ensemble sous prétexte de commerce.
Béjard entendait reconquérir sa liberté pour épouser une autre héritière. Depuis qu'il l'avait ruinée, Gina ne représentait plus qu'un obstacle à sa fortune. N'osant se débarrasser de sa seconde femme comme il avait du le faire, là-bas, de la première, il avait tenté, par persuasion, de faire consentir Gina au divorce. L'intérêt de son enfant, et aussi le souci de sa réputation, avaient empêché Gina de se rendre à ses instances, autrement elle eût été la première à souhaiter la rupture de cette abominable union. En présence de ce refus, Béjard avait eu recours à la menace, puis, comme sa femme ne cédait toujours pas à sa volonté, il l'avait battue, oui, battue, sans pitié. Toutefois un jour, qu'il levait de nouveau la main sur elle, Gina s'arma d'un couteau et menaça de le lui plonger dans le ventre. Aussi lâche que méchant, il se l’était tenu pour dit. Mais, pour briser la résistance de son épouse, il devait mettre en œuvre des moyens autrement abominables. Il avait essayé de la pousser dans les bras du Chilien. Elle déconcerta ces embûches et le rasta en fut pour ses frais de galanterie. Enfin, en désespoir de cause, ne parvenant pas à induire sa femme en adultère, Béjard avait résolu de la faire condamner et flétrir comme si elle était coupable. De connivence, toujours, avec Vera-Pinto, il n'avait pas hésité, pour l'atteindre, à frapper les petites Saint-Fardier.
Voici, présumait Gina, quelle était la trame du complot :
– Après avoir averti Béjard de la partie galante liée pour la soirée, le Chilien s'y était rendu avec l’une ou l'autre de ses conquêtes.
« Il n'en manque pas, je l'avoue, même dans ce qu'on appelle la bonne société, disait Mme Béjard, car mes égales ne partagent pas toutes mon aversion pour cet équivoque métis. Inutile de les nommer. Plus heureuse qu'Angèle et Cora, la troisième dame mêlée à cette aventure aura pu, du moins, s'enfuir à temps. Cette personne ne se doute pas qu'elle doit précisément son salut à la haine que me vouent Béjard et son âme damnée. Il importait à ceux-ci de la faire disparaître avant l'arrivée de la police pour m'impliquer moi-même dans cette affaire. Ne m'avait-on pas vue l'après-midi en compagnie de mes malheureuses cousines ? Et von Frans, Ditmayr et Vera-Pinto ne sont-ils pas demeurés tout le temps plantés sous noire balcon ? La scène chez Casti représente l'épilogue d'une intrigue nouée à l’Hôtel Saint-Antoine, et, demain, dans Anvers, il ne se trouvera personne, sauf mon père et vous, qui ne soit persuadé de mes relations avec ce Chilien ! Ah ! Laurent ! Dire que Bergmans lui-même croira les calomniateurs ! Quand c'est dans son souvenir que je puisais la force de rester vertueuse !
C'est lui que j'aimais, c'est lui que je devais épouser ! Je le décourageai par ma vanité, et lorsqu'il se retira, mon amour-propre l'emportant encore sur mon amour, je consentis au plus funeste des mariages. Pour piquer celui que j'aimais, je me suis rendue éternellement malheureuse ! »
En vain Paridael avait-il tenté d'user sa passion, de la rendre de plus en plus absurde en multipliant à l'envi, de propos délibéré, les obstacles et les barrières qui le séparaient de sa cousine ; en vain était-il descendu si bas que jamais plus elle ne pourrait le relever jusqu'à elle.
Il se croyait guéri, il n'avait fait que recuire son mal. On sait comment avait tourné, quelques heures auparavant, son animosité contre la jeune femme.
Les accidents, les liaisons, les promiscuités de sa vie vagabonde, son commerce avec les réfractaires et les irréguliers, gaillards peu vergogneux de leur nature, initiés à n'importe quelle turpitude, l'avaient aussi dépouillé de tout préjugé et rendu plus entreprenant et plus expéditif.
Pendant qu'elle lui dénonçait les brutalités de Béjard, Paridael se dédoublait étrangement ; une partie de son moi compatissait du plus profond de l'âme à tant d'infortune et s'insurgeait contre si monstrueuse vilenie, et l'autre partie brûlait de sauter sur la femme éplorée, de la battre à son tour, de la traiter avec plus de barbarie que tout à l'heure sur le « cours », Jamais les extrêmes de sa nature ne s'étaient ainsi contredits. Ses sentiments s'entrechoquaient comme les fluides contraires pendant un orage.
La nudité des deux blondes adultères, surprises au restaurant Casti, frémissait encore devant son regard et lui incendiait le sang.
« Que ne déshabilles-tu prestement cette femme pantelante ? Seras tu moins crâne que le petit violateur de Pouderlée ? » lui suggérait le côté matériel de son individu. « Je trouverai assez de grandeur d'âme pour l'aimer mieux que Bergmans lui-même ! » se promettait l'autre partie de sa nature. Et il ne caressait pas idée moins généreuse, moins extravagante, que celle de se sacrifier pour faire le bonheur de la chère femme en la débarrassant, et Anvers avec elle, de ce spoliateur exécré.
Ce fut sous l'influence de cette pensée à la Don Quichotte qu'il dit à Gina, après un long silence, en gardant ses mains dans les siennes :
– Tu aimes donc encore Bergmans ?
L'accent de sa voix décelait tant de tristesse et d'affection que Gina le regarda. Mais elle fut tout étonnée de lui trouver ces yeux noyés et bizarres qu'elle lui avait vus déjà, un jour d'alerte, dans l'orangerie, et comme il lui serrait les mains de plus en plus fort :
– Laurent ! fit-elle… Laurent ! en essayant de le repousser et sans répondre à sa question.
Lui, cependant, continuait de sa voix infléchie et mourante :
– Ne crains rien de moi, Gina… Pense tout ce que tu voudras sur mon compte ; accable-moi de mépris, maïs dis-toi bien qu'il n'est rien que je ne tente pour ton bonheur…
Telle était l'expression sincère de ses sentiments, mais pourquoi, tout en tenant à Gina ces propos respectueux, la pression trop rude de ses doigts et la flamme fauve de ses prunelles démentaient-elles ce discours ?
– S'il venait à disparaître, ce Béjard, c'est Bergmans que tu épouserais…
Sa voix semblait venir de l'autre monde comme celle de ceux qui rêvent tout haut.
– Veux-tu que je le tue, dis, ton mari ? Tu n'as qu'à parler pour cela !… Voyons, parle !… Parle, te dis-je !
Le regard d'assassin ne menaçait pas seulement celui qui en avait défini de cette façon l'intensité troublante et le feu concentré. Gina venait d'y lire autre chose qu'une furie meurtrière, une postulation plus directe, une menace imminente…
– Avant que j'assure à jamais ton bonheur et celui de Bergmans, sois bonne un seul instant pour moi, Gina… l'instant que dure le baiser d'une sœur… Après, je partirai pour accomplir ma mission… Et plus jamais tu ne me reverras… Vite, ce baiser… ce baiser d'adieu, ma Régina…
Sa voix s'altérait, se faisait rauque et menaçante, son imploration sonnait faux ; il attirait de force la jeune femme contre sa poitrine en lui meurtrissant les poignets.
– Laurent ! Finissez ! Vous me faites mal…
Au lieu d'obéir, il lui patinait le charnu des bras ; il portait même les mains à son corsage et, au frisson des soins, sous l'étoile mince du peignoir, il appuya goulûment ses lèvres contre les siennes. Presque renversée, sur le point de lui appartenir, elle parvint à se dégager et bondit de l'autre côté de la table :
– Tous mes compliments, maître fourbe. Et dire que j'accusais Vera-Pinto ! C'est toi le suppôt de Béjard ! J'y suis à présent. Après l'avoir payé pour me maltraiter cette après-midi, il comptait me surprendre avec toi, vilain pitre ! Ta laideur et ta saleté eussent encore corsé l'énormité de ma faute. »
Flagellé par cette apostrophe virulente, aussi aveuglé que si elle lui avait flaqué du vitriol au visage, Laurent ne tenta pas même de se justifier. Les apparences l'accablaient ; ce qu'il avait de mieux à faire était de détaler au plus vite. L'arrivée de Béjard eût converti la calomnieuse hypothèse en réalité.
Laurent s'enfuit, non sans trébucher plusieurs fois, prêt à tomber.
Gina, sa bien-aimée Gina ! le croire capable, d'une pareille félonie ! Jamais Laurent ne s'en relèverait. Il aurait le droit désormais de se rouler dans toutes les fanges, d'accumuler ignominies sur ignominies : ses pires forfaits paraîtraient des bonnes œuvres à côté de celui dont elle l'avait incriminé, et les arrêts les plus draconiens, les expiations les plus infernales, que lui vaudraient une liste d'iniquités inimaginables, lui seraient douces et clémentes comparées à la rigueur et à la cruauté de cette accusation.
Gina même ne pourrait revenir sur son erreur et réparer son injustice. Celle-ci était indélébile. N'importe quelle réhabilitation ou quelle amnistie arriverait trop tard.
VII. LA CARTOUCHERIE
Ce jour de mai, les brouillards d'un hiver exceptionnellement tenace s'étaient dissipés pour ne laisser flotter dans l'air qu'une évaporation diaphane à travers laquelle l'azur offrait une intéressante pâleur de convalescence et qui s'irisait, à la radieuse lumière, comme un pulvérin de perles fines.
Après une longue maladie contractée le lendemain de son orageux Mardi gras, Laurent, aussi convalescent que la saison, faisait sa première sortie de l'hôpital où les praticiens l'avaient sauvé malgré lui et moins, sans doute, par intérêt pour sa personne que pour triompher d'un des cas de typhus les plus opiniâtres et les plus compliqués qui se fussent rencontrés dans l'établissement.
Remis sur pied, rendu à la vie du dehors, il semblait revenir d'un long et périlleux voyage, comme amnistié d'un exil qui aurait duré des années. Aussi jamais, même le jour de sa rentrée à Anvers, la métropole ne lui était apparue sous cet aspect de puissance, de splendeur et de sérénité. Au port, l'activité se ressentait de la température printanière. La famine récente causée par le blocus de l'Escaut n'avait pas persisté après la débâcle des glaces. Plus que jamais la rade et les docks regorgeaient de navires et une recrudescence formidable succédait à la longue accalmie du trafic.
Les ouvriers travaillaient sans souffrance, heureux de dépenser leurs forces, considérant aujourd'hui la corvée, si souvent pénible, comme une gymnastique rendant l'élasticité a leurs membres longtemps engourdis.
Même les émigrants, stationnant aux portes des consulats, semblaient à Paridael moins pitoyables, plus résignés que de coutume.
Passant devant le Coin des Paresseux, il constata que tous les habitués en étaient absents.
Leur roi, chômeur permanent, ne travaillant pas quand les paresseux les plus fieffés se laissaient embaucher, dérogeait exceptionnellement à sa fainéantise. Cette constatation humilia quelque peu Laurent Paridael. Il demeurait l'unique bourdon de la ruche en pleine activité. Il lui tardait de se régénérer par le travail.
À cette fin il aborda plusieurs brigades de débardeurs et demanda de l'emploi, n'importe lequel, à leur baes, mais celui-ci, après l'avoir dévisagé, peu soucieux de s'empêtrer d'une main-d'œuvre aussi dérisoire que celle d'un particulier rongé par deux mois de fièvres, l'engageait à repasser le lendemain, alléguant que la journée était déjà trop avancée.
Charriant les fardiers, passaient, d'une allure majestueuse et lente, les grands chevaux des « Nations ». À leurs larges colliers des clous dorés dessinaient le nom ou le monogramme de la corporation propriétaire. Les voituriers de ces chars n'emploient pour toutes rênes qu'une longue corde de chanvre passée dans un des anneaux du collier. Soit qu'ils trônent debout sur leurs chariots lèges à la façon des cochers antiques, ou qu'ils marchent, placides et apparemment distraits, à côté du véhicule charge, leur adresse, leur coup d'œil et aussi l'intelligence de leurs chevaux sont tels, que les attelages se croisent, se frôlent, sans jamais s'accrocher.
Laurent ne se lassait pas de s'extasier devant ces rudes chevaux et ces magnifiques conducteurs, il s'immobilisait même sur leur passage et à tout instant il se fût fait écraser, si un impératif claquement de fouet ou une gutturale onomatopée ne l'eût averti de se garer.
Ivre de renouveau, il pataugeait avec volupté dans cette boue grasse, sueur noire et permanente d'un pavé continuellement foulé par le pesant roulage ; il enjambait des rails et des excentriques de voies ferrées ; des amarres le faisaient trébucher, des ballots jetés à la volée, de mains en mains, comme de simples muscades par des jongleurs herculéens, menaçaient de le renverser, et l'équipe dont il contrariait la manœuvre rythmique et cadencée, le houspillait dans un patois énorme et croustilleux comme leurs personnages.
Rien n'altérait, aujourd'hui, la belle humeur de Laurent ; il prenait plaisir à se sentir rudoyé par le monde de ses préférences, jouissait de l'extrême familiarité que lui témoignaient ces débardeurs aussi robustes que placides.
Il longea le grand bassin du Kattendyk. Son cœur battit plus fort à la vue des compagnons de l'Amérique, la « Nation » dont il avait fait partie, en train de décharger des grains. Les sacs agrippés à fond de cale par les crocs de la grue étaient guindés à hauteur des mats et de la cheminée, puis le formidable levier, décrivant un horizontal quart de cercle, entraînait sa portée jusqu'au-dessus du camion attendant sur le quai.
Debout sur le camion, nu-tête et bras nus, un grand gaillard, les reins sanglés comme un lutteur, une sorte de serpe à la main, accrochait au passage les sacs surplombant sa tête, les débarrassait de leurs élingues et, du même coup, rendait la liberté de son mouvement à la machine qui virait pour continuer ses fouilles.
À la file, d'autres compagnons, coiffés, ceux-ci, du capuchon, s'approchaient à point nommé pour transborder sur un second camion la charge que l'homme nu-tête soulevait d'un tour de main et assujettissait contre leur échine. Alentour, les balayeuses rassemblaient en tas le grain qui se répandait à chaque voyage de la machine par les fissures des sacs accrochés et mordus.
En s'approchant, Laurent reconnut dans le principal acteur de cette scène, dont lui seul, peut-être, parmi ses contemporains, ressentait jusqu'aux moelles la souveraine beauté et qui eût sollicité Michel-Ange et transporté de lyrisme Benvenuto Cellini, le débardeur secouru par lui dans le galetas et s'estima récompensé au delà de toute perspective terrestre ou divine par l'émotion dont l'emplissait la vue do cette noble créature restituée à la vie et à son décor. Un instant Laurent songea à héler le personnage, mais il n'en fit rien ; le brave gars eût pu croire, tant son bienfaiteur avait l'air minable et vanné, que celui-ci faisait brutalement appel à sa reconnaissance. Paridael se hâta même de poursuivre son chemin, craignant d'être reconnu, se félicitant d'avoir eu ce scrupule, mais non sans envoyer du fond de l'âme à son obligé l'effluve le plus chaud de son fluide affectif.
Il dépassa les cales sèches, traversa force ponts et passerelles, atteignit les entrepôts de matières inflammables, les magasins de naphte immergés dans des bas-fonds marécageux, les tanks à pétrole, cuves immenses comme des gazomètres, tous objets d'apparence topique contribuant à la démarcation de ce paysage commercial.
Ici s'arrêtait, lors de ses dernières vagations, l'industrie accapareuse et vorace de la métropole.
Aussi ne fut-il pas peu surpris en constatant que, passé les réservoirs à pétrole, vers le hameau d'Austruweel – piteux coin de village cruellement séparé de son clocher par les nécessités stratégiques, et réuni de force à la région urbaine – s'élevait un agglomérat de constructions sommaires et hâtives comme un baraquement, d'un aspect si trouble, si rebutant, édifiées tellement à la diable, que Laurent n'était pas loin de leur attribuer, en effet, une origine diabolique. Aucun nom, aucune enseigne ne les revêtait, comme si le propriétaire eût été honteux de revendiquer sa propriété ou comme s'il e exercé une profession inavouable. Ces masures avaient dû pousser là comme les champignons germent en une nuit dans les endroits humides, propices aussi à l'éclosion de crapauds.
L'ensemble tenait à la fois du lazaret, du dispensaire, du chantier d'équarrissage, d'un entrepôt de contrebande, d'une brûlerie clandestine reléguée hors la zone des industries normales. Choqué désagréablement, Laurent Paridael s'arrêta malgré lui devant ces pourpris interlopes, consistant en cinq corps de bâtiments sans étages, faits d'épaves, de torchis, de gravats, de matériaux agglutinés comme une chose provisoire à laquelle on ne demanderait qu'une consistance éphémère.
Entouré d'un méchant palis, garde fous vermoulu, l'ensemble jetait une note discordante dans l'harmonie grandiose et loyale, dans l'impression de probe aloi produite aujourd'hui par le panorama d'Anvers. Ces bicoques sans destination apparente intriguaient Paridael plus qu'il ne l'aurait voulu.
Il fut distrait de sa critique par une dizaine d'apprentis, garçons et jeunes filles, qui, bâtant le pas et devisant joyeusement, allaient précisément s'engager dans ces chantiers équivoques.
Il les aborda avec l'angoisse d'un sauveteur qui saute à l'eau ou au mors de chevaux emballés, pour secourir le prochain en détresse, et leur demanda ce que représentait ces installations suspectes.
– Ça ? mais c'est la Cartoucherie Béjard lui dirent-ils en le regardant comme s'il tombait de la lune.
À cette réponse il dut avoir l'air encore plus ahuri. Comment n'avait-il pas prévu cette corrélation ? Établissement de mine si repoussante et de dehors si maléfique ne pouvait évidemment servir qu'à Béjard.
Laurent Paridael se rappela qu'on lui avait parlé de la dernière opération de l'ancien esclavagiste. Sans se réconcilier avec Bergmans, il avait applaudi à la campagne véhémente conduite par le tribun contre les menaçantes œuvres du marchand de viande humaine, et s'il ne s'était pas mêlé plus activement à cette opposition, c'est qu'il croyait le Magistrat incapable de tolérer pareilles manipulations à l'intérieur de la ville. Et voilà que Paridael trouvait ses prévisions démenties et le salut public mis en péril malgré les philippiques, les adjurations et les cris d'alarme de Bergmans !
Béjard, le méchant alchimiste, était parvenu à établir son laboratoire où bon lui semblait.
C'était dans ces ateliers précaires, presque ouverts à tous les vents, plutôt aménagés pour séduire les chauve-souris que pour abriter des êtres humains, que se pratiquaient ces opérations redoutables !
C'était dans le proche voisinage des matières les plus combustibles qu'on tolérait la présence des plus foudroyants producteurs du feu ! Non seulement on installait une soute aux poudres à côté des entrepôts de naphte et d'huile, mais on se livrait sur cette poudre à une trituration des plus propres à la faire éclater.
C'était des gamins, des bambines fatalement volages et étourdis, appartenant par essence à la classe la plus turbulente et la plus téméraire des prolétaires anversois, que l'on chargeait d'un travail pour lequel on n'aurait jamais requis manipulateurs trop sages et trop rassis !
Et pour que rien ne manquât à cette gageure, pour que le défi criât mieux vengeance au ciel, pour tenter plus sûrement Dieu ou plutôt l'Enfer, on outillait d'engins grossiers et rudimentaires ces menottes novices et maladroites.
Enfin, provocation suprême, on logeait une machine à vapeur et son foyer à proximité de la poudrière, on traitait littéralement la poudre par le feu !
Ne considérant que le peu de difficulté, comportée par la tâche même, simple travail de mazettes, « un véritable jeu d'enfant ! » disait en ricanant l'âpre capitaliste, celui-ci avait tout bonnement rabattu deux cents de ces tout jeunes voyous et maraudeurs, pullulant dans le quartier dos Bateliers et de la Minque, graine de ribaudes, de colporteuses, de pilotins, de smugglers et de runners, truandaille à faibles prétentions qu'il salariait à raison de quelques liards par jour. Béjard s'occupait aussi peu de la sécurité de ces pauvrets que de celle des émigrants. Cette cartoucherie était le digne pendant du navire avarié. Laurent s'imagina même reconnaître dans ces planches moussues et goudronnées, des épaves de la Gina, et par plus de recul encore il songeait aux navires qu'avaient aidé à construire du temps de Béjard père, les apprentis suppliciés pour amuser Béjard fils.
L'aîné des gamins, auxquels Laurent venait de s'adresser, ne courait que sa seizième année et il apprit de lui que la plupart de ses compagnons n'atteignaient pas cet âge.
En les interrogeant, Paridael prenait à leur sort un intérêt encore inéprouvé, leur portait d'emblée une impérieuse et presque cuisante sollicitude, la plus intense, la plus jalouse qu'être humain eût éveillée en ses moelles, s'ingéniait à prolonger la conversation pour les retenir, là, auprès de lui, et retarder de minute en minute leur rentrée dans l'usine.
Il se creusait la tête afin de les détourner de leur travail, de licencier cet atelier délétère. Jamais il n'avait nourri pareille envie de disputer à une usine son peuple de servants ; de débaucher, de libérer, d'affranchir les apprentis attelés aux métiers homicides. Toutes ses amours passées revivaient, se condensaient en cet attachement suprême.
– Dans ce bâtiment-là, devant votre nez, est l'atelier où les garçons vident les cartouches. Derrière la remise, la douane… Au milieu, cette espèce de fort entouré de terre battue vous représente la poudrière dans laquelle nous mettons en caisse la poudre provenant des cartouches démontées… De l'autre côté de la poudrière : l'atelier des filles… C'est là que s'applique ma bonne amie, la rousseaude, qui se cache derrière cette autre pisseuse… Comme autrefois à l'école, on sépare les culottes des jupons. Je ne dis pas qu'on ait tout à fait tort… d'autant plus que nous nous dédommageons à la sortie, n'est-ce pas, la Carotte ? Enfin, ce hangar-là contient le four en maçonnerie où l’on fond séparément en lingots le cuivre et le plomb…
« Le même auvent protège la machine à vapeur servant à écraser les douilles vidées et brûlées. Moi, je travaille au four. C'est moi, Frans Vervvinkel, qui fais partir le fulminate des amorces après avoir vidé les douilles. Il faudrait me voir à l'œuvre ! C'est très amusant et pas plus difficile que de planter une taloche à celui-ci. Vlan ! je fais ainsi. Et le tour est joué ! Ne te fâche pas, Pitiet, c'était pour expliquer le truc à monsieur ! »
À mesure que l'aîné lui donnait sans récriminer, même sur un ton de forfanterie, fortement imprégné du savoureux bagout local, ces détails et d'autres encore sur les lieux, le matériel et les travailleurs, les affinités de Laurent pour cette traînée de lurons et de luronnes se corsaient au paroxysme de la commisération.
Ils avaient la charnure bien modelée, la mine saine quoiqu’un peu déveloutée, le museau éveillé, les allures balancées et dégourdies, les vives prunelles, les lèvres mobiles, ce teint un peu hâlé, ces pommettes briquetées, cette complexion brune des riverains du port, ce type local tellement prisé par Laurent qu'il lui rendait sympathiques jusqu'aux runners et autres requins de terre.
En les dévisageant, comment se fit-il soudain la réflexion que les premières victimes de Béjard et de ses charpentiers de navires, que les petits crucifiés du chantier Fulton devaient avoir eu leur âge, leur galbe, leur gentillesse, leur crânerie ? C'était bien là les congénères de ces fiers bonshommes qu'au dire des gazettes du temps on avait pu brimer et martyriser à l'envi sans les pousser à la délation, sans seulement en tirer une plainte.
– Et vous ne vous faites point mal ? On ne vous fait point de mal là-dedans ? Bien sûr ? Cet homme, Béjard, ne prend-il point plaisir à voir couler votre sang ? Oh, dites, n'ayez point peur !… N'est-ce pas que vous vous prêtez à ses amusements féroces, qu'il vous brûle et vous charcute, le bourreau !… Ne dites pas non ! Je le connais… Prenez garde !
Ils se regardaient en pouffant, ne comprenant rien aux divagations de ce carême-prenant.
Le pressentiment d'occultes dangers qui les menaçaient, angoissait atrocement Paridael, attristait, pour employer la parole sublime du Sauveur, son âme jusqu'à la mort. Un attirail de supplices et de questions guettait cette chair adolescente. Il aurait voulu racheter ces pauvrets au prix de son propre sang, il ne savait à quels vivisecteurs.
Un moment il crut avoir trouvé le moyen de conjurer leur fortune.
Après avoir calculé mentalement ce qu'il possédait encore, il proposa de but en blanc à toute la flopée de la conduire à la campagne, au-delà d'Austruweel où il les aurait régalés de riz au safran, « de pain de corinthes » et de café sucré, tout comme Jésus traite ses élus au Paradis.
Mais, en même temps qu'il fouillait ses poches pour en retirer son dernier argent, il se tâtait, en quête de bandelettes, de charpie et d'onguent. Ses hardes s'en étaient-elles imprégnées à l'hôpital, mais, simultanément, une abominable odeur de phénol, de laudanum, de chair cautérisée, outragea ses narines.
Ficelé dans un de ces accoutrements picaresques à la composition desquels il apportait un véritable dandysme, les joues creusées, la mine ravagée par la maladie et rendue plus hagarde, plus décomposée encore par l'angoisse présente, des propos saugrenus et incohérents brochant sur la dégaine défavorable du personnage, Laurent Paridael était si peu le particulier de qui on eût pu attendre largesse, qu'en lui entendant proposer cette mirifique régalade à la campagne, les gamins se crurent positivement en présence d'un fou, d'un fumiste ou d'un ivrogne incapable de tenir ce qu'il leur offrait et se mirent à l'étourdir par un tas de propositions burlesques :
– Dis, Jan Slim, as-tu fini de couïonner ton monde ? Apprends-nous plutôt l'adresse de ton tailleur. – Eh ! l'oiseau rare, puisque tu es en veine de prêche, si tu nous récitais les dix commandements de Dieu ! – Certes qu'on t'accompagnera, mon petit père, et tout de suite encore, mais pourrais-tu nous mener dîner à l'Hôtel Saint-Antoine ou chez. Casti ? – Soit dit sans te blesser, mais tu nous fais l'effet d'un échappé de la rue des Béguines ou d'un pèlerin de Merxplas. – C'est-il avec l'argent volé que tu nous gaveras la panse ?
Loin de se formaliser de ces brocards, Laurent regrettait profondément de ne plus disposer du moindre billet de cent francs pour les partager entre ces garnements et payer leur rançon à la fatalité. Lui-même était à bout de ressources, et à moins qu'il ne trouvât demain à louer ses bras affaiblis, il lui faudrait, en effet, se rendre en pèlerinage à Merxplas, à l'hospitalier dépôt des musards et des las d'aller, où il aurait retrouvé Karel le Forgeron et tant d'autres dignes anathèmes.
Averti d'une détresse de plus en plus imminente, Laurent insista pour entraîner les jeunes ouvriers loin de cet endroit ; les supplia presque avec des larmes d'aller s'embaucher ailleurs comme goujats, terrassiers, trieuses de café, harengères, ou tout au moins de chômer aujourd'hui, un seul après-midi, de faire l'usine buissonnière durant le restant du jour.
Mais jugeant que cette mystification tournait à la scie, leur chef, un polisson aux grands yeux couleur de châtaigne mûre, à la moue gouailleuse, au menton carré et volontaire marqué d'une délicieuse fossette, un espiègle difficile à prendre sans vert, le même Frans Verwinkel qui se disait chargé de « faire partir le fulminate » tira respectueusement sa casquette à Paridael et, inclinant sa caboche noire et frisée, le harangua à ces termes :
– Ce n'est pus, mon vieux frère, que ta compagnie nous soit particulièrement désagréable ou que ta conversation manque de ragoût, mais si tu m'en crois, tu prendras les devants et iras nous attendre à Wilmarsdonck… Voilà au moins une heure que la cloche a sonné et, sans être tout à fait le croquemitaine que tu nous disais, le Béjard ne se gênerait pas pour nous coller des amendes ou nous foutre tous à la porte, certain qu'il est, le roublard, de piger toujours assez d'artistes de notre force pour faire marcher sa boutique.
« Et comme, dans ce cas, ce n'est pas encore toi, notre oncle, qui beurreras nos tartines et nous nicheras dans un poulailler, ou tendras le cul à notre place pour recevoir une fessée aussi paternelle que brûlante, nous te souhaitons le bonsoir, l'ami. Salut et bon vent arrière ! »
Laurent tenta de lui barrer le passage, l'arrêta par le bras, lui retint les mains :
– Allons hop ! l'ami ! Bas les pattes ! Au large, entends-tu ?
Le fringant apprenti se dégagea et Laurent eut beau s'accrocher désespérément aux blouses et aux jupes, tous passèrent outre, à la suite de leur chef, non sans molester un tantinet le chanteur de noires complaintes. Et, avec des huées, dos sifflets, à grand renfort de gestes cyniques à son adresse, ils s'engouffrèrent dans la cartoucherie, plus effrontés, plus tapageurs qu'une volée de moineaux narguant l'épouvantail.
Paridael demeura en cet endroit longtemps après que la porte se fut refermée sur le dernier des retardataires. Leur rire sonore, leur voix vibrante claironnait encore à ses oreilles ; il voyait reluire et pétiller les profonds yeux couleur de châtaigne mûre du plus grand, se remémorait le ragoût de son mouvement, lorsque d'un revers de main il avait relevé vers le ciel la visière de sa casquette à la façon d'une mésange querelleuse qui hérisserait sa huppe.
Le cœur de Paridael saignait de plus en plus douloureusement sous sa poitrine. Et cela, à propos de galopins qui lui étaient absolument étrangers !
« Il en gredine des centaines, voire des milliers, du même moule, du même fion dans les quartiers populaires, depuis Merxem jusqu'à Kiel ! » lui aurait fait observer le judicieux et raisonnable Marbol.
Eux-mêmes ne venaient-ils pas de reconnaître que Béjard n'eût pas été embarrassé de lever plus d'une réserve de conscrits de pareil acabit.
La ville prolifique les jetait sur le pavé, négligemment, les exposant aux aventures, les abandonnant à leur propre industrie, à leurs bons ou mauvais instincts, les vouant presque tous à l'ilotisme, mais les prodiguant pour la plus grande saveur de la rue et du rivage.
S'ils ne servent pas à la nourriture des poissons, un jour ils s'allongent sur la dalle des morgues ou contribuent à l'instruction des carabins. Possédaient-ils bien l'unique, le suprême cachet que leur prêtait Laurent ? Incontestablement. Eût-il même été seul à les voir sous cette couleur chaude et en si ferme relief, c'est qu'ils étaient créés, qu'ils existaient ainsi.
Sur le point de relancer les apprentis dans leur atelier afin de suspendre les malignes pratiques auxquelles on se livrait sur eux et de les disputer à Béjart lui-même, la même odeur que tout à l'heure, mais plus véhémente encore, une touffeur d'abattoir mêlée à des relents d'infirmerie et à des bouffées de roussis fondit à sa rencontre. Comme si on lui eût fait respirer un violent anesthésique, il eut un éblouissement, un vertige ; les objets tournoyèrent autour de lui.
La palissade enclavant la cartoucherie fut balayée, la maçonnerie s'effrita, les murs se lézardèrent et s'entrouvrirent comme des décors d'opéra, ou comme si se déclaraient de subites voies d'eau et, dans une verte lumière de bengale ayant la couleur d'une mer glauque et phosphorescente, d'insolites formes humaines tourbillonnèrent devant ses yeux, plus rapides, plus fugaces qu'un banc de poissons lumineux ou que les mille chandelles folletant sous la paupière d'un apoplectique. Quoique endiablées que fussent leurs virevousses, Laurent démêla dans ces apparitions des têtes sans corps, des torses sans membres, des pieds et des mains amputés, et un qui le consterna surtout, dans ce météore, fut l'expression conjuratrice, implorante ou terrifiée des yeux éclairant ces talus exangues, les mêmes beaux yeux d'adolescents si fripons il y a quelques secondes, et le rictus, la convulsion, la grimace d'atroce souffrance de ces bouches, les mêmes bouches tout à l'heure si mutines, si railleuses, et ces minois ouverts et hardis de bouts d'hommes émancipés ne reculant devant rien, tordus a présent, convulsés dans il ne savait quel spasme…
Assistait-il à un naufrage ou à un incendie ? Il revoyait à la fois les enfants martyrisés du chantier Fulton et les émigrants qui avaient sombré avec la Gina. Et un de ces visages, celui du jeune Frans Verwinkel, ressemblait extraordinairement à celui de son cher petit Pierket, le frère cadet d'Henriette et l'image de la jeune fille, mais une version mutine et luronne de cette pensive image.
Cette fantasmagorie ne dura qu'une mortelle seconde, après laquelle la lumière verte s'éteignit, les parois se refermèrent, le palis se releva et la vilaine usine reprit son apparence revêche, mais normale.
« Ah ça ! se dit Paridael, deviendrais-je fou ? »
Et rougissant de cet accès morbide qu'il attribuait à une hyperesthésie causée par sa maladie, à l'action capiteuse de l'air après une longue claustration, il se décida enfin à tourner le dos à ces objets hallucinants et se dirigea vers le fleuve.
Deux ou trois fois, cependant, il ramena les regards vers le chantier, revint un instant sur ses pas comme s'il avait oublié quelque chose ou si quelqu'un de bien aimé le rappelait pour lui redire adieu.
Graduellement ce charme cessa d'opérer. L'apparence normale et rassurante du reste des objets sous la lumière et dans la tiédeur de ce premier beau jour le lénifia lui-même. Pas un nuage n'offusquait l'opale azurée du ciel. D'imperceptibles vaguilles ridant la rivière inondée de soleil faisaient songer à ce frisson d'aise, a cette petite mort courant au flanc d'une monture flattée par son cavalier.
Laurent ne distinguait plus les gréements et les cordages des vaisseaux lointains, de sorte que leurs voiles blanches, plus blanches que les draps de son lit numéroté à l'hôpital ou que la bâche des civières, semblaient flotter sans entrave dans l'espace et suggéraient les ailes d'anges envoyés à la rencontre des âmes attendues prochainement là-haut !
Parvenu sur la digue, au point même d'où il avait vu décroître le vaisseau emportant les Tilbak, amoureusement, jalousement, Paridael embrassa le panorama de sa ville natale. Ses regards parcoururent les contours et les arêtes des monuments, ils en firent une délinéation minutieuse et appuyée comme pour une épure, en même temps que son enthousiasme avivait les teintes, multipliait, chromatisait à l'infini les nuances de ces architectures familières. Il inhala avec une avidité d'asphyxié rappelé à la vie, l'air salin, les arômes du large, les émanations des épices odoriférantes et même les vireuses matières organiques chargées sur les flottes marchandes. L'odeur obsédante de l'hôpital se dissipa dans ce bouquet majeur.
Laurent apercevait les équipes diligentes, surprenait les manœuvres d'ensemble sous les grands gestes des élévateurs et des grues, enregistrait les appels, les signaux et les commandements. Il confondait dans un immense transport d'affection l'horizon natal et tous ceux dont cet horizon bornait la vue. Une profonde et totale béatitude l'envahit, une sorte de nirvana, de voluptueuse stupeur. Tout en savourant, en dégustant la réalité ambiante et tangible, il ne se sentait déjà plus faire partie de la Cité. Celle-ci prenait les proportions et le caractère d'une sublime œuvre d'art. Était-ce qu'il ne participait plus en rien à la création ou bien qu'il s'était fondu et dissous dans les essences et les principes mêmes qui la constituent ?
C'était le premier jour qu'il l'appréciait, qu'il se l'assimilait ainsi par tous les pores. De quelle vie étrange vivait-il donc ? Si telles délices constituaient le jour sans lendemain, il ne se fût jamais lassé de leur éternité !
Une saltarelle de carillon préluda au coup de trois heures.
Avant le premier tintement, Paridael éprouva cette sensation de froid d'un dormeur qui se réveille à la belle étoile ; en même temps, il lui sembla qu'on le tirait fortement par la manche et que les dernières voix humaines qu'il eût entendues, celles des jeunes ouvriers de Béjard, le hélaient de très loin. Il se retourna vers les bâtiments de la cartoucherie. Il n'y avait âme qui vive entre ces bâtiments et le fleuve, et, ennuyé par ce rappel, Laurent allait reporter ses regards du côté de la rade.
En même temps que sonnait le premier coup de l'heure, il entendit partir de la cartoucherie une série de petites détonations de plus en plus précipitées, et comme il renonçait à les compter, une commotion lui laboura les jambes, le sol se tendit et se détendit comme un tremplin sous ses pieds et le fit bondir, d'un élan involontaire, à quelques mètres en avant.
Un tonnerre, comparable à celui de tous les canons des forts réunis en une seule batterie, lui brisait le tympan et faisait jaillir le sang de ses oreilles. Simultanément, une partie de la cartoucherie – hélas, les ateliers des enfants ! – oscilla, se désagrégea comme un simple château de cartes et ramassé, englobé dans une trombe blanche, monta, fusa vers le ciel.
Cela monta d'un seul jet très vite, ah ! trop vite, droite tige d'une végétation spontanée et au bout de cette tige, blanche et cotonneuse, qui n'en finissait pas, se forma l'immense masse bulbeuse d'une tulipe rose et noire s'épanouissant comme la fabuleuse agave au fracas de la foudre, mais floraison mort-née effeuillant ses pétales en un funèbre feu d'artifice.
Au deuxième coup de trois heures, durant le millième de seconde que vécut cette fleur pyrique, Laurent, scrutait ces pétales, démêla des bras, des jambes, des tronçons, et aussi d'entières silhouettes humaines, gesticulant horriblement, tels des pantins trop désarticulés. Il se rappela gestes et contorsions analogues dans des toiles de peintres hallucinés, évocateurs de sorciers se rendant au sabbat… Et ces parties de la tulipe rose et noire, sanguinolentes ou carbonisées, décrivaient dans toutes les directions de longues trajectoires, et sans cesse pleuvaient, pleuvaient, pleuvaient d'innombrables débris avec accompagnement d'intraduisibles clameurs et de la continuelle pétarade. Giries de brûlés vifs ! Pyrotechnie néronienne !
Comme il semblait à Laurent avoir entendu déjà de ces voix, quelques masses s'abattaient autour de lui en même temps qu'une grêle de balles, et il eut la vision précipitée d'un tronc auquel adhérait un corsage, d'un pied d'enfant encore logé dans son petit sabot, d'une jambe musclée culottée de velours, et du même coup il se rappelait la cambrure de ce corsage, le pli de ce pantalon, le bruit guilleret de petits sabots courant à leur besogne et la belle impudence d'un visage émerillonné sous certaine visière bravache :
« C'est moi, Frans Verwinkel, qui fais partir le fulminate ! Il faudrait me voir à l'œuvre. Je n'ai qu'à frapper ainsi, et le tour est joué ! »
Peut-être le pauvret n'avait-il eu qu'à frapper ainsi…
Non, c'était impossible ! Laurent n'en pouvait croire ses sens. Le mirage reprenait de plus belle. Pour se convaincre de son état d'hallucination, il poussa un immense éclat de rire, mais il s'entendit rire et le cauchemar persista. Vers l'extrémité de l'enceinte urbaine, à l'endroit où s'élevait, il y a moins d'une seconde, un tènement du hameau d'Austruweel, il ne restait debout des vingt bicoques que l'estaminet In den Spanjaard, contemporain de la domination espagnole et arborant le millésime 1560. Par la trouée furieuse on découvrait la campagne, les talus verdissants des remparts, un rideau d'arbres en bourgeons et le placide clocher d'Austruweel, au-dessus duquel l'alouette chantait sa première chanson. La guérite d'une sentinelle gisait au bas du rempart.
Capricieuse comme la foudre, l'explosion avait ménagé de proches et précaires masures qu'un souffle aurait dû balayer et préservé même une partie de la cartoucherie, alors qu'elle avait renversé et pulvérisé des constructions situées à plusieurs kilomètres de là, réduit en bouillie des maçonneries à l'épreuve des torpilles, rompu comme un fétu de paille les madriers et les pilotis des débarcadères, converti le fer en limaille, ramassé et chiffonné ainsi qu'une étoffe de soie les toitures en tôle galvanisée des hangars.
Des ruines penchaient dans un état d'équilibre instable et se déchiquetaient en profils fabuleux, en architectures inouïes.
Tout cela s'était accompli au deuxième coup de trois heures.
Avant le troisième coup avait surgi, derrière la cartoucherie, sifflant, hurlant comme un essaim de guivres, un geyser enflammé dont les ondes déferlèrent – toujours avant que l'heure n'eût sonné – sur une surface de dix hectares : toute la réserve du pétrole, cinquante mille barils, flambaient comme une simple allumette.
Et tels étaient le progrès de la déflagration, telle fut la furie de cette marée incendiaire qu'elle paraissait devoir submerger la métropole et ne faire qu'une gorgée de son fleuve.
Par un trompe-l'œil de la perspective, les énormes langues rouges démesurément allongées, dardées toutes dans la même direction, léchaient les contreforts de la cathédrale. Malgré le plein jour la flèche altière reflétait un coucher de soleil. Et les navires des bassins, alternativement masqués et découverts suivant que s'écartaient ou se rapprochaient les vagues flamboyantes, semblaient, jouets de ces flots dévorateurs, tanguer sur un océan en éruption.
L'apocalyptique splendeur du spectacle finissait par noyer dans une monstrueuse extase l'horreur et la pitié de Laurent. Mais le bitume et le soufre ne pleuraient pas de l'empyrée. Jamais si pur, si doux éther n'avait empli l'espace, jamais ciel si bleu si paressant n'avait leurré les mortels. Contrairement à la prophétie les astres ne s'écroulaient pas, le jour printanier continuait de sourire indifférent, même réjoui, et la fumée épaisse et noire, déroulant au loin ses volutes pressées, noire écume de cette tempête de flammes, ne parvenait à voiler ou à troubler l'impavide et sereine majesté du soleil.
Cependant, après l'inertie et la consternation du premier moment, un vent d'épouvante balayait la population vers la campagne méridionale et chassait de leurs foyers, sous une grêle de plâtras et de vitres cassées, les habitants des quartiers les plus éloignés de la cartoucherie. Des ouvriers échappés à la mort : calfats, débardeurs, trieuses, femmes portant des poupons sur les bras, jeunes filles presque nues, matelots, douaniers, éclusiers, hagards, horriblement essoufflés, les prunelles plus dilatées que par la belladone ; la bouche fendue, élargie par un cri prolongé, les cheveux et les habits brûlés, parfois atteints jusqu'à la chair, torchères vivantes dont la course stimulait l'activité, se ruaient à l'assaut des berges et allaient même se jeter dans l'Escaut.
Un de ces fuyards courut sur Laurent qu’il faillit renverser. Laurent reconnut Béjard et, arraché brusquement à la fascination, la haine lui restituant toute sa lucidité, persuadé que cette extermination était l'ouvrage de son ennemi, Le couronnement de ses iniquités, il le harpa au passage.
En cet instant hypercritique, il récupéra ses forces perdues. Il allait tenir parole : venger Régina, venger Anvers, venger les émigrants délibérément jetés aux poissons, venger enfin les petiots de la cartoucherie.
Ah, c'était donc la les « vues » que le destin avait sur lui !
Béjard se débattit, hurla même « à l'incendiaire ! » mais tout entiers à leur propre détresse, les fugitifs poursuivaient leur course sans se préoccuper de ce corps à corps.
Laurent matait Béjard, le serrait d'une poigne implacable tenant à la fois des crocs du bouledogue, des serres du gypaète, des tentacules de l'araignée, des ventouses de la pieuvre.
Ah ! il s'était flatté, l'exacteur, le tortionnaire, le marchand d'âmes, de survivre à cette hécatombe d'enfants ! il touchait au salut, le fléau semblait, l'amnistier, mais quelqu'un de plus vigilant et de plus acharné que les flammes se trouvait heureusement là pour suppléer à leur aveugle clémence et leur restituer la proie qu'elles laissaient échapper.
Aussi implacable que la mort même, justicier absolu, Laurent ramenait son patient du côté de la gehenne. Il était le seul, dans tout Anvers, qui se dirigeât de sang-froid vers ce foyer d'horreur. Il comptait bien y rester avec son condamné. L'idée du trépas n'avait rien pour lui répugner. Ne s'était-il pas senti partir délicieusement, il y a quelques minutes ?
Béjard, devinant l'atroce dessein de son bourreau, ruait, mordait, jouait de tous ses membres, le désespoir décuplant aussi sa vigueur normale.
Parfois il opposait une telle résistance que Laurent ne parvenait plus à avancer et qu'ils se crochetaient sur place. Mais l'avantage restait toujours à Paridael et il poussait victorieusement sa capture en avant, à travers tout, par-dessus des amas visqueux, des matières flasques ou carbonisées dans lesquelles on aurait eu peine à reconnaître des restes humains.
Il foulait même des blessés, l'idée de la vengeance le rendait sourd à leur râle. Des cartouches partaient constamment sous ses pieds, des balles sifflaient à ses oreilles, il aurait pu se croire sur un champ de bataille, au cœur de la fusillade décisive.
La chaleur devenait intolérable. Le naphte enflammé l'asphyxiait. En cette extrémité, il n'adressait qu'une prière à Dieu : celle de ne mourir qu'après avoir tué Béjard.
Dieu l'exauça.
Au moment même où, à bout de forces, Paridael allait lâcher prise, ce qui restait des cartouches fit masse et détermina une explosion suprême. Les derniers vestiges de l'usine Béjard sautèrent. Une autre tulipe rose et noire s'épanouit dans les éclairs.
Deux ombres étroitement enlacées s'abattirent au milieu du lac de feu.
Pièce justificative
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE
Séance du 23 mai 1889.
Interdiction d'accoster un navire ou de se trouver à bord d'un navire, sans ordre de l'autorité ou sans autorisation du capitaine.
Rapport fait, au nom de la section centrale, par M. De Decker
Messieurs,
La section centrale, en présence de la concision extrême de l'Exposé des motifs, a désiré s'éclairer. Elle a, dans ce but, posé au Gouvernement une série de questions.
Les réponses à ces questions, en ce qui concerne le métier ou les métiers des « runners », les excès qu'on leur reproche, ont paru être empreints de quelque exagération, sinon il ne serait point compréhensible qu'un Gouvernement comme le nôtre, vigilant et soucieux du bon ordre, ne se soit ému que si tardivement, n'ait songé à proposer des mesures de répression que trente ans après que les premières plaintes s'étaient produites.
Il faut donc faire. Messieurs, la part de l'exagération, comme il importe aussi de faire la part de la rudesse de mœurs habituelle chez les marins et chez tous ceux qui sont en contact avec eux.
Le mal, du reste, est général dans toutes les contrées maritimes : l'Exposé des motifs ainsi que les réponses du Gouvernement aux questions de la section l'affirment.
Dans d'autres pays, ce mal doit avoir été plus grand qu'en Belgique, puisque les gouvernements de ces pays ont cru devoir précéder le nôtre dans la voie de la répression.
Avant de faire rapport de l'examen fait en section centrale du projet de loi et de dire le système auquel la section centrale s'est arrêté, il y a lieu de faire connaître les questions posées et les réponses faites par le Gouvernement.
D. – Le Gouvernement pourrait-il dire en quoi consiste en réalité le trafic des « runners » dont parle l'Exposé des motifs ?
R. – Les « runners » représentent une catégorie de trafiquants et de fournisseurs qui vivent de la clientèle des équipages, tels que racoleurs et enrôleurs de matelots, logeurs, bouchers, tailleurs, cordonniers, victuailleurs, etc.
Ceux qui font les métiers de logeur, d'embaucheur et d'enrôleur de matelots sont d'ordinaire des étrangers, des gens sans aveu ou mal famés. Il est de notoriété qu'ils exploitent les passions des marins avec une habileté et une effronterie sans pareilles.
En Angleterre, on les désigne sous le nom significatif de Land Sharks (requins de terre).
Le marin, surtout celui qui revient d'un long voyage, est une proie facile pour ces individus. On lui distribue des liqueurs, on lui fait une avance sur ses gages, et une fois débarqué, il est entraîné, sous prétexte de logement, dans un bouge quelconque. Là on le pousse à dépenser sans compter.
Lorsqu'il est complètement dépouillé, le matelot s'en remet aux enrôleurs du soin de lui trouver un nouvel embarquement pour lequel ils perçoivent encore une commission onéreuse.
Il arrive parfois aussi que les logeurs font déserter les marins, les cachent chez eux en ville, ou même à la campagne et les conduisent clandestinement, la nuit, à bord des navires en rivière, s'ils ne les expédient pas sur un port voisin.
Les logeurs, racoleurs et enrôleurs sont la lèpre do la marine marchande.
D. – Les abus qu'on veut réformer existent-ils depuis longtemps ou se sont-ils produits récemment ?
R. – De tout temps, les capitaines des navires de commerce, spécialement ceux arrivant d'un voyage au long cours ont eu à souffrir des « runners », mais jadis ceux-ci n'accostaient les navires qu'en rade ou dans les bassins.
C'est depuis 1867 que des plaintes sont venues au jour ; à cette époque, les « runners » ont commencé à se rendre au-devant des navires dans l'Escaut. Actuellement leur audace ne connaît plus de bornes ; ils vont à la rencontre des bâtiments, jusqu'à Flessingue. Ils montent à bord malgré les capitaines, insultent et menacent les officiers, qui veulent leur défendre l'accès du navire ; ils enivrent les équipages dans te but d'obtenir la préférence pour le logement, la vente d'effets d'habillement, etc.
D. – Comment le Gouvernement a-t-il pu se convaincre de la réalité des faits qui ont donné lieu à des plaintes ?
R. – Comme il est dit dans la réponse a la question précédente, c'est en 1867 que l'attention du Gouvernement a été attirée, pour la première fois, sur le trafic des « runners », par une plainte émanant d'une cinquantaine de petits commerçants d'Anvers.
Les pétitionnaires reconnaissaient qu'ils se trouvaient parfois au nombre de plus de cinquante à bord d'un navire, entravant les manœuvres et faisant aux gens de larges distributions d'alcool dans l'espoir d'avoir leur clientèle. Ils demandaient instamment que, pour faire cesser cet abus, on défendit de monter à bord avant l'arrivée du navire à destination.
Des capitaines étrangers, au nombre d'une trentaine, ont appuyé cette pétition.
Les commerçants établis dans les environs des bassins protestèrent de leur côté, en 1868, contre les abus résultant de la tolérance laissée aux « runners » de monter à bord des navires en route. Ils déclaraient que les bâtiments du commerce étaient parfois encombrés, avant d'atteindre le port, de plus de cent personnes étrangères et que dans le nombre se glissaient même des femmes de mœurs douteuses. Cette pétition fut appuyée par le collège échevinal.
Mais c'est en 1886 et 1887 que les plaintes sont devenues particulièrement vives. Un grand nombre de capitaines, à leur arrivée à Anvers, ont saisi le consul général d'Angleterre de protestations très énergiques contre les agissements éhontés des « runners ». Il suffira d'en extraire quelques faits, pour montrer le degré d'impudence où sont arrivés ces trafiquants.
En juin 1880, un navire, en route pour Anvers, est assailli dans l'Escaut par douze à quinze « runners » qui montent à bord malgré les menaces du capitaine et qui, à leur arrivée à Anvers, semblent s'être vantés d'avoir réalisé un bénéfice de 1.500 francs sur le navire. Le plus malmené fut un vieux marin de soixante ans dont l'avoir se montait à 800 francs et qui, après dix jours, avait tout dépensé.
Le 15 mars 1887, une barque est envahie par des « runners » malgré tous les efforts que fait le capitaine pour les écarter. À peine sur le pont, les « runners » se battent entre eux à coups de bâton, de barres de fer, de couteau. La lutte finie, ils se répandent parmi l'équipage avec les bouteilles de gin dont ils sont munis ; en moins d'une demi-heure, tous les hommes du bord sont ivres morts ; aucun d'eux n'est plus capable du moindre travail ; le capitaine et les officiers sont contraints de se mettre eux-mêmes à la besogne, ils n'ont plus personne pour les aider.
D. – Les plaintes dont parle l'Exposé des motifs n'ont-elles pas donné lieu à une enquête ?
Si oui, le Gouvernement ne pourrait-il communiquer à la section centrale le dossier de cette enquête ?
R. – Les plaintes qu'ont provoquées les « runners » n'ont pas donné lieu à une enquête proprement dite.
Mais l'administration a tenu à s'assurer, à différentes reprises, de leur bien-fondé et elle a chargé le commissaire maritime du port et l'inspecteur du pilotage d'examiner la situation.
En 1880, le commissaire maritime s'exprimait en ces termes :
« Chaque fois qu'un navire arrive à Anvers d'un voyage au long cours, une quantité considérable de personnes se rendent à bord, telles que logeurs, tailleurs, enrôleurs, commis de courtiers, etc., etc., chacun pour recommander son article.
Il arrive souvent qu'une catégorie de ces personnes, telles que les logeurs, se munissent de liqueurs alcooliques pour régaler l'équipage et débaucher les matelots et mettent ainsi le capitaine et le pilote dans l'impossibilité de faire exécuter les manœuvres nécessaires. Bien des fois mon concours a été réclamé par les capitaines à leur arrivée pour faire débarquer cette nuée d'oiseaux de proie, qui empêchent même la circulation sur le pont, tellement ils sont nombreux. Le fait s'est présenté ici en rade qu'un capitaine a dû faire feu pour éloigner de son bord ces importuns visiteurs. »
En 1886, l'inspecteur du pilotage formulait un rapport dans lequel on lit ce qui suit :
« L'acharnement que mettent les « runners » de toutes catégories à se faire la concurrence ne connaît plus de bornes et les pousse à commettre des abus, parmi lesquels celui qui consiste à enivrer les équipages est certes un des plus graves. En effet, il a pour conséquence d'amener les hommes du bord à l’inexécution des ordres donnés par les pilotes, ce qui peut être une première cause de collisions ou d'échouements. »
Enfin, dans une lettre récente, le commissaire maritime d'Anvers expose de nouveau les pratiques auxquelles ont recours les « runners ».
« Ils sont, dit-il, ordinairement pourvus de boissons fortes avec lesquelles ils enivrent les marins dans le but d'obtenir la préférence pour le logement, la vente, etc., etc. Le cas se présente souvent que tout l'équipage est ivre à bord dans le moment difficile où le capitaine a besoin de ses hommes pour manœuvrer, pour accoster le quai ou pour entrer au bassin, ou pour mouiller en rade. »
D. – Le capitaine n’est-il pas suffisamment maître à son bord pour empêcher les abus qui se produisent ?
R. – Quand un navire est assailli par les « runners », il est fort difficile, sinon impossible au capitaine de conserver assez d'autorité pour interdire l'accès du bord ; les « runners » sont toujours en nombre, ils s'accrochent avec leurs canots aux flancs du navire, et assurés qu'ils sont de l'impunité, ne reculent ni devant les injonctions, ni devant les menaces.
Il ne resterait au capitaine que d'avoir recours aux armes à feu pour faire respecter son autorité, moyen extrême – on le comprendra – qu'il hésite à employer. D'ailleurs les matelots, qui n'ignorent pas que ces gens viennent leur apporter des liqueurs fortes et leur offrir leurs services, n'exécutent que mollement les ordres, de sorte que le capitaine est impuissant.
Un fait survenu en 1868 montrera à quel point un capitaine est peu maître à bord de son navire, dès que celui-ci est envahi par les « runners ». À cette époque, le navire Arcilla fit son entrée dans les bassins d'Anvers. À peine s'y trouvait-il, qu'il fut assailli, et cela en pleine ville, par quantité de « runners ». Le capitaine voulut les obliger à déguerpir, ils s'y refusèrent et l'un d'eux frappa même cet officier. Exaspéré, celui-ci prit son revolver et fit feu sur la foule ; un cordonnier fut blessé.
[1] Empoisonnements. Un vénéfice était un empoisonnement par sorcellerie, historiquement.
[2] Travail qu'un capitaine ou un armateur peut exiger des matelots d'un autre navire quand ils sont inoccupés, à titre de corvée et sans rétribution, pour charger ou décharger des marchandises.
[3] Tablier d'enfant, d'écolier, à manches longues et boutonné par derrière. Orthographe commune : sarrau.
[4] Apathique, fainéant.
[5] Voir l’Autre Vue
[6] Il convient de faire remarquer ici que ce livre fut écrit avant l’introduction en Belgique du service militaire obligatoire et personnel. La même observation s’applique à d’importants passages de la troisième partie de cet ouvrage, notamment au chapitre intitulé Contumance. G.E.
[7] La Bourse d’Anvers brûla dans la nuit du 2 août 1858.
[8] Voir les Nouvelles Kermesses : la fête des saints Pierre et Paul.
[9] Voir, dans Kees Doorik, la troisième partie.
[10] Voir les Fusillés de Malines.
[11] Vennes, meers, étangs et mares de la Campine ; scaddes, feux de bruyère et de branches de sapins.
[12] Voir la Faneuse d’Amour.
[13] Voir la Faneuse d’Amour.
[14] Voir « le Tribunal au Chauffoir » dans le Cycle Patibulaire.
[15] Voir dans les Nouvelles Kermesses « Chez les Las d’Aller ».
[16] Voir l’Autre Vue.
[17] Voir dans les Nouvelles Kermesses « Chez les Las d’Aller ».
[18] Le Kattendijk-Dok mesurait neuf hectares, le grand vieux Bassin sept, représentant ensemble une superficie d’eau de cent soixante mille mètres. Inaugurés en 1869, deux ans après, ces bassins étaient insuffisants, car pendant les mois de février et de mars 1871, près de trois cent cinquante navires furent forcés de rester échelonnées sur une ligne immense dans la rivière.
[19] Voir dans les Nouvelles Kermesses « Bon pour le service »
[20] Voir la Faneuse d’amour.
[21] Voir dans le Cycle patibulaire « le Quadrille du Lancier »
[22] Voir dans les Nouvelles Kermesses « Dimanches mauvais »