
Cdt Adrien de Gerlache de Gomery
QUINZE MOIS DANS L’ANTARCTIQUE
L’EXPÉDITION DE LA BELGICA (1897-1899)
(1902)
À la mémoire de mon père,
Le lieutenant-colonel de Gerlache de Gomery.
PRÉFACE
Dans ce volume, M. de Gerlache, qui est un candide autant qu’un résolu, nous raconte avec une touchante modestie la récente expédition du navire la Belgica dans les eaux de l’Antarctide. Ce ton d’effacement généreux ajoute à l’œuvre un charme de plus, mais les amis de l’auteur ont le droit de tenir un autre langage et d’insister avec énergie sur la valeur très grande de ce voyage mémorable. M. de Gerlache est récompensé, par les travaux accomplis, de la persévérance vraiment héroïque avec laquelle, pendant les longues et pénibles années de sa jeunesse, il recueillit sou à sou les faibles ressources strictement indispensables à son entreprise. Elles ont suffi à faire de grandes choses et l’exploration de la Belgica précède très dignement celles que l’on vient de doter d’une façon si généreuse pour inaugurer les découvertes du XXe siècle.
Tout d’abord, constatons le fait qui devra de siècle en siècle ramener le nom de la Belgica parmi ceux des navires qui visitèrent les terres australes : M. de Gerlache et ses vaillants compagnons sont parmi tous les hommes les premiers qui aient hiverné dans la zone glaciale du Sud au-delà du cercle polaire. Pendant treize longs mois ils ont vécu, ou plutôt ils ont réussi à garder le souffle et le mouvement, dans la grande prison de glace, dans la banquise qui dérivait deçà et delà au-devant des terres présumées du continent antarctique. N’ayant pas eu la chance de trouver, soit la mer libre, soit un promontoire favorablement situé, qui leur permît de passer le long hiver en de meilleures conditions d’économie vitale, il leur fallut rester dans leur navire, mordus par la mâchoire de glace, entendre sans cesse le craquement des flardes entrechoquées, la rumeur sourde de tout cet univers de fraisis cristallin qui se brise et se regèle, participer jusque dans la moelle des os à tous les chocs que subissait la membrure* du navire, travailler constamment à le dégager des situations périlleuses, lui éviter le heurt des blocs et des monts de glace, et s’accommoder le moins mal possible à ce va-et-vient de la dérive*, qui les promena en ligne brisée sur un espace de deux mille kilomètres.
Il est vrai que les navigateurs n’ont pas dépassé vers le sud la latitude de 71° 36’, mais cette question d’ordre kilométrique est des plus secondaires en comparaison des observations et des recherches qu’ils ont faites sur les divers phénomènes du milieu où ils ont vécu.
Un premier problème à étudier était celui des relations de structure que présentent la pointe méridionale du continent sud-américain et la “terre de Graham”, ainsi qu’on appelle provisoirement la saillie de l’Antarctide présumée, s’avançant au nord dans la direction de la Terre de Feu. Les Andes continuent-elles leur longue épine vers les terres australes, qui se rattacheraient, en conséquence, à l’ensemble continental du Nouveau Monde ? Nombre de géographes pensaient qu’il en était ainsi, mais les sondages faits par les savants de la Belgica nous prouvent qu’il n’en est rien. On a jeté la sonde jusqu’à la profondeur de quatre mille quarante mètres dans le “détroit de Drake”, cette mer qui s’étend au sud de la Terre de Feu et de son cortège d’îles : un large lit s’ouvre donc en cet endroit entre les deux bassins de l’Atlantique et du Pacifique. Sur la carte publiée par M. de Gerlache, la forme de la cuvette sous-marine se montre avec la chute brusque du socle américain et la pente graduelle des terres immergées qui se relèvent au sud vers les îles ou le continent de l’Antarctide. S’il existe entre les deux océans un seuil que l’on puisse considérer comme un prolongement des Andes, il doit se trouver très à l’est du détroit de Drake et se rattache peut-être aux chaînes volcaniques des Orkney du Sud et des Sandwich.
Grâce à l’expédition de la Belgica, la cartographie des archipels qui s’élèvent du fond de ce détroit de Drake gagne beaucoup en précision. Les Shetland du Sud, que pourtant des pêcheurs avaient déjà visitées par milliers sans en indiquer la véritable forme, ont pris des contours plus arrêtés et plus sûrs pour la navigation. De même, tout à fait au sud, les parages antarctiques où l’on dessinait récemment la terre de Walker, présentent un aspect nouveau sous la calotte du cercle polaire.
Les observateurs ont aussi mis hors de doute un fait d’ordre capital dans l’histoire géographique moderne de la planète. Les terres qu’ils ont visitées portent toutes des traces d’une extension antérieure des glaciers. Les rivages de la Terre de Feu présentent en maints endroits des roches moutonnées et des moraines provenant de glaciers disparus ; l’île des États, qui n’a plus un seul champ de glace, offre sur tout son pourtour les marques d’un ancien revêtement de neiges et de névés ; enfin des terres antarctiques elles-mêmes se trouvent évidemment dans la période du recul des glaces : la calotte australe eut aussi des âges plus “glaciaires” que de nos jours, de même que la calotte boréale et, probablement, à la même époque.
Quant au théâtre spécial des découvertes de la Belgica, le détroit qui portera désormais le nom glorieux de l’explorateur a été parcouru en long et en large avec le plus grand soin, dans tout son développement d’environ deux cents kilomètres, du nord-est au sud-ouest. Les îles qui se succèdent, à droite et à gauche, ont été mesurées et dénommées, les formes en ont été fixées par des milliers de dessins et de photographies, les contours en ont été relevés exactement, et même on a pu obtenir par le sondage une profondeur du chenal, à six cent vingt-cinq mètres. Les naturalistes de l’expédition ont étudié avec ardeur les divers phénomènes des neiges et des glaces, banquises, rondelles, flardes et dalles*, bourguignons*, toroses, masses tabulaires d’arrachement, blocs irréguliers ; ils ont observé surtout la riche faune du détroit, où des myriades d’organismes infiniment petits colorent l’eau des nuances les plus délicates, où l’on entend sans cesse ronfler le souffle profond des cétacés, où sur mainte pente éblouissante de neige on voit s’allonger les masses noires des phoques ; où des familles prodigieuses de pingouins, d’espèces différentes, ont établi leurs campements, les uns vivant en communautés parfaites, modèles d’existence noble, harmonieuse et paisible, tandis que d’autres, toujours rageurs et furieux, se disputent à coups de bec les limites de leur étroite propriété. Les algues du détroit et la flore avare des rivages encombrés de neiges et de glaces, des lichens, des mousses et seulement une humble graminée, représentant tout le monde supérieur des végétaux, seront aussi figurés et décrits dans les ouvrages de grand luxe que publieront bientôt les membres de l’expédition.
Ce n’est pas tout : M. de Gerlache et ses compagnons ont également pensé à leurs successeurs. De part et d’autre, ils ont étudié les plages et les promontoires pour y chercher les emplacements de stations où pourront s’établir utilement les explorateurs futurs. Car ces parages, jadis lointainement entrevus, puis explorés maintenant en détail, seront un jour, sinon habités, du moins visités, explorés à nouveau, utilisés à l’occasion pour des recherches spéciales, et puis pour lieux de séjour dans les grandes expéditions internationales faites sur divers points du globe pour l’étude des principaux phénomènes terrestres ou pour l’observation des astres. Le détroit de Gerlache offre aux savants futurs une station placée de dix degrés plus au sud que toutes celles qu’on utilisa précédemment pour ces études collectives.
Ainsi la surface connue de la Terre va s’accroissant chaque année. Dans ces parages qui s’étendent au sud de l’Amérique, voici la Terre de Feu déjà complètement annexée au domaine économique de l’homme policé, mais à un prix bien douloureux, le sacrifice des habitants primitifs, que les balles ont décimés et que la phtisie dévore. Puis, au loin dans la mer, la montueuse et tempétueuse île des États où, du moins, une station de sauvetage, San Juan del Salvamento, a pu arracher de nombreux navires à une destruction totale. Encore plus loin dans le sud et déjà dans le groupe des archipels de l’Antarctide, se montrent les îles Shetland du Sud, déjà trop visitées par les pêcheurs, puisque, sans aucun souci de la durée des espèces, ils viennent y tuer par centaines de milliers les phoques à fourrure, à l’époque de la parturition, en massacrant tout ce qu’ils trouvent devant eux ; une station de sauvetage, que le gouvernement argentin doit établir prochainement dans cet archipel, rachètera quelque peu ce crime des exterminations. Maintenant, les terres nouvelles, visitées par M. de Gerlache et ses compagnons, apparaissent à leur tour par-dessus l’horizon du Sud et convient l’homme à les utiliser, ne fût-ce que pour accroître sa connaissance de la Terre et de ses phénomènes !
C’est là une grande conquête, pour laquelle nous devons toute reconnaissance à ceux qui l’ont menée à bonne fin, et notre gratitude doit être d’autant plus émue que le voyage a coûté de précieuses vies, données généreusement au service de l’humanité, celles du matelot Wiencke, emporté par les vagues, et du géodésien Danco, mort d’épuisement à son labeur. Ces hommes, dignes de celui qui leur donnait l’exemple du dévouement, ont été parmi les heureux, puisque leur œuvre fut bonne.
ÉLISÉE RECLUS
Les gravures ont été faites d’après les photographies de MM. Arctowski, Cook, Danco, de Gerlache, Lecointe, Albéric Lunden, Racovitza. Les longitudes sont comptées, sauf spécification contraire, à partir du méridien de Greenwich. Les températures sont exprimées en degrés centigrades.
INTRODUCTION
LES EXPÉDITIONS QUI ONT PRÉCÉDÉ CELLE DE LA BELGICA AUX RÉGIONS ANTARCTIQUES
SUD-AMÉRICAINES
L’Antarctique ! Est-il une dénomination géographique évoquant moins d’idées précises ? Quelques lignes pointillées, des ébauches de contours, voilà tout ce que les cartes les mieux à jour mettent sous les yeux. On pourrait croire que cette zone déserte et inhospitalière a rebuté les navigateurs, alors qu’au contraire ils ont, sur tout son pourtour, multiplié leurs tentatives. C’est de ces efforts, fructueux ou non, que je me propose de tracer ici l’historique sommaire, en me formant aux expéditions qui ont précédé celle de la Belgica dans les régions antarctiques voisines du méridien du cap Horn. Je voudrais ainsi à la fois familiariser le lecteur de ce livre avec les parages où il devra nous suivre, lui faire mieux comprendre le but et l’intérêt de l’Expédition antarctique belge, enfin – pourquoi ne pas l’avouer ? – lui montrer, par l’exemple de nos hardis devanciers, quels étaient les périls et les difficultés de notre tâche.
Pour la clarté de cet exposé, je serai forcément amené à suivre, en dehors des limites que je me suis assignées, des navigateurs qui firent des voyages circumpolaires ; mais j’abrégerai autant que possible tout ce qui ne se rapportera pas directement au “secteur antarctique sud-américain”.
Dès une époque reculée, on a cru à l’existence d’un continent s’étendant autour du pôle Sud et nécessaire – affirmaient les philosophes et les géographes, qui lui assignaient de vastes proportions – à l’équilibre du monde.
Les hypothèses et les théories les plus hardies et les plus fantaisistes ont été émises à cet égard ; nous ne les passerons pas en revue, car cela nous entraînerait loin, et, laissant de côté la fiction, nous aborderons immédiatement l’histoire des voyages effectués vers les régions qui nous intéressent ici.
Nous verrons ainsi que la première découverte antarctique date de trois siècles déjà et que cette découverte, toute fortuite d’ailleurs et à peine relatée, fut faite par un marin néerlandais.
À cette époque, les Hollandais venaient de nouer de fructueuses relations commerciales avec les Indes orientales.
Plusieurs expéditions, équipées par des marchands d’Amsterdam, avaient accompli avec succès le périlleux voyage des Indes par le cap de Bonne-Espérance. Stimulés par cet exemple, et aussi par les conseils du cosmographe belge Pierre Plane, des négociants de Rotterdam résolurent d’équiper à leur tour une escadre qui gagnerait les Indes, non plus par la route du Cap, mais par celle qu’avait tracée Magellan. Ils s’unirent, à cet effet, sous la raison sociale “Compagnie de Pierre Verhagen”.
Armée en guerre, comme l’étaient à cette époque troublée toutes les expéditions commerciales, l’“Expédition des cinq navires de Rotterdam” comportait un effectif de cinq cents hommes, marins et soldats, placés sous le commandement supérieur de l’amiral Jacques Mahu[1] et du vice-amiral Simon de Cordes.
Des cinq bâtiments de cette escadre, il en est un qui nous intéresse tout particulièrement : le yacht Blyde Boodschap. Ne jaugeant que soixante-quinze tonnes, c’était le plus petit de la flottille ; il portait cinquante-six hommes d’équipage commandés au début de la campagne par Sebald De Weert.
Le 26 juin 1598, l’escadre mettait à la voile à la Brille : ce n’est que le 6 avril de l’année suivante, après de pénibles vicissitudes et avec des équipages déjà décimés par les maladies, que les cinq navires donnèrent dans* le détroit de Magellan.
L’amiral Jacques Mahu avait succombé peu après le passage de la Ligne et avait été remplacé dans le commandement supérieur par Simon de Cordes. Appelé au commandement d’un autre navire de l’escadre, le Trouw, De Weert avait remis celui du yacht à Dirck Gherritz, marin expérimenté, qui avait déjà fait, à bord de bâtiments portugais, le voyage du Japon.
Le 6 avril donc, l’escadre entrait dans le détroit de Magellan ; le surlendemain, elle franchissait le second goulet.
Elle ne tarda pas à être assaillie par des vents contraires, et Simon de Cordes décida d’hiverner dans le détroit. Cette fâcheuse détermination fut fatale à plus de cent hommes qui succombèrent aux rigueurs du climat.
À la fin d’août, on appareillait de nouveau, et, le 3 septembre, on entrait dans le Pacifique.
Des gros temps survinrent presque aussitôt et la flottille subit de sérieuses avaries. Le Blyde Boodschap fut désemparé et ce fut à grand-peine qu’on le remit en état. Enfin, le 10 septembre, une tempête du nord-ouest dispersa l’escadre, et le Blyde Boodschap, jeté hors de sa route, atteignit le 64e parallèle sud, où Dirck Gherritz aperçut une terre présentant des montagnes élevées, couvertes de neige, “comme dans le pays de Norvège”. Cette terre faisait vraisemblablement partie de l’archipel que nous avons visité avec la Belgica, en 1898.
Gherritz parvint à regagner une latitude plus clémente et, quelque temps plus tard, il mouillait dans la baie de Valparaíso, n’ayant plus à son bord que neuf hommes valides.
Reçu à coups de mousquets par les colons espagnols, il fut grièvement blessé et fait prisonnier, tandis que son navire était saisi.
Les autres vaisseaux ne furent guère plus heureux que le Blyde Boodschap et, de cette flotte brillante dans laquelle on avait mis tant d’espérance, seul le Trouw revint en Hollande.
Après avoir été séparé de ses conserves, il était entré dans le détroit de Magellan pour regagner l’Europe. À quelque distance dans l’est du cap des Vierges, De Weert découvrit, le 24 janvier 1600, trois petites îles qu’il plaça par 50° 40’ S, à environ soixante lieues du continent, et auxquelles il donna le nom de Sebaldines. Elles faisaient partie du groupe qui devait recevoir, par la suite, les noms de Malouines et de Falkland[2].
Dans la relation hollandaise de l’expédition de Pierre Verhagen, il n’est fait aucune allusion à la découverte fortuite de Dirck Gherritz ; elle ne figure pas davantage sur les cartes publiées, en Hollande, à cette époque. Le premier géographe qui l’ait mentionnée est Gaspar Van Baerle, qui joignit à la traduction latine qu’il publia, en 1622, de la Historia general de las Indias Occidentales, de Herrera, un résumé des voyages faits au détroit de Magellan.
Le privilège octroyé par les États généraux à la Compagnie hollandaise des Indes orientales interdisait à tous autres marchands et habitants des Provinces-Unies de naviguer vers les Indes, soit par l’orient du cap de Bonne-Espérance, soit par le détroit de Magellan. Ce privilège, faut-il le dire, excitait l’envie des “autres marchands”.
Isaac Lemaire, Tournaisien de naissance, mais établi à Amsterdam depuis 1585, séduit par l’idée de la recherche du passage du Sud-Ouest préconisé par Plane, s’en entretint avec le pilote Wilhelm-Cornelius Schouten, qui jouissait d’une grande réputation de hardiesse et d’habileté.
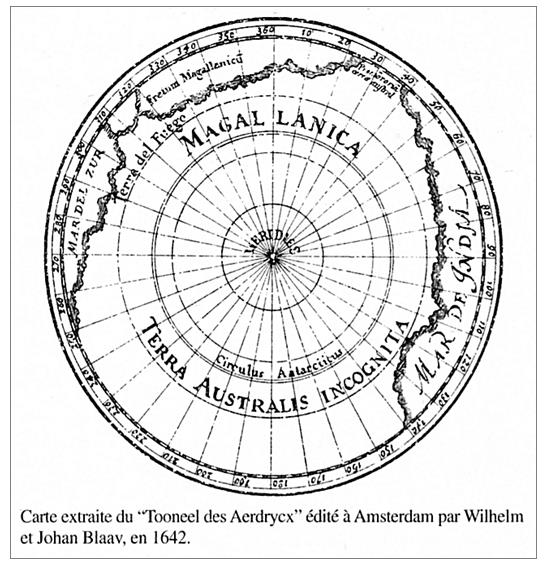
Schouten mit dans le secret quelques-uns de ses concitoyens de Hoorn, et recueillit parmi eux une somme qui, jointe à celle qu’Isaac Lemaire avait lui-même sacrifiée, suffisait pour défrayer une expédition.
Deux navires furent équipés : le Eendracht, trois-mâts monté par soixante-cinq hommes et une fuste*, nommée le Hoorn, montée par vingt-deux hommes. Cornélius Schouten prit le commandement du trois-mâts ; on confia celui de la fuste à Jacob Lemaire, fils du promoteur et principal bailleur de fonds.
L’objet de l’expédition n’avait pas été ouvertement avoué ; ceux qui s’étaient intéressés à l’entreprise avaient formé entre eux la “Compagnie australe” ; la destination des navires restait secrète pour ceux mêmes qui s’y enrôlaient et qui s’engageaient “à naviguer partout où on les conduirait”.
Les deux navires prirent la mer le 14 janvier 1615 ; ce n’est que le 25 octobre, quelques jours après le passage de la Ligne, que Lemaire et Schouten informèrent leurs équipages du but réel du voyage.
En décembre, les deux bâtiments furent conduits à Port-Desire, en Patagonie, pour être abattus en carène et nettoyés.
Au cours de cette opération, le feu prit au Hoorn, qu’il fut impossible de sauver. Son équipage passa à bord de l’Eendracht et, au commencement de janvier, on remit à la voile.
Le 24 janvier 1616, après avoir dépassé l’entrée du détroit de Magellan, on embouquait* dans un nouveau détroit séparant la Terre de Feu d’une terre nouvelle qu’on baptisa du nom de Terre ou Païs des États, en l’honneur des États généraux, tandis qu’on donnait au nouveau passage le nom de Lemaire.
Le 29 janvier, les Hollandais découvrirent encore deux îles, qu’ils laissèrent à tribord – les îles Barnevelt – et plus loin, un promontoire élevé qu’ils nommèrent le cap Hoorn[3].
Continuant à s’élever dans le Sud, ce n’est que lorsqu’ils eurent atteint le 59e parallèle qu’ils firent route vers les Indes.
Deux années s’étaient à peine écoulées depuis les découvertes de Schouten et Lemaire que l’Espagne équipait une expédition pour aller reconnaître le nouveau passage. Le commandement en fut confié aux frères de Nodal qui engagèrent quelques pilotes hollandais.
Les navigateurs espagnols découvrirent, au sud-ouest du cap Horn, les îles Diego Ramirez ; puis ils accomplirent le périple de la Terre de Feu.
Cependant la première expédition qui ait étudié la partie méridionale de la Terre de Feu avec quelque précision est celle commandée par Jacob L’Hermite et montée sur les onze navires réunis sous la dénomination de “flotte de Nassau” (1623-1626).
Tandis qu’Abel Jansen Tasman, ayant découvert la Nouvelle-Zélande, la baptisait du nom de terre des États, dans la croyance qu’elle était rattachée à la terre vue par ses compatriotes Schouten et Lemaire, un autre Hollandais, Hendrik Brower, était chargé par la Compagnie hollandaise des Indes occidentales d’une nouvelle croisière dans le Pacifique. Se trouvant, le 5 mars 1643, à l’entrée septentrionale du détroit de Lemaire, il fut favorisé par un temps si clair qu’il vit la terre des États tout entière et s’aperçut qu’au lieu d’être une partie d’un vaste continent, ce n’était, en réalité, qu’une petite île.
Les vents n’étant pas favorables au passage du détroit de Lemaire, Brower résolut de poursuivre sa route vers le cap Horn en contournant l’île par l’est, ce qu’il put faire sans encombre.
Trente-deux ans se passent. En 1675, un marchand nommé Anthony La Roche, né à Londres de parents français, poussé hors de sa route par les vents et les courants, découvre à son retour du Pacifique, loin à l’est de l’île des États, une île qui doit être identifiée avec celle que Cook baptisa plus tard du nom de Géorgie du Sud.
La même année, un navire marchand espagnol, le León, fit le périple de cette île à laquelle il donna le nom de San Petro.
Toutes ces découvertes furent dues au zèle commercial servi par le hasard ; c’est seulement à l’époque où nous sommes arrivés que nous nous trouvons en présence de projets d’expéditions à tendances plus nettement géographiques.
Dès 1669, le Zélandais Roggewein avait remis à la Compagnie des Indes occidentales un mémoire relatif à la découverte de terres australes. Ce mémoire fut favorablement accueilli et la puissante compagnie allait équiper des vaisseaux pour y donner suite, quand survinrent, selon l’expression pittoresque d’un contemporain à qui nous devons ces détails, des “brouilleries” entre l’Espagne et les Provinces-Unies.
Peu avant sa mort, Roggewein exhorta son fils Jacob à ne pas abandonner son projet.
Jacob Roggewein ne parut pas, tout d’abord, y attacher beaucoup d’attention, car, à la mort de son père, nous le voyons se consacrer entièrement à l’étude du droit et aller ensuite aux Indes orientales, en qualité de conseiller à la Cour de justice ; mais nous le retrouverons plus tard fidèle au projet paternel.
Sur ces entrefaites, Guillaume III d’Angleterre donne, en 1699, une commission de capitaine au célèbre astronome Halley, auquel il confie le commandement du Paramon Pink, pour faire une expédition dans le but de perfectionner les moyens de détermination des longitudes en mer, d’étudier les variations du compas* et de découvrir les terres inconnues qu’on suppose exister dans l’Atlantique austral.
Mais les officiers et matelots placés sous ses ordres, méconnaissant l’autorité de ce capitaine d’occasion, refusent de lui obéir et deviennent à ce point insolents et intraitables qu’il doit rentrer en Angleterre sans avoir accompli sa tâche.
En 1708, le célèbre boucanier* William Dampier, âgé déjà de cinquante-six ans, terminait sa brillante carrière par un dernier voyage de circumnavigation, non plus en qualité de chef, mais comme pilote du Duke et de la Duchess, que des marchands de Bristol avaient armés pour donner la chasse aux croisières espagnoles dans les mers du Sud et que commandaient Woodes Rogers et le créole Cook.
Partie de Cork, le 1er septembre, la flottille atteignit les Falkland en décembre et, après avoir été drossée* par les vents contraires jusqu’au 62e parallèle en doublant le cap Horn, elle arriva, en janvier 1709, à Juan Fernández. Quatre ans plus tôt, Alexandre Selkirk (Robinson Crusoé) avait été abandonné dans cette île déserte par le capitaine Stradling. Woodes Rogers, Cook et Dampier l’y trouvèrent, et Selkirk, embarqué à bord du Duke, y remplit les fonctions de second maître.
Après de fructueuses croisières sur les côtes du Pérou, du Mexique et de la Californie, les deux bâtiments traversèrent le Pacifique pour rentrer enfin dans la Tamise, en 1711, avec un butin de cent cinquante mille livres sterling.
Le succès de cette expédition poussa quelques marchands de Londres à profiter, en 1718, de la guerre engagée entre l’Allemagne et l’Espagne pour organiser, avec une commission spéciale de Charles VI, une nouvelle croisière contre les navires et les établissements espagnols du Pacifique.
Deux vaisseaux furent équipés à cet effet dans la Tamise : le Success de trente-six canons et le Speedwell de vingt-quatre pièces ; débaptisés, ils devinrent le Prince Eugène et le Stamenberg.
Ce dernier fut envoyé à Ostende sous les ordres de Georges Shelvocke pour y enrôler des officiers et des matelots flamands, et recevoir la commission impériale.
Mais la Grande-Bretagne ayant, sur ces entrefaites, déclaré elle-même la guerre à l’Espagne, les marchands londoniens résolurent de se livrer à la course sous leur propre pavillon ; les navires reprirent leurs premiers noms et les marins flamands furent licenciés.
Le Success et le Speedwell quittèrent Plymouth le 19 février 1719 ; le 25, ils essuyèrent une violente tempête qui les sépara jusqu’à leur arrivée dans le Pacifique.
Sans plus nous occuper du Success, dont le voyage n’offre rien de remarquable au point de vue qui nous intéresse ici, suivons le Speedwell que commandait le capitaine Shelvocke. Nous le retrouvons aux Canaries le 17 mars, deux jours après le départ de sa conserve qui, le croyant perdu, avait quitté ce premier rendez-vous après dix jours d’attente.
Les îles du Cap-Vert avaient été fixées comme second point de ralliement, mais les capitaines ne parvinrent pas davantage à s’y joindre.
Après avoir attaqué et pillé un vaisseau portugais sur les côtes du Brésil, Shelvocke entra dans le détroit de Lemaire pour doubler le cap Horn. Mais il eut à essuyer de si violentes tempêtes que son navire fut drossé jusqu’à une haute latitude australe (?).
C’est cet incident, croit-on, qui inspira à Coleridge ces beaux vers :
And now the storm blast came,
The ship drove fast, loud roar’d the blast,
And southward aye we fled ;
And now there came both mist and snow,
And it grew wondrous cold,
And ice mast high came floating by
As green as emerald.
Enfin, vers le milieu de novembre, Shelvocke reconnut la côte ouest de l’Amérique du Sud et, le 30 du même mois, il mouillait à Chiloé.
Peu après, le boucanier commençait ses déprédations…
C’est maintenant que nous allons retrouver Jacob Roggewein. Rentré en Hollande, il avait repris le projet de son père, et, en 1721, il présentait à son tour à la Compagnie des Indes occidentales un mémoire relatif à la découverte de terres australes.
Les conclusions de ce mémoire ayant reçu l’approbation de la puissante Compagnie, des ordres furent donnés pour la mise en état de trois vaisseaux : l’Aigle, le Tienhoven et la Galère d’Afrique.
Ils portaient respectivement trente-six, vingt-huit et quatorze pièces d’artillerie, cent onze, cent et soixante hommes d’équipage, sous les ordres des capitaines Koster, Jacques Bauman et Henri Rosenthal.
L’Aigle battait le pavillon de l’amiral Roggewein.
Le 21 août 1721, la petite escadre quittait le Texel.
À la hauteur des Canaries, elle fut attaquée par des pirates qu’elle mit en fuite après deux heures de combat. Suivant les instructions qui étaient données aux capitaines des Compagnies hollandaises des Indes orientales et occidentales, on ne leur donna pas la chasse et Roggewein resta sur la défensive. Cette affaire lui coûta une douzaine de morts et quelques blessés.
Dans le cours de la navigation qui suivit, plusieurs hommes souffrirent du scorbut, mais tous se rétablirent à l’approche des côtes du Brésil.
Après avoir ancré sur ces côtes pour renouveler sa provision d’eau, Roggewein se mit à la recherche de la terre connue alors sous le nom de Hawkins’s Maidenland.
L’intention de Roggewein était d’y établir une station qui, tout en servant de base pour l’exploration des terres australes, devait permettre du même coup à ses compatriotes d’éviter à l’avenir de faire aiguade* sur les côtes soumises à la domination portugaise.
Ses recherches furent d’abord vaines.
Le 21 décembre se produit pour Roggewein ce qui a tant de fois déjà contrarié la navigation de ses prédécesseurs : coups de vent (par 40° environ de latitude australe), dispersion de la flottille ; le Tienhoven, fuyant devant la bourrasque, disparaît…
À la hauteur du détroit de Magellan, les navigateurs découvrent la côte orientale d’une isle qui a deux cents lieues de circuit, éloignée des côtes de l’Amérique d’environ quatre-vingts lieues. Ils l’appellent Belgia Australis, alors que c’était en réalité la terre qu’ils cherchaient.
“Cette isle, dit un des compagnons de Roggewein, paraissait un païs très beau et très fertile…, mais notre amiral ne voulut pas perdre de tems parce que ce retardement auroit pu causer des obstacles à passer le Cap de Horn ; ainsi il voulut différer cette recherche jusqu’au retour des Terres Australes…”
L’expédition ayant pris, au retour, la route des Indes orientales, ce projet ne fut point exécuté.
En quittant cette Belgia Australis, l’escadre cingla vers le détroit de Magellan pour y attendre des vents favorables. Puis on mit le cap au sud pour franchir le détroit de Lemaire.
“Ce passage, dit encore l’auteur précité, se fit à cause du courant d’eau d’une vitesse incroïable.
On poussa jusque vers la hauteur de soixante-deux degrés et demi, et là les navigateurs hollandais eurent, pendant trois semaines de suite, des tempêtes terribles d’Ouest, accompagnées de grêle, de neige et de froid… Nous appréhendâmes, continue notre auteur, que la violence des tempêtes pendant les brouillards ne poussât nos vaisseaux dans les glaces ; dans ce cas-là, il eût été presque impossible d’échapper au naufrage…
La grande quantité d’oiseaux que nous vîmes ici, aussi bien que la force des courants, nous firent présumer que nous ne devions pas être fort éloignés de quelque terre…”
L’Aigle et la Galère d’Afrique gagnèrent enfin l’océan Pacifique.
À Juan Fernández, Roggewein eut la joie de retrouver le Tienhoven qui, séparé de ses conserves pendant l’ouragan du 21 décembre, avait atteint le Pacifique par la voie de Magellan.
Poursuivant sa route vers l’ouest, sans tenter une nouvelle pointe vers le sud, Roggewein découvrit l’île de Pâques, déjà reconnue par Davis, et qu’il baptisa ainsi en souvenir de la date où il la vit surgir des eaux désertes.
Les jours suivants furent marqués par la reconnaissance de plusieurs îles et aussi par la perte de la Galère d’Afrique.
Les deux autres bâtiments, dont les équipages avaient été décimés par le scorbut et de sanglants conflits avec les insulaires du Pacifique, parvinrent enfin à Java.
À Batavia, Roggewein eut le sort cruel de voir ses vaisseaux capturés par la Compagnie rivale des Indes orientales.
Les équipages rapatriés débarquèrent à Amsterdam, deux ans, jour pour jour, après leur départ.
Le 19 juillet 1738, un officier français, Bouvet, quittait Lorient avec deux frégates pour reconnaître la terre par 44° S et 5° O de Ténériffe, figurée sur d’anciennes cartes comme un promontoire du continent austral. Il ne trouva rien dans la position spécifiée ; mais, le 1er janvier 1739, étant par 54° 20’ S et 25° 47’ E de Ténériffe, il découvrit une terre dont il baptisa la pointe septentrionale du nom de cap Circoncision.
C’était une terre élevée et très escarpée, couverte de neige, et dont la côte était bordée de glace. L’état de la mer n’ayant pas permis à Bouvet d’y aborder en canot, il la quitta sans avoir pu déterminer si c’était une île ou une partie du continent austral.
Bien que cette découverte sorte des limites que nous avions assignées à cette étude, il nous a paru nécessaire de la mentionner parce qu’elle formera un des objectifs de la deuxième expédition de Cook, dont nous parlerons bientôt.
Avec le règne de George III s’ouvre en Angleterre une ère nouvelle, féconde en grandes découvertes.
Plus désireux d’accroître le domaine de la science que d’agrandir ses possessions, George III songe, dès son avènement, à organiser une expédition australe.
Profitant de la Paix de Paris pour mettre ses projets à exécution, il choisit comme chef John Byron et lui donne des instructions où les motifs qui l’ont inspiré se trouvent exprimés à peu près dans ces termes :
“Sa Majesté, prenant en considération que rien ne peut rejaillir sur la grandeur d’une nation et la dignité de la couronne, ni contribuer à l’accroissement des relations maritimes et commerciales, comme la découverte de contrées jusqu’ici inconnues ; qu’il y a des raisons de croire que des terres et des îles de grande étendue doivent se trouver entre le cap de Bonne-Espérance et le détroit de Magellan ; qu’enfin les îles Pepy et Falkland, bien qu’elles aient été découvertes et visitées par des navigateurs anglais, n’ont pas été si soigneusement examinées que nous ayons pu nous former sur elles un jugement exact ; estimant, en outre, qu’on ne saurait concevoir de circonstance plus propice à une telle entreprise qu’une époque de paix profonde comme celle dont nous jouissons, – a décidé que cette expédition se ferait maintenant.”
Byron eut sous ses ordres deux bâtiments qui quittèrent l’Angleterre le 17 juin 1764.
La croisière ne donna malheureusement pas les résultats qu’on en attendait et si l’on identifia la Pepy’s Island, de Cowley, avec le Maidenland, de Hawkins, on ne rapporta rien de nouveau qui étendît ou précisât les connaissances de la zone antarctique.
Mais cette tentative louable poussa, comme on va le voir, à de nouvelles investigations qui font époque dans les annales de la géographie.
Au point où nous sommes arrivés de l’histoire des découvertes australes, le grand problème qui, depuis des siècles, préoccupait les géographes, se posait encore dans toute son intégrité : existait-il ou non un continent austral et, s’il existait, était-ce, comme d’aucuns le prétendaient, une contrée aussi riche que vaste dont la possession devait assurer à ceux qui s’en rendraient maîtres plus de bien-être et de puissance que les conquêtes des Cortez et des Pizarre n’en avaient apportés à l’Espagne ?
Déjà, il est vrai, les contours de ce continent hypothétique avaient été circonscrits dans des limites plus restreintes que celles qu’on lui donnait au XVIe siècle.
Mais tous les navigateurs qui avaient été envoyés à la découverte de ce continent mystérieux, par le passage sud-ouest, s’étaient empressés de gagner la région tropicale aussitôt qu’ils étaient parvenus dans le Pacifique ; aussi restait-il dans la partie inexplorée de cet océan bien de l’espace pour de vastes terres.
C’est alors que nous voyons apparaître l’immortel Cook.
Au cours d’un premier voyage de circumnavigation qui avait duré trois ans et quelques jours, l’illustre marin avait accompli le périple de la Nouvelle-Zélande et exploré la côte orientale de la Nouvelle-Hollande.
Il avait établi qu’il fallait séparer ces terres de la grande Terra Australis Incognita ; mais, si les limites de celle-ci s’en trouvaient considérablement reculées, le troublant mystère austral n’en continuait pas moins à tourmenter les géographes et les philosophes.
Aussi décida-t-on, dès le retour de Cook, de lui confier le commandement d’une nouvelle expédition, avec mission spéciale, cette fois, d’explorer la zone australe.
Lord Sandwich, alors chef de l’Amirauté, fut un des plus chauds partisans du projet et déploya une grande activité à préparer cette expédition.
On acheta deux navires marchands presque neufs, sortant des mêmes chantiers que celui avec lequel Cook avait si heureusement effectué son premier voyage de découvertes. Le plus grand jaugeait quatre cent soixante-deux tonnes ; on l’appela Resolution et l’on compléta son chargement à Deptford ; l’autre, l’Adventure, jaugeait trois cent trente-six tonnes ; il fut équipé à Woolwich. James Cook prit le commandement de la Resolution et confia l’Adventure à Tobias Furneaux, un ancien second de Wallis.
M. Hoodges fut embarqué comme dessinateur ; MM. John Rheinhold Forster et son fils, comme naturalistes.
Le 22 juin 1772, l’expédition quittait Sheerness.
Après avoir touché au cap de Bonne-Espérance, Cook, se conformant aux instructions qu’il avait reçues, fit voile vers le cap Circoncision de Bouvet.
Le 10 décembre, on aperçut le premier iceberg et bientôt les montagnes de glace flottante devinrent innombrables.
Le 2 janvier 1773, Cook se trouvait près de la position assignée par Bouvet à sa découverte et, bien que le temps fût remarquablement clair, il n’aperçut aucune terre. Il en conclut que le navigateur français avait été le jouet d’une illusion, ou que ce qu’il avait pris pour une terre n’était qu’un énorme iceberg.
Cook continua sa route au sud. Le 17 janvier 1773, date mémorable dans les annales de la géographie de la zone antarctique, il franchit, le premier, le cercle polaire par 39° 35’ E.
Le même jour, par 67° 15’ S, il rencontra la banquise s’étendant à perte de vue, de l’est à l’ouest-sud-ouest.
La saison était avancée ; l’été austral touchait à sa fin ; Cook jugea prudent de gagner la Nouvelle-Zélande.
Pendant les deux années suivantes, il franchit deux fois encore le cercle polaire et atteignit, dans le Pacifique austral, le point extrême de son glorieux itinéraire : 71° 10’ S par 106° 54’ O.
Il explora différentes parties de la côte du sud de la Terre de Feu, ainsi que l’île des États, puis il fixa la position de l’île San Petro qu’il appela, comme nous l’avons vu, Géorgie du Sud et dont il releva les approches septentrionales. Le 31 janvier 1775, il découvrit une côte élevée hérissée de sommets neigeux, à laquelle il donna le nom de Thule Australe.
Au-delà, vers l’est, s’apercevait une série de pics qu’il groupa sous le nom de Terre de Sandwich en l’honneur du chef de l’Amirauté britannique qui l’avait si bien secondé dans ses préparatifs.
Contournant cette terre, il continua ensuite à naviguer au sud-est jusqu’au 58° 15’ S par 21° 34’ O et, ne voyant plus ni terre ni aucun signe qui en indiquât la proximité, il en conclut que ce qu’il avait découvert était un archipel ou une pointe avancée du continent, “car, disait-il, je crois fermement qu’il existe près du pôle des terres d’où proviennent la plus grande partie des glaces qui se trouvent répandues sur ce vaste océan austral”.
“… Ce n’est pas faute d’inclination, dit-il aussi, que je ne poursuivis pas mes investigations au sud, mais pour d’autres raisons. C’eût été folie de ma part d’exposer tout ce que nous avions fait pendant ce voyage à seule fin de découvrir et d’explorer une côte qui, une fois découverte et explorée, n’aurait été utile ni à la navigation, ni à la géographie, ni, en vérité, à aucune science.”
Le consciencieux navigateur s’efforça encore cependant de trouver le cap Circoncision de Bouvet, mais il ne fut pas plus heureux cette fois-ci que la première[4].
Cook gouverna ensuite vers l’est, jusqu’à ce qu’il eût rencontré sa route de 1772, puis il cingla vers le cap de Bonne-Espérance et l’Angleterre.
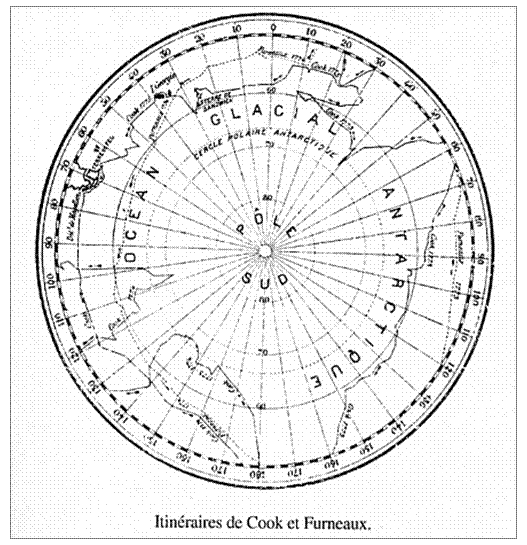
Il avait accompli le tour complet de la région antarctique et, si ses pointes hardies jusqu’à la banquise polaire prouvaient de façon irréfutable la non-existence de terres habitables dans ces parages, il émettait par contre l’opinion que les grands icebergs* si abondants dans les hautes latitudes de l’hémisphère Sud devaient provenir d’un continent massé autour du pôle.
Mais il se gardait bien, le savant navigateur, d’indiquer autre chose sur sa carte que la terre de Sandwich qu’il avait découverte. Les contours de cette terre et les itinéraires nets et précis de ses deux vaisseaux remplaçaient les contours fantaisistes que les philosophes et les géographes s’étaient plu à donner au mystérieux continent. La fiction faisait place à la froide réalité.
Cook avait signalé la multitude d’éléphants de mer et d’otaries qui fréquentaient les côtes de la Géorgie méridionale ; aussi ne tarda-t-on pas à équiper des navires pour aller les chasser : les éléphants de mer pour leur huile, les otaries pour leur fourrure.
Bientôt on se livra à cette chasse avec un tel acharnement qu’en 1820 ces deux espèces avaient presque disparu de ces parages.
On avait transporté sur le marché de Londres environ deux cent mille tonnes d’huile. Une grande quantité de peaux d’otaries provenant de la Géorgie du Sud étaient importées annuellement en Angleterre. Mais, les fourreurs anglais ne sachant pas les préparer convenablement, elles n’avaient pas grande valeur.
À la même époque, les Américains, auxquels le marché de Chine était ouvert, transportaient leurs cargaisons de peaux directement des lieux d’origine en Chine, où elles leur étaient payées de vingt-cinq à trente francs pièce.
On estimait à plus de un million le nombre de peaux prises par les Anglais et les Américains dans le seul archipel de Géorgie, depuis Cook jusqu’en 1820[5].
Aussi les phoquiers commençaient-ils à regretter l’extermination imprévoyante de leur précieux gibier, quand on apprit que de nouvelles découvertes allaient ouvrir un vaste champ à leur activité.
Des terres mystérieuses, soupçonnées depuis des siècles par les géographes, venaient d’être abordées par le capitaine d’un vaisseau marchand anglais qui avait coutume de faire le trafic entre le Rio de La Plata et le Chili.
William Smith, de Blythe, montant le brick* William, qui, de Buenos Aires, gagnait Valparaíso, ayant cinglé vers le sud afin de se soustraire aux forts vents d’ouest qui règnent généralement près du cap Horn, se trouva, en février 1819, dans les eaux d’une terre environnée de glaces et couverte de neige.
Ne voulant pas s’éloigner avant de s’être assuré qu’il n’était pas l’objet d’une illusion d’optique, et profitant de la clémence du temps, il poussa résolument vers les côtes. Il constata ainsi l’existence d’un groupe d’îles rocheuses autour desquelles nageaient de nombreux phoques et des baleines.
Arrivé à Valparaíso, il fit part de sa découverte à ses compagnons qui ne le crurent point et se moquèrent de lui. Leur incrédulité et sa ténacité personnelle lui firent tenter une nouvelle pointe jusqu’au 62e parallèle, à son retour, vers le Río de La Plata. Mais comme il effectuait ce voyage en hiver, les glaces et les vents contrarièrent ses projets.
À Montevideo, quelques négociants américains, moins incrédules que les Anglais établis à Valparaíso, essayèrent de s’approprier les résultats de ses découvertes. Ils lui offrirent de fréter son vaisseau pour l’envoyer à la pêche de la baleine ; mais, au moment de signer le contrat, l’insistance avec laquelle ils s’enquirent de la position exacte des îles entrevues éveilla les soupçons de Smith qui, en bon patriote, refusa le marché.
Ayant entrepris un nouveau voyage vers Valparaíso, en octobre, il reconnut encore la terre par le 62e parallèle.
La sonde à la main, il approcha du rivage, s’en éloignant par prudence pendant la nuit, mais revenant au matin, plus curieux que jamais de reconnaître ces promontoires pointant au milieu d’une côte étendue au loin vers le nord-est.
Enfin, ayant trouvé un havre sûr, il y envoya son second pilote et quelques matelots avec mission de prendre possession de ces terres au nom du roi.
Ainsi fut fait, et l’on donna aux îles le nom de Nouvelle-Bretagne du Sud, auquel on préféra bientôt, pour éviter toute confusion, celui de Nouvelles-Shetland du Sud.
À la rentrée du navigateur anglais à Valparaíso, la précision de son récit leva les derniers doutes.
Le commandant du stationnaire* anglais Andromaque, M. Shireff, chargea un de ses officiers, M. Edward Bransfield, et quelques personnes de son entourage, de retourner avec le William aux Nouvelles-Shetland du Sud. Le départ s’effectua le 19 décembre 1819.
Après une alternative de bourrasques et de calmes, Bransfield aperçut la terre par 62° 56’ S et 60° 54’ O, puis il croisa dans un golfe d’immense étendue, qui était en réalité le détroit qui a gardé son nom.
Cinq mois plus tard, Bransfield rentrait à Valparaíso ; il rapportait une contribution notable à la cartographie des nouvelles terres.
En juillet de la même année 1819, le brick Hersilia, un beau navire doublé de cuivre et équipé soigneusement, quittait la rade de Stonington (États-Unis) pour un voyage d’exploration et de chasse aux phoques dans l’hémisphère austral.
Il était commandé par James Sheffield, et avait pour subrécargue* W.-A. Fanning, dont le frère, Edmund Fanning, avait déjà visité la Géorgie du Sud au printemps, c’est-à-dire à l’époque de la débâcle des glaces.
Edmund Fanning avait remarqué que, quelques jours après une tempête de l’ouest-sud-ouest, de nombreux icebergs étaient venus de cette direction contre la côte sud-ouest de la Géorgie, tandis que les masses de glace détachées de l’île dérivaient elles-mêmes vers l’est pendant les bourrasques d’ouest. Il en avait conclu que ces icebergs devaient provenir de quelque terre située dans l’ouest-sud-ouest.
Outre ces indications, le capitaine de l’Hersilia était, prétend Fanning, en possession d’un manuscrit relatant la découverte de Dirck Gherritz.
Après avoir relâché à l’île des États, l’Hersilia cingla vers le sud et eut connaissance, en février 1820, de Mount Pisgah Island (qui est l’île Smith de la carte anglaise) et d’un groupe d’îles situées plus à l’est, que le capitaine Sheffield appela Fanning’s Islands, mais qui n’étaient autres que quelques-unes des Shetland. D’un point élevé, on vit, vers l’est, d’autres terres ; mais, la saison étant trop avancée, on préféra rentrer au port afin d’instruire les autres phoquiers de l’existence de ces terres nouvelles, assez tôt pour qu’ils pussent s’y rendre la saison prochaine[6].
Nous allons trouver maintenant de vraies petites flottes croisant et chassant aux environs de ces terres nouvelles.
L’Hersilia avait rapporté une belle cargaison de peaux de phoques, et son capitaine estimait à cinquante mille le nombre des phoques à fourrure qui restaient sur la seule île Ragged lorsqu’il la quitta ; aussi songea-t-on, dès son retour à Stonington, à équiper d’autres navires pour la chasse aux phoques aux Shetland.
Pendant la saison de 1820-1821, quatre navires armés dans ce port du Connecticut se rendirent donc aux Nouvelles-Shetland : le brick Frederick, capitaine Benjamin Pendleton, commandant en chef ; le schooner Express, capitaine E. Williams ; le Free Gift, capitaine F. Dunbar, et le sloop Hero, capitaine Nathaniel B. Palmer, un nom qu’il nous faut retenir.
Cette flottille était mouillée à l’île Déception quand des membres de son personnel aperçurent un jour, d’une hauteur et par temps limpide, des montagnes, dont un volcan en activité, surgissant vers le sud : c’était, dit Fanning, la terre connue actuellement sous le nom de terre de Palmer.
Voici, d’après Fanning, les circonstances qui lui valurent d’être baptisée :
Afin de reconnaître la terre entrevue, Pendleton envoya Palmer, à bord du Hero, vers ces rivages. Palmer trouva de hautes montagnes stériles, d’aspect plus âpre et plus sinistre, plus couvertes de glace et de neige que celles des Nouvelles-Shetland ; il y vit des léopards de mer, mais point d’otaries. La côte était si encombrée par les glaces que, bien qu’on fût au cœur de l’été, il fut impossible d’atterrir.
Au retour, le Hero, pris par le calme et la brume, un peu plus près des Shetland que de la terre nouvelle, resta en panne.
Lorsque le brouillard se dissipa, quel ne fut pas l’étonnement de Palmer en voyant près de son faible bateau une frégate et un sloop de guerre !…
Sans retard, il hisse le pavillon des États-Unis ; ses voisins répondent en hissant les couleurs russes.
Aussitôt un canot détaché de la frégate gagne le Hero, et le lieutenant qui le commande remet à Palmer une invitation à se rendre auprès du Commodore.
Les deux bâtiments étaient le Wortock, capitaine Bellingshausen, et le Mirni, capitaine Lazarew, chargés d’une croisière autour du monde par l’empereur Alexandre de Russie.
Palmer donna au commandant russe les renseignements qu’il lui demanda et ce n’est pas sans un sentiment de fierté qu’il l’instruisit de l’endroit où ils se trouvaient et du nom des îles qu’ils avaient devant eux[7]. Il s’offrit même à lui servir de pilote, se targuant de bien connaître ces parages, et s’enorgueillissant d’appartenir à une flottille de cinq navires mouillée aux environs, dans Yankee Harbour.
“Peu d’instants avant d’être enveloppés par la brume”, lui dit alors Bellingshausen, “nous avions vu, en effet, ces îles, et nous nous flattions de les avoir découvertes, mais quand le ciel se dégagea mon étonnement fut grand de trouver à nos côtés un navire américain en aussi bon état que s’il venait de quitter le port. N’eût été que cela ! mais son capitaine m’offre aussitôt de me conduire à un mouillage… Je me rends, ajouta-t-il en souriant, sans conteste la palme vous revient.”
Mettant le comble à la surprise du commodore russe, Palmer l’informa ensuite de l’existence d’une terre, plus rapprochée du pôle, qu’il lui serait loisible de voir du haut des mâts quand le brouillard serait complètement dissipé.
Cette terre que, de l’île Déception, on apercevait au sud, et vers laquelle Palmer s’était dirigé, est évidemment celle désignée à tort par les hydrographes de l’Amirauté anglaise sous le nom de Trinity Land[8].
Disons deux mots de ce voyage de circumnavigation que terminait Bellingshausen lorsqu’il rencontra Palmer.
Durant les derniers jours de l’année 1819 et les premiers de 1820, il avait exploré les îles Sandwich ; puis, croisant au sud, il avait été arrêté par des glaces impénétrables au 69° 30’ S.
Le 30 mars, il avait jeté l’ancre à Port Jackson, en face de Sydney, pour en repartir le 8 mai, et, après avoir exploré le Pacifique et découvert l’archipel d’Alexandre-Ier, il était venu reprendre son mouillage à Port Jackson (sept. 1820).
S’étant octroyé deux mois de repos, il avait repris le large, cinglant droit au sud, puis au sud-est, louvoyant parmi les icebergs jusqu’au 70e parallèle qu’il n’avait pu franchir nulle part à cause des glaces “d’une épaisseur de trois cents pieds”.
Mais sa persévérance et son intrépidité avaient été récompensées en janvier 1821 par la découverte de l’île de Pierre-Ier et de la terre d’Alexandre.
Il en arrivait lorsque, s’étant engagé au milieu des Shetland dont il ignorait l’existence, il rencontra Palmer.
Il continua par la suite à naviguer vers l’est et reconnut l’archipel de Sandwich découvert par Cook, accomplissant ainsi, à son tour, le périple de la zone antarctique.
Nous avons dit plus haut qu’à partir de 1820 de vraies petites flottes se réunissent aux environs des Shetland méridionales.
En effet, après le William et l’Hersilia, ce sont les navires de Stonington sous le commandement de Pendleton que nous y trouvons ; puis ce sont encore l’Elisa et la Dove, l’Ann, la Grâce, le Vigilant, la Cora, la Mellona, le George, l’Indien, le Lynx, le Nancy, le Brusso, le Clothier, le Henry, le James Monroë et d’autres sans doute.
En 1821 et 1822, on tua plus de trois cent vingt mille phoques dans ces parages. “Aussitôt, nous avoue Weddell, qu’un phoque touchait terre, il était tué, quels que fussent son espèce, sa taille et son sexe, et il était dépecé sur-le-champ.” Aussi, à la fin de 1822, n’en restait-il presque plus.
Mais, si le métier de phoquier avait été lucratif, il n’avait pas été exempt de dangers. Durant les années 1820, 1821 et 1822, sept navires se perdirent aux Shetland, presque tous durant des tempêtes de l’est.
L’équipage d’un de ces navires fut obligé d’hiverner à la côte ; pendant de longs mois, il fut soumis aux plus dures épreuves.
Parmi les capitaines de ces bâtiments phoquiers, Powell est un de ceux qui ont le plus contribué à la connaissance géographique des Shetland. Powell commandait l’Elisa, mais il avait une conserve, la Dove. Avec ces deux bâtiments, il rangea* la côte nord de l’archipel. À la fin de novembre 1821, il rencontra le sloop américain James Monroë, commandé par Palmer. Comme l’année précédente, la flottille de Stonington, toujours sous les ordres de Pendleton, était venue mouiller à Yankee Harbour et, comme précédemment aussi, Palmer avait été envoyé vers le sud avec le James Monroë pour reconnaître la terre qui porte son nom.
Il poussa ses investigations le long des côtes vers l’est ; bien qu’on fût en plein été, il les trouva presque partout encombrées de glaces épaisses. Il était du côté nord du détroit de Bransfield, à l’île de l’Éléphant, quand Powel le rencontra. Ils convinrent de naviguer de conserve vers l’est et, laissant en arrière l’île Clarence, ils atteignirent Coronation Island, une des îles d’un groupe nouveau qu’ils nommèrent Orcades du Sud (South Orkneys).
Continuant leur croisière, ils traversèrent deux détroits parallèles : celui de Washington et celui de Lewthwaite.
De cette campagne dirigée avec soin – on peut même dire avec méthode –, Powell rapporta de précieux renseignements : sondages nombreux, notes relatives au climat, à la vitesse des courants, à la direction des vents, aux mouvements des marées et des glaces.
Mais, bien qu’il eût navigué de conserve avec Palmer, il n’apparaît point qu’il apprît directement de lui l’existence de la terre de Palmer.
Il dit à ce sujet que de cette terre du Sud on ne connaît presque rien, sinon qu’elle est appelée Palmer’s Land, qu’on y voit des entrées en forme de détroits, qui divisent probablement le massif rocheux, et constituent des rangées d’îles semblables aux Shetland.
Weddell, qui, dès 1820, avait visité les Shetland du Sud, quittait de nouveau les côtes anglaises, le 17 septembre 1822, avec deux petits bâtiments, le brick Jane, de Leith, jaugeant cent soixante tonnes, et le cutter Beaufoy, de Londres, de soixante-cinq tonnes.
Il commandait le brick et le capitaine Mathew Brisbane, le cutter.
Ces deux navires portaient respectivement vingt-deux et treize hommes d’équipage, ainsi que des vivres pour deux ans.
L’objectif du voyage était la chasse aux otaries dans les mers australes.
Le 21 janvier 1823, Weddell reconnaît les Orcades du Sud où il avait déjà débarqué l’année précédente. Il séjourne dix jours dans cet archipel dont il dresse consciencieusement la carte. Il s’assure ensuite qu’il n’existe pas de terre entre les Orcades et le groupe des Sandwich ; puis il fait route au sud et parvient sans difficulté, le 20 février 1823, par 74° 15’ S et 34° 17’ O, au point le plus rapproché du pôle qu’on ait atteint jusqu’au voyage de Ross.
Au-delà, dit Weddell, la mer se trouvait libre de glaces. Et, comme il savait que les icebergs procèdent de la terre, il conclut qu’il n’en existait pas à une grande distance au sud de sa position, et que le pôle austral devait être d’accès plus facile que le pôle boréal !
La brise soufflait du sud, et, de plus, la saison était déjà avancée, en sorte que Weddell jugea prudent de virer de bord et de faire route vers la Géorgie méridionale. Il y fit une relâche de quelques semaines, puis il se dirigea vers les Falkland.
En octobre, il se rendit encore aux Shetland qu’il trouva défendues au nord par une ceinture de glace ; il y subit quelques avaries, puis il gagna la Terre de Feu.
D’autres navigateurs ont, par la suite, essayé de reprendre la route de Weddell ; mais, moins heureux que lui, ils rencontrèrent une banquise invulnérable par des latitudes moindres de plusieurs degrés…
En 1824, le phoquier américain Hoseason se rend dans le golfe de Hughes et y fait quelques découvertes.
Foster, marin expérimenté qui avait accompagné Parry dans les régions arctiques en qualité d’astronome, est envoyé à son tour dans l’Antarctique, dans le but de faire des observations sur la physique du globe.
Il équipe un trois-mâts-barque, le Chanticleer, de deux cent trente-sept tonnes, monté par cinquante-sept hommes d’équipage, et quitte Falmouth le 3 mai 1828.
Il fait escale à Funchal, Ténériffe, Fernando Noronha, Rio de Janeiro, Montevideo, enfin à l’île des États où il rencontre Palmer, commandant cette fois le schooner Penguin. Le capitaine américain, à qui ces parages sont familiers, le pilote dans North Port Hatchett où il séjourne quelque temps.
Le 21 décembre, le Chanticleer fait voile de l’île des États pour la Terre de Feu.
Après une très courte relâche dans Wigwam Cove (Terre de Feu), il reprend le large le 29 décembre et gagne les Shetland, dans l’intention d’y chercher un point de débarquement favorable aux observations pendulaires.
Le 7 janvier, le capitaine Foster et le lieutenant Kendall, son second, débarquent sur un promontoire situé par 63° 46’ S et 61° 45’ O ; c’est une pointe avancée d’une terre s’étendant vers le sud. Ils baptisent le lieu de débarquement du nom de cap Possession et y déposent, sous un cairn, un document où se trouve relatée la prise de possession de cette terre, au nom de leur souverain. Puis le Chanticleer se dirige vers l’île Déception où les phoquiers s’accordaient à signaler l’existence de bons ports.
Le 9 janvier 1829, on reconnaît cette île volcanique et, l’ayant suffisamment approchée, on met en panne pour explorer en canot l’entrée de la belle rade qu’elle offre.
Le 11, le Chanticleer est mouillé dans Pendulum Cove. Les instruments sont débarqués, les tentes dressées et l’on commence bientôt les observations.
Au cours de leurs excursions dans l’île, les marins du Chanticleer découvrent, à demi ensevelies sous le sable, des épaves d’un bâtiment de grandes dimensions, derniers débris de Dieu sait quelle triste odyssée !
Ils trouvent aussi sur les bords d’une crique des huttes en ruine dont les parois noircies par la fumée attestent le séjour prolongé de quelque équipage de bâtiment phoquier.
Après un séjour de deux mois, consacré en grande partie à des observations pendulaires, le Chanticleer quitte l’île Déception le 8 mars et fait voile vers la Terre de Feu où il arrive seize jours plus tard. Là le capitaine Foster mourut accidentellement et ce fut son second, le lieutenant Kendall, qui ramena l’expédition.
À la fin d’octobre de cette année 1829, Palmer repartait de New York avec les bricks Annawan et Shraph, une centaine d’hommes et un équipement soigneusement conditionné, en vue d’une exploration polaire antarctique. M. Pendleton commandait le Shraph. Les deux capitaines étaient assistés dans cette entreprise particulière par le Dr James Eight, d’Albany, naturaliste. On ne possède de ce voyage, croyons-nous, qu’une relation assez fantaisiste publiée par ce dernier.
Bien que, depuis plusieurs années déjà, la chasse aux phoques ne répondît plus guère aux espérances de ceux qui s’y livraient dans ces lointains parages, MM. Enderby, de Londres, dont le nom est intimement lié à l’histoire de la pêche de la baleine et de la chasse aux phoques dans les mers australes, se proposèrent néanmoins d’y tenter la découverte de nouvelles rockeries*.
Ils armèrent dans ce but la Tula et le Lively, un brick et un cutter, jaugeant respectivement cent quarante-huit et soixante-dix tonnes, qu’ils confièrent au capitaine John Biscoe, en lui recommandant de faire, si possible, quelques découvertes dans les hautes latitudes.
Biscoe part de Londres, le 14 juillet 1830, touche aux îles du Cap-Vert pour y embarquer du sel, cingle vers les Falkland, visite le groupe des Sandwich, puis gouverne à l’est en restant toujours à une latitude élevée, entrevoit la terre d’Enderby et essuie finalement de très gros temps au cours desquels les deux navires se perdent de vue.
Le 7 mai, la Tula relâchait en Tasmanie, tandis que le Lively allait reposer à Port-Philippe son équipage épuisé.
En octobre 1831, les bâtiments reprennent la mer, croisent jusqu’à la fin de l’année aux abords de la Nouvelle-Zélande, des îles Chatham et Bounty, se livrant, sans grand succès, à la chasse aux phoques.
Le 4 janvier 1832, ils cinglent vers le sud-est ; le 25 du même mois, par 60° 45’ S et 132° 7’ O, Biscoe rencontre de nombreux icebergs.
Le 12 février, par 66° 27’ S et 81° 51’ O, il compte, du pont, deux cent cinquante icebergs et voit une multitude d’oiseaux, ainsi que de nombreux mégaptères* et baleinoptères*.
Trois jours plus tard, se trouvant par 67° 1’ S et 71° 48’ O, il aperçoit la terre à une grande distance.
Ayant gouverné de ce côté, il reconnaît le lendemain matin une île qu’en l’honneur de la reine il baptise du nom d’île Adélaïde.
Pendant la quinzaine suivante, il découvrit d’autres îles encore, gisant dans l’est-nord-est – ouest-nord-ouest, non loin d’une grande terre très élevée qu’il nomma terre de Graham, tandis qu’il laissait son propre nom à l’archipel.
D’après Biscoe, l’île Pitt, qui se trouve par 66° 20’ S et 66° 38’ O, ne serait pas très éloignée de cette importante terre de Graham.
Le 21 février, Biscoe réussit à débarquer dans une vaste baie de la terre de Graham dont il prit possession.
Il se trouvait à proximité des monts William et Moberly.
La position (64° 45’ S et 63° 51’ O) qu’il assigne au mont William correspond assez exactement à celle que nous avons trouvée nous-mêmes à bord de la Belgica. En sorte qu’il y a tout lieu de croire que la baie où débarqua Biscoe est celle à laquelle nous avons donné son nom, et qui forme une échancrure profonde dans la partie sud de l’île Anvers.
Biscoe se dirigea ensuite vers les Shetland où, ayant été drossé à la côte, il perdit son gouvernail et n’échappa que par miracle.
Au retour, il relâcha aux Falkland sur les côtes desquelles il perdit sa conserve, le cutter Lively.
Remarquons ici que la Belgica a passé sans les voir sur le gisement* des îles Biscoe telles qu’elles sont portées sur les cartes. Le temps était assez bouché, il est vrai, et ces îles dont la position exacte n’est, du reste, pas connue, pouvaient se trouver à quelques milles dans l’est ou dans l’ouest de notre route.
De 1838 à 1843, la zone antarctique est explorée scientifiquement par trois expéditions, une française, une américaine et une anglaise : celle de Dumont d’Urville, celle de Wilkes et celle de James Clarke Ross.
On a publié des relations très complètes de ces voyages. Aussi ne les mentionnerai-je que pour mémoire et me bornerai-je à résumer très succinctement les découvertes géographiques que firent ces expéditions dans la zone qui nous intéresse.
De la Terre de Feu, d’Urville cingla, en 1838, vers la mer polaire. Il croisa jusqu’à la lisière de la banquise, rangea ensuite les Nouvelles Orcades, les îles Clarence et de l’Eléphant du groupe des Shetland, puis, traversant le détroit de Bransfield, il découvrit la terre de Joinville et la terre de Louis-Philippe, pénétra un peu dans une vaste échancrure qu’il appela canal d’Orléans, et qui semble séparer la terre de Louis-Philippe de la terre de la Trinité.
Dumont d’Urville était accompagné d’un ingénieur hydrographe, Vincendon Dumoulin, auquel on doit une carte détaillée de ces découvertes.
Wilkes, le chef de l’expédition américaine, disposait de cinq bâtiments ; mais, équipés à la hâte, ils n’étaient pas tous également propres aux durs services qu’on réclamait d’eux.
Aussi cette expédition, qui fit dans le Pacifique des travaux remarquables, n’a-t-elle pas donné, au point de vue spécial de l’exploration antarctique, tout ce que méritait la vaillance de ses chefs.
Le 25 février 1839, Wilkes, à bord du brick Porpoise, quittait la baie Orange, accompagné du Sea-Gull, commandé par le lieutenant Johnson.
Le 1er mars, on reconnaissait l’île Ridley, puis l’île du Roi-George et le lendemain les îles O’Brien et Aspland.
Wilkes essaye en vain de débarquer à l’île Bridgeman ; puis, faisant route au sud, il se dirige vers ce qu’il appelle la terre de Palmer, et détermine la position du mont Hope qui marque, d’après lui, l’extrémité orientale de cette terre et qu’il place par 63° 25’ S et 57° 55’ O[9].
Il découvre trois îlots qu’il nomme Adventure. Mais, la glace défendant les approches de la terre, il en reste assez éloigné.
Le lendemain, il ordonne à sa conserve de regagner la baie Orange en passant par l’île Déception, tandis que lui-même se dirigera au nord pour examiner encore quelques-unes des Shetland.
Pendant ses deux premières campagnes estivales dans l’océan Antarctique, Ross avait visité la partie de cet océan qui s’étend au sud de la Nouvelle-Zélande ; il y avait atteint de très hautes latitudes et s’était illustré par la découverte, à jamais mémorable, de la terre de Victoria et par la détermination approximative du pôle magnétique austral.
La troisième année (1842), Ross fit voile des Falkland, le 17 décembre. Il se proposait de suivre la route qui avait permis à Weddell d’atteindre la latitude élevée de 74° 15’ S.
Il compléta vers le sud le lever de l’île de Joinville et de la terre de Louis-Philippe ; il fut bloqué dans les glaces du 9 au 16 janvier 1843 au large de ces terres ; puis, s’étant dirigé vers l’est, il tenta vainement de pénétrer dans la banquise, là où Weddell avait vu la mer dégagée.
C’est Smiley, un baleinier américain, que nous trouvons encore aux Shetland méridionales et à la terre de Palmer en 1842.
En se dirigeant vers la terre de Palmer, Smiley visite l’île Déception et n’y compte pas moins de treize volcans en activité, il y trouve le thermomètre à minima* qu’y avait déposé Foster en 1829 et qui avait échappé, en 1839, à Johnson, de l’expédition Wilkes. Ce thermomètre indiquait -20,5°.
À la suite de ce voyage, Smiley écrivit à Wilkes que la terre de Palmer consiste en une grande quantité d’îles séparées par des chenaux profonds, étroits et dangereux.
Mais il ne semble pas que Smiley plus que ses devanciers ait rapporté des documents qui permissent aux géographes de modifier les contours indécis de la carte des terres situées à l’ouest du canal d’Orléans.
Nouvelle phase de l’exploration des régions qui nous occupent.
En 1873-1874, nous y voyons paraître, pour la première fois, un bâtiment à vapeur.
Du 17 novembre 1873 au 4 mars 1874, le capitaine allemand Dallmann poursuit le phoque aux abords des Shetland, des Orcades et de la terre de Palmer, à bord du navire mixte Groenland, armé par la “Deutschen Polarschiffarts Gesellschaft”, de Hambourg.
Il atterrit une première fois, le 30 décembre 1873, près des récifs Farewell, à l’ouest de la terre de la Trinité.
Les premiers jours de janvier, il se trouve au large de la terre de Graham qu’il trouve défendue par de nombreux écueils, sur lesquels la mer brise avec force et qui, presque partout, se termine par une falaise de glace de plusieurs centaines de pieds de hauteur. Le 8 janvier, vers sept heures du soir, Dallmann débarque en un point qu’il place par 64° 45’ de latitude, et qui, bien que nous n’en connaissions pas la longitude, nous semble, par la description qu’il en fait, voisin de celui où débarqua Biscoe en 1832.
Puis il navigue vers le nord gardant la terre en vue ; le 9 janvier, à midi, il se trouve par 64° 2’ S et 64° 56’ O ; il se dirige alors, d’abord vers le sud-est, puis, le soir, vers un cap situé plus au sud.
Le 10 janvier, il découvre une baie profonde dans laquelle émergent une quantité de récifs et de petites îles basses : “Cette baie, dit-il, se termine par un détroit ou passage s’étendant à perte de vue.” La terre qu’il aperçoit semble être formée de plusieurs îles, car, au-delà de la baie, il voit dans le ciel “de ces rayures bleues qui annoncent des détroits ou des passes”. Il atterrit par 64° 55’ S. Puis il gouverne de nouveau au nord-nord-est le long de la côte.
Le 11 janvier à midi, le Groenland se trouve par 64° 6’ S et 63° 27’ O, à l’ouest de nombreux récifs groupés à une dizaine de milles de la côte. De ce point, dit Dallmann, la côte se dirige vers l’est. Peu après, il découvre dans le sud-est une baie large et profonde vers laquelle il gouverne, mais il la trouve si remplie d’icebergs et de glaçons qu’il ne peut pas pousser assez loin pour s’assurer si ce n’est pas un détroit.
Le lendemain 12 janvier, il reconnaît le cap Cockburn ; puis, ayant pénétré dans la baie de Hughes, Dallmann constate que la carte n’en donne pas exactement les contours et que les positions assignées à l’île des Deux-Hummocks* et à d’autres îles situées dans cette grande baie sont également entachées d’erreurs. Il découvre aussi que la terre de la Trinité se trouve détachée par le sud et par l’est des terres voisines.
Enfin il parcourt le détroit de Bransfield et pousse jusqu’aux Orcades.
De ce séjour dans l’Antarctique, le capitaine allemand a rapporté des notes intéressantes concernant la géographie, la zoologie et la botanique. Toutefois les renseignements consignés dans son journal de bord étaient trop vagues pour que les géographes eussent pu en tirer beaucoup de profit ; aussi les cartes qu’ils publièrent de ce voyage du Groenland sont-elles loin de répondre à la réalité.
La grande ouverture que Dallmann avait aperçue le 10 janvier, alors qu’il se trouvait à l’ouest de la terre de Graham, y est figurée sous la dénomination de détroit de Bismarck, et celui-ci va, avec une majestueuse ampleur, s’amorcer indifféremment, soit vers le nord dans la baie de Hughes, soit vers le nord-est ou l’est dans le canal d’Orléans ou l’Atlantique austral. La terre de Palmer, séparée par ce détroit de la terre de Graham, est encore représentée sur ces cartes par un massif unique ; mais celui-ci se trouve profondément découpé au nord par une baie étendue (baie de Dallmann) et au sud par un chenal ébauché, orienté nord-sud.
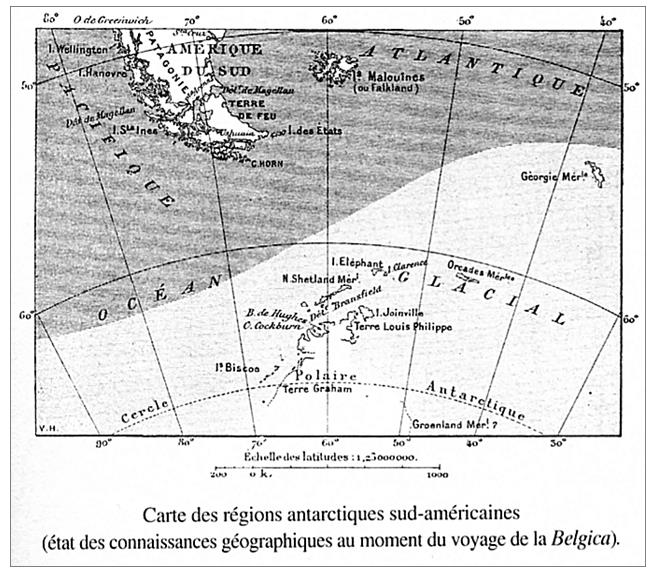
Après le Groenland et le Challenger qui fit, la même année, une pointe au-delà du cercle polaire, la zone antarctique tout entière resta inexplorée jusqu’en 1892. Pendant la saison de 1892-1893, trois baleiniers écossais, la Balœna, la Diana et l’Active, de Dundee, ainsi qu’un baleinier norvégien, le Jason[10], de Sandefjord, parcoururent les eaux qui baignent l’île Joinville et la terre de Louis-Philippe.
L’Active découvrit un détroit séparant l’île Joinville d’une petite île qu’on nomma l’île Dundee, tandis que le détroit recevait le nom du navire.
L’année suivante, le Jason retournait dans ces mers en compagnie de deux conserves appartenant comme lui à la compagnie “Oceana” : le Castor et la Hertha.
Ce nouveau voyage du Jason fut tout à fait remarquable, et ses résultats ravivèrent l’intérêt des géographes pour ces régions désolées.
Le capitaine Larsen, qui commandait le Jason, a bien voulu me communiquer son journal de bord et j’en ai extrait les détails qui suivent.
Le 18 novembre, Larsen et quelques-uns de ses hommes débarquent à l’île Seymour. Ils rapportent de cette excursion une belle collection d’échantillons géologiques et des fragments d’arbres fossiles trouvés à quatre milles à l’intérieur, à une altitude de près de cent mètres !
Le 29 novembre, se trouvant par 64° 50’ S et 55° 33’ O, le capitaine Larsen décide de profiter de l’absence relative de “pack*” pour pousser ses investigations plus au sud.
Le lendemain, à midi, le Jason se trouve par 65° 57’ S et 58° O. Il fait un temps radieux. Le soir on voit, vers l’ouest, une apparence de terre.
Le 1er décembre, le temps est d’abord très brumeux ; mais, pendant la matinée, il s’éclaircit et l’on voit alors distinctement dans l’ouest une grande terre couverte de neige, dont la côte suit la direction nord-sud et présente à l’arrière-plan des crêtes élevées. Cette terre, que le capitaine norvégien appelle la terre du Roi-Oscar-II, est probablement la partie orientale de la terre de Graham. Larsen reconnaît la possibilité de débarquer en plus d’un point de la côte. Mais il avait mission, dit-il, de chasser les phoques et non de faire des découvertes géographiques, et il dut refréner son désir de visiter l’intérieur.
Un promontoire s’avançant très loin vers l’est est baptisé cap Framnaes, tandis que la montagne élevée qui se dresse sur cette pointe reçoit le nom du navire (mont Jason). Larsen place le mont Jason par 65° 44’ S et 60° 40’ O.
Favorisé par le temps, il poursuit sa route vers le sud, rangeant la côte d’aussi près que possible. Il voit de nombreuses et profondes échancrures dans la falaise de glace.
Le 6 décembre, à six heures du soir, il constate l’impossibilité d’aller plus loin ; il se trouve, d’après l’estime, par 68° 10’ S. La lisière de la banquise, qu’il avait jusque-là à l’est, s’infléchit vers la côte qu’elle rejoint en formant, vers le sud, une barrière impénétrable. Du nid de corbeau* on voit la terre du Roi-Oscar-II se continuer à perte de vue vers le sud.
Le Jason vire de bord.
Le 9 décembre, Larsen découvre, à une certaine distance au large de la terre, une île dont il place le point central par 66° 26’ S et 60° 45’ O. Il l’appelle Veirö (île du Temps). L’après-midi, le Jason passe à proximité d’une île sans neige ni glace dont la partie nord est basse, mais qu’exhausse un sommet que Larsen place par 65° 20’ S et 58° 47’ O. Elle s’appellera désormais l’île Robertson, en l’honneur d’un des propriétaires du phoquier.
Le lendemain il vente frais, il neige et le temps reste brumeux toute la journée. Mais, le 11 décembre, l’atmosphère s’étant éclaircie, on voit dans le nord-ouest de l’île, et séparée d’elle par un étroit canal, un îlot qu’occupe entièrement un volcan en activité ; plus loin, dans la même direction, gît un autre îlot, en forme de pain de sucre, également volcanique. On dénomme le premier île ou volcan Christensen en l’honneur du constructeur du Jason ; et l’autre, Lindenberg Sukkertop, du nom d’un des armateurs. Larsen débarque sur la banquise avec son second et, chaussés de “skis” (patins à neige norvégiens), ils atteignent, non sans peine, le volcan Christensen. Ils rencontrent de très nombreux phoques et, en ayant tué quelques-uns, ils trouvent dans l’estomac de plusieurs les restes d’un petit poisson ressemblant au merlan.
Dans l’ouest-nord-ouest de l’île Christensen, le capitaine norvégien aperçoit un chapelet de cinq îles qui, comme elle, sont dégarnies de neige. Il en conclut qu’elles sont toutes volcaniques. Elles ont reçu les noms d’îles Oceana, Castor, Hertha, Jason et Larsen.
Larsen donne pour coordonnées de la plus occidentale (celle qui porte son nom) 64° 5’ S et 60° 8’ O, c’est-à-dire qu’il estime à quarante milles environ la distance qui l’en séparait, ce qui paraît pour le moins exagéré. Bien qu’il nous semble déjà téméraire de se prononcer sur ce qui simplement existe ou non à pareille distance, Larsen ajoute que la glace qui recouvre la mer entre ces îles et jusqu’au cap Foster est plate et émerge peu, et que, pour autant qu’il ait pu en juger par le temps clair, il n’y avait plus aucune terre dans le nord-ouest.
Nous savons aujourd’hui que l’intrépide marin se trompait, car c’est dans cette direction que se trouve la terre à laquelle des circonstances cruelles nous ont fait donner le nom de Danco.
Au point de vue commercial les résultats de cette expédition ne furent pas engageants, et les armateurs de Sandefjord n’envoyèrent plus leurs navires dans ces eaux qui demeurèrent inexplorées jusqu’au voyage de la Belgica.

I
LES PRÉPARATIFS
Comment naquit mon projet. – À la recherche de trois cent mille francs, d’un navire et d’un personnel. – Souscription nationale. – L’achat de la Patria. – L’armement de la Belgica. – Le problème des approvisionnements et celui du recrutement. – De Sandefjord à Anvers. – Dernières difficultés matérielles. – Une exposition improvisée sur les quais d’Anvers. – Enfin prêts !
Le 16 août 1897, au matin, la Belgica, escortée par toute une flottille d’embarcations, saluée par les clameurs de la foule et les accents de La Brabançonne, que des coups de canon scandaient à intervalles réguliers, quittait Anvers et descendait l’Escaut pour gagner la mer.
L’expédition qui débutait par ce départ en fête devait être longue et difficile. Moins longue encore et moins difficile, je pense, que n’avait été sa préparation.
Ce matin-là, je ne faisais que partir, et, cependant, mon état d’esprit était celui d’un homme qui vient d’atteindre son but.
J’avais un bon navire sous mes pieds, de vaillants compagnons autour de moi, et devant moi la mer. Il ne me restait plus qu’à naviguer, sur les flots connus d’abord, sur les flots inconnus ensuite. Et cela, c’était mon métier.
J’en avais fini avec les ingrates besognes d’occasion qui m’avaient absorbé pendant trois ans, fini avec les sollicitations, avec les expédients, avec l’interminable chasse aux ressources indispensables…
Ce départ, c’était la délivrance, l’évasion… et les espoirs infinis.
… Les régions polaires avaient de bonne heure exercé leur fascination sur mon âme de voyageur, que les pays tropicaux tentaient moins.
En 1891 – j’avais vingt-cinq ans – ayant appris que Nordenskjöld, l’illustre explorateur arctique, projetait une nouvelle expédition, dirigée cette fois vers l’Antarctide, mais ne disposait pas de ressources suffisantes, je lui écrivis pour lui demander de servir à son bord et lui proposer de faire une tentative pour réunir en Belgique la somme qui lui manquait. J’attendis vainement une réponse. Si j’avais pu garder quelque rancune au grand navigateur, ce sentiment se serait dissipé quand j’eus expérimenté personnellement quelle quantité d’offres de service on reçoit en pareil cas.
Cependant une idée d’abord vague était née, puis s’était précisée dans mon esprit : pourquoi n’entreprendrais-je pas moi-même, de ma propre initiative, un voyage de découvertes dans la zone antarctique, si peu connue ?… En 1894, mon plan était fait. Au mois de septembre, je me hasardai à le confier à quelques membres de l’Académie royale de Belgique et de la Société royale de géographie de Bruxelles. Leur concours me fut tout de suite acquis.
Il me fallait de l’argent, un navire et un personnel. Où les trouver ?
Pour rendre mon projet réalisable et pour lui donner quelques chances d’aboutir, je devais limiter au strict nécessaire le budget de mes dépenses. C’est dans cet esprit que fut dressé mon devis qui s’élevait à trois cent mille francs en chiffres ronds, somme bien modeste si on la compare aux prévisions d’autres expéditions projetées ailleurs à la même époque et qui n’ont été réalisées que six ans plus tard.
Elle était modeste, cette somme, et combien pourtant elle fut difficile à réunir !
En janvier 1896, s’ouvrit à Bruxelles, sous les auspices de la Société royale de géographie, une souscription nationale en faveur de l’expédition.
Déjà un an auparavant, un industriel belge, généreux autant que riche, M. Ernest Solvay – avais-je besoin de le nommer pour qu’on le reconnût ? – m’avait promis de coopérer pour vingt-cinq mille francs aux frais de l’entreprise. Inscrite en tête des listes, cette souscription constitua une belle “étrenne”. Une telle sanction matérielle, apportée à mon projet par un mécène aussi éclairé, entraîna le succès.
Grâce au concours des comités de propagande qui s’étaient constitués à Anvers, à Liège, à Gand, à Louvain, pour seconder la Société de géographie dont l’action s’exerçait surtout à Bruxelles, grâce aussi à l’appoint fourni par des fêtes militaires, des concerts, voire des ascensions de ballons, grâce encore au concours de dévoués conférenciers et à l’appui de la presse belge tout entière, nous avions recueilli en mai plus de cent mille francs.
C’était un résultat matériel déjà considérable – un résultat moral plus important encore.
Dans des pays comme la Norvège et la Suède, confinant aux glaces arctiques, et dont bien des enfants se sont illustrés en de semblables aventures, l’idée d’une expédition nationale aux régions polaires peut obtenir un succès spontané. Mais la Belgique est un pays pour ainsi dire sans marine, sinon sans marins ; le goût des entreprises lointaines y est relativement peu développé et toute l’initiative des Belges dans ce sens se trouve d’ailleurs absorbée par la grande œuvre congolaise. Un projet de voyage vers le pôle, et surtout vers le pôle Sud, ne devait donc être accueilli, au début, par l’opinion publique de mon pratique pays, qu’avec un profond étonnement, sinon une complète indifférence.
Pourtant, l’entrain de mes amis et, dois-je le dire ? ma propre persévérance firent si bien qu’en quatre mois deux mille souscripteurs avaient apporté cent mille francs au petit lieutenant de marine qui s’était mis en tête de promener le pavillon belge à travers les mystérieuses étendues glacées de l’autre hémisphère, d’inscrire des noms belges au livre d’or des découvertes géographiques, de donner des appellations belges à des rivages nouveaux.
Aux temps difficiles du début, j’avais l’aveugle volonté de réussir ; je ne voulais rien voir des obstacles laissés la veille derrière moi, ni de ceux qu’il me faudrait vaincre le lendemain ; je luttais au jour le jour, ne distinguant que le but à atteindre, fermant les yeux sur les impossibilités : c’est ce qui m’a soutenu.
Maintenant qu’il m’est permis de jeter un regard sur l’œuvre accomplie, je comprends qu’elle ait pu d’abord paraître irréalisable. Les hésitations, les doutes qu’avait rencontrés mon projet, maintenant je les trouve naturels, et je me sens pénétré de la plus vive reconnaissance pour ceux qui eurent confiance.
Forts de l’appui matériel et moral de l’opinion publique, mes amis et moi nous nous décidâmes à solliciter de la législature un premier crédit de cent mille francs ; il fut voté à l’unanimité par les deux Chambres.
Déjà mes préparatifs étaient commencés.
Avec un budget aussi restreint que le mien, je ne pouvais songer à faire construire un navire neuf, sur des plans particuliers. Dès la fin de 1894, je m’étais mis en rapport avec des armateurs de baleiniers et de phoquiers (sealers) écossais et norvégiens. Au commencement de 1895, j’obtins d’une importante maison d’armement la faveur de faire une campagne au nord de Jan Mayen et dans la banquise du Groenland, à bord d’un de ses navires, le Castor. C’est au cours de cette campagne que je vis pour la première fois la Patria, qui devait plus tard devenir la Belgica, et qui, moins grande que le bâtiment sur lequel je me trouvais, me parut plus solide et plus maniable. La Patria n’était pas à vendre alors, et d’ailleurs mes fonds n’étaient pas encore réunis. Mais je bénéficiai, par la suite, de toute une série de circonstances favorables. La société anonyme à laquelle appartenait ce navire ayant été dissoute l’année suivante, il fut mis en vente, et, suivant l’usage norvégien, tous les concurrents s’effacèrent devant le capitaine, qui commandait la Patria depuis dix années et désirait s’en rendre acquéreur. Il se la vit adjuger à un prix minime. Toutes ses économies passèrent néanmoins à cet achat, et il dut recourir à un emprunt pour entreprendre sa première campagne de pêche. Cette situation l’effraya, et quand je lui proposai de me céder la Patria en réalisant un bénéfice, il accepta. Le 29 février 1896, avant son départ pour la chasse aux phoques, il me consentit une option d’achat exécutable en juillet au prix de cinquante mille couronnes.
Construit à Svelvig, près de Drammen, en 1884, sous la direction du maître charpentier Christian Jacobsen, le navire est gréé en trois-mâts-barque avec huniers* à rouleau*, et pourvu d’une machine auxiliaire de trente-cinq chevaux nominaux sortant des ateliers de la “Nylands Vœrksted” de Christiania. Sa jauge nette est de deux cent quarante-quatre tonneaux, mais l’épaisseur de sa robuste membrure est celle d’un bâtiment de tonnage triple. Sa coque est garnie d’un soufflage* en greenheart dans toutes les parties exposées au frottement des glaces. Son étrave est renforcée et défendue extérieurement par des bandes de fonte ; la proue est élancée, taillée de façon à monter sur la glace pour la briser sous son poids. L’hélice, en acier de Suède très épais, est à deux ailes ; elle est établie dans un châssis qui peut être remonté, dans un puits, le long de coulisses à crémaillères, pour la marche prolongée à la voile. Le gouvernail est d’une solidité à toute épreuve ; la jaumière* est très large, de sorte qu’on peut, du pont, briser la glace qui viendrait s’y former et rendre impossible la manœuvre du gouvernail. Au sommet du grand mât, le nid de corbeau traditionnel servait de poste d’observation, enfin aux porte-manteaux* sont suspendues quatre embarcations, dont deux grandes baleinières.
Long de trente mètres et large de six mètres cinquante au maître-bau*, c’était en réalité un tout petit bâtiment que cette Patria – si petit que j’eus un moment l’intention de lui donner le nom de Coquille.
Le 11 juin 1896, la Patria rentrait à Tenvig, près Tönsberg, avec un plein chargement. Ce succès avait modifié les intentions du capitaine Pedersen, qui ne désirait plus se défaire de son navire. Aussi les négociations furent-elles longues, et ce n’est que le 2 juillet, veille de l’expiration de l’option, que nous tombâmes d’accord.
C’est de cette époque que date pour moi l’ère des tiraillements d’argent qui ne devait se clore qu’avec l’expédition elle-même. Deux cent mille francs m’étaient promis ; j’avais du crédit, mais je ne disposais pas encore d’un centime. Si bien que le navire faillit m’échapper et que, pour le payer, je dus recourir à l’obligeance d’un ami.
Le 4 juillet enfin, la Patria arriva à Sandefjord, et le lendemain, à midi, le pavillon norvégien qui flottait à la corne d’artimon* fut amené et remplacé pour toujours par les couleurs belges. Avec des amis nous saluâmes l’événement d’une salve de vingt et un coups de canon. Le navire reçut le nom de Belgica.
L’été et l’automne de 1896 furent employés à aménager la Belgica en vue de sa nouvelle destination.
Les travaux d’appropriation, confiés, après une adjudication, au chantier Christensen de Sandefjord, comprenaient : la réfection du soufflage en greenheart ; l’application sur la carène, du soufflage à la quille, d’un doublage en feutre recouvert de bois pour la préserver de l’attaque des tarets* ; l’application, dans le même but, de feuilles de plomb sur l’étambot* et la partie immergée du gouvernail, ainsi que d’une couleur spéciale à base de cuivre sur le restant des œuvres vives* ; la mise en place d’une nouvelle hélice en acier de Suède ; la construction sur le pont, à l’avant du grand panneau*, d’un rouf* pour l’installation des laboratoires de zoologie et d’océanographie ; l’agrandissement de la dunette* ; l’aménagement sous la dunette d’un carré, de cabines, cambuse* et dépendances ; la réfection du pont, des pavois de bastingage*, etc. Pour plus de sécurité, la chaudière fut renouvelée.

Ces travaux furent interrompus par l’hiver, mais reprirent au printemps de 1897. Au mois de juin, la Belgica était armée et inscrite pour un nouveau terme de six ans à la première classe par le Bureau Veritas norvégien.
Entre-temps, j’avais engagé des pourparlers à Copenhague avec le commandeur Ch. Wandel, directeur du service hydrographique danois, pour la reprise d’un matériel de pêche en eau profonde qui avait servi à deux campagnes effectuées par l’Ingolf, en 1895 et 1896, dans les eaux groenlandaises. Le gouvernement danois me céda gracieusement une grande partie de ce matériel : treuil à vapeur, bôme, dynamomètre, deux mille mètres de câble en acier galvanisé pour funes, poulies de retour, montures en fer pour chaluts, etc. L’arsenal de la marine danoise se chargea de la construction de divers engins et accessoires, et le sous-officier Moller, ancien maître d’équipage de l’Ingolf, m’aida dans l’installation à bord de tout ce matériel, que compléta une machine à souder, construite par M. Le Blanc, de Paris.
Pendant tout l’hiver de 1896-1897, que j’avais passé en Norvège, je m’étais entraîné en vue de l’expédition, m’exerçant à l’usage des skis et des raquettes à neige, complétant mes approvisionnements et expérimentant le matériel d’hivernage, les traîneaux, tentes, sacs-couchettes, réchauds de Nansen et de Jackson, etc.
« Le profane croit naturellement que les misères commencent quand la vigie, de son nid de corbeau, signale les premiers blocs de glace ; il ne se doute pas des mille tracas que causent les préparatifs de l’armement et qui font que le départ définitif paraît être une véritable délivrance… Le choix ou la construction du navire, l’étude des moyens à adopter pour qu’il puisse lutter contre les glaces, la question des approvisionnements, la composition de l’équipage, l’embarquement de ces mille riens auxquels on pense à peine, mais qui sont absolument indispensables pour un séjour de plusieurs années dans des régions inhabitées, tout cela impose à celui qui est chargé de l’installation un fardeau considérable de soucis et de préoccupations. Quiconque prend sa responsabilité au sérieux est, pendant de longs mois avant le départ, l’être le plus tourmenté sous la calotte des cieux. Rien que l’élaboration de la liste des objets à emporter, liste pour laquelle le plus souvent il n’existe aucun modèle, occupe l’esprit nuit et jour, car on sait que le moindre oubli aura des conséquences graves et que le manque d’une bagatelle, telle que du fil, des aiguilles, des allumettes et d’autres objets futiles en apparence, entraîne les suites les plus désagréables. On voudrait tout voir et tout contrôler, et l’on est forcé de devenir un génie universel qui doit donner son avis, tantôt sur l’habillement et tantôt sur la chaussure, demain sur les poêles et la batterie de cuisine, après-demain sur les instruments astronomiques ou magnétiques. »
C’est ainsi que s’exprimait un jour, dans une conférence, l’illustre explorateur Weyprecht, à propos des préparatifs de l’expédition arctique autrichienne du Tegethof, et je ne sais ce que je pourrais ajouter de mon cru qui ne fît double emploi avec ce tableau si précis, sinon que ces préoccupations multiples et diverses se sont toujours compliquées pour moi de cruels embarras pécuniaires.
Quel mélange hétéroclite, quel bizarre recueil de correspondance mon copie[11] de lettres de cette époque n’offre-t-il point ! On y trouve, datées du même jour parfois, des lettres adressées aux quatre coins de la Belgique, à Paris, à Londres, à Vienne, à Copenhague, en Amérique, en Australie même, soit pour solliciter l’appui de quelque millionnaire, soit pour demander un renseignement à quelque consul, pour traiter d’une affaire de charbon ou faire une recommandation à un fabricant de conserves alimentaires, pour commander tel ou tel appareil à tel ou tel constructeur, pour commander même – rie qui voudra ! – des instruments de musique : j’avais voulu, en effet, organiser une petite fanfare parmi mes futurs matelots, mais des défections qui se produisirent, au moment du départ, me firent abandonner cette idée[12].
Il est vrai qu’Arctowski, Danco et Racovitza, dont le concours dévoué m’était acquis dès 1896, appliquaient, de leur côté, toute leur activité à la préparation de ce qui les concernait. Mais nous étions généralement éloignés les uns des autres, et comme je n’avais pas de secrétaire – les modestes ressources de l’expédition ne me permettant pas ce luxe – et que, d’autre part, je n’eus que beaucoup plus tard la bonne fortune d’associer Lecointe à mon entreprise, j’étais seul à représenter “l’administration centrale”.
Que de lettres il me fallut écrire et combien aussi j’en ai reçues, en dehors de celles qui formaient le courant…, lettres de sollicitations de toutes sortes et de toutes provenances, lettres d’inventeurs méconnus prônant des moyens merveilleux pour atteindre infailliblement le pôle Sud !
Que ceux auxquels je n’ai pas répondu me pardonnent !
J’achèverai de donner une idée de la minutie qu’il faut apporter aux moindres détails d’organisation, en notant ici un tout petit détail, à la fois plaisant et caractéristique. Il montre bien comme l’on doit, en pareil cas, appliquer son esprit aux préoccupations qui lui sont le plus étrangères et qui paraissent le plus mesquines… J’avais dressé ma liste d’approvisionnements de bouche et j’avais inscrit, parmi les denrées de première nécessité : pâtes alimentaires. Mais quelles pâtes choisir ? Des macaronis ? Des nouilles ? Peu importe, pensez-vous – et je fus d’abord tenté de penser de même. Pourtant, avec un peu de réflexion, je m’avisai que le macaroni est rond et creux, tandis que les nouilles sont plates et pleines. Donc, le macaroni devait être écarté, comme tenant plus de place. Et, en effet, avec seize caisses de nouilles, j’eus sur la Belgica l’équivalent en poids de vingt-quatre caisses de macaronis.
Restait la question délicate du recrutement du personnel. À peine avais-je fait connaître mon projet que de jeunes savants belges s’étaient proposés avec élan à m’accompagner. Pour composer l’état-major scientifique de l’expédition, je n’avais qu’à choisir parmi ces enthousiastes ! Malheureusement, les décevantes lenteurs inévitables eurent tôt fait de les décourager. C’est alors, à point nommé, qu’Arctowski m’offrit son concours. Peu de temps après, en février 1896, Danco, que je connaissais de longue date, mettait également au service de l’expédition tout son ardent dévouement. Enfin, quelques mois plus tard, des circonstances heureuses me mirent en rapport avec Racovitza.
Arctowski, dont la spécialité était la chimie, et qui s’était déjà beaucoup occupé de géologie, se prépara aux recherches géologiques et océanographiques ; plus tard, il voulut bien se charger aussi de la météorologie. Danco s’appliqua à l’étude de la physique du globe. Quant aux attributions de Racovitza, qui était docteur en sciences naturelles, elles devaient embrasser la zoologie et la botanique.
Le personnel marin de l’expédition fut recruté partie en Belgique, partie en Norvège ; mais, jusqu’au moment du départ, sa composition subit – du fait de défections surtout – de fréquentes modifications.
En juin 1897, j’offris à Lecointe le commandement en second du navire et de l’expédition. Brillant officier d’artillerie, en stage dans la marine française, où il avait conquis le grade de lieutenant de vaisseau, Lecointe était, à cette époque, détaché à l’observatoire de Montsouris. Il devait se charger de l’astronomie et de l’hydrographie. Au bout de moins de huit jours il entrait en fonctions.
Tous les préparatifs s’étaient poursuivis simultanément en Norvège et en Belgique. En juin 1897, la Belgica était encore à Sandefjord. Successivement, elle y reçut la visite de sir Cléments Markham, président de la Société de géographie de Londres, et, le 19 juin, celle du Dr Fridtjof Nansen, accompagné de M. Rolf Andvord, consul de Belgique à Christiania. Nansen – ainsi que Sverdrup et Johansen, ses compagnons de l’expédition du Fram – m’avait donné déjà, au cours de l’hiver passé par moi en Norvège, d’utiles conseils et de précieuses indications. Le jour de sa visite, un banquet nous réunit chez M. Bryde, le correspondant de l’expédition en Norvège, qui, lui aussi, m’avait aidé de son expérience. Au dessert, ce fut le grand explorateur qui me porta le toast d’adieu.
Une semaine après, le 26 juin, à midi, l’ancienne Patria quitta enfin Sandefjord et, après une relâche à Frederikshavn pour embarquer des vivres et divers instruments, elle arriva le 5 juillet à Anvers où de nouvelles difficultés m’attendaient.
La première fut plutôt comique. J’avais, pour lester le navire dont le chargement ne devait être complété qu’en Belgique, fait remplir d’eau douze caissons* en tôle que nous avions dans la cale, bien que quatre seulement fussent destinés à la provision d’eau. À Anvers, il fallut donc en vider huit pour y arrimer du charbon. L’équipage était encore incomplet ; nous avions de la besogne plein les bras. Le commandant des pompiers m’offrit l’assistance de ses hommes et j’eus la malencontreuse idée d’accepter. Il y avait quelques badauds sur le quai ; ils virent des pompiers vidant la cale de la Belgica ; ce ne fut pas long : quelques heures après le bruit se répandait que mon navire faisait eau de toutes parts. La rumeur en parvint en haut lieu ; elle trouva de l’écho au Parlement, et on prétendit faire entrer la Belgica en cale sèche, pour visiter ses fonds. Heureusement, je pus dissiper toutes les craintes en produisant les certificats du Bureau Veritas norvégien : la Belgica fut réhabilitée.
Nous embarquons cent soixante tonnes de charbon, dont quarante spécialement destinées au chauffage, et environ quarante tonnes de vivres, dont la presque totalité est emballée dans dix mille boîtes de fer-blanc. Nous sommes prêts au grand départ. Mais il manque toujours quelque quatre-vingt mille francs pour assurer le sort de l’expédition.
Afin de réveiller l’intérêt du public, nous l’invitons à visiter la Belgica, et nous exposons sur le quai nos engins de pêche en eau profonde à côté de ceux destinés à la pêche pélagique* et de surface, nos appareils de sondage, les traîneaux, tentes, skis, raquettes à neige, etc.
Le navire est très visité. L’exposition est gratuite, mais elle provoque de nouvelles souscriptions : sou par sou, nous recueillons six mille à sept mille francs. Le conseil communal d’Anvers vote un nouveau crédit de cinq mille francs. Mme Ernest Osterrieth, notre gracieuse bienfaitrice, organise au Parc, à notre profit, une fête qui réussit à merveille.
Mais tout cela ne suffit pas… Je dois, en désespoir de cause, user d’un expédient, faire courir le bruit que, faute d’un complément de ressources, je vais liquider, mettre tout en vente. On s’émeut, et j’obtiens du ministre de l’Intérieur qu’une demande de subsides supplémentaires sera soumise aux Chambres législatives. Ce nouveau crédit de soixante mille francs est, comme le premier, voté à l’unanimité. Voté, oui…, mais non liquidé. Il faut compter avec les lenteurs administratives, avant de compter avec… la Banque nationale. En quittant la Belgique, je devrai, au nom de l’expédition, une somme assez rondelette à l’un de mes amis.
Le 14 août, je fais signer au personnel subalterne un contrat qui n’aura qu’une valeur morale et dont voici les clauses principales :
X… s’embarquera à dater du… 1897, à bord du navire mixte Belgica ou par la suite à bord de tout autre navire ou embarcation qui, par fortune de mer ou à raison des nécessités de l’expédition, viendrait à remplacer provisoirement ou définitivement ledit navire.
Il prend l’engagement de suivre l’expédition pendant toute sa durée – celle-ci devant être de deux ans, mais pouvant, par suite de circonstances imprévues, être écourtée ou prolongée – et ce partout où son chef actuel ou celui qui viendrait à lui succéder croira devoir la diriger, tant sur la terre ferme ou sur la glace qu’en pleine mer, quelles que soient d’ailleurs la latitude et la longitude.
Pour des raisons diverses, indépendantes de ma volonté, nous partons sans rôle d’équipage* : je n’aurai d’autre recours contre les hommes que la menace de débarquement.
Les dernières difficultés étant levées, le départ est fixé, enfin, au lundi 16 août 1897.
II
D’ANVERS À PUNTA ARENAS
Le départ. – Relâche à Madère. – La traversée de l’Atlantique. – Torride prologue d’une expédition polaire. – Le passage de la Ligne. – Escale à Rio de Janeiro. – Embarquement du Dr Cook. – Le cap Polonio. – Montevideo. – On demande un cuisinier. – Première tempête.
Dans la nuit du 14 au 15 août, la Belgica a quitté les bassins pour aller jeter l’ancre en rade. Toute la journée du dimanche 15, c’est, à bord, un défilé ininterrompu d’amis qui viennent nous souhaiter bon voyage, de députations qui nous lisent des adresses.
Je reçois des paquets de télégrammes, des lettres m’apportant de toutes parts des vœux de réussite. Nansen me télégraphie : “Que succès et bonheur vous accompagnent, vous et la Belgica. Puisse votre voyage donner les résultats scientifiques que promettent ses minutieux préparatifs et puissent ces résultats projeter une clarté nouvelle sur la plus obscure partie du globe.” – Mme Wilkes, la vénérable veuve de l’éminent explorateur, évoque en termes émus le souvenir de l’expédition américaine de 1840 et m’adresse aussi ses souhaits de réussite. – “Je regrette, m’écrit le général Brialmont, de ne pouvoir me rendre à Anvers demain pour assister à votre départ, mais vous ne nous quitterez pas sans que je vous adresse mes félicitations et mes vœux : mes félicitations pour le résultat, longtemps inespéré, qu’ont fini par obtenir vos persévérants efforts soutenus par une conviction ardente ; mes vœux pour le succès d’une expédition qui fera honneur au pays… Je serai de cœur avec les Belges distingués qui vous feront escorte et qui vous crieront : en avant, braves compatriotes, pour la Science, pour l’Honneur et pour la Patrie !” – Et voici encore, extraites d’une lettre d’un vieux magistrat que je connais à peine, ces lignes touchantes : “Je demande à Dieu d’assister à votre retour, moi qui suis vieux, vous qui allez aux dangers. Je vous aime comme un vieil ami et vous serre dans mes bras avec une paternelle effusion.”
– Le 16, dès huit heures du matin, le canon tonne en notre honneur au yacht-club, dont nous portons le guidon*.
À neuf heures quarante-cinq, nous commençons à lever l’ancre. Comme tous les navires polaires en partance, la Belgica est surchargée ; le pont est à cinquante centimètres à peine de la flottaison*.
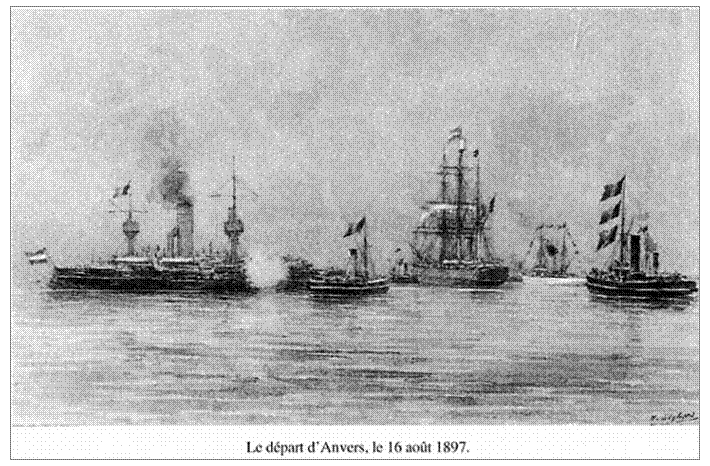
– À dix heures, nous dérapons* et remontons l’Escaut jusqu’à l’extrémité sud des promenoirs. Puis nous virons de bord et passons ainsi devant toute la ville dont les quais sont noirs de foule. À la hauteur de la vieille basilique, nous saluons du pavillon. Nos hommes répondent par des hourras aux acclamations qui nous accompagnent jusqu’au tournant du fleuve. Dans la rade, tous les navires sont pavoisés. Les vaisseaux étrangers nous saluent au passage. Nous marchons en tête d’une petite flottille de yachts, de remorqueurs, de chaloupes. L’Emeraude porte les personnages officiels : le ministre de l’Intérieur, les présidents et des membres des sociétés de géographie de Bruxelles et d’Anvers, les autorités civiles et militaires, les représentants de la presse, des membres de sociétés savantes ; nos amis les plus intimes sont sur le Brabo, où les rejoindront nos parents et notre chère et généreuse amie Mme Osterrieth, quand il leur faudra quitter notre bord.
À la limite des eaux hollandaises, une vive émotion nous attend : la toute gracieuse reine Wilhelmine a envoyé un cuirassé pour nous escorter jusqu’au large. C’est au Doel qu’a lieu la rencontre, et elle ne laisse pas que d’être émouvante. Le Kortenaar hisse au grand mât les couleurs belges, et les salue de vingt et un coups de canon ; à notre bord nous hissons les couleurs hollandaises. L’équipage tout entier du cuirassé, massé sur le pont, pousse de retentissants hourras. Sur plusieurs yachts de notre flottille on entonne l’hymne hollandais. Cette scène, éclairée par un merveilleux soleil, est inoubliable.
Les passagers de l’Emeraude passent sur la Belgica pour nous faire leurs adieux. Un à un les yachts de l’escorte nous quittent.
Nous sommes seuls maintenant avec le Kortenaar et le Brabo – le Brabo qui, dans un moment, me prendra tout ce que j’aime. À trois heures, celui-ci nous accoste ; l’heure suprême des séparations a sonné ; nous brusquons les adieux, sentant que notre sang-froid va nous échapper. Je saute à bord du Brabo pour serrer les mains des amis qui s’y trouvent. Puis je reviens sur la Belgica. On vide en hâte une coupe de champagne, on s’étreint, on s’embrasse, on pleure… Un dernier cri de : “Vive la Belgique !” et les deux navires s’éloignent rapidement l’un de l’autre, pour se perdre bientôt de vue.
Nous étions un peu grisés tantôt par l’apparat dont a été entouré notre départ. La Belgica et sa brillante escorte avaient l’air d’emporter un joyeux pique-nique. Maintenant que nous sommes seuls, nous nous sentons singulièrement émus.
Pour faire diversion, nous nous efforçons de songer déjà à la joie inexprimable du retour, à cette joie si spéciale qui, savourée d’avance, fera pendant deux ans le charme de nos rêveries, et que nul ne peut apprécier s’il n’a été séparé par une longue absence des êtres et des lieux qui lui sont chers. Puisse cette heure n’être obscurcie pour nous d’aucune ombre douloureuse !
… Je devais pourtant revoir les miens plus tôt que je ne le supposais.
À peine étions-nous dans la mer du Nord qu’un accident survint à la machine. Nous décidâmes d’aller la réparer à Ostende. Là, le lendemain de notre arrivée, deux hommes demandèrent à débarquer. Je repartis aussitôt pour Anvers, afin d’y chercher deux remplaçants.
Étrange retour, deux jours après notre sensationnel départ. C’est presque en me cachant que je me rendis à Anvers, sentant bien que l’enthousiasme qui nous avait salués l’avant-veille avait été un peu produit par la griserie du moment, par ces coups de canon, ces mille drapeaux flottant au soleil. La méfiance restait latente chez le plus grand nombre de mes compatriotes. Et les misères qui m’assaillaient déjà ne pouvaient que l’augmenter.
Le double contretemps survenu à l’expédition – accident et défection – eut pourtant une heureuse conséquence. Le 21 août, je fis une précieuse recrue en engageant un jeune Polonais, Antoine Dobrowolski, étudiant en sciences naturelles, qui, avec une touchante insistance, demandait à être embarqué, fût-ce comme novice. Il devait nous rendre d’importants services comme aide de laboratoire et assistant météorologue, et justifier amplement la formule connue : last but not least[13].
Le surlendemain, lundi 23 août, la brise d’ouest qui avait soufflé toute la semaine précédente ayant molli, nous appareillâmes. À huit heures, nous levions l’ancre. Un remorqueur prit notre bosse de remorque. Une demi-heure après, nous quittions Ostende, salués de trois hourras par l’équipage du yacht royal près duquel la Belgica était mouillée.
Le golfe de Gascogne ne mentit point pour nous à sa réputation de mer difficile. Puis, le temps se mit au beau fixe, les brises devinrent favorables et, le 11 septembre, par une soirée idéale, nous mouillions devant Funchal, le port principal de Madère.
Le dimanche 12 septembre, au matin, à peine avons-nous obtenu la libre pratique* qu’aussitôt nous sommes entourés d’embarcations qui viennent nous offrir des fruits et divers produits de la petite industrie de l’île.
À huit heures, nous recevons la visite de M. Carlo de Bianchi, chargé par son père, le consul de Belgique, retenu malade à la campagne, de nous faire des souhaits de bienvenue.
Sitôt débarqués, nous nous occupons de changer en reis une partie des livres anglaises dont nous sommes munis ; nous nous trouvons alors posséder tous ensemble quelque cent mille reis : fortune illusoire qui sera vite dissipée ! Naguère la livre sterling valait encore quatre mille cinq cents reis ; aujourd’hui elle en vaut six mille six cents.
… L’après-midi nous rendons visite aux Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, bien connues de tous les marins qui font escale à Madère. Dès qu’un navire arrive sur rade, les bonnes sœurs s’enquièrent de la durée de son séjour et, si celui-ci est suffisamment long, elles se rendent à bord pour solliciter du travail.
Elles se chargent du lavage du linge et de différents travaux de couture. C’est là, avec quelques leçons particulières, la principale ressource de cette noble institution qui entretient environ quatre-vingts orphelins et donne l’instruction à plus de cinq cents enfants.
Au cours de notre visite, les sœurs me présentent une liste de souscription. En l’examinant, je constate que les officiers des différents navires de guerre ou marchands de passage à Madère y sont inscrits pour des chiffres variant de cinq mille à dix mille… Perdant de vue le système monétaire portugais, je suis bouleversé à cette vue ; je ne sais comment avouer notre pauvreté ; je finis par dire, tout confus, que mes faibles ressources ne me permettent pas de souscrire plus d’une livre sterling. À mon grand étonnement, cette offre est accueillie avec joie ; il se fait que ma souscription, convertie en reis, est une des plus fortes de la liste !
Avant de nous laisser partir, la mère supérieure nous remet à chacun une petite médaille bénite, que nous acceptons de grand cœur.
La mendicité sévit à Funchal sur une grande échelle. Ressource naturelle de quelques miséreux éclopés, elle a été érigée à l’état d’institution sociale par un nombre incalculable d’individus de tout âge, d’ailleurs parfaitement valides. Elle a même été réglementée et, à la porte de certain dépôt de mendicité, les pensionnaires sollicitent à tour de rôle la charité du public. Il y a mieux encore ; passant un soir devant une caserne, quelle ne fut pas notre stupéfaction de voir le factionnaire déposer son fusil avec bruit, comme pour attirer notre attention, puis nous tendre la main en implorant une aumône !
Les moyens de locomotion utilisés par les habitants de Funchal sont aussi variés qu’originaux.
Il paraît qu’on compte à peine une dizaine de voitures dans tout Madère. Généralement les transports se font par traîneaux attelés de bœufs ou à dos de mulet. On peut encore, ce qui constitue un certain luxe, se faire porter en hamac par deux hommes. Enfin, d’un faubourg élevé dans lequel se trouve l’église de Notre-Dame-du-Mont, lieu de pèlerinage très fréquenté, on descend en toboccaning, à la mode canadienne, tandis qu’on y accède par un chemin de fer à crémaillère. Le plus bizarre de tous ces moyens de locomotion est certes le traîneau à bœufs, grande machine carrée en osier, avec deux banquettes se faisant face ; aux quatre angles, des montants portent un toit en toile cirée noire, d’où descendent deux rideaux bariolés, le tout rappelant beaucoup les voitures de carrousels de nos foires, moins les paillettes. Deux bœufs magnifiques sont attelés à ce traîneau et conduits par un garçon qui les précède en courant dans les montées et les retient dans les descentes, au risque de se faire écraser ; un second conducteur court à leurs côtés en les excitant sans cesse de la voix et du fouet. J’ai rencontré dans un de ces véhicules un commodore anglais, en grande tenue, revenant d’une visite officielle : c’était fort drôle.
Pendant qu’à bord on renouvelle la provision d’eau douce et qu’on embarque des vivres frais, sous la direction d’un des officiers, les autres membres de l’état-major consacrent la journée du lundi à la traditionnelle et toujours pittoresque excursion au Grand Coral.
Le lendemain nous levons l’ancre.
La traversée de l’Atlantique fut longue, monotone et plutôt pénible. Les alizés nous faussèrent souvent compagnie.
Je ne retrouve au journal du bord aucune notation d’incident marquant. J’y relève cependant cette mention, à la date du 4 octobre :
« À une heure trente, dépassé le quatre-mâts français Antoinette, de Dunkerque, en vue depuis le matin. Au moment où nous sommes par le travers* l’un de l’autre, nos couleurs sont hissées simultanément et quelqu’un crie de la dunette du bâtiment français : « Vive la Belgique ! Vivent les hardis explorateurs ! » Tout l’équipage français répète ces vivats, auxquels il est répondu de notre bord par les cris plusieurs fois répétés de : « Vive la France ! »
Il n’y a pas de place dans un livre de bord pour de longs développements. Mais, en dépit de son laconisme, ce simple procès-verbal suffit à évoquer dans ma mémoire une scène profondément émouvante.
Arctowski et Racovitza souffrent beaucoup, le second surtout, du mal de mer. Ils n’en emploient pas moins vaillamment leurs heures valides à aménager les laboratoires, qui finissent par prendre, dans leur exiguïté, un air confortable et sérieux, faisant fort bien augurer de l’avenir.
Une expédition antarctique ne saurait débuter autrement que par une traversée de la zone torride. Futurs explorateurs de la banquise, en attendant d’avoir des glaçons plein la barbe, nous sommes accablés par la chaleur, en dépit de nos sommaires costumes blancs et de nos chapeaux de paille. Dans les cabines, disposées autour de la machine, et soigneusement calfeutrées en prévision des basses températures qui nous attendent, le thermomètre s’élève à plusieurs reprises jusqu’à 55° au-dessus de zéro ; aussi avons-nous installé des hamacs sur le pont et abandonné temporairement nos couchettes.
Les moments gais de la journée sont ceux des repas qui nous réunissent autour de la table du carré. Partie de sujets scientifiques ou plaisants, de souvenirs de voyages ou de la vie d’étudiant, presque toujours la conversation aboutit à l’Antarctique, le mystérieux pays de nos rêves !
Le soir, après le souper, les matelots réunis sur le gaillard d’avant* chantent tantôt de naïves mélodies scandinaves, empreintes toujours d’une teinte très douce de mélancolie, tantôt de bruyants et gais refrains flamands tout débordants de vie, et que l’accordéon allègrement accompagne. Nous les écoutons en faisant les cent pas sur la dunette, en matière de promenade de digestion, ou bien assis sur la passerelle. À huit heures, la musique cesse, le changement de quart s’effectue et tout rentre dans le calme.
Nous sommes fréquemment suivis par des dauphins qui s’amusent à lutter de vitesse avec nous, ce qui n’est pas bien difficile. Quand, pendant la nuit, la mer est phosphorescente, les sillages ondulés qui décèlent leur présence semblent autant de grands serpents de feu prêts à nous enlacer : c’est fort beau, un peu fantastique même.
Il nous arrive de rester de longues heures sur le pont, sous le charme des belles nuits tropicales, bercés par le clapotement monotone de l’eau sur notre coque ; de nos yeux grands ouverts nous contemplons les milliers d’étoiles scintillantes qui emplissent le ciel et semblent grésiller en se reflétant dans la mer ; parfois un météore, telle une flèche d’or doux, traverse le ciel pour glisser jusqu’aux flots le long de la voûte bleue.
Le 6 octobre, passage de la Ligne, fêté avec tout le cérémonial bon enfant du temps jadis. Nombreux sont, à bord, ceux qui n’ont pas encore franchi l’équateur. Tous se prêtent de bonne grâce au baptême traditionnel, condition essentielle à l’obtention du diplôme que Neptune exige pour le passage d’un hémisphère dans l’autre. Les diplômes de la Belgica, préparés depuis plusieurs jours dans le plus grand mystère, sont illustrés de dessins mettant humoristiquement en relief les petits travers des récipiendaires.
Une distribution de vin et de tabac aux hommes, un concert, une audition du phonographe complètent la fête.
Nous fîmes ainsi joyeusement notre entrée dans l’hémisphère austral.
… Tout en naviguant sous le soleil ardent des tropiques, nous préparons l’hivernage prévu[14]. Nous opérons un triage des vivres, classant les caisses et les marquant d’un H et d’un numéro d’ordre. Les premiers numéros désignent les objets et les denrées les plus indispensables, afin que, si le temps venait à nous manquer pour tout débarquer, nous ne fussions pas au moins privés du strict nécessaire. Sur le pont brûlant sont étalés, comme par une antithèse préméditée, des couvertures, des bottes, des mocassins, des fourrures.
Le 15 octobre, nous commençons à faire la toilette de notre petit navire en vue de l’arrivée à Rio. La Belgica étant le premier bâtiment belge qui entrera dans ce port, depuis des années, c’est bien le moins qu’il fasse bonne figure, et que nos compatriotes établis là-bas n’aient pas à rougir de nous. Aussi tirons-nous tout le parti possible des quelques pots de couleur dont nous disposons.
Il était deux heures de l’après-midi, le 22 octobre, lorsque nous pénétrâmes dans la rade de Rio de Janeiro, laissant à bâbord le fameux “pain de sucre”. Il pleuvait malheureusement à torrents, ce qui nous gâta la vue du merveilleux panorama qu’offre cette rade par temps clair.
Une lettre de crédit, qu’on me remit dès l’arrivée et sans laquelle nous restions en panne, m’apprit que l’administration avait enfin déposé chez mes correspondants d’Anvers le montant du second subside gouvernemental.
… La réception que l’on nous fit à Rio restera à jamais dans mon souvenir. Je remplirais un chapitre entier rien qu’à résumer les nombreuses et touchantes marques de sympathie dont les membres de l’expédition furent l’objet durant les huit jours de l’escale, aussi bien de la part des autorités, de la population et du monde savant brésiliens que de la colonie belge tout entière.
Le ministre de Belgique, comte van den Steen de Jehay, prit la peine de nous accompagner dans toutes nos courses et démarches, et, mettant le comble à son amabilité, il nous invita à passer deux jours dans sa résidence de Petrópolis où il réunit à sa table, en notre honneur, les ministres et chargés d’affaires étrangers, ainsi que le commodore anglais. Le docteur Moreas, président de la République, nous accorda une audience privée. L’Institut d’histoire et de géographie nous admit au nombre de ses membres, nous reçut en une séance extraordinaire et nous exprima en d’inoubliables termes les vœux les plus ardents pour le succès de notre entreprise.
Les marques de sympathie ne se bornèrent pas là : les arsenaux de la Marine de l’État furent mis à notre entière disposition, et nos compatriotes allèrent jusqu’à vouloir solder de leurs deniers toutes les petites dépenses que l’expédition avait été forcée de faire, et dont le total s’élevait à environ deux mille francs.
Presque tous les Belges habitant Rio de Janeiro vinrent à bord et m’exprimèrent la joie qu’ils ressentaient à voir enfin, sur la rade, le pavillon national. Quelques-uns étaient tout heureux de parler wallon ou flamand avec nos hommes ; la Belgica était pour eux comme un coin de la patrie retrouvée.
Cependant, le samedi 30 octobre, il fallut partir. La Belgica fut escortée par trois petits vapeurs pavoisés : celui de la Compagnie du gaz (compagnie belge), à bord duquel se trouvait le ministre de Belgique et quelques membres de la colonie ; un autre monté par notre compatriote M. Cruls, l’éminent directeur de l’Observatoire, enfin un vapeur de l’État. Nous étions sous petit pavois*, les couleurs brésiliennes au grand mât. Tous les vaisseaux de guerre mouillés sur rade nous saluèrent au passage et hissèrent des signaux nous souhaitant bon succès. À bord du cuirassé anglais Retribution, le commandant et son état-major, alignés sur le pont arrière, donnèrent eux-mêmes le signal des vivats à l’équipage rangé à l’avant et massé dans les haubans*, face à la Belgica, tandis que l’homme de garde présentait les armes. Sur le fort Villegagnon, devant lequel nous passâmes, une musique militaire joua La Brabançonne…
Notre traversée jusqu’à Punta Arenas devant encore durer plusieurs semaines, Racovitza, que le mal de mer avait le plus éprouvé, nous avait quittés à Rio. Il avait pris passage sur un paquebot rapide, l’Oravia, qui le conduisit en six jours dans le détroit de Magellan où il put, en nous attendant, se livrer à des études zoologiques et botaniques.
En revanche, nous avions embarqué le Dr Cook, dont j’ai déjà raconté l’engagement, fait à la yankee, et avec lequel je n’avais échangé jusque-là que quelques mots – par câble.
Pour une expédition comme la nôtre, le choix des compagnons de voyage est de la plus haute importance – surtout le choix du médecin. Non seulement il faut un praticien habile ; mais il est indispensable qu’il soit doué du meilleur caractère. Ses devoirs professionnels n’absorbant qu’une faible partie de son temps, il doit savoir employer utilement ses loisirs, sans quoi son oisiveté deviendrait un danger pour la bonne entente générale.
Guidé uniquement par le hasard, j’ai eu la main heureuse. Cook est un charmant camarade, serviable, actif et ingénieux. Il rendra à l’expédition, comme médecin, d’inappréciables services, et il prendra une part importante à nos travaux scientifiques. Il a trente-deux ans : c’est le doyen d’âge du carré.
Le 8 novembre, au moment où nous entrons dans le Rio de La Plata, un pampero nous assaille. Je me décide à aller étaler* ce coup de vent de suroît* à l’abri du cap Polonio. Le lendemain, nous profitons d’un moment d’embellie pour nous rendre à terre, où nous recevons un accueil cordial des vingt personnes qui habitent là deux ou trois maisonnettes bâties autour du phare.
Ces braves gens vivent de la chasse aux phoques qui se pratique tous les ans, du 15 mai au 15 octobre, sur les îlots gisant en chapelet à quelques encablures* de la côte ; la petite colonie a capturé cette année neuf mille phoques et elle a établi une fonderie de graisse.
… Du 11 au 14 novembre, escale à Montevideo. Un compatriote rencontré là, M. Huysmans, me conduit au marché, qui est fort beau, spacieux et bien approvisionné. Pendant deux heures, nous y marchandons des légumes, des fruits, de la volaille, de la viande et du poisson, afin de reposer l’équipage des conserves.
Cette promenade me remet en mémoire une première visite que je fis, il y a quelque dix ans, à ce même marché de Montevideo. J’étais alors matelot à bord d’un voilier anglais, parti d’Anvers pour San Francisco et que les fortunes de la mer avaient, après six mois de pénible navigation, amené désemparé à Montevideo où il fut condamné, c’est-à-dire délaissé à ses assureurs, puis vendu. Le navire avait été déchargé et nous n’étions plus à bord que quatre ou cinq hommes, les autres ayant déserté ou ayant été licenciés à leur demande. Tous les jours nous conduisions le capitaine à terre dans une des embarcations du bord. Un jour, un samedi, si ma mémoire est fidèle, au lieu de nous renvoyer immédiatement en nous désignant l’heure à laquelle il désirait que nous vinssions le chercher, le capitaine ordonna aux autres hommes de l’attendre et me demanda de l’accompagner au marché. Ne m’attendant pas à cette promenade sur “le plancher des vaches”, j’étais nu-pieds, n’ayant d’ailleurs pour tout vêtement qu’une chemise de flanelle et un pantalon de toile, car il faisait très chaud. Et c’est dans ce simple appareil que j’allai pour la première fois au marché de Montevideo et que j’en revins, tenant dans chaque main une dinde vivante qui se débattait.
Aujourd’hui aussi j’ai acheté des dindes, mais ce n’est plus moi qui les porterai à bord. Dix années ont passé sur ma tête et, de simple matelot, je suis devenu capitaine et chef d’une expédition. En suis-je plus heureux ? Autrefois, c’était une vie rude, toute pliée sous une obéissance passive ; mais j’avais vingt ans, j’étais insouciant, confiant dans l’avenir. L’avenir rêvé déjà alors, c’est le présent d’aujourd’hui. Mais quelle réalité atteignit jamais au doux éclat des rêves ! Je ne relève plus que de moi-même et pourtant il me faut obéir encore, obéir aux obligations, aux responsabilités de tous genres qui pèsent sur moi… C’était plus facile autrefois…
Notre consul à Montevideo, M. André, possède une qualité que n’ont pas tous les consuls de Belgique : il est belge et il aime son pays. Je n’ai pas oublié qu’il fut un des premiers souscripteurs de l’Expédition antarctique, et je suis heureux d’avoir l’occasion de l’en remercier verbalement. Un autre représentant de notre pays, M. Van Bruyssel, ministre de Belgique à Buenos Aires, m’envoie une invitation pressante à aller passer deux jours dans la capitale argentine, où nos nationaux, très nombreux, désirent nous recevoir et nous fêter. Mais je dois refuser faute de temps.
Je me proposais de quitter Montevideo le 13 de grand matin, quand un incident nous causa un retard de vingt-quatre heures : je fus obligé de congédier le cuisinier pour manquement grave à la discipline et je trouvai difficilement à le remplacer en m’adressant à un “marchand d’hommes” du port.
Le Razón, un grand journal local, publia ce jour-là un long article sur l’expédition. En terminant, il relata le débarquement du coq de la façon suivante : “Nous apprenons que le cuisinier renonce à l’honneur d’accompagner M. de Gerlache. Nous ne savons si celui-ci a trouvé un remplaçant, mais il y aurait lieu de faire une annonce ainsi conçue : Cuisinier. – On demande un cuisinier pour le pôle Sud ; on n’est pas exigeant sur les aptitudes culinaires ; mais il devra cependant savoir accommoder le cachalot (?) et le phoque ; au surplus il ne devra pas être frileux. Il sera libre tous les dimanches.”
Un cuisinier suédois fut engagé. Il tomba malade le lendemain du départ et dut être débarqué par la suite à Punta Arenas.
Le 14, puis le 15, nous faisons des tours d’horizon* pour régler les compas. Le 17, nous voyons les premiers albatros ; le surlendemain, les premiers manchots.
… Les soirées sont délicieuses. Le soleil se couche de plus en plus tard et y met une coquetterie dont le spectacle nous ravit toujours. Au ciel d’un bleu profond, pas un nuage, et une brise légère rafraîchit la température. Les albatros noir et blanc sont de plus en plus nombreux. Sur la mer, de grandes algues ondulent aux caprices des vagues.
Les aurores et les crépuscules, très longs maintenant, déploient devant nos yeux éblouis toute la magie des couleurs, tout l’orient des plus belles nacres. Avant de descendre sous l’horizon, le soleil prend des formes étranges ; tour à tour il présente l’aspect d’un champignon, puis d’une enclume, enfin d’une cuvette. Quand il a disparu, le ciel se colore, un reflet d’or l’illumine longtemps encore et ce n’est que très, très lentement qu’il s’assombrit assez pour que la clarté des étoiles soit distincte. À l’avant, la Croix du Sud se dessine, moins “ardente” que ne l’a proclamé le poète, sollicitant nos rêveries vers les prestigieux pays de l’extrême Sud.
Le 26 novembre cependant, le temps se gâte. Le lendemain, une forte tempête du sud-ouest s’abat sur nous. La mer est démontée. Je dois recourir au filage de l’huile* pour tempérer autour de nous l’action des flots.
La Belgica se comporte à merveille ; mais, vers dix heures du soir, le vent souffle avec une telle violence, la mer est si grosse que je vais me résoudre à fuir devant le temps et à chercher l’abri des Falkland, ce qui nous ferait perdre plusieurs jours.
Heureusement la brise mollit soudain, le temps devient plus maniable, le ciel s’entrouvre et la première constellation qui se montre est la Croix du Sud. Sans être superstitieux, ne puis-je y voir un heureux présage ? Le lendemain matin nous dégréons les perroquets* dont nous ne nous servirons plus désormais jusqu’à notre retour.
Le 29, à cinq heures du matin, nous apercevons le cap des Vierges et, à midi, nous embouquons dans le détroit de Magellan.
La navigation dans le détroit de Magellan, comme en général dans tous les canaux de la Terre de Feu, exige la plus grande attention ; les courants y sont d’une grande violence et l’on y essuie des coups de vent terribles. “Pour faire cette navigation, est-il dit aux Instructions nautiques, il faut un navire sûr de ses évolutions, un équipage déjà exercé, de bonnes ancres et de bonnes chaînes, de la patience, de l’activité, de la persévérance et de bons yeux.”
Avant d’atteindre Punta Arenas, on doit franchir deux goulets étroits où les courants de marée atteignent une vitesse de sept à huit nœuds*. Nous ne pouvions songer à nous engager dans ces passes autrement qu’avec le flot, c’est-à-dire avec le courant de marée montante venant de l’Atlantique. Nous avons donc procédé par étapes, et ce n’est que le surlendemain de notre entrée dans le détroit, c’est-à-dire le 1er décembre, que nous arrivons au mouillage de Punta Arenas.
M. Curtze, notre correspondant, et notre camarade Racovitza montent aussitôt à bord. Celui-ci, qui nous avait quittés à Rio en assez triste état, est maintenant en florissante santé ; avec son poncho, ses hautes bottes et son grand chapeau mou qui fait ici ses derniers beaux jours, il a l’air d’un solide gaucho. Il est enchanté de l’emploi de son temps. Pendant sa traversée à bord de l’Oravia, il a fait la connaissance de M. Moreno, le savant fondateur et directeur du musée de La Plata, arbitre argentin dans la question délicate et épineuse, depuis si longtemps en litige, de la délimitation des frontières chilo-argentines. Dès leur arrivée, ils ont organisé une caravane pour se diriger vers la cordillère des Andes. Racovitza a ainsi voyagé vingt jours avec ce distingué compagnon, vivant de la vie de “campo”. De cette excursion et d’une autre de six jours entreprise vers Port-Famine, l’ancienne colonie, il a rapporté des échantillons intéressants de la faune et de la flore magellaniques.
III
DANS LES CANAUX DE LA TERRE DE FEU
Punta Arenas, la ville la plus méridionale du monde. – Quatre hommes débarqués. – La navigation dans les canaux. – Ushuaia et le Rév. Thomas Bridges. – Nous puisons dans le dépôt de charbon argentin. – La fête de Noël. – Échouage dans le canal du Beagle : la Belgica en perdition. – Harberton.
Les traités intervenus en 1881 et 1893 entre la république du Chili et la République argentine laissent à la première, du côté continental, les rives du détroit de Magellan et une bande territoriale s’étendant jusqu’au 52e parallèle et, de l’autre côté du détroit, les parties septentrionale et occidentale de la Terre de Feu et tout l’archipel magellanique situé à l’ouest du canal de Cockburn et au sud de celui du Beagle, tandis que la partie orientale de la Terre de Feu et l’île des États appartiennent à la République argentine.
Punta Arenas est la capitale des territoires chiliens désignés officiellement sous la dénomination de colonie de Magellan. Son nom de Punta Arenas, en anglais Sandy Point, lui vient de la pointe de sable qui s’avance vers le nord du mouillage.
C’est la ville la plus méridionale du monde.
Déjà, en 1582, une tentative d’établissement avait été faite dans le détroit par le célèbre navigateur Sarmiento pour assurer à l’Espagne la possession de ce passage. Ce n’est pas, à vrai dire, à l’endroit occupé aujourd’hui par la petite cité chilienne que Sarmiento s’établit, mais plus au sud, près de l’extrémité de la presqu’île de Brunswick ; il appela cette station lointaine : Ciudad Real de Felipe. La rigueur du climat, l’imprévoyance et l’anarchie contribuèrent au désastre de cette colonie d’extrême Sud : le nom de Port-Famine (Puerto Hambre), qui en perpétue le souvenir à travers les âges, est suffisamment explicite pour que je n’aie pas à insister autrement.
Bien que la région magellanique passât pour inhospitalière et stérile, le gouvernement chilien n’hésita pas à y fonder, en 1843, un poste militaire : le fort Bulnes.
Ayant bientôt reconnu les inconvénients et les dangers de ces lieux exposés aux frimas et que les Andes dominent de façon trop immédiate, on transporta l’établissement plus au nord, près de la pointe de sable dont nous avons parlé plus haut et qui ménage un mouillage excellent, auquel sa situation sur le détroit donne une grande importance stratégique.
Comme celle des établissements antérieurs, l’histoire de Punta Arenas abonde en péripéties dont la dernière date de 1877. Punta Arenas était alors une colonie pénale où les forçats et leurs gardiens traînaient une existence misérable – si misérable qu’enfin tous se révoltèrent, les soldats d’accord avec les galériens. Les rebelles s’emparèrent de la ville, mutilèrent le commandant de la garnison, le mirent à mort et lui tranchèrent la tête, qu’ils attachèrent sur la porte de la prison. Puis ils pillèrent. Mais, trois jours après, l’apparition d’un navire de guerre chilien les mit en fuite. Les mutins commirent l’imprudence de charger la quarantaine de chevaux dont ils disposaient de leur butin, inutile bric-à-brac, sans songer à prendre des vivres. Après avoir successivement tué tous les chevaux pour subsister, ils périrent jusqu’au dernier dans le terrible désert patagon.
Ce drame allait avoir, sur l’avenir de Punta Arenas, la plus heureuse répercussion : la ville se trouva du coup débarrassée de la prison qui ne fut pas rétablie, et de la triste population qui la gangrenait. Plus rien désormais ne s’opposait à sa prospérité.
Le gouvernement s’efforça d’y attirer des colons, auxquels il accordait le passage, remboursable à longue échéance et sans intérêts, auxquels il donnait en outre un terrain propre à la culture, des ustensiles, quatre vaches, un bœuf, deux chevaux et des matériaux pour bâtir une cabane. Des émigrés de tous les pays du monde civilisé répondirent à cet appel et la colonie ne tarda pas à prospérer. Quatre ans plus tard, la population était montée de cent quatre-vingt-quinze à huit cents âmes.

Dès 1868, les vapeurs de la Pacific Steam Navigation Cy avaient commencé à traverser le détroit de Magellan et faisaient escale à Punta Arenas. Aujourd’hui, des paquebots allemands alternent avec les vapeurs anglais ; Punta Arenas est ainsi en communication hebdomadaire et avec Valparaiso et avec Buenos Aires et l’Europe. Déclaré port franc, cette même année, 1868, Punta Arenas n’a pas cessé de prospérer et, lors de notre passage, sa population s’élevait à quatre mille cinq cents habitants environ.
La classe prolétaire est en grande partie composée de Dalmates, gens laborieux et honnêtes, qui se livrent surtout aux métiers de la mer ; les Allemands sont fort nombreux et plusieurs d’entre eux se sont fait de jolies situations dans le commerce ; tous les pays de l’Europe sont représentés au moins par quelques colons.
Le personnel administratif chilien se compose d’un gouverneur civil, d’un greffier, d’employés des postes, d’un receveur des impôts ou trésorier, d’un médecin chirurgien, d’un capitaine du port.
La petite cité patagonne est, en outre, le siège principal des missions des RR. PP. salésiens qui dirigent deux établissements abritant quelques centaines de Fuégiens : celui de l’île Dawson, sur le territoire chilien, et celui de Rio Grande, dans la portion argentine de la Terre de Feu.
Depuis qu’un Anglais, M. Reynard, a eu l’idée de faire venir des moutons des îles Falkland et de fonder une estancia aux environs de Punta Arenas, l’exemple a été suivi. L’élevage du mouton est pratiqué maintenant dans toute la Patagonie australe et même de l’autre côté du détroit, dans la partie pampéenne de la Terre de Feu. C’est à Punta Arenas que les estancieros embarquent leur laine. C’est dans ses magasins, grands bazars où l’on trouve de tout, qu’ils viennent se pourvoir de ce qui leur est nécessaire. C’est là encore que les prospecteurs, les chercheurs d’or, vendent les rares pépites qu’ils trouvent dans ces parages désolés, depuis le cap des Vierges jusqu’au cap Horn, et notamment dans le petit arroyo del Oro ; c’est là aussi qu’ils dépensent en orgies la valeur des quelques centaines de grammes du précieux minerai qu’ils ont souvent mis plusieurs mois à recueillir.
Il y a quelques années, on parla avec enthousiasme du charbon, dont on prétendait avoir trouvé une veine importante à proximité de la ville. Une compagnie d’exploitation s’était formée et une petite voie ferrée était déjà construite, quand on s’aperçut que le charbon tant vanté n’était qu’un mauvais lignite qui ne valait pas les frais d’extraction.
Quelques négociants arment à Punta Arenas de petites goélettes pour la chasse aux otaries à fourrure, sur les îlots du sud et de l’ouest de la Fuégie ; ils se créent ainsi de beaux revenus, en dépit des lois prohibitives qu’a édictées le gouvernement chilien pour préserver de l’extermination ces intéressants pinnipèdes.
Des hommes d’initiative ont établi des scieries importantes, des chantiers de construction, des forges.
Quelques-uns enfin, ils sont quatre ou cinq, exercent le métier de scaphandrier que les naufrages et les accidents de mer, très fréquents dans ces parages, rendent extrêmement lucratif.
Bref, Punta Arenas n’est pas le “petit trou” que l’on pourrait croire. Il serait exagéré pourtant de prétendre que c’est une belle ville. Larges, tirées au cordeau, selon le système des cuadras, les rues ne sont pas pavées et elles sont à peu près impraticables lorsqu’il pleut, ce qui n’arrive que trop souvent. Elles sont bordées de maisons basses, construites en bois et recouvertes de tôle ondulée, occupées presque toutes par de grands magasins où les marchandises les plus disparates sont entassées.
Comme toutes les villes hispano-américaines, Punta Arenas a une place publique, sorte de square, où se dresse le palais du Gouvernement, bâtiment à un étage, construit en briques et en pierre.
Sur la même place se trouve le dernier vestige des premiers jours de la colonie, l’ancienne résidence officielle, vilaine bâtisse en bois, dont le toit, jadis couvert de tuiles, a été curieusement rapiécé avec de la tôle, des ardoises, des planches, voire du chaume, ce qui donne à cette bicoque un air aussi lamentable que pittoresque. C’est là qu’est installé maintenant le poste de police.
Devant quelques maisons s’étendent des plates-bandes de fleurs, et la plupart des fenêtres sont ornées de pots de fuchsias ou de géraniums obtenus à grand-peine.
Si l’hiver n’est pas très rigoureux, il ne fait, par contre, jamais très chaud en été. L’hiver est la saison la plus saine : l’atmosphère est sèche, le beau temps est habituel, les forts vents sont plus rares.
Par contre, l’été est humide ; le ciel, presque toujours couvert, se résout en pluies fréquentes et les terribles vents du sud-ouest règnent constamment. On note comme température moyenne environ +7° centigrades. La température maximum observée de 1891 à 1895 est de +26° (7 février 1893) ; la température minimum, de -6,9° (13 juillet 1895) ; les températures moyennes pour ces cinq années sont respectivement : +6,44° +6,69° +7,29° +7,02° et +7,04°.
Punta Arenas possède plusieurs hôtels dont l’un, tenu par une Française de Marseille, Mme Euphrasie Dufour, eut l’avantage de nous héberger.
Une des curiosités locales est le corps des pompiers : Cuerpo de Bomberos. Cette institution est organisée par les habitants ; les membres sont des marchands, des estancieros ou des fonctionnaires, tous volontaires. Ils possèdent un beau matériel et un local spacieux qui, dès le jour de notre arrivée, fut mis gracieusement à notre disposition. C’est une habitation bâtie sur le modèle des anciennes maisons coloniales américaines, à façade peinte en rouge et décorée de piliers. Les “salons” de ce poste sont les lieux de réunion de MM. les pompiers, qui viennent tous les soirs y faire au baccara des différences de plusieurs milliers de piastres, tout en absorbant force verres de bière ou d’autres boissons.
Punta Arenas est d’ailleurs l’une des villes du monde où l’on boit le plus. Le nombre de barriques et de bouteilles de vin ou de liqueurs qui y sont importées chaque année est considérable. Vides, les barriques sont employées dans les fonderies de graisse de mouton. Quant aux bouteilles, quelques habitants en ont trouvé un emploi bien plus original ; ils en ont construit des maisons en les reliant entre elles par du mortier.
Fonctionnaires, colons, officiers du stationnaire chilien Magalhanes, s’ingénièrent à l’envi à nous rendre agréable notre relâche, prolongée par les difficultés de l’embarquement des briquettes, expédiées de Belgique, et qui nous avaient attendus sur un ponton.
Le deuxième dimanche, nous fûmes invités à un grand pique-nique. Nous étions peut-être soixante en tout à cette fête champêtre et cependant dix-neuf nationalités s’y trouvaient représentées. Un Suisse, ancien officier de l’armée russe, était notre amphitryon. Combien il eût été intéressant d’entendre tous ces gens raconter leur roman vécu !
J’étais assis à côté d’un millionnaire de la Terre de Feu, qui possède une estancia de cent mille moutons et entretient des carabiniers auxquels il alloue une livre sterling par scalp de “chien sauvage” ; on désigne ainsi les malheureux Indiens dans le monde des affaires.
Mon second voisin, un Français, ancien sous-officier de cavalerie, parti de chez lui il y a quelque trente ans, sans sou ni maille, mais riche d’un portefeuille de ministre de la Guerre que lui avait conféré cet extraordinaire aventurier qui, sous le nom d’Orélie Ier, était alors roi d’Araucanie, avait fini par échouer ici ; il s’était alors occupé d’élevage, et lui aussi était en passe de devenir millionnaire.
Qui sait si parmi les convives de ce pique-nique international ne se trouvait pas, sous un nouveau nom d’emprunt, Jean Orth, cet archiduc d’Autriche qui, las des pompes impériales, se fit capitaine au long cours, puis disparut, et que d’aucuns disent établi aujourd’hui en Patagonie ?
La fin de notre séjour à Punta Arenas fut marquée par un incident déplorable. Des actes d’insubordination se produisirent. Privé, comme je l’ai mentionné déjà, de rôle d’équipage, je ne pouvais appliquer aucune mesure répressive (fers, arrêts de rigueur ou retenue de solde), et il me fallut bien user du seul droit que j’eusse : le licenciement. Je dus débarquer quatre hommes, non sans regret, mais il était indispensable de sauvegarder la discipline.
Comme, d’autre part, le cuisinier suédois, embauché à Montevideo, était toujours malade, je renonçai également à ses services et ne trouvai pas à le remplacer. Ainsi, nous n’étions plus à bord de la Belgica que dix-neuf, dont sept matelots[15].
C’est à peine suffisant. De plus, nous sommes déjà en retard et nous devons encore faire un crochet pour aller achever de remplir nos soutes à charbon à Lapataïa, dans le canal du Beagle, où le gouvernement argentin possède un dépôt dans lequel il nous a généreusement invités à puiser. Il est désormais impossible d’atteindre la terre Victoria cette année. Nous nous bornerons donc cette saison à visiter la baie de Hughes et la terre de Graham, puis nous nous dirigerons vers l’Australie où nous pourrons arriver en mai, afin d’y passer la mauvaise saison australe. L’année suivante nous gagnerons la mer de Ross… Ce second programme devait d’ailleurs avoir le même sort que le premier.
Nous appareillons le 14 décembre, par un temps assez brumeux. Dans nos hunes, garde-manger aéré à souhait, sont accrochés de gros quartiers de bœuf que nous ont donnés les pères. Vers midi nous entrons dans le Magdalena Sound qui, avec le canal Cockburn, sépare des îles occidentales de l’archipel, la Terre de Feu proprement dite. Ne pouvant pas, avant la tombée de la nuit, atteindre un autre mouillage aussi favorable, nous entrons vers une heure dans le petit havre de l’Espérance (Hope Harbour) que forme une échancrure de l’île Clarence.
La position des écueils qui rendent si délicate la navigation dans les canaux de la Terre de Feu est toujours révélée, de jour, par les amas d’algues (Macrocystis pyrifera) qui les recouvrent et tiennent lieu de balises pour le marin qui connaît cette particularité ; mais, la nuit, ces eaux ne sont pas “éclairées” et il serait téméraire de s’y aventurer.
Nous devons donc procéder par étapes et choisir chaque jour un bon mouillage pour la nuit.
Hope Harbour est, paraît-il, très fréquenté par les Indiens Alacaloufs, et nous espérions en rencontrer quelques-uns ; nous ne vîmes qu’un wigwam abandonné. Cette misérable hutte était faite de quelques branches d’arbres fichées en terre, entre lesquelles s’entrecroisaient des branchages.
Le 15, ayant quitté le mouillage de grand matin, nous reconnaissons à sept heures la base du mont Sarmiento dont la cime neigeuse est enveloppée de brume ; dans l’après-midi, nous sentons la houle du large en doublant la péninsule de Brecknock. Nous essayons d’entrer dans une crique que nous apercevons sur la côte nord de l’île London, mais l’état de la mer et l’étroitesse de l’entrée de ce petit havre en rendent l’accès difficile, et nous préférons poursuivre notre route vers l’est et chercher plus loin un abri pour la nuit.
Il est près de dix heures, et l’obscurité ne nous permet plus de naviguer avec sécurité, quand nous mouillons sous le vent* de l’île Basket, à l’entrée d’une petite baie découpée vers le milieu de la côte est.
Une multitude de récifs émergent au large et les brisants indiquent des basses nombreuses. Toute la nuit durant, des rafales violentes descendent des montagnes et couchent littéralement sur l’eau notre petit bâtiment. Aussi laissons-nous la machine sous pression et quittons-nous, dès le point du jour, ce mouillage peu sûr.
En faisant route vers le Whale Boat Sound, nous naviguons entre d’innombrables récifs et îlots qui ne figurent pas sur la carte ; et cependant, si imparfaite que soit celle-ci, nous sommes saisis d’admiration profonde pour les marins qui l’ont dressée et qui ne disposaient que de bâtiments à voiles pour parcourir ces parages dangereux, semés d’écueils, et où la tempête est la règle.
Avant d’arriver à Ushuaia, nous mouillons trois fois encore.
Pendant cette navigation, nous sommes fréquemment assaillis par de brusques rafales. Alors que tout est calme, le ciel et l’eau, sans un souffle, sans un frémissement, soudain un grondement sourd semble partir du haut des montagnes, dévalant sur leurs flancs avec un bruit d’avalanche. Un sifflement strident passe dans les vergues* ; le navire donne de la bande* comme si, couvert de toile, il était surpris par un grain. Puis, après quelques secondes, il se relève : tout est redevenu serein.
Le 21 décembre enfin, nous parvenons à huit heures du soir devant la presqu’île d’Ushuaia ; nous contournons le chapelet d’îles qui gisent dans le sud-est, et à dix heures et demie l’ancre tombe dans la baie par dix mètres d’eau.
Ushuaia, qui dispute à Punta Arenas l’honneur d’être la ville la plus méridionale du monde, n’est, en dépit de son titre officiel de capitale de la Terre de Feu argentine, qu’une simple bourgade composée d’une vingtaine de maisons et d’une chapelle construite en bois.
Ses débuts furent presque aussi tragiques que ceux de Punta Arenas. Ce n’est qu’après un désastre et de nombreuses difficultés secondaires que la South America Missionary Society parvint à s’établir à Ushuaia, en 1862. L’année suivante, elle confiait la direction de ce poste au révérend Thomas Bridges, à qui elle donnait pour coadjuteur John Lawrence. L’histoire d’Ushuaia se confond dès lors avec celle de ces deux hommes.
Dès le début de l’établissement de la mission, quelques Indiens, surtout des Yahgans, vinrent se grouper autour des révérends. La majorité des survivants de cette tribu vivent aujourd’hui, soit autour de la mission d’Ushuaia, soit près de sa succursale de Tekenika (baie Orange). Est-ce à dire qu’ils soient convertis et qu’ils se portent mieux ? Nous nous permettons de mettre en doute le premier point ; quant au second, nous pouvons affirmer le contraire. La mortalité chez les Yahgans, plus encore que chez les Alacaloufs et les Onas, atteint des proportions effrayantes et, d’ici à très peu de temps, de l’aveu des missionnaires eux-mêmes, les établissements des Révérends évangélistes, aussi bien que ceux des RR. PP. salésiens, du reste, n’auront plus de raison d’être en tant que missions. Le cas a été sagement prévu, d’ailleurs.
Tom Bridges était un homme éminemment pratique. Il n’entrait guère dans ses idées de vivre de la vie des Yahgans, de souffrir leurs peines, de partager leurs joies. Il ne comprenait pas l’évangélisation comme la pratiquent d’autres missionnaires, dans un esprit d’entière abnégation. Le soin de son bonheur éternel ne lui paraissait nullement incompatible avec celui de sa fortune et de sa prospérité terrestre. En échange de leur nourriture, les Indiens de la mission travaillaient à la ferme, soignaient les bestiaux et les moutons, sans que jamais ils pussent prétendre, même après des années de servitude, à devenir eux-mêmes propriétaires ou à entrer pour une part quelconque dans les bénéfices que donnait l’exploitation.
Depuis près de dix ans, le révérend Bridges s’est retiré du sacerdoce pour se consacrer entièrement aux affaires. À cette époque, il se rendit à Buenos Aires, où il donna force conférences dans lesquelles il cherchait à apitoyer l’opinion publique sur le sort des malheureux Yahgans. Il obtint ainsi du gouvernement argentin une concession gratuite de vingt mille hectares de terrains situés un peu à l’est d’Ushuaia, à proximité de l’entrée du canal du Beagle vers l’Atlantique, dans la plus belle partie assurément de la Terre de Feu. En accordant cette concession, le but du gouvernement était évidemment de permettre aux indigènes de s’initier aux travaux de l’agriculture et à l’élevage des bestiaux. Le résultat le plus clair fut de fournir à Thomas Bridges le moyen d’acquérir une fortune considérable. Il s’est installé sur les bords d’une petite baie qui offre un des meilleurs mouillages de toute la partie australe de la Fuégie et qu’il a baptisée du nom d’Harberton, en souvenir, paraît-il, de la localité anglaise où naquit sa vaillante épouse. Là, il poursuit avec les indigènes le lucratif échange de peaux de loutres et de guanaques qu’il avait instauré à Ushuaia dès les débuts de la mission.
Le révérend Lawrence, qui lui a succédé à Ushuaia, paraît avoir moins d’aptitudes aux affaires. Il laissera néanmoins à ses fils une situation enviable, lorsqu’au seuil de la mission le dernier des Yahgans sera mort de phtisie : ils étaient trois mille il y a quarante ans, ils ne sont plus que deux cents aujourd’hui.
En 1884, le gouvernement argentin établissait à grands frais la sous-préfecture d’Ushuaia en même temps que celle de San Juan del Salvamento (île des États).
Quelques mois plus tard, le lieutenant de frégate Paz fut chargé de rechercher le point de la Terre de Feu le plus favorable à l’établissement du chef-lieu de la colonie argentine. Sur les conseils quelque peu intéressés des missionnaires anglicans qu’il visita à Ushuaia, il choisit cet endroit, qui fut élevé ainsi du rang de sub prefectura à celui de gobernación. On n’aurait pu faire un choix moins judicieux[16]. Séparée de la partie pampéenne du territoire, celle où l’on se livre avec fruit à l’élevage du mouton, par des montagnes élevées, Ushuaia se trouve en réalité très isolée des estancias occupées par des Blancs. Aussi n’a-t-elle guère prospéré et, en dehors des fonctionnaires qui forment la majorité des habitants, on n’y trouve que cinq ou six “administrés” qui parviennent tout juste à vivoter en tenant les uns un débit de boissons, les autres un magasin. Les prospecteurs qui mènent, à chercher de l’or sur les plages inhospitalières de la Fuégie, la plus misérable existence qu’on puisse imaginer, fournissent à ces “almacens” leur principal et bien précaire achalandage.
On nous a raconté la lamentable histoire d’un brave pharmacien allemand qui, ayant appris que le gouvernement argentin fondait une nouvelle ville à la Terre de Feu, n’hésita pas à s’expatrier, persuadé qu’en arrivant bon premier il ferait une fortune rapide. Le pauvre homme confondait un peu l’Amérique du Sud avec l’Amérique du Nord. Arrivé à Ushuaia plein d’enthousiasme, il ne tarda pas à perdre toutes ses illusions ; lorsque ses dernières économies furent épuisées, il ne lui resta que la ressource de s’enrôler dans l’armée pour ne pas mourir de faim. Le jour de notre arrivée, nous le vîmes en faction devant le Gouvernement.
Ushuaia est, depuis quelque temps, un lieu de déportation pour les militaires condamnés à des peines relativement légères. Les meurtriers, ou ceux qui se sont rendus coupables de manquements graves à la discipline, sont déportés à Saint-Jean (île des États).
À défaut de nombreux administrés, il y a donc, à Ushuaia, une quantité respectable de fonctionnaires : gouverneur, secrétaires, employés, chef de la police et du port, percepteur des postes, préposés à la colonie pénitentiaire, etc. On y trouve même un instituteur et une institutrice qui disposent d’un matériel scolaire très moderne, mais qui sont l’un et l’autre privés d’élèves, car les missionnaires anglais ont leur école à eux et, quant aux fonctionnaires argentins, comme ils assimilent leur séjour à Ushuaia à une espèce d’exil qu’ils tâchent d’écourter le plus possible, ils laissent généralement leur famille dans la métropole.
C’est dans une maison assez spacieuse, située en face d’un môle, que sont logés le gouverneur et les principaux fonctionnaires et que sont installés les bureaux. Convenablement meublé, ce bâtiment est mal approprié au climat : on ne peut pas y faire de feu ; Cook, qui a visité Ushuaia en hiver, à notre retour, nous a raconté qu’il y avait vu les malheureux officials transis de froid et réduits à battre la semelle.
La température moyenne de l’été n’est en effet que de 8° à 9°, celle de l’hiver de 2° à 3° au-dessus de zéro. Il neige souvent, même en été, et la pluie est d’une grande fréquence. De plus, la gobernación d’Ushuaia a le mauvais sort d’être abritée du soleil, pendant une bonne partie de la journée, par de hautes montagnes, de sorte qu’en hiver l’astre bienfaisant n’y luit guère.
Comme toutes les sous-préfectures fuégiennes et celle de l’île des États, Ushuaia est reliée à Buenos Aires par un service de transports argentins qui s’efforce, sans y parvenir jamais, d’être mensuel et régulier. Ces navires font le service postal (qui est gratuit) et importent ce qui est nécessaire à la subsistance des colons, car c’est à peine si l’on parvient à cultiver quelques légumes sous ce rude climat. Parfois, ils apportent à un bienheureux fonctionnaire un ordre de rappel ; plus souvent, ils amènent quelques nouveaux condamnés pour les pénitenciers d’Ushuaia et de Saint-Jean. Leur arrivée est toujours attendue avec impatience, accueillie avec joie.
Je dois ajouter que, si la situation d’Ushuaia ne convient que très médiocrement à son rôle de capitale, sa baie spacieuse et bien abritée en fait une station navale de tout premier ordre, capable de recevoir une flotte plus nombreuse que l’Armada Argentina qui compte cependant plusieurs unités d’importance.
Après nous être munis d’une lettre du secrétaire du gouverneur – qui remplace ce dernier en congé dans la métropole –, nous quittons la baie d’Ushuaia le 23 décembre, à la première heure, pour nous rendre au dépôt de charbon argentin situé dans la baie de Lapataïa, à quelques milles plus à l’ouest. Le docteur Cook reste avec Arctowski à la mission évangélique pour y poursuivre des études ethnographiques et anthropologiques.
À neuf heures trente, nous jetons l’ancre à une encablure d’un hangar bâti sur la côte, au fond d’une vaste baie, et sur lequel nous lisons : la Carbonera argentina. Junio del 96. Ce qui nous apprend que c’est en juin de l’année précédente qu’a été installé ce dépôt.
Quelques coups de sirène, et bientôt nous recevons la visite de M. Brussotti, gérant d’une importante scierie établie au bord d’une petite rivière qui se déverse dans la baie. Le gouvernement lui a confié la garde et la comptabilité du dépôt. Nous lui remettons notre lettre ; puis, de concert avec lui, nous prenons des dispositions pour procéder à l’embarquement du charbon.
L’opération est difficile : nous ne disposons pour l’effectuer que d’une mauvaise allège pouvant contenir à peine cinquante sacs et que nous halons contre notre bord à l’aide d’un va-et-vient*. De plus, le travail est contrarié par le mauvais temps et fréquemment interrompu par la mauvaise tenue du fond*, qui fait que nous chassons sur nos ancres* à plusieurs reprises.
Le 24 décembre, vers six heures, Arctowski rentre à bord accompagné de deux Indiens qui lui ont servi de guides à travers la forêt de hêtres antarctiques qui s’étend depuis Ushuaia. Après le souper, auquel nous avons convié les deux indigènes, nous constatons qu’un feu allumé par Arctowski sur le rivage, pour attirer notre attention, a été mal éteint et se propage dans la forêt. Immédiatement j’envoie à terre tous les hommes d’équipage, munis de seaux, sous la direction de Lecointe, avec mission d’éteindre l’incendie. Arctowski, Danco et Racovitza se joignent à eux.
Au moment où l’ordre est donné aux hommes de se rendre à cette corvée, après une rude journée de travail, je surprends quelques murmures. Ces braves gens estiment que je pourrais bien leur accorder un peu de repos pour la veillée de Noël ! Quant à moi, je suis ravi de l’incident qui me sert à souhait. Pendant toute la journée, j’avais cherché vainement un moyen d’éloigner les matelots au début de la soirée.
Restés seuls, Amundsen et moi, nous nous hâtons de préparer la fête qui les attend à bord, au retour de la corvée imprévue. Nous descendons dans le poste de l’équipage et, après avoir recouvert de pavillons les couchettes et les tables, nous déclouons les caisses qui m’ont été remises la veille du départ d’Anvers par des amis de l’expédition – Mme Osterrieth, le général Wauwermans, Mme Ramlot – et par ma famille, avec recommandation expresse de ne rien ouvrir avant ce jour.
Au milieu du poste nous dressons un petit arbre de Noël, puis nous disposons pour chaque homme un paquet contenant : un anorak et un pantalon de toile à voile, un tricot d’Islande, une paire de mitaines et un bonnet fourré offerts par l’expédition ; puis des “surprises”, des jeux de patience, des pipes, des blagues remplies de tabac, souvenirs de notre bonne fée anversoise Mme Osterrieth.
Nous préparons ensuite les cadeaux destinés à l’état-major : des porte-crayons en argent, des cachets également en argent, avec cette devise pleine de promesses : Audaces fortuna juvat ; des foulards, des livres enfermés dans des couvertures brodées aux initiales de chacun et choisis suivant leurs goûts. Voici Pêcheur d’Islande où Amundsen retrouvera un peu de lui-même dans le grand Ian ; du Balzac pour le rêveur Arctowski ; pour Danco les merveilleux Trois contes de Flaubert ; du Flaubert encore pour Lecointe ; pour Cook les Contes extraordinaires de son compatriote Edgar Poe ; pour Racovitza, du Zola ; pour moi enfin, l’admirable Uilenspiegel, de Charles De Coster, qui parlera à mon cœur de la lointaine patrie, de la vieille Flandre héroïque et indomptable. Ce sont enfin, pour tout le monde, état-major et équipage, des gâteaux délicieux faits spécialement à Bruxelles, il y a trois mois, et qui semblent cuits d’hier.
Vers huit heures et demie, averti du retour de tout mon monde, je me mets au cœlophone* sur lequel je joue La Brabançonne. L’équipage accourt et demeure tout ébloui à l’entrée du poste ; la stupéfaction s’étale sur ces figures rudes et naïves et la joie les illumine.
Je fais servir un grog ; puis Van Rysselberghe et Tollefsen prennent la parole à tour de rôle au nom de leurs camarades belges et norvégiens, pour me renouveler l’assurance de leur dévouement.
Je les remercie de leurs cordiales paroles, et, les exhortant une fois de plus à la bonne entente, j’attire leur attention sur notre devise nationale qui doit être aussi celle de la Belgica pour que notre campagne soit fructueuse. Mes derniers mots sont couverts par des hourras en l’honneur de la Belgique.
Tout le monde est profondément ému ; les distances hiérarchiques sont bien près de s’effacer ; nous sentons si bien en ce moment que nous sommes les membres d’une même famille et que, pour vaincre, nous devons nous serrer cœur contre cœur, car l’heure des périls et des fatigues va sonner pour nous.
… L’heure des périls ! je ne croyais pourtant pas qu’elle dût sonner si tôt, si loin du but !
Le 30 décembre, l’embarquement du combustible étant terminé et notre approvisionnement complété à cent quarante tonnes, nous avions levé l’ancre, puis nous étions retournés devant Ushuaia où le docteur Cook avait rallié le bord et où nous avions embarqué de l’eau.
Le 1er janvier 1898, à midi, nous avions définitivement fait nos adieux aux autorités de la petite localité fuégienne, et nous nous dirigions vers Harberton, où le révérend Lawrence avait exprimé le désir d’être conduit auprès de son collègue Bridges, et que nous n’étions pas fâchés de visiter nous-mêmes. L’administration nous avait, par la même occasion, confié le courrier d’Harberton… La Belgica paquebot-poste !
Dans la soirée, vers dix heures, l’obscurité ne nous permettant plus de suivre un alignement d’îlots qui repère la route, nous gouvernions au compas. Nous avions modéré la vitesse et Tollefsen avait été envoyé au poste de sondage*.
Nous sondons vingt-huit mètres. Mais, presque immédiatement après, nous apercevons par le bossoir* de bâbord un banc de goémons. Ces bancs signalent presque toujours un danger. Venu de deux quarts sur tribord* : sondé sept mètres. Laissé la barre à bord* pour venir davantage sur tribord : sondé six mètres et touché.
Nous faisons machine arrière à toute vitesse, mais cette manœuvre reste sans effet. Nous stoppons, amenons un canot et sondons tout autour de nous.
La Belgica est échouée sur un récif très accore*, couvert de cinq mètres cinquante d’eau environ : sans doute elle touche une pointe de roche, car son tirant d’eau* n’est pas de cinq mètres. Un courant assez fort porte de l’ouest vers le récif, sur lequel nous avons par conséquent été drossés.
Amené toutes les embarcations pour alléger un peu le navire et fait alternativement machine avant et machine arrière : ces manœuvres n’ont d’autre résultat que de nous faire pivoter légèrement. Nous stoppons donc de nouveau et nous élongeons* une ancre à jet* par tribord avant ; nous embraquons* l’aussière* au grand treuil de pêche. Au jour naissant, vers une heure et demie, j’envoie une embarcation à terre pour observer la marche de la marée : elle descend lentement ; aussi, vers trois heures du matin, la Belgica s’incline-t-elle sur tribord. Mouillé immédiatement l’ancre de bâbord et placé en béquilles à tribord les vergues de perroquet. Relevé l’ancre à jet pour la mouiller à bâbord par le travers ; passée par un sabord* à hauteur du maître-bau, l’aussière frappée* sur cette ancre est raidie* au treuil. La sonde accuse quatre mètres vingt au maître-bau au lieu de cinq mètres cinquante. Vers quatre heures, le fils aîné de M. Bridges arrive à bord accompagné d’Indiens Onas. Il vient nous offrir assistance.
Nous élongeons alors, au prix d’énormes difficultés, l’ancre de bossoir* de tribord, à environ soixante-dix mètres vers le large du banc. Sur la chaîne, tout près de l’ancre, nous avons frappé une forte aussière qui sera embraquée à l’aide du treuil à vapeur. Le navire ne touche qu’en un point, à bâbord, un peu à l’avant du maître-couple*, et l’on peut encore espérer le dégager en faisant force sur cette ancre.
Les Onas assistent l’équipage au guindeau*, mais leurs efforts combinés avec ceux du treuil restent inutiles. Nous convenons avec le fils Bridges qu’il se rendra à terre pour chercher un chaland dans lequel on jettera des briquettes afin d’alléger le bâtiment. M. Lawrence profite de l’occasion pour débarquer, ainsi que le docteur, qui voudrait visiter sans retard les campements indiens d’Harberton. Il ne croit pas au danger qui nous menace et que, moi aussi, je feins de ne pas voir.
Vers dix heures, une nouvelle embarcation arrive d’Harberton. Cette fois, c’est un canot de sauvetage que commande le capitaine Davis, du brick Phantom de la maison Bridges. La mer sera haute vers deux heures, dit-il, mais elle marne* très peu. Il n’y a donc plus guère d’espoir, puisque nous avons touché trois heures environ avant la mer haute et qu’à la marée de la nuit le navire n’a pas été renfloué.
Cependant, la Belgica se redresse peu à peu. Mais en même temps la brise s’établit de l’ouest-sud-ouest et graduellement fraîchit : la mer se forme*, courte, clapoteuse ; le carène heurte violemment la roche fatale. Nous établissons le petit hunier et les voiles auriques* ; simultanément on fait force sur la chaîne et l’aussière de l’ancre de tribord, tandis que la machine marche à toute vapeur.
Vains efforts. La mer devient mauvaise, le navire heurte de plus en plus lourdement.
En attendant l’allège que le fils de Bridges est allé chercher et qui a beaucoup de peine à nous joindre, nous vidons dans la cale l’eau de nos réservoirs pour la pomper à la vapeur.
Enfin l’allège a pu s’amarrer le long du bord. On y jette sept à huit tonnes de briquettes. Puis on vire encore au guindeau. Bien qu’elle soit allégée d’une trentaine de tonnes, la Belgica ne bouge pas. Il ne paraît plus possible de la déséchouer à cette marée, et nous carguons les voiles.
M. Bridges et le capitaine du Phantom nous quittent avec leurs matelots et les Onas. À peine se sont-ils éloignés que la brise fraîchit encore et souffle en coup de vent.
Le navire donne de la bande sur bâbord : comme il est clair que c’est de ce côté qu’il se couchera cette fois-ci, à la marée descendante, nous y portons les béquilles et les assujettissons fortement. Mais les espars* se brisent et le navire s’incline davantage.
À présent la mer déferle furieusement contre la muraille de tribord ; des deux bords elle embarque.
Soulevée par les flots, la Belgica tressaute sur l’écueil qui, d’un moment à l’autre, peut la transpercer.
Notre pauvre petit navire est en perdition : il a déjà presque l’air d’une épave !
La Belgica en perdition ! Comprend-on le drame que je revis en le relatant ? La Belgica perdue, c’est l’Expédition antarctique belge terminée avant d’être commencée. C’est la défaite avant le combat.
Déjà, pendant cette nuit d’inutiles efforts, j’avais envisagé cette éventualité affreuse. J’avais eu la vision de la ruine totale de mon entreprise et de mes espérances.
Entre deux manœuvres, j’étais entré un instant dans ma cabine pour me recueillir et là, je l’avoue, j’avais pleuré…
Je veux cependant tenter un suprême effort.
Je fais établir le petit hunier ; ensuite tout le monde fait force sur le guindeau, tandis qu’au treuil à vapeur on embraque l’aussière frappée sur la chaîne. Dans la machine, la tension est poussée à sa limite et le cylindre de basse pression est utilisé comme cylindre de haute pression.
Le navire est redressé maintenant ; la marée est haute. Mais les lames, de plus en plus fortes, nous soulèvent et sans répit nous font battre l’écueil.
Soudain, sous l’action combinée des forces qui le sollicitent, le bâtiment oscille sur sa quille et prend de l’erre*. C’est avec entrain que l’on continue alors à relever l’ancre du bossoir, et c’est sans regret qu’on coupe l’aussière de l’ancre à jet qui doit être abandonnée. La brise d’ouest souffle furieusement, mais la Belgica est sauvée.
L’état-major et l’équipage ont montré pendant cette longue lutte une énergie et une confiance admirables. Au moment où Lecointe jugeait comme moi la situation désespérée, il avait prié Arctowski, tous les hommes étant occupés à la manœuvre, de l’aider à hisser les couleurs comme salut suprême à notre patrie.
C’est au moment même où le pavillon s’élève que la Belgica échappe à l’écueil. Alors, le salut d’adieu se transforme de lui-même en salut de délivrance. Et Lecointe, avec un beau sang-froid, marque l’heureuse coïncidence. Me rejoignant sur la passerelle, il me dit de sa voix chaude et avec un sourire : “Commandant, c’est dimanche ; vous voyez, j’ai fait hisser les couleurs.”
Nous sommes sous le vent d’Harberton où Cook nous attend fiévreusement : nous ne saurions atteindre la baie. Nous fuyons devant le temps pour chercher l’abri de l’île Navarin qui borde au sud le canal du Beagle.
À sept heures du soir, nous jetons l’ancre dans la baie désignée sous le nom de Port-Toro. Quelques débris de charpente témoignent de l’existence éphémère d’une sous-préfecture chilienne qu’on établit là, il y a quelques années, dans l’espoir, resté stérile, de faire pièce à la station argentine d’Ushuaia.
Dès l’aube, le lendemain, nous mettons de l’ordre dans notre petit bâtiment si rudement éprouvé et nous cherchons une aiguade pour renouveler notre provision d’eau potable que nous avons dû sacrifier. Mais nous n’en trouvons pas de praticable. Aussi refaisons-nous route, à midi, vers Harberton.
Le temps est bon ; la bourrasque d’ouest a fait place à une légère brise d’est ; la mer est à peine ridée par le vent.
Vers six heures du soir, la Belgica est mouillée dans le petit port d’Harberton, à une encablure du brick Phantom dont l’équipage nous a prêté assistance la veille.
Nous faisons enfin la connaissance du personnage le plus considérable de la Terre de Feu, le révérend Bridges, ou plutôt Mister Bridges.
Mister Bridges – car c’est ainsi qu’on l’appelle du cap Horn à Buenos Aires – possède, au bord de la baie, une maison d’extérieur modeste, aménagée intérieurement avec tout le confort du home anglais. Adossés à cette habitation, se trouvent des magasins bien fournis où les détaillants d’Ushuaia viennent s’approvisionner. Les chercheurs d’or peuvent également s’y ravitailler en conserves, vêtements et outils de tous genres. Le Phantom, qui appartient à l’ex-missionnaire, vient justement d’arriver d’Europe avec des marchandises diverses ; il portera sur le marché de Londres la laine de l’année.
Comme je l’ai dit plus haut, le révérend Bridges, qui a l’éloquence persuasive, ainsi qu’il convient à un missionnaire, a obtenu du gouvernement argentin une belle concession de terrain, sous prétexte d’y établir une colonie agricole et pastorale, pour le plus grand bien des aborigènes. Aussi voit-on à Harberton, outre les bâtiments précités, quelques misérables huttes, faites de débris de caisses et de boîtes à conserves, qui abritent tant bien que mal une douzaine de Yahgans déguenillés. C’est là, paraît-il, la colonie agricole… Il est juste cependant de reconnaître que, si le révérend Bridges a plutôt le souci de ses affaires personnelles que celui de l’éducation des Indiens, ceux-ci, qu’ils soient Yahgans ou Onas, loin d’être molestés par lui, trouvent toujours à Harberton aide et protection, ce qui est déjà quelque chose.
L’estancia Bridges est la ferme la plus méridionale du monde entier. On y élève des moutons et du gros bétail ; récemment, une laiterie modèle y a été installée.
Nous sommes presque dépourvus d’eau, et M. Bridges, qui ne dispose d’aucune source dans ses environs, ne peut nous céder que deux petits tonnelets d’eau de pluie. Les “arroyos” du voisinage sont malaisément accessibles et j’estime qu’il sera plus expéditif de faire encore un détour et de nous rendre à l’île des États où les Instructions nautiques signalent de bonnes aiguades.
Toutefois, avant de quitter Harberton, nous visitons une tribu d’Indiens Onas campés dans les environs et nous assistons au départ pour la chasse qui les retiendra deux mois dans l’intérieur du pays.
IV
LES ABORIGÈNES DE LA FUÉGIE
Les pêcheurs : Alacaloufs et Yahgans. – Leur disparition. – Les Onas. – Leurs démêlés avec les “estancieros”. – Les chasseurs d’Indiens. – Extermination systématique.
Les aborigènes du vaste archipel que délimite au nord le détroit de Magellan, bien que désignés sous la dénomination générique de Fuégiens, appartiennent à trois groupes qui diffèrent très sensiblement entre eux par les traits, les mœurs et le langage : les Alacaloufs, les Yahgans et les Onas.
Les Alacaloufs sont les plus misérables et les plus déshérités des Fuégiens. Leur race est presque éteinte aujourd’hui. Ils vivent au bord de la mer, se nourrissant de poissons, de moules et de coquillages.
Étant riverains, ils ont, ainsi que les Yahgans, été aperçus des premiers navigateurs qui visitèrent ces régions : ils étaient signalés par Magellan dès l’année 1520. Ils sont petits ; leur visage est large et cuivré et leurs jambes sont contrefaites et arquées par suite de la posture accroupie qui leur est habituelle ; ils sont très laids, comme on a pu en juger à Paris, où une troupe de ces malheureux fut exhibée en 1881. Les Alacaloufs n’ont presque aucun rapport avec les Blancs et l’on n’en trouve qu’un nombre très restreint dans les missions.
Ils sont confinés dans la partie ouest du détroit de Magellan et sur les canaux latéraux qu’ils parcourent dans des pirogues assez habilement construites. Nous n’en avons point rencontré au cours de notre navigation dans ces canaux.
Les Yahgans, chez lesquels on observe à peu près les mêmes caractères physiques que chez les Alacaloufs – en moins laids – vivent, comme eux, des produits de la mer. Pourtant ils chassent aussi certains oiseaux à l’aide de frondes qu’ils manient très adroitement, et les phoques au moyen de harpons en bois terminés par des pointes en os de baleine.
Ils habitent l’archipel proprement dit du cap Horn et surtout la partie sud du canal du Beagle. Comme les Alacaloufs, ils construisent des pirogues qu’ils manœuvrent avec adresse et dont ils se servent pour se livrer à la pêche et traverser les innombrables chenaux de leur territoire.
Les derniers survivants de cette peuplade, qui fut nombreuse, industrieuse et puissante, sont presque tous groupés aujourd’hui autour des missions évangéliques d’Ushuaia et de Tekenika, où ils sont à l’abri de la famine. Autrefois les baleines[17] et les phoques abondaient dans ces parages et leur fournissaient une copieuse subsistance ; mais, depuis, ils ont connu des jours d’extrême détresse, et, si quelques voyageurs les ont fait passer pour anthropophages, c’est peut-être qu’après des tempêtes prolongées, alors qu’il leur avait été impossible de se procurer aucune nourriture, poussés par la faim, ils furent parfois réduits à sacrifier l’un des leurs pour sauver la tribu.
Les Yahgans sont doués d’un remarquable talent d’imitation. Weddell rapporte à ce sujet qu’un de ses matelots, ayant donné une tasse de café à un Yahgan, s’aperçut que le contenant ne lui avait pas été rendu après absorption du contenu. Il réclama sa tasse à l’indigène ; mais tous les mots qu’il employait lui étaient aussitôt répétés par celui-ci. L’Anglais se fâcha et, haussant le ton, apostropha rudement le Yahgan : “You copper coloured rascal, where is my pot ?” L’Indien, loin d’être décontenancé, prit l’attitude de son adversaire et lui répéta la phrase avec une telle perfection que tout le monde éclata de rire, sauf le matelot volé qui retrouva finalement sa tasse sous le bras du Yahgan.
Les Indiens Yahgans ne sont pas tatoués, mais ils s’ornent le visage de peintures rouges ou blanches. Autrefois ils portaient pour tout vêtement une peau de phoque jetée sur les épaules. Ils sont presque tous maintenant vêtus de défroques d’Européens, provenant souvent, dit-on, des hôpitaux des grandes villes.
Nous devons à l’obligeance du révérend Bridges un vocabulaire anglais-yahgan de plus de trente mille mots, importante contribution à nos rapides travaux ethnographiques, lesquels furent forcément limités aux Fuégiens, puisque les terres antarctiques ne sont ni habitées, ni habitables.
Les Yahgans semblent craindre les représentants du troisième groupe : les Onas, hommes grands et vigoureux, offrant beaucoup d’analogie avec les Tehuelches, qui occupent, de l’autre côté du détroit, la Patagonie australe.
Quelques explorateurs ont prêté aux Onas comme aux Tehuelches des proportions fantastiques, trompés sans doute par la largeur de leurs épaules, la grosseur de leur tête et leur façon de se draper d’une grande peau de bête qui les fait paraître plus grands qu’ils ne sont.
En réalité cependant, c’est une race superbe. Généralement ils mesurent six pieds, quelquefois six pieds six pouces. Les femmes, plus petites, ont les attaches fines et, dans leur jeunesse, la poitrine ronde et ferme.
La peau des Onas est relativement blanche. Leurs cheveux sont noirs et longs. Ils ont le visage ovale, les joues peu proéminentes, les yeux foncés. Leurs dents sont régulièrement plantées, mais jaunes.
Ils ont toujours vécu à l’intérieur de la Terre de Feu proprement dite ; aussi ont-ils joui longtemps du bonheur de demeurer inconnus des explorateurs. Pendant des siècles, ils ont été les maîtres uniques et incontestés de la grande île fuégienne ; depuis, les Yahgans sont venus s’établir sur la côte du canal du Beagle et les Alacaloufs le long de la côte ouest. Mais ni les uns ni les autres ne se sont jamais aventurés dans l’intérieur.
Les montagnes du Sud-Est et du milieu de l’île, les immenses prairies du Nord ont été jalousement gardées comme territoires de chasse par les Onas jusque dans ces dernières années.
Ces régions étaient considérées comme sans valeur. Le premier qui s’avisa – pour le malheur des Onas – d’y établir une petite estancia fut, paraît-il, l’agent consulaire anglais à Punta Arenas. Il fit venir des moutons des îles Falkland et confia l’établissement à un missionnaire. Ce moyen très diplomatique de se faire bien voir du gouvernement chilien (l’estancia est sur la partie chilienne de la Terre de Feu) et d’en obtenir gratuitement de vastes concessions, devait aussi, dans l’esprit de l’adroit consul, avoir une excellente influence sur les malheureux qu’on allait dépouiller de leur domaine. Le missionnaire chargé de les convertir espérait, la Bible en main, faire de ces libres fils de la nature les gardiens des troupeaux qui allaient vivre et prospérer à leurs dépens. Pendant plusieurs mois, les Onas vinrent en grand nombre pour écouter la bonne parole ; seulement, chaque nuit, ils emmenaient des moutons.
Dans ces conditions, les affaires du propriétaire de l’estancia et de ceux qui l’avaient imité, risquaient de tourner mal ; c’est alors que les fusils commencèrent à parler et que les chasseurs d’Indiens firent leur apparition.
Une livre sterling par tête d’Ona tué sur leurs terres, voilà le taux auquel les riches éleveurs qui se partagent aujourd’hui les plaines fuégiennes rémunèrent les services de misérables chenapans dont ces meurtres sont la seule industrie[18].
Traqués comme des bêtes fauves, les Onas n’ont d’autres refuges que la concession Bridges d’Harberton et la mission catholique de Rio Grande où on les laisse en paix.
Mais ils sont si jaloux de leur liberté qu’ils ne séjournent jamais longtemps près de ces établissements. Ils regagnent alors les montagnes, pour y mourir de faim et de froid, en contemplant de loin la plaine où leur race vécut heureuse.
Faut-il s’étonner qu’ils y descendent parfois pour opérer des razzias dans les troupeaux, voler aux gardiens leurs chevaux pour les abattre et s’en nourrir, ou même massacrer quelques Blancs par représailles ?
Des troupes de cavaliers, armés de fusils, se lancent alors à la poursuite des Indiens, dont la seule ressource est de franchir la frontière chilo-argentine. Le Chili ne tolérerait pas l’invasion de son territoire par une force armée d’Argentins, pas plus que le gouvernement argentin ne supporterait que le même délit fût commis par les Chiliens, et c’est dans cette rivalité entre hommes blancs que réside la suprême sauvegarde des derniers Onas.
Il est arrivé cependant qu’une bande d’Onas épuisés, mourants, se soient rendus d’eux-mêmes à une grande estancia, demandant au propriétaire de leur allouer une bande de terrain près d’une rivière, pour y vivre, y chasser et y pêcher librement, moyennant quoi ils s’engageaient à ne plus toucher à un mouton.
Mais toutes les transactions de ce genre ont fini invariablement de deux manières : un beau jour, les Indiens s’en sont allés après avoir fait une rafle de bétail ; ou bien ce sont les soldats argentins, chargés de punir un forfait quelconque, qui ont fait une rafle d’Onas pour les transporter dans les déserts du Grand-Chaco, où ils ont péri ensuite misérablement.
La chasse à mort aux guanaques est un complément, moins odieux que la chasse à l’homme, mais non moins efficace, de l’œuvre d’extermination des Indiens.
Le guanaque est pour le Fuégien ce que le renne est pour le Lapon. C’est une espèce de lama, un ruminant dont la chair excellente constitue – ou plutôt constituait – presque exclusivement la subsistance de l’Ona ; sa fourrure lui fournit son vêtement et il en tapisse l’intérieur de sa pauvre tente ; il se sert des tendons pour assembler les peaux, et des os aiguisés comme d’aiguilles. Les tendons fournissent aussi à l’Ona la corde de son arc ; les flèches sont faites d’une baguette de hêtre antarctique fendue à une extrémité ; dans la fente est introduit un fragment de tesson de bouteille (seul emprunt du Fuégien à notre civilisation) très adroitement taillé au silex et maintenu en place par un tendon vigoureusement serré.
Souvent, les Onas, dont l’agilité est surprenante, capturent les guanaques à la course ; ils triompheraient dans ce sport de tous les professionnels du monde.
Le guanaque, autrefois très abondant, paissait l’herbe des immenses prairies de la plaine. Cette herbe étant désormais réservée aux précieux moutons qui enrichissent les estancieros, ceux-ci n’hésitèrent pas à entreprendre l’extermination de l’espèce. Ils traquèrent les guanaques, dont la peau est d’ailleurs d’un certain rapport, et en firent de grandes tueries. Tout ce qu’il en reste s’est réfugié, comme les Indiens eux-mêmes, dans les montagnes, où ils trouvent difficilement à se nourrir.
Quand il n’y aura plus du tout de guanaques, il n’y aura plus guère d’Onas. Alors seulement finira la lutte sauvage, dont je viens d’esquisser les péripéties.
On peut estimer à un millier à peine le nombre des Onas actuellement survivants. Leur ancienne organisation par clans a presque disparu ; il n’est plus question de luttes intestines parmi eux ; ce sont de malheureux nomades sans autre lien social que leur résistance désespérée à l’ennemi commun.
Ils construisent des huttes de branches d’arbres sommairement assemblées, précaire abri contre le détestable climat du pays ; la pluie, la neige et l’air y entrent librement ; du côté du vent sont à peine accrochées quelques peaux.
Le vêtement des Onas se compose d’une peau de guanaque qu’ils mettent tantôt de l’un, tantôt de l’autre côté de leur corps, suivant la direction du vent.
Leur langage est extrêmement rude et guttural. Pas plus que les autres Fuégiens, ils ne font usage d’instruments de musique.
Les Onas émigrent quelquefois. On en a vu mêlés aux Yahgans et aux Alacaloufs et, fait beaucoup plus curieux, aux Patagons ! N’ayant pas de canots, ils ont donc dû traverser à la nage le détroit de Magellan, dans une de ses parties les plus étroites.
Le mariage, pas plus que les autres institutions des Onas, n’est régi par des règles fixes ; il est arrangé suivant les convenances des parties contractantes, avec cette restriction que les femmes ont peu de chose à dire et ne disposent guère de leur propre sort.
Les femmes onas vivent d’ailleurs en parfaite intelligence sous le régime de la polygamie. Très souvent les femmes d’un même homme proviennent de la même famille. Quand une femme se trouve heureuse en ménage, il n’est pas rare qu’elle engage sa sœur à la rejoindre dans la hutte conjugale pour partager avec elle l’affection du mari. Si une enfant orpheline est adoptée dans une famille, elle devient, lorsqu’elle est en âge de se marier, la femme de son bienfaiteur.
Dans la hutte cependant, chaque femme a son coin particulier et ses occupations personnelles. Elle réunit autour d’elle ses propres enfants et tout ce qui constitue sa fortune mobilière : son panier à viande, ses aiguilles, les tendons qui lui servent de fil et ses bouts de fourrure.
De même que chez les Yahgans et les Alacaloufs, on voit dans les familles d’Onas très peu d’enfants. Non que la Fuégienne soit stérile, au contraire ; mais la mortalité infantile, de deux à dix ans, est effrayante, tant à cause des privations que de l’extrême rigueur du climat.
Tout conspire ainsi à la destruction de cette race dont l’histoire aura été la même que celle des Indiens de l’Amérique du Nord, des Patagons, des aborigènes de l’Australie et de tant d’autres, avec cette importante différence toutefois que l’alcoolisme n’aura été pour rien dans sa disparition. Les Onas n’ont jamais été tentés par l’eau de feu – et leur race sera anéantie sans avoir passé par la phase intermédiaire de l’abrutissement.
V
L’ÎLE DES ÉTATS ET LES SHETLAND DU SUD
La sous-préfecture de San Juan del Salvamento. – Station de sauvetage et établissement pénitentiaire. – Le phare le plus austral du monde. – Nos adieux au monde habité. – Sondages dans le détroit de Drake. – Vision des Shetland dans la brume et la tempête. – Mort tragique de Wiencke.
Le 7 janvier, à quatre heures du soir, nous pénétrons dans la baie de San Juan del Salvamento dont l’entrée est imposante et sauvage.
À peine sommes-nous au mouillage que nous recevons la visite de l’adjudant de marine, M. Nicanor Fernández, qui remplit, en l’absence du titulaire, les fonctions de sous-préfet de l’île des États, et qu’accompagne M. le docteur Ferrand, attaché à la colonie.
Le gouvernement argentin a eu pour nous toutes les attentions ; il a spontanément donné au personnel de la sous-préfecture les instructions les plus bienveillantes pour notre passage éventuel.
Dès le lendemain, M. Fernández enverra une grande embarcation et des hommes, avec tout le matériel nécessaire pour faire de l’eau à un ruisselet qui se déverse au fond de la baie. Le docteur, aussi aimable que son compagnon, se met également à notre entière disposition.
Afin de distraire nos visiteurs, je fais jouer pour eux la belle boîte à musique qui occupe un des angles du carré. L’effet est tout autre que celui que j’attendais. Le docteur Ferrand, qui est exilé ici depuis plusieurs mois, aime passionnément la musique, et il n’en a plus entendu depuis son départ de Buenos Aires : les accents grêles et mélancoliques de notre boîte l’émeuvent à un tel point qu’il se met à pleurer. Ayant appris que les matelots ont un cœlophone, il demande à l’entendre. Je lui laisse le choix des morceaux, et, après s’être enquis de notre répertoire, il a la délicate attention de demander d’abord La Brabançonne, et seulement après l’Ave Maria, et d’autres morceaux de notre collection.
L’île des États est couverte de montagnes élevées, terminaison de la chaîne des Andes qui s’est prolongée sans interruption à travers la partie méridionale de la Terre de Feu. Les fjords l’entaillent si profondément qu’ils la séparent presque en quatre îles différentes.
Jusque dans ces dernières années, elle n’avait été habitée que temporairement soit par des marins naufragés, soit par des équipages de phoquiers.
Les otaries à fourrure, ou phoques à deux poils, comme les appellent les marins, étaient naguère extrêmement abondants sur les côtes. Ces animaux ont le corps couvert de poils longs et fins, noirâtres ou d’un gris argenté, au-dessous desquels il y a une belle fourrure courte, serrée, soyeuse et de couleur brune, connue dans le commerce sous le nom de sealskin, et que les pelletiers vendent pour de la fourrure de loutre. La chasse n’ayant pas été réglementée à temps et la surveillance des rockeries étant du reste quasi impossible, cette espèce précieuse est bien près de disparaître, là comme aux environs du cap Horn.
On n’en trouve plus guère que dans les rockeries presque inaccessibles du sud de l’île. Les otaries qui vivent au nord sont des otaries communes ou phoques à un poil.
En 1884, le gouvernement argentin établit un phare à l’entrée de la baie de Saint-Jean, plutôt, sans doute, dans le but de prendre possession effective de l’île que pour rendre service à la navigation.
Très mal situé, ce feu sera bientôt remplacé par un phare plus important, construit sur une des petites îles New Year, sises près de la côte nord de l’île, et qui viendra sérieusement en aide aux voiliers qui doublent le cap Horn.
Peu après le phare, on a créé à Saint-Jean, sur un petit plateau surélevé à quelque distance de l’intérieur de la baie, une sous-préfecture maritime disposant d’un personnel de quelque vingt hommes et d’un life-boat*.
Les bâtiments de la sous-préfecture sont reliés au phare, dont ils sont distants d’un mille environ, par un sentier qui a reçu le nom pompeux d’avenue : c’est l’avenue Piedrabuena.
Au moment où nous la visitâmes, l’intéressante petite station venait d’accomplir son seizième sauvetage. Au mois d’avril, elle avait recueilli l’équipage du trois-mâts-barque allemand Esmeralda qui, faisant route d’Anvers à Talcahuano, s’était jeté à la côte entre Port Hoppner et le cap San Antonio.
Depuis plusieurs années, l’île des États sert de pénitencier pour condamnés militaires. Sauf quelques-uns qui sont mariés et jouissent du privilège d’occuper avec leur famille une misérable cabane, les prisonniers sont logés dans une grande baraque en bois[19]. Ils sont sous la surveillance de deux lieutenants et de quelques hommes de troupe, mais on leur laisse, en somme, une liberté relative. Leurs corvées consistent à faire provision de bois pour le chauffage, à entretenir l’avenue Piedrabuena et les dépendances de la sous-préfecture, etc. On leur permet de quitter la station quand aucun travail pressant ne les réclame, mais ils sont toujours très exacts à y retourner. Le sol de l’île des États est partout humide et tourbeux ; il n’offre aucune ressource. Celui qui quitte la prison n’en retire d’autre avantage qu’une rude diversion à la monotonie de son exil. Une ou deux nuits passées à la belle étoile, ou plutôt aux intempéries, et les tiraillements de la faim ont bientôt calmé toute humeur vagabonde. Quant à la fuite, elle est impossible. Le détroit de Lemaire est trop large (vingt milles environ) et les courants y sont trop violents pour qu’il puisse être traversé à la nage.
La station de Saint-Jean est reliée à la métropole par le même service de transports que les établissements argentins de la Patagonie et de la Terre de Feu. Ce service constituant le seul moyen de ravitaillement de la colonie, l’arrivée des paquebots y est encore plus impatiemment attendue que dans les autres stations.
La faune et la flore de l’île des États sont identiques à celles de la Terre de Feu ; elles présentent toutefois moins de variétés ; le guanaque notamment ne s’y rencontre pas.
De nombreux oiseaux de mer viennent nicher dans les anfractuosités des falaises ; sur les roches qui bordent l’île, sont établies des rockeries de manchots et de cormorans.
Elle est tout entière couverte de hêtres antarctiques ; mais, sauf dans quelques endroits abrités, la violence des vents ravale généralement cette belle essence à l’état d’arbuste rabougri. Les vagues déferlent parfois avec fureur contre le rivage et il n’est pas rare de les voir lécher les falaises à trente et trente-cinq mètres de hauteur.
La température moyenne est de +5,7° ; la température la plus élevée, observée pendant une période de dix ans, de +19°.
Il pleut, il neige ou il grêle à Saint-Jean deux cent cinquante-deux jours et il n’y fait calme que soixante jours par an.
Le ciel est presque toujours couvert et le vent souffle avec une force moyenne de sept mètres et demi par seconde.
Ce n’est donc pas un éden que cette terre des États, et le sort des fonctionnaires qui doivent y vivre n’est guère plus enviable que celui des prisonniers dont ils ont la garde.
Si encore ils avaient la consolation d’y faire fortune ou tout au moins d’être largement rétribués ! Mais tel n’est point le cas, et leur isolement les empêche même d’user de l’expédient qu’emploient, pour augmenter leurs ressources, quelques-uns de leurs collègues de Patagonie.
Des stations de sauvetage étant généralement adjointes aux sous-préfectures, on est censé y entretenir une vingtaine de matelots, alors qu’en réalité il s’y trouve rarement plus de deux ou trois hommes. Le transport de l’État arrive-t-il, ou bien son commandant ferme les yeux, ou bien il se contente d’une vague explication : précisément la veille, tout le personnel a déserté et on n’a pas pu le remplacer.
À Saint-Jean, pas de désertion possible, et une fois qu’un homme a été débarqué, prisonnier ou marin, il faut bien pourvoir à sa subsistance.
Nos nouveaux amis, MM. Fernández et Ferrand, s’évertuent à nous rendre agréable le séjour que les fortunes de la mer nous ont amenés à faire auprès d’eux.
Nous avons le plaisir de dîner à la sous-préfecture.
C’est avec une cordialité charmante et une bonne humeur que les tristesses de l’exil ne sont point parvenues à assombrir, que M. Fernández nous fait les honneurs d’un repas composé de trois plats de mouton accommodés de façons différentes. Du mouton et toujours du mouton, c’est la seule viande qu’apportent les paquebots argentins qui se la procurent à Ushuaia ou à Harberton.
Les convives sont, outre M. Fernández et les membres de l’expédition, le docteur Ferrand, deux sous-lieutenants, un prisonnier de marque, le capitaine C***, et sa femme. Le capitaine C*** a été condamné à la relégation à vie pour avoir tué un supérieur, et sa jeune femme, voulant partager les misères de ce terrible exil et les atténuer par sa présence, a eu l’admirable courage de l’accompagner.
Le mobilier de la sous-préfecture, assez disparate, et pour cause, est en grande partie composé d’épaves provenant de différents naufrages. Sur la grosse vaisselle blanche dans laquelle nous mangeons, nous lisons le nom de l’Esmeralda, le navire allemand échoué il y a quelques mois.
Les rafales continuelles qui s’abattent sur la baie rendent l’embarquement de l’eau très difficile. Tandis que ce travail se poursuit lentement et péniblement, Arctowski et Racovitza recueillent des matériaux qui seront utilement comparés avec ceux qu’ils collectionneront bientôt plus au sud.
Nous visitons le phare où j’éprouve une certaine satisfaction à reconnaître des lampes belges.
Le 10 janvier, accompagnés du docteur Ferrand et du capitaine C***, nous nous rendons près du cap Saint-Jean, pour visiter les rockeries de manchots, de cormorans et d’otaries. Nous tentons de ramener à bord, en le prenant à la remorque, un énorme lion de mer, mais la violence du courant nous force à l’abandonner.
Ce n’est que le 13, dans l’après-midi, que nous obtenons enfin le plein de notre quatrième caisson.
Le lendemain, à sept heures du matin, nous levons l’ancre. Je fais hisser les couleurs belges à la corne d’artimon, les couleurs argentines au grand mât. Il est huit heures quand nous passons devant la sous-préfecture. Le personnel de la station tire une salve et signale : “Souhaits.” Nous répondons : “Remerciements. Adieux.”
Devant le phare, nous échangeons les mêmes signaux.
Nous quittons le dernier endroit habité pour nous enfoncer dans le Sud mystérieux.
C’est vers les Shetland et la baie de Hughes que nous nous dirigeons.
Je me propose de visiter minutieusement la baie avec le secret espoir d’y trouver dans le sud un passage vers la mer de George-IV Je voudrais profiter de l’expérience de Weddell, qui put naviguer sans grande difficulté dans cette mer, trouvée par lui, libre de glace jusqu’à 74° 15’.
Je compte que, fin avril, nous pourrons ramener à Ushuaia Racovitza et Cook ; ils y feront, pendant l’hiver, des recherches zoologiques et des observations anthropologiques, et viendront nous rejoindre ensuite à Melbourne. Nous repasserons alors à Saint-Jean pour y embarquer un jeune prisonnier nègre que sa bonne conduite et des aptitudes spéciales ont fait choisir comme cuisinier de la sous-préfecture. J’ai demandé la grâce de ce brave garçon, qui n’est pas un bien grand criminel : étant de faction devant une caserne de Buenos Aires, il avait, à trois reprises, prié un passant qui le narguait de passer son chemin ; à la fin, et après l’avoir averti sans succès, obéissant à sa consigne, il fit feu sur lui, sans l’atteindre d’ailleurs ; aussitôt, effrayé de l’acte qu’il venait de commettre, il avait jeté son arme et s’était enfui à toutes jambes. Arrêté, il fut condamné par les tribunaux militaires à dix ans de déportation dans l’île des États, pour avoir quitté le poste qui lui était confié. M. Fernández ne doute pas que sa grâce me sera accordée. Malheureusement pour le pauvre petit nègre, nos projets vont subir des modifications essentielles, et il attend toujours que nous venions le chercher.
Notre traversée de l’île des États aux Shetland n’offrit aucun intérêt au point de vue anecdotique. Par contre, elle nous a permis d’effectuer une ligne nouvelle de sondages, à laquelle la rigueur de ces parages tempétueux donne une valeur toute spéciale.
La baie de Saint-Jean se trouvant près de l’extrémité orientale de l’île, nous contournons celle-ci par l’est. À midi, nous effectuons notre premier sondage ; nous sommes encore en vue de terre et notre position est déterminée par la méthode des segments*. La profondeur accusée par la sonde est de deux cent quatre-vingt-seize mètres. Un deuxième sondage, opéré dans l’après-midi, donne déjà mille cinq cent soixante-quatre mètres. Nous sommes aux confins du plateau continental.
Le lendemain, 15 janvier, nous rencontrons trois voiliers ; puis, l’après-midi, encore trois autres ; tous font route au nord-est. Ces navires sont les derniers que nous verrons d’ici longtemps.
Le même jour, à midi, par 55° 51’ S et 63° 19’ O, nous obtenons le plus grand brassiage* de la coupe que nous avons pratiquée à travers le détroit de Drake : quatre mille quarante mètres.
Puis, nous trouvons encore : le 16, trois mille huit cent cinquante mètres ; le 18, trois mille huit cents mètres ; le 20, deux mille neuf cents mètres, à midi, et, neuf milles plus au sud, mille huit cent quatre-vingts mètres.
L’ensemble de ces chiffres révèle donc l’existence, entre l’Amérique et les terres australes, d’une cuvette à fond plat qui se relève légèrement vers le sud.
Les sondages dans la mer du cap Horn, qu’une houle constante soulève, sont des plus délicats. Ce n’est pas sans difficultés qu’on parvient à maintenir le navire à l’aplomb du fil, et, sans l’emploi de l’huile, qu’on ne saurait assez recommander en l’occurrence, nous n’eussions pas toujours réussi.
Nous ne nous sommes pas bornés à faire des sondages. À l’aide des thermomètres à renversement*, nous avons déterminé la température de la mer à diverses profondeurs. Nos bouteilles à eau, de Sigsbee, nous ont permis de puiser, soit au fond, soit dans les couches intermédiaires, des échantillons d’eau dont le poids spécifique a été déterminé par Arctowski, dans son petit laboratoire, et qui ont été ensuite précieusement conservés à fin d’analyse ultérieure.
… Nous rencontrons en assez grand nombre des albatros à bec noir (Diomedea melanophrys) et des albatros blancs (Diomedea exulans). Les matelots s’amusent à les pêcher à la ligne. En effet, ces oiseaux très voraces qui suivent le navire se précipitent sur tout ce qu’on jette ou laisse tomber par-dessus bord. Lorsqu’on lance un hameçon chargé d’un appât, ils s’abattent dessus avec une incroyable rapidité et s’enferrent. Avec les os des ailes, nos hommes se confectionnent de beaux tuyaux de pipe.
Le 19, vers midi, par 61° 06’ S 63° 04’ O, nous apercevons pour la première fois, dans le sud-ouest, ce que je prends d’abord pour de l’iceblink*, c’est-à-dire une lueur blanche, étirée au ciel, que les marins habitués à la navigation polaire savent être le reflet de vastes champs de glace étendus au loin. Les approches des Shetland étant libres de pack, ce n’est pas, en réalité, de l’iceblink, mais plutôt du landblink*, autrement dit la réverbération sur le ciel de terres couvertes de neige, dont le gisement s’annonce ainsi à l’horizon. Le même jour, nous avons des rafales de neige et, à quatre heures, nous rencontrons le premier iceberg. C’est un petit événement à bord, et tout le monde accourt sur le pont pour le regarder curieusement.
Les oiseaux planent, de plus en plus nombreux autour du navire : nous reconnaissons des sternes, des albatros, des pigeons du Cap, l’oiseau des tempêtes, d’autres encore.
Le 20 janvier, à quatre heures, par 62° 11’ S et 61° 37’ O, nous apercevons la terre dans le sud-est. Le temps est couvert ; pendant la nuit, l’atmosphère s’épaissit et bientôt règne une brume opaque. Il fait calme plat, mais la mer reste ondulée par une légère houle d’ouest. Nous marchons sous toute petite vapeur, toujours le cap au sud. Nous croisons plusieurs icebergs et nous percevons, comme un lointain bruit d’orage, produit par l’effondrement des glaces : ces détonations, soit lointaines et sourdes, soit violentes et stridentes, nous allons les entendre constamment pendant bien des mois.
Le 21, dans la matinée, je fais remarquer au mécanicien qu’il n’a pas assez de pression pour manœuvrer s’il faut éviter un iceberg. Un quart d’heure à peine après cette observation, vers huit heures et demie, nous touchons soudain le pied immergé d’un grand glaçon ; presque aussitôt, nous apercevons autour de nous des roches qui apparaissent brusquement. J’ordonne de renverser la marche, mais, la pression étant insuffisante, la machine s’arrête et ne repart plus. Nous touchons légèrement les roches, de l’avant, puis de l’arrière. Un morceau de la fausse quille* est enlevé. Nous nous trouvons au milieu d’un hérissement d’écueils et nous éprouvons quelque peine à sortir de cette fâcheuse situation.
Ces roches doivent être celles qui émergent au nord de Start Point.
Après avoir fait un peu de route au nord, nous mettons le cap au sud-ouest. La brume est moins épaisse maintenant et nous voyons de nombreux icebergs, mais ils sont de médiocre taille.
À midi et demi, nous laissons à un mille environ, par bâbord, six rochers à fleur d’eau sur lesquels la mer déferle. Un quart d’heure après, nous passons à la même distance d’une roche élevée, de forme régulière et entourée d’écueils : Castle Rock, sans doute.
Vers une heure et demie, une courte éclaircie nous permet de voir, au sud-est, une île couverte de neige ; des falaises à pic coupées de glaciers la bordent. Ce doit être Snow Island des cartes anglaises.
Après cette brève vision de la terre, la brume redevient plus intense. Tout doucement nous continuons à marcher au sud ; la mer est libre de glace ; nous ne rencontrons que quelques glaçons épars, sur lesquels curieusement des manchots nous regardent passer.
22 janvier. La brume persiste toute la nuit ; une faible brise souffle de l’est ; le temps est néanmoins à rafales. Toujours route au sud sous les voiles en pointe* et à soixante-cinq tours seulement dans la machine. Vers trois heures et demie du matin, la brume se dissipe un peu ; nous distinguons bientôt la terre au sud-sud-ouest ; quelques instants après, nous voyons et entendons des brisants. Nous mettons à la cape*, bâbord amures*, et réduisons encore la vitesse. La brise fraîchit, la brume s’épaissit de nouveau ; il y a de fréquents grains de neige. À six heures, nous virons de bord. La mer se forme et, à onze heures, elle est très grosse ; nous filons de l’huile. À onze heures cinquante, aperçu dans une éclaircie une terre à un quart à l’arrière du travers par tribord (vers le sud-ouest). Nous passons plusieurs icebergs. Dans l’eau les manchots sont nombreux.
Les terres, îles et îlots que nous entrevoyons depuis deux jours appartiennent au groupe des Shetland du Sud. La plupart de ces îles sont volcaniques ; elles sont séparées par des canaux profonds et entourées d’écueils qui en rendent les abords extrêmement dangereux, étant donné l’épais voile de brume qui les enveloppe constamment. Elles sont couvertes de hautes collines et de montagnes dont quelques-unes atteignent une altitude de plus de mille deux cents mètres. Pendant toute l’année, l’archipel est enseveli sous un épais manteau de neige. Pourtant, au cœur de l’été, en janvier, de maigres mousses et quelques lichens couvrent les roches, çà et là, de leur triste végétation.
Ces îles, que le soleil éclaire rarement pendant plusieurs heures consécutives, sur lesquelles les étoiles, constamment cachées par un ciel lourd et bas, ne scintillent pas, sont bien les plus désolées qu’on puisse imaginer.
Si, comme il en a la très louable intention, le gouvernement argentin se décide jamais à créer ici une station de sauvetage, il faudra que les fonctionnaires qu’il y enverra soient fréquemment remplacés, car on ne peut songer à faire vivre longtemps des êtres humains dans des parages aussi effroyablement lugubres. Bien que le climat ne soit pas malsain, ils ne résisteraient pas à la morne désespérance de ces paysages noyés dans une brume éternelle.
Notre passage dans cette région devait nous laisser à tous un douloureux souvenir.
C’est, en effet, dans l’après-midi du 22, en vue de l’île Low, que notre jeune matelot Auguste-Karl Wiencke paya de sa vie une désobéissance légère due, d’ailleurs, à un excès de zèle.
La mer est démontée ; nous embarquons beaucoup. Un des dalots de dessous le vent se trouve obstrué et l’eau s’écoule difficilement. L’officier de quart charge Johansen et Wiencke de dégager ce dalot. Insoucieux du danger et croyant activer sa besogne, Wiencke se suspend en dehors du navire. Au même instant, une immense lame le prend et l’enlève. Johansen crie aussitôt : “Un homme à la mer !” La sinistre phrase amène tout le monde sur le pont. Anxieux, impuissants, bien que nous tentions par tous les moyens de lui venir en aide, nous assistons à l’agonie du pauvre Wiencke.
Venant justement d’abattre d’une couple de points* pour éviter un iceberg, nous avons beaucoup d’erre. On loffe* sur-le-champ. Il ne peut être question de mettre une embarcation à la mer ; la tempête fait rage. Cependant, Wiencke lutte ; il est parvenu à saisir la ligne du loch* qui traîne dans le sillage. Avec mille précautions, le docteur, qui se trouve à l’arrière, sur la dunette, l’amène le long du bord. Mais, épuisé par l’effort qu’il a fait, l’infortuné est sans connaissance ; il ne peut saisir les manœuvres* qu’on lui tend.
Lecointe s’offre à descendre à la mer. On lui passe à la ceinture un bout de filin que deux hommes maintiennent, et il se laisse affaler dans l’eau glacée. Il va saisir Wiencke, quand un coup de mer l’en sépare. Le malheureux lâche la ligne du loch à laquelle il était resté convulsivement cramponné ; nous voyons son corps s’éloigner, roulé par les flots, et bientôt, sous nos yeux, il s’engloutit et disparaît à jamais… Tout ce drame s’est déroulé en quelques instants.
Wiencke était très aimé de ses camarades, et ses chefs appréciaient sa rare intelligence, son excellent caractère et son dévouement. Sa perte est vivement ressentie par tous.
La brume est toujours intense, la pluie alterne avec la neige, et la mer, toujours démontée, brise avec fureur sur les rives d’une terre que, dans une éclaircie, nous apercevons par la hanche* de bâbord, et qui doit être l’île Low. Nous prenons l’allure du vent arrière afin de nous mettre à l’abri de cette terre. Dans une course folle des icebergs nous frôlent, zébrant le ciel sombre de leurs arêtes livides. Les vagues, avec un grondement sourd, montent à l’assaut du navire dont le pont est balayé par de grands paquets de mer. Vers six heures, nous arrivons sous le vent de l’île ; durant cette nuit qui nous sembla, à bord, plus morne et plus sombre, nous gardons la cape.
Le lendemain, 23 janvier, le temps est maniable ; nous cinglons vers le golfe de Hughes de la carte de l’Amirauté portant, en berne, les couleurs belges à la corne d’artimon et les norvégiennes au grand mât.
VI
TERRES NOUVELLES
La baie de Hughes. – Découverte d’un détroit. – Débarquements. – Paysages grandioses. – Le lever de la carte. – Huit jours d’alpinisme dans l’Antarctique. – La baie des Flandres. – Le cap Renard. – Entrée dans le Pacifique austral.
C’est le 23 janvier 1898 que la Belgica pénètre dans la baie de Hughes.
Nous passons à faible distance du cap que nous appellerons plus tard cap Neyt, en l’honneur du général Neyt, le premier souscripteur qui répondit à l’appel de la Société de géographie de Bruxelles. Puis nous obliquons vers l’est.
De hautes montagnes semblent fermer la baie de toutes parts, mais il règne une légère brume qui ne nous permet pas de reconnaître exactement la configuration de la côte. Nous sommes entourés de terres élevées ; dans la baie, nous voyons plusieurs icebergs et quelques îles et îlots dont l’un, très dégagé de neige, attire particulièrement notre attention ; les cartes ne l’indiquant pas, je lui donnerai par la suite le nom de mon père et le baptiserai îlot Auguste.
À neuf heures trente du soir, nous y effectuons notre premier débarquement. Nous y restons une heure environ et, lorsque nous rallions le bord, nous sommes porteurs d’une assez jolie collection d’échantillons géologiques, de mousses, de lichens, d’œufs de manchots, etc. Nous ramenons aussi deux jeunes manchots vivants.
Pendant le reste de la nuit, nous croisons sous petite vapeur. Il faut fréquemment manœuvrer pour éviter des icebergs. Le temps reste assez épais.
Dans la matinée du 24, nous effectuons un second débarquement sur un îlot que, pas plus que celui de la veille, nous ne pouvons identifier avec rien de ce qui existe sur la carte.
Nous faisons route ensuite vers le sud-est où les terres semblent ouvrir entre elles un passage praticable. Vers une heure, nous donnons dans cette échancrure ; une demi-heure après, le front d’un vaste glacier, qui la ferme vers l’est, nous arrête. Nous sommes au fond de la baie qui est aujourd’hui portée sur la carte sous le nom de Brialmont, en reconnaissance des services rendus à notre expédition par l’éminent ingénieur militaire. Elle est parsemée de petits icebergs ; la mer en a érodé plusieurs de la façon la plus fantaisiste.
Ayant viré de bord, nous sortons de la baie Brialmont vers trois heures ; nous doublons le cap Spring qui en marque l’entrée sud et nous continuons à ranger la terre par bâbord. Nous en relevons les contours au compas.
Vers cinq heures, la brume s’étant dissipée, nous remarquons deux défilés assez larges dans la chaîne de montagnes qui nous avait paru fermer la baie.
L’un de ces défilés, orienté vers le nord-ouest, sépare du continent antarctique la terre de Palmer ou de la Trinité et en fait une île : c’est le canal de Dallmann. L’autre, orienté vers le sud-ouest, paraît indiquer l’existence d’un canal important conduisant au Pacifique. Nous laissons en effet par bâbord une ouverture qui s’approfondit à perte de vue ; à six heures, nous en relevons l’axe au sud-ouest.
Au nord, nous avons une terre qui divise en deux le golfe de Hugues. Comme elle présente deux pics élevés très caractéristiques, nous l’identifions bientôt avec l’île des Deux-Hummocks de la carte de l’Amirauté.
Nous avons hâte de nous engager dans le nouveau détroit ouvert au sud, et qui est libre de glace. Mais nous résistons à la tentation qui nous tenaille et nous séjournons dans le golfe de Hughes jusqu’au 27, afin d’en parfaire le lever. Ayant dépassé l’entrée du détroit, nous continuons notre route vers l’ouest.
Peu après, nous apercevons une masse brune flottante que Racovitza et Arctowski vont reconnaître en canot. Ils constatent que c’est un glaçon chargé d’argile et de pierres. Puis ils effectuent le troisième débarquement sur une petite île (île Harry), d’où ils reviennent vers minuit avec des échantillons géologiques.
Le lendemain, 25 janvier, le temps est clair et calme, et le soleil radieux éclaire une nature grandiose et sauvage. Il fait si chaud que l’un de nous attrape un coup de soleil.
Après avoir effectué un nouveau débarquement à l’île Harry, nous remontons un peu vers le nord, en longeant la terre à bâbord.
L’après-midi, nous effectuons le cinquième débarquement, près du cap Neyt, sur une grande terre que, plus tard, nous appellerons l’île Liège ; Lecointe y détermine une droite de hauteur* ; le docteur prend des photographies ; nous voyons des phoques de Weddell en grand nombre.
Le soir, nous retournons à l’îlot Auguste ; des cétacés évoluent fréquemment autour de nous et nous entendons leur souffle puissant tout contre notre bord.
Le coucher du soleil est admirable et teinte féeriquement tout ce qui nous entoure.
Bien que le soleil disparaisse quelques heures sous l’horizon, nous n’avons plus de nuit : le crépuscule et l’aurore se confondent. Nous en profitons pour marcher et travailler sans répit. À peine stoppons-nous quelques heures très tard dans la soirée. De grand matin, Lecointe et moi, sommes sur la passerelle ; Arctowski et Racovitza classent les matériaux recueillis la veille ; Cook développe les clichés ; tous attendent impatiemment de nouveaux débarquements ; chacun se met à toutes les besognes : au besoin, les savants manieront l’aviron.
Pendant notre séjour dans le golfe, le temps s’est maintenu presque calme, et, somme toute, suffisamment clair. Les positions de plusieurs points ont pu être déterminées astronomiquement.
La seule île que nous ayons pu identifier avec celles portées sur les cartes antérieures est celle des Deux-Hummocks dont la position, toutefois, était erronée.
Enfin, le 27 janvier, à trois heures et demie, nous entrons dans le détroit entrevu le 24 et dont la baie de Hughes n’est que l’entrée.
Est-ce vraiment un passage ? Et où nous conduira-t-il ?… Dans le Pacifique, comme le ferait supposer sa direction initiale, ou vers la mer de George-IV, dans l’Atlantique austral ?
Impossible pour le moment d’émettre un jugement à cet égard : on ne saurait même dire si c’est dans un détroit ou dans un fjord que nous embouquons. Devant nous, la vue, quoique bien plus étendue que par le travers, est fermée par des terres qui se projettent les unes devant les autres et peuvent cacher des issues insoupçonnées ou quelque décevant obstacle.
En dépit de nos craintes, nous éprouvons cette joie et cette émotion spéciales qui s’emparent des navigateurs lorsque l’étrave de leur navire laboure des flots vierges.
Nous n’avons pas assez de regards pour contempler les hautes falaises qui plongent dans la mer, ces baies où dévalent des glaciers, ces aiguilles qui pointent dans le ciel. Tout cela est sauvage, stérile, dénudé : ce sont pourtant nos richesses, puisque ce sont nos découvertes.
Le panorama qui se déroule sous nos regards, et que nuls autres yeux n’ont jamais contemplé, est d’une grandeur farouche. À mi-hauteur des falaises noires, grises ou rouges, flottent des nuages légers comme d’impalpables gazes ; à leur pied reparaît la glace, d’une blancheur éclatante, qui se teinte d’azur au niveau de la mer. Çà et là flottent de blancs icebergs aux arêtes bizarres, aux formes étranges, châteaux enchantés ou grottes azurées, attirantes ou perfides. Les glaciers, semblables à de grands fleuves figés, viennent se pencher et se perdre dans la mer qui paraît toute noire en opposition avec tant de blancheurs. Les sommets, couronnés de glace et de neige, étincellent de mille feux sous le soleil ; ils projettent derrière eux des ombres aux teintes subtiles et mourantes, des bleus tendres, des violets très pâles. Le soleil couchant surtout les colore délicieusement ; il multiplie des reflets de nacre, et prête à ce monde nouveau un aspect surnaturel et merveilleux…
Nous n’avons pas une heure à perdre : pour faire œuvre utile, il faut travailler rapidement, sans s’arrêter aux détails, de façon à obtenir une bonne carte d’ensemble, indiquant, pour les besoins de la navigation, la physionomie de ces parages. Tandis que les uns sont à terre, les autres, à bord de la Belgica, vont d’un rivage à l’autre, cherchant des points de repère, mesurant des angles, levant la carte.
Notre zèle se double d’enthousiasme.
Quand nous débarquons, Arctowski, détachant avec un marteau des éclats de vulgaire granit, semble un prospecteur cherchant du quartz aurifère ; Racovitza, dans les rares solutions de continuité de l’épais manteau de glace qui recouvre les terres, cueille parfois une graminée minuscule avec les mêmes soins que s’il s’agissait d’une orchidée rarissime…
Sur les plaques de glace, des phoques de Weddell et des phoques crabiers somnolent béatement ou s’étirent avec volupté sous les caresses du soleil.
Les flots sont peuplés de cétacés, bien plus nombreux encore que dans le golfe de Hughes. De quelque côté que nous regardions, nous en voyons des jeux de trois ou quatre individus, baleinoptères et surtout mégaptères. Durant la nuit, nous entendons leur grand souffle profond qui, seul, avec le cri perçant des manchots et les sourdes détonations produites au loin par le vélage* des glaciers, rompt l’impressionnant silence qui règne autour de nous.
Les hautes terres qui, de part et d’autre, bordent le détroit, sont découpées par des baies nombreuses et importantes ou par de simples criques au fond desquelles s’écoulent les glaciers. Les roches à pic ou les nunataks*, qui profilent leurs silhouettes noires sur le fond blanc du paysage, sont les seuls points dont nous puissions nous servir pour le lever de la carte. Encore ces repères se présentent-ils sous des aspects bien différents, suivant le point d’où on les considère et l’éclairage qu’ils subissent. Pour procéder sûrement à la mesure de leurs distances angulaires, il faut, sous peine de les confondre, ne pas les perdre de vue un instant.
Mais n’anticipons pas les événements.
La première nuit, harassés de fatigue, nous stoppons dans le dessein de rester en panne jusqu’à l’aube. À partir de minuit, l’atmosphère s’embrume par intervalles.
Pendant la matinée du 28 janvier, nous profitons d’une éclaircie pour sonder et déterminer la température de l’eau à différentes profondeurs. Nous trouvons un brassiage considérable : six cent vingt-cinq mètres. C’est le seul sondage que nous ayons opéré dans le détroit.
À onze heures, nous rallions la côte est, dans le but de la ranger de près pour en suivre et relever tous les contours et embouquer dans la première issue qu’elle présentera.
Nous reconnaîtrons par la suite que cette terre, bordée de hautes montagnes (monts Bulcke), et à laquelle, plus tard, nous avons donné le nom de Danco, s’étend jusqu’à la sortie du détroit, et que les solutions de continuité qu’elle paraît présenter ne sont que de grandes baies.
La brume ne tarde pas à nous contrarier de nouveau.
À midi, nous stoppons au large du cap Reclus, à proximité d’un îlot, sur lequel nous débarquons pendant quelques instants, Arctowski et moi, pour recueillir des échantillons de roches. (Cet îlot reçut le nom de mon frère Gaston.)
Le lendemain, 29 janvier, le temps reste brumeux, et il règne une assez forte houle du nord-est. Nous profitons de quelques éclaircies pour poursuivre notre reconnaissance. L’axe du canal s’incline vers l’ouest. La terre de Danco présente ici une belle échancrure, que nous avons baptisée du nom de baie de la Reine-Wilhelmine, en souvenir de la gracieuse attention que le gouvernement néerlandais eut pour nous au départ.
Dans l’après-midi, nous amarrons à un petit iceberg, dont la face supérieure présente des cuvettes remplies de belle eau de fusion ; nous espérions en embarquer quelques barils, mais la houle nous oblige bientôt à larguer nos amarres.
Nous rallions la côte dont nous nous sommes rapprochés depuis le matin et nous y débarquons au pied d’une falaise abrupte dominant une petite crique (près du cap Anna). En rentrant à bord, nous capturons un manchot de la terre Adélie, le premier de cette espèce que nous ayons rencontré. Pendant la soirée, le ciel se rassérène, la brise mollit et, pour la première fois depuis notre entrée dans le détroit, nous jouissons d’un horizon très étendu.
Sauf vers le nord-est, nous sommes entourés de terres.
De toutes parts, nous voyons s’ébattre des cétacés.
Pendant la nuit, nous restons en panne à proximité des îlots Emma et Louise (noms de ma mère et de ma sœur).
Tandis que les îlots du golfe de Hughes étaient, pour ainsi dire, dépourvus de neige, ceux-ci en sont couverts. Ils affectent une forme très caractéristique, que je ne pourrais mieux comparer qu’à celle de ces bonbons appelés “patiences” : leur surface est légèrement bombée et le pourtour est à pic ; çà et là, au niveau de la mer, la roche à nu indique qu’on se trouve bien en présence d’une île et non d’un iceberg.
Le lever de la carte présente de grandes difficultés. Du 23 janvier au 13 février, la lune ne fut pas visible. Le soleil seul put servir à la détermination du point ; malheureusement, outre qu’il s’élevait peu au-dessus de l’horizon, il était souvent masqué à nos yeux soit par les terres, soit par la brume, qui nous laissait peu de répit. Quant aux étoiles, nous ne les voyions pas, puisqu’il n’y avait, à proprement parler, pas de nuit.
Le 30 janvier, nous décidons, Danco et moi, de débarquer pour tenter d’atteindre un sommet élevé et faire un lever rapide par la méthode de l’amiral Mouchez, c’est-à-dire que les angles verticaux, mesurés de la station choisie, nous donneront, par une simple résolution de triangles rectangles, l’éloignement des points observés, tandis que les azimuts* en fourniront les gisements. Amundsen, Arctowski et Cook nous accompagneront.
Nous choisissons sur la côte nord-ouest une grande terre (île Brabant) présentant une crête élevée (monts Solvay), dont l’ascension nous paraît praticable et d’où nous pourrons, peut-être, nous rendre compte de ce qui existe vers l’ouest, c’est-à-dire vers le Pacifique.
Nous préparons deux traîneaux ; nous y chargeons et assujettissons le théodolite*, la tente en soie, des skis, des raquettes à neige, un réchaud, des réservoirs à pétrole, des lits-sacs en peau de renne, en un mot tout ce qui est nécessaire pour une excursion de quelque durée sur la neige et la glace. Bien que nous ne nous proposions pas de quitter le bord pour plus de huit jours, nous emportons des vivres pour quinze.
Vers quatre heures de l’après-midi, nous arrivons devant une petite anse (baie Buls), près du point qui nous a paru le plus propice au débarquement et où la côte n’est pas trop escarpée (cap d’Ursel). Les traîneaux tout chargés ont été mis dans un canot, mais la rive est encombrée d’une bouillie de glace et l’embarcation n’avance qu’avec peine. Le débarquement a lieu au pied d’une roche occupée par des cormorans ; la houle le rend pénible et difficile.
Lecointe nous aide avec deux matelots à hisser nos traîneaux. La pente est raide : trente-cinq à quarante degrés. Nous enfonçons dans la neige et ce n’est qu’après de vigoureux efforts que, vers huit heures, nous atteignons, à environ mille cent pieds d’altitude, une espèce de plateau où nous établissons notre campement pour la nuit. La tente est dressée, tandis que nos camarades rallient la Belgica.
Pendant mon absence, Lecointe continuera à explorer le canal vers le sud et le sud-ouest.
Notre première nuit à terre se passe aussi confortablement que possible. Nous sommes chaudement enfouis dans nos sacs de peau de renne ; d’ailleurs, il ne fait pas très froid, et nous avons plutôt à souffrir de l’humidité.
Le 31 janvier, vers neuf heures du matin, nous plions bagage et quittons le lieu du campement ; il fait très brumeux et nous nous dirigeons au compas vers le nord-nord-ouest, où nous avons aperçu des sommets rocheux. Mais bientôt la brume devient si intense que nous sommes obligés de camper de nouveau.
À une heure, l’atmosphère s’étant allégée, nous reprenons notre marche vers une déclivité qui paraît devoir nous conduire à un point élevé. Nous traversons d’abord une plaine coupée de quelques crevasses ; puis, toujours halant péniblement nos traîneaux, nous gravissons environ cent mètres d’une pente à quarante-cinq degrés.
Après quatre heures d’efforts, nous nous trouvons devant une crevasse large et profonde, absolument infranchissable ; nous n’avons d’autre ressource que de rebrousser chemin et de retourner camper pour la nuit dans la plaine que nous avons traversée l’après-midi.
Le 1er février, à notre réveil, il neige ; le vent chasse sur la plaine des tourbillons de grains durs et menus comme du sable. Nous tentons de gravir une autre pente, au sud des pics rocheux, but de nos efforts ; mais bientôt nous constatons que ceux-ci sont absolument abrupts et que leur ascension est impossible.
Pendant cette marche, nous avons une vive alerte.
Danco est attelé au même traîneau que moi ; lui à gauche, moi à droite, nous sommes à quelques mètres l’un de l’autre. Soudain, mon brave ami disparaît brusquement comme si une trappe s’était ouverte sous ses pieds. Je m’arc-boute immédiatement pour le retenir. Mais il est probable que j’eusse été entraîné avec lui au fond de l’abîme si ses grands skis ne s’étaient accrochés aux parois de la faille, par bonheur peu large, et qu’un pont de neige avait dissimulée à ses yeux. Nos camarades se précipitent en avant pour se porter au secours de Danco et nous le retirons bientôt de sa périlleuse situation, sans une égratignure.
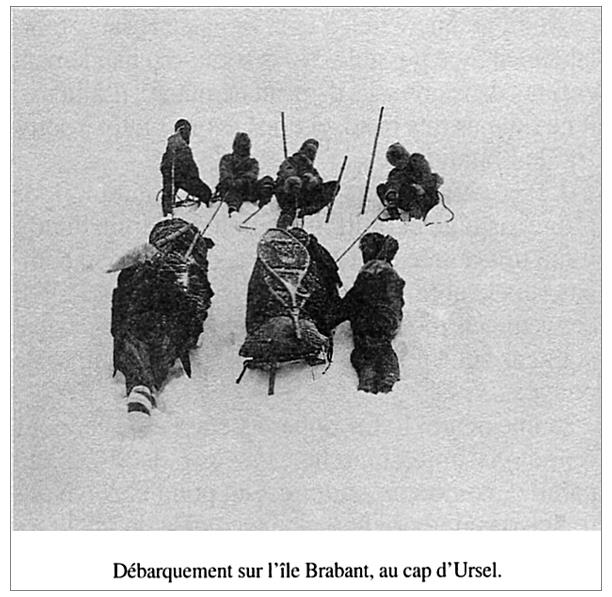
Nous sommes constamment exposés à des accidents de ce genre : la plaine de névé, sur laquelle nous marchons, est coupée de nombreuses crevasses, étroites, mais très étendues, qui ne sont à découvert que sur une minime partie de leur parcours. Il est donc prudent de sonder, à chaque pas, le sol avec son bâton.
À cinq heures, nous établissons la tente dans la plaine. Force nous est, après ces essais infructueux, de choisir pour point d’observation le sommet d’un des escarpements rocheux (nunataks) qui dominent l’anse à l’entrée de laquelle nous avons débarqué.
Le 2 février, dans la matinée, nous parvenons, en nous livrant à une gymnastique périlleuse, à atteindre le sommet de ce nunatak dont l’altitude est de trois cent quinze mètres, et nous nous y installons en station avec le théodolite. Mais le temps s’épaissit et il est impossible de rien relever.
Le 3 février, il fait très clair pendant quelques heures et, du haut de notre nunatak, nous jouissons d’un grandiose et merveilleux panorama. À nos pieds, le beau glacier qui s’écoule dans la baie a, dans sa partie inférieure toute coupée de crevasses, l’aspect d’une mer houleuse figée et glacée. Au-delà du détroit qui s’étale devant nous dans sa majestueuse ampleur, la terre de l’Est (terre de Danco) est visible à perte de vue. Elle présente l’aspect d’un immense champ de neige parfaitement uni : l’inlandsis a tout nivelé, comblant de glace les vallées les plus profondes, ensevelissant le continent qui fort probablement s’étend au sud. Malheureusement, l’altitude n’est pas assez considérable pour que les nombreuses îles qui sont dans l’Est se détachent nettement de la terre principale.
Bien que l’inclémence du temps ne nous ait pas permis de tirer de la méthode de l’amiral Mouchez tout le parti que nous en espérions, les quelques observations qu’il nous a été donné de faire ce jour-là serviront néanmoins d’utile vérification au lever exécuté sous vapeur.
Le 4, pendant une partie de la matinée, nous prenons encore des relèvements*, mais le soleil est caché à midi et il nous est impossible d’obtenir une hauteur méridienne*.
Depuis notre débarquement, la brume et le mauvais temps nous condamnent le plus souvent à l’oisiveté. Alors nous menons dans notre fragile home une vie de sybarites, nous levant tard, nous couchant tôt, mangeant beaucoup et souvent pour tuer le temps. Danco, particulièrement, a un appétit féroce et le petit réchaud ne chôme guère. La tente est presque constamment remplie des émanations odorantes du chocolat ou d’un bon et réconfortant fumet de soupe aux pois ou de gruau d’avoine.
Mais cette vie douillette ne devait pas se prolonger. Le 5 février, nous changeons de campement et allons nous établir sur la déclivité qu’il faudra descendre pour embarquer. Il vente très fort de l’est-nord-est et la tente se déchire de toutes parts. Nous essayons d’abord de la raccommoder à l’aide d’épingles de sûreté : celles-ci ne servent qu’à produire de nouvelles déchirures. À la fin, pour sauver au moins en partie notre abri, force nous est d’adopter une solution énergique : nous le réduisons considérablement, sacrifiant ce qui est trop mauvais ; puis, pour le protéger contre le vent, auquel il ne résisterait pas, nous élevons, du côté où il souffle, un mur de neige. Nous sommes ainsi fort à l’étroit, vraiment entassés les uns à côté des autres. Il ne fait pas froid, mais nous souffrons toujours de l’humidité ; il dégèle et le névé est si mou que nous y enfonçons.
Pendant toute la nuit du 5 au 6 février, le temps est épouvantable. Il vente et il pleut. Il pleut si fort que notre abri de neige se met à fondre. Le matin, notre campement, noyé par le dégel, perdu d’eau et de neige fondue, offre l’aspect le plus lamentable.
La brise ayant un peu molli, nous escaladons une éminence où nous plantons un petit drapeau pour signaler notre présence à la Belgica, que nous apercevons, avec un plaisir que tout le monde comprendra, voguant au loin dans le détroit.
Nous levons le campement et descendons vers la rockerie de cormorans, où nous avons débarqué. À cinq heures, la Belgica arrive près du cap d’Ursel ; un canot nous est envoyé, et, une heure plus tard, nous remettons les pieds sur le pont de notre bon petit navire.
Le temps de notre absence a été bien utilisé : la Belgica a parcouru le détroit plus à l’ouest. Lecointe et Racovitza ont débarqué dans une vaste baie au sud (baie Andvord), et recueilli d’intéressants échantillons botaniques et zoologiques. Lecointe a, en outre, relevé plusieurs îles nouvelles : les îles de Rongé, couvertes de hautes montagnes, et l’île Cavelier de Cuverville, qui présente une muraille rocheuse presque verticale, haute de plusieurs centaines de mètres.
Du haut de notre poste d’observation, nous avions joui pendant quelques heures d’une vue étendue ; aussi, coordonnant les notes et croquis de Lecointe avec les nôtres, nous eûmes bientôt une notion plus nette du labyrinthe où nous nous trouvions.
De notre station de montagne, Danco et moi avions cru reconnaître, au loin, l’île des Deux-Hummocks. Or, comme après notre entrée dans le détroit, nous avions été enveloppés de brume pendant vingt-quatre heures, par une brise très fraîche du nord-est, nous croyions avoir dérivé fortement et il y avait une solution de continuité dans le lever.
Il fallait s’assurer si c’était bien l’île en question que nous avions vue, et, du coup, en poussant une nouvelle pointe vers le golfe de Hughes, raccorder les deux parties de notre travail.
Nous refîmes aussitôt route vers le cap Murray, qui marque du côté est l’entrée du détroit, et d’où l’on embrasse la vue du golfe.
C’était bien, en effet, l’île des Deux-Hummocks que nous avions aperçue de notre nunatak. La brise du nord-est ne nous avait portés que de six milles au sud-ouest, bien que le mouvement de l’eau contre nos murailles indiquât une dérive d’au moins deux milles à l’heure : probablement, sans nous en douter, avions-nous été soumis à des courants de marée.
Nous restons en panne pour la nuit, près du cap Murray.
Le 7 février, après avoir relié des points remarquables du golfe à d’autres du détroit, nous embouquons de nouveau dans celui-ci, serrant de près, cette fois, la côte orientale et pénétrant dans les moindres criques et anses.
Nous reconnaissons ainsi successivement la baie Charlotte (ainsi baptisée en l’honneur de la gracieuse fiancée de Lecointe), le cap Reclus, et un chenal séparant la terre de Danco des îles Delaite, Nansen, Brooklyn, Wyck et Pelseneer. Nous donnerons plus tard à ce chenal le nom de chenal de La Plata, en reconnaissance des services que nous ont rendus les Argentins.
Au fond de la baie de la Reine-Wilhelmine, Arctowski détache d’une belle falaise quelques fragments de schiste, les seuls spécimens de roches sédimentaires que nous ayons recueillis. Malheureusement, une grande masse de glace qui surplombe la falaise rend des plus dangereux le débarquement en cet endroit : je dois prier le zélé géologue d’écourter ses recherches, en sorte qu’il ne peut suivre, comme il le désirerait, les traces de ce terrain. Nous, doublons le cap Anna et nous avons, en nous dirigeant de là vers le bord occidental du détroit, une belle échappée sur le canal de Schollaert, dans lequel Lecointe a quelque peu pénétré avec la Belgica pendant notre excursion sur l’île Brabant.
Le 8, en rangeant l’île Anvers, qui présente un beau massif rocheux, les monts Osterrieth, nous pénétrons dans un chenal, étroit mais sûr, formé par cette grande île et l’île Wiencke.
Parcourue suivant la direction nord-est (qui est aussi celle des monts Osterrieth, des monts Solvay et des monts Brugmann) par la belle sierra Du Fief, l’île Wiencke offre les sites les plus pittoresques qu’il nous ait été donné d’admirer.
La navigation dans la première partie du chenal où nous avons pénétré, le chenal de Neumayer, bordée par deux murailles abruptes, est vraiment saisissante.
L’île Wiencke se projetant devant l’île Anvers, nous ne savons pas, tout d’abord, si elle n’y est pas rattachée et si ce n’est pas dans un fjord plutôt que dans un canal que nous nous sommes engagés. Chaque découpure de la côte nous ménage une surprise, et nous éprouvons à la fouiller et à en faire le croquis cette ivresse particulière au savant que de patientes recherches conduisent à de nouveaux arcanes.
Mais nous avons le pressentiment que nous touchons au terme de cette navigation passionnante dont chaque étape a modifié, complété la carte antérieure, et que bientôt nous allons arriver au seuil du Pacifique. Et, effectivement, lorsque, vers neuf heures du soir, nous stoppons, nous avons à tribord, sur l’île Anvers, les monts William et Moberly, découverts et baptisés par Biscoe qui s’en approcha par le Pacifique, en 1832, et devant nous s’ouvre, en une admirable échappée, l’étendue du Grand Océan.
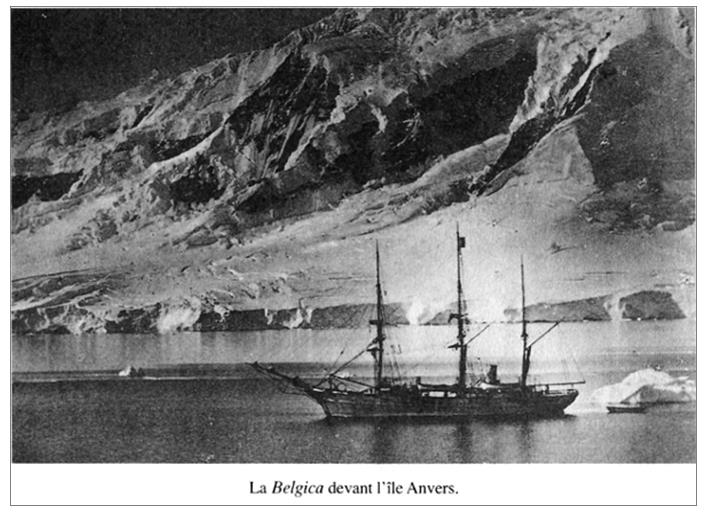
Le lendemain 9 février, nous débarquons sur l’île Wiencke et, plus tard, sur une des îles Wauwermans, recouverte, comme tous les îlots de ces parages, par un glacier en forme de calotte.
De là, nous embrassons un vaste panorama : au nord, le chenal de Neumayer et le cap Albert Lancaster, qui sépare ce chenal d’une vaste baie découpée dans l’île Anvers, peut-être celle où débarquèrent Biscoe en 1832 et Dallmann en 1874. Le mont William et le mont Moberly se projettent l’un sur l’autre, tandis qu’à l’est la sierra Du Fief profile sur le ciel bleu sa crête festonnée. Au sud-est s’approfondit au loin une échancrure où dévalent d’imposants glaciers, soudés sur les hauteurs en un immense champ de glace, l’inlandsis antarctique. Au sud, de hautes falaises prolongent, à peu près dans cette direction, les sommets de la sierra Du Fief. À l’ouest, enfin, le Pacifique sans limites.
Il fait presque calme ; la mer, à peine ridée, brasille sous le soleil.
L’après-midi de cette journée radieuse, nous doublons le cap Errera, et, rentrant dans le détroit, nous longeons la côte est de l’île Wiencke qui, comme la côte ouest, est d’un grand caractère. Nous entrons dans un chenal qui sépare l’île Wiencke de deux petites îles couvertes de neige (les îles Fridtjof et Bob), que nous laissons par tribord, après y avoir débarqué Racovitza, Danco, Arctowski et Cook, que nous devons venir reprendre deux heures plus tard. Avec la Belgica, nous nous dirigeons vers la côte est du détroit, où Lecointe a navigué, pendant notre campement sur l’île Brabant et dont nous désirons préciser quelques détails.
Nous étant attardés à ce travail, il fait presque nuit noire lorsque nous allons chercher, à l’île Bob, nos camarades qui commençaient à désespérer de nous voir revenir et éprouvaient cruellement les tiraillements de la faim. En souvenir de cet incident, l’île Bob fut longtemps désignée à bord sous le nom d’île Famine.
Le 10 février, nous croyons enfin avoir trouvé le passage vers l’est que nous cherchions depuis tant de jours. Nous entrons dans un détroit ou bras de mer, que nous apercevons orienté vers le sud-est. Mais bientôt nous reconnaissons que nous sommes dans une grande baie (baie des Flandres) entourée de nombreux glaciers, qui tous atteignent les flots au fond de petites anses, où ils dressent leurs falaises de cristal.
Des icebergs qui s’en sont détachés, dérivant à proximité, parsèment la baie tout entière de leurs masses errantes, au milieu desquelles il est difficile de se frayer un chemin.
Les glaciers du détroit diffèrent essentiellement des glaciers alpestres, dont la masse principale est à environ trois mille mètres d’altitude. Dans la région où nous sommes, le niveau des neiges éternelles est presque au niveau de la mer, et les glaciers plongent dans les flots à l’endroit de leur plus grande puissance : ils se terminent donc par une haute muraille, incessamment poussée en avant par le lent fleuve de glace qui descend derrière elle et qui, par des ruptures successives, essaime sur la mer de grands icebergs tabulaires.
Dans la baie des Flandres, nous relevons les îles Moureau, complètement ensevelies sous l’inlandsis et semblables à des meules de glace. Nous sommes enveloppés de brume, qui, par moments, se dissipe un peu, nous laissant entrevoir des terres.
Nous passons la nuit dans la baie et, le lendemain, nous en suivons tous les contours de pointe en pointe.
Dans la matinée, le soleil, qui s’est enfin montré, permet quelques observations : on devine les terres, mais on ne peut voir leurs parties élevées, qui restent embrumées.
Vers le soir, le temps s’épaissit ; puis la mer, la brume et la glace prennent une teinte bleue très étrange rappelant la couleur de l’étincelle électrique. Pendant près de une heure, nous demeurons les témoins émerveillés de ce phénomène pendant lequel tout ce qui nous entoure revêt un aspect étrange, très impressionnant. La petite baie près de laquelle nous sommes en ce moment est baptisée du nom de baie d’Azur.
Ce même soir (11 février), à notre sortie de la baie des Flandres, nous ne pûmes, par suite d’un ordre mal interprété dans la machine, éviter une collision avec un iceberg, ce qui coûta à notre navire la perte de sa guibre*.
Le 12 février, après avoir doublé le superbe cap Renard, nous effectuons près de ce point remarquable, qui marque la sortie du détroit vers le Pacifique, un vingtième et dernier débarquement.
Puis nous entrons dans le chenal de Lemaire, qui sépare la terre de Danco des îles Danebrog (ainsi nommées en reconnaissance de l’appui que l’expédition a trouvé en Danemark). Large d’environ trois quarts de mille, ce chenal est libre de glace et bordé de falaises abruptes au pied desquelles s’étendent, de-ci de-là, de petits glaciers plats. Il est “sain*”, mais sa sortie vers le sud, dans le Pacifique, est encombrée de récifs entre lesquels nous devons nous engager pour gagner le large ; la houle de l’océan y brise avec fracas.
Nous pénétrons un peu dans une vaste ouverture, qui se présente à l’est, encombrée de glace et d’icebergs. Cette ouverture, dans laquelle il serait dangereux, sinon impossible, de naviguer pour le moment, pourrait bien être le détroit de Bismarck, du capitaine Dallmann.
Nous avons passé exactement vingt jours dans le golfe de Hughes et dans le beau détroit qui le relie au Pacifique. Ce temps a été consciencieusement employé. Commencés dès les premières heures du jour, nos travaux ne cessaient que tard dans la soirée. Nous avons débarqué partout où nous avons pu le faire, en des points suffisamment éloignés et tellement dispersés que les matériaux recueillis donneront certainement la caractéristique de la région.
Les endroits, comme l’île Cavelier-de-Cuverville ou le cap Van Beneden, où l’on peut atterrir par tous les temps, sont rares.
À proximité du cap Neyt s’étend une petite grève assez accessible lorsqu’il n’y a pas de houle. Mais, sur tous les autres points, les débarquements furent toujours difficiles, sinon dangereux. La côte présente parfois une succession de petits dômes rocheux, peu élevés, mais à parois lisses, polies par le frottement des glaces et extrêmement glissantes. Parfois encore elle est elle-même facilement accessible, comme à l’île Louise, mais elle est défendue par des récifs, au milieu desquels notre canot court grand risque de se briser. Généralement, lorsque nous arrivions près du point de débarquement choisi, nous nous laissions porter par le flot, puis nous sautions à terre avant qu’il se retirât ; le plus souvent, un homme restait dans le canot pour le garder, parce qu’il était impossible de l’amarrer. On a beaucoup de peine, dans ces conditions, à transporter à terre des instruments scientifiques délicats.
Nombre de points sont absolument inaccessibles, soit que la roche apparaisse à nu en une falaise droite et raide, soit que de grands glaciers à parois verticales bordent le canal.
Le personnel marin, déjà si restreint à notre départ de Punta Arenas, s’était diminué encore d’une unité dans les tristes circonstances rapportées plus haut ; aussi, le plus souvent, les membres de l’état-major ont dû manœuvrer eux-mêmes l’embarcation qui les conduisait à terre.
Nos débarquements sur l’Antarctide n’en ont pas moins été plus nombreux que ceux de tous nos devanciers ensemble.
Cette simple constatation donne une idée du zèle et du dévouement qu’apportèrent mes compagnons à l’accomplissement de leur tâche.
Lecointe et moi, ne quittions jamais en même temps la Belgica, car celle-ci ne pouvait être mise à l’ancre à cause des icebergs, dont il fallait éviter l’abordage. Généralement le navire restait en panne, prêt à évoluer à la moindre alerte. Quelquefois aussi on l’amarrait à un grand glaçon – ce qu’il fallut faire pour embarquer de l’eau douce sous forme de neige – mais il arrivait que celui-ci se mettait en mouvement, pivotait sur lui-même ou entraînait le navire vers la terre ; il ne restait plus alors qu’à se dégager au plus vite.
Comme on peut le constater en comparant notre carte de ces parages à celle de l’Amirauté anglaise, il reste bien peu de chose des contours hypothétiques qui avaient été adoptés avant nous. La Belgica a navigué sur des emplacements désignés comme terres ; les officiers et les savants de l’expédition ont débarqué sur des terres qui se superposent à des parties teintées auparavant comme mers. Cela n’a rien qui doive étonner.
La cartographie de beaucoup de côtes antarctiques est basée sur une série d’hypothèses. Les phoquiers anglais ou américains, qui se livraient à la chasse dans les Shetland, poussaient parfois plus au sud – comme je l’ai relaté dans les prolégomènes de ce récit –, à la recherche des phoques à fourrure qu’ils avaient, pour ainsi dire, exterminés sur cet archipel. Ils apercevaient des terres, des sommets couverts de neige et de glace ; ils voyaient, ou croyaient voir, des côtes se continuer dans telle ou telle direction ; ils estimaient à vue de nez la distance qui séparait deux points. Souvent aussi ils étaient trompés par les nuages, les phénomènes de réfraction si fréquents dans les régions polaires. Revenus à leur port d’attache, ils racontaient ce qu’ils avaient vu. D’après leurs vagues indications, les géographes dressaient des cartes approximatives et baptisaient les terres nouvelles.
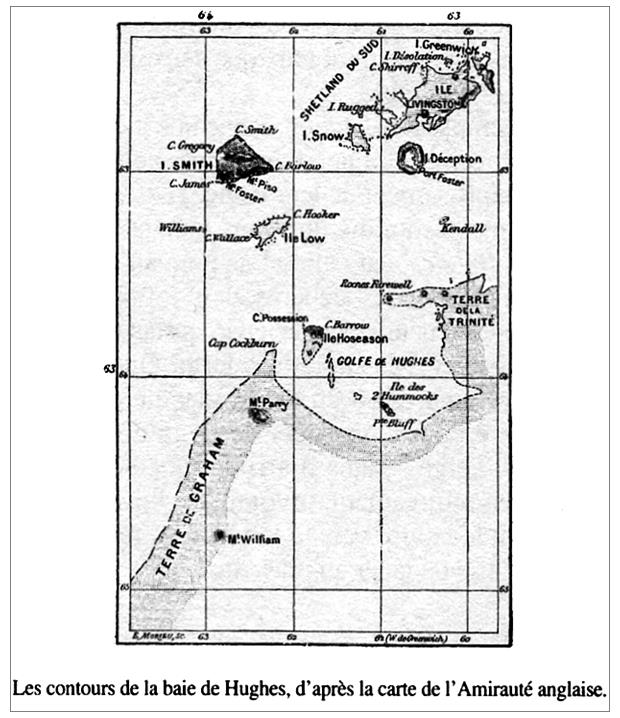

Combien de noms furent ainsi donnés à des apparences d’îles, à des nuages qui avaient produit l’illusion d’un massif montagneux, à des icebergs qui avaient simulé des rivages !
Souvent aussi les chasseurs fournissaient intentionnellement des indications fausses. Quand ils avaient trouvé des îles inconnues peuplées de phoques, ils avaient soin d’en cacher l’existence ou de mal renseigner sur leur position, dans la crainte des concurrents.
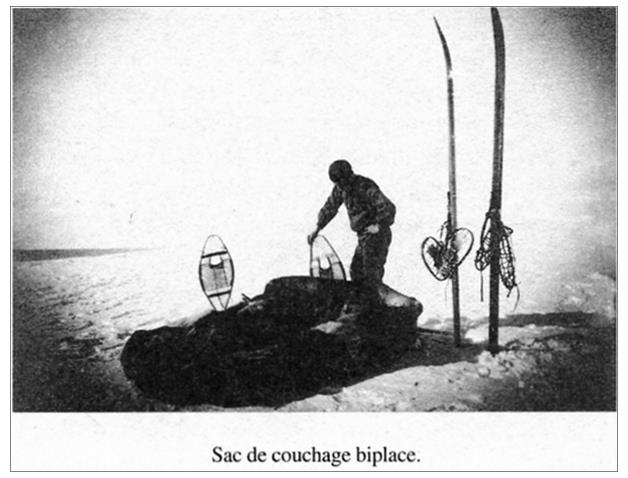
D’autres expéditions, plus scientifiques, n’avaient pu opérer de débarquements en nombre suffisant.
Or, nous avons constaté nous-mêmes, à maintes reprises, combien les choses se présentent différemment, selon qu’elles sont vues de près ou de loin.
Rien n’est plus malaisé que de distinguer un détroit d’une baie peu profonde ou d’un fjord coudé, une île d’un promontoire continental.
Pour faire un travail complet, il faut disposer de beaucoup de temps, suivre dans tous leurs méandres les rivages entrevus, pénétrer dans les moindres échancrures dont la distribution et les contours peuvent être totalement modifiés par un coude brusque ou une bifurcation insoupçonnée. On arrive à constater ainsi que ce qu’on croyait être d’abord un vaste massif terrestre n’est qu’un archipel déchiqueté.
Si notre itinéraire sur l’emplacement de la baie de Hughes et de la terre de Graham avait moins fouillé tous les coins du littoral, nous n’aurions pu tracer les contours à peu près exacts de notre carte si différente des précédentes[20].
VII
FAUNE, FLORE, ETC.
Les manchots et leurs mœurs. – La propriété individuelle chez les manchots antarctiques. – Organisation communiste des colonies de manchots papous. – Le bec-en-fourreau. – Pétrels et goélands. – Faune terrestre : puces, mouches et araignées. – Mousses et lichens. – Observations géologiques. – La vie et la mort des icebergs. – Jubartes, rorquals et phoques.
De tous les animaux que nous avons rencontrés au cours de cette exploration du golfe de Hughes et du détroit, les manchots sont, sans contredit, les plus intéressants[21].
Un peu partout, soit sur les terres qui bordent le détroit, soit sur les îles dont il est parsemé, nous avons trouvé des rockeries ou colonies de ces oiseaux, assemblées bruyantes et comiques que notre approche ne dispersait pas ; n’ayant jamais vu d’hommes avant nous, ils n’ont pas appris à les craindre.
Ils fournirent à Racovitza d’inépuisables sujets d’étude. Notre spirituel zoologue nous a raconté et a narré plus tard dans des conférences les résultats de ses observations.
“Rien n’étonne plus, dit-il, que la rencontre de cet être bizarre et comique qui s’appelle le manchot. Figurez-vous un petit bonhomme droit sur ses pieds, pourvu de deux larges battoirs à la place de bras, d’une tête, petite par rapport au corps dodu et replet : figurez-vous cet être couvert sur le dos d’un habit sombre à taches bleues, s’effilant par-derrière en une queue pointue traînant à terre, et orné sur le devant d’un frais plastron blanc et lustré ; mettez cet être en marche sur ses deux pattes et donnez-lui en même temps un petit dandinement cocasse et un constant mouvement de la tête : vous aurez devant les yeux quelque chose d’irrésistiblement attrayant et comique.
Ces oiseaux ne peuvent plus voler, car leurs plumes sont très réduites sur les ailes et transformées en sortes d’écailles ; mais, par contre, quels merveilleux nageurs ! À grands coups d’ailes, ils fendent les flots ou bien ils sautent au-dessus de l’eau par bonds successifs, comme des marsouins. À terre ils sont plus gauches ; cela ne les empêche pas cependant de grimper dans les falaises, à des hauteurs étonnantes. Ils sautent de roche en roche ou bien ils font des rétablissements sur leurs ailes, en s’aidant des pattes et du bec.
Deux espèces de manchots peuplent le détroit. Ils y ont fondé des cités populeuses et animées, mais dépourvues de toute institution sanitaire. On pratique dans ces villes et villages le système d’épandage sur place, et de loin le vent nous apportait, sur la Belgica, les effets odorants de cette hygiène rudimentaire. Avec ces odeurs nous arrivaient aussi, pour certaines de ces cités, les échos d’un bruit épouvantable. C’étaient des kaah… kaah… féroces, suivis du chœur furibond d’une foule en délire. Nous nous demandions, étonnés, si nous n’étions pas tombés en pleine période électorale, et je fus débarqué pour faire une enquête à ce sujet.
Les citoyens de ces villes bruyantes étaient les manchots antarctiques (Pygoscelis antarctica), espèce de 0,60 m de hauteur, qui se distingue de toutes les autres par une mince ligne noire qui se recourbe sur sa joue blanche comme la moustache en croc d’un mousquetaire. Cela donne au manchot antarctique un air provocant et querelleur, air qui répond fort bien à son caractère.
Je fus accueilli, en débarquant, par une tempête de cris, d’apostrophes véhémentes et d’exclamations indignées, qui ne me laissèrent aucun doute sur l’opinion défavorable que ces oiseaux avaient de ma personne. Je pensai qu’avec le temps je finirais par me faire agréer et je m’assis sur une roche à quelque distance. Mais mon amabilité et ma patience furent dépensées en pure perte. Tous les manchots, tournés vers moi, dressés sur leurs ergots, les plumes hérissées sur la tête, et le bec grand ouvert, me lançaient à jets continus des paroles que je jugeais, d’après leur ton, gravement injurieuses et que, bien heureusement – étant donné ma timidité naturelle –, je ne comprenais pas du tout, les philologues n’ayant pas encore fixé le dictionnaire manchot. De guerre lasse, je fis un grand détour et je revins vers la cité en me dissimulant derrière les roches. Je pus ainsi observer ces animaux sans qu’ils s’en doutassent, sans que leur vie normale fût troublée par la présence d’un intrus.
La surface du sol de la cité était assez inégale ; elle était établie sur une plage inclinée, parsemée de rocs tombés du haut de la falaise ; le sol était divisé en lots sur chacun desquels était installée une famille composée du père, de la mère et de deux petits. Le nid rond était une simple aire, ayant comme fond le sol même, limitée par un mur très bas, formé de petits cailloux mêlés de quelques os d’ancêtres manchots, que l’esprit peu respectueux mais pratique de ces oiseaux avait su utiliser au mieux de leurs intérêts. Il est manifeste que ce mur était simplement destiné à empêcher les œufs de rouler sur le terrain en pente de la cité. Les jeunes étaient encore recouverts de duvet gris ; ils avaient un gros ventre bourré de nourriture qui traînait presque à terre. Avec leur petite tête, leurs petits bras et leurs petites pattes cachées sous l’énorme bedaine, ils paraissaient de grosses pelotes de laine grise, roulant çà et là dans l’intérieur du nid. Les parents étaient à côté, veillant avec sollicitude sur leur progéniture, empêchant les jeunes de quitter la maison paternelle et allant, à tour de rôle, leur chercher la subsistance.
Autour de chaque nid était une zone, constituant la propriété de chaque famille, séparée de la zone voisine par des limites virtuelles. C’est ce système qui créait des procès continuels dans la cité ; dès qu’un manchot posait la patte sur la propriété de son voisin, le propriétaire protestait avec violence et la dispute dégénérait tout de suite en querelle aiguë. Les deux citoyens, auxquels se mêlaient souvent un troisième et un quatrième, se plaçaient l’un en face de l’autre, se regardant dans le blanc des yeux, et le corps penché en avant, les bras ramenés en arrière, le bec grand ouvert et les plumes hérissées sur la tête, ils se criaient l’un à l’autre les plus dures vérités. Ils ressemblaient de loin à deux marchandes de poisson, se reprochant réciproquement la fraîcheur de leur marchandise. Ce sont ces querelles constantes entre les habitants de la cité qui produisaient le vacarme que nous entendions de la Belgica – querelles qui, par conséquent, n’étaient pas dues aux démêlés électoraux, mais aux contestations judiciaires entre propriétaires fonciers.
D’autres cités, non moins populeuses et animées, ne sont pas, à beaucoup près, aussi bruyantes, et leurs habitants se montrent dignes et calmes. Il s’agit d’une seconde espèce de manchots, le papou (Pygoscelis papua), un peu plus grand que le manchot antarctique et plus somptueusement vêtu. Le dos est encore couvert d’un manteau à taches bleues ; sur la poitrine et le ventre brille toujours l’immaculé plastron blanc ; mais le bec et les pattes sont d’un rouge écarlate. C’est au douzième débarquement surtout que les cités de ces manchots étaient nombreuses et peuplées ; j’évalue à une dizaine de mille le nombre des citoyens qui les composaient.
Dès le moment où je mis pied à terre chez eux, je vis qu’il y avait une considérable différence de caractère entre les deux espèces de manchots. Je me glissai, en effet, sur la plate-forme rocheuse où était établie une grande ville de papous, et je constatai avec satisfaction que ma personne leur paraissait, sinon sympathique, du moins indifférente. Naturellement tous se tournèrent vers moi, me considérèrent attentivement ; quelques citoyens même, plus susceptibles, poussèrent des cris de protestation ou d’inquiétude ; mais quand ils eurent constaté que je m’asseyais tranquillement au milieu d’eux sans les incommoder, ils ne firent bientôt plus attention à moi et ils s’occupèrent de leurs affaires. Je pus donc les observer commodément, les photographier même et je n’ai pas à me repentir des longues heures que je dus leur consacrer, car ce que je vis était un spectacle réellement remarquable.
Les nids de ces manchots sont exactement semblables à ceux du manchot antarctique ; mais, au moment où je devins citoyen honoraire de la cité papoue, ces nids n’étaient plus occupés. Tous les jeunes, déjà de grande taille, vêtus d’une ample houppelande de duvet et ayant sur la poitrine une bavette blanche, avaient, comme leurs congénères antarctiques, vastes bedaines traînant à terre, petits bras et dandinante démarche ; cependant, au lieu d’être répartis entre les nids paternels, ils étaient tous réunis au milieu de la cité. L’observation me démontra que cette disposition était parfaitement voulue et qu’une organisation sociale particulière avait été établie au mieux de l’intérêt général. Pour bien s’en rendre compte, il est nécessaire de donner quelques détails sur la topographie des lieux.
La ville papoue était établie sur une plate-forme adossée à une haute falaise, à trente mètres environ au-dessus du niveau de la mer. Cette plate-forme avait un contour vaguement quadrilatéral ; un des côtés était appuyé à la falaise ; deux côtés donnaient directement sur la mer et formaient la crête d’une paroi verticale ; le quatrième côté donnait sur une pente très raide qui aboutissait à une petite plage caillouteuse. Les jeunes, au nombre d’une soixantaine, étaient rassemblés au milieu et seulement huit adultes se trouvaient à ce moment avec eux. Ces derniers étaient postés de distance en distance près des bords de la plate-forme, mais seulement sur les trois côtés qui donnaient sur la mer ; il n’y en avait aucun du côté de la falaise. J’avais sous les yeux un véritable établissement d’éducation, car les huit adultes étaient des surveillants, des pions chargés d’empêcher les jeunes de tomber du haut de la plate-forme. Ils étaient campés droit sur leurs pattes, graves et immobiles, et tout pénétrés de l’importance de leur mission. Dès qu’un jeune s’approchait trop près du bord de la plate-forme, le pion le plus rapproché ouvrait un bec énorme et lui lançait d’une voix sévère une admonestation bien sentie. Si cela ne suffisait pas, un coup de bec bien appliqué rappelait le récalcitrant au sentiment du devoir. Poussant des cris aigus, roulant sa bedaine rondelette et agitant ses petits moignons de bras, le jeune élève rejoignait ses compagnons, et le pion reprenait sa position après avoir déposé gravement à côté de lui la touffe de duvet qui souvent lui restait dans le bec.
Ces adultes, chargés de la surveillance des petits, se relayaient de temps en temps. L’une des sentinelles, fatiguée, levait la tête en l’air, ouvrait le bec et poussait un cri ressemblant beaucoup à celui de l’âne. À ce cri répondait un autre cri parti de la petite plage au pied de la falaise. Il y avait, en effet, à cet endroit, quelques adultes qui attendaient leur tour de faction en se lissant les plumes, ou bien étendus paresseusement sur le sable. Le cri du factionnaire se répétait plusieurs fois, chaque fois suivi d’une réponse venant du corps de garde et poussée par le même individu. Les appels d’en haut devenaient de plus en plus pressants, les répliques d’en bas de plus en plus ennuyées. À la fin l’individu du corps de garde se décidait ; péniblement il grimpait le long d’un sentier caillouteux jusqu’à la plate-forme, allait prendre la place de celui qui l’avait appelé, et se mettait en faction avec la même conscience et la même gravité. La sentinelle relevée se hâtait vers la petite plage avec une visible satisfaction, et s’élançait joyeusement dans la mer en faisant jaillir l’eau de tous côtés.
Les sentinelles ne s’occupent pas de la nourriture des jeunes : leur rôle est simplement éducateur et moral. Ils enseignent à coups de bec, à l’enfance inexpérimentée, la prudence et l’expérience de la vie ; la nourriture est apportée aux deux enfants de chaque famille par le mâle et la femelle qui leur ont donné naissance. En effet, à tour de rôle arrivaient des adultes, le jabot rempli de ces petits crustacés pélagiques qui servent de nourriture à tous les manchots, et de loin les enfants, qui les reconnaissaient, se portaient à leur rencontre ; le jeune s’accroupissait, ouvrait le bec tout grand, tandis que le parent, courbant le col et croisant son bec avec celui du petit, dégorgeait la succulente pâtée que contenait son vaste jabot.
Dans d’autres cités, sises au niveau de la mer, les jeunes étaient aussi groupés, mais la surveillance n’était plus aussi stricte, étant moins nécessaire : cela démontre que l’intelligence de ces animaux sait adapter les lois sociales aux circonstances topographiques, et qu’ils ne sont pas poussés seulement par l’instinct mécanique.
La différence de caractère des deux manchots provient donc d’une différente organisation sociale. L’antarctique, bruyant et mauvais coucheur, est un strict individualiste, constamment en procès et querelles pour défendre sa propriété ; le brave et honnête papou est un communiste avisé n’ayant rien à défendre contre ses concitoyens, ayant mis le sol en commun et ayant simplifié la besogne de l’élevage par l’installation d’un pensionnat communal. Cela lui a donné la sagesse du philosophe, le calme du sage et les nombreux loisirs que procure toujours une organisation sociale bien comprise.”
À ces détails si amusants et pourtant si véridiques, malgré certaines invraisemblances, j’ajouterai que les manchots paraissent posséder à un haut degré la faculté d’orientation. Nous en avons vu en mer, à cent milles de toute terre ; dans les canaux du détroit nous en avons rencontré à de grandes distances des rockeries et cependant ils ne semblaient pas éprouver la moindre hésitation à l’“atterrissage”. Lorsque nous étions dans un de leurs villages, nous reconnaissions aux allures de ceux qui arrivaient du large, et à l’accueil qu’ils recevaient, qu’ils étaient bien chez eux.
Nous avons aussi rencontré dans les eaux du détroit quelques rares représentants d’une troisième espèce de manchots : le manchot de la terre Adélie (Pygoscelis Adeliœ).
Souvent, près de ces rockeries de manchots, nous avons vu, vivant pour ainsi dire côte à côte avec ces derniers, avec lesquels leur station verticale leur donne d’ailleurs un air de parenté, des groupes de cormorans.
Quelquefois un bec-en-fourreau (Chionis alba pour les naturalistes) venait se poser tout près de nous sur les falaises au pied desquelles nous avions débarqué et que nous gravissions pour y recueillir des spécimens de mousses et de lichens. Le bec-en-fourreau est le seul oiseau antarctique qui n’ait pas les pattes palmées ; aussi, simple herbivore, se contente-t-il d’algues et ne va-t-il pas, comme ses compatriotes ailés, chercher sa nourriture au sein des flots. Élégant petit oiseau tout blanc, de la taille d’une colombe, il doit le nom bizarre que lui ont donné les marins à de singulières excroissances qui recouvrent son bec.
Le grand pétrel (Ossifraga gigantea), lourd, disgracieux et laid, est également un des principaux habitants de ces lieux.
Cet oiseau, dont le plumage varie, suivant les individus, du blanc sale au brun le plus foncé, est le plus grand des oiseaux antarctiques proprement dits ; ses ailes atteignent parfois jusqu’à deux mètres d’envergure. Armé d’un bec puissant, il peut entamer la peau des cadavres de phoques qu’il rencontre sur la glace ou sur les plages. Dès que nous avions tué un phoque – la science a de cruelles exigences – nous pouvions voir les grands pétrels surgir des quatre points cardinaux ; et ils n’attendaient pas toujours que nous eussions quitté les lieux du drame pour profiter de l’aubaine, et se gorger de chair et de sang jusqu’à ne plus pouvoir s’envoler.
Abonde également dans ces parages une sorte de labbe (Megalestris antarctica), oiseau brun et assez grand. Très courageux, il sait défendre ses petits avec la dernière énergie, ainsi que l’a raconté Racovitza qui eut une désagréable querelle avec un ménage de ces oiseaux. À la vérité, je n’ajoute qu’une foi relative à la version qu’il fournit lui-même de l’incident : il aurait voulu se hisser sur une plateforme de la falaise pour y cueillir une petite graminée, mais à mi-chemin il aurait été vigoureusement attaqué par un père et une mère qui, nichant sur la même plate-forme, s’imaginaient qu’il en voulait à leur progéniture. Moi qui connais Racovitza et qui sais combien, chez lui, le zoologue domine le botaniste, j’ai quelque peine à croire à cette innocente histoire. Je n’admettrai jamais qu’il ait passé près d’une proie comme celle que lui offrait le nid, sans essayer de se l’approprier. J’incline à croire que ses intentions étaient beaucoup moins pures qu’il ne veut bien le dire, et que les deux oiseaux avaient vraiment de sérieuses raisons de se méfier de lui. Notre zoologue devait d’ailleurs jouir dans tout le détroit d’une réputation déplorable, et il n’est pas inadmissible que l’écho de ses crimes fût, dès lors, parvenu jusque sur la plate-forme dont on lui défendait l’accès avec un si beau courage.
La gent ailée est encore représentée dans ces régions désolées par le beau goéland dominicain (Larus dominicanus), blanc-gris, avec les ailes et une partie du dos brun foncé, le bec et les pattes jaunes ; les sternes blanches, aux ailes effilées, gracieuses au possible ; le pétrel des neiges (Pagodroma nivea), tout blanc aussi, avec les pattes et les yeux noirs ; les damiers ou pigeons du Cap (Daption capensis) ; l’oiseau des tempêtes (Oceanites oceanicus) qui ressemble à l’hirondelle dont il a la taille et le vol élégant.
Si les régions antarctiques ne sont habitées ni par l’ours blanc, ni par le bœuf musqué, ni par aucune espèce de renard ou de renne, en un mot par aucun des mammifères que l’homme poursuit sur les terres boréales, elles n’en ont pas moins leur faune terrestre. En vérité, elle est minuscule et rarissime, cette faune terrestre antarctique, et c’est peut-être ce qui lui a valu d’échapper aux investigations de nos prédécesseurs.
Pour la décrire, simple profane, je céderai encore la plume à mon camarade Racovitza qui eut l’honneur d’en découvrir l’existence :
“Nous étions curieux, dit-il, de savoir quelles sont les espèces animales qui utilisent les maigres ressources végétales de ce climat ennemi. Des recherches minutieuses nous permettent d’en dresser la liste. D’abord une podurelle, petite puce des neiges, noir-bleu, sautille sur les rochers et parmi les plantes, ou bien s’assemble en grandes bandes sous les pierres plates ou les vieilles coquilles. Ensuite une mouche, la Belgica antarctica, pauvre petit être dépourvu de l’attribut important des diptères, puisque ses ailes sont réduites et ne peuvent lui servir pour le vol. Il s’est passé ici ce qui a été déjà signalé pour les insectes habitant les îles océaniques où souffle un vent très fort et très fréquent. Ces insectes, en effet, ont perdu par sélection, et par la réduction de leurs ailes, la faculté de voler, les mieux doués pour le vol étant constamment emportés par le vent et noyés dans la mer. Enfin, il me reste à citer trois ou quatre espèces d’acariens, sortes de petites araignées qui mènent une vie précaire dans les touffes de mousse et de lichens.”
On le voit, il n’y avait pas là matière à ample collection : aussi était-ce surtout de représentants de la faune marine littorale que nous nous enrichissions à chacun de nos débarquements.
Quant à la flore chétive des terres que nous visitâmes, elle se réduit à quelques mousses ou lichens qui tachent çà et là les roches des falaises ; sur les plages, quelques petites algues ; enfin, seule plante phanérogame*, une frêle graminée dont Racovitza a trouvé, dans les endroits les plus abrités, de petites plaques que, dans son enthousiasme, il désignait sous le nom de “prairies”. Nous apportâmes cependant un tel acharnement et une telle minutie à fouiller les moindres recoins que, malgré cette pénurie de végétation, les spécimens rapportés par la Belgica ont doublé ou triplé le nombre des espèces antérieurement connues de la flore antarctique.
Si les collections réunies par le naturaliste sont intéressantes et variées, celles du géologue ne le sont pas moins. Dans nos différents débarquements, Arctowski n’a point manqué de prendre des échantillons de toutes les roches qu’il a rencontrées. Il a pu ainsi, en coordonnant ses trouvailles, tracer un bon croquis géologique d’ensemble. Aux roches Sophie (baie Wilhelmine), à l’île Banck et aux îles Moureau (baie des Flandres), il a trouvé du granit. On peut donc admettre que la partie de la terre de Danco qui s’étend de la baie Wilhelmine à la baie des Flandres forme un massif granitique. Le cap Anna Osterrieth est formé de serpentine. À l’île Cavelier-de-Cuverville et au cap Van Beneden, celle-ci est remplacée par la porphyrite. Au contraire, au cap Renard, dans toute la partie ouest du détroit et dans les îles de la baie de Hughes, Arctowski a trouvé surtout de la diorite présentant des compositions variées ; en certains endroits des diorites quartziques. Dans l’île Brabant, il a constaté que l’un des nunataks que nous avons escaladés est formé de gabbro. Aux roches Sophie, il a trouvé un terrain sédimentaire : une partie de ces roches est formée de schistes. Nous avons encore recueilli un grand nombre de roches erratiques*, telles que gneiss, porphyre, et des roches volcaniques modernes.
Les icebergs que nous avons rencontrés errant dans les eaux du détroit affectaient les aspects les plus fantastiques.
À leur naissance, ils sont généralement prismatiques, tabulaires ; mais, peu à peu, leur forme s’altère par suite des mille incidents de leur course vagabonde. À la flottaison, l’iceberg subit constamment l’assaut des vagues qui le rongent et l’entament peu à peu. Vienne une crevasse, la vague a bientôt fait de l’élargir et de la changer en excavation. Lorsque deux crevasses de ce genre s’entrecroisent, une grotte, parfois haute et profonde, se forme. La mer s’y engouffre et la creuse toujours plus profondément jusqu’à ce qu’enfin l’iceberg soit percé de part en part en façon d’arcade. Très souvent aussi, au-dessus d’une de ces grottes, la voûte, dont l’action du soleil diminue constamment l’épaisseur, finit par s’écrouler, et la montagne de glace devient alors un petit havre mouvant dans lequel je ne conseillerais à aucun navigateur de chercher un abri.
Dans la vie d’un iceberg, et jusqu’à sa destruction complète et sa disparition, bien des accidents encore peuvent se produire, dont les moindres ne sont pas les rencontres, suivies d’effondrements totaux ou partiels. Dans ce dernier cas, il arrive que l’iceberg tronqué perde l’équilibre, se renverse, se retourne et prenne ainsi un aspect tout à fait différent de celui qu’il présentait auparavant.
Toujours rongé par la mer, soumis à l’action dissolvante du soleil, il s’en va diminuant de volume et finit par n’être plus qu’un simple glaçon pour s’évanouir dans l’océan.
Moins dangereux pour nous, assurément, que le voisinage de ces immenses masses inertes était celui des grands cétacés dont nous étions constamment entourés : baleinoptères, mégaptères, hyperoodons. Dans la baie de Hughes et dans le détroit nous les voyions s’ébattre, en troupes nombreuses, justifiant souvent l’expression d’argot “rigoler comme une baleine”. Un jour, nous en vîmes un bondir, dans un élan fou, tout droit et tout entier hors de l’eau ; c’était, nous sembla-t-il, un énorme baleinoptère, mais son apparition fut trop brève pour que nous ayons pu établir, d’une façon certaine, son identité.
Il me souvient aussi qu’un matin où une brume épaisse nous condamnait à une inaction momentanée, deux mégaptères de taille respectable vinrent exhaler tout contre la muraille du navire leur souffle nauséabond. Ils restèrent longtemps là, presque immobiles, à nous observer, tels des sous-marins qui auraient surgi à nos flancs. Nous ne paraissions leur inspirer aucune crainte ; de notre côté, nous n’avions rien à redouter d’eux : dans ces grandes machines qui, placées là, évoquaient forcément la comparaison avec les terribles engins de destruction que l’homme tente de construire à leur image, ne palpitaient que de paisibles cœurs de bonasses cétacés. Ce n’est qu’au bout de plusieurs minutes, et après s’être laissé très complaisamment photographier, qu’ils s’éloignèrent un peu, se battant les flancs de leurs énormes nageoires pectorales.
Les baleinoptères et les mégaptères, que les marins désignent sous les noms de rorquals et de jubartes, sont des cétacés à fanons comme la baleine franche. Fréquemment plus grands, ils sont de forme plus effilée et beaucoup moins gras que leur congénère : ils fournissent donc moins d’huile. De plus, leurs fanons étant moins longs et, au dire des fabricants de corsets, de qualité inférieure, on peut espérer qu’ils resteront soustraits longtemps encore aux poursuites de l’homme. Au nord, il est vrai, au large des côtes de Norvège, d’Islande, des îles Féroé, du Japon même, ces considérations, non plus que les difficultés plus grandes que présente leur chasse, ne les ont préservés. Mais ici, tout au bout du monde, ils sont si loin des “grands marchés” qu’ils demeureront sans doute longtemps indemnes.
L’hyperoodon, qui doit à la bizarre conformation de sa tête la dénomination pittoresque de “bottlenose whale”, sous laquelle le désignent les baleiniers anglais, est un cétacé à dents. Sa longueur dépasse rarement dix mètres.
Chassé dans les mers du Nord, pour son huile très riche en spermaceti ou blanc de baleine, il a encore moins de valeur que les rorquals, puisqu’il n’a pas de fanons. Aussi, dans l’Antarctide, ne sera-t-il pas, non plus, troublé de sitôt dans ses paisibles ébats.
Il ne me reste plus à signaler que l’existence dans ces parages de deux espèces de phoques : le phoque dit de Weddell (Leptonychotes Weddelli) et le phoque crabier (Lobodon carcinophaga). Le plus généralement nous les rencontrions somnolant sur quelque glaçon ou quelque plage rocheuse, parfois réunis en petits groupes, souvent tout à fait solitaires.
Nous n’en avons vu que quelques centaines ; leur peau n’ayant pas grande valeur commerciale leur chasse serait encore moins rémunératrice que la pêche aux cétacés.
VIII
VERS LE SUD
Dans le Pacifique austral. – Le long de l’iskant*. – À corps perdu dans la banquise. – Une navigation fantastique. – Bloqués.
Puisque le hasard, au lieu de nous conduire dans la mer de George-IV, de Weddell, nous a menés dans le Pacifique, nous ne saurions mieux terminer cette campagne qu’en poussant vers le sud-ouest, pour reconnaître la région comprise entre la terre de Graham et l’île Pierre-Ier.
Après avoir franchi heureusement les écueils qui rendent si délicat l’accès du Pacifique par le chenal de Lemaire, nous continuons à gouverner au sud et à ranger la côte d’aussi près que nous le permet le pack qui la défend.
Le 13 février, à neuf heures du matin, nous essayons d’aller reconnaître les côtes de la terre de Graham ; mais la banquise est trop compacte et nous sommes obligés de regagner le large après avoir parcouru quelques milles vers le sud-ouest. Nous gouvernons pendant une quinzaine de milles au N 30° O environ. Nous atteignons ainsi et nous traversons un chapelet d’îlots bas entourés d’écueils, offrant, avec leur carapace glacée, l’aspect caractéristique de toutes les petites îles que nous avons rencontrées dans la partie méridionale du détroit.
Le lendemain 14, nous remettons le cap au sud-ouest vrai. Le temps est brumeux, mais la brise est favorable et nous naviguons à la voile seulement. De temps à autre nous avons un iceberg à éviter. Par bâbord, c’est-à-dire du côté de la terre, un fort reflet blanc (iceblink) dans la brume accuse l’existence d’une grande quantité de glace.
Nous traversons quelques bandes de drift-ice* et, à diverses reprises, nous devons gouverner plus à l’ouest pour éviter la banquise.
Nous passons sans les voir sur le gisement des îles Biscoe, telles qu’elles sont portées sur la carte de l’Amirauté ; il est vrai que le temps est assez bouché et que nous pouvons avoir laissé ces îles à quelques milles d’un bord ou de l’autre de notre route.
Le 15 février, nous gouvernons au S 20° O, toujours sous voiles. Nous rencontrons plusieurs icebergs. Sur notre sillage, de nombreux albatros, d’envergure majestueuse, volent en compagnie d’élégants damiers ou pigeons du Cap.
À midi, nous hissons les couleurs pour marquer le passage du cercle antarctique et célébrer notre entrée dans la zone polaire proprement dite.
Vers la terre, à bâbord, la brume devient de plus en plus compacte ; de longues bandes de drift-ice, orientées du sud-est au nord-ouest, sont détachées de la lisière du pack.
À trois heures et demie, l’atmosphère étant un peu plus élevée, nous apercevons quelques icebergs à bâbord, puis de l’iceblink, révélant la présence de grandes masses de glace. Peu après, en effet, nous distinguons l’iskant ou lisière de la banquise (le mot est dano-norvégien), à deux milles environ.
Une heure plus tard, une belle, mais courte éclaircie nous permet de distinguer dans l’Est des terres élevées dont les sommets sont noyés dans la brume : c’est la terre de Graham. Nous en sommes séparés par la banquise, semée de bergs, qui semble s’étendre jusqu’à elle. Dans l’Ouest, la mer est libre avec quelques icebergs seulement.
Le 16, la brise du nord-est ayant molli, nous continuons notre route sous vapeur. À quatre heures du matin, étant par 67° 40’ S et 69° 55’ O par estime, nous voyons une terre, dans le sud-est environ : l’île Adélaïde, entrevue par Biscoe, sans doute. Autour de nous, nous comptons quatre-vingt-cinq icebergs.
Nous courons au S 30° E pour nous approcher de la terre ; mais, après avoir couvert quelque douze milles dans cette direction, nous arrivons à la lisière de la banquise : elle est impénétrable et s’étend jusqu’à la côte. Nous la rangeons en y pénétrant un peu par moments. À une heure, nous nous retrouvons en mer libre avec de l’iceblink au sud. Peu après nous apercevons une autre terre dans le S 20° O. Laissant toujours l’iskant par bâbord, nous mettons le cap vers cette terre. Mais une nouvelle banquise s’interpose, qui nous oblige à gouverner plus à l’ouest.
Le temps étant clair, nous obtenons la position par observation (69° 50’ S 70° 39’ O) et, à quatre heures, nous stoppons pour sonder : trouvé cent trente-cinq mètres ; nous sommes sur le plateau continental. La terre d’Alexandre – car c’est la terre d’Alexandre, découverte par Bellingshausen, que nous avons en vue au sud – apparaît superbe avec ses puissants glaciers, se détachant en blanc jaunâtre sur l’azur foncé du ciel, à peine séparés les uns des autres par quelques pics plus sombres.
Mais, peu à peu, le temps s’assombrit ; il pleut ; le pont et les agrès se couvrent de verglas. La lumière crépusculaire, d’un rouge vif, est particulièrement intense ce soir. Vers minuit, la mer, la banquise et la terre prennent, sous cette lueur, l’aspect d’une fournaise.
Du 17 au 28 février, tantôt à la voile, tantôt à la vapeur, nous continuons à explorer la lisière, pénétrant dans chaque brèche qu’elle présente. Couverts de neige, les glaçons qui forment le pack sont tout blancs ; mais, lorsque l’étrave les entame, la glace mise à nu est colorée en jaune d’ocre verdâtre par l’abondance des diatomées*. Sur les pans, quelques phoques crabiers et des léopards de mer sont nonchalamment étendus.
À plusieurs reprises, notamment le 18, le 20 et le 22, nous sommes bloqués pendant quelques heures et ne regagnons le large qu’à grand-peine. Il nous faut alors rebrousser chemin vers le nord pour retrouver, à travers la banquise plus disloquée, la mer libre que révèlent des bandes de watersky*, estompées au ciel ; dans le sud règne un éclatant iceblink.
Le 21 février, à huit heures du soir, nous ne comptons pas moins de trois cent vingt icebergs tout autour de l’horizon. À la lisière du pack, les glaçons, surélevés par la réfraction, apparaissent comme une ville au bord de la mer. Une haute aiguille dont le sommet scintille au soleil couchant et qui semble un phare, complète l’illusion.
Le 24 février, par 69° 30’ S et 81° 31’ O, nous trouvons un brassiage de cinq cent dix mètres.
Le 25, par 69° 17’ S et 82° 24’ O, la sonde accuse deux mille sept cents mètres. Nous avons quitté le plateau continental de la terre d’Alexandre.
Ce sondage du 25 février est le plus coûteux que nous ayons fait : par suite de coques*, nous perdîmes deux mille six cents mètres de cordelette, une sonde de Brooke, une bouteille à eau et deux thermomètres à renversement – un vrai désastre !
Le 27, à midi, par 69° 24’ S et 84° 39’ O, sondé deux mille six cents mètres. Il fait très beau et la mer est libre au sud ; nous en profitons pour gagner quelques minutes en latitude.
À cinq heures du soir, par 69° 41’ S et 84° 42’ O, nous trouvons un brassiage de mille sept cent trente mètres. Peu après, la brise s’établit à l’est-nord-est et fraîchit.
Vers huit heures, nous voyons la glace dans le sud ; sous voilure très réduite, nous continuons vers le sud-ouest.
Pendant la nuit, le temps se couvre et s’embrume ; la mer se forme ; l’iskant s’ébrèche. Et, le lendemain, 28 février, date mémorable dans l’histoire de l’expédition, une occasion unique de pénétrer dans la banquise, de la traverser peut-être, se présente à nous.
Bien que la saison soit très avancée, bien que, dans nos tentatives antérieures pour entrer dans le pack, nous ayons déjà observé la formation de jeune glace, prodrome de l’hiver qui s’approche, l’occasion me paraît propice pour faire route au sud.
En somme, cette époque semble être la plus favorable pour naviguer à travers la banquise australe. Lors de sa seconde campagne antarctique (1841-1842), Ross, qui s’était présenté, le 18 décembre, sur le bord septentrional du pack, n’atteignit le bord opposé que le 2 février, c’est-à-dire après quarante-six jours d’efforts, tandis qu’il ne mit que quelques jours, à la fin de février, pour le traverser en sens inverse. Pendant l’été 1894-1895, le baleinier norvégien Antarctic mit cinq semaines pour franchir cette même banquise du nord au sud, tandis qu’il en sortait plus tard en quelques jours.
Nous nous trouvons dans les parages où Bellingshausen a signalé une muraille de glace impénétrable ; et, au lieu de cette barrière, nous sommes en présence d’une banquise à lisière déchiquetée, coupée d’échancrures nombreuses et larges, pratiquable en somme. Peut-être cette banquise ne s’étend-elle pas jusqu’au continent antarctique et laisse-t-elle au sud, tout comme celle où Ross s’engagea avec tant de bonheur, une vaste mer libre. En y pénétrant, nous pourrons probablement atteindre une latitude élevée, parcourir des eaux inexplorées.
Sans doute, mes projets primitifs étaient autres ; mais, en matière de navigation polaire, il importe, avant tout, d’agir selon les circonstances et de saisir les occasions.
Que nous franchissions la banquise ou que nous y soyons arrêtés, que nous parvenions à nous dégager à temps pour éviter l’hivernage ou que nous restions bloqués, nous devons, me semble-t-il, tenter l’aventure.
Les savants de mon état-major sont, je le sais, en complète divergence d’opinions avec moi ; la crainte du péril n’existe pas pour eux, mais nous avons recueilli déjà une belle moisson de faits scientifiques ; nos collections sont précieuses ; ils voudraient les mettre en sûreté, avant de se jeter dans de nouveaux dangers. Ces considérations sont respectables, sages même peut-être ; pourtant la banquise s’est ouverte devant nous ; marin avant tout, je ne résiste pas à la tentation d’y pénétrer.
Lecointe est de quart sur la passerelle. Je vais le trouver, après avoir mûrement réfléchi et pesé toutes les chances bonnes et mauvaises que nous allons courir, et j’ai la joie de le trouver dans les mêmes dispositions que moi. Je reçois son adhésion dans un vigoureux shake-hand, et le cap est mis au sud.
À neuf heures du matin, le 28 février, nous nous engageons donc à corps perdu dans les glaces.
Vers le sud, les clairières* se succèdent, longues parfois de plusieurs milles ; elles sont séparées les unes des autres par des plaques de glace entre lesquelles la Belgica se fraye un passage. Mais la vigoureuse impulsion du vent ne suffit pas toujours ; souvent il faut user de la machine et forcer la glace, sur laquelle monte alors l’avant du navire pour la briser sous son poids.
La brise, déjà si dure, fraîchit encore. À six heures du soir, elle souffle en tempête.
Dans les clairières, le navire marche rapidement, malgré le peu de toile établie, si bien que, lorsque nous arrivons devant le bord opposé, nous devons loffer pour ne pas heurter trop violemment l’obstacle.

À midi, nous étions par 70 28’ S. Nous ne devons pas être loin maintenant du 71e parallèle.
L’anémomètre accuse une vélocité de cent kilomètres à l’heure. Il neige abondamment ; on n’y voit pas à une encablure. La nuit s’épaissit. Notre navigation dans l’obscurité grandissante, à travers le chaos des blocs de glace heurtés, bousculés par notre étrave avec un fracas que domine à peine le bruit de la tempête, revêt un caractère fantastique.
Nous entrons, semble-t-il, dans un autre monde ; comme les héros des sagas Scandinaves, les dieux terribles nous y soumettent à des épreuves surnaturelles. Et n’est-ce pas dans un monde nouveau que nous pénétrons ce jour-là, non pas pour délivrer quelque Walkyrie endormie, mais pour arracher à la blanche Antarctide quelques-uns de ses secrets si jalousement gardés ?
À dix heures du soir, l’obscurité est complète. Nous mettons à la cape dans une clairière où nous croisons jusqu’au petit jour. La brise mollit bientôt et, lorsque à quatre heures du matin, le 1er mars, nous reprenons notre route vers le sud, il fait calme plat. La banquise reste d’abord très détendue, très disloquée. Les clairières se succèdent, unies comme des lacs. L’après-midi, après avoir forcé, pendant près de deux heures, un agglomérat de plaques, nous naviguons encore dans un lac d’eau libre, que j’ai aperçu le matin, du nid de corbeau, allongé vers le sud. Mais à cinq heures, arrivés à l’extrémité de cette clairière, nous sommes arrêtés : devant nous la banquise s’étend invulnérable.
Nous restons en panne toute la nuit dans l’espoir d’une détente, et effectivement, le lendemain, nous pouvons faire encore un peu de route. À midi, nous sommes par 71° 31’ S et 85° 16’ O, c’est-à-dire à environ quatre-vingt-dix milles au sud du point où nous avons pénétré dans la banquise. Hier après-midi, nous étions par 71° 17’ S et 85° 26’ O ; depuis lors nous n’avons guère parcouru, de clairière en clairière, plus d’une couple de milles vers le sud : nous avons donc dérivé vers le pôle avec la banquise tout entière, et le pack étendu derrière nous n’a pas en réalité quatre-vingt-dix milles de largeur, mais quatre-vingts environ.
Les pans de glace qui nous entourent forment bientôt un floe* compact dans lequel il devient impossible d’avancer.
Le 3 mars, de petits chenaux se dessinent ; nous nous y faufilons, mais ne tardons pas à nous convaincre que le résultat obtenu n’est guère appréciable. Nous sommes par 71° 28’, c’est-à-dire cinq milles plus au nord que la veille : cette fois nous avons été entraînés par un recul de la dérive. Sur une des plaques qui nous entourent, trente à quarante manchots sont en train de muer.
L’après-midi, une légère détente s’étant produite vers le nord, nous parvenons à couvrir sans difficulté huit à dix milles dans cette direction. Je compte, du nid de corbeau, cent vingt-sept icebergs autour de nous. Un grand iceberg tabulaire, que nous avions le matin à une couple de milles dans l’est, s’est sensiblement rapproché.
Le temps est clair et, le soir, jaillit soudain à l’horizon dans le nord-nord-est un vif éclat rouge : c’est la lune. Peu à peu elle émerge, toute déformée par la réfraction ; elle présente des contours bizarres et illumine féeriquement l’admirable panorama d’alentour.
Quel poète chantera jamais la splendeur de ce monde polaire ? Quel langage humain pourra jamais évoquer sa magie ? Nous restons sous le charme de ce spectacle que l’imagination est impuissante à concevoir, que ma plume ne saurait décrire. Plus qu’en aucun pays de la terre, la lumière ici a des caprices imprévus et merveilleux ; le monde morne et désolé qui nous enclave, soudain, comme sous la baguette d’un magicien, elle le transforme en un séjour féerique, aux éblouissements de rêve ; puis tout retombe aux aspects si impressionnants d’un monde chaotique et mort.
Pendant la nuit, la distance qui nous sépare du grand iceberg tabulaire diminue de façon inquiétante ; nous le suivons des yeux avec un commencement d’anxiété. Vers minuit, il passe à cent mètres seulement à l’avant, continue à dériver vers l’ouest, puis repasse plus tard devant le navire. N’est-ce pas plutôt la banquise qui se déplace avec nous, puis passe et repasse devant l’iceberg échoué ?
4 mars. Ce matin, brise légère du nord-nord-est ; aussi la latitude méridienne est-elle 71° 22’ : nous avons quelque peu dérivé au sud. Le temps est brumeux, avec de courtes éclaircies.
Puisque nous ne pouvons plus avancer vers le sud, nous allons tâcher de regagner le large. Nous mettons donc, à toute vapeur, le cap au nord. Mais la banquise se resserre et les clairières qui subsistent encore de la tempête du 28 février sont couvertes de jeune glace ; s’il n’y entre pas avec assez de vitesse pour déterminer une longue crevasse, le navire est arrêté au bout de quarante ou cinquante mètres.
5 mars. La jeune glace est de plus en plus consistante et nos progrès sont nuls.
Plus que jamais ce jour-là, je songe aux êtres chers dont je suis séparé : c’est ma fête patronale et, j’en suis certain, à chaque seconde de cette journée, ils pensent à moi qui suis loin, perdu pour eux ; leur tendresse s’inquiète ; ils ne savent même pas où nous sommes et si nous vivons encore.
Le 6 mars, des crevasses s’ouvrent dans la glace récente qui nous enserre. En faisant alternativement machine arrière et machine avant, nous réussissons à la forcer et à atteindre l’extrémité nord de la clairière, complètement prise, dans laquelle nous étions bloqués. Mais au-delà, une zone de grands pans nous arrête.
Le 7, un manchot papou, embarqué le 9 février, meurt dans d’horribles convulsions. C’était le dernier survivant de trois jeunes manchots capturés dans le détroit et que nous avions essayé d’élever à bord. On l’appelait Bébé, et nous prenions de lui un soin extrême.
À midi, nous sommes par 71° 26’ S et 85° 44’ O ; nous avons donc dérivé vers le sud et l’ouest. La banquise est très close. Des pans de cinquante à soixante mètres de diamètre nous entourent et se soudent entre eux pour former bientôt un champ immense et continu. Du nid de corbeau, nous comptons quatre-vingt-trois icebergs.
Le 8, pendant la matinée, une légère détente se produit encore, mais elle est insuffisante pour rendre le pack maniable. L’après-midi d’ailleurs, la banquise se referme et des pressions sévissent.
Les jours suivants se produisent encore quelques alternatives de détente et de pression ; mais, dans le voisinage immédiat de la Belgica, le pack reste irréductiblement clos.
Le 10 mars seulement, nous avons pu parcourir un demi-mille vers le nord.
Le personnel descend maintenant sur la glace pour se promener, et commence à s’exercer à l’usage des skis, longues planchettes de bois, recourbées et effilées aux deux bouts ; la grande surface de ces patins permet de glisser sur la neige sans y enfoncer, mais rend leur usage assez difficile aux débutants.
Le 12, le thermomètre indique déjà – 18,6°centigrades.
Le 14, nous observons la première aurore polaire, une aurore en draperie, qui reste visible de neuf heures du soir à trois heures du matin.
Dès le 15 mars (qui correspond au 15 septembre de l’hémisphère Nord), nous notons un minimum de -20,3°. Nous nous rappelons l’observation de Nansen qui enregistrait, le 25 septembre, une température de -13°. Comme lui, mieux que lui encore, nous pouvons dire : “L’hiver approche à grands pas…”
Toutefois, le 16, nous avons de nouveau, pendant quelques heures, l’espoir de pouvoir nous dégager de l’étreinte des glaces.
Depuis la veille, le vent souffle en tempête de l’est-nord-est. Vers neuf heures du soir, il survente. La houle, qui doit être très grosse au large, c’est-à-dire à soixante milles au moins dans le nord, se propage jusqu’à nous, soulevant les grands floes avec violence et les crevassant. Soudain, une immense fissure déchire la vaste nappe blanche ; nous la voyons s’allonger dans la direction de la Belgica, tel un colossal serpent venant à nous. On active les feux qui sont restés allumés ; nous sommes prêts à appareiller. La crevasse continue à s’étendre ; elle nous atteint et bientôt la Belgica flotte dans une petite lagune…
Mais la brise diminue et vire vers l’est ; la banquise se referme, la houle s’apaise ; tout rentre dans le calme. Seul, le watersky régnant au nord indique qu’il y a de l’eau dans cette direction. Décidément, l’hivernage est devenu inévitable.
Le dimanche 20 mars, l’automne austral commence ; tandis que dans l’hémisphère Nord on salue avec joie l’avènement du printemps, nous devons, plus que jamais, songer à nos aménagements en vue de l’hiver tout proche. Ce renversement des saisons nous fait ressentir, plus vivement qu’aux voyageurs arctiques, le contraste entre la vie polaire et celle qu’on mène dans des régions plus hospitalières.
Des observations faites à plusieurs reprises accusent une dérive vers le sud-ouest de plus de trois milles par jour. Cette dérive va-t-elle se poursuivre et où nous conduira-t-elle ? En admettant qu’aucune terre ne nous barre le passage, ce qui est peu probable, il nous faudrait plusieurs années pour atteindre la mer libre de l’autre côté du pôle, et nous avons des vivres pour deux ans au plus. Il est vrai que les manchots et les phoques seront un appoint à notre ordinaire. À condition pourtant qu’ils ne désertent pas la banquise pendant l’hiver : déjà nous en voyons moins autour de nous.
L’avenir nous apparaît plein de menaces et de mystère.
Tous, cependant, nous prenons de bonne grâce notre parti de la situation.
Nous allons être les premiers hiverneurs de la banquise antarctique, et ce seul fait nous promet une ample moisson de renseignements à recueillir, de phénomènes à étudier. N’est-ce pas là ce que nous avons désiré, ce que nous avons cherché ?…
IX
LE PREMIER HIVERNAGE DANS LA BANQUISE AUSTRALE
Extinction des feux de la chaudière. – Aménagements pour l’hivernage. – Déboires culinaires. – Les trois huit. – Occupations de l’état-major. – Les habitants de la banquise. – Dégel intempestif.
L’hivernage étant devenu inévitable, nous songeons tout d’abord à aménager le plus confortablement possible la prison dans laquelle nous allons vivre pendant huit ou neuf mois au moins.
Nous entourons le navire d’un talus de neige s’élevant jusqu’à hauteur du pont, afin de réduire la déperdition de chaleur par rayonnement.
Utilisant les matériaux destinés, dans mon projet primitif, à l’érection de cabanes d’hivernage sur la terre de Victoria, nous construisons une toiture qui recouvre une partie du pont, le transformant en un hangar clos fait de planches, de toile à voile imperméable, de carton bitumé, où l’on pourra travailler à l’abri et dans lequel on établit la forge. On y place, en outre, le distillateur à eau ; on garnit les parois de râteliers, auxquels sont accrochés les skis, les raquettes à neige et autres objets indispensables aux promenades au-dehors : c’est donc aussi notre vestiaire.
Sous le carré des officiers, à l’arrière de la chambre des machines, nous aménageons une soute avec casiers, où nous déposons les conserves en boîtes ; elles seront là mieux à l’abri de la gelée et de l’humidité que dans la cale, où nous laissons seulement les denrées emballées dans les caisses zinguées, et que le froid affecte peu ou point, telles que riz, haricots, nouilles, sucre, etc. La partie de l’entrepont ainsi dégagée sera convertie en lieu de travail pour l’équipage, et en cuisine.
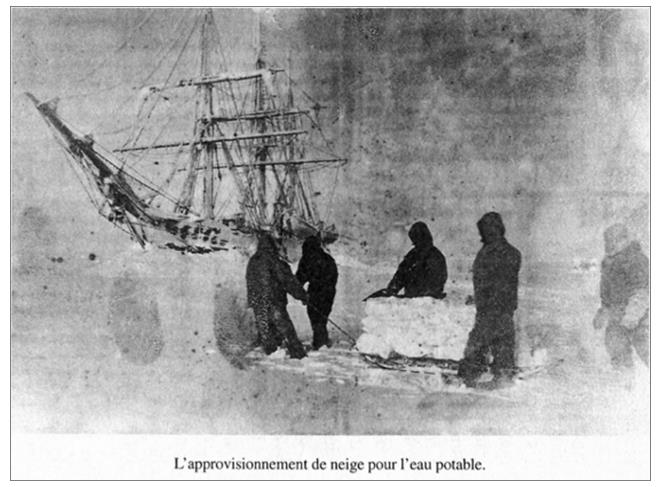
En arrangeant la cale, nous trouvons dans une caisse, contenant de la verrerie de laboratoire, une carte avec cette mention : “Bonne réussite et bonne santé aux hardis explorateurs, 7 juillet 1897. Signé : L’emballeur L. Laumont, rue Pierreux, 61, Liège.” Voilà des souhaits bien opportuns !
Des édicules sont construits sur la glace pour servir aux observations.
Contre le navire, à tribord, par le travers de la machine à sonder, nous creusons un trou par lequel on pompera l’eau en cas d’incendie et par lequel aussi on pourra sonder et pêcher.
Le 26 mars, nous laissons éteindre les feux de la chaudière, que nous avions entretenus jusque-là. Nous procédons à une estimation de ce qui nous reste de combustible : soixante-dix tonnes de charbon dans les soutes et près de quarante tonnes d’anthracite dans les caissons.
Nous déverguons* les voiles, sauf toutefois, afin de n’être pas complètement désemparés au cas, peu probable, d’une détente subite, la trinquette*, les huniers et la brigantine*.
Nous établissons un plancher sur le grand panneau qui, dans le rouf de l’arrière, donne accès à la chambre des machines. Sur ce plancher, nous installons un petit poêle qui chauffera tant bien que mal nos cabines disposées tout autour. Devant la porte des laboratoires est construit un tambour recouvert de carton bitumé.
Ces travaux d’aménagement occupent l’équipage pendant tout le mois d’avril. L’état-major prend, pendant ce temps, ses dispositions pour assurer le service des observations. La machine à sonder de Le Blanc, construite surtout pour l’emploi de la vapeur, est difficile à manœuvrer à la main. Au moyen de quelques-unes des pièces essentielles de cette machine, je fais installer sur la glace, près du trou à eau, un dispositif simple et maniable.
Momentanément, nous ne sommes plus des navigateurs, mais une petite colonie de condamnés à la réclusion à temps. Nous avons nos cellules et nos salles communes à bord de la Belgica. Nous avons, pour prendre de l’exercice, un préau de glace que la neige recouvre, que balaie le vent. Mais il nous est interdit de nous éloigner à plus de quelques kilomètres et de perdre la mâture de vue. Nous sommes, en effet, sur un plancher mobile, sujet à des dislocations partielles. Les accidents de la glace, hummocks, icebergs, ne subissent parfois aucune modification notable pendant plusieurs semaines. Puis, un beau jour, un groupe d’icebergs reste en arrière ou s’en va en avant. Celui qui aurait compté sur ces points de repère pour s’orienter et retrouver le chemin de la Belgica serait perdu. Nous dûmes, plus tard, payer de mortelles inquiétudes quelques imprudences de ce genre.
Petit à petit, notre existence s’organise, monotone.
La question du régime alimentaire est de la plus haute importance. Les vivres ne nous manquent pas et nous possédons des échantillons de tout ce qui est susceptible d’être conservé : j’ai emporté, je l’ai dit, le plus possible et le plus varié possible sous le plus petit volume possible.
Je dresse, une fois pour toutes, un tableau de vingt-huit menus, présentant tous entre eux une différence appréciable. Il y en a quatre pour chaque jour de la semaine, et ce n’est que le vingt-neuvième jour que le cycle recommence. Je dois reconnaître, cependant, que la variété réside surtout dans les noms. Toutes ces conserves ont, à peu de chose près, le même goût et il n’est pas toujours facile de distinguer, par exemple, le veau du bœuf.
Voici un menu complet d’une journée prise au hasard :
MERCREDI
Matin
Café, pain et beurre
Marmelade d’oranges
Midi
Purée de pois
Lard avec pommes de terre et choucroute
Tête de veau tortue
Raisins de Málaga
Soir
Riz au gras
Pâté de foie de porc
Maquereaux à l’huile
Thé
Les mêmes plats sont servis sur la table du carré des officiers et sur celle du poste de l’équipage.
Enfin, véritable confort, nous avons du pain frais tous les jours, grâce à la farine stérilisée que nous avons emportée.
Les fonds sous la banquise étant trop profonds, nous n’avons pas la ressource du poisson frais ; mais les manchots et les phoques nous fournissent un appoint de viande fraîche plus abondant que savoureux. Les filets d’un manchot impérial suffisent à composer la pièce de résistance d’un repas pour tout l’équipage.
La chair de l’oiseau et celle de l’amphibie se ressemblent ; c’est une viande noire et coriace, très grasse et huileuse, mais qui, contrairement à ce que l’on croit communément, n’a pas le moindre goût de poisson ; manchots et phoques se nourrissent d’ailleurs presque exclusivement de crustacés minuscules.
Si les vivres ne font pas défaut, il nous manque un cuisinier.
Depuis Punta Arenas, Michotte, la bonne volonté personnifiée, en cumule les fonctions avec celles de maître d’hôtel.
Ce brave garçon – qui fut, comme légionnaire algérien, un garçon brave – ne m’en voudra pas de déclarer qu’il n’avait pas précisément le génie de la cuisine. Ses compositions culinaires, dans lesquelles il ne déployait souvent que trop d’imagination, associant les denrées les plus disparates, étaient généralement assez peu réussies. Essentiellement économe, il avait une façon particulière d’accommoder les restes : nous ayant donné deux jours de suite des mets différents, il mélangeait le troisième jour les reliefs des deux jours précédents, quels qu’ils fussent. C’était surtout au souper que Michotte apportait ces variantes au menu officiel. La seule chose qu’il réussit toujours était le potage ; encore faut-il ajouter qu’il n’avait qu’à le réchauffer sans même devoir y ajouter de sel. Son triomphe était la soupe aux tomates ; par bonheur il ne chercha jamais à y introduire des éléments étrangers ; elle lui demeura sacrée, à lui qui violait si inconsciemment les lois les plus élémentaires de la cuisine.
Malheureusement, par surcroît, Michotte avait de l’ambition. Le titre de cuisinier, lui paraissant insuffisant, il voulut y joindre celui de pâtissier. Un beau jour, le brave garçon s’avisa de nous faire une tarte et, bien que le résultat fût invraisemblable (le contenu d’un pot de confiture renversé sur une véritable planchette de pâte), Michotte nous en servit, dès lors, de pareilles chaque semaine, à jour fixe.
Comme boulanger, il n’était pas beaucoup plus heureux, et la réussite du pain était une simple affaire de hasard. Nous étions renseignés à cet égard dès le matin. À quatre heures, Michotte était à son four et, lorsque la cuisson matinale avait réussi, Lecointe, de quart à ce moment, recevait peu après un petit pain confectionné à son intention et déposé, sans un mot, sur la table du carré. Lorsque Michotte n’apportait pas de petit pain, nous ne savions que trop ce que cela voulait dire.
Pauvre Michotte ! il était si plein de zèle que nous fermions les yeux sur son manque d’aptitudes culinaires. Et d’ailleurs quel autre à bord eût pu le remplacer et faire mieux ?
… À part un grog servi à l’équipage, le dimanche soir ou dans les circonstances solennelles, les liqueurs sont proscrites.
Tous les dimanches, les hommes reçoivent quinze centilitres de vin de Bordeaux ; les autres jours, ils boivent, quelques-uns avec plaisir, de la tisane de houblon. Quand nous sommes particulièrement satisfaits de l’état de propreté du poste, ils sont gratifiés, le dimanche matin, d’un verre de porto. Une fois par semaine, le samedi, il est procédé à une distribution de cinq cents grammes de sucre – par homme –, cinq cents grammes de beurre, cent grammes de tabac, une boîte d’allumettes, sel, poivre et moutarde.
Il reste de l’eau potable dans les caissons, mais il serait imprudent de continuer à en faire usage : nous pourrions être pris au dépourvu s’il venait à se produire dans la banquise une détente nous permettant de regagner le large.

Tous les matins nous faisons donc provision de neige que nous allons chercher à quelque distance du navire, car celle qui entoure la Belgica est souvent souillée, non seulement par les débris de tous genres jetés par-dessus bord et par les dépouilles d’animaux qu’on abandonne après en avoir extrait les bons morceaux, mais encore par la suie échappée des cheminées et qui va se déposer quelquefois très loin.
Au moyen de lard de phoque, débité en briquettes, nous alimentons le foyer du distillateur installé sur le pont ; et la neige se transforme bientôt en une belle eau cristalline, sans que nous ayons à user du charbon, dont nous devons être économes.
Dans l’étroit espace où nous sommes confinés, chacun trouve à s’occuper. Comme règle générale, nous avons adopté la division socialiste du temps : huit heures de travail, huit heures de récréation et huit heures de repos.
L’équipage entretient le bon état et la propreté du navire, fait les corvées ; parfois il doit pomper l’eau de la cale, car dans les navires en bois comme le nôtre il y a toujours un peu d’infiltration. Les matelots aident aussi aux sondages et à quelques travaux de laboratoire, tels que dépeçage et empaillage d’animaux.
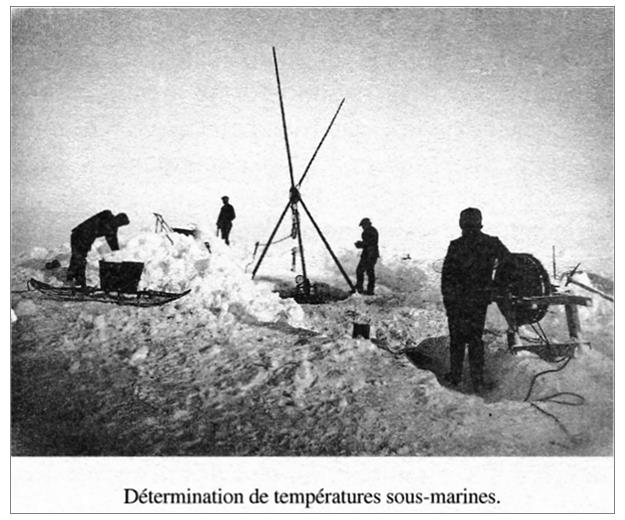
L’état-major se livre à des observations diverses. Quand le temps est clair, Lecointe fait le point, les vents et peut-être des courants nous entraînant en tous sens avec le champ de glace qui nous enserre ; j’effectue un sondage, et Arctowski recueille les sédiments rapportés, puis, avec une extrême minutie, observe la température de la mer et prend des échantillons d’eau à diverses profondeurs pour les analyser ensuite.
Nous pratiquons la pêche pélagique au moyen de filets coniques, très fins, terminés par un seau filtreur qui laisse passer l’eau et retient les moindres micro-organismes.
D’autres fois, nous procédons à des pêches de fond. Comme les pêches du plancton, ce sont les premières qui aient été faites à cette latitude et qui permettent de fixer les caractères de la faune marine antarctique. Nous péchons, soit avec un petit chalut confectionné à bord pour remplacer les engins de haute mer peu maniables sans le treuil à vapeur, soit au moyen de nasses, de la drague ou de fauberts, sortes de grandes floches de chanvre qu’on leste et qu’on laisse traîner sur le fond qu’elles balayent, tandis que les organismes divers restent accrochés à leurs fibres. Plus rarement, le grand filet pélagique est employé ; il se manœuvre difficilement ; après l’avoir descendu à la profondeur voulue, tout l’équipage s’attelle au câble et relève le filet d’un vigoureux effort, en courant sur la glace.

Après chaque pêche, Racovitza a de la besogne de laboratoire pour plusieurs jours. Les organismes qui ne peuvent être convenablement préparés pour la conservation sont étudiés au microscope, dessinés, décrits. Pour certains poissons qui, morts, perdent leur coloration naturelle, le zoologue prend des annotations de couleurs à l’aquarelle.
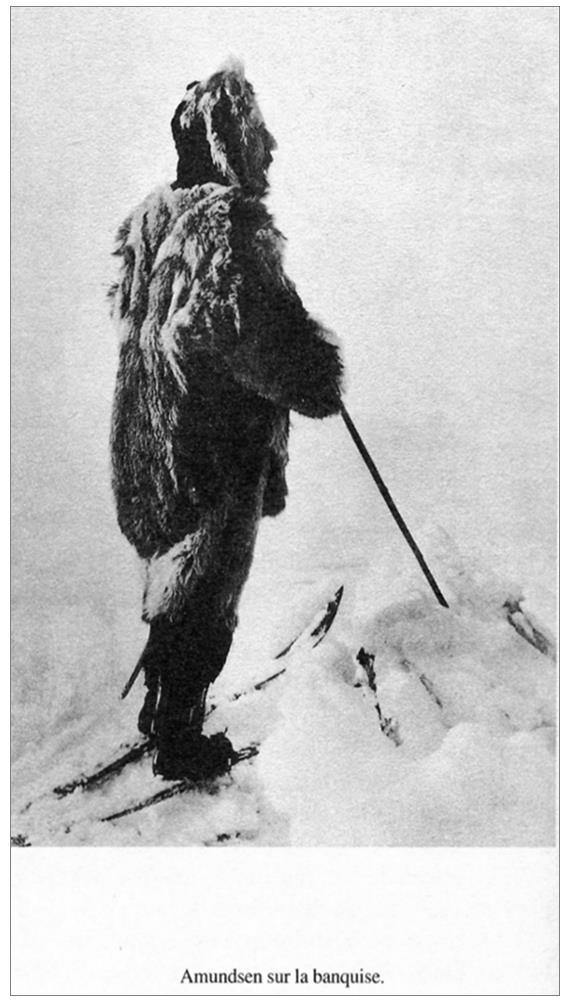
Très souvent le filet ramène des pierres, des spongiaires et de beaux échantillons de corail.
Le service météorologique est assuré par Arctowski, Dobrowolski, Lecointe, Amundsen et moi, mais surtout par les deux premiers. Les observations sont faites d’heure en heure.
Dobrowolski se livre d’une façon suivie à l’étude des nuages, et c’est le nez en l’air, en train de les suivre des yeux, sans jamais se lasser, qu’on le trouve le plus souvent.
Danco, à qui incombent les observations magnétiques, prend chaque jour trois séries de mesures.
Mais notre grande préoccupation à tous, notre distraction aussi, c’est la banquise qui nous entoure et qui se transforme fréquemment. Chaque jour, nous examinons les nouvelles crevasses de notre prison, ou celles qui se sont refermées par suite de pressions et dont la trace est marquée par des toroses ou des hummocks, éminences formées par les débris entassés de la glace.
Lorsqu’il fait calme, des veines nombreuses s’ouvrent ; la banquise se disloque, se détend. Vienne un coup de vent, les grands floes se rapprochent les uns des autres, se heurtent avec fracas, se chevauchent, écornent leurs arêtes dont les débris s’amoncellent avec un bruit métallique.
Sur les fentes, la jeune glace qui se forme fait entendre une plainte continue, mélancolique et douce : c’est la chanson de la glace, faible d’abord, puis, lorsque les champs se heurtent, grondante, sinistre et coupée souvent par la clameur stridente des icebergs qui s’écroulent.
Le vent, en chassant ainsi les grands pans les uns contre les autres, détermine des pressions qui se manifestent d’abord à la surface par de petits toroses ; mais, à mesure que l’hiver approche, elles deviennent plus violentes et les toroses font place à des hummocks de plus en plus élevés. Souvent le navire, enserré comme dans un étau, frémit et vibre douloureusement.
Les beaux jours sont rares, mais de quelle magie ils parent la blanche banquise ! La plaine, comme poudrée de diamants, étincelle sous le clair soleil ; les icebergs et les hummocks dressent leurs arêtes d’argent et projettent derrière eux des ombres diaphanes, d’un bleu si pur qu’elles semblent un lambeau détaché du ciel. Les chenaux décrivent des méandres de lapis-lazuli, et, sur leurs bords, la jeune glace prend des teintes d’aigue-marine. Vers le soir, insensiblement, les ombres changent, tournent au rose tendre, au mauve pâle, et, derrière chaque iceberg, il semble qu’une fée, en passant, ait laissé accroché son voile de gaze. Lentement, l’horizon se colore en rose, puis en jaune orange, et, lorsque le soleil a disparu, longtemps encore une lueur crépusculaire persiste, s’estompant délicieusement sur le fond bleu sombre du ciel où scintillent, innombrables, les étoiles.
Plus souvent, hélas ! la brume noie tout ce qui nous entoure dans de blancs floconnements ; les nuages bas se confondent avec les dos arrondis des hummocks ; les ombres ont disparu avec les contours des choses, et c’est à tâtons qu’il faut marcher dans ces blancheurs opaques.
… Avril se passe ; la température moyenne du mois a été assez basse : le 3 (qui correspond au 3 octobre de l’hémisphère boréal), nous notions, à six heures du soir, un minimum de -26,5°.
La durée des jours s’abrège de plus en plus. Le froid augmente sensiblement. Pourtant, la banquise n’est pas déserte encore.
Nos amis les manchots ne nous ont pas abandonnés.
Ils appartiennent à d’autres variétés que celles qui peuplaient les terres du détroit.
Le plus remarquable est le manchot de Forster ou manchot impérial, oiseau géant dont la taille atteint parfois un mètre vingt et qui pèse jusqu’à quarante kilogrammes. Il a le dos d’un noir bleuâtre avec le ventre et la poitrine blancs ; la tête est noire également, avec, de chaque côté, une tache jaune orangé ; le bec allongé est noir, strié de rouge et de bleu à sa base. Vu de dos, il ressemble beaucoup, à distance, aux Frères des écoles chrétiennes. Son énorme embonpoint témoigne d’une préoccupation unique : il est bien évident qu’un bon repas, suivi d’une paisible digestion, est à ses yeux la grande affaire de la vie. Or, sous ce rapport, la banquise est pour lui un éden. Lorsqu’il a faim, il s’avance en se dandinant de droite à gauche jusqu’à la crevasse la plus proche, s’y plonge le bec ouvert et s’y gorge de minuscules crustacés ; puis, remontant sur la glace, il va digérer à l’abri du vent.
Qui donc oserait troubler la quiétude de ce roi des oiseaux polaires ? Certes, ce n’est pas le manchot de la terre Adélie (Pygoscelis Adeliae). Beaucoup plus petit, il ne dépasse pas soixante-dix centimètres, mais il est relativement plus corpulent encore. Sa tête et son bec sont noirs ; sa gorge est toute blanche ou toute noire, suivant la variété à laquelle il appartient. Vif dans ses mouvements, qui n’en sont pas moins grotesques, il est extrêmement curieux, d’une curiosité qui lui a valu de faire fréquemment avec nous une connaissance beaucoup plus intime qu’il ne l’eût sans doute désiré : nous en avons mangé un grand nombre. Comme tous les manchots, il emprunte à sa station verticale une apparence vaguement humaine qui en fait à nos yeux le clown de l’Antarctique. Lorsqu’il nous aperçoit, il accourt de toute la vitesse de ses petites pattes et, pour aller plus vite, souvent il se met à plat ventre et glisse sur la neige, en s’aidant des pattes et des ailerons, le plus drôlement du monde. Lorsque l’étrange petit véhicule qu’il figure ainsi est arrivé à quelques pas de nous, il se redresse, reprend son attitude humaine et pousse de temps en temps un petit cri pour exprimer sans doute l’étonnement que lui inspire l’être bizarre que nous constituons à ses yeux.
Ces oiseaux sont de vrais philosophes, peut-être des fatalistes ; ils ne cherchent pas à lutter contre le destin. Un jour, en ayant capturé trois, nous les avions placés sur le pont à un endroit d’où il leur était matériellement impossible de descendre ; ils restèrent où nous les avions mis sans protester ni manifester aucune frayeur.
Avant l’hiver, ces pauvres oiseaux ont un moment difficile à passer. Tandis qu’ils vivent généralement solitaires sur la banquise, au moment critique de la mue ils se groupent, trouvant sans doute leurs misères plus faciles à supporter en commun. Debout ou couchés sur le ventre ou même parfois sur le dos, ils regardent tristement leurs plumes tomber une à une autour d’eux ; ils perdent toute leur vivacité et paraissent malades, comme engourdis dans une espèce de somnolence, de torpeur, dont ils ne sortent que lorsque la nature les a complètement revêtus d’un nouveau plumage.
Nous avons retrouvé également sur la glace nos vieilles connaissances ailées du détroit : les différents pétrels, les sternes, les goélands. Enfin, parmi les autres notables de la banquise, il faut signaler plusieurs espèces de phoques, auxquels nos estomacs doivent bien aussi quelque reconnaissance. C’est surtout pendant le second été que nous en avons vu en grand nombre : j’y reviendrai plus loin.
Mais il est un animal tout petit qu’il est impossible de passer sous silence, car il est la base de la vie animale dans l’Antarctique. C’est un crustacé du plancton qui rappelle un peu la crevette de nos eaux littorales, avec des dimensions moindres. Cet animal étrange, appelé Euphausia, est lumineux. Il possède tout le long du corps de véritables appareils d’éclairage, composés d’un foyer lumineux, d’un réflecteur et d’une lentille, le tout microscopique. Extrêmement répandu sur la banquise, il y forme des bancs immenses ; les phoques, comme les cétacés, n’ont qu’à ouvrir la bouche pour en absorber copieusement ; les manchots aussi s’en repaissent exclusivement.
Comme les autres animaux du plancton, les euphausias sont des herbivores qui se nourrissent de diatomées, autres merveilles du monde de Lilliput que nous ont révélé l’excellent microscope de Racovitza et ses savantes explications.
Les diatomées sont si nombreuses qu’elles teintent en brun ocre verdâtre la glace de mer et lui donnent cet aspect sale que les marins polaires anglais et Scandinaves désignent sous l’appellation pittoresque de “glace pourrie”. Charmantes de variété et de perfection géométrique, leurs formes ne sont pas visibles à l’œil nu.
… Nous continuons à nous organiser. La petite société qu’abrite notre bonne Belgica constitue une vraie démocratie.
Notre sort commun est désormais lié à l’existence de notre cher navire. Nos joies à tous, comme nos peines, procèdent des mêmes causes. L’union, la fraternité et l’égalité dans le travail nous sont nécessaires : la devise nationale belge, écrite en lettres d’or à l’endroit le plus apparent du pont, est là pour nous le rappeler.
En avril, je règle, comme suit, le service pour l’hivernage : travail de huit heures du matin à midi et de une heure à cinq heures ; – repas à sept heures et demie, midi et cinq heures et demie ; – extinction des feux à dix heures dans le poste de l’équipage, à onze heures au carré ; – repos le jeudi après-midi et le dimanche après l’inspection du matin.
Une buanderie a été installée dans l’entrepont, à l’arrière de la cuisine : les hommes s’y baigneront aussi souvent que possible et, au moins, une fois par semaine.
En mai, le docteur Cook commence des observations physiologiques sur les membres de l’état-major, puis sur l’équipage ; il observe la température du corps et les pulsations ; tout le monde est pesé.
Lecointe a installé sur la glace un petit observatoire en planches recouvert de carton bitumé, haut d’un mètre soixante-dix, large d’un mètre soixante-quinze ; des fenêtres mobiles s’ouvrent sur les quatre faces latérales et permettent d’embrasser chacune cent dix degrés d’horizon. À l’intérieur, devant les fenêtres, les instruments sont posés sur des tuyaux en grès remplis de glace et couverts d’une pierre de taille. Afin d’éviter de transporter les chronomètres sur la banquise et de les exposer ainsi au froid, qui risquerait de les détériorer, Lecointe a mis sa cabine à bord, où ils sont déposés, en communication électrique avec la cabane.
Mais, pendant toute la première moitié du mois de mai, il dégèle constamment. La neige, à l’intérieur de la cabane, fond à différentes reprises par suite de la quantité de chaleur absorbée par le carton noir, de sorte que la base s’enfonce peu à peu et inégalement dans le sol.
En même temps, par le fait du dégel, la banquise subit de sensibles modifications. Notre floe est morcelé par des crevasses et des veines nombreuses. Une d’elles se forme juste à côté du petit observatoire, déjà si compromis, et le sépare de la glace qui entoure le navire. Lecointe, Amundsen et Cook passent toute la matinée du 13 mai à sauver l’édicule qui, pris comme dans un étau, est presque complètement écrasé. Après le sauvetage, il est réinstallé plus près du navire.
Le dégel devient si fort qu’il est nécessaire de déblayer le pont. Les agrès et les cordages sont couverts d’une couche de glace et de givre qui atteint, par places, jusqu’à vingt centimètres de diamètre ; elle se détache par grands blocs, qui viennent tomber sur le pont avec un bruit mat, nous réveillant à tout moment en sursaut pendant notre sommeil. De nouvelles crevasses se forment un peu partout et l’une d’elles aboutit à l’étrave.
La température est fonction directe de la direction du vent. Les vents du sud apportent les grands froids, tandis que par ceux qui soufflent du nord, c’est-à-dire du large, la température s’élève rapidement jusqu’à zéro ou même quelques dixièmes au-dessus. Ce sont ces vents du nord qui nous donnent en mai une température moyenne (-6,5°) plus élevée de 5,3° que celle d’avril.
Nous atteignons en mai les points extrêmes de notre dérive vers le sud, le 16 : 71° 35’ par 89° 10’ O, et le 31 : 71° 36’ S.
Peu à peu, la banquise, un moment détendue, se resserre.
Le champ de glace qui nous entoure se couvre de plus en plus de hummocks de pression.
Vers la mi-mai, le soleil ne se montre plus que quelques instants au milieu du jour.
La nuit polaire s’abat sur nous.
X
LA NUIT POLAIRE
Une nuit de seize cents heures. – Paysage de glace et de ténèbres. – Un “concours de beauté”. – Les caricaturistes du bord. – Une alerte. – La maladie et la mort de Danco. – Funérailles sur la banquise. – Dépression morale. – Un cas de folie.
Le 17 mai, à l’occasion de la fête nationale norvégienne, je fais donner du champagne à l’équipage pour le repas de midi.
À la demande des hommes, je les rejoins dans le poste, où ils boivent à ma santé. Somers, qui aime le champagne, m’exprime le regret de ne pas voir plus de nationalités différentes, partant plus d’anniversaires à bord. Ce n’est pas mon avis : si notre cave est fraîche, elle est peu garnie ; nous ne possédons que quelques bouteilles, cadeau d’amis qui ont pensé pour moi au superflu. Encore sommes-nous engagés d’honneur à rapporter deux bouteilles intactes, les deux dernières d’une caisse qui nous a été fournie gracieusement par un restaurateur d’Anvers. Il veut, à notre retour, les exposer sur son comptoir.
Après la petite fête, l’équipage, qui a repos, profite du temps exceptionnellement beau pour aller se promener sur la glace.
Ce jour-là, un fragment du disque du soleil nous apparut encore, grâce à la réfraction ; puis commença une nuit de seize cents heures.

Au milieu de la journée, pourtant, l’obscurité cessait d’être complète.
Vers neuf heures au début et plus tard, au solstice, vers dix heures, l’aurore naissait ; c’était une clarté blafarde dont la faible intensité ne variait qu’à peine. On sentait que cette pâle aurore était impuissante à enfanter le jour ; bientôt elle renonçait à l’effort tenté pour triompher des ténèbres ; par une transition insensible, elle devenait crépuscule ; vers trois heures, ce crépuscule lui-même s’éteignait.
Encore fallait-il, pour nous donner ce triste semblant de jour, que l’atmosphère fût sereine, ce qui était relativement rare ; par les temps couverts et lorsqu’il neigeait, nous devions allumer les lampes pour le repas de midi.
Dans la lumière diffuse qui remplissait l’atmosphère durant quatre heures sur vingt-quatre, on ne distinguait pas les aspérités de la banquise, qui apparaissait comme une grande plaine, d’un blanc sale, tout unie. Dans les promenades que nous nous imposions par hygiène, il nous arrivait de trébucher contre les hummocks, les monticules de glace, qu’aucune ombre n’indiquait. On appréciait également mal les distances et les dimensions des objets. Il me souvient qu’un jour je crus voir, à une centaine de mètres, une caisse assez grande. J’étais loin du navire et je me demandais pourquoi on avait porté là cette caisse ; au surplus, le bois était pour nous chose trop précieuse pour que nous le gaspillions. Très intrigué, je me dirigeai donc vers l’objet… Au bout de trois enjambées, mes skis le touchaient : c’était un petit morceau de journal qui, du bord, avait volé là !
À ces quelques heures de clarté nébuleuse, combien nous préférons, malgré leur mélancolie intense, les belles nuits claires, trop rares, hélas !
L’immense plaine se déroule alors à l’infini sous la molle et douce clarté de la lune. La Croix du Sud étend au ciel ses bras de lumière doucement scintillante. Çà et là, les icebergs dressent leurs formes étranges aux arêtes brillantes comme de l’argent et projettent derrière eux une ombre immense et triste, noire sur la blancheur de la banquise. La Belgica immobile, les cordages raidis par le gel et couverts de givre, ne décelant un peu de vie que par la légère fumée qui s’élève au-dessus du pont, à l’avant et à l’arrière, prend l’aspect d’un vaisseau fantôme. Le spectacle est d’une beauté grandiose et funèbre ; l’astre mort semble n’éclairer qu’un monde mort lui-même ; et, pourtant, si spectrale que soit sa clarté, elle repose nos yeux fatigués des ténèbres et de la brume.
Pourtant, pour que ces merveilleuses nuits soient sereines, il leur manque le silence : ce silence fait de mille bruits subtils, indicibles, imperceptibles presque, et qui sont comme le souffle régulier et doux de la terre endormie, prête à se réveiller à la prochaine aurore, rajeunie, triomphante, débordante de vie.
Ici tout clame et bruit, non pas la vie, mais la destruction et la mort : grondement sourd et continu, qui monte angoissant de l’immense banquise mouvante où la glace convulsée lutte constamment, broyée, pressée par le vent et la houle ; bruit menu, crissement de l’étau qui se resserre autour de notre frêle coque ; chocs des floes qui se rencontrent ; détonations lointaines des glaces qui s’écroulent.
Les phoques, les oiseaux s’en sont allés plus au nord. Le pétrel des neiges a été le dernier à nous quitter. Peut-être vient-il encore voltiger parfois autour de nous sans que nous l’apercevions : il est si blanc que sa silhouette gracieuse se détache à peine sur la grande plaine blanche.
Dans les chenaux, les frêles diatomées elles-mêmes, flétries et fanées, sont mortes ; toute manifestation de la vie a bien disparu de la surface de la banquise. Pourtant, sous l’épaisse couche de glace, elle triomphe encore, en secret, de tous les obstacles qui semblent s’opposer à son épanouissement. Entre deux eaux nagent les animaux du plancton. Microscopiques et rudimentaires, ils se nourrissaient de diatomées, pendant l’été ; maintenant, faute de mieux, ils en sont réduits à se manger les uns les autres, car nulle part la lutte pour l’existence ne se fait plus implacable et plus féroce que dans ce monde des infiniment petits. Les débris morts du plancton tombent des couches supérieures de l’océan, où il vit, pour aller nourrir, dans l’abîme, d’autres êtres mystérieux et obscurs.
… L’abîme !… nul mot n’éveille pareille idée d’horreur. En effet, c’est bien là un milieu effroyable : l’eau interceptant la lumière du soleil, à une faible profondeur[22] l’obscurité est complète, éternelle. L’effet des vagues, des courants, s’arrêtant à quelques mètres de la surface, dans l’abîme, l’immobilité de l’eau est absolue. La température se maintenant à zéro environ, le froid y est intense et constant.
Et, dans ce milieu épouvantable, des organismes naissent, vivent et se meuvent, suppléant par leur propre perfection à tout ce qui manque autour d’eux. Gracieux, élégants ou terribles, bardés de véritables cuirasses, munis de piquants ou de pinces, ils sont armés pour l’attaque et pour la défense.
Ces êtres bizarres, aux formes étranges, richement colorés pour la plupart, projettent dans l’obscurité ambiante la phosphorescence de leurs corps doucement lumineux.
Tout au fond, dans les ténébreuses vallées sous-marines, à des profondeurs dont la pensée seule donne le vertige, d’autres êtres encore se nourrissent de vase, de poussière, de débris tombés de couche en couche des hauteurs de l’océan !…
… Mais tous ces animaux dont la science nous a révélé et prouvé l’existence, nous ne les voyons pas et ils ne contribuent en aucune façon à animer notre morne domaine…
Chaque fois que le temps le permet, généralement pendant les heures du crépuscule, au milieu du jour, nous sortons pour nous promener.
Nous sommes chaudement vêtus d’un jersey en laine d’Islande que recouvre l’anorak en toile à voile, vêtement sans boutons, dont la coupe est empruntée aux Esquimaux, qui se passe par-dessus les épaules et est muni d’un capuchon. Sous le capuchon nous portons d’abord un passe-montagne, puis le bonnet en cuir à oreillères des chasseurs de phoques norvégiens.
Lorsqu’il vente, nous enfilons le pantalon de toile à voile que le vent ne pénètre pas. Nous sommes chaussés de finneskos, sortes de mocassins lapons, en peau de renne, que nous fourrons chaudement de senegraes, herbe palustre de Laponie. Par les très grands froids, nous revêtons nos chauds costumes en peau de loup de Sibérie. Mais, bien que maintenant la température descende fréquemment jusqu’à 30° sous zéro, les promenades à skis constituent un exercice si violent que souvent nous sommes en nage lorsque nous rentrons à bord.
Malheureusement les beaux jours sont rares et de fréquents chasse-neige nous tiennent bloqués dans le navire. Lorsqu’il est fort, le vent soulève sur la banquise des nuages de poudrin, grains de neige menus et durs comme du sable. Il les chasse à une grande hauteur ; et la neige qui tombe du ciel forme, avec la neige qui s’élève du sol, d’irrésistibles tourbillons. Elle pénètre et s’infiltre partout, mettant hors d’usage certains instruments très délicats, tels que les hygromètres à cheveu. Lorsque ces tempêtes, qui projettent parfois la neige plus haut que le nid de corbeau, durent quelque temps, il arrive que le navire soit comme enseveli. Il nous faut alors plusieurs jours de travail ardu pour le dégager.

Nos logements sont trop exigus pour être confortables ; mais, du moins, grâce au feutre qui en garnit les cloisons, la température y est rarement inférieure à 10° au-dessus de zéro, et nous évitons, ou à peu près, les condensations dont eurent tant à se plaindre d’autres explorateurs polaires.
Généralement, en dehors des heures de travail, l’état-major est réuni autour de la table du carré et celui-ci retentit souvent de joyeux éclats de rire : nous sommes jeunes et pleins d’espérance ; la maladie ne nous a pas encore atteints et, ma foi ! nous cherchons à tuer le temps le plus gaiement possible, car, pendant ces longs jours d’emprisonnement, les occupations sérieuses n’absorbent qu’une partie de la journée.
Ne sachant comment délasser nos esprits, n’avons-nous pas, à la fin de mai, organisé un concours de beauté !…
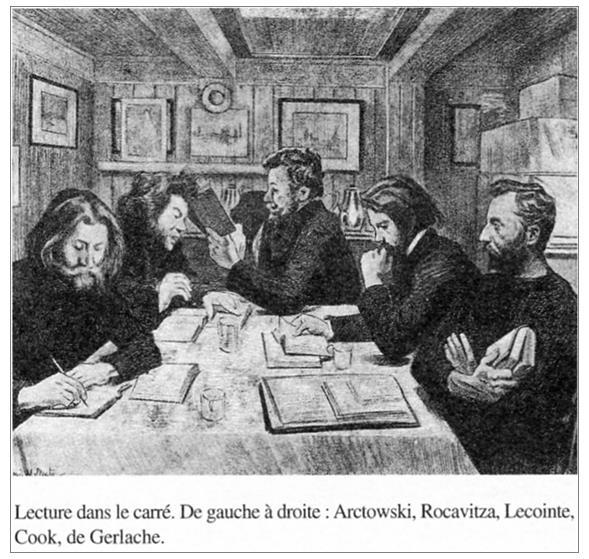
Un concours de beauté dans la banquise ?
Parfaitement. Un vrai concours de beauté auquel étaient admises deux cents actrices ou danseuses, réunies dans un album de photogravures que nous avait donné un de nos amis d’Anvers.
Cette plaisanterie nous occupa et nous amusa huit jours : il s’agissait de distribuer plusieurs prix dont un prix d’honneur, et dame ! il fallait bien avoir le temps de se faire une opinion, de choisir parmi tant de concurrentes.
Huit jours de réclames et de manœuvres électorales !
Est-il besoin de dire que les opérations du jury, le dernier soir, furent des plus animées et qu’elles ne se terminèrent que très tard ?
Depuis le début du voyage, chaque soir, Racovitza s’éclipse du carré à la même heure. Il va dans son laboratoire mettre son journal au courant, puis méditer sur les événements de la journée, les petites querelles entre camarades, les théories qui ont été développées, les mots échappés à l’un ou à l’autre de nous : la caricature résultant de cette méditation est un régal attendu par tous avec impatience.
Une heure environ après nous avoir quittés, Racovitza rentre au carré et, sans rien dire, dépose flegmatiquement un dessin au milieu de la table. On se jette dessus, on se le dispute, et c’est alors généralement un bon moment de gaieté. Ceux mêmes qui sont visés par le caricaturiste rient le plus souvent de bon cœur, ce qui est du reste le meilleur moyen de désarmer les railleurs.
Quelle jolie, quelle humoristique histoire de l’expédition l’on ferait avec ces caricatures ? Parmi les plus réussies, en voici une, digne des Fliegende Blœtter : Arctowski, aidé de son inséparable Dobrowolski, a planté un jalon pour mesurer la quantité de neige tombée ; à l’angle de l’observatoire magnétique, dans un coin, on voit la tête de Danco qui les observe ; tandis qu’Arctowski rentre à bord, Danco, suivi de Dufour, son assistant, sort de sa cachette et, à grands coups de maillet, va enfoncer le jalon ; puis il retourne en observation derrière sa cabane ; Arctowski revient pour mesurer la neige tombée ; ahuri de voir le jalon presque enfoui sous la neige en si peu de temps, il lève les bras au ciel pour marquer sa stupéfaction ; on le voit enfin dans son laboratoire rédigeant un rapport.
L’équipage, qui n’a décidément rien à envier à l’état-major, a aussi son caricaturiste : le matelot norvégien Koren manie le crayon avec humour. Il va sans dire que sa verve s’exerce le plus généralement aux dépens des officiers, à la grande joie de ses camarades ; ses dessins représentent tantôt Lecointe de mauvaise humeur, tantôt “le commandant montrant un coin sale à bord” ; parfois on s’enhardit à nous les mettre sous les yeux.
Il y a sur la Belgica un coin particulièrement pittoresque : c’est l’espèce de petit hall établi à côté du carré, sur la chambre des machines. Il est éclairé uniquement par le poêle, autour duquel pendent constamment toutes sortes de hardes. C’est un vrai campement de bohémiens. Sur une des parois s’ouvre la fenêtre de la cabine des quatre savants : avec son chapelet de chaussettes trouées, elle a l’air d’une fenêtre de roulotte.
Pendant nos moments de loisir, nous raccommodons nos vêtements, du moins ceux qui ne sont pas trop usés, car depuis longtemps toute coquetterie, toute élégance, si élémentaires qu’elles fussent, ont été abandonnées.
Quelques jours après le commencement de la longue nuit d’hiver, nous eûmes un moment de vive alerte. Des craquements de la glace autour de la Belgica annoncèrent de fortes pressions. Elles se produisirent bientôt.
Du 28 au 31 mai, la banquise se convulsa violemment ; des blocs chevauchèrent, s’amoncelèrent : le navire tressaillit longuement ; toute sa membrure vibra.
La nuit surtout, les pressions étaient distinctes dans le silence qui régnait à bord.
J’avais confiance dans la solidité de mon bon navire, et pourtant la plainte aiguë du bateau, tout frémissant sous l’étreinte obstinée, n’était pas sans m’impressionner douloureusement : elle est si puissante, si terrible, la banquise ! Et, opposée à ses forces déchaînées, notre petite carène est si frêle ! Pourtant, la Belgica supporta admirablement cette rude épreuve.
Le 29 mai, pendant plusieurs heures, ce ne furent que craquements plaintifs du bois qui résistait, sourds grondements de la glace qui se mouvait autour de nous.
Une veine, ouverte la veille à tribord, se ferma, déterminant la formation d’une barrière de hummocks.
Le 30, sous l’action de pressions très fortes, cette barrière se rapprocha du navire, la glace s’amoncela contre la muraille tribord et s’éleva à l’arrière jusqu’à hauteur du plat-bord*. Nous constatâmes qu’une énorme plaque de glace, ayant glissé sous la banquise au lieu d’être broyée comme d’autres, avait soulevé notre avant d’une couple de pieds et obstrué le trou à eau.
Le 1er juin, le calme se rétablit… Mais nous avions envisagé, depuis deux jours, les pires éventualités.
Si la Belgica avait été écrasée dans les convulsions de la glace, nous nous serions certes trouvés en plus mauvaise posture que les expéditions arctiques auxquelles arrive pareil désastre.
Au nord, la carapace glaciaire se prolonge jusqu’à des terres que l’on peut atteindre avec des traîneaux et d’où l’on peut gagner, en été, des lieux fréquentés par les baleiniers ou les chasseurs. Au sud, au contraire, les côtes hospitalières sont séparées de la banquise par d’énormes espaces de mer libre. La Terre de Feu est aussi loin du cercle antarctique que l’Écosse du cercle arctique.
Notre seule ressource, en cas de perte du navire, eût été de gagner le bord de la banquise en traînant deux canots chargés d’autant de vivres que nous en eussions pu emporter. Puis, nous aurions navigué en longeant la lisière, dans la direction des Shetland du Sud, nous réfugiant dans la glace pour étaler le gros temps. Enfin, et c’était le plus difficile à exécuter, il aurait fallu, avec les canots, entreprendre la traversée de la mer tempétueuse du cap Horn… Nous n’aurions pas eu une chance sur cent d’échapper.
Mais nous fûmes favorisés : aucune autre pression sérieuse ne nous menaça pendant toute notre réclusion. Le danger eût été plus grand si la Belgica s’était trouvée bloquée dans une banquise moins compacte ; mais le champ de glace qui nous enfermait était d’une solidité exceptionnelle, et il nous assura, jusqu’au bout, une protection efficace.
Ces préoccupations pour notre sécurité s’étaient à peine dissipées que nous nous sentîmes menacés d’un autre grand malheur qui, celui-là, hélas ! ne devait pas nous être épargné. Le navire ne paraissait plus en danger ; mais nous allions être soumis à une douloureuse épreuve.
L’hiver austral s’était appesanti sur nous depuis quelques jours à peine que, déjà, nous savions qu’il faudrait lui payer un tribut.
Tout de suite, des symptômes inquiétants s’étaient manifestés dans la santé de notre camarade Danco. Nous le savions de complexion délicate, faible de poitrine, croyions-nous, en dépit de sa haute stature et de son exubérante gaieté : mais nous espérions que l’air froid et vif des régions polaires aurait sur lui un effet tonifiant et le guérirait peut-être.
Danco devait succomber à un autre mal dont il portait les germes en lui et dont nous ne le soupçonnions pas atteint. Les troubles cardiaques, dont nous devions bientôt nous ressentir tous, l’affectèrent profondément, dès les premiers jours de la nuit polaire ; lorsqu’il sortait pour faire avec nous la promenade quotidienne, il était obligé de s’arrêter après quelques pas, pris de suffocations, puis de rentrer à bord. Bientôt il renonça complètement aux sorties. Les crises d’étouffement ne s’en succédèrent pas moins à des intervalles de plus en plus rapprochés. Le pauvre garçon avait encore toutes les apparences extérieures d’une bonne santé, que déjà nous le sentions irrémédiablement perdu.
Tant qu’il le put, vaillamment, il continua à faire ses observations magnétiques. Mais, le 20 mai, il dut renoncer à tout travail.
Lorsque, ce même jour, le docteur vint me trouver, m’annonçant l’inévitable dénouement, je sentis mon cœur se briser, car nul, parmi mes compagnons, ne m’était plus cher, et nul non plus, je crois, ne m’était plus dévoué. Dès lors, j’assistai avec une morne angoisse à la lente désagrégation de cet être si courageux, si intelligent et si bon.
Il fut bientôt visible pour tous que son état s’aggravait de jour en jour, presque d’heure en heure. Mais, par une grâce d’état particulière, il était seul à ne pas s’en apercevoir. Attribuant son mal à une affection passagère, il gardait toute sa gaieté, tout son espoir dans le retour du soleil qu’il ne devait jamais revoir.
Ses forces, cependant, déclinaient rapidement, et sa respiration, devenue haletante, s’entendait dans tout le carré, nous rappelant, à chaque seconde, qu’un homme que nous aimions agonisait sous nos yeux.
Dès le début de sa maladie, nous lui avions abandonné la banquette du carré des officiers, le seul endroit un peu confortable du navire ; dans les couchettes étroites et basses de nos cabines, le malade ne pouvait plus respirer. C’est donc là, au milieu de nous, qu’il vécut ses derniers jours, assistant aux repas qui nous réunissaient tous autour de la petite table, donnant son avis dans la partie de whist, le soir, et s’égayant des plaisanteries auxquelles nous nous efforcions pour dissimuler notre angoisse.
Lui, toujours sans se douter de la gravité de son état, continuait à faire, pour le moment où il serait guéri et où la clarté du jour nous serait rendue, de beaux projets où se montrait toute la vaillance de son âme.
Trois semaines à peine s’étaient écoulées depuis que le docteur avait prononcé son terrible pronostic, lorsque, le 5 juin, il vint me trouver, le visage bouleversé et la voix tremblante, me disant : “Commandant, ce sera pour aujourd’hui.”
Ah ! l’horrible, l’inoubliable journée !
Les matelots, consternés comme les officiers, ne riaient plus, ne parlaient qu’à voix basse, étouffaient le bruit de leurs pas dans l’attente anxieuse de l’inévitable événement.
Un lourd silence régnait à bord.
Et, tandis que dans notre lointaine patrie c’était la saison adorable, aux longs jours ensoleillés, parfumés de brises odorantes, où la nature, les mains pleines de fleurs, chante toutes ses joies et toutes ses gloires – dans la nuit sinistre et froide, au milieu de cette désolation des désolations qu’est la banquise antarctique, se déroulait ce drame simple et poignant : la mort d’un des membres d’une toute petite famille isolée et perdue au bout du monde.
Le malade, très affaissé, ne parlait plus, toute parole lui étant devenue une fatigue et une souffrance ; mais il souriait encore d’un sourire très doux à ceux qui à tour de rôle allaient s’informer de lui.
Ce jour-là nous prîmes nos repas dans mon étroit salonnet, car le moindre bruit fatiguait maintenant notre pauvre ami.
Vers sept heures, après le souper, Lecointe, qui avait été son camarade de promotion à l’École militaire, se rendit auprès de lui pour lui parler de son cher régiment, tout ce qui lui tenait encore lieu de famille. Mais le malheureux était épuisé. L’effort de volonté, la réaction espérée ne se produisirent pas. Pourtant, lorsque quelques instants après nous nous groupâmes tous auprès de lui, il tourna vers nous ses bons yeux reconnaissants et, d’une voix basse et faible comme un souffle, il murmura : “Je me sens mieux, merci.” Presque aussitôt, son visage amaigri se couvrit d’une pâleur effrayante ; ses traits se contractèrent et il se raidit en arrière… Il était mort…
Lorsque nous fûmes un peu revenus de la consternation qui nous avait rendus muets et immobiles, nous songeâmes à lui rendre les derniers devoirs. Nous le couvrîmes du drapeau national qu’il avait tant aimé et, après avoir annoncé le triste événement à l’équipage désolé, je le fis défiler devant le corps.
Alors, commença pour moi une lugubre veillée dont Lecointe devait me relever plus tard.
Resté seul en présence de ce corps inerte, je ne pouvais détacher les yeux du visage amaigri, si calme dans la sereine majesté de la mort.
Je repassai, dans mon esprit, la vie de mon pauvre camarade ; tout au moins ce que j’en savais. Je l’avais connu alors que nous n’étions encore tous deux que des enfants. Élevé durement par un père sévère et qui pourtant l’adorait, il avait été tenu de près, absolument privé des libertés qu’on accorde généralement aux jeunes gens.
Cette éducation, qui eût pu être dangereuse pour une nature moins souple, moins foncièrement droite et bonne, lui avait merveilleusement réussi. Seulement il avait, aux approches de la trentaine, gardé le caractère d’un garçon de dix-huit ans, encore tout plein de très juvéniles enthousiasmes et d’une espèce de naïveté de sentiments qui était le grand charme de ce beau garçon très instruit et d’une intelligence d’élite.
Quand son père, “le père”, comme il disait avec une ferveur touchante, fut mort, le laissant absolument sans famille, à la tête d’une jolie fortune, relâché soudain d’une surveillance par trop étroite, il voulut jouir de sa liberté, de sa fortune, vivre enfin.
Mais pour cette âme délicate, cet esprit cultivé, la vie ne pouvait se résumer dans les satisfactions faciles et grossières qui font la principale préoccupation de tant de jeunes gens.
Les grands voyages le tentaient. Quand il apprit que j’allais partir pour une lointaine expédition, il se souvint de nos anciennes relations et vint me trouver, me suppliant de le prendre avec moi à n’importe quel titre.
J’hésitai longuement à cause de sa santé que je soupçonnais mauvaise et, fort probablement, j’aurais fini par refuser catégoriquement d’assumer la responsabilité de l’emmener, si je n’avais appris qu’en cas de refus de ma part il était décidé à partir pour le Congo. J’acceptai alors, croyant le climat du pôle moins pernicieux pour lui que celui des tropiques.
Successivement je l’envoyai à Vienne, à Iéna, à Berlin, à Paris, pour acheter des instruments de géophysique et s’initier à leur maniement dans différents laboratoires ; puis je l’emmenai en Norvège pour l’entraîner en vue de la prochaine expédition.
Danco était ravi d’aller et de venir librement ; lui qui n’avait jamais quitté la Belgique s’épanouissait réellement et ne perdait pas une occasion de m’exprimer sa reconnaissance.
Pauvre garçon, comme il a payé chèrement le bonheur de servir une œuvre qu’il estimait noble et utile !
Pendant cette triste veillée, je me rappelai mes hésitations et j’interrogeai ma conscience. Avais-je bien fait de céder à ses sollicitations ?
Cook m’a dit qu’en Belgique Danco eût pu vivre une année ou deux de plus. Mais alors il fût mort sans gloire. Ici, il est tombé en vaillant soldat, au champ d’honneur. Si le choix de son destin lui eût été laissé, je crois qu’il n’eût pas hésité ; car il n’avait pas seulement mis au service de l’expédition son intelligence et sa vie, mais il lui avait donné son cœur tout entier, ce cœur enthousiaste et vibrant si bien fait pour l’absolu dévouement.
Que de fois, dans la première partie du voyage, ses camarades, voulant le taquiner, prirent plaisir à dénigrer en sa présence, et, fort innocemment d’ailleurs, tel ou tel ami ou bienfaiteur de l’expédition ! Danco alors s’indignait, se fâchait très fort, et on avait grand-peine à le calmer.
Insensiblement ma pensée glissa de ce mort regretté à mes autres camarades. Ma mélancolie devint plus profonde et une inquiétude me poignit. L’anémie polaire nous avait tous atteints ; tous, nous étions menacés maintenant. Je les savais vaillants eux aussi et sans peur devant la mort. Mais, si nous devions disparaître, qui donc rapporterait en Belgique le fruit de nos travaux ? La pensée que ce libre sacrifice de nos vies pût devenir absolument inutile me fit froid au cœur ; je me sentis affreusement triste.
Le lendemain, 6 juin, tout travail fut suspendu à bord en signe de deuil.
Seul, le voilier procéda à la confection d’un sac en toile à voile pour servir de linceul.
Au moment où nous ensevelissions la dépouille de notre ami, mû par une touchante pensée, Van Rysselberghe s’approcha de lui et déposa sur sa poitrine quelques fleurs, maintenant fanées, que sa mère lui avait données avant le départ.
Puis, comme il devenait dangereux pour la santé des vivants de conserver plus longtemps à bord le corps de notre infortuné camarade, nous le transportâmes sur la banquise, où il fut déposé sur un traîneau à côté du navire.
Le 7, jour fixé pour les funérailles, il faisait mauvais ; la bise était âpre et glaciale ; on eut toutes les peines du monde à creuser le trou par lequel notre ami devait disparaître à jamais.
Comme toutes les manœuvres, les drisses* des pavillons, raidies par le gel, n’étaient pas maniables. Je désirais cependant que notre lointaine patrie fût représentée aux funérailles de Danco et je fis attacher l’emblème national à mi-hauteur des grands haubans*.
Vers onze heures, lorsque la nuit eut fait place à la lueur blafarde et diffuse qui tenait lieu de jour, quatre hommes s’attelèrent au traîneau, sur lequel le corps de notre camarade avait été déposé, et le halèrent jusqu’au lieu d’immersion. L’état-major tout entier, puis l’équipage, vêtu de ses meilleurs vêtements, suivaient.
Au bord du trou ouvert dans la glace, le convoi s’arrêta et, tandis que tous nous nous découvrions, inclinant nos têtes sous le vent glacé, j’adressai quelques mots d’adieu à l’ami dont nous allions nous séparer pour toujours.
Puis, le corps fut soulevé et posé horizontalement dans le trou. Comme le sac avait été lesté d’un poids, du côté des pieds, il se dressa tout droit avant de descendre lentement et de s’engloutir dans l’abîme. Quelques matelots reculèrent alors, saisis d’une instinctive horreur.
… Ce deuil, qui nous avait tous consternés, eut une influence déprimante sur le moral des hommes de l’équipage, dont plusieurs d’ailleurs étaient fort souffrants ; la cérémonie du matin surtout avait été, pour beaucoup de ces braves cœurs, une très dure épreuve.
Le docteur Cook, qui était descendu dans le poste le soir, après le souper, avait jugé les hommes excessivement démoralisés ; il vint me trouver, me conseillant d’envoyer aux matelots le cœlophone, qui fait leurs délices et pour lequel, du reste, nous avons des airs religieux. Bien que le conseil fût sage, je ne pus me résoudre à le suivre ; comprenant cependant qu’il fallait secouer un peu la torpeur où le triste événement de ces derniers jours avait jeté l’équipage, je fis distribuer un grog.
À partir du moment où Danco nous fut enlevé, notre existence se fit plus morne.
Il semblait que la mort, qui venait de nous visiter, eût laissé partout des traces de son passage, jetant à bord comme une pernicieuse semence.
Notre vitalité diminua en quelque sorte ; tous, nous nous sentîmes atteints d’une langueur morbide ; chez tous aussi, le docteur constata la décoloration des muqueuses, l’accélération du pouls devenu irrégulier et capricieux. Il nous arrivait d’avoir jusqu’à cent trente, voire cent quarante pulsations, après le moindre effort physique, après une simple promenade d’une demi-heure à peine. Plusieurs d’entre nous souffraient de vertiges. Tout travail intellectuel un peu prolongé nous était devenu impossible et notre sommeil était interrompu par de longues insomnies, lorsqu’il n’était pas agité de cauchemars.
Ainsi, tout ce qui eût pu nous réconforter nous manquait à la fois : les distractions et le repos.
Bientôt, notre teint devint d’un jaune verdâtre ; nos organes sécréteurs fonctionnaient avec peine, et d’inquiétants symptômes d’affections cardiaques et cérébrales commencèrent à se manifester.
L’un des marins fut atteint d’accès d’hystérie qui le privèrent pendant quelques jours de l’ouïe et de la parole. Le retour du soleil le sauva seul de la folie.
Pour un autre, un Norvégien, les conséquences de l’hiver antarctique devaient être plus graves encore. Ce matelot, très intelligent, s’intéressait beaucoup aux travaux du laboratoire et y était fréquemment employé comme aide pour le dépeçage et l’empaillage sommaire de certains animaux. Un jour, sans aucun motif, il déclara qu’on lui faisait faire une besogne indigne de lui et, dès lors, s’y refusa obstinément. D’autres menus faits, qui nous avaient étonnés déjà, nous revinrent à la mémoire. Bientôt le docteur constata que le malheureux était atteint de la manie des grandeurs ; sa folie, qui resta toujours douce, prit cependant à nos yeux un caractère plus inquiétant, lorsqu’il déclara que ses camarades en voulaient à sa vie et qu’il n’était plus en sécurité au milieu d’eux. Poursuivi par cette idée fixe, il déserta sa couchette du poste et alla dormir dans un coin de l’entrepont. À partir de ce moment, le pauvre matelot fut l’objet d’une surveillance incessante, car nous craignions qu’il lui arrivât quelque accident ou que sa folie devînt subitement mauvaise.

Enfin, Van Rysselberghe, atteint de troubles cardiaques, nous donna de sérieuses inquiétudes. Bien qu’il n’eût jamais gardé le lit, son état exigea, jusqu’au retour du soleil, les plus grands ménagements. Chaque jour, il prenait, le torse nu, un bain de chaleur derrière le poêle du petit hall.
Quant aux officiers, pas un seul n’échappa à la maladie. Arctowski et Racovitza souffraient beaucoup de l’estomac ; Lecointe fut en danger pendant plusieurs jours ; et moi-même je fus très sérieusement souffrant. À un certain moment, le docteur crut de son devoir de me dire qu’il avait relevé dans mon état des symptômes qui ne trompent généralement pas et qu’il me croyait atteint de scorbut.
Comme on le voit, le poste de médecin à bord n’était pas une sinécure.
Cook, qui avait acquis une grande expérience durant une des expéditions arctiques du lieutenant Peary, trouva au milieu de nous de nombreuses occasions de faire preuve d’un dévouement qui ne se démentit jamais.
Cet hivernage a eu sur tous un effet curieux : il a mis à nu nos “tares” physiques, les “défauts de nos cuirasses” ; pas un, affligé d’une infirmité quelconque, souvent insoupçonnée jusque-là, qui n’en ait souffert pendant quelques jours. Nous fournissions ainsi, bien malgré nous, de constants sujets d’observation à l’excellent Cook.
L’obscurité prolongée, qui avait des effets déplorables sur notre circulation, l’isolement, le froid et, plus encore que le froid, l’humidité, n’étaient pas les seules causes de ce mauvais état de santé. Bien que nos conserves fussent excellentes, l’usage constant et exclusif, en un mot, l’abus que nous étions obligés d’en faire avait déterminé chez tous une paresse intestinale extrêmement pernicieuse.
À la fin de l’hiver, nous pûmes capturer quelques manchots et des phoques, dont la chair fraîche vint reposer nos estomacs fatigués. Les malades en mangèrent même régulièrement trois fois par jour, sur l’ordonnance du médecin. Nous avions fini par surmonter notre répugnance du début pour cette chair huileuse, qu’il faut littéralement calciner, afin d’en chasser l’excès de graisse.
… Notre vie se poursuit monotone et presque machinale. Nos cerveaux anémiés ne nous permettent pas de fixer longtemps notre attention sur les travaux intellectuels.
Chaque jour, pendant les quelques heures de crépuscule, nous sortons, lorsque le temps le permet, faisant à skis le tour de notre prison de glace, relevant les changements si fréquents et si brusques qui s’opèrent par suite des contractions et des dislocations partielles de la banquise.
Un iceberg, prisonnier comme nous et éloigné de deux milles du navire, est le but ordinaire de ces promenades, dont très souvent, d’ailleurs, nous sommes privés par suite de tempêtes et de chasse-neige. Ceux-ci ont, à mes yeux, l’inappréciable avantage de fournir aux hommes un travail forcé, qui constitue pour eux un excellent exercice. Après chacune de ces tourmentes, qui nous tiennent calfeutrés à bord, le navire est, pour ainsi dire, enseveli, et tout le personnel, sans distinction de rang, doit travailler au déblaiement.
Pendant la maladie de Danco, nous avions pris l’habitude de jouer au whist près de lui pour le distraire. Après sa mort, pour apporter un peu de variété à la monotonie de notre vie confinée, nous persistons à faire chaque soir la partie dans mon salonnet. Racovitza, Cook et moi nous jouons régulièrement, le quatrième étant soit Lecointe, soit Arctowski et plus rarement Amundsen.
Au début, les pertes se soldaient à l’aide de haricots, chacun en ayant reçu cent, qui constituaient le capital. Mais nous étions d’une témérité folle, nous risquions beaucoup, et pour plusieurs d’entre nous ce capital fut vite épuisé. Alors, on fit des bons de tant d’unités. Unités de quoi ? Nous n’en sûmes jamais rien. Certaines pertes finirent par se chiffrer par cent mille et deux cent mille unités ! ! Ces parties animaient beaucoup nos réunions du soir. Dire qu’autrefois j’avais une telle horreur des cartes que, dans les rares occasions où j’avais dû me dévouer pour remplacer un partenaire manquant, je n’étais même pas capable de tenir convenablement mon jeu ! Les leçons n’avaient produit aucun résultat : je n’avais pas le feu sacré.
Il a fallu une expédition polaire pour faire de moi un redoutable adversaire au whist : encore ne m’y suis-je pas enrichi, même en haricots !
Quand nous ne jouons pas aux cartes, la lecture occupe nos soirées jusqu’à onze heures, heure à laquelle invariablement on éteint la lampe du carré.
Nous recherchons avidement les livres qui peuvent détourner nos pensées de notre triste situation. Je trouve pour ma part un charme tout particulier à la lecture d’Africaines, le livre attachant dans lequel mon ami Charles Lemaire a si heureusement évoqué l’Afrique : ces visions empruntent au contraste un charme puissant.
Souvent un grand éclat de rire rompt le silence : c’est l’un de nous, généralement Racovitza, qui s’esclaffe bruyamment aux passages les plus gais des comédies de Labiche, dont l’esprit désopilant eut toujours le don de nous arracher au sentiment de nos misères. Comme il avait raison, notre ami Paul Errera, qui nous en fit don, d’y joindre ces quelques mots d’envoi : “Jamais un peu de gaieté n’a nui aux plus sérieuses entreprises ! En souhaitant bon voyage à l’Expédition antarctique belge, je la prie d’emporter ces quelques volumes de Labiche : c’est de la quintessence de joyeuse humeur. – 13 août 1897.”
Pour les hommes de l’équipage, les heures de loisirs sont difficiles à occuper et se traînent mortellement longues.
Eux aussi jouent aux cartes et assez souvent au jeu de dames ; puis ils lisent : Dumas est leur auteur favori et ils affectionnent tout particulièrement Les Trois Mousquetaires, dont l’emphase héroïque et l’invraisemblance même captivent singulièrement ces esprits naïfs. Quelques matelots jouent de l’accordéon, et Somers raconte des histoires. Cet Ostendais montre une verve, disons le mot, une blague intarissable. Mais, forcément, il arrive au bout de son chapelet ; alors le cycle recommence avec des amplifications, des détails inédits que l’imagination marseillaise de notre mécanicien forge de plus en plus extraordinaires. À la fin, ces histoires sont devenues tellement invraisemblables que le plus crédule des matelots a cessé d’y croire.
Il y a encore au poste, en fait d’attraction, le cornet à piston pour lequel Van Mirlo professe un amour malheureux. Il joue si abominablement faux que les manchots eux-mêmes, quand ils commencèrent à revenir sur la banquise, s’en montrèrent effrayés, et pourtant, à en juger par leur propre cri, ils ne doivent pas être des juges sévères en matière d’harmonie !
Le 21 juin, au moment où nos chronomètres marquent six heures, a lieu pour nous le solstice d’hiver.
Le vent est du sud-ouest, il fait très froid, l’air est très transparent. À partir de ce moment, les jours vont croître ou plutôt, puisqu’il n’y a pas de jour et que le soleil ne se montrera à l’horizon que dans cinq semaines, l’aurore et le crépuscule seront de plus en plus longs.
L’atmosphère étant exceptionnellement pure ce jour-là, on pouvait lire sur le pont, de onze heures du matin à une heure de l’après-midi, des caractères d’imprimerie de la grosseur de ceux de ce livre.
À midi, le ciel était merveilleusement coloré ; le fond d’azur sur lequel se détachaient, brillantes, la planète Jupiter et quelques étoiles de première grandeur, était diapré à l’horizon de toutes les couleurs du spectre solaire, tandis que, dans la région zénithale, un amas de cirrus vivement teintés de rose s’estompaient sur la voûte de saphir. À six heures, Lecointe put observer une éclipse du troisième satellite de Jupiter.
Le soir, tout le personnel fut pesé, pour faire suite aux observations physiologiques du docteur. Le poids moyen des hommes de l’équipage était à ce moment de 70 kil. 295 gr. ; celui des membres de l’état-major, de 70 kil. 291 gr.
Pendant l’hiver, nous avons vu très peu d’aurores australes, et celles que nous avons observées étaient si pâles qu’on les distinguait à peine.
Par contre, un jour, nous fûmes témoins d’un étrange phénomène de réfraction. C’était aux environs de midi : à l’orient, nous aperçûmes tout à coup, s’élevant sur l’horizon, comme un grand iceberg tabulaire, large d’environ quatre fois sa hauteur apparente, et tout illuminé d’une belle teinte jaune orange, comme s’il avait été éclairé par le soleil couchant. Nous étions tous fort intrigués. Mais, peu à peu, l’apparition se modifia ; une bande de brume vint la diviser en deux, horizontalement ; la partie inférieure s’évanouit, tandis que le rectangle supérieur se changeait d’abord en un pentagone, puis en un fragment de disque. Nous constatâmes alors que ce mystérieux iceberg était tout bonnement la lune qui se levait.
XI
LE PRINTEMPS ET L’ÉTÉ ANTARCTIQUES
Le retour du soleil. – Le vélocipède sondeur. – Repeuplement de la banquise. – Battues aux rats. – Une excursion mouvementée. – La marche de la dérive. – Les chasse-neige. – Clairières. – Préparatifs prématurés d’appareillage. – Le Nouvel An.
Notre situation devait s’améliorer beaucoup avec le retour du soleil. Cet événement, mémorable pour nous, et qui fut salué avec une joie profonde, se produisit le 21 juillet.
À cette date, nos couleurs, hissées au grand mât, fêtèrent à la fois l’anniversaire de la dynastie belge et la réapparition de l’astre qui nous avait tant manqué.
À vrai dire, ce jour-là, il ne s’éleva pas encore au-dessus de notre horizon. Mais comme, à midi, il n’en était plus qu’à quelques minutes de degré, nous pûmes apercevoir un fragment du disque, du haut d’un iceberg voisin dont l’ascension était aisée.
En même temps, ses rayons, sans descendre jusqu’au pont de la Belgica, dorèrent un instant les plis du pavillon tricolore qui battait au sommet du grand mât.
Après qu’il eut disparu, nous demeurâmes pendant quelque temps en contemplation devant la lueur qui se reflétait encore sur l’horizon ; puis tout retomba aux ténèbres des dernières semaines.
Mais nos yeux restaient éblouis de la radieuse vision, et nos cœurs réconfortés s’ouvraient à l’espérance des jours meilleurs où la banquise redeviendrait navigable et où l’étau de glace dans lequel nous étions enserrés s’ouvrirait pour nous livrer passage.
Il faut avoir été privé du soleil pour savoir à quel point il est bienfaisant pour le corps et pour l’âme ; on comprend alors le sentiment des peuplades sauvages qui en ont fait, de tout temps, la première de leurs divinités. Nous sacrifiâmes à ce dieu en amplifiant le menu du jour qui fut, en l’honneur de la fête nationale, composé, dans la mesure du possible, de mets belges :
Matin
Café, pain et beurre
Pain d’épices de Gand
Filet d’Anvers
Midi
Potage aux poireaux
Pingouin royal rôti, sauce venaison
Pommes de terre en purée
Asperges de Malines
Jambon des Ardennes
Dessert
Soir
Boudins noirs de Liège
Compote de pommes
Ce menu fut commun à l’état-major et à l’équipage, mais celui-ci put arroser cette ripaille de trois bouteilles de champagne, tandis que l’état-major, dont trois membres ne boivent jamais de vin, eut de la peine à en vider une.
Cependant le retour du soleil n’a pas apporté un changement matériel radical ni subit dans notre existence. Nous ne sommes pas passés brusquement de la nuit ténébreuse à un océan de lumière. La transition est presque insensible. Seulement, au lieu de la triste lumière crépusculaire que nous avions au milieu de la journée, le soleil se montre maintenant chaque jour, durant quelques minutes, et, à mesure que les jours s’écoulent, son apparition se fait plus longue. Avec son premier rayon, la divine espérance, ce “miel de l’âme” comme disaient les anciens, est entrée dans nos cœurs.
C’est pour nous une idée réconfortante de savoir que nous ne verrons plus la triste nuit polaire qui nous a tant éprouvés et que, lorsqu’elle s’abattra de nouveau sur la banquise, délivrés de son étreinte, nous l’aurons quittée depuis longtemps.
Le froid est très vif, plus vif qu’en juin, où la plus basse température avait été de -30° (le 3) et la moyenne de -15,5°. En juillet, la température moyenne descend à -23,5° : c’est la moyenne la plus basse de tout l’hivernage. Le 17, nous avons observé une température minimum de -37°.
À la fin du mois, le thermomètre se maintient aux environs de -30°. Mais le temps est admirable et d’une régularité sans précédent. À part deux courtes interruptions causées par des bouffées de brise du nord, chargée de brumes, nous jouissons d’un ciel pur pendant quinze jours consécutifs.
Nous commençons donc à faire quelques excursions autour du navire. Pas bien longues au début, car, en l’état de faiblesse où nous sommes, le moindre effort pourrait nous être fatal.
Tous, nous sommes des convalescents et tous, nous avons besoin de grands ménagements.
Depuis notre entrée dans la banquise, nous avons beaucoup changé physiquement : nous sommes bouffis et jaunes ; mutuellement nous nous trouvons vieillis ; nos traits sont fatigués, tirés, et nos visages ont conservé, des souffrances de l’hiver, une expression préoccupée et triste.
Nos barbiers habituels – le docteur et Michotte – ne nous taillent que très rarement les cheveux et la barbe qui nous protègent contre le froid. Ceux d’entre nous dont le système pileux est très développé ont un aspect véritablement sauvage : la chevelure de Racovitza rappelle ces brosses appelées “têtes de loup” qui servent à nettoyer les plafonds ; Cook et Arctowski ont un air d’apôtres sous leurs longs cheveux tombants…
Les travaux scientifiques ont repris très activement : nous péchons, nous sondons et draguons fréquemment ; Lecointe, qui a assumé la succession de Danco, fait les observations magnétiques.
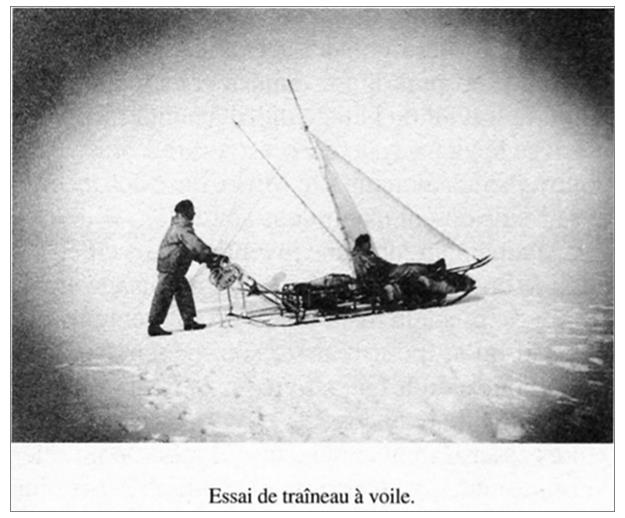
Les hommes de l’équipage, habiles à tous les travaux manuels, ne manquent pas d’occupations. Les uns travaillent à la forge établie sous l’abri du pont ; les autres se livrent à des travaux de menuiserie, de charpentage, de matelotage et de voilerie, ou bien réparent leurs effets et lavent leur linge.
Quelques-uns imaginent des perfectionnements pour nos engins. Le plus ingénieux de tous est le jeune Van Mirlo ; chaque jour il invente de nouvelles combinaisons. La plus curieuse de ses inventions fut certes le “vélocipède sondeur”, destiné, selon le prospectus illustré qui accompagnait la demande de brevet, à “lier l’utile à l’agréable… et à partager sur tout le corps, comme dans la vélocipédie ordinaire, le travail de halage du fil à sonder, si pénible avec le vieux système, c’est-à-dire à bras… On pourra même, ajoutait Van Mirlo, faire des records avec l’aide du compteur de la sonde.”
C’était, en un mot, une invention merveilleuse ; aussi le brevet fut-il accordé. Selon l’usage établi à bord, je mis à la disposition de l’inventeur tout ce qu’il fallait pour réaliser son idée, et Somers, notre maître de forge, suivit ses indications avec son habituelle bonne grâce.
Les essais furent concluants : il fallut, pour relever la sonde, développer trois ou quatre fois plus de force qu’avec “le vieux système, c’est-à-dire à bras”, et, en fait de record, on n’aurait pu établir que celui de la lenteur. Il est juste d’ajouter que d’autres inventions de Van Mirlo, pour être d’une portée moins ambitieuse, furent d’une application plus pratique.
La banquise se ranime peu à peu sous les caresses du soleil, et, chaque jour, nous entendons plus nombreux les kaah… kaah… discordants des manchots, nos amis.
Au cœur de l’hiver, la banquise présentait parfois des lacunes ; des clairières, de longs chenaux ou de simples veines d’eau s’y formaient ; mais elles ne tardaient pas à se combler, soit par congélation, soit par suite de pressions.
À présent qu’il gèle moins, il arrive que des chenaux et des clairières restent ouverts plusieurs jours de suite.
À mesure que la saison avance, ces déchirures deviennent plus nombreuses dans la nappe blanche, infinie, qui nous entoure.
Fréquemment, des cétacés viennent y souffler, trahissant ainsi, non seulement leur proche présence, mais encore la proximité de quelque nouvelle ouverture dans la glace.
Au bord des clairières, des phoques se montrent par petits groupes.
Peu à peu, Racovitza recueille des embryons, de stades de plus en plus avancés.
Les oiseaux aussi planent plus fréquemment au-dessus de nous.
Bref, les occasions se multiplient d’observer, sur le vif, les hôtes habituels de la banquise, et cette étude est autrement intéressante pour le passionné zoologue qu’est notre camarade, autrement attrayante pour nous-mêmes, que ne le serait la contemplation de squelettes, de peaux empaillées, ou de cadavres conservés dans l’alcool, dans les vitrines d’un musée, que ne le serait même celle d’animaux vivants, captifs dans un jardin zoologique.
Les phoques que nous avons rencontrés sur la banquise sont de quatre espèces. Propres aux régions antarctiques, n’ayant pas de représentants dans les glaces du Nord, ces quatre espèces sont les seules citées jusqu’ici comme habitant la banquise australe.
Le plus commun de ces phoques, et aussi le plus petit, est le phoque crabier. Sa taille atteint environ deux mètres et son pelage est d’un blond verdâtre. Il possède des dents aiguës et tranchantes qui lui servent à broyer les coquilles et les carapaces des petits animaux dont il se nourrit. Relativement belliqueux, les phoques crabiers que nous rencontrons au cours de nos promenades sur la glace s’attaquent parfois à nos skis lorsque nous les approchons.
Le phoque de Weddell, beaucoup plus pacifique, est cependant plus grand et plus gros. Il se meut difficilement sur la glace ; sa fourrure est gris fer, marquée de petites taches rondes et jaunes ; il a de beaux yeux ronds au regard humide, presque humain.
Mais le plus grand des phoques antarctiques est le grand léopard de mer (Ogmorhynus leptonix) dont la taille dépasse trois mètres. Agile, méchant, pourvu de très fortes dents, c’est le plus redoutable des habitants de la banquise : sa robe ressemble à celle du phoque de Weddell.
Beaucoup plus tard, le 17 décembre, au cours d’une excursion sur la banquise, Cook et moi nous rencontrâmes pour la première fois, assoupi sur la glace, à trois cents ou quatre cents mètres d’une clairière, un phoque d’une espèce nouvelle pour nous : c’était l’Ommatophoca Rossi, ou phoque de Ross. Ses membres sont si réduits qu’ils sont à peine visibles, ce qui donne à l’animal l’aspect d’un long sac pointu de la forme d’un cigare. Le phoque de Ross se nourrit uniquement de grands poulpes. Chaque fois que nous avons pu, par la suite, en tuer et en dépecer – ce qui est arrivé rarement, car nous n’en avons aperçu que treize pendant notre séjour dans les glaces – nous avons trouvé dans leur estomac des becs de poulpes et, chose curieuse, nous n’avons jamais vu de céphalopodes. Où donc cet animal va-t-il les chercher ?
Tandis que les autres phoques aboient, le phoque de Ross chante ! Oh ! ce n’est pas un chant harmonieux, mais, sur la banquise, on apprend à n’être pas difficile. Lorsque la bête est irritée ou effrayée, son larynx se gonfle fortement, et il en sort une suite peu mélodieuse de roucoulements enroués, de gloussements et de reniflements.
Il n’est pas jusqu’au plancton qui ne se ressente des bons effets de l’été. Les diatomées, que l’hiver avait tuées, teintent de nouveau la glace dans les fentes des chenaux, et la pâle couleur verdâtre dont elles la colorent constitue toutes les richesses de l’été antarctique ; le plancton va puiser, dans sa nourriture favorite, une vigueur nouvelle, et les animaux qui le composent n’en seront plus réduits à se dévorer entre eux pour la conservation de leur espèce.
À bord aussi, malheureusement, la “vie animale” se fait plus intense : nous sommes infestés de rats. Bien malgré nous, nous les avons embarqués à Punta Arenas où, pour le chargement du charbon, nous avons dû amarrer contre un ponton d’où il leur était facile de pénétrer chez nous. L’hiver austral ne semble leur avoir fait aucun mal ; ils se portent à merveille et leur vitalité doit être étonnante, à en juger d’après la façon dont ils se sont reproduits, envahissant toutes les parties du navire. La nuit surtout, ils se livrent à un sabbat épouvantable ; ce ne sont entre eux que disputes et poursuites. Le long des parois de nos cabines, des dégringolades folles nous empêchent de dormir. Impuissants à les écarter, nous les entendons grignoter des choses précieuses, irremplaçables pour nous, avec les débris desquelles ils se construisent, dans la cale, de chauds petits nids. Lorsque Michotte descend dans la soute aux vivres, il lui arrive de mettre la main sur un de ces nids très ingénieusement confectionnés avec des brins de paille, des morceaux de laine ou de coton. Sans le moindre scrupule, nous exécutons les nichées en les noyant dans la veine d’eau la plus proche. Mais nous avons beau en détruire, le nombre de ces parasites par trop indiscrets semble croître de jour en jour.
Nous avons construit des trappes, elles n’ont produit aucun effet. Nous avons ensuite organisé des battues en règle ; plus malins et surtout plus agiles que nous, les rats éventaient toutes nos ruses et continuaient à nous narguer insolemment. Cook alors imagina un système très simple et qui seul donnait parfois un résultat satisfaisant : de grands cornets de papier étaient disposés çà et là, puis les traqueurs, armés de bâtons, entraient en campagne. L’un ou l’autre des rats, effrayé par le bruit, allait se réfugier dans un des cornets ; le docteur alors, avec une prestesse extraordinaire, fondait dessus et fermait vivement l’ouverture. Mais qu’était-ce qu’un rat de moins dans une armée comme celle qui avait investi le navire ?
En dépit des distractions que nous nous évertuions à imaginer, notre existence présentait une monotonie grandissante qui se reflète trop, peut-être, au gré du lecteur, dans ce récit sincère.
Tous, nous aurions donné gros pour changer de milieu, fût-ce pendant vingt-quatre heures. Aussi, lorsque Lecointe voulut entreprendre, avec Amundsen et Cook, une excursion vers un bel iceberg tabulaire que nous avions en vue, à une grande distance, je compris ce désir et y accédai volontiers.
Le 30, nos trois camarades quittèrent donc le bord, emmenant un traîneau sur lequel avaient été chargés : une tente faite de draps de lit et qui devait remplacer celle en soie à ballon si malencontreusement déchirée à l’île Brabant, trois sacs de couchage, quelques litres d’alcool et un réchaud ; enfin, une certaine quantité de vivres en boîtes.
Ils n’allèrent pas loin ; le soir même, ils étaient arrêtés par une crevasse infranchissable, au bord de laquelle ils établirent leur campement, en attendant qu’une pression se produisît, qui rapprochât le champ de glace voisin.
Ils construisent une maison de neige, ronde, à la manière des Esquimaux. À quelques pas, la tente est dressée et sert de hangar pour le matériel.
Mais les jours passent et la crevasse ne se ferme pas ; la brume est intense et le froid vif (-35°) ; les vivres commencent à diminuer d’inquiétante façon ; il faut songer au retour ; malheureusement, la brume noie les hummocks qui doivent servir de point de repère ; d’autre part, le compas attaché au traîneau est mis hors d’usage par les secousses et les heurts dès qu’on reprend la marche.
Pour comble de malheur, la banquise se met en mouvement et se crevasse de toutes parts ; il faut camper pour la nuit, et nos voyageurs, après avoir choisi une plaque de glace qui leur paraît assez solide, s’y installent aussi confortablement que possible. Mais à peine le campement est-il établi que le glaçon, détaché, part à la dérive. Très petit déjà, il se ronge et s’effrite constamment ; la situation devient critique ; bientôt, la glace ferme ne s’étend plus guère au-delà de la tente.
Heureusement, il fait clair le lendemain. Inquiet sur le sort des absents, je monte au nid de corbeau, d’où je puis me rendre compte de leur détresse. Immédiatement, j’envoie à leur secours des matelots, amarrés les uns aux autres et qui, passant de glaçon en glaçon, les aident à se tirer de leur dangereuse situation.
Cette aventure nous servira de leçon, et, désormais, nous nous abstiendrons de toute excursion prolongée sur le pack. En supposant, d’ailleurs, que nous voulions étendre de la sorte nos investigations vers le sud, le résultat de pareilles tentatives serait très problématique, car la dérive peut nous porter plus rapidement vers le nord que nous ne marcherions vers le pôle.
2 août. J’ai aujourd’hui trente-deux ans. Dois-je dire “déjà” ou “seulement…” ? – “Déjà”, si l’on considère la rapidité avec laquelle s’écoule l’existence… “Seulement”, si, dans le miroir, j’examine mes précoces cheveux gris et si je songe aux rhumatismes dont je souffre parfois cruellement.
Quoi qu’il en soit, je n’oublierai pas de sitôt cette journée ; au souvenir de cet anniversaire passé dans les glaces polaires, si loin du lieu de ma naissance, restera lié celui d’un des plus beaux levers de soleil qu’il m’ait été donné de contempler. Il était à peine sept heures que déjà l’horizon était tout empourpré à l’orient par le jour naissant ; peu à peu, la lueur aurorale devenant plus vive à mesure qu’elle gagnait le zénith, avait pris l’aspect d’une immense conflagration, grâce à de longs stratus filamenteux qui semblaient diviser cette lueur en autant de flammes gigantesques ; de gros nuages sombres, flottant, semblables à de la fumée, dans les régions plus élevées, complétaient encore l’illusion. Une percée dans ces nuages laissait voir le ciel, ou plutôt, d’autres nuages, si singulièrement éclairés que leurs couleurs amalgamées s’unissaient dans l’éclatante douceur d’une plaque de nacre du plus bel orient. Naturellement, c’est de ce côté que se portèrent mes pas, à l’heure de la promenade quotidienne, après le déjeuner.
Un large chenal s’était ouvert la veille dans cette direction. Considérablement élargi pendant la nuit, il formait une vaste clairière où se reflétait le soleil levant.
Arrivé au bord de cette clairière, je jouis d’un spectacle nouveau et inattendu : tournant le dos à la grande plaine blanche qui emprisonnait la Belgica, j’avais l’illusion parfaite d’un lever de soleil vu de la rive d’un large fleuve. De l’eau, qu’aucun souffle n’agitait, s’élevait une légère buée, tandis que, baignée dans cette vapeur transparente, plongée encore dans la pénombre, la banquise, surélevée un peu par un effet de mirage, simulait la rive opposée du fleuve. Les grands icebergs tabulaires, là-bas, tout à l’horizon, présentant leur face non éclairée, semblaient autant de bâtiments plongés, eux aussi, dans ces vapeurs lumineuses qui s’élèvent des cours d’eau à l’aube d’un beau jour… Mais, peu à peu, l’astre qui montait sur l’horizon finit par éclairer, toujours très obliquement, mais non plus tangentiellement, les aspérités de la banquise.
Celle-ci apparut alors dans sa blancheur immaculée… L’illusion s’était effacée !
C’est de l’autre côté de cette vaste clairière que se trouvaient Lecointe et ses deux compagnons, qui ne rentrèrent à bord que le lendemain.
Les jours suivants le temps est morne ; le ciel, entièrement voilé, ne laisse arriver sur la glace que de la lumière diffuse ; il neige par intervalles ; le pack est uniformément blanc ; aucune ombre n’estompe plus les hummocks et les inégalités de la banquise : on n’y voit pas au-delà des skis.
Le beau temps est rare maintenant et ne se maintient guère ; mais, lorsque le soleil brille, la banquise est si éblouissante que nos yeux n’en peuvent supporter l’éclat ; nous ne sortons pas alors sans conserves.
Si généralement le ciel est gris et bas, il nous est donné cependant d’observer d’admirables phénomènes optiques. Les aurores et les crépuscules sont parfois d’une beauté féerique. Autour du soleil et de la lune apparaissent souvent des couronnes, des halos, des parhélies* ou parasélènes* splendides. Fréquemment aussi, l’azur est coupé, du côté opposé au soleil, par de beaux arcs-en-ciel.
Souvent le mirage, le matin surtout, surélève en apparence les bords de la banquise, qui semblent alors se dresser verticalement comme des murailles de glace. Parfois aussi, par suite de la réfraction, nous pouvons voir de grands icebergs tabulaires qui se trouvent au loin, en dessous de notre horizon.
Le 25 août, les matelots Koren et Van Mirlo nous donnent les plus vives inquiétudes. Profitant du congé du jeudi, ils sont partis à skis après le repas de midi et ne sont pas rentrés le soir. Pendant l’après-midi, une brume assez dense s’est abattue ; il vente et il neige ; les malheureux se sont probablement égarés dans la tourmente. À huit heures, je fais hisser deux fanaux blancs ; puis Lecointe, Amundsen, Arctowski et Cook, munis de signaux phoniques, quittent le bord pour explorer la banquise aussi loin que la brume leur permet de s’aventurer ; ils rentrent à neuf heures et demie sans avoir ni vu ni entendu les deux hommes.
Le lendemain matin, à six heures, au moment où je me disposais à partir à leur recherche avec Racovitza et quelques hommes, Koren et Van Mirlo rentrent à bord ; c’est un grand soulagement pour tous. Les imprudents me racontent que, la brume les ayant empêchés de retrouver le navire, la veille, ils ont construit un abri avec des blocs de glace et qu’ils y ont passé la nuit, tant bien que mal.
En août, la température s’est relevée : moyenne -11,3°. Mais au commencement de septembre, elle descend plus bas que jamais : le 8, à quatre heures du matin, le thermomètre tombe à -43,1°, chiffre minimum de tout le voyage. La moyenne de septembre est de -8,5°.
Nous faisons, vers cette époque, plusieurs expériences de conflagration de la glace par la tonite. Peut-être serons-nous forcés de faire sauter le floe autour du navire pour nous dégager, le moment venu ; nous voulons savoir de quelle force nous disposons. À cet effet, trois ou quatre kilogrammes de tonite sont déposés dans une petite cavité convenablement préparée. Aussitôt que la mèche au fulminate est allumée, nous nous empressons de détaler pour ne nous arrêter, comme le commande la plus élémentaire prudence, qu’à cinq ou six cents mètres. Le résultat est pitoyable : on entend un bruit sourd, une certaine quantité de bouillie de glace est projetée dans l’air, tandis qu’un trou pas bien grand se forme dans la banquise.
Nous renouvelons plusieurs fois nos expériences sans parvenir à percer complètement la glace.
Vers le 20 septembre, il dégèle fortement ; les blocs de givre détachés du gréement s’abattent sur le pont avec fracas ; bientôt les agrès sont entièrement dégarnis de neige et de glace.
Nous commençons à déblayer le pont ; la dunette était couverte d’une couche de neige de trente à quarante centimètres.
Le 21 septembre, l’état-major se réunit pour arrêter le programme de la saison d’été. Après une discussion dans laquelle chacun a donné son avis, il est décidé que nous gagnerons la mer libre aussitôt que nous le pourrons et que nous compléterons nos recherches zoologiques et océanographiques au large de la terre de Graham ; puis nous explorerons la partie ouest de l’archipel de Dirck Gherritz ; enfin, nous tâcherons de relier notre lever à celui de Dumont d’Urville. Nous ne pouvons plus songer, même si une détente suffisante se produisait, à nous avancer davantage dans la banquise ; nous sommes tous trop affaiblis pour courir les risques d’un second hivernage.
En vue de la délivrance, que nous espérons prochaine, nous enverguons les voiles. Nous fondons tous les jours une grande quantité de neige afin de remplir les caissons à eau. Nous démontons soigneusement, pièce par pièce, la toiture du pont, qui devra peut-être encore servir.
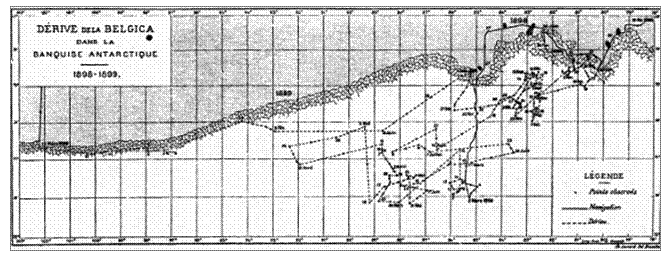
Au commencement d’octobre, des clairières sont visibles dans toutes les directions, mais nous demeurons toujours bloqués dans notre floe. Celui-ci mesure plus de deux milles de diamètre. Sur le bord le plus voisin du navire, à six cents mètres environ, une clairière s’ouvre et demeure béante, ne se refermant plus que partiellement et temporairement à la suite de pressions. Ces pressions déterminent des crevasses, qui ébrèchent peu à peu notre champ de glace ; mais ce travail de la nature est bien lent.
Par les grands froids qui règnent encore souvent, la glace se forme rapidement dans les clairières ; nous avons observé dans le trou à eau qu’en quarante-huit heures elle atteint jusqu’à dix-neuf centimètres d’épaisseur.
Comme la température, la dérive est fonction du vent. D’une manière générale, nous dérivons dans le sens des courants atmosphériques. Mais un autre élément semble intervenir pour modifier parfois la direction : c’est la configuration des côtes qui sûrement se trouvent dans l’est et dans le sud. Lorsque le vent souffle de l’ouest la dérive s’infléchit généralement vers le nord-est.
Il semble qu’à mesure que la glace est poussée vers l’est, elle se rapproche d’un obstacle qui la fait dévier, glisser vers le nord. Sur la carte de la dérive, on ne voit qu’une ligne dirigée au sud-est (22-24 août 1898). Le continent semble même plus proche à l’est de notre position moyenne, qu’au sud. Je crois que, par 90° de longitude ouest, il y a lieu de repousser au-delà du 74e parallèle, et peut-être beaucoup plus loin, les côtes de l’Antarctide.
La dérive nous mène, nous emmène, nous ramène, nous promène. Le 31 mai, un de ses caprices nous a fait atteindre notre latitude extrême : 71° 36’ ; le 1er novembre, elle nous reconduit au point exact où nous avons passé le 22 février, en naviguant à la vapeur.
De la marche générale de cette dérive, on peut conclure que, durât-elle plusieurs années, elle ne nous conduirait pas plus avant dans la direction du pôle. Aussi est-il exaspérant, à la longue, d’aller ainsi sans but, sans direction, de-ci de-là, au gré des forces aveugles que nous sommes impuissants à maîtriser, dont nous sommes incapables de nous affranchir.
Le 28 octobre, conformément à la promesse faite à l’Institut historique de Rio de Janeiro, pendant la séance solennelle du 28 octobre 1897, je fais hisser au grand mât les couleurs brésiliennes…
En novembre, les chasse-neige sont toujours très violents ; la neige, chassée sur la banquise, forme du côté du vent un talus qui s’élève de plus en plus haut ; la nouvelle neige glisse sur l’ancienne et arrive jusqu’au navire, où elle tourbillonne entre le laboratoire et le rouf arrière, et s’amasse à un mètre de hauteur sur le pont dégarni trop tôt de la toiture qui l’abritait.
Le 6 novembre, il devient difficile de sortir du rouf arrière à cause de la neige amoncelée contre les portes.
Le 19, la communication entre le carré et le laboratoire est devenue si malaisée par suite d’une nouvelle tourmente que, pendant son quart de nuit, Arctowski doit renoncer à faire des observations horaires des baromètres anéroïde et marin installés à l’arrière, et se contenter d’observer un baromètre du laboratoire.
Le 21, tout l’arrière est presque enseveli. L’état-major aide l’équipage à dégager le navire, et ce n’est qu’après plusieurs jours que le déblaiement est enfin achevé.
Pendant tout l’été les chasse-neige continuèrent aussi fréquents que pendant l’hiver. Au cours d’une année révolue, de mars 1898 à mars 1899, nous compterons deux cent cinquante-sept jours de neige.
Il n’est pas toujours facile de savoir si elle est précipitée – c’est-à-dire s’il neige – ou si, simplement, elle est transportée par le vent. L’examen attentif des formes cristallines peut seul, bien souvent, donner la solution au problème.
Après les tempêtes de neige, la banquise prend l’aspect d’un désert de sable ; des ondulations douces se produisent par places à la surface ; devant les obstacles, tels que les hummocks, ce sont des pentes légèrement montantes, avec, subitement, une pente raide ; derrière les hummocks, au contraire, de longues traînées de neige s’accumulent ; puis ce sont des rides avec de petites crêtes, tout comme sur les plages au bord de la mer.
Ce n’est que le 27 novembre que nous avons le spectacle du soleil de minuit.
Depuis une dizaine de jours déjà, il ne disparaissait plus sous notre horizon ; mais, le temps ayant été presque constamment couvert, nous n’avions pas encore pu le voir à cette heure. Tout le personnel est resté levé pour assister à ce spectacle que la sérénité du ciel avait annoncé et qui jamais encore n’avait été contemplé dans la zone australe à pareille époque de l’année.
La variation diurne de la température devient très sensible. Nous touchons au milieu de l’été.
De jour en jour s’amincit la couche de neige qui recouvre la glace. Dépouillés de la blanche fourrure qui arrondissait leurs contours, les hummocks présentent maintenant des angles saillants.
Sur le pack, de grandes flaques d’eau de fusion se forment, lui donnant cet aspect lamentable des champs de glace aux premiers jours de dégel, que connaissent bien les patineurs.
Le 6 décembre, à l’occasion de la Saint-Nicolas, j’offre à l’équipage une caisse de cigares, qui est reçue avec reconnaissance.
Mais les semaines passent et toujours la banquise est close. Chaque jour, je l’examine longuement du nid de corbeau, et c’est à peine si j’y découvre quelques veines et quelques lagunes. Notre floe s’entame parfois un peu par suite de pressions qui s’exercent sur ses bords et que nous percevons parfaitement pendant la nuit, lorsque tout est tranquille.
Vers la mi-décembre, le docteur, Amundsen et Tollefsen partent en excursion vers un grand iceberg tabulaire qu’on relève au loin dans l’est. Ils ne reviennent que le lendemain, après l’avoir escaladé. Ils estiment ses dimensions à six cents mètres sur quatre cents, et trente-cinq mètres de hauteur. Chemin faisant, ils ont rencontré de nombreux hummocks, très grands et tout récents, formés sans doute par les pressions dont nous entendions, tandis qu’ils s’en allaient, le bruit, pareil au son lointain de sirènes à vapeur. Quelques jours après, des changements considérables se produisent dans les positions relatives des icebergs qui nous entourent. La distance qui nous sépare du plus grand de nos voisins d’hivernage, précisément l’iceberg tabulaire que nos compagnons ont visité, semble diminuer. Un bloc plus petit, qui présente deux éminences en forme de tours carrées, se détache maintenant sur la gauche d’un iceberg incliné, tandis que, quelques jours auparavant, il se trouvait à une vingtaine de degrés sur la droite.
Le 20 décembre, nous ouvrons le panneau de la machine.
Le 22, les mécaniciens étant parvenus à faire accomplir un tour complet à l’hélice, les feux sont chargés afin d’essayer la machine qui marche pendant une heure ; puis la chaudière, dont le plein avait été fait avec de l’eau de mer pour cet essai, est vidée, et peu à peu nous la remplissons d’eau douce.
Nous sommes au cœur de l’été, et cependant, certains jours, lorsque le vent souffle du sud, il fait assez froid pour que la jeune glace se forme sur les rares clairières ; par vent du nord, il fait presque chaud.
Le 23, nous enlevons, au moyen d’eau bouillante, la glace qui encombre la jaumière.
À l’aide de la sonde géologique, Arctowski mesure l’épaisseur de la glace en divers points du floe ; à cent mètres environ du navire, près d’un hummock, il trouve plus de huit mètres.
Le 24 décembre, après le souper, je remets au personnel subalterne quelques effets d’habillement, des couverts, des cigares et double ration de tabac en guise de cadeaux de Noël. Le lendemain, avant le dîner, l’état-major descend dans le poste pour y prendre un verre de vin avec l’équipage.
Le menu du repas de midi, plus soigné qu’à l’ordinaire, se compose de : soupe aux poireaux, roulades de veau aux pommes de terre, pâté de volaille, plum-pudding au rhum, une bouteille de château-semeilhan, café et vieille fine champagne.
Mais la fête manque d’entrain, car chaque jour qui passe diminue maintenant nos chances de délivrance. La mélancolie de tous est encore accrue par l’état mental de celui de nos matelots dont la raison s’est égarée. Atteint de la manie de la persécution, ce malheureux ne dort presque plus et fuit la société de ses camarades dans lesquels il voit des ennemis.
Nous avons noté, pour le mois, quelques températures positives. La moyenne est de -2,2°.
Le 31 décembre, nous sommes par 70° 03’ S et 85° 20’ O, c’est-à-dire près du point où nous avons rencontré l’iskant à notre entrée dans le pack, il y a dix mois. Et, cependant, depuis lors, notre dérive en tous sens nous a fait couvrir plus de mille trois cents milles !
Du nid de corbeau, on voit au loin, dans l’est, une clairière très étendue. Autour de notre floe, néanmoins, la situation reste stationnaire. La clairière voisine subsiste toujours, là-bas, à quelque six cents mètres par tribord ; mais, étroitement enchâssée dans son étau de glace, la Belgica est impuissante à l’atteindre.
Au loin, les icebergs continuent à se mouvoir en sens divers, ce qui indique évidemment que la banquise n’est pas partout aussi compacte qu’aux abords immédiats de notre bâtiment.
À onze heures du soir, j’envoie une lettre de souhaits à chacun des membres de l’équipage.
À ces lettres sont joints des “bons” à toucher au retour de l’expédition. Ce sont là mes cadeaux à ces braves gens. Les matelots recevront une gratification ; les mécaniciens et le maître d’hôtel, un chronomètre en or.
Les officiers et le personnel scientifique réveillonnent avec les matelots.
1er janvier 1899. Le drapeau national et le guidon du yacht-club d’Anvers sont arborés.
Dans la matinée, je descends dans le poste avec Lecointe ; tout y est en bon ordre et le moral des hommes paraît satisfaisant, malgré la grave perspective d’un nouvel hivernage.
À midi, dîner de gala : potage aux tomates, garniture de vol-au-vent (sans pâte), grouses aux pommes de terre, myrtilles, pudding de la Vega, porto, château-ferrand, moët-et-chandon.
XII
DÉLIVRANCE
Nous entreprenons d’ouvrir un canal. – À la pioche, à la scie et à la tonite. – Graves inquiétudes. – Préparatifs pour l’évacuation éventuelle du navire. – Rationnement en prévision d’un second hivernage. – Détente. – Sous vapeur. – Nouvel emprisonnement. – La mer promise. – Conclusions à tirer de nos sondages.
Au commencement de janvier, nous ne pouvons plus supporter notre inaction. Il faut tenter quelque chose, mais quoi ?
L’expérience des longs mois qui viennent de s’écouler nous montre clairement que nous ne devons plus compter sur le soleil et le dégel, insuffisants pour ouvrir la banquise même en plein été.
Nous nous y sommes faufilés à la faveur d’une tempête qui la disloquait : il faudrait une occasion semblable pour en sortir ; nous sommes las d’attendre. Après délibération, sur la proposition de Cook, nous décidons, en nous servant d’explosifs et des scies spéciales que nous possédons, d’ouvrir dans le floe une tranchée qui l’affaiblira et en déterminera peut-être la rupture. Si nous n’obtenons aucun résultat, du moins nous emploierons l’équipage à un travail violent, qui le distraira de l’inquiétude que je commence à lire sur tous les visages. L’inaction est devenue dangereuse ; elle conduirait, à brève échéance, à un découragement qui aurait, pour la santé de tous, les plus graves conséquences.
Le 7 janvier, une détente se produit ; la clairière voisine s’élargit, elle s’allonge vers le nord-est ; les vapeurs foncées dont l’horizon est chargé témoignent de l’existence de lointaines clairières. Nous commençons, suivant l’axe du navire, une tranchée orientée de l’étrave vers le chenal qui prolonge la clairière.
Les distances hiérarchiques sont abolies : du commandant aux matelots, le personnel entier, divisé en deux bordées*, maniera jour et nuit la pioche et la scie.
Le 9, poursuivant notre travail, nous avons, sur toute la longueur du tracé, débarrassé la glace de la couche de neige qui la recouvre ; puis, nous avons attaqué, à la pioche, la couche de névé qui a vingt à vingt-cinq centimètres d’épaisseur, et nous sommes arrivés, enfin, à la couche aquifère, épaisse également d’une vingtaine de centimètres ; en sorte que nous avons, se dirigeant de l’étrave jusqu’au chenal d’eau libre sis au nord-est, comme une rigole suivant laquelle nous nous proposons de scier et de faire sauter la glace. Nous essayons une torpille composée d’un tuyau de grès rempli de seize kilogrammes de tonite et filée sous la glace dans un trou préalablement ouvert au moyen d’une petite charge du même explosif. Mais l’explosion ne produit qu’un agrandissement insignifiant du trou.
Le lendemain, arrivés près de l’extrémité de la tranchée, nous en commençons une seconde formant un V avec la première, dans l’espoir d’arriver à faire un chenal. La forme en V facilitera l’évacuation de la glace, qui devra être sciée suivant les tranchées latérales et transversales. Le même jour, nous commençons à scier suivant la première tranchée, en partant de l’eau libre. À cet endroit, la glace n’a pas plus d’une cinquantaine de centimètres d’épaisseur et nous faisons aisément quinze mètres à l’heure. Mais, après cent cinquante mètres, nous trouvons une région plus épaisse et le travail devient beaucoup plus difficile.
Le 11 janvier, nous faisons exploser une nouvelle torpille ; elle produit un trou d’une dizaine de mètres de diamètre, et qui reste rempli de glace réduite en bouillie et en petits fragments. Ce résultat est absolument insuffisant, et, d’autre part, il est impossible d’entamer, à la scie seulement, la glace avoisinant le navire, car elle compte jusqu’à cinq mètres d’épaisseur. Force nous est donc d’abandonner les travaux dans cette direction.
Je propose alors, et nous décidons, d’ouvrir un canal dirigé de l’arrière du navire vers la clairière, en suivant, autant que possible, un chenal qui, s’étant ouvert le 13 mai dernier, s’est refermé depuis par congélation. Cette veine est recouverte d’une couche de glace bien unie, qui n’a pas plus de un mètre d’épaisseur. Toutefois, pour la rejoindre, nous devrons, sur une longueur de cent mètres, scier de la glace épaisse de deux mètres.
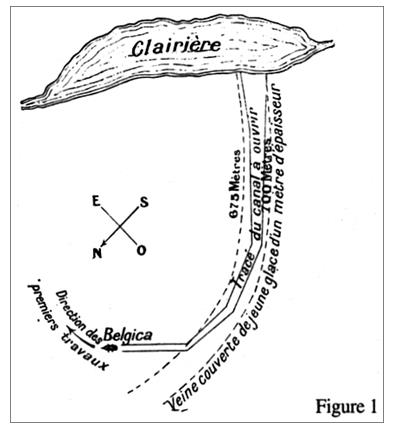
Le tracé que nous adoptons est deux fois coudé (figure 1) ; le bord intérieur aura une longueur de six cent soixante-quinze mètres ; le bord extérieur en aura sept cents. Ce tracé présente l’inconvénient grave d’aboutir à l’arrière du navire. Il faudra donc faire machine arrière et présenter au choc des glaces deux organes essentiels, l’hélice et le gouvernail. Mais nous n’avons pas le choix des moyens, et, sans retard, nous nous remettons à la besogne.
Dès le 12 janvier, nous procédons au jalonnage du floe. Puis nous creusons, à la pioche, des tranchées de un pied de largeur, en partant nécessairement de la clairière. Nous enlevons d’abord les couches de neige et de névé ; nos tranchées présentent l’aspect de rigoles au fond desquelles stagne l’eau qui se trouve entre le névé et la vieille glace : c’est celle-ci qu’il faut scier.
Le 13, nous voyons un oiseau des tempêtes, le premier que nous rencontrons dans le pack. Peut-être est-ce un indice de la proximité de la mer libre, et pouvons-nous le considérer comme le porteur du rameau de la délivrance : il y a dix mois que nous sommes prisonniers, tout comme la famille de Noé dans l’arche.
Nous commençons, le 14, à scier la vieille glace et avançons pendant la matinée de quarante mètres environ de chaque côté. Le 15, nous entreprenons des tranchées transversales d’après la disposition représentée par la figure 2. Nous détachons, au moyen de charges de tonite de trois à cinq kilos, les soixante-dix ou quatre-vingts premiers mètres de glace, qui sont ensuite évacués dans la clairière au moyen d’espars et d’avirons.
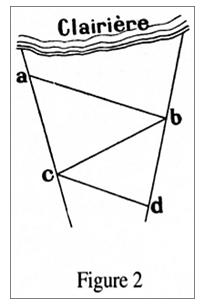
L’explosif, quoique employé en plus petite quantité que pour les expériences précédentes, produit maintenant l’effet demandé parce que la proximité de l’eau permet le mouvement d’expansion latérale dans le sens voulu.
Un petit manchot assiste de très près à l’une de ces explosions et ne manifeste aucun effroi.

Le 16, nous faisons encore quarante-cinq mètres environ à gauche et trente mètres à droite, le matin, et à peu près autant l’après-midi ; puis nous recourons de nouveau à la tonite. Mais, pour détacher le premier bloc seul, nous sommes obligés d’employer successivement six charges, soit environ vingt kilos d’explosif. Ces explosions répétées produisent beaucoup de bouillie que le vent empêche de sortir du chenal et qui, sous l’action du froid, ne tarde pas à reformer une masse compacte dans laquelle il faudra scier à nouveau.
Le 17, toute la glace brisée la veille par la tonite s’est ressoudée. Nous reconnaissons que notre système de partage de la glace en plaques triangulaires est défectueux : en effet, lorsque nous usons de la tonite, la plaque sciée reste souvent coincée par suite de l’expansion. Nous adoptons le système de la figure 3, bien que la quantité de glace à trancher soit plus considérable. Ce ne sont plus des triangles, mais de grands quadrilatères que nous détachons.

La petite baleinière est affalée* et ensuite halée jusque dans la clairière, afin de remorquer en dehors du chenal la glace qui encombre l’entrée. Mais la brise est fraîche et souffle droit dans la direction du chenal. Nous éprouvons les plus grandes difficultés à faire sortir ainsi trois glaçons de petites dimensions.
Le 18 et le 19 janvier, il fait très froid et la couche aquifère des tranchées gèle rapidement. Le travail se poursuit cependant nuit et jour. Du nid de corbeau, on voit un peu plus d’eau libre que les jours précédents. Le ciel est gris, voilé de brume ; la neige tombe fréquemment, tantôt floconneuse, tantôt fine et abondante.
Le 20 janvier, un hyperoodon pénètre dans la partie dégagée du canal et y évolue très à l’aise : nous en sommes tout fiers !
Après le souper, celui de nos hommes qui a perdu la raison sort à skis pour se promener. Son absence se prolonge au point de donner les plus vives inquiétudes et le travail de nuit est interrompu afin d’aller à sa recherche. Le malheureux rentre tranquillement à bord à deux heures du matin, sans se douter des angoisses qu’il a causées.
Le 22 janvier, à quatre heures du matin, le canal atteint près de quatre cents mètres de longueur. Il reste environ deux cent cinquante mètres à scier pour arriver à l’arrière de la Belgica. Nous avons été obligés de tendre une amarre en travers de l’entrée pour empêcher la glace flottante de la clairière de venir l’obstruer à nouveau.
Le 26, le travail, si pénible déjà, devient plus rude encore. Nous ne sommes plus dans le chenal ouvert en mai, mais dans de la glace plus ancienne et par conséquent plus épaisse. Nous arrivons pourtant, le 27, tout contre l’arrière du navire.
Le lendemain, notre pauvre fou, qui paraît à bout de forces, quitte son travail dans la matinée et va se coucher ; il déclare cependant n’être ni fatigué, ni malade. Son état mental ira désormais s’aggravant.
Pendant que sans relâche nous poursuivons le percement du canal, la dérive, si hésitante jusque-là, a pris une direction nettement déterminée : navire, champ de glace, canal, clairière, tout se transporte de l’est à l’ouest.
Le 30 janvier, il ne nous reste plus à scier que quelques mètres de glace à l’arrière de la Belgica. Vers neuf heures du matin, des pressions se font sentir ; une grande crevasse, dirigée de l’étrave jusqu’à la clairière et parallèle à peu près à la direction générale du canal, s’ouvre devant le floe. Plus large, elle serait la délivrance ; telle qu’elle se présente, elle n’a d’autre effet que de rétrécir notre canal et de placer le navire en quelque sorte à la charnière des pressions (figure 4). Heureusement la glace qui subsiste à l’arrière le protège.
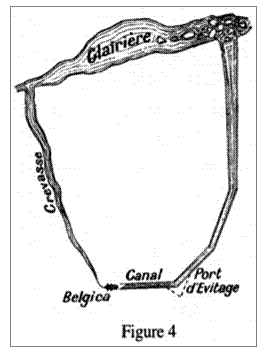
Nous embarquons divers objets laissés sur le floe et nous hissons à poste la petite baleinière qui a servi à l’évacuation des glaces. Les feux sont rallumés. Du nid de corbeau, on voit, l’après-midi, de nouvelles fissures ; par contre, la clairière voisine est très réduite ; elle ne s’étend plus au sud que jusqu’à l’entrée de notre canal, tout obstruée de glaçons.
Le 31 janvier, la crevasse s’est élargie, tandis que, par une conséquence naturelle, notre canal s’est rétréci. Mais ni l’un ni l’autre ne sont praticables. Les pressions sévissent en poupe. Considérée du nid de corbeau, la banquise est très compacte, bien que plus fragmentée.
Tout est remis en question. Le dur labeur des trois dernières semaines semble inutile, nuisible presque à notre sécurité. Nous envisageons, avec un désespoir que nous cherchons à nous dissimuler les uns aux autres, l’éventualité d’une seconde année d’emprisonnement dans la banquise. Nous avons assez de provisions pour vivre, en nous rationnant, pendant treize ou quatorze mois ; mais notre navire résistera-t-il à une nouvelle épreuve aussi prolongée ? Nous-mêmes ne sommes-nous pas bien affaiblis ?
Dès à présent, le diagnostic si sûr du docteur a désigné parmi nous quatre victimes, hors d’état de supporter une seconde fois la nuit polaire et que, seule, la sortie des glaces pourrait sauver !
Cependant il faut envisager d’un cœur ferme les pires éventualités et chercher à tirer le meilleur parti possible d’une situation presque désespérée. La baleinière moyenne et le canot major* sont amenés et halés jusque dans le canal où nous expérimentons leur stabilité et leur capacité ; puis nous faisons des essais comparatifs de halage sur la glace, afin de décider laquelle de ces embarcations il conviendrait d’équiper en vue d’une évacuation forcée de la Belgica. Notre choix tombe sur le canot major, et nous nous mettons immédiatement à la construction d’un traîneau pour le transport sur la glace de ce fragile esquif dans lequel tiendra bientôt, peut-être, tout notre espoir de salut.
Je fais un relevé des vivres restant à bord et je dresse des menus qui nous permettront de les faire durer tous jusque vers le 15 avril 1900, même sans l’appoint certain que nous fournirait la chasse.
Cependant, de cinq cents grammes, la ration hebdomadaire de beurre et de sucre est réduite à cent cinquante grammes par homme ; celle de pain est réduite à un pain de cent grammes et un biscuit de soixante-cinq grammes par homme et par jour. Inutile d’ajouter que cette mesure est générale et que l’état-major est traité exactement de la même manière que l’équipage. Dans le danger croissant, les situations s’égalisent singulièrement ; plus que jamais nous sommes frères et nous luttons ensemble pour le salut commun.
Pendant le mois de janvier, les vents ont été surtout de la partie est-nord-est. Aussi nous trouvons-nous, à la fin du mois, à environ soixante-quinze milles dans l’ouest-sud-ouest du point occupé le 3 décembre. La température s’élève parfois à quelques dixièmes de degré au-dessus de zéro. Le minimum thermométrique du mois est de -8,1° (2 janvier à deux heures du matin) ; la moyenne est de -1,2°.
Le 1er février, le pont est couvert de neige et, du nid de corbeau, la banquise apparaît désespérément close. C’est à peine si, de loin en loin, on distingue une veine étroite. Le froid est vif, l’air piquant, on se croirait déjà en hiver. Le canal, ouvert au prix de tant d’efforts, s’est peu à peu recouvert de jeune glace ; la crevasse aussi est gelée. Il ne semble plus que nous puissions éviter un second hivernage.
Cependant, lorsqu’il fait très clair, l’azur du ciel est souvent plus foncé au nord ; vers le soir surtout, une grande traînée sombre, qui va s’accentuant chaque jour, s’estompe sur l’horizon du côté du large. Nous nous perdons en conjectures sur les causes de ce phénomène. Ne serait-ce pas tout simplement un lointain watersky ?
Beaucoup d’animaux nous entourent encore, et chaque jour nous tuons des phoques et des manchots ; parfois un pétrel vient se poser sur le gréement ; des bandes de trente à quarante ossifragas se reposent sur la banquise.
À bord, les travaux se poursuivent activement en prévision d’une évacuation forcée du navire. Le traîneau destiné au halage de l’embarcation que nous avons choisie est achevé ; nous ajoutons quelques caisses de vivres assortis à celles qui sont restées préparées dans l’entrepont pendant tout l’hiver ; nous composons pour chaque homme un trousseau qui est enfermé dans un sac en toile portant le nom du propriétaire. Nous constatons alors tous les ravages qu’ont faits les rats dans nos réserves de vêtements. Le voilier fabrique des gaines pour les registres et les cartes. Des peaux de phoques séchées sont découpées en lanières qui nous feront des traits solides et serviront à toutes sortes d’usages.
… Le 4 février, la Belgica commence à se balancer un peu ; les chocs qu’elle reçoit par tribord sont réguliers, comme rythmés. Nous reconnaissons bientôt que la glace s’est morcelée davantage et qu’un léger, presque imperceptible mouvement de houle en anime les fragments. À chaque nouveau choc, la membrure du bâtiment gémit, grince ; les baux* ploient, laissant un vide entre eux et les bordages* du pont. Pendant la nuit, les pressions se font sentir plus fortes ; les frictions de la glace contre nos murailles produisent un bruit sourd qui nous empêche de dormir. Le lendemain, la houle cesse ; malgré son morcellement plus grand, la banquise reste compacte ; la couche de glace et de neige qui recouvre notre canal est maintenant assez épaisse pour qu’on puisse s’y aventurer.
Le 11 février, grande détente dans la banquise, si close la veille encore. La houle se manifeste de nouveau ; des craquements se produisent dans notre floe. Du nid de corbeau, on voit de longs chenaux orientés au nord-nord-est. Vers sept heures et demie du soir, la houle s’accentue, devient très sensible ; le canal se crevasse tout au long ainsi que la fissure de proue. Je fais activer les feux de façon à être rapidement sous pression en cas de besoin.
À trois heures du matin, le 12, la fente qui lézarde le canal s’élargit ; nous pouvons croire un instant qu’il va être possible de faire machine arrière, mais bientôt, hélas ! le pack se resserre. Nous faisons sauter, à la tonite, les derniers blocs qui adhèrent à l’arrière et que nous avions respectés, à cause de l’efficace protection qu’ils offraient contre les pressions. Mais le chenal continue à se refermer, la glace fragmentée à se coincer. Tandis que nous scions la jeune glace et l’enlevons par quartiers, le temps devient mauvais ; il tombe de la neige pulvérulente.
Le 13 février, nous scions dans le coude le plus proche de grandes plaques qui, poussées au-dehors, ménageront en cet endroit un petit havre où le navire pourra éviter* (figure 4).
Le lendemain, vers huit heures du soir, nous profitons d’une détente pour faire machine arrière jusqu’au-delà du port d’évitage*. Faisant alors sauter à la tonite les plaques que nous y avons découpées et dont le vent pousse les débris dans la partie que nous venons de quitter, nous entrons dans le petit port. Mais, tandis qu’au moyen d’aussières fixées sur la glace par des ancres spéciales nous tâchons de tourner le navire cap pour cap, le pack se resserre au moment même où la Belgica se présente aux pressions dans le sens de sa quille. Nous courons le danger d’avoir notre gouvernail mis en pièces, notre hélice endommagée. Par bonheur, nous nous en apercevons assez tôt pour nous dégager. Nous restons dans l’expectative. Il est près de minuit.
À deux heures du matin, le 15 février, une nouvelle détente se produit. Le canal s’ouvre largement : nous évitons sans peine cette fois, et par notre canal nous gagnons à toute vapeur la clairière, puis une autre, plus vaste, située à un mille environ au sud de notre station d’hivernage.
Mais ce n’est pas encore le salut. Cette lagune où la Belgica vient d’entrer, ne présente aucune issue. Force nous est donc d’y rester en panne, jusqu’à ce qu’une passe quelconque s’ouvre vers le nord.
À neuf heures du matin, des mouvements s’étant produits dans le pack, nous nous remettons en marche et, autant que nous le permet la capricieuse topographie de la banquise, nous faisons route au nord. Du nid de corbeau, nous découvrons de nombreuses clairières ; mais il n’est pas toujours facile de se rendre de l’une à l’autre ; seules des passes étroites et tortueuses, coupées d’angles brusques que nous heurtons violemment, les relient entre elles ; souvent même des pans considérables qu’il faut attaquer à pleine vapeur, en usant de l’étrave comme d’un coin, les séparent. Il est rare que cette manœuvre de force réussisse d’emblée ; il faut généralement répéter ces assauts plusieurs fois de suite et ce sont alors des chocs effroyables dont notre bonne Belgica frémit de la quille à la pomme des mâts*. Si, au lieu de heurter la glace plane de l’hiver, on en rencontre de plus ancienne et plus hummockée, elle oppose à tout progrès un infranchissable obstacle. On attend alors, plusieurs heures durant, un léger mouvement qui finisse par ouvrir un passage.
La persévérance de nos efforts nous conduit, le 16 février, à huit heures du soir, dans une petite lagune au-delà de laquelle la banquise se présente compacte. Nous relevons, à une quinzaine de milles dans le sud-est, un grand iceberg tabulaire qui fut un de nos voisins de détention : nous sommes à douze milles environ au nord de notre poste d’hivernage.
Vers dix heures, sous l’influence de la houle, la banquise tout entière se met à onduler. La mer libre ne peut plus être bien loin, pour que nous sentions de la sorte sa vivante respiration.
Nous ne sommes pas encore, cependant, au bout de ces alternatives de confiance et de désespoir. Peu après, le pack se clôt encore. La Belgica est de nouveau bloquée, mais dans des conditions tout autres qu’auparavant.
Le danger n’a pas disparu, il s’est modifié. Jusqu’au 1er février, nous craignions de ne pouvoir nous dégager du floe dans lequel notre navire se trouvait enchâssé ; mais cet étau de glace nous protégeait contre les rudes pressions qui sévissaient autour de lui.
Maintenant, nous sommes relativement plus libres ; la glace qui nous entoure n’est pas compacte ; ce sont des plaques mal soudées : d’un instant à l’autre, elles peuvent s’écarter pour nous livrer passage, mais, d’un instant à l’autre aussi, elles peuvent se rapprocher pour nous broyer. À tout prendre, malgré ses périls, je préfère cette situation à l’ancienne.
Elle ne se prolongera pas moins d’un mois. Trente jours durant, notre petit navire, légère et fragile construction de bois, demeurera à la merci des masses de glaces pesantes et brutales que balance la houle du large de plus en plus forte…
Vers le 20, nous apercevons, du nid de corbeau, une longue ligne noire bordant le pack en deçà de l’horizon du nord. C’est la mer libre, la mer promise ! Cette fois, plus de doute, nous nous rapprochons de l’iskant que les flots entament.
Nous sommes à moins de dix milles du large. Comme nous nous sommes éloignés de douze milles environ de notre station d’hivernage, nous pouvons en conclure que celle-ci, qui se trouvait au début à quatre-vingts milles de la lisière, s’en est rapprochée de soixante milles pendant notre détention.
La dérive nous entraîne toujours à l’ouest.
Soulevée par la houle, parfois très forte, la glace nous heurte, nous bouscule. Tout le jour, toute la nuit, nous éprouvons des chocs terribles. Mais, insensiblement, nous continuons à nous rapprocher de la lisière.
Au commencement de mars, avec une jumelle, on peut voir, du pont, la mer briser contre les glaçons. Nous ne sommes donc plus qu’à trois ou quatre milles du large.
Cependant, le gouvernail souffre énormément du choc des glaces. À maintes reprises, nous devons descendre sur la banquise pour arrondir les angles trop saillants qui éraillent le soufflage et menacent de déchirer la carène. À l’arrière, adhère une grande plaque très dure ; nous y pratiquons une échancrure dans laquelle le gouvernail est abrité. Nous sommes obligés d’employer la tonite pour faire sauter quelques grands pans tout proches dont la lourde masse rend le voisinage dangereux.
Les icebergs qui nous entourent semblent se déplacer vers l’est ; en réalité, c’est nous qui continuons à dériver plus vite qu’eux, vers l’ouest.
Sur les plaques voisines, les manchots pullulent ; c’est la saison où les petits bonshommes se réunissent pour muer ; ils arrivent un à un et se groupent à l’abri du vent, derrière les hummocks. Désintéressés de ce qui les entoure, ils se renferment dans la mélancolie inhérente à cette pénible phase de leur existence, et ne détournent même plus la tête pour nous observer…
Le 14 mars seulement, notre situation périlleuse, pleine d’alternatives d’angoisse et d’espoir, prend fin.
La veille, nous avions observé de grands changements dans la position respective des icebergs qui nous environnaient. Deux des plus importants s’étaient dirigés vers nous d’une façon inquiétante, en même temps qu’ils se rapprochaient l’un de l’autre. La situation était extrêmement critique : nous risquions d’être broyés entre eux. Mais nous étions sous pression, prêts à saisir la première occasion favorable.
Vers deux heures du matin, une détente se produit. Je fais pousser les feux*.
À quatre heures, je vois, du nid de corbeau, la lisière de la banquise formant baie. Mais le navire n’est pas encore libre dans ses évolutions, et nous dérivons vers un grand iceberg tabulaire contre lequel, portés par le courant, nous courons grand risque de nous affaler. Heureusement, dans la glace en mouvement, de nouveaux jours s’ouvrent ; nous nous y faufilons et prenons la fuite.
À midi, nous gagnons le large.
C’est avec un sentiment de joie, de délivrance, de soulagement, dont l’intensité ne peut s’exprimer par des mots, qu’après treize mois nous nous retrouvons en eau libre.
Nous sortons du pack à trois cent trente-cinq milles au N 85° O de la position observée le 2 mars de l’année précédente. Depuis le 31 janvier, nous avons couvert plus de deux cent soixante milles vers l’ouest. Quant au parcours total de la dérive, il est de mille sept cents milles environ. Si, au lieu de dériver en tous sens, nous avions été portés constamment à l’ouest, nous eussions parcouru, à cette latitude, près de quatre-vingt-dix degrés et nous serions arrivés à trois cents milles à peine du cap Adare (terre de Victoria).
L’ensemble des sondages que nous avons opérés au cours de la dérive corrobore l’hypothèse d’après laquelle la terre d’Alexandre serait reliée à la terre vue par Ross le 23 février 1842, à l’extrémité est de la grande muraille glaciaire, par une ligne de côtes dont la direction générale serait ouest-sud-ouest. En effet, si l’on groupe des sondages effectués sensiblement sur le même méridien, on constate que le brassiage décroît à mesure qu’il est déterminé plus au sud. Et si l’on examine ceux qui se succèdent le long d’un même parallèle, on s’aperçoit que les profondeurs, sauf de légères ondulations du plateau continental, croissent de l’est vers l’ouest, passant par exemple de mille sept cent quarante mètres par 93° 43’ de longitude, à quatre cent quatre-vingt-cinq mètres par 85° 52’.
En février et jusqu’au 13 mars, les vents soufflèrent presque exclusivement de la partie est ; aussi notre dérive vers l’ouest a-t-elle été très rapide. Celle du 12 au 13 mars est surtout remarquable. Le 12, à midi, nous étions par 70° 56’ S et 99° 55’ O ; le lendemain, à quatre heures du soir, nous nous trouvions par 70° 50’ S et 102° 15’ O ; en vingt-huit heures nous avions donc parcouru cinquante-trois milles au N 83° O. Comme, durant ce temps, la direction générale du vent a été le sud-sud-est avec une vitesse moyenne de trois à quatre milles à l’heure, il semble qu’on doive attribuer à quelque courant cette dérive extraordinaire.
… C’est au commencement de mars que je rassemblai un jour mes compagnons, pour baptiser, de commun accord avec eux, les points remarquables de la région nouvelle que nous avions explorée l’année précédente. Nous avions attendu jusqu’alors parce que nous espérions reprendre nos investigations dans ces parages et y faire de nouvelles découvertes.
Mais la saison était trop avancée pour songer à revoir ces terres et en compléter le lever ; le moment était donc venu de leur donner des noms définitifs.
Tout d’abord, nous tenions à consacrer la mémoire de nos deux infortunés compagnons : la grande terre qui borde à l’est le détroit que nous avons nommé détroit de la Belgica, en l’honneur tout à la fois de notre patrie et de notre cher petit navire[23], s’appellera désormais terre de Danco ; et la plus importante des îles qui parsèment ce détroit, l’île Wiencke.
Ne pouvant exprimer de cette façon “matérielle”, à chacun de ceux qui apportèrent leur obole à notre entreprise, la reconnaissance que nous leur devons, nous avons donné ensuite les noms de Brabant, Anvers et Liège aux trois îles principales de l’archipel qui borde le détroit à l’ouest ; c’est dans ces provinces, en effet, que nous avons trouvé le plus d’appui.
Ces îles étant dominées par de très belles chaînes de montagnes, nous baptisâmes celles-ci des noms de Solvay, Osterrieth et Brugmann en souvenir de trois des personnes auxquelles l’expédition doit le plus de gratitude : M. Ernest Solvay, le mécène éclairé qui, le premier, nous donna son concours pécuniaire ; Mme Osterrieth, notre bienfaitrice anversoise ; M. Georges Brugmann, qui fut aussi un de nos plus enthousiastes protecteurs.
En très faible témoignage de notre reconnaissance nous avons aussi marqué sur notre carte le nom de De Rongé, en souvenir de l’excellente Mme De Rongé, qui nous fut si dévouée ; celui du général Brialmont ; celui du capitaine Lemaire, mon vaillant ami ; ceux d’Andvord, Bryde, Bulcke, Buls, Delaite, Du Fief, Errera, Harry, Houzeau de Lehaie, Kaiser, Lagrange, Lancaster, Pelseneer, Renard Schollaert, d’Ursel, Wauters, Wauwermans, Pierre Willems, d’autres encore qui nous ont aidés et que je ne saurais citer tous ici.
Nos obligations étant remplies, dans la mesure du possible, je priai les membres de l’état-major de désigner chacun deux noms à son choix.
XIII
LE RETOUR. – LES RÉSULTATS
De la banquise à la Terre de Feu. – Atterrissage mouvementé. – Rentrée dans le monde des vivants. – Résultats de l’expédition. – Retour en Belgique.
Le 14 mars, vers midi, nous voguons en mer absolument libre ; nous mettons aussitôt le cap au nord. Devant nous, plus un seul fragment de glace ; au sud, la blanche lisière du pack s’éloigne de plus en plus ; et bientôt, à part l’iceblink qui persiste au ciel, plus rien ne nous rappelle la perfide banquise qui nous tint si longtemps prisonniers.
Le temps se couvre, il bruine ; nous ne pouvons déterminer notre position. Nous sondons cependant et trouvons deux mille huit cents mètres ; notre latitude doit être à peu près 70° 40’ S ; les bords du plateau continental s’infléchissent donc de plus en plus vers le sud.
Le 16, à deux heures et demie, nous sommes par 68° 42’ S et 100° 56’ O. Les jours suivants, favorisés par une brise du sud-est, nous faisons bonne route, toutes voiles dehors, machine stoppée ; mais le temps reste bouché.
De nombreux oiseaux nous environnent et nous suivent : pétrels géants, pétrels antarctiques, pigeons du Cap, etc. Fait remarquable, nous ne rencontrons aucun iceberg.
Le 23, nous sommes par 56° 28’ S et 84° 46’ O. La brise a molli, mais la houle persiste et nous éprouvons quelque difficulté à sonder : nous trouvons un brassiage de quatre mille huit cents mètres, le plus considérable que nous ayons enregistré. Profitant de l’embellie, nous prenons ensuite une série très complète de températures sous-marines.
Un peu avant de quitter la banquise, Lecointe avait pu déterminer, par observation de l’éclipsé du premier satellite de Jupiter, l’état absolu* des chronomètres. La longitude que nous venons d’obtenir est donc aussi exacte que possible. Nous sommes à l’ouest de l’archipel de la Terre de Feu et deux routes s’offrent à nous pour atteindre Punta Arenas : celle du détroit de Magellan par le cap Pillar, et celle du canal de Cockburn.
Bien que l’existence d’un phare sur les “Evangelistas” rende l’atterrissage beaucoup plus aisé par le cap Pillar, je me soucie peu d’adopter cette voie, parce qu’elle nous expose, soit à rencontrer un vapeur se rendant au Chili, soit à être dépassés par un autre bâtiment gagnant l’Europe et qui pourrait annoncer, avant nous, par la voie télégraphique, notre rentrée dans le “monde des vivants”. Or, j’appréhenderais fort pour les parents du pauvre Wiencke (Danco n’a pas laissé de proches parents), la fausse joie que leur causerait la nouvelle de notre salut, parvenue au pays sans le fatal complément que la triste fin de leur fils y apportera. Je me décide donc pour le canal de Cockburn, qui n’est pas fréquenté et qui aboutit dans le détroit de Magellan, non loin de Punta Arenas.
Nous faisons route à l’est-nord-est, afin de reconnaître l’île Noir, qui nous offrira un abri pour la nuit si nous atterrissons le soir.
Petit à petit, les oiseaux antarctiques nous ont quittés ; nous ne sommes plus suivis que par des albatros et des pigeons du Cap.
Après avoir soufflé très régulièrement du sud-est, la brise a halé* l’ouest-sud-ouest d’abord, puis, lentement, elle a anordi*. Aussi la température s’est-elle élevée et notons-nous + 5,7° le 24, à midi. Il y a bien longtemps que nous n’avons joui d’une pareille “chaleur” !
Le 25 mars, après quelques heures de calme, le vent s’établit à l’ouest-sud-ouest ; la mer est assez houleuse ; le temps est couvert et pluvieux.
Pendant la nuit, la brise fraîchit et la mer se forme ; nous continuons à faire bonne route, à la voile seulement.
26 mars. Depuis près de trois jours, le temps est resté bouché ; nous sommes sans observation ; mais, en tenant compte d’un courant de deux milles à l’heure vers l’est-sud-est, l’estime nous met près de l’île Noir.
Autour de nous, les albatros et les damiers planent de plus en plus nombreux, signe certain de la proximité de quelque côte, et cependant nous n’entrevoyons rien. Afin de nous rapprocher de terre, nous serrons le vent* qui souffle de l’ouest-nord-ouest.
Pendant la matinée, l’horizon, resté très gras, s’embrume davantage.
Dans ces conditions et vu l’incertitude de notre position, il ne serait pas sage de chercher à atterrir ; et il n’est plus possible, avec la brise qui règne, de gagner le cap Pillar. Je me résigne donc, à regret, à doubler le cap Horn, pour entrer dans le détroit par le cap des Vierges.
Cette détermination, que la prudence m’impose, n’est pas sans causer quelque désappointement autour de moi, car elle aura pour effet de retarder de cinq à six jours notre arrivée à Punta Arenas, et tous, nous avons hâte de rassurer ceux qui nous sont chers et d’en recevoir des nouvelles…
Nous “arrivons” donc de quelques points* afin de “donner un bon tour*” au cap Horn.
Il vente grand frais de l’ouest-nord-ouest ; la mer est très houleuse ; l’horizon reste embrumé.
Vers trois heures de l’après-midi, nous apercevons un cormoran, volant à tire-d’aile vers le nord-nord-est ; nous reconnaissons bientôt que cet oiseau se dirige vers une terre dont la silhouette apparaît vaguement derrière le voile de brume qui nous en avait tout d’abord dérobé la vue. Quelques minutes plus tard, nous voyons des roches par le bossoir de bâbord. Après quelque hésitation, nous reconnaissons les “Tower Rocks” : c’est l’île Noir que nous avons par le travers. Nous étions donc, ce matin, moins à l’est que nous ne l’avons cru.
L’obscurité ne va pas tarder à tomber : nous ne pouvons plus songer à embouquer directement dans le canal de Cockburn, dont les approches sont parsemées d’écueils : je décide de passer la nuit sous le vent de l’île Noir.
Nous serrons le vent ; rapidement on active les feux ; les ancres sont mises en mouillage.
La brise hale l’ouest et augmente d’intensité ; la mer est très grosse ; mais, à six heures, nous commençons à sentir l’abri de la côte et, une demi-heure après, nous jetons l’ancre dans la rade qui s’étend à l’est de l’île.
Pendant la nuit, le vent est très dur ; des rafales, dont la violence va croissant, couchent sans cesse le navire sous leur puissant effort.
Vers quatre heures du matin, ces rafales, de plus en plus fréquentes, sévissent avec une violence extrême ; elles halent le sud-ouest ; la rade n’est plus abritée et la houle y pénètre…
Nous chassons sur notre ancre.
Branle-bas général ! Je fais filer de la chaîne* et pousser les feux.
Les rafales redoublent ; elles soulèvent des nuées d’embrun et se confondent bientôt en une impétueuse bourrasque.
Dans la lueur blafarde de l’aube naissante, le spectacle est d’une effroyable grandeur.
Mais notre ancre continue à labourer le fond et, dans l’embrun que balaye la tempête, ont surgi soudain, à deux encablures à peine, des roches qu’entourent des brisants et sur lesquelles les vagues déferlent furieusement. Nous sommes drossés vers ces écueils.
Comme le 2 janvier de l’année précédente, la Belgica est en perdition, en perdition si près du port et après tant de dangers courus ! J’avais bien cru, l’an dernier, ne pas sortir des canaux de la Terre de Feu. Cette fois, je puis croire pendant quelques heures que nous n’y rentrerons pas.
Vainement, en s’y mettant tous, savants et matelots, on s’est efforcé de virer l’ancre* pour appareiller. Il faut la sacrifier maintenant, sans hésitation, et filer la chaîne par le bout pour sauver le navire.
La trinquette est établie, la machine est mise en marche ; vent arrière et à toute vapeur nous fuyons…
S’élevant à la lame, haletante sous les pulsations de la machine, débarrassée du croc qu’elle traînait sur le fond, la Belgica est revenue à la vie ; elle n’est plus la chose inerte que les roches allaient impitoyablement briser.
Nous filons de l’huile, par le bossoir de tribord ; grâce à cet expédient, nous “embarquons” peu[24].
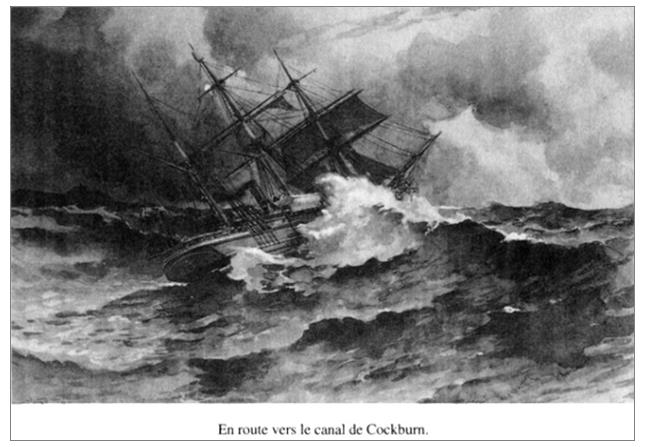
Mais la mer est démontée et notre coquille est bien petite !
Aussi, fut-ce une navigation bien impressionnante que nous fîmes ce matin-là, et je ne pense pas que le souvenir s’en atténue jamais dans mon esprit…
Malgré les nuées qui obscurcissent l’air, le jour peu à peu se fait. Par le travers, l’île Kempe s’estompe vaguement dans la brume en des contours indécis. Plus près de nous, plus nettes, les pointes innombrables de la “Voie lactée” déchirent la mer et, en un effroyable chaos de brisants, évoquent à nos yeux les conséquences de la moindre erreur de route.
Le petit hunier est établi, nous marchons bon train.
Bientôt, à l’avant, des roches se dessinent : ce sont les “Furies” de l’Ouest, balises sauvages qui, dans le tumulte des flots écumants, marquent l’entrée de la passe.
À huit heures, nous doublons ces roches, nous entrons dans le canal ; insensiblement nous sentons l’abri de la terre, tandis qu’au large la tempête fait toujours rage…
Dois-je dire l’émotion que nous éprouvâmes tous à la vue de la verdure qui garnissait les rives très proches entre lesquelles nous voguions maintenant en une relative sécurité ?
Le lendemain, au point du jour, nous jetons l’ancre en rade de Punta Arenas.
… On nous félicite, on nous embrasse, on nous harcèle de questions, nous qui voudrions tant nous-mêmes avoir des nouvelles et qui, le cœur serré, n’osons en demander.
Enfin, on nous remet nos lettres. De quelles mains tremblantes, inquiètes, nous en déchirons les enveloppes. Si, depuis quinze mois, nous avons plus que d’autres été exposés aux mauvaises chances de la vie, pour ceux qui nous sont chers le temps aussi a marché… Mais, hélas ! notre correspondance ne nous apprend rien. C’est à Melbourne qu’on nous attendait ; ici nous ne trouvons que de vieilles lettres à peine postérieures à notre départ. À Buenos Aires seulement, nous aurons les détails si désirés, si redoutés aussi. Pour presque tous alors, la joie du retour se changera en douleur, car presque tous nous apprendrons que nous avons été frappés dans nos affections les plus chères.
Pendant les longs mois que nous avons passés hors de l’humanité, que d’événements, dont beaucoup sont déjà devenus des souvenirs pour les autres hommes, et qui pour nous sont de toutes fraîches nouvelles : la guerre hispano-américaine, une querelle entre les Boers et les Anglais, qui semble prendre une fâcheuse tournure, la convocation des peuples par le tsar à la conférence de la Paix, l’affaire Dreyfus en France… que sais-je ?
Dans les sphères de la science et de l’industrie, plus sereines que celles de la politique, le génie humain a fait de nouvelles et importantes conquêtes : l’automobilisme a pris un essor inattendu ; on parle d’un petit steamer, la Turbinia, qui aurait filé près de quarante milles à l’heure ; d’un brise-glace merveilleux ; l’air a été liquéfié ; on peut télégraphier sans fil à de grandes distances…
La découverte de Marconi nous intéresse tout particulièrement, car, un jour sans doute, elle sera d’une aide puissante aux explorateurs polaires auxquels elle permettra de correspondre avec des navires de secours laissés au large.
Enfin, nous apprenons qu’on est toujours sans nouvelles de l’héroïque André, parti en ballon vers le pôle Nord, un mois avant notre départ pour l’autre bout du monde.
Et nous, qu’avons-nous fait pendant nos quinze mois de séjour dans l’Antarctique ? Nos travaux répondent-ils à ce qu’on en espérait ? Il ne m’appartient pas de me prononcer à cet égard. Nous disposions de ressources si modestes auprès de celles des puissantes expéditions qui vont bientôt investir toute la zone polaire australe, que notre mission ne devra être considérée que comme une reconnaissance d’avant-garde[25].
Envisagée comme telle, nous pouvons affirmer qu’elle a été fructueuse.
Il aura suffi au lecteur de jeter un regard sur la carte dressée par nous, pour se rendre compte des résultats géographiques de la première période de notre voyage.
Si, pendant notre détention dans la banquise, nous n’avons aperçu aucune terre, les indications de notre dérive n’en sont pas moins intéressantes : les nombreux sondages que nous avons opérés établissent que nous étions dans le voisinage du continent antarctique dont l’existence était soupçonnée ; mais ces sondages, aussi bien que les positions que nous avons successivement occupées, nous font, comme je l’ai dit déjà, rejeter sensiblement au sud les limites de ce que les spécialistes avaient cru pouvoir assigner à ce continent.
Nous avons constaté que ce n’était qu’une “apparence”, une fausse apparence de terre, qu’avait vue, vers le 100e méridien ouest, Walker, de l’expédition Wilkes, puisque la dérive nous a portés en ce point, sans que nous l’ayons retrouvée.
Dans le détroit qui sépare la terre de Danco de l’archipel auquel nous croyons devoir donner, comme les Allemands, le nom de Dirck Gherritz, nous avons débarqué aussi souvent que possible. Nous avons pu recueillir ainsi d’importantes collections géologiques et zoologiques, qui ont été complétées plus tard par les sondages et les dragages effectués au cours de l’hivernage.
D’autres, mettant à profit nos observations, iront sans doute un jour poursuivre et parfaire les études que nous n’avons pu qu’ébaucher.
Parmi nos points de débarquement, il en est deux ou trois qui paraissent tout indiqués pour une station d’hivernage. Lors de l’expédition internationale polaire de 1882-1883, tandis que dans la région arctique on observait jusqu’au-delà du 80e parallèle, les stations les plus proches du pôle austral se trouvaient établies dans la baie Orange (Fuégie) et à la Nouvelle-Géorgie. Je suis persuadé que si l’on avait connu à cette époque le détroit que nous avons visité, on y aurait établi, sans hésiter, une station dont la latitude eût été ainsi de dix degrés plus élevée.
Pendant toute la durée de notre emprisonnement dans le pack, des observations météorologiques ont été faites d’heure en heure. Nous apportons la première série d’observations embrassant le cycle complet d’une année entière. Si leurs résultats viennent étayer certaines hypothèses émises sur les conditions climatériques des régions antarctiques, elles en infirmeront sans doute beaucoup d’autres.
Enfin, des mesures absolues des éléments magnétiques, obtenues dans soixante stations, apporteront une contribution utile à la connaissance du magnétisme terrestre.
Le fait brut d’un hivernage a aussi son importance. Il établit la possibilité d’hiverner avec un navire solide dans les glaces antarctiques ; de plus, il a eu lieu là même où les promoteurs de l’expédition anglaise s’étaient proposé d’établir une station à terre pour la pénétration du continent polaire austral : aussi l’itinéraire projeté de cette expédition a-t-il été profondément modifié depuis notre retour.
D’autres, avant nous, avaient tenté déjà de soulever un coin du voile qui recouvre la mystérieuse Antarctide. À peine sommes-nous rentrés que d’autres vont partir.
Le temps n’est plus à ce qu’on pourrait appeler les “expéditions records”, incontestablement fort héroïques, mais bien peu productives pour la science. Ce qu’il faut maintenant, c’est une série d’expéditions attaquant sur différents points les glaces australes, s’entendant entre elles pour coordonner leurs travaux, et formant autour du Sphinx antarctique un immense cercle d’investissement avançant et se resserrant lentement, jusqu’au jour où le dernier mot de l’énigme lui aura été arraché, c’est-à-dire où le pôle même aura été atteint. Chacune de ces expéditions aurait à explorer une zone relativement restreinte, mais elle devrait y faire des observations complètes, y aborder et y résoudre tous les problèmes. Les expéditions postérieures auraient à imiter, plus au sud, l’exemple de leurs aînées, en profitant de l’expérience acquise.
Je crois pouvoir dire, sans fausse modestie, que, dans cet ordre d’idées, en ce qui nous concerne, tout ce qui pouvait être humainement tenté, nous l’avons fait. J’espère aussi, et je crois, que les résultats obtenus justifient les sacrifices accomplis[26].
Comme nous n’avions plus beaucoup de charbon et pas les moyens d’en acheter, la traversée de retour devait se faire à la voile et être longue. Je ne voulais pourtant pas faire perdre à mes collaborateurs scientifiques un temps précieux : il fut convenu que Racovitza, Arctowski et Dobrowolski rentreraient directement en Europe, où ils pourraient utilement travailler, dès leur retour, au classement des collections que nous avions recueillies et à la coordination de certaines observations. Lecointe, de son côté, allait faire à ma place une reconnaissance en Patagonie, car ma qualité de capitaine me défendait de quitter le bord. Le docteur Cook, enfin, compléterait dans la Terre de Feu, avant de regagner les États-Unis, ses études sur les Indiens.
Nous eûmes quelques avaries dès les premiers temps de notre séjour sur la rade de Punta Arenas.
Nous avions jeté l’ancre sur une vieille épave qu’aucune bouée n’indiquait ; la chaîne s’usa rapidement et, au premier coup de vent, elle se rompit. C’était la seconde ancre que nous perdions en moins de quinze jours.
Il fallut les remplacer par d’autres, achetées là d’occasion ; nous dûmes aussi faire fondre de nouveaux écubiers et, comme la fonderie locale était mal outillée pour ce travail, ce ne fut qu’après plusieurs semaines que nous pûmes quitter le détroit de Magellan et faire route pour le Río de La Plata.
Avant de nous rendre à Buenos Aires où nous conviaient M. Oostendorp, notre très distingué consul général, et la colonie belge tout entière, nous relâchâmes à La Plata et nous y achevâmes la toilette de la Belgica afin qu’elle pût figurer dignement dans le grand port argentin.
Sur les instances de nos compatriotes établis là, nous fîmes à Buenos Aires un séjour prolongé.
Je sortirais du cadre de ce récit en relatant par le détail les manifestations, si flatteuses à la fois pour notre drapeau et pour nous-mêmes, qui nous y accueillirent.
Je me bornerai à faire remarquer qu’il y a là une preuve ajoutée à tant d’autres invoquées par les esprits clairvoyants de l’utilité qu’il y aurait pour la Belgique à posséder une flottille de bâtiments dont la mission serait de la mieux faire connaître, d’aller montrer son pavillon dans les ports lointains.
On objectera que c’était le but tout spécial de notre mission qui nous valut partout, au retour comme à l’aller, si bon accueil. Sans doute, il y avait un peu d’attendrissement à notre endroit, au cœur de nos compatriotes, lorsqu’ils nous exprimaient la joie qu’ils éprouvaient à fouler le pont de notre petit bâtiment ; mais il n’y avait pas que cela. C’était le navire lui-même, bien plus que ceux qui le montaient, dont la vue leur causait une émotion inaccoutumée.
Il m’a été donné de voir, à Buenos Aires, la colonie française tout entière se réjouir, elle aussi, à l’annonce de l’arrivée d’un croiseur portant les couleurs nationales. Ce ne pouvait être la venue prochaine de compatriotes qui excitait l’enthousiasme de ces Français, puisque chacun d’eux était entouré, à Buenos Aires même, de plusieurs milliers d’autres Français. Mais, depuis de nombreuses années, aucun bâtiment de la flotte française n’avait paru dans les eaux du Río de La Plata, où les autres grandes nations sont représentées presque en permanence ; on éprouvait quelque honte de cette apparente infériorité ; on était heureux de la voir cesser momentanément ; et en même temps on prévoyait, un peu confusément, que le commerce français tirerait quelque profit de cette escale du beau croiseur qui allait faire bonne figure à côté des autres.
La Belgica jouait, jusqu’à un certain point, le même rôle à l’égard de la colonie belge, dans les ports où elle relâchait…
C’est l’exportation vers les grands marchés d’outre-mer, bien plus encore que l’exploitation des colonies, qui enrichit les nations industrielles : le commerce et l’industrie allemands n’ont pas attendu, pour prendre leur remarquable essor, qu’on dotât l’Empire des colonies qu’il possède aujourd’hui ; du jour, lointain déjà, où l’Allemagne organisa sa marine, date sa grande prospérité commerciale.
Nous n’avons que faire, en Belgique, d’une marine de guerre ; mais ce qui nous manque, ce qu’il faut à notre pays pour mieux affirmer son existence dans le monde et pour mieux occuper partout la place qu’il mérite, c’est une marine représentative, que j’appellerais volontiers une marine “consulaire”.
Deux ou trois bâtiments suffiraient, mais il faudrait qu’ils fussent appropriés aux longs voyages et que, chargés de missions scientifiques ou simplement d’enquêtes commerciales, ils fussent très actifs. On ne tarderait pas à se rendre compte de leur utilité et de l’efficacité de leurs pacifiques croisières.
Le 14 août 1899, la Belgica quittait Buenos Aires, faisant route pour la Belgique.
La traversée de l’Atlantique fut longue et difficile ; les vents contraires nous entraînèrent non loin du banc de Terre-Neuve ; et ce n’est que le 30 octobre que nous abordâmes enfin à Boulogne-sur-Mer.
Huit jours après, l’élite de la Belgique venait à notre rencontre sur l’Escaut, et Anvers nous faisait une réception grandiose dont le souvenir ne s’effacera jamais de ma mémoire. Quelques jours plus tard, c’est à Bruxelles que nous étions reçus triomphalement.
Avant de clore ces pages, il me reste un devoir à remplir. Je tiens à exprimer la gratitude profonde que m’ont inspiré l’abnégation, le zèle, le dévouement absolu et sans bornes avec lesquels mes compagnons ont secondé mes efforts. C’est grâce à leur rare désintéressement que l’Expédition antarctique belge a pu se faire dans des conditions si modestes, si précaires, dirai-je même. C’est grâce à leur concours éclairé qu’elle a obtenu les résultats scientifiques qui seront bientôt mis en valeur dans les nombreux mémoires édités, aux frais du gouvernement, par les soins de la Commission de la Belgica.
Et ma reconnaissance émue va aussi tout entière à Danco et à Wiencke, à ces braves que je n’ai pas eu le bonheur de ramener – comme elle se reporte également sur mes officiers, mes mécaniciens et mes matelots, dont jamais le dévouement n’a failli.
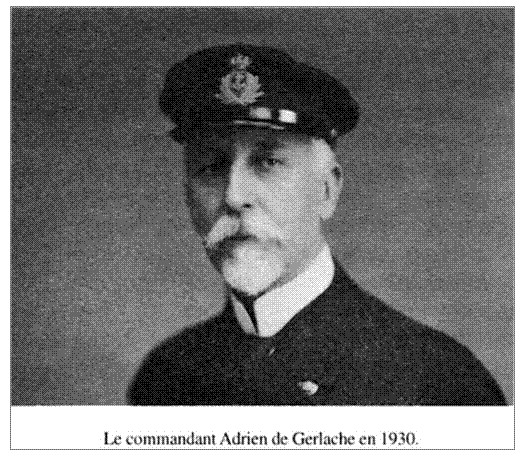
ANNEXES
I
BUDGET
DE L’EXPÉDITION ANTARCTIQUE BELGE
Ressources
|
Souscription initiale (Ernest Solvay, décembre 1894) |
25 000 fr. |
» » |
|
Souscription de sociétés savantes et de particuliers |
67 476 fr. |
44 |
|
Subsides de l’État belge |
201 000 fr. |
» »* |
|
Id. de conseils provinciaux |
1 500 fr. |
» » |
|
Id. de conseils communaux |
16 000 fr. |
» » |
|
Produit de fêtes en faveur de l’expédition |
16 007 fr. |
21 |
|
Souscriptions recueillies à bord avant le départ |
6 520 fr. |
» » |
|
Id. au cours du voyage |
256 fr. |
50 |
|
Souscription de membres de l’expédition |
11 211 fr. |
21 |
|
Total |
344 971 fr. |
36 |
* Y compris 41 000 francs, prix de la cession de la Belgica à l’État belge (voir annexe 3).
Dépenses
|
Matériel (Belgica et son inventaire, engins et instruments) |
142 444 fr. |
75* |
|
Personnel (traitement, vêtements, etc.) |
63 871 fr. |
59** |
|
Vivres |
31 839 fr. |
06* |
|
Entretien du navire et du matériel |
16 232 fr. |
62 |
|
Charbon, huile, etc. |
19 265 fr. |
20 |
|
Droits de pilotage, lamanage, remorquage, frais de ports, etc. |
1 767 fr. |
61 |
|
Administration (voyages, ports et droits d’entrée, télégrammes, etc.) |
7 167 fr. |
61 |
|
|
|
|
|
Dépenses afférentes à l’Expédition antarctique |
282 588 fr. |
44 |
|
Frais d’une exploration en Patagonie |
6 028 fr. |
77 |
|
|
|
|
|
Ensemble des dépenses |
288 617 fr. |
21 |
|
|
|
|
|
L’excédent des ressources a été employé comme suit : |
|
|
|
Prix de la Belgica (voir annexe 4) |
41 000 fr. |
» » |
|
Gratification de 1 000 francs à treize membres du personnel |
13 000 fr. |
» » |
|
Don à l’Œuvre des Enfants martyrs |
154 fr. |
15 |
|
Don à la Ligue patriotique contre l’alcoolisme |
200 fr. |
» » |
|
Don à la Villa coloniale |
200 fr. |
» » |
|
Don à l’Œuvre du grand air pour les petits |
300 fr. |
» » |
|
Don à la Ligue maritime belge |
1 500 fr. |
» » |
|
|
|
|
|
Total |
344 977 fr. |
36 |
* Déduction faite du produit de ventes.
Les instruments scientifiques restés en bon état ont été déposés à l’Observatoire royal, à l’École militaire et aux universités de Gand et de Liège.
Différents objets ont été remis au musée du Steen à Anvers.
Quelques vivres ont été distribués par le Bureau de bienfaisance d’Anvers.
** Les membres du personnel scientifique n’étaient pas rétribués.

II
COMMISSION DE LA BELGICA
ARRÊTÉ ROYAL
LÉOPOLD II, Roi des Belges,
À tous présents et avenir, SALUT.
Voulant donner une nouvelle preuve de Notre sollicitude pour ce qui peut contribuer au progrès des sciences ;
Considérant les vœux émis par M. A. de Gerlache et par la Société royale belge de géographie, au nom du personnel scientifique de l’Expédition antarctique belge :
Vu le contrat intervenu le 25 juin 1896 entre le gouvernement d’une part, M. A. de Gerlache et ladite société d’autre part ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Instruction publique.
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article premier – Il est institué une commission chargée d’examiner et d’étudier les questions relatives à la publication des mémoires qui seront consacrés à la mise en valeur des matériaux scientifiques rapportés par l’Expédition antarctique belge et de faire rapport au gouvernement à ce sujet.
Art. 2 – Pour la rédaction de ces mémoires les membres du personnel scientifique de l’expédition conserveront la faculté de désigner leurs collaborateurs.
Art. 3 – Sont nommés membres de cette commission ; MM. Arctowski, géologue, membre du personnel scientifique de la Belgica ;
le lieutenant général Brialmont, membre de l’Académie royale de Belgique ;
le docteur Cook, membre du personnel scientifique de la Belgica ;
Crépin, directeur du Jardin botanique de l’État, membre de l’Académie royale de Belgique ;
de Gerlache, lieutenant de la marine de l’État belge, promoteur et commandant de l’Expédition antarctique belge ;
de la Vallée Poussin (Charles), professeur à l’université de Louvain, associé de l’Académie royale de Belgique ;
Dobrowolski, naturaliste, membre du personnel scientifique de la Belgica ;
Du Fief, secrétaire général de la Société royale belge de géographie ;
Dupont, directeur du Musée royal d’histoire naturelle, membre de l’Académie royale de Belgique ;
Errera (Léo), professeur à l’université de Bruxelles, directeur de l’Institut botanique et membre de l’Académie royale de Belgique ;
Lagrange (Ch.), directeur du Service astronomique de l’Observatoire royal, membre de l’Académie royale de Belgique ;
Lancaster, directeur du Service météorologique de l’Observatoire royal, membre de l’Académie royale de Belgique ;
Lecointe, lieutenant au 1er régiment d’artillerie, capitaine en second de la Belgica ;
Racovitza, docteur en sciences naturelles, membre du personnel scientifique de la Belgica ;
Renard, professeur à l’université de Gand, membre de l’Académie royale de Belgique ;
Spring (W.), professeur à l’université de Liège, membre de l’Académie royale de Belgique ;
Van Beneden (E.), professeur à l’université de Liège, membre de l’Académie royale de Belgique.
Art. 4 – Sont nommés respectivement président, vice-président et secrétaire de cette commission :
MM. le lieutenant général Brialmont,
Adrien de Gerlache,
Lecointe.
Art. 5 – Notre ministre de l’Intérieur et de l’Instruction publique est chargé du présent arrêté.
Donné à Laeken, le 4 décembre 1899.
LÉOPOLD
PAR LE ROI :
Le Ministre de l’Intérieur et de l’Instruction publique,
J. DE TROOZ
La Commission de la Belgica s’est adjoint, pour l’étude des matériaux recueillis par l’Expédition antarctique belge, la collaboration de soixante-dix-huit spécialistes belges et étrangers.
LISTE DES MÉMOIRES
publiés par les soins de la Commission de la Belgica
VOLUME I
Relation du voyage et résumé des résultats, par A. de Gerlache de Gomery.
Travaux hydrographiques et instructions nautiques, par G. Lecointe.
Note relative à l’usage des explosifs sur la banquise, par G. Lecointe.
VOLUME II, Astronomie et physique du globe
Étude des chronomètres (deux parties), par G. Lecointe.
Recherche des positions du navire pendant la dérive, par G. Lecointe.
Observations magnétiques, par C. Lagrange et G. Lecointe.
Note relative aux mesures pendulaires, par G. Lecointe.
Conclusions générales sur les observations astronomiques et magnétiques, par Guyou.
VOLUMES III ET IV, météorologie.
Rapport sur les observations météorologiques horaires, par H. Arctowski.
Rapport sur les observations des nuages, par A. Dobrowolski.
La neige et le givre, par A. Dobrowolski.
Phénomènes optiques de l’atmosphère, par H. Arctowski.
Aurores australes, par H. Arctowski.
Discussion des résultats météorologiques, par A. Lancaster.
VOLUME V, océanographie et géologie
Rapport sur les sondages et les fonds marins recueillis, par H. Arctowski et A.-F. Renard.
Rapport sur les relations thermiques de l’océan, par H. Arctowski et H.-R. Mill.
Détermination de la densité de l’eau de mer, par J. Thoulet. Rapport sur la densité de l’eau de mer, par H. Arctowski et J. Thoulet.
Note sur la couleur des eaux océaniques, par H. Arctowski.
Les glaces antarctiques (Journal d’observations relatives aux glaciers, aux icebergs et à la banquise), par H. Arctowski.
Note relative à la géographie physique des terres antarctiques, par H. Arctowski.
La géologie des terres antarctiques, par A.-F. Renard.
Note sur quelques plantes fossiles des terres magellaniques, par M. Gilkinet.
VOLUMES VI, VII, VII ET IX, botanique et zoologie
Botanique
Diatomées (moins chaetocérés), par H. Van Heurck.
Péridiniens et chaetocérés, par Fr. Schütt.
Algues, par E. De Wildeman.
Champignons, par Mmes Bommer et Rousseau.
Lichens, par E.-A. Wainio.
Hépatiques, par F. Stephani.
Mousses, par J. Cardot.
Cryptogames vasculaires, par Ch. Bommer.
Phanérogames, par E. De Wildeman.
Zoologie
Foraminifères, par A. Kemna et Van den Brœck.
Radiolaires, par Fr. Dreyer.
Tintinoïdes, par K. Brandt.
Spongiaires, par E. Topsent.
Hydraires, par C. Hartlaub.
Hydrocoraillaires, par E. v. Marenzeller.
Siphonophores, par C. Chun.
Méduses, par L. Schultze.
Alcyonaires, par Th. Studer.
Pennatulides, par H.-F.-E. Jungersen.
Actiniaires, par O. Carlgren.
Madréporaires, par E. v. Marenzeller.
Cténophores, par C. Chun.
Holothurides, par E. Hérouard.
Astérides, par H. Ludwig.
Échinides et ophiures, par R. Kœhler.
Crinoïdes, par J.-A. Bather.
Planaires, par L. Böhmig.
Céstodes, trématodes et acantocéphales, par P. Cerfontaine.
Némertes, par Bürger.
Nématodes libres, par J.-D. de Man.
Nématodes parasites, par J. Guiart.
Chaetognathes, par O. Steinhaus.
Géphyriens, par J.-W. Spengel.
Oligochètes, par P. Cerfontaine.
Polychètes, par G. Pruvot et E.-G. Racovitza.
Bryozoaires, par A.-W. Waters.
Brachiopodes, par L. Joubin.
Rotifères et tardigrades, par C. Zelinka.
Phyllopodes, par Hérouard.
Ostracodes, par G.-W. Müller.
Copépodes, par W. Giesbrecht.
Cirripèdes, par P.-P.-C. Hœk.
Crustacés édryophthalmes, par J. Bonnier.
Schizopodes et cumacés, par H.-J. Hansen.
Crustacés décapodes, par H. Coutière.
Pycnogonides, par G. Pfeffer.
Acariens libres, par A.-D. Michael et Dr Trouessart.
Acariens parasites, par G. Neumann.
Aranéides, par E. Simon.
Myriapodes, par C. v. Attems.
Collemboles, par V. Willem.
Orthoptères, par Brunner von Wattenwyl.
Hémiptères, par E. Bergroth.
Pédiculides, par V. Willem.
Diptères, par J.-C. Jacobs.
Coléoptères, par Schouteden, E. Rousseau, A. Grouvelle, E. Olivier, A. Lameere, Boileau, E. Brenske, Bourgeois et Fairmaire.
Hyménoptères, par C. Emery, Tosquinet, E. André et J. Vachal.
Solénoconques, par L. Plate.
Gastropodes et Lamellibranches, par P. Pelseneer.
Céphalopodes, par L. Joubin.
Tuniciers, par E. Van Beneden.
Poissons et reptiles, par L. Dollo.
Bile des oiseaux antarctiques, par P. Portier.
Oiseaux (Biologie), par E.-G. Racovitza.
Oiseaux (Systématique), par Howard Saunders.
Cétacés, par E.-G. Racovitza.
Embryogénie des pinnipèdes, par E. Van Beneden.
Organogénie des pinnipèdes, par Brachet et Leboucq.
Encéphale des pinnipèdes, par Brachet.
Pinnipèdes (Biologie), par E.-G. Racovitza.
Pinnipèdes (Systématique), par E. Barrett-Hamilton.
Bactéries de l’intestin des animaux antarctiques, par J. Cantacuzène.
VOLUME X, physiologie, anthropologie & ethnologie
Medical report, par F.-A. Cook.
Report upon the Onas, par F.-A. Cook.
Grammaire et dictionnaire anglo-yahgans, coordonnés et publiés par F.-A. Cook, d’après les notes de feu le Rév. Thomas Bridges.
III
CE QU’EST DEVENUE LA BELGICA
D’abord cédée à l’État belge en échange d’un subside qui permit au chef de l’expédition de solder les derniers comptes et de donner, en outre, une gratification aux membres du personnel subalterne, la Belgica fut achetée en décembre 1900, par quelques Belges et Norvégiens qui constituèrent une société anonyme pour la grande pêche polaire.
La Belgica continue à naviguer sous le pavillon belge. Elle prend la mer au commencement de mars de chaque année et, jusqu’à la fin de juillet, son équipage se livre à la chasse aux phoques et à la pêche aux hyperoodons aux abords de l’île Jan May en, de l’Islande et du Groenland.
Elle fournira sans doute, encore, une longue carrière.
IV
ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE
CLASSE DES SCIENCES
PRIX DE LA BELGICA
Conformément au désir du commandant de Gerlache, il a été mis par l’État belge, à la disposition de la Classe des sciences de l’Académie, un capital de quarante et un mille francs – provenant de la vente de la Belgica – dont les intérêts serviront :
1° À la création et à l’octroi d’une médaille d’or de la valeur de cinq cents francs, dite Médaille de la Belgica, pour les explorateurs qui se seront livrés, avec le plus de succès, à l’intérieur du cercle polaire antarctique, à des recherches de géographie physique ;
2° À subsidier des Belges désirant entreprendre des travaux océanographiques.
La Classe des sciences, dans sa séance du 16 décembre 1901, a accepté cette fondation.
GLOSSAIRE[27]
Abattre d’une couple de points : changer la route du navire en déplaçant celui-ci sous le vent. Un angle droit représente huit points de compas.
Accore : se dit d’une côte coupée verticalement à la surface de la mer et dont les navires peuvent s’approcher à la toucher.
Affaler (s’) : s’approcher trop de la côte ou d’un point situé sous le vent, dont un navire ne réussit pas à s’éloigner.
Aiguade : lieu où se trouve l’eau que les embarcations vont chercher pour l’approvisionnement d’un bâtiment.
Amures (bâbord ou tribord) : point d’attache inférieur d’une voile carrée, du côté gauche (bâbord) ou droit (tribord). Le point extérieur opposé est appelé l’écoute.
Ancre à jet : ancres de moindre dimension que les autres ancres, employées pour procurer des points fixes dans la mer ; on les fait porter par des embarcations qui les mouillent aux lieux indiqués.
Ancre de bossoir : ancre d’usage courant toujours suspendue ou à portée d’être suspendue aux supports nommés bossoirs, afin d’être facilement jetée à la mer ou mouillée.
Anordir : se dit du vent quand il tourne au nord.
Arriver de quelques points : s’éloigner de quelques points.
Artimon : voile aurique qui s’envergue sur la corne d’artimon, et se lace au mât d’artimon.
Auriques (voiles) : voiles à quatre côtés non symétriques.
Aussières : sorte de cordage de forte dimension à trois ou quatre torons, pouvant servir d’amarre ou de remorque.
Azimut : angle que fait un plan vertical fixe avec le plan vertical passant par un corps céleste.
Bâbord amures : “avoir les amures à bâbord ou à tribord”, se dit quand la voilure est disposée à recevoir le vent par la droite ou par la gauche. Changer d’amures : virer de bord.
Baleinoptères : genre de cétacés des mers froides, appelés rorquals et pouvant atteindre quinze à seize mètres.
Bande de watersky (voir Watersky).
Barre (laisser la barre à bord) : laisser la barre ou gouvernail à fond le plus possible. La barre est le levier qui commande le gouvernail.
Baux : poutres principales placées en travers des bâtiments pour en lier les deux murailles, pour les maintenir dans l’écartement voulu, ou pour supporter les bordages des ponts, ainsi que leur charge.
Bergs (icebergs) : grandes masses de glaces flottantes ou ancrées qui se sont détachées d’un glacier ou de la falaise côtière. Ils ont souvent une hauteur et une superficie considérable.
Bôme : vergue sur laquelle se borde la brigantine.
Bordages : revêtement qui couvre les membrures d’un navire.
Bordée : ensemble des marins affectés spécialement au service d’un des côtés du navire : bordée des tribordais ou des bâbordais.
Bossoir : pièce de bois ou de fer qui supporte l’ancre ; sorte d’arc-boutant auquel on suspend une embarcation en dehors du navire. (On dit aussi : porte-manteaux.)
Boucanier : marins ou navires antillais qui chassaient le bœuf sauvage et exerçaient souvent la piraterie. Ces marins ont été très renommés.
Bourguignons : nom donné par les Terre-Neuviens aux glaçons isolés ou détachés.
Brassiage : mesure à la sonde de la profondeur de l’eau.
Brick : navire à voiles de petit tonnage, à deux mâts à voiles carrées.
Brigantine : voile trapézoïdale, enverguée sur la corne d’artimon.
Caisson : banquette d’attache ou fixe en forme de caisse, servant à renfermer les provisions, ustensiles, etc.
Cambuse : magasin situé dans l’entrepont d’un navire où se conservent et se distribuent les vivres.
Canot major : canot du bord affecté au service de l’état-major.
Cape (mettre à la cape) : mettre, par mauvais temps, le moins de voile possible, de façon à produire, par dérive, une zone de calme pour le navire ; rester à la cape : rester en vitesse réduite.
Chasser sur les ancres : se dit d’un navire, quand étant au mouillage il entraîne ses ancres par effet du vent, du courant et de la mer.
Clairière : nom donné à un passage de mer plus ou moins étroit entre deux bancs flottants de glace.
Cœlophone : sorte de coffret à musique à soufflets actionnés à l’aide d’une manivelle et sur lequel on fait passer des registres à musique (papier perforé). Cet instrument donne un son assez semblable à celui de l’harmonium.
Compas : les marins appellent ordinairement les boussoles du nom de compas ; ainsi, celles qui servent à diriger la route d’un bâtiment s’appellent compas de route, compas de mer ou, plus simplement, compas.
Coques (par suite de coques) : sorte d’anneau, de boucle, qui se trouve dans les cordages, ce qui les empêche de courir dans les poulies lorsqu’ils sont sollicités. Si l’on n’y pourvoit à temps, ce peut être un obstacle ou une cause d’avarie.
Corne d’artimon : sorte de vergue dont un bout s’appuie par un croissant, sur l’arrière d’un mât, et dont l’autre bout est soulevé obliquement par des cordages qui appellent du haut de ce mât ; on se sert de cornes pour l’artimon, la brigantine, etc.
Dalles : conduit pour l’écoulement des eaux (dalots).
Déraper : détacher, ou se détacher du fond, en parlant d’une ancre.
Dérive : déviation de la route d’un vaisseau, causée par les vents ou les courants.
Déverguer : dépouiller de ses vergues.
Diatomées : algues microscopiques, qui forment dans les eaux douces ou salées des amas brun rougeâtre de consistance gélatineuse.
Donner dans (une passe ou un port), c’est faire route pour traverser la passe ou pour entrer dans le port.
Donner de la bande : inclinaison transversale que prend un navire sous le poids d’un arrimage mal fait, ou sous l’effort du vent.
Donner un bon tour (à un cap), c’est le contourner à assez de distance pour qu’il n’y ait pas de danger d’y toucher.
Drift-ice : glaces flottantes qui dérivent sous l’effet du vent ou des courants.
Drisse : cordage qui sert à dresser une voile, un pavillon.
Droite de hauteur : méthode de calcul astronomique pour établir le point, c’est-à-dire la position du navire par des observations stellaires, étoiles, lune, soleil ou planètes.
Drosser : se dit des courants ou du vent qui dérangent un navire dans sa course, et le portent d’un bord ou de l’autre, ou vers une côte.
Dunette : partie d’un navire située à l’arrière, sur le pont, au-dessus du logement du commandant, et qui est plus élevée que le reste du pont.
Élonger (une ancre), c’est la faire porter ou mouiller par une embarcation dans une direction prescrite.
Embouquer : s’engager dans une passe étroite.
Embraquer : tirer sur un cordage pour le raidir.
Encablure : le dixième d’un mille marin, soit 185,2 m.
Erratique : bloc de roche qui se trouve transporté par glaces à une grande distance de son gisement naturel.
Erre (prendre de l’erre) : ce mot signifie vitesse, élan, quand il est question de la marche d’un navire.
Espars : bouts de mâts de huit, douze et dix-huit mètres de long, servant à faire des mâts, ou des vergues d’embarcation.
Étaler : résister avec égalité, se soutenir contre, maintenir l’équilibre.
Étambot : forte pièce de bois, implantée dans la quille d’un navire, qu’elle continue obliquement à l’arrière.
État absolu (des chronomètres) : pour un instant donné, différence qui existe entre l’heure du temps que l’on considère et l’heure marquée par cette montre à ce même instant. L’état absolu d’une montre marine est la constatation de sa marche, qui, lorsqu’elle est bien connue, met à même de la suivre avec succès pour en déduire la détermination de la longitude du lieu où se trouve le navire.
Évitage : mouvement de rotation d’un navire autour d’une ancre sur laquelle il est mouillé. Espace suffisant pour qu’il puisse exécuter ce mouvement.
Éviter : se dit d’un navire qui exécute un mouvement de rotation sur ses ancres.
Fausse quille : suite de pièces de construction qui doublent la quille extérieurement, qui la garantissent dans les échouages et qui donnent du pied au navire contre la dérive. La fausse quille est doublée de cuivre.
Filage de l’huile : opération consistant à répandre de l’huile sur la mer, dans le but de calmer la violence des vagues.
Filer de la chaîne : lâcher, laisser aller pour diminuer la tension.
Floes : morceaux grands ou petits de glace flottant sur l’océan. Leur superficie peut varier de quelques mètres carrés à plusieurs kilomètres carrés.
Flottaison : partie de la coque d’un bâtiment où, lorsqu’il est droit, il est atteint par la surface d’une eau tranquille.
Former (la mer se forme) : c’est-à-dire qu’elle devient plus agitée.
Frapper (sur) : assujettir un cordage.
Fuste : bâtiment long et à bas bord, marchant à la voile ou à la rame.
Gaillard d’avant (ou d’arrière) : partie extrême du pont supérieur d’un navire.
Gisement : situation des côtes ; leur direction générale par rapport à un point fixe.
Grands haubans : haubans du grand mât.
Grand panneau : celui qui sert à fermer la grande écoutille (trappe pratiquée sur le pont du navire, pour descendre à l’intérieur).
Guibre : construction ayant pour but de fournir au gréement de beaupré (mât saillant horizontalement de l’avant du navire) des points d’appui en saillie de l’étrave.
Guidon : pavillon triangulaire ou à deux pointes servant d’insigne de commandement.
Guindeau : treuil horizontal pour lever les ancres.
Haler l’ouest : se dit quand le vent, en s’approchant, change progressivement de direction.
Hanche : partie de l’arrière du navire entre les porte-haubans d’artimon et la poupe.
Haubans : cordages servant à étayer les mâts d’un navire.
Hauteur méridienne d’un astre est sa hauteur lorsqu’il se trouve dans le méridien du lieu de l’observateur.
Huile (emploi de l’huile) : voir Filage.
Hummocks : monticules de glace de mer accumulés les uns sur les autres.
Hunier (petit) : voiles dites carrées, fixées aux vergues des mâts.
Hunières : voiles de hunier.
Iceblink : lueur jaunâtre dans le ciel produite par la réverbération sur les nuages de masses de glaces et aperçue avant les glaces elles-mêmes.
Inlandsis : nom donné à toute calotte glaciaire ou à une grande accumulation de glace reposant sur un fond continental.
Iskant : lisière de la banquise.
Jaumières : ouvertures pratiquées dans la voûte d’un vaisseau pour le passage de la tête du gouvernail.
Landblink : réverbération sur les nuages de terres couvertes de neige, dont le gisement s’annonce ainsi à l’horizon.
Libre pratique : permission accordée à un navire de communiquer après l’accomplissement des formalités sanitaires.
Life boat : canot de sauvetage.
Ligne du loch : cordage de six à douze fils, long de soixante brasses (environ un mètre soixante) ; la ligne du loch sert à jeter, retenir et retirer le loch.
Loch : petit secteur en bois flottant verticalement, jeté à la mer à l’aide d’une ligne pour évaluer la marche du navire. L’ancien loch est remplacé maintenant par une hélice en cuivre rattachée à une ligne de loch en filin tressé. Cette hélice est immergée, et par la vitesse (déplacement du navire) son mouvement de rotation se transmet à la ligne, reliée à un cadran enregistreur. Il suffira de lire sur ce cadran le nombre de milles (mille huit cent cinquante-deux mètres) parcourus en une heure, pour se rendre compte de la vitesse du navire.
Loffer : diriger le gouvernail et manœuvrer les voiles de manière à ce que le navire fasse avec la quille un angle moins ouvert avec la direction du vent. Loffer est le contraire d’abattre.
Maître-bau : le grand bau est celui situé dans la plus grande largeur du navire.
Maître-couple : la plus grande des pièces qui s’élèvent de chaque côté de la quille, jusqu’à la hauteur du plat-bord.
Manœuvre : sorte de cordage du bord.
Marner : monter au-dessus du niveau ordinaire, en parlant de la marée.
Mât d’artimon : le plus petit des trois mâts verticaux d’un navire, dit à trois mâts.
Mât de misaine : mât d’avant, appelé aussi “trinquet”.
Mégaptères : genre de cétacés voisins des baleines que l’on rencontre dans presque toutes les mers.
Membrures : totalité des couples et des membres d’un bâtiment. Les couples sont les pièces courbes symétriques par rapport à la quille et montant par parties accouplées jusqu’au plat-bord. Les membres sont les grosses pièces qui forment les couples du navire.
Nid de corbeau : tonneau fixé au mât de misaine aussi haut que possible et qui permet à un homme de vigie d’annoncer des navires, ou des terres.
Nœud : pour préciser la vitesse d’un navire, on dit qu’il file tant de nœuds, marqués sur la ligne de loch ; le nœud correspond à la cent vingtième partie d’un mille marin, soit quinze mètres quarante-trois.
Nunatak : escarpements rocheux dans un glacier.
Œuvres vives : carène immergée d’un navire.
Pack : terme employé par les explorateurs polaires pour désigner une vaste étendue de glaces flottantes.
Parasélène : cercle lumineux autour de la lune.
Parhélie : image du soleil réfléchie dans un nuage formé de cristaux de glace.
Pavois de bastingage : bordage cloué sur le plat-bord.
Pélagique (pêche) : pêche de haute mer.
Perroquet : mât, voile, vergue qui se grée au-dessus d’un mât de hune.
Petit pavois (être sous) : battre au mât, avant le pavillon de destination (mât arrière), le pavillon d’armement, et à la corne ou au mât de pavillon, le pavillon national.
Phanérogame : se dit des plantes dont les organes de reproduction sont apparents.
Plat-bord : bordage épais qui termine le pourtour d’un navire.
Pomme des mâts : petits blocs arrondis, ajustés à l’extrémité des mâts.
Porte-manteau : le canot que l’on hisse à bord aux bossoirs est dit être en porte-manteau, par suite on l’appelle porte-manteau. C’est aussi le nom des potences fixées aux bordages d’un navire et sur lesquelles on hisse les embarcations.
Poste de sondage : lieu où sont installés les appareils nécessaires à cette manœuvre.
Pousser les feux : pousser la vapeur ou augmenter la pression sur les chaudières.
Quarts sur tribord (deux) : changer la direction (la route) de deux points de compas sur la droite.
Raidir un cordage : c’est agir dessus avec assez de force pour le tendre.
Ranger : longer, passer près de (ranger une côte).
Relèvements : appréciation exacte d’un point.
Rockeries : tribus de pingouins ou de manchots.
Rôle d’équipage : distribution de l’équipage dans les divers services. Registre dans lequel sont inscrits les noms, qualités et conditions d’engagement de tout l’équipage navigant.
Rouf : logement établi sur le pont à l’arrière.
Rouleau (hunier à) : cylindre de bois dur qu’on voit en divers endroits à poste fixe.
Sabord : ouverture pratiquée dans la poupe.
Sain : se dit d’une côte sans danger, sans écueil.
Segment : division d’angles.
Serrer le vent : gouverner au plus près du vent que possible.
Soufflage : couche de bois que l’on ajoute à la carène d’un navire qui n’a pas assez de stabilité.
Sous le vent de : être en deçà d’un autre navire ou d’un rivage par rapport au vent.
Stationnaire : petit bâtiment de guerre mouillé en tête d’une rade, à l’entrée d’un port.
Subrécargue : agent d’un armateur sur un bâtiment, pour en administrer et régir la comptabilité.
Suroît : vent du sud-ouest.
Taret : sorte de ver qui attaque les bois de construction.
Tenue du fond : on donne ce nom à la qualité, bonne ou mauvaise, du fond d’un mouillage.
Théodolite : instrument géodésique qui a pour but de ramener à l’horizon les angles observés à son aide, quelle que soit la hauteur des points observés.
Thermomètre à minima : thermomètre qui indique la température minimum à laquelle il se trouve porté.
Thermomètre à renversement : thermomètre dont le mécanisme est déclenché par un simple renversement.
Tirant d’eau : quantité dont un navire s’enfonce verticalement dans l’eau depuis la quille jusqu’à la flottaison.
Tour d’horizon : placer le navire successivement dans tous les points de la rose des vents, ce qui permet avec des relèvements à terre de procéder à la compensation du compas étalon (réglage du compas).
Travers (par le) : apercevoir un objet perpendiculairement à la quille du navire.
Trinquette : voile triangulaire portée par la vergue du mât de misaine.
Va-et-vient : filin établi entre la terre et un navire, ou entre deux rives, pour établir une communication.
Vélage : détonations produites par la dislocation des icebergs qui se désagrègent par suite de la hausse de température ou par le contact avec les courants chauds.
Vergues : longues pièces de bois qu’on installe sur les mâts d’un navire et qui portent la plus grande partie des voiles. Elles se désignent par les noms des voiles qui y sont enverguées.
Virer l’ancre : faire effort sur une ancre, afin de lever cette ancre et de s’en rapprocher.
Voiles auriques : voir Auriques.
Voiles en pointe (sous les) : qualification que l’on donne aux voiles autres que celles dites “carrées”.
Watersky : bandes noires dans le ciel, produites par la réverbération sur les nuages de mer libre ou de clairières entre des bancs de glaces flottantes.
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Juillet 2013
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : Jacques, Jean-Marc, FabienB, PatriceC, Coolmicro.
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.