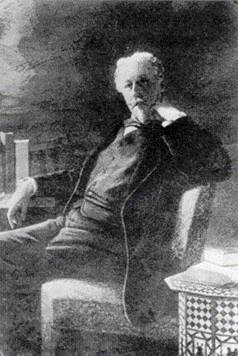
Arthur de Gobineau
(1816 – 1882)
LE MOUCHOIR ROUGE ET AUTRES NOUVELLES
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/
Table des matières
Chapitre premier Comment ledit Scaramouche se trouva épris d’une grande dame
Chapitre II Comment Scaramouche empêcha le Comte Foscari de faire un riche mariage
Chapitre III Comment Scaramouche s’était jusque-là méconnu, et de la conclusion de son histoire
À propos de cette édition électronique
SCARAMOUCHE
Chapitre premier
Comment ledit
Scaramouche se trouva épris d’une grande dame
Ami lecteur, t’attendrais-tu par hasard à me voir commencer cette historiette par : « La lune pâle se levait sur un ténébreux horizon… » ou par : « Trois jeunes hommes, l’un blond, l’autre brun et le troisième rouge, gravissaient péniblement… » ou par… Ma foi, non ! tous ces débuts, étant vulgaires, sont ennuyeux et, puisque je n’ai pas assez d’imagination pour te jeter sur la scène de mon récit d’une manière un peu neuve, j’aime mieux ne pas commencer du tout et t’avertir tout bonnement que Matteo Cigoli était, de l’aveu général, le meilleur garçon, le plus gai, le plus actif et le plus spirituel qu’eût produit son village, situé à quelques lieues de Bologne. Au moment où nous le ramassons sur la grand-route, il est dix heures du matin ; le soleil brûle la poussière et Matteo vient de faire ses adieux à monsieur son père. Que de tendresse dans ces adieux !
– Jeune homme, lui a dit le patriarche, grand et fort comme tu es, tu manges trop ; va te nourrir ailleurs. Surtout sois vertueux et que je ne te revoie jamais, sinon…
Ici l’orateur avait tracé du pied et de la main une sorte d’hiéroglyphe plus compréhensible que ceux de feu Champollion ; puis il avait ajouté :
– Voici un bâton et ta gourde pleine de vin. Bonjour.
Matteo, vivement stimulé par le geste de l’auteur de ses jours, était parti au pas de course. Et le voilà, avec ses dix-huit ans, lancé dans le monde, comme jadis Sixte-Quint, Giotto, Salvator, Pierre de Cortone et tant d’autres. Marche, ô Matteo ! je ne doute pas qu’il ne t’arrive plus d’une étonnante aventure !
J’achève en hâte mon invocation, car je m’aperçois que mon héros a rejoint sur la grand-route un vaste chariot qui se traîne paresseusement sous le soleil et qui me paraît contenir une joyeuse société.
– Ohé ! l’ami ! s’écria d’une voix forte un personnage décoré de magnifiques favoris noirs et lustrés, et qu’au fouet qu’il tenait en main on reconnaissait pour le conducteur, sommes-nous encore loin d’un village ?
– Je ne sais pas, mon bon seigneur, répondit Matteo, je ne suis pas du pays.
– J’ai terriblement soif, grommela l’automédon.
– Et moi furieusement, répétèrent deux personnages assez fantastiquement accoutrés qui se tenaient près de lui.
Aussitôt quatre ou cinq voix d’hommes, de femmes et d’enfants sortirent du creux de la machine et s’écrièrent :
– J’ai soif, moi ! J’ai faim ! J’ai chaud !
Bref, ce fut un concert qui proclamait tous les besoins tourmentant la frêle humanité.
Matteo, en homme qui s’ennuie d’aller à pied, offrit la gourde qui pendait à son bâton, elle fut acceptée avec reconnaissance, vidée avec soin et rendue au prêteur par le gros cocher qui l’accompagna de ces paroles gracieuses :
– Es-tu fatigué, toi ?
– Certes, oui.
– Monte dans la patache.
Matteo accepta avec une reconnaissance tellement empressée qu’il écrasa le pied d’un enfant et tomba sur les genoux d’une des femmes. En se relevant, il s’aperçut qu’elle était jolie et salua.
La carriole continua sa route du même pas traînard qu’auparavant, mais la présence de Matteo avait ranimé la conversation prête à s’éteindre. Il narra sa courte et prosaïque biographie, et il eut la satisfaction d’entendre la jeune femme sur les genoux de laquelle il avait fait son entrée dans le chariot s’écrier : « Poverino ! » d’une manière toute compatissante. Ensuite il s’enquit d’une voix timide de la profession de ses nouveaux amis.
– Corpo di Baccho ! s’écria le gros cocher, il faut que tu sois un rustre bien ignorant et bien peu favorisé de la fortune pour ne pas nous connaître. Jeune homme ! je suis Polichinelle ; ce monsieur brun et sec est l’honnête et bergamasque Arlequin ; Pizzi, lève ton nez et montre à ce brave garçon la face extravagante de l’honnête Tartaglia. Tu viens d’écraser le pied de l’Amour ; c’est sur les genoux de Colombine que tu es tombé, et, quant à cette vénérable matrone qui surcharge de son poids l’arrière de notre brouette, elle n’est artiste que dans les grandes circonstances ; d’ordinaire elle reçoit l’argent à la porte. Découvre-toi cependant, Matteo Cigoli, dame Barbara a produit deux chefs-d’œuvre : Colombine et moi !
Matteo ne put assez se féliciter en lui-même d’être, dès son début, tombé dans la société d’aussi augustes personnages ; il devint fort gai, partant spirituel, et se concilia l’affection de toute la société, à l’exception de Tartaglia, qui en lui-même trouva ridicules les regards que le nouvel arrivé jetait fréquemment du côté de Colombine.
– Cher ami ! s’écria tout à coup Arlequin d’un ton sentencieux, le contenu de ta gourde t’a conquis à jamais ma tendresse ; écoute-moi, je te prie, avec une grande attention. Dans ce coffre, dit-il en frappant du doigt sur la caisse à demi défoncée qui lui servait de siège, dans ce coffre se trouvent la fortune et la gloire, consistant en un nez postiche, un pantalon, une perruque et autres accessoires.
– Matteo Cigoli, reprit Polichinelle en second dessus, notre cousin Carpaccio a eu la sottise de déserter le culte des Muses pour se faire chaudronnier ; je me joins à Arlequin pour t’offrir sa dépouille. Quelle magnifique position nous te présentons là ! D’abord part à nos bénéfices ! Quand je dis part, c’est demi-part ! mais part entière à notre vie aventureuse, à notre incomparable fainéantise, à nos délicieux plaisirs, à nos succès ! Oui, Matteo ! les duchesses, les marquises se font un devoir… tu remueras leurs cœurs à la pelle !
– Bah ! reprit Pantalon qui était couché au fond de la voiture entre deux paquets, et qui n’avait pas encore parlé, pourquoi tant de frais d’éloquence ? Il n’a pas le sou, cela se lit sur sa mine ; nous lui proposons notre appui…
– Notre protection, dit Barbara.
– Notre amitié, siffla Colombine.
– Notre carriole pour voyager, hurla Polichinelle, de l’air dont on reproche un bienfait.
– Et surtout une portion de notre gloire, psalmodia de nouveau Arlequin : c’est à prendre ou à laisser.
– Mais si, au lieu de parler tous à la fois, vous me laissiez le temps de vous répondre, répliqua Matteo, cela vaudrait bien mieux, car j’accepterais.
– Vraiment ?
– Avec joie et…
– Avec joie suffit, interrompit le gros Polichinelle en lui tendant les bras ; qu’il subisse un embrassement général !
Ému jusqu’aux larmes, Matteo se prêta volontiers à cette opération, espérant qu’après la figure huileuse de Polichinelle, la face anguleuse d’Arlequin, la mine bouffie de Tartaglia, l’angle aigu de Pantalon et le faciès inqualifiable de la vieille dame, il parviendrait à l’Eden semé de roses des joues de Colombine ; mais arrivé à cette dernière station, Tartaglia, n’y tenant plus, le jeta au fond de la voiture d’un coup de poing dans l’estomac, et il accompagna cette brutalité d’un regard si terrible, que le nouvel artiste dramatique jugea qu’il était prudent de ne pas l’exaspérer.
Cependant Polichinelle reprit :
– Veux-tu être Cassandre ?
– J’aimerais mieux un autre rôle, dit Matteo d’un air boudeur, en se frictionnant le creux de l’estomac.
– Eh bien, jeune ambitieux, le rôle du Docteur te convient-il ?
– C’est trop bête.
– Nous avons besoin d’un Scaramouche, observa Colombine.
– Scaramouche ! dit Matteo en cessant tout à coup de se préoccuper de sa santé ; Scaramouche ! n’est-ce pas le résolu Scaramouche qui parle vite, beaucoup et bien, qui embrouille et débrouille les intrigues, porte une collerette blanche et une longue épée ? Vive Dieu ! je me sens capable de m’élever à la hauteur de ce rôle. Eh ! je puis être mélancolique, sentimental, amoureux, voleur, escroc, honnête, stupide, fou, en un mot, le résumé de toutes les vertus et de toutes les faiblesses humaines comme ce grand modèle ! Je joue des castagnettes et pince de la guitare !
Le rayon du Ciel venait d’éclairer Matteo, et sa vocation se décidait. Il versa quelques larmes, tribut de son émotion, et serrant la main de Polichinelle d’une manière expressive :
– Ô mes frères ! s’écria-t-il, je suis Scaramouche !
Ici, donnant un vigoureux coup d’éperon à feu le cheval Pégase, que je ressuscite pour me servir dans cette narration noble et tout épique, je crois devoir, par égard pour le lecteur, sauter par-dessus les deux ou trois mois d’apprentissage de Matteo, non pas qu’ils aient été indignes de lui ; mais quand on a vu Phèdre, va-t-on parler de l’Alexandre ? Sa réputation arriva promptement à un degré assez remarquable pour que la troupe, dans laquelle il avait déjà pris une influence qui le disputait à celle de Polichinelle, résolût d’aller tenter la fortune à Venise la belle, la cité des plaisirs et de la fortune par excellence. Arlequin et Pantalon, qui étaient des gens de bon conseil, proposèrent de déterrer quelque abbé meurt-de-faim, comme il s’en trouvait tant dans la ville, afin qu’il leur fît des pièces. L’avis fut adopté – et dame Barbara n’eut pas longtemps à chercher pour trouver le pauvre abbé Corybante, petit jeune homme maladroit et malingre, grand amoureux des Muses, et n’ayant pas le sou. Le prix de chaque pièce fut fixé une fois pour toutes à dix écus, et l’abbé se mit au travail.
Comme il était heureux, ce pauvre abbé ! il allait enfin produire un fils de son imagination et empocher dix écus, chose rare, chose presque immémoriale dans sa vie ! Aussi, à dater de ce jour, combien il se montra distrait dans les leçons de latin dont il ennuyait les jeunes nobles, et dans les leçons de mandoline qui amusaient les jolies patriciennes ! Le matin de la représentation, l’abbé était complètement hors de lui lorsqu’il se présenta au palais Tiepolo pour faire le professeur auprès de la belle Rosetta, dont il était plus particulièrement le souffre-douleur. Il est bon de dire que la signora Rosetta Tiepolo était une riche héritière que la mort de ses parents avait fait tomber sous la tutelle de la Sérénissime République ; elle possédait des biens immenses en Candie et dans l’Archipel, et son illustre tutrice n’eût pas été fâchée de trouver un prétexte pour accaparer ces richesses. Cependant, on avait autorisé le comte Jean Foscari, un des jeunes nobles les plus ruinés de la République, à faire la cour à la belle Rosetta. Tout cela procédait convenablement, régulièrement, ennuyeusement et comme il convient à des personnes d’un haut rang.
– Arrivez donc, l’abbé ! dit la jeune fille. Où êtes-vous ? Que faites-vous ?
– Madame, je demande des millions d’excuses à Votre Excellence Illustrissime. Voici la musique ; commençons, s’il vous plaît… Ah ! pardon.
– Vous êtes bien ennuyeux, l’abbé, de laisser tomber la musique comme cela, mais vous avez quelque chose ! Oh ! la drôle de figure ! Je veux savoir ce que vous avez. Êtes-vous malade ?
– Non, Excellence.
– Vous ressemblez à un casse-noisettes.
– Excellence, je suis heureux quoique bien inquiet.
– Grands dieux ! que vos lenteurs m’impatientent ! s’écria l’irascible héritière en frappant du pied.
L’abbé prévit un orage, et, se hâtant de le détourner, il avoua qu’il était l’auteur de la pièce qui se jouait le soir même au théâtre de Saint-Ange.
– Vraiment, l’abbé ; vous avez donc de l’esprit ?
– J’ai fait plusieurs acrostiches sur le nom de Votre Excellence.
– Ah ! c’est vrai. Je veux voir votre pièce.
– Il est temps alors que Votre Excellence se hâte de faire retenir les places, dit le bon abbé en se rengorgeant ; car une grande partie en est déjà prise par la plus haute société.
Rosetta se mit à courir dans sa chambre, en appelant :
– Zanna ! Theresa ! Lotta ! qu’on vienne m’habiller. Vite, vite, vite ! Préparez la gondole. L’abbé, courez me retenir ma loge. Zanna, donnez-moi mon masque. Dépêchez-vous, grands dieux ! dépêchez-vous. Partez donc, l’abbé ! Vous n’êtes pas encore parti ? Il n’y aura plus de places ! Mon éventail, mes gants, mon bouquet. Bon, l’abbé est parti. Gondolier, chez la signora Cattarina Cornaro !
Et la gondole partit et arriva ; Rosetta s’élança avec vivacité vers le sofa où était couchée son indolente amie.
– Je viens te chercher pour que nous nous promenions, lui dit-elle ; puis j’ai chargé l’abbé de nous retenir une loge au théâtre de Saint-Ange, pour voir une pièce qu’il m’assure être fort belle.
– En effet, répondit Cattarina, qui savait toujours tous les bruits de la ville, on parle beaucoup de cette représentation. Il paraît même que le Scaramouche est assez bien tourné.
– Vraiment ?
– On le dit.
– Il faut voir cela.
– J’y consens.
– Nous partons ?
– D’accord.
Et, comme deux oiseaux, les charmantes filles s’élancèrent dans la gondole et s’y assirent. En passant dans le canal Saint-Georges, la signora Cornaro dit à son amie :
– Voilà ton beau fiancé.
En effet, une gondole élégante longeait la leur en ce moment.
Rosetta étouffa un bâillement profond avec son éventail, et répondit :
– Ah ! charmante, si tu savais comme il m’ennuie ! Cachons-nous de peur qu’il ne nous voie.
– Il n’a garde, répondit Cattarina : ne t’aperçois-tu pas qu’il est absorbé dans une conversation intime avec la Fiorella, prima donna du théâtre de Saint-Jean-Chrysostome ?
– Il a donc toujours cette Fiorella ? dit nonchalamment la future épouse. Quelle fidélité ! Ah ! voilà l’abbé. Gondolier, approchez du traghetto. L’abbé, sautez, et ne perdez pas votre perruque. Là, bien ! Les billets ?
– Les voilà, Excellence.
– Hâtons-nous !
La salle où Scaramouche et sa troupe donnaient leurs représentations était loin d’être digne du public d’élite qui s’y était réuni ce jour-là. Cependant, on paraissait faire peu d’attention à la rusticité du local, et de tous côtés on préludait par des rires de bon aloi au plaisir que l’on paraissait certain d’avoir et qu’on eut ; car jamais Polichinelle n’avait été plus vantard et plus colère, Tartaglia plus niais, Arlequin plus vif, Pantalon plus lourd et plus fin, Colombine plus jolie ; mais que dirai-je de Scaramouche ? Rappellerai-je qu’il fit pâmer un inquisiteur des Dix, qui de son existence n’avait ri, et que le morceau de musique qu’il chanta – car l’abbé avait eu le bon sens d’exploiter la voix magnifique que Matteo possédait à son insu – fit déclarer que, si ce garçon-là travaillait, il irait loin. De toutes parts ce ne furent qu’applaudissements, et, en sortant du spectacle, les nouveaux acteurs furent portés aux nues. Le comte Foscari décida que Colombine était digne d’attention ; mille guitares s’accordèrent pour elle ; quant à Rosetta, elle trouva Matteo si charmant, si charmant… (ma foi, j’ai peur que le lecteur ne craigne un conte de fées !) ; elle le trouva, dis-je, si charmant, qu’elle ne dormit pas de la nuit, se tourna et retourna sur sa blanche couchette, et mangea des confitures jusqu’à l’aurore pour s’occuper.
Le jour venu, elle envoya chercher l’abbé ; et, après quelques circonlocutions qui l’étonnèrent elle-même, tant elle avait la bonne habitude de céder à tous ses caprices, elle lui déclara qu’elle avait envie de voir un théâtre derrière la toile, et qu’il fallait qu’il la conduisît à celui de Polichinelle. L’abbé pâlit à cette proposition plus que hasardée : il balbutia, puis trouva, dans sa stupéfaction, la force de se roidir ; mais tout cela fut inutile : la résistance rendit à la belle Vénitienne sa force d’âme, et elle insista si bien que, quelques minutes après l’entrée de l’abbé au palais Tiepolo, Scaramouche et ses compagnons virent arriver au milieu d’eux le digne Corybante donnant le bras à un masque dont la taille semblait assez bien prise.
Cette entrée parut singulière au fantasque Arlequin, car la pureté des mœurs de l’abbé était hors de toute atteinte. Mais surtout, ce qui étonna tout le monde, c’est que le joli masque ne quitta pas le bras de son protecteur ; tandis que le protecteur paraissait fort embarrassé de sa personne, ménageait ses paroles comme des perles, et appelait Polichinelle Excellence. On était en train de répéter ; sur l’invitation spéciale de l’abbé, on continua. Par une sorte d’instinct, de coquetterie, pourrais-je dire, Matteo fut sémillant au dernier point, tant et tant que Colombine, qui voyait tout, lui dit bas en lui montrant le masque : « Gare au cœur ! » La répétition finie, le masque parla bas à l’abbé, et l’abbé dit : « Nous partons ! » Tartaglia, qui ne comprenait jamais pourquoi le timbre d’une horloge frappait douze coups quand l’aiguille était sur douze, lui répondit brutalement : « Eh bien, va-t’en ! » Scaramouche escorta galamment les visiteurs jusqu’à la porte et l’abbé, avec une répugnance visible, lui jeta ces paroles : « La signora vous invite à vous promener quelquefois sur la Piazzetta vers neuf heures. »
Ô premières sensations de l’amour, qu’on vous a décrites de fois avec justesse, et que vous serez encore décrites à l’infini ! Matteo se promena sur la Piazzetta ; Matteo aima ; une gondole venait le prendre à l’heure dite ; il y trouvait le masque et l’inévitable abbé qui se chargeait des réponses et qui bientôt accapara aussi les demandes ; car plus Matteo voyait sa silencieuse et invisible divinité, plus il devenait amoureux et – le mot est difficile à dire mais il est vrai – plus il perdait le sens. Que ces promenades étaient délicieuses ! Pendant deux heures, dans le plus absolu silence, on fendait les ondes de la lagune, et rien dans cet accord parfait de deux cœurs, rien absolument ne se faisait entendre que les prosaïques bâillements de l’abbé.
Matteo le torturait ; tous les jours c’était une nouvelle instance pour obtenir le nom de sa belle ; une fois même, il lui proposa de l’étrangler. L’abbé se moucha et lui tourna les talons.
Et vous croyez que Rosetta n’avait pas trouvé un but à son existence ? Vraiment elle était heureuse comme dix reines et cent princesses. L’abbé la tenait au courant de toutes les folies que le pauvre Scaramouche accumula bientôt et, comme elle sentit le besoin de faire partager son bonheur à quelqu’un, elle prit pour confidente la belle Cattarina Cornaro, et toutes deux riaient à la journée du comédien amoureux. On discutait gravement le genre de faveur qu’on lui accorderait ; un jour, c’était la silencieuse promenade en gondole ; un autre jour, une rencontre fortuite sous les arcades sombres des Procuraties ; on lui pinçait le bras et l’on s’éloignait rapidement. Divine plaisanterie ! vous faites le bonheur de la jeunesse !
Dans tout cela le plus malheureux, c’était ce bon Corybante.
Cependant, comme on ne peut manquer de trouver la vérité lorsqu’on la cherche avec ardeur, Matteo, après de longs calculs, avait découvert que sa maîtresse invisible était la femme d’un marchand de soieries qui demeurait à l’angle de la rue San-Giuliano, et dont les jalousies étaient toujours hermétiquement fermées. Peste ! je le crois ; elle recevait tour à tour ses trois amants. Il fit part, bien entendu, de cette belle découverte à l’abbé et elle causa de vifs éclats de rire.
Hélas ! il en vint à un tel degré d’amour qu’il méprisa l’insouciance heureuse et sans fatigue dans laquelle il avait vécu jusque-là. Il se prit à rêver palmes et couronnes. « Ah ! pensait-il, on dit que ma voix est belle et douce ! Si je pouvais la rendre assez mélodieuse pour en faire un appeau à l’amour !… Ne serais-je pas plus digne d’être aimé ? N’a-t-il pas fallu tout le génie d’un ange de bonté pour deviner sous ces habits grotesques tout ce que je suis peut-être ! Ô ma déesse, ô puissance encore inconnue qui me tires de la poussière, qui m’élèves à la gloire, je ne serai pas ingrat envers toi ! je travaillerai ! je… »
Le tout était débité en regardant les étoiles et les larmes aux yeux, comme cela se pratique généralement. Il confia son amour et ses projets à la belle et bonne Colombine. Elle pleura beaucoup ; car, à seize ans, on n’aime pas à perdre un ami ; elle lui conseilla de se défier de cette passion, n’augurant rien de favorable d’une femme aussi mystérieuse ; et enfin elle lui dit avec un gros soupir :
– Travaille ta voix, mon bon Matteo, réussis et pense à nous.
Scaramouche profita beaucoup avec les nouveaux maîtres qu’il se donna. La danse surtout et l’escrime firent de lui un des hommes les plus élégamment gracieux qui se pussent voir. Il n’apprit pas moins bien la grammaire et la belle prononciation toscane ; bientôt on n’eût pu le reconnaître pour le grossier comédien qui, à un an de là, était arrivé à Venise. Non ; sa main, désormais blanche et délicate, devint habile à faire naître l’harmonie sur le luth et sur la guitare, sur le violon et sur la difficile épinette. Sa voix incisive et sonore, dirigée par un maître célèbre et par son goût naturel, atteignit bientôt un grand degré de souplesse. Enfin la nouvelle de ses progrès se répandit de jour en jour par toute la ville où Scaramouche était adoré, et le bruit d’une heureuse semaine fut que le sans égal Matteo Cigoli, quittant les planches de la comédie, allait débuter sur la scène plus noble de l’Opéra, au théâtre de Saint-Jean-Chrysostome.
Et c’était l’amour qui avait opéré cette merveille. Si j’étais un écrivain classique, je pourrais ajouter une phrase plus ou moins fleurie, dont le sens serait : le petit drôle en a fait bien d’autres.
Pendant le temps que j’ai mis à vous tenir au courant des immenses travaux accomplis par Scaramouche, je n’ai pu vous raconter le sort du mobile de ces mêmes travaux, de son amour ; et, comme je n’aime point à retourner sur mes pas, sachez seulement qu’il avait été de mal en pis, c’est-à-dire qu’il était plus fort que jamais. Du côté de la signora Rosetta, les choses ne se passaient pas tout à fait ainsi ; cependant la nouvelle des succès de son amoureux, l’idée que c’était pour elle que cela était ainsi, l’avaient flattée ; et une fois, ô bonheur suprême pour un amant ! au moment où elle sortait de la gondole pour s’éloigner, elle s’était écriée d’une voix haute et intelligible :
– Bonsoir, monsieur !
Matteo faillit, de joie, en faire une maladie.
Cependant ; à Venise, tout se sait. Le cavalier Tiepolo, oncle de la belle héritière, avait appris de bonne source que sa nièce commettait des légèretés capables de la compromettre ; il en avait averti le fiancé Foscari qui avait ri aux larmes du récit de l’intrigue ; car l’abbé, soumis tout d’abord à un interrogatoire, avait avoué, avec force pleurs de repentir, que les amoureux n’en étaient à se parler que depuis deux jours. Du palais Foscari on s’était transporté en corps chez la signora Cattarina ; elle avait achevé d’exalter la gaîté de l’oncle et du fiancé en leur confirmant les faits ; et tous ensemble on s’était rendu chez la belle héritière, qui, aux premiers mots, avait ri à se tenir les côtes. Je ne sais cependant par quel caprice cette preuve de froideur parut ou insuffisante ou bizarre à messire Foscari, généralement peu jaloux ; il demanda des preuves, et la Vénitienne promit de lui en donner.
Effectivement, le lendemain, l’abbé Corybante entra dans la chambre de Matteo avec la répugnance d’un chien qu’on fouette : métaphore vulgaire, mais frappante d’exactitude. Il dit à son ami d’un air lugubre :
– Matteo, je viens vous annoncer une bien bonne nouvelle.
– Laquelle, l’abbé ? dit le jeune acteur.
– il m’est permis de vous dire le nom du masque.
– Ah ! parlez, parlez vite !
– C’est…
– La marchande de soieries ?
– Non.
– Parlez donc !
– C’est la signora Rosetta Tiepolo.
– La pupille de la République, qui demeure sur le grand canal, dans ce palais bâti par le Sansovino ? Impossible !
Matteo était anéanti. L’abbé prit une prise de tabac.
– Très possible, plus que possible : c’est vrai. Ce soir, à minuit, elle vous attend à une fenêtre basse ; vous lui parlerez de votre gondole.
– Que de bonheurs ! que de bonheurs ! s’écria l’amant en frappant des mains avec frénésie ; et je débute demain soir. Ah ! l’abbé, l’abbé, vous êtes mon ange gardien.
L’excellent Corybante, qui n’était pas un crocodile, se dit en lui-même :
– Je suis un bien grand misérable !
Et il se moucha. Il se jugeait mal ; il était tout simplement incapable de faire du mal à une puce et du bien à son père, c’est-à-dire le dernier insecte de la création.
La représentation était affichée en grosses lettres par toute la ville pour le lendemain : Adonis, par…
Avant de s’habiller pour son rendez-vous, l’ex-Scaramouche alla faire ses adieux à ses camarades. Polichinelle le bouda, puis l’embrassa tendrement. Pantalon l’envoya promener. La mère noble l’appela ingrat, et menaça ses yeux d’une cohésion fort vive avec ses ongles. Arlequin lui donna de sages conseils, et Tartaglia, ayant mis Colombine sous clef, le serra dans ses bras avec transport et lui souhaita beaucoup de prospérité.
Il sortit du théâtre ; le soir vint, puis la nuit, puis minuit.
Rosetta, sans masque, dans toute sa jeune beauté, fraîche comme les roses, était appuyée sur son balcon à l’heure où la gondole de Matteo s’arrêta au-dessous. Les rideaux pourpres de la croisée étaient fermés derrière elle, de sorte qu’elle semblait devoir être toute à celui qu’elle attendait.
Pour Matteo, il osait à peine la regarder ; la beauté de la patricienne était pour lui quelque chose de céleste qu’un regard, pensait-il, pourrait peut-être profaner. Il s’élança cependant hors de la gondole, et se tint debout, les deux pieds sur une pierre sculptée qui ressortait de la muraille, de telle sorte que, la tête au niveau de la fenêtre, il appuyait son bras sur le tapis de Perse qu’on y avait étalé. Il était rouge, embarrassé, ému, heureux enfin !
Rosetta lui dit :
– Quand débutez-vous ?
– Demain soir, madame.
– Le cœur vous tremble-t-il ?
– Ah ! jugez-en, mon amour !… (et il se reprit modestement), ma vie est attachée à cette gloire. Sans elle, je perds tout et je deviens indigne à jamais !…
– Je voudrais bien entendre quelque chose de cet opéra nouveau.
– Je vais chanter, dit-il avec une simplicité pleine de douceur.
Et, se redressant avec une sorte d’inspiration noble et calme, il livra au vent cette cavatine passionnée :
Morir per te non mi doglie…
On assure que le célèbre Marchesi la regardait comme un chef-d’œuvre.
L’oncle Tiepolo, le chevalier Foscari et Cattarina, qui étaient dans le salon, furent quasi attendris par la mélodieuse voix de l’amant ; cependant ils revinrent bien vite de leur distraction et, s’avançant tous trois vers la croisée :
– Madame, dit Foscari à Rosetta en tirant le rideau, vous avez convaincu mon amour avec autant d’esprit que de force. Nul soupçon ne m’est plus permis. Et toi, brave garçon, tu chantes à faire envie à un rossignol ; avec cela tu grimpes bien aux murs ; c’est en considération de ces qualités que tu ne seras pas bâtonné comme tu le mérites ! va-t’en en paix, et que je ne te revoie jamais sous mes pas.
Matteo, pendant ce discours, était devenu plus blanc que ses dentelles ; car, en voyant Rosetta rester calme et sourire tandis qu’on l’insultait, il lui fallut reconnaître qu’il était victime d’un infâme guet-apens auquel elle avait prêté les mains.
– Gondoliers, approchez ! dit l’oncle. Recevez monsieur, ajouta le comte en riant.
Et il le poussa d’une telle façon que Matteo tomba la tête la première dans le canal. Il eut le temps d’entendre le rire de Rosetta se mêler à celui des autres, puis il s’enfonça dans l’eau verdâtre, et s’évanouit.
Ses gondoliers, bonnes gens, au lieu de s’en aller, le retirèrent à grand-peine ; il est vrai qu’ils n’étaient pas encore payés ; puis, comme ils connaissaient le comédien, ils le portèrent à son logement. On le mit au lit ; deux heures s’écoulèrent et il ne reprenait pas connaissance. Le médecin que l’on fit appeler le traita comme un noyé, puis comme un asphyxié, puis comme un mort. Matteo revint à lui sur ces entrefaites ; mais il avait reçu un coup funeste. Il eut quelque peine à retrouver le souvenir de ce qui venait de se passer. Son amour le remit sur la voie ; son esprit, par habitude, courut à l’image de Rosetta, et, le rire moqueur de la jeune fille lui revenant tout à coup en mémoire, il se mit à pleurer comme un enfant.
La nouvelle de son aventure s’était bien vite répandue. Les acteurs principaux en avaient amusé les oisifs des Procuraties ; et Rosetta, craignant comme le feu qu’on ne soupçonnât son cœur d’avoir été pour quelque chose dans cette affaire, s’empressa d’en régaler toutes ses amies. L’impresario de l’Opéra n’apprit pas plus tôt l’événement qu’il trembla pour sa représentation du soir ; le doge et la Seigneurie tout entière devaient s’y trouver, il n’y avait donc pas de retard possible. Je me trompe : le digne directeur était parfaitement libre de retarder le plaisir de tant de nobles patriciens en courant le risque de passer quelques jours en prison. À tort ou à raison, cette idée lui répugnait. Il prit sa canne et son chapeau, et courut chez l’infortuné ténor aussi vite que ses jambes le purent porter.
– Ah ! per lo bambino, cher seigneur, vous voilà bien malade ? Quelle douleur pour moi ! quel désespoir ! je voudrais être en votre place, mon cher amour ! Laissez-moi relever cet oreiller. Vous donnerai-je cette potion ? Prenez cette tisane ; ah ! prenez-la pour l’amour de moi !
– Monsieur, dit la vigilante hôtesse, qui s’était installée dans la chambre du malade pour voir un peu de quoi se composait sa garde-robe, connaissance bonne à avoir en cas de mort, monsieur, on lui a recommandé le repos.
– Le repos ? le repos, chère dame ? Ah ! le pauvre ami, qu’il se repose ! Ne parlez pas, ne parlez pas, mon enfant ; reposez-vous bien jusqu’à cinq heures.
– Comment ! jusqu’à cinq heures ! dit l’hôtesse ; est-ce que vous voulez le faire jouer ce soir ?
– Moi ? non, oh ! certainement non. Mais la Sérénissime République, vénérable dame, la Sérénissime République veut qu’il joue ! Ah ! Seigneur Dieu, s’il ne jouait pas, je serais perdu, ruiné, emprisonné ! Il jouera ! N’est-ce pas que tu joueras, mon enfant, mon ami, mon fils, mon… ? Ah ! ah ! ah ! s’il ne jouait pas, je le ferais jeter au cachot !
– Mort-Dieu ! s’écria le malade, va-t’en à tous les millions de diables, je jouerai !
– Benissime, caro mio, très bien ; je m’en vais. Surtout pas d’imprudence ; il est deux heures, jusqu’à cinq heures, vous avez amplement le temps de vous reposer.
Jusqu’au moment de paraître sur la scène, le temps s’écoula pour Matteo dans une espèce d’assoupissement douloureux. Le souvenir de Rosetta jouissant de son humiliation ne quittait pas le cerveau de l’infortuné Scaramouche. Enfin l’heure fatale sonna. L’impresario envoya prendre son ténor ; du plus loin qu’il l’aperçut, il ne se fit pas illusion, mais il se dit : « Pourvu qu’il paraisse, on saura bien que le reste ne dépendait pas de moi. »
La salle était remplie : la curiosité de voir Scaramouche devenu le sentimental et infortuné amant de Vénus était universelle. Le doge et ses conseillers, le corps diplomatique, les belles dames, les élégants cavaliers s’encombraient dans les loges tapissées de velours, galonnées d’or, où une illumination a giorno jetait des flots de lumière. L’ouverture obtint un grand succès ; cependant on voulait le chanteur et non la musique ; le chanteur, le pauvre chanteur, dont le cœur était déchiré pour l’amour d’une femme qui brillait à l’une des plus belles loges.
La toile se leva, Vénus parut. C’était la ravissante Fiorella qui faisait ce rôle ; elle fut fort applaudie et elle le méritait ; puis vint Mars, le dieu de la guerre. Je me souviens qu’il avait un ventre énorme et des jambes torses ; mais, avec cela, une de ces basses formidables, indispensables à un guerrier. Puis vint Adonis : il était pâle comme la fleur née de la dépouille de Narcisse ; il s’avança lentement du fond de la scène, et sa démarche était si noble, sa pose si nonchalamment rêveuse et triste, sa pâleur même se mariait avec tant de charme à la couronne de fleurs diverses qui ceignait sa tête, qu’un murmure flatteur passa sur toutes les lèvres. Il ouvrit la bouche, étendit les bras vers Vénus, rencontra les yeux de Rosetta… l’orchestre se tut ; la salle profondément stupéfaite s’effraya ; aucun son ne sortit des lèvres bleues de l’acteur ; il fit des efforts inouïs, déchirants, hélas, inutiles ! Sa tête se perdit, et il tomba comme foudroyé sur les planches d’où il fallut l’emporter.
Préalablement on le mit à la porte. L’amour lui coûtait : I la paix de l’ignorance ; 2 sa voix ; 3 son pain.
Comme il fallait manger avant tout, opération préparatoire sans laquelle on est bientôt hors d’état de soupirer, il retourna au théâtre de Polichinelle qui, depuis son départ, avait un peu perdu de sa vogue. On l’embrassa, on s’attendrit sur ses douleurs et, agréant sa proposition, on se résolut à quitter l’ingrate Venise pour Florence. La vue des lagunes poignardait Scaramouche. D’ailleurs, le grand-duc de Toscane, homme de plaisir et de goût, qui avait entendu exalter la supériorité de Matteo sur toutes les autres troupes du même genre, faisait depuis longtemps, par l’organe de son envoyé à Venise, de très belles propositions qui, cette fois, furent acceptées. Inutile de dire que le prince fut aussi enchanté des acteurs que l’avaient été les Vénitiens, et que Scaramouche vit commencer l’aurore d’une faveur telle que les courtisans et ses camarades n’en pouvaient prévoir la portée.
Cependant le destin avait résolu de ne pas le laisser en paix de quelque temps. Pour connaître les menées de ce Dieu aveugle, je ramène brusquement le lecteur à Venise, où Rosetta, revenue des frayeurs que lui avait causées son invasion dans la vie théâtrale, recommençait à mener la vie la plus ennuyeuse. Pour surcroît de malheur, l’abbé, ayant hérité d’une de ses tantes religieuse, était parti pour Rome et ne pouvait plus lui servir de jouet. Aussi regrettait-elle beaucoup son petit Scaramouche avec ses airs passionnés si amusants ; et en faisait-elle d’interminables lamentations avec son inséparable amie.
Un jour, elle apprit que son ex-amoureux obtenait les triomphes les plus flatteurs en Toscane, et que le grand-duc lui avait donné le titre de premier valet de chambre, emploi qui pouvait le mener très loin. Cette heureuse fortune de Matteo lui parut une taquinerie de la destinée à son endroit et, tout en se lissant les cheveux avec sa jolie main, elle dit à la signora Cornaro :
– Veux-tu que je le fasse revenir ?
– Revenir ! Sainte mère de Dieu ! Matteo revenir ! Tu n’y penses pas, ma toute charmante ? Il doit te haïr plus que Lucifer et tu veux te mettre en balance avec les grands succès qu’il obtient, l’argent qu’il gagne et les faveurs dont on le comble ? Permets-moi de te dire que c’est la démence de l’amour-propre.
– Démence ou bon sens, à ton gré, continua la belle enfant ; mais, si je veux, il viendra à Venise.
Cattarina continua à nier, Rosetta à affirmer. Pari fait et tenu. Six mois furent fixés pour la durée de la négociation et le plus grand silence juré, attendu que la réputation de la signora Tiepolo aurait pu souffrir si l’histoire s’était répandue. Elle prit la plume et, après quelque réflexion, fit partir le billet suivant :
« Ingrat ! fuir ainsi et m’abandonner à la tyrannie d’une famille soupçonneuse et d’un fiancé jaloux ! Revenez ; j’ai besoin de voir un ami, peut-être ne voudrai-je plus le quitter quand j’aurai pressé sa main.
Le Masque. »
Cette lettre fut remise à Matteo au sortir d’une représentation donnée au palais. Il la lut avec la plus louable attention, bien qu’en grinçant des dents et en frappant du pied, car c’était un naturel violent ; au bout d’un instant, il se calma et reprit l’épître sur laquelle il médita pendant une heure, assis dans un grand fauteuil et buvant un sorbet à petits coups, tandis que ses camarades et Colombine et Barbara bruissaient et cabriolaient dans la chambre.
– Que fait donc le favori du prince ? À quoi pense le ministre futur ? dit Arlequin.
– Vous répétez toujours la même chose, répondit Matteo, rêveur.
– Voyez donc le dissimulé, reprit Colombine ; il connaît bien l’histoire de Farinelli et il sait qu’il vaut tout autant.
– J’ai grand besoin d’aller à Venise, murmura Scaramouche en se parlant à lui-même.
– À Venise ! à Venise ! s’écria la sage et prudente assemblée avec stupéfaction ; es-tu devenu fou ?
– Non, j’ai des affaires à régler.
– Des affaires d’intérêt sans doute, observa ironiquement Tartaglia, avec le directeur de l’Opéra.
– Je te casse la tête si tu parles de ce damné théâtre, dit Matteo furieux et brandissant une chaise au-dessus du crâne du malencontreux jaloux ; quelle que soit la raison que j’en aie, je veux aller et j’irai à Venise.
Il prit son chapeau et sortit pour se rendre au palais et demander au grand-duc un congé pour lui et pour sa troupe ; je dis sa, car il en était directeur, et c’était justice. Si Polichinelle, en costume civil, pouvait se pavaner dans un bel habit de velours coquelicot, si le sombre Tartaglia avait pu garnir de verrous dans toute sa hauteur la porte de ces dames, si ces dames elles-mêmes prodiguaient tout le satin, la soie, le brocart, les fleurs et la toile d’argent dans leurs atours, c’était incontestablement à l’esprit incomparable du cent fois spirituel Scaramouche que tous en étaient redevables.
Le duc reçut Matteo gracieusement, comme à son ordinaire.
– Eh bien, dit Son Altesse, trop délicieux Scaramouche, que nous veut Votre Jovialité ?
– Monseigneur, répondit le saltimbanque touché de cette bonté parfaite, et s’inclinant avec émotion sur la main de l’illustre prince, j’oserai solliciter de Votre Altesse un moment d’entretien ?
– Volontiers Matteo. Messieurs, dit-il à ses courtisans, laissez-nous seuls un peu.
On put voir de loin le comédien s’exprimer avec les gestes d’une personne qui raconte. Le prince riait, puis bientôt sa gaieté fit place à une attention plus grave ; il parut laisser échapper des paroles de blâme, puis de compassion, puis enfin refuser une demande. Mais, quand il se rapprocha de la compagnie, on l’entendit s’exprimer en ces termes :
– Puisque tu y mets tant d’obstination, je consens ; emmène-les tous, mais souviens-toi bien que ton absence ne doit pas dépasser quelques semaines, sous peine de tomber dans ma disgrâce. Mon trésorier te portera ce soir 6.000 livres : accepte-les comme don de voyage.
– Le bon prince ! comme il fait le bonheur de ses peuples ! disait dame Barbara, en essuyant méthodiquement une larme qui n’était pas sur son vieil œil, tandis que Matteo racontait cette particularité et que Pantalon déplorait la perte de la veuve d’un conseiller. Scaramouche, pressé de partir, n’écouta aucune réclamation ; et, aidé de l’honnête Polichinelle, il eut bientôt déterré un carrosse commode, deux voitures de suite et un fourgon pour le bagage, de sorte que le lendemain, de grand matin, la caravane se mit en route pour Venise, où, après un voyage qui n’offrir aucune particularité remarquable, la bande arriva en parfait état de conservation.
Sitôt que la signora Tiepolo apprit l’arrivée de son soupirant, elle n’eut rien de plus pressé que de prendre sa mantille et son loup, de se jeter dans sa gondole et de se faire conduire chez Cattarina :
– Ah ! divine, lui dit-elle d’un petit ton triomphalement railleur ; le voilà, notre infidèle ! notre amant transi ! notre amoureux frénétique !
– Que dis-tu ?… Matteo !…
– Matteo, lui-même, belle confidente ! Serait-ce le Grand Turc, par hasard ? Il est vrai que si je me mettais en tête de le marier avec la République, j’y réussirais certainement.
– Bah ! Matteo est à Venise ! répéta la patricienne avec le plus grand étonnement. Ce gaillard-là n’a donc ni entrailles, ni amour-propre, à défaut de fierté ?
– Ah ! oui, fierté ! un comédien ! Pour toucher le bout du doigt d’une dame, ces gens-là tueraient père et mère ; mais je viens te chercher ; il va sans doute venir ; allons chez moi.
– Que prétends-tu faire, étourdie ?
– Moi ? rien ; quand j’aurai ri, je l’enverrai…
– Je comprends que tu l’enverras promener. Mais, tiens, à vrai dire, ce retour si prompt m’étonne, et je m’attends à quelque ennui.
– Je voudrais bien qu’il fît le fier, dit l’arrogante Rosetta ; il prendrait un second bain dans le canal.
Cependant, au milieu de tous ces discours, Cattarina avait appelé ses femmes ; une toilette élégante avait remplacé le déshabillé paresseux où l’avait trouvée son amie ; et elles partirent.
Les deux dames s’attendaient à trouver Matteo sur leur route ; elles ne le virent pas. Arrivées au palais Tiepolo, elles s’informèrent ; il n’était pas venu. Lecteur, je ne te tiendrai pas longtemps dans l’ignorance ; Matteo, était en ce moment dans une des prisons du palais ducal, et voici comme, à peine arrivé à Venise, il nous a échappé ; nous allons retourner à lui. Il se leva de bonne heure, fit venir un coiffeur et, s’étant fait poudrer convenablement, il mit sa veste ventre de biche brodée – veste sans égale lorsqu’elle dessinait sa taille svelte et souple – et ce magnifique habit de velours prune pailleté d’argent qui, depuis, a fait tant de victimes. Il donnait un dernier coup d’œil à sa toilette quand Colombine entra et, le voyant en si grands frais d’élégance, s’écria de la porte :
– Eh ! bon cher jésus ! où vas-tu, mon Adonis ?
– Où irais-je, Colombine, répondit gravement Scaramouche, sinon chez cette ingrate, cette infâme, cette…
– Trêve d’épithètes, je l’ai reconnue à la première. Sais-tu qu’en partant je soupçonnais une escapade de ce genre ? Tu ne m’as rien confié et dans le voyage je n’ai pu trouver l’occasion de te parler en secret. C’est une grande imprudence, Matteo !
– Peut-être. Tiens, elle m’a écrit ; voilà sa lettre.
– Le style en est pressant. C’est une impudente drôlesse ; te croit-elle assez bête pour ajouter foi à son maladroit verbiage ?
– Probablement, dit Matteo d’un air fat en donnant un dernier coup d’œil au miroir et en glissant avec indifférence un tout petit stylet dans la poche gauche de sa veste.
– Mais que veux-tu lui faire ?
Scaramouche prit un ton jovial :
– Rien ; lui planter ce bijou dans la gorge.
– Malheureux !… Au fait, tu n’as pas tort. Mais la police ? Songe que c’est une patricienne.
– Songe, toi, reprit le jeune homme, avec une fureur sans pareille, qu’elle s’est jouée d’un homme qui ne pensait pas à elle, l’a ensorcelé, l’a rendu plus idiot qu’un idiot ; puis, après l’avoir livré à la risée de ses amis, elle veut reprendre son jouet pour le fouler encore aux pieds ! Ah ! c’est trop !…
Matteo prononça ces paroles avec le plus grand emportement et, s’élançant de la chambre sans écouter Colombine, il sortit de la maison et s’achemina vers le canal pour y prendre une gondole. À ce moment, deux messieurs excessivement polis l’invitèrent à arrêter son choix sur la leur, qui était là à attendre, au bord du traghetto ; Scaramouche les remercia gracieusement et voulut continuer sa recherche, car, malgré leurs formes pleines d’aménité, ses interlocuteurs avaient des figures passablement patibulaires ; alors ils lui firent observer qu’ils avaient l’honneur d’appartenir aux trois inquisiteurs d’État, lesquels étaient fort désireux de l’entretenir. Le pauvre Matteo frémit de tout son corps et, comprenant qu’il était impossible de ne pas se rendre à une telle invitation, il entra dans la malencontreuse gondole et vint débarquer à une porte assez basse, sombre, et à laquelle il trouva un aspect très maussade. On le fit monter par un escalier éclairé au moyen de lampes fumeuses, attendu que le jour arrivait mal ou n’arrivait point à travers les murs épais ; et, toujours guidé par les deux messieurs si polis, il fut introduit dans un petit cabinet où on le laissa seul.
Dire qu’il se hâta, aussitôt qu’il fut assis, de réfléchir à sa position, ce serait lui faire copier tous les prisonniers présents, passés et futurs ; or je désire lui voir une nature d’exception, et en route il avait fait ce raisonnement très simple : un pauvre diable de comédien comme moi ne peut avoir affaire aux trois inquisiteurs, à moins de complot ou de crime d’État ; or, il est facile de prouver que je n’ai conspiré ni en action, ni en pensée, ni même en paroles ; si, supposant que je voulusse du mal à Rosetta, on m’eût arrêté par précaution, j’aurais tout bonnement comparu devant la « quarantie » criminelle, et non devant Eaque, Minos et Rhad… « Au fait, avait conclu Matteo avec beaucoup d’esprit, attendons et ne nous troublons pas, parce que ma main serait tantôt mal assurée. »
Il terminait ce consolant monologue, lorsque la porte s’ouvrit ; deux geôliers vinrent le prendre et, après quelques tours et détours dans des corridors dont la description serait peut-être de rigueur, il arriva dans une grande salle où il ne fut pas peu étonné de trouver, outre les figures rébarbatives des trois juges et des familiers, et la mine plombée d’un grand coquin dont l’air paraissait assez décontenancé, les figures joviales, bien qu’un peu stupéfaites, de ses camarades, bravement encadrés dans une bordure de sbires le sabre au poing.
– Matteo Cigoli, dit Scaramouche, commença le président d’une voix non moins digne que nasillarde, avant de répondre à nos questions, pénétrez-vous bien de cette vérité : comme Dieu, dont il est le représentant sur la terre, le vénérable Conseil n’ignore rien ; aucun détour, aucun mensonge n’est impénétrable pour lui, et ce que, dans votre intérêt, vous pouvez faire de mieux, c’est de dire toute la vérité. Déclarez-nous donc le jour où vous avez été pour la première fois chez l’ambassadeur d’Espagne.
Matteo répondit :
– Illustrissime juge, je ne connais pas du tout ce digne seigneur.
– Coquin ! s’écria le magistrat avec un air de dignité tout à fait imposant, ne cherche pas de subterfuges. Quand as-tu vu l’ambassadeur d’Espagne ? Quand as-tu transporté chez lui huit caisses contenant des fusils, des canons et même des couleuvrines ? Réponds catégoriquement.
L’étonnement de Matteo était devenu démesuré : cependant il se posa en victime, les deux pieds joints, les mains unies, le dos légèrement voûté, comme surchargé du poids d’une fortune adverse, la tête pendante sur la poitrine, et il fit cette courte harangue :
– Mon digne seigneur, si vous voulez faire comparaître l’envoyé de Florence, il vous dira que je n’ai quitté son maître que depuis huit jours ; que nous avons cependant habité cette ville auparavant, mes camarades et moi, et que jamais, pauvres artistes que nous sommes, nous n’avons cessé de mériter la confiance de l’Illustrissime République.
– Mais vous, Matteo Cigoli, dit Scaramouche, interrompit un second inquisiteur, vous ne nierez pas avoir eu personnellement des rapports avec des patriciens ?
– Au contraire, Illustrissime, je le nie.
– Qui donc aurait écrit cette lettre ? s’écrièrent en chœur les juges en montrant le brouillon de l’épître de Rosetta. Qui donc aurait caché sous une correspondance galante le fil d’une intrigue coupable ?
– Ma foi, monseigneur, puisqu’il s’agit du cou de tous mes camarades aussi bien que du mien, je vais vous narrer cette histoire.
Là-dessus, sans leur faire grâce d’un détail, depuis la visite première de l’abbé et du masque jusqu’à la chute de l’opéra d’Adonis, il raconta toute sa liaison avec la belle patricienne ; puis, pour donner un nouveau poids à sa déclaration, en disant ce qu’on ne lui demandait pas, il exhiba la lettre, la remit à ses juges ; et, en racontant la douleur et la honte qui n’avaient cessé de le poursuivre depuis la scène du plongeon, et la rage qui s’y était jointe depuis la nouvelle preuve d’outrecuidance de Rosetta, il se mit, avec une vivacité vraiment italienne, à pleurer, à crier, et il raconta tout du long la manière dont il avait résolu de se débarrasser de la perfide, quelques signes d’effroi que laissât échapper son inébranlable amie, la fidèle Colombine.
Lorsqu’il eut terminé son récit, les trois inquisiteurs se mirent à se consulter entre eux à voix basse. Le colloque dura longtemps ; mais enfin il finit, et celui qui avait presque toujours parlé, appelant un familier, lui dit quelques mots à l’oreille et s’adressa ensuite à l’assistance en ces termes :
– Le Conseil n’ignore rien ; les choses les plus cachées sont bientôt découvertes par sa haute sagesse. Il sait que le nommé Domenico Ragazzo, observateur des Dix, s’est trompé, sciemment ou à son insu, dans sa déposition ; il le condamne aux plombs pour le reste de ses jours. La troupe d’histrions, à savoir Polichinelle, Tartaglia, Colombine, Barbara, Arlequin, Pantalon et l’Amour, seront immédiatement mis en liberté et bannis à tout jamais de Venise, d’où ils devront sortir dans les deux heures qui vont suivre. Quant à Matteo Cigoli, dit Scaramouche, il sera remis entre les mains d’un huissier du Conseil, pour que les ordres du dit Conseil soient exécutés dans toute leur plénitude.
Cela dit, les trois juges se retirèrent. Domenico Ragazzo, l’observateur qui s’était trompé, fut emmené à son nouveau domicile, et toute la troupe, moins Matteo, fut mise à la porte du palais ducal. Colombine croyait bien que c’en était fait de son pauvre Scaramouche ; Polichinelle essayait de tromper sa douleur en se bourrant le nez de tabac, ce qui le faisait éternuer, et Arlequin, mécontent de l’air de béatitude que ne pouvait dissimuler Tartaglia en se voyant débarrassé d’un aussi épouvantable rival, s’était uni à Pantalon, qui déjà se distrayait en lui infligeant son pied dans la chute des reins.
Cependant Matteo, livré à son guide silencieux, avait été également conduit hors du palais ; une gondole élégante s’approcha ; le familier souffla deux mots dans l’oreille du gondolier, et l’on partit.
– Tenez-vous de manière à ce qu’on vous voie du dehors, dit gravement l’huissier en s’enfonçant dans un coin.
Matteo obéit.
Il était environ cinq heures de l’après-dînée. Cattarina et Rosetta, lasses d’attendre, étaient cependant restées à la croisée, et l’oncle Tiepolo et le fiancé Foscari badinaient avec elles.
– Par la Vierge, dit tout à coup Foscari, quel est ce gentilhomme qui se pavane dans une gondole ? C’est un étranger, je pense ; mais j’ai vu cette figure-là quelque part.
– Ce gentilhomme, dit Tiepolo après l’avoir examiné avec attention, ce gentilhomme est Scaramouche.
Rosetta échangea un brillant regard avec son amie ; ce regard voulait dire bien des choses ! Le triomphe, l’orgueil, la moquerie s’en disputaient l’éclat ; mais aussi le dépit de se voir si bien et si mal à propos entourée.
– Je crois vraiment, s’écria le fiancé, que la gondole s’arrête ici ! Le saltimbanque aurait-il pris la passion des bains froids ?
– Comment ! il revient encore ?, répondit l’oncle Tiepolo.
– Précisément, répliqua Foscari. Quelle effronterie ! Que diable peut-il avoir à nous dire ?
– Mais, interrompit Cattarina, quel est ce petit homme noir qui entre avec lui ?
– Est-ce que ces faquins-là n’ont pas des laquais comme nous ! observa dédaigneusement le vieil oncle.
– À coup sûr, reprit la belle Rosetta, ce n’est pas son laquais, car il fait bien des façons pour le laisser passer devant.
La compagnie se perdait ainsi en conjectures quand les arrivants furent introduits.
– Au nom du Conseil des Dix, s’écria l’huissier, qui avait un fausset très remarquable, Rosetta Tiepolo, patricienne de Venise, Votre Excellence connaît-elle cet homme ?
À cette redoutable interpellation, Rosetta pâlit étrangement. L’oncle et le fiancé reculèrent et Cattarina, prenant son voile, se hâta de sortir. L’huissier ne s’y opposa pas. Après quelques minutes d’attente, Rosetta répondit d’une voix faible :
– Oui.
– Avez-vous écrit cette lettre ?
– Oui.
– Le Conseil, considérant que la Sérénissime République, votre marraine et tutrice, doit prendre soin de votre honneur et ne peut vous permettre de le compromettre impunément, engage Votre Excellence à se retirer dans le couvent de Sainte-Marie. La gestion de ses biens appartiendra désormais au sérénissime prince.
L’arrêt était dur : payer une plaisanterie – cruelle, il est vrai, mais qui ne l’avait pas étonnamment amusée – de la perte de sa liberté et de ses biens, et de l’acquisition d’une vocation religieuse, était aussi pénible qu’on le peut dire. Mais que faire ? Obéir fut inévitable. Ce qui parut le plus affreux à la fière Rosetta, ce fut la présence de Scaramouche qui, tout généreux qu’il voulût être, laissa voir sa satisfaction. Pour lui, il s’empressait, voyant l’exécution faite, de prendre congé ; mais l’huissier, ordonnant au fiancé (assez bizarre commission) de mener Rosetta jusqu’à son couvent, ne voulut pas abandonner Matteo jusqu’à ce qu’il l’eût conduit en terre ferme ; là, il le quitta en le priant de se souvenir que, s’il mettait jamais les pieds à Venise, il n’aurait à accuser que lui seul de ce qui pourrait advenir.
Après le départ de l’huissier, Matteo se dirigea vers la plus prochaine auberge ; il y trouva ses compagnons qui le croyaient déjà au fond du canal Orfano, et qui eurent tant de joie de son retour que Tartaglia lui-même fut gagné par l’enthousiasme général ; ce n’étaient que trépignements joyeux, sauts de carpes, embrassades et cris, ou plutôt hurlements de joie. Cependant le jaloux reprit bientôt l’air le plus lugubre, quand Matteo, profitant d’un instant de silence, s’écria d’une voix émue :
– Mes chers, mes bons camarades, après bien des folies, je puis même dire des erreurs causées par un indigne amour, je reconnais enfin que je n’ai pas de meilleurs amis que vous, de plus tendre affection que toi, ma chère Colombine ! Dame Barbara, vos pigeons à la crapaudine étant incomparables, je vous prie de nous en confectionner en y mettant toute la science que vous tenez du cuisinier français, votre défunt époux ; mais avant tout, mais surtout je vous prie de m’accorder la main de mon adorable Colombine, à qui je prétends m’unir en légitime…
– Imbécile ! lui dit prestement la jolie fille en lui riant au nez, te voilà aussi bête que Tartaglia ; embrasse-moi ; ne sois amoureux de personne, pas même de ta très humble servante ; vivons tranquilles ou plutôt joyeux, et ne nous épousons que le moins possible.
Cela dit, elle se jeta à son cou.
Ce fut un signal général de renouvellement d’embrassades : le souper parut un moment après ; puis, après avoir bien mangé et bu davantage, on se mit à dormir, et la caravane repartit le matin pour Florence, où le grand-duc, apprenant ce qui était arrivé, la reçut avec plus de ferveur que jamais.
Chapitre II
Comment
Scaramouche empêcha le Comte Foscari de faire un riche mariage
Le grand-duc de Toscane se promena, pendant un quart d’heure d’une matinée de printemps, dans son cabinet tendu de velours rouge ; puis, s’étant gratté le front d’un air vivement contrarié, il sonna. Un chambellan entrouvrit la porte avec respect, et présenta son visage dévoué et prêt à obéir.
– Qu’on fasse venir M. Cigoli, dit Son Altesse.
Un moment après, Scaramouche s’inclinait devant le prince.
– Je t’aime, lui dit son souverain, et je crois t’en avoir donné mille preuves. Par toi, mes soirées sont devenues charmantes, piquantes et variées au-delà de toute expression ; comme auteur, tu es sans égal ; comme musicien, sans rival ; et même comme conseiller privé, je fais cas de tes avis, bien que tu n’aies point de titre officiel qui t’oblige à me les donner. Rien ne me coûterait plus que de me séparer de toi. Croirais-tu cependant, mon pauvre ami, que la comtesse Bernardina ne peut pas te souffrir ? Son antipathie est décidée, et ses boutades à ton sujet sont tellement vives que, tout en la blâmant, je ne puis m’empêcher d’en rire ; car tu connais toute la grâce et la causticité de son esprit. Je sais que tu vas encore m’objecter ses avances repoussées par toi, et ta chasteté vis-à-vis de cette belle amoureuse… S’il faut te dire la vérité, je ne crois pas un mot de cette histoire-là ! Laisse-moi parler !…
Quoi qu’il en soit, Bernardina veut que tu t’en ailles. Tu comprends bien que j’ai résisté avec énergie, avec emportement même ; mais enfin la femme qu’on adore – tu le sais, pardieu ! comme moi – est une divinité qui n’admet pas la discussion de ses ordres : aussi faut-il que tu partes. Il m’en coûte, et beaucoup ; j’ai le cœur déchiré ; ton aspect me fait un mal que je ne puis te dire. Adieu donc, mon pauvre Scaramouche ; épargne à un prince qui t’aime de pénibles explications ; de loin comme de près, je garderai le vif souvenir des moments agréables que je t’ai dus. Adieu, adieu…
Ce disant, le grand-duc tendit la main à Matteo, qui, plongé dans la stupeur la plus profonde, la baisa machinalement, et il disparut.
Ce qui distingue tout homme habitué aux brusques revirements de la fortune, et, partant, tout homme vraiment digne de ce titre si estimé des anciens Grecs, c’est la facilité avec laquelle il accepte les coups les plus funestes. Scaramouche tourna sur ses talons sans rien dire et se mit en devoir de regagner son logis. Ses camarades, qui, par hasard, s’y trouvaient réunis au grand complet, n’apprirent pas sans le plus vif chagrin la désastreuse nouvelle qu’il apportait ; elle était d’autant plus inopportune qu’avec son imprévoyance habituelle la digne compagnie avait d’avance dilapidé les traitements échus et à échoir, et contracté des dettes pour plusieurs milliers de livres.
Or, le prince, en renvoyant les comédiens, ne leur donnait pas un sou. Dame Barbara le qualifia de tyran et de sangsue du pauvre peuple ; mais cela ne détruisait nullement la difficulté, tout en prouvant que le bonheur public n’était pas indifférent à l’antique comédienne. Chacun ne manqua pas de proposer son moyen pour sortir de cette terrible gêne ; mais, suivant l’usage, le moins extravagant de ces moyens était encore inexécutable. Enfin on venait d’arrêter le plan d’une représentation extraordinaire au profit des pauvres et que devait défrayer une pièce à grand succès, intitulée Castor et Polynice ; Colombine devait remplir le rôle du grand prêtre Polysperchon, et toute la troupe couvait déjà des yeux l’idéal de la recette, quand la destinée jugea à propos de renverser cette dernière espérance.
Elle entra, la malicieuse, sous l’humble contenance d’un valet de chambre du grand-duc, aux livrées de la marquise Bernardina, et remit à Matteo un papier plié, d’une couleur désagréable. C’était un ordre du chef de la police, engageant les comédiens à partir le soir même et redemandant les clefs du théâtre sur lequel ils avaient si longtemps paradé. Ce fut un concert unanime de gémissements et de plaintes. Arlequin et dame Barbara, se tenant étroitement embrassés, versaient d’abondantes larmes ; Polichinelle et l’Amour criaient de concert comme les estropiés un jour de foire. Pour Tartaglia, sa douleur passait toutes les bornes, et lorsque Matteo, Pantalon et Colombine, qui s’en étaient tenus à une morne consternation, jetèrent un coup d’œil sur le désespoir général, ce furent aussi ses gémissements qui les étonnèrent davantage. Il se tenait couché sur le sofa, embrassant un coussin avec fureur, criant et pleurant et frappant le bois avec ses pieds, à coups redoublés.
– Que diable ! imbécile, lui dit en riant Matteo, ne peux-tu te comporter d’une manière plus décente ? Le chagrin n’excuse pas tout ; et n’as-tu pas honte de t’abandonner, comme un enfant, à tes lubies ?
– Cela vous est bien facile à dire, en vérité, répondit Tartaglia en gémissant. Vous en serez quittes pour courir les grandes routes et pour mourir de faim ; vous ne risquez pas la prison comme moi.
– Nous ne risquons pas la prison ! dit Polichinelle d’un air indigné. Et qui donc, si ce n’est moi, doit mille ducats à ce damné parfumeur qui demeure en face ? Le pâtissier d’Arlequin n’a-t-il pas obtenu une prise de corps contre lui ? Colombine n’est-elle pas brouillée avec sa modiste, Barbara avec la crémière, Pantalon avec le carrossier, et jusqu’à ce pendard d’Amour avec le plumassier ?
– Holà, holà ! continua Tartaglia en pleurant plus fort, vous n’avez pas vu que ce damné domestique vient de me remettre une missive ; sa maîtresse s’imagine que c’est ma pauvre langue qui a raconté au prince son intrigue manquée avec Matteo, et elle m’informe qu’avant une heure je serai au cachot, pour ce qu’elle appelle mes crimes.
Il avait à peine terminé, qu’un coup violent ébranlait la porte de la rue. Colombine courut à une petite fenêtre et revint en riant aux éclats.
– Sauve qui peut ! dit-elle ; le plumassier, le pâtissier, le parfumeur, le carrossier, la modiste et la crémière, le tout soutenu d’un piquet de fantassins, à l’adresse de Tartaglia, assiègent la maison ! Envolons-nous, mes oiseaux !
Tout le monde fut debout, Polichinelle laissa son chapeau d’homme du monde et sauta sur son costume de théâtre ; il n’en trouva qu’une partie, mais ce fut autant d’emporté. Arlequin brandit sa latte, chercha sa bourse et la trouva vide. Il l’emporta de même. Barbara embrassa une casserole d’argent, l’Amour prit ses jambes à son cou, et tout le monde, y compris Matteo, s’enfuit vers le jardin et en arpenta les allées. Par bonheur, la petite porte était ouverte. Les fugitifs se jetèrent dans la rue, chacun se sauva de son côté et, pour se rejoindre, Matteo cria ce mot d’ordre :
– À Santa-Honorata !
En effet, le soir, assez tard, chacun se trouva au rendez-vous. Un seul manquait : c’était Tartaglia qui, trop gros pour courir et moins ingambe que Polichinelle, avait cru faire merveille en se mettant derrière un arbre et s’y était fait prendre. Il ignorait, hélas ! que cette ruse, découverte primitivement par l’autruche, n’a jamais sauvé son inventeur. Ainsi donc, au moment de la réunion générale, le pauvre garçon se trouvait prisonnier sous n’importe quel prétexte ; mais, dans le fait, victime innocente et infortunée de la vindicative comtesse Bernardina.
Lorsqu’on eut assez déploré l’absence du malheureux Tartaglia, on s’achemina, pour tenir conseil, vers un cabaret champêtre qui étalait sur le bord de la route ses tonnelles de vigne vierge quelque peu poudreuse. Matteo fit venir l’hôtelier et, après un examen assez triste des finances de la troupe, fit apporter un broc de gros vin de la Romagne et quelques menues victuailles.
La situation, embarrassée quelques heures auparavant, était désormais des plus simples, et c’est là le bon côté des catastrophes. La délibération fut très courte, et voici ce qu’on résolut : d’abord de vendre les habits assez propres dont chaque comédien s’était trouvé couvert au moment de sa fuite ; d’y joindre les quelques anneaux dont Colombine avait ses doigts ornés et, avec l’argent qui en reviendrait, de se procurer des vêtements plus simples et des costumes de théâtre, afin de pouvoir continuer l’exercice de leur profession.
Ainsi pourvu du nécessaire, il fallait se mettre en route au plus tôt pour Naples et ne s’arrêter en chemin que le temps nécessaire pour donner quelques représentations et augmenter ainsi le trésor commun. Naples était l’Eldorado qu’il fallait atteindre à tout prix ; c’était dans cette cité bénie que le sage Pantalon et le judicieux Polichinelle espéraient revoir les beaux jours que ne voulaient plus leur accorder Venise ni Florence.
Arlequin fut chargé de la vente des dépouilles ; il s’en acquitta à merveille, et le lendemain matin la troupe des ci-devant acteurs, revenus à leur état premier de comédiens ambulants, frisant le saltimbanque, se trouva vêtue d’une manière aussi modeste que sa fortune et propriétaire d’une longue charrette où chacun se casa comme il put. Les temps étaient changés, la garde-robe de la troupe n’était ni de velours, ni de soie, ni garnie de dentelles comme par le passé ; mais sous la serge et la bure bariolée, on avait conservé tout entiers cette verve et cet esprit qui avaient enthousiasmé deux grandes capitales. On se mit donc joyeusement en voyage pour gagner Naples. On cheminait comme au jour où l’on avait rencontré Matteo sur la grand-route : Arlequin faisait cette fois l’office de cocher et laissait dormir le fouet sur le dos de son paresseux cheval, tandis que Polichinelle raclait sa guitare, assis les jambes pendantes sur le devant de la charrette.
Pendant plusieurs jours, nos amis ne rencontrèrent aucune aventure qui mérite d’être rappelée ; je laisse de côté les épisodes vulgaires, les bons ou les mauvais chemins et le séjour des auberges, et je conviens que l’ennui commençait à peser de tout son poids sur la compagnie, habituée aux émotions continuelles par la vie que chacun de ses membres avait menée à Florence. Mais, le soir du quinzième jour, la scène changea, et c’est aussi à cet endroit que je rattache les deux bouts de mon récit.
C’était quelques heures avant le coucher du soleil, et la charrette descendait lentement un chemin creux qui se contournait à chaque instant, de sorte qu’on ne voyait la route qu’à dix pas devant soi. Tout le monde, hormis Matteo, dormait, et surtout le cocher, quand tout à coup des cris lamentables se firent entendre. Scaramouche, surpris, mais brave comme un César, y répondit par un holà belliqueux, et, sans attendre que ses camarades fussent bien éveillés, il arrêta le cheval, sauta en bas du chariot et courut en avant. Voici ce qu’il trouva. Un vieillard richement vêtu était couché dans le sentier. Il ne bougeait pas ; il ne prononçait plus un mot. Au bruit que fit Scaramouche en s’approchant de lui, il s’écria :
– Eh bien, monsieur, puisque c’est votre métier, qu’attendez-vous ? Fouillez dans ma poche et prenez-y ma bourse ! Faut-il que j’aie l’honneur de vous la remettre moi-même ?
Matteo protesta qu’il n’avait aucune prétention au bien d’autrui et, avec toutes les formes de politesse imaginables, il remit le vieillard sur ses deux pieds. Celui-ci paraissait étonné ; il chercha dans ses poches et trouva apparemment que tout était en bon ordre, car il se dit à lui-même :
– On ne m’a rien pris ! c’est donc… décidément il faut m’attendre à tout ; mais je ne céderai pas.
Polichinelle, qui s’était approché avec toute la bande, offrit à cette nouvelle connaissance le flacon de sels de dame Barbara ; mais le vieillard, sans le regarder et sans lui répondre, ramassa sa canne et s’en alla tout droit devant lui. Les comédiens marchaient derrière en se communiquant à demi-voix leurs sentiments sur ce brusque personnage, et c’est ainsi qu’en moins de trois minutes ils se trouvèrent à l’entrée d’un village d’où sortaient deux vigoureux paysans. Les nouveaux venus mirent le chapeau à la main et, s’approchant du vieillard, ils lui dirent :
– Excellence, venez-vous du chemin creux ? Le petit Pierre, qui gardait ses chèvres dans le bois, nous a dit qu’on y poussait des cris à fendre les rochers ! Que s’y passe-t-il donc ?
– Rien, doubles sots que vous êtes ! Retournez chez vous et laissez-moi tranquille.
– Ah ! répondirent les paysans d’un air de compassion ironique, c’est quelque nouveau tour de…
– Vous êtes d’impudents menteurs ! s’écria le gentilhomme en continuant sa route.
Les paysans se rangèrent de côté pour voir défiler la caravane, et, lorsqu’ils eurent reconnu la profession de Matteo et de sa bande, ils en témoignèrent leur joie de mille manières ; puis ils partirent en toute hâte pour annoncer dans le village l’heureuse arrivée d’une troupe de comédiens.
À peine s’étaient-ils éloignés que deux autres personnages d’un extérieur respectable se présentèrent sur le chemin et abordèrent le vieillard :
– Seigneur podestat, et vous, seigneur curé, apprenez qu’il vient de m’arriver un nouveau malheur.
– Cela ne nous étonne point, don Geronimo, répondit le curé ; jusqu’à ce que vous vous soyez rendu plus raisonnable, je ne doute pas qu’il n’en soit toujours ainsi.
– Cela peut être, répondit sèchement le vieux gentilhomme. Mais deux drôles, que je suspecte depuis longtemps, vont répandre dans le village la nouvelle de ma mésaventure : ne pourrait-on pas en rejeter le méfait sur ces histrions qui me suivent ?
Le podestat leva les épaules sans répondre et, s’approchant avec le curé des nouveaux arrivants, il leur fit un compliment de bienvenue qui sentait son amateur forcené de théâtre.
– Vous êtes, si je ne me trompe, de véritables enfants de Melpomène ?
– Point ! dit le curé d’un air de mépris ; oubliez pour aujourd’hui, seigneur podestat, votre goût déraisonnable pour les fades peintures de la vie réelle, qu’il vous plaît de nommer comédies ; laissez les gens à courte vue mettre leur plaisir dans la copie léchée et sans grâce de la nature, et apprenez une fois à comprendre l’idéal, dont la comédie de l’art nous présente une des innombrables faces. N’est-ce pas, mes amis, que je comprends bien vos intentions !
Scaramouche allait faire une réponse polie et affirmative ; mais Polichinelle se dressa sur la charrette et adressa à la compagnie un compliment macaronique, qui fit rire tout le monde, hors don Geronimo, et qui put convaincre le judicieux curé du talent réel et profond que ses nouvelles connaissances possédaient dans son art favori.
Cependant la charrette allait se remettre en route pour chercher un gîte, quand le digne ecclésiastique, arrêtant Matteo par la basque de son habit, lui dit :
– Monsieur le directeur, si un dîner de presbytère ne vous effraye pas, je vous emmène afin de faire avec vous plus ample connaissance. Nous aurons pour convives le seigneur don Geronimo, mon digne ami le podestat et un jeune homme que je vous présenterai, et qui n’est pas tout à fait indigne de notre réunion, puisqu’il a jadis écrit pour le théâtre.
On arriva au presbytère ; le nouveau convive fut présenté à Matteo, et la surprise et la joie furent égales des deux côtés ; car, sous l’habit fort propre d’un homme du monde, Scaramouche reconnut son ancien confident, le cher Corybante.
Il avait des manchettes brodées, un habit gris-perle et l’épée au côté ; cette parure annonçait suffisamment que ses affaires étaient dans un état florissant ; mais, du reste, son ami le retrouva si pâle et si embarrassé qu’il ne put s’empêcher d’en faire l’observation en riant, et qu’il lui dit :
– Pardieu ! mon pauvre Corybante, serais-tu donc toujours le souffre-douleur des héritières ?
Cette plaisanterie ne réussit point. Le podestat et le curé prirent un air fort sérieux ; don Geronimo fronça le sourcil, et Corybante devint blême. Sur ces entrefaites, on se mit à table ; mais à peine avait-on expédié les premiers mets qu’un gros domestique accourut tout effaré et annonça au gentilhomme que le feu était à sa grange. Tout le monde se leva.
– Vous n’en croyez pas nos avis, don Geronimo, dit le podestat ; vous payerez cher votre obstination.
– Cela doit vous être fort indifférent, répondit le vieillard.
Il prit sa canne et sortit.
– Décidément, messieurs, s’écria Matteo que la curiosité exaspérait, votre village est le séjour des mystères ; et, pour n’y pas courir le risque de devenir indiscret, il faudrait être muet et aveugle de naissance. Je n’y tiens plus, je vous l’avoue, et j’ose vous supplier très humblement de me dire quel est ce don Geronimo, qui me parait un entêté fort déraisonnable, d’après vos propres paroles ; qui, à coup sûr, a le langage peu avenant, et sur lequel tombe un déluge incessant de disgrâces.
– Monsieur Cigoli ; dit le podestat, je me ferais un vrai plaisir de satisfaire votre curiosité sur ce point, s’il me fallait pour cela entrer dans certains détails très compromettants pour l’honneur d’une noble famille. Permettez-moi donc de faire le discret ; peut-être les choses en viendront-elles à ce point que le scandale se fera jour, mais jusque-là tous les confidents doivent se taire, et j’ose même vous demander votre parole de ne parler à personne, pas même à vos camarades, de la manière dont vous avez fait connaissance avec don Geronimo.
Matteo fit un signe d’acquiescement.
Le podestat reprit :
– C’est fort bien, je vous crois honnête homme ; et comme malheureusement il n’y a pas de temps à perdre, permettez-moi d’engager devant vous M. Corybante à faire une démarche qui ne peut plus être retardée. Levez-vous, mon cher ami, dit-il au jeune homme, qui laissa tomber sa fourchette d’un air consterné ; courez au château et prévenez M. le comte Jean Foscari qu’il ne saurait trop se hâter de conclure.
À ce nom de Jean Foscari, Matteo faillit tomber à la renverse.
– Quoi ! dit-il, ce scélérat est ici !
– Comment, scélérat ? dit le curé scandalisé. Pesez mieux vos paroles, je vous prie : M. le comte Foscari est un gentilhomme vénitien fort respectable ; on voit bien que vous ne le connaissez pas.
Scaramouche, en donnant une description détaillée de la personne de son ancien rival, prouva qu’il en savait aussi long sur cet article que les autres assistants, et il invoqua même le témoignage de Corybante ; celui-ci ne le démentit point, mais fit la grimace. Scaramouche s’en soucia peu et, après avoir raconté à ses nouveaux amis l’origine de sa connaissance avec ce seigneur, narration qu’il faisait volontiers, il les régala du récit de quatre ou cinq aventures de jeu peu honorables pour le comte et qui d’ailleurs étaient tellement vraies que le pauvre Corybante, interpellé, ne put s’empêcher de joindre son récit à celui de Matteo.
– Pourquoi donc, lui dit sévèrement le podestat, n’avez-vous jamais confié des choses aussi graves à don Geronimo ?
– On se fait déjà, sans le vouloir, assez d’ennemis ! répondit Corybante en cachant sa confusion derrière un cure-dent.
– Je reconnais le doigt de Dieu dans cette aventure, dit le curé d’un air sentencieux. Je ne vois pas trop, à la vérité, ce qui pourra sortir de tout ceci, mais évidemment il y a quelque chose qui passe ma compréhension, et, dans ce cas-là, je m’incline devant la toute-puissance. Seigneur podestat, je ne sais si vous partagez mon avis, mais il ne me semble pas juste de laisser un homme aussi indigne que ce Vénitien épouser la fortune de dona Paula. Puisque M. Corybante est un homme sans caractère, ce que je n’aurais jamais cru de lui, le seigneur Matteo saura remplir un devoir ; levez-vous donc, monsieur Cigoli ; faites-vous conduire au château ; ma gouvernante va vous y mener ; vous raconterez à don Geronimo tout ce que vous m’avez dit, et vous aurez eu le double mérite de démasquer un fripon et d’arracher une jeune fille, d’ailleurs peu intéressante, à un hymen qu’elle déteste.
– Votre Révérence peut ajouter à ces deux plaisirs, dit Scaramouche, la joie de ruiner les espérances d’un traître que je voudrais voir pendu la tête en bas !
Il serra le poing pour assurer l’effet de son imprécation et, précédé de Jacinthe, il s’avança joyeusement vers le château qui s’élevait sur une colline à quelque cent pas seulement du presbytère.
Pendant que tout ceci se passait, la troupe comique laissée aux soins de Polichinelle qui ne manquait jamais de reprendre le commandement lorsque Matteo s’absentait, la troupe comique, disons-nous, avait continué son voyage dans la rue et enfin, après avoir longtemps regardé en l’air, elle découvrit, à l’enseigne de Sainte-Euphrosine, une auberge qui parut à nos voyageurs la meilleure du village, attendu qu’elle était la seule. D’ailleurs, le peu d’argent qui restait dans la bourse commune était une raison de ne pas se montrer difficile. L’hôte, actif et intelligent, eut relayé la charrette, en un tour de main, et quant aux logements il fut aisé d’y pourvoir. La maison était petite, mais l’imagination était grande. Dans la cuisine fut servi le repas. Une chambrette devint le partage de dame Barbara et de Colombine, et pour les hommes, il fut décidé qu’ils coucheraient dans la grange où le théâtre fut en outre établi. L’odeur du foin est si agréable ! Pantalon et Polichinelle se félicitèrent. Il n’y eut qu’Arlequin qui chercha à réclamer ; mais on lui prouva qu’il avait tort et qu’il n’était pas aussi grand seigneur qu’il voulait en avoir l’air devant la servante. À la fin, il se rendit. Les choses étaient ainsi convenues et, pendant qu’on apprêtait le repas, Colombine vint prendre l’air sur la porte. À peine avait-elle jeté un coup d’œil dans la rue, qu’elle vit accourir un jeune garçon bien tourné qui, de la voix la plus insinuante, lui demanda la faveur d’un entretien particulier. À coup sûr, cette demande n’avait rien d’extraordinaire pour Colombine ; on la lui avait souvent présentée, et j’aime à me persuader qu’en toute innocence elle avait pu y consentir quelquefois ; or, toujours on avait traité la même affaire. La bonne fille, ne s’imaginant donc pas qu’il pût être question d’autre chose entre elle et le jeune homme si empressé, leva les épaules en riant et se prépara à rentrer dans l’auberge ; mais son interlocuteur l’arrêta par sa jupe.
– Vous vous trompez sans doute, mon bel ange, lui dit-il. Il est vrai que je suis amoureux fou de vos beautés et que, pour vous plaire, j’irais aux grandes Indes sur les genoux ; mais il ne s’agit pas de cela en ce moment ; je veux faire partie de votre troupe ; à toute force, il faut que vous m’y trouviez un rôle et, si vous saviez tout mon savoir-faire, je ne doute pas que vous ne m’admissiez avec enthousiasme.
– Tout cela est fort possible, répliqua Colombine ; mais je ne vous connais pas, et vous m’avez l’air d’un petit effronté bien avancé pour son âge.
– Peut-être plus que vous ne pensez, répondit cavalièrement le jeune homme ; mais réfléchissez à ma proposition et faites en sorte d’y donner une réponse favorable. Là, croyez-moi, je dois avoir l’air de valoir quelque chose ; mais, sans vanité, je tiens plus que je ne promets. Et, entre nous, vous n’aurez à craindre de moi aucune perfidie.
– À bas les mains ! dit Colombine en riant ; voilà un petit bonhomme qui n’a guère plus de quinze ans et qui est déjà bien délibéré.
– Ah çà ! mais, je ne me trompe pas, dit une voix à côté des deux causeurs.
C’était don Geronimo. Il saisit le garçon par le bras, le regarda bien en face, et, d’un ton très sec, il continua :
– Ma foi, il y a plaisir à lutter avec vous ; tous moyens vous sont bons ; des petites espiègleries vous passez aux médiocres, et de celles-là aux plus grosses ; aujourd’hui vous en êtes à me faire assommer, à mettre le feu chez moi, à… Vous avez peu d’imagination, mon enfant, et vous en venez trop vite aux extrêmes. Allons, suivez-moi, il est temps de rentrer.
Ce disant, le vieux gentilhomme tira à lui le jeune garçon qui n’eut que le temps d’envoyer, à la dérobée, un baiser à Colombine. De ce moment, celle-ci, jugeant que son amoureux était persécuté, lui fit une petite part dans sa sympathie.
De cette façon, don Geronimo était à peine rentré quand Scaramouche se présenta chez lui. Un domestique l’introduisit dans un cabinet somptueusement décoré, où le vieillard se trouvait assis sur un grand fauteuil, ayant à sa droite une jeune fille qui brodait et vis-à-vis de lui messer Jean Foscari, vêtu d’une manière convenable à son rang, mais cependant avec plus de sévérité que de coutume. Il faut le dire à la honte de notre ancienne connaissance, à force de faire des présents à la Fiorella et à d’autres, à force de mener joyeuse vie et de courtiser le pharaon, sa fortune, naturellement égale à zéro, avait rapidement dépassé cette base négative, et il se trouvait, dans ce moment même, sous le coup de plus de cent mille ducats de dettes criardes qu’il lui fallait payer. Voilà pourquoi le comte Jean Foscari cherchait à se marier.
Quand Scaramouche entra et se fit reconnaître, son antagoniste de Venise ressentit quelque trouble. Malgré sa colère et l’intérêt qu’il avait à nier les faits que le comédien s’empressa d’exposer, en s’autorisant de l’avis du curé, il se défendit très mal car, malgré ses vices, il avait de l’orgueil et ne se sentait pas fait pour le rôle d’accusé. Enfin il se laissa démasquer, et l’œil dur et sévère de don Geronimo lui dit assez, avant qu’aucune parole lui eût signifié son arrêt, que toute la faveur du vieillard lui était retirée.
– Monsieur le comte, dit enfin celui-ci, vous sentez que nos positions sont bien changées ; je ne me faisais nul scrupule de faire plier la volonté de ma nièce devant la mienne, lorsque je vous prenais pour un gentilhomme aussi honorable de cœur que de nom. Désormais, je vous retire ma parole, et dona Paula peut remercier le hasard qui me force à rompre un mariage pour lequel elle montrait assez étourdiment une répugnance irréfléchie.
La jeune brodeuse leva la tête à ces mots et, regardant en face le comte Foscari, elle lui dit :
– Vous n’êtes donc point un homme suivant le cœur de mon oncle ? amoureux des vieux livres et avare de votre argent ?
– Cela me semble assez prouvé désormais, mademoiselle, répondit le Vénitien en souriant amèrement.
– S’il en est ainsi, je ne vois plus d’obstacle à notre mariage, dit la jeune fille avec le plus grand sang-froid, et je vous épouse très volontiers.
– Je m’attendais presque à cette algarade, reprit don Geronimo, et elle ne me déconcerte pas. Quand je voulais cette union et qu’elle était raisonnable, vous n’en vouliez point et vous sortiez de toutes les bornes pour m’y faire renoncer ; aujourd’hui qu’elle devient impossible et que tous mes sentiments s’y opposent, vous la désirez. Avant une heure, vous serez amoureuse folle de monsieur, cela est dans l’ordre ; mais, mademoiselle, vous me connaissez, et je ne céderai point. Sortez et rentrez dans votre chambre.
Dona Paula se mit en devoir d’obéir ; mais, regardant le seigneur Foscari d’un air d’impératrice, elle lui dit en se retirant, de manière à être entendue de tout le monde :
– Je vous aime, et je vous épouserai.
« Quel démon de femme ! pensa Scaramouche ; et elle semble à peine avoir seize ans ! Je n’y entends rien, mais ce que je sais, c’est que ce faquin de Foscari ne l’épousera pas, ou j’y perdrai ma réputation d’homme d’esprit. » Le vieux gentilhomme, après avoir congédié sa nièce, était rentré dans son appartement, et le Vénitien, sans regarder Matteo, était parti. Celui-ci crut convenable d’en faire autant, mais, voulant à tout prix s’opposer au bonheur de l’homme qu’il détestait, il s’achemina vers le presbytère et vint demander au curé et au podestat de lui découvrir tous les mystères de cette étrange histoire, et surtout celui du caractère déterminé de l’héroïne.
À cette fois, les deux vénérables fonctionnaires ne résistèrent plus ; ils comprirent, par ce que leur dit Matteo, que celui-ci tenait déjà une partie des secrets : à quoi bon lui faire mystère du reste ? En outre, Corybante, dont ils se méfiaient, était retourné au château du vieux gentilhomme, où il avait un appartement ; on se pressa donc autour de la petite table, et l’on raconta au comédien ce qu’il avait tant envie de savoir.
Don Geronimo était le dernier rejeton d’une famille qui, sans être illustre, était néanmoins des plus recommandables dans l’ordre de la noblesse. Ses aïeux n’avaient point été courtisans des papes ni des ducs ; mais, dans quelques républiques comme Pérouse ou Lucques, plusieurs d’entre eux avaient exercé des charges, quelquefois s’étaient enrichis, plus souvent encore avaient été dépouillés, bannis ou pendus ; bref, ils avaient légué à leur dernier rejeton une fortune très honorable et un caractère fort têtu et très entier. Don Geronimo, en se mariant, avait espéré acquérir une nombreuse postérité, mais ses espérances furent déçues ; la signora resta stérile et, au bout de dix années qui ne furent qu’un long ouragan, attendu que les deux époux étaient à peu près de la même humeur, la noble dame décéda, laissant son mari dans la cruelle expectative de rendre à sa mort tous ses fiefs au marquis de Bianconero, son suzerain. Rien ne pouvait lui être plus désagréable car, dans toutes les circonstances de sa vie, don Geronimo avait trouvé le marquis sous ses pas : affaires d’amour, affaires d’argent, affaires d’ambition avaient, par une fatalité extraordinaire, placé toujours ces deux originaux nez à nez, et, comme le grand seigneur l’avait généralement emporté sur le simple gentilhomme, celui-ci lui en voulait un mal de mort.
Il ne lui restait plus qu’une chance de lui faire pièce, c’était de rechercher si son frère, qu’il avait perdu de vue depuis plus de trente ans, existait encore ou avait laissé des traces de son passage sur cette terre. Une fois cette idée dans la tête, don Geronimo y sacrifia tout. Pendant dix ans, il fit les recherches les plus actives, et enfin il apprit que don Giulio Torrevermiglia, son frère, avait eu deux enfants de deux maîtresses différentes ; que ce pauvre seigneur avait été tué en duel par le prince Jérôme Boccatorta et que, pour ce qui concernait les deux enfants, l’un était resté aussi inconnu que sa mère, l’autre était la fille d’une bohémienne qui avait reçu l’éducation de sa famille maternelle, et qui, âgée déjà de quatorze à quinze ans, courait les grandes routes avec sa tribu, dont elle était le plus bel ornement.
Don Geronimo Torrevermiglia ne fut point effrayé des mœurs patriarcales de sa nièce ; il se promit au contraire un vif plaisir des soins généreux, des combats que nécessiterait la transformation de ce naturel probablement sauvage et, s’étant mis en route pour les Apennins, il eut le bonheur d’embrasser sa nièce, qui vint lui demander l’aumône à l’entrée d’un village. À vrai dire, le marquis de Bianconero courait grand risque d’être frustré de ses espérances, si jamais il les avait eues.
Quand la jeune dona Paula se vit installée dans le château de son oncle, elle commença, dès le premier mois, à donner les marques du caractère le plus impétueux et le plus indépendant. Sans respect pour sa propre dignité, elle aimait à jeter ses livres par les fenêtres, prenait grand soin de maintenir son ignorance intacte ; dérobait çà et là ce qui lui faisait plaisir, les pâtisseries, l’argent même, et en accusait intrépidement les domestiques.
Du reste, comme elle semblait faire grand cas des jouissances matérielles et de la vie luxueuse qui l’entourait, don Geronimo, d’ailleurs captivé par l’amour de la lutte, se frottait les mains de satisfaction et espérait bien finir par dompter sa nièce. Ses amis, le curé et le podestat, ne partageaient plus ses espérances, qu’à peine ils avaient nourries pendant les premières années. Le naturel sauvage des bohémiens, l’entêtement de cette race paraissaient avoir pris trop de développement dans le cœur de dona Paula, pour qu’elle pût en revenir jamais. Quoi qu’il en soit, don Geronimo se tenait sûr de son fait, et, pour ne rien négliger de ce qui pouvait rendre brillante l’éducation de sa pupille, il écrivit à Rome à un de ses amis, afin qu’on lui envoyât quelque professeur capable de faire de son héritière un sujet merveilleux. L’ami eut la main malheureuse, car il dépêcha au gentilhomme notre pauvre Corybante qui, après avoir déposé le manteau d’abbé par suite de la mort de sa tante, mangeait mesquinement sa succession, et qui accepta la place qu’on lui offrait, moitié par faiblesse de caractère et pour ne pas dire non, moitié aussi parce qu’il ne savait que faire de lui-même.
La rusée Paula avait bien vite reconnu le naturel de lièvre de son pédagogue : il était devenu son très humble serviteur ; il vivait sous sa pantoufle de la même manière qu’il avait vécu sous celle de Rosetta ; avec cette différence cependant que cette dernière ne l’eût jamais employé qu’à des étourderies, tandis que sa nouvelle maîtresse était fort capable de le mêler à des entreprises scabreuses. Cependant, malgré toute l’attention possible, l’éducation de l’héritière de Torrevermiglia n’avançait point ; on eût pu croire, au contraire, que le contact des bons principes exaspérait cette âme endurcie dans le mal, car tous les jours elle devenait pire. La seule chose qu’elle eût apprise, c’était à tirer le pistolet.
Force fut bien à don Geronimo de comprendre qu’il n’en ferait jamais une sainte personne ; et, bien que dans ses entretiens avec le curé et le podestat, il se montrât toujours plein d’espérance, les deux amis s’aperçurent un jour qu’il était à peu près convaincu de l’inutilité de ses efforts, puisqu’il annonça l’intention de la marier. Pour dona Paula, elle reçut cette proposition avec de grands éclats de rire et le refus le plus formel ; elle dit à son oncle, et lui fit dire par Corybante que jamais elle ne consentirait à devenir l’esclave d’une poupée : c’était ainsi qu’elle qualifiait tous les honorables gentilshommes des environs ; et enfin elle jura ses grands dieux que, si on la poussait à bout, elle ferait voir ce dont elle était capable. Bien entendu, don Geronimo renferma en lui-même le secret de ce qu’il pensait être des fanfaronnades, et il commença ses recherches pour déterrer un homme de bien qui consentît tout à la fois à le débarrasser de sa nièce, ce qui pouvait n’être pas séduisant, et à frustrer les Bianconeri du retour de ses fiefs, ce qui n’était qu’agréable. Nous devons aussi. ajouter que, jusqu’à ce moment, hors les confidents intimes de la famille et les domestiques, tout le pays était tenu dans une quasi-ignorance des singulières allures de dona Paula. Son oncle s’en faisait un point d’honneur : il regardait la réputation de sa famille comme engagée à ce que le dernier rejeton jouît d’une bonne renommée ; et si dans le village des propos de laquais avaient réussi à éveiller l’attention, on jasait très bas, de peur d’éveiller la colère implacable du vieux gentilhomme.
Messer Foscari, prévenu de l’existence de la riche Paula, et réduit aux abois par ses créanciers, avait pris la poste et était venu offrir sa personne et son nom à don Geronimo. Sur ces deux articles, il n’y avait point de difficultés à faire. Il était beau garçon et des mieux nés. Quant à sa conduite, on sait que la censure eût pu en devenir dangereuse pour sa gloire ; il sut donc habilement en passer sous silence les traits les plus remarquables, et la mine austère qu’il affecta de prendre rejeta le reste dans la catégorie insignifiante des aventures de jeunesse. Corybante aurait pu le trahir ; mais, outre que le brave homme n’en aurait jamais trouvé le courage, il souhaitait, pour sa part, encore plus ardemment que don Geronimo, le mariage de dona Paula ; son plus beau rêve était de s’en voir débarrassé, et il soupirait après le jour où la jeune fille, prenant le chemin de l’autel, le laisserait libre de prendre celui de Rome où il comptait aller passer des jours pleins de repos. Le comte Foscari n’avait donc dans la maison que des amis ; le curé et le podestat étaient ses alliés pour la même raison que Corybante ; et dona Paula seule lui tenait tête.
C’était avoir affaire à assez forte partie. Sûre d’elle-même et parfaitement certaine que son courage ne plierait devant aucune attaque, la jeune bohémienne organisa un système de défense qui la faisait rire aux éclats quand elle était seule dans sa chambre à le combiner. Un jour, elle faisait venir tous les domestiques, en l’absence de son oncle, et, soi-disant par son ordre, les mettait tous à la porte ; don Geronimo, au retour, était obligé de courir après eux ; allait-on se mettre à table, elle renversait les plats, les assiettes, et faisait un carnage complet de toute la vaisselle ; elle ne dédaignait pas même de descendre à la ferme pendant la nuit, d’ouvrir elle-même les étables, et de chasser devant elle lés bestiaux, qu’il fallait ensuite plusieurs jours pour ramener au complet. Quand le comte Foscari s’aperçut de tout cela, on peut croire qu’il en prit quelque inquiétude ; pas le moins du monde. Il en fut ravi. « Toute autre femme me gênerait, se dit-il ; pour celle-ci, en la claquemurant dans un cloître, je lui rendrai justice, et tout le monde, loin de m’accuser, me plaindra. » Don Geronimo pénétrait peut-être les sentiments de son futur gendre, mais il n’en donnait pas signe et chacun continuait à jouer son rôle : l’oncle promettait le mariage ; le futur le sollicitait, et la fiancée faisait le diable. En définitive, que voulait-elle, me demanderez-vous, ami lecteur ? Elle voulait que don Geronimo Torrevermiglia la mît à la porte et que sa famille campée dans les Apennins lui rouvrît ses bras et lui rendît sa liberté. Pour cela, jamais elle ne put l’obtenir, comme on va le voir.
Enfin, lorsqu’elle fut bien assurée que ce mariage, qu’elle redoutait parce qu’elle voyait la contrainte au bout, se devait faire, elle se jura à elle-même d’assommer son oncle ou son fiancé. On sait qu’elle y aurait réussi sans l’arrivée inopinée des comédiens. Le reste de l’histoire est connu jusqu’ici ; nous n’avons plus besoin que de suivre ce qui va arriver.
Après cette révélation, Scaramouche sortit de chez le curé, tout pensif. Il comprit fort bien que du côté de dona Paula, comme de celui de son oncle, les choses en étaient à toute extrémité, et que, si la première voulait sincèrement se marier, elle ne manquerait pas d’accepter un enlèvement que le comte Foscari ne se ferait, lui, aucun scrupule de proposer. Il se promit donc bien de veiller à ce que cela n’eût pas lieu ; et, pensant qu’il ne pouvait trop se hâter, il se rendit au château. Comme il faisait nuit close, la porte en était fermée ; Matteo fit le tour du bâtiment. en se tenant pourtant à quelque distance et sous les arbres, afin de n’être point vu. Tout à coup, à quelques pas de lui, il aperçut le comte Jean, qui s’avançait avec précaution vers une partie de l’édifice qui faisait face à l’endroit où était caché le saltimbanque. Arrivé là, le Vénitien fit un signal, une fenêtre s’ouvrit ; à la clarté des étoiles, Matteo reconnut parfaitement Paula ; le comte, en s’aidant d’une treille, escalada le mur, arriva à la fenêtre et sauta dans la chambre. « Comme j’ai bien fait de venir ! pensa le Cigoli. Je vais les laisser dans cet appartement tant qu’ils voudront ; mais, s’ils essayent d’en sortir, je me mets à crier au voleur, et il faudra bien que le comte lâche sa proie. »
Il finissait à peine cette réflexion mentale que, d’un autre coin du parc, s’avança un second personnage : c’était Corybante. Il regarda la fenêtre, poussa un profond soupir et, comme un homme qui accomplit un devoir pénible à bien des titres, il s’accrocha aux barreaux de l’espalier et grimpa dans la chambre, comme le patricien l’avait fait avant lui. « Il parait décidément que cette chambre virginale est comme la place d’armes », pensa Matteo.
Puis il ajouta, comme frappé d’une idée subite : « Puisque tout le monde y entre, pourquoi n’y serais-je pas reçu, moi aussi ? Je ne serais peut-être pas un membre inutile de la conférence qui se tient ? » Et, sans hésiter davantage, il prit la route que lui avaient enseignée ses prédécesseurs, et tomba dans le boudoir de dona Paula, avec la grâce et l’aisance d’un homme auquel pareille manière de s’introduire n’était pas tout à fait nouvelle.
– Voilà un conseiller de plus qui nous arrive, dit la jeune bohémienne sans montrer le moindre étonnement. Donnez-moi votre avis, monsieur le comédien ; je voudrais que le comte m’enlevât cette nuit même, et il n’y veut point consentir, de peur de se brouiller avec don Geronimo, et par conséquent avec sa fortune.
– Chère Paula, interrompit galamment le patricien, vous vous méprenez étrangement.
– Point, répliqua-t-elle ; je vous connais parfaitement et, si je tiens à vous épouser depuis que j’ai su que vous étiez mauvais sujet, c’est que j’ai trouvé mille manières de vous mettre hors d’état de me nuire comme vous l’auriez pu faire impunément étant homme grave et respecté.
– Mais, madame, en accordant votre main à M. le comte, insinua Scaramouche, quel projet poursuivez-vous ?
– De me rendre libre, répondit-elle ; il a de l’argent, je n’en ai point, attendu que mon oncle se méfie de l’usage que j’en pourrais faire, et je ne puis m’enfuir assez loin pour ne pas être reprise, si je n’ai quelque bonne somme.
– Qu’à cela ne tienne, reprit Matteo, venez avec nous, nous vous cacherons.
– J’y ai pensé, mon digne Scaramouche ; mais, décidément, votre Colombine me déplaît et je ne serais pas en sûreté parmi vous. Décidément j’épouserai le comte, puisque lui seul peut me donner de l’argent pour ma fuite.
Foscari tomba aux genoux de la belle Paula et jura par tous les saints du Paradis qu’elle se méprenait sur ses intentions, qu’il l’adorait en toute conscience et qu’il faudrait bien qu’elle en restât convaincue. Pour Scaramouche, voyant qu’il n’avait rien à faire dans ce boudoir et qu’il lui fallait de toute nécessité empêcher la fuite des deux amants, il souhaita le bonsoir à la compagnie, repassa par la fenêtre et, quand il se trouva seul dans le parc, il réfléchit profondément à ce qu’il convenait de faire. Avertir don Geronimo, c’était retarder l’événement, mais point l’empêcher. Le gentilhomme, fidèle à son culte pour le nom que portait dona Paula, aurait cherché de mille façons à étouffer tout scandale ; Foscari, éloigné pendant quelques jours, serait revenu ferme dans son projet ; Paula l’aurait attendu et l’enlèvement, tenté une seconde fois, aurait réussi. Décidément, Matteo ne vit qu’une seule chose à faire, et cette chose était de s’emparer lui-même de dona Paula.
Voici comment il combina cette grande entreprise.
Il courut en toute hâte à l’auberge de Sainte-Euphrosine qu’il n’eut aucune peine à trouver par la raison que nous avons donnée plus haut et qui obligeait ses camarades à y planter leur tente. À grands cris, il se fit ouvrir la porte, enseigner le chemin de la grange et, secouant vigoureusement Polichinelle et les autres, endormis sur des bottes de paille, il les eut bientôt arrachés aux voluptés du premier somme.
– Es-tu possédé du diable, grommela Pantalon en s’étirant les bras, pour venir nous faire un pareil vacarme ? On dort la nuit et on ne court pas les champs.
– C’est pourtant ce que vous allez tous faire, mes chers amis, reprit Scaramouche.
Il leur raconta comment il avait retrouvé Corybante et le comte Foscari ; et il insista sur sa ferme volonté de se venger du patricien en empêchant son mariage.
– Comment t’y prendras-tu ? objecta Arlequin, qui aurait voulu soulever des difficultés insurmontables afin de pouvoir regagner sa couche champêtre.
– Voici ce que nous allons faire, dit Scaramouche ; réveillez Colombine et Barbara, et partons tous ensemble. Il n’y a qu’une route possible pour sortir de la vallée au bout de laquelle le château est bâti ; nous allons nous mettre en embuscade dans un recoin du bois. Aussitôt que nos fugitifs passeront devant nous, chacun s’élancera avec courage, nous les saisirons, nous prendrons le Vénitien que nous attacherons à un arbre, en le bâillonnant pour que personne ne le puisse délivrer avant demain matin ; et pour Paula, nous l’emmènerons avec nous.
– Je suppose qu’après cette équipée, il nous faudra quitter le village, dit Pantalon, auquel cette extravagance ne plaisait pas.
– Ainsi ferons-nous, continua Scaramouche. Allons, leste ! attelez la charrette, payez l’hôte, que ces dames s’habillent, et partons.
On obéit, et Colombine fit hâter tout le monde ; au bout de peu d’instants, on se mit en route. À la clarté de la lune, Arlequin se posait en chef de brigands ; Pantalon s’était fait une ceinture redoutable avec sa cravate, et il manœuvrait un long bâton, comme s’il eût eu dans les mains la plus terrible des carabines. Cependant on avançait lentement, grâce à la charrette ; et Scaramouche, impatient, précédait la troupe de quelque cinquante pas. Tout à coup, il revint en toute hâte et s’écria :
– Dépêchez-vous ; laissez l’Amour garder la voiture ! J’entends le bruit d’une chaise de poste, et à peine si nous arriverons à temps.
En effet, chacun prêta l’oreille ; le bruit rapide des roues et le pas des chevaux retentissaient sourdement sur le chemin couvert de mousse de cette forêt.
Les comédiens coururent ; ils brandirent d’un air effroyable leurs grands bâtons : le postillon épouvanté se laissa tomber sous le ventre des chevaux, la voiture s’arrêta, et Scaramouche, ouvrant la portière, s’écria d’un air de triomphe :
– Eh bien, monsieur le comte, vous ne m’attendiez pas ?
– Plût au Ciel que le comte fût ici ! répondit en sanglotant la voix bien connue du désolé Corybante : je ne serais pas aussi compromis.
Matteo, stupéfait, détacha une des lanternes de la chaise de poste, regarda dans l’intérieur ; et il n’y vit que dona Paula, qui descendit gaiement le marchepied en s’aidant de sa main, et M. Corybante tout en larmes. Voici ce qui était arrivé : le comte Foscari avait fait préparer sa voiture, dona Paula s’était mise en disposition de partir, et, au moment fatal, craignant que son précepteur ne trahît le secret de sa fuite, elle s’était résolue à l’emmener. En vain celui-ci, épouvanté, avait-il protesté contre cette décision, la jeune fille n’avait voulu rien entendre ; elle l’avait fort maltraité et, le menant elle-même à sa chambre, à travers les corridors déserts, elle l’avait forcé de faire son paquet devant elle, tandis que Foscari achevait ses préparatifs. C’est ainsi qu’elle découvrit un secret que Corybante lui avait toujours soigneusement caché. Il avait de l’argent, le rusé ; il avait même quelques milliers de livres ; jamais il n’en avait soufflé mot et s’en était même donné de garde, sachant fort bien l’humeur de son écolière. Mais cette prudence ne le sauva point. Dona Paula bâtit un nouveau projet sur cette découverte. Elle ne se faisait enlever par le comte que pour pouvoir gagner sa liberté ; elle trouvait beaucoup plus commode de se passer d’un compagnon auquel, après tout, le pouvoir de la régenter pouvait échoir. Elle ramena Corybante dans son propre appartement et, lorsque Jean Foscari fut de retour et annonça que tout était prêt, elle trouva moyen, sous un prétexte quelconque, de faire entrer le comte dans une petite chambre noire et sans issue ; un tour de clef lui répondit de son prisonnier ; il réclama vivement, elle n’en fit que rire.
– Allons vite, Corybante, prenez les paquets et partons.
Corybante, en pleurant, lui obéit ; ils gagnèrent ensemble la chaise de poste ; le postillon, ne sachant rien, ne s’étonna de rien ; la voiture partit au galop ; les comédiens l’arrêtèrent. Paula riait, Corybante sanglotait, protestant de la pureté native de ses intentions, et suppliait Matteo de le délivrer.
Il était aussi bien triste de voir la position malheureuse de l’ex-abbé ; Colombine, après avoir beaucoup ri, cherchait à le consoler de son mieux ; mais, pour les hommes, pas un d’eux, y compris même Scaramouche, ne prenait son sort en pitié ; chacun, au contraire, le raillait, sans daigner réfléchir qu’un bonheur n’est un bonheur qu’autant qu’on le croit tel.
Tout ce tumulte avait pris du temps, et les explications assez bruyantes qui avaient eu lieu avaient même concentré l’attention à tel point que nul ne s’était aperçu qu’une large voiture de voyage passait à côté d’eux. Au moment où la clarté de ses falots tomba sur la scène grotesque que nous avons essayé de peindre à nos lecteurs, les glaces de la nouvelle voiture furent baissées précipitamment ; le cocher violemment interpellé s’arrêta, la portière s’ouvrit et le gros Tartaglia, oui Tartaglia lui-même, la tête et le corps soigneusement enveloppés contre les froids nocturnes, tomba dans les bras de ses camarades. Cette nouvelle péripétie fit à tout le monde le plus vif plaisir ; dona Paula elle-même, comprenant ce qui se passait, se joignit à la satisfaction générale et, avec la légèreté de caractère qui s’alliait chez elle à l’entêtement, elle ne montra aucune envie de presser sa fuite. Tartaglia raconta en peu de mots à ses collègues ce qui lui était arrivé. D’abord jeté en prison pour dettes, par les soins de la marquise Bernardina, le chagrin et l’ennui l’avaient fait considérablement maigrir. La seule consolation qu’il eût dans son malheur, c’était d’écrire sur grand papier vélin, en écriture moulée, de lamentables placets au grand-duc. Pendant dix jours, il n’avait reçu aucune réponse et tous les jours il expédiait une nouvelle requête. Enfin, un matin, un valet de chambre était venu le chercher, en lui annonçant que toutes ses dettes étaient payées, ainsi que celles de ses camarades, puis il l’avait conduit chez Son Altesse. Le prince lui avait fait le meilleur accueil, et il avait pu comprendre aisément que la marquise était en complète disgrâce, ce dont il s’était réjoui. Après quoi, le grand-duc l’avait chargé d’inviter ses camarades à revenir et lui avait fait remettre dix mille livres, tant comme dédommagement que comme marque de sa faveur.
– Pendant vingt-quatre heures, ajouta Tartaglia, j’ai couru les rues de Florence, enchanté d’être libre ; décidé à hâter votre retour, j’ai même loué une maison ravissante sur le bord de l’Arno. Mais le lendemain, qui fut un peu dégrisé ? Votre serviteur. Je reçus un billet de la marquise Bernardina, qui m’invitait fort sèchement à passer chez elle. Je me suis étonné, j’ai été aux informations et j’ai bientôt appris que, raccommodée avec le prince, elle jouissait d’une faveur plus grande que jamais. Alors, en général habile, j’ai exécuté ma retraite avec précipitation, laissant là notre palais, sans payer le propriétaire, bien entendu, et je vous suis à la piste, désireux de déposer entre les mains de notre digne caissière, dame Barbara, la dépouille des Philistins.
Et Tartaglia, finissant sa harangue, remit le portefeuille à la matrone qui s’écria : « Après tout le prince marquera dans l’histoire ! »
Il était temps que le saltimbanque se tût ; sans quoi le lecteur aurait ignoré les circonstances intéressantes que nous avons écrites sous sa dictée. Car à peine fermait-il la bouche que l’on put apercevoir de nombreuses lumières qui éclairaient les fenêtres du château, et qui paraissaient descendre vers le village.
– On va chercher les paysans pour courir après nous, s’écria dona Paula. En route !
Elle rentra dans sa voiture, entraîna Corybante… Il réclama, il est vrai, mais personne n’avait le loisir de l’écouter ; Polichinelle le poussa dans la chaise de poste et ferma la portière ; le postillon partit au galop… Pour nos amis… Mais je pense qu’il est bon d’en finir avec l’histoire de dona Paula, d’autant plus que nous n’aurons plus occasion de la retrouver sous les pas triomphants de Scaramouche.
Quand sa mère, pour une modique somme, l’avait livrée à don Geronimo Torrevermiglia, la jeune bohémienne n’avait ressenti de douleur que pour la perte de sa liberté. Les entraves que la civilisation lui imposait lui devinrent bientôt insupportables, et elle s’était décidée à tout risquer pour les rompre. Mais, si le devoir et la contrainte ne pouvaient convenir à cette nature déjà imprégnée des goûts de la vie sauvage, les jouissances du luxe l’avaient bien vite conquise et, à son insu, elle ne pouvait même plus s’en passer. Elle partait du château de son oncle, en faisant avec elle-même un compromis qu’elle n’analysait pas. « Tant que j’aurai de l’argent, se disait-elle, je mènerai joyeuse vie ; quand tout me manquera, je rejoindrai ma tribu et je vivrai comme elle. »
Bientôt les ressources de Corybante furent dévorées ; dans la compagnie assez délurée où Paula se lança bientôt, elle trouva des adorateurs ; sans goût et sans plaisir, sans amour de l’argent, elle céda, pour éloigner le terme qu’elle avait fixé à sa réunion avec sa famille. Enfin arrivée à trente ans, la vieillesse précoce, ordinaire à sa race, flétrit sa beauté ; elle sentit que l’insolence et la rudesse de ses manières allaient manquer de ce qui les faisait adorer ; elle se résolut, ruinée d’ailleurs qu’elle était, à recommencer la vie de son enfance, qui, après tout et de loin, lui paraissait pleine de charme ; et, ayant donné une grande fête qui devait être ses adieux à la vie élégante, elle gagna une fluxion de poitrine et en mourut.
Retournons vers la grande route, où nos amis sont à délibérer sur le parti qu’ils ont à prendre. Ils s’imaginent qu’on va poursuivre dona Paula et peut-être les impliquer dans cette affaire. Ils se trompent bien ; don Geronimo, réveillé avec toute sa maison par les cris de fureur du comte Foscari, s’occupe paisiblement à transférer le patricien dans la prison du village, pour scandale nocturne, trop heureux qu’il est de ne pas payer plus chèrement sa folie. Cependant les comédiens sont loin de croire à cette indifférence. Effrayés qu’ils sont, et comptant sur les dix mille livres apportées par Tartaglia, ils abandonnent la charrette, le cheval et les costumes de bure à leur malheureux sort ; Barbara, Colombine et l’Amour se mettent dans la voiture. Scaramouche les suit, Tartaglia fait de même ; Pantalon, Arlequin et Polichinelle se hissent sur l’impériale comme les masques un jour de mardi gras, et fouette cocher ! les voilà tous partis, au triple galop, sur la route de Naples, où nous les retrouverons.
Chapitre III
Comment
Scaramouche s’était jusque-là méconnu, et de la conclusion de son histoire
Jusqu’ici, je vous ai gâté, lecteur. Je vous ai mené bride abattue à travers tous les événements de mon histoire et, désireux de vous plaire jusqu’à me gêner moi-même, je ne vous ai arrêté dans le récit, en vous disant : « Regardez ceci, considérez cela ! » qu’aux passages où votre curiosité devait être, à coup sûr, intéressée. Croyez-vous que j’aie pris grand plaisir à vous épargner ainsi les côtés languissants de ma biographie ? En aucune manière ; et, si vous l’avez cru un seul instant, vous êtes tombé dans une capitale erreur, où je prétends bien de ne pas vous laisser. Entre nous, vous êtes ingrat naturellement, et l’habitude et l’éducation vous font passer trop légèrement sur toutes les peines qu’éprouvent : les autres à vous satisfaire ; souffrez que je ne m’accommode pas de cette nonchalance et que je vous parle un peu des droits que j’ai à votre gratitude.
Et d’abord, je ne vous ai fatigué par aucune digression. Voilà le point principal. Croyez-vous qu’il ne m’eût pas été fort doux de me jeter à corps perdu dans quelque définition de la Commedia dell’Arte, telle que la jouaient mes héros ? de vous représenter au naturel ces lazzis piquants, ces situations bouffonnes dont un ancien canevas traçait seul la marche, et dont aucune scène écrite ne gravait le caractère précis dans la mémoire d’acteurs assez intelligents pour être eux-mêmes auteurs ? N’aurais-je trouvé aucun plaisir, je vous le demande, à vous dépeindre l’improvisation facile de Scaramouche, et les gracieuses reparties de Colombine, et le naturel et l’art exquis dont leurs compagnons assaisonnaient leurs rôles ? Mais je ne l’ai point voulu faire, parce qu’en général vous êtes fort peu artiste et que les événements avaient plus de chance de vous amuser que les réflexions.
De même, si les caractères de nos personnages sont tracés dans votre esprit, je puis dire, grâce à Dieu ! que ce n’est avec l’aide d’aucune analyse psychologique. Je vous l’ai tout à fait épargnée, et mon volume a pu s’en désenfler d’autant. Croyez-moi, les trois petites historiettes que je viens de vous raconter eussent pu suffire aisément à défrayer deux tomes in-octavo.
Voilà mes mérites, sachez-m’en gré ; je continue.
Nos amis étaient donc à Naples. La fortune leur souriait peu : car justement les comédiens de Goldoni commençaient à gagner faveur et, bien que quelques amateurs déterminés des canevas italiens tinssent encore fidèle compagnie aux masques, le beau monde courait plus volontiers où était la mode. On gagnait donc peu d’argent et l’on ne faisait guère que végéter.
Un soir, après le spectacle, Polichinelle était monté à sa chambre, située au cinquième étage d’un escalier tortueux et noir ; il s’était déshabillé tristement, en songeant à la mesquinerie de la recette ; puis, couché, il s’était mélancoliquement endormi et commençait à rêver couronnes et ducats jetés sur la scène par des mains libérales, vrai songe introduit par la porte d’ivoire, lorsque, au bas de l’escalier, se fit entendre un pas lourd et hésitant, qui commençait à monter en cherchant les marches. D’abord ce pas mystérieux se tira assez adroitement des difficultés de la situation ; il montait, montait avec prudence et succès, lorsque tout à coup la chance tourna, le pied glissa, une bruyante culbute ébranla tout l’escalier et fit gémir la rampe. « Holà hé ! diable ! Ouf ! Je me suis cassé les jambes ! Ouf ! Au secours ! » Enfin tous les gémissements d’un homme mécontent de sa fortune.
À ce vacarme, Polichinelle se réveilla en sursaut, se jeta en bas de son lit et ralluma sa lampe. Puis il vint se pencher au haut de l’escalier en cherchant à faire pénétrer la lumière jusqu’en bas, et demanda d’une voix flûtée :
– Monsieur demande quelqu’un ?
Du fond de l’abîme s’éleva cette réponse :
– Monsieur Polichinelle !
– Donnez-vous la peine de monter en prenant garde aux marches que je crois mauvaises, répondit courtoisement l’artiste dramatique.
Quelques secondes après, il se trouva en face d’un gros monsieur en habit de velours rouge, coiffé d’une énorme perruque, embroché d’une épée, et qui se frottait les côtes.
À l’aspect de son visiteur, Polichinelle, frappé de surprise et de respect, ne sut plus quelle contenance tenir.
– Monsieur le marquis de Bianconero ! Grand Dieu ! À qui dois-je l’honneur d’une pareille visite ? Excellence, asseyez-vous ! Permettez-moi de passer au moins un vêtement indispensable.
– Non, non, Polichinelle, répondit débonnairement le marquis, vous êtes fort bien, et je n’ai qu’un mot à vous dire : c’est au sujet d’un jeune homme qui est votre camarade.
– Scaramouche, Excellence ?
– Précisément. Je voudrais savoir ce qu’il est et d’où il vient.
Polichinelle répondit :
– Excellence, c’est un homme du plus grand mérite et qui devrait être empereur ; malheureusement la fortune l’a maltraité. Une famille dénaturée a privé ses premières années des conseils d’un père ; abandonné jeune à lui-même, il n’en a pas moins rendu illustre une naissance commune, puisqu’il doit le jour à un paysan de la Romagne.
Le marquis tira de sa poche un carnet et marmotta entre ses dents :
– Fort juste ! Ne porte-t-il pas derrière l’oreille gauche un signe orangé ?
– Non, monsieur le marquis, c’est derrière l’oreille droite et tirant vers le menton.
– Oreille droite, fort bien ! Jusqu’ici les rapports sont exacts. N’a-t-il pas des sentiments pleins de noblesse, le goût des belles choses, l’amour d’un sexe qui fait adorer jusqu’à ses cruautés, la patience courte, l’épée prompte à sortir du fourreau, enfin tout ce qui distingue un… un…
– Un artiste dramatique ? Sans nul doute, Excellence.
– Ce n’était point artiste dramatique que je voulais dire : mais il n’importe. Ces renseignements sont parfaits et conformes à ceux que je possède déjà. Demain, que ce jeune homme passe à mon palais ; j’ai à lui parler de choses de la plus haute importance. Ne manquez pas de faire ma commission. Bonsoir, Polichinelle.
– Monsieur le marquis, je suis le serviteur de Votre Excellence. J’ose me permettre de rentrer dans mon lit, car la nuit est froide et je suis vêtu fort légèrement. Voici mon flambeau que je vous prie de laisser au bas de l’escalier et d’éteindre.
Le marquis de Bianconero regagna sans accident aucun la porte de la rue et rentra chez lui.
Le lendemain, Scaramouche, proprement vêtu, se présenta au palais et demanda à parler à M. le marquis. On l’introduisit aussitôt dans un vaste salon, splendidement orné. Quelques domestiques vinrent le considérer d’un air respectueux, mais étonné, et l’attente durant déjà depuis quelques minutes, il commençait à se croire victime d’une mystification quand une jolie soubrette vint le prendre et l’introduisit chez la marquise.
Mme de Bianconero était une femme d’un certain âge, qui avait pu être fort belle, mais qui ne l’était plus. Elle était pourtant tirée à quatre épingles et avait un air très avenant. Quand Matteo Cigoli entra, elle courut plutôt qu’elle n’alla à sa rencontre, le considéra quelques instants d’un air passionné et se précipitant enfin dans ses bras :
– Mon fils, mon cher fils, je te retrouve donc enfin ! s’écria-t-elle.
Et elle s’évanouit.
Scaramouche, confondu d’étonnement, se trouvait fort embarrassé et ne savait où la mettre ; qu’on ne lui en veuille pas de cette apparente insensibilité. La voix du sang ne parlait pas encore assez haut dans son cœur, pour lui faire oublier le côté ridicule de la situation. D’ailleurs, et avant de s’attendrir, il voulait qu’on s’expliquât, et la marquise revint à elle fort à propos pour satisfaire ce désir raisonnable.
Elle l’embrassa tendrement à plusieurs reprises et puis, le faisant asseoir auprès d’elle sur un sofa, elle se mit à pleurer et dit :
– Vous êtes, don César, le fruit, l’unique fruit de mes trop malheureuses amours avec l’infortuné don Giulio Torrevermiglia. À peine étiez-vous né qu’on vous fit partir secrètement pour la Romagne, sous la garde d’un serviteur de confiance, attaché depuis trente ans à ma famille et à qui l’on confia pour vous une somme de soixante mille ducats, qui devait servir à l’éducation de vos premières années. Mais voyez à quel point le cœur de l’homme est fragile ! Ce vieux serviteur se laissa probablement tenter par le désir de s’approprier les soixante mille ducats ; ce que je puis vous dire, c’est que, malgré tous mes efforts, je n’ai plus jamais entendu parler de lui.
« Le prince Jérôme Boccatorta, joueur effréné et amoureux de moi comme un tigre, tua don Giulio, la veille du jour où j’allais l’épouser, et je me trouvai plongée dans la plus affreuse douleur et sans espoir d’être jamais consolée, puisque je croyais vous avoir perdu sans retour.
En vain M. de Bianconero me faisait-il une cour assidue, je ne voulais pas entendre parler de mariage. Homme dévoué et aimable ! malgré mes refus, il n’en continua pas moins de me voir tous les jours et, quand ma tristesse croissante et le ravage des années eurent éloigné tous mes courtisans, il me resta seul, ami tendre et aussi respectueux qu’au premier jour. Depuis quinze ans, il a pris le goût des collections d’insectes et, comme il m’en parlait toujours dans ses visites quotidiennes d’une heure à quatre et de cinq à minuit, je lui ai accordé ma main, par découragement, à condition qu’il ne m’ouvrirait jamais la bouche de ses plaisirs scientifiques et qu’il vous reconnaîtrait aussitôt que vous seriez retrouvé.
Trois fois mon amour maternel a été égaré. La première, j’ai payé les dettes d’un mousquetaire français, ruiné par le jeu, qui, ayant entendu parler de mon aventure, est arrivé de Paris en poste, avec une tache légèrement orangée sous l’oreille gauche. Le misérable a vendu une magnifique collection de scarabées, faite par le marquis, à un amateur très habile au reversis ; puis il s’est enfui avec ma femme de chambre.
Le second était un Grec qui m’avait vendue d’avance (il y a dix ans de cela) au pacha d’Égypte, et qui, sous prétexte d’une promenade sur mer, me voulait remettre entre les mains du mahométan. Il a été roué vif.
Le troisième était un Florentin qui a failli m’empoisonner pour avoir ma succession plus tôt. Mais enfin j’ai trouvé mon fils, mon fils réel ! C’est vous, mon cher enfant ! Je vous ai vu au spectacle, je vous ai suivi au bal masqué, j’ai su vos aventures, votre manière de vivre, et, persuadée de la vérité, j’ai fait partager ma conviction au marquis. Oui, vous êtes mon pauvre fils ! je suis heureuse ! Embrasse-moi donc ! »
Scaramouche, ou plutôt le comte don César Bianconero, baisa la main de sa mère et, avant qu’il eût pu trouver une parole sensée dans sa tête où son imagination bouleversée faisait le plus étrange tohu-bohu, le marquis entra, le serra sur son cœur et, enchanté d’avoir enfin un auditeur chez qui la patience allait devenir une vertu forcée, il l’entraîna vers ses collections.
Après une longue extase, quand les mouches, les sauterelles, les cloportes, les papillons, les guêpes, les hannetons, les cerfs-volants, les limaçons, les fourmis, les cirons et autres êtres merveilleux, qui composaient les trésors scientifiques du palais, eurent été examinés consciencieusement sur le dos, le ventre, les pattes, les trompes et les ailes, et qu’il n’y eut plus la plus petite chose à voir, ni la moindre observation à émettre, le marquis mena don César dans un bosquet, sur un banc et, s’étant croisé les jambes, il lui demanda ce qu’il savait de son histoire.
L’ex-Scaramouche rapporta fidèlement ce que ses plus anciens souvenirs avaient conservé et, avec l’honnêteté qui le distinguait, il jura qu’il s’était toujours considéré comme le fils véritable du brutal Cigoli ; cependant il avoua que le trait principal de leur séparation aurait pu le porter à en douter.
Le marquis essuya ses lunettes avec son mouchoir d’un air très méditatif, puis il dit à don César :
– Mon ami, je dois vous dire que je ne suis pas aussi persuadé que Mme de Bianconero de votre filiation ; néanmoins je vous crois un caractère honorable et, comme la fantaisie de retrouver ce malheureux enfant a fait le malheur de sa vie, que, sans trop d’efforts, il vous est facile de la rendre heureuse, loin de m’opposer à ce que vous soyez reconnu comme son enfant et le mien, je vous en supplierais même, s’il en était besoin.
« Mais, entendez-moi bien et retenez mes paroles. Le bonheur de Mme de Bianconero est ma première étude. Si vous vous conduisez bien avec elle, si vous ne lui causez pas l’ombre d’un chagrin, ma reconnaissance sera sans bornes, et mon attachement facilitera tous les chemins à votre ambition. Si, au contraire, vous trompiez mes espérances, vous auriez en moi le plus impitoyable ennemi.
Oui, don César, je ne vous pardonnerais jamais et j’essayerais même de trouver au fond de mon cœur assez d’énergie – et cet effort me coûterait la vie en m’ôtant le repos – assez d’énergie, dis-je, pour vous faire tout le mal qui serait en mon pouvoir. »
Don César, touché d’un pareil attachement et de l’expression passionnée du vieux marquis, allait protester, et du fond de son cœur, de la droiture de ses intentions, quand la marquise parut, rajeunie par un air de joie qu’on ne lui avait pas vu depuis bien longtemps. M. de Bianconero salua sa femme avec une déférence pleine d’une tendresse timide, elle prit le bras de don César et l’on entendit le son joyeux d’une cloche.
C’était l’annonce du dîner. Ce dîner fut bon.
Un des premiers devoirs que remplit l’heureux don César Bianconero, lorsqu’il se vit installé dans sa nouvelle famille, fut de l’instruire du tendre attachement qu’il avait pour ses anciens camarades. Il ne dissimula rien des services journaliers que lui rendait Polichinelle, des bons conseils dont ne le laissait jamais manquer Colombine et du dévouement véritable que Tartaglia déguisait sous son enveloppe jalouse et brutale.
La marquise Bianconero, en mère passionnée, prit avec chaleur la cause des comédiens et déclara qu’elle les recevrait publiquement dans sa maison, qu’elle les présenterait partout, et qu’elle allait employer tout son crédit pour qu’eux seuls eussent le privilège de jouer les pièces à canevas, non seulement à Naples, mais dans tout le royaume. À cette déclaration quelque peu fougueuse, le marquis baisa la main de sa femme avec tendresse et lui dit :
– Madame, la reconnaissance va bien à la pureté de votre âme ; mais, lorsque vous aurez réfléchi, je ne doute pas que vous n’aperceviez tous les inconvénients de votre projet.
– Homme sans générosité ! dit la marquise. Et elle ne voulut pas lui permettre même de donner ses raisons ; elle lui reprocha ses préjugés et sa froideur et tout en resta là.
Don César fut bientôt lancé dans ce que la ville avait de plus considérable. Sa romanesque histoire, la comparaison avec ses prédécesseurs, la justice qu’on lui avait rendue comme comédien, tout contribuait à le faire désirer partout ; et, comme la malignité de l’homme s’éveille toujours au moment où commence son attention, on chercha avec grand soin un moyen légitime de le prendre en horreur.
Il était l’unique sujet de toutes les conversations.
– Marquise, disait un jour la belle vicomtesse de Charpigny, nièce d’un cardinal, à Mme de X…, ne trouvez-vous pas inouï de recevoir un comédien chez soi ?
– Que dites-vous, ma toute belle ? répondit la vieille dame ; s’il n’avait été que comédien, ce serait peu ; mais l’abbé Lorzi l’a connu à Nice, marchand d’oranges. Après tout, il porte un beau nom ; sa fortune sera immense et l’on dit qu’il va épouser la petite Fieramonte.
La nouvelle était vraie. M. de Bianconero, par amour pour sa femme, s’était mis en campagne et avait mené à bien ce projet d’alliance. Mais ce n’était pas tout ; pour le rendre possible, il fallait une révolution dans les mœurs de don César.
La continuation de ses premières amitiés avait enchanté tout le monde au début. On avait trouvé cela d’autant plus louable qu’on le jugeait plus héroïque, car une espèce de parvenu devait être fort tenté, dans son for intérieur, de rompre avec tout ce qui lui rappelait sa première fortune.
Au bout d’un mois, cette longue vertu finit par ennuyer ; et c’est bien simple : dans le monde on aime à voir changer souvent la décoration. On se demanda donc : « Ah çà ! que fait le jeune Bianconero avec ces histrions ? Est-ce qu’il n’aurait jamais d’intimités plus relevées ? On ne trouve qu’eux dans le salon de sa mère. »
Au bout de six mois on se plaignait universellement de ne pouvoir plus aller dans cette maison-là. Au bout de huit mois, la marquise elle-même était parfaitement lasse de tous ces braves gens, qui n’avaient en aucune manière ni le ton ni les habitudes de la bonne compagnie ; enfin elle finit par leur faire défendre sa porte, catastrophe que le marquis avait prévue depuis longtemps et dont il avait voulu leur éviter les déboires. Il continua, quant à lui, à les recevoir le matin comme par le passé, et à leur rendre tous les services qui étaient en son pouvoir.
Enfin, au bout de dix mois, don César reçut de Colombine le billet suivant :
Mon bon Scaramouche, car je ne puis me déshabituer de te donner ce nom sous lequel je t’ai connu si beau, si spirituel, si aimé, je n’ai plus le courage de te voir et je t’écris pour t’annoncer que, par mon ordre, notre porte te sera dorénavant fermée. Chacun doit faire son métier. Le tien n’est plus de mener joyeuse vie derrière la toile, bras dessus bras dessous avec la misère, et d’amuser le public sur la scène. Il te faut désormais assister à de longs dîners, à de longues soirées, à de nombreuses réunions et faire beaucoup de visites, afin de te faire annoncer plus souvent, ce qui t’apprendra ton nom. Pauvre ami, ta jadis chère Colombine n’a plus qu’un conseil à te donner. C’est de ne pas devenir plus impertinent, et de jeter un peu moins ta qualité à la tête des gens. Pardonne-moi, du reste, la mauvaise humeur de cette lettre, si elle te blesse ; elle vient de mon cœur, non de ma vanité. Je t’aime trop pour te perdre tranquillement. Adieu, mon bon, adieu, mon cher petit. Sois aussi sage que tu pourras et cela pour toi seul, pour ton bonheur. Souviens-toi souvent de ton amie et de tes amis, surtout quand tu auras des chagrins. Adieu. Je t’embrasse de bien bon cœur.
Colombine.
Après avoir lu cette lettre, don César pleura pendant vingt-cinq minutes. Il y eut même en lui une sorte de lutte entre son ancien caractère et celui que les nouvelles circonstances dans lesquelles il vivait avaient, comme forcément, développé chez lui ; mais le combat fut court, parce que les forces n’étaient pas égales.
Le nouveau gentilhomme trouvait sa position trop douce pour en céder une ligne, et toi, lecteur, tu eusses fait comme lui, ne le nie pas. Le soir, don César était tout aise et délivré d’un grand poids. Comme M. de Bianconero ne le voyait plus aller chez ses anciens camarades, et que ceux-ci ne lui parlaient plus de ce bon Scaramouche, il lui demanda un jour ce qu’il en était ; à quoi don César répondit en lui montrant la lettre de Colombine.
Le marquis la lut et, ayant regardé quelque temps son beau-fils par-dessus ses lunettes, il leva les épaules et lui mit dans les mains un magnifique hanneton dont il préparait en ce moment le lit mortuaire.
Revenons au mariage de don César. Mlle de Fieramonte était la fille de la femme la plus célèbre que Naples ait jamais produite pour l’étude de l’anatomie ; cette dame, dont les ouvrages sont, à ce qu’il paraît, fort estimés du praticien, avait alors quarante-neuf à cinquante ans. Elle était petite, grosse, rouge et fort concentrée en elle-même. Comme ses journées étaient partagées entre l’étude et les doctes conversations, elle n’avait pas eu le temps de s’occuper de sa fille et l’avait confiée à une gouvernante que nous appellerons Sylvie.
Don César fut présenté dans la maison de Mme de Fieramonte par son beau-père. Il y arriva, un beau soir, comme un futur époux, assez embarrassé de sa personne, et décidé à être aimable et brillant, c’est-à-dire qu’il ne fut ni l’un ni l’autre. Mme de Fieramonte était retenue par ses études, et sa fille et dame Sylvie reçurent les deux visiteurs. Que dame Sylvie était laide ! Dieu ! qu’elle était ridée ! Dieu ! qu’elle parut à don César acariâtre et impérieuse ! N’en soyez point surprise, belle dame qui me lisez ; elle produisait assez généralement ce double effet.
Don César s’adressa particulièrement à sa future ; quoique peu remarquable, comme je viens de le dire, sa conversation fut sensée et, en somme, convenable. Il sortit avec le marquis, enchanté de sa soirée, et fut content de la belle Herminie, à qui il pensait avec raison n’avoir pas déplu. Le lendemain, il fut reçu par Mme de Fieramonte, qui, en feuilletant un volume de dissection, lui exprima tous ses regrets de ne pouvoir tenir sa parole ; mais elle lui avoua que, ne voulant en rien influencer les déterminations de sa fille, elle se croyait obligée de repousser ses vœux. En ce moment, dame Sylvie entra dans l’appartement, ne salua pas le comte, et confirma d’une voix sèche l’arrêt qui frappait le pauvre don César.
Ce malheureux jeune homme revint tout déconfit apprendre sa mésaventure à son beau-père et lui en témoigna tout son étonnement.
– Il y a complication dans votre fait, lui dit le marquis ; Mme de Fieramonte refuse votre alliance, et votre mère… Mais allons d’abord à la première affaire. Vous êtes sans expérience, don César, car sans cela vous eussiez fait attention qu’hier au soir je vous poussai le coude en entrant dans le salon, et vous eussiez salué la dame Sylvie la première.
– Quoi ! avant Mlle de…
– Avant la maîtresse légale du logis elle-même. Vous ne savez pas ce que c’est que le pouvoir des gouvernantes, dames de compagnie et autres domestiques panachés qui s’emparent des clefs du logis. Peste ! mon enfant ! celle-là vous a fait rompre votre mariage parce que vous l’avez saluée la dernière ; j’en ai connu une en Danemark, qui avait fait renvoyer un mari au beau milieu de la lune de miel. Il n’est pas d’araignée, même d’araignée-crabe, plus dangereuse que ces sortes de… Mais passons à la seconde affaire.
Mon cher ami, je vais vous parler sérieusement. Vous avez des défauts : ne me regardez pas d’un air effrayé ; je veux dire que vous n’êtes point parfait ; ce qui, à mes yeux, ne vous inculpe aucunement. Mais pendant vingt ans, que votre mère vous a attendu, elle s’est fait du fils qu’elle a perdu un si parfait idéal qu’elle ne peut supporter la pensée d’aucune imperfection dans un être aussi cher. C’est une bien malheureuse disposition, don César ; bien malheureuse, sans nul doute, mais elle existe. Depuis quelque temps, Mme de Bianconero est inquiète, soucieuse ; je crains tout de la vivacité de son imagination et, hélas ! – je puis vous le dire en pleurant – de la faiblesse de sa tête. Si elle découvre tout à coup que les légères taches qu’elle soupçonne dans votre caractère, et que je vous connais, mon ami, existent réellement, elle est capable, oui, elle est capable…
– Capable !… vous m’effrayez, monsieur le marquis, capable de quoi ?
– Capable de… eh bien, oui ! de déclarer que vous n’êtes pas son fils.
– Mais ce serait absurde !
– Voilà un mot que je ne puis vous passer, monsieur, appliqué à une femme aussi respectable ; mais je veux bien l’attribuer pour cette fois à la vivacité de votre âge. Voici ce que j’ai résolu. Vous allez partir sous le prétexte de voyager ; votre train sera digne du rang que vous occupez dans la société. J’ai annoncé cette nouvelle à la marquise, elle l’a accueillie avec douleur sans doute, mais enfin j’ai su la persuader, et elle a consenti. Faites vos préparatifs, et que dans deux jours vous soyez sur les grands chemins ; c’est ce que, je vous souhaite à vous, à elle, à moi, du plus profond de mon cœur. Écrivez-nous souvent, tâchez de vous arranger de manière à venir passer un mois tous les ans auprès de nous, et je pense que nous n’aurons rien à craindre.
Voilà quelle fut la harangue du marquis Bianconero. Don César la trouva fort remarquable, moins comme pièce d’éloquence que par les faits qu’elle contenait. Il eut un instant l’idée de demander des explications catégoriques sur la nature du rôle qu’il jouait. Il s’indigna de la position ambiguë qu’on lui avait faite ; mais le titre, la fortune, la position dont il jouissait étouffèrent toutes ces fumées de dignité offensée ; il se tut, fit de tendres adieux à sa mère qui pleura beaucoup, le serra longtemps sur son cœur, et il partit. Pendant six semaines il parcourut l’Italie, vit Rome, alla saluer à Florence le grand-duc, qui reçut le grand seigneur tout aussi bien que jadis le comédien, puis il vint enfin s’abattre à Venise pour y fixer, du moins momentanément, son séjour.
Six ans au moins, s’étaient écoulés depuis qu’il avait quitté cette ville, et il ne revit pas sans émoi ces quais, ces palais, ces arcades, ces places, témoins de ses premières amours. Quant à la défense qui lui avait été faite d’y jamais rentrer, on pense bien qu’il ne s’en inquiéta guère. Ce n’était pas au comte de Bianconero à se souvenir des humiliations de Scaramouche.
Mais si cet illustre personnage oublia, ou à peu près, toutes les douleurs de l’ex-bohémien, il n’en fut pas de même de ses joies ; car, à peine arrivé, don César se mit en quête de tous les plaisirs que présentait cette capitale, célèbre à jamais, comme on sait, par la facilité des mœurs de ses habitants et surtout de ses belles habitantes. Le Jeu ; la comédie, le bal, les mascarades remplissaient les journées de l’heureux comte Biancoriero ; il se trouva bientôt lié avec ce que la ville comptait de plus brillants cavaliers et surtout de plus nobles ; car, il faut l’avouer, don César, parmi toutes les brillantes qualités qui le distinguaient, avait depuis son élévation laissé germer, pousser et grandit une certaine morgue qui ne lui permettait pas de se lier avec des gens de naissance peu remarquée. Lorsque quelque étranger le trouvait en compagnie d’un jeune homme ou d’un vieillard respectable ou le voyait saluer un personnage dans la rue, il aimait pouvoir dire avec une négligence apparente :
– Tenez ! ce seigneur est le marquis Mocenigo. Famille ducale et assez ancienne ! Ce vieux magistrat est le digne chevalier Barbarigo, dont vous connaissez l’illustration. Pour ce gentilhomme, c’est l’ambassadeur de France, mon meilleur ami !
Bien différent en cela de son beau-père qui, sans jamais s’abaisser, voyait habituellement des gens de toute espèce, pourvu qu’ils fussent honnêtes, et qui, de sa vie, rangée et probe, n’avait été atteint de la peur de s’encanailler.
Les nouveaux amis de don César lui firent connaître force courtisanes et quelques femmes qualifiées d’une réputation très embrumée. Mais cela, comme on pourrait le croire, ne suffisait pas à cette époque, à Venise, pour être ce que nous pourrions appeler, de nos jours, un homme à la mode. Il fallait à toute force avoir une intrigue nouée et parachevée dans quelque couvent. Ne jetez pas les hauts cris ; belle lectrice, ni vous non plus, lecteur qui savez vivre, et soumettez-vous à ce sacrilège, en commentant cette phrase magique : « C’était la mode ! »
Scaramouche – Je me trompe, don César – n’aurait pu supporter la pensée de ne pas être parmi les favoris de cette divinité ; il se mit donc en quête d’une aventure de ce côté-là. Mais, pendant quinze jours, il eut beau parcourir toutes les églises de monastères, assister à tous les services comme un bon et fervent chrétien, il ne vit pas une figure qui lui donnât envie de mener à mal celle qui la possédait et il dut se résoudre à voir le bonheur de Paul Cigliari, du baron de Hesse-Benfeld, du chevalier de la Mézie, et de sir George Hutton, sans pouvoir rivaliser avec eux d’écorniflures faites à la grille du parloir.
Un soir cependant, au palais de je ne sais plus lequel, le chevalier de la Mézie, qui lui voulait du bien, parce que don César lui prêtait fréquemment de l’argent, lui proposa de l’accompagner à un rendez-vous où une épée de plus ne serait peut-être pas inutile. Bianconero était brave, on le sait, et il accepta. Les deux complices escaladèrent une grande muraille et se trouvèrent sous des tonnelles de verdure qui laissaient à peine pénétrer les rayons de la lune.
Là, M. de la Mézie, habitué de ce dédale, fit asseoir le comte dans un coin obscur et, après avoir donné un signal probablement convenu d’avance, reçut, avec la galanterie et la grâce toute parfaite que Paris entier lui reconnaissait, une jeune novice, charmante à en juger par sa tournure et sa démarche et qui, pour débuter, se jeta dans ses bras.
– Mon cher chevalier, lui dit-elle, avez-vous amené quelqu’un ?
– Sans doute, belle Angélique, répondit ce seigneur. Voici M. de Bianconero qui nous aidera plus encore dans notre fuite qu’il ne nous est nécessaire.
– Cela n’est pas aussi certain que vous le pensez, répondit l’infidèle épouse du Seigneur, car je suis décidée à faire le bonheur d’une de nos mères qui n’aspire qu’à s’enfuir du couvent, qui ne veut ni d’un amant ni d’un mari, et qu’il s’agit seulement de mener à Trieste, d’où elle compte gagner l’Allemagne. M. de Bianconero aura-t-il bien tant de bonté que de l’accompagner dans ce périlleux voyage – j’entends, jusqu’à Trieste – et cela en engageant sa parole de gentilhomme de ne la point tourmenter pour savoir son nom ou même pour voir son visage ?
– Mais, ma toute charmante, de quel nouveau soin embarrassez-vous mon amour ?
– D’aucun, cher chevalier, car j’aime tant mon amie que, si vous refusez, je reste.
– Peste ! murmura M. de la Mézie visiblement contrarié. Essayons.
Et, s’approchant de don César, il lui dit d’un air dégagé :
– Mon cher comte, remerciez-moi, je fais votre bonheur ! Une femme ravissante, belle, aimable et faite au tour, qui a conçu pour vous un vif sentiment d’estime (j’oubliais de vous dire qu’elle est religieuse dans ce monastère), a envie d’aller à Trieste et voudrait vous avoir pour compagnon de route. Convenez, mon cher comte, que la fortune vous traite en enfant gâté. Cette plaisanterie sera du goût le plus exquis, et n’était la petite Angélique avec qui j’ai des engagements, je voudrais être de la partie ! Tous nos seigneurs vont vous envier !
– Mais, objecta don César, je n’ai pas envie d’aller à Trieste.
– Je vous dis que c’est du meilleur goût.
– Mais c’est fort loin !
– Elle est charmante.
– On se moquera de moi !
– Tout le monde voudrait être, à votre place. Belle Angélique, le comte attend votre amie et exécutera tout ce qu’elle exige, n’en doutez pas. Maintenant, partons, car nos rameurs attendent, et le jour va paraître.
– Je vais chercher mon amie, dit la capricieuse nonne en s’enfuyant.
– Diable ! objecta M. de la Mézie ; en prenant une prise de tabac.
Au bout de quelques minutes, les deux nonnes parurent à l’extrémité de l’allée. La nouvelle venue était voilée avec le plus grand soin et l’on pouvait préjuger, d’après sa démarche naturelle et ferme, une certaine fierté de caractère qui ne s’accordait pas trop bien avec l’action qu’elle commettait en ce moment. Les compliments furent courts, ainsi qu’on le peut croire, et on se hâta de prendre place dans la gondole qu’avaient amenée les deux amis et qui partit comme une flèche dans la direction de la terre ferme.
Un peu avant que le jour eût paru, on toucha la terre. Je passe sur la conversation qui eut lieu auparavant ; elle fut, de la part du chevalier, un feu roulant de choses aimables et pleines d’esprit qu’il est inutile d’enregistrer et auxquelles Angélique répondait avec plus d’embarras que d’amour. Sa compagne ne disait mot, et don César l’imita, après quelques efforts pour nouer la conversation. Au moment de se séparer, la religieuse embrassa Angélique et lui dit :
– Soyez heureuse, mon, enfant, autant que je le veux et plus que je ne le crois.
Angélique se mit à pleurer comme il est d’usage en pareille occurrence, et le comte saisit cette occasion pour dire au chevalier, en le prenant par le bras :
– Pardieu ! je suis bien aise qu’elle ait prononcé cet aphorisme, car je la croyais muette ; c’est un poisson, mon cher ami, avec qui tu me laisses en tête-à-tête.
– Je te réponds, sur mon âme, de sa beauté et des grâces de sa conversation, s’écria le chevalier en serrant son ami dans ses bras ; mais elle n’est bien que sans témoin. Adieu et reçois ma bénédiction avec mes remerciements.
Cela dit, il fit monter Angélique dans une chaise de poste qui se trouvait là à les attendre et qui les porta… ma foi, je ne sais pas où et je n’ai pas le temps de le chercher.
– Belle dame, dit alors don César, je sais que vous avez un vif désir de voir Trieste… C’est une belle ville… et certainement…
– Monsieur, interrompit la religieuse, allons d’abord à Ancône où je compte m’embarquer ; je crois que nous pourrons nous quitter là.
Don César ne l’écoutait plus ou plutôt ne la comprenait plus ; tous ses sens étaient confondus dans son oreille, pour bien saisir, pour mieux analyser les modulations de cette voix trop connue.
– Eh ! par le diable ! madame, s’écria-t-il enfin, vous êtes… ce n’est pas possible… Ah ! Rosetta, perfide Rosetta, est-ce vous que je retrouve ?
C’était Rosetta, la toujours belle Rosetta ; mais aussi c’était Rosetta bien changée. La solitude, l’éloignement des mauvais conseils avaient réchauffé le bon sang qui coulait dans ses veines. Après quelques mois de réclusion, elle avait pu réfléchir à la cruauté de sa conduite passée envers le pauvre comédien et, en appréciant ce qu’il valait, elle avait aussi reconnu la honte dont sa conduite légère aurait pu couvrir sa famille. Il n’en fallait pas plus pour une âme aussi fière. De ce moment, toutes ses pensées s’étaient tournées vers le recueillement et la piété, et bientôt les remords de deux actions, coupables sans doute, mais au fond excusées par sa jeunesse, avaient fait place à une grande exaltation de sentiments religieux. En un mot, servir Dieu était depuis longtemps sa seule et unique existence.
Elle n’avait pas tardé à découvrir, cependant, la profonde démoralisation de son cloître qui, pareil à tous ceux de Venise, était loin d’observer à la lettre les vœux monastiques ; et toujours romanesque, elle avait pris la résolution de fuir du couvent pour aller s’enfermer dans quelque autre du même ordre qu’elle irait chercher en Allemagne, où elle ne doutait pas que la règle fût mieux observée. Pour se faire protéger dans ce long voyage, elle avait compté sur sa fierté et sur l’argent qu’elle emportait. Du reste, sûre d’elle-même, elle ne redoutait pas une impertinence.
Elle expliqua tout cela au comte aussitôt qu’elle l’eut reconnu. De son côté, il la mit au fait de ses aventures et de l’étrange histoire de sa naissance ; néanmoins, il oublia de lui dire que cette croyance était déjà un peu ébranlée. La vue de Rosetta fit naître d’étranges indécisions dans le cœur de don César. Nous savons déjà combien il était rancuneux. Mais, en cette circonstance, la colère s’éclipsa devant l’amour qui se releva plus fort que jamais dans son cœur. Quand je dis que la colère s’éclipsa devant l’amour, je me trompe, ce fut devant l’espérance qu’elle s’éteignit. Jadis, Scaramouche n’avait aucun espoir de devenir l’époux de l’héritière des Tiepolo ; aujourd’hui, le comte Bianconero, sans trop de fatuité nobiliaire, pouvait avoir cette prétention cela changea toutes ses dispositions.
Que les romanciers sont donc malheureux ! et que l’on avoue avec grande raison que c’est le pire de tous les métiers ! Pendant que je raconte ce que disent, pensent, ne disent pas ou ne pensent pas mes deux interlocuteurs, j’ai bien été obligé de ne pas vous apprendre qu’ils étaient arrivées dans un bourg, y avaient acheté une voiture et qu’à l’aide de deux gros chevaux, dont l’un boiteux et l’autre borgne, conduits par un postillon qui réunissait ces deux qualités, ils étaient depuis longtemps en route pour Ancône, où ils arriveront, s’il vous plaît, sans que je prenne l’embarras de m’interrompre pour vous dire où et comment ils relayèrent. Dans cette ville d’Ancône, ils s’embarquèrent, ainsi qu’ils l’avaient résolu, et je ne sais s’ils eurent bon ou mauvais vent. Bref, je vous dirai, charmante lectrice, ce qu’il conviendra de vous dire et, quand ils seront arrivés, je vous en préviendrai.
Ce qu’il est important de savoir, c’est que don César redevint plus amoureux qu’il n’avait jamais été ; mais Rosetta, bien qu’avec une douceur infinie, ne voulut lui laisser aucune espèce d’espérance. Elle le réconfortait de son mieux, l’assurait de son repentir du mal qu’elle lui avait fait, lui donnait avec une autorité tendre et presque maternelle, quoiqu’elle fût plus jeune que lui, de sages conseils sur sa conduite, surtout sur ses prétentions dont elle s’était vite aperçue ; mais elle lui confirma sa résolution de consacrer le reste de sa vie à la prière et à la méditation.
Don César essaya en vain de tous les moyens de respect et d’amour pour lui persuader de l’aimer ; n’y pouvant réussir de cette façon, il voulut prendre une méthode plus cavalière, et, après y avoir rêvé quelque temps, s’abandonnant à des inspirations fort peu respectueuses, il laissa tomber sous ses pieds un billet qu’elle ramassa et qui contenait les vers suivants :
Je voudrais bien, céleste créature,
Dans ta chambrette une nuit pénétrer,
De mes deux bras te faire une ceinture,
Clore ta bouche avec un chaud baiser,
Enfin, enfin, te contraindre à céder.
Ô ma Chloris, je meurs, je me consume…
L’amour me poind… consens donc à m’aimer !
Prends de ce feu que ton regard allume,
Et qui bientôt va tout me dévorer,
Si tu ne veux toutefois me céder.
Oui, cède-moi, c’est l’amour qui l’ordonne,
C’est l’âge ardent où tu viens d’arriver,
C’est la beauté de toute ta personne,
C’est le délire où je me sens tomber.
Ah ! c’est ma mort si tu ne veux céder.
Les rimes n’étaient point riches, c’étaient des vers de grand seigneur.
Don César ; attendait ; avec une grande anxiété, comme tout autre aurait fait à sa place, l’effet de cette incartade maladroite, et dont il se repentit du moment qu’il l’eut faite. Rosetta lut jusqu’au bout avec une grande attention et sans marquer le moindre mécontentement ; puis elle recommença cette lecture et sembla étudier les strophes les unes après les autres ; enfin, elle prit une plume, retrancha quelques mots, en ajouta d’autres et, présentant à don César ébahi une sorte d’hymne mystique à la manière de sainte Thérèse, elle lui promit d’une voix douce et calme de la méditer chaque jour dans ses oraisons.
Après ce trait, il fallait se tenir pour battu, et don César prit ce parti. Les deux voyageurs étaient à Trieste depuis deux jours quand cette résolution fut arrêtée et je vous demande pardon de ne pas vous en avoir prévenu plus tôt et de n’avoir pas indiqué l’auberge qu’ils avaient choisie.
Rosetta ne se trouvait pas assez loin de l’Italie, elle ne voulut pas s’arrêter dans cette ville et, comme elle avait éprouvé le respect de don César, elle consentit à ce qu’il l’accompagnât jusqu’en Autriche, où elle voulait se réfugier dans le premier couvent de son ordre qu’elle rencontrerait, en y payant une nouvelle dot et en faisant pénitence de sa fuite.
Le départ était fixé pour le lendemain et ils étaient à table dans leur chambre quand ils entendirent un grand bruit dans les, corridors : des gens montaient, descendaient ; on portait des paquets, des domestiques couraient çà et là. Enfin, comme les chambres d’auberge ont des cloisons plus qu’indiscrètes, on finit par entendre ces mots prononcés vraisemblablement par quelque gros laquais joufflu :
– Est-ce là qu’il faut déposer les malles du capitaine Corybante ?
– C’est là ! répondit l’hôtelier.
Puis le corridor retentit sous des pas éperonnés et une voix grêle, répondant probablement à un respectueux salut, laissa tomber ces mots :
– Bonsoir, bonsoir, faites-nous servir, car mademoiselle meurt de faim, et nos amis vont arriver.
– Ah ! mais, c’est Corybante, dit don César en sautant de sa chaise à la porte, qu’il ouvrit.
Et il se trouva en face de Colombine donnant le bras à l’ex-abbé, décoré d’une paire de moustaches, enterré dans un justaucorps de buffle, et ayant précisément la mine de ces féroces. guerriers de bois que le génie des fabricants de Nuremberg campe si fièrement, les bras en anse, sur un cheval de carton.
Inutile de dire et les embrassades et les compliments. Rosetta s’était retirée dans un coin de la chambre, et après les premiers saluts, prenait peu de part à ce qui se passait. Corybante s’exprima ainsi :
– Vous êtes sans doute surpris, seigneur don César, de me voir dans la milice mais ma pauvre dona Paula m’a forcé d’acheter une compagnie, sous prétexte que cela me donnerait du relief, et je suis en ce moment au service de Naples. J’en arrive, chargé par le marquis de Bianconero d’une commission qui m’est bien pénible à remplir, et si pénible que je préfère voir mademoiselle Colombine s’en acquitter à ma place.
– Qu’est-ce donc ? s’écria le comte tout effaré.
Colombine hésita un instant, puis, prenant son parti, mit ses deux mains sur les épaules de don César et lui dit, tout en l’embrassant :
– Mon pauvre ami, tu n’es pas le fils de la marquise Bianconcro, on a découvert d’une manière positive que ce fils n’était autre que Polichinelle. Il a montré, étant gris, des papiers qu’il conservait soigneusement comme des amulettes contre la fièvre et qui sont les preuves irréfragables de sa naissance. En apprenant cette nouvelle, la marquise, qui avait toujours rêvé son fils sous la forme d’un ange, est morte de saisissement, et son vieux mari, désespéré, s’est retiré à la campagne, où il n’a guère le courage, je t’assure, de s’amuser avec ses bêtes. Mais te voilà pâle et défait ! Voyons mon chéri, console-toi. Tu as toujours de l’argent, et l’argent, vois-tu…
– Je ne garderai pas seulement un écu de cette famille maudite ! s’écria Matteo, désespéré qu’elle ne fût pas la sienne. Au diable la noblesse ! Je déteste les gens qui veulent s’élever au-dessus des autres. Ce vieux Bianconero n’aurait pas pu me reconnaître, moi qui vaux mieux que lui !
– Il vous fait dix mille écus de rente, observa le capitaine ; mais il ne vous reconnaît pas pour son fils, par respect pour ses aïeux, à ce qu’il dit.
– Je ne recevrai pas un sou de lui ! cria Matteo, en allant s’asseoir tout sanglotant dans un coin.
– Mais vous recevrez cette rente de moi, mon cher Matteo, dit Rosetta en s’avançant. Ce n’est pas un don ; c’est à peine ce que vaut le mal que je vous ai fait : la perte de votre voix, votre emprisonnement, bien que momentané, et surtout les peines que je vous ai causées. Mon oncle Tiepolo n’hésitera pas à faire droit à ma requête contenue dans cette lettre que je vous remets. Adieu. Supportez votre malheur avec courage et regardez-moi toujours comme une amie. Vous, mademoiselle Colombine, vous m’accompagnerez jusqu’en Autriche, cela me sera plus agréable que de déranger le seigneur Matteo.
Elle allait continuer, quand toute la bande des comédiens entra dans la salle : Pantalon, Tartaglia, Arlequin, dona Barbara, Polichinelle lui-même, le nouveau comte, qui était en procès pour rattraper sa fortune donnée aux Dominicains, procès qui dura tout un an sans qu’il en ait tiré un sou et qui dure encore entre ses héritiers et l’ordre des Frères Prêcheurs. Tout cela sautait et cabriolait de joie autour de Matteo retrouvé ; Rosetta s’empressa de sortir en emmenant Colombine.
Je dois dire que le spectacle annoncé pour le soir avec la permission des autorités, n’eut pas lieu ; mais bien d’autres se firent, par la suite, brillants et magnifiques ; car Matteo ne voulut pas recevoir le don de Rosetta, pas plus que celui du vieux comte, avec qui, du reste, il fut toujours en affectueuse correspondance, aussitôt que sa fureur fut calmée, et qui même vint le voir une fois à Gaète.
Matteo, donc, redevint Scaramouche. De plus, d’après le conseil de Rosetta que lui apporta Colombine, il épousa cette fois ladite Colombine et fut avec elle aussi heureux qu’on peut l’être sur la terre.
Deux auteurs célèbres ont estimé que se marier c’était faire une fin : Le Sage termine ainsi son immortel Gil Blas ; Victor Hugo, ne sachant plus que faire du capitaine Phébus, le marie ; il assure même que ce genre d’épilogue peut être assimilé à une fin tragique. Ce mot me semble trop dur, en général, et point applicable au cas particulier que je traite. Je me contenterai donc de répéter que Scaramouche se maria. Pour la vie du capitaine Corybante, elle se trouve probablement parmi les biographies des grands hommes de guerre de cette époque.
MADEMOISELLE IRNOIS
I
M. Pierre-André Irnois fut un des marchands d’argent qui, sous la République, firent le mieux leurs affaires. Sans arriver aux splendeurs quasi fabuleuses des Ouvrard, M. Irnois devint très opulent, et, ce qui le distingua surtout de ses confrères, c’est qu’il eut le talent de conserver son bien ; enfin, il n’imita pas Annibal : il sut vaincre d’abord, puis conserver sa victoire ; sa race, si elle eût duré, eût pu le comparer à Auguste.
Dans sa sphère, son élévation avait été plus étonnante encore que celle de l’adopté de César. M. Irnois était parti de rien ; ce n’est pas là ce qui m’émerveille ; mais il n’avait pas l’ombre de talent ; il n’avait pas l’ombre non plus d’astuce ; il n’était que médiocrement coquin ; quant à se faufiler auprès des grands ou des petits, à capter d’utiles bienveillances, il n’y avait jamais songé, étant bien trop brutal, ce qui remplaçait chez lui la dignité. Mal bâti, grand, maigre, sec, jaune, pourvu d’une énorme bouche mal meublée, et dont la mâchoire massive aurait été une arme terrible dans une main comme celle de l’Hercule hébreu, il n’avait dans sa personne rien qui, par la séduction, fût de nature à faire oublier les défectuosités de son caractère et celles de son intelligence. Ainsi, matériellement et moralement, M. Pierre-André Irnois ne possédait aucun moyen de faire comprendre comment il avait pu réaliser une énorme fortune et se placer au rang des puissants et des heureux. Et pourtant, il était arrivé à avoir six hôtels à Paris, des terres bâties dans l’Anjou, le Poitou, le Languedoc, la Flandre, le Dauphiné et la Bourgogne, deux fabriques en Alsace et des coupons de toutes les rentes publiques, le tout couronné par un immense crédit. L’origine de tant de biens n’était explicable que par les étranges caprices de la destinée.
M. Irnois, ai-je dit, avait eu son berceau fort bas ; tout le monde, du moins, le croyait, et lui comme tout le monde ; mais, par le fait, on n’en savait rien ; il ne s’était jamais connu ni père ni mère, et avait commencé sa carrière sous la livrée de marmiton, dans les cuisines d’un bon bourgeois de Paris. De là, chassé pour avoir laissé brûler une rôtie confiée à ses soins un jour de gala, il avait erré quelque temps, soumis aux tristes fluctuations du vagabondage. Le pauvre diable s’était ensuite raccroché à un emploi de laquais chez un procureur, et, bientôt congédié comme trop insolent et un peu voleur, il avait manqué mourir de faim, une nuit fatale que le guet le ramassa, expirant d’inanition, sous un des piliers des Halles, où il s’était traîné après avoir en vain cherché, dans les bourriers[1] d’alentour, quelque honteux comestible.
On voulut l’envoyer aux Îles. Il s’échappa, se cacha dans le jardin d’une dame philosophe et philanthrope, et, découvert, raconta son histoire. Par bonheur, cette dame avait ce jour-là autour d’elle plusieurs personnes invitées à dîner, et parmi ces convives, M. Diderot, M. Rousseau de Genève, et M. Grimm.
Le récit du vagabond déguenillé servit de texte heureux à différentes considérations trop justes, hélas ! sur l’ordre social. M. Rousseau de Genève embrassa publiquement Irnois en l’appelant son frère ; M. Diderot l’appela aussi son frère, mais il ne l’embrassa pas ; quant à M. Grimm, qui était baron, il se contenta de lui faire de la main un geste sympathique en l’assurant qu’il voyait en lui l’homme, ce chef-d’œuvre de la nature. L’expression de cette grande vérité, reconnue par toute la compagnie, ne suffisait pas au pauvre diable. Par le plus étonnant des hasards, en le renvoyant, on pensa à lui faire donner une soupe et un lit. Le lendemain matin, la maîtresse de la maison l’avait déjà oublié, et certainement aurait donné ordre de le mettre dehors si on lui eût rappelé le chef-d’œuvre de la création, l’homme que la veille elle avait si philosophiquement accueilli ; mais une vieille intendante lui trouva les épaules suffisamment plates pour y mettre des charges de bois, et les bras assez longs pour scier des bûches. Il gagna ainsi sa vie jusqu’au jour où il redevint laquais. C’était une fortune ; c’était de là qu’enfin l’aigle devait prendre son vol.
En peu de temps, Irnois passa du service de la dame philosophe à celui d’un comte dévot, puis d’une marquise intrigante, puis d’un turcaret ; ce turcaret, le voyant suffisamment inepte, le jugea digne de recevoir les droits à la porte d’une petite ville. Voilà Irnois commis ; c’était une belle position pour ce malheureux. Il ne sut pas la garder, il tint mal ses comptes ; il fut chassé. Alors il voulut revenir à Paris, et dans le trajet il lui arriva une aventure qui semblera peu probable, mais qui n’en est pas moins véritable. Qu’on se souvienne en la lisant qu’Irnois était destiné à devenir le favori de la fortune.
Comme il avait gagné quelque petit argent dans sa gestion, il avait acheté un pauvre cheval gris dont il comptait se défaire à l’arrivée. Un matin qu’il était parti de fort bonne heure de sa couchée, il arriva au rond-point d’un grand bois vers le moment où l’aube commençait à poindre. C’était au mois d’octobre, le temps était brumeux, le jour fort terne, et, enveloppé dans sa cape, son chapeau sur les yeux, Irnois était loin d’avoir chaud. Par conséquent. son âme, peu virile d’ordinaire, n’avait pas grande fermeté. Que devint donc l’ex-commis, parvenu au débouché du rond-point, lorsqu’il vit à l’entrée de l’avenue qui lui faisait face, et par laquelle il devait absolument passer, un groupe d’hommes à cheval !
Irnois n’hésita pas en sa pensée ; il les reconnut pour voleurs, et qui plus est, voleurs de grand chemin. Il songea à fuir ; mais s’il tournait les talons, ces misérables allaient sans doute mettre d’horribles mousquets en état et le cribler de balles ! Il frissonna d’horreur et resta planté sur sa selle, son cheval retenu fermement.
Les cavaliers placés de l’autre côté du rond-point, le voyant ainsi immobile, attendirent quelque temps, en l’observant, mais comme il ne bougeait pas (il n’aurait pas remué pour un empire !), ils prirent leur parti après un colloque animé, et un d’entre eux s’avança vers Irnois. Celui-ci se crut à sa dernière heure et allait tirer sa bourse pour la donner, lorsque le cavalier mettant son chapeau à la main lui dit avec une extrême politesse : – Monsieur, ce bois n’est pas ce que vous croyez ; on vous aura fait quelque faux rapport, veuillez en être convaincu ; mais dans notre désir de vous être agréables ; nous vous offrirons cinq mille livres ; c’est en conscience tout ce que nous pouvons faire.
Irnois, à cet étrange discours, pensa que les brigands voulaient ajouter la raillerie à la férocité et se proposaient de l’égorger en riant. Sa peur redoubla, et s’il ne se fût cramponné des deux mains à l’arçon de sa selle, il serait certainement tombé de cheval. Le cavalier, le voyant muet, ne commit aucune violence, salua au contraire, et retourna vers ses compagnons.
Irnois, dont les dents claquaient, s’aperçut bientôt que deux hommes se détachaient de nouveau du groupe et se dirigeaient vers lui. Ils l’abordèrent non moins poliment qu’avait fait le premier, et l’un d’eux prit la parole :
– Allons, monsieur, dit-il, vous avez décidément l’esprit prévenu ; ne parlons plus de cinq mille livres ; mettons-en dix et concluons.
« Oh ! les scélérats ! se disait Irnois au comble de l’épouvante, les scélérats ! »
Pourtant, cette fois encore, il ne lui arriva aucun mal. Les cavaliers, après avoir attendu inutilement sa réponse, s’éloignèrent, et la conférence recommença entre eux et leurs compagnons. Enfin, toute la bande se dirigea vers Irnois qui, pour le coup, se tint assuré d’être arrivé à sa dernière heure. Mais quelle fut sa stupéfaction, quand le cavalier qui lui avait parlé d’abord lui dit :
– Monsieur, vous êtes au moment d’avoir une mauvaise affaire !
– Ah ! monsieur, répondit Irnois d’un air lamentable, que je vous aurais de reconnaissance si vous vouliez bien m’en tenir quitte !
Le cavalier se mit à rire.
– Je vois, monsieur, que vous êtes plaisant, et savez la valeur des choses. Mes associés et moi, nous voulons agir rondement avec vous. Voici, ajouta-t-il, en tirant un portefeuille de sa poche, vingt mille livres ; ne nous en demandez pas plus. Cette coupe de bois est une bonne spéculation sans doute ; mais elle deviendrait détestable si votre désistement nous coûtait davantage.
Irnois, malgré l’épaisseur de sa judiciaire, comprit alors que ces affreux scélérats étaient des marchands de bois qui voyaient en lui un adjudicataire rival. En effet, on leur en avait annoncé un. Il s’empressa de prendre les vingt mille livres, plus sa part d’un excellent déjeuner, et il renonça de grand cœur à tout ce qu’on voulut.
Ces vingt mille livres se comportèrent vaillamment dans ses mains. Le gouffre de l’agiotage ne lui engloutit pas le plus mince écu ; il eut beau aller de l’avant avec l’imperturbable témérité de la sottise, tout lui réussit ; et si bel et si bien qu’il fit douter plusieurs fois certains vétérans de la Ferme générale s’il n’était pas un génie financier de premier ordre.
Heureusement pour lui qu’avec ces succès il n’était encore que petit compagnon, lorsque la Révolution arriva. Son humble tête n’appela pas la foudre, dont il eût peut-être mérité les éclats ; il se cacha et avec lui ses pistoles, et il ne sortit de son trou pour friponner la République que lorsque le fort de la tourmente fut passé. Il réussit assez dans le tripotage des assignats ; pourtant ses triomphes dans ce genre ne furent rien, comparés à ses exploits dans les fournitures de souliers ; il avait eu le bon esprit, par couardise, de se mettre à l’abri derrière quelques esprits aventureux, auxquels il se contentait de prêter de l’argent et qui, eux, agissaient en leur propre et privé nom auprès du gouvernement. Il vit arriver des monts d’or dans ses caisses, et au comble de l’enivrement, Bonaparte était déjà consul à vie qu’il se considérait encore comme le plus grand homme du siècle.
Un beau jour il prit femme. La compagne qu’il choisit pour perpétuer sa race était la fille d’un spéculateur comme lui, Mlle Maigrelut ; et ce ne fut pas la moindre faveur de son étoile que de la lui avoir donnée simple, sotte et ennemie du faste et des plaisirs, comme lui-même était. Avec elle il épousa, en quelque sorte, Mlles Catherine et Julie Maigrelut, les sœurs, que la ruine et la mort de leur père firent tomber bientôt dans son ménage. Il ne s’en plaignit pas. Il avait, comme il se plaisait à le dire, de quoi tremper la soupe pour tout le monde, et, aimant peu les assemblées, les visites, les plaisirs mondains, et sentant que la capacité de l’esprit de Mlles Maigrelut et de Mme Irnois se haussait précisément à la hauteur du sien, il trouvait du charme dans leur société, ce qui le dispensait de sortir de chez lui.
Tel était M. Irnois, telles étaient les compagnes de sa solitude. Quant à la vie qu’il menait, il faut en parler ici. M. Irnois, avec tous ses hôtels, ses grands biens, ses immenses revenus, n’avait jamais pu se faire au luxe, et se trouvait gêné dans les grands appartements. On l’accusait d’avarice, et l’on était injuste ; s’il ne dépensait pas, c’est que cela ne l’amusait point. Il habitait au second étage d’une maison sise dans le quartier des Lombards. On sait ce que sont les demeures humaines dans ce coin de Paris. Toutes les chambres étaient uniformément carrelées de rouge, hors le salon parqueté ; toutes les chambres étaient uniformément sombres, hors les chambres à coucher, plus sombres que tout le reste, parce qu’elles donnaient sur la cour. Les meubles étaient d’acajou dans les grands appartements, de noyer dans les petits ; le velours d’Uttrecht jaune régnait partout en maître, et quelques pendules dorées, représentant Flore et Zéphyre ou l’Amour attrapant un papillon, sous verre, étaient les dernières limites de la magnificence Irnois. D’objets d’art, il n’y en avait pas d’autres que le portrait à l’huile du maître du logis, épouvantable création de quelque barbouilleur d’enseignes. Le domestique se composait d’une cuisinière, d’une grosse femme de confiance et d’un petit garçon mal vêtu et jamais peigné qui cumulait des emplois d’importance très diverse, tantôt fendeur de bois, tantôt commissionnaire, tantôt secrétaire intime, tantôt laquais. Voilà l’organisation de ce ménage où M. Irnois ne trouvait rien à changer, où il trônait en despote, parlant fort, grondant fort ou rechignant du matin au soir.
Mais ainsi que dans ces vallées étroites, stériles, affreuses, que la nuit couvre d’ombres épaisses, et où le voyageur marche d’un pas chancelant et effrayé, il finit toujours par apparaître quelque clarté lointaine qui vous rend la joie, ainsi, dans l’antre de M. Irnois, il y avait une clarté ; clarté faible et douteuse, il est vrai, mais charmante cependant pour les yeux qu’elle éclairait et qui n’avaient pas besoin d’un grand jour. Dans cet appartement obscur et maussade, peuplé de gens désagréables, il y avait, comme dans toutes les choses humaines, un bonheur où s’allait échauffer le peu de poésie de ces grossières cervelles, un bonheur où se confondaient toutes les affections. Quel lien commun auraient eu les cœurs de Mlles Maigrelut, de Mme et de M. Irnois sans ce point lumineux de leur vie ? Le cent de piquet saris doute, c’est bien quelque chose ; le reversis encore ; mais avec la meilleure volonté du monde, ce n’est pas tout ; et ce que le cent de piquet et le reversis ne suffisaient pas à donner de chaleur, de vie et de douceur à ce cercle bourgeois, c’était Emmelina qui le donnait.
Emmelina ! Quand on avait dit Emmelina dans la maison, on avait tout dit : maîtres et valets pensaient tout le jour à procurer à Emmelina la plus grande satisfaction possible. Sans Emmelina, il n’y avait rien ; avec elle il y avait tout. Père, mère, tantes, servantes et secrétaire intime riaient, pâlissaient et pleuraient tour à tour, suivant l’accent avec lequel ce nom : Emmelina, était prononcé le matin par la grosse Jeanne, la femme de confiance, à son sortir de la chambre sacrée.
La passion de tous ces honnêtes gens pour l’être chéri n’était pas identique, de même valeur et de même poids. M. Irnois faisait peu de bruit de son affection, n’en parlait jamais que je sache, mais la ressentait plus vivement, plus sérieusement que personne. La seule manière dont il manifestât son amour pour sa fille était de ne pas la rudoyer comme il faisait les autres. Il aimait Emmelina sans trop le savoir ; et comment l’aurait-il su, lui qui, de sa vie, n’avait réfléchi ni aux choses, ni aux hommes, ni à lui-même ? Sa fille ne pouvait l’empêcher d’être maussade, mais elle pouvait le rendre vingt fois plus désagréable qu’il n’était d’ordinaire, et cela, par le seul fait que, le matin, il n’aurait pas été réveillé par un rapport satisfaisant sur l’état de santé d’Emmelina. Bref, il l’aimait passionnément.
Mme Irnois, de tempérament calme, que dis-je ! glacial, et n’ayant de sa vie éprouvé la moindre sensation vive (sans quoi elle n’eût jamais voulu entendre parler d’épouser monsieur son mari), Mme Irnois passait une grande partie du jour à tenir sa fille sur ses genoux, à l’embrasser, à la caresser, à lui dire tous les riens que lui présentait son imagination. Ces riens n’étaient pas jolis, ils n’étaient pas variés, surtout ils n’avaient rien de spirituel. Mme Irnois était aussi complètement nulle que peut l’être une bourgeoise vieille, laide et ignorante ; mais elle faisait de son mieux pour amuser sa chère enfant ; elle sentait son cœur se fondre quand elle la regardait, et ne pouvait pas la regarder sans l’embrasser.
Sous ce rapport, sa tendresse ressemblait beaucoup à celle de Mlles Maigrelut, tantes maternelles d’Emmelina, seulement un peu plus jaseuses que leur sœur mariée. Mlles Maigrelut étaient tout ce qu’on peut désirer de plus parfait comme types de vieilles filles. On les eût lâchées l’une et l’autre au milieu d’une ville de province, qu’elles eussent développé avec une puissance inouïe une méchanceté de tigre et de vipère ; mais leur séjour constant au sein de la solitude, dans une claustration presque absolue, avait maté ces natures dangereuses, et toute leur ardeur s’était tournée en dévouement servile et convaincu pour Emmelina.
Ainsi aimée, ainsi adorée et servie, Mlle Irnois atteignit sa dix-septième année ; c’est le moment où commence l’anecdote que j’ai à raconter. Elle avait donc ce bel âge de jeunesse qui est comme la porte dorée de la vie. Il est temps de dire ce qu’elle était et de la montrer entourée de sa cour, à savoir de son père maigre et jaune, de sa mère grosse et commune, de ses tantes sèches, effilées et bavardes, et de ses servantes qui ne valent pas l’honneur d’une description.
On s’attend sans doute à entendre un récit merveilleux de perfections inouïes, à contempler une jeune fille douée par les fées de tous les charmes de la beauté et de l’esprit… Nous allons voir !
II
Emmelina, cet ange, cette divinité, cet objet de tant de vœux, était, à dix-sept ans, une pauvre créature de la taille d’une fille de dix ans, et qu’un sang mauvais avait privée tout à la fois de croissance, de conformation régulière, de force et de santé. Sans être précisément bossue, elle avait la taille déjetée, et, en plus, sa jambe droite était moins longue que sa jambe gauche. Sa poitrine était comme enfoncée, et sa tête, penchée de côté par le vice de sa taille, s’inclinait aussi en avant. Avait-elle au moins un joli visage pour contrebalancer quelque peu d’aussi grands défauts ? Hélas ! non : sa bouche n’était pas bien faite ; ses lèvres trop grosses lui donnaient un air boudeur ; sa pâleur maladive ne lui seyait pas bien ; seulement ses grands yeux bleus étaient assez beaux et touchants, et sa chevelure, blonde comme celle d’une fée, était incomparable. Aussi dans la maison parlait-on souvent de ses magnifiques cheveux ; les cheveux d’Emmelina étaient le point de comparaison favori auquel on aimait à rapporter ce qu’on voulait louer le plus.
La pauvre fille, ainsi maltraitée par la nature, avait grand-peine à marcher et à changer de place ; elle était un peu comme un roseau, toujours pliée et affaissée, sur elle-même, et la vieille Jeanne, sa bonne, qui l’avait portée enfant, la portait encore, toute grande demoiselle qu’elle était. Elle n’aimait pas à marcher, elle y trouvait trop de peine et de fatigue ; puis elle ne s’y était jamais accoutumée ; de telle sorte que, lorsqu’il s’agissait de passer d’une chambre dans une autre, on entendait la petite voix douce d’Emmelina :
– Jeanne ! porte-moi !
Et Jeanne la portait.
On pourrait croire que, se voyant ainsi adorée, adulée et obéie, Emmelina était gâtée, très volontaire, capricieuse et toujours en dépense de fantaisies et de volontés. Mais point. Elle passait à peu près tout le jour dans le silence et sans rien faire. Sa mère aurait aimé à la voir s’occuper, mais jamais on n’avait pu obtenir cela d’elle. La broderie, la tapisserie ne la séduisaient pas ; l’éclat des laines et de la soie lui importait peu ; elle n’avait aucun goût de toilette ; elle ne songeait jamais à la parure, et jamais elle ne s’était demandé si sa figure était belle ou laide ; son tempérament était apathique ; jamais elle ne voulait ni ne désirait rien ; elle ne paraissait pas s’ennuyer, mais elle ne s’amusait pas non plus. Une fois, on l’avait conduite à l’Opéra ; l’événement avait fait époque dans la maison. M. Irnois, sa femme, ses deux belles-sœurs et Jeanne avaient été très frappés de la magnificence du spectacle ; Emmelina seule n’avait rien témoigné et n’en parla point dans la suite. Véritablement, elle avait peu de part à la vie, et, dans ses grands jours d’activité, elle prenait un ourlet, toujours le même.
D’éducation intellectuelle, elle n’en avait reçu aucune ; d’ailleurs, personne autour d’elle ne l’avait même jugé nécessaire. Seulement, la tante Julie Maigrelut, qui, de temps en temps, feuilletait assez volontiers un roman de M. Ducray-Duminil, ou de Mme de Bournon-Malarme, lui avait appris à lire, et elle se servait de cette science pour prendre quelquefois Peau d’Âne ou le Chat Botté dans le volume de Perrault ; elle avait commencé par là avec son institutrice, et elle ne s’était jamais risquée seule à aller plus loin. À dix-sept ans encore, elle prenait Peau d’Âne, ou le Chat Botté et passait toute une journée dans sa compagnie. Elle n’y rencontrait pas grand charme, mais non plus grande fatigue, et il ne lui en fallait pas davantage.
Tous les jours, à huit heures, Jeanne, qui couchait dans sa chambre auprès de son lit, s’en approchait pour savoir comment elle avait dormi, demande quotidienne à laquelle Emmelina répondait quotidiennement :
– Bien, Jeanne.
Mais son teint plus ou moins pâle, ses yeux plus ou moins battus étaient les véritables témoins que Jeanne interrogeait. La consultation terminée, Jeanne se rendait tout en courant chez M. et Mme Irnois, où elle communiquait ses sentiments, où elle déclarait combien de fois Emmelina avait bu pendant la nuit ; si le bulletin était mauvais, M. Irnois devenait plus loup que de coutume, et sa voix furibonde allait porter la terreur jusqu’au fond de la cuisine. Mlles Maigrelut savaient alors à quoi s’en tenir sur la marche de toute la journée, et venaient par leurs glapissements prendre part à la désolation générale. Si, au contraire, les déclarations de Jeanne étaient favorables, si Emmelina n’avait demandé à boire que deux fois, M. Irnois était plus économe de jurons et d’invectives, et chacun se ressentait de cette bénignité.
Alors Jeanne retournait habiller la jeune fille ; ce n’était pas une toilette charmante comme celle des Grâces ; on lui mettait quelque robe de mérinos en hiver ou de toile en été, avec un bonnet qui tenait ses beaux cheveux enfouis, et l’affaire était faite jusqu’au moment de se coucher.
Habillée, Emmelina recevait dans son fauteuil les bonjours et les mamours de toute la famille, et la brusque accolade de son père ; après déjeuner, il était assez dans ses habitudes de dire à sa mère :
– Maman, je vais m’asseoir sur tes genoux.
– Viens, mon cher ange, répondait Mme Irnois. La pauvre enfant malade se couchait sur le giron de sa mère et souvent s’y endormait, ou veillait sans rien dire en se laissant couvrir de baisers qu’elle ne rendait pas.
On ne viendra sans doute pas demander, maintenant, si Emmelina avait de l’esprit. Non, certes elle n’en avait pas, la malheureuse fille ! ni rien qui ressemblât à l’agitation de l’intelligence. Qu’est-ce que l’esprit, sinon de savoir deviner et exprimer les rapports réels ou factices qui existent entre les choses ? L’esprit ne saurait se développer au milieu de la solitude, ni avec la compagnie des imbéciles, et il n’était personne dans la maison de M. Irnois dont le contact pût permettre à Emmelina d’avoir de l’esprit. Puis, comme on ne lui avait rien appris, elle n’avait nulle matière à exercer son intelligence ; partant, sa conversation, si, par hasard, quelqu’un fût venu la solliciter, n’aurait eu rien que de très vulgaire.
Voici donc mon héroïne : contrefaite, point jolie de visage, sans esprit, et la plupart du temps silencieuse ; maladive, et trouvant son plus grand bien-être à se tenir couchée sur le sein maternel, comme un enfant de quatre ans. Il n’y a rien, dans une telle peinture, qui séduise beaucoup. Mais le portrait n’est pas achevé tout à fait, puisqu’il n’a rien été dit de cette disposition rêveuse qui faisait le désespoir de toute la maison Irnois, et qui non seulement formait le trait principal du caractère d’Emmelina, mais était même tout son caractère.
La pauvre fille, sans avoir ni la conscience ni le regret de ses imperfections physiques, était, comme tous les êtres mal conformés, vouée à une profonde et incurable tristesse, en apparence sans cause, mais que la réaction du physique sur le moral explique trop complètement. De cette tristesse irréfléchie, qui ne faisait que jeter un voile sombre sur l’existence de Mlle Irnois, il ne s’exhalait jamais aucune plainte ; mais, lorsque dix-sept ans étaient arrivés, et avec cet âge les développements mystérieux de l’être, tout l’essaim de pensées printanières qui ; à cette époque de la vie, s’élancent et accourent autour de l’âme était venu faire entendre des bourdonnements bien mélancoliques. Emmelina, jeune fille, était devenue plus silencieuse encore qu’Emmelina enfant. Bien qu’elle ne connût pas le travail intérieur de son être, qu’elle fût très loin de pouvoir l’analyser, elle en restait mal à l’aise, elle en restait malheureuse, elle aspirait à ce bien inconnu que les dieux de la jeunesse, le blond Vertumne et la fraîche Pomone dispensent en souriant ; mais elle y aspirait avec souffrance, et volontiers aurait éprouvé le désir de mourir, si elle eût su se poser à elle-même une question.
Néanmoins, sa tristesse devenait tous les jours plus profonde. Une cause extérieure était venue donner à cette âme déshéritée plus de souffrance avec plus de vie. Tout à l’heure nous en parlerons en détail.
Emmelina avait renoncé à chercher protection sur les genoux maternels ; elle préférait maintenant passer sa journée à une fenêtre de sa chambre qui donnait sur la cour, et ne voulait plus guère aller dans le salon. Par une singularité qui étonnait tout le monde, elle sembla pendant quelque temps avoir plus de force et de santé qu’on ne lui en avait jamais vues. Ses joues avaient même eu pendant quelques jours une teinte rosée qui avait paru, aux yeux charmés de toute la maison, réaliser l’idéal des doigts de l’Aurore. Pourtant, elle ne voulait plus sortir de sa chambre, et, dans sa chambre, n’aimait que le coin de la fenêtre choisie. La si douce Emmelina, bientôt, alla plus loin encore ; chose inouïe, elle eut une volonté ; elle prétendit rester seule : elle renvoya mère, bonne et tantes sans pitié, et un jour, qu’inquiète d’innovations si étranges Mme Irnois essayait quelques observations timides, Emmelina, prodige effrayant ! Emmelina frappa du pied et fondit en larmes. Toute la famille fut consternée pendant deux jours ; mais M. Irnois défendit de la manière la plus sévère qu’on osât se permettre de contrarier sa fille. L’arrêt était rendu en termes véritablement terribles ; mais le juge était redoutable ; et, comme personne ne contestait la justice du fait, on se mit à obéir avec une ardeur rare chez ceux qui obéissent. Ainsi Emmelina resta libre de passer de longues journées seule dans sa chambre, assise dans un fauteuil, à l’angle de sa fenêtre, y faisant… personne ne savait quoi.
Cependant elle avait dix-sept ans. M. Irnois s’était marié, si j’ai bonne mémoire, vers juillet ou août 1794. Ce n’était pas trop une époque convenable pour songer au mariage ni à aucune joie ; mais le brave capitaliste n’avait pas l’âme très sensible aux dangers de la patrie, et il s’était uni sans remords à Mlle Maigrelut. À l’époque où je prends mon histoire, on était donc en 1811, et si l’ancien fournisseur vivait très retiré, son existence n’était pas pour cela inconnue. L’éclat de l’or est tout aussi évident que celui du soleil, et un coffre-fort bien rempli ne saurait se dérober à la connaissance, à l’admiration et à la convoitise des citoyens d’un grand État. En vain M. Irnois habitait le quartier des Lombards, en vain sa porte, soigneusement fermée aux hommes graves comme aux freluquets, ne s’ouvrait presque pour personne ; on savait de point en point combien il y avait d’écus dans la maison numéro tant, on était pleinement édifié sur les habitudes du logis, et l’on avait une parfaite connaissance de l’existence de Mlle Irnois, laquelle, en sa qualité d’unique héritière des gros biens paternels, tenait attachées au bout de sa ceinture virginale les clefs de la caisse. Or, quel serait l’heureux mortel vainqueur du dragon (le père Irnois) et possesseur des pommes d’or (la grosse fortune) ? C’était une question que l’on s’adressait volontiers dans quelques cercles des plus élevés de ce temps-là.
L’époque actuelle a la réputation mauvaise ; on lui reproche d’aimer l’argent avec excès ; mais, pour ne pas être injuste envers elle, il faut avouer que la passion du pécule a dévoré bien des hommes avant que notre génération apparût sur la scène du monde, et que, sous l’Empire, on pouvait trouver sans peine des personnages qui, tranchant par leurs convoitises sur les passions guerrières du temps, s’abandonnaient au goût des capitaux avec autant de verve que nos hommes de bourse les plus acharnés. Dans ce temps-là, certains grands messieurs, spéculant sur la gloire nationale, aimaient à mettre la main dans les caisses de l’étranger. Il y en eut aussi d’autres qui mirent leurs espérances de fortune dans la conclusion de riches mariages, ni plus ni moins que les illustres roués de la Régence, et, par une circonstance toute particulière à cet âge, ces gens-là surent détourner souvent à leur profit l’action de la puissance impériale, en faisant intervenir la volonté du maître dans des unions qui, sans ce secours quasi divin, n’auraient jamais pu se conclure. Sans doute je ne prétends pas dire que Napoléon se soit fait, de gaieté de cœur, le soutien d’ambitions aussi basses ; mais il voulait, en principe, que les grandes fortunes revinssent aux grands emplois, et, comme il arrive fréquemment sur cette terre,
Où les plus belles choses
Ont le pire destin,
que les plus beaux principes y ont aussi quelquefois des applications fâcheuses, plus d’une avidité subalterne profita des sentiments de l’Empereur, et se faufila, par leur moyen, dans des familles qui ne voulaient pas l’accueillir.
Il y avait, en 1811, au Conseil d’État, un certain comte Cabarot dont les services étaient fort appréciés, et qui était en effet un homme de mérite. Petit avocat avant la Révolution à je ne sais quelle cour souveraine, il avait sucé avec le lait, dans la famille de basoche dont il était issu, une érudition judiciaire vraiment profonde. Dès son plus bas âge, Cabarot avait entendu parler chicane ; les coutumes, la loi romaine, toutes les lois imaginables, lombardes, bourguignonnes, franques, et jusqu’à la loi salique, avaient été les constantes occupations données à son cerveau par l’auteur de ses jours. Petite merveille donc s’il se fut trouvé à trente ans, dans le barreau, un des hommes les mieux instruits. Envoyé à la Convention, mais orateur peu disert et trembleur parfait, il s’était rejeté dans la pratique silencieuse des affaires. Sous le Directoire, le citoyen Cabarot s’était fait remarquer dans les bureaux des ministères. On l’avait employé avec succès à toutes sortes de besognes : dans ce temps-là les gens de plume devaient être un peu des Michel Morin. Cabarot avait été ministre plénipotentiaire, puis commissaire de je ne sais quoi, puis chef de division à la Justice, puis beaucoup d’autres choses. Bref, Bonaparte, le voyant si expert, le prit et le mit dans le Conseil d’État, où sa vaste érudition en matière légale acheva de le rendre agréable au maître. On l’avait fait comte.
Encore une fois, Cabaret était… je veux dire le comte Cabarot était un homme érudit et distingué par ses connaissances pratiques. Mais il était aussi perdu de mœurs que savant et habile. Je ne puis, ni n’en ai la moindre envie, entrer dans les détails de son existence intérieure. Il me suffira de dire que la société qu’il voyait, réunion de généraux, d’hommes de son métier, de diplomates, tous gens peu bégueules, riaient volontiers de ses habitudes, et que le prince Cambacérès lui accordait une part dans ses confidences.
Le comte Cabarot, avec tant de mérites et la faveur de César, n’était pas riche pourtant : tout au plus comptait-il trente mille francs de revenu, qui auraient bien semblé une montagne d’or à son père, le pauvre homme, mais qui ne lui suffisaient pas. Ajoutez à ce chiffre vingt mille francs de dettes par an environ, et vous conviendrez que ce n’était pas assez.
Le comte Cabarot, un jour qu’il travaillait avec sa Majesté Impériale et Royale, osa lui toucher respectueusement quelques mots de sa profonde détresse.
Le souverain des mondes, pour me servir d’une expression orientale, ne répondit à cette plainte touchante que par des reproches, peut-être mérités, sur les horribles voleries de M. le comte. M. le comte s’excusa de son mieux et revint à la charge, si bien qu’il lui fut demandé ce qu’il voulait.
– La main de Mlle Irnois mettrait le comble à mes vœux, répondit le conseiller d’État en s’inclinant.
Là-dessus explication sur ce qu’était Mlle Irnois : comme quoi, au physique, elle était probablement peu jolie (il était loin de le savoir au juste), mais aussi comme quoi au moral elle avait quatre ou cinq cent mille livres de rentes, et qu’une telle union comblerait le plus humble et dévoué sujet de sa Majesté Impériale et Royale, etc., etc.
Par bonheur, le comte Cabarot, en homme d’esprit et parfaitement informé, s’était pressé d’agir ; il savait vaguement que la fille avait dix-sept ans et qu’avec les vertus qu’il se plaisait lui-même à signaler en elle, il ne se pouvait pas qu’avant un mois l’attention de bien d’autres céladons de son genre ne se fût éveillée aussi. En effet, on y pensait déjà, mais on ne se hâta pas assez ; le comte Cabarot fut plus alerte.
La puissance auguste qu’il implorait se montra de son côté bénévole. Cabarot ne quitta le cabinet qu’en emportant un ordre adressé à M. l’aide de camp de service, ou tel autre personnage qui alors transmettait les volontés impériales, de commander à M. Pierre-André Irnois de se présenter à trois jours de là devant son souverain.
Le comte Cabarot se vit transporté au septième ciel ; jamais il n’avait été aussi heureux depuis le jugement de Tallien qui l’avait regardé de travers.
III
Le comte Cabarot était un trop fin diplomate pour faire prématurément confidence à ses meilleurs amis de l’espoir charmant qu’il avait conçu. Il gardait, au contraire, la réserve la plus complète le soir de ce beau jour où l’Empereur lui avait daigné promettre d’intervenir en sa faveur. Mais, malgré cette discrétion, un si complet épanouissement dilatait son laid visage, élargissait sa face plate, que le prince archichancelier, non moins que M. d’Aigrefeuille et autres, ne purent s’empêcher d’en faire la remarque.
– Faites-moi le plaisir de me dire ce qui charme si fort Cabarot ce soir ? se disait-on.
C’était bien simple : le tendre Cabarot pensait à sa prochaine union avec Mlle Irnois.
Ici quelque lecteur s’imaginera peut-être que le comte, n’ayant jamais vu sa belle ni entendu parler de ses infirmités, se préparait à lui-même une douloureuse reculade. On croira peut-être qu’il n’aurait pas voulu d’une jeune femme dans l’état de la pauvre Emmelina. Qu’on se détrompe. Il faut ici connaître le comte Cabarot tout entier. Pour six cent mille livres de rente, et même pour beaucoup moins, il aurait donné sans hésiter sa main à Carabosse, avec tous les travers de taille et les monstruosités d’humeur de cette fée célèbre. Le comte Cabarot était un homme positif.
Je dis donc que ce soir-là, dans le salon du prince Cambacérès, il fut adorable d’esprit et de gaieté. Lorsque, la foule s’étant retirée, il n’y eut plus autour de la cheminée qu’un petit nombre d’intimes, il se mit à raconter une foule d’aventures plus ou moins risquées, avec un goût, un tact, un mordant qui lui valurent des applaudissements unanimes. Il était si heureux !
Dans la maison de la rue des Lombards, la sensation ne fut pas absolument la même. Lorsque la missive impériale avait été remise à M. Irnois, M. Irnois avait ressenti une profonde terreur. L’idée de paraître devant son souverain n’avait pas fait naître en lui ce sentiment d’orgueil qui gonfle aujourd’hui la poitrine de tout officier de la garde civique enlevé pour la première fois au tonneau obscur où croupit son raisiné, pour briller, astre nouveau, dans les régions lumineuses d’un bal de la cour. M. Irnois était comme tous les gens à argent de ce temps-là : il n’aimait pas le contact du pouvoir ; le mot gouvernement le faisait frissonner ; il ne voyait, dans les hommes dépositaires de l’autorité, que des ennemis-nés de sa caisse, des harpies toujours en quête de spoliations. Il manqua tomber de son haut lorsqu’un gendarme lui remit le hatti-schérif qui le mandait au palais.
Il arriva pâle et la figure renversée dans son salon, où bavardaient sa femme et ses belles-sœurs, et bien que ce fût chose assez rare chez lui que de parler de ses affaires ou de demander conseil, il se planta au milieu de l’aréopage féminin, et, tendant sa lettre d’un air désespéré, il s’écria :
– Mille noms d’un diable ! regardez quel pavé me tombe sur la tête !
Six yeux s’illuminèrent de curiosité ; six bras s’étendirent ; six mains armées en tout de trente doigts crochus voulurent se saisir de l’épître qui bouleversait à tel point le cerveau du maître du logis.
Mlle Julie Maigrelut fut la plus agile ; elle s’empara de la lettre et la lut rapidement tout haut, puis elle se laissa tomber dans son fauteuil, en s’écriant :
– Ah mon Dieu !
Mlle Catherine Maigrelut saisit au vol le précieux papier tombé des doigts de sa sœur et s’écria de même après l’avoir lu tout haut :
– Ah mon Dieu !
Mme Irnois, ne pouvant croire ce qu’elle avait entendu deux fois déjà, récita ainsi que ses deux sœurs le contenu de la lettre, et donna comme elles des témoignages évidents de sa désolation profonde.
Les trois femmes pensèrent un instant qu’il ne s’agissait de rien de moins que de faire un très mauvais parti à M. Irnois.
L’ancien fournisseur fut cependant plus brave que ses compagnes et les assura que, suivant toutes probabilités, les choses n’en viendraient pas là. D’ailleurs, ce serait par trop inique. Jamais il n’avait mal parlé d’aucun gouvernement, et de celui de l’Empereur moins que de tout autre ; ses contributions avaient toujours été régulièrement payées. Sans doute il y avait eu jadis quelque peu à redire dans la manière dont il avait chaussé les régiments ; mais toutes ces peccadilles étaient passées depuis longtemps, et d’ailleurs il n’avait jamais été en nom dans les fournitures. Décidément l’Empereur ne pouvait lui vouloir le moindre mal ; que lui voulait-il donc ?
Mlle Julie Maigrelut fut la première à ouvrir un avis important sur cette question nouvelle ; je dis nouvelle, parce que du noir on était passé au rose. Elle insinua que l’Empereur mandant son frère, son frère innocent comme un agneau, il fallait absolument que ce fût pour le récompenser ; mais récompenser de quoi ?
– De son immense fortune, répondit aussitôt Mlle Catherine Maigrelut.
– Elle a raison, dit Mlle Julie.
– Elle a cent fois raison, murmura Mme Irnois.
– Me récompenser ? s’écria le richard, de quelle manière ? On ferait mieux de me laisser tranquille, ventre-bleu !
– Je ne serais pas étonnée, mon frère, reprit Mlle Julie, que Sa Majesté Impériale voulût vous faire duc ou maréchal de l’Empire ! Vraiment ! un homme si riche que vous, il n’y aurait rien de surprenant !
– Vous êtes trois sottes ! cria M. Irnois d’une voix tonnante. Pour devenir maréchal, il faut avoir été soldat ; il me nommera plutôt baron ! Enfin n’importe ! Je veux que la peste m’étouffe, si je suis bien amusé d’aller parader dans ces Tuileries ! Comment faudra-t-il m’habiller ?
Ce fut encore une délicate question. On ouvrit et l’on repoussa beaucoup d’avis ; enfin, on se rangea au seul raisonnable, qui fut d’appeler le tailleur et de le consulter. On n’avait que trois jours devant soi ; la précipitation ne pouvait être trop grande.
La désolation de M. Irnois fut sans bornes, lorsqu’il apprit le soir même qu’à toute force il lui fallait endosser habit brodé, culotte de casimir, bas de soie blancs, souliers à boucles, chapeau à claque, et se faire friser, et s’embrocher d’une épée, et mettre des gants ! Cependant, il se soumit ; et, tout en jurant et en se démenant comme une mécanique, il s’abandonna aux soins du malheureux, du trop malheureux artisan chargé de donner des grâces à sa personne.
La maison était sens dessus dessous, et cependant Emmelina ne prenait pas la moindre part aux terribles événements déchaînés autour d’elle. Lorsque la lettre du château avait été montrée par son père à sa mère et à ses tantes, elle était seule dans sa chambre, suivant son usage ; le soir, elle entendit parler autour d’elle de ce qui allait advenir ; on lui dit même (ce fut Mlle Catherine) :
– Tu ne sais pas, Emmelina ? Ton père qui va après-demain à la cour… C’est joli ça, ma petite !
Emmelina sourit doucement, en regardant qui lui parlait ; mais elle ne répondit pas, et ne parut même avoir compris que médiocrement ce qui lui avait été dit. Sa mère la contempla avec anxiété, puis leva les yeux au ciel en soupirant profondément. Dans ce moment, Mme Irnois ne fut plus la grosse et sotte bourgeoise que nous connaissons, mais une espèce de Niobé, tant il y avait de vraie et profonde douleur dans ce regard lancé vers les régions où l’on va si souvent en vain demander soulagement.
Emmelina, de jour en jour, devenait plus absorbée. Elle n’était pas plus triste ; mais elle parlait encore moins, et ne s’intéressait plus à rien absolument ; ni le bavardage de ses tantes, ni les caresses de Jeanne, ni Peau d’Âne, ni l’ourlet ne pouvaient plus rien sur elle ; les tendresses mêmes de sa mère ne semblaient plus lui tenir à cœur : autrefois du moins, elle les cherchait ; maintenant elle paraissait plutôt les éviter, car elle les recevait avec indifférence ou montrait même en être impatientée.
Et cependant, était-elle malheureuse ? Ce n’était pas croyable, car elle avait parfois sur la bouche et dans les yeux comme un fin sourire, comme une flamme subtile qui dénotait un bien-être infini. Quand on la regardait à la dérobée, on la voyait plongée dans une sorte d’extase qui semblait l’enivrer des plus ardentes délices : elle ressemblait alors à une des saintes du Moyen Age, et si les gens de son entourage eussent su ce que c’est que l’intelligence, ils en auraient vu la plus sublime expression sur cette physionomie inspirée. Il fallait que cette puissance de l’exaltation fût pourtant bien vive, car Jeanne tombait quelquefois dans des contemplations muettes devant sa maîtresse, et restait partagée entre l’admiration et une secrète terreur. Quand elle s’arrachait à cet état si étrange pour elle, elle sortait de la chambre sur le bout du pied, sans faire de bruit, et s’en allait dans la cuisine s’écrier :
– Jésus ! Jésus ! que Mademoiselle Emmelina ressemble à la Sainte Vierge !
La grande crise qui avait lieu autour de la jeune extatique ne produisit donc aucune impression sur cette imagination perdue dans une autre sphère, et M. Irnois dut se passer, dans ses hautes préoccupations, des sollicitudes filiales. Du reste, il n’en sentit pas le vide ; il ne pouvait être exigeant, et il était d’ailleurs si absorbé, suspendu entre la crainte et l’espérance, écoutant tour à tour les conjectures de son conseil privé et les importantes communications de son tailleur, qu’il n’avait pas le temps de chercher à diviser ses pensées entre sa présentation à l’Empereur et la tranquillité trop complète de sa fille ; il lui eût été d’ailleurs impossible de rêver à la fois à deux choses différentes.
Enfin il arriva, ce grand jour où, aux yeux émerveillés de toute la maison, dont les locataires, avertis, s’étaient ameutés sur les différents paliers, M. Pierre-André Irnois franchit le seuil de sa porte en grand costume de cour, suivi du secrétaire intime qui, laquais ce jour-là, descendait l’escalier en se laissant glisser le long de la rampe pour arriver plus vite à la voiture de louage et ouvrir la portière.
M. Irnois, le riche capitaliste, était d’autant plus laid et disgracié de la nature en cette circonstance mémorable, que sa toilette était plus somptueuse et étalait davantage la prétention de faire ressortir des avantages physiques. Je ne puis m’empêcher en courant de jeter un coup d’œil détracteur sur ces pauvres bas réduits à envelopper… ce qu’ils enveloppaient ! sur cette pauvre culotte de casimir flottant en plis malgracieux autour de ces cuisses qu’on devinait décharnées, sur ce corps maigre orné d’un jabot et d’un habit marron brodé d’argent, sur cette pauvre et déplorable épée !
La voiture roula comme elle put, car elle était fort antique et délabrée, et atteignit les abords du Carrousel. En ce temps-là, on aimait fort le luxe, et le souverain, qui voulait ranimer le commerce, en ordonnait l’étalage. M. Irnois ne fut pas autorisé à faire rouler son équipage sur la noble poussière de la cour impériale ; il mit pied à terre, et, sa lettre d’audience à la main, gagna, non sans quelque risque, à travers les voitures et les chevaux, l’escalier d’honneur.
Il y avait grande réception. À côté de l’aide de camp de service qui appelait le nom de tous les présentés, se trouvait un homme d’une quarantaine d’années assez laid, mais portant physionomie fine, madrée et spirituelle. C’était le comte Cabarot, fort inquiet de l’arrivée de son futur beau-père. L’aide de camp, ayant jeté les yeux sur la lettre d’invitation et sur le personnage qui l’avait remise, lança un regard significatif au conseiller d’État. Celui-ci toisa fixement son futur beau-père…
Mais au lieu d’assister ainsi à une réception impériale, ce qui est un bien trop grand honneur pour ce petit récit, mieux vaut nous en retourner dans la sphère plus humble du salon de Mme Irnois.
Là, plus de splendeurs, assez de magnificences, plus de cette pompe un peu théâtrale comme on l’entendait sous l’Empire. Une lampe brûle assez tristement sur un guéridon au milieu de l’appartement. La tante Julie tricote, la tante Catherine tricote, et Mme Irnois tricote aussi. Emmelina est auprès du feu dans son fauteuil, et, les yeux fixés sur les charbons, considère, probablement en y plaçant l’acte qui se joue lentement dans sa tête, le monde igné dont la flamme change à chaque instant les formes.
L’inquiétude est à son comble ; tout le monde parle à la fois. Jeanne a servi longtemps de messager entre les terreurs du salon et celles de la cuisine ; mais les émotions sont trop vives, la cuisine monte au salon, et à entendre parler roi, empereur, maréchal, baron, duc, prison et mort, on se croirait dans une réunion politique.
Enfin, un violent coup de sonnette se fait entendre. Le cri de oh ! très prolongé s’échappe de toutes les bouches ; la cuisinière court ouvrir. M. Irnois se précipite dans le salon, pâle, non, blême ! les yeux flamboyants, et jurant contre toutes les divinités de l’Olympe, à part le Styx qu’il ne peut nommer, ne le connaissant pas. Certes, depuis les jours où le bourgeois, le comte, le procureur, la dame philanthrope, ses anciens maîtres, lui donnèrent son congé, il n’avait pas été plus démonstratif dans sa colère et dans son dépit ; mais, aux emportements de son langage se mêlait un sentiment profond de frayeur qui n’échappa à aucun des témoins de cette scène émouvante.
Enfin, M. Irnois, ayant beaucoup juré, lança son chapeau à claque à la tête du secrétaire intime, s’assit brusquement devant le feu, et, ayant mis à la porte, par un dernier éclat de voix, tous les échappés de la cuisine, il commença à satisfaire la curiosité trop surexcitée de sa famille.
– Au nom de tous les saints, s’écriaient les trois femmes, dites-nous ce qui vous est arrivé !
– Je suis un homme perdu, ruiné par d’affreux scélérats, s’écria M. Irnois ; voilà ce qui m’est arrivé, mille noms d’un… ! Ah ! mon Dieu ! dans quelle affreuse position je suis ! Vous ne savez pas ce qui se passe ? Eh bien donc, j’entre dans les Tuileries : une cohue, un bruit, une chaleur dont on ne se fait pas l’idée ! J’étais pressé de voir l’Empereur, pour savoir ce qu’il me voulait et m’en retourner. J’arrive dans un dernier salon ; on m’avait ôté ma lettre des mains, je ne sais qui, je ne sais comment ; j’étais ahuri ! Un grand homme, tout brodé, avec des épaulettes et un grand ruban rouge en travers, me pousse par l’épaule, car, ennuyé de tout ce fracas, je ne bougeais pas plus qu’un terme. Je ne voyais plus rien ! et je me trouve nez à nez avec l’Empereur !
– Avec l’Empereur ! répéta l’assistance, à l’exception d’Emmelina qui n’écoutait point.
– Silence donc, bavardes infernales que vous êtes ! s’écria M. Irnois, en donnant un grand coup de pied dans les bûches, violence qui fit tressaillir, puis soupirer sa fille. Silence donc ! Oui, l’Empereur ! Et il me dit, cet Empereur, en me montrant du doigt un homme placé derrière lui : « Préparez-vous à marier votre fille à M. le comte Cabarot ; je le fais ambassadeur ! » Ma foi, dans le premier moment, sans trop savoir ce que je disais, je m’écriai : « Donner Emmelina à ce… » Je n’allai pas plus loin, car l’Empereur me jeta un regard, oh ! quel regard ! Il me sembla que la terre s’enfonçait sous moi, que j’allais être emprisonné, fusillé, égorgé, massacré ! Je me trouvai près de m’évanouir ; et il parait même que je m’affaissais, car je fus soutenu dans les bras d’un misérable !… C’était, le croiriez-vous, ce misérable auquel l’Empereur veut que je donne Emmelina, qui osait m’empêcher de tomber ! Je le regardai d’une façon !… comme l’Empereur m’avait regardé ; mais cela ne lui produisit pas le même effet. Au contraire, il me fit une grimace en façon de sourire, et me dit : « Mon cher Monsieur Irnois, notre connaissance arrive un peu brusquement ; mais n’en soyez pas moins sûr de mes respects ; nous avons des amis communs ! – Je ne crois pas, lui répondis-je avec ce ton que vous me connaissez, je n’ai pas d’amis ! » Il ne fut pas étonné ; et il me dit en me saluant : « J’irai présenter mes hommages respectueux à Mme Irnois demain, sans faute. – Je serai sorti ! m’écriai-je. – L’Empereur vous ordonne de rester chez vous, toutes les fois que je vous en avertirai », me répliqua-t-il en me regardant dans les yeux. J’eus peur, et je m’en revins. Concevez-vous une pareille position !
– C’est monstrueux ! s’écrièrent les femmes.
– Il vient demain, le monstre ? demanda Mlle Julie.
–Demain ! dit M. Irnois.
– Eh bien ! je suis d’avis, poursuivit la vieille fille, qu’on lui dise son fait en trois mots : « Vous n’aurez pas Emmelina ! vous ne l’aurez pas ! ah dame ! »
– Sotte que vous êtes ! hurla M. Irnois ; il ira chercher la gendarmerie, et je serai traîné en prison !
– Aimez-vous mieux la mort d’Emmelina ? dit la mère.
– Non, répondit M. Irnois ; mais, quand je serais coffré, cela n’empêcherait pas le mariage.
– Que faire donc ? dit Mlle Catherine.
– Emmelina, dit la mère d’une voix pleine de larmes et en se mettant à genoux devant sa fille, Emmelina, on veut te marier ! Emmelina, on veut t’emmener d’ici, mon cher amour ! réponds-moi, que veux-tu que je fasse ?
IV
Tout le monde fut consterné, lorsque à la question de sa mère, on vit Emmelina soulever doucement la tête de côté et dire avec un sourire ineffable de douceur et des regards brillants :
– Oui, maman, je veux bien m’en aller.
– Comment, dit M. Irnois, tu veux bien t’en aller ?… Qu’est-ce que cela signifie ?… Tu veux nous quitter pour suivre ce Cabarot que tu ne connais pas ?
– Si fait bien, répondit la pauvre fille en secouant la tête d’un air joyeux ; si, je le connais !… Je veux m’en aller avec lui.
Chacun se regarda ; mais plus on faisait d’efforts pour comprendre, moins on y parvenait. Il ne semblait pas possible qu’Emmelina, toujours enfermée dans la maison, ne sortant jamais, eût pu connaître l’époux que la volonté impériale imposait à ses parents.
– Mais, dit Mme Irnois, où l’as-tu vu ?
– Ah ! ah ! répondit Emmelina fixement… et puis elle s’arrêta, réfléchit et reprit : je ne veux pas le dire.
– Ne la contrariez pas, dit la tante Julie. Elle aura sans doute rêvé quelque chose, et demain, vous la verrez plus raisonnable : car elle est pleine d’esprit, cette petite Emmelina. N’est-ce pas, mon bijou, que tu seras demain plus raisonnable ?
– Je veux bien m’en aller avec lui, reprit Emmelina… Quand est-ce que je. partirai ?
– Ah ! mon Dieu ! dit Mme Irnois, élevez donc les enfants pour qu’ils soient aussi ingrats ! Cette petite, qui est adorée ici, et qui ne songe qu’à suivre le premier malotru !… Emmelina, vous nous faites beaucoup de peine !
Emmelina resta fort insensible à cette plainte ; elle souriait, elle riait, elle frappait ses mains l’une contre l’autre ; elle était en proie à une agitation nerveuse, telle que jamais on ne lui en avait vu une pareille. Tout le monde autour d’elle était confondu.
M. Irnois ne savait que penser, et était tout prêt à lancer des volcans de jurons. Sans y avoir beaucoup songé, il se croyait sûr de l’éternel attachement de sa fille ; il avait construit sur la mauvaise santé de cet enfant tout un édifice d’espérances que le moment présent faisait crouler. La garder constamment auprès de lui avait été le bonheur sur lequel il avait le plus fermement compté, L’heure présente était bien cruelle. Il se promenait de long en large dans l’appartement ; mais il ne disait rien ; il était trop affecté pour pouvoir parler. Les deux tantes et la mère pleuraient à chaudes larmes. La jeune fille n’y faisait pas la moindre attention.
Ce fut ainsi que la soirée finit dans une consternation profonde d’un côté ; de l’autre dans une joie qui ne cherchait pas à se contenir. Jamais on n’avait entendu chanter Emmelina. Quand Jeanne vint la prendre dans ses bras pour l’emmener coucher, on l’entendit gazouiller des notes confuses aussi gaies que l’oiseau puisse en conter aux arbres des bois.
À peine Emmelina sortie, la bombe éclata : M. Irnois tomba dans un accès de colère et de désespoir qu’il ne chercha plus à contenir ; et les femmes, bien que faisant chorus avec lui, ne purent esquiver une bonne partie de ses reproches. Il les accusa d’avoir reçu Cabarot en son absence, d’avoir souffert que Cabarot lui enlevât l’affection de sa fille, d’avoir par sottise féminine monté la tête à une enfant innocente ; il les accusa, bref, de son mieux, et elles se défendirent autant qu’elles purent. Au fond, elles se croyaient ensorcelées, comme aussi leur fille et nièce ; car jamais de leur vie elles n’avaient aperçu l’ombre d’un homme qui s’appelât Cabarot, et deux heures auparavant elles auraient encore juré qu’Emmelina ne le connaissait pas plus qu’elles. Mais, maintenant, elles ne savaient plus à quoi s’arrêter. C’était donc une désolation générale, mêlée de curiosité ; car, enfin, il devait y avoir un mot à l’énigme, et le temps, certes, le ferait connaître.
Le lendemain à midi, le secrétaire intime, remplissant les fonctions d’introducteur, annonça dans le salon qu’un monsieur demandait à voir Mme Irnois.
– Comment s’appelle-t-il, ton monsieur ?
– Il dit qu’il s’appelle le comte Cabarot.
– Ah ! grands dieux du ciel ! s’écria toute l’assemblée ; monsieur Irnois, faites entrer ce monsieur !
M. Irnois alla en rechignant, mais poussé par la sainte terreur de l’autorité impériale, au-devant de son futur gendre ; il le trouva dans l’antichambre, se débarrassant de son carrick.
Le comte Cabarot avait fait une toilette de fiancé ; il avait pensé que la parure la plus soignée semblerait à la famille dans laquelle il s’introduisait une preuve d’égards ; comme il les savait fort bourgeois, il avait aussi étalé ses ordres et ses croix sur sa poitrine, dans le but de les éblouir quelque peu.
« Ma façon de m’introduire auprès de leur fille, s’était-il dit, est un peu vive ; maintenant que nous sommes entré au moyen d’un coup d’éclat, c’est d’une bonne politique que d’atténuer l’effet produit par des procédés convenables. »
Il mit tout à la fois en œuvre ce système de conduite aussitôt que la longue figure de M. Irnois se présenta à lui. Le train du corps penché en avant, la tête rejetée en arrière, les yeux, les joues, la bouche, tout souriant, les deux mains affectueusement tendues.
– Eh ! bonjour donc, monsieur ! s’écria-t-il ; permettez-moi l’indiscrétion de venir vous troubler si vite ! Je n’ai fait que vous entrevoir hier au château, et, je l’avoue j’avais le désir le plus vif de vous serrer la main ! Voulez-vous bien me conduire auprès de votre charmante famille ? Je brûle de lui être présenté.
– Monsieur, dit l’ancien fournisseur, vous pouvez me suivre si vous voulez. Madame Irnois, et vous, mesdemoiselles Maigrelut, voilà le comte Cabarot dont l’Empereur m’a parlé.
Le conseiller d’État salua plus bas qu’il n’avait fait pour le maître du logis, et en agitant sa main droite d’une manière tout à fait galante et respectueuse. Quand il releva les yeux, il chercha à deviner laquelle de ces trois personnes était la proie qu’il convoitait ; mais il comprit bientôt que la tante Julie, la plus jeune des trois sœurs, n’avait pas un profil de seize ans. Il se résolut à patienter ; puis il engagea l’entretien.
– Mon Dieu, mesdames, dit-il d’une voix doucereuse, vous voyez en moi un homme tout rond, tout d’une pièce, qui vous demande la permission d’être à son aise au milieu d’une famille qu’il estime. Sa Majesté l’Empereur, dont la sagesse et la haute bonté égalent la puissance, a daigné penser que je pourrais, par ma position, mon caractère, mes principes, assurer le bonheur de mademoiselle votre fille, qui, par son esprit et par ses grâces, est digne de tout respect. Ne pensez-vous pas que cette auguste approbation, en me comblant de reconnaissance, vous donne en même temps des garanties certaines de ce que je suis ? Non, l’Empereur, notre glorieux maître ne voudrait pas sacrifier le bonheur d’une personne aussi intéressante que Mlle Irnois. Veuillez me considérer, madame, comme un fils respectueux et dévoué, et, bien que notre connaissance soit un peu nouvelle, agissez-en avec moi comme vous feriez envers un ancien serviteur.
« Voilà, se dit-il en lui-même après avoir débité ce discours, qui ne peut manquer de plaire à ces pleutres. Je leur mets la bride sur le cou ; nous allons devenir compères et compagnons. »
Quelques seigneurs de la Cour Impériale avaient une forte tendance à se poser en très véritables magnats devant les autres classes de la nation.
Mme Irnois salua légèrement le comte et lui répondit :
– Vous êtes bien bon ; je ne désirais pas marier ma fille.
– Ah ! mon Dieu ! pourquoi, chère dame ? Elle a seize ans, elle doit avoir seize ans ; n’est-ce pas l’âge où le cœur commence à…
– Vous ignorez peut-être dans quel état de santé est notre Emmelina ?
– J’ai ouï dire, en effet, que vous aviez conçu quelques inquiétudes sur sa poitrine, continua Cabarot de l’air doucereux qui, pensait-il, lui réussissait si bien. Sans doute une croissance hâtive, le développement précoce de l’intelligence. Il ne faut pas trop vous inquiéter, chère et bonne dame ; vous ne devez pas douter du soin avec lequel je soignerai cette belle fleur !
Toute la famille regardait le comte d’un air effaré. Évidemment, il ne connaissait pas Emmelina ; il ne l’avait ni vue ni entretenue, et c’était la vérité : Cabarot avait bien su vaguement que de par le monde il existait un richard nommé Irnois, et que ce richard avait une fille, mais il s’en était tenu à ce renseignement, et il ne s’était nullement enquis du caractère, de la santé, de la beauté que pouvait avoir la femme dont il convoitait la dot.
Mais alors, comment Emmelina pouvait-elle être tombée amoureuse folle d’un homme qui parlait si aveuglément de sa croissance trop hâtive et du développement précoce de son intelligence ? Voilà ce que M. Irnois et les trois femmes se demandaient avidement des yeux.
– Monsieur, reprit Mme Irnois, vous n’êtes pas, je crois, bien informé de ce qui touche notre pauvre enfant. Elle est contrefaite, je dois vous le dire.
– Ah ! madame, quel blasphème proférez-vous là ? s’écria Cabarot qui vit se peindre dans son imagination le profil d’une bosse. Je suis bien certain que vous exagérez quelque léger défaut tout à fait insignifiant. D’ailleurs, serait-il vrai que mademoiselle votre fille pût manquer absolument de beauté, que sont les fragiles avantages des charmes physiques dans la vie du ménage ? Ses grâces et son esprit…
– Sans doute, dit M. Irnois, mais elle ne dit jamais mot !
– Les vertus dont elle est douée ! s’écria le comte Cabarot avec un redoublement d’enthousiasme, oui, ses vertus, voilà ce qui m’attache à elle ! Croyez-moi, je n’ai jamais ambitionné qu’une épouse vertueuse et sage ! Mais ne pourrais-je voir la belle et touchante Emmelina ? ne me sera-t-il pas permis de déposer à ses pieds mêmes l’hommage de mon cœur ? Vous comprenez mon impatience et…
Une crainte subite vint serrer le cœur de Mme Irnois :
– Je vous avertirai d’une chose, dit-elle.
– Et de laquelle ? s’écria le comte prêt à souscrire à tout, à ne se laisser arrêter par aucune difficulté, à accepter toutes les conditions, au moins provisoirement.
– Je vous prie de remarquer que ma fille est une enfant, et qu’il ne faut pas supposer mal des manières qu’elle pourra avoir avec vous. Elle sera peut-être un peu plus affectueuse qu’il n’est d’usage.
« Peste ! songea Cabarot, il paraît que c’est une égrillarde ! On y veillera. »
Il ajouta tout haut :
– Caractère franc et sans façon : c’est un gage de bonheur à ajouter à tant d’autres.
– Je vous avertis, poursuivit Mme Irnois, qu’elle est prévenue en votre faveur, et cela je ne sais comment, car elle ne sort jamais, et je ne sache pas qu’elle vous ait jamais vu.
– C’est un effet de la sympathie, s’écria Cabarot en riant ; mais encore, ne pourrai-je la voir ? Nous causerons de tout cela fort à loisir ! Je brûle de lui être présenté.
– Catherine, dit Mme Irnois, va je te prie dire à Jeanne de l’apporter.
Ce mot : l’apporter, donna un frisson au comte Cabarot. Il pensa qu’on venait de lui parler de difformité. Il se figura les choses au pire. De quelque philosophie qu’il fût doué, il eut un moment d’hésitation. Il fut sur le point de se poser lui-même son mariage comme une question et d’admettre des causes de rupture ; heureusement, cette crise ne dura pas. Il se rappela sur-le-champ qu’une auguste volonté avait été compromise par lui dans cette affaire, et que reculer, c’était, en quelque façon, faire mépris des bienfaits du maître ; que d’ailleurs il épousait fort peu la fille et beaucoup la dot ; qu’avec une fortune comme celle dont il aurait la jouissance, il aurait la pleine liberté de loger sa femme aussi loin de lui qu’il voudrait, et même de la reléguer à la campagne, si le séjour dans un même hôtel venait à lui déplaire.
Le comte Cabarot avait à peu près terminé les réflexions que l’on vient de voir plus haut quand la porte s’ouvrit, et la tante Catherine reparut.
– Voici Emmelina, dit-elle, en reprenant sa chaise et son tricot.
En effet, derrière elle entra Jeanne, portant la jeune fille dans ses bras. Ce fut une scène singulière.
Au moment où l’on vit la vieille domestique et son vivant fardeau, la pauvre malade parut rouge comme une cerise, les yeux pleins d’une ivresse angélique, belle, très belle, tant elle avait d’émotion et d’amour répandus sur tous les traits. Mme Irnois avait bien fait de prévenir le comte, car le premier mot d’Emmelina fut de s’écrier :
– Où est-il ? Où est-il ?
Et elle étendait ses deux bras, et elle se penchait en avant avec une passion indicible.
« Vrai Dieu ! se dit le comte Cabarot, elle est horrible cette malheureuse éclopée, et furieusement vive ! »
Et comme il avait bien réfléchi, ainsi qu’on l’a vu, et qu’il s’était cuirassé contre les dégoûts probables de l’aventure, il se précipita bravement au-devant de sa fiancée et voulut lui prendre les mains pour les baiser avec autant de feu qu’il en était capable.
Mais Emmelina ne le regarda seulement pas, et, retirant ses mains comme on fait à un importun, s’écria :
– Où est-il donc ?
– Mais devant toi, dit sa mère, voilà M. Cabarot avec qui tu veux t’en aller.
Emmelina se jeta en arrière dans les bras de Jeanne, en poussant un cri d’horreur et d’effroi.
– Je ne le connais pas, dit-elle en pleurant. Ce n’est pas lui, Jeanne, ce n’est pas lui !
Elle se mit à sangloter. Son père la prit dans ses bras, elle le repoussa. « Laissez-moi », dit-elle.
On la plaça dans son fauteuil, et elle continua à pleurer sans vouloir lever la tête ni regarder son fiancé, qui maintenait toujours avec soin sur ses lèvres son sourire courtois et soumis.
Au fond du cœur, le comte Cabarot était impatienté outre mesure.
« Quoi ! pensait-il, ce n’est pas assez d’avoir une femme bâtie comme celle que voilà, il faut qu’outre toutes ses difformités je lui découvre encore une affection pour quelque fat ! J’aurai bien à faire avec cette petite personne si je veux lui redresser l’entendement ! Mais patience ! j’en viendrai à bout. »
Le salon de Mme Irnois était cependant une vraie tour de Babel ; on ne savait plus qu’y devenir. Après quelques sanglots, après s’être tordu les mains, Emmelina, le visage noyé de larmes abondantes, était devenue pâle, pâle comme la mort, ses yeux s’étaient subitement ternis, elle était tombée à la renverse dans le fauteuil et s’était évanouie.
– Voilà ma fille qui se meurt ! s’écria Mme Irnois.
– Mille tonnerres ! hurla le fournisseur.
Les deux tantes imitèrent les parents en accourant avec précipitation autour de la malade.
Cabarot ne fut pas moins leste. Cette scène douloureuse rentrait pour lui dans les choses prévues. Il ne s’était pas attendu à en être quitte à moins, car il avait trop d’esprit pour supposer que l’affaire de son mariage, déterminée si brusquement par une volonté d’en-haut, se pourrait conclure sans quelque récri du côté de l’indépendance violentée.
Il offrit gracieusement son flacon pour faire revenir à elle son adorable Emmelina, comme il lui plut de s’exprimer ; mais le flacon n’y faisait rien : Emmelina restait sans connaissance.
– Mon Dieu ! dit Mme Irnois en levant les épaules et en regardant Cabarot en face, tout ce monde qui est là autour d’elle lui fait plus de mal que de bien.
Cabarot ne crut pas devoir jouer la sourde oreille ; il pensa en avoir assez fait pour un premier jour.
– Ah ! madame, s’écria-t-il d’un ton soumis, que je suis malheureux de ne pouvoir encore revendiquer un droit à prodiguer ici mes soins ! Mais je comprends du moins vos inquiétudes maternelles, et je me retire. Adieu, madame ; adieu, mesdemoiselles, à demain. Recevez mes profonds respects.
Il saisit la main de Mme Irnois et la baisa avec effusion ; il fit la même faveur aux mains sèches et tannées des deux vieilles filles ; il glissa un napoléon dans les doigts de Jeanne ; puis, en se retournant, il prit M. Irnois par le bras et l’entraîna avec lui vers la porte. Bien lui prit de le tenir ferme, car, s’il n’eût dépendu que de sa volonté, le futur beau-père n’aurait pas suivi son futur gendre.
– Que me voulez-vous ? dit M. Irnois, arrivé dans l’antichambre à la remorque, ne voyez-vous pas qu’il faut soigner ma fille ?
Cabarot prit un ton mitoyen entre la débonnaireté et la raideur impérieuse :
– Mon cher monsieur, j’ai vu mademoiselle votre fille, et elle me convient sous tous les rapports. J’obéirai très aisément à l’Empereur. À quand fixons-nous la signature du contrat ?
– Diable ! vous allez vite !
– C’est mon usage. Et d’ailleurs, l’Empereur le veut.
– Mais l’Empereur ne sait pas que ma fille est malade !
– Nous la soignerons. Il faut en finir. L’Empereur n’aime pas les résolutions qui traînent.
– Mais si Emmelina ne veut pas de vous ?
– Ce sont là des caprices de jeunes filles auxquels des hommes sages tels que vous et moi ne doivent pas s’arrêter. Comme père, il doit vous suffire d’avoir une confiance entière en ma probité.
– Mais je ne vous connais pas !
– Et comme sujet, reprit Cabarot d’une voix haute et grave, vous devez obéissance à l’Empereur.
Irnois sentit passer dans ses membres un frisson d’épouvante. Il se trouva si fort à la discrétion de Cabarot qu’il fut sur le point de tomber à ses pieds et de lui demander pardon.
– Eh bien ! à quand le contrat ? reprit l’impassible épouseur.
– Quand vous voudrez.
– Je vais donc passer sur-le-champ chez mon notaire et lui donner ordre de s’entendre avec le vôtre. Nous serons aisément d’accord. Vous n’avez pas d’autre héritier que la future comtesse Cabarot ? C’est très bien ! Adieu donc et à demain !
– Je voudrais, s’écria Irnois, quand le conseiller d’État ne fut plus à portée de l’entendre, que tous les diables pussent te tordre le cou dans la nuit !
V
La pauvre Emmelina demanda aussitôt après le départ du comte à rentrer dans sa chambre, et toute sa famille était vraiment trop affectée et étonnée pour avoir la force de contrarier, même par une simple observation, les volontés de celle qui produisait sur tous ses entours à peu près l’effet touchant d’une martyre.
L’évanouissement s’était dissipé comme tout se dissipe, mais en laissant la jeune fille une torpeur physique et une sorte de désolation dont on pouvait aisément se rendre compte en la regardant. Elle était beaucoup plus pâle que d’ordinaire, et ses yeux avaient perdu l’éclat particulier dont tout le monde avait été si surpris autour d’elle depuis quelque temps. Évidemment, à l’exaltation avait succédé l’abattement ; au délire d’une espérance inconnue, un désespoir dont il était impossible de concevoir la cause. On n’y comprenait rien ; et, pour tout dire, ce fut presque avec satisfaction que Mme Irnois et ses sœurs virent s’éloigner l’objet de toutes leurs tendresses ; car, en sa présence, on ne pouvait qu’accumuler des questions qui restaient sans réponse ; et, en son absence du moins, on avait toute liberté d’épuiser les différentes séries de commentaires et de suppositions dont les imaginations féminines ne sont jamais privées. C’était peu de chose sans doute pour arriver à la découverte de la vérité ; mais c’était beaucoup pour se consoler d’un mal que l’on croyait irrémédiable, puisqu’on en ignorait la source et qu’on ne prévoyait pas même pouvoir la découvrir.
– Avec toute autre qu’Emmelina, disait la mère désespérée, il y aurait un moyen quelconque d’obtenir des confidences ; mais cette petite fille est tellement taciturne que jamais on ne parviendra à la faire parler, Et cependant, comment se résoudre à ignorer pourquoi elle était si joyeuse depuis quelque temps, pourquoi l’idée d’épouser M. le comte a paru d’abord lui faire si grand plaisir, et enfin pourquoi, lorsqu’elle a vu ce même prétendu qu’elle attendait avec tant d’impatience, elle est tombée dans un tel chagrin, et n’a seulement pas voulu le regarder ? A-t-on jamais imaginé des parents plus malheureux que nous ? Pour moi, je ne crois pas qu’il en existe ; et si j’avais jamais pu prévoir que ma propre fille manquerait à ce point de confiance envers moi, j’aurais maudit mille fois déjà le jour où elle est née.
– Ne dites pas de sottises ! s’écria M. Irnois qui rentrait dans la salle à la fin de cette tirade. Cette petite me paraît assez désolée sans qu’il soit besoin de l’accabler d’injures. Je voudrais pour tout au monde n’avoir pas fait fortune et que l’Empereur n’eût jamais entendu parler de moi. Je ne serais pas forcé de donner mes écus à ce M. Cabarot.
Tandis que père, mère et tantes se désolent à loisir et se chamaillent entre eux, suivons Emmelina dans sa chambre. À peine y est-elle arrivée, à peine s’est-elle placée dans son fauteuil dans l’angle ordinaire de la fenêtre, qu’elle renvoie Jeanne, et lorsqu’elle se trouve seule, bien seule, elle ouvre les battants de cette croisée que presque toujours on laissait fermée ; ses yeux glissent un regard avide dans l’intervalle, et à mesure qu’elle contemple un point sur lequel semblent fixées toutes les forces de son âme, la rougeur reparaît sur ses joues, le feu, l’animation dans ses prunelles, le sourire sur ses lèvres, l’existence, la vie dans tout son être. La malheureuse fille ne semble plus vivre de sa vie ordinaire. Il semble, à la voir, qu’elle soit en quelque sorte transfigurée ; c’est bien la même personne, si l’on veut, ce n’est plus le même individu ; c’est bien Emmelina, mais ce n’est plus Emmelina boiteuse, bossue, contrefaite, disgraciée de la nature, Emmelina au cerveau faible, ignorante, apathique ; ce n’est plus même un corps, si l’on veut bien me permettre de poursuivre aussi loin que possible l’image de ce qu’elle me produit à moi, l’auteur, à moi qui la vois : elle ressemble à ces chérubins dont parlent les écrivains mystiques de l’Église, qui sont tout amour, toute passion et que, pour cette cause, on ne représente qu’avec une tête entourée d’ailes de flamme.
Telle apparaît Emmelina ; c’est un visage de chérubin enflammé de tendresse. Oui, de tendresse ! Puisque nous sommes seuls avec elle dans sa chambre, c’est le moment de savoir tout ce qui se passe en elle depuis quelques semaines.
Comme il a été dit au commencement de cette histoire, la maison de M. Irnois, située dans une des ruelles du quartier des Lombards, donnait, quant aux chambres à coucher, sur une cour assez sombre. Cette cour était, comme on le pense bien, carrée et entourée des trois autres côtés de bâtiments fort élevés et percés de fenêtres, comme était aussi la face dans laquelle s’enterrait le logis du modeste millionnaire.
Au cinquième étage, vis-à-vis les deux fenêtres de la chambre à coucher d’Emmelina, et par conséquent trois étages au-dessus d’elle, était une mansarde de fort méchant aspect, placée juste à la naissance du toit, qui n’était pas faite pour attirer longtemps le regard. Mais à cette triste fenêtre travaillait tout le jour un jeune ouvrier, tourneur … On commence, j’imagine, à entrevoir où nous allons en venir.
Et, en vérité, ce jeune ouvrier était remarquablement joli ; à peine devait-il avoir dix-huit ans ; des cheveux blonds bouclés naturellement, une physionomie de fillette, et d’autant plus qu’il prenait très bien l’air fort timide et réservé lorsque par hasard il venait quelqu’un dans sa mansarde pour lui parler, pour lui faire quelque commande, par exemple. D’ailleurs, le petit ouvrier était joyeux comme un pinson, chantait tout le jour à gorge déployée, et passait même quelques instants, quelques quarts d’heure de sa journée assis sur le rebord de sa fenêtre, à manger son déjeuner ou son dîner, en regardant chez les voisins. C’était moins un garçon qu’un vrai moineau, tant il était haut niché, gai, chantant, agile et remuant.
Voilà la cause des émotions d’Emmelina.
Il s’était passé naturellement bien du temps avant que la fille de M. Irnois eût levé ses yeux nonchalants jusqu’à la mansarde du cinquième, et lorsqu’elle l’avait fait pour la première fois, elle n’avait eu certes aucun pressentiment de ce qui allait advenir à son cœur. Cette pauvre nature stagnante n’avait pas assez de force en elle-même pour rêver ni pour désirer ; une passion vive ne pouvait commencer pour elle à l’instant, sur le coup ; les passions de ce genre n’appartiennent qu’aux êtres vivaces, qui sont toujours pressés par instinct de se mettre en action. Emmelina n’était pas, tant s’en fallait, de ces êtres-là.
Mais sur les âmes qui ne sont que faibles et qui ne sont pas gâtées, il est plusieurs choses qui n’emploient jamais vainement leur puissance : la gaieté, la jeunesse et la beauté. Quand Emmelina ; dans ses longues heures d’oisiveté, eut contemplé quelquefois son jeune voisin, elle trouva, à ce spectacle d’un être si différent de ce qu’elle était elle-même, une sorte de satisfaction qui, dans cette nature incomplète se manifesta par un bien-être inanalysé. Du moment qu’elle éprouva quelque plaisir à contempler le voisin, ce lui devint un but, une préoccupation constante, une nouveauté exquise ; car jamais encore elle n’avait joui de ce bien, de s’attacher à quelque chose ; sa mère, son père, ses tantes, sa bonne, son ourlet et son Chat botté ne constituaient pas dans son existence des accidents causés par elle-même, et ne lui produisaient pas plus d’impression que l’air qu’elle respirait. Mais pour sa nouvelle connaissance, ce fut tout différent. Elle l’avait en quelque sorte créée, imaginée elle-même. Personne n’était intervenu dans le plaisir qu’elle se forgeait, et elle trouva bientôt une jouissance infiniment délicate, la plus grande, qu’elle eût jamais goûtée, à regarder ce petit jeune homme.
Emmelina n’agissait jamais par volonté réfléchie ; toutes ses actions étaient, comme celles des êtres guidés par la raison moins que par l’instinct, des résultats d’une impression embrumée dont jamais elle n’eût su donner la cause ni aux autres ni à elle-même. Aussi ne fût-ce ni par dissimulation ni par crainte qu’elle s’appliqua dès les premiers moments à se cacher à tout ce qui l’entourait. Lorsque Jeanne, ou quelque autre personne était auprès d’elle, elle ne soulevait pas les rideaux ordinairement fermés de sa fenêtre ; et en cela elle poussait la précaution bien loin, car jamais on ne se fût imaginé, même l’eût-on vue tout le jour regardant vers la mansarde, qu’elle attachait l’intérêt le moindre à l’individu du jeune ouvrier.
Eh bien ! c’est pourtant ce qui avait fini par arriver. Le développement physique d’Emmelina avait été précoce plus qu’il ne l’est d’ordinaire dans nos climats ; ce fait n’est pas rare chez les personnes que la nature a d’ailleurs. maltraitées ; il était difficile qu’un je ne sais quoi plus tendre ne se mêlât pas bientôt à la curiosité qui attirait les regards de Mlle Irnois du côté de la joyeuse mansarde. Avoir les yeux fixés sur cette benoîte croisée lui devint enfin un besoin impérieux, et ce fut alors qu’elle commença à vouloir rester seule dans sa chambre. Aux premiers jours de sa contemplation mystérieuse, elle n’avait voulu confier son plaisir, tout petit qu’il fût, à personne ; aux jours de sa joie, de son ivresse, de son bonheur, le mystère fut commandé plus impérieusement encore par le vœu secret de son âme. Il lui devint si nécessaire, le contraire lui parut si odieux, si mortel pour le sentiment qui l’animait, que son caractère prit une nouvelle allure ; ce fut à ce moment qu’elle eut ces accès de volonté dont chacun s’étonna, et qu’elle habitua parents et domestiques à ne pas entrer chez elle avant d’avoir prévenu par un coup frappé à la porte ; alors, avertie, elle se rejetait en arrière dans son fauteuil, poussait sa croisée et recevait le visiteur bien ou mal, suivant sa disposition du moment, plus souvent mal que bien, car on la troublait ; bref, elle vivait pour la première fois.
Ce grand. mystère dont elle entourait sa passion montre bien qu’il y entrait quelque chose des sens. L’âme a sa pudeur, sans doute ; mais cette pudeur-là n’est, chez les amoureux, qu’un reflet des flammes qui brûlent ailleurs dans leur être.
Un jour, Emmelina reçut une impression bien inattendue et bien singulièrement obscure d’un événement qui paraîtra fort naturel. Il commençait à se faire tard ; c’était vers huit heures du soir en été, et l’on sait qu’à ce moment, bien que la clarté du ciel soit encore assez pure, le cristal des airs commence pourtant à se mélanger de quelques teintes plus ternes. La journée avait été chaude, et tout le jour Emmelina avait vu son tourneur, la figure échauffée par le travail, les cheveux en désordre et sa chemise entrouverte, sans cravate, livrant sa blanche poitrine aux souffles d’air qui peuvent s’égarer au-dessus des toits de Paris.
À ce moment, le jeune homme était assis sur le rebord de sa fenêtre, jambe de-ci, jambe de-là, occupé à brosser, avec une délicate attention, sa casquette de dimanche. Tout à coup, à un signe de tête accompagné d’un sourire qu’il adressa au fond de sa chambre, Emmelina put comprendre que quelqu’un entrait, quelqu’un d’ami, en vérité, car l’ouvrier ne se dérangea pas autrement ; au contraire, il se mit à brosser sa casquette avec plus d’entrain qu’auparavant, et même, quand la casquette eut atteint son plus haut degré de lustre, il attira à lui un habit qui, sans doute, était posé sur une chaise dans l’intérieur de la chambre, et fit subir à cet ornement futur de son corps la même opération dont il venait de faire les frais pour l’ornement de sa tête.
Ces menus détails ne sont rien pour le lecteur, et pas davantage pour l’auteur de ce récit, on peut le croire ; mais ils faisaient toute la vie d’Emmelina.
L’ouvrier en était peut-être à son dixième coup de brosse sur la manche de son habit, et au mouvement de ses lèvres, on voyait qu’il causait et riait avec la personne qui était entrée dans la chambre, quand cette personne apparut à son tour aux yeux d’Emmelina.
C’était une, jeune fille assez jolie, une grisette. Elle était gentiment atournée comme pour une partie de plaisir. Son bonnet étalait une magnificence luxuriante de rubans roses dont la teinte assez vive luttait sans désavantage avec la couleur relevée de ses joues. Cette bonne fille riait du meilleur rire ; ce qui peut donner à croire également que la conversation avec l’ouvrier était fort plaisante dans le sens que les modernes donnent à ce mot, ou fort plaisante dans la signification plus gracieuse que lui prêtaient nos aïeux.
La grisette tenait à la main un pot de giroflées et le posa en cérémonie sur le bord de la fenêtre. Puis elle rentra dans l’intérieur de la chambre et revint avec un vase plein d’eau dont elle arrosa largement les pétales bruns et jaunes de l’odorante fleurette, tandis que les gouttes tombaient en pluie sur le mur. Et quand c’en fut fini avec les fleurs, l’ouvrier prit la tête de sa jolie connaissance et l’embrassa sur les deux joues sans qu’elle se défendît beaucoup.
Emmelina voyait tout. Elle n’eut pas de la jalousie ; non, ce ne fut pas un sentiment jaloux qu’elle éprouva. Son orgueil, sa colère ne s’allumèrent pas contre la grisette ni contre le jeune homme ; elle ne ressentit pas de haine ; elle n’eut pas l’amertume cruelle d’un amour qui se croit méconnu ou trahi ; mais une tristesse profonde mêlée d’un mystérieux redoublement de curiosité envahit tout son être. Dans ce baiser si joyeusement donné et reçu il y eut pour elle tout un monde de secrets, dont il fut impossible à son innocence et à son imagination privée d’ailes, hélas ! de découvrir le mot. Le voile qui lui cachait ce qu’elle aurait voulu savoir s’agita mais ne se déchira pas, et elle pleura longtemps, tout le reste de la soirée, sans savoir pourquoi elle pleurait. Du reste, elle avait conçu si peu d’humeur et était même si peu portée de mauvaise volonté contre la grisette qu’en ouvrant sa fenêtre le lendemain, elle désirait vaguement la revoir.
Il y a un conte de La Fontaine dont je suis quasiment fâché d’introduire le titre jovial dans cette pudique et un peu mélancolique histoire ; mais il rend si bien, si justement ce que je veux expliquer, quoique dans un sens différent sans doute, que je n’ai pas le courage de me priver de son secours : Comment l’esprit vient aux filles.
Beaucoup de filles ont l’esprit allègre avant que l’amour soit accouru pour lui délier les jambes. Emmelina, comme on sait, la pauvre enfant, n’était pas de ce nombre, et même l’amour ne pouvait pas se vanter de lui donner de l’esprit. Il ne lui apprit ni la ruse ni la réflexion ; mais il lui découvrit, comme nous l’avons vu, le secret d’avoir une, volonté, celui de désirer quelque chose, celui de trouver en elle-même un ardent plaisir. Non, ce ne fut pas de l’esprit que l’Amour lui donna. Le cadeau du dieu fut-il meilleur, fut-il pire ? Je laisse ce point à décider aux philosophes et aux femmes. Il lui donna une âme.
Elle n’en avait point auparavant, ou, si l’on veut absolument me contredire, l’âme dont l’avait gratifiée la nature à sa naissance était si pesante, si engourdie, si bien liée dans les nœuds misérables d’une conformation imparfaite, que c’était tout comme si elle n’eût pas existé. Maintenant qu’Emmelina aimait, cette âme avait reçu le feu de vie, et s’était, non pas dressée debout, car il semblait que dans ce corps tortueux la voûte fût trop surbaissée pour que l’âme pût s’y développer à son aise, mais elle s’était, en se repliant sur elle-même, donné une énergie et une ardeur tout extatique dont la puissance eût vraiment effrayé tous ceux qui auraient pu la contempler, je veux dire là comprendre.
Emmelina, encore une fois (j’y insiste parce que ce point est essentiel pour que l’histoire de Mlle Irnois soit bien comprise), Emmelina ne cherchait en aucune façon à se rendre compte du comment et du pourquoi de ce qui se passait en elle. Elle ne savait pas même le nom du sentiment qui possédait son être tout entier d’une manière aussi étrange. Faut-il pousser l’aveu jusqu’à l’extrême ? Avant le jour où elle avait, pour la première fois, contemplé avec un bonheur vraiment épanoui le jeune homme à sa fenêtre, elle n’avait eu aucune vie morale, elle était presque idiote ; à dater de ce moment, elle était devenue une sorte d’extatique.
Aussi indifférente qu’autrefois au reste des événements de la vie, elle existait dans le coin de passion qui s’était ouvert pour elle ; elle ne souhaitait rien, ne prévoyait rien ; elle aimait comme un chien aime son maître, sans passé, sans avenir, sans exigence, sans gaieté même à vrai dire, car la puissante sensation par laquelle son être était dominé ne saurait avoir pour nom un des mouvements, un des états ordinaires de l’âme. Elle n’était pas heureuse ; si je l’ai dit, je me suis trompé : elle était plus qu’heureuse, elle était vivante ! Vivante, oui ! mais dans son amour seulement ; car, de tout autre côté, plus morte que jamais.
Voilà dans quelle situation se trouvait Emmelina le soir où elle accepta avec un bonheur si vif l’idée de quitter sa famille pour suivre le comte Cabarot, singularité qui excita tant de surprise.
VI
Ainsi possédée par cette passion si fervente et d’un caractère presque mystique, Emmelina plus que jamais, ignora ce qui se passait autour d’elle ; et à cette remarque faite dans le chapitre précédent, que son intelligence ne s’accrut nullement en raison du progrès de l’exaltation de son âme, je pourrais ajouter qu’elle devint encore plus nulle que par le passé sur tous les points qui tiennent à l’existence ordinaire. Ainsi, autrefois, dans son fauteuil, sur le sein de sa mère, dans les bras de Jeanne, elle prenait quelquefois part à la vie de tous, un incident réussissait parfois à la frapper ; il arrivait (rarement sans doute, mais enfin il arrivait quelquefois) qu’un mot l’attachait, et alors elle souriait ou donnait une marque quelconque de plaisir.
Du moment qu’elle fut amoureuse, cette faible part à l’existence commune lui fut aussi retirée. Elle devint comme les gens dont parle l’Évangile, qui ont des oreilles et des yeux, mais qui ne voient ni n’entendent ; M. Irnois et le reste de l’aréopage traitaient cela d’indifférence croissante ; les dignes bourgeois se trompaient : c’était impuissance. L’amour avait fait pour cette nature embrumée tout ce qu’il avait pu ; il s’en était emparé, il l’avait absorbée, il l’avait introduite dans son univers, et l’avait absolument détachée de tout ce qui n’était pas lui.
Pour Emmelina, l’univers entier, c’était l’espace qui s’étendait de son fauteuil à la fenêtre de l’artisan, distance immense qu’en un élan passionné son désir franchissait vingt fois le jour, mais que sa volonté ne songeait pas, ne pouvait pas songer à détruire par les moyens matériels dont son pauvre esprit ne suffisait pas à lui révéler l’existence.
Quand on lui proposa de quitter la maison paternelle et d’aller vivre ailleurs avec un être différent de tous ceux qui l’entouraient, elle ne fit pas réflexion que cet être pouvait être différent aussi de celui dont elle était possédée. Comment aurait-elle pu imaginer cela ? J’ai dit que c’était son univers. N’est-il pas évident que la création pour elle ne comptait qu’une seule personne ? Les paroles de sa mère firent éclater dans son âme un cantique de béatitude, de bonheur infini ; elle ne supposa pas même qu’il lui fût possible, matériellement possible, de changer d’existence sans commencer une autre vie qui eût pour but unique l’artisan. Lui faire comprendre le contraire, si on l’eût essayé, aurait été à ce moment impossible, oui impossible ! Et comment faire concevoir à cette folle qui n’avait qu’un flambeau mystique qu’elle était la fille d’un millionnaire, qu’un conseiller d’État recherchait sa main, que le chef d’un grand empire disposait d’elle pour récompenser des services politiques, et qu’il lui fallait se préparer à devenir une grande dame ? On aurait pu tenter cette explication, mais elle n’aurait eu d’autre succès que de frapper l’oreille inattentive d’Emmelina par un déluge de paroles aussi peu comprises les unes que les autres. Il ne fallait, pour faire entrer la réalité dans cette tête barricadée, rien moins que le contact du fait lui-même. Il fallait que le comte Cabarot parût en personne. C’est ce qui avait eu lieu.
On a vu ce qui en advint. L’illusion d’Emmelina, brutalement heurtée, rendit, comme un vase d’airain, un son strident et plaintif dont la vibration était effrayante. Mais enfin ce son, si longtemps qu’il se prolongeât, finit par cesser ; les plaintes, les larmes s’arrêtèrent, l’oubli vint avec la disparition de l’objet qui avait causé la douleur, et, obstinément, Emmelina retomba dans son illusion.
Quand elle se retrouva à sa croisée, qu’elle eut tiré le rideau, ouvert le vitrage, et qu’à vingt pas d’elle l’être aimé, courbé sur son établi, lui apparut, elle perdit la pensée de Cabarot et du reste aussi complètement que si elle ne l’eût jamais eue. Tout son bonheur lui revint avec les flammes accoutumées, et, avec le même abandon, la même confiance, la même extase que la veille, elle se laissa aller à cette contemplation qui gonflait de vie sa pauvre poitrine et usait par son ardeur le peu d’existence que le sort avait départi à cette organisation maltraitée.
On est peut-être curieux de savoir si une passion aussi véhémente, aussi belle, avait produit quelque effet sur l’être qui en était l’objet. D’ordinaire, ce me semble, le lecteur d’une histoire s’intéresse à celui qui a l’initiative en amour, et n’aime pas à le savoir opprimé ni malheureux. Cette disposition bienveillante n’aura pas ici grande satisfaction. La seule sensation que fit Emmelina sur son voisin fut toujours celle d’une petite personne fort désœuvrée et très curieuse qui, grâce à l’immense fortune de son père, pouvant vivre dans la fainéantise (je me sers presque des expressions de l’ouvrier), passait son temps à voir ce qui se passait chez les voisins. Il s’en expliquait quelquefois dans ces termes avec sa bonne amie Francine, la petite lingère au pot de giroflées.
– A-t-on de la chance, s’écriait-il, de pouvoir employer ainsi toute sa journée les bras croisés, dans un bon fauteuil, à ne rien faire et à regarder en l’air ! c’est, ma foi, une profession qui me conviendrait !
Francine était femme, et ses idées plus vives arrivèrent plus près de la vérité.
– Veux-tu que je te dise ? déclara-t-elle un jour à son amant, je suis sûre que Mlle Irnois en tient pour tes beaux yeux !
– Allons donc ! répondit l’ouvrier. Une bossue comme elle, et qu’en outre on dit idiote ! Le diable m’enlève si j’en voudrais avec tous ses écus !
Franchement, il ne croyait pas à l’amour qu’il inspirait. M. Irnois était fort connu dans le quartier, et l’ouvrier nourrissait pour lui ce profond respect que l’argent ne mérite pas en général, mais obtient le plus souvent, et sans le demander. Aussi le petit tourneur se fût-il bien gardé d’offenser un homme aussi respectable et ‘aussi puissant ; mais il ne fallait pas moins qu’une telle autorité pour l’empêcher de faire des niches à Emmelina. Quelquefois même, le turbulent garçon secoua le frein de la crainte jusqu’au point de chanter malicieusement, quand Emmelina le regardait trop longtemps, quelque chanson délurée, dans le but de la faire retirer de la fenêtre. Mais, à sa grande surprise, ce moyen n’avait jamais réussi. C’était tout simple : la jeune fille ne comprenait pas un mot à ces badineries, et ne se sentait impressionnée que par le ton joyeux de la romance.
– Ma foi, disait le tourneur, elle est tout de même assez effrontée, Mlle Irnois : je lui chante des drôleries à faire dresser les cheveux sur la tête, et elle ne sourcille pas !
– Gamin, s’écriait Francine, est-ce que tu ne rougis pas de débaucher les jeunesses ? Je te dis que la pauvre bossue perd la tête pour toi.
Francine n’aimait pas Emmelina.
Ainsi les amours de notre héroïne n’étaient pas de celles qu’on peut nommer fortunées ; il s’en fallait bien.
Quelques jours avant le mariage du comte Cabarot, de grands événements arrivèrent toutefois pour cet amour ; c’était bien peu de chose, mais l’importance des faits est toute relative. Racontons-les comme ils se sont passés et sans rhétorique.
La cuisinière eut le malheur de casser une chaise dans son antre, M. Irnois, au fond de son cœur, ne détestait pas ces incidents domestiques qui donnaient lieu à son éloquence de s’exercer pleinement. Chaque matin, en robe de chambre, il faisait la visite du maître par toute la maison, et lorsqu’il remarquait un détail défectueux, tel qu’une serviette hors de place, une bouteille débouchée, une bûche mal placée, il commençait un discours ab irato qui portait la terreur dans l’âme des coupables.
Pour éviter d’être foudroyée par une de ces pièces oratoires, la cuisinière, ayant cassé sa chaise, prit conseil du secrétaire intime et de sa fidèle compagne Jeanne, puis elle monta en hâte trois étages et alla conter son méfait à l’ouvrier tourneur.
Celui-ci s’empressa de mettre à la disposition de la belle désolée, son talent, ses outils et son bois, et il entra ainsi dans l’appartement de M. Irnois, où il n’avait jamais mis le pied. Le hasard voulut qu’au moment où Emmelina traversant l’appartement, non pas portée, mais appuyée sur Jeanne, essayait dans son domaine une de ses promenades qu’elle ne consentait plus à faire que lorsque le tourneur n’était pas à sa fenêtre, et qu’elle l’avait attendu longtemps en vain, elle se trouva face à face avec le jeune homme.
Le coup fut électrique. En le voyant à quelques pas devant elle, Emmelina éprouva une sensation comparable à celle de ces gens à qui l’on met une vive lumière devant les yeux. Elle poussa un cri et rejeta sa tête en arrière. Dans ce mouvement brusque, son bonnet mal attaché tomba, son peigne se défit, ses beaux cheveux blonds se déroulèrent en boucles innombrables sur ses épaules. Soudain on vit aussi s’animer ses grands yeux, et je ne crains pas de dire qu’avec toutes les imperfections de sa personne, elle eut à ce moment une exquise beauté.
Oui, exquise, c’est le mot qui convient. Il ne pouvait être question, pour la pauvre enfant, d’un de ces triomphes de grâces réelles qui l’eussent fait admettre par le berger troyen à lutter sur le mont Ida avec les trois déesses. Mais si, douée de l’expression sublime qu’elle eut à ce moment, elle eût été, sur le bord d’une fontaine, rencontrée par quelque voyageur allemand, celui-ci l’aurait prise pour une de ces séduisantes ondines dont les charmes surnaturels passaient avec raison pour irrésistibles.
À cette apparition singulière, le jeune homme s’effraya presque. Il ôta respectueusement son bonnet, hésita une minute, regarda Emmelina, croyant qu’elle allait dire quelque chose ; mais elle ne dit rien. Elle se contentait de le regarder avec l’expression la plus poignante que l’on puisse se figurer. Elle restait la tête rejetée en arrière, les yeux fixés sur lui, se tenant au bras de Jeanne qu’elle serrait avec force, et ne trouvant pas un seul mot à articuler. Ce qu’elle éprouvait n’était pas, à la vérité, facile à dire. Des personnes plus habiles que la jeune fille à reconnaître leurs sentiments, à démêler leurs impressions, n’en seraient certainement pas venues à bout, si elles se fussent trouvées sous le poids de la passion véhémente qui dominait à cette heure Emmelina. Elle était plongée dans une situation analogue à celle des extatiques qui, par la force de la prière, se sont comme élevés au-dessus du sol.
L’ouvrier, voyant que Mlle Irnois ne lui parlait pas, se dit en lui-même : « En voilà une folle ! »
Il gagna la porte, l’ouvrit, passa, la referma, et descendit l’escalier pour gagner l’autre corps de logis où était sa chambre.
Emmelina se mit à pleurer.
– Qu’as-tu, ma petite ? demanda la vieille Jeanne. Pourquoi pleures-tu, mon enfant ? pourquoi regardais-tu ce garçon comme tu as fait ? Est-ce qu’il te donnait peur ?
– Oh non ! dit Emmelina, en cachant son front dans les bras de sa fidèle servante.
– S’il ne te faisait pas peur, reprit cette dernière, pourquoi t’es-tu détournée ? Tu voudrais peut-être que je le rappelasse ?
Emmelina attacha ses beaux yeux sur la vieille femme, et lui dit d’une voix profonde et tremblante d’émotion :
– Oui, rappelle-le !
Jeanne ne comprit pas, à coup sûr, le sentiment qui faisait parler la jeune malade.
Elle courut vers l’escalier et appela l’artisan. Celui-ci s’empressa de remonter.
– Mademoiselle veut vous voir, lui dit la vieille femme. Tiens, mon Emmelina, le voilà revenu ce petit jeune homme ! Veux-tu lui parler ? Qu’est-ce que tu as à lui dire ? Veux-tu que je lui parle pour toi ?
– Oui, dit Emmelina.
– Que faut-il lui dire ?
C’était une scène enfantine. Dans l’esprit de la vieille domestique et dans celui du tourneur, il ne s’agissait que de distraire puérilement un enfant malade ; mais que ces apparences étaient vaines et insolemment fausses ! Tandis que Jeanne s’épuisait en propositions et en observations niaises, Emmelina se livrait tout entière à la contemplation passionnée de ce qu’elle aimait. Son âme était absorbée par le bonheur étrange de l’amour qui vit pour lui-même. Combien cet amour-là peut-il durer chez les êtres ordinaires ? Peu de temps, sans doute, si même il existe jamais ; mais ce n’est pas d’une telle question qu’il s’agit ici. Pour Emmelina, c’était le bonheur complet, l’extase entière.
Elle n’avait ni écouté ni entendu la série de questions que Jeanne avait adressées en son nom : partant, elle n’y répondit rien. Ce que voyant, la domestique se mit à causer pour son propre compte avec le tourneur.
Jeanne questionna le jeune ouvrier sur son âge, sur son état, sur sa situation.
Emmelina faisait grande attention aux réponses. Elle sourit d’une façon tout émue quand le petit voisin se plaignit de la dureté du temps et de la peine qu’il avait à gagner sa vie, et qu’il ajouta :
– Ma foi, il y a des moments où on me donnerait un peu plus d’argent que je n’en gagne, que je serais fort content !
Emmelina prit la parole et dit à Jeanne :
– Allons dans ma chambre.
– Oui, ma petite… Eh bien ! adieu, mon garçon, à revoir !
– Non ! dit Emmelina.
– Tu veux qu’il vienne dans ta chambre avec nous ?
– Oui, dit Emmelina.
– Allons, jeune homme, venez ! … Mademoiselle a aujourd’hui de singulières idées.
Quand le trio fut arrivé dans le sanctuaire :
– C’est ici que je demeure ! dit Mlle Irnois, en regardant l’ouvrier avec une tendresse indicible.
– Ah ! oui, mademoiselle ! répondit celui-ci.
Au fond, ce qu’on lui disait lui était parfaitement indifférent, et il ne comprenait pas pourquoi la fille du millionnaire l’avait fait entrer. Tout ce qu’il croyait deviner, c’est que cette petite personne, fort désœuvrée et dont il croyait déjà connaître l’esprit curieux, cherchait à distraire son oisiveté en le retenant.
Pendant qu’au lieu de regarder la chambre, comme l’observation d’Emmelina semblait l’y engager, il se livrait à ces réflexions peu flatteuses pour celle qui en était l’objet, Emmelina s’était approchée de son secrétaire, avait pris une petite boite qui était dedans et en avait tiré une vingtaine de napoléons.
– Donne-lui cela, dit-elle à Jeanne.
– Voilà bien un miracle ! s’écria celle-ci… Prenez, mon cher ami ; vous êtes la première personne à qui Mademoiselle ait donné, car elle ne pense d’ordinaire à âme qui vive !… Ne soyez pas honteux, allez ! Elle pourrait vous en jeter dans la poche cent fois plus sans se faire tort. Elle ne connaît pas sa fortune, ni son père non plus ne la connaît pas, le pauvre homme !
L’ouvrier se perdit en expressions de reconnaissance. Emmelina s’assit dans son fauteuil, et, la tête appuyée sur sa main, elle parut se perdre dans la plus délicieuse des rêveries.
Elle ne regardait pas le jeune homme ; elle vivait tout en elle.
Mademoiselle va s’endormir, dit Jeanne tout bas ; allez-vous-en !
L’autre ne demandait pas mieux, et, ses vingt louis dans la main, le cœur joyeux, il s’esquiva.
Quand Emmelina releva la tête et ne le trouva plus, elle se mit à pleurer ; mais ce fut sans amertume : son cœur était comme fatigué par l’excès de bonheur ; elle pleurait sans doute de cette séparation subite ; mais comme elle venait de goûter la plus grande joie qu’elle eût connue de sa vie, elle n’était pas accessible encore à une véritable douleur. Ses larmes coulaient sur ses joues, comme il arrive quelquefois après un rêve délicieux dont on regrette le prestige, tout en goûtant encore quelque volupté secrète dans l’examen de cette joie évanouie.
– C’est bien étonnant, c’est bien étonnant, murmurait la vieille Jeanne, assise à ses pieds ; je ne l’ai jamais vue ainsi.
Au bout d’une demi-heure, Emmelina pencha sa tête dans son fauteuil et s’endormit réellement. Elle respirait doucement, comme un enfant de six ans aurait pu faire, et la plus exquise sérénité se peignait sur son front lisse, uni et légèrement coloré.
Puis un bruit la réveilla…
On apportait, de la part de M. le comte Cabarot, une riche corbeille de mariage, rapidement improvisée.
Mme Irnois la porta elle-même à sa fille ; mais Emmelina ne la regarda point, sourit en tournant sa tête de l’autre côté dans son fauteuil, et fit effort pour se rendormir. Était-ce qu’elle poursuivait un rêve, ou qu’elle se reposait de son bonheur ? Je ne sais.
VII
Comme on voit, le cher comte n’avait pas perdu de temps. Après sa visite essentielle à son notaire, n’ayant plus qu’à disposer de ses moments jusqu’au dîner, il avait visité les marchands. Il s’était fait un point d’honneur de réussir vite, en semant l’or à profusion, à composer une corbeille d’un goût bon et magnifique. M. Cabarot aimait à courir les magasins ; il avait la prétention d’exceller dans le choix des ajustements féminins, et visait à la réputation d’oracle de l’élégance et du bon goût.
M. Cabarot fit merveilles dans les boutiques ; châles, dentelles, belles étoffes, tissus précieux, bijoux et diamants, il alla tout voir ; il choisit avec réflexion, mais aussi avec promptitude, et, comme on voit, en peu d’heures il pouvait envoyer à Mlle Irnois le somptueux résultat de ses galants efforts.
On a vu à quel point ce cadeau avait été peu apprécié.
La lettre qui l’accompagnait ne fit pas plus d’effet. Elle était cependant conçue dans les termes les mieux faits pour attendrir le cœur d’une cruelle et faire ressortir la réputation d’homme d’esprit que possédait le comte ; mais dans la maison, on avait trop de prévention contre lui pour être fort sensible à ses démonstrations passionnées, et sa lettre, après avoir passé dans les mains et sous les yeux des trois vieilles dames, fut jetée sur une table sans qu’on jugeât à propos de tourmenter Emmelina en la lui faisant lire.
– Puisqu’il faut qu’elle se marie, la malheureuse, dit Mme Irnois, laissons-lui au moins les derniers moments de sa liberté. Je n’ai pas grande idée de ce M. Cabarot, ou plutôt j’ai l’idée qu’il n’est pas fort honnête homme. Malheureuse enfant ! À quoi sert à M. Irnois tout l’argent qu’il a amassé ? Si j’avais su que cet argent dût me préparer tant de malheurs, je n’en aurais jamais été si fière !
M. Irnois était rentré avant l’arrivée de la corbeille. Il avait raconté avec douleur le résultat négatif de sa démarche auprès de Cabarot, et, comme tous les gens dont l’esprit n’est pas très actif et dont la nature physique est grossière, il avait à peu près pris son parti du chagrin qui lui arrivait. Il aimait certainement beaucoup sa fille, mais cet amour ne pouvait cependant le transformer, et une des qualités les plus admirables en lui, un des ressorts de sa fortune avait été la facilité avec laquelle il avait plié le cou sous tous les échecs. Lorsqu’il était envahi par quelque infortune irréparable, jamais il ne se gendarmait, ne se passionnait, ne se révoltait. Il baissait la tête en laissant le flot passer. Voyant que l’Empereur voulait que le comte Cabarot épousât sa fille, il s’était représenté la grande puissance de l’Empereur et avait cédé ; plus tard, il lui était venu l’idée que, moyennant finances, le fiancé pourrait lâcher la main de sa fille ; il avait fait une tentative de ce côté-là, la tentative n’avait pas réussi ; il se résignait ; ses murmures, ses jurons ne prouvaient rien contre cette vérité ; il avait beau crier, il était désormais hors d’état de résister et la pauvre Emmelina était perdue.
Pour Cabarot, il avait bien de l’esprit, de cet esprit sarcastique, incrédule, mauvais, déshonnête, qui est souvent le partage des gens vieillis dans les affaires ; il devait enthousiasmer de vieux diplomates, de vieux hommes d’État, mais il était horriblement laid, et ne pouvait raisonnablement produire une impression satisfaisante sur une jeune fille ; à plus forte raison sur Emmelina dont le cœur était préoccupé comme on l’a vu.
Le lendemain du jour, qui était un dimanche, où Emmelina vit l’ouvrier dans sa chambre, les bans furent publiés à la mairie. Ils furent proclamés aussi à l’église.
Tout Paris sut désormais officiellement que le comte Cabarot allait épouser Mlle Irnois. Le chiffre de la fortune apportée en dot par la fiancée, les espérances surtout se trouvèrent plus formidables qu’on ne l’avait cru. M. Irnois était immensément riche. « Comment se peut-il, se disaient les rivaux dépités, que ce polisson de millionnaire ait su se cacher si bien dans son trou, et que Cabarot ait été le premier à le déterrer ? »
Outre le bonheur d’épouser Mlle Irnois, le comte eut celui de voir doubler sa renommée de fin diplomate, tant cette négociation entreprise par lui dans son intérêt particulier lui fit d’honneur sous le rapport de la discrétion avec laquelle elle avait été conduite, des augustes moyens qu’il avait su employer, et, finalement, de l’éclatant succès qu’il avait remporté. On en parla dans ce sens en bon lieu, et plus que jamais l’ambassade qui lui était promise lui fut assurée.
Il allait tous les jours faire sa cour à sa future. Je l’ai déjà dit, il détestait les moyens violents et tout ce qui y ressemblait. Avec ses intimes, il ne se cachait plus de l’impression que lui produisait tout ce qu’il voyait chez sa chère belle-mère ; mais il faisait tout comme s’il eût été transporté d’aise, une fois qu’il se trouvait dans la maison de sa future.
– Un soir surtout, il en causa à cœur ouvert. C’était en petit comité, chez M. le baron R… Il était deux heures du matin ; on avait joué un jeu d’enfer, et, après souper, cette fine fleur des gens d’esprit de l’époque se délassait en faisant un doigt de conversation.
– D’honneur, s’écria un des convives, Je ne conçois pas votre conduite, mon cher Cabarot. Car d’aller épouser la fille d’Irnois, étant ce qu’elle est, c’est déjà bien fou ! J’ai pris des informations en tapinois, et la pauvrette, m’a-t-on dit, serait plutôt bonne à mener à l’hôpital qu’à l’autel ! Mais, outre que vous l’épousez, vous y allez tous les jours ! C’est d’une patience dont je ne vous aurais jamais cru capable.
Cabarot enfonça ses mains dans ses poches jusqu’aux coudes, et prenant un de ces airs que l’on appelle moitié figue moitié raisin, il se laissa aller à quelques menus propos qui ressemblaient assez à des confidences.
– Eh ! dit-il, je mérite les compliments ! Il est certain que je ne manque pas de longanimité, et qu’il y a bien des moments où je suis tenté d’envoyer au diable ma future famille.
– Ils ne sont pas aimables, hein ? dit le maître de la maison en riant.
– Comme vous le dites, mon cher, reprit Cabarot ; je viens d’y faire une séance de deux heures, et j’ai failli me jurer à moi-même que la première de mes actions en sortant de l’église serait de me brouiller avec mon beau-père.
– Et la seconde ? demanda quelqu’un.
– D’en faire autant avec ma belle-mère.
– La troisième probablement de leur renvoyer votre femme, s’écria un autre interlocuteur.
– Ne devançons pas l’avenir, poursuivit Cabarot ; l’impatience m’emportait ; mais me voyez-vous pendant deux heures, assis dans un fauteuil à peu près comme je suis là, ayant devant moi la fille qui pleure ; à ma droite, deux tantes qui gémissent ; à ma gauche, la mère qui fond en larmes ; derrière mon dos, le père qui se promène en maugréant ? Et pendant deux heures, je suis là le sourire sur les lèvres, blâmant doucement cette sensibilité exagérée, faisant des mamours de tous les côtés, et feignant de pleurer de compagnie quand je n’ai pas sur les lèvres un sourire de bénignité.
– Je m’étonne de votre mansuétude, dit le baron R…, car puisque vous épousez décidément, vous n’avez pas besoin de vous torturer à plaisir en voyant ces gens-là tous les jours.
– Eh ! dit Cabarot, ma mansuétude m’a déjà servi à quelque chose.
– À quoi, bon Dieu !
– À m’obtenir la confiance de la petite.
– On dit qu’elle ne parle jamais.
– De fait, elle n’est pas bavarde, et je ne me plaindrai pas d’elle sous ce rapport. Mais elle articule quelquefois de petites phrases, et la preuve, c’est qu’elle m’a honoré d’un colloque. Vous voulez savoir ce qu’elle m’a dit ?
– Volontiers ! dit le baron.
– Ce matin, comme j’écoutais toutes les lamentations, voilà ma petite personne qui tout à coup, sèche ses larmes et se met à me regarder fixement. Je n’ai, je vous l’avoue, jamais eu de fatuité. À vingt ans, j’étais laid et le savais ; jugez si à quarante-cinq j’ai des prétentions à me mettre à côté d’Adonis ! Cependant, j’ai eu quelquefois en ma vie occasion de reconnaître que la beauté ne fait pas la séduction, ou du moins que la séduction s’en passe aisément. Sans donc être trop effrayé de cet examen, je m’empressai de donner à ma physionomie cette expression entrante qui attire tout d’abord la confiance.
– Oui ! dit en riant un des écouteurs, et que vous aviez le jour où Tallien sembla témoigner l’envie de vous faire décréter d’accusation.
– N’insistons pas sur le passé. Bref, la petite n’imita pas le tribun, et avec une candeur toute virginale, elle me tendit la main.
– Peste ! dit le baron ; elle vous tendit la main ?
– Oui, et s’écria…
– Voyons. ce qu’elle s’écria.
– Elle s’écria : « Donnez-moi de l’argent pour lui ! – Pour lui ? » dis-je un peu étonné. On m’expliqua alors qu’il y avait dans la maison une espèce de petit ouvrier qui avait fait entendre à Mlle Irnois ces plaintes banales sur sa situation, que font toujours ces gens-là, et que depuis ce moment elle allait demandant partout, à père, mère, et, comme vous voyez, au futur, les moyens de satisfaire à sa charité un peu mal dirigée.
Je m’empressai de profiter de cette circonstance inattendue pour faire ma cour. J’affirmai à Mlle Irnois que non seulement je lui donnerais tout l’argent qu’elle pourrait désirer pour son favori ; mais que j’irais moi-même m’informer de la situation de ce jeune homme. Comme je vis qu’elle m’écoutait avec attention, je crus utile de pousser jusqu’au dithyrambe : « Quoi de plus intéressant, m’écriai-je, pour une âme sensible, que la vue de la jeunesse luttant courageusement contre le malheur ? Est-il rien de plus admirable qu’un pauvre garçon gai, content au milieu de l’infortune ! Ah ! s’il est un Dieu qui protège l’innocence, ce Dieu, sans doute, n’a pas de plus grandes délices que… » Je vous avoue que je m’entortillai un peu dans mes phrases ; mais je ne le regrettai pas, tant ma belle semblait mettre d’attention à m’écouter. Je poussai presque jusqu’à l’extravagance, et pour couronner l’œuvre j’offris d’aller m’informer sur l’heure même de la situation du malheureux. Un empressement marqué accueillit ma proposition, et je m’élançai vers la mansarde. Je ne trouvai point, comme je m’y attendais, quelque maroufle mourant de faim, mais un petit gaillard frétillant, qui me fit l’effet d’un véritable héros de guinguette.
– Ah ! mon pauvre Cabarot ! s’écria le baron en éclatant de rire, est-ce que ?…
– Ce fut précisément l’idée qui me vint, reprit le comte. Je me dis comme vous : « est-ce que ?… » Et je fis causer l’ouvrier. Il me rassura, quant au passé, et ne me laissa pas sans inquiétude sur les dispositions de ma future. Quand je dis sans inquiétude, c’est une façon de parler ; car je vous assure, et vous me croirez, que l’amour fidèle de Mme la comtesse Cabarot serait pour moi un bien grandement inutile. Mais il paraît que la petite personne a les passions vives, et que j’aurai ainsi mille raisons pour la tenir en chartre privée, ou pour la mettre à l’écart, comme il me conviendra mieux.
Vous voyez donc que je n’ai pas tort de faire l’empressé, puisque je dois à cette façon d’agir de précieuses notions sur le caractère de ma prétendue.
On rit beaucoup de l’avenir conjugal qui paraissait réservé à Cabarot : ce pauvre Cabarot ! On fit succéder aux observations particulières sur le cas présent des observations générales sur les femmes, qui, dirent ces messieurs, avaient toutes, spirituelles ou sottes, malades ou valides, un fond natif de perversité contre lequel l’éducation luttait en vain. Les habitants de ce salon avaient peu d’estime pour la belle moitié du genre humain.
L’époque du mariage avançait rapidement. Emmelina ne s’en occupait point. Elle avait même pris un certain goût pour Cabarot, depuis la visite du conseiller d’État chez le jeune tourneur. M. Irnois en avait tiré la conséquence que sa fille n’était pas fâchée de se marier ; et Mlles Maigrelut abondèrent dans son sens, en déclarant qu’après tout il n’était pas désagréable de devenir comtesse et grande dame. Mme Irnois seule, à demi éclairée par un instinct qui fait le mérite et la gloire de la sarigue, concevait des doutes et même des inquiétudes graves. Emmelina, encore une fois, ne s’occupait de rien, et passait toute sa journée à sa fenêtre, occupée à regarder l’artisan.
Voici la fin de l’histoire qui approche ; je voudrais lui enlever toutes les apparences du mélodrame. Le mélodrame n’est pas vrai ; la vérité seule est triste.
Le matin du jour marqué pour le mariage, Cabarot arriva de très bonne heure, avec ses témoins. M. Irnois avait convoqué les siens : deux hommes de son espèce. On se réunit dans le salon. Grâce au comte, il régnait une espèce de gaieté ; d’ailleurs, Mlles Maigrelut avaient fini par le trouver aimable, pour des pastilles qu’il leur avait quelquefois apportées.
On habilla la mariée en blanc, avec une couronne et un bouquet de fleurs d’oranger, comme c’est l’usage. Elle s’impatienta beaucoup, parce que tous ces dérangements inaccoutumés l’empêchèrent de se mettre à la fenêtre. Quand il fallut sortir, elle éprouva un grand déplaisir, et lorsque M. Cabarot s’avança au-devant d’elle, en grand costume, et lui prit la main, qu’elle vit des visages inconnus et une sorte de solennité répandue partout, elle parut réfléchir et comprendre qu’il se passait quelque chose qui méritait son attention.
À la mairie, elle devina, à ce qu’il paraît, ce qu’on lui disait et toute la portée des paroles, car elle devint blanche comme sa robe. Quand le magistrat lui demanda le oui sacramentel, elle avait la tête baissée et ne répondit rien ; mais on n’y prit pas garde, et la cérémonie s’acheva.
À l’église, on la soutenait pour la faire marcher ; le comte était fort gai et poli. Il avait désormais toute assurance de n’avoir pas perdu sa peine, et il fut jugé galant homme par les promesses qu’il fit à Mme Irnois de considérer, comme il fallait, l’état de souffrance de sa fille.
Le moment de la séparation fut assez pénible. Comme je l’ai dit, Emmelina comprenait ce qui avait lieu, et en ressentait profondément l’ébranlement ; mais elle ne dit rien. On lui trouva beaucoup de fièvre, et M. Cabarot fit promptement venir un médecin. L’homme de l’art se montra surpris qu’on eût marié une fille ainsi conformée et qu’on eût choisi surtout un moment où elle était visiblement en proie à une réelle souffrance.
On coucha la mariée, et une garde-malade s’installa à côté d’elle. Le lendemain, en se réveillant à demi de la torpeur dans laquelle elle avait été comme ensevelie, Emmelina appela Jeanne. Ce fut une figure inconnue qui se présenta. Ainsi, tout était chagrin pour une âme qui n’avait pas besoin d’être violemment secouée pour être anéantie.
Emmelina voulut se lever. On se récriait. Elle insista en pleurant. Enfin l’on céda, et à demi habillée, elle se traîna jusqu’à la fenêtre, et leva le rideau. On devine ce qu’elle allait chercher.
Au lieu de voir la mansarde et l’ouvrier, elle aperçut le jardin de son hôtel.
Elle se laissa aller dans les bras de la femme qui la soutenait et perdit toute connaissance. On cria, on appela, on porta la comtesse sur son lit. Le médecin accourut et secoua la tête.
Ce qui se passait depuis la veille ne créait pas une maladie mortelle, mais développait rapidement toutes les causes de dissolution déposées par une constitution viciée dans ce pauvre être.
Au milieu de la journée, le comte Cabarot vint demander des nouvelles de sa femme. Il renvoya les gens de service, s’établit près du lit, puis au bout d’une demi-heure il rappela les domestiques et s’en alla.
Le médecin avait eu raison de secouer la tête. La comtesse traîna encore huit jours. Tous les matins, elle faisait ouvrir sa fenêtre pour voir si elle apercevait la mansarde ; puis, trompée, elle soupirait.
Elle ne fit pas une plainte et ne prononça pas un seul mot qui pût donner à connaître ce qui se passait en elle.
Le huitième jour, elle mourut.
Le comte Cabarot lui fit des obsèques magnifiques. Il héritait de tout ce qu’elle avait apporté en dot. Par suite de sa prudence et de ses bons procédés, il obtint de M. Irnois la confirmation des dispositions dernières qu’avant de mourir Emmelina avait signées en sa faveur.
La mère, les tantes, le père tombèrent dans un chagrin qu’on ne saurait exprimer ; mais chacun autour d’eux les trouvait plus à féliciter qu’à plaindre.
– Ce n’était vraiment pas une femme, disaient les voisins en levant les épaules.
Les voisins avaient raison. Mlle Irnois était une âme. Sa vie n’avait pas été pareille à l’existence ordinaire des enfants des hommes. Si, par un hasard difficile, j’en conviens, elle eût pu rencontrer ce que réclamait son organisation, un amour angélique comme le sien, elle eût peut-être atteint à une intensité de bonheur que pourront comprendre ceux qui savent à quel point de perfection arrivent les facultés laissées aux gens mutilés.
Les aveugles entendent mieux que personne ; les sourds voient plus loin.
Emmelina n’avait que le pouvoir d’aimer, et elle aima bien !
SOUVENIRS DE VOYAGE
LE MOUCHOIR ROUGE
Céphalonie est une île charmante. Je pourrais vous rappeler ce qu’en dit Homère, mais son héros n’ayant aucune relation avec Sophie, je ferai tout aussi bien de glisser sur l’opinion de l’auteur de l’Odyssée. Les Vénitiens s’étaient rendus maîtres de ce pays-là de toutes les manières. Ils y avaient apporté leurs lois et implanté leurs mœurs, qui n’en sont plus sorties, vivaces de telle sorte qu’elles ont survécu à la domination de Saint-Marc. Quand on se promène dans la rue principale d’Argostoli, on ne manque pas de remarquer des maisons où le style de Palladio a été reproduit de cinquième, ou sixième main par un élève architecte peu maladroit ; et bien que les arcades n’aient pas la majesté des grandes arcades ouvertes au rez-de-chaussée du palais Mocenigo ou du palais Vanier, bien que les fenêtres à grands cintres, couronnées de guirlandes massives, n’aient pas tout à fait l’air somptueux de leurs modèles sur le canal Grande, bien que, surtout, les édifices que l’on contemple manquent de largeur et d’ampleur, possédant rarement plus d’un étage, encore est-il, que l’on retrouve là un souvenir vivant. et juste, quoique rapetissé, de l’ancienne souveraine de l’Adriatique. Perpendiculairement à, cette rue que je décris. et dont la chaussée est rayée à l’italienne de deux larges lignes de dalles, s’ouvrent des ruelles étroites, obscures, assez mystérieuses, serpentantes, qui ne sont pas moins caractéristiques que la voie tout ouverte et toute droite à laquelle elles aboutissent ; celle-ci représente l’élégance et la gaieté italiennes, les autres en figurent l’astuce et les dangereuses réserves.
Dans la grande rue, au coin d’une des ruelles, existe un hôtel, un des plus beaux de la ville. Il appartient, comme il a toujours appartenu, à la famille des comtes Lanza, une des plus illustres maisons de l’île. Je ne crois pas qu’elle soit fort ancienne ; tout est neuf dans ce vieux pays ; mais vers la fin du dix-septième siècle, un certain Michel Lanza, le héros de sa race, fut anobli par un décret du grand conseil, et même créé chevalier de Saint-Marc ; il donna naissance à une lignée d’avocats et de médecins redoublés, qui s’appelèrent à tout jamais les comtes Lanza, firent fortune, se signalèrent par une avarice sordide, prêtèrent leur argent à gros intérêts aux bourgeois, aux ouvriers, aux paysans frappés de respect, et prirent rang, de l’aveu général, parmi les cinq ou six maisons citées comme les plus respectables et les plus illustres des îles vénitiennes. Tant que la République régna, ces seigneurs, médecins et avocats, furent toujours des premiers admis à la table des provéditeurs, quand ces dignitaires donnaient à souper ; les capitaines des galères se faisaient un honneur de les inviter à leurs fêtes navales ; il ne se jouait pas une partie de pharaon en bonne compagnie qu’ils n’en fussent priés ; quant à eux, de mémoire d’homme, ils ne donnèrent jamais un verre d’eau à qui que ce soit, ce qui confirma leur réputation méritée de patriciens prudents et avisés.
Quand le dernier doge se fut décoiffé de la corne ducale et que les îles Ioniennes ne surent plus à qui se rendre, le comte Jérôme Lanza devint le point de mire des espérances de ses compatriotes. Tout le monde se tourna vers lui dans l’attente de ce qu’il allait faire, et la patrie effarée sollicita ses conseils. Il ne trompa pas les espérances. Le front grave, la bouche serrée, il lui arriva de hocher la tête d’un air composé qui donna beaucoup à réfléchir. Il fut dévoué aux Français, très dévoué aux Russes, extrêmement dévoué aux Anglais, et professa toujours hautement l’opinion que la domination qui précédait celle sous laquelle il parlait avait été désastreuse et bien heureusement remplacée. Les pouvoirs successifs le considérèrent comme un homme sûr et comme un grand citoyen ; il avait reçu la croix de la Légion d’honneur de l’empereur Napoléon Ier ; il devait à l’estime de l’empereur Alexandre la croix de Sainte-Anne, et la reine Victoria jugea que c’était honorer la croix de Saint-Georges que de la lui offrir. Il l’accepta avec une modeste fierté. Du reste, il était de mœurs simples, et allait dans les rues en habit noir râpé, en cravate d’un blanc douteux, quelquefois en pantoufles, fidèle en cela au laisser-aller italien, et toujours sans le moindre ruban à sa boutonnière. On lui en savait gré.
Le comte Jérôme Lanza avait au fond du cœur des passions fortes, et s’il était, en réalité, assez indifférent aux affaires des autres, il ne l’était nullement, tant s’en faut, à ses intérêts, ses plaisirs et ses affections. Peu de semaines après son retour de Padoue, où il avait reçu ses degrés et pris ses licences, il avait rencontré chez une de ses cousines, une nouvelle mariée, la comtesse Palazzi, dont la première vue le frappa singulièrement. Ce fut le coup de foudre dont les gens qui raisonnent sur l’amour ont tant parlé. Lanza était, à cette époque, fort agréable, causait bien, chantait avec plus de goût naturel que de savoir, en somme semblait tout à fait digne de plaire, et il plut. Un an s’écoula à peine, et madame Palazzi venait d’avoir son premier enfant que, devenu l’ami intime de l’époux, il se trouva installé dans tous les droits, devoirs, prérogatives, jouissances, immunités et douceurs d’un état qui devait durer sa vie entière. Dans ce côté de son existence, il porta un dévouement qui dépassa l’ordinaire. Il ne voulut jamais se marier, il paya deux fois les dettes de Palazzi, qui se laissa successivement égarer par une cantatrice et par une certaine miss Julia Boyle, venue à Céphalonie sur le même navire que l’état-major du 84e des highlanders ; circonstance extraordinaire due à des malheurs de famille, comme l’expliquait ce pauvre Denys Palazzi, qui ne douta des mérites et des vertus de sa Julia que lorsqu’il eut rencontré une dame de Paris ; celle-ci lui fit faire du chemin. Jérôme Lanza montra dans ces occasions une douceur et une patience égales à sa générosité. Il ne s’emporta jamais contre son ami et se chargea même du fils premier-né, Spiridion, charmant jeune homme, qui, avec le temps, devint l’accessoire indispensable du principal café d’Argostoli, d’où il ne bougeait, et où l’on pouvait le trouver à toute heure en face d’une tasse de café ou d’un verre d’eau. Mais la favorite avouée du comte Jérôme, c’était Sophie Palazzi, de deux ans plus jeune que son frère. Chacun savait dans la ville que son parrain ne s’était pas marié en grande partie à cause d’elle, et on la considérait comme son héritière assurée, ce qui n’était pas sans rehausser sensiblement l’éclat de ses perfections aux yeux des gens raisonnables.
La mère de cette jeune merveille, madame Palazzi, avait été très belle, un peu grasse, un peu lourde, des yeux de gazelle plus doux que vifs et plus vifs qu’intelligents ; mais en somme tout cela constituait une grande beauté à la manière méridionale, et le comte Jérôme n’avait pas eu tort. L’étroite union de ces deux personnes paraissait des plus heureuses. Toutefois, les mauvaises langues assuraient que ce ciel n’était pas, non plus que les autres, exempt d’orages. Il est certain que vers 1825, après de longues années déjà de la plus belle passion de la part des deux amants, les curieux avaient constaté certains faits, dont on ne parlait d’ailleurs qu’avec beaucoup de prudence, et qui, dégagés des exagérations, se réduisaient à peu près à ceci :
Il était arrivé de Paris un jeune homme de l’île, qui venait d’y terminer son éducation. C’était un fort beau garçon ; on le nommait le comte César Tsalla ; ne vous étonnez pas de tous ces comtes : soit dit en passant, les Vénitiens en avaient peuplé leurs territoires ioniens. Le comte César avait été formé par une société choisie de ces dames aimables qui accueillaient si bien la jeunesse étrangère à la Grande-Chaumière et ailleurs. Il avait été fort distingué par des personnes sensibles et avait conçu de lui-même une assez bonne opinion. Madame Palazzi lui parut charmante ; il ne vit aucune raison de le lui cacher ; Jérôme Lanza en témoigna un peu d’humeur ; César n’en devint que plus insistant ; Madame Palazzi ne laissait pas que de rougir quand elle le rencontrait ; était-ce de plaisir, était-ce d’impatience ? C’est ce qu’il serait assez difficile de décider, et peut-être serait-il arrivé de grands troubles dans la maison de Denys Palazzi, qui lui-même commençait à regarder un peu de travers la nouvelle connaissance de sa femme, si tout à coup, subitement, et sans que l’on pût savoir ni comment, ni pourquoi, le beau César disparut.
On s’en étonna. Les Vénitiens étaient gens contenus et prudents, et les descendants de leurs anciens sujets le sont de même. On fit des observations, mais sous la couverture. Personne ne s’avisa d’aller interroger Jérôme Lanza, dont la physionomie avait repris la plus grande sérénité. On sut d’ailleurs que le comte Tsalla était à Pétersbourg, où il avait pris du service dans les chevaliers-gardes. Cette nouvelle fit beaucoup rire Palazzi, quand on lui en parla au café, et il bouffonna si bel et si bien sur ce sujet, que tous les soupçons revinrent. Ils augmentèrent davantage quand on fit courir le bruit qu’un certain Apostolaki, grand gaillard redouté, qui n’avait, d’autre profession que d’accompagner de loin le comte Jérôme dans ses promenades et de dormir dans sa cour après avoir soupé à sa cuisine, s’était vanté au cabaret d’avoir fait un coup d’autant plus beau que personne n’en saurait jamais rien. Des lettres de Pétersbourg apprirent à qui voulut l’entendre que le comte César n’avait jamais paru dans cette capitale, à plus forte raison que les chevaliers-gardes ne le possédaient pas dans leurs rangs. À force de chuchoter entre Céphaloniotes, on finit par admettre quelques Anglais dans la confidence ; d’ailleurs Jérôme Lanza, comme tous les grands hommes, n’était pas sans compter des ennemis secrets ; et finalement, un beau matin, le comte fut invité par le commissaire britannique à venir lui parler.
Les Européens apportent dans leurs affaires une précision qui a toujours paru souverainement ridicule, grossière et répugnante aux Orientaux, et il faut avouer que rien n’est plus désagréable que certaines questions. Cependant le comte Jérôme se tira parfaitement de l’indiscrète insistance du général. Il repoussa avec l’indignation qui convenait à un homme de sa naissance les soupçons odieux jetés sur sa moralité ; il défia qu’on pût lui présenter aucune preuve, et en effet il n’y en avait pas ; il parla avec émotion de sa vie consacrée tout entière à faire le bien, et rappela délicatement le dévouement sans bornes dont il avait donné tant de marques au trône de la Grande-Bretagne et d’Irlande. Il conclut, dans une péroraison véhémente, en faisant observer à son grave interlocuteur que ceux qui prétendaient noircir sa réputation appartenaient tous à ce détestable parti d’anarchistes et de démagogues, si répandu alors dans toute l’Europe et qui tendait visiblement, dans les îles Ioniennes, à ébranler l’autorité légitime du lord haut-commissaire. Soit que le fonctionnaire anglais ait été sensible à ce cri de l’honneur méconnu, soit, ce qui est beaucoup plus probable, que, dans l’absence de preuves, il ait été étourdi par les déclamations, les attendrissements, les indignations et le flux de paroles du comte Jérôme, il est sûr qu’il lui serra la main avec effusion, et l’invita à dîner pour le jour même. Quant à Jérôme, il déploya une grandeur d’âme qui lui gagna tous les cœurs. Il fit remettre dix thalaris à une parente éloignée du comte César, dont la position était fort misérable. Il n’en est pas moins vrai qu’on ne sut jamais ce qu’était devenu le trop aimable jeune homme. La comtesse Caroline Palazzi resta tout aussi placide qu’auparavant, commença à engraisser, devint très grosse en peu d’années, et persista dans un attachement imperturbable pour le comte Lanza, dont on prétendait qu’elle avait un peu peur.
En 1835, les charmes de cette belle, absolument noyés dans les exagérations d’une santé exubérante, n’existaient plus qu’en souvenir dans l’âme fidèle de son heureux amant ; mais Sophie était devenue adorable, et une Vénus antique n’était pas mieux faite : Elle avait les yeux de sa mère avec le feu sombre qui manquait à ceux-là ; beaucoup de calme, mais quelque chose sous son silence ; un nez aquilin, qui avec le temps devint un peu trop courbé, mais dont on était contraint d’admirer la noblesse ; des pieds, des mains à faire crier au miracle, et des dents comme deux fils de perles. Sa mère la regardait avec assez de complaisance ; son père Palazzi empruntait de l’argent à Jérôme pour être en état de ne lui rien refuser, et Jérôme, son parrain, restait en contemplation devant elle pendant des heures entières, livré à une sorte d’adoration extatique.
Cette félicité était de nature à se prolonger éternellement, quand un accident vint la troubler. Toute la bonne compagnie d’Argostoli et les officiers anglais fréquentaient le salon de la comtesse Palazzi. Chaque soir on y faisait le whist, et quelquefois les jeunes gens y dansaient ; d’autres fois encore ils y jouaient à une quantité de jeux innocents, où l’on se parle bas à l’oreille, et d’ordinaire l’hiver ne finissait pas sans quelques mariages. Un soir, Jérôme Lanza était particulièrement de bonne humeur, presque gai ; il venait d’avancer à trois lieutenants leur solde du mois ; on était au 24, et naturellement c’était un acte d’obligeance dont il, se savait gré. Il l’accomplissait souvent ; la garnison le connaissait bien ; tout le monde y gagnait, lui surtout. Il se sentait donc le cœur dilaté quand son regard tomba par hasard sur un groupe de jeunes gens, dont l’un lui parut considérer avec une attention soutenue sa chère Sophie.
C’était un grand garçon, mince et de tournure distinguée. Ses yeux trahissaient, malgré lui, là préoccupation la plus tendre. C’en était assez pour que le vieux comte prît garde ; mais tout à coup il pâlit légèrement, ses lèvres minces se serrèrent, il lui passa comme un nuage au-dessus du cerveau.
– Quel est ce charmant jeune homme ? demanda-t-il d’un air gracieux au chevalier Alexandre Paléocappa, qui se bourrait le nez de tabac à côté de lui.
– Ne le connaissez-vous pas ? C’est Gérasime Delfini, le fils de Catherine Delfini, si ravissante il y a quinze ans, qui faisait les beaux jours de Zante, et avec qui notre ancien ami César Tsalla a été si lié. Vous vous souvenez bien de César Tsalla, pauvre diable ! dit en terminant l’imbécile. Et il s’enveloppa le visage dans un immense mouchoir de coton bleu pour étouffer, mais trop tard, le plus sonore des éternuements.
Pendant que ce bout de conversation avait lieu, Gérasime Delfini s’était mis au piano et chantait un air du poète et musicien zantiote Solomo, d’une voix qui parut à Jérôme Lanza produire l’impression la plus vive sur la belle Sophie. D’un regard qui ne pouvait pas se tromper, il aperçut en quelque sorte le cœur même de sa filleule, il le vit battre, il en compta les palpitations précipitées. Sans qu’elle s’en aperçût, tant elle était absorbée, ce regard, le plus incisif et le plus aigu de tous les regards, entra dans ses yeux, et y trouva et y vit des larmes et s’y brûla ; il entra dans cette tête charmante, que l’aile de la passion touchait et courbait légèrement du côté de la voix séductrice ; il y découvrit, il y saisit en flagrant délit d’existence ce monde de pensées que l’amour demande et que la jeunesse tient toutes prêtes. Enfin, il acquit la conviction absolue que Gérasime aimait Sophie, et que Sophie le lui rendait de tout son cœur.
On peut se demander s’il avait éprouvé une douleur plus poignante le jour où la fidélité de la mère lui parut douteuse. Quand chacun fut parti et qu’il se trouva seul dans le salon avec madame Palazzi, il lui dit :
– Par quelle singulière idée, ma chère, admettez-vous dans votre salon ce Gérasime Delfini ?
– On me l’a présenté il y a quinze jours, répondit la comtesse en rougissant légèrement, ce qui lui arrivait toutes les fois qu’elle supposait Jérôme Lanza un peu fâché. Il est le neveu de madame Barretta, qui a des parents à Zante, et il est venu passer un mois ici. Je n’en sais pas plus long sur son compte. Je crois seulement ; mais je n’en suis pas sûre, que Sophie l’a rencontré quelquefois chez ma sœur.
À ces paroles prononcées avec la nonchalance qui lui était particulière en tout temps, mais qui arrivait à son apogée dans les moments où elle avait envie d’aller se coucher, le vieux sigisbée éprouva un tel mouvement d’impatience, qu’enfonçant les deux mains dans les poches de son pantalon, il se promena quelque temps à grands pas, faisant une méditation sur ce texte sévère : Brutta bestia ! Quand il fut un peu calmé, il prit une chaise, l’approcha du fauteuil dans lequel était plongée Caroline, et, non sans un certain luxe de gesticulation nerveuse, échangea avec elle ces paroles ailées :
– Vous ne savez donc pas que votre Delfini est le parent, disons tout, le fils de votre …non ! de ce misérable… Je veux dire de M. Tsalla ?
– Comment donc ? comment donc ? que voulez-vous dire ?
– Je veux dire ce que je dis, et je ne parle pas au hasard. Vous n’avez pas fait attention que ce monsieur fait les yeux doux à Sophie ?
– Il n’est pas le seul, murmura apathiquement la comtesse.
– Et vous ne voyez pas que cette petite sotte de Sophie… mais non ! je ne veux pas le croire ! je ne veux pas y penser ! Ce serait trop affreux ! Être trahi deux fois dans sa vie dans une affection pareille ! et par qui, grands dieux ! Ne répondez pas, ne répondez pas, ma chère âme ; prenez que je n’ai rien dit ! Je ne vous accuse pas, je ne l’accuse pas ; je ne sais rien, je ne crois rien, je ne me doute de rien ! Êtes-vous contente ?
– Pas trop, répliqua la comtesse un peu secouée à la fin par cette véhémence acrimonieuse. Je ne sais pas ce que vous voulez dire ; vous roulez des yeux à faire peur, vous vous donnez du poing dans la tête et sur les genoux. Enfin, qu’est-ce que vous voulez ? Est-ce que je pouvais me douter que M. Delfini vous déplairait ?
– Me déplaire ! mon Dieu ! Elle appelle cela me déplaire ! Ah ! les femmes ! les femmes ! Qui est-ce qui a donc dit que les femmes… Je ne sais pas qui l’a dit, mais c’est vrai ! Et cet homme-là, avec ses yeux de charbon et cette ressemblance atroce, car tout d’abord elle m’a saisi, elle m’a poignardé, j’ai failli tomber à la renverse et m’évanouir, je vous le jure ! Eh bien, cet homme-là, il ne vous remue pas les entrailles, il ne vous fait pas horreur ? Qu’est-ce que vous avez donc dans les veines ? du lait bouilli ? quoi ?
– Enfin, que demandez-vous ? qu’ordonnez-vous ? Si vous vous expliquiez du moins, on pourrait vous complaire, mon amour.
– Je ne veux plus rencontrer ce fantôme-là chez vous, et il faut, dès demain matin, que vous défendiez à votre fille de lui parler jamais.
– Allons, méchant, dit la comtesse en se mettant sur ses pieds et en prenant son bougeoir, on fera ce que vous commandez.
Jérôme, un peu plus calme, lui baisa la main et s’en retourna chez lui.
Il était midi environ quand Sophie entra chez sa mère pour s’informer de ses nouvelles, et la trouva prenant son café et fumant une cigarette. Elle paraissait un peu plus soucieuse que d’ordinaire, ou du moins plus pensive ; car je suis obligé d’avouer que la divine Sophie avait de celle qui l’avait mise au monde une opinion assez peu flatteuse au point de vue de l’esprit. Elle se demandait donc ce qui pouvait se passer d’inusité dans cette tête, quand la tête parla.
– Je voudrais te dire une chose, Sophie, mon enfant.
– Dites, ma mère.
– Mais je vais te contrarier.
– Je ne sais pas ce que vous entendez par là.
– Est-ce que Gérasime te fait la cour ?
Sophie regarda sa mère fixement et ne crut pas devoir l’honorer de sa confiance.
– Pas plus qu’à une autre, je pense, répondit-elle.
– C’est que ton parrain ne veut plus qu’il vienne ici, et je lui ai écrit tout à l’heure que nous partions pour Corfou et qu’il ne prît pas la peine de se présenter ; comme il saura que nous ne sommes pas parties, il comprendra, et tu ne le verras plus.
Je ne trouve pas cela très poli ; qu’a-t-il fait de mal ?
– Il n’a rien fait de mal, et je le crois un garçon honnête et de mérite. Mais, entre nous, il déplaît à ton parrain. Il est d’une famille qui s’est montrée fort ingrate pour notre excellent Lanza ; le comte souffre à voir ces gens-là chez nous, et nous ne devons pas le contrarier. Il est parfait pour ton père ; tu sais combien il nous a rendu de services, et tu dois hériter de lui. Je te prie donc, si tu as quelque penchant pour Gérasime, de n’y plus penser, parce que cela ne servirait à rien.
Sophie prit sa tapisserie, qui représentait au naturel un épagneul vert couché sur un coussin rouge, au milieu d’un fond blanc, et ne répondit pas un mot. Caroline fut, au fond, ravie de voir que les choses eussent passé si aisément.
Je ne sais si la journée parut longue ou courte à la jeune demoiselle : mais le soir, à la nuit tombante, elle se montra à demi dans l’embrasure d’une fenêtre étroite donnant sur une de ces ruelles tortueuses dont j’ai déjà parlé. Par hasard, sans doute, Gérasime vint à passer, et tout à coup, ce qui ne pouvait pas être un hasard, un petit paquet tomba brusquement au milieu de la chambre. Sophie courut le ramasser. C’était du papier cerclé d’une ficelle, sous lequel il y avait une lettre, et une pierre pour donner plus de consistance au tout. Sophie s’enferma bien vite, et lut ce qui suit : « Mademoiselle, pourquoi les paroles ne sont-elles que des paroles et non pas des flammes et des épées, pour vous rendre un compte plus fidèle des tortures que j’éprouve et de la douleur dans laquelle je suis plongé ! Ne plus vous voir, ne plus vous entendre, ne plus vous parler ! Ah ! Sophie ! plutôt mourir mille fois et de suite, à l’instant, du genre de mort le plus atroce, et ne pas souffrir un martyre pareil ! Votre mère, cruelle et sans âme (pardonnez-moi ce blasphème, ange adoré, qu’une trop juste indignation arrache à mon âme ulcérée !), votre mère n’a donc jamais connu la pitié, puisqu’elle me repousse ainsi loin de vous ? Mais qu’ai-je fait ? De quoi suis-je coupable ? J’allais aujourd’hui même lui demander votre main. Je croyais que mille raisons existaient qui pouvaient me la faire obtenir ; mon rang, ma fortune, une existence dévouée à l’amour de la patrie souffrante, tous ces sentiments généreux que je sens brûler dans mon âme et que vos vertus eussent encore fait grandir ! Pourquoi m’écarter avec cette violence ? Ah ! Sophie, ma Sophie vous m’avez permis de vous aimer, de vous le dire, de tout espérer ; me faut-il perdre à jamais cette couronne de gloire dont j’allais me parer et qui m’aurait fait le plus heureux des hommes ?… »
Il y en avait huit pages sur ce ton-là, mélange très naturel, dans le Midi, de sentiments parfaitement vrais que l’emphase de l’expression rend un peu ridicules pour les gens du Nord. Il y avait aussi des vers, des protestations d’un amour inébranlable, l’assurance qu’il écrirait encore le lendemain et tous les jours, une prière fervente de ne pas l’oublier et le serment de vaincre toutes les résistances par la fermeté de sa résolution ; bref, Sophie fut contente de Gérasime, se dit mille fois qu’elle était aimée, et ne souffla mot de tout ceci.
Deux jours après, Gérasime était assis sur le port dans une attitude mélancolique, lorsque le comte Lanza vint à passer. Celui-ci l’aperçut, vint à lui, le salua avec amitié, et, de la voix la plus affectueuse, lui demanda pourquoi on ne le voyait plus chez la comtesse Palazzi.
Gérasime commença par donner les défaites ordinaires en pareil cas, et ne s’expliquait pas autrement, quand le diable voulut qu’il se rappelât tout à coup, non pas les bruits qui avaient couru sur la disparition du comte Tsalla, mais l’histoire des dix thalaris donnés jadis à une de ses tantes. La vérité est qu’il avait besoin d’espérer comme de respirer l’air, et qu’il cherchait à se rattacher à n’importe qui et à n’importe quoi. Les moindres apparences de bienveillance lui eussent. suffi pour lui faire croire à une sympathie dont il avait soif ; il se figura, parce qu’il en mourait d’envie, que cet admirable comte Lanza, qui avait donné dix thalaris à sa tante autrefois, et qui lui parlait avec une si onctueuse affection, était un ami que le ciel lui envoyait tout parfumé d’intentions excellentes, et, d’abondance de cœur, sans rien omettre, avec le luxe d’expressions colorées qu’il employait dans son style épistolaire, il lui raconta son histoire d’un bout à l’autre.
Il lui raconta que son inclination pour Sophie avait commencé, il y avait un an, jour pour jour, à la campagne, à Zante, où la jeune fille était allée passer trois semaines avec sa mère. La jeune demoiselle s’était vite laissé persuader, Gérasime en convint, avec des transports de reconnaissance et d’amour qui excluaient jusqu’au soupçon d’une vanité quelconque. Il répéta mille fois que ses vues ne rendaient qu’à demander sa main à deux genoux, à l’obtenir, s’il le pouvait, et qu’il ne comprenait pas pourquoi la comtesse Palazzi l’avait si brusquement exclu de son cercle, sans qu’il eût quoi que ce soit à se reprocher.
– Je ne le comprends pas non plus, mon jeune ami, dit le vieux Jérôme en secouant la tête d’un air de commisération douloureuse. C’est un fait complètement inexplicable pour moi ; du reste, je veux plaider votre cause auprès de la mère, et vous connaissez trop bien ma fidèle amitié, mon attachement sans bornes à votre famille, pour ne pas être sûr d’avance de mon zèle à défendre vos intérêts. Mais il serait bien important de connaître la cause de votre malheur. Caroline Palazzi n’est pas capricieuse ; il faut que quelqu’un vous ait calomnié. Peut-être avez-vous un rival ?
Le malheureux Gérasime secoua les épaules pour exprimer sa profonde ignorance, et rejeta la tête en arrière, geste turc qui implique toutes les négations possibles, puis ramenant ses regards sur son confident, une idée lui traversa l’esprit. Il lui trouva, au milieu de ses grimaces sympathiques, un zest de goguenarderie qui l’épouvanta. Il lui sembla, dans un éclair de soupçon, qu’il marchait sur quelque chose de dangereux, et cette pensée s’empara si bien de lui, que la conversation changea absolument de caractère.
– Enfin, continuait Jérôme, il ne faut pas. vous décourager, mon enfant. Vous aimez Sophie, vous en êtes aimé, c’est là le principal ; j’ai été jeune comme vous, et la victoire finit toujours par rester aux amants. Sans doute vous avez gardé un moyen quelconque de correspondre avec la jeune fille ? Je ne vous fais pas cette injure de croire que vous négligerez une précaution si nécessaire. C’est d’ailleurs un plaisir si doux ! Comment communiquez-vous ensemble ?
– Hélas ! jusqu’à présent il m’a été absolument impossible de lui rien faire dire, et pas davantage d’en recevoir un encouragement quelconque.
– Vraiment !
– Je vous le jure. À quoi me servirait-il de feindre avec vous, qui êtes mon unique soutien dans le monde ?
– En effet, je le suis et n’en doutez jamais. Vous passez bien cependant quelquefois sous les fenêtres de Sophie ?
– Je n’ai osé le faire qu’une fois, et je n’ai pas été assez heureux pour l’apercevoir.
– Voilà qui, est tout à fait fâcheux. Je ne peux pas supporter que les choses restent ainsi. Tenez ! entrons chez vous. Écrivez de suite quelques lignes pour tranquilliser la pauvre enfant. Ne lui dites rien, bien entendu, qu’un homme de ma sorte ne puisse avouer. Je lui glisserai adroitement cette consolation sans que sa mère en sache rien, et avant la fin de la semaine j’espère avoir arrangé les choses de manière que l’affaire soit devenue ce que nous pouvons la souhaiter.
Gérasime était tombé dans un état lamentable ; d’un côté, il désirait avec passion s’abandonner à Jérôme ; de l’autre, il s’en méfiait horriblement depuis une minute. Il lui avait parlé avec la candeur la plus absolue ; mais aussi il lui avait fait des contes bleus ; s’il avait eu tort d’être sincère, quels malheurs n’allaient pas en résulter peut-être pour Sophie elle-même ? Si ; au contraire, il avait fait une sottise en se défiant, ses mensonges retomberaient sur sa tête, et pour peu que Jérôme s’en aperçût, celui-ci aurait le droit de se piquer, qui sait même ? de le traiter en ennemi. Maintenant, fallait-il donner une lettre ? ne fallait-il pas la donner ? Que croire ? que penser ? qu’imaginer ? que résoudre ? que faire ? Il y avait plus de tapage et d’agitation dans sa tête que dans un haut fourneau où vingt foyers lancent des colonnes de flammes, où le fer en fusion grésille et où, vingt marteaux gigantesques battent tous ensemble à contre-mesure au bruit étourdissant des chutes d’eau qui les font mouvoir. Au milieu de ses incertitudes, il se laissa aller, et, tout en se demandant s’il était prudent d’écrire, il écrivit. Il avait une malheureuse disposition native pour les plumes et l’encre. Il écrivit à sa manière onze pages de divagations amoureuses, de promesses de mourir, d’exclamations fulminantes, et par une conséquence assez naturelle de son tempérament, tout en étant très exalté, il eut grand soin de ne rien dire qui impliquât nécessairement le contraire de ce qu’en dernier lieu il avait affirmé à Jérôme et qui n’était nullement vrai, comme vous le savez. Il se méfiait que son confident ne remettrait pas la lettre ; il se tenait à peu près sûr qu’en tout cas il la lirait, mais il avait eu à l’écrire un plaisir excessif, et dût-elle ne jamais arriver dans les mains adorées de Sophie, c’était quelque chose que d’avoir pu encore une fois mettre sur du papier ces phrases de roman qui dépeignaient si bien et si agréablement à leur auteur l’état intéressant de son âme.
Le comte Jérôme, qui, pendant le temps que Gérasime écrivait, avait paru lire avec componction la traduction d’un discours du général Foy sur la liberté des peuples, reçut enfin la précieuse épître des mains de son protégé, embrassa celui-ci avec effusion sur les deux joues, en le pressant contre son cœur, et dans une péroraison que l’amoureux aurait trouvée sublime s’il n’avait pas eu des doutes véhéments sur l’honnêteté de l’orateur, celui-ci paraphrasa la généreuse maxime : Vaincre ou mourir ; puis il alla trouver madame Palazzi, et eut avec elle un entretien qui dura au moins deux heures, et à la suite duquel Sophie fut appelée chez sa mère.
Le comte était parti. Madame Palazzi, roulant son chapelet dans ses mains d’un air fort ennuyé, n’eut pas ouvert la bouche qu’à ses premiers mots Sophie décida ceci : Ma mère récite une leçon.
– Ma bonne petite, dit la belle Caroline, ton parrain est fort en colère. Il m’a appris des choses épouvantables. Le jeune Delfini parle de toi de la manière la plus offensante ; il prétend que tu l’adores, que tu lui as donné une chaîne de montre en cheveux, de tes propres cheveux, où il suspend un cœur en or percé d’une flèche sur lequel il y a écrit Sophie ; et, en plein café, il a lu ce matin à tous les jeunes gens de la ville une lettre qu’il t’adresse, et qui est un tissu d’impertinences. Il a poussé l’étourderie à ce point de laisser cette lettre à un de ses amis, entre les mains duquel le comte l’a trouvée et l’a prise… Tu devrais bien ne pas encourager ce jeune homme.
Caroline s’arrêta et regarda un peu par la fenêtre pour se délasser après un effort comme celui qu’elle venait de faire ; mais sa fille avait compris que tout n’était pas encore dévidé du peloton de fil qu’on avait mis dans les mains maternelles, et qu’il fallait attendre la fin. Elle s’assit donc, reprit la tapisserie du chien vert, et se mit à passer des points avec un sang-froid parfait et dans un complet silence.
– Pour moi, je te dirai, continua Caroline quand elle eut suivi de l’œil pendant quelque temps les âniers descendant vers le port, que je ne comprends pas grand-chose à toute cette histoire-là. Ton parrain n’aime pas Delfini, voilà ce qu’il y a de clair, et cette malheureuse lettre que voici l’a mis hors de lui de colère. Au fond, elle est fort bien écrite cette lettre et je n’y vois rien de très mal.
Sophie continua à broder, sans lever les yeux sur la lettre que sa mère lui montrait et qu’elle vit parfaitement. Madame Palazzi continua :
– Le plus fâcheux c’est que ton parrain veut que nous quittions Céphalonie. Il s’est mis dans la tête d’aller passer deux ou trois ans à Ancône, où il a un cousin employé dans les douanes, et il a persuadé à ton père que c’était la plus belle chose du monde. Tu le sais : ton père ne contredit jamais ton parrain. Mais, ma fille, qu’est-ce que nous allons devenir à Ancône ? Je voudrais bien que cette idée ne fût jamais venue au comte !
– Maman, ne pensez-vous pas que si je faisais la langue du chien d’un vert plus clair, cela vaudrait mieux ?
– Oui, mon enfant ; mais je l’aimerais mieux violette, c’est plus naturel. Me vois-tu d’ici installée à Ancône pour des années ? Qu’est-ce que, c’est qu’Ancône ? Je suis sûre qu’on ne parle qu’anglais dans cette ville-là, et moi qui n’ai jamais pu en retenir un mot ! Je t’assure que nous y mourrons d’ennui. Tu devrais bien trouver un moyen de nous empêcher d’aller à Ancône.
Le lendemain, à dix heures du matin, Gérasime étant assis au café, fut accosté par une petite fille du peuple, très pauvrement habillée, qui lui dit :
– Monsieur, ma cousine Vasiliki m’a chargée de vous dire qu’elle vous priait de faire parvenir ce paquet à mon oncle Yoryi.
Et l’enfant remit à Gérasime une sorte de rouleau de quelques pouces de long enveloppé dans de la toile, puis, sans attendre la réponse, elle s’enfuit.
Gérasime fut un peu étonné. Il avait eu à son service, trois mois auparavant, un certain Yoryi, qui l’avait quitté pour se rendre sur la côte ferme en Acarnanie, où tout portait à croire qu’il exerçait la profession de brigand ; mais instruit de ce fait par les propos de ses camarades, il n’avait avec son ancien domestique aucune relation, et il ne comprenait pas pourquoi on le chargeait d’une commission pour lui. En y réfléchissant, il se rappela pourtant que Vasiliki était cuisinière chez madame Palazzi. Ce fut un trait de lumière ou plutôt une lueur d’espérance, et en songeant à sa lettre de la veille, il pensa que Jérôme lui avait déjà tenu parole, et que Sophie probablement avait trouvé ce moyen, d’accord avec son parrain, d’établir une correspondance. Il se leva bien vite de sa chaise et courut chez lui. Il prit des ciseaux pour découdre la toile du rouleau qui était très fortement cousue, ouvrit le tout, et dans une seconde enveloppe formée d’un vieux journal, il trouva quelque chose qui lui fit une telle et si subite impression que, laissant tout tomber, le contenu du paquet s’étala sur le plancher : c’était un mouchoir de soie rouge, un petit poignard très pointu et un bouquet de violettes fané.
Le bouquet de violettes n’avait pas de mystère, et c’était une signature certaine. Il l’avait donné à Sophie un mois auparavant, et elle lui avait promis de le conserver toujours. Le poignard était un de ces instruments qu’on n’envoie à quelqu’un que pour qu’il s’en serve, et le mouchoir rouge montrait ce qu’il en fallait faire. En langage du pays, c’était aussi clair que l’annonce d’une enseigne en lettres d’or sur une boutique de la rue de la Paix.
Ce qui ne l’était pas autant, c’était de savoir quelle était la victime désignée. En proie à une émotion excessivement violente et très compréhensible, Gérasime s’assit, les deux coudes appuyés sur sa table, pâle comme un mort, pâle comme un homme à qui une femme adorée commande tout droit de tuer quelqu’un, qui trouverait déshonorant de refuser, qui juge bon, utile, nécessaire, indispensable de le faire, mais qui ignore complètement quel est ce quelqu’un, et qui ne laisse pas que d’avoir une arrière-crainte obscure de l’autorité judiciaire, pointe assez piquante au milieu de tant d’autres sensations.
Qui fallait-il tuer ? Là était la question, et plus il l’examinait, plus il devenait perplexe. Car d’aller s’en prendre à une victime innocente, il n’y avait pas d’apparence de bon sens. Ne pas se tromper était essentiel. Mais qui était-ce ? Il fit en quelques instants, au fond de son esprit, une vraie jonchée de cadavres ; puis il les ressuscita successivement, dans l’espérance que ce n’était pas celui qu’il avait cru qui lui était demandé ; et malheureusement sa situation était telle qu’il lui fallait passer en revue comme possibles, comme probables, les actions les plus atroces.
« Voyons, se disait-il avec un frisson, est-ce que ce serait Palazzi que cet ange me désignerait ? »
Palazzi ! Il vit dans son imagination la personne maigre, efflanquée, ravagée, de ce bon vivant caduc. Il vit ses cheveux teints, son chapeau sur l’oreille, son gilet de velours, sa chaîne d’or, sa petite canne à pommeau de cornaline ; il vit surtout son sourire grimaçant, et il entendit sa bouffonnerie favorite.
« Est-ce que Palazzi l’aurait offensée ? Est-ce qu’il s’opposerait à notre amour ? Ah ! le misérable !… Mais pourquoi ? que lui importe ? Il ne s’est jamais mêlé de rien ! Je ne lui ai rien fait. Pour trois ou quatre guinées qu’il m’a empruntées et que je ne l’ai jamais pressé de me rendre, il ne m’aurait pas mis à la porte de chez lui. Ce n’est pas Palazzi, et d’ailleurs, si je le tuais et que ce fût une maladresse, peut-être que Sophie croirait juste de ne pas me le pardonner. Mais à qui donc m’en prendre ? Sa mère ? Cette grosse dame ? Allons donc ! Paléocappa ? Est-ce que, par hasard, il ferait la pluie et le beau temps dans cette maison ? Mais non ! C’est Lanza, et Lanza, bien que je m’en défie, ne m’a fait que du bien. Qui donc, qui donc ? mon Dieu ! »
Il eut une idée. C’était le dimanche matin. Il courut en toute hâte à l’église, et se plaça sur les marches du péristyle au moment où la foule des fidèles sortait des offices. On entendait les derniers chevrotements de la voix nasillarde des popes. Une personne de connaissance passa, puis une seconde, puis une troisième, puis beaucoup. Au milieu de ce monde, il aperçut Sophie marchant d’un air grave et tout à fait édifiant. Elle avait sa mère à droite et son parrain à gauche, et Palazzi, donnant de sa main blanche un tour heureux aux boucles extrêmement pommadées de sa chevelure noire, suivait par-derrière. Gérasime regarda fixement la jeune fille, et d’un air qui en disait beaucoup. Elle comprit, et en passant devant lui avec son escorte, elle ne lui rendit pas son salut ; mais arrêtant ses yeux droit sur les siens, elle les reporta brusquement sur Jérôme Lanza, les ramena sur son amant et parut attendre. C’était clair. Il fit un signe d’assentiment, À la même minute, il se sentit assez vivement poussé par-derrière, et se retournant, il aperçut un homme de mauvaise mine qui, sans s’excuser, lui laissa voir dans sa manche un couteau ouvert, et disparut.
« Ah ! c’est comme ça ! pensa Gérasime. Eh bien ! nous allons voir ! » L’idée de recevoir quelques pouces d’acier dans le corps lui donna de l’activité. Le soir même, il était parti pour l’Acarnanie, et quelques jours après il dînait paisiblement dans une maison de Missolonghi avec Yoryi, dont il était venu prendre les bons conseils. Ce n’est pas qu’il eût eu besoin de se déranger pour ce qu’il avait à faire. Grâce au ciel, à Zante, à Céphalonie, dans toutes les îles, il lui eût été facile, et je crois qu’il le sera toujours à tout le monde, de trouver de braves garçons prêts à faire le chemin libre à leurs amis pour des prix raisonnables. Mais il lui avait été commandé de remettre le mouchoir rouge à Yoryi ; il crut devoir suivre ses instructions à la lettre.
Quand l’amoureux eut raconté à cet excellent homme ce dont il s’agissait et qu’il lui eut fait confidence entière de sa situation, Yoryi fit un geste de surprise que Gérasime remarqua, et dont il lui demanda la raison.
– La raison ? Vous n’avez pas trop besoin de la savoir, lui répondit son confident. Je puis seulement vous dire qu’il y a dans la vie des choses très extraordinaires. Il m’est arrivé, il y a une quinzaine d’années, de travailler avec le vieux Apostolaki et quatre ou cinq autres camarades pour M. le comte Lanza, qui même nous paya bien, je le dis à sa louange ; et maintenant Apostolaki est tout à fait hors de service, deux de nos associés ont été pendus par les Anglais, ce qui fut dommage, et voilà que je m’en vais m’occuper du comte Lanza, et pour qui ? Pour vous ! C’est singulier ; mais il paraît qu’il y a une justice, bien que ce ne soit pas mon affaire.
Il n’en voulut pas dire davantage sur ce point, et passa immédiatement, en homme pratique qu’il était, à l’examen et à la discussion des moyens d’accomplir de la façon la plus satisfaisante la mission dont Gérasime lui faisait l’honneur de le charger.
À une semaine de là, c’était dans la nuit du lundi au mardi, et il pouvait être minuit à peu près, le comte Jérôme Lanza, précédé d’une servante portant un falot, tournait une petite rue étroite par laquelle il passait d’ordinaire lorsque, revenant de chez Madame Palazzi, il regagnait sa demeure, quand il se vit subitement entouré par cinq hommes, dont quatre étaient ou lui parurent de très haute taille, et il fut tout d’abord terrassé par un coup violent sur l’épaule ; presque immédiatement il en reçut un second, puis un troisième, et au moment où il distinguait une figure plus mince que les autres, mais couverte d’un voile, qui se penchait sur lui, il s’évanouit complètement.
La petite servante eut sa lanterne cassée ; mais elle avait eu l’instinct de pousser des cris affreux ; quelques fenêtres s’ouvrirent ; en voyant ce dont il s’agissait, personne ne se pressa notablement d’intervenir ; mais enfin les assassins ayant disparu, on se risqua, on alla chercher la garde, le policeman fut averti, il vint avec son camarade. On courut prévenir le commissaire anglais ; on réveilla Madame Palazzi, qui marqua beaucoup d’étonnement et versa d’abondantes larmes avant de se décider à se mettre en route avec sa fille ; Palazzi serait bien accouru de suite, mais on ne put le trouver nulle part ; ce ne fut que le lendemain qu’il apprit cet événement en revenant d’une partie de campagne.
Le vieux comte était étendu dans son lit, la tête cassée, les bras et les jambes fracturés en plusieurs endroits, et un beau coup de poignard au travers du corps. On avait ramassé sur les lieux une sorte de massue en bois noueux, garnie de gros clous la pointe en l’air. Le juge présuma et le greffier consigna dans son procès-verbal que les meurtriers avaient fait usage de cet engin de destruction sur la personne du malheureux Jérôme. Il le pensa également, donna d’une voix faible plusieurs renseignements ; mais quand on lui demanda s’il avait reconnu ses assassins, il répondit qu’il n’avait distingué personne, et on ne put le tirer d’un mutisme absolu sur cette question, cependant intéressante. Il est d’usage en pareil cas que les gens maltraités pèchent plutôt par excès que par faute de soupçons ; ils soupçonnent tout le monde, et, si on les en croyait, on arrêterait toute une ville. Le vieux Lanza fit exception à la règle, et se refusa à désigner qui que ce fût, ce qui parut extraordinaire. Les médecins déclarèrent qu’il était atteint mortellement, et que ce serait beaucoup s’il vivait quelques heures encore. On se décida à le laisser tranquille.
Quand il se vit seul avec Madame Palazzi et Sophie, qui pleuraient à sanglots sans s’arrêter, le comte dit à son amie :
– Ma chère, c’est Gérasime qui me tue. Je l’ai reconnu au moment où il se penchait sur moi, bien qu’il eût un voile sur la figure. Je ne veux pas que la justice se mêle de cette affaire-là, qui ne la regarde pas ; mais, au contraire, si l’on venait à trouver quelques traces compromettantes, vous allez me jurer de faire tous vos efforts pour innocenter Gérasime. Vous direz, sous serment, que vous savez son innocence. Puis vous prendrez dans ma maison, que je laisse à Sophie, autant d’argent qu’il vous en faudra pour que Gérasime soit tué à son tour, à la même place où il m’a fait tomber, et de la même manière, et avec des massues toutes pareilles… J’aimerais bien qu’il reçût du même couteau à travers le corps.
Pendant l’expression de ce désir bien naturel, Madame Palazzi redoubla ses pleurs et ses gémissements. Les parents arrivèrent, les prêtres les suivirent, la ville entière stationnait dans la rue, et le vieux Jérôme rendit l’âme sans avoir voulu embrasser ni sa chère Caroline, ni son adorable Sophie ; il est évident qu’une seule pensée l’occupait, c’était le désir ardent de se voir rejoint par Gérasime de la façon dont il avait ordonné les choses.
L’enterrement fut splendide. Le métropolitain officia lui-même en grand costume, et tous les papas lui firent escorte, venus des différentes paroisses de la ville ; le commissaire britannique prononça un discours en anglais, dans lequel il rendit justice aux qualités politiques du défunt, constamment dévoué à la cause de l’ordre et de la religion ; le président du comité philhellénique parla à son tour en grec moderne, pour célébrer les généreux efforts du comte en faveur de la cause de l’indépendance ; mais il ne spécifia que de nobles aspirations. Le maire, dans un discours italien, pleura sur la ville de ce qu’elle avait perdu un membre aussi éclairé de son conseil municipal, et rappela les progrès que le comte Lanza avait fait faire dans toute l’Europe à la science économique, quand il traduisit du français, il y avait trente ans, une brochure sur la liberté du commerce des grains ; enfin l’administrateur du collège, dans un discours en grec ancien du plus pur attique, mais auquel personne ne comprit un seul mot, vanta le génie littéraire de cet éminent comte Lanza, qui avait traduit dans sa jeunesse le roman français aussi, la Dot de Suzette, de l’éminent et illustre M. Fiévée, en langage romaïque corrigé, ce qui avait fait considérablement avancer tout l’Orient chrétien dans les voies de la civilisation.
Ces discours durèrent huit heures consécutives, après quoi chacun regagna son logis. La justice fit les recherches les plus habiles et les mieux dirigées, mais elle ne découvrit quoi que ce fût. Quand elle essaya de savoir si le comte Lanza avait quelque ennemi déclaré qui eût intérêt à le faire disparaître, elle ne trouva personne ; le comte Lanza n’avait pas un seul ennemi ; mais quand elle poussa ses investigations jusqu’à vouloir apprendre s’il était aimé, elle s’aperçut qu’il était détesté universellement, et cette contradiction flagrante brouillant toutes ses cartes, elle fut bientôt obligée de lâcher prise, de s’avouer vaincue ; et ce ne fut plus que pour la forme et afin de couvrir sa retraite plus honorablement qu’elle afficha encore pendant quelque temps de s’occuper d’une affaire où, tout d’abord, elle avait compris qu’elle ne comprendrait jamais rien.
Gérasime Delfini, absent de Céphalonie depuis un mois au moins avant l’assassinat du comte, reparut deux mois après, revenant de Naples, dont il raconta des merveilles et où il s’était beaucoup amusé.
Sophie, toujours très occupée à broder son chien vert, dit à sa mère :
– Maman, est-ce que vous n’inviterez pas M. Delfini à venir vous voir ?
Madame Palazzi fit entendre une sorte de gémissement :
– Mais tu sais bien, mon enfant, murmura-t-elle, ce que ton parrain m’a dit ?
– Est-ce que vous croyez cela ? demanda Sophie avec sa candeur habituelle, mais en arrêtant sur sa mère un regard dont la fixité étonnait toujours. Est-ce que vous croyez cela ? N’a-t-on pas raconté autrefois des histoires terribles contre mon parrain à propos du comte Tsalla ?
– Pauvre Tsalla ! murmura la comtesse ; et, ce qui ne fût jamais arrivé du vivant de Jérôme Lanza, elle passa son mouchoir sur ses yeux, qui, en effet, contenaient quelques larmes.
– Est-ce que vous croyez que mon parrain avait fait assassiner le comte Tsalla ?
– Mon enfant, dit la comtesse, ce sont de ces choses dont il ne faut jamais parler. Tu es jeune et tu ne sais pas… Jérôme était incapable certainement de rien faire de semblable, et je ne crois pas non plus que Gérasime… Je te jure que je n’ai rien contre ce dernier ; si seulement il voulait ressembler un peu moins à sa mère, cette Madame Delfini qui ne valait pas grand-chose, je t’assure ; et comme je l’ai dit quelquefois au pauvre Tsalla, il avait bien tort de s’encanailler avec des créatures pareilles. Mais enfin, je te jure que j’ai pour Gérasime beaucoup d’amitié ; et si tu ne crois pas que ce soit manquer à la mémoire de ton parrain, il me semble que je peux bien le recevoir.
Quelques semaines après, Gérasime épousait Sophie ; ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.
Athènes, 25 mai 1868.
AKRIVIE PHRANGOPOULO
Naxie.
Les Cyclades sont un des endroits du monde auquel l’épithète de séduisant s’applique avec le plus de vérité. Pourtant beaucoup d’entre elles peuvent être qualifiées en toute justice de rochers stériles ; mais au sein de ces mers de la Grèce, où la main des dieux les a semés, ces rochers brillent comme autant de pierres précieuses. La lumière qui les inonde au milieu d’une atmosphère sans tache, et les flots d’azur qui les enchâssent, en font, suivant les heures du jour, autant d’améthystes, de saphirs, de rubis, de topazes. La réalité est stérile, pauvre, assez nue, certainement mélancolique ; mais ces inconvénients s’effacent sous une majesté et une grâce incomparables. Les Cyclades donnent l’idée de très grandes dames nées et élevées au milieu des richesses et de l’élégance. Aucune des somptuosités du luxe le plus raffiné ne leur a été inconnue. Mais des malheurs sont venus les frapper, de grands, de nobles malheurs ; elles se sont retirées du monde avec les débris de leur fortune ; elles ne font plus de visites, elles ne reçoivent personne ; néanmoins ce sont toujours de grandes dames, et du passé il leur demeure comme le suprême raffinement interdit aux parvenues, une sérénité charmante et un sourire adorable.
Il y a quelques années, la corvette de guerre anglaise, l’Aurora, venant de Corfou et naviguant à la voile, suivant les sages prescriptions de l’amirauté, avare de son charbon, se trouvait un matin, un peu avant le jour, au beau milieu de l’archipel dont il est ici question. Le commandant Henry Fitzallan Norton dormait sur sa couchette, quand un timonier, dépêché par le navigating-officer, vint le réveiller.
– Monsieur ! monsieur !…
Au son de cette voix bien connue, le commandant avait ouvert les yeux et répondait :
– Qu’est-ce que c’est ?
Monsieur, on voit Naxie.
– C’est bon, répondit Norton ; et comme il avait fait le whist assez tard dans le carré, il se retourna sur son lit avec l’intention de se rendormir, ce qui ne lui fut pas permis. Quelque chose de noir et de velu s’éleva lentement du bord de la couchette, le bruit d’un bâillement prolongé se fit entendre, et tandis qu’une langue énorme s’avançait vers son menton avec le désir évident de le faire disparaître sous sa surface rose, des yeux aussi intelligents que des yeux de chien peuvent l’être, le regardaient en face et lui disaient :
– Au nom du ciel, éveillez-vous donc ; j’ai assez dormi.
– Eh bien, puisqu’il le faut, répondit le commandant, je me lève, Didon, je me lève !
Et en effet le commandant se leva.
L’aube allait paraître, mais il ne faisait pas jour encore. La bougie qui éclaira bientôt de sa lumière parcimonieuse la hâtive toilette de Henry Norton tomba sur les objets accumulés dans la chambre de bord de façon à les faire plutôt deviner que reconnaître. Rien n’est moins gai qu’une pareille habitation, bien qu’il soit à la mode, parmi les habitants tenaces de l’intérieur des terres, de s’extasier sur le luxe naval. S’agit-il d’un navire de guerre français, l’appartement accommodé sur un patron invariable comme l’infaillibilité administrative, est peint en blanc avec des baguettes dorées reproduites à profusion, comme dans un cabinet de restaurateur, et le mobilier est rouge, à moins qu’il ne s’agisse de loger un vice-amiral. Devant cette considération puissante, l’administration maritime faiblit pour mieux triompher, et alors tout devient inévitablement jaune. Les lois des Perses et des Mèdes et les arrêts de Minos n’avaient rien de plus absolu. Sur la table s’étagent régulièrement quelques journaux, un annuaire de la marine, et c’est tout, à moins que l’officier, père de famille, n’ait tenu à orner les cloisons çà et là de photographies domestiques. Dans la marine anglaise, le goût individuel a plus de latitude. Les chambres des commandants ne sont pas toujours revêtues de la même couleur ; la volonté de l’habitant peut en décider ; il y a moins de cloisons et de petits trous, moins de portes se fermant sur des réduits de quatre pieds de large ; plus de rideaux laissant circuler l’air et le jour, et, ce qui est caractéristique et curieux, on y contemple fréquemment des tableaux, des objets d’art, et surtout des livres. Sous ces derniers rapports, le logis de Henry Norton était riche en dépit de sa petitesse. Des gravures d’après d’anciens maîtres d’Italie, deux ou trois petites toiles achetées à Messine et à Malte, et, partout où l’on avait pu assujettir des tablettes, des volumes de différentes grosseurs et épaisseurs : traités de mathématiques, livres d’économie politique, histoire, philosophie allemande, romans nouveaux, tout cela s’alignait, se pressait, se foulait, se montait l’un sur l’autre, et il en traînait encore sur les chaises ; Henry Norton était un admirateur passionné de Dickens et de Tennyson, ce qui ne l’empêchait pas de faire consciencieusement son métier et de le bien savoir. Arrivé à trente-trois ans avec une jolie figure blonde et douce, il parlait peu, songeait beaucoup, rêvait assez, présentait ce mélange si commun chez ses compatriotes d’esprit positif, d’esprit romanesque et d’énergie, et, fort avancé dans sa carrière, puisqu’il était déjà capitaine de vaisseau, il ne s’amusait pas dans le monde d’une manière bien remarquable. Cependant aucune disposition au spleen n’avait jamais apparu chez lui.
Quand il fut habillé, il monta sur le pont et du pont sur la passerelle ; le lavage réglementaire était en bon train, et la rumeur des seaux d’eau lancés à tour de bras et le bruissement sonore des fauberts faisaient leur tapage accoutumé. Norton rendit silencieusement le salut que lui adressa le navigating-officer, enveloppé dans son paletot comme un digne homme arrivé à la fin de son quart de nuit, et promena les yeux sur la scène ouverte autour de son navire. L’aube se levait et donna vivement à Norton l’impression de la sagesse extrême des poètes du passé, qui ont vu et décrit l’Aurore avec des doigts de rose ; en général, aucun pays au monde ne porte si bien à personnifier les phénomènes de la nature que les pays du Levant. Tout s’y manifeste avec une telle netteté, s’y détache avec une telle précision, y déploie tant de vie, y revêt tant de charmes, qu’on trouve naturel de s’imaginer les portes du jour ouvertes par une charmante fille, et l’astre lumineux triomphalement porté à travers les plaines célestes par les chevaux fougueux et brillants du plus beau et du plus intelligent des dieux. La mer, calme d’un calme profond, bleue comme une pervenche, non ridée mais plissée coquettement pour faire miroiter sur son sein les faisceaux de la jeune lumière ruisselant d’en haut en cascades étincelantes, allait chercher bien loin, au bout de l’horizon oriental, ce qui restait des nuances délicates du crépuscule du matin. Elle se teignait à plaisir et dans un cercle de plus en plus large de cette pluie de fleurs safranées ou d’un rose pâle, et peu à peu le safran devint orange, le rose se parsema d’écarlate, des filons d’or coururent de toutes parts, et une clarté éblouissante, chaude, dominatrice, électrisa la nature entière.
Çà et là se montraient des îles, les unes plus près, les autres plus loin. Des formes douces, arrondies, fines, dessinaient les contours de ces terres montagneuses ; là, c’était Paros, ici, sa sœur Antiparos ; plus loin dans la vapeur, Santorin ; enfin en face, Naxie, la belle Naxie commençait à mettre en relief non plus seulement son plan général, mais ses sommets, ses collines, ses vallées, ses gorges, ses rochers, et on voyait s’avancer la ville, blanche comme une fiancée.
Il fallut cependant quelques heures encore pour l’atteindre. La brise était extrêmement faible, et le navire marchait peu. En attendant, les détails de la côte se révélaient à chaque instant d’une manière plus sensible. On aperçut l’entrée du port se creusant entre les rochers, et sur la droite, ce petit îlot stérile, encore riche de quelques pans de murs antiques, restes d’un temple d’Hercule. Les maisons baignaient leur pied dans l’eau, s’étageant les unes au-dessus des autres comme les loges d’un amphithéâtre, et par-dessus ces bâtisses plébéiennes s’élevait, avec plus de bonhomie que de grandeur, l’ensemble d’habitations qu’on nomme la citadelle ou le château, et que des restes d’anciens remparts écroulés ou employés à faire de nouveaux logis rendent encore assez digne d’une appellation devenue néanmoins un peu ambitieuse. Cet aspect était frais, gai, aimable, accueillant. L’Aurora continuait à s’avancer avec lenteur vers cette rive hospitalière, quand survint un incident sur lequel on ne comptait pas, et qui faillit changer du tout au tout le caractère paisible de cette arrivée.
Au moment même où la corvette franchissait l’entrée du port, une vive bouffée de brise accourut du large et se jeta étourdiment au travers des voiles, grandes ouvertes au peu d’air qui avait soufflé jusqu’alors. Le navire affolé prit sa course, et comme il n’était pas à trois cents mètres de la côte rocailleuse, il allait inévitablement s’y briser, quand le commandant donna rapidement un ordre. L’équipage entier sauta sur le pont, du pont sur les vergues ; l’action s’exécuta de façon si prompte, que des douzaines de bonnets et de chapeaux s’envolèrent et vinrent parsemer la mer ; mais la moindre toile fut carguée en un instant et l’Aurora s’arrêta. subitement, pas assez tôt toutefois pour qu’une petite partie de son bordage n’eût labouré la pierre ; néanmoins ce n’était pas, à proprement parler, une avarie, ce dont chacun se félicita ; et quand on eut constaté que le péril évité ne laissait derrière lui qu’une quasi-nécessité de s’arrêter à Naxie pendant cinq à six jours au plus, afin de remettre quelques planches, comme, d’ailleurs la machine avait besoin aussi de réparations, le commandant et les officiers, au lieu de déplorer l’accident, en furent enchantés. L’ordre fut donné de mouiller, et tandis qu’on l’exécutait, on vit monter à bord deux personnages qui demandèrent à parler au commandant.
Ces nouveaux venus étaient l’un et l’autre en habits, pantalons, gilets noirs, cravates blanches, et tenaient à la main le chapeau de feutre en usage parmi toutes les nations civilisées ; mais ce costume, peu remarquable en lui-même, frappa extrêmement Henry Norton car dans l’espèce, il présentait l’aspect le plus absolument archaïque auquel ce mode de vêtement puisse atteindre. L’observateur le plus superficiel ne pouvait faire moins que de lui assigner, comme date la plus récente, 1820 au plus près. Des collets énormes et bosselés, des manches froncées et larges du haut, très étroites du bas, une taille courte, des basques démesurées, les pantalons à la cosaque, les gilets de soie noire extrêmement ouverts eussent tiré des larmes d’attendrissement des yeux de Georges Brummel, s’il avait pu revenir au monde pour contempler ces souvenirs de sa jeunesse ; les cravates amples, larges, étoffées, de six pouces de hauteur, ornées de nœuds savamment étudiés et d’une complication à faire perdre la tête à un gabier, se couronnaient avantageusement de deux cols de chemise empesés, qui devaient être certainement en lutte perpétuelle les bords du chapeau, quand celui-ci recouvrait le chef des remarquables possesseurs de cette précieuse garde-robe ; mais en ce moment les chapeaux reposaient dans les mains de leurs maîtres. Il ne faut d’ailleurs pas plaindre ces instruments singuliers, hauts chacun d’un pied et demi, garnis de bords d’une largeur redoutable ; ils étaient de taille à se défendre, et leur aspect poilu et hérissé leur donnait une physionomie farouche. Norton resta frappé d’admiration devant cet appareil ; il se rappela les héros d’un autre âge, et il eut besoin de faire un effort pour concentrer son attention sur les physionomies des deux arrivants. Elles étaient des plus respectables et des plus dignes. Toutes deux se ressemblaient en ce point que les cheveux étaient taillés, comme les habits, d’après le goût antique, de façon à former sur les tempes des accroche-cœurs comparables aux pavillons ornementés dont s’accompagnent les grands monuments, tandis que de vastes toupets gris, s’élevant avec noblesse sur le sommet de la tête et couronnant la largeur du front, rappelaient encore mieux ces frontons rigides, qui signalent au respect des peuples les tribunaux de première instance.
Voilà ce que les deux insulaires avaient en commun ; pour le reste, ils différaient. Celui qui marchait le premier était petit, un peu gros, assez haut en couleur, l’air souriant et heureux ; l’autre, au contraire, élancé, extrêmement maigre, d’un teint un peu jaune, paraissait souffrant et triste, mais résigné. Norton ne put se défendre de leur trouver des physionomies extrêmement distinguées ; leurs figures vieillottes n’appartenaient pas aux premiers venus, et il lui passa dans l’esprit des réminiscences de certains types de gentilshommes français et italiens rencontrés par lui dans sa première jeunesse.
Sous l’empire de cette impression, et désireux de savoir jusqu’à quel point elle était justifiée, il fit descendre ses visiteurs dans sa chambre, et s’enquit poliment de ce qui les amenait. Le Naxiote gros et gai s’annonça comme étant M. Dimitri de Moncade, agent consulaire de Sa Majesté Britannique. Il venait offrir ses services, et présenta son compagnon et ami, M. Nicolas Phrangopoulo, consul des Villes Hanséatiques. La conversation naturellement avait lieu en grec ; Henry Norton parlait couramment cette langue, grâce à un séjour de plusieurs années dans les mers du Levant, et ni M. de Moncade ni M. Phrangopoulo ne savaient le moindre mot d’un autre idiome.
On a pu entrevoir, d’après ce qui a été dit déjà du commandant de l’Aurora, qu’il était d’un naturel curieux et cherchant l’instruction. L’apparence des deux personnages assis dans sa chambre de bord l’avait suffisamment excité pour qu’il tînt à en savoir un peu plus long sur leur compte, ne fut-ce que pour servir d’introduction à ses futures observations touchant l’île de Naxie. Il dirigea donc l’entretien de façon à se renseigner, autant que la politesse le pouvait permettre, et ses efforts ne furent pas infructueux. Voici, en bloc, ce qu’il apprit par pièces et par morceaux :
M. l’agent consulaire de Sa Majesté Britannique devait son emploi à ce fait que son père et son grand-père l’avaient jadis exercé avec honneur ; naturellement, il était rémunéré par l’éclat qui en rejaillissait sur sa personne, et aucune indigne considération de lucre ne s’y rattachait. Il avait connu l’amiral Codrington, et gardait dignement le souvenir d’un déjeuner auquel il avait pris part à bord du bâtiment monté par ce grand homme de mer, vers le temps de la bataille de Navarin. Environ une fois tous les sept à huit ans, quelque navire de guerre anglais passait à Naxie et venait réjouir sa vue. En 1836, un voyage à Athènes l’avait mis en mesure d’apprendre une foule de choses intéressantes, dont il ne s’était jamais douté jusqu’alors. Il demanda à Henry Norton des nouvelles de Sa Grâce le duc de Wellington, et se montra extrêmement peiné d’apprendre que cet illustre capitaine avait cessé de vivre. Il rappela ses mérites extraordinaires en quelques sentences bien choisies, et ce fut probablement la dernière oraison funèbre prononcée sur les cendres du vainqueur de Waterloo. Cette pénible émotion s’étant un peu dissipée, M. de Moncade offrit quelques observations sarcastiques contre les Français en général et contre l’esprit révolutionnaire en particulier, et sans se prononcer nettement, il laissa entrevoir qu’en ce qui le concernait, il trouvait peu de plaisir aux souvenirs de la guerre de l’indépendance hellénique, attendu que le gouvernement d’Athènes jugeait à propos d’envoyer un éparque dans l’île, tandis que jamais, au grand jamais, tant que le Sultan avait régné sur l’Archipel, on n’y avait vu un Turc, grand ou petit. Pour lui, il n’estimait que les vieilles familles, les gens de race noble, c’est-à-dire d’origine européenne ; il était incapable d’oublier que ses ancêtres, étaient venus du midi de la France, où il était possible que leur nom existât encore, et il savait de science certaine qu’aucune mésalliance n’avait altéré la pureté du sang circulant dans ses veines. M. de Moncade, plus vif et plus causant que M. Phrangopoulo, prenait soin le plus souvent de parler au nom de ce dernier. Ainsi Norton apprit que celui-ci n’était pas moins bon gentilhomme que le consul de Sa Majesté Britannique, malgré son nom de consonance grecque, ce qui d’ailleurs portait témoignage en sa faveur, puisqu’il signifie : un fils de Franc, le nom réel de la race ayant malheureusement été perdu et oublié. Toutes les opinions politiques et sociales de M. de Moncade étaient partagées par son ami, qui les appuyait d’un signe de tête ; mais il s’en fallait que cet ami eût une aussi grande érudition sur les choses de ce monde.
De sa vie il n’était sorti de l’île. Il représentait les Villes Hanséatiques au même titre héréditaire que M. de Moncade faisait la Grande-Bretagne. Mais, moins heureux que celui-ci, il n’aurait même jamais vu de ses yeux mortels un citoyen de la puissance allemande à laquelle il appartenait, si, en 1845, un brick de commerce hambourgeois chargé de planches ne s’était laissé emporter hors de sa route par un coup de vent et jeter sur les roches d’Antiparos. Il en était résulté un naufrage où la cargaison avait été perdue ; mais on avait sauvé les hommes, et le capitaine Peter Gansemann avait, après un séjour d’un mois à Naxie, laissé entre les mains de M. Phrangopoulo un certificat par lequel il informait la postérité la plus reculée, dans le but de servir à tout ce que de raison, que M. Phrangopoulo était l’homme le plus honorable qu’il eût jamais rencontré, et l’avait nourri lui et son équipage pendant son séjour forcé dans l’île, générosité d’autant plus méritoire, ajoutait le reconnaissant capitaine, que ce digne consul lui avait paru vivre dans un état voisin de la misère.
Sans être trop optimiste, on peut croire que beaucoup de bonnes actions ont leur récompense dès ce bas monde. M. Phrangopoulo, du moins, obtint la sienne en ce sens que le séjour du capitaine Gansemann fit époque dans son existence. Comme celui-ci ne parlait qu’allemand, il ne communiqua pas beaucoup d’idées nouvelles à son hôte ; mais il resta le héros de l’événement capital dans les fastes de la maison consulaire, et l’esprit du vieux gentilhomme travailla sur ce thème de manière à en faire une sorte de conte des Mille et une Nuits. Il estimait d’autant plus son certificat qu’il n’avait jamais trouvé occasion de le faire traduire, et ne se doutait pas plus de ce qu’il disait que si on lui eût mis dans les mains les quatre livres de Confucius en original.
L’imagination de Henry Norton n’avait pas besoin de beaucoup d’aide pour s’exciter. En cette circonstance, elle se monta d’elle-même au seul contact de si singuliers personnages. Une île de l’archipel grec dans toute sa grâce merveilleuse représentée par deux vieux débris de la noblesse européenne ; ces deux vieux débris ne parlant que le grec, ne sachant quoi que ce soit de ce qui se passait dans le vaste monde, en ce temps de bavardage où chacun est plus au fait des affaires d’autrui que des siennes propres, et, par cette ignorance singulière, semblant vouloir prouver que leur habitation, éloignée seulement de quelques heures d’Athènes, se trouve plus loin, en fait, de l’univers civilisé, que les provinces centrales de l’Amérique, c’était là un de ces paradoxes violents tels que le capitaine de I’Aurora les adorait. Cependant celui-là lui parut si fort, qu’avant d’en savourer le charme il en voulut avoir la démonstration, et ses amis improvisés ne se firent pas prier pour la lui administrer complète.
Aucun bateau poste ne circule entre la plupart des îles et la Grèce continentale, et cela pour cette raison excellente que ces petits territoires ne possédant ni commerce ni industrie, ni importation ni exportation, ne donnent lieu à l’échange d’aucunes correspondances. Chaque quinzaine seulement, une goélette part de Syra, pour Paros, y porte quelque peu de lettres ou de paquets à cette destination, et quand, par un hasard fort rare, il s’en trouve pour Naxie, une barque quelconque s’en charge à loisir ; ce mode de circulation suffit parfaitement. De la sorte, les journaux arrivent dans l’île ; mais quel intérêt peuvent-ils exciter chez des gens confinés chez eux et n’ayant nulle envie d’en sortir ; ne lisant jamais rien, ne sachant rien des choses de ce monde et ne se souciant pas d’en rien savoir ; ne possédant que des vignes, des oliviers, des orangers, des grenadiers et, par-ci par-là, quelques moutons, et vivant comme l’homme d’Horace dans une médiocrité, laquelle d’ailleurs n’est pas dorée ? Tout au plus ces philosophes pratiques ramassent-ils au hasard dans ce qu’ils apprennent de la sorte, à bâtons rompus, quelques sujets de conversation peu passionnants, et c’est ainsi que, trop pauvres pour avoir besoin de personne, suffisamment vêtus et nourris sous un ciel délicieux pour n’éprouver aucune souffrance dans cette ravissante indigence, indolents avec conviction, fiers du passé et sachant garder la dignité nécessaire au présent, les gentilshommes naxiotes vivent paisiblement et ne s’en estiment pas d’un grain au-dessous des hommes les plus agités de la société moderne la plus remuante.
Naturellement ils ont en commun avec les habitants de l’Hellade une vénération solide pour l’origine du pays qu’ils habitent, et le rayonnement de cette gloire planant sur leur tête, ils en réclament une part de propriété ; mais c’est surtout au temps des croisades qu’ils aiment à se reporter. Alors fut fondé le duché français des Cyclades, et les chevaliers se firent des fiefs dans les îles. La plupart des gentilshommes de Naxos font remonter leur généalogie à cette époque. Mais là, beaucoup se trompent. Le duché français a passé depuis lors par bien des péripéties. Les races conquérantes s’éteignirent successivement et furent remplacées par d’autres également franques à la vérité, mais moins anciennes ; les Vénitiens introduisirent des Italiens en grand nombre ; les aventuriers français et espagnols du dix-septième siècle apportèrent leur appoint ; des Grecs également. Bref, quand le dernier héritier de la maison ducale européenne eut été contraint de déposer son pouvoir entre les mains des Turcs, ceux-ci, à la vérité, ne changèrent rien à la constitution politique de l’île, et n’y envoyèrent pas de représentants de l’Islam ; ils firent même plus : ils intronisèrent un duc de leur choix, qui fut un médecin juif du Sultan. Mais ce fils de Moïse n’eut pas de successeur, et comme il n’avait jamais résidé dans l’île, son palais, devenu propriété nominale du Sultan, fut abandonné et peu à peu démoli par la noblesse elle-même, qui trouva commode de prendre des matériaux à bon marché dans ces constructions qu’on ne réclamait pas, qu’on ne protégeait pas et qu’on ne réparait pas. Et dès lors le gouvernement du lieu devint tout à fait municipal et républicain entre les mains des vieilles familles, et, nobles et peuple, aussi pauvres l’un que l’autre, habitués à vivre ensemble oubliés de l’univers entier, n’ayant aucun prétexte pour se quereller, puisqu’ils n’avaient rien à se disputer, vécurent et vivent encore dans une union si parfaite que le catholicisme des uns, l’orthodoxie des autres, la présence de deux évêques appartenant aux rites ennemis, un couvent de Lazaristes français qui est venu, on ne sait trop pourquoi, acheter là des terres, la fondation d’un autre couvent d’Ursulines bourguignonnes, rien n’a pu prévaloir contre la douceur obstinée de cette population, qui se permet de vivre au dix-neuvième siècle dans une sorte d’état paradisiaque.
Lorsque la conversation de ses deux hôtes qu’il avait retenus à déjeuner lui eut fait comprendre cette situation, Henry Norton, enchanté, fit rapidement ses préparatifs pour descendre à terre et voir de plus près des choses si intéressantes. Après avoir donné ses instructions à son second, il monta dans sa baleinière avec M. de Moncade et M. Phrangopoulo, et suivi de Dido, non moins satisfaite que lui de quitter le bord, il se dirigea vers un petit débarcadère en planches, où une partie notable de la population, c’est-à-dire une douzaine de pêcheurs, l’attendait avec une joyeuse curiosité. Quelques femmes tenaient de beaux enfants dans leurs bras. Tout ce monde salua l’étranger d’un air de bonne humeur, et flanqué de ses introducteurs, gravissant un sentier étroit à travers les ruines de toute espèce, les gravats et les places vides, il parvint, après quelques minutes d’une ascension assez roide, jusqu’à une porte surbaissée, dernier reste de la citadelle. Cette issue, un peu sombre, l’introduisit dans une ruelle pavée de dalles. C’était la grand-rue ; elle montait en serpentant à travers des maisons à un étage, affectant les formes de l’architecture italienne du dix-huitième siècle. Sur chaque porte étaient gravés des écussons d’armoiries. Ce lieu sombre et frais avait si peu de passants, qu’il ressemblait plus à la cour d’une habitation privée qu’à une voie publique. De distance en distance, un mulet chargé de bois, de légumes ou de fruits, cheminait en choisissant son terrain avec prudence. M. de Moncade s’arrêta devant une porte voûtée, armoriée à la clef comme les autres, et faisant un profond salut au commandant, il le pria de lui faire l’honneur de se reposer un instant chez lui, requête aimable aussitôt accordée que présentée, et poussant un battant en bois vermoulu, le consul de Sa Majesté Britannique à Naxos introduisit Henry Norton dans une vaste salle voûtée, pareille à un de ces celliers où les riches abbayes aimaient jadis, en Europe, à recueillir les tonneaux et les futailles pleins de l’honneur de leurs vendanges.
Le jour n’entrait dans ce lieu solennel que par la large baie au milieu de laquelle était pratiquée la porte en bois, et dont le charpentage contenait en outre trois fenêtres de rang. Les murailles étaient crépies à la chaux. Le sol, pavé dans le même système que la rue, avec laquelle il s’unissait absolument, était de plain-pied avec elle. Au fond de l’appartement s’étendait un tapis vieux et extrêmement délabré, et là erraient quelques meubles : un bahut en bois sculpté dans le goût vénitien, deux ou trois fauteuils couverts en velours d’Utrecht jaune, des chaises de paille et une table ornée de vases en albâtre de la fabrique de Florence. Les portraits de la reine Victoria et du prince consort évidemment exécutés par un ennemi mortel de la dynastie hanovrienne, furent signalés au commandant avec un certain orgueil. Peu de chefs-d’œuvre pareils existaient dans l’île.
À peine assis, Norton fut pris d’un désir puissant de ne pas passer sa journée à regarder la voûte, blanche arrondie au-dessus de sa tête ; en conséquence, il consulta ses amis sur la meilleure manière d’employer le temps. On posa en principe qu’on ne le quitterait pas d’une minute, et il s’aperçut que réclamer la solitude serait à la fois désoler ses hôtes et les blesser gravement. Ce premier point ne fut donc discuté qu’autant que la discrétion parut lui en faire un devoir. Norton s’aperçut ensuite qu’il ne lui fallait pas songer à envelopper son séjour dans un incognito impossible. L’apparition d’un bâtiment de guerre dans le port de Naxos était un événement si extraordinaire, que toute la vie sociale du pays s’en trouvait affectée ; partout on en parlait ; la grande nouvelle volait sur les ailes de la renommée avec une rapidité si prodigieuse qu’avant peu d’instants elle allait avoir traversé de part en part les vallons les plus solitaires ; dès lors rien de plus nécessaire que de satisfaire la juste curiosité des notables et aller montrer aux évêques, aux deux ou trois représentants des plus grandes familles du pays ce que c’était qu’un commandant anglais, espèce d’entité dont les plus savants avaient entendu parler, mais que nul n’avait vue. Ce devoir accompli, on se rendrait à la campagne chez M. Phrangopoulo, et on y passerait le reste du jour.
Les choses ainsi arrangées, Henry se mit en devoir de s’exécuter gaillardement. Sur le pas des portes, hommes, femmes, enfants étaient rassemblés et saluaient l’étranger du meilleur sourire du monde. Ces braves gens avaient l’air de nonchalance et de calme que donnent le loisir et l’absence de besoins. La beauté de la plupart des femmes était saisissante. Un ciel magnifique, une cité pittoresque à l’excès, et toute petite et toute ramassée, et toute semblable au nid d’une seule famille, la paix la plus inaltérable, un charme extrême sur beaucoup de visages, la bonne humeur sur tous, voilà ce qui accueillait le nouveau venu, et il n’avait pas l’âme faite de façon à n’en pas être doucement remuée et attendrie. Deux heures ne s’étaient pas écoulées depuis que les vieux gentils-hommes s’étaient présentés sur l’Aurora, et Henry Norton ne les trouvait plus ni ridicules, ni même singuliers ; il n’apercevait plus en eux que leur exquise politesse, leur désir de se rendre agréables, la distinction vraie et la noblesse native de leurs manières.
Dans toutes les visites, du café et des cigarettes furent présentés. Les questions sur l’état de l’Europe eurent leur cours légitime, et ces préliminaires indispensables accomplis à la satisfaction universelle, et notamment à celle de Didon, pressée d’en finir, les trois amis quittèrent l’enceinte de la forteresse et le champ de décombres qui en couvrait les pentes pour aller trouver derrière une masure trois mulets mandés par M. Phrangopoulo, et qui allaient avoir l’honneur d’emporter les voyageurs.
Marcher à Naxos dans les sentiers voisins de la mer serait une tâche, sinon impossible, du moins difficile et fatigante. Tout est sable et sable mouvant, fin, profond ; des haies épaisses, hautes et fleuries, encadrent ce sol instable et grimpent sur les rochers qui le bordent. On va ainsi pendant plusieurs heures. Le ciel rit, le soleil brûle. Puis les montagnes se découvrent les unes après les autres, arrondies, coupées par des ravins profonds. Quelques chênes verts, des lentisques ; au pied des pentes, des ruisseaux d’une fraîcheur adorable et des lauriers-roses en foule. Un peu de bétail erre çà et là. Sur les collines se dressent, comme des enfants gracieux qui font les mutins, de petits châteaux carrés d’une blancheur éblouissante, ayant peu de fenêtres et aux coins quatre poivrières à toits ronds. Quelques-uns sont crénelés. Ces manoirs minuscules, tout à fait féodaux, produisent un effet singulier dans une île grecque. Ce sont des souvenirs du temps où les pirates barbaresques couraient les mers environnantes, tentaient des descentes hardies, et, enlevant les belles filles, allaient les vendre sur les marchés de Constantinople, d’Alexandrie ou de Smyrne, donnant ainsi naissance à une quantité de romans dont la presque totalité est restée inédite. Les populations, peu soucieuses de se prêter à ces incidents poétiques, n’osaient habiter sur les plages, et c’est pourquoi, dans tout l’Archipel, les habitations planent constamment au sommet des hauteurs, et autant que possible sur une élévation d’où l’on pouvait découvrir la pleine mer.
Rien n’est joli comme ces castels ; ils sont entourés de vignes, d’orangers énormes, de figuiers, de pêchers et de plantations de toute sorte, fort peu soignées sans doute, mais d’autant plus plantureuses, libres et vivaces.
Après avoir marché pendant deux ou trois heures, un de ces petits châteaux se montra au penchant d’une colline. Plus blanc que les autres, plus attirant, plus élégant, plus coquet, dressant plus finement ses quatre tourillons, entouré d’arbres plus verts, plus touffus, plus chargés de citrons et d’oranges, plus contourné de vignes, il frappa d’abord les regards de Henry Norton, et les retint. Ce fut une sorte de fascination, et quand M. de Moncade, qui portait volontiers la parole, eut annoncé que c’était là le but de la promenade et que, passé un petit pont jeté sur le ruisseau, on allait trouver le domaine de son ami, le voyageur anglais eut l’impression que c’était une sorte de Rubicon qu’il allait franchir, et qu’il laisserait sur une rive sa vie ancienne pour, sur l’autre, recommencer une nouvelle existence.
Les natures nerveuses, non seulement s’ébranlent en mille occasions à propos de tout et à propos de rien, et, qui pis est, elles s’abandonnent volontiers à la créance que leurs oscillations sont d’une importance prophétique et leur ouvrent l’avenir. Il arrive, en conséquence, qu’elles s’égarent ; mais ce serait un genre particulier de superstition que de réduire en axiome qu’elles se trompent toujours.
En tout cas, ceci est certain : Norton s’avança vers le petit manoir le cœur tout ouvert, l’âme exaltée d’une joie sans cause et se laissant caresser l’esprit par mille idées, par mille pensées, par mille sentiments tous plus vifs, plus gais, plus animés les uns que les autres.
Naturellement, dans cette île montagneuse de Naxos, on monte constamment ou l’on descend. Ici les promeneurs gravirent encore un sentier caillouteux et tournant, fort roide, et furent ainsi conduits à travers quelques cours et par-devant des maisons de paysans jusqu’au sommet de l’éminence où était juché le manoir, et mettant pied à terre au bas d’un étroit escalier de pierre, ils atteignirent une terrasse aussi étroite, pour entrer dans une salle très semblable à celle que Norton avait déjà admirée en ville chez M. de Moncade. C’était de même un long cellier blanchi à la chaux, voûté comme une église, clair et plus simplement, ou si l’on aime mieux, plus pauvrement meublé encore. Un sofa bas recouvert d’indienne régnait au bout de l’appartement, et de l’autre côté un escalier en bois, très léger, s’élevait jusqu’à une galerie conduisant à une porte petite et basse servant d’entrée aux chambres d’habitation de la famille. On devinait de suite qu’aux époques anciennes où le château avait été bâti sur le haut d’une cime par crainte des surprises des pirates, on avait trouvé bon d’y ajouter la précaution supplémentaire, au cas où ces redoutés envahisseurs auraient trouvé moyen de descendre à terre sans être aperçus, de pouvoir leur abandonner le bas de l’habitation en se réfugiant dans le haut, qu’un coup de pied donné à l’escalier suffisait pour isoler. Somme toute, le manoir n’avait que quatre ou cinq pièces, et se terminait par une plate-forme flanquée des quatre guérites, et sur laquelle séchait à ce moment la récolte du maïs.
Tout cela fut visité et examiné par Norton dans le plus grand détail, et quand il se fut rassasié de la beauté du paysage étendu autour de la vieille demeure vénitienne, il revint à la grande salle, où l’attendait un spectacle d’une autre espèce. La partie féminine de la famille était réunie sur le sofa. Il y avait la mère, madame Marie Phrangopoulo, respectable matrone fort grasse, peu mobile, faisant rouler gravement entre ses doigts ronds et courts les grains de son chapelet. On lui voyait les grands yeux noirs du pays et un air de calme absolu ; pas l’ombre d’animation, mais quelque vingt ans en ça elle avait dû être ce qui s’appelle une beauté. La dame assise à côté d’elle, et que l’on dit à Norton être sa belle-fille, était brune ; elle avait la figure accentuée, avec des cheveux noirs lustrés admirables, un regard d’une profondeur à faire réfléchir ; peut-être n’y avait-il rien au fond, mais c’est là un mystère à laisser à l’écart : c’était madame Triantaphyllon Phrangopoulo. À son jupon se cramponnaient deux petits garçons, l’un châtain et l’autre brun comme elle, tous deux beaux comme des anges et regardant l’étranger de cet air d’implacable méfiance et de profonde admiration toujours si plein de charme chez les enfants. La jeune femme tenait un troisième baby sur ses genoux, et celui-là serrait entre ses petites mains roses une orange où se concentraient toutes ses facultés ; une fillette de quelques mois était portée par une petite servante syrienne, et à ce sujet il faut dire ici que tout le passé des îles se reflète d’une manière bien exacte dans le présent. Aux temps antiques, les Cyclades ont vu s’établir sur leurs plages plus d’Asiatiques que de Grecs, encore plus de Phéniciens que d’Hellènes, et les antiquités qu’on y trouve montrent moins rarement les idoles difformes de Tyr et de Sidon que les dieux élégants d’Athènes ; aujourd’hui les choses vont à peu près de même. Les Athéniens n’ont pas de hâte pour venir s’échouer sur ces plages, où les séductions de la nature luttent vainement contre les appels de la grande Constantinople, de la commerçante Smyrne, de l’opulente Alexandrie, et, de leur côté, les peuples de Chanaan n’ont pas désappris les anciens chemins ; c’est pour ce motif que l’on rencontre des serviteurs de leur race à Naxos, où ils se mêlent parmi les successeurs des chevaliers de la croisade.
Norton examinait en lui-même tous ces détails quand il entendit la porte de la galerie haute s’ouvrir, et à l’apparition de la personne qui se présenta, il se crut d’abord le jouet d’un rêve tant il s’y attendait peu. C’était une jeune fille plus que modestement vêtue d’une robe de cotonnade brune à pois blancs, taillée et cousue certainement par elle-même, et qui, très impuissante à lui servir de parure, n’était absolument qu’un vêtement. Des manches larges attachées au poignet ; pas de dentelles, de mousseline : rien de plus austère. Une taille élancée, forte, ferme, saine, la carnation d’une des néréides de Rubens ; des yeux merveilleux, brillants comme des saphirs bleus et de la même transparence que ces pierres, et une chevelure mordorée, épaisse, abondante, tordue et, semblait-il, avec quelque impatience de la peine qu’elle donnait pour la soumettre, bien que plus fine que la soie et souple à miracle ; la bouche la plus rose, le sourire le plus épanoui, les dents les plus dignes de la comparaison ancienne avec un rang de perles ; une candeur adorable et sans tache se montrant, se prouvant d’elle-même au premier aspect ; le calme charmant de la sécurité.
Devient-on amoureux du premier coup, ou ne l’est-on qu’après plusieurs blessures ? C’est une question discutée entre les doctes. Il semblerait pourtant qu’il en doit être de l’amour ainsi que de la mort, plus faible que lui, au dire du livre saint. Quand on n’est pas tué dès la première atteinte, c’est que l’on a été mal navré ; mais le coup qui vous jette à terre pour toujours aurait pu se passer de ceux qui l’ont précédé. De même, au moment où l’amour vous terrasse, c’est qu’il avait frappé juste, et ainsi de fait on se trouve amoureux dès le premier moment. Norton aurait probablement contredit cet axiome. Jamais les gens fiers n’aiment à se voir renversés à la première étreinte. Pourtant, lorsque la jeune demoiselle, ayant atteint le bas de l’escalier, traversa la longue salle pour venir s’asseoir à côté de sa mère, le commandant jugea nécessaire d’appeler à son secours toute la roideur civilisée afin de couvrir son émotion, et il s’imposa un air froid et compassé digne du pavillon britannique. Ce ne fut nullement sa faute si la démarche souple, noble, d’une grâce inouïe de la nouvelle arrivée présenta à sa mémoire l’hémistiche de Virgile sur la façon dont s’avancent les déesses ; ce le fut encore bien moins quand, la jeune fille étant assise, il vit les yeux de toute la famille attachés sur les siens et toutes les bouches souriant avec le plus candide orgueil, tandis que M. de Moncade lui disait de l’air d’un homme qui expose une vérité incontestable :
– Je pense que vous n’avez jamais rien vu d’aussi beau que ma filleule Akrivie ?
Chacun parut attendre la réponse du commandant avec une entière confiance ; l’objet d’une telle remarque sourit sans nul embarras, et parut convaincue elle-même qu’il était impossible de disputer sur ce qui venait d’être dit. Norton, ahuri d’une infraction si exorbitante à tous les usages et aux plus sacrées convenances, prit une attitude embarrassée et fit un salut. On ne saurait absolument répondre qu’il ne sentit pas surgir dans un coin de sa cervelle quelqu’une de ces vilaines méfiances dont les gens cultivés ont provision. Mais si ce malheur lui arriva, il faut répondre à sa louange qu’il ne permit pas à cette infamie de se produire devant sa réflexion, et tout ce qui en résulta, c’est que, par une réaction qui lui fit honneur, il passa sur le ventre du Cant britannique pour répondre paisiblement à M. de Moncade :
– Je ne croyais pas qu’il pût rien exister d’aussi parfait que mademoiselle.
– Ce n’est pas, poursuivit le consul d’Angleterre, que ma filleule n’ait de dignes rivales dans notre île. Lorsque vous viendrez dimanche à la messe, vous verrez que nos jeunes filles sont jolies ; mais une autre comme elle ne se rencontre pas, c’est un fait incontesté ; et cela ne la fâche pas. Voulez-vous une cigarette ?
On passa du tabac. Norton se dit :
« Je suis fou ou occupé à le devenir. Elle est jolie ; à quoi servirait de le contester ? Mais fagotée comme on ne l’est pas ! Elle me paraît gracieuse, parce que je suis à Naxos et que je la vois à travers un fouillis d’orangers et de lauriers-roses ; dans un salon de Londres, ce serait différent. Je crois entendre d’ici les bonnes remarques de lady Jane. Quel massacre ! Et puis, d’ailleurs, quelle éducation a reçue cette malheureuse enfant ? Elle doit être sotte à plaisir ! Il faut que je la fasse causer. »
Dans les pays du Levant, des gens se voulant du bien et heureux d’être ensemble, jouissent volontiers de ce plaisir pendant des heures entières sans ouvrir la bouche. On reste assis, on fume, on se regarde, on est content, on ne souffle pas mot, et on n’a pas la moindre envie de faire de l’esprit. C’est ce qui explique comment les habitants de ce pays-là ne s’ennuient jamais. Norton aurait donc pu prolonger indéfiniment son reploiement en lui-même sans que le fait parût extraordinaire. Le maître de la maison, aidé d’un petit domestique, préparait savamment des limonades. Madame Marie comptait les grains de son chapelet avec béatitude. Madame Triantaphyllon berçait doucement le gros baby, qui, ayant réussi à faire un trou dans son orange, s’était endormi en la suçant, et les deux garçons étaient partis avec la servante syrienne et le nourrisson. La belle Akrivie regardait franchement l’étranger, et, sans nulle malice, elle le contemplait comme lui offrant un spécimen d’homme différent de ce qu’elle avait jamais vu. Quant à M. de Moncade, il fumait avec une gravité qui eût été fort digne de respect de la part d’un chef mohican épuisant le calumet de paix.
Norton, suivant son projet dédaigneux, essaya de lier conversation avec Akrivie dans le but innocent d’inventorier le mobilier de son esprit, pour plus tard passer à celui de son cœur. C’était le remède cherché à la commotion reçue trop vite. L’esprit lui parut singulier ; il n’y vit rien de ce qui orne l’imagination d’une jeune demoiselle dans les pays heureux où fleurissent les bonnes éducations et les salons distingués. À vrai dire, elle ne savait quoi que ce soit, et ne paraissait pas se douter de l’utilité d’être autrement. Norton découvrit par hasard qu’elle croyait l’Espagne voisine de l’Amérique, sans savoir d’ailleurs où gisait cette partie du monde, assez éloignée de Naxos, suivant toute probabilité. Il eut la pédanterie de chercher à réformer ses notions à cet égard. Elle le laissa dire, et ne parut pas accorder la moindre attention à ses paroles. Il la trouva sensible à la perspective de voir les Chrétiens rentrer en possession de Constantinople, et, au rebours de son père et de son parrain, fort animée contre les Turcs, dont elle souhaitait ardemment la destruction radicale. Elle ne doutait pas que ces monstres ne mangeassent les enfants vivants, et elle les croyait à la veille de faire de nouvelles descentes dans l’île. Norton la trouvant fortement imbue de poésie en matière politique, essaya de la mettre sur la littérature ; là, elle montra un vide absolu : elle n’avait jamais rien lu que son livre de prières, et ne l’avait nullement commenté. Il s’étonna que cette imagination, montée à voir des choses si singulières à propos de la future conquête de l’impériale Stamboul et à en entourer la scène de si riches inventions, n’eût pas l’air de soupçonner le moindre charme dans les pages imprimées d’un livre. Il voulut se rabattre à l’analyse des beautés pittoresques de l’île et de la mer. Akrivie parut flattée que le gentilhomme anglais trouvât le pays à son gré ; comme elle n’en connaissait pas d’autre, elle était foncièrement convaincue que c’était le plus beau du monde et le plus aimable ; mais précisément à cause de l’impossibilité des comparaisons, elle sembla indifférente et fermée à tout enthousiasme sur ce sujet. Ainsi elle ne parlait de rien, elle ne savait rien, elle n’avait réfléchi à rien, et n’avait ce qui s’appelle de conversation sur rien. Cependant elle souriait, elle ouvrait ses beaux yeux, et elle était ravissante.
Norton ne put réussir à la trouver sotte. Il arriva même tout le contraire. Des éclairs du jugement le plus droit, de la conviction la plus imperturbable et la plus absolue, une visible vigueur, une santé certaine dans cet esprit quasi sauvage lui donnèrent plus à penser que n’eussent pu faire les effusions les mieux fleuries, dont la meilleure part eût simplement, dans un esprit aussi raffiné que le sien, ravivé des souvenirs et remué des citations. L’entretien le promenait non dans une plaine stérile, mais sur une terre inculte, ce qui est fort différent pour celui qui cherche à se rendre compte des ressources d’un pays. Il ne trouva pas ce qu’il demandait ; il soupçonna des choses dont il ne savait ni le nom, ni l’usage, ni la valeur intrinsèque, et qui cependant avaient du prix, et plus Akrivie mettait de franchise dans ses rires, plus elle ouvrait ses grands yeux en le regardant et semblait disposée à le laisser lire au fond de son âme, moins il la comprenait, et il arriva naturellement qu’à l’attrait de la voir si belle se joignit bientôt celui de la trouver d’autant plus mystérieuse qu’en vérité elle-même ne s’en doutait pas.
Elle se montra femme sur un point essentiel. Par un hasard, et comme par inspiration, il eut l’idée de lui parler toilette. Ici l’intérêt d’Akrivie fut visiblement éveillé, comme aussi celui de sa belle-sœur, et sa mère elle-même eut une commotion dans sa léthargie. Mais Norton s’aperçut que pour être vraiment compris, il ne fallait pas monter trop haut ; Akrivie et Triantaphyllon considéraient sincèrement une robe de velours comme le dernier point possible de l’élégance humaine, et des bracelets d’or comme devant combler tous les vœux de la mortelle la plus exigeante. Quant aux modes proprement dites, elles ne s’en rendaient pas un compte très exact. En somme, Norton ne s’ennuya point ; il s’intéressait même de plus en plus à mesure que l’intimité s’accroissait, de sorte qu’il fut assez surpris quand ses hôtes lui dirent que s’il voulait regagner son bord le même soir, comme il en avait exprimé à plusieurs reprises la ferme intention, il était juste temps de se mettre en route. Mais on le supplia de si bonne grâce de revenir le lendemain, qu’il s’y engagea volontiers.
Les gens amoureux, ainsi que les esprits qu’un dieu anime, ont probablement des lumières refusées aux autres mortels. Ils tournent volontiers en incidents gros de conséquences et en révélations extraordinaires des faits que les têtes calmes considéreraient comme insignifiants. Norton, homme sage d’ordinaire, fut sensiblement préoccupé de la conduite de Didon pendant cette journée mémorable. Lorsque Akrivie était apparue au haut de l’escalier, Didon s’était levée de la place qu’elle avait choisie aux pieds de son maître, et où, la tête allongée sur ses deux pattes de devant, elle avait eu visiblement l’intention de se reposer des fatigues de sa promenade. Regardant avec fixité la jeune fille pendant tout le temps mis par celle-ci à descendre les marches, elle s’était avancée au-devant d’elle, et voyant qu’on ne prenait pas garde à ses avances, l’avait suivie affectueusement jusqu’au sofa, s’était assise et n’avait pas cessé de la considérer de ses grands yeux noirs qui brillaient comme des escarboucles au milieu de sa toison plus noire encore. Elle ne l’avait pas perdue de vue une minute pendant cette longue visite ; à deux ou trois reprises, elle avait posé sa lourde patte sur les genoux de celle qui lui inspirait une si vive sympathie et avait réussi à se faire caresser, à sa visible satisfaction. Enfin, quand il fut bien résolu qu’on s’en allait, Didon se fit appeler trois fois avant d’obéir à son maître ; celui-ci garda dans son cœur l’impression d’une conduite si étrange de la part de sa favorite. Rien de pareil n’était jamais arrivé ; Didon ne s’était jusqu’alors laissé distraire par qui que ce soit de son affection absolue pour Henry, et Thompson lui-même, le grand et influent Thompson, chargé de régler les détails de sa vie domestique, et qui avait tenu toujours une place distinguée dans son estime, n’avait pu cependant lui inspirer rien qui ressemblât à de telles préférences. Norton fut presque épouvanté de voir Didon aussi peu sensée que lui. Il était tard quand le commandant, après avoir dit adieu à ses deux excellents et aimables hôtes, eut regagné l’Aurora. En montant l’échelle, en apercevant les hommes de garde qui vinrent le recevoir avec une lanterne, en répondant au salut de l’officier, il rentra dans son monde de tous les jours, celui où il avait l’habitude de se trouver à l’aise. Cette fois-ci, il n’éprouva pas la même impression, et, aussi vite qu’il put, il traversa la réalité pour se replonger dans le rêve. Cependant il lui fallut entendre le rapport du second. Tout allait bien sur l’Aurora. Les très légères avaries étaient en voie d’une prompte réparation ; les officiers avaient passé la journée à terre et trouvé une place admirable pour y installer une partie de cricket, laquelle avait été des plus mouvementées. On se proposait de recommencer le lendemain. On avait acheté des moutons superbes, au dire du cuisinier, et des légumes frais dont on avait apprécié à dîner la saveur exceptionnelle. Le second assura à son chef que Naxos était un excellent pays. Norton craignait fort de ne partager que trop cette manière de voir, bien que pour d’autres motifs ; il descendit chez lui, suivi de Didon, dans laquelle il entrevoyait avec une certaine terreur des préoccupations analogues aux siennes.
Mais il ne put tenir sur son lit. Il alluma un cigare, regagna le pont, et là commença une de ces promenades monotones, chères aux marins, dans lesquelles ils ont coutume de dépenser l’excédent de leurs rêveries, de leurs désirs étouffés, de leurs projets non réalisés, de leurs ennuis trop pesants. De l’extrémité de l’arrière au pied du grand mât, il marchait, l’esprit à mille lieues du monde des planches et des cordes où son corps s’agitait. Le ciel de la nuit était limpide et profond, la lune étincelante ; chacune des milliers d’étoiles flamboyait ; certainement son âme ne brillait pas moins en lui-même. Elle passait, comme un général d’armée, une étrange revue ; celle des formes charmantes auxquelles depuis qu’elle se connaissait elle avait voué, ne fût-ce qu’une semaine, un sentiment de tendre admiration. La fraîche Irlandaise aux traits fins qui l’avait fait rêver quand il était sorti d’Eton ; Molly Greeves, qui avait tant pleuré quand il avait quitté la maison de son oncle après son premier congé ; Catherine Ogleby, à laquelle il avait été fiancé, et qui avait épousé un officier des gardes pendant son séjour en Chine ; Mercedès de Silva à Buenos-Ayres, Iacinta à Santiago, Marianne Ackerbaum dans un des ports de la Baltique ; en vérité, en vérité, il avait aimé tout cela, plus ou moins, mais il avait aimé ; il avait espéré, il avait cru, il s’était agité, il avait eu plaisir, peine, peur, ennui, douleur, joie intense, tristesse réelle ; tout cela n’était plus que cendres, mais il avait aimé, et ces cendres se réunissant dans un nouveau foyer servaient maintenant à le rendre plus chaud, et au milieu, dessus, d’un nouveau bois, d’une nouvelle flamme et plus haute de beaucoup que toutes celles qui l’avaient jadis animé, s’élançait son amour pour la fille de Naxos.
Les comparaisons qu’il pouvait faire entre les sentiments dont il avait été successivement occupé et celui qui venait de l’envahir l’amenaient invinciblement à cette conclusion qu’il aimait cette fois d’une manière nouvelle, plus forte, plus dominatrice, à coup sûr plus pénétrante, et qui saisissait jusqu’à la dernière des fibres de son être. Était-ce dû seulement à la beauté d’Akrivie ? Cette beauté, il est vrai, était incomparable et supérieure à ce qu’il avait jamais vu ou rêvé ; cependant elle n’eût pas suffi à opérer le miracle. On n’aime plus aujourd’hui une femme uniquement parce qu’elle est belle ; cela arrivait autrefois, dans les temps antiques, dans les temps barbares, mais ne saurait plus se produire chez des esprits aussi raffinés que ceux de l’époque actuelle. L’énergique David, fils de Ruth, voulant à tout prix posséder une Bethsabée, dont il ne connaissait que les belles épaules, faisait tuer, à cette intention, son meilleur serviteur, accumulait les iniquités et risquait de se brouiller à jamais avec Jéhovah pour cette belle affaire. De même encore Pâris, fils de Priam, devait aller au-devant de tous les malheurs sur la simple vision de posséder un jour la créature la plus physiquement accomplie de l’univers ; bien que ne l’ayant jamais vue, il l’adorait d’avance et de confiance en cette qualité. Mais ce ne sont pas là des sentiments modernes, et Norton, grand analyste, n’avait pas besoin de considérer longtemps l’état de son cœur pour se convaincre que l’agitation qu’il y voyait n’était pas le résultat de la seule influence des yeux. D’où venait-elle donc ? Akrivie était sans esprit, montrait l’ignorance baptismale en toutes choses, et, dénuée de la moindre coquetterie, n’avait cherché en rien à plaire pas plus qu’à déplaire à son admirateur ; s’il lui avait inspiré un sentiment quelconque, c’était celui de la curiosité, et il n’en était résulté sans doute sur l’imagination de la belle qu’une impression de la singularité des étrangers en général et des capitaines de la marine anglaise en particulier. Et pourtant Norton devinait quelque chose d’autre encore dans cette nature, si différente de celle des autres femmes qu’il avait plus ou moins aimées ; cette autre chose l’attirait, le charmait, en un mot qui contient tout, le rendait amoureux comme il l’était devenu. Il mit du temps à découvrir le secret ; à la fin il y réussit, et cela lui faisait honneur.
Les conditions d’existence réunies autour d’Akrivie étant exactement celles où se trouvaient les femmes d’il y a trois mille ans, isolement, affections limitées, ignorance absolue du monde extérieur, le résultat produit avait été pareil sur la fille de Naxos à ce qu’on avait pu le voir sur les tempéraments d’élite de ces temps reculés. Les qualités natives de la jeune fille n’avaient pas été supprimées mais concentrées, et au lieu de s’épandre luxueusement en fibrilles multipliées, couvertes de feuilles, de fleurs, de fruits, elles avaient poussé droit en branches fortes, sans nœuds, montant vers le ciel, ayant du charme mais encore plus de majesté, de la séduction, mais plus encore de grandeur. Toute la puissance de son âme s’était concentrée dans son entourage, et aucune curiosité de regarder au-delà ne l’agitant, ne l’occupant même, rien de ce qu’elle avait d’énergie pensante n’avait été distrait de ce qu’elle devait aimer, et aucun instinct ne l’avait portée à en agrandir le cercle. Encore une fois, Akrivie était la femme des temps homériques, ne vivant, n’existant, n’ayant de raison d’être que par le milieu où elle se mouvait, fille, sœur exclusivement, en attendant qu’elle devînt, d’une manière non moins absolue, épouse et mère. L’être indépendant se retrouve peu dans de telles natures ; ce sont des reflets ; elles ne peuvent et ne veulent être davantage, et leur gloire et leur valeur, qui ne sont pas petites, sont là. Rien qui ressemble moins à la femme parfaite, telle que les sociétés actuelles l’ont inventée et la réalisent plus ou moins ; celle-ci veut, cherche, arrive ou échoue à ses périls propres ; en tout cas, elle est fort différente de l’autre, et, sans injustice, on ne saurait jamais les comparer. Quoi qu’il en soit, bien ou mal, voilà ce qu’était Akrivie, et Norton le voyait. Elle lui rappelait avec raison une de ces belles filles peintes sur les vases athéniens, puisant l’eau dans leur amphore à la fontaine de la cité, et regardant d’un œil impassible les héros se battre et mourir pour leur conquête aussi longtemps que le résultat de la lutte ne les a pas consacrées au vainqueur.
Voici le plus curieux : Norton, homme du monde par excellence, fait à la meilleure et à la plus brillante compagnie de l’Europe, gardait au fond du cœur, à l’état latent et sans l’avoir jamais aperçu lui-même, faute d’occasion, un attrait puissant pour cette sorte de tempérament féminin. Il s’en étonna d’abord, car, jusqu’à ce jour, il avait été constamment séduit par les qualités contraires. En y regardant bien pourtant, il s’accorda sans peine que le charme n’avait jamais été d’une longue durée ; les ruptures avaient eu lieu sans autant de souffrance qu’il en aurait fallu pour être un amant parfait ; à l’extrême vivacité de l’une de ses maîtresses, à l’esprit étincelant de l’autre, à la tendresse abandonnée d’une troisième, il avait trouvé des arrière-goûts ; disposition funeste ressemblant fort à l’ingratitude et dont il s’était accusé en secret. Maintenant, il se prenait à aimer une sorte de grande enfant, étrangère à ses habitudes, à ses admirations, à ses mœurs, à ses idées, et cela sans avoir de meilleure raison à se donner que, visiblement, elle était la complète antithèse de ce qui ne lui avait qu’à moitié plu jusqu’alors ; il en concluait qu’elle était née et faite pour lui.
C’est en tant qu’Anglais, et Anglais jusqu’au bout des ongles, Anglais d’imagination comme de sang, que l’événement avait lieu. Cette race normande, la plus agissante, la plus ambitieuse, la plus turbulente, la plus intéressée de toutes les races du globe, est en même temps la plus portée à reconnaître et à pratiquer le renoncement aux choses. Norton, né dans une situation sociale propre à lui permettre de prétendre à beaucoup, ne s’était jamais reposé sur les protections qui entouraient sa jeunesse, et, par orgueil comme par activité naturelle, il s’était donné autant de mal que l’eût pu faire un homme de rien pour gravir le plus vivement possible les échelons de son métier. Il avait navigué, travaillé sans relâche, lu énormément, beaucoup pensé, et chaque fois qu’une occasion d’agir s’était présentée, il ne l’avait jamais laissée échapper. On a déjà vu qu’il avait dans l’esprit infiniment de poésie ; mais en aucun cas il n’avait permis à la rêverie d’intervenir entre lui et les faits ; le monde ambiant n’avait connu de son âme que le côté pratique et l’âpreté judicieuse, honorable, mais enfin l’âpreté au succès. Et c’était à ce moment où, parvenu jeune à un degré supérieur dans son état, tout lui devenant facile, promenant sur ce tout un regard désenchanté ; il se demandait à lui-même quelle était la valeur, intrinsèque des biens pour lesquels il avait si obstinément lutté jusqu’alors. Cette question, il se l’était adressée bien des fois depuis quelques mois déjà, et à chaque rencontre, il trouvait plus difficile de résoudre le problème, ou, pour mieux dire, il descendait un degré de plus vers une réponse méprisante. C’était à ce tournant de son existence que la fortune l’amenait à Naxos, où rien de ce qu’il avait contemplé jusqu’alors n’existait, et elle lui montrait Akrivie.
Le jeune commandant se rendit compte de tout. Pendant sa promenade nocturne, il aperçut avec lucidité le point où il en était. Il se vit sollicité par des forces divergentes. Encore l’homme de la veille, déjà l’homme du lendemain, juge et arbitre entre les deux, tout ce qui lui appartenait d’énergie dans l’âme fut employé à ne pas hâter une solution. Car, se dit-il avec une certaine amertume, la carte que je suis disposé à jeter dans cette partie sera une carte décisive, et ces coups-là ne doivent pas se jouer sous les dangereuses influences d’une nuit sublime et d’un cœur troublé.
C’était un homme logique et suprêmement maître de lui. À la grande joie de Didon, qui dormait mal sur les planches et avait depuis longtemps envie de s’étendre en bas sur sa peau d’ours, il alla se coucher. Dès le matin, de bonne heure, il était sur pied, et trouva la majeure partie de ses officiers déjeunant à la hâte, pour courir reprendre leur partie de cricket et revêtir des costumes étranges, que tout véritable Anglais chérit en pareille circonstance. Des bottes montantes ou des brodequins de couleur, des pantalons de tricot blanc serré ou des hauts-de-chausses bigarrés flottants sur les hanches, des camisoles rouges, ou bleu de ciel, ou rayées de mille façons, le cou, les bras nus jusqu’à l’épaule, quelquefois des gants de peau de daim, des casquettes extravagantes ou des chapeaux de paille avec des rubans, et l’énorme battoir, instrument du jeu, sur l’épaule, c’est dans cet équipage que le gentleman imbu du respect de lui-même doit se produire à l’admiration publique ! Que ce soit sur une prairie anglaise, sur une savane de l’Australie, en vue d’une pagode de la Chine, sur une plaine glacée aux environs du pôle Nord, un Anglais de bonne fame et renommée qui va jouer au cricket ne saurait s’affubler autrement sans se compromettre. Norton souhaita beaucoup de plaisir à ses compagnons, et ayant, dans sa baleinière, rapidement atteint le rivage, il y trouva fidèlement MM. de Moncade et Phrangopoulo, arrivés là pour l’attendre, et toujours dans leurs habits antiques et leurs hautes cravates blanches ; il échangea avec ces vénérables personnages deux franches poignées de main, et sautant sur le mulet préparé, il reprit avec eux le chemin du manoir.
La journée se passa mal pour Norton, bien qu’en réalité aucun incident saisissable ne fût venu s’y produire. Mais les amants ont une manière à eux d’apprécier ce qui arrive. La réception du marin anglais par les dames avait pourtant été plus cordiale que la veille, par ce seul fait qu’il était déjà mieux connu. Madame Marie n’avait pas plus parlé, mais elle s’était montrée plus à l’aise. Madame Triantaphyllon avait été réjouie de voir son plus jeune enfant dans les bras du commandant et lui prenant les cheveux à pleines mains sans témoigner aucune crainte. Akrivie s’était montrée aussi insoucieuse, mais Norton, et là était le sujet de peine, en avait sagement conclu que cette grande tranquillité indiquait trop qu’il n’avait fait aucune impression et qu’il n’existait même pas de raison de croire qu’il en pût faire jamais. Ce dernier mot est assuré de tenir constamment une place distinguée dans le vocabulaire des gens épris.
De sorte qu’il ne se passa rien et seulement Norton fut de plus en plus confirmé dans son opinion touchant le caractère de la belle Naxiote, et comme il y avait en lui un combat marqué entre l’homme civilisé qui voulait être aimé et sentait ne pas l’être, et l’homme ennuyé et quasi dégoûté, tout enclin à brûler ce qu’il avait adoré et à adorer ce qu’il ignorait, il revint à bord, contrit d’une part, jurant qu’Akrivie était une sotte, sans âme et sans chaleur, et d’autre part disposé plus que la veille à trouver que c’était une grande âme, bien digne d’être son initiatrice à une vie meilleure et plus libre, plus logique et plus vraiment mâle que celle dont jusqu’alors il avait suivi les pratiques. Il ne se promena pas sur le pont, se coucha, mais Didon fut seule à dormir. Comme le cricket avait été semé des incidents les plus dignes d’être commentés, Norton entendit fort tard des discussions animées dans le carré des officiers. Il n’avait pas fermé l’œil quand le jour le mit sur pied, et, après avoir donné ses instructions à son second et écouté les différents rapports d’usage qui lui parurent, peut-être pour la première fois de sa vie, parfaitement ridicules et souverainement insupportables, il alla retrouver ses deux hôtes, plus que jamais revêtus de leurs immortels habits noirs.
Cette troisième journée se distingua par un fait de conséquence. Norton proposa à la compagnie une partie en mer, et l’occasion en fut fournie par l’à-propos d’aller voir où en était le volcan nouvellement apparu à Santorin. Il n’y a que peu d’années que ce grand phénomène a commencé ou plutôt recommencé, et le commandant vanta ce que ce spectacle avait de prodigieux, afin de faire naître quelque curiosité chez les habitantes du manoir. Madame Marie secoua la tête avec dédain, et fut inébranlable dans sa résolution de ne pas bouger ; madame Triantaphyllon avoua qu’elle serait bien aise de voir comment la corvette anglaise était faite ; quant au reste, cela ne l’intéressait pas. Akrivie trahit un peu plus d’animation ; c’était, comme sa belle-sœur, la corvette qui l’attirait principalement ; mais le voyage ne lui déplaisait pas. Quant au volcan, elle s’en souciait peu ; une montagne en flammes lui semblait un pur paradoxe et ne lui inspirait rien. Les deux vieillards parurent infiniment plus excités. Ils acceptèrent avec empressement l’invitation, et, après beaucoup de débats, on convint que la belle Akrivie occuperait la chambre du commandant ; son père et son parrain prendraient le salon ; madame Triantaphyllon accompagnerait sa belle-sœur jusqu’à bord et déjeunerait sur l’Aurora, où on lui montrerait tout, puis reviendrait à la campagne, tandis que la corvette ferait son expédition limitée à trois jours au plus.
Les conversations furent interminables ; à ce sujet les questions les plus naïves et les plus enfantines furent faites, et avec une gaieté extrême ; mais Norton eut le plaisir de constater une fois de plus qu’il ne causait pas à Akrivie la plus fugitive émotion.
Le lendemain, les choses se passèrent comme on l’avait arrangé la veille. À six heures du matin, la famille naxiote était sur le pont du navire. On déjeunait, on montrait le bâtiment de fond en comble aux visiteurs. Triantaphyllon trouva ce spectacle fort extraordinaire, et il en resta pour toujours dans sa tête une étrange confusion de cordes, de mâts, de plaques de tôle, de pistons de cuivre et de fumée noire. Ce qu’elle déclara parfaitement beau, ce fut le grand canon de l’arrière, sur lequel on ne put jamais la décider à appuyer la main, bien qu’elle en mourût d’envie. Quand le moment fut venu pour elle de retourner à terre, il y avait déjà deux heures qu’elle le souhaitait ardemment, parce que c’était la première fois qu’elle avait quitté ses enfants pendant un temps si long, et elle était excessivement inquiète. Néanmoins, elle s’aperçut qu’elle l’était presque également de ce qui pouvait arriver à ses parents dans leur aventure inouïe, et avant de quitter la corvette, elle embrassa étroitement Akrivie en répandant sur son cou quelques larmes amères, mais silencieuses ; puis elle partit, et l’Aurora, ayant levé ses ancres, se mit en mouvement, sortit lentement du port et gagna la haute mer.
À mesure que l’on avança vers Paros et qu’Akrivie, donnant plus d’attention à ce qui se passait autour d’elle, sortit davantage de sa tranquillité, Norton remarqua avec un intérêt extrême qu’elle n’avait point une insensibilité si inébranlable qu’il avait paru jusqu’alors. Ce qui se voyait au large, ce qui se passait à bord mettait des rayonnements dans ses yeux. Henry l’épiait comme un jardinier suit les progrès d’un bourgeon qui s’ouvre et devient fleur. Elle paraissait chercher à comprendre les gens qui l’entouraient ; ceux-ci, à leur tour, faisaient de leur mieux pour obtenir un regard d’une si adorable personne, car on peut assez se figurer que l’état-major de l’Aurora était en admiration. Le second étalait les grâces de sa poitrine et faisait miroiter son pantalon blanc, les boutons d’or de sa chemise aux plis irréprochables et la chaîne de sa montre. Le navigating-officer, bien qu’absorbé par le service, trouvait des moments pour offrir une observation ingénieuse en donnant un tour des plus séduisants à ses favoris rouges. Les masters s’empressaient de monter sur le pont des fauteuils de toutes les formes, et préparaient des breuvages élaborés avec les éléments les plus étranges. Seul, le docteur, maintenu dans son calme par ses soixante ans, essayait d’obtenir, au moyen du peu de grec qu’il savait et qu’il maniait avec des procédés plus que suffisants pour donner une attaque de nerfs à Démosthène si ce grand orateur avait pu l’entendre, quelques renseignements sur la flore de Naxos, et M. Phrangopoulo lui décrivait un arbre quand son savant interlocuteur avait cru tenir la monographie d’un brin d’herbe microscopique. M. de Moncade était en admiration devant l’hélice, qui faisait alors soixante-quinze tours. Ce qui captivait le plus Akrivie, c’étaient les aspirants, surtout le plus petit. Ils étaient en ébullition par sa présence ; mais la discipline ne leur permettant pas de s’aventurer sur l’arrière, ils se contentaient de dévorer la jeune fille des yeux. Elle ne faisait d’ailleurs aucune question ; mais Norton sentait qu’elle regardait tout, et il s’amusait de la voir ainsi.
Quand on fut à Antiparos, engagé dans le chenal entre l’île et un îlot couvert de broussailles, Akrivie étendit la main avec admiration vers les grandes falaises de la côte, et dit à Henry : « C’est du marbre ! » C’était du marbre, du marbre blanc, et l’effet en est prestigieux. La mer, les vents, la pluie, les tempêtes ont en vain souillé de leurs haleines ces masses énormes d’une matière divine ; elles gardent toute leur noblesse et toute leur beauté et l’étalent pompeusement au long de ces rivages. Quelques voyageurs ont déjà fait l’observation que le seul fait d’être bâtie en marbre, et même en marbre brut, suffit pour mériter à Gênes l’appellation glorieuse de Gênes la Superbe ; que peut-on dire d’une île dont les rochers sont du marbre et du marbre parent de celui d’où sortirent jadis la Vénus et tant de milliers de divinités maîtresses de l’admiration du monde ? Akrivie n’analysait pas ses sensations, et n’en eût pas trouvé les moyens dans sa petite raison ignorante ; mais elle sentait comme par un pouvoir magnétique, et, se dit Henry en lui-même, par cette sorte d’affinité que toutes les expressions de la beauté ont entre elles, le voisinage et l’effet de la splendeur dressée devant ses regards.
On résolut d’aller se promener dans l’île, et de ne partir qu’à la nuit pour Santorin.
Chacun était gai et excité. Il est sans doute agréable de naviguer avec une jolie femme, mais il l’est plus encore de se promener avec elle sur la terre ferme. L’air de la mer, la vivacité inusitée des conversations, l’aspect de tant de choses inconnues, avaient rehaussé les couleurs du teint d’Akrivie, et ce fut en riant du meilleur cœur qu’elle accepta l’empressement joyeux des officiers à la conduire dans l’embarcation. Plus on approcha du rivage, plus on le vit aussi comme il était, c’est-à-dire un peu dépouillé du charme que prêtent de loin la pureté de l’air et les belles colorations qui en sont les accompagnements, dès lors, austère, pierreux, désert, et, pour unique végétation, ne présentant que des buissons et çà et là un arbre rabougri. Quand on eut touché le sable, Norton envoya plusieurs des aspirants à la découverte, et presque aussitôt un de ces enfants, Charles Scott, un Écossais, revint en courant apprendre à son supérieur que derrière une petite colline, à trois cents pas de la grève environ, on apercevait une demeure assez vaste. La caravane prit aussitôt cette direction, et M. Phrangopoulo, après s’être recordé avec M. de Moncade, expliqua ce que devait être le propriétaire du domaine vers lequel on se dirigeait.
Cinq à six ans en çà, un Grec des îles Ioniennes, le comte Spiridion Mella, était venu planter et cultiver la vigne à Antiparos, dans l’intention de lutter avec les produits de Santorin. Il réussissait ou ne réussissait pas, c’est ce que personne ne savait ; en tout cas, il représentait dans ce coin paisible l’omniprésence et l’omniagitation de l’industrie européenne. Antérieurement, il avait représenté bien d’autres choses. Au temps de sa jeunesse, il avait servi en Russie et figuré sur les cadres d’un régiment ; aide de camp d’un général, il s’était fait quelque réputation dans le beau monde de Moscou. Puis laissant là les épaulettes, il avait pris son chemin vers Constantinople, où la politique s’était emparée de lui. Préconisé par les uns, dénigré par les autres, il s’était difficilement faufilé à travers bien des méandres, et après d’assez longues années d’agitation, on l’avait vu à Alexandrie faisant le commerce. Là il s’était mis en relation avec des négociants, ce qui l’avait conduit dans l’Inde. Probablement les profits du voyage avaient été minces, car le comte Mella, retournant vers sa patrie avec un équipage très modeste, s’était établi dans le Péloponnèse, où il était resté quelques années. Cependant il avait vieilli ; soixante-dix ans ou à peu près sonnaient à ses oreilles le conseil de devenir sage. Il en profita pour épouser une toute jeune femme, et après deux ans d’union, il était venu tenter la fortune une fois de plus à Antiparos. Ainsi, tour à tour militaire russe, politique turc ou grec, négociant égyptien, courtier indien, le comte ionien se trouvait maintenant viticulteur dans les Cyclades. On ne peut refuser à ce type, qui n’est nullement. rare en Orient, beaucoup d’activité, beaucoup d’ingéniosité, beaucoup de souplesse et une grande philosophie contre la mauvaise fortune.
Norton vit venir de loin l’insulaire à la rencontre des hôtes qui lui arrivaient ; du moins il supposa, et avec raison, que la description des deux Naxiotes ne pouvait, dans toute l’île d’Antiparos, convenir qu’à la seule figure cheminant à cette heure au bout du sentier. Le comte était un homme de moyenne taille, pauvrement vêtu, mais non sans prétention, et qui ne paraissait nullement avoir l’âge avancé que M. Phrangopoulo lui attribuait. Il se montra fort hospitalier, emmena la bande débarquée de l’Aurora à sa maison construite au milieu des pierres, lui fit admirer quatre malheureux petits arbres de six pieds de haut, plantés en haie devant la façade, et qui ne pouvaient manquer de devenir grands quelque jour et même d’avoir des feuilles, si le vent leur prêtait vie ; montra d’un air mystérieux et satisfait une demi-douzaine de fragments de marbre horriblement mutilés, découverts en posant les fondations de la maison, et fit une longue description des chefs-d’œuvre antiques sur lesquels il se tenait assuré de mettre la main quelque jour. En attendant, il n’avait que de très mauvais débris de la plus basse époque. La célèbre découverte de la statue trouvée en 1821 dans l’île de Milo est devenue la légende favorite des Cyclades, et il n’est pas dans tout l’archipel si mince rocher dont les habitants ne rêvent la prochaine exhumation de quelque Vénus.
L’île d’Antiparos n’est pas grande ; elle possède pourtant un certain nombre de cabanes de pêcheurs, et même elle a un village ; mais son attrait est d’un autre genre. Le comte Mella conseilla à ses hôtes de ne pas perdre une si belle occasion de visiter la fameuse grotte située au sommet de l’île, et tous les officiers se montrant pleins d’ardeur pour l’expédition, Norton, charmé de courir la campagne auprès d’Akrivie, acquiesça avec empressement au vœu général. On envoya sur le navire chercher des hommes de renfort, des cordes, des échelles et des torches, et l’on se mit en route.
Aucune île grecque n’est si absolument dénudée qu’elle ne possède quelque peu de verdure à l’intérieur, et, comme ces belles personnes à qui le moindre ornement suffit, le plus petit buisson donne soudain à un coin de paysage une grâce inimitable. La région parcourue par les promeneurs était extrêmement accidentée ; c’étaient toujours de grandes masses de marbre blanc, ici tachées de noir, là d’une couleur de rouille qui atteignait les tons orangés les plus vifs ; des arbustes épineux tordaient, dans les angles où la terre végétale avait pu maigrement se former, leurs rameaux gris piquetés de feuilles minces, lancéolées, peu colorées ; le long des ravins, où pendant l’hiver coulaient des torrents tumultueux et colères, mais dont en ce moment il ne restait pas une goutte d’eau, se dressaient, par touffes épaisses, de beaux lauriers luxuriants ; pourtant ce luxe ne se révélait que quand on l’avait cherché avec peine ; belle image de la gloire, elle ne se rencontre pas sur les sentiers faciles. Charles Scott, l’aspirant écossais, trouva pourtant moyen de cueillir deux bouquets. Il offrit le premier à Akrivie en rougissant jusqu’aux oreilles, au passage d’une sorte de petit défilé où il crut n’être vu de personne ; le second, elle le trouva le soir auprès de son lit, le coupable l’ayant remis à Thompson avec l’horrible mensonge que la jeune demoiselle l’avait cueilli elle-même, et qu’il s’était chargé de le porter. De sorte qu’Akrivie eut ce jour-là, dans l’état-major de l’Aurora, deux amoureux et une foule d’admirateurs. Norton s’apercevait qu’il avait un rival ; mais il n’en était point inquiet, et loin d’en concevoir de l’humeur, il sentit augmenter sa sympathie ancienne pour l’audacieux, son protégé de tout temps. La mère de Charles Scott, veuve d’un clergyman et sans aucune fortune, possédait deux enfants, une fille aînée, Effie, à peu près de l’âge d’Akrivie, et Charles. Pour élever celui-ci et lui faire obtenir son entrée dans la marine, il avait fallu bien des efforts et une longue résignation à bien des misères. Charles le savait non seulement par ses yeux, mais par son cœur, et vivre pour sa mère et pour Effie était le grand mobile de son âme et un but toujours présent à ses pensées. Il n’avait d’autre idée que d’arriver à faire l’existence aussi belle que possible à ces deux êtres chéris. Pas de palais qu’il n’examinât d’un œil critique et ne se promît d’acheter, s’il en valait la peine, afin d’y loger ses idoles un jour. Il ne prétendait rien leur rendre, et voulait tout leur donner. Quant à lui, il était résolu à ne point se marier, pour s’occuper uniquement des enfants d’Effie lorsqu’elle aurait épousé le plus jeune, le plus beau et le plus riche des membres de la chambre des lords. À la vérité, Akrivie venait de faire sur lui une impression qui le bouleversait ; mais il trouvait que la jeune Naxiote ressemblait à Effie. Norton s’en douta, et dit au jeune homme :
– Scott, ne trouvez-vous pas que cette jeune personne rappelle Effie ?
– Oh ! oui, monsieur, répondit l’aspirant en rougissant jusqu’aux oreilles.
Les choses eussent été au mieux, si pendant la promenade un autre aspirant ne s’était permis quelques plaisanteries audacieuses sur la préoccupation de son camarade. Il en résulta une bataille à coups de poings où Charles fut l’agresseur, et il mit une colère si chaude dans l’action, qu’il fallut lui arracher des mains son malheureux adversaire, les deux yeux noirs et la bouche saignante. Le docteur, seul confident de cette équipée, que l’on sut dérober à la connaissance du second, observa judicieusement, en bassinant le visage de la victime, que partout où Vénus se faisait voir, Mars n’était pas loin. C’était un homme damnablement classique que ce vieux docteur ; mais il n’en raconta pas moins avec aplomb au terrible second que ce maladroit Georges Sharp s’était laissé tomber sur des pierres.
Cependant on était arrivé au point culminant de l’île, et l’ouverture de la grotte, déjà aperçue du pied du dernier piton, se présentait dans toute sa majesté aux regards des visiteurs réunis sous sa voûte. C’est une immense coupole taillée par la nature en plein marbre, et qui ne paraît pas profonde surtout parce qu’elle est haute. On disposa les cordes, on alluma les torches, et les matelots, les premiers hommes du monde pour les expéditions de ce genre, se mirent à préparer la descente sous la direction savante d’un des lieutenants qui connaissait les lieux.
On peut à la rigueur comprendre que les géologues ou les naturalistes, gens à prétentions dans ces matières et habiles par état à découvrir des clartés dans des trous noirs, soient autorisés à descendre en de tels endroits sauvages ; mais les autres humains n’ont rien à y faire. Les savants pensent rencontrer là un butin quelconque ; s’ils se rompent le cou ou quelque membre, ils ne sauraient être absolument ridicules ; on n’en pourrait dire autant de leurs ignorants imitateurs. Pour descendre dans la grotte d’Antiparos, il faut se glisser comme un renard par un des couloirs étroits ouverts au fond, à droite et à gauche de la grande entrée. On entre dans des ténèbres opaques, plié en deux pour ne pas se casser la tête contre la roche surplombante. On se traîne péniblement et dans la position la plus absurde sur une pierre suintante et glissante, et l’on attrape un bout de corde. On s’y cramponne et on se laisse glisser assez bien tant que le plan sur lequel on chemine est incliné ; tout d’un coup il devient rentrant, et l’on s’accroche alors aux anfractuosités avec la main qui ne tient pas la corde, cherchant à ne pas aller tomber on ne sait où, puisqu’on n’y voit goutte. Voilà pour le premier chapitre ; ce plaisir s’arrête lorsqu’on sent un terrain sous ses pieds. Il ne faut pas se réjouir prématurément ; on est sur une corniche étroite, et il est bon de la quitter très vite. Le second chapitre commence, et en approchant la torche de près et en s’appuyant sur la paroi contre laquelle on vient de glisser, on arrive à une brèche où s’attache une échelle de corde. On en voit la tête, mais au-dessous rien, c’est le vide noir et béant ; aucune illumination ne pourrait en faire apercevoir davantage, car on n’a pas encore eu le temps de chasser de ses yeux la dilatation normale apportée quelques minutes auparavant par les rayons du jour.
On est donc sur l’échelle de corde ; on descend avec les précautions que l’instinct naturel inspire. Le mur en pierre sur lequel on travaille a suffisamment d’inclinaison pour faire adhérer l’échelle, et si les mains n’ont que fort peu de prise, le bout des pieds en a moins encore ; cependant il est intéressant de ne pas lâcher, car on n’a aucune idée ni de l’endroit où l’on irait choir, ni des circonstances qui accueilleraient l’arrivée en bas. On n’apprécie le fait qu’après avoir réussi à plonger sans encombre dans ce gouffre. On est alors sur une sorte de plate-forme très restreinte, ruisselant de l’eau transsudée par la roche ; il fait froid comme au fond d’une cave, et l’humidité saisit. De moins en moins on se trouve à l’aise ; l’air est lourd et chargé de vapeurs. Les torches qui brillent çà et là et l’habitude déjà prise des ténèbres vous font découvrir assez vite que vous n’êtes pas au bout. Vous vous baissez, vous saisissez une autre corde liée à l’anfractuosité d’une pierre, et de nouveau vous vous laissez glisser. Cette fois, vous en avez fini avec ce mode de locomotion par suspension dans le vide. On est arrivé sur un terrain fortement incliné et composé uniquement d’angles aigus très saillants, c’est-à-dire qu’on a à franchir un semis de gros quartiers de marbre tranchant tombés de la voûte, et sur la pointe desquels il s’agit de marcher en équilibre. On s’éreinte, et c’est ainsi qu’on parvient tout au fin fond de la caverne ; là, on lève la tête, et on est dignement récompensé de l’ineptie de tant d’efforts : on ne voit quoi que ce soit qui vaille la peine d’être cherché à trois pas.
L’élévation assez haute de la voûte manque de caractère, d’abord parce que c’est de ce lieu même que l’on est descendu, et l’on en garde rancune, ce qui tue radicalement toute cette part de sympathie sans laquelle il n’y a pas d’admiration ; ensuite parce que l’œil peut monter aisément jusqu’au dernier comble en suivant des entassements successifs de débris et des circonvolutions multipliées de corniches rompues et sans proportions aucunes. L’espace compris sous cette calotte mal agencée serait peut-être vaste, mais il ne le paraît pas ; il est interrompu dans le milieu par de trop grands éboulements formant une foule de compartiments assez petits, et le long du rocher, les stalactites pendantes, croulantes, éparses, ont formé une série de cabinets particuliers, parfaitement semblables à ces arrière-caves où se conservent les vins estimés précieux. Quant aux stalactites elles-mêmes, ce sont ces laideurs connues dont raffolent partout les amateurs des merveilles de la nature ; une contrefaçon du sucre de pomme figé hors du moule ; quelque chose de coulant, d’informe, de gauche, large mal à propos, mince à contretemps, et avec des prétentions larmoyantes. La seule chose qui console un peu de l’ennui qu’on éprouve, c’est de rencontrer des inscriptions fort éloquentes sur la bêtise organique de la race humaine. Une surtout est remarquable. Au fond d’un recoin, au revers d’une des grosses stalactites, s’étale la phrase suivante : « Hélène de Tascher, femme incomparable ! trésor du marquis de Chabert ! – 1775. » Il faut que le marquis de Chabert ait lutté bien malheureusement contre une indiscrétion naturelle irrésistible, pour s’être vu contraint d’y céder au fond de la grotte d’Antiparos. Le courage malheureux a peu de traits plus touchants.
Quand les officiers anglais eurent assez vu qu’il n’y avait rien à voir, on remonta, et, par parenthèse, s’il n’est pas commode de descendre, l’opération retournée est encore plus laborieuse. Heureusement, les accidents se bornèrent à quelques chutes sans gravité et à des pantalons compromis. Norton avait cru devoir sacrifier quelques instants, qu’il aurait pu passer assis à l’entrée de la caverne auprès d’Akrivie, à la convenance de ne pas abandonner son monde. Il en fut quelque peu récompensé par l’effet terrible que les récits de l’énorme difficulté de l’entreprise, offerts par le comte Mella à l’imagination de la belle Naxiote, réussirent à produire. Le gentilhomme corfiote en dit tant, qu’au moment où il achevait la peinture de l’écrasement complet de vingt-deux personnes, dont un pacha turc, par les roches détachées de la voûte, Norton, reparaissant avec son monde, apparut comme un héros et fut reçu avec d’autant plus d’enthousiasme qu’Akrivie, tenant la perte de l’état-major, commandant en tête, pour un fait consommé, se demandait déjà comment elle pourrait retourner jamais à Naxos. Elle fut si expansive dans sa joie, que Norton, qui n’en soupçonnait pas la cause véritable, sentit naître en lui une vague espérance, et déjà porté à surfaire ses progrès dans l’esprit de sa belle au bois dormant, il commença à perdre quelque peu de son sang-froid. À dater de ce moment, il crut possible de devenir quelque chose aux yeux d’Akrivie.
L’effet immédiat de son illusion fut de l’exalter, et son humeur en devint communicative et charmante ; mais il n’est pas toujours heureux d’être heureux. On tombe hors de garde et on néglige trop les précautions en cheminant au travers des épines du monde. Quoi qu’il en soit, Henry était désormais dans cette disposition qui fait apercevoir toutes choses sous un jour si brillant, que longtemps après l’instant où l’on a senti de la sorte, on se souvient des moindres détails, des moindres accidents, des moindres faits comme des plus délicieuses apparitions que la vie entière ait pu fournir.
La visite à la grotte avait pris un temps considérable, et, de retour à la plage, il fallut se presser de faire des adieux au comte Mella et de retourner à bord, afin d’aller trouver un dîner préparé avec toute la magnificence dont le cuisinier des officiers était capable, car, à la demande de l’état-major, Norton avait consenti à accepter pour ses hôtes et pour lui l’hospitalité du carré.
Le moral des officiers de marine subit par la vie de bord une double influence. Dans les premières années du service, l’ennui des longues journées monotones est heureusement combattu par l’amour du métier ; cependant il pèse quelquefois beaucoup, et alors tout ce qui vient changer le régime ordinaire est ardemment accueilli et goûté avec transport. Plus tard, l’amour du métier n’existe plus ; l’officier ne continue à servir que parce que la nécessité l’y contraint ; il est dégoûté mais résigné, et dans cet état déplorable de l’âme, qui n’est autre que l’abattement de la servitude sans espérance, la seule consolation, l’unique adoucissement est précisément cette monotonie morose qui, au début, était l’inconvénient de la profession. C’est pourquoi les vieux officiers ont une horreur marquée pour tout ce qui vient modifier ou interrompre le cours régulier de l’existence navale, et ils détestent le séjour des étrangers, et plus particulièrement encore celui des femmes au milieu d’eux. Cela trouble la paix de la tanière, et force bon gré mal gré à penser à quelque chose.
Par une fortune singulière, il n’y avait pas de vieux officiers à bord de l’Aurora, de sorte que tous sentiments répulsifs du genre de ceux que je viens de décrire en étaient absents. Charles Scott, l’aspirant, n’était pas le seul à s’attendrir en secret sur les perfections d’Akrivie et à pousser des soupirs. On prétendit plus tard que le vieux docteur lui-même rêva dans la nuit qui succéda à ce jour mémorable qu’il trouvait une plante nouvelle sur la plage de Milo et qu’une voix céleste se faisait entendre et lui commandait de désigner sa découverte à l’attention des botanistes sous le nom d’Akrivia incomparabilis. En un mot, le navire de Sa Majesté britannique flottait sur les eaux tout parfumé des sensations les plus discrètes et les plus délicieuses.
Soit par réaction de la sympathie générale, soit que, peu à peu, elle se trouvât plus à son aise, Akrivie, en vérité, montrait à chaque instant aux yeux ou à l’imagination de Norton des grâces et des mérites de plus. Il s’aperçut qu’elle avait une nuance de délicatesse et d’enthousiasme dans tout ce qu’elle expliquait ; elle ne savait pas grand-chose, et pour mieux dire elle ne savait rien, mais elle sentait bien et avec justesse, et son langage était rempli d’observations qui faisaient sourire quelquefois, mais qui plaisaient singulièrement. Elle n’allait pas chercher les petites choses ; elle courait au-devant des grandes, et ne les comprenant pas toujours, elle les regardait volontiers. Norton la comparait de plus en plus aux généreuses filles de Priam, que le soin de conduire un cheval à l’abreuvoir ou de mêler le vin et l’eau dans les amphores n’humiliait nullement. Cette disposition de la fille de Naxos à s’exalter pour les choses belles ou qui lui apparaissaient telles, eut une occasion naturelle de s’exercer vers le soir du lendemain. La nuit était venue, et l’air relativement obscur, bien que pénétré de la lueur générale des étoiles, étendait sur la mer une teinte bleue d’une douceur uniforme, quand on vit poindre à l’horizon une clarté rouge comme le sang.
« Voilà le volcan de Santorin ! » dit Norton en étendant le bras, et il regarda la jeune fille, curieux de voir la sensation qui allait se peindre sur ce charmant visage.
Son espérance ne fut pas trompée. L’effet produit fut instantané et sublime. Une admiration profonde se marqua dans les beaux traits qu’il examinait avec passion ; Akrivie parut grandir devant la merveille offerte à sa vue. Rien de mesquin, aucune curiosité banale, aucune prétention maladroite d’émotion factice, aucune exclamation niaisement admiratrice ne sortit de ces belles lèvres serrées. Tout fut sincère, franc, comme la cause de l’émotion était elle-même digne de l’inspirer. Il ne se peut rien voir, en effet, de plus complètement beau que le spectacle qui s’étala bientôt dans toute sa magnificence aux yeux des spectateurs de l’Aurora.
L’obscurité empêchait d’apercevoir les terres de Santorin et des îlots avoisinants, ou du moins son voile les enveloppait si bien, qu’à peine s’estompaient-elles légèrement au milieu des flots, et sur ce fond de même nuance doucement sombre s’élevait majestueusement, pareil à une théophanie et entouré d’un limbe lumineux, le cône immense d’une montagne incandescente. Sur les pentes robustes coulaient à grandes nappes les matières ignées. C’était un manteau de pourpre qui déroulait incessamment de nouveaux plis ; à mesure que l’étoffe enflammée arrivait vers la base, elle se séparait en franges qui semblaient soyeuses, et la couleur se modifiant passait du rouge le plus éclatant aux différentes teintes d’orangé, de jaune vif et de cinabre. Quelques-unes de ces minces lanières se prolongeaient beaucoup plus loin que les autres, et, atteignant le pied du mont, plongeaient dans la mer, où elles ne s’éteignaient pas sans avoir fait jaillir des millions d’étincelles, feux d’artifice permanents qui correspondaient d’une manière admirable avec les explosions constantes du sommet, où d’immenses gerbes phosphorescentes à tout moment projetées faisaient tourbillonner des torrents de fumée opaque, bizarrement éclairés un instant et retombant graduellement dans l’ombre, pour s’éclairer un moment après d’une manière nouvelle. Des mugissements terribles servaient de basse continue à des détonations stridentes, qui accompagnaient les émissions abondantes de la riche matière. Les uns partaient des flancs de la base, des pieds cachés de la montagne ; les autres semblaient siffler dans le sommet. Tout ce spectacle était terrible comme la puissance de Jupiter ; mais si fort, si grand, si imposant, si sérieux, qu’il commandait la vénération et non la crainte. Akrivie passa la moitié de la nuit sur le bastingage, ne pouvant se détacher des émotions qui la saisissaient si puissamment. Elle ne tarissait pas en questions sur les causes du phénomène, sur ses effets probables. Norton lui expliquait tout de son mieux et cherchait à lui rendre compréhensibles les résultats les plus simples des théories scientifiques : Il n’y parvenait guère, et il s’aperçut bientôt qu’Akrivie accueillait avec quelque dédain l’exposition des causes trop misérablement disproportionnées, trop humbles pour convenir aux impressions extrêmes dont son âme était possédée. Il démêla sans peine qu’elle aurait cru beaucoup plus volontiers à ses discours s’il lui avait parlé de géants coupables ensevelis sous les eaux afin d’expier leurs crimes, et soufflant leur désespoir, ou de dieux en travail pour étonner l’univers. Probablement, comme bonne chrétienne, elle eût préféré encore que tout cet appareil fût provenu de la puissance de saint Georges ou de celle de saint Dimitri. Le résultat obligé de ce désaccord entre les sentiments et les explications fut que la belle enthousiaste oublia les dernières à mesure qu’elle les entendit, et se composa pour son propre usage, dans le fond de sa pensée, une sorte d’idée vague, obscure, mais très convenable et très poétique de ce qu’était un volcan. Norton fut, en réalité, enchanté de voir qu’elle ne se démentait pas. Les caractères logiques aiment leurs pareils, et l’absurde leur cause moins de peine que l’inconséquence.
On dormit peu cette nuit-là, et le lendemain, au petit jour, la corvette mouillait devant Santorin, en face de la falaise dominée par la ville de Théra. Santorin n’est autre chose qu’une partie de la crête écroulée d’un ancien cratère. C’est un demi-cercle ébréché jaillissant brusquement du sein des eaux, et qui se poursuit à l’est et au sud en une sorte de plaine inclinée qui va bientôt rejoindre l’autre rive de la mer ; et qui formait jadis, à des époques antérieures à l’homme, le sommet de la montagne. L’intérieur de l’ancien gouffre a été envahi tout entier par les eaux, et il est si profond, qu’au ras même de la côte la corde trouve soixante, soixante-dix et quatre-vingts brasses de fond. Seulement, à quelques centaines de mètres, une aiguille de rochers s’est maintenue ; c’est le seul point où les navires puissent jeter l’ancre ; en face, à quelque distance, des éruptions volcaniques soit antérieures, soit postérieures à notre ère, ont fait successivement surgir de petits îlots contigus. Un volcan éteint depuis quelques siècles s’élevait au milieu d’eux, quand la nouvelle commotion est venue tout à coup remuer et remanier la configuration de ce sol incertain. Tel est l’aspect général de la rade de Santorin. Quand le temps est mauvais, il est presque impossible d’aborder dans l’île, car les embarcations seraient broyées sans rémission contre la falaise.
Ce jour-là, heureusement, rien de semblable n’existait, de sorte que le canot du commandant de l’Aurora aborda sans difficulté sur le rebord étroit servant de débarcadère. On prit des chevaux pour monter jusqu’en haut, et en suivant une route appliquée en lacets multipliés contre la roche peu solidement agglomérée et où les éboulements sont fréquents, on arrive à se hisser jusqu’à Théra après une marche d’au moins une demi-heure. M. de Moncade avait là, ainsi que son ami, quelques parents à visiter. Santorin faisait partie autrefois du duché des Cyclades, et compte, comme Naxos, quelques familles d’origine franque. Mais la destinée a traité plus favorablement le territoire pourvu de vignobles célèbres que son ancien chef-lieu. À Santorin, on est riche, on a des communications fréquentes avec Syra, sinon avec Athènes ; et les relations constantes avec Constantinople, même avec Odessa, où se vendent presque tous les vins du pays, rapprochent la population des habitudes du reste de l’univers. Il ne faudrait cependant pas se figurer de l’excès sous ce rapport.
Les maisons ressemblent à celles de Naxie ; elles sont construites de la même façon et pour les mêmes besoins. Ce sont toujours les grandes salles voûtées accompagnées d’une ou deux petites chambres, et les mêmes précautions contre l’irruption brusque des pirates, et cette façon de vivre dans une rue qui n’est qu’une cour commune. On fut reçu avec l’hospitalité aimable et affectueuse ordinaire partout dans les îles grecques. Il fallut goûter et admirer le vin, richesse du pays ; entendre les lamentations sur le sort que les exhalaisons du volcan causent aux vignes, et les dangers dont il menace la santé des habitants, car il a développé beaucoup de maladies d’yeux en remplissant l’air d’une poussière impalpable, mélange de pierre ponce et de soufre. Il fallut aussi gémir sur l’ennui des coups de vents, maîtres turbulents de cette hauteur abandonnée à toute leur furie, et quand on eut rempli ces différents devoirs et embrassé les parents, arrière-parents et amis qui se présentèrent, on se hâta de redescendre, pour aller, dans les embarcations, aborder à l’autre côté de la rade, le point principal de la visite et celui qui promettait le plus d’amusement.
Tout se montra bientôt nouveau, singulier, attrayant, dans cette expédition. La mer, absolument jaune et d’un jaune d’or, charriait des masses de pierres ponces ; dans les premiers temps de l’éruption, on y avait vu flotter des amas de poissons morts ; les restes de petites maisons, servant pendant l’été d’établissements de bains, avaient été graduellement submergés par les flots ou engloutis sous les matières volcaniques ; un quai venait d’être achevé, et désormais il plongeait sous la mer ; enfin des pierres noires d’où se dégageait une vapeur sulfurique étaient en mouvement perpétuel, et, poussées en dessous, tantôt elles s’élevaient par un mouvement ascensionnel en ligne verticale, tantôt, mal étayées, elles s’écroulaient, roulaient dans la mer et élargissaient ainsi la base de l’îlot en voie de formation, qui pourra devenir très grand un jour, s’il ne disparaît à l’improviste. Tout cela était noir comme l’encre, fumeux, brûlant à ne pouvoir toujours y poser la main, et à l’entour l’eau était bouillonnante ; si l’on était tombé dedans, on s’y fût brûlé.
Gravir sur le cône igné aurait été impossible. Outre que la base même en était formée de cendres brûlantes, les ruisseaux de feu s’y promenaient de toutes parts et eussent rendu l’entreprise insensée. Mais il y avait moyen d’aller considérer le géant d’assez près en montant jusqu’au sommet de l’ancien cratère, qui lui faisait face. C’est ce que Norton proposa immédiatement aux hommes. Akrivie se sentit le courage si haut, que sa nonchalance habituelle ne réclama même pas quand elle supplia son père et son parrain de lui permettre de les accompagner. On se mit donc en route tous ensemble, Akrivie s’appuyant dans les passages plus difficiles sur ses deux guides naturels, quelquefois acceptant l’aide que Norton, toujours à son côté, était prêt à lui donner ; quelquefois aussi dispensant, sans y penser, cette faveur à Charles Scott, qui en savourait la douceur jusqu’au fond de son âme. Cette ascension n’est pas ce qu’on peut appeler pénible, mais elle est fatigante, parce que jusqu’aux deux tiers de la hauteur on marche dans des cendres fines et mobiles, où le pied s’enfonce profondément. La pente est semée de quelques arbustes buissonneux, où l’on pourrait se retenir si l’on venait à glisser, et on ferait bien d’user de cette précaution, car la montagne, de même que la falaise de Théra, plonge immédiatement dans une mer profonde. On n’oublie pas, en outre, que sur ce point l’eau est brûlante.
Quand on a gravi la zone incinérée, on a des pierres plates à franchir, puis des aiguilles pointues à contourner, et on se trouve alors sur un vaste plateau tourmenté, rempli de creux, de fissures, de trous, d’où sortaient jadis les déjections volcaniques. Ici, tout est brûlé, rôti, marqué de plaques rouges ou jaunes, bouleversé de mille manières ; les rochers bousculés, jetés les uns sur les autres, présentent les restes brutaux d’une scène de violence inouïe ; les fragments gros et petits de soufre natif couvrent le sol, et comme pour montrer que tout n’est pas fini et que ce qui a été pourrait bien arriver encore, çà et là, au revers d’une paroi calcinée, sort, menaçante et sombre, une colonne épaisse de fumée, dont les flocons vont se perdre dans le bleu de l’atmosphère.
Mais on avait autre chose à voir que le passé et l’avenir ; les splendeurs du présent s’étalaient vivantes et turbulentes à quelques toises de distance en face même du plateau. En se penchant sur le bord septentrional, on se voyait surplombant au-dessus d’une grande vallée pareille à quelque profondeur d’enfer, grise, sombre, démontée de toutes parts, ombragée par le reflet sinistre des grandes ombres que projetait aux alentours le panache de fumée balancé sur le sommet du volcan tout voisin et opérant librement en face de ses œuvres. On le voyait à chaque seconde se crevasser et s’ouvrir à de nouveaux courants de feux. Le bruit était si épouvantable, qu’il fallait se parler ou plutôt se crier mutuellement dans les oreilles pour parvenir à s’entendre, et encore, quand le monstre prenait sa voix de tête, était-on forcé d’attendre qu’il eût fini ses exclamations. À chaque instant, il lançait au hasard des volées de pierres ponces, de pierres à demi-calcinées, de cailloux tirés du fond de ses entrailles, et il fallait se tenir en garde contre cette meurtrière libéralité. Rien de plus imposant et de plus majestueux. Des heures s’écoulèrent dans cette contemplation. De même qu’un rêveur assis sur une plage attend constamment qu’une vague succède à une autre vague et ne s’aperçoit pas de la fuite du temps, de même ici, Akrivie, Norton et la majeure partie de leurs compagnons ne se pouvaient lasser de voir les puissantes explosions déployer leurs colonnes immenses et faire tomber au large leur pluie de projectiles ; et quand une crise était finie ; ils attendaient l’autre. Il faut dire cependant que quelques-uns des officiers, plus prosaïques, avaient déjà décidé M. de Moncade à descendre avec eux longtemps auparavant, et que ce groupe de gens positifs fut retrouvé plus tard, assis à l’abri d’un buisson, à proximité du canot, et mangeant avec une vive satisfaction du plumcake arrosé de gingerbeer.
Enfin tout finit ; il fallut s’en aller. Norton pensa avec chagrin que peu d’heures allaient s’écouler, qu’on reverrait Naxos, qu’Akrivie retournerait dans sa maison au milieu des lauriers-roses, et que lui avec l’Aurora s’en irait continuer à vivre comme il avait vécu jusqu’alors, emportant un souvenir qui lui rendrait tout pénible en lui faisant sentir, plus encore que par le passé, les côtés fastidieux de son existence. Il avait réussi, en examinant ses impressions d’Antiparos et par la confiance plus grande d’Akrivie, à multiplier les raisons qu’il avait cru avoir d’être sinon aimé, du moins remarqué. Norton n’était pas un fat, et ne se laissait pas aller volontiers aux suggestions de ce genre d’amour-propre. Se croyant distingué quand il aimait, et comparant ce qu’il supposait être l’état de l’âme de la jeune fille à l’idée qu’il se faisait de son caractère, dont il était aussi épris que de sa personne, il se décida, après une mûre délibération, à une demande qui portait au plus suprême degré le caractère du romanesque, par la circonstance aggravante de la préméditation. Un Anglais seul est capable de ces choses-là, et pour bien apprécier ce que fit Norton, il faut comprendre qu’il ne cherchait qu’à mettre en pratique les goûts de beaucoup de ses compatriotes.
Dans les pays les plus lointains du globe et préférablement dans les plus excentriques, on est presque assuré de rencontrer un de ceux-ci, établi bravement au sein de la solitude la plus complète que les circonstances locales ont pu lui permettre de trouver. Rarement ce solitaire est un homme du commun ; le plus ordinairement, c’est une personne du monde, bien née et bien apparentée, ayant eu, souvent ayant encore une grande fortune ; généralement c’est un militaire, un légiste ou un marin. Toujours c’est un esprit cultivé, aux habitudes élégantes qui se sont résumées en un besoin de simplicité presque barbare, mais jamais vulgaire. En réunissant des souvenirs, je pourrais dresser une liste de ces déserteurs du beau monde ; j’en ai connu un à l’extrémité de la Nouvelle-Écosse, dans les forêts voisines de Sydney ; un autre dans les montagnes de la Mingrélie, non loin de Koutais ; un troisième dans la contrée tout à fait sauvage située au nord-est de la Grèce, vers la frontière turque ; j’en pourrais citer beaucoup dans des pays moins extraordinaires mais tout aussi déserts, et moralement aussi distants de la société britannique. Je conclus en répétant que ce goût pour l’exil et le renoncement est si fortement prononcé chez cette race à personnalité puissante, qu’il atteint même les femmes ; lady Esther Stanhope et Zanthe n’ont pas été seules à préférer soit le désert des Arabes, soit Damas, à l’habitation continuée des salons. Norton était donc en plénitude de ses facultés anglaises, et voyant Akrivie assise dans un grand fauteuil sur le pont, et pour un moment isolée, prit place à côté d’elle et lui dit gravement :
– Mademoiselle, je vous aime, et je voudrais savoir de vous si je puis espérer que vous partagerez ce sentiment.
Akrivie le regarda avec une douceur charmante, et lui répondit :
– Oui, monsieur, certainement, je vous aime beaucoup.
Norton se méfia singulièrement de l’extrême facilité de cette déclaration, qui, faite si vite et sans le trouble le plus léger, ne lui parut pas du tout comporter ce qu’il voulait, Il insista d’un air convaincu :
– Je vous remercie infiniment, mademoiselle ; je voudrais pourtant savoir si vous m’aimez assez pour me permettre de demander votre main.
Et comme Akrivie faisait un geste pour lui tendre la main en souriant, il vit clairement qu’elle n’avait encore rien compris, et il ajouta :
– C’est-à-dire pour vous demander de devenir ma femme.
– Non ! répondit brusquement Akrivie, et alors elle rougit profondément, les larmes lui vinrent aux yeux, elle se leva et descendit dans la chambre. Norton resta sur ses pieds, en face des débris de son château de cartes.
Le coup était rude, et le commandant ne s’y était pas attendu. Mais ce sont les moments de crise qui mettent en leur jour les grands caractères. Il envisagea gravement sa situation.
« Si elle m’aimait, se dit-il, elle ne serait pas ce que j’aime en elle, la fille de l’antiquité et de la vie simple, étrangère aux orages du sentiment. Akrivie ne doit aimer que ses parents, son mari et ses enfants ; hors de là, le monde n’existe pas pour elle. Je me suis laissé égarer dans les maudites routes de mon éducation moderne. Revenons au vrai. L’épreuve où je viens d’échouer, loin de me détacher de ma résolution, doit m’y confirmer davantage, car je vois plus que jamais à quel point le trésor découvert par moi est pur et sans mélange. Je ne prétends pas chercher les agitations d’une tendresse à l’européenne ; ce sont les éléments d’une vie spéciale que je recueille. Ma faute serait irréparable si je n’entrais de suite dans la bonne voie. »
Voyant sur le pont M. Phrangopoulo et M. de Moncade qui se faisaient expliquer la manière de pointer un canon, il alla vers eux et leur demanda un moment d’attention. Sa figure était grave, et ses deux amis composèrent immédiatement les leurs à son exemple :
– Messieurs, leur dit-il, j’ai l’intention de quitter la marine dans un délai très prompt. Naxos me plaît, et je m’y fixerai. Probablement je m’y occuperai de quelque établissement agricole ; en tout cas, j’y résiderai d’une manière définitive. Comme il n’est pas bien que l’homme soit seul, je désire me marier ; une femme étrangère ne s’accoutumerait peut-être pas aisément dans ma nouvelle patrie ; je préfère donc épouser une fille du pays, et si vous n’y voyez pas d’inconvénients, je vous serais obligé de m’accorder la main de mademoiselle votre fille et filleule.
Ce petit discours fut débité du ton le plus froid. M. de Moncade ouvrit de grands yeux. M. Phrangopoulo se redressa d’un air digne, et, contrairement à ce qui arrivait dans l’ordinaire de la vie, il ne laissa pas son ami prendre la parole, mais répondit ainsi lui-même au commandant :
– Monsieur, je suis flatté de votre proposition, et je vous en remercie au nom de ma famille. Mais je dois vous faire remarquer que ma fille n’a aucune dot, et pourtant notre naissance nous impose certains devoirs dans nos alliances et beaucoup de précautions. Je ne doute pas de votre mérite, je n’ai aucune espèce d’hésitation, vous le pouvez croire, quant à votre honneur ; mais je ne connais pas du tout votre respectable famille, et je serais peiné qu’il y eût dans sa condition passée tels obstacles à votre projet que toute ma bonne volonté ne pourrait vaincre. En un mot monsieur, nous sommes des gentilshommes, et ma fille n’épousera qu’un homme de notre rang.
L’assentiment de Norton à cette déclaration ne se fit pas attendre une minute. Il était fort content de la tournure que prenait sa négociation. Son futur mariage, en cas qu’il réussît, bien que désiré par l’amour le plus enthousiaste, était traité avec la roideur, le formalisme et l’absence de toute manifestation extérieure de sensibilité qui sont assurément les premiers éléments des convenances et leur triomphe.
– Je suis disposé, monsieur, répondit-il à M. Phrangopoulo avec la sécheresse convenable, à vous offrir sur ma famille et sur moi-même les renseignements que vous êtes en droit de me demander ; et si vous voulez bien jeter les yeux sur quelques documents et ensuite délibérer entre vous, je serai heureux d’avoir votre réponse ce soir même, car nous allons arriver à Naxos que voici en vue, et il me paraît à propos de connaître votre résolution dernière.
Cela dit, le commandant exposa brièvement sa position sociale, et la justifia par un passage du « Peerage and Baronetage of the United Kingdom of Great-Britain and Ireland » ; ensuite il apporta le « Navy List », où son nom figurait entre la désignation de son grade et celle du bâtiment qu’il commandait, et où se passait l’entretien. Il avait fort bien remarqué qu’on ne lui avait pas dit un mot de sa fortune ; il voulut éclairer ce point, mais on ne parut pas y attacher beaucoup d’importance, et les deux arbitres de son sort se retirèrent pour délibérer. Pendant ce temps, il se promena sur le pont, les mains derrière le dos. L’attente ne dura pas plus d’une demi-heure. Après quoi, M. de Moncade vint lui annoncer que la main d’Akrivie lui était accordée, et que M. Phrangopoulo était descendu dans la chambre pour informer sa fille de la résolution prise à son égard. Il se passa encore un peu de temps ; puis M. de Moncade étant allé voir où en étaient les choses, remonta et pria Norton de venir jouir de son bonheur. Il était accepté, nouvelle charmante qu’il reçut avec le flegme le plus digne.
En retrouvant Akrivie, il vit des larmes sur ses joues. Il lui serra la main :
– Vous ne m’aimez pas ?
– Ce n’est pas cela, lui dit-elle en secouant la tête ; j’aurais mieux aimé que vous fussiez Hellène.
Ce qui arriva ensuite n’a pas besoin d’être raconté. Le mariage fut fixé à quelques mois de là. Norton devait prendre le temps de rendre son commandement, de donner sa démission et de revenir à Naxos. Toutes ces affaires furent terminées plus tôt encore qu’il ne l’avait espéré.
Il était marié depuis huit jours, quand il entendit le bruit d’une vive altercation entre Triantaphyllon et Akrivie. Celle-ci soutenait à sa belle-sœur que les Anglais étaient d’aussi bons marins que les Hellènes, et comme les raisons pour prouver son dire lui manquaient, elle répétait avec constance : « je suis Anglaise, moi ! » et y mettait infiniment de fierté.
« Chère fille de Priam ! se dit Norton, elle commence à comprendre qu’elle a un mari. »
Akrivie apprit sa nouvelle langue très promptement ; elle apprit encore d’autres choses, lut un peu, mais ne s’attacha à rien de tout cela. Son mari lui fit faire un voyage en Angleterre ; elle fut très bien reçue, et avec tous les honneurs dus à une belle singularité. Il lui arriva même, dans un château du Yorkshire, où elle fut invitée, une sorte d’aventure bien propre à lui faire comprendre tout son mérite. Un délicieux jeune homme lui avoua la vérité vraie sur lui-même ; il passait les nuits à pleurer le triste sort d’une femme si supérieure unie par un destin toujours barbare et aveugle à un homme incapable de la comprendre. Il n’est pas sûr en effet qu’Akrivie comprît très bien Norton, mais il est incontestable qu’elle comprit encore moins le délicieux jeune homme, et elle s’ennuyait tellement en Angleterre et d’une manière si visible, que Henry, ne s’y amusant pas beaucoup lui-même, la ramena tout droit à Naxos.
Aujourd’hui elle a deux enfants charmants qui jouent dans les orangers ; elle ne les perd pas de vue, et tient pour non moins certain que l’Évangile la supériorité absolue de son mari sur le reste de la chrétienté.
Patissia, août 1867
LA CHASSE AU CARIBOU
Terre-Neuve.
Charles Cabert était fils d’un homme devenu passablement riche dans des affaires où il était question de zinc. Il avait été élevé au collège comme tout le monde, en était sorti sans plus de science que ses camarades, et, en garçon distingué, s’était fait recevoir membre d’un club où il perdait assez d’argent pour être traité avec considération. Ses amis lui firent connaître des dames, et afin de ne pas se singulariser, il se résolut un matin à épouser une figurante.
Son père avait d’autres desseins, et il éleva contre ce projet une assez vive opposition. Pendant huit jours, le club fut tenu en haleine par les hauts et les bas de cette crise. Charles déclara qu’il épouserait, ou mettrait fin à ses jours par un de ces moyens remarquables que les progrès de la science offrent aux désespoirs modernes. Heureusement une invasion du Géronte irrité, dans son délicieux appartement de la rue Taitbout, écarta cette cruelle alternative. Charles ne se tua pas et ne se maria pas non plus ; il consentit à partir dans la semaine pour un pays quelconque. Il est à craindre que l’ancien industriel, fort agité, ne se soit abandonné à une pantomime indigne d’un galant homme.
Certaines situations sont pénibles pour les âmes délicates. Ne pas exécuter une résolution violente, annoncée à l’avance, coûte beaucoup, surtout en présence d’un monde où se trouvent toujours des gens enclins à adopter des interprétations désobligeantes. Au fond du cœur, Charles fut pourtant satisfait que son père eût pris des mesures pour empêcher l’impétueuse Coralie de venir lui peindre les horreurs de la situation d’une amante abandonnée ; la tendresse de son cœur en murmura, mais il y gagna du calme. Sa seule affaire resta de décider en quels lieux il allait porter sa mélancolie. Ce point voulait être pesé d’après toutes les règles de l’art.
Avant tout, l’important était de montrer à la galerie l’excès de ses souffrances. Ceci ne pouvait s’indiquer que par la force des distractions auxquelles il aurait recours. Cette considération excluait naturellement l’idée d’un voyage sur les bords du Rhin, en Suisse, en Angleterre et même en Italie. De telles promenades ne sauraient appeler sur ceux qui les exécutent aucune espèce d’intérêt. Il y a peu d’années, en s’enfonçant dans la direction de l’Espagne, on aurait eu plus de chances d’ébranler les imaginations. C’eût été s’exposer, ou mieux, paraître s’exposer à quelques fatigues insolites, et donner à entendre qu’on allait affronter les mœurs dangereuses des imitateurs de l’Impeciñado. Mais depuis la création des chemins de fer de la Péninsule, les illusions de ce genre s’affaiblissent. Après avoir cherché quelque temps, Charles se rappela que plusieurs semaines avant la catastrophe dont il était la victime, il avait soupé chez un de ses amis avec un Anglais bon vivant, lequel avait raconté des histoires de chasse et obtenu un succès estimable par un récit très embrouillé dont Terre-Neuve avait été le théâtre ; le fait avait été jugé piquant et nouveau. Charles résolut d’aller aussi à Terre-Neuve ; c’était bien préférable à un tour en Orient, qui, dans tous les cas, vous expose à prendre un vernis d’archéologue, inconvénient à éviter. Il annonça sa résolution ; elle surprit. Personne de son intimité ne savait au juste où était Terre-Neuve, preuve frappante de la sagesse du parti auquel il s’était arrêté.
Il se composa un costume de chasse. Les bottines étaient admirables ; justes aux pieds sans les serrer, d’un cuir souple qui ne prenait pas l’humidité, pourvues de semelles fortes sans être dures, couronnées à l’Exposition de 1865. Les courses à cheval devant être fréquentes à son avis, et souvent nocturnes, il fit confectionner des étriers pourvus de lanternes ; une tente d’une invention merveilleuse, pouvant au besoin servir de bateau ou de voiture, s’enfermant dans un parapluie, avec un lit, un pliant, une table, et ne prenant pas plus de place que… ce qui en peut prendre le moins. Inutile de vanter le nécessaire de toilette, il était sublime ! On pourrait toucher un mot des armes : deux fusils, deux revolvers, deux bowieknifes, le tout de la fabrication la plus nouvelle ; mais ce serait trop s’étendre, et il suffit de constater que la somme de ces belles choses, livrées pendant huit jours, dans sa salle à manger, au jugement éclairé de ses amis, persuada Charles, par les éloges qu’elle reçut, de la sagacité et de l’esprit pratique qui avaient dirigé ses choix. Seulement, de tout cela, rien n’aurait jamais pu servir ; il y a de la différence entre la façon dont on juge les nécessités de la vie sauvage chez les fabricants de Paris et ces nécessités elles-mêmes.
Enfin, après avoir, dans un dernier dîner, déploré avec ses compagnons la rigueur de son sort, Charles Cabert monta en wagon et se trouva lancé dans le vaste monde seul avec le souvenir de son amour interrompu et ses inénarrables douleurs. Inutile de dire comment il s’embarqua sur un paquebot de la Compagnie Cunard et débarqua sur le quai de Saint-Jean de Terre-Neuve. Ces sortes de tableaux sont monotones, à moins de circonstances extraordinaires, qui ne se présentèrent pas.
Le jeune et intéressant voyageur était porteur d’une lettre de recommandation pour le consul général de Hollande, M. Anthony Harrison. Sa toilette achevée à l’auberge où il était descendu, il s’empressa de se faire conduire chez l’homme qui devait être son conseil et son guide dans la grande entreprise à laquelle il s’était voué et dont il s’applaudissait de plus en plus d’avoir eu l’idée, prévoyant la gloire qu’il allait en recueillir. Un domestique de l’hôtel le mena à travers des rues pavées à peu près et d’autres qui ne l’étaient pas du tout jusqu’à un immense magasin construit en planches, où siégeait sur une chaise de paille un homme assez gros, étalant sur son genou gauche un mouchoir de poche de coton bleu et inscrivant dans un carnet grossier des chiffres que lui criaient trois commis. Deçà, delà, à droite, à gauche, au fond, sur les côtés et presque sur la tête, des murailles de barils entassés les uns sur les autres contenaient de la morue sèche et salée, précieuse denrée qui fait la fortune de l’île.
– M. Harrison ? demanda le touriste en ôtant son chapeau.
– 888, 955, 357, 11, 49, 2453 ! répondit une voix glapissante de l’extrémité du magasin.
– M. Harrison, s’il vous plaît ? répéta Charles poliment incliné, est-ce ici que je puis le trouver ?
– Hein ? répliqua brusquement le gros homme au mouchoir de coton bleu. Qu’est-ce que vous cherchez ?
– M. Harrison, le consul général de Hollande, je vous prie ?
– C’est moi, que vous faut-il ?
– Voici, monsieur, une lettre que M. Paterson, banquier à Paris, m’a chargé de vous remettre :
– Passez-moi ça, mon garçon !
– Quelle brute ! pensa Charles Cabert ; et il donna la lettre.
– Ah ! Bon ! je vois ce que c’est, dit le négociant après avoir lu. Mais je n’ai pas le temps de causer à cette heure. Venez dîner avec moi, et nous verrons ce qui vous convient. Bonjour !
Ce « bonjour » était si péremptoire et ressemblait de si près à un ordre sans réplique de débarrasser le terrain, que presque instinctivement Charles se trouva dans la rue. Sa dignité était justement froissée, et il se résolut à ne pas mettre les pieds chez un malotru de pareille espèce. Cependant il réfléchit que s’il n’allait pas chez ce malotru incontestable, il lui était difficile d’aller chez personne autre, et alors pas de chasse aux caribous ; il ne lui restait plus qu’à s’en retourner à Paris sans avoir rien fait. Cette judicieuse remarque, née de la droiture de son jugement, fit revenir Charles Cabert à des sentiments plus modérés, et décidé à se contenter d’une vengeance épigrammatique, il se tourna vers le domestique de l’hôtel. Celui-ci l’accompagnait et marchait sur la même ligne que lui. Le jeune homme demanda d’un ton méprisant :
– Qu’est-ce que c’est que ce Harrison ?
– Harrison ? répondit l’Irlandais ; c’est un homme comme vous ne devez pas en avoir beaucoup dans votre sale Europe, je vous en réponds. Il a donné cette année cinq cents livres pour les travaux de la cathédrale, mille pour les écoles ! il fait peut-être travailler, à l’heure qu’il est, plus de quinze cents personnes, et, avec l’aide de l’évêque, pas un homme ne le vaut dans le gouvernement colonial ! Harrison ? Est-ce que vous ne connaissez pas Harrison dans votre pays ? Alors, qu’est-ce que vous connaissez donc ?
– Auriez-vous la prétention de croire, mon cher ami, répliqua Charles un peu stupéfait de l’outrecuidance patriotique de son suivant, que l’on s’occupe à Paris des grands hommes de Terre-Neuve ?
– Vous pouvez bien avoir envie de faire les fiers, je ne dis pas, riposta l’homme ; il est cependant assez connu que nous vous avons fait mettre les pouces dans l’affaire des pêcheries et qu’il n’est pas un de vos royaumes ou empires du vieux monde qui ne commence à trembler quand l’Amérique lui parle. Vous imaginez-vous que nous ne le savons pas ?
« Ah çà, mais les consuls généraux et les domestiques me paraissent ici fort extraordinaires », pensa Charles. Il garda cependant le silence, jugeant trop enfantin de se compromettre avec un valet de place, lequel d’ailleurs continuait à marcher à ses côtés en sifflant philosophiquement.
À six heures, on annonça au brillant Parisien la voiture de M. Harrison. D’après les précédents, il se préparait à monter dans une charrette ; mais ce fut un délicieux coupé dont un groom en livrée marron et jonquille lui ouvrit la portière, et il n’avait pas encore fini d’apprécier et de louer en connaisseur le capitonnage de la boîte roulante, que les chevaux s’arrêtèrent à la porte d’un. cottage d’une élégance parfaite.
Au milieu de la verdure, des fleurs, des plantes grimpantes, six marches de granit gris, apportées du continent, menaient à un palier entouré de vitrages où Harrison lui-même, enceint d’un vaste habit bleu, était établi sur ses fortes jambes.
– Oh ! oh ! mon jeune homme ! arrivez donc, arrivez donc ! cria l’homme considérable en étendant sa vaste main, dont la circonférence parut à Charles contenir plus de cinq doigts ; arrivez donc, vous dis-je, vous êtes en retard ! Et tandis que de la dextre le négociant serrait ce que contenait le gant de son hôte de façon à l’aplatir à jamais, de la gauche il saisissait l’infortuné par l’épaule, le faisait tourner sur lui-même avec la facilité d’un tonton, et le mettait en présence de six jeunes demoiselles et de huit jeunes gens dont le moindre le dépassait d’un demi-pied.
– Mes enfants ! dit Harrison.
Au fond, sur un canapé, siégeait une respectable dame, remarquable par une dent incisive décidément brouillée avec ses compagnes et débordant la lèvre inférieure de plus de quatre lignes. Cette dame était décorée d’un immense bonnet à coques, et portait avec une majesté douce une robe de soie noire et une montre attachée à une énorme chaîne d’or.
– Ma femme ! cria Harrison.
Enfin, contre la fenêtre, debout, se tenait une espèce de géant, quelque chose de pareil au Caligorant du Pulci, un gaillard large comme est long un enfant de huit ans, avec une tête monstrueuse, couverte d’une forêt de cheveux bruns à demi gris, bouclés dru les uns sur les autres, et qui, enveloppé, Dieu sait comme ! d’un habit noir dont on eût pu habiller quatre personnes raisonnables, le cou très à l’aise dans une cravate bleu clair, regardait avec des yeux de même couleur la personne du nouvel arrivant.
– Mon ami M. Georges Barton, à qui vous allez avoir affaire ! s’écria encore Harrisson en terminant le cercle de ses présentations.
Charles était ahuri. Il salua à droite, il salua à gauche ; les femmes répondirent, les hommes peu, et l’on passa immédiatement dans la salle à manger.
Un essai de conversation avec madame Harrison amena celle-ci à des confidences. Depuis plusieurs années, elle souffrait de maux de dents extrêmement répétés ; elle en décrivit avec douceur les principales singularités, et s’enquit des connaissances de son auditeur dans la matière. Celui-ci s’efforça de répondre à cette confiance en indiquant des spécifiques ; mais imparfaitement préparé à une pareille discussion, il se vit obligé, pour ne pas rester absolument au-dessous de son rôle, de toucher quelques mots de la Revalescière Dubarry, et il s’étendait avec conviction sur l’éloge de cette substance, quand le bruit de la conversation générale devint si fort qu’il se tourna à demi pour écouter. Madame Harrison le voyant inattentif, laissa tomber l’entretien avec résignation, et il fut tout entier aux propos qui s’échangeaient avec de puissants éclats de voix, des éclats de rire, des éclats d’indignation et de temps en temps un coup de poing violemment assené sur la table, ce qui faisait sauter tout ce qui était dessus.
– Et c’est ce que je lui ai dit ! hurlait le fils aîné, William. Je lui ai dit : Les presbytériens sont des ânes, et il est très connu que les méthodistes ne valent pas mieux, et bien qu’aux dernières élections nous ayons consenti à voter à Plaisance pour leur candidat Nigby, ça ne signifie pas que nous recommencerons toujours ! Si nous avons été battus dans le dernier vote, c’est que cette canaille s’est laissé gagner par l’argent des puritains !
– Je vous l’avais annoncé d’avance, moi ! interrompit Edouard Harrison ; mais Henry que voilà prétendait qu’il n’y avait pas de risques.
– C’est à cause de Harriett Poole, s’écria la voix argentine de miss Louisa.
Cette observation suscita un rire général.
– Ce n’est pas à cause de Harriett Poole, et si c’était à cause de Harriett Poole, je ne verrais là rien de plus étonnant que lorsque Louisa passe la moitié de ses journées chez Virginie Beyley pour causer avec Tom Beyley, qui est anabaptiste !
– Ça n’est pas vrai ! riposta Louisa en rougissant jusqu’aux oreilles au milieu de nouveaux éclats de rire.
– Ah ! ma chère, murmura sa sœur Jenny assez haut pour être entendue, vous savez bien que si !
La voix d’Harrison domina le tumulte :
– Je suis, s’écria-t-il, de cette opinion qu’il faut en finir, et je me promets de dire à l’évêque, en propres termes : Il est fort désagréable, sans doute, de traiter avec les épiscopaux ; mais si nous voulons une bonne fois terminer cette question qui touche aux intérêts les plus sacrés de la colonie, je veux dire l’exportation de la morue et la restriction du commerce de la boëtte, il faut mettre sous nos pieds toutes les répugnances, et voter avec Codham et ses amis, du moins jusqu’à ce que la question soit vidée ! Et l’évêque me comprendra ! Mais c’est assez ! Je demande à porter une santé.
Le plus profond silence s’établit ; Harrison prit son verre, et debout, la main gauche appuyée sur la nappe, dans l’attitude d’un orateur déterminé à émouvoir une grande assemblée, il prononça le discours suivant :
« Gentlemen and ladies ! des philosophes ont avancé avec raison que, loin d’être une frontière, les fleuves étaient les grandes routes naturelles des nations ! Quel jugement porterons-nous donc de la mer, le plus immense de tous les fleuves, et de l’Amérique, assez heureuse pour voir ses rivages enveloppés de toutes parts par cette grande voie naturelle ? »
Ici un murmure flatteur salua l’exorde. Harrison continua d’une voix plus haute :
« N’en doutez pas ! C’est par la mer que le monde sera régénéré, et c’est l’Amérique qui fera l’aumône d’un peu de sa force, d’un peu de sa vertu, d’un peu de son génie, d’un peu de sa richesse à ce vieux monde souffreteux, et particulièrement à cette misérable Europe, accablée en ce moment sous le fardeau de son ignorance, de sa misère, de son asservissement ! »
L’enthousiasme devint énorme ; les huit fils avaient les yeux hors de la tête et buvaient coup sur coup, les six filles étaient rouges comme des petits coqs, et M. Georges Barton approuvait en grommelant de la façon la plus encourageante. Quant à madame Harrison, elle porta mélancoliquement la main à sa joue gauche, ce qui sembla indiquer l’invasion de quelque douleur lancinante. Harrison, promenant sur cette scène un sourire d’orgueilleuse satisfaction, continua en ces termes :
« C’est pourquoi, mes chers concitoyens, je vous propose un toast à notre nouvel ami, M. Charles Cabert, lui souhaitant la bienvenue dans notre pays libre, et désirant du fond de mon cœur que les observations qu’il pourra faire et l’expérience qu’il pourra recueillir l’amènent à comprendre la supériorité de nos institutions et la grandeur de notre avenir. »
L’orateur s’assit, M. Charles Cabert s’inclina pour le remercier, et après avoir vidé son verre, il croyait tout fini, quand M. Georges Barton lui cria d’une voix de stentor :
– À votre tour, maintenant, répondez !
« Diable ! se dit le jeune élégant, qu’est-ce que je m’en vais leur dire ? »
Tous les yeux étaient fixés vers lui, il fallait s’exécuter.
« Mesdames et messieurs, commença l’orateur d’une voix émue, pardonnez à un étranger obligé de se servir d’une langue qui n’est pas tout à fait la sienne, bien que… dans ces temps de haute civilisation… naturellement… tous les hommes soient frères et faits pour se comprendre ! »
Ce début parut joli, et l’auditoire se montrant satisfait, Charles se sentit dans la bonne voie et poursuivit en ces termes :
« Le commerce… non !… si !… Je veux dire le commerce et l’industrie éclairés par la science, et la science à son tour suivant les conseils de l’expérience, sont, dans une certaine mesure, à considérer comme les piliers de la société moderne, dont je ne crains pas d’affirmer que l’Amérique, avec ses étonnants travaux… c’est-à-dire que l’Amérique avec ses étonnants travaux éclairés par la science, est incontestablement le couronnement de la liberté !
– Hourrah ! hourrah ! s’écrièrent Harrison, ses fils et Barton, en se démenant sur leurs chaises. Les six jeunes filles frappaient contre leurs verres avec leurs couteaux. Charles, hors de lui d’un si beau triomphe, s’écria :
– C’est pourquoi, fier de fouler ce sol vierge de toutes les passions qui désolent des contrées moins heureuses, je vous propose la santé de M. Harrison, cet homme si honorable et si pur, de la respectable madame Harrison, le modèle des mères de famille, de mesdemoiselles Harrison, dont les grâces se peuvent passer de toutes les louanges, et enfin de MM. Harrison fils et de M. Barton, ces citoyens si éminents de la plus belle des parties du monde ! »
Charles voulut se rasseoir, mais il ne le put pas. Il fut saisi au vol par son hôte, embrassé, passé à un autre, serré dans les bras de tous les assistants, qui le déclarèrent, en hurlant, le plus « jolly boy » qu’ils eussent jamais rencontré, et ce ne fut que couvert d’applaudissements qu’il retomba enfin sur sa chaise.
Avec tout cela, il était tard. Charles songea à prendre congé ; mais il apprit que son bagage avait été apporté de son hôtel, et on le conduisit dans une chambre extrêmement confortable, où le maître de la maison, après avoir constaté lui-même que rien ne manquait à son bien-être, le laissa se mettre au lit et se reposer de cette soirée agitée.
La nuit, Charles eut une série de rêves. Il était l’évêque de Terre-Neuve, galopait sur les falaises, en grand risque de se casser les membres, à cheval sur un caribou, lequel caribou se trouvait être un prédicateur wesleyen, qui lui faisait des grimaces, et un nuage de morues salées le poursuivait, criant autour de lui pour qu’il leur fît un discours.
Une si grande agitation, surexcitée outre mesure par tout ce que Harrison lui avait fait boire, se calma vers le matin, et il dormait profondément, quand il fut réveillé par l’entrée de deux personnes dans sa chambre. Les deux personnes étaient Harrison et Barton.
– Encore couché ? dit le premier. Je suis fâché de vous tirer de votre sommeil, mais il est tard, six heures au moins, et mes affaires m’appellent. Je n’ai cependant pas voulu partir sans vous annoncer mes arrangements pour vous. Voici M. Barton, mon ami, propriétaire d’un bel établissement pour la pêche des phoques. Il part demain matin et vous emmène. Des caribous, il vous en fera chasser tant que vous voudrez, tuer de la perdrix et du courlieu, pêcher du saumon et de la truite, enfin tous les sports imaginables seront à votre disposition.
Charles voulut remercier, mais Harrison ne lui en laissa pas le temps et continua :
– Il est pressé de s’en aller ; cependant, comme nous tenons aussi, nous, à vous garder un peu, il a consenti à ne se mettre en route que cette nuit, à deux heures. Vous passerez la journée avec mes filles, et ce soir nous aurons un petit bal en votre honneur. Allons, mon garçon, frottez-vous les yeux, sautez en bas du lit, et tâchez de vous amuser, puisque vous n’avez que cela à faire !
Sans attendre aucune réponse, Harrison sortit de la chambre avec son ami, qui n’avait pas ouvert la bouche, et Charles, un peu blessé de la façon dégagée dont on disposait de lui sans consulter ses convenances, mais s’avouant toutefois en lui-même que tout était pour le mieux, ne put pas se rendormir et prit le parti de commencer sa toilette, opération toujours longue chez quelqu’un qui se respecte, mais qu’il traîna encore plus que d’habitude, afin de faire sentir à ses hôtes l’étendue de son indépendance.
Je ne sais s’ils le comprirent ; mais quand il descendit au salon, il y trouva les six jeunes filles déjà dans de brillants atours, et pas un des garçons, ceux-ci étant, comme leur père, à leurs affaires. Il fut reçu en vieille connaissance, et six jolies mains serrèrent la sienne. Les interrogations sur Paris, sur les spectacles, sur les promenades, sur la mode, commencèrent, s’animèrent, et son rôle devint assez brillant. On apporta le thé, force jambon, viande froide, pain grillé, confitures, le tout pour aider l’estomac à prendre patience jusqu’au déjeuner. Les sœurs le servirent avec une gentillesse infinie ; cependant il aurait pu remarquer que les attentions des trois aînées n’étaient que polies, tandis que celles des trois cadettes impliquaient un certain désir de plaire.
Au plus fort de la conversation, et comme Charles essayait de dessiner, d’une main assez inhabile, le modèle d’une chemisette dont il venait de dire des merveilles, la porte s’ouvrit avec fracas, et un jeune homme très brun, avec des cheveux noirs bouclés, des yeux comme des charbons, une barbe touffue et des moustaches épaisses, se précipita dans l’appartement en poussant un grand éclat de rire. Jenny rougit profondément, se leva, marcha droit à l’arrivant, et ils se serrèrent la main avec un intérêt qui ne se dissimulait pas. Au même instant, Harrison faisait son entrée d’un autre côté.
– Bonjour, mes petites demoiselles, comment vous portez-vous ? cria le bruyant personnage si bien accueilli par Jenny. Bonjour, Harrison. Hé, vieux père, comment va cette santé ? Très bien ! Tant mieux ! Tant mieux vous dis-je ! Vivent les amours et la verte Irlande ! Ah ! c’est vous, monsieur le Français ? Charmé de vous voir ! Nous parlions de vous tout à l’heure sur le port, et il ne s’en est fallu de rien que je ne vous aie lancé à travers les jambes un article qui, j’en suis sûr, aurait fait tomber le ministère colonial comme un capucin de cartes, et peut-être même renvoyé le gouverneur en Angleterre avec accompagnement de pommes de terre dans le dos !
– Il s’agit de moi ! s’écria Charles au comble de l’étonnement.
– Oui, de vous ! de vous-même en propre personne ! Jenny, mon cher ange, donnez-moi une tasse de thé, je vous prie, et huit tartines !
Jenny n’avait pas cessé de regarder avec l’admiration la plus convaincue et la plus tendre le nouvel arrivé, depuis son invasion dans la chambre ; elle s’empressa de le servir, pendant qu’il continuait son explication.
– Oui, vous dis-je, j’allais vous empoigner dans mon journal l’Informateur commercial, et voilà comme j’avais l’idée de vous prendre ; je débutais ainsi :
« Les gouvernements de l’Europe, à bout de voies, réduits au désespoir par l’intrépide attitude du parlement colonial, forcés de reculer devant les manifestations redoutables d’un peuple libre, se sont décidés à recourir aux manœuvres du machiavélisme le plus effréné. Nous apprenons de source certaine, par nos correspondants de Paris… – je n’ai pas besoin de vous dire, monsieur Rupert, que je n’ai pas à Paris le moindre correspondant, mais ces choses-là plaisent aux abonnés ! – nous apprenons, dis-je, qu’un nommé Rupert…
– Cabert, dit tout bas la jolie Jenny.
– Cabert ? Je vous remercie, Jenny ! Vous êtes toujours la meilleure fille qu’il y ait au monde ! Cabert, Robert, Rupert, Chabert, homme taré, employé depuis vingt ans dans les basses œuvres les plus révoltantes de l’inquisition politique…
– Ah çà, mais ! ah çà, mais, monsieur, s’écria Charles.
– Silence, jeune homme, laissez-moi finir : « …vient d’arriver à Saint-Jean, dans l’intention déclarée d’acheter la connivence de nos ennemis ! Nous sommons l’administration vénale qui nous opprime de nous avouer pourquoi ces conférences multipliées avec ce Ribert ?… » J’en étais là, quand on m’a appris que vous étiez des amis d’Harrison ; dès lors, vous êtes des miens à la vie, à la mort ! Ayez un procès, je suis avocat ; une querelle, je ne manque jamais mon coup ! Ne me demandez pas d’argent, je n’en ai pas ; mais prêtez-m’en si vous voulez, je ne vous le rendrai jamais ! Quel malheur que vous soyez l’ami d’Harrison !
– Mais monsieur, ceci passe la plaisanterie ! Vous aviez l’intention de me calomnier de la manière la plus…
–Eh ! laissez donc ! laissez donc ! Si nous avions pu avec ce coq-à-l’âne réussir à ce que nous voulons, j’avais une position, moi ! J’épousais Jenny que voici, et que son crocodile de père ne me refusait pas plus longtemps, sous prétexte que je n’ai rien, et vous ne vous en portiez pas plus mal ! Mais c’est assez causer ; il faut aller au tribunal plaider pour Hogdson contre Watson ; cet imbécile-là, je dis Watson, m’avait apporté sa cause le premier, figurez-vous ; mais il n’a jamais voulu entendre à me donner cinquante livres de plus que m’offrait Hogdson ; de sorte que j’ai passé à l’ennemi enseignes déployées, tambours battants, mèches allumées, cavalerie cavalcadant, canons sautants…
L’orateur se mit sur ses pieds et imita ce qu’il décrivait avec un tel entrain, que l’assistance partit d’un fou rire.
– Quel écervelé que cet O’Lary ? dit miss Maria en s’essuyant les yeux.
– La gaieté milésienne, mes enfants ! Ah ! à propos, Jenny, avant que je parte, je vous en prie, je vous en supplie, jouez-moi « la Dernière Rose de l’été » !, ça me donnera du cœur pour tout le jour.
Jenny s’assit au piano et chanta la chanson irlandaise. Charles n’y prit pas trop garde, car la conversation était plus bruyante que jamais, tandis que les deux amants s’absorbaient dans leur musique. Cependant, tout en écoutant une dissertation passionnée de Harrison sur le prix probable auquel la morue allait monter cette année, il vit qu’O’Lary, assis sur un tabouret à côté de Jenny et accroupi comme un singe, s’était caché la tête dans ses mains, et aux dernières notes du chant, quand il releva son visage, l’avocat avait des larmes plein les yeux. Il se releva brusquement, tira à lui Jenny, la considéra d’un regard plein d’amour et sortit comme il était entré.
La journée se passa à merveille. Les jeunes filles menèrent Charles à la campagne ; madame Harrison ne parut pas, et il ne fut pas question d’elle. On mangea, on se promena, et on se mit à table régulièrement à l’heure du dîner, qui fut solennel. Il y avait trente deux convives, et parmi eux des personnages marquants. Ensuite vint le bal.
Jenny dit à Charles :
– Voulez-vous me permettre un conseil ?
– Mais je vous en serai très reconnaissant.
– Ne dansez qu’avec mes trois dernières sœurs et les jeunes personnes que je vous indiquerai. Celles-là ne sont pas encore engagées ni en voie de l’être, au moins que je sache. En vous adressant aux autres, on vous laisserait faire parce que vous êtes étranger, mais vous feriez de la peine à quelqu’un.
L’idée de ménager les sentiments d’autrui parut si singulière à Charles, qu’il ne put s’empêcher de répondre :
– Mais, mademoiselle, je ne suis pas forcé de savoir que monsieur un tel s’occupe de mademoiselle une telle !
– Vous n’êtes pas forcé de le savoir, sans doute, répliqua innocemment Jenny, parce que vous êtes étranger ; mais je vous le dis, et d’ailleurs, encore une fois, si vous voulez absolument danser avec quelqu’un, je suis sûre qu’on se fera un plaisir… Pourtant, ce n’est pas l’usage.
En ce moment O’Lary décoré d’une immense cravate blanche, et montrant ses trente deux dents par l’effet du sourire le plus jovial, s’approcha en s’écriant :
– Dites donc, Rambert, si vous voulez danser avec Jenny, ne vous gênez pas, je suis sûr qu’elle en sera très contente !
– Bien certainement, dit Jenny.
Charles se sentit blessé ; il devint rouge et dit d’un ton sec :
– Monsieur, je ne m’appelle pas Rambert, mais Cabert ! Cabert !
– Cabert ! for ever ! hourrah ! cria l’Irlandais ; et prenant Cabert par le milieu du corps, il l’éleva jusqu’au plafond de la salle ; le montra un instant aux conviés, qui applaudirent, et le reposa à terre pour le serrer sur son cœur.
Jenny le détacha de cette étreinte à moitié étouffé, rouge, indigné, exaspéré, et l’entraîna au milieu de la contredanse, déjà commencée. Le mouvement le calma un peu ; il comprit le ridicule dont il se couvrirait en prenant au sérieux la façon inadmissible d’un O’Lary. Il se persuada donc de condescendre à une conversation avec Jenny, et celle-ci ne lui cacha pas que ; dans son opinion, pas un homme sur la terre ne valait le petit doigt du turbulent Irlandais. Quand la musique cessa, Charles alla faire un tour dans le jardin, afin d’échapper un instant, à l’horrible chaleur répandue dans les salles, où la foule s’encombrait, et il vit avec admiration un nombre considérable de couples qui, tête à tête, chacun pour soi et ne, pensant qu’à soi, s’enfonçaient dans les allées sombres, ou même entraient dans un kiosque fort obscur, sans qu’aucune mère, aïeule ou tante accourût pour s’en préoccuper.
« Quelles mœurs ! » se dit en lui-même Charles avec une vertueuse indignation. Mépriser ses hôtes, leurs amis, la population tout entière, lui causa une sensation ineffable. Il se sentit soulagé. On le comblait d’attentions et on l’étouffait de cordialité ; mais on l’offensait à chaque instant. Il était opprimé, et, ce qui est sans doute la plus dure des conditions, il éprouvait l’instinct secret de sa faiblesse, honorable, flatteuse même, puisqu’elle provenait de la distinction exquise de sa nature, mais enfin de sa faiblesse, et partant de son infériorité vis-à-vis de ces natures brutales. On peut imaginer que, dans les temps où les Barbares du Nord envahissaient l’Italie et, de gré ou de force, s’asseyaient dans toutes les chaises curules de l’Empire, les Romains élégants, qui réellement ne pouvaient pas prendre au sérieux des gens pareils, devaient éprouver des sentiments analogues à ceux ressentis par Cabert au milieu des hommes riches de Saint-Jean. Comme il s’enfonçait dans ses méditations avec un surcroît d’amertume d’autant plus marqué que le froissement de toutes ces robes blanches et l’écho de certaines phrases arrivant à ses oreilles lui portaient fort sur les nerfs, une demi-douzaine de jeunes gens l’entoura, et on le pressa de venir boire un verre de vin, ce qu’il ne put refuser. Il remarqua dans la bande un officier qui lui parut assez mélancolique. Comme il lui fit l’honneur de lui trouver l’air distingué, il interrogea O’Lary à son sujet.
– Vous voulez dire O’Callaghan, répondit l’avocat en prenant une physionomie attendrie, que Cabert trouva ridicule au premier chef. Pauvre diable ! il est né ici. Il est entré dans un régiment anglais. Il est devenu amoureux de cette diablesse de Kate Sullivan, la plus jolie fille de l’Amérique assurément après Jenny Harrison. Son corps a été commandé pour la Crimée, et c’était une superbe affaire, car il était à peu près sûr de revenir capitaine, sans bourse délier ; or il lui est assez difficile de délier sa bourse, par la bonne raison qu’il n’en a pas. Mais Kate lui a fait ce petit discours : « John O’Callaghan, si vous restez ici, je vous attendrai, fût-ce vingt ans. Mais si vous partez, je ne réponds de rien. »
– Et il est parti ?
– Non, il est resté. Il a permuté avec un autre officier dans une compagnie coloniale, et il n’est pas capitaine ; mais il voit Kate tous les jours et il attend.
– Il s’est déshonoré !
– Qui ? O’Callaghan ? Pourquoi déshonoré ?
– Comment ! son régiment va se battre et il reste auprès d’une femme !
– Ah çà, vous plaisantez ? Quel mal voyez-vous à cela ?
– Mais le mal, que tout le monde a dû dire qu’il avait peur.
– O’Callaghan avoir peur ? Voilà une bonne idée ! Non, mon cher et aimable petit monsieur, nous autres Irlandais nous n’avons pas peur, et nous nous soucions très peu de l’opinion des sots. C’est le colonel lui-même qui a conseillé à O’Callaghan de rester ici, et il n’y a pas un plus brave garçon dans le monde ; et celui qui dirait le contraire pourrait s’attendre à recevoir sur la figure les deux poings d’O’Lary, qui pèsent quelque chose, on vous en répond !
Je voudrais être chez moi, dans la rue Taitbout, pensa Charles. Il en avait assez de toutes ces violences. Mais à ce moment, on vint le prévenir que Georges Barton l’attendait à la porte. Il avait vu le colosse dans le bal avec un habit noir et une cravate cerise à points bleus ; il le retrouva sur le perron en bottes de pêche montant jusqu’au ventre, avec un paletot de gros drap qui paraissait bien avoir trois pouces d’épaisseur, un cache-nez en laine tourné un nombre infini de fois autour de son cou de taureau, et un chapeau sans forme et sans couleur. Harrison était à côté de son ami ; les huit fils d’Harrison derrière leur père, les six filles devant lui, et peu à peu tout le bal se trouva rassemblé.
– Il est deux heures du matin, dit Barton, il faut partir. Bonsoir la compagnie ! Vos bagages sont sur ma goélette, et vous vous habillerez là pour la mer.
– Adieu donc, mon garçon ! s’écria Harrison avec un shakehands formidable. Pardon de ne vous avoir pas mieux reçu ! Encore un verre de vin ! La vieille femme a mal aux dents et m’a chargé de ses compliments ; versez pleins tous les verres ! Y êtes-vous ? Gentlemen and ladies, un hourrah pour Charles Cabert… hep, hep, hep, hourrah !
Tout le monde beugla.
– Once more ! hurla Harrison, hep, hep, hep, hourrah !
Les vitres tressaillirent, et la maison parut prête à s’écrouler.
– Maintenant, reprit Harrison, retournez danser ! J’accompagnerai mon hôte à la goélette avec mes fils et ceux qui voudront venir.
– Nous irons tous ! cria la foule.
O’Lary se précipita tête baissée, saisit Charles par le milieu du corps, l’assit sur son épaule, et malgré les coups de pied que celui-ci lui assenait dans la poitrine, l’emporta rapidement vers le quai ; tout suivit en vociférant des hourrahs !
Arrivé à destination, Charles fut posé à terre ; les embrassades recommencèrent. Barton y mit fin en entraînant son compagnon et en retirant la planche qui leur avait servi à gagner la goélette ; mais tandis qu’il manœuvrait avec les deux hommes formant son équipage, pour se débrouiller hors des nombreux bâtiments au milieu desquels il avait été mouillé et gagner la sortie du port, on entendit longtemps encore des hourrahs ! et des « Cabert for ever ! » à défrayer toute une élection anglaise.
– Allez m’ôter ces jolies choses que vous avez sur le corps, dit Barton, et mettez-vous en tenue de mer ! Voilà la cabine.
Charles trouva le conseil bon, et entra ; mais à la lueur de la petite lampe pâle qui éclairait la cellule navale, il eut beaucoup de peine à savoir où placer le pied, car le plancher était couvert de paniers de provisions de toute espèce, de bouteilles de toutes formes, bordeaux, champagne, sherry, marsala, eau-de-vie, rhum, ale, porter et spruss, dont la sollicitude d’Harrison avait pris soin d’approvisionner son voyage.
Horrible bête ! pensa Cabert, révolté plus que touché par cette munificence de mauvais goût. Il était si exaspéré contre les gens au milieu desquels il était tombé, et d’ailleurs si épuisé de fatigue, qu’au lieu de changer de vêtement et de revenir sur le pont, il se coucha et s’endormit d’un profond sommeil.
Quand il s’éveilla, il fut comme aveuglé par le jour. Il regarda sa montre. Il était midi. Mais la goélette dansait horriblement.
Il ne manquait plus que cela, se dit le jeune homme. Un gros temps ! Probablement nous sommes en retard, car nous devrions être rendus. J’imagine que ce M. Barton demeure à quelques heures de Saint-Jean ; dans tous les cas, voyons un peu.
Charles s’habilla, non sans peine, en luttant contre le roulis et le tangage, et il arriva trébuchant sur le pont. Il pleuvait à verse, et le vent soufflait à décorner les bœufs. Barton était à la barre, couvert de toile cirée et fumant son cigare.
– J’ai bonne chance, dit-il à Cabert en souriant avec aménité ; si nous pouvons garder ce même vent pendant trois jours, dans huit jours nous serons chez nous.
– Comment, dans huit jours ! s’écria Charles au désespoir. Où allons-nous donc ?
– Mais sur la côte ouest, j’imagine, et, à moins que mon îlot n’ait changé de place, à quinze mille de la Baie des îles : Où croyiez-vous donc aller ?
– Je croyais que votre maison de campagne était dans les environs de Saint-Jean, et si j’avais pensé…
– Maison de campagne ! Le mot est joli. Pour qui me prenez-vous ? Je vais vous faire voir des choses dont vous n’avez pas la plus petite idée dans votre Europe pourrie. D’ailleurs, puisque vous voulez chasser le caribou, il vous faut bien aller sur la côte ouest.
Le propre des gens vraiment civilisés et raffinés est de se soumettre à leur sort ; les barbares seuls sont obstinés dans la résistance. Charles passait sa vie, depuis son arrivée dans ces tristes parages, à constater des faits révoltants, mais en même temps la nécessité de les subir ; c’est ce qu’il fit encore cette fois-là, et d’autant mieux, que le mal de mer le prit avec une violence marquée. Barton, qui lui avait proposé d’apprendre quelque chose de la manœuvre afin de se rendre utile, ce qui, disait-il, est toujours agréable, y renonça de bonne grâce quand il vit son passager étendu livide sur le pont et livré à toutes les angoisses d’une souffrance si cruelle. Il le porta sur le lit, le soigna par le punch, par le jambon cru, par le poisson cru, par la pomme de terre, et finit par laisser dormir le patient.
Comme si le temps eût été à ses ordres, le vent désiré se maintint pendant les trois jours. Peu à peu tout se calma, la pluie ne tomba plus continuellement, il y eut des éclaircies ; mais généralement une brume blanchâtre flottait sur les eaux troublées du golfe Saint-Laurent, et les côtes de la Grande-Terre étaient plus ou moins voilées dans le brouillard. Comme la goélette ne s’en tenait pas loin, on voyait défiler les grèves stériles, les bois de sapins sans grandeur, la verdure ruisselante d’eau, les roches moussues. Ce n’était pas beau, mais très sauvage. Charles s’ennuyait à cœur joie, et regrettait de toute son âme l’idée qu’il avait eue de se singulariser d’une façon si désagréable. Il maudissait son père qui l’avait fait partir, ses amis qui l’avaient félicité de son plan, et Coralie, cause première de son malheur ; puis il s’endormait.
Le huitième jour, à quatre heures du matin, Georges Barton le réveilla.
– Allons, debout, lui dit-il, on va mouiller tout à l’heure, nous sommes arrivés ! Lucy vient au-devant de nous !
– Qui est Lucy ? demanda Charles en se frottant les yeux.
– Ma fille, donc ! répondit Barton.
Par exception, la journée s’annonçait assez belle. Les nuages ouverts laissaient voir le bleu du ciel à travers leurs déchirures. La goélette entrait vent arrière dans une baie tranquille, formée par les deux pointes d’un îlot de rocher ; pas un arbre, pas un buisson, pas un brin d’herbe. À droite, une grève sur laquelle séchaient des morues ; à gauche, deux ou trois magasins en bois, couverts de toile goudronnée ; au fond, une assez grande maison à un seul étage, moitié pierres, moitié planches. Quelques hommes circulaient çà et là, clouant des barriques ou faisant quelque gros ouvrage. Des groupes de chiens jouaient dans l’eau, avec autant d’enfants réunis autour des barques tirées à terre. Une embarcation menée à la rame par deux jeunes filles avec la précision que les baleiniers d’une frégate de guerre eussent pu y mettre, arrivait sur la goélette ; une autre jeune fille tenait la barre.
– C’est Lucy, répéta Barton en bourrant une nouvelle pipe, et si vous en trouvez une autre comme elle pour aller au large, par une bonne brise, aussi tranquille qu’au coin de son feu, faire son chargement de harengs là où mes hommes ne prennent rien, je lui tirerai mon chapeau à celle-là !
L’objet d’un éloge aussi enthousiaste accosta vivement la goélette, et tandis que les deux autres filles restaient dans l’embarcation, Lucy grimpa à bord sans que son père parût même avoir l’idée de lui tendre la main pour l’aider ; il ne le fit que quand elle s’approcha de lui, et en manière de caresse cordiale.
– Eh bien, Lucy, ma bonne fille, vous allez comme à votre ordinaire ? dit Barton avec un gros sourire. Voilà un hôte que je vous amène de Saint-Jean : M. Charles Cabert, de Paris.
Lucy fit une sorte de salut un peu effarouché. Elle était habillée comme une barbare ! Une robe d’indienne bleue, un fichu de soie rouge au cou. Une servante respectable n’aurait pas voulu de ces atours. Cependant Charles, en faisant cette réflexion avec un juste mépris, ne put s’empêcher de remarquer que les yeux étaient splendides, les couleurs d’une fraîcheur nacrée et rosée incomparable, les cheveux du blond le plus avenant et d’une opulence magique, et tous les mouvements empreints de cette grâce parfaite qui ne s’apprend pas et que la nature seule peut donner aux êtres heureux auxquels elle a accordé une taille sans défauts.
– Vous allez bien vous ennuyer avec nous, monsieur, dit Lucy en levant timidement les yeux sur le nouvel arrivant.
– Ah ! mademoiselle, répondit celui-ci…, et il s’inclina, parce qu’il serait de mauvais goût de nos jours de se répandre en compliments vieillis ; c’est déjà beaucoup de les sous-entendre.
On arriva rapidement près de terre, et au moyen de l’embarcation amenée par Lucy, on descendit. Barton avait communiqué à sa fille cette nouvelle agréable qu’il lui rapportait de Saint-Jean beaucoup de choses.
– Voyez-vous, ma chère, avait dit le gros homme, j’ai là pour vous une armoire à glace comme la reine d’Angleterre n’en a pas. Huit robes de soie et tout ce que j’ai pu trouver de chapeaux et autres fanfreluches, votre passion à vous autres femmes ! Je vais faire débarquer le tout devant mes yeux, et je vous rejoindrai à la maison, où vous conduirez d’abord M. Cabert dans la chambre que vous jugerez la meilleure pour lui.
C’est ce qui fut exécuté. Lucy, avec l’empressement d’une maîtresse de maison pénétrée de ses devoirs, introduisit Cabert dans un appartement assez joli, tout en sapin, plancher, plafond et murailles, et après y avoir porté elle-même, en un tour de main, une table et une commode qui manquaient, tandis qu’une servante prodiguait les serviettes et autres menus détails, elle sortit et laissa Charles en possession de son domaine.
– Belle, sans doute, se dit-il, mais muette comme les poissons qu’elle fréquente, aussi sotte et ne valant pas la dernière des. femmes de chambre, ô Coralie !
Il se mit à la fenêtre ; ce n’était au-dessous que roche et sable. Un peu au-delà, la mer. À droite, les côtes de la Grande-Terre avec leurs sapins ; à gauche et plus au large, deux immenses montagnes de glace ; ces masses blanches semblaient clouées sur les vagues pour l’éternité.
Charles bâilla. Il eut un moment de découragement pénible. Pourtant il se secoua, et commença sa toilette avec l’intention charitable de montrer à ses malheureux hôtes ce que c’est qu’un homme élégant, afin qu’ayant joui une fois dans leur vie de cette brillante apparition, ils pussent ne l’oublier jamais.
Son travail prit du temps et avait bien duré deux bonnes heures, quand il entendit les pas de Barton dans le corridor. Ces maisons de bois sont d’une sonorité désespérante, et on ne saurait remuer à un bout qu’à l’autre on ne l’apprenne.
– Je vous cherche pour déjeuner. C’est dimanche aujourd’hui, et je vous ai envoyé chercher un homme d’esprit, qui causera avec vous à la française tant que vous voudrez. C’est M. John, notre maître d’école. J’ai aperçu aussi au large la yole de mon fils Patrice. Depuis quinze jours, il chasse au Labrador. Comptez sur lui pour vous faire tuer des caribous.
Charles fut un peu blessé de ce que Barton ne parût pas sentir l’immense distance qui sépare un homme convenablement habillé d’un autre qui n’est que vêtu. Le fait est que le pêcheur de phoques n’y mit pas la moindre malice et n’en eut, que plus tort, ce qui ne l’empêcha pas de conduire Cabert tout droit dans le salon.
Un tapis luxueux, des rideaux de soie rouge aux fenêtres, des tables de palissandre, deux corps de bibliothèque remplis de très beaux livres, et quelques vases de porcelaine avec des fleurs artificielles, une gravure représentant la mort du général Wolfe à la bataille de Québec, telles étaient les magnificences étalées dans la principale pièce de la maison de Barton. Quoi qu’en pût penser Charles, c’était le nec plus ultra du luxe réalisé jusqu’alors dans ces parages, et les gens d’imagination vive qui avaient eu le bonheur d’admirer cette installation, la considéraient comme une reproduction très satisfaisante des splendeurs de Paris et de Londres.
Assise sur un fauteuil de damas rouge, et vêtue d’une belle robe de soie, avec des manches et un col de dentelles, Lucy n’était plus mi sauvage ni ridicule, et Charles ne put s’empêcher d’être frappé du charme de cette jeune fille. À côté d’elle se tenait un monsieur extrêmement maigre, à physionomie grave et maladive, mais d’une distinction si saisissante, que le, jeune Parisien n’en fut guère moins étonné que des perfections nouvelles qu’il découvrait en Lucy. Cette figure austère, ce front dénudé, cette apparence ravagée lui furent un spectacle inattendu ; il eut l’instinct, qu’il se trouvait en présence d’un être aussi dépaysé que lui dans ces latitudes, et cette sensation fut accompagnée d’une antipathie subite et d’un mouvement d’aversion bien senti.
Ce personnage singulier était le maître d’école. Comme Cabert n’en sut jamais plus long sur son compte et n’eut pas d’autre nom à lui donner que celui de M. John, il faut, pour l’intelligence parfaite de ce qui se passa ensuite, raconter ce que M. John était véritablement.
Il se nommait sir Hector Latimer, et dans sa jeunesse avait occupé un emploi de quelque importance dans le service civil de la Compagnie des Indes, présidence de Madras. On sait que beaucoup de jeunes demoiselles anglaises, sans fortune, vont dans ces pays avec l’intention avouée d’y chercher des maris. Sir Hector fit, dans un bal donné par le 104e régiment de la Reine, la connaissance de miss Géraldine Leed, en devint amoureux et l’épousa. Un an après, et comme sa passion allait toujours croissant, il trouva un soir, sur la table de son cabinet, une lettre l’avertissant que sa femme, n’étant pas parvenue à l’aimer malgré d’héroïques efforts, s’était décidée à réclamer l’appui de M. Henry Heaton, du IIe régiment des fusiliers, et était partie avec lui pour l’Angleterre. Lady Géraldine terminait ce document, écrit de sa propre main et signé de son nom de fille, par l’assurance qu’elle conserverait toujours de la gratitude pour les bons soins de son mari, dont elle reconnaissait n’avoir jamais eu à se plaindre.
Sir Hector donna sa démission, revint à Londres, et se mit à jouer et à boire. Il vécut avec des grooms et des gens de là pire espèce, et prenait le grand chemin de se ruiner, et peut-être de finir devant quelque cour de justice, quand, une nuit où il traversait le Strand, parfaitement ivre, le hasard lui fit rencontrer une voiture, dans laquelle il aperçut sa femme avec l’officier qui la lui avait enlevée.
Cette vue le dégrisa complètement, et la réflexion qu’il fit fut celle-ci : Au cas où elle m’a vu et reconnu, elle a contemplé un être encore plus dégradé qu’elle-même, et je n’ai rien à lui reprocher.
Quelques jours après, il fit trois parts de sa fortune : deux furent remises en son nom à ses sœurs ; la troisième, comprenant une rente de cinquante livres, dut être payée à un notaire de Saint-Jean à Terre-Neuve pour une destination inconnue. Lui-même se retira aux environs de la Baie-des-Îles, où il s’était rappelé être venu chasser dans sa jeunesse. Cherchant un moyen aussi humble, aussi abaissé que possible d’expier ses fautes et celles des autres, il se fit maître d’école sous le nom de M. John, et rendit de grands services à la population abandonnée de chasseurs et de pêcheurs établie dans cette contrée. Il vivait du travail de ses mains autant qu’il le pouvait, et sur les cinquante livres que le notaire lui transmettait secrètement, il faisait du bien en se cachant de son mieux. En somme, sir Hector Latimer, protestant, rendait parfaitement témoignage, sans y songer, que l’esprit d’ascétisme et de rude pénitence est profondément empreint dans certaines âmes anglaises, quel que soit leur culte. C’était l’homme qui avait déplu tout d’abord à Charles Cabert, et on ne peut là qu’admirer le tact sûr des divers tempéraments.
On passa dans la salle à manger, et on se mit à table. La beauté de Lucy préoccupait Cabert de plus en plus. Il était l’objet des attentions de la jeune fille, et cela l’enivrait ; M. John ne soufflait mot. Georges Barton parlait politique.
– À quel parti appartenez-vous demanda-t-il brusquement à son hôte.
– Je vous avouerai, répondit celui-ci, que je n’ai pas beaucoup d’opinions. Je laisse ce luxe à ceux qui croient à quelque chose. En général, je fuis les exagérations, et je me borne à souhaiter le progrès et le développement du bien-être matériel. En somme, je penche pour les idées démocratiques, mais je ne me lie qu’avec des hommes bien élevés.
– Quel galimatias me racontez-vous là ? s’écria Barton. Vous êtes démocrate, vous ? avec votre redingote pincée et votre raie dans les cheveux ? Allons donc ! Voulez-vous voir un vrai, démocrate ? eh bien, regardez-moi, mon garçon ! Je suis des Barton du Somerset, et nous sommes passés en Irlande du temps de la reine Bess ; depuis cette époque, et cela commence à dater, il ne s’est pas donné une taloche dans le Leinster que nous n’y ayons eu part, soit pour l’appliquer, soit pour la recevoir. Mon grand-père est allé s’établir à la Nouvelle-Écosse ; mon père s’est fixé au Canada ; moi je suis venu ici dans cet îlot, que j’ai trouvé désert ; les Anglais n’ont pas le droit d’y mettre le pied, bien qu’ils en soient souverains ; et les Français qui pourraient y pêcher ne sont pas autorisés à s’y établir. Un de vos amiraux m’a dit l’année dernière : Monsieur Barton, vous savez que je pourrais vous forcer à quitter la place ? – Amiral, lui ai-je répondu, je le sais ; mais comme vous n’y auriez aucun profit, vous ne le ferez pas ; si cependant vous exigez mon départ, j’embarque mes engins de pêche, mes meubles et mes planches, et je vais m’établir plus haut, en dehors du détroit, sur la côte du Labrador, et, s’il le faut, vers le Groënland ! Car je ne connais ni rois, ni empereurs, ni ducs, ni présidents, ni magistrats. Je suis mon magistrat à moi-même ! Je paye ce que je dois, je prends ce qui m’appartient ; si l’on m’attaque, je me défends, et j’ai des bras pour m’en servir. Voilà ce que j’appelle un vrai démocrate !
Charles ne put retenir une grimace ironique.
– Ce que vous décrivez là, dit-il, c’est : de la piraterie et du vagabondage, mais non pas de la démocratie d’après les principes.
– C’est de la démocratie américaine, mon garçon, et c’est la bonne ! Vous voulez parler de principes ? Lucy, ma bonne fille, dites-lui quelques mots là-dessus, vous qui avez été élevée à l’école de Saint-Jean, et montrez-lui que nous savons nous servir de notre langue aussi bien que ces bavards d’Européens. Ah ! voilà Patrice !
Patrice entra ; il ressemblait à son père et un peu à sa sœur. Il posa son fusil dans un coin de la salle, et, sans saluer personne ni souffler mot, il s’assit et commença à manger. La conversation continua.
– Vous parliez d’amiral tout à l’heure, dit M. John d’une voix douce et qui avait quelque chose de musical ; je vous annoncerai que, pendant votre absence, Gregory a fait bénir son mariage et baptiser ses quatre enfants par l’aumônier de la frégate.
– J’en suis bien aise répondit Barton ; Gregory et sa femme sont de braves gens et des personnes tout à fait respectables et religieuses.
– Avec quatre enfants en avance d’hoirie, fit observer le sarcastique Charles.
– Ils n’en sont pas moins bons chrétiens pour cela, répliqua Barton. Nous n’avons sur toute cette côte ni ville ni prêtre, et vous pensez bien que les jeunes gens ne s’en marient pas moins. À vingt ans, on s’aime et on s’épouse.
– Sur l’autel de la nature, dit spirituellement Cabert.
– Comme vous voudrez, mais on ne songe pas à mal. Quand un prêtre passe, souvent après plusieurs années, on lui demande son, secours, et cela ne nuit à personne.
Charles ne répliqua pas ; le sérieux de Barton lui en imposait, la gravité de M. John le glaçait, la présence de Lucy le gênait pour le développement de sa pensée. Il n’en fut pas moins très frappé de ce qu’il venait d’entendre, et cela lui fit éclore un monde d’idées.
Enfin on cessa de tenir table, on entra dans le parloir, et Charles resta seul avec la jeune maîtresse de la maison. Il était manifeste que Barton rie voyait dans son visiteur qu’un étranger, chasseur de caribous, dont il s’était chargé par obligeance et par ce goût fastueux d’hospitalité, ordinaire à tous les hommes lorsqu’ils ont peu d’occasion de l’exercer. Mais l’impression produite par la vue du Français sur l’esprit de la jeune fille avait été, dès l’abord, d’une nature différente, et, pour être sincère ; il faut avouer que, dans son âme et conscience, Lucy lui avait rendu pleine justice et l’avait trouvé charmant. Comme Cabert ne ressemblait en aucun point aux hommes qu’elle avait pu voir jusqu’alors, il représentait pour elle, à un degré suprême, cette apparition de l’inconnu, toujours si puissante sur les imaginations féminines. Il était de taille médiocre, et elle ne connaissait que des géants ; sa figure un peu pâle, ses cheveux fins et rares, sa moustache à peine dessinée, ses favoris clairsemés donnaient à la jeune Irlandaise l’idée d’une délicatesse de nature qui lui sembla presque angélique, en même temps que l’accent un peu aigre de la voix, le plus souvent timbrée par l’ironie, lui parut indiquer, d’une manière certaine, l’expression de pensées décidément supérieures. Ce qui était fort, étant constamment sous ses yeux, lui paraissait vulgaire. Une nature mince et débile devait être le comble de la distinction, et avec cette rapidité d’expression, de sentiment, de résolution qui envahit les êtres voués à la solitude et à la monotonie, elle décida que Charles Cabert était, à n’en pas douter, une créature d’élite, sinon venue du ciel, du moins parente de celles qui en étaient venues, et que le plus souverain bonheur qui pouvait échoir à une femme dans ce monde et dans l’autre devait être de se voir aimée d’un pareil héros de roman.
Quand, dans les villes d’Europe, une jeune fille bien née est, par hasard, touchée d’une intuition de cette espèce, elle sait qu’elle n’a qu’une chose à faire, qu’elle n’a au monde qu’un devoir, et un devoir le plus impérieux de tous les devoirs, c’est de penser ce qu’elle peut, mais, avant tout et surtout, et quelle que soit sa conviction, de n’en rien montrer. Sa considération, son honneur, son prestige est à ce prix. Tous les codes féminins dont elle a pu entendre parler sont précis sur cet article. Il n’en va pas de même dans le nouveau monde. Si une femme aime un homme, elle désire l’épouser ; si elle veut l’épouser, il faut qu’elle se charge directement de cette affaire, car c’est une affaire, et la plus sérieuse, et la plus positive qu’elle puisse jamais conduire. Elle se trouve exactement dans la position d’un jeune débutant dans la vie qui préfère la marine au commerce, ou un régiment à un tribunal. Il faut qu’elle cherche à acquérir celui qu’elle a choisi, comme le candidat doit faire tous ses efforts pour gagner son épaulette ou tout autre insigne de la profession par laquelle il est séduit. Si Juliette aspire à Roméo, il faut qu’elle s’arrange de façon à réussir par elle-même et le plus vite possible. Le vieux Capulet n’interviendra que pour offrir sa bénédiction.
Je dois le dire, Lucy ne perdit pas une minute. Elle ne pensait pas vouloir rien de déraisonnable ni de douteux. Elle aimait Charles ; elle prétendait l’épouser au plus vite, et ne supposait pas que ce vœu impliquât rien dont son idole pût être offensée, car elle se savait digne d’être acquise : belle, courageuse, dévouée, tendre, fidèle comme l’or. Pourquoi hésiter ? Si le jeune Français ne voulait pas d’elle, il le dirait, et tout serait fini. Il n’y a que les pédants qui prétendent que la logique est la même partout ; les idées sont des carrefours d’où descendent une grande quantité de routes fort divergentes.
Charles s’aperçut d’abord des bonnes intentions de Lucy à son égard ; mais, partant de la même impression qui agissait sur la jeune fille, il suivit une voie tout autre. Il pensa que, dans un pays où on se mariait provisoirement, risque à ne rencontrer un prêtre et sa bénédiction qu’un nombre illimité d’années après l’union, il était tout à fait explicable que les jeunes demoiselles eussent du goût pour le premier venu. La fille de Georges Barton était une charmante personne, et bien plus excusable, dans le cas présent, que toutes ses compagnes, attendu qu’elle était soumise à une tentation difficile à surmonter. Un Parisien orné de ses grâces, perfectionné par la vie élégante, connaissant à fond les passions, ayant le revenant bon de ses expériences, une pareille perle échouant sur les rives sauvages de la Baie-des-Îles, quelle merveille qu’une jolie main voulût se saisir d’un tel trésor ! Le trésor se prêtait à être ramassé, mais non pas serré dans un écrin, mis sous clef, gardé à jamais. L’amour est l’amour, il dure, il ne dure pas, il flambe, il fume, il s’éteint, il se rallume. Que diable ! on ne sait ce qu’il devient, et il ne faut pas se lier.
– Non, mademoiselle, répondit Charles en souriant à une question que lui adressait Lucy d’un air ému, non, je vous l’avoue, je n’aime pas la poésie, et en général je ne lis jamais rien ! Je suis essentiellement ce que vous appelez en Amérique un homme pratique. Je déteste les rêves et ne me plais qu’aux réalités. Je n’ai jamais lu ni Byron ni Lamartine, et Musset m’ennuierait beaucoup si je le trouvais sur ma table ; je ne le tolère qu’au théâtre, où l’on peut au moins, pendant la pièce, regarder dans les loges si les femmes sont jolies, ou causer avec ses voisins. Laissons cela ; les idées de chacun n’ont pas besoin de messieurs qui accouplent des rimes pour dire des fadaises, et quand mon cœur est possédé par un sentiment sincère, surtout alors je trouve ces niaiseries extrêmement rebutantes.
– Est-ce que vous aimiez quelqu’un ? demanda Lucy d’un air intéressé.
– Je ne suis pas parvenu jusqu’à vingt-trois ans, répondit Charles, sans avoir horriblement souffert. J’ai aimé, j’ai cessé d’aimer, et sans doute le souvenir des tortures que j’ai éprouvées m’aurait détourné à jamais d’affronter de nouvelles épreuves, si je ne sentais en ce moment…
Lucy rougit et eut une impression de joie céleste.
– Vous n’aurez pas été fidèle ? dit-elle avec un sourire que la pauvre enfant voulut rendre malicieux.
– Tellement fidèle, tellement dévoué, que je ne suis ici, auprès de vous, que par ce motif. J’ai tout abandonné, famille, patrie, fortune, bien-être, pour fuir un souvenir déchirant. Mais vous avez raison. Hier, j’étais au désespoir, et, puisque vous voulez la vérité, aujourd’hui je ne le suis plus !
Les choses, comme on voit, allaient vite, et la question se développait, quand M. John entra. Il venait chercher Charles de la part de M. Barton pour lui faire visiter le jardin, et les établissements de pêche, et les cuves pour la fonte des huiles provenant de la dépouille des phoques.
« Que le diable l’emporte ! » pensa Charles.
– À ce soir, dit-il à Lucy.
– À ce soir ! lui répondit-elle ; et il y avait des deux côtés, dans ces simples mots, un monde de promesses différemment entendues.
Quand Charles eut fait quelques pas avec M. John, celui-ci lui dit de cette voix douce et pénétrante qui lui était particulière :
– Monsieur, je n’ai pas l’honneur d’être de votre connaissance, et vous auriez le droit de trouver mauvais mon intervention dans vos affaires ; mais mon âge me prête quelques prérogatives, et dans votre intérêt, je vous engage à ne pas vous croire ici dans un salon d’Europe.
– Je ne m’y crois pas non plus, monsieur ! répliqua Charles avec cet accent d’ironie qu’il maniait à la perfection. Il me faudrait une puissance d’illusion que je ne possède pas !
– C’est donc à merveille, repartit froidement M. John ; buvez, mangez, chassez, amusez-vous de ce qu’on vous offre, mais ne commettez pas de méprise, vous n’en comprenez pas les conséquences.
– Ce que je ne comprends pas, c’est votre discours. Voulez-vous que j’en demande l’explication à M. Barton ?
Le maître d’école se mordit la lèvre ; Charles pensa que c’était de crainte, et il en rit bien en lui-même, car il croyait deviner que le vieux bonhomme, malgré sa maigreur et son air éteint, avait sournoisement pris feu pour Lucy, et, comme le chien du jardinier, empêchait les autres de manger le dîner auquel il ne pouvait toucher lui-même. Pendant qu’il s’applaudissait de sa sagacité, de sa pénétration et de sa résolution, Barton s’approcha avec son fils Patrice. Il fit faire à Charles le tour de l’îlot, lui en détailla les curiosités, entre autres un carré de quinze pieds environ, où, au moyen de quelque peu de terre à peu près végétale apportée de loin, on avait réussi à faire pousser une demi-douzaine de choux et des plants de rhubarbe. La visite générale achevée, on retourna se mettre à table pour attendre le dîner.
Lucy allait et venait, mais à chaque instant quelque pêcheur, les femmes, les filles de ces messieurs, toutes avec des chapeaux à fleurs et des robes de soie des coupes les plus extravagantes, entraient, s’asseyaient, causaient ; ces hommes étaient beaux, ces femmes étaient charmantes ; il y avait autant d’honnêteté et de courage dans la figure des premiers que de modestie et de candeur dans celle de leurs compagnes ; c’était à merveille ; mais Charles s’impatientait de voir sa conversation avec Lucy souffrir tant de retardements.
« Quand je leur dirai à Paris, pensait-il, ce qui m’arrive ! C’est-à-dire, en vérité, que je suis comme le fameux César : je suis venu, j’ai vu, ou plutôt on m’a vu, et j’ai vaincu ! Le tout non pas en un jour, mais en douze heures, si je puis seulement parler encore un instant à cette charmante entraînée ! Ma foi, ces anciens drôles, Richelieu et Lauzun, je voudrais bien savoir ce qu’ils eussent fait de mieux ! »
Enfin, à force de manger pour attendre le dîner, le dîner arriva. On se livra sérieusement aux occupations multipliées qu’il vint présenter, et comme M. John devait s’en retourner le soir à la Grande-Terre, Barton et Patrice, qui n’avait pas ouvert la bouche, depuis le matin, et dont c’était si bien l’habitude que personne n’y prenait garde, se chargèrent de reconduire le maître d’école dans une embarcation. Charles, à sa joie extrême et presque avec émotion, bien qu’il eût tenu à l’honneur de n’en pas convenir, se trouva seul avec Lucy.
Il jugea, en homme de guerre consommé, qu’il ne fallait pas là perdre son temps en manœuvres stratégiques, mais bien tout enlever d’un coup de main.
– Écoutez-moi, mademoiselle, lui dit-il d’un ton pénétré ; les âmes comme les nôtres n’ont pas besoin de phrases et ne veulent pas d’hypocrisie ; vous et moi, nous sommes au-dessus de pareilles sottises. Comme je vous l’ai dit ce matin, j’ai aimé ! J’ai aimé une femme divine, parée de toutes les séductions que les arts et l’intelligence peuvent prêter à une créature humaine. Des circonstances, sur lesquelles je ne pourrais m’appesantir sans que mon cœur se brisât, nous ont séparés à jamais. Voulez-vous de cette âme souffrante que je dépose à vos pieds ? Voulez-vous me faire oublier un passé que je maudis, et m’ouvrir, de cette main charmante, un avenir plein de félicité et des aspirations les plus pures vers l’idéal ?
Ce n’était pas là absolument ce qu’il se figurait ; mais la phraséologie moderne exige ces transpositions de sens. Malheureusement, Lucy n’était pas avertie, de sorte qu’elle répliqua fermement :
– Je vous aimerai si bien, que vous ne regretterez personne ; et si quelquefois je sens, malgré moi, combien je suis inférieure à cet objet sublime de votre ancienne affection, ce ne sera que pour éprouver plus de reconnaissance devant Dieu, et de joie en moi-même de l’honneur que vous m’aurez fait.
– Ah ! Lucie, s’écria Charles, mon destin est fixé à vos pieds !
– Pour jamais ! répondit Lucy.
En ce moment Patrice entra, et, s’asseyant dans un fauteuil, regarda fixement Charles Cabert, qui, malgré lui, sentit un léger frisson et fut tout prêt de perdre contenance.
– Que vous êtes revenus vite ! lui dit Lucy. Vous n’êtes donc pas allés à la Grande-Terre ?
Patrice leva les épaules et montra la fenêtre. Lucy s’aperçut alors qu’il y avait un coup de vent. Presque aussitôt Barton parut avec M. John, et comme tout ce monde ne quitta plus le salon, il n’y eut plus d’entretien particulier possible ; seulement, la joie de Lucy était si évidente, elle prenait si peu soin de la cacher, elle avait pour Charles des attentions, des coquetteries et presque des tendresses si vives, que celui-ci en éprouvait le plus cruel malaise, et, en lui-même, se laissait aller à qualifier sévèrement une franchise de si mauvais goût ; il ne fut donc pas autrement fâché quand Barton, après avoir sommeillé toute la soirée, déclara, en s’étirant avec un bâillement formidable, qu’il était temps d’aller se coucher, et on lui obéit.
Charles avait une nature trop fine et trop nerveuse pour s’endormir brusquement, comme les gens grossiers dont il était entouré. Il eût volontiers entonné un chant de triomphe, s’il n’avait professé pour les manifestations bruyantes le plus juste mépris. L’îlot de Barton lui faisait aussi l’effet d’une île enchantée, et il se rappelait quelque chose qu’il avait lu dans la Bibliothèque, des chemins de fer sur les enchantements de Tahiti et des territoires adjacents. Il ne pouvait s’empêcher de rire en pensant à l’effet qu’il allait produire à son club, quand il raconterait ses aventures par terre et par mer. Naguère, il avait compté modestement sur ses exploits contre les caribous ; mais il en aurait bien d’autres à étaler ! Réellement ; il vit passer devant ses yeux tant d’images ravissantes, que son imagination en était tout illuminée dans les ténèbres de la nuit, et en dépit de lui-même, de cette nature correcte dont il faisait gloire, il faut le déclarer, il fut poète ! Et tellement poète, que le matin à six heures, ne tenant plus dans son lit, il s’habilla pour aller sur les grèves mirer son bonheur dans celui de la nature, qui, partout et sous toutes les latitudes, est heureuse.
Il passait devant la porte du salon, quand cette porte s’ouvrit toute grande, et il se trouva en face de Georges Barton et de son fils. Les deux géants le regardèrent avec des yeux étincelants de joie, et l’orgueil du bonheur peint sur leurs larges figures.
– Donnez-moi votre main, mon brave garçon, donnez-la-moi ! Donnez-la à Patrice ! Je vous ai aimé tout de suite ; j’ai deviné d’abord, à Saint-Jean, ce que vous valiez, et c’est le ciel qui m’a conduit au-devant de vous ! Asseyez-vous là ! Que je suis bête ! Un vieux loup comme moi s’émouvoir à ce point. Mais pardonnez au pauvre Barton ! Quand vous serez père vous-même, vous comprendrez ces sottises-là !
« Qu’est-ce qu’il veut dire ? » se demanda Charles.
– Figurez-vous, continua Barton, qu’hier au soir, après votre départ, cette folle de Lucy m’a embrassé en pleurant, et m’a dit une quantité de choses auxquelles j’ai commencé par ne rien comprendre ; à la fin pourtant, elle a conclu, et j’ai compris que vous étiez tous les deux engagés !
Charles rougit, se troubla, mais ne trouva pas un mot à articuler.
Barton poursuivit :
– Eh bien, vous avez raison ! Une meilleure fille, un plus grand cœur que Lucy ne se rencontre pas dans l’univers, et je vous vois plus d’esprit dans votre pouce pour avoir deviné cela du premier moment, que tous les philosophes des deux mondes n’en ont dans leur cervelle ! C’est une bonne affaire pour vous ; mais je sais que c’en est aussi une fort bonne pour elle. Le vieux Harrison me l’a confié ! Votre père est riche, et vous l’êtes vous-même ! Voici ce que j’ai arrangé de mon côté avec Patrice. Je pense que cela vous conviendra, car nous sommes des Barton du Somerset, et je n’entends pas que Lucy se marie comme une mendiante. Nous partirons tous demain sur la goélette pour Saint-Jean ; l’évêque lui-même vous mariera ; nous vous donnerons tout ce que nous avons dans la banque et nos actions sur le chemin de fer d’Halifax ; vous monterez une maison de commerce pour l’exportation des huiles, et que je sois pendu, mon garçon, si, avant que votre fils aîné fasse sa première communion, nous n’avons fait entre nous la plus belle fortune de la colonie !
En traçant ce tableau enchanteur, Barton s’exaltait, et Patrice, qui n’en parlait pas davantage, riait silencieusement en balançant la tête de l’air le plus approbateur.
Charles, épouvanté au plus haut point, et sentant le danger sur lui, la gueule ouverte, lui soufflant au visage, comprit que, s’il ne voulait être dévoré, il n’avait juste que le temps de se mettre en défense.
– Mais, mon cher monsieur Barton, s’écria-t-il, je ne vous comprends pas bien ! Je crains qu’il n’y ait en tout ceci un grave malentendu dont je serais désolé, croyez-le bien !
– Quel malentendu ?
– Je veux dire un malentendu qui fait que nous ne nous entendrions pas !
– Vous n’êtes pas engagé à Lucy ?
– Je ne lui ai jamais dit…
– Qu’est-ce que vous ne lui avez pas dit ?
– Je ne lui ai pas dit que je comptais… D’ailleurs, vous savez, dans tous les cas, il faudrait que je prévinsse mon père, et, sans son aveu, je ne saurais réellement… Il y a des résolutions graves que… Certainement, j’ai pour mademoiselle Lucy une admiration… Mais je croyais que l’usage de ces îles…
– Lucy ! cria Barton.
Lucy entra presque aussitôt.
– Fais-le s’expliquer, dit le père ; je ne comprends pas un mot à ce qu’il dit.
Lucy regarda Charles avec de l’amour plein les yeux et une candeur absolue. Charles en conclut que c’était un monstre de calcul, de perfidie, de dissimulation, et il se jugea dans un piège. L’amour-propre irrité l’excita, et il dit brusquement à la jeune fille :
– Comment ! mademoiselle, est-ce que j’ai prononcé le mot de mariage avec vous ? Est-ce que je vous ai dit que je voulais vous épouser ?
Lucy devint pâle et balbutia :
– J’ai entendu que vous m’avez offert votre âme, et vous m’avez dit que votre destin était fixé à mes pieds, alors…
– L’avez-vous dit, en effet ? interrompit Barton.
Le géant avait prodigieusement rougi, et Patrice, qui s’était levé et s’approchait d’un pas lent, montrait aussi une physionomie peu avenante ; Charles les regarda, et se trouva dans la position exacte d’un moineau entre deux milans. Pourtant il se roidit, et, en essayant de rire, il répliqua :
– Mademoiselle, je vous demande bien pardon, si vous y tenez ; mais il me semble que, pour une phrase sans importance, vous m’attirez là une scène tout à fait singulière.
– Ah ! dit Lucy.
Elle mit la main sur son cœur et tomba sur une chaise, mais elle ne s’évanouit pas. Barton repoussa rudement Patrice, qui arrivait droit sur Charles, dans je ne sais quelle intention.
– Monsieur Cabert, dit le pêcheur de phoques, vous avez voulu tromper une honnête fille. Cela ne se fait point dans nos pays, et je ne crois pas que la loi de Dieu le permette nulle part. Si, maintenant, moi qui suis le père de Lucy, et Patrice, qui est son frère, nous menions M. Charles Cabert, ici présent, dans une barque, et que, pieds et poings liés, avec deux pierres de quatre-vingts livres attachées au corps pour assurer son équilibre, nous allions le jeter à une lieue au large, qu’en penserait M. Charles Cabert ?
Charles Cabert était assurément un garçon de courage ; mais on ne saurait nier qu’il éprouva à ces paroles un sentiment désagréable. Il s’écria pourtant, bien que d’une voix un peu chevrotante :
– Monsieur Barton, si vous agissiez de la sorte, vous savez que l’officier commandant la station navale française viendrait vous en demander compte.
– Vous voulez plaisanter, mon cher monsieur Cabert ! Votre officier ne passera que dans un an, et je vous prie de me faire connaître par quels moyens il serait informé de votre triste sort. Vous êtes dans mes mains, monsieur ; vous êtes… peu de chose, monsieur ; et si je ne vous écrase pas comme un ver, c’est que je vaux mieux que vous, monsieur !
La porte s’ouvrit, et M. John entra. Ce fut pour Charles un tel surcroît d’humiliation et de chagrin, vu l’antipathie qu’il avait éprouvée d’abord pour le maître d’école, que peu s’en fallut que, dans son désespoir, il n’éclatât en bravades, surtout quand il entendit Barton exposer le cas au nouveau venu, dans des termes crus et peu ménagés, et en prêtant à son malheureux hôte les intentions les moins droites. Je ne sais si réellement celui-ci les avait eues, mais ce lui était une raison pour désirer d’autant moins les voir étalées devant ses yeux.
– Mon cher Barton, ma chère Lucy, s’écria M. John en souriant, et le rire avait une expression si singulière sur ses traits, qui n’y semblaient pas accoutumés, que cela seul commandait l’attention ; comment avez-vous pu, sérieusement, vous méprendre à l’amabilité toute française et toute bienveillante de cet excellent jeune homme, M. Cabert ? Comment avez-vous pu croire qu’il ait été capable d’une action aussi noire, aussi contraire au respect de l’hospitalité, que celle que vous lui prêtez ?
– Mais, reprit Barton, ne vous ai-je pas dit…
– J’entends bien ; mais là, vous êtes par trop sauvage, mon cher Barton ; et vous, Lucy, revenez donc à vous, mon enfant !
En parlant ainsi, il prit la main de la pauvre fille, la serra, et la garda quelque temps dans les siennes, pendant qu’il fixait ses yeux sur les siens avec persistance. Il continua :
– Si vous accusez de tant de crimes les gens qui disent à une femme : je suis à vos pieds… Je vous offre mon cœur… et autres billevesées pareilles, c’est que vous n’avez pas la plus légère teinte des façons de parler du grand monde.
– Le diable les emporte ! cria Barton avec colère.
– Voyons, mon enfant, continua M. John en serrant de plus en plus la main de Lucy, rappelez-vous bien… qu’est-ce que M. Cabert vous a dit, en somme ?
– Pas grand-chose, murmura la jeune fille d’une voix faible, et je crois, en effet, que je me suis trompée.
En prononçant ces derniers mots, les larmes lui vinrent avec tant de force, qu’elle cacha son visage dans son mouchoir et sortit en sanglotant. Patrice alla d’abord vers la fenêtre, tambourina quelque peu sur les vitres, et quitta la chambre pour aller rejoindre sa sœur. Barton se promena de long en large, puis tout à coup marcha droit à Charles, et lui tendant la main :
– Monsieur Cabert, lui dit-il, je vous demande pardon. Cette petite fille s’est trompée et m’a trompé moi-même. Voilà tout ce que je peux vous dire ; mais comme, franchement, nous ne sommes pas faits aux belles manières, et que ma Lucy aurait de la peine à vous voir désormais, vous m’obligeriez si vous vouliez vous en aller, je ne vous le cache pas.
– Très volontiers, répondit Charles.
Il ne fit qu’un bond jusqu’à sa chambre, ferma sa malle, et, sous la conduite de l’odieux M. John, qui lui était plus odieux que jamais, il gagna la Grande-Terre, où une goélette marchande le prit et l’amena à Halifax, d’où il regagna l’Europe.
Il n’avait ni tué ni vu des caribous ; mais il croyait avoir échappé aux amabilités et aux pièges des horribles pirates du nouveau monde, et il s’en félicita longtemps. Ce qu’il racontait surtout de jugements sur Lucy, M. John et le vieux Harrison, était à faire dresser les cheveux sur la tête.
ADÉLAÏDE
Madame de Hautcastel arrangea commodément sa jolie tête sur le dossier de son fauteuil ; chacun fit silence et le baron parla en ces termes :
L’année même où Frédéric Rothbanner sortit de l’Académie militaire pour entrer aux Chevau-légers, Elisabeth Hermannsburg le distingua. Ce fut une sorte de coup de théâtre. Rien n’avait préparé la société à une chose si singulière et, dans le premier moment, les clameurs furent infinies. Le gros Maëlstrom, soupirant déclaré de la comtesse depuis des années, et surtout Bernstein, dont les folies pour elle étaient si connues, folies qu’incontestablement elle avait encouragées, jetèrent feu et flamme et ne manquèrent pas de partisans. Le grand-duc lui-même se. laissa toucher par l’indignation générale et adressa à la coupable une épigramme si aiguë qu’elle aurait dû en rester transpercée ; mais elle répondit vertement à Son Altesse Royale et, pourtant, sous une couverture tellement respectueuse, que les rieurs passèrent de son côté. Bref, ce qui était fut et resta tel sans qu’on y pût rien changer. Au bout de six mois tout le monde, sauf les deux transis évincés, en avait pris. l’habitude, et il n’en était plus question.
Cependant, en apparence, du moins, rien de plus absurde. Elisabeth avait trente cinq ans et était dans l’éclat parfait de sa beauté, avec une réputation d’esprit grandissant chaque jour et qu’il était impossible de surfaire. De son côté, Rothbanner, pour faire admettre son bonheur, n’exhibait que ses vingt deux ans, une jolie tournure et rien encore de cette valeur intrinsèque qu’on lui a reconnue depuis ; mais alors ce joyau était caché dans sa coquille. Pour déterminer ce qui était arrivé, il avait fallu cette profondeur de réflexion et cette sagacité d’égoïsme, dons précieux de la comtesse, la plus accomplie des créatures en toutes choses et surtout dans cette sagesse des enfants du siècle qui mène ceux qui la possèdent à n’avoir pas volé la damnation éternelle. Elisabeth Hermannsburg avait pensé qu’au comble de sa gloire elle était bien voisine de la pente qui allait la conduire à en descendre. Elle avait monté dans les fleurs ; il allait falloir bientôt descendre dans les ronces. Pour savoir ce qu’une femme adorée devient d’ordinaire, elle n’avait eu besoin que de jeter les yeux autour d’elle et les jardins d’Armide où elle régnait lui avaient montré en foule leurs gazons verdoyants peuplés de vieilles cigales dont les voix prophétiques n’étaient comprises de personne hormis d’elle-même. Elle examina l’une après l’autre la destinée de chacune de ces tristes métamorphosées et elle crut pouvoir admettre que la cause de leur malheur était à trouver dans l’insouciance avec laquelle chacune avait lié son bonheur à un homme qui le dominait, et qui, partant, le pouvait briser aussitôt que son cœur, à lui, conseillerait la désertion.
Elle se dit : je ferai un heureux. J’aurai un esclave qui me devra tout et le premier succès et le premier bonheur et la première gloire et la première expérience. Il m’adorera et si je l’adore, je ne le lui dirai pas comme je le sens, et je régnerai sur lui ; je l’entraînerai où il me plaira qu’il aille et je le connaîtrai à fond, tête et cœur, bien et mal, vices et vertus ; des premiers je flatterai ceux qui me serviront, des secondes, j’étoufferai celles qui pourraient se dresser contre moi. Je l’aurai tout à moi, d’abord, parce qu’il sera très jeune et qu’il se donnera sans réserve et je profiterai de ce moment pour le pétrir et le repétrir de telle sorte, que s’il songe jamais à se révolter, il n’aura plus ni nerfs ni muscles pour servir son intention ; de cette façon-là, je réaliserai une des plus belles fictions des romans, j’aurai créé un des amours hypothétiques qui durent toujours, et, jusqu’à mon dernier soupir, si cela me plaît, je serai servie, je serai aimée, du moins le monde, et c’est l’essentiel, me croira telle ; enfin, en admettant que ce soit là une chaîne propre à devenir lourde, moi et non pas lui, ma volonté et non la sienne, décidera de la rupture.
Quand elle vit Rothbanner pour la première fois, il lui plut assez pour qu’elle le marquât en sa pensée du signe de sa possession. Elle prit juste le temps de se convaincre qu’il avait du cœur et tout fut fait ainsi qu’elle l’avait décidé. Il va sans dire que Rothbanner se trouva d’autant plus heureux qu’il ne douta pas de l’avoir perdue et d’en avoir tout reçu.
Les choses marchèrent ainsi très bien pendant cinq ans et chacun peut porter témoignage que pas une distraction, pas une marque d’ennui ne furent surprises chez l’amant. Madame d’Hermannsburg avait alors quarante années échues et les choses allaient à merveille, quand, aussi sottement et mal à propos que tout ce qu’il avait fait dans sa vie, son mari s’avisa de mourir, ce qui fut le signal de la catastrophe, car il se découvrit des mystères que personne n’aurait jamais été soupçonner.
Au bout d’un an de deuil, la comtesse qui, depuis dix-huit mois environ, paraissait souvent préoccupée et d’une gaieté un peu extrême, pressa Rothbanner de reconnaître ce qu’elle avait fait pour lui, en mettant fin par un mariage, à l’irrégularité notoire de leur position. Rothbanner fut surpris et, ce qui n’était pas adroit, il faut en convenir, montrant plus de bonne foi que d’amour, il le laissa voir. Du reste il y avait de quoi s’étonner : la comtesse, de sa nature esprit fort, ne s’était jamais beaucoup préoccupée des questions au-dessous d’elle. Son rang dans le monde, son sang-froid, et, pour tout dire, son audace avaient toujours commandé et obtenu le respect, et il était convenu qu’on lui pouvait et devait passer beaucoup de choses. Rothbanner objecta à la fantaisie de la dame que sa délicatesse s’opposait absolument à satisfaire le désir exprimé ; il était pauvre et il paraîtrait avoir abusé de son influence pour des motifs peu honorables ; on le croirait d’autant mieux qu’en définitive une fort grande différence d’âge existait entre lui et la comtesse, et les unions contractées malgré de pareils empêchements donnent toujours à gloser. Ensuite, il était catholique, la comtesse protestante et sa famille à lui, qui passait sur beaucoup de choses, sous le manteau de la cheminée, trouverait certainement à redire et très fort à une sorte de renonciation publique à des principes héréditaires. Enfin, et c’était là son suprême argument, il répéta à satiété qu’il ne voyait pas pourquoi un bonheur si long, si soutenu, si exempt de nuages serait troublé, évidemment troublé, par la manie de changer le bien en mieux.
Tout cela fut bien dit, bien exposé ; cependant la comtesse resta ferme dans sa proposition et ne daignant prendre au sérieux qu’une seule des objections, elle s’en alla, un matin, sans rien dire à Frédéric, trouver l’Évêque de B***. Elle fit part au prélat de son désir de se convertir. Le prélat qui n’y entendait pas malice, fut naturellement touché, enchanté. La néophyte avait justement le genre d’esprit qu’elle voulait avoir ; elle alla au-devant de toutes les instructions, étourdit les abbés qu’on lui donna pour maîtres par la variété et l’orthodoxie de ses connaissances théologiques, et, ma foi, par un beau dimanche, le troisième après Pâques, je crois, elle fit tranquillement son abjuration dans la cathédrale de B*** à la stupéfaction profonde du public. Le lendemain, elle revint à la charge auprès de Rothbanner et le somma de l’épouser.
La conversation entre les deux contendants fut d’abord affectueuse et parfaitement tendre ; puis elle devint un peu sèche et quand la comtesse se fut bien convaincue que la victoire ne viendrait pas toute seule, elle prit son parti et mit le fer sur la gorge de l’antagoniste.
– Ainsi, bien décidément, lui dit-elle, en le regardant avec des yeux dont il n’avait pas encore vu l’expression âpre et décidée, ainsi vous ne consentez pas ?
– Je ne peux pas.
– Vous ne pouvez pas ?
– Je vous l’ai expliqué.
– Eh bien, donnez-moi encore vos raisons !
Il énuméra de nouveau et non sans une nuance de colère, tout ce qu’il avait déjà répété vingt fois.
– Ce sont là vos raisons ?
– Vous le voyez bien.
– Pourquoi ne me donnez-vous pas la seule véritable ?
– Qu’entendez-vous par là ?
– Je vous demande pourquoi vous ne me dites pas franchement le motif sérieux qui vous empêche de me céder ?
– Je ne sais ce que vous entendez par là !
– J’entends votre liaison avec ma fille !
– Oh ! madame !
– Avec ma fille ! vous dis-je ; nous voilà, enfin, en pleine bonne foi, et c’est ainsi que nous allons nous expliquer.
On peut s’imaginer l’attitude des deux lutteurs ; car d’amants, il n’en était pas question dans ce moment-là. Elisabeth pâle de cette pâleur de l’homme de guerre causée uniquement par la rage de vaincre ; Frédéric, pâle, mais de la pâleur de l’animal pris dans un piège dont il voit peu de chances de se tirer.
– Monsieur, dit la comtesse, je ne vous ferai pas de reproches ; calmez-vous, rassurez-vous. Ce n’est pas moi qui puis être votre juge. J’en ai perdu le droit du moment que j’ai abdiqué toute dignité. C’est moi qui vous ai introduit dans cette maison, qui vous y ai fait régner, qui en vous accablant de tout pouvoir, vous ai donné toute licence. Il est naturel que vous en ayez abusé jusqu’au crime. Oh ! ne vous révoltez pas ! Au point où en sont les choses, si je puis et dois vous épargner les reproches, il est au moins naturel que vous consentiez à envisager la vérité en face. Si elle n’est pas belle, convenez que sur ce point du moins, ce n’est pas à moi qu’il faut s’en prendre. Vous avez trouvé une enfant toute jeune, incapable de rien comprendre, de rien savoir, de rien prévoir… Mais laissons le passé et songeons à l’avenir. Vous et moi nous avons donné tant de scandales au monde que je vous avoue mon impuissance à y en ajouter un nouveau. Peut-être auriez-vous la condescendance d’épouser mademoiselle d’Hermannsburg si je vous en pressais ; mais notre relation a été si publique que la pensée seule d’une pareille monstruosité me fait horreur. Ce sont des arrangements assez ordinaires, je ne l’ignore pas ; mais ils ne vont pas à mon tempérament et je ne vois qu’une chose à faire : régulariser notre position mutuelle d’abord ; éloigner mademoiselle d’Hermannsburg pour quelque temps et la marier. De cette façon tout peut se réparer encore et je ne saurais imaginer qu’il puisse vous entrer dans l’esprit de refuser la seule réparation en votre pouvoir.
Dans ce que venait de dire Elisabeth et qui ne se coordonnait pas trop mal, il y avait du vrai, du douteux et du faux ; c’est ce que l’entrée subite d’Adélaide Hermannsburg dans le boudoir de sa mère mit sous le jour le plus lumineux. Adélaide venait d’atteindre ses dix-huit ans. Elle était blonde extrêmement, blanche à éblouir, une taille de reine, des bras admirables, rien d’une jeune fille, beaucoup d’une impératrice, au grand moins l’esprit de sa mère, et son audace et sa hauteur implacable, et, en plus, ce qui n’était pas à dédaigner, le sentiment parfaitement défini qu’elle tenait le pas comme femme aimée vis-à-vis de celle qui ne l’était plus et comme beauté dans sa fleur vis-à-vis de la rose plus d’à demi effeuillée. Quant à une notion quelconque des rapports de fille à mère, pas l’ombre.
Il faut avouer qu’entre ces deux Olympiennes, le pauvre Frédéric Rothbanner, si doux, si poli, si affectueux toujours, si spirituel quand rien ne presse, ne faisait pas grande mine et je me l’imagine assez accoudé sur le marbre de la cheminée, dans son attitude toujours élégante, et correcte, mais ne trouvant pas le plus petit mot à dire.
Elisabeth fut un peu surprise de l’apparition de sa fille, et, par son hésitation, elle perdit l’avantage de l’attaque. D’ailleurs, elle ne savait pas ce que la jeune demoiselle avait dans l’esprit.
– Madame, dit mademoiselle d’Hermannsburg d’un ton froid et léger, je vous demande pardon d’entrer ainsi chez vous ; mais comme je suppose que monsieur vous a déjà parlé, vous comprenez que la question m’intéresse et si j’ai sujet de me mêler de mes propres affaires. Depuis quinze jours déjà, M. de Rothbanner m’annonce son intention de vous demander ma main ; j’y ai consenti, mais chaque matin et chaque soir il m’allègue quelque raison pour n’avoir rien fait encore. Je désire la fin de cette situation, et si monsieur vous a fait connaître nos intentions, je tiens à le savoir. S’il n’a rien dit, je désire qu’enfin il s’explique.
– Mademoiselle, répondit la comtesse, vous n’épouserez pas monsieur de Rothbanner.
– Pourquoi, madame ?
– Parce que M. de Rothbanner m’appartient et m’épouse.
– Répondez, Frédéric, dit Adélaïde en se tournant d’un air hautain vers le jeune homme. Celui-ci se trouva en face de deux paires d’yeux qui le tenaient en joue et on ne peut pas assurer qu’il fût à son aise. Il cherchait à condenser quelque chose de conciliant dans une phrase qui ne déterminât pas une explosion, quand la comtesse prit la parole.
– Mon Dieu ! je ne comprends pas très bien ce débat et il serait ridicule, il faut en convenir, si votre inexpérience ne l’excusait un peu. Rentrez chez vous et pensez à autre chose.
– Madame, reprit violemment Adélaïde, en croisant les bras sur sa poitrine et en portant alternativement sur sa mère et sur Frédéric des regards où la tempête éclatait, comme je n’ai rien à ménager, je demande ce qui m’appartient ; et vous, parlez ! dit-elle en frappant du pied. Vous savez ce qu’il vous appartient de déclarer !
– Et moi encore mieux ! s’écria Elisabeth ; tenez, finissons-en et pas de mélodrame ! J’ai l’horreur des scènes et du mauvais ton. Vous pouvez être assurés tous deux que je ne me laisserai écraser ni par l’un ni par l’autre, mais je vous écraserai l’un et l’autre peut-être. Vous, mademoiselle Hermannsburg, vous n’êtes pas majeure et je vous mettrai dans un couvent, en disant pourquoi ; vous, M. de Rothbanner, vous vous débattrez avec l’opinion publique qui, peut-être, comprendra mal que dans une maison, la mienne, vous vous soyez permis tant de libertés. Je ne vous donne pas une heure pour choisir, je vous donne une minute. Ou moi, ou ce que je vous dis ! Répondez !
Adélaïde prononça les mots qui suivent en serrant les dents mais d’une manière fort distincte, et en même temps, elle regardait le jeune homme en face : le couvent, le déshonneur le plus complet, l’abandon de votre part, tout ! mais que cette femme ne triomphe pas !
La comtesse revint et la minute achevée :
– Hé bien ? murmura-t-elle.
Je ne dis pas que Frédéric joue ici un beau rôle ; mais le sort ne donne pas toujours à choisir ce qu’on voudrait parmi les personnages de la comédie de la vie. Choisir ! C’était là fort mal aisé et je le donnerais en cent aux plus habiles ; il était clair qu’en obéissant à Adélaïde, Frédéric n’avait ni la personne de la jeune fille, ni aucun des avantages de l’amour ; mais, en désobéissant à la comtesse, il était déshonoré à tout jamais, perdu pour le monde, chassé certainement de l’armée, obligé de s’expatrier et il n’avait pas le sou, ce qui aggravait singulièrement la situation, ne perdez pas ce point-là de vue. Aussi sa perplexité peut-elle être peu héroïque, elle n’en est pas moins assez concevable.
Naturellement, ne sachant au monde quel parti prendre, il prit celui de perdre contenance et son nez rougit légèrement, ses yeux devinrent humides et il tira son mouchoir de sa poche pour se moucher. Ces différents symptômes produisirent sur les deux femmes des effets très contraires. Adélaïde sourit avec dédain et sortit de la chambre ; la comtesse se posa en face de Frédéric et lui saisit la main.
– En retour, lui dit-elle, je vous pardonne tout, j’oublie tout, je ne vous retire rien du dévouement aveugle que depuis tant d’années je vous porte et que vous connaissez si bien ! je ne suis ni une sotte ni une bourgeoise. Eh ! mon Dieu, Frédéric, à mon âge on ne se sauve que par la bonté et l’indulgence. Vous étiez jeune… vous avez été entraîné autant qu’entraînant… tout s’oubliera.
Elle parla ainsi pendant une demi-heure sur le ton de l’affection la plus maternelle. Un autre genre de tendresse n’eût pas été de mise à ce moment et elle le comprenait comme elle comprenait tout. N’admirez-vous pas aussi avec quel art consommé elle avait supposé d’abord partie gagnée et ville conquise ? Frédéric eut bien l’idée de le contester, mais il perdit du temps à réfléchir à la meilleure manière d’essayer son opposition, et il se trouva, au bout d’un quart d’heure, si bien enguirlandé, paqueté, emballé, cloué dans sa caisse que… ce n’est pas qu’il n’eût par moments des spasmes et des soubresauts ; mais rien de plus inutile ! Cet ange d’Elisabeth comprenait tout, excusait tout, ce n’était plus une amante irritée, ce n’était pas même une future épouse peu exigeante sur la théorie de ses droits, ce n’était pas une Ariane raccommodée avec Thésée par l’entremise de Bacchus, c’était une sœur de Charité ! Enfin, il n’y a qu’un mot qui serve : mademoiselle d’Hermannsburg qui, notoirement avait adoré son père, s’en alla passer trois mois chez une de ses tantes à l’époque du mariage de sa mère avec Rothbanner ; mais comme il n’était pas moins notoire qu’elle adorait autant sa mère que son père, les trois mois n’étaient pas écoulés qu’elle remuait ciel et terre pour retourner auprès d’elle, ce qui, vu la résistance opposée à son désir, détermina l’ouverture d’une campagne stratégique auprès de laquelle les plus savantes manœuvres des généraux anciens et modernes ne sauraient que pâlir.
La comtesse disait à toutes ses bonnes amies :
– Ma fille est un prodige de dévouement et d’abnégation ! Qu’elle n’ait pas de goût pour son beau-père, je ne saurais le trouver mauvais et je lui en veux d’autant moins que, dans toutes les lettres qu’elle m’écrit, elle est parfaite à cet égard de convenance et de mesure ; mais il ne m’est pas difficile de démêler sa pensée. Adélaïde est trop pure et trop naïve pour savoir dissimuler. Si elle insiste tant pour revenir auprès de moi, savez-vous la pensée qui la dirige ? Elle s’imagine que mon jeune mari ne me rendra pas heureuse et elle veut être là pour me consoler et me soutenir. Elle a conçu ce roman dans sa petite tête et n’en veut pas démordre jusqu’à présent ; mais cette fantaisie passera et je tiens à ce qu’Adélaïde reste chez sa tante Thérèse jusqu’à l’époque de son mariage. Elle y est parfaitement heureuse ; et vous comprenez que même ce qu’il y a de passion dans sa tendresse pour moi m’oblige à un sacrifice, le plus grand que je puisse faire, assurément ! celui de me séparer pour un temps d’une enfant si chère et qui jusqu’à présent ne m’avait jamais quittée !
De son côté, Adélaïde disait à qui voulait l’entendre : ma mère sera certainement malheureuse avec M. de Rothbanner ; elle n’eût pas dû se remarier ; mais ce n’est pas à moi, sa fille, qu’il appartient de la blâmer ; je ne puis voir et je ne vois que ses périls ! C’est la meilleure des mères ! Quoi qu’elle fasse, par un sentiment exagéré de son affection, je sais que je lui suis indispensable. Je lui sacrifierai ma vie ! Je ne veux qu’elle ! je n’aime qu’elle ! Je retournerai auprès d’elle et je ne me marierai jamais !
Elle se mit en devoir de tenir parole. On lui présenta, vous vous en souvenez peut-être, Philippe de Rubeck : soixante mille florins de revenus en biens-fonds, beau nom, trente-cinq ans, jolie figure ! Elle le refusa. À la suite comparurent deux ou trois autres prétendants qui n’étaient guère moins convenables. Ils furent évincés de même. La grande-duchesse s’en mêla et fit venir Adélaïde pour la sermonner. Celle-ci pleura excessivement, demanda sa mère, voulut sa mère, eut une attaque de nerfs, si bien que notre excellente souveraine n’y voyant que du feu, se tourna tout entière au parti d’Adélaïde et dit à une ou deux reprises que madame de Rothbanner n’avait pas raison.
Celle-ci commença à se trouver dans un certain embarras, mais elle tomba bientôt dans une perplexité pire. Elle avait l’habitude assez judicieuse d’aimer à se rendre compte de tout. Les principes sont choses admirables ; malheureusement, dans l’état d’imperfection où s’agite la nature humaine, ils nécessitent des applications rarement irréprochables. Il arrivait à Elisabeth d’exécuter des visites domiciliaires chez son mari pendant que celui-ci était dehors. Un beau jour, elle tomba sur un billet d’Adélaïde et bien que le texte fût insignifiant ou, pour mieux dire, incompréhensible, il en résultait que ce billet avait eu des frères aînés et aurait certainement des cadets en quantité inappréciable. Cette découverte conduisant Madame de Rothbanner à éclaircir de plus en plus près la conduite de Frédéric, elle ne fut pas tout à fait certaine que, sous prétexte d’affaires de service, il s’absentait de la ville, mais elle eut lieu de le soupçonner. Le fait est que les chevaux du mari étaient surmenés. De sorte que pressée de toutes parts, blâmée par la grande-duchesse, tenant avant tout à conserver sa position de mère incomparable, clef de la situation dans la manœuvre qu’elle suivait, se voyant tournée par l’ennemi, que dis-je ! soupçonnant cet ennemi d’avoir dans la place les plus belles intelligences, elle se décida à un changement de front, écrivit à Adélaïde que ses supplications l’avaient vaincue, l’alla chercher elle-même chez la tante Thérèse et la ramena en triomphe. Il n’en est pas moins vrai, qu’ayant gagné la première manche, elle venait de perdre la seconde et elle avait trop de sens pour chercher à se le dissimuler. Aussi ne montra-t-elle aucune humeur, ni en public, ni en particulier.
Mais je m’aperçois que me laissant trop entraîner par le courant des faits, je ne vous ai pas arrêté assez longtemps sur la personne même d’Adélaïde. Il est, cependant, essentiel de vous faire bien connaître cette remarquable créature, et pour la juste appréciation que vous pouvez désirer faire de ce que je viens d’avoir l’honneur de vous exposer, et pour celle de ce qui va advenir. Très belle, très intelligente et d’une intelligence aventureuse et sans scrupules aucuns, outrageusement gâtée par son imbécile de père, pour qui elle avait le plus souverain mépris, absolument abandonnée, même ignorée par sa mère, que des occupations de toute nature absorbaient, Adélaïde avait eu pour unique guide dans la vie sa gouvernante anglaise, Miss Dickson, très sentimentale, très adonnée à la philosophie nuageuse, aimant le sherry, ne détestant pas le grog et se saturant en secret le moral de romans français, capables de faire rougir des gendarmes et qu’elle avait grand soin de passer à sa pupille.
Dès l’âge de quatorze ans, Adélaïde avait su ce que M. de Rothbanner faisait dans la maison et comme Miss Dickson ne lui ménageait pas les commentaires sur ce point, ce que sa jeune tête n’eût pu encore concevoir lui était facilement élaboré et transmis dans sa réalité la plus authentique par les connaissances supérieures de la demoiselle anglaise. Supposons un instant que le docteur Gall eût pu interroger la tête charmante de mademoiselle d’Hermannsburg ; je ne fais pas de doute qu’il y eût reconnu au degré suprême l’organe de la combativité et, en effet, l’amour de la lutte dominait de bien loin tous les autres penchants d’Adélaïde ; et pendant la vie entière de cette héroïne, ces penchants étant, grâce à Dieu, devenus des passions, avec le temps l’amour de la bataille a chez elle prédominé sur tous les autres genres d’amour. Elle s’imagina vers sa seizième année que ce serait la plus belle chose du monde que de se jeter à la traverse des sentiments de sa mère et de détourner de son propre côté et à son profit exclusif ce qui devait avoir tant de valeur puisque l’on paraissait y tenir si fort. Outre ce qu’une conquête avait en elle-même de désirable et de glorieux, outre qu’il était à regretter qu’à seize ans, on n’eût pas encore pris garde à elle, outre que le bien d’autrui est nécessairement bien plus enviable que le bien qui n’appartient à personne, comme sa mère était, en définitive, l’être le plus puissant dont elle eût la notion, elle ne conçut rien de si chevaleresque, de si vaillant, de si hardi, de si digne d’admiration que d’affronter sa mère et, si elle pouvait, de la battre et de la dépouiller. Remplie d’un projet si généreux, elle ne perdit pas une minute à en poursuivre la réalisation et, subitement, sans transition aucune, Frédéric Rothbanner se vit l’objet des attentions passionnées et bientôt des déclarations brûlantes de ce petit monstre, la plus jolie, la plus spirituelle, la plus séduisante des filles de la Résidence.
Il en éprouva d’abord l’étonnement le plus prodigieux. Il refusa à y croire. Il chercha à fuir l’enchanteresse, mais la chose était difficile puisqu’il lui fallait passer sa vie dans la maison. Il aurait dû, peut-être, prévenir la Comtesse ; mais il était si doux, si poli, si éloigné de tout ce qui ressemble à des violences qu’il lui eût été, dans tous les cas, fort difficile d’aborder une pareille démarche dont les conséquences l’épouvantaient. Épouvanté, il le fut bientôt plus encore quand aux attendrissements, aux regards profonds succédèrent des scènes pathétiques, et des menaces violentes de se tuer. Un soir, la comtesse qui avait dû rester très tard à la cour, à cause d’une réception d’un prince voyageur, rentra sans défiance et toutes les infortunes du monde étaient consommées. Frédéric s’était indignement conduit, son désespoir était sans bornes, il se condamnait sans ménagements ; il comprenait très bien, trop bien, que ce n’était pas une excuse que de mettre au défi tous les patriarches de l’Ancien Testament et notamment le plus convenable de tous, d’avoir pu affronter une pareille aventure ; le fait est qu’il avait tort. Mais s’il avait tort, impossible d’en revenir et, la faute commise, le remords ; au lieu d’étouffer l’amour, donna des forces à ce qui n’avait presque pas même été une fantaisie, et si bien qu’il devint passionnément épris de l’ange de ténèbres dont la griffe tenait son cœur.
Et elle aussi, Adélaïde, devint éprise de lui à la rage. Vous pensez que je n’ai nulle intention de vous faire une apologie de ce petit Satan ; mais il ne faudrait pas être injuste non plus. Détestablement élevée, complètement abandonnée dès sa petite enfance, n’ayant jamais trouvé en sa mère que l’indifférence la plus glacée et commençant à sentir que, dans la mesure où sa beauté se développait, elle allait y faire naître la haine, douée comme je l’ai dit, de la fureur des combats, fureur en soi admirable et qui n’est pas l’indice d’une âme vulgaire, elle n’avait rien fait jusqu’alors que de fort coupable sans doute, mais rien non plus qui fût de bas-lieu ; si on avait pu lui donner Frédéric comme elle le voulait, certainement elle se serait mise à l’aimer tout de bon et je ne vois aucune raison pour penser qu’elle n’eût pu devenir une excellente et digne femme, si peu qu’elle eût été éloignée du milieu déplorable où elle avait vécu jusqu’alors. J’ajouterai, cependant, que la direction d’un mari sage, ferme et d’une âme grande n’eût pas été de trop pour ramener une nature aussi véhémente, et je ne connais personne à qui j’eusse conseillé d’entreprendre une telle éducation.
Cette observation nécessaire pourrait bien, je le sens trop, réduire à néant toute ma théorie. Rothbanner, nous le connaissons, est assurément ce qu’on appelle un homme distingué ; les gens spéciaux, les militaires vous diront qu’il a introduit une amélioration notable dans la construction de la culasse des obusiers, il passe à bon droit pour bon administrateur ; on l’aime fort dans le monde où il ne porte que les meilleures façons et le ton d’une bienveillance universelle. Mais avec tout cela, il me fait exactement l’effet d’un chapeau de Paris : c’est ravissant, bien chiffonné, d’un air exquis, ça coûte très cher et quand on analyse le fait, ça ne vaut pas quatre sous de bon argent. Les gens comme Rothbanner sont comme les vélocipèdes : ils ne roulent que sur les trottoirs. Hors des trottoirs, ça tombe. Moi, j’aime mieux les gens qui sont gênés sur les trottoirs, mais qui peuvent très bien marcher dans les bois.
Quoi qu’il en soit de ma digression, voilà Adélaïde revenue où elle voulait aller et installée au cœur de sa conquête. Elisabeth n’eut pas même deux heures devant elle pour organiser les barricades. Aussitôt qu’aux yeux de toute la maison attendrie les deux femmes se furent embrassées, Adélaïde suivit sa mère dans sa chambre, poussa le loquet, s’assit et fit le discours suivant :
– Madame, puisqu’il vous a plu de faire le malheur de ma vie, vous ne trouverez pas extraordinaire que je vous rende la pareille. Vous devez bien sentir que la partie n’est pas égale entre nous !
– Vous êtes la plus forte ?
– Assurément et je ne compte pas vous rien céder.
– Je m’y attendais et c’est pourquoi je vous cède tout. M. de Rothbanner est ici et je vais le faire appeler.
Le verrou ouvert, Elisabeth sonna, fit demander son mari, celui-ci se présenta. Elle sortit et le laissa seul avec Adélaïde. M. de Rothbanner prenant un air digne et froid rendit à la jeune demoiselle les lettres qu’il en avait reçues depuis le séjour chez la tante Thérèse et se jeta dans les considérations les plus vraies, les plus incontestables sur le présent et sur l’avenir. Il prouva sans peine que sa conscience d’honnête homme était engagée à mettre fin à une situation injustifiable à tous les égards ; qu’il se considérerait comme le dernier des misérables s’il avait la faiblesse de dévier de son devoir si clair, si naturel, si nécessaire ; il peignit vivement et avec sensibilité, la reconnaissance dont lui, le cadet sans ressources, était et devait être pénétré pour une femme qui avait fait sa fortune ; il se condamna pour ce qui avait eu lieu et supplia Adélaïde de se marier. Il parla très bien, oh ! très bien ! Et quand il eut fini, il se leva et voyant qu’Adélaïde regardait fixement devant elle et ne répondait pas un mot, il sortit. Elle avait perdu la troisième manche.
Ma foi ! huit jours n’étaient pas passés que Christian Grünewald lui faisait la cour. Vous savez bien, ce petit Christian, mon cousin, qui a un si joli cheval provenant des haras du feu Roi de Wurtemberg ? Vous ne vous en rappelez pas ?… Enfin, cela importe peu ; ce qui est certain, c’est qu’il se mit, comme je vous le disais, à lui faire la cour, et il fut très bien accueilli par elle. On commença à en parler partout. Chez madame de Stein on dit même que la corbeille avait été commandée à Paris. Madame de Rothbanner, discrètement interrogée, ne répondit pas précisément, mais laissa entendre qu’on ne lui parlait pas de choses impossibles. Ce que le monde voyait de la façon la plus claire, c’est que la santé d’Elisabeth assez chancelante depuis quelque temps se rétablissait à vue d’œil, et l’air de félicité parfaite établi sur son visage était de nature à pousser toutes les femmes d’un certain âge à épouser des jouvenceaux. On était au plus fort de cette affaire qui intéressait la société entière quand le ministre de la Guerre donna son grand bal annuel.
Quelques personnes remarquèrent de bonne heure que Rothbanner, dans sa grande tenue d’aide de camp qui, par parenthèse, lui allait à merveille, ne sortait pas de l’embrasure d’une porte où il était à moitié caché par un rideau. Il était pâle comme un mort. Vers une heure du matin, Adélaïde, belle à tourner la tête à l’univers, d’une gaieté étourdissante, ayant semé à droite et à gauche mille mots charmants qu’on répétait, n’avait pas quitté une minute le bras de Christian fou, ivre, délirant de bonheur (le bonheur lui sortait par tous les pores, au brave garçon, et le camélia qu’il avait à la boutonnière semblait le respirer). Comme on venait de finir une valse, le couple heureux se promenant de droite et de gauche, recueillant partout des sourires, arriva à la porte où se tenait Rothbanner adossé contre la boiserie. Adélaïde s’arrêta devant cet homme qui de pâle devint livide. Elle le considéra un instant sans parler, puis d’une voix pénétrante, elle lui dit en le regardant dans le fond des yeux d’une façon singulière :
– Veux-tu que je le chasse ?
– Oui, répondit Frédéric.
Mon Dieu ! Ce n’est pas grand-chose qu’un oui, pas plus qu’un non, et il ne faut guère de temps pour émettre de pareils monosyllabes. Mais si vous voulez un peu vous représenter la nature pliante et molle de Frédéric, et ce qu’il lui avait évidemment fallu de tortures pour le hausser jusqu’à l’expression si nette et si absolue d’un désir, vous serez d’avis que jamais parole humaine n’a contenu plus de passion que ce oui-là.
Il était à peine prononcé que se tournant vers son partenaire et dégageant son bras du sien, mademoiselle d’Hermannsburg s’écria :
–Mon Dieu, mon cher Christian ! Comme vous me fatiguez ! Depuis un mois tout à l’heure, si je calcule bien, vous me répétez, chaque soir que Dieu fait la même chose ! Savez-vous ce qui en est résulté ? C’est, et je l’ai appris ce soir par hasard, qu’on prétend que je vous épouse ! Allons donc ! Faites-moi l’amitié désormais de me laisser tranquille et jusqu’à ce que ces bruits ineptes aient cessé tout à fait, je vous défends de me parler. Monsieur de Rothbanner, donnez-moi votre bras, s’il vous plaît.
Georges de Zévort se trouvait là et il entendit ces propos, avec vingt personnes aussi distinctement que je vous les dis ; il n’eut que le temps tout juste d’étendre les bras pour y recevoir le pauvre Christian qui tomba comme foudroyé. On lui fit prendre un verre d’eau, on l’emporta chez lui ; il en fit une maladie, je ne sais laquelle, et on prétend même qu’il en a contracté un tic nerveux incurable. Quand Madame de Rothbanner apprit les nouvelles, elle demanda de suite ce qu’était devenue sa fille, personne n’en savait rien. Seulement on l’avait vue prendre le bras de Frédéric. Ils n’étaient plus au bal ni l’un ni l’autre ; le temps de s’en assurer, le temps d’appeler la voiture, le temps de la faire avancer à travers une queue interminable, tout cela dura et il se passa bien deux heures avant qu’Elisabeth exaspérée pût rentrer chez elle. Il lui fut impossible de savoir où était son mari, où était sa fille, toutes les portes étaient fermées à clef, excepté la sienne, et elle n’était pas femme à prendre ses domestiques pour confidents. Maintenant, je vous laisse vous la figurer, seule dans sa chambre, pendant cette nuit-là. Imaginez un peu l’état de cette âme toute domination, toute puissance, toute orgueil… Que de haine, n’est-ce pas ?
Le lendemain s’ouvrit, pour les deux coupables, un paradis d’enchantement. Toutes leurs passions satisfaites à la fois ! Victoire, vengeance, amour, bien joué, tout cela formait la part d’Adélaïde ; celle de Frédéric se composait d’une jalousie détruite, d’une atroce souffrance abolie, d’une passion arrivée par la résistance au dernier degré d’insanité et qui n’avait plus rien à souhaiter ! Nous ne pouvons guère nous représenter, nous autres gens paisibles, ce que peuvent être, ce que doivent être, ce que sont nécessairement les transports et les jouissances de fous pareils. Pour peu que les lois physiques s’appliquent à l’amour comme au reste des choses de ce monde, il est clair que la force d’expansion est en raison des obstacles qu’elle fait sauter et que la fille la plus aimante des romans bénins d’Auguste Lafontaine, le jour où elle épouse par-devant notaire le plus candide et le plus adoré des commis de Chancellerie, ne saurait l’aimer comme une Adélaïde ! Reste à savoir si l’amour d’une Adélaïde ne nous ferait pas nous-mêmes éclater comme une machine à vapeur mal construite. Du matin au soir, Frédéric et Adélaïde ne se quittaient plus. On les rencontrait dans les bois, pendus au bras l’un de l’autre. Cette fille singulière avait du goût pour tout, du talent pour tout. Elle lisait les vers comme personne, chantait comme autrefois la Sontag, donnait à la musique des sens que personne n’avait été chercher. De tout cela, après bien autres choses, elle grisait Frédéric et ils cueillaient ensemble des pervenches et des germandrées ! On rentrait tard pour dîner. On ne s’imposait aucune contrainte devant Elisabeth, et chacun sut par la ville que, décidément, cette chère Adélaïde s’était habituée à son beau-père ; elle lui montrait beaucoup d’amitié ; on félicita l’heureuse madame de Rothbanner qui, fière comme le cacique indien attaché par l’ennemi au poteau de torture, accueillait ces compliments avec le plus doux sourire.
Au bout d’un mois, la scène changea, Frédéric se dit à lui-même : je suis indigne de vivre.
Entre nous, je crois qu’il était la machine à vapeur mal construite et pas trop capable de porter l’amour d’une Adélaïde. Il commença à devenir sombre. Peut-être avait-il dit à madame sa femme quelques mots offensants dans les jours de sa félicité. Il devint doux comme une fille. Il trouva sa victime angélique et fut remercié avec larmes. Adélaïde prit les choses de très haut et maltraita vivement l’un et l’autre. Ce n’était pas une nature à concessions. Ce que voyant, Frédéric formula quelques vérités morales d’une grande portée, d’où résulta une explication violente dans la chambre d’Adélaïde. De paroles en paroles on s’échauffa, et ce matin-là, Frédéric déjeuna en tête-à-tête avec Elisabeth. Il voulut, cependant, dans la journée, monter chez mademoiselle d’Hermannsburg pour lui faire apprécier un plan de conduite entièrement nouveau dont l’idée lui était venue, mais il apprit que sa belle-fille était allée passer la journée chez une de ses amies. Ce jeu-là continua pendant quatre ou cinq jours, Frédéric devint troublé et inquiet et Elisabeth, toujours résistant, toujours espérant, toujours luttant du moins, mais se sentant cruellement maîtrisée par le sort qu’elle s’était fait, continua en y usant les ressorts de sa volonté, à garder la couverture de mansuétude dans laquelle elle avait jugé indispensable de s’envelopper.
Le cinquième jour, la mère de l’amie d’Adélaïde demanda à madame de Rothbanner si elle agréerait la recherche que le comte de Potz, secrétaire de légation, se proposait de faire de sa chère fille. Depuis cinq jours, les jeunes gens se voyaient chez elle et paraissaient sympathiser. Elisabeth ne se trompa pas une minute sur le sens de ce nouvel intermède et elle eut le double courage et la prudence admirable, d’abord de témoigner des doutes quant à l’acquiescement de sa fille à un mariage, secondement de ne pas dire un mot à son mari. De cette façon, elle s’innocentait d’avance aux yeux du monde des extravagances qu’Adélaïde pouvait méditer et elle n’éveillait pas, elle-même, chez Frédéric cette jalousie qu’elle avait appris à connaître et dont elle savait d’avance les conséquences. Il est curieux que les passions de ce dernier ordre-là ont d’autant plus d’énergie et de cruauté que ceux qui les éprouvent sont plus faibles.
Le pendant exact de ce qui s’était produit avec Christian arriva avec M. de Potz, c’est-à-dire qu’Adélaïde s’attacha par les attentions les plus délicates à lui tourner absolument la tête et y réussit parfaitement. On parla de leur union comme d’une chose assurée. Rothbanner l’apprit et, pendant quelques jours, sembla disposé à y prêter les mains. Il en plaisanta avec Adélaïde elle-même. Cependant les deux femmes intéressées à suivre les mouvements de son cœur, le virent bientôt devenir sombre, inquiet, absorbé ; l’une et l’autre, avec des sentiments, à coup sûr, bien différents, prévirent que sa maladie allait aboutir à une crise.
En effet, il entra un matin chez Adélaïde, s’assit à côté d’elle et lui prit la main. Elle se laissa faire et le regarda froidement.
– Me comprends-tu ? lui dit-il avec une douceur douloureuse.
– Parfaitement, répondit-elle ; vous n’avez la force ni de me vouloir ni de renoncer à moi.
– Puis-je te vouloir ?
– Assurément non.
– Puis-je renoncer à toi ?
– Je puis renoncer à vous et je l’ai fait.
– Tu l’as fait ?
– Je me marie.
– Et c’est à moi que tu oses…
– D’abord vous savez qu’il ne m’est pas si difficile d’oser ; vous, vous ne savez pas vouloir, moi j’ai cette science-là. Je me marie, vous dis-je, à un homme que j’estime, à un homme que j’aime et, tenez, au point où nous en sommes, je ne sais pourquoi je ne serais pas sincère, à un homme qui m’est plus cher que vous ne le fûtes jamais. Le mot est dit et je ne le retirerai pas.
En parlant ainsi, elle regarda fixement Frédéric, car le connaissant comme elle faisait, elle savait quel poignard elle lui enfonçait dans le plus profond du cœur. Ce coup-là le rétablit soudain en parfait équilibre avec lui-même. Jaloux, la passion dominante excitée le fit nager en pleine eau dans la volonté qu’elle suggérait et qu’il ne tirait jamais d’ailleurs. Furieux, il saisit Adélaïde par le bras :
– Aime-le, ne l’aime pas, si tu le revois, si tu le regardes, je le soufflette et je le tue !
– S’il se laisse tuer ; mais de toutes manières il vaut mieux que vous. Pas de ces façons-là, M. de Rothbanner ! Que voulez-vous ? Avez-vous la prétention de me faire passer mon existence entière dans la position odieuse que nous nous sommes créée, vous et moi ? L’amour que j’ai eu pour vous, vous accorde-t-il cette prérogative inouïe de me condamner au malheur et à l’isolement éternels ? C’est là ce que vous appelez de l’amour ?
– Je n’ai rien à expliquer, rien à justifier… Tiens, Adélaïde, j’ai eu tort, je t’aime, je n’aime que toi, je ne peux pas, je ne veux pas te perdre ! Impose-moi telle condition que tu voudras, j’y souscris, je te jure que je la tiendrai !…
– Tu ne tiendras rien ! je ne veux pas te tromper, je t’ai menti, je n’aime pas cet homme ! Je n’aime que toi, je n’aimerai que toi, tant que je respirerai, tant que je vivrai, il n’y aura que toi au monde pour moi ! Mais je te méprise, entends-tu bien, autant que je t’aime ! Tu me trahiras, tu m’abandonneras, tu me vendras à cette femme que tu exècres autant que moi et cela non pas pour un bien, non pas pour une vertu… tu n’en as pas ! mais pour la peur honteuse de quelques phrases dont tu ne crois pas le premier mot ! Il te faut pourtant le savoir et j’aurai la triste et poignante joie de te le dire une fois dans ma vie : tu m’as perdue et tu as fait de moi ce que j’ai bien l’intelligence de connaître que je suis, non pas pour m’avoir prise, puisque c’est moi qui t’ai pris, mais pour n’avoir pas su me garder et tu vas me reprendre et tu me. rejetteras encore et tu me reprendras toujours et tu me rejetteras sans cesse et tout cela pour être honnête à tes propres yeux et tu n’es pas assez inepte pour pouvoir jamais croire l’être devenu !
– Je te jure !
– Ne jure rien ou jure tout ce que tu voudras. Tiens, Frédéric, tu n’es qu’un lâche, mais lâche comme tu es, je t’aime ! je me rends et me rendrai toujours !
Vous le devinez bien : la pauvre fille ne voyait que trop juste et ne disait que trop vrai. Cette scène-là, ce raccommodement fut suivi de dix scènes en sens contraire qui en amenèrent dix autres contrastantes. La maison était un enfer, bien que les apparences fussent gardées toujours. On se douta bien au-dehors de quelque chose et je n’aurais pas conseillé à des bourgeois de mener cette petite vie ; mais comme il n’y eut pas d’éclat bien clair, la bonne compagnie protégea les siens et le grand-duc, qui avait assez aimé le feu comte d’Hermannsburg, ne voulut jamais souffrir le moindre propos contre sa fille. Madame de Rothbanner fut sublime dans son genre ; elle céda, ne pouvant mieux faire, et ne se découragea jamais. Il en résulta quelque chose d’assez bizarre et qui aurait pu surprendre également les deux femmes ; à force de lutter ensemble et de se trouver également inépuisables en ressources, en haine, en courage, elles prirent l’une pour l’autre cette estime secrète que l’énergie inspire aux gens énergiques même les plus ennemis et, en outre, elles se trouvèrent un beau matin absolument unies dans l’intensité du même mépris pour ce pauvre Rothbanner.
Je les ai tous connus dans un temps où le malheureux n’osait plus venir à table, encore bien moins paraître devant ses femmes à aucune heure du jour, et, quand il n’était pas de service, par conséquent forcé de passer le temps hors de chez lui, il s’arrangeait de façon à dormir toute la sainte journée et à n’être sur pieds que pendant que ces dames allaient dans le monde ou reposaient dans leurs lits. Il devint comme une espèce de spectre et c’est ainsi que les années de la jeunesse se passèrent pour lui et pour Adélaïde, absolument dégoûtée de son idole.
Si je vous détaillais un roman, je ferais tranquillement ici mourir l’un et l’autre d’épuisement, de confusion et de douleur. Il y aurait de quoi. Mais, pas du tout. Les choses n’ont guère de ces conclusions dans la vie réelle. Quand ce diable de Rothbanner eut attrapé quarante ans et un ventre assez respectable, et que, surtout, il eut inventé sa fameuse culasse à mortier, sa jalousie à l’endroit d’Adélaïde était devenue fort traitable. Quant à l’amour, depuis longtemps ce sentiment avait disparu pour lui comme pour elle. En somme, Madame de Rothbanner pouvait être considérée comme victorieuse sur toute la ligne ; elle possédait, sans nul partage, un époux qui, désormais, ne valait ni plus ni moins qu’un autre. Je ne peux pas deviner par quelle fantaisie de vieille fille, Adélaïde voulut alors se marier. On lui fit épouser un chambellan, mais avant la fin de l’année, elle planta là son mari et revint vivre chez sa mère. Ces femmes avaient une telle habitude de se détester et d’employer l’esprit que le ciel leur a donné à aiguiser des mots sanglants l’une contre l’autre et à torturer Rothbanner d’un commun accord, dernière et unique marque d’attention qu’elles ne lui ont pas retirée, qu’on les voit décidément inséparables et telles gens qui disent s’aimer ne se tiennent pas de cette force.
J’ai dîné l’autre jour avec le colonel Rothbanner et la raison en est qu’il désire passionnément la croix de Louis le Pieux ; je crois pouvoir la lui faire atteindre. C’est ce qui m’a remis toute cette affaire en mémoire et n’ayant rien de mieux à vous offrir, je vous l’ai racontée.
Pendant ce récit du baron, la ravissante Mme de Hautcastel avait, dans le fond de son fauteuil, pris une ou deux fois un air assez scandalisé ; elle poussa alors un profond soupir et en manœuvrant son écran dans sa main divine, elle posa son petit pied sur le chenet, sans dire un mot. Georges de Hamann, regardant la pendule, s’aperçut qu’il était temps d’aller faire un tour chez la princesse Ulrique-Marie et après avoir donné un coup d’œil à sa cravate, il sortit discrètement.
Quant à Monsieur de Hautcastel, il avait dormi pendant presque tout le temps ; il se leva avec un effort marqué, et tira d’un trait la conclusion morale de ce qu’on vient de lire :
– Ce satané baron est bien la plus mauvaise langue que je connaisse ! Toutes ces balivernes n’empêchent pas Madame de Rothbanner d’être une personne charmante et elle joue au whist comme jamais femme n’y a joué !
Rio de Janeiro, 15 Xbre 1869.