
Constant Guéroult
LE RETOUR DE ROCAMBOLE
Sur des notes laissées par PONSON DU TERRAIL
(1877)
PROLOGUE
LE CABARET DE LA PROVIDENCE
I
LE FIACRE
Des rues non pavées, dont le sol défoncé disparaissait sous une épaisse couche de boue noire et infecte ; des maisons basses, mal bâties, couvertes de tuiles cassées, de plantes disjointes, le plus souvent de carton bitumé, réduit en pâte et crevé par la pluie ;
Des cabarets borgnes, de noires usines, rejetées là par les règlements de police à cause des odeurs qui s’en dégagent : fonderies de graisses, fabricants de couperose et de noir animal, cuiseurs d’os, aplatisseurs de cornes ;
Tel était le tableau qu’offrait le village d’Aubervilliers à l’époque où se passe cette histoire, c’est-à -dire vers la fin de l’année 186…
Le soir venu, les réverbères, se détachant de loin en loin dans les ténèbres comme de pâles nébuleuses, projetaient une lumière rougeâtre qui rendait plus hideux encore les toits crevassés, les façades sordides et le sol fangeux. Sous cette lueur tremblante et maladive comme le regard d’un mourant, les misérables créatures reléguées dans ces lieux maudits semblaient des ombres errant tristement le long des sombres masures ; les boutiques de fruitiers ou de marchands de vin, vaguement éclairées par la lueur d’une chandelle ou d’une lampe fumeuse, répandaient des airs de sépulcre ; tout enfin affectait des formes fantastiques qui eussent glacé l’âme la mieux trempée.
C’est dans une des rues les plus désertes de ce village, la rue du Pont-Blanc, que se passait, le 30 novembre 186… la scène que nous allons raconter.
Au milieu de cette rue, dont les dernières maisons ont pour limite la plaine des Vertus, s’élevait alors un cabaret mal famé, exclusivement fréquenté, disait-on, par une clientèle des plus équivoques.
C’était le cabaret de la Providence, tenu, comme l’indiquait l’enseigne, par Pierre Rascal.
La physionomie de cet établissement était en parfaite harmonie avec la réputation qu’on lui avait faite.
Le sol de deux marches en contrebas de la rue, son unique fenêtre ornée d’épais rideaux de cotonnade rouges et blancs, sa façade peinte en vert foncé et toujours souillée de boue, ses abords fangeux, semés d’os, de verres cassés, de détritus de légumes, de têtes d’oies et de canards, tout cela formait un ensemble si repoussant, que cet étrange établissement ne pouvait tenter que des clients d’une espèce tout exceptionnelle.
Au reste, sa situation était très-favorable à ces équivoques clients qui, au lieu de s’y rendre par le village, pouvaient, en faisant un léger détour, y arriver par la plaine des Vertus, où ils étaient assurés de ne rencontrer personne.
Ce jour-là , une animation inusitée régnait depuis le matin dans le cabaret.
Quatre ou cinq individus de mauvaise mine s’y étaient glissés l’un après l’autre en rasant les habitations, presque toujours désertes dans le jour, car elles sont occupées par des maraîchers que leurs travaux retiennent aux champs jusqu’à la nuit, autre gage de sécurité pour les habitués de la Providence. Ces individus étaient sortis et rentrés plusieurs fois, toujours isolément et avec les mêmes précautions ; c’est-à -dire à dix minutes d’intervalle l’un de l’autre, et en gagnant chaque fois la plaine des Vertus pour se rendre dans le village, au lieu de prendre la rue du Fort, qui abrégeait le chemin de moitié.
Puis, quand, au crépuscule, une lumière brilla dans le cabaret, on eût pu voir, se mouvant comme dans un brouillard à travers les épais rideaux de cotonnade, des ombres aller et venir d’un air affairé qui tranchait singulièrement avec le calme mystérieux et la sombre torpeur qui distinguaient ordinairement le cabaret de la Providence.
Cette agitation inexplicable, d’un caractère étrange et sinistre, durait depuis quelque temps déjà , quand la porte du cabaret, s’ouvrant brusquement, livra passage à une femme belle encore, quoiqu’elle eût évidemment dépassé la quarantaine, et qui, les traits bouleversés, les yeux hagards, les mains plongées dans son épaisse chevelure noire, s’élança dehors en criant d’une voix altérée par l’épouvante :
— Seigneur ! Jésus ! ils me feront couper le cou ! ils me feront couper le cou !
Au même instant, un homme bâti en hercule, les manches retroussées jusqu’au coude, les bras et les mains rouges de sang, bondissait à son tour par la porte restée ouverte, tombait à deux pas de cette femme accroupie et frissonnante, et levant sur sa tête ses poings énormes :
— Tais ta gueule ou je t’écrase, murmura-t-il d’une voix rauque.
La femme leva sur lui un regard craintif, puis, courbant de nouveau la tête, au-dessus de laquelle elle éleva ses bras, comme pour amortir le coup qu’elle attendait :
— Eh bien ! tue-moi, balbutia-t-elle d’une voix défaillante, tue-moi si ça te plaît, mais je ne veux pas de sang ici, je ne veux pas de meurtre.
— Imbécile ! répliqua l’hercule en l’enlevant de terre d’une seule main, comme il eût fait d’un enfant, c’est toi qui veux nous faire couper la tête en parlant de sang et de meurtre quand personne n’y songe ici.

Il jeta un regard inquiet du côté de la rue, craignant que les paroles de sa femme n’eussent été entendues de quelque passant.
La rue était déserte.
Alors, revenant à sa femme et lui montrant d’un geste impératif la porte du cabaret :
— Rentre là et n’en sors plus, lui dit-il.
Mais il tressaillit tout à coup en voyant une jeune fille sur le seuil de la maison, d’où elle avait assisté à la scène qui venait de se passer entre lui et sa victime.
C’était une enfant de quatorze à quinze ans.
Sous les vêtements bruns, usés, troués, grossièrement raccommodés qui la couvraient à peine, sa taille droite et légèrement cambrée se profilait avec grâce dans le sombre encadrement de la porte, et ses grands yeux noirs et fixes, sa physionomie ouverte et rêveuse à la fois, ses cheveux d’un châtain roux et lumineux, bizarrement effarés autour du front, donnaient à ses traits maigres et pâles une beauté mystérieuse et une originalité pleine de charme.
— Que fait-elle ici, celle-là ? on dirait qu’elle nous espionne, murmura sourdement Rascal.
— Tu sais bien qu’elle ne parle pas, répondit la cabaretière.
— Non, mais elle entend, répliqua l’homme en jetant sur l’enfant un regard soupçonneux.
Il ajouta :
— Ne la perds pas de vue et tâche qu’elle ne voie rien de ce qui va se passer, je m’en défie ; surtout empêche-la de filer, elle est capable de nous dénoncer ; tu entends, Micheline.
Un bruit sourd et mat attira aussitôt son attention du côté de la plaine.
Il porta ses regards de ce côté et attendit, en proie à une anxiété visible.
Quelques instants après, un fiacre paraissait au bout de la rue et s’y arrêtait.
— Enfin ! murmura le cabaretier avec un sombre sourire.
— C’est elle ? demanda Micheline d’une voix tremblante.
— Ça ne peut être qu’elle.
Il regarda de nouveau.
À la pâle lueur d’un réverbère, il vit deux hommes ouvrir la portière du fiacre et en retirer une femme.
Sa tête et son visage étaient enveloppés dans une écharpe blanche, sans doute pour étouffer ses cris, les diamants dont ses doigts étaient garnis jetaient des feux dans les ténèbres, et, au milieu du silence, on entendait distinctement le froufrou de sa robe de soie, froissée par l’individu qui l’emportait dans ses bras.
— C’est bien elle ! dit Rascal.
Il s’élança aussitôt vers la porte du cabaret et, s’adressant à cinq ou six individus à mine de forçat qui jouaient aux cartes à la maigre clarté d’une chandelle :
— La voilà ! leur cria-t-il.
Deux hommes se levèrent aussitôt et sortirent en courant.
Ils s’élancèrent hors du cabaret et disparurent en un clin d’œil dans la direction de la rue du Fort.
— Et vous autres, dit l’hercule aux quatre individus restés assis autour de la table, dissimulez avec soin vos frimousses, elles en disent trop long, il n’en faudrait pas davantage pour faire mourir de peur notre belle comtesse, qui n’en a jamais vu de pareilles dans ses salons, et ça gâterait nos affaires.
— Et toi, dit Micheline, est-ce que tu ne vas pas cacher tes mains toutes rouges de sang ?
— Le sang des abattoirs, quoi ! Preuve que je ne suis pas un feignant ; faudrait-il pas mettre des gants à dix boutons pour ne pas effaroucher le monde ? Mes moyens ne me le permettent pas, et, d’ailleurs, je n’ai jamais pu trouver ma pointure.
Il ajouta en baissant la voix :
— Silence ! la voilà .
Et se tournant vers sa femme :
— La chambre est prête ?
— Oui.
— Bon. Introduis-y la jeune dame.
Celle-ci arrivait au seuil du cabaret dans les bras de l’individu qui l’avait tirée du fiacre.
Sur un signe du cabaretier, il descendit les deux marches qui conduisaient à la salle commune et suivit Micheline.
— Et à présent, mes petits, dit Rascal aux quatre chenapans auxquels il venait de recommander de cacher leurs figures, il s’agit de sortir, de vous disperser le long de la rue en sentinelles perdues et de ne laisser approcher personne de la maison, vu qu’il va y avoir bientôt un branle-bas et des cris et des lamentations qui ne doivent être entendus de personne ; il y va de votre cou, je ne vous dis que ça.
II
LA SAGE-FEMME
Vers la même heure à peu près à laquelle se passaient les événements que nous venons de raconter, deux hommes traversaient la place de l’Église et s’engageaient dans la rue de Paris, qu’ils parcouraient d’un pas rapide.
Leur costume plus que négligé, leur barbe inculte, leur teint terreux, l’expression inquiète de leurs regards, enfin l’absence de linge qui les distinguait l’un et l’autre, classaient ces deux individus dans une des catégories les moins honorables de la société.
Bref, un agent de police qui les eût rencontrés marchant dans ces chemins déserts de cette allure inquiète et précipitée, se serait défié et n’eût pas manqué de les filer.
La rue de Paris se termine par un chemin irrégulier tracé à travers champs dans la direction de la barrière de la Villette, à laquelle il aboutit, après avoir traversé plusieurs rues où s’élèvent çà et là quelques maisons basses, isolées l’une de l’autre.
Après dix minutes de marche, les deux sinistres compagnons, auxquels tout ce pays semblait familier, quittèrent tout à coup le chemin pour tourner à gauche et s’engager dans une de ces rues.
C’était la rue de la Goutte-d’Or. Ils marchèrent droit à un groupe de trois ou quatre maisons, en face desquelles s’élevait un réverbère.
Quoiqu’il fût six heures à peine, toutes ces maisons étaient déjà closes.
À la lueur du réverbère, ils purent lire, non sans peine, les enseignes étalées au front de ces masures :
Lambricht, marchand de ferraille ; Naïs, cuiseur d’os ; Mme Morel, sage-femme.
Le plus âgé des deux hommes frappa discrètement à la porte de cette dernière maison, composée, comme presque toutes celles du quartier, d’un rez-de-chaussée et d’un étage.
Personne ne répondit.
Il frappa de nouveau. Deux minutes s’écoulèrent sans qu’on donnât signe de vie.
— Nom d’un nom, murmura-t-il, qu’est-ce que ça signifie ? Est-ce que la vieille mégère serait sortie ? Impossible, elle est prévenue ; elle a promis de ne pas bouger de toute la soirée, et elle sait bien…
Voyant que personne ne paraissait, il lâcha un juron et s’écria avec colère :
— Tonnerre ! j’ai envie d’enfoncer la porte ; ce ne sera pas bien difficile, toutes ces cambuses-là sont bâties de boue et de crachat.
— Oh ! mais non, pas de bêtises, père Vulcain, lui dit son compagnon ; vu la besogne que nous faisons en ce moment, il faut y aller en douceur ; nous pourrions attirer sur nous l’attention de la rousse, et le quart d’heure serait mal choisi pour ça ; c’est pas le moment d’esbroufer le monde.
— Où la chercher ? à qui m’informer ? reprit le père Vulcain en frappant du pied avec rage.
Et jetant autour de lui un regard désespéré :
— Personne à qui parler ! Pas une maison ouverte, pas une fenêtre éclairée, pas une âme dans ce chien de quartier ! On dirait un cimetière plutôt qu’une rue.
Incapable de dominer plus longtemps sa fureur, il fit un geste pour donner un violent coup de pied dans la porte.
— En douceur, lui dit tranquillement son ami en le saisissant à bras-le-corps et le tenant à distance.
— Mais, animal, s’écria le père Vulcain, tu ne comprends donc pas la situation ? Si nous ne ramenons pas la Morel, c’est la mort de la jeune dame.
— Ce serait malheureux, dit philosophiquement le sinistre personnage.
— Malheureux pour elle et malsain pour nous, car sais-tu ce que c’est que cette jeune dame ? Une comtesse, rien que ça !
— Qu’est-ce que ça me fait ? Les titres sont abolis. Tel que tu me vois, je suis l’égal d’un duc et même d’un prince. C’est un des bienfaits de la Révolution. Moi, d’abord, je suis à cheval sur la loi ; les immortels principes de 89, je ne sors pas de là .
— Possible, mais n’empêche qu’une comtesse, une grande dame du faubourg Saint-Germain, ne disparaît pas comme ça sans qu’on s’inquiète de savoir où elle est passée, et si celle-ci allait laisser son âme à la Providence, toute la séquelle de la rue de Jérusalem serait en l’air pour retrouver sa trace. Comprends-tu ça, mon ami Collin ?
— Oui, oui, je comprends que ça pourrait mal tourner pour nous et que nous avons le plus grand intérêt à retrouver cette satanée sage-femme… c’est-à -dire elle ou une autre.
— Une autre !… nous mettrions peut-être deux heures à la trouver dans ce pays perdu. Et puis, c’est pas une autre, c’est la Morel qu’il nous faut, vu que nous avons les meilleurs renseignements sur son compte, que ses principes sont connus, qu’elle a souvent rendu des petits services dans le genre de celui-ci et même mieux, à preuve qu’elle a eu des mots avec la correctionnelle, de sorte qu’elle connaît déjà la paille humide des cachots. Son tempérament y est fait, tandis qu’une autre… bref, il nous faut absolument la Morel.
À ces derniers mots, le père Vulcain, trompant la surveillance de son ami Collin, ébranla la porte d’un violent coup de pied.
— Canaille ! s’écria Collin en jetant autour de lui des regards effarés, tu veux donc nous faire pincer ?
— Silence ! répliqua Vulcain, je viens de dénicher l’oiseau, vois plutôt.
Une lumière venait de se montrer derrière la fenêtre du premier étage, qui s’ouvrit aussitôt et à laquelle parut une tête de vieille au visage ridé, à la physionomie cynique, au teint allumé, aux cheveux gris et mal peignés.
C’était la sage-femme.
— Qui est là ? demanda-t-elle.
— Moi, Vulcain ; allons, descendez et plus vite que ça, on vous attend là -bas.
— Là -bas ? où donc ? demanda la vieille d’une voix traînante et empâtée.
— Rue du Pont-Blanc, répondit Vulcain en baissant la voix.
— Rue du Pont-Blanc, ah ! oui, je me souviens, dit la sage-femme en refermant lentement sa fenêtre, me voilà , me voilà .
— Ah çà , qu’est-ce qu’elle a donc ? dit Vulcain à son camarade, je ne la reconnais plus.
— Elle dormait peut-être, répondit Collin.
Cinq minutes après, la porte s’ouvrait et la sage-femme sortait enfin.
— Allons, filons, lui dit brusquement Vulcain, voilà déjà bien du temps de perdu, c’est pas le moment de moisir ici, on nous attend avec impatience.
Et il s’était mis à marcher tout en parlant.
— Ah ! vous allez trop vite, je ne peux pas vous suivre, lui dit la sage-femme en s’arrêtant brusquement.
Vulcain s’approcha d’elle, la regarda sous le nez, et levant les bras au ciel :
— Éméchée ! s’écria-t-il.
— Ce n’est rien, dit la sage-femme en se balançant légèrement à droite et à gauche, j’ai fait une politesse à madame Isidore, qui me l’a rendue, et…
Elle s’interrompit pour souffler bruyamment.
Vulcain recula de deux pas.
— Plus que ça d’absinthe ! merci, dit-il.
— Je vous dis que ce n’est rien, reprit madame Morel en saisissant son bras, sur lequel elle s’appuya de tout le poids de son corps, le grand air va dissiper ça tout de suite, il n’y paraîtra plus dans deux minutes, je connais ça.
— À la bonne heure.
On se mit en marche, et vingt minutes après on arrivait au cabaret de la Providence.
Deux hommes en blouse rôdaient dans la rue, à dix pas l’un de l’autre.
C’étaient les sentinelles posées là par Rascal.
— Eh ! arrivez donc ! dit l’un des deux hommes en reconnaissant les camarades, vous ne savez donc pas…
Un cri parti du cabaret l’interrompit brusquement, un cri si aigu, si déchirant, qu’on eût dit un adieu suprême à la vie.
— Nom d’un nom ! balbutia le père Vulcain, saisi d’un léger tremblement, voilà une créature qui n’est pas sur un lit de roses.
Et, s’adressant à la sage-femme, qui ne témoignait aucune émotion :
— Ah çà ! mais ça ne vous remue donc pas, vous ?
Et il l’entraîna en lui criant :
— Allons, en avant !
En entrant dans l’auberge, ils aperçurent Rascal attablé en face d’un homme jeune encore et élégamment vêtu.
— Lui ! murmurèrent Collin et le père Vulcain en ôtant leurs casquettes.
À leur entrée, le jeune homme s’élança vers eux, et attirant la sage-femme avec une violence presque brutale :
— À l’œuvre ! à l’œuvre ! lui dit-il d’une voix frémissante, ah ! Dieu veuille que vous n’arriviez pas trop tard !
Mais au lieu de le suivre vers la chambre de Micheline, où il voulait l’entraîner, la Morel se laissa tomber sur un siège, et, s’affaissant sur elle-même :
— C’est drôle, balbutia-t-elle d’un air hébété, je croyais que le grand air… Eh bien, non, au contraire.
— Mais, malheureuse, hâtez-vous donc, reprit le jeune homme en la secouant avec force, cinq minutes de retard peuvent la tuer.
— Je ne peux pas, balbutia la sage-femme en roulant autour d’elle des yeux stupides, je ne vois plus clair et mes bras sont comme du plomb, je ne peux pas.
III
UN MOMENT CRITIQUE
Le jeune homme resta quelques instants atterré.
Puis, après avoir examiné avec attention la Morel, immobile et affaissée sur sa chaise comme une masse inerte :
— Malédiction ! s’écria-t-il avec un geste désespéré, elle est ivre.
— Complètement ivre, ajouta Rascal, tu n’as donc pas vu cela, Vulcain ?
— Ça sautait aux yeux, mais elle nous a dit que ça allait se dissiper en route, tandis qu’au contraire le grand air l’a achevée.
— Allons, reprit vivement le jeune homme, cette femme ne peut nous être d’aucun secours, qu’on aille en chercher une autre.
— Impossible, dit Vulcain.
— Pourquoi cela ?
— Parce que celle-là est la seule, vu les antécédents… dont elle jouit, à laquelle on puisse tout demander sans crainte de trahison.
Des cris perçants partirent de nouveau de la chambre de Micheline.
Ces cris, jaillis des entrailles de l’infortunée, exprimaient une si intolérable souffrance, que le jeune homme et ses trois compagnons se regardèrent en pâlissant.
— Oh ! mais c’est horrible ! c’est horrible ! murmura le premier en marchand à grands pas comme pour se soustraire à l’émotion que lui causaient ces cris, dont parfois l’accent n’avait plus rien d’humain.
— Et puis, fit observer Vulcain, qu’il passe en ce moment un agent de police ou un appariteur, nous sommes tous pincés.
— Et cette femme qui ne peut rien, rien pour la sauver ! s’écria le jeune homme en se tordant les mains.
Les bras battants et la tête sur la poitrine, la sage-femme ne semblait pas même entendre ce qui se disait autour d’elle.
Elle était plongée dans un complet abrutissement.
Et les cris déchirants qui, revenant par crises, se faisaient entendre à peu près toutes les cinq minutes, là laissaient aussi insensible que si elle eût été de pierre.
À la fin, cependant, ils atteignirent à un tel diapason et exprimèrent une si effroyable torture, que la Morel tressaillit légèrement et murmura d’une voix à peine distincte :
— Ça va mal… y a des complications… elle va étouffer, si on ne se hâte de… mais je peux pas… je peux pas.
— Horrible mégère ! s’écria le jeune homme en tirant un stylet de la poche de sa jaquette, je ne sais ce qui me retient de l’étendre morte à mes pieds.
— Pas d’imprudence, lui dit Rascal, la jeune dame est en danger de mort, ses cris affreux, et surtout les paroles que vient de prononcer la Morel, qui s’y connaît, tout prouve qu’elle va passer peut-être à la première crise, et c’est assez d’un cadavre sur les bras, c’est trop.
— Mourir ! s’écria le jeune homme, oh ! mais il ne faut pas, je ne veux pas qu’elle meure !
Puis, s’adressant à Rascal :
— Il y a une pharmacie par ici ? Où est-elle ?
— Sur la place de l’Église.
— J’y cours.
Et il s’élança dehors.
— Je ne reconnais plus le maître, dit alors le père Vulcain ; lui, toujours si froid, si impassible au milieu des plus grands périls !…
— Oui ; mais ici il se trouve en face d’ennemis qu’il ne peut combattre, répliqua Rascal : la souffrance et la mort ; car la jeune dame n’en a peut-être pas pour dix minutes, à moins qu’il ne trouve un moyen. Mais d’ici là , nous avons vingt chances d’être tous arrêtés. Mon sang ne fait qu’un tour quand j’entends ces cris aigus, et je m’attends sans cesse à voir entrer…
— Oui, oui, il est certain qu’il ne fait pas bon ici, dit Collin en jetant un regard du côté de la porte, et j’avoue que je donnerais bien quelque chose pour être loin d’ici.
— Tu es libre de filer, mais rappelle-toi les paroles du maître, c’est une partie décisive que nous jouons en ce moment, c’est une fortune colossale qui doit nous tirer tous de la misérable position où jusqu’ici nous n’avons trouvé que la faim, le froid, l’angoisse perpétuelle et la perspective presque inévitable du bagne ou de l’échafaud.
— Oui, mais cette partie-là , nous allons la perdre, la mort tient les cartes et elle a les atouts dans la main.
La porte s’ouvrit en ce moment avec une telle violence, que les trois bandits en frissonnèrent, croyant à une irruption de la police.
C’était celui qu’ils venaient d’appeler le maître.
Sans prononcer un mot, il tira de sa poche un flacon, le déboucha, et s’approchant de la sage-femme, le lui posa sous les narines.
L’effet du liquide ne se fit pas attendre.
Il fut foudroyant.
La Morel, secouée dans tout son corps, comme par la décharge d’une pile électrique, se leva brusquement, promena autour d’elle des yeux hagards, et murmura avec effroi, mais d’une voix claire et distincte cette fois :
— Qu’est-ce que j’ai donc ? qu’est-ce qui m’arrive ?
— Eh bien, êtes-vous dégrisée, misérable ? lui demanda le jeune homme.
— Je ne suis pas plus grise que vous.
— Vous savez pourquoi on vous a fait venir ?
— Parfaitement.
— Vous sentez-vous maintenant la main assez ferme, l’esprit assez lucide pour venir en aide à la jeune femme dont vous entendez les cris ?
— Non, ma vue est encore trouble et j’éprouve dans tous les membres un tremblement qui… enfin, je ne peux pas ; son état est grave, je le comprends à ses cris, il faudrait toute mon habileté tout mon sang-froid, toute ma fermeté, et tout me manque ; je suis incapable de rien avant une heure, je le sens.
La porte de la chambre s’ouvrit en ce moment et Micheline parut toute frémissante, les traits pâles et décomposés.
— Oh ! malheur ! malheur ! s’écriait-elle en se laissant tomber sur un siège, la pauvre femme étouffe, elle commence à râler, cinq minutes encore et il sera trop tard. Pauvre dame ! si jeune, si jolie ! ça fait pitié !
— Cinq minutes ! murmura le jeune homme.
Alors une révolution subite s’opéra en lui.
Une résolution, froide, implacable se peignit, sur ses traits ; il vint se poser devant la sage-femme, et, plongeant dans ses yeux son regard aigu, étincelant, incisif comme une pointe d’acier :
— Écoute-moi bien, lui dit-il d’une voix grave et pénétrante, et sache que je n’ai jamais manqué à ma parole : si cette jeune femme meurt, ce sera par ta faute ; eh bien, je te jure que tu ne lui survivras pas une minute.
Il ajouta en lui montrant son stylet :
— Et maintenant, sa vie et la tienne sont entre tes mains, je n’ai plus rien à te dire.
Et il se jeta sur un siège.
La sage-femme avait lu son arrêt de mort dans ses yeux.
La terreur qu’elle en ressentit acheva comme par enchantement le miracle qu’avait commencé le flacon d’ammoniaque ; en un clin d’œil elle recouvra sa présence d’esprit et l’usage de toutes ses facultés.
— Conduisez-moi, dit-elle à Micheline.
Toutes deux passèrent dans la chambre où la jeune femme râlait et se tordait de douleur.
Les quatre hommes, debout, muets et immobiles, le regard fixé sur la porte de la chambre, attendaient, en proie à une effroyable angoisse.
Qu’allait-il se passer là ? Qu’allait leur annoncer tout à l’heure la Morel ?
La délivrance ou la mort ?
Voilà ce qu’ils se demandaient en tremblant, autant pour eux-mêmes que pour l’infortunée dont la vie était entre les mains de l’ignoble créature tout à l’heure abrutie par l’ivresse.
Tout à coup un cri terrible, un cri dans lequel on croyait saisir le déchirement de tous les liens de la vie, les fit bondir tous les quatre.
— C’est fini, murmura Rascal, c’est la mort ; on ne survit pas à une pareille torture.
Le jeune homme, lui, ne dit rien.
Il prit son stylet, qu’il avait jeté sur la table et, l’œil brûlant, les traits couverts d’une pâleur livide, il attendit, le regard fixé sur la porte de la chambre.
— La Morel est dans de vilains draps, murmura Vulcain à l’oreille de son camarade Collin, je ne donnerais pas deux sous de sa peau.
Au cri d’agonie qui avait glacé les quatre hommes, avait succédé un silence qui ne faisait que confirmer leurs craintes.
L’oreille tendue vers la porte, ils tâchaient de saisir un bruit sur lequel ils pussent baser une conjecture.
Mais rien, toujours rien.
Pas un mot, pas un mouvement ; au bout de cinq minutes d’une fiévreuse anxiété, ils entendirent enfin un bruit de pas.
La porte s’ouvrit.
Ce fut la Morel qui entra.
— Morte ! murmura le jeune homme en s’avançant, vers elle son stylet à la main, mais la main derrière le dos.
— Délivrée, répondit la sage-femme, dont les traits rayonnaient.
Elle ajouta, en s’essuyant le front :
— Et sauvée.
— Tu réponds de ses jours ?
— J’en réponds.
Elle ajouta :
— Oh ! vous avez un moyen de dégriser les gens, vous !…
— Excellent puisqu’il a réussi.
Puis, tirant de sa poche un porte-monnaie, où il prit un billet de banque :
— Tiens, lui dit-il, es-tu contente ?
— Cent francs ! s’écria la Morel, qui faisait payer ses accouchements dix francs et un litre.
— Et maintenant un mot : peut-on la transporter demain chez elle ?
— Oui, si on veut la tuer.
— Mais quand donc ?
— Pas avant huit jours.
Le jeune homme parut atterré.
— Huit jours ! s’écria-t-il en se frappant le front, c’est impossible ; tout serait perdu… à moins que…
Et se tournant vers Rascal.
— Le fiacre qui t’a amené est toujours là ?
— À l’entrée de la plaine.
— Je le prends.
Il sortit en disant :
— Informons-nous du mari.
— Et moi, s’écria la Morel en s’asseyant, une chopine… d’eau-de-vie, naturellement ; je l’ai bien gagnée.
IV
LA MUETTE
La sage-femme commençait à siroter sa chopine de fine champagne à trente sous le litre, quand elle fut interrompue par l’entrée d’un personnage qui se précipita dans le cabaret avec la violence d’une trombe.
— Miséricorde ! s’écria la Morel, qui faillit tomber à la renverse, qui est-ce qui peut entrer comme ça ? On ne peut donc pas boire sa pauvre chopine tranquillement, dans ce cabaret de malheur ! Est-ce que…
Mais elle se tut aussitôt.
Dans le nouveau venu, elle avait reconnu avec terreur l’homme au stylet.
— Rascal, dit celui-ci en parcourant la pièce d’un regard rapide, je n’ai pas retrouvé mon portefeuille dans ma poche, d’où je l’ai enlevé peut-être en tirant mon stylet ; il doit être ici. Il aura roulé à terre, sans doute, il faut le chercher à l’instant et le trouver absolument ; je ne voudrais pas, pour une fortune, qu’il tombât en des mains étrangères.
Rascal prit la lumière et tout le monde se mit à la recherche du portefeuille.
— Il renfermait peut-être une forte somme ? demanda le père Vulcain.
Le jeune homme haussa les épaules et répondit avec une sombre ironie :
— Il renferme des secrets dont dépend notre destinée, à tous.
En poursuivant ses recherches, il se trouva tout à coup en face d’un personnage qui se tenait blotti et presque invisible dans le coin le plus sombre du cabaret.
C’était la muette.
— Qu’est-ce que c’est que cela ? dit-il en se redressant tout à coup.
— C’est Nizza, une petite muette que nous avons recueillie… il y a longtemps.
— Elle n’entend pas ?
— Parfaitement, au contraire.
— Et elle est là depuis l’entrée de la jeune femme ?
— Oui, maître.
— Elle a tout vu, tout compris, alors ?
— Vu, oui, mais compris, c’est différent, elle est un peu idiote.
— Il n’y paraît pas à son regard.
Du coin où elle était blottie l’enfant jetait sur lui un regard inquiet, à la fois craintif et inquisiteur.
— Me connaît-elle ? demanda le jeune homme.
— De nom seulement, puisque vous venez ici pour la première fois.
— Et… sous quel nom ?
— Sir Ralph. Oh ! il n’y a rien à craindre ; elle ne parle pas et ne sait pas écrire, comment se ferait-elle comprendre ? à qui pourrait-elle communiquer ses pensées ? D’ailleurs, elle ne voit personne que nous et son infirmité la fixe dans cette maison, d’où elle n’ose même pas s’éloigner.
— Demande-lui si elle a vu mon portefeuille.
Avant que le cabaretier n’eût exécuté cet ordre, Nizza, dont le regard était resté constamment fixé sur sir Ralph, fit un signe de tête négatif.
— Tu ne mens pas ? lui dit ce dernier d’une voix brève et rude.
Elle répéta le même signe d’un air décidé, quoique très-pâle et en proie à une émotion visible.
Complètement rassuré, sir Ralph dit au cabaretier :
— Tu m’entends, Rascal, il faut que ce portefeuille se retrouve ; forcé de partir à l’instant pour Paris, c’est sur toi que je compte, et aussitôt retrouvé, tu me l’enverras sans perdre un instant.
Il ajouta au moment de sortir :
— Je m’informerai si la malade peut rester huit jours ici sans danger pour nous. Dans le cas contraire, il faudrait la transporter à Paris la nuit prochaine, et tu recevrais demain mes instructions à cet égard.
— La nuit prochaine, s’écria la Morel, mais elle passerait en route !
— En route, soit, c’est son affaire, ça ne nous regarde plus.
— Et l’enfant ? demanda Rascal.
— Nous le gardons.
Et il sortit.
Revenons à Nizza.
À l’aspect de la jeune femme, transportée dans le cabaret de la Providence et dont l’extrême élégance était sans doute pour elle un spectacle tout nouveau, la pauvre muette avait été à la fois surprise et ravie. Cédant alors au sentiment d’admiration dont elle se sentait subitement pénétrée, elle était entrée derrière elle dans la chambre de Micheline et ne l’avait plus quittée du regard jusqu’au moment où on l’avait débarrassée de l’écharpe qui enveloppait son visage et comprimait sa bouche.
La jeune femme était admirablement belle, et la double impression d’horrible souffrance et d’indicible terreur sous laquelle elle était en ce moment, la jetait dans un état d’exaltation qui rendait ses traits éblouissants et pour ainsi dire lumineux.
La vie était décuplée sur ce beau visage, dont chaque ligne exprimait quelque chose et où rayonnaient, dans une douloureuse extase, toutes les tortures auxquelles elle était en proie.
En face de cette beauté surhumaine, Nizza, émerveillée et profondément attendrie, s’agenouilla et tendit les bras vers l’infortunée, dont elle devinait la souffrance sans la comprendre.
Ce qu’elle ressentait pour elle, c’était à la fois une profonde pitié, une ardente sympathie et une admiration qui tenait du délire, car tout, dans cette jeune femme, lui révélait un monde inconnu, quelque chose comme ce paradis dont on lui avait parlé dans son enfance.
Elle eût voulu s’élancer vers elle et la presser dans ses bras ; mais au moment où elle allait peut-être céder à l’entraînement de son cœur, l’homme qui venait de poser la jeune femme sur le lit de Micheline l’aperçut et lui ordonna de sortir.
Comme elle se relevait pour obéir à cet ordre, Nizza vit quelque chose briller à terre.
C’était un bijou, un médaillon en or entouré d’émeraudes.
La muette comprit que cet objet avait dû se détacher du cou ou de la ceinture de la jeune femme dans les efforts qu’elle avait faits pour s’arracher à l’étreinte du misérable qui la portait dans ses bras, et, heureuse de posséder quelque chose qui lui appartenait, elle ramassa le bijou d’un geste rapide et le glissa dans sa poche.
Puis, elle quitta la chambre et alla se blottir dans un coin de la salle commune.
Là , elle entendit les cris de la jeune femme, et ne pouvant en comprendre la cause, elle pâlit affreusement, convaincue que Micheline, qui était restée près d’elle, lui faisait subir quelque horrible torture.
À chaque crise, — et elles se renouvelaient fréquemment, — elle était prise d’un tremblement nerveux et sentait son cœur bondir dans sa poitrine.
Vingt fois, elle avait été sur le point de s’élancer à son secours ; mais elle n’avait pas bougé, sachant qu’elle serait durement repoussée et n’osant braver la brutalité de Rascal et de ses compagnons, dont la mine, plus sombre et plus sinistre encore que de coutume, lui laissait deviner quelque horrible drame et la glaçait d’épouvante.
Ce supplice ne cessa qu’avec les cris de la jeune femme et lorsqu’elle eut entendu dire qu’elle ne souffrait plus.
Mais elle resta blottie dans son coin, écoutant, observant, réfléchissant à la situation de celle qui venait d’éveiller en elle, pauvre créature jusque-là maudite et maltraitée, tout un monde d’émotions inconnues, se creusant la tête pour comprendre le danger dont elle la sentait menacée et demandant comment elle pourrait lui venir en aide.
Nous avons vu ce qui venait de se passer entre elle et celui qu’on appelait sir Ralph.
Quand ce dernier se fut éloigné, la muette souleva doucement le bas de sa jupe, qui traînait sur le sol où elle était accroupie, et après s’être assurée qu’elle n’était pas observée, elle attira lentement à elle un objet qu’elle tenait caché là .
C’était le portefeuille perdu.
Elle le glissa dans la poche où elle avait déjà serré le médaillon, puis, gagnant furtivement la porte, sans que personne s’inquiétât d’elle, elle l’ouvrit avec précaution et sortit, après avoir jeté un regard plein de résolution sur la chambre où reposait la jeune femme.
La porte qui communiquait de cette chambre à la salle commune était vitrée, de sorte que Micheline, soulevant par hasard le rideau en ce moment, avait tout vu, mais sans rien comprendre.
Cinq minutes après, elle était retournée s’asseoir près de la malade, quand un des individus qui faisaient sentinelle dans la rue du Pont-Blanc entra dans le cabaret et demanda à Rascal :
— Qu’a-t-on donc fait à la petite muette ?
— Rien, pourquoi ça ?
— Elle vient de passer devant moi, en courant comme si elle avait le diable à ses trousses.
— En courant ? s’écria Rascal bouleversé, de quel côté allait-elle ?
— Du côté de Paris.
Micheline entra brusquement :
— Nizza est partie, dit-elle, et à qui donc est le portefeuille que je viens de voir entre ses mains ?
Rascal fit un bond vers sa femme.
Il était tout frémissant.
— Un portefeuille, dis-tu ? Ah ! malédiction ! malédiction ! elle a tout deviné et elle n’a pris la fuite que pour nous dénoncer.
Et s’adressant à l’individu qui venait de lui annoncer la fuite de Nizza :
— Nous sommes perdus si nous ne la rattrapons ; lançons-nous à sa poursuite, elle ne peut être loin et ne saurait nous échapper.
V
À L’HÔTEL DE SINABRIA
La suite des événements nous conduit de la rue du Pont-Blanc à la rue de Varennes, et du cabaret de la Providence dans l’une des demeures les plus aristocratiques du faubourg Saint-Germain, l’hôtel de Sinabria, où nous allons introduire le lecteur.
Il était huit heures environ, quand un élégant coupé s’arrêta à la porte de cet hôtel.
Un jeune homme, mis avec une recherche du meilleur goût, en descendit, tira le bouton de cuivre de la sonnette, et la porte lui ayant été ouverte aussitôt, il entra rapidement.
Sans jeter son nom au concierge, dont il devait être connu, il tourna à gauche, pénétra dans un large vestibule, orné de marbres, de vases pleins de fleurs, et discrètement éclairé par des lanternes en verre dépoli, et monta un escalier de pierre monumental, dont les degrés disparaissaient sous un tapis de drap rouge.
Un timbre avait annoncé sa visite, et en arrivant au premier étage il trouva une femme de chambre qui l’attendait.
Il était visiblement sous l’empire d’une profonde émotion.
Il resta un instant sans parler, la main posée sur sa poitrine, comme s’il eût étouffé ; puis, après avoir jeté un regard autour de lui :
— Eh bien, Fanny, dit-il d’une voix faible et altérée, où est ?…
La femme de chambre l’interrompit d’un geste et, le saisissant par la main :
— Suivez-moi, lui dit-elle.
Elle ouvrit une porte, lui fit traverser un vaste salon, plongé en ce moment dans l’obscurité, et l’introduisit dans une pièce dont les tentures et l’ameublement en satin blanc et rose annonçaient la chambre d’une jeune femme.
— Maintenant, monsieur Gaston, lui dit-elle, vous pouvez parler ; ici nous n’avons pas à craindre les oreilles indiscrètes.
— Vous avez raison, Fanny, dit le jeune homme, nous ne saurions nous entourer de trop de précautions.
Et, parcourant la chambre du regard :
— Où donne cette porte ? dit-il.
— Dans le petit salon. Oh ! nous sommes bien seuls maintenant !
— Eh ! bien, Fanny… où est-elle ?
— Partie.
— Ah !
Il se tut, en proie à un trouble profond.
— N’est-ce pas vous-même qui le lui avez conseillé ? reprit Fanny, et, d’ailleurs, n’était-ce pas le seul parti qu’il y eut à prendre ?
— C’est vrai, murmura Gaston, mais, si inévitable qu’elle fût, cette détermination est si grave, elle peut entraîner de si terribles conséquences, que je ne puis y songer sans frémir.
— Cette résolution lui offre au moins quelques chances de salut, tandis qu’en restant elle allait elle-même, et à coup sûr, au-devant de sa perte.
— Je le sais, dit Gaston.
Il se laissa tomber sur un siège et reprit au bout d’un instant :
— Ainsi, elle est chez madame…
— Bourassin, rue Sainte-Anne, la sage-femme que vous avez choisie vous-même.
— En effet, c’est un trajet bien long, bien dangereux. Dans l’état où elle était, comment aura-t-elle supporté cette fatigue ?
— C’est ce dont je suis aussi inquiet que vous-même, monsieur Gaston ; je tremble à la pensée de tous les accidents auxquels elle était exposée, et je suis bien tentée d’aller voir…
— Non, dit le jeune homme en se levant, j’y cours ; j’ai hâte de m’assurer par moi-même de son état ; et puis, pauvre Rita ! l’isolement où elle est doit ajouter encore à la tristesse, aux angoisses dont elle est dévorée.
— Monsieur Gaston, permettez-moi de vous adresser une prière.
— Parlez, Fanny.
— Soyez assez bon pour me faire savoir de ses nouvelles.
— Je vous le promets.
Après une longue hésitation, il reprit avec une anxiété et une appréhension visibles :
— Pas de lettres du comte ?
— Non, monsieur.
— Ah ! Dieu soit loué ! Qu’il tarde huit jours encore ! huit jours, et c’est le salut.
Il partit, reconduit par la femme de chambre, et deux minutes après sa voiture brûlait le pavé.
Restée seule, Fanny se mit à calculer le temps qu’il fallait à M. Gaston de Coursol pour aller à la rue Sainte-Anne et en revenir, après être resté quelque temps près de la comtesse, et elle décida qu’il ne pouvait être de retour avant deux heures.
Elle s’était enfoncée dans un large fauteuil, et, tout en jetant de temps à autre un regard sur la pendule, elle attendait là depuis trois quarts d’heure environ, quand elle entendit résonner le timbre.
Elle se leva pour aller au-devant du visiteur, mais avant qu’elle eût ouvert la porte du salon, un homme faisait irruption dans la chambre avec tous les signes du plus violent désespoir.
C’était Gaston de Coursol.
— Grand Dieu ! monsieur Gaston, qu’avez-vous donc ? lui demanda Fanny effrayée.
Gaston s’arrêta en face d’elle, et la regardant avec la fixité de la folie :
— Je viens de la rue Sainte-Anne, lui dit-il d’une voix défaillante.
— Vous m’effrayez, monsieur, dit Fanny en pâlissant, qu’est-il donc arrivé à madame la comtesse ?
— Ce qui est arrivé ! s’écria le jeune homme, quelque chose d’inouï, d’inexplicable et de si terrible que je ne sais comment je n’ai pas été frappé de folie quand cette femme me l’a révélé.
— Ma maîtresse est malade… en danger de mort peut-être.
— Pis que cela, cent fois pis que cela.
— Pis qu’un danger de mort ! Mais qu’est-ce donc, mon Dieu ?
— La comtesse n’a pas paru chez la sage-femme de la rue Sainte-Anne.
— Que me dites-vous là ? balbutia Fanny, saisie d’un tremblement subit à cette étrange révélation.
— La vérité, l’épouvantable vérité !
— Oh ! mais c’est incroyable, c’est impossible.
— C’est ce que je me suis répété cent fois en revenant ici et pourtant…
Il porta brusquement la main à son front comme saisi d’un éblouissement subit.
Il reprit bientôt avec une espèce de fièvre :
— Comprenez-vous, comprenez-vous ma stupeur, mon effarement ? J’arrive chez cette femme, j’ouvre la bouche, je veux lui parler de la comtesse, et c’est elle qui me demande si je lui amène la personne… dont je lui ai parlé la veille. Cette question tomba sur moi comme un coup de foudre, je la regardais sans pouvoir répondre, le délire s’emparait de mon cerveau. Comment admettre un malheur aussi effroyable, aussi incompréhensible ? Je ne voulais pas y croire ; alors elle me fit voir son appartement et toutes ses pensionnaires ; la comtesse n’y était pas ! Partie d’ici en voiture pour se rendre chez cette femme, elle n’y avait pas paru !… Oh ! c’est affreux ! que faire, mon Dieu ! que faire ?
— C’est terrible en effet, balbutia Fanny altérée, que penser ? À quoi nous résoudre. Où la chercher ? À qui s’adresser pour retrouver sa trace ?
— Et son mari ! son mari qu’on attend depuis un mois et qui sera ici dans quelques jours, comment lui annoncer ?… Que va-t-il se passer quand il rentrera ici, quand il ne trouvera plus sa femme ?
Et, se jetant sur un siège, il plongea dans ses deux mains ses traits défigurés par le désespoir.
On sonna en ce moment à la porte de la maison.
La femme de chambre y courut et revint bientôt, une lettre à la main.
— Une lettre de M. le comte, dit-elle après avoir jeté un coup d’œil sur les caractères de l’adresse et sur le timbre dont elle était revêtue.
Gaston se leva d’un bond.
— Vous êtes sûre qu’elle est du comte ? s’écria-t-il tout bouleversé.
— Je connais parfaitement son écriture et d’ailleurs il n’y a que lui qui puisse écrire d’Amsterdam.
Gaston prit la lettre et la froissant entre ses doigts :
— L’annonce de son retour est là , murmura-t-il, ce retour dont j’ai tant d’intérêt à connaître l’époque, et impossible de rompre ce frêle cachet, impossible de déchirer ce chiffon de papier sous lequel se cache ce que j’ai tant d’intérêt à connaître, c’est-à -dire combien de jours il me reste pour retrouver la pauvre Rita, pour la ramener ici et la sauver du plus épouvantable malheur.
Il achevait à peine de parler quand un léger bruit de pas se fit entendre derrière lui.
Il se retourna ainsi que Fanny et tous deux jetèrent un cri de surprise à l’aspect d’un homme vêtu de noir qui sortait du petit salon attenant à la chambre.
Calme et impassible comme s’il eût été annoncé et introduit par un domestique, l’inconnu s’avança jusqu’à la table et, désignant la lettre du doigt :
— Étrange amoureux que celui qui s’arrête devant un tel obstacle, quand il s’agit de l’honneur et peut-être de la vie de celle qu’il aime, dit-il avec une froide ironie.
Et, regardant fixement Gaston :
— Vous voulez connaître le jour et l’heure du retour du comte de Sinabria, eh bien ! je vais vous le dire.
VI
UN SAUVEUR
Revenu de la surprise où l’avait jetée cette apparition, Fanny dit au mystérieux inconnu :
— Pourriez-vous me dire, monsieur, comment vous vous trouviez dans ce petit salon ?
— De la façon la plus naturelle, belle camériste, répondit celui-ci avec calme ; j’y suis venu par le petit corridor qui aboutit à l’escalier de service.
— Mais, monsieur, la porte du petit salon et celle qui donne sur l’escalier de service étaient fermées à clef.
— Je ne dis pas non, belle camériste.
Et, lui tournant le dos, il se mit à examiner la chambre avec l’apparence du plus vif intérêt.
Son attention s’attacha particulièrement à deux objets, les portraits du comte et de la comtesse de Sinabria.
Le comte était un homme d’environ trente ans, de taille moyenne, les traits pâles, l’air fatigué, la physionomie froide, mais les yeux très-beaux, vifs et intelligents.
Sa jeune femme, représentée en toilette de bal, était une brune aux traits irréguliers, mais d’une originalité saisissante et d’un charme irrésistible. Il y avait dans son attitude, pleine d’abandon, un mélange de distinction, d’indépendance et de grâce familière qui la rendaient infiniment séduisante.
— Délicieusement jolie ! grande dame jusqu’au bout des ongles ! murmura l’inconnu.
Puis, parcourant la chambre du regard :
— Et le nid est digne de l’oiseau.
Il ajouta avec un indéfinissable sourire :
— Comme on comprend que le luxe est son élément naturel et que cette adorable créature ne peut vivre qu’enveloppée de toutes ces élégances !
Gaston de Coursol fit un pas vers lui.
L’inconnu se retourna et attendit.
— Monsieur, lui dit le jeune homme, dois-je considérer comme sérieux l’engagement que vous venez de prendre de me faire connaître l’époque du retour du…
— Du comte de Sinabria, acheva l’inconnu, c’est ce que je vais faire à l’instant même, monsieur.
Il tira de sa poche un canif, l’ouvrit, prit la lettre du comte, introduisit dans un angle de l’enveloppe la lame fine et mince et la fit glisser avec des précautions infinies jusqu’à l’angle opposé.
L’enveloppe était coupée dans son pli avec une merveilleuse netteté.
La femme de chambre voulut se récrier.
— La vie de votre maîtresse ou cette petite indélicatesse, choisissez, lui dit-il en fixant sur elle un regard résolu.
Puis, tirant la lettre de son enveloppe, il la déplia et la parcourut d’un coup d’œil.
— Tenez, dit-il en passant la lettre à Gaston, le comte sera ici dans trois jours.

— Trois jours ! s’écria le jeune homme en se jetant sur la lettre qu’il dévora du regard.
— Et que lui répondra-t-on quand il demandera sa femme ? reprit l’inconnu en regardant fixement Gaston.
— Quoi ! balbutia celui-ci, vous savez…
— Naturellement, puisque j’étais là … et voulez-vous que je vous dise pourquoi, quand vous avez connu la disparition de la comtesse, la pensée ne vous est pas venue d’aller faire votre déclaration à la préfecture de police, comme cela se pratique en pareil cas ? D’abord parce que la comtesse est sur le point de devenir mère, et ensuite parce que le comte, son époux est absent de Paris et même de France, depuis un an.
— C’est une calomnie, monsieur ! s’écria Gaston.
— Si c’est une calomnie, pourquoi donc la comtesse allait-elle chez une sage-femme au lieu de rester ici, au milieu de ses serviteurs, dans ce magnifique hôtel, au sein du luxe et du bien-être dont elle a toujours été entourée et qui lui seraient plus indispensables que jamais ?
Gaston ne répondit pas.
— Vous voyez bien que je sais tout, monsieur ; jouons donc cartes sur table, c’est le seul moyen de sortir de l’abîme effroyable où vous êtes plongés l’un et l’autre et d’où je puis seul vous tirer si je veux m’en mêler.
— Vous ! s’écria Gaston, vous pourriez… Ah ! monsieur, je vous devrais plus que la vie.
Et, saisissant sa main qu’il pressa fiévreusement dans les siennes :
— Monsieur, ah ! monsieur, si vous faisiez cela !
— Je pourrais compter sur votre reconnaissance ?
— Oh ! demandez-moi ce que vous voudrez ; sauvez-la et ce ne sera pas assez de toute ma fortune pour…
— Je vous crois, car, si vous tremblez à la seule pensée de ce mari rentrant dans sa demeure et n’y trouvant plus sa femme, mettant la police sur pied et apprenant l’effroyable vérité, vous faites-vous une idée de ce que doit souffrir votre malheureuse complice quand cette terrible perspective se présente à son esprit ? La voyez-vous seule, éperdue, réfugiée au fond de quelque bouge où elle rêve de suicide peut-être, la voyez-vous évoquer toute tremblante ces sinistres images ? Oui, je crois à votre reconnaissance au cas où je viendrais à vous sauver tous deux.
— Mais c’est impossible !
Il y eut un long silence.
— Écoutez, reprit enfin l’inconnu, le comte sera ici dans trois jours, c’est-à -dire samedi soir à onze heures.
— Oui.
— Eh bien, samedi soir, avant dix heures, la comtesse sera ici.
— Mais vous savez donc où elle est ?
— Je ne sais rien, mais Paris n’a pas de mystère pour moi. Dans quarante-huit heures, je l’aurai sondé jusque dans ses recoins les plus infimes, et j’aurai découvert la comtesse. Seulement…
Il s’interrompit brusquement. Puis il reprit après un moment de réflexion :
— Voilà la question à résoudre ; la comtesse, redoutant sans cesse le retour de son mari, a dû attendre la dernière heure pour se rendre chez la sage-femme ; et il est plus que probable qu’elle est devenue mère au moment où nous parlons. Son état exige donc les plus grands ménagements, et peut-être ne pourrait-elle être transportée ici sans courir risque de la vie. Or, quel parti prendre ? L’exposer à un danger de mort pour la soustraire à la révélation terrible et presque inévitable qui résulterait de son absence, ou bien songer avant tout à sauver sa vie et lui donner tous les soins qui lui sont indispensables en mettant de côté toute autre préoccupation ; telle est la grave question sur laquelle je veux être fixé avant de me mettre à sa recherche.
Le cas était embarrassant.
La première inspiration du jeune homme fut de s’écrier :
— Sauvez-la ! Sa vie avant tout !
Mais après réflexion, il comprit que le premier soin du comte en apprenant la disparition de sa femme serait de lancer à sa recherche les plus habiles limiers de la police, que ceux-ci ne manqueraient pas de la découvrir dans le lieu où elle se croirait en sûreté avec son enfant, et que la révolution qu’elle en éprouverait dans sa situation l’exposerait peut-être à une mort foudroyante.
Après avoir communiqué à l’inconnu les réflexions qui le faisaient hésiter entre deux décisions également effrayantes :
— Je suis incapable de vous donner un avis, lui dit-il enfin, et je ne vois qu’un parti à prendre, c’est de consulter la comtesse elle-même, si Dieu veut que vous la retrouviez, et de vous en rapporter à son inspiration.
— C’est, en effet, le parti le plus sage et le plus prudent, répliqua l’inconnu ; je vais donc me mettre à la recherche de la comtesse, mais sans pouvoir vous affirmer qu’elle sera ici avant son mari, puisque désormais c’est elle qui doit en décider.
— Faites-moi savoir au moins, je vous en supplie, le résultat de vos recherches et l’état dans lequel vous l’aurez trouvée.
— Je vous le promets.
Il fit un mouvement pour sortir ; puis, revenant sur ses pas :
— Dans cette mystérieuse affaire il est un point important à éclaircir.
— Lequel ? demanda vivement Gaston.
— En montant dans le fiacre qui l’amenait chez la sage-femme de la rue Sainte-Anne, la comtesse a donné naturellement cette adresse au cocher, comment se fait-il donc qu’elle ne soit pas arrivée à cette destination ? Il y a évidemment là -dessous une intervention mystérieuse, intéressée… qu’il faut absolument découvrir et que je vous ferai bientôt connaître, je l’espère.
Saluant Gaston de la main, il partit comme il était venu, c’est-à -dire par la porte du petit salon.
VII
MONSIEUR BADOIR
Après avoir traversé le petit salon, le mystérieux visiteur, dans lequel le lecteur a reconnu sir Ralph, s’engagea dans un couloir sombre, au bout duquel il trouva à tâtons une porte qui s’ouvrit d’elle-même à son approche.
Un homme l’attendait derrière cette porte.
C’était François, le cocher du comte de Sinabria.
Il s’inclina devant sir Ralph, qui lui glissa un billet de banque dans la main en lui murmurant ces mots à l’oreille :
— Un mot à la poste dès qu’il y aura du nouveau.
Le cocher salua, et sir Ralph descendit l’escalier plongé dans les ténèbres, comme le corridor qu’il venait de traverser.
Il passa devant la loge du concierge sans rien dire et trouva la porte cochère entr’ouverte.
C’était une attention de François.
Une voiture l’attendait devant l’hôtel, voiture de maître élégante et confortable.
Il s’y jeta en disant à son cocher :
— Rue Cassette, 15.
La voiture partit, et dix minutes après il était arrivé.
C’était une maison de médiocre apparence, dont la porte à un seul battant, le vestibule étroit et l’escalier en bois à balustres lourds et massifs avaient une physionomie claustrale.
— M. Badoir ? demanda sir Ralph à la concierge qui travaillait dans un grand fauteuil, devant un bon feu et à la lueur d’une bonne lampe.
— Au troisième, à droite, répondit la vieille d’une voix pour ainsi dire ouatée, tant elle était calme, reposée et incolore.
Sir Ralph se mit à gravir l’escalier.
Arrivé au troisième étage, il vit à la droite du palier une double porte garnie en cuir vert et capitonnée.
Un paillasson épais, en crin végétal, était jeté au bas de cette porte, dont la mesure avait été prise avec un soin si minutieux, qu’il en touchait exactement les deux montants.
— Simplicité, confort, propreté méticuleuse et régularité mathématique, murmura sir Ralph en examinant chaque détail, on dirait la demeure d’un chanoine. M. Badoir est laïque, mais il est de la fabrique de Saint-Sulpice et il reçoit beaucoup de prêtres, cela se devine avant même d’avoir franchi le seuil de son appartement.
Il tira discrètement le cordon de la sonnette.
La porte s’ouvrit bientôt et il se trouva en face d’une domestique de cinquante ans environ, courte, grasse, à la physionomie calme et discrète, et portant le costume et la coiffure bretonnes.
— M. Badoir est-il chez lui ? demanda sir Ralph.
— Oui, monsieur, répondit la Bretonne avec une légère révérence, mais à cette heure-ci…
— Dites-lui que c’est la personne qui lui a écrit hier et dont il attend la visite.
La servante sortit et revint bientôt.
— Monsieur vous attend, dit-elle à sir Ralph en marchant devant lui une bougie à la main.
Ils traversèrent un salon, dont la cheminée offrait un détail original ; c’était, à droite et à gauche d’une pendule de style Empire, deux flambeaux de bronze doré, garnis de bougies roses, et sous verre, comme la pendule.
La Bretonne ouvrit une porte et sir Ralph entra.
La pièce dans laquelle on l’introduisait était en parfaite harmonie avec le reste.
Elle était vaste, carrée, garnie de douze chaises recouvertes en crin noir, rangées le long du mur avec symétrie, et d’un bureau en acajou devant lequel M. Badoir travaillait à la clarté d’une lampe fort simple, mais excellente, à en juger par la lumière claire et blanche qui en rayonnait.
Un feu de bois flambait dans la cheminée, dont le carreau était soigneusement balayé, et répandait partout une chaleur tempérée.
M. Badoir était un homme de plus de cinquante ans, maigre, nerveux, dont le front large et contracté, les yeux recouverts d’épais sourcils en broussailles, les traits anguleux et la bouche comprimée, dénotaient un esprit positif, un caractère prudent et réfléchi.
C’était tout ce qu’on lisait d’abord sur cette tête impassible.
— Sir Ralph ? demanda-t-il en sondant le visiteur d’un rapide coup d’œil.
Celui-ci s’inclina.
M. Badoir lui fit signe de prendre place sur une chaise, qui avait été approchée par la Bretonne, sans doute.
Sir Ralph se rendit à cette invitation, tout en examinant à la dérobée le personnage auquel il avait affaire.
— Monsieur, dit M. Badoir après avoir attendu un instant, vous me faites savoir par votre lettre que vous avez une grande affaire à me proposer.
Sir Ralph fit un signe affirmatif.
— Je dois vous prévenir tout d’abord, reprit M. Badoir d’un ton bref et un peu cassant, que, s’il s’agit d’argent, je n’en ai pas ; maintenant, parlez. Qu’avez-vous à me dire ?
— Il ne me resterait plus qu’à vous dire adieu si je prenais vos paroles au pied de la lettre, répondit sir Ralph avec calme, car c’est précisément d’argent qu’il s’agit.
— Alors, monsieur, inutile d’aller plus loin ; je n’en ai pas, je vous le répète.
— Hélas ! monsieur, j’ai eu affaire dans ma vie à vingt hommes d’argent, à vingt banquiers, veux-je dire, et tous sans exception ont débuté par la même déclaration : ils n’avaient pas d’argent.
M. Badoir eut un geste plein de hauteur.
— Eh bien ! soit, vous n’avez pas d’argent ; alors, c’est une autre affaire que je vais vous proposer, ou plutôt c’est la même affaire, avec une autre combinaison, d’après laquelle vous pourrez me rendre le même service sans débourser un sou.
— Je vous écoute, monsieur, dit M. Badoir d’un air résigné.
— Monsieur Badoir, reprit le jeune homme, je veux me marier.
— Ah ! fit celui-ci.
— Et, naturellement, je veux faire un riche mariage ; or, étranger et sans relations dans Paris, quelle confiance puis-je inspirer ? Comment pénétrer dans les grandes familles parmi lesquelles je voudrais choisir une épouse. Il y a aujourd’hui tant de chevaliers d’industrie qui, après avoir laissé derrière eux les plus déplorables antécédents, viennent audacieusement étaler à Paris un luxe auquel on se laisse toujours prendre, que je ne veux pas m’exposer à être rangé dans cette triste catégorie. Je ne connais qu’un moyen, pour un étranger, d’être honorablement accueilli dans le monde où je voudrais avoir accès ; ce moyen, c’est d’y être patronné par un homme d’une honorabilité irréprochable, connu pour la pureté de ses mœurs et l’austérité de ses principes religieux, un homme de votre caractère enfin, monsieur Badoir, et voilà le service que j’attends de votre obligeance.
À cette conclusion inattendue, l’air ennuyé et résigné de M. Badoir disparut tout à coup pour faire place à l’expression d’une profonde surprise.
— Moi ! fit-il enfin, stupéfait et indigné à la fois, moi, monsieur Badoir, que je commette l’imprudence de vous patronner, vous que je ne connais pas, dans un monde où je suis estimé et honoré de tous ? Ah çà , qui êtes-vous ? D’où sortez-vous ? De quoi vivez-vous ? Est-ce que je sais rien de tout cela, moi ? Et non-seulement votre situation et vos antécédents, mais l’étrangeté de votre démarche, pour ne pas dire plus, ne peuvent que m’inspirer une extrême défiance ; aussi ne puis-je croire que vous m’adressez sérieusement une pareille demande.
— C’est pourtant ce qu’il y a de plus sérieux, je vous le jure, monsieur Badoir, répliqua tranquillement sir Ralph.
— Eh bien, monsieur, dit sèchement M. Badoir, je refuse.
— Alors, monsieur Badoir, dit le jeune homme en cinglant légèrement sa botte du bout de son stick, je me vois forcé de revenir à ma première idée.
— Quelle est cette idée ?
— C’est de vous emprunter cent mille francs.
— En vérité ! dit M. Badoir avec une impertinente ironie, et sur quel gage ?
Sir Ralph se leva et le regardant froidement en face :
— Sur l’engagement que je prendrai vis-à -vis de vous de ne pas vous envoyer au bagne, monsieur Badoir.
— Misérable ! s’écria le banquier, rouge de colère et d’indignation.
— Asseyez-vous donc, monsieur Badoir, lui dit sir Ralph du ton le plus poli, et causons un peu de la comtesse de Sinabria.
À ce nom, M. Badoir, changeant tout à coup de physionomie, pâlit affreusement et s’affaissa dans son fauteuil.
VIII
UN HOMME SUR LE GRIL
D’abord étourdi sous ce coup de massue, M. Badoir, caractère fortement trempé, recouvra bientôt sa présence d’esprit pour faire face à l’ennemi qui se dressait si inopinément devant lui.
— Monsieur, lui dit-il, je me suis laissé abattre un instant par l’excès de l’indignation, mais je me demande ce que vient faire ici le nom de la comtesse de Sinabria, et je ne puis comprendre que…
Sir Ralph l’interrompit d’un geste :
— Tout à l’heure, monsieur Badoir, lui dit-il, nous aborderons ce sujet… délicat ; mais d’abord, permettez-moi, quoi qu’en puisse souffrir votre modestie, de m’extasier un instant sur votre profonde habileté. Savez-vous qu’il y a du génie dans le choix de votre rue et de la maison que vous habitez ? Savez-vous que l’homme le plus défiant se sentirait tout à coup pénétré de respect et de vénération pour celui qui possède un pareil mobilier, une servante de cette physionomie, une concierge de cette encolure, une porte si béatement capitonnée, un carreau si rouge et si brillant d’encaustique, et enfin, car c’est là le bouquet, ces deux flambeaux sous verre, témoignage si éloquent, si caractéristique de la candeur de votre âme et de l’innocence toute patriarcale de vos mœurs ? Ah ! monsieur Badoir, vous êtes un observateur d’une haute portée, un Balzac pratique, tout simplement, et je vous jure que j’éprouve pour vous une véritable admiration.
— Monsieur, répliqua M. Badoir avec dignité, je me suis logé, meublé et entouré conformément à mes goûts, et les profondes combinaisons qu’il vous plaît de m’attribuer sont bonnes pour les chevaliers d’industrie dont vous parliez tout à l’heure ; ceux-là ont besoin d’avoir constamment un masque sur le visage et de jouer la comédie jusque dans les moindres actes de leur existence.
— Parfaitement raisonné, monsieur Badoir, répliqua sir Ralph sans se départir de son calme, la question est de savoir seulement où vous prenez ces chevaliers d’industrie et c’est ce que je vous mettrai à même de décider tout à l’heure, après vous avoir félicité de deux autres traits de génie, l’idée de vous faire recevoir membre de la fabrique de Saint-Sulpice et celle de vous entourer presque exclusivement d’ecclésiastiques. On a beau crier contre les prêtres, monsieur Badoir, c’est encore parmi eux qu’on trouve le plus de moralité, et les vils coquins qui, comme Tartuffe, prennent le masque de leurs vertus comme la meilleure amorce à jeter aux honnêtes gens qu’ils veulent duper, attestent par cela même la haute estime dont ils ont su se rendre dignes. Et maintenant que j’ai rendu hommage à votre habileté, parlons un peu de la comtesse de Sinabria, votre belle cousine.
— La comtesse, ma parente en effet, répondit M. Badoir avec une froideur pleine de dignité, est une personne dont j’estime trop le caractère pour tolérer que son nom soit mêlé à un pareil entretien.
— Nous l’y mêlerons pourtant, monsieur Badoir, quelle que soit l’estime que je professe moi-même pour sa personne, car non-seulement elle n’est pas aussi étrangère que vous paraissez le croire à l’affaire qui m’amène ici, mais je pense qu’elle contribuera puissamment à son succès.
— Prétention aussi bizarre qu’insensée, monsieur.
Sir Ralph se contenta de sourire.
— Monsieur Badoir, reprit-il, si vous aimez la comtesse de Sinabria autant que vous l’estimez, vous apprendrez avec peine l’étrange aventure dont elle vient d’être victime.
— Victime ! elle, ma cousine, s’écria le banquier avec l’expression d’une vive inquiétude.
— Vous l’ignoriez ? dit sir Ralph avec une imperceptible ironie, je m’en doutais. Eh bien ! monsieur Badoir, voici ce qui est arrivé à cette jeune et belle comtesse… Mais je vous en préviens, cela est si extraordinaire, que vous aurez peine à y croire.
— Dites toujours, monsieur, répliqua M. Badoir en essayant de cacher sous un air de vif intérêt l’agitation à laquelle il était en proie.
— Voici donc l’histoire qu’on raconte : il paraît que la belle comtesse étant enceinte et sur le point de devenir mère…
— C’est impossible, monsieur ! s’écria M. Badoir, ce seul détail prouve tout de suite la fausseté de votre histoire.
— Comment cela, monsieur ?
— La comtesse est la plus honnête femme que je connaisse, et le comte de Sinabria, son mari, est en Hollande depuis plus d’une année.
— Le rapprochement de ces deux faits, cette longue absence et cette prétendue grossesse, impliquent en effet une contradiction flagrante, répondit gravement sir Ralph, quoique pourtant on ait vu quelquefois…
— Je vous répète, monsieur, que c’est impossible.
— Vous paraissez y tenir beaucoup, monsieur.
— Ne s’agit-il pas de l’honneur de ma parente ?
— En effet ; mais admettons un instant cette calomnie et laissez-moi poursuivre mon histoire, malheureusement trop vraie quant à la suite. Dans cette situation tout exceptionnelle, la comtesse, voyant approcher le moment critique et redoutant l’arrivée de son mari, qu’elle attendait chaque jour, résolut de se rendre chez une sage-femme. C’est là , monsieur Badoir, que l’aventure prend une tournure aussi inquiétante que fantastique. Le jour fatal venu, elle attend le soir, fait venir un fiacre, y monte avec peine et, déjà en proie à de cruelles souffrances, donne ordre au cocher de la conduire rue Sainte-Anne, où elle était attendue. Vous croyez, naturellement, qu’elle est arrivée rue Sainte-Anne ? Eh bien, pas du tout, elle n’y a pas paru, et, depuis deux jours qu’elle a quitté son hôtel, on ne sait ce qu’elle est devenue. Eh bien, que dites-vous de cela, monsieur Badoir ?
Le banquier fut un instant sans pouvoir répondre. Par un immense effort de volonté, il parvint à imprimer à ses traits un calme imperturbable ; mais un léger tremblement trahissait ce qui se passait en lui et démentait cette apparente tranquillité.
— Eh ! monsieur, dit-il enfin d’une voix altérée, je ne nie pas la disparition momentanée de la comtesse, et j’avoue que je ne sais comment l’expliquer ; mais quant à la façon dont on interprète son absence, je n’hésite pas à déclarer qu’elle est invraisemblable, absurde, inadmissible.
— Je le crois comme vous, monsieur Badoir, répliqua sir Ralph ; au reste, c’est un point sur lequel on ne tardera pas à être fixé.
— Comment cela ? demanda le banquier avec une vivacité qu’il regretta aussitôt, car il reprit en changeant de ton :
— Comment espère-t-on arriver à découvrir…
— Grâce à une circonstance vraiment providentielle.
— Ah ! fit M. Badoir.
— Une fruitière qui demeure presque en face de l’hôtel de Sinabria a distingué le numéro du fiacre sur une de ses lanternes et l’a retenu, parce qu’il correspondait précisément à celui que venait de tirer son fils, conscrit de cette année.
— Étrange fatalité !… étrange et heureuse, balbutia M. Badoir, auquel il devenait de plus en plus difficile de dissimuler son trouble.
— Cette circonstance… heureuse, comme vous dites, ayant été aussitôt portée à la connaissance du commissaire de police, le mystère qui entoure cette inquiétante disparition sera, sans nul doute, éclairci d’ici ce soir.
Une pâleur subite se répandit sur les traits de M. Badoir à ces derniers mots.
— Oui, oui, balbutia-t-il en essayant un sourire qui ne produisit qu’une affreuse contraction de la bouche, il est impossible qu’avec ce numéro on ne découvre pas ce soir… oui, ce soir…
Il fut brusquement interrompu par un éclat de rire dont l’expression méphistophélique le fit frissonner.
— Qu’avez-vous donc, monsieur ? dit-il à sir Ralph, qui le regardait sans cesser de rire.
— Ah çà ! monsieur Badoir, s’écria celui-ci, vous ne voyez donc pas que, depuis une heure, je vous fouille le cœur et l’âme comme un chirurgien fouille une plaie du bout de son scalpel ? Vous ne comprenez donc pas que j’appelle tour à tour sur votre visage le trouble et la pâleur, la terreur et l’angoisse pour y saisir la preuve de votre crime ? Je vous ai menti en vous parlant de ce numéro de fiacre et des indications qu’il allait fournir à la police. La police, non, ce n’est pas elle que vous avez à craindre en ce moment, mais un homme non moins perspicace, tout aussi redoutable, et cet homme, c’est moi !
IX
LE MASQUE TOMBE
M. Badoir contemplait sir Ralph avec une expression de stupeur et d’ahurissement qu’il ne songeait même pas à dissimuler.
Celui-ci n’était plus le même homme, il semblait transfiguré.
Une vapeur incandescente semblait jaillir de son regard, d’où se dégageait une audace indomptable et froide, une résolution implacable, une pénétration presque infaillible et une indifférence du danger qui trahissait tout un passé de luttes et de violences.
Après avoir magnétisé le banquier au point de le contraindre à déposer son masque et à renoncer à dissimuler ses impressions, il reprit :
— Non, monsieur Badoir, la police ne sait rien et ne saura rien, quant à présent du moins, car la vie d’une femme et l’honneur d’une famille sont en jeu dans cette affaire, et, à moins qu’on m’y contraigne plus tard, je veux éviter un scandale. Mais moi, je sais ce que la police ignore, je sais, non le numéro du fiacre qui a enlevé la comtesse de Sinabria, mais mieux que cela, car je connais le cocher lui-même.
M. Badoir plongea brusquement son visage dans ses deux mains.
Il se sentit pâlir et ne voulait pas laisser voir son émotion.
— Cela ne veut pas dire qu’il soit à ma discrétion et qu’il m’ait révélé la retraite où il a conduit la comtesse, dit sir Ralph en observant le banquier à la dérobée ; non, je vous l’avoue, je n’ai pu lui arracher son secret, qui lui a été largement payé, sans doute, pour qu’il ne le trahisse pas, et c’est sur vous seul que j’ai compté pour être renseigné sur ce point.
M. Badoir releva la tête et sir Ralph remarqua que le trouble qui, tout à l’heure, bouleversait son visage, se dissipait rapidement sous l’influence de ces dernières paroles.
Un sourire ironique se dessina sur les lèvres du jeune homme, et il attendit.
Quand il se sentit tout à fait maître de lui-même, M. Badoir se tourna vers sir Ralph, et du ton le plus dégagé :
— Monsieur, lui dit-il, je suis vivement ému de la disparition de la comtesse de Sinabria et des dangers auxquels elle doit être exposée, car elle est évidemment victime de quelque guet-apens ; j’en suis ému au point d’avoir divagué plusieurs fois en vous écoutant, comme vous l’avez pu voir ; aussi suis-je désolé de ne pouvoir vous donner aucun renseignement sur cette triste aventure, que j’ignorais encore il y a une heure.
— Non-seulement, je vous croyais parfaitement renseigné sur cette affaire, reprit sir Ralph, mais je pousse même la franchise jusqu’à vous avouer que je n’étais pas éloigné de vous croire le complice, peut-être même l’instigateur de l’infâme guet-apens que vous déplorez comme moi.
— Monsieur ! s’écria M. Badoir qui se rassurait de plus en plus.
— Continuons de causer tranquillement, monsieur Badoir, dit sir Ralph d’un ton plein de bonhomie, et laissez-moi vous dire sur quels arguments je basais ma supposition.
— Hâtez-vous donc, monsieur, car je n’ai pas de temps à perdre.
— Je serai bref. Vous êtes riche, fort riche, monsieur Badoir, car l’opinion publique vous attribue un million de fortune, joli chiffre pour un homme qui est venu à Paris en sabots, comme il s’en vante parfois ; mais, toujours au dire de l’opinion, vous êtes aussi cupide que riche, vos désirs insatiables n’ont pas de limites et aucun scrupule ne vous arrête quand il s’agit d’accroître cette fortune, déjà si considérable.
M. Badoir voulut s’emporter.
Sir Ralph se hâta de lui couper la parole et poursuivit :
— Or, supposons que vous ayez un oncle à Calcutta.
M. Badoir tressaillit et parut frappé de stupeur.
Sir Ralph n’eut pas l’air de s’en apercevoir et continua :
— Supposons qu’inspiré par cette dévorante cupidité, vous ayez pris des informations sur cet oncle, auquel personne ne songeait dans votre famille, qu’on vous ait répondu : 1° qu’il était riche de sept à huit millions ; 2° qu’il était resté célibataire. Supposons encore, car on peut tout supposer, que vous et votre jeune cousine, la comtesse de Sinabria, représentiez à vous deux une des trois têtes ayant droit à cet immense héritage, il est évident que votre intérêt était de supprimer cette cohéritière et naturellement l’enfant qui naîtrait d’elle, si le malheur voulait qu’elle en eût un.
M. Badoir avait de nouveau perdu toute son assurance. Il semblait être sous l’influence d’un mauvais rêve.
— Je dis que tel était votre intérêt, poursuivit sir Ralph ; restait à savoir si tels étaient vos instincts et si vous étiez homme à sacrifier l’héritière pour conquérir l’héritage. C’est ce que je voulais savoir. Je m’informai, j’épiai, j’observai, et après avoir soumis votre caractère à une minutieuse analyse, après vous avoir fait poser devant moi comme l’accusé devant la cour, je me répondis à moi-même : Sur mon honneur et sur ma conscience, oui, M. Badoir est coupable, c’est lui qui a commis le crime.
Le banquier se leva brusquement et se mit à marcher à grands pas dans son cabinet.
Le sang lui était monté tout à coup à la tête, il étouffait.
Il avait besoin de mouvement. Il lui semblait sentir les symptômes de l’apoplexie.
Sir Ralph le regardait avec un calme qui ne faisait qu’accroître son supplice.
Quand, au bout de quelques minutes, il eut recouvré un peu de sang-froid :
— Monsieur, dit-il à sir Ralph, je ne prendrai pas la peine de réfuter une imputation basée sur des hypothèses aussi fausses, aussi absurdes l’une que l’autre.
— Eh bien, moi, monsieur, répliqua sir Ralph, je me donnerai la peine de vous apprendre comment s’est accompli l’enlèvement de la comtesse de Sinabria. Connaissez-vous François, monsieur Badoir ?
— Nullement, monsieur.
— Vous avez la mémoire courte, monsieur, car c’est ce François, cocher du comte de Sinabria, qui, ayant surpris le secret que sa maîtresse prenait tant de peine à dissimuler, vous en a fait la confidence, confidence habilement provoquée et largement payée par vous : c’est encore lui qui, ayant surpris entre Fanny et sa maîtresse un entretien dans lequel se décidaient le jour et l’heure où celle-ci quitterait son hôtel pour se rendre en fiacre chez la sage-femme de la rue Sainte-Anne, se chargea d’avoir tous les soirs, à quelques pas de l’hôtel, vers l’époque désignée par la comtesse, un fiacre dont le cocher avait reçu d’avance vos instructions ; et ces instructions, voulez-vous que je vous dise en quoi elles consistaient ? Conduire la comtesse, qui ne connaît pas Paris, à l’extrémité de Plaisance, dans une masure isolée, habitée par la famille du cocher, une famille de bandits, dont la consigne était de n’appeler ni sage-femme, ni garde-malade, précaution excellente pour être promptement débarrassé des deux héritiers : la mère et l’enfant.
Voilà la vérité sur la disparition de la comtesse de Sinabria, monsieur Badoir ; le cocher n’a rien dit, mais François m’a tout conté. Et maintenant, il ne me reste plus qu’à faire connaître l’histoire à la préfecture de police, avec l’indication du lieu où l’on trouvera la victime ; si vos intentions ont été exactement suivies, on y trouvera deux cadavres, et alors, monsieur Badoir, je n’ai pas besoin de vous dire ce qui vous attend ; ce n’est pas au bagne que vous iriez, comme je vous le disais tout à l’heure, mais plus haut.
Sir Ralph se tut.
M. Badoir, cette fois, ne tenta pas de répondre.
Il était livide et fixait sur le jeune homme un regard halluciné.
Cinq minutes s’écoulèrent ainsi ; ce fut sir Ralph qui rompit le silence.
— Monsieur Badoir, dit-il d’un air dégagé et presque souriant, voilà bien des bavardages et des divagations ; revenons donc, je vous prie, à notre affaire. Voyons, je vous disais que vous pouviez m’être utile, soit en me prêtant cent mille francs, indispensables pour me poser dans le monde, soit en me présentant dans certaines familles, où le patronage d’un homme aussi estimé, aussi recommandable que vous me vaudra le meilleur accueil et me mettra à même de contracter un brillant mariage. Trouvez-vous ces prétentions déraisonnables et, dans le cas contraire, quel est celui de ces deux services qu’il vous convient de me rendre ?
Après un moment de silence, pendant lequel il se demanda sans doute sur quel ton il devait le prendre avec celui qui venait lui déclarer si ouvertement la guerre, M. Badoir comprit que la prudence lui commandait de courber la tête et d’accepter sa défaite.
— Quant aux cent mille francs, répondit-il, je vous assure qu’il me serait difficile de les trouver et qu’on vous a singulièrement exagéré l’état de ma fortune.
— Je vous crois sur parole, n’en parlons donc plus.
— Pour ce qui est de vous présenter dans le monde, vous devez savoir, puisque mes habitudes vous sont si bien connues, que je n’y vais presque jamais.
— Je le sais, mais vous allez fréquemment chez les différents membres de votre famille.
— Et c’est là que vous voulez être présenté ? s’écria Badoir en frissonnant.
— Oui, car c’est là qu’est la jeune fille dont je veux faire ma femme, la plus délicieuse créature qui se puisse rêver, une enfant, un ange, une fée tout à la fois.
M. Badoir était atterré.
— Ça ou cent mille francs, décidez, dit sir Ralph d’un ton résolu.
Après une longue hésitation, M. Badoir répondit en détournant les yeux et en rougissant légèrement :
— Eh bien… je vous présenterai… Mais le nom du parent qui…

— Je vous le ferai connaître dans quelques jours, répondit sir Ralph.
Il ajouta en se levant :
— Quant à la comtesse, dans quarante-huit heures elle sera morte ou sauvée, je vous le ferai savoir aussitôt.
X
UNE FAMILLE ASSORTIE
En traversant le salon, reconduit par M. Badoir, sir Ralph dit à celui-ci, en lui montrant les flambeaux qui l’avaient frappé !
— Quelle triomphante idée ! Oh ! croyez-moi, monsieur Badoir, gardez-les toujours sous verre, c’est un de vos prestiges, ce serait tout un plaidoyer en votre faveur si jamais vous aviez affaire à la justice.
M. Badoir ne jugea pas à propos de répondre.
Arrivé à la porte du palier, sir Ralph lui laissa, en partant, ce dernier avertissement :
— Surtout, monsieur Badoir, ne donnez jamais votre démission de membre de la fabrique, et gardez-vous de renoncer à vos soirées cléricales, votre salut est là en cas de danger. Allons, à bientôt, monsieur Badoir.
Le banquier avait éprouvé un saisissement en entendant ces deux recommandations, qui lui rappelaient la gravité de sa situation, mais sir Ralph, qui n’avait peut-être pas eu d’autre but, tout en affectant une parfaite bonhomie, feignit de ne pas remarquer cette impression et descendit rapidement l’escalier en murmurant :
— Je ne suis pas sorcier, monsieur Badoir, mais je parierais bien que vous n’allez pas passer tranquillement la soirée au coin du feu.
Arrivé rue Cassette, il prit place dans sa voiture, un élégant coupé qu’il louait au mois, et donna ordre à son cocher de le conduire rue Saint-Médard, à Plaisance.
— Et bon train, lui dit-il, vingt francs pour toi si j’y suis dans dix minutes.
Le cocher transmit cette recommandation à son cheval au moyen de deux coups de fouet cinglés sur les oreilles, et dix minutes après, la voiture s’arrêtait au coin de la rue Saint-Médard.
— Attends-moi là et ne t’impatiente pas, dit sir Ralph au cocher en sautant à terre, je ne reviendrai peut-être pas avant une heure.
Et il s’engagea d’un pas rapide dans la rue de Vanves.
À mesure qu’il avançait, les maisons qui bordaient cette rue, presque entièrement peuplée d’ouvriers, prenaient une physionomie de plus en plus sombre.
Bientôt il n’aperçut plus, se dessinant vaguement à droite et à gauche, que des maisons basses, des rez-de-chaussée à peine éclairés, des boutiques d’épiciers, de petits merciers et de liquoristes, dont l’intérieur, vaguement perceptible, lui rappelait les quartiers déserts et les rues fangeuses d’Aubervilliers.
Enfin, la rue se terminait par quelques masures sinistres, isolées l’une de l’autre, et dont quelques-unes, s’écartant de l’alignement, dessinaient çà et là , à travers champs, leurs sombres silhouettes, aplaties sur le sol ou blotties dans quelques plis de terrain, comme des fauves qui se rasent et guettent une proie.
Sir Ralph quitta brusquement la rue et se dirigea, par un sentier à peine distinct, vers une de ces étranges demeures, où nous allons le précéder de quelques instants.
Là , dans une pièce assez vaste, mais basse de plafond et faiblement éclairée par une petite lampe dont le verre était cassé et dont l’abat-jour noir, huileux et tout déchiré, penchait et tenait à peine sur son fil de fer, quatre personnes, deux hommes et deux femmes, étaient réunies, groupées devant un feu de poussier de mottes.
Le plus âgé des quatre était un homme de cinquante à soixante ans, mais qui n’en paraissait guère plus de quarante, tant il était vigoureux et solidement bâti.
Sa barbe noire n’avait pas été faite depuis plus de huit jours, ses cheveux grisonnants semblaient n’avoir jamais été couchés par le peigne, et ses petits yeux, d’un jaune clair, avaient une expression de férocité qui le rendait effrayant.
L’une des deux femmes, sa compagne sans doute, était accroupie devant le feu, dont la faible lueur mettait en saillie son front bas et déprimé, ses joues creuses, son menton de galoche, sa bouche entrouverte, ses dents jaunes et largement espacées, sa mâchoire inférieure lourde, massive, solide, dépassant hideusement la mâchoire supérieure et rappelant vaguement à l’imagination la gueule de certains carnassiers.
Debout, à quelques pas derrière elle, se profilait harmonieusement dans la pénombre une jeune fille de dix-huit à vingt ans, aux traits bistrés, mais éclatants de santé, à la taille cambrée, à l’œil noir et ardent.
Le quatrième personnage, jeune garçon de quinze à seize ans, dont la frêle charpente, le teint plombé, les cheveux d’un roux clair et l’œil bleu faïence tranchaient avec la robuste apparence des trois autres, fumait une pipe hideusement culottée, debout dans le coin le plus sombre de la pièce.
Celui-ci paraissait calme, insouciant, tandis que les autres, l’oreille tendue, le regard souvent tourné vers la porte, semblaient dans l’attente de quelque grave événement.
Un profond silence régnait entre eux et rendait le tableau plus effrayant encore.
— Les volets sont-ils bien fermés ? demanda enfin le vieillard d’une voix enrouée.
— Je les ai fermés moi-même, répondit la vieille sans tourner la tête.
— C’est que nous avons des ennemis dans le quartier. J’en ai vu hier encore qui rôdaient autour de la maison pour épier ce qui se passe chez nous et aller nous débiner près des sergents de ville.
— Des envieux ! dit le gamin en parcourant la pièce d’un regard ironique.
— Que je leur aurais bien cassé une patte, si nous n’étions pas si mal notés ! mais dès qu’il arrive quelque chose aux environs, c’est à nous qu’on s’en prend.
— Fais ce que dois, advienne que pourra ! dit sentencieusement le gamin en lâchant une bouffée.
— Pour quelle heure, le rendez-vous ? demanda le vieillard à la jeune fille.
— Neuf heures.
— Le particulier est jeune.
— Vingt-cinq ans à peine.
— Quelle apparence ?
— Grand, large des épaules, la taille cambrée, l’air résolu.
— Blond ou brun ?
— Tout ce qu’il y a de plus brun.
— Tant pis, les bruns ne sont pas faciles.
— Non, mais inflammables, dit le gamin, donc il viendra.
— Le crois-tu, Malvina ?
— J’en suis sûre.
— Comment ça s’est-il passé ?
— Il m’a suivie depuis le Luxembourg jusqu’au bout de la rue de Vanves.
— Merci ! plus que ça de flamme ! fit le gamin, c’est pas un homme, ça, c’est une succursale du Vésuve.
— Tais ton bec, toi, Arthur.
— Oui, pépère, répondit celui-ci avec un respect ironique.
— Et pour lors ? reprit le père en se tournant vers la jeune fille.
— Eh bien, quoi ! il m’a débité toutes les balivernes en usage, me trouvant adorable, m’affirmant que j’avais une tête angélique, me suppliant de le recevoir, voulant passer ses jours à mes pieds et me faire un sort de duchesse.
— Il vidait son carquois, ce jeune homme, murmura Arthur.
— Enfin ? demanda le vieillard avec impatience.
— Quand je lui ai dit que je consentais à le recevoir, il a été ravi.
— Une chaumière et son cœur ! s’écria Arthur.
— Mais quand je lui eus montré la maison où je lui ai affirmé que je demeurais seule, il a paru désenchanté.
— L’effet de la chaumière, dit le gamin ; il est certain qu’elle ne rappelle Trianon que de bien loin. Et les bergers qui l’habitent, donc ! c’est ceux-là qui manquent de panetières et de houlettes ! oh ! là ! là !
— Bref, il viendra ?
— Il voulait venir le soir même, répondit Malvina.
— C’était trop tôt.
— Justement, rien n’était prêt pour le recevoir, dit la jeune fille avec un sombre sourire et en appuyant sur ces derniers mots.
— Et tu crois qu’il viendra ce soir ?
— J’en suis sûre.
— Et la braise ? demanda Arthur.
— Je ne sais s’il en aura, mais il a des diamants aux doigts et une montre avec une magnifique chaîne.
— On s’en contentera.
— Pourvu qu’il ne se défie pas et qu’il vienne seul, dit le père.
— Je le lui ai fait jurer, et d’ailleurs il ne se défie nullement.
— À preuve, qu’il te trouve un galbe angélique, dit Arthur.
— Pourvu que ça ne rate pas encore comme l’affaire de cette satanée comtesse qui devait nous rapporter deux billets de mille et qui nous a passé devant le nez, dit la vieille en ravivant le poussier de mottes du bout de ses pincettes.
— C’est dommage, répliqua le gamin, en voilà une qui eût été dorlotée ! Et l’enfant ! le pauvre petit chérubin ! c’est celui-là qui eût été à la noce !
Le vieillard allait répliquer quand la vieille, levant la main vers lui et tendant l’oreille, lui dit à voix basse :
— Claude, j’entends marcher dans le sentier.
— Vite, s’écria Arthur, donnons un aspect respectable à la maison et dérobons-nous.
Et, s’emparant de trois tasses et d’un litre d’eau-de-vie posés sur la cheminée, il disparut par une porte le long de laquelle étaient suspendus quelques vêtements de femme, ce qui la dissimulait complètement.
Claude et sa femme le suivaient en entendant frapper au dehors.
— As-tu ton couteau ? demanda la vieille à voix basse.
— Oui, répondit Claude en refermant la porte.
— Entrez, cria alors la voix jeune et fraîche de la jeune fille.
XI
LA FIN D’UN RENDEZ-VOUS
Sur l’invitation de la jeune fille, la porte s’ouvrit et un jeune homme entra.
Il répondait assez exactement au portrait qu’elle en avait tracé.
Grand, bien fait, la poitrine et les épaules développées, il avait l’air déterminé, comme elle l’avait dit ; mais le trait dominant et caractéristique de sa physionomie était un mélange de distinction et d’urbanité qui trahissait à la fois une nature d’élite et un homme du meilleur monde.
À peine entré, un léger trouble se manifesta sur ses traits, où se lisait clairement une profonde déception.
Au lieu de s’avancer vers la jeune fille, qui l’examinait avec surprise et paraissait le trouver tout autre qu’elle ne l’avait vu la veille à la lueur du gaz, il parcourait du regard cet étrange intérieur, presque entièrement dépourvu de meubles, où tout attestait non-seulement la misère, mais encore et surtout le désordre, la paresse et l’incurie. Puis ses yeux se portaient sur la jeune fille, si belle et si superbement campée dans l’ombre qui enveloppait et poétisait ses formes, et il semblait à la fois stupéfait et affecté de ce triste contraste.
— Tant de pauvreté vous étonne et détruit toutes vos illusions, n’est-ce pas, monsieur ? lui dit Malvina en faisant un pas vers lui.
— La pauvreté ? Oh ! non, mademoiselle, non-seulement je respecte la pauvreté, mais elle m’attire, elle a toutes mes sympathies.
Il ajouta en jetant un nouveau regard autour de lui :
— Mais…
Il hésita un instant à dire sa pensée, puis il se tut. À l’expression de sa physionomie, Malvina comprit ce qui se passait en lui et fut saisie tout à coup d’horreur et de dégoût pour ce hideux tableau, au milieu duquel elle avait vécu jusque-là avec insouciance.
Puis, secouant la tête d’un air décidé, elle se rapprocha encore du jeune homme en lui disant :
— Vous avez désiré me voir, monsieur, j’y ai consenti, vous voilà chez moi, permettez-moi de vous demander ce que vous avez à me dire.
Le jeune homme la regarda fixement.
Son teint bistré, ses grands yeux noirs, sa taille élégante parurent faire sur lui une profonde impression, et, subissant peu à peu le prestige de sa beauté, il parvint à l’isoler complètement du milieu qui l’entourait et trouva même que ce contraste était pour elle comme une fantastique auréole qui la faisait plus complètement belle.
— Vous me demandez ce que j’ai à vous dire, répondit-il, j’ai d’abord à vous demander pardon du ton que j’ai pris avec vous hier soir, car, je vous le répète, j’ai le respect de la pauvreté, et, vous voyant pauvre, j’aurais dû vous parler avec plus d’égards.
La jeune fille parut étonnée de ce langage.
Elle n’avait jamais soupçonné de pareils sentiments, et elle se demandait sérieusement si elle devait considérer ce jeune homme comme un modèle de délicatesse ou comme un ridicule maniaque.
— Vous paraissez surprise, reprit le jeune homme, vous n’êtes pas la seule ; il paraît que ce qui me semble tout simple est fort extraordinaire, car je passe généralement, aux yeux de mes amis, pour un don Quichotte, un rêveur, un insensé, dont la folie, douce et inoffensive, doit être traitée avec ménagement ; aussi se contentent-ils de sourire quand j’exprime devant eux des opinions et des sentiments entièrement opposés à leur manière de voir. Ainsi, pour citer un exemple entre mille, si nous rencontrons, dans les jardins publics, dans les squares, sur les boulevards, des familles d’ouvriers ou de petits marchands, leur toilette et surtout celle de leurs enfants, qu’ils traitent de singes habillés, excitent leur gaieté et deviennent pour eux une source de railleries et de bons mots ; moi, au contraire, c’est sur ces enfants-là que se porte mon attention et tout mon intérêt. Je pense à tout ce que ces accoutrements disgracieux et parfois grotesques ont coûté de peine et de privations aux pauvres parents, et, quand je les vois admirer naïvement ces petits êtres si étrangement fagotés, bien loin de les trouver ridicules, je me sens profondément attendri. J’éprouve les mêmes impressions quand je vois le soir des jeunes filles rentrer chez elles, après une longue journée de travail, qui leur produit à peine de quoi manger, et c’est sous l’empire d’un sentiment pareil que je vous ai abordée hier soir dans le jardin du Luxembourg. Je ne vous dirai pas que mes intentions étaient d’une pureté irréprochable, non ; j’avoue que votre beauté était pour beaucoup dans la sympathie que vous m’inspiriez, et que j’eusse donné tout au monde pour me faire aimer de vous.
— Sur ce point-là , au moins, répliqua la jeune fille d’un ton railleur, trop affecté pour être vrai, on ne vous accusera pas d’originalité, vous pensez et vous agissez comme le premier venu.
— Pas tout à fait, car voici quelle était mon intention : vous arracher à un entourage que je me figurais dangereux pour vous, vous mettre en apprentissage dans une maison honorable, exerçant une industrie lucrative, vous meubler et vous fournir le nécessaire pendant toute la durée de cet apprentissage, mais dans des conditions modestes ; puis, après avoir assuré votre avenir et vous avoir mise en position de n’écouter que les inspirations de votre cœur, et non les dures exigences de la misère, je serais venu vous dire : Voulez-vous m’aimer ? vous ferez de moi le plus fortuné des hommes, et j’apporterai tous mes efforts à vous rendre heureuse : en aimez-vous un autre et voulez-vous l’épouser ? Je mettrai tout en œuvre pour amener la réalisation de votre rêve, et, s’il ne faut que de l’argent pour lever les obstacles, ils disparaîtront, je vous le jure.
Si invraisemblable que cela puisse paraître, Malvina, dans le milieu ignoble où elle s’était développée, était restée inaccessible aux passions, et avait miraculeusement échappé à la débauche. Les grossières galanteries auxquelles elle avait été exposée dans le monde exceptionnel que fréquentait sa famille lui avaient inspiré, il faut l’avouer, plus d’indifférence que de dégoût et si elle n’avait pas été révoltée de certaines tentatives de séduction, elle y était au moins restée insensible.
En écoutant pour la première fois le langage que lui tenait ce jeune homme, si différent de tous ceux qu’elle avait vus et entendus jusque-là , elle sentit s’éveiller dans son cœur un monde d’impressions qui la bouleversaient délicieusement, et, quand il lui exprima, d’un accent pénétrant et d’une voix émue, avec quelle délicatesse il l’aimait, elle, fille et sœur de bandits, elle, associée à leur criminelle existence et complice de leurs infâmes guet-apens, alors, la honte de se trouver si indigne, l’orgueil d’être adorée de la sorte, une secrète volupté de cœur et un subit épanouissement de toutes les facultés, toutes ces sensations réunies faisant explosion en elle produisirent une véritable transfiguration.
L’effet fut si violent, si rapide et pour ainsi dire si foudroyant, qu’elle fut sur le point de saisir la main de celui qui venait de la transformer tout à coup et de la porter à ses lèvres.
Peut-être même eût-elle cédé à ce mouvement, si un incident ne fût venu glacer son sang dans ses veines.
Après avoir parlé, le jeune homme la contemplait avec amour et, pour la première fois, elle se laissait aller au bonheur d’être aimée, quand elle vit s’agiter légèrement les robes suspendues au-dessus de la porte par laquelle étaient sortis son père, son frère et sa mère.
Puis la porte s’ouvrit avec précaution et elle entrevit la tête maigre et blafarde d’Arthur.
Elle pâlit à cette vue, et, se penchant vers le jeune homme :
— Partez, partez vite ! lui souffla-t-elle à l’oreille.
Celui-ci la regardait sans comprendre.
— Faites un bond jusqu’à la porte et courez sans retourner la tête, une minute de retard et vous êtes perdu.
Le jeune homme ne comprit qu’une chose, c’est qu’il était en danger et qu’il fallait fuir.
Il se retourna et s’élança d’un bond vers la porte.
Il était trop tard.
Claude y était déjà adossé et son couteau à la main.
Arthur se montrait en même temps à l’autre porte, armé comme son père.
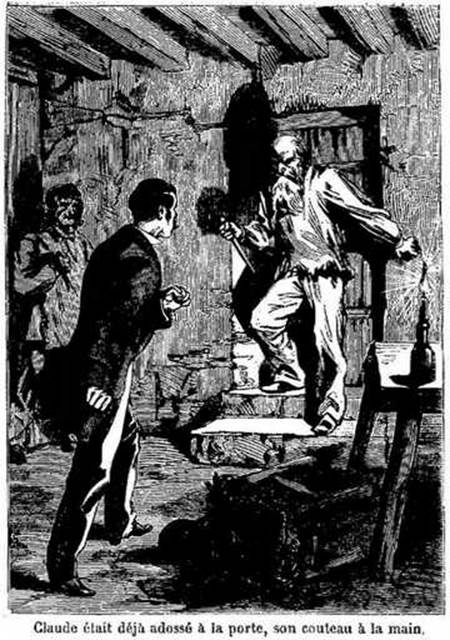
XII
LE COMBAT
Les trois principaux acteurs de ce drame, les deux assassins et celui qui allait devenir leur victime, se tenaient immobiles et silencieux, s’épiant mutuellement du regard, le gamin dans un angle de la pièce, le jeune homme au milieu, le père adossé à la porte de la rue, qu’il avait fermée à double tour au moment où il avait vu ce dernier faire un mouvement pour s’élancer de ce côté.
Le père et le fils, nous l’avons dit, étaient armés de couteaux, leur adversaire était sans armes.
La situation était critique, pour ne pas dire désespérée.
Cependant, le jeune homme, robuste, agile, le regard intrépide, l’air déterminé, malgré la pâleur qui couvrait son visage, pouvait être encore un ennemi redoutable, et telle devait être l’opinion des deux assassins, car au lieu de s’élancer sur lui, ils attendaient, et, de temps à autre, se concertaient comme pour se recommander la prudence.
Mais le vrai motif de cette extrême circonspection se révéla bientôt.
Le jeune homme tournait le dos à la porte par laquelle le père et le fils venaient de faire irruption, sans que celui-ci pût s’expliquer leur apparition subite, car, on s’en souvient, quelques robes suspendues au-dessus de cette porte la cachaient complètement.
Or, comme le plus profond silence planait sur ce sombre drame, la porte secrète s’entrouvrit, poussée avec des précautions infinies, et laissa voir la tête hideuse de la vieille, inquiète, sans doute, de ce long silence et voulant en connaître la cause.
À peine s’était-elle montrée, qu’un regard du vieillard tomba sur elle, étincelant, expressif, impérieux.
Ce regard, d’une inexprimable éloquence, contenait un ordre, et cet ordre, la vieille le comprit, car elle y répondit par un signe de tête et se retira lentement en fermant la porte sans faire entendre le plus léger bruit.
Un instant après, une double porte formant plancher, comme on en voit encore chez beaucoup de marchands de vin, s’abaissa peu à peu, insensiblement, et laissa un grand vide.
C’était la cave.
Le gouffre s’ouvrait à quelques pas derrière le jeune homme qui, le regard constamment fixé sur ses deux ennemis, n’avait rien vu, rien entendu et ne pouvait rien soupçonner.
Quand il vit que son ordre muet avait été si bien compris et si adroitement exécuté, Claude jeta un nouveau regard vers son fils, et tous deux, en même temps, rasant les murs, changeant de place de manière à faire face au gouffre, qui s’ouvrait tout près de la porte secrète, firent quelques pas vers leur adversaire.
Ce dernier, comme l’avait prévu le vieillard, comprenant qu’il lui serait plus facile de faire face à ses deux ennemis à la fois s’il pouvait se blottir dans un angle, recula lentement devant eux sans les quitter un instant du regard.
Un sinistre sourire effleura les lèvres de l’assassin.
Chaque pas qu’il faisait en arrière rapprochait le jeune homme de l’abîme.
Et Claude connaissait trop bien sa compagne pour n’être pas convaincu qu’elle l’attendait au fond de la cave pour l’achever à coups de couteau, au moment même où il tomberait, tout étourdi d’une chute de trois mètres.
Et il avançait toujours pas à pas, ainsi que son fils qui, comme sa digne mère, avait tout de suite pénétré les intentions du vieillard.
De son côté, le jeune homme frémissait d’impatience.
Il n’osait hâter sa marche, mais un rayon d’espoir brillait dans son regard à chaque pas qui le rapprochait de cette position, qu’il considérait comme un port de salut, car, de là , il pourrait tenir tête à ses deux ennemis, et il se sentait de force à leur résister dès qu’il ne courrait plus le risque d’être attaqué à la fois par devant et par derrière.
Enfin il ne lui resta plus qu’un pas à faire pour tomber dans le piège qui lui était tendu.
Il avait déjà un pied levé au-dessus du gouffre.
Il était perdu, quand il se sentit tout à coup saisi au collet, arrêté dans sa marche rétrograde.
Croyant à une agression de la part d’un nouvel ennemi, il voulut s’y soustraire en faisant un bond en arrière.
Mais la main qui le tenait semblait de fer et il ne put s’arracher à son étreinte.
— Mais, regardez donc, malheureux ! cria en même temps une voix à son oreille.
C’était la voix de Malvina.
Il la reconnut, mais sans en être plus rassuré, car il avait deviné sans peine qu’elle était la complice de ses assassins et que ce rendez-vous n’était qu’un guet-apens.
— Misérable ! s’écria-t-il.
— Méprisez-moi, soit, mais regardez donc ! lui cria la jeune fille en lui montrant le gouffre dans lequel il allait être précipité, si elle ne se fût élancée à temps pour l’arrêter.
Le jeune homme recula brusquement.
Mais, au même instant, il vit briller au-dessus de sa tête la lame de deux couteaux.
— Canailles ! s’écria alors Malvina en se jetant au-devant du jeune homme, et en repoussant violemment son père et son frère.
— Ah çà , qu’est-ce qui lui prend donc ? s’écria Claude avec colère.
— C’est moi qui l’ai amené dans cette caverne, reprit la jeune fille l’œil étincelant, la joue enflammée, les cheveux en désordre ; c’était pour le livrer à vos coups, c’est vrai ; mais enfin, c’est moi qu’il a suivie, c’est à moi qu’il appartient, et je ne veux point qu’on le tue.
— Allons, range-toi de là et laisse-nous faire, s’écria Claude en la saisissant par le bras et la jetant brutalement contre la muraille.
Le jeune homme avait profité de cette altercation pour franchir d’un bond l’ouverture de la cave, de sorte que ce gouffre, au fond duquel il avait failli trouver la mort, devenait pour lui un moyen de salut en mettant entre ses ennemis et lui un obstacle presque infranchissable.
— Bien, lui cria la jeune fille, ne bougez pas de là .
Au moment où elle lui jetait ce conseil, le jeune homme voyait venir à lui un nouvel ennemi.
La vieille, comprenant vaguement que celui-ci avait échappé au gouffre qu’elle avait ouvert sous ses pas, s’était mise à gravir l’escalier, dans la pensée de surprendre le jeune homme tout occupé de faire face à ses deux ennemis et de l’attaquer par derrière à l’improviste.
Elle tenait à la main une hachette, qu’elle avait trouvée au fond de la cave, et gravissait rapidement l’escalier, ignorant la position que venait de prendre le jeune homme, qu’elle croyait toujours au milieu de la pièce.
Celui-ci la vit venir, sa hache à la main.
Il recula d’un pas, s’effaça tout à fait dans l’angle, où elle ne pouvait l’apercevoir, et attendit, sans perdre de vue ses deux autres ennemis.
Quelques secondes s’écoulèrent et la tête de la vieille apparut au-dessus du sol.
Le jeune homme épiait ce moment. Comme elle avançait la main qui tenait la hache pour la poser à terre et sauter hors de la cave, il s’avança brusquement vers elle et, d’un violent coup de pied sur le crâne, l’envoya rouler au bas de l’escalier.
Un cri aigu, cri de rage et de douleur, se fit entendre aussitôt.
Ce fut tout.
— Pristi ! dit le gamin, plus rien, pas un gémissement ! maman a reçu là un mauvais atout.
— Morte peut-être, murmura Claude en jetant sur son adversaire un regard furieux.
Telle était aussi la pensée de ce dernier, il croyait avoir tué la vieille et nous devons dire qu’il n’en éprouvait aucun remords.
Il s’en félicitait même vivement en voyant la hache qui était échappée des mains de celle-ci pour aller rebondir au loin sur le carreau.
Elle était courte, bien emmanchée, facile à manier comme une hache de combat, et c’eut été une arme redoutable entre les mains de cette vieille tigresse.
Mais comme il reportait toute son attention sur le père et le fils, se croyant bien débarrassé de la mère, un bruit singulier frappa son oreille.
Il regarda à ses pieds, d’où le bruit semblait partir, et il resta stupéfait en voyant se refermer brusquement la porte de la cave, c’était la revanche de la vieille.
Alors il se vit perdu.
Le plancher rétabli, plus d’obstacle entre lui et ses ennemis, il pouvait lutter longtemps peut-être, mais il devait infailliblement succomber.
— Roublarde, mémère, très-roublarde, murmura Arthur, elle nous la faisait au cadavre.
— Allons, il faut en finir ! s’écria alors Claude en brandissant son couteau avec une résolution farouche.
— Mon père, s’écria alors Malvina, vous ne voulez pas le laisser partir ?
— Allons donc ! répondit Claude en faisant un signe à son fils, qui se prépara à bondir sur l’ennemi.
— Alors, c’est bien, dit Malvina d’un ton bref et déterminé.
Et sautant sur la hache qui était restée à terre, elle la jeta aux pieds du jeune homme, en lui criant :
— Voilà une arme, défendez-vous !
Celui-ci saisit la hache et regardant ses ennemis en face :
— Maintenant, leur cria-t-il, vous pouvez venir, je ne vous crains plus.
Il y eut un moment d’hésitation.
— Après tout, nous sommes deux, dit Claude, et d’ailleurs nous ne pouvons plus reculer, s’il sort d’ici vivant, nous sommes perdus.
Mais comme le combat allait commencer, on frappa deux coups à la porte de la rue.
— Qu’est-ce que c’est que ça ? dit Claude en pâlissant.
XIII
UNE VISITE OPPORTUNE
Ces deux coups frappés à la porte avaient suspendu le combat sur le point de s’engager, et les quatre acteurs de ce drame, se tenant toujours sur la défensive, attendaient, muets et immobiles, en proie à une égale anxiété.
— La rousse, peut-être ? murmura Claude à l’oreille de son fils.
— Possible tout de même, murmura celui-ci d’un ton peu rassuré.
Malvina partageait cette crainte et frémissait d’horreur à la pensée de se voir arrêter et traîner à la préfecture de police, sous les yeux de celui qui, en quelques minutes, avait bouleversé tous ses sentiments.
Ce dernier, de son côté, se demandait qui pouvait venir frapper à pareille heure, à la porte d’un tel bouge, et ce qu’il redoutait, lui, c’était un renfort d’assassins, hypothèse aussi vraisemblable que peu rassurante.
Aussi, pour un motif tout différent, était-il aussi inquiet que Claude et son fils de voir s’ouvrir cette porte.
Personne ne bougeait.
— Ça ne peut être que ça ! murmura de nouveau le vieillard, saisi d’un léger tremblement à la pensée que, si c’était cela en effet, il allait être surpris en flagrant délit d’assassinat.
Quelques instants s’étant écoulés sans qu’on frappât de nouveau, Arthur dit tout bas à son père :
— Si c’étaient eux, ils auraient recommencé et menacé d’enfoncer la porte.
— C’est vrai, répondit Claude en étreignant son couteau dans sa main et en glissant un regard vers le coin où se tenait toujours le jeune homme.
La même supposition s’était présentée en même temps à l’esprit de Malvina, qui fit aussitôt cette réflexion :
— Quel que soit celui qui frappe, c’est un sauveur ; si je le laisse s’éloigner, ce jeune homme est perdu.
S’adressant alors à Claude et lui désignant celui-ci :
— Mon père, lui dit-elle d’un ton froidement résolu, voulez-vous le laisser partir ?
— Non, répondit celui-ci, convaincu qu’il n’avait plus rien à craindre.
Plusieurs coups frappés violemment à la porte le firent aussitôt tressaillir.
— Vous ne voulez pas ? dit la jeune fille, alors ne vous en prenez qu’à vous-même de ce qui va arriver.
Et, avant qu’on eût eu le temps de s’y opposer, elle s’élança vers la porte et l’ouvrit brusquement.
Un homme entra alors et tous tressaillirent à sa vue.
Rien dans sa personne ne justifiait les craintes que chacun d’eux avait conçues.
Ce ne pouvait être ni un assassin ni un bandit.
Sa mise, correcte et élégante, était celle d’un homme du monde.
Son regard froid et pénétrant embrassa d’un seul coup l’étrange tableau qui s’offrait à lui : deux bandits armés de couteaux en face d’un homme distingué de mise et de figure armé lui-même et réfugié dans un coin de ce bouge ignoble.
Il comprit tout et, s’avançant de quelques pas :
— Eh bien ! dit-il d’une voix grave et parfaitement calme, que se passe-t-il donc ici ? est-ce qu’on s’égorge ?
Claude, dont les traits avaient exprimé une profonde surprise à l’aspect de ce personnage, voulut lui adresser la parole : mais celui-ci le regarda fixement : un coup d’œil d’intelligence, imperceptible pour tous, s’échangea entre ces deux hommes, et le vieillard garda le silence.
— Ma foi, monsieur, dit alors le jeune homme en allant droit à l’inconnu, vous n’avez que trop bien deviné, et j’ai mille grâces à vous rendre, car ces deux misérables en voulaient à ma vie, et, si vous fussiez entré seulement deux minutes plus tard, le sang allait couler ; laissez-moi donc vous remercier comme mon sauveur et, vu le lieu et la singularité de notre rencontre, permettez-moi de me présenter moi-même.
Et, s’inclinant courtoisement :
— Le comte Paul de Tréviannes.
— Sir Ralph Litson, répondit le nouveau venu, en s’inclinant à son tour.
Puis le comte de Tréviannes ayant exprimé à sir Ralph le désir d’aller lui rendre une visite, et celui-ci ayant répondu, avec le plus vif empressement, qu’il s’en trouverait fort honoré, tous deux échangèrent leurs cartes, puis se serrèrent la main avec effusion.
C’était un véritable changement à vue.
Les façons du faubourg Saint-Germain succédaient sans transition à une scène de tapis-franc.
— Maintenant, monsieur le comte, dit sir Ralph, vous devez être curieux de savoir par quel étrange hasard je suis venu frapper à la porte d’une telle maison.
— J’en suis aussi surpris, je l’avoue, que vous devez l’être vous-même de m’y trouver, répondit le jeune homme.
— Voici l’explication du mystère. Il y a dans ce triste quartier de Plaisance un ancien serviteur de ma famille auquel je fais une petite pension ; or, ce brave homme n’étant pas venu la toucher à son échéance, c’est-à -dire hier, j’ai craint pour sa santé, fort chancelante depuis quelque temps déjà , et j’ai pris le parti de le venir voir moi-même, au lieu de lui envoyer un domestique. Malheureusement j’avais mal retenu son adresse, sans doute, car j’avais déjà frappé à dix portes inutilement, quand, me trouvant à quelques pas de cette espèce de masure, j’eus l’inspiration, dont je ne saurais trop me féliciter à cette heure, de faire là une dernière tentative, elle m’a réussi, puisque j’ai eu la chance d’arriver si à propos pour vous, monsieur le comte.
Claude semblait frappé de stupeur.
Il contemplait sir Ralph d’un air effaré et l’écoutait parler avec un sentiment de profonde admiration.
— Sir Ralph, répondit le jeune comte, qui semblait s’être pris pour celui-ci d’une subite sympathie, je ne sais quelle est votre situation, quels sont vos projets et vos espérances, mais ma famille a de hautes relations et une grande fortune, je les mets à votre disposition, dans le cas où elle vous serait nécessaire, dans le cas contraire, je vous offre mon amitié et serai très-heureux d’obtenir la vôtre.
— Elle vous est tout acquise, répliqua sir Ralph, dont l’œil noir étincela d’un feu étrange en se fixant sur la franche et loyale figure du jeune homme.
Claude, lui, eut un vague et diabolique sourire.
— Et maintenant, monsieur le comte, reprit sir Ralph du ton le plus sérieux, si rien ne vous retient plus ici, nous allons partir, vous pour rentrer à votre hôtel, où vous vous reposerez des émotions de cette soirée, moi pour me remettre à la recherche de mon vieux.
— Oh ! non, s’écria le jeune homme en souriant, non, rien ne me retient ici, je ne tiens pas à finir l’entretien commencé avec ces messieurs.
Et il fit un pas vers la porte. Mais il s’arrêta aussitôt en voyant Malvina s’avancer vers lui.
Ce n’est qu’après une longue hésitation qu’elle s’était décidée à lui adresser la parole.
Ses traits pâles s’étaient empourprés sous l’empire d’une violente émotion, et ce fut d’une voix tremblante qu’elle murmura ces mots en s’approchant du comte :
— Pardon, monsieur, mais je voudrais vous prier…
Le jeune homme l’interrompit.
— En effet, mademoiselle, dit-il en la regardant froidement, vous m’avez sauvé la vie en me jetant cette hache et je serais impardonnable de ne pas vous donner le témoignage de reconnaissance… que vous méritez.
Et, tirant vivement de sa poche un porte-monnaie, il l’ouvrit et en tira un billet de banque.
Mais en le lui offrant, il vit deux larmes jaillir des yeux de la jeune fille.
Et, comme il la regardait avec l’expression d’une profonde surprise, elle lui dit en repoussant le billet de banque :
— Oui, vous avez raison, monsieur, c’est là le témoignage de reconnaissance que je mérite, et la preuve, c’est que je l’aurais accepté il y a une heure.
— Que me vouliez-vous donc, mademoiselle ? reprit le comte touché de l’émotion de la jeune fille et ému lui-même d’un sentiment de délicatesse auquel il était loin de s’attendre.
— Monsieur, répondit Malvina en essuyant les deux larmes qui avaient roulé de ses yeux sur ses joues, je voulais vous prier de ne pas dénoncer mon père.
— C’est pourtant ce que le devoir me commanderait de faire, dit le comte ; mais, puisque je ne puis vous témoigner autrement la reconnaissance que je vous dois, je m’engage à garder le silence sur cette aventure.
Il ajouta, le regard fixé sur la jeune fille et avec un vague sentiment de pitié dans l’accent :
— Aventure extraordinaire sous tous les rapports, car enfin vous m’avez sauvé la vie en me donnant une arme pour me défendre, mais qui m’a attiré ici dans le seul but de m’y faire assassiner ? vous aussi je cherche vainement à m’expliquer par quel inconcevable revirement…
— Ne cherchez pas à le comprendre, interrompit vivement la jeune fille, ce serait peine inutile.
— Après tout, reprit le comte, c’est grâce à vous que je suis encore de ce monde ; voilà ce que je ne puis méconnaître et je ne voudrais pas partir sans vous laisser…
— Écoutez, monsieur, dit Malvina, je ne vous demanderai pas de ne pas me mépriser, cela est impossible, je le comprends, mais ne me haïssez pas et vous serez quitte envers moi.
— Voilà donc une affaire arrangée, dit sir Ralph ; alors, monsieur le comte, puisque tous vos comptes sont réglés, il ne nous reste plus qu’à quitter cette demeure peu hospitalière.
Le jeune homme se tourna aussitôt vers lui.
Sir Ralph avait ouvert la porte en échangeant encore avec Claude un signe d’intelligence, et un instant après, il était dehors avec son nouvel ami.
XIV
OÙ L’ON CAUSE D’AFFAIRES
Dès que sir Ralph et le jeune comte furent sortis, la porte secrète s’ouvrit et livra passage à la vieille, qui entra en faisant entendre un gémissement.
Le sang coulait de son front et son Å“il droit disparaissait dans un large cercle noir.
— Pristi ! m’man, quelle torgnolle ! s’écria Arthur en prenant un air désolé.
— C’est ce gredin de mirliflor qui m’a arrangée comme ça d’un coup de botte, s’écria la vieille avec rage, et dire que vous l’avez laissé partir quand il vous était si facile de le nettoyer ! Deux contre un, c’était donc pas assez ! Ah ! tenez, vous n’avez pas de cœur au ventre !
— D’abord, mémère, nous sommes excusables, répondit Arthur, vu que ce n’est pas là qu’on le met et que t’es en désaccord avec la Faculté. Si j’avais le cœur au ventre, j’irais me montrer dans toutes les foires comme phénomène de première classe.
— Tais-toi, lâche.
— C’est ta faute, aussi ; il était sans armes et tu te charges de lui fournir une hache.
— Pourquoi n’avoir pas sauté dessus quand elle m’a échappé des mains ?
— Dame ! quand je t’ai vue rouler au fond de la cave avec un coup de talon de botte sur le crâne en manière de cataplasme, ça m’a donné un saisissement et je me suis écrié tout bas : « Te reverrai-je, ô ma bonne mère ! Seigneur ! faites qu’elle ne claque pas au fond de la cave ! » Le Seigneur a écouté ma prière et tu te plains !
— Dis donc, Marianne, lui dit Claude, sais-tu qui s’est jeté sur la hache et l’a mise entre les mains de notre ennemi ? C’est elle, Malvina.
Et, fixant sur celle-ci un regard farouche :
— Plus que ça d’amour filial, merci ! s’écria-t-il avec une sombre ironie, ah ! ce n’est pas ta faute si je n’ai pas la tête fendue à l’heure qu’il est, misérable ! Mais quel est donc le motif qui t’a poussée à armer ce jeune homme contre nous ?
— C’est facile à deviner, dit le gamin, un plomb dans l’aile, oh ! là , là !
— Pas possible ! murmura Claude, tu aimerais ce particulier que tu as vu ce soir pour la première fois !
— C’est faux ! s’écria vivement la jeune fille en rougissant, c’est faux.
— C’est bon, nous réglerons ce compte-là plus tard ; j’ai autre chose à faire ce soir.
— Quel est donc cet autre qui est arrivé tout exprès pour faire manquer le coup ? demanda Marianne à son mari.
— Eh bien ! c’est lui.
— Qui, lui ?
— Sir Ralph.
— Ah ! celui qui nous a enlevé l’affaire de la comtesse pour la porter à d’autres.
— Il avait ses raisons pour ça, d’ailleurs ne m’a-t-il pas fait gagner trois cents francs ?
— Oui, pour conduire le fiacre qui emmenait la jeune femme à Aubervilliers et pour le faire d’abord stationner trois soirées de suite aux environs de son hôtel, c’est tout ce qu’il faut pour te convaincre de complicité et te gratifier de dix ans de bagne en cas de mort de la victime !
— Vingt ans comme récidiviste, répliqua froidement Claude, peut-être même la tête serait-elle en jeu ; aussi, j’avoue que je ne serais pas fâché d’avoir des nouvelles de la victime.
— Trois cents francs ! belle poussée pour s’exposer à perdre la liberté.
— Et l’honneur ! ajouta Arthur en faisant flamber une allumette sur sa cuisse.
— Patience ! reprit Claude, j’ai idée qu’il se prépare un bon coup.
— Qui le fait croire ça ?
— La visite de sir Ralph.
— Il est parti.
— Pour revenir, il me l’a fait savoir par un signe que j’ai compris.
Un coup fut frappé discrètement à la porte, en ce moment.
— C’est lui, dit Claude, va ouvrir, Arthur.
Puis s’adressant à sa fille :
— Toi, va te mettre au lit, je ne veux pas d’espions ici.
Sans daigner répondre un mot pour se disculper, la jeune fille se dirigea vers la porte secrète et sortit.
Sir Ralph entrait au même instant.
— Et le jeune homme, lui dit Claude, ne craignez-vous pas qu’il soupçonne ?…
— Rien, répondit sir Ralph, il m’a quitté convaincu que je restais par ici pour me remettre à la recherche de mon vieux serviteur.
Il poursuivit, en changeant de ton :
— Maintenant, écoutez-moi tous les trois.
La famille se groupa autour de lui.
— Voulez-vous d’abord me permettre une question ? lui demanda Claude.
— Parle.
— Je voudrais bien avoir des nouvelles de la comtesse.
— Tu t’y intéresses donc beaucoup ?
— Oui, au point de vue de la guillotine, répondit Arthur, papa est très-chatouilleux du cou, et il suffirait…
— Assez, tais ton bec, dit Claude.
— C’est justement de la comtesse que je viens te parler, dit sir Ralph.
— Ah !
— Rassure-toi, elle est vivante.
— J’en suis bien aise.
— Mais le sera-t-elle encore dans quarante-huit heures ? Je l’ignore et j’en doute.
— Elle est malade ?
— Non, mais très-faible, extrêmement faible et elle veut absolument rentrer à son hôtel, malgré les observations de la sage-femme, qui a déclaré qu’elle pouvait mourir en route.
— Diable ! espérons qu’elle ne nous jouera pas ce mauvais tour.
— Cela peut arriver pourtant, et, dans ce cas que faire du cadavre ? Le faire déposer chez elle. Impossible, son mari pourrait être de retour et avoir prévenu la police, dont le premier soin serait d’établir une souricière dans l’hôtel même et aux abords. Le déposer au coin d’une rue ou le jeter à la Seine ? Moyen dangereux ; on dit que les morts ne parlent pas, c’est une grave erreur ; il y a vingt exemples de cadavres qui par leurs plaies béantes ont dénoncé leurs assassins. Après y avoir mûrement réfléchi, j’ai songé à cette maison : on apportera le cadavre ici et il y sera enterré.
— Pourquoi pas dans la maison même où je l’ai transportée ? objecta Claude ; il me paraît bien dangereux de traverser tout Paris avec un cadavre dans une voiture.
— Le danger, au contraire, serait de l’enterrer dans la maison où elle est accouchée. Le jour où la police sera en l’air pour retrouver la trace de la comtesse de Sinabria, dont la disparition causera une profonde sensation dans Paris, il me semble presque impossible que les agents qui iront rôder de ce côté ne recueillent pas quelques indications des habitants de la rue du Pont-Blanc et particulièrement des voisins du cabaret de la Providence. Le mouvement inusité qui s’est fait ce jour-là chez Rascal, les allées et venues occasionnées par l’état de la comtesse, les cris aigus qu’elle faisait entendre, les indiscrétions possibles de la sage-femme, dont il y a tout à craindre dans un moment d’ivresse, toutes ces causes réunies peuvent devenir des indices et diriger sur cette maison les soupçons de la police, et c’est précisément pour cela que j’ai songé à cacher le cadavre aux antipodes de la rue du Pont-Blanc.
— Tout cela est parfaitement raisonné, dit Marianne qui, la tête dans les deux mains, avait écouté jusque-là sans prendre part à l’entretien, et j’approuve votre idée en cas de mort de la comtesse, mais si elle ne meurt pas, ce qui me paraît le cas le plus probable, quel est votre projet à son égard ?
— Je vous l’ai dit, la faire reconduire à son hôtel en prenant toutes les précautions imaginables pour ne pas se laisser pincer.
Un sombre sourire entrouvrit la bouche bestiale de la vieille.
Elle reprit après une pause :
— Mais supposons que, soit en entrant, soit en sortant, soit pendant son séjour, cette jeune femme ait saisi un indice sur le quartier, la rue, ou la maison où on l’a transportée, ce qui me semble inévitable, son premier soin sera de tout révéler et alors nous sommes tous perdus.
— Il y a là un danger, en effet, mais comment s’y soustraire ?
— Quoi que vous en disiez, sir Ralph, les vivants sont plus dangereux que les morts et je ne vois qu’un moyen de nous mettre tous à l’abri d’une indiscrétion de la comtesse.
— Et ce moyen ? demanda sir Ralph.
— Vous la faites conduire ici, on l’engage à passer dans la chambre dont la porte est là -bas sous ces vêtements de femme, et alors savez-vous ce qui arrivera ?
— Non.
— Je vais vous le montrer.
Elle se leva, sortit par la porte qu’elle venait de désigner, revint au bout de quelques instants et dit à sir Ralph :
— Approchez et regardez.
Elle prit une grosse bûche du poids de sept à huit livres environ, et la laissa tomber sur la porte de la cave qui formait plancher.
La porte s’affaissa aussitôt et montra un gouffre béant, au fond duquel la bûche alla rebondir avec fracas.
— Voilà , dit Marianne ; au moyen d’un petit mécanisme préparé d’avance, la comtesse disparaîtra comme ce morceau de bois, au moment où elle posera le pied sur cette porte.
— Oui, dit froidement sir Ralph, l’idée est ingénieuse et il est certain que cela nous délivrerait de bien des soucis. J’interrogerai la comtesse, et pour peu qu’elle ait le moindre indice sur la rue ou même sur le quartier où elle a été transportée, elle fera l’expérience de cette petite invention, mais dans ce cas seulement, car il est de notre intérêt qu’elle vive, ce sera une mine à exploiter.
Puis se tournant vers Claude :
— Je suis venu ce soir pour vous donner un avis. M. Badoir, qui le premier avait eu l’idée d’enlever la comtesse et vous a payé pour cela, viendra ce soir même vous demander ce qu’elle est devenue. Vous lui répondrez qu’elle est parvenue à s’enfuir et que vous n’avez pu retrouver sa trace. Il est important, dans notre intérêt à tous qu’il reste sur ce point dans une complète ignorance et dans une continuelle perplexité.
— C’est entendu, dit Claude, mais il vous a donc prévenu de cette visite ?
— Loin de là , il a affecté le plus grand calme afin de me laisser croire qu’il allait passer la soirée chez lui ; mais je l’ai tellement effrayé au sujet de la comtesse, je l’ai jeté dans de telles angoisses et lui ai laissé entrevoir de si terribles perspectives en cas de mort de celle-ci, qu’il doit être en route pour venir vous voir et qu’il va peut-être frapper à cette porte avant dix minutes. Or, il me faut une preuve palpable de sa complicité dans cette affaire, et c’est pour cela que je lui ai inspiré, sans qu’il s’en doutât, la pensée de venir te trouver ce soir même.
— Que faut-il faire ?
Sir Ralph tira un papier de sa poche.
— Le forcer par la menace, par tous les moyens possibles, à copier et à signer cet écrit.
— Nous lui montrerons nos couteaux, s’il le faut, et ce sera fait.
— Je compte sur vous, et rappelez-vous qu’il y va de notre fortune à tous. Adieu, faites vos préparatifs pour recevoir la comtesse dans quarante-huit heures.
XV
LA FUITE
Dix minutes après avoir quitté Claude et son honorable famille, sir Ralph abordait son cocher qui, on le sait, l’attendait rue Saint-Médard.
Avant de monter en voiture, il regarda l’heure à sa montre, et dit au cocher :
— Nous allons chez moi, rue Taitbout, mais il suffit que j’y sois dans deux heures, nous avons donc tout le temps de nous promener, et, comme j’ai grand besoin d’air, vu le bouge où je viens de passer une heure, tu vas prendre le chemin le plus long et choisir de préférence les voies les plus larges et les mieux aérées.
La voiture partit aussitôt, et, au bout de quelques instants, elle roulait sur le boulevard Montparnasse, gagnait le carrefour de l’Observatoire et, tournant à gauche, enfilait le boulevard Saint-Michel.
Parvenu au boulevard Saint-Germain, le cocher, après avoir calculé mentalement le trajet qu’il pouvait parcourir pour arriver rue Taitbout à l’heure indiquée par son maître, prit cette voie, puis les ponts, pour gagner la Bastille et de là se diriger vers la rue Taitbout par les boulevards.
Un quart d’heure après, la Bastille était dépassée depuis quelque temps déjà et sir Ralph, blotti dans un coin de sa voiture, était absorbé dans ses réflexions, quand son attention fut attirée tout à coup par un attroupement qui s’était formé sur le boulevard, à la porte d’une maison très-vivement éclairée.
Il fit résonner le timbre qui donnait au cocher l’ordre de s’arrêter, et, se penchant à la portière :
— Quel est donc cet établissement si étincelant de lumière ? lui demanda-t-il.
— Monsieur, répondit le cocher, c’est le grand Café Parisien.
— Quelle peut donc être la cause de cet attroupement ?
— Je l’ignore, monsieur.
— La surabondance des consommateurs peut-être ?
— Je ne crois pas, l’établissement est immense et pourrait contenir les deux ou trois cents individus que vous voyez entassés sur le trottoir.
— Puisque j’ai du temps à perdre, je suis curieux de savoir ce qui se passe là .
Il ouvrit la portière et, sautant à terre :
— Je reviens dans un instant, dit-il.
Sir Ralph eût voulu pénétrer dans l’intérieur de l’établissement, mais la foule était si compacte qu’il dut y renoncer aussitôt.
Cependant il ne voulut pas s’éloigner sans savoir de quoi il s’agissait.
Il remarquait dans tous les groupes une exaltation qui excitait au plus haut point sa curiosité.
Il s’approcha et se mit à écouter.
— Je vous dis, s’écriait l’un de ceux qui parlaient de l’événement avec le plus de feu, que c’est une tentative d’assassinat ; je le sais bien, puisque j’ai vu le meurtrier de mes propres yeux.
— Bah ! fit un incrédule ; et qui prouvait que ce fut un meurtrier ?
— Il n’y avait pas à s’y méprendre : il avait les mains toutes rouges du sang de la victime.
— Et qu’est-ce que c’est que cette victime, un homme ou une femme ?
— Une jeune fille, presque une enfant.
— Il voulait la voler ?
— Oh ! quant à ça, il n’y avait pas mèche.
— Pourquoi ?
— Parce qu’on ne donnerait pas cinq francs de toutes ses frusques, et quant aux bijoux, pas plus que dans mon œil !
— Alors pourquoi l’assassiner ?
— Est-ce que je sais ? Ce qu’il y a de certain, c’est que j’ai vu les mains du meurtrier et que le sang en dégouttait, qu’on aurait pu le suivre à la trace.
— Où avait-il blessé l’enfant ?
— Ah ! quant à ça, je n’ai pu voir, j’ai aperçu sa tête à travers la foule, et c’est tout.
— Elle avait sans doute perdu connaissance ?
— Au contraire, elle gesticulait des mains et des doigte comme un petit écureuil.
— Et que disait-elle ? demanda vivement sir Ralph, saisi d’un vague pressentiment.
— Elle ne disait rien, ce que j’ai attribué à la grande émotion qu’elle avait éprouvée.
— Vous n’y êtes pas du tout, répliqua un jeune ouvrier ; il paraît qu’elle est muette, c’est pour ça qu’elle ne parlait pas.
— Muette ! et l’homme a les mains rouges de sang ! murmura sir Ralph, en proie à une stupide émotion. Est-ce que ce serait ?… Non, c’est impossible ; comment seraient-ils ici l’un et l’autre ? Non, ma supposition est absurde, et, à l’heure qu’il est, ils sont tranquillement assis dans le cabaret de la Providence.
Il ajouta après un moment de réflexion :
— C’est égal, il faut que je voie cela.
Et il s’enfonça dans la foule, faisant des efforts inouïs pour la percer, affirmant à ceux qui lui faisaient obstacle, qu’une affaire pressante l’appelait au Café Parisien.
Mais cette masse vivante était un mur infranchissable, il s’en aperçut bientôt et comprit qu’il lui serait impossible d’arriver à l’entrée du café.
— Tenez, monsieur, lui dit enfin un gamin, faut pas user votre sueur inutilement, vous ne pourrez jamais y arriver par là , et si j’ai un conseil à vous donner, c’est d’aller de l’autre côté.
— Il y a donc une seconde entrée ?
Le gamin parut stupéfait qu’on pût ignorer cela.
— Mais sans doute, dit-il, par la rue du Château-d’Eau.
— Merci, dit sir Ralph.
Il se dégagea de la foule et ne tarda pas à gagner la rue du Château-d’Eau.
Un groupe de curieux, beaucoup moins considérable que la foule amassée sur le boulevard, lui signala tout de suite cette seconde entrée, et un instant après il pénétrait dans l’intérieur.
Il ne vit rien d’abord, car là encore il y avait foule.
Les consommateurs, réunis tous sur un même point, formaient un immense cercle, impénétrable au regard.
Là , au moins il lui fut facile de s’approcher, de se glisser entre quelques personnes d’humeur accommodante et de voir le spectacle sur lequel se concentraient tous les regards.
Il tressaillit alors en reconnaissant, dans l’homme et l’enfant dont on venait de lui parler tout à l’heure, Rascal, le patron de la Providence, et la muette, Nizza.
Stupide d’étonnement, il avait peine à en croire ses yeux, ne pouvant s’expliquer par quelle miraculeuse circonstance l’ouvrier des abattoirs, avec ses bras rouges jusqu’au coude et cette petite muette, qui n’avait jamais quitté la rue du Pont-Blanc, se trouvaient réunis dans un café, au centre de Paris et au milieu d’une foule dont ils semblaient absorber toute l’attention.
Mais peut-être est-il bon, pour l’intelligence des événements de revenir de quelques pas en arrière, c’est-à -dire au moment où la petite muette sortait en courant de la rue du Pont-Blanc et s’élançait dans la direction de Paris.
Elle n’avait jamais quitté la rue du Pont-Blanc, comme nous l’avons dit ; mais à force d’observer et d’écouter, elle avait fini par comprendre de quel côté était Paris et quel chemin y conduisait.
Le chemin le plus court, elle l’avait souvent entendu dire, c’était la rue de Paris ; mais ce renseignement ne lui eût absolument servi à rien, puisqu’elle ne savait pas lire et ne pouvait s’informer, si, une fois seule, elle n’eût saisi cette indication, que la rue de Paris commençait à la place de l’Église.
Et, comme parfois, s’étant hasardée à faire quelques pas dans la plaine des Vertus, elle avait aperçu de loin le clocher de l’église, elle put se diriger de ce côté sans hésitation en fuyant de la rue du Pont-Blanc.
Une seule rue donne sur la place de l’Église, la rue de Paris, elle la reconnut donc tout de suite, s’y engagea résolument et se mit à courir à toutes jambes dans la direction de Paris.
Le mobile auquel elle obéissait, le lecteur l’a deviné sans doute, c’était la stupide et profonde sympathie que lui avait inspirée la comtesse.
Elle voulait aller révéler à Paris, à qui ? elle n’y avait même pas songé, les tortures qu’on faisait subir à la jeune dame couchée dans la chambre de Micheline et qui, dans sa pensée, finirait par être tuée par Rascal et ses amis.
Stimulée par l’espoir de la sauver, elle courait toujours sans vouloir s’arrêter, craignant qu’une minute de repos ne causât sa mort, quand, au bout de vingt minutes environ, aux approches de la Villette, il lui sembla entendre un bruit de pas derrière elle.
Elle s’arrêta un instant pour écouter et s’aperçut avec terreur qu’elle ne se trompait pas.
On ne marchait pas, on courait. Et avec la finesse d’ouïe qui distingue généralement ceux qui sont privés de quelque autre sens, elle reconnut à la précipitation des pas qu’elle était poursuivie par deux hommes, et non par un seul, comme elle l’avait cru d’abord.
Elle reprit aussitôt sa course en redoublant de vitesse.
Elle parcourut ainsi toute la rue de Flandre et arriva brisée, harassée, à l’entrée du faubourg Saint-Martin.
Là elle s’arrêta brusquement, stupéfaite, émerveillée à l’aspect des innombrables lumières, fixes ou mouvantes, qui étincelaient sur toute l’étendue de cette longue voie.
Jamais si beau spectacle n’avait frappé ses regards et elle hésita un instant à s’engager dans cette cohue de lumières, qui lui inspiraient autant de terreur que d’admiration.
Elle repartit presque aussitôt, cependant, se rappelant ses persécuteurs et tremblant à la pensée de tomber entre leurs mains.
Le boulevard Magenta lui parut plus admirable encore que le faubourg Saint-Martin, et, réfléchissant, en outre, que ses ennemis iraient toujours tout droit, dans la pensée que, ne connaissant pas Paris, elle irait tout naïvement devant elle, elle tourna à gauche et s’élança sur un des trottoirs de ce large boulevard.
Au bout d’un quart d’heure, elle arrivait sur la place du Château, et, se croyant enfin sauvée, elle allait s’asseoir sur le bord de la fontaine, quand elle sentit une main se poser sur son épaule.
Elle tourna la tête et jeta un cri terrible à l’aspect de celui qui se dressait devant elle.
C’était Rascal.
XVI
LE CAFÉ PARISIEN
La petite muette ne s’était pas trompée dans ses prévisions.
Comme elle l’avait supposé, Rascal s’était dit que, ne connaissant pas Paris et craignant de s’y égarer, elle avait dû aller toujours droit devant elle, jusqu’à ce qu’un monument ou une rue transversale vinssent lui barrer le passage.
C’est parce qu’elle avait deviné qu’il raisonnerait ainsi, que, pour faire perdre sa piste à son ennemi, elle avait tourné tout à coup à gauche et s’était engagée sur le boulevard Magenta.
Or, Rascal et son compagnon, arrivant à la hauteur de ce boulevard, presqu’en même temps que la muette, allaient, en effet, continuer de descendre le faubourg Saint-Martin, quand l’idée vint à celui-ci de demander à quelques personnes qui stationnaient là si elles n’avaient pas vu passer une enfant de quatorze à quinze ans, tête nue et vêtue d’un simple jupon de laine brune.
Ces individus répondirent que, tout entier à leur conversation, ils n’avaient fait aucune attention aux passants.
Rascal, fort contrarié et regrettant les deux minutes qu’il venait de perdre, allait s’élancer de nouveau dans le faubourg Saint-Martin, quand un commissionnaire qui l’avait entendu demander ce renseignement l’arrêta au moment où il allait reprendre sa course :
— Vous dites que la petite a de quatorze à quinze ans ? lui demanda-t-il.
— Oui, mais elle les paraît à peine.
— Et qu’elle est tête nue ?
— Précisément.
— N’est-elle pas un peu… toquée ?
— Nullement.
— C’est que, la voyant s’arrêter tout à coup à deux pas de moi et regarder à droite et à gauche, comme si elle cherchait son chemin, je lui ai demandé où elle allait.
— Et qu’a-t-elle répondu ? s’écria Rascal.
— Rien ; elle m’a fait des signes que je n’ai pas compris, ce qui m’a fait croire quelle avait quelque chose là , fit le commissionnaire en se touchant le front.
— C’est elle, dit vivement Rascal.
Il ajouta aussitôt :
— Quelle direction a-t-elle prise ?
— Celle-là , dit le commissionnaire en montrant le boulevard Magenta.
— Merci.
Et s’adressant à son compagnon :
— Allons, filons de ce côté.
— Et si vous voulez la rattraper, lui cria le commissionnaire, je vous conseille de ne pas vous amuser en route, car elle courait comme un lapin.
Rascal ne négligea pas le conseil du commissionnaire, car, ainsi que nous l’avons vu, il arrivait à la fontaine du Château-d’Eau en même temps que la petite muette.
À l’aspect de cet homme, qui lui avait toujours inspiré une vague terreur et qui en ce moment, lui produisait l’effet d’une apparition surnaturelle, la pauvre petite se mit à trembler de tous ses membres.
— Misérable ! lui cria Rascal en la secouant rudement, pourquoi t’es-tu enfuie de la maison ?
Nizza courba la tête.
— Allons, reprit Rascal, file devant moi et rentrons plus vite que ça.
L’enfant releva la tête et fit un signe négatif, Rascal la saisit par le bras et voulut l’entraîner. Alors elle se jeta à terre, prit un arbre dans ses bras et, s’y cramponnant de toutes ses forces, elle ne bougea plus.
— Tonnerre ! murmura Rascal avec un sourd rugissement, comment l’enlever de là et la décider à marcher ? Je la rouerais de coups avec bonheur, mais ça ameuterait les passants et ils prendraient tous fait et cause pour elle ; le monde est si bête ! Impossible d’employer la force ; essayons de la ruse.
Et, se penchant vers elle :
— Allons, Nizza, ma petite Nizza, lui dit-il en adoucissant sa voix, je ne t’en veux pas, après tout. Tu as voulu voir Paris, c’est bien naturel, tu en as entendu parler si souvent. J’aurais dû penser à cela et t’y amener quelquefois ; mais aussi, pourquoi ne m’en avoir pas exprimé le désir ? Enfin, puisque nous y sommes, je veux t’y promener, et même en voiture, car tu dois être brisée de fatigue après une si longue course.
La petite muette releva la tête en entendant parler de promenade dans Paris, et, au mot de voiture, ses traits exprimèrent un véritable ravissement.
Un mauvais sourire effleura les lèvres de Rascal :
— Bon ! pensa-t-il, une fois en voiture, je te conduirai où il me plaira et te ramènerai à la rue du Pont-Blanc sans que tu t’en doutes, et, une fois là , je me charge de te faire passer le goût des escapades.
Il ajouta d’un ton plein de douceur :
— Dis-moi, ma petite Nizza, n’aurais-tu pas trouvé par hasard un portefeuille là -bas, à la maison ?
La muette fit un signe négatif.
— Toujours le même mensonge, murmura Rascal, caprice d’enfant, elle n’en soupçonne pas l’importance et c’est à ses yeux un jouet nouveau dont elle ne veut pas se séparer.
Il dit bas à son compagnon qui, fatigué par cette course effrénée, s’était assis haletant sur l’appui de pierre de la fontaine :
— Barbot, veille sur elle pendant que je vais chercher une voiture, et pour plus de sûreté, prends-la par sa jupe et ne la lâche pas avant mon retour.
Barbot saisit la jupe de la muette et Rascal s’éloigna, après avoir dit à celle-ci, en lui donnant une tape amicale sur la joue :
— Je reviens tout de suite avec une voiture, ma petite Nizza.
La muette exprima sa joie en frappant ses deux mains l’une contre l’autre et le regarda s’éloigner.
Puis son regard se porta sur Barbot qui, harassé, fourbu et affaissé sur lui-même, soufflait comme un phoque.
Après un moment de réflexion, elle se pencha doucement en avant, parut chercher quelque chose à terre, puis, se relevant elle toucha l’épaule du bandit et fit un geste pour attirer son attention.
Celui-ci releva la tête et la regarda en face pour chercher à comprendre la signification de ce geste.
Au même instant il recevait une poignée de poussière dans les yeux et un coup en pleine poitrine qui l’envoyait rouler de l’autre côté de l’appui de pierre sur lequel il était assis.
Après s’être ainsi délivrée de son gardien, la petite muette s’élança à toutes jambes vers le boulevard, où elle était attirée par les lumières et l’affluence des promeneurs.
Son instinct lui disait qu’elle trouverait là des défenseurs dans le cas où Rascal viendrait à la rattraper de nouveau, ce qui n’était pas impossible ; la file des voitures vers laquelle il s’était dirigé très-rapidement n’étant éloignée de la fontaine que de quelques pas.
Elle courait ainsi depuis un instant, quand elle entendit une voix crier derrière elle :
— Arrêtez ! arrêtez ! c’est une voleuse.
À ce cri, elle vit aussitôt plusieurs passants s’élancer sur ses traces.
Alors, folle de terreur, comprenant qu’on allait bien vite s’emparer d’elle et qu’elle allait infailliblement retomber dans les mains du terrible Rascal, elle jeta autour d’elle un regard éperdu, désespéré, le regard de la biche effarée sentant déjà sur son cou l’haleine ardente de la meute et, saisie d’une inspiration subite, elle s’élança en deux bonds dans un large vestibule étincelant de lumières.
C’était l’entrée du Café Parisien. Presque aussitôt elle entendait retentir derrière elle les lourds souliers de Rascal, dont son ouïe délicate avait tout de suite reconnu le bruit tout particulier. Alors, redoublant encore de vitesse, elle parvint à le devancer par un effort qui épuisa le peu de forces qui lui restait et vint tomber haletante au milieu des consommateurs qui remplissaient le vaste établissement.

Rascal, qui était sur ses talons, s’élança sur elle, l’enleva de terre et l’emporta dans ses bras.
Mais un cri rauque, déchirant, étrange, jaillit de la poitrine de l’enfant, attira sur elle tous les regards, et vingt personnes, la voyant se débattre entre les bras sanglants d’une espèce de bandit à l’œil farouche et au visage de bête fauve, s’élancèrent au-devant de celui-ci pour lui barrer le passage.
Le cercle qui venait de l’envelopper s’accrut rapidement, et bientôt il se voyait entouré de plus de cent personnes, qui semblaient animées à son égard des sentiments les moins sympathiques.
Il voulut percer la foule, mais personne ne bougea.
— Ah çà , dit-il avec une sourde colère, qu’est-ce qu’ils me veulent donc ceux-là ? est-ce que je ne suis pas libre de sortir d’ici ?
— Oui, dit une voix, quand vous aurez dit ce que c’est que cette enfant que vous voudriez emporter de force.
— C’est ma fille, répondit brutalement Rascal.
Nizza fit de la tête un signe négatif et ses traits mobiles et expressifs firent comprendre que ce prétendu père ne lui inspirait que l’horreur et l’épouvante.
Un personnage d’une cinquantaine d’années se détacha alors de la foule, et, prenant la main de l’enfant dans les siennes :
— Est-il vrai, petite, que cet homme soit ton père ? lui demanda-t-il.
Nizza répondit par le même signe de tête.
— Oh ! tu peux parler, ne crains rien, nous sommes là pour te protéger contre cet homme s’il est vrai que tu ne sois pas son enfant.
Nizza ouvrit la bouche et fit comprendre par gestes qu’elle était muette. Et elle exprima de nouveau, avec une extrême véhémence, la terreur que lui inspirait Rascal.
— Muette ! pauvre petite ! murmura-t-on de toutes parts.
Et le redoublement de sympathie qui venait de s’attacher à elle accrut en même temps le sentiment de dégoût et de répulsion dont chacun se sentait animé vis-à -vis de Rascal.
— Commencez par déposer cette enfant à terre, reprit alors l’individu qui venait d’interroger Nizza, nous allons vous interroger tous deux et décider si nous devons te la livrer ou la garder, auquel cas je m’en chargerais, moi.
C’est à ce moment que sir Ralph était entré dans le Café Parisien.
XVII
MONSIEUR PORTAL
Rascal avait longtemps hésité à déposer Nizza à terre, comme le lui avait commandé le personnage qui, de son autorité privée, s’était posé en arbitre entre lui et l’enfant.
Après avoir roulé autour de lui un regard plein de haine et de rage concentrée, il était presque résolu, confiant dans sa force herculéenne, à s’élancer comme une trombe à travers le flot humain qui lui barrait le passage, et peut-être eût-il réussi à s’y faire une trouée en se ruant sur eux à l’improviste ; mais, chose étrange, un seul homme eut le pouvoir de l’arrêter dans ce dessein.
Cet homme, c’était celui qui venait de lui commander de rendre la liberté à la muette. M. Portal, — c’était le nom sous lequel il était connu au Café Parisien, — était loin pourtant d’avoir la redoutable apparence et l’effrayante expression de Rascal.
Il était de taille ordinaire et toute sa personne respirait un calme imperturbable. Mais sous ce calme, comme sous la surface unie d’une mer apaisée, on sentait une énergie surhumaine, de sourdes et irrésistibles tempêtes, des colères domptées, une puissance sans limites, mais, indolente et hautaine comme celle du lion.
Tout cela se résumait dans le regard froid et impérieux qu’il laissa tomber sur Rascal et sous lequel celui-ci, interdit et comme magnétisé se sentit tout à coup fléchir, sans force et sans volonté.
Nizza, subissant elle-même le prestige inexplicable qui se dégageait de cet homme, courut se presser près de lui dès qu’elle fut à terre, libre de ses mouvements.
Nous avons dit que son défenseur avait fait quelques pas vers Rascal, de sorte qu’il se trouvait isolé de la foule.
— Ainsi, lui dit-il, vous prétendez que cette pauvre muette est votre enfant ?
— Je l’affirme, répondit brusquement le cabaretier.
— C’est ce que nous allons bientôt savoir.
Et se tournant vers Nizza :
— Pourquoi avoir quitté la maison de ton père, mon enfant ? lui demanda-t-il.
La muette attesta de nouveau, par les plus énergiques dénégations, que Rascal n’était pas son père, et exprima pour la seconde fois les sentiments de crainte et d’horreur qu’il lui inspirait.
— Vous avez compris ? dit M. Portal au cabaretier.
— Comment aurais-je compris ce qui n’a pas de signification, répliqua celui-ci ; elle a le cerveau fêlé et fait à tort et à travers des signes incohérents qui n’ont jamais eu la prétention d’exprimer quelque chose.
— Comment se fait-il donc que tout le monde ici ait compris ce qu’elle veut dire ?
— Ils sont malins, ceux qui ont deviné cela, dit Rascal en ricanant.
M. Portal reprit son interrogatoire.
— Dis-moi, mon enfant, pourquoi t’es-tu enfuie de la maison de cet homme ?
Nizza lui fit signe quelle allait tout expliquer, et le pria par gestes d’apporter toute son attention à ce qu’elle allait lui dire.
Le cercle se resserra et tous les regards se fixèrent sur l’enfant avec un redoublement d’intérêt.
Sir Ralph, lui, se dissimulant dans la foule, car il redoutait le regard de la muette, attendait avec anxiété le résultat de cet interrogatoire.
Pour la première fois il voyait en pleine lumière l’enfant dont il avait pu à peine distinguer les traits dans le sombre cabaret de la Providence, et il était frappé de tout ce qu’ils exprimaient d’intelligence et de pénétration.
Privée par son infirmité de toute communication avec ses semblables, répudiée par les autres enfants qui la raillaient et la maltraitaient, habituée conséquemment à s’absorber en elle-même, à analyser et à réfléchir, Nizza avait acquis, dans cette précoce contention d’esprit, dans cette constante obligation de tout observer et de tout raisonner, un jugement et une perspicacité tout à fait au-dessus de son âge.
Sir Ralph comprenait tout cela à l’expression de sa physionomie, d’une étonnante mobilité, et au rayonnement extraordinaire de ses grands yeux noirs.
Aussi s’effrayait-il en ce moment de tout ce qu’elle avait pu comprendre au cabaret de la Providence et des révélations qu’elle allait faire devant cette foule qui la couvait du regard et n’allait pas perdre un seul de ses gestes.
Rascal, lui, affectait l’indifférence et le dédain, mais on eût pu deviner au tressaillement de ses muscles, les accès de rage sourde qui faisaient bouillonner son sang.
Nizza commença enfin son récit mimé.
Beaucoup de femmes fréquentent le Café Parisien soit seules, soit avec leurs maris ; la muette en désigna une, puis, se promenant avec gravité, passant avec un sentiment d’orgueil les mains sur ses vêtements d’abord, et ensuite sur son visage, elle fit comprendre clairement qu’elle voulait parler d’une grande dame et que cette grande dame était jolie et élégamment vêtue.
Tout à coup ses traits exprimèrent l’effroi ; elle désigna du doigt Rascal, fit de nouveau le portrait de la dame et la montra emportée par celui-ci et se débattant dans ses bras.
Puis se courbant, étendant les mains sur le plancher, recommençant le portrait de la dame, elle fit comprendre qu’on l’avait couchée dans un lit ; après quoi, changeant tout à coup l’expression de sa physionomie, elle se tordit violemment, ouvrit la bouche toute grande et tortura ses traits pour exprimer les cris arrachés par d’horribles souffrances.
Tout le monde tressaillit, tant ce récit était précis, intelligible et éloquemment rendu.
La pantomime expressive, passionnée et ardente de la muette avait fait de cette histoire un tableau si net, si coloré, si palpitant, que l’assemblée en était émue, et qu’après le murmure de sympathie qui s’éleva d’abord en sa faveur, tous les regards se tournèrent vers Rascal avec une expression de colère à laquelle celui-ci ne pouvait se méprendre.
Alors la peur succédant à la rage, il se demanda en tremblant comment cette scène allait finir pour lui.
Cependant l’imminence du danger lui rendit quelque sang-froid.
Il comprit qu’il était perdu s’il se laissait dominer par l’effroi et se prépara à repousser énergiquement les accusations de l’enfant.
— Eh bien, lui demanda M. Portal, avez-vous compris cette fois ? Si vous ne savez pas ce que vient de dire cette enfant, si vous persistez à prétendre que ses gestes sont le résultat d’un cerveau en démence et ne veulent rien exprimer, je vais vous dire, moi, ce qui ressort pour nous tous de sa pantomime si claire et si expressive, pour nous qui, la voyant aujourd’hui pour la première fois, ne sommes pas familiarisés comme vous avec son langage. Eh bien, ce qu’elle a voulu dire, c’est qu’une femme du monde, une femme jeune, élégante et jolie a été enlevée par vous et déposée sur un lit, où elle se tordait en proie à de violentes douleurs. Voilà tout ce qu’elle a pu saisir ; mais il y a derrière cette histoire, dont elle n’a pu comprendre que le côté visible et palpable, quelque sanglant mystère que vous seul pourriez nous faire connaître.
Rascal était bouleversé.
Cependant il eut la force de répondre par un éclat de rire.
— Des grandes dames ! s’écria-t-il d’un ton ironique, en effet, j’ai bien l’air d’un amoureux qui enlève les grandes dames et mon taudis est un joli palais pour les recevoir ! Si jamais une dame a passé le seuil de ma masure, je veux bien que le bon Dieu me patafiole à l’instant même.
La muette, dont l’œil ardent s’était fixé sur lui pendant qu’il parlait, se frappa le front dès qu’il eut fini, et plongeant vivement la main dans la poche de sa jupe, elle en tira un médaillon en or et le remit à M. Portal en faisant comprendre très-distinctement qu’il appartenait à la dame dont il était question.
Un frémissement de colère parcourut le corps de Rascal, qui murmura tout bas, en jetant à l’enfant un regard brûlant de haine :
— Si jamais tu retombes sous ma patte, toi, ton compte sera bientôt réglé.
M. Portal tourna deux ou trois fois le médaillon entre ses doigts, puis il appuya sur un point qui formait une saillie presque imperceptible.
Le médaillon s’ouvrit et montra dans ses deux cavités deux portraits qui se faisaient face.
Un jeune homme d’une figure distinguée.
Une jeune femme, extrêmement jolie, mais moins remarquable encore par sa beauté que par l’expression originale et toute charmante de sa physionomie.
Après avoir examiné cette dernière tête quelques instants, M. Portal la mit sans rien dire sous les yeux de la muette.
Les traits de Nizza prirent aussitôt un air de ravissement et, saisissant vivement le médaillon, elle porta le portrait à ses lèvres et le couvrit de baisers.
— Serait-ce là la dame dont tu viens de nous parler, mon enfant ? lui demanda M. Portal.
La muette fit un signe de tête affirmatif et, toute rouge d’émotion, les yeux mouillés de larmes, elle porta la main à son cœur.
— Cette dame est donc ta parente ? lui demanda M. Portal.
Nizza répondit négativement.
— Ta protectrice, peut-être ?
Même réponse.
— Alors, pourquoi l’aimes-tu tant ?
Elle fit un geste qui signifiait :
— Je ne sais pas.
— Vous voyez bien qu’elle est folle, s’écria Rascal, ce qui ne l’empêche pas d’être rouée comme un vieux procureur quand il s’agit de mentir et de faire le mal, et la preuve c’est qu’elle n’est pas plus muette que vous et moi et qu’elle vous joue tous par-dessous la jambe depuis dix minutes.
Il ajouta avec un rire ironique :
— Ah çà ! tas de naïfs que vous êtes, où avez-vous donc vu des muets qui entendent ? vous ne savez donc pas qu’ils ne peuvent pas parler parce qu’ils n’entendent pas ? C’est connu de tout le monde, ça.
Cette observation, parfaitement juste d’ailleurs parut frapper l’assemblée, parmi laquelle se manifesta un sentiment de défiance.
Alors, Nizza qui, cette fois encore, avait écouté attentivement les paroles de Rascal, s’approcha de M. Portal, et, lui montrant sa bouche toute grande ouverte, lui fit signe de regarder.
Celui-ci se pencha pour mieux voir, puis il recula frappé d’horreur.
— Quoi donc ? demandèrent plusieurs voix à la fois.
— Elle a la langue coupée, répondit M. Portal d’une voix émue.
XVIII
À BON CHAT BON RAT
Il y eut un long silence de stupeur dans la foule qui assistait à ce spectacle.
Puis, tous les regards se reportèrent de l’enfant sur le farouche personnage qui lui inspirait une si profonde terreur, et nul ne douta qu’il ne fût l’auteur de l’horrible mutilation que l’infortunée avait subie.
Alors, des paroles menaçantes se firent entendre autour de lui, et il remarqua en frissonnant que le cercle qui l’enveloppait se resserrait rapidement.
— Silence ! s’écria M. Portal d’un ton plein d’autorité, et surtout pas de violences, car ce serait le moyen de tout gâter. Nous sommes ici en face d’une affaire des plus graves, tous nos efforts doivent tendre à la découverte de la vérité, et nous manquons notre but si nous ne procédons avec calme à l’enquête que nous avons entreprise.
— Mais, s’écria un ouvrier en s’avançant vers Rascal l’œil enflammé et les poings crispés, c’est lui qui a mutilé cette pauvre enfant, et nous souffririons…
À ces mots, Nizza qui, toujours aux aguets, ne perdait ni un mot, ni un geste, s’élança au-devant de Rascal, comme pour le protéger contre les colères qu’elle voyait soulevées autour de lui, et promenant un rapide regard sur les plus exaspérés, elle déclara par signes qu’il était innocent de ce crime et qu’il ignorait même la cause de sa mutité.
— C’est vrai, murmura Rascal qui, devant les grondements de la fureur populaire, était devenu livide.
Nizza ajouta, en abaissant sa main à deux pieds du sol, que cela remontait bien loin, bien loin, à l’époque où elle était petite.
— Comment ! dit alors M. Portal au cabaretier, vous prétendez être le père de cette enfant et vous ignoriez la cause de son infirmité.
Rascal était confondu.
Le mensonge était trop clairement prouvé par cet argument inattendu pour qu’il persistât davantage à le soutenir.
Il le comprit et garda le silence.
— Cette enfant n’est donc pas à vous et vu les sentiments que vous lui inspirez et qu’elle vient de manifester de la façon la moins équivoque, elle restera ici, je me charge de son sort.
Nizza s’élança vers M. Portal, prit une de ses mains et la porta à ses lèvres.
Ses traits rayonnaient de bonheur.
— C’est une infamie, murmura Rascal ; si je ne suis pas son père, je lui en ai tenu lieu ; je l’ai recueillie chez moi, je l’ai nourrie, habillée, accablée de soins.
— Vous voulez dire de coups, répliqua M. Portal.
La muette fit un signe affirmatif.
— Vous voyez !
— Elle ment, s’écria Rascal.
— Cette enfant est la franchise et la loyauté mêmes, elle vient de le prouver en attestant votre innocence en ce qui concerne la mutilation dont elle a été victime ; c’est donc vous qui mentez.
Décidément Rascal n’avait pas de chance, tout tournait contre lui.
— Eh bien, soit, dit-il, gardez-la, puisque ça vous amuse ; après tout, c’est un bon débarras, mais qu’elle me rende au moins ce qu’elle m’a volé.
— Volé ! tu as volé quelque chose à cet homme ? demanda M. Portal à Nizza.
Celle-ci répondit négativement.
— Elle nie.
— Ah ! elle a du vice.
— Enfin, que vous a-t-elle volé ?
— Un portefeuille.
À ce mot une exclamation sourde et aussitôt étouffée se fit entendre dans la foule.
Rascal porta ses regards vers le point d’où elle était partie et tressaillit en reconnaissant sir Ralph.
Celui-ci avait pâli en apprenant que son portefeuille était au pouvoir de la muette, et d’un regard il intima l’ordre à Rascal de le reprendre à tout prix.
— Au surplus, reprit Rascal avec assurance, ce portefeuille, elle l’a sur elle, fouillez-la et vous le trouverez dans une de ses poches.
M. Portal allait interroger de nouveau la muette, quand celle-ci, glissant vivement la main dans la poche de sa jupe, en tira en effet un portefeuille.
— Eh bien, s’écria Rascal d’une voix triomphante, direz-vous encore qu’elle est incapable de mentir ?
Un douloureux désappointement s’était peint sur tous les visages devant cette révélation si accablante pour celle à laquelle on s’était si vivement intéressé jusque-là .
M. Portal lui-même ne pouvait dissimuler la fâcheuse impression qu’il en avait reçue.
— Impossible de nier, puisque voilà le corps du délit, dit-il.
Et, tendant le portefeuille à Rascal :
— Tenez, reprenez ce qui vous appartient.
Rascal avança la main et un éclair de joie brilla dans les yeux de sir Ralph.
Mais, au moment où le cabaretier allait s’emparer du précieux portefeuille, Nizza fit un bond, le saisit dans la main de M. Portal et le mit sous son bras, où elle le serra avec force.
— Il faut le rendre, lui dit vivement M. Portal, il lui appartient.
— Non, fit l’enfant en secouant la tête avec force.
— Il est donc à toi ?
Elle fit la même réponse.
— Vous voyez bien qu’elle ne sait ce qu’elle dit, s’écria Rascal, et vous comprenez tous qu’un portefeuille comme celui-là surtout ne saurait appartenir à une enfant de cet âge. Allons, il faut pourtant en finir.
Et, s’avançant brusquement vers la muette, il voulut lui saisir le bras.

Mais celle-ci se réfugia dans les jambes de son défenseur, qui étendit la main et tint le cabaretier à distance.
Alors Nizza, avec de grands efforts, parvint à faire comprendre que ce portefeuille n’était ni à elle, ni à Rascal, mais à un monsieur bien mis, qui était là quand on avait amené la belle dame du médaillon et qu’elle avait emporté l’un et l’autre, médaillon et portefeuille, pensant que cela pourrait être utile à la dame.
— Parfait ! voilà qui s’explique, dit M. Portal, et cette enfant avait raison de dire qu’elle ne vous avait pas volé, puisque ce portefeuille ne vous appartient pas.
— Il appartient à un ami qui me l’a confié, c’est un dépôt, il faut que je le restitue.
— Eh bien, vous direz à votre ami de venir le réclamer ici et d’y laisser son adresse, j’irai le lui restituer moi-même.
Vivement déconcerté par cette réponse, Rascal chercha du regard sir Ralph et l’aperçut toujours à la même place.
Son visage bouleversé attestait l’angoisse qui le dévorait.
Il en conclut que la confiscation de ce portefeuille constituait un grave danger pour sir Ralph et conséquemment pour lui-même.
Résolu alors à le ravoir à tout prix, il imagina tout à coup un plan à l’aide duquel lui ou sir Ralph pouvaient le ressaisir.
Mais il fallait pour cela être secondé par celui-ci, et, ne pouvant lui communiquer ce plan, il le prévint, par un signe, de se tenir prêt à tout événement.
Alors, croisant ses bras musculeux sur sa large poitrine et promenant autour de lui un regard de défi :
— Ah çà ! s’écria-t-il d’une voix éclatante, c’est donc un coupe-gorge que cet établissement-là ? J’y viens reprendre une enfant qui m’appartient, quoique je ne sois pas son père, et on me la refuse ! J’y réclame un portefeuille qui est à moi, puisqu’on me l’a confié et que j’en dois compte à son propriétaire, on me le vole ! Allons donc, ce n’est pas un café, ça, c’est un tapis-franc, et tous ses habitués sont un tas de grinches et d’escarpes !
Rascal avait compté sur un effet, et il eut bientôt la preuve qu’il ne s’était pas trompé dans son calcul.
Cette grossière apostrophe souleva tout à coup un débordement de colères, de clameurs et de menaces, et vingt individus s’élancèrent à la fois vers lui.
— Vingt contre un ! s’écria-t-il, eh bien ! à la bonne heure, aussi lâches que filous, c’est complet.
Et il jeta sur sir Ralph un coup d’œil expressif. Celui-ci comprit sa pensée.
Confiant dans sa force prodigieuse, que décuplait encore une adresse extrême dans l’art de la savate et du pugilat, il allait provoquer une mêlée générale, et à la faveur du désordre qui devait s’ensuivre, procurer à sir Ralph le moyen de se glisser jusqu’à la muette et de lui arracher son portefeuille, qu’elle tenait toujours sous le bras.
Il eut aussitôt la preuve qu’il avait deviné juste. Rascal fit tout à coup un bond en arrière, se campa solidement sur ses hanches, et, portant ses poings en avant :
— Allons, s’écria-t-il, qui est-ce qui commence la danse ?
Son aspect était vraiment terrible en ce moment. L’œil fulgurant, les traits contractés, les narines dilatées comme si elles eussent aspiré d’avance l’odeur du sang, il ressemblait plutôt à une bête fauve qu’à un être humain.
— Eh bien, s’écria-t-il de nouveau avec un ricanement sauvage, personne ne se présente ? Vous avez donc peur, tas de feignants ! Eh bien, je vais tâcher de vous donner un peu de cœur à l’ouvrage en ouvrant le bal et en commençant par celui qui veut faire le malin !
Au même instant, il s’élançait sur le protecteur de la muette et lui allongeait en plein visage un formidable coup de poing.
Mais le coup n’arriva pas à sa destination.
Avant que son poing ne touchât le visage de M. Portal, il recevait dans l’estomac un coup de pied qui le faisait reculer de cinq ou six pas.
Toujours impassible, M. Portal lui dit d’un ton dédaigneux :
— Je t’avais pris pour un hercule et tu n’es qu’un petit crevé. Allons, tu ne mérites pas que je m’occupe de toi !
Il appela :
— Milon !
Un homme de taille moyenne, mais trapu et large des épaules, s’avança en se dandinant légèrement.
— Monsieur désire s’amuser un instant, lui dit M. Portal, veux-tu faire sa partie ?
— Je ne demande pas mieux que d’obliger monsieur, répondit Milon en allant se poser à trois pas de Rascal.
— C’est toi qui vas payer pour les autres, lui cria celui-ci avec un sourd rugissement.
Remis de la stupeur où l’avait jeté le coup de pied de M. Portal, il n’éprouvait plus qu’une rage aveugle et une soif de vengeance qui le rendaient féroce.
Après avoir étudié un instant son ennemi, il bondit sur lui les poings en avant, et le combat s’engagea.
Sir Ralph en suivait les péripéties avec plus de curiosité que d’intérêt.
M. Portal avait fait manquer le plan qui lui eût fourni l’occasion de se glisser jusqu’à la muette et de lui enlever son portefeuille.
Ce coup l’avait accablé.
Il était en proie aux plus sombres réflexions, quand il entendit tout à coup un bruit étrange.
Ce n’était ni un cri ni un gémissement.
Cela ressemblait à un râle.
Il en eut bientôt l’explication en voyant l’adversaire de Rascal se redresser tout à coup sur ses jambes, tandis que celui-ci restait étendu tout de son long sur le carreau, le visage bleu et gonflé, et portant sur le cou l’empreinte visible de cinq doigts.

XIX
UN HOMME ESCAMOTÉ
À l’aspect de cette tête violacée et de ce corps inerte, un sentiment d’effroi se peignit sur tous les visages.
— Il est mort ! s’écrièrent plusieurs voix à la fois.
— Une mort violente dans mon établissement ! s’écria à son tour le maître du Café Parisien, mais ce serait affreux, cela me ferait le plus grand tort et la police pourrait bien…
— Rassurez-vous, mon brave, dit Milon en l’interrompant, je l’ai ménagé et je vous affirme qu’il n’est qu’évanoui ; qu’on le transporte chez un pharmacien, à l’aide d’un tonique un peu énergique il lui rendra l’usage de ses sens, et dans dix minutes il n’y paraîtra plus.
— Il y en a un rue de Vendôme, à cinq minutes d’ici.
— Qu’on l’y transporte sans retard, dit M. Portal à quelques personnes qui s’avançaient pour s’emparer du corps, qui continuait à ne donner aucun signe de vie, et qu’on le ramène ici quand il aura recouvré l’usage de ses sens ; j’ai quelques éclaircissements à lui demander sur certains faits qui me paraissent fort graves, et je verrai ensuite quel parti nous devons prendre à son égard.
Puis se penchant à l’oreille de Milon :
— Toi, prends les devants, recommande vivement cet homme au pharmacien, car son état m’inspire des inquiétudes, paie-le largement de ses soins, et ramène-moi ce paroissien-là , j’ai à causer avec lui.
Il y avait là un homme bien autrement anxieux encore que M. Portal, le maître du café et tous les témoins de cette scène.
Cet homme, c’était sir Ralph.
La cause de cette anxiété, ce n’était pas la mort de Rascal, à laquelle il avait cru un instant comme tout le monde et dont il avait facilement pris son parti, c’était la crainte de le voir tomber entre les mains de M. Portal, personnage dont l’équivoque et mystérieuse physionomie lui inspirait les plus vives appréhensions.
L’impression qu’avaient produite sur cet étrange individu les réponses de la petite muette, les soupçons qu’elles avaient fait naître dans son esprit au sujet de Rascal, la double détermination qu’il venait de prendre d’interroger celui-ci et de garder Nizza près de lui, et enfin ce portefeuille resté en son pouvoir et qu’il allait évidemment scruter sans le moindre scrupule dans l’espoir d’y trouver la révélation du mystère qu’il n’avait fait qu’entrevoir, tels étaient les motifs qui bouleversaient sir Ralph et lui faisaient considérer l’intervention de ce redoutable personnage comme un immense danger suspendu sur sa tête.
Mais le danger le plus grave, peut-être, le plus immédiat à coup sûr, était de voir Rascal, une brute inintelligente, aux prises avec une nature aussi pénétrante, aussi fine, aussi déliée que paraissait l’être cet énigmatique et effrayant M. Portal, et toute la préoccupation de sir Ralph se portait en ce moment sur ce seul point.
C’est sous l’empire de ces pensées qu’il quitta le Café Parisien, dès qu’il eut entendu dire qu’on allait transporter Rascal chez un pharmacien, où il devait assurément recouvrer l’usage de ses sens.
Rascal, nous l’avons dit, était grand et solidement taillé, ce n’était donc pas une tâche facile que de transporter ce corps d’hercule du Café Parisien à la rue de Vendôme.
Un brancard était indispensable et c’est ce que demandèrent ceux qui avaient offert spontanément leurs services.
Le patron du café n’en avait pas, mais il envoya deux de ses garçons chez un négociant de la rue de Bondy, où l’on était sûr d’en trouver un.
Il fallut attendre cinq minutes, et lorsqu’au bout de ce temps, très-long, vu l’état du malade, les deux garçons reparurent enfin, ils déclarèrent que les magasins du négociant étaient fermés à cette heure et qu’ils n’avaient trouvé personne pour leur délivrer le brancard.
— Allons, dit alors l’un de ceux qui devaient transporter Rascal, nous le prendrons par la tête et par les jambes ; ce n’est pas commode quand il s’agit d’un particulier de ce volume ; mais il n’y a pas une minute à perdre.
Un instant après, en effet, ils l’emportaient ainsi.
Alors, M. Portal, longtemps distrait de la petite muette par les scènes que nous venons de raconter, reporta son attention sur elle.
Nizza, toujours collée contre son protecteur, comme si elle eût craint d’en être séparée, leva sur lui un regard dont l’expression, à la fois inquiète et suppliante, émut vivement M. Portal, qui y lut clairement l’appréhension à laquelle elle était en proie.
— Rassure-toi, mon enfant, dit-il, se hâtant de répondre à la secrète pensée de la petite muette, je t’emmène chez moi et tu ne me quitteras plus. Et puis, tu trouveras là une petite mère qui remplacera celle qui te manque depuis bien longtemps, sans doute, celle que tu as perdue ou dont on t’a violemment séparée et que nous retrouverons, je le jure, si elle est encore de ce monde.
Ces mots firent jaillir des larmes des yeux de l’enfant qui, tout en pleurant, lui fit comprendre qu’elle n’avait plus l’espoir de jamais retrouver sa mère après une si longue séparation.
M. Portal allait répliquer, quand il vit entrer coup sur coup et l’air tout effaré, Milon d’abord, puis les trois individus qui venaient d’emporter Rascal.
— Et bien, qu’est-ce ? que se passe-t-il donc ? demanda M. Portal à Milon.
— Et notre bandit, que j’attends depuis un quart d’heure chez le pharmacien, demanda celui-ci en jetant autour de lui des regards stupéfaits, où est-il donc passé ?
— Demande-le à ces trois messieurs, qui viennent de l’emporter et avec lesquels tu t’es croisé peut-être.
Mais ces trois individus, qui rentraient immédiatement après Milon, semblaient plus effarés et plus interdits encore que celui-ci.
— Où est-il ? s’écria Milon en s’élançant au-devant de ces hommes.
— Disparu ! répondit l’un d’eux.
— Disparu ! ah çà , il n’était donc pas évanoui ? c’était donc une frime.
— Pas du tout, il était comme mort, respirant à peine et incapable de remuer ni pied, ni patte, mais voilà ce qui est arrivé : nous venions de passer le seuil du café, portant avec peine notre particulier, quand un jeune homme vient à nous et nous offre obligeamment sa voiture pour le transporter rue de Vendôme, nous disant qu’il connaissait l’affaire dont il venait d’être témoin, et insistant pour que nous acceptions son offre, non-seulement dans notre intérêt, mais surtout dans l’intérêt du blessé, dont une minute de retard pouvait causer la mort. Ces raisons nous paraissent justes et nous déposons notre homme dans la voiture, où le jeune homme prend place à côté de lui, en nous engageant à suivre à pied jusque chez le pharmacien. La voiture part au pas, nous la suivons sans défiance, mais voilà qu’arrivés en face de la caserne, le cocher tourne tout à coup et sangle ses chevaux, qui partent ventre à terre dans la direction du boulevard Magenta. Saisis, ahuris à ce coup de théâtre inattendu, nous restons quelques instants sans pouvoir ni crier, ni courir, et lorsqu’enfin nous revenons à nous, il n’était plus temps, ils étaient déjà loin.
— Je comprends, dit M. Portal, après un moment de silence, un compère.
Puis, s’adressant à celui qui lui avait fait ce récit :
— Ce jeune homme, qui disait être au courant de ce qui venait de se passer ici, l’aviez-vous aperçu dans le café ?
— Oui, j’avais même remarqué qu’il suivait le combat, non-seulement avec intérêt, comme tout le monde, mais avec tous les signes d’une violente inquiétude.
— Plus de doute, c’était un complice du persécuteur de la petite muette.
Il reprit :
— Et vous dites que cet homme était bien mis ?
— Fort bien, et tout à fait l’air d’un homme du monde ; je jurerais même que la voiture était à lui, car c’était une voiture de maître des plus élégantes.
M. Portal réfléchit quelques instants, puis il murmura :
— Le but de ces deux hommes, si différents l’un de l’autre sous tous les rapports et dont l’association constitue déjà un fait significatif, grave et inquiétant au plus haut point, ce but était évidemment de reprendre ce portefeuille ; tous leurs efforts tendaient là , plus je me rappelle et plus j’en demeure convaincu et c’est dans cette seule pensée qu’ils ont poursuivi cette enfant jusqu’ici. Ce portefeuille contient donc quelque terrible secret, des notes dont le sens se cache sous des signes de convention, des chiffres, des mots isolés, sans signification apparente, des hiéroglyphes intelligibles pour les seuls initiés, un chaos impénétrable enfin. Mais que je saisisse seulement, un bout du fil et je saurai bien le dévider jusqu’au bout.
Puis prenant le portefeuille des mains de Nizza et le glissant dans sa poche :
— Allons, dit-il à la muette, en prenant sa petite main dans la sienne, rentrons chez nous.
— Mauvaise affaire, maître, lui dit Milon d’un air confus, roulé comme un écolier.
— Excellente affaire, au contraire, répondit M. Portal en frappant sur la poche qui contenait le portefeuille, l’homme nous échappe mais son secret nous reste, et si je ne me trompe, nous devons avoir là une mine précieuse à exploiter. Nous commencions à nous rouiller dans l’inaction, mon vieux Milon, mais j’ai le pressentiment que nous allons trouver là l’occasion de recommencer une de ces belles campagnes où nous risquions notre vie dix fois par jour. Je ne sais si je me trompe, mais je crois sentir fourmiller là , sous le maroquin de ce portefeuille, toute une bande de redoutables coquins qui nous donneront du fil à retordre, mais qui, je le jure, trouveront en nous des adversaires dignes de faire leur partie.
— Que le ciel vous entende, maître, répondit Milon en se frottant les mains, l’eau m’en vient à la bouche. Nous commençons à peine et j’ai déjà une revanche à prendre, c’est une chance, rien de mieux pour vous donner du cœur au ventre.
Ils s’entretenaient ainsi en sortant du Café Parisien. Un quart d’heure après, ils s’arrêtaient devant une maison de la rue Amelot située au fond d’un jardin.
— Nous voici chez nous, dit M. Portal à Nizza.
La petite lui témoigna, en pressant vivement sa main dans les siennes, le sentiment de joie et de reconnaissance qui débordait de son cœur.
XX
LE PORTEFEUILLE
Après avoir traversé le jardin qui précédait le corps de logis, M. Portal ouvrit une porte et pénétra dans un large vestibule éclairé par une lanterne suspendue au plafond.
Deux portes donnaient dans ce vestibule.
Il ouvrit celle de droite et entra dans un petit salon confortablement meublé et dont le luxe consistait particulièrement dans ces mille fantaisies, œuvres d’adresse et de goût, qui décèlent la présence d’une femme dans une demeure.
Une femme était là , en effet, travaillant à la lueur d’une lampe devant une cheminée où flambait un grand feu.
Elle était blonde et ne paraissait pas plus de trente ans, quoiqu’on pût reconnaître, en l’observant avec attention, qu’elle avait dépassé cet âge de quelques années.
Elle était mince, élégante de taille et de tournure, et ses traits, d’un ovale un peu allongé, d’une pâleur à peine colorée, portaient l’empreinte d’un caractère viril, uni à une nature tendre et dévouée, contraste qui lui constituait une beauté toute particulière, à la fois imposante et attractive.
Nizza, qui suivait M. Portal, était restée sur le seuil, stupéfaite et ravie en face des merveilles qui frappaient ses yeux pour la première fois.
Elle promenait des regards étonnés d’un objet à l’autre et semblait être sous l’empire d’un rêve.
— Eh bien, entrez donc, mon enfant, lui dit M. Portal en souriant de son air ahuri.
Elle fit deux pas en avant et s’arrêta, les regards fixés à terre avec un embarras visible.
Elle n’osait fouler sous ses gros souliers le beau tapis rouge et blanc qui recouvrait le parquet.
— Mais viens donc, reprit M. Portal.
Puis la prenant par la main et l’attirant près du feu, en face de la jeune femme qui la regardait curieusement :
— Ma chère Vanda, dit-il à celle-ci, je vous amène une enfant ; elle est à nous et ne nous quittera plus.
Vanda l’examina des pieds à la tête, et la rapprochant d’elle :
— Chère petite, dit-elle avec un accent plein de bonté, elle est charmante sous ses pauvres vêtements et sa figure me revient tout à fait.
— Alors, vous consentez à l’adopter.
— Si j’y consens ! mais avec joie, je sens que je l’aime déjà , et je me considère dès à présent comme sa mère.
Et s’adressant à Nizza :
— Dis-moi, chère petite, veux-tu être mon enfant ?
Nizza montra du doigt sa bouche, et ses traits mobiles prirent aussitôt une expression mélancolique.
— Que veut-elle dire et pourquoi ne me répond-elle pas ? demanda la jeune femme.
— Elle est muette, répondit M. Portal.
Et il lui apprit la cause effroyable de l’infirmité dont elle était frappée.
Alors Vanda, l’attirant brusquement dans ses bras, la couvrit de baisers en murmurant d’une voix émue :
— Oh ! pauvre petite ! pauvre petite !
Stupéfaite et profondément touchée de cet élan de sympathie, auquel elle était si loin de s’attendre de la part de cette belle dame, elle, pauvre misérable, la muette s’agenouilla devant elle et la regarda en pleurant.
— Qu’as-tu donc à pleurer, mon enfant ? lui demanda la jeune femme.
Un éclair de bonheur rayonna de ses yeux à travers ses larmes et elle passa plusieurs fois la main sur son cœur, pour faire comprendre qu’elle pleurait de joie.
— Pauvre enfant ! dit Vanda, elle me navre et me charme tout à la fois.
Et s’adressant à Nizza, qui la contemplait avec extase :
— Allons, chère petite, lui dit-elle, prends ce coussin, et assieds-toi là , devant le feu, car tu as les mains glacées et tu dois geler sous cette pauvre petite jupe.
Nizza se hâta de se rendre à cette invitation, et à l’air de béatitude avec lequel elle présentait ses mains ouvertes à ce grand feu, il était évident qu’elle n’avait jamais été à pareille fête.
Après l’avoir un instant examinée en souriant, Vanda, redevenant tout à coup sérieuse, tira vivement le cordon d’une sonnette.
Une jeune fille vint aussitôt.
— Lise, lui dit Vanda en lui montrant la petite muette, cette enfant reste avec nous et fait désormais partie de la famille. Vous allez d’abord lui préparer un lit dans le petit cabinet qui touche à ma chambre, et, dès demain matin, vous vous occuperez de lui faire faire trois vêtements complets et bien chauds, dont un plus habillé que les autres.
La femme de chambre allait se retirer.
— Ah ! lui dit Vanda, un renseignement, la pauvre petite est muette.
— Ah ! fit la jeune fille d’un ton de sympathique pitié.
— Mais elle entend et elle est intelligente. Vous pourrez donc lui parler et vous faire facilement comprendre d’elle.
Lise s’inclina et sortit.
Nizza, qui l’avait regardée avec attention, comme toutes les personnes qu’elle voyait pour la première fois, fit signe qu’elle la trouvait gentille et tout à fait à son goût.
— Maintenant, dit Vanda à M. Portal, je ne serais pas fâchée de savoir où vous avez fait la rencontre de cette enfant et comment vous est venue la pensée de l’adopter.
M. Portal fit à la jeune femme le récit détaillé de tout ce qui venait de se passer au Café Parisien.
Puis il ajouta :
— Nous n’avons pas de temps à perdre, nous allons mettre tout de suite à exécution une idée qui m’est venue chemin faisant. Nous avons le plus puissant intérêt à connaître la demeure du chenapan que Milon a failli étrangler ; la petite muette ne peut nous la dire, mais elle peut nous l’écrire, et c’est ce qu’il faut lui demander dès ce soir, pour nous mettre en campagne dès demain matin, car, peut-être, auront-ils filé dans vingt-quatre heures. Milon, apporte sur cette table de quoi écrire.
Milon s’empressa d’obéir.
Alors M. Portal, montrant à Nizza le papier, l’encre et la plume :
— Lève-toi, mon enfant, et approche-toi de cette table.
La muette fit ce qu’il lui demandait.
— Maintenant, prends cette plume et réponds par écrit aux demandes que je vais t’adresser.
Elle le regarda fixement et son front se plissa, comme si on lui eût donné un problème à résoudre.
— Est-ce qu’elle ne saurait pas écrire ? s’écria M. Portal.
Nizza répondit négativement.
— Malédiction ! moi qui comptais sur elle pour découvrir la demeure de notre bandit et arriver par là à suivre les autres à la piste.
— C’est un retard, voilà tout, dit Milon ; et, d’ailleurs, elle peut faire mieux que de nous faire connaître par écrit la demeure de cet homme.
— Comment cela ?
— Elle peut nous y conduire.
— En effet.
Et s’adressant à Nizza :
— Tu sais bien le nom de la rue où tu demeurais ?
— Non, fit la muette en secouant la tête.
— Tu connais le quartier, au moins ?
Elle fit la même réponse.
— Mais tu saurais bien retrouver le chemin que tu as suivi pour venir de cette rue au café dans lequel tu es venue tomber, poursuivie par cet homme ?
La muette se mit à réfléchir, et, au bout de quelques instants, elle répondit par un signe affirmatif.
— Enfin ! s’écria M. Portal.
Il reprit aussitôt :
— Au reste, peut-être allons-nous trouver ce renseignement avec beaucoup d’autres sur les feuillets de ce portefeuille.
Il le tira de sa poche et l’ouvrit en murmurant :
— La clef du mystère est là , qu’allons-nous apprendre ?
Il s’arrêta dès le premier feuillet.
— Qu’est-ce que c’est que cela ?
Une liste de noms. Mais quels sont les individus que désignent ces noms ? Des complices ou des victimes ?
— Lisez, dit Vanda, peut-être devinerons-nous.
Il lut :
Santaris.
Tatiane + +
J. Turgis.
Badoir.
Sinabria.
Valcresson.
Taureins.
— Ce ne sont pas là des noms de bandits, murmura M. Portal, cela me fait tout l’effet de victimes signalées et condamnées.
— Je le crois comme vous, dit Vanda ; mais, parmi ces noms, il en est un, si toutefois c’est un nom, qui m’a frappée par sa singularité.
— Lequel ?
— Tatiane.
— C’est un nom de femme.
— C’est la première fois que je l’entends.
— Il est italien, Tatiane est le féminin de Tatius, nom très-répandu en Italie.
— Mais je vois qu’ils se prononcent différemment.
— En effet, l’un se prononce Tatius et l’autre Tatiane.
— Il s’agit donc d’une femme, une jeune fille peut-être ?
— Oui, et cette femme est tout particulièrement notée, car son nom est marqué de deux croix.
— Tenez, je ne sais pourquoi, dit Vanda avec une vague émotion, mais j’ai peur pour cette femme, et j’ai le pressentiment qu’elle est menacée de quelque effroyable malheur.
— Il est certain que ces deux croix ne disent rien de bon ; mais nous reviendrons demain sur ce chapitre, poursuivons.
Il parcourut rapidement plusieurs feuillets couverts de signes bizarres et de caractères étrangers dans lesquels il crut reconnaître l’hindou.
— Oui, oui, s’écria-t-il après avoir étudié un instant ces caractères, c’est de l’hindou, et je connais l’hindou pour l’avoir parlé dans le pays même, avec les indigènes.
Il ajouta d’un ton plus calme :
— Oui, mais il y a vingt dialectes dans la langue hindoue, et je rencontre là bien des mots dont le sens m’échappe complètement. Bah ! j’étudierai cela demain à loisir, et après deux heures de méditation je saurai bien ce que ces phrases-là ont dans le ventre.
Il tourna encore quelques feuillets, puis il s’arrêta tout à coup et laissa échapper un geste de surprise.
— Eh bien qu’avez-vous donc ? lui demanda Vanda étonnée de cette émotion chez un homme toujours si maître de lui-même, vous semblez pétrifié.
— C’est que je le suis, en effet, et vous allez voir s’il y a de quoi.
Et il lut :
— « Rocambole. »
— Hein ? firent en même temps Vanda et Milon en tressautant sur leurs sièges.
— « Rocambole, » répéta M. Portal, c’est écrit en toutes lettres et ce n’est rien encore, écoutez ce qui suit :
XXI
LE RÉVEIL DU LION
— Voici ce qu’il y a après le nom de Rocambole, dit M. Portal à Vanda et à Milon, encore sous le coup de la surprise qui venait de les saisir.
Avant de lire il ajouta :
— Ces lignes sont écrites en langue hindoue, mais heureusement dans le dialecte bengali, celui que je parlais constamment dans l’Inde et le seul que je connaisse assez pour le traduire en le lisant. Écoutez donc cette pièce vraiment curieuse :
« Rocambole, héros de bagne, nom prestigieux, panache éclatant, excellent pour entraîner. Toute l’armée des malfaiteurs s’inclinera devant ce célèbre bandit et marchera sans hésiter, quoi qu’on lui commande. Or, un chef qui impose la confiance la plus aveugle, ayant derrière lui tout un passé de miracles accomplis, dont les traits d’intrépidité, d’audace et d’habileté sont passés à l’état de légende et font de ce personnage, pour tous les repris de justice, quelque chose comme un de ces grands capitaines qui ne sauraient être vaincus, voilà ce qu’il nous faut ; et, à défaut du grand, du vrai Rocambole, qui doit être mort, il faut en inventer un. Ce nom seul est un talisman avec lequel tout devient possible ; nous allons donc le ressusciter, et, quand, avec son aide toute-puissante, nous aurons fait trébucher l’un après l’autre, dans l’abîme que nous creusons sous leurs pas, tous les membres de la famille condamnée ; quand l’immense héritage sur lequel ils comptent et qui va devenir pour eux la source de tant de larmes, de désespoirs, de hontes et de tortures de tout genre sera tombé entre nos mains, alors nous replongerons dans les limbes d’où nous l’aurons tiré un instant pour notre usage personnel ce grand nom de Rocambole ; nous crèverons ce héros en baudruche, la veille encore effroi des Parisiens et épouvantail de la police, et nous nous exilerons sur la terre étrangère. À l’œuvre donc, et vive Rocambole, notre providence ! »
Cette lecture fut suivie d’un silence de quelques instants, silence de stupeur, pendant lequel ces trois personnages semblaient se demander s’ils n’étaient pas sous l’empire de quelque hallucination.
— Eh bien ! s’écria enfin M. Portal en se croisant les bras, que pensez-vous de l’audace de ces misérables ? Que dites-vous du hasard inouï, providentiel qui met cette pièce entre les mains de l’homme qu’elle intéresse le plus et qui veut qu’elle soit écrite dans une langue connue de lui seul peut-être dans tout Paris ? Il faut avouer qu’il y a d’étranges fatalités ! Ah ! je comprends maintenant l’importance qu’ils attachaient à ce portefeuille et les efforts qu’ils ont tentés pour le ressaisir. Ah ! s’ils avaient su qui j’étais, quand tout à l’heure nous nous sommes rencontrés face à face ! s’ils avaient pu soupçonner que l’homme auquel était échu ce redoutable portefeuille était Rocambole lui-même, ce Rocambole dont ils veulent ressusciter le nom pour en faire un usage aussi infâme, qu’auraient-ils donc fait pour lui arracher des mains ce redoutable écrit ? Et voyez l’ironie du destin ; ils se rassurent sans doute en se disant : Bah ! c’est écrit en bengali, et qui donc à Paris, qui donc en France connaît le bengali ! Et voilà que cette pièce indéchiffrable tombe justement sous les yeux de celui qui, seul peut-être à Paris, puisse lire couramment cette langue ? Allons, voilà un heureux présage pour la lutte qui va s’engager entre nous et cette bande qui, dès son début, fait preuve d’une si rare audace ; le sort est pour nous ; il nous met, au moment du combat, une arme dans la main, c’est à nous à savoir nous en servir.
Puis, s’adressant à Vanda et à Milon :
— Allons, mes enfants, leur dit-il, assez de Capoue comme cela, il faut se rejeter dans la mêlée.
— Quand vous voudrez, maître, répondit Milon.
— Je suis prête, dit Vanda avec un calme sous lequel on sentait vibrer une indomptable énergie.
— Où est Marmouset ?
— Au club des Asperges, qu’il ne quitte jamais avant minuit ou une heure.
— Fort bien, je prévois qu’il pourra nous rendre de grands services de ce côté, car il m’est prouvé, dès à présent, que cette bande a des ramifications dans toutes les classes de la société et particulièrement dans le grand monde, comme l’attestent le train et les façons de celui qui nous a si subtilement escamoté le bandit aux mains sanglantes, et dans lequel je vois le chef ou l’un des chefs de cette redoutable association.
— À propos de l’homme aux bras rouges, dit Milon, il me vient une idée.
— Voyons.
— Le sang dont il était couvert ne peut être le résultat d’un crime, comme l’ont cru beaucoup d’habitués du Café Parisien.
— Qui te fait supposer cela ? La douceur de son regard, l’aménité de ses manières ?
— La première pensée d’un assassin est de faire disparaître toute trace de sang.
— Parfaitement raisonné, mais alors à quoi attribues-tu le sang qui couvrait ses bras ?
— À la profession qu’il exerce ; le sans-façon avec lequel il se montre ainsi prouve que c’est son état habituel.
— Et tu en conclus ?…
— Que cet homme doit être employé aux abattoirs, indice qui nous sera d’un grand secours pour trouver sa trace, dans le cas où nous ne pourrions découvrir sa demeure.
— C’est juste et c’est une heureuse inspiration que tu as eue là , Milon.
Il ajouta, en jetant un regard sur Nizza qui, en se chauffant, ne perdait pas un mot de cet entretien :
— Il serait fâcheux d’en être réduit à cette ressource, car il y a bien des abattoirs dans Paris et cela nous ferait perdre beaucoup de temps ; mais je compte sur cette enfant pour nous éviter toutes ces recherches, elle saura nous conduire à la demeure de son bourreau et nous aurons dès demain un point de repère précieux pour la chasse à laquelle nous allons nous livrer. Cet homme sera le fil d’Ariane qui, une fois dans notre main, doit nous conduire à travers le labyrinthe où s’éparpille la bande, labyrinthe difficile à explorer, car c’est tout Paris, mieux que cela, ce sont toutes les couches sociales superposées qui composent la population de ce Paris immense, que nous aurons à sonder jusqu’au tuf.
— Œuvre effrayante, entreprise impossible pour tout autre que Rocambole, dit Vanda en fixant sur M. Portal son regard doux et résolu à la fois.
M. Portal, dans lequel, depuis longtemps déjà , le lecteur a reconnu Rocambole, répondit après une pause :
— Paris, oh ! oui, je le connais ce vaste pandémonium, à la fois si étincelant et si sombre, si rieur et si sinistre, si heureux et si misérable, si éblouissant à la surface et si noir dans les bas-fonds ! Ce Paris où, à la même heure, à la même minute, l’on chante et l’on tue ! Ce Paris où, au moment même où cent millionnaires se demandent par quelles fenêtres ils pourraient bien jeter leur argent, cent mille misérables se demandent où ils trouveront les quelques sous dont ils ont besoin pour manger, et où vingt mille autres rôdent dans les rues un monseigneur et un couteau dans la poche, le gagne-pain du voleur et l’arme de l’assassin ; oh ! oui, ce Paris-là , cet immense fouillis d’êtres humains qui pullulent côte à côte dans le luxe et dans la misère, cette vivante avalanche qui roule au milieu des larmes et des éclats de rire, dans des flots de champagne et de sang ; oui, ce Paris, je le connais, je l’ai fouillé vingt fois de fond en comble, tantôt pour voler et pour tuer, tantôt pour protéger et pour sauver ; je saurai donc découvrir nos ennemis, dans quelque zone qu’ils se cachent, en haut ou en bas, dans la lumière ou dans l’ombre, dans les clubs ou dans les tapis-francs, et je leur ferai payer cher leur infamie.
Il fit quelques pas en proie à une subite et violente émotion ; puis, s’arrêtant brusquement et croisant les bras sur sa poitrine :
— Ainsi s’écria-t-il d’une voix dont l’accent pénétrant laissait deviner une profonde douleur, ainsi tout ce que j’ai fait pour réhabiliter mon nom, tout va crouler et disparaître dans le sang et dans la boue parce qu’un homme aura eu la fantaisie de s’emparer de ce nom pour le souiller de tous les crimes qu’il va commettre ! j’ai eu un passé criminel effroyable, digne des plus terribles châtiments, car je n’ai reculé devant rien, pas même devant le meurtre, pour satisfaire mes passions, mais enfin au moment même où j’étais lancé à fond de train dans la voie du mal, quand j’avais le délire et le vertige du crime, j’ai eu la force, presque sans exemple, de faire une halte subite dans cette voie fatale, de changer brusquement de route et de mettre au service du bien toute l’ardeur, toute la passion, toute l’énergie que j’avais dépensées jusque-là pour faire le mal.
Tout ce que j’ai accompli de grandes et belles actions, depuis cette heureuse conversion, dépasse de beaucoup, je puis le dire, les fautes dont je m’étais rendu coupable, et, quand je jette un regard dans le passé, je puis me rendre cette justice de reconnaître que j’ai essuyé plus de larmes que je n’en ai fait couler et que j’ai sauvé plus d’innocents au péril de ma vie que je n’ai fait de malheureux pour assouvir mes vices. Je voulais amasser sur ce nom exécré de Rocambole assez de bénédictions pour le laver de toutes les haines et de toutes les hontes dont il avait été souillé jadis.
Enfin, cette haute ambition, cette œuvre gigantesque, devant lesquelles tout autre eût reculé, j’étais parvenu à les réaliser, et je me reposais, sinon dans la paix de ma conscience, car elle ne sera jamais apaisée, au moins dans la joie et dans l’orgueil d’avoir fait tout ce qui était humainement possible pour racheter les fautes du passé, et voilà que tous ces efforts, tous ces sacrifices, tous ces dévouements, toutes ces abnégations, tous ces périls affrontés, tout cela va disparaître dans l’abîme de hontes et de crimes où un misérable se prépare à replonger ce nom presque réhabilité ! Aussi ce n’est plus cette fois pour les autres seulement que nous allons combattre, ce n’est plus seulement pour la cause sacrée de la justice et de la faiblesse que nous allons affronter le danger, c’est pour nous-mêmes, c’est pour notre propre cause, c’est pour l’œuvre de réhabilitation que nous avons si péniblement édifiée et qui va crouler si nous n’arrivons à temps pour la sauver de l’immense péril qui la menace.
Vanda se leva et, pressant avec force la main de Rocambole :
— Mon ami, lui dit-elle, mettez-vous hardiment à l’œuvre, vous trouverez toujours en moi l’instrument dévoué qui ne vous a jamais failli dans les longues et difficiles épreuves que vous avez traversées.
— Oh ! je sais que je puis compter sur vous, Vanda, et soyez tranquille, vous aurez votre rôle dans les drames qui vont se jouer.
Il reprit d’un ton dégagé :
— Allons nous coucher et à demain les affaires !
XXII
LA PISTE
Le lendemain matin, nous retrouvons Rocambole, Vanda, Milon, Nizza et Albert de Prytavin réunis et attablés dans la salle à manger.
Ce dernier est celui que Rocambole désignait la veille sous le nom de Marmouset et qui, rencontré un jour par le maître dans les bas-fonds du vice, se laissa facilement convertir au bien et y est demeuré fidèlement attaché depuis.
Aujourd’hui, Albert de Prytavin, membre du club des Asperges et cavalier accompli, est admis dans le meilleur monde.
Dans la matinée, Vanda, sa femme de chambre et une ouvrière se sont réunies pour improviser un vêtement complet à Nizza, qui s’interrompt souvent de manger pour admirer sa belle toilette et la touche sans cesse avec des sourires de ravissement.
C’est qu’elle doit sortir avec Rocambole et Milon, et il était absolument impossible de la laisser aller avec sa petite jupe brune toute trouée.
— Ainsi, dit Vanda à Rocambole, c’est décidément aujourd’hui que vous entrez en campagne ?
— Oui, certes, répondit celui-ci, car j’ai fait depuis hier une découverte qui, plus que jamais, nous fait un devoir de ne pas perdre une minute.
— C’est donc quelque chose de bien grave ?
— Jugez-en.
Il tira de sa poche le portefeuille qui lui avait fourni de si précieux renseignements, tourna quelques feuillets et lut enfin ce qui suit :
« Que faire de la comtesse ? Question fort grave. Vivante, elle peut devenir d’un excellent rapport, le nouveau-né surtout, dont on peut tirer un grand parti, mais… »
— La phrase s’arrête là , dit Rocambole, mais cette interruption même a un sens terrible ; on y sent une sentence de mort suspendue sur la tête de l’infortunée qu’ils appellent la comtesse.
À ce dernier mot, Nizza bondit sur son siège.
Puis, l’œil étincelant, le teint animé, le geste fébrile, elle s’élança vers Rocambole et lui fit signe de répéter ce qu’il venait de dire.
— Qu’a-t-elle donc ? dit Vanda, surprise de cette subite émotion.
— Je ne sais, mais évidemment une de mes paroles vient d’éveiller en elle quelque souvenir que nous avons peut-être intérêt à connaître.
— Je le crois, mais quelle est celle de vos paroles qui l’a frappée ?
— Voilà ce qu’il est impossible de deviner.
Nizza eut un geste d’impatience et répéta le même signe.
— Au fait, elle a raison, dit Rocambole, c’est le seul moyen de savoir à quoi nous en tenir ; je vais redire ma phrase et nous l’examinerons tous pendant que je parlerai pour saisir le mot dont elle sera impressionnée.
Il recommanda du geste à la petite muette de bien écouter ses paroles puis il recommença sa phrase avec une lenteur et une netteté qui ne permettaient pas d’en perdre un mot.
Le regard ardemment fixé sur lui, Nizza écoutait avec une profonde attention, mais jusqu’à la fin aucune émotion ne se manifesta sur son visage.
Le dernier mot de la phrase était comtesse.
En l’entendant prononcer, la petite muette tressaillit, puis, par quelques signes plusieurs fois répétés, elle désigna le médaillon en or qui renfermait deux miniatures.
— Bon, j’y suis, dit Rocambole.
Et il tira le médaillon de sa poche.
Nizza le prit et voulut l’ouvrir ; puis, après de vains efforts, elle le remit à Rocambole en le priant d’en faire jouer le secret.
Rocambole se hâta de satisfaire son désir.
Alors avec celle ardeur, cette vivacité de geste et cette mobilité de physionomie qui distinguent les muets quand ils sont fortement impressionnés, elle montra du doigt le portrait de la jeune femme.
— Je crois comprendre, dit Rocambole après un moment de réflexion.
Et, regardant fixement Nizza :
— Cette belle dame que tu as vue là -bas, criant et se tordant dans la douleur, elle se nomme la comtesse, n’est-ce pas ?
Nizza répondit affirmativement et parut transportée de joie d’avoir fait connaître le nom de celle à laquelle elle s’intéressait.
Car dans sa pensée, comtesse était un nom, et plusieurs fois, pendant les terribles scènes du cabaret de la Providence, elle avait entendu désigner ainsi la comtesse, dont le nom de Sinabria n’avait jamais été prononcé.
— Je ne me trompais pas, reprit Rocambole, elle a entendu désigner cette jeune femme par son titre et croit que c’est son nom. Enfin nous savons maintenant qu’elle est comtesse et les lignes que je viens de vous lire nous apprennent que son sort est en ce moment l’objet d’une délibération dont le résultat peut être un arrêt de mort. Vous le voyez, du plus ou moins d’activité que nous mettrons dans nos recherches dépend la vie de cette jeune femme enlevée à sa famille et retenue au fond de quelque quartier perdu, dans un ignoble et misérable taudis, la demeure du bandit aux bras rouges.
— Et ça n’est pas tout, s’écria Vanda en se frappant le front, j’entrevois dans ce drame quelque chose d’horrible, un détail effroyable.
— Que voulez-vous dire ? demanda Rocambole.
— Dans le récit que vous a fait cette enfant et que vous m’avez répété, elle a dit que cette jeune femme jetait de grands cris et se tordait de douleur sur le lit où elle avait été déposée.
— En effet.
— Et dans les lignes que vous venez de lire, il y a ces mots : « Vivante, la comtesse peut être d’un excellent rapport, le nouveau-né surtout. »
— Oui il y a cela.
— Or, comprenez-vous maintenant pourquoi cette jeune femme criait et se tordait dans d’horribles tortures ? C’est qu’elle était en proie aux douleurs de l’enfantement.
— Oh ! c’est horrible ! horrible ! s’écria Rocambole en frissonnant.
— Voyez-vous cette jeune femme, cette comtesse, accoutumée à tous les raffinements du luxe et du bien-être, la voyez-vous enlevée violemment et devenant mère dans ce milieu infâme et dans ces terribles circonstances !
— Voilà pourquoi il faut tout mettre en œuvre pour trouver au plus vite la demeure du bandit chez lequel elle est retenue prisonnière.
— En quoi puis-je vous être utile ? demanda à Rocambole Albert de Prytavin, qui avait été mis au courant de cette affaire.
— À rien, quant à présent, répondit Rocambole, mais plus tard tu nous seras d’un grand secours, je le prévois, car les chefs de la bande à laquelle nous allons avoir affaire doivent opérer dans le monde où tu as accès et où peut-être tu les as déjà coudoyés sans t’en douter. Ton heure viendra donc, sois-en sûr, mais aujourd’hui c’est moi seul que cela regarde, moi et Milon.
Puis, se levant brusquement de table :
— Allons, dit-il à Milon, en avant, et ayons toujours cette pensée présente à l’esprit, que la vie d’une femme est, à cette heure, entre nos mains et que nous pouvons avoir sa mort à nous reprocher si nous apportons la moindre négligence dans la mission que nous nous sommes imposée.
Il ajouta d’une voix brève et d’un ton résolu :
— Que cette enfant nous mette sur la voie, qu’elle nous montre la demeure du misérable, et, je le jure, la malheureuse jeune femme n’y restera pas une heure de plus.
— Que le ciel vous vienne en aide, dit Vanda, car je vois l’infortunée dans un grand péril.
— Le succès de l’entreprise dépend d’elle, dit Rocambole en montrant Nizza.
Puis il prit la petite muette par la main et sortit avec elle et Milon.
— La petite ne connaît pas Paris, dit Milon, j’ai compris d’après les paroles de son bourreau qu’elle ne quittait jamais sa demeure, je crains donc qu’elle n’ait beaucoup présumé en s’engageant à nous conduire à la demeure de celui-ci.
— J’ai déjà réfléchi à cela, répliqua Rocambole, et j’ai fait mon plan en conséquence. Elle ne doit connaître de Paris que le trajet qu’elle a parcouru pour venir de sa demeure au Café Parisien. Nous allons donc la conduire là ; elle est intelligente, et, après avoir reconnu l’endroit où s’est terminée sa course, je ne doute pas qu’elle ne sache s’orienter, retrouver le chemin qu’elle a suivi et nous amener ainsi jusqu’à son point de départ.
Dix minutes après ils arrivaient tous au Café Parisien.
Rocambole allait y entrer, quand Nizza, le tirant tout à coup par la main avec de grandes démonstrations, lui montra le monument du Château-d’Eau.
Puis, l’attirant jusque-là , elle s’assit, sur l’appui où elle s’était arrêtée la veille et lui fit comprendre que c’était là qu’elle avait été rejointe par l’homme aux bras rouges, car c’est ainsi qu’elle le désignait en passant les mains sur ses bras avec un geste d’horreur.
— Et par quel chemin es-tu arrivée là ? lui demanda Rocambole.
Elle promena autour d’elle son regard intelligent.
Puis elle montra d’un geste brusque et décidé le boulevard Magenta.
— C’est par là ; elle n’a pas un moment d’indécision : prenons donc le boulevard Magenta.
Il s’engagea dans cette voie, en recommandant à Nizza de regarder à droite et à gauche jusqu’à ce qu’elle retrouvât la rue par laquelle elle était arrivée au boulevard.
Après un quart d’heure de marche on arrivait au faubourg Saint-Martin.
Mais il n’avait pas la physionomie de la veille, quand elle l’avait parcouru à la lumière du gaz, entre deux lignes de feu qui avaient excité son admiration.
Elle passa tout droit et arriva ainsi jusqu’au haut du boulevard Magenta, à quelques pas du boulevard Ornano.
Une fois là , elle s’arrêta tout court, regarda de tous les côtés d’un air interdit, puis ses traits prirent une expression de tristesse et elle fit signe qu’elle ne reconnaissait plus rien depuis qu’on avait quitté le boulevard Magenta.
— Allons toujours, dit Rocambole, elle a reconnu le boulevard Magenta, et un fait me prouve que sur ce point elle ne s’est pas trompée ; c’est dans cette direction que notre bandit a été emporté évanoui par la voiture de son complice.
Et ils s’engagèrent tous trois dans Montmartre.
Mais la piste était perdue, et ils rentrèrent quelques heures après sans espoir de trouver le moindre indice.
Si le lecteur veut nous suivre maintenant rue du Pont-Blanc, il reconnaîtra que Rocambole avait prophétisé plus juste qu’il ne le croyait lui-même en disant à propos de la comtesse :
— Qui sait si le couteau des assassins n’est pas déjà suspendu sur sa tête et si une heure de retard ne serait pas son arrêt de mort !
XXIII
AU BORD DE L’ABÎME
Avant de pénétrer dans le cabaret de la Providence, peut-être le lecteur est-il curieux de savoir ce qu’est devenu Rascal emporté par la voiture de sir Ralph.
Les chevaux étaient partis ventre à terre, et ce galop furieux ne s’était un peu ralenti qu’aux abords du faubourg Saint-Martin.
Là , le cocher, obéissant sans doute aux instructions qui lui avaient été données d’avance, avait pris le trot en tournant à droite pour s’engager dans le faubourg.
Alors seulement, sir Ralph s’était hasardé à abaisser une des glaces pour laisser pénétrer l’air dans la voiture, espérant que cela suffirait pour ramener Rascal à lui.
Mais celui-ci continuait à ne donner aucun signe de vie et, à la lueur du gaz, sir Ralph s’aperçut avec épouvante que son visage était toujours bleu, gonflé, et aussi rigide que si c’eût été un cadavre.
Cependant il n’osa encore s’arrêter, dans la crainte d’être poursuivi, et il ne s’y décida que vers l’extrémité de la rue de Flandre.
Mais comme il mettait pied à terre pour se mettre à la recherche d’un pharmacien, il crut entendre un gémissement.
Rascal revenait à lui.
— Patience, lui dit sir Ralph, je suis à la recherche d’un pharmacien pour…
— Un pharmacien ! n’en faut pas. Je connais mon tempérament, un bon verre d’eau-de-vie me ranimera tout de suite.
Sir Ralph eut bien vite trouvé un marchand de vin, car ce n’est pas là ce qui manque dans la rue de Flandre, et, un instant après, Rascal ingurgitait un grand verre d’eau-de-vie qu’un garçon lui apportait dans la voiture.
L’effet de l’alcool prouva qu’il connaissait bien son tempérament, comme il l’avait dit, car un instant après il recouvrait peu à peu l’usage de sa langue et de ses membres.
La voiture était repartie, au grand soulagement de sir Ralph, et au bout d’un quart d’heure elle arrivait en face du fort, sur la route du Bourget, c’est-à -dire à peu de distance de la rue du Pont-Blanc.
Ils descendirent tous deux de la voiture et sir Ralph reconnut avec joie que Rascal se tenait solidement sur ses jambes.
— Pierre, dit-il alors à son cocher, vous pouvez retourner à Paris, je prendrai une voiture dans ce quartier.
Puis il s’engagea dans la rue du Fort avec Rascal, et ils arrivaient bientôt après au cabaret de la Providence.
Ils y trouvèrent trois personnes assises autour du poêle de fonte qui occupait le milieu de la pièce, Micheline, Vulcain et Collin.
— Eh bien ! demanda Micheline à son mari, et la petite, tu ne l’as donc pas rattrapée ?
— Rattrapée et reperdue, répondit Rascal en jetant sa casquette dans un coin, c’est un singe pour la malice, je l’ai toujours dit.
— Ma foi, pour l’agrément qu’elle avait ici, elle a aussi bien fait de filer.
— Possible, mais tu ne sais pas ce qu’elle peut nous amener sur les bras, la gueuse !
— Quoi donc ?
— Toute la rousse, rien que ça.
— Comment cela ? demanda vivement le père Vulcain.
— Elle a deviné à peu près toute l’histoire de la dame qui est là ; elle l’a racontée devant moi à un particulier qui me fait l’effet de n’avoir pas froid aux yeux, qui s’y est intéressé tout de suite, et dont la première pensée, j’en suis sûr, va être d’aller faire des potins à la police, à moins qu’il ne se charge lui-même de l’affaire, en se faisant guider jusqu’ici par la muette, ce dont je le crois bien capable.
Sir Ralph, dont le visage s’était tout à coup assombri depuis un instant, s’approcha du poêle à son tour, et faisant signe qu’il voulait parler :
— Il est important que ni ma voix, ni mes paroles ne parviennent aux oreilles de la comtesse, écoutez-moi donc avec attention, dit-il.
Tous se rapprochèrent pour mieux l’entendre.
— Un seul danger nous menace, c’est elle, reprit-il en montrant la porte de la chambre, c’est sa présence ici, il faut donc qu’elle quitte cette maison ce soir même.
— Il y a danger pour sa vie, dit vivement Micheline.
— Laissez-moi dire. Il faut donc qu’elle parte, mais la question est de savoir où nous la conduirons, et c’est ce que nous déciderons après l’avoir interrogée.
— Que voulez-vous lui demander ? dit Micheline.
— Je veux qu’elle me dise si elle sait quel est le quartier où on l’a conduite.
— Si elle le sait, elle comprendra qu’il y a danger pour elle à l’avouer et elle s’en gardera bien.
— Je saurai lui inspirer assez de confiance pour qu’elle ne me cache rien.
— Et alors ? demanda Micheline.
— Si elle ne sait rien, je la fais conduire à son hôtel.
— Et si elle sait ?
— Alors on donnera tout haut au cocher, qui sera Collin, l’adresse de l’hôtel de la rue de Varennes, mais il la conduira chez Claude.
— Chez les amis de la rue de Vanves, dit Collin, c’est vraiment pas la peine de changer de logement, elle n’y sera pas mieux qu’ici.
— Mais elle y sera plus longtemps, dit sir Ralph d’un ton qui glaça ses auditeurs.
Il y eut un moment de silence.
— Bah ! dit enfin le père Vulcain, est-ce que…
— Une heure après son entrée dans la maison de Plaisance, dit sir Ralph en baissant encore la voix, nous n’aurons plus rien à craindre, nous serons pour toujours à l’abri de ses bavardages.
— Diable ! ça demande réflexion, ça, dit le père Vulcain.
— Les révélations de la petite muette, le caractère de l’homme auquel elle les a faites et l’intention fermement exprimée par lui de s’occuper de cette affaire, qui a paru l’impressionner violemment, tout nous fait une loi de suivre impitoyablement la voie que je viens d’indiquer concernant la comtesse ; sauvée si elle ne sait rien, supprimée si elle sait, ou même si elle est soupçonnée seulement.
Puis s’adressant à Micheline :
— Allez dire à la comtesse qu’on a fait demander un médecin pour savoir si elle pouvait être conduite à sa demeure sans danger, qu’il vient d’arriver et demande à être introduit près d’elle.
Micheline disparut et revint presque aussitôt dire à sir Ralph qu’il pouvait entrer.
Un instant après, celui-ci, rendu presque méconnaissable par une paire de lunettes bleues, s’asseyait au chevet de la comtesse, après avoir pris la précaution de fermer soigneusement la porte derrière lui.
Cela fait, il se pencha à son oreille et parlant à voix basse :
— Madame, lui dit-il, on a pris pour m’amener près de vous des précautions qui, je l’avoue, sont loin de me rassurer. Deux hommes sont venus me chercher en voiture à mon domicile, en me prévenant que la course était un peu longue, mais à peine avons-nous fait deux cent pas, que l’un d’eux tire un mouchoir de sa poche et que, bon gré, mal gré, ils me bandent les yeux. C’est ainsi que je suis arrivé à la porte de cette maison, dont la physionomie ni les habitants n’étaient pas de nature à me tranquilliser, car, entre nous, cela me faisait tout à fait l’effet d’un coupe-gorge. Enfin, on me fait passer dans cette chambre, près de la malade, pour que j’aie à constater, d’après son état, si elle peut, sans danger supporter un long trajet en voiture, et mes transes augmentent quand j’aperçois dans ce bouge infect une femme dont les grandes manières et la distinction frappante me font tout de suite pressentir un crime ou un guet-apens ; je vous en supplie donc, madame, dites-moi ce que je dois penser de toute cette aventure.
— Vos soupçons et vos craintes ne sont que trop motivés, monsieur, répondit la comtesse, je suis victime de je ne sais quel effroyable complot et j’ai cru jusqu’à présent qu’on en voulait à ma vie, mais je suis rassurée sur ce point par le soin qu’on a pris de vous appeler pour décider si je pouvais être transportée chez moi. Je n’ai pas le temps d’entrer dans de plus longs détails et je m’empresse de profiter des courts instants que vous avez à passer près de moi pour vous supplier de déclarer, quoi que vous en puissiez penser d’ailleurs, que mon état ne s’oppose nullement à ce que je fasse le trajet dont on redoute pour moi les conséquences. Oh ! monsieur, ajouta-t-elle en joignant les mains et d’une voix pleine de sanglots, si vous saviez quelle terrible situation est la mienne et quel puissant intérêt j’ai à me trouver chez moi aujourd’hui même ! Monsieur, je voudrais pouvoir me mettre à vos genoux pour obtenir…
— Assez, madame, interrompit vivement sir Ralph, votre cause est toute gagnée, et je me rends à votre prière sans vouloir connaître votre secret.
— Oh ! soyez béni, monsieur, soyez béni, murmura la jeune femme en portant à ses lèvres la main de sir Ralph, sur laquelle tomba une larme brûlante.
— Comptez sur moi, reprit celui-ci, mais il faut tout prévoir ; si, malgré ma déclaration, vos ennemis, changeant tout à coup d’avis, allaient persister à vous garder prisonnière…
— Hélas ! je suis à leur discrétion.
— C’est vrai ; mais moi, je n’y serai plus dans quelques instants et je puis vous arracher de leurs mains.
— Vous, monsieur.
— C’est mon devoir d’honnête homme tout simplement, madame ; seulement…
— Quoi ?

Sir Ralph jeta un regard défiant du côté de la porte.
Puis il reprit :
— Seulement il faudrait pour cela connaître le nom de cette rue, et, je vous l’ai dit, j’y suis venu les yeux bandés, de sorte que je ne sais même pas quels quartiers j’ai traversés.
— On a pris les mêmes précautions à mon égard, dit la comtesse, mais je connais sinon la rue, au moins le quartier.
Elle lui fit signe d’approcher encore.
Un léger frisson parcourut le corps de sir Ralph. Les accents de cette jeune femme l’avaient ému.
Il s’était pris de pitié pour elle.
— Allons, murmura-t-il, c’est sa sentence de mort qu’elle va prononcer.
La comtesse approcha tout à fait sa bouche de son oreille et elle lui dit :
— Ma voiture m’a conduite quelquefois dans la banlieue de Paris.
— Malheureuse ! pensa sir Ralph, elle sait !
— Or, reprit la jeune femme, le bandeau dont ces hommes avaient couvert mes yeux s’étant détaché un instant, j’ai reconnu parfaitement le quartier que nous traversions.
— Et ce quartier ? demanda sir Ralph en frémissant.
— C’est la barrière d’Italie.
Le faux docteur releva la tête et respira bruyamment.
Puis se levant tout à coup :
— Ce renseignement me suffit, dit-il. Encore une fois, comptez sur moi ; si on ne vous rend pas la liberté ce soir même, je saurai bien vous trouver demain et vous délivrer avec l’aide de quelques amis. Mais je pourrais exciter leur défiance en demeurant plus longtemps près de vous. Dans votre propre intérêt, je vais vous quitter. Adieu, madame.
Il passa dans l’autre pièce, et s’approchant de Collin :
— C’est à son hôtel qu’il faut la conduire, elle ne sait rien.
— Vous ferez ce qu’il vous plaira, dit Micheline, mais elle passera en route, c’est moi qui vous le dis, madame Bourassin me le répétait, il y a une heure encore, et c’est son cadavre que vous déposerez à la porte de son hôtel.
— L’essentiel est qu’on ne le trouve pas ici, répliqua sir Ralph. Allons, va chercher un fiacre et je te donnerai mes instructions.
XXIV
LE RETOUR
Depuis l’inexplicable disparition de la comtesse, Gaston de Coursol s’était présenté cinq ou six fois à son hôtel, donnant pour prétexte, aux yeux des domestiques, la hâte qu’il avait de voir arriver le comte et de l’entretenir d’une affaire de la plus haute gravité.
Mais le véritable but de ces visites réitérées, but connu de Fanny seule, était la comtesse de Sinabria, dont l’absence prolongée jetait le jeune homme dans de mortelles angoisses.
Il espérait toujours trouver à l’hôtel une lettre, un mot, un signe quelconque faisant savoir au moins qu’elle était toujours de ce monde.
Et chaque fois, il s’en allait désespéré, la mort dans l’âme, tremblant pour la vie de la comtesse et frémissant en même temps, si toutefois elle était sauvée, de voir arriver le comte avant qu’elle ne fût rentrée à l’hôtel, car il savait qu’elle ne survivrait probablement pas à cette révélation éclatante de sa faute.
Il était dix heures environ, et Gaston se présentait pour la sixième fois à l’hôtel de Sinabria.
Comme de coutume, il était monté au premier étage, où il était sûr de trouver Fanny dans la chambre de la comtesse.
Elle y était en effet, et à l’expression de ses traits, il devina qu’elle n’avait rien de bon à lui apprendre.
Il pâlit, et se laissant tomber sur un siège avec un profond accablement :
— Rien encore, n’est-ce pas ? balbutia-t-il.
— Plût à Dieu qu’il n’y eût rien ! répondit la femme de chambre, non moins abattue que le jeune homme.
— Quoi ! Que voulez-vous dire ? s’écria celui-ci en relevant brusquement la tête.
— Je veux dire qu’il y a une lettre.
— D’elle ! s’écria Gaston en bondissant vers Fanny.
— Hélas ! non.
— De qui donc ?
— Du comte.
Il y eut un moment de silence.
Gaston n’osait interroger de nouveau.
— Je tremble de vous questionner, dit-il enfin d’une voix défaillante.
— Et il y a de quoi trembler, monsieur Gaston !
Il y eut une nouvelle pause.
Puis le jeune homme, ne pouvant supporter plus longtemps les tortures de celle incertitude, s’écria en se frappant le front :
— Mais qu’y a-t-il donc, et que dit cette lettre ! Mais parlez ! parlez donc, Fanny !
— La voilà , dit Fanny en touchant du doigt une lettre jetée sur la cheminée.
Gaston la saisit avidement.
— Décachetée, dit-il.
— Oui, j’ai pensé, comme le mystérieux personnage d’hier, qu’il était puéril et même coupable de respecter le cachet d’une lettre, quand de son contenu dépend peut-être la vie d’une femme.
Gaston tenait la lettre au bout des doigts, mais il en détournait les regards comme s’il eût craint d’en déchiffrer les caractères.
— Et… que dit le comte ? demandait-il.
— Voyez et lisez à haute voix, car je l’ai parcourue rapidement et n’ai osé y jeter un coup d’œil depuis ; je voudrais me persuader que j’ai mal compris.
— Voyons, dit Gaston.
Et surmontant enfin l’anxiété qui faisait trembler sa main, il lut :
— « Chère Rita, je t’avais dit trois jours, mais trois jours sans te voir c’est trop long pour mon impatience. Je ne puis attendre jusque-là , cet effort est au-dessus de mon courage ; j’ai pris mes mesures pour avancer mon retour, et je serai près de toi demain soir, jeudi, avant minuit.
« GEORGES DE SINABRIA. »
— Ainsi, murmura Gaston, atterré, il sera ici dans une heure, dans dix minutes, peut-être, et la comtesse !… oh ! c’en est fait, elle est perdue, perdue sans ressource.
Il y eut un long silence, pendant lequel Gaston et la femme de chambre, anéantis, écrasés sous le poids de cette situation effroyable et sans issue, semblaient incapables de concevoir une idée.
— Il va arriver, s’écria enfin Gaston de Coursol, ce n’est plus une hypothèse, c’est un fait, un fait terrible, inévitable, imminent, auquel il faut être prêt à faire tête, car, qu’allez-vous lui répondre quand il va vous demander où est sa femme ? Quelle sera la réponse des domestiques ? et vous-même, comment expliquerez-vous l’absence de votre maîtresse ?
— Madame la comtesse a prévu cette situation redoutable, et pour tous les domestiques, hors pour moi, à qui elle a dû se confier, elle est allée passer quelques jours chez une amie intime, très-connue de son mari, et qui habite Tours.
— Mais en quatre heures on est à Tours, et, vous le voyez, le comte est trop impatient de revoir sa femme pour attendre tranquillement ici le jour où il lui plaira de revenir.
— C’est à craindre, dit Fanny.
— C’est-à -dire qu’on peut affirmer que demain, à la première heure, il partira pour Tours, où il arrivera avant midi : Là , il ne trouvera pas sa femme ; on répondra à ses questions qu’on ne sait pas ce qu’il veut dire, et alors, comprenez-vous le coup de foudre ? Et s’il n’en est frappé mortellement, vous faites-vous une idée de l’état dans lequel il reviendra ici ? À sa place, je sais que j’en deviendrais fou.
Il fut interrompu par Fanny, qui bondit tout à coup de son siège, comme mue par un ressort.
Elle était livide, et ses lèvres, agitées d’un tremblement convulsif, ne pouvaient proférer une syllabe, malgré les efforts qu’elle faisait pour parler.
Gaston de Coursol tremblait lui-même, sans savoir pourquoi, mais comprenait au trouble subit de la femme de chambre qu’il se passait quelque chose de grave.
— On a sonné à la porte cochère, balbutia enfin Fanny, recouvrant peu à peu l’usage de la parole, c’est lui, c’est M. le comte.
— Malheur ! malheur ! murmura le jeune homme atterré, j’en avais le pressentiment ; tout est perdu !
— Je cours le recevoir moi-même afin d’empêcher une parole imprudente et de retarder l’explication autant que possible, dit Fanny.
Elle sortit rapidement, laissant Gaston dans un état de stupeur et d’hébétement qui paralysait toutes ses facultés.
Semblable à l’infortuné dont la folie envahirait tout à coup le cerveau, il cherchait à fixer sa pensée, à suivre un raisonnement, à se rendre compte de ce qui se passait, et il n’y pouvait parvenir.
Tel était le trouble de son esprit, qu’il y voyait passer comme des ombres, le comte, la comtesse et lui-même sans pouvoir s’expliquer le drame dans lequel ils s’agitaient, ni le rôle que chacun y jouait.
Peu à peu, cependant, par un persévérant effort de sa volonté, il parvint à dominer cette espèce d’hallucination, la lumière se fit dans son esprit, et il comprit enfin l’horreur de la situation qui allait résulter de l’arrivée du comte pendant l’absence de la comtesse.
Pendant ce temps, Fanny, descendant rapidement les escaliers, était arrivée à la porte cochère au moment même où elle venait de s’ouvrir.
Elle se précipita dans la rue et se trouva en face d’un cocher qui était descendu de son siège pour sonner.
— Pas de malles ! dit-elle en jetant sur le fiacre un regard surpris.
— C’est-à -dire, entendons-nous, répondit celui-ci avec un rire goguenard, y en a et y en pas, n’y a pas de malles, mais je crois bien qu’y a du mal.
— Monsieur serait malade !
Et Fanny courut ouvrir la portière.
Mais elle recula aussitôt en jetant un cri de surprise.
C’est que ce n’était pas un homme, mais une femme qu’elle apercevait dans le fiacre.
Et cette femme c’était la comtesse.
C’était elle ; mais pâle, immobile, les traits profondément altérés, les lèvres livides et les yeux clos.
Un nouveau cri s’échappa de la bouche de Fanny, mais cette fois un cri de terreur.
— Miséricorde ! murmura-t-elle ensuite, on dirait une morte.
Elle s’approcha d’elle et toucha son visage.
Il était glacé !
Fanny se mit à trembler de tous ses membres.
— Grand Dieu ! fit-elle en reculant brusquement, mais c’est vrai, elle est morte !
— Je ne crois pas, ma petite bourgeoise, lui dit le cocher, qui l’avait entendue, il doit rester encore quelque chose, mais, sans vous commander, je crois qu’il ne faudrait pas la laisser moisir dans ma voiture, vu qu’il ne fait pas chaud et que…
— Où l’avez-vous prise ? demanda vivement la femme de chambre.
— Voilà ma petite bourgeoise : je flânais comme ça sur le boulevard Saint-Denis, en attendant la pratique, quand je suis accosté par un camarade. Il venait de casser son brancard et me demandait si je voulais me charger de conduire sa bourgeoise à son domicile, rue de Varennes. Ce n’était pas loin, ça me va ; il transporte la petite dame de sa voiture dans la mienne en me recommandant de ne pas trop la trimbaler, vu qu’elle était fragile, et je pars. Je l’ai ménagée, et je vous la remets en bon état, et à présent, ma petite bourgeoise, si vous trouvez que ça mérite un bon pourboire, ne vous gênez pas, je ne suis pas fier.
Pendant que le cocher lui contait son histoire. Fanny avait avancé la tête dans la voiture pour s’assurer de l’horrible vérité.
— Fanny ! murmura la comtesse d’une voix faible comme un souffle.
— Vivante ! s’écria Fanny en tressaillant de joie, elle est vivante.
Et avisant François qui venait de se montrer à la porte cochère :
— François, madame la comtesse est évanouie, prenez-la dans vos bras et montez-la à sa chambre.
XXV
MASQUE ET VISAGE
Après avoir payé le cocher, sans oublier le pourboire dont il s’était déclaré si digne, Fanny avait suivi François, qui, un instant après, déposait la comtesse sur son lit.
Gaston de Coursol, qui attendait le comte, faillit jeter un cri de joie à l’aspect de la comtesse, mais, sur un signe de Fanny, il se contint et attendit dans un coin de la chambre que le cocher fût sorti.
Alors il s’approcha d’elle, et, à la clarté de la lampe que tenait Fanny, il put la voir.
Ses yeux toujours fermés, sa pâleur cadavéreuse et ses lèvres d’un violet livide lui donnaient toutes les apparences de la mort.
Les traits du jeune homme se décomposèrent à cette vue, et son regard exprima un désespoir si navrant, que Fanny, comprenant sa pensée, se hâta de lui dire :
— Non, elle n’est pas morte, elle vient de me parler.
Puis elle courut prendre un flacon sur un meuble, le déboucha et le passa sous les narines de la comtesse.
Ses traits perdirent bientôt cette immobilité de marbre qui la rendait si effrayante, puis ses yeux s’ouvrirent et elle promena autour d’elle un regard vague, voilé, et pour ainsi dire inconscient, comme celui des petits enfants.
Cela dura quelques instants, puis un éclair d’intelligence anima ses grands yeux noirs.
Elle reconnaissait les objets.
La mémoire lui revenait rapidement, et avec la mémoire une expression de terreur et de souffrance qui contractait ses traits.
Tout à coup, elle se tourna vers sa femme de chambre, et la regardant fixement :
— Est-il revenu ? demanda-t-elle d’une voix basse et inquiète.
— Madame la comtesse veut parler de M. le comte ? demanda Fanny.
— Oui.
— Est-il de retour ?
— Non, madame.
Un rayon de bonheur éclaira sa tête pâle et flétrie.
— Le ciel ne m’a donc pas abandonnée ! murmura-t-elle faiblement.
— Rita ! soupira une voix à son oreille.
Elle tourna la tête et reconnut Gaston de Coursol. Elle lui tendit tristement la main.
— On dirait que ma présence vous afflige, Rita ? lui dit-il.
— Ah ! si vous saviez ce que j’ai souffert ! dit-elle d’une voix dont l’expression était navrante.
Elle respira péniblement, puis elle reprit :
— J’ai tant souffert, que j’ai senti quelque chose comme un voile funèbre tomber sur mon cœur et l’envelopper tout entier. C’est sous ce voile de deuil qu’il battra désormais c’est à travers ce voile que lui viendront toutes les impressions, tous les échos de la vie. Ma vie, hélas ! elle est sombre comme un tombeau et nul sentiment de joie ne viendra plus l’éclairer.
Elle tressaillit tout à coup, une profonde émotion se refléta sur ses traits et elle murmura d’une voix douce et pénétrante :
— Oh ! ma pauvre tête ! il faut qu’elle soit bien malade pour avoir oublié… j’étais aveugle et ingrate en parlant ainsi, car j’ai dans le cœur un rayon de joie qui le réchauffera et le soutiendra à travers toutes les épreuves, c’est l’image d’un ange…
— Un fils ? demanda tout bas Fanny.
— Oui, un fils et si beau !
— Mais où est-il donc ?
— Il était là bas avec moi, dans cette odieuse demeure… dont je ne veux pas parler, ma tête est trop affaiblie pour supporter de pareils souvenirs, j’en deviendrais folle.
— Il n’est pas resté là ? demanda Gaston d’un air inquiet.
— Oh ! non ; il a quitté le repaire maudit en même temps que moi.
— Mais à qui a-t-il été confié ?
— Oh ! je suis bien tranquille ; celui qui s’en est chargé est un médecin qui s’est vivement intéressé à moi, qui m’avait offert ses services, et que ces misérables, obéissant à un sentiment de pitié, ont précisément choisi pour emporter mon enfant. Je les ai vus partir tous deux dans une voiture qui précédait la mienne.
— Et où l’a-t-il conduit ? demanda Fanny.
— Chez une nourrice, puisqu’il m’est impossible de le nourrir moi-même.
— Connue du médecin ?
— Qui me répond d’elle ; il sera là comme auprès de sa mère.
— Et il vous a donné l’adresse de cette nourrice ?
— Naturellement.
— Elle demeure loin ?
— Tout près d’ici, à Plaisance : on la nomme madame Claude : une excellente femme, m’a dit le docteur.
— C’est parfait, Plaisance n’est pas loin, en effet, nous pourrons l’aller voir souvent.
Fanny garda un instant le silence.
Puis elle reprit avec quelque embarras :
— Pardon, madame la comtesse, mais malgré toute la peine que j’éprouve à vous tourmenter dans l’état où vous êtes, il faut que je vous prévienne…
— De quoi donc ? demanda la comtesse avec inquiétude.
— Eh bien ! M. le comte arrive ce soir.
— Si tôt ?
— Tenez, voici sa lettre, que j’ai décachetée dans votre intérêt, pour pouvoir prendre les mesures nécessaires ; vous y verrez qu’il annonce son retour pour ce soir, et peut-être sera-t-il ici dans une heure.
— Sitôt ! répéta la comtesse, le regard fixe et hagard.
Recouvrant enfin sa présence d’esprit :
— Écoute, dit-elle à Fanny, il paraît que j’ai plutôt l’air d’une morte que d’une vivante ; ma figure et ma faiblesse pourraient me trahir et éveiller ses soupçons, c’est ce qu’il ne faut pas. Je veux qu’il me retrouve telle qu’il m’a quittée, fraîche, souriante, pleine de vie, et c’est à toi que je m’en rapporte pour cela.
— À moi, madame la comtesse ? je ne vous comprends pas.
— Rien de plus simple pourtant ; il y a des femmes de cinquante ans qui, à force d’artifices, n’en paraissent que trente ; eh bien, ces artifices, tu vas les employer sur moi, non pour me rajeunir, mais pour dissiper toute trace de maladie et me donner toutes les apparences de la santé. Heureusement il arrive le soir, et tard, il est donc tout naturel qu’il me trouve au lit ; oui, cela est heureux, car, n’eût-il fallu rester debout que cinq minutes seulement pour éviter tous les malheurs que je redoute, j’aurais été incapable de cet effort.
Elle se tut tout à coup, sa tête s’affaissa sur sa poitrine et elle murmura :
— Fanny, je suis même trop faible pour rester ainsi, tu vas me déshabiller et me mettre au lit.
— Vous comprenez, monsieur Gaston, vous ne pouvez rester davantage, dit Fanny au jeune homme.
— Je le comprends, dit celui-ci en prenant son chapeau, je reviendrai demain.
— Ah ! lui dit vivement la comtesse, avant de venir, vous passerez chez la nourrice, vous la verrez, vous me direz si elle est jeune, belle et bien portante, comme me l’a affirmé le docteur. Et puis vous verrez aussi le pauvre petit abandonné et…
L’émotion lui coupa la parole.
— Donnez-moi l’adresse de cette femme et comptez sur moi, dit Gaston.
La comtesse voulut fouiller dans la poche de sa robe, mais elle n’en eut pas la force.
— Tiens, dit-elle à Fanny, cherche dans cette poche, mais hâte-toi, je suis si faible, je crains de perdre connaissance ; et puis si le comte arrivait, qu’il me vît en cet état, livide et défigurée comme un cadavre, tout serait perdu. J’arrive de la campagne, il faut que je sois brillante de santé, sans quoi qu’y serais-je allée faire ? il s’inquiéterait, il soupçonnerait… et, une fois la défiance entrée dans son esprit, il s’enquerrait… et finirait par découvrir. Mets-moi donc vite au lit avec mon plus beau linge, des dentelles et donne à mon visage tout l’éclat et toute la fraîcheur de la santé. Tu trouveras sur ma toilette tout ce qu’il faut pour cela.
Puis laissant tomber son front dans sa main blanche et effilée :
— Oh ! ma pauvre tête ! elle ne peut suivre deux idées à la fois. Que cherches-tu donc dans ma poche, Fanny ?
— L’adresse de la nourrice, madame, et la voici.
Gaston la prit en y jetant un coup d’œil :
— Madame Claude…
— C’est cela, dit la comtesse, partez, partez vite.
Le jeune homme se hâta de sortir.
Dix minutes après, la comtesse était au lit, parée d’une élégante toilette de nuit.
Alors Fanny, aidée de ses conseils, lui mit du rouge, du blanc, un peu de noir au coin des yeux pour en doubler l’éclat. Cette opération terminée, elle n’était plus reconnaissable.
Le pinceau avait passé sur toutes les parties de son visage, dont le ton cadavéreux avait complètement disparu sous un enduit de rouge et de blanc.
C’était un masque éclatant posé sur une tête de morte.
L’illusion était si complète, que Fanny, après l’avoir contemplée un instant, s’écria avec stupeur :
— Je n’en reviens pas moi-même, madame, on dirait que vous allez partir pour le bal.
La comtesse voulut sourire, mais l’expression d’une horrible souffrance contracta sa bouche et elle murmura d’une voix affaiblie :
— Cet effort m’a brisée, la sueur inonde mon front ; essuie-le, Fanny, et tu y remettras du blanc.
La femme de chambre fit ce que lui commandait sa maîtresse.
Le timbre de la porte cochère l’interrompit tout à coup.
— C’est lui, balbutia la comtesse ; c’est pour le coup qu’il faut sourire, coûte que coûte, et pourtant je me sens défaillir.
Elle ajouta, en tournant vers Fanny son regard sans vie :
— Cours au-devant de lui, accompagne-le jusqu’ici, et ne me quitte pas.
Fanny partit et, cinq minutes après, elle rentrait, précédée du comte, qui s’élança vers sa femme en s’écriant :
— Rita ! ma chère Rita ! nous voilà donc enfin réunis !
Et il la pressa dans ses bras avec une telle force, que la jeune femme, vaincue par la douleur, ne put retenir un cri.
— Qu’avez-vous donc, mon amie ? demanda le comte en reculant effrayé.
— Rien, répondit la comtesse, la pointe d’une épingle qui m’est entrée dans l’épaule, ce n’est rien.
Elle ajouta aussitôt d’une voix brève et en fixant sur ses lèvres serrées et frémissantes un sourire qu’elle y retint par un effort suprême :
— Ah ! vous ne savez pas, moi aussi j’ai voyagé.
— Vous ! murmura le comte, dont les sourcils se froncèrent tout à coup, car il était d’un naturel affreusement jaloux.
— Oui, je suis allée à Tours, chez mon amie Marie de Signerol, qui a été charmante ; elle a donné un bal pour fêter mon séjour, et j’ai dansé toute la nuit, c’était la nuit dernière, aussi suis-je brisée de sommeil et je dormais quand vous êtes entré.
Elle fit un signe à Fanny, qui la comprit et lui glissa un flacon de sels, en feignant de relever ses oreillers.
Elle ne pouvait poursuivre.
Un tremblement subit, produit par son extrême faiblesse, agitait tous ses membres et faisait entrechoquer ses dents l’une contre l’autre.
— En effet, chère amie, lui dit le comte avec une imperceptible ironie, je constate avec plaisir que vous avez fort bien supporté mon absence, je ne vous ai jamais vue si fraîche et si jolie.
Il ajouta après une pause :
— Mais puisque vous avez tant besoin de sommeil, je veux vous laisser reposer ; à demain, ma chère Rita.
Il lui baisa la main et sortit.
— Je le crois un peu fâché, dit Fanny à sa maîtresse.
— Il était temps qu’il mît fin, en sortant, à cette horrible contrainte, balbutia la comtesse d’une voix défaillante, j’ai cru que j’allais mourir.
En prononçant ce dernier mot, elle s’affaissa sur elle-même et ne donna plus signe de vie.

— Je vais appeler, s’écria Fanny effrayée.
— Non, non, soupira la jeune femme d’une voix si faible et si basse, qu’on l’entendait à peine, je viens de me sauver et tu me perdrais.
À force de soins, la femme de chambre parvint à la rappeler à elle.
— Maintenant, lui dit la comtesse, passe la nuit près de moi pour me secourir au besoin, demain cela ira mieux.
— Oui, murmura Fanny, mais si M. le comte a des soupçons, comment cela se passera-t-il ?
Elle ajouta en se plongeant dans un vaste fauteuil :
— Et puis, si M. Gaston allait apporter de mauvaises nouvelles de l’enfant, dans l’état où elle est, ce serait le coup de la mort !… ou la folie peut-être.
XXVI
LA POPULARITÉ
Le lendemain du jour où la comtesse de Sinabria et son enfant avaient quitté le cabaret de la Providence, nous retrouvons dans cet établissement plusieurs bandits de notre connaissance.
C’est d’abord Rascal, le maître du logis, dont la figure s’est dégonflée, mais dont les pommettes sont restées bleu azur, ce qui l’a fait surnommer le tatoué par ses camarades.
Puis Barbot, qui a les yeux tout rouges et peut à peine les ouvrir, souvenir du moyen ingénieux imaginé par Nizza pour le forcer à lâcher sa jupe. Il souffre comme un damné, et la main constamment posée sur ses yeux, qui ne peuvent supporter la lumière, il sacre, il jure, il tempête et il lance incessamment l’anathème contre l’infernale petite muette, auteur de son supplice, ne demandant au ciel d’autre grâce que de la faire tomber entre ses mains.
Ce vœu trouve un écho dans le cœur de Rascal, qui s’engage à la casser en deux si jamais il la rattrape.
Voici en outre Collin, Claude, repris de justice, comme Rascal et Barbot, le père Vulcain ; enfin quatre nouvelles figures plus sinistres les unes que les autres.
Micheline va et vient parmi ces honorables clients, servant à chacun, suivant son goût, une chopine d’eau-d’af ou une bavaroise au verre pilé, vulgairement appelée absinthe par le bourgeois.
— Plus que ça de réunion ! merci, dit Collin au père Vulcain, et quel chic ! y en a deux qui ont du linge ; on se croirait au Café de Paris. Ah çà , qu’est-ce qui va donc se passer ici ce soir ?
— Il paraîtrait que nous allons voir face à face notre chef, mais là , notre vrai chef, c’est comme qui dirait une présentation.
— Je le connais, notre chef, c’est sir Ralph.
— Tu n’y es pas ; sir Ralph n’est que son lieutenant, ce qui ne l’empêche pas de déjeuner au Café Riche, où je l’ai vu entrer encore pas plus tard qu’hier.
— Tu fréquentes ces quartiers-là , toi ?
— J’ai habité par là autrefois, rue Saint-Georges, et véritablement, mon ami Collin, on ne peut pas vivre ailleurs ; passé le boulevard de Gand, c’est la banlieue.
— C’est sans doute dans ces parages que monsieur achète ses deux sous de ficelle ?
— Non, c’est à la Civette, elle est plus juteuse. Mais faut pas blaguer, papa, on le connaît le Café Riche, et même qu’on y déjeune quelquefois.
— Toi avec ces frusques ! oh ! là , là .
— Oui, moi… dans la personne de mon fils.
— Hein ! t’as un fils ?
— Dont je devrais être fier, mais que je désavoue, vu sa conduite envers son auteur.
— Qu’est-ce qu’il t’a donc fait ?
— Je vais te le dire ; quand j’ai de la peine, j’aime à m’épancher dans le sein d’un ami.
— Oui, ça te prend généralement au troisième verre d’absinthe, j’en ai fait la remarque.
— L’absinthe, tiens, voilà justement ce qui nous a brouillés.
— Comment ça ?
— Mon fils est artiste, c’est une vocation qu’il tient de son père, car j’étais modèle, et, si tu allais au Luxembourg, tu y verrais mon torse sous toutes les formes ; c’est de là que m’est venu le surnom de père Vulcain ; mais je n’étais pas seulement artiste, j’avais une loge à moi.
— Aux Italiens ?
— Non, au rez-de-chaussée d’une maison de la rue Saint-Georges, et mon propriétaire, qui avait du bon, quoique ingriste, avait logé mon fils sous les combles, où il s’était arrangé une manière de petit atelier, le tout à l’œil.
— C’était gentil de la part de cet homme.
— Je ne dis pas non, mais enfin il était ingriste, ça ne pouvait pas marcher longtemps entre nous deux. En effet, un jour que je sortais de prendre l’absinthe avec un ami, je rencontre mon propriétaire ; ce jour-là , j’étais plein de douceur et de mansuétude, je l’aborde poliment, et je le prie, là , d’amitié, de renoncer à ses opinions et de convenir avec moi que M. Ingres n’était qu’un polisson. Il refuse : qu’aurais-tu fait à ma place ? je te le demande ; naturellement tu serais tombé sur ton propriétaire à bras raccourci et tu l’aurais roulé dans le ruisseau ; c’est ce que je fis. Un autre à sa place m’eût payé l’absinthe, c’eût été une noble vengeance ; mais il était ingriste, c’est tout dire ; le lendemain, mon fils et moi, nous étions sur le pavé. Mon fils faisait peu d’économies et je me voyais souvent dans la nécessité de les manger, nécessité cruelle pour un père, mais on a un principe ou on n’en a pas, or, mon principe à moi, c’est le droit à l’absinthe.
Un jour donc que la dèche était au grand complet, je dis à Jacques : — Tu sais bien, Jacques Turgis ? tu dois connaître son nom, pourvu que tu aies une teinture des arts ; Jacques Turgis, le paysagiste, genre Troyon, avec plus d’air et moins de vaches, — je lui dis donc : « Mon fils, je puis le dire à ma louange et sans crainte d’être démenti, depuis l’âge de raison, jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans où je suis parvenu aujourd’hui, je n’ai jamais passé un jour sans prendre l’absinthe ; or, tu ne voudrais pas qu’il fût dit… »
Il fut interrompu tout à coup par l’entrée de sir Ralph.
— Je te conterai le reste plus tard, mon vieux, dit alors Vulcain à son ami, et tu verras tout ce que ce fils dénaturé a versé d’amertume dans mon cœur de père.
— Enfin, il y a versé quelque chose, répliqua Collin, ça remplaçait l’absinthe.
L’entrée de sir Ralph avait fait sensation.
On s’était empressé de lui faire place près du poêle et on lui avait cédé la plus belle chaise de l’établissement.
— On veille au dehors ? demanda d’abord sir Ralph à Rascal.
— Soyez tranquille, ils sont quatre, et à la moindre figure équivoque…
— C’est bien, dit sir Ralph en prenant place près du poêle.
Tous les regards étaient fixés sur lui, et on attendait.
— Mes amis, dit-il, en parcourant du regard ce cercle de bandits aux yeux de tigre, je vais commencer par vous adresser une question : Êtes-vous contents de votre sort ?
Il y eut un moment d’hésitation.
— Dame ! fit le père Vulcain.
— Comme ça ! dit Collin à son tour.
— On boulotte, ajouta Barbot.
— On joint les deux bouts, dit un quatrième.
— Voilà le grand mot lâché, s’écria sir Ralph, on boulotte, on joint les deux bouts ; eh bien, franchement, ce n’est pas assez pour des gens qui jouent tous les jours leur tête ou le bagne à perpétuité. Qu’on se contente de boulotter quand on mène la vie tranquille, idiote et béate d’un mercier ou d’un horloger, qu’on s’estime heureux de joindre les deux bouts quand on est décidé à tourner tous les jours la même roue, comme un écureuil en cage, et à s’arranger pendant quarante ans de cette existence abrutissante, je comprends cela, et c’est la seule ambition à laquelle puissent s’élever ces larves de la civilisation, dont le rôle ici-bas est de ramper, dont la nature débile se refuse à toute émotion puissante, dont l’esprit hébété ne saurait comprendre les passions qui dévorent des hommes tels que vous et qui se déclarent vertueuses parce qu’ayant de l’eau tiède dans les veines, nul désir, nulle aspiration ne les pousse en dehors de la voie mathématiquement tracée par la loi.
Un murmure d’approbation se fit entendre de toutes parts.
Véritable orateur populaire, sir Ralph savait qu’il faut parler au peuple, non pour réprimer ou blâmer ses passions, mais pour les flatter et les exalter, et l’on voit qu’il savait quel langage il fallait tenir à son peuple à lui.
Après s’être assuré qu’il avait touché juste, il reprit après une pause et sur un ton un peu plus déclamatoire :
— Et quelles lois que les leurs ! ah ! parlons-en, de ces lois ! elles sont sévères, inflexibles, impitoyables pour le misérable qui ne craint pas de voler une livre de plomb à son semblable ! pour le monstre assez dénaturé, assez abandonné du ciel pour oser acheter cette livre de plomb ! car voilà de ces méfaits qui ébranlent une société jusque dans ses fondements.
« Voler le plomb d’autrui ! quel crime abominable ! Aussi n’est-il pas de châtiments assez sévères pour punir de pareils crimes. Ah ! parlez-moi des hommes honorables, vêtus de noir, cravatés de blanc, et parfois même décorés, qui se mettent en boutique pour voler ! Ceux-là ne s’intitulent pas brutalement caroubleurs, roulottiers, voleurs au bonjour ou à l’américaine. Oh ! non, pas si simples, ils prennent les titres plus rassurants et garantis par le gouvernement de banquiers, d’agents de change, de membres de comités de surveillance, de notaires et, au lieu de détrousser les gens sur le grand chemin, métier dangereux et malsain, ils attendent tranquillement devant un bon feu qu’ils apportent eux-mêmes leur argent dans la caisse qu’ils sont bien décidés à emporter le jour où elle sera suffisamment remplie à leur gré. Ceux-là se laissent aussi pincer quelquefois ; quand ce malheur leur arrive, mon Dieu ! la justice ne leur demande pas précisément quelle est la peine qu’il leur serait le moins désagréable de se voir appliquer, mais elle sait que la peine la plus juste, la plus rationnelle et la plus redoutée de ces messieurs consisterait à leur faire restituer le fruit de leur vol, et elle s’en garde bien. On rend la livre de plomb, mais on ne rend pas les millions ; les roulottiers sont condamnés au bagne, les banquiers et les notaires à six mois de prison et à cinq cents francs d’amende ; voilà leur loi ! S’indigner contre elle serait inutile et absurde, il y a quelque chose de mieux à faire, c’est d’en tirer parti en cherchant dans le Code même le moyen de voler sans danger.
« Voilà ce que je rêve pour vous, pour nous tous depuis longtemps ; mais, pour mettre à exécution une pareille idée, il fallait un homme supérieur, d’une intelligence hors ligne, d’une audace sans égale et joignant à ces grandes qualités un passé assez éclatant pour nous inspirer à tous une confiance aveugle ; eh bien ! cet homme, il existe, il consent à se mettre à notre tête et son nom seul vous prouvera que je ne l’ai pas trop vanté ; il s’appelle Rocambole.
— Rocambole ! s’écrièrent toutes les voix à la fois.
Tous les bandits s’étaient levés, en proie à un véritable enthousiasme.
— Où est-il ? demanda l’un d’eux.
— Il y a cinq jours il était au bagne ; je lui ai écrit que nous comptions sur lui…
— Et maintenant ?
— Il est parmi vous.
XXVII
LE MAÎTRE À TOUS
À ces mots, tous les bandits se regardèrent mutuellement.
— Parmi nous ! dit le père Vulcain après avoir dévisagé tous ses camarades ; dame ! nous nous connaissons à peu près tous et je ne vois pas…
— C’est le seul qui ne se soit pas levé quand j’ai prononcé le nom de Rocambole, répliqua sir Ralph.
Tous les regards se tournèrent alors vers un individu qui, seul, en effet, était resté assis près du poêle.
Rien dans sa mise ne le distinguait de ses camarades, sinon qu’il avait du linge, particularité qui l’avait déjà signalé à l’attention de Collin.
Il était d’une taille un peu au-dessus de la moyenne. Sa pose pleine d’aisance, ses membres bien proportionnés, son air libre et dégagé, et par-dessus tout ses grands yeux d’un gris verdâtre dont la fixité étrange et l’éclat magnétique lui donnaient une vague ressemblance avec certains oiseaux de proie, tout cela en faisait un personnage qui imposait dès le premier abord et dans lequel on reconnaissait tous les signes d’une incontestable supériorité.
Impassible sur le siège où il était resté assis, il promenait lentement autour de lui son regard froid et pénétrant, et son œil de faucon semblait fouiller jusqu’au tuf l’individu sur lequel il s’arrêtait.
Quand il les eut tous, pour ainsi dire, jaugés l’un après l’autre, il prit enfin la parole :
— Oui, dit-il d’une voix grave et avec un léger accent étranger, je suis Rocambole, ce Rocambole dont vous avez tous entendu parler et qu’on croyait mort, parce que, fatigué de tout et surtout de la vie dont il avait si largement usé, il restait au bagne de Toulon sous un nom d’emprunt, voulant être aussi complètement oublié que s’il eût été au fond de la tombe. Je suis ce Rocambole qui, sorti de la lie du peuple, a parcouru tous les degrés de l’échelle sociale, qui a fréquenté le plus grand monde, étalé le luxe le plus effréné, porté les noms les plus aristocratiques pour retomber tout à coup de ces hautes régions dans les bas-fonds où grouillent tous les maudits et tous les déshérités de la vie. Et savez-vous ce que c’est que Rocambole ? Un seul fait va vous apprendre à l’apprécier. Un jour, c’était encore au bagne de Toulon, un de ses camarades est condamné à mort. L’arrêt était injuste. Rocambole décide qu’il ne s’exécutera pas et il prend l’engagement solennel de sauver le condamné ; le jour de l’exécution arrive, l’heure fatale sonne, l’échafaud se dresse, tous les forçats sont réunis autour de l’instrument sinistre, enfin le malheureux forçat en monte les degrés, pâle, livide, voyant déjà sa tête rebondir sanglante au fond du panier, et Rocambole, présent comme les autres à la sanglante cérémonie, restait impassible, le regard fixé sur le condamné. Enfin, on le jette sur la planche, on le glisse sous le terrible couperet, qui tombe… et s’arrête à six pouces du cou. La lame avait rencontré dans sa chute des fragments de fer incrustés dans la rainure, où désormais elle ne pouvait plus glisser, ce qui força le bourreau à reculer l’exécution de vingt-quatre heures.
Un murmure d’admiration accueillit cette prodigieuse histoire, dont quelques-uns avaient entendu parler.
Rocambole poursuivit :
— Mais le lendemain, quand le geôlier se rendit à la prison pour y prendre le condamné, il ne trouva personne ; le prisonnier avait disparu. On fouilla le bagne de fond en comble et on s’aperçut alors qu’il manquait quatre hommes : le condamné à mort, Rocambole et deux autres qu’il avait plu à celui-ci d’emmener avec lui.
— Pristi ! murmura Collin, ce n’est pourtant déjà pas si facile de s’en sauver tout seul de ce bagne-là !
— Je l’ai quitté trois fois, répliqua Rocambole, et la dernière fois c’était pour me rendre parmi vous. Le lundi, par un intermédiaire que je m’étais ménagé avant d’y rentrer, je recevais la lettre par laquelle mon ami Ralph me priait de venir me mettre à votre tête ; le lendemain, à la même heure, je sortais du bagne, et trois jours après je faisais mon entrée dans Paris sous le nom de Mac-Field, que je porterai désormais dans le monde. J’ai accepté la proposition de Ralph, à une condition, c’est que mes ordres ne seront jamais discutés, c’est que je trouverai en vous une obéissance passive et une confiance aveugle, c’est qu’enfin, retenez bien cela, j’aurai le droit de vie et de mort sur les traîtres, si jamais il s’en trouvait parmi vous.
Un silence glacial suivit ces derniers mots.
— C’est raide, dit enfin le père Vulcain.
— Que t’importe si tu ne veux pas trahir ?
— Certainement je ne veux pas trahir, mais je ne voudrais pas non plus être complice d’un assassinat, même par ma seule présence.
— C’est pourtant ce qui arrivera, il faut t’y attendre ; d’ailleurs un acte de justice n’est pas un assassinat.
— Eh bien ! soit ; mais on ne tuera pas sans preuves au moins ?
— Pour qui me prends-tu ? je suis impitoyable, mais avant tout je suis juste. Maintenant écoutez-moi : en échange de l’engagement que vous prenez tous de m’obéir aveuglément, voici celui que je contracte vis-à -vis de vous, et vous savez, par l’exemple du condamné dont j’avais promis de sauver la tête, quel cas on doit faire de ma parole. Je vous ramasse tous ici déguenillés, misérables, traînant la savate, fuyant le jour comme des chauves-souris, maigres, hâves, le teint terreux et la figure sinistre ; eh bien, avant huit jours, vous aurez tous changé de pelure et de figure. Vous serez confortablement vêtus, vous serez nourris comme des financiers, vous fumerez des londrès, vous aurez la mine fleurie et rebondie, au lieu de ces maigres et sinistres figures de mendiants et de bandits qui vous signalent tout de suite au regard défiant de l’agent de police, et, loin de vous cacher honteusement dans d’ignobles tapis-francs, où vous buvez du vitriol en guise de cognac, vous vous montrerez ouvertement sur les boulevards et au bois de Boulogne, où vous exciterez l’admiration par l’éclat de vos toilettes et l’ampleur de vos mollets.
Un sourire d’incrédulité passa sur tous les visages à ce séduisant tableau.
— Allons donc ! fit tout bas Vulcain en haussant les épaules.
— Il veut nous épater, murmura Barbot.
— Il nous la fait à l’oasis, dit Collin.
— Bref, reprit Mac-Field avec un calme imperturbable, je veux faire de vous tous des domestiques de grande maison, le sort le plus enviable qu’il y ait en ce monde.
— La livrée ! murmura Vulcain, pour un artiste, pour un homme qui a posé devant Delacroix et qui a semé son torse sur toutes les parties du globe, c’est dur.
— Imbécile ! lui dit Mac-Field, aimes-tu mieux crever de faim sous la livrée de la misère et du crime ?
— Au fait, je n’avais pas réfléchi à ça, répliqua le vieux modèle, livrée pour livrée, j’aime mieux celle qui tient chaud.
— Mais, reprit Mac-Field, ne croyez pas que je vous estime assez peu pour vous condamner à la livrée à perpétuité, non, non, cette situation n’est pour vous tous qu’un marchepied pour arriver à la fortune.
— Comment ça, demanda Collin, en économisant sur nos gages ?
— Allons donc ! il vous faudrait trente ans pour amasser de quoi grignoter une croûte de pain au fond d’un village breton.
— Alors, je ne comprends pas…
— Voilà ce que c’est ; il y a dans Paris une famille qui, d’ici à quelque temps, va hériter d’une fortune de nabab ; cette fortune, j’ai résolu qu’elle tomberait entre nos mains. Mais vous comprenez que cela ne se fera pas tout seul ; pour en arriver là , il faut tenir dans nos mains tous les membres de la famille que nous voulons dépouiller, et le seul moyen d’atteindre le résultat que nous nous proposons, c’est de vivre dans leur intimité, c’est de connaître jour par jour, heure par heure, toutes leurs démarches et, autant que possible, toutes leurs pensées ; voilà pourquoi je veux mettre près de chacun d’eux un espion, c’est-à -dire un domestique qui me tienne incessamment au courant de ce qu’il aura vu et entendu.
— Parfait ! je saisis, s’écria Collin.
— Moi aussi, je saisis, dit Claude qui, s’il n’avait rien dit jusque-là , avait tout écouté avec une extrême attention, moi aussi je trouve cela parfait ; mais, quand nous aurons fait réussir cette grande opération financière dont le succès va dépendre de nous seuls, quelle sera notre part dans le gâteau ?
— Elle est déjà faite, répondit froidement Mac-Field.
— Et le chiffre ?
— À chacun cent mille francs.
— C’est flatteur.
— Est-ce tout ce que tu as à dire ?
— Non.
— Parle.
— Je me demande comment vous vous y prendrez pour faire mettre à la porte les domestiques qui sont déjà en place dans ces maisons et pour nous faire entrer chez leurs maîtres.
— Ça, c’est mon affaire, j’ai une combinaison dont le succès est certain, que cela te suffise, et, si cette réponse ne te satisfait pas, voilà la porte.
— Oh ! ça me suffit, ça me suffit, répondit Claude un peu déconcerté par le regard que Mac-Field venait de laisser tomber sur lui. Seulement !
— Quoi encore ? demanda celui-ci d’un ton bref.
— Je voudrais demander s’il ne faudrait pas aussi des femmes, des cuisinières, des femmes de chambre.
— Des femmes de chambre, oui, répondit vivement Mac-Field, leurs fonctions les retiennent constamment près de leur maîtresse et les mettent à même de connaître bien des secrets.
— C’est que j’ai une fille jeune et jolie qui…
— Jeune et jolie, ce sera une camériste très-recherchée, je m’en charge.
Il ajouta après une pause :
— Un dernier mot. Avant huit jours, vous serez tous placés et vous recevrez mes instructions sur la conduite que vous aurez à tenir chez vos différents maîtres ; mais, en attendant que je vous convoque, vous allez cesser absolument votre petite industrie, et, comme d’ici là vous ne pouvez vivre de l’air du temps, je vous prie d’accepter cette petite somme que je vous offre à titre de bienvenue.
Et tirant un petit sac de sa poche, il le vida sur une table éclairée par la lueur d’une chandelle.
C’était de l’or.
En voyant les pièces de vingt francs étinceler sur la table, tous les bandits, saisis de vertige et cédant à un irrésistible instinct, s’élancèrent de ce côté.
— Un instant ! s’écria Mac-Field en se jetant au-devant d’eux, il y a là deux cents francs pour chacun de vous, c’est sir Ralph qui va en faire le partage. Restez donc à vos places, car j’ai une nouvelle à vous apprendre.
Au commandement du maître, tous revinrent s’asseoir en cercle autour du poêle.
— Malheureusement, reprit gravement Mac-Field, ma nouvelle n’est pas gaie.
Et, promenant autour de lui son regard froidement résolu.
— Mes amis, nous sommes trahis, à l’heure où je vous parle nous sommes cernés par la police, qui nous enveloppe à cent pas de distance, et c’est pour cela que vos sentinelles n’ont pas bougé.
Tous les bandits avaient pâli.
— Cernés ! murmura l’un d’eux.
— La police n’attend qu’un signal pour se ruer sur cette maison, reprit Mac-Field, et ce signal, un coup de pistolet, doit partir d’ici, car il y a un agent parmi nous.
XXVIII
PRIS AU PIÈGE
— Un agent ici, parmi nous ! s’écrièrent plusieurs voix en même temps.
Tous s’étaient levés et se regardaient mutuellement avec défiance.
Sir Ralph allait bondir du côté de Mac-Field, quand celui-ci lui jeta un regard d’intelligence qu’il comprit, car il resta immobile à sa place.
— Un agent ici ! s’écria de nouveau Rascal en roulant autour de lui des regards farouches, mais où est-il ? où est-il donc ?
Mac-Field, lui, les mains dans les poches, paraissait assister à ce spectacle avec une parfaite indifférence.
Les bandits continuaient à se toiser avec défiance, la main sur le manche de leur couteau, et un silence de mort rendait la scène plus lugubre et plus effrayante encore.
— Vous demandez où est cet agent qui a eu l’audace de se glisser parmi nous, dit Mac-Field, je vais vous le désigner, ce martyr de la police, cet ambitieux agent qui n’a pas craint de risquer sa vie dans l’espoir d’obtenir de l’avancement, leur rêve à tous !
Le regard fixé sur Mac-Field, chacun attendait, avec une indicible angoisse le nom qui allait sortir de ses lèvres.
Il reprit après une pause :
— Quel est celui qui, seul ici, n’a pas son couteau à la main ?
À ces mots, tous les yeux se tournèrent vers un des quatre inconnus qu’on voyait pour la première fois au cabaret de la Providence.
Il disait se nommer Godard.
Lui seul n’était pas armé.
Il avait les mains dans ses poches.
C’était un homme d’une trentaine d’années, de petite taille, d’une physionomie intelligente, l’œil vif et perçant.
Il était affreusement pâle et tout son corps était agité d’un imperceptible tremblement.
Mac-Field reprit :
— Demandez-lui pourquoi il tient si obstinément les mains dans ses poches, et, s’il refuse de vous le dire, fouillez-le donc.
Rascal voulut s’élancer sur lui. Godard fit aussitôt un mouvement pour ôter la main droite de sa poche.
Mais, au même instant, il était étreint si brusquement et avec une telle violence, qu’il lui devenait impossible de faire un geste.
C’était sir Ralph, qui, prévenu tout à l’heure par un coup d’œil de Mac-Field, s’était posté derrière lui, l’avait épié et venait de le saisir à bras-le-corps.
Tandis qu’il le tenait ainsi, il fut facile à Rascal de le fouiller et de tirer de sa poche un revolver qu’il tenait tout armé.
— Voilà le traître, dit Mac-Field, et voilà l’arme qui devait donner le signal.

Puis, croisant les bras sur sa poitrine et promenant sur les bandits un regard triomphant :
— Eh bien ! s’écria-t-il, croyez-vous que je sois arrivé à temps parmi vous ? Sans moi, vous étiez tous pincés à l’heure qu’il est.
S’adressant ensuite à l’agent que Rascal tenait par le bras :
— Toi, ton compte est clair ; sachant qui tu étais et quelle était la mission que tu avais acceptée, j’ai néanmoins déroulé devant toi le plan que j’ai conçu et expliqué à chacun le rôle qu’il aurait à y jouer ; c’est assez te dire que ta mort est résolue.
L’agent de police, recouvrant subitement tout son courage en face de ce dénouement terrible, inévitable, regarda fixement Mac-Field et répondit avec calme :
— Vous n’oseriez.
— En vérité ! répliqua Mac-Field en ricanant, et pourquoi cela ?
— Parce que vous seriez arrêtés par la peur de l’échafaud, car vous savez que vous êtes cernés par mes camarades et que pas un de vous ne peut leur échapper.
— En es-tu bien sûr ?
— Aussi sur que vous-mêmes qui n’en pouvez douter.
— C’est ce qui te trompe, maître Godard, et je vais te prouver tout de suite qu’au lieu d’être tous pincés, comme tu t’en flattes, pas un de nous ne tombera aux mains de tes amis.
Un sourire incrédule effleura les lèvres de l’agent.
— À midi, je connaissais ton projet, reprit Mac-Field, et c’est toi-même qui me l’as révélé.
— À midi ? murmura Godard interdit.
— Où étais-tu à cette heure ?
L’agent feignit de chercher.
— Je vais aider ta mémoire, reprit Mac-Field. À midi, tu étais rue Saint-Antoine, à l’Arche de Noé, un marchand de vin fort achalandé.
Godard se déconcertait de plus en plus.
— Tu causais là à cœur ouvert avec un collègue sans remarquer que le poêle, dont tu t’étais rapproché, coupait une cloison et se trouvait à cheval sur deux pièces.
— Eh bien ? fit Godard.
— Eh bien ! il y avait des vides entre le poêle et la cloison, et, comme j’étais assis dans la pièce voisine, également près du poêle, tes paroles me parvenaient par ces vides aussi distinctement qu’à ton collègue lui-même.
Godard resta quelques instants anéanti.
— Vous sortiez tous deux au bout d’une heure, et tu m’avais confié, sans t’en douter, que le chef de la sûreté, prévenu de l’existence d’une bande redoutable dans Paris, et sachant qu’elle se réunissait rue du Pont-Blanc, au cabaret de la Providence, quinze agents allaient être envoyés le soir même pour opérer cette capture, tu avais tout conté, jusqu’au rôle que tu devais jouer, et que tu joues en ce moment dans l’affaire, tout, excepté le dénouement, que tu ne connaissais pas encore, et que tu ne pouvais prévoir.
Le malheureux agent, l’œil hagard et les traits bouleversés, avait perdu toute son assurance.
Cependant, après un moment de silence, son œil s’illumina tout à coup et il répliqua :
— Tout cela est exact, j’en conviens ; mais à quoi cela vous avance-t-il ? vous n’en êtes pas moins cernés et dans l’impossibilité de fuir.
— J’allais aborder cette question, maître Godard. Une fois renseigné, je quitte à mon tour le marchand de vin, je prends une voiture, j’accours ici et je visite la maison du haut en bas, dans l’espoir d’y trouver quelque issue secrète qui nous permette d’échapper à la troupe de M. le préfet de police. C’est que la situation était difficile, maître Godard ! Pas moyen de prévenir mes amis, dont il m’était impossible de me procurer l’adresse, par la raison bien simple que la plupart d’entre eux ignorent le matin leur domicile du soir. Il fallait forcément les laisser venir s’engouffrer l’un après l’autre dans la souricière où la police allait les guetter et les pincer tous. Je n’avais qu’un moyen de les sauver, un seul, empocher d’abord le signal convenu, ce que je viens de faire, trouver ensuite ou pratiquer l’issue qui devait être notre salut, et c’est fait.
Un murmure de stupeur se fit entendre à ces derniers mots.
Quoique déjà accoutumés à croire que rien n’était impossible à Rocambole, les bandits semblaient pourtant douter de ce dernier tour de force.
Cette impression n’échappa pas à Mac-Field.
— Il y a ici des gens qui osent douter quand j’affirme, dit-il en se redressant de toute sa hauteur et en les toisant d’un regard de dédain ; eh bien, tenez.
Il courut à la cheminée, où il n’y avait pas de feu, puisque la pièce était chauffée par le poêle de fonte, et, touchant du pied la haute et large plaque qui couvrait le fond de l’âtre, il la fit tomber à terre.
On put voir alors, derrière cette plaque, une vaste ouverture pratiquée dans un mur de briques.
— Eh bien, maître Godard, et vous tous, dit Mac-Field en s’adressant à la fois à l’agent et aux bandits, qu’en dites-vous ? vous ai-je trompés ? Voilà l’issue par laquelle nous allons fuir. Après m’être assuré que ce mur de briques était mitoyen avec la propriété voisine et que cette propriété était inhabitée en ce moment, j’ai songé tout de suite à tirer parti de cette double circonstance, et voilà ce que j’ai fait, seul et de mes propres mains.
— Sauvés ! nous sommes sauvés, murmurèrent Collin, Barbot et le père Vulcain.
— Oui, vous êtes sauvés, dit Mac-Field, car cette brèche ouvre sur un vestibule qui aboutit à un vaste jardin, et au bout du jardin c’est la plaine des Vertus.
— Oui, mais la plaine n’est pas libre, fit observer le père Vulcain ; il doit y avoir là pas mal d’agents, puisque nous sommes cernés de tous côtés.
— Sans nul doute, mais j’y ai songé et j’ai trouvé le moyen de nous en débarrasser.
— Comment cela ?
— En donnant le signal convenu au moment même où le dernier d’entre nous disparaîtra par cette brèche, lequel aura soin de relever cette plaque et de la remettre en place, ce qui sera facile à l’aide d’un crochet de fer que j’ai préparé d’avance. Au bruit du coup de feu, ils s’élanceront tous vers le cabaret, nous laissant libres de filer du côté de la plaine, et, avant qu’ils aient découvert le secret de notre fuite, nous aurons tous le temps de gagner du terrain.
— Où nous retrouverons-nous ? demanda Claude.
— Rue Gracieuse, à l’hôtel de la Paix.
— Un hôtel ! fit Collin.
— Hôtel garni et marchand de vin à la fois, répondit Mac-Field.
— À la bonne heure !
Après une longue pause, Mac-Field reprit d’une voix lente et grave :
— Maintenant il est un point sur lequel il faut que nous soyons tous d’accord.
Et, laissant tomber sur l’agent un regard implacable, il ajouta :
— C’est la mort de cet homme !
Ces mots furent suivis d’un silence funèbre.
— Il sait tous nos secrets, et il s’est glissé parmi nous comme un traître, poursuivit Mac-Field, il a mérité doublement la mort ; tout nous en fait une loi, la justice et notre propre intérêt.
Personne ne répondait, et une hésitation visible se lisait sur tous les visages.
Le malheureux agent, blanc comme un linge et agité d’un tremblement qui trahissait ses angoisses, promenait de l’un à l’autre un regard effaré, essayant de lire son sort sur tous ces visages.
— Tu as peur ? lui dit Mac-Field d’un ton méprisant.
— J’ai une femme et des enfants, répondit simplement l’agent.
Il y eut un faible murmure, murmure de pitié qui fit jaillir des yeux de l’infortuné un rayon d’espérance.
— Imbéciles ! s’écria Mac-Field, quand ils s’emparent de nous et jettent notre tête au bourreau, s’inquiètent-ils de savoir si nous avons des enfants ?
Puis, le regard fixé sur l’agent, il reprit au bout d’un instant :
— Eh bien, soit, je veux faire droit à vos scrupules, pas de meurtre, nous allons le juger.
XXIX
L’EXÉCUTION
Tout le monde s’était assis.
L’agent Godard promenait autour de lui un regard mobile et inquiet, faisant d’inutiles efforts pour dominer le tremblement nerveux qui secouait tous ses membres.
C’est qu’il songeait qu’en ce moment même, sa femme et ses deux petites filles se mettaient à table, après l’avoir attendu jusqu’à cette heure.
Il les voyait assises autour de la soupière fumante, la femme un peu contrariée, mais non inquiète d’un retard qui s’expliquait par le genre de ses occupations, les enfants insoucieuses de ce retard, jouant et riant entre elles.
Et ce rire joyeux, éclatant, argentin, traversant son imagination à cette heure funeste, lui brisait le cœur et lui faisait monter les larmes aux yeux.
Car il se disait que, dans quelques heures, on allait le rapporter sanglant et inanimé au milieu de ces trois êtres si heureux, dans cette demeure où retentissaient de si joyeux éclats de rire.
Et quand son regard se portait au delà de ce tableau si terrible et si navrant à la fois, il voyait la femme et les pauvres enfants, si rieurs et si heureux la veille, tristes et désespérés, accablés par la misère, souffrant la faim et le froid et pleurant celui qui, lorsqu’il était là , avait toujours éloigné de sa famille les privations dont ils souffraient si cruellement aujourd’hui.
Et, en pensant à ceux qu’il aimait tant et qui allaient rester exposés à de telles tortures, il était tenté de s’humilier devant ces misérables, de se traîner à leurs genoux et de leur demander grâce de la vie.
Il l’eût fait peut-être s’il eût espéré les attendrir, foulant aux pieds tout sentiment d’orgueil et de dignité, pour ne songer qu’à sa femme et à ses enfants, mais quelle pitié attendre de ces hommes ?
Cette pensée l’arrêta et il attendit en silence qu’on décidât de son sort.
Tous les regards étaient tournés vers Mac-Field, dont chacun attendait la parole et épiait les impressions.
— Eh bien, dit enfin celui-ci, que voulez-vous faire de cet homme ? Parlez. Il est venu ici pour saisir nos secrets, pour nous trahir ensuite et avec le plus ardent désir de nous envoyer tous au bagne, sinon à l’échafaud, sachant combien il serait agréable à son chef de voir tomber nos têtes et voyant dans ce sanglant holocauste l’occasion d’un rapide avancement. Il a réussi ; il ne lui manque plus, pour achever son œuvre, que d’obtenir la liberté, afin d’aller rendre compte de sa mission et de nous signaler à la sollicitude de la police. Eh bien, qui vous empêche de lui rendre ce service ?
— Écoutez, maître, répliqua le père Vulcain, je crois qu’on peut se tirer de là par un moyen dont nous venons de causer par ici et qui arrangerait tout.
— Voyons ton moyen.
— Cet homme a une femme et des enfants qu’il aime, on peut même dire qu’il adore, car c’est cette pensée-là qui l’a fait pâtir et trembler.
— Après ? dit Mac-Field, le regard fixé sur le bout de sa botte.
— Cette famille est donc pour lui quelque chose de cher et de sacré par-dessus tout ; eh bien, qu’il jure sur leurs têtes de ne pas révéler un mot de tout ce qu’il a entendu ici et de ne jamais en tirer parti contre nous ; je crois qu’on pourrait compter sur un pareil serment et lui rendre la liberté sans danger.
Mac-Field tourna la tête du côté du père Vulcain, et le toisant avec une légère nuance de dédain :
— Quel âge as-tu ? lui demanda-t-il.
— Dame ! répondit celui-ci un peu déconcerté, je vais sur la cinquantaine.
— Et tu as conservé ta candeur jusqu’à cet âge ! je t’en fais mon compliment, tu rendrais des points à un enfant de quinze ans. Un serment pour obtenir grâce de la vie, oh ! il n’hésitera pas à le faire, j’en suis convaincu, je veux même croire qu’il le fera de bonne foi, avec la ferme intention de le tenir fidèlement. Mais une fois hors de danger, une fois la vie sauve et désormais rassuré sur le sort de sa famille, sais-tu ce qui arrivera ? Il se dira que, si d’un côté l’honneur lui commande de rester fidèle à son serment, de l’autre, le devoir de sa profession et l’intérêt de la société lui font une loi de révéler un secret d’où va peut-être dépendre la vie de plusieurs personnes ; car, ces misérables, qu’il épargne par un excès de scrupule, qui sait à quelles extrémités ils pourront se porter, et s’ils allaient jusqu’au meurtre, ce qui n’est que trop probable, ne deviendrait-il pas le complice du crime qu’il aurait pu empêcher en les livrant à la justice ? Voilà , n’en doutez pas, le raisonnement qu’il se tiendra, et je n’ai pas besoin de vous dire de quel côté penchera définitivement la balance : du côté du devoir professionnel, de l’intérêt de la société… et de l’avancement.
— C’est que c’est ça ! s’écria Collin, persuadé par les arguments de Mac-Field.
Claude et Barbot parurent partager son avis, tandis que Micheline et Rascal flottaient évidemment entre les deux partis proposés.
Le père Vulcain le comprit et se hâta de reprendre la parole :
— Et puis, s’écria-t-il d’un ton résolu, je n’ai pas tout dit.
— Parle vite, alors, car il faut en finir, répliqua vivement Mac-Field.
— Eh bien, voilà : nous voulons faire des affaires, nous savons tous qu’on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs, et nous voulons bien risquer la correctionnelle : mais la cour d’assises, mais l’échafaud, ah ! mais non, merci, n’en faut pas, c’est pourquoi nous ne voulons pas de sang répandu.
— Non, s’écria à son tour Micheline, je ne veux pas qu’on me coupe le cou ; on m’a entraînée assez loin comme ça, je ne ferai pas un pas de plus !
Il y eut un long silence.
Le malheureux agent commença à concevoir quelque espérance quand il comprit qu’à la pitié qu’il avait pu inspirer d’abord, mais qu’avaient singulièrement ébranlée les arguments de Mac-Field, venait se joindre chez ses ennemis l’intérêt personnel, la peur de l’échafaud.
— Écoutez, dit tout à coup Mac-Field avec un accent déterminé, je ne discuterai pas plus longtemps, il n’y a qu’un moyen de sortir de là . Nous sommes ici deux partis, l’un pour la clémence, l’autre pour la justice implacable ; eh bien, nous allons employer le procédé dont on se sert en toute circonstance, quand les avis sont divisés. Voici une plume, de l’encre et du papier ; nous allons couper ce papier en morceaux, que nous nous partagerons et sur lesquels chacun de nous inscrira son vœu, oui, si c’est la mort ; non, si c’est la clémence. C’est la majorité qui aura décidé, rien de plus juste, et, quelle que soit cette décision, nul n’aura rien à dire, puisque chacun aura exprimé librement son avis.
— Mais, hasarda timidement le père Vulcain, si je préférais me retirer tout de suite de l’association que de courir les chances de ce jugement ?
— Si, maintenant que tu connais nos secrets, tu osais seulement renouveler cette proposition, je te brûlerais la cervelle de ma main, répondit froidement Mac-Field en lui montrant le revolver de l’agent qu’il tenait à la main.
— Diable ! diable ! murmura le père Vulcain d’un air soucieux.
— Tout le monde ici sait-il écrire ? demanda alors Mac-Field.
Tous répondirent affirmativement.
— Approchez donc.
Sir Ralph avait déjà découpé une feuille de papier en une douzaine de petits carrés.
Il en prit un, saisit la plume et, le premier, y exprima son avis.
Mac-Field vint après.
L’agent, qui suivait cette opération d’un regard anxieux, ne se fit pas d’illusion sur ces deux votants.
Il savait, comme s’il l’eût eu sous les yeux, le mot qu’ils venaient d’écrire l’un et l’autre.
C’était oui.
C’était la mort.
Mais le reste de la bande était divisé d’opinion.
Quel était l’avis qui allait prévaloir ?
Il était déjà assuré de trois voix.
Le père Vulcain, Micheline et Rascal. Hors Collin, les autres n’avaient rien laissé deviner de leurs impressions, il pouvait donc espérer qu’ils lui seraient favorables sinon tous, au moins quelques-uns.
Bref, en étudiant toutes les chances, bonnes et mauvaises, il demeurait à peu près convaincu que la majorité allait être pour lui.
Il doutait toujours, cependant, aussi fut-ce avec une profonde angoisse qu’il entendit Mac-Field dire à sir Ralph :
— Combien de bulletins ?
— Dix.
— Jetez-les dans mon chapeau ; c’est le père Vulcain, le plus favorable à la cause de l’agent, qui va tirer et lire chaque bulletin.
Sir Ralph fit ce qui lui était ordonné et le père Vulcain s’avança.
Sa main tremblait légèrement quand il tira le premier bulletin.
Il lut :
— Non.
Ce début était d’un heureux présage.
Telle fut la pensée de l’agent qui, le regard rivé sur le chapeau où était renfermée sa sentence, laissa échapper un soupir de soulagement.
Vulcain tira un second bulletin :
— Non.
Les traits de l’agent se détendirent.
Il entrevoyait la délivrance.
Vulcain continua et tira successivement les huit autres bulletins.
Six disaient : oui.
Deux disaient : non.
Résultat : quatre non contre six oui.
L’agent était condamné à mort.
— Tu as entendu et tu sais le sort qui t’attend, lui dit Mac-Field.
Godard ne répondit pas.
Il laissa tomber sa tête sur sa poitrine et ses lèvres livides s’agitèrent comme s’il murmurait une prière.
— Rascal, reprit Mac-Field, prends une corde et attache-le solidement sur sa chaise.
Rascal obéit.
— Est-ce que vous allez le tuer… comme ça, le pauvre ? demanda Micheline d’une voix tremblante.
Mac-Field lui jeta un regard sévère et ne répondit pas.
Puis s’adressant de nouveau à Rascal :
— Il ne s’agit pas d’oublier les camarades, qu’on aille prévenir ceux qui font sentinelle au dehors et qu’on leur dise de se rabattre ici l’un après l’autre et sans précipitation, pour éviter d’éveiller les soupçons.
Rascal sorti, il ordonna à chacun de se tenir prêt à partir dans un instant par l’ouverture qu’il avait pratiquée au fond de l’âtre de la cheminée.
Rascal rentrait au bout de cinq minutes, bientôt suivi de ses camarades.
— Tout le monde est là ? demanda Mac-Field.
— Oui, répondit Rascal.
— Qu’on se rapproche de la cheminée.
Tous les bandits allèrent se grouper de ce côté.
L’agent restait seul, assis et attaché sur sa chaise, au milieu de la pièce, où régnait un silence lugubre.
— Maintenant, reprit Mac-Field, descendez tous dans le vestibule qui se trouve à deux pieds au-dessous de cette ouverture, et vous m’attendrez là .
Cette opération demanda encore sept ou huit minutes.
L’agent tremblait si fort, qu’on entendait sa chaise tressauter sur le carreau.
— Bon, dit Mac-Field en jetant un regard sur l’ouverture par laquelle venait de passer toute la bande, il ne me reste plus qu’à donner le signal qui va attirer ici toute la rousse et à filer moi-même, sans oublier de remettre la plaque de fonte en place.
Et, se rapprochant de la cheminée :
— Attention, cria-t-il aux bandits entassés là , voilà le signal.
Au même instant, un coup de feu se faisait entendre aussitôt, suivi d’un grand cri.
C’était l’agent qui roulait sanglant sur le carreau.
La balle de Mac-Field l’avait atteint à la tête.

FIN DU PROLOGUE
PREMIÈRE PARTIE
UNE SOCIÉTÉ ANONYME
I
UNE TROUVAILLE
Huit jours se sont écoulés depuis les événements que nous avons déroulés sous les yeux du lecteur.
En franchissant le seuil de la petite maison de la rue Amelot, nous retrouvons, par une froide soirée de décembre, Rocambole, Vanda, Milon et Nizza réunis dans le petit salon où nous les avons déjà vus.
Rocambole feuillette avec ardeur le portefeuille tombé entre ses mains dans l’espoir d’y trouver une phrase, un mot, un signe qui le mettent sur la trace du propriétaire de ce portefeuille, ou qui lui révèlent enfin la rue où s’est perpétré le crime mystérieux accompli sur la jeune femme désignée par Nizza sous le nom de la comtesse.
Car, durant ces huit jours, il a parcouru toutes les rues de Montmartre, puis des Batignolles, égaré par les fausses indications de Nizza, et il se désespère de ne pouvoir découvrir le bouge où l’infortunée jeune femme est, sans nul doute, exposée aux plus grands périls.
Vanda, elle, poursuivant le même but par d’autres moyens, a entrepris l’éducation de Nizza, à laquelle elle donne tous les jours une leçon de lecture et d’écriture, afin de la mettre à même d’écrire les noms qui sont restés dans sa mémoire et qu’elle ne peut prononcer, ou de les désigner du doigt en les voyant écrits.
Pendant ce temps, Milon, sur la recommandation de Rocambole, lit consciencieusement chaque soir la Gazette des Tribunaux où, dans la pensée de celui-ci, il est impossible qu’on ne parle pas bientôt de la disparition, peut-être de l’assassinat de cette jeune comtesse.
— Rien, toujours rien, murmurait de temps à autre Rocambole en froissant le portefeuille.
— Quels sont donc les quelques mots que je vois écrits là , au bas de ce feuillet, en caractères lilliputiens ? demanda Vanda qui, tout en s’occupant de la petite muette, avait l’œil un peu partout.
— Voilà ce qu’il y a, répondit Rocambole : New… dixième rue… et ces mots, écrits en effet en caractères minuscules, sont rendus presque illisibles par une rature.
— Cette rature, reprit Vanda, ne prouverait-elle point qu’ils ont une signification dangereuse pour celui qui les a tracés ?
— Peut-être.
Milon fit en ce moment un soubresaut qui attira l’attention de son côté.
— Qu’y a-t-il donc ? lui demanda Rocambole, aurais-tu enfin découvert quelque chose ?
— Rien de ce que nous cherchons, répondit Milon, mais je viens de lire le récit d’un crime qui m’a vivement impressionné.
— Voyons donc cela ?
Milon se mit à lire :
« Le chef de la sûreté, averti que depuis quelque temps une bande de malfaiteurs se réunissait fréquemment dans un cabaret de la banlieue, dirigeait hier sur ce point une douzaine d’agents. Ceux-ci, après avoir cerné la maison avec toute la circonspection que commandait la circonstance, y firent tout à coup irruption à un signal donné par un de leurs camarades, qui n’avait pas craint de se glisser parmi les bandits pour surprendre leurs secrets ; mais qu’on juge de leur surprise et de leur douleur lorsque, arrivés là , ils trouvèrent le malheureux agent étendu sur le carreau avec une balle dans la tête ; il n’était pas mort, mais on l’a transporté à son domicile, rue Laharpe, dans un état désespéré. Quant à la bande, elle avait disparu. La rue du Pont-Blanc, où s’est passé ce drame… »
Milon fut brusquement interrompu par la petite muette qui, s’élançant vers lui en proie à une subite émotion, posa son doigt sur le journal et lui fit signe de relire les derniers mots.
— Quelque chose vient de la frapper dans cette dernière phrase, dit Rocambole. Milon, relis donc.
Nizza se posa devant Milon et le regarda fixement.
Celui-ci lut :
« Quant à la bande, elle avait disparu. »
Il interrogea l’enfant du regard.
Elle fit un signe négatif et, par un geste bref et impatient, posa de nouveau son doigt sur le journal.
— Elle vous prie de continuer, dit Vanda.
Milon poursuivit :
« La rue du Pont-Blanc, où… »
Nizza l’arrêta tout à coup, puis, se tournant vers Rocambole, l’œil étincelant, les traits empourprés, l’air radieux, elle lui fit comprendre que c’était dans cette rue qu’était située la maison d’où elle s’était enfuie.
— Ainsi, lui demanda vivement Rocambole, c’est là , dans la rue du Pont-Blanc, qu’est renfermée la jeune et jolie dame, la comtesse ?
Nizza, dont l’émotion allait toujours croissant, répondit affirmativement, et, montrant du doigt la porte, fit signe à Rocambole qu’il fallait aller la délivrer tout de suite.
— C’est bien mon intention, s’écria Rocambole tout joyeux du hasard providentiel qui lui révélait si inopinément ce qu’il cherchait vainement depuis huit jours ; mais il faut savoir d’abord où se trouve cette rue du Pont-Blanc, dont j’entends parler aujourd’hui pour la première fois.
— Je n’ai pas fini, dit Milon, peut-être est-il question de cela à la fin de l’article.
— Lis donc vite, et toi, enfant, écoute.
Nizza reprit sa position.
Debout et immobile devant Milon, elle le dévorait du regard tandis qu’il lisait :
« La rue du Pont-Blanc, où s’est passé ce drame, reprit-il, est située à l’extrémité du village d’Aubervilliers, près de la plaine des Vertus. »
Nizza frappa ses mains l’une contre l’autre pour témoigner sa joie, et fit signe qu’elle reconnaissait ces noms pour les avoir entendu souvent prononcer.
— Enfin ! s’écria Rocambole.
Et s’adressant à Milon :
— Est-ce tout ?
— Pas tout à fait.
— Achève.
Milon reprit le journal.
Nizza écouta.
« C’est dans une espèce de tapis-franc que se réunissait cette redoutable bande, espèce de bouge connu sous le nom de cabaret de la Providence, et tenu par un certain Rascal, repris de justice. »
En entendant ces derniers mots « cabaret de la Providence et Rascal », Nizza se livra à de nouvelles démonstrations, et l’espèce d’exaltation à laquelle elle était en proie disait clairement que c’était là la maison d’où elle s’était enfuie et le nom de l’individu qui l’avait poursuivie jusqu’au Café Parisien, ce qu’elle exprima d’ailleurs à plusieurs reprises en passant les mains sur ses bras avec un sentiment d’horreur.
Ce fut avec l’expression d’une profonde inquiétude que Rocambole accueillit cette dernière révélation.
— Ainsi, dit-il, c’est là , dans ce cabaret de la Providence, repaire de malfaiteurs, qu’avait été transportée la comtesse, c’est là qu’elle est devenue mère, et il y a de cela huit à dix jours à peine ; comment se fait-il donc qu’il ne soit pas question de cette jeune femme dans l’article que vient de lire Milon ? et comment expliquer le silence qui plane sur cette affaire ? Tout fait supposer que cette infortunée a été assassinée là avec son enfant ; tout me prouve que le mobile du crime est quelque grand intérêt de famille, intérêt d’argent ou de vengeance, et que les instigateurs du meurtre appartiennent au plus haut monde. Voilà ce que nous avons à découvrir, et pour cela il faut commencer par visiter le cabaret de la Providence, où quelque vestige, quelque indice imprévu nous révélera peut-être un coin du mystère.
— Mais j’y songe, dit tout à coup Vanda, ce portefeuille qui parle de créer un faux Rocambole et d’en faire un chef de bande !
— Lequel portefeuille appartient précisément au complice du bandit aux bras rouges, de ce Rascal, patron du cabaret de la Providence, s’écria Rocambole, comprenant tout à coup la pensée de Vanda.
— Qui nous dit que ce projet n’est pas déjà mis à exécution et que le chef de cette bande n’est pas ce prétendu Rocambole ?
— Ce n’est que trop probable, et déjà , sans doute, voilà mon nom chargé d’un meurtre qui, si j’en juge par l’audace dont viennent de faire preuve ces misérables, n’est que le commencement d’une série de crimes, dont toute la responsabilité retombera sur moi.
Rocambole se leva d’un bond, et, les traits subitement contractés par la colère :
— Ah ! les infâmes ! ils veulent traîner de nouveau dans la fange et dans le sang ce nom que j’avais presque réussi à laver de ses souillures ! Ah ! ils s’attaquent à moi et me forcent à me mêler de leurs affaires ! Eh bien, soit, je vais m’en mêler, et, ainsi que cela m’est arrivé quelquefois, je ferai peut-être à moi seul ce que n’aura pu faire la police avec toutes les forces, tous les hommes, tous les moyens dont elle dispose. C’est moi qui veux chercher leur piste, les traquer l’un après l’autre, les saisir sous les faux noms et les faux titres qui les couvrent déjà , et les livrer enfin à la justice ; moi, moi, Rocambole, isolé et paralysé dans mes moyens d’action, puisque moi-même je suis rejeté de la société, et que la supposition de ma mort me met seule à l’abri des poursuites de cette même police, dont j’entreprends d’accomplir l’œuvre.
Et, s’adressant à Milon :
— Demain, à la première heure, il faut que nous soyons au cabaret de la Providence.
Le lendemain, en effet, Rocambole et Milon pénétraient, dès huit heures du matin, dans ce cabaret dont la porte était ouverte.
Car, ainsi que l’avait deviné Rocambole, la police, après avoir quelque temps surveillé le cabaret de la Providence, où elle comptait voir venir quelques affiliés de la bande, ignorants de ce qui s’était passé, n’avait dû livrer cette affaire à la publicité que du jour où elle avait reconnu inutile de pousser plus loin cette surveillance.
Rocambole et Milon se livraient depuis quelques heures déjà aux plus actives investigations, quand le premier s’arrêta tout à coup devant un petit point brillant qui faisait saillie dans le mur, perçant imperceptiblement le papier.
C’était à la hauteur du lit sur lequel la comtesse était restée couchée quarante-huit heures.
— Qu’est-ce que c’est que cela ? dit Rocambole.
Il déchira le papier et découvrit, dans une petite cachette, creusée longuement, obstinément, à l’aide des ongles, une espèce de petit porte-monnaie qu’on avait recouvert ensuite de papier.
Il portait un chiffre, des armoiries en or et contenait plusieurs cartes réduites à la dimension d’une pièce de vingt francs.
Rocambole en lut une et jeta un cri de joie.
II
UNE LUTTE DE VITESSE
Nous connaîtrons bientôt l’importance de la découverte que venait de faire Rocambole, mais transportons-nous d’abord à l’hôtel de Sinabria, où nous avons laissé la comtesse dans une situation des plus critiques.
Lorsqu’en s’éveillant, le lendemain de son retour, elle regarda l’heure à sa pendule, elle fut stupéfaite d’avoir dormi si longtemps.
Il était dix heures.
Elle ne fut pas moins surprise de se trouver seule, Fanny s’étant endormie la veille dans un fauteuil, près de son lit.
Puis elle pensa à son mari, à l’accueil pour le moins singulier qu’elle lui avait fait après une si longue séparation et à la facilité avec laquelle il avait accepté ses explications et s’était retiré dans son appartement.
Maintenant qu’elle était reposée des secousses physiques et morales de la veille par douze heures de sommeil non interrompu, elle voyait les choses sous leur véritable jour, et tremblait à la pensée des impressions qu’elle avait dû laisser dans l’esprit de son mari, dont elle connaissait l’extrême jalousie.
— Dix heures, et il ne s’est pas encore présenté, murmura-t-elle, c’est bien étrange.
Elle ajouta, après un moment de réflexion :
— Il doit être levé depuis longtemps. Que peut-il faire ?
Il y eut encore une pause.
— Et Fanny qui ne vient pas, dit-elle avec une impatience mêlée d’inquiétude : je l’interrogerais ; elle doit savoir ce qui se passe ; il est impossible qu’elle ne se soit pas informée, sachant quelle doit être mon anxiété. Allons, il faut en finir, cette incertitude me tue.
Elle tira le cordon de sonnette qui se trouvait à portée de sa main.
La porte de sa chambre s’ouvrit et une femme entra.
C’était Mariette, la femme de charge.
— Vous ! fit Rita stupéfaite, où est donc Fanny ?
— Elle est sortie, il y a une heure, pour aller voir sa mère, tombée subitement et dangereusement malade, et elle m’a priée de la remplacer près de madame la comtesse pendant son absence.
Ne recevant pas de réponse de Rita, Mariette reprit :
— Madame la comtesse veut-elle que je l’habille ?
— Tout à l’heure, répondit celle-ci d’un air distrait.
Elle reprit bientôt :
— Allez donc dire à M. le comte que je le prie de passer chez moi.
— M. le comte est sorti, madame.
— Déjà ! dit la jeune femme en relevant vivement la tête.
— Il est sorti ce matin de bonne heure.
— Ah !
Une vive inquiétude se peignit sur les traits de la comtesse.
— A-t-il dit à quelle heure il rentrerait ? reprit-elle.
— Je l’ignore, madame.
Elle allait l’interroger de nouveau, quand on entendit un bruit de pas dans le salon qui précédait la chambre de la comtesse.
— Lui sans doute ! dit vivement celle-ci, voyez donc !
Mariette courut ouvrir la porte.
— Non, dit-elle, c’est Fanny.
— Alors je n’ai plus besoin de vous, elle va m’habiller.
La femme de charge se retira.
— Eh bien, demanda alors Rita à la femme de chambre, comment va ta mère ?
— Ma mère se porte bien et n’a jamais été malade, madame, répondit Fanny en ôtant vivement son chapeau.
— Que m’a donc dit Mariette ?
— Ce que je lui avais recommandé de répondre à madame la comtesse au cas où elle me demanderait.
— Que signifie cette comédie ?
— Cela signifie, madame, qu’il se passe quelque chose de très-grave.
— Mais, en effet, je te trouve l’air bien agité, Fanny.
— Et ce n’est pas sans motif, madame.
— Qu’y a-t-il donc ? tu me fais peur.
— Madame la comtesse était hier dans un tel état de trouble, de faiblesse et de prostration, qu’elle n’avait plus conscience de rien, sans quoi elle eût été frappée de l’air dont M. le comte la quittait après avoir échangé quelques mots à peine avec elle.
— Ah ! c’est de lui qu’il s’agit ?
— Oui, madame la comtesse.
— Oh ! parle, parle vite, dit la jeune femme avec une agitation fébrile.
Fanny se rapprocha de la comtesse et baissant la voix :
— Moi, madame, j’avais remarqué sa politesse froide et ironique au moment où il vous disait adieu, j’y réfléchis une partie de la nuit, et mes craintes grandissant à mesure que j’y pensais, une idée s’empara de mon esprit et le posséda bientôt à ce point que je résolus de la mettre à exécution dès le matin.
— Et cette idée ? demanda la jeune femme.
— Convaincu que M. le comte, dont l’inquiétude avait été visible au moment où vous lui parliez de votre voyage à Tours, ne pourrait résister au désir d’interroger son valet de chambre à ce sujet, je résolus de l’épier et de tout mettre en œuvre pour l’écouter.
— Après ? demanda la comtesse.
— Le hasard me servit ; comme j’approchais de sa chambre avec précaution, je m’aperçus qu’elle était restée entrouverte. Je m’avançai sur la pointe des pieds, je me penchai en avant en retenant ma respiration, et voici le dialogue que j’entendis :
— Dites-moi, Joseph, disait M. le comte d’un ton indifférent.
— Monsieur le comte.
— Vous savez combien je tiens à ce que mes chevaux soient soignés, François a-t-il eu la précaution de les promener pendant l’absence de madame la comtesse ?
— Oui, monsieur le comte.
— Au reste, le mal n’eût pas été grand quand il l’eût oublié, cette absence a été si courte…
— C’est vrai, monsieur le comte, pas tout à fait trois jours.
Il y eut un moment de silence comme si M. le comte eût hésité à adresser une nouvelle question.
Il reprit enfin :
— En conduisant madame la comtesse au chemin de fer, j’espère que François aura fait prendre à ses chevaux un trot raisonnable, je le lui ai recommandé de tout temps, surtout quand madame la comtesse est seule dans la voiture.
— Ah ! mais madame la comtesse n’a pas voulu être conduite par sa voiture ce jour-là .
— Elle est allée à pied ?
— Non, monsieur le comte, madame la comtesse a pris un fiacre.
Il y eut encore une pause. J’en compris la raison au tremblement de la voix de M. le comte, quand il répondit :
— Ah ! un fiacre !… elle a bien fait.
Je l’entendis marcher quelques instants dans sa chambre sans rien dire.
— Quelle heure est-il ? demanda-t-il enfin d’une voix brève.
— Huit heures dix minutes à la pendule de monsieur le comte, répondit Joseph.
— Je vais sortir, reprit M. le comte ; dans le cas où je ne serais pas rentré pour l’heure du déjeuner, qu’on ne m’attende pas.
— Je vais faire atteler ? demanda Joseph.
— Non… Va me chercher un fiacre.
La comtesse avait écouté ce récit avec tous les signes d’une violente anxiété.
— Oh ! tu as raison, Fanny, murmura-t-elle, tout cela est grave, bien grave ; il se défie, c’est évident, et qui sait !…
— Hélas ! madame, tout cela n’est rien encore, dit Fanny.
— Rien encore ! s’écria la jeune femme en jetant sur Fanny un regard effaré, que vas-tu donc m’apprendre ?
— Effrayée de ce que je viens d’entendre et de ce que laissaient pressentir les dernières paroles de M. le comte, j’ai une inspiration. Je viens prendre mon chapeau, je préviens que je vais voir ma mère malade, je cours prendre un fiacre et je recommande au cocher de suivre celui qui va bientôt partir de l’hôtel de Sinabria, dont je lui donne l’adresse.
« Cinq minutes après, ma voiture partait à la suite de celle qui emportait M. le comte.
« Le trajet dura environ une demi-heure, au bout de laquelle le fiacre de M. le comte s’arrêta enfin dans la gare d’un chemin de fer que je voyais ce jour-là pour la première fois.
« J’ignorais donc où j’étais.
— Un chemin de fer ! murmura la jeune femme, qu’allait-il faire là ?
— Je le laisse descendre le premier, puis je saute moi-même à terre et je le suis jusqu’au guichet, le corps enveloppé dans un immense châle et les traits couverts d’un voile si épais, qu’il était impossible de me reconnaître. D’ailleurs, il était tellement absorbé qu’il ne voyait rien autour de lui. Nous nous confondons dans la foule ; son tour arrive, et jugez du tremblement dont je me sens saisie, quand je l’entends dire à la buraliste :
— Une première pour Tours.
La comtesse bondit sur son lit à ce dernier mot.
Puis, passant la main sur son front et promenant autour d’elle des yeux égarés :
— Tours ! murmura-t-elle d’une voix défaillante, et tu dis qu’il est parti ?
— Il est en route depuis trois quarts d’heure ; dans quatre heures il sera arrivé.
— Et Marie de Signerol qui n’est pas prévenue ! s’écria Rita en se rejetant dans son lit avec des gestes désespérés, ah ! je suis perdue ! je suis perdue, mon Dieu !
Et plongeant son visage dans ses deux mains, elle se mit à sangloter.
Alors Fanny jeta un regard du côté de la porte et se penchant vers sa maîtresse.
— Non, madame la comtesse, vous n’êtes pas perdue.
— Mais songe donc, dans quatre heures il sera près de Marie de Signerol.
— Dans deux heures vous lui aurez parlé, vous lui aurez dicté la réponse qu’elle aura à faire à votre mari.
— Tu es folle, Fanny, que veux-tu dire ?
— Je veux dire, madame la comtesse, qu’il y a quelque chose de plus rapide que la vapeur, c’est l’électricité.
— Une dépêche ! s’écria la comtesse en se frappant le front, ah ! tu as raison ; je suis sauvée. Vite, donne-moi de quoi écrire.
Fanny lui apporta tout ce qu’il fallait.
Rita écrivit :
« Madame veuve de Signerol, Tours.
« Mon mari sera près de toi dans quelques heures, dire que j’ai passé trois jours chez toi. Il y a eu bal le 15. À demain lettre explicative.
« RITA. »
— Tiens, dit-elle en remettant ce papier à Fanny, porte cela en courant au bureau télégraphique le plus proche, c’est lui qui me sauve ; va, Fanny, va.
La femme de chambre mit son chapeau à la hâte et partit.
III
RECHERCHES
Comme elle revenait du bureau télégraphique, Fanny, en se rangeant pour éviter les voitures, fut très-surprise de reconnaître Gaston de Coursol dans un coupé.
Celui-ci ne la vit pas, ce qui, d’ailleurs, ne la surprit nullement.
Non-seulement la voiture était fermée, mais il paraissait plongé en ce moment dans de sérieuses réflexions.
Mais ce qui l’étonna, ce fut de le voir traverser la rue de Varennes, près de laquelle avait lieu cette rencontre, et continuer de monter la rue du Bac, dans la direction de la rue de Sèvres, sans s’arrêter à l’hôtel de Sinabria.
C’est que Gaston de Coursol, se rappelant les instantes recommandations que Rita lui avait faites la veille au sujet de l’enfant et de la nourrice, se rendait directement à Plaisance à cet effet, et ne voulait pas paraître devant la comtesse sans lui apporter les renseignements qu’elle attendait avec tant d’impatience.
Dix minutes environ après avoir dépassé la rue de Varennes, la voiture arriva à la chaussée du Maine, à la droite de laquelle s’étend Plaisance.
Il en fut prévenu par le cocher, car c’était la première fois qu’il venait dans ce quartier.
Gaston jeta un coup d’œil sur l’adresse de la nourrice, qu’il venait de tirer de sa poche.
— Nous allons rue de la Procession, n° 85, dit-il au cocher.
Celui-ci remonta sur son siège, fouetta ses chevaux et ne tarda pas à gagner la rue de la Procession.
La maison portant le n° 85 était une espèce de bicoque composée d’un rez-de-chaussée et d’un seul étage, comme il s’en trouve beaucoup dans ce quartier.
La façade, d’un jaune sale, les fenêtres étroites, où étaient étendues des loques et des haillons séchant au grand air, la boutique de savetier qui occupait le rez-de-chaussée avaient un aspect sordide et repoussant dont le jeune homme fut désagréablement impressionné.
Il n’avait jamais rien vu de pareil, ne connaissant guère de Paris que les quartiers luxueux, les boulevards, les Champs-Élysées et le bois de Boulogne.
— Quoi ! murmura-t-il, vivement désappointé, c’est là qu’habite la nourrice ! c’est là que respire notre enfant !
Ne soupçonnant même pas ce que pouvait être Plaisance, dont le nom avait rarement frappé son oreille, il savait seulement que c’était une espèce de campagne et s’était attendu à trouver la nourrice de son enfant installée dans une petite maison de campagne bien aérée et entourée de jardins.
Il entra dans un petit vestibule étroit, aperçut à sa droite, à travers une porte vitrée, une petite pièce, qui était à la fois la loge du concierge et la boutique du savetier qu’il venait de remarquer, et entrouvrant la porte, il demanda :
— Madame Claude, s’il vous plaît ?
Le savetier, profondément absorbé dans l’opération d’un béquet, continua de tirer son ligneul comme s’il n’eût rien entendu.
La savetière releva la tête, regarda le jeune homme à travers ses lunettes, dont les verres avaient la forme et la dimension d’une pièce de cinq francs, et d’un ton qui attestait son peu de sympathie pour la couche sociale à laquelle appartenait celui-ci :
— Hein ? comment que vous dites ça ? lui demanda-t-elle.
— Madame Claude ? reprit Gaston.
— Qu’est-ce que c’est que ça ? Qu’est-ce que ça fait ? quelle espèce de femme est-ce que votre dame Claude ?
— Mais elle est jeune, belle femme, bien portante.
— Ah ! bon, j’y suis, fit la portière en dévisageant Gaston avec un sourire narquois.
Puis, aspirant bruyamment une large prise puisée dans une tabatière à queue de rat :
— Passez donc votre chemin, jeune homme, nous ne tenons pas cet article-là dans la maison, une maison honnête et bien tenue, je m’en flatte. Vous vous trompez de quartier, tournez-moi donc les talons et allez voir rue Breda, vous y trouverez l’objet de votre flamme.
Un moment déconcerté par cette singulière apostrophe, le jeune homme reprit bientôt d’un ton qui imposa à la portière :
— Vous vous trompez vous-même, madame, la femme que je cherche est la nourrice de mon enfant.
— Fallait donc le dire tout de suite, répliqua la portière, je ne vous aurais pas pris pour un godelureau à la recherche de…
— Peu importe, interrompit Gaston, vous savez maintenant qu’il s’agit d’une nourrice.
— Que vous appelez ?
— Madame Claude.
— Eh bien, nous n’avons pas ça.
— Comment ! s’écria Gaston en se troublant tout à coup, vous n’avez pas ici…
— Pas plus de Claude que de nourrice.
Gaston resta atterré.
Son enfant perdu, enlevé, pis encore, peut-être ! Cette pensée fit passer sous ses yeux, en un clin d’œil, mille tableaux sinistres et son sang se glaça dans ses veines en songeant à l’effet que pourrait produire sur la comtesse une semblable révélation.
— Oh ! c’est impossible ! c’est impossible ! balbutia-t-il en se parlant à lui-même.
— Comment, impossible, répliqua la portière d’un ton vexé, je connais pas mes locataires, peut-être bien.
— Alors, c’est une erreur de numéro, voilà tout. Voyons, madame, n’avez-vous pas entendu parler d’une nourrice à laquelle on a apporté un nouveau-né hier dans la soirée ?
— Je n’ai pas entendu dire un mot de ça ; et toi, Raoul ?
Raoul caressa d’un œil complaisant son béquet qu’il venait de terminer, et toujours sans lever la tête, il répondit avec un accent germanique fortement prononcé :
— Che n’ai bas endentu barler te sa.
Gaston sortit en se répétant tout bas :
— Oui, oui, il y a erreur dans le numéro, ce ne peut être que cela.

Puis, s’adressant à son cocher :
— Celui qui a écrit cette adresse a commis une erreur qui me force à parcourir toute la rue en demandant de porte en porte. Attendez-moi là pendant ce temps, il est probable que je trouverai près d’ici la personne que je cherche.
Et il se mit en quête de madame Claude, nourrice, la demandant à chaque concierge et recevant partout la même réponse qu’au numéro 85.
Il parcourut ainsi toute la rue de la Procession, qui est très-longue.
Brisé, désespéré, en proie aux plus terribles angoisses, il adressait pour la centième fois la même question à la concierge de l’une des dernières maisons de la rue, s’attendant au même résultat, quand celle-ci, après un moment de réflexion, lui répondit :
— Attendez donc ! attendez donc ! mais certainement que je connais ça.
Elle ajouta bientôt, en se frappant le front :
— Madame Claude ! mais je ne connais que ça, même que nous échangeons une politesse chaque fois que nous nous rencontrons.
Gaston ignorait qu’échanger une politesse, c’était se payer mutuellement plusieurs verres d’eau-de-vie ou d’absinthe.
— Et elle demeure bien à Plaisance ? demanda-t-il à la concierge.
— À Plaisance, oui, mais pas rue de la Procession.
— Où donc ?
— Tout au bout de la rue de Vanves, pas loin des fortifications, une petite maison située un peu à l’écart ; un étage, des volets verts et une branche de pin.
Les traits de Gaston s’épanouirent et tous les sombres pressentiments qui venaient de l’assaillir se dissipèrent aussitôt.
— Enfin ! s’écria-t-il.
Dans son ravissement, il donna une pièce d’or à la portière, qui en resta toute ébahie, puis il courut rejoindre sa voiture.
— Vite, cria-t-il au cocher, au bout de la rue de Vanves !
— De quel côté ?
— Près des fortifications, et bon train.
Obéissant à cette recommandation, le cocher gagna en peu de temps le bout de la rue de Vanves, et, grâce à la précision des indications qu’on venait de lui donner, Gaston ne tarda pas à trouver le bouge ou se sont passées, entre la famille Claude et Paul de Tréviannes, des scènes dont le lecteur a sans doute gardé le souvenir.
Saisi de dégoût à l’aspect de cette demeure, il s’arrêta sur le seuil.

— Madame Claude ? demanda-t-il à Marianne, qui, assise devant l’âtre sans feu et les épaules couvertes d’un vieux carrick de cocher, semblait plongée dans de noires réflexions.
— C’est moi, répondit Marianne en jetant un sombre regard du côté de Gaston.
— Vous ! s’écria celui-ci avec un mouvement d’horreur dont il ne fut pas maître.
— Pourquoi pas ?
— C’est que je cherche madame Claude, nourrice d’un enfant qu’on a dû lui apporter hier soir, mais cette nourrice, c’est peut-être votre fille.
— Ni moi, ni ma fille, répondit brusquement Marianne.
— Quoi ! murmura le jeune homme d’une voix déraillante, on n’a pas apporté ici un enfant nouveau-né ?
— Un enfant ! ah ! oui, je sais… mais c’est une bonne affaire et les bonnes affaires on les donne aux autres, dit Marianne avec une ironie sauvage ; l’enfant n’a jamais mis les pieds ici.
À cette déclaration, que le ton de l’horrible vieille ne permettait pas de mettre en doute, Gaston eut un éblouissement.
Il faillit s’affaisser sur lui-même comme un homme foudroyé, et fût tombé à la renverse s’il ne s’était retenu à temps au montant de la porte.
— Eh bien, quoi ? reprit Marianne en lui jetant un regard de travers, l’enfant n’est pas ici, que voulez-vous de plus ?
— Rien, rien, murmura le jeune homme d’une voix faible.
Il se retira et regagna sa voiture d’un pas chancelant.
Il voyait tout tourner autour de lui, et il murmurait tout bas :
— Où aller ? Où le chercher, maintenant.
Arrivé à sa voiture, il y prit place et donna au cocher le numéro de l’hôtel Sinabria.
— Oui, murmura-t-il, tout le corps secoué par un tremblement nerveux, Rita seule peut me mettre à même de retrouver la trace du médecin qui l’a emporté sous ses yeux, en me faisant connaître l’endroit où elle a passé ces deux jours.
Mais, à mesure qu’il se rapprochait de la rue de Varennes, il se sentait glacé à la pensée de révéler à la comtesse l’horrible vérité, et, cette appréhension le bouleversant de plus en plus, il résolut enfin de remettre au lendemain cette redoutable confidence.
Ce parti une fois résolu, il se pencha à la portière, et s’adressant au cocher juste au moment où celui-ci allait tourner pour entrer dans la rue de Varennes :
— Non, lui dit-il, j’ai changé d’avis, je ne vais pas aujourd’hui rue de Varennes, mettez-moi chez moi.
Il demeurait rue de Grammont.
En arrivant chez lui, il trouva son domestique, Germain, qui paraissait l’attendre avec impatience.
— Qu’y a-t-il donc ? lui demanda Gaston, un peu inquiet, est-il venu quelque chose pour moi ?
— Non quelque chose, mais quelqu’un, répondit Germain.
— Qui donc ?
— Un monsieur.
— Il est parti ?
— Il est resté et attend monsieur au salon.
— Son nom ?
— M. Portal !
— Je ne connais pas ça ; enfin je vais lui parler.
IV
TRAITÉ D’ALLIANCE
En entrant dans son salon, Gaston de Coursol vit se lever et venir à lui un homme d’une cinquantaine d’années, dont le regard pénétrant, la physionomie à la fois sérieuse et déterminée le frappèrent tout de suite.
— Monsieur Gaston de Coursol ? demanda Rocambole.
— Oui, monsieur.
— Et moi je suis M. Portal, comme vous l’a déjà appris la carte qu’on a dû vous remettre.
Gaston s’inclina, et, désignant du doigt un fauteuil au visiteur, il s’assit lui-même en face et attendit qu’il prît la parole.
— Monsieur, dit vivement Rocambole, je vous demande pardon d’entrer un peu brusquement en matière, surtout quand il s’agit d’un sujet qui demanderait à être abordé avec une extrême délicatesse, mais les circonstances me commandent d’aller vite dans notre intérêt commun, dans le vôtre surtout.
Fort étonné de ce langage de la part d’un homme qui lui était complètement inconnu, Gaston lui répondit :
— Parlez comme vous le jugerez à propos, monsieur ; sachant d’avance de quelles intentions vous êtes animé à mon égard, je ne saurais m’offenser de vos paroles.
— Monsieur de Coursol, reprit Rocambole, je viens vous parler d’une femme que vous aimez et qui vous aime ; cette femme, c’est la comtesse de Sinabria.
— Monsieur, s’écria le jeune homme en se levant d’un air indigné, je ne permettrai pas qu’on insulte une femme dont l’honorabilité…
— Bon ! interrompit Rocambole, voilà que vous perdez déjà un temps précieux, malgré l’avertissement que je viens de vous donner. Oui, monsieur de Coursol, madame la comtesse Rita de Sinabria vous aime, ou tout au moins elle vous a aimé, et je pourrais vous dire au juste dans quelle mesure, car j’ai lu les lettres que vous lui écriviez.
— Vous, monsieur, allons donc ! D’abord je ne me suis jamais permis…
— Voici vos lettres, monsieur.
Il remit au jeune homme le carnet lilliputien qu’il avait trouvé la veille au cabaret de la Providence.
Gaston le regardait avec un mélange de stupeur et de colère.
— Mais, monsieur, dit-il enfin avec une certaine hauteur, comment se fait-il que de pareilles lettres se trouvent entre vos mains ?
— Permettez-moi de répondre à votre question par une autre, monsieur. Savez-vous ou était madame la comtesse de Sinabria pendant les deux jours qu’elle vient de passer hors de son hôtel ?
Le jeune homme resta tout interdit à cette question.
— Vous l’ignorez ; eh bien ! moi, je le sais et je vais vous le dire ; elle a passé ces deux jours dans un coupe-gorge, au milieu d’une bande d’assassins, dont elle n’était séparée que par une cloison ; c’est là , c’est dans ces conditions qu’elle est devenue mère, mère de votre enfant, monsieur de Coursol.
Gaston voulut encore se récrier.
— Ah ! on ne nie pas l’évidence, monsieur, dit froidement Rocambole, il est question dans vos lettres de cet enfant prochainement attendu, de même qu’on y exprime la crainte de voir revenir, avant le terme fatal, le mari absent depuis plus d’une année. Est-ce assez clair, monsieur de Coursol ? Vous auriez voulu grouper là , en un faisceau aussi lumineux que possible, toutes les charges qui s’élèvent contre vous et votre complice, je vous jure que vous n’auriez pu mieux faire.
Gaston garda un moment de silence :
— Et c’est là , dit-il enfin, c’est dans ce coupe-gorge que vous avez trouvé ces lettres ?
— Déposées par la comtesse dans une petite cachette où de minutieuses investigations ont pu seules me les faire découvrir.
— Et comment, à quel titre vous êtes-vous trouvé dans un pareil lieu ? demanda le jeune homme après un moment d’hésitation.
— Ce n’est pas à titre de complice de ces messieurs les bandits, je commence par vous le déclarer, c’est même pour un motif absolument contraire.
— Vous êtes l’ennemi de ces hommes ?
— Vous l’avez dit.
— Je comprends, s’écria Gaston, vous appartenez à la police.
— Vous n’y êtes pas du tout, c’est pour mon propre compte que je veux combattre et anéantir cette bande, dont les chefs sont des hommes redoutables.
— Vous les connaissez ?
— Par leurs œuvres et c’est par vous que je compte parvenir à les suivre pas à pas dans les ténèbres où ils se cachent et à les voir enfin face à face…
— Par moi ! je ne vous comprends pas.
— Réfléchissez, monsieur ; croyez-vous que ce soient d’obscurs bandits ceux qui ont conçu et exécuté le dessein d’enlever une comtesse de Sinabria au moment de devenir mère ? Dans quel but ! je ne sais, mais il y a là -dessous quelque profonde et infernale combinaison qui ne tardera pas à se révéler.
Voyons, monsieur, que s’est-il passé chez la comtesse de Sinabria depuis son retour à son hôtel ?
Le jeune homme se leva tout à coup en s’écriant :
— Un fait épouvantable, monsieur, et sur lequel vos paroles commencent à m’éclairer.
— Quoi donc ? parlez.
— Oh ! vous avez raison, monsieur, vous avez raison, il y a dans cette affaire un dessein profond et terrible. Ces misérables ont bien rendu la liberté à la comtesse, mais l’enfant…
— Eh bien ?
— Eh bien, monsieur, ils l’ont emporté chez une nourrice, sa mère étant obligée de s’en séparer.
— Et cette nourrice ? demanda Rocambole.
— N’a jamais existé, je viens de m’en convaincre.
— De sorte que l’enfant est perdu, c’est-à -dire volé. Voilà ce dont je me suis douté tout de suite quand j’ai appris, par le plus singulier des hasards, qu’une jeune femme du monde, une comtesse, avait été transportée dans ce coupe-gorge au moment de devenir mère et qu’elle y était accouchée en effet.
— Oh ! c’est affreux ! c’est affreux !
— C’est un épouvantable malheur, en effet, monsieur, dit Rocambole ; mais permettez-moi de ne pas trop m’en affliger.
— Que dites-vous, monsieur ? s’écria Gaston indigné de ce qu’il prenait pour une odieuse plaisanterie.
— Laissez-moi m’expliquer et vous allez me comprendre. Je suis une des victimes de cette terrible bande, qui se prépare à en faire bien d’autres. J’ai l’intérêt le plus grave, le plus puissant à la découvrir et à la livrer à la justice avant qu’elle n’ait mis à exécution un plan qui aurait pour moi les plus redoutables conséquences ; bref, nos deux causes sont intimement liées, vos ennemis sont les miens, et, par l’effet du hasard étrange dont je viens de vous parler, j’apprenais l’effroyable situation de la comtesse de Sinabria, en même temps que l’immense danger qui me menaçait moi-même. Cependant, ému de pitié pour la situation si grave, si extraordinaire et si pleine de périls où je la voyais plongée, c’est dans son intérêt surtout que je me rendis au bouge où elle a enduré un si douloureux martyre, et jugez de ma joie quand j’y découvris ce carnet et ces lettres qui me mettaient tout à coup sur la trace de la comtesse et sur la vôtre.
— Comment cela ? demanda Gaston, ces lettres ne contiennent ni mon adresse ni le nom de la comtesse.
— Non, mais les armoiries de la comtesse sont gravées sur ce petit carnet, et j’ai bientôt su à quelle famille elles appartenaient en consultant un armorial de la noblesse française que j’ai chez moi.
— Soit, mais mon adresse ?
— M’a été donnée par un membre du club dont vous faites partie. Il me reste à vous expliquer maintenant la parole quelque peu féroce en apparence que je viens de proférer à propos de la disparition de votre enfant. Je vous ai dit que je ne m’en affligeais pas trop et voici pourquoi : d’abord votre enfant ne court aucun danger.
— Vous croyez, monsieur ?
— Je vous le jure, et je vais vous en convaincre tout de suite. Dans quel but vous a-t-on enlevé votre enfant ? Dans un but de chantage, c’est incontestable. La comtesse de Sinabria est riche, vous avez une immense fortune, l’enfant représente une forte, une très-forte somme qu’on viendra vous demander bientôt, contre la restitution de cet enfant. Voilà ou j’attends nos ennemis, ils sont habiles, déterminés, et, dans une circonstance aussi grave, ils s’entoureront de toutes les précautions imaginables ; mais je me sens capable de lutter de ruse avec eux, et cette affaire, dans laquelle ils voient une fortune, est le filet que nous allons leur tendre et dans lequel je les prendrai tous.
— Mais, en effet, s’écria Gaston dont les traits s’épanouirent à ces paroles, non-seulement il m’est prouvé maintenant que je n’ai rien à craindre pour notre enfant, mais nous avons là un moyen certain de livrer ces misérables…
— Moyen dont je ne vous engagerai pas à user sans mon concours, car vous seriez roulé par eux, et, ayant perdu tout espoir de l’exploiter, Dieu sait ce qu’ils feraient de votre enfant.
Gaston tressaillit.
— Aussi, dit-il, suis-je bien résolu à n’agir que d’après vos conseils et à n’être entre vos mains, dans toute cette affaire, qu’un instrument docile et passif.
— Je vous y engage dans votre intérêt, lui dit Rocambole.
Puis il reprit avec un accent froid et résolu :
— Cette lutte, dans laquelle, je puis vous l’affirmer, vous succomberiez avant même d’avoir combattu, cette lutte est bien peu de chose près de toutes celles que j’ai soutenues dans le cours de ma vie. J’ai l’habitude du danger, nul péril ne peut ébranler mon sang-froid et je connais à fond, pour les avoir déjouées cent fois, toutes les ruses de l’ennemi auquel nous allons avoir affaire, fiez-vous donc à moi, ne faites rien sans me consulter, ne me dissimulez rien de ce qui pourra survenir et je réponds du succès.
Il ajouta en se levant :
— Et, dans le cas où vous vous demanderiez qui je suis et quelles garanties je vous offre en échange de la confiance que j’exige de vous, je vous réponds tout de suite : Je suis M. Portal et je vous ai rendu ces lettres dont un ennemi eût pu faire contre vous l’usage le plus redoutable. Adieu, monsieur de Coursol, je vous reverrai bientôt.
Et il sortit reconduit par Gaston.
Celui-ci venait de rentrer dans le salon, quand un violent coup de sonnette les fit tressaillir.
Un instant après, il voyait entrer Fanny, la figure toute bouleversée.
— Que se passe-t-il donc ? lui demanda Gaston en s’élançant vers elle.
— Venez vite, lui dit Fanny, madame la comtesse est en proie à un désespoir qui me fait craindre pour sa raison.
— Est-ce que le comte ?…
— Non, ce n’est pas cela ; il s’agit d’une lettre que vient d’apporter un commissionnaire et dont la lecture l’a rendue comme folle.
— J’y cours.
V
LE PLAN D’UN DRAME
Quand Gaston de Coursol arriva chez la comtesse, il la trouva plongée dans un fauteuil, affaissée sur elle-même, dans un état d’inertie et de prostration complètes.
Elle était si parfaitement immobile, qu’on l’eût crue morte ou endormie.
Elle ne tourna même pas la tête à l’entrée de Gaston, quoiqu’elle eût reconnu le bruit de ses pas.
Celui-ci, qui s’attendait à tous les éclats, à toutes les tempêtes d’un désespoir furieux, demeura stupéfait à cet aspect.
Il s’y méprit et croyant sa douleur apaisée :
— Qu’avez-vous donc, mon amie ! lui demanda-t-il en l’abordant.
La jeune femme releva à peine la tête, et d’une voix dont le calme et la douceur étaient d’un effet plus navrant que les cris et les sanglots :
— Ce que j’ai ? dit-elle, mon Dieu, je suis perdue, complètement, irrévocablement perdue, voilà tout.
— Oh ! c’est impossible, répliqua Gaston, si cela était, vous ne me le diriez pas avec cette tranquillité.
— Quand on n’a plus qu’à attendre la mort, à quoi bon se débattre ? répondit Rita sur le même ton.
— Mais que s’est-il donc passé et qui peut vous mettre en cet état ? Le départ subit de votre mari pour Tours ? Ah ! c’était un coup terrible, j’en conviens, mais ne l’avez-vous pas paré aussitôt par une dépêche qui a mis votre amie sur ses gardes et a dissipé le danger ? Ce n’est donc pas là la cause du désespoir où je vous trouve, mais alors qu’y a-t-il ? Parlez, je vous en supplie.
La comtesse répondit avec son calme inaltérable :
— Imaginez la catastrophe la plus terrible, le malheur le plus effroyable qui puisse atteindre une femme, et quoi que vous puissiez inventer, vous n’aurez encore qu’une faible idée de ce qui m’arrive. Mon mari, dites-vous ? Et que m’importe qu’il sache ou qu’il ignore la vérité ! c’est si peu de chose, auprès du drame sans nom, sans analogue qui m’enveloppe à cette heure et dans lequel je vais être broyée !
— Si peu de chose, dites-vous ? s’écria Gaston atterré.
— Et pourtant, reprit Rita, je ne méritais pas un pareil châtiment. J’ai commis une faute, c’est vrai, mais que d’autres auraient succombé à ma place !
« J’étais jalouse de mon mari, et un an à peine après notre union, il part pour une excursion scientifique que lui confie le gouvernement. Je me résignais à cette séparation, faisant le sacrifice de mon bonheur à la considération, à la gloire qui devaient être pour lui la récompense de cette mission, quand j’apprends par vous qu’il est parti en compagnie d’une femme… d’une femme du plus haut monde qu’il avait aimée avant notre mariage. Je me trouvais seule, tous les jours exposée à vous voir, à vous entendre, en proie à toutes les tortures de la jalousie, à toutes les inspirations de la vengeance… Je luttai longtemps, puis je succombai. Quelle est donc celle qui, à ma place, n’eût pas failli comme moi ? Mais à peine tombée, souvenir fatal ! j’apprends du même coup que cette femme venait de mourir et qu’alors que je la croyais tout entière aux enivrements de la passion, elle emportait dans son sein une maladie mortelle, si affreuse que les plus intrépides n’y peuvent songer sans pâlir, un cancer, qui la dévorait et devait la faire mourir bientôt dans les plus cruelles souffrances. Ainsi ma faute devenait désormais sans excuse ! et je ne pouvais vous en vouloir, car vous aviez été de bonne foi en me révélant la prétendue trahison de mon mari.
— Pourquoi rappeler ce souvenir, Rita ? dit Gaston en pressant la main de la jeune femme.
— Pourquoi ? Pour vous faire juge en même temps de la faute et de l’expiation, et vous demander si le sort a équitablement proportionné l’une à l’autre.
— De quelle expiation voulez-vous donc parler, Rita ?
La jeune femme garda un instant le silence, puis, se tournant lentement vers Gaston :
— Vous êtes allé à Plaisance, lui demanda-t-elle ?
Gaston tressaillit.
— Mais oui, oui, répondit-il d’une voix troublée.
— Vous avez trouvé la nourrice ?
— Je l’ai trouvée.
— Elle est telle qu’on me l’a dépeinte, jeune et bien portante ?
— Très-bien portante, répéta Gaston.
— Fort bien.
Ces questions et le ton singulier dont elles étaient faites ne faisaient qu’accroître le trouble du jeune homme.
— Et mon enfant ? reprit la comtesse avec le même accent.
— Également bien portant.
— Vous l’avez vu ?
— Pouvez-vous en douter ?
— Eh bien ! moi aussi je veux le voir, je vais faire avancer une voiture et nous allons partir à l’instant même pour Plaisance.
— Oui, oui, sans doute, balbutia Gaston atterré, tout de suite… quand vous voudrez.
Puis il reprit :
— C’est que… je me rappelle, la nourrice doit être à cette heure chez sa mère, à … à Montrouge, avec l’enfant, naturellement, et il vaudrait mieux attendre…
— Qu’on ait retrouvé l’enfant et découvert la nourrice, n’est-ce pas ? dit Rita en se retournant brusquement et en regardant Gaston en face.
Celui-ci pâlit et resta comme foudroyé à ces paroles.
La comtesse continua de le regarder fixement quelques instants encore, puis elle murmura d’une voix faible et brisée :
— C’était donc vrai !
— Quoi ! s’écria Gaston hors de lui, vous savez…
— Tout, répondit la comtesse avec son calme navrant, cette adresse était de pure invention et vous n’avez pas trouvé de nourrice.
— Mais qui a pu vous dire…
— Lisez cette lettre qu’on m’a apportée, il y a une heure, vous y verrez au fond de quel gouffre je suis tombée.
— Oui, oui, cette lettre dont m’a parlé Fanny, dont la lecture vous a jetée dans un si violent désespoir.
— J’ai commencé par là , en effet ; maintenant que j’ai compris que ma destinée était aussi inévitable que terrible, j’ai fait comme les martyrs en face des bêtes féroces, contre lesquelles il eût été insensé de vouloir lutter, je me suis croisé les bras, j’ai fermé les yeux et j’attends.
— Mais que peut donc contenir cette lettre, grand Dieu ?
— La voilà . Lisez, dit la comtesse.
Gaston prit la lettre, qui avait été jetée sur un siège, l’ouvrit et lut avidement ce qui suit :
« Madame la comtesse, je profite de l’absence de votre mari pour vous faire remettre cette lettre par un commissionnaire, lettre sans importance et même des plus futiles, puisqu’elle a pour objet de vous demander votre avis sur le plan d’un drame que j’ai l’intention de faire pour… la Porte-Saint-Martin.
« Le voici raconté aussi brièvement que possible.
« D’abord la scène se passe à Paris.
« La comtesse de S… a trahi ses devoirs d’épouse pendant une longue absence de son mari, et sur le point de devenir mère, au moment où celui-ci annonce son retour, elle se retire à la campagne, où elle met au monde un fils, mais dans les circonstances les plus étranges et les plus dramatiques. Naturellement, elle rentre seule à son hôtel et confie l’enfant à un médecin, qui l’emporte et rassure la jeune mère, en lui affirmant qu’il lui a trouvé une excellente nourrice. J’ouvre une parenthèse pour appeler votre attention sur ce médecin, madame, il est destiné à jouer, dans le drame, un personnage fort curieux.
« Je reprends : la mère a pris l’adresse de cette nourrice, qui demeure dans la banlieue de Paris, à une demi-heure de l’hôtel de S…, une attention de ce bon docteur, et son premier soin est d’envoyer son amant chez cette femme, car elle a hâte d’avoir des nouvelles du pauvre petit être, d’autant plus cher à son cœur qu’il doit toujours vivre loin d’elle. Gaston, supposons qu’il se nomme Gaston, sort pour aller s’acquitter de cette mission, puis il rentre au bout de deux heures à peine, les traits bouleversés, en proie au plus violent désespoir, et apprend à l’infortunée jeune femme que cette nourrice n’a jamais existé. Leur enfant a été volé. »
— Par l’auteur de cette lettre, sans nul doute, dit Rita, mais ce n’est là que le début du drame, vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Poursuivez.
Gaston reprit sa lecture :
« Cette situation me semble assez corsée, qu’en pensez-vous, madame ? mais ce n’est encore qu’un préambule, une exposition, un point de départ pour arriver au véritable drame, dont voici l’idée, la carcasse en quelques mots : un moment écrasée sous ce coup de foudre, la comtesse de S… après s’être longtemps séquestrée du monde, se décide enfin à y reparaître, cédant aux instances de son mari, dont elle craint d’éveiller la défiance. Un jour, au milieu d’une fête donnée par une de ses meilleures amies, elle s’aperçoit qu’elle est l’objet de manifestations malveillantes de la part de presque toutes les femmes, qui chuchotent, qui ricanent en la regardant, et s’éloignent d’elle quand elle les approche. Elle se demande avec une vague terreur ce que cela signifie, quand elle est abordée par un individu, le docteur déjà signalé, qui lui dit à brûle-pourpoint : Je devine la raison de votre trouble, madame, et je vais vous donner la signification des symptômes qui vous inquiètent. Ces dames ont imaginé contre vous une calomnie heureusement trop invraisemblable pour mériter autre chose que votre dédain, elles prétendent que vous avez eu un enfant pendant l’absence de votre mari, que cet enfant est venu au monde dans un tapis-franc, et que pour cacher plus sûrement votre faute, vous l’avez fait disparaître, de concert avec votre amant. Bref, elles vous accusent à la fois d’adultère et d’infanticide, rien que cela ; elles vont même jusqu’à affirmer, pour donner à ce conte ridicule un air de réalité, que cet enfant est déclaré, sur les registres de la commune d’Aubervilliers, où il est né, comme fils de la comtesse de S… À ces mots, madame, la jeune comtesse jette un cri et la toile tombe sur son évanouissement. Le drame se corse de plus en plus, comme vous voyez ; mais poursuivons. À force de se répéter dans le monde, cette histoire arrive aux oreilles de la justice, qui s’en inquiète et fait un beau jour une descente chez la comtesse de S… à laquelle on fait subir un interrogatoire solennel. Elle nie tout, naturellement, et son mari s’indigne qu’on ose porter contre sa femme une semblable accusation, mais jugez de sa stupeur et de l’accablement de la comtesse, quand on produit coup sur coup à leurs yeux : 1° le registre de la commune d’Aubervilliers, où sont inscrits le nom de l’enfant et celui de la comtesse de S… sa mère ; 2° la sage-femme qui reconnaît la comtesse pour celle qu’elle a délivrée de cet enfant, déclaré par elle. Encore une fois, madame, est-ce assez corsé et peut-on désirer une situation plus empoignante que celle-là ? Je crois qu’il y a là de quoi satisfaire les plus difficiles et, pourtant, jusque-là l’auteur a ménagé les nerfs de son public et c’est sur le dernier acte qu’il a concentré ses plus saisissantes péripéties. Auprès de cet acte-là , tout le reste est à l’eau de rose, et c’est sur ce point culminant du drame que j’appelle toute votre attention. »
VI
RAYON D’ESPOIR
Gaston de Coursol s’interrompit tout à coup.
— Mais, grand Dieu ! s’écria-t-il tout bouleversé, quelle est donc cette épouvantable comédie ?
— Une comédie ! répondit la comtesse, oh ! non, mais un drame, un vrai drame qui va se jouer, non sur un théâtre, mais ici, et dont je suis l’héroïne, un drame qui se terminera… Mais continuez donc, car il faut que vous en connaissiez le dénouement.
Gaston reprit sa lecture :
« Devant ces preuves palpables, écrasantes : la naissance d’un enfant constaté à la fois par la sage-femme et sur les registres de la commune, il est impossible de nier, d’autant plus impossible, que les dates correspondent exactement aux deux jours pendant lesquels la belle comtesse a été absente de son hôtel, sous prétexte d’aller prendre l’air à la campagne. Elle doit donc avouer et elle avoue le crime d’adultère en face de son mari, qui reste muet, paralysé en entendant cette foudroyante révélation. Ce résultat obtenu, le juge d’instruction poursuit son œuvre et demande à la jeune femme ce qu’elle a fait de son enfant. Elle répond qu’elle l’a confié à un médecin, qui lui a promis de le mettre aux mains d’une bonne nourrice, que le lendemain elle a envoyé chez cette femme, rue de la Procession, à Plaisance, et qu’il a été impossible de la découvrir.
« — Il y aurait de bonnes raisons pour cela, s’il faut en croire le bruit public, réplique le juge d’instruction, car on prétend que, pour anéantir toute trace de votre faute, vous auriez donné la mort à votre enfant.
« À cette imputation directe et partant de la bouche d’un magistrat, la comtesse se révolte, pleure, se désespère et s’indigne sans ébranler la conviction de celui-ci, qui répond à ses protestations d’innocence :
« — Donnez-moi alors le nom et l’adresse du médecin auquel vous dites avoir confié votre enfant.
« La jeune femme répond qu’elle ignore l’un et l’autre.
« — Quoi ! réplique le magistrat, vous auriez confié votre enfant à un inconnu, et sans même lui demander son nom ! Avouez qu’une pareille légèreté de la part d’une mère est absolument inadmissible ; et puis comment voulez-vous qu’on croie à l’existence de ce médecin, qui n’était pas là quand vous aviez besoin de son ministère, puisque vous avez été délivrée par les seuls soins de cette sage-femme, et qui s’y trouve juste à point pour emporter un enfant qu’on cherche vainement depuis ?
« Bref, il ne doute pas de la culpabilité de la comtesse, contre laquelle s’élèvent les charges les plus écrasantes, et, conformément à l’acte d’accusation dressé par lui, la jeune femme comparaît bientôt devant la cour d’assises sous la double inculpation d’adultère et d’infanticide. À quoi sera-t-elle condamnée, elle et son amant ? car dans mon plan celui-ci est accusé et convaincu de complicité ; ou bien encore, dois-je les faire condamner ou acquitter ? L’acquittement serait un beau coup de théâtre et rien ne serait plus facile en introduisant dans l’action un traître intéressé à la mort de l’enfant et dont les aveux forcés détruiraient en un clin d’œil tout l’échafaudage de preuves amassées contre les accusés.
« C’est sur le choix à faire entre ces deux dénouements que je voudrais vous consulter, madame ; aussi serais-je fort heureux de vous rencontrer à la fête que doit donner votre parent, M. Mauvillars, vers la fin de la semaine prochaine.
« Quel que soit votre avis et à quelque parti que je m’arrête, je crois pouvoir affirmer que le drame tel qu’il est a au moins le mérite, essentiel dans toute œuvre dramatique, d’être irréprochable au point de vue de la logique. Examinez les situations où j’ai mis mon héroïne, étudiez-les, creusez-les, retournez-les dans tous les sens, et vous conviendrez que chacune est une impasse d’où il lui est impossible de sortir. Jugez plutôt.
« Elle va accoucher dans un coupe-gorge, elle comtesse de S !… pourquoi ?
« Évidemment pour cacher le fruit de sa faute, comme elle en a dissimulé les conséquences alors qu’elles devaient être devenues visibles pour tous, et tout cela dans la pensée préconçue de se débarrasser de ce témoignage vivant de son déshonneur ; cela saute aux yeux et toute autre explication imaginée par l’accusée est inadmissible.
« Ce n’est pas tout, qui appelle-t-elle auprès d’elle au moment de devenir mère, elle à qui sa fortune permet de s’adresser aux plus célèbres médecins ? est-ce un praticien habile ? Non, c’est une obscure et vulgaire sage-femme, notoirement adonnée à la boisson, mais dont par cela même on croit pouvoir acheter le silence.
« Portons la lumière sur un autre point ; en quittant le bouge où elle est devenue mère, il semble impossible qu’elle n’emporte pas son enfant avec elle. Du tout, elle le confie à un autre, et à qui ? À un homme qui se dit, ou qu’elle dit être médecin et auquel, en lui confiant un pareil dépôt, elle ne demande ni son nom, ni son adresse.
« Mais cet homme, assure-t-elle, a déposé son enfant chez une excellente nourrice, madame Claude, demeurant rue de la Procession, 85, à Plaisance. On court à Plaisance et dans toute la rue de la Procession on ne trouve ni nourrice, ni madame Claude.
« Eh bien, qu’en dites-vous, madame, jamais héroïne malheureuse et persécutée a-t-elle été aussi complètement enferrée que celle-ci ?
« Dans l’espoir de votre approbation et de notre rencontre à la fête Mauvillars, je vous prie d’agréer, madame, l’assurance de ma haute considération.
« X… »
Cette lecture terminée, Gaston de Coursol se laissa tomber dans un fauteuil, en proie à un profond accablement.
— Eh bien, que dites-vous de ce réquisitoire ? lui demanda Rita, car c’est un véritable réquisitoire, des plus serrés et des plus irréfutables, il faut en convenir ; toutes les preuves de ma culpabilité sont là , c’est ma condamnation à mort, à moins que je ne meure de honte avant la fin de ces ignobles débats.
Il y eut une longue pause.
— Et vous devez comprendre, reprit la comtesse, que ce ne sont pas là de vaines menaces ; non, non, mon enlèvement, ma translation dans cette maison infâme, la déclaration de mon enfant à la mairie avec mention de mon nom, enfin la disparition de cet enfant, tout cela est le résultat d’un plan mûrement, profondément médité ; et ceux qui m’ont enveloppé dans cette effroyable machination iront irrévocablement jusqu’au bout de leur dessein. Ma honte et ma mort sont nécessaires à quelqu’un, à qui et pourquoi ? Je l’ignore, et je suis irrévocablement condamnée par ces gens-là , je le sens.
— Non, Rita, répondit Gaston en relevant vivement la tête, tel n’est pas le but que se proposent ceux qui, j’en conviens, tiennent à cette heure notre destinée, notre vie même entre leurs mains.
— Qui vous fait penser cela quand tout prouve le contraire ? lui demanda la comtesse.
— C’est l’avis d’un homme qui nous sera d’un immense secours pour combattre nos mystérieux ennemis, un homme auquel le hasard a déjà révélé une partie de notre histoire et qui, devinant le dessein que poursuivent ces redoutables bandits, m’a juré de les détruire, et je le crois de taille à tenir ce serment.
— Mais, cet homme, qui est-il ? dans quel intérêt nous offre-t-il sa protection, et qui nous prouve qu’il n’est pas plutôt un de ces ennemis auxquels il prétend vouloir faire la guerre ?
— Cette preuve, la voici, répliqua Gaston en tirant de sa poche le petit carnet que venait de lui remettre Rocambole.
— Vos lettres ! s’écria Rita stupéfaite.
— Mes lettres qu’il a trouvées dans une cachette pratiquée à la tête du lit sur lequel vous êtes restée couchée deux jours.
— Oui, oui, je me rappelle en effet, répondit la comtesse.
— Songez à l’usage qu’il aurait pu faire de ces lettres, et dites maintenant si nous pouvons avoir confiance en cet homme.
— Il y a là de quoi me rassurer sur sa bonne foi, j’en conviens ; mais quel est le mobile qui peut le pousser à entreprendre, dans l’intérêt de gens qu’il ne connaît pas, une lutte dans laquelle il va courir les plus grands dangers ? Voilà ce dont je voudrais avoir l’explication.
— C’est très-simple, les gens qui ont organisé le complot dont nous sommes victimes se sont attaqués à lui et le mettent lui-même dans un immense péril. Ce péril, terrible, imminent, un hasard extraordinaire le lui a appris, ainsi que l’effroyable situation dans laquelle vous vous trouviez au milieu de ces bandits, mais sans lui fournir le moindre indice qui pût le mettre sur la trace de ses ennemis. Un jour enfin, une lueur se glisse dans ces ténèbres, il découvre l’ignoble cabaret où vous avez passé deux jours dans de bien mortelles angoisses, il y court, cherche, fouille partout et finit par découvrir ce petit carnet qui le met sur notre trace. Il vient aussitôt à moi, m’apprend que nous sommes menacés par les mêmes ennemis, exposés aux mêmes dangers et me propose son concours pour déjouer le redoutable complot qui nous menace tous trois, lui, vous et moi. Quant à l’intérêt qu’il trouve à s’associer à nous, le voici : dans tout ce qu’ils ont fait contre vous et moi, ces hommes n’ont eu qu’un but, que vous allez saisir tout de suite et qui va calmer vos craintes ; ce but, c’est le chantage.
— Qu’est-ce que c’est que cela ?
— C’est une industrie qui consiste à s’emparer d’un secret compromettant et à se faire payer pour ne pas le révéler ou pour en détruire les preuves.
— Oui, oui ; dit vivement Rita, ce pourrait être cela.
— M. Portal, lui, c’est le nom de notre allié, est convaincu que ce ne peut être que cela. Or, dit-il, vous ne pouvez tarder à entendre parler de ces hommes, il faut de toute nécessité qu’ils se manifestent, qu’ils sortent de l’ombre où ils se cachent et qu’ils se mettent en relation avec vous pour en arriver aux fins qu’ils se sont proposées ; voilà le fil conducteur qui me guidera jusqu’à eux. Au premier signe de vie qu’ils donneront, prévenez-moi, puis acceptez toutes les conditions qui vous seront faites, promettez de vous trouver aux rendez-vous qui vous seront donnés, mais tenez-moi exactement au courant de tout et rapportez-vous en à moi ; je m’engage à vous sauver tous deux de l’abîme où vous êtes plongés.
— Oh ! s’il pouvait dire vrai, mon Dieu ! s’écria la comtesse en joignant les mains.
— J’ai confiance en lui, et, si vous le connaissiez, vous ne douteriez ni de sa puissance, ni de sa loyauté. Cet homme a dans le regard, dans le ton, dans l’accent, quelque chose qui vous pénètre et vous fait croire à son infaillibilité.
— Mettons donc en lui une foi entière, notre salut est peut-être là .
Elle reprit avec quelque inquiétude :
— Mais maintenant que décider au sujet de cette lettre, de ce rendez-vous ?
— Il faut y aller et en prévenir M. Portal, auquel nous saurons bien procurer une lettre d’invitation et qui, là , pourra voir enfin l’ennemi face à face.
— Oui, mais, si cet ennemi, qui doit être incessamment sur ses gardes, allait s’apercevoir que nous le faisons épier, ne serait-il pas à craindre qu’il se vengeât en mettant à exécution les menaces que contient cette lettre ?
— Rassurez-vous, nous pouvons nous en rapporter à la prudence de M. Portal.
— Tenez, prenez cette lettre, faites-la lui lire et qu’il décide s’il doit, oui ou non, se rendre au bal de M. Mauvillars ; s’il le trouve à propos, je saurai bien lui en procurer les moyens.
VII
UN DÉFILÉ
Il était onze heures environ et déjà une grande affluence se faisait remarquer dans les salons de M. Mauvillars, qui occupait rue de la Ferme-des-Mathurins un des plus beaux hôtels de cet aristocratique quartier.
L’opinion attribuait à M. Mauvillars une fortune considérable. Parti de Paris pour aller occuper dans une grande maison de New-York un emploi modeste, son intelligence des affaires, sa prodigieuse activité, son esprit aventureux jusqu’à la témérité, qualités essentiellement américaines, l’avaient bientôt fait distinguer à ce point que, quelques années après, et tout jeune encore, il se trouvait à son tour à la tête d’une maison considérable, s’occupant en même temps de banque et de commerce.
Véritable brasseur d’affaires, très-entreprenant, hardi jusqu’à l’imprudence, mais toujours heureux dans ses opérations, objet de surprise et d’admiration pour les Américains eux-mêmes qui, effrayés de la multiplicité et de l’importance des entreprises où il se lançait tête baissée, attendaient chaque matin la nouvelle de sa déconfiture, il se retirait à l’âge de trente-cinq ans avec une fortune de trois ou quatre millions et reprenait aussitôt le chemin de la France.
Il avait fait à New-York la connaissance d’un négociant français du nom de Valcresson, qui avait suivi à peu près la même voie et les mêmes errements que lui, cédant, comme tant d’autres, à cette fièvre d’affaires à outrance dont, en cet étrange pays tout le monde semble dévoré, et qui, après bien des chances diverses, était en train de réaliser sa troisième faillite au moment où Mauvillars se retirait des affaires.
M. Valcresson l’avait chargé d’une lettre pour un de ses neveux qui habitait Paris.
Un mois après, M. Mauvillars se présentait chez ce neveu, M. Jules Valcresson, où l’attendait un triste tableau.
Ce jeune homme se mourait, miné par la douleur que lui avait causée la perte de sa femme, morte deux ans auparavant, dans tout l’éclat de sa jeunesse et de sa beauté.
Il laissait une sœur, de quelques années plus jeune que lui, et une petite fille de quatre ans à laquelle un proche parent de sa femme, Italien comme elle et parrain de l’enfant, avait donné le singulier prénom de Tatiane.
Le sort de Tatiane était assuré, son père lui ayant laissé en mourant une fortune estimée à deux cent mille francs environ, fortune qui bientôt devait fructifier entre les mains habiles de M. Mauvillars, car, quelques mois après la mort de Jules Valcresson, celui-ci devenait le tuteur de l’enfant en épousant sa jeune tante, mademoiselle Jeanne Valcresson.
Treize années se sont écoulées depuis cette union, et aujourd’hui la petite Tatiane est une jeune fille de dix-sept ans.
Quant à M. Mauvillars, il n’a pu s’arranger longtemps de la vie fastueuse et inactive de Paris, son rêve quand il était dans les affaires.
Bientôt blasé, fatigué, ennuyé de tous les plaisirs de Paris, il avait cherché un aliment aux instincts aventureux et à la dévorante activité que sa propre nature d’abord et la vie américaine ensuite avaient si prodigieusement développés en lui, et il s’était mis à jouer.
Il jouait sous toutes les formes, à la Bourse, dans les salons parisiens, et même à Bade, où il allait faire une excursion de temps à autre.
Et là , comme dans les affaires, la chance lui avait été constamment favorable jusqu’à ce jour.
Toute sa personne reflétait, pour ainsi dire, sa nature, ses instincts et son passé.
Il était de haute taille, la poitrine bombée, les épaules développées, vigoureusement taillé sans être corpulent, le teint ardent sans être très-coloré, la barbe et les cheveux d’un blond tirant au roux, le geste brusque et le verbe haut.
Madame Mauvillars, au contraire, de taille moyenne, les cheveux d’un châtain foncé, les traits pâles et réguliers, d’une distinction remarquable, avec quelque chose de timide, de calme et de discret dans le geste, formait un frappant contraste avec son mari.
L’un et l’autre, chacun à sa façon, faisaient à tous leurs invités, à mesure qu’ils étaient annoncés, l’accueil le plus empressé et le plus courtois.
Mademoiselle Tatiane n’était pas là pour les aider dans cette tâche ; mais, quoique absente, elle n’en faisait pas moins beaucoup de bruit dans le salon.
On n’entendait que son nom répété de tous côtés, surtout dans les groupes de jeunes filles ses amies.
— Où est donc Tatiane ?
— Mais que fait donc Tatiane ?
— Tatiane ne viendra donc pas ?
— Tatiane serait-elle malade ?
— Oh ! non, la fête n’aurait pas eu lieu.
Et partout et toujours le même nom.
Tatiane par ci, Tatiane par là ; il semblait vraiment qu’il n’y eût au monde que Tatiane.
L’une des jeunes filles se décida enfin à arrêter au passage madame Mauvillars pour lui en demander des nouvelles.
— Nous ne verrons donc pas Tatiane, madame ? lui demandait-elle.
— Oui, mes enfants, vous allez la voir bientôt, répondit madame Mauvillars en souriant.
— Comment ! elle est encore à sa toilette ! dit une autre.
— Vous vous trompez, mesdemoiselles, elle est habillée depuis longtemps, et c’est une autre toilette qui l’occupe en ce moment.
— Laquelle ?
— Eh ! mon Dieu ! celle de sa grand’mère.
— En effet, que deviendrait grand’maman Mauvillars si Tatiane n’était pas là pour veiller à sa toilette et y mettre la dernière main !
— Et grand-papa Mauvillars donc ! Il serait inconsolable si le nœud de sa cravate n’était fait par les petites mains de sa chère Tatiane.
— Il est certain, répliqua madame Mauvillars, qu’ils ne respirent que pour et par Tatiane ; aussi cette perpétuelle adoration a produit un véritable miracle à leur égard. Depuis qu’ils la couvent des yeux, c’est-à -dire depuis qu’elle est née, on dirait qu’il se dégage d’elle je ne sais quel merveilleux fluide qui les rajeunit tous les ans, si bien qu’aujourd’hui ils paraissent dix-sept ans de moins que le jour de sa naissance.
Un colloque d’un tout autre style se tenait en même temps sur un autre point du salon, entre cinq ou six jeunes gens.
Ces messieurs passaient en revue tous les invités de M. Mauvillars et ne se faisaient pas faute de gloser un peu sur l’un et sur l’autre.
— Quel est donc, demanda l’un d’eux, cette belle petite blonde à l’œil si vif et à l’air si…
— Si peu décourageant ?
— Je ne trouvais pas le mot.
— C’est madame Beausire, une des femmes les plus austères de Paris, sans en avoir l’air.
— En effet, elle n’en a pas l’air.
— Grâce à certaines façons familières dont elle a pris l’habitude, elle reçoit régulièrement par mois six déclarations d’amour écrites, sans compter les déclarations orales.
— Elle les accepte ?
— Avec empressement.
— C’est raide.
— Mais pour les remettre le soir même à son mari, avec lequel elle rit des dithyrambes amoureux de ses soupirants. Seulement, sur six elle en remet cinq, c’est bien le moins qu’elle en garde une pour elle.
Une sur six, on n’est pas plus honnête. Aussi, grâce à cet innocent stratagème, M. Beausire est-il le plus épanoui des maris, et madame Beausire la plus tranquille des pécheresses.
— Fort intelligente, cette petite blonde ! C’est égal, voilà une couleur dont je me suis toujours défié et que je me promets bien de ne jamais conduire à l’autel.
— Mais quel est donc ce couple mi-parti mélancolique et souriant qui s’avance vers nous ?
— Il y a sur ces deux époux une légende qui explique la mélancolie de l’un et le sourire de l’autre.
— Je raffole des légendes ; conte-nous donc celle-là .
— L’époux est un Anglais, le comte de Barnholt ; or, ce comte avait épousé en premières noces une jeune Allemande blonde et grasse qui le rendait le plus heureux des hommes. Malheureusement elle n’était pas sans défaut, et la preuve c’est qu’un beau jour elle mourut d’une indigestion. L’Anglais voulut se suicider ; mais, comme il n’y avait personne là pour l’en empêcher, il se raisonna lui-même et parvint à s’en dissuader ; mais il ne voulut jamais se séparer de sa chère Charlotte, et, comme rien ne résiste à la puissance de l’or, il obtint l’autorisation de la garder chez lui. Vous croyez peut-être qu’il la mit en terre ou qu’il la réduisit en cendres ? Pas du tout.
S’il avait voulu la garder, c’était pour la voir toujours belle comme de son vivant. Il avait son idée et quelques jours après elle était réalisée ; Charlotte était en bocal.
— Hein ? comment ? s’écrièrent plusieurs voix à la fois.
— L’Anglais avait fait faire un immense bocal de cristal, l’avait fait remplir d’esprit-de-vin et y avait introduit sa bien-aimée. Pais il avait fait étendre ce singulier cercueil au milieu d’une pièce de son château, toujours éclairée par de nombreuses bougies, et tous les jours, de une heure à deux, après son déjeuner, il allait la contempler.
Il s’absorbait ainsi depuis deux ans dans sa douleur, ne désespérant toujours pas d’en mourir, lorsqu’un jour qu’une affaire importante l’avait appelé à Londres, il y fit la rencontre d’une jeune Américaine, pauvre et jolie, qu’il épousa, mais en mettant pour condition expresse à cette union que Charlotte serait religieusement conservée dans son bocal.
— Et l’Américaine a toujours respecté cette relique ?
— Toujours ; seulement, comme, en sa qualité d’Américaine, elle a l’esprit positif, elle lui a donné une destination pratique.
— Comment pratique ?
— Aujourd’hui Charlotte est passée à l’état de baromètre et sert à annoncer la pluie et le beau temps.
— Allons donc !
— Quand les deux époux décident de sortir, on relève le bocal ; si Charlotte remonte de cinq centimètres, ça annonce un temps variable ; si elle va se taper la tête au plafond de son bocal, c’est signe de grande pluie. Charlotte jouit de la même propriété que les grenouilles, et c’est à l’Américaine que revient le mérite d’avoir fait cette précieuse découverte.
— Autre couple, celui-là rappelle le songe de Pharaon, les vaches grasses et les vaches maigres, le mari rendrait des points à un hippopotame et la femme lutterait de maigreur avec une perche.
— C’est madame Langevin, elle me rappelle une des plus pénibles impressions de ma vie. Un jour je l’ai vue décolletée, je ne m’en suis jamais consolé ; c’est de ce jour-là que date ma mélancolie. Aujourd’hui elle dissimule ses avantages naturels sous des flots de dentelle ; elle les voile aux yeux indiscrets des profanes. Heureux profanes ! ils n’ont pas comme moi dans le cœur un éternel sujet de méditations navrantes et de désespoir incurable.
L’entretien fut interrompu par l’annonce retentissante de cinq ou six nouveaux invités.
— M. Badoir.
— Sir Ralph Litson.
— Lord Mac-Field.
— M. le comte et madame la comtesse de Sinabria.
— M. Portal.
— M. Albert de Prytavin.
VIII
NOUVELLES FIGURES
Depuis quinze jours, la comtesse de Sinabria avait en partie recouvré sa santé, si violemment ébranlée par les événements que nous avons fait connaître au lecteur.
À la profonde altération de ses traits, à la lividité de son teint avaient succédé une pâleur mate, une langueur dans l’attitude et dans la démarche qui lui donnaient un charme tout nouveau et ne faisaient que modifier le caractère de sa beauté.
Cependant, son regard avait en ce moment quelque chose d’inquiet et de troublé qui trahissait chez elle quelque vive et récente émotion.
Cette impression n’était que trop réelle, et voici quelle en était la cause.
Dans cette terrible lettre qui lui avait été adressée sous la forme d’un plan de drame, un passage l’avait particulièrement frappée, c’était celui qui était relatif à la déclaration de son enfant à la mairie d’Aubervilliers.
Si l’on s’en souvient, on lui disait que, dans cet acte, l’enfant était déclaré fils de la comtesse Rita de Sinabria.
Cette pensée la dévorait sans relâche, c’était une idée fixe, incessante qui dominait tout chez elle et ne lui laissait plus une minute de repos.
Sa honte écrite là en toutes lettres sur un registre ouvert à tous ; son déshonneur constaté par un acte authentique et impérissable, voilà ce qui bouleversait son âme et l’épouvantait, jusqu’au vertige.
Dans tout le reste, elle ne voyait que des paroles, des menaces effrayantes, il est vrai, mais qui pouvaient n’avoir d’autre but que de l’inquiéter pour tirer d’elle une somme considérable, comme le pensaient Gaston de Coursol et ce nouvel allié qu’on appelait M. Portal, et si redoutable que fut même cette perspective, elle entrevoyait cependant sur ce point bien des chances de salut.
Mais son nom inscrit sur ce registre fatal, ce témoignage public, éternel et indiscutable de sa faute étalé là à tous les yeux, voilà ce qu’elle ne pouvait supporter.
C’était quelque chose de si affreux, de si intolérable, qu’elle en vint bientôt à penser que ses persécuteurs avaient vu là un moyen puissant d’intimidation et qu’ils l’avaient imaginé pour la résoudre à d’immenses sacrifices.
Mais elle ne pouvait vivre dans le doute, et après avoir longtemps reculé le moment de cette redoutable épreuve, elle s’était enfin décidée à aller s’assurer de la vérité par ses propres yeux.
Elle fit donc prévenir Gaston de Coursol de son intention, lui donna rendez-vous sur la place Feydeau pour deux heures, vint l’y prendre et partit avec lui pour Aubervilliers.
C’était le même jour où elle devait se rendre à la fête de Mauvillars.
Au bout de trois quarts d’heure environ, la voiture s’arrêtait à la mairie d’Aubervilliers.
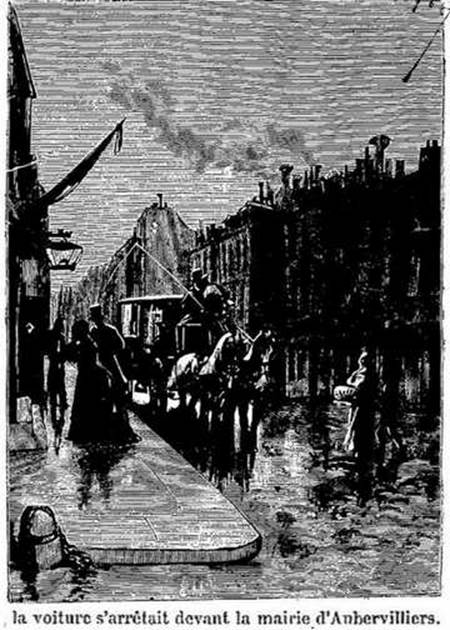
La comtesse était enveloppée dans une grande pelisse de velours et un voile épais dissimulait complètement son visage.
Ils entrèrent tous deux, Gaston de Coursol se fit indiquer la salle des naissances et là , il pria un employé de vouloir bien lui délivrer l’acte de naissance d’un enfant né le 1er décembre de cette année et présenté par une sage-femme.
— Le nom du père et de la mère ? demanda l’employé en ouvrant son registre.
— Je l’ignore.
— C’est qu’alors, il devient difficile…
— S’il n’y a qu’un enfant déclaré le 1er décembre et qu’il le soit par une sage-femme, ce ne peut être que celui-là .
— En effet, répondit l’employé.
Il feuilleta son registre.
— Voilà , dit-il bientôt, 1er décembre, un enfant du sexe masculin.
— C’est bien cela, dit vivement Gaston.
— Déclaré par madame Morel, sage-femme.
— Plus de doute.
— D’autant plus qu’il n’y a pas d’autre déclaration ce jour-là .
— Le nom du père ? demanda Gaston.
— Père inconnu.
— Et de même pour la mère, sans doute ?
— Non pas.
— Ah ! le nom de la mère est mentionné ?
— Certes.
— Et ce nom ?
À cette question, la comtesse, qui tremblait de tous ses membres depuis son entrée à la mairie, se sentit fléchir sur ses jambes, et Gaston remarqua avec inquiétude qu’elle s’appuyait sur son bras de tout le poids de son corps.
— Attendez donc, dit l’employé en se penchant sur son registre, c’est un nom assez singulier ; je ne le crois même pas français. Ah ! voilà ; la mère de l’enfant est la comtesse Rita de Sinabria.
La jeune femme ne put comprimer un soupir.
— Mon Dieu ! balbutia-t-elle d’une voix défaillante, ce n’était pas une invention, mon nom est là .
Ce soupir fit lever la tête à l’employé, qui lui jeta un regard à la dérobée, et la comtesse comprit avec effroi qu’elle s’était trahie.
Enfin l’employé remit bientôt l’acte de naissance à Gaston, qui paya et sortit avec la comtesse.
La terreur de celle-ci ne connaissait plus de bornes et dès qu’elle fut remontée en voiture elle se livra au plus violent désespoir.
C’est sous l’empire du trouble profond où l’avait jetée cette effrayante révélation que la comtesse de Sinabria arrivait avec son mari à la fête de Mauvillars.
Le comte, lui, était plein d’égards et d’attentions pour sa femme, dont l’air distrait et préoccupé l’inquiétait vivement.
Il était revenu de Tours convaincu de l’injustice de ses soupçons, et lui en avait demandé pardon, en lui avouant franchement le voyage qu’il venait de faire et les motifs qui l’y avaient déterminé.
Après avoir échangé quelques mots affectueux avec M. et madame Mauvillars, les deux époux s’étaient séparés, le comte pour aller serrer la main à quelques amis qu’il n’avait pas encore vus depuis son retour, la comtesse pour se mêler à un groupe de jeunes femmes retirées dans un angle du salon et qu’elle connaissait presque toutes intimement.
Les salons continuaient à se remplir, et le coin infernal, dont nous avons signalé les médisances plus ou moins innocentes, poursuivait la mission qu’il s’était donnée de faire la biographie des invités, à mesure qu’ils étaient annoncés ou qu’ils passaient devant eux.
— M. et madame Taureins ! cria le domestique à l’entrée d’un nouveau couple.
À ce nom, tous les regards se tournèrent vers la porte avec l’expression d’une vive curiosité.
— Attention ! dit un des jeunes gens, voilà une reine de beauté.
Il eût été difficile, en effet, d’imaginer une plus belle créature que madame Taureins.
Elle était de taille moyenne ; mais elle se tenait si fièrement et en même temps si gracieusement cambrée, qu’elle semblait plus grande qu’elle n’était réellement.
Cette attitude avait en outre le mérite de dessiner nettement ses formes, naturellement et harmonieusement accusées.
Ses traits étaient réguliers sans froideur, grâce à une expression à la fois tendre, grave et recueillie qui leur communiquait un grand charme.
Son teint, d’une superbe pâleur de brune, sa bouche fermement dessinée, la vague pénombre qui ornait sa lèvre supérieure, les cils longs et recourbés qui jetaient comme une ombre autour de ses beaux yeux noirs, enfin la splendide chevelure châtain foncé relevée çà et là par masses d’un fauve presque noir, tout cet ensemble faisait de madame Taureins une des femmes les plus remarquablement belles de Paris.
Son mari était juste de sa taille et, conséquemment, paraissait petit.
Il avait le teint blafard et bilieux, l’œil gris, clair et froid, les jambes mal équilibrées, la démarche gauche et, dans toute sa personne, quelque chose à la fois de contraint, d’important et de despotique qui décelait le parvenu parti de bas.
— Voilà un mariage parisien, dit un des membres du coin infernal ; d’un côté, tous les charmes, toutes les beautés, toutes les perfections, toutes les délicatesses, tous les grands sentiments ; de l’autre, un coffre-fort et toutes les vulgarités physiques et morales. Un beau jour le hasard, qui aime à rire, pêche, comme cela, dans la mêlée humaine, deux êtres profondément dissemblables, les met face à face, puis leur persuade de s’unir pour l’éternité. Mais la farce ne tarde pas à tourner au drame ; une fois blasée sur le luxe qui l’a décidée à surmonter sa répulsion, la femme prend son mari en horreur, en attendant qu’elle le prenne en dégoût, et son cœur, qui n’a pas encore été effleuré, cherche avec une ardeur dissimulée l’aliment sans lequel il ne peut vivre, la passion. Alors gare les catastrophes ! Il y a toujours autour de toute jolie femme quelqu’un qui rôde quærens quem devoret attiré par les émanations de l’amour comme le lion par l’odeur de la chair, et un beau jour les drames font irruption dans le ménage mal assorti. C’est ce qui arrivera dans celui-ci, pas n’est besoin d’être prophète pour deviner cela. Voyez cet incomparable ensemble de grâces et de beautés, et dites si la seule et unique mission de cette femme ici-bas n’est pas d’aimer et d’être aimée, et n’est-il pas également évident que ce ne saurait être à ce vulgaire personnage qu’il appartient de chanter l’adorable duo d’amour que Dieu a mis dans son cœur et qui s’exhale de toutes les âmes à son seul aspect ? Cette femme est faite pour traverser la vie au milieu des enivrements et des orages de l’amour ; c’est sa destinée, elle n’y saurait faillir.
Tous les jeunes gens déclarèrent unanimement que le mari était condamné, qu’il serait scandaleux qu’il en fut autrement et que ce châtiment lui était bien dû pour le crime de lèse-beauté dont il s’était rendu coupable en enchaînant cette merveille de grâce à son triste et disgracieux individu.
Deux nouveaux auditeurs, qui s’étaient approchés de ces jeunes gens depuis un instant et qui avaient paru écouter avec un vif intérêt tous les détails relatifs au couple Taureins, applaudirent à cet arrêt et exprimèrent le vœu que la foudre conjugale tombât sans retard sur la tête de ce déplorable mari, assez barbare pour n’avoir pas compris que son rôle se bornait à sertir ce beau diamant de tout le luxe qui pouvait le mettre en relief, et de se garder de jamais l’approcher dans la crainte de le ternir de son haleine.
Ces deux nouveaux venus, si attentifs aux renseignements qui venaient d’être donnés sur la belle madame Taureins, étaient sir Ralph et lord Mac-Field.
Mais leur attention, ainsi que celle des jeunes gens qui les entouraient, fut aussitôt distraite de ce sujet, quand on entendit plusieurs voix de jeunes filles s’écrier d’un ton joyeux :
— Ah ! voilà Tatiane.
IX
TATIANE
Alors un tableau aussi charmant qu’imprévu s’offrit à tous les regards, et l’effet en fut si saisissant, si spontané, qu’un profond silence se fit tout à coup dans cette foule tout à l’heure si bruyante et si agitée.
Une porte donnant dans les appartements de M. Mauvillars s’était ouverte et on avait vu entrer dans le salon trois personnes.
Deux vieillards, ceux qu’on venait d’appeler grand-papa et grand’maman Mauvillars, et une jeune fille de seize à dix-huit ans.
Les deux vieux époux, avec leurs vêtements d’une coupe surannée, quoique battant neufs, leur chevelure d’un blanc d’argent, leur teint frais et reposé, leur sourire béat et ravi, avaient tout à fait l’air de deux ancêtres descendus de leurs cadres pour venir se mêler à une fête moderne.
Deux détails se faisaient particulièrement remarquer dans leur toilette, c’étaient, chez la grand’maman, les quelques fleurs mêlées à ses cheveux blancs et, chez le grand-papa, les larges nœuds de sa cravate blanche, si délicatement étalés qu’ils semblaient n’avoir pas été touchés.
C’était l’œuvre des petites mains de leur chère Tatiane, et on devinait que c’était là la vraie raison de leur orgueilleux sourire.
Ils s’avançaient à travers la foule avec des saluts et des révérences qui sentaient bien un peu le règne de Louis XVI, mais dont la bizarre solennité complétait merveilleusement leur type et achevait leur physionomie de vieux portraits de famille.

Tatiane s’avançait entre eux, si pure, si fraîche et si radieuse au milieu de ces deux vieillards, qu’on eût dit une primevère poussée au milieu de la neige.
Elle était blonde, de ce blond cendré si rare et qui donne au visage tant de poésie et de distinction.
Plutôt petite que grande, elle avait toutes les séductions de la blonde, un cou, des bras et des épaules d’une éclatante blancheur, d’un galbe exquis, d’un dessin très-pur, pleins et arrondis sans être gras.
L’ensemble de ses traits n’avait rien de régulier, mais chaque détail en était charmant. La bouche surtout, d’un rouge vif comme une cerise, un peu grande, délicieusement ciselée, souvent entr’ouverte par un sourire d’enfant, était ravissante.
Mais le plus grand charme, la vraie beauté, l’incomparable et irrésistible séduction de Tatiane était dans l’expression de sa physionomie.
Toutes les précieuses qualités de sa charmante nature, la bonté, l’indulgence, la tendresse, la sensibilité s’y épanouissaient dans un rayonnement qui donnait à sa jolie tête quelque chose de toujours souriant et de toujours ému.
Quand il paraissait quelque part, cet aimable et radieux visage devait produire l’effet d’un rayon de soleil.
On comprenait en la voyant qu’elle fût adorée de toutes ses amies, pour lesquelles elle ne devait jamais avoir que de bonnes et gracieuses paroles.
— La charmante jeune fille ! murmura l’un des jeunes gens qui, jusque-là , s’étaient montrés si peu indulgents dans leurs appréciations.
— Voilà un heureux mortel que celui qui aura le bonheur de lui plaire ! répliqua son voisin ; elle a toutes les perfections ; c’est la plus jolie de toutes ces jeunes filles, c’est la plus entourée, la plus sollicitée, la plus accablée d’invitations, et il n’en est pas une qui ne l’adore, pas une qui ne proclame qu’elle est meilleure encore que jolie ; n’est-ce pas le plus bel éloge qu’on puisse faire de son cœur et de son caractère ?
— Cette jeune fille n’est-elle pas mademoiselle Mauvillars ? demanda Mac-Field à celui qui venait de parler.
— Non, monsieur, répondit celui-ci, c’est mademoiselle Tatiane Valcresson, la nièce de M. Mauvillars.
— Merci.
Avant d’aller se joindre à ses jeunes amies, qui, toutes, lui faisaient signe de venir à elles, Tatiane alla placer ses grands-parents à un endroit qu’elle avait choisi de l’œil en entrant comme le plus commode et le plus agréable, c’est-à -dire près de quelques vieux amis qui étaient déjà là et qu’elle invitait elle-même à chaque fête exprès pour eux, juste au beau milieu du salon, pour qu’ils pussent embrasser du regard toutes les danses à la fois, et enfin loin de la porte, pour les mettre à l’abri des courants d’air.
Quand elle les eut placés, elle passa les doigts dans les nœuds de la cravate du grand-père, ébouriffa légèrement une boucle des cheveux de la grand-mère ; puis, se reculant de quelques pas et les montrant à deux de ses amies qui l’avaient suivie jusque-là :
— Mais regardez-les donc, s’écria-t-elle toute rayonnante, sont-ils assez gentils tous les deux ! Tiens, grand-papa, tu n’as pas trente ans, et toi, grand’mère, je t’assure que tu vas faire tourner toutes les têtes.
La grand’mère sourit et le grand-père essuya une larme qui venait de perler à sa paupière.
— Surtout, reprit la jeune fille en prenant un petit air grondeur, promettez-moi d’être sages ; amusez-vous bien et ne vous tourmentez pas pour moi toute la soirée, comme vous faites toujours. Je suivrai toutes vos recommandations, je ne valserai pas beaucoup, je ne m’approcherai pas des fenêtres ouvertes et je ne prendrai pas de glaces ; êtes-vous contents ?
Puis se penchant vers eux et leur donnant tour à tour son front à baiser :
— Allons, embrassez votre petite Tatiane, qui vous promet de venir vous voir après chaque danse, et, encore une fois, amusez-vous bien.
Et elle s’éloigna avec ses amis.
— Pauvre petite, murmura le grand-père en s’adressant à ses vieux amis, quand je pense que bientôt, dans quelques mois peut-être, nous ne serons plus là pour…
— Que voulez-vous, mon pauvre ami ? répondit le vieillard, nous sommes tous mortels, il faut bien se résigner à mourir.
— Mourir, ce n’est rien, répondit le grand-père, mais ne plus la voir, voilà ce qui me désole.
Et, pour la seconde fois, les larmes lui vinrent aux yeux.
Puis il reprit :
— Ah ! si vous la connaissiez !
— Eh ! je ne la connais que trop.
Le grand-papa Mauvillars se retourna brusquement vers son ami, et le regardant d’un air indigné :
— Que voulez-vous dire, monsieur Chamouillard ?
— Eh bien, je veux dire que tout le monde vous envie et moi comme les autres. Tandis que nous ayons tous des belles-filles et des petites-filles coquettes, poseuses, cavalières, absorbées dans le soin de leurs propres personnes, s’apercevant à peine que nous existons, nous traitant avec une insolente indifférence, quand ce n’est pas avec une impitoyable dureté, vous avez, vous, un ange d’une gentillesse, d’une grâce, d’une bonté incomparables, qui met son bonheur à vous entourer de prévenances, à vous rendre la vie heureuse et facile, à écarter les pierres de votre chemin, et va jusqu’à inviter à ses fêtes cinq ou six vieilles momies comme nous, pour que grand-papa et grand’maman Mauvillars ne soient pas exposés à s’ennuyer ; et vous voulez que je voie ça de sang-froid ! Ah ! mais non.
Ce bizarre éloge de sa petite Tatiane dissipa la colère du vieillard, qui se mit à rire de bon cœur, tout en plaignant de son mieux son ami Chamouillard.
Pendant ce temps on continuait à s’entretenir de la jeune fille dans le camp des jeunes.
— Croyez-vous qu’elle aime quelqu’un ? demanda l’un d’eux.
— J’en doute, il y a tant de candeur et d’ignorance dans ces beaux yeux bleus ! c’est le regard d’un enfant.
— Elle a dix-sept ans cependant, il n’y aurait donc rien d’étonnant à ce que son cœur eût parlé, mais elle est si naïve qu’il peut fort bien arriver qu’elle aime sans se rendre compte du sentiment qu’elle éprouve.
— Tenez, dit tout à coup un jeune homme, ne serait-ce point celui qui l’aborde en ce moment ? Je l’ai vu souvent danser avec elle.
— Paul de Tréviannes ? Non ; je puis vous garantir que vous vous trompez.
— Il vous l’a dit ?
— Non, mais il aime ailleurs, et d’un amour si profond, si violent, si enthousiaste, que j’ai surpris son secret.
— Et il est aimé ?
— Je le crois.
— La dame est mariée ?
— Naturellement.
— Et nous la connaissons ?
— Tous.
— Elle assiste à cette fête ?
— Ah ! vous en demandez trop ; arrêtons-nous ici.
Mac-Field et sir Ralph, qui ne s’étaient pas éloignés de ce groupe, foyer de cancans scandaleux et d’anecdotes instructives, prêtaient toute leur attention à ce dialogue, tout en feignant de s’absorber dans la contemplation des jolies femmes qui passaient et repassaient devant eux.
À quelques pas de ce groupe, deux individus, très-différents d’âge et de figure, semblaient, eux aussi, s’entretenir des jolies femmes qui abondaient à cette fête, mais il n’en était rien.
— Allons, disait à son jeune compagnon le plus âgé des deux, il faut avouer que le sort nous favorise singulièrement et c’est à nous seuls que nous devons nous en prendre si nous ne tirons pas parti des atouts qui nous tombent dans la main.
— De quels atouts voulez-vous parler ? demanda le jeune homme.
— Te rappelles-tu les noms signalés dans le portefeuille de celui que je crois être le chef de la bande d’Aubervilliers ?
— Oui, oui.
— Ils sont tous ici ou à peu près : Sinabria, Mauvillars, Taureins, Valcresson et Tatiane. Nous sommes ici en plein champ de bataille ; nos ennemis y sont présents, puisqu’ils y ont donné rendez-vous à la comtesse Rita ; ils vont opérer sous nos yeux, nous allons donc enfin les connaître et pouvoir engager le combat, c’est-à -dire suivre leur piste et prendre nos mesures. Tu ne perds pas de vue la comtesse de Sinabria ?
— Pas une minute.
— Dès que quelqu’un viendra l’aborder, préviens-moi aussitôt, ce ne peut être que l’individu qui lui a donné rendez-vous ici. Celui-là , nous ne le quitterons plus, et c’est par lui que nous arriverons à connaître du même coup la bande qu’il commande sans doute et le complot dans lequel sont enveloppés tous les noms inscrits sur son portefeuille.
— Jusqu’à celui de cette pure et charmante jeune fille, dit Albert de Prytavin.
— Tatiane ! répliqua Rocambole, celui-là est marqué de deux croix, preuve qu’il est menacé d’une façon toute particulière et qu’il se trame contre l’infortunée jeune fille quelque chose de terrible, mais nous serons là et…
— M. Jacques Turgis cria en ce moment le domestique chargé d’annoncer.
— Turgis ! dit sir Ralph, voilà qui est singulier, c’est le nom d’un de nos hommes, le père Vulcain.
X
MAUVAISES NOUVELLES
Sir Ralph et Mac-Field continuaient à rôder autour des cinq ou six jeunes gens dont le bavardage avait pour eux l’avantage de les éclairer sur bien des gens qu’ils avaient intérêt à connaître ou de confirmer ce qu’ils en savaient déjà .
Tout en écoutant cependant, ils se tenaient à une assez grande distance l’un de l’autre, ne se rapprochaient que rarement pour échanger rapidement quelques observations et se quitter aussitôt, mettant tout en œuvre pour qu’on les crût absolument étrangers l’un à l’autre.
— Tiens, dit tout à coup l’un des jeunes gens, qu’est-ce que c’est que ce vieux beau ? on dirait qu’il est en bois et que toutes les parties de son corps sont vissées l’une dans l’autre.
— C’est bien cela, mais la vis du cou aurait besoin d’être graissée, elle paraît jouer avec difficulté. J’ai envie d’aller lui proposer certain cambouis de qualité supérieure et souveraine pour…
— Garde-t’en bien, c’est encore un Valcresson, un cousin de madame Mauvillars.
— Comment le nommes-tu ?
— M. Pontif.
— Joli nom et merveilleusement approprié à l’individu ; on dirait qu’il porte une tiare, tant sa démarche est solennelle, et, à la gravité avec laquelle il promène son regard autour de lui, il semble se préparer à parler urbi et orbi.
— Que fait M. Pontif ?
— Il jouit de dix mille livres de rente après avoir passé trente années au ministère de la justice, d’où il est sorti chef de bureau et décoré.
— Naturellement ; c’est égal, ce n’est pas celui-là qui fera monter les actions de la Légion d’honneur.
— C’est un vieux garçon ?
— À son grand désespoir.
— Comment ! avec dix mille livres de rente pour compenser ses désavantages naturels, il n’a pu trouver…
— Il a fait vingt tentatives qui, toutes, ont échoué. Ce pauvre M. Pontif est un de ces hommes gauches qui, suivant un dicton populaire, se noieraient dans un verre d’eau ; partout où il passe, il commet bévues sur bévues, maladresses sur maladresses et parvient toujours à choquer quelqu’un avec les meilleures intentions du monde. Voici comment il a échoué dans sa dernière tentative de mariage. Tout était arrangé, il avait enfin trouvé une jeune fille résignée, gracieuse de tout point, sauf une imbécillité chronique, suite d’une grande émotion et qu’une violente secousse pouvait dissiper tout à coup, et admirablement faite, à part une légère gibbosité dont elle avait fait une grâce par les jolis petits manèges qu’elle employait pour toujours se présenter de face. Bref, tout était prêt, la corbeille était commandée, M. Pontif allait voir couronner sa flamme, lorsqu’on décide de donner une grande soirée pour le présenter à quelques parents de province, parmi lesquels une tante à héritage. C’était une femme de cinquante ans, qui avait de grandes prétentions à la jeunesse.
Le salon était plein quand arriva M. Pontif ; mais, loin de se déconcerter, il sourit d’un air satisfait au moment où on le présente à la tante, car il a préparé son compliment :
— Madame, lui dit-il en s’inclinant galamment devant elle, on m’avait bien dit que vous aviez de beaux restes ; mais, maintenant que j’ai pu le constater de visu, je n’hésite pas à vous affirmer que je n’ai jamais vu une femme de votre âge aussi bien conservée.
À ce singulier compliment, une violente envie de rire s’empare de tous les assistants, qui portent leur mouchoir à leur bouche et se livrent à mille contorsions pour la comprimer. Heureusement la tante, qui n’était pas une sotte, donne le signal de la gaieté en éclatant la première, et alors on a le spectacle inouï de cinquante personnes se pâmant, se tordant, se mouchant et pleurant à force de rire. La jeune fiancée était si dépitée qu’elle s’oublia jusqu’à tourner le dos ; c’était la première fois de sa vie. Aussi, attribuant à son futur la révélation de son infirmité, qu’elle croyait absolument ignorée de tous jusqu’à cette fatale soirée, elle ne lui pardonna pas. Du reste, M. Pontif s’était fait justice lui-même. Effaré, étourdi, ahuri, à moitié fou en face de ces bruyants et interminables éclats, il s’était glissé sournoisement vers la porte ; et quand, le calme, une fois rétabli, on se mit à sa recherche, il n’était plus là .
— Alors il doit avoir renoncé à ses projets matrimoniaux, car il faut avouer qu’il y avait là de quoi décourager à tout jamais l’homme le plus philosophe.
— J’en doute, mais il l’affirme et déclare n’avoir jamais voulu se marier dans l’intérêt de sa chère petite nièce Tatiane, à laquelle il réserve toute sa fortune.
En ce moment sir Ralph, dont les regards étaient fixés sur Mac-Field, avec lequel il échangeait de temps à autre quelques signes d’intelligence, vit celui-ci se troubler tout à coup.
Il se rapprocha de lui lentement, avec une indifférence marquée, et lui tournant le dos à demi :
— Que se passe-t-il donc ? lui demanda-t-il.
— Tournez vos regards vers l’entrée du salon, répondit Mac-Field d’une voix brève.
— Eh bien ? dit sir Ralph après avoir suivi cet avis.
— Vous ne voyez donc pas ?
— Je vois le domestique de M. Mauvillars.
— Et derrière lui ?
— En effet, il y a quelqu’un ; une espèce de petit groom.
— Le mien.
— Que peut-il venir faire ici ?
— Je lui ai donné ordre en partant de ne pas quitter la maison, et, dans le cas où il viendrait une lettre de l’étranger, de me rapporter aussitôt.
— De l’étranger ! murmura sir Ralph en frissonnant, et vous croyez…
— Ce ne peut être que cela qui l’amène.
— Alors, courez donc…
— Non pas, ce serait prouver que je guettais cette lettre, et qui sait si un jour… enfin ce serait une imprudence ; attendons qu’on vienne me prévenir.
Puis les deux complices se séparèrent, et, malgré l’impatience dont il était dévoré, Mac-Field parcourut lentement le salon, l’air calme et souriant.
Il n’attendit pas longtemps.
Comme il feignait d’être absorbé dans la contemplation d’un groupe de jeunes femmes, il vit tout à coup paraître devant lui le domestique de M. Mauvillars.
— Pardon, monsieur, dit celui-ci en s’inclinant respectueusement, monsieur n’est-il pas lord Mac-Field ?
— Précisément, répondit tranquillement celui-ci ; vous avez quelque chose à me dire ?
— C’est le domestique de milord qui est là , dans l’antichambre et voudrait parler à milord.
— Je vous suis.
Il arriva près de John un instant après, et le tirant un peu à l’écart :
— Eh bien ! lui demanda-t-il, est-ce qu’il serait venu une lettre ?
— De l’étranger, oui, milord, répondit John.
— D’Europe ? demanda Mac-Field d’un air indifférent.
— Non, milord, d’Amérique.
Mac-Field tressaillit légèrement, mais il domina son trouble et reprit :
— Et la ville ?
— New-York.
Et, tirant une lettre de sa poche, il la remit à son maître.
— C’est bien, tu peux rentrer maintenant.
Le groom partit.
Une fois seul, Mac-Field s’approcha d’une lampe qui éclairait l’antichambre et lut avidement cette lettre, qui était écrite en chiffres.
Voici ce qu’elle contenait :
« La lumière commence à se faire sur le crime accompli, il y a deux mois, dans la dixième rue. D’après certains indices découverts sur le lieu du meurtre, on avait cru d’abord que le coupable avait pris la route de l’Inde, et deux détectives avaient été lancés à sa poursuite. Mais la police, éclairée par de nouveaux faits, a tout lieu de croire aujourd’hui qu’elle a été jetée sur une fausse piste et, croyant avoir trouvé la bonne, elle vient d’envoyer quatre de ses meilleurs limiers en Europe, deux à Londres et deux à Paris. »
Après avoir lu cette lettre, Mac-Field la plia méthodiquement, car il se sentait observé par le domestique en sentinelle dans l’antichambre, et, un peu plus pâle que tout à l’heure, il regagna le salon d’un pas lent et tranquille.
Il ne tarda pas à rencontrer sir Ralph sur son chemin.
— Eh bien ! lui demanda celui-ci d’une voix basse et d’un ton bref.
— Je ne me trompais pas.
— Une lettre ?
— Oui.
— De New-York ?
— Oui.
Il y eut une pause.
Sir Ralph respirait avec peine.
— Et… quelles nouvelles ? demanda-t-il enfin.
— Aussi mauvaises que possible.
— Ah ! fit sir Ralph, qui devint plus pâle encore que Mac-Field.
— Notre truc a été éventé.
— Cependant, ne nous a-t-on pas fait part que la police avait envoyé…
— Deux détectives à Calcutta, c’est vrai, mais depuis ils ont fait je ne sais quelles découvertes qui les ont remis dans le vrai chemin.
— Et alors ?
— Eh bien, quatre nouveaux détectives, et des plus forts, ont été dépêchés, mais cette fois en Europe.
— L’Europe est grande.
— Deux sont partis pour Londres et deux pour Paris.
— Pour Paris ? balbutia sir Ralph.
— Qui sait s’ils n’y sont pas déjà ?
— Si tôt !
— Qui sait même s’ils ne sont pas à cette fête ?
— Quoi ! vous croyez qu’ils soupçonneraient…
— Je ne puis le croire, mais ils peuvent être venus ici au hasard. N’a-t-on pas constaté, d’après l’empreinte des semelles dans le sang de la victime, que les meurtriers devaient appartenir à la haute société, ou qu’ils devaient au moins y vivre ?
— C’est vrai.
— Le péril est donc imminent, et c’est le moment de redoubler d’audace et d’activité en réalisant au plus vite le double plan que nous avons basé sur M. Badoir et la comtesse de Sinabria.
— Oui, oui, il n’y a pas une minute à perdre.
— Occupez-vous de la comtesse ; moi, je me charge de M. Badoir.
On entendait depuis un instant les accords de l’orchestre.
— Croyez-vous que la comtesse vous ait reconnu ? demanda Mac-Field à son complice.
— Je suis certain du contraire ; elle m’a vu passer trois ou quatre fois devant elle sans me remarquer.
— C’est bien étrange !
— Nullement ; j’avais toute ma barbe quand je lui ai parlé au cabaret de la Providence, et mes yeux étaient cachés sous d’énormes lunettes bleues.
— Allez donc, et rappelez-vous que, dans la situation où nous sommes, il faut un succès rapide et complet.
— Nous la tenons trop bien pour qu’elle hésite, quoi que je puisse lui demander.
— M. Badoir hésitera peut-être, lui, mais il n’en cédera pas moins.
Ils se séparèrent.
Sir Ralph se dirigea aussitôt vers la comtesse de Sinabria, et, s’inclinant :
— Madame la comtesse peut-elle me faire l’honneur de danser ce quadrille avec moi ?
— Je suis bien souffrante, monsieur, répondit la jeune femme, et j’ai résolu de ne pas danser aujourd’hui.
— Mon Dieu ! madame la comtesse, vous savez ce que c’est qu’un quadrille, c’est une occasion de causer plutôt que de danser, et j’ai l’amour-propre de croire que vous eussiez trouvé quelque intérêt à ma conversation…
À ces derniers mots, accentués avec une intention marquée, la comtesse fixa sur sir Ralph un regard effaré, et, après une minute d’hésitation, elle répondit d’une voix troublée :
— Volontiers, monsieur, volontiers.
XI
UN TIGRE AMOUREUX
Si le lecteur se rappelle la scène qui s’est passée, il y a longtemps déjà , entre sir Ralph et M. Badoir, il devinera sans peine que c’est à ce dernier que Mac-Field et son ami devaient les lettres d’invitation qui leur avaient été adressées par M. Mauvillars.
On peut croire que ce n’était pas spontanément et de son plein gré qu’il avait rendu ce service à ses nouvelles connaissances, mais on se rappelle qu’il avait d’excellentes raisons pour ne pas le refuser.
Or, M. Badoir était en ce moment dans une salle de jeu, mêlé à la galerie, car il ne jouait jamais, quand il sentit une main se poser doucement sur son épaule.
Il se retourna vivement et se sentit mal à son aise en reconnaissant lord Mac-Field dans celui qui l’abordait.
— Monsieur Badoir, lui dit celui-ci à voix basse, voudriez-vous m’accorder quelques instants ? Il s’agit d’une consultation.
— Une consultation ! répéta M. Badoir avec une vague inquiétude.
— Fort courte, monsieur Badoir, dix minutes à peine.
— À vos ordres, milord, répondit le banquier, croyant prudent de prendre au sérieux ce nom et ce titre de lord Mac-Field, dont l’authenticité lui semblait très-problématique.
— Venez donc par ici, nous serons très-bien pour causer.
Il l’entraîna dans un coin de la salle de bal et lui fit prendre place à côté de lui sur une banquette, trop éloignée des danseurs pour que personne vînt les troubler là .
— Monsieur Badoir, reprit alors Mac-Field, mon ami Ralph et moi, nous éprouvons le besoin de nous créer, dans la société, une de ces situations modestes, nettes et honorables, qui font voir clair dans la vie d’un homme, défient tout commentaire et mettent pour toujours à l’abri de la calomnie ; bref, nous voulons fonder une maison de commerce, et c’est sur ce point que je désire avoir votre avis.
— Une maison de commerce, vous ! dit M. Badoir avec stupeur.
— Nous avons songé à une maison de commission ; ayant parcouru à peu près toute l’Amérique, nous avons pu étudier les besoins de chaque pays, les articles qui ont chance de s’y écouler avec avantage, la plupart des grandes maisons avec lesquelles on peut traiter en toute sécurité, et nous possédons en outre, l’un et l’autre, je puis le dire, l’instinct des grandes affaires ; enfin, point essentiel, nous commençons avec des capitaux qui nous permettent de toujours traiter au comptant, avantage énorme que vous êtes, mieux que personne, à même d’apprécier, monsieur Badoir.
— En vérité, vous me surprenez, dit M. Badoir ; à vous entendre parler, on jurerait que vous avez passé votre vie dans les affaires.
— J’ai passé quelques années à New-York, où on respire les affaires par tous les pores, de sorte que tout le monde les connaît sans les avoir étudiées.
— Mais, vu les connaissances spéciales, les aptitudes particulières, les avantages de toutes sortes que vous possédez, je ne puis qu’approuver votre projet.
— Bien, je tenais à votre approbation, et maintenant que nous l’avons, vous n’avez aucune raison pour désapprouver la raison de commerce sous laquelle nous allons nous établir.
— Quelle est-elle ?
— Badoir et compagnie.
M. Badoir bondit sur sa banquette.
— Hein ? murmura-t-il d’une voix étranglée, vous dites… ?
— Badoir et compagnie, vous avez parfaitement entendu.
M. Badoir pâlit et resta quelques instants sans pouvoir proférer une parole.
— Allons, dit-il enfin en essayant un sourire que ses traits contractés ne purent ébaucher, allons, vous voulez rire ; c’est une plaisanterie, voilà tout.
Mac-Field, lui, eut un sourire sinistre.
— Écoutez-moi, dit-il, et vous comprendrez qu’il n’y eut jamais projet plus sérieux et basé sur des raisons plus solides.
Il y a quelques mois, un Mexicain et sa femme vinrent habiter New-York. L’homme, âgé de quarante ans environ, était huit ou dix fois millionnaire ; la femme avait vingt-cinq ans à peine et passait avec raison pour la plus belle créature qu’on eût jamais vue à New-York. Aussi avait-elle, dès le premier jour mis le feu à toutes les imaginations, la ville était pleine de ses adorateurs, tous les jeunes gens la suivaient à la promenade, des murmures d’admiration l’accueillaient lorsqu’elle se montrait au théâtre ; enfin on ne parlait plus, on ne rêvait plus que de madame Christiani.
Parmi tous ces soupirants, il en était un qui ne se livrait à aucune manifestation, qui ne la suivait que de loin et ne parlait jamais d’elle ; mais celui-là l’aimait d’un amour profond et jaloux, et, quand il comprit un jour que cette passion minait son cerveau en même temps que son cœur et le conduisait droit à la folie, il se jura qu’elle serait à lui ou ne serait à personne, pas même à son mari, qu’il haïssait de toutes les forces de son âme.
À partir du jour où il avait fait ce serment, il se mit à épier tout ce qui se passait dans la maison de celle qu’il aimait, attendant patiemment une occasion de lui parler.
Elle s’offrit enfin.
Un matin, il vit le mari partir à cheval, suivi d’un domestique.
Ils habitaient une belle maison isolée, entourée de jardins dans la dixième rue.
Caché au fond du jardin, il la vit s’avancer sur une élégante véranda, dire adieu de la main à son mari, puis agiter son mouchoir blanc jusqu’à ce qu’elle l’eût perdu de vue.
Elle était dans un élégant costume du matin qui laissait voir presque entièrement ses beaux bras nus et une partie de ses épaules.
Brown, c’est le nom de celui qui l’aimait, Brown en eut un éblouissement.
Il plongea sa tête dans ses deux mains et resta quelques instants absorbé dans cette vision, qu’il conservait au fond de son cœur aussi splendide, aussi étincelante que si elle eût été encore sous ses yeux.
Il demeura là jusqu’au milieu du jour.
Il avait attendu l’heure de la sieste, sachant qu’à ce moment tous les domestiques étant endormis et n’ayant d’ailleurs aucun sujet de défiance, il pourrait facilement s’introduire dans la maison.
Quand il vit que nul mouvement ne se manifestait, que nul bruit ne se faisait entendre autour de la maison, il franchit une grille et se trouva dans le jardin.
Il était tout planté de grands bouquets d’arbustes le long desquels il se mit à ramper jusqu’à la maison.
Mais une fâcheuse surprise l’attendait là .
Toutes les portes, toutes les fenêtres, toutes les issues du rez-de-chaussée étaient soigneusement fermées.
Il fit deux fois le tour de la maison sans pouvoir trouver la plus petite ouverture par où il pût se glisser.
Mais il n’était pas homme à se décourager.
Il chercha de nouveau, et bientôt un rayon d’espoir brilla dans ses yeux.
Il venait de remarquer une liane puissante qui, partant du sol, allait envelopper toute la vérandah et se tordre ensuite sur les combles.
Et, au delà de la vérandah, les fenêtres de la chambre de madame Christiani étaient restées ouvertes.
Brown eut bientôt pris son parti.
Après s’être assuré d’un coup d’œil qu’il n’y avait personne ni dans le jardin, ni aux environs, il se cramponna à l’une des plus fortes branches de la liane, s’y hissa comme un mousse à un cordage et gagna rapidement la vérandah.
Il enjamba sans hésiter la balustrade, et, un instant après, il pénétrait dans la chambre de madame Christiani.
Elle était étendue sur un lit de repos et dormait.
Ses bras, croisés sous sa tête, lui servaient d’oreiller ; ses cheveux noirs, à reflets bleuâtres, se déroulaient autour de son charmant visage, dont ils faisaient encore valoir l’éclatante fraîcheur, et son peignoir, légèrement entr’ouvert, laissait voir ses épaules et une partie de sa gorge.
Brown la contempla un instant, puis il s’assit.
Le sang lui montait à la tête ; ses yeux se troublaient, et un tremblement nerveux agitait tous ses membres.
— Qu’elle est belle ! murmura-t-il d’une voix altérée par l’émotion.
Il fut quelque temps à se remettre.
Lorsqu’enfin il eut recouvré quelque sang-froid, il se rapprocha d’elle, porta à ses mains une boucle de ses cheveux qui avait roulé jusqu’au tapis, effleura du doigt un de ses beaux bras, et, se relevant aussitôt, attendit, debout à quelques pas d’elle.
La jeune femme ouvrit les yeux et regarda devant elle, mais sans rien voir d’abord.
Elle semblait dormir tout éveillée, et son regard, trouble et voilé, fut quelques instants sans rien distinguer.
Puis, voyant une ombre entre elle et la fenêtre, elle tourna la tête de ce côté, aperçut un homme, et alors elle bondit de son lit de repos vers son alcôve, où elle s’enveloppa en un clin d’œil d’un ample vêtement.
— Ne criez pas, n’appelez pas, lui dit vivement Brown en restant immobile à sa place pour ne pas augmenter sa terreur, ce serait vous exposer à mille désagréments et vous ne courez aucun danger avec moi, je vous le jure.
La jeune femme ne bougea pas.
Blottie dans le coin où elle s’était retirée, serrant avec force autour de son corps le vêtement dans lequel elle cachait ses épaules nues, elle regardait avec effarement cet homme qu’elle ne se rappelait pas avoir jamais vu et qu’elle trouvait tout à coup dans sa chambre.
Jetant enfin un regard autour d’elle, elle s’aperçut qu’elle était loin du cordon de sonnette qui eût pu appeler dix domestiques à son secours, et, se voyant seule, sans défense, elle n’osa désobéir à cet homme, qui la suppliait de ne pas crier.
— Soit, monsieur, dit-elle enfin quand elle put articuler quelques mots, je ne crierai pas, je n’appellerai pas, je veux vous croire quand vous m’affirmez que vous n’avez contre moi aucune mauvaise intention, mais de grâce, dites-moi pourquoi vous êtes venu et comment vous vous trouvez ici, car la maison est fermée et ce ne peut être qu’en forçant une porte que…
— Non, madame, interrompit Brown, les portes sont restées fermées, mais votre fenêtre était ouverte et l’on peut y arriver par une liane commode comme une échelle pour qui sait s’en servir.
— Mais, monsieur, dans quel but vous introduire de la sorte, comme un voleur, dans ma chambre et pendant mon sommeil ?
— Pour vous dire une chose que vous n’eussiez jamais voulu entendre si je ne vous y eusse contrainte, madame, pour vous dire que je vous aime et comment je vous aime.
À ces mots la jeune femme devint affreusement pâle, et, se serrant plus que jamais dans les plis de son vêtement, elle se pelotonna dans le coin où elle s’était réfugiée, comme si elle eût espéré s’incruster dans la muraille.
Mac-Field allait continuer, après une courte pause, quand il fut interrompu par M. Badoir.
— Ce récit est fort intéressant, je me plais à le reconnaître, dit celui-ci, mais, tout en l’écoutant, je me demande quel rapport il peut avoir avec la maison de commerce que vous voulez fonder, et surtout avec votre désir d’y associer mon nom.
— Ce rapport existe pourtant, monsieur Badoir, répliqua Mac-Field, et vous serez forcé d’en convenir vous-même tout à l’heure, quand j’aurai tout dit ; laissez-moi donc achever mon histoire.
— Je vous écoute, milord.
Mac-Field poursuivit.
— Brown regarda quelques instants madame Christiani avec l’expression d’une sombre douleur.
— Vous ne sauriez croire, madame, lui dit-il enfin, combien je suis désespéré de vous causer une pareille impression. Je vous aime, je viens de vous l’avouer, mais il y a dans cet amour tant de respect, tant d’humilité, tant de crainte de vous déplaire, que vous ne sauriez vous offenser d’un pareil sentiment. Cessez donc de trembler devant moi, je vous en supplie, madame, et veuillez m’écouter, sinon avec indulgence, au moins sans frayeur.
— Parlez, monsieur, répondit la jeune femme, ne suis-je pas forcée de vous entendre ?
— Cent autres vous adorent dans cette ville, madame, et nul d’entre eux n’a osé vous le dire ; et pourtant, quoique cela ressemble fort à une ironie, pas un ne vous a voué un culte aussi pur que le mien. Je vous aime d’un amour insensé et qui cependant se contenterait de bien peu de chose. En échange de cette passion qui dévore mon cœur et qui mine ma vie, savez-vous ce que je vous demande, ce qui comblerait tous mes vœux et changerait en ivresse ineffable les intolérables souffrances que j’endure ? Une fleur jetée par vous la nuit, du haut de cette véranda, le dernier jour de chaque mois ; cette nuit-là je franchirais la grille, je viendrais ramasser la fleur sur le sable, et j’emporterais plus de bonheur que n’en a jamais procuré à un amoureux la possession d’une maîtresse adorée. Voilà ce que je vous demande à genoux, madame, voulez-vous me l’accorder ?
Brown s’agenouilla en face de madame Christiani, mais sans faire un pas vers elle.
— Puis-je répondre librement et sans avoir à redouter de vous quelque violence ? dit la jeune femme.
— Tenez, madame, répondit Brown en se levant et en s’éloignant encore, approchez-vous de ce cordon de sonnette, et, au moindre mot, au moindre geste qui pourra vous inquiéter, appelez vos domestiques.
Madame Christiani parut hésiter un instant.
— Non, dit-elle enfin, je me fie à vous.
— Et votre réponse, madame ?
— La voici : j’aime mon mari, je l’aime passionnément, comme j’en suis aimée ; je l’aime, non comme un époux auquel le devoir nous commande de rester fidèle, mais comme un fiancé choisi entre tous, avec qui l’on subirait toutes les privations le sourire aux lèvres ; c’est vous dire que je ne saurais accorder à un autre ni une pensée, ni un regard, ni une fleur.
Tandis qu’elle parlait ainsi de son mari, une rapide transformation s’était opérée dans toute la personne de Brown.
Le sang lui était monté au visage, de sombres éclairs avaient jailli de ses yeux et un imperceptible frémissement avait agité ses membres.
— Votre mari, madame, murmura-t-il sourdement après un long silence, je le haïssais déjà , je l’exècre maintenant et je veux lui rendre une partie des tortures qu’il me fait endurer. Je ne vous parle plus de mon amour, je comprends que je suis condamné sans rémission et que je dois me résigner à ne jamais rien obtenir de vous ni un regard, ni une fleur, vous l’avez dit ; mais un supplice auquel je ne me résignerai jamais, madame, c’est de laisser un autre jouir en paix du plus immense bonheur que puisse rêver un homme ici-bas, celui de vous posséder et d’être aimé de vous.
— Que voulez-vous dire, monsieur ? demanda la jeune femme effrayée de la colère qui faisait flamboyer les yeux de Brown.
— Voilà , ce que je veux dire, madame : que cet homme soit votre mari ou non, peu m’importe, ma jalousie ne fait pas de ces distinctions, je ne vois en lui qu’un rival, je ne veux pas qu’il soit heureux et je vous jure que je le tuerai si, à partir de cette heure, vous n’êtes aussi impitoyable envers lui qu’envers moi-même.
Madame Christiani le regardait avec stupeur.
— En vérité, dit-elle enfin, je me demande si j’ai bien compris, et je ne puis le croire. Quoi ! vous voulez que mon mari…
— Vous devienne complètement étranger dès à présent, oui, madame : encore une fois, c’est un rival et je ne puis souffrir qu’il soit heureux près de la femme qui me repousse. Je vous le répète, madame, l’amoureux pouvait se résigner, le rival sera implacable. Voici votre chambre, faites-en préparer une autre pour votre mari et faites-lui comprendre qu’il ne doit jamais passer le seuil de celle-ci, la nuit surtout. À partir de cette heure, j’aurai l’œil sur vous et sur lui, et vous savez qu’il n’est pas aisé de tromper l’œil d’un jaloux. Je continuerai de penser à vous, à vous seule, comme par le passé, mais avec de tout autres sentiments dans le cœur, les tortures d’un amour dédaigné et une soif de vengeance qui ne reculera pas devant un crime, je vous en préviens, madame.
Brown semblait rugir ces paroles plutôt que les prononcer, tant il y avait de férocité dans son accent et dans son regard.
La jeune femme était atterrée.
Surmontant enfin son épouvante, elle reprit au bout d’un instant :
— Ainsi, monsieur, j’étais heureuse, j’aimais mon mari et j’en étais aimée, l’horizon de ma vie se déroulait pur et limpide, pas un nuage ne l’obscurcissait, pas un symptôme inquiétant ne menaçait cette ineffable félicité, je m’épanouissais en plein bonheur enfin, et parce que vous m’avez vue, parce que vous m’avez aimée à mon insu, sans même que j’en aie rien soupçonné, il faut que je renonce à tout ce qui faisait ma vie heureuse, à l’amour de mon mari ; il faut que j’élève une infranchissable barrière entre moi et celui que j’aime de toutes les forces de mon âme ? Tenez, monsieur, cela est si inouï, si prodigieux, que je me demande si je rêve ou si je suis folle.
— Tout cela est absurde, inique, barbare, j’en conviens, et je vous plains, et je me condamne moi-même, mais la souffrance que j’endure domine tous les raisonnements, et la pensée du bonheur que vous accordez à votre mari me rend fou, fou furieux, et me pousse irrésistiblement au meurtre.
La jeune femme comprit, avec un affreux serrement de cœur, qu’il disait vrai, que cet homme, sous l’empire de la passion qui absorbait toutes ses facultés, n’était plus maître de ses actes, et qu’une épouvantable catastrophe était inévitable.
Alors, tremblant pour son mari, craignant tout pour lui de la part de cet homme et cédant à l’inspiration de la peur, elle murmura avec quelque hésitation :
— Eh bien, monsieur, si vous me jurez que votre amour se contentera toujours de cette fleur jetée par moi de loin en loin sur le sable de ce jardin, je consentirai à …
Brown l’interrompit d’un geste. Puis, avec une sombre ironie :
— Merci, madame, cette fleur, je n’en veux plus.
Et comme la jeune femme le regardait avec surprise, stupéfaite d’un changement si subit :
— Oh ! reprit-il, si j’avais pu voir dans cette faveur un mouvement de sympathie ou seulement un sentiment de pitié pour un amour que vous pouviez partager, cette fleur, je vous l’ai dit, eût comblé tous mes vœux, et jamais mon rêve ne fût allé au delà : mais comme vous avez pris soin de m’enlever cette illusion, il est clair maintenant pour moi que cette concession ne vous serait arrachée que par la crainte des dangers où vous voyez votre mari exposé. En réalité, c’est une nouvelle preuve d’amour que vous lui donneriez ; c’est avec cette pensée que je la recevrais de vous, cette fleur maudite, et elle me deviendrait aussi odieuse qu’elle m’eût été chère sans cela.
— Alors, monsieur, comment puis-je vous calmer ? demanda en tremblant madame Christiani, dites, que voulez-vous que je fasse ?
— Rien que vous conformer à la volonté que je viens de vous exprimer.
— Oh ! mais c’est odieux ; et, d’ailleurs, c’est l’impossible, ce que vous me demandez là ; comment voulez-vous que j’exige de mon mari…
— Comment ? cela ne me regarde pas, madame, et je ne suis pas payé, avouez-le, pour m’inquiéter des embarras de votre situation.
— Monsieur, monsieur, s’écria la jeune femme en faisant quelques pas vers lui, je vous en supplie, je vous en prie en grâce, ne persistez pas dans cette résolution, ayez pitié de moi.
— De la pitié, madame ! en ai-je trouvé chez vous ; avez-vous senti remuer quelque chose au fond de votre cœur quand je vous ai exprimé les intolérables tortures que me fait endurer cette fatale passion ? Loin de là , vous vous êtes attachée à les accroître en me parlant de votre amour pour un autre, en me déclarant que votre vie tout entière lui appartenait et que vous n’en vouliez pas détacher une minute, pas une seconde pour le malheureux qui vous implorait. Oh ! l’illusion ne m’est pas permise, je vous le répète, et je n’en conserve aucune, je serai donc implacable.
Il ajouta en l’enveloppant d’un regard plein de flammes :
— D’ailleurs, vous êtes trop belle, il m’est plus facile de mourir que de vous savoir aux bras d’un autre ; car c’est deux condamnations que vous prononcerez du même coup, si vous oubliez ce que je vous ai dit, lui d’abord, moi ensuite.
Il ajouta aussitôt :
— Mais l’heure de la sieste va finir et vos domestiques vont bientôt circuler dans la maison, il faut que je parte. Adieu, madame, adieu et souvenez-vous.
Et s’élançant vers la vérandah, il saisit la liane à l’aide de laquelle il était monté et se laissa glisser à terre, laissant la jeune femme, pâle, tremblante et comme foudroyée.
XII
UNE ASSOCIATION FORCÉE
On se figure aisément quelles furent les angoisses de madame Christiani à partir de cette scène étrange.
Elle se demanda vingt fois durant cette journée quel parti elle devait prendre à l’égard de cet homme, sans pouvoir s’arrêter à aucune résolution.
Toutes lui semblaient dangereuses quand elle songeait au caractère du personnage.
Elle le connaissait de vue pour l’avoir aperçu quelquefois la suivant de loin, et il lui semblait vaguement avoir entendu prononcer son nom comme celui d’un homme violent et dangereux ; aussi ce souvenir l’avait-il décidée à repousser tout de suite la pensée qui lui était venue d’abord de se confier à son mari.
La police ? Elle y avait songé ; mais Brown devait se défier ; il devait être sur ses gardes et pouvait éviter le piège. Alors il eût voulu se venger, et un duel était à craindre entre lui et son mari, perspective effrayante qui lui glaçait le sang dans les veines.
Et puis, autre motif d’anxiété, quelle allait être sa conduite envers son mari quand il allait rentrer ?
Quel prétexte imaginer pour le résoudre à aller habiter une chambre loin de la sienne ? C’est ce qu’elle cherchait vainement, bien décidée pourtant à tout mettre en œuvre pour se conformer aux volontés du terrible Brown.
C’était donc avec une inexprimable émotion qu’elle attendait le retour de son mari.
L’heure si vivement redoutée sonna enfin, M. Christiani rentra vers la chute du jour, comme il l’avait promis à sa femme en la quittant.
Comment madame Christiani s’y prit-elle ? Quelle ruse féminine appela-t-elle à son aide ? C’est ce qu’il serait difficile de deviner, mais ce soir-là elle coucha seule dans sa chambre.
Et, tour de force plus extraordinaire encore, cela dura quinze jours au moins.
Un soir, comme on parlait d’un duel au revolver dont le résultat, après six balles échangées de part et d’autre, avait été deux jambes cassées pour l’un des combattants, un œil crevé et une mâchoire fracassée pour l’autre, madame Christiani profita adroitement de cette circonstance pour interroger son mari sur celui dont l’image la poursuivait sans relâche.
— Je parierais, dit-elle, que l’un de ces féroces duellistes est ce terrible personnage dont j’ai souvent entendu parler, et qu’on nomme, je crois… Brown ?
— Tu perdrais, chère amie, répondit M. Christiani, Brown est innocent de ce duel, et il en a assez d’autres sur la conscience sans qu’on y ajoute celui-là .
— Tant mieux pour lui, répliqua la jeune femme, mais vous savez donc le nom de ceux…
— Nullement, je sais seulement que ce n’est pas Brown, par l’excellente raison qu’il a quitté New-York, il y a cinq jours, sur un bâtiment qui partait pour l’Inde ; j’étais là au moment où le bâtiment quittait la rade et je l’ai vu sur le pont, parmi les autres passagers.
Un soupir de soulagement s’échappa de la poitrine de la jeune femme.

Et le soir même elle mettait fin à l’exil de son mari.
À quelque temps de là , les domestiques de M. Christiani étaient brusquement éveillés au milieu de la nuit par le bruit de cinq ou six détonations qui semblaient partir du premier étage.
Tous se précipitèrent dans l’escalier qui conduisait à la chambre de leurs maîtres, auxquels ils étaient tout dévoués.
La porte étant fermée, ils l’enfoncèrent sans hésiter, et alors un épouvantable tableau s’offrit à leurs yeux.
Au milieu de la chambre, M. Christiani était étendu, les bras en croix, la chemise toute rouge du sang qui s’échappait par plusieurs blessures.
Sur le lit, sa jeune femme, atteinte d’une balle à la poitrine, se tordait de douleur dans ses draps sanglants.
Pendant que deux femmes s’approchaient de madame Christiani pour lui porter secours et que les autres domestiques se penchaient vers leur maître, immobile sur le parquet, un de ces hommes vit tout à coup un individu sortir d’un angle de la vérandah, où il se tenait blotti, franchir d’un bond la balustrade et se cramponner des deux mains à la liane, le long de laquelle il disparut.
— L’assassin ! s’écria-t-il en s’élançant de ce côté armé d’un revolver, qu’il avait saisi en entendant des coups de feu dans la chambre de son maître.
Tous les autres domestiques s’étaient élancés comme lui vers la vérandah.
Comme ils y arrivaient, l’assassin touchait terre et prenait son élan à travers le jardin.
Mais avant qu’il n’eût fait vingt pas, un coup de feu se faisait entendre et le meurtrier, arrêté brusquement dans sa course, portait la main à son épaule en poussant une espèce de rugissement.
— Il est touché, crièrent plusieurs voix, allons, encore une balle, Peters, et vise à la tête.
— Moi, je vais l’achever avec cette trique, dit un autre en s’élançant par le même chemin que venait de prendre le meurtrier.
Au même instant, Peters envoyait à ce dernier deux balles coup sur coup.
On le crut atteint mortellement, car il était tombé à terre comme foudroyé.
Mais on reconnut aussitôt que c’était une ruse.
Il s’était jeté à plat ventre pour échapper aux balles et pour ramper vers un bouquet d’arbustes, où il disparut bientôt à tous les regards.
Mais Bob, le domestique qui venait de s’élancer à sa poursuite, le suivait à la piste et s’enfonçait en un clin d’œil dans le même fourré, où il pensait le trouver agonisant ou à peu près.
— Allons ! cria alors Peters, que deux d’entre nous aillent aider Bob à transporter ce misérable dans la maison, où nous le garderons à vue jusqu’au petit jour ; les autres, pendant ce temps, vont s’occuper des blessés.
Ces ordres furent aussitôt exécutés. Mais quand on pénétra dans le fourré où Bob venait de se glisser à la suite de l’assassin, on ne trouva qu’un homme étendu, sur le sol, sans connaissance et le crâne fracassé, et cet homme c’était le domestique.
Le meurtrier avait disparu.
Revenu à lui, Bob raconta qu’au moment où il allait s’emparer de ce dernier, qu’il avait trouvé adossé à un arbre et affaissé sur lui-même, il avait reçu un coup de casse-tête si rudement appliqué qu’il avait cru que son crâne se fendait en deux parties.
Puis il avait perdu l’usage de ses sens et ignorait ce qui s’était passé à partir de ce moment, mais il était évident que ce coup de casse-tête était l’œuvre d’un complice qui, après avoir débarrassé le meurtrier de son ennemi, l’avait ensuite emporté sur ses épaules.
Lorsque, une heure après, un médecin arrivait sur le lieu du crime, il déclarait, quant à M. Christiani, n’avoir autre chose à faire qu’à constater sa mort ; et après avoir sondé la plaie de la jeune femme, il se montrait fort inquiet des suites de sa blessure.
Le surlendemain, on mettait le mari en terre ; quelques jours après, la femme était transportée dans sa famille, à cent lieues de là , et au bout d’un mois le bruit de sa mort venait jeter la consternation dans New-York, où son éclatante beauté avait laissé la plus vive impression.
Quant à Brown, la police se mit à sa recherche avec un zèle et une ardeur qui, sans nul doute, eussent été couronnés de succès s’il eût commis l’imprudence de rester à New-York ; mais il l’avait quitté le lendemain même du meurtre, et dix jours s’étaient déjà écoulés quand on apprit qu’il était en route pour l’Inde.
On télégraphia à Calcutta, mais le meurtrier l’avait prévu, et le bâtiment qui l’emportait ayant fait escale en route, il s’était fait descendre à terre. Un mois après, il était à Paris où il jugeait prudent de changer son nom de Brown contre celui de Mac-Field.
— Hein ? s’écria M. Badoir en tressautant sur sa banquette.
Puis, regardant fixement Mac-Field :
— Vous, vous seriez le meurtrier ?…
— De M. et de madame Christiani ; c’est pour cela, vous le comprenez maintenant, qu’il me faut une situation qui me permette de me dissimuler dans l’ombre sans que j’aie l’air de me cacher et me constitue, à moi et à mon ami sir Ralph, une honorabilité indiscutable aux yeux des plus défiants. Or, je vous le demande, que pouvais-je trouver de mieux, pour atteindre ce but, que cette admirable combinaison Badoir et C° ? Qui donc pourrait suspecter la loyauté et les antécédents des associés d’un homme si justement et si généralement estimé ? Mais un titre pareil équivaut tout simplement à un prix Monthyon !
— Mais, monsieur, balbutia le banquier, saisi d’un tremblement subit, songez donc aux épouvantables conséquences qu’aurait pour vous la révélation de votre identité dans le cas où la police viendrait à retrouver votre trace.
— C’est justement cette crainte qui nous a décidés à nous mettre à l’abri du péril sous le pavillon si honorable et si respecté de M. Badoir. Nous avons changé de nom et transformé notre physionomie au point de pouvoir défier toute la police de New-York, mais c’est bien moins dans cette métamorphose que dans le titre d’associés de M. Badoir que nous mettons notre sécurité.
— Oui, oui, je comprends cela, répondit M. Badoir après une pause, mais je comprends aussi les dangers auxquels m’exposerait une pareille association, et je refuse.
Un sourire d’une ironie féroce effleura les lèvres de Mac-Field.
— Monsieur Badoir, reprit-il, vous oubliez le rôle que vous avez joué dans l’enlèvement de la comtesse de Sinabria ; permettez-moi de vous le rappeler et d’ajouter un détail que vous ignorez. L’enfant de la comtesse a disparu ; si dans huit jours l’acte de société de la maison Badoir et C° n’est pas signé, une dénonciation d’infanticide sera lancée à la préfecture de police contre vous, avec le récit développé de tout ce que vous avez exécuté contre la comtesse et des motifs qui vous ont poussé au double crime de rapt et d’infanticide.
— Infanticide ! moi ! s’écria M. Badoir atterré.
— Comment prouverez-vous le contraire ? L’enfant a disparu, il ne se retrouve plus ; qui donc a eu intérêt à s’en débarrasser, si ce n’est l’homme qui faisait enlever la comtesse de Sinabria à la veille de devenir mère, pour l’envoyer dans un repaire de bandits ?
M. Badoir courba la tête.
Il était vaincu.
XIII
UN MARCHÉ
Sachons maintenant ce qui se passait entre sir Ralph et la comtesse de Sinabria.
Quand ils eurent pris leur place au quadrille dont ils faisaient partie, la comtesse, convaincue qu’elle avait affaire à son ennemi et impatiente de connaître ses intentions, se décida à lui parler la première.
— Monsieur, lui dit-elle, vous m’avez dit que vous m’invitiez moins pour danser que pour causer ; vous avez donc quelque chose de particulier à me dire ?
— Ce que j’ai à vous dire, madame, répondit sir Ralph, ou du moins le sujet sur lequel je veux vous entretenir, vous le connaissez déjà , puisque vous êtes venue au rendez-vous que je vous ai donné, puisque vous dansez en ce moment avec moi malgré vos angoisses maternelles.
La comtesse tressaillit à ces derniers mots.
Puis elle reprit :
— Ainsi, c’est vous, monsieur, qui, sous la forme d’un plan de drame, m’avez adressé ces menaces…
— Qu’il ne tient qu’à vous de conjurer, madame, et c’est pour vous en fournir les moyens que je vous ai engagée à vous trouver à cette fête, le seul endroit où je puisse vous parler, et je vais vous dire pourquoi.
— Je vous écoute, monsieur.
— Si je vous eusse donné rendez-vous à votre hôtel, madame, à l’heure où votre mari est à son cercle, c’est-à -dire de cinq à sept heures, voulez-vous que je vous dise ce qui serait arrivé ?
— Vous m’obligerez, car je l’ignore moi-même.
— Peut-être ; enfin, madame, voici ce qui serait arrivé. J’aurais été guetté à mon arrivée, espionné pendant mon entretien avec vous, et on m’eût suivi ensuite jusqu’à ma demeure, afin de savoir quel homme je suis et quelles armes il faut employer contre moi.
La comtesse s’était troublée.
— Vous voyez bien, madame, reprit sir Ralph auquel ce mouvement n’avait pas échappé, que tel était votre projet ou celui de M. de Coursol et de ses amis.
— Mais, monsieur, murmura la comtesse, je vous assure…
— Peut-être même, reprit sir Ralph, suis-je épié, à cette heure, par quelqu’un de ces amis, auquel vous allez rendre compte de notre entretien, des conditions qui vont être stipulées entre nous et qui se propose, au sortir de cette fête, de me préparer quelque bon guet-apens.
La comtesse, qui s’observait cette fois, ne laissa rien soupçonner de la stupeur où la jetait l’étrange pénétration de cet homme.
— Mon Dieu ! madame, reprit sir Ralph comme s’il eût saisi sa pensée, ce que vos amis ont fait là est si élémentaire, que je n’ai aucun mérite à le deviner.
Il ajouta, après avoir jeté un regard dans toutes les directions :
— Tenez, voici là -bas, un peu à droite, deux individus qui font semblant de trouver un plaisir extrême à regarder danser, et qui, de temps à autre, coulent de notre côté un regard rapide, en gens accoutumés à observer ; pourriez-vous m’affirmer qu’ils ne sont pas de votre connaissance ?
Ces deux individus étaient Rocambole et Albert de Prytavin.
— C’est la première fois que je les vois, répondit la comtesse avec un accent de sincérité qui parut convaincre sir Ralph.
— Soit, je me trompe peut-être.
Il reprit d’un ton froid et résolu :
— Maintenant, madame, il me reste un conseil à vous donner. Si, comme je le crois, on a organisé contre moi le petit complot dont je viens de vous parler, je vous préviens que vous en serez la première victime.
— Moi ? s’écria avec effroi la comtesse.
— Si l’on tente quoi que ce soit contre moi ; si l’on apporte la moindre entrave à l’exécution du marché que je vais vous proposer ; enfin si j’entrevois dans cette affaire l’ombre d’une trahison, je brise immédiatement le contrat par lequel nous allons nous lier mutuellement, et j’exécute à la lettre le plan que vous savez.
Et n’espérez pas me tromper, madame ; dans l’attente des représailles auxquelles j’allais être exposé, j’ai pris mes mesures pour me tenir au courant de tout ce qui pourra être tenté contre moi ; je vous ai enveloppée d’un réseau de surveillance auquel il vous est d’autant plus difficile d’échapper, que vous ne le soupçonnez même pas et, de quelques précautions que vous vous entouriez, vous ne prendrez pas une détermination, vous ne ferez pas une démarche dans le but de trahir vos engagements, que je n’en sois aussitôt averti. Or, je vous le répète, pénétrez-vous de cette pensée, qu’une heure après cette tentative de trahison vous seriez prise dans l’engrenage du drame dont je vous ai déroulé toutes les péripéties et que vous y passeriez tout entière. Vous voilà prévenue, c’est à vous à décider maintenant s’il vous convient de confier à d’autres qu’à M. de Coursol, qui doit forcément les connaître, les clauses du marché que nous allons passer ensemble.
La comtesse était atterrée.
Elle comprenait qu’elle était désormais à la discrétion de cet homme, qui avait tout prévu, qui la tenait dans ses mains comme un oiseau pris au piège et auquel il ne fallait même pas tenter d’échapper.
— Parlez, monsieur, répondit-elle en affectant un calme qu’elle était loin de ressentir, et soyez assuré que je tiendrai l’engagement que je prendrai vis-à -vis de vous, quel qu’il soit.
— Permettez-moi d’abord de vous remettre sous les yeux votre véritable situation, non pas absolument telle qu’elle est, mais telle qu’elle se présenterait aux yeux de la justice. À la veille de devenir mère et contrainte de quitter votre hôtel, où vous pourriez être surprise par votre mari, dont le retour coïncide justement avec le terme fatal, vous allez accoucher dans un bouge mal famé et par les soins d’une sage-femme des plus mal notées dans le pays, singularités qui s’expliquent bientôt par la nécessité de trouver des complices pour faire disparaître votre enfant. En effet, cet enfant, que vous prétendez avoir confié à un médecin, dont vous ne pouvez dire ni le nom, ni l’adresse, cet enfant ne se retrouve pas, et le crime d’infanticide est logiquement et surabondamment prouvé par la fausse position où vous vous trouviez vis-à -vis de votre mari et par les précautions que vous avez prises pour dissimuler les conséquences de votre faute. Pour la justice, je vous le répète, voilà la vérité, et, tout ce que vous pourrez dire concernant un rapt, une séquestration, l’ignorance du lieu où vous avez été transportée de force et les yeux bandés, et autres inventions plus ou moins romanesques, tout cela sera considéré comme autant de contes dont l’invraisemblance saute aux yeux et qui ne méritent même pas d’être discutés. Vous êtes donc condamnée d’avance, vous ne sauriez vous faire la moindre illusion à cet égard, et quoiqu’on ce moment cela vous fasse l’effet d’un rêve inouï, monstrueux, impossible, cette condamnation, c’est la peine de mort, ou tout au moins les travaux forcés à perpétuité. La réalité, madame, la réalité dans toute son horreur et sans exagération, la voilà .
La comtesse avait pâli à cet effroyable tableau, et elle avait besoin d’un grand effort de volonté pour ne pas s’affaisser sur le parquet.
Sir Ralph, après avoir constaté d’un coup d’œil l’effet qu’il venait de produire, reprit aussitôt :
— Eh bien, voyons, madame, que ne donneriez-vous pas, de quel effort ne seriez-vous pas capable pour vous soustraire à une pareille destinée ? Dites, madame, n’accueilleriez-vous pas comme un sauveur celui qui vous dirait : Choisissez, cela ou cinq cent mille francs !
— Cinq cent mille francs, balbutia la comtesse, sur l’esprit de laquelle ce chiffre produisit l’effet d’un étourdissement, mais, grand Dieu ! monsieur, où voulez-vous que je trouve une pareille somme ?
— Aussi, madame, n’est-ce pas sur vous que nous avons compté pour cela, vous seriez obligée de vous adresser à votre mari, et franchement les motifs que vous feriez valoir pour lui demander un pareil sacrifice ne seraient pas de nature à l’y déterminer.
— Eh bien, monsieur, puisque vous convenez de cela, comment voulez-vous que je fasse ?
— Encore une fois, madame, ce n’est pas sur vous que nous comptons ?
— Sur qui donc, monsieur ?
— Sur votre complice, M. Gaston de Coursol.
— Cela lui est à peu près aussi impossible qu’à moi-même ; il sera riche un jour, mais, quant à présent, il a à peine trente mille livres de rentes.
— Eh bien, madame, il lui en restera cinq, sa destinée sera encore brillante, comparée à celle de la majorité des Français.
— Oh ! mais c’est horrible cela, monsieur.
— Eh ! madame, supposez un millionnaire condamné à mort, demandez-lui s’il voudrait sa grâce à la condition de vivre désormais avec vingt sous par jour, et vous verrez s’il hésitera à accepter. Eh bien, que M. de Coursol se persuade bien que tel est son cas, et il consentira avec joie.
— Enfin, monsieur, si M. de Coursol acquiesce à vos exigences, que ferez-vous en échange ?
— Je lui remettrai votre enfant et m’engagerai à ne rien révéler du drame que nous connaissons l’un et l’autre.
— Pardon, monsieur, mais… qui me garantira que vous tiendrez cet engagement ?
— Un écrit, signé de moi, dans lequel je raconterai, dans le plus grand détail et avec des preuves à l’appui, l’histoire vraie de votre enlèvement, avec le nom de celui qui a conçu ce plan infernal et avec la révélation des motifs qui l’ont poussé à un double crime, car, dans sa pensée, à lui, la mère et l’enfant devaient disparaître, au fond d’une cave où ils eussent été achevés à coups de couteau.
— Et ce monstre vous le connaissez ? murmura la comtesse en frémissant.
— Moins que vous-même, madame la comtesse, car vous le connaissez, vous, depuis vos plus jeunes années et vous l’avez vu souvent chez vous, où il vient encore parfois.
— Oh ! quelle infamie !
— Cet homme ne m’inspire pas la moindre sympathie et je n’éprouverai aucun remords à vous le livrer pieds et poings liés ; seulement, comme j’ai intérêt à le ménager un certain temps encore, j’imposerai à M. de Coursol la condition de ne révéler ce nom à qui que ce soit, pas même à vous, avant le jour où je jugerai à propos de l’y autoriser.
— Vous pourrez compter sur la parole de M. de Coursol.
— Je le sais, mais voilà le quadrille qui tire à sa fin, un dernier mot avant de nous quitter, madame ; il se peut que je sois obligé de quitter la France brusquement, dans vingt-quatre heures peut-être, veuillez en prévenir M. de Coursol et lui recommander de tenir prête la somme convenue, que je puis aller lui demander d’un moment à l’autre.
Il ajouta :
— Et rappelez-vous, madame, quelles seraient pour vous les conséquences d’une trahison, ou même d’une simple indiscrétion.
Il la reconduisait à sa place, lorsqu’il se croisa avec Tatiane, qui allait embrasser ses grands patients après le quadrille, comme elle le leur avait promis.
Tout en accompagnant la comtesse, il se détourna pour suivre la jeune fille du regard.
XIV
UN QUADRILLE MÊLÉ
Nous avons dit qu’après le quadrille qu’elle venait de danser Tatiane était allée embrasser ses grands-parents, qui naturellement n’avaient eu d’yeux que pour elle, et qu’elle trouva encore tout émerveillés de sa grâce et de sa gentillesse.
Elle avait eu l’attention d’amener son cavalier et de choisir son vis-à -vis juste en face de la banquette où elle les avait placés, de sorte que, pendant toute la durée du quadrille, ils ne l’avaient pas perdue de vue un seul instant.
— Eh bien, dit-elle après leur avoir donné son front à baiser, vous amusez-vous bien tous les deux ?
— Si nous nous amusons ! s’écria grand-papa Mauvillars, dont la figure épanouie répondait éloquemment à cette question, c’est-à -dire que nous sommes ici comme le poisson dans l’eau.
Vois-tu, Tatiane, tu danses comme une petite fée.
— Vous êtes un vilain flatteur, grand-papa.
— Demande plutôt à Chamouillard, ton vieil ami Chamouillard, il n’est pas flatteur celui-là , surtout quand il s’agit de toi, car je ne sais pourquoi, mais il t’en veut positivement.
— Vous m’en voulez, monsieur Chamouillard ? dit la jeune fille avec une petite moue, qui la rendait charmante.
— Oui, mademoiselle Tatiane, répondit Chamouillard d’un ton un peu bourru, je vous en veux… de n’être pas ma petite-fille. Mais ce satané Mauvillars, il a toujours eu de la chance, c’est à lui que ce bonheur-là devait arriver.
En ce moment un domestique présenta un plateau chargé de glaces.
Les deux vieux époux avancèrent la main pour en prendre.
— Non pas, dit vivement Tatiane en se mettant au-devant d’eux, pas de glaces ; moi aussi, je m’y oppose, vous allez prendre un bouillon.
— Voyez-vous le petit despote ! dit la grand’mère en souriant.
— Oui, oui, vous feriez de jolies choses, si je n’étais là pour veiller sur vous, reprit vivement Tatiane ; des glaces ! en vérité vous ne doutez de rien tous les deux.
— Ne dirait-on pas que nous avons cent ans.
— Non certes, vous ne les avez pas, et la preuve…
Elle ajouta en s’inclinant avec un charmant sourire :
— Grand-papa, veux-tu bien m’accorder le prochain quadrille ?
Un éclair de joie brilla dans les petits yeux du grand-père.
Cependant il crut devoir se récrier :
— Allons donc, petite folle, tu n’y penses pas, dit-il, à quel propos une pareille folie ?
— À quel propos ? mais pour me remercier d’avoir bien voulu accomplir aujourd’hui ma dix-septième année.
— En effet, s’écria la grand’mère, c’est aujourd’hui.
— Allons, dit la jeune fille, c’est entendu, et grand’maman nous fera vis-à -vis, je vais lui chercher un cavalier.
— Mais, dit une voix aux oreilles de Tatiane, il est tout trouvé, mademoiselle, si toutefois madame Mauvillars veut bien m’accepter.
Tatiane se tourna vivement vers le jeune homme qui se trouvait là si à propos pour satisfaire son désir, puis, dès qu’elle l’eut vu, elle devint toute rouge et baissa les yeux.
— Volontiers, monsieur Turgis, volontiers, répondit la grand’mère, non moins ravie que son mari.
Puis, s’adressant à sa petite-fille, qui semblait s’être tout à coup pétrifiée :
— Eh bien, qu’as-tu donc, ma chérie ? te voilà toute troublée et rouge comme une pivoine ; serais-tu malade ?
— Mais pas du tout, grand’mère, s’écria la jeune fille qui devint tout à fait coquelicot, je ne suis pas troublée, pourquoi serais-je troublée ?
— Voyons, tu vois bien que tu l’ennuies, cette enfant, dit le grand-papa, voulant venir en aide à Tatiane, elle n’est pas troublée, elle a l’air ému, voilà tout.
La pauvre Tatiane ne savait plus que devenir et on peut affirmer qu’en ce moment elle eût voulu disparaître sous le parquet.
— Mademoiselle, dit alors le jeune homme voulant mettre fin à l’embarras de Tatiane, va-t-on danser de suite ce quadrille, ou bien ?…
— De suite, monsieur, répondit la jeune fille avec une ravissante expression de timidité et de joie contenue, parce que, voyez-vous, je ne veux pas que grand-papa et grand’maman aillent se coucher trop tard et je viens de demander un nouveau quadrille aux musiciens.
— Alors, madame, dit le jeune homme en s’approchant de la grand’mère, si vous voulez bien me donner votre bras…
— Le voilà .
Au rayonnement de bonheur qui se répandit sur les traits du jeune homme, on eût dit qu’il donnait le bras à la plus jolie personne du bal, mais le secret de ce ravissement était facile à expliquer pour ceux qui avaient pu observer la petite scène muette qui venait de se passer entre lui et Tatiane.
Ce jeune homme était Jacques Turgis, peintre de talent, qui, après avoir traversé ces terribles épreuves de la misère où succombent tant de courages, en était sorti triomphant et commençait à conquérir une certaine célébrité.
Si le lecteur se rappelle l’entretien dans lequel le père Vulcain racontait à son ami Collin sa propre histoire et celle de son fils, Jacques Turgis, il pourra se faire une idée de ce que ce dernier avait eu à souffrir avec un pareil père.
Un seul détail fera comprendre cette vie de martyr.
Le père Vulcain qui, dans ses moments lucides, avait l’esprit constamment tendu vers son propre bien-être, se creusait la tête pour trouver le moyen de tirer parti du talent de son fils, lorsqu’il rencontra dans un des ateliers où il posait un vieux juif du nom de Mardochée, dont le métier était d’exploiter les jeunes gens qui avaient du talent et pas de nom.
Vulcain mit son fils en relation avec ce juif qui, doué d’un flair presque infaillible, devina tout de suite qu’il y avait là pour lui une mine d’or à exploiter.
Il conclut avec le jeune homme un traité par lequel celui-ci, moyennant la somme de deux cents francs qui lui seraient comptés chaque mois par Mardochée, s’engageait à ne travailler que pour lui, à lui faire tel genre de peinture qu’il lui demanderait et à le laisser libre de signer ses toiles de tel nom qu’il lui plairait.
Jacques ne vendait rien et avait pour toute ressource deux leçons qui ne lui produisaient même pas de quoi manger tous les jours : il accepta. Mardochée lui fit faire des Ruysdaël.
Il avait un secret pour donner aux tableaux certains tons roux et enfumés qui leur communiquaient des airs de vieilles toiles à tromper les plus habiles ; il fit d’excellentes affaires avec Jacques Turgis.
Lorsqu’à la fin du mois celui-ci alla toucher ses deux cents francs, Mardochée lui en remit cent vingt, puis une note détaillée de divers à -compte remis par lui au père Vulcain.
Jacques ne fit aucun reproche à son père. Il le pria seulement de ne rien demander à Mardochée, qui pouvait glisser dans la note des sommes prêtées quelques erreurs volontaires, et il fut décidé qu’à l’avenir Vulcain s’adresserait directement à son fils.
Le vieux modèle observa consciencieusement cette clause et se fit donner une cinquantaine de francs par son fils, qui se félicita du parti qu’il avait pris ; mais lorsque Jacques se présenta à la fin du mois chez Mardochée, celui-ci lui compta quatre-vingt-dix francs et lui présenta une nouvelle note d’acompte au père Vulcain, montant cette fois à la somme de cent dix francs.
Le jeune homme comprit cette fois qu’il était perdu et rentra chez lui la mort dans l’âme, en proie à un découragement si profond qu’une pensée de suicide traversa son esprit.
Nous saurons plus tard quel hasard providentiel le tira de cet abîme.
De taille moyenne, souple et bien prise, libre et dégagé dans ses mouvements, l’artiste trahissait dans toute sa personne une de ces natures loyales, ouvertes, généreuses qui se devinent dès le premier abord et laissent une impression sympathique partout où elles passent.
Sa tête était belle, mais pour ainsi dire d’une beauté morale et intellectuelle qui résultait surtout du rayonnement de ses qualités de cœur et d’esprit.
Son front blanc et bien dessiné était couronné par une forêt de cheveux d’un châtain un peu ardent et si abondants, que la raie, qu’il y traçait difficilement sans doute était à peine distincte.
Ses yeux noirs, d’une expression à la fois triste et contemplative, accusaient, sous la franchise et la bonté qui formaient le type caractéristique de sa physionomie, la vie de luttes et de souffrances qu’il avait traversée et ce double caractère donnait à sa tête un charme inexplicable, mais profond et pénétrant.
Il portait toute sa barbe, un peu plus claire que la chevelure et vaguement partagée au menton par un imperceptible sillon.
C’était vraiment un charmant contraste que celui de ces deux couples allant se mettre en place pour le quadrille.
D’un côté, Tatiane fraîche et radieuse au bras de grand-papa Mauvillars, droit comme un i et si fier, qu’il en avait l’air provocant, comme le faisait malicieusement observer l’envieux Chamouillard.
De l’autre, Jacques Turgis, souriant et épanoui, lui aussi, pressant sous son bras celui de grand’maman Mauvillars, dont les traits naturellement graves et discrets trahissaient en ce moment un orgueil difficilement contenu.
Ce tableau avait attiré tout le monde, jusqu’à ceux qui faisaient galerie autour des tables de jeu, et chacun s’extasiait sur le bonheur que montrait Tatiane de danser avec son grand-père.
Ce grand bonheur prenait bien aussi sa source dans un autre sentiment qu’elle cachait au fond de son cœur ; mais ce sentiment, nul ne le soupçonnait, nul, deux personnes exceptées, celle qui l’inspirait, Jacques Turgis, et une autre qui l’avait surpris avec autant de rage que de douleur.
Cette autre, c’était sir Ralph.
Pâle et les traits contractés, lui seul était sombre au milieu de la joie qui épanouissait tous les visages.
Après avoir accompagné jusqu’à sa place la comtesse de Sinabria, il était revenu près de Tatiane et, se trouvant là au moment où elle parlait d’aller chercher un cavalier pour sa grand’mère, il allait se proposer, quand il fut prévenu par Jacques Turgis. Il avait été témoin du trouble et du ravissement de la jeune fille à l’aspect de l’artiste, et c’est la rage dans le cœur qu’il les avait vus s’éloigner l’un et l’autre.
— Et pourtant, murmura-t-il entre ses dents ; elle sera ma femme, je le jure !
— Quelle est donc la malheureuse à laquelle vous pronostiquez un si cruel destin ? dit alors une voix à son oreille.
XV
LES ENNEMIS DE TATIANE
C’était Mac-Field qui venait d’adresser ce compliment à sir Ralph.
Il reprit d’un ton plus sérieux :
— Ah çà ! dois-je ajouter foi à ce que je viens d’entendre et songeriez-vous réellement à vous marier ?
— Je ne songe plus qu’à cela, répondit sir Ralph d’une voix sourde.
— Est-ce une veuve ou une jeune fille ?
— C’est une jeune fille.
— Quel âge ?
— Seize ans.
— Alors ce n’est pas sérieux ?
— Malheureusement oui.
— Allons donc ! une enfant ne saurait inspirer un sentiment profond, surtout à un homme de votre âge ; elle vient à peine de dire adieu à ses poupées.
— Celle-là n’a de l’enfant que l’innocence ; elle a toutes les grâces, tous les charmes, toutes les séductions, toutes les exquises qualités de la jeune fille. Elle remplit de son âme aimante et candide la maison qui la possède ; tous ceux qui l’entourent respirent et s’épanouissent sous sa douce et pénétrante influence, comme les plantes sous les rayons du soleil, et tout s’éteindrait et s’étiolerait dans la cage où elle palpite si elle venait à la quitter.
— Mais c’est un conte de Perrault, c’est l’histoire de la fée Gracieuse que vous me faites là .
— Il n’y a pas de fée qui lui soit comparable.
— Oh ! oh ! vous me paraissez sérieusement pris, mon pauvre Ralph ; il faut soigner cela.
— Rappelez-vous la passion que vous avait inspirée madame Christiani.
Mac-Field fronça légèrement le sourcil à ce souvenir.
— Si vous eussiez eu le choix entre l’amour de cette femme et la plus brillante destinée, qu’auriez-vous fait ?
— Oh ! murmura Mac-Field d’une voix profonde, son amour et la misère ensuite !
— Voilà où j’en suis, avec cette différence que celle que j’aime évoque autour d’elle tout un monde de douces et charmantes visions, que l’atmosphère qui l’enveloppe n’est peuplée que de tableaux exquis et que les impressions qu’elle soulève sur son passage sont pures et célestes comme son regard. Vous parlez de fée, celle-là est la fée du foyer qui, par sa seule présence, fait un enchantement des scènes les plus vulgaires de la famille, qui plane sur tout, veille à tout, prévoit tout et dont la puissance va même jusqu’à rajeunir les vieillards.
— Êtes-vous bien sûr que cette merveille vive ailleurs que dans votre imagination ?
— Elle est ici et devant vos yeux en ce moment même.
— Montrez-la-moi donc, j’ai hâte de la connaître.
— Tenez, cette jeune fille qui danse avec un vieillard, son grand-père.
— Mademoiselle Tatiane ?
— C’est elle.
Mac-Field regarda quelques instants la jeune fille.
— Ma foi, dit-il enfin, je dois convenir que vous n’avez rien exagéré et que toute sa charmante personne répond exactement au portrait que vous venez de tracer d’elle.
— Comprenez-vous maintenant que je veuille en faire ma femme ?
— Non-seulement je le comprends, mais je vous approuve, car ce mariage aurait l’avantage immense de se lier intimement au plan que nous avons conçu et d’en favoriser l’exécution, loin de l’entraver, comme je le redoutais en vous entendant exalter l’objet de votre amour. Nièce de M. Mauvillars, elle a en perspective l’héritage, ou une grande partie de l’héritage de cet oncle archimillionnaire, et petite-nièce de Valcresson, de New-York, elle doit encore toucher de ce côté quelque chose comme deux millions ; vous avez donc très-bien placé votre flamme et je vous engage à ne pas la laisser moisir, car…
Mac-Field s’interrompit un instant, puis il reprit :
— Car au moment même où je vous parle, je vois surgir un obstacle.
— Un obstacle ? dit sir Ralph d’une voix émue.
— Et même fort grave.
— Quel est-il donc ? Parlez.
— La charmante Tatiane a le cœur pris.
— Quoi ! balbutia sir Ralph en pâlissant, c’est si visible que cela ?
— Je ne suis pas sorcier, et pourtant je parierais qu’elle aime le jeune homme qui lui fait vis-à -vis et qu’elle en est aimée.
— C’est vrai.
— Ah ! vous le saviez déjà ?
— Comme vous, je viens de l’apprendre à l’instant, ils se sont trahis tous deux devant moi.
— Et si j’en juge par le bouleversement de vos traits, vous n’avez pas su prendre la chose du bon côté.
— J’ai dans le cœur autant de rage que d’amour.
— J’ai passé par là et je comprends ce que vous devez éprouver ; mais haïr, cela n’avance à rien ; si je m’étais contenté de cela, la jalousie m’aurait rongé jusqu’à la moelle et je ne serais plus de ce monde. Voyons, que prétendez-vous faire ? Avez-vous quelque dessein en tête ou préférez-vous abandonner la place à votre heureux rival ?
— Je le tuerais plutôt, murmura sir Ralph d’une voix sifflante.
Il reprit après une pause :
— Mais nous ne serons pas forcés d’en arriver là ; j’ai conçu un projet, vague encore dans mon esprit, qui nous débarrassera de cet obstacle.
— Soit, mais l’obstacle, c’est-à -dire le jeune homme disparu ou repoussé, il restera dans le cœur de la jeune fille l’amour qu’il a inspiré.
— Non.
— Comment cela ?
— Si je réussis dans ce que je veux entreprendre, j’arracherai cet amour du cœur de Tatiane.
— Mais supposons que vous ne réussissiez pas ; supposons que cet amour résiste à tout, ce qui n’a rien que de très-vraisemblable chez une jeune fille.
— Je ne sais ce que je ferai, mais j’emploierai tous les moyens imaginables, je remuerai ciel et terre pour qu’elle soit à moi.
— À quel titre ?
— Comme ma femme et pour la vie ; on ne saurait la rêver autrement.
— Pauvre petite !
— Mais je l’adorerai comme jamais femme n’a été adorée.
— Et le passé ?
— Le seul moyen de conjurer les périls de ce passé est de nous retrancher dans une position inexpugnable en nous rattachant à la société par de profondes et solides racines ; or, mon union avec une famille aussi honorablement connue que les Mauvillars compléterait admirablement le plan que vous avez conçu.
— Badoir et C°, oui, dit Mac-Field, il serait difficile de deviner, dans les associés de celui-ci et dans le gendre de M. Mauvillars, les deux auteurs du drame de la Dixième rue de…
— Silence ! lui dit vivement sir Ralph.
— C’est égal, si l’on venait à soulever un jour le voile qui cache le passé de ce gendre, avouez que ce serait un singulier réveil pour une jeune fille comme celle-ci. Ah ! il y a d’étranges fatalités, il faut en convenir, et celle qui donnerait à cette chaste et ravissante enfant un mari tel que vous est une des plus effrayantes qui se puissent imaginer. Enfin, elle représente pour nous une chance de salut : le sort la jette dans l’engrenage de nos combinaisons, où elle sera broyée sans nul doute. Que sa destinée s’accomplisse ! chacun pour soi et Dieu pour tous !
— Vous êtes désespérant, Mac-Field.
— Je vois clair et je suis pratique, et la preuve, c’est que, tout en prévoyant le dénouement fatal dont nous sommes menacés, je songe en même temps à prendre toutes les précautions possibles pour y échapper. Tandis que vous vous perdez vaguement dans votre double rêve d’amour et de vengeance, je pense, moi, aux moyens d’exécution, dont vous ne vous êtes nullement préoccupé, j’en suis sûr. La première chose à faire quand on a à vaincre deux obstacles tels que l’amour d’une jeune fille et un amoureux comme celui-ci, car outre qu’il est fort joli garçon, il ne me semble pas d’un tempérament à vous céder facilement la victoire, la première chose à faire en pareil cas, dis-je, c’est d’avoir quelqu’un dans la place.
— Vous avez raison, Mac-Field.
— Ce qu’il y aurait de mieux, ce serait d’avoir pour soi la femme de chambre de mademoiselle Tatiane.
— Il faut la gagner ; avec de l’or, tout est facile.
— Pas toujours ; cette jeune fille, vous en faites l’expérience par vous-même, et l’admiration dont elle est l’objet en ce moment nous en est une nouvelle preuve, cette jeune fille doit inspirer de vives et profondes sympathies, et une tentative de corruption sur sa femme de chambre pourrait tourner contre nous.
— Quel est donc votre projet à l’égard de cette femme ?
— Mon projet est de la remplacer.
— Mais si, comme vous le craignez, elle est dévouée à sa jeune maîtresse ?
— Il y a dévouement et dévouement ; elle peut être incapable de vouloir lui nuire à aucun prix et très-capable de la quitter pour une condition plus avantageuse, ou même, s’il faut aller jusque-là , pour aller habiter un joli appartement où elle régnerait en souveraine, grâce aux libéralités d’un bienfaiteur… dont je jouerais le rôle au besoin…
— Vous avez quelqu’un en vue pour mettre à sa place près de la jeune fille ?
— Une perle.
— Diable !
— Oh ! mais entendons-nous, une perle pour nous pour l’usage que nous voulons en faire.
— Je comprends. Et où l’avez-vous ramassée, cette perle ?
— Dans un bouge que vous connaissez comme moi, car c’est de la fille de Claude que je veux vous parler.
— Claude de Plaisance ?
— Précisément.
— Malvina ?
— C’est son nom ; son père la dit jolie et assez façonnée pour faire une femme de chambre.
— Il a raison.
— Quant aux principes, on devine ceux qu’elle a dû puiser dans un pareil milieu, nous n’aurons pas de grands scrupules à vaincre.
— Qui sait ?
— Dans tous les cas, nous la tenons par son père et sa mère, qui doivent avoir tous les droits possibles au bagne ou à l’échafaud, et, en supposant même qu’elle les haïsse et les méprise, il y a toujours ce vieux préjugé de l’amour filial dont on peut jouer et qui l’empêcherait de laisser couper la tête des auteurs de ses jours.
XVI
DOUBLE SURVEILLANCE
Pendant ce dialogue, un cercle compact s’était formé autour du quadrille où Tatiane, Jacques Turgis et les deux vieux époux formaient, par les contrastes, un si charmant tableau.
On admirait surtout Tatiane, non-seulement pour cette grâce native qui faisait, pour ainsi dire, partie intégrante de sa personne et que la danse mettait si vivement en relief, mais aussi pour l’expression de bonheur et de profond ravissement qui épanouissait son charmant visage et qui faisait dire à tous ceux qui la connaissaient :
— Mais voyez donc Tatiane ! elle n’a jamais été si jolie.
— Ni si heureuse.
— C’est la joie de danser avec son grand-père qui la rend si heureuse.
Il est certain que jamais Tatiane n’avait été si prodigue de sourires, de gentillesses, de regards caressants pour grand-papa Mauvillars.
Aussi l’excellent vieillard, trompé comme les autres sur la cause de l’immense joie qui épanouissait les traits de sa chère Tatiane, était-il lui-même dans une exaltation de bonheur qui touchait au délire.
— Voyez-vous la petite tartufe ? dit Mac-Field à sir Ralph ; voyez-vous comme elle trompe tout le monde ?
— Qui sait si elle ne se trompe pas elle-même ! Qui sait si, dans sa profonde innocence, elle sait distinguer les vrais sentiments qui la rendent folle de bonheur en ce moment ?
— Elle peut les ignorer, en effet, mais nous, qui ne pouvons nous y méprendre, nous voyons là un avertissement que nous serions coupables de négliger ; il faut donc agir sans retard. Dès demain, nous entamerons simultanément trois opérations : d’abord s’insinuer près de la femme de chambre dont nous voulons nous débarrasser ; ensuite, donner les instructions nécessaires à la fille de Claude, concernant son service, sans rien lui confier de nos projets quant à présent, et enfin nous faire présenter officiellement chez M. Mauvillars par M. Badoir, qui, en outre, nous fera inviter aux soirées intimes qui ont lieu tous les samedis. Voilà ce dont il faut nous occuper tout d’abord ; puis nous porterons notre attention sur l’ennemi, c’est-à -dire sur l’amoureux. Savez-vous ce que c’est que ce jeune homme ?
— C’est un artiste, un peintre.
— Son nom ?
— Jacques Turgis.
— Turgis ! j’ai entendu ce nom-là quelque part.
— C’est le nom du père Vulcain.
— Est-ce qu’il serait parent de ce jeune homme ?
— Peut-être.
— Il faudra nous informer de cela.
— J’y avais déjà songé.
— Est-il admis dans la maison ou seulement invité aux soirées extraordinaires ?
— Voilà ce que j’ignore.
— Je le saurai ce soir même, c’est important.
— Maintenant je vous laisse vous repaître de vos tortures pour aller m’occuper de deux autres membres de la famille Valcresson, sur lesquels j’ai des vues encore vagues, mais qui ne peuvent que prendre une tournure très-sérieuse, car la femme n’aura pas moins d’un tiers dans l’héritage de l’oncle.
— Quels sont-ils ?
— Le couple Taureins.
— Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que quelque drame doit couver dans ce ménage.
— Il est trop mal assorti pour qu’il en soit autrement ; et puis une beauté aussi parfaite, aussi excitante que celle de madame Taureins attire forcément la passion. Cet intérieur doit être gros d’orages.
— C’est ce qu’il faudrait savoir.
— Et c’est ce que nous saurons d’ici à quelques jours.
— Comment cela ?
— Nous aurons là un instrument tout dévoué.
— Placé par vous ?
— Non, trouvé par moi, déjà en place dans la maison et honoré de la confiance du patron.
— Quelle position occupe-t-il là ?
— Il est caissier.
— Et vous avez pu gagner cet homme ?
— Il ne demandait qu’à se vendre ; il est pourvu d’ailleurs des plus détestables antécédents, que je connaissais déjà avant d’entrer en relation avec lui et qui naturellement ont singulièrement facilité nos petits arrangements. C’est un homme très-habile, profondément pervers, à peu près capable de tout et auquel je crois ne devoir moi-même accorder qu’une confiance limitée, car je le crois de taille et de caractère à jouer au besoin un double rôle, heureusement je le tiens par son passé.
Il avait fait un mouvement pour s’éloigner, quand, revenant sur ses pas :
— Un avis avant de nous séparer, dit-il à sir Ralph.
— Parlez.
— L’esprit préoccupé des deux détectives envoyés de New-York à Paris, à notre intention, j’ai passé en revue tous les invités de M. Mauvillars, sur lesquels j’ai même demandé des renseignements à un des parents de la famille, un M. Pontif, qui a saisi avec empressement cette occasion de me prouver qu’il connaissait tout le monde.
— Eh bien ?
— En effet, il a pu me dire les noms, les qualités, le caractère, les habitudes et jusqu’à la fortune présumée de chaque invité.
— Sans exception ?
— Il y en a trois, au contraire.
— Qui sont ?
— Vous d’abord.
— Et les deux autres ? demanda vivement sir Ralph.
— Ceux que vous voyez là -bas, dans le cercle qui entoure le quadrille des grands-parents.
— Je m’en doutais.
— Pourquoi ?
— Parce que je les ai surpris plusieurs fois m’observant à la dérobée.
Mac-Field se troubla.
— Seraient-ce nos deux Américains ? murmura-t-il.
— Je ne crois pas ; ils n’en ont ni le type, ni les allures, ni l’accent, car je suis passé près d’eux dans le seul but de les entendre et je crois pouvoir affirmer qu’ils sont Français et même Parisiens.
— Alors d’où vient donc la défiance qu’ils vous inspirent ?
— Je les crois ici pour le compte de M. de Coursol, dont l’absence ne fait que confirmer mes soupçons. Sachant que la comtesse de Sinabria était attendue ici par l’auteur de ce terrible plan qui a dû les bouleverser tous les deux, il a évité de venir pour nous inspirer une entière sécurité, mais cette précaution même a tourné contre son but en excitant ma défiance. J’ai observé autour de moi et les allures de ces deux hommes m’ont inquiété ; ce que vous me dites de l’ignorance où l’on est sur leur compte achève de me les rendre suspects.
— Vous n’avez pas entendu prononcer leurs noms ?
— Nullement.
— Cela demande à être éclairci ; il faut absolument que je sache quels sont ces deux hommes.
— Plus je les examine, plus je les crois dangereux, malgré le calme, le sans-façon et l’indifférence qu’ils affectent l’un et l’autre.
— Ils vous ont vu causant avec la comtesse.
— Ils m’ont vu et observé.
— Et depuis cet entretien, ils ne se sont pas approchés de la comtesse ?
— Ils s’en seraient bien gardés. S’ils jouent le rôle que je suppose, c’eût été de leur part une grave maladresse.
— Si vous avez deviné juste, ils sont ici pour savoir qui nous sommes et pour contrecarrer nos projets sur la comtesse, et en ce cas leur jeu est de nous suivre à la sortie de cette fête.
— Naturellement.
— Ils en seront pour leurs pas et nous avons un moyen bien simple de leur échapper.
— Lequel ?
— C’est de ne pas rentrer chez nous.
— Où passer le reste de la nuit ?
— Chez Brébant, d’où nous ne sortirons qu’à huit heures. Alors il fera grand jour, nous prendrons une voiture, nous irons faire une promenade au bois, absolument désert à cette heure, et, si quelqu’un s’avise de nous suivre, nous le verrons bien.
— Excellente idée !
— Mais nous aussi, nous allons les faire suivre et, comme ils ne se savent pas soupçonnés, comme très-probablement l’un d’eux rentrera chez lui, nous saurons dès demain quels sont ces individus, quelle est leur position dans la société et s’ils sont gens à s’occuper de nos affaires.
— Il faudra déployer une extrême prudence, car peut-être sont-ils eux-mêmes sur leurs gardes et je ne les crois pas faciles à tromper.
— Je donnerai mes instructions en conséquence.
Il demanda en baissant la voix :
— Rascal est-il ici ?
— Oui, chez un marchand de vin qui fait le coin de la rue et porte pour enseigne : À la Comète.
— Bien ; est-il seul ?
— Non pas.
— Qui est avec lui ?
— Collin.
— Je vais faire le tour des salons en me promenant pour éviter d’éveiller les soupçons de ces deux hommes, et dans un quart d’heure je sortirai.
— Et vous reviendrez ?
— Je reviendrai pour deux motifs, d’abord parce que ma disparition pourrait leur donner à réfléchir, ensuite parce qu’il peut survenir tel incident qui exige que nous agissions de concert.
— Adieu donc, et surveillez-les, mais comme eux, sans en avoir l’air.
— Rassurez-vous, je ne les perdrai pas de vue.
XVII
UNE DÉCOUVERTE
Comme il traversait la salle du bas pour se rendre chez le marchand de vin où il devait trouver Rascal et Collin, Mac-Field avait rencontré sur son chemin M. Pontif, qui l’avait arrêté et lui avait dit d’un air triomphant :
— Monsieur, je vous cherchais pour vous dire que je sais son nom.
— Le nom de qui ? demanda Mac-Field.
— Le nom du plus âgé des deux invités sur lesquels vous m’interrogeâtes naguère, c’est-à -dire il y a une heure, répondit M. Pontif, qui parlait la langue de M. Prud’homme.
Et il désignait du doigt les deux personnages dont Mac-Field venait de s’entretenir avec sir Ralph :
— Ah ! vous connaissez ce monsieur ? demanda vivement Mac-Field.
— Oui, monsieur. Je viens de m’informer et j’ai eu la chance de tomber justement sur quelqu’un qui l’a entendu annoncer.
— Et on le nomme ?…
— M. Portal, répondit fièrement M. Pontif, qui mettait son amour-propre à connaître tout le monde.
— Et la position de ce M. Portal ?
— Je l’ignore. Mais remarquez, monsieur, que sur cent cinquante personnes que vous voyez ici, il n’y en a que deux dont le nom me soit inconnu.
— C’est vraiment prodigieux, monsieur.
Et Mac-Field sortit après avoir remercié avec effusion M. Pontif.
Un instant après il était dans la rue et il eut bientôt trouvé le marchand de vin que lui avait désigné sir Ralph.
Il entra et n’aperçut d’abord que quelques cochers qui prenaient un canon sur le comptoir.
— Un joli canon du broc ! demanda un individu qui entrait derrière lui.
Cette voix frappa Mac-Field, qui se retourna et reconnut François, le cocher du comte de Sinabria.
Ce François, le lecteur s’en souvient, était l’âme damnée de sir Ralph ; c’était lui qui, après avoir d’abord trahi sa maîtresse pour M. Badoir, qu’il avait mis au courant de la situation de celle-ci et du parti qu’elle avait pris d’aller passer quelques jours chez une sage-femme, avait ensuite trahi M. Badoir pour sir Ralph, si bien que le fiacre aposté aux abords de l’hôtel Sinabria avait eu successivement, et dans l’espace de quelques heures, trois destinations différentes : la rue Sainte-Anne, Plaisance et Aubervilliers.
Nous savons maintenant quel eût été le sort de la comtesse, si M. Badoir l’eût emporté dans cette singulière lutte ; nous avons vu fonctionner la trappe par laquelle madame Claude, dans un accès de zèle peut-être, se proposait de faire disparaître la jeune femme dès son entrée dans l’ignoble bouge, et nous pouvons apprécier le service que le cocher avait rendu à sa maîtresse, sans s’en douter, en faisant prévaloir le plan de sir Ralph.
Naturellement, ce dernier s’était empressé de mettre François en rapport avec Mac-Field, avec ordre de lui obéir comme à lui-même.
Mac-Field attira le cocher dans un coin et lui dit à voix basse :
— N’aurais-tu pas vu M. de Coursol par ici ?
— Précisément, il rôde comme une âme en peine autour de l’hôtel Mauvillars, ce qui m’a étonné, vu que je le croyais dedans avec M. le comte et madame la comtesse.
— Est-il seul, ou accompagné ?
— Je l’ai vu passer deux ou trois fois en rasant les maisons et en se dissimulant dans son cache-nez, et il était toujours seul.
— Oh ! murmura Mac-Field, novice dans le métier de fileur, pas dangereux, M. de Coursol.
Puis il reprit :
— Rien de neuf à l’hôtel Sinabria ?
— Absolument rien.
— Pas de brouille dans le ménage ?
— Ah bien, oui ! deux tourtereaux, quoi !
— Tu es toujours bien avec le valet de chambre de M. le comte ?
— Les deux doigts de la main.
— Il cause toujours volontiers ?
— C’est un homme qui sait vivre, il ne refuse jamais une politesse, et comme c’est toujours moi qui paie, et du bouché, s’il vous plaît, là , mais du chenu, il est sensible à ce procédé.
— C’est-à -dire qu’il n’a rien de caché pour toi ?
— C’est ça.
— Voilà de quoi l’entretenir dans ces sentiments, dit Mac-Field en glissant un billet de cent francs dans la main du cocher.
Puis il reprit :
— Et la femme de chambre ?
— Oh ! celle-là , faut pas y compter ; pas moyen de lui arracher une parole ; c’est dévoué à sa maîtresse ; malheur ! ça lui fait une belle jambe.
— Écoute, il se passe quelque chose de grave en ce moment.
— Entre monsieur et madame ?
— Non, entre madame la comtesse et M. de Coursol.
— Bon !
— C’est le moment de guetter, d’épier, d’écouter avec plus d’ardeur que jamais.
— Suffit, on aura l’œil.
— Et au premier rapport important, cinq cents francs.
— Pour moi seul ?
— Et cent pour ton camarade.
— Alors, il ne se prononcera pas quatre paroles dans la maison qu’il n’en tombe au moins une dans nos oreilles.
— C’est bien, tu recevras un mot de moi ces jours-ci pour te fixer un rendez-vous où nous pourrons causer.
— À vos ordres, milord.
Tout en causant avec François, Mac-Field avait parcouru du regard l’établissement du marchand de vin et un petit cabinet pratiqué au fond de la boutique avait attiré son attention.
Ce cabinet avait une porte vitrée à travers laquelle on voyait briller de la lumière.
— Ils doivent être là , pensa-t-il.
Il s’approcha du marchand de vin.
— Il y a deux personnes dans ce cabinet, n’est-ce pas ? lui demanda-t-il.
— Trois sans vous commander, répondit le marchand de vin.
— Ils attendent quelqu’un ?
— Ils me l’ont dit, un monsieur très-bien, ce doit être monsieur.
— C’est moi.
— Ces messieurs ont pris une bouteille d’absinthe et ils sont en train de récidiver ; que faut-il servir à monsieur ? du doux ? un mêlé ? une bonne bouteille de bouché ?
— Un mêlé, répondit en souriant Mac-Field.
Et il se dirigea vers la porte vitrée.
En entrant dans le cabinet, il reconnut les trois hommes qui s’y trouvaient attablés.
C’étaient Collin, Rascal et le père Vulcain.
Tous trois se découvrirent et s’empressèrent de lui faire place autour de la table.
— Parbleu ! dit Mac-Field au vieux modèle, je suis bien aise de vous rencontrer ici, père Vulcain.
— La joie et l’honneur sont de mon côté, milord, répondit Vulcain qui, pour parler son langage, était déjà quelque peu éméché. Mais puis-je vous demander ?…
— Silence.
Le garçon entrait.
Quand il fut sorti, après avoir déposé le mêlé devant Mac-Field, celui-ci reprit :
— Vulcain n’est pas votre nom, n’est-ce pas ?
— Non, maître, c’est celui d’un certain dieu de l’Olympe, serrurier de son état, et sur l’épouse duquel il y a eu pas mal de potins dans le temps ; c’est, du moins, ce que je me suis laissé dire.
— Et vous avez été fort bien renseigné ; mais, votre vrai nom ?
— Turgis, pour vous servir.
— Seriez-vous parent d’un jeune peintre du nom de…
— Jacques Turgis ?
— C’est cela.
— Il me doit le jour.
— Pas possible !
— Il me doit même son talent et sa célébrité ; c’est moi qui l’ai mis en relation avec Mardochée, qui lui payait ses toiles au poids de l’or ; et quelle a été ma récompense ? l’ingratitude !
— Pourquoi n’êtes-vous pas resté avec lui ?
— Il refusait de prendre l’absinthe avec moi et quelques bons zigues de ma connaissance, des amis avec lesquels je trinquais depuis vingt ans ! Vous comprenez, on a beau être père, il y a des affronts qu’on ne peut pas tolérer.

— Ah ! vous êtes le père de Jacques Turgis ! c’est bon à savoir.
— Ah çà , vous le connaissez donc ? demanda le père Vulcain.
— Depuis une heure.
— Comment ! mais il est donc là , dans l’hôtel Mauvillars ?
— Où il danse en ce moment avec une charmante jeune fille.
— À laquelle il débite des fadeurs, au lieu de venir ici s’épancher dans le sein de son père.
— C’est indigne, j’en conviens.
— Oh ! dit le père Vulcain avec une profonde amertume, ça ne m’étonne pas de sa part, il a toujours aimé les aristocrates.
Mac-Field jeta tout à coup un regard du côté de la porte et après s’être assuré qu’elle était bien fermée :
— Ah çà , mes enfants, dit-il en baissant la voix, ce n’est pas le moment de se croiser les bras.
— Il y a un coup à faire ? demanda Collin.
— Il y a quelqu’un à filer.
— Ça, c’est ma partie, dit Rascal.
— C’est qu’ils sont deux et il faut prévoir le cas où ils iraient chacun de son côté.
— Je me charge de l’autre, dit Collin.
— Je vous préviens que vous avez affaire à deux malins ; je ne les connais que pour les avoir vus de loin, mais, pour sûr, ce ne sont pas des naïfs.
— Ils partiront en voiture ?
— Naturellement.
— Nous allons amener deux fiacres devant l’hôtel.
— Bon, et une fois vos fiacres en place, voilà ce que vous aurez à faire.
— Voyons.
— Vous vous introduirez tous deux dans la cour de l’hôtel, où vous me verrez descendre quelques minutes avant leur départ, c’est-à -dire au moment où je les verrai passer au vestiaire.
— Après ?
— Vous ne m’approcherez pas naturellement, mais vous aurez les yeux fixés sur moi pour observer mes signes.
— Compris.
— Quand je les verrai descendre à leur tour, je porterai la main à mon front ; ce sera le moment d’écouter de toutes vos oreilles, et quand vous entendrez crier par un domestique : La voiture de M. Portal…
— Hein ? s’écria Rascal en bondissant sur son siège, vous dites ?…
— M. Portal.
— Un homme de quarante-cinq à cinquante ans ?
— C’est bien cela.
— L’œil noir et vif, l’air sérieux et résolu ?
— Justement.
— C’est mon homme.
— Qui donc ?
— Vous vous rappelez celui qui a pris la défense de la petite muette au Café Parisien et m’a détaché au creux de l’estomac un coup de pied…
— Et qui a emporté du même coup la petite Nizza et le portefeuille de sir Ralph ?
— Oui.
— Comment sais-tu son nom ?
— Sir Ralph étant très-inquiet au sujet de son portefeuille, je suis allé le réclamer le lendemain matin au Café Parisien, pensant bien qu’à cette heure je n’y trouverais pas mon homme. Il n’y était pas, en effet, mais on m’apprit que le portefeuille était entre les mains de M. Portal, qui se ferait un plaisir de le porter lui-même à l’adresse qu’on lui indiquerait.
— Et tu ne t’es pas fait indiquer sa demeure ?
— On a refusé de me la faire connaître.
— Tout s’explique maintenant, dit Mac-Field, et je ne m’étais pas trompé en affirmant que cet homme nous observait. Ce M. Portal est un ennemi, le portefeuille dont il s’est emparé a dû lui apprendre nos secrets ; nous avons le plus grand intérêt à connaître sa demeure.
— D’autant plus qu’il a chez lui la petite muette avec laquelle j’ai un compte à régler, dit Rascal d’une voix sourde.
Mac-Field se leva et sortit en disant :
— Tout à l’heure, dans la cour de l’hôtel.
XVIII
MADAME TAUREINS
De retour dans la salle de bal, le premier soin de Mac-Field fut de se mettre à la recherche de sir Ralph.
Il le trouva assis dans un coin, l’air sombre et presque sinistre.
— Déridez-vous, lui dit-il, en s’asseyant près de lui, je vous apporte une bonne nouvelle.
— Dites-la donc vite, cela changera peut-être le cours de mes idées.
— Que diriez-vous si je vous apprenais où est le portefeuille qui vous a été ravi au Café Parisien ?
— Vous ! s’écria sir Ralph stupéfait, allons donc ! c’est impossible.
— Et si je faisais mieux encore ! si je vous montrais l’individu qui l’a en son pouvoir !
— Celui qui s’est emparé de la petite muette ?
— Après avoir régalé Rascal d’un magistral coup de pied dans l’estomac.
— Où l’avez-vous donc vu ?… chez le marchand de vin d’où vous sortez ?
— Pas du tout.
— Ici ?
— Vous l’avez dit.
— Quoi ! cet homme ! cet homme qui tient tous nos secrets entre ses mains, il est ici !
— Et il n’est pas invraisemblable qu’il y soit venu pour nous, pour nous seuls.
— Mais je l’ai vu cet homme ; il a été sous mes yeux pendant plus d’un quart d’heure au Café Parisien, je l’aurais reconnu.
— Vous l’avez revu ici et regardé longtemps sans le reconnaître, car c’est l’un des deux individus qui vous observaient pendant que vous dansiez avec la comtesse de Sinabria ; et tenez le voilà qui se promène tranquillement avec son ami.
— Il est méconnaissable ; là -bas, il avait toute sa barbe et, aujourd’hui, il ne porte plus que la moustache ; et puis ce n’est plus le même type ; au Café Parisien, c’était un vulgaire bourgeois, fumant paresseusement son cigare, la main dans la poche, enfoui dans son gros paletot comme un ours dans sa fourrure. Ici c’est un homme du monde dans toute l’acception du mot, et, chose extraordinaire, sa physionomie a subi une transformation aussi complète que sa mise et ses manières. Vous connaissez son nom ?
— Il se fait appeler M. Portal.
— Sa demeure ?
— Ça, c’est différent, on l’ignore ici comme au Café Parisien, mais nous la connaîtrons ce soir.
— Qui se chargera de le filer ?
— Rascal.
— J’ai hâte de le connaître, car c’est un ennemi, je le sens ; et, quand je songe à tout ce que renferme ce fatal portefeuille !… Heureusement j’ai eu la précaution de tout écrire dans une langue qui, à coup sûr, lui est inconnue.
— Mais qu’il a pu faire traduire.
— Cette pensée m’épouvante et…
Il s’interrompit tout à coup, réfléchit un instant ; puis, se frappant le front :
— Il me vient un soupçon.
— Lequel ?
— Si cet homme était d’accord avec la comtesse de Sinabria ?
— Comment auraient-ils été mis en relation ? Il faudrait pour cela un hasard si extraordinaire, si miraculeux, que j’ai peine à y croire.
— Remarquez que M. de Coursol n’est pas ici ; or, il est impossible que la comtesse n’ait pas à ce bal quelques amis dévoués venus là pour connaître l’homme qui, après lui avoir adressé les plus terribles menaces, lui a donné rendez-vous pour lui proposer un pacte.
— En effet, dit Mac-Field.
Il reprit brusquement, après une pause :
— Mais, j’y songe, le nom de la comtesse de Sinabria ne se trouve-t-il pas sur ce portefeuille ?
— Oui, comme celui de plusieurs autres membres de la famille Valcresson qui assistent à cette soirée.
— Avec cette différence, concernant la comtesse de Sinabria, que la petite muette, qu’il a amenée avec lui, a dû lui donner sur celle-ci des renseignements qui ont pu exciter son intérêt et le pousser à se mettre en communication avec elle.
— C’est juste, s’écria sir Ralph frappé de cette observation. Ah ! cette muette maudite, je l’avais oubliée.
— Bref, reprit Mac-Field, il me paraît prouvé maintenant que ces deux hommes sont les alliés de la comtesse et de M. de Coursol ; qu’ils sont venus ici pour connaître l’ennemi qui les tient entre ses mains, et qu’au sortir de ce bal ils vont se concerter pour nous faire une guerre à mort.
— Il faut donc absolument les dépister, nous verrons ensuite ce qu’il y a à faire contre eux.
— Nous nous réunirons demain à cet effet.
— Quant à la comtesse, reprit sir Ralph, je crois pouvoir affirmer qu’elle ne rapportera pas un mot de ce qui a été dit entre nous, et qu’elle niera même que j’aie été autre chose pour elle qu’un simple danseur, n’ayant aucun rapport avec le personnage qui lui avait donné rendez-vous à ce bal ; je l’ai tellement effrayée sur les conséquences d’une indiscrétion que je suis presque assuré de son silence.
— Néanmoins, veillez toujours sur elle et sur nos mystérieux ennemis ; pendant ce temps, moi, je vais m’occuper du couple Taureins.
Mac-Field quitta sir Ralph et se dirigea vers un quadrille où, parmi les danseurs, il avait remarqué la belle madame Taureins.
Son cavalier était un jeune homme d’une tournure pleine de distinction, dont les traits pâles et sérieux trahissaient un état maladif ou quelque souffrance morale.
Jusqu’à l’entrée de M. et madame Taureins, il s’était promené dans la foule d’un air inquiet et préoccupé, le regard fixe et rêveur, s’arrêtant parfois devant les danseurs et restant là dix minutes sans rien voir, absorbé enfin dans une attente qui le minait et le rendait indifférent à tout le reste.
Quand la voix du domestique annonça madame Taureins, il devint livide, tourna vers la porte un regard troublé et s’appuya à l’espagnolette d’une fenêtre, car il sentait ses jambes fléchir sous lui.
Puis il la regarda traverser la foule au bras de son mari, fière et grave dans sa démarche, éblouissante dans sa pâleur mate, qui se colorait du reflet d’une vague émotion.

Quand elle passa à quelques pas du jeune homme, séparé d’elle par un flot d’admirateurs, il sembla à celui-ci qu’une étincelle, partie de ses yeux noirs, jaillissait jusqu’à lui.
Mais ce fut si rapide qu’il se demanda aussitôt s’il n’était pas dupe d’une illusion.
Et il en vint bientôt à se le persuader, car elle n’avait pas tourné la tête de son côté.
Comment donc aurait-elle pu le voir ?
Il la suivit des yeux jusqu’à ce qu’elle quittât son mari pour aller se joindre à un groupe de jeunes femmes, ses amies.
Dès ce moment, son regard ne la quitta plus.
Et, tout en se promenant dans la foule, où il se dissimulait avec soin, il se rapprochait d’elle peu à peu, mais avec un sentiment de crainte évidente.
Ce manège dura bien un quart d’heure, puis faisant un violent effort sur lui-même, il se décida enfin à aborder la jeune femme, qui se trouvait isolée en ce moment, ses amies l’ayant quittée pour aller prendre place à un quadrille.
— Madame, lui dit-il en s’inclinant, voulez-vous me faire l’honneur…
Un regard sévère de la jeune femme lui coupa la parole.
— Encore vous, monsieur ! murmura-t-elle tout bas.
— Je vous en supplie, madame, reprit-il d’une voix que l’émotion faisait trembler, je vous en supplie, permettez-moi de solliciter ce que vous accordez ici au premier venu, le bonheur… l’honneur de danser avec vous.
Il y eut un moment d’hésitation de la part de madame Taureins.
Mais son regard rencontra celui du jeune homme, et il exprimait une telle angoisse, qu’elle se leva en disant :
— Vous avez raison, je dois accepter ici l’invitation du premier venu, sous peine de manquer à toutes les convenances.
Elle prit son bras, et un instant après elle prenait place à un quadrille avec son cavalier.
Ce cavalier, personnage déjà connu du lecteur, était Paul de Tréviannes.
— Monsieur, lui dit madame Taureins, toujours grave et froide, je vous ai dit à quel titre j’acceptais votre invitation, je vous avouerai pourtant que j’ai été sur le point de la refuser et vous en comprenez la raison.
— Mais, madame, répondit Paul de Tréviannes avec embarras, je ne comprends pas…
— Alors, monsieur, je vous demanderai pourquoi, depuis quelque temps, je vous trouve à toutes les fêtes auxquelles je suis invitée et me poursuivant partout de votre amour. Je ne vous connaissais pas, je ne vous avais jamais vu, quand il y a quinze jours, au bal du comte de Merval, vous avez osé me parler d’un amour dont j’ai été d’autant plus surprise, d’autant plus indignée que, je vous le répète, je vous voyais ce jour-là pour la première fois.
— Depuis trois mois, madame, répondit le jeune homme, je vous connaissais et vous aimais déjà d’un amour insensé.
— Vous me connaissiez ?
— Je vais vous dire où et comment je vous ai vue pour la première fois, madame.
Madame Taureins ne répondit pas.
Elle attendait.
Elle l’autorisait donc à parler de son amour ! C’est ce que crut comprendre le jeune homme et ce fut d’une voix tremblante de bonheur qu’il reprit la parole.
XIX
UNE VISION
— Il y a quelques mois, madame, reprit Paul de Tréviannes, je quittais Paris pour aller passer quinze jours à Orléans, où demeurent mon père et ma mère. C’était à la fin de mai, le ciel était tout bleu, l’atmosphère, pure et fraîche, était chargée des émanations printanières qui se dégagent des prés en fleurs ; tout était grâce, fraîcheur et sérénité dans la nature. Nous étions à une heure d’Étampes environ, lorsque, en me penchant à la portière pour admirer le paysage, charmant sur toute cette ligne, je vois à vingt pas de moi, se promenant sur la terrasse d’une jolie villa, une jeune femme vêtue d’un peignoir blanc, la tête couverte d’un chapeau de paille dont les larges bords jetaient une ombre sur son charmant visage, et si belle, si fraîche, si gracieuse dans cette simple toilette, qu’elle semblait avoir été jetée là , comme Ève dans les splendeurs du paradis terrestre, pour compléter l’harmonie de ce ciel bleu, de cette atmosphère parfumée et de ces prés en fleurs.
Le train passa, je la vis quelques secondes, ce fut une vision, mais une vision qui tomba au fond de mon cœur avec tout son charme et toute sa beauté et y demeura éblouissante.
À partir de cette minute, madame, je ne vis plus autre chose, je n’eus plus d’autre pensée, mon cœur devint inaccessible à toute autre impression. Je la contemplais au fond de ce sanctuaire où elle s’était fixée, où elle brillait comme dans une lueur d’auréole avec son vague et charmant sourire, avec son cou si blanc et si pur, avec cette démarche cadencée qui mettait en relief des charmes à donner le vertige, et je ne vivais plus que pour me repaître des émotions que me communiquait cette ravissante image.
Au bout de huit jours, ravi et miné en même temps par l’incessante adoration de cette femme et par la dévorante pensée que d’infranchissables barrières me séparaient d’elle à jamais, j’étais changé à ce point que mon père et ma mère en furent frappés et m’en exprimèrent leur surprise, le séjour de leur campagne produisant ordinairement sur moi un effet absolument contraire.
Ne pouvant vivre plus longtemps sans la revoir, leur inquiétude, trop justifiée d’ailleurs, fut pour moi un prétexte dont je m’empressai de profiter. Je partais le lendemain et m’arrêtai à la station qui précédait la villa où j’avais laissé toute mon âme.
Une fois là , je gagnai le petit village d’où dépendait cette habitation, en face de laquelle j’arrivai au bout de dix minutes.
J’entrai dans un café qui se trouvait à quelques pas, et, donnant pour raison au maître de l’établissement l’intention où j’étais d’acheter une maison de campagne dans le pays, je l’interrogeai sur la villa qui s’élevait presque en face de la maison et sur ses propriétaires.
Le patron du café m’apprit tout ce que je voulais savoir et même quelque chose de plus, car je sus par lui…
Paul de Tréviannes s’interrompit un instant, puis, après une légère pause, il reprit avec quelque hésitation :
— Cette merveilleuse et adorable créature que j’avais entrevue huit ou dix secondes à peine, qui avait passé devant mes yeux comme la lueur éblouissante et fugitive d’un éclair, et qui, dans ce rapide espace de temps, avait bouleversé toute mon âme et s’en était emparée à jamais, cette femme qui était devenue à la fois le rêve et le désespoir de toute ma vie, c’était vous, madame, vous l’avez compris.
— Moi ? murmura la jeune femme en feignant la surprise.
Mais la parole ardente et profondément émue de Paul de Tréviannes avait produit sur elle une impression qui se devinait au trouble de son regard et au frémissement nerveux qui faisait trembler son éventail dans sa main.
— Oui, madame, murmura Paul à voix basse, oui, cette femme que j’admire et que j’adore jusque dans les plis de sa robe, jusque dans l’insaisissable parfum qui se dégage de sa personne comme de la corolle d’une fleur, cette femme qui désormais tient mon âme et ma vie dans ses mains, qui d’un regard peut me plonger dans un désespoir mortel ou me jeter dans l’extase du bonheur, cette femme, c’est vous, et vous le savez bien, madame. D’où viennent la pâleur et l’altération de mes traits, symptômes si visibles qu’ils inquiètent tous ceux qui m’aiment ? D’où vient le tremblement qui s’empare de moi quand je vous aborde, l’oppression qui m’étouffe quand j’effleure votre main, si ce n’est de cette fatale passion qui brûle mes veines et bouleverse mon âme ?
Paul de Tréviannes était en proie à une telle exaltation, en parlant ainsi, que la jeune femme en fut effrayée.
— Calmez-vous, calmez-vous, je vous en supplie, lui dit-elle à voix basse, votre trouble pourrait me compromettre.
— Pardon, oh ! pardon, madame, balbutia Paul, je me suis laissé entraîner plus loin que je ne voulais. Ah ! vous voyez bien que je suis fou !
Il reprit d’une voix dont l’accent navrant parut impressionner la jeune femme :
— Fou ! ah ! madame, si vous devez toujours rester indifférente à mon amour, qui sait si bientôt je ne le serai pas tout à fait ?
— Monsieur ! murmura madame Taureins avec une expression de pitié dont elle ne fut pas maîtresse.
— C’est alors seulement que je ne serais pas à plaindre, madame, car la folie seule pourrait mettre fin à la plus intolérable torture.
— Je vous en prie, monsieur, ne me parlez plus ainsi ; encore une fois, je crains qu’on ne vous remarque.
— Soit, madame, mais j’avais quelque chose à vous dire, et je ne sais plus… Ah ! je me rappelle, je vous parlais des informations que j’avais recueillies dans un café, voisin de votre habitation. Tenez, madame, je vous demande pardon de ce que j’ai à vous dire et vous supplie d’abord de me croire incapable de rien inventer même dans l’intérêt de mon amour.
— Je crois à votre loyauté, monsieur ; qu’a-t-on pu vous dire contre moi ?
— Contre vous, madame ! Oh ! c’était impossible. On me fit de vous, au contraire, le plus grand éloge, mais…
— Achevez, monsieur.
— Eh bien, madame, ce fut sur un tout autre ton qu’on me parla de votre mari.
— Ah ! fit vivement la jeune femme.
Elle reprit après un moment d’hésitation :
— Et…. que vous a-t-on dit sur son compte ?
— Une chose incroyable, madame.
— Enfin ?
— On m’a dit que, loin d’être adorée à genoux comme elle le méritait, madame Taureins était délaissée et trahie pour la plus indigne et la plus méprisable des créatures.
Il y eut encore une pause.
Puis, la jeune femme reprit avec une légère agitation :
— Si vous m’assurez que vous n’inventez pas…
— Sur mon honneur, je vous le jure, madame.
— Ce serait un moyen odieux et indigne d’un homme de cœur.
— C’est pour cela, madame, que je suis incapable de l’employer.
— On connaît cette femme ?
— Oui, madame.
— C’est infâme.
Elle ajouta après un silence :
— Son nom ?
— La marquise de Santarès.
— Marquise !
— Oh ! fit ironiquement Paul de Tréviannes, marquise jusqu’au jour où il lui plaira de se faire duchesse.
— Je comprends.
— Au reste, elle demeure rue des Martyrs et c’est tout dire, madame.
— Ainsi, cette honteuse histoire est connue là -bas, à ma campagne ?
— Connue de tout le pays.
— Comment donc a-t-on pu savoir là une intrigue qui se passe à Paris, et que, naturellement, M. Taureins a dû s’efforcer de tenir secrète ?
— C’est que, madame, répondit le jeune homme avec quelque embarras, il n’a fait aucun effort pour cela… au contraire.
— Au contraire ! que voulez-vous dire ?
— Hélas ! madame, c’est que je touche là au point délicat, difficile de la révélation que j’ai été entraîné à vous faire.
— Quoi, monsieur, il y a quelque chose de plus difficile à dire que ce que vous m’avez appris déjà ?
— Oui, madame.
— Mais qu’est-ce donc, grand Dieu !
— Est-il vrai, madame, que vous ayez fait, il y a deux mois, un voyage dans le Dauphiné ?
— Oui, monsieur, je suis allée passer un mois chez ma mère.
— Et ce mois-là , où pensez-vous que M. Taureins l’ait passé, lui ?
— À Paris, où le retenaient ses affaires.
— Eh bien, vous vous trompez, madame.
— Mais où donc ?…
— Ce mois-là , M. Taureins l’a passé à Savigny.
— Dans notre maison de campagne ? c’est impossible.
— C’est l’exacte vérité, madame.
— Qui serait-il allé faire là , seul ?
— Ah ! c’est que… il n’était pas seul.
— Qui donc avait pu l’accompagner là ?
— La marquise de Santarès.
Madame Taureins resta un moment muette et comme atterrée.
— Oh ! murmura-t-elle enfin avec une expression de dégoût, une telle infamie est-elle possible ?
Elle ajouta en baissant la tête :
— Quelle honte ! quelle humiliation pour moi !
— C’est pour cela qu’elle l’a exigé, madame.
— Mais pourquoi ? que lui ai-je fait à cette femme ?
— Vous êtes l’épouse légitime, c’est-à -dire l’ennemie.
— Pour lui plaire il a commis cette lâcheté ?
— Dieu veuille qu’il n’aille pas plus loin, madame !
— De quel ton vous dites cela ?
— C’est que, dans votre intérêt, madame, je me suis enquis de cette femme, et…
— Et que vous en a-t-on dit ?
— C’est un monstre ; elle a la passion du mal.
— Et c’est là la femme qu’il me préfère ?
— Il y a une raison.
— Laquelle ?
— C’est que cette femme est un prodige de vice en même temps que de méchanceté.
— Horreur ! horreur !
— Enfin, madame, voilà comment l’intrigue de M. Taureins a été connue à Savigny.
— Faites-moi grâce du galop et veuillez me reconduire à ma place, monsieur, je succombe sous le poids de la honte et de l’indignation.
XX
Paul de Tréviannes et madame Taureins avançaient difficilement à travers la cohue qui se produit toujours à la suite d’une danse, quand la jeune femme, s’arrêtant tout à coup et portant la main à sa poitrine, dit d’une voix altérée :
— Conduisez-moi, je vous prie, vers une fenêtre ; j’ai besoin d’air, j’étouffe.
Sept ou huit fenêtres ouvraient sur un jardin, et la plus éloignée était entièrement libre.
Paul parvint à la gagner, après avoir fendu la foule à grand-peine.
La température était exceptionnellement douce, quoiqu’on fût au mois de décembre ; cependant madame Taureins étant décolletée, il pouvait y avoir danger pour elle à s’exposer au grand air.
Paul de Tréviannes le comprit, et, tirant de sa poche un épais foulard blanc, qui lui servait de cache-nez, il le jeta sur les épaules de la jeune femme, en la priant de s’en envelopper.
— Que m’importe ! répondit celle-ci d’un ton indifférent et sans toucher au foulard.
Paul se rapprocha d’elle, et se penchant à son oreille :
— Valentine !
Il se reprit aussitôt :
— Madame, je vous en supplie, prenez soin de vous, ne vous exposez pas.
Valentine ne répondit pas et resta immobile, le regard fixe et perdu dans les ténèbres qui enveloppaient le jardin.
Paul reprit au bout d’un instant :
— Vous l’aimez donc, madame ?
Il ajouta aussitôt avec force :
— Oh ! c’est impossible !
— Je suis humiliée, répondit la jeune femme, voilà tout.
Puis l’interrogeant sans se retourner :
— Qui vous a dit mon prénom ?
— Je l’ai entendu prononcer par une de vos amies au bal du comte de Merval, et si vous saviez que de fois je l’ai redit depuis au fond de mon cœur ! Valentine ! Ah ! que de charme, que de grâce, que de poésie je lui trouvais, à ce nom qui ne fait qu’un avec vous et me rappelle votre image chaque fois que je le murmure en moi-même ou qu’il frappe mon oreille !
Un soupir presque insensible s’échappa de la poitrine de la jeune femme.
Elle comparait sans doute le langage et les sentiments de ces deux hommes, celui qu’elle eût dû aimer et celui qui devait lui rester à jamais étranger, pensée d’où se dégageait une profonde tristesse.
— Écoutez-moi, madame, reprit Paul de Tréviannes après un long silence, j’ai une grâce à vous demander et c’est à genoux que je voudrais vous supplier de ne pas me la refuser.
— Que voulez-vous dire, monsieur ? répondit Valentine avec une affectation de froideur que démentait le léger tremblement de sa voix.
— Madame, un homme capable de trahir une femme telle que vous et de s’attacher à la créature que vous savez, cet homme-là n’a que de mauvais instincts et l’on peut tout redouter de lui, surtout lorsqu’il subit l’empire d’une femme comme cette marquise de Santarès, votre ennemie. Vous êtes donc dès à présent exposée à des dangers de toute nature et d’autant plus effrayants que, ne pouvant les prévoir, il vous est impossible de vous en garantir. Eh bien, madame, la grâce que je vous demande, c’est de me permettre de me mêler à votre vie pour la protéger, en épiant ces deux ennemis et en vous défendant contre eux.
— J’espère, monsieur, répondit Valentine, que vous exagérez la situation, fâcheuse sans doute, qui m’est faite par cette indigne liaison, mais qui ne saurait aller jusqu’à m’exposer à …
— Madame, je vous en prie, interrompit vivement Paul de Tréviannes, ne vous obstinez pas à fermer les yeux devant l’évidence et à nier les périls trop réels qui planent sur vous dès à présent, je vous le jure, et j’en ai pour garant le caractère bien connu de cette odieuse créature à laquelle, dans son monde, on a donné le surnom de la Vipère.
Madame Taureins hésita longtemps à répondre.
— Monsieur, dit-elle enfin, je veux croire à la loyauté et au désintéressement des sentiments qui vous animent à mon égard, mais vous comprenez que je ne saurais accepter une offre qui me mettrait dans cette étrange situation de voir en vous mon appui, mon défenseur naturel, et un ennemi dans mon mari.
— Votre ennemi, madame, mais il l’est depuis longtemps, il l’est depuis le jour où il vous a fait l’injure insigne d’installer chez vous publiquement la plus infâme et la plus dégradée des créatures. Elle a voulu vous infliger cet affront, et il y a consenti ; mais croyez-moi, madame, ce n’est là que le premier pas vers le but qu’elle se propose, but mystérieux, mais redoutable, car cette misérable ose voir en vous une rivale, et une rivale d’autant plus détestée, qu’elle a sur elle toutes les supériorités, y compris la beauté, celle qu’elle apprécie et qu’elle estime par-dessus tout. Aussi ne s’arrêtera-t-elle pas là , je vous le répète, et lui, il consentira toujours, il consentira à tout.
— Monsieur, répliqua Valentine d’une voix tremblante, avez-vous donc juré de me faire mourir de frayeur ?
— Je voudrais vous ouvrir les yeux et vous décider à regarder l’abîme qui se creuse sous vos pas ; je voudrais surtout vous faire comprendre que vous ne pouvez rester sans défense en face de deux ennemis qui vont s’acharner à votre perte, tout vous l’atteste, et vous résoudre à me confier la mission de veiller sur votre destinée.
— Eh bien, soit, monsieur, répondit la jeune femme, cédant enfin sous l’empire de la terreur qui venait de s’emparer d’elle, je consens à ce que vous me demandez, mais à une condition.
— Dites, madame.
— C’est que votre générosité ne vous exposera vous-même à aucun danger et que vous renoncerez à me protéger du jour où vous vous verrez menacé par mes ennemis.
— Mais, madame, c’est une lâcheté que vous me demandez là , vous n’y réfléchissez pas.
— C’est vous, monsieur, qui ne songez pas combien je serais très-coupable de consentir à ce que vous écartiez de ma tête, pour les attirer sur vous, la haine et la vengeance de mes ennemis.
— Quoi ! madame, vous voulez que je me retire de la lutte dès que je me verrai menacé personnellement et que je vous laisse à la discrétion des ennemis dont l’audace et la méchanceté m’auraient fait reculer ! Mais, si j’étais capable de prendre un pareil engagement, vous me mépriseriez, madame, et vous auriez raison.
— Ces sentiments sont fort nobles, monsieur, et je les comprends de votre part, répliqua Valentine, mais ma conscience ne parle pas moins haut que votre honneur, et je ne veux pas, vous m’entendez, monsieur, je ne veux pas m’exposer au remords d’avoir causé votre perte pour me sauver moi-même.
— Mais, madame…
— Je n’écoute plus rien ; voulez-vous prendre cet engagement oui ou non ? À cette condition seulement j’accepte vos services et je me mets sous votre protection.
— Puisque vous le voulez absolument, madame, soit donc, je prends l’engagement que vous exigez de moi.
— Merci, et comptez sur ma reconnaissance.
Puis, enlevant de ses épaules le foulard qui les couvrait, elle le rendit à Paul de Tréviannes en lui disant :
— Je me sens mieux, je vais regagner ma place.
Elle prit le bras qui lui était offert et se dirigea vers le coin du salon où Paul était venu la prendre.
Comme elle jetait de tous côtés des regards furtifs, le jeune homme lui dit à voix basse :
— Soyez sans inquiétude ; j’aperçois votre mari à une table de jeu où il était déjà quand je suis allé vous inviter.
Il ajouta avec embarras :
— Après ce qui vient d’être convenu entre nous, madame, il faut que vous sachiez qui je suis, mon nom…
— Je le sais, dit Valentine en se troublant légèrement.
Et, tout émue de cet aveu, elle le quitta brusquement pour aller rejoindre ses amies, déjà revenues à leur place.
Paul de Tréviannes était resté immobile, plongé dans un inexprimable ravissement.
— Elle savait mon nom murmura-t-il d’une voix profondément altérée.
Son bonheur et celui de la jeune femme eussent été singulièrement troublés s’ils eussent pu soupçonner ce qui se passait sous la fenêtre, près de laquelle avait eu lieu cet entretien.
Ce jardin était de plain-pied avec les salons.
Or, cinq minutes après l’instant où Paul de Tréviannes et madame Taureins s’étaient approchés de cette fenêtre, une ombre se glissant dans les ténèbres avec des précautions infinies venait se blottir juste au-dessous d’eux, et là , perdue dans l’obscurité, écoutait, sans en perdre un mot, le dialogue auquel nous venons d’assister.
Les deux amoureux une fois partis, l’ombre sortait de sa cachette et rentrait dans la salle.
C’était Mac-Field.
Mais à peine celui-ci avait-il quitté le jardin, qu’une seconde ombre, également blottie sous la fenêtre, à quatre ou cinq pas de Mac-Field, pour lequel elle était invisible, se retirait à son tour vers la porte du salon, où elle rentrait.
Cette ombre-là se nommait Albert de Prytavin.
Le jeune homme, après s’être assuré d’un coup d’œil que ni Mac-Field ni sir Ralph ne l’avaient vu revenir du jardin, alla rejoindre aussitôt M. Portal, c’est-à -dire Rocambole, qui se promenait en l’attendant.
— Eh bien, lui demanda celui-ci, qu’as-tu appris par là ?
— J’ai appris d’abord que vous ne vous étiez pas trompé en supposant que Mac-Field ne passait dans le jardin que dans le but d’espionner M. de Tréviannes et madame Taureins.
— Qui s’aiment, n’est-ce pas ?
— Une passion insensée.
— Et ce Mac-Field a tout entendu ?
— Il a surpris, comme moi, un secret au fond duquel je devine quelque sinistre mystère.
— Qu’il avait intérêt à connaître ?
— Je le suppose, quoique rien ne le prouve encore cependant.
— Il n’a pas soupçonné ta présence ?
— Heureusement j’ai des yeux de chat, qui voient clair dans les ténèbres, de sorte que j’ai pu me placer à quatre pas de lui sans qu’il m’aperçût.
— Et cette mystérieuse histoire que tu as surprise ?
— Retirons-nous dans un coin plus propice, et je vais vous conter cela.
XXI
HISTOIRE D’UNE PARURE DE PERLES
Mac-Field avait dit en passant à sir Ralph :
— Je viens d’apprendre quelque chose de neuf et d’intéressant concernant madame Taureins, je vais rôder maintenant autour du mari dans la salle de jeu. Je ne sais si je me trompe, mais je crois qu’il se prépare quelque chose de corsé dans ce ménage mal assorti, et que d’ici à peu de jours notre ami Goëzmann aura de quoi leur tailler de la besogne.
Puis il quitta rapidement sir Ralph et se rendit dans la salle de jeu.
On faisait cercle autour de deux joueurs devant lesquels s’étalaient des tas d’or, et des liasses de billets de banque.
Ces joueurs étaient les deux cousins, Mauvillars et Taureins, deux caractères bien opposés, deux types si tranchés et si différents de physionomie, de ton et d’allures, qu’il eût été difficile d’imaginer un plus parfait contraste.
M. Mauvillars, avec sa poitrine bombée, ses larges épaules, son teint ardent, son verbe haut et bref, son rapide coup d’œil, son geste calme et résolu quand il payait ou qu’il abattait ses cartes, sa philosophique insouciance en face de la perte ou du gain, offrait bien le type du beau joueur, préparé d’avance à toutes les chances bonnes ou mauvaises, et ne se laissant jamais accabler par les revers, parce qu’il les a prévus et acceptés résolument avant de commencer la partie.
Tout autre était M. Taureins.
Petit, étriqué de corps et de tournure, le teint blafard, le geste lent et indécis, la voix faible et incolore, il n’abattait ses cartes qu’après de longues hésitations, ramassait avec fièvre l’or qu’il avait gagné et n’avançait qu’avec un tremblement nerveux la somme qu’il avait perdue.
Depuis deux heures qu’ils étaient là , la veine avait été presque constamment du côté de M. Taureins.
Il gagnait une somme assez considérable, on le devinait à son teint, livide quand il perdait, légèrement coloré quand la fortune lui était favorable.
C’était chez lui un indice certain et sur lequel on pouvait se baser infailliblement quand il était assis à une table de jeu.
— Ah çà , cousin Taureins, vous avez donc juré de me ruiner ce soir ? lui dit M. Mauvillars, en avançant une liasse de dix billets de mille francs.
— Ce serait trop long, mon cher Mauvillars, répondit le banquier en se frottant joyeusement les mains.
— C’est que vous avez une veine aujourd’hui !
— Qui n’est pas dans mes habitudes quand je vous ai pour adversaire, répondit M. Taureins. Au reste, vous êtes homme à prendre votre revanche ; et qui sait comment finira la partie ? Ah ! c’est qu’il faut toujours trembler avec vous.
— Allons donc ! vous me gagnez toujours, d’ailleurs c’est justice : vous faites un si galant usage de vos gains au jeu, que la Fortune, qui est femme, doit toujours se ranger de votre côté ; elle ne fait en cela que payer une dette de reconnaissance.
M. Taureins se troubla tout à coup à ce compliment, débité par Mauvillars avec un ton de parfaite bonhomie.
— Je ne vous comprends pas, répondit-il tout en ramassant ses cartes, je ne sais ce que vous voulez dire avec votre galant usage.
— Allons, voyons, ne faites pas le modeste, ou plutôt ne vous défendez pas d’être le modèle des maris. C’était bon à la cour de Louis XV, ces sentiments-là . Mais aujourd’hui, grâce au ciel, on ne rougit plus d’adorer sa femme, surtout lorsque comme madame Taureins elle a tout pour être adorée. Avouez donc que vous l’aimez assez pour lui faire parfois de ces charmantes surprises dont, malheureusement, les maîtresses seules ont trop souvent le privilège.
— Décidément, répliqua le banquier, que ces allusions inconscientes troublaient de plus en plus, vous parlez ce soir par énigmes, ni plus ni moins que les Calchas de la foire de Saint-Cloud ; aussi je renonce à vous comprendre.
— Allons, puisqu’il faut vous mettre les points sur les i, je vais révéler hautement le galant usage que vous avez fait des dix mille francs gagnés par vous à la dernière fête du comte de Merval.
— Comment pouvez-vous savoir…
— J’en sais plus long que vous ne pensez ; le lendemain même, vers deux heures, vous entriez chez Janisset…
— Oh ! je sais, je sais, une folie, inutile de parler de cela, dit vivement M. Taureins, qui avait affreusement pâli.
— Non pas, non pas, s’écria M. Mauvillars, vous m’avez contraint à dévoiler vos vertus conjugales et quoi qu’en puisse souffrir votre modestie, j’irai jusqu’au bout. D’ailleurs, il est bon de mettre de tels exemples, quand on les rencontre, sous les yeux des maris.
Alors, cessant de jouer pour adresser la parole à ceux qui faisaient cercle autour de lui :
— Donc, mesdames et messieurs, dès le lendemain, comme je vous le dis, mon cher cousin entrait chez Janisset et y faisait emplette d’une parure de perles fines dont le prix s’élevait juste à la somme qu’il avait gagnée dans la nuit, dix mille francs, rien que cela ; vous jugez si c’était une merveille.
M. Taureins était sur des épines.
— Allons donc ! balbutia-t-il, qui a pu vous faire un pareil conte ?
— J’étais sûr que sa modestie allait se révolter ; heureusement je puis citer mes auteurs. Celui qui m’a fait ce récit, et non ce conte, est un de mes amis qui vous connaît et vous est inconnu. Il venait acheter deux boutons de diamants pour une destination moins vertueuse que la vôtre ; il est vrai qu’il n’est pas marié ; et le marché s’est fait sous ses yeux ; vous voyez bien que vous avez été pris en flagrant délit et que vous ne pouvez nier votre bonne action.
M. Taureins grimaça un sourire ; il ne pouvait articuler une parole.
— J’avoue même, reprit M. Mauvillars, que j’ai été fort surpris ce soir de ne pas voir votre charmante femme parée de ces belles perles qui doivent lui aller si bien.
— Voyez-vous cette petite cachottière de Valentine ! s’écria une jeune femme qui naturellement avait écouté tous ces détails avec le plus vif intérêt, je l’ai vue hier pour savoir quelle toilette elle porterait ce soir, et non-seulement elle ne m’a pas montré sa magnifique parure, mais elle ne m’en a même pas soufflé mot. Oh ! mais je vais aller la gronder de ce pas et la provenir que je l’irai voir demain tout exprès pour admirer le cadeau de son mari.
Elle fit un mouvement pour sortir.

M. Taureins se tourna brusquement vers elle, et l’œil hagard, les traits bouleversés :
— Pardon, pardon, s’écria-t-il.
La jeune femme s’arrêta.
— Quoi donc ? lui dit-elle.
M. Taureins resta un instant sans trouver un mot à dire.
— C’est que, dit-il enfin, Valentine ignore encore que je lui ai acheté cette parure.
— Comment ! depuis quinze jours que vous l’avez ?
— C’est que, je vais vous dire, c’est un secret.
— Eh bien ! vous les gardez longtemps, vos secrets.
— Voilà pourquoi, reprit le banquier, dont le trouble se trahissait de plus en plus : c’est dans quelques jours l’anniversaire de notre mariage et…
— Et c’est ce jour-là seulement que vous vouliez… Ah ! très-délicat, très-délicat, dit la jeune femme qui, frappée enfin de l’embarras de Taureins, commençait à concevoir de vagues soupçons.
Elle ajouta, en étudiant sur son visage l’effet de ses paroles :
— Et quelle est la date de ce bienheureux anniversaire ?
— Le 3 janvier.
— Eh bien, j’attendrai jusqu’au 4 pour aller voir votre belle parure.
M. Taureins ne put comprimer un tressaillement.
— C’est cela, c’est cela, balbutia-t-il, attendez jusqu’au 4.
— Bon ! pensa la jeune femme, je suis fixée maintenant. Pauvre Valentine !
— Allons, dit alors M. Mauvillars, qui, lui, n’avait rien deviné, l’incident est clos, continuons.
Et il se mit à examiner son jeu.
Mais, comme M. Taureins allait jeter une carte, un domestique s’approcha de lui et lui dit à voix basse :
— Monsieur, il y a là quelqu’un qui demande à vous parler.
— Quelqu’un qui est là , dans les salons ? eh bien, qu’il vienne, je ne puis quitter la partie.
— Pardon, monsieur, c’est que… la personne n’est pas une invitée, et alors je l’ai fait entrer dans le petit salon qui sert de vestiaire.
— Mais, enfin, quelle est donc cette personne ?
— Voici sa carte, monsieur.
Le nom gravé sur cette carte était surmonté d’une couronne de marquis.
Ce nom produisit sur le banquier l’effet de la tête de la Méduse.
Il resta comme pétrifié, le regard fixé sur la carte, les traits livides et les muscles du visage agités de légers tressaillements.
— Que faut-il répondre ? demanda le domestique après un long silence.
— Dites que j’y vais ; j’y vais de suite, dit M. Taureins d’un air égaré.
Le domestique parti, il glissa la carte dans sa poche et se leva en disant à M. Mauvillars :
— C’est pour affaire grave, une importante nouvelle que j’avais intérêt à savoir ce soir même, mais ce ne sera pas long ; attendez-moi, je reviens tout à l’heure.
— Pourquoi ne pas faire entrer cette personne, puisqu’elle est de vos amis ? lui dit M. Mauvillars. Agissez donc ici comme chez vous.
— D’abord, ce n’est pas un ami, c’est un boursier, et vous comprenez…
— Un boursier ! diable ! mauvaise nouvelle peut-être ; je comprends votre trouble.
— Mauvaise, je ne sais encore, mais je crains…
— Courez donc vite ; les affaires avant tout, c’est une devise.
M. Taureins sortit rapidement et s’engagea dans la foule qui encombrait en ce moment la salle de bal et lui faisait obstacle à chaque pas.
Sa marche brusque et heurtée au milieu de ces promeneurs indolents attira de son côté les regards de madame Taureins qui l’aperçut et fut frappée de son air effaré.
Elle regarda autour d’elle et, apercevant Paul de Tréviannes, elle alla à lui.
— Monsieur, lui dit-elle d’une voix brève, je tiens la parole que je vous ai donnée en vous demandant un service à l’instant même.
— Parlez, madame, répondit vivement le jeune homme.
— Tenez, voyez-vous mon mari, là -bas ?
— Oui, il a l’air très-ému.
— Je ne sais pourquoi, mais j’ai peur, je redoute quelque chose ; je vous en prie, tâchez de le suivre et de savoir où il va.
— Comptez sur moi, madame.
XXII
L’ENNEMIE
M. Taureins trouva dans l’antichambre le domestique qui était venu lui apporter la carte de son mystérieux visiteur.
— Où est la personne ? lui demanda-t-il.
— Par ici, monsieur.
Il ouvrit une porte et l’introduisit dans une pièce aux murs de laquelle étaient suspendus de nombreux vêtements ; puis il referma la porte sur lui.
Une femme était là , se promenant dans cette petite pièce avec des mouvements d’impatience.
Ce qui frappait tout d’abord en elle, c’était sa toilette, d’une extrême élégance, mais excentrique et tapageuse au plus haut point.
D’une taille élevée, la tête haute, l’air altier et dégagé, douée d’un embonpoint un peu trop accusé, mais qui, nettement dessiné par les modes modernes, constituait peut-être aux yeux de ses adorateurs habituels une de ses plus puissantes séductions, elle avait une beauté un peu théâtrale qui frappait les yeux et saisissait l’imagination au premier abord.
Elle avait de grands yeux fauves, un beau teint de brune, chaud et coloré, une abondante chevelure, d’un roux splendide, mais évidemment artificiel, car tout, dans son type, attestait que le noir devait être la couleur naturelle de ses cheveux, et une bouche petite et mince, dont l’expression perfide, enfiellée et froidement méchante faisait songer vaguement à un reptile.
Elle portait au cou et aux oreilles une merveilleuse parure de perles, dont quelques-unes étaient d’une grosseur prodigieuse.
C’était une beauté excitante qui donnait en même temps le vertige et inspirait un inexplicable sentiment d’inquiétude et presque d’effroi.
— Vous voilà enfin, ce n’est pas malheureux, dit-elle au banquier dès qu’elle l’aperçut.
— Vous ! vous ici, s’écria le banquier d’un air atterré.
— Oui, moi ici, répondit-elle avec un mélange d’ironie et de rage concentrée ; mais reléguée au vestiaire comme un vieux manteau, tandis qu’elle étale ses belles épaules et sa magnifique toilette à l’éclat des bougies, elle !
L’accent avec lequel elle avait prononcé ce dernier mot était sinistre. On y sentait vibrer tout ce que la voix humaine peut exprimer d’envie, de haine insatiable et d’ardente soif de vengeance.
— Voyons, Nanine, parlons d’autre chose, lui dit M. Taureins ; que vous a-t-elle fait, après tout, pour que vous la détestiez ?
— Moi, la détester ! s’écria Nanine avec un éclat de rire furieux, dites tout de suite que je l’envie pendant que vous y êtes ! Et qu’aurais-je donc à lui envier s’il vous plaît ? Sa tête fade et insignifiante ? sa douceur de pensionnaire ? sa vertu… forcée ?
— Nanine !…
— Oui, forcée, car elle porte le grand nom des Taureins et noblesse oblige.
Et elle partit d’un nouvel éclat de rire.
Puis, changeant tout à coup de ton :
— Si je n’étais plus belle qu’elle, pourquoi donc m’auriez-vous préférée ?
— Vous avez raison, mon amie, répondit le banquier, faisant évidemment tous ses efforts pour la calmer.
— Pourquoi m’auriez-vous donné cette parure de perles, si vous n’étiez convaincu que je la porterais en grande dame, tandis qu’elle lui donnerait à elle l’air d’une bourgeoise endimanchée ?
— Eh ! mon Dieu ! oui, je conviens de tout cela, dit le banquier, disposé à toutes les concessions pour obtenir la paix, mais encore une fois à quoi bon toutes ces récriminations ?
— Au fait, vous avez raison, on croirait vraiment que je m’abaisse jusqu’à l’envier, comme vous venez de le dire si finement.
— Eh bien, non, vous ne l’enviez pas, vous ne la haïssez pas, vous n’avez aucune raison pour cela, voilà qui est bien convenu, et maintenant, dites-moi, je vous prie, ce qui vous amène ici.
— Très-volontiers. Mais d’abord, savez-vous d’où je viens ?
— Je ne le devine pas.
— De l’opéra.
— Comment ! mais il est deux heures.
— Ah ! c’est qu’en sortant de l’Opéra, je suis allée souper.
— Où donc et avec qui ? demanda le banquier avec l’expression d’une vive inquiétude.
— Chez Rosa, duchesse du Pont-de-l’Arche… comme je suis marquise de Santarès ; un souper fin commandé chez Potel et Chabot ; une petite fête intime tout à fait charmante, et d’une décence…
La mère en eût permis le spectacle à sa fille.
Nous avons ri tout le temps.
— Mais, encore une fois, avec qui ? reprit M. Taureins, dont l’anxiété devenait de plus en plus visible.
— Il y avait d’abord quatre femmes, toutes plus jolies l’une que l’autre.
— Et puis ?
— Quatre hommes, naturellement ; deux jeunes, un mûr et un ratatiné ; celui-là m’était échu en partage, c’était mon cavalier, mon mourant, comme on disait jadis. Une perruque blonde, pas de dents, le chef légèrement branlant et la voix chevrotante, voilà son portrait en quelques mots.
— Je veux bien vous croire, Nanine ; cependant je ne trouve pas très-convenable que…
— Que je ne reste pas chez moi à rêver de votre image pendant que vous allez dans le monde avec… madame ! Merci ! je n’ai jamais eu de goût pour le rôle de Cendrillon. D’ailleurs, quand je vous dis que j’avais le ratatiné !
— Alors, c’est fort bien.
— Ce qui ne l’a pas empêché de me faire les propositions les plus extravagantes, une voiture, des chevaux et même un château, en attendant son nom et sa main, qu’il m’offrirait le jour où il fermerait les yeux à sa tante, qui s’obstine à les tenir ouverts à quatre-vingt-trois ans, une manie !
— J’aime à croire que vous avez accueilli ces propositions comme elles méritaient de l’être.
— Naturellement, avec les plus grands égards et en le renvoyant à l’époque de la fermeture des yeux de sa tante, qui l’enterrera probablement.
— Après ? demanda le banquier avec humeur.
— C’est tout ; il ne me reste plus qu’à vous dire où je vais.
— C’est pour me faire cette confidence que vous êtes venue ici ?
— Juste, et vous allez me comprendre.
Quand on a passé sa soirée à l’Opéra et qu’on a fait ensuite un petit souper semé de truffes, arrosé de champagne et émaillé d’éclats de rire, on n’est pas en train de rentrer chez soi ; d’ailleurs, je m’ennuie chez moi quand tu n’y es pas, mon Anatole.
Elle s’interrompit brusquement et se pinça les lèvres pour comprimer une violente envie de rire.
— Qu’avez-vous donc ? lui demanda M. Taureins avec humeur, car il comprenait parfaitement.
— Que voulez-vous ? c’est ce petit nom d’Anatole… Enfin, je m’y ferai peut-être.
Bref, il fallait achever ma nuit quelque part, et j’étais justement invitée à une petite fête que donne aujourd’hui mon amie Beppa, comtesse de la Puerta del Sol, qui serait une ravissante Espagnole si elle n’était née rue Maubuée. Comme j’avais parlé de cela pendant le souper, mon vieux duc, car c’est un duc, me propose de me conduire dans sa voiture et de m’accompagner même jusqu’au sein de la fête, ayant depuis longtemps l’honneur de connaître Beppa. Merci ! me voyez-vous entrer dans un bal au bras d’un homme qui a l’air d’avoir séjourné trois mille ans sous une pyramide. Je refuse avec d’autant plus d’empressement, qu’il m’était venu une idée. Je venais de songer à vous, Anat… mon ami, je m’étais dit : C’est dans sa voiture et à ses côtés que je veux me rendre chez Beppa, c’est à son bras que je veux faire, au milieu de la fête, une entrée triomphante. Je me suis dit cela et me voilà .

Puis, regardant tranquillement l’heure à sa montre :
— Deux heures et demie : pas une minute à perdre, hâtons-nous de partir.
Frappé de stupeur à ces derniers mots, M. Taureins regarda quelques instants la marquise de Santarès sans répondre.
— Ah çà ! lui dit-il enfin, ce n’est pas sérieusement que vous me faites une pareille proposition ?
Une subite transformation s’opéra alors sur les traits de la marquise.
Le visage contracté, l’œil ardent, les lèvres serrées l’une contre l’autre, elle se dressa en face du banquier, les bras croisés sur sa poitrine et le regardant dans les deux yeux :
— Je crois, en vérité, murmura-t-elle d’une voix basse et vibrante, que vous me faites l’affront d’hésiter entre moi et elle.
— Mais, ma chère amie, balbutia M. Taureins en pâlissant, vous ne réfléchissez pas à ce que vous me demandez ; quoi ! je suis là avec ma femme, chez un parent, au milieu de sa famille, et je partirais, je la laisserais seule toute la nuit, et je ne serais pas là , au moment de rentrer, pour l’accompagner jusqu’à sa voiture…
— La nôtre pour cette nuit, s’il vous plaît, monsieur Taureins.
Le banquier était atterré.
Il devinait que le ton enjoué qu’avait pris jusque-là la marquise n’était qu’une comédie sous laquelle elle dissimulait la noire méchanceté qu’elle avait préméditée et pour laquelle seule elle était venue.
— Nanine, dit-il enfin d’un ton résolu, je suis à vous demain, après-demain, toute la semaine, tout le mois, si vous voulez ; je suis tout prêt à satisfaire vos caprices, vos fantaisies les plus coûteuses, mais ce que vous voulez exiger de moi en ce moment est impossible, n’en parlons plus.
— N’en parlons plus, soit, répliqua la marquise en changeant tout à coup de ton ; alors c’est à un autre que j’en parlerai, à un autre qui, quoique marié comme vous, mettra à ma disposition sa voiture, sa personne, tout son temps au premier mot que je lui dirai, et n’hésitera même pas à abandonner l’autre pour moi, si tel est mon bon plaisir.
— Le comte Borelli ? murmura le banquier en frémissant.
— Lui-même.
Et, s’enveloppant dans son manteau de fourrures, elle fit un pas vers la porte.
Le banquier se jeta au-devant d’elle.
— Écoutez-moi, Nanine, écoutez-moi, lui dit-il d’une voix saccadée, je vais vous dire…
— Oui ou non, voilà tout ce que je veux entendre, et je n’admets pas l’hésitation ; dans cinq minutes j’aurai passé le seuil de ce cabinet et il sera trop tard.
Elle fit un nouveau pas vers la porte.
— Je consens, balbutia M. Taureins.
— Partons donc, et rappelez-vous que vous et votre voiture vous êtes à moi jusqu’au jour.
M. Taureins chercha son paletot et, un instant après, livide et tout tremblant, il faisait approcher sa voiture et y montait avec la marquise.
— Allons, murmurait celle-ci en partant, cela va bien, je suis curieuse de voir comment la belle Valentine va prendre cela.
XXIII
CANCANS
Nous avons laissé M. Mauvillars à la table de jeu, où il attendait le retour de son cousin.
Au bout de dix minutes, il commença à s’étonner. Il attendit quelque temps encore ; puis, comme la patience n’était pas une de ses vertus, il s’écria brusquement en jetant sur la table les cartes qu’il battait fiévreusement depuis un instant :
— Ah çà , à la fin, se moque-t-il de moi, mon cher cousin ?
— C’est bien étrange, en effet, dit la jeune femme dont nous avons déjà parlé ; il avait promis de revenir de suite et voilà déjà vingt minutes qu’il est absent.
— Et il était en veine ! s’écria M. Mauvillars.
— Et il laisse plus de vingt mille francs sur le tapis ! ajouta l’amie de madame Taureins.
— Je ne reconnais plus ce cher cousin, il sort tout à fait de son caractère.
— Il faut qu’il lui soit arrivé malheur.
— Quelque désastre financier, sans doute, puisque ce visiteur est un boursier, du moins c’est ce qu’il a dit.
— En tous cas, reprit la jeune femme, ce n’est pas un boursicotier, ce ne peut être qu’un gros bonnet de la finance, car j’ai vu sa carte et j’ai parfaitement distingué une couronne au-dessus du nom.
— Qui sait ? dit en riant M. Mauvillars, c’est peut-être le baron de Rothschild.
— Il est permis d’en douter.
— J’en doute en effet.
— D’autant plus que c’était une couronne de marquis.
— Ça s’embrouille de plus en plus alors, dit M. Mauvillars.
Puis se levant tout à coup :
— Au fait, il n’y a qu’un moyen de savoir à quoi s’en tenir, c’est d’y aller moi-même, car ce long retard commence à m’inquiéter.
Il sortit aussitôt et se dirigea vers l’antichambre.
Il y trouva le domestique qui était venu parler à M. Taureins.
— Antoine, lui dit-il, où avez-vous fait entrer M. Taureins et la personne qui l’a fait demander ?
— Là , monsieur, dans ce petit salon, répondit Antoine en montrant le vestiaire.
— Je vais frapper, dit M. Mauvillars en s’approchant de la porte. Il faut que je sache…
— Pardon, monsieur, dit le domestique, mais ils n’y sont plus.
— Où sont-ils donc ?
— Ils sont partis.
— Tous deux ?
— Tous deux…
— Ils ont quitté l’hôtel ?
— Oui, monsieur.
— Par exemple ! voilà qui est fort.
Il reprit :
— Il ne vous a rien dit pour moi en partant ?
— Non, monsieur.
— C’est à ne pas y croire. Il y a là -dessous quelque mystère, quelque guet-apens peut-être !…
Et, se tournant brusquement vers Antoine :
— Cet individu avec lequel il vient de partir, quelle espèce d’homme est-ce ?
Et comme le domestique hésitait à répondre :
— Allons, voyons, répondrez-vous ? s’écria M. Mauvillars.
— C’est que, murmura Antoine avec un embarras visible, je ne sais si je dois dire à monsieur…
— Vous devez tout me dire ; que signifie cette hésitation ?
— Eh bien, monsieur, l’individu avec lequel M. Taureins vient de partir…
— Eh bien ?
— C’est une femme.
M. Mauvillars resta atterré.
— Une femme, dit-il enfin, oh ! une domestique sans doute ?
— Non, monsieur, une grande dame, du moins elle en avait la toilette, sinon les manières, car nous avons remarqué qu’elle était un peu… délurée.
— Bref, cette femme avait l’air d’une cocotte ?…
— Je n’osais le dire à monsieur, mais c’est ce qu’il nous a semblé.
— C’est inouï, s’écria M. Mauvillars avec un mélange de stupeur et de colère, une pareille créature venir le relancer ici, jusque chez moi !… et il part avec elle !
Il ajouta en se parlant à lui-même :
— C’est indigne ! mais il est sorti pour quelques instants sans doute, il ne saurait tarder à revenir.
Et il rentra en disant à Antoine :
— Dès que vous verrez reparaître M. Taureins, dites-lui que je le prie de venir me rejoindre dans la salle de jeu, où je l’attends.
Pendant ce temps, des rumeurs étranges circulaient parmi les invités de M. Mauvillars.
Comment le scandaleux incident que nous venons de mettre sous les yeux du lecteur avait-il franchi l’antichambre et fait irruption dans les salons ? c’est ce qu’il serait difficile de dire, mais il est certain qu’il y était connu une demi-heure à peine après le départ de M. Taureins.
Non-seulement on savait que le banquier avait quitté l’hôtel Mauvillars avec une femme aux allures équivoques, mais on savait encore qu’il avait emmené cette femme dans sa propre voiture, de sorte que, si madame Taureins eût voulu partir, elle eût été obligée de rentrer seule et en fiacre.
Madame Taureins était riche, admirablement belle, d’une extrême élégance et d’une rare distinction ; il n’en fallait pas davantage pour lui créer des ennemies, et elle en avait beaucoup, quoiqu’elle passât en même temps pour être pleine d’indulgence et de bonté.
La belle des belles abandonnée, trahie, publiquement outragée par son mari, il y avait là de quoi faire bondir de joie toutes les femmes laides, mûres, passées ou plâtrées dont les charmes artificiels s’éclipsaient à sa seule apparition.
Aussi vit-on bientôt tout le clan des déshéritées passer et repasser devant la jeune femme, les unes en lui jetant des regards pleins d’une compassion affectée, les autres en comprimant, ou plutôt en laissant deviner de violentes envies de rire sous le mouchoir ou sous l’éventail.
Ce manège dura longtemps sans attirer l’attention de Valentine, trop absorbée dans ses pensées pour rien voir de ce qui se passait autour d’elle.
Elle se demandait avec inquiétude où pouvait être passé son mari, qu’elle ne voyait pas rentrer au bout de trois quarts d’heure, et avec angoisse à quelle cause attribuer la longue absence de Paul de Tréviannes, qui lui avait promis de revenir bien vite lui rendre compte de ce qu’il aurait appris concernant l’air effaré et la sortie précipitée de M. Taureins.
À la fin cependant elle finit par remarquer ces regards et ces sourires, ces affectations de gaieté et de compassion, et, comprenant bientôt qu’elle était l’objet de ces manifestations malveillantes, elle se demanda avec un violent serrement de cœur de quel malheur elle pouvait être menacée.
La pensée de son mari lui vint aussitôt et, se rappelant l’histoire que venait de lui raconter Paul de Tréviannes, elle eut le pressentiment que le malheur redouté devait lui venir de ce côté.
Elle jeta autour d’elle des regards inquiets et ne vit personne pour la protéger.
Saisie alors d’une espèce de vertige, elle allait se lever et s’élancer vers la salle de jeu, où elle venait de voir entrer M. Mauvillars, quand une figure amie, douce, gracieuse et souriante, lui apparut tout à coup comme une bonne fée.
C’était la baronne Aline de Villarsay, la jeune femme dont tout à l’heure les questions avaient si fort embarrassé M. Taureins.
Elle prit place près de celle-ci et, pressant affectueusement sa main dans les siennes :
— Qu’avez-vous donc, ma chère Valentine ? lui dit-elle ; vous paraissez bien émue.
Madame Taureins, en quelques mots, lui apprit la sortie de son mari tout effaré et la mit au courant de ce qui venait de se passer entre elle et Paul de Tréviannes, qu’elle n’aimait pas, disait-elle, mais dont une dure nécessité l’avait contrainte à accepter les services.
La jeune baronne allait répondre, quand, s’arrêtant tout à coup, elle montra du doigt à Valentine Paul de Tréviannes qui entrait.
— Je brûle de savoir ce qu’il a à m’apprendre, murmura madame Taureins ; mais comment faire ? je n’ose l’aborder.
— Je l’oserai, moi, dit la jeune baronne, je ne l’aime pas et je n’en suis pas aimée ; je puis tout braver.
— Vous le connaissez ?
— À peine ; mais, vu la gravité de la circonstance et pour le plaisir de vous être agréable, je vais brusquer la connaissance.
Elle fit un mouvement pour se lever, mais elle en fut empêchée par un incident inattendu.
Dans son impatience d’avoir des nouvelles de M. Taureins, M. Mauvillars venait de quitter la salle de jeu pour se rendre à l’antichambre, où il voulait interroger de nouveau Antoine au sujet de son cousin, sur lequel il espérait avoir de nouveaux détails.
Il passait devant les deux amies, madame Taureins et la baronne, lorsqu’il rencontra précisément là Paul de Tréviannes, qui l’arrêta et lui dit à haute voix, de manière à être entendu de toutes les femmes qui, en ce moment, se repaissaient des angoisses de la pauvre Valentine :
— Ah ! monsieur Mauvillars, je vous cherchais pour m’acquitter d’une commission.
— Je vous écoute, monsieur de Tréviannes.
— Vous aviez une partie en train avec M. Taureins ?
— Oui, et même assez importante ; aussi ai-je été surpris d’apprendre qu’il venait de quitter l’hôtel sans même me prévenir.
— C’est moi qu’il a chargé de ce soin, monsieur Mauvillars.
— Vous, monsieur de Tréviannes ?
— Je sortais pour reconduire un ami dans ma voiture, lorsque je l’ai vu montant dans la sienne avec la personne qui est venue interrompre votre partie, et il m’a prié de vous dire la cause de son départ subit.
— Et cette cause ?
— Un client, avec lequel il fait des affaires considérables, étant tombé subitement et très-dangereusement malade, il y a quelques heures, lui a envoyé sa femme avec recommandation expresse de le ramener immédiatement près de lui.
— À la bonne heure, voilà qui explique tout, s’écria M. Mauvillars ; et moi qui voyais là une aventure galante ! Ah ! pauvre Taureins !
XXIV
COMPLOTS DE FEMMES
Le groupe féminin qui circulait depuis quelques instants autour de madame Taureins s’était dissipé comme une bande d’oiseaux de nuit.
L’explication si claire et si simple que venait de donner Paul de Tréviannes d’un fait dans lequel elles avaient vu pour le moins un sanglant outrage pour une rivale exécrée ne répondait nullement à leur attente.
Cependant quelques-unes émettaient des doutes sur la véracité de ce récit et ne voulaient pas admettre que cette prétendue femme de financier ne fût pas une maîtresse.
— Au reste, disaient celles-ci, nous saurons bientôt à quoi nous en tenir sur ce point ; si l’histoire de M. de Tréviannes est vraie, M. Taureins reviendra prendre sa femme, ou tout au moins lui renverra sa voiture ; si, au contraire, il a été enlevé par une maîtresse, celle-ci se fera un point d’honneur de garder toute la nuit le mari et la voiture, afin de jouer un beau tour à l’épouse légitime.
On attendait donc patiemment l’heure de l’épreuve, c’est-à -dire le moment où madame Taureins quitterait la fête.
Pendant que ces dames se retiraient fort peu satisfaites, la baronne de Villarsay s’approchait de Paul de Tréviannes et lui montrant une place près de madame Taureins :
— Monsieur de Tréviannes, lui disait-elle, j’aurais quelques questions à vous adresser sur cette affaire ; voudriez-vous vous asseoir un instant là près de moi ?
Le jeune homme devina que la baronne n’était que l’émissaire de madame Taureins et que celle-ci avait imaginé ce moyen de se faire donner, sans se compromettre, des renseignements qu’elle devait attendre avec une vive impatience.
Il s’empressa donc de se rendre à l’invitation qui lui était faite par la baronne, qui, pour mieux éloigner les soupçons, s’assit entre lui et son amie.
— Eh bien, monsieur, demanda alors Valentine, qu’avez-vous à m’apprendre ? dois-je croire ce que vous venez de dire à M. Mauvillars ?
— Malheureusement non, madame, répondit Paul.
— Alors, je vous en prie, faites-moi connaître la vérité.
— Si triste et si navrante qu’elle soit, madame, dit le jeune homme, je crois devoir vous l’apprendre tout entière, car il faut que vous connaissiez votre mari, il faut que vous sachiez de quoi il est capable pour être enfin convaincue que vous devez toujours vous tenir en garde contre lui.
— Quelle nouvelle infamie a-t-il donc commise ? est-il vrai que ce soit une femme qui l’a fait demander tout à l’heure ?
— Oui, madame.
— Et cette femme ?
— Toujours la même.
— Cette prétendue marquise…
— De Santarès.
— Vous en êtes sûr ?
— J’étais là , dans l’antichambre, épiant la sortie de M. Taureins, quand la porte du petit salon où il était enfermé s’ouvre enfin et je le vois paraître avec une femme que je reconnais tout de suite.
— Vous la connaissiez donc ?
— Comme tout le monde, pour l’avoir vue cent fois au bois et à toutes les premières représentations.
— Ainsi, devant les domestiques qui étaient là !… Oh ! le malheureux !
— Je tournai le dos dès que je les eus reconnus l’un et l’autre, mais c’était un soin inutile. Il était si absorbé, si violemment préoccupé, qu’il ne m’aperçut même pas. À vrai dire, il était loin de paraître heureux ; pâle et effaré, il cédait évidemment à une pression supérieure à sa volonté et à laquelle il cèdera toujours, comme je vous l’ai déjà dit, madame.
De même qu’il est des amours qui élèvent l’âme et y font germer les plus nobles passions, il en est d’autres qui la dégradent et la poussent fatalement au mal et à l’infamie ; tel est le sentiment qu’inspirent les femmes comme cette marquise de Santarès. Jetées en dehors de la société, qu’elles haïssent et qui les méprise, qu’elles éclaboussent et qui les dédaigne, elles se font une joie féroce d’en bouleverser les règles et d’en violer les devoirs ; et quand elles tiennent sous leur joug de fer un membre de cette société, leur ennemie, leur principale préoccupation est de l’avilir, de le pousser de chute en chute jusqu’à l’oubli de tout, jusqu’au scandale, jusqu’à la ruine, jusqu’au déshonneur, afin de pouvoir dire à ses pareils en leur montrant cette créature avilie : Voilà l’un des vôtres ; quel est donc le plus méprisable, de lui ou de moi ?
— Et c’est là la femme qu’il aime, qu’il me préfère ! murmura Valentine atterrée.
— Monsieur de Tréviannes a raison, lui dit la baronne, il est des hommes dont l’âme ne s’ouvre qu’aux passions malsaines, des hommes qui, pareils à ces hideux reptiles, qui grouillent au milieu de marais fétides ne vivent et ne respirent à l’aise qu’au soin d’une atmosphère empoisonnée, et il faut bien le reconnaître, ma pauvre Valentine, ton mari est de ceux-là .
Puis, se tournant vers le jeune homme.
— Dites-moi, monsieur de Tréviannes, quelle toilette avait-elle ?
— Une toilette de bal, madame.
— Des plus élégantes, naturellement ?
— D’une fantaisie et d’une extravagance éblouissantes, mais qui, je dois l’avouer, convenait parfaitement à son type excentrique et faisait merveilleusement valoir son étrange beauté.
— N’avez-vous rien remarqué dans cette toilette de particulièrement, d’exceptionnellement beau ?
— Oui, une admirable parure de perles.
— C’est cela, murmura la jeune femme.
Elle reprit à haute voix :
— Elle peut être belle, en effet, elle a été payée dix mille francs.
— Par lui ? s’écria Valentine.
— Oui, par lui.
— Mais qui a pu te dire ?
— Je l’ai appris tout à l’heure par le plus singulier des hasards ; il a été contraint d’avouer lui-même qu’il l’avait achetée ; seulement, il a prétendu que c’était à toi qu’elle était destinée. C’est à ce moment que j’ai commencé à soupçonner la cruelle vérité ; mais je ne t’aurais rien dit si elle ne t’était révélée maintenant tout entière. Au point où en sont les choses, je crois comme M. de Tréviannes que loin de te rien cacher, il faut te révéler au contraire tout ce qui peut t’éclairer sur un pareil homme.
— Ainsi, dit Valentine à Paul de Tréviannes, vous les avez vus sortir ensemble de ce cabinet ?
— Oui, madame, mais je ne me suis pas contenté de les voir, j’ai voulu savoir où ils allaient.
— Et vous y êtes parvenu ?
— Voici ce qui s’est passé ; arrivé dans la cour de l’hôtel, M. Taureins a fait appeler sa voiture, qui s’est approchée, et où il a pris place avec elle.
— Elle ! cette femme ! prendre ma place là , publiquement et sous les yeux de mes domestiques, oh !
— Ce n’est pas tout, madame, attendez. Dès que j’eus compris qu’ils allaient partir ensemble, je m’élançai dehors et me jetai dans un fiacre en recommandant au cocher de suivre la voiture, que j’allais lui désigner. Presque au même instant elle passait le seuil de l’hôtel ; je la montrai du doigt à mon cocher, qui sauta sur son siège, fouetta ses chevaux et s’élança sur sa trace. Au bout de dix minutes environ la voiture de M. Taureins s’arrêtait devant une maison de belle apparence, en haut de la rue Blanche. Il y avait là un encombrement de voitures grâce auquel mon cocher put, sans attirer l’attention, s’arrêter tout près de la voiture qu’il avait suivie. J’avais abaissé ma glace pour voir et entendre, ce qui me fut facile du reste, ni M. Taureins ni la marquise ne pouvant soupçonner qu’ils fussent suivis, et voici ce dont je fus témoin. La cour de cette maison étant trop petite pour permettre aux voitures d’y entrer, M. Taureins et la marquise mirent pied à terre près de la porte cochère.
— Faut-il retourner à l’hôtel Mauvillars ou attendre monsieur ici ? demanda alors le cocher à M. Taureins.
Ce fut la marquise qui répondit.
— Il faut attendre ici, dit-elle avec un accent dans lequel perçait une joie perfide, attendre jusqu’à ce qu’il plaise à monsieur de quitter le bal, et je vous préviens que ce ne sera pas avant le petit jour.
— Ainsi, murmura Valentine en pâlissant, non-seulement il me laisse seule toute la nuit, mais ma voiture ne viendra pas me prendre.
— C’était le triomphe qu’avait rêvé la marquise, madame. Je les laissai partir tous deux, puis, dès qu’ils furent entrés, je m’approchai de votre cocher :
— Pierre, lui dis-je, vous comprenez que vous ne sauriez, pour obéir à cette femme, exposer votre maîtresse à l’affront de ne pas trouver sa voiture au moment de rentrer.
Pierre hésitait.
Je lui glissai un billet de cent francs dans les mains, et j’ajoutai :
— Vous êtes prévenu que votre maître ne partira pas avant le jour, c’est-à -dire avant trois heures ; vous avez donc tout le temps de venir prendre votre maîtresse à l’hôtel Mauvillars, de la conduire chez elle et de vous retrouver ici au bout d’une heure.
— Votre cocher comprit cela, et en ce moment, madame, votre voiture vous attend.
— Oh ! monsieur, que de reconnaissance ! murmura Valentine d’un ton pénétré.
— Vous ne soupçonnez pas l’importance du service que vous lui rendez en ce moment, lui dit à son tour la baronne ; le bruit de cette aventure s’est répandu ici, et quelques méchantes créatures se réjouissent à la pensée que ma pauvre amie sera obligée de s’en aller dans un fiacre ou dans une voiture d’emprunt.
— Nous allons tout de suite détruire cette illusion. Êtes-vous disposée à partir en ce moment, madame ?
— Tout de suite, répondit Valentine.
— Attendez et écoutez.
Il sortit et passa dans l’antichambre, d’où il revint bientôt pour aller se perdre dans la foule.
On ne dansait pas en ce moment, et la salle de bal était presque silencieuse.
Alors un domestique, debout en haut du perron, mais se tournant de manière à ce que sa voix parvînt au salon, dont la porte avait été laissée ouverte à dessein par Paul de Tréviannes, cria d’une voix retentissante :
— La voiture de madame Taureins !
Valentine se leva et traversa gravement le groupe malveillant qui s’était rapproché tout à coup.
— C’est impossible, dit l’une de ces femmes, la voiture n’y est pas, nous allons assister à un curieux spectacle.
Et deux ou trois d’entre elles suivirent madame Taureins à quelques pas.
Un instant après elles rentraient fort désappointées elles-mêmes et disaient à leurs dignes amies :
— Sa voiture était là ; décidément l’histoire de M. de Tréviannes était vraie, c’était la femme d’un client et non une maîtresse.
XXV
LES ENNEMIS EN PRÉSENCE
Un des invités de M. Mauvillars avait quitté la salle de bal un peu après M. Taureins, c’était Albert de Prytavin, l’enfant d’adoption de Rocambole ; nous saurons bientôt pourquoi.
L’un et l’autre, le maître et l’élève, après un long entretien avec Gaston de Coursol, auquel Rocambole avait montré les noms inscrits sur le portefeuille tombé entre ses mains, avaient bientôt acquis la conviction que le complot dont la comtesse de Sinabria avait été la première victime, englobait toute une même famille, la famille des Valcresson, c’est-à -dire les Mauvillars, les Taureins, les Sinabria et Tatiane Valcresson, cette dernière notée d’un signe particulièrement menaçant.
Instruits ensuite des terribles menaces adressées à la comtesse de Sinabria et des rendez-vous que l’auteur de la lettre lui donnait à quelques jours de là chez M. Mauvillars, ils avaient demandé deux lettres d’invitation pour cette fête, où ils trouvaient l’occasion, si ardemment souhaitée, de voir enfin face à face l’homme dans lequel ils devinaient à la fois l’organisateur du complot dont la comtesse avait été victime, le propriétaire du portefeuille qui renfermait des secrets d’une si haute importance et le chef de la bande d’Aubervilliers.
Grâce à la comtesse de Sinabria, qui les avait demandées à madame Mauvillars, Rocambole et Albert avaient reçu ces lettres et n’avaient pas manqué d’en profiter, comme nous l’avons vu.
Une fois sur le champ de bataille, car pour eux cette fête n’était pas autre chose, ils avaient d’abord constaté que tous les personnages signalés se trouvaient réunis là , puis ils s’étaient attachés à les suivre et à les étudier tous avec la plus sérieuse attention, tout en paraissant s’absorber dans le plaisir de regarder les danses et d’admirer les jolies femmes et les splendides toilettes.
Un peu après avoir quitté le jardin où il surprenait en même temps les secrets du ménage Taureins et l’espionnage dont la jeune femme était l’objet de la part de Mac-Field, Albert de Prytavin rentrait dans la salle de bal.
Alors, se retirant avec Rocambole dans un coin à peu près désert en ce moment, ils avaient résumé le résultat de leurs observations dans le courant de la soirée.
— D’abord, dit Rocambole, il me paraît surabondamment prouvé maintenant : 1° que les deux individus que nous avons entendu annoncer sous les noms de Mac-Field et de sir Ralph sont les chefs de la bande d’Aubervilliers ; 2° que sir Ralph est l’auteur de la lettre écrite à la comtesse de Sinabria, qu’il n’a invitée à danser que pour lui faire connaître les conditions auxquelles il voulait bien s’engager à ne pas la perdre ; 3° que la liaison de M. Taureins et de cette effroyable créature connue sous le nom de marquise de Santarès n’est autre chose qu’un des engrenages de la mystérieuse machine dans laquelle doit passer toute la famille Valcresson ; 4° que cette charmante jeune fille qu’on appelle Tatiane est particulièrement menacée par sir Ralph, qui me fait tout l’effet d’en être violemment épris ; 5° enfin que toute cette famille est enveloppée et déjà prise dans un vaste réseau de complots, profondément combinés, témoins ceux dans lesquels se débattent dès à présent la comtesse de Sinabria et madame Taureins. Voilà ce que nous voyons clairement, mais un point reste obscur pour nous, c’est la raison cachée, c’est le mobile secret de ces sinistres machinations, et tant que nous n’aurons pas réussi à éclaircir ce point capital, nous marcherons à tâtons vers le but que nous nous sommes proposé, et nous risquerons fort, conséquemment, de nous perdre dans les ténèbres. Nos ennemis ont sur nous un avantage immense, incontestable : ils savent ce qu’ils veulent et où ils vont ; pour les combattre efficacement, il faut que nous pénétrions leurs desseins. On ne peut opérer une contre-mine qu’à la condition d’être parfaitement renseigné sur la mine qu’on veut détruire. Le mal que font nos ennemis, nous le savons, mais pourquoi le font-ils ? Voilà ce que nous ignorons et ce qu’il faut absolument savoir ; c’est à ce résultat suprême que doivent tendre nos efforts.
— Oui, maître, mais voilà le difficile, je ne dis pas l’impossible, car vous nous avez prouvé cent fois que ce mot-là n’existait pas pour nous. Que faire pour arriver à connaître un secret dont ils ne parlent qu’entre eux et en s’entourant des plus grandes précautions ?
— C’est pourtant ce qu’il faudra trouver, et nous en viendrons à bout. Le plus pressé, quant à présent, c’est d’avoir des alliés et des espions sur tous les points menacés, c’est-à -dire chez la comtesse de Sinabria, chez les époux Taureins et chez M. Mauvillars pour Tatiane. Chez la comtesse, nous avons un allié naturel dans M. de Coursol, doublement intéressé à veiller et à nous renseigner, puisqu’il est exposé exactement aux mêmes dangers que la comtesse. En ce qui concerne les Taureins, notre ligne est toute tracée et notre allié est tout trouvé.
— Qui donc ? demanda Albert.
— Paul de Tréviannes, qui, lorsque je lui aurai signalé les trames ténébreuses ourdies autour de celle qu’il aime, et dont il ne sait que la surface, sera à nous corps et âme. Si je l’ai bien jugé, et je me crois bon physionomiste, c’est un homme d’énergie et d’intelligence tout à la fois, et nous aurons en lui un instrument précieux. Pour ne rien négliger concernant les Taureins, il faut aussi nous créer des intelligences chez la marquise de Santarès ; j’entrevois déjà un moyen… Mais c’est tout un plan à mûrir et nous en reparlerons plus tard. Quant à M. de Tréviannes, il n’y a ni ruses, ni détours à prendre avec lui, c’est un homme loyal, auquel nous avons à proposer loyalement notre concours pour sauver celle qu’il aime des plus redoutables périls ; nous n’avons donc qu’à aller droit à lui, et je me charge de la négociation. Reste la pauvre et innocente colombe sur laquelle ce sinistre vautour de Ralph étend déjà sa serre d’acier, la charmante Tatiane. Quels sont nos alliés de ce côté ? Je n’en vois pas. M. Mauvillars est un homme énergique et intelligent, mais tout d’une pièce, qui va droit au but en toutes choses et qui, au lieu d’employer la ruse pour circonvenir sir Ralph et arriver à le prendre dans nos pièges, lui et les siens, perdrait tout par une franchise maladroite. N’ayant donc aucune intelligence de ce côté, il faut songer à nous en créer, et commencer naturellement par nous faire renseigner sur le personnel de la maison Mauvillars. Voilà ce dont nous nous occuperons dès demain, mais nous avons autre chose à faire cette nuit même, c’est de faire filer sir Ralph et Mac-Field pour connaître leur demeure d’abord et savoir ensuite quelle situation ils se donnent dans le monde. Milon doit rôder autour de l’hôtel.
— Oui, et je sais où le trouver.
— Va et prends tes mesures avec lui, il faut absolument que nous sachions où gîtent ces messieurs, et nous avons ce soir une occasion que nous ne retrouverions peut-être pas.
Le jeune homme allait s’éloigner.
Rocambole le retint.
— Un avertissement, d’abord, lui dit-il. Malgré toutes nos précautions, sir Ralph et Mac-Field se sont aperçus que nous les observions. J’ai vu cela ; or, comme ils ne sont pas plus naïfs que nous, et que, dans l’œuvre qu’ils poursuivent, ils doivent toujours être en éveil et se tenir sur leurs gardes, il n’y aurait rien d’impossible à ce que, de leur côté, il leur vînt la pensée de savoir cette nuit même quels sont ces deux personnages dont, j’en suis sûr, ils se défient déjà .
— C’est fort possible, en effet, et, en ce cas, que devrait faire Milon ? nous prévenir aussitôt naturellement ?
— Au contraire.
— Comment ?
— Nous partirons les premiers : si ces messieurs ont l’intention de nous suivre, ou de nous faire suivre, Milon, qui sera là aux aguets, et auquel tu les auras désignés, verra tout de suite si leur voiture ou celle de quelqu’un de leurs acolytes prend la même direction que la nôtre.
— Bon ! mais que fera-t-il alors ?
— Mac-Field et sir Ralph se chargent de la besogne eux-mêmes, il fera comme eux, il nous suivra jusqu’à la rue Amelot. Une fois là , il les laissera observer le terrain, en ayant soin de se dissimuler avec son fiacre dans quelque encoignure de rue ; puis, dès qu’il verra repartir leur voiture, il lancera la sienne sur leur trace, bien certain qu’alors ils se laisseront suivre sans défiance, complètement rassurés par le facile succès qu’ils viendront d’obtenir.
— En effet, la ruse est excellente, en admettant toutefois qu’il vous soit indifférent que votre demeure soit connue de ces misérables.
— J’y tiens beaucoup au contraire ; ils ne manqueront pas de tenter quelque coup contre moi et c’est là que je les attends. Ma maison va devenir pour eux une souricière, où il est impossible que je n’en prenne pas au moins un, et une fois celui-là en mon pouvoir, je me charge de le faire parler. Allons, va trouver Milon.
C’est alors qu’Albert de Prytavin était sorti, et, comme nous l’avons dit au commencement de ce chapitre, c’était un instant avant M. Taureins qu’il vit entrer d’un air très-agité dans le cabinet où l’attendait la marquise de Santarès.
Au moment où la porte s’ouvrait il aperçut une femme.
— Tiens, tiens, pensa-t-il, que se passe-t-il donc de ce côté ? Il faut que je surveille un peu cela, dès que j’aurai parlé à Milon.
XXVI
DANS LA MONTAGNE
En quittant la cour de l’hôtel Mauvillars, tout encombrée de riches équipages, de valets aux livrées éclatantes, de superbes chevaux qui piaffaient et mordaient leur frein, Albert de Prytavin aperçut, parmi la foule des curieux entassés sur le trottoir opposé, un charbonnier aux traits noircis et portant le costume traditionnel de l’Auvergnat.
C’était Milon.
Albert lui fit un signe imperceptible, tourna à gauche et gagna une rue complètement déserte à cette heure de nuit.
— As-tu quelque chose de nouveau à m’apprendre ? lui demanda le jeune homme.
— Précisément.
— Quoi donc ?
— Il y a une heure environ, comme j’étais là , à mon poste, en face de l’hôtel et feignant de m’extasier sur la superbe livrée de MM. les valets qui venaient faire la roue devant la foule, j’ai vu passer et repasser plusieurs fois un individu de mauvaise mine qui, ensuite, est entré chez un marchand de vin à quelques pas de là .
— Et tu ne l’as plus revu ?
— Attendez. Vu sa mise, ses allures et la station qu’il venait de faire devant l’hôtel Mauvillars, l’idée me vint que ce particulier pourrait bien appartenir à la bande à laquelle nous avons affaire et dont les chefs prennent part à cette fête.
— Oui, ils sont là . Nous le soupçonnions, nous en sommes sûrs maintenant.
— Bon. Cette idée me travaillant de plus en plus, je résolus d’en avoir le cœur net et me glissai vers la boutique du marchand de vin, dans l’espoir d’y découvrir mon homme et de le dévisager un peu. Quelques individus prenaient un canon sur le comptoir, mais il n’était pas parmi eux. Dix pas plus loin, un filet de lumière brillait à travers les volets fermés ; je m’en approche, j’y colle mon œil, et qui est-ce que je reconnais, assis entre deux chenapans de son espèce ? le bandit aux bras rouges, le patron du cabaret de la Providence, enfin ce Rascal que j’ai à moitié étranglé au Café Parisien.
— Précieuse découverte, qui confirme nos soupçons au sujet de cette bande et de ses deux chefs. As-tu remarqué chez ces hommes quelque chose de particulier ?
— Ils buvaient et causaient, ce qui ne m’apprenait pas grand-chose ; seulement, aux regards qu’ils jetaient de temps à autre du côté de la porte, je compris qu’ils attendaient quelqu’un.
— Et tu n’es pas resté pour savoir…
— Impossible, le maître m’avait recommandé de demeurer toute la nuit en face de l’hôtel pour être toujours à même de recevoir ses ordres.
— Nous irons tout à l’heure jeter un coup d’œil du côté de ce marchand de vin ; mais retournons d’abord à l’hôtel Mauvillars, où j’ai laissé en suspens une petite aventure dont je tiens à connaître le dénouement. Je vais m’envelopper dans mon paletot pour qu’on ne soupçonne pas en moi un invité, et nous allons nous dissimuler tous deux dans la foule, où je resterai jusqu’à ce que je voie paraître mon homme et sa compagne, si toutefois ils osent sortir ensemble, ce que je ne puis croire, car ce serait d’un cynisme !…
— Bon ! une histoire d’amour, dit Milon.
— Une histoire infâme, dans laquelle l’amour n’entre pour rien, si j’en crois le caractère bien connu de la femme.
— Allons donc les attendre ; c’est toujours amusant, ces sortes d’aventures.
Un instant après, ils étaient tous deux sur le trottoir où Albert avait aperçu Milon ; mais, au lieu de se mettre en évidence, ils se perdaient dans la foule, de manière à voir distinctement tout ce qui se passait dans la cour de l’hôtel, sans être vus eux-mêmes.
Ils étaient là depuis cinq minutes à peine, quand Albert murmura à l’oreille de Milon :
— La voilà .
Il ajouta aussitôt :
— Elle est avec lui ! Que va-t-il donc se passer ?
La cour de l’hôtel était si vivement éclairée, qu’on distinguait parfaitement à trente pas la physionomie des personnes qui la traversaient.
Quand la marquise parut au bras de M. Taureins, qui paraissait fort embarrassé de cette faveur, une exclamation de surprise s’échappa de la bouche de Milon :
— Quelle est donc cette femme ? demanda-t-il vivement à Albert.
— C’est celle dont je suis venu ici guetter la sortie ; c’est la maîtresse de M. Taureins, dont je te dirai l’histoire, dont la femme est là , au milieu de cette fête.
— Mais celle-ci, reprit Milon avec une certaine agitation, cette femme éblouissante de luxe, quelle est-elle, comment la nomme-t-on ?
— La marquise de Santarès.
— Elle, marquise ! fit Milon en ricanant, elle est marquise comme je suis duc.
— Mais tu la connais donc, toi ?
— Je la connais et je ne la connais pas, mais je l’ai vue dans des circonstances…
— Attends, interrompit le jeune homme, je suis curieux de voir…
M. Taureins venait de faire approcher sa voiture, et il y prenait place à côté de la marquise.
— Le misérable ! murmura Albert, il quitte le bal, où est sa femme, et part avec cette créature.
Au même instant il avisa un jeune homme qui traversait rapidement la cour, le visage enfoui dans son paletot, et qui allait aussitôt se jeter dans une voiture de place, après avoir dit quelques mots au cocher qui, au lieu de partir, resta debout près de la portière, le regard fixé sur la porte de l’hôtel.
— Paul de Tréviannes ! murmura Albert ; ah ! le brave jeune homme ! je devine son intention, il a guetté le Taureins et la marquise, et il épie leur sortie pour les suivre. À la bonne heure ! il ne se contente pas de déplorer le sort de celle qu’il aime, celui-là , il se met en quatre pour la servir et la protéger. Oh ! le maître l’a bien jugé.
Un instant après, en effet, la voiture de M. Taureins franchissait le seuil de l’hôtel et elle était aussitôt suivie par le fiacre dans lequel venait de monter Paul de Tréviannes.
— Et maintenant, dit Albert à Milon, raconte-moi l’histoire de cette femme.
— J’en sais peu de chose, mais assez pour m’étonner de la situation où je la vois aujourd’hui. Mais il faut que je remonte au temps où j’étais occupé pour le compte du gouvernement… au bagne de Toulon, avant l’époque où le maître, m’ayant ramassé dans les bas-fonds du crime, résolut de faire de moi un honnête homme, ce qui m’eût paru impossible alors, ce dont je l’ai béni tous les jours depuis que j’ai connu les émotions de cette vie nouvelle. J’avais pour compagnon de chaîne à Toulon un homme à mine fausse, ignoble et cauteleuse qui respirait le vice et le crime par tous les pores et que tous les camarades avaient pris en aversion ; c’était le n° 990, un Allemand du nom de Goëzmann. Il m’avait raconté sa vie, qui était des plus étranges, des moins exemplaires et dont un incident me frappa surtout. Cela se passait dans je ne sais quelle colonie espagnole ; un jour qu’à la suite d’un assassinat commis sur un pauvre voyageur, possesseur de quelques milliers de dollars, il s’était réfugié dans une montagne abrupte, où il s’engageait vers le milieu du jour, à l’heure où les rayons d’un soleil de plomb tombaient à pic sur ces roches, qu’ils semblaient avoir calcinées, il rencontra tout à coup une créature humaine au milieu de cette solitude incandescente, où ne poussait pas un brin d’herbe, où nul être animé ne pouvait vivre, où ne se faisait entendre aucun bruit, hors l’espèce de crépitement que produisait le sol tout gercé sous la pluie de feu qui l’inondait et en dégageait comme de pales étincelles.
Cette créature humaine, c’était une femme qui s’arrêta brusquement à sa vue, stupéfaite elle-même de rencontrer un homme dans un tel lieu.
À la stupeur que lui avait causée d’abord une rencontre aussi imprévue, succéda aussitôt un vague éblouissement devant la beauté de cette femme, beauté sauvage, mais splendide, d’où se détachaient tout d’abord à son regard émerveillé une taille souple et cambrée aux ondulations de panthère, une abondante chevelure, d’un noir mat et profond, éparse et emmêlée comme une crinière, de grands yeux fauves, au fond desquels on voyait comme un fourmillement d’étincelles, et un teint qui, doré et non brûlé par le soleil, qui semblait être son élément, était à peu près du même ton que ses yeux.
Il remarqua en outre, sans pouvoir s’expliquer cette singularité, qu’elle avait un cercle sanglant à chaque poignet et au-dessus de chaque cheville du pied.
Pour tout costume, elle avait une chemise de grosse toile, qui laissait nus les bras et les épaules, d’un dessin admirable, et une jupe de laine rouge, presque en haillons, qui s’arrêtait à mi-jambe.
Jetée ainsi au milieu de cette étrange solitude, sous cette température de feu, au sein de ces roches calcinées et dorées par le soleil, elle formait un tableau d’une sauvage harmonie, et un grand artiste n’eût pas choisi un autre cadre pour un pareil modèle.
La première minute de saisissement passée, son œil de tigresse fouilla, pour ainsi dire, les yeux de l’homme qui se dressait si inopinément devant elle, puis elle glissa sa main droite dans sa jupe trouée, en tira un revolver et l’armant avec un calme parfait :
— Qui es-tu ? dit-elle à celui-ci.
XXVII
POUR UNE GOUTTE D’EAU
Cette façon d’interroger avait quelque peu déconcerté l’Allemand, qui répondit après un moment d’hésitation :
— Mais je suis… voyageur.
— C’est faux, répondit la jeune femme.
— Mais, répliqua Goëzmann, je vous assure que…
— C’est faux, te dis-je, nul ne voyage dans ces parages, ces montagnes sont, pour ainsi dire inabordables, les plus intrépides n’osent s’y aventurer, on n’y peut venir, à cette heure du jour surtout, que pour s’y cacher ou pour chasser ceux qui s’y cachent, et je te soupçonne d’être de ces derniers.
— Vous vous trompez, señora, répondit l’Allemand, reconnaissant au type et à l’accent qu’il avait affaire à une Espagnole.
— Dis-moi donc franchement, sans hésitation et sans détour, qui tu es et ce qui te pousse dans ces montagnes, dont l’atmosphère est mortelle pour ceux qui n’ont pas l’habitude du climat, et je te préviens que, si tes explications ne me satisfont pas, tu es un homme mort ; pèse donc tes paroles avant de répondre.
Et, en parlant ainsi, elle l’ajustait avec son revolver.
Ils n’étaient qu’à dix pas l’un de l’autre, et Goëzmann, qui n’avait d’autre arme qu’un couteau, n’était pas rassuré.
Il devinait parfaitement à l’expression de sa physionomie, froide et implacable, qu’elle était femme à le tuer comme un chien, pour peu qu’elle doutât de sa sincérité.
Il comprenait en même temps qu’il avait affaire à une nature violente, indisciplinée, en révolte à cette heure contre la société et capable de tout pour échapper au péril auquel elle se croyait exposée.
Quand, après quelques minutes de réflexion, il se fut ainsi rendu compte de sa propre situation et des motifs probables qui avaient poussé cette femme à chercher un refuge dans ces redoutables montagnes, il se convainquit que ce qu’il avait de mieux à faire dans cette bizarre circonstance était de dire la vérité.
— Eh bien, dit-il en étudiant sur le visage de la jeune femme l’effet de ses paroles, je fuis la justice du pays, voilà pourquoi je suis dans ces montagnes, où j’ai cru qu’on n’oserait me suivre.
— Qui me prouve que tu n’as pas imaginé ce mensonge pour mieux me trahir ? répliqua l’Espagnole sans quitter sa position.
Pour toute réponse, l’Allemand mit la main à sa poche, en tira un couteau catalan et l’ouvrit.
La lame était rouge de sang.
— Tu as tué ? demanda la jeune femme sans témoigner la moindre émotion.
— Oui.
— Je t’avais pris pour un limier lancé à ma poursuite.
— Je vous l’ai dit, je les fuis comme vous.
— C’est bien ; maintenant tu peux approcher.
Et elle abaissa son arme, qu’elle garda à la main.
Alors l’Allemand vint à elle.
— Assieds-toi là , sur cette roche, en face de moi, lui dit-elle.
— Je meurs de soif, lui dit Goëzmann, vous qui avez déjà parcouru cette montagne, n’y avez-vous pas rencontré quelque source ?
— Dans la vaste étendue que nous embrassons du regard, un insecte ne trouverait pas à se désaltérer, aussi n’y entends-tu pas même le chant d’un grillon.
— J’ai le gosier brûlant, ma langue se colle à mon palais, cette soif de damné me donne des hallucinations, et au moment de tourner l’angle de cette roche, derrière laquelle je vous ai rencontrée, je sentais mes yeux se voiler et mes jambes fléchir sous moi ; j’allais tomber pour ne plus me relever. L’émotion de cette rencontre m’a ranimé quelques instants, mais le vertige s’empare de mon cerveau, je ne puis faire un pas de plus, je suis perdu.
— De sorte que ton salut à cette heure dépend de quelques gouttes d’eau.
— J’ai là six mille dollars, fruit du meurtre que je viens d’exécuter, je les donnerais sans hésiter pour autant de gouttes d’eau.
Pour la seconde fois l’Espagnole mit la main dans la poche de sa jupe.
Cette fois, ce fut une gourde qu’elle en tira.
— Cette gourde est pleine d’eau et de tafia, dit-elle à l’Allemand qui la dévorait du regard, car avant de m’engager dans cette montagne, si justement appelée la Fournaise par les gens du pays, j’ai songé à deux choses : une gourde et une arme, de quoi combattre les deux ennemis que j’avais à redouter là , la soif et les agents de la justice.
— Je vous en supplie, murmura l’Allemand dont le corps s’affaissait et dont les yeux se voilaient de plus en plus, quelques gouttes seulement… ou je meurs.
— Que donnerais-tu pour boire ?
— Mon or, mon âme, ma liberté, tout, tout ce qu’on me demanderait.
— Veux-tu jurer de m’appartenir corps et âme à tel titre qu’il me conviendra et pour tout ce qu’il me plaira, comme un esclave, comme un chien appartiennent à leur maître ?
— Oui, oui, tout ; à boire, à boire ! balbutia l’Allemand en se traînant à genoux jusqu’à elle.

— Si j’échappe à mes ennemis, reprit l’Espagnole en éloignant sa gourde, vers laquelle le malheureux tendait ses mains suppliantes, si je rentre dans la société, je me sens capable de tout pour y atteindre aux premiers rangs, car j’y reviendrai avec une âme débordant de haine et d’amertume, avec un cœur bronzé, inaccessible à tout sentiment de pitié, dégagée enfin de tous les sentiments, de toutes les considérations qui peuvent entraver la carrière d’une femme ; mais j’ai compris, dans les longues heures de rêverie où je me plongeais là -bas, au sein de mon dur esclavage, j’ai compris qu’isolée dans cette société, la femme la plus énergique, la plus déterminée, serait souvent réduite à l’impuissance et qu’il lui fallait un homme pour associé ; voilà pourquoi je te demande si tu veux être à moi corps et âme.
— À boire ! à boire ! murmura l’Allemand d’une voix haletante et presque indistincte.
— Tu consens, alors ?
Le malheureux fit un signe de tête. Il n’avait plus de salive et faisait de vains efforts pour articuler une syllabe.
— Allons, bois, dit la jeune femme.
Et débouchant sa gourde, elle en appliqua le goulot sur les lèvres de l’Allemand.
Celui-ci but avidement.
Alors tout son être sentit une rapide transformation.
Ses yeux s’ouvrirent et se dilatèrent sous la sensation d’une inexprimable volupté.
Ses traits livides se colorèrent insensiblement.
Un rayonnement de bonheur se répandit sur tout son visage.
En moins de deux minutes, il s’était transfiguré.
— Assez, dit tout à coup l’Espagnole en enlevant la gourde de ses lèvres avides, dans l’état de faiblesse où vous êtes, le tafia mêlé à cette eau pourrait produire l’ivresse, puis le sommeil, et le sommeil ici ce serait la mort, et puis il faut songer à l’avenir, c’est-à -dire aux quelques heures qui nous séparent encore de la nuit, car c’est la nuit seulement que nous pourrons nous hasarder à quitter ces montagnes et à gagner la ville, où, grâce à tes dollars, nous pourrons trouver passage sur un bâtiment en destination pour l’Europe.
Toujours à genoux devant elle, l’Allemand promenait autour de lui des regards où se lisait un débordement subit de vie et de bonheur.
— Ah ! je me sens renaître, murmura-t-il d’une voix profonde.
— Maintenant que les forces te sont revenues, lui dit la jeune femme en se levant, il faut fuir ce soleil de plomb qui, en vérité, ferait éclater notre crâne comme une noix sèche, si nous y restions plus longtemps exposés.
— Mais comment nous y soustraire ? demanda l’Allemand ; le soleil est à pic au-dessus de nos têtes, et je ne vois pas un pouce d’ombre autour de nous.
— Avant de me résoudre à fuir et à me jeter dans la Fournaise, seule voie où les soldats n’osent se hasarder à la poursuite des fugitifs, j’ai pris la précaution de m’entourer de renseignements, et une de mes compagnes de misères, qui un jour avait osé fuir par cette même voie, mais qu’on avait reprise et ramenée quelques jours après, cette compagne m’a indiqué une espèce de caverne ouverte sous un monticule dont elle m’a dit assez exactement la forme et la situation, car je venais de le reconnaître et j’y marchais quand je t’ai rencontré.
— Où est-il donc ?
— Là -bas, ce pic dentelé comme une forteresse.
— Hâtons-nous donc de le gagner, et nous sommes sauvés, si nous trouvons cette caverne.
— Sauvés du soleil, dit l’Espagnole, mais après ?
L’Allemand se leva, et ils se mirent en marche.
XXVIII
HISTOIRE D’AMOUR
Trop accablé jusque-là par les tortures de la soif pour songer à autre chose, l’Allemand, une fois désaltéré et redevenu maître de ses facultés, jeta un coup d’œil sur le site étrange qu’on appelait la Fournaise et il en fut presque terrifié.
C’est qu’en effet il était difficile de se défendre d’un sentiment d’horreur et d’épouvante à la fois devant cet effrayant tableau.
C’étaient, sur une étendue de dix ou douze lieues de circonférence, une centaine de monticules taillés à pic, s’étageant de toutes parts de manière à former comme un gigantesque entonnoir, au fond duquel scintillait une vapeur lumineuse et incolore, dégagée du sol brûlant par les rayons du soleil, qui allaient s’engouffrer dans ces profondeurs.
C’est dans cet abîme embrasé qu’erraient en ce moment, comme au fond d’un cratère, l’Allemand et la jeune Espagnole.
Pas un brin d’herbe, pas même une tache de cette mousse courte et presque impalpable qui s’incruste comme une lèpre sur les granits les plus durs, rien, absolument rien ne se voyait sur ces roches, dont quelques-unes s’étaient teintes de tons mordorés ou jaune clair sous l’action incessante d’un soleil tropical.
— C’est horrible et admirable ! s’écria tout à coup l’Allemand en montrant à sa nouvelle compagne ce sinistre paysage.
— Oui, répondit ironiquement l’Espagnole ; mais ce qui est horrible sans être admirable, c’est notre situation, c’est le sort qui nous attend l’un et l’autre si nous ne parvenons pas à sortir de cet enfer, à gagner la ville et à nous embarquer cette nuit même.
— Pourquoi en désespérer ? dit Goëzmann.
— Je ne désespère jamais, répondit gravement l’Espagnole, mais je ne cherche pas davantage à me bercer d’illusions. Je regarde le péril en face, je le juge froidement ; c’est le seul moyen de vaincre les obstacles.
Au bout d’une demi-heure de marche en plein soleil, au sein d’une atmosphère de feu, ils arrivaient enfin au pied du monticule à la cime dentelée.
C’était là qu’ils devaient trouver la caverne ; c’était là qu’ils allaient trouver l’ombre et la fraîcheur après lesquelles ils aspiraient si ardemment l’un et l’autre.
Mais s’ils allaient être déçus dans leur attente ?
À cette seule pensée, l’Allemand se sentait défaillir.
L’Espagnole, elle, restait grave et impassible.
Il semblait que rien ne pût ébranler ce farouche courage.
— Des plantes ! s’écria-t-elle tout à coup ; un terrain frais a pu seul les produire, la caverne est là , on ne m’a pas trompée.
En effet, des ronces aux feuilles vertes rampaient au pied de la montagne.
L’Allemand y courut, les écarta de la main et jeta un cri de joie à l’aspect d’une profonde excavation d’où sortait une bouffée d’air frais.
— La voilà ! s’écria-t-il, nous sommes sauvés.
Il souleva les ronces comme un rideau et l’Espagnole entra dans la caverne.
L’Allemand l’y suivit aussitôt.
Une fraîcheur exquise enveloppait leurs membres sans les pénétrer, car ils avaient la précaution de rester à l’entrée de la caverne.
Il leur semblait passer de l’enfer dans le paradis. L’Espagnole s’assit sur une grosse pierre qui sortait du sol comme un énorme champignon, et, en montrant une pareille à l’Allemand :
— Assieds-toi là , lui dit-elle, et dis-moi qui tu es, puis je me présenterai moi-même.
— Volontiers, dit l’Allemand, puisque nous sommes associés.
— Hein ? fit la jeune femme en fronçant le sourcil.
— Puisque je vous appartiens désormais, reprit vivement Goëzmann, il faut bien que nous nous fassions connaître l’un à l’autre.
— Parle donc.
— Eh bien, señora, je suis Allemand. Je me nomme Goëzmann. Je me suis toujours connu fort peu de scrupules, et pas mal de mauvais instincts. J’ai beaucoup de vols sur la conscience, mais un seul meurtre, celui qui m’a été payé six mille dollars par la victime, et cette vie de labeurs ne m’a pas conduit à la fortune. Voilà mon histoire, aussi véridique et aussi succincte que possible.
— Elle prouve plus de perversité que d’intelligence ; tu n’as pas su tirer parti de tes vices, voilà ce que je vois de plus clair dans ton histoire, et je ne sais maintenant si je dois donner suite à l’engagement que je viens de prendre avec toi.
— Je crois que vous auriez tort, señora !
— Sur quoi bases-tu cette croyance ?
— Je me sens une véritable vocation pour la fausseté, la trahison, l’ingratitude, et même un certain penchant pour la férocité, que mitige et modère fort heureusement une profonde antipathie pour le péril ; or, je suis porté à croire que ces qualités, exploitées par un esprit déterminé et doué d’initiative, doivent produire les plus beaux résultats.
— Peut-être as-tu raison ; je verrai de quoi tu es capable et te dirai bientôt ce que j’ai résolu.
— À vos ordres, señora.
— Maintenant, à mon tour à te faire ma confession.
— Je n’en ai nul besoin, señora.
— Mais moi j’y tiens ; si nous devons rentrer dans la société, unis par le pacte que nous venons de conclure, il faut que tu me connaisses tout entière pour pouvoir au besoin deviner mes intentions.
— Je m’incline et j’écoute.
— Tu sauras d’abord que je suis née à Madrid, que je me nomme Inès et que je suis sortie des derniers rangs du peuple, car je suis fille d’un aguador. À quinze ans je chantais dans les rues et sur les promenades publiques ; j’étais dans tout l’éclat, dans tout l’épanouissement de ma beauté, que j’entendais vanter partout sur mon passage et qui m’était attestée plus vivement encore par les regards et les déclarations d’amour des plus élégants jeunes gens de la ville.
Si je n’avais eu dans l’âme que l’ambition vulgaire des jeunes filles de ma condition, j’aurais été bien vite perdue, il eût suffi pour cela de quelque riche parure ; mais la triste destinée de quelques-unes de mes compagnes, victimes de leur crédulité, m’avait éclairée et mise en garde contre les mille tentations dont j’étais enveloppée. Je résistai donc longtemps et j’aurais résisté toujours aux excitations de la vanité et de la coquetterie, mais un jour vint où j’aimai… comme devait aimer une nature telle que la mienne, avec toute la fièvre, tous les transports, tous les enivrements, tout l’abandon d’un cœur de seize ans. C’était un jeune homme, du nom de Juan Benavidès, fils d’un riche marchand de Madrid. Je le rencontrais tous les jours sur mon chemin, et lui, au lieu de me lancer en passant de banales galanteries ou d’insultantes propositions, me jetait un regard plein de mélancolie et s’éloignait sans oser m’adresser la parole. Cet amour timide, auquel on ne m’avait pas habituée, commença par me faire rire, puis il me fit rêver, et, éclairée enfin par le sentiment tout nouveau qui m’envahissait à mon insu, je compris que ce respect et cette tristesse étaient les plus purs témoignages d’un véritable amour, et je me sentis profondément touchée. Je ne sais s’il s’aperçut du changement qui s’était tout à coup opéré dans mes sentiments et qui, sans doute, se trahissait sur mon visage chaque fois que je le rencontrais, mais un soir que je traversais le Prado, où je venais de chanter comme de coutume, il osa enfin m’aborder, après avoir longtemps marché derrière moi. Il était si ému, sa voix tremblait tellement qu’il était à peu près impossible de le comprendre ; et pourtant je sentis tout mon être s’épanouir au son de cette voix qui tombait dans mon cœur comme une musique céleste, au bruit de ces paroles confuses, éperdues, folles, sans aucun sens, mais où revenait souvent le mot amour, qui chaque fois me faisait frissonner de bonheur. Je rentrai ravie et bouleversée dans ma petite chambre, qui me sembla éblouissante comme un palais. À partir de ce jour, ces rencontres se renouvelèrent tous les soirs, me laissant chaque fois dans un trouble qui m’eût livrée à lui sans défense si l’occasion s’en fût présentée. Épris l’un de l’autre comme nous l’étions, cette occasion ne pouvait se faire longtemps attendre ; elle s’offrit enfin. Un jour, il me supplia de le recevoir chez moi à l’heure où j’étais assurée d’y être seule, me jurant que c’était à titre de fiancé qu’il réclamait cette faveur, et qu’avant peu de temps je serais sa femme. Je n’hésitai pas à le croire, je l’aimais tant !… Je le reçus chez moi, ne me faisant pas illusion, je dois le dire, comprenant bien que c’était à ma perte que je consentais, mais pleine de foi dans sa parole et le considérant déjà comme mon époux.
À un mois de là environ, je dus quitter Madrid pour aller soigner ma grand’mère, tombée dangereusement malade dans le village qu’elle habitait à quelques lieues de là . Sa maladie se prolongea deux mois, au bout desquels elle mourut, et je revins à Madrid. Deux mois de séparation ! deux mois sans voir mon Juan, sans entendre sa voix me parler d’amour ! Ah ! qu’il avait dû souffrir et avec quelle impatience il avait du m’attendre, moi toute sa vie ! Voilà ce que je me disais en approchant de sa demeure, car j’avais fait pour cela un long détour. J’y arrive enfin, toute palpitante ; la boutique de son père était fermée. Je redoute un malheur ; je me précipite affolée au-devant d’une femme qui passait et lui demande ce que cela signifie.
— Comment ! vous ne savez donc pas ? me dit-elle ; le jeune Juan Benavidès…
— Mort ! balbutiai-je en pâlissant.
Je repris :
— Eh bien ! Juan Benavidès ?
— Il se marie.
XXIX
L’AMOUR D’UNE ESPAGNOLE
Il y eut une pause.
Puis l’Espagnole murmura d’une voix basse et vibrante :
— Marié !… À ce mot il me sembla que toutes mes facultés s’éloignaient à la fois, que je cessais de voir, d’entendre et de penser, comme si j’eusse été foudroyée sur le coup.
La vieille s’en aperçut.
— Qu’avez-vous donc ? me dit-elle, vous voilà blanche comme un linge.
Je me laissai tomber, saisie d’un tremblement subit, sur les marches d’un perron, à l’entrée de sa demeure, à lui.
— Ce n’est rien, dis-je à cette femme, c’est la fatigue, j’ai fait une longue route à pied et je suis brisée.
Elle allait s’éloigner.
Je trouvai la force de lui adresser de nouveau la parole.
— Je connais un peu le señor Juan, lui dis-je, veuillez donc me dire… qui il épouse.
— Sa cousine, une charmante jeune fille, jolie comme les amours.
— Vous la connaissez ? repris-je en posant ma main sur la marche du perron, car je me sentais défaillir.
— Je viens de la voir partir pour l’église.
— Ah ! ils sont à l’église, m’écriai-je en essayant de me lever.
— Ils viennent d’y entrer à peine et c’est tout près d’ici ; oh ! vous arriveriez encore à temps pour voir la cérémonie, qui sera fort belle, car les deux familles sont riches, les deux jeunes gens charmants, je vous assure que ce sera un fort joli coup d’œil.
Et elle s’éloigna en me recommandant de nouveau d’aller jouir de ce gracieux spectacle.
Au bout de quelques minutes, secouant enfin l’espèce d’anéantissement dans lequel j’étais tombée, je me mis à réfléchir.
Puis recouvrant toutes mes forces sous l’empire d’une inspiration subite, je courus à ma demeure, d’abord, qui n’était qu’à quelques pas de l’église, et, mon père n’y étant pas, je pus en sortir presque aussitôt.
Un instant après, j’entrais dans l’église.
Les orgues jouaient une espèce de fanfare.
C’était un chant de triomphe pour célébrer la sortie des nouveaux époux.
Ils venaient du chœur, marchant d’un pas lent et grave, suivis de leurs parents et amis de fête.
Je m’adossai à un pilier et j’attendis, les regardant venir à moi et comptant avec une sombre impatience les secondes qui nous séparaient encore.
Ils arrivèrent enfin.
Alors me détachant du pilier auquel je m’appuyais, je m’avançai vers eux, et, me dressant, grave et pâle, devant le nouvel époux :
— Juan Benavidès, lui dis-je, me reconnais-tu ?
Juan recula d’un pas, tremblant et atterré à ma vue.
Il fixa sur moi des yeux hagards et une pâleur livide se répandit sur ses traits, qui s’étaient affreusement contractés.
Il voulut parler, mais un frisson convulsif agitait ses lèvres et il ne pouvait proférer une parole.
— Juan, repris-je alors, en plongeant mes regards dans ses yeux, me reconnais-tu et te rappelles-tu l’engagement solennel que tu as pris vis-à -vis de moi, il y a deux mois ?
Comme il continuait à garder le silence, son père s’avança vers moi et me dit avec hauteur :
— Que veux-tu dire ? Quel engagement mon fils a-t-il pu prendre envers la fille d’un aguador ?
— Regarde-le, dis-je au vieillard, vois sa pâleur et son égarement et tu comprendras les remords dont il est dévoré à ma vue.
Puis m’adressant de nouveau à Juan :
— Tu m’as odieusement trahie ; tu as foulé aux pieds tes promesses les plus sacrées ; tu m’as fait au cœur une blessure qui saignera toujours, tu m’as pris mon honneur et tu l’as détruit comme un jouet, si bien qu’aujourd’hui je n’ai plus rien, rien ! Je suis souillée ; mon cœur est vide et froid comme un tombeau ; ma vie est finie à l’âge où elle commence pour les autres, et je ne vois autour de moi que ruines, hontes et désastres. Voilà ce que tu as fait de moi, Juan ; voilà ce que je te dois en échange de l’amour le plus dévoué et après les plus solennels serments. Eh bien, Juan, crois-tu que tu aies été assez cruel et que je sois assez malheureuse ?
Il tremblait toujours et ne pouvait détacher ses regards de moi.
Alors, me rapprochant de lui et changeant tout à coup de ton :
— Mais, moi aussi, m’écriai-je, moi aussi j’ai fait un serment ! Et comme il y a dix minutes à peine, je n’ai pas eu le temps de l’oublier comme tu as oublié les tiens ; j’ai juré que n’étant pas à moi tu ne serais à aucune autre, et je tiens ma parole.
Et, m’élançant sur lui, je lui plongeai dans la gorge la lame du poignard que j’étais allée chercher chez moi et que je tenais caché dans ma manche.

Il ouvrit les bras, chercha un appui dans le vide, puis chancela tout à coup et tomba en murmurant :
— Pauvre Inès !
Pauvre Inès !… À cette parole, à ce cri d’amour jeté par lui au moment même où je lui arrachais la vie, je sentis tout mon cœur se fondre dans ma poitrine. Pauvre Inès ! voilà tout le reproche qu’il m’adressait en mourant. Et, ces deux mots, il les avait prononcés du même ton, du même accent dont il les murmurait jadis quand, agenouillé devant moi, il plongeait dans mes yeux ses beaux yeux humides d’amour.
Ce cri fut pour moi un trait de lumière ; la vérité me fut révélée tout à coup avec l’éclat et la rapidité de l’éclair. Il m’aimait toujours. J’avais été jusqu’à la dernière minute son Inès adorée, et, en épousant cette autre, son caractère faible et timide n’avait fait que céder à la contrainte.
À cette pensée, les sanglots me montèrent à la gorge. Je jetai avec horreur mon poignard tout ruisselant et je voulus me précipiter sur lui pour le couvrir de mes baisers, pour boire le sang qui s’échappait de sa blessure.
Mais je me sentis aussitôt saisie et entraînée.
Un instant après, j’étais hors de l’église, en face d’une foule exaspérée qui m’accueillit par des cris furieux et des menaces de mort, car mon crime était déjà connu. Mais que me faisaient la colère et les menaces de ces hommes ? Je passais au milieu d’eux sans les entendre, absorbée toute entière par une vision déchirante, mon cher Juan tombant ensanglanté et me criant d’une voix pleine d’amour et de pitié : Pauvre Inès ! Et tout le long du chemin que je parcourais, au milieu du tonnerre de malédictions qui pleuvaient sur ma tête, je murmurais tout bas, en essayant d’imiter sa voix et son accent : Pauvre Inès ! pauvre Inès ! Et les larmes ruisselaient de mes yeux et inondaient mon visage.
C’est ainsi que j’arrivai jusqu’à la prison.
Un mois après, j’étais jugée et condamnée à passer le reste de mes jours aux Présides, où on ne tarda pas à me transporter.
J’ai passé trois années dans cette épouvantable captivité, au milieu d’un climat mortel pour les Européens, en proie aux brutalités de gardiens choisis parmi les hommes les plus féroces, courbée tout le jour sous des travaux au-dessus de mes forces et fréquemment soumise, par suite de mon caractère indiscipliné, à une aggravation de peine, telle que les fers aux mains et aux pieds, par exemple, dont tu vois encore la trace sanglante.
Enfin, poussée à bout, je résolus de me soustraire par la fuite à cette existence infernale. J’avais toujours été arrêtée dans ce projet par les périls et les obstacles sans nombre qu’offrait le passage de la Fournaise, où plusieurs condamnés avaient trouvé la mort la plus horrible, la mort par la chaleur et par la soif ; mais, comme je te l’ai dit, une de mes compagnes, qui avait accompli avec succès ce terrible trajet, mais qui avait été ramenée parmi nous, m’ayant donné des instructions, tant sur les précautions que je devais prendre, que sur le chemin que j’avais à suivre, mon parti fut aussitôt pris. Il y a quatre heures environ, comme nous étions à travailler une terre aride, en plein soleil, je saisis le moment où nos gardiens, accablés par ce soleil de plomb, s’étaient tous endormis, et mes compagnes m’ayant aidée à me débarrasser de mes fers, non sans faire saigner mes membres, je suis partie. J’emportais avec moi cette gourde qui t’a sauvé la vie, quelques biscuits, et un revolver à six coups tout armé. Grâce à mon énergie, j’ai surmonté à peu près tous les obstacles, j’ai trouvé cette grotte dont la fraîcheur va calmer notre sang embrasé et nous permettre de goûter un repos dont nous avons grand besoin pour affronter de nouveau le soleil et la fatigue d’une longue marche sur un sol brûlant, car nous n’aurons pas franchi avant trois heures les dernières limites de la Fournaise.
Après deux heures de repos, l’Allemand et la jeune Espagnole se remettaient en route.
Quelques heures après ils arrivaient à un port de mer, trouvaient un navire en partance pour l’Espagne, où ils arrivaient après trois semaines d’une rude traversée, puis passaient les Pyrénées pour venir en France, où Goëzmann ne tardait pas à se faire pincer pour une vieille peccadille qui lui valait une condamnation à cinq ans de travaux forcés.
C’est à cette circonstance que j’ai dû de faire sa connaissance à Toulon.
Or, il y a environ quatre ans, je traversais le boulevard, par une journée de dégel, quand j’aperçois mon Allemand pataugeant dans la neige fondue avec une femme à son bras, une femme splendide et dont la beauté me frappa d’autant plus qu’elle était misérablement vêtue.
Cette femme, c’était celle que vous appelez la marquise de Santarès…
XXX
OÙ IL EST QUESTION DE NIZZA
— Voilà une étrange histoire, dit Albert de Prytavin, quand Milon eut terminé son récit.
— Et vraie de point en point, j’en suis convaincu, répliqua Milon.
— Crois-tu que la femme que tu as vue clapotant dans la neige fondue au bras de l’Allemand soit cette beauté sauvage qu’il avait rencontrée au sein des montagnes ?
— Je suis porté à le croire, car son type se rapportait assez bien au portrait qu’il m’avait tracé de l’autre, mais modifié par les cinq ou six années qui s’étaient écoulées depuis cette singulière rencontre et par les dures épreuves qu’elle traversait évidemment le jour où je les ai croisés sur le boulevard.
— Et tu es sûr que la magnifique et élégante créature qui vient de partir dans la voiture de M. Taureins est la même que tu as rencontrée sur le boulevard, il y a quatre ans ?
— Je le jurerais.
— Quelle était la couleur des cheveux de celle-ci ?
— Noirs, tout ce qu’il y a de plus noir.
— Comme la belle Espagnole de la montagne ?
— Justement.
— Tandis que la marquise de Santarès est rousse.
— Qu’est-ce que ça prouve ? Sinon que le roux est à la mode et que cette couleur doit être celle de toutes les femmes qui se respectent.
— Et surtout de celles qui ne se respectent pas.
— C’est pourquoi la marquise ne pouvait se dispenser d’être rousse.
Au reste, si j’ai occasion de la revoir, comme je l’espère, je suis à peu près certain de la reconnaître à un signe.
— Lequel ?
— La marque des fers qu’elle portait là -bas et dont il est impossible qu’il ne soit pas resté quelque trace.
— C’est probable et ce serait en effet un indice certain.
« Et ton ancien compagnon Goëzmann, sais-tu ce qu’il est devenu ?
— Je ne l’ai pas vu depuis cette rencontre sur le boulevard, où je regrette bien aujourd’hui de ne lui avoir pas adressé la parole. Mon titre d’ancien compagnon de chaîne lui eût inspiré confiance, il m’eût donné son adresse et mis au courant de la vie qu’il menait à Paris, et il est probable que nous aurions eu par lui les plus précieux renseignements sur la marquise de Santarès.
— Peut-être, car je doute fort que celle-ci ait consenti à l’entraîner dans les régions où elle s’est élevée ; c’eût été attacher à sa fortune un lourd boulet ; il est probable qu’en s’élevant elle l’a laissé dans la fange où tu l’as rencontré un jour et où, sans nul doute, il a dû mourir de misère.
— Laissons donc là ce gredin pour nous occuper de ceux dont je viens de vous parler, dit Milon.
— Tu dis qu’ils sont chez un marchand de vin ?
— À deux pas d’ici, venez.
Ils sortirent de la foule et gagnèrent bientôt la boutique du marchand de vin déjà connu du lecteur.
Milon conduisit Albert à un volet à travers lequel filtrait la lumière, et après avoir jeté d’abord un coup d’œil à travers la fente :
— Tenez, dit-il au jeune homme, ils sont trois attablés autour d’une bouteille d’absinthe, et celui qui nous fait face est Rascal.
— Vrai type d’assassin, dit Albert.
Il ajouta après un moment de réflexion :
— J’aperçois, à droite de ce Rascal, et à trois ou quatre pas de la table où ces messieurs paraissent causer très-intimement, une petite porte vitrée qui doit ouvrir sur un autre cabinet.
— Je l’ai remarquée comme vous, répondit Milon.
— Eh bien ! cette porte me donne une idée.
— Voyons-la.
— Si ce cabinet, qui n’est pas occupé, puisqu’on n’y voit pas de lumière, avait une autre entrée !
— Eh bien ?
— Et si le marchand de vin, qui doit être beaucoup plus dévoué à ses propres intérêts qu’à ceux de ces messieurs, voulait bien nous y introduire moyennant un prix… déraisonnable.
— Je comprends, s’écria Milon.
— Allons donc tâter le marchand de vin.
Ils pénétrèrent aussitôt dans la boutique, qui, par un heureux hasard, était veuve de clients en ce moment.
— Que faut-il servir à ces messieurs ? s’écria le patron en les voyant entrer.
— Un cabinet noir, répondit Albert.
— Avec une lumière, riposta le marchand de vin en riant de ce qu’il prenait pour une farce.
— Non pas ; entièrement noir, et attenant à celui-ci.
— Tiens, tiens, dit le patron en clignant de l’œil, est-ce que ces messieurs seraient curieux de…
— Nous sommes très-curieux, et comme il faut payer ses défauts, nous payerons convenablement votre hospitalité si vous avez la chance qu’il y ait une autre entrée que la porte vitrée qui donne dans le cabinet de vos clients.
— Ma foi ! vous tombez à pique, il y a justement une seconde entrée, mais je ne sais si je dois… vous comprenez, des clients…
— Qui vont vous faire gagner quinze sous dans toute la soirée, tandis que moi, je vous loue ce cabinet pour une heure seulement, et je vous paie…
Le marchand de vin tendit l’oreille.
— Cent francs l’heure, dit Albert.
— Le cabinet est à vous, monsieur, s’écria le patron, dont les scrupules venaient de s’évanouir comme par enchantement.
Il prit un trousseau de clés et dit à Albert et à Milon :
— Veuillez me suivre, messieurs.
Et il s’engagea dans une espèce de petit couloir étroit et circulaire qui semblait faire le tour de son établissement.
Après une vingtaine de pas, il s’arrêta, glissa une clé dans une serrure avec tant de précautions, qu’on n’entendait même pas le grincement du fer, puis une porte s’ouvrit et il murmura tout bas :
— Vous y voilà , entrez.
La lumière du cabinet voisin jetait une vague clarté dans cette pièce, et permettait de s’y reconnaître.
Albert et Milon s’approchèrent de la porte vitrée, se postèrent de chaque côté et écoutèrent.

— Tenez, s’écriait en ce moment Rascal, le teint très-allumé par l’absinthe, nous sommes trois ici, n’est-ce pas ?
— C’est positif, répondit le père Vulcain.
— Eh bien, nous sommes trois imbéciles.
— J’en vois bien deux, répliqua le vieux modèle, quant au troisième.
— Je te dis que nous sommes trois imbéciles et je te le prouve.
— Voyons ça.
— Qu’est-ce que font en ce moment nos deux associés, sir Ralph et Rocambole, c’est-à -dire Mac-Field, attention à la consigne, toujours Mac-Field, jamais Rocambole.
— Eh bien, ils sont au bal, où ils s’occupent de nos affaires.
— Oui, ils s’en occupent, mais comment ? En se livrant à la bonne chère, en se faisant traîner en voiture, en s’habillant chez les premiers tailleurs, en dansant comme des perdus et en prenant le menton aux grandes dames ; je connais ça ; il n’y a pas besoin d’aller dans le monde pour savoir comment ça se passe ; et pendant ce temps-là , nous trimons comme des galériens, nous sommes vêtus de paletots à poil en été, d’étoffe transparente en hiver, nous nous régalons d’absinthe au vitriol chez le mastroquet, et les grandes dames jetteraient de beaux cris si nous leur demandions la plus innocente faveur.
— Ce serait à craindre, dit froidement Vulcain ; mais enfin où veux-tu en venir ?
— Eh bien, voilà ; je veux dire que sir Ralph et Mac-Field se servent de nous pour tirer les marrons du feu, et qu’une fois la farce jouée et le magot en poche, ils fileront un beau matin, nous laissant là avec la responsabilité de la chose pour tout potage et une partie de cache-cache avec la police pour tout divertissement.
— Qui te fait croire ça ?
— D’abord, nous ne savons rien de rien de ce qu’ils manigancent ; ainsi, qu’est-ce qu’il y a au fond de cette affaire de la comtesse de Sinabria qui est venue faire son petit au cabaret de la Providence ? Ni vu, ni connu, nous n’en savons pas un mot ; et ainsi de tout le reste. Ce n’est pas tout : nous connaissons tous le domicile les uns des autres, fichus domiciles pour la plupart, des garnis à quatre sous la nuit, punaises comprises, enfin nous les connaissons, mais eux, qui est-ce qui sait où ils perchent ? Personne. Ce n’est pas encore tout : l’autre jour que j’étais arrivé sur la pointe des pieds au cabinet du marchand de vin où ils m’avaient donné rendez-vous, je les ai entendus parler de New-York, de la Dixième rue, de bien des affaires dont je n’entendais que quelques mots, d’où il est résulté pour moi que Roc… que Mac-Field nous arrive de l’Amérique, et non pas de Toulon, comme il s’en vante. Voilà pourquoi je n’ai pas confiance, voilà pourquoi je ne leur ai rien dit de certaine petite affaire que je mijote depuis longtemps sans en avoir l’air et qui peut m’enrichir tout à coup, moi et les amis que je m’associerai.
— Qu’est-ce que c’est que ça ? demandèrent à la fois Collin et le père Vulcain en se penchant vers Rascal.
— Cette affaire, dans laquelle je flaire une fortune, et que nous allons mettre en actions, si ça vous va, en trois actions, une pour chacun de nous, c’est l’affaire dite de la petite muette.
— Nizza.
— Cette petite-là a peut-être un million dans le ventre.
— Et tu sais quelque chose sur son compte ?
— Je connais sa mère.
— Ah ! bah !
— Mieux que ça, je connais la femme qui lui a coupé la langue.
— Mais pourquoi cette…
— Ah ! voilà le mystère qu’il s’agit de sonder ; si nous arrivons à toucher le fond, j’ai idée que nous y trouverons un trésor.
— Et tu crois être sur la voie ?
— Je n’en sais rien encore, mais ce n’est pas pour contempler le paysage qu’en quittant le cabaret de la Providence je suis allé demeurer rue des Partants.
— Oui, mais la petite muette ?
— Est chez M. Portal, que nous allons filer tout à l’heure ; or, une fois son domicile connu, la petite n’y moisira pas, avant huit jours, elle sera rue des Partants.
La porte du cabinet s’ouvrit brusquement et un homme entra.
C’était sir Ralph.
— Debout, dit-il, voilà le moment d’agir, les salons commencent à se vider. M. Portal ne saurait tarder à partir. Trois fiacres nous attendent, je vous donnerai mes instructions au moment du départ.
Les trois bandits se levèrent et sortirent à sa suite.
— Allons, dit Albert à Milon, je ne regrette pas mes cent francs, ils sont bien placés, ils rapporteront de bons intérêts.
XXXI
FAUSSE ALERTE
En quittant la boutique du marchand de vin, sir Ralph s’était immédiatement dirigé vers l’hôtel Mauvillars.
Ses trois acolytes le suivaient à dix pas de distance.
Arrivés en face de la porte cochère, ils allèrent se blottir dans l’encoignure d’une porte faisant face à celle de l’hôtel Mauvillars, position d’où, un peu dégagés de la foule, ils pouvaient voir tout ce qui se passait dans la cour et se trouver à portée de la vue de sir Ralph.
— Écoutez, leur dit celui-ci en se rapprochant d’eux, restez ainsi tous les trois groupés à cette place jusqu’à ce que je vienne vous parler. J’ai retenu deux fiacres qui sont à vingt pas de là et qui ne nous lâcheront pas, car j’ai donné cinq francs à chaque cocher à titre de pourboire, en leur promettant le double pour la course ; toutes mes précautions sont prises. Voici leurs numéros 508 et 1524.
Il remit un de ces numéros à Rascal et l’autre à Collin.
— Je rentre dans le bal, reprit-il, je ne quitte plus de l’œil M. Portal et son ami jusqu’au moment où ils passeront au vestiaire. Alors je vous rejoins, nous faisons avancer les fiacres, vous y prenez place, nous guettons le moment où l’on appellera la voiture de M. Portal, vous attendez qu’elle franchisse la porte cochère, et le reste vous regarde.
— Soyez tranquille, murmura Rascal, j’ai un vieux compte à régler avec ce M. Portal ; je ne rêve plus qu’à me revenger de lui et l’occasion est trop belle pour que je la laisse échapper.
— Je sais la haine que tu lui portes et je compte sur toi.
— Et vous avez raison.
— Sur toi aussi, Collin.
— N’ayez pas peur, je ne suis pas plus manchot que Rascal, et comme il y va de notre intérêt à tous…
— Et moi ? demanda Vulcain d’un air froissé, on me prend donc pour un propre à rien !
— Quant à vous, père Vulcain, votre jour n’est pas encore venu, mais il viendra, n’en doutez pas, et si je ne me trompe, nous vous mettrons bientôt à même de rendre à l’association un signalé service.
— À la bonne heure, parce que, voyez-vous, je ne veux pas qu’on me prenne pour un feignant, ça m’humilie, chacun a son amour-propre ; enfin, pour aujourd’hui ?
— Vous n’avez rien à faire qu’à retourner chez le marchand de vin achever la bouteille d’absinthe.
— Elle est payée, c’est mon devoir.
— Ainsi, dit sir Ralph à Rascal et à Collin, c’est bien entendu, vous ne bougez pas d’ici jusqu’à ce que je paraisse.
— Nous sommes rivés à cette place.
Ralph se hâta de rentrer à l’hôtel Mauvillars et de regagner la salle de bal où il ne tarda pas à rejoindre Mac-Field.
— M. Portal ? lui demanda-t-il vivement.
— Toujours ici.
— Parfait, et son ami ?
— Il a disparu un instant, je le croyais au jardin et je viens de le voir rentrer derrière vous, ce qui m’intrigue quelque peu.
— Ne les perdons plus de vue.
— Tout est arrangé avec Rascal et Collin ?
— Ils attendent mes ordres et la sortie de M. Portal en face de l’hôtel.
— Les fiacres ?
— Sont retenus.
— Fort bien, nous n’avons plus, maintenant, qu’à attendre le bon plaisir de M. Portal.
Au même instant, Albert de Prytavin abordait Rocambole.
— Eh bien ? lui demanda celui-ci.
— On attend notre sortie pour nous filer.
— Je le sais, mais qui s’en charge ?
— Rascal et un de ses dignes compagnons.
— Mauvaise affaire ! Milon devant accompagner mes fileurs jusqu’à la rue Amelot pour les filer à son tour, il eût été à désirer que sir Ralph ou Mac-Field se chargeât lui-même de la besogne, c’était une excellente occasion de connaître leur demeure.
— Malheureusement, nous ne pouvons leur souffler cette idée.
— Non, mais on pourrait trouver peut-être quelque moyen… Il faut que je songe à cela.
— Ah ! reprit vivement Albert, une découverte.
— Quoi donc ?
— La mère de Nizza existe.
— Et tu la connais ? s’écria Rocambole.
— Non, mais je suis sur une piste qui peut me la faire découvrir.
— Conte-moi donc cela.
Rocambole entraîna le jeune homme hors de la foule, et tous deux s’entretinrent longtemps, tout en se promenant et en jetant, de temps à autre, un regard du côté de Mac-Field et de sir Ralph.
Une demi-heure environ après la rentrée de ce dernier dans la salle de bal, Mac-Field lui dit à voix basse :
— Enfin !
— Quoi donc ? demanda sir Ralph.
— Il part.
— M. Portal ?
— Tenez, il sort et va droit au vestiaire.
— Il est seul.
— En effet, où donc peut être passé le jeune homme ?
— À une table de jeu, peut-être.
— Je ne l’y vois pas.
— Peu importe, l’essentiel, c’est M. Portal ; je cours m’assurer qu’il est bien passé au vestiaire et je vais aussitôt communiquer à mes hommes mes dernières instructions.
Il sortit à la hâte et arriva à temps dans l’antichambre pour voir entrer M. Portal au vestiaire.
Il prit son paletot des mains d’un domestique, auquel il l’avait confié avant de rentrer au bal, et courut à la place où il avait laissé Rascal et Collin.
Deux minutes après, il rentrait de nouveau et abordait Mac-Field d’un air tout effaré.
— Qu’avez-vous donc ? lui demanda celui-ci avec inquiétude.
— Rascal et Collin, balbutia sir Ralph tout haletant.
— Eh bien, quoi ! Que leur est-il arrivé ?
— Disparus.
— Malédiction !
— J’arrive à la place où je les avais laissés, d’où ils ne devaient pas bouger, quoi qu’il pût en advenir, jusqu’au moment où je viendrais les prévenir du départ de M. Portal ; ils n’y étaient plus.
— Ils avaient été obligés de changer de place, peut-être ?
— Cette pensée m’est venue tout d’abord, je les ai cherchés dans la foule, où ils avaient pu se dissimuler par prudence, personne.
— Et les fiacres ?
— Partis.
— Avec eux ?
— D’après les renseignements que m’ont donnés les autres cochers, j’en suis à peu près sûr.
— C’est incompréhensible.
— Il me restait encore un doute cependant, ils pouvaient avoir cédé à la tentation d’aller vider avec le père Vulcain une bouteille d’absinthe chez le marchand de vin.
— Vous y êtes allé ?
— Et le père Vulcain buvait seul, il ne les avait pas revus.
— Que faire ? Nous ne pouvons pas cependant laisser échapper cette occasion de connaître la demeure de M. Portal, un redoutable ennemi, tout nous le prouve.
— Il n’y a pas à hésiter, nous ne pouvons plus compter que sur nous ; filons-le nous-mêmes.
— Pourvu qu’il en soit temps encore.
— Il sortait du vestiaire à l’instant ; deux minutes se sont écoulées à peine ; il faut plus de temps que cela pour permettre à la voiture de se dégager des autres et d’approcher du perron.
— Partons donc.
Et ils sortirent à la hâte, sans se douter que c’était ce même M. Portal qui les forçait à le filer eux-mêmes.
Voici ce qui était arrivé :
Collin et Rascal étaient à leur poste, attendant patiemment le retour de sir Ralph, lorsqu’ils virent sortir de l’hôtel un jeune homme qui, sans chercher, sans hésiter, vint droit à eux :
— Vous êtes Rascal, et vous, Collin, n’est-ce pas ? leur dit-il d’un air agité.
Comme ceux-ci ne répondaient pas et le regardaient avec défiance, il reprit aussitôt :
— La rousse est aux trousses de la bande. Plusieurs agents déguisés sont là , au bail même ; Mac-Field et sir Ralph, qui les ont reconnus, ont filé par une porte du jardin et m’ont chargé de venir vous prévenir. C’est l’affaire Sinabria qui nous vaut ça. Décampez donc au plus vite, il n’est que temps.
Les deux bandits étaient fort troublés. Cependant ils ne paraissaient pas tout à fait convaincus.
— Ah ! reprit vivement le jeune homme, j’allais oublier une recommandation de sir Ralph. Prenez les deux fiacres qu’il a retenus et payés ; ils portent les numéros 508 et 1524.
Pour le coup il n’était plus possible de douter.
Aussi Rascal et Collin s’empressèrent-ils, sans répliquer un mot, de courir à la recherche de l’un des fiacres, jugeant inutile et même dangereux d’en prendre deux, et, cinq minutes après, ils étaient déjà loin.
C’est qu’en parlant à ses deux acolytes, sir Ralph ne s’était pas défié d’un lourd et épais Auvergnat qui leur tournait le dos et semblait n’avoir d’yeux et d’oreilles que pour les beaux équipages.
Cet Auvergnat n’était autre que Milon qui, ayant saisi au vol les numéros 508 et 1524, en avait fait part à Albert.
Sur ce précieux renseignement, et sur ceux que le jeune homme venait de recueillir chez le marchand de vin, Rocambole avait imaginé le plan qui obtenait en ce moment un si complet succès.
FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE
DEUXIÈME PARTIE
LES VALCRESSON
I
NOUVELLES DIVERSES
À quelques jours de là , nous trouvons Rocambole, Vanda et Nizza réunis dans le petit salon déjà connu du lecteur.
Depuis un mois qu’elle est là , la petite muette a appris à lire et à écrire, et c’est alors qu’elle a pu faire savoir à ses nouveaux amis qu’elle s’appelait Nizza.
Elle vient de rentrer brusquement toute pâle et tout émue, et c’est avec tous les signes d’une extrême frayeur qu’elle est allée se jeter dans les bras de Vanda.
— Eh ! ma chère petite, que t’arrive-t-il donc ? s’écria celle-ci en baisant l’enfant au front.
Nizza se serra contre sa petite mère, — c’est le titre qu’elle lui donnait, — et tendit vers la rue sa main toute tremblante.
— Que veut-elle dire ? demanda Rocambole cherchant vainement à comprendre.
— Je ne sais. Un pauvre a sonné tout à l’heure à la porte de la rue, comme de coutume je lui ai envoyé quelques sous par Nizza, qui aime beaucoup à faire ces sortes de commissions, et voilà dans quel état elle revient.
— Elle n’a eu aucun sujet de frayeur en chemin ?
— Aucun, du vestibule où nous étions toutes deux, je l’ai suivie des yeux à travers le jardin jusqu’à ce qu’elle arrivât à la porte et passât sa main par la grille pour remettre son aumône au vieux mendiant qui avait sonné, puis je suis entrée ici.

La petite muette, qui, suivant son habitude, n’avait pas quitté Vanda des yeux tandis qu’elle parlait, fit comprendre par signes que cet homme n’était pas un mendiant.
— Qui était-ce donc ? demanda Vanda en souriant.
Nizza passa ses mains sur ses bras avec une expression d’horreur et d’effroi. C’est ainsi, on s’en souvient, qu’elle désignait le bandit aux bras rouges.
— Rascal ? lui demanda Rocambole.
Elle fit un signe de tête affirmatif ; puis, tremblant de tous ses membres, elle se précipita à genoux aux pieds de Vanda, et, dans une mimique éloquente et parfaitement comprise de celle-ci, elle la supplia en pleurant de la garder près d’elle.
Vanda la releva et lui promit, en l’embrassant, qu’elle ne la quitterait jamais.
— Mais es-tu bien sûre de ne t’être pas trompée, mon enfant ? lui dit Vanda quand elle la vit un peu calmée ; ce mendiant était tout courbé et avait une barbe grise ; c’était un vieillard, tandis que ce Rascal…
Nizza l’interrompit brusquement pour lui faire comprendre que ce costume était un déguisement auquel elle-même s’était trompée d’abord, mais qu’elle avait aussitôt reconnu Rascal à deux signes : à ses doigts tout couverts de poils roux, et à son regard, dont l’expression féroce était restée gravée dans son esprit.
— Que dites-vous de cela, mon ami ? demanda Vanda à Rocambole.
— Je crois que l’enfant a raison, ce doit être Rascal, en effet.
— Il rôderait donc par ici dans l’intention de nous l’enlever ?
— Justement.
— Oh ! vous me faites trembler, s’écria-t-elle en pressant énergiquement l’enfant dans ses bras.
— Ne vous ai-je pas dit qu’il prétendait connaître sa mère et qu’il fondait sur Nizza des espérances de fortune ?
— Oui, mais, après la façon dont vous l’aviez traité, vous et Milon, je n’aurais jamais cru qu’il eût l’audace…
— Et moi, je m’y attendais, mais mes précautions sont si bien prises contre toute espèce de surprise, que j’ai jugé inutile de vous faire de nouvelles recommandations.
— Mais maintenant que nous sommes prévenus, voilà un danger contre lequel il faut se mettre en garde.
— C’est déjà fait ; ce misérable se croit sans doute bien caché sous ses haillons de mendiant, il ne faut pas le détromper ; s’il revient, envoie-lui encore ton aumône par Nizza, en lui recommandant de feindre de ne pas le reconnaître, et laissons-le rôder par ici tout à son aise. J’ai à son endroit une petite combinaison à laquelle il n’est pas préparé, j’en suis sûr.
Il ajouta avec un mouvement d’impatience :
— Mais je ne vois revenir ni Albert, ni Milon ; ils tardent bien tous les deux.
Il achevait de parler à peine, quand on entendit s’ouvrir et se refermer la porte de la rue.
C’était Milon qui entrait un instant après.
— Eh bien ? lui demanda Rocambole.
— Dénichés, répondit Milon en se jetant sur un siège.
— Diable ! fit Rocambole.
Il reprit après un moment de réflexion :
— Quoi que tu en dises, ils ont dû s’apercevoir, l’autre jour, qu’ils étaient filés, et c’est là ce qui les a déterminés à changer de gîte.
— Ils n’ont rien vu, et ce n’est pas là ce qui les a fait déménager, j’en suis plus convaincu que jamais, répliqua Milon.
— Qui te donne cette conviction ?
— Voilà ; je me présente, il y a une heure, à l’hôtel du Levant, et je demande sir Ralph. On me répond qu’il n’habite plus là depuis ce matin.
— Et lord Mac-Field ? demandai-je.
— Parti avec son ami.
Le domestique auquel je m’adressais paraissait d’assez mauvaise humeur, je compris, à son ton, qu’il était mécontent de ce départ subit. Je lui confiai alors, en lui glissant une pièce de dix francs dans la main, que j’étais créancier de sir Ralph pour une forte somme, et le priai de me dire quelle était, selon lui, la raison qui avait pu résoudre ces messieurs à quitter son hôtel.
— Il faut vous dire d’abord, me dit-il, que ces deux messieurs sont des originaux qui ne fréquentaient personne dans Paris et qu’on ne venait jamais voir ; vous êtes le premier. Hier soir, ce matin même, ils ne songeaient nullement à nous quitter, et la preuve, c’est qu’ils venaient de payer un mois d’avance, suivant leur coutume. Mais voilà que, sur les dix heures, je leur montre un journal venant d’Amérique à leur adresse, de New-York, je crois ; aussitôt, sans même s’apercevoir de ma présence, tant ils étaient troublés, l’un d’eux ouvre brusquement le journal, le parcourt d’un coup d’œil, pâlit en lisant quelques lignes, puis passe la feuille à l’autre, en lui désignant du doigt le passage qui venait de le bouleverser. L’autre, sir Ralph, après avoir lu ce passage, éprouve une émotion plus violente encore, car il tomba comme une masse dans un fauteuil, ce que voyant, je m’esquive tout doucement, pensant que ma présence, en ce moment, ne pouvait leur être que désagréable, et je descends rendre compte au patron de ce qui venait de se passer. Un quart d’heure après, ils descendaient tous deux, encore tout pâles, me priaient de descendre leurs malles et d’aller leur chercher une voiture, et partaient bientôt, après avoir payé leur note. Voilà la pure vérité, monsieur.
— New-York ! New-York ! murmura Rocambole, et le portefeuille de sir Ralph porte cette indication : New… Dixième rue. Décidément, ils ont laissé par là quelque fâcheux souvenir. Ah ! voilà ce qu’il faudrait connaître.
Et, s’adressant à Milon :
— Et c’est tout ce que tu as pu tirer de ce domestique ?
— Absolument tout.
— Il n’a pas eu l’idée de remarquer le numéro de la voiture qui les a emmenés ?
— C’est ce que je lui ai demandé tout de suite, mais il n’y avait pas songé.
— Imbécile !
— Et maintenant qui sait si nous les retrouverons ! Qui sait s’ils n’ont pas quitté Paris !
On frappa à la porte en ce moment, puis on entra tout de suite.
C’était la femme de chambre qui apportait une lettre.
Rocambole la décacheta et la lut rapidement ; puis se tournant vers Milon :
— Rassure-toi, lui dit-il, nous les reverrons bientôt, cette lettre m’en donne l’assurance.
— Bah ! fit Milon stupéfait.
— Écoute.
Il lut :
« Monsieur, je vous connais encore bien peu, mais vous m’avez inspiré une confiance aveugle et j’ai foi en vous comme en la Providence même. Vous m’avez recommandé de tout vous dire, de vous rendre compte de tout, et c’est ce que je fais en vous envoyant, aussitôt reçue, la lettre ci-jointe, qui m’a été remise ce matin, à midi. Vos visites chez moi pourraient être remarquées, je vous en supplie, venez me voir ce soir aux Italiens, loge 17, j’y serai probablement seule.
« Votre très-reconnaissante,
« C. de S. »
Voici la lettre que la comtesse de Sinabria joignait à la sienne :
« Madame la comtesse, une affaire de la plus haute importance me force à quitter Paris à l’improviste, comme je vous l’avais fait pressentir, et me contraint en même temps, à mon grand regret, à modifier les conditions arrêtées entre nous ; c’est un million qu’il me faut dans trois jours. Dans l’espoir que vous ne me mettrez pas dans la pénible obligation de demander cette somme à votre mari, je vous prie de me croire le plus humble et le plus dévoué de vos serviteurs.
« XXX. »
II
BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
— Cette lettre est de sir Ralph, dit Rocambole à Milon, et elle confirme les renseignements qui t’ont été donnés à l’hôtel du Levant. C’est évidemment sous l’empire de quelque fâcheuse nouvelle que les deux associés ont jugé à propos de quitter précipitamment cet hôtel, où ils craignaient d’être dépistés, et c’est la même raison qui les décide à s’éloigner de Paris dans trois jours. Le journal de New-York leur est remis à dix heures et la comtesse de Sinabria reçoit cette lettre a midi : les deux incidents naissent donc de la même cause, impossible d’en douter. Mais qu’ont-ils pu faire à New-York ? Je flaire quelque crime là -dessous ; c’est la seule façon possible d’expliquer l’épouvante dont ils ont été saisis.
Il plongea sa tête dans ses deux mains et se mit à réfléchir.
— Milon, dit-il enfin au bout d’un instant, tu as eu tort de cesser de lire chaque soir la Gazette des Tribunaux, peut-être y aurions-nous découvert ce que nous aurions tant d’intérêt à connaître.
— C’est un tort facile à réparer, répondit Milon ; j’ai cessé cette lecture depuis quinze jours environ, je vais aller prendre ces quinze numéros à mon cabinet de lecture et nous saurons bientôt à quoi nous en tenir sur ce point.
— Vas-y tout de suite alors ; il faut que je sois renseigné d’ici à demain, car un pareil fait, s’il existe, comme j’en ai le pressentiment, serait le salut de la comtesse.
— J’y cours.
— Pauvre femme ! murmura Vanda quand Milon fut sorti, quelle effroyable situation que la sienne !
— Il serait difficile d’en imaginer une plus terrible.
— Où trouver un million pour satisfaire ces misérables, qui la tiennent sous leurs pieds ?
— M. de Coursol peut en fournir la moitié et il le fera sans hésiter pour sauver celle qu’il aime, mais l’autre demi-million !… Ah ! si je n’étais pas Rocambole, le grand coupable auquel la justice peut demander compte de quarante années de bagne accumulées sur sa tête, j’irais trouver directement le préfet de police, je lui confierais toute cette histoire et nous saurions bien trouver à nous deux quelque moyen d’en finir avec ces misérables sans compromettre la comtesse. Mais cette voie m’est fermée, je ne puis rien de ce côté.
— Ne pourriez-vous envoyer contre eux, à la préfecture de police, une dénonciation anonyme ? Ce sont les chefs de la bande d’Aubervilliers, les assassins de l’agent trouvé sanglant et à moitié mort dans le cabaret de la Providence, repaire de cette bande ; une fois arrêtés sur les renseignements fournis par vous, tels que le dernier hôtel qu’ils ont habité et le signalement exact de leurs personnes, une fois confrontés avec Nizza et l’agent de police, leur victime, heureusement revenu à la vie et en voie de guérison, leur culpabilité serait surabondamment prouvée, ils seraient à tout jamais rayés de la société, condamnés à mort peut-être, et la comtesse serait sauvée.
— Et la comtesse serait perdue, répliqua gravement Rocambole, c’est pour cela que je n’ai pas usé de ce moyen, trop simple et trop pratique pour ne s’être pas présenté tout de suite à mon esprit. Cette dénonciation, c’est à elle ou à ses protecteurs qu’ils l’attribueraient et dès lors ils n’hésiteraient pas à se venger en révélant toute son histoire soit au comte, soit au tribunal même devant lequel ils comparaîtraient.
Songez qu’il y va pour elle de la cour d’assises ; sir Ralph le lui a rappelé l’autre jour, au bal Mauvillars, et après avoir relu et sérieusement étudié la lettre dans laquelle, sous la forme d’un plan de drame, il lui déduit toutes les conséquences de sa situation, je dois convenir que leur plan est admirablement ourdi et que la malheureuse comtesse est prise dans cet exécrable guet-apens comme une mouche dans une toile d’araignée.
— Mais alors, fit observer Vanda, en supposant même que ces hommes se soient rendus coupables d’un crime en Amérique, comme vous le fait croire l’impression que leur a fait éprouver ce journal de New-York, en supposant que vous en obteniez la preuve évidente, palpable, vous n’en pourriez faire usage contre eux, vous seriez réduit à l’impuissance par la même considération, la crainte de perdre la comtesse de Sinabria.
— Je sais cela. Aussi ne comptais-je me servir de cette preuve, si je parviens à l’acquérir, que le jour où j’aurais mis la comtesse à l’abri de leurs vengeances.
— Cela me paraît absolument impossible ; nulle puissance au monde ne saurait les empêcher de parler ou d’écrire dès qu’ils seront arrêtés ou même dès qu’ils se sentiront seulement menacés, et songez à tous les témoignages qu’ils peuvent élever contre l’infortunée comtesse ; l’enfant disparu, dont ils peuvent faire ce qu’il leur plaira, même un cadavre ; terribles pièces à conviction, l’inscription de cet enfant sur les registres de la mairie d’Aubervilliers, la déposition de la sage-femme qui a délivré la comtesse et déclaré l’enfant.
Vous l’avez dit, ce plan infernal est admirablement conçu, ils tiennent leur malheureuse victime pieds et poings liés, et peuvent la pousser jusqu’à l’échafaud. Voilà ce qui fait leur force, ils se font un rempart de la pauvre femme, vos coups ne peuvent les atteindre qu’en la frappant d’abord, ils sont donc invulnérables, puisqu’ils ont ainsi trouvé le moyen de paralyser tous vos efforts et toute votre énergie.
— Tous les avantages sont de leur côté, j’en conviens, ils peuvent tout et je ne puis rien ; mais je suis sorti, dans le cours de ma vie, de situations plus difficiles encore que celle-là , et si insurmontables que semblent les obstacles qui s’entassent devant moi, je ne désespère pas de trouver une issue à cette impasse.
— Dieu le veuille ! murmura Vanda.
— Mais ce n’est pas tout, reprit Rocambole, il faut que je veille en même temps sur madame Taureins et sur Tatiane, innocentes colombes qui ne soupçonnent pas les périls qui les enveloppent et ne voient pas même ces terribles oiseaux de proie planant au-dessus de leurs têtes et prêts à fondre sur elles.
Par ce qu’ils ont fait de la comtesse, on peut juger des trames qu’ils ont ourdies autour de ces deux femmes ; ils creusent évidemment sous leurs pieds quelque effroyable abîme, et il ne me faut rien moins qu’un actif espionnage et une surveillance de tous les instants pour arriver à pénétrer ce redoutable mystère. Qu’ont-ils médité contre la femme et contre la jeune fille ! Quel est le but qu’ils se proposent et quels moyens comptent-ils mettre en œuvre pour y arriver ? Voilà ce qu’il faudrait savoir et voilà à quoi tendent en ce moment tous mes efforts. Ah ! si je pouvais seulement entrevoir la raison secrète pour laquelle ils s’attaquent à toute une famille à la fois ! Car les Sinabria, les Taureins, les Mauvillars, la jolie Tatiane, tout cela, c’est la famille des Valcresson ! Si la moindre lueur venait éclairer ce point capital, je serais bien fort ; mais voilà ce qui m’échappe et j’en suis au désespoir, car je suis dans la position d’un ennemi attaqué dans l’obscurité et ne sachant où porter ses coups.
— Qui sait, répliqua Vanda, si vous n’êtes pas déjà débarrassé de tous ces soucis par la fuite de ces deux hommes !
— Ils ne peuvent être partis, puisque sir Ralph donne rendez-vous à la comtesse de Sinabria dans trois jours à son hôtel.
— Ne peut-il pas envoyer à sa place un de ses complices, étranger à cette mystérieuse affaire de New-York, dans laquelle sir Ralph et Mac-Field semblent seuls compromis ?
— C’est possible, en effet, et dans ce cas nous n’aurions plus à nous occuper ni de Tatiane, ni de madame Taureins ; la comtesse seule resterait en péril et c’est sur ce point unique que j’aurais à concentrer tous mes efforts.
Rocambole fut interrompu par un coup frappé à la porte, qui s’ouvrit aussitôt.
C’était Albert de Prytavin.
— Eh bien, lui demanda Rocambole, as-tu été heureux dans ton expédition ? Nous apportes-tu quelque chose ?
— Mais oui, répondit Albert, quelques renseignements qui, si je ne m’abuse, ne manquent pas d’importance.
— Voyons d’abord les Mauvillars, quoi de neuf de ce côté ?
— Un changement dans le personnel.
— Ah ! fit Rocambole.
— La femme de chambre de mademoiselle Tatiane, qui semblait très-attachée à sa jeune maîtresse, l’a quittée brusquement.
— A-t-elle été remplacée ?
— Dès le lendemain.
— Par qui ?
— Une jeune fille de vingt ans, assez jolie, douce, complaisante, pleine de zèle, mais fort novice dans le métier de camériste.
— Son nom ?
— Malvina.
— La maison d’où elle sort ?
— On n’a pu me le dire.
— Mais la personne qui l’a recommandée et l’a fait accepter ?
— Oh ! tout ce qu’il y a de plus rassurant.
— Enfin !
— M. Badoir.
— Qu’est-ce que c’est que ça ?
— Un cousin de madame Mauvillars et de mademoiselle Tatiane, un homme fort honorable, qui jouit de la plus haute considération dans le faubourg Saint-Germain et notamment dans sa paroisse.
— Qui est ?
— Saint-Sulpice.
— Nonobstant la haute considération dont jouit M. Badoir, dont je ne me défie qu’au point de vue de la perspicacité, cette femme de chambre si vite partie et si brusquement remplacée m’inspire les plus mauvaises pensées ; il faudra savoir chaque jour ce qui se passe de ce côté. Quels sont pour aujourd’hui les projets des époux Mauvillars ?
— Ils vont ce soir aux Italiens avec mademoiselle Tatiane.
— Fort bien ; passons maintenant aux Taureins.
III
UNE RÉSURRECTION
— Chez M. Mauvillars, reprit Albert de Prytavin, c’est un vieux domestique quelque peu ivrogne qui m’a donné les renseignements que je viens de vous faire connaître. On m’avait signalé son péché mignon, ainsi que le café où il va passer une heure chaque soir et chaque matin ; je m’y suis rendu ce matin, j’ai engagé l’entretien par l’offre d’un mêlé cassis, auquel ont succédé quelques consommations variées, et ayant mis le bonhomme sur le compte de ses maîtres dont, par parenthèse et par exception, il ne m’a dit que du bien, j’ai obtenu de lui tous les renseignements désirables, sans avoir l’air de les demander.
— Parfait, dit Rocambole, nous avons là un espion d’autant plus précieux qu’il est espion sans le savoir ; on tirera de lui tout ce qu’on voudra. Et comment as-tu procédé chez les Taureins ?
— Là , c’est différent, je ne connaissais personne, la tâche était plus difficile. Après réflexion, je décidai de m’adresser au concierge, mieux à même que personne de connaître les gens du logis ; après avoir longuement étudié sa physionomie et m’être convaincu qu’elle ne reflétait pas les plus beaux sentiments, je l’abordai, je lui parlai des mœurs de son maître, de la maîtresse qu’il entretenait, je lui avouai que j’étais son rival près de la marquise de Santarès, qu’il connaît parfaitement, et prenant pour prétexte la jalousie, je le priai de vouloir bien me mettre au courant de tout ce qui concernait M. Taureins, ses habitudes, son train de maison, son personnel, etc. ; cette prière, accompagnée d’un double louis, ne fut point repoussée du concierge qui, donnant, lui, pour prétexte à sa petite infamie, l’indignation que lui causait l’immoralité de son maître, répondit à toutes mes questions et m’apprit, dans le plus grand détail, tout ce que j’avais intérêt à connaître. Et je vous donnerais à deviner en mille qui j’ai découvert dans le personnel de M. Taureins.
— Qui donc ?
— Goëzmann.
— Cet Allemand dont Milon t’a raconté la singulière histoire ?
— Je suppose que c’est lui, du moins.
— Que t’en a dit le concierge ?
— Tout le bien imaginable.
— Bah !
— Mais j’ai eu tout de suite l’explication de ces éloges.
— Comment cela ?
— L’Allemand, étant venu à traverser la cour au moment où nous causions, s’est approché de la loge restée entr’ouverte, a fait un profond salut au concierge et a demandé avec componction comment se portait ce bon monsieur Pitard. Comment trouver un seul défaut à un homme si poli ?
— Quelle position occupe ce Goëzmann chez M. Taureins ?
— Autre sujet d’étonnement quand je m’en informai.
— Un poste de confiance, dit Rocambole en souriant.
— Il est caissier.
— Singulier choix, si c’est l’homme que nous supposons.
Rocambole reprit tout à coup en se frappant le front :
— Le concierge t’a-t-il dit par qui cet Allemand avait été placé chez M. Taureins ?
— Je le lui ai demandé, mais il l’ignore.
— Depuis combien de temps occupe-t-il cette place ?
— Depuis trois ans.
— Et la marquise de Santarès, dans laquelle Milon a reconnu positivement la femme qu’il a rencontrée un jour au bras de l’Allemand Goëzmann, son ancien compagnon de chaîne, est depuis plus de trois ans la maîtresse de M. Taureins.
— C’est juste, s’écria Vanda ; il est donc très-probable que c’est elle qui a placé là l’atroce compagnon dont elle fit un jour la rencontre dans cette montagne où il serait mort de soif sans elle.
— Si nous avons deviné juste, et tout le prouve, dit Rocambole, cet homme est là beaucoup moins pour gagner sa vie que pour servir d’instrument à la marquise de Santarès, et Dieu sait tout ce qu’on peut attendre de l’association et des efforts réunis de deux pareils monstres !
— Maintenant, dit Vanda, la question est de savoir s’ils s’entendent avec sir Ralph et Mac-Field pour atteindre le même but, qui ne saurait être que la perte de madame Taureins, ou s’ils travaillent chacun de son côté à cette œuvre diabolique.
— Dans tous les cas, répliqua Rocambole, cette jeune femme, prise entre ces quatre misérables, plus terribles, plus impitoyables, plus effrayants l’un que l’autre, est menacée des plus grands malheurs, et nous aurons fort à faire pour la sauver.
Et, s’adressant à Albert :
— Quel effet t’a produit cet homme ?
— Aussi répulsif que possible. Il paraît âgé de quarante ans environ, de taille moyenne, la figure complètement rasée, le teint frais et béat comme un chanoine, l’œil gris, le regard faux, l’air cauteleux, il peut tromper un regard peu observateur par cette franchise apparente et cet air de bonhomie qui distingue les Allemands et les rend si dangereux.
— Tu verras souvent ce concierge et nous aurons constamment l’œil sur le Goëzmann.
— Naturellement.
— Que se passe-t-il en ce moment dans le ménage Taureins ?
— Monsieur et madame ne se voient guère qu’aux heures des repas, parlent de la pluie et du beau temps devant les domestiques et se retirent le soir chacun dans son appartement, quand ils restent chez eux.
Il ajouta :
— Ah ! j’oubliais de vous dire que madame Taureins, de même que les Mauvillars, ira ce soir aux Italiens où elle a sa loge.
— Tu as bien fait de ne pas l’oublier, je tirerai parti de ce renseignement. Ta voiture est là ?
— Oui, maître.
— C’est qu’il faut repartir tout de suite.
— À vos ordres.
— Vanda, vous avez là l’adresse de MM. Paul de Tréviannes et Jacques Turgis ?
Vanda ouvrit un calepin et chercha.
— Les voilà , dit-elle.
M. Paul de Tréviannes demeure rue Le Peletier, 27.
M. Jacques Turgis, rue Duperré, 15.
— Veuillez écrire ces adresses sur deux enveloppes.
Vanda fit ce qu’on lui demandait.
— Maintenant, dit Rocambole en remettant ces enveloppes à Albert, tu vas te rendre aux Italiens et prendre trois fauteuils d’orchestre, situés de façon à ce que de ces places on puisse embrasser toute la salle.
— Les trois places se suivant naturellement ?
— C’est bien cela.
— Et puis ?
— Tu mettras un coupon sous chaque enveloppe et tu iras déposer toi-même chacune à son adresse.
— Bien ; et le troisième fauteuil ?
— Tu le rapporteras ici.
Albert partit.
Quelques instants après, Milon revenait avec un paquet de journaux à la main.
C’étaient les quinze derniers numéros de la Gazette des Tribunaux.
— Allons, dit Rocambole, mettons-nous tous à l’œuvre : à nous trois nous aurons dépouillé ces quinze journaux en moins d’une heure.
Le paquet fut déposé sur la table, autour de laquelle s’assirent Milon, Rocambole et Vanda et chacun se mit à lire.
Pendant une demi-heure on n’entendit d’autre bruit que le froissement du papier.
Les journaux disparaissaient un à un sans apporter le renseignement qu’on y cherchait.
Il n’en restait plus que trois.
Chacun prit le sien.
Mais Rocambole n’espérait plus rien de ce côté, quand un cri se fit entendre.
C’était Vanda qui venait de découvrir quelque chose.
— Qu’est-ce ? lui demanda Rocambole.
— Des détails sur un crime commis à New-York.
— Lisez, lisez vite.
Vanda lut ce qui suit :
« Nos lecteurs se rappellent sans doute le double meurtre commis il y a trois mois à New-York, sur la personne de M. et madame Christiani, dans la Dixième rue. »
— La Dixième rue ! s’écria Rocambole.
— Il y a bien la Dixième rue, répondit Vanda en lui mettant le journal sous les yeux.
— L’indication notée sur le portefeuille de sir Ralph !
— Exactement.
— Continuez, Vanda, nous sommes sur la piste.
Vanda poursuivit :
« M. Christiani avait été trouvé mort au milieu de sa chambre. Madame Christiani, atteinte d’une balle à la poitrine, avait été emportée mourante dans sa famille et, peu de temps après, le bruit de sa mort se répandait à New-York. Heureusement, ce bruit était faux ; madame Christiani, complètement rétablie aujourd’hui et ne songeant plus qu’à venger son mari, qu’elle adorait, est venue faire sa déposition à New York et a fourni sur le principal coupable les plus précieux renseignements à la police, qui se félicite doublement de cette espèce de résurrection, car cette jeune femme seule a vu le meurtrier qui, sans ce témoignage, pouvait échapper à la justice. Au reste, nous apprenons qu’on est sur ses traces et qu’il ne saurait tarder à tomber avec son complice sous la main des deux habiles détectives envoyés à leur poursuite. »
— Voilà qui est clair, s’écria Rocambole ; c’est à la lecture de ce même article, qui leur a été envoyé de New-York par quelque affidé, qu’ils ont décampé de l’hôtel du Levant et qu’ils ont décidé de filer avec un million… qu’ils ne tiennent pas encore et qui pourrait devenir leur pierre d’achoppement.
IV
UN ÉTRANGE AMOUREUX
Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que Rocambole avait été frappé des dangers auxquels était exposée madame Taureins, menacée à la fois par Mac-Field et sir Ralph d’une part, puis par la marquise de Santarès et son digne allié, l’Allemand Goëzmann, qu’il supposait d’accord avec celle-ci et placé là par elle dans un dessein évidemment hostile à la jeune femme.
Transportons-nous à l’hôtel Taureins, et nous saurons jusqu’à quel point les craintes de Rocambole étaient fondées.
Si nous pénétrons dans les bureaux du banquier, nous voyons tout d’abord, assis derrière un grillage, dans lequel est pratique un guichet, l’homme de confiance de M. Taureins, le caissier Goëzmann.
Penché sur ses registres, il semble complètement absorbé dans ses calculs, et, à voir sa figure calme, bonasse et vulgaire, il serait absolument impossible de lui supposer d’autre ambition que celle de balancer parfaitement ses comptes.
De temps à autre il se redresse sur son siège, s’y affermit, reste une minute, rarement deux, dans une parfaite immobilité, afin de reposer ses reins, puis tire lentement de sa poche un large mouchoir à carreaux, tout maculé de tabac, l’étale méthodiquement, et toujours sans se presser, se mouche bruyamment, replie soigneusement son mouchoir, le remet dans la poche d’où il l’a tiré, reste une minute encore dans une complète immobilité, puis se remet au travail avec la même lenteur méthodique.
C’est l’image la plus parfaite du comptable et du caissier réunis dans une même personne.
C’est sur la recommandation d’un confrère, fort estimé dans la finance, mais aussi fort lancé dans le monde des actrices et fort bien vu des dames du lac, que Goëzmann est entré dans les bureaux de M. Taureins, ce qui semble détruire la supposition de Rocambole au sujet d’une complicité entre le caissier et la marquise de Santarès.
Au reste, le banquier est enchanté de son employé et en fait les plus grands éloges.
Jamais de mémoire de comptable on n’a eu l’exemple d’une pareille régularité.
Goëzmann n’est pas un homme, c’est un chronomètre. Tous les jours il arrive au bureau à neuf heures moins trois minutes, à sa montre, qu’il règle chaque matin sur la Bourse, déjeune derrière son grillage en trente-cinq minutes, prend cinq autres minutes pour savourer deux prises, essuyer les verres de ses lunettes et se raffermir dans son fauteuil, et enfin quitte son bureau à six heures deux minutes pour aller dîner.
Quelquefois, mais très-rarement, il est arrivé à l’Allemand de quitter son bureau pour aller communiquer quelque importante affaire à M. Taureins, à l’heure de son déjeuner, et chaque fois il s’est confondu devant la jeune femme en saluts et en génuflexions si humbles et si obséquieux qu’elle avait peine à dissimuler le dégoût que lui inspiraient tant de bassesses.
Or, ce même jour où il avait été question de lui chez Rocambole, Goëzmann, par un de ces cas extraordinaires dont nous venons de parler, quittait son bureau pour se rendre chez son patron, un registre sous le bras.
Pour se rendre dans la salle à manger où devait être M. Taureins à cette heure, on traversait un large vestibule sur lequel ouvraient plusieurs portes.
Goëzmann s’arrêta à l’une de ces portes et y frappa deux coups aussi timides que possible.
— Entrez ! dit une voix.
L’Allemand ouvrit la porte et entra.
Il se trouvait dans un petit salon meublé avec un goût parfait et où madame Taureins travaillait en ce moment à un ouvrage de femme.
— Vous, monsieur Goëzmann ? dit celle-ci avec surprise.
L’Allemand s’inclina.
— J’ai cru que c’était Suzanne.
Goëzmann garda le silence.
— Vous cherchez M. Taureins, reprit Valentine, vous devriez savoir qu’on ne le trouve jamais dans ce salon ; au reste, vous ne le trouverez pas davantage dans la salle à manger, car il n’a pas déjeuné ici aujourd’hui.
— Je le sais, madame, répondit Goëzmann avec calme.
— Vous le savez ! s’écria la jeune femme stupéfaite, eh bien, alors que venez-vous faire ici ?
— Je vais vous le dire, madame, répondit le caissier en déposant son registre sur un siège et en se rapprochant d’elle.
Madame Taureins le regardait avec une stupeur toujours croissante.
— Madame, dit l’Allemand d’une voix qui se troubla tout à coup et avec un embarras visible, malgré tous ses efforts pour le dissimuler, vous êtes belle !
À ces mots et au ton dont ils étaient prononcés, Valentine recula brusquement son fauteuil, et, après avoir toisé le caissier d’un air tout ahuri :
— Hein ? fit-elle, j’ai mal entendu, qu’avez-vous dit ?
— Vous êtes belle, madame, reprit l’Allemand.
Valentine se leva d’un bond, laissa tomber sur le caissier un regard écrasant de mépris et tendit froidement la main vers la porte sans prononcer un mot.
Un moment déconcerté, Goëzmann se remit bientôt :
— Oh ! dit-il, je savais d’avance comment je serais accueilli ; je ne me suis pas fait illusion à cet égard ; mais, après deux années d’hésitation, je me suis décidé enfin à parler, et, maintenant que le premier mot est lâché, j’irai jusqu’au bout.
Il reprit d’un ton déterminé :
— Eh bien ! oui, madame, vous êtes belle, admirablement belle, je m’en suis aperçu comme les autres, et je vous aime.
Cette phrase avait été lâchée d’un seul coup et tout d’une haleine, comme si celui qui la prononçait eût craint de ne pouvoir aller jusqu’au bout.
À cette déclaration inouïe et imprévue, la colère, l’indignation et surtout un sentiment de profond dégoût se peignirent sur la belle tête de madame Taureins, qui avait pâli.
Elle ouvrit la bouche pour laisser éclater ces sentiments, mais alors son regard s’étant arrêté sur cette tête épaisse, vulgaire, joufflue et béate, sur cette tournure lourde, disgracieuse et gauche, où se reflétaient si éloquemment toutes les prosaïques habitudes du comptable, un changement subit s’opéra sur son visage, et, après les plus violents efforts pour se contenir, après s’être mordu la lèvre jusqu’au sang, il lui devint impossible de résister plus longtemps, et elle partit d’un éclat de rire bruyant, sonore et qui se prolongea plus d’une minute.
Goëzmann, lui aussi, changea brusquement de visage.
Impassible devant la colère, devant le mépris et même devant le dégoût qui avaient accueilli sa déclaration d’amour, il avait pâli devant l’éclat de rire.
Sa large face, ordinairement toute calme et toute rose, était devenue blême et s’était violemment contractée, tout son corps était agité d’un tremblement nerveux, et ses petits yeux gris, grotesquement enfouis dans la boursouflure des paupières semblaient injectés de fiel.
Les bras croisés sur la poitrine et le regard fixé sur la jeune femme qui s’était laissée tomber sur son siège, il attendit, sans bouger, que la gamme de ses éclats de rire fût épuisée.
— Madame, dit-il enfin d’une voix qui passait difficilement entre ses dents serrées, il paraît que je suis fort risible quand j’aime et surtout quand je le dis ; on apprend tous les jours à se connaître, j’avoue que je ne me croyais pas si drôle que cela.
Devant le bouleversement qui s’était subitement opéré dans toute la personne de l’Allemand, madame Taureins avait elle-même changé tout à coup de physionomie.
— Monsieur, lui dit-elle avec l’expression d’un froid mépris, loin de vous en plaindre, félicitez-vous que j’aie accueilli votre étrange déclaration par un éclat de rire, au lieu de sonner et de vous faire jeter à la porte de ce salon d’abord, et ensuite des bureaux de mon mari.
— Votre mari, madame ! Si vous lui racontiez ce qui vient de se passer, il ferait comme vous, il rirait, il trouverait cela très-amusant et ne verrait pas là un motif pour me chasser.
— Vous vous trompez, monsieur ; il rirait d’abord, car il serait difficile de faire autrement, mais il vous chasserait ensuite.
— Essayez donc, madame.
Valentine frissonna de colère à cet insolent défi. Mais, en même temps, elle éprouva un vague sentiment d’effroi sous le regard sinistre que l’Allemand plongeait dans ses yeux.
Ce n’était plus le même homme et celui-là ne donnait pas envie de rire.
Le grotesque avait disparu pour faire place à une espèce de monstre, dont la face livide, subitement transfigurée, laissait deviner les plus effroyables instincts.
C’était la figure que devait avoir cet homme le jour où, à l’entrée de la Fournaise, il assassinait un malheureux voyageur pour lui voler ses six mille dollars.
— Tenez, madame, dit-il enfin, toujours entre ses dents qui ne pouvaient se desserrer, vous m’apprenez une chose dont je me suis toujours douté ; je suis très-drôle quand j’aime, j’espère vous prouver bientôt que je suis beaucoup moins drôle quand je hais.
Madame Taureins se leva frissonnante.
— Écoutez-moi, je n’ai pas tout dit, murmura l’Allemand.
V
LE VER DE TERRE
Un moment paralysée par le saisissement qui venait de s’emparer d’elle, madame Taureins releva enfin la tête, et, regardant fièrement l’Allemand :
— Je crois, monsieur, que vous osez me menacer, lui dit-elle.
— Au contraire, madame, répondit celui-ci avec un sourire sinistre, je vous félicite, oui, je vous félicite d’avoir ri de si bon cœur, car c’est peut-être le dernier éclat de rire qui sera sorti de vos belles lèvres.
Cette dernière menace, proférée avec une rage concentrée et l’accent d’une ardente conviction, troubla de nouveau profondément la jeune femme.
— Que voulez-vous dire ? lui demanda-t-elle d’une voix émue ; voyons, parlez, expliquez-vous.
Goëzmann la regarda un instant en silence, comme s’il eût joui de la frayeur à laquelle il la voyait en proie.
Puis il reprit :
— Madame, imaginez-vous une femme entourée de précipices et de fondrières et marchant les yeux bandés au milieu de ces abîmes, et vous aurez à peu près une idée de votre situation. Le péril vous enveloppe de toutes parts et sous toutes les formes, et vous tenteriez vainement d’y échapper, votre perte est résolue. Un seul homme eût pu vous y soustraire, c’est moi, et, pour remplir cette difficile mission, j’aurais manqué aux engagements les plus sacrés, je me serais exposé moi-même aux plus graves dangers ; vous ne l’avez pas voulu, que votre sort s’accomplisse.
Révoltée dans sa fierté en considérant le personnage qui osait lui parler ainsi, Valentine fut tentée un instant de répondre à ces paroles par le dédain et de lui montrer de nouveau la porte. Mais il y avait quelque chose de si terrible, de si effrayant dans le mystère même dont s’enveloppaient ces menaces qu’elle en fut atterrée et que, son orgueil cédant à la crainte dont elle se sentait saisie, elle répliqua :
— Des périls ! des abîmes ! ma perte résolue ! quels sont donc mes ennemis et qu’ai-je pu faire pour m’attirer de pareilles haines, moi qui n’ai jamais blessé personne ?
— Oh ! dit l’Allemand, je me garderai bien de vous éclairer sur tous ces points, madame ; je me garderai de vous désigner vos ennemis et de vous laisser entrevoir, même vaguement, la nature des dangers qui vous entourent et au-devant desquels vous marchez sans vous en douter. Sachez seulement qu’ils vous attendent et vous guettent partout, à chaque pas, dans toutes les circonstances de votre vie, et qu’ils fondront sur vous à l’heure même où vous vous croirez le plus en sûreté, chez vous, dans votre famille, dans la foule, au théâtre, partout enfin, et sans que vous puissiez même rien tenter pour les éviter, puisque vous ignorez à la fois les gens dont il faut vous défier et les pièges qui vous sont tendus.
En écoutant parler le caissier, la jeune femme se sentait prise d’une espèce de vertige.
Ces abîmes cachés, ces trames ténébreuses, ces ennemis invisibles, elle croyait les sentir autour d’elle, et ses regards se portaient de toutes parts avec un sentiment de crainte inexprimable.
— Mais, balbutiait-elle enfin, tout cela est impossible, je ne vous crois pas, c’est une atroce invention de votre part pour porter le trouble dans mon esprit et me jeter dans des transes qui feraient de ma vie un perpétuel supplice ; c’est une odieuse et basse vengeance.
— Restez dans cette rassurante pensée, madame, répliqua Goëzmann avec une ironique pitié, le réveil viendra toujours assez tôt.
Il y avait dans son ton une assurance devant laquelle Valentine se sentait défaillir.
— Tenez, madame, reprit l’Allemand qui guettait et surprenait une à une toutes les impressions par lesquelles passait la malheureuse jeune femme, si réellement vous preniez mes paroles pour une invention cruelle et pour une basse vengeance, vous m’auriez déjà chassé d’ici ; car, à coup sûr, ce n’est pas la pitié qui vous retient, vous m’en avez donné tout à l’heure une preuve assez éclatante. Si donc vous supportez si patiemment ma présence, qui vous est odieuse, c’est que vous vous sentez réellement et sérieusement menacée, c’est que vous comprenez que je connais, moi, les pièges terribles tendus sous vos pas et le sort effroyable qui vous attend, et, si je n’en étais déjà convaincu, votre pâleur et le tremblement qui vous agite ne me laisseraient aucun doute.
Vaincue enfin par l’épouvante qui peu à peu avait fini par l’envahir tout entière, madame Taureins plongea sa tête dans ses deux mains, comme pour fuir les sinistres visions qui l’assaillaient.
Implacable comme un amoureux bafoué et raillé, l’Allemand, au lieu de la prendre en pitié, lui porta ce dernier coup de massue :
— Non-seulement je sais tout ce qui vous est réservé, madame, mais qui vous dit que je ne sois pas un de vos exécuteurs ?
À ces derniers mots, la jeune femme se leva d’un bond et courut se jeter dans un fauteuil à l’autre extrémité de la pièce.
Elle s’y blottit tout entière, puis s’enveloppant de ses deux bras et se pelotonnant sur elle-même, elle tourna vers son ennemi ses grands yeux noirs tout éperdus, que l’épouvante faisait plus grands et plus splendides encore.
— Voilà des regards qui n’expriment pas l’amour, dit Goëzmann avec une froide ironie, mais je m’aperçois avec plaisir que j’ai cessé d’être ridicule : c’est un progrès. N’est-ce pas, madame, que je ne vous donne plus envie de rire ?
Immobile et comme pétrifiée, Valentine le regardait toujours avec la même expression et sans pouvoir proférer une parole.
— Ah ! madame, reprit l’Allemand, si vous saviez comme vous êtes belle en ce moment, vous comprendriez toute la haine qui a succédé dans mon cœur à l’amour que vous venez de tuer par un éclat de rire. Depuis deux ans, époque à laquelle cette fatale passion s’est emparée de moi, je vous contemple, du coin infime où m’a jeté le hasard, comme un ver de terre amoureux d’une étoile, ainsi que l’a dit un de vos poètes, et, à force de vous admirer, je me suis mis à vous aimer, sans songer que moi, ridicule et laid, je devais fuir vos regards au lieu de les attirer sur ma personne, que j’étais un de ces êtres maudits et déshérités qui, en échange même d’un dévouement aveugle, ne sauraient inspirer d’autres sentiments que le mépris et le dégoût, et auxquels leur laideur, qui les isole de tous, ne laisse en ce monde d’autre joie que celle de haïr et de se venger. Heureusement, madame, vous venez de me rappeler à mon rôle de maudit, à ma véritable mission, qui est de faire le mal, et je vais m’y replonger avec ardeur, avec volupté. Ces beaux yeux, si doux quand ils se reposent sur un autre peut-être, et qui n’ont pu exprimer pour moi que la répulsion et le dégoût, je leur ferai pleurer des larmes de sang, et ces larmes-là , du moins, elles seront à moi, bien à moi, car c’est moi qui les aurai fait couler. C’est tout ce que j’aurai de vous, madame, mais, ne pouvant aspirer à autre chose, je saurai me contenter de cela, et je ne demande au ciel qu’une grâce, c’est de voir ces larmes qui seront mon œuvre et de me repaître de vos tortures, car vous devez être bien belle quand vous pleurez, madame. Ah ! vous ne savez pas ce que c’est que de railler un amour longtemps couvé, vous ne soupçonnez pas tout ce que cela peut éveiller de rage dans le cœur et quelle terrible soif de vengeance ça lui inspire ! Vous l’apprendrez bientôt.
Madame Taureins était incapable de répondre un mot.
Elle était restée immobile dans la même position.
La terreur s’était, pour ainsi dire, figée sur ses traits, qui semblaient pétrifiés. C’était comme un masque tragique d’une fulgurante beauté.
— Adieu, madame, lui dit enfin l’Allemand en s’emparant du registre qu’il avait déposé sur un siège.
Mais, au lieu de se diriger vers la porte, il se rapprocha d’elle et, la regardant fixement :
— Il en est temps encore, madame, réfléchissez et décidez avant de me laisser franchir le seuil de cette porte ; que voulez-vous que je sois : votre exécuteur ou votre sauveur ?
Valentine se leva toute droite, comme mue par un ressort, et, laissant tomber sur lui un regard écrasant de mépris :
— Horreur ! horreur ! s’écria-t-elle en frissonnant de tous ses membres.
Il fit un mouvement pour se retirer.

— Oh ! mais, dit la jeune femme, sortie enfin de sa torpeur, je parlerai à mon mari, je lui rapporterai tout cet entretien, je lui dirai vos odieuses menaces et…
Elle fut interrompue par un petit rire sec et bref.
— Parler à votre mari, madame, dit Goëzmann, lui confier tout ce que je viens de vous dire ! lui demander l’explication des périls qui vous enveloppent ! je ne vous y engage pas, à moins que vous ne soyez décidée à précipiter le sinistre dénouement que je vous ai prédit. Si telle est votre intention, vous ne sauriez employer un meilleur moyen. Allons, madame, adieu.
Il sortit enfin, laissant la jeune femme en proie à un vertige qui ressemblait à un commencement de folie.
VI
LES AMOURS VRAIS
Il y avait, ce jour-là , représentation extraordinaire aux Italiens, or on sait l’aspect que présente cette salle quand une solennité y réunit son public exceptionnel.
Les femmes y font assaut de toilette ; c’est le luxe dans ce qu’il a de plus élégant et le goût dans ce qu’il a de plus délicat, mélange à la fois éblouissant et calme, d’où naît un coup d’œil féerique et une exquise harmonie.
Après avoir parcouru les premières loges et la galerie, le regard s’arrêtait forcément sur une loge de côté occupée par trois personnes, un homme d’une cinquantaine d’années, grand, haut en couleur et vigoureusement taillé, une femme de quarante ans environ, à la figure calme distinguée et sympathique.
La troisième personne était une jeune fille, et c’était elle qui attirait tous les regards sur cette loge.
Disons tout de suite que cette jeune fille était Tatiane, ce qui nous dispensera de faire son portrait.
Quant aux deux personnages qui l’accompagnaient, on devine que c’étaient M. et madame Mauvillars.
Avec cette franchise de sentiment et cette naïveté d’expansion qui faisaient son plus grand charme, elle laissait rayonner sur son doux et gracieux visage tout le plaisir qu’elle ressentait d’assister à cette solennité musicale et de s’y montrer dans une ravissante toilette.
C’est que ce jour-là elle avait accompli des prodiges de coquetterie pour mettre en relief toutes les merveilles de sa blonde beauté, et disons tout de suite qu’elle avait parfaitement réussi et que jamais ce triple caractère de bonté, de grâce et de candeur, qui formaient son type, n’avait éclaté avec autant de charme sur son frais visage.
Mais était-ce pour le public seul qu’elle avait fait tous ces frais ? C’est ce qu’il eût été difficile de deviner ; cependant nous croyons pouvoir affirmer que le public eût été bien fat de le supposer.
En sa qualité de femme, Tatiane avait commencé naturellement, en promenant sa lorgnette sur tous les points, par s’assurer de l’effet qu’elle produisait sur la salle ; puis, une fois cet effet constaté, la lorgnette subissant peu à peu une légère inclinaison avait rapidement parcouru les fauteuils d’orchestre et s’était relevée aussitôt.
La subite rougeur qui colora alors les traits de la jeune fille eût appris tout de suite à celui qui l’eût observée en ce moment que sa lorgnette venait de rencontrer là le spectateur, le seul pour lequel elle venait de consulter l’opinion de la salle au sujet de sa toilette.
Ce spectateur, le lecteur l’a deviné, n’était autre que Jacques Turgis.
Il avait rencontré là , séparé de lui par un fauteuil seulement, Paul de Tréviannes, qu’il s’était contenté de saluer, ne le connaissant que de nom et pour s’être trouvé avec lui dans quelques salons parisiens.
Entre ces deux jeunes gens était assis un individu qu’à son embonpoint, à la sacoche de cuir passée en bandoulière sur sa poitrine, aux épais favoris roux qui lui descendaient en deux points au-dessous du menton, et l’inaltérable sang-froid avec lequel il lorgnait les jolies femmes et les brillantes toilettes, on reconnaissait tout de suite pour un Anglais.
Paul de Tréviannes et Jacques Turgis lorgnaient beaucoup aussi.
Nous savons où visait la lorgnette de ce dernier.
Celle de Paul de Tréviannes s’était tout d’abord portée sur une loge occupée par une seule personne, une femme, et, à la vue de cette femme, il s’était troublé tout à coup.
C’était madame Taureins, dont les traits, plus pâles encore que de coutume, portaient l’empreinte d’une secrète et profonde souffrance.
C’est que quelques heures seulement s’étaient écoulées depuis l’horrible scène qui s’était passée entre elle et l’Allemand Goëzmann et son esprit était encore troublé des sombres perspectives que le misérable avait déroulées devant ses yeux.
L’Anglais, lui, avait aussi son point de mire, auquel il revenait fréquemment, mais avec moins de fièvre et moins d’émotion que ses deux voisins, c’était une loge également occupée par une seule femme, la comtesse de Sinabria.
Celle-ci n’était ni moins pâle, ni moins agitée que madame Taureins, et nous en savons également les raisons.
Des femmes d’une autre catégorie avaient aussi, aux fauteuils d’orchestre, leurs admirateurs exclusifs, et un groupe de jeunes gens ne tarissait pas d’éloges sur le chic et sur la haute excentricité d’une rousse, dont la toilette éclatante avait produit une vive sensation.
Cette superbe rousse était la marquise de Santarès.
— Eh bien ! oui, mes enfants, s’écria le plus âgé du groupe, un individu de trente-cinq à quarante, ans, que sa tête intelligente, son œil à là fois ardent et rêveur, sa chevelure abondante et quelque peu inculte, sa moustache à la Van Dyck désignaient tout de suite comme un poète ou un artiste, oui mes enfants, vous avez raison, de chanter cette créature trop calomniée qu’on a baptisée du nom vulgaire de cocotte, car, entre autres mérites que je passe sous silence, elle a celui de nous garantir des amours vrais, le mal le plus redoutable que je connaisse. J’en puis parler en connaissance de cause, car je suis une des victimes de cette affreuse maladie. Un jour, jour fatal et à jamais maudit ! j’ai aimé une femme honnête ; Dieu vous garde à jamais d’un tel malheur ! Je suis même parvenu à m’en faire aimer, et le jour où elle m’en fit l’aveu, jamais, je vous le jure, jamais ivresse plus pure et plus ineffable n’a inondé une âme humaine. C’était plus que de l’amour, c’était un culte, une adoration, une idolâtrie, et je le lui ai dit dans vingt lettres qui sont des chefs-d’œuvre, je puis le déclarer, car elles jaillissaient des sources vives de mon cœur. Mon exaltation était trop ardente, trop sincère pour n’être pas contagieuse, elle finit par la gagner et une heure vint, heure de crise suprême, où, succombant sous un baiser de feu, elle me cria d’une voix suppliante : grâce et je vous serai éternellement reconnaissante ! Cette femme était pour moi quelque chose de si sacré, je l’aimais d’un amour si prodigieux, si complètement en dehors de tous les sentiments humains, que, dans l’état de démence amoureuse où j’étais parvenu, j’éprouvai une profonde et douloureuse volupté à lui faire le sacrifice qu’elle me demandait, convaincu que son amour, qui m’était cent fois plus précieux encore que sa possession, allait centupler après ce trait d’héroïque abnégation.
Le narrateur s’arrêta tout à coup, plongea son front dans sa main et resta quelques instants dans cette position.
— Eh bien ! lui demanda l’un de ses auditeurs.
Il releva sa tête, qui avait légèrement pâli :
— Eh bien ! dit-il avec une affectation de gaieté qui démentait le tremblement de sa voix, cette sublime niaiserie méritait un châtiment, il ne se fit pas attendre ; quelques jours après elle me congédiait en m’assurant de toute son estime, et un peu plus tard je découvrais qu’elle avait reporté ses rêves sur un commis, employé dans je ne sais quelle industrie. Ses vraies aspirations étaient pour le commerce ; mon tort était de n’avoir pas deviné cela et de n’avoir pas compris aussi qu’au lieu d’un cœur, que je croyais y avoir senti, c’était un morceau de parchemin qu’elle avait dans la poitrine. Ah ! croyez-moi, mes enfants, ne poétisez jamais la femme ; il vient toujours une heure où il faut lui arracher du front l’auréole qu’on y a mise.
Il ajouta aussitôt en changeant de ton :
— Parlez-moi de la cocotte, avec celle-là au moins il n’y a pas de désillusions, le cœur n’est jamais de la partie, on ne risque pas d’en laisser quelque lambeau entre ses mains, ce sont les seules amours où puisse se risquer, sans danger, un homme de bon sens et surtout un poète ; voilà où j’en voulais venir en vous racontant ma ridicule histoire.
— Tu as beau faire le fanfaron et vouloir rire de ta douleur, lui répondit un jeune homme, la blessure saigne encore.
— Je crois même qu’elle saignera toujours, répondit le poète en passant insoucieusement la main dans son épaisse chevelure, mais j’en ai pris mon parti.
— Mon cher ami, si l’on pouvait avoir le secret de tout ce qui s’est fait de grand dans les arts et dans les lettres, on découvrirait peut-être que les plus purs chefs-d’œuvre ont été faits avec les larmes et les tortures du cœur.
— Qui sait si je n’en serai pas une nouvelle preuve. Je ferai un roman avec mes douleurs, et il y aura là , je vous le jure, une curieuse étude de femme.
À la suite de cet entretien, que nous avons reproduit à titre de curiosité, parce qu’il atteste que tout se trouve dans ce Paris réputé si frivole, même, ou plutôt surtout, les passions vraies, les grands sentiments, le culte du beau, le dévouement à l’art, à l’art qui s’alimente de tout et va puiser la vie jusque dans les cœurs blessés, l’écrivain dit à ses amis en leur désignant Tatiane :
— Voyez donc la ravissante jeune fille ! Ah ! on peut aimer celle-là sans rien craindre ; elle ne se fera pas un jeu de déchirer les cœurs après les avoir enivrés ; il se dégage de son charmant visage une expression de bonté qui suffirait seule à la faire adorer, si elle n’était ravissante de tout point.
— Tiens ! quel est donc le monsieur qui vient s’asseoir près d’elle ? dit un jeune homme avec humeur. Je ne sais pas dans quelle intention, mais si c’est dans le seul but de produire un contraste, il peut se flatter d’avoir réussi ; on dirait le prince des ténèbres parlant à l’oreille d’un séraphin.
— Monsieur, dit en ce moment une voix à l’oreille de Jacques Turgis, voilà le moment de lorgner la loge des Mauvillars : mademoiselle Tatiane est en péril, je vous en préviens.

VII
ALLIANCE DÉFENSIVE
Jacques Turgis se retourna brusquement et resta stupéfait en se trouvant face à face avec l’Anglais dont la mine et la tournure l’avaient fait sourire un instant auparavant.
— C’est vous qui venez de me parler, monsieur ? dit-il au gros homme qui recommençait à lorgner.
— Moi-même, monsieur, répondit l’Anglais sans changer de position.
— Alors, monsieur, veuillez me donner l’explication de vos paroles.
— C’est ce que je vais faire.
Et se tournant enfin vers l’artiste :
— Vous êtes monsieur Jacques Turgis paysagiste, n’est-ce pas ?
— Oui, monsieur.
— Et vous aimez mademoiselle Tatiane ?
— Mais, monsieur, dit Jacques d’un ton froid, une pareille question…
— Est indiscrète, je le sais, mais nous n’avons pas le temps de nous arrêter à ces petites considérations. Tenez, voyez-vous cet individu qui vient de s’asseoir près d’elle, pendant que M. et madame Mauvillars causent au fond de la loge avec un personnage que je crois avoir vu à leur fête ?
— M. Badoir, leur parent ?
— Ah ! c’est là M. Badoir ! je m’étonne de le voir lié avec l’individu que je viens de vous signaler, mais nous examinerons cela plus tard ; quant à présent, occupons-nous de ce qui vous concerne, vous et M. Paul de Tréviannes.
Ce nom avait été prononcé assez haut pour frapper l’oreille du jeune homme, qui, à son tour, se tourna tout à coup vers l’Anglais en lui disant :
— Vous me connaissez, monsieur ?
— Fort peu, répondit celui-ci, mais assez cependant pour vous avoir envoyé, ainsi qu’à M. Jacques Turgis, que je vous présente, le fauteuil d’orchestre dont vous avez bien voulu profiter l’un et l’autre.
— Quoi ! s’écrièrent à la fois les deux jeunes gens, c’est vous qui…
— C’est moi qui, ayant appris que mademoiselle Tatiane et madame Taureins devaient se rendre à cette représentation extraordinaire ai cru vous être agréable à tous deux en vous mettant à même d’y assister.
— Mais, dit vivement Paul de Tréviannes, un peu déconcerté, je suis attiré ici par le seul attrait de cette représentation, et…
— Par l’espoir d’y rencontrer madame Taureins, que vous ne cessez de lorgner et dont l’extrême pâleur vous cause une inquiétude visible et malheureusement trop justifiée.
Le jeune homme frissonna à ces derniers mots, puis regardant l’Anglais d’un air inquiet :
— Qui êtes-vous donc, monsieur ? lui demanda-t-il.
— C’est ce que je vais vous dire, ainsi qu’à monsieur Jacques Turgis, si vous voulez bien m’écouter tous les deux.
Il ajouta aussitôt, sans leur laisser le temps de répondre :
— Je ne suis pas Anglais, comme vous l’avez cru tous deux, c’est un déguisement dont je vous dirai les motifs ; je me nomme M. Portal, je suis Français et rentier. Maintenant, entrons en matière.
« Vous devez bien penser l’un et l’autre que je ne vous ai pas fait venir ici pour vous procurer le plaisir d’entendre chanter un opéra italien, non, c’est pour un motif plus grave, et le voici. Le hasard m’a fait faire, il y a quelque temps, une étrange et effrayante découverte, un réseau de complots formidables tendu autour d’une même famille, dont trois membres sont particulièrement menacés : la comtesse de Sinabria, madame Taureins et mademoiselle Tatiane Valcresson.
— Des complots ! s’écria Jacques, mais les complots sont dirigés par des hommes, et ces hommes, il y a deux moyens de s’en débarrasser, suivant les gens auxquels on a affaire, par un duel ou par l’intervention de la police. Qu’en dites-vous, monsieur de Tréviannes ?
— Rien de plus simple, en effet, répondit celui-ci.
— Rien de plus difficile, répliqua Rocambole, pour déjouer un complot, il faut savoir en quoi il consiste, pour s’attaquer à un homme, il faut savoir où le saisir, et je ne sais rien de tout cela.
— Mais, fit observer Jacques d’un ton un peu incrédule, à quoi avez-vous reconnu l’existence de ces dangers dont il vous est impossible de préciser la nature, et même de nous faire connaître la cause ?
— J’ai été mis sur la voie de ces sinistres desseins par un portefeuille tombé entre mes mains et sur lequel étaient inscrits les noms que je viens de vous citer.
— Et celui de mademoiselle Tatiane ? demanda vivement l’artiste.
— Ce nom-là était marqué d’un signe qui semblait appeler sur sa tête des menaces ou des vengeances tout exceptionnelles.
L’artiste se troubla tout à coup à ces mots.
Cependant il reprit, en affectant de se rassurer :
— Que prouvent ces noms inscrits sur un portefeuille, dont le propriétaire est peut-être un fort honnête homme ?
— Justement, c’est que ce propriétaire est un misérable de la plus dangereuse espèce.
— Vous le connaissez ?
— Et je puis vous le montrer.
— Où est-il donc ?
— Près de mademoiselle Tatiane.
Jacques Turgis lança un regard sur la loge des Mauvillars, et tressaillit à la vue de l’inconnu qui, en ce moment, causait très-intimement avec la jeune fille.
C’était sir Ralph.
— En effet, murmura-t-il, il y a quelque chose de sinistre dans cette tête-là .
Il ajouta :
— Mais si cet homme est ce que vous dites, comment se fait-il qu’il soit dans la loge de M. Mauvillars ?
— Vous voyez, il y est avec M. Badoir, qui lui a donné accès dans la maison de son parent.
— Quoi ! s’écria l’artiste, ce misérable, cet homme infâme serait admis chez M. Mauvillars ?
— Admis à ses soirées intimes, où il a déjà paru deux fois.
— Dans quel but, grand Dieu ?
— Je ne saurais le dire au juste : mais rappelez-vous que mademoiselle Tatiane est notée d’un signe tout particulier sur le fatal portefeuille, le sien.
— Mais rien ne prouve, après tout, quel que soit cet homme, que l’inscription d’un nom sur ce portefeuille soit une menace.
— J’en ai une preuve, au contraire, preuve palpable et terrible, dans la destinée de l’une des trois femmes que je viens de vous citer.
— Laquelle ? demanda vivement Paul de Tréviannes.
— La comtesse de Sinabria !
— Que lui est-il donc arrivé ?
— Quelque chose de si effroyable, que je défie l’imagination la plus infernale d’inventer une situation pareille ; c’est au point que je me demande comment son cerveau peut résister à de telles angoisses, comment il n’a pas été envahi par la folie.
Les deux jeunes gens avaient pâli.
— Et vous dites, murmura Paul, que madame Taureins est menacée par cet homme ?
— Par ces hommes, car ils sont deux ; oui, monsieur de Tréviannes.
— Et mademoiselle Tatiane ? balbutia à son tour Jacques Turgis.
— Je ne dirai pas également, mais plus que tout autre, je vous en ai prévenu.
— Alors, je vais aller trouver M. Mauvillars et lui faire connaître ce misérable, qu’il va chasser aussitôt.
— Il faudrait pour cela avoir quelque chose à articuler contre lui ; or, qu’aurez-vous à dire ?
— Ce que vous m’apprendrez vous-même.
— Je ne vous apprendrai rien.
— Pourquoi cela, monsieur ? s’écria Jacques Turgis.
— Parce que la moindre tentative exercée contre cet homme ou son complice, le moindre mot prononcé pour leur nuire, déterminerait la perte immédiate et définitive de la comtesse de Sinabria, qui, je vous le répète, est entièrement à leur discrétion.
— Ainsi, dit Paul de Tréviannes, voilà deux femmes exposées aux plus grands périls et nous ne pouvons rien pour elles ! et nous allons assister les bras croisés aux catastrophes qui vont fondre sur leurs têtes !
— Les bras croisés ! oh ! que non pas ! ce n’est pas pour cela que je vous ai réunis ici tous deux. Vous allez, au contraire, associer vos efforts aux miens pour surveiller incessamment ces ennemis et les combattre sans relâche, mais à leur façon, dans l’ombre et sans jamais vous montrer : le succès est à ce prix. J’aurais pu me passer de vous, à la rigueur, mais j’ai deux raisons pour réclamer votre concours : la première, c’est qu’ayant affaire à des ennemis redoutables et capables de tout, je suis assuré de trouver en vous des auxiliaires intelligents et résolus, au cas où je viendrais à être momentanément mis hors de combat dans la lutte à mort que nous allons entreprendre ; la seconde, c’est que je suis convaincu que vous me saurez un gré immense de vous fournir l’occasion de risquer votre vie pour sauver celles que vous aimez.
Les deux jeunes gens allaient le remercier, quand l’un des deux, Jacques, murmura d’une voix défaillante :
— Mon Dieu ! qu’arrive-t-il donc à Tatiane ?
Les traits de la jeune fille s’étaient subitement décolorés et c’était d’un air hagard qu’elle écoutait les paroles de sir Ralph.
— Eh bien, me croyez-vous maintenant ? lui dit Rocambole.
Il ajouta :
— Malheureusement, la prudence, l’intérêt même de la jeune fille vous commandent d’assister de loin à son supplice ; allez rendre demain une visite à M. Mauvillars et elle vous dira son secret ; mais, quant à présent, ne bougez pas de là , quoi que vous puissiez en souffrir, il le faut.
Puis, s’adressant à Paul de Tréviannes :
— Vous, au contraire, monsieur de Tréviannes, rien ne s’oppose à ce que vous alliez visiter madame Taureins dans sa loge ; elle a reçu aujourd’hui, c’est évident, quelque terrible secousse dont il est important que nous soyons instruits ; et moi, de mon côté, je vais voir la malheureuse comtesse de Sinabria, qui m’attend, en proie aux plus cruelles angoisses.
VIII
UNE DEMANDE EN MARIAGE
Peut-être le lecteur est-il curieux de savoir ce qui se passait entre sir Ralph et Tatiane et la raison de l’altération profonde que Jacques Turgis avait remarquée sur les traits de la jeune fille.
C’était, en effet, M. Badoir qui venait d’introduire sir Ralph dans la loge de Mauvillars, et nous savons qu’il se trouvait dans l’impossibilité de rien refuser à ses deux associés, car l’association était un fait accompli, l’acte était signé et la maison Badoir et Cie fondée depuis huit ou dix jours.
C’était le jour même où ils avaient quitté l’hôtel du Levant, après la lecture du journal américain dont nous connaissons maintenant le contenu, que Mac-Field et sir Ralph avaient compris la nécessité de se dissimuler au plus vite derrière le nom et l’honorabilité incontestée de M. Badoir, et quarante-huit heures après ils disparaissaient sous la raison de commerce Badoir et Cie.
En priant le banquier de la rue Cassette de l’accompagner dans la loge de M. Mauvillars, sir Ralph ne lui avait pas fait mystère du motif qui l’y attirait, et il avait été décidé entre eux qu’il ferait en sorte d’attirer les deux époux au fond de la loge, afin de le laisser libre de s’entretenir quelques instants avec la jeune fille.
Comme nous l’avons vu, ce plan avait parfaitement réussi, et, tandis que M. Badoir retenait les deux époux dans le petit salon qui précédait la loge, sir Ralph avait demandé et obtenu la permission d’aller présenter ses hommages à mademoiselle Tatiane.
Et s’asseyant près de la jeune fille, qui en paraissait plus gênée que ravie, sir Ralph commença naturellement par lui faire les compliments d’usage sur sa grâce, sa beauté, le goût exquis de sa toilette, puis il ajouta en baissant la voix et en donnant à son accent quelque chose de plus intime :
— Mademoiselle, voulez-vous me permettre de vous demander un conseil ?
— Un conseil, à moi ! répondit Tatiane en souriant, vous n’y songez pas, monsieur, je suis plutôt d’âge à en recevoir qu’à en donner.
— En thèse générale, peut-être avez-vous raison, mademoiselle, répliqua sir Ralph, mais, pour le cas particulier sur lequel je veux vous consulter, je suis convaincu que vous êtes plus apte que personne à me donner un avis.
— Parlez donc, monsieur, puisque vous avez tant de foi dans ma vieille expérience.
— Mademoiselle, je veux me marier.
Tatiane ne jugea pas à propos d’approuver ou de combattre ce désir.
Sir Ralph reprit :
— L’usage en pareil cas, je le sais fort bien, est de s’adresser d’abord aux parents de la jeune fille à laquelle on prétend, et cet usage me paraît fort sensé quand on voit dans le mariage une affaire, ce qui, hélas ! n’arrive que trop fréquemment au temps où nous vivons.
La jeune fille continua de garder le silence.
— Mais, poursuivit sir Ralph, lorsqu’on aime la jeune fille dont on voudrait faire sa femme, lorsqu’on a mis dans cette union tout le bonheur de sa vie, quand les questions d’argent, de relations, de convenances et toutes les considérations secondaires disparaissent à vos yeux devant le seul désir de lui plaire, alors, mademoiselle, je crois qu’il est permis de violer les usages reçus et de s’adresser tout d’abord à celle qui tient votre destinée entre ses mains.
Cette fois, sir Ralph regarda Tatiane de manière à lui faire comprendre qu’il attendait une réponse.
— Peut-être avez-vous raison, monsieur, répondit la jeune fille avec embarras, mais je vous avouerai que je n’ai jamais réfléchi à ces choses-là , de sorte qu’il m’est impossible de vous dire mon opinion.
— Et moi, je ne doute pas que vous n’ayez un avis à me donner sur ce point quand vous saurez le nom de la jeune fille que j’aime et dont je veux connaître les sentiments à mon égard avant de la demander à sa famille.
— Je la connais ? demanda Tatiane.
— Parfaitement.
— Et elle se nomme ?…
— Elle porte un nom aussi étrange que charmant, Tatiane.
— Moi ? balbutia la jeune fille en se troublant tout à coup.
Il y eut un moment de silence très-gênant pour Tatiane, qui était fort embarrassée de sa contenance, n’osant relever les yeux dans la crainte de rencontrer ceux de sir Ralph et comprenant cependant qu’elle ne pouvait les tenir constamment baissés.
— Vous voyez, mademoiselle, lui dit enfin sir Ralph, que j’avais raison de dire que vous étiez mieux à même que personne, en dépit de votre âge, de me donner un conseil dans cette circonstance.
— C’est vrai, monsieur, balbutia la jeune fille, de plus en plus troublée.
— Et m’approuvez-vous de m’être adressé à vous d’abord ?
— Mais… oui, monsieur.
Un rayon de joie et d’espoir passa dans les yeux de sir Ralph.
— Je vous approuve de m’avoir parlé d’abord, reprit Tatiane en faisant un effort pour vaincre sa timidité, parce que cela vous évitera l’ennui de faire près de mon oncle Mauvillars une démarche inutile.
— Inutile ! répéta sir Ralph en changeant brusquement de physionomie, comment dois-je interpréter cette parole, mademoiselle ?
— D’une façon qui n’a rien de blessant pour vous, monsieur, je ne veux pas me marier.
Sir Ralph garda un instant le silence.
Il se mordait les lèvres et une sombre colère éclatait dans son regard.
— Mademoiselle, reprit-il enfin, à votre âge on sait à peine lire dans son propre cœur, permettez-moi donc de vous aider à déchiffrer ce qui se passe dans le vôtre.
— Dites, monsieur, reprit la jeune fille, qui se sentait saisie d’un vague effroi.
— Est-ce le mariage qui vous déplaît, ou le mari qui s’offre à vous ?
— Je vous l’ai dit, monsieur, c’est le mariage.
— Vous me l’avez dit, en effet ; mais je me demande si vous feriez la même réponse à tout le monde.
— Sans doute, monsieur.
— Même au jeune homme que vous voyez aux fauteuils d’orchestre, causant avec un gros Anglais et qu’on nomme, je crois, M. Jacques Turgis ?
Tatiane devint rouge comme une pivoine.
— Monsieur, balbutia-t-elle, je n’ai pas à répondre à …
— C’est inutile, dit sir Ralph d’une voix brève et amère, votre émotion répond pour vous.
Il ajouta après un silence :
— Au reste, je l’avais deviné. Voilà donc celui qui a le bonheur de vous plaire, eh bien ! mademoiselle, si ce jeune homme vous convient pour mari, il n’a pas mon agrément et je vous déclare que vous ne l’épouserez pas.
À ces mots la fierté de la jeune fille déborda tout à coup et elle allait répliquer quand sir Ralph l’interrompit.
— Pardon, dit-il vivement, ce n’est pas une volonté que j’exprime, c’est une prophétie que je fais entendre. Je suis quelque peu doué du don de seconde vue, j’en ai fait quelquefois l’expérience et, en étudiant la physionomie de M. Jacques Turgis, j’y vois clairement que de terribles catastrophes vont élever entre vous et lui d’insurmontables obstacles, catastrophes où il trouvera le désespoir, la honte, la mort peut-être et qui naîtront de cet amour, condamné d’avance par le destin. Ce sera payer cher le bonheur d’avoir été aimé de vous, mais ce sera ainsi, j’en ai le pressentiment, ou, pour mieux dire, l’intime conviction. Son sort est entre vos mains, c’est à vous à décider si vous l’aimez assez pour renoncer à lui par amour pour lui-même.
C’est alors que les traits de la jeune fille tout à l’heure si frais et si épanouis, s’étaient couverts de cette subite pâleur dont Jacques Turgis avait été frappé.
Sir Ralph reprit, la tenant tremblante et atterrée sous son regard :
— Et maintenant, si je lis au fond de vos beaux yeux, si j’y cherche les événements qui vont marquer votre vie et qui se déroulent clairement à cette vue intérieure dont je suis doué, j’y découvre qu’en dépit de tous les efforts que vous pourriez tenter pour vous y soustraire, en dépit même de la volonté de votre famille, si elle était tentée de s’y opposer, vous serez la femme de celui que vous venez de repousser tout à l’heure.
— Votre femme ! murmura Tatiane en laissant échapper un cri étouffé.
— Je vois clairement cette union s’accomplir, poursuivit sir Ralph avec un accent dont la sombre solennité porta jusqu’au vertige l’épouvante de la jeune fille, je la vois dans tous ses détails, mais sous deux aspects différents, calme, brillante, heureuse avec votre consentement ; accomplie malgré vous, au contraire, je la vois précédée d’orages, enveloppée de drames effroyables dont vous êtes le centre et au sein desquels vous marchez pâle, chancelante, effarée, brisée sous le poids des malheurs inouïs que vous avez appelés sur votre tête.
La pauvre Tatiane était comme foudroyée.
Pâle, immobile et muette, elle fixait devant elle un regard vague, hagard, halluciné, un regard de fantôme, et, avec ses grands yeux bleus et sa magnifique chevelure blonde, elle rappelait en ce moment la douce et belle Ophélie promenant sa folie au milieu des splendeurs de la cour de Danemark.
— Adieu, mademoiselle, lui dit sir Ralph en faisant un mouvement pour se retirer, réfléchissez et souvenez-vous.
Il ajouta avant de partir :
— Un dernier mot ; M. Jacques Turgis, qui ne nous perd pas de vue et auquel votre trouble n’a pu échapper, vous demandera, sans nul doute, la confidence de ce qui vient de se passer entre nous. Agissez comme il vous plaira, je n’ai aucun conseil à vous donner à cet égard, je ne puis que vous prévenir de ce qui vous arrivera. Il est brave, cela se devine, il me provoquera, et, comme je suis de première force à toute arme, il me mettra dans la fâcheuse obligation de le tuer, pour n’être pas tué moi-même.
Il se leva, et, saluant la jeune fille le plus galamment du monde, il alla rejoindre M. Badoir.
IX
CONSULTATION
En quittant son fauteuil d’orchestre, Rocambole, nous le savons, s’était rendu à la loge de la comtesse de Sinabria.
On se souvient que la comtesse, en lui faisant part des nouvelles exigences désir Ralph, lui avait donné rendez-vous là pour ce même soir.
En entendant ouvrir la porte de sa loge, elle se retira au fond, convaincue que ce devait être M. Portal ; mais elle jeta un cri de surprise et de désappointement à l’aspect d’un gros Anglais, porteur d’une sacoche en bandoulière, sans plus de cérémonie que s’il eût été aux courses.
L’Anglais entra tranquillement, referma la porte derrière lui, et, saluant la comtesse :
— Rassurez-vous, madame, lui dit-il en s’asseyant près d’elle, je suis M. Portal, et cette figure de John Bull est un déguisement destiné à tromper mes ennemis et les vôtres.
— Ah ! Dieu soit loué ! vous voilà près de moi, monsieur ; je me sens un peu moins désespérée, murmura la comtesse avec un profond soupir.
— Ne vous laissez pas aller au découragement, madame, lui dit Rocambole, c’est le moyen de tout perdre en laissant tout l’avantage à son ennemi. Quelle que soit la situation, eût-on même un pied dans l’abîme, il faut toujours lutter, toujours se raidir contre le destin et ne jamais désespérer tant qu’il reste un souffle de vie.

— Ne pas me décourager, monsieur, s’écria la comtesse en tordant ses belles mains, mais songez donc, dans quarante-huit heures il me faut un million ou je suis perdue ! Un million ! comprenez-vous ? où voulez-vous que je trouve un million ?
— C’est impossible et je m’en félicite.
— Comment ! s’écria Rita en le regardant fixement, mais vous ne comprenez donc pas ? je suis à la discrétion de cet homme ! et si je n’ai pas cette somme à lui donner…
— Vous êtes perdue, c’est entendu, seulement si vous la lui donnez, vous n’êtes pas sauvée.
— Comment cela ?
— Que vous a-t-il promis en échange de cette somme ?
— Il m’a promis de me rendre mon enfant et de me remettre un écrit dans lequel il me ferait connaître le véritable instigateur du drame dont je suis victime, avec tous les détails de cette infernale combinaison, qu’il déclarerait mensongère, calomnieuse et entièrement inventée par ce misérable, intéressé à ma perte.
— C’est fort bien, mais je connais cette espèce, quand il aura empoché ce million, son premier mouvement sera un regret, celui de n’avoir pas demandé davantage, et vous le verrez bientôt revenir à la charge.
— N’aurais-je pas, pour repousser ses prétentions, cet écrit par lequel il reconnaîtrait hautement mon innocence ?
— Il haussera les épaules et vous répondra : Madame, j’ai les preuves palpables de votre crime ; d’abord un vivant témoignage, l’enfant, que je produirai quand il le faudra, puis son nom inscrit à la mairie d’Aubervilliers, et enfin le témoignage de madame Morel, la sage-femme. Que dire à cela ? Vous indigner ? il en rira et il faudra faire des efforts surhumains pour trouver cette nouvelle somme, quitte à recommencer plus tard, jusqu’au jour où, à bout de ressources, ne pouvant plus rien donner, vous n’aurez plus qu’à tendre la gorge à votre bourreau.
La comtesse était atterrée.
— Mais alors, monsieur, dit-elle avec un accent désespéré, tout est fini, inutile de lutter, je suis dans une impasse sans issue où je n’ai plus qu’à attendre la mort, voilà ce que vous me prouvez jusqu’à l’évidence, et vous me dites de ne pas me décourager !
— Pardon, madame, je vous dis que des millions ne vous sauveraient pas et je vous en ai expliqué les raisons ; c’est dans une autre voie qu’il faut chercher votre salut.
— Ne venez-vous pas de me démontrer que je ne pouvais rien contre les témoignages accablants qu’ils ont entre les mains ?
— Parfaitement, et c’est sur ce terrain que doivent porter tous nos efforts.
— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire qu’ils ont tous les atouts en main et qu’il faut tout mettre en œuvre pour les faire passer dans notre jeu.
— C’est trop fort pour moi, cela, monsieur, je ne vous comprends pas.
— C’est par la ruse qu’il faut combattre ces gens-là , et depuis quelque temps déjà , je m’occupe de cette affaire sans vous en avoir rien dit.
— Et vous espérez ?… s’écria la comtesse.
— J’espère toujours, quelles que soient les difficultés qui s’élèvent devant moi, mais je ne me dissimule pas que cette fois elles sont immenses.
— Si elles n’étaient qu’immenses, nous en viendrions à bout, soupira la comtesse, mais je les crois insurmontables.
— Peut-être ; mais en attendant, il faut songer au plus pressé, à la réponse à faire à sir Ralph lorsque, dans deux jours, il viendra réclamer son million.
— Que faire ? mon Dieu ! que faire ?
— Obtenir un répit de quelques jours, pendant lesquels je trouverai peut-être quelque moyen… enfin obtenez un délai, tout est là quant à présent.
— Mais ce délai écoulé, je…
— Ce délai écoulé, j’aurai peut-être découvert ce qui décidera probablement du succès des efforts que je vais tenter, c’est-à -dire le mystérieux instigateur de cette sinistre affaire et les agents secrets dont se servent nos ennemis. D’après certains détails que vous m’avez donnés, ces agents doivent être chez vous, dans votre maison même, bref, parmi vos serviteurs.
— Vous croyez, monsieur ? s’écria la comtesse indignée.
— J’en jurerais.
— Oh ! c’est affreux à penser.
— Êtes-vous bien sûre de votre femme de chambre ?
— Comme de moi-même, monsieur ; elle m’a donné des preuves de dévouement qui ne me permettent pas de mettre en doute sa fidélité.
— Avez-vous la même confiance dans vos autres domestiques ?
— Quant aux autres, je n’ai pas été à même de les mettre à l’épreuve et ne puis guère me faire une opinion sur leur compte.
— Eh bien, moi, je m’en suis fait une, quoique je n’aie fait que les entrevoir en passant.
— Ah ! fit Rita stupéfaite.
— Vous avez là un cocher qui ne me dit rien de bon.
— François ?
— Précisément ; la tête de ce François m’a produit la plus fâcheuse impression et je ne serais pas surpris… mais je saurai bientôt à quoi m’en tenir sur son compte, et s’il joue près de vous le rôle que je suppose, je ne désespère pas d’arriver par lui à connaître le principal et véritable auteur de tous vos maux. Le jour où j’aurai atteint ce résultat, c’est alors que vous pourrez vous considérer comme sauvée, car pour combattre efficacement les effets, il faut, avant tout, connaître les causes, et c’est là , en ce moment, l’objet de mon active préoccupation.
Il ajouta, en montrant la loge de M. Mauvillars :
— Ce personnage, qui cause au fond de la loge avec les époux Mauvillars, est M. Badoir, n’est-ce pas ?
— Notre parent, oui, monsieur.
— Que pensez-vous de lui ?
— Tout le bien qu’on puisse penser d’un homme, monsieur ; il jouit de la considération la plus haute et la mieux méritée.
— On me l’a déjà dit ; savez-vous que c’est lui qui a introduit chez M. Mauvillars ce misérable sir Ralph, votre ennemi, que vous voyez en train de causer avec mademoiselle Tatiane.
— Je le sais ; il est évident qu’il a été indignement trompé sur le compte de ce misérable, qu’il m’est malheureusement impossible de démasquer.
— Et qui profite de ce silence forcé pour commettre quelque nouvelle infamie. Voyez plutôt la pâleur et l’air effaré de la jeune fille en écoutant ses paroles.
— Pauvre Tatiane ! murmura la comtesse en tressaillant ; serait-elle, ainsi que moi, victime de quelque infernale machination ?
— N’en doutons pas ; mais nous saurons bientôt à quoi nous en tenir sur ce point, et, de ce côté-là encore, sir Ralph et son digne associé trouveront à qui parler.
Il reprit bientôt après avoir fixé un long regard sur la loge des Mauvillars :
— Il n’existe aucune affaire d’intérêt entre vous et M. Badoir.
— Aucune, répondit Rita. Pourquoi cette question ?
— Je ne puis vous le dire. Vu l’opinion que vous avez de M. Badoir et qui doit être juste, vous vous révolteriez contre la pensée qui vient de traverser mon esprit, mais dans laquelle je ne persiste pas, quoique cette liaison avec sir Ralph…
— Je vous affirme que sa bonne foi a été surprise et qu’il est en ce moment la dupe de cet homme, en attendant qu’il soit sa victime, comme tant d’autres.
— Peut-être.
— Mais, j’y songe, ce misérable m’a déjà vue ou va me voir, dans ma loge, et il profitera sans doute de l’occasion pour venir me rappeler la visite qu’il doit me rendre après-demain.
— C’est probable.
— Que lui répondre ?
— Je vous l’ai dit, madame, demander un délai.
— Pressé comme il est, il insistera pour que je précise un jour.
Rocambole réfléchit un instant.
Puis il dit à la comtesse :
— Demandez huit jours de plus, c’est-à -dire dix jours à partir d’aujourd’hui. Dans dix jours tout sera accompli, votre sort sera décidé, vous serez perdue ou sauvée.
La comtesse se mit à trembler de tous ses membres à ces derniers mots.
Rocambole reprit :
— La perspective est terrible, j’en conviens, et je comprends que vous trembliez à l’approche de l’heure où se livrera la lutte suprême, mais si vous succombez, vous m’entraînez dans votre chute, c’est vous dire que je ferai des efforts surhumains pour triompher.
— Ah ! que d’angoisses ! et qui sait si d’ici là Dieu n’aura pas brisé ma vie ou éteint ma raison.
— Je vous l’ai dit, madame, espérons jusqu’au dernier souffle. Mais sir Ralph quitte la loge des Mauvillars ; il se peut qu’il vienne ici, comme vous le pensez. Au revoir, madame la comtesse.
X
CRUELLES ALTERNATIVES
Paul de Tréviannes, lui aussi, en entrant dans la loge de madame Taureins, avait trouvé une femme en proie aux plus violentes angoisses.
Dans l’état de surexcitation où elle se trouvait en ce moment, son isolement au milieu de cette loge ajoutait encore à la morne tristesse qui la dévorait, aussi ne put-elle comprimer un mouvement de joie en voyant entrer M. de Tréviannes.
Des larmes lui vinrent même aux yeux, résultat d’une espèce de crise nerveuse, et ce fut avec un élan auquel elle s’abandonnait ce jour-là , pour la première fois, qu’elle avança sa main vers le jeune homme.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! murmura-t-elle avec un soupir étouffé pendant que celui-ci pressait longuement cette belle main sur ses lèvres.
— Que vous arrive-t-il donc, chère Valentine ? lui dit-il en s’asseyant derrière elle, de manière à n’être pas vu du public, je n’ai cessé de vous regarder depuis votre arrivée, et je ne saurais vous dire quel serrement de cœur j’ai éprouvé en vous voyant si pâle et si accablée.
— Ah ! c’est que ce qui m’est arrivé aujourd’hui est si révoltant, si odieux et si effrayant à la fois, que j’en pleure de honte, que j’en frissonne d’horreur et de dégoût.
— Quelque nouvelle torture de votre mari, n’est-ce pas ?
— Oh ! pis que cela !
— Qu’est-ce donc ? parlez, Valentine.
— C’est si humiliant, que je sens la rougeur de l’indignation me monter au visage rien que d’y penser, et que je n’oserai jamais vous dire…
— Chère et adorée Valentine, dit Paul en pressant tendrement sa main dans les siennes, ne suis-je pas votre ami, votre protecteur ? C’est à ce double titre, que vous avez bien voulu m’accorder, que je vous supplie de me confier tous vos secrets, toutes vos terreurs, toutes vos souffrances ; ne me l’avez-vous pas promis ?
— Oui, mais non toutes mes hontes.
— Ce n’est pas à vous à en rougir, mon amie, mais au misérable qui vous les inflige.
Après de longues hésitations, la jeune femme se décida enfin à confier à Paul l’affront qu’elle avait subi le matin même de la part de l’Allemand Goëzmann.
Paul de Tréviannes avait écouté ce récit avec de sourds rugissements.
La colère et l’indignation lui faisaient monter le sang au visage.
En terminant, Valentine eut une espèce de spasme.
Puis, les sanglots lui montèrent à la gorge et elle ne put retenir ses larmes.
— Oh ! chère, chère Valentine, murmura Paul à son oreille, vous si pure, si divinement belle, qu’on ose à peine vous adorer à genoux, vous, exposée aux outrages d’un tel misérable !
— Oh ! j’ai cru que j’en mourrais de honte, soupira Valentine en courbant la tête.
— Et cet infâme prétend que, si vous alliez vous plaindre à votre mari, il ne ferait qu’en rire !
— Oui, mon ami ; il a même ajouté que cela ne ferait que précipiter une catastrophe suspendue sur ma tête, qu’il peut déterminer à son gré et dans laquelle il m’a donné à entendre que mon mari était de complicité avec lui.
— Oh ! mais c’est épouvantable, s’écria Paul hors de lui.
Il y eut un moment de silence, puis il reprit en se penchant vers la jeune femme :
— Écoutez, mon amie, et croyez que c’est un conseil loyal et désintéressé que je vais vous donner. Au lieu de trouver dans votre mari un soutien, un protecteur, vous avez en lui un ennemi qui, poussé par l’infâme créature qu’il entretient publiquement, scandaleusement, fera tout au monde pour vous perdre. Ce qui vient de se passer vous prouve qu’il se trame contre vous quelque terrible et mystérieux complot, dont il est le principal instrument, situation inouïe, effroyable, presque sans exemple et à laquelle il faut vous soustraire au plus vite.
— Mais le moyen ? le moyen ? s’écria la jeune femme en se frappant le front avec un geste désespéré.
— Il n’en est qu’un : il faut fuir.
— Jamais ! C’est alors que je serais perdue. Fuir ! Mais ce serait aller au-devant de ses vœux, ce serait courir moi-même à ma perte en me donnant toutes les apparences d’une faute, et qui sait si ce n’est pas là ce qu’il s’est proposé en me faisant insulter par ce lâche et misérable Allemand, qui peut-être n’a feint la passion que pour me pousser à cette extrémité en jetant le trouble et l’épouvante dans mon esprit ?
— Tout cela est possible, et pourtant vous ne pouvez demeurer dans une maison où vous vous sentez menacée à toute heure, où la trahison vous guette à chaque pas, où l’affront d’aujourd’hui se renouvellera demain peut-être, plus brutal, plus humiliant encore, et poussé même jusqu’aux plus révoltantes extrémités si cette suprême infamie entre dans les desseins de votre mari.
— Oh ! mais c’est horrible ! c’est horrible ! murmura la jeune femme en plongeant dans ses mains sa belle tête, qui venait de rougir à ce hideux tableau.
— Oui, c’est horrible, c’est invraisemblable à force d’être infâme, et pourtant plus j’y songe, plus je demeure convaincu que tel doit être le but que se propose cette infernale marquise de Santarès, l’abaissement et la dégradation de celle qui fait obstacle à son ambition, le déshonneur et la honte de son ennemie portés jusqu’à l’ignoble ; oui, c’est là son rêve, croyez-moi.
— Oh ! vous me mettez la mort dans le cœur, mon ami, s’écria Valentine atterrée.
— Je vous montre votre situation sous son vrai jour, afin de vous bien convaincre que la fuite est votre seule ressource. En effet, comment vous garantir autrement contre les odieux desseins de vos ennemis ? Avec la complicité de votre mari et dans sa propre maison, tout devient facile contre vous, vous êtes livrée sans défense à leurs plus honteuses entreprises ; ils peuvent tout employer pour atteindre le but infâme que poursuit la marquise et que je viens de vous signaler, tout, les narcotiques, les serrures forcées pendant votre sommeil… comprenez-vous ?
Valentine écoutait ces paroles, en proie à une espèce d’hallucination.
Effarée, livide, haletante, elle passait de temps à autre la main sur son front avec des gestes d’insensée, et un frisson convulsif agitait ses lèvres décolorées, d’où ne sortait aucun son.
— Non, non, balbutia-t-elle enfin d’une voix saccadée, je n’ai ni affection, ni estime pour mon mari, mais je le crois incapable de pousser jusque-là l’oubli de son propre honneur.
— Quel que soit le mépris qu’il m’inspire, répliqua Paul, je le crois, comme vous, incapable de concevoir un pareil projet, mais je le crois très-capable de l’exécuter le jour où la marquise le lui ordonnera, et ce jour est venu, n’en doutez pas ; l’outrage que vous avez subi ce matin, avec l’approbation tacite ou formelle de votre mari, on vous l’a fait entendre, cet outrage n’est que le prélude de l’effroyable et honteux scandale sous lequel on veut vous écraser et qui devait se présenter fatalement à l’esprit d’une créature telle que cette marquise de Santarès.
— Ah ! vous avez raison, s’écria Valentine en frémissant ; avec cette femme on peut tout admettre ; tout devient possible ; rien n’est invraisemblable, et le passé est là pour attester qu’il obéira toujours, et aveuglément, à toutes ses inspirations, si monstrueuses qu’elles soient.
Et, en proie au plus violent désespoir, elle se renversa en arrière en balbutiant d’une voix pleine de sanglots :
— Mon Dieu ! mon Dieu ! je suis donc perdue sans ressources, déshonorée ? Si je fuis, déshonorée ! et couverte d’ignominie si je reste. Que faire, mon Dieu ? que faire ?
— Qui vous empêche de vous retirer sous le toit d’un parent, M. Mauvillars ou le comte de Sinabria ?
— Il faudrait avoir à articuler contre mon mari quelque fait, quelque chose de positif : les relations de M. Taureins avec cette indigne créature ne leur paraîtraient pas un motif suffisant pour prêter les mains à une rupture éclatante, et, quant au complot infâme qui nous est attesté par mille indices, ils refuseraient d’y croire.
— Il faut le tenter cependant, car c’est votre seule chance de salut. Tenez, la comtesse de Sinabria est là , seule dans sa loge ; qui vous empêche d’aller tout de suite lui demander asile chez elle ? Elle est malheureuse en ce moment, je le sais, et conséquemment plus disposée que personne à croire au malheur des autres et à y compatir.
— Eh bien, oui, oui, j’irai, répondit madame Taureins après un moment de réflexion, car je crois que je deviendrais folle. Tout à l’heure j’ai cru voir à l’orchestre le misérable dont l’odieuse image me poursuit depuis ce matin ; je me suis reculée avec horreur, puis j’ai regardé un instant après et ne l’ai plus vu, c’était une minute de vertige.
J’irai tout à l’heure me confier à Rita et lui demander de me recevoir dès demain.
— Non pas demain, mais ce soir même, dit vivement Paul.
— Ce soir ! c’est impossible, je ne puis aller ainsi… non, c’est impossible.
— Valentine ! Valentine ! murmura le jeune homme avec une vive anxiété, j’ai les plus tristes pressentiments ; je vous en supplie, ne passez pas cette nuit chez vous.
— Je vous le répète, mon ami, c’est tout à fait impossible, mais demain…
— Ce retard me désespère. Où est votre mari ? Dans la loge de cette femme, où je viens de l’entrevoir, caché derrière elle.
— Ah ! si je pouvais savoir ce qui se dit là ! Mais je puis, au moins, aller guetter ce qui se passe de ce côté, et c’est ce que je vais faire.
XI
UN JOLI TRIO
Le premier acte de Rigoletto était joué, et aussitôt le rideau tombé, un grand nombre de spectateurs s’était répandu dans les couloirs.
Dans la foule élégante qui se promenait là , on eût pu remarquer un individu qui semblait passablement dépaysé sur ce terrain, quoiqu’il fût en habit noir et en cravate blanche comme presque tous ceux qu’il coudoyait.
Mais cette toilette, que les autres portaient avec aisance, paraissait le gêner fortement, et on sentait que sa robuste encolure se fût trouvée plus à l’aise sous une simple jaquette.
Du reste, il se préoccupait peu de ce que pouvait penser de lui ce monde, auquel il était évidemment étranger, et regardait passer les promeneurs avec l’expression d’une vive curiosité.
L’endroit où le hasard l’avait porté était précisément fort encombré ; c’était aux abords de la loge occupée par la lionne du jour, la belle et excentrique marquise de Santarès.
Il était là depuis quelque temps déjà , continuant à dévisager les gens avec une indiscrétion qui excitait le sourire des uns et le dédain des autres, lorsqu’il tressaillit à l’aspect d’un personnage modestement vêtu qui se glissait dans la foule comme une anguille, courbant l’échine, saluant humblement ceux qu’il froissait en passant et faisant ainsi un rapide chemin à travers les obstacles.
Il le suivit des yeux jusqu’à ce qu’il le vit s’arrêter à la porte d’une loge à laquelle il frappa timidement.
C’était la loge de la marquise de Santarès.
La porte s’ouvrit presque aussitôt, et le cauteleux personnage entra.
Dès qu’il l’eut vu disparaître, l’hercule en habit noir fendit rapidement la foule à son tour, mais en tournant le dos à la loge, descendit le premier escalier qu’il rencontra et se dirigea vers l’entrée des fauteuils d’orchestre.
Là il rencontra le gros Anglais à la sacoche, c’est-à -dire Rocambole qui, dès qu’il l’aperçut, alla à lui et l’entraîna vers un angle du couloir, désert en ce moment.
— Tu as quelque chose à me dire, Milon ? lui demanda-t-il.
— Je viens de rencontrer mon homme.
— Quel homme ?
— Mon Allemand.
— Ton ancien compagnon ?
— Oui.
— Tu es bien sûr que c’est lui ?
— J’en suis d’autant plus sûr que je viens de le voir entrer dans la loge de la marquise de Santarès, que j’avais déjà reconnue pour la femme avec laquelle je l’ai rencontré un jour sur le boulevard.
— Alors plus de doute en effet.
— Que faut-il faire ?
— Retourner te mettre en sentinelle aux abords de la loge de la marquise, y rester jusqu’à la sortie de l’Allemand, le filer adroitement, ne pas le perdre de vue une seule minute, voir à qui il parle, faire tous tes efforts pour saisir quelques paroles et me prévenir dès qu’il retournera dans la loge de la marquise.
— Il se brasse donc ce soir quelque chose d’extraordinaire.
— Je le crains.
— Contre qui ?
— Contre madame Taureins, qu’il faut que je te montre, car, dans le courant de cette soirée, il peut devenir très-utile que tu la connaisses.
— Mon petit compagnon recommence donc à faire des siennes ?
— C’est le plus grand misérable que je connaisse.
— Je m’en doutais bien un peu.
— M. de Tréviannes, qui sort de la loge de M. Taureins, vient de m’apprendre de lui une infamie… qu’il paiera cher, je le jure.
Rocambole entraîna Milon à l’entrée de l’orchestre et, lui montrant une loge découverte :
— Vois-tu cette jeune femme ?
— Parfaitement.
— C’est madame Taureins, regarde-la bien et grave ses traits dans ta mémoire.
— Elle est trop belle pour qu’on l’oublie quand on l’a vue une fois seulement.
— Maintenant, va te mettre à l’affût du Goëzmann et souviens-toi de mes instructions. Moi, je vais m’occuper de mon côté car, si je ne me trompe, le vent va souffler en tempête, et il faut que tout le monde soit sur le pont.
Milon allait partir.
Rocambole le retint.
— Ah ! j’allais oublier ; s’il survenait quelque chose d’imprévu, que tu eusses besoin de me communiquer sur l’heure, tu me trouverais ici aux fauteuils d’orchestre pendant la représentation, et pendant les entr’actes dans un petit café borgne, le premier à gauche dans la rue Neuve-des-Petits-Champs, portant pour enseigne : Café français.
Milon parti, Rocambole sortit du théâtre et se rendit aussitôt au café qu’il venait de désigner à celui-ci.
L’établissement était peu brillant et encore moins bruyant.
C’était un long boyau, garni de chaque côté de petites tables de marbre noir scellées au mur, et sordidement éclairé par quatre becs de gaz qui ne prodiguaient pas leur lumière.
Il s’y trouvait en ce moment deux vieux rentiers jouant aux dominos, trois domestiques consommant de la bière, autant de boutiquiers jouant aux cartes leur consommation, qui consistait en mazagrans, et enfin un commissionnaire qui s’endormait devant un petit verre, vide, il est vrai, et dont les traits disparaissaient à moitié sous un chapeau mou, tombé sur son nez.
Rocambole entra d’un pas solennel, et, avec un accent britannique, fortement prononcé :
— Garçonne, cria-t-il, donnez à moâ un bouteille de porter.
— Milord, il n’en reste plus que quelques bouteilles dont je ne suis pas assez sûr pour vous les servir, mais si milord veut du faro comme on n’en boit pas à Bruxelles…
— C’est bien, interrompit Rocambole, servez le faro à moâ, apportez deux verres.
— Deux verres pour un ! sont-ils cocasses, ces Anglais ! murmura le garçon en s’éloignant.
Rocambole s’assit en face du commissionnaire, qui s’était attablé dans un angle formé par la cage de l’escalier et où pénétrait difficilement la faible clarté du gaz, et, quand on lui eut servi ce fameux faro, si supérieur à celui de Bruxelles qu’il ne lui ressemblait même plus :
— Petite commissionnaire, dit-il à celui-ci, boivez le faro avec moâ, je ne boirais jamais seul.
Le commissionnaire se frotta les yeux, salua l’Anglais et vida le verre que celui-ci lui présentait.
Puis, quand au bout de quelques instants ils s’aperçurent l’un et l’autre que personne ne songeait à les observer, l’Anglais et le commissionnaire se mirent à causer tout bas et sur un ton d’intimité fort extraordinaire chez deux hommes qui semblaient se voir pour la première fois.
Nous saurons bientôt quel était le sujet de cet entretien, évidemment fort intéressant, car il les absorbait complètement ; mais nous pouvons dire dès à présent, sans trahir son incognito, que le lecteur serait singulièrement surpris si nous lui révélions le nom du mystérieux personnage qui paraissait en si bons termes avec Rocambole.
Mais nous sommes obligés, pour la clarté de notre récit, de les abandonner un instant pour nous transporter dans la loge de la marquise de Santarès, où nous avons vu entrer l’Allemand Goëzmann.
Au moment où l’Allemand pénétrait dans la loge, M. Taureins et la marquise causaient à voix basse, mais d’un air très-animé.
M. Taureins était pâle et sous l’empire d’une profonde agitation.
La marquise souriait, mais d’un sourire particulier qui, soulevant les coins de sa bouche et laissant entrevoir ses dents étincelantes, ressemblait au froncement de lèvres du tigre en face d’un ennemi.
Ce sourire, bien connu de ses adorateurs qui s’accordaient à le trouver effrayant, entrait pour beaucoup dans le succès de sa beauté en lui créant un type qui la classait à part dans le monde de la haute galanterie.
— Monsieur Taureins, disait-elle d’une voix brève, pénétrante et nerveuse qui se mariait parfaitement au caractère de sa physionomie, savez-vous que ces perpétuelles hésitations commencent à me donner singulièrement sur les nerfs ? Laquelle des deux aimez-vous décidément : elle ou moi ? Décidez, car, je vous le répète, il faut en finir, il faut que l’une des deux soit sacrifiée, et je n’admets pas une minute de retard. Tout est convenu, tout est préparé, tout s’accomplira ce soir même, car je suis bien résolue à ne pas laisser échapper l’occasion si longtemps attendue et qui se présente si heureusement aujourd’hui.
— Je ne refuse pas mon consentement, dit M. Taureins embarrassé, seulement…
— Eh bien ? demanda la marquise avec un mouvement d’impatience.
— Goëzmann n’entrera pas dans la chambre.
— Cela va sans dire, pour quelle femme me prenez-vous donc ? répliqua la marquise avec fierté ; on attestera qu’il y est entré, cela suffit pour le résultat que nous nous proposons.
Et, s’adressant vivement à Goëzmann, qui assistait à cet entretien dans une attitude pleine d’humilité :
— Voyons, Goëzmann, réponds franchement, n’est-ce pas là ce qui a été convenu entre nous deux ?
Un moment interdit, l’Allemand se remit vite et répondit avec assurance :
— Oui, señora, c’est bien cela.
— Eh bien, dit la marquise au banquier, êtes-vous rassuré maintenant ?
— Complètement, répondit celui-ci.
— Cette discussion m’a fatiguée, on étouffe ici, dit la marquise en agitant son éventail, ouvrez donc cette porte.
En parlant à M. Taureins, elle avait fait un signe à Goëzmann, qui l’avait parfaitement compris, car, au moment où le banquier lui tournait le dos pour aller ouvrir la porte de la loge, il s’était brusquement penché vers elle.
— Reste fidèle à nos conventions, lui glissa-t-elle rapidement à l’oreille, tu entreras, tu resteras, et…
Son sourire de tigresse acheva sa pensée.
Une flamme étrange s’alluma dans les yeux de l’Allemand, qui répondit par un signe de tête.
— Maintenant, lui dit la marquise du ton le plus calme, quand M. Taureins eut repris sa place, tu sais ce qui est convenu, va et veille à tout.
XII
EXIGENCES
Cinq minutes avant que Goëzmann ne quittât la loge de la marquise, le rideau s’était levé et les couloirs avaient été subitement désertés par la foule qui les encombrait.
Il n’y restait plus qu’un seul flâneur qui lisait son journal en parcourant toujours le même trajet et sans paraître se soucier le moins du monde de la diva qui chantait en ce moment.
Ce flâneur obstiné, on l’a deviné déjà , n’était autre que Milon.
De temps à autre, il allait jeter un regard à travers le carreau d’une loge, comme pour voir l’aspect de la salle, mais en réalité pour savoir ce qui se passait dans cette loge, qui était toujours la même, celle de la marquise.
Puis il recommençait sa promenade et se replongeait de nouveau dans la lecture de son journal, derrière lequel il se proposait bien de dissimuler son visage, dès qu’il verrait paraître l’Allemand.
Il était en train d’arpenter le couloir quand il sentit une main se poser sur son épaule.
Il se retourna vivement.
C’était l’Anglais à la sacoche.
— L’Allemand est toujours là ? demanda Rocambole.
— Toujours.
— Seul avec la marquise ?
— Et M. Taureins.
— Tu les as vus tous les trois ?
— Je vais de temps à autre coller mon œil au carreau.
— Qu’as-tu remarqué ?
— Une discussion animée entre M. Taureins et la marquise.
— Et qu’as-tu induit de l’expression des physionomies pendant celle discussion ?
— Que le banquier refusait de se rendre aux volontés de la marquise, qui exigeait sans doute quelque chose de monstrueux, car M. Taureins était très-pâle en l’écoutant.
— Et l’Allemand ?
— Il gardait humblement le silence comme un homme désintéressé dans la question, mais aux regards qu’il jetait en dessous, du côté de la marquise, il était évident qu’au contraire il y prenait le plus vif intérêt.
— Il n’est pas difficile de deviner le résultat de cette discussion, dit Rocambole ; quoi que puisse exiger la marquise, M. Taureins cédera toujours.
Il ajouta, le regard fixé sur la loge de la marquise :
— Moi, je sors du Café Français, où je crois avoir assez bien employé mon temps ; et maintenant, rien ne m’appelant dans la salle, quant à présent, je vais t’aider dans la tâche difficile et très-importante d’épier les moindres actions de ce Goëzmann qui, défiant et rusé comme tous ceux de sa race, doit être très-difficile à tromper. Laisse-moi ta place un instant ; caché dans la foule au moment où il est entré dans la loge de la marquise, il t’a été facile d’éviter ses regards ; ce serait plus difficile, ce serait presque impossible, si, en sortant, il t’apercevait seul dans ce couloir. Les traits de l’homme avec lequel on a passé des années scellé à la même chaîne se gravent à jamais dans la mémoire : nous savons cela pour en avoir souvent fait l’expérience, et, s’il te reconnaissait dans cette toilette, aux Italiens, aux abords d’une loge où il est entré pour comploter une mauvaise action, la coïncidence de toutes ces singularités le mettrait immédiatement sur ses gardes et ferait échouer tout notre plan.
— Oui, dit Milon, il n’est pas prudent de me montrer, je comprends cela.
— Tandis que moi, outre que je lui suis complètement inconnu, je trouve dans mon travestissement tous les avantages imaginables pour l’épier sans danger, et même sans éveiller sa défiance.
L’Anglais a chez nous d’immenses privilèges ; il peut être inconvenant, indiscret, importun, il peut tout se permettre enfin ; on dit : c’est un Anglais, c’est un original, et on lui passe tout.
— Vous reprenez donc mon poste, c’est entendu ; quelles sont maintenant mes instructions ?
— Te promener dans les couloirs du rez-de-chaussée, où tu ne cours aucun risque de rencontrer l’Allemand et attendre là que j’aie besoin de toi.
Un bruit se fit entendre en ce moment du côté de la loge.
— La porte s’ouvre, ce doit être lui, disparais, dit Rocambole à Milon, qui s’élança aussitôt vers l’escalier et le dégringola en moins d’une minute.
C’était Goëzmann en effet.
Il sortait radieux de la loge de la marquise et nous savons pourquoi.
Celle-ci lui avait dit : Tu entreras et tu resteras !
Il referma doucement et humblement la porte, puis il alla regarder au carreau de la loge voisine.
Ce qu’il regardait, en face de cette loge, c’était la femme que la marquise venait de jeter en pâture à sa grossière passion, c’était madame Taureins.
Mais il la voyait mal de si loin et à travers une vitre.
Il voulut se repaître de sa beauté avant l’heure si ardemment désirée et maintenant si proche où elle allait tomber en son pouvoir, et, quittant la place d’où il ne pouvait la voir qu’imparfaitement, il s’engagea dans le couloir pour gagner sa loge.
Il ne fit guère attention au gros Anglais qu’il rencontra sur son passage, se promenant tranquillement, la poitrine en avant, les mains derrière le dos, la figure épanouie et aspirant l’air avec une satisfaction qui attestait hautement qu’il n’était venu là que dans le but hygiénique de dilater ses poumons.
Et il continua son chemin sans s’inquiéter de savoir s’il était suivi par cet original.
Il s’arrêta enfin à la loge de madame Taureins, et, approchant son visage du carreau, il put la contempler dans toute sa beauté.
Le front dans sa main, la tête penchée en avant, comme accablée sous le poids des profondes angoisses auxquelles elle était en proie, madame Taureins était plus belle dans sa tristesse que l’Allemand ne l’avait jamais vue dans ses heures de calme et de sérénité.
Aussi son œil flamboyait-il sous l’empire des rêves qui envahissaient son imagination en feu, quand tout à coup un léger cri se fit entendre dans la loge et le força à se retirer brusquement.
En tournant la tête vers la porte, peut-être dans un vague espoir de revoir Paul de Tréviannes, madame Taureins avait aperçu, collée au carreau, comme une hideuse et fantastique vision, l’horrible tête de l’Allemand, rendue plus repoussante encore par le regard de satyre dont il couvait la jeune femme.
Goëzmann s’était éloigné rapidement, suivi de loin par Rocambole, qui, le voyant prendre l’escalier de droite, s’était élancé dans celui de gauche, qui aboutissait au même point.
Il y arrivait quelques instants après lui et le suivait hors du théâtre en faisant signe à Milon, qui se promenait par là , suivant sa consigne, de venir le rejoindre.
Un instant après, l’Allemand entrait chez un marchand de vin de la rue d’Amboise, dont l’établissement, probablement très-fréquenté pendant les entr’actes, était désert en ce moment.
Il traversa rapidement la boutique et entra dans un petit cabinet donnant sur la rue et vivement éclairé par le jet éclatant d’un bec de gaz.
On ne pouvait rien voir à travers les vitres, garanties contre les regards indiscrets par d’épais rideaux de cotonnade rouge, ce dont Milon éprouva un vif désappointement.
— Diable ! dit-il, impossible de voir ce qui se passe là dedans, et c’est furieusement dommage, car, à coup sûr, nous aurions là toute la clef du mystère qui se prépare et auquel, quant à moi, je ne comprends goutte jusqu’à présent. Mais, avec des rideaux comme ceux-là , pas moyen de…
— Peut-être, dit Rocambole.
Il examina d’abord la boutique du marchand de vin, puis la maison qui faisait face, et il dit à Milon :
— Le moyen est trouvé.
— Bah ! fit Milon stupéfait.
— Ces rideaux n’atteignent pas le haut de la fenêtre.
— En effet.
— Il s’en faut de vingt centimètres.
— À peu près.
— On peut donc voir parfaitement par cet espace ce qui se fait dans ce cabinet, heureusement fort bien éclairé.
— Oui, avec une échelle.
— Nous avons mieux que cela.
— Quoi donc ?
— Cet entresol, qui fait justement face au cabinet du marchand de vin.
— Mais cet entresol est habité.
— Par le concierge, en même temps tailleur en vieux, comme l’indique cet écriteau, et que je viens de voir assis à la turque sur son établi.
— Oh ! alors…
— Montons.
Rocambole sonna, la porte s’ouvrit et il monta suivi de Milon.
Deux personnes étaient dans la loge en ce moment : le tailleur et sa femme.
— Monsieur, dit Rocambole d’un ton bref, nous sommes agents de police.
Le tailleur tressauta sur son établi et sa moitié se piqua le nez avec son aiguille à tricoter.
— Rassurez-vous, reprit Rocambole, ce n’est pas à vous que j’ai affaire, mais à quelques malfaiteurs que je viens de voir entrer chez le marchand de vin d’en face, après les avoir filés jusque-là . En examinant les lieux, je me suis aperçu qu’on devait distinguer de votre loge tout ce qui se passe dans le petit cabinet où ils ont pénétré, et je viens vous demander l’autorisation…
— Tout ce que vous voudrez, monsieur, s’écria le concierge en sautant de son établi à terre.
Rocambole et Milon prirent sa place et reconnurent aussitôt que, de là , leurs regards plongeaient en plein dans le cabinet, où venait d’entrer Goëzmann.
— Tiens, tiens, dit Milon, voilà des visages de connaissance : Collin, le père Vulcain, Rascal ; mais que diable font-ils donc ?
Ils déballaient un énorme paquet d’où ils tiraient toutes sortes de vêtements.
— Je comprends, dit Milon, ils ont volé ça quelque part et ils procèdent au partage.
— Tu n’y es pas, mon vieux, lui dit Rocambole, observe toujours et tout à l’heure tu comprendras peut-être.

XIII
GUET-APENS
Il était près de minuit quand le rideau était tombé sur le dernier acte.
Aussitôt avait commencé aux abords du théâtre ce merveilleux et splendide tumulte qui se compose de l’inextricable mêlée des équipages, du piaffement des chevaux, des cris des cochers, du bruit des roues sur le pavé, de la voix retentissante des valets ; appelant la voiture de leurs maîtres, du fracas des portières ouvertes et refermées avec tapage, des fiacres pris d’assaut par trois ou quatre familles à la fois, des piétons circulant à travers les roues et les pieds des chevaux avec des cris d’effroi, désordre éblouissant et féerique, curieux à voir surtout aux grandes représentations de l’Opéra ou des Italiens.
Avant de quitter sa loge, madame Taureins avait cherché du regard Paul de Tréviannes aux fauteuils d’orchestre et ne l’apercevant plus à la place où elle l’avait vu pendant le cours de la représentation, elle avait ressenti un douloureux serrement de cœur.
Elle éprouvait le sentiment de terreur dont est saisi l’enfant qui se voit tout à coup seul, sans appui, sans protection au milieu d’une foule.
Perdu, isolé, au sein de cette masse compacte où nul ne songe à lui, où le danger l’enveloppe de toutes parts, où il peut être foulé aux pieds, écrasé en un clin d’œil dans un brusque mouvement à droite ou à gauche, il tremble et pleure au fond de cet abîme humain qui le dépasse de tous côtés, et n’attend plus que la mort.
Telles étaient à peu près les impressions qui envahissaient peu à peu le cœur de Valentine en se voyant seule pour sortir de cette loge où elle était restée isolée pendant quatre heures, seule pour traverser cette foule élégante où chaque femme trouvait un bras pour la soutenir et la protéger, un époux ou un ami pour lui sourire.
Depuis le moment où elle avait vu apparaître à la porte de sa loge la tête ignoble et repoussante de l’Allemand, une morne et profonde tristesse était tombée dans son cœur, et tout avait pris à ses yeux quelque chose de funèbre.
Elle frissonnait en sortant de sa loge et promenait un regard craintif dans les corridors encombrés, où personne ne s’occupait d’elle, cherchant toujours Paul de Tréviannes, s’inquiétant et se désespérant à la fois de ne pas le rencontrer sur son passage.
C’est en ce moment surtout qu’elle comprit et qu’elle s’avoua tout bas qu’il tenait une place immense dans sa vie ; car il était une chose qui, à cette heure même, dominait chez elle la crainte et la tristesse de l’isolement, c’était le désir de voir surgir dans la foule le regard ardent et loyal du jeune homme la cherchant avec une inquiète tendresse.
C’est dans ces dispositions qu’après dix minutes d’une marche pénible dans le flot humain qui la pressait de toutes parts et l’entraînait avec lui, elle atteignit enfin le vestibule du théâtre, où elle promena un long regard, convaincue que Paul de Tréviannes devait l’attendre là .
Mais elle le chercha vainement, il n’y était pas, et son beau front s’assombrit sous l’impression d’un douloureux désappointement.
Elle fut arrachée à sa tristesse par ce cri, parti des marches du théâtre :
— La voiture de madame Taureins !
Au même instant, un domestique, confortablement vêtu d’une longue capote blanchâtre et les épaules couvertes d’un collet de fourrure dans l’épaisseur duquel disparaissait la moitié de son visage, ouvrait la portière, abaissait le marchepied et se rangeait de côté en voyant s’avancer sa maîtresse.
Dès qu’elle fut installée, il referma la portière avec un soin tout particulier, puis il s’élança derrière la voiture, qui se dégagea lentement de toutes celles qui encombraient la place.
Au moment où elle allait perdre de vue la façade du théâtre, ces paroles vinrent frapper les oreilles de Valentine :
— La voiture de madame la marquise de Santarès.
Elle se pencha en avant, se demandant si son mari aurait le cynisme de lui donner le bras jusqu’à sa voiture au moment même où sa femme venait de monter seule dans la sienne.
Mais à son extrême surprise, l’Espagnole était seule aussi.
Elle s’avança vers le domestique, qui se disposait à lui ouvrir la portière, lui fit signe de n’en rien faire, lui donna un ordre et se retira sous le péristyle du théâtre.
Le domestique alors jeta un mot au cocher, qui fouetta ses chevaux, puis il se dirigea en toute hâte vers la rue par laquelle les fiacres arrivaient à la file.
— Qu’est-ce que cela signifie ? se demanda Valentine pendant que sa voiture partait au grand trot.
Puis se rappelant le monde auquel appartenait cette femme, monde étrange où devaient régner le désordre et la fantaisie, elle ne vit là qu’un des mille caprices qui devaient constituer toute la vie de cette créature et elle n’y pensa plus.
Elle oublia de même les douloureuses impressions et les vagues terreurs qui l’avaient si profondément attristée pour concentrer toutes ses pensées sur un seul être, sur l’ami dévoué dont l’image lui apparaissait comme un phare dans le ciel d’orage dont elle se voyait enveloppée.
Paul ! tel était le nom qu’elle murmurait tout bas, pelotonnée dans un coin de sa voiture.
Et son imagination, évoquant librement des rêves qu’elle refoulait au fond de son cœur quand il était près d’elle, quand il eût pu les deviner au trouble de ses yeux, au tremblement de sa voix et profiter de cette émotion pour lui arracher le secret toujours près de lui échapper, elle le revit tel qu’il était tout à l’heure dans sa loge, penché vers elle, effleurant son front de ses beaux cheveux noirs, plongeant dans ses yeux son regard à la fois plein de flamme et de tendresse et murmurant son nom avec un accent qui la remuait jusqu’au fond de l’âme.
Puis, comparant involontairement l’être trivial et vulgaire auquel un fatal destin l’avait liée pour la vie à cette nature si noble, si élevée, si délicate, si pleine de tendresse, si magnifique d’élan, d’enthousiasme et d’exaltation, elle éprouva un subit accès de révolte contre la cruauté du sort qui l’avait unie à l’homme contre lequel tout se soulevait en elle et l’avait à jamais séparée de celui vers lequel l’entraînaient irrésistiblement toutes les délicatesses de sa propre nature.
L’âme toute meurtrie des cruelles émotions qui étaient toute sa vie depuis quelque temps, Valentine s’était oubliée dans les enchantements de son rêve, comme un voyageur dans l’oasis rencontrée au sein du désert.
Le temps s’était écoulé sans qu’elle s’en aperçût.
Mais son regard s’étant un instant porté au dehors elle fut tout à coup rappelée à elle-même par l’aspect des objets qui frappèrent ses yeux.
Au lieu de rues et de maisons, c’étaient des arbres et des champs qu’elle voyait se dérouler à la clarté de la lune.
Alors seulement elle fut frappée de la longueur du trajet qu’avait dû parcourir la voiture depuis qu’elle avait quitté la place du théâtre.
— Mon Dieu ! balbutia-t-elle en pâlissant tout à coup, qu’est-ce que tout cela signifie ?
Elle voulut abaisser la glace pour parler à son cocher.
Mais elle fit d’inutiles efforts.
Impossible de la faire mouvoir.
Elle tenta d’ouvrir la portière, décidée, dans le vertige qui venait de s’emparer d’elle, à s’élancer hors de sa voiture, au risque de se faire écraser.
Le bouton semblait scellé dans le bois, et après s’y être meurtri les mains, elle dut renoncer à le faire jouer.
Si effroyable que fût cette découverte, il lui fallut reconnaître enfin qu’elle était prisonnière dans sa voiture.
Alors, mille pensées, plus effrayantes l’une que l’autre, traversèrent son imagination affolée.
Elle était victime d’un guet-apens, elle ne pouvait se le dissimuler.
Mais que voulait-on faire d’elle ?
Où l’emmenait-on ?
Dans quel but l’entraînait-on loin de Paris ?
Questions redoutables qui la faisaient frissonner d’épouvante.
Subitement éclairée en ce moment sur plusieurs incidents auxquels elle n’avait accordé aucune attention, absorbée qu’elle était alors dans sa morne tristesse, elle se rappela d’abord que le domestique qui avait ouvert sa portière avait enfoui son visage jusqu’aux yeux dans la fourrure de son collet, de manière à le cacher presque entièrement, et ensuite qu’il avait mis bien du temps à fermer la portière.
Puis, elle songea à l’étrange idée qu’avait eue la marquise de Santarès de renvoyer sa voiture pour prendre un fiacre et se demanda s’il n’existait pas quelque mystérieuse corrélation entre ce prétendu caprice et le guet-apens dont elle était victime.
— La marquise ! oui, c’est elle, c’est elle, murmura la jeune femme en roulant autour d’elle des yeux auxquels l’excès de l’épouvante donnait l’éclat surnaturel de la folie, c’est elle qui, d’accord avec mon mari peut-être, a organisé ce guet-apens. Mais que veulent-ils faire de moi ? En voudraient-ils à ma vie ? Oui, oui, c’est cela, elle veut prendre ma place, elle veut le nom et la fortune de mon mari ; je suis un obstacle et il faut que je disparaisse.
Et, se roulant dans sa voiture, au paroxysme du désespoir, elle s’écria avec des sanglots :
— Oh ! je suis perdue, mon Dieu ! je suis perdue !
XIV
LA VILLA
Alors, du fond de l’abîme où elle se sentait rouler, la jeune femme vit surgir et flamboyer dans son cerveau, comme dans les divagations de la fièvre, tous les incidents qui avaient précédé et annoncé l’horrible catastrophe qui la frappait en ce moment.
Mais, au-dessus de tout, elle voyait passer Paul de Tréviannes, triste et soucieux ; elle l’entendait lui parler des sinistres pressentiments qui le poursuivaient et la supplier d’aller se réfugier cette nuit même chez la comtesse de Sinabria.
Paul, à cette heure même où elle se débattait sous l’étreinte d’un désespoir sans bornes, à cette heure sinistre où elle sentait planer sur sa tête quelque épouvantable tragédie, il rêvait à elle sans doute, il murmurait son nom avec un accent plein de tendresse et se la représentait chez elle, triste, mais relativement calme, et, de son côté, songeant peut-être à lui.
Voilà ce qu’elle se disait.
Puis, tout à coup, une réflexion se fit jour à travers son désespoir :
— Mais, se dit-elle, comment se fait-il que les pressentiments qui le tourmentaient ne lui aient pas inspiré la pensée de veiller sur moi ? Je l’ai vainement cherché, en sortant, dans les couloirs, dans les escaliers, sous le péristyle du théâtre, partout, et je ne l’ai pas vu ; comment a-t-il pu m’abandonner ainsi à ma destinée, au moment où il me croyait en péril ?
Elle reprit aussitôt :
— Mais non, je le calomnie, c’est impossible, il m’aime trop pour être resté insoucieux de mon sort. Ne pouvant m’aborder, il a dû veiller sur moi, caché dans la foule, et naturellement il est parti entièrement rassuré après m’avoir vue monter dans ma voiture. En effet, que pouvait-il craindre dès lors ? Comment concevoir la moindre inquiétude ? S’il a pu trembler pour moi jusque-là , il a cessé de me croire en danger du moment où il m’a vue installée dans ma propre voiture. Et qui donc n’aurait pensé comme lui ? Qui donc, me sachant même entourée d’ennemis, eût jugé nécessaire de pousser plus loin la surveillance ? Ah ! il n’a rien à se reprocher, lui ; c’est moi seule qui suis coupable de n’avoir pas cru à ses pressentiments et d’avoir repoussé ses conseils !
Puis, recouvrant peu à peu quelque sang-froid dans l’horreur de sa situation, elle se mit à regarder à travers les glaces le pays que traversait la voiture, dans l’espoir de découvrir au moins de quel côté on l’entraînait.
Mais toujours, toujours des champs et des arbres.
Rien, pas un indice qui pût la renseigner sur le pays qu’elle traversait.
Cet état d’incertitude dura dix minutes encore.
Puis enfin la voiture s’arrêta.
Alors la jeune femme se mit à trembler de tous ses membres.
Son cœur battit à lui rompre la poitrine et elle sentit le vertige de la folie s’emparer de son cerveau.
L’heure fatale avait sonné !
Qu’allait-il advenir d’elle ?
Elle voyait se dresser devant son imagination en délire le fantôme sanglant de l’assassinat.
Tous les détails et toutes les péripéties du meurtre se dressaient devant elle, se déroulant dans son esprit halluciné comme avec les proportions fantastiques et monstrueuses d’un effroyable cauchemar.
Elle se voyait frappée par le couteau des assassins, perdant son sang par vingt blessures, toujours fuyant, toujours atteinte par ses impitoyables ennemis, tombant enfin épuisée, se traînant haletante, puis rampant sur le parquet tout rouge de son sang pour aller enfin se blottir dans un coin, où elle exhalait son dernier soupir.
Tout à coup elle bondit sur elle-même en entendant s’ouvrir la portière de sa voiture.
Instinctivement elle se jeta dans le coin opposé et s’y tint accroupie, dardant sur la portière un œil fixe et ardent.
Elle s’ouvrit et un homme se montra aussitôt.
Il portait le costume ordinaire de ses domestiques : une capote blanchâtre tombant jusqu’à la cheville et un épais collet de fourrure.
Et pourtant cet homme n’appartenait pas à sa maison.
Elle le reconnut aussitôt pour celui qui lui avait ouvert la portière de sa voiture au moment où elle sortait des Italiens et dont elle avait à peine vu le visage en ce moment.
— Madame est arrivée, lui dit cet homme avec autant de calme que si rien ne s’était passé d’extraordinaire.
Et, comme Valentine le regardait avec des yeux atterrés, toujours muette et immobile à sa place :
— Quand madame voudra, reprit le faux domestique en lui tendant la main.
— Non, je ne veux pas, je ne veux pas, balbutia la jeune femme d’une voix tremblante et avec un accent terrifié.
Et ses mains crispées se cramponnèrent aux coussins de la voiture.
— Nous ne pouvons cependant pas rester ici, reprit l’équivoque personnage, dont la rude voix ajoutait encore à l’effroi de Valentine, et je serais désolé que madame me mît dans la nécessité de l’emporter dans mes bras.
Révoltée à la pensée de se sentir dans les bras de cet homme et comprenant que toute tentative de résistance serait insensée, madame Taureins surmonta enfin sa frayeur et prit le parti de descendre de sa voiture.
— Si madame veut s’appuyer sur mon bras ?
Elle refusa d’un signe et le suivit lentement, car elle fléchissait sur ses jambes.
Ils se trouvaient en face d’une espèce de villa dont l’élégante façade était toute tapissée de plantes qui, en été, devaient lui donner un aspect des plus gracieux.
Une des pièces du premier étage était vivement éclairée.
Avant de franchir le seuil de cette demeure, la jeune femme s’arrêta et, s’adressant à l’homme qui la précédait :
— Je vous en supplie, lui dit-elle d’une voix défaillante, dites-moi où je suis, quels sont les gens qui m’ont entraînée ici et ce qu’on veut faire de moi ; dites-moi cela et ma reconnaissance…
— Je ne sais rien, madame, répondit le faux domestique, absolument rien.
Et il entra.
Valentine comprit qu’elle ne pourrait rien tirer de cet homme ; elle le suivit, non sans un affreux battement de cœur, mais résolue à se soustraire à des violences qui n’eussent fait qu’ajouter à son supplice.
Elle monta un étage derrière son guide, qui ouvrit une porte, se rangea de côté et lui fit signe d’entrer.
Elle se trouvait dans un petit salon meublé avec une élégance quelque peu équivoque.
— Dans le cas où madame se trouverait indisposée, lui dit le domestique, voici de l’eau, du sucre et des flacons de sels.
Puis il sortit et ferma la porte à double tour.
La jeune femme tressaillit au grincement de la serrure.
Puis elle promena ses regards autour d’elle et, après avoir observé tous les objets qui garnissaient cette pièce, elle reconnut qu’elle devait être ordinairement habitée par une femme du monde exceptionnel auquel appartenait la marquise de Santarès.
— Je suis chez elle, peut-être, murmura-t-elle.
Et, quoiqu’elle eût déjà soupçonné la main de cette femme dans ce qui lui arrivait, elle se sentit défaillir en acquérant la presque certitude qu’elle ne s’était pas trompée.
Effrayée à la pensée de perdre l’usage de ses sens dans cette demeure, elle prit un des flacons de sels posés sur la cheminée et en aspira les fortifiantes exhalaisons.
Alors, se sentant un peu remise, elle se dirigea d’un pas craintif vers une porte opposée à celle par laquelle elle était entrée.
Cette porte l’inquiétait.
— Qui sait s’ils ne sont pas là , le couteau à la main, attendant le moment d’entrer et de s’élancer sur moi ? balbutia-t-elle tout bas.
Et, frissonnant à cette pensée, elle retira brusquement sa main, qu’elle avait posée sur le bouton.
Puis elle s’éloigna de la porte, marchant avec précaution sur le tapis, dont l’épaisseur étouffait le bruit de ses pas.
Mais son regard se tournait toujours vers cette porte derrière laquelle elle sentait des ennemis aux aguets.
Elle la considérait avec une inexprimable épouvante, et, en même temps, cédant malgré elle à l’espèce de fascination qui l’attirait de ce côté, elle s’en rapprochait peu à peu, tout en parcourant le salon de long en large.
Bientôt enfin elle n’en fut plus qu’à deux pas.
Il se livra encore en elle un long combat.
Puis cédant au désir de mettre fin à l’anxiété qui la dévorait, elle posa de nouveau la main sur le bouton de cette porte.
Pour la seconde fois, elle s’arrêta au moment d’ouvrir.
— Qu’ai-je donc ? murmura-t-elle en portant la main à son front.
Elle resta un instant immobile, promenant autour d’elle des regards où se lisait un sentiment de fatigue et d’affaissement.
— Mon Dieu ! reprit-elle de nouveau avec un vague effroi et en faisant des efforts visibles pour regarder fixement devant elle, que se passe-t-il donc en moi ?
La porte, sur le bouton de laquelle sa main était posée, s’ouvrit brusquement, un homme parut, et, se dressant devant elle, les bras croisés sur sa poitrine :
— Ce qui se passe en vous, madame, lui dit-il, je vais vous l’apprendre. Ce flacon que vous venez de respirer contient un narcotique dont vous commencez à ressentir les effets. Dans dix minutes un sommeil de plomb se sera emparé de vous et vous mettra à ma discrétion.
Cet homme, on l’a deviné, c’était l’Allemand Goëzmann.

XV
UNE POSITION CRITIQUE
À l’apparition imprévue du hideux personnage et à la terrible révélation qu’il venait de lui faire entendre, madame Taureins, dominant le lourd sommeil qui commençait à appesantir ses paupières, s’était élancée à l’autre extrémité du salon et, de là , elle contemplait avec un inexprimable sentiment d’horreur le misérable qui venait de lui annoncer, comme imminent et inévitable, le sort le plus odieux, le plus révoltant dont elle pût être menacée.
— Eh bien ! madame, lui dit l’Allemand après un moment de silence, qu’en dites-vous ? N’est-ce pas que je ne prête pas à rire quand je hais ?
La jeune femme était incapable de répliquer un mot.
Ses traits, livides et affreusement contractés exprimaient, avec une navrante éloquence, l’effroyable torture sous laquelle elle se débattait.
Mais, ainsi que l’avait déjà remarqué l’Allemand, les plus cruelles angoisses, les plus violents désespoirs ne pouvaient altérer cette merveilleuse beauté, ils ne faisaient que la modifier et la transfigurer.
Un moment paralysée par le flot d’émotions qui venait de lui monter au cœur, madame Taureins, recouvrant peu à peu l’usage de ses facultés, songea enfin à faire un effort pour se soustraire au sort affreux dont elle était menacée.
Elle promena autour d’elle ses grands yeux noirs, et après un moment d’hésitation, elle courut à la porte par laquelle elle était entrée et voulut l’ouvrir.
Mais elle était fermée en dehors et à double tour.
Elle s’en souvint alors et laissa retomber ses bras le long de son corps avec l’expression d’un profond découragement.
Assis et renversé dans un fauteuil, Goëzmann la regardait faire avec un sourire froidement ironique.
— Ne perdez pas courage, madame, lui dit-il, continuez vos recherches et vos tentatives de fuite ; tenez, voici une autre porte, celle derrière laquelle je vous épiais tout à l’heure, allez donc l’ouvrir, ne vous gênez pas, je vous jure que je n’y mettrai aucune opposition ; seulement, je vous préviens que ce n’est pas le salut qui vous attend de ce côté, au contraire, car derrière cette porte vous trouverez une chambre.
La jeune femme frissonna tout à coup, et se redressa de toute sa hauteur.
C’est qu’elle venait de sentir ses paupières se fermer sous l’empire du sommeil qui la dominait de plus en plus, et elle faisait un effort surhumain pour rester éveillée en face de cette bête fauve qui la guettait comme une proie.
— Oh ! vous avez beau faire, lui dit Goëzmann, qui avait saisi son mouvement et deviné sa pensée, le sommeil devient de minute en minute plus impérieux, vous le sentez bien, et dans quelques instants vous ferez d’inutiles efforts pour résister, il vous étendra là , à mes pieds ; j’attends donc patiemment mon heure.
Et, les regards attachés sur la jeune femme, il croisa ses jambes l’une sur l’autre, et demeura tranquillement dans cette position.
— Non, non, je ne veux pas dormir, s’écria Valentine en se redressant de nouveau contre la porte, et en raidissant ses membres avec la violence d’un épileptique.
Mais cette lutte acharnée contre le sommeil se trahissait par une profonde altération du visage, et en dépit de tous ses efforts pour les tenir ouverts, ses yeux restaient à demi fermés.
L’Allemand souriait toujours.
— Non, non, je ne veux pas dormir, répéta-t-elle tout à coup avec un accent plein d’énergie.
Elle marcha en chancelant vers un guéridon sur lequel étaient posés un verre et une carafe pleine d’eau, et remplissant le verre :
— Cette eau glacée va me réveiller, dit-elle.
Et elle vida le verre d’un trait.
— Oui, murmura Goëzmann avec un calme parfait, l’eau glacée est un excellent antidote contre le sommeil, seulement…
Valentine tourna vers lui ses yeux demi-clos et comme voilés d’un nuage.
— Seulement, reprit l’Allemand, j’ai oublié de vous prévenir que cette carafe contient un soporifique plus puissant encore que celui du carafon que vous venez de respirer.
Valentine jeta un cri déchirant.
Puis, passant ses mains blanches sur ses yeux qui se fermaient malgré elle, elle balbutia d’une voix presque inintelligible :
— Le misérable a dit vrai, le sommeil est le plus fort, il me gagne avec une rapidité… qui m’effraye ; je ne puis plus ouvrir les yeux, mon corps s’affaisse et chancelle… je suis vaincue.
Elle ne pouvait plus soulever ses paupières, qui retombaient sur ses yeux comme si elles eussent été de plomb, et le regard qui en jaillissait encore de temps à autre, éteint par la puissance du sommeil qui paralysait peu à peu toutes ses facultés, ne distinguait plus les objets.
Elle le repoussa, comprenant que si elle s’y laissait aller, elle s’endormirait aussitôt.
Elle fit quelques pas en avant puis, la face tournée contre la muraille, élevant ses mains au-dessus de sa tête, elle se cramponna là de toute l’énergie qui lui restait.
— Mon Dieu ! balbutia-t-elle tout bas, prenez pitié de moi.
— Rassurez-vous, madame, lui dit l’Allemand, vous avez encore deux minutes avant de tomber endormie sur ce parquet, et juste à mes pieds, comme je vous l’ai prédit, car vous vous êtes rapprochée de moi, et ces deux minutes écoulées, je n’aurai qu’à tendre les bras pour vous recevoir.
Un frisson convulsif agita le corps de la jeune femme.
À travers les ténèbres qui obscurcissaient déjà son esprit, elle avait entendu et compris ces effrayantes paroles.
Il lui restait encore un peu de force et une vague lucidité d’esprit ; elle les concentra dans un effort suprême et se laissant tomber à genoux :
— Monsieur, monsieur, balbutia-t-elle en se tournant vers l’Allemand, je vous demande pardon du mal que je vous ait fait, je vous demande pardon à genoux, vous le voyez, oubliez mes torts et faites-moi grâce, monsieur. Oh ! grâce !… grâce ! je vous en supplie, je vous en serai éternellement reconnaissante, je vous considérerai et vous traiterai comme un ami ; je vous récompenserai généreusement, monsieur ; tenez, j’ai sur moi des bijoux, des diamants, prenez-les, je vous les donne, et ce ne sera pas tout, je vous promets une fortune, vous entendez, monsieur, une fortune, ah ! je tiendrai parole, je vous le jure.
— Non, non, madame, murmura à son oreille la voix frémissante de l’Allemand, il n’est pas de fortune au monde qui puisse me faire renoncer à vous en ce moment.
Et en lui parlant ainsi, il couvait d’un œil ardent sa belle tête, qui se détachait, blanche et effarée, de la masse noire de ses cheveux tout épars.
Valentine était à bout de forces.
La lutte contre le sommeil était devenue impossible.
Un gémissement sourd, déchirant, s’échappa de ses lèvres, dernier appel à la pitié de son bourreau.
Puis ses yeux se fermèrent tout à fait, sa tête s’inclina sur sa poitrine, son corps s’affaissa sur le parquet et sa bouche laissa échapper ces deux mots dans un soupir : Grâce ! grâce !
Elle dormait !
L’Allemand la contempla longtemps.
Il était comme ébloui devant tant de beauté.
C’est qu’en effet, cette tête admirable dont la blancheur mate et lumineuse accentuait encore le charme profond et l’exquise pureté, cette tête, encadrée dans l’abondante chevelure dont les flots épars ruisselaient sur ses gracieux contours et les mettaient en saillie, formait le plus merveilleux tableau que jamais peintre eût pu rêver.
Puis, après cette longue et ardente contemplation, il bondit tout à coup, les traits empourprés, l’œil étincelant, et d’une voix rauque comme un rugissement de bête fauve :
— Enfin, elle est à moi ! s’écria-t-il.
— Pas encore, maître Goëzmann, lui répondit une voix.
Au même instant la porte de la chambre s’ouvrait et un homme se dressait sur le seuil, à deux pas de l’Allemand.
Un moment atterré par cette subite apparition, Goëzmann se remit bien vite.
Il lança un regard sinistre sur l’inconnu, puis il glissa la main dans la poche de son pantalon, en tira brusquement un revolver, l’arma et ajustant son ennemi presque à bout portant :
— Sortez, ou je vous casse la tête, dit-il d’un ton résolu.
Mais le dernier mot était à peine prononcé, qu’un violent coup de pied, appliqué sur la main de l’Allemand, envoyait le revolver au plafond.
Le mouvement avait été imprévu et rapide comme l’éclair.
— Pauvre Goëzmann, dit alors l’inconnu en lui riant au nez, qui s’imagine m’arrêter avec un revolver ! Allons ! je vois bien que vous ne connaissez pas M. Portal ; eh ! bien ! nous allons faire connaissance.
XVI
LE CHÂTIMENT
Quand il se vit désarmé, Goëzmann, passant subitement de la fureur à l’épouvante, regarda avec inquiétude à quel homme il avait affaire.
Le regard de Rocambole, ce regard pénétrant, froidement résolu, dans lequel on lisait tant de dangers affrontés et cette indomptable confiance en soi qui centuple la puissance d’un homme, ce regard paralysa le peu d’énergie qui lui restait.
Il se sentit petit et faible devant cet inconnu ; il reconnut en lui une nature supérieure et se mit à trembler devant lui comme le chien devant son maître.
Rocambole, lui, se mit à l’examiner des pieds à la tête avec une expression de curiosité et de dégoût, comme s’il eût étudié quelque monstre étrange et hideux.
— Enfin, dit-il après ce long et insultant examen, le voilà donc ce lâche et féroce animal, si brave avec les femmes, si intrépide, si calme et si railleur quand il ne court aucun danger ! nous allons voir quelle figure il fait devant un homme.
Tout en écoutant Rocambole, l’Allemand regardait ailleurs.
Rocambole suivit la direction de son regard et aperçut sur le tapis le revolver qu’il avait fait sauter au plafond.
Il alla le ramasser en disant :
— Cela vous donne des distractions, maître Goëzmann.
En voyant l’arme entre les mains de son ennemi, l’Allemand devint plus pâle encore et fit un mouvement pour s’élancer à l’autre extrémité de la pièce.
— Rassure-toi, misérable, lui dit Rocambole d’un ton dédaigneux, je ne fais pas l’œuvre du bourreau et c’est au bourreau que tu appartiens.
— Moi ! moi ! s’écria Goëzmann en frissonnant.
— Je te le prouverai tout à l’heure en te rappelant certain épisode de ta vie que tu as oublié peut-être ou que tu crois inconnu de tous.
Puis, changeant tout à coup de ton, il s’écria d’une voix vibrante, en lui montrant madame Taureins étendue pâle et immobile sur le parquet :
— Regarde, misérable, crois-tu donc n’avoir pas mérité cent fois pis que la mort pour tous les outrages que tu as fait subir à cette noble créature, pour le crime que tu allais commettre et dont elle serait morte, car une femme comme celle-là ne survit pas au contact d’un monstre de ton espèce.
Et sa colère s’exaltant encore à ce souvenir, à la vue de la jeune femme plongée dans un sommeil qui la livrait sans défense aux passions de cet homme, il ajouta, la main tendue vers ce corps immobile et en foudroyant l’Allemand de son regard :
— Quand je songe que si je n’eusse veillé sur elle, sa honte serait accomplie à cette heure ! Quand je songe à cela, ah !… je ne sais qui me retient de t’étrangler de mes mains !
Et tout son corps tremblait sous la commotion que lui communiquait la colère, parvenue au plus haut paroxysme.
Goëzmann s’était collé contre la muraille et jetait de son côté des regards effarés.
Après une minute de silence, qui parut un siècle à celui-ci :
— Non, non, s’écria de nouveau Rocambole toujours en proie à la même exaltation, je te l’ai dit, ta tête appartient au bourreau, je la lui réserve, ce ne sera pas la mort… ce sera autre chose, un signe, un stigmate ineffaçable qui prouvera à tous que tu es un lâche coquin et te rappellera chaque jour et à toute heure de ta vie les outrages et les tortures inouïes dont tu as abreuvé cette pure et infortunée jeune femme.
Puis il promena autour de lui un regard rapide.
Goëzmann suivait la direction de ce regard avec un inexprimable sentiment d’angoisse.
Rocambole bondit enfin vers un meuble où, parmi beaucoup d’objets, était jetée une cravache.
Il la saisit et revenant vers l’Allemand toujours collé contre la muraille :
— Approche, lui dit-il.
Après un moment d’hésitation, l’Allemand fit quelques pas vers lui.
Quand il fut au milieu de la pièce :
— À genoux ! lui dit Rocambole.
Goëzmann hésita encore.
— Je crois vraiment que ta dignité se révolte ! s’écria Rocambole avec un ricanement plus effroyable encore que sa colère.
Et sa main s’appesantit sur l’épaule de l’Allemand qui tomba à genoux.
— Maintenant, reprit Rocambole, ici, devant ta victime, je vais t’imprimer non sur l’épaule, mais sur la face, afin qu’elle soit visible pour tous, une marque qui y restera comme un éternel témoignage de ton infamie.
Et il leva la cravache.
Goëzmann jeta un cri et plongea son visage dans ses deux mains.
— Bas les mains et la tête haute ! lui dit Rocambole d’une voix brève et implacable.
— Non, non, pas cela, balbutia Goëzmann sans changer de position.
Rocambole ne répliqua pas.
Quelques secondes s’écoulèrent et l’Allemand commençait à concevoir un vague espoir, quand un claquement sec le fit tressaillir tout à coup.
Il releva la tête et vit Rocambole braquant froidement sur lui son propre revolver qu’il venait d’armer.
— Ça ou ça, choisis, lui dit-il en lui montrant successivement le revolver et la cravache.
— Grâce ! grâce ! murmura Goëzmann en se traînant sur ses genoux jusqu’à lui.
— Ce mot est ta condamnation irrévocable, lui dit Rocambole, car c’est celui que l’infortunée prononçait tout à l’heure en tombant à tes pieds, c’est la dernière prière qui s’est échappée de ses lèvres aussitôt fermées par le sommeil, prière à laquelle tu es resté insensible, tu me le rappelles imprudemment, misérable.
Puis se reculant d’un pas :
— Allons, dit-il, il faut en finir ; il faut que justice se fasse à l’instant, devant celle que tu as outragée et dont le supplice crie vengeance. Je ne te permets pas une minute d’hésitation, obéis de suite ou tu es mort.

![]()
Il ajouta, le revolver d’une main et la cravache de l’autre :
— Bas les mains et la tête haute !
En voyant le revolver braqué sur lui, Goëzmann se hâta d’obéir.
Il laissa retomber ses bras le long de son corps et releva la tête, de manière à offrir son visage en plein au coup qui allait le frapper.
Il était livide et fixait sur son ennemi des yeux hagards.
Il les ferma tout à coup en voyant la cravache se lever au-dessus de sa tête.
Elle cingla deux fois l’air en sifflant et traça un sillon sanglant sur chaque joue du misérable.
Elles étaient incisées l’une et l’autre comme par la lame d’un rasoir, et le sang en jaillit tout à coup.
Fou de douleur, l’Allemand se leva d’un bond en jetant un cri aigu et en portant brusquement les mains à son visage.
Puis, les sentant humides, il les retira aussitôt et les regarda.
Elles étaient toute rouges.
— Horreur ! s’écria-t-il en frissonnant.
— Vous êtes bien sensible… quand il s’agit de votre propre personne, maître Goëzmann, lui dit Rocambole en jetant froidement au loin la cravache dont il venait de se servir.
L’Allemand ne répondit point.
Il s’était précipité vers une glace et restait saisi en considérant les deux incisions béantes qui traversaient ses joues.
— Grand Dieu ! murmura-t-il, mais ces plaies sont horribles, je suis défiguré pour la vie !
— Défiguré, répéta Rocambole, allons donc ! Je vous trouve bien fat, maître Goëzmann, vous l’étiez en naissant, la nature s’en était chargée et je n’ai fait que retoucher son œuvre.
Puis il reprit d’un ton impérieux :
— Ah çà , vous trouvez donc bien du plaisir à contempler votre image ! Assez comme cela, je vous prie, nous n’avons pas fini.
L’Allemand se retourna brusquement.
Ses traits étaient bouleversés.
— Pas fini ! balbutia-t-il d’une voix tremblante ? n’est-ce pas assez ? Que voulez-vous donc encore ?
— Ta confession, misérable !
— Je ne vous comprends pas, répondit Goëzmann tout interdit.
— Tu vas comprendre tout à l’heure.
Et jetant un regard du côté de madame Taureins :
— Je t’accorde cinq minutes pour laver le sang de tes blessures, pendant que je vais m’occuper de cette jeune femme ; hâte-toi donc.
Goëzmann courut à une cuvette, la remplit d’eau et y plongea son visage tout sanglant.
Pendant ce temps, Rocambole allait ouvrir la porte de la chambre d’où l’Allemand était sorti quelques instants auparavant.
Au fond de cette chambre était une autre porte.
Il l’ouvrit également et, du haut d’un escalier sur lequel elle donnait, il appela :
— Vanda !
Un instant après, la jeune femme entrait suivie de Lise, sa femme de chambre.
Il les emmena dans le salon et, montrant à Vanda madame Taureins étendue à terre :
— La voilà , dit-il, plongée dans un sommeil dont elle ne sortira sans doute pas avant quelques heures.
— L’effet d’un narcotique, comme vous me l’aviez dit ? demanda Vanda.
— Oui, et voilà son bourreau, avec lequel je viens déjà de m’expliquer sur un point.
— L’infâme ? murmura Vanda ; oh ! ne l’épargnez pas ; jamais de pitié pour les bourreaux !
— Milon est là ? reprit Rocambole.
— Il attend vos ordres.
— Vous allez déposer madame Taureins sur le lit qui est à côté, vous lui donnerez tous les soins dont elle peut avoir besoin et vous direz à Milon de se tenir là , tout prêt à la transporter, dès que j’en donnerai l’ordre, dans sa voiture, où vous monterez avec elle, accompagnée de Lise.
Vanda alors prit la jeune femme par les épaules, sa femme de chambre la saisit par les pieds, et toutes deux l’emportèrent dans la chambre.
Rocambole referma la porte et, revenant vers l’Allemand :
— Maintenant, maître Goëzmann, lui dit-il, à nous deux !
XVII
LES SOUVENIRS DE GOËZMANN
— Pardieu ! maître Goëzmann, s’écria Rocambole en toisant l’Allemand, qui attendait humblement ses ordres, il faut avouer qu’il y a d’étranges fatalités ! Ainsi votre premier soin, en arrivant ici, est de faire couper les cordons des sonnettes qui, violemment agitées par madame Taureins, eussent pu donner l’alarme dans quelque villa voisine ; le second de recommander expressément à vos trois complices, MM. Vulcain, Collin et Rascal, de ne pas bouger, quoi qu’ils entendent dans ce salon, et voilà que toutes ces précautions qui devaient assurer le succès de votre lâche entreprise tournent contre vous et me favorisent dans mon œuvre de justice et de vengeance. Ah ! maître Goëzmann, quelle leçon si les chenapans de votre espèce n’étaient bien résolus, par système, à nier la Providence dont, à vrai dire, ils n’ont rien de bon à attendre !
L’Allemand garda le silence, ne jugeant pas opportun d’entamer une discussion sur ce sujet.
— Mais, reprit Rocambole, laissons là la Providence, qui ne doit pas avoir vos sympathies, et passons aux affaires sérieuses. Il doit y avoir de quoi écrire ici.
— Je ne sais, répondit Goëzmann, en parcourant le salon d’un coup d’œil.
— Rien, dit Rocambole qui lui aussi, avait cherché du regard, ni encre, ni plumes, ni papier.
Puis, avisant un petit meuble dans un coin de la pièce :
— Ceci est un secrétaire de femme, dit-il, nous trouverons là ce qu’il nous faut.
Il voulut ouvrir ce meuble.
Il était fermé et la clef ne se trouvait nulle part.
— Bah ! fit-il.
Il tira de sa poche un couteau-poignard, l’ouvrit, glissa la lame épaisse et bien trempée dans la fissure de la petite porte qui le fermait et fit une pesée.
La porte sauta.
Le secrétaire contenait une papeterie complète, de l’encre et des plumes.
— J’en étais sûr, dit Rocambole en refermant tranquillement son couteau-poignard.
Et, s’adressant à l’Allemand :
— Asseyez-vous là , maître Goëzmann.
Celui-ci obéit.
— Avant d’écrire, répondez à une question.
Goëzmann écouta.
— À qui appartient cette villa ?
— Je l’ignore.
— Et moi, je le sais ; j’ai voulu simplement mettre votre franchise à l’épreuve ; maintenant, je suis fixé à votre égard sur tous les points. Aussi lâche que féroce, aussi menteur que lâche ! Cette villa est à la marquise de Santarès, dont tu dois avoir au moins entendu parler, je suppose.
— Non, répondit Goëzmann.
— Toujours ! comment se fait-il donc qu’on t’ait vu ce soir dans sa loge avec M. Taureins ?
Cette fois l’Allemand se troubla et ne répondit pas.
— Mais, reprit Rocambole, peut-être la connais-tu depuis peu de temps ?
— Depuis fort peu de temps.
— À la bonne heure, dit Rocambole ricanant, voilà de la franchise, à la fin.
Goëzmann le regarda d’un air inquiet.
— Mais, balbutia-t-il, je vous assure…
— Que tu ne peux te dispenser de mentir, n’est-ce pas ? Je m’en aperçois. Allons, écris ce que je vais te dicter.
L’Allemand trempa sa plume dans l’encrier et attendit.
Rocambole commençai ainsi :
— 990…
Au lieu d’écrire, Goëzmann se leva d’un bond et tourna vers Rocambole des regards effarés.
— Eh bien, quoi ? que signifie cette émotion ? Est-ce qu’il y a dans ce chiffre quelque chose qui vous soit particulièrement désagréable, maître Goëzmann ?
— Mais non, non, balbutia l’Allemand tout troublé.
— Alors rasseyez-vous donc et continuez d’écrire.
Goëzmann s’assit et reprit sa plume.
Rocambole dicta :
— 990 est le numéro que je portais au bagne de Toulon.
— Moi ? moi ? s’écria l’Allemand atterré, jamais je…
— Hein ! dit Rocambole en l’interrompant, vous ne me saviez pas si bien au courant de vos petites affaires, n’est-ce pas ?
Il ajouta :
— Allons, achevez la phrase que je viens de vous dicter, il vous reste trois mots à écrire : bagne de Toulon ; vous aimeriez mieux autre chose, je comprends cela, mais nous n’avons pas le choix.
Goëzmann écrivit.
Rocambole poursuivit :
— J’avais été condamné à cinq ans de bagne pour tentative de meurtre sur un vieillard qui, deux ans auparavant, m’avait accueilli pauvre, mourant de faim, dénué de tout, et m’avait même procuré une place de comptable chez un de ses amis.
Les traits de l’Allemand exprimaient la stupeur.
Il s’était interrompu un instant, avec l’intention évidente de protester, mais, après un moment d’hésitation, il avait continué.
— Au reste, dicta de nouveau Rocambole, je n’avais pas le droit de me plaindre du sort, car j’avais mieux sur la conscience qu’une simple tentative de meurtre, ayant assassiné un voyageur trois ans avant cette condamnation.
— Je n’écrirai pas cela, c’est faux, c’est faux, s’écria Goëzmann, s’arrêtant au milieu de la phrase.
— C’est-à -dire que vous ne pouvez croire que je sois instruit de cette affaire, dit Rocambole ; je vais donc préciser et vous verrez si je suis bien renseigné. Je dicte, écrivez :
— Ce voyageur était un pauvre colporteur espagnol qui retournait dans sa famille, après avoir amassé lentement, péniblement une petite fortune de six mille dollars. Il eut l’imprudence de me les montrer, et une heure après il tombait sous mon poignard. Cela se passait dans une colonie espagnole, à l’entrée d’un site étrange, connu dans le pays sous le nom de la Fournaise.
Il y eut un moment de silence. Goëzmann regardait Rocambole d’un air ahuri.
— Eh bien, lui dit celui-ci, en se croisant les bras, qu’en dites-vous, maître Goëzmann, est-ce bien cela et oserez-vous dire encore que c’est faux ?
L’Allemand était anéanti ; le regard fixé sur Rocambole, il semblait se demander si c’était un homme ou un démon. Enfin, devant des détails aussi précis, il comprit l’impossibilité de nier et il écrivit.
— C’est fait ? demanda Rocambole.
Goëzmann fit un signe affirmatif.
Rocambole reprit :
— Le meurtre accompli, au lieu de continuer le chemin que j’avais suivi jusque-là avec le voyageur, je me jetai dans la Fournaise pour éviter d’être poursuivi, sachant que cette espèce de gouffre, tout hérissé de monticules arides et criblé tout le jour par les rayons du soleil, était presque impraticable. C’est là , dans ce site désert, sauvage, presque mortel, que je rencontrai une jeune Espagnole échappée des Présides, portant aux pieds et aux mains la marque de ses fers et qui, quelques années plus tard, devait se faire à Paris une singulière célébrité sous le nom de marquise de Santarès.
Cette fois, l’Allemand ne put retenir un cri de surprise.
— Est-ce vrai ? lui demanda Rocambole.
— C’est vrai ! balbutia Goëzmann stupide d’étonnement.
— Écrivez-donc.
Et il dicta :
— Je la rencontrai au moment où j’allais mourir de soif au fond de la Fournaise ; elle me sauva la vie, et il fut fait un pacte entre nous par lequel je m’engageais à la servir de tout mon pouvoir et dans tout ce qu’elle exigerait de moi, une fois rentrés l’un et l’autre au sein de la société. C’est une année après que je me laissais prendre en France et que j’allais purger à Toulon la peine à laquelle j’avais été condamné par contumace. En sortant de là , je retrouvais Inès à Paris où, à la suite de deux années de dures épreuves, elle s’élançait tout à coup dans la haute position qu’elle occupe aujourd’hui. C’est alors qu’elle fit la connaissance de M. Taureins et que, poussée à la fois par l’ambition et la méchanceté, qui forment le fond de sa nature, elle résolut de tout mettre en œuvre pour perdre madame Taureins, et c’est dans ce but que, voulant avoir dans la maison même un instrument dévoué, elle me fit placer, par l’intermédiaire d’un banquier de ses amis, dans les bureaux de M. Taureins.
Rocambole s’interrompit pour dire à Goëzmann :
— C’est toujours cela, n’est-ce pas ?
— Je dois l’avouer, répondit l’Allemand, qui, de plus en plus effaré, semblait se demander s’il était sous l’empire d’un rêve.
— Jusqu’à présent, reprit Rocambole, j’ai pu dicter sans vous interroger, car tout votre passé et presque tout votre présent me sont connus, vous en avez la preuve ; mais quant au reste, et particulièrement en tout ce qui concerne la tentative infâme dirigée contre madame Taureins et dont, sans moi, elle serait victime à cette heure, c’est de vous que j’attends des détails. Or, vous allez comprendre tout de suite que vous avez le plus grand intérêt à me les donner aussi exacts, aussi précis que possible, et surtout à ne rien dissimuler du rôle odieux qu’ont joué dans cette affaire vos deux complices, M. Taureins et la marquise de Santarès. La pièce que je vous dicte, je ne vous le dissimule pas, est une arme que je tiendrai constamment braquée sur vous et dont je ferai usage quand je le jugerai à propos, vous comprenez donc que plus M. Taureins et sa digne amie se trouveront compromis dans cet acte terrible, plus ils seront intéressés à en empêcher la révélation qui amènerait à la fois leur perte et la vôtre. Plus cet écrit mettra leur culpabilité en lumière, plus ils feront d’efforts et de sacrifices pour vous sauver, puisque désormais vos intérêts ne feront qu’un, votre cause sera la même. Vous voilà prévenu, commençons.
XVIII
LE SIGNAL
Goëzmann se disposait à écrire de nouveau sous la dictée de Rocambole.
— Un mot d’abord avant de continuer, lui dit celui-ci.
— À vos ordres, répondit Goëzmann en tamponnant avec une serviette les plaies de ses deux joues toujours béantes, mais d’où le sang avait cessé de couler.
— Où est, à cette heure, la marquise de Santarès, où comme l’appellent ses chastes amies, Nanine la Rousse ?
— Tout près d’ici, dans une maison d’où elle peut voir les fenêtres de sa villa.
— Qu’attend-elle ?
— Le résultat du guet-apens organisé par elle, car je n’ai joué dans cette affaire qu’un rôle tout passif.
— Qui doit lui en porter la nouvelle ?
— Une lampe posée sur cette fenêtre ouverte.
— Et quelle sera la signification de cette lampe posée là ?
— Elle lui apprendra que… que tout est fini…
Rocambole tressaillit.
— Elle attend cela ! murmura-t-il d’une voix sourde.
Il ajouta après un silence :
— Quand je songe que tout serait fini en effet si…
Puis se tournant brusquement vers l’Allemand :
— Sais-tu bien, misérable, s’écria-t-il, saisi d’une colère subite, sais-tu ce qui serait arrivé alors ? Je ne t’aurais pas tué, non, c’est trop vite fait, mais je t’aurais arraché les yeux de la tête avec la pointe de mon poignard, je le jure.
Estime-toi donc heureux de m’avoir trouvé en travers de tes infâmes projets et d’en être quitte pour deux balafres au visage.
Goëzmann frissonna à la pensée du terrible châtiment auquel il venait d’échapper.
— Tu m’entends ? lui dit Rocambole en le regardant froidement entre les deux yeux, rappelle-toi mes paroles et sache bien que si, cédant aux excitations de la marquise, tu osais renouveler cette odieuse tentative, c’est là ce qui t’attend.
Il reprit après une pause :
— Tu es sûr que la marquise est venue dans cette maison et y attend ton signal ?
— C’était convenu, elle a même dû renvoyer sa voiture et prendre un fiacre au sortir du théâtre, ne voulant pas, naturellement, mettre ses domestiques dans le secret de cette affaire.
Il ajouta après un moment de réflexion :
— Mais j’y songe, il se peut qu’elle ait vu votre voiture suivre celle de madame Taureins, qu’elle ait soupçonné la vérité et que craignant d’être compromise elle ait rebroussé chemin.
— Ma voiture était arrivée ici avant celle de madame Taureins, répondit Rocambole.
Goëzmann le regarda avec une profonde surprise.
— Mais, dit-il, vous saviez donc ?…
— Je savais tout, jusqu’à la demeure où devait s’accomplir le crime.
— C’est extraordinaire, murmura Goëzmann stupéfait, ces détails n’étaient connus que de moi, la marquise, M. Taureins et les trois individus que nous avions travestis en domestiques.
— Oui, dit Rocambole, chez un marchand de vin de la rue d’Amboise.
— C’est vrai, s’écria Goëzmann, qui marchait de surprise en surprise.
— Ah ! c’est que moi aussi, dit Rocambole, j’ai des intelligences un peu partout ; mais…
Mais expliquez-moi donc le mystère de la voiture.
Quant aux livrées, j’ai parfaitement compris que vous en aviez fait faire trois pareilles à celles des domestiques de M. Taureins, rien de plus simple, mais la voiture…
— La voiture était celle de M. Taureins.
— Mais les vrais domestiques qui devaient la conduire étaient donc vos complices ?
— Nullement ; c’eût été une grave imprudence.
— Comment alors expliquer leur absence à l’heure où ils devaient être là à attendre leur maîtresse à la sortie du spectacle ?
— De la façon la plus simple, on les avait grisés à force de champagne dans un café voisin du théâtre.
— Fort bien ; maintenant, reprenons notre petit travail pour lequel je compte sur vos renseignements, et je crois avoir prouvé que vous aviez tout intérêt à me les donner aussi complets que possible.
— Je l’ai parfaitement compris et je suis à vos ordres, répondit l’Allemand.
Et il se mit en devoir d’écrire.
— Ah ! dit Rocambole, j’allais oublier…
— Quoi, donc ?
— Je veux faire quelque chose pour cette bonne marquise.
— Ah ! fit Goëzmann.
— Ouvrez donc cette fenêtre.
L’Allemand se leva et alla ouvrir la fenêtre.
— Prenez une de ces lampes.
Goëzmann obéit.
— Qu’en faut-il faire ? demanda-t-il.
— Parbleu ! la poser au milieu de cette fenêtre.
— Je comprends, dit Goëzmann en faisant ce que lui commandait Rocambole.
— Cette excellente créature ! murmura celui-ci en souriant, cela va lui procurer un moment de joie.
L’Allemand avait repris sa place, et la plume à la main il attendait.
Nous connaîtrons plus tard le résultat de ce travail ; quant à présent, nous prions le lecteur de nous suivre dans la maison où la marquise de Santarès était allée s’installer pour y attendre des nouvelles de l’odieux complot tramé par elle contre madame Taureins.
Cette maison, située à cinquante pas de la sienne, était à la fois un restaurant et un hôtel, où elle avait loué une chambre pour la nuit.
Ce que n’avait pas dit l’Allemand, ce qu’il ignorait peut-être, c’est qu’elle n’était pas seule dans cette chambre.
M. Taureins était avec elle.
La chambre qu’ils occupaient était faiblement éclairée par une petite lampe, dont la lumière avait été baissée à dessein.
Assis en face l’un de l’autre près de la fenêtre ouverte, ils causaient presque à voix basse et laissaient souvent tomber la conversation.
La marquise jetait des regards fréquents du côté de sa villa et, chaque fois, le talon de sa bottine frappait le parquet avec impatience.
M. Taureins était en proie à une agitation qui se trahissait par le décousu de ses paroles et la profonde altération de ses traits.
— Ah çà , mon cher ami, dit tout à coup la belle rousse, savez-vous que je vous trouve d’une faiblesse déplorable, pour ne pas dire honteuse. Vous prétendez m’adorer ; vous ne rêvez, à vous entendre, que sacrifices et dévouements ; vous vous plaignez des entraves qu’apporte à notre amour une union aussi fatigante que légitime ; vous aspirez chaque jour à vous débarrasser d’une épouse si douce et si insignifiante, qu’elle commence à tourner à l’agneau, il ne lui manque que le bêlement, qui ne saurait tarder à venir, et le jour où nous avons enfin trouvé le moyen de combler vos vœux à l’aide d’un stratagème… innocent, vous voilà triste et déconfit comme s’il vous arrivait un malheur ! Expliquez-vous, à la fin ; décidément, voulez-vous, oui ou non, une séparation ?
— Eh ! sans doute, je la veux, vous le savez bien, je vous l’ai dit cent fois.
— Alors, qui veut la fin veut les moyens.
— Les moyens, voilà justement ce qui ne me convient pas.
— Une simple comédie, un simulacre de séduction ! ne voilà -t-il pas quelque chose de bien effrayant !
— S’il faut vous dire toute ma pensée, je n’ai pas une confiance absolue dans ce Goëzmann.
— Vous le jugez mal, je le connais mieux que vous et je réponds de lui : il ne dépassera pas les limites convenues, rassurez-vous donc.
— Je suis entièrement rassuré, non que je me fie le moins du monde à la parole de Goëzmann, mais parce que j’ai pris mes précautions.
— Lesquelles ? demanda vivement Nanine.
— J’ai recommandé à Rascal, l’un des faux domestiques, de veiller à la porte du salon, d’écouter, d’épier et de s’y précipiter dès qu’il comprendra que Valentine est endormie.
La marquise froissa si violemment une de ses manchettes, qu’elle en arracha la dentelle.
— Que de prévoyance ! que de sollicitude ! s’écria-t-elle d’une voix frémissante de colère, mais vous êtes la perle des maris, mon cher.
Elle ajouta à voix basse, en jetant un regard brûlant de haine sur les fenêtres de sa villa :
— Ah ! je comprends maintenant… ce n’est pas un retard, tout est manqué !
Puis s’adressant brusquement à M. Taureins :
— Alors, d’où vient donc votre inquiétude, je ne me l’explique pas ?
— Je tremble que les conséquences de cette affaire ne retombent sur ma tête ; et puis, même en cas de succès, il résultera d’un procès de cette nature un scandale dont la pensée m’épouvante.
— Parbleu ! je voudrais bien savoir de quoi vous n’êtes pas épouvanté ; votre vie se passe à …
Elle s’interrompit tout à coup pour jeter un cri de joie.
— Qu’avez-vous donc ? lui demanda le banquier stupéfait.
— Jetez vos regards sur ma maison, qu’y voyez–vous ?
— Une fenêtre ouverte.
— Et sur cette fenêtre ?
— Une lampe.
— Dont je vais vous dire la signification. Madame Taureins a-t-elle encore sa mère ?…
— Sans doute, mais…
— Eh bien, cher ami, depuis cinq minutes elle n’est plus digne de l’embrasser, voilà ce que signifie la lampe.
Et elle partit d’un éclat de rire.
M. Taureins était devenu affreusement pâle.
— Auriez-vous par hasard l’intention de vous évanouir ? lui dit la marquise en enveloppant sa tête d’un voile de laine ; il faudrait voir à refouler ça, mon cher, je n’ai pas le temps de vous taper dans les mains ; nous avons d’autres chiens à peigner pour le quart d’heure.
Elle alla prendre le chapeau du banquier, et le lui posant sur la tête :
— Allons, venez, lui dit-elle.
— Où donc ?
— Chez moi, parbleu !
— Pourquoi faire ? demanda le banquier ahuri.
— Eh bien ! et la scène des constatations !

![]()
XIX
LES ENNEMIS EN PRÉSENCE
Quelques instants après, la marquise arrivait à sa villa, accompagnée ou plutôt suivie de M. Taureins qui, accablé sous le coup de massue que venait de lui porter celle-ci, avait peine à régler son pas sur le sien.
La grille était ouverte, ce dont la marquise s’étonna d’abord.
Ils traversèrent le jardin.
Arrivés au corps de logis, ils trouvèrent la porte d’entrée également ouverte.
— À quoi songent-ils donc ? murmura la marquise.
Elle entra.
— Personne dans l’antichambre ?
Elle appela :
— Rascal !
Pas de réponse.
— Qu’est-ce que cela signifie ? s’écria-t-elle avec colère, il devait nous attendre ici avec ses dignes amis, cependant.
Et, se tournant vers le banquier :
— Que dites-vous de cela ?
— Rien, répondit celui-ci d’une voix brève.
— Je ne sais ce que vous avez aujourd’hui, vous êtes d’une humeur…
— Montons, dit M. Taureins sur le même ton.
— Vous avez raison ; là -haut du moins, nous sommes sûrs de trouver quelqu’un.
Ils montèrent.
La porte était fermée à double tour, mais en dehors.
La marquise l’ouvrit et entra brusquement, suivie du banquier.
Mais elle resta interdite à la vue d’un inconnu qui était là , debout, au milieu de la pièce, et dont le regard, tombant droit sur elle, la cloua au seuil de la porte.
— Que venez-vous faire ici, madame, lui demanda Rocambole.
— Ce que je viens faire ! s’écria la marquise en le toisant insolemment des pieds à la tête, je suis chez moi ici, monsieur, et je m’étonne de vous y voir, n’ayant pas l’honneur de vous connaître.
— Vous n’êtes pas au bout de vos surprises, madame, je vous en prépare bien d’autres.
— Préparez ailleurs ce qu’il vous plaira, mais commencez d’abord par sortir de chez moi, après m’avoir appris, toutefois, comment et pourquoi vous vous y êtes introduit.
— Comment ? répondit Rocambole, mais tout simplement par la porte, comme tout le monde. Pourquoi ? Ah ! cela demande de plus longues explications.
Il allait continuer, quand la marquise, ayant aperçu enfin Goëzmann assis devant son secrétaire, s’écria en se levant tout à coup :
— Mais, grand Dieu ! qu’avez-vous donc au visage ? En quel état vous a-t-on mis ?
— Ce qu’il a au visage, répondit Rocambole, c’est la marque ineffaçable de deux coups de cravache, et celui qui l’a mis en cet état, c’est moi.
La marquise porta sur l’Allemand, puis sur Rocambole et autour d’elle enfin, un regard où se peignaient à la fois la stupeur, l’indignation et la colère, puis elle s’écria tout à coup :
— Ah çà ! que se passe-t-il donc ici à la fin ?
— Ce qui se passe ici, madame, répondit Rocambole en enveloppant d’un sombre regard la marquise et le banquier, je vais vous le dire, mais vous aurez peine à y croire, tant c’est monstrueux. Il y avait en ce monde trois êtres infâmes, pétris de tous les vices, de toutes les bassesses, de tous les mauvais instincts imaginables, si féroces, si lâches, si immondes, que le destin avait pris soin de les faire naître dans des pays différents, redoutant les malheurs que pourrait amener la réunion de ces trois monstres.
L’un était né en France, l’autre en Espagne et le troisième en Allemagne.
La marquise tressaillit.
Puis elle répliqua aussitôt :
— Où voulez-vous en venir, monsieur, et qu’avons-nous besoin de vos histoires ?
— Eh bien, madame, poursuivit Rocambole, la précaution qu’avait prise le destin d’isoler ces trois êtres malfaisants se trouva déjouée ; telle était la puissance d’attraction qu’ils exerçaient l’un sur l’autre, que, s’attirant mutuellement et irrésistiblement à travers les espaces, ils se trouvèrent un jour agglomérés sur un même point, Paris. Là se trouva bientôt prise entre leurs mauvaises passions une femme jeune, belle et pure, créature candide et touchante, digne de tous les respects et de toutes les adorations, qu’une de ces unions absurdes et coupables appelées mariages de convenance avait liée pour toujours au sort d’un de ces trois monstres. Or savez-vous, madame, l’effroyable combinaison de ces trois cœurs dépravés ? Le mari de cette charmante jeune femme, poussé par sa maîtresse, espèce de tigresse qui, dès l’âge de seize ans, avait déjà assassiné un homme, son amant, le mari lui-même entra dans un complot qui avait pour but de livrer la pauvre innocente aux passions d’un misérable de la plus vile espèce. Eh bien ! madame, que dites-vous de cela ? n’est-il pas vrai que c’est monstrueux au point d’en devenir invraisemblable ? Mais je puis vous nommer les masques, le mari est un banquier français du nom de Taureins, la femme est une Espagnole qu’on appelle indifféremment Nanine la rousse ou la marquise de Santarès, et l’ignoble coquin qui avait osé lever les yeux sur la jeune femme et auquel on la jetait en pâture est un Allemand, nommé Goëzmann, parfaitement digne au reste de faire sa partie dans cet estimable trio, puisqu’il a passé cinq ans au bagne.
— Au bagne ? s’écria M. Taureins avec un frisson d’horreur.
— Oui, monsieur Taureins, cinq ans, trois ans de plus que madame la marquise au bagne des Présides, et la moitié du temps, peut-être, que vous y passerez vous-même comme banqueroutier frauduleux.
— Hein ? balbutia le banquier en reculant atterré sous le regard flamboyant de Rocambole.
— Nous reparlerons de cela tout à l’heure ; mais dites-moi, monsieur, et vous surtout, belle Nanine, vous ne me demandez pas des nouvelles de madame Taureins, à laquelle vous vous intéressez cependant beaucoup, en ce moment surtout !
La marquise ne répondit pas.
— Au fait, reprit Rocambole, vous savez à quoi vous en tenir, cette lampe vous a appris à tous deux que vous pouviez vous réjouir du résultat de votre guet-apens, elle vous a dit qu’une noble et pure jeune femme venait d’être souillée par les embrassements d’un lâche et ignoble coquin, et tous deux, le mari sans âme et l’infâme concubine, vous vous êtes dit : Enfin, elle est perdue ! enfin, elle est souillée ! et dans votre cœur vous avez entonné un chant de victoire sur la honte de cette belle et touchante créature ! et vous vous êtes représenté, en riant, ses larmes et son désespoir au réveil, à l’heure où l’épouvantable vérité lui serait révélée ! Mais cela ne suffisait pas encore, son malheur n’était pas assez complet, sa honte n’était pas assez éclatante, il fallait constater son déshonneur, il fallait la traîner devant les tribunaux et la jeter, rouge de honte, aux regards et aux insultes de la foule ; voilà les rêves que cette lampe a subitement éveillés dans votre belle âme, n’est-ce pas, noble couple ? Et vous êtes accourus en vous disant :
Allons d’abord constater le fait, puis nous enverrons aussitôt chercher le magistrat, qui notera un à un les révoltants détails de l’adultère, minutieusement racontés par notre digne ami Goëzmann, détails développés bientôt avec éclat devant la justice, en face d’un auditoire avide de scandale, en face de la coupable qui, à la suite d’une condamnation infamante, mourra probablement de sa honte, dénouement qui nous permettra d’unir légalement nos destinées après avoir uni l’une à l’autre nos deux belles âmes. N’est-ce pas, noble Taureins, n’est-ce pas, estimable Nanine, que ces gracieux tableaux se sont présentés à votre esprit à la vue de cette lampe posée là ?
Le banquier, courbant la tête sous cette insultante apostrophe, était incapable de répliquer un mot.
Il n’en était pas de même de la marquise.
Dans le mystère qui planait au-dessus de cette scène, un fait lui apparaissait clair, évident, et la rendait forte contre tout le reste, c’était l’heureuse issue de son guet-apens, issue affirmée par cet homme, évidemment leur ennemi.
Elle jeta un regard sur Goëzmann, espérant que celui-ci confirmerait ces paroles par un signe.
Mais l’Allemand fixait devant lui un regard dans lequel il était impossible de rien lire, et il ne tourna pas la tête de son côté.
Suffisamment convaincue néanmoins, Nanine releva la tête avec audace, et, regardant en face son ennemi :
— Monsieur, lui dit-elle, je ne prendrai pas la peine de relever les ridicules calomnies que vous venez de proférer sur mon compte, et nous remettrons à plus tard l’explication de votre présence ici et de l’intérêt, un peu compromettant pour elle, que vous portez à madame Taureins. Voici, quant à présent, ce que j’ai à vous dire, ce qui restera acquis à la justice en dépit de tout ce que vous pourrez inventer pour la justification de votre intéressante protégée. En rentrant chez lui, à la sortie des Italiens, M. Taureins a été très-surpris d’apprendre que sa femme n’avait pas encore paru. Il attendit une heure, mais en vain ; justement inquiet, il s’enquit, il chercha et finit par trouver dans la chambre de madame Taureins une lettre de son caissier Goëzmann d’ou il ressortait d’abord que des relations coupables existaient entre eux, ensuite qu’elle devait se rendre, en sortant des Italiens, à la villa Santarès, où Goëzmann irait l’attendre. Mis ainsi sur la piste des coupables, M. Taureins est accouru ici pour s’assurer de la vérité avant d’envoyer chercher le commissaire de police ; voilà la vérité, que tous vos efforts ne pourront détruire. Et maintenant, monsieur, puisque vous vous êtes emparé de ma maison, dans un but qu’explique assez clairement l’intérêt que vous inspire la belle Valentine, c’est à vous que nous demandons : Où est madame Taureins ?
XX
PRIS AU PIÈGE
— Vous tenez donc beaucoup à voir madame Taureins ? dit Rocambole à la marquise.
— Je tiens… c’est-à -dire M. Taureins veut la voir de suite, il est impatient de…
— De constater le flagrant délit, seul moyen d’arriver à une séparation, condition que vous avez mise à la continuation de vos bontés pour lui et qu’il a eu la lâcheté d’accepter.
— Monsieur ! s’écria le banquier, stimulé par un regard d’indignation que venait de lui jeter la marquise.
— Oh ! monsieur, lui dit Rocambole, je suis tout prêt à vous rendre raison de mes épithètes ; mais, entre nous, je doute que vous y teniez beaucoup ; quand on préfère à une femme telle que madame Taureins une créature comme Nanine la Rousse, on a l’âme trop basse pour ressentir bien vivement une injure, et encore moins pour la venger au péril de sa vie.
— Allez toujours, monsieur, lui dit la marquise d’un ton méprisant, je suis femme, vous n’avez rien à craindre.
— Quant à vous, madame, répliqua Rocambole, si vous étiez un homme, je refuserais de vous rendre raison avant que vous ne m’eussiez expliqué l’origine des deux cercles roses que je vois à vos poignets.
Nanine rentra instinctivement ses mains sous ses manches de dentelle.
— Mais revenons donc à ce qui vous intéresse, à madame Taureins, dont, permettez-moi de le dire, vous vous préoccupez beaucoup plus que son mari.
— Elle est là , j’en suis sûre, s’écria la marquise en montrant la porte de la chambre, elle ne peut être que là .
— En effet, madame, si l’honnête programme arrêté entre vous et votre digne ami Goëzmann a été exactement suivi, elle ne peut être que là . Voyez-y donc, puisque vous êtes chez vous.
Nanine courut à la chambre, dont la porte était restée entrouverte.
M. Taureins ne l’avait pas suivie.
Il était resté comme pétrifié à la même place.
Au bout d’une minute on entendit un cri rauque.
Puis on vit reparaître tout à coup la marquise l’œil étincelant et les traits empreints d’une fureur qui les rendait effrayants.
— Elle n’y est pas ! elle n’y est pas ! balbutia-elle d’une voix étranglée.
Et elle se jeta pâle et haletante dans un fauteuil.
Elle étouffait.
— Vous paraissez émue, madame, lui dit tranquillement Rocambole.
La marquise se retourna vers lui avec la furie d’une lionne et, lui jetant un regard enflammé :
— Où est-elle, monsieur ? lui demanda-t-elle d’une voix saccadée, puisque vous êtes tout, puisque vous faites tout ici, répondez ; où est-elle ?
Rocambole restait immobile comme s’il prêtait l’oreille à quelque bruit.
— Je vais vous le dire, madame, répondit-il enfin ; écoutez.
La marquise se leva et écouta.
Un roulement de voiture se fit entendre.
— Qu’est-ce que c’est que cela ? demanda-t-elle.
— C’est madame Taureins qui part dans sa voiture.
— Elle ! s’écria la marquise en frappant du pied avec rage.
— Hélas ! oui, madame.
Elle reprit, après une pause :
— Qu’importe après tout ? Elle rentre au milieu de la nuit, et M. Taureins a fait constater son absence, à une heure du matin, par ses domestiques.
— Il peut la faire constater de nouveau longtemps encore, car elle ne rentre pas et ne rentrera plus chez elle, le lieu est trop mal habité.
— Tant mieux, s’écria Nanine avec joie, c’est sa condamnation, quoique l’aventure de cette nuit suffise largement pour la convaincre de…
— Je suis désolé de vous ôter une illusion qui paraît vous être bien chère, madame, lui dit Rocambole avec une imperceptible ironie, mais cette aventure a été aussi innocente que possible, et madame Taureins sort d’ici aussi pure qu’elle est sortie du théâtre des Italiens.
— Allons donc ! s’écria la marquise en tournant involontairement ses regards vers la lampe.
— Ah ! oui, dit Rocambole, le signal convenu entre vous et votre complice. Eh bien, belle marquise, ce signal est une petite mystification que je me suis permise à votre endroit.
— C’est faux ! s’écria Nanine.
Et, s’adressant à Goëzmann :
— Eh bien, parlerez-vous enfin ? Que s’est-il passé ?
— Vous le voyez bien, répondit l’Allemand avec humeur. J’ai reçu deux coups de cravache qui m’ont coupé la figure.
— Avant ou après ? demanda la marquise avec un accent tout particulier.
— Oh ! avant.
Il y eut une pause.
— Ah çà , monsieur, dit enfin la marquise à Rocambole, pourriez-vous nous avouer les motifs du vif intérêt que vous portez à madame Taureins ?
— Sans la moindre difficulté, madame. J’ai appris, par le plus heureux des hasards, qu’une femme jeune, belle, honnête, digne de toutes les sympathies, se trouvait prise dans l’engrenage d’une effroyable machination, d’où son honneur devait sortir souillé pour la plus grande joie de trois monstres associés pour la perdre, et, poussé par un instinct tout particulier de ma nature, j’ai résolu, non-seulement de sauver la victime menacée, mais de replonger à jamais dans la fange, d’où ils n’eussent jamais dû sortir, les lâches bourreaux de celle que je prenais désormais sous ma protection.
— En vérité ! s’écria la marquise avec un ricanement sauvage, vous êtes donc un personnage bien redoutable ?
— Je suis M. Portal, rentier, pas autre chose !
— Et, étant si peu que cela, vous prétendez nous réduire en poussière ?
— C’est déjà fait.
— Tiens ! tiens ! dit Nanine avec ce sourire d’hyène qui la rendait effrayante, je serais curieuse de voir cela de près.
— Ce ne sera pas long.
— Je vous écoute.
— Depuis trois ans que vous avez des bontés pour lui, M. Taureins, qui connaît votre cœur et qui sait comment on s’attache une nature délicate comme la vôtre, vous a payé votre amour à raison de deux cent mille francs par an, soit six cent mille francs pour trois ans : un joli denier ; trop peu sans doute pour une affection aussi sincère ; mais enfin, je le répète, un joli denier. Il en résulta un creux dans la caisse, creux très-prononcé, qu’on eût pu combler néanmoins en renonçant à cet amour de luxe. M. Taureins n’en eut pas le courage et se trouva bientôt acculé dans une impasse d’où il pouvait sortir de deux façons : un arrangement honorable, mais ruineux, ou une banqueroute frauduleuse. Il choisit le moyen que devaient lui désigner à la fois ses propres instincts et un conseiller tel que vous, la banqueroute frauduleuse.
— Vous insultez et vous calomniez M. Taureins, s’écria la marquise.
— Je poursuis, dit tranquillement Rocambole. M. Taureins est à la veille de déposer son bilan, et ses livres, arrangés par le plus habile des faussaires, j’ai nommé votre ami Goëzmann, peuvent lutter de régularité avec ceux de la Banque de France. Il sortira donc de cette affaire blanc comme neige, donnera vingt pour cent à ses créanciers, touchés de cet acte de probité, et se trouvera avoir gagné trois ou quatre millions à la suite de cette habile opération. Mais, comme il faut tout prévoir et que les femmes de votre… profession sont douées d’une prévoyance tout exceptionnelle, vous avez fait comprendre à M. Taureins que l’examen de ses livres pouvant entraîner entre vous une séparation momentanée… pour cause de bagne, il serait délicat de sa part de vous prémunir contre la gêne par l’offre gracieuse d’un demi-million. M. Taureins, qui tient à votre cœur et sait qu’on ne se l’attache pas avec des faveurs roses, a trouvé la demande tout à fait raisonnable et il tient en réserve le demi-million, qu’il vous comptera le jour même où il déposera son bilan, c’est-à -dire dans cinq jours. Eh bien, madame la marquise, je ne sais si vous êtes de mon avis, mais pour un joli tour, voilà ce que j’appelle un joli tour.
— Qui vous a fait ces contes absurdes ? s’écria la marquise qui avait pâli en écoutant ces paroles.
— Je poursuis, dit Rocambole ; à moins d’y être contraint par M. Taureins lui-même, je n’ai pas à m’occuper de sa petite faillite, c’est une affaire entre lui et ses créanciers ; et, quant à la réserve d’un demi-million, je l’approuve complètement.
— Ah ! fit Nanine.
— Oui ; seulement, je me permettrai d’en changer la destination.
— Vraiment !
— Si cela vous est égal, ces cinq cent mille francs représentant exactement la dot de madame Taureins, c’est à elle que nous les donnerons.
À ces mots, Nanine jeta un regard foudroyant sur Rocambole.
Mais elle parvint à se contenir, et, se tournant vers M. Taureins, elle lui dit du ton le plus calme :
— Est-ce votre avis, monsieur ?
— Pardon, dit Rocambole, je ne demande l’avis de personne, c’est ma volonté que j’exprime, à laquelle il faut se soumettre et que je résume en quelques mots. Demain matin j’accompagnerai M. Taureins chez lui, il prendra dans sa caisse les cinq cent mille francs qui y sont déposés en billets de banque, et nous nous rendrons ensemble chez son notaire, auquel il les remettra au nom de sa femme, en donnant pour motif de cette détermination une séparation amiable, qui semblera toute naturelle, sa scandaleuse liaison avec Nanine la rousse étant connue de tout le monde.
— Très-joli ! tout à fait joli ! s’écria la marquise en grimaçant un éclat de rire.
Puis, regardant Rocambole en face :
— Et si l’on refusait d’exécuter vos volontés ?
— Alors il y aurait demain trois lettres au parquet, la première dénonçant les faux introduits par M. Taureins dans sa comptabilité, la seconde révélant l’assassinat d’un voyageur espagnol, au lieu dit la Fournaise, par l’Allemand Goëzmann, et la troisième faisant connaître la prétendue marquise de Santarès comme une dangereuse aventurière, condamnée à cinq ans de présides pour cause de meurtre, devant encore trois années à la justice espagnole, à laquelle elle parvenait à se soustraire au bout de deux ans. À l’appui de ces trois dénonciations, je fournirai ce petit mémoire justificatif que votre estimable complice vient d’écrire sous ma dictée et où se trouvent relatés, en outre, tous les détails de l’infâme complot que vous aviez tramé contre l’honneur de madame Taureins.
Puis, s’emparant de ce mémoire qu’il glissa dans sa poche :
— Maintenant, dit-il, je me retire dans cette chambre et vous laisse à vos réflexions, vous prévenant que vous êtes gardés à vue dans cette maison, d’où nous sortirons tous ensemble demain matin pour aller, Goëzmann et vous, madame, où il vous plaira, et M. Taureins à sa caisse, accompagné de M. Portal, pour se rendre de là chez le notaire, comme il vient d’être dit. Allons, au revoir et bonne nuit !
Et il passa dans la chambre voisine.
XXI
LE RÉVEIL DE VALENTINE
Le lendemain, vers midi, voici ce qui se passait rue Amelot, chez M. Portal.
Nizza, que nous retrouvons maintenant les traits calmes, le teint frais et pur sous une toilette dont la simplicité élégante fait valoir sa jolie tournure, d’une grâce encore naïve et presque enfantine, Nizza est occupée à ranger, à tout mettre en ordre dans le petit salon de sa mère, car c’est ainsi qu’elle appelle Vanda.
Son œuvre terminée, elle était en train de l’examiner d’un petit air capable et avec les signes d’une satisfaction évidente, quand la porte s’ouvrit.
La petite muette se retourna vivement et courut se jeter dans les bras de celle qui venait de paraître sur le seuil.
C’était Vanda.
Nizza lui montra le salon, lui expliqua par gestes ce qu’elle venait de faire et lui en demanda son avis avec un air d’assurance et de contentement qui n’admettait guère la critique.
Aussi Vanda lui affirma-t-elle qu’il n’y avait rien à redire, ni à retoucher à son travail, que tout était rangé dans un ordre et un goût parfait, puis elle lui demanda :
— Mais pourquoi t’es-tu donné tant de peine aujourd’hui, toi qui ne t’occupes jamais de ces soins-là ?
Nizza leva le doigt vers le plafond, pencha sa tête sur sa main en faisant le simulacre de dormir et, passant les mains tout le long de son corps avec un sentiment d’orgueil et d’admiration, fit comprendre qu’elle parlait d’une personne élégante et belle.
— Je comprends, dit Vanda en souriant, tu as pris toute cette peine pour la belle dame que j’ai amenée ici cette nuit et qui dort là -haut ?
Nizza fit un signe affirmatif, puis elle ajouta que la dame serait heureuse, à son réveil, de trouver un salon si beau et si bien rangé.
— Pauvre femme ! murmura Vanda avec l’expression d’une vive inquiétude, pourvu qu’elle s’éveille !
Un homme entra en ce moment.
C’était Milon.
— Eh bien ? demanda-t-il vivement.
— Rien encore, répondit Vanda, elle reste toujours plongée dans ce sommeil, qui se prolonge d’une manière effrayante.
— Il faudrait peut-être envoyer chercher un médecin.
— J’y ai songé, mais je n’ose le faire sans l’avis de Rocambole.
— Et lui, pas encore de retour.
— Pas encore.
— Il a voulu rester seul avec ces trois misérables, je regrette qu’il ne m’ait pas gardé près de lui.
— Il a pensé que ta présence était plus nécessaire pour nous protéger au besoin, moi et surtout madame Taureins, qui pouvait être exposée à quelques nouveaux périls, et il a eu raison.
— C’est égal, ce retard commence à m’inquiéter.
— Et moi, répliqua Vanda, je suis parfaitement tranquille, Rocambole est aussi prudent que brave, aussi rusé qu’intrépide, il a eu affaire toute sa vie à des gens autrement trempés que ces trois misérables, et tous ont trouvé en lui leur maître.
Le bruit de la grille brusquement fermée leur fit tourner les regards du côté du jardin.
— Tiens, que te disais-je ? s’écria Vanda, le voilà .
C’était Rocambole, en effet, qui traversait le jardin d’un pas précipité et qui entra bientôt dans le salon.
— Madame Taureins ? demanda-t-il à Vanda après lui avoir pressé la main.
— Toujours endormie.
— Cela commence à devenir effrayant ; mais cela s’explique néanmoins ; car, après avoir d’abord aspiré le soporifique dans un flacon de sels, elle l’a pris ensuite sous une autre forme, c’est-à -dire dans un verre d’eau, qu’elle but précipitamment dans l’espoir de combattre ainsi le sommeil qui l’envahissait et qui ne fit que le rendre plus rapide et plus accablant encore.
La porte s’ouvrit de nouveau.
Cette fois, c’était Lise, la femme de chambre de Vanda, qui l’avait laissée près de madame Taureins, avec ordre de ne pas la quitter.
— Eh bien ! lui dit Vanda, comment se fait-il que…
— Madame, interrompit Lise avec une certaine agitation, j’ai quitté cette jeune dame pour venir vous prévenir qu’elle va s’éveiller sans doute, elle se débat dans son lit, jette parfois des cris déchirants, murmure avec épouvante des paroles sans suite ; enfin, elle paraît en proie à quelque affreux cauchemar et se croit évidemment menacée de quelque grand péril.
— Retourne près d’elle, Lise, je te suis, lui dit Vanda.
Une fois Lise partie, elle se mit à réfléchir, puis elle dit à Rocambole :
— La pauvre jeune femme a sans cesse présent à l’imagination l’horrible danger auquel, en s’endormant, elle a cru succomber, et cette scène hideuse la poursuit jusque dans son rêve ; il faut qu’à son réveil elle ait sous les yeux un tableau d’un caractère tout opposé, une famille entière groupée à son chevet et veillant sur elle avec la même sollicitude que si c’était sa propre famille.
— C’est une heureuse inspiration que vous avez là , Vanda, dit Rocambole.
— Fais-je partie du tableau ? demanda Milon.
— Certainement, ta bonne tête de terre-neuve ne peut qu’y produire un excellent effet.
— Et moi ? demanda par signe la petite muette, ravie à l’idée de jouer un personnage et d’être enfin comptée pour quelque chose.
— Toi surtout, ma chérie, répondit Vanda en caressant de la main sa belle chevelure brune aux reflets un peu fauves.
Elle ajouta, en la regardant avec tendresse.
— Une enfant aux traits gracieux, souriants et sympathiques comme celle-ci, quoi de plus charmant et de plus rassurant à la fois à mettre sous les yeux de la jeune femme à son réveil !
— Montons, dit Rocambole.
Un instant après, ils étaient tous réunis dans la chambre de madame Taureins.
C’était une pièce assez vaste, tendue de perse d’un dessin charmant, plein de fleurs et d’oiseaux et dont les fenêtres, donnant sur des jardins, laissaient pénétrer largement la lumière du dehors.
Madame Taureins dormait toujours, mais ses traits, plus colorés que de coutume, exprimaient une vive agitation.
— Oh ! grâce ! grâce ! murmura-t-elle bientôt. Tenez, mes diamants… ma fortune… ma fortune… mais grâce… oh ! pitié ! pitié !
— Pauvre femme ! murmura Vanda, elle souffre comme à l’heure même où elle tombait, vaincue par le sommeil, aux pieds du misérable.
Puis, s’adressant à ceux qui l’entouraient :
— Elle ne saurait tarder à s’éveiller. Plaçons-nous autour de son lit. Tenez, vous, Rocambole, à ses pieds, Milon à la tête, moi et Lise à deux pas du lit, et Nizza tout près, de manière à ce que son premier regard rencontre trois femmes, et, avant tout, le visage candide et souriant d’une enfant.
Cette petite mise en scène terminée, on attendit.
L’attente ne fut pas longue.
Valentine se débattit un instant dans son lit, ses lèvres s’agitèrent convulsivement sans pouvoir proférer un mot, puis ses yeux s’entrouvrirent et elle promena d’abord autour d’elle un regard vague et inconscient.
Puis ce regard se fixa enfin sur le groupe que formaient Vanda, Lise, la petite muette, et ses traits contractés se détendirent peu à peu et s’épanouirent enfin sous l’influence visible d’un ravissement intérieur.
— Oh ! mais, murmura-t-elle bientôt en passant sa belle main sur son front, je rêve encore, tout ce monde m’est inconnu… cette chambre, ces meubles, je n’ai jamais vu cela… Oui, je rêve… ou je suis folle. Folle ! pourquoi ? J’ai là , au cœur, comme le sentiment d’une horrible souffrance… Où me suis-je donc endormie ?…
Tout à coup son front se contracta de nouveau, une expression d’horreur et d’épouvante bouleversa ses traits, et elle plongea sa tête dans ses deux mains en s’écriant d’une voix déchirante :
— Ah ! je me souviens, je me rappelle tout, ah ! je suis perdue, mon Dieu, je suis perdue !
À la vue de cette immense douleur, Nizza éclata tout à coup en sanglots, et, jetant ses deux bras au cou de la jeune femme, elle se mit à l’embrasser en faisant entendre de petits gémissements qui, dans sa pensée, devaient être des paroles de consolation.
Au même instant Rocambole s’approchait du lit, et saisissant la main de madame Taureins, qu’il pressa affectueusement dans les siennes :
— Rassurez-vous et relevez la tête, madame, lui dit-il, vous n’avez ni à rougir ni à vous désespérer.
Valentine se retourna brusquement et dardant sur lui un regard où se lisaient l’espoir et l’anxiété.
— Que voulez-vous dire, monsieur ? balbutia-t-elle d’une voix tremblante, oh ! parlez, parlez !
— Je veux dire, madame, que j’étais dans la chambre voisine de la pièce où se passait l’horrible scène qui vous revient en ce moment à la mémoire, et qu’à la minute même où Goëzmann, vous voyant tomber endormie à ses pieds, jetait un cri de triomphe, je me précipitai entre lui et vous, et lui coupai la figure de deux coups de cravache après vous avoir remise aux mains de Vanda, que voici et qui vous ramenait chez moi.
— Cela est bien vrai, monsieur, vous me le jurez ? s’écria Valentine avec une exaltation de bonheur qui jetait comme une auréole sur son beau front.
— Je vous le jure sur ce que j’ai de plus cher et de plus sacré, madame.
— Oh ! monsieur, monsieur, balbutia alors la jeune femme à travers les sanglots qui lui coupaient la parole, oh ! c’est à genoux et les mains jointes que je voudrais vous remercier, comme on remercie Dieu lui-même.
Et portant à ses lèvres les mains de son sauveur, elle les couvrait de larmes et de baisers.
XXII
HEUREUSE NOUVELLE
Quand elle fut un peu calmée, madame Taureins dit enfin, en jetant autour d’elle un regard tout rayonnant de calme et de sérénité :
— Ainsi, je ne rêvais pas, comme je l’ai cru en voyant autour de moi, à mon réveil, ces bonnes et gracieuses physionomies guettant avec une inquiète sollicitude mon retour à la vie, car vous avez dû croire que ce long et lourd sommeil était le dernier.
— Non, madame, ce n’est pas un rêve, répondit Vanda en venant prendre près d’elle la place de Rocambole, qui se retirait, vous êtes ici au milieu d’amis qui vous protégeront, vous feront oublier, à force de soins et d’affection, les terribles épreuves que vous venez de traverser, et parmi lesquels vous resterez aussi longtemps que vous vous y plairez.
— Oh ! mais c’est le paradis ici, murmura Valentine en promenant autour d’elle des regards ravis, j’y sens le calme, la sécurité, l’affection, tout ce qui me manque, hélas ! depuis longtemps, et déjà se dissipent, au milieu des cœurs dévoués qui m’entourent, toutes les sombres impressions qui m’enveloppaient comme un voile funèbre.
Puis, contemplant longuement le groupe des trois femmes penchées vers elle :
— Quel changement ! dit-elle avec un vague et doux sourire, ne dirait-on pas qu’une bonne fée m’a touchée de sa baguette et a tout transformé autour de moi ! Au lieu des trois monstres qui me persécutaient sans relâche et m’entraînaient dans d’effroyables abîmes, je vois à mon réveil, qui devait être si horrible, trois anges qui me sourient et me promettent un avenir de calme et de bonheur. Mais, dites-moi donc, madame, comment s’est fait cet heureux changement ?
— M. Portal, votre sauveur, a été mis au courant des infâmes projets de Goëzmann et de la honteuse complicité de votre mari par un jeune homme qui, ensuite, l’a aidé de tout son pouvoir dans l’entreprise qui vient de réussir si heureusement ; ce jeune homme porte le nom de Paul de Tréviannes.
— Ah ! fit Valentine dont les traits se couvrirent d’une vive rougeur à ce nom.
Vanda feignit de n’en rien voir.
— Dès lors, M. Portal se mit à épier toutes les démarches du digne trio, M. Taureins, Goëzmann et la marquise de Santarès, et hier soir, aux Italiens, où il était allé dans ce seul but, il acquérait la certitude que ces trois misérables allaient mettre cette nuit même à exécution l’odieux complot, dont le résultat, constaté par un magistrat, devait amener une séparation si ardemment souhaitée par la marquise.
— Oh ! s’écria Valentine en cachant son visage dans ses deux mains ; ainsi non contents de me déshonorer, ils voulaient rendre ma honte publique.
— Aussi publique et aussi éclatante que possible, c’est-à -dire par les tribunaux, et naturellement par la presse ensuite.
— Oh ! infamie ! infamie !
— Mais, avant votre sortie des Italiens, M. Portal connaissait d’avance tous les détails du guet-apens et prenait si bien ses mesures, qu’après avoir assisté, caché derrière une porte, à l’horrible scène qui devait finir par votre perte, il s’élançait sur Goëzmann au moment même où celui-ci vous croyait entièrement à sa discrétion.
— Ah ! monsieur, murmura la jeune femme avec une effusion de reconnaissance, c’est cent fois plus que la vie que je vous dois.
Puis, son front s’obscurcit tout à coup et elle s’écria avec un profond sentiment de terreur :
— Mais, j’y songe, mon mari peut me contraindre à rentrer sous son toit, la loi est pour lui, il ne manquera pas de l’invoquer, et alors je retombe dans les griffes de ces trois monstres, plus implacables que jamais et plus que jamais acharnés à ma perte.
Et elle ajouta avec l’accent du plus violent désespoir :
— Mon Dieu ! mon Dieu ! je m’étais trop pressée de croire au bonheur.
— Calmez-vous, madame, lui dit Rocambole, vous n’avez rien à redouter de votre mari : il ne peut rien contre vous.
— Est-ce possible ? demanda la jeune femme en tournant vers Rocambole ses yeux pleins d’effroi.
— Croyez-vous donc que je vous aie arrachée des mains de ces misérables sans avoir les moyens de vous soustraire pour toujours à leur haine et à leur vengeance ? Non, non, je les tiens tous les trois en mon pouvoir, pas un ne bronchera, pas un n’osera désormais tenter quoi que ce soit contre vous, et, quant à votre mari, particulièrement, non-seulement il n’usera pas de son droit de vous contraindre à réintégrer le domicile conjugal, mais, si vous le voulez, je le forcerai, moi, à consentir à une séparation demandée par vous.
— Comment ferez-vous pour le résoudre ?… Non, jamais, jamais il ne consentira.
— Vous croyez dit en souriant Rocambole.
Il ajouta aussitôt :
— Tenez, savez-vous d’où je sors, il y a une heure à peine ? De chez le notaire de M. Taureins.
— Quoi faire ? demanda Valentine avec surprise.
— M. Taureins, par suite d’une circonstance dont je crois inutile de vous entretenir aujourd’hui, avait mis en réserve dans sa caisse une somme de cinq cent mille francs, qu’il devait porter ces jours-ci à la marquise de Santarès.
— Ah ! le malheureux ! s’écria Valentine avec indignation.
— Eh bien, je l’ai décidé, en présence même de celle créature, à aller déposer cette somme chez son notaire en votre nom.
— Ils ont consenti ? demanda Valentine stupéfaite.
— Voici le reçu en bonne et due forme, rédigé par le notaire, répondit Rocambole.
Et tirant un papier de sa poche, il le remit à madame Taureins, qui le parcourut rapidement.
— C’est prodigieux ! murmura-t-elle.
— Ainsi, non-seulement votre mari renonce à jamais à faire valoir ses droits sur vous, mais il vous restitue votre dot et assure votre avenir ; ce résultat vous donne une idée du pouvoir que j’exerce sur lui et de tout ce que je puis exiger.
— J’en demeure confondue.
— Et maintenant, comme je ne tiens nullement à me faire passer pour sorcier à vos yeux, je vais vous dire à l’aide de quel talisman je dirige à mon gré la volonté de M. Taureins, de Goëzmann et même de Nanine la Rousse, marquise de Santarès, la plus redoutable des trois. Ce talisman n’est autre chose qu’une espèce de mémoire écrit par l’Allemand Goëzmann sous l’inspiration de mon revolver et dans lequel sont révélés, outre l’odieux complot dont vous avez failli être victime, tous les crimes et toutes les infamies dont les trois complices se sont rendus coupables. Il y a là de quoi les envoyer tous au bagne.
— Tous ? s’écria Valentine en frissonnant.
— Tous, même M. Taureins, pour certains méfaits que je vous ferai connaître plus tard. Ils savent cela, ils savent que d’un mot je puis les mettre sous la main de la justice, et voilà pourquoi, me sachant implacable, pas un ne bronchera. Eh bien, c’est par le même procédé que je compte décider M. Taureins à une séparation basée non sur un scandale dont vous vous seriez rendue coupable, suivant le plan qu’il avait conçu, mais sur une plainte de vous, plainte motivée par sa liaison ruineuse avec la prétendue marquise de Santarès.
— Que de reconnaissance, monsieur, si vous pouviez briser tous les liens qui m’attachent à cet homme !
— Ce sera fait, je vous le jure, et je tâcherai que votre vœu se réalise avant qu’il ne se mette dans le cas d’aller s’asseoir sur les bancs de la police correctionnelle, ce à quoi il s’exposera le jour où il déposera son bilan.
— Quoi ! il en est là ! s’écria Valentine stupéfaite.
— Voilà où on en arrive fatalement quand on lie sa destinée à celle d’une Nanine la Rousse ; les uns n’y laissent que la fortune, les autres y perdent tout ! La fortune et l’honneur et, si je ne me trompe, ce sera le cas de M. Taureins.
Le bruit d’une sonnette interrompit brusquement cet entretien.
— On sonne à la grille, dit Vanda.
Et, s’adressant à la petite muette :
— Va donc ouvrir, Nizza.
Nizza s’élança dehors, enchantée d’échapper, par cette petite distraction, à l’ennui que lui causait une conversation aussi sérieuse.
Elle rentrait, quelques instants après, dans un état d’agitation extraordinaire.
Elle était toute rouge, ses yeux étincelaient, et, dans l’excès de son émotion, elle se livra à une mimique si rapide et si confuse, que Vanda, qui d’habitude la comprenait parfaitement, l’engagea à se calmer, lui déclarant qu’elle ne savait ce qu’elle voulait dire.
Nizza alors ayant mis plus d’ordre et de méthode dans ses signes, Vanda finit par comprendre d’abord qu’elle voulait parler du cabaret de la Providence de Rascal, l’homme aux bras rouges, puis enfin de la belle dame au médaillon, dont la beauté, l’élégante toilette et les cris de douleur avaient si vivement frappé son imagination.
— Que veut-elle dire ? demanda Valentine pour laquelle ce langage était tout nouveau.
— Elle nous annonce précisément la visite d’une personne que vous connaissez beaucoup, répondit Vanda.
— Qui donc ? demanda la jeune femme avec quelque inquiétude.
— La comtesse de Sinabria.
— Ma parente et mon amie !
— Elle a quelque chose à me communiquer, dit Rocambole, je cours la recevoir et, dès que nous aurons causé de l’affaire qui l’amène, je l’introduirai près de vous, si cela vous est agréable.
— J’en serai très-heureuse.
Rocambole s’empressa de descendre au salon, où il trouva la comtesse.
Elle lui apprit que la veille au soir elle avait reçu dans sa loge la visite de sir Ralph, comme elle le prévoyait, qu’elle lui avait demandé un délai de dix jours et qu’elle l’avait difficilement obtenu, mais avec serment, de la part de celui-ci, de mettre immédiatement ses menaces à exécution si, ce dixième jour, la somme n’était là .
— Nous serons en mesure, dit Rocambole.
— De payer ?
— Non pas, mais de jouer à sir Ralph un petit tour de ma façon.
Puis il engagea la comtesse à le suivre au premier étage, où, lui dit-il, il allait la mettre en face d’une personne qu’elle ne s’attendait guère à trouver là .
XXIII
UN TALENT INCOMPRIS
Arrivé à la chambre occupée par madame Taureins, Rocambole ouvrit la porte, après avoir frappé, et laissa passer la comtesse.
— Rita !
— Valentine !
Ces deux cris partirent à la fois, et la comtesse alla se jeter dans les bras de madame Taureins.
Celle-ci alors présenta à son amie Vanda et Rocambole, c’est-à -dire M. Portal, car c’est sous ce nom qu’elle le connaissait.
— Si tu savais, chère Rita, lui dit-elle ensuite, tout ce que je leur dois et à quel péril ils m’ont arrachée ! Je te conterai cela et alors seulement tu comprendras quelle dette de reconnaissance j’ai contractée envers eux.
Vanda pensa que la présence des étrangers réunis autour d’elle empêchait seule les deux amies de se confier leurs secrets, et elle fit un signe à Rocambole qui la comprit.
— Allons, dit-elle, reprenons chacun nos occupations et laissons ces dames ensemble.
Tout le monde sortit, mais non sans que Nizza eût été embrasser la comtesse, à laquelle elle voulut expliquer par signes où elle l’avait rencontrée.
Mais elle en fut aussitôt empêchée par Vanda qui lui fit comprendre que cela pourrait raviver en elle de douloureux souvenirs.
L’enfant alla embrasser aussi Valentine, qui lui tendait les bras, puis elle sortit la dernière.
Elle courut au jardin, tandis que Rocambole, Vanda et Milon rentraient dans le petit salon du rez-de-chaussée.
— Encore une victime que vous avez arrachée des mains de ses bourreaux, dit alors Vanda à Rocambole. Pauvre jeune femme ! quelle joie ! quel ravissement ! quels élans de reconnaissance ! je me sens tout heureuse de son bonheur.
— Oui, en voilà une de sauvée, dit Rocambole ; restent maintenant la comtesse de Sinabria et la jolie Tatiane, non moins sérieusement menacées que madame Taureins.
— Quant au danger que court cette dernière, vous l’ignorez encore ? demanda Vanda.
— Oui, mais Jacques Turgis doit aller rendre aujourd’hui visite aux Mauvillars ; il fera en sorte de se trouver quelques minutes seul avec la jeune fille et lui demandera la cause de la violente émotion qu’elle a éprouvée hier en écoutant sir Ralph.
— Et c’est aujourd’hui que vous verrez ce jeune homme ?
— Il doit m’attendre à son atelier entre quatre et cinq heures.
Puis, s’adressant à Milon :
— Tu es sûr de l’adresse de ton ami ? lui demanda-t-il en appuyant sur ce dernier mot.
— Parfaitement sûr.
— Rue du Foin-Saint-Jacques…
— 5.
— Parle-t-on au concierge ?
— Il n’y en a pas.
— L’étage ?
— Le quatrième.
— À quelle époque était-il à Toulon ?
— De 1860 à 1864, époque à laquelle il obtint la remise du temps qui lui restait à faire.
— Quel numéro avait-il ?
— 150.
— Et tu dis qu’il se nomme Robert ?…
— Duval.
— De son vrai nom ?
— Oui, mais ce n’est pas celui qu’il porte maintenant.
— Naturellement.
— Il se fait appeler M. Robertson.
— Alors il se dit Anglais.
— Justement.
— Il se cache donc ?
— Avec le plus grand soin.
— Il a quelque chose sur la conscience ?
— Depuis sa rentrée dans le monde il a commis quelques petites peccadilles qui, vu ses antécédents, pourraient bien le faire renvoyer là -bas, et il en a assez.
— Toujours des faux ?
— C’est sa partie.
— Et tu dis qu’il y est très-fort ?
— Surprenant ; je vous ai cité…
— Je me rappelle, et c’est justement ce qui m’a frappé. Où vous êtes-vous rencontré ?
— Place de la Bastille.
— Le jour et l’heure ?
— Avant-hier matin, vers dix heures.
— Et tu lui as offert le vin blanc ?
— Chez le marchand de vin qui fait le coin de la rue de Charenton. Je me suis rappelé que j’avais fait une bêtise en n’abordant pas mon ancien compagnon Goëzmann, dont j’aurais pu tirer de si utiles renseignements pour l’affaire que vous venez de terminer si heureusement, et je n’ai pas voulu retomber dans la même faute.
— Et que lui as-tu dit de ta position actuelle ?
— Je l’ai faite aussi mauvaise que possible et lui ai dit que j’étais à la recherche d’une affaire, afin de me ménager un motif de lui demander son adresse et de l’aller voir en cas de besoin.
— Et tu as été bien inspiré, car ce cas se présente justement aujourd’hui. À propos, sous quel nom te connaît-il ?
— Milon.
— Tu comprends que j’ai besoin de tous ces détails, afin de lui inspirer confiance pour le cas où il m’interrogerait.
— D’autant plus que le particulier est défiant en diable.
— Alors, écris-moi ces deux lignes de recommandation pendant que je vais aller prendre un costume de circonstance :
« Je te recommande mon ami Baptistin, domestique de bonne maison ; il a une bonne affaire ; beaucoup de braise, une fois le coup fait, et il commence par éclairer.
« MILON.
« Détruire ce billet tout de suite. »
Rocambole sortit aussitôt et monta à sa chambre.
Il rentrait un quart d’heure après, en petite livrée du matin :
Veste et culotte grise ;
Guêtres de drap marron ;
Casquette écossaise de la même couleur ;
Favoris roux.
Il était complètement méconnaissable.
— C’est fait ? demanda-t-il à Milon.
— Voilà .
Rocambole prit le papier, le parcourut d’un coup d’œil, le mit dans sa poche et partit.
Il pouvait sortir ainsi sans crainte d’être reconnu des voisins.
Il prit une voiture sur le boulevard et se fit conduire rue Saint-Jacques, au coin de la rue Saint-Séverin.
La rue du Foin-Saint-Jacques est à quelques pas de là .
Il dit à son cocher de l’attendre là , et, quelques instants après, il entrait dans l’allée de la maison de la rue du Foin portant le n° 5.
Elle était longue, étroite, noire et fétide, signalement qui peut s’appliquer à peu près à toutes les allées de cette rue.
Il se mit à gravir l’escalier, très-raboteux et également mal éclairé par des jours de souffrance qui laissaient passer moins de lumière que d’exhalaisons.
Il s’arrêta au quatrième.
Il n’y avait qu’une porte sur le carré.
Il frappa discrètement et colla son oreille à la serrure.
Alors il saisit un bruit vague et presque imperceptible.
Le bruit d’un pas effleurant le carreau.
Mais la porte ne s’ouvrit pas.
Rocambole frappa de nouveau, et, tirant en même temps de sa poche le billet de Milon, il le glissa sous la porte.
Il s’écoula deux minutes encore, puis enfin cette porte s’ouvrit, mais avec lenteur et précaution.
— Entrez, lui dit la voix d’un individu qu’il distinguait vaguement à l’entrée d’un couloir obscur.
Il entra.
Celui-ci referma la porte à double tour, prit la main de Rocambole et l’entraîna dans une pièce où enfin celui-ci put le voir, cette pièce étant claire.
C’était un homme d’une cinquantaine d’années, aux traits fortement accentués, au front bas, à la chevelure rude et inculte.
— Vous connaissez Milon ? demanda-t-il à Rocambole en le scrutant d’un regard défiant.
— Nous avons été ensemble dans la peine ; je l’ai connu à Toulon ; en 65, six mois après votre départ. C’est là que j’ai entendu parler de votre talent dans les écritures, talent qui pourrait vous faire faire une bonne affaire aujourd’hui.
— De quoi s’agit-il ? demanda M. Robertson, en étudiant toujours la physionomie du prétendu Baptistin.
— Voilà ce que c’est ; mon maître a besoin d’opérer une petite modification à certain acte d’une grande importance ; or, Milon m’a affirmé que, par je ne sais quels procédés chimiques, vous pouviez rendre entièrement nette et blanche une page couverte d’écriture et écrire ensuite sur cette même page tout ce qu’on voudra vous dicter, en imitant même, avec une entière perfection, les caractères que vous auriez détruits.
— Milon a dit vrai.
— Et bien, c’est là ce que je viens vous demander.
— Combien veut-on payer pour ça ?
— Mille francs.
— Mais qui me garantit ?
— Tenez, voici trois lignes écrites sur une feuille, faites-moi ce travail à titre d’essai, et voilà cent francs.
— Volontiers.
M. Robertson commença par empocher le billet de banque, puis il s’approcha d’une table, déboucha un flacon et répandit sur les caractères qui couvraient le haut de la feuille, un liquide limpide comme de l’eau pure, qu’il étendit avec le doigt sur toute la partie écrite.
Deux minutes après il montrait la feuille à Baptistin, qui demeura stupéfait.
L’écriture avait entièrement disparu.
— Passez le papier contre la vitre, dit M. Robertson.
Rocambole obéit et, dans la transparence du papier, il n’aperçut pas la moindre trace d’écriture.
— C’est admirable, dit-il.

Il ajouta :
— Reste maintenant la seconde partie de l’expérience, qui consiste à couvrir d’une autre écriture la place que vous venez de rendre nette.
M. Robertson prit la feuille et écrivit trois lignes à la place même où étaient celles qu’il venait de détruire. Les caractères étaient d’une netteté parfaite.
— C’est merveilleux, dit Rocambole, je puis maintenant garantir le succès à mon maître, et dans quelques jours je viendrai vous prendre.
Il quitta M. Robertson et alla rejoindre sa voiture qui l’attendait au coin de la rue Saint-Séverin.
— Rue du Bac, au coin de la rue de Varennes, dit-il au cocher.
XXIV
LE MAÎTRE ET L’ÉLÈVE
Il y avait alors, rue de Varennes, près de la rue du Bac, un café de très-modeste apparence, mais très-achalandé et dont la clientèle se composait presque exclusivement de l’aristocratie de la domesticité.
C’était là que les maîtres d’hôtel, les sommeliers, les chefs de cuisine, les cochers, les valets de pied de tous les grands hôtels des environs venaient se renseigner mutuellement sur la valeur morale et intrinsèque de leurs maîtres respectifs.
Et nous devons convenir qu’après de longues discussions sur ce sujet, toujours inépuisable, tous finissaient par déclarer en chœur, et d’un commun accord, que leur maison était une baraque.
L’un des familiers de ce café, qui avait pour enseigne : Au Rendez-vous des Amis, était François, le cocher du comte de Sinabria.
Il y allait le matin pour tuer le ver, à cinq heures pour prendre l’absinthe, le soir pour bêcher ses maîtres.
Il y était, ce matin-là , vers onze heures, au moment où Baptistin, c’est-à -dire Rocambole, entrait dans l’établissement.
Nous savons que Rocambole était allé voir plusieurs fois la comtesse à son hôtel, qu’il y avait aperçu le cocher et avait même fait part à celle-ci du peu de confiance que lui inspirait ce personnage.
Il alla droit à lui, et, en l’abordant, il eut soin de compléter sa transformation par un accent méridional qui achevait de le rendre méconnaissable.
Aussi François n’eut-il pas un moment la pensée de soupçonner en lui le personnage qu’il avait vu venir deux ou trois fois à l’hôtel.
— Monsieur François, n’est-ce pas ? lui dit Rocambole en le saluant.
— Moi-même, répondit François en examinant d’un coup d’œil la livrée de son confrère.
— Monsieur François veut-il me faire l’honneur d’accepter un madère ?
— À la condition de rendre la réciproque, riposta François qui se flattait de posséder les grandes manières du noble faubourg.
— C’est convenu, dit Baptistin en allant s’asseoir dans un coin du café, très-peu fréquenté en ce moment.
Le garçon était accouru demander ce qu’il fallait servir à ces messieurs.
— Deux madères, et vivement, avait répondu François.
Quand ils furent servis, Baptistin se pencha vers le cocher, et baissant la voix :
— Ah çà ! lui dit-il, c’est pas tout ça, c’est de la part de Rascal que je viens vous trouver.
— Bah ! dit François en se mettant au diapason de son confrère, et pourquoi n’est-il pas venu lui-même ?
— On a fait des potins sur son compte, et il croit avoir vu un des roussins rôder autour de lui depuis quelques jours. Au reste, nous sommes les deux doigts de la main, et je connais l’affaire de la comtesse comme lui-même.
— Ah ! fit le cocher, dans l’intention évidente de sonder son homme, il vous a dit dans quel lieu de plaisance elle était allée passer deux jours ?
— Et ce qu’elle était allée y faire ; je connais l’histoire du petit ; quant à ce pauvre Rascal, il ne se console pas d’avoir perdu son cabaret de la Providence, où il ne peut remettre les pieds depuis le meurtre de l’agent.
— Allons, je vois que vous êtes au courant, dit François en trinquant, à présent nous pouvons causer à cœur ouvert.
— C’est comme si vous parliez à Rascal.
— Eh bien, voyons, de quoi s’agit-il ?
— Voilà ; il faut vous dire d’abord que Rascal est un malin.
— Il y a longtemps que je m’en suis aperçu.
— Voilà le raisonnement qu’il s’est fait : sir Ralph et Mac-Field sont deux étrangers, deux intrigants, deux aventuriers qui n’ont ni feu, ni lieu, quoiqu’ils fassent de l’esbroufe, et un beau jour, quand ils auront fait leur beurre en nous mettant en avant, ils s’évanouiront comme une fumée, et c’est nous qui payerons la casse.
— Ce raisonnement-là n’est pas d’un imbécile.
— Ce n’est pas tout, d’après bien des petites observations qu’il a faites par-ci, par-là , sans avoir l’air, il est arrivé à penser que derrière ces deux chevaliers d’industrie devait se cacher quelque personnage d’importance, le véritable auteur de la fameuse combinaison où s’est laissée prendre la comtesse.
— Rascal a le nez creux, prononça sentencieusement le cocher.
— Or, s’est-il dit, si nous connaissions ce personnage, qui doit avoir le sac, pignon sur rue et peut-être une haute situation, bref ce qu’on appelle dans le monde une surface, il y aurait un coup de maître à faire en lâchant nos deux oiseaux de passage pour aller trouver directement ce paroissien, qui, devant la menace d’une dénonciation, n’hésiterait pas à cracher au bassinet.
— Tiens ! tiens ! tiens ! murmura François en prenant son menton dans sa main, ce qui l’aidait sans doute à réfléchir, mais c’est que c’est une idée, ça !
Il ajouta en se touchant le front :
— Je dirai même que c’est une idée majeure.
— Oui, mais, reprit Baptistin, comment découvrir ce personnage ? Ce doit être un malin, et il ne sera pas facile de…
— Il y a plus malin que lui, dit François en se caressant le menton avec fatuité.
— Ah bah ! est-ce que vous soupçonneriez ?…
— Mieux que ça.
— Vous le connaissez ?
— Un peu, mon neveu.
— Quel est-il ?
François se pencha tout à fait au-dessus de la table et, parlant à l’oreille de Rocambole, qui l’écoutait avec une attention anxieuse :
— Le propre parent de madame la comtesse.
— Pas possible ?
— Comme je vous le dis.
— Et vous le nommez.
— M. Badoir.
— Vous m’étonnez ! s’écria Rocambole frappé de stupeur.
— Pourquoi ça ? Vous le connaissez donc ?
— Nullement, mais j’ai entendu parler de lui.
— Et on vous l’a dépeint comme un saint, comme un modèle de probité ?
— Justement.
— Oh ! là ! là !
— Il paraît qu’on se trompe sur son compte ?
— C’est lui qui a imaginé tout le plan.
— Comment avez-vous su cela ?
— C’est moi qu’il a choisi pour complice et qui lui ai donné tous les renseignements dont il avait besoin.
— Je comprends, il lui fallait un espion dans la place.
— Et c’est sur moi qu’il a jeté les yeux.
— Il ne pouvait faire un meilleur choix ; vous avez l’œil américain, vous, sans vous flatter.
— Dame ! dit le cocher en se dandinant légèrement, on ne passe pas pour un imbécile.
Il reprit après avoir ingurgité son verre de madère :
— Au reste, il y avait une raison majeure pour qu’il me donnât la préférence sur tout autre.
— Ah !
— Nous nous connaissions de vieille date.
— En vérité.
— Et je lui avais déjà rendu un petit service dans une circonstance… assez délicate.
— Dans le genre de celle-ci ?
— À peu près.
— Oh ! mais contez-moi donc ça, monsieur François ?
— C’est une affaire de la plus haute gravité, répondit François, et je ne sais si je dois…
— C’est pour m’instruire que je vous demande ça, pas pour autre chose. Tenez, Rascal me le disait encore ce matin en m’envoyant vous faire part de son petit projet : Si tu veux faire ton éducation et devenir un malin, écoute causer François et profite de ses leçons, c’est le roi des roublards.
Le cocher savoura cette louange avec un sourire dans lequel on eût vainement cherché la moindre trace de modestie.
— Aussi, ajouta Baptistin en jetant sur son confrère un regard plein d’une respectueuse admiration, si je vous prie de me raconter cette histoire, ce n’est pas qu’elle m’intéresse le moins du monde en elle-même, mais c’est pour y puiser une leçon ; car, du moment que vous y avez joué un rôle, vous avez dû y déployer des prodiges de finesse et d’habileté, et il est certain que je ne trouverai jamais une si belle occasion de m’instruire.
— Je ne dis pas, je ne dis pas, répliqua François en se caressant toujours le menton, mais, je le répète, mon garçon, c’est bien grave ; et puis, j’ai promis le secret.
— Bah ! dit Rocambole sans se choquer de la familiarité avec laquelle le traitait son maître, avec un novice comme moi, il n’y a pas de danger.
— Ça, c’est vrai, riposta François avec le naïf sentiment de sa supériorité.
— Allons, c’est décidé, s’écria Rocambole en se frottant les mains.
Et, dans l’élan de sa joie, il s’écria :
— Garçon, deux madères !
— C’est moi qui paye, dit François en mettant la main à sa poche avec un empressement un peu exagéré.
— Monsieur François, voulez-vous me faire du chagrin ? demanda Rocambole en prenant un air désolé.
— J’en serais au désespoir, mon garçon.
— Alors, pour la première fois que j’ai celui de me trouver en votre estimable société, laissez-moi l’honneur de payer toute la consommation.
— C’est pour t’obliger, mon garçon, répondit François, obtempérant sans peine à cette prière ; au reste, nous sommes gens de revue. Et maintenant, je vais te conter l’histoire en question.
XXV
UN PARADIS TERRESTRE
François commença son récit.
— Il y a une dizaine d’années, je venais de sortir de prison, où j’avais passé deux ans par suite d’une de ces erreurs que la justice commet si souvent à l’égard des pauvres diables comme toi et moi, lorsqu’un jour je vois entrer un monsieur à l’air très-respectable dans le misérable garni où je logeais à raison de dix francs par mois.
Il faisait partie d’une société de bienfaisance instituée dans le but de venir en aide aux malheureux libérés qui, au sortir de la prison, se trouvent dénués de tout, et conséquemment exposés à de nouvelles tentations.
Il causa longuement avec moi et me quitta en me laissant vingt francs, avec promesse de me chercher un emploi et de revenir bientôt me voir.
Il revenait au bout de huit jours, en effet, et m’annonçait avec douleur qu’il n’avait rien trouvé.
— Mais, ajouta-t-il, en attendant une place, qui ne saurait tarder à se présenter, j’ai en ce moment une occasion de vous faire gagner une assez bonne somme.
Je le priai de s’expliquer, et voici ce qu’il me proposa :
— Voyez-vous, mon ami, me dit-il, notre mission ne se borne pas seulement à secourir les infortunés, que la justice rend à la société sans pouvoir leur procurer les moyens d’y vivre et d’y rester honnêtes ; non, elle est plus haute et plus étendue ; voulant prévenir le mal en l’attaquant dans sa racine, elle s’attache surtout à l’enfant, étudie avec soin sa famille, son entourage, et fait tous ses efforts pour l’arracher aux milieux viciés au soin desquels ses heureux instincts pourraient se dénaturer.
J’avoue que je me sentis pénétré d’admiration pour ce nouveau saint Vincent de Paul.
— Voulez-vous m’aider dans cette tâche ? reprit-il après avoir étudié sur mon visage l’effet de ses paroles.
— Comment, si je le veux ! m’écriai-je, mais j’en serai très-honoré, monsieur Badoir, car il m’avait dit son nom.
— Fort bien, je vous en ai dit assez pour que vous compreniez le but que nous nous proposons et que nous voulons atteindre par tous les moyens possibles, maintenant vous saurez à quoi vous en tenir le jour où vous vous mettrez à l’œuvre.
— Quand il vous plaira, monsieur Badoir.
— Tenez-vous donc prêt, ce sera dans quelques jours.
Il revenait au bout de trois ou quatre jours.
— C’est aujourd’hui, me dit-il, une voiture nous attend, venez.
Nous partons, et une heure après nous arrivions à Fontenay-aux-Roses.
Je l’avais vainement interrogé sur ce que j’allais avoir à faire.
Il m’avait répondu : Je vous dirai cela plus tard.
À Fontenay, nous déjeunons, puis il laisse la voiture à l’auberge et m’emmène à l’extrémité du village, dans un endroit où s’élevaient de charmantes maisons de campagne.
Il en était une surtout qui était littéralement couverte de roses.
Non-seulement les branches enlaçaient toute la façade, dont les murs disparaissaient complètement sous les fleurs, mais elles s’élançaient jusque sur le toit, d’où elles retombaient ensuite à quelques pieds du sol.
Le jardin qui précédait cette charmante demeure était également criblé de fleurs.
On en voyait partout et on ne voyait pour ainsi dire que cela.
Nous regardions cette espèce de petit paradis terrestre à travers une haie très-épaisse, où une trouée semblait avoir été pratiquée dans le feuillage pour servir d’observatoire.
— Tenez, me dit tout à coup M. Badoir, regardez du côté de la maison.
C’est ce que je fis.
La maison était séparée du jardin par un perron de quatre marches, dont les rampes de pierre étaient devenues absolument invisibles sous le débordement de capucines et de volubilis qui les inondaient.
Je vis paraître au haut de ce perron une jeune femme et un enfant.
L’enfant était une petite fille de quatre ans environ, au teint éclatant de fraîcheur, aux yeux noirs et aux cheveux châtains qui s’ébouriffaient autour de son front.
La jeune femme, vêtue d’une élégante toilette du matin, était une jolie blonde à la taille fine et souple, à la démarche gracieusement nonchalante et aux yeux d’un bleu foncé.
Elle tenait par la main son enfant, qui eût voulu franchir d’un bond les quatre marches et qui, maintenue par sa mère, se voyait forcée de les descendre une à une, à son grand déplaisir.
Mais, dès qu’elle eut touché le sol, elle lâcha la main de sa mère et s’élança à travers le jardin en poussant des cris de joie.
La jeune mère la suivait du regard avec un vague sourire, et rien ne saurait donner une idée du mélange de bonheur et d’attendrissement qui se lisait au fond de ses beaux yeux bleus.
Ces deux êtres, la mère et l’enfant, semblaient ne faire qu’un avec les fleurs qui les enveloppaient de toutes parts et dont elles égalaient la grâce et la fraîcheur.
C’était le plus charmant tableau qu’on pût imaginer.
— Vous voyez cette jeune femme, me dit M. Badoir qui, au lieu de s’épanouir comme moi, fronçait le sourcil avec une expression de dureté que je ne lui avais jamais vue.
— Oui, je la vois, répondis-je, et je la trouve belle comme une fée.
— Au physique, oui, j’avoue qu’elle a quelque charme.
— Peste ! vous êtes difficile ; ah ! çà , vous avez donc passé votre vie au milieu des houris de Mahomet ? Quelque charme ! excusez.
— C’est que moi, répliqua M. Badoir d’un ton sévère, je vois sa beauté à travers les souillures de son âme.
— Elle ! des souillures ! pas possible !
— Apprenez donc que cette femme n’est pas mariée.
— J’en suis fâché pour elle ; mais, franchement, ça ne me la change pas, je la trouve toujours très-belle.
— Belle ou laide, peu importe, c’est une femme perdue, et mon devoir, comme membre de la société moralisatrice dont je vous ai parlé, me force à prendre vis-à -vis d’elle une mesure sévère.
— Que voulez-vous donc lui faire, à la pauvre créature ?
— Son exemple serait inévitablement fatal à cette enfant.
— Vous croyez ?
— C’est certain, et je manquerais à la mission que j’ai acceptée, au serment solennel que j’ai prêté en entrant dans notre société, si je laissais cette enfant se gangrener au contact impur d’une pareille mère.
— Quelle est donc votre intention ? m’écriai-je avec une vague inquiétude.
— Il faut les séparer.
— Ah ! pauvre femme !… pauvre enfant ! Rien que d’y penser, ça me serre le cœur.
— Et moi, ça me laisse très-indifférent, je ne me sens aucune pitié pour les âmes corrompues.
— Enfin, quelle est votre intention ?
— Enlever cette enfant à sa mère, près de laquelle elle serait perdue un jour.
Enlever cette enfant ! à cette pensée, il me passa un frisson dans le dos.
Je les regardais toutes deux au milieu de cet abîme de fleurs tout emperlées de rosée, dont les gouttes scintillaient au soleil comme des diamants ; au sein de ce grand silence qui enveloppait cette gracieuse demeure et ajoutait encore à l’impression toute printanière qui s’en dégageait de toutes parts, et, pour la première fois de ma vie, je sentais s’éveiller en moi toutes sortes de douces émotions que je n’avais jamais ressenties et qui, je l’avoue, ne me sont jamais revenues depuis.
— Pristi ! dis-je à M. Badoir, savez-vous que ça me fait frémir, ce que vous me proposez là ? Cette pauvre jeune femme, voyez donc comme ses beaux yeux bleus couvent son enfant ! voyez comme la chère petite se retourne sans cesse pour la regarder et lui sourire ! Comme on sent bien que ces deux charmantes créatures ne vivent que l’une par l’autre, que le monde est tout entier pour elles dans ce paradis en fleurs.
— Elle n’est pas mariée et le devoir me commande d’arracher l’enfant au contact de cette impure.
Je lui jetai un regard de travers. Il venait de me prendre une violente tentation de m’élancer sur lui et de l’étrangler.
— Pas mariée ! pas mariée ! répliquai-je, elle a l’air si chaste et si honnête ! Il y a peut-être des circonstances atténuantes.
— Je n’en admets aucune, pas de concession avec le vice.
En ce moment la jeune mère, qui était venue s’asseoir sur un banc à quelques pas de nous, appela son enfant qui courait après un papillon.
— Jeanne ! cria-t-elle.
L’enfant accourut et vint se jeter dans ses bras.
Elle était rouge comme un coquelicot et son front était inondé de sueur.
— Te voilà déjà tout en nage, lui dit sa mère en la regardant avec une tendresse inquiète, j’en étais sûre. Je te recommande toujours de ne pas tant courir, mais tu ne te plais qu’à faire de la peine à ta petite mère.
— Ne gronde pas, maman, je ne le ferai plus, dit l’enfant en lui baisant les mains.

![]()
La jeune femme tira de sa poche un mouchoir de batiste et se mit à lui éponger délicatement le visage.
L’enfant toussa légèrement.
— Tiens ! voilà que tu tousses, mon Dieu ! mon Dieu ! lui dit sa mère toute troublée.
Elle mit de nouveau la main à sa poche, en tira une bonbonnière et y prit une boule de gomme qu’elle mit dans la bouche de l’enfant.
Puis, dans une autre poche, elle prit un petit foulard blanc qu’elle lui noua autour du cou en lui disant :
— Allons, va jouer, mais ne cours plus si fort.
La petite Jeanne s’élança à travers le jardin.
La recommandation était déjà oubliée.
Et, nous, nous guettions l’occasion d’enlever cette enfant à cette mère.
XXVI
L’ENLÈVEMENT
François poursuivit ainsi son récit :
— Une heure s’écoula, pendant laquelle la jeune mère, le regard incessamment fixé sur son enfant, laissait fréquemment percer l’inquiétude que lui causaient son extrême turbulence et son ardeur effrénée au jeu.
— Jeanne, ne saute pas sur ce banc, tu me fais frémir.
— Jeanne, repose-toi un peu.
— Jeanne, ne reste pas exposée au soleil.
Telles étaient les recommandations qu’elle lui faisait entendre à chaque instant.
Et, toujours en éveil, toujours tremblante et anxieuse, elle tressaillait et faisait un mouvement pour s’élancer vers l’enfant, au plus léger cri, au moindre faux pas de celle-ci.
— Oh ! le petit démon ! murmura-t-elle enfin, impossible d’en venir à bout ; il lui faut pourtant un peu de calme, ou elle se rendrait malade.
— Jeanne ! lui cria-t-elle.
— Maman ? répondit celle-ci sans bouger.
— Viens ici.
— Pourquoi faire ?
— Viens toujours.
Et l’enfant accourut en rejetant à droite et à gauche son abondante chevelure, qui tombait sur ses yeux.
— Qu’est-ce que tu me veux, maman ? dit-elle quand elle fut près de sa mère.
— D’abord essuyer ton front et ton visage, encore une fois couverts de sueur.
Quand elle lui eut encore tamponné le cou et la figure avec son mouchoir de batiste, elle lui dit :
— As-tu fait ta prière ce matin ?
— J’ai oublié, s’écria Jeanne interdite.
— C’est très-mal, ça, mademoiselle.
— Oh ! mais, ce soir…
— Non, il faut la faire tout de suite ; vois donc, ce sera gentil au milieu de toutes ces fleurs, sous ce beau ciel bleu et agenouillée devant ta petite mère.
— Ce sera très-gentil ! s’écria l’enfant toute joyeuse, et sans soupçonner que ce n’était là qu’une innocente ruse de sa mère pour la forcer au repos.
— Tiens, agenouille-toi sur ce petit banc de bois ; joins tes petites mains, appuie-toi sur moi et commence.
Jeanne obéit et se mit à réciter sa prière à haute voix :
« Mon Dieu, je vous prie de veiller sur papa, qui est bien loin, bien loin. »
Elle s’interrompit tout à coup et, levant ses beaux yeux sur ceux de sa mère :
— Dis donc, maman, pourquoi est-il si loin, papa ?
— Pour travailler, mon enfant, pour gagner de l’argent et t’acheter de belles robes, répondit la mère avec un soupir étouffé.
Jeanne reprit :
« Mon Dieu, faites que papa réussisse dans son entreprise. »
Nouvelle interruption.
— Maman, qu’est-ce que c’est qu’une entreprise ?
— Tu es trop petite pour comprendre cela, continue.
« Mon Dieu, veillez aussi sur ma petite mère. »
Interruption.
— Maman, si je lui disais comment tu t’appelles, au bon Dieu, pour qu’il ne veille pas sur une autre ?
— C’est inutile, mon enfant, Dieu ne se trompe jamais.
— C’est égal, je vais le lui dire tout de même.
Reprenant sa prière :
« Veillez sur ma petite mère, elle s’appelle Louise Prévôt. Prenez mon cœur, et faites, ô mon Dieu !… »
Tout à coup elle tourna vivement la tête en s’écriant :
— Maman, le voilà , je le reconnais.
— Quoi donc ? demanda la jeune mère stupéfaite.
— Mon papillon, je t’assure que c’est lui. Je le reconnais bien, il est tout jaune.
— Allons, dit Louise en souriant, je vois bien qu’il faut renoncer à te faire faire ta prière aujourd’hui. Assieds-toi sur ton petit banc et je vais te dire un conte.
— C’est cela, s’écria l’enfant enchantée d’en finir avec la prière.
Elle était assise avant que sa mère n’eût achevé sa phrase.
— Voyons, quel conte veux-tu ?
— Le Chat botté, non ; Peau d’âne ou bien Cendrillon ou bien encore la Belle au bois dormant.
Puis ne pouvant décidément se résoudre à faire un choix entre tous ces jolis contes qu’elle avait entendus cent fois et qui la ravissaient tous également, elle ajouta en se tournant vers sa mère :
— Qu’est-ce que tu aimes le mieux, toi, maman ?
— C’est le Chat botté.
— Eh bien, c’est ça, conte-moi le Chat botté.
Souvent interrompu par les exclamations, les réflexions, les étonnements, et les éclats de rire de l’enfant, le Chat botté dura longtemps.
Alors Jeanne demanda Cendrillon.
Et la jeune femme, avec cette patience et cette abnégation admirables dont une mère seule est capable, se mit à raconter la merveilleuse épopée de Cendrillon.
Puis Peau d’Âne.
Puis encore la Belle au bois dormant, qui finissait au moment où le soleil déclinait à l’horizon.
— Allons, ma petite Jeanne, dit alors la jeune mère en se levant, la nuit va bientôt venir, tu pourrais te refroidir, rentrons.
Jeanne se leva, prit la main de sa mère et, cinq minutes après, toutes deux étaient rentrées dans la maison.
Quant à moi, j’étais resté comme ébloui et en même temps tout attendri de ce que je venais de voir et d’entendre.
Je n’avais jamais rien soupçonné de pareil et l’impression que je ressentis ce jour-là resta longtemps gravée dans mon esprit.
Et encore longtemps après j’ai vu passer dans mon imagination tous les détails de cette scène, cette charmante jeune mère et cette ravissante enfant, pour ainsi dire enfouies dans ce chaos de fleurs, dont elles semblaient faire partie ; la petite Jeanne, agenouillée devant sa mère et récitant sa prière, si fréquemment et si gentiment interrompue par ses questions et ses réflexions enfantines et la tendre sollicitude de la jeune femme pour son enfant, oui, tout cela m’est revenu souvent à l’esprit comme un rêve qu’on aime à se rappeler.
Quand elles eurent disparu, je me retournai vers M. Badoir :
— C’est là ce que vous appelez une impure ? lui dis-je.
— Ah ! répliqua-t-il avec un sourire dédaigneux, j’étais sûr que vous la trouveriez parfaite ; les hommes se laissent toujours séduire par l’enveloppe ; mais moi, je vous le répète, je vois au delà , et dans celle qui vous paraît un ange, je découvre un monstre. Bref, l’enfant est en péril sous la direction d’une telle mère ; j’ai pour mission de la sauver et je n’y faillirai pas.
— Et vous voulez l’enlever ?
— Ce soir même.
— Eh bien, moi je ne m’en sens pas la force.
Il me jeta un regard irrité.
— C’est bien, me dit-il, je m’adresserai à un autre ; il ne manque pas de malheureux dans le même cas que vous qui saisiront avec empressement l’occasion de gagner la somme de cinq cents francs que je voulais vous offrir, et de plus une bonne place de cocher ou de valet dans quelque maison du faubourg Saint-Germain.
Cocher dans une grande maison ! mon rêve ! Ça ou la misère, les privations, la faim ! je fus ébranlé ; puis réfléchissant que mon refus n’empêcherait rien, je consentis enfin.
— Mais, dis je à M. Badoir, vous m’affirmez que c’est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle sera heureuse au moins ?
— Parfaitement heureuse.
— Alors ça va, dites-moi ce qu’il faut faire.
— Écoutez-moi bien : on couche l’enfant à huit heures, de sorte qu’à dix heures, vous le comprenez, un coup de canon ne l’éveillerait pas.
— Je comprends ça, après ?
— La chambre où elle couche, qui est celle de sa mère, donne sur ce chemin, où il ne passe plus une âme à partir de neuf heures et demie, et la jeune femme travaille dans un petit salon du rez-de-chaussée avec sa femme de chambre jusqu’à onze heures.
— De sorte que la petite se trouve absolument seule et profondément endormie de dix à onze heures ?
— C’est cela.
— Je saisis parfaitement votre idée, mais comment pénétrer dans cette chambre ?
— Tout est préparé pour vous en faciliter les moyens.
— Ah ! bah !
— Il faut vous dire que cette jeune femme je la connais, je suis reçu chez elle.
— Pas possible !
— Je l’ai vue hier soir, j’ai voulu voir l’enfant dans son berceau, et en m’appuyant contre la fenêtre, j’ai faussé le petit ressort à l’aide duquel on la ferme ; si bien que ce soir il n’y aura qu’à pousser.
— Et une échelle ?
— Inutile, le jardin est en contrebas de la ruelle, de sorte que la chambre, au premier étage, de ce côté, n’est qu’un peu au-dessus du rez-de-chaussée du côté de la ruelle.
Bref, nous retournâmes dîner dans le pays, puis, le soir venu, nous attendîmes dix heures.
À dix heures précises, pendant que M. Badoir faisait le guet, je pénétrais dans la chambre où dormait l’enfant, n’ayant eu en effet qu’à pousser la fenêtre, qu’on n’avait pu fermer.
Pauvre petite ! À la lueur d’une veilleuse qui brûlait à quelques pas d’elle, je la regardai dormir dans son petit lit tout blanc, ayant à portée de sa main, pour la trouver au réveil, une belle poupée aux cheveux blonds.
Je la trouvai plus belle encore dans son sommeil que riant et courant au milieu des fleurs et un moment le courage me manqua. Oh ! si j’avais pu soupçonner ce qui allait lui arriver, je n’aurais pas consenti pour une fortune à … c’est si horrible que ça me revient encore dans mes rêves ! mais… mais je ne savais pas. Je m’approchai, je la pris dans mes bras, j’arrachai du lit sa couverture dans laquelle je l’enveloppai, puis, revenant à la fenêtre, je la passai à M. Badoir qui attendait là .
Quand je me retrouvai près de lui dans la ruelle :
— Partons vite, me dit-il.
Et nous nous éloignâmes à grands pas.
Et la pauvre petite dormait dans ses bras avec autant de calme et de sécurité que dans son petit lit blanc.
XXVII
LE PARADIS PERDU
— M. Badoir, poursuivit François, avait sans doute réfléchi que cet enlèvement allait amener l’intervention de la police, que le cocher de sa voiture qui nous avait amenés pouvait devenir un témoin dangereux, et que, conséquemment, il était imprudent de se servir de cette voiture pour une pareille expédition, aussi l’avait-il congédié à l’heure du dîner en déclarant qu’au lieu de retourner à Paris, nous avions résolu d’aller faire une promenade à Châtillon.
Nous parcourions donc à pied le chemin qu’avait pris M. Badoir.
Ce chemin nous ramenait vers Paris.
Le ciel était chargé de nuages, la nuit était noire, nous ne voyions pas à dix pas devant nous.
Au bout d’un quart d’heure d’une marche rapide, pendant laquelle nous n’avions pas échangé une parole, M. Badoir s’arrêta, et, se tournant vers moi :
— Je suis brisé, me dit-il d’une voix haletante ; chargez-vous donc de l’enfant à votre tour.
Il la mit dans mes bras.
La pauvre petite était toute découverte.
Entièrement absorbé par le mobile qui le faisait agir, il avait laissé traîner la moitié de la couverture, qui n’enveloppait plus que les épaules, de telle sorte qu’elle n’avait plus pour se garantir de la fraîcheur que sa grande chemise de nuit, qui lui donnait l’air d’un petit fantôme.
Je l’enveloppai avec soin dans la couverture et nous reprîmes notre marche, M. Badoir allant devant et m’excitant toujours à accélérer le pas.
L’enfant dormait toujours de son sommeil doux et paisible, rêvant de sa poupée peut-être ou de sa mère !
Nous avions dépassé depuis quelque temps les fortifications et nous approchions de l’église de Montrouge, quand tout à coup j’éprouvai une commotion si violente que je fus obligé de m’arrêter.
Onze heures sonnaient à l’horloge de cette église.
Onze heures !… l’heure à laquelle la pauvre jeune femme entrait dans sa chambre, ouvrant la porte avec précaution, marchant sur la pointe des pieds pour ne pas éveiller son enfant, s’avançant le sourire aux lèvres pour la voir dormir et trouvant le petit lit vide, la fenêtre ouverte !…
À cette pensée, à l’horrible tableau qui s’offrit tout à coup à mon imagination, j’eus comme un étourdissement et je sentis mes jambes flageoler sous moi.
Je n’eus que le temps d’appeler M. Badoir et de lui mettre l’enfant dans les bras.
Elle m’échappait des mains.
— Eh bien, qu’avez-vous donc ? me dit-il, vous voilà tout tremblant.
Il n’avait pas fait attention à l’heure, lui, et ne soupçonnait même pas ce qui se passait en moi.
— Ce n’est rien, lui dis-je, une faiblesse, ça va se passer.
Je m’étais appuyé contre un mur, où je restai cinq minutes avant de me remettre, au grand ennui de M. Badoir, qui me répétait sans cesse avec angoisse :
— Voyons, un effort ; songez donc qu’aussitôt l’enlèvement découvert on va se mettre à nos trousses dans toutes les directions, celle de Paris surtout, et nous sommes sur le chemin. Allons, un peu de courage.
Je pus me remettre en marche, enfin et, au bout de dix minutes, je reprenais l’enfant dans mes bras.
Arrivé aux Quatre-Chemins, M. Badoir avait enfilé la chaussée du Maine.
Parvenu aux environs du champ d’Asile, il tourna brusquement à gauche.
C’était la rue de Vanves.
Nous la parcourûmes dans toute sa longueur.
Cette rue est boueuse et mal pavée ; quand j’atteignis son extrémité, je tombais de fatigue.
Parvenu à ce point, M. Badoir tourna à gauche et se dirigea, par un sentier dans lequel j’enfonçais jusqu’à la cheville, vers une maison basse où brillait vaguement une lumière.
Cela commença à m’étonner et à me donner à réfléchir.
J’avais toujours pensé, vu la mission moralisatrice en vue de laquelle M. Badoir prétendait agir, que nous conduisions l’enfant dans quelque couvent de femmes, où elle allait être entourée de soins.
— Ah çà , lui demandai-je, où diable allons-nous donc ? Ça pue le vice et la misère ici.
— Rassurez-vous, me dit-il, je sais ce que je fais ; quant à présent, il s’agit surtout de cacher l’enfant.
Il frappait en même temps à la porte de la maison dont l’aspect m’avait paru si équivoque.
La porte s’ouvrit et je fus à la fois atterré et écœuré par le tableau qui s’offrit à ma vue.
C’était une vaste pièce dont le sol n’était même pas carrelé, dont tout l’ameublement se composait de trois ou quatre escabeaux et d’une table de bois blanc, toute maculée de taches de vin bleu, et où couvait, au fond d’une grande cheminée sans chenets, un feu de poussier de mottes dont les exhalaisons vous prenaient à la gorge.
Autour de la table étaient assis un homme et une femme en train de boire de l’eau-de-vie.
La femme avait les traits si fortement accentués, l’air si dur et quelque chose de si bestial dans l’expression de la physionomie, qu’on se demandait d’abord si ce n’était pas un homme, et les étranges haillons dont elle était couverte ne faisaient que confirmer ce doute.
— Enfin ! dit-elle d’une voix rauque et bourrue, c’est pas malheureux, voilà une heure que nous attendons.
— En buvant, dit M. Badoir avec un sourire de complaisance.
— Un malheureux litre ! faut bien se distraire.
La malheureuse était ivre.
— Voilà l’enfant, dit M. Badoir en enlevant la petite Jeanne de mes bras.
— Et vous dites qu’il faut la dissimuler ?
— À tout prix, madame Claude.
Celle-ci se tourna vers son mari :
— Dis donc, ton ami le saltimbanque qui part demain pour Chartres, qu’est-ce que tu dis de ça ?
— Fameuse occase ! Il a la main un peu lourde, mais il n’a pas son égal pour former les enfants ; disloquer sans casser, voilà sa devise.
J’étais ahuri.
Je voyais clair enfin dans le jeu de M. Badoir et comprenais trop tard que sa prétendue mission moralisatrice consistait à faire disparaître une enfant dont l’existence était préjudiciable à ses intérêts, à moins qu’il ne fallût attribuer cet acte de barbarie à quelque sentiment de vengeance ou de jalousie.
— C’est entendu, dit madame Claude, elle partira demain matin avec Jacques, la Terreur des Alcides, ça lui fera une carrière, à cette enfant.
Elle reprit aussitôt en fronçant le sourcil :
— Oui, mais pourvu qu’elle ne jabote pas en route ! ça pourrait amener du vilain pour Jacques, et pour nous aussi.
— En la surveillant bien, dit M. Badoir.
— Dame ! c’est une fille, et les filles ça crie et ça parle malgré tout ; c’est ça qui me taquine.
En ce moment, la petite Jeanne s’éveilla dans les bras de M. Badoir.
Elle promena autour d’elle un regard étonné ; puis, passant de la surprise à l’épouvante à l’aspect de l’affreux taudis et des sinistres figures qui s’offraient tout à coup à ses regards, elle s’élança à terre en criant :
— Maman ! où est maman ? je veux voir maman.
Puis, sa terreur grandissant rapidement devant ces figures inconnues qui, la regardant avec une sombre impassibilité, lui semblaient autant d’apparitions fantastiques, elle se mit à courir pieds nus dans toutes les directions, en cherchant une issue et en jetant des cris aigus.
— Nom d’une pipe ! s’écria madame Claude d’une voix rauque et avinée, si elle ne se tait pas tout de suite elle va passer un mauvais quart d’heure.
— Ah ! mais emmenez-la, dit Claude à son tour, ses cris pourraient nous mettre la rousse sur les bras, on nous accuserait de complicité d’enlèvement et ça finirait mal pour nous ; emmenez-la vite.
— Merci ! répliqua brusquement madame Claude, il y va de cinq cents francs, je ne la lâche pas et je saurai bien la faire taire.
Elle s’élança sur l’enfant, la saisit par les poignets et, dardant sur elle ses yeux gris, auxquels l’abus de l’alcool donnait un éclat effrayant :
— Tais-toi tout de suite, ou je t’étrangle, lui dit-elle.
La petite Jeanne fut atterrée ; mais, au lieu de se taire, elle se mit à jeter des cris si perçants qu’on devait les entendre à une grande distance.
Madame Claude la regarda un instant avec une fureur concentrée.
Les traits contractés, tout le corps agité d’un tremblement nerveux, elle était effrayante à voir.
Puis, saisissant l’enfant dans ses bras, elle l’emporta dans une autre pièce en murmurant d’une voix sourde :
— Il faut que ça finisse.
Les cris de l’enfant redoublèrent.
Puis ils cessèrent tout à coup.
— Mon Dieu ! l’aurait-elle tuée ? dis-je à M. Badoir, qui semblait lui-même tout interdit.
J’attendais, dans une mortelle angoisse, le retour de madame Claude.
Elle reparut enfin, plus livide et plus sinistre qu’à sa sortie.
— Elle ne parlera plus ! murmura-t-elle en nous enveloppant tous d’un sombre regard.
Je regardai sa main.
Elle tenait quelque chose de rouge au bout de ses doigts, ruisselant de sang.
— Elle ne parlera plus ! ajouta-t-elle sur le même ton.
Et elle jeta au loin ce qu’elle tenait au bout de ses doigts.
Savez-vous ce que c’était ?
François se tut un instant.
Il était devenu très-pâle.
— Eh bien, reprit-il d’une voix troublée, c’était la langue de l’enfant.
XXVIII
UNE RÉVÉLATION
À ce dénouement aussi terrible qu’inattendu, Rocambole s’était levé d’un bond.
Il était plus pâle encore et plus agité que François.
Il passa sa main sur son visage et resta quelque temps ainsi muet et immobile.
Puis son émotion se calmant peu à peu, il laissa retomber sa main, reprit sa place devant le cocher, et d’une voix frémissante :
— Vous dites qu’il y a dix ans que cela s’est passé ?
— Oui, dix ans.
— Et l’âge de l’enfant ?
— Quatre ans.
— De sorte qu’elle aurait quatorze ans aujourd’hui ?
— Précisément.
— Si c’était elle ! murmura Rocambole à voix basse.
Il ajouta :
— Tout se réunit pour me le faire croire : l’âge de l’enfant, cette mutilation si extraordinaire… Et puis, je me rappelle maintenant, elle nous a dit un jour que cela remontait à l’époque où elle était toute petite.
Puis s’adressant au cocher :
— Que se passa-t-il ensuite ? lui demanda-t-il.
— Après quelques minutes d’anéantissement, pendant lesquelles il me sembla que j’étais paralysé des pieds à la tête, l’horrible réalité se dressa tout à coup devant moi ; alors saisi d’un vertige qui ressemblait à un accès de folie, je m’élançai vers l’horrible créature qui venait de mutiler l’enfant et lui détachai dans les reins un si vigoureux coup de pied, que je l’envoyai tomber, la tête la première, dans un coin de la pièce, où elle resta sans mouvement, puis j’ouvris la porte et, bondissant dehors, je me mis à courir à travers la campagne sans savoir où j’allais.
Dans cette course folle, j’avais incessamment deux tableaux devant les yeux : d’un côté, la jeune mère cherchant son enfant avec des larmes, des sanglots, des cris de désespoir ; de l’autre et à la même heure, cette enfant effroyablement mutilée, puis livrée à un saltimbanque qui allait la disloquer et la faire travailler dans les foires et marchés !
Le jour commençait à poindre quand je rentrai dans mon garni.
Ce que j’avais fait durant toute cette nuit, je ne saurais le dire, mais j’avais dû parcourir un trajet considérable, car j’étais brisé de fatigue.
— Et cette infortunée jeune femme, vous ignorez ce qu’elle est devenue ?
— Je voulus le savoir. Huit jours après, je me rendis à Fontenay-aux-Roses, non sans avoir longtemps hésité, retenu par la crainte d’être reconnu pour avoir été vu rôdant dans le pays le jour de l’enlèvement de l’enfant. Ce fut donc avec quelque appréhension que je me dirigeai vers la jolie villa où de si charmants tableaux s’étaient déroulés sous mes yeux. Quel changement, grand Dieu ! La maison était close du haut en bas, les fleurs étaient couchées, toutes flétries, dans les hautes herbes qui avaient envahi le jardin ; on eût dit un immense tombeau au milieu d’un cimetière. J’aurais voulu interroger quelqu’un, mais je craignais d’attirer l’attention sur moi. J’allais donc m’éloigner, lorsque j’entendis la voix de deux femmes qui venaient de s’arrêter en face de cette demeure.
— Comment ! disait l’une, on n’a jamais su ce qu’était devenue la pauvre petite ?
— Jamais, répondit l’autre. Au reste, ça n’a rien d’étonnant ; on ne voyait jamais personne chez la mère ; on disait qu’elle n’avait pas de famille.
— Et elle, la pauvre jeune femme, qu’est-elle devenue ?
— Que voulez-vous ? Son enfant était toute sa vie, il est arrivé ce qu’on devait prévoir, le lendemain du malheur elle était folle.
Folle ! ça me donna un coup si violent que, craignant de laisser voir mon trouble, je partis sans en écouter davantage.
Rocambole garda quelques instants le silence.
Il paraissait sous l’empire d’une profonde agitation.
— Et M. Badoir, reprit-il enfin, quand l’avez-vous revu ?
— Quinze jours après ; il avait sans doute voulu me laisser le temps de me calmer. Il me remit les cinq cents francs convenus et m’annonça qu’il m’avait trouvé une bonne place. J’étais dans la misère, j’avais besoin de lui, je ne fui fis aucun reproche, heureux de me caser en qualité de cocher dans une grande maison où, grâce à sa recommandation j’entrais dès le lendemain.
— Et depuis ?
— Bien des années s’étaient écoulées sans que j’eusse entendu parler de lui, lorsqu’un jour, il y a de cela six mois environ, il vint me trouver chez un nouveau maître, où il m’avait découvert je ne sais comment, et me proposa d’entrer chez M. le comte de Sinabria.
— Il méditait déjà l’affaire dans laquelle vous lui avez donné un si fameux coup de main.
— C’est ce que j’ai pensé depuis.
— Eh bien, que dites-vous de l’idée de Rascal ?
— Mon garçon, tu peux lui dire qu’il a mon approbation ; je n’ai pas compté avec M. Badoir, mais je sais, pour l’avoir entendu dire par M. le comte, qu’il doit être quelque chose comme millionnaire, nous serions donc bien naïfs de ne pas le faire chanter. Dis à Rascal de venir me voir et nous mitonnerons cette petite affaire-là ensemble.
Rocambole se leva, remercia chaleureusement son collègue d’avoir bien voulu l’honorer d’un si long entretien, puis, après avoir payé leur consommation, il sortit.
Il prit une voiture rue de Varennes et se fit conduire chez lui pour y quitter son travestissement.
Il y trouva Albert de Prytavin qui venait de rentrer.
— J’arrive d’Aubervilliers, lui dit ce dernier.
— Qu’as-tu fait de ce côté ? lui demanda Rocambole.
— J’ai réussi à obtenir des renseignements sur notre homme.
— Quels sont-ils ?
— Excellents… à notre point de vue.
— C’est-à -dire détestables.
— Il est joueur et ivrogne.
— Parfait ! Combien gagne-t-il ?
— Quinze cents francs.
— C’est beaucoup pour un garçon de bureau.
— C’est le maximum.
— Il doit être criblé de dettes ?
— Ses appointements sont frappés d’oppositions, aussi est-il menacé de perdre sa place.
— Tu lui as parlé ?
— Oui, mais sans préciser ; j’ai jeté des jalons.
— Comment cela a-t-il pris ?
— À merveille ; je suis sûr du succès.
— Il faudra le revoir dans quelques jours, jouer cartes sur table, connaître le chiffre de ses dettes et t’engager à les payer une fois l’affaire faite.
Une heure après, Rocambole avait repris le costume et la physionomie de M. Portal.
À quatre heures, il montait en voiture et se faisait conduire rue Duperré.
C’était là qu’il avait rendez-vous avec Jacques Turgis.
Le jeune homme l’attendait dans son atelier, où il le trouva devant une toile, la palette et les pinceaux à la main.
— Voilà un beau paysage, s’écria Rocambole en lui serrant la main.
— Dites admirable, répliqua Jacques.

Et comme Rocambole le regardait avec quelque surprise :
— Vous ne voyez donc pas que j’en finis une copie. Tenez, voici l’original, le plus beau Ruysdaël qu’il y ait au monde, peut-être.
Et il lui montrait un tableau posé sur un chevalet en face de lui.
— À qui appartient-il ? demanda Rocambole.
— À un marchand de tableaux de la rue Laffitte, qui l’a acheté cinquante mille francs.
— Ça ! cinquante mille francs ! s’écria Rocambole stupéfait.
— On lui en offre soixante mille, et il les refuse.
— Êtes-vous sûr qu’il ne fasse pas une sottise ?
— C’est le plus rapace et le plus retors des marchands ; il n’a jamais fait une mauvaise affaire.
— Tant mieux pour lui ; mais à propos d’affaire, parlons donc de celle qui vous intéresse. Avez-vous vu mademoiselle Tatiane ?
— Et je lui ai parlé.
— Eh bien ?
— Savez-vous ce que lui disait ce misérable ? s’écria l’artiste saisi d’une colère subite ; il lui parlait de son amour, sollicitait d’elle l’autorisation de demander sa main à son oncle, et comme elle répondait par un refus, il lui déclarait sur un ton de menace qu’elle serait bientôt sa femme, en dépit de tous et en dépit d’elle-même. J’aurais donné tout au monde pour pouvoir aller le souffleter chez lui, mais je m’étais engagé à ne rien faire sans vous consulter.
— Et vous avez bien fait de vous rappeler votre parole. Mais vous savez donc où il demeure ?
— Sans doute, rue Cassette, chez son associé.
— Et le nom de cet associé ?
— M. Badoir.
Rocambole tressaillit.
— Le plus honnête homme du monde, m’a dit mademoiselle Tatiane, et évidemment trompé sur le compte de ce sir Ralph.
— Peut-être, murmura Rocambole.
— Comment ! douteriez-vous de la probité…
— Non, non, je ne doute pas, je sais à quoi m’en tenir sur ce point et je suis ravi du renseignement que vous venez de me donner ; je verrai bientôt M. Badoir, et quant à sir Ralph, son mariage n’est pas encore fait, rassurez-vous.
XXIX
L’ATELIER
— Ce n’est pas tout, reprit Jacques Turgis, sir Ralph a déclaré en outre à mademoiselle Tatiane que son amour pour moi étant la véritable raison de son refus, quoiqu’elle affirmât le contraire, elle allait attirer sur ma tête les plus terribles catastrophes, si elle s’obstinait à le repousser, et c’est là surtout ce qui l’a bouleversée, la chère petite.
— Ne dédaignez pas ces menaces et tenez-vous toujours sur vos gardes, dit Rocambole à l’artiste, cet homme est capable de tout.
— Ah ! si le ciel pouvait lui inspirer la pensée de m’attaquer franchement et à visage découvert !
— Parbleu ! vous n’êtes pas difficile, mais n’y comptez pas, le ciel ne vous enverra pas cette joie, cet homme n’attaque jamais de front. Je connais ses façons de procéder, j’ai pu le juger à l’œuvre et je vous jure qu’il est dangereux, très-dangereux.
— Ne m’avez-vous pas dit que vous connaissiez sur son compte les choses les plus compromettantes ?
— De quoi l’envoyer au bagne, et même plus loin… je veux dire plus haut.
— Alors pourquoi ne pas le dévoiler ? Il suffirait de dire un mot à M. Mauvillars pour le faire chasser.
— Malheureusement ce mot, je ne puis le dire.
— Qui vous arrête ?
— Il tient entre ses mains l’honneur et la vie d’une pauvre jeune femme, si bien prise dans les filets où il l’a fait tomber, qu’il peut l’envoyer sur les bancs de la cour d’assises et la faire condamner à coup sûr, quoique innocente du crime qui lui serait imputé, et, le jour où il serait dénoncé, c’est sur elle que retomberait sa colère, car c’est à elle seule qu’il attribuerait la révélation de son passé. Il lui a donné cet avertissement et voilà ce qui m’empêche de rien faire contre lui.
— Mais combien de temps serez-vous donc astreint à ces ménagements ?
— Tant que je n’aurai pas trouvé le moyen d’arracher de ses mains la jeune femme dont je viens de vous parler.
— Et cela peut durer ?
— Huit ou dix jours, c’est l’échéance fatale à laquelle le drame doit se dénouer d’une façon quelconque.
— Et pendant tout ce temps, s’écria Jacques, il sera libre de voir Tatiane et de lui parler !
— Devant sa famille, car il sera facile à la jeune fille de ne jamais se trouver seule avec lui, et alors que vous importe ?
— La pensée de savoir cet ange si candide et si pur exposé aux regards et aux hommages de ce misérable, cette seule pensée me révolte.
Il s’écria au bout d’un instant :
— Mais non, les énormités qu’il a sur la conscience doivent le tenir dans des transes perpétuelles et il est impossible que dans cette situation il ait l’audace de demander la main de Tatiane.
— Peut-être au contraire voit-il là un moyen de salut, et je suis tenté de le croire.
— Comment cela ?
— Tenez, je ne sais si je me trompe, mais je crois avoir deviné son plan. Associé de M. Badoir, homme d’une honorabilité incontestée, sinon incontestable, gendre de M. Mauvillars, archimillionnaire et recommandable sous tous les rapports, il voit là un rempart d’honneur et de probité derrière lequel il est impossible qu’on soupçonne un aventurier couvert de crimes, et se croit assuré, dans tous les cas, de trouver mille moyens de salut dans la haute influence de deux personnages directement intéressés à le tirer d’embarras par tous les moyens possibles.
— Mais c’est épouvantable ! s’écria l’artiste hors de lui, et vous voulez que je laisse plus longtemps Tatiane face à face avec cet infâme !
— Je vous demande de la prudence et de la circonspection, voilà tout. Encore une fois, je vous le répète, j’ai acquis la preuve que nous avions affaire à des ennemis redoutables et d’une habileté effrayante, combattons-les avec leurs propres armes, c’est le seul moyen de les vaincre : maintenant je vous quitte pour m’occuper de vos affaires. Je pars plus riche de trois renseignements qui vont m’être d’un grand secours : 1° la résolution de sir Ralph d’épouser mademoiselle Tatiane, même contre son gré ; 2° l’association de sir Ralph et de lord Mac-Field avec M. Badoir ; 3° enfin, l’adresse de ce dernier. Allons, à bientôt, monsieur Turgis, rappelez-vous ma recommandation ; soyez constamment sur vos gardes, rapportez-vous-en entièrement à moi du soin de surveiller les agissements de sir Ralph et absorbez-vous dans votre Ruysdaël, c’est ce que vous avez de mieux à faire dans votre propre intérêt et dans celui de mademoiselle Tatiane.
Il ajouta, en jetant un coup d’œil sur la copie de l’artiste :
— Je trouve cela fort beau, tout aussi beau que l’original, mais je me demande par quel étrange caprice un artiste de votre talent peut consacrer à faire une copie le temps qu’il pourrait employer beaucoup mieux en créant une œuvre qui ne pourrait que grandir son nom.
— Voici la clef du mystère, répondit Jacques ; Chaumont, le marchand de tableaux auquel appartient cette toile, m’a rendu quelques services, dans le temps où je n’étais pas sûr de manger tous les jours, services dont il se remboursait à gros intérêts, il est vrai, en vendant un très-bon prix ce qu’il m’achetait pour un morceau de pain, mais dont je lui ai toujours su gré, néanmoins, puisqu’après tout il m’a sauvé la vie. Or, il y a quelques jours, un riche étranger, un Anglais, je crois, entra dans la boutique de Chaumont et lui demanda le prix de son Ruysdaël, exposé à la vitrine de celui-ci : « Quatre-vingt mille francs, » répondit le marchand. Ce chiffre parut décourager l’amateur qui, après un moment de réflexion, dit au père Chaumont :
— Connaissez-vous le peintre Jacques Turgis ?
— Si je le connais ! C’est moi qui l’ai lancé.
C’est la prétention de Chaumont d’avoir lancé tous les artistes arrivés.
— Ne trouvez-vous pas comme moi, reprit l’Anglais, qu’il y a quelque rapport entre sa manière et celle de Ruysdaël ?
Chaumont, qui a trois toiles de moi dans sa galerie, flaira une affaire.
— Un rapport frappant, monsieur, s’écria-t-il ; et je vois que j’ai affaire à un connaisseur, car l’opinion que vous venez d’exprimer là est celle de tous les paysagistes.
— Tenez, Corot me le disait encore l’autre jour, c’est étonnant comme les toiles de Jacques Turgis se rapprochent des Ruysdaël.
— J’en ai été frappé, dit l’Anglais.
— Parbleu ! monsieur, reprit Chaumont, c’est le cas de dire que vous tombez à pique, j’ai justement dans ma galerie trois toiles de Jacques Turgis où cette ressemblance avec les Ruysdaël se manifeste d’une façon particulièrement saisissante, c’est même pour cela que je les ai achetés ; venez les voir, et je suis sûr…
— Non, répondit l’Anglais, ce serait inutile, c’est ce Ruysdaël qui me plaît.
— Mais puisque vous ne voulez pas y mettre le prix et que vous raffolez du talent de Jacques Turgis, surnommé le Ruysdaël moderne…
— À juste titre, répliqua l’Anglais ; or, voilà la petite combinaison que j’ai à vous soumettre. Ne pouvant avoir le Ruysdaël original et la manière de Jacques Turgis ayant un rapport frappant avec celle du paysagiste hollandais, je voudrais une copie de cette toile par le jeune peintre français.
Le père Chaumont commença par jeter les hauts cris en déclarant qu’un artiste de ma valeur ne consentirait jamais à faire une copie.
C’était un truc pour amener l’étranger à payer très-cher une copie déclarée impossible.
Le truc réussit pleinement, sans doute, car le jour même le père Chaumont venait me proposer cette affaire en m’offrant un prix très-raisonnable, c’est-à -dire tout à fait en dehors de ses habitudes.
J’ai consenti, et je viens vous dire la raison qui m’avait déterminé ; vous savez maintenant pourquoi je fais cette copie.
— Et je ne puis que vous approuver ; encore une fois ne vous occupez plus que de cela, vos affaires ne peuvent qu’y gagner. Adieu, vous me reverrez maintenant quand j’aurai besoin de vous ou que j’aurai quelque chose de nouveau à vous annoncer.
— Adieu, monsieur Portal.
Le jour tombait et le crépuscule commençait à venir lorsque ce dernier sortit de l’atelier de l’artiste.
Il se croisa dans la rue avec deux individus en blouse, auxquels il ne fit aucune attention, mais qui, eux, se retournèrent dès qu’il fut passé et le regardèrent s’éloigner avec l’expression d’une profonde surprise.
— M. Portal ! s’écria l’un d’eux, pas possible ! M. Portal chez Jacques Turgis ! comment diable le connaît-il et que vient-il faire là ?
Et, se tournant vers son compagnon :
— Dites donc, père Vulcain, avez-vous jamais entendu parler de M. Portal par votre fils ?
— Jamais, et je suis sûr qu’ils ne se connaissaient pas.
— Voilà qui est furieusement louche.
— Je suis de votre avis et la chose me paraît assez grave pour que nous entrions quelque part afin de creuser cette affaire. Qu’en dites-vous, sir Ralph !
— J’allais vous le proposer, père Vulcain, d’autant plus que le petit plan dont nous avons à causer ne peut guère non plus se traiter en plein air.
Puis jetant un regard autour de lui :
— Vous qui avez habité le quartier, dit-il au vieux modèle, connaissez-vous un bon marchand de vin de ce côté ?
— Ils sont tous bons ; tenez, entrons chez celui-ci, au coin de la rue Fontaine.
— Entrons, mais c’est bien entendu, n’est-ce pas ? vous êtes bien résolu à vous venger des odieux procédés d’un fils ingrat envers un père qui s’est sacrifié pour lui toute sa vie et auquel il doit sa gloire ?
— Je vous l’ai dit, mon fils est un gueux, un sacripant, un monstre d’ingratitude, et je serai sans pitié pour lui comme il l’a été envers son auteur.
— À la bonne heure, vous avez du sang dans les veines, vous, vous n’êtes pas un père Cassandre.
— Suffit, il apprendra ce que c’est que de manquer d’égards envers son père en lui refusant l’absinthe. Mais voilà le marchand de vin, entrons et déroulez-moi votre plan.
Nous saurons plus tard quel était le plan de sir Ralph et pourquoi il avait besoin du concours du père Vulcain.
XXX
UN PÈRE MODÈLE
Il était six heures environ lorsque le père Vulcain et sir Ralph, ce dernier vêtu d’une blouse comme son compagnon, sortaient de chez le marchand de vin, où ils venaient de tramer le complot que nous connaîtrons plus tard par ses résultats.
Ils allaient descendre la rue Fontaine pour gagner les boulevards, quand sir Ralph, saisissant le bras du vieux modèle :
— Père Vulcain, lui dit-il en lui montrant un jeune homme qui, lui, remontait cette rue et se dirigeait vers le boulevard extérieur, est-ce que vous n’avez pas vu ce particulier-là quelque part ?
— Mais, je ne me trompe pas, c’est Jacques, dit le père Vulcain.
— C’est ce qu’il me semble.
— Ne dirait-on pas le fils d’un prince ? Voyez donc un peu quelle cassure, quel galbe et quel chic !
— Oui, oui, c’est flatteur pour vous, on ne soupçonnerait jamais qu’il est votre fils.
— Possible, dit le modèle, peu ravi de ce compliment, mais, après tout, à qui doit-il tout ça ?
— À vous, c’est incontestable ; il avait dans son père un exemple qui lui a été d’un grand secours, en ce sens qu’il n’a eu qu’à faire exactement le contraire pour devenir un grand artiste et un homme distingué.
— Sir Ralph, riposta le père Vulcain d’un air piqué, je n’aime pas qu’on me bêche.
— C’est une simple plaisanterie, car vous êtes aussi une illustration dans votre genre, père Vulcain, et vous laisserez un nom dans l’histoire des modèles.
— Je m’en flatte.
— Mais, dites-moi, ne trouvez-vous pas que votre fils a quelque chose de vainqueur dans la démarche ?
— Ça ne me frappe pas.
— Moi, ça me frappe et ça me fait faire une réflexion.
— Laquelle ?
— Vu cette démarche et vu les divinités qui habitent les hauteurs vers lesquelles il se dirige, je me demande s’il n’irait pas se reposer en ce moment, chez quelque beauté moins candide, de la tenue mélancolique et distinguée qu’il est contraint de s’imposer devant la pure et naïve Tatiane.
— Dame ! dit le père Vulcain, on a vu plus fort que ça ; on brûle de l’encens aux pieds de l’une et on fume sa bouffarde chez l’autre, et généralement on revient toujours à celle qui se contente de l’encens du tabac.
— Vous parlez comme un philosophe, père Vulcain ; aussi suis-je porté à croire que le beau ténébreux de la candide Tatiane se rend à cette heure chez quelque vierge à la bouffarde.
— Je ne dis pas non, c’est un joli cavalier, galbeux et genreux, qui a fait beaucoup de ravages dans le cœur de ces dames, et peut-être lui reste-t-il quelques incendies à éteindre avant d’allumer les flambeaux de l’hyménée.
— Ah ! si je pouvais le surprendre en flagrant délit de liaison demi-mondaine ! Si j’avais un nom et une adresse à citer à la charmante Tatiane et à son oncle, quel coup de massue pour mon heureux rival ! Quel atout pour moi… et pour vous aussi, père Vulcain.
— Et ce sera bien fait pour lui, car il est certain que, s’il épouse cette petite pimbêche, il me trouvera déplacé dans ses soirées.
— Tandis que, moi, je vous y invite d’avance.
Le vieux modèle pressa silencieusement la main de sir Ralph.
— Mais, vous savez, dit-il, l’habit à queue de morue fait totalement défaut dans ma garde-robe.
— Je me charge de le fournir.
Tout en causant ainsi, ils suivaient de loin Jacques Turgis, qui marchait lentement, l’air rêveur et non vainqueur, comme l’avait dit sir Ralph.
Arrivé au boulevard, le jeune homme tourna à gauche.
Sir Ralph et le père Vulcain continuèrent à le suivre.
— Ah çà , ce fils dénaturé vous a donc jeté à la porte ? demanda sir Ralph au modèle.
— Je ne puis dire cela, ce serait exagérer, répondit le père Vulcain ; seulement, comme je crois vous l’avoir dit un jour, il voulait imposer des conditions à son père, il dédaignait mes amis, il trouvait mauvais qu’ils vinssent prendre l’absinthe et fumer une pipe avec moi dans son atelier, sous prétexte que ça lui faisait du tort vis-à -vis des marchands de tableaux et de sa clientèle de grandes dames et d’aristos.
— Bref, il méprisait son père !
— Il me méprisait au point de vouloir payer lui-même ma nourriture au restaurant, au lieu de me remettre l’argent en mains propres, disant que je le dépensais à boire et qu’il ne me restait plus un sou au milieu du mois.
— Des calomnies ?
— Pures ; non que ça ne me soit arrivé quelquefois, mais quoi ! on est artiste ou on ne l’est pas, et, comme dit Alexandre Dumas dans Kean : De l’ordre ! et que deviendrait le génie ? Bref, il m’avait imposé une vie d’huître, antipathique à ma nature et à mes aspirations, voilà pourquoi nous avons rompu.
On était parvenu à la barrière Blanche.
Jacques traversa la chaussée.
— Ah ! dit sir Ralph, nous brûlons, le domicile de la belle n’est pas loin.
Et ses traits rayonnèrent.
Il ne doutait pas qu’un artiste jeune, joli garçon et déjà presque célèbre comme Jacques Turgis, n’eût quelques liaisons dans ce quartier et il comptait tirer un immense parti de cette découverte.
— Eh bien, non, s’écria tout à coup le père Vulcain, vous n’y êtes pas du tout.
— Que voulez-vous dire ? lui demanda sir Ralph.
— Je veux dire que vous vous mettez le doigt dans l’œil.
— Voyons, expliquez-vous.
— Il ne s’agit pas du tout d’amour en ce moment.
— Vous croyez ?
— Je suis sûr.
— Vous savez où il va ?
— Parbleu !
— Eh bien ?
— Il va béquiller.
— Hein ?
— Manger, si vous aimez mieux.
— Ah !
— Tenez, voyez-vous là , en face, cette boutique si bien éclairée ?
— Parfaitement.
— C’est la table d’hôte où il prend ses repas.
— Vous êtes sûr de…
— J’y suis allé quelquefois avec lui.
— Alors, c’est bien, je me suis trompé, dit air Ralph avec l’expression d’un vif désappointement.
— Et nous n’avons plus qu’à tourner les talons, dit le modèle.
Il fit un mouvement pour rebrousser chemin.
Sir Ralph allait l’imiter, quand une réflexion traversa tout à coup son esprit.
— Un instant, dit-il.
— Qu’est-ce ? demanda le père Vulcain.
— La partie n’est peut-être pas encore perdue.
— Puisque je vous dis qu’il va manger.
— J’entends bien, mais je connais quelque peu les mœurs de messieurs les artistes ; ils ne font guère mystère de leurs amours et les affichent même très-volontiers et emmènent généralement à leur pension leurs épouses de la main gauche.
— C’est tout de même vrai, ce que vous dites-là , dit le modèle, et j’ai vu beaucoup de couples de ce genre-là à la table d’hôte en face.
— Il faudrait pouvoir y entrer, dit sir Ralph.
— Qui vous en empêche ?
— Moi, oui, mais vous ? que dirait votre fils ?
— N’est-ce que cela ? ne vous inquiétez pas, répliqua le père Vulcain en traversant la chaussée.
— Que comptez-vous faire ?
— Il y a un café attenant à la salle du restaurant.
— Compris ; nous pouvons nous installer dans le café sans crainte d’être vus.
— Mieux que cela.
— Quoi donc ?
— Non-seulement nous ne serons pas vus, mais nous pourrons voir et entendre.
— C’est à merveille, entrons donc.
— Laissons d’abord Jacques entrer et s’installer.
Le père Vulcain ne s’était pas trompé ; après avoir traversé la chaussée, Jacques Turgis était entré dans l’établissement que le vieux modèle avait désigné à sir Ralph.
Ces deux derniers y pénétraient eux-mêmes cinq minutes après l’artiste.
Comme l’avait dit le père Vulcain, l’établissement était partagé en deux pièces.
L’une, la plus vaste, était affectée au restaurant.
De l’autre on avait fait le café.
Il fallait traverser le café pour se rendre à la table d’hôte, et les deux pièces étaient partagées par une cloison vitrée, garnie de rideaux si transparents qu’ils permettaient de distinguer parfaitement les convives.
En outre, la porte qui donnait passage dans l’une et dans l’autre pièce était ouverte, sans doute pour laisser pénétrer l’air dans une pièce garnie de vingt convives, de sorte qu’on devait entendre tout ce que disaient ceux-ci.
Sir Ralph commença par demander deux absinthes.
Puis, approchant son visage de la vitre :
— Voyons s’il a pris place à côté d’une femme, murmura-t-il.
Il ne tarda pas à découvrir Jacques Turgis.
Mais, nouvelle déception ! Il était assis entre deux jeunes gens.
Les femmes ne manquaient pas. Il y en avait de tous les âges et de toutes les conditions, c’est-à -dire de toutes les toilettes, car ces dames appartenaient toutes à la même condition ; seulement elles y occupaient un rang plus ou moins distingué.
— Il nous reste encore une espérance, dit sir Ralph au père Vulcain, écoutons et peut-être apprendrons-nous quelque chose.
Il achevait à peine, quand une voix s’écria tout à coup :
— Eh bien, mon ami Jacques, comment vont les amours ?
Sir Ralph tressaillit de joie.
— J’avais raison d’espérer, s’écria-t-il, nous le tenons.
Et, se frottant les mains :
— Allons, allons, nous allons rire !
XXXI
LA MÈRE ALEXANDRE
Sir Ralph attendit avec anxiété la réponse que l’artiste allait faire à cette question :
— Comment vont les amours ?
Jacques sourit.
— Très-mal, répondit-il avec une emphase railleuse ; il y a longtemps que j’ai rompu tous les liens qui m’attachaient à la terre pour me réfugier dans le seul amour vrai, l’amour de l’art.
— Les voilà bien tous ! s’écria une jolie fille à la mise excentrique et aux allures quelque peu hasardées, quand ils veulent nous lâcher, c’est toujours le même refrain, l’art ! Pendant six mois nous sommes tout pour eux : ils nous accablent de gentillesses et de petits noms : ma chatte blanche, mon petit lapin bleu, mon petit chien en sucre ; il n’y a rien d’assez joli pour nous dans le dictionnaire des amours. Puis un beau jour, nous devenons les liens qui les attachent à la terre, et v’lan ! ils nous plantent là pour se réfugier au ciel de l’art. As-tu fini avec ton ciel ? L’art par-ci, l’art par-là , toujours l’art. Tenez, voulez-vous que je vous dise ? Eh bien ! l’art, je voudrais qu’il fût dans le troisième dessous. Voilà ma manière de voir à son égard.
Un bruyant éclat de rire accueillit cet anathème contre l’art.
— Nom d’une palette ! s’écria un jeune homme, c’est étonnant comme ça me rappelle les imprécations de Camille par mademoiselle Rachel.
— Mireille, ajouta un autre, avez-vous lu Colomba ?
— Connais pas, ça a-t-il des pattes ?
— Non, mais ça a des ailes. Eh bien ! lisez Colomba, et vous y verrez que, le jour où vous serez fatiguée de Paris, vous avez un emploi tout trouvé en Corse, celui de vocifératrice.
— Ah ! voilà que je vocifère à présent ! Eh bien ! merci, vous êtes joli, vous, répliqua Mireille, qui depuis deux ans avait quitté son nom de Sophie pour celui de l’héroïne du poème provençal.
Puis, se tournant brusquement vers son voisin, un jeune homme blond que ses fureurs faisaient éclater de rire :
— Quant à toi, mon amour, le jour où tu voudras me faire passer à l’état de lien qui t’attache à la terre, je te préviens que j’irai te faire un boucan dans ton ciel de l’art ! Ah ! mais, que ce sera ça et que je ne t’y laisserai pas moisir.
— Mireille, mon amie, répliqua le jeune homme en lui riant respectueusement au nez, depuis que tu fréquentes le théâtre des Batignolles, tu négliges singulièrement ton style. Qu’as-tu fait, hélas ! de ce beau langage qui était une de tes séductions à l’époque où j’eus la chance inouïe de toucher ton cœur à force d’amour, d’égards, de soupirs ?
— Et de mobilier, murmura une voix.
— Ta, ta, ta, s’écria le jeune homme qui avait interrogé Jacques, laissons là les amours d’Edgar et de Mireille, qui éclatent librement au grand soleil et sous l’œil de Dieu, et revenons à mon interpellation, à laquelle notre ami Jacques n’a pas répondu du tout.
— Au contraire, dit l’artiste, je t’ai répondu que l’art seul désormais…
— Fort bien, mais où prends-tu l’art ? Ne serait-ce point par hasard dans les yeux d’une ravissante jeune fille qui attirait tous les regards à l’une des dernières représentations des Italiens et qui fixait particulièrement les tiens ?
Jacques était devenu tout à coup sérieux.
— J’ai beaucoup regardé cette jeune fille, j’en conviens, répondit-il, mais comme tout le monde, puisque tu reconnais toi-même qu’elle attirait l’attention de la salle entière.
— Oui, mais la salle entière ne la regardait pas du même œil et avec les mêmes sentiments que toi ; la salle entière ne pâlissait pas de jalousie en la voyant causer avec un individu qu’elle paraissait écouter avec émotion, émotion pénible, j’en conviens, et qui devait te rassurer complètement sur la façon dont ses hommages étaient accueillis.
Il y eut un moment de silence.
— Eh bien ! oui, répondit Jacques d’une voix grave, j’avoue que j’ai regardé celle jeune fille avec un sentiment d’admiration et d’enthousiasme que ne devaient pas éprouver les autres spectateurs, mais de là à aimer il y a loin. D’ailleurs, le sentiment qu’elle m’a inspiré est de ceux qu’on croirait profaner en les étalant devant tous, en les exposant aux propos d’une table d’hôte, et je prie ceux qui tiennent à ne pas m’être désagréables à ne plus revenir sur un sujet dont je garde le secret au fond de ma pensée et qui n’en sortira jamais.
— À moins qu’on ne l’en arrache malgré vous, dit une voix.
Cette voix était celle d’une femme d’une cinquantaine d’années, dont la mise bizarre annonçait le désordre et le mauvais goût, plutôt que la gêne.
Tout ce qu’elle portait sur elle, y compris le chapeau jaune qui couvrait ses cheveux gris, sortait évidemment de chez la marchande à la toilette.
Ses traits anguleux et couperosés conservaient la trace d’une vie agitée, successivement traversée par la misère et par les passions, et ses yeux, où brûlait une flamme mystérieuse, trahissaient un état d’exaltation permanente, étrange et inexplicable pour qui ne connaissait pas la singulière profession à laquelle elle se livrait.
— Bon ! s’écria Mireille en riant, voilà la mère Alexandre qui enfourche son dada, nous allons rire.
— Vous êtes une petite sotte, ma chère, lui dit la mère Alexandre en lui jetant un regard de travers, et vous en serez bientôt convaincue si M. Jacques consent…
— À tout ce que vous voudrez, mère Alexandre, répondit l’artiste, je n’ai pas l’irrévérence de douter de votre science, je crois même au magnétisme dans une certaine mesure, mais je crois en même temps que je suis un sujet récalcitrant, peu susceptible de subir son influence, aussi vous autorisai-je de grand cœur à tenter sur moi tout ce qu’il vous plaira.
— Ainsi, c’est bien entendu, vous me permettez de vous contraindre à révéler ici même et à haute voix le secret que vous avez résolu de garder au fond de votre cœur ?
— Je ne crois pas courir grand risque en vous accordant toute liberté sur ce point, répondit Jacques en souriant ; arrachez-moi donc ce secret et tous ceux qu’il vous plaira pendant que vous y serez.
— Fort bien, mais vous allez venir vous asseoir près de moi pour plus de commodité.
— Quant à cela, non, je suis bien là , j’y reste.
— Pardon, je ne vous demande pas si cela vous convient, je vous dis que vous allez y venir et vous y viendrez.
— Compris, c’est par la force.
— Justement.
— Allez-y donc, mère Alexandre, envoyez le fluide.
Il se croisa les bras, et toujours souriant, il fixa son regard sur la magnétiseuse.
Tous regardèrent également la mère Alexandre avec un sourire d’incrédulité.
Celle-ci restait impassible.
— Retirez-vous de là , dit-elle au jeune homme qui était assis près d’elle, cette place est pour M. Jacques.
Le jeune homme se retira en riant comme les autres.
Alors la mère Alexandre, posant ses coudes sur la table et sa tête dans ses deux mains, darda sur Jacques un regard étincelant comme celui de la vipère.
Il se fit un profond silence.
Cinq minutes s’écoulèrent ainsi.
Ce temps écoulé, le sourire s’effaçait peu à peu des lèvres de l’artiste.
Un instant après, son œil prenait un éclat vitreux et restait fixe.
Puis il se leva et faisant le tour de la table, avec quelque chose d’automatique dans la démarche, il vint s’asseoir près de la magnétiseuse, se tourna vers elle et la regarda en face.
On ne riait plus et une curiosité émue se lisait sur tous les visages.
La mère Alexandre prit la main du jeune homme et, continuant à le regarder fixement :
— Aimez-vous cette jeune fille ? lui demanda-t-elle.

— Oui, répondit Jacques.
— Lui avez-vous parlé ?
— Souvent.
— Vous êtes donc reçu dans sa famille ?
— Oui.
— Et elle, croyez-vous qu’elle vous aime ?
— J’en suis sûr.
— Dites-moi son nom ?
— Tatiane.
— Ce n’est pas un nom français.
— C’est un nom italien, qu’elle tient de son parrain.
— Vous voudriez l’épouser ?
— C’est mon plus ardent désir.
— L’espérez-vous ?
— Oui, quoique…
— Vous avez une inquiétude sur ce point, expliquez-vous.
— Elle est exposée aux persécutions d’un misérable qui…
La magnétiseuse fut interrompue par plusieurs voix.
— Assez, mère Alexandre, assez, lui cria-t-on, nous sommes convaincus maintenant, et il serait indiscret de pousser vos questions plus loin.
— Comme vous voudrez.
Et elle dit à Jacques :
— Retournez à votre place.
Jacques obéit.
Quand il eut repris sa place, elle le regarda encore en faisant deux ou trois passes.
Jacques fit un soubresaut, promena autour de lui un regard étonné, puis apercevant la mère Alexandre.
— Eh bien ! vous le voyez, lui dit-il, je n’ai pas bougé de place.
— C’est-à -dire que vous venez d’y retourner après avoir passé dix minutes près de moi.
— Allons donc ! s’écria l’artiste.
— Demandez donc à tous ceux qui viennent d’assister à notre entretien, ce que vous m’avez dit concernant mademoiselle Tatiane.
— Tatiane ! murmura Jacques bouleversé, j’ai prononcé son nom ?
— Dame ! nous l’ignorions tous.
— C’est effrayant, balbutia-t-il.
— Eh bien ! ma petite, que dites-vous de ça ? demanda la mère Alexandre à Mireille.
— Je dis que vous me faites l’effet du diable en personne, répondit celle-ci en la regardant avec épouvante.
— Quelle femme ! disait de son côté sir Ralph, atterré comme les autres de la puissance de la magnétiseuse, je me souviendrai de cette scène-là .
— Allons, nous n’avons plus rien à faire ici, filons.
XXXII
Quand ils furent dehors, sir Ralph dit au père Vulcain :
— Pas de maîtresse ! voilà ce dont nous venons d’acquérir la preuve ; juste le contraire de ce que j’espérais.
— C’est vrai, pas de chance ! dit le père Vulcain en tirant de sa poche un brûle-gueule atrocement culotté.
— C’est égal, je ne regrette pas le spectacle auquel je viens d’assister, c’est curieux et instructif ; j’y ai appris à connaître le magnétisme, que je raillais comme tant de gens, sans jamais m’être rendu compte de ses effets. Quelle femme que cette mère Alexandre, et qui croirait jamais qu’une nature aussi vulgaire possède une telle puissance !
— J’en suis encore épaté, dit le vieux modèle tout en bourrant sa pipe.
— Enfin, si fâcheux qu’ait été le résultat de notre espionnage, nous devons toujours nous féliciter de savoir à quoi nous en tenir, car nous savons maintenant qu’il faut plus que jamais persévérer dans le petit plan que nous venons de combiner tous les deux.
— Et qui ferait honneur à un diplomate, je ne crains pas de le dire, ajouta le père Vulcain.
— Ainsi, lui dit sir Ralph, il est bien entendu que la porte de votre fils ne vous est pas fermée ?
— Pas du tout ; je puis aller le voir, si ça me plaît, et c’est ma dignité seule qui m’en empêche.
— Bon !
— Et quand nous mettons-nous à l’œuvre ? demanda le modèle.
— Je saurai cela tout à l’heure ; la chose dépend d’une réponse que je ne connais pas encore.
— Quand vous voudrez ; quant à moi, ça m’est indifférent, dit Vulcain avec cette insouciance de brute qu’il devait autant à son instinct naturel qu’à l’abus de l’absinthe.
— Dans tous les cas, lui dit sir Ralph, trouvez-vous, dans trois jours, à cinq heures, chez le marchand de vin de la rue Fontaine ; j’y serai, et nous déciderons du jour et de l’heure.
— C’est convenu.
Sir Ralph quitta le vieux modèle et prit une voiture sur le boulevard, près de la barrière Blanche.
Où se fit-il conduire ? C’est ce que nous ne saurions dire ; mais, une heure après, il se présentait chez M. Badoir, débarrassé de sa blouse et dans une tenue des plus convenables.
Il n’y trouva que Mac-Field, installé dans une chambre d’un confortable luxueux.
On sait que, pour plus de sécurité, les deux complices, en fondant la maison Badoir et C°, avaient eu soin d’établir leur domicile chez leur associé.
— Eh bien, demanda vivement sir Ralph, M. Badoir ?
— Pas encore rentré.
— Mauvais signe.
— Comment cela ?
— S’il eût eu une bonne nouvelle à m’apporter, il se serait hâté.
— Ah çà , s’écria Mac-Field, est-ce que sérieusement vous comptiez inspirer à la jolie Tatiane autre chose qu’une profonde aversion ?
Sir Ralph tressaillit à ce mot.
— Je ne comptais pas sur son amour, puisque je sais qu’elle aime Jacques Turgis, répliqua-t-il ; mais j’espérais que, dans l’intérêt même de celui-ci et pour la soustraire à l’effet de mes menaces, elle consentirait.
— C’est possible, après tout, nous ne savons rien encore, mais j’ai de mauvais pressentiments.
— J’en serais au désespoir, car je vous l’ai dit, j’aime éperdument cette jeune fille et ce n’est pas seulement une affaire que j’ai eue en vue en demandant sa main.
Mac-Field allait répliquer quand on frappa à sa porte.
— Entrez, cria-t-il.
La porte s’ouvrit.
C’était M. Badoir.
Il était vêtu comme pour une soirée.
— Eh bien ? lui demanda sir Ralph, en allant au-devant de lui avec tous les signes d’une violente agitation.
— Refusé, répondit le banquier en se laissant tomber sur un siège.
Il y eut une pause.
— Tatiane était là ? demanda enfin sir Ralph dont la voix tremblait légèrement.
— Elle y était, répondit M. Badoir.
— Avez-vous remarqué l’impression que lui causait votre demande ?
— Naturellement.
— Eh bien ?
— Eh bien ! elle a pâli et s’est mise à trembler de tous ses membres.
— Et puis ?
— Ma demande faite, M. Mauvillars me répondit : « Mon cher Badoir, je ne connais guère sir Ralph, mais je vous connais, vous ; je sais que vous êtes l’honneur même et que vous n’avez pu vous associer qu’à un homme d’honneur. Vous avez dû vous entourer de tous les renseignements, de toutes les garanties imaginables avant de conclure un contrat qui vous rend solidaire, non-seulement de tous les actes, mais du passé même de votre associé ; ce titre est donc pour sir Ralph la meilleure des recommandations à mes yeux, je n’en exige pas d’autre et suis tout prêt à accueillir sa demande ; mais ce n’est pas moi qui épouse, c’est Tatiane, c’est elle qui engage sa vie entière dans cette union, c’est donc à elle de décider si elle accepte celui dont va dépendre désormais tout son bonheur, toute sa destinée. »
Puis, se tournant vers la jeune fille :
« Tatiane, lui dit-il, tu viens d’entendre M. Badoir, c’est à toi de répondre, je te laisse entièrement libre. »
— Et alors ? demanda sir Ralph avec une sourde colère.
— Tatiane était très-pâle, comme je vous l’ai dit, et c’est avec une anxiété évidente qu’elle avait attendu la réponse de son oncle. Pendant que celui-ci parlait, elle dardait sur lui un regard fiévreux, et son agitation était si violente, que je craignais de la voir tomber sans connaissance sur le parquet.
— Détails très-flatteurs pour moi, dit sir Ralph d’une voix frémissante, mais je tiens à connaître la vérité tout entière ; poursuivez donc, monsieur Badoir.
M. Badoir reprit :
— Son agitation s’était un peu calmée lorsqu’elle avait entendu M. Mauvillars déclarer qu’elle était entièrement libre de son choix et que c’était à elle seule à prendre une décision dans cette circonstance. Ce fut donc avec un peu plus d’assurance qu’elle me répondit, sur l’invitation de son oncle.
— Monsieur Badoir, me dit-elle, veuillez dire à sir Ralph que je suis très-honorée de sa demande, mais que je suis résolue à ne pas me marier.
— C’est la réponse qu’elle m’a faite à moi-même, dit sir Ralph avec un accent dans lequel perçait une violente colère.
Il ajouta en frappant du pied :
— Elle en réserve une autre à M. Jacques Turgis ; ah ! mais, moi aussi, je lui réserve quelque chose, à celui-là .
Il fit quelques pas en proie à une émotion qui faisait trembler tout son corps.
— À lui et à elle, ajouta-t-il en s’arrêtant tout à coup ; non-seulement je rendrai leur mariage impossible ; mais, puisqu’elle me contraint d’employer la force et la ruse pour l’obtenir, je la mettrai, comme je le lui ai dit, dans l’obligation absolue d’accepter cette main qu’elle repousse aujourd’hui. Oh ! ce sera quelque chose d’effroyable, mais je l’ai prévenue, elle l’aura voulu, qu’elle ne s’en prenne donc qu’à elle-même.
Ces menaces semblaient mettre M. Badoir à la torture.
— Voyons, sir Ralph, dit-il à celui-ci, calmez-vous, et, je vous en supplie, renoncez à ces projets de vengeance qui me font frémir et dont j’assumerais en partie la responsabilité par la démarche que vous m’avez contraint de faire aujourd’hui près de M. Mauvillars. Après tout, quels sont les torts de Tatiane à votre égard ? Vous dites qu’elle aime Jacques Turgis ; je l’ai observée depuis et je le crois comme vous, mais elle le connaît depuis longtemps et elle l’aimait avant de vous connaître, vous. Qu’avez-vous donc à lui reprocher ? Je ne vous demande pas d’être généreux, soyez juste seulement ; envisagez d’un œil calme et impartial la conduite de Tatiane et vous serez forcé de convenir que vous n’avez contre elle aucun grief réel.
Il y eut un instant de silence.
Puis, sir Ralph vint se poser devant le banquier, les bras croisés sur la poitrine, et d’une voix pleine d’ironie :
— Monsieur Badoir, lui dit-il, je vous trouve magnifique, vous prêchez la générosité, le pardon des injures et l’oubli des offenses avec une éloquence vraiment entraînante, seulement… permettez-moi de vous demander ce que vous feriez à ma place.
— Ce que je vous conseille de faire vous-même.
— Bref, vous êtes du parti de la clémence ?
— Oui, en ce cas surtout, la clémence devant être chose facile vis-à -vis d’une jeune fille à laquelle, je vous le répète, vous n’avez rien à reprocher.
Sir Ralph le regarda en silence.
Mais l’ironie empreinte sur ses traits s’accentua avec une énergie qui parut gêner singulièrement M. Badoir.
— Mais, lui demanda-t-il enfin, qu’avez-vous donc à me regarder ainsi ?
— Je suis sous l’empire d’une profonde surprise, monsieur Badoir.
— Et la cause de cette surprise ?
— Ces sentiments sont fort beaux assurément et je ne puis que les admirer, mais…
— Mais quoi ?
— Mais pourriez-vous me dire ce que vous avez fait de Louise Prévôt et de la petite Jeanne ?
À ces mots, M. Badoir se leva brusquement, devint horriblement pâle, puis se laissa retomber sur son siège, comme foudroyé.
XXXIII
ENTRE ASSOCIÉS
Sir Ralph garda quelques instants le silence.
Toujours debout en face de M. Badoir, il semblait se faire une joie cruelle de le laisser écrasé sous le coup qu’il venait de lui porter.
— Louise Prévôt, balbutia enfin le banquier, je ne connais… je ne sais ce que vous voulez dire.
— Bah ! dit sir Ralph en ricanant, et vous voilà tout bouleversé au seul nom d’une personne que vous ne connaissez pas.
M. Badoir ne trouva rien à répliquer !
— Eh bien, moi, répliqua sir Ralph, je suis plus avancé que vous, et je vais vous dire ce que c’est que Louise Prévôt.
— Vous ! fit le banquier stupéfait.
— Louise Prévôt, reprit sir Ralph, était une jeune et charmante personne mariée à un misérable criblé de vices qui, après l’avoir plongée dans la misère, la poussait ouvertement a tirer parti de sa beauté, lorsqu’elle rencontra un jeune homme qui, mis au courant de cette horrible situation par une amie de cette infortunée, lui procura les moyens de fuir ce mari infâme en prenant un établissement de couturière.
Ce protecteur, aussi délicat que généreux, ne voyait que rarement sa protégée et quoique vivement touché de sa beauté et de ses malheurs, il lui cacha longtemps avec soin l’impression qu’elle avait produite sur lui. Mais celle-ci n’avait pas tardé à deviner les sentiments qu’elle lui avait inspirés, et la générosité avec laquelle il s’attachait à dissimuler son amour avait produit sur elle beaucoup plus d’effet que les plus ardentes déclarations. La situation était pleine de périls et devait fatalement faire explosion quelque jour ; c’est ce qui arriva. Un an après, Louise était mère et deux ans plus tard, son protecteur, que nous nommerons Pierre Valcresson, si vous voulez, la quittait pour aller chercher fortune en Amérique, n’hésitant pas à s’imposer la douleur d’une longue séparation pour assurer l’avenir de Louise et de son enfant. Au reste, il se proposait de les appeler près de lui le jour où il aurait réussi, ne voulant pas exposer sa Louise bien-aimée aux angoisses qui devaient infailliblement l’attendre à ses débuts. Et puis il était rassuré sur son sort en partant, car il laissait près d’elle un ami dévoué, en même temps son parent, un certain M. Badoir, cœur loyal, âme généreuse, nature d’élite, en qui il avait une entière confiance. N’est-ce pas, monsieur Badoir, qu’on est heureux d’avoir de pareils amis ?
— Mais, répliqua le banquier, qui vous dit que j’aie manqué aux devoirs de l’amitié ?
— Ce n’est pas moi, pas encore du moins, nous examinerons cela tout à l’heure. Au bout d’une année de séjour en Amérique, les affaires de Valcresson commençaient à prospérer, et pour comble de bonne fortune, il lui tombait du ciel un héritage, grâce auquel, avec son intelligence, ses relations et sa connaissance du pays, il comptait gagner plusieurs millions dans l’espace de quelques années. C’est ce qu’il écrivit à son bon parent et ami, M. Badoir, en lui envoyant une certaine somme et une lettre pour sa chère Louise, qu’il priait de venir le rejoindre au plus vite. Or, que fit M. Badoir, ce modèle des amis ? Il garda la somme et la lettre, et au lieu de sa chère Louise et de son enfant, qu’il attendait avec tant d’impatience, Pierre Valcresson recevait bientôt une affreuse nouvelle. Son parent et ami lui apprenait que Louise Prévôt avait quitté sa villa de Fontenay-aux-Roses dans un accès d’aliénation mentale, que tout faisait supposer qu’elle avait emmené son enfant avec elle et qu’il avait fait vainement les plus actives recherches pour retrouver leurs traces.
Le pauvre Valcresson en éprouva une si violente secousse, que sa raison en fut ébranlée et que ses affaires, jusque-là si brillantes, prirent tout à coup une très-mauvaise tournure. Dégoûté de la vie, l’esprit affaibli par une catastrophe aussi terrible qu’imprévue et qui désormais lui montrait l’avenir sans but et sans intérêt, il marcha rapidement à sa ruine et fit deux fois faillite en quelques années. Enfin, il parvint à dominer le désespoir dans lequel il était resté si longtemps écrasé, et se jetant alors corps et âme dans les affaires, s’y absorbant tout entier pour oublier sa douleur, il répara rapidement tous ses désastres et devint bientôt un des plus riches négociants de New-York. M. Badoir avait, de ce côté, quelque mystérieux correspondant qui le tenait au courant des variations que subissait la fortune de cet oncle d’Amérique, et c’est lorsqu’il apprit que cette fortune, désormais solidement assise, se chiffrait par millions, qu’il résolut de faire disparaître du même coup, sous la trappe de madame Claude, la comtesse de Sinabria, et l’enfant qu’elle portait dans son sein, cohéritiers avec lui d’une part de ces millions. Voilà l’histoire de Valcresson et de Louise Prévôt, voilà du moins tout ce que j’en sais, et je vous dirai tout à l’heure comment ces détails sont venus à ma connaissance, mais je serais très-curieux de savoir d’abord ce que sont devenus la jeune femme et son enfant et je pense que vous pourriez me renseigner à cet égard si vous vouliez consulter vos souvenirs.
— Moi, s’écria M. Badoir, je l’ignore complètement. Je ne sais autre chose, au sujet de Louise Prévôt, que ce que vous venez de raconter vous-même.
— Pourquoi donc avez-vous tremblé et pâli tout à l’heure quand j’ai prononcé ce nom ? Rien ne motive un pareil trouble dans tout ce que je viens de vous dire.
— Mais, répliqua le banquier avec embarras, c’est… la surprise. J’étais si loin de croire que vous connaissiez cette jeune femme.
— Alors vous ne savez rien de plus, décidément ?
— Absolument rien.
— Allons, je vois bien qu’il faut que je vienne encore en aide à vos souvenirs.
M. Badoir regarda sir Ralph avec une inquiétude qu’il essayait vainement de dissimuler.
Ce dernier reprit :
— Eh bien, monsieur Badoir, Louise Prévôt a quitté sa villa de Fontenay-aux-Roses dans un accès de folie, et la cause de cette folie, puisqu’il faut vous l’apprendre, c’était l’enlèvement de son enfant, arrachée de son berceau pendant son sommeil par… Faut-il vous dire aussi le nom du ravisseur ? Faut-il vous apprendre l’ignoble bouge où fut conduite la pauvre petite Jeanne endormie ? faut-il vous nommer la famille de bandits aux mains de laquelle on la livrait ? Enfin, voulez-vous que je vous fasse le récit de l’horrible scène qui se passa à son réveil et de l’effroyable mutilation que lui fit subir… madame Claude ?
À mesure que sir Ralph déroulait ces souvenirs, M. Badoir détournait de plus en plus la tête, et en entendant les dernières paroles il se leva d’un bond et recula de quelques pas.
— Quand je songe, s’écria sir Ralph avec un ricanement insultant, quand je songe que vous faisiez la bégueule avec nous, que vous nous trouviez trop tarés pour nous accorder l’honneur d’associer notre nom au nom si honorable de M. Badoir, et que tout à l’heure encore vous me reprochiez comme un crime de vouloir unir mon nom souillé à celui d’une innocente jeune fille ! Quand je songe à tout cela, monsieur Badoir, je ne sais si je dois rire ou m’indigner de tant d’impudence. Et qui vous a poussé à ces actes sauvages, à ce double crime cent fois plus épouvantable que ceux que vous nous reprochiez ? Le même mobile qui vous a déterminé à supprimer la comtesse de Sinabria et son enfant. Naturellement, toute la fortune de Pierre Valcresson devait revenir à Louise Prévôt, qu’il n’eût pas manqué d’épouser à la mort de son mari ; c’était la ruine de toutes vos espérances, et le seul moyen de conjurer ce péril, pour un homme d’une logique aussi serrée, aussi radicale que vous l’êtes, c’était de se débarrasser de la mère et de l’enfant, et vous saviez bien qu’en enlevant l’enfant, vous poussiez fatalement la mère à la folie ou à la mort. Voilà tout ce que je sais de cette sinistre histoire, dit sir Ralph en terminant, et vous ne pouvez nier que je ne sois parfaitement renseigné, mais j’ignore ce que sont devenues la mère et l’enfant, et voilà ce que vous pourriez peut-être m’apprendre, vous.
— Je vous jure que je l’ignore, répondit M. Badoir.
— Je veux bien vous croire ; et maintenant, mon cher monsieur Badoir, moi, qui ne me pique pas comme vous de finesse et de mystère dans tous les actes de ma vie, je vais vous dire franchement à quelle source j’ai puisé tous les renseignements que je viens de vous donner.
M. Badoir écouta avec l’expression d’une vive curiosité.
— Nous avons là -bas, près de Pierre Valcresson, un ami, un complice, si vous l’aimez mieux, qui nous tient au courant de toute la vie de celui-ci. Ce complice, qui est son domestique de confiance, en fouillant un peu partout chez son maître, a découvert toute la correspondance de Louise Prévôt et la vôtre jusqu’à la nouvelle de la disparition de la mère et de l’enfant inclusivement, et m’a tout envoyé. Voilà pour la première partie. Quant à la seconde, concernant l’enlèvement de l’enfant et tous les détails qui s’y rapportent, nous en devons la communication à l’obligeance d’un personnage bien placé pour être au courant de cette affaire, car c’est François lui-même, François votre complice.
M. Badoir était atterré.
— Je vous ai gardé une bonne nouvelle pour la fin, monsieur Badoir, ajouta sir Ralph. Que savez-vous de la santé de Pierre Valcresson ?
— D’après la dernière lettre que j’ai reçue il y a quelques jours, elle est excellente.
— Bien ! Quelle heure est-il maintenant ?
— Mais, répondit M. Badoir en regardant la pendule, il est neuf heures et demie.
— Eh bien ! Pierre Valcresson doit être mort depuis deux heures.
XXXIV
BILAN SOCIAL
Cette fois encore M. Badoir avait éprouvé une violente secousse.
— Mort ! s’écria-t-il, Pierre Valcresson, mort !
— Depuis deux heures, comme je viens de vous le dire, répondit tranquillement sir Ralph.
— Comment est-ce possible ? à quoi attribuer une mort si rapide, arrivant à heure fixe, et comment pourriez-vous prévoir de si loin un événement aussi extraordinaire et que rien ne fait supposer, puisque je viens de recevoir les meilleures nouvelles de sa santé ?
— Je vais vous donner l’explication de tout ce qui vous semble impossible, monsieur Badoir, répondit sir Ralph, car non-seulement je ne veux laisser planer aucun mystère sur cette affaire, mais je tiens, au contraire, à ce que vous soyez instruit de tout ce que nous faisons, Mac-Field et moi, pour un but qui nous est commun à tous trois, afin de vous unir à nous dans une étroite complicité.
Cette déclaration parut impressionner désagréablement M. Badoir qui, dès lors, attendit avec plus d’angoisse que de curiosité les explications de sir Ralph.
— Nous aussi, monsieur Badoir, reprit sir Ralph, nous sommes doués comme vous d’une logique rigoureuse, implacable, en vertu de laquelle nous marchons droit au but que nous nous sommes proposé, sans nous inquiéter des ruines et des désastres que nous laissons sur notre passage. Or, nous nous sommes fait ce raisonnement, dont la justesse vous frappera, je l’espère : que cherchons-nous dans une union avec mademoiselle Tatiane Valcresson, en dehors de la passion qu’elle m’inspire ? Une part de l’héritage de son oncle. Quel est le moyen le plus sûr et le plus pratique d’hériter d’un homme ? c’est de le supprimer. S’il y a quelque chose au monde de clair, de logique et d’indiscutable, je crois que c’est ce raisonnement-là . En conséquence, inspirés d’ailleurs par votre exemple au sujet de Louise Prévôt et de son enfant, que vous aviez exécutés avec une résolution, une énergie qui font le plus grand honneur à la fermeté de vos principes, en conséquence, dis-je, il fut décidé entre nous que j’écrirais à notre ami Charles Durand une lettre ainsi conçue : « Le moment est venu, le temps presse, il faut conclure le 4 du mois prochain dans la soirée. »
Il savait ce que nous entendions par conclure.
La lettre est partie et il a dû la recevoir le premier du mois.
Or, voilà comment les choses se sont passées, car le programme de l’affaire avait été médité, discuté et définitivement arrêté entre nous trois quelques jours avant que nous ne prissions la fuite à la suite du meurtre des époux Christiani. M. Valcresson a des habitudes très-régulières, toute la journée est consacrée au travail, et le soir, après son dîner, il se repose en parcourant les journaux, en fumant un cigare et en prenant un grog, que lui prépare son domestique Charles Durand. Ce Charles, espèce d’aventurier, tombé un jour au pouvoir d’une tribu de Peaux-Rouges, où d’abord il avait eu le désagrément d’être scalpé, était resté quelques années parmi ces sauvages, qui l’avaient initié à la connaissance de certains poisons d’autant plus dangereux qu’ils ne laissaient aucune trace. Il en était un, entre autres, qui produisait exactement tous les effets de l’apoplexie ; c’est sur celui-là que se fixa notre choix, et il fut convenu que Charles l’emploierait dès qu’il recevrait de nous l’ordre de conclure. Nous ne devions envoyer cet ordre, cela va sans dire, que le jour où nous aurions, l’un ou l’autre, un titre à une part de l’héritage Valcresson.
Notre premier soin, en arrivant à Paris, fut donc de nous mettre à la recherche de la famille de ce dernier, dans le but de connaître la position et de pénétrer les secrets de chacun de ses membres, afin d’en tirer parti. Vous avez ainsi l’explication du hasard qui me fit me rencontrer avec vous dans l’affaire de la comtesse de Sinabria, hasard heureux pour celle-ci, puisque sans moi elle serait aujourd’hui au fond de la cave des époux Claude. Notre attention se fixa ensuite sur deux autres familles, les Taureins et les Mauvillars, ceux-ci en vue de Tatiane, future héritière de Pierre Valcresson, car elle n’était pas autre chose pour moi avant le jour où je la vis au bal donné par son oncle : les Taureins, dans l’espoir d’une catastrophe, inspirée par sa liaison avec Nanine la Rousse, créature redoutable dont on pouvait tout espérer, qui, par l’appât d’une fortune pouvait se laisser entraîner à tout, même à la complicité d’un meurtre déjà tout préparé et si habilement combiné, qu’en supprimant M. Taureins, on laissait planer tous les soupçons sur sa femme, qui, désormais à notre discrétion, se trouvait dans l’impossibilité de refuser la main de Mac-Field.
M. Badoir écoutait sir Ralph avec une stupeur qui alla bientôt jusqu’à l’hébétement.
Cet amas de crimes, de combinaisons monstrueuses, entassés, enchevêtrés l’un dans l’autre, lui produisait l’effet d’un effroyable cauchemar et, aux regards hallucinés qu’il promenait autour de lui, on eût dit que sa raison commençait à s’égarer.
— Mais tout cela est horrible, tout cela est révoltant, s’écria-t-il en se frappant enfin le front avec désespoir.
— Je ne dis pas le contraire, répliqua sir Ralph, mais tout cela est dépassé par deux drames effroyables qui ont pour titre : l’un, la Comtesse de Sinabria ; l’autre, Louise Prévôt et la petite Jeanne, et l’auteur de ces deux drames, vous le connaissez, monsieur Badoir.
Le banquier courba la tête.
— Je poursuis, reprit sir Ralph. L’une des deux affaires que nous avions combinées et qui devait nous assurer à chacun une part dans l’héritage Valcresson, l’affaire Taureins, est ratée, quant à présent du moins, par suite de la trahison d’un individu sur lequel nous comptions et qui a tout fait manquer par sa folle passion pour madame Taureins. C’est un Allemand du nom de Goëzmann, très-fin, très-roué, que l’amour a rendu imbécile et qui, en fait de faveurs, a reçu à travers le visage deux coups de cravache qui l’ont défiguré pour toujours. Ce châtiment lui a été infligé par un homme dont je vous ai déjà parlé, M. Portal, notre ennemi et le vôtre.
— Je n’ai pas eu affaire à cet homme, répliqua vivement M. Badoir, et je ne vois pas pourquoi…
— Vous le trouveriez sur votre chemin ? Vous l’y rencontrerez cependant, gardez-vous d’en douter. C’est lui qui a pénétré le complot organisé contre madame Taureins par la marquise de Santarès et son propre mari ; c’est lui qui a sauvé cette jeune femme d’un supplice qui, pour une nature délicate et fière comme la sienne, était cent fois pire que la mort, et j’ai quelques raisons de craindre qu’il ne soit au courant de l’affaire Sinabria. Heureusement toutes nos précautions sont bien prises de ce côté, je tiens la comtesse écrasée sous un amas de preuves qui la mettent si complètement à ma discrétion, que je défie qui que ce soit de l’arracher de mes griffes. Mais revenons : je dis donc que, sur deux affaires, il en est une qui nous échappe momentanément, car nous la reprendrons en sous-œuvre, et je ne désespère pas de voir un jour, bientôt peut-être, madame Taureins porter le beau nom de Mac-Field ; mais, quant à l’autre affaire, c’est-à -dire mon mariage avec mademoiselle Tatiane Valcresson, celle-là est en bonne voie, je suis sûr du succès, et c’est du jour où j’ai eu la certitude de compter bientôt parmi les héritiers de Pierre Valcresson, que j’ai écrit à notre ami Charles de verser enfin à celui-ci le poison apoplectique dont je viens de vous parler et qui, à cette heure, a fait son office.
Après un long silence, sir Ralph reprit :
— Mais ce n’est pas tout : il est une autre affaire dont je ne vous ai rien dit jusqu’à présent.
— Encore ! s’écria M. Badoir avec effroi.
— Oh ! rassurez-vous, il s’agit d’un personnage qui vous inspire peu d’intérêt.
— Son nom ? demanda le banquier.
— M. Pontif.
— Pontif ! Que lui voulez-vous ? À quoi peut-il vous servir ? Que voulez-vous tirer de lui ?
— M. Pontif et Tatiane Valcresson représentent à eux deux une tête dans l’héritage à venir, soit environ quatre millions à partager… et que je voudrais bien ne pas partager.
— Mais vous voulez donc sa mort ? s’écria M. Badoir hors de lui.
— Oh ! par des moyens doux, innocents, tout à fait anodins.
— Qu’entendez-vous par là ?
— J’ai imaginé tout un système de petites persécutions destinées à le rendre d’abord imbécile ; et il en est si peu éloigné qu’il y aura peu de choses à faire pour cela. Une fois idiot, il s’affaissera peu à peu et finira par s’éteindre tout doucement, sans même s’en apercevoir. Voyons, monsieur Badoir, est-il une fin plus enviable que celle-ci, et croyez-vous que mon procédé ne soit pas plein d’humanité, comparé à celui que vous avez employé vis-à -vis de la petite Jeanne ?
Le banquier frissonna à ce nom.
— Je vous en supplie, monsieur, dit-il à sir Ralph, cessez de me rappeler cet horrible souvenir, vous ne savez pas comment cela s’est passé et je vous jure que je suis moins coupable que vous ne pensez.
— C’est possible, je ne suis pas votre juge et ne tiens nullement à creuser l’affaire. Quant à M. Pontif, je dois vous dire qu’il est venu à ma connaissance une nouvelle qui rend son cas fort grave et me force à m’occuper de lui dans le plus bref délai.
— Qu’est-ce donc ?
— Il songe à se marier.
— C’est impossible, il a soixante-sept ans.
— Vous savez bien que c’est son idée fixe, et cette fois la chose prend des proportions sérieuses, car il s’agit d’une jeune élève du Conservatoire qui veut un époux riche à tout prix et aussi rapproché de la tombe que possible. Quant à mon exécuteur des hautes œuvres, spécialement chargé desdites persécutions, il vous est connu, c’est Arthur, le digne fils des époux Claude. Je lui ai loué une petite chambre au cinquième et dernier étage, juste au-dessus de M. Pontif, il s’y est installé dès hier et a déjà dû commencer à travailler celui-ci.
Voilà où nous en sommes. Maintenant, monsieur Badoir, résumons-nous.
XXXV
UNE TRANSFORMATION
Cet entretien semblait mettre M. Badoir à la torture.
Après s’être rendu coupable des crimes que nous avons fait connaître, il eût voulu les oublier, et peut-être était-il parvenu à se persuader qu’ils n’existaient pas à force de les éloigner de sa pensée.
Mais voilà qu’au moment même où il avait réussi à endormir sa conscience, un homme venait brutalement tirer de l’oubli où il les avait ensevelis tous ces tableaux effrayants, voilà qu’il faisait impitoyablement défiler sous ses yeux, comme des fantômes menaçants, toutes ces victimes de sa cupidité, et qu’il secouait les remords au fond de son âme, qu’ils remplissaient de cris et de sanglots.
Alors, pour la première fois peut-être, il avait eu horreur de lui-même et s’était senti glacé d’épouvante à la pensée de tout ce qu’il avait fait.
Ce fut donc avec un mélange de crainte et de colère qu’il s’écria :
— Oh ! assez, sir Ralph, assez sur ce sujet, je vous en supplie.
— Non pas, s’écria celui-ci, il faut que je résume les faits accomplis et que je fasse à chacun sa part dans l’héritage, proportionnée aux services rendus.
Reconnaissons tout d’abord que cet héritage nous échappait à tous, si Louise Prévôt et son enfant eussent vécu ; car il est incontestable que Pierre Valcresson eût reconnu l’une et épousé l’autre et qu’il eût laissé son immense fortune à celle-ci. C’est donc vous, monsieur Badoir, qui, en déterminant la folie, puis la disparition de la mère, en enlevant l’enfant et en la mettant dans l’impossibilité de révéler ni son nom, ni sa demeure, ni aucun détail pouvant établir son identité, nous avez conservé les millions de l’oncle Valcresson. Je sais bien que j’ai rendu moi-même un immense service à l’association en fixant à bref délai le partage de cette immense fortune dont nous n’eussions jamais vu un sou peut-être sans le parti énergique auquel je me suis décidé ; mais, enfin, il faut bien reconnaître qu’il n’y avait plus rien à faire et que tout était perdu pour nous sans l’heureuse inspiration de M. Badoir concernant Louise et la petite Jeanne. Donc, pour récompenser notre digne associé suivant ses mérites et l’importance du service rendu, je propose qu’une fois le partage fait nous lui allouions un million sur ce qui nous reviendra à Mac-Field et à moi.
— Adopté, dit Mac-Field.
— Je n’en veux pas ! je n’en veux pas ! s’écria M. Badoir en se levant tout à coup en proie à une espèce de vertige.
— Nous comprenons tout ce qu’il y a de généreux dans ce refus, répliqua sir Ralph avec une admiration ironique ; mais nous avons trop le sentiment de la justice, pour ne pas persister dans notre détermination.
— Votre sentiment de justice, oh ! je n’en suis pas dupe, dit le banquier, cette récompense n’a d’autre but que d’établir ma complicité dans l’assassinat de Pierre Valcresson et dans tous les crimes que vous avez commis.
— Il y a un peu de vrai dans ce que vous dites là , monsieur Badoir, répliqua sir Ralph, et je dois reconnaître que vous ne manquez pas de perspicacité, mais remarquez qu’en vous forçant, par ce moyen, à accepter une part de la responsabilité de nos… actes, nous prenons notre part des vôtres, puisque cette complicité, une fois constatée, nous rend tous trois solidaires l’un de l’autre, et avouez que si l’on pouvait analyser exactement la qualité de toutes nos petites infamies, tout l’avantage serait de votre côté dans ce partage forcé. Mais je crois voir où le bât vous blesse, et je vais vous le dire.
Quand vous poussiez la comtesse de Sinabria vers la trappe du bouge de la rue de Vanves, quand vous jetiez la petite Jeanne entre les mains de la mère Claude pour qu’elle en fît ce que vous savez, vous n’aviez qu’un complice, qui avait le même intérêt que vous à garder le silence, et qui, une fois désintéressé par vous, moyennant une petite rente viagère, vous laissait jouir en paix, sans trouble et sans inquiétude, du fruit de vos travaux. Alors, pour peu que vous ayez les instincts bucoliques et que vous partagiez le goût bien connu des gens vertueux pour le lever de l’aurore, vous vous retiriez dans quelque splendide campagne, ornée d’un beau parc aux arbres séculaires, et là vous finissiez tranquillement vos jours, si calme, si parfaitement heureux, si bien entouré de l’estime et de la considération générales, que vous finissiez vous-même par vous y laisser prendre et par considérer le passé comme un rêve. Voilà la douce et commode existence que vous vous étiez arrangée, voilà le charmant et confortable édifice que vous aviez bâti sur les larmes, le désespoir, les tortures, la mort de quelques victimes sacrifiées à votre bonheur, et il faut avouer que c’était très-séduisant. Mais, hélas ! nous paraissons, nous venons nous mêler à vos petites affaires, et d’un souffle nous dispersons à tous les vents cette gracieuse oasis que vous habitiez déjà en songe.
Au lieu d’un complice subalterne, soumis, facile à reléguer dans quelque coin au prix d’un faible sacrifice, vous vous trouvez associé, indissolublement lié à deux hommes résolus, déterminés, marchant toujours en avant, vous traînant à leur suite, de gré ou de force, dans la voie sinistre déjà parcourue, et bien décidés à ne s’arrêter que le jour où ils atteindront le but déjà marqué dans le livre des destins : la fortune ou l’échafaud.
À ce dernier mot, M. Badoir se leva d’un bond, s’élança à l’autre extrémité de la pièce en proie à un vertige qui faisait claquer ses dents et trembler tous ses membres, et se blottissant dans un coin, l’œil hagard et les traits bouleversés :
— Non, non ! s’écria-t-il d’une voix étranglée, je ne veux pas, je ne veux pas vous suivre, je ne veux pas de complicité, je ne veux rien, je renonce à tout, prenez tout.

Et, se ramassant tout à fait sur lui-même, comme s’il eût espéré disparaître tout à fait, il plongea sa tête dans ses deux mains comme pour échapper à cette terrible vision de l’échafaud qu’on venait de faire flamboyer devant son imagination et balbutia tout bas :
— Je ne veux rien, laissez-moi, laissez-moi, je ne veux rien !
Sir Ralph le regarda quelques instants avec une pitié méprisante.
Puis il reprit :
— Mais, nous, monsieur Badoir, nous sommes de loyaux complices, nous ne sommes pas gens à rompre une association librement contractée par tous au moment même où elle va produire ses résultats ; non, non ! vous nous avez mal jugés si vous nous avez crus capables d’une telle indélicatesse, nous respecterons jusqu’au bout le contrat qui nous lie, nous partagerons avec vous ce que nous avons gagné avec votre concours si intelligent, si actif, et le partage sera égal, sauf la prime d’un million que nous vous attribuons, mon ami Mac-Field et moi, et que vous avez si bien méritée.
M. Badoir était comme foudroyé.
Il releva enfin la tête et, tournant vers sir Ralph des yeux dans lesquels on eût cru voir passer les piles lueurs de l’agonie.
— Écoutez, lui dit-il, je viens de vous dire que je renonçais à tout, que je ne voulais rien de l’héritage de Valcresson, eh bien…
Il passa la main sur son front comme si ses idées lui échappaient.
Il reprit enfin :
— Eh bien, écoutez : je vous abandonne jusqu’à ma part, jusqu’à ce qui me revient, à moi, légalement, et je ne vous demande en échange que de rompre notre association et de me rendre ma liberté, voilà tout. Vous ne pouvez repousser une pareille proposition, vous avez tout avantage à l’accepter, n’est-ce pas ?
Sir Ralph se fit un cruel plaisir de faire attendre sa réponse au banquier qui dardait sur lui des regards pleins d’anxiété.
— Eh bien, mon cher monsieur Badoir, dit-il enfin, nous ne pouvons accepter cette offre généreuse et vous allez comprendre pourquoi.
— Vous refusez ! vous refusez ! s’écria le banquier avec l’expression du plus violent désespoir.
Puis, quittant brusquement la place où il se tenait accroupi, et s’élançant d’un bond vers sir Ralph qui se tint sur ses gardes, le croyant devenu tout à coup fou furieux.
— Écoutez, écoutez, balbutia-t-il d’une voix stridente, saccadée, et que le tremblement continuel de sa mâchoire rendait presque inintelligible, j’ai une autre proposition à vous faire, et celle-là , il est impossible que vous ne l’acceptiez pas.
— Voyons cela, répondit sir Ralph d’un ton calme et froid qui tranchait avec la violente agitation du banquier.
— Voyons, reprit M. Badoir, vous êtes un homme de sens, d’intelligence, et il est impossible que vous ne compreniez pas.
— Au fait, monsieur Badoir, au fait, lui dit tranquillement sir Ralph.
— Eh bien, voilà ! les combinaisons les plus habiles échouent bien souvent, il en peut être ainsi de celle qui doit nous livrer les millions de Valcresson. Eh bien, rendez-moi ma liberté, et outre tous mes droits sur cette fortune éventuelle, je vous donne les trois quarts de la mienne, c’est-à -dire, un million.
Et, le regard ardemment fixé sur sir Ralph, il attendit sa réponse comme si c’eût été un arrêt de vie ou de mort.
XXXVI
UNE VOIE DANGEREUSE
Sir Ralph commença par éclater de rire.
— Parbleu ! monsieur Badoir, dit-il enfin, il faut avouer que vous donnez en ce moment un curieux spectacle. Depuis dix ans vous couvez l’héritage de votre parent et ami Pierre Valcresson, depuis dix ans vous amassez crimes sur crimes, atrocités sur atrocités, pour atteindre ce but, qui est devenu votre idée fixe, et, au moment de réaliser ce rêve, si longtemps et si ardemment poursuivi, quand, par un hasard inouï, inespéré, l’homme dont vous convoitez la fortune meurt tout à coup, au lieu de vous la faire attendre vingt ans encore, comme vous deviez le craindre, voilà que vous renoncez brusquement à cet héritage ! Et ce n’est pas tout : non-seulement vous ne voulez plus toucher un sou de ces millions qui vous donnaient le vertige, mais vous poussez tout à coup le mépris des richesses jusqu’à vouloir vous dépouiller de presque toute votre fortune, fortune acquise longuement, patiemment, à force de travail, d’économie, d’usure et de privations. Allons, allons, voilà une étrange conversion, avouez-le, monsieur Badoir.
— Je vous l’ai dit, répliqua le banquier, il n’est pas de sacrifices que je ne fasse pour reprendre ma liberté, pour rompre l’association qui nous lie, pour vous laisser, avec tous mes droits à l’héritage Valcresson, toute la responsabilité de ce qui a été fait en vue de cette fortune. Je vous en supplie, sir Ralph, ne repoussez pas ma proposition, et, si ce n’est pas encore assez, eh bien ! prenez tout et laissez-moi cinq ou six mille livres de rente, de quoi vivre ignoré dans quelque coin.
— Désolé, monsieur Badoir, reprit sir Ralph, mais je ne puis vous accorder votre demande.
À cette réponse, M. Badoir chancela et s’appuya sur un meuble, comme saisi d’un étourdissement.
— Je comprends, balbutia-t-il, vous voulez ma perte.
— Nullement, et je vais vous expliquer le motif de ma résolution. Je compte être l’époux de Tatiane avant trois semaines et nous ne recevrons pas avant cette époque la nouvelle de la mort de Pierre Valcresson. Mais supposons un instant que je vienne à échouer dans la combinaison que j’ai imaginée pour forcer la jeune fille à m’accorder sa main, supposition que je considère comme tout à fait invraisemblable depuis quelques jours surtout, mais qu’il est toujours prudent d’admettre, quels seraient nos titres pour aller réclamer quelque chose de cet héritage, qui est notre œuvre, puisque sans nous, je le répète, on l’eût attendu vingt et peut-être trente ans encore, c’est-à -dire jusqu’à la mort, inclusivement, de tous les cohéritiers ? Nous n’aurions qu’à nous croiser les bras et à regarder ceux-ci se partager en paix cette fortune que nous aurions jetée dans leurs mains en risquant notre tête. Vous, au contraire, vous pourriez faire valoir hardiment vos droits, plaider au besoin et récolter en grande partie du moins tout ce que nous avons semé ; vous voyez donc bien qu’il est de notre intérêt absolu de vous conserver comme associé et de vous laisser votre part de responsabilité comme stimulant.
Mais j’ai encore un autre motif pour vous garder parmi nous.
— Lequel ? demanda le banquier avec inquiétude.
— Toujours en cas d’échec près de Tatiane, je veux vous avoir là , sous la main, pour vous charger de décider la jeune fille à m’accepter pour mari. Retenez bien ceci, monsieur Badoir, il me faut Tatiane, d’abord parce que je l’aime, ensuite parce que ce mariage nous offre un gage de sécurité contre les poursuites auxquelles nous sommes incessamment exposés, Mac-Field et moi, et dont les conséquences seraient le déshonneur de la famille Mauvillars et votre perte, à vous, monsieur Badoir, car, sachez-le bien, pour votre gouverne, le jour où nous tomberions sous la main de la justice, le jour où notre tête serait en jeu, nous n’hésiterions pas un instant à vous entraîner avec nous dans l’abîme.
M. Badoir était atterré.
Les motifs que faisait valoir sir Ralph lui démontraient clairement qu’il était rivé pour toujours à ces deux hommes.
— Mais, reprit-il, toujours en proie à un trouble profond, ce n’est pas seulement pour tout ce qui concerne l’affaire Valcresson que vous avez à redouter les poursuites de la justice, il en est une autre, à laquelle je suis complètement étranger, le meurtre des époux Christiani.
— Pour lequel, je vous l’ai dit, deux détectives ont été envoyés de New-York à Paris et nous recherchent activement à cette heure. Non, vous n’êtes pour rien dans cette affaire ; mais, puisque nous avons mis en commun tous nos petits délits, pourquoi ne pas ajouter celui-ci à la masse commune ? C’est ce que nous avons décidé, Mac-Field et moi, et de même que nous acceptons la responsabilité de ce que vous avez commis seul contre Louise Prévôt et son enfant, vous voudrez bien endosser celle de l’affaire Christiani.
— Que voulez-vous dire ? demanda M. Badoir en attachant sur sir Ralph un regard terrifié.
— Je veux dire que, tout devenant désormais commun entre nous, nous comptons sur vous pour nous sauver de ce danger.
— Mais je ne puis empêcher qu’on ne vous découvre, s’écria le banquier.
— C’est surtout pour nous mettre à l’abri de ce désagrément que nous avons conçu la pensée de créer la maison Badoir et C°, où nous nous croyons parfaitement à l’abri de toutes les recherches.
— Mais, enfin, si cette précaution ne suffisait pas ?
— J’en serais désolé pour nous d’abord et on ne peut plus contrarié pour vous, mon cher monsieur Badoir.
— Pour moi ? mais cela ne me regarde pas, vous ne pouvez pourtant pas m’accuser de complicité dans un meurtre qui s’est accompli à New-York, où je n’ai jamais été et à une époque où je ne vous connaissais pas.
— C’est absolument impossible, vous avez raison ; mais, comme on n’a qu’une tête à perdre, une fois condamnés, nous sommes décidés à entrer dans la voie des aveux, comme disent les journaux, et alors nous dirons tout, non-seulement en ce qui concerne le meurtre des époux Christiani, mais aussi au sujet de l’affaire Valcresson, sans oublier aucun des épisodes qui s’y rattachent, ne doutant pas que le tribunal, touché de tant de franchise, ne signe immédiatement un recours en grâce, ou tout au moins une commutation de peine en notre faveur.
— Oh ! mais c’est affreux ! c’est affreux ! s’écria M. Badoir en se laissant tomber sur un siège avec accablement.
— Oui, reprit sir Ralph avec un sourire ironique, la situation que nous vous faisons s’éloigne singulièrement de la douce et calme existence que vous aviez rêvée et que nous sommes venus troubler si brutalement. Mais, que voulez-vous ? Nous avons fait notre rêve aussi, nous, et il faut que l’un des deux soit sacrifié à l’autre. Notre rêve, notre idée fixe, à nous, c’est de sauver notre tête, et c’est sur vous que nous avons jeté les yeux pour cela. Or, du moment où vous serez bien convaincu que votre tête et la nôtre doivent tomber dans le même panier, je suis sûr que nous pourrons compter sur votre dévouement et que vous veillerez sur nous avec la même sollicitude que si nous étions vos enfants.
— Mais ce que vous faites là est odieux, s’écria le banquier avec désespoir. Vous êtes recherchés tous deux en ce moment par la police américaine, dont les agents peuvent vous découvrir demain, aujourd’hui, dans une heure peut-être, et vous voulez me rendre responsable de cette arrestation. Voyons, réfléchissez, que voulez-vous que je fasse pour l’empêcher ? Changez les rôles, mettez-vous à ma place, que feriez-vous ?
— Je l’ignore complètement, et il est probable que je serais fort embarrassé, répondit tranquillement sir Ralph, mais on est bien fort quand on a sa tête à défendre, et, dès que la vôtre est intéressée dans l’affaire, je suis sûr que vous accomplirez des miracles pour épier, veiller, prévoir et éloigner, par tous les moyens imaginables, le péril que nous redoutons. C’est une immense responsabilité pour vous, monsieur Badoir, j’en conviens, et il y a dans cette combinaison quelque chose qui choque la justice et même le bon sens, c’est incontestable, mais quelle sécurité pour nous, de quel rempart de sollicitude vous allez nous entourer désormais ! Considérez la question à ce point de vue et vous conviendrez que c’est une heureuse inspiration, que nous avons eue là .
M. Badoir comprit enfin qu’il était inutile de discuter et de supplier davantage.
Il se tut et resta sombre et immobile dans son fauteuil.
On frappa en ce moment.
C’était le domestique de M. Badoir, qui entra et remit une carte à sir Ralph.
Celui-ci y jeta un coup d’œil. Le nom inscrit sur cette carte était Goëzmann.
— On attend ? demanda sir Ralph.
— Oui, monsieur, dans le cabinet.
— C’est bien.
Il sortit et se rendit dans le cabinet de M. Badoir.
L’Allemand était là , plus hideux que jamais avec sa figure balafrée de deux larges lignes rouges.
Ses traits blafards exprimaient en ce moment une joie féroce.
— Eh bien ! lui demanda sir Ralph, quoi de neuf ?
— J’ai découvert sa demeure, dit l’Allemand d’une voix sifflante.
— La demeure de qui ?
— De madame Taureins.
— Parfait, et son adresse ?
— Chez notre ami !
— M. Portal ?
— Oui, de sorte que notre haine pourra les viser tous deux à la fois.
— Suivez-moi, nous allons nous entendre avec Mac-Field.
Et ils sortirent tous deux.
XXXVII
DEUX VIEUX AMIS
Nous avons des raisons pour ne pas faire assister le lecteur au conciliabule qui se tint ce soir-là , au sujet de madame Taureins, entre sir Ralph, Mac-Field et l’Allemand Goëzmann, devenu l’ennemi mortel de la jeune femme et de l’homme qui lui avait infligé un si rude châtiment.
Franchissons un intervalle de vingt-quatre heures et dirigeons-nous vers la rue Duperré, entre quatre et cinq heures.
Là nous assistons à la rencontre de deux personnages assez équivoques de mine et de mise, qui jettent un cri de surprise en s’apercevant l’un l’autre.
— Père Vulcain !
— Arthur !
Le pâle voyou de la rue de Vanves est méconnaissable.
Il a échangé sa blouse, son pantalon de toile et sa casquette plate contre une redingote vert pomme, un gilet jaune ouvert, un pantalon à plis, dit à la Jocko, et un chapeau tromblon, le tout à la dernière mode de 1840, acheté seize francs cinquante chez un marchand de bric-à -brac.
Aussi excite-t-il la stupeur du père Vulcain, qui tourne autour de lui avec une respectueuse admiration.
— Peste ! murmure-t-il, plus que ça de garde-robe ! Excusez du peu ; ah çà , mais tu as donc fait un héritage ?
— Non, répond Arthur d’un air suffisant, j’ai trouvé un emploi.
— Bah ! auditeur au conseil d’État.
— Non, je suis déjà auditeur à l’Ambigu, ce serait du cumul.
— Enfin, quel est ton emploi ?
— Gêneur.
— Hein ? tu dis ?
— Gêneur.
— J’en connais beaucoup, mais ils ne sont pas payés pour ça.
— Ils ne sont pas malins !
— Enfin, explique-moi…
— Volontiers, mais j’ai comme un commencement de pépie ; si nous écrasions un grain ?
— Ça me flatterait ; mais, pour ce qui est de la braise, je ne crains pas de l’avouer, les toiles se touchent.
— N’y a pas d’affront, répliqua le gamin.
Et, avec un geste plein de fatuité, il plongea les mains dans les poches de son pantalon à plis et les secoua fortement.
Il en sortit un son argentin qui fit dresser l’oreille au vieux modèle.
— Pas possible ! cria-t-il, t’as donc tes grandes entrées dans les caves de la Banque de France ?
— Faudrait me donner la peine de me baisser pour ramasser l’or ; je laisse ce soin à mon bailleur de fonds.
Tout en causant, ils étaient arrivés à la porte d’un marchand de vin.
— Honneur au dieu Plutus ! dit le vieux modèle, qui, ayant posé successivement pour tous les dieux de l’Olympe, se flattait de connaître sa mythologie.
Et il se rangea sur le seuil pour laisser passer Arthur.
— Je n’en ferai rien ; à vous la pose, répliqua celui-ci, en s’effaçant à son tour avec une exquise urbanité.
Cet assaut de politesse se termina comme de coutume, c’est-à -dire qu’ils finirent par entrer tous les deux à la fois.
Quand ils furent installés dans un petit cabinet et devant une chopine d’absinthe, car c’était aussi la liqueur favorite d’Arthur, ce dernier prit ainsi la parole :
— Vous connaissez sir Ralph, père Vulcain ?
— À preuve que pas plus tard qu’hier, nous causions comme une paire d’amis chez le marchand de vin du coin ; un bon zigue, sir Ralph !
— Donc, l’autre jour, il vient nous rendre une visite, et, après avoir présenté ses hommages à ma mère, sans aller toutefois jusqu’à lui baiser la main, il me dit tout aussitôt, comme dans je ne sais plus quelle pièce de l’Ambigu : Arthur, as-tu du cœur ?
— Dame ! que je réponds, pas au point d’en être gêné, mais enfin, quand il en faut, on sait où le trouver.
— Ce peu suffit pour la circonstance ; or voilà ce dont il s’agit : j’ai un vieil ami qui a une singulière maladie ; son sang s’épaissit considérablement, mais à ce point qu’il finirait par s’arrêter dans ses veines s’il n’était fortement secoué par de continuelles émotions, bonnes ou mauvaises, peu importe, mais pourtant, mauvaises de préférence, ce sont les plus efficaces, c’est l’avis du médecin.
— En voilà une drôle de maladie ! que je m’écrie en regardant sir Ralph dans les deux yeux.
— Eh bien, Arthur, reprend sir Ralph, c’est sur toi que j’ai compté pour faire circuler le sang de mon vieil ami dans ses vieilles veines.
— Je le ferai circuler de mon mieux, dis-je à sir Ralph, mais c’est la première fois qu’on m’emploie à ce genre de…
— Tu es intelligent, un peu d’imagination suffit pour trouver des motifs d’émotion, je sais que je puis compter sur toi.
— Bon, mais où demeure-t-il votre vieil ami ?
— Rue Duperré, 17.
— Et vous l’appelez ?
— M. Pontif.
— C’est bon, j’irai flâner par là et je verrai…
— Du tout, s’écrie sir Ralph, je t’ai loué une chambre dans la maison, au-dessus de son appartement.
— Pas possible ! Je serai logé ?
— Et meublé comme un prince.
— C’est un rêve.
— Plus trois francs par jour pour la nourriture et les distractions.
— Trois francs ! à moi ! à moi tout seul ! pour en faire ce que je voudrai ?
— Absolument.
— Dans mes bras !
Il refusa de s’y précipiter et ajouta en me tenant à distance :
— Sans compter les gratifications que tu tireras de M. Pontif, auquel tu pourras rendre bien des petits services et qui les acceptera sans défiance, car il a la candeur d’un enfant.
— Suffit, j’en abuserai.
— Ah ! j’allais oublier ; il y a dans la maison une jeune élève du Conservatoire et sa mère, qui ont des idées matrimoniales à l’endroit de M. Pontif, c’est là que l’infortuné puise ces émotions douces qui lui sont si fatales. Il s’agit de jeter beaucoup de bâtons dans les roues de ce côté.
— On en jettera.
Et sir Ralph, qui en affaires a toujours l’habitude d’éclairer, se fendit de vingt-cinq francs en me disant :
— Il faudrait voir à changer de frusques, une tenue décente est de rigueur pour inspirer la confiance.
— Pour lors, j’ai songé à un marchand de bric-à -brac dont la boutique n’a pas d’apparence, mais qui, dans son arrière-magasin, tient tout ce qu’il y a de plus chouette en fait de vêtements d’homme. Ce n’est pas la mode d’hier, ni même celle d’aujourd’hui qu’on trouve chez lui, c’est celle de demain. En effet, en sortant de sa boutique, j’allai promener mon vêtement au boulevard des Italiens, et je n’en ai pas trouvé un seul pareil au mien ! misère ! ils étaient tous en retard de vingt-quatre heures. Aussi, quand je suis allé étrangler un perroquet chez Tortoni, me regardaient-ils tous avec des éclats de rire qui dissimulaient mal l’envie que je leur inspirais, et ce n’est vraiment pas trop cher, le vêtement complet, chapeau compris, seize francs cinquante. On m’a assuré que c’était plus cher chez Dusautoy.
— Eh ! bien, non, ce n’est pas trop cher, s’écria le père Vulcain en examinant Arthur des pieds à la tête ; car, ma parole d’honneur ! tu es pourri de chic, un vrai fils de famille, quoi !
Puis il s’écria en se touchant le front :
— Mais j’y pense, tu dis que ce monsieur près duquel tu vas jouer le rôle de gêneur demeure rue Duperré ?
— Oui, père Vulcain.
— Numéro ?
— 17.
— C’est bien cela ; eh bien, c’est là aussi que demeure mon fils.
— Ah ! oui, un peintre ; j’ai entendu parler de ça.
— Même que j’allais chez lui quand je t’ai rencontré.
— Je croyais qu’il y avait du froid entre vous.
— Et tu ne te trompais pas ; mais, que veux-tu ? on a un cœur de père.
— Et les toiles qui se touchent, ajouta Arthur en riant.
— Arthur, tu es un sceptique, le sentiment paternel parle seul en moi.
— Ça ne m’étonne pas, vous êtes capable de tout, père Vulcain, même de pardonner à votre fils, qui doit avoir les plus grands torts envers vous.
— Ils sont oubliés, déclama le vieux modèle avec un geste plein de noblesse.
— Père Vulcain, je vous étreindrais si je ne craignais de froisser ma chemise, que j’ai mise toute blanche il y a huit jours.
Il ajouta, en tirant une pièce de cinq francs de la poche de son pantalon :
— Mais assez causé comme ça ; il faut que je me rende près de M. Pontif, qui m’avait prié de lui rapporter du tabac de la Civette et dont le nez doit s’impatienter.
— Eh bien, dit le père Vulcain, nous allons faire route ensemble, puisque je me rends chez mon fils.
Arthur avait frappé violemment sur la table avec sa pièce de cinq francs.
Quand le garçon parut, il la lui jeta avec un geste royal en lui disant :
— Payez-vous, garçon.
Le garçon sortit.
— Et ta mère ? demanda le modèle.
— Elle est mélancolique.
— Pourquoi ça ?
— Elle avait l’habitude de nous battre, ma sœur et moi, chaque fois qu’elle se piquait le nez, c’était sa manie, à cette pauvre vieille.
— Eh bien ?
— Eh bien, ma sœur est femme de chambre et moi j’ai quitté ma bonne mère pour m’occuper de M. Pontif.
— Je comprends.
— N’ayant plus personne sous la main, elle a voulu se rattraper sur mon père.
— Et alors ?
— La première fois papa y a écrasé le nez d’un coup de talon de botte.
— Fichtre !
— La seconde fois il y a démoli la mâchoire par le même procédé ; plus de quenottes sur le devant, son jeu de dominos est très-incomplet.
— Pas de chance !
— Ça l’a dégoûtée du jeu.
— De sorte qu’elle ne bat plus personne ?
— Et voilà la cause de sa mélancolie.
Le garçon rapportait la monnaie.
Arthur lui octroya deux sous et sortit, suivi du père Vulcain.
XXXVIII
LES PETITES MISÈRES DE M. PONTIF
Quelques instants après, le père Vulcain pénétrait dans la maison habitée par son fils.
Il était toujours accompagné de son ami Arthur.
— Bonjour, m’ame Cither, dit le jeune voyou à la concierge, grosse commère à la figure rubiconde et renfrognée, dont le menton, orné d’une petite forêt de poils jaunâtres, achevait de lui donner une ressemblance avec un bouledogue.
— Bonjour, monsieur Arthur, répondit madame Cither en continuant de balayer sa loge, eh bien ! ce bon M. Pontif…
Elle s’interrompit tout à coup pour adresser la parole à une locataire qui rentrait et qui filait devant sa loge avec l’intention évidente de passer inaperçue.
Mais si madame Cither avait la tête du bouledogue, elle avait l’œil du lynx, et, de plus, la langue de la vipère, ce qui constituait un phénomène assez singulier, mais moins rare qu’on ne pense et dont on trouve même de nombreux exemples dans les loges de Paris.
Peut-être faut-il attribuer cette bizarrerie à l’air méphitique qu’on y respire.
La locataire n’échappa donc pas à l’œil de lynx de la concierge qui, se penchant en dehors de sa porte, lui cria avec un affreux sourire :
— Eh ! bonjour, madame Torchebœuf, comment allez-vous aujourd’hui ? Et mademoiselle Torchebœuf, est-elle contente ? J’ai entendu parler de ses succès au Conservatoire ; j’ai vu ça dans le Figaro, où il n’est question que de mademoiselle Torchebœuf.
La locataire se retourna vivement et le teint enflammé, l’œil étincelant de colère :
— Madame Cither, s’écria-t-elle…
Mais soit que la colère l’étouffât, soit qu’elle reconnût l’impossibilité d’articuler son grief contre la concierge, elle s’interrompit net et se mit à gravir rapidement l’escalier.
— Qu’a-t-elle donc ? demanda Arthur à la concierge.
— Je le sais bien ce qu’elle a, répondit celle-ci en aspirant bruyamment une prise de tabac, dont la moitié resta dans ses moustaches jaunes, elle n’aime pas qu’on l’appelle par son nom. Dame ! est-ce que c’est ma faute, à moi ? C’est-y son nom, c’est-y pas son nom ? Je ne peux pourtant pas l’appeler Montmorency quand elle s’appelle Torchebœuf. Et ajoutez à ça que c’est la veuve d’un boucher. Ah ! ah ! ah ! j’en ris comme une petite folle. Ah ! oui, que sa fille a eu un succès au Conservatoire, quelle veste, mes enfants, quelle veste ! ils en ont assez rigolé au Figaro. Elle dit que sa fille a cent mille livres de rente dans le gosier ; ils sont tout au fond alors, car jusqu’à présent il n’en sort que des chats, une vraie gouttière, quoi ! On n’en avait jamais tant vu au Conservatoire ; on se demande quand ce sera épuisé. C’est pourtant pas l’assurance qui lui manquait, malheur ! Si jamais elle tombe malade, ce ne sera pas d’un accès de pudeur ! Ah ! pauvre M. Pontif ! En voilà un qui en verra de toutes les nuances de l’arc-en-ciel ! Il n’est que temps qu’il les tire de la dèche : ça porte des fourrures, du velours, des ombrelles à canne, des talons Louis XV, des tignasses de cheveux dans le dos, et ça donne 10 francs à une pauvre concierge au jour de l’an ! 10 francs ! mais qu’elle les garde donc ses 10 francs, Dieu merci ! je suis au-dessus de ça.
— Bon ! murmura Arthur, je commence à comprendre.
Puis s’adressant à la concierge d’un ton plein de bonhomie :
— Voyons, madame Cither, ne vous gênez donc pas, dites tout ce que vous avez sur le cœur ; pourquoi vous contraindre ?
— Moi, répliqua la concierge, je n’ai rien à dire de mes locataires, les affaires des autres ne me regardent pas. Dieu merci ! je suis connue dans le quartier, on sait que je n’aime pas les potins ; mais faut pas qu’on fasse sa tête quand on n’a pas seulement de quoi donner des étrennes à sa concierge. Quant à son nom, de quoi se plaint-elle ? Eh bien, quoi ! elle est Torchebœuf, elle est Torchebœuf ! Est-ce que j’y puis quelque chose ?
Puis, changeant tout à coup de ton :
— Ah ! dites donc, vous, monsieur Arthur, vous avez comme un air de tourner autour de ma nièce ; je vous préviens que ça ne me va pas ; Louisette est une honnête fille, innocente comme l’enfant qui vient de naître, et si vous faisiez mine de la détourner, suffit, je viens de faire l’acquisition d’un manche à balai tout neuf, je ne vous dis que ça.
— Et ça me suffit, répondit Arthur, je respecterai l’innocence de Louisette, je le jure sur vos moustaches jaunes.
Et sans attendre la réplique de madame Cither, il s’élança dans l’escalier.
Le père Vulcain le suivait d’un pas plus modéré.
Au second étage, ils se rencontrèrent avec un personnage qui venait de sonner à une porte et qui se redressait de toute sa hauteur avant d’entrer, car la porte venait de s’ouvrir.
Une jeune fille, d’une mise excentrique et d’une tournure très-dégagée, était sur le seuil, adressant au visiteur un sourire des moins décourageants.
C’était mademoiselle Isoline Torchebœuf, la jeune élève du Conservatoire.
— Tiens, monsieur Pontif, s’écria Arthur.
Et, glissant la main dans la poche de sa redingote vert pomme :
— Je viens de la Civette, lui dit-il, et je vous apporte un quart de…
M. Pontif lui fit un signe qui signifiait clairement :
— Silence ! pas un mot de plus devant cette jeune fille.
— Hein ! quoi ? dit Arthur, qui avait parfaitement compris.
— Nous parlerons de cela plus tard, lui dit M. Pontif en faisant mine d’entrer.
— Non pas, prenez-le tout de suite, lui dit le gamin en lui mettant dans la main le petit paquet qu’il venait de tirer de sa poche, mademoiselle sait bien qu’à votre âge on a ses petites manies ; d’ailleurs, ça n’est pas sale de priser, quand on a soin de veiller sur sa roupie, et on peut dire que vous surveillez les vôtres, vous, monsieur Pontif, car, sauf celle de l’autre jour, qui a disparu tout à coup au moment où vous preniez votre café et qu’on n’a jamais pu savoir où elle était passée…
— Allons, assez, dit M. Pontif en s’emparant vivement du paquet de tabac qu’il fourra dans sa poche.
— Dame ! écoutez donc, reprit Arthur, on n’arrive pas comme ça à soixante-sept ans sans avoir quelques petites infirmités, et vous devez vous estimer heureux d’en être quitte pour cette maladie de peau…
— Imbécile ! murmura M. Pontif en lui jetant un regard de colère.
— Quant à votre râtelier, il ne vous gêne pas, n’est-ce pas ? reprit Arthur, c’est l’essentiel ; on n’a pas de coquetterie à votre âge, et, pourvu que ça fonctionne bien…
— Ah çà ! à la fin, voulez-vous me laisser la paix ? s’écria M. Pontif hors de lui.
— Mais qu’est-ce qu’il a donc ? qu’est-ce qu’il a donc ? murmura Arthur avec une naïveté parfaitement jouée.
Puis il ajouta, au moment où le vieillard allait disparaître :
— Monsieur Pontif ?
— Quoi, encore ? s’écria celui-ci.
— Je viens de passer chez la blanchisseuse, vous aurez votre corset demain matin ; quant à la sous-ventrière.
— Animal ! murmura M. Pontif en s’élançant vers mademoiselle Torchebœuf.
— On vous la livrera après-demain, en même temps que le plastron sudorifuge, si efficace contre les sueurs abondantes dont monsieur est affligé, lui cria Arthur avant que la porte ne se fût refermée.
Puis, éclatant de rire et se tournant vers le père Vulcain :
— Eh bien ! lui dit-il, si elle n’en est pas dégoûtée, ce ne sera pas ma faute. Mais ce n’est rien que cela, nous n’en sommes encore qu’aux roses ; nous allons nous y mettre sérieusement, et alors ça va être drôle.
— À quel étage demeures-tu ? lui demanda le vieux modèle.
— Au cinquième, juste au-dessus de M. Pontif pour avoir toujours l’œil sur lui. Et votre fils ?

![]()
— Au troisième.
— Nous y voilà .
— Alors, au revoir.
Et le père Vulcain frappait à une porte, tandis que son jeune ami continuait à monter.
— Entrez, cria-t-on de l’intérieur.
Vulcain s’aperçut alors que la clef était à la porte.
Il ouvrit et entra.
Jacques Turgis était seul et en train de travailler à sa copie, qui était presque terminée.
— Tiens, c’est toi, mon père, s’écria-t-il en s’avançant vers celui-ci, la main tendue, voici bien longtemps que tu n’es venu me voir.
— C’est vrai, répondit le modèle en pressant la main de son fils avec une expression d’humilité dont celui-ci parut touché.
— Pourquoi donc avoir tant tardé à venir, mon père ?
— Que veux-tu, répondit le père Vulcain en courbant la tête, je m’étais comporté comme un gueux, comme un chenapan, à ton égard, et quand j’ai compris enfin l’indignité de ma conduite, j’en ai été si honteux que je n’osais plus revenir.
— Tu avais tort, mon père, répliqua Jacques avec un accent plein d’effusion, et je suis d’autant plus heureux de te revoir, que tu me reviens, j’en suis sûr, entièrement converti.
— Ah ! je te le jure, mon cher Jacques.
Le jeune homme ajouta, en jetant un coup d’œil sur la blouse, le pantalon déchiré et les souliers éculés du vieux modèle :
— Nous allons passer aujourd’hui même chez mon tailleur.
— Ton tailleur ! Allons donc ! Non, mais chez un marchand d’habits, puisque tu es assez bon pour…
— Oh ! assez, mon père.
— Et en attendant que je trouve de l’ouvrage, des poses ou autre chose, reprit le père Vulcain de ce ton humble et repentant qui touchait si vivement son fils, je viendrai ici me réchauffer, le tenir compagnie et faire tes commissions, si tu le veux bien.
— Tu feras ce que tu voudras, mon père ; sauf le travail, auquel je m’oppose, tu es d’âge à te reposer, et je gagne assez pour subvenir à tes besoins.
— Excellent fils ! s’écria le modèle en pressant de nouveau la main de Jacques ; ah ! tiens, tu me fais rougir, tu méritais d’avoir un autre père.
— Bah ! oublions le passé, et maintenant que tu es rentré dans la bonne voie, ne songeons qu’au bonheur de nous voir réunis.
Il ajouta avec un sourire plein d’indulgence.
— Mais, j’y songe, voici l’heure de l’absinthe.
— L’absinthe, s’écria le père Vulcain avec un geste d’horreur, ne m’en parle jamais, c’est ce qui m’avait dégradé, j’y ai renoncé pour toujours ; sans ça, tu ne m’aurais jamais revu.
— Ah ! mon père, s’écria Jacques avec transport, si tu savais comme tu me rends heureux !
Et, se jetant dans ses bras, il le pressa fortement contre sa poitrine.
Il avait des larmes dans les yeux.
— Ah ! que c’est bon de faire son devoir, dit le modèle essuyant ses yeux parfaitement secs ; je commence à comprendre ça.
— Ah ! c’est maintenant, s’écria l’artiste en regagnant sa palette et ses pinceaux, c’est maintenant que je vais avoir du cœur à l’ouvrage !
XXXIX
PRÉPARATIFS
Le lendemain, vers la chute du jour, Arthur sortait pour se rendre au petit restaurant où il dînait tous les jours.
Pour vingt et un sous, il faisait là des repas de Sardanapale :
Potage, deux plats au choix, un dessert, un carafon de vin et pain à discrétion.
Et tout lui paraissait succulent. Jamais il ne s’était vu à pareille fête.
En descendant la rue Fontaine, où était situé ce restaurant phénoménal, il s’arrêta tout à coup devant les bocaux rouges et bleus d’un pharmacien.
Une inspiration venait de jaillir de son cerveau.
Il entra, se fit servir une drogue dont il sera parlé plus tard et sortit de là avec un sourire méphistophélique.
Puis, quelques pas plus loin, il entrait à son restaurant.
Il ne s’y trouvait encore que peu de clients.
Avant de prendre place à une table, il parcourut la salle d’un coup d’œil et trouva sans doute ce qu’il cherchait, car il se dirigea droit vers un coin presque obscur.
Un seul client s’y trouvait attablé.
C’était sir Ralph.
— Eh bien, dit Arthur à celui-ci, comment trouvez-vous mon petit restaurant ?
— Franchement, répondit sir Ralph, à juger des mets par les exhalaisons, il ne me dit rien de bon ; je doute que Lucullus y eût pris ses repas. Au reste il répond assez exactement à l’opinion que je m’en étais faite.
— Je vois ce que c’est, vous avez des préjugés sur les restaurants à vingt et un sous.
— Je l’avoue, et je viens de voir servir une cervelle qui ne fait que m’y affermir ; elle était rouge, bleue, jaune, verte et toute zébrée de lignes violacées ; une vraie carte géographique ; et un bouquet !
— Eh bien, vous avez été trompé par les apparences ; tout est exquis ici ; vous allez en juger.
— J’aime mieux m’en rapporter à toi, et, puisque tu trouves la cuisine si exquise, je te cède ma part.
— Oh ! je ne suis pas bégueule, je l’accepte.
— Commande donc deux dîners, et tu les consommeras à toi seul.
— Ça va.
Et Arthur commanda deux juliennes.
— Eh bien, demanda sir Ralph, qu’as-tu à m’apprendre au sujet de M. Pontif ?
— Une grande nouvelle : il va donner un déjeuner auquel il a invité de nombreux amis.
— À quelle occasion ?
— Pour leur présenter mademoiselle Isoline Torchebœuf ; c’est comme qui dirait un déjeuner de fiançailles.
— Déjà ! s’écria sir Ralph.
— Le bonhomme est très-épris.
— Et la jeune fille ?
— Très-pressée de se marier avec n’importe qui, pourvu qu’il y ait un sac ; ce n’est pourtant pas ma faute si elle conserve quelques illusions au sujet de M. Pontif.
Et il raconta à sir Ralph la scène de la veille.
— Mais, bah ! ajouta Arthur, on lui prouverait qu’il est lépreux, qu’elle le prendrait tout de même, après ce qui vient de lui arriver au Conservatoire.
— Oui, j’ai vu cela dans le Figaro, dit sir Ralph, et j’en ai conclu qu’elle allait redoubler d’efforts pour fasciner le candide M. Pontif.
— Il en perd la cervelle.
— Et as-tu quelque plan pour empêcher ?…
— J’en ai trente-six, mais très-vagues ; je verrai, je guetterai, et, comme je suis toujours là à l’affût sur l’escalier ou chez M. Pontif même, je saurai bien trouver quelque occasion… Enfin, comptez sur moi.
— Tu sais que si tu réussis, il y aura une récompense ?
— Ce n’est pas de refus.
— Allons, j’ai confiance en toi ; mais tu ne tiens pas à ce que je te regarde dîner jusqu’au bout, n’est-ce pas ?
— Dame ! à moins que ça ne vous amuse.
— C’est curieux ; mais j’ai affaire ailleurs, je vais payer ton dîner et le mien au comptoir.
— Allez-y, je ne suis pas susceptible.
— Dès que le déjeuner des fiançailles aura eu lieu, écris-le-moi et donne-moi un rendez-vous ; j’ai hâte d’en connaître les détails.
— Convenu, et soyez tranquille, je vous tiendrai au courant de tout, je serai là , et il ne m’échappera ni un mot, ni un geste, ni un coup d’œil.
— À bientôt donc !
Sir Ralph se leva, paya au comptoir et sortit.
Une fois dehors il remonta la rue Fontaine jusqu’à la rue Duperré et entra chez le marchand de vin qui fait le coin de ces deux rues.
C’est là , si l’on s’en souvient, qu’il avait déjà eu une entrevue avec le père Vulcain.
Celui-ci l’y attendait, toujours en compagnie de la chopine d’absinthe pour laquelle il avait exprimé la veille une si profonde horreur.
Sa mise avait subi une transformation aussi complète que celle de son jeune ami Arthur, mais beaucoup moins excentrique.
Il était convenablement vêtu, ce qui empêcha sir Ralph de le reconnaître au premier abord, quoiqu’il fût seul dans le cabinet où il l’attendait.
— Peste ! père Vulcain, lui dit-il enfin après l’avoir examiné de près, quelle toilette ! un vrai gandin !
— Oui, oui, on a l’air cossu, répondit le vieux modèle en se rengorgeant.
— On a donc fait quelque bonne affaire ?
— Je suis allé voir mon fils hier, comme c’était convenu.
— Eh bien, comment avez-vous été accueilli ? demanda vivement sir Ralph.
— À bras ouverts.
— Bah !
— S’il y avait eu un veau gras dans l’atelier, il l’aurait tué.
— Pour fêter le retour du père prodigue.
— Et sa conversion.
— Ah ! vous lui avez fait croire…
Le père Vulcain haussa les épaules.
— Non, dit-il avec un dandinement plein de fatuité, on ne sait pas jouer sa petite comédie ! On est gnole, on est gauche, on est emprunté.
— Enfin que s’est-il passé ?
— Je suis entré chez lui la tête basse et la rougeur au front comme un enfant de chœur qui a bu les burettes de M. le curé, j’ai confessé mes fautes avec la componction d’une vieille dévote, je me suis traité de chenapan, de gredin, de pas grand-chose, de père marâtre indigne de posséder un pareil fils, la grande scène de Tartuffe avec Orgon, quoi.
— Et il n’a pas soupçonné ?…
— Il a coupé dedans comme dans du beurre. Pas fort, mon fils, pas fort, murmura le modèle avec un épanouissement de vanité.
Malgré sa dépravation, sir Ralph eut peine à dissimuler le sentiment de profond dégoût que lui inspirait ce père se vantant d’avoir abusé de la bonne foi et de la générosité de son fils.
— Ce n’est pas tout, reprit le vieux modèle rayonnant comme s’il eût raconté quelque beau trait, une fois la paix faite, voilà le pauvre garçon qui, par pitié pour ma petite faiblesse, me propose l’absinthe, lui qui n’en a jamais pris. Ah ! c’est là que j’ai été vraiment beau, sir Ralph ! C’est là qu’il eût fallu me voir ! C’est à ce moment que j’ai été digne d’être contemplé par quarante siècles du haut des Pyramides. L’absinthe ! me suis-je écrié avec une indignation qui faisait trembler ma voix, car positivement elle tremblait, cette liqueur infâme qui m’a perdu, qui m’a dégradé, qui avait tout tué, tout éteint en moi, jusqu’au sentiment paternel, ah ! ne m’en parle jamais, elle ne touchera plus mes lèvres !
— Et qu’a-t-il dit à cela ?
— Les larmes lui sont venues aux yeux et il s’est jeté dans mes bras, fallait voir ça de près ; jamais acteur n’a obtenu un pareil succès. Enfoncé l’artiste, pas de force à lutter avec son auteur ; on est vieux, mais on n’est pas ramolli, ah ! mais non.
Sir Ralph regardait le vieux modèle avec stupeur.
Il restait pétrifié devant une si complète absence de sens moral et ne se sentit même pas le courage d’applaudir son complice.
— Et, reprit-il au bout d’un instant, c’est à la suite de ce beau mouvement qu’il a décidé de vous habiller des pieds à la tête ?
— Il ne pouvait pas faire moins.
— Alors notre but est atteint, notre cause est complètement gagnée et vous avez un libre accès chez votre fils ?
— J’y passerai toutes mes journées, c’est convenu.
— Et, demanda sir Ralph avec quelque hésitation, rien n’est changé, notre plan tient toujours ?
— Pourquoi pas ? répliqua le père Vulcain avec un étonnement dont le cynisme acheva de stupéfier sir Ralph.
— En effet, dit-il en dissimulant son impression, il n’y a aucune raison pour cela.
Il se leva en ajoutant :
— Je vais à Montmartre, rue de l’Empereur, voulez-vous m’accompagner ?
— Tout de même, répondit le modèle en avalant d’un trait ce qui restait de sa chopine d’absinthe.
Dix minutes après ils gravissaient ensemble la rue de l’Empereur, qui conduit au plateau de la butte Montmartre, après l’avoir contournée.
Il était huit heures et la nuit était complète.
Sir Ralph s’arrêta vers le milieu de la rue, en face d’une petite maison à un seul étage et isolée des autres par un jardin.
— C’est là , dit-il au père Vulcain.
Il frappa à la porte.
Au bout d’un instant, on entendit une voix de femme qui demandait :
— Qui est là ?
— La personne qui vous a annoncé sa visite pour ce soir.
— Sir Ralph ?
— Oui.
— Entrez.
La porte s’entrouvrit et sir Ralph entra en disant au vieux modèle :

![]()
— J’en ai pour un quart d’heure, attendez-moi là .
— C’est drôle, murmura celui-ci quand il fut seul, il me semble avoir entendu cette voix il n’y a pas longtemps de cela.
Mais il se creusa vainement l’esprit pour se rappeler en quel lieu il avait entendu cette voix de femme. Au bout d’un quart d’heure sir Ralph sortait de cette maison.
— Voilà qui est convenu, dit-t-il à la femme, qui le reconduisait et tenait toujours la porte entr’ouverte, de manière à ne pas se laisser voir, vous serez à ma disposition pour tel jour qu’il me plaira ?
— À la seule condition de m’écrire la veille, répondit la femme.
— Je n’y manquerai pas, et le soir une voiture viendra vous prendre.
La porte se referma.
— Maintenant, dit sir Ralph au père Vulcain, rentrons dans Paris.
XL
AMOUR ET PEINTURE
Jacques Turgis était en train de piocher son Ruysdaël, tout en causant avec son père, qui fumait un cigare, assis dans un grand fauteuil et les pieds devant le feu, lorsqu’on frappa à la porte.
— Entrez, cria-t-il.
On entra.
C’était madame Cither, qui, vu l’heure matinale, était en jupon court avec d’immenses poches, pareilles à des sacs à plâtre.
Elle tenait à la main une lettre qu’elle remit à l’artiste en disant :
— Monsieur Jacques, je dois vous prévenir qu’elle est à la loge depuis huit heures, mais j’étais allée faire une course ultra minos…
— Hein ? comment dites-vous ? lui demanda Jacques stupéfait.
— Ultra minos ! c’est à vous que je l’ai entendu dire, un jour que vous alliez à Neuilly.
— Extra muros, madame Cither, dit l’artiste en souriant.
— Chacun prononce à sa façon. Moi, je dis ultra minos.
C’était à Romainville que j’étais allée causer avec mon homme d’affaires pour un tas de misères que veut me faire la famille de mon défunt au sujet d’un héritage donc que j’ai tous les droits de mon côté, vu que je suis mariée sous le régime sacerdotal. Faut vous dire qu’il faisait un temps à ne pas mettre un caniche à la porte ; c’était bien le cas de dire : Ô tempus ! ô mores ! Quel temps pour la morue ! Enfin il n’y avait pas à dire : mon bel ami, pas une minute à perdre, le temps pressait, et comme dit le proverbe : Il faut battre son frère pendant qu’il est chauve. Je prends donc l’omnibus qui me met en haut de Belleville, même qu’arrivée là je me croise avec un pauvre mort qu’on conduisait au cimetière, sa dernière demeure ; c’est bien le cas de dire : Dis-moi si tu y entres, je te dirai si tu y es ; même que j’ai causé avec des membres de la famille, et il paraît que le pauvre homme était mort d’une fièvre moqueuse. Mais ça ne me regardait pas, j’avais d’autres chiens à peigner et pour lors…
Deux coups frappés à la porte interrompirent madame Cither, qui courut ouvrir et s’esquiva en même temps.
Un individu d’une soixantaine d’années, à l’œil dur et cupide, à la physionomie grossière et brutale, entra et se dirigea aussitôt vers l’artiste.
— Eh bien, où en sommes-nous ?… dit-il à celui-ci, en attachant successivement son œil de faucon sur chaque toile, la copie et l’original.
— Vous voyez, monsieur Chaumont, répondit l’artiste, encore quarante-huit heures de travail et tout sera fini.
— Ainsi je puis faire prendre l’une et l’autre dans trois jours ?
— Dans trois jours, c’est entendu.
— Votre copie est parfaite, dit le marchand de tableaux, après avoir sérieusement examiné la toile de Jacques.
— Je crois avoir rendu assez fidèlement l’original.
— C’est au point qu’on pourrait s’y tromper.
Il ajouta en regardant l’original du même œil qu’un autre eût regardé une maîtresse adorée :
— J’ai vu ce matin un amateur qui est venu voir mon Ruysdaël vingt fois depuis un mois, savez-vous ce qu’il m’en donne ?
— Je ne devine pas.
— Quatre-vingt mille francs.
— Juste le prix que vous en demandez.
— Plus souvent que je le céderai pour ce prix-là ; il ne sortira pas de chez moi à moins de cent mille francs.
— Et le jour où l’on vous en donnera cent mille francs, vous en voudrez cent vingt mille.
— Il les vaut ! s’écria le marchand avec conviction.
— Vous y voilà arrivé, répliqua Jacques en éclatant de rire, il vaut cent vingt mille francs, pas un sou de moins.
— On ne sait pas, dit M. Chaumont en hochant la tête.
Puis, serrant la main de l’artiste :
— C’est entendu : dans trois jours je viendrai prendre les deux toiles. Adieu, mon cher Jacques, je suis enchanté de votre copie, c’est un vrai chef-d’œuvre.
Et il sortit en se frottant les mains.
— Voyons donc ce que me veut cette grande lettre, dit Jacques quand il fut seul.
C’était une invitation pour un bal que donnait le surlendemain la baronne de Villarsay.
— L’invitation me semble un peu tardive, murmura l’artiste.
Il chercha du regard la date.
Elle remontait à trois jours.
Il réfléchit un instant et ses traits exprimèrent une vive émotion.
Il venait de se faire ce raisonnement :
La baronne de Villarsay, amie intime de madame Taureins, est liée en même temps avec toute la famille de celle-ci, et particulièrement avec les Mauvillars ; or, qui sait si le nom de Jacques Turgis n’avait pas été omis dans la liste d’invitations, et si ce nom ne lui a pas été rappelé par Tatiane avec cette finesse qui distingue les plus innocentes quand l’amour les inspire.
Cette façon d’expliquer le retard qu’on avait mis dans l’envoi de l’invitation le charmait trop vivement pour qu’il hésitât à l’interpréter ainsi, et, du fond du cœur, il remercia la baronne de Villarsay d’un oubli qui lui valait une nouvelle preuve d’amour de sa chère Tatiane.
Le père Vulcain jetait un coup d’œil à la dérobée sur son fils tout en fumant son cigare, car il prétendait avoir renoncé au brûle-gueule en même temps qu’à l’absinthe, et l’émotion du jeune homme ne lui échappa pas.
— Il paraît que cette lettre t’apporte une bonne nouvelle, lui dit-il, car tu parais bien heureux.
— Oui, mon père, au comble du bonheur.
— Une commande, peut-être ? une toile dont on te donne un bon prix ?
— Oh ! si ce n’était que cela !
— C’est quelque chose pourtant pour un artiste.
— C’est qu’il ne s’agit pas de l’artiste en ce moment, mon père, mais de l’homme.
— Comprends pas.
— Eh bien, mon père, cette bonne nouvelle est tout simplement une invitation à un bal.
— Rien que ça ?
— Oui, mais à ce bal je vais rencontrer une jeune fille qui…
— Bon ! j’y suis, une amourette ! j’ai connu ça dans mon temps.
— Non, pas une amourette, mon père, mais un amour immense, aussi pur que profond ; mais bientôt, je l’espère, nous aurons occasion de causer de cela plus longuement.
— Je comprends, il y a du conjungo sous jeu.
— Pas encore, mais je n’en désespère pas.
Il ajouta en se remettant au travail :
— Eh bien, père, as-tu enfin trouvé un logement dans les environs ?
— Mieux que ça, répondit le modèle.
— Comment ?
— J’ai trouvé mon affaire dans la maison.
— Bah ! la concierge, à laquelle j’en avais parlé, m’a répondu que tous les logements étaient occupés.
— Oui, mais moi j’en connais un qui sera libre dans quinze jours au plus.
— Lequel ?
— Au cinquième, une chambre louée toute garnie par madame Cither à un jeune homme que je connais un peu et qui m’a prévenu en confidence qu’il le quitterait dans dix ou douze jours.
— Parfait ! s’écria Jacques tout joyeux, voilà qui se trouve à merveille, tu seras enfin logé convenablement, au lieu de coucher chaque nuit dans cet atelier, sur un matelas, ce que tu aurais pu éviter, du reste, en allant à l’hôtel, comme je te l’avais proposé.
— C’était de la dépense inutile, répliqua le modèle, je n’ai pas des habitudes de petite maîtresse, moi, et je suis très-bien ici. D’ailleurs, huit ou dix jours sont bientôt passés.
On comprendra sans peine combien parurent longues à l’artiste les quarante-huit heures qui le séparaient de cette soirée, où il allait rencontrer Tatiane, car il ne doutait pas qu’elle y fût.
Aussi, pour tromper son impatience, se mit-il à travailler avec un redoublement d’ardeur.
Et comme il était en verve, comme chaque coup de pinceau portait et n’avait pas besoin de retouche, sa copie se trouva terminée le surlendemain dans la matinée.
— Enfin, s’écria-t-il en donnant la dernière touche, je puis maintenant m’absorber tout entier dans mon bonheur.
Il sortit pour faire quelques emplettes et se rendit un peu tard à sa table d’hôte, où, par extraordinaire, la mère Alexandre manquait ce soir-là , ce qui l’exposa, de la part de ses amis, à quelques plaisanteries un peu risquées sur la passion dont ils le disaient atteint à l’endroit de la magnétiseuse.
Puis, vers neuf heures, il gagna son appartement, situé rue Duperré, comme son atelier, mais quelques maisons plus haut, et procéda minutieusement à sa toilette.
Il était dix heures et demie lorsqu’il envoya chercher une voiture par son concierge, et à onze heures il descendait dans la cour de l’hôtel de la jeune baronne, rue de Miroménil.
Il s’écoula plus de vingt minutes encore avant qu’il pût pénétrer dans l’intérieur de l’hôtel, tant la cour, le perron et l’antichambre étaient encombrés d’invités, et il serait difficile de dire la quantité de malédictions dont il accabla ceux qui retardaient encore pour lui le moment de revoir sa jolie Tatiane.
Enfin la foule s’écoula peu à peu et il put entrer dans la salle de bal.
Il se hâta de la parcourir après avoir salué la maîtresse de la maison.
Mais Tatiane n’y était pas.
La famille Mauvillars n’avait pas encore paru.
XLI
UN MYSTÈRE
Jacques Turgis, très-désappointé en reconnaissant que Tatiane n’était pas là , se mit à se promener autour des danses, en se disant qu’après tout il n’y avait pas là de quoi se désespérer et qu’il n’y avait rien d’étonnant à ce que la famille Mauvillars ne fût pas encore arrivée, puisque les salons de la baronne de Villarsay n’étaient encore qu’à moitié remplis.
Et, pour calmer son impatience, il s’approcha des danseurs et tâcha de s’intéresser au quadrille des lanciers, qui déroulait en ce moment ses bizarres et gracieuses figures.
Mais, au bout d’une demi-heure, il passait de l’impatience à l’inquiétude, et, quoiqu’il fût toujours en face des danseurs, il ne distinguait plus rien qu’une espèce de tourbillon confus et inexplicable qui s’enroulait et s’emmêlait à la lueur éclatante des bougies comme une fantastique vision.
Il attendit encore cependant, il attendit longtemps ; mais, lorsque, après avoir consulté sa montre, il s’aperçut qu’il était minuit, il se sentit saisi d’un affreux pressentiment et il lui devînt impossible de subir plus longtemps l’angoisse qui le dévorait.
Après quelques minutes d’hésitation, il se dirigea vers la baronne de Villarsay et saisissant pour l’aborder un moment où elle était seule :
— Madame la baronne, lui dit-il avec quelque embarras, est-ce que M. ou madame Mauvillars seraient malades ?
— Pourquoi cela, monsieur Turgis ? répondit la jeune femme avec un imperceptible sourire.
— C’est que… je sais qu’ils se rendent assidûment à vos soirées, et, ne les ayant pas encore aperçus, quoiqu’il soit plus de minuit…
— Cela vous inquiète au sujet de M. et madame Mauvillars, n’est-ce pas ? dit la baronne, toujours sur le même ton.
Elle ajouta aussitôt :
— Rassurez-vous, monsieur Turgis, mademoiselle Tatiane n’est pas malade.
Le jeune homme se troubla légèrement en se voyant si bien compris.
Cependant le gracieux et indulgent sourire de la baronne lui rendit un peu d’assurance et il reprit :
— Alors, puisque personne n’est malade, ce n’est qu’un retard et ils viendront ?
— Permettez-moi de vous faire observer que vous tranchez un peu témérairement les questions, lui dit la jeune baronne, qui vous dit qu’il n’y ait personne de malade chez eux ? Ce n’est pas moi.
Jacques fixa sur elle un regard bouleversé, et d’une voix troublée :
— Mais, balbutia-t-il, ce n’est pas mademoiselle Tatiane au moins, puisque vous venez de m’affirmer…
Il n’eut pas la force d’achever.
— Mais, reprit la baronne, il n’y a pas que mademoiselle Tatiane au monde, comme vous paraissez le croire, monsieur Turgis ; il y a d’autres personnes sur le globe et particulièrement dans la famille Mauvillars.
— Vous avez raison, madame, répondit l’artiste, aussi m’intéressai-je à la famille entière, et si j’ai prononcé le nom de mademoiselle Tatiane…
La fin de la phrase ne venait pas.
— C’est que vous vous intéressez à elle un peu plus qu’aux autres, voilà tout, dit la jeune femme avec une bonhomie quelque peu ironique.
Elle ajouta aussitôt avec un charmant sourire :
— Allons, pardonnez-moi d’avoir un peu joué avec vos terreurs d’amoureux et rassurez-vous, monsieur Turgis, il n’est rien arrivé de fâcheux à mademoiselle Tatiane… personnellement.
— Est-ce que quelqu’un de sa famille serait malade ? demanda Jacques avec une inquiétude visible.
— Malheureusement oui, répondit la baronne.
— De sorte que…
— Elle ne viendra pas, comme vous l’avez deviné.
— Ah ! fit l’artiste.
— La chère petite m’a écrit une lettre, il y a quelques heures à peine, par laquelle elle m’apprend que sa grand’maman Mauvillars ne pouvant se rendre à ma soirée, par suite d’indisposition, elle se voit privée elle-même de ce plaisir, quoique la pauvre femme s’y fût opposée de tous ses efforts. Mais elle sait que son grand-père et sa grand’mère ne peuvent vivre sans elle, et elle est si parfaitement bonne, cette chère enfant, qu’elle n’a pas hésité à renoncer à une fête qui, je le sais, avait pour elle bien des attraits.
— En effet, la danse est un grand plaisir à son âge, insinua Jacques.
— Vous voudriez bien me faire causer, lui dit la baronne avec un fin sourire, mais je ne dis que ce que je veux et non ce qu’on veut me faire dire. Cependant, pour vous consoler un peu de l’absence de Tatiane, je veux vous raconter un petit incident, assez insignifiant en apparence, mais qui ne vous déplaira pas, j’en suis sûre. Ma petite amie est venue me voir, il y a deux jours, dans la matinée, et, mettant l’entretien sur ma fête, à laquelle alors elle se faisait une joie d’assister, elle me dit : « Vous aurez, comme de coutume, une société d’élite, les plus beaux noms en tout genre ; je serais curieuse de les connaître d’avance. Laissez-moi donc parcourir la liste de vos invitations. » Il faut vous dire que Tatiane est traitée ici en enfant gâtée, elle peut tout s’y permettre, et elle le sait bien. Je lui donne ma liste, elle la lit avec attention, puis, me la rendant : « Elle est fort belle, me dit-elle, l’art surtout y est fort bien représenté, la peinture historique, la peinture religieuse, la peinture de genre, la marine… » Je l’arrêtai d’un geste, j’avais compris. « Il y manque un genre et un nom, lui dis-je, et, grâce à toi, ma chérie, je puis encore réparer un oubli fâcheux. » Je pris une lettre d’invitation et, la faisant asseoir devant mon secrétaire : « Écris une adresse sur cette lettre. » Elle trempa la plume dans l’encrier et attendit tout émue. Elle aussi avait compris. Je dictai : « M. Jacques Turgis, peintre paysagiste, rue Duperré, 17. » Et maintenant, ajoutai-je, trouves-tu ma liste complète ? « Mais, répondit-elle en souriant et rougissant à la fois, il me semble qu’il n’y manque plus rien. » Eh bien ! que dites-vous de cela, monsieur Turgis ?
— Je dis que vous êtes la plus charmante et la meilleure des femmes, répondit Jacques avec une émotion contenue.
— Alors je vous laisse avec votre bonheur et je vais m’occuper des autres.
Et elle s’éloigna, laissant l’artiste en proie à un profond ravissement.
Sous cette nouvelle impression, la fête, qui jusque-là lui avait paru monotone et presque lugubre, lui sembla tout à coup brillante et pleine d’entrain.
Il était occupé à admirer les toilettes, qu’il trouvait toutes du meilleur goût, quand son regard rencontra brusquement une figure qui l’impressionna désagréablement.
Cette figure était celle de Mac-Field, qu’il se rappela vaguement avoir vu à la fête de M. Mauvillars.
Mac-Field le regardait en ce moment et un sourire sinistre effleurait ses lèvres.
L’expression de cette tête, naturellement peu sympathique, avait quelque chose de si effrayant en ce moment que l’artiste en fut violemment impressionné.
Ce sombre et fatal sourire, ce regard attaché sur lui avec un sentiment de joie diabolique semblaient lui annoncer quelque malheur.
Il venait de détourner la tête pour se soustraire à cette funeste impression, quand tout à coup il resta frappé de stupeur en entendant ces deux noms annoncés d’une voix retentissante :
— Sir Ralph Sitson !
— Mademoiselle Tatiane Valcresson !
— Oh ! j’ai mal entendu, murmura-t-il ; Tatiane seule ici et arrivant immédiatement après cet homme ! non, c’est impossible.
Et il s’élança vers la porte du salon.
Mais alors il se crut subitement frappé de folie devant le spectacle qui s’offrit à ses regards, spectacle si étrange, si prodigieux, si invraisemblable que l’assemblée entière en restait frappée d’immobilité, regardant ce qui se passait sous ses yeux avec autant d’effarement que si elle eût vu surgir tout à coup du parquet quelque apparition surnaturelle.
C’est qu’en effet il était permis à tous de douter du témoignage de leurs yeux en voyant s’avancer lentement, au milieu des invités, qui s’écartaient avec stupeur, Tatiane Valcresson appuyée sur le bras de sir Ralph.
Et ce qui ajoutait encore à l’étonnement dont chacun était saisi, ce qui confirmait Jacques dans la pensée qu’il était sous l’empire d’un accès de folie et qu’il croyait voir ce qui ne pouvait être que le produit de son esprit en délire, c’était l’expression de la physionomie de Tatiane.
Jamais peut-être son teint n’avait été si frais et si reposé ; jamais le sourire, qui était un de ses plus grands charmes, ne s’était épanoui si calme et si pur sur son gracieux visage ; jamais elle n’avait traversé la foule de ses admirateurs d’un air plus virginal et plus radieux.
Quant à sir Ralph, ses traits respiraient à la fois l’orgueil et le bonheur.
Il passait calme et fier au milieu de la foule stupéfaite.
— Oh ! oui, oui, je rêve ou je suis fou, balbutia Jacques en passant lentement la main sur son front, mais je vais savoir si tout cela existe ou non, si c’est Tatiane ou un fantôme créé par mon imagination en délire ; elle va passer près de moi, elle va me voir et alors…
Tatiane passa près de lui.
Elle le vit et pas un muscle de son visage ne tressaillit, et elle conserva immuable l’expression calme et radieuse de sa physionomie.
XLII
OÙ LE MYSTÈRE S’ÉPAISSIT
Les trois quarts des invités qui remplissaient les salons de la baronne de Villarsay connaissaient Tatiane et la famille Mauvillars ; aussi, à l’étonnement de voir la jeune fille entrer au bras d’un inconnu, succéda celui de n’apercevoir derrière elle aucun des membres de sa famille.
Tout mouvement s’était arrêté : l’orchestre jouait une valse, mais personne ne valsait.
Tous les danseurs s’étaient réunis sur le même point et formaient, dans la longueur du salon, deux haies compactes au milieu desquelles passaient les deux nouveaux venus.
C’était un spectacle étrange, presque fantastique, et à voir cette fraîche et pure jeune fille passer, épanouie et souriante, au bras de cet inconnu, à travers cette foule élégante, immobile et frappée de stupeur, sous l’éclatante lumière des bougies qui faisaient étinceler les diamants sur son passage, aux sons de cette musique jouant une valse qui ressemblait à une rêverie, on eût cru voir se réaliser un de ces contes de fées qui restent si éblouissants et si merveilleux dans les yeux et dans l’imagination des enfants.
On eût dit une de ces gracieuses princesses, touchantes victimes de la mauvaise fée, traversant, au bras d’un sombre génie, les splendeurs d’un château enchanté, et marchant, la joie au front et l’innocence au cœur, vers quelque effrayante et mystérieuse destinée.
La baronne de Villarsay était aussi pâle et presque aussi bouleversée que Jacques Turgis.
Amie de la famille et mise au courant de tout ce qui s’y passait d’important, connaissant l’amour de Tatiane pour Jacques et l’horreur que lui inspirait sir Ralph, sachant enfin le refus formel par lequel la jeune fille avait accueilli la demande de ce dernier, refus aussitôt ratifié par M. Mauvillars, elle restait ahurie, pétrifiée devant ce qui se passait sous ses yeux, ne pouvant croire à ce qu’elle voyait et se demandant, comme Jacques, si ce n’était pas quelque mauvais rêve.
À la fin cependant les légers murmures, les chuchotements qui couraient dans la foule étonnée l’arrachèrent à la stupeur sous laquelle toutes ses facultés étaient restées un moment anéanties.
Elle alla droit à sir Ralph.
— Monsieur, lui dit-elle, permettez-moi de vous demander l’explication d’un fait dont tout le monde est aussi surpris que moi, vous devez le remarquer.
— À quel fait madame la baronne fait-elle allusion ? demanda sir Ralph avec un calme parfait.
— Je me demande, monsieur, comment il se fait que mademoiselle Tatiane soit seule ici avec vous.
Sir Ralph sourit.
Puis, il répondit avec une imperturbable assurance :
— Il y aurait là une énormité dont vous auriez en effet le droit de vous étonner, et même plus, madame la baronne, mais rassurez-vous, je suis aussi incapable que mademoiselle Tatiane elle-même d’une pareille inconvenance.
— Dites d’un pareil scandale, monsieur, car il n’y a pas d’autre nom à donner à ce qui se passe en ce moment si vous ne parvenez à l’expliquer.
En prononçant ces mots, la baronne de Villarsay avait fixé sur Tatiane un regard sévère.
Mais, à son extrême surprise, la jeune fille, au lieu de se troubler sous ce regard, resta impassible dans sa sérénité.
— L’explication que vous me demandez est fort simple, madame, répondit sir Ralph, et je m’étonne même que vous n’ayez pas deviné la vérité.
Tous les regards étaient fixés sur lui et chacun attendait avec une impatience pleine d’anxiété l’explication qui devait dissiper les pénibles pensées que faisait naître cet étrange incident.
— Parlez donc, monsieur, dit vivement la baronne.
— Eh bien, madame, répondit froidement sir Ralph je suis entré seul dans votre salon avec mademoiselle Tatiane, il est vrai, mais nous sommes venus avec M. Mauvillars et tout mon tort est de ne pas l’avoir attendu pour entrer.
— Comment ! s’écria la jeune femme, M. Mauvillars est là ?
— Sans doute, madame, mademoiselle Tatiane n’y serait pas sans cela.
— Où est-il donc alors et comment se fait-il ?…
— L’un des chevaux s’étant abattu au moment où la voiture entrait dans la cour de votre hôtel, M. Mauvillars m’a prié de le précéder avec mademoiselle Tatiane pendant qu’il allait examiner avec son cocher si son cheval ne s’était pas blessé. J’aurais dû l’attendre dans l’antichambre, j’en conviens, mais je le croyais sur mes pas, et convaincu que nous le précédions de quelques secondes seulement, j’ai cru pouvoir entrer avec mademoiselle.
— Mais, reprit la baronne, madame de Mauvillars est donc restée aussi pour voir l’état de son cheval au lieu d’accompagner sa nièce ?
— Madame Mauvillars est demeurée chez elle, madame ; elle n’a pas cru pouvoir s’éloigner de sa belle-mère, qui est légèrement indisposée.
— Je l’ai appris, en effet, mais M. Mauvillars tarde bien à paraître, dit la baronne en portant ses regards du côté de la porte.
— C’est la réflexion que je me faisais à moi-même, dit sir Ralph.
— Je vais au-devant de lui ; je suis impatiente de savoir…
— Permettez-moi d’y aller avec vous, madame, ce retard m’étonne et doit inquiéter mademoiselle Tatiane.
Si la jeune fille était réellement inquiète, rien dans son attitude ni dans l’expression de sa physionomie ne pouvait la faire supposer.
Cette expression était toujours la même et n’avait pas varié depuis son entrée.
La jeune femme, qui l’examinait avec une surprise toujours croissante, crut enfin avoir trouvé l’explication de ce mutisme obstiné, de cette immuable placidité.
— Évidemment, pensa-t-elle, cet homme, repoussé, il y a quelques jours, a trouvé le moyen de se faire agréer par l’oncle et de décider celui-ci à contraindre la volonté de sa nièce, dont la raison a sans doute été ébranlée par ce coup, c’est la seule interprétation à donner à ce silence et à cette impassibilité dans une telle situation.
Elle allait se diriger vers la porte du salon, suivie de sir Ralph et de Tatiane, quand ce nom se fit entendre tout à coup avec un sanglot si déchirant, si désespéré, qu’un frisson de pitié parcourut toute l’assemblée :
— Tatiane ! Tatiane !
Et, au même instant, Jacques, les yeux pleins de larmes, les traits pâles et bouleversés, venait tomber aux pieds de la jeune fille.

Puis, saisissant sa main, et levant sur elle un regard effaré :
— Tatiane, balbutia-t-il avec l’accent d’une douleur navrante, oh ! qui vous a contrainte à venir ici au bras de cet homme ? Que se passe-t-il, ô mon Dieu ? Expliquez-moi cet effroyable mystère ? Parlez… oh ! parlez, Tatiane !
Pour la première fois, au son de cette voix, une émotion se manifesta sur les traits de la jeune fille, qui devint tout à coup sérieuse ; un éclair brilla dans ses yeux bleus et sa main s’éleva au-dessus de la tête du jeune homme avec un geste plein d’une douce pitié, tandis que son beau front se contractait légèrement, comme si elle eût cherché à rappeler quelque souvenir.
Sir Ralph suivait les progrès de cette émotion avec tous les signes d’une violente angoisse.
— Tatiane ! Tatiane ! s’écria de nouveau le malheureux artiste au paroxysme du désespoir, oh ! parlez, regardez-moi, je suis Jacques, dites-moi tout ; mais, d’abord, repoussez cet homme avec horreur, c’est un misérable. Tatiane, oh ! ne me reconnaissez-vous pas ; je suis Jacques, Jacques qui vous aime ; oh ! ayez pitié de moi, Tatiane !
Alors la jeune fille abaissa lentement son regard vers lui, son visage se troubla et sa bouche s’entrouvrit pour parler.
Mais aucun son ne sortit de ses lèvres.
Au comble de l’anxiété, sir Ralph jeta autour de lui un rapide coup d’œil et rencontra tout de suite celui qu’il cherchait.
C’était Mac-Field.
Les deux complices échangèrent un regard d’intelligence.
— Tatiane ! je baise vos pieds, oh ! parlez, dites-moi tout, je vous en supplie, reprit Jacques.
Et saisissant le bas de sa robe, il la couvrait de larmes et de baisers.
— Mais vous voyez bien que cet homme est fou, complètement fou, s’écria tout à coup Mac-Field.
Et se précipitant sur Jacques, il l’enleva de terre et l’entraîna vers une fenêtre, loin de la jeune fille.
— Non, je ne suis pas fou, je ne suis pas fou, criait Jacques en se débattant avec une furie qui fit partager à tout le monde l’opinion de Mac-Field.
Pendant ce temps, sir Ralph s’était hâté de se diriger du côté de la porte avec la baronne de Villarsay et tenant toujours Tatiane à son bras.
Quand ils furent arrivés à l’antichambre, la jeune femme demanda à l’un de ses domestiques s’il avait vu M. Mauvillars.
Celui-ci répondit négativement.
— Peut-être est-il encore dans la cour, dit-elle en se dirigeant vers le perron.
Mais comme elle allait poser le pied sur la première marche :
— Ne prenez pas une peine inutile, madame, lui dit sir Ralph.
— Que voulez-vous dire ? monsieur, lui demanda la baronne avec surprise.
— Je veux dire, madame, que tout à l’heure, devant vos invités, j’ai menti par égard pour cette jeune fille.
— Quoi ! balbutia la baronne atterrée, M. Mauvillars ?…
— Dort tranquillement chez lui à cette heure et je suis venu seul à votre fête avec mademoiselle Tatiane.
La jeune femme laissa échapper un cri et resta un instant comme étourdie.
— Grand Dieu ! s’écria-t-elle enfin avec un geste désespéré, est-ce bien possible !
— Informez-vous, madame, et l’on vous dira que M. Mauvillars n’a pas paru ici.
— Mais alors, monsieur, que voulez-vous que je pense, mon Dieu.
— Tout ce qu’il vous plaira, madame, répondit sir Ralph avec un calme ironique et en entraînant Tatiane.
Et, avant que la jeune fille fût revenue du coup qui venait d’ébranler un instant son esprit, ils avaient disparu tous les deux.
XLIII
CONSOLATIONS
Le lendemain matin, vers onze heures, Jacques Turgis se présentait chez la baronne de Villarsay et demandait à lui parler.
Le domestique auquel il s’adressa le regarda d’un air aussi ahuri que s’il lui eût demandé la lune.
— Mais, monsieur, lui dit-il, vous n’y songez pas ; madame la baronne ne reçoit jamais avant deux heures, et encore ! Mais à onze heures ! et le lendemain du jour où madame la baronne a donné une fête ! C’est tout au plus si elle est éveillée.
— Je sais fort bien qu’en me présentant à cette heure je choque tous les usages et toutes les convenances, répondit l’artiste, et pourtant je me permettrai d’insister, car il s’agit d’une affaire fort grave.
— Dame ! monsieur, je vais vous conduire à la femme de chambre de madame la baronne et vous lui parlerez.
Il lui fit traverser plusieurs pièces et l’introduisit dans une petite salle d’attente.
Puis il appuya sur un timbre et presque aussitôt Jacques voyait entrer une jeune fille.
— Anna, lui dit le domestique, monsieur voudrait parler à madame la baronne.
Et il sortit.
— Mademoiselle, dit alors Jacques à la femme de chambre, je n’ignore pas qu’on ne se présente pas à pareille heure chez une femme comme madame la baronne ; mais j’espère cependant qu’elle sera assez bonne pour me recevoir quand elle saura qui je suis.
Il remit sa carte à Anna, qui y jeta un coup d’œil.
Elle connaissait l’incident du bal et savait le rôle qu’y avait joué le peintre Jacques Turgis. Aussi se sentit-elle prise d’une vive sympathie pour l’amant désespéré qui avait si vivement excité l’intérêt de toutes les femmes.
Et puis, Jacques était affreusement pâle ; il avait les paupières rouges et les yeux battus comme un homme qui n’a pas fermé l’œil de la nuit, et ses traits fatigués portaient l’empreinte d’une mortelle tristesse.
Toutes ces raisons lui gagnèrent aussitôt le cœur de la femme de chambre.
— En effet, monsieur, lui dit-elle de sa plus douce voix, madame la baronne n’aurait pu vous recevoir à pareille heure, mais, pour un hasard tout à fait exceptionnel et dont j’ignore la cause, madame est levée et tout habillée, de sorte qu’il n’est pas impossible… enfin je vais remettre à madame la baronne la carte de monsieur.
Elle sortit aussitôt.
Un instant après, la porte de la petite salle s’ouvrait et c’était la jeune baronne elle-même qui se présentait.
— Madame la baronne, lui dit Jacques en allant à elle et en pressant la main qu’elle lui présentait, laissez-moi d’abord m’excuser de…
— Oh ! trêve de cérémonies, lui dit la jeune femme on l’interrompant, vous souffrez, vous n’avez pu attendre plus longtemps et vous êtes venu me demander l’explication d’un événement qui vous brise le cœur, n’est-ce pas ?
— Vous avez deviné, madame, répondit l’artiste.
— Eh bien, vous avez bien fait de venir, monsieur Jacques, et non-seulement je vous excuse, mais je vous estime d’avoir écouté avant tout le cri de votre cœur, qui doit cruellement souffrir.
— Ah ! madame, murmura Jacques en se laissant tomber sur un siège, en face de la jeune femme.
— Malheureusement, reprit la baronne après un moment d’hésitation, j’ai le regret de vous avouer que, loin de pouvoir verser quelque baume sur votre blessure, je vais, au contraire, vous retourner le poignard dans la plaie.
Jacques lui jeta un regard plein d’angoisse, regard si profondément navrant, que la jeune femme en eut le cœur serré.
Elle reprit cependant :
— Ce que je vais faire là est cruel, c’est une tâche de bourreau ; mais pour arriver à pénétrer le mystère qui enveloppe cette affaire, il faut que vous connaissiez la vérité.
— Je suis venu pour vous la demander, et je suis prêt à l’entendre, madame, répondit l’artiste avec un tremblement qui trahissait son émotion.
— Je ne doute pas de votre résolution, lui dit la baronne. Cependant, armez-vous de courage, vous en aurez besoin, je vous en préviens.
— Parlez, madame, parlez, je vous en supplie, dit Jacques d’une voix de plus en plus troublée.
— Ne croyez pas que je sois restée indifférente à votre douleur, monsieur Turgis, non ; je n’étais pas loin de vous lorsque vous êtes revenu à la raison, quand vous vous êtes arraché avec un sentiment de colère et d’horreur des bras de lord Mac-Field, qui cependant…
— Pardon, pardon, madame, dit Jacques en interrompant vivement la jeune femme, vous connaissez ce lord Mac-Field ?
— Pour l’avoir rencontré à deux ou trois fêtes, et, entre autres, à celle de M. Mauvillars.
— N’est-il pas lié avec sir Ralph ?
— Je les ai vus plusieurs fois ensemble, en effet.
— Et moi, je me suis rappelé tout à coup les avoir vus causer intimement dans un coin du salon de M. Mauvillars, et voilà pourquoi j’ai repoussé lord Mac-Field avec horreur, car hier ces deux hommes s’entendaient, je le jure, et c’est pour obéir à un mot d’ordre convenu d’avance entre eux que ce Mac-Field s’est précipité sur moi et m’a arraché des pieds de Tatiane au moment où, se penchant vers moi, elle allait me parler.
— Cela est possible, répondit la baronne, car tout dans cette affaire, est mystérieux et incompréhensible. Mais nous reviendrons sur cet incident et sur les soupçons que vous avez conçus. J’étais donc près de vous lorsque, recouvrant quelque sang-froid, vous avez jeté un regard de tous côtés en murmurant : Où est-elle ? Et si alors je ne vous ai pas abordé, c’est que vous étiez incapable de rien entendre en ce moment. Une jeune femme vous répondit : Elle est partie. Vous vous êtes élancé alors vers la porte, et je vous ai laissé sortir, me réservant de vous écrire le lendemain pour vous apprendre ce que je vais vous dire de vive voix et vous déclarer que je me mettais à votre disposition pour tous les services que je puis vous rendre dans cette triste circonstance.
— Merci ! oh ! merci, madame, s’écria Jacques en baisant, dans un élan de reconnaissance, la main de la jeune femme, car, hélas ! que deviendrais-je sans vous ! Qui me parlerait de Tatiane ? Qui me dirait…
— Calmez-vous et écoutez-moi, dit la jeune femme, je devine sans peine l’objet de votre préoccupation, et, à vrai dire, je n’ai pas été trop surprise tout à l’heure quand on m’a remis votre carte en annonçant que vous étiez là .
— Eh bien ! madame, demanda l’artiste avec une appréhension visible, qu’est-il advenu pendant ces dix minutes de délire où je ne distinguais rien de ce qui se passait autour de moi ? Que vous a dit M. Mauvillars, qui a dû entrer immédiatement après Tatiane, comme l’avait annoncé sir Ralph ?
— Vous touchez justement le point difficile à aborder, répondit la baronne.
— Parlez, madame, et ne me cachez rien, car, vous l’avez dit tout à l’heure, dans mon intérêt comme dans celui de Tatiane, il faut que je connaisse la vérité tout entière.
— Écoutez-moi donc ; quand on vous eut emporté, je dis à sir Ralph : M. Mauvillars tarde bien, cela m’inquiète, je vais au-devant de lui. — Je vous accompagne dit-il alors. Et il me suivit, tenant toujours le bras de Tatiane, qui continuait à obéir à son impulsion, machinalement, passivement, sans prononcer un mot, sans se départir un instant de cette inexplicable sérénité, que l’aspect de votre désespoir avait pu seul troubler quelques minutes. Arrivés au perron, et comme je m’informais de M. Mauvillars, sir Ralph me dit : Inutile de le chercher, madame, il n’est pas là , il est chez lui, et je suis venu seul avec mademoiselle Tatiane. À ces mots, je jetai un cri de désespoir en lui disant : Que voulez-vous donc que je pense, monsieur ? — Tout ce qu’il vous plaira, me répondit-il froidement. Et il partit, emmenant Tatiane, qui le suivit avec cette même docilité que je ne puis m’expliquer que par quelque dérangement d’esprit.
Jacques était en proie à une violente agitation.
De pâles qu’ils étaient, ses traits étaient devenus livides et son regard fixe brillait d’un éclat surnaturel.
— Seule ! murmura-t-il enfin, elle est venue seule avec lui ! et ils sont repartis seuls !… Mon Dieu ! mon Dieu ! que penser, qu’y a-t-il au fond de cet effroyable mystère ?
Après un instant de silence, il s’écria de nouveau avec un accent déchirant :
— Seule ! avec lui ! ah ! elle est perdue mon Dieu ! elle est perdue pour moi !
La jeune femme lui prit la main et d’une voix douce et pénétrante :
— Monsieur Turgis, lui dit-elle, savez-vous pourquoi je suis levée et tout habillée à cette heure matinale ?
Jacques avait à peine compris.
— Non, non, madame, répondit-il machinalement.
— Je vais chez Tatiane à laquelle je m’intéresse autant que vous-même.
— Vous allez la voir, madame ! s’écria le jeune homme avec explosion, oh ! permettez-moi de revenir tantôt vous demander…
— Mieux que cela : venez avec moi. Vous m’attendrez dans ma voiture pendant que je serai près d’elle, de sorte qu’avant une heure vous saurez… tout ce que j’aurai pu tirer d’elle.
— Oh ! que vous êtes bonne, madame.
Un instant après, la voiture de la baronne les emportait tous deux.
XLIV
LA FAMILLE
L’intention de la baronne de Villarsay, en se rendant chez les époux Mauvillars, avait été de se faire conduire à la chambre de Tatiane et d’avoir une explication avec elle.
Cette chambre était située dans l’aile opposée à celle qu’habitaient M. et madame Mauvillars, de sorte qu’il paraissait facile d’y arriver sans être vu par ceux-ci.
Mais, à peine était elle entrée dans la cour, laissant, comme nous l’avons dit, Jacques Turgis dans sa voiture, qu’elle vit un vieux domestique venir à elle d’un air effaré :
— Ah ! madame la baronne, lui dit-il, vous arrivez à propos.
— Comment cela ? demanda la jeune femme stupéfaite.
— Monsieur allait se rendre chez vous.
— Chez moi ! si tôt ! dit la baronne avec surprise.
— Si madame la baronne veut me suivre, je vais l’introduire dans le salon, où est réunie toute la famille.
— Et la cause de cette réunion ? demanda la baronne.
— Je l’ignore, mais il se passe quelque chose d’extraordinaire, car tout le monde paraît consterné.
— Et mademoiselle Tatiane fait partie de la réunion ?
— Non, madame la baronne.
— Allons, conduisez-moi.
Un instant après, le vieux domestique ouvrait la porte du salon et annonçait :
— Madame la baronne de Villarsay.
Quatre personnes étaient réunies là , assises, mornes et tristes, au milieu de la pièce.
C’étaient M. et madame Mauvillars et les deux grands-parents.
À l’annonce de la baronne, tous quatre se levèrent, comme mus par un même ressort, et tournèrent vers celle-ci des regards où se peignaient à la fois la stupeur et l’anxiété.
M. Mauvillars marcha vers elle, lui prit la main, et d’une voix où se trahissait une solennelle tristesse :
— Vous ici, à une heure aussi insolite, lui dit-il, c’est donc vrai ce que l’on dit ?
La baronne resta un instant interdite, ne sachant au juste comment interpréter ces paroles, quelque peu énigmatiques, et n’osant faire un pas en avant dans la crainte de commettre quelque inconséquence.
— Expliquez-vous plus clairement, mon ami, dit-elle enfin, et je vous répondrai.
— Veuillez prendre place parmi nous, dit M. Mauvillars en lui avançant un siège entre sa femme et son père.
Toutes les mains se tendirent vers celle de la baronne qui les pressa en silence et s’assit en proie à une vive émotion.
— Voici la lettre que je viens de recevoir, dit alors M. Mauvillars à la jeune femme.
Il ouvrit cette lettre et lut :
« Monsieur, il s’est passé hier, à la fête donnée par madame la baronne de Villarsay, un fait dont je crois de mon devoir de vous prévenir le premier. Mais permettez-moi d’abord une courte explication ; j’aimais mademoiselle Tatiane Valcresson, votre nièce, j’ai eu l’honneur de vous faire demander sa main par M. Badoir, votre parent et mon ami, et, malgré toutes les garanties que vous trouviez dans l’amitié dont m’honore cet homme si respectable, j’ai eu l’immense douleur de voir ma demande repoussée. Si je n’eusse vu qu’une affaire d’intérêt ou de convenance dans l’alliance que je sollicitais, j’aurais pu me résigner, mais j’adorais mademoiselle Tatiane et j’avais rêvé dans cette union un bonheur auquel je ne me sentais pas le courage de renoncer. À partir de ce moment je résolus de mettre tout en œuvre pour conquérir ce bonheur, qui m’avait été refusé quand je l’avais demandé loyalement, et en conséquence de cette résolution, je me présentai hier au bal de madame la baronne de Villarsay avec mademoiselle Tatiane Valcresson à mon bras. Notre entrée ne pouvait manquer d’être remarquée, toutes les danses ont cessé à notre apparition, tous les invités se sont pressés sur notre passage, et nous avons traversé ainsi deux fois le salon sous les regards stupéfaits de deux cents personnes dont vous êtes plus ou moins connu et qui aujourd’hui répandront la nouvelle dans tout Paris.
« C’est à la suite de ce fait, qui me met vis-à -vis de vous dans une situation toute nouvelle, que je viens aujourd’hui, pour la seconde fois, vous demander la main de mademoiselle Valcresson. Inutile d’ajouter, après l’événement que je viens de vous rapporter, qu’il s’est fait une révolution complète dans les sentiments de mademoiselle Tatiane à mon égard et que vous la trouverez toute disposée à accepter aujourd’hui la demande qu’elle a repoussée il y a quelques jours. Il ne me reste plus qu’à connaître votre décision et j’aurai l’honneur d’aller vous la demander aujourd’hui même.
« Agréez, monsieur, l’assurance de ma plus haute considération.
« SIR RALPH SITSON. »
Quand il eut terminé la lecture de cette lettre, M. Mauvillars se tourna vers la baronne :
— Eh bien ! lui demanda-t-il, qu’y a-t-il de vrai dans ce que vous venez d’entendre ?
— Malheureusement, répondit la jeune femme d’une voix grave, tout est vrai, du moins quant au fait matériel raconté par sir Ralph, car j’ignore entièrement à quel mobile a pu obéir Tatiane en accomplissant un acte aussi contraire à son caractère qu’aux sentiments que je lui ai souvent entendu exprimer à l’égard de sir Ralph.
Un morne et douloureux silence accueillit la déclaration de la jeune femme.
— Ainsi, c’est vrai ! murmura enfin M. Mauvillars, nous n’en pouvons plus douter.
Il reprit au bout d’un instant :
— Permettez-moi de vous adresser quelques questions, madame, car tout cela est si horrible, si invraisemblable, que j’ai besoin, pour en pénétrer mon esprit, que les faits me soient précisés.
— Interrogez-moi, je suis prête à répondre à toutes vos questions, répliqua la baronne.
— Vous étiez là au moment où ils sont entrés ?
— J’étais là , j’ai entendu annoncer sir Ralph, mademoiselle Tatiane Valcresson ; d’abord très-surprise du rapprochement de ces deux noms, mais convaincue que les nouveaux-venus entraient isolément, je fais un mouvement pour aller au-devant de Tatiane, et reste pétrifiée en la voyant entrer appuyée au bras de sir Ralph.
— Ah ! s’écria M. Mauvillars en portant la main à sa gorge comme s’il eût étouffé.
Le grand-père, lui, laissa tomber lourdement sa tête sur sa poitrine, tandis que sa femme portait son mouchoir à ses yeux, déjà rougis par les larmes.
— Et tout le monde les a vus, comme il le dit ? reprit M. Mauvillars.
— Tous nos invités ont couru au-devant d’eux et se sont échelonnés sur leur passage, aussi stupéfaits et presque aussi désolés que moi, car il n’en était pas un parmi eux dont Tatiane n’eût conquis la sympathie.
— Mais alors, s’écria M. Mauvillars, qu’avez-vous pensé ? qu’avez-vous dit ?
— J’ai demandé à sir Ralph une explication.
— Et il a répondu ?…
— Devant tous il a répondu que vous étiez là et que vous alliez entrer ; mais, à moi, il m’a déclaré qu’il était venu seul avec Tatiane, puis il est parti avec elle, me laissant si bouleversée que la pensée ne me vint qu’après leur départ que j’eusse dû la retenir près de moi.
— Mais elle, elle, Tatiane, que disait-elle et quelle était sa contenance ?
— Elle n’a pas prononcé un mot, et elle est restée, tout le temps de sa présence au bal, aussi calme et aussi souriante que si elle eût été entourée de sa famille.
— Quoi ! elle ne comprenait pas l’infamie…
— Ne dis pas cela ! ne dis pas cela ! s’écria le grand-père en se levant tout à coup, pâle et tremblant, ne prononce pas un pareil mot quand il s’agit de Tatiane, tu la calomnies. Je ne comprends rien à tout cela, je ne sais comment cela est arrivé ; mais, quoi qu’on puisse dire, quoi qu’on puisse prouver contre Tatiane, je la connais, moi, la chère petite, je connais l’innocence de son cœur, et devant l’évidence même je dirai que c’est faux, qu’on se trompe et qu’elle n’est pas coupable.
— Et tu auras raison, Joseph, ajouta la grand-mère avec un sanglot.
— Je partage entièrement cet avis, dit à son tour la baronne ; moi aussi, j’ai une foi aveugle dans l’innocence de Tatiane et la sérénité même qu’elle conservait dans une telle circonstance est pour moi la preuve qu’elle ne saurait être coupable.
— Elle n’en est pas moins perdue aux yeux du monde, s’écria M. Mauvillars avec un accent désespéré, et d’ailleurs, quelque douleur que nous en ressentions tous, quelle que soit notre confiance dans l’innocence et dans les principes de Tatiane, nous ne saurions pourtant admettre qu’elle ait consenti à se rendre à une fête, seule avec un inconnu, sans comprendre la gravité d’un pareil acte. Voilà qui domine tout et ce dont il faut que nous ayons une explication immédiate.
Il tira le cordon d’une sonnette.
— Pierre, dit-il au vieux domestique qui s’était présenté, avez-vous vu mademoiselle Tatiane ce matin ?
— Non, monsieur, répondit Pierre ; mais je viens de parler à Malvina, la femme de chambre, et il paraît qu’elle dort encore.
— Dites à Malvina d’aller l’éveiller et de la prévenir que nous l’attendons ici dans ce salon.
— J’y cours monsieur, répondit Pierre en sortant lentement.
— Tout ce que nous pourrions dire maintenant serait inutile, dit M. Mauvillars ; nous ne pouvons que nous perdre en conjectures, attendons.
Chacun comprit la justesse de cette observation, et il ne fut plus prononcé une parole.
Le salon était plongé, depuis un quart d’heure, dans ce lugubre silence, quand la porte s’ouvrit doucement.
C’était Tatiane qui entrait.
XLV
LE TRIBUNAL DE FAMILLE
Les cinq personnes qui attendaient Tatiane dans ce salon restèrent stupéfaites en voyant sa charmante tête apparaître, fraîche, candide et épanouie comme de coutume.
Un moment interdite à l’aspect de ces figures graves, attristées et presque menaçantes, la jeune fille jeta un cri de joie à la vue de la baronne de Villarsay, et, courant à elle :
— Vous, ma chère Céline ! s’écria-t-elle.
Mais un bras l’arrêta dans son élan.
C’était celui de M. Mauvillars.
— Vous paraissez surprise de voir ici madame la baronne de Villarsay, lui dit-il en laissant tomber sur elle un regard sévère.
— Très-surprise, répondit Tatiane, sans remarquer l’expression de ce regard. Après la fatigue qu’a dû lui occasionner son bal, je la croyais encore endormie.
— Et vous ne devinez pas le motif de sa présence ici à pareille heure ?
— Pas du tout.
Il se fit un silence.
M. Mauvillars contemplait la jeune fille avec un inexprimable sentiment de stupeur et tout le monde semblait frappé comme lui de l’air de candeur et de sérénité qu’elle conservait après les événements de la nuit.
C’est que jamais cette ravissante expression n’avait éclaté avec autant de charme sur sa jolie tête.
Éveillée par Malvina et pressée de se rendre à l’invitation de son oncle, elle avait passé à la hâte une robe de chambre et avait relevé négligemment sa belle chevelure blonde, dont la masse, formant un splendide fouillis autour de son front d’enfant, accentuait encore le caractère naïf de sa physionomie.
— Asseyez-vous là , en face de nous, lui dit M. Mauvillars, et répondez à mes questions.
Cette fois Tatiane fut frappée du ton dont lui parlait son oncle et de l’expression triste et sévère empreinte sur tous les visages.
Nature tendre, délicate et profondément impressionnable, elle se troubla tout à coup devant ces figures qui, au lieu de sourire à son approche, comme de coutume, lui restaient pour ainsi dire fermées et se dressaient devant elle, sombres et hostiles, et ce fut avec un douloureux serrement de cœur qu’elle prit place sur le siège que lui désignait son oncle.
— Tatiane, lui demanda enfin M. Mauvillars, où avez-vous passé cette nuit ?
À cette question, la jeune fille regarda M. Mauvillars du même air que s’il lui eût parlé une langue étrangère, incompréhensible pour elle.
— Vous refusez de répondre ? reprit celui-ci.
— Oh ! non, mon oncle, dit Tatiane du ton le plus naturel, mais c’est que… j’ai mal entendu.
— Je répète donc ma question, et vous prie de me dire où vous avez passé la nuit.
Au lieu de se choquer, de rougir, de paraître embarrassée, comme on s’y attendait, la jeune fille ne montra qu’une profonde surprise.
— Mais, mon oncle, répondit-elle avec un vague sourire, où voulez-vous que je l’aie passée, si ce n’est dans mon lit, que je viens de quitter.
Cette absence complète de trouble, cet accent de parfaite sincérité, cette surprise si naïvement exprimée portèrent au plus haut point la stupeur des cinq personnes qui l’écoutaient.
Aussi fût-ce avec quelque embarras que M. Mauvillars reprit la parole :
— Vous venez de quitter votre lit, c’est évident, dit-il, mais pouvez-vous me dire où vous étiez de minuit à une heure du matin ?
— Mais, toujours dans mon lit, mon oncle, puisque je me suis couchée à dix heures en même temps que grand-papa et grand’maman Mauvillars, répondit Tatiane avec un sourire dont l’expression toute particulière laissait deviner qu’elle croyait à quelque mystification.
— Alors, répliqua M. Mauvillars, comment se fait-il qu’on vous ait vue, de minuit à une heure, au bal de madame la baronne de Villarsay ?
— Moi ! moi ! au bal de… ah ! pour le coup, mon oncle, c’est trop fort !
Et elle faillit éclater de rire.
Mais un coup d’œil jeté sur les quatre personnes assises en face d’elle l’arrêta tout à coup.
Toutes étaient d’une gravité si solennelle et d’une tristesse si navrante que Tatiane en fut subitement atterrée.
— Mais, murmura-t-elle d’une voix qui devint tout à coup tremblante, qu’y a-t-il donc ? que se passe-t-il ici, et que me veut-on ?
Ses fraîches couleurs s’étaient évanouies comme un soleil qui se couche, et elle promenait autour d’elle des regards troublés.
La jeune baronne fut émue de pitié.
Elle se leva, s’approcha d’elle, et, prenant sa main qu’elle pressa affectueusement dans les siennes :
— Mon enfant, lui dit-elle, pourquoi nier que tu as paru à ma fête, puisque je t’ai vue, puisque je t’ai parlé ?
La jeune fille se leva brusquement et, le regard plongé dans les yeux de la baronne, la main posée sur son épaule :
— Vous m’avez vue à votre fête ? vous m’avez parlé ? murmura-t-elle d’une voix altérée par l’émotion.
— Oui, mon enfant, répondit la jeune femme, tu as traversé mon salon au milieu de mes deux cents invités stupéfaits de te voir là sans ta famille.
— Ainsi, reprit Tatiane, j’aurais été là seule ?
— Seule ! oh ! non, malheureusement, dit M. Mauvillars.
— Je ne comprends pas, balbutia la jeune fille.
— Vous êtes entrée à ce bal au bras d’un homme, un inconnu.
— Moi ! moi !
— Et cet homme, c’était sir Ralph.
— Sir Ralph !
Tatiane avait jeté ce nom avec un cri d’horreur.
Puis elle resta immobile, les traits pâles et bouleversés, et murmurant d’un air égaré :
— Sir Ralph avec moi ! au bal ! cette nuit !
Elle garda quelques instants le silence, la tête penchée sur la poitrine, le regard fixé sur le parquet.
Puis, sortant peu à peu de cette torpeur et promenant lentement autour d’elle ses beaux yeux bleus :
— Je vous en prie, dit-elle d’une voix calme et douce, répondez à la question que je vais vous adresser et fixez-moi sur un point qui m’inquiète sérieusement ; suis-je folle ou ai-je l’usage de ma raison ?
— Folle, chère petite ? quelle idée ! lui dit la baronne.
— Alors, puisque je ne suis pas folle, je puis affirmer que je me suis couchée à dix heures, que je n’ai quitté mon lit que ce matin, il y a dix minutes, et que c’est vous qui êtes dans l’erreur quand vous dites m’avoir vue à votre bal.
— Mais, chère enfant, répliqua la jeune femme, en supposant que j’aie pu commettre une méprise aussi prodigieuse, on ne saurait admettre que deux cents personnes aient été dupes de la même erreur, et tout le monde t’a reconnue.
— Tout le monde s’est trompé, s’écria Tatiane, car il m’est bien plus difficile d’admettre, moi, que je n’ai pas passé la nuit dans mon lit et surtout que j’aie pu me rendre à votre fête en compagnie de sir Ralph. La folie seule pourrait expliquer un pareil oubli de toute pudeur et de tous les sentiments dont je suis animée, je le répète ; puisque je ne suis pas folle, cela n’est pas.
La baronne de Villarsay garda un instant le silence.
On devinait qu’elle venait de concevoir un projet et qu’elle hésitait à le mettre à exécution.
— Allons, dit-elle enfin avec un geste résolu, il faut que la lumière se fasse, il le faut à tout prix.
Et, se tournant vers M. Mauvillars :
— Veuillez sonner, lui dit-elle.
M. Mauvillars obéit.
Pierre, le vieux domestique qui avait introduit la baronne, parut un instant après.
La jeune femme alla au-devant de lui et lui dit quelques mots à l’oreille.
— Bien, madame la baronne, répondit le vieux serviteur en se retirant.
— Que prétendez-vous faire ? demanda Tatiane à la jeune femme.
— C’est mon secret, répondit celle-ci.
— Une accusation pareille ! s’écria la jeune fille, avec plus de stupeur que de désespoir, oh ! mais c’est inouï, c’est odieux.
Puis, après un moment de réflexion, elle s’écria tout à coup en s’adressant à la baronne :
— Eh bien, puisque vous m’avez vue, quelle était la toilette que je portais !
— La toilette de faye rose que je t’ai vue, il y a deux mois, au bal de madame de Tréviannes.
— Bien, répliqua vivement Tatiane, elle est depuis quinze jours chez ma couturière et c’est la seule robe rose que j’aie dans ma garde-robe.
— En vérité ? Tu me dis bien vrai, Tatiane ? demanda la baronne avec un rayon d’espoir dans les yeux.
— Venez visiter ma garde-robe, veuillez nous accompagner, ma tante, et, si vous trouvez chez moi cette toilette de faye rose, croyez alors tout ce qu’il vous plaira.
— Soit, car je ne demande qu’à être convaincue, répondit la baronne.
Et elle quitta le salon avec Tatiane et madame Mauvillars.
Cette épreuve devait être décisive, aussi la jeune fille était-elle rayonnante.
Un instant après, elle ouvrait la porte de sa chambre en leur disant :
— Tenez, cherchez d’abord dans cette pièce.
Les deux femmes fouillèrent toute la pièce sans rien découvrir.
— Rien ici, dit avec joie madame Mauvillars.
— Visitons maintenant mon cabinet de toilette, dit Tatiane en ouvrant avec empressement la porte qui conduisait à cette pièce.
Mais à peine eut-elle poussé cette porte qu’elle s’arrêta sur le seuil en laissant échapper un cri étouffé. Le premier objet qui avait frappé ses regards était sa robe de faye rose pendue à une patère.
— Malheureuse enfant ! s’écria madame Mauvillars avec un accent désespéré, mais la voilà , cette robe !
Tatiane porta la main à son front, en murmurant tout bas :
— Oh ! oui, oui, je dois être folle.
— Allons, ma chère Tatiane, lui dit la baronne, en la forçant à s’appuyer sur son bras, on nous attend au salon, il faut descendre.
Tatiane la suivit machinalement et sans rien dire.
— Eh bien ? demanda M. Mauvillars en les voyant reparaître.
— La robe rose est là , répondit tristement madame Mauvillars.
— Reprenez votre place, Tatiane, dit froidement M. Mauvillars à la jeune fille, qui obéit avec une morne résignation.
Au même instant la porte s’ouvrait ; Pierre entrait et disait à la baronne de Villarsay :
— Madame la baronne, voici la personne.
— Introduisez-la, dit la jeune femme.
Pierre annonça :
— M. Jacques Turgis.
— Lui ! lui ! s’écria Tatiane en cachant dans ses deux mains son visage, qui venait de se couvrir d’une rougeur subite.
XLVI
UN GRAND COEUR
Jacques Turgis entra.
Il paraissait extrêmement ému ; mais, à l’aspect de Tatiane, assise en face de cinq personnes à l’air sombre et désolé, comme un criminel devant ses juges, il s’arrêta interdit et en proie à une profonde angoisse.
— Mes amis, dit alors la baronne en s’adressant à toute la famille, je vous présente M. Jacques Turgis, artiste peintre, homme de cœur et de talent, et dont le témoignage a une grande importance dans l’affaire qui nous occupe, car il aime Tatiane.
— Ah ! fit M. Mauvillars en observant l’artiste.
— Il l’aime d’un amour profond, respectueux et discret, reprit la baronne, car il ne m’a pas confié ses sentiments, c’est moi qui les ai surpris, et, si je vous les révèle aujourd’hui, c’est pour vous faire comprendre la valeur que nous devons attacher à ses moindres paroles dans cette circonstance.
La jeune femme reprit après un moment de réflexion :
— M. Turgis assistait à ma fête et, comme moi, il a vu Tatiane s’y présenter appuyée sur le bras de sir Ralph. Est-ce vrai, monsieur Turgis ?
À cette question, Tatiane releva la tête, la tourna lentement vers Jacques, fixa sur lui un regard à la fois inquiet et anxieux, et attendit avec tous les signes d’une profonde agitation.
Jacques garda quelques instants le silence, regardant tour à tour Tatiane et les juges, et évidemment en proie à une irrésolution qui prenait sa source dans la crainte d’affliger la jeune fille.
La baronne de Villarsay devina ce sentiment, et, adressant aussitôt la parole à l’artiste :
— Monsieur Turgis, lui dit-elle, il y a dans cette étrange affaire un mystère qui peut causer la perte de Tatiane, si nous ne parvenons à le pénétrer ; c’est donc dans son intérêt que je vous adjure de dire la vérité sans ménagement ni réticence, comme je viens de le faire moi-même, et vous savez si j’aime cette chère enfant.
— Répondez, monsieur, lui demanda à son tour M. Mauvillars, avez-vous vu ma nièce, mademoiselle Tatiane Valcresson, entrer, hier à minuit, dans le salon de madame la baronne de Villarsay, au bras de sir Ralph ?
Tatiane attendit la réponse de Jacques avec une appréhension qui ramena la pâleur sur ses traits.
C’est qu’elle avait dans son amour et dans sa loyauté une foi aveugle, et elle se disait :
— Quand il aura parlé, je saurai enfin si malgré moi, malgré ma volonté et, pour ainsi dire, sans ma participation, j’ai commis l’acte inouï dont on m’accuse.
— Rappelez-vous ce que je viens de vous dire, monsieur Turgis, lui dit la baronne, songez que l’honneur, que la destinée entière de Tatiane sont en jeu en ce moment et qu’il n’est qu’un seul moyen de la sauver, c’est de dire et de chercher la vérité par tous les moyens possibles.
— Eh bien, oui, monsieur, répondit enfin Jacques en se tournant vers M. Mauvillars, oui, j’ai vu mademoiselle Tatiane se présenter à la fête de madame la baronne, appuyée sur le bras de sir Ralph.
Et, après cette déclaration, prononcée lentement, mot à mot, avec un effort visible, il se laissa tomber, accablé, sur le siège qu’on lui avait avancé.
— Il m’a vue ! murmura alors Tatiane avec l’accent d’un sombre désespoir, c’est donc vrai, j’y étais… et j’y étais avec cet homme ! Oh ! quelle honte ! mon Dieu ! quelle honte !
— Eh bien, Tatiane, lui demanda M. Mauvillars, qu’avez-vous à répondre à cela ?
— Toujours la même chose, mon oncle, répondit la jeune fille, je n’ai pas quitté ma chambre, je n’ai rien à dire de plus.
— Vous révoquez donc en doute la bonne foi de M. Turgis ?
— Dieu m’en garde ! mon oncle, j’estime trop le caractère de M. Turgis pour douter de sa parole ; mais, quand l’univers entier se joindrait à lui pour affirmer que j’ai été vue à ce bal, je ferais toujours la même réponse : je n’ai pas quitté ma chambre.
Puis changeant tout à coup de ton :
— Voyons, mon oncle, ma bonne tante, mes chers vieux parents, dit-elle d’une voix altérée par les sanglots qui lui montaient à la gorge, vous tous qui aimez votre Tatiane, vous qui, la suivant depuis son enfance, l’avez vu se développer heure par heure sous vos yeux, vous devant qui elle a toujours ouvert son cœur et qui avez pu y voir éclore, à mesure qu’elle les ressentait elle-même, tous ses sentiments et toutes ses pensées, voyons, dites, croyez-vous qu’elle soit capable de mentir ? Croyez-vous qu’elle ait pu quitter, la nuit, en cachette, cette maison où elle a grandi dans la pureté et dans l’innocence, pour aller où ? au milieu d’une fête, pleine d’amis et de connaissances qui devaient la dénoncer le lendemain ! avec qui ? avec un homme qui ne lui inspirait que de l’horreur et dont elle avait refusé la main quelques jours auparavant ? Voyons, mes chers parents, réfléchissez et dites si cela est possible.
Ces paroles, prononcées d’une voix douce et pénétrante, et que rendaient plus touchantes encore les larmes qui ruisselaient sur ce charmant visage, où éclataient si vivement la franchise et la naïveté de son âme, produisirent une profonde impression sur tous ceux qui l’écoutaient.
— Non ! s’écria le grand-père avec explosion, cela n’est pas possible, ma chère petite Tatiane est incapable de mentir, je ne vois que cela et je ne crois qu’elle.
Et, n’y pouvant plus tenir, il courut à la jeune fille et la pressa dans ses bras, mêlant ses larmes aux siennes.
Jacques n’était pas moins ému que le vieillard.
Il eût voulu aller se jeter aux pieds de Tatiane et lui demander pardon de la douleur qu’il venait de lui causer en déclarant qu’il l’avait vue avec sir Ralph, mais, obligé de se contenir, il se contentait de la regarder de loin, et la contraction de ses traits trahissait seule l’émotion à laquelle il était en proie.
— Hélas ! dit enfin M. Mauvillars au milieu du silence qui s’était fait, moi aussi je connais l’innocence de Tatiane, moi aussi je la sais incapable de mentir ; mais enfin, quand de toutes parts on vient vous dire : « Elle était à ce bal ; elle y était au bras de sir Ralph, je l’y ai vue ! » et quand cette déclaration vous est faite par les gens qui l’aiment le plus, qui donneraient tout au monde pour prouver son innocence, que faire à cela ? Comment douter devant le témoignage de deux cents personnes, venant confirmer les faits avancés dans la lettre de ce sir Ralph ?
— Vous avez raison, mon oncle, reprit Tatiane en essuyant ses larmes ; tout est contre moi, tous les témoignages s’élèvent pour m’accabler, et je n’ai que ma parole à opposer à toutes ces preuves. Rendez-vous donc à l’évidence, qui me condamne, je n’ai plus rien à dire et renonce à me défendre davantage.
— Mais, malheureuse enfant, s’écria M. Mauvillars, comprends donc l’horrible situation qui nous est faite. Que nous consentions à t’absoudre, nous tous qui connaissons la noblesse et la candeur de ton âme, tu n’en seras pas moins perdue aux yeux du monde, qui a vu et ne peut croire que ce qu’il a vu.
— Je comprends cela, mon oncle, répondit Tatiane, mais je n’y puis rien faire ; victime de je ne sais quelle effroyable fatalité, je ne puis que courber la tête sous la réprobation qui me frappe injustement et attendre dans les larmes que la honte et la douleur me tuent.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! murmura madame Mauvillars avec l’accent du plus profond désespoir, comment sortir de cette terrible situation ? comment pénétrer l’épouvantable mystère qui nous enveloppe ? comment arracher cette pauvre enfant de l’abîme où elle est tombée et où elle va périr si Dieu ne lui vient en aide ?
Jacques se leva.
— Madame, dit-il d’une voix grave et émue, il est peut-être un moyen, sinon de porter la lumière dans les ténèbres qui entourent cette affaire, du moins d’attester aux yeux du monde l’innocence de mademoiselle Tatiane et de témoigner hautement qu’un dépit de toutes les apparences qui s’élèvent contre elle sa considération n’a rien souffert dans l’opinion de ceux qui la connaissent et sont à même de l’apprécier.
— Et ce moyen ? demanda vivement monsieur Mauvillars.
— Oh ! parlez, monsieur, dit Tatiane d’une voix tremblante.
Tous les regards étaient tournés vers l’artiste, et chacun attendait avec une émotion anxieuse la parole qui allait tomber de sa bouche, la voie de salut qu’il allait indiquer.
— Monsieur Mauvillars, reprit Jacques, pardonnez-moi de faire ici mon propre éloge, les circonstances l’exigent. Né dans la plus humble des conditions, j’ai eu à traverser de ces épreuves où beaucoup, et des plus fiers, laissent toujours quelque chose de leur considération ou de leur dignité ; j’en suis sorti, moi, sans y rien abandonner dont ma conscience ait à rougir, j’ai dégagé mon nom du creuset de la misère, pur et sans tache, j’ai payé cher le peu de renommée que j’ai conquis dans mon art et la place que je me suis faite dans la société, mais jamais au prix d’une bassesse ou d’une concession à la probité ; enfin, monsieur, consultez mes amis, mes camarades, mes maîtres, et tous vous diront avec quel soin scrupuleux j’ai toujours veillé sur mon honneur, tous vous jureront que je suis homme à tout lui sacrifier, jusqu’à mon propre cœur, jusqu’à la plus impérieuse des passions ; eh bien, monsieur Mauvillars, je vous demande la main de mademoiselle Tatiane Valcresson.
Dans le silence qui suivit ces paroles, on entendit la voix de Tatiane prononcer le nom de Jacques d’une voix basse et profondément attendrie.
Les deux grands-parents, les traits radieux et les yeux pleins de larmes, paraissaient résister avec peine à la tentation de courir se jeter dans les bras du jeune homme.
Madame Mauvillars et la jeune baronne laissèrent déborder elles-mêmes le sentiment d’admiration dont elles étaient pénétrées pour l’artiste.
M. Mauvillars, lui, semblait impassible, et chacun se demandait avec inquiétude ce qui se passait en lui, lorsque, marchant tout à coup vers l’artiste :
— Monsieur Turgis, lui dit-il avec une brusquerie qui dissimulait mal son émotion, laissez-moi vous serrer la main, vous êtes un homme de cœur.
À ce mouvement inattendu, Tatiane était devenue rayonnante.
Déjà elle s’abandonnait à l’espoir avec cette naïveté charmante qui formait un des traits caractéristiques de cette nature toute d’expansion, quand, la porte s’ouvrant doucement, Pierre parut sur le seuil et annonça :
— Sir Ralph Sitson !

![]()
XLVII
LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ
À l’entrée de sir Ralph, Tatiane s’était levée brusquement et avait jeté de son côté des regards effarés.
Puis, saisie d’une faiblesse subite et se sentant fléchir sur ses jambes, elle s’était laissée retomber sur son siège, toute pâle et toute tremblante.
Quant à lui, il était calme ou tentait de le paraître.
Il s’avança d’un pas lent et grave, feignant de ne pas voir les regards sombres et irrités qui se dirigeaient vers lui.
Arrivé au milieu du salon, à quelques pas des cinq personnes qui s’y trouvaient assises, ayant à sa gauche Tatiane et à sa droite Jacques Turgis, auquel il affecta de n’accorder aucune attention, il salua en silence et attendit qu’on l’invitât à s’asseoir.
Ce n’est pas par là du moins que commença M. Mauvillars.
— Monsieur, lui dit-il avec une froideur hautaine, mademoiselle Tatiane, ma nièce, a hérité de son père une fortune de trois cent mille francs, qui, depuis douze ans que je l’ai reçue en dépôt, a fructifié entre mes mains et a presque doublé.
— Monsieur ! fit sir Ralph avec un geste plein de noblesse qui signifiait clairement : De grâce, laissons-là les questions d’argent.
— Laissez-moi continuer, lui dit M. Mauvillars d’un ton bref.
Il reprit :
— Ce n’est pas tout, j’ai cent cinquante mille livres de rentes, je n’ai pas d’enfants, j’ai toujours considéré Tatiane comme ma fille, et tout le monde sait qu’elle héritera un jour de ma fortune. Vous avez été mis au courant de tous ces détails, dont je ne fais mystère à personne, et vous m’avez fait demander la main de ma nièce. Votre demande ayant été repoussée, vous eussiez dû vous en tenir là , et c’est ce qu’eût fait un honnête homme, mais non un chevalier d’industrie à la recherche d’une fortune et décidé à la conquérir par tous les moyens possibles. C’est alors que vous avez imaginé je ne sais quelle combinaison infernale pour me contraindre à vous accorder la main de Tatiane, c’est alors que vous l’avez compromise publiquement, de manière à ce qu’elle n’eût plus d’autre alternative que de choisir entre le déshonneur et vous, c’est-à -dire entre deux hontes. Voilà ce que vous avez fait, monsieur ; eh bien, laissez-moi vous dire ma pensée en deux mots : si je n’écoutais que les sentiments que vous m’inspirez, je vous aurais déjà fait jeter à la porte.
Sir Ralph avait écouté ce compliment avec une résignation apparente, mais que démentaient la pâleur et la contraction de ses traits.
— Monsieur Mauvillars, répliqua-t-il, je n’ai qu’un mot à répondre, à une apostrophe qui, vous l’avouerez, ne brille pas au moins par la modération, je vous demande mademoiselle Tatiane sans dot.
M. Mauvillars répondit par un éclat de rire ironique.
— Voilà de la grandeur d’âme à bon marché, lui dit-il, Tatiane a une fortune personnelle de six cent mille francs dont nul ne peut la priver, et vous savez que nous l’aimons trop pour ne pas lui laisser au moins les trois quarts de notre fortune.
— Je vous assure, monsieur, que l’amour a été mon seul mobile dans cette circonstance.
— Laissons cela de côté, monsieur, et parlons d’autre chose. Vous m’avez écrit pour me faire savoir ce qui s’était passé chez madame la baronne de Villarsay, qui m’a confirmé le fait énoncé dans votre lettre, mais vous ajoutez que je dois voir dans ce fait la preuve que les sentiments de mademoiselle Tatiane à votre égard ont complètement changé et qu’elle est toute disposée désormais à accepter la main qu’elle a refusée d’abord.
— Oh ! s’écria Tatiane avec un inexprimable sentiment d’horreur.
— Voici sa réponse, monsieur, reprit M. Mauvillars, et non-seulement ce déplorable événement n’a rien changé aux sentiments que vous lui inspiriez, mais elle affirme n’avoir pas quitté sa chambre de toute la nuit, et nie conséquemment avoir paru à votre bras au bal de madame la baronne de Villarsay.
— À cela j’ai une réponse bien simple à faire, dit sir Ralph, que madame la baronne prononce, et je m’engage d’avance à m’en rapporter à sa déclaration.
— Je viens de vous le dire, madame la baronne confirme le fait, il est donc incontestable ; d’un autre côté, Tatiane, qui est incapable de mentir, déclare avoir passé la nuit entière dans son lit ; or, vous seul, monsieur, qui avez entraîné cette jeune fille au sein d’une fête dans le dessein de la compromettre publiquement, vous seul, pouvez nous donner l’explication de ce mystère, et je vous adjure de nous dire la vérité.
— Oh ! je vous en prie, je vous en supplie, monsieur, s’écria tout à coup Tatiane en se tournant vers sir Ralph, les mains jointes et le regard suppliant, faites-nous connaître la vérité sur cette horrible affaire.
Il y eut un moment de silence. Sir Ralph semblait hésiter et ses traits exprimaient un embarras qui donna quelque espoir à la jeune fille.
— Oh ! je vous en prie en grâce, monsieur, dites la vérité et je vous pardonnerai du fond du cœur tout le mal que vous m’avez fait.
— Mon Dieu, mademoiselle, dit enfin sir Ralph, je suis désolé de la réponse que je vais vous faire, mais enfin l’évidence est là . Non-seulement nous sommes entrés ensemble à cette fête, mais tout le monde a pu voir que vous y paraissiez sans la moindre contrainte, que vous y étiez venue de votre plein gré, que vous vous appuyiez sur mon bras, le calme au front et le sourire aux lèvres, et que le sentiment qui dominait dans l’expression de votre physionomie était un sentiment de bonheur ; la vérité que vous me priez de dire, vous la connaissez donc comme moi, et s’il y a un mystère dans cette affaire pour ceux qui nous écoutent, ce mystère n’existe pas plus pour vous que pour moi-même.
— Oh ! le malheureux ! le malheureux ! s’écria Tatiane en se frappant le front avec un geste désespéré, il voudrait faire croire que je suis sa complice.
Puis, se tournant de nouveau vers sir Ralph :
— Voyons, monsieur, lui dit-elle d’une voix frémissante, répondez aux questions que je vais vous adresser, si ce n’est pour moi, au moins pour ma famille et pour mes amis, mes juges en ce moment. Dites-leur donc, je vous en supplie, comment vous avez pénétré près de moi, par quel moyen vous avez pu me résoudre à vous suivre et comment il se fait que je sois arrivée chez madame la baronne de Villarsay en toilette de bal, sans en avoir conscience, sans en avoir conservé le moindre souvenir.
— Hélas ! mademoiselle, répondit sir Ralph, je comprends parfaitement le but où tendent ces questions mais je suis désolé de ne pouvoir me rendre au désir qu’elles me laissent deviner et qu’il m’est absolument impossible de satisfaire. Comment, en effet, voulez-vous que je fasse croire que vous n’êtes pas venue avec moi à ce bal quand deux cents personnes vous y ont vue ? Comment pourrais-je affirmer que vous n’aviez pas conscience de vos actes quand chacun a admiré sur votre physionomie l’expression de sérénité qui lui est habituelle ? Quant à dire toute la vérité devant votre famille, c’est à quoi je ne saurais me résoudre, et je crois m’expliquer assez clairement en leur déclarant que je suis prêt à réparer le tort que j’ai fait à votre réputation.
— Oh ! c’est affreux ! c’est affreux ! s’écria Tatiane en se tordant de désespoir.
Puis, se levant tout à coup :
— Mon oncle, mes chers parents, mes amis, dit-elle d’une voix tremblante d’émotion ; je vous jure par tout ce que j’ai de plus cher, par le souvenir de ma mère, je vous jure qu’il ment, qu’il ment pour me perdre et pour me contraindre à l’accepter pour époux.
— Monsieur Mauvillars, dit à son tour Jacques Turgis, mademoiselle Tatiane a deviné les desseins de cet homme ; le mensonge et l’infamie sont écrits en toutes lettres sur son visage, et plus que jamais, depuis qu’il l’a calomniée, je suis convaincu de l’innocence de mademoiselle Tatiane, dont je vous demande de nouveau la main.
Sir Ralph se tourna lentement vers l’artiste et dardant sur lui un regard haineux.
— Vous n’êtes pas l’oncle de mademoiselle Tatiane, vous, monsieur, lui dit-il ; je vous demanderai raison de vos paroles.

![]()
— C’est avec joie que je vous ferai cet honneur, monsieur, répliqua vivement Jacques, et dès demain.
— Oh ! dit sir Ralph avec un sourire ironique, je suis moins pressé que vous ; avant de vous demander réparation, j’en ai une à accorder ici, celle-là passera d’abord, si vous le voulez bien.
— Mais moi, je ne veux pas, je ne veux pas ! s’écria Tatiane en sanglotant tout à coup, je préfère la mort à cette odieuse union ! la mort ou un couvent, où je passerai le reste de mes jours !
— Ni la mort, ni un couvent ne vous rendraient l’honneur, Tatiane, lui dit gravement son oncle.
La baronne de Villarsay prit tout à coup la parole :
— Mon ami, dit-elle à M. Mauvillars, puisque sir Ralph, par un sentiment de délicatesse que je me permets de trouver excessif, refuse de nous faire connaître la vérité, il faut la chercher ailleurs, et je viens de penser à une personne dont le témoignage pourrait peut-être jeter quelque lumière dans ces ténèbres.
— Qui donc ? demanda vivement la jeune fille.
Sir Ralph attendit en fronçant légèrement le sourcil.
— Malvina, la femme de chambre, répondit la baronne.
Tatiane jeta un cri de joie.
— En effet, dit-elle, comment n’y avons-nous pas encore songé ?
Au nom de Malvina, le front de sir Ralph s’était rasséréné, et un équivoque sourire avait effleuré ses lèvres.
M. Mauvillars avait déjà sonné et avait donné ordre à Pierre, qui s’était présenté aussitôt de lui envoyer Malvina.
La jeune femme de chambre entrait un instant après.
Le lecteur se souvient sans doute que Malvina était la fille des époux Claude, de Vanves, et qu’elle avait été placée près de Tatiane par la mystérieuse influence de Mac-Field et de sir Ralph.
— Malvina, lui dit M. Mauvillars, vous avez été appelée cette nuit par mademoiselle Tatiane, n’est-ce pas ?
— Non, monsieur, répondit la femme de chambre, après avoir jeté un coup d’œil du côté de sir Ralph, ou du moins, si mademoiselle m’a appelée, je lui en demande bien pardon, mais je n’ai rien entendu.
— Ainsi vous êtes sûre, bien sûre de ne pas vous être relevée vers minuit pour vous rendre près de votre jeune maîtresse ?
— Oh ! très-sûre, monsieur, je me suis couchée à dix heures, je me suis endormie de suite et ne me suis éveillée que ce matin à sept heures.
— C’est bien, c’est tout ce que j’avais à vous demander ; vous pouvez vous retirer.
Quand elle fut sortie :
— Vous pouvez en faire autant, monsieur, dit froidement M. Mauvillars à sir Ralph, je vais continuer de chercher la vérité que vous refusez de nous faire connaître et bientôt vous recevrez de mes nouvelles.
Sir Ralph salua en silence et sortit.
XLVIII
LUEUR D’ESPOIR
Après le départ de sir Ralph, il y eut un long silence.
Ce fut Tatiane qui le rompit.
— N’est-ce pas, mon cher oncle, dit-elle à M. Mauvillars, que vous ne croyez pas aux calomnies de cet homme ?
— Je le crois capable de tout et j’entrevois dans cette affaire quelque infernale machination, répondit M. Mauvillars, mais il reste toujours ce fait terrible, écrasant, inexplicable, tu as été vue entrant avec lui seul au bal de madame la baronne, te promenant calme et souriante parmi les invités, stupéfaits et scandalisés d’un pareil spectacle, que veux-tu que je dise à ceux qui ont été témoins de cette énormité et que veux-tu que j’en pense moi-même ?
— Vous avez raison, mon oncle, dit Tatiane avec l’accent d’un morne désespoir, il y a là de quoi confondre la raison et je conviens qu’il est impossible de révoquer en doute ce qu’on a vu de ses propres yeux, et c’est comme si vous aviez vu, puisque ce fait inouï, incroyable vous est attesté par mon amie, par M. Jacques Turgis, et vous sera répété aujourd’hui peut-être par cent personnes.
— Écoutez, monsieur Mauvillars, dit alors Jacques Turgis, nous nous trouvons en ce moment entre deux affirmations absolument contradictoires et également dignes de foi l’une et l’autre ; d’un côté, madame la baronne de Villarsay et ses deux cents invités déclarant qu’ils ont vu mademoiselle Tatiane entrer au bal appuyée ou bras de sir Ralph ; de l’autre, mademoiselle Tatiane jurant solennellement qu’elle a passé ta nuit entière dans son lit ; eh ! bien, si vous voulez m’en croire, ne portons aucun jugement, ne décidons rien avant d’avoir éclairci cet inexplicable mystère ; si j’ai le bonheur de vous inspirer quelque confiance, permettez-moi de joindre mes efforts aux vôtres pour arriver à ce résultat.
— Je vous remercie et j’accepte votre offre, monsieur, répondit M. Mauvillars, mais voici à quelles conditions : si, malgré tout ce que nous allons tenter, ce mystère reste impénétrable, l’honneur exige que Tatiane, perdue par sir Ralph, devienne son épouse ; si au contraire vous parvenez à prouver hautement et publiquement que Tatiane, victime d’un complot infâme, est innocente et si vous le démontrez de manière à ce que l’ombre d’un doute ne puisse s’élever désormais sur sa réputation, alors vous aurez conquis Tatiane et je vous la donne.
— Ah ! monsieur, s’écria Jacques en se jetant sur la main de M. Mauvillars, qu’il pressa énergiquement dans les siennes.
— Mon cher oncle ! s’écria à son tour la jeune fille dans un transport de joie qui la rendit aussitôt toute confuse.
— Hélas ! mes enfants, répondit M. Mauvillars en hochant tristement la tête, ne vous hâtez pas trop de vous réjouir : la tâche que nous allons entreprendre là est bien difficile, pour ne pas dire impossible, et si nous y échouons, si Tatiane reste compromise, je vous le répète, je serai inflexible, elle sera la femme de sir Ralph.
— Soutenu par ma foi dans l’innocence de mademoiselle Tatiane et par la perspective du bonheur qui m’est promis, s’écria Jacques avec exaltation, je suis sûr du succès.
— Mais il faut nous fixer une époque : combien demandez-vous de temps ?
— Huit jours, répondit vivement l’artiste.
— Moi, je dis quinze, et je vais écrire immédiatement à sir Ralph que, ce temps écoulé, je lui ferai part de ma résolution, et, si le ciel est pour nous dans l’entreprise où nous allons nous engager, soyez tranquille, c’est moi qui me charge du châtiment de ce misérable.
— Mais, s’écria Jacques, il m’a provoqué.
— C’est bon, c’est bon, nous verrons quand nous en serons là ; quant à présent, ne songeons qu’à l’œuvre que nous avons à accomplir, elle offre assez de difficultés pour nous absorber tout entiers. Nous sommes deux, il est vrai, mais…
— Nous serons trois, dit Jacques.
— Quel est donc le troisième ?
— Un ennemi de sir Ralph, un homme aussi habile que déterminé qui a juré sa perte et dont l’aide et les conseils nous seront d’un grand secours. On le nomme M. Portal et il est rentier, je vous le présenterai et nous nous entendrons tous trois pour combiner un plan.
— Vous avez une grande confiance dans cet homme ?
— Une confiance aveugle et que vous partagerez dès que vous l’aurez vu ; malgré les obstacles presque insurmontables qui se dressent devant nous, je répondrai du succès s’il consent à nous accorder son concours, et, vu la haine dont il est animé contre sir Ralph, je suis à peu près certain de l’obtenir.
— Eh bien, allez voir ce M. Portal et entendez-vous avec lui, nous n’avons pas une minute à perdre.
Jacques quitta la famille Mauvillars, le cœur plein de joie et d’espoir, mais ne se dissimulant pas cependant les immenses difficultés qui se dressaient entre lui et la réalisation de son rêve.
Une demi-heure après, il arrivait rue Amelot, chez Rocambole, pour lui M. Portal.
Il le trouva avec Paul de Tréviannes, qui depuis le jour où elle avait été si miraculeusement sauvée du piège infâme qui lui avait été tendu par son mari et Nanine la Rousse, venait souvent prendre des nouvelles de madame Taureins, rue Amelot.
Il lui avait parlé quelquefois, mais toujours en présence de Vanda, qui néanmoins avait eu beaucoup de peine à y consentir, et ne lui accordait que rarement cette faveur, ne voulant pas, disait-elle, même à ses propres yeux, qu’il pût y avoir rien d’équivoque dans la protection dont M. Portal entourait une jeune femme arrachée par lui aux dangers qu’elle courait près d’un mari infâme.
En voyant entrer Jacques Turgis, Paul de Tréviannes allait se retirer après lui avoir pressé la main, quand Rocambole le retenant d’un geste :
— Restez, lui dit-il, vous pouvez, vous devez même assister à notre entretien, car nous avons affaire tous les trois aux mêmes ennemis, nos intérêts sont intimement liés les uns aux autres et nous avons tout à gagner à nous entraider en nous confiant mutuellement les machinations que dirigent contre nous nos ennemis communs.
Puis, s’adressant à Jacques Turgis :
— D’ailleurs, lui dit-il, je crois deviner l’affaire qui vous amène, et si, comme je le pense, il s’agit du scandale causé hier par l’entrée de mademoiselle Tatiane au bras de sir Ralph chez la baronne de Villarsay, vous n’avez rien à cacher sur ce point à M. de Tréviannes, car il assistait à ce bal et m’exprimait tout à l’heure le douloureux étonnement que lui avait causé cet étrange spectacle.
— Alors, répliqua vivement l’artiste, je tiens à ce que M. de Tréviannes entende tout ce que j’avais à vous dire, car il a dû concevoir de mademoiselle Tatiane une opinion absolument fausse et que je tiens à détruire.
Alors il se mit à raconter dans le plus grand détail toutes les scènes que nous avons déroulées sous les yeux du lecteur.
Quand il eut terminé ce récit :
— Eh bien ! demanda-t-il à Rocambole, entrevoyez-vous quelque clarté dans ces ténèbres ?
— Je n’ai vu mademoiselle Tatiane qu’une seule fois, répondit Rocambole, et c’est parce que je partage votre opinion à son égard c’est, parce que j’ai, comme vous, une confiance entière dans son innocence et dans sa bonne foi, que je trouve cette affaire absolument incompréhensible.
— Mais vous ne doutez pas, n’est-ce pas, reprit vivement Jacques, qu’elle ne soit victime de quelque infâme et ténébreuse machination ?
— J’en doute d’autant moins que je sais déjà ce dont ce sir Ralph est capable, que je connais de lui un complot non moins extraordinaire, non moins impénétrable, non moins perfidement ourdi que celui dans lequel il a pris mademoiselle Tatiane ; mais, comme je suis parvenu à porter la lumière dans celui dont je vous parle, je ne désespère pas d’arriver à démêler les fils de cette nouvelle trame.
— Ah ! que le ciel vous entende ! s’écria Jacques, je vous devrais plus que la vie, plus que l’honneur même, car je mets celui de Tatiane au-dessus du mien.
— Voyons, reprit Rocambole, il faut marcher pas à pas et méthodiquement dans ces ténèbres, c’est le seul moyen de n’y pas faire fausse route et d’arriver à trouver la voie de la vérité. Procédons donc par ordre en suivant la méthode que j’ai toujours adoptée et qui m’a constamment réussi dans les affaires de cette nature, c’est-à -dire commençons par étudier le personnel de la maison sur laquelle doivent porter nos investigations et plus particulièrement les gens qui, se trouvant en contact direct avec la victime, doivent connaître l’affaire ou peut-être même y avoir joué un rôle. Mademoiselle Tatiane a-t-elle une femme de chambre attachée à son service ?
— Oui, répondit Jacques.
— La jeune fille n’a pu s’habiller sans son aide, surtout pour un bal ?
— C’est ce qu’on a pensé, et Tatiane elle-même, entrevoyant un espoir de trouver la lumière de ce côté, a demandé à ce qu’elle fût interrogée ; j’ai oublié de vous rapporter ce détail.
— Eh bien, qu’en est-il résulté ?
— Une obscurité plus complète encore, car Malvina, c’est le nom de la femme de chambre, a déclaré avoir dormi toute la nuit, depuis dix heures jusqu’à sept heures du matin.
— Malvina ! demanda Paul de Tréviannes, vous dites qu’elle se nomme Malvina ?
— Oui, c’est son nom.
— C’est que j’ai connu, dans une circonstance assez extraordinaire, une jeune fille de ce nom qui…
Paul de Tréviannes se rappelait sa romanesque excursion dans la rue de Vanves et le bouge où il avait été coup sur coup entraîné, puis sauvé par une jeune fille qu’il avait entendu appeler Malvina.
Mais, songeant aussitôt au milieu dans lequel il l’avait vue, à la hideuse famille à laquelle elle appartenait, il murmura aussitôt :
— Non, non, ce ne peut-être celle-là .
S’il eût raconté son histoire, s’il eût prononcé le nom de la rue de Vanves, s’il eût nommé sir Ralph d’abord, puis les époux Claude, il eût tout à coup fait luire la lumière aux yeux de Rocambole, qui, dans le fait de cette jeune fille placée près de Tatiane, eût deviné tout de suite la main de sir Ralph.
Il garda le silence et la lumière ne se fit pas.
— Quel âge a cette femme de chambre ? demanda Rocambole.
— Une vingtaine d’années.
— Ses mœurs ?
— Je ne sais rien sur ce point.
— Moi, je saurai bientôt à quoi m’en tenir, et, si je ne me trompe, c’est là qu’il faut chercher. Cette jeune fille a dû mentir, il est impossible qu’elle ne sache rien. J’aurai sondé le terrain dans la journée, ce soir au plus tard, revenez donc demain, j’espère avoir quelque chose à vous apprendre.
Jacques remercia chaleureusement Rocambole et prit congé de lui.
XLIX
UN ANTHROPOPHAGE À PARIS
Jacques Turgis se sentait presque heureux en quittant Rocambole.
Et pourtant rien n’était changé dans l’horrible situation qui était faite à sa chère Tatiane ; nulle lueur n’avait pénétré dans le sombre abîme où elle se débattait et qui menaçait d’engloutir tous ses rêves, toute son âme et toute sa vie ; car comment supporter l’existence sans Tatiane ?
Mais M. Portal lui avait promis de l’aider à pénétrer les ténèbres qui enveloppaient cette mystérieuse affaire, et, comme tous ceux qui approchaient ce singulier personnage, il avait en lui une foi si complète, si aveugle, que le succès lui semblait désormais assuré.
Et le succès, c’était le bonheur, car il se rappelait avec ravissement tes paroles de M. Mauvillars : « Si vous parvenez à sauver Tatiane, vous l’aurez conquise, et je vous la donne. »
Parole précieuse et à laquelle se mêlait un adorable souvenir : le cri de joie par lequel sa chère et naïve Tatiane avait accueilli cette promesse.
C’était donc la joie dans l’âme et le front rayonnant que Jacques se dirigeait vers sa demeure, lorsqu’en entrant dans la rue Duperré il remarqua un attroupement considérable aux abords de la maison qu’il habitait.
Il reconnut bientôt que c’était bien en face du n° 17 que cette foule s’était amassée et il fut frappé de l’agitation extraordinaire qui s’y manifestait.
Aux gestes animés auxquels se livraient tous les individus qui composaient cette foule, à l’extrême animation qu’exprimaient leurs visages, aux mille propos qui s’échangeaient entre eux, remplissant la rue d’un murmure bruyant et incessant, assez semblable au bruit continu de la vague déferlant sur la plage, il était évident qu’il se passait là quelque chose d’extraordinaire.
Ne pouvant percer la masse qui encombrait la rue, le trottoir et jusqu’à l’allée de la maison, Jacques demanda quelle était la cause de cette espèce d’émeute.
— Ah ! monsieur, répondit une vieille dame qui tenait son chien sous son bras, une aventure étonnante, comme en n’en a jamais vu dans Paris.
— Pas possible !
— Un sauvage, monsieur, un sauvage, une manière de Peau-Rouge qui s’est échappé des îles Marquises et qu’on vient de découvrir dans cette maison.
— Non, madame, dit à son tour un personnage au ventre proéminent, au ton doctoral et emphatique, vous n’y êtes pas du tout ; les sauvages des îles Marquises sont doux et inoffensifs, tandis que celui-ci est d’un aspect terrible. D’après ce qu’on dit de lui, je serais plutôt porté à croire que c’est un naturel de l’Afrique centrale et septentrionale du sud de l’équateur, contrée fertile en anthropophages, comme chacun sait.
— On assure qu’il a un anneau d’or au nez, dit un garçon boucher, qui attendait obstinément l’apparition du sauvage avec trente kilos de viande sur sa tête.
— Avec un diamant gros comme une noix, répliqua une cuisinière.

![]()
— Ce n’est pas étonnant, dit le gros monsieur, dans ce pays-là les enfants jouent aux osselets avec des pierres précieuses.
— Où s’est-il réfugié ? demanda Jacques, qui écoutait tous ces détails sans rire.
— On ne sait pas, répondit la dame au chien ; ce qu’il y a de certain, c’est que tous les locataires se sont renfermés et barricadés chez eux et qu’ils sont dans des transes terribles, s’attendant toujours à être attaqués par le sauvage qui, dit-on, est d’une force herculéenne, un taureau, quoi ! capable de renverser d’un coup d’épaule toutes les portes et tous les meubles entassés derrière. Aussi tenez, voyez-les, ils sont tous aux fenêtres, si pâles qu’on les dirait enfarinés comme des pierrots.
En effet, toutes les fenêtres étaient garnies de locataires aux visages livides et effarés.
— Où est-il ? demandaient les gens de la rue aux locataires des premier et deuxième étages.
— Nous ne savons pas, répondirent deux vieillards du premier, dont les mâchoires tremblaient tellement qu’on les entendait claquer comme des castagnettes.
— Êtes-vous bien barricadés ?
— Nous avons traîné notre lit et notre armoire à glace devant la porte, mais on le dit si fort !
— Il n’en fera qu’une bouchée !
— Seigneur ! Jésus ! Sainte Vierge ! murmura la femme qui se mit à flageoler sur ses jambes.
— Vous savez qu’il est anthropophage !
— On nous l’a dit, répondit le vieillard en fléchissant à son tour, mais nous sommes si maigres !
— Raison de plus, vous êtes croustillante, et il y a des anthropophages qui aiment ça, et il paraît que celui-ci a des dents !
— Zénobie, murmura le vieillard en pâlissant encore, mets ton pantalon de futaine, donne-moi mon paletot à longs poils et ma casquette de loutre.
— Avez-vous de la viande ? leur cria le boucher.
— Nous avons un gigot.
— Est-il cuit ?
— Non.
— Tant mieux !
— Pourquoi ?
— Ce gigot peut vous sauver.
— Comment ça ?
— Si le sauvage enfonce votre porte, lancez-lui le gigot dans les jambes, il se jettera dessus et vous filerez pendant qu’il le dévorera.
— Merci, bon jeune homme ; merci.
— Dame ! faut être juste, c’t homme, s’il n’a mangé personne depuis le sud de l’équateur jusqu’à Paris, il doit avoir le ventre furieusement creux.
Tout à coup, des cris aigus et déchirants partirent de tous les étages de la maison, mais successivement, comme une gamme descendante, partant du cinquième étage pour arriver jusqu’au premier.
Les femmes lançaient des notes si aiguës et si affolées qu’on eût cru toucher à la fin du monde, et, dans leur effarement, elles se penchaient au balcon de leur fenêtre en criant :
— Le sauvage ! le sauvage ! le voilà ! Il frappe à notre porte, nous sommes perdus !
— Zénobie ! Zénobie ! s’écriait le vieillard du premier en courant de tous côtés comme un insensé, ma casquette de loutre ! mon paletot à longs poils !
Et dans l’égoïsme de la peur, il oubliait le pantalon de futaine, qui devait garantir Zénobie contre les dents de l’anthropophage.
Au moment même où se déclarait cette panique, un petit jeune homme, vêtu d’un pantalon à plis, d’un gilet jaune et d’une redingote vert pomme, descendait rapidement l’escalier et courait se jeter dans la foule en s’écriant :
— Je viens de le voir, je viens de voir le sauvage.
— Il ne vous a rien mangé ? lui cria quelqu’un.
— Je lui ai jeté mon chapeau, il est en train de le dévorer.
— Comment est-il ? lui demanda-t-on de toutes parts.
— D’abord il est tout nu, mais là ce qui s’appelle nu comme un ver.
— Ah ! le vilain effronté ! s’écria la vieille dame au chien avec un geste plein de pudeur.
— C’est ce qui l’a fait reconnaître tout de suite comme sauvage par la nièce de la portière, car c’est elle qui l’a découvert et qui a donné l’alarme.
— Est-ce vrai qu’il a un anneau dans te nez ?
— Énorme.
— Et un diamant à l’anneau ?
— Fabuleux, il jette des feux qu’on dirait vingt becs de gaz.
— Enfin comment est-il ?
— D’abord il a la peau toute rouge.
— Naturellement.
— Et puis il est tout tatoué des pieds à la tête de mille dessins bizarres.
— Ça fait frissonner rien que d’y penser, dit la vieille au chien.
— Il a un soleil dans le dos et une pipe culottée sur la poitrine, ce qui me fait penser qu’il appartient à la redoutable tribu des Pipards.
— La plus féroce des tribus du sud de l’équateur, prononça gravement le personnage au ton doctoral.
— De quoi est-il armé ? demanda une voix.
— D’un casse-tête qu’il brandit incessamment en l’air avec des claquements de dents comme un loup affamé, répondit Arthur, que le lecteur a déjà reconnu à son costume.
En ce moment arrivait au milieu de la foule une grosse commère aux traits courts, carrés, ramassés comme ceux d’un bouledogue, et la lèvre ornée d’une moustache jaune, aux poils épars, hérissés et saupoudrés de tabac.
— Qu’est-ce qu’y a, qu’est-ce qu’y a dans la maison ? demanda-t-elle en fronçant ses épais sourcils.
— Comment, qu’est-ce qu’il y a ? répondit la dame nu chien, mais il y a un sauvage dans la maison.
— Ça ne pouvait pas manquer, répliqua la commère, toutes les fois que je vas ultra minos, il arrive quelque chose, cette fois c’est un sauvage. Ah ! ben, attends, attends, je vas t’en donner, moi, du sauvage !
Et perçant la foule à coups de coude :
— Laissez-moi passer, je suis madame Cither, la concierge de la maison.
Grâce à ce procédé énergique, elle eut rapidement gagné sa loge.
— Prenez garde, madame Cither, lui crièrent plusieurs personnes, c’est un sauvage de l’équateur, tout ce qu’il y a de plus féroce, et il est armé d’un casse-tête.
— Moi aussi j’ai un casse-tête, dit la concierge en démanchant un balai, et tout neuf.
— C’est ça, s’écria Arthur, étrennez-le sur les reins du sauvage, j’aime mieux ça.
— Un sauvage ! s’écria madame Cither en brandissant son manche à balai comme un sabre, attends donc, je vais t’apprendre à venir salir mes escaliers et à faire du bruit dans une maison tranquille ; tu vas déloger plus vite que ça et t’en retourner dans tes équateurs.
— Ma tante, ma tante ! cria une voix au fond de la loge.
— Qu’est-ce que c’est ? demanda madame Cither.
Une tête pâle et bouleversée sortit de la ruelle du lit.
C’était celle de Louisette.
— N’y allez pas, ma tante, cria-t-elle d’une voix tremblante, c’est un anthropophage, ça mange le monde.
— Je me mettrai en travers, riposta la concierge, et nous verrons si ça passera.
« Où est-il, ton autrepophage ?
— Au quatrième, ma tante ; mais n’y allez pas, il ne vous laissera que les os.
— À moins que je ne lui brise les siens, et c’est ce que nous allons voir.
Et, son manche à balai à la main, elle gravit résolument l’escalier en murmurant :
— A-t-on jamais vu un pareil sauvage ? choisir justement ma maison pour y faire ses orgies !
Pendant qu’elle montait, Arthur se frottait les mains en disant tout bas :
— Allons, nous allons rire ; ça va faire du bien à ma rate, elle avait besoin de ça.
L
UNE POSITION CRITIQUE
Il nous faut remonter de quelques heures en arrière pour faire connaître au lecteur l’histoire de l’anthropophage de la rue Duperré.
Ce jour-là avait été choisi par M. Pontif pour donner à ses amis le grand déjeuner à l’issue duquel il devait leur présenter mademoiselle Isoline Torchebœuf comme sa fiancée.
Et, comme le déjeuner ne devait avoir lieu qu’à une heure, M. Pontif avait décidé de prendre le matin une tasse de café au lait.
Il avait résolu également de réclamer les services d’Arthur pour aider le cuisinier qui devait lui apporter un déjeuner de chez Potel et Chabot.
Enfin, M. Pontif, sachant parfaitement compter et n’étant pas de ceux qui jettent l’argent par les fenêtres, s’était fait ce raisonnement : puisque j’emploie Arthur, puisque sa journée entière m’appartient, moyennant trois francs, fort joli denier pour un gamin de son âge, pourquoi ne ferait-il pas mon café au lait, ma femme de ménage étant malade en ce moment ?
Et il avait recommandé à Arthur de venir dès huit heures du matin.
Funeste inspiration !
Tout en confectionnant le café au lait, pendant que M. Pontif, mollement couché dans son lit, rêvait aux charmes de la belle Isoline, Arthur avait tiré de sa poche la drogue qu’il avait achetée quelques jours auparavant chez un pharmacien de la rue Fontaine, et il l’avait perfidement mêlée au café, tout en fredonnant sa chanson favorite pour inspirer confiance au vieux chef de bureau :
Je reviens d’enterrer ma tante,
Je l’ai mis’ dans un p’tit cercueil,
Elle me laiss’ quat’ mille liv’ de rente,
Avec ça j’ porterai son deuil.
J’y ai fait faire un’ bell’ boît’ de chêne,
Ousqu’ell’ peut s’étendre à loisir ;
Là -dedans ell’ n’aura pas de gène,
Où y a d’la gèn’ y a pas d’ plaisir.
Puis il avait porté la tasse de café à M. Pontif, qui s’était montré fort sensible à cette attention.
Il avait bien trouvé d’abord une certaine amertume à ce café, mais, Arthur lui ayant fait observer que c’était le goût particulier du pur moka, il avait achevé sa tasse avec délices.
Puis, Arthur ayant demandé à se retirer pour aller s’habiller, afin de lui faire honneur vis-à -vis de ses convives, il s’était décidé à se lever et à procéder lui-même à une toilette digne de la circonstance.
Vers onze heures environ, M. Pontif venait de passer un caleçon de flanelle rouge, un gilet de même étoffe et de même couleur, c’était une de ses petites coquetteries, lorsqu’il crut entendre sortir de ses entrailles des bruits insolites, tenant à la fois des vagissements d’un nouveau-né et des miaulements d’un chat en délire.
Un doute affreux traversa son esprit :
— Grand Dieu ! murmura-t-il, se pourrait-il que précisément aujourd’hui, quand j’attends ma fiancée !… Oh ! non, c’est impossible ! le destin ne serait pas assez cruel…
Une violente douleur, rapide comme un coup de foudre et prenant sa source au même point d’où étaient partis les miaulements, fut la réponse du destin.
Il n’y avait pas à s’y tromper, c’était ça.
M. Pontif voulut s’habiller à la hâte pour aller méditer ailleurs sur le phénomène qui se manifestait en lui.
Mais ailleurs, c’était sur le carré, et les manifestations se reproduisaient rapides et puissantes.
— Je ne puis pourtant pas y aller en cet état, murmura M. Pontif en proie à des angoisses qui le faisaient rougir et pâlir tour à tour.
Et il se précipita vers sa chemise, qu’il avait étendue avec soin sur une chaise.
Mais à peine l’avait-il touchée qu’il se redressa tout à coup, en proie à une crise qui le rendit livide et menaça de lui faire jaillir les yeux de la tête.
Puis, saisi de vertige, renonçant brusquement à l’idée de passer sa chemise, comme à une entreprise folle, il traversa son appartement en courant, ouvrit la porte qui donnait sur le carré, franchit le palier comme un sylphe et s’élança d’un bond vers le port du salut.
Il était sauvé.
Mais, penché au-dessus de la cage de l’escalier, à l’étage supérieur, Arthur veillait, et une pensée infernale venait de lui traverser l’esprit.
Il descendit à pas de loup. Or, comme M. Pontif savourait avec volupté la joie de pouvoir désormais, libre de toute préoccupation, se consacrer tout entier à ses amis et à sa fiancée, il entendit un bruit sec qui lui donna la chair de poule, et, aussitôt après ce bruit, ces paroles prononcées par la voix d’Arthur :
— Quel vent ! pristi, quel vent !
Il regarda par une ouverture pratiquée à hauteur d’homme dans la porte qui le cachait aux regards des profanes, et alors il devint affreusement pâle.
Le bruit sec qu’il venait d’entendre lui était expliqué.
C’était sa porte qui s’était refermée.
Et la clef était en dedans !
Et ses invités allaient arriver, et avec eux madame Torchebœuf et la charmante Isoline !
Et il était là en caleçon et en gilet de flanelle rouge !
Quand il se fut rendu exactement compte de sa position, M. Pontif sentit ses cheveux se dresser sur sa tête.
Que faire ? Comment sortir de cette effroyable situation ?
C’était à en devenir fou.
Si Arthur eût été là , il eût pu se hasarder et franchir un étage dans ce léger costume pour aller lui faire part de son embarras et le prier de l’en tirer.
Mais Arthur venait de sortir.
— Que faire, mon Dieu ? que faire ? murmurait M. Pontif en se labourant le crâne avec ses ongles, car il n’avait pas encore posé sa perruque sur sa tête, un amour de perruque blonde qui le rajeunissait de vingt ans. Que faire ? Aller moi-même à la recherche d’un serrurier ? Il n’y faut pas songer, j’aurais à mes trousses tous les polissons du quartier, sans compter les sergents de ville qui pourraient bien me conduire au poste. Passer la matinée dans ce réduit ?… C’est également impossible. Outre que d’autres y ont des droits que je dois respecter, dans une demi-heure toute l’armée de Potel et de Chabot va arriver avec sa batterie, ils vont encombrer le carré et l’escalier, carillonner à ma porte, faire amasser les voisins, enfin une vraie bacchanale, pendant laquelle arriveront à la file mes amis, madame Torchebœuf, la candide et pudique Isoline ; on m’appellera, on me cherchera partout, on finira par me découvrir… ici… sous ses yeux ?
À cette pensée, M. Pontif faillit s’évanouir.
Il faut avouer que la situation était tendue et que les désolantes perspectives qui se déroulaient devant lui étaient de nature à troubler un cerveau plus solide que le sien.
Aussi était-il tombé dans un accablement qui eût inquiété ses amis s’ils eussent été là . C’étaient les premiers symptômes de la folie.
D’abord il murmura des paroles incohérentes.
Puis un sourire idiot se dessina sur ses lèvres.
Puis enfin, se croyant au sein d’un splendide paysage de l’Amérique, il se figura être nègre et se mit à danser la danse des Cocos piétinant sur place, se dandinant à droite et à gauche, l’index de chaque main élevé à la hauteur de la tête, et murmura d’une voix douce et plaintive cette chanson bien connue :
Dansez, Bamboula,
Maître n’est pas là .
Vu le lieu où il se passait, ce spectacle était navrant.
Bref, la folie envahissait le cerveau, sir Ralph touchait au but qu’il s’était proposé en confiant M. Pontif aux soins d’Arthur, quand tout à coup l’infortuné s’arrêta en équilibre sur l’orteil du pied gauche.
Une idée venait de traverser la case qui restait encore lucide dans son cerveau :
— Si j’appelais madame Cither ? se dit-il en se touchant le front.
Cette inspiration c’était le salut.
Madame Cither allait accourir à son appel, il l’envoyait chercher un serrurier, sa porte était ouverte avant un quart d’heure, il s’élançait triomphant dans son appartement, procédait à sa toilette et se trouvait prêt à temps pour recevoir les marmitons d’abord, puis ses amis et la pure et touchante Isoline.
— Sauvé ! merci, mon Dieu, merci ! s’écria M. Pontif, jetant instinctivement ce cri qui, au boulevard, couronne tous les dénouements heureux.
Puis, ouvrant discrètement la porte du réduit, prêtant attentivement l’oreille et jetant un regard prudent à droite et à gauche, il s’avança, sur la pointe des pieds, jusqu’à une fenêtre de l’escalier donnant sur la cour, se pencha en dehors et cria d’une voix tonnante :
— Madame Cither !
— Qui qu’appelle ? répondit une voix de femme.
— M. Pontif, montez vite.
Et craignant d’attirer, par ce cri, quelque locataire sur le palier, il courut à son refuge.
Malheureusement madame Cither, nous le savons déjà , était allée ultra minos, cette circonstance causa la perte de M. Pontif, sur lequel la fatalité s’acharnait impitoyablement ce jour-là .
Au bout de quelques instants, il entendait le bruit d’un pas dans l’escalier :
— Un pas de femme, c’est elle, murmura-t-il tout joyeux.
Ce n’était pas madame Cither. Mais c’était Louisette, sa nièce, récemment débarquée de sa campagne.
— Peu importe, se dit M. Pontif, elle saura bien trouver un serrurier.
Et, oubliant la légèreté de son costume, il ouvrit brusquement la porte et s’avança vers la jeune fille.
À son aspect, celle-ci atterrée et paralysée d’abord par la peur, s’élança tout à coup dans l’escalier, qu’elle se mit à dégringoler en jetant des cris qui attirèrent aussitôt tous les locataires sur les paliers.
— Qu’y a-t-il ? lui demanda-t-on de toutes parts.
— Un sauvage dans la maison, répondit Louisette qui, malheureusement, avait vu, à la foire de son pays, un Caraïbe de la rue Mouffetard mangeant des poules crues.
Et elle continuait de descendre en criant.
Au même instant Arthur, qui n’était pas loin, parcourait à son tour l’escalier en criant aux locataires :
— Je viens de le voir, c’est un anthropophage, rentrez chez vous, barricadez-vous derrière vos portes.
Aux premiers cris de Louisette, M. Pontif s’était précipité dans son refuge, d’où il écoutait ce vacarme, plus mort que vif.
LI
LES TORTURES DE M. PONTIF
C’est à la suite du vacarme causé par les cris de Louisette et par les recommandations d’Arthur aux locataires concernant l’anthropophage que madame Cither, se frayant de vive force un passage à travers la foule, était arrivée à sa loge.
Nous avons vu que son premier mouvement, en entendant parler de l’intrus qui venait de si loin salir ses escaliers et troubler la tranquillité de sa maison, avait été de s’armer d’un manche à balai tout neuf et de s’élancer intrépidement au-devant de l’ennemi.
Elle parcourut ainsi tous les étages sans rien rencontrer.
Elle allait gravir le cinquième lorsqu’une porte s’ouvrant tout à coup une voix lui cria :
— Madame Cither !
Elle se retourna brusquement et elle aussi, à l’aspect d’un homme en caleçon et en gilet de flanelle rouges, avait fait un bond en arrière en jetant des cris de terreur.
— N’ayez pas peur, madame Cither, c’est moi, lui dit le faux sauvage, c’est moi, moi, M. Pontif.
La concierge cessa tout à coup de crier, s’approcha du chef de bureau, l’examina, le flaira, le palpa, puis elle s’écria avec colère :
— Monsieur Pontif ! déguisé en sauvage ! eh bien, à la bonne heure, il ne vous manquait plus que ça ! Ah çà , avez-vous fini ? Est-ce la dernière de vos farces ? Il serait temps de vous arrêter, voyez-vous, je commence à en avoir assez ! À votre âge, de perdre votre temps à faire des charges et des mystifications ! Oh ! vous avez beau jouer l’indignation, Arthur m’a tout dit.
— Madame Cither, s’écria M. Pontif en saisissant la main de la concierge, qui le repoussa avec un geste plein de pudeur, je me laverai plus tard de cette infâme accusation ; quant à présent, je n’ai plus qu’un souci, qu’une préoccupation, rentrer chez moi.
— Qui vous en empêche !
— J’étais là quand le vent a poussé ma porte, la clef est en dedans ; j’ai été obligé d’appeler, Louisette est venue et…
— Et elle vous a pris pour un sauvage, voilà ce que vous vouliez, encore une farce ! Ah çà , encore une fois, monsieur Pontif, avez-vous bientôt fini vos fredaines ? Je vous préviens que la moutarde commence à me monter au nez et que je ne souffrirai pas davantage qu’on trouble ainsi ma maison et qu’on tourne le sang à mes locataires.
Madame Cither était furieuse.
Sa voix avait atteint un tel diapason qu’elle était parvenue jusqu’à plusieurs locataires qui, l’oreille collée à la porte, attendaient dans des transes mortelles l’attaque de l’anthropophage.
En entendant la voix de leur concierge, ils se rassurèrent un peu, et plusieurs portes s’entrebâillèrent, laissant passer des têtes d’hommes et de femmes, pâles et effarées.
À leur vue, M. Pontif se sentit défaillir.
— Madame Cither, murmura-t-il en se rapprochant de la concierge d’un air suppliant.
— Ne m’approchez pas, homme dépravé, s’écria celle-ci en levant son manche à balai, vous devriez rougir de vous montrer dans un pareil costume devant une personne du sexe.
Puis, apercevant les têtes qui se montraient timidement aux portes :
— Arrivez donc, arrivez donc, leur cria-t-elle, le voilà cet autre pophage qui met la maison sens dessus dessous et qui cause une émeute dans la rue, c’est M. Pontif ; encore une farce de sa façon ! mais venez donc, accourez tous ; le spectacle en vaut la peine, allez !
— Madame Cither, je vous en supplie, madame Cither !… balbutiait M. Pontif en se rapprochant de celle-ci pour lui parler à l’oreille…
— Ne m’approchez pas, vieil érotique, s’écria la concierge en faisant un bond en arrière ; il ne vous manquait plus que de me compromettre à présent.
Pendant ce temps, les locataires du quatrième, hommes et femmes, sortaient de leur appartement et venaient se grouper sur le carré.
M. Pontif était atterré.
— Je suis perdu ! je suis déshonoré ! murmurait-il en les regardant d’un air ahuri.
Il perdit tout à fait la tête en entendant les portes s’ouvrir et se refermer aux étages inférieurs et en voyant arriver successivement tous les locataires de la maison, qui bientôt formèrent un cercle compacte autour de lui.
— Comment ! comment ! murmurèrent alors des voix indignées, c’est M. Pontif qui fait tout ce tapage ?
— Il est vraiment très-bien comme ça, M. Pontif, disaient les femmes en comprimant une violente envie de rire ; on comprend qu’il veuille se montrer dans ce costume, qui est du dernier galant.
L’infortuné Pontif aurait voulu être à cent pieds sous terre.
Il promenait autour de lui des regards effarés, cherchant vainement un coin où il pût se cacher, se demandant avec angoisse quand et comment allait finir cette horrible scène, en proie à des hallucinations qui lui montraient sous un jour fantastique le cercle qui l’enveloppait et les risées dont il était l’objet.
— Ah çà , monsieur Pontif, lui dit enfin un locataire, savez-vous que c’est une singulière idée que vous avez eue là ?
— Monsieur, répondit M. Pontif que l’émotion faisait bégayer ; je vous… je vous jure… que jamais… que jamais je n’ai songé… D’ailleurs… mon caractère, mon âge… enfin, monsieur, voilà ce que c’est…
Il fut interrompu tout à coup par un bruit de ferraille partant de l’escalier.
— Grand Dieu ! murmura-t-il, ce sont les marmitons de Potel et Chabot.
Et s’adressant à la concierge qui, appuyée sur son manche à balai, le contemplait d’un air railleur :
— Je vous en supplie, madame Cither, allez chercher un serrurier, ma porte est fermée, la clef en dedans, et…
— M. Pontif ? demanda en ce moment le cuisinier, qui débouchait de l’escalier à la tête de ses marmitons et de la batterie de cuisine.
— Le voilà , répondit madame Cither d’un ton gouailleur.
Le cuisinier et les marmitons jetèrent sur M. Pontif des regards stupéfaits.
— Où faut-il entrer ? demanda le cuisinier.
— Voilà l’appartement de monsieur, dit madame Cither.
— Alors, reprit le cuisinier, si monsieur veut bien nous introduire, il n’y a pas de temps à perdre, car, vu la presse d’aujourd’hui, nous sommes en retard d’une bonne demi heure.
— Quelle heure est-il donc ? demanda vivement M. Pontif.
— Midi trois quarts, monsieur.
Le chef de bureau frissonna de tous ses membres.
— L’heure à laquelle j’attends mes convives, balbutia-t-il d’une voix troublée.
Puis, s’adressant brusquement à l’un des marmitons :
— Mon ami, lui dit-il, ma porte est fermée, cours vite chercher un serrurier, ramène-le et je te promets une bonne récompense.
Madame Cither qui, entendant un bruit de pas, venait de se pencher au-dessus de la rampe de l’escalier, s’écria tout à coup d’une voix triomphante :
— Ah bien ! en voilà qui ne sont pas en retard, on voit bien qu’il s’agit de bâfrer.
M. Pontif devint blafard.
— Que voulez-vous dire ? que voulez-vous dire, madame Cither ? demanda-t-il avec une angoisse qui contractait son visage.
— Une bonne nouvelle, monsieur Pontif, voici madame et mademoiselle Torchebœuf qui montent.
M. Pontif ferma les yeux et étendit les bras pour chercher un point d’appui. Il voyait tout tourner et sentait ses jambes se dérober sous lui.
— Elles sont superbes, s’écria madame Cither, et on sent d’ici les parfums dont la belle Isoline est inondée, elle a des roses blanches dans les cheveux, emblème de son innocence ; as-tu fini ? et madame Torchebœuf ! plus que ça de toilette, excusez ! Elle a mis son châle tapis pour la circonstance, il est tout frais, on voit qu’il sort de chez sa tante, à qui elle le donne à garder toute l’année, même l’hiver. Faut voir comme elle se carre ! on dirait une châsse. Ah ! elle s’arrête pour faire bouffer la robe de sa fille par derrière, c’est tout simple, elle veut mettre en relief tous ses avantages ; dame ! elle en a enfin trouvé le placement, faut soigner ça, vieille intrigante, va !
Elle ajouta presque aussitôt :
— Tiens, tiens, tiens, c’est le défilé qui commence, voilà les autres invités qui arrivent à la file ; des dames très-bien, ma foi ! des toilettes épatantes ! des châles des Indes ! c’est le châle tapis de madame Torchebœuf qui va faire une drôle de figure à côté de ça.
— Les voilà ! les voilà tous, dites-vous ? s’écria M. Pontif en roulant autour de lui des regards affolés.
Et, saisi d’une inspiration à laquelle il regretta sans doute aussitôt d’avoir obéi, il fendit la foule des locataires et s’élança dans son refuge favori dont on l’entendit tirer le verrou.
Cette résolution désespérée excita les bruyants éclats de rire de madame Cither, des locataires et des marmitons, et c’est au milieu de ce concert assourdissant que débouchèrent successivement sur le carré les dames Torchebœuf et tous les invités de M. Pontif.
Rien ne saurait donner une idée de leur stupeur à l’aspect de tous ces gens riant aux larmes, se tordant, se roulant le long des murs, se livrant aux poses les plus bizarres et les plus diverses dans un accès de gaieté qui ressemblait à de la folie.
Le premier moment de surprise passé, madame Torchebœuf, écrasant d’un regard de mépris son ennemie, madame Cither, qui était venue lui rire sous le nez, traversa majestueusement cette foule affolée, alla droit à la porte de M. Pontif et tira le cordon de la sonnette.
— C’est pas là , il a changé de logement, lui cria la concierge.
— Comment ! il a changé !
— Oui, à présent, c’est là qu’il a établi son domicile.
Et madame Cither désignait le refuge où venait de s’enfermer M. Pontif.
— Que signifie cette mauvaise plaisanterie ?
Alors tous les locataires, la main tendue vers le réduit, comme un chœur d’opéra prêtant un serment solennel, se mirent à chanter sur l’air des Lampions :
— Il est là ! il est là ! il ne sortira pas de là ; il est là ! il est là ! il est là ! il ne sortira pas de là .
Qu’on se figure, si l’on peut, la figure que devait faire en ce moment le pauvre M. Pontif.
Madame Torchebœuf ayant sonné trois fois en vain, les invités commencèrent à s’étonner.
— Quand je vous dis qu’il est là , leur dit madame Cither.
— Madame Cither a raison, dirent tous les locataires à la fois, il est là .
Alors un des invités s’approchant de la porte :
— Allons, mon cher Pontif, répondez, lui dit-il.
Un gémissement se fit entendre d’abord, puis la porte s’ouvrit, et un spectacle lamentable s’offrit aux regards des assistants.
M. Pontif, debout sur le seuil du refuge, les bras le long du corps, la tête penchée sur la poitrine, les traits livides et l’œil mourant, avait plutôt l’air d’un mort que d’un vivant.
— Isoline, retournez-vous, dit sévèrement madame Torchebœuf à sa fille.
— Mais que diable faites-vous là dans ce costume et dans cette attitude ? demanda l’invité à M. Pontif.
Celui-ci allait répondre quand on entendit une voix crier :
— Voilà le serrurier !
C’était Arthur, qui s’élança en même temps vers M. Pontif en lui disant :
— C’est moi qui vous sauve.
— Trop tard, murmura M. Pontif en se touchant le front, j’ai reçu un coup là .
— Appuyez-vous sur mon bras, c’est le bras d’un ami.
La porte venait de s’ouvrir. M. Pontif rentra aussitôt, appuyé sur le bras de son ami Arthur et suivi de tous ses invités.
LII
LE RUYSDAËL
Nous avons dit que Jacques Turgis était arrivé rue Duperré au plus fort de l’émotion causée par la présence du sauvage dans la maison gouvernée par madame Cither.
Dans la disposition d’esprit où il se trouvait, il s’était amusé quelque temps de tous les propos échangés dans la foule au sujet de l’anthropophage, puis il s’était décidé à se rendre à son appartement pour y échanger sa toilette contre son costume d’atelier.
On sait que cet appartement était situé dans la même rue, quelques maisons plus haut.
Il était là depuis une heure environ quand il entendit frapper bruyamment à sa porte.
— Voilà un particulier bien pressé, pensa-t-il.
Et il courut ouvrir.
Un homme se précipita aussitôt dans sa chambre et, se posant devant lui, le regard farouche et le visage bouleversé :
— Mon tableau ? mon tableau ? lui dit-il d’une voix rauque.
Cet homme était Chaumont, le marchand de tableaux.
— Votre tableau ! dit Jacques en le considérant avec surprise, eh bien, mais, il est à l’atelier, vous pouvez le faire prendre avec la copie, qui est terminée.
— À l’atelier, murmura le marchand en se frappant le front, vous dites qu’il est à l’atelier ! il n’est pas ici.
Et se laissant tomber comme une masse dans un fauteuil :
— Je suis perdu, balbutia-t-il d’une voix haletante, je suis perdu !
— Ah çà , qu’avez-vous donc ? lui demanda Jacques, que vous est-il arrivé ? Vous n’avez pas l’air d’avoir les idées bien saines, ce matin ; madame Chaumont serait-elle malade ?
— Eh ? si ce n’était que cela ! s’écria naïvement le marchand en bondissant de son siège comme une bête fauve.
— C’est pourtant déjà quelque chose, répliqua Jacques en souriant.
Chaumont revint aussitôt à Jacques, et, frappant violemment du pied :
— Il ne s’agit pas de ma femme, hurla-t-il, en lui jetant un regard furibond, il s’agit de mon tableau qui m’a été volé.
— Volé ! Ah ! ça que voulez-vous dire, monsieur Chaumont ? D’où peut vous venir cette singulière idée ?
— Je viens de passer à l’atelier, il n’y est pas.
— Allons donc ! répondit Jacques en souriant, c’est impossible.
Il ajouta :
— Vous avez parlé à mon père ?
— Votre père n’y était pas.
— Comment donc êtes-vous entré dans mon atelier ?
— La clef était à la porte.
— Et mon père n’était pas là ?
— Non.
— Il était descendu pour quelque commission.
— Je ne sais, mais mon tableau ! se mit à hurler de nouveau M. Chaumont en frappant du poing sur un meuble, mon tableau n’y est pas.
— C’est-à -dire qu’il n’est pas à sa place accoutumée, dit Jacques ; cela tient à ce que mon père fait son lit dans mon atelier, ce qui l’oblige à ranger chaque soir les deux toiles dans un coin.
— Je n’ai pas vu de lit.
— Il l’avait enlevé et n’avait pas encore fait l’atelier, voilà tout ce que cela prouve. Rassurez-vous donc, mon cher monsieur Chaumont, vous allez revoir votre cher Ruysdaël, et vous pourrez le faire emporter tout de suite avec la copie qui est complètement terminée.
Et, endossant sa vareuse de drap rouge :
— Allons, dit-il, descendons.
Le marchand de tableaux le suivit un peu moins farouche, mais toujours très-agité :
— C’est égal, dit-il avec humeur, vous avouerez que votre père est bien imprudent de laisser la clef à la porte d’un atelier qui renferme une pareille toile.
— Je vous répète, monsieur Chaumont, que mon père n’a pu être absent que quelques minutes. Tenez, il est fumeur, je parierais qu’il était chez le marchand de tabac qui demeure juste en face du n° 17.
Un instant après ils étaient dans la rue.
L’espèce d’émeute dont M. Poncif avait été la cause involontaire et infortunée s’était dissipée.
La rue et le trottoir étaient entièrement libres, et la porte était enfin dégagée.
— Allons, montons, dit Jacques à M. Chaumont, j’ai hâte de dissiper les nuages amassés sur votre front, et qui, je vous le jure, ne vous rajeunissent pas du tout.
Il gravit rapidement les trois étages qui conduisaient à son atelier.
La clef était encore à la porte. Jacques l’ouvrit et entra après le marchand de tableaux.
— Tiens, dit-il un peu troublé, mon père n’est pas encore rentré.
— Eh bien, mon tableau, où est-il ? Montrez-le-moi, lui demanda brusquement M. Chaumont.
Jacques parcourut l’atelier d’un coup d’œil.
Alors une pâleur mortelle se répandit sur ses traits, il éleva les bras au-dessus de sa tête en jetant un cri rauque, et s’affaissa brusquement sur un siège, qui heureusement se trouvait là .
— Ah ! mon Dieu, s’écria le marchand de tableaux en le regardant avec épouvante, mon Dieu ! je ne m’étais donc pas trompé, c’est donc vrai, il est volé !
L’artiste ne répondit pas, il ne bougea pas.
Le corps affaissé, les bras pendants de chaque côté du fauteuil, la tête penchée sur la poitrine, si pâle et si complètement immobile, qu’on eût dit une tête de marbre ; il avait toutes les apparences de la mort.
M. Chaumont s’aperçut qu’il avait perdu connaissance, mais il en fut fort peu touché.
Son tableau seul le préoccupait et il ne songeait même pas à tenter de rappeler à la vie le malheureux artiste étendu là , inanimé sous ses yeux.
— Mon tableau ! mon tableau ! criait-il en parcourant l’atelier et en se frappant le front comme un fou furieux, mon tableau ! volé ! volé !
Il s’arrêta tout à coup et, se croisant les bras avec un geste plein de violence :
— Quatre-vingt mille francs ! s’écria-t-il avec un éclat de rire d’une ironie sauvage, j’en ai refusé quatre-vingt mille francs !
Et, recommençant à arpenter l’atelier d’un pas furieux :
— Imbécile ! imbécile ! s’écria-t-il en accentuant chaque syllabe avec rage.
Puis, s’arrêtant tout à coup devant l’artiste, toujours immobile :
— Il prend bien son temps pour s’évanouir, celui ci, dit-il en dardant sur lui un regard impitoyable.
Il ajouta après un moment de réflexion :
— Il faut pourtant que je m’occupe de lui si je veux qu’il m’aide à retrouver sinon mon tableau, au moins la trace du voleur.
Il jeta un regard autour de lui, et, ayant aperçu dans un coin une fontaine avec une cuvette et une serviette accrochée à côté, il y courut.
Il revenait bientôt avec la cuvette pleine d’eau et la serviette.
Alors, après avoir déboutonné le col de chemise du jeune homme et l’avoir débarrassé de sa cravate, il lui tamponna les tempes, le front et les poignets, avec de l’eau fraîche.

![]()
Stimulé par le désir de se mettre au plus vite à la recherche de son tableau, il continua de lui prodiguer ses soins avec une patience et une sollicitude des plus touchantes jusqu’au moment où le teint, en se colorant d’une légère rougeur, annonça enfin te retour à la vie.
Jacques promena autour de lui un regard vague et inconscient, puis, apercevant le marchand de tableaux agenouillé près de lui, une serviette à la main :
— M. Chaumont, murmura-t-il.
Et, le regardant fixement :
— Que faites-vous dans cette position ? lui demanda-t-il.
— Vous ne vous rappelez donc pas ? s’écria celui-ci en se relevant tout à coup, mon tableau !
À ce mot qui lui rappelait brutalement la terrible vérité, Jacques faillit s’évanouir de nouveau.
— Allons, allons, du courage ! lui dit doucement le marchand, comprenant l’imprudence qu’il venait de commettre, tout n’est peut-être pas perdu si nous nous mettons activement à la recherche du voleur.
— Oui, oui, vous avez raison, répondit Jacques, recouvrant rapidement l’usage de ses sens et la lucidité de son esprit, nous n’avons pas un instant à perdre.
Il se leva et, quoique encore très-affaibli, il remit à la hâte un peu d’ordre dans sa toilette.
— Mais, mon père ! mon père ! s’écria-t-il tout à coup, comment se fait-il qu’il soit si longtemps absent, ayant laissé la clef à la porte ?
Il reprit aussitôt :
— J’y songe ! peut-être s’est-il aperçu du vol et peut-être est-il sur la piste du voleur, ce qui expliquerait cette distraction.
— Peut-être mais ne comptons que sur nous et descendons vite.
Arrivé au rez-de-chaussée :
— Il se peut que mon père ait parlé à la concierge, dit-il au marchand, je vais m’informer.
Madame Cither était précisément sur le seuil de sa loge.
— Madame Cither, lui dit Jacques, à quelle heure mon père est-il sorti ?
— Pour sortir, répondit la concierge, il aurait fallu d’abord qu’il fût rentré.
— Que voulez-vous dire ? demanda Jacques étonné.
— Je veux dire qu’il est sorti hier au soir et qu’il n’est pas revenu.
— Hier au soir… à quelle heure ?
— À onze heures.
— Et vous dites qu’il a passé la nuit dehors ?
— Mon Dieu, oui, même que j’ai été très-surprise de voir ce matin la clef à votre porte.
— Et en sortant hier il ne vous a rien dit ?
— Absolument rien ; mais vous devez bien savoir où il allait, puisque c’était pour vous qu’il sortait.
— Comment le savez-vous ? puisqu’il ne vous a pas parlé ?
— Dame ! il était facile de voir qu’il s’agissait d’une commission dont vous l’aviez chargé ; il emportait un tableau sur ses épaules.
À ces mots le jeune homme ouvrit la bouche pour jeter un cri, mais la voix mourut dans sa gorge, et il demeura en face de la concierge, la bouche entrouverte, l’œil fixe, le corps immobile et comme foudroyé.
— C’est lui ! c’est lui ! s’écria le marchand de tableaux après un moment de stupeur.
LIII
LE MARCHAND DE TABLEAUX
— Eh bien, quoi ? qu’est-ce qui n’y a donc ? demanda madame Cither, effrayée de l’état où elle voyait l’artiste ; qu’est-ce qui vous prend, monsieur Jacques ? Vous ne me paraissez pas à votre aise, entrez donc vous asseoir et prendre quelque chose : j’ai une petite liqueur de ma composition, qui est souveraine contre les faiblesses. Louisette, prépare un verre de…
— Merci, merci, madame Cither, dit vivement Jacques, recouvrant enfin l’usage de la parole, ce n’est rien, un étourdissement qui se passe déjà .
— Si vous voulez m’en croire, lui dit M. Chaumont, nous allons remonter chez vous ; après ce que nous venons d’entendre, nous avons à causer, et nous sommes mal ici pour cela.
— Oui, oui, montons, répondit Jacques.
— Et, si vous avez besoin de moi pour n’importe quoi, lui dit madame Cither, ne vous gênez pas, monsieur Jacques ; on est un peu vive, mais on a le cœur sur la main, c’est connu. Ah ! c’est que vous êtes un digne jeune homme, vous, et qui se respecte, et qui ne fait pas venir des créatures sans pudeur pour les faire poser pour l’ensemble, comme ils disent ; que j’ai vu ça une fois que j’étais entrée chez votre prédécesseur ; que les cheveux m’en sont restés dressés sur la tête pendant plus de quinze jours, et que je me suis laissé dire que le gouvernement l’avait décoré pour ces orgies-là , quand on aurait dû l’envoyer aux galères.
Jacques était déjà au deuxième étage, et madame Cither parlait toujours.
Il l’entendait encore au moment où il ouvrait la porte de son atelier.
— Allons, lui dit M. Chaumont, asseyez-vous et tâchez un peu de remonter sur votre bête ; ce n’est pas le moment de perdre la tête, au contraire.
Jacques avait obéi machinalement ; mais, l’esprit absorbé par la terrible catastrophe dont il était victime, il n’entendait même pas ce que lui disait le marchand de tableaux.
— Volé ! volé par mon père ! s’écria-t-il en cachant son visage dans ses deux mains. Ah ! c’est horrible ! c’est horrible !
— C’est affreux, j’en conviens, répondit M. Chaumont, mais permettez-moi de vous dire que vous avez été bien imprudent de vous lier au père Vulcain. Mais vous ne saviez donc pas que, depuis longtemps déjà , il mène une vie de bohémien, pour ne pas dire plus, et qu’on le rencontre dans les cabarets les plus mal famés, avec des gens de mine plus que suspecte.
— Perdu, ruiné, déshonoré par mon père ! s’écria de nouveau l’artiste, oh ! quelle honte ! quelle honte !
— Voyons, mon cher Jacques, lui dit le marchand en posant la main sur son épaule, je suis obligé de vous rappeler que la situation est grave et exige toute notre énergie et toute notre attention.
— Vous avez raison, monsieur Chaumont, répondit Jacques, je vous écoute, et suis entièrement à votre discrétion pour tout ce que vous jugerez à propos de faire.
— Mon Dieu ! répliqua M. Chaumont, je ne puis vous cacher que la première chose à faire en pareil cas est de nous rendre immédiatement chez le commissaire de police et de lui déclarer…
— Dénoncer mon père ! s’écria Jacques avec horreur, vous n’y songez pas !…
— Je comprends que la chose vous répugne, à vous son fils ; mais moi, qui n’ai aucun motif pour ménager l’homme qui m’a volé, je vais aller de ce pas faire ma déclaration au commissaire afin qu’il mette immédiatement la police aux trousses du père Vulcain.
— Monsieur Chaumont, je vous en supplie, ne faites pas cela, s’écria le jeune homme, l’œil hagard et les traits bouleversés ; que vous n’éprouviez aucune pitié pour mon père, je le comprends ; mais moi, moi, que vous ai-je fait pour me déshonorer, pour briser ma carrière en jetant sur mon nom, que j’ai toujours maintenu honorable et pur, une honte ineffaçable, un de ces scandales ignobles auxquels ne survit pas une âme délicate ?
— Malheureusement, répliqua M. Chaumont qui, depuis qu’ils étaient rentrés dans l’atelier, étudiait sur la physionomie du jeune homme l’effet de chacune de ses paroles, il est certain que l’ignoble ne manquerait pas dans cette affaire, et vous en seriez effrayé, si vous pouviez soupçonner le genre de vie que mène votre père depuis quelque temps et surtout le genre de monde qu’il fréquente. Tenez, ajouta-t-il en baissant la voix, il faut que je vous le dise, pour que vous connaissiez toute l’horreur de sa situation qui vous est faite et pour que vous agissiez en conséquence : ses amis et connaissances se composent presque entièrement de repris de justice.
Jacques jeta un cri d’horreur à cette terrible révélation.
— Je ne vous en ai jamais rien dit, reprit le marchand avec un accent plein de bonté, mais j’ai su cela, il y a quelque temps déjà , par un vieux modèle, ancien compagnon du père Vulcain, que le hasard avait mis au courant du genre de vie de celui-ci.
— Oh ! Tatiane ! Tatiane ! murmura l’artiste en plongeant son visage dans ses deux mains, tu serais donc perdue pour moi !
M. Chaumont reprit en dardant sur le jeune homme son Å“il dur et cupide :
— Et il ne faut pas vous le dissimuler, mon cher monsieur Jacques, le scandale que vous redoutez est inévitable.
— Inévitable ! s’écria l’artiste, en relevant brusquement la tête.
— Je vais vous le prouver. Les gens parmi lesquels votre père vit depuis longtemps et dont il a pris les mœurs et les habitudes ne travaillent jamais isolément, pour employer leur langage ; ils trouvent dans l’association d’immenses facilités ; ils ne font rien sans se concerter, et il est évident pour moi que le retour du père Vulcain près de son fils est le résultat d’un complot concerté entre celui-ci et ses amis, c’est-à -dire ses complices. On s’est partagé les rôles, et naturellement le père Vulcain s’est chargé de s’introduire dans la place au moyen d’une réconciliation, et de nourrir le poupard, c’est-à -dire de guetter et de couver une bonne affaire. C’est ce qu’il a fait : il a vu dans le Ruysdaël l’occasion qu’il attendait et il ne l’a pas laissée échapper, il a emporté le tableau. Mais là finit son rôle et commence celui des complices qui une fois le magot livré entre leurs mains, doivent en chercher le placement. Car vous voyez tout de suite la marche et les péripéties de l’affaire : le père Vulcain, dénoncé par moi, est aussitôt traqué par la police, dont il est déjà connu, vu ses fréquentations, et qui saura tout de suite où le trouver. Arrêté, il ne tarde pas à faire des aveux, à la suite desquels on met bientôt la main sur le receleur et sur celui qui lui a vendu le tableau. Puis, d’aveux en aveux, de découvertes en découvertes, on arrive à s’emparer d’une bande de repris de justice, parmi lesquels figure Jean Turgis, dit le père Vulcain, accusé d’avoir volé un tableau chez son fils Jacques Turgis et condamné pour ce fait et pour complicité dans la plupart des délits commis par la bande des repris de justice. Je vous le répète, ne vous faites pas d’illusion, voilà l’affaire telle qu’elle se déroulera bientôt devant le tribunal de police correctionnelle.
Jacques était atterré.
Ses traits se décomposaient à mesure que Chaumont faisait passer sous ses yeux tous les détails de cet horrible tableau et lui prouvait clairement que son nom devait sortir de là honteusement, ignominieusement souillé.
— Écoutez-moi, monsieur Chaumont, dit-il à celui-ci après un moment de silence, vous ne savez pas encore toutes les conséquences que peut avoir sur ma destinée un scandale de cette nature, je vais vous dire toute la vérité et j’espère qu’alors vous renoncerez à poursuivre cette affaire.
— Je vous écoute, mon cher Jacques, mais je doute pourtant que je me résigne à ne rien tenter pour retrouver un tableau que j’estime à quatre-vingts et peut-être cent mille francs.
— Monsieur Chaumont, reprit Jacques, j’aime une jeune fille qui appartient à une excellente famille, je l’aime de toute mon âme et j’ai le bonheur d’en être aimé, j’ai mis en elle le rêve de toute ma vie, toutes mes espérances de bonheur et, s’il me fallait renoncer à la réalisation de ce rêve, je n’y survivrais pas, je vous le jure. Je pourrais me consoler de tout, hors de la perte de ma bien-aimée Tatiane. Or, vous comprenez qu’elle serait à jamais perdue pour moi, après tout ce qui rejaillirait d’infamie sur mon nom, à la suite de ces ignobles débats.
Le marchand de tableaux avait écouté cette confidence avec l’apparence d’un vif intérêt, mais en même temps une lueur étrange s’était allumée dans son regard.
— Votre situation est des plus intéressantes, mon cher Jacques, répliqua-t-il en pressant avec effusion la main du jeune homme, dont le visage s’éclaira d’un rayon d’espoir à cette marque de sympathie, et, quoique bien loin aujourd’hui de cet heureux âge, je me rappelle encore assez les émotions de ma jeunesse pour comprendre vos tortures et y compatir, mais enfin, je vous le demande, que voulez-vous que je fasse et que feriez-vous vous-même à ma place ?
Jacques garda quelques instants le silence, évidemment embarrassé par cette question.
— Malheureusement, répondit-il enfin, je ne suis pas en mesure de vous proposer la seule solution qui pourrait tout arranger, le payement du tableau volé. J’ai eu de longues années d’épreuve, pendant lesquelles j’ai contracté des dettes, rapidement décuplées par les intérêts usuraires qu’il me fallait accepter, mais enfin ces dettes sont payées, je me suis fait un nom, mes toiles commencent à se vendre un très-bon prix, de huit à dix mille francs, vous le savez mieux que personne, et, si vous le vouliez, nous pourrions prendre des arrangements.
— Tenez, s’écria tout à coup le marchand avec une explosion de bonhomie parfaitement jouée, vous m’avez toujours inspiré de l’intérêt, et je vais vous le prouver en consentant à un arrangement absurde, dangereux, car enfin on ne sait ni qui vit, ni qui meurt ; vous pouvez mourir demain, et alors il me resterait pour tout potage un papier bon à allumer ma pipe ; mais enfin je consens pour vous à courir ce risque.
— Ah ! mon cher monsieur Chaumont, que de reconnaissance ! s’écria l’artiste transporté de joie.
— Bah ! ne parlons pas de ça. Mais un pareil acte ne se fait pas au pied levé ; je vais libeller ça chez moi pour le mieux de nos intérêts communs et je vous l’enverrai tantôt pour que vous y apposiez votre signature.
Et il partit, laissant Jacques ravi d’une solution aussi inattendue.
Sa joie eût été plus modérée s’il eût réfléchi que Chaumont était le plus dur, le plus retors, le plus rapace des marchands de tableaux, et s’il eût remarqué que, depuis son retour à l’atelier, il avait changé de ton et d’allure, comme un homme qui a conçu un projet et s’y est arrêté.
LIV
LE PÈRE MARDOCHÉE
Peut-être le lecteur est-il curieux d’avoir quelques détails sur la destinée du Ruysdaël qui venait de disparaître de l’atelier de Jacques Turgis.
Nous allons satisfaire ce désir.
La veille au soir, vers dix heures, c’est-à -dire au moment même où Jacques Turgis se rendait au bal de la baronne de Villarsay, ne soupçonnant guère la catastrophe qui allait fondre sur lui pendant ce temps, le père Vulcain rentrait à l’atelier, provisoirement sa chambre à coucher.
Il avait passé la soirée avec des amis, et, comme de coutume, l’absinthe avait fait les frais de la fête.
Il était donc rentré un peu allumé, et madame Cither, qui ne le portait pas dans son cœur, lui avait recommandé, un peu aigrement, de ne pas tant secouer la rampe de son escalier, sur laquelle il s’appuyait avec l’énergie d’un homme qui n’a qu’une médiocre confiance dans la solidité de ses jambes.
Arrivé à l’atelier, il commença par allumer une bougie, puis, se posant devant le Ruysdaël :
— Au fait, murmura-t-il en jetant sur la toile un regard stupide, mon ami Collin a raison, pourquoi donc que je me gênerais ? D’abord je ne suis venu ici que pour ça ; seulement je croyais emporter une toile de mon fils et le hasard m’envoie une toile de maître, preuve que la Providence est dans mon jeu. Et puis, mon fils est un feignant, un propre à rien et un ingrat, qui s’habille comme un agent de change et dîne à deux francs par tête, tandis que son pauvre père porte la blouse de prolétaire et se nourrit d’arlequins, quand ce n’est pas de l’air du temps ; ça ne pouvait pas durer longtemps comme ça ; ça criait vengeance, le ciel s’est fâché à la fin et l’heure de l’expiation a sonné. Nous allons laver le tableau et nous donner un peu de bon temps, chacun son tour ; assez trimé comme ça, nous allons rigoler un brin. Qu’est-ce qui pourrait y trouver à redire ? Après tout, je suis son père, je suis dans la dèche, il est pourri de braise, je pourrais lui demander des pensions alimentaires, et je me contente d’une simple toile, il faut pourtant bien se mettre quelque chose sous la dent. Allons, mon brave Ruysdaël, viens avec moi, ma vieille branche, tu peux te vanter d’obliger aujourd’hui deux bons zigues.
Et, saisissant enfin le tableau, il le chargea sur son épaule.
Puis après avoir eu la précaution d’éteindre la bougie, il sortit de l’atelier, ferma la porte, à laquelle il laissa la clef, et entreprit la tâche périlleuse de descendre l’escalier avec son fardeau.
Il trébuchait à chaque marche, et vingt fois, dans le courant de ce redoutable trajet, il faillit être lancé dans le vide, la tête en avant.
Mais la vérité du proverbe qui dit qu’il y a un Dieu pour les ivrognes fut attestée cette fois encore, et il arriva sain et sauf au rez-de-chaussée.
Là il demanda le cordon, et madame Cither, qui avait frissonné vingt fois en entendant gémir la rampe de son escalier, son incessante préoccupation, s’empressa d’obtempérer à son désir, heureuse de le voir enfin franchir le seuil de sa maison.
Une fois dehors, le père Vulcain tourna à droite, gagna le boulevard, se dirigea du côté du bal de la Reine-Blanche et entra dans la boutique d’un marchand de vin, espèce de cave sombre, de trois marches au-dessous du sol et lugubrement éclairée par un seul bec de gaz.
Après avoir traversé la boutique, absolument veuve de clients, il passa dans un petit cabinet où, à la sordide clarté d’une chandelle deux hommes étaient attablés devant une bouteille d’eau-de-vie.
L’un de ces hommes, que le lecteur a déjà vu au début de ce récit, au cabaret de la Providence, rue du Pont-Blanc, était Collin, l’ami intime du père Vulcain. L’autre était le père Mardochée, dont le nez crochu, le regard faux et rusé, la longue barbe en pointe, d’un gris sale comme sa chevelure longue, plate et grasse, rappelaient à l’imagination ces juifs du moyen âge qui s’enrichissaient par l’usure et passaient leur vie courbés sous les humiliations et les outrages.
Le père Mardochée faisait à peu près tous les métiers, mais il avait une prédilection particulière pour le commerce des tableaux et possédait au plus haut point le secret de donner à des toiles neuves ces tons roux et enfumés qui distinguent les œuvres des vieux maîtres.
— Brenez carde, mon ami, disait-il à Collin au moment où le père Vulcain entrait, fus pufez drop, c’est drès-maufai bur le zanté.
— Oui, et ça coûte de l’argent, n’est-ce pas, père Mardochée ?
— Non, fus ne me gombrenez bas, dit le vieux juif, c’est bar intérêt bur…
— Oui, oui, l’intérêt, ou plutôt les intérêts, c’est votre fort, c’est connu, répliqua Collin avec un sourire ironique.
— Che fus chure, mon pon ami…
— Allons donc, ne faites donc pas le malin avec moi, ça ne prend pas ; avouez que vous êtes un vieux ladre et que votre sang ne fait qu’un tour à chaque petit verre que je bois et n’en parlons plus.
Le vieux Mardochée allait se disculper de nouveau du reproche d’avarice, quand le père Vulcain entra avec son tableau.
— Tonnerre ! s’écria-t-il en le posant à terre, je commençais à en avoir assez.
— Foyons, foyons le Ruystaël, s’écria le vieux juif en se levant brusquement.
Tous les feux de la cupidité s’étaient allumés dans ses petits yeux noirs ; il frémissait de joie à la pensée de l’acquisition qu’il allait faire, et ce fut d’une main tremblante d’émotion qu’il prit la chandelle et en promena la lumière sur toutes les parties de la toile.
Dans son délire, cependant, il ne perdait pas de vue les petites économies.
— Mon pon ami, cria-t-il au père Vulcain, fus pufez poire mon ferre, ché n’y ai bresque bas duché.
— Merci, je suis plus dégoûté que ça, répondit le vieux modèle ; d’ailleurs, ma religion me défend de boire après un juif ; et puis, de l’eau-de-vie, merci, n’en faut pas, ça ne se sent pas au passage.
Il frappa bruyamment sur la table :
— Une chopine d’absinthe, commanda-t-il au garçon qui était accouru.
Le juif tressaillit, mais il n’osa faire aucune observation.
Et il recommença à étudier la toile qu’il avait sous les yeux.
— Drès peau ! oh ! drès peau ! murmura-t-il tout has, de manière à n’être pas entendu des deux buveurs.
Plus il regardait et plus son enthousiasme grandissait.
Mais il se gardait bien de le laisser voir.
— Eh bien, voyons, que pensez-vous de ça, père Mardochée ? lui demanda Collin.
— Eh ! eh ! eh ! fit le juif avec une moue quelque peu dédaigneuse, c’est un Ruystaël, c’est éfitent, che ne tis bas non, mais un Ruystaël de la bremière manière.

![]()
— Qu’est-ce que vous me chantez, avec vos manières ? répliqua brusquement le vieux modèle. M. Chaumont, qui est un roublard et qui s’y connaît, l’a payé soixante mille francs et on lui en a donné quatre-vingt mille, ce qui prouve qu’il est de la bonne manière.
— M. Jaumont est un richard qui beut se basser des vantaisies et qui a une gliendèle de millionnaires, dantis que moi…
— Allons, assez de finasseries comme ça, nous n’avons pas le temps de jaboter, qu’est-ce que vous donnez de la toile ?
Mardochée se mit à examiner de nouveau la toile pour se donner le temps de réfléchir.
— Eh bien ! quand vous voudrez, lui dit le père Vulcain avec impatience.
— Eh bien ! dit enfin le juif, ch’en tonne… oui, c’hen… et pien, oui, ch’en tonne cinq mille vrancs.
— Cinq mille francs ! un tableau de quatre-vingt mille ! jamais.
— Remarquez, mon pon ami, que che ne beux bas le fendre à Paris, d’abord barce qu’il est gonnu de tus les marjands de dapleaux et puis barce que M. Jaumont ira tut de suite vair sa déglarasion à la brevecture de bolice.
— Ça, c’est une raison.
— Il vaut que je barte tut de suite le fendre en Anglederre afant qu’on y abrenne le fol… che feux tire, la disbarition t’un Ruystaël ; ça vait tes crands vrais, vrais te foyage, t’empallache, te dransbort, et buis les Ruystaël se fendent très-mal en Anglederre.
— Vieux farceur, va !
— Et buis, envin che gours quelques risques de bolice gorrectionnelle.
— Pas le moindre ; un fils ne poursuit pas son père, ou alors ce serait un monstre ; il me ferait horreur à moi-même et je le renierais. Or, du moment que je ne suis pas inquiété, vous ne courez aucun risque.
— Fotre vils ne boursuivra bas son bère, mais M. Jaumont…
— Diable ! c’est vrai, dit le père Vulcain, dont le front se rembrunit tout à coup ; je n’avais pas réfléchi à ça, moi !
— Enfin, reprit Mardochée, c’est dout ce gue che beux faire, mais fus êtes libre de le broboser à un audre.
C’était l’argument suprême du vieux juif dans ces sortes d’affaires.
Le coup portait toujours.
— Oui, merci, dit le père Vulcain, aller trimballer ça de maison en maison pour nous faire pincer tout de suite ! N’y a pas de presse. Oh ! il sait bien qu’il nous tient par là , le vieux singe !
Et s’adressant au juif :
— Allons, aboulez les cinq mille balles, l’affaire est dans le sac.
— Che les ai chustement sur moi.
— Ah ! le vieux malin ! s’écria le père Vulcain, il le connaissait déjà le Ruysdaël pour l’avoir vu à la vitrine de M. Chaumont et il avait pris ses mesures pour ne pas le laisser échapper.
— Du tout, che ne le gonnaissais pas, répliqua le juif en tirant de sa poche un petit sac de cuir.
Il dénoua la ficelle qui attachait ce sac, qu’il vida sur la table.
Il ne contenait que des pièces d’or, dont la vue fit flamboyer son regard et qu’il compta et rangea d’une main frémissante.
— C’est bien ça ! dit-il quand il eut compté la somme.
— Oui, oui, le compte y est, répondit le père Vulcain, et maintenant nous allons vous porter le tableau chez vous.
— Non, non ; s’écria vivement Mardochée, je m’en charche.
— C’est lourd et il y a loin d’ici à votre logement de la rue des Buttes.
— Oh ! che suis encore solite.
Et, saisissant le tableau avec autant de respect que si c’eût été une relique, il le posa sur son épaule et sortit.
FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE
TROISIÈME PARTIE
LES REVANCHES DE ROCAMBOLE
I
ESPIONNAGE
Rocambole était chez lui, rue Amelot, seul avec madame Taureins, dans le petit salon du rez-de-chaussée, et, tout en causant avec la jeune femme, il jetait des regards fréquents du côté du jardin, comme s’il s’attendait à chaque instant à voir arriver quelqu’un.
— Ah ! monsieur Portal, disait en ce moment Valentine, vous ne sauriez vous faire une idée de mon bonheur. Depuis que j’ai passé le seuil de votre maison, je vis, je pense, je respire avec un calme, un abandon et une sécurité dont j’avais perdu jusqu’au souvenir. C’est quelque chose de si doux et de si nouveau pour moi de pouvoir aller et venir, manger et dormir, sans trembler à chaque minute, sans redouter dans l’incident le plus insignifiant quelque piège horrible ou quelque honteuse infamie.
— Oui, oui, répliqua Rocambole, je comprends cela ; vous avez tant souffert qu’aujourd’hui le repos et la sécurité c’est pour vous le suprême bonheur.
— Ne plus entendre parler de ces trois monstres ; ne plus être exposée à les revoir, quelle joie, mon Dieu ! quel ravissement ! soupira la jeune femme avec l’expression d’une profonde béatitude.
— Ah ! fit Rocambole en s’approchant de la fenêtre, attiré par le bruit que venait de faire la porte de la rue en s’ouvrant.
Il ajouta aussitôt avec une expression de désappointement :
— C’est le facteur !
Le facteur entra presque aussitôt en effet, remit une lettre et sortit.
Cette lettre était à l’adresse de madame Taureins.
— Qui peut m’écrire ? dit la jeune femme en la décachetant avec quelque appréhension ; car, depuis les terribles épreuves qu’elle avait subies, tout devenait pour elle un sujet d’inquiétude.
Cette lettre était ainsi conçue :
« Madame, M. Taureins, qui sort de chez moi à l’instant, m’a déclaré que non seulement il renonçait à vous contraindre à revenir habiter avec lui, mais qu’il était tout disposé à entrer dans vos vues concernant une séparation de corps et de biens. Il voudrait seulement éviter le scandale qu’entraînerait un débat judiciaire, et m’a exprimé le désir que l’affaire s’arrangeât à l’amiable dans mon cabinet. Si telle est votre intention, comma j’ai cru pouvoir le lui affirmer, veuillez, je vous prie, vous trouver chez moi après-demain, à trois heures, afin que nous puissions nous entendre sur bien des points avant l’arrivée de M. Taureins, qui doit se présenter vers quatre heures.
« Agréez, madame, l’assurance de ma haute considération,
« HECTOR CHAUTARD. »
— Eh bien, que pensez-vous de cela, mon cher monsieur Portal ? demanda Valentine à Rocambole.
— Je pense que M. Taureins, reconnaissant que la partie est perdue pour lui, renonce aux infâmes projets que lui avait suggérés Nanine la Rousse et qu’il trouve tout avantage à conquérir une entière liberté en vous rendant la vôtre. Cette idée doit lui avoir été soufflée par la marquise de Santarès, que votre absence du domicile conjugal va délivrer désormais de toute contrainte.
— Alors, vous me conseillez d’accepter la proposition de mon mari ?
— Il vous tend la perche, vous ne sauriez hésiter à la saisir.
— Vous savez à quel point j’en serai heureuse, je me demande seulement s’il n’y aurait pas là quelque nouveau piège.
— Le rendez-vous a lieu chez votre avocat, que pouvez-vous craindre ? Ne sera-t-il pas là pour vous conseiller et pour vous protéger au besoin ?
— Vous avez raison, dans ces conditions je n’ai rien à redouter et je vais répondre à maître Chautard que je serai chez lui au jour et à l’heure indiqués.
La porte de la rue s’ouvrit de nouveau.
— Ah ! cette fois, dit Rocambole, c’est Vanda ; que va-t-elle nous apprendre ?
Vanda parut bientôt.
— Eh bien, avez-vous réussi ? lui demanda Rocambole.
— Hélas ! non, répondit Vanda.
— Vous n’avez pu voir Malvina ?
— Au contraire.
— Que s’est-il passé alors ?
— Je lui ai fait observer qu’il était impossible qu’elle ne fût pas au courant de ce qui s’était passé dans la nuit fatale où sir Ralph avait si odieusement compromis mademoiselle Tatiane, je lui ai affirmé qu’elle n’avait rien à craindre de cet homme, qui peut-être l’avait effrayée par ses menaces, j’ai essayé de lui faire comprendre toute la gravité du crime dont elle se rendrait coupable en causant, par sa complicité ou par son silence, l’éternel malheur de sa jeune maîtresse, elle est restée sourde à toutes mes objurgations, et, malgré toute l’invraisemblance d’une telle supposition, je suis très-portée à croire qu’elle ne sait absolument rien et qu’elle a dormi toute cette nuit, comme elle me l’a déclaré de nouveau.
— C’est ce que je ne puis admettre, répliqua Rocambole, et j’en suis toujours pour ce que j’ai dit tout d’abord ; sir Ralph connaît sur son compte quelque secret compromettant et il la tient par là . Enfin elle ne veut rien dire, il est impossible de la faire parler malgré elle, et cela est d’autant plus désespérant que le délai de quinze jours au bout duquel M. Mauvillars s’est engagé à donner une réponse à sir Ralph finit aujourd’hui.
— Je savais cela, aussi ai-je fait tous mes efforts pour réussir.
— Il faudra chercher une autre combinaison, puisqu’il faut décidément renoncer à celle-ci. Avez-vous vu Milon ?
— Non.
— Il rôde avec Albert autour de la maison Mauvillars, mais sans plan déterminé, se contentant d’épier à tout hasard ce qui se passe par là et comptant vaguement sur une occasion.
Il achevait à peine de parler quand la porte s’ouvrit de nouveau.
C’était Albert de Prytavin qui entrait.
— Eh bien ! demanda-t-il à Vanda, la femme de chambre a-t-elle parlé ?
— Non, répondit Vanda.
— J’espère qu’elle parlera, dit Albert.
— D’où te vient cet espoir ? demanda vivement Rocambole.
— Voilà ce que c’est ! Nous nous sommes dit Milon et moi : Si le maître a deviné juste, comme tout le prouve, si Malvina connaît le mystère que nous cherchons à pénétrer, deux motifs peuvent seuls l’empêcher de le révéler ; la cupidité, excitée par la promesse d’une généreuse récompense à la suite du mariage, ou la peur que lui inspirerait sir Ralph, possesseur de quelque secret important de nature à la perdre.
— Fort juste, dit Rocambole, après ?
— Je me suis dit alors : Admettons l’hypothèse la plus probable, celle d’un secret compromettant, il est évident que, si nous par venons à nous emparer de ce secret, à l’aide duquel sir Ralph impose silence à la jeune fille, nous pouvons, nous, nous en servir pour la contraindre à parler.
— Oui, mais y a-t-il un secret ?
— Depuis cinq ou six jours que nous sommes aux aguets, nous commencions à en désespérer…
— Et aujourd’hui tu crois…
— Aujourd’hui, c’est-à -dire depuis une heure, je suis sûr.
— Comment as-tu su cela ?
— J’ai employé un truc qui n’est pas neuf, mais qui réussit toujours, je me suis insinué dans les bonnes grâces du concierge au moyen de quelques libations, dont l’effet a été de m’attendrir, de me pousser aux confidences et de lui avouer une immense passion pour Malvina, passion honnête, ayant le bon motif pour base, mais tourmentée par une jalousie dévorante. Vu l’honnêteté de mes principes, et touché aussi par l’offre d’une calotte grecque à gland d’or, son rêve depuis de longues années, le concierge comprit mon désir de connaître à fond la vie privée de celle dont je voulais faire ma compagne, et s’engagea non-seulement à me faire part des visites qu’elle pouvait recevoir, mais à me communiquer les lettres qui lui seraient adressées. Cette convention est demeurée cinq jours sans résultat, mais ce matin, comme j’étais en train de déjeuner avec Milon, chez le marchand de vin où j’ai élu domicile pour toute la durée de cette affaire, je vois arriver mon concierge qui, une fois seul avec nous, tire mystérieusement une lettre de sa poche et me la remet. Elle portait l’adresse de mademoiselle Malvina, femme de chambre chez M. Mauvillars. Elle était scellée à l’aide d’un simple pain à cacheter, faible défense contre les indiscrétions. Je pose un instant ce cachet au-dessus de la buée produite par mon café, j’ouvre la lettre sans froisser ni déchirer le papier, et voici ce que je lis : « Malvina, je t’attends ce soir, de neuf heures à dix heures, chez le marchand de vin, au n° 10 de la rue, n’y manque pas, c’est important. »
Voilà tout, et pas de signature.
La lettre lue, je la recachetai et la rendis au concierge avec accompagnement d’une pièce de cinq francs, et il partit.
— Voilà qui promet, dit Rocambole ; il doit y avoir quelque amourette sous jeu.
— C’est ce que je pense. Mais ce n’est pas tout, le plus joli de la chose c’est que le marchand de vin chez lequel on donne rendez-vous à la femme de chambre est précisément celui où nous prenons tous les jours nos repas, Milon et moi.
— Ce qui rend une entente facile entre vous.
— C’est déjà fait.
— Ah !
— Nous avons parlé au marchant de vin qui, désireux de conserver les clients qui veulent bien croire à l’authenticité de son vieux pommard et qui le payent comme tel, s’est engagé à nous mettre à même de tout entendre.
— C’est pour ce soir ? demanda Rocambole.
— De neuf à dix heures ; je suis accouru vous faire part de celle nouvelle et vous demander s’il vous convient d’assister à ce rendez-vous.
— Oui, certes.
— Vous vous rappellerez, numéro 10, au coin de la rue…
— Et je demanderai ?
— M. Albert.
— À ce soir donc !
— Et je retourne à mon observatoire. Je ne sais si je me trompe, mais j’ai le pressentiment que nous tenons là de quoi rouler le sir Ralph et sauver la pauvre Tatiane de la honte de lui appartenir.
Quand Albert fut parti, Rocambole dit à madame Taureins :
— Ce rendez-vous me fait penser au vôtre, madame, et en me rappelant à quelles gens vous avez affaire et de quelle défiance vous devez être toujours armée vis-à -vis d’eux, j’ai résolu de vous accompagner de loin chez votre avocat, de vous attendre à la sortie et de vous suivre de nouveau jusqu’ici. Avec toutes ces précautions, vous pourrez braver leurs mauvais desseins, s’ils en ont contre vous.
Suivons Albert de Prytavin chez le marchand de vin où il doit assister au rendez-vous de Malvina.
II
UNE LUEUR DANS LES TÉNÈBRES
Il était un peu plus de neuf heures quand Rocambole entrait chez le marchand de vin dont Albert lui avait donné l’adresse et pénétrait ensuite dans le petit cabinet où l’attendait celui-ci en compagnie de Milon.
— J’arrive à temps ? demanda Rocambole en entrant.
— Oui, personne n’a encore paru, répondit Albert.
— Qu’y a-t-il de convenu avec le marchand de vin ?
— Il va faire entrer ses clients dans une pièce attenante à celle-ci.
— Mais, dit Rocambole en parcourant la pièce d’un coup d’œil, comment pourrons-nous entendre ? Je ne vois d’autre porte ici que celle qui donne sur la boutique.
— Aussi n’est-ce pas d’ici que nous assisterons à l’entretien qui va avoir lieu. La pièce dans laquelle vont être introduits la femme de chambre et celui que nous croyons devoir être un amoureux est exactement semblable à celle-ci et doit conséquemment leur inspirer une entière sécurité ; seulement il y a, au plafond de cette pièce, un judas qui communique à une chambre, celle du marchand de vin, et, en ouvrant ce judas, on entend très-distinctement tout ce qui se dit au-dessous.
— Excellente invention ! dit Rocambole.
— D’autant meilleure, que nul ne s’en défie ; on regarde toujours autour de soi, jamais au-dessus.
On frappa à la porte en ce moment.
— Entrez, cria Rocambole.
C’était le marchand de vin.
Il ferma la porte avec précaution, et s’approchant d’Albert :
— En voilà déjà trois, lui dit-il.
— Trois ! s’écria Albert stupéfait.
— Deux hommes et une femme.
— Alors nous nous sommes trompés, il ne s’agit pas d’amour. Vous êtes sûr qu’ils viennent pour la jeune fille ?
— Ils m’ont dit : Donnez-nous un cabinet où l’on puisse causer en toute sûreté, sans crainte d’être entendu, ni dérangé ; une jeune fille viendra bientôt et vous demandera si quelqu’un ne l’attend pas. Vingt ans, jolie mise de femme de chambre, voilà son signalement, vous la ferez entrer, et vous nous laisserez la paix ensuite jusqu’à ce qu’on vous appelle. En attendant un litre de cognac, du chenu et du dur, pas de fine champagne, c’est bon pour les poitrinaires du Café Anglais.
— Tiens, tiens, elle a de singulières connaissances, la femme de chambre.
Le marchand de vin allait répliquer, quand un coup de sonnette se fit entendre dans la boutique.
Il y courut.
Mais son absence fut de courte durée. Il revint au bout de cinq minutes.
— C’est la femme de chambre, dit-il.
— Vous l’avez introduite près de ceux qui l’attendaient ?
— Oui.

![]()
— Nous pouvons monter à notre chambre, alors ?
— Venez.
Tous trois se levèrent et suivirent le marchand de vin.
Quelques instants après, celui-ci leur ouvrait la porte d’une chambre au premier étage.
Sur le carreau rouge de cette pièce se détachait, juste au milieu, un carré en bois de chêne.
C’était le judas.
Le marchand de vin s’en approcha sur la pointe des pieds, en recommandant à ceux qui le suivaient de marcher avec les mêmes précautions, puis il enleva doucement ce carré.
Il fit signe alors à Rocambole de se pencher au-dessus de l’ouverture qu’il venait de mettre à découvert.
Rocambole s’approcha et vit au-dessous de lui une pièce garnie d’une table, autour de laquelle il distinguait confusément quatre personnes, deux hommes et deux femmes.
La chandelle placée au milieu de la table répandait trop peu de clarté pour permettre de reconnaître les traits de ces quatre individus.
Le marchand de vin venait de sortir.
Rocambole se coucha à terre et posa sa tête dans le trou du judas pour ne rien perdre de l’entretien qui allait avoir lieu.
— Malvina, dit une voix qui fit tressaillir Rocambole, c’est demain, vous le savez, que M. Mauvillars doit me faire connaître sa décision, et comme il n’est pas plus avancé qu’il y a quinze jours, comme rien, absolument rien, n’a transpiré du mystère qu’il cherche à pénétrer avec l’aide de Jacques Turgis, auquel j’ai créé ailleurs des préoccupations qui vont le détourner forcément de cette affaire et le forcer en outre à renoncer à ses prétentions conjugales, comme enfin il reste prouvé pour le monde que Tatiane m’a accompagné de son plein gré au bal de la baronne de Villarsay, acte inouï qui ne permet que la plus déplorable des interprétations, les termes de la lettre que je vais recevoir de M. Mauvillars ne sauraient être douteux ; je l’ai acculé dans une impasse dont il ne peut sortir qu’en consentant à mon union avec sa nièce. Mon plan a pleinement réussi, et je dois dire que votre discrétion est pour beaucoup dans ce succès. Je vais donc épouser Tatiane, cette solution si ardemment souhaitée par moi est devenue inévitable ; mais le mariage n’est pas encore fait et jusque-là vous allez être exposée à bien des tentatives de corruption de la part de mes ennemis, si même ils n’ont déjà commencé.
Il fit une pause avec une intention marquée.
Il attendait une réponse à l’insinuation que renfermaient ses dernières paroles.
— Non, répondit Malvina d’une voix brève.
— Cela ne peut manquer, reprit sir Ralph, et c’est dans cette prévision que j’ai voulu… que nous avons voulu vous parler ce soir.
— Qu’avez-vous à me dire ? demanda la jeune fille, toujours sur le même ton.
— Vos parents vont vous répondre.
— Ma chère enfant, dit alors une voix rauque et rude, dans laquelle on reconnaissait cependant une voix de femme, sir Ralph est un digne jeune homme qui d’un mot pourrait nous envoyer sur la plateforme à Charlot, et qui n’en fera rien si tu gardes le silence jusqu’à la conclusion du mariage ; or, tu ne voudrais pas avoir à te reprocher la mort de tes bons parents, n’est-ce pas, ma chère petite Malvina ? et tu vas nous donner ta parole de rester muette comme la tombe jusqu’au jour du mariage.
Il y eut un moment de silence.
— C’est cela, répondit enfin la jeune fille d’une voix frémissante, enfant, vous m’avez accablée de mauvais traitements, jeune fille, vous m’avez élevée dans une atmosphère de vices, vous avez voulu faire de moi une fille perdue, une voleuse et même la complice d’un assassinat, et j’aurais été tout cela, et j’aurais passé ma vie moitié dans la débauche et moitié dans les prisons, si je n’eusse été sauvée par un sentiment… dont il est inutile que je vous parle, car vous ne le comprendriez pas.
— Oui, oui, dit la vieille en ricanant, ce jeune homme que tu nous as livré un soir, que tu as ensuite arraché de nos mains, et qui, aujourd’hui, est ton amant, sans doute.
— Taisez-vous, s’écria Malvina d’une voix vibrante d’indignation.
Elle reprit après une pause :
— Je ne l’ai jamais revu, je ne le reverrai jamais peut-être, mais son image est restée gravée dans mon cœur, c’est elle qui m’éclaire et me guide dans la vie, c’est d’elle que me viennent mes inspirations, c’est elle qui m’a refait une conscience, et si je suis pure et honnête aujourd’hui, étant née de vous et élevée par vous, c’est à elle que je le dois.
La jeune fille avait prononcé ces paroles avec un mélange d’exaltation et d’attendrissement qui avait vivement impressionné Rocambole et ses deux compagnons.
Elle reprit bientôt :
— La Providence, qui m’avait prise en pitié, a voulu achever son œuvre en me mettant en contact avec une jeune fille que Dieu a créée parfaite, à laquelle il a donné toutes les grâces et toutes les vertus, si bonne et si charmante, qu’il est impossible de l’approcher sans l’aimer ; et cette jeune fille, pour laquelle je donnerais tout mon sang, on me force à entrer dans un complot qui a pour but de la jeter dans les bras d’un homme… qui est votre ami, c’est tout dire.
— Ah ! mais dis donc, s’écria la vieille avec colère, si tu voulais ménager tes termes, à la fin !
— Ah ! c’est infâme ! c’est infâme ! s’écria Malvina en éclatant tout à coup, et j’ai été la complice de ce crime, cent fois plus horrible et plus odieux qu’un assassinat, et cette pure et jeune fille, innocente et candide comme un enfant, le monde la croit perdue et souillée, quand d’un mot je pourrais lui rendre l’honneur et la soustraire à la plus effroyable des hontes, celle d’appartenir à un pareil homme, et tout cela pourquoi ? pour vous sauver de l’échafaud… que vous avez si bien mérité tous les deux ; tandis qu’elle, la chère et innocente créature, elle qui m’a prise en affection et me donne chaque jour des marques de sympathie, avait-elle mérité le malheur que lui prépare mon ingratitude ? Mais voilà ! vos têtes sont exposées, et pour les sauver, il faut qu’elle meure de honte et de douleur, elle, la pauvre et innocente enfant. Oh ! tenez, s’écria-t-elle hors d’elle-même et en se levant brusquement, je vous exècre et vous maudis pour ce crime que vous me forcez à commettre aujourd’hui.
Cette violente apostrophe fut encore suivie d’un silence.
Ce fut sir Ralph qui le rompit.
— Eh ! grand Dieu ! dit-il, voilà bien des paroles pour peu de chose. De quoi s’agit-il, après tout ? d’un amour contrarié, amour de pensionnaire, dont il ne restera pas de traces dans quelques mois. Mais il faut en finir, nous avons voulu vous voir ce soir pour vous rappeler le serment que vous avez fait et les terribles conséquences qu’aurait un parjure pour ceux qui, après tout, sont vos père et mère, et sur lesquels je me vengerais sans pitié d’une indiscrétion qui ferait manquer mon mariage, je vous en préviens. Deux seules personnes peuvent révéler le mystère d’où dépend mon bonheur et toute ma destinée, vous et la mère Al…
Il s’interrompit tout à coup. Puis il reprit :
— Celle-ci a autant d’intérêt que moi-même à garder le silence, quant à vous…
— Moi, interrompit vivement Malvina, je marcherai jusqu’au bout dans la voie infâme ou vous m’avez engagée, et d’où je ne pourrais sortir qu’en jetant au bourreau deux têtes, qui pourtant ne méritent guère de pitié.
Maintenant, vous êtes rassurés, c’est tout ce que vous vouliez tous trois, permettez-moi donc de ne pas m’imposer plus longtemps le supplice de votre société ; adieu.
Elle se dirigea vivement vers la porte.
— À mon tour, dit Rocambole en se levant vivement, moi aussi j’ai à causer avec vous, belle Malvina.
Il dit à Albert et à Milon en ouvrant la porte de la chambre :
— Restez ici pour écouter l’entretien de ces trois chenapans, moi je cours après cette jeune fille ; elle vient de révéler ici de beaux sentiments et un attachement profond pour sa jeune maîtresse, je parlerai à son cœur et il est impossible que je ne lui arrache pas la vérité.
III
UN COIN DU VOILE
Malvina avait à peine fait vingt pas dehors quand elle sentit une main toucher légèrement son épaule.
La nuit était noire, la rue déserte à cette heure, la jeune fille jeta un cri d’effroi et voulut doubler le pas.
— Rassurez-vous, Malvina, c’est un ami, lui dit une voix qui n’avait rien d’effrayant.
Et, comme elle semblait hésiter :
— Un ami qui veut vous parler de mademoiselle Tatiane.
Complètement rassurée cette fois, la jeune fille s’arrêta, et, se tournant vers celui qui lui adressait la parole :
— Vous connaissez ma jeune maîtresse ? lui demanda-t-elle.
— Je connais surtout Jacques Turgis, répondit Rocambole.
— Pauvre jeune homme ! murmura Malvina.
— Oui, pauvre jeune homme que le désespoir tuera s’il faut qu’il renonce à sa chère Tatiane.
— Ah ! fit Malvina, il vous a dit…
— Oui. Quant à mademoiselle Tatiane, je l’ai vue une fois, mais cela a suffi pour que je m’intéresse vivement à elle, car, ainsi que vous le disiez tout à l’heure, c’est une si charmante et si sympathique nature qu’il est impossible de la voir sans l’aimer.
— Quoi ! dit Malvina d’une voix inquiète, vous avez entendu…
— Tout votre entretien avec sir Ralph et vos père et mère.
— Tout ? demanda la jeune fille d’une voix émue.
— J’étais venu exprès pour cela et je n’ai rien perdu de ce qui a été dit.
— J’étais espionnée alors ?
— Vous l’avez dit.
— Mais dans quelle intention ? demanda Malvina qui se mit à trembler.
— Dans l’intention de connaître la vérité sur l’effroyable complot qui enveloppe à cette heure votre jeune maîtresse.
Tout en causant, ils avaient fait une centaine de pas dans la rue de Miromesnil.
— Tenez, dit Rocambole en montrant le boulevard Malesherbes entièrement désert à cette heure, tournons de ce côté, nous y serons beaucoup mieux pour causer.
Ils enfilèrent le boulevard dans la direction du parc Monceau.
Rocambole reprit :
— Cet entretien m’a appris, entre autres choses, que vous aviez au cœur une grande et noble passion et que vous puisiez là toutes vos inspirations comme à une source pure.
— Oh ! monsieur ! balbutia la jeune fille avec embarras.
— N’en rougissez pas, reprit vivement Rocambole, cet amour a été à la fois votre guide et votre sauvegarde, il vous inspirera, je l’espère, une généreuse résolution.
— Que voulez-vous dire ? demanda la jeune fille avec hésitation.
— Malvina, dit gravement Rocambole, il ressort clairement des paroles échangées entre vous et sir Ralph que mademoiselle Tatiane ne s’est pas rendue de son plein gré au bal de la baronne de Villarsay en compagnie de cet homme ; malheureusement, c’est tout ce que je sais, l’explication du sinistre mystère qui plane sur cette affaire étrange, cette explication que j’attendais avec une si vive impatience n’a pas été abordée dans votre entretien, et je ne sais qu’une chose, c’est que, malgré toutes les apparences qui la condamnent, votre jeune maîtresse est innocente. Vous pouvez m’avouer cela, puisque vous venez de l’affirmer tout à l’heure avec des paroles d’indignation contre ceux qui vous ont contrainte à les aider dans le complot organisé contre elle.
— C’est vrai, répondit Malvina.
— Voilà donc un fait acquis, prouvé, incontestable : l’innocence de mademoiselle Tatiane, mais cela ne suffit pas, cela ne change absolument rien à la situation de votre jeune maîtresse, il faut pouvoir donner au monde, qui l’a jugée et condamnée, l’explication du piège dans lequel elle est tombée, et, c’est là ce que j’attends de vous, Malvina…
— C’est impossible, répondit la jeune fille d’un ton résolu.
— Impossible ! pourquoi ?
— Puisque vous avez tout entendu, vous le savez.
— Je sais, en effet, que sir Ralph vous tient par une menace terrible, par une menace de mort suspendue sur la tête de votre père.
— Et de ma mère, murmura Malvina.
— C’est effrayant, et il a là de quoi imposer silence à une fille, quels que soient ses sentiments à l’égard de ses parents, j’en conviens ; mais cette menace, sir Ralph n’oserait la mettre à exécution.
— Oh ! il est capable de tout.
— Oui, je le crois impitoyable pour les autres, mais en même temps très-prudent quand il s’agit de lui, et sir Ralph a pour le moins autant de titres que votre père à la plate-forme à Charlot, comme dit madame Claude.
— Ah ! dit vivement Malvina, vous connaissez le nom de mes parents ?
— Parfaitement ; je connais même aussi leur demeure, située à l’extrémité de la rue de Vanves.
— C’est bien cela ; mais comment ?
— Nous causerons de cela plus tard : quant à présent, c’est de mademoiselle Tatiane qu’il s’agit. J’ai résolu de l’arracher des mains de cet infâme sir Ralph, je l’ai juré à Jacques Turgis, je me le suis juré à moi-même, car, je vous l’ai dit, je m’intéresse à cette jeune fille comme si elle était mon enfant ; et maintenant que je viens d’acquérir la certitude de son innocence, dont j’avais déjà l’intime conviction, maintenant que vous m’avez révélé l’existence du complot dont j’avais le pressentiment, vous comprenez qu’il me faut la vérité tout entière.
— Je vous le répète, monsieur, cela est impossible, et vous savez quelle est la raison qui m’empêche du parler.
— Prenez-y garde, répliqua sévèrement Rocambole, si vous vous obstinez à me refuser l’explication que je vous demande, vous me contraindrez à vous faire subir une humiliation que je voudrais vous éviter, car j’ai la plus profonde estime pour votre caractère.
— Une humiliation ? balbutia la jeune fille avec inquiétude.
— Si vous ne consentez de bonne grâce, si vous persistez à plonger dans un désespoir sans bornes deux infortunés dont la destinée est entre vos mains et dépend de vous seule, alors j’irai trouver moi-même mademoiselle Tatiane et je lui révélerai, avec le secret de l’honorable famille à laquelle vous appartenez, tous les détails de la scène à laquelle je viens d’assister.
— Monsieur, oh ! je vous en supplie, monsieur, ne faites pas cela ; mademoiselle Tatiane me chasserait, et qui pis est, elle me mépriserait.
Et, tout en prononçant ces mots d’une voix qui attestait le trouble profond qui l’agitait, elle pressait avec force dans ses deux mains la main de Rocambole.
— Ce sera avec peine et à la dernière extrémité que je prendrai un parti qui sera votre perte, je le comprends, et dont la conséquence peut être pour vous une effroyable torture si elle vient à la connaissance de l’homme qui vous a inspiré un amour si profond et si pur.
À ces derniers mots, un cri étouffé s’échappa de la poitrine de Malvina, qui murmura d’une voix défaillante :
— Oh ! s’il savait cela !
— Je finirai par le découvrir et il le saura par moi.
— Oh ! monsieur !
— Je serai sans pitié pour vous comme vous l’êtes pour votre jeune maîtresse.
— Mais, monsieur, puisque vous m’avez entendue, vous savez à quel point je l’aime, vous savez quelle impérieuse nécessité m’empêche de la sauver en révélant la vérité. Ah ! s’il ne s’agissait que de moi ; si je pouvais, au péril de ma vie…
— Vous vous dévoueriez pour elle, j’en suis convaincu, mais c’est la tête de deux misérables que vous voulez sauver à ses dépens, eh bien, voilà ce que je n’admets pas. Écoutez donc, ceux-là ne sont pas de ma famille, à moi, je n’ai aucune raison pour m’intéresser à eux ; or retenez bien ce que je vais vous dire ; si vous refusez ce soir de me donner l’explication du complot dans lequel vous avez trempé, le père et la mère Claude, dénoncés par moi, seront arrêtés demain matin.
— Oh ! mais c’est affreux ! c’est affreux ! s’écria Malvina en proie au plus violent désespoir.
— Je ne reculerai devant rien pour sauver mademoiselle Tatiane, je vous l’ai dit. Voilà donc la situation : dites la vérité, sir Ralph dénonce vos parents ; refusez de la faire connaître, c’est, par moi qu’ils sont dénoncés ; mais, dans le premier cas, du moins, vous aurez fait votre devoir et vous vous serez épargné un remords éternel.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! que faire ? murmura la jeune fille en se tordant les mains de désespoir.
Il y eut un moment de silence.
— Tenez, dit tout à coup Rocambole, il me vient une idée qui peut tout arranger.
— Parlez, parlez, s’écria la jeune fille.
— Tout à l’heure sir Ralph disait que deux seules personnes pourraient révéler le mystère dont je cherche le secret, vous et la mère Al… ; mais il s’est arrêté brusquement et n’a pas prononcé le nom de cette femme. Eh bien, ce nom, faites-le moi connaître, et c’est à elle que j’irai demander la vérité que vous avez de si puissantes raisons de me cacher.
— Oh ! malheur ! malheur ! s’écria Malvina, ce nom qui eût été mon salut, ce nom, je ne le sais pas, on a toujours eu la précaution de ne pas le prononcer devant moi.
— J’en suis désolé pour vous, mais alors je suis obligé de maintenir les conditions que je viens de vous poser.
Il y eut une assez longue pause, pendant laquelle la jeune fille paraissait plongée dans de profondes inflexions.
— Écoutez, monsieur, dit-elle enfin d’un ton grave et déterminé, le cas est assez grave pour que je demande à réfléchir.
— Je le comprends, répondit Rocambole.
— Laissez-moi la nuit.
— Et demain ?
— Demain, j’aurai pris un parti.
— Quand dois-je aller chercher votre réponse ?
— À midi. Adieu, monsieur.
Et elle s’éloigna.
— Enfin, soupira Rocambole, demain je saurai tout, demain Tatiane sera sauvée.
IV
ESPOIR DÉÇU
Le lendemain, dans la matinée, Rocambole recevait la visite de Jacques Turgis.
Une tristesse grave était empreinte sur les traits du jeune homme et altérait sensiblement l’expression habituelle de sa physionomie, généralement ouverte et souriante.
— Mon cher monsieur Portal, dit-il à celui-ci en lui pressant la main, j’ai reçu votre lettre ; elle est digne d’un Lacédémonien : « Bonne nouvelle, venez ! » cela ne dit rien, mais ça laisse tout à espérer, et j’accours plein d’espoir.
— Et cet espoir ne sera pas déçu, mon cher monsieur Jacques.
Et il raconta à l’artiste tout ce que nous avons déroulé sous les yeux du lecteur dans les deux précédents chapitres.
Quand M. Portal eut terminé ce récit, Jacques s’écria :
— Ah ! je savais bien, moi, que Tatiane n’était pas coupable ! Les preuves les plus accablantes, les plus palpables s’accumulaient contre elle ; mais il y avait là , au fond de mon cœur, un témoignage plus fort, plus éclatant que tous ceux qui se réunissaient pour la condamner, et, à l’éclat de cette pure lumière, je voyais briller son innocence aussi clairement que celui qui lit au fond des consciences.
— Je l’avais jugée comme vous, dit Rocambole, et comme vous je suis heureux de pouvoir attester hautement son innocence ; mais c’est aujourd’hui seulement que notre triomphe sera complet, c’est-à -dire lorsque Malvina nous aura dévoilé toute l’odieuse machination imaginée par sir Ralph pour perdre Tatiane. Voici alors quel est mon projet, et je ne doute pas qu’il ne soit approuvé par M. Mauvillars. Nous réunirons chez celui-ci, sous prétexte de matinée, tous les invités du dernier bal de la baronne de Villarsay, sans oublier sir Ralph, et alors, devant ces témoins de la honte de Tatiane, nous ferons raconter par Malvina tous les détails de l’infâme complot ourdi par sir Ralph, pour perdre la jeune fille et la mettre dans l’impossibilité de refuser sa main.
— À quelle heure doit vous être faite cette précieuse révélation ? demanda Jacques.
— À midi.
— Malvina viendra ici ?
— Non, c’est moi qui vais me rendre chez elle.
— Merci, cher monsieur Portal, merci pour Tatiane, que vous aurez sauvée d’une honte et d’un malheur auxquels elle n’eût pas survécu, dit Jacques avec l’accent d’une profonde émotion.
— Merci pour Tatiane, répliqua en souriant Rocambole, c’est bien ; mais il me semble que vous pourriez me remercier un peu pour vous-même, car vous êtes quelque peu intéressé dans la question.
— Non, monsieur Portal, répondit tristement l’artiste, Tatiane est perdue pour moi.
— Comment, dit Rocambole en le regardant fixement, est-ce que, malgré vos protestations en faveur de son innocence, vous douteriez…
— Douter de l’innocence de Tatiane ! s’écria Jacques, oh ! je douterais plutôt de mon honneur !
— Alors je ne vous comprends plus. Quoi ! nous nous lançons à la poursuite d’un but qui semblait absolument impossible à atteindre. Je parviens, par un hasard providentiel, à percer les ténèbres impénétrables qui nous cachaient la vérité, et, au moment même où elle va éclater, quand nous touchons enfin à la réalisation de ce triple rêve, la confusion de votre ennemi, la réhabilitation de Tatiane, votre bonheur à tous deux, c’est alors que vous me dites : Tatiane est perdue pour moi. Voyons, mon cher monsieur Jacques, donnez-moi, je vous prie, l’explication de ce problème.
— C’est une confession pénible que vous me demandez là , mon cher monsieur Portal, répondit Jacques, mais vous avez tant fait pour moi, pour ma chère et adorée Tatiane, que je ne saurais avoir de secrets pour vous ; écoutez-moi donc et vous allez connaître enfin la cause de la profonde tristesse que vous avez remarquée en moi depuis quelque temps. Vous vous rappelez cette belle toile de Ruysdaël que vous avez vue un jour à mon atelier.
— Parfaitement ! Un tableau estimé quatre-vingt mille francs, chiffre que j’ai même eu l’outrecuidance de trouver quelque peu exagéré.
— Eh bien, le jour même où j’étais rentré chez moi, heureux de la promesse que vous m’aviez faite de m’aider à sauver Tatiane, comme je me disposais à quitter mon appartement pour aller travailler, je vois tomber chez moi M. Chaumont, le marchand de tableaux, auquel appartenait cette toile. Il était pâle, hagard, et c’est d’une voix désespérée qu’il m’apprend que son Ruysdaël n’est plus dans mon atelier, d’où il sortait à l’instant. J’y cours avec lui, croyant à une erreur, mais il n’était que trop vrai, la toile avait disparu.
— Volée ? s’écria Rocambole.
— Oui, monsieur Portal, volée, et par qui ? Ah ! voilà ce qu’il y a d’horrible et d’effroyable dans cette affaire, volée par mon père !
— Ah ! c’est horrible, en effet, murmura Rocambole avec un mouvement de profonde pitié.
Jacques reprit après un moment de silence :
— M. Chaumont voulait se rendre immédiatement chez le commissaire de police, je le suppliai de n’en rien faire et de consentir à un arrangement avec moi pour le payement de son tableau, ce qu’il fit enfin, en insistant avec une singulière complaisance sur les terribles conséquences qu’aurait pour mon nom l’éclat d’une pareille affaire portée devant les tribunaux. Il partit en me promettant de m’envoyer le lendemain un projet de traité et il tint parole. Ce projet que j’ai gardé sur moi, le voici.
Il tira un papier de sa poche et lut ce qui suit :
« Entre les soussignés, Michel Chaumont, marchand de tableaux, demeurant rue Laffitte, d’une part ;
« Et M. Jacques Turgis, artiste peintre, demeurant rue Duperré, d’autre part ;
« Il a été convenu ce qui suit :
« M. Chaumont consent à n’exercer aucune poursuite contre M. Jacques Turgis au sujet d’une toile de Ruysdaël confiée par ledit M. Chaumont à cet artiste et qui a été volée dans son atelier par un modèle connu sous le sobriquet de père Vulcain. »
— Vulcain ! s’écria Rocambole, mais j’ai entendu parler de ça.
— C’est mon père, dit Jacques, et vous comprenez la raison pour laquelle M. Chaumont a tenu à mentionner, en tête de cet acte, le vol et le nom du voleur.
— Oui, c’est un homme prudent et avisé, je vois cela.
Jacques reprit la lecture de l’acte :
« Pour indemniser M. Chaumont de la perte de cette toile, dont il lui avait été offert quatre-vingts mille francs, dont il pouvait espérer de vendre cent vingt mille, mais dont il veut bien porter l’estimation à cent mille par considération pour M. Jacques Turgis, à cause de leurs anciennes et excellentes relations, ce dernier s’engage :
« 1° À fournir à M. Chaumont quatre toiles originales par an, d’un mètre de long au moins, au prix de deux mille francs chaque. »
— Deux mille francs, s’écria Rocambole, combien les vendez-vous donc ?
— De huit à dix mille.
— Mais ce n’est pas un homme, ce marchand de tableaux, c’est un vampire !
— Je continue, dit froidement Jacques :
« 2° À faire, pour M. Chaumont, huit copies par an, dans les mêmes proportions que les toiles originales, et au prix de cinq cents francs chaque copie.
« 3° À travailler exclusivement pour M. Chaumont qui, de son côté, s’engage à prendre, aux prix sus-énoncés, toutes les toiles que pourra produire Jacques Turgis, outre le nombre dont il est fait mention plus haut.
« 4° Ledit traité aura son cours jusqu’à concurrence du remboursement intégral de la somme de cent mille francs, dont M. Jacques Turgis se reconnaît débiteur vis-à -vis de M. Chaumont.
« 5° Il est bien entendu que ledit acte serait nul et de nul effet au cas où M. Chaumont serait remis en possession du Ruysdaël qui lui a été soustrait par le dénommé Vulcain.
« Fait double et de bonne foi,
« Michel CHAUMONT »
« Jacques Turgis »
« Paris, ce 27 mars 186… »
— De bonne foi surtout, s’écrie Rocambole avec colère ; l’affreux Arabe que ce marchand de tableau !
Puis s’adressant à l’artiste :
— Et vous avez pu risquer cela ?
— Cela ou mon nom déshonoré, c’est-à -dire mon père traduit en police correctionnelle, condamné pour ce vol et pour divers autres délits commis de complicité avec une bande de repris de justice, voilà le choix qui m’est laissé.
— En effet, dit Rocambole, il n’y avait pas à hésiter.
— Songez donc que, pendant huit ou neuf années, pendant la période la plus féconde et la plus puissante de ma vie d’artiste, je vais gagner juste de quoi vivre ; c’est une carrière brisée.
Rocambole ne répliqua pas.
Il ne pouvait s’empêcher de reconnaître que l’artiste avait raison et qu’il n’y avait rien d’exagéré dans le sentiment de délicatesse qui le déterminait à renoncer à la main de celle qu’il aimait.
— Mais, reprit Jacques, je ne m’en intéresse pas avec moins d’ardeur au salut de Tatiane et j’en suis aussi heureux, je vous le jure, que si elle devait être ma femme.
— Alors, luit dit Rocambole, venez avec moi ; je veux que vous assistiez à mon entretien avec Malvina et que vous appreniez en même temps que moi la vérité sur cette ténébreuse affaire. Quelle heure est-il ?
Il regarda sa montre.
— Onze heures et demie, c’est le moment de partir ; avec une voiture, nous devons être à midi rue de Miroménil.
— Pourvu qu’elle consente à parler !
— Je n’ai pas l’ombre d’un doute sur ce point, je lui ai prouvé qu’elle avait tout intérêt à me faire connaître la vérité, elle l’a parfaitement compris et la réflexion n’a pu que la confirmer dans cette opinion.
— Partons donc, dit Jacques, j’ai hâte de savoir à quoi m’en tenir.
Un instant après une voiture les emportait vers la rue de Miroménil et ils arrivaient vers midi à l’hôtel Mauvillars.
— Enfin nous y voilà , murmura Jacques tout tremblant d’émotion, dans quelques instants le sinistre mystère nous sera révélé.
Ils venaient de pénétrer dans la cour de l’hôtel.
— Mademoiselle Malvina ? demanda Rocambole au concierge.
— Elle n’y est pas, répondit celui-ci.
— Elle rentrera bientôt sans doute ?
— Elle ne rentrera pas.
— Que voulez-vous dire ?
— Elle est sortie dès le matin et on a trouvé dans sa chambre un mot par lequel elle prévient mademoiselle Tatiane qu’elle part pour ne plus revenir.
Jacques devint tout pâle à ces paroles.
Rocambole lui-même demeura un instant tout interdit.
Mais il n’était pas homme à se décourager.
— Allons, dit-il en se retournant vers l’artiste, tout est à recommencer !
V
UN MAUVAIS TRIO
La marche des événements nous amène à nous occuper de trois personnages que nous avons laissés dans l’ombre depuis bien longtemps.
Ces personnages sont M. Taureins, Goëzmann et Nanine la Rousse, dite marquise de Santarès.
Or, la veille du jour où madame Taureins recevait de son avocat la lettre par laquelle celui-ci lui donnait rendez-vous dans son cabinet pour s’entendre avec son mari sur les termes d’une séparation à l’amiable, nous trouvons l’honorable trio réuni chez la marquise.
Celle-ci, à moitié couchée sur un canapé, le front soucieux et le sourcil froncé, semblait plongée dans de profondes réflexions.
Assis en face d’elle dans un large fauteuil, M. Taureins, le regard fixé sur la belle rousse, attendait avec une vague inquiétude qu’elle voulût bien prendre la parole.
Quant à Goëzmann, il se tenait humblement sur une chaise à une distance respectueuse, suivant sa coutume, et ne témoignait ni impatience, ni inquiétude.
— Eh bien, belle Nanine, dit enfin M. Taureins, ennuyé de voir se prolonger le silence de la marquise, vous nous avez fait mander tous deux pour une communication importante, nous voilà et nous attendons qu’il vous plaise de nous faire connaître votre pensée.
La marquise lui jeta un regard étrange et d’une voix légèrement dédaigneuse :
— Et je parierais, dit-elle, que vous ne soupçonnez même pas quel est le sujet dont je veux vous entretenir.
— Je l’avoue, répondit M. Taureins.
— Et vous, Goëzmann ? dit Nanine, sans daigner tourner la tête du côté de l’Allemand.
— Je le soupçonne, répondit froidement celui-ci.
— Ah ! fit Nanine.
— Je suppose qu’il est question de madame Taureins.
— Et vous n’avez pas deviné cela, vous ? dit Nanine à M. Taureins.
— Nous en sommes débarrassés, que voulez-vous de plus ? répondit M. Taureins.
La marquise se tourna vers M. Taureins, avec un mouvement de lionne en furie, et, dardant sur lui un regard de flamme :
— Elle vit ! dit-elle avec un accent qui fit tressaillir le banquier.
Il y eut un moment de silence.
— Elle vit, reprit-elle d’une voix basse et avec un accent sinistre, et vous dites que nous en sommes débarrassés ! Mais, si votre ambition se contente de si peu, il n’en est pas de même de la mienne. Quand j’aime, je ne veux pas de partage ; quand j’aime, il me faut tout de celui à qui j’ai tout donné : son cœur, son âme, sa personne et jusqu’à son nom.
À ce dernier mot, M. Taureins, dont le visage s’était épanoui devant un débordement de jalousie qui flattait sa vanité, se troubla tout à coup.
— Mon nom ! balbutia-t-il, mais je ne puis pourtant pas le donner à deux femmes à la fois.
— Alors, je le refuserais ; ne vous ai-je pas dit que je ne voulais pas de partage ?
— Quelle est donc votre pensée ! expliquez-vous.
— C’est ce que je vais faire, puisqu’il faut vous mettre les points sur les i, puisque vous ne trouvez dans votre amour ni assez de dévouement, ni assez d’énergie pour mettre fin à une situation intolérable.
Deux femmes ont des droits sur vous, l’une qui les puise dans son cœur, l’autre qui les tient de la loi, l’une qui vous aime, l’autre qui vous exècre et vous méprise ; eh bien, l’une des deux est de trop, et doit disparaître.
— Pourquoi vous préoccuper de madame Taureins ? répliqua le banquier ; n’est-il pas décidé que nous allons quitter la France dans quelques jours ?
— Oui, mais dans quelles conditions ! en fugitifs, en criminels, emportant deux millions qui appartiennent à vos créanciers, traînant après nous un nom souillé ! Et, tandis qu’elle, saluée de tous, comme une noble et touchante victime, se fera de ce nom une couronne d’épines et une auréole de martyre, moi, à qui vous voulez bien accorder la faveur de m’en parer, une fois contraints de nous cacher à l’étranger, je le porterai comme un stigmate d’infamie ! Ah ! voilà ce que je ne veux pas ! s’écria la marquise en bondissant comme une tigresse ; non, je ne veux pas qu’il y ait deux madames Taureins, l’une honorée et adorée comme une sainte, l’autre courbée sous le poids de la honte et méprisée comme la dernière des créatures.
Puis, dardant sur le banquier ce regard implacable qui la rendait effrayante dans ses colères :
— Allons, s’écria-t-elle, assez d’hésitation comme cela, il faut en finir, et, si vous avez peur, laissez-moi faire, je prends sur moi tous les risques et toute la responsabilité.
Devant ce débordement de fureur, M. Taureins était resté pétrifié.
Alors Nanine se tournant brusquement vers Goëzmann :
— Avez-vous une idée ? lui demanda-t-elle.
— Oui, car j’attendais tous les jours le vœu que vous venez d’exprimer.
— Voyons votre plan.
— Je vais vous le faire connaître, dès que vous aurez répondu à une question.
— Parlez !
— Je m’ennuie en France et demande à passer avec vous à l’étranger.
— C’est bien ainsi que je l’entends.
— Après l’immense service que je vais vous rendre et où il y va de ma tête, je crois pouvoir vous demander à ne jamais vous quitter, à vous suivre partout, à vivre de votre vie et sur le pied d’une parfaite intimité.
— Me croyez-vous assez ingrate pour agir autrement ?
Elle ajouta en scandant chaque mot avec intention :
— N’ai-je pas toutes sortes de raisons pour vous être attachée et pour tenir à vous fixer près de moi ?
— Merci de vous en souvenir, señora, répondit l’Allemand avec un regard et un sourire qui exprimaient à la fois la défiance et la menace.
Puis il reprit :
— Eh bien ! mon plan, le voilà . En sortant d’ici, M. Taureins se rend chez maître Chautard, avocat de sa femme.
— Pour quoi faire ? demanda vivement le banquier.
— Pour faire savoir à madame Taureins que, conformément au désir qu’elle en a fréquemment exprimé, vous consentez enfin à une séparation de corps et de biens à l’amiable et que vous désirez vous entendre avec elle à ce sujet dans le cabinet de maître Chautard, dont vous acceptez d’avance l’arbitrage en cas de différend.
— Mais pas du tout, s’écria le banquier, je n’ai aucune confiance en cet homme, tout dévoué aux intérêts de madame Taureins et il ne me convient pas…
— Écoutez-moi jusqu’au bout, vous ferez vos objections ensuite, dit Goëzmann.
Il poursuivit :
— Vous conviendrez donc d’un rendez-vous dans le cabinet de l’avocat de votre femme, et, pour ajouter encore à la confiance de celle-ci, vous demanderez que ce rendez-vous ait lieu entre trois et quatre heures, c’est-à -dire en plein jour.
— Après ? dit M. Taureins stupéfait.
— Vous arrivez au jour et à l’heure convenus, vous débattez vos intérêts avec maître Chautard, vous vous montrez coulant, on finit d’autant mieux par s’entendre, que vous serez décidé d’avance à faire toutes les concessions qu’on exigera de vous. Enfin, maître Chautard rédige un petit acte et vous n’avez plus qu’à signer.
— Et vous prétendez que je signe ?…
— Tout ce qu’on voudra.
— Et puis ? demanda Nanine.
— Quand vous aurez apposé chacun votre signature au bas de cet acte, dont toutes les clauses seront à l’avantage de madame Taureins, il ne vous reste plus qu’à prendre congé d’elle, ce que vous faites en lui disant : Madame, j’ai eu de grands torts à votre égard, je le confesse ; mais, vous devez le reconnaître, je les ai réparés de mon mieux en vous faisant tous les avantages dans l’acte que nous venons de signer ; si cela ne vous suffit pas, je suis prêt à vous accorder plus encore et ne vous demande en échange que l’oubli du passé et votre main en signe de pardon au moment de vous dire un éternel adieu.
— Et nous nous quitterons ? demanda M. Taureins stupéfait.
— Attendez donc. Après la grandeur d’âme dont vous aurez fait preuve, madame Taureins, touchée d’ailleurs de l’accent ému que vous saurez donner à votre voix, ne pourra se dispenser de vous offrir sa main, sa main droite, celle qu’elle aura dégantée pour signer ; vous la presserez dans la vôtre avec effusion, avec une vive effusion, et vous prendrez congé d’elle.
— Et après ? demanda le banquier d’un air ahuri.
— Et bien ! après, c’est-à -dire deux heures après, vous serez veuf.
— Hein ? veuf ? comment cela ? s’écria M. Taureins.
— Ah ! reprit Goëzmann en souriant, c’est que j’oubliais un détail.
— Dites donc.
L’Allemand tira de son doigt un anneau orné d’une émeraude et, la mettant sous les yeux de M. Taureins :
— Examinez cette pierre, lui dit-il, et vous remarquerez qu’au lieu de former une facette aplatie, elle se termine en pointe assez aiguë.
— En effet.
— Elle a une autre singularité : elle est creuse.
— Ah !
— Mais au moment de vous rendre chez maître Chautard, elle sera remplie d’un certain poison à moi connu, et vous l’aurez au doigt, mais le chaton tourné en dedans. Comprenez-vous, maintenant ?
— À peu près, répondit le banquier en se troublant tout à coup.
— En pressant la main de votre femme, vous lui faites à la main une légère écorchure, presque imperceptible, mais suffisante pour infiltrer le poison sous l’épiderme, et madame Taureins retourne radieuse chez M. Portal, sans se douter qu’elle emporte la mort avec elle.
— C’est fort ingénieux, dit froidement la marquise.
— Et fort agréable… pour celui qui l’emploie, répliqua Goëzmann en souriant, en ce que ce poison ne laisse aucune trace. J’ai appris cela dans l’Inde, où j’ai passé de longues années, ce qui prouve, comme on l’a dit souvent, que les voyages forment la jeunesse.
Il ajouta en se levant :
— Je vous quitte pour aller préparer mon petit liquide, que je n’introduirai dans l’émeraude qu’au moment où vous partirez pour nous rendre chez maître Chautard.
Il partit emportant un charmant sourire de la marquise.
Il franchit d’un pas lourd et bruyant la pièce qui faisait suite à celle qu’il venait de quitter ; puis, s’arrêtant brusquement, il ôta ses souliers, revint sans bruit sur ses pas et colla son oreille à la porte.
Voici le fragment de dialogue qu’il put entendre :
— Rassurez-vous, disait Nanine, je sais que vous ne pouvez le souffrir ; il me déplaît autant qu’à vous, et je n’ai jamais eu l’intention de l’emmener.
— Mais comment ferez-vous pour nous en débarrasser ?
— Le jour du départ convenu, nous filerons la nuit précédente, et, en quittant Paris, j’adresserai une petite note à la préfecture de police concernant notre ami Goëzmann, qui sera arrêté et coffré le lendemain.
— C’est ce que nous verrons ! murmura l’Allemand.
Et il sortit sur la pointe des pieds et ses souliers à la main.
VI
LA GOUTTE DE SANG
Il était deux heures environ lorsque Paul de Tréviannes se présenta chez M. Portal, prévenu par une lettre de celui-ci de l’heureuse tournure que prenaient les affaires de madame Taureins.
Il trouva la jeune femme tout habillée et causant avec Vanda et Rocambole en attendant l’heure de partir pour la rue de Provence, où demeurait son avocat.
À son entrée, un charmant sourire effleura les lèvres de Valentine, qui lui tendit la main en lui disant :
— Vous savez la bonne nouvelle ?
— Et j’accours vous en féliciter, répondit le jeune homme en baisant la belle main qu’on lui offrait.
Il ajouta d’un ton sérieux et inquiet :
— Mais êtes-vous bien sûre que ce ne soit pas un nouveau piège imaginé par cette odieuse marquise de Santarès ?
— C’est impossible, le rendez-vous a lieu en plein jour, au centre de Paris, et chez mon avocat.
— En effet, dit Paul, quelque défiance que m’inspirent cette femme et son lâche complice, je ne vois pas quel danger vous pourriez courir dans de telles conditions.
— Quoiqu’il y ait là en effet de quoi vous rassurer complètement, dit Rocambole, j’ai résolu, par surcroît de précaution, de suivre de loin la voiture de madame Taureins, de surveiller les abords de la maison tout le temps qu’elle restera chez son avocat, et de l’accompagner de même au retour, jusqu’à ce qu’elle ait passé le seuil de cette maison.
— Voulez-vous me permettre de me joindre à vous, monsieur Portal ? demanda vivement Paul de Tréviannes.
— Très-volontiers, quoique je n’en voie pas l’utilité.
— D’abord je serai heureux, bien heureux de veiller sur madame.
— Je comprends cela.
— Et puis mon concours ne vous sera peut-être pas tout à fait inutile.
— Quant à cela…
— Vous veillerez autour de la maison, n’est-ce pas ?
— Oui.
— Mais êtes-vous bien sûr qu’on ne puisse pas organiser quelque guet-apens dans l’escalier ?
— Vous avez raison, je n’avais pas songé à cela.
— Eh bien, c’est là que je ferai sentinelle. Or protégée par vous dans la rue, par moi dans l’escalier, par Me Chautard dans sa propre maison, je me demande quel est le danger qui pourrait atteindre madame Taureins.
— Je crois que nous avons tout prévu et que nous n’avons rien à redouter.
— Non, non, dit à son tour Valentine, il n’y a pas de piège, j’en suis convaincue ; M. Taureins est de bonne foi en me proposant cette séparation, et c’est la première fois que j’aurai eu à me louer de cette marquise de Santarès qui, j’en suis sûre, lui a suggéré cette idée. Elle a voulu rompre tous les liens qui m’attachaient à celui qu’elle veut tenir seule sous son joug, et je ne puis que me féliciter de cette inspiration qui va briser presque entièrement une union devenue pour moi depuis longtemps une honte et un supplice.
— Cette chère marquise, dit Paul en riant, elle aura donc accompli une bonne action dans sa vie sans le vouloir, il est vrai.
— Allons ! puisque tout le monde est content, ne laissez pas échapper une si belle occasion, et permettez-moi de vous faire observer que la joie vous fait oublier l’heure, dit Vanda en montrant la pendule qui marquait deux heures et demie.
— En effet, dit Rocambole en se levant, c’est à trois heures que vous devez être chez Me Chautard, madame, ne le faisons donc pas attendre.
Voici justement les voitures qui ont été commandées pour cette heure-ci.
Deux voitures venaient de s’arrêter en effet devant la porte.
— Vanda, dit Rocambole au moment de partir, la comtesse de Sinabria doit venir entre trois et quatre heures, vous voudrez bien la prier de m’attendre.
Puis prenant deux lettres sur son bureau :
— Il faudrait faire jeter ces lettres à la poste, dit-il en les lui remettant.
L’une de ces lettres était adressée à M. Robertson, rue du Foin-Saint-Jacques, n° 5.
Et l’autre portait cette suscription qui étonnera sans doute le lecteur : « Monsieur Rascal, rue des Partants, n° 14. »
Puis il sortit avec Paul de Tréviannes et madame Taureins.
Celle-ci monta dans une voiture qui partit aussitôt.
Rocambole et Paul de Tréviannes prirent place dans l’autre, qui laissa prendre à la première une avance d’une centaine de pas.
— Allons, dit Rocambole au jeune homme, il me semble que l’horizon de vos amours commence à s’éclairer.
— Hélas ! répondit Paul, je vois là pour madame Taureins un dénouement heureux à une situation humiliante et pleine de périls, mais moi, personnellement, quel avantage retirerai-je de cette séparation ? Aucun ; le lien qui l’attache à cet homme, quoique très-relâché désormais, n’en existe pas moins, elle reste toujours enchaînée et ce misérable est toujours un obstacle à mon bonheur.
— En attendant qu’un événement imprévu supprime cet obstacle et vu le milieu où vit M. Taureins, je m’attends toujours à quelque drame ; en attendant cela, vous pourrez voir librement madame Taureins, qui demeurera chez elle dans quelques jours.
— Qui sait si elle voudra me recevoir ?
— C’est moi qui le sais, elle vous aime trop pour vous refuser sa porte.
— Elle m’aime, oh ! oui, je le crois… je le sais, mais cette situation de femme séparée va lui imposer une extrême circonspection, elle se sentira plus que jamais surveillée par ses ennemis, par la marquise surtout, dont la haine insatiable guettera sans cesse une occasion de vengeance, de sorte que l’accès de sa maison va me devenir plus difficile peut-être que lorsqu’elle habitait sous le même toit que son mari.
Il reprit après un moment de silence :
— Une affreuse pensée s’empare de moi à l’instant.
— Qu’est-ce donc ?
— Une séparation ne saurait suffire à la marquise, cela ne remplit pas le but qu’elle se propose et que j’ai deviné depuis longtemps, elle voudrait se dépouiller, comme d’un vêtement souillé, de ce nom de marquise de Santarès, qui la relègue à jamais dans la partie impure et gangrenée de la société, et elle rêve de le remplacer par un nom qui lui ouvre toutes grandes les portes du monde qui la méprise et la répudie aujourd’hui.
— Et vous croyez que la pensée d’un crime…
— Ne l’arrêterait pas, non certes.
— Je le crois comme vous, car elle a débuté dans la vie par un meurtre, accompli à l’âge de seize ans, mais alors, pourquoi cette séparation, qui a pour conséquence de mettre madame Taureins à l’abri de ses coups ?
— Au contraire, elle la met précisément à sa discrétion.
— Comment cela ?
— La marquise a dû se faire ce raisonnement :
En allant de moi-même au devant d’une séparation, car elle sait bien qu’on lui attribuera cette idée, je rassure complètement madame Taureins, je lui fais croire que toute mon ambition se borne là , et je lui inspire la plus entière sécurité. Rassurée désormais sur mes intentions, ne se croyant plus menacée, elle se laisse vivre sans défiance, sans prendre aucune des précautions dont elle s’est entourée jusque-là , et alors, dans l’isolement où elle va se trouver, il me sera facile de l’atteindre.
— Il se peut, en effet, que vous ayez deviné juste et que tel soit l’espoir de la marquise, mais elle sera trompée dans ses prévisions, car, loin de m’endormir dans une dangereuse confiance, j’ai résolu de redoubler de vigilance et de sollicitude autour de madame Taureins à partir du jour où elle quittera ma maison pour s’installer dans la sienne. Ce jour-là je lui donnerai pour majordome et pour homme de confiance, chargé d’abord de choisir lui même, puis de surveiller tous ses domestiques, un individu qui fera bonne garde, je vous le jure, et sur qui elle pourra compter comme sur moi-même, c’est Milon.
— Je le connais et sais qu’on peut se reposer sur lui.
— Il ne bougera pas de là quand elle sera au logis et l’accompagnera partout quand elle sortira ; avec un pareil gardien je puis défier l’odieux trio qui, depuis si longtemps, s’acharne à sa perte. Mais nous voici arrivés.
La voiture de madame Taureins venait de s’arrêter.
Rocambole fit arrêter également sa voiture à une certaine distance de celle de la jeune femme, puis il sauta à terre, ainsi que Paul de Tréviannes.
Celui-ci s’élança aussitôt vers la porte cochère que venait de franchir madame Taureins, et elle était à peine au milieu de l’escalier au moment où il touchait les premières marches.
L’escalier était large et clair, et l’avocat demeurait au premier étage.
Paul de Tréviannes sentit se dissiper à l’aspect de cette maison toute crainte de piège et de guet-apens, ce qui ne l’empêcha pas de rester là jusqu’à ce que madame Taureins fût entrée chez l’avocat.
Puis, réfléchissant que M. Taureins devait venir après sa femme, il gravit le second étage pour éviter sa rencontre et se tint en observation dans l’escalier, où il résolut d’attendre la sortie de la jeune femme.
Il était là depuis une demi-heure quand il entendit un bruit de pas dans l’escalier.
Il se pencha avec précaution au-dessus de la rampe et reconnut M. Taureins, qui, un instant après, sonnait à la porte de Me Chautard et était introduit.
Paul de Tréviannes resta immobile à son poste.
Au bout de trois quarts d’heure, la porte de l’avocat s’ouvrit de nouveau, et il vit sortir M. Taureins, qui descendit rapidement l’escalier et disparut.
Quelques minutes après, la jeune femme sortait à son tour.
Paul descendit rapidement et l’aborda :
— Eh bien ? lui demanda-t-il.
— Tout s’est passé pour le mieux, répondit Valentine toute rayonnante ; il faut de sérieux griefs pour obtenir la séparation, et M. Taureins, je dois en convenir, a reconnu et laissé constater tous ses torts avec une franchise et une facilité dont j’ai été touchée.
Tout en causant, ils étaient arrivés au bas de l’escalier.
Là ils trouvèrent Rocambole, qui attendait la jeune femme avec impatience.
— Tout est terminé, lui dit celle-ci allant au devant de ses questions ; la séparation sera prononcée sans difficulté. Me Chautard en est convaincu.
Comme elle gantait sa main droite, Paul de Tréviannes lui dit tout à coup d’un ton inquiet :
— Vous vous êtes donc blessée ? Je vois une gouttelette de sang à la paume de votre main.
Valentine regarda sa main, essuya le sang avec son mouchoir et répondit en souriant :
— Une écorchure imperceptible ; ce n’est rien, je ne l’ai même pas sentie.
— Et maintenant, dit Rocambole d’un ton joyeux, en route pour la rue Amelot !

VII
LES BONS COMPTES FONT LES BONS AMIS
Le soir de ce même jour, vers neuf heures environ, nous trouvons les trois complices attablés chez la marquise de Santarès, devant un splendide dessert, au milieu duquel se dressent çà et là quelques bouteilles de champagne et de liqueurs.
La marquise est fort animée ; Goëzmann rit de temps à autre, mais de ce rire équivoque qui lui est particulier et qui est toujours quelque chose d’inquiétant.
M. Taureins seul, malgré tous les stimulants dont il a usé et même abusé pendant le dîner et le dessert, reste impassible.
Ni les mets exquis, ni le champagne, ni le café, ni les liqueurs n’ont pu dérider ses traits, ni dissiper la pâleur de son teint qui est resté livide depuis le commencement jusqu’à la fin du repas.
— Ah çà ! lui dit enfin la marquise, après avoir longtemps et vainement essayé de lui arracher un sourire, avez-vous bientôt fini de nous faire cette figure de spectre.
— Un spectre ! murmura le banquier en tressaillant à ce dernier mot, le seul qu’il eût entendu.
— Oh ! vous commencez à me fatiguer avec vos perpétuelles terreurs, s’écria Nanine avec un mouvement d’impatience ; voyons, tâchez de surmonter cette faiblesse indigne d’un homme, et répondez enfin à la question que je vous ai posée vingt fois depuis une heure sans pouvoir obtenir de réponse ; comment s’est passé l’incident final de votre entrevue avec madame Taureins ?
— Eh bien, répondit le banquier d’une voix sourde, qui semblait sortir avec peine de sa gorge, cela s’est passé… comme il était convenu.
— Oh ! cela ne me suffit pas, précisez, je vous en supplie, précisez.
— Que voulez-vous que je vous dise ? Une fois l’acte rédigé et signé, je lui ni demandé de me donner la main en signe d’oubli et de pardon.
— Et elle a consenti ?
— Non sans hésiter.
— Enfin ?
— Enfin elle m’a présenté sa main nue, je l’ai pressée de manière à appuyer assez fortement sur la paume l’émeraude de l’anneau et…
— Et elle n’a pas jeté un cri de douleur ?
— Soit que la douleur fut très-légère, soit que madame Taureins fût très-préoccupée, en ce moment, de ce qui venait de se passer, elle n’a rien manifesté.
— Êtes-vous sûr au moins d’avoir percé l’épiderme ?
— J’en suis sûr.
— Qui vous le prouve, puisqu’elle n’a rien ressenti ?
— J’ai vu du sang à la paume de sa main.
— Alors, le succès est complet.
Elle ajouta en jetant sur le banquier un regard défiant :
— Au reste si le poison a porté, nous le saurons demain matin, car à l’heure qu’il est tout doit être fini depuis longtemps, et dans le cas où, faute d’énergie, vous auriez échoué, eh bien, ce serait à recommencer, voilà tout.
Un rire sec et strident se fit entendre en ce moment.
La marquise se retourna étonnée.
C’était Goëzmann qui riait ainsi.
— Qu’avez-vous donc ? lui demanda-t-elle froidement.
— C’est donc décidément demain que vous partez, c’est-à -dire que nous partons ? demanda l’Allemand.
— Sans doute, demain, à six heures du matin, comme je vous l’ai dit hier.
— Pour l’Espagne ? reprit Goëzmann.
— Certainement, pour l’Espagne.
— Le pays des châteaux en l’air, s’écria l’Allemand avec ce même rire discordant qui venait de frapper la marquise.
— Ah çà ! dit celle-ci en le regardant fixement, vous avez d’étranges gaietés aujourd’hui, mon cher Goëzmann, vous êtes donc bien joyeux ?
— Extrêmement joyeux, répondit Goëzmann.
— Et la raison de cette grande joie ?
— Mais, la perspective de l’heureuse existence que je vais mener désormais entre vous deux, dans ce beau pays d’Espagne qui vous à vue naître, belle marquise.
Il ajouta aussitôt en changeant de ton :
— Et puis, je riais aussi d’un rêve que j’ai fait la nuit dernière.
— Il est donc bien drôle, votre rêve, dit Nanine, le regard toujours attaché sur l’Allemand, dont la gaieté lui semblait de moins en moins naturelle.
— Il est drôle et il n’est pas drôle, ça dépend du tempérament de ceux qui l’écoutent.
— Contez-le-moi donc, ce rêve, car moi aussi j’ai envie de rire, dit la marquise en se rapprochant de l’Allemand.
— D’abord, je voyais passer madame Taureins ; elle rentrait chez notre ennemi, M. Portal, et là seulement, en ôtant son gant, elle remarquait à la paume de sa main une légère déchirure et un peu de sang.
— Ah ! fit joyeusement la belle rousse.
— Sept ou huit heures passaient, poursuivit Goëzmann, et, à mon extrême surprise, je voyais madame Taureins dans son lit, dormant d’un sommeil calme, régulier, souriant à quelque doux rêve et murmurant tout bas un nom : Paul.
— Paul de Tréviannes, celui qu’elle aime autant qu’elle vous hait, dit Nanine en se tournant vers M. Taureins avec un rire diabolique.
M. Taureins ne répondit pas.
Il frissonnait comme s’il eût eu la fièvre ; sa pâleur prenait des tons cadavéreux, et ses yeux, d’un éclat et d’une fixité extraordinaire, trahissaient une sombre et mystérieuse surexcitation.
— Puis, poursuivit Goëzmann, ainsi qu’il arrive souvent dans les rêves, où l’impossible semble tout naturel, je voyais assis en face l’un de l’autre, dans la chambre de madame Taureins et causant tranquillement de leurs petites affaires, devinez qui ? M. Taureins et la belle marquise de Santarès.
— Cela ne manquait pas d’originalité, dit celle-ci en riant.
— Ils causaient de votre humble serviteur, reprit Goëzmann, et la belle rousse disait au banquier : « Soyez tranquille, il me déplait pour le moins autant qu’à vous et je n’ai nullement l’intention de l’emmener en Espagne, comme je viens de le lui faire croire. Nous partirons donc la veille du jour convenu avec lui ; mais, comme nous ne pouvons nous montrer ingrats à son égard après le service qu’il vient de nous rendre en nous débarrassant de votre femme, il faut au moins nous occuper de lui trouver un logement avant de partir, et je vais écrire un mot à cet effet à M. le préfet de police qui, vu la façon toute particulière dont je le recommanderai, se fera un devoir de lui procurer un logement sain et bien clos. »
À ces mots la marquise se leva tout à coup, en proie à un trouble subit.
— Qu’est-ce que cela signifie ? demandait-elle.
— Laissez-moi donc achever mon rêve, répliqua l’Allemand avec son équivoque sourire, rêve toujours insensé, puisqu’il me montre Goëzmann l’oreille collée à la porte de madame Taureins et écoutant le dialogue du banquier et de la marquise.
— Allons ! s’écria celle-ci avec un sourire qui se changea aussitôt en grimace sur ses traits contractés, vous avez raison, votre rêve est un tissu d’absurdités.
— Vous avez dit le mot, répliqua l’Allemand ; mais vous ne savez pas encore jusqu’à quel degré de folie il s’élève ; écoutez plutôt. Un changement à vue s’opère, nous passons de la chambre de madame Taureins dans une salle à manger dont le luxe et le confortable rappellent… celle-ci, tenez ! Là se trouvent réunis à la même table tes trois personnages dont mon rêve continue à s’occuper ; M. Taureins, la marquise et Goëzmann. On dîne, on trinque, on s’amuse, quand tout à coup l’Allemand tire un revolver de sa poche et dit au banquier : « Cher monsieur, j’ai l’honneur de vous faire part du mariage de M. Fritz Goëzmann avec mademoiselle Nanine, marquise de Santarès, qui a été célébré, il y a six ans, à Barcelone ; ce qui autorise ledit Goëzmann à vous brûler la cervelle, vu l’atteinte grave que vous portez à son honneur et à sa considération en entretenant publiquement sa femme légitime depuis plusieurs années. »
Et en parlant ainsi, Goëzmann tirait de sa poche un revolver dont il dirigeait les six gueules sur M. Taureins.

— Ah çà , que veut-il dire ? Que veut-il dire ? s’écria celui-ci en se rejetant vivement en arrière.
Mais la marquise était incapable de répondre.
Elle avait affreusement pâli et ses lèvres blêmies s’agitaient sans pouvoir proférer une parole.
— Voilà ce que c’est, répondit Goëzmann, qui, lui, était resté calme ; la belle Nanine, comprenant tous les services que pouvait lui rendre un homme dévoué et peu scrupuleux à la fois, avait eu la pensée aussi profonde que peu commune de m’attacher irrévocablement à sa personne par le lien du mariage : Reste dans l’ombre, laisse-moi faire fortune par tous les moyens permis et autres, et, quand nous serons riches, nous nous retirerons tous deux dans quelque capitale, où nous éclabousserons les imbéciles en riant des dupes qui se seront laissé dépouiller par moi.
Je suis d’un pays où l’on n’est pas superstitieux à l’endroit de la morale, j’acceptai le marché et puis me rendre cette justice que j’ai tenu fidèlement, en ce qui me concerne, toutes les clauses du contrat ; je comptais sur une loyale réciprocité de la part de mon honorable et légitime moitié, et voilà qu’au moment où nous pouvons aller jouir en paix du fruit de nos petites économies, je découvre que toute sa reconnaissance se borne à vouloir me recommander à la sollicitude de M. le préfet de police. Ah ! mais non, ce n’est pas là mon rêve, je me fâche, et, puisque vous voulez faire bande à part, voici mes conditions : vous irez ensemble de votre côté, j’irai seul du mien ; mais pour me consoler de mon isolement et pour panser les blessures faites à mon honneur, je demande un million. Vous qui savez mieux que personne que l’honneur est sans prix, monsieur Taureins, vous serez le premier à reconnaître que ma demande est modeste et je ne doute pas que vous ne vous empressiez d’y faire droit.
M. Taureins et la marquise étaient atterrés et ce petit discours fut suivi d’un assez long silence.
— Mais, balbutia enfin le banquier, où voulez-vous que je trouve un million ?
— Mais, répandit tranquillement Goëzmann, dans le petit coffret que vous avez apporté avec vous et que j’ai vu à votre main, caché dans le café en face, d’où je guettais votre arrivée.
— Mais, dit M. Taureins, je vous assure…
Goëzmann arma son revolver ; puis, avec le plus grand calme :
— Vous partez à minuit avec madame, je le sais ; moi je pars à onze heures, nous n’avons donc pas de temps à perdre.
Et ajustant le banquier :
— Le million tout de suite, ou je lâche le coup ; et pour que vous compreniez bien que cela est sérieux, je vous préviens que j’ai apporté avec moi mon acte de mariage qui, je vous le répète, me permet de vous tuer comme un chien chez ma femme et sans que ma peau coure le moindre risque, sans quoi je vous épargnerais, croyez-le bien.
M. Taureins comprit qu’en effet la menace était sérieuse et qu’il n’y avait pas à hésiter.
Il sortit et revint bientôt avec un coffret à la main.
— Allons ! soupira-t-il en l’ouvrant.
Il était bourré de billets de banque.
— Tenez, donnez-m’en la moitié au hasard, dit Goëzmann.
C’est ce que fit le banquier.
L’Allemand se leva alors et, souriant à M. Taureins et à la marquise :
— Et, comme vous avez été gentils avec papa, leur dit-il, je vous promets pour bientôt une bonne petite nouvelle.
Et son paquet de billets sous le bras, il sortit.
VIII
LES MALICES DE GOËZMANN
M. Taureins et la marquise furent quelque temps à se remettre de l’émotion qu’ils venaient d’éprouver.
— Un million ! s’écria enfin le banquier, trahissant par un seul mot le principal objet des réflexions dans lesquelles il était resté absorbé, le misérable ! Il m’a volé un million !
— Eh ! monsieur ! s’écria Nanine, il faut être juste et avouer franchement ses fautes, Goëzmann n’est pas un misérable, c’est nous qui sommes des imprudents, c’est nous qui avons eu tort de ne pas nous défier et de le laisser surprendre un entretien qui devait nous en faire un ennemi en lui prouvant qu’il était trahi. Il a pris sa revanche, nous sommes vaincus, résignons-nous et tâchons de profiter de la leçon pour l’avenir. Mais hâtons-nous d’achever nos préparatifs. Vous avez envoyé votre malle à la gare, n’est-ce pas !
— C’est-à -dire que je l’y ai transportée moi-même dans une voiture publique, et que je ne suis venu ici qu’après l’avoir fait inscrire sous mes yeux.
— Bon ! les miennes sont prêtes, je n’ai plus que quelques objets précieux à y jouter et nous partons.
— Oui, oui, le plus tôt possible, dit M. Taureins, qui ne cessait de frissonner, je ne respirerai librement que du moment où nous aurons passé lu frontière.
— Eh ! calmez-vous donc, lui dit la marquise en haussant les épaules, que pouvez-vous craindre et comment voulez-vous qu’on ait quelque soupçon de votre fuite ?
— C’est impossible, car j’ai pris mes précautions et donné pour raison de mon absence un petit voyage d’agrément de quelques jours.
— Eh bien, dans quelques jours nous serons à Madrid et quand on découvrira le pot aux roses, nous nous moquerons de la police française.
— Quelle heure est-il ? demanda le banquier en jetant un regard inquiet du côté de la pendule.
— Onze heures, je vais envoyer chercher une voiture et nous partons.
— Oui, oui, partons, partons vite, murmura M. Taureins en essuyant la sueur qui coulait de son front, je suis mal à mon aise dans Paris et je voudrais déjà être en route.
Il piétinait avec impatience tout en parlant.
— Mais dominez-vous donc, lui dit Nanine, vous êtes pâle comme un mort, et vos traits expriment si clairement les transes qui vous dévorent, qu’un agent de police vous arrêterait de confiance, convaincu que vous venez de faire un mauvais coup.
— Un mauvais coup ! murmura le banquier en se laissant tomber dans un fauteuil, il ne se tromperait pas. Ma femme morte à cette heure, tuée par moi !… Et qui me dit qu’on ne se soit pas déjà aperçu…
Comme il prononçait ces paroles, un coup de sonnette se fit entendre.
M. Taureins se leva d’un bond, et le frisson qui l’agitait depuis deux heures redoubla tout à coup.
— Nanine ! Nanine ! balbutia-t-il, en proie à une angoisse qui lui serrait la gorge, qu’est-ce que c’est ? qu’est-ce que ça peut-être ? Qui peut venir à cette heure ?
— Rassurez-vous, ce n’est pas le bourreau, répondit la marquise avec un accent méprisant.
— Le bourreau ! le bourreau ! murmura le banquier en fléchissant sur ses jambes, vous avez des mots !…
La porte venait de s’ouvrir.
— Je vous en prie, dit M. Taureins à la marquise, allez voir qui est là .
— Allons, j’y vais, dit celle-ci en sortant.
Elle rentrait un instant après.
— Qu’est-ce que c’est ! qu’est-ce que c’est ? demanda M. Taureins qui n’était rejeté dans son fauteuil.
— C’est la concierge.
— Que voulait-elle ?
— Elle apporte une lettre pour vous.
— Pour moi ! s’écria le banquier avec effroi, on me sait ici alors ! et…
— Cette lettre vient d’être remise par un garçon de café avec prière à la concierge de la monter de suite.
Elle remit la lettre au banquier, qui la décacheta avec une impatience fiévreuse et voulut la lire.
Mais il la tendit aussitôt à la marquise en lui disant :
— Je ne peux pas, je ne vois rien, je ne distingue pas un mot, tout se mêle et se confond devant mes yeux. Lisez.
— Tiens ! dit Nanine stupéfaite, c’est l’écriture de Goëzmann.
— Cette lettre doit contenir quelque chose d’effroyable. J’ai peur de cet homme, murmura M. Taureins.
— J’avoue que je n’en attends rien de bon, répliqua la marquise en fronçant légèrement le sourcil.
Elle lut :
« Cher monsieur Taureins, vous et ma belle marquise, vous m’avez blessé dans mon amour-propre en refusant de m’emmener en Espagne, où nous eussions vécu tous les trois dans une si douce et si touchante intimité. Alors, cédant à un mouvement de dépit bien naturel, je me suis vengé en vous faisant une petite malice… que vous êtes loin de soupçonner et dont je vais vous faite la confidence. J’avais d’abord résolu de vous dénoncer comme l’auteur de la mort de madame Taureins en donnant des détails sur la nature du poison, sur ses effets et sur la façon dont il aurait été inoculé ; mais j’ai renoncé à ce projet et suis heureux de vous rassurer complètement sur ce point en vous donnant les meilleures nouvelles de la santé de votre femme, qui n’a nullement été empoisonnée, par la raison que l’émeraude était vide quand je vous l’ai remise…
— Sauvée ! elle est sauvée ! s’écria la marquise en frémissant de colère. Ah ! le misérable ! comme il nous a joués !
Elle reprit la lecture de la lettre :
« Je vois d’ici cette chère marquise bondir comme une lionne à laquelle on vient d’arracher sa proie ; mais je continue. Si j’ai renoncé à cette vengeance, c’est que j’avais trouvé, comme je vous le dis plus haut, une petite malice infiniment plus réjouissante ; je ne sais si vous serez de mon avis ; enfin, la voici. Après être rentré en possession de mon émeraude vide, j’eus l’idée de la remplir, avec l’espoir de trouver bientôt le placement de son contenu. L’occasion s’en présenta promptement en effet.
« Vous rappelez-vous, cher monsieur Taureins, qu’à votre arrivée chez la marquise, je m’élançai pour vous aider à vous débarrasser de votre pardessus, et que, dans mon empressement, je vous fis à la main une légère éraflure qui m’attira de votre part l’épithète un peu vive d’animal ? Eh bien, cette éraflure ne provenait pas d’un coup d’ongle, comme je vous l’ai fait croire alors, mais de mon émeraude, dont vos veines venaient d’absorber le contenu. »
— Grand Dieu ! s’écria M. Taureins en se levant tout à coup et en regardant sa main, où se voyaient encore quelques traces de sang, mais alors je serais perdu.
Il ajouta en passant la main sur son front brûlant.
— Oh ! non, non, c’est impossible, il a voulu m’effrayer, voilà tout.
— C’est possible, dit la marquise en regardant le banquier avec une singulière expression, moi je vous trouve bien pâle ; mais continuons de lire et peut-être allons-nous apprendre que ce n’est qu’une atroce plaisanterie.
Elle lut :
« Je ne sais si mon poison prendra, mais voici à quels signes vous le reconnaîtrez : 1° frissons de plus en plus violents à mesure que le sujet se rapproche de la catastrophe finale ; 2° pâleur cadavéreuse ; 3° faiblesse générale ; 4° sueur abondante ; 5° enfin, dernier symptôme, précédant la mort de dix minutes à peine, contraction effrayante des muscles de la face, qui se contourne, se tasse, se pétrit, se racornit et se défigure jusqu’à ce qu’elle n’ait plus rien d’humain et au milieu d’atroces tortures pour le sujet. »
— Ah ! je suis perdu ! je suis perdu ! s’écria M. Taureins en se levant brusquement et courant comme un insensé à travers la salle à manger ; tous ces symptômes je les ressens depuis une heure, et déjà j’éprouve à la face…
Il courut se poser devant une glace, et alors il jeta un cri désespéré.
La bouche commençait à se tordre affreusement.
— Ah ! c’est horrible ! c’est horrible ! s’écria-t-il en essuyant la sueur qui ruisselait sur ses traits blafards.
Et il se jeta sur un fauteuil ; où il se mit à se rouler, en proie à des souffrances qui lui arrachaient des hurlements.
— Voyons, voyons, dit la marquise, dont la main tremblante pouvait à peine tenir la lettre, lisons jusqu’au bout, et peut-être apprendrons-nous…
Elle reprit :
« Vous mourrez, au moins, avec cette pensée consolante que, de votre dernier soupir, datera le bonheur de votre femme, qui, en face de votre cadavre, cadavre peu intéressant ! ne pourra s’empêcher de songer que rien ne la sépare plus de son cher Paul de Tréviannes, rien que le délai légal des dix mois. Autre pensée non moins agréable et qui adoucira singulièrement les effroyables tortures que je vous promets avant le dernier soupir, votre digne compagne assistera tranquillement à cette terrible agonie, et peut-être n’en attendra-t-elle pas la fin pour emporter le million qui vous reste et qui fait à ses yeux tout votre mérite, n’en doutez pas. Et maintenant que je vous ai procuré une mort aussi horrible que puisse la désirer un ennemi, je veux vous laisser une douce parole pour finir. L’aimable créature que vous n’apprendrez à connaître qu’au moment de passer dans un monde meilleur, va avoir, elle aussi, une petite surprise de mon invention, qui me vaudra, je l’espère, toute la haine et toutes les malédictions que peut lui inspirer sa douce nature. »
Quand elle eut terminé cette lettre, la marquise jeta un regard sur M. Taureins.
Il se tordait à terre en faisant entendre des cris sourds et rauques comme une bête fauve.
Elle le contempla froidement.
Puis elle alla prendre sur un meuble le coffret d’ébène d’où le banquier venait de tirer un million pour Goëzmann, puis elle cria à sa femme de chambre :
— Maria, mes malles sont-elles descendues ?
— Oui, madame.
— La voiture est en bas ?
— Oui, madame.
— Partons.
Et enjambant le corps du banquier, qui s’était roulé jusqu’à elle, elle sortit avec le coffret d’ébène sous le bras.
IX
LA SURPRISE
Il était onze heures trois quarts quand la marquise arriva avec sa femme de chambre à la gare du chemin de fer d’Orléans.
Elle ne s’était pas aperçue qu’une voiture stationnant à vingt pas de sa maison était partie en même temps que la sienne et l’avait suivie jusqu’à cette gare, où elle s’était également arrêtée.
— Madame prend le train de minuit ? lui demanda le commissionnaire qui vint lui ouvrir la portière et prendre ses bagages.
— Oui, répondit Nanine en sautant de voiture, son coffret d’ébène à la main.
— Alors madame n’a pas une minute à perdre pour faire enregistrer ses bagages.
— Faites donc vite.
Et, s’adressant à sa femme de chambre :
— Maria, suivez cet homme pendant que je vais prendre nos billets au bureau.
Maria accompagna le commissionnaire, qui portait une malle sur les épaules.
Quelques instants après elle était rejointe par sa maîtresse, qui, ayant pris ses billets, venait faire enregistrer ses malles.
Cette opération terminée :
— Maintenant, dit-elle à Maria, rendons-nous vite à la salle d’attente.
Elles allaient s’éloigner, quand deux individus, qui les suivaient de loin depuis leur entrée dans la gare, s’approchèrent de la marquise.
— Madame, lui dit l’un de ces hommes, vous êtes bien madame la marquise de Santarès ?
— Sans doute, répondit la marquise en examinant le personnage auquel elle avait affaire.
— Alors, madame, reprit celui-ci, veuillez nous suivre.
— Vous suivre ! s’écria la belle rousse en reculant d’un pas, où donc, s’il vous plaît ?
— Chez vous d’abord, madame.
— Chez moi ! et pourquoi faire ? demanda la marquise avec un ton plein de hauteur.
— C’est ce qu’on vous dira quand nous y serons.
— Mais, monsieur, vous vous trompez certainement, je suis victime de quelque méprise, prenez-y garde.
— Vous êtes la marquise de Santarès, vous venez de le reconnaître vous-même, il n’y a donc pas de méprise, et c’est au nom de la loi que je vous somme de me suivre.
— Et moi, monsieur, s’écria la marquise qui avait pâli, mais qui espérait intimider l’agent à force d’assurance, je vous répète que cette arrestation est le résultat d’une erreur, et je vous déclare que je vous rends responsable des conséquences que pourrait entraîner un retard dans…
— Pardon, madame, interrompit l’agent d’un ton un peu bref, nous n’avons pas le temps de discuter, veuillez donc nous suivre.
— Non, dit la marquise, puisant une indomptable énergie dans le danger dont elle se sentait menacée, sans en soupçonner toute l’étendue, j’entreprends un voyage de la plus haute importance, je n’ai rien à démêler avec la justice et je veux partir.
— Madame, lui dit l’agent en baissant la voix, je serais désolé d’employer la violence pour vous forcer à me suivre, mais on commence à s’attrouper autour de nous, et je vais me voir forcé malgré moi…
En effet, une vingtaine de personnes faisaient déjà cercle autour d’elle.
Elle en fut effrayée, et, comprenant que toute résistance était inutile et ne pourrait que lui être funeste, elle dit à l’agent :
— Je vous suis, monsieur, mais rappelez-vous ce que je vous dis, vous commettez une grave méprise et c’est vous que je rends responsable…
— J’accepte cette responsabilité, mais partons, madame.
Il se mit à la droite de la marquise ; son compagnon se rapprocha de la femme de chambre, et tous quatre se dirigèrent vers la voiture qui les attendait au milieu de la cour.
— Pardon, dit l’agent qui se tenait près de la marquise, permettez-moi de vous débarrasser de cette boîte, qui me paraît fort lourde et doit vous fatiguer.
— Ce sont mes bijoux, dit Nanine en cherchant à se soustraire à cette politesse.
— Je vous les rendrai s’il y a lieu, dit l’agent en s’emparant un peu malgré elle du précieux coffret d’ébène.
Cette insistance fut un trait de lumière pour la marquise.
— Ah ! je comprends tout, murmura-t-elle en frissonnant, c’est la surprise dont ce misérable Goëzmann m’a menacée dans sa lettre. Oh ! l’infâme !
Arrivés à la voiture qui les avait amenés, les deux agents se rangèrent galamment pour laisser monter les dames d’abord, puis ils prirent place en face d’elles, et le cocher fouetta ses chevaux qui partirent d’un train assez rapide.
Une demi-heure après, ils s’arrêtaient à la porte de la marquise de Santarès, au haut de la rue Blanche.
À l’extrême surprise de Nanine, la loge de la concierge était vivement éclairée et une quinzaine de personnes étaient groupées dans le vestibule.
— La voilà ! la voilà ! chuchotèrent toutes les voix dès qu’elle parut.
— Quels sont donc ces gens ? murmura-t-elle avec un vague effroi.
— Les locataires de la maison, répondit Maria.
Au même instant, un homme vêtu de noir et ceint d’une écharpe sortait de la loge.
— Monsieur le commissaire, lui dit un des agents, voici madame la marquise de Santarès.
— C’est bien, montons, répondit le magistrat.
— Le commissaire ! balbutia la marquise saisie d’un tremblement nerveux, que me veut-il ?
Parvenu au deuxième étage, où demeurait la marquise, le magistrat somma celle-ci d’ouvrir sa porte.
Elle obéit et entra, suivie du magistrat, des deux agents et de sa femme de chambre.
Celle-ci tenait à la main un flambeau que lui avait prêté la concierge.
— Asseyez-vous, madame, dit le magistrat à la marquise qui avait perdu toute son assurance.
Elle obéit machinalement.
Puis elle demanda, en jetant autour d’elle un regard inquiet :
— Que me veut-on ? qu’est-ce que tout cela signifie ?
— Madame, lui dit le commissaire, vous êtes accusée d’avoir empoisonné M. Taureins dans le but de vous approprier une somme d’un million qu’il portait sur lui en venant dîner chez vous ce soir.
— Moi ! moi ! s’écria la marquise en frémissant, accusée d’assassinat !
— Le corps de la victime doit être ici, reprit le magistrat en faisant un signe à l’un des agents.
Celui-ci prit le flambeau, l’éleva au-dessus de sa tête et parcourut toute la pièce du regard.
— Voilà là -bas, dans le coin, quelque chose qui ressemble assez à un corps humain, dit-il.
Il s’approcha de l’objet qu’il désignait, suivi de son camarade et du commissaire de police.
Le corps était si étrangement recroquevillé sur lui-même, que sa tête était repliée sur les genoux qui touchaient la nuque.
— Placez-le de manière à ce qu’on voie la face, dit le magistrat à un agent.
Celui-ci s’agenouilla près du corps et voulut le dérouler.
Mais la mort, et peut-être la violence du poison, l’avaient tellement raidi, qu’il fallut de grands efforts pour le redresser.
Lorsqu’enfin le visage fut exposé à leurs yeux, le commissaire et les deux agents laissèrent échapper un cri d’horreur.
C’est qu’il était impossible de reconnaître là une figure humaine.
Tous les traits, contractés, bouleversés, tiraillés et emmêlés l’un dans l’autre, offraient un chaos informe et hideux, où le nez, la bouche, les yeux, le front, les pommettes des joues et le menton formaient çà et là des trous et des saillies indéchiffrables.
— C’est bien là M. Taureins ? demanda le commissaire à la marquise.
— Oui, monsieur, répondit celle-ci en jetant un coup d’œil du côté du corps.
— Mort empoisonné, vous ne pouvez le nier, il suffit de regarder cette tête pour…
— Oui, monsieur, répondit la marquise d’un air accablé.
— Ah ! vous avouez donc enfin que vous l’avez empoisonné ?
— Moi ! je le nie, c’est faux, ce n’est pas moi ! s’écria la marquise en se levant tout à coup.
— Où est le coffret d’ébène ? demanda le commissaire en se tournant vers l’un des agents.
— Le voici, répondit celui-ci en le posant devant le magistrat.
— Vous avez la clef de ce coffret, madame ? dit le commissaire à la marquise.
— Oui, monsieur.
Elle tira la clef de sa poche et la remit au commissaire, qui ouvrit le coffret.
— Madame, lui dit-il en désignant les billets de banque, ce coffret et son contenu appartenaient à M. Taureins ?
— Oui, monsieur, mais il m’avait…
— Laissez-moi dire. M. Taureins vient dîner chez vous avec un coffret contenant un million, quelques heures plus tard on le trouve mort dans votre salle à manger, que vous avez quittée précipitamment en emportant ce million et sans vous inquiéter du cadavre que vous laissez derrière vous, et vous prétendez que vous n’êtes pas l’auteur de cet empoisonnement ! Voyons, madame, qu’avez-vous à opposer aux preuves qui s’élèvent contre vous ?
— Ce que j’ai à opposer ! s’écria la marquise dont le front s’éclaira sous l’empire d’une inspiration subite, un témoignage éclatant de mon innocence, une lettre du misérable qui m’a dénoncée, lettre dans laquelle il se reconnaît l’auteur de l’empoisonnement de M. Taureins. Tenez, cette lettre est ici, je vais vous la montrer.
Et les traits rayonnants, elle se mit à la recherche de la lettre de Goëzmann.
Cinq minutes s’écoulèrent.
La lettre ne se trouvait pas.
— Maria ! Maria ! mais aide-moi donc à chercher cette lettre ; il me la faut ! dit la marquise avec une impatience fiévreuse.
— Mais, dit Maria après avoir cherché quelque temps, je me rappelle que madame jetait une lettre au feu au moment où je suis venue la prévenir que la voiture était là .
— Ah ! je me rappelle aussi, s’écria la marquise en se tordant les mains avec les signes du plus violent désespoir ; c’était cette lettre ! Ah ! malheureuse, qu’ai-je fait !
— Ce ne pouvait être que cette lettre, dit le commissaire en souriant.
Puis, fermant le coffret et le mettant sous son bras :
— Allons, madame, il faut partir.
— Où m’emmenez-vous donc, monsieur ? demanda la marquise en fixant sur lui des regards effarés.
— Au dépôt de la préfecture, madame.
À ce mot de dépôt, la marquise jeta un cri déchirant et tomba sur le parquet, en proie à une violente attaque de nerfs.
X
RÉVÉLATION IMPRÉVUE
Le lendemain du jour où s’étaient passés les événements que nous venons de raconter, Rocambole, Albert de Prytavin, Milon, madame Taureins et Vanda étaient à table et achevaient de déjeuner, cette dernière ayant près d’elle la petite Nizza, quand le domestique entra et remit à Valentine une lettre que venait d’apporter le facteur.
Elle était timbrée de Paris et portait cette singulière suscription :
Madame veuve Taureins,
Rue Amelot, chez M. Portal.
— Veuve ! dit la jeune femme ; qui donc peut se permettre une pareille plaisanterie ?
— Une personne sans doute fort au courant de vos affaires et qui veut faire allusion à votre séparation, répondit Rocambole.
— Ce doit être cela, dit Valentine en décachetant la lettre.
Elle la déplia en disant à ceux qui l’entouraient :
— Je n’ai ici que des amis dévoués, écoutez donc la lecture de cette lettre, dont je veux que vous connaissiez le contenu en même temps que moi, car j’ignore même jusqu’au nom de celui qui l’a écrite, elle n’est pas signée.
Elle lut :
« Madame, vous avez été touchée de la grandeur d’âme dont M. Taureins a fait preuve dans l’entrevue qu’il a eue avec vous chez Me Chautard ; touchée à ce point, que vous avez consenti à lui donner la main comme un gage d’oubli et de pardon.
« Je suis désolé de vous enlever une illusion, madame, mais il faut que vous connaissiez le secret de la générosité de M. Taureins et le véritable mobile qui l’avait poussé à vous proposer un rendez-vous chez votre avocat sous prétexte de séparation. Toutes les mesures étaient habilement prises pour vous inspirer une entière confiance, convenez-en, madame, et vous ne pouviez soupçonner qu’il y avait là une combinaison diabolique dont le but réel était d’arriver à ce serrement de main dans lequel vous n’avez vu qu’un incident sans importance et qui devait vous donner la mort aussi sûrement qu’un coup de poignard en pleine poitrine… »
— Mon Dieu ! murmura la jeune femme en frissonnant.
— À la bonne heure ! s’écria Rocambole, cette générosité me déroutait complètement, maintenant je reconnais mon Taureins. Mais voyons donc comment vous pouviez mourir d’un serrement de main.
Madame Taureins reprit la lecture de la lettre :
« Voici ce qu’avait imaginé la marquise de Santarès : elle possède dans son écrin un petit bijou unique en son genre, c’est une émeraude creuse, fort habilement taillée en pointe et contenant un poison qui, lorsqu’on appuie cette pointe sur l’épiderme, s’infiltre dans le sang et donne la mort en moins de deux heures. Il fut convenu entre la marquise et votre mari que celui-ci, dans l’affaire qui vous réunirait chez Me Chautard, se conduirait assez noblement pour vous mettre dans l’impossibilité de lui refuser votre main, qu’il presserait avec effusion, de manière à faire pénétrer dans la paume la pointe de son émeraude tournée en dedans de sa main. C’est ce qui eut lieu, et vous avez dû remarquer du sang… »
Madame Taureins s’interrompit et pâlissant tout à coup :
— En effet, s’écria-t-elle, cette goutte de sang à la paume de ma main !
— Rassurez-vous et continuez de lire, lui dit Rocambole, ce poison tue en deux heures et vous êtes très-bien portante.
Valentine poursuivit, non sans quelque appréhension :
« Heureusement celui qui vous écrit ces lignes, et dans lequel vous avez toujours vu votre plus cruel ennemi, avait rendu l’émeraude inoffensive en la vidant avant de la remettre à votre mari, qui vous croyait morte deux heures après vous avoir laissée chez votre avocat. Mais admirez les jeux du sort, madame ; le même soir, le poison qui devait vous tuer s’infiltrait dans les veines d’un autre, et cet autre, mort dans d’horribles tortures à l’heure où vous recevrez cette lettre, c’est M. Taureins. Voilà l’explication de cette adresse : Madame veuve Taureins.
— Mort ! il est mort ! murmura la jeune femme saisie d’un tremblement nerveux à cette nouvelle imprévue.
— Ne vous avais-je pas dit que, dans ce milieu criminel et infâme, il était sans cesse menacé de quelque fin terrible ? fit observer Rocambole.
Madame Taureins ne répondit pas.
Elle était tombée dans un état de stupeur qui, pour quelques instants au moins, semblait lui ôter l’usage de ses facultés.
— Cette nouvelle vous a atterrée et vous rend incapable de poursuivre cette lecture, madame, lui dit Rocambole ; voulez-vous me permettre de la continuer ?
Valentine lui tendit la lettre sans répondre.
Rocambole reprit :
« Naturellement, c’est la marquise de Santarès qui s’est chargée de cette petite opération, mais il faut reconnaître que c’est un peu la faute de M. Taureins. Il avait eu l’imprudence d’apporter un million, avec lequel ils allaient passer en Espagne, où il devait l’épouser, après avoir fait constater votre mort. La marquise, qui sait compter, a préféré garder pour elle seule le million, dont l’appât pouvait décider quelque duc et grand d’Espagne à lui donner son nom et son titre, et voilà ce qui l’a déterminée à se débarrasser de M. Taureins, qu’elle n’a jamais pu souffrir, du reste. Mais, ainsi qu’il est dit quelque part, le règne des méchants est court, et la justesse de cet axiome va se vérifier ce soir même dans la personne de cette chère marquise de Santarès, qui, si j’en crois certains pressentiments, pourrait bien aller passer cette nuit en prison, en attendant l’échafaud ou les travaux forcés à perpétuité, fin logique d’une vie comme la sienne, mais qui s’éloigne singulièrement des rêves dont elle s’était bercée et qui allaient se réaliser sans l’intervention inattendue de deux gêneurs, moi et la Providence. Réjouissez-vous donc, madame, rien ne vous empêche de réaliser votre rêve en épousant votre cher Paul de Tréviannes, et vous n’avez plus à craindre d’être troublée dans votre bonheur, ni par M. Taureins, qui est mort, ni par la marquise, que la loi va contraindre à prononcer des vœux éternels, ni par moi, qui emporte sur la terre étrangère le souvenir ineffaçable de vos bontés, les deux sillons sanglants tracés sur mes joues par la cravache de M. Portal. »
— C’est Goëzmann ! s’écria madame Taureins.
— Je l’avais deviné depuis longtemps, dit Rocambole.
— Étrange chose que la destinée ! murmura Valentine, je devrais être dans la tombe à cette heure, et des trois misérables qui voulaient ma perte et n’ont cessé de me poursuivre de leur haine, l’un est mort, l’autre va être flétrie par la loi et, à jamais rejetée de la société, et le troisième est en fuite, exposé à tomber lui-même sous la main de la justice, et tout cela dans l’espace de quelques heures !
— Oui, dit Rocambole, on eût bien étonné ce terrible trio si on lui eût prédit hier ce qui arrive aujourd’hui. Mais je continue :
« Vous voilà donc débarrassée de trois ennemis mortels, madame, mais ne vous croyez pas hors de danger pour cela, le péril sera d’une autre nature, voilà tout. »
— Encore ! balbutia Valentine avec un vif sentiment de terreur.
— Quels autres ennemis avez-vous donc à craindre ? dit Rocambole. Voyons, Goëzmann va nous l’apprendre.
Il lut :
« Avant que la marquise ne se chargeât de supprimer votre époux, deux hommes m’avaient payé pour faire cette besogne, on les nomme sir Ralph et Mac-Field.
— Tiens ! tiens ! tiens ! fit Rocambole ; voilà du nouveau.
« Lord Mac-Field voulait vous faire veuve afin de vous offrir sa main, non qu’il convoitât la fortune de M. Taureins, qu’il savait fort embrouillée ; non qu’il fût amoureux de vous, il est trop positif pour cela ; mais parce que cette union entre dans un vaste plan conçu par ces deux aventuriers pour accaparer l’immense fortune d’un certain oncle d’Amérique, du nom de Valcresson ; fortune, dont un cinquième, soit deux on trois millions, forme votre part dans l’héritage. C’est le même mobile qui pousse sir Ralph, recommandé par M. Badoir, à vouloir à tout prix, et bon gré mal gré, épouser mademoiselle Tatiane Valcresson, et c’est pour cela qu’il vient de la compromettre publiquement par je ne sais quel moyen. J’ai su tout cela par un entretien que j’ai surpris entre ces deux hommes et M. Badoir, un jour que Mac-Field m’attendait pour me parler de M. Taureins, entretien dans lequel il était également question d’une certaine Louise Prévôt et de son enfant, mais je ne sais à quel propos. »
Les traits de Rocambole rayonnaient tandis qu’il lisait cette dernière partie de la lettre de Goëzmann, et la joie du triomphe brillait dans ses yeux.
— Oh ! mais, s’écria-t-il, voilà des révélations aussi précieuses qu’inattendues ; c’est tout un monde qui s’ouvre devant moi, c’est un torrent de lumière qui m’arrive et me dévoile la vérité que je cherchais vainement depuis si longtemps. L’héritage Valcresson, douze ou quinze millions, paraît-il, voilà qui explique tout : les deux complots organisés contre Tatiane et la comtesse de Sinabria, l’enlèvement de la petite Jeanne, fille dudit Valcresson, la folie et la fuite de Louise Prévôt, résultat facile à prévoir et ardemment désiré, puisque le mariage de celle-ci avec son oncle détruisait toutes les espérances. Enfin, je ne marche plus dans les ténèbres, je sais ce qu’on veut, je sais où je vais et où il faut frapper. Ah ! si je voyais aussi clair dans le mystère qui enveloppe le drame ourdi autour de Tatiane !
— Il est grandement temps, dit Albert de Prytavin, car on parle d’afficher les bans la semaine prochaine, et dans quinze jours l’odieuse union sera accomplie. Aussi la pauvre jeune fille ne quitte plus sa chambre, où elle pleure du matin au soir ; son désespoir est si grand qu’on craint pour sa raison.
En ce moment la porte s’ouvrit et le domestique annonça :
— M. et madame Mauvillars.
— Faites entrer au salon, dit Rocambole.
Mais ils suivaient le domestique et entrèrent aussitôt.
C’étaient les deux vieillards.
Le grand-père et la grand’mère de Tatiane.

![]()
XI
GRAND-PAPA ET GRAND’MAMAN MAUVILLARS
Comme de coutume, les deux vieillards se faisaient remarquer par une mise dont la mode remontait au temps de leur jeunesse et qui ajoutait encore à l’expression naïve et profondément vénérable de toute leur personne.
Une propreté méticuleuse éclatait dans cette toilette d’un autre âge et leur donnait l’apparence de deux portraits de famille bien vernis et soigneusement époussetés.
La vieille dame portait à son bras gauche une espèce de sac, connu autrefois sous le nom de ridicule, et elle le couvait d’un œil inquiet, comme s’il eût contenu quelque chose de précieux.
Tous deux semblaient accablés sous le poids d’une tristesse qui donnait à leur bonne et honnête physionomie quelque chose de touchant.
Tout le monde s’était levé à leur entrée et continuait de rester debout.
— Je vous en prie, je vous en supplie, messieurs et mesdames, dit le vieillard tout confus des égards dont il était l’objet, veuillez vous asseoir, je ne voudrais déranger personne.
De son côté, la grand’mère se confondait en révérences.
— Monsieur Mauvillars, lui dit Rocambole en faisant un pas vers la porte, c’est par erreur qu’on vous a introduits ici tous deux, ayez l’obligeance de me suivre au salon.
— Non, répandit le vieillard, restez, nous sommes bien ici et c’est devant vos amis que je veux vous parler ; peut-être aurai-je besoin d’eux pour intercéder en ma faveur et appuyer la demande que j’ai à vous adresser.
Il ajouta, en le regardant timidement :
— Car vous êtes bien M. Portal, n’est-ce pas ?
— Oui, monsieur, répondit Rocambole en approchant deux sièges.
— Merci, monsieur ; mais nous voulons rester debout ; nous venons en suppliants et c’est l’attitude qui nous convient.
Il ajouta aussitôt :
— Monsieur Portal, connaissez-vous notre petite-fille Tatiane ?
— Oui, monsieur, dit Rocambole ; j’ai eu l’honneur de la voir au bal de M. Mauvillars, et, comme tous ceux qui l’ont approchée une fois seulement…
— Vous l’aimez, n’est-ce pas ? dit vivement le vieillard.
Et, se tournant vers sa femme, il lui dit avec une émotion qui faisait trembler sa voix :
— Entends-tu, Félicie ? M. Portal aime notre petite Tatiane, c’est déjà d’un bon augure.
— Eh ! qui donc ne l’aimerait, la chère enfant ! répliqua la vieille dame.
— Monsieur Portal, reprit le grand-père, vous savez peut-être le malheur qui est arrivé à la pauvre enfant !
— Vous voulez parler de son étrange aventure avec sir Ralph ?
— Aventure qui la contraint d’accepter pour époux cet homme qu’elle exècre.
— Je sais cela, monsieur.
— Mais elle est innocente, monsieur Portal, s’écria le vieillard avec feu.
— Je le sais mieux que personne, et je le jurerais sur ce que j’ai de plus cher au monde, quoiqu’il me soit impossible d’en donner la preuve.
— Ah ! monsieur, ça vous fendrait le cœur de la voir pleurer, car elle ne fait que cela jour et nuit, et la pauvre petite, que vous avez vue si fraîche et si souriante, est si triste et si pâle, que vous ne la reconnaîtriez plus. S’il faut que cette affreuse union s’accomplisse, elle n’y survivra pas, monsieur, et nous ne pouvons pas la laisser mourir. Que voulez-vous que nous devenions ici-bas si elle n’y est plus, nous qui ne vivons plus que pour la regarder, pour nous réjouir de ses joies et pleurer de ses douleurs ?
Écoutez, monsieur, je vais vous dire ce qui nous amène près de vous. Nous connaissons M. Jacques Turgis, un brave et excellent jeune homme qui aime Tatiane autant que nous, et il nous a dit ce matin : « Il n’y a qu’un homme qui puisse la sauver, si la chose est possible, c’est M. Portal. » Alors j’ai dit à Félicie : Écoute, ma femme, habille-toi, habillons-nous tous deux et nous allons nous rendre chez M. Portal. Nous nous mettrons à genoux devant lui pour le supplier de sauver notre chère Tatiane ; nous sommes vieux, il aura pitié de nos larmes…
Un sanglot lui coupa la parole.
Tout en parlant il avait tiré son mouchoir de sa poche, non pour se moucher, mais pour essuyer ses yeux.
C’était un mouchoir à carreaux, qu’il tamponnait entre ses mains, de manière à lui donner peu à peu la forme d’une boule parfaitement lisse à l’extérieur, espèce de tic qu’on lui avait toujours connu et qui, pratiqué en ce moment, au milieu de cette immense douleur, excitait à la fois le sourire et les larmes.
— Ma bonne amie, dit le vieillard, joins la voix à la mienne pour supplier M. Portal de…
Les deux vieillards tombèrent aussitôt aux genoux de Rocambole :
— Ah ! monsieur, monsieur ! s’écria la grand’mère en sanglotant, sauvez notre chère petite Tatiane et toute notre vie se passera à vous bénir, et cela vous portera bonheur, monsieur, car vous aurez fait là une bonne action.
— Madame, s’écria Rocambole en se penchant vivement vers la vieille dame pour la relever, asseyez-vous, je vous en prie.
— Non, monsieur, non, reprit le vieillard, Félicie et moi, nous resterons là jusqu’à ce que vous nous promettiez de la sauver.
Puis, s’adressant à sa femme, qui s’était emparée d’une main de Rocambole et l’inondait de larmes :
— Passe-moi le sac, ma bonne amie.
La grand’mère lui remit le ridicule qu’elle avait au bras.
Le vieillard en tira une liasse de papiers enveloppés et ficelés, et, l’offrant à Rocambole :
— Tenez, monsieur Portal, toute notre petite fortune, toutes nos économies de quarante ans sont là ; il y a cent vingt mille francs, acceptez-les, nous en faisons le sacrifice pour sauver Tatiane.
— Ah ! monsieur, fit Rocambole en reculant d’un pas.
— Oh ! monsieur, vous pouvez les prendre, nous n’en avons pas besoin ; je suis vieux, mais je suis encore solide et je puis travailler. Je connais la tenue des livres, j’ai une bonne écriture, je puis gagner deux mille francs par an, et que nous faut-il de plus pour vivre ? Nous n’aurons pas de bonne, mais ma pauvre vieille femme est bien portante et elle sera heureuse de faire ce sacrifice à notre chère Tatiane.
— Ah ! monsieur, s’écria la vieille dame, en éclatant de nouveau en sanglots, avec quel bonheur je servirais même chez les autres, si à ce prix je pouvais voir le sourire reparaître sur son joli visage.
— Mesdames et messieurs, s’écria à son tour le vieillard, en passant sur ses yeux pleins de larmes son mouchoir, qu’il ne cessait de tamponner entre ses mains, si vous saviez comme elle est gentille, quelle belle âme ! quel bon petit cœur ! et comme elle nous aime, vous trouveriez tout simple ce que nous faisons. La première chose que nous voyons à notre réveil, c’est elle, c’est son charmant visage, tout rose et tout souriant, elle vient nous embrasser et nous conter tous ses rêves, toutes ses pensées et toutes ses impressions de jeune fille ; tout cela s’exhale naturellement de son cœur innocent et candide comme le parfum de la fleur, car elle n’a rien à cacher, la chère enfant, puis elle nous embrasse et s’en va, nous laissant heureux, mais si heureux, que chaque fois nous nous regardons et nous pleurons sans pouvoir dire autre chose que ces mots : Pauvre cher ange ! chère petite Tatiane ! Aussi c’est à nous, à nous seuls qu’elle devra son salut, nous l’avons décidé.
Oh ! je sais bien que mon fils ne voudra pas que je travaille, ni que ma chère femme s’impose aucune privation, et il est assez riche pour subvenir à tous nos besoins, mais nous tenons à nous sacrifier, nous mettrons notre joie et notre orgueil à souffrir pour notre chère Tatiane.
En voyant ces deux vieillards pleurant et sanglotant, toujours agenouillés devant M. Portal, tous les témoins de cette scène étaient profondément attendris.
Rocambole lui-même était en proie à une émotion qu’il n’essayait pas de dissimuler.
— Je vous le répète, dit-il aux deux vieillards, mademoiselle Tatiane m’inspire le plus vif intérêt, je m’occupe ardemment de cette affaire et je vais mettre tout en œuvre pour sauver votre chère petite-fille de l’affreux malheur dont elle est menacée ; mais, je vous en supplie, relevez-vous d’abord, et ensuite ne me faites pas l’affront de m’offrir votre fortune pour me décider à faire ce que je considère comme un devoir.
Et en même temps il aidait la grand’mère à sa relever.
Le vieillard était déjà debout.
— Mon Dieu, monsieur, dit-il d’un air embarrassé et craignant évidemment d’avoir blessé Rocambole, je n’ai pas voulu vous offenser, croyez-le bien, je serais au désespoir que vous puissiez m’attribuer une pareille intention… mais j’ai pensé que pour arriver à découvrir la vérité il y aurait des démarches… des frais… des gens à gagner peut-être… et c’était pour cela…
— Ne parlons plus de cela, monsieur Mauvillars, dit Rocambole en souriant, vous avez commis une méprise, voilà tout, mais le mobile qui vous a poussé à me faire cette offre est trop beau, trop généreux pour que je vous en veuille.
— Et vous me promettez de sauver Tatiane ? demanda le vieillard.
— Je vous promets de faire pour cela tout ce qui sera en mon pouvoir et de m’occuper d’elle comme si elle était, non ma fille, mais mieux encore, ma petite-fille ; n’est-ce pas tout dire ?
— Vous êtes la bonté même, monsieur Portal, et je vous quitte plein de confiance.
— Écoutez-moi, monsieur Mauvillars, s’il ne s’agissait que d’empêcher cette union, ce serait fait tout de suite ; je me rendrais chez votre fils, j’y attendrais sir Ralph et je le chasserais d’un seul mot. Mais là n’est pas la question ; quel que soit cet homme, M. Mauvillars a décidé qu’ayant perdu la réputation de mademoiselle Tatiane il devait la réhabiliter en l’épousant, but que s’est proposé le misérable par l’infâme machination dont nous cherchons à pénétrer le mystère ; or c’est là ce que je cherche, c’est l’explication de ce mystère d’où doit sortir, pure et sans tache, l’innocence de la jeune fille, et c’est alors seulement que je pourrai confondre le misérable.
— Écoutez, monsieur, reprit le vieillard, c’est dans quinze jours que doit avoir lieu cette fatale union, et, par une coïncidence extraordinaire, c’est à peu près le même jour que nous devons célébrer notre cinquantaine, car il y a cinquante ans, monsieur, que j’ai épousé ma chère Félicie, et, nous pourrons le dire pour la seconde fois, cette cérémonie sera le plus beau jour de notre vie, si notre chère petite-fille est sauvée, mais dans le cas contraire… oh ! alors, il n’y aura pas de cinquantaine, monsieur, ce ne serait pas la peine, car la douleur la tuerait, la pauvre enfant, et nous-mêmes…
Il s’interrompit pour porter à ses yeux son mouchoir à carreaux, plus tamponné que jamais.
La pauvre grand’mère s’était mise aussi à pleurer.
— Allons, monsieur Mauvillars, allons, chère madame, rassurez-vous, nous sortirons de cet abîme, j’en ai un si vif pressentiment que je m’invite à votre cinquantaine.
— Oh ! que vous seriez le bienvenu, monsieur Portal !
Il ajouta aussitôt :
— Mais nous vous avons assez dérangé comme cela.
Et, se tournant vers sa femme :
— Allons, Félicie, donne-moi le bras, ma bonne amie.
Ils saluèrent tout le monde et sortirent.
Un jeune homme se croisa avec eux sur le seuil.
C’était Paul de Tréviannes.
XII
SOUVENIR D’AUTREFOIS
Paul de Tréviannes venait voir madame Taureins.
Celle-ci s’empressa de lui communiquer la lettre qu’elle venait de recevoir, et on se figure aisément quelle fut la joie du jeune homme en apprenant la mort de M. Taureins, dont la fin terrible ne pouvait le toucher que médiocrement après la tentative qu’il avait faite lui-même contre sa femme.
Cependant il était trop homme du monde pour laisser éclater ses sentiments à ce sujet devant Valentine, encore sous l’empire de la violente émotion que lui avait causée cette nouvelle.
Il garda donc le silence sur ce point et se contenta de se réjouir de la catastrophe qui terminait si tragiquement la carrière de la marquise de Santarès.
— Mes enfants, dit tout à coup Rocambole en se levant de table, je vous laisse pour m’occuper d’une affaire fort grave.
Et donnant une tape amicale sur la joue de la petite muette :
— Viens avec moi, Nizza.
L’enfant se leva d’un air ravi.
Vanda lui mit son manteau et son chapeau, qu’elle était allée chercher en courant, et elle sortit avec Rocambole, qui la tenait par la main.
— Dis donc, ma petite Nizza, lui dit celui-ci en souriant d’avance, si nous prenions une voiture ! Qu’en dis-tu ?
Nizza bondit de joie à cette proposition et répondit par trois ou quatre signes de tête dont le sens n’était pas équivoque.
Aller en voiture était une de ses grandes joies et Rocambole le savait bien.
Il en prit une sur le boulevard et donna cette adresse au cocher :
— Rue Cassette.
La voiture partit.
Nizza aurait voulu qu’elle n’arrivât jamais.
Elle ne pouvait rester en place.
Un sourire perpétuel sur les lèvres, elle allait d’une portière à l’autre, s’asseyait tantôt à côté, tantôt en face de Rocambole et, dans l’expansion de son bonheur, venait de temps à autre se jeter dans ses bras.
Ces élans, cette exaltation, ces rayonnements de joie, que n’accompagnait aucune parole, étaient charmants et tristes à la fois, et c’est avec un sourire plein de mélancolie que Rocambole admirait le bonheur sans mélange qui éclatait dans les beaux yeux de la petite muette.
La voiture s’arrêta enfin.
Un vif désappointement se peignit aussitôt sur les traits mobiles et expressifs de l’enfant.
Rocambole sourit et la baisant au front :
— Ne te désole pas, ma petite Nizza, lui dit-il, la voiture va nous attendre là et nous la reprendrons en sortant de cette maison.
Le sourire reparut aussitôt sur les lèvres de la petite muette.
— M. Badoir ? demanda Rocambole à la concierge.
— Au deuxième, la porte à droite.
Il gravit deux étages et sonna.
La vieille Bretonne, déjà connue du lecteur, vint lui ouvrir et l’introduisit dans le cabinet de M. Badoir, en le faisant passer par la salle à manger, sur la cheminée de laquelle brillaient, toujours conservés sous verre, les deux flambeaux dorés qui avaient si vivement excité l’admiration de sir Ralph.
On se souvient peut-être que ce dernier, causant avec M. Badoir au bal de M. Mauvillars, lui avait signalé M. Portal comme un ennemi redoutable.
Ce ne fut donc pas sans quelque émotion qu’il le vit entrer chez lui.
Mais convaincu, après une rapide réflexion, qu’il était impossible qu’il connût la nature de ses relations avec sir Ralph et Mac-Field, qui seuls étaient instruits de certains actes criminels de sa vie, pure et inattaquable pour tous, il se remit bien vite et se drapa aussitôt dans cette dignité froide et austère qui se mariait si bien à son caractère supposé.
Suivant une habitude qui était le résultat d’un calcul et qui lui réussissait près de sa clientèle ordinaire, généralement composée de solliciteurs affamés d’argent et résignés d’avance à toutes les humiliations pour s’en procurer, il désigna du doigt un siège à Rocambole, sans se lever de son fauteuil pour le recevoir, puis il lui dit d’une voix brève et impassible :
— Veuillez me dire ce qui me vaut l’honneur de votre visite, monsieur.
— C’est ce que je vais faire en quelques mots, répondit Rocambole sur le même ton.
Puis, lui désignant du doigt Nizza, assise à côté de lui :
— Vous rappelez-vous avoir vu quelque part cette enfant, monsieur ?
— Nullement, monsieur, répondit M. Badoir, en jetant sur la petite muette un regard indifférent.
— Vous la connaissez pourtant, monsieur.
— Je n’en ai pas le moindre souvenir.
— Je vais tâcher d’aider votre mémoire.
Il reprit après un moment de silence et en le regardant fixement :
— Monsieur Badoir, connaissez-vous l’histoire de l’empoisonneur Desrues ?
— Que voulez-vous dire, monsieur, répondit le banquier tout interdit à cette question, et quel rapport y a-t-il entre moi et…
— Et cet empoisonneur ? Il y en a un, monsieur, et très-frappant… Car ce Desrues, qui, d’ailleurs, habitait comme vous le faubourg Saint-Germain, s’y était fait une réputation de probité, de vertu et de dévotion qu’on ne saurait comparer qu’à celle dont vous jouissez aujourd’hui et dont tout le monde fut dupe jusqu’au jour où l’on découvrit que tout cela n’était qu’un masque sous lequel se cachait un monstre d’hypocrisie et de férocité, coupable des crimes les plus odieux.
— Et c’est avec un pareil homme que vous osez me trouver une ressemblance, monsieur ? s’écria M. Badoir d’un ton plein de hauteur.
Au lieu de répondre, Rocambole laissa tomber sur lui un regard plein d’une sombre ironie.
Puis il reprit d’une voix lente et grave :
— Avant de vous indigner, monsieur, veuillez répondre aux trois questions que je vais vous adresser.
— Monsieur, répliqua vivement M. Badoir, je ne vous reconnais pas le droit…
— Laissez-moi donc parler, monsieur, interrompit vivement Rocambole, ou je croirais que vous avez peur de m’entendre.
Il ajouta aussitôt :
— Voici les trois questions auxquelles je vous prie de répondre :
D’abord, pouvez-vous me dire ce qu’est devenue Louise Prévôt depuis sa disparition de la villa de Fontenay-aux-Roses ?
Au nom de Louise Prévôt, M. Badoir n’avait pu réprimer un tressaillement.
Rocambole poursuivit sans paraître s’en apercevoir :
— Ensuite, pourriez-vous me confier ce que vous avez fait de son enfant après l’avoir enlevée à sa mère ?
— Mais monsieur… balbutia M. Badoir, de plus en plus déconcerté.
— Enfin, continua Rocambole, vous plairait-il de m’apprendre quel est le motif qui a pu vous déterminer à demander la main de votre nièce, mademoiselle Tatiane Valcresson, pour sir Ralph, que vous saviez peut-être coupable de certain assassinat commis à New-York, de complicité avec Mac-Field, et dont, en tous cas, vous ne pouviez ignorer l’infâme guet-apens commis sur la comtesse de Sinabria, puisque vous étiez de moitié avec lui dans cette affaire ?
M. Badoir ne trouva pas un mot à répondre.
Il était comme écrasé sous cette triple accusation, qu’il ne s’attendait guère à entendre sortir de la bouche de M. Portal.
En effet, comment, par quel inexplicable hasard pouvait-il être instruit de l’affaire de Louise Prévôt et de son enfant ?
Que cette aventure fût venue à la connaissance de sir Ralph, cela se comprenait par les relations qui avaient pu naturellement s’établir entre celui-ci et le cocher François, son ancien complice dans l’enlèvement de la petite Jeanne ; mais M. Portal, à quelle source avait-il pu puiser ces renseignements ?
— Vous ne répondez pas, monsieur ? lui dit enfin Rocambole.
M. Badoir garda le silence.
— Eh bien, monsieur, c’est moi qui vais répondre pour vous, sur deux questions au moins, car pour la première, celle qui concerne Louise Prévôt, j’avoue que je ne sais que ce que vous savez vous-même, c’est-à -dire sa disparition à la suite d’un accès de folie causé par l’enlèvement de son enfant comme vous l’aviez prévu. Quant à cette enfant, c’est différent, je puis vous dire ce que vous en avez fait et ce qu’elle est devenue depuis. Après l’avoir emportée endormie de chez sa mère, vous l’avez jetée entre les mains de deux monstres, Claude et sa femme, et celle-ci, plus féroce encore que son mari, a fait subir à la pauvre petite une mutilation… dont la seule pensée me glace d’horreur, et cela sous vos yeux, sans que vous y mettiez obstacle. À la suite de cette horrible torture qui la privait pour toujours de l’usage de la parole, la malheureuse enfant était livrée à une espèce de saltimbanque, surnommé la Terreur des Alcides, mais dont le vrai nom était Jacques… Jacques Rascal, qui l’emmena de ville en ville et la fit danser sur la corde raide jusqu’au jour où…
Il s’interrompit tout à coup pour reprendre bientôt sur un autre ton :
— Celle-là , je puis vous dire ce qu’elle est devenue.
— Ah ! fit M. Badoir en regardant Rocambole avec un vif sentiment d’appréhension.
— Je puis vous apprendre d’abord qu’elle n’est pas morte, comme vous deviez l’espérer.
— Ah ! monsieur.
— Seulement, elle a été longtemps perdue, comme cela devait être, car vous aviez bien pris vos mesures pour qu’elle ne pût jamais s’informer de sa mère, ni de ses amis, ni du pays d’où on l’avait arrachée.
— Enfin ? demanda M. Badoir d’une voix inquiète.
Rocambole se tourna vers la petite muette qui, comprenant qu’on parlait d’elle, fixait sur lui des regards pleins d’émotion et de curiosité.
— Nizza, lui dit-il, approche-toi de monsieur et regarde-le en face.
L’enfant obéit.
— Maintenant, ouvre ta bouche et montre-la-lui.
Nizza fit encore ce que lui commandait Rocambole. Alors, à la vue du tronçon de langue qui s’arrêtait au milieu de la bouche, M. Badoir devint affreusement pâle et cacha son visage dans ses deux mains, mais en laissant échapper un cri étouffé.
XIII
LE PÈRE DE NIZZA
Effrayée de la pâleur et de l’agitation de M. Badoir, Nizza était accourue près de Rocambole.
Celui-ci allait adresser la parole au banquier, quand la porte s’ouvrit.
La Bretonne parut sur le seuil et annonça :
— M. Pierre Valcresson !
À ce nom, M. Badoir se leva tout à coup, et on eut dit qu’une nouvelle pâleur tombait comme un suaire sur ses traits déjà livides.
Immobile, l’œil fixe et le front contracté, il était comme foudroyé.
Mais cet état dura quelques secondes seulement.
Revenant brusquement à lui, il courut à Rocambole et lui jeta rapidement ces mots :
— Partez, je vous en prie ; revenez plus tard, et…
Pierre Valcresson entrait.
Rocambole ne bougea pas.
Pierre Valcresson était un homme d’une cinquantaine d’années, de haute taille, large des épaules, maigre et nerveux, dont les traits bronzés, anguleux et énergiques, étaient empreints d’une profonde tristesse.
— Ah ! mon cher ami, s’écria-t-il en faisant un mouvement pour se jeter dans les bras de M. Badoir.
M. Badoir voulut s’élancer au-devant de lui.
Rocambole se leva et se dressa entre eux.
— Monsieur, dit-il en s’adressant à Pierre Valcresson, il y a quinze années environ que vous avez quitté M. Badoir, n’est-ce pas ?
— À peu près, répondit M. Valcresson en fronçant légèrement le sourcil, mais que vous importe ?
— En quinze années, monsieur, poursuivit gravement Rocambole, il s’opère d’étranges changements dans les hommes et dans les choses, rappelez-vous cela et, avant de vous jeter dans les bras de cet ancien ami, sachez d’abord ce qu’il est devenu depuis le jour où vous vous êtes quittés.
M. Valcresson regarda avec surprise celui qui lui tenait cet étrange langage, puis, se tournant vers M. Badoir :
— Ah çà , lui dit-il, quel est cet homme et que signifient ces paroles ?
— Écoutez d’abord l’avertissement que je vous donne, reprit Rocambole, et tout à l’heure vous pourrez embrasser votre vieil ami si vous y tenez encore.
Pierre Valcresson examina le banquier et, remarquant enfin son attitude embarrassée :
— Ah çà , mon cher ami, lui dit-il, qu’avez-vous donc ? Me donnerez-vous enfin le mot de cette énigme ?
— Je vous expliquerai cela quand nous serons seuls, répondit le banquier en essayant de prendre un air dégagé.
— Je comprends parfaitement, répliqua Rocambole, c’est un congé, mais je ne l’accepte pas, monsieur Badoir, et je ne vous laisserai pas seul avec M. Valcresson.
— Cependant, monsieur, dit M. Valcresson dont le regard étincela tout à coup, s’il ne convient pas à mon ami…
— Il lui convient que je reste, riposta froidement Rocambole, je resterai.
M. Badoir ne répliqua pas.
Pierre Valcresson était frappé de stupeur.
Rocambole reprit sa place en disant à M. Valcresson :
— Je vous engage à faire comme moi, monsieur, car nous avons à causer.
— Monsieur, dit le banquier d’une voix basse et suppliante, en se rapprochant de Rocambole, je vous en prie…
— De quoi me priez-vous ? demanda Rocambole en élevant la voix avec intention, parlez.
Et, comme M. Badoir ne répondait pas, il ajouta en s’adressant à M. Valcresson :
— Voulez-vous que je vous dise, monsieur, quelles sont les deux personnes dont vous alliez parler tout d’abord à M. Badoir ? Louise Prévôt et la petite Jeanne, sa fille… et la vôtre.
— C’est vrai, répondit Pierre Valcresson, stupéfait, mais qui donc vous a confié le secret le plus intime de ma vie ?
— Un hasard tout à fait providentiel, monsieur, et dont nous parlerons plus tard. Ce que je puis vous dire, quant à présent, c’est qu’il est heureux que vous m’ayez trouvé ici, car vous auriez vainement interrogé M. Badoir sur les deux êtres qui vous intéressent par-dessus tout en ce monde, il n’eût pu vous répondre, et moi, je le puis.
Il ajouta :
— Que vous a écrit M. Badoir, au sujet de la mère et de l’enfant ?
— Que mon enfant avait été enlevée et que la mère, frappée d’un subit accès de folie, avait disparu.
— C’est tout ?
— Absolument tout.
— Eh bien, monsieur, je vais compléter ces renseignements.
— Monsieur, je vous en supplie, balbutia M. Badoir, en tournant vers Rocambole son visage bouleversé, et avec l’expression d’une poignante angoisse, laissez-moi seul avec mon ami Valcresson.
— Pas avant de lui avoir appris ce qu’il a intérêt à savoir, répondit Rocambole sans détourner la tête.
Le banquier n’osa insister.
— Oh ! je sais que je vous inflige une effroyable torture, ajouta Rocambole, mais interrogez votre conscience, et elle vous dira si vous l’avez méritée.
Et, s’adressant de nouveau à Pierre Valcresson qui, promenant de l’un à l’autre un regard ahuri, cherchait vainement à comprendre ce qui se passait sous ses yeux :
— Voici, dit-il, l’histoire de votre enfant et de celle que vous considériez comme votre femme, que vous appeliez près de vous en Amérique, pour lui donner votre nom. Louise Prévôt habitait à Fontenay-aux-Roses une fraîche et charmante villa, où elle était aussi heureuse que le permettait sa position, et il était impossible d’imaginer un plus gracieux tableau que celui qu’offraient cette jeune mère et son enfant quand elles se promenaient toutes deux dans cette retraite toute en fleurs. Il y a dix ans de cela, la petite Jeanne en avait quatre alors, et elle passait pour une petite merveille de grâce et de beauté.
Tout en écoutant parler Rocambole, M. Valcresson regardait Nizza avec un mélange d’attendrissement et de curiosité.
— Dix ans ! murmura-t-il.
Il ajouta en désignant la petite muette :
— Quel âge a cette enfant ?
— Quatorze ans, monsieur.

![]()
Un profond soupir s’échappa de la poitrine de Pierre Valcresson.
— Si vous vouiez me permettre d’interpréter ce soupir, reprit Rocambole, il signifie : C’est l’âge qu’aurait ma petite Jeanne.
— Vous avez deviné juste, monsieur.
— Nizza, va t’asseoir près de monsieur, dit Rocambole à l’enfant.
Celle-ci s’approcha aussitôt de Pierre Valcresson, qui l’enleva de terre, l’assit sur son genou, et, contemplant avec ravissement sa charmante tête, à laquelle son infirmité même donnait une expression pleine d’originalité, de finesse et de pénétration :
— Voulez-vous rester un instant avec moi, mon enfant ? lui demanda-t-il.
Nizza, qui n’était pas banale dans ses affections et qui ne prenait jamais une détermination à la légère, le regarda fixement, comme pour se rendre compte, avant de se prononcer, du personnage auquel elle avait affaire, puis elle répondit par un signe de tête et un sourire.
Elle consentait à rester.
— Qu’a-t-elle donc ? demanda M. Valcresson, surpris de cette singulière réponse.
— Elle est muette, monsieur, dit Rocambole.
— De naissance ?
— Non, monsieur, car alors elle n’entendrait pas.
— Par suite d’un accident alors ?
— Oui, monsieur.
— Et comment ce malheur lui est-il arrivé ?
— Je vous le dirai… plus tard.
— Et il y a longtemps de cela ?
— Dix ans.
— Pauvre enfant ! murmura Pierre Valcresson en la pressant doucement contre sa poitrine.
Pendant ce dialogue, les impressions les plus cruelles et les plus diverses se succédaient dans l’âme de M. Badoir et bouleversaient affreusement ses traits livides.
Rocambole reprit :
— Hélas ! le bonheur de la pauvre jeune femme touchait à sa fin, une épouvantable catastrophe allait fondre sur elle et sur son enfant. Un soir que la chère petite avait été couchée comme de coutume dans son berceau bleu et blanc, les deux couleurs auxquelles elle avait été vouée par sa mère, deux hommes, qui tout le jour les avaient suivies du regard dans le jardin tout en fleurs et que n’avait pu attendrir le touchant spectacle de leur mutuelle affection, s’approchèrent de la maison, et, à l’aide d’une échelle, l’un deux pénétra dans la chambre où reposait l’enfant pendant que sa mère travaillait au rez-de-chaussée. Elle dormait ! il l’emporta dans ses bras et un quart d’heure après, lui et son atroce compagnon étaient déjà loin.
— C’était mon enfant, s’écria Pierre Valcresson, d’une voix profondément altérée, cette chère petite Jeanne que je n’avais pas vue, mais à laquelle je songeais sans cesse, que je suivais de loin, dont je m’étais fait la plus charmante image, que j’adorais et pour laquelle je faisais les plus beaux rêves, c’était elle qu’ils emportaient ainsi ! Oh ! mais c’est affreux ! c’est affreux ! mais, grand Dieu ! que voulaient-ils donc faire de la pauvre enfant ?
— C’est ce que je vais vous dire, répondit gravement Rocambole, et c’est pour ce moment-là qu’il faut réserver vos larmes, car, lorsque vous saurez la vérité, vous n’en aurez jamais assez pour pleurer sur votre enfant.
Un léger tremblement s’empara de M. Valcresson à ces paroles.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! balbutia-t-il en fixant sur Rocambole des yeux hagards, qu’ont-ils donc fait à ma pauvre petite Jeanne ?
— C’est si horrible que j’ose à peine vous l’apprendre.
Pierre Valcresson se mit à trembler si fort que Nizza, violemment agitée sur le genou où elle était assise, le regarda avec effroi.
— Et moi, monsieur, murmura-t-il d’une voix défaillante, j’ai peur de vous interroger.
Il y eut un moment de silence pendant lequel M. Badoir, atterré, haletant, défiguré par l’angoisse qui le dévorait, semblait à chaque instant sur le point de défaillir.
Après une longue hésitation, M. Valcresson reprit enfin :
— Mais ils l’ont donc torturée, ma pauvre petite Jeanne ?
— Oui, monsieur, torturée, répondit Rocambole presque à voix basse.
— Ah ! ma pauvre enfant ! ma pauvre enfant ! s’écria le malheureux père en éclatant en sanglots.
Et il pleura longtemps en répétant sans cesse :
— Torturée ! ma petite Jeanne ! ma pauvre petite Jeanne ! Oh ! c’est horrible ! c’est horrible !
Nizza le regardait pleurer avec l’expression d’une profonde compassion.
N’y tenant plus enfin, elle se pencha vers lui et passa doucement la main sur sa joue, en lui faisant signe d’essuyer ses larmes.
— Pauvre petite, murmura M. Valcresson en l’embrassant, ma petite Jeanne aurait son âge !
Il reprit bientôt, avec un effort visible :
— Enfin, monsieur, que lui ont-ils fait ? Je veux tout savoir.
— Eh bien, monsieur, ils l’ont emmenée dans un repaire de bandits, et là une femme, une atroce créature, ivre d’absinthe, il est vrai, irritée de l’entendre jeter des cris qui pouvaient la dénoncer à la police, l’entraîna dans un coin, des ciseaux à la main, lui ouvrit la bouche de force… et, un instant après, la pauvre enfant était privée pour toujours de l’usage de la parole.
— Elle lui avait coupé la langue ? demanda M. Valcresson en fixant sur Rocambole un regard effaré.
— Oui.
L’infortuné jeta un cri déchirant.
Il resta quelques instants immobile, la tête dans les deux mains.
Quand il la releva, il était presque méconnaissable.
L’excès du désespoir l’avait défiguré en quelques minutes.
— Achevez, dit-il à Rocambole d’un air égaré, d’ailleurs je devine le reste, maintenant elle est morte, n’est-ce pas ?
Rocambole se leva et, désignant du doigt la petite muette :
— Maintenant, dit-il… elle est sur les genoux de son père.
XIV
DÉMASQUÉ
Pierre Valcresson semblait pétrifié.
Il passait tout à coup, sans transition, d’un désespoir mortel à une joie immodérée, du fond de l’enfer au septième ciel.
C’était trop, et sa raison en parut un moment ébranlée.
Il roulait autour de lui des regards hallucinés et semblait se demander où il était et quelles étaient les gens qui se trouvaient là .
Quelqu’un tressaillit de joie à la pensée de voir se produire un subit accès de folie.
C’était M. Badoir, qui, par cette péripétie imprévue, se voyait tout à coup délivré des transes terribles sous lesquelles il se sentait défaillir depuis quelques instants.
Mais cet espoir féroce fut bientôt déçu.
Le vertige qui venait de s’emparer de M. Valcresson se dissipa aussi brusquement qu’il était venu.
Son regard s’attacha sur la petite muette, et le voile qui obscurcissait sa raison tomba aussitôt.
— Mon enfant ! ma chère petite Jeanne ! c’est elle, elle ! murmura-t-il d’une voix que l’émotion faisait trembler.
Et la saisissant dans ses bras, il la couvrit de baisers.
Nizza se dégagea doucement de ses embrassements, et tournant vers Rocambole un regard inquiet et interrogateur, sembla lui demander ce que tout cela signifiait.
— Oui, mon enfant, lui dit celui-ci, monsieur est ton père, il revient de bien loin et maintenant il ne te quittera plus.
Pierre Valcresson la contemplait avec un attendrissement mêlé d’admiration et il répétait tout bas :
— Mon enfant ! ma petite Jeanne ! c’est elle !… oh ! mais tant de bonheur est-il possible ? n’est-ce pas un rêve ?
Et s’adressant à Rocambole :
— Vous êtes bien sûr que c’est elle, monsieur !
— Il y a malheureusement un signe qui empêche toute méprise et ne permet pas de la confondre avec une autre, c’est son infirmité et surtout la mutilation qui l’a déterminée.
— Oh ! pauvre enfant, comme ils t’ont torturée ! murmura M. Valcresson, dont les yeux se voilèrent de larmes à la pensée de l’horrible supplice qu’avait enduré sa chère petite Jeanne.
Puis il s’écria en se frappant le front avec désespoir :
— Mais pourquoi, dans quel but ces misérables ont-ils enlevé cette enfant à sa mère ? Car enfin on ne commet pas de pareils crimes sans y être poussé par un mobile quelconque.
— Aussi le principal auteur de cet exécrable forfait en avait-il un.
— Lequel ?
— La cupidité.
— Je ne comprends pas.
— C’est pourtant bien simple : vous passez pour posséder une fortune de quinze millions, est-ce vrai ?
— C’est vrai.
— Or, supposez un héritier comptant toucher pour sa part deux ou trois millions et apprenant tout à coup que vous avez un enfant, dont vous comptez épouser la mère, son premier mouvement sera de souhaiter la mort de la mère et de l’enfant ; mais si c’est un héritier honnête, il se bornera au souhait, sinon il enlèvera l’enfant, convaincu que la mère en mourra ou en deviendra folle, ce qui ne manque pas, et par cette habile combinaison, il supprime, sans se rendre coupable de meurtre, les deux obstacles qui menaçaient sa fortune.
— Un héritier, dites-vous ! mais alors le misérable qui a commis ces crimes horribles serait donc de ma famille ?
— Naturellement.
— Un parent ! s’écria Pierre Valcresson dont les traits s’animèrent tout à coup d’un sentiment de haine et d’une soif de vengeance qui le rendaient effrayant, c’est à un parent que je devrais de retrouver mon enfant affreusement mutilée et ma chère Louise disparue, folle, perdue pour toujours, morte de faim ou de douleur peut-être, et tout cela pour de l’argent !… Ah ! c’est horrible, c’est monstrueux !
Puis, s’élançant vers Rocambole et lui saisissant énergiquement la main, tout tremblant de rage et l’œil flamboyant :
— Son nom, monsieur, son nom ? je vous en supplie !
Il y eut un moment de silence.
Alors Pierre Valcresson entendit ce mot prononcé derrière lui à voix basse :
— Grâce !
Il se retourna brusquement et resta frappé de stupeur à l’aspect de M. Badoir à genoux et la tête cachée dans ses deux mains.
— Que fait-il là ? Qu’est-ce que cela signifie ? murmura-t-il.
— Vous ne comprenez pas ? lui dit Rocambole.
— Non, je ne sais pourquoi…
— Eh bien ! celui dont vous me demandez le nom…
Pierre Valcresson recula d’un pas, et jetant sur Rocambole un regard effaré :
— Quoi ! balbutia-t-il, ce serait ?…
— C’est lui.
— Ah !
Cette exclamation s’échappa comme un râle de sa poitrine oppressée.
Puis, le sang lui monta brusquement au visage, ses yeux démesurément dilatés dardèrent un regard terrible sur le coupable agenouillé à ses pieds et il s’écria avec un inexprimable sentiment de haine, d’horreur et de dégoût :
— Lui ! lui qui se disait mon meilleur ami ! lui à qui j’avais confié ma Louise et mon enfant, et qui m’avait juré de veiller sur elles. Oh ! l’infâme ! l’infâme !
Il promena autour de lui un rapide regard, comme s’il cherchait quelque chose, puis il s’écria d’une voix rauque, altérée par la colère :
— Oh ! je n’ai pas besoin d’arme, je veux l’étrangler de mes mains.
Et il fit un mouvement pour s’élancer sur lui et le saisir au cou.

Rocambole l’arrêta :
— Laissez-moi, laissez-moi ! s’écria-t-il d’une voix tonnante et en se débattant comme un fou furieux entre les mains de Rocambole, qui lui avait saisi les deux poignets et les tenait comme dans un étau.
Et il bondissait et faisait des efforts inouïs pour s’arracher à cette puissante étreinte.
Mais ses poignets semblaient rivés aux mains de Rocambole, qui ne bronchait pas plus que s’il eût été de bronze.
— Je vous demande deux minutes d’attention, lui dit-il enfin, et, si, après m’avoir entendu vous n’êtes pas convaincu qu’il est de votre intérêt de le laisser vivre, alors je vous laisse libre d’en faire ce qu’il vous plaira.
— Soit, dit M. Valcresson en faisant un effort pour se calmer, je consens à vous écouter, mais je doute… Enfin, parlez.
— Si vous le tuez, on vous arrête, on vous juge, et, en supposant l’admission des circonstances les plus atténuantes, en admettant toute l’indulgence imaginable de la part du tribunal, on vous condamne au moins à cinq ans de prison.
— Eh ! que m’importe ? s’écria Pierre Valcresson hors de lui.
— La joie de la vengeance assouvie vous consolera de la perte de votre liberté, soit ; je comprends cela ; mais Louise Prévôt, qui donc se mettra à sa recherche ? Qui donc, si ce n’est vous, trouvera dans son cœur assez d’amour, d’énergie, de persévérance et de dévouement pour la retrouver, fallût-il fouiller tout Paris et même la France entière ? L’infortunée sera donc à jamais perdue, à jamais privée des soins qui pourraient la ramener à la raison, à la vie, au bonheur, parce que vous aurez préféré à tout la joie amère de la vengeance.
Au nom de Louise Prévôt l’exaltation furieuse de Pierre Valcresson était tombée tout à coup pour faire place à un profond abattement.
— Pauvre Louise ! murmura-t-il, qui s’occuperait d’elle en effet si je n’étais plus là ? et ma chère petite Jeanne elle-même…
— Oh ! dit vivement Rocambole, Jeanne, que nous appelons Nizza, n’ayant connu que très-tard son véritable nom, Jeanne a trouvé chez moi une famille qui l’a adoptée de cœur, qui l’aime à l’idolâtrie et ne vous la rendra qu’à regret.
— Merci ! oh ! merci, monsieur, dit M. Valcresson en pressant avec attendrissement la main de Rocambole.
Il ajouta, en jetant un regard sur la petite muette :
— Mais depuis quand est-elle avec vous ?
— Depuis trois mois à peine.
— Trois mois !… et qu’est-elle donc devenue pendant les dix années qui ont suivi son enlèvement.
— Oh ! monsieur, c’est affreux à dire.
— Dites toujours, monsieur, la voilà , elle est près de moi maintenant, je puis tout entendre.
Cependant c’est avec une vive expression d’angoisse qu’il attendit la réponse de Rocambole.
— Immédiatement après lui avoir fait subir cette effroyable mutilation, elle a été livrée à un saltimbanque qui s’éloignait de Paris le lendemain même, et à partir de ce jour elle a fait des tours de souplesse, joué son rôle dans les parades et dansé sur la corde roide.
Pierre Valcresson jeta un cri de colère, et, se tournant brusquement vers M. Badoir, toujours agenouillé et la tête cachée dans ses mains :
— Misérable ! s’écria-t-il, tout prêt de céder à un nouvel accès de rage.
— Souvenez-vous de Louise Prévôt, lui dit Rocambole en lui posant la main sur l’épaule.
Il ajouta, en désignant M. Badoir :
— Quant à cet homme, il peut nous être utile et il faut que nous en tirions parti.
— Quel service peut-il nous rendre ?
— D’abord c’est grâce à lui que Louise Prévôt est perdue, c’est à lui de la retrouver, et je lui donne quinze jours pour cela. Mais ce n’est pas tout, il a un autre crime à réparer, il a ourdi, de complicité avec un misérable de la plus dangereuse espèce, un infâme complot contre Tatiane Valcresson, votre nièce et la sienne, dans le but de contraindre cette jeune fille à épouser un homme, qu’elle déteste et qu’elle méprise ; il faut qu’il nous dévoile toute la mystérieuse machination imaginée par sir Ralph pour…
— Sir Ralph ! interrompit vivement M. Valcresson, cet homme n’est-il pas intimement lié avec un certain Mac-Field ?
— Précisément.
— Ce sont deux assassins, ils ont payé mon domestique pour m’empoisonner.
— Eh bien, monsieur Valcresson, voici leur complice, car M. Badoir est le chef de la maison Badoir et Compagnie, nouvellement fondée, et les deux associés qui se cachent sous ce titre : « et Compagnie, » sont tout simplement sir Ralph et Mac-Field.
XV
LA VILLA DE FONTENAY-AUX-ROSES
Pierre Valcresson fut quelques instants sans pouvoir proférer une parole.
Il considérait M. Badoir avec cette curiosité mêlée d’horreur qu’inspire la vue de quelque monstrueux reptile.
— Ainsi, s’écria-t-il enfin, cet homme dont les vertus m’imposaient le respect et la confiance la plus aveugle, cet homme que je considérais comme un ami dévoué, voilà ce qu’il a fait ! Il a livré mon enfant à des bourreaux qui l’ont mutilée, il a poussé à la folie, à la mort peut-être, celle que j’aimais d’un amour sans bornes, dont je voulais faire ma femme et que j’avais confiée à sa garde ; il a voulu jeter sa nièce dans les bras de son complice, qu’il savait déjà coupable d’un double assassinat commis à New-York ; et enfin, pour compléter son œuvre, à laquelle il fallait ce couronnement pour qu’il pût recueillir le fruit de tous ses crimes, il s’est entendu avec deux misérables de son espèce pour me faire empoisonner par mon domestique ! Allons, il faut en convenir, maître Badoir, voilà une vie bien remplie, qu’en dites-vous ?
— Je dis, répondit humblement le banquier, en se redressant enfin, que je suis digne de votre haine et de votre mépris, que j’ai commis des forfaits qui ne méritent ni pardon, ni pitié, mais en avouant les crimes dont je me suis rendu coupable envers Louise Prévôt, son enfant et Tatiane, je jure que je ne suis rien dans le complot ourdi contre vous.
— Et sur quoi me jurez-vous cela ? lui dit Pierre Valcresson avec une méprisante ironie, serait-ce sur votre honneur ?
— Accablez-moi, je n’ai pas le droit de m’offenser, répliqua M. Badoir d’un ton résigné, refusez de croire à ma parole, c’est le juste châtiment de mes fautes, et mon rôle désormais est de courber la tête sous l’outrage, mais j’ai dit la vérité, je le répète.
— Comment veux-tu qu’on te croie, misérable, et à quoi t’eût servi de te débarrasser de ceux qui te privaient de ta part d’héritage si tu eusses laissé vivre celui dont tu devais hériter ?
— Toutes les apparences sont contre moi, je le sais et je me tais.
— Relève-toi et attends que nous ayons pris un parti à ton égard, lui dit M. Valcresson.
M. Badoir se leva, reprit sa place dans son fauteuil et attendit, le regard fixé à terre.
— Monsieur Badoir, lui dit alors Rocambole, je me suis engagé à sauver mademoiselle Tatiane de la honte d’appartenir à votre infâme complice, sir Ralph ; pour cela, il faut que je prouve l’innocence de cette jeune fille en dévoilant le moyen dont s’est servi celui-ci pour la décider à l’accompagner, seule et à minuit, au bal de la baronne de Villarsay ; ce moyen, il est impossible que vous l’ignoriez, et je vous somme de me le faire connaître.
— Comme vous, monsieur Portal, répondit le banquier, je soupçonne là quelque profonde machination, mais je vous jure que sir Ralph a refusé de me confier ce secret quand je le lui ai demandé, et qu’il m’a toujours affirmé que Tatiane avait consenti librement à se rendre avec lui à cette fête, ne pouvant ignorer qu’elle s’engageait par là à devenir sa femme.
— Il a menti, je le sais, cela m’a été dit par la femme de chambre de mademoiselle Tatiane qui malheureusement, s’est bornée à me jurer que sa maîtresse était innocente, sans vouloir me révéler le secret de sir Ralph, et celui-ci, l’ayant forcée dès le lendemain à quitter la maison de M. Mauvillars, il me fallut renoncer à l’espoir que j’avais un moment conçu d’apprendre la vérité par la bouche de cette jeune fille. Mais, je le répète, il est impossible que sir Ralph, pour lequel vous avez demandé la main de votre nièce, sachant à quel homme vous alliez confier sa destinée, vous ait fait mystère du complot qu’il a imaginé pour perdre cette jeune fille et la contraindre à l’accepter pour époux.
— Je ne puis que vous répéter ce que je viens de vous dire ; sir Ralph a refusé de me confier son secret et je ne soupçonne même pas le moyen qu’il a pu employer pour entraîner Tatiane au bal de la baronne de Villarsay.
— C’est possible, dit M. Valcresson, car on ne se confie pas tout entre complices, mais retenez ce que je vais vous dire. J’arrive à Paris avec une déposition de mon domestique devant un magistrat, appuyée d’une correspondance que j’apporte avec moi, et d’où il ressort que sir Ralph et Mac-Field ont formé avec celui-ci un complot dans le but de m’empoisonner ; eh bien, si dans huit jours vous n’êtes pas en mesure de nous donner sur cette mystérieuse affaire tous les détails nécessaires pour prouver hautement l’innocence de Tatiane et de dévoiler le moyen employé par ce misérable pour la perdre, je vous fais arrêter avec eux comme complice de cette tentative d’empoisonnement.
— Mais, s’écria M. Badoir, comment voulez-vous que je contraigne sir Ralph…
— Oh ! peu m’importe ! dit Pierre Valcresson, les difficultés, les obstacles, ça, c’est votre affaire, cela ne me regarde pas, je vous dis ce que je veux, et vous savez ce que je vous promets en cas d’insuccès, basez-vous là -dessus et sachez d’avance que je n’aurai aucune pitié de vous.
— Ce n’est pas tout, ajouta Rocambole, rappelez-vous que vous avez quinze jours pour retrouver Louise Prévôt.
— Quinze jours ! dit M. Badoir avec un accent désespéré, mais songez donc qu’elle est perdue depuis dix ans ; comment voulez-vous ?…
— Vous avez fait le mal, c’est à vous de le réparer.
Pendant toute cette scène, Pierre Valcresson n’avait cessé d’être en proie à une violente agitation.
— Monsieur, dit-il à Rocambole, nous n’avons plus rien à faire ici, sortons, sortons vite, car lorsque je vois ma pauvre petite Jeanne face à face avec son bourreau, en même temps le bourreau de sa mère, j’éprouve d’irrésistibles tentations de m’élancer sur cet homme et de l’étrangler comme un chien.
— Alors, vous avez raison, monsieur, partons vite.
— Ah ! monsieur, ajouta M. Valcresson en pressant dans ses mains tremblantes la main de Rocambole, combien je bénis le ciel de vous avoir rencontré ici ! Sans ce hasard providentiel, non-seulement je n’eusse pas retrouvé ma pauvre enfant, mais j’aurais pressé cet homme dans mes bras comme le meilleur des amis, j’aurais continué de mettre en lui toute ma confiance, et lui, l’infâme, il ne se fût pas lassé de me tromper. Ah ! je vous le répète, monsieur, c’est la Providence qui vous a envoyé ici en même temps que moi.
Puis, se retournant vers M. Badoir, affaissé sur son fauteuil, dans un état de complète prostration :
— Un dernier avertissement, monsieur, lui dit-il, gardez-vous de prévenir vos complices, sir Ralph et Mac-Field, de mon arrivée à Paris, ils me croient mort des suites du poison qui devait m’être administré par leur ordre, au jour et à l’heure désignés par eux dans une lettre jointe à leur dossier, laissez-les dans une croyance qui, en les tenant dans une entière sécurité, va nous les livrer pieds et poings liés, et sachez bien, que dans le cas où ils viendraient à prendre la fuite, c’est à votre indiscrétion que je l’attribuerais et c’est vous que j’en rendrais responsable.
— Je vous jure de garder le secret, répondit M. Badoir.
— Partons, dit Rocambole.
Et, s’adressant à la petite muette, qui avait assisté à toute cette scène avec un étonnement mêlé d’inquiétude :
— Nizza, lui dit-il, donne la main à ton père.
Nizza fit ce qu’il lui commandait et ils sortirent tous trois.
Quand ils furent dehors, Valcresson dit à Rocambole :
— Monsieur, dites-moi, je vous prie, le nom de celui à qui je dois plus que la vie.
— M. Portal, rue Amelot ; au reste, je vous emmène chez moi, je veux vous présenter à Vanda, celle qui a servi de mère à votre enfant depuis qu’elle est parmi nous.
— Je serai heureux, bien heureux de la voir et de la remercier, monsieur, répondit M. Valcresson ; mais, depuis longtemps, j’ai au cœur un désir, un rêve qui est devenu plus impérieux que jamais depuis quelques instants, et vous allez comprendre, ce rêve, c’est de revoir la jolie villa où ma chère Louise et ma petite Jeanne ont vécu si longtemps heureuses.
— Je comprends votre hâte de voir cette demeure, monsieur, répondit Rocambole, et je suis à votre disposition si vous voulez vous y rendre de suite.
— Ce sera pour moi un immense bonheur, monsieur, c’est vous dire que je ne voudrais pas retarder d’un instant…
— À vos ordres, monsieur, j’ai justement une voiture, veuillez y prendre place.
Il fit monter M. Valcresson et Nizza, ravie de se retrouver en voiture, et il dit au cocher :
— À Fontenay-aux-Roses.
Le cocher continua la rue Cassette, au bout de laquelle il tourna la rue de Vaugirard à droite.
Au bout d’une heure la voiture s’arrêtait à l’entrée du village de Fontenay-aux-Roses.
— Attendez-nous là , dit Rocambole en désignant une auberge au cocher, nous allons faire une promenade dans le pays et nous revenons dans une heure.
Puis il sauta à terre, ainsi que M. Valcresson, qui reçut ensuite Nizza dans ses bras.
— Vous savez où est située la maison ? demanda celui-ci à Rocambole.
— Oui, car moi aussi j’ai été curieux de connaître la villa où avait grandi la petite Jeanne ; et puis j’avais un vague espoir de retrouver là quelque indice qui me mît sur la trace de Louise Prévôt.
— Et qu’avez-vous découvert ? demanda vivement Pierre Valcresson.
— Rien, et en effet, en y réfléchissant, je compris tout de suite que je m’étais bercé d’un espoir insensé ; songez que dix années s’étaient écoulées.
— Vous avez raison, c’était impossible.
Au bout de dix minutes, on arrivait enfin à la villa.
— La voici, dit Rocambole.
Le jardin était parfaitement entretenu, mais, comme on n’était encore qu’à la fin de mars, on n’y voyait que quelques fleurs printanières, des violettes, des primevères et des grappes de boutons aux lilas.
— La villa est habitée, dit M. Valcresson.
— L’état du jardin l’annonce, répondit Rocambole.
— J’en suis fâché, mon intention était de l’acheter.
— Vous pouvez vous en passer la fantaisie, monsieur, dit une voix derrière eux.
Ils se retournèrent et aperçurent une vieille paysanne arrêtée comme eux devant la villa.
— Que voulez-vous dire, ma brave femme ? lui demanda Rocambole.
— Je veux dire que la maison n’est point louée et que le propriétaire fait entretenir le jardin pour lui donner de la mine.
— Comment se fait-il qu’une aussi jolie demeure reste inhabitée ?
— Ah ! monsieur, y a une raison pour ça, répondit la paysanne en baissant la voix.
— Et quelle est cette raison ?
Cette fois, ce fut tout à fait à voix basse que la bonne femme répondit :
— La maison est hantée, monsieur.
— Bah ! et par qui ?
— Par les esprits, pardi.
— Pas possible !

![]()
— Tout le monde sait ça dans le pays, et dame ! vous comprenez qu’on ne se soucie pas de se faire tirer par les pieds au milieu de la nuit.
— C’est incommode, je comprends cela ; mais dites-moi donc l’adresse du propriétaire.
— C’est au notaire qu’il faut s’adresser, monsieur.
— Et il demeure ?
— Sur la place de l’Église.
— Y allons-nous ? demanda Rocambole à M. Valcresson.
— Certainement.
Ils remercièrent la paysanne de son renseignement et se rendirent chez le notaire.
XVI
LES SOUVENIRS DE NIZZA
Quelques instants après, Rocambole et M. Valcresson étaient chez le notaire, et au bout de deux heures de débats ou plutôt d’explications données par celui-ci, concernant les charges et les servitudes attachées à la propriété, l’affaire était conclue, la villa appartenait à Pierre Valcresson, qui n’avait pas besoin de la visiter pour savoir si elle lui convenait, puisque c’est à titre de souvenir qu’il voulait la posséder.
Quand tout fut terminé, Rocambole dit en souriant au notaire :
— Ah çà , monsieur Dufour, il est une servitude dont vous avez omis de nous parler.
— Laquelle ? demanda le notaire étonné.
— Il paraît que la maison est hantée par un hôte mystérieux qui a la mauvaise habitude de venir tirer les gens par les pieds pendant la nuit ; voilà ce que j’appelle une servitude désagréable.
Le notaire sourit à son tour.
— Oui, dit-il, je sais que les gens du pays ont fait courir ce bruit ridicule, et je l’attribue à la visite de quelque maraudeur qui, sachant la maison inhabitée, s’y sera introduit et aura été vu entrant ou sortant la nuit.
— C’est un point à éclaircir, reprit Rocambole, car enfin les esprits sont généralement malfaisants, et il est bon de savoir à quoi s’en tenir sur le caractère et sur les habitudes de celui-ci.
— Allons voir la maison, dit Pierre Valcresson, j’ai hâte de la visiter en détail, vous comprenez pourquoi, mon cher monsieur Portal ; peut-être aurons-nous la chance d’y rencontrer l’esprit qui en a déjà pris possession sans bourse délier, et nous lui demanderons alors quelles sont ses intentions pour l’avenir.
— C’est peu probable, répliqua Rocambole, car tout le monde sait que ces hôtes mystérieux ne se montrent que la nuit, quand ils consentent à se montrer.
Puis, s’adressant au notaire :
— Quand M. Valcresson pourra-t-il avoir l’acte de vente ?
— Il ne sera pas prêt avant ce soir, et on pourra l’envoyer demain à la première heure.
— Qui nous empêche de faire une promenade dans les environs, qui sont charmants ? dit Rocambole à M. Valcresson, nous reviendrions ce soir et nous emporterions cet acte aujourd’hui même.
— Très-volontiers, mais peut-être s’inquiétera-t-on chez vous d’une si longue absence ?
— Nullement, cela m’arrive assez fréquemment, et Vanda sait qu’elle n’a rien à redouter pour moi.
— Alors c’est entendu, restons jusqu’à ce soir.
— Nous attendrons la nuit pour visiter la villa et nous aurons quelque chance de rencontrer notre esprit.
— Oh ! je veux la voir tout de suite, ce qui ne nous empêchera pas d’y faire plus tard une seconde visite. Veuillez donc nous remettre les clefs, monsieur.
— Mon domestique va vous accompagner, dit le notaire.
— Non, répondit vivement Pierre Valcresson, je veux y aller seul avec M. Portal.
Le notaire lui remit les clefs et il sortit avec Rocambole et la petite muette.
Un quart d’heure après ils franchissaient la porte de la villa.
À la suite de cette porte s’étendait une allée de tilleuls qui conduisait au jardin.
— Commençons par le jardin, dit M. Valcresson.
Il paraissait vivement ému.
Rocambole comprit la cause de cette subite émotion et il resta un peu en arrière pour lui permettre de s’y abandonner sans contrainte.
Ils avaient fait cent pas à peine à travers les plates-bandes, plantées de violettes et de primevères, quand Nizza donna tout à coup les signes d’une agitation visible.
Elle embrassa d’abord le jardin d’un coup d’œil.
Puis, arrêtant successivement son regard sur divers points, elle montra tout à coup à Rocambole un banc de bois ombragé par un immense lilas, alors tout chargé de bourgeons et de grappes de boutons qui commençaient à se colorer de rouge.
— Qu’est-ce que c’est que cela, mon enfant ? Que veux-tu dire ? lui demanda-t-il.
Le teint de Nizza s’anima tout à coup, elle représenta par une pantomime expressive une jeune personne, élégante et belle, se promenant dans le jardin, puis une enfant toute petite, jouant et sautant sur ce banc, et elle fit comprendre que cette enfant c’était elle.
Pierre Valcresson s’était arrêté et suivait tous ses gestes avec une curiosité émue.
— On dirait qu’elle reconnaît ce jardin, dit-il à Rocambole.
— Parfaitement, répondit celui-ci, elle me dit qu’elle s’y est promenée et qu’elle y a joué avec une belle et élégante jeune femme.
Puis s’adressant à Nizza :
— Tu te la rappelles, cette belle dame, lui demanda-t-il.
L’enfant répondit par deux ou trois signes de tête affirmatifs.
— Tu l’aimais bien ? reprit Rocambole.
Nizza porta vivement la main à son cœur.
— Comment t’appelait-elle ?
Le front de l’enfant se contracta légèrement.
Elle faisait un effort pour rappeler ses souvenirs.
— Jeanne peut-être ? lui dit Rocambole.
Son œil étincela tout à coup, elle ouvrit la bouche comme pour jeter un cri, puis avec une agitation toujours croissante, elle fit plusieurs signes de tête pour affirmer que c’était bien cela.
— Oui, oui, elle reconnaît tout et elle se rappelle sa mère, murmura M. Valcresson.
On se remit à parcourir le jardin.
Nizza avait pris les devants et elle marchait rapidement, montrant sur son chemin les arbustes, les plates-bandes, les grands arbres, le jet d’eau qui sans doute lui rappelaient l’un après l’autre quelque souvenir de son enfance.
Tout à coup elle s’arrêta devant une tonnelle donnant sur le chemin qui longeait la villa.
Rocambole la reconnut, c’était celle dont lui avait parlé François, et où s’était passée, entre la mère et l’enfant, une scène qui avait profondément ému le cocher.
Après un instant d’immobilité, Nizza entra d’un pas grave sous la tonnelle, s’approcha du banc, s’agenouilla, joignit ses mains, leva ses beaux yeux sur un être imaginaire, qu’elle se figurait assis sur ce banc, et remua les lèvres comme si elle priait.
Puis, se tournant vers les deux hommes qui la contemplaient d’un air attendri, elle leur montra le banc et leur fit, comme tout à l’heure, le portrait de la jeune et belle dame qui se promenait avec elle dans le jardin.
Son teint était plus animé que jamais et des larmes ruisselaient sur ses joues.
— Elle pleure, la pauvre enfant, s’écria Valcresson, dont les yeux s’humectèrent aussi à cette vue ; qu’a-t-elle donc, que veut-elle dire ?
— C’est que ce banc et cette tonnelle lui rappellent un charmant souvenir, répondit Rocambole ; le jour même où ils guettaient l’occasion propice pour l’enlever à sa mère, M. Badoir et son complice l’ont vue agenouillée là devant la jeune femme, qui lui faisait faire sa prière, elle prononçait le nom de son père, qui était bien loin.
— Pauvre enfant ! pauvre Louise ! balbutia Pierre Valcresson, dont les larmes, longtemps contenues, jaillirent tout à coup à ces paroles.
Et, s’élançant vers la petite muette, il l’enleva de terre et la pressa dans ses bras la couvrant de baisers.
Nizza le regarda, parut surprise de voir couler ses larmes, et, se tournant vers Rocambole, lui en demanda la cause par un geste que celui-ci comprit :
— Ma petite Nizza, lui dit-il, te rappelles-tu la prière que tu faisais là , aux genoux de ta mère, car cette belle dame c’était ta mère ?
— Oui, oui, ma mère, fit Nizza dans son langage.
— Cette prière, te la rappelles-tu ?
Elle chercha quelques instants en fronçant le sourcil.
— Non, fit elle enfin, par un signe de tête.
— Est-ce que tu n’y parlais pas de ton père, qui était bien loin ?
Nizza réfléchit encore.
Puis son regard rayonna et elle fit un signe affirmatif.
— Eh bien, ce père qui était bien loin et pour qui tu priais ici, à genoux devant ta mère, le voilà .
Cette fois, l’enfant comprit ce que signifiait ce nom de père, qui, lorsqu’elle l’avait entendu prononcer chez M. Badoir, l’avait laissée indifférente, et, jetant aussitôt ses bras au cou de M. Valcresson, elle lui rendit avec une espèce de fièvre les caresses que celui-ci lui prodiguait.
Après l’avoir longtemps embrassé ainsi, elle releva tout à coup la tête et se tournant vers Rocambole, dont elle se savait comprise, elle lui demanda par signes où était sa mère.
— Ta mère, mon enfant, elle est partie bien loin à son tour, mais elle reviendra bientôt.
— Demain ? demanda-t-elle par un signe, car bientôt n’avait pas de signification pour elle.
— Oui, demain, répondit Rocambole.
Alors un éclair de joie brilla dans ses yeux.
Puis elle fit comprendre qu’elle voulait être mise à terre pour continuer sa promenade.
Tout le jardin était visité.
On pénétra dans la maison et, sur la demande de M. Valcresson, Rocambole le conduisit à la chambre où reposaient la mère et l’enfant.
En entrant dans cette pièce sans meubles, Nizza jeta d’abord de tous côtés des regards indécis.
Elle ne la reconnaissait pas, n’y voyant ni son berceau, ni le lit de sa mère.
Mais, après une longue investigation, son regard s’arrêta sur la petite fenêtre garnie de verres de couleur donnant sur la ruelle du village.
Elle la montra, par un geste plein de vivacité.
Puis, après avoir cherché un instant du regard, elle désigna du doigt l’endroit où était son berceau et le fit comprendre en posant sa tête sur sa main et en fermant les yeux.
— C’est là qu’elles dormaient toutes deux, murmura Pierre Valcresson, c’est là qu’on l’a trouvée endormie et qu’on l’a emportée…
Il ajouta au bout d’un instant.
— L’émotion m’étouffe, sortons, j’ai besoin de marcher dans la campagne, mais nous reviendrons ici ce soir, avant de quitter le pays.
XVII
LA MAISON HANTÉE
En sortant de la villa, Pierre Valcresson dit à Rocambole :
— Qu’allons-nous faire jusqu’à l’heure du dîner ?
— Voulez-vous être agréable à Nizza, ou plutôt à Jeanne, à laquelle il faut enfin restituer son véritable nom ? dit Rocambole.
— Oui, certes, et c’est son goût seul qu’il faut consulter, car la pauvre petite vient de passer deux heures bien ennuyeuses chez le notaire.
— En ce cas, nous allons lui faire faire une longue promenade en voiture à travers la campagne en prenant sa fantaisie pour guide, et nous dînerons là où nous nous trouverons entre cinq et six heures.
Et, se tournant vers la petite muette qui, le regard fixé sur lui, l’écoutait avec une extrême attention :
— Qu’en dis-tu, ma petite Jeanne, cela te convient-il ?
Jeanne répondit par des signes de tête répétés et par un sourire dont l’expression n’était pas équivoque.
On gagna donc l’auberge où était resté le cocher et une demi-heure après la voiture entraînait les trois voyageurs en pleine campagne, à la grande joie de l’enfant qui, indiquant tantôt un point, tantôt un autre, suivant qu’ils charmaient plus ou moins son regard, faisait suivre au cocher le plus capricieux des itinéraires.
La température était douce, et, les glaces ayant été baissées, Jeanne promenait sur la campagne ses grands yeux ravis, tandis que Pierre Valcresson, lui, concentrait toute son attention sur l’enfant, ne pouvant se lasser d’admirer sa charmante tête, éclairée en ce moment par l’espèce d’extase que lui communiquait le spectacle tout nouveau pour elle des champs et des bois se déroulant à l’infini.
Cette promenade se prolongea jusqu’à six heures.
Alors le jour commençant à baisser, Rocambole fit observer à Jeanne que bientôt on ne verrait plus rien, que d’ailleurs il était l’heure de manger et il lui montra une auberge de gracieuse apparence, lui demandant si elle voulait dîner.
L’enfant alors, ayant sans doute consulté son estomac, mis en appétit par le grand air, et trouvant aussi l’auberge à son gré, s’empressa de donner son assentiment et on entra.
C’était à Bagneux, village situé à peu de distance de Fontenay-aux-Roses.
Là encore, Pierre Valcresson voulut que les mets que pouvait fournir l’auberge fussent soumis à la décision de Jeanne, ce qui produisit un dîner des plus fantaisistes.
On remontait en voiture au bout d’une heure, et il était huit heures environ lorsqu’on arrivait chez le notaire de Fontenay.
Quand il eut pris là les actes qui devaient lui être livrés, Pierre Valcresson dit à Rocambole :
— Maintenant, allons rendre encore une visite à la demeure de ma chère Louise, puis nous prendrons le chemin de la rue Amelot, où l’on doit s’étonner d’une si longue absence.
Il ajouta aussitôt :
— Mais il fait nuit, et, quoique la lune soit brillante, il nous faudrait une lumière pour nous diriger dans l’intérieur de la maison.
— Nous trouverons tout ce qu’il nous faut dans la cuisine, répondit Rocambole, j’ai vu un flambeau avec une bougie et des allumettes, déposés là sans doute par le jardinier, qui doit en avoir besoin lorsque son travail se prolonge jusqu’à la nuit.
On trouva tout cela en effet et on se mit à visiter minutieusement chaque pièce de la maison.
À chaque pièce qu’il traversait, Pierre Valcresson reconstituait heure par heure, dans sa pensée, toute la vie des deux êtres qui lui étaient si chers.
Dans la salle à manger, il voyait sa Louise bien-aimée attablée près de son enfant, la servante veillant avec sollicitude à ce que rien ne lui manquât.
Dans le petit salon attenant à cette pièce, il se la représentait travaillant à quelque gracieux ouvrage, à quelque élégante fantaisie destinée à son enfant, tandis que celle-ci, voulant imiter sa mère, habillait et déshabillait sa poupée à laquelle elle ne ménageait ni les gronderies, ni les recommandations qu’elle s’attirait souvent elle-même.
Après avoir visité tout le rez-de-chaussée, il allait monter au premier étage, quand Jeanne, qui pendant ce temps avait fait quelques pas à l’entrée du jardin, arriva tout à coup dans le petit salon et, s’approchant de Rocambole d’un air à la fois mystérieux et effrayé, le prit par la main et l’entraîna doucement vers la porte, en lui faisant signe de marcher avec précaution et de ne pas se montrer au dehors.
Pierre Valcresson les suivit.
Jeanne s’arrêta au seuil de la porte qui donnait sur le jardin, et, se tenant cachée dans l’ombre, elle tendit la main dans une direction, attirant l’attention de Rocambole de ce côté.
Celui-ci jeta un regard vers le point indiqué par l’enfant, puis, se tournant vers M. Valcresson :
— La vieille paysanne ne s’était pas trompée, lui dit-il en souriant.
— Que voulez-vous dire ?
— Ne nous a-t-elle pas prévenus que la maison était hantée ?
— Eh bien ?
— Eh bien, voilà l’hôte surnaturel qui en prend possession à l’heure des ténèbres ; c’est Jeanne qui vient de l’apercevoir.
— Où est-il ?
— Tenez, il se promène ou plutôt elle se promène à travers le jardin d’un pas lent et solennel, comme il convient à une ombre.
M. Valcresson aperçut en effet une forme noire qui suivait lentement les sentiers du jardin.
— À quel sexe appartient cette ombre-là ? dit-il. Est-ce une femme ou un homme enveloppé d’un manteau ?
— C’est ce qu’on ne peut guère distinguer d’ici.
— J’en suis fâché pour elle, mais je vais la prévenir que, cette demeure devant être désormais habitée, les ombres sont priées d’en déloger au plus vite.
— Attendons ; après avoir parcouru le jardin, ce mystérieux personnage va venir par ici et pénétrer dans la maison, où probablement il vient chercher un abri pour la nuit, car je suis toujours convaincu que c’est quelque maraudeur, et alors nous pourrons nous montrer et lui signifier son congé.
— Eh bien, soit, attendons.
Pendant ce dialogue le promeneur nocturne arrivé à la tonnelle y était entré, sans doute pour s’y reposer et y jouir en paix de la douceur de l’atmosphère, embaumée en ce moment par le parfum des violettes, car il y demeura quelque temps.
Il en sortit enfin et s’engagea dans un sentier qui aboutissait à la porte près de laquelle se tenaient Pierre Valcresson, Rocambole et Jeanne.
— Allons, dit tout bas Rocambole, l’heure fatale a sonné, voilà une ombre qui va se trouver sur le pavé et bientôt arrêtée peut-être comme étant en état de vagabondage, à moins qu’elle ne trouve un refuge dans les carrières d’Amérique, où elle rencontrera beaucoup d’ombres de son espèce.
Le mystérieux hôte de la villa n’était plus qu’à quelques pas.
— Tiens, dit Rocambole, c’est une femme.
— En effet, murmura M. Valcresson.
— Je suis curieux de voir ce qu’elle va faire, reprit Rocambole ; laissons-la donc entrer et aller et venir dans la maison avant de nous montrer à elle.
— Soit.
— Et, pour ne pas éveiller sa défiance, éteignons cette lumière.
Il souffla sur la bougie, qui avait été posée à terre, et, prenant par la main Pierre Valcresson et Jeanne, il les entraîna tous deux derrière la porte, où tous trois se tinrent immobiles.
Un instant après, le bruit d’un pas lent et léger se faisait entendre et on voyait entrer la femme aux vêtements noirs.
Elle fit quelques pas dans la cuisine, promena un instant ses regards autour d’elle, puis elle se dirigea vers l’escalier, qu’elle gravit toujours du même pas, lent et régulier.
— Attendons encore, dit Rocambole à voix basse.
Il sentit aussitôt la main de Jeanne presser la sienne avec une énergie qui trahissait l’impression à laquelle elle était en proie.
La pauvre petite, ne comprenant rien à ce qui se passait, était évidemment effrayée de tout ce mystère et se croyait peut-être menacée de quelque danger.
Il se pencha vers elle et lui murmura à l’oreille :
— Ne crains rien, mon enfant, n’es-tu pas avec ton père et ton ami Portal, qui veillent sur toi ?
Il l’embrassa tendrement, et l’enfant, subitement rassurée par ces paroles et par cette caresse, cessa de frissonner et de lui presser fiévreusement la main.
Rocambole et Pierre Valcresson écoutèrent avec attention pour se rendre compte de ce que faisait l’inconnue.
Ils entendirent ses pas frôler le parquet et purent la suivre ainsi de pièce en pièce jusqu’au moment où enfin le bruit cessa complètement.
— Où est-elle et que fait-elle ? dit Pierre Valcresson à Rocambole.
— C’est ce qu’il faudrait savoir, répondit celui-ci, voilà le moment de monter et de faire connaissance avec elle.
Il tira la petite muette par la main et tous trois gagnèrent l’escalier, où ils s’engagèrent en marchant sur la pointe des pieds.
Un instant après ils arrivaient.
Ils parcoururent quatre pièces sans rencontrer l’inconnue.
Ils la découvrirent enfin dans la chambre à coucher.
Elle était là , agenouillée, les mains jointes, priant et pleurant à quelques pas de la petite fenêtre à vitraux coloriés qui avait frappé la petite muette.
À un signe de Rocambole, Pierre Valcresson et l’enfant s’arrêtèrent au seuil de la chambre et tous trois écoutèrent.
— Mon enfant ! ma pauvre enfant ! murmurait l’inconnue, ma chère petite Jeanne ! pourquoi t’es-tu envolée ?
— Mon Dieu ! oh ! mon Dieu ! balbutia M. Valcresson en pressant avec force ses mains contre sa poitrine, cette voix… mon Dieu ! oh ! faites que ce ne soit pas un rêve !
Puis, s’élançant tout à coup dans la chambre, il courut d’abord ouvrir la petite fenêtre aux vitraux coloriés, par laquelle entra un rayon de lune, éclatant comme un flot de lumière blanche, puis il courut à l’inconnue dont la tête était éclairée en plein par cette lumière.
XVIII
LA FOLLE
L’inconnue, qui semblait âgée d’une trentaine d’années, avait les traits pâles, fatigués, creusés par la douleur ou par la misère, par l’une et l’autre, peut-être, et quelques rides précoces sillonnaient légèrement son front.
La douceur et la tristesse empreintes sur sa physionomie lui avaient conservé un charme profond, malgré les ravages qui l’avaient altérée, et son regard avait je ne sais quoi d’hésitant et de craintif, qui donnait à toute sa personne quelque chose de touchant.
À l’approche de M. Valcresson, elle s’était levée tout à coup, et un cri d’effroi s’était échappé de sa poitrine.
Alors celui-ci la retenant doucement par la main et la contemplant à la clarté de la lune, dont les rayons l’éclairaient tout entière, s’écria d’une voix profondément émue :
— C’est elle, c’est ma bien-aimée Louise !
Celle-ci fixa sur lui ses grands yeux bleus, et, retirant la main dont il s’était emparé :
— Oh ! laissez-moi, laissez-moi, murmura-t-elle d’une voix dont la douceur pénétrante allait au cœur et le remuait douloureusement, laissez-moi ici, ne me renfermez plus, je serai sage.
— Louise, ma chère Louise, lui dit Pierre Valcresson en se penchant vers elle avec inquiétude, tu ne me reconnais donc pas ? je suis Pierre Valcresson, ton ami, ton époux.
— Pierre ! dit la jeune femme en passant lentement sur son front ses doigts blancs et effilés, oui, oui, je sais…
Elle ajouta sur le même ton, en fronçant légèrement le sourcil :
— Valcresson ! je connais ce nom-là … mais il est si loin, si loin !…
— Pauvre jeune femme ! dit Rocambole, elle a perdu la raison.
— Oh ! c’est horrible ! murmura M. Valcresson.
— Il y avait mille chances pour qu’elle eût perdu la vie, estimez-vous donc heureux de la retrouver, même en cet état.
— Oui, j’en suis heureux et j’en bénis le ciel, dût-elle ne jamais recouvrer la raison, répondit Pierre Valcresson. Mais comment a-t-elle vécu depuis dix ans ? comment se fait-il qu’elle revienne dans cette maison au bout d’un si long laps de temps, et qui donc a pris soin d’elle dans cette triste situation où, semblable à un enfant, elle ne pouvait même pas songer à sa nourriture ?
— Je l’avoue, dit Rocambole, il y a là un problème inexplicable ; essayez donc de la faire parler.
Pierre Valcresson lui prit de nouveau la main, qu’elle lui abandonna cette fois.
— Voyons, ma chère Louise, lui dit-il, que viens-tu faire ici ?
Elle avait écouté avec une extrême attention et en fixant sur lui un regard étrange, à la fois pénétrant et hagard.
Elle garda un instant le silence, réfléchissant profondément, comme si elle cherchait à se rendre compte de ce qu’elle venait d’entendre.
— Ici ? dit-elle enfin en promenant autour d’elle ses grands yeux bleus, ici ?…
Puis son front s’éclaira tout à coup, un naïf sourire entrouvrit ses lèvres et elle murmura, en montrant du doigt une place sur le parquet :
— Ici est le berceau de l’enfant, c’est pour cela que j’y suis ; je viens de la coucher, elle dort.
Elle se pencha en avant, prêta l’oreille, se redressa bientôt et, se tournant vers Pierre Valcresson, un doigt posé sur les lèvres :
— Elle dort, reprit-elle à voix basse.
— Voyons, dit Rocambole, essayons de frapper son imagination, peut-être parviendrons-nous à faire jaillir une étincelle des ténèbres qui enveloppent son esprit.
— C’est possible, mais que prétendez-vous faire ?
— Vous allez le voir.
Il dit quelques mots à l’oreille de la petite muette, qui répondit par un signe de tête qu’elle consentait à ce qu’il lui demandait.
Alors, se dégageant de l’ombre où elle était restée cachée jusque-là , elle s’avança dans le cercle éclairé par les rayons de la lune et se coucha à terre.
À son aspect, Louise Prévôt avait laissé échapper un cri de surprise.
— Un enfant ! une petite fille ! murmura-t-elle d’une voix attendrie.
Jeanne s’approcha d’elle, non sans une certaine appréhension, la tira par la manche de sa robe pour la forcer à se pencher vers elle, puis enlaça son cou dans ses deux bras et l’embrassa cinq ou six fois de suite sur les joues, après quoi elle se coucha tout de son long sur le parquet, à l’endroit occupé autrefois par son berceau.
Déjà très-émue des embrassements de l’enfant, Louise la regarda s’étendre à terre, la contempla quelques instants en silence, puis vint s’agenouiller près d’elle et murmura à voix basse :
— Dors, mon enfant, dors, ma petite…
Elle s’interrompit tout à coup, parut faire un effort de mémoire et, s’adressant à l’enfant :
— Ton nom ? lui demanda-t-elle.
— Jeanne, répondit Rocambole en baissant lui-même la voix.
— Jeanne ? répéta la pauvre folle en se penchant jusqu’à terre pour regarder l’enfant, je l’ai connue ; mais, un jour, elle est partie, elle s’est envolée dans l’azur du ciel comme l’alouette, et, à cette heure, elle doit être dans le paradis.
Tandis qu’elle parlait, couvant de ses grands yeux bleus la petite muette, qui la considérait elle-même avec une singulière curiosité, Rocambole était allé ouvrir la fenêtre qui donnait sur la ruelle.
Cela fait, il s’approcha de l’enfant, l’enleva dans ses bras et revint avec elle vers la fenêtre, qu’il fit le simulacre d’enjamber, comme s’il se disposait à la descendre dans la ruelle.
Il marchait lentement, sur la pointe des pieds et en tournant vers la porte des regards inquiets, comme s’il eût craint d’être surpris.
Louise avait suivi tous ses mouvements, d’un air étonné d’abord, puis avec une inquiétude visible et qui allait toujours croissant à mesure quelle le voyait se rapprocher de la fenêtre avec l’enfant dans ses bras.
Elle était haletante, et son regard, attaché sur l’enfant, exprimait une angoisse, qui bientôt alla jusqu’à la souffrance, car ses traits se contractaient à vue d’œil.
Lorsqu’enfin elle vit Rocambole se pencher avec Jeanne au-dessus de la ruelle, sa poitrine se gonfla tout à coup, un éclair de désespoir passa dans ses yeux effarés et elle s’élança vers l’enfant en criant d’une voix déchirante :
— Jeanne ! mon enf…
Du coin où il s’était retiré, afin de ne pas distraire la jeune femme de la comédie qu’avait imaginée Rocambole pour éveiller sa sensibilité en lui rappelant un souvenir terrible, Pierre Valcresson avait suivi avec une inexprimable émotion toutes les impressions qui se reflétaient sur les traits de la pauvre folle.
Son cœur déborda de joie quand il la vit s’élancer vers son enfant en l’appelant par son nom et en jetant un cri qui trahissait le réveil du sentiment maternel.
Mais ce ne fut qu’un éclair et cette joie se changea aussitôt en désespoir quand il la vit chanceler, pâlir affreusement et porter les mains en avant comme pour chercher un appui dans le vide.
Il accourut à temps pour la recevoir, dans ses bras.
— Ah ! monsieur Portal, s’écria-t-il, tout bouleversé, nous l’avons tuée !
Rocambole, qui avait posé l’enfant à terre, s’approcha de la jeune femme et l’examina avec attention.
— Non, dit-il après un moment de silence, j’ai provoqué une violente secousse morale, et nous avons déjà obtenu un véritable succès en rappelant à son esprit le nom de son enfant et le souvenir du drame qui a causé sa folie. Nous sommes parvenus à l’émouvoir, et cette émotion a déterminé dans le cerveau un ébranlement salutaire. Tenez, la voilà qui reprend ses sens ; il n’y a donc aucune inquiétude à concevoir, et, si vous m’en croyez, nous allons immédiatement tenter une seconde expérience.
— J’ai peur, dit M. Valcresson.
— Rassurez-vous ; cette fois, le sentiment que je veux éveiller en elle ne peut provoquer que de douces émotions et des larmes de bonheur.
— Oh ! soyez prudent, monsieur Portal ; prenez garde de compromettre sa vie en essayant de la rappeler à la raison.
— Fiez-vous à moi ; le pis qui puisse m’arriver c’est d’échouer dans la tentative que je vais faire, mais elle ne saurait avoir qu’un résultat, heureux si je réussis.
— Quel est votre projet enfin ?
— La voilà tout à fait revenue à elle ; emmenez-la dans le jardin.
— Et puis ?
— Cette violente émotion a dû l’affaiblir, conduisez-la sous la tonnelle où elle pourra se reposer ; le reste me regarde.
— Mais vous me jurez…
— Qu’il n’y a aucun danger.
— Allons, je m’en rapporte à vous, dit Pierre Valcresson en mettant sur son bras celui de Louise, qui le suivit sans résistance et sans même tourner la tête du côté de Jeanne, qu’elle semblait avoir complètement oublié.
Il lui fit descendre l’escalier en la soutenant à chaque marche, car de temps à autre elle fléchissait sur ses jambes, et, quelques instants après, ils étaient assis tous deux sur le banc de la tonnelle, vivement éclairée en ce moment par les rayons de la lune.
Ils étaient là depuis quelques minutes quand M. Valcresson vit venir de ce côté Jeanne et M. Portal.
Ce dernier se tint à l’écart, tandis que celle-ci entrait sous la tonnelle.
Aussitôt elle s’agenouilla sur le sable, posa ses coudes sur la jeune femme, joignit ses mains, et, levant vers elle ses beaux yeux, se mit à répéter sa prière d’autrefois.
Rocambole, auquel François l’avait rapportée textuellement, s’en était souvenu et venait de la lui apprendre.
Louise Prévôt écouta les premiers mots avec étonnement.
Puis son regard se fixa sur Jeanne, empreint d’un vif sentiment de sollicitude, et, glissant sa main dans la poche de sa robe, elle en tira un mouchoir qu’elle passa doucement sur le front, sur le cou et sur le visage de l’enfant en murmurant avec un accent plein de tendresse :
— Toujours en transpiration, elle finira par attraper du mal.
Puis elle se pencha vers elle et la baisa au front.
Jeanne la regardait avec une expression extraordinaire.
— Reconnais-tu cette dame ? lui demanda Rocambole.
Jeanne répondit qu’elle lui ressemblait, mais que l’autre était plus jeune, plus jolie et plus élégante.
— Vous le voyez, dit Rocambole à M. Valcresson, la lumière se fait peu à peu dans le chaos, les souvenirs reviennent, la raison se fera bientôt jour quand la jeune femme va se trouver dans un milieu sympathique et toujours occupé d’elle. Mais, quant à présent, il faudrait savoir où elle demeure et comment elle vit.
XIX
FIGURES DE CONNAISSANCE
— Oui, répliqua M. Valcresson, je veux absolument connaître les bonnes âmes qui ont recueilli et nourri ma pauvre Louise, et, si j’ai la chance qu’elles ne soient pas heureuses, ce sera pour moi une grande joie de leur venir en aide.
Et, se tournant vers la jeune femme :
— Louise, lui dit-il, il est temps de retourner chez toi, mon enfant.
— Oui, répondit celle-ci en jetant un regard sur le jardin, inondé en ce moment par les rayons de la lune, voici le jour, c’est le moment de rentrer.
Elle se leva et posa son bras sur celui de Pierre Valcresson, et ils sortirent tous deux de la tonnelle, suivis de Jeanne et de Rocambole, qui tenait l’enfant par la main.
Elle se dirigea vers une porte située à l’extrémité du jardin et qui fermait à l’aide d’un ressort secret.
Là elle pressa du doigt un gros clou qui faisait saillie sur un montant de la porte, qui s’ouvrit aussitôt.
Tout le monde sortit, elle referma la porte et on se mit en marche.
Elle allait toujours devant avec Pierre Valcresson qui, ne sachant de quel côté était située sa demeure, se laissait guider par elle.
Au bout d’un quart d’heure elle avait franchi les limites de Fontenay-aux-Roses et elle marchait devant elle, en pleine campagne, sans suivre ni chemins, ni sentiers tracés, et sans jamais hésiter sur la direction qu’elle devait suivre.
Après une demi-heure de marche on se trouvait dans la banlieue, mais par des chemins si peu usités et si peu praticables, que Rocambole, auquel les coins les plus inconnus de Paris et de la banlieue étaient cependant très-familiers, cherchait vainement à se rendre compte des quartiers qu’il parcourait.
Enfin elle s’arrêta et dit en montrant une maison :
— C’est là .
— Entrons, dit Pierre Valcresson.
Louise le regarda avec un mélange d’étonnement et d’inquiétude, puis, après un moment de réflexion, elle parut prendre son parti et marcha résolument vers la demeure qu’elle venait de désigner.
C’était une maison d’un seul étage, isolée sur un terrain vague.
— Attendez, dit Rocambole à M. Valcresson, au moment où celui-ci allait frapper à la porte.
— Que voulez-vous faire ? demanda celui-ci.
— Je veux savoir quelles sont les gens parmi lesquels a vécu la pauvre jeune femme.
— Le fait seul de l’avoir recueillie nous prouve que ce ne peuvent être que de bonnes et honnêtes créatures.
— C’est possible, mais je ne les connais pas et en pareil cas j’ai pour principe de me défier d’abord ; restez donc un peu en arrière avec elle et l’enfant et laissez-moi faire.
Il s’approcha d’un volet, à travers lequel filtrait un filet de lumière, et par cette fissure il put voir ce qui se passait à l’intérieur.
Dès le premier coup d’œil il laissa échapper une exclamation de surprise.
Puis il colla son oreille au volet dans l’espoir d’entendre ce qui se disait à l’intérieur.
Mais il comprit aussitôt qu’il fallait y renoncer.
Pas un mot, pas même un son de voix ne parvenait jusqu’à lui.
— Il faut pourtant que j’entende ce qui se dit là , murmura-t-il.
Et, quittant aussitôt son poste, il fit le tour de la maison en la sondant du regard de haut en bas.
Il s’arrêta enfin devant un soupirail de cave, et, après un moment de réflexion :
— Voilà une entrée, dit-il, mais une fois au fond de la cave, où vais-je aboutir ? Enfin je n’ai pas le choix, je ne vois pas d’autre issue que celle-là , essayons.
Il ôta son chapeau, se débarrassa de son paletot, qui avait le double inconvénient de gêner ses mouvements et de doubler l’ampleur de sa personne, puis il se glissa dans le soupirail, dont l’ouverture se trouva juste assez large pour lui livrer passage.
Par un heureux hasard, les rayons de la lune, tombant en plein sur cette ouverture, lui rendirent d’abord le service de lui montrer à quelle hauteur il se trouvait du sol, sur lequel il put sauter sans crainte, puis celui de distinguer les premières marches d’un escalier qu’il eût eu beaucoup de peine à découvrir dans les ténèbres.
Cet escalier conduisait naturellement au rez-de-chaussée, mais aboutissait-il à la pièce où se trouvaient réunis les individus dont il tenait si vivement à entendre l’entretien ?
Voilà ce qu’il se demandait avec inquiétude, tout en le gravissant lentement et avec précaution.
Il avait monté une quinzaine de marches quand sa tête porta contre un plancher.
Il le toucha de la main et ne tarda pas à reconnaître que ce plancher était une porte pratiquée horizontalement, comme on en voit chez beaucoup de marchands de vin.
Parvenu là , il entendit très-distinctement un bruit de voix.
Alors il se coucha sur les marches, de manière à ce que sa tête touchât la porte, et il s’aperçut alors que, grâce à de larges fentes pratiquées par le temps au milieu de cette porte, non-seulement le son des voix, mais des paroles et des phrases entières parvenaient clairement à son oreille.
Il s’accouda sur une marche et écouta.
La voix qu’il entendit le fit tressaillir.
— Voici comment il se fait que je vous ai amené la folle, puisque vous tenez à savoir toute la vérité, disait cette voix. Attiré par je ne sais quelle inexplicable puissance vers cette maison qui me fait horreur en me rappelant deux souvenirs… que je donnerais tout au monde pour oublier, j’aperçois une femme qui rôdait autour du jardin et le regardait avec une curiosité pleine d’émotion. J’allais passer tout droit, lorsqu’en m’apercevant sur son chemin elle vient à moi et me dit avec un accent étrange :
— C’est là , n’est-ce pas ? c’est là que demeure l’enfant ? J’ai fait bien du chemin pour retrouver le pays et la maison, mais je la reconnais maintenant : c’est là ?
Je restai frappé de stupeur à la vue de cette femme, dans laquelle je venais de reconnaître Louise Prévôt, la mère de l’enfant dont…
— Dont j’ai supprimé le chiffon rouge, dit une voix rauque et avinée. Dame ! on n’est qu’une femme, mais on a du zinc.
Elle ajouta avec un rire sauvage :
— Même que vous m’avez payé l’opération cinq cents balles, comme à un grand chirurgien. Et pourtant j’ai pas passé d’examens ; c’est d’instinct, c’est de vocation, quoi ! Chacun a ses petits penchants.
— Je veux l’interroger, poursuivit le narrateur, elle me répond par des divagations ; elle était folle. Il y avait danger pour moi à la laisser courir ainsi à travers champs ; tout en divaguant, elle pouvait laisser échapper mon nom et révéler une partie de la vérité. C’est pour conjurer ce péril que je songeai à la conduire ici, en attendant que je trouvasse quelque occasion de m’en débarrasser tout à fait en l’emmenant un jour loin de Paris, assez loin pour qu’elle ne pût jamais y revenir.
— Quant à nous, monsieur Badoir, ça nous est égal ; vous ne regardez pas à la braise ; pour six jours qu’elle a passés ici vous donnez cent francs ; il est vrai qu’elle est bien logée, bien couchée, bien nourrie, et des égards ! de l’eau-de-vie à discrétion, dont elle n’abuse pas, c’est positif ; enfin, c’est pour vous dire que ça durera sur ce pied-là tant que vous voudrez.
— C’est que, justement, répliqua M. Badoir avec un accent qui trahissait son embarras, je désire que ça ne dure pas plus longtemps.
— Comment l’entendez-vous ? lui demanda madame Claude que le lecteur a reconnue.
— J’ai vu ce matin des gens qui lui portent un intérêt très-vif, qui, s’ils parvenaient à la découvrir, feraient tous leurs efforts pour la rappeler à la raison, et, si cela arrivait, Dieu sait ce que j’aurais à redouter de cette mère quand la vérité lui serait révélée ! Ce serait une lionne, une furie attachée après moi, je le sens, elle me poursuivrait de sa haine sans une minute de relâche, sans merci ni pitié, et qui sait ce que j’aurais à redouter !
— De sorte que… insinua madame Claude d’une voix qui semblait faire appel aux mauvais instincts.
— Eh bien, je voudrais être à l’abri de cette haine, je le voudrais… à tout prix.
— C’est bien simple, répondit la femme, j’ai une petite cave à secret, vous le savez, celle qui avait été préparée pour votre comtesse de Sinabria, ça ferait parfaitement l’affaire de la folle. Oh ! rien de plus facile ; j’ouvre la porte, je décroche une barre de fer qui la soutient, je la remplace par une baguette sur laquelle je rabats doucement les deux battants, la folle passe dessus, les croyant toujours solides, et patatras ! disparue ! un joujou d’enfant, quoi ! Eh bien, ça va-t-il ?
M. Badoir ne répondit pas.
— Qui ne dit mot consent, dit la vieille.
Elle ajouta en se levant :
— N’y a pas de temps à perdre, voilà l’heure où elle rentre.
Et elle se dirigea d’un pas lourd et traînant vers la porte de la cave.
Elle l’ouvrit, descendit quelques marches et bientôt on entendit le bruit d’une barre de fer tombant et rebondissant sur un mur.
Puis elle sortit de la cave, rabattit avec précaution les deux battants de la porte et retourna s’asseoir en face de son mari.
M. Badoir ne dit pas un mot, mais on entendit bientôt le bruit des pièces d’or roulant sur la table.
— Vous dites qu’elle va rentrer ? demanda-t-il ensuite.
— Elle devrait déjà être ici.
— Je ne tiens pas à ce qu’elle me voie, je pars.
— Allez et comptez sur nous, lui dit la vieille.
— Je viendrai demain savoir de vos nouvelles, dit M. Badoir en se dirigeant vers la porte.
— Vous serez le bienvenu, monsieur Badoir.
Ce dernier sortit enfin.
Un instant après on frappait à la porte.
— Entrez, cria Claude.
La porte s’ouvrit.
C’était Louise Prévôt.
— Vous rentrez bien tard, ma mignonne, lui dit madame Claude ; il ne vous est rien arrivé, ma mignonne ?
Louise ne répondit pas.
— Vous devez être fatiguée, allez vous coucher, ma belle, reprit la vieille en lui montrant sa chambre au delà de la porte de la cave.
XX
RECONNAISSANCES
Louise Prévôt se dirigea vers sa chambre.
L’aimable couple la suivait du regard, Claude avec une certaine anxiété, sa hideuse moitié avec un sourire féroce.
Elle n’était plus qu’à deux pas de la porte qui devait s’effondrer sous ses pieds, quand un homme, faisant irruption dans l’ignoble bouge avec la violence d’une trombe, s’élança vers elle, la saisit par le bras et la ramena brusquement au milieu de la pièce.
Cet homme, c’était Rocambole.
La pauvre folle, effrayée de cette brusque apparition et se croyant menacée, se mit à crier et fit des efforts inouïs pour échapper aux mains de son sauveur et s’élancer vers sa chambre en passant par-dessus la porte de la cave.
— Ah çà , d’où sort-il donc celui-là ? s’écria madame Claude en s’avançant vers Rocambole, armée d’une bouteille dont elle allait lui fendre la tête, quand celui-ci, sans se retourner, lui envoya dans l’estomac une ruade qui la fit reculer de six pas.
— Arrive donc, feignant, cria celle-ci à son mari, en poussant un hurlement de douleur, on maltraite ton épouse.
Claude s’était jeté sur un couteau.
Il bondit au-devant de Rocambole, tandis que sa femme revenait sur celui-ci en brandissant sa bouteille.
Pris ainsi entre deux adversaires terribles, déterminés, et obligé en même temps de lutter avec sa pauvre folle qui, croyant trouver dans sa chambre un refuge contre cet ennemi, l’attirait avec l’énergie du désespoir vers l’abîme au fond duquel ils devaient trouver la mort l’un et l’autre, Rocambole se voyait perdu.
Il ne pouvait se sauver qu’en lâchant la folle pour faire face à ses ennemis, mais alors celle-ci allait bondir sur la porte fatale et se briser la tête sur l’escalier de la cave.
Et il préférait risquer sa propre vie que d’exposer l’infortunée à cette mort horrible.
Dans cette situation critique, il eut une inspiration.
Enlevant Louise dans ses bras avec une facilité dont tout autre eût été incapable, il franchit d’un bond les deux battants de la porte et se trouva dès lors séparé de ses ennemis par un obstacle, devant lequel ceux-ci s’arrêtèrent stupéfaits d’un pareil tour de force.
Ce fut une relâche d’une minute à peine, après laquelle les deux époux, tournant autour de la porte, se mirent en devoir de l’attaquer des deux côtés à la fois.
Mais cette courte trêve, Rocambole, avec ce sang-froid qui ne l’abandonnait jamais dans les circonstances périlleuses, l’avait mise à profit.
Ouvrant brusquement la porte de la chambre dans laquelle avait voulu se réfugier la folle, il l’y poussa et l’y enferma à double tour ; puis, débarrassé de tout souci de ce côté, il glissa une main dans la poche de sa jaquette et se tourna aussitôt vers ses deux adversaires en leur mettant tour à tour sous le nez les gueules béantes d’un revolver qui les fit bondir en arrière tous les deux.
Alors Rocambole, croisant les bras sur sa poitrine et laissant tomber sur eux un regard ironique :
— Ah ! ah ! il paraît que nous sommes dégoûtés du jeu ! eh bien, soit, la partie est finie, maintenant nous allons causer.
— Causer, répliqua la vieille, qui ne se laissait pas facilement effrayer, nous n’avons pas d’affaire avec vous ; que venez-vous faire dans notre demeure ?
— Je vais vous le dire, répondit Rocambole.
Il fit le tour de la porte, gagna le milieu de la pièce, s’assit à califourchon sur une chaise, et, tout en jouant avec son revolver :
— Mes petits amours, leur dit-il, je ne suis pas si méchant que j’en ai l’air ; je suis, au contraire, très-bon enfant au fond, et je vais vous le prouver en vous laissant le choix sur deux questions qui ont leur importance.
Les deux époux se regardèrent avec une vague inquiétude.
— Et d’abord, reprit Rocambole, honneur au sexe ! commençons par les dames. Voyons, madame Claude, dites-moi franchement ce qui vous agréerait le plus de recevoir une balle de mon revolver en pleine poitrine, ou de passer simplement sur la porte de cette cave.
À cette proposition imprévue, la vieille eut un frisson.
— Oh ! prenez votre temps, dit Rocambole, je ne suis pas pressé ; vous avez cinq minutes pour réfléchir. Au reste, vous pouvez arranger cela entre vous, la balle sera pour l’un, la promenade au-dessus de cette porte sera pour l’autre. Allons, consultez-vous tous deux et faites votre choix.
— Ah çà , s’écria Claude, feignant une assurance qui était loin de son esprit, qui êtes-vous ? de quel droit êtes-vous entré ici et que signifient ces menaces ?
— Mon cher monsieur Claude, dit Rocambole, je répondrai volontiers à ces questions quand madame Claude aura bien voulu m’expliquer l’espèce de répugnance qu’elle éprouve à passer sur cette porte, répugnance bien extraordinaire, puisqu’elle hésite entre cela et une balle dans la poitrine.
— Nous sommes chez nous ici, répliqua Claude, ma femme fait ce qu’elle veut, il ne lui convient pas d’obéir aux caprices d’un inconnu, et vous n’avez pas le droit…
Rocambole se leva brusquement et, dardant sur Claude ce regard froid et dominateur sous lequel se courbaient les plus intrépides :
— Vous parlez de droits, maître Claude, lui dit-il, pourriez-vous m’apprendre en vertu de quel droit vous avez enterré un enfant au fond de votre cave ?
— Moi ! moi ! balbutia Claude dont les traits se couvrirent d’une subite pâleur à ces paroles.
Rocambole ajouta en se tournant vers la femme :
— Et vous, madame Claude, dites-moi donc, je vous prie, sur quel droit vous vous êtes basé pour mutiler une pauvre enfant et la priver à jamais de l’usage de la parole.
— Je… je ne sais pas… je ne sais ce que vous voulez dire, balbutia à son tour l’horrible vieille, une enfant mutilée, non, jamais, jamais !
— Ah ! fit Rocambole avec un accent ironique, on vous aurait donc calomniée, madame Claude.
— Oui, oui, c’est une calomnie ; je n’ai jamais torturé aucun enfant, je n’en ai jamais vu ici.
— Alors je veux confondre le calomniateur à l’instant même.
Il courut ouvrir la porte.
C’était un signal convenu entre lui et Pierre Valcresson, qui entra aussitôt tenant Jeanne par la main.
Claude et sa femme regardèrent les deux nouveaux venus avec un mélange de crainte et de défiance.
L’enfant les intriguait surtout, quoique ni l’un ni l’autre ne soupçonnât ce qu’elle pouvait être.
Outre que l’âge avait complètement modifié ses traits, elle avait aujourd’hui une mise, une tournure, une expression de physionomie qui lui créaient un type tout nouveau et la rendaient entièrement méconnaissable.
Mais que venait faire là une enfant ?
Voilà ce qu’ils se demandaient.
— Mon enfant, dit Rocambole en prenant Jeanne par la main, regarde bien cette maison d’abord, puis examine attentivement cette femme et dis-moi si l’une et l’autre n’éveillent pas quelque souvenir dans ton esprit.
— C’est elle ! murmura la vieille en frissonnant.
Elle venait de la reconnaître à ses yeux et à sa chevelure brune avec des reflets roux, abondante, touffue et naturellement crêpée.
Après avoir promené lentement son regard sur toutes les parties de la pièce, Jeanne tressaillit et pressa avec force la main de Rocambole.
Puis ses grands yeux se fixèrent sur la vieille.
Elle la considéra quelques minutes à peine, et, saisie aussitôt d’une profonde terreur, elle pâlit affreusement et se jeta, en tremblant de tous ses membres, dans les bras de Rocambole.
— Rassure-toi, mon enfant, et dis-moi ce qui te fait trembler ainsi, lui dit Rocambole. Voyons, parle, tu sais bien qu’avec moi tu n’as rien à craindre.
Rassurée, en effet, par ces paroles, Jeanne, avec des gestes d’une précision claire et énergique, montra trois choses coup sur coup ; madame Claude, la chambre dans laquelle Rocambole venait d’enfermer Louise Prévôt, puis sa bouche ouverte ; c’est-à -dire le bourreau, le lieu du supplice, et le genre de torture qu’on loi avait fait subir.
— Eh bien, dit alors Rocambole à la vieille, direz-vous encore qu’on vous calomnie ? Voici l’enfant que vous avez mutilée, et non-seulement vous l’avez reconnue, je l’ai lu dans vos yeux, mais elle-même, au bout de dix années, elle se rappelle l’horrible scène qu’une effroyable torture a pour toujours gravée dans sa mémoire, elle se rappelle la tête ignoble et hideuse de celle qui fut son bourreau, et vient de désigner, sans hésiter, le lieu où elle a été entraînée par l’infâme créature.
Puis, se tournant vers Pierre Valcresson en proie à une émotion qui contractait tous ses traits et lui désignant du doigt madame Claude :
— Voilà le monstre qui, après avoir fait subir à votre enfant, il y a dix ans, la plus effroyable mutilation, allait précipiter votre femme au fond d’un abîme en la faisant passer sur cette porte, comme je viens de vous le dire ; et maintenant faites ce qui est convenu.
À ces mots un cri rauque s’échappa de la poitrine de Pierre Valcresson, et, bondissant comme un tigre jusqu’à l’affreuse vieille, il l’enleva dans ses bras, revint vers la cave et la tint suspendue au-dessus de la porte en criant à Rocambole :
— Est-il temps ?

![]()
Celui-ci laissa attendre un instant sa réponse pour jouir de l’angoisse mortelle qui en ce moment bouleversait les traits livides de l’ignoble créature.
— À moi ! Claude, à moi ! balbutia celle-ci d’une voix défaillante.
— Un geste et tu es mort ! dit froidement Rocambole en ajustant le mari.
Mais celui-ci, pâle et atterré, ne songeait nullement à aller au secours de sa digne moitié.
— Eh ! eh ! madame Claude, dit Rocambole, tandis que celle-ci, suspendue au bout des bras de Pierre Valcresson, attendait avec terreur le moment d’être plongée dans l’abîme, où elle avait mille chances d’être broyée, eh ! eh ! les temps sont bien changés, reportez-vous à dix ans d’ici, à la sinistre soirée où cette enfant se tordait de douleur entre vos mains, et vous conviendrez qu’il y a un étrange changement dans les rôles.
L’œil hagard et les traits décomposés, la vieille ne songeait pas à répondre.
— Faut-il la lâcher ? demanda Pierre Valcresson.
— Pas encore, répondit Rocambole, posez-la au bord de l’abîme, on l’y précipitera si elle refuse de répondre à la question que je vais lui adresser.
Le père de Jeanne fit ce que lui commandait Rocambole.
— Maintenant, dit celui-ci à la femme Claude, retenez ce que je vais vous dire ; si vous ne voulez ou même si vous ne pouvez répondre à cette question, le père de votre victime va exécuter l’arrêt que je viens de suspendre.
— Je répondrai, murmura la vieille d’un air hébété.
— Il y a quelques jours vous étiez avec votre digne époux, sir Ralph et votre fille, chez un marchand de vin de la rue Miroménil, où vous avez eu un entretien concernant le prochain mariage de celui-ci avec mademoiselle Tatiane Valcresson, et quelques phrases de cette conversation m’ont prouvé que vous connaissiez le mystérieux complot imaginé par sir Ralph pour perdre cette jeune fille et la mettre dans la nécessité d’accepter sa main ; eh bien, c’est ce complot qu’il faut me révéler tout entier.
XXI
LA MÈRE ET LA FILLE
Pierre Valcresson avait étendu madame Claude le long de la porte de la cave et il la maintenait dans cette position en lui appuyant la main sur le cou.
— Laissez-moi au moins me redresser si vous voulez que je parle, lui dit brutalement celle-ci.
M. Valcresson retira sa main et elle se mit sur son séant.
— Eh bien, lui demanda Rocambole, qu’avez-vous à répondre ?
— J’ai à répondre que je ne sais rien, dit la vieille.
— Ainsi, vous affirmez que sir Ralph ne vous a pas confié son secret ?
— Il n’en a pas soufflé mot.
— Tant pis pour vous.
— Comment ça ?
— Je viens de vous le dire ; puisque vous n’avez rien à m’apprendre, vous allez faire le plongeon à travers cette porte que vous avez préparée si habilement, bien loin de soupçonner à qui elle devait servir.
— Mais puisque je vous dis que j’ignore…
— C’est fâcheux, car vous n’aviez que ce moyen-là de sauver votre vie.
— Ah çà , décidément, qui êtes-vous donc, vous, pour disposer, comme ça de la vie des gens ? s’écria la vieille, revenant tout à coup à son état normal, qui était la colère.
— Je suis le vengeur de Jeanne et de sa mère, que vous vouliez précipiter tout à l’heure au fond de cette cave.
— Mais vous n’êtes pas de la rousse, vous, vous n’êtes pas de la justice, tout ça ne vous regarde pas, mêlez-vous donc de vos affaires.
— C’est que précisément mes affaires, et je n’en ai pas d’autres, consistent à venger les victimes et à châtier les bourreaux partout où je rencontre l’un et l’autre, et jamais je n’ai trouvé une si belle occasion de satisfaire ce double penchant, car jamais je n’ai trouvé à la fois une victime aussi intéressante que cette enfant, des bourreaux aussi hideux, aussi féroces, aussi répulsifs que vous et votre digne compagnon.
Ainsi, c’est bien entendu, vous n’avez rien à m’apprendre concernant le moyen employé par sir Ralph pour compromettre mademoiselle Tatiane Valcresson ?
— Rien.
— Je ne vois donc aucune raison de me priver de la joie de vous rendre une partie de ce que vous avez fait souffrir aux autres en vous faisant profiter de l’ingénieuse combinaison que vous avez imaginée pour cette pauvre folle, qui, à cette heure, serait étendue sanglante au fond de votre cave, si je ne fusse arrivé à temps pour la sauver. Lorsque, lancée à travers cette porte par deux bras solides, vous aurez rebondi vous-même jusqu’au bas de l’escalier de la cave, vous saurez alors par expérience l’effet que produit une pareille opération sur le corps humain, et l’opération sera aussi bien faite que possible, étant confiée aux soins de M. Valcresson, père de cette enfant, que vous avez si cruellement mutilée ; il a une terrible revanche à prendre, et soyez tranquille, il n’ira pas de main morte.
— Est-il temps ? demanda Pierre Valcresson en saisissant la vieille à la gorge.
— Oui, répondit froidement Rocambole.
M. Valcresson voulut enlever la vieille dans ses bras, mais elle le mordit à la main et lui fit lâcher prise.
Puis, se tordant sur le sol comme une vipère, elle s’écria :
— Ne me touchez pas ou je crie, et comme il rôde toujours quelques agents ou sergents de ville aux environs…
Elle ajouta en s’adressant à son mari et continuant à se tordre avec furie pour échapper aux étreintes de Pierre Valcresson :
— Claude, cours ouvrir la porte pour que mes cris soient entendus du dehors.
Claude jeta un regard sur le revolver avec lequel jouait Rocambole et hésita à obéir à la recommandation de sa moitié.
— Ne vous dérangez donc pas, lui dit tranquillement ce dernier, je vais l’ouvrir moi-même.
Il se leva, en effet, et alla ouvrir la porte.
— Maintenant, dit-il à la vieille, vous pouvez crier et appeler à votre aide, et si quelque agent se présente, eh bien, nous allons rire.
Madame Claude cessa un instant de se tordre pour demander à Rocambole :
— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire que je prierai cet agent de se procurer une pioche et de descendre avec moi à la cave, où nous ne tarderons pas à faire une découverte qui pourrait bien vous mettre bientôt face à face avec monsieur de Paris.
— Le bourreau ! murmura la vieille atterrée.
— Oui, le bourreau, qui vous tranchera proprement la tête à tous deux, tandis qu’avec une chute dans l’escalier vous en serez quitte pour une jambe de moins, deux tout au plus. Maintenant faites votre choix et criez, si le cœur vous en dit ; la porte est toute grande ouverte et vous êtes sûre d’être entendue.
Puis, jetant à M. Valcresson un coup d’œil expressif :
— Allons ! lui dit-il.
Paralysée par la peur, la vieille n’était plus sur ses gardes.
Pierre Valcresson en profita pour l’enlever de terre en un clin d’œil.
Il la tenait au bout de ses bras, au-dessus de la porte, et il allait la lâcher, quand un cri d’effroi se fit entendre derrière lui.
Il se retourna et aperçut, debout à l’entrée de la maison, une jeune fille qui le regardait avec épouvante.
— Ma mère ! s’écria-t-elle en reportant ensuite son regard sur madame Claude.
À ce mot, M. Valcresson, renonçant tout à coup à son projet, en face de cette fille, antithèse vivante de sa mère, remit celle-ci sur ses pieds.
Alors Malvina s’approchant de Rocambole, qu’elle venait de reconnaître :
— Mon Dieu ! monsieur, lui dit-elle tout émue du spectacle qui venait de s’offrir à elle, que se passe-t-il donc ici !
— Un acte de justice, mademoiselle, répondit Rocambole. Si vous étiez arrivée une seconde plus tard, cette odieuse créature allait être lancée sur l’escalier de la cave dont les secrets doivent vous être connus.
De pâle qu’elle était, la jeune fille devint pourpre.
— Vous n’osez demander le motif de cette exécution, n’est-ce pas ? reprit Rocambole. Vous connaissez trop votre mère pour ne pas craindre d’apprendre quelque chose d’horrible !
Malvina garda un silence embarrassé.
— Ce motif, je n’aurai pas la cruauté de vous le faire connaître, reprit Rocambole, il vous rappellerait le temps où vous viviez dans ce bouge infâme, au milieu de ces deux monstres, et raviverait en vous des souvenirs que vous voudriez pouvoir effacer de votre vie, je le sais, mais je puis vous dire, que vous eussiez été en partie responsable de l’acte qui allait s’accomplir.
— Moi ! s’écria la jeune fille stupéfaite.
— Je m’intéresse à mademoiselle Tatiane et à Jacques Turgis, qui l’aime de toute son âme, vous le savez, je me suis voué corps et âme au salut de cette fille et je n’aurai pas une minute de relâche que je n’aie pénétré le secret du complot grâce auquel sir Ralph la tient à sa discrétion. Ce secret, je vous l’ai demandé et vous avez refusé de me le révéler, quoiqu’il vous fût connu ; or je savais, par un entretien surpris entre eux et sir Ralph, que cet homme et cette femme le connaissaient également, et, au moment de punir celle-ci d’un acte de cruauté qu’il est inutile de rappeler, je lui ai proposé sa grâce à la condition qu’elle me dévoilerait le mystère que j’ai juré de pénétrer à tout prix. Elle m’a affirmé que je me trompais, qu’ils ignoraient le secret de sir Ralph, et devant la terrible vengeance dont je la menaçais et qui allait s’exécuter, elle a gardé le silence.
Malvina jeta du côté de sa mère un regard stupéfait, puis, se retournant vers Rocambole :
— Et pourtant, lui dit-elle, ce secret, ils le connaissent comme moi.
— Quoi ! s’écria Rocambole, frappé de surprise, elle le connaît, et, quand d’un mot elle pouvait échapper à une exécution terrible, mortelle peut-être…
— Ah ! c’est qu’elle avait de graves raisons pour garder le silence, dit la jeune fille, mais puisqu’ils refusent de parler, moi, je vais tout dire.
— Misérable ! s’écria la vieille avec un grincement de dents qui la rendait effrayante, tais-toi ou je te casse la figure à coups de sabot.
Et elle se baissa brusquement pour saisir un des sabots qu’elle avait aux pieds.
Mais Pierre Valcresson le lui arracha aussitôt des mains, et, le jetant par-dessus sa tête :
— Silence, vieille furie, lui dit-il, et ne bougeons pas ou je te casse l’autre sur la tête.
Malvina regarda sa mère en face et répondit froidement :
— Je parlerai.
Elle ajouta après une pause :
— D’ailleurs c’est déjà fait.
— Déjà ! hurla la vieille en frémissant de colère.
— Je sors de chez M. Paul de Tréviannes, auquel j’ai tout révélé.
— Paul de Tréviannes ? s’écria madame Claude, avec un ricanement grossier, son amant, ils se sont entendus tous deux pour nous envoyer à l’échafaud ; parbleu ! ça ne pouvait pas manquer, elle devait finir par là , la débauche mène à tout.
— La débauche ! répondit la jeune fille avec un sourire amer, je l’ai évitée le jour où je suis sortie de cette maison, le jour où j’ai fui loin de mon père et de ma mère, qui m’y poussaient. Quant à celui que vous appelez mon amant, c’est l’âme la plus noble et la plus délicate qu’on puisse rencontrer, et c’est lui qui m’a inspiré les sentiments qui m’ont fait prendre en horreur les odieux principes que j’avais puisés près de vous. Enfin, il a été mon ange tutélaire, et je remercie Dieu tous les jours de l’avoir mis sur mon chemin.
— Je vous écoute, dit M. Portal impatient d’entendre la révélation que venait de lui promettre Malvina.
— Deux raisons ont empêché ma mère de parler, lui dit la jeune fille, la peur et la cupidité ; sir Ralph leur avait promis une somme assez considérable, une fois le mariage conclu, et les avait menacés d’une dénonciation, en cas d’indiscrétion de leur part ou de la mienne. Voilà pourquoi je me suis tue moi-même, quand vous m’avez interrogée ; mais ce silence qui condamnait ma jeune et excellente maîtresse à une éternité de honte et de larmes pesait cruellement sur ma conscience ; et, voulant m’éclairer sur la conduite que j’avais à tenir dans une circonstance aussi difficile, je suis allée consulter l’homme que j’estime le plus au monde.
— Son amant ! grommela la vieille entre ses dents.
— Quand je lui eus tout conté ; « Mon enfant, me dit-il, il faut sauver mademoiselle Tatiane, sans exposer la vie de vos parents, si indignes d’intérêt qu’ils soient l’un et l’autre. »
— Feignant, va ! murmura la vieille.
« — Et voilà ce qu’il y a à faire ; quant à mademoiselle Tatiane, cela me regarde, je me charge de faire connaître dès ce soir la vérité à M. Portal ou à Jacques Turgis, et, quant à vos parents, ils peuvent se soustraire à la vengeance de sir Ralph en passant immédiatement à l’étranger. »
— À l’étranger ! s’écria madame Claude, et avec quoi ?
— Avec dix mille francs que voici, répondit Malvina.
Et, tirant un portefeuille de sa poche, elle le remit à Claude.
— À la bonne heure ! fit Claude, je me disais aussi, cet homme-là a l’air d’un bon zigue.
— Après tout, répliqua la vieille en aspirant une prise avec ivresse, Malvina est assez belle fille pour…
— Ma mère ! s’écria la jeune fille, qui devint rouge d’indignation.
Puis, se tournant aussitôt vers Rocambole :
— Sortons, sortons d’ici, monsieur, je vous dirai tout dehors, cet air m’étouffe.
— Oui, sortons, dit Rocambole.
Et, courant ouvrir la chambre dans laquelle il avait enfermé Louise Prévôt, il la ramena par la main et sortit avec M. Valcresson, Jeanne et Malvina.
XXII
UN BON CONSEIL
En attendant le jour où nous jugerons à propos de faire connaître au lecteur l’entretien qui eut lieu ce soir-là entre Rocambole et la fille des époux Claude, transportons-nous à l’autre extrémité de Paris, à la barrière de la Villette, et entrons au Lapin amoureux, l’un des marchands de vin les mieux achalandés de l’endroit.
Dans la salle du premier étage, toute grouillante de clients des deux sexes, consommant pour la plupart des saladiers de vin sucré, dernier terme de la galanterie chez les cavaliers de ce monde à part, nous remarquons trois individus attablés près de la fenêtre, où ils causent en buvant un litre à quinze.
Ces trois personnages, très-connus du lecteur, sont Collin, le père Vulcain et Rascal, l’ancien patron du cabaret de la Providence.
Le père Vulcain a l’air mélancolique, Collin n’est pas gai et Rascal paraît soucieux.
— Cette gueuse d’argent ! s’écria tout à coup le père Vulcain en donnant un coup de poing sur la table, c’est étonnant comme ça vous fond dans les mains. Il y a quinze jours, au faîte des grandeurs, à l’apogée de la fortune, roulant sur l’or, ayant l’œil et l’oreille des dames de comptoir, l’enfant chéri des beautés de la barrière du Combat, beau joueur, hasardant des billets de banque comme un prince, mangeant tous les jours du lapin, et du vrai, dans les plus brillants restaurants de la barrière des Trois-Couronnes, payant des bouteilles de vin bouché à tous les camarades, tous les raffinements, toutes les gloires et tous les triomphes, quoi ! et aujourd’hui, plus rien, la débine, la dèche, les humiliations, l’arlequin pour régal, et les airs méprisants des dames de comptoir qu’on avait si souvent invitées à tuer le ver ! Voilà la vie ! Ah ! misère ! tenez, les hommes me dégoûtent.
— Oui, oui, dit Rascal, j’ai su par les autres que vous vous en donniez de l’agrément, et tout ça, comme un sournois, sans inviter les amis ; tenez, père Vulcain, voulez-vous que je vous dise ? je n’ai pas trouvé ça gentil, boire seul n’est pas le fait d’un galant homme.
— Est-ce que je savais où vous trouver, moi ? répondit le vieux modèle ; demandez à Collin s’il n’a pas été de toutes mes parties et si, pendant ces quinze jours, je l’ai laissé rentrer une seule fois chez lui sans qu’il fût pochard.
Collin prit la main du père Vulcain, la pressa fortement dans la sienne et, avec une émotion à laquelle le vin n’était pas étranger :
— Père Vulcain, lui dit-il, tu t’es conduit comme un véritable ami, comme un frère, tu n’as pas bu un verre de vin sans moi ; et ces choses là , vois-tu, ça ne s’oublie pas.
Puis, lui secouant énergiquement la main, il ajouta d’une voix attendrie :
— Père Vulcain, c’est à la vie à la mort.
— Ah çà , vous aviez donc hérité ? demanda Rascal au modèle.
— Oui, répondit celui-ci, j’avais hérité… d’un tableau.
— Un tableau ! Eh ! il y en a qui représentent une fortune.
— À qui le dites-vous ? Celui-là valait cent mille francs !
— Et vous avez mangé cent mille francs en quinze jours ! s’écria Rascal.
— Oh ! entendons-nous, répliqua le modèle, il les valait, maison ne m’en a pas donné ça.
— Enfin, vous l’avez toujours bien vendu cinquante mille ?
— Ah ! bien oui, on voit bien que vous ne connaissez pas le père… le paroissien qui me l’a acheté.
— Combien vous en a-t-il donné ?
— Cinq mille francs.
— C’est un vol !
— Parbleu ? mais quoi ! la bêtise est faite ; le vin est tiré, il faut le boire.
— Malheureusement, il est bu, voilà le chiendent, dit Collin en secouant mélancoliquement la tête.
— Comment ! s’écria Rascal en se croisant les bras, vous avez été indignement volé, vous êtes dans la dèche jusqu’au cou, quand vos habits devraient être doublés de billets de banque, et vous vous contentez de vous désoler ! Ah ! tenez, vous êtes trop naïf, père Vulcain, et, sauf le respect que je vous dois, vous étiez bien né pour tenir l’emploi des pigeons dans la société, votre vocation était d’être plumé.
Le vieux modèle regarda Rascal d’un air à la fois surpris et humilié.
— Que voulez-vous que j’y fasse ? lui demanda-t-il, et comment vous tireriez-vous de là , vous qui faites le malin ?
— Rien de plus simple, j’irais trouver mon homme et je lui tiendrais à peu près ce langage : C’est pas tout ça, ma petite vieille, tu as abusé de mon innocence pour me dépouiller comme un pauvre agneau, ça ne peut pas se passer comme ça, mon tableau vaut cent mille francs ; en me le payant dix mille, tu fais encore une affaire d’or, c’est donc cinq mille que tu vas abouler tout de suite ; sinon je te dénonce à celui chez qui j’ai trouvé la toile ; car vous savez, père Vulcain, je ne coupe pas dans l’héritage, vos ancêtres étaient riches en vertus, je n’en doute pas, mais complètement dépourvus de galerie de tableaux.
— Rascal, répondit gravement le modèle, il faut vous rendre justice, vous avez le nez creux, le tableau ne provient pas d’un ancêtre, au contraire, mais permettez-moi de vous dire que votre idée n’est pas si chouette que ça.
— Bah !
— Mon acheteur est un vieux roublard, qui me répondra à son tour : Ma petite vieille, si ça t’amuse de dénoncer, tu aurais tort de t’en priver, dénonce tant que tu voudras ; seulement ce n’est pas moi, c’est toi qui seras pincé. Je dirai que j’ignorais la valeur du tableau que tu m’as vendu cinq mille francs, qu’en tout cas le prix d’une œuvre d’art est une affaire de pure fantaisie, tandis que toi, on te sommera de déclarer où tu l’as pris et tu ne pourras pas répondre qu’il est tombé par hasard sur tes épaules comme tu passais sous les fenêtres d’un atelier. Eh bien, mon pauvre Rascal, que dites-vous de ça ? Collé !
— Pas collé du tout, mais désolé, répondit Rascal avec un sourire légèrement dédaigneux, oui, désolé de trouver si peu de jugeote dans une tête de cinquante-cinq ans.
— Que répondriez-vous donc à ça, vous, monsieur le diplomate ?
— Ces simples paroles : Ma vieille branche, si dans cinq minutes tu n’as pas déposé les cinq billets de mille dans cette main-là , avant une heure je serai chez le propriétaire du tableau, auquel je me dénoncerai moi-même, en ajoutant : Jurez-moi de me pardonner et je vous conduis chez le gueux de receleur qui m’avait indiqué le coup et qui m’a payé votre toile cinq mille francs. Ravi de rentrer en possession de son tableau, ledit propriétaire n’hésitera pas à me faire grâce, et c’est toi, ma vieille branche, qui seras pincé sous la double inculpation de complice et de receleur.
— Tiens, tiens, tiens, dit le père Vulcain en jetant sur Rascal un regard d’admiration, c’est une vraie idée ça, un bon truc pour effrayer mon voleur et le faire cracher au bassinet.
— Mais, reprit Rascal, ce n’est pas tout que l’idée, faut posséder la manière de s’en servir, faut de la ruse et une langue bien pendue.
— C’est positif, dit le modèle, et, si je connaissais un avocat qui voulût se charger de cette affaire…
— Faut pas y compter, il la trouverait véreuse, comme ils disent ; l’avocat rend volontiers les assassins à la société, surtout quand ils sont chargés de crimes, ça le pose dans le barreau, mais les tableaux jamais, ça ne fait pas assez de bruit.
— C’est dommage, je lui aurais bien donné cent francs et un dîner à discrétion à une barrière de son choix.
— C’est flatteur, dit Rascal.
Il reprit après une pause :
— Dites donc, père Vulcain ?
— Qu’est-ce ?
— Vous dites cent francs et un dîner…
— À une barrière de son choix. Connaîtriez-vous un grand avocat qui…
— J’en connaissais un, mais il vient de passer garde des sceaux, et vous comprenez…
— Je comprends ; il ne peut pas les quitter, puisqu’il est payé pour les garder.
— Eh bien ! écoutez, je connais quelqu’un qui se chargerait volontiers de l’affaire à ces conditions et qui répond du succès.
— Un avocat ?
— Mieux que ça, celui qui a conçu l’idée.
— Vous, Rascal.
— Croyez-vous que je sois plus manchot qu’un autre ?
— Ma foi, non.
— Remarquez que, l’idée étant de moi, je la comprends mieux que personne naturellement et que, stimulé en outre par l’appât d’un billet de cent et d’un dîner à tout casser, je ferai des pieds et des mains pour réussir.
— C’est tout de même vrai, s’écria le vieux modèle ; eh bien, c’est entendu, c’est vous que je charge de l’affaire.
— Alors, dit Rascal, faut mettre les fers au feu tout de suite, aujourd’hui même ; qui sait si demain il ne serait pas trop tard !
— Vous avez raison, s’écria le père Vulcain en se frappant le front, vous me rappelez que le vieux singe devait aller le vendre en Angleterre ; pourvu qu’il ne soit pas déjà parti !
— Donc, pas une minute à perdre, reprit vivement Rascal.
Et, se levant brusquement :
— L’adresse du bonhomme ?
— Mardochée, rue des Buttes…
— Numéro ?…
— Diable ! je n’ai jamais remarqué le numéro.
— Enfin, une indication quelconque.
— Au coin de la rue des Acacias, dans la maison de l’épicier.
— Vous n’oubliez que le quartier.
— À Montmartre.
— Vous dites Mardochée, alors c’est un juif, n’est-ce pas ?
— Juste ?
— J’y cours, et dans une demi-heure je verrai le particulier face à face.
— Et dans deux heures vous pouvez être ici.
— Oui, mais il faut prévoir les obstacles.
— En ce cas, à demain matin.
— Le lieu ?
— Eh bien, ici, à dix heures, nous déjeunerons.
— Allons, je file et comptez sur les cinq billets de mille.
Il partit, laissant le vieux modèle ébloui devant la perspective des noces sans nombre qu’il voyait déjà se lever à l’horizon.
XXIII
LA COURSE AU TABLEAU
En sortant de l’établissement du Lapin amoureux, Rascal tournai à droite et enfila la rue de Flandre jusqu’au boulevard extérieur.
Arrivé là , il jeta un regard à droite et à gauche et parut chercher quelqu’un.
Il aperçut enfin sur un trottoir un individu en blouse qui se tenait là dans une immobilité parfaite.
Il alla droit à lui et prononça ce nom : Christian !
L’homme à la blouse se retourna.
Rascal le reconnut.
— C’est fait, lui dit-il.
— Vous connaissez l’acheteur ? demanda vivement celui qui répondait au nom de Christian.
— Oui.
— Qui est-ce ?
— Un juif, du nom de Mardochée.
— Ah ! le vieux gredin !
— Vous le connaissez ?
— De réputation, c’est la Providence des apprentis Raphaël, il leur vend des bijoux, des parures, des colifichets pour leurs maîtresses, contre des tableaux, genre de payement qui rend ceux-ci coulants sur les prix, et il fait ainsi des affaires d’or.
— Dans le genre de celle qu’il a conclue avec le père Vulcain.
— Combien a-t-il payé le tableau ?
— Cinq mille francs.
Christian parut stupéfait.
— Il en vaut quatre-vingt mille, dit-il, et il est sûr de le revendre quarante mille à un particulier, car il est trop malin pour aller l’offrir à un marchand de tableaux, sachant qu’ils doivent avoir été prévenus et qu’il se ferait pincer tout de suite. Où demeure-t-il ?
— Rue des Buttes, à Montmartre.
— Il faut le voir ce soir même.
— C’est bien mon intention.
De nombreuses voitures stationnaient sur le boulevard.
Ils en prirent une en recommandant au cocher d’aller bon train et une demi-heure après ils arrivaient à la rue des Buttes.
Rascal ne tarda pas à trouver la maison qui lui avait été indiquée par le père Vulcain.
— Entrons, dit-il à l’inconnu, seulement vous m’attendrez chez le concierge, nous pourrions effaroucher le bonhomme et exciter sa défiance en nous présentant tous deux chez lui.
— Oui, c’est plus prudent.
— M. Mardochée ? demanda Rascal au concierge.
— Il vient de partir, monsieur.
— À quelle heure doit-il rentrer ?
— Pas aujourd’hui.
— Comment, il découche ?
— Plusieurs nuits, car il part pour un assez long voyage.
— Tonnerre ! s’écria Rascal, en voilà une fatalité.
Puis, frappé d’une idée subite, il s’écria tout à coup :
— N’a-t-il pas emporté quelque chose avec lui ?
— Précisément, un tableau.
— Trop tard ! dit Rascal à son compagnon avec un accent désespéré, il est allé le vendre.
— Malédiction ! s’écria à son tour celui-ci, et, s’adressant au concierge :
— Savez-vous à quelle gare il se rend ?
— À la gare du Nord.
— J’y suis, dit Christian à Rascal, il va le vendre en Angleterre.
— Nous sommes roulés.
— Peut-être.
— Que voulez-vous faire ?
— À quelle heure est-il parti ? demanda l’ami de Rascal au concierge.
Celui-ci jeta un coup d’œil sur sa pendule.
Elle marquait huit heures et demie.
— Il y a juste une demi-heure.
— Neuf heures ! il faudrait savoir à quelle heure part le train pour Calais, toute la question est là .
— Monsieur trouvera peut-être ça dans ce livre, qui a été oublié ici par un ancien locataire et que le père Mardochée a consulté avant de partir.
Ce livre était un Guide-Conti.
Christian le feuilleta rapidement et ne tarda pas à y trouver l’indication qu’il cherchait.
— Tout n’est pas perdu, s’écria-t-il.
— L’heure du train ? demanda Rascal.
— Neuf heures vingt-cinq minutes.
— Si notre cheval est solide, nous pouvons peut-être…
— Il n’y a pas de mauvais chevaux, il n’y a que de bons ou de mauvais pourboires.
— Alors filons vite.
— Je vous achète votre Guide-Conti, dit Christian.
Il prit le livre et mit cinq francs dans la main du concierge, ravi de cette aubaine.
Un instant après, ils étaient en voiture.
— Gare du Nord ! et dix francs de pourboire, si nous y sommes dans un quart d’heure, dit Rascal au cocher.
— On y sera, s’écria celui-ci en ramenant vivement ses guides.
Et, cinglant avec entrain les oreilles de son cheval :
— Et toi, Coco, lui dit-il, en corrigeant, par une promesse flatteuse ce que cette caresse avait d’un peu trop accentué, double picotin si tu me fais gagner mes dix francs. Allons, Coco, allons, un bon coup de collier, il ne s’agit pas de roupiller en route aujourd’hui, c’est le moment de te rappeler tes ancêtres et les lauriers que tu as cueillis jadis aux courses de Longchamp ! Ah ! ma pauvre vieille ! nos beaux jours sont passés à tous deux. Phaéton foudroyé, je suis tombé de mon propre tilbury sur ce siège banal et peu lucratif, et toi, te voilà dégringolé des triomphes du champ de courses entre les deux brancards d’un mauvais fiacre ! Que veux-tu ? ainsi va le monde, ma pauvre vieille, faut en prendre son parti.
Coco, qui semblait comprendre le langage de cet homme de cheval, victime comme lui des coups du sort, avait retrouvé pour un moment ces jambes qui jadis avaient fait gagner plus d’un million à ses différents maîtres, et le quart d’heure était à peine écoulé, lorsque la voiture s’arrêtait devant la magnifique façade de la gare du Nord.
Rascal sauta hors de la voiture, remit quinze francs au cocher et se précipita avec son compagnon dans l’immense galerie où se promènent les voyageurs avant d’entrer dans les salles d’attente.
Il s’y trouvait peu de monde en ce moment et ils ne tardèrent pas à se convaincre que Mardochée n’y était pas.
— Vous êtes sûr de le reconnaître ? demanda Christian à Rascal.
— Très-sûr, répondit celui-ci, je l’ai vu une seule fois causant avec le père Vulcain, et il y a longtemps de cela ; mais il a une de ces têtes qui ne s’oublient pas.
— Et vous ne voyez rien de pareil ici ?
— Non, il n’y est pas.
— Il doit être dans la salle d’attente.
— Sans aucun doute, répondit Rascal en jetant un coup d’œil sur le cadran placé au bout de la galerie, car le train part dans cinq minutes.
Ils coururent aussitôt à la salle d’attente.
— Vos billets, messieurs ? leur demanda l’employé qui se trouvait là .
— Nous n’en avons pas, répondit Rascal, nous sommes à la recherche de quelqu’un qui…
— Il est trop tard, impossible de vous laisser entrer sans billets.
— Je cours en prendre, dit Christian.
Et, s’adressant à l’employé :
— Où est le guichet ?
— Le premier à droite dans la galerie.
Christian sortit en courant.
Comme il y arrivait, un bruit sec lui apprit qu’il se fermait.
— Monsieur, monsieur ! cria-t-il à l’employé, je vous en supplie, un billet… une affaire de la plus haute gravité… toute ma fortune est compromise si…
Mais demander à un employé de retarder d’une minute la joie de quitter son bureau, autant vaudrait demander la lune : peut-être même aurait-on plus de chances de l’obtenir.
Le malheureux revint toujours courant à la salle d’attente.
— Le guichet est fermé, dit-il à Rascal.
— Que faire ? murmura celui-ci avec découragement, le vieux gredin est là , à deux pas ; nous n’avons pour ainsi dire qu’à étendre la main pour le saisir et nous le laisserions filer.
— Oh ! mais non ! s’écria Christian.
— Mais nous n’avons plus que trois minutes.
En ce moment, un voyageur arrivait tout essoufflé, son billet à la main.
— Une idée ! dit tout à coup Christian en se précipitant au-devant de cet homme.
C’était un ouvrier dont la mise était loin d’annoncer l’aisance.
— Combien avez-vous payé ce billet ? lui demanda-t-il.
— Vingt-deux francs.
— Je vous l’achète le même prix pour une minute et vous en avez encore trois.
— Une minute ! fit l’ouvrier stupéfait.
— Le temps d’entrer et de dire un mot à quelqu’un.
— Ça va.
Il remit le billet et en reçut le prix.
— Tenez, dit Christian en le donnant à Rascal, vous qui le connaissez, entrez.
Rascal montra le billet à l’employé, qui le laissa passer dans la salle d’attente.
Il la parcourut à grands pas et découvrit bientôt, près de la porte, dans un coin obscur, le vieux juif, tenant sur ses genoux le tableau enveloppé d’une toile.
Il l’aborda aussitôt.
— Maître Mardochée, lut dit-il.
Le vieillard tressaillit.
— Que me fulez-fus ? demanda-t-il en toisant avec inquiétude celui qui lui adressait la parole.
— Il y a là , dans la galerie, quelqu’un qui désire vous parler.
— Che ne beux bas, le drain fa bardir, répondit Mardochée.
— Vous laisserez partir le train.
— C’est imbossible, il s’achit t’une avaire imbordande que che fais vaire à …
— À Londres, je sais, mais c’est justement à propos de cette affaire que ce monsieur veut vous parler.
— Mais che fous tis que che ne beux bas, répliqua Mardochée qui se troublait de plus en plus, tenez, on oufre les bordes.
Rascal se pencha vers le vieillard et lui dit à l’oreille :
— La personne qui veut vous parler est un agent de police.
— Ah ! fit le vieillard, saisi d’un tremblement subit, un achent te ?…
— De police, et moi aussi.
— Mais bourguoi feut-il me barler ?
— Il a deux mots à vous dire au sujet du petit tableau que vous tenez sur vos genoux.
Mardochée se leva en poussant un profond soupir et en jetant sur son tableau un regard désespéré.
Un instant après il sortait de la salle d’attente avec Rascal et l’ouvrier rentrait en possession du billet qu’il avait loué vingt-deux francs pour une minute.

![]()
XXIV
LARMES DU COEUR
À quelques jours de là , madame Taureins recevait, rue Amelot, une lettre par laquelle elle était invitée à se rendre le lendemain dans le cabinet de M. le juge d’instruction Gérard.
Il avait été convenu entre elle et Rocambole qu’elle attendrait la liquidation de la maison de banque de son mari pour aller s’installer chez elle.
Jusque-là elle devait rester près de Vanda, dont elle était devenue l’amie.
Le lendemain du jour où M. Taureins avait été trouvé mort chez la marquise de Santarès, elle avait été appelée pour le reconnaître, et l’impression qu’elle avait éprouvée à la vue de cette tête dans laquelle il ne restait plus rien qui donnât l’idée d’une créature humaine l’avait ébranlée au point de faire craindre pour sa santé.
Il lui en était resté un sentiment d’horreur qui ne la quittait plus et qui, en se reflétant sur ses traits, en modifiait sensiblement l’expression.
Le deuil, qu’elle avait pris le lendemain, complétait le changement qui s’était opéré en elle.
Ce vêtement, entièrement noir, la pâlissait encore, et, à cette impression dont nous venons de parler et qui s’était pour ainsi dire figée sur ses traits, se joignait une mélancolie qui achevait de poétiser son type plein de charme et d’élévation.
— Mon Dieu, dit-elle à Rocambole et à Vanda, qui étaient près d’elle en ce moment, l’idée de paraître devant ce magistrat, dont je suis absolument inconnue, me bouleverse et me trouble d’avance, je voudrais pouvoir m’en dispenser.
— Il n’y faut pas songer, répondit Rocambole, il faut même vous faire d’avance à la possibilité d’une rencontre qui ne pourrait qu’accroître votre embarras.
— Une rencontre ! dit Valentine en jetant sur Rocambole un regard plein d’inquiétude.
— Inévitablement.
— Avec qui ?
— Mais avec celle qui est accusée d’avoir empoisonné votre mari.
— La marquise ! s’écria Valentine en tressaillant, me retrouver face à face avec cette femme !
— Rassurez-vous, madame, vous ne serez pas seule, je serai près de vous.
— Vous, monsieur Portal ? vous pourriez m’accompagner dans le cabinet du magistrat !
— Je l’espère ; je vais lui écrire pour lui demander à être entendu et le prévenir que j’ai des communications de la plus haute importance à lui faire au sujet de M. Taureins et de la marquise de Santarès.
— Je serai bien heureuse de ne pas me trouver seule en face de cette femme, elle me fait peur.
— C’est elle qui tremblera et courbera la tête devant vous.
— Qui sait ? elle est si perverse et si audacieuse, on a tout à redouter de pareilles créatures.
— Ne craignez rien, je serai là , il est impossible que le magistrat instructeur refuse de m’entendre, quand je lui promets d’importantes révélations, dans une affaire qu’il est chargé de poursuivre.
La porte s’ouvrit en ce moment, et Lise, la femme de chambre de Vanda annonça :
— M. Jacques Turgis.
Rocambole alla au-devant de l’artiste et madame Taureins lui présenta gracieusement la main.
Elle avait eu souvent occasion de le voir depuis qu’elle s’était réfugiée chez Rocambole, et puis il avait un titre à ses bonnes grâces, il était l’ami de Paul de Tréviannes, auquel il avait fait, ainsi qu’à madame Taureins elle-même, la confidence de son amour pour Tatiane et des tortures que lui avait fait endurer la terrible catastrophe qui était venue fondre sur son bonheur.
Il y avait en outre, entre sa destinée et celle de Tatiane, une similitude qui avait beaucoup contribué à la sympathie qu’elle ressentait pour l’artiste.
Elle s’intéressait vivement à cet amour, traversé en ce moment par des obstacles qui semblaient devoir rendre à jamais impossible l’union des deux jeunes gens, et elle faisait tout bas les vœux les plus ardents pour voir se dissiper l’orage amoncelé sur leurs têtes.
— Merci de vous être rendu à mon invitation, mon cher monsieur Jacques, lui dit Rocambole qui, comme tous les amis du peintre, avait pris l’habitude de l’appeler par son prénom.
— Cette invitation était trop aimable et trop pressante pour que je pusse hésiter à m’y rendre, répondit Jacques avec un accent qui trahissait un singulier mélange de bonheur et de tristesse.
— Cet empressement me prouve, ce que je savais du reste, que vous êtes un homme poli et bien élevé, reprit Rocambole en souriant. Mais, permettez-moi de vous faire observer que vous apportez avec vous une teinte de mélancolie qui ne nous promet pas un convive bien amusant.
— J’arrive sous une impression un peu triste, je l’avoue ; et je vais vous en dire la raison. Je passais, il y a une heure, devant l’hôtel Mauvillars…
— Par hasard ? dit Rocambole, car ce n’est pas pour abréger le chemin que vous avez pris par la rue de Miroménil pour venir de la rue Duperré au boulevard Beaumarchais.
— Je passais donc par là , reprit l’artiste sans répondre à cette observation, quand je vois une voiture découverte déboucher du boulevard Malesherbes et s’engager dans la rue de Miroménil. Dans cette voiture étaient M. Mauvillars et la pauvre Tatiane, si triste, si pâle et si défaite que je faillis fondre en larmes en la voyant. Elle devint plus pâle encore en m’apercevant et elle aussi les larmes lui vinrent aux yeux. Elle passa comme un éclair ou plutôt comme un fantôme, ma pauvre chère Tatiane, et je dus me contenter de la saluer, quand, pour presser seulement sa main dans la mienne, pour entendre sa douce et charmante voix me dire comme autrefois : Bonjour, monsieur Jacques ! j’aurais donné…
Il s’interrompit tout à coup, puis il s’écria d’une voix altérée :
— Pardon, monsieur Portal ; pardon, madame, mais je n’y tiens plus.
Et, se jetant dans un fauteuil, il éclata en sanglots.
— Ah ! tenez, monsieur Portal, s’écria à son tour madame Taureins, vous êtes cruel de prolonger la douleur de ce pauvre M. Jacques, quand vous pouvez d’un mot lui mettre la joie dans le cœur.
— C’est à vous que je veux laisser ce plaisir, madame, répondit Rocambole ; dites-lui donc la vérité.
Jacques avait relevé la tête et il écoutait en essuyant ses larmes.
— Eh bien, lui dit la jeune femme, sachez donc que M. Portal connaît enfin le moyen infernal imaginé par sir Ralph pour décider mademoiselle Tatiane à l’accompagner au bal où elle s’est montrée avec lui aux yeux de deux cents personnes.
— Mais, murmura l’artiste en fixant sur Valentine un regard à la fois ravi et anxieux, comment expliquer l’air heureux et souriant de Tatiane quand…
— Tout est expliqué par la révélation du mystérieux stratagème mis en œuvre par sir Ralph.
— Et ce stratagème, demanda Jacques, tout tremblant de bonheur.
— Vous le connaîtrez bientôt, répondit Rocambole, quand j’aurai en main tout ce qu’il me faut pour confondre et écraser sir Ralph ; mais il me manque encore quelque chose, et, avec un adversaire comme celui-là , la moindre imprudence peut tout perdre…
— Mais au moins, s’écria le jeune homme en pressant la main de Rocambole, hâtez-vous de faire parvenir cette bonne nouvelle à Tatiane et de mettre fin à ses larmes et à ses angoisses.
— Mademoiselle Tatiane est trop candide pour pouvoir dissimuler, sa joie percerait malgré tous ses efforts, en dépit de toutes les recommandations, et il faut, pour ne pas compromettre le succès, que sir Ralph ne soupçonne rien jusqu’il la dernière minute.
— Mais moi, moi, vous pouvez tout me dire.
— Non, mon cher monsieur Jacques, car si vous vous retrouviez en face de mademoiselle Tatiane et si elle pleurait devant vous, nulle considération ne pourrait vous empêcher de trahir un secret pour lui épargner une larme. Contentez-vous donc de savoir qu’elle est désormais sauvée et que dans quelques jours nul obstacle ne s’opposera plus à votre bonheur.
— Hélas ! monsieur Portal, répliqua Jacques, vous savez bien que tout mon bonheur désormais, et celui-là est immense, est de voir ma chère Tatiane échapper au malheur et à la honte d’appartenir à cet infâme sir Ralph.
— En effet, répliqua Rocambole, je connais les scrupules qui vous empêchent d’aspirer maintenant à la main de celle que vous aimez et dont vous êtes aimé, et, tout en trouvant ces scrupules exagérés, je les admire et les respecte.
Il reprit après une pause :
— Mais vous croyez peut-être que c’est pour le seul plaisir de vous avoir à dîner avec nous que je vous ai fait venir ?
— Vous me le dites et je l’ai cru, répondit l’artiste avec embarras.
— Eh bien, non, c’est surtout pour vous demander un service et cet apparent témoignage d’amitié ne cache au fond qu’un hideux égoïsme.
— Vous m’étonnez, monsieur Portal ; mais, en tous cas, je suis heureux de me trouver en passe de vous rendre enfin un service, moi qui n’ai fait qu’en recevoir de vous jusqu’à présent. Voyons, de quoi s’agit-il ?
— D’un tableau que je voudrais acheter et sur la valeur duquel je désire d’abord avoir votre avis.
— Dites-moi où je pourrai le voir, et dès demain…
— Non pas demain, mais tout de suite ; le tableau est dans ma chambre. Venez, et vous, madame, veuillez nous accompagner, je vous prie.
On monta à la chambre de Rocambole, où Vanda était en ce moment avec Jeanne.
Un tableau était appendu au mur, recouvert d’une toile.
— Tenez, dit Rocambole, regardez cela et dites-moi franchement votre opinion.
Il enleva la tuile qui cachait la peinture.
Alors un cri s’échappa de la poitrine de Jacques Turgis.
Puis, pâlissant tout à coup et s’appuyant à un meuble, comme s’il se sentait défaillir :
— Grand Dieu ! balbutia-t-il, mais ce tableau… c’est mon Ruysdaël !
— Oui, dit Rocambole, votre Ruysdaël que j’ai arraché des mains de Mardochée, auquel l’avait vendu quelqu’un… qu’il est inutile de nommer.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! est-ce possible ? balbutiait l’artiste tenant toujours sa tête dans ses mains.
— Et tout à l’heure vous allez voir arriver ici M. Chaumont, qui, à son grand regret peut-être, va vous rendre, contre la remise de son tableau, le traité qui brisait votre carrière.
— Oh ! mais alors, s’écria l’artiste, dont les traits s’épanouirent et rayonnèrent aussitôt comme par enchantement, Tatiane…
— Tatiane sera votre femme avant un mois.
— Ah ! monsieur… monsieur Portal ! s’écria Jacques en proie à un véritable délire.
— Eh bien, eh bien ! est-ce que vous allez vous trouver mal à présent ?
— Ah ! madame ! balbutia Jacques en se tournant vers Valentine et en lui baisant les mains.
— Il est fou, s’écria Rocambole en riant pour cacher son émotion.
— Ah ! comme je vous comprends, mon cher monsieur Jacques, murmura la jeune femme en lui prenant la main.
— Allons, s’écria Rocambole, descendons et mettons-nous à table ; il ne reste plus trace de mélancolie, et je crois que maintenant nous pouvons compter sur un joyeux convive.
XXV
UNE CONVERSION
Ainsi que l’avait espéré Rocambole, le dîner fut très-gai, et Jacques Turgis surtout, à moitié fou de bonheur, y jeta l’esprit et la verve à pleines mains.
Deux autres invités assistaient à cette petite fête ; c’étaient Pierre Valcresson et Paul de Tréviannes.
La joie de ce dernier, qu’on avait placé naturellement près de Valentine, n’était pas moins grande que celle de l’artiste, pour être moins expansive, et Pierre Valcresson lui-même était relativement heureux, car il avait près de lui son enfant, jolie et brillante de santé ; et un célèbre médecin aliéniste, appelé par lui pour donner ses soins à sa chère Louise, lui avait donné l’espoir que, dans un laps de temps assez court, il pourrait la rappeler à la raison.
Mis au courant des causes qui avaient déterminé la folie de la jeune femme, le docteur considérait comme pouvant exercer une heureuse et puissante influence sur son esprit son retour dans la demeure où elle avait passé quatre années avec son enfant.
Elle y était en ce moment sous la garde de Milon, qui s’était chargé de veiller sur elle pendant les fréquentes absences que faisait M. Valcresson, pour la poursuite d’une affaire dont il sera parlé plus tard.
Mais, avant d’aller plus loin, nous croyons devoir au lecteur l’explication d’un fait qui a dû lui paraître incompréhensible. Il a dû se demander comment il se faisait que le Ruysdaël repris à Mardochée par Rascal, complice et instrument de sir Ralph, se retrouvait le lendemain dans la chambre de Rocambole.
C’est à cette question que nous allons répondre.
On se souvient sans doute qu’un jour la petite muette, étant allée faire l’aumône à un mendiant qui sonnait à la porte de la rue Amelot, était revenue aussitôt vers Vanda en donnant les signes d’une extrême frayeur et qu’interrogée par celle-ci elle lui avait fait comprendre que ce prétendu mendiant n’était autre que l’homme aux bras rouges, c’est-à -dire Rascal, le patron du cabaret de la providence.
À partir de ce jour, Rocambole, flairant là une tentative d’enlèvement et ne doutant pas qu’elle se renouvelât bientôt, s’était tenu sur ses gardes et s’était mis à observer.
Quelques jours après, il voyait le même mendiant rôder à une certaine distance de sa maison, dont il ne détachait pas ses regards, tout en feignant de s’arrêter de porte en porte pour demander l’aumône.
— Bon, pensa-t-il, maintenant je suis fixé.
Et il se promit de veiller plus activement que jamais.
Mais, un soir qu’il était sorti avec Milon et que Nizza, cédant sans doute au désir de faire ce qui lui était défendu, s’était aventurée à cent pas de la maison, l’enfant se sentit enlevée tout à coup par deux bras vigoureux et emportée dans une voiture qui partait aussitôt à fond de train.
Au bout d’une demi-heure, la voiture s’arrêtait dans un affreux quartier et à l’entrée d’une rue immonde.
C’était la rue des Partants.
Arrivée là , Rascal, car c’était lui qui enlevait l’enfant, sauta à terre en tenant celle-ci sous son bras avec un mouchoir sur la bouche pour l’empêcher de crier, mit la main à sa poche pour payer le cocher.
— Tiens, dit-il avec surprise, il n’y avait qu’un cocher et en voilà deux !
— Oui, répondit le vrai cocher, reconnaissable à son gilet rouge et à son chapeau ciré, un camarade qui passait par là et qui est grimpé sur mon siège au moment où vous entriez dans la voiture avec la petite.
— Bon ! c’est votre affaire, répondit Rascal en donnant deux francs au cocher.
Puis il entra dans une allée si sombre, si humide et d’un aspect si lugubre, que Nizza effrayée se mit à s’agiter avec frénésie.
Mais Rascal continuait son chemin sans plus se préoccuper d’elle que s’il eût eu un paquet sous le bras.
Au bout de l’allée, on rencontrait un escalier étroit et presque aussi noir que l’allée.
Il le gravit et s’arrêta au premier étage, ouvrit une porte et entra.
Mais comme il allait la refermer, il fut tout stupéfait de se trouver face à face avec le cocher et son compagnon, qui l’avaient suivi pas à pas jusqu’à la chambre.
— Ah çà ! qu’est-ce que vous venez faire là , vous autres ? leur demanda-t-il brusquement.
Au lieu de répondre, le cocher repoussa Rascal, entra, suivi de son compagnon, et ferma la porte à double tour.
— Mille tonnerres ! s’écria Rascal.
Et, se débarrassant de Nizza, qui courut se réfugier dans un coin, il retroussa les manches de sa veste et se prépara à tomber sur les deux intrus.
Mais déjà le cocher avait jeté de côté son chapeau ciré, arraché ses faux favoris et montrait à Rascal stupéfait les traits bien connus de M. Portal.
— Si tu y tiens, lui dit tranquillement celui-ci en retroussant également ses manches, je veux bien faire la partie ; mais rappelle-toi le coup de pied que je t’ai détaché un jour au Café Parisien, et, crois-moi, restes-en là avec moi… car, si je m’y mets sérieusement, je te casserai quelque chose.
Cet avertissement et le souvenir que rappelait Rocambole parurent faire impression sur Rascal qui, au lieu d’entamer le combat, se contenta de répondre :
— Eh bien, voyons, que me voulez-vous et pourquoi pénétrez-vous de force chez moi ?
— Tu ne me demandes pas d’abord comment il se fait que je me trouve sur le siège de la voiture dans laquelle tu enlevais Nizza.
— Parbleu ! je vois bien que tout ça était arrangé d’avance et que j’ai été joué.
— Justement, je savais qu’il te fallait un fiacre, j’en ai tenu un à ta portée ; j’ai fait sortir à la nuit celle que tu guettais depuis longtemps et à laquelle on avait recommandé de se laisser enlever, puis, au moment où tu croyais toucher au but, mon fidèle Milon, celui qui a failli t’étrangler, montait sur le siège à côté de moi, et nous filions tous de compagnie pour la rue des Partants.
— Oui, je vois bien que je suis pris et que j’ai coupé dedans comme un imbécile ; mais dans quel but tout ça ? Qu’est-ce que je vous ai fait et quelles sont vos intentions à mon égard ?
— Commence d’abord par nous dire dans quel but tu enlevais cette enfant.
— Je suis à votre discrétion, je ne vous cacherai rien ; c’est pour le compte de sir Ralph que j’agissais.
— Je m’en suis bien douté, mais quel intérêt pouvait avoir sir Ralph à m’enlever Nizza ?
— Il a deviné en vous un ennemi, il vous croit au courant de certains secrets et en mesure de le contrecarrer dans ses plans de fortune, et il voulait avoir cette enfant entre ses mains pour vous tenir en respect, sachant que vous lui avez voué une affection paternelle.
— Est-ce tout ?
Rascal hésita à répondre.
— Allons, parle, et je te jure que tu ne t’en repentiras pas.
— Au fait, vous m’inspirez confiance, vous, dit Rascal.
Il ajouta après une pause :
— Eh bien, non, ce n’est pas tout.
— Que voulait donc encore sir Ralph ?
— Lui et Mac-Field s’entendent avec la marquise de Santarès, qui est parvenue à leur faire passer une lettre par laquelle elle leur promet deux cent mille francs contre certain mémoire de l’Allemand Goëzmann écrit sous votre dictée, et qui, vu la façon dont elle y est traitée, exercerait la plus fâcheuse influence sur l’esprit de ses juges.
— À la bonne heure ! je commence à comprendre, dit Rocambole.
Il regarda fixement Rascal, puis il reprit au bout d’un instant :
— Écoute-moi, Rascal, si je t’ai laissé enlever Nizza, c’est que je voulais connaître la demeure pour pouvoir te faire pincer ou t’attraper moi-même, quand je le jugerais à propos ; mais, depuis un instant que je t’examine, j’ai changé d’avis, et je vais te faire une proposition. Je suis assez bon physionomiste et au fond je te crois meilleur que tu n’en as l’air.
— Dame ! répondit Rascal, je n’ai pas été élevé sur les genoux des duchesses et je n’ai pas fréquenté le monde ; je suis un peu brutal, j’ai gagné ma vie comme je pouvais et pas toujours comme je devais, mais au fond, comme vous le dites, j’ai toujours préféré le bien au mal, et je ne demanderais qu’à vivre comme tout le monde, à manger mon pain tranquillement et sans trembler toujours.
— Allons, s’écria Rocambole, je ne m’étais pas trompé. Écoute, tu es à cette heure dans un très-mauvais cas, mais si mauvais qu’il y va de ta tête, rien que cela.
— Bah ! murmura Rascal en pâlissant.
— Tu étais le patron du cabaret de la Providence, où un agent de police a été assassiné et n’a échappé à la mort que par miracle.
— Je le sais, mais ce n’est pas moi qui…
— C’est toi qui, en qualité de patron de l’établissement où a été commis le crime, en assumes toute la responsabilité, à moins que tu ne puisses t’y soustraire en dénonçant et en livrant les vrais coupables.
— C’est que c’est vrai tout de même, je comprends ça, balbutia Rascal, très-vivement ému.
— Eh bien, voilà ce que j’ai à te proposer ; reste en apparence le complice de sir Ralph, de Mac-Field et de tous leurs instruments, tes dangereux camarades ; passe dans mon camp et sers-toi de tes anciennes relations pour combattre les gredins que tu as aidés jusqu’alors et qui t’eussent conduit inévitablement au bagne ou à l’échafaud, aussi sûrement que je te conduirai, moi, au calme, au repos, au bien-être, par le travail et une vie honorable ; fais cela et tu t’en trouveras bien.
— Mais je ne demande pas mieux, s’écria Rascal, et je regrette que vous ne m’ayez pas tenu ce langage au Café Parisien, au lieu de m’envoyer dans l’estomac un coup de pied qui ne ressemblait nullement à une proposition.
— Toute chose vient en son temps ; ce coup de pied était une entrée en relations et tu ne t’en repentiras pas plus tard.
— Loin de là , répliqua vivement Rascal, je bénis l’heure où je l’ai reçu, puisqu’il est le point de départ de notre connaissance et de la vie nouvelle dans laquelle je vais entrer.
— Allons, viens me voir demain et nous nous entendrons sur ce qu’il y a à faire.
Puis, s’adressant à Milon et à Nizza :
— Et nous, mes enfants, retournons rue Amelot.
XXVI
HISTOIRE D’UN BOA
Après cette explication, le lecteur comprendra par qui Rocambole avait appris la complicité de François, le cocher du comte de Sinabria, dans l’enlèvement de la petite Jeanne ; comment, s’étant présenté à cet individu en qualité de confrère, honoré de la confiance de Rascal, il s’était fait donner par lui les renseignements, grâce auxquels il avait pu éclairer Pierre Valcresson sur le compte de M. Badoir et sur la double catastrophe qui l’avait frappé dans ce qu’il avait de plus cher au monde, Louise Prévôt et son enfant.
Le lecteur a également deviné que le personnage qui, sous le nom de Christian, s’était mis avec Rascal à la chasse du Ruysdaël que Mardochée emportait en Angleterre, n’était autre que Rocambole.
Comme le dîner tirait à sa fin, ce dernier dit à ses convives :
— Ah çà , mes amis, savez-vous qui nous devons remercier des heures agréables que nous passons ensemble en ce moment ?
— Mais, vous, ce me semble, répliqua Jacques Turgis.
— Pas du tout ; celui auquel nous devons cette heureuse chance, et sans lequel nous n’eussions jamais été réunis, c’est sir Ralph, notre ennemi commun, sir Ralph qui a tenté de faire empoisonner M. Valcresson, sir Ralph qui trempait dans le complot dirigé contre madame Taureins par son mari, la marquise de Santarès et l’Allemand Goëzmann, sir Ralph qui, avec ses doux complices, Mac-Field et Badoir, a imaginé l’effroyable machination dans laquelle la malheureuse comtesse de Sinabria se débat à cette heure comme la colombe dans les serres du vautour ; sir Ralph qui, avec ce même Mac-Field, m’a porté à moi-même un coup qui peut être mortel, si je ne parviens à le parer ; sir Ralph enfin, le véritable auteur du vol dont vous avez été victime, monsieur Jacques, car c’est lui qui l’a imaginé, pour vous mettre dans l’impossibilité de contrecarrer ses desseins sur mademoiselle Tatiane, en vous écrasant sous une catastrophe, dont les conséquences étaient incalculables et pouvaient aller jusqu’à vous atteindre dans votre honneur en faisant suspecter votre probité.
— Le misérable ! s’écrièrent en chœur plusieurs voix.
— Ne le maudissons pas trop, dit Rocambole, il nous a fait connaître les uns aux autres et n’aura réussi, je l’espère, qu’à faire des amis de gens qui ne se connaissaient pas, et qui, grâce à lui, apprendront à s’apprécier en se rapprochant pour combattre le péril commun.
— Grand Dieu ! que serais-je devenu sans vous ? s’écria Jacques Turgis. Ma carrière brisée, Tatiane perdue pour moi, et, qui pis est, unie à un misérable de la plus vile espèce. Voilà les épouvantables malheurs sous lesquels je serais resté écrasé toute ma vie.
— Et moi, dit à son tour madame Taureins, si vous saviez, messieurs, à quel odieux et infâme guet-apens j’ai échappé, grâce à l’intelligence, à l’énergie et au dévouement de M. Portal.
— Quant à moi, s’écria Pierre Valcresson, il m’a fait retrouver ma femme et mon enfant que je croyais morts, et qui, sans lui eussent été à jamais perdus pour moi ; il a démasqué devant moi le misérable qui avait su capter ma confiance et auquel je devais tous mes malheurs ; enfin, de désespéré que j’étais, il a fait de moi un homme heureux, presque consolé du passé et plein d’espoir dans l’avenir.
— Bah ! fit Rocambole, j’avais le bon droit et la prudence pour moi, je devais triompher ; cependant, ne nous hâtons pas trop de chanter victoire : la bataille dure encore, et qui sait quelle en sera l’issue ? Madame Taureins a triomphé de ses ennemis, M. Valcresson tient dans ses mains les êtres qui lui sont chers et n’a plus rien à redouter ; mais, jusqu’au jour où j’aurai écrasé la tête de l’hydre, le sort de mademoiselle Tatiane et de la comtesse de Sinabria sont toujours en question.
Puis, s’adressant à M. Valcresson :
— Mais dites-nous donc, je vous prie, comment vous avez échappé au poison que nos ennemis, sir Ralph et Mac-Field, devaient vous administrer à quinze cents lieues de distance.
— Je vous ai dit que Baptiste, c’est le nom de mon domestique, était le complice de ces deux hommes qui, gens pratiques avant tout, s’étaient engagés à lui donner une très-belle prime sur mon héritage, dont ils comptaient s’attribuer une large part en épousant, l’un ma nièce Valentine Taureins, et l’autre ma petite nièce, Tatiane Valcresson. Tous les soirs, en lisant mes journaux, j’ai l’habitude de prendre un grog, que Baptiste me préparait et venait poser à ma portée, et c’est dans ce grog que devait être versé le fatal breuvage. Deux jours avant le moment fixé par les deux complices dont Baptiste recevait les instructions, j’eus besoin de faire un voyage et j’emmenai mon domestique avec moi. Nous avions à traverser une forêt vierge dont les arbres les plus forts et les plus rapprochés avaient été coupés à un mètre du sol et avaient servi de base pour la pose des rails. Un jour, le train avait fait halte au sein de la forêt, où avait été installée une station, et comme il faisait chaud et que nous devions passer là une heure, tous les voyageurs s’étaient étendus sur le sol et s’étaient endormis à l’ombre épaisse d’une luxuriante végétation. On croyait n’avoir rien à redouter des animaux dangereux qui peuplent ces forêts, le passage du train leur inspirant une frayeur qui les tient constamment éloignés de la ligne.
Le plus profond silence régnait parmi les voyageurs, plongés dans le sommeil, lorsqu’un cri aigu, déchirant, dont l’accent trahissait une inexprimable terreur, se fit entendre tout à coup.
En un clin d’œil tout le monde fut sur pied et chacun porta la main à son revolver, tout en cherchant la nature du péril que venait de signaler ce cri d’effroi.
Alors un affreux spectacle s’offrit aux regards des voyageurs et les glaça tous d’épouvante.
Un boa, de moyenne grosseur, s’était enroulé autour du corps d’un jeune homme, et, la gueule ouverte, les yeux étincelants, faisant entendre des sifflements sinistres, il balançait, à la hauteur du visage de celui-ci, une tête effrayante.
Le malheureux allait être broyé par le redoutable reptile si l’on tardait deux minutes seulement à lui porter secours.
Mais la terreur était générale ; nul n’osait approcher, et il était impossible de tirer à distance sur le boa, qui ne faisait qu’un avec sa victime.
Si tous les voyageurs étaient émus, je vous laisse à penser ce que j’éprouvai moi-même quand, dans ce malheureux, menacé d’une mort horrible et inévitable, je reconnus mon domestique, auquel j’étais très-vivement attaché.
— À moi ! à mon secours ! s’écriait l’infortuné d’une voix déchirante, les traits affreusement contractés, roulant autour de lui des yeux hagards, convulsés par l’épouvante, oh ! ne m’abandonnez pas, ne me laissez pas mourir, accourez tous ou je suis perdu.
Mais personne ne bougeait.
Le gigantesque reptile tournait lentement sa tête hideuse et dardait sur le cercle qui l’enveloppait son fixe et étincelant regard dont l’éclat étrange glaçait le sang dans les veines des plus hardis.

![]()
Un nouveau cri aigu, horrible, plein d’angoisse s’échappa de la poitrine du malheureux.
— Je suis perdu ! je suis perdu ! balbutia-t-il en fermant les yeux pour échapper au regard fascinateur du boa qui, en ce moment, concentrait sur lui seul toute sa rage, je sens ses anneaux se serrer autour de mon corps, il va me broyer…
Et il murmura d’une voix défaillante et en laissant tomber sur son épaule sa tête, pâle et défaite.
— Je suis perdu ! je suis perdu !
Alors, saisi d’horreur comme les autres, mais n’écoutant que ma pitié pour mon infortuné serviteur, j’armai rapidement mon revolver, je m’élançai sur le monstrueux reptile, et, l’étreignant juste au-dessous de la tête, dont le continuel balancement m’eût empêché de le viser juste, je lui logeai, à bout portant, une balle dans la gueule, qu’il tenait toute grande ouverte.
Aussitôt la tête retomba inerte sur la poitrine du malheureux Baptiste, on vit les formidables anneaux du monstre se détendre à vue d’œil, puis glisser le long du corps et tomber flasques et informes sur le sol.
Mon domestique était sauvé. Mais la secousse qu’il avait éprouvée avait été si violente qu’il se rendait à peine compte de ce qui se passait autour de lui et que ce ne fut qu’au bout d’un quart d’heure qu’il comprit enfin que c’était à moi qu’il devait la vie.
À mon grand étonnement, au lieu de se répandre en effusions de reconnaissance, quand il reçut cette nouvelle il en demeura tout troublé et ne put que murmurer plusieurs fois, d’un air à la fois ému et contraint :
— Merci, monsieur Valcresson, oh ! merci ! merci !
J’étais blessé d’une froideur dans laquelle je voyais une marque d’ingratitude, et c’est sous cette impression que je repris ma place dans le train, qui se remit en marche après une heure d’arrêt. Le soir, nous arrivions au but de notre voyage sans autre accident.
Je venais de dîner à la table d’hôte et je m’étais retiré dans ma chambre pour y fumer ma pipe et prendre mon grog, suivant mon invariable habitude, quand Baptiste, après avoir déposé le verre devant moi, tomba tout à coup à genoux et s’écria en sanglotant :
— Maître, maître, je suis un monstre, tuez-moi, c’est votre droit, car je l’ai mérité.
Et, comme je le regardais, me demandant tout bas si l’excès de la terreur ne l’avait pas rendu fou :
— Maître, reprit-il, vous venez de me sauver la vie.
— Et j’en suis heureux, mon ami.
— Eh bien, moi, maître, je guette tous les jours le moment favorable pour vous donner la mort.
Il me raconta alors en détail le complot qui avait été formé contre moi et me mit sous les yeux toute la correspondance de ses deux complices qui, l’ayant intéressé dans leur criminelle entreprise pour une forte somme, croyaient pouvoir compter sur son dévouement. Ils n’avaient pas prévu le bizarre événement qui devait me sauver la vie et les mettre eux-mêmes à ma discrétion en changeant du tout au tout les sentiments de Baptiste à mon égard.
XXVII
CHEZ LE JUGE D’INSTRUCTION
Le lendemain, vers trois heures, Rocambole et madame Taureins quittaient la rue Amelot pour se rendre chez le juge d’instruction, où ils étaient appelés l’un et l’autre.
Précédons-les de quelques instants dans le cabinet du magistrat et nous trouverons là notre ancienne connaissance, la marquise de Santarès, en train de subir un interrogatoire.
La marquise est toujours la belle rousse qui a excité tant de passions, entraîné tant de désastres, et qui partout, au Bois, aux courses, au théâtre, concentrait sur elle tous les regards et toutes les admirations.
Tout en adoptant ce jour-là une toilette sévère, commandée par la circonstance, elle a déployé dans sa mise mille coquetteries, dont les yeux d’une femme pourraient seuls distinguer les détails et reconnaître l’intention, mais dont l’ensemble doit charmer un homme sans qu’il se rende compte de ce qui l’impressionne.
Avec cet art profond que possèdent les femmes de cette sorte, entraînées par leur genre de vie à étudier tous les caractères et à se transformer sans cesse suivant les gens auxquels elles ont affaire, elle avait imprimé ce jour-là à ses traits un air de douceur, de résignation et de sérénité qui devaient exercer sur le magistrat une mystérieuse influence.
Nanine la Rousse a appris, par de nombreuses expériences, que, sous la robe du juge, comme sous l’uniforme du soldat, il y a toujours l’homme qui reste, en dépit de tout, soumis aux séductions de la beauté et au charme de la femme. D’ailleurs le juge d’instruction est jeune, ce qui double pour elle les chances du succès dans le duel mystérieux qui va s’engager entre eux.
— Madame, lui disait en ce moment le magistrat, tandis qu’elle feignait de rattacher une agrafe du corsage qui comprimait difficilement sa poitrine, dont on entrevoyait la naissance d’une éblouissante blancheur, madame, vous êtes prévenue d’avoir empoisonné M. Taureins, avec lequel vous entreteniez des relations coupables, dans le but de vous approprier une somme d’un million, dont vous avez été trouvée nantie, comme vous alliez partir en chemin de fer, laissant chez vous le cadavre de votre victime.
Renonçant enfin à rattacher cette agrafe qui avait peut-être le tort de remplir trop scrupuleusement sa pudique mission, Nanine répondit, en tournant vers son juge sa belle tête, éclairée par un vague sourire :
— Voyons, monsieur, regardez-moi bien et dites si j’ai la figure d’une empoisonneuse.
— Je dois convenir que non, répondit le jeune magistrat, mais la marquise de Brinvilliers eût pu en dire autant, et vous savez…
— Je connais son histoire, répliqua Nanine, mais la Brinvilliers était noble, elle était riche, elle avait des loisirs et la passion de la chimie, elle expérimentait pour tuer le temps.
— Si elle n’eût tué que cela !
— Elle a eu des torts, j’en conviens, mais enfin elle avait besoin de s’occuper, tandis que moi, c’est bien différent, je n’avais qu’un seul souci, mais qui prenait toute ma vie, me faire belle, et vous ne savez pas, monsieur, tout ce que cela prend de temps, tout ce que cela demande d’étude et de méditation. Je vous jure que toutes mes heures étaient prises par cette occupation, infiniment plus grave et plus absorbante que vous ne pensez, et qu’il ne me restait pas une minute pour empoisonner.
Elle s’interrompit un instant pour relever sa manche et rattraper son porte-bonheur, qui était remonté jusqu’au haut de l’avant-bras, admirable de forme et de blancheur, puis elle reprit, en jetant à la dérobée un regard sur son juge pour se rendre compte de l’impression produite :
— Et puis, pourquoi aurais-je attenté à la vie de M. Taureins, dont la bonté avait été pour moi inépuisable jusqu’à présent et auquel je pouvais tout demander jusqu’à son honneur ? C’eût été tout simplement tuer la poule aux œufs d’or et je connaissais trop bien mon La Fontaine pour commettre une pareille sottise.
— Enfin, madame, le fait est là , palpable et indéniable, le cadavre de M. Taureins trouvé chez vous et le million surpris entre vos mains au moment où vous alliez quitter Paris pour passer en Espagne ; qu’avez-vous à répondre à cela ?
— Ma réponse est très-simple, monsieur, et je vais vous donner la preuve de ma franchise en avouant tous mes torts. Ce jour-là , M. Taureins, que j’attendais pour dîner, est arrivé chez moi, la figure toute bouleversée, portant à la main un coffret d’ébène, et m’annonça que, ses affaires étant fort embrouillées, il allait quitter la France pour quelque temps et passer avec moi en Espagne. Il ajouta, en me montrant son coffret, qu’il y avait là un million, avec lequel il me priait de prendre les devants et me promettant de venir me rejoindre quelques jours après. Puis, comme il exprimait le désir de passer la nuit chez moi, ayant, disait-il, des raisons particulières pour ne pas vouloir rentrer ce soir-là , je ne crus pas devoir m’y opposer, et c’est aussitôt après mon départ qu’il a mis à exécution le funeste projet auquel l’avait sans doute poussé le mauvais état de ses affaires.
— Pourquoi n’avez-vous rien dit de cela à M. le commissaire de police qui vous a fait subir chez vous, et en face du cadavre même, un premier interrogatoire ? dit le jeune magistrat en consultant un dossier étalé devant lui. Je vois là qu’interrogée par ce magistrat, vous avez reconnu au contraire que M. Taureins était déjà mort, ou qui pis est presque mort, au moment où vous quittiez votre appartement avec son million sous le bras, vous bornant à attribuer le crime à un certain Goëzmann, dont vous n’avez pu retrouver la lettre qui, disiez-vous, contenait la preuve de votre affirmation.
Convaincue de contradiction dans ses deux dépositions, la marquise resta un moment interdite.
Et puis elle avait remarqué qu’en dépit de sa jeunesse le juge d’instruction restait insensible à toutes les séductions qu’elle mettait en œuvre pour l’émouvoir, et cet échec, auquel elle n’était pas accoutumée, contribuait encore à lui ôter beaucoup de son assurance.
Elle se remit bientôt cependant et répondit avec un calme apparent :
— Mon Dieu ! monsieur le juge d’instruction, cette contradiction, sous laquelle vous me croyez accablée, ne prouve absolument rien contre moi.
— Comment l’expliquez-vous donc, madame ?
— De la façon la plus naturelle. Tenez, monsieur, prenez la femme la plus honnête, la plus pure, la plus innocente du monde, arrêtez-la au moment où elle va partir en voyage, calme, tranquille, la conscience en paix, traînez-la devant un cadavre en lui disant : Madame, c’est vous qui avez empoisonné cet homme !
Faites cela, et vous verrez quelle sera la contenance de cette femme en face d’une pareille accusation ; vous verrez si elle conservera assez de sang-froid pour vous faire le récit exact de ce qui s’est passé. Pour peu qu’elle ait affaire à ce que vous appelez un homme habile, c’est-à -dire à un magistrat assez fin, assez rusé pour lui poser des questions qui la poussent à avouer ce qu’il croit être la vérité, vous l’amènerez à se reconnaître coupable du crime dont elle est innocente, et, lorsque plus tard, revenue à elle, ne se rappelant même plus ce qu’elle a répondu dans son trouble et dans son épouvante, elle vous tiendra un tout autre langage, celui de la vérité, cette fois, alors vous triompherez et, l’écrasant sous la contradiction flagrante de ses deux interrogatoires, vous vous écrierez, comme en ce moment : Madame, vous avez voulu tromper la justice, vous êtes coupable, je n’en veux pas d’autre preuve.
La marquise avait débité cette tirade avec une chaleur et une force de conviction qui avaient produit une certaine impression sur le magistrat.
Il reprit au bout d’un instant :
— Voyons, madame, ce qui reste évident pour moi dans cette affaire, c’est que vos deux versions sont absolument dissemblables, veuillez donc choisir entre les deux et me dire à laquelle vous vous tenez ; est-ce à la première ou à la seconde ? Réfléchissez avant de répondre, car cette fois votre déclaration sera bien méditée, et il n’y aura plus à y revenir.
Pour le coup, la marquise dut être bien convaincue qu’il fallait renoncer à troubler son juge.
Il la mettait dans la situation la plus critique, la plus difficile en la forçant à se prononcer sur une question d’où allait dépendre sa destinée.
Aussi se recueillit-elle avant de répondre comme il le lui conseillait.
Après y avoir réfléchi, elle crut devoir définitivement maintenir sa dernière déclaration et renoncer à celle qui était la vraie.
Outre que, pour soutenir celle-ci, elle n’avait plus en mains la lettre par laquelle Goëzmann se reconnaissait lui-même coupable de l’empoisonnement de M. Taureins, lettre qu’elle avait eu l’imprudence de brûler, il ressortait encore de cette première déclaration un fait effroyable et qui ne pouvait manquer de soulever contre elle une réprobation générale, c’était sa fuite avec le million de M. Taureins et l’abandon de celui-ci, se tordant de douleur et râlant son dernier soupir comme elle refermait la porte sur lui.
— Eh bien, madame ? lui demanda enfin le magistrat après une assez longue pause, à quoi vous arrêtez-vous ?
— À dire la vérité, monsieur, répondit la marquise en le regardant fixement.
— Et quelle est décidément la vérité, madame ?
— La déclaration que vous venez d’entendre, monsieur, l’autre ayant été faite sous l’empire d’une émotion qui me troublait au point de m’ôter entièrement l’usage de mes facultés.
— Ainsi, il n’est plus question maintenant de ce Goëzmann, auquel vous aviez d’abord imputé la mort de M. Taureins ?
— Non, monsieur, répondit la marquise avec effort et désolée au fond de ne pouvoir pas laisser peser sur le vrai coupable l’accusation dont elle l’avait chargé d’abord.
— C’est bien, dit le juge d’instruction en prenant note de chaque réponse de la marquise.
Il reprit ensuite :
— Maintenant, madame, j’ai fini de vous interroger ; il ne reste plus qu’à vous confronter avec quelqu’un qui attend là , pour contrôler votre déclaration par la sienne.
— Quelqu’un ! murmura la marquise en se troublant tout à coup ; qui donc, monsieur ?
Et, comme il ne répondait pas :
— Je vous en prie, reprit-elle avec angoisse, dites-moi qui est là .
— Vous allez le savoir à l’instant, madame, répondit le magistrat en appuyant le doigt sur un timbre.
XXVIII
CONFRONTATIONS
Un garçon de bureau était accouru.
— Faites entrer, lui dit le magistrat.
La marquise darda sur la porte un regard inquiet.
Le garçon de bureau était sorti. Un instant après deux personnes entraient et à leur aspect la marquise se troublait tout à coup.
Ces deux personnes étaient Rocambole et madame Taureins.
Profondément humiliée de se montrer en accusée devant celle qu’elle avait persécutée sans relâche, la belle rousse, le premier saisissement passé, toisa la jeune femme avec un air de hauteur et de dédain qui dissimulait parfaitement la rage dont elle était dévorée.
— Madame, dit le magistrat en s’adressant à madame Taureins avec des marques de déférence qui firent pâlir la marquise, veuillez vous asseoir et répondre aux questions que je vais vous adresser.
Il se contenta d’inviter par un signe M. Portal à prendre place près de la jeune femme.
— Vous connaissez madame ? dit le magistrat à Valentine en désignant la marquise.
— Oui, monsieur, répondit la jeune femme sans détourner la tête.
— Était-il venu à votre connaissance que celle qui se faisait appeler marquise de Santarès entretenait des relations avec votre mari ?
— Je le savais depuis longtemps, monsieur ; madame n’avait rien fait pour que je l’ignorasse, au contraire.
— Est-ce que, avant le fatal événement qui a amené l’arrestation de la marquise de Santarès, vous avez eu à vous plaindre de ses procédés à votre égard ?
— Oh ! oui, répondit Valentine avec un soupir très-significatif.
— M’est-il permis d’adresser une question à madame ? demanda la marquise.
— Je vous y autorise.
— Il est arrivé à madame une aventure assez fâcheuse et qui a eu un certain retentissement, dit Nanine avec un calme sous lequel on sentait vibrer la haine, je connais la petite histoire, fort romanesque et même très-touchante, qu’elle a imaginée à ce sujet et, ne doutant pas qu’elle ne vous la raconte à sa façon, je voudrais vous mettre en garde en vous faisant connaître la vérité, avec une preuve à l’appui de mes paroles.
— Nous ne sommes pas ici pour cela, répondit le magistrat ; si madame vous accuse, vous répondrez.
— Madame vous doit des remerciements, monsieur, dit la marquise avec une violente ironie, car, en m’imposant silence, vous lui rendez un service dont vous ne soupçonnez pas l’importance.
— Parlez donc, madame, lui dit Valentine avec un sourire méprisant.
Alors la belle rousse, tirant une lettre de sa poche et la remettant au juge d’instruction :
— Tenez, monsieur, lui dit-elle, voici une lettre qui vous édifiera sur le compte de madame.
Le magistrat lut cette lettre à haute voix :
« Madame la marquise,
« Enfin mes vœux vont être comblés. Madame Taureins, touchée de mon amour, m’accorde un rendez-vous pour cette nuit ; au sortir des Italiens, une voiture nous emportera tous deux pour une campagne, d’où elle ne reviendra que demain matin ; retenez donc M. Taureins, comme vous me l’avez promis, et je vous engage la reconnaissance éternelle de votre serviteur.
« GOËZMANN. »
— Ah ! quelle infamie ! s’écria madame Taureins en se levant tout à coup et en foudroyant la marquise d’un regard d’indignation.
— Pardon, madame, dit Nanine, les mots ne signifient rien en pareil cas, j’ai apporté une preuve à l’appui de mes paroles, en avez-vous une à m’opposer ?
Rocambole se leva à son tour et, tirant, lui aussi, non une lettre, mais un rouleau de papier de sa poche :
— Monsieur le juge d’instruction, dit-il, veuillez joindre la lettre de madame au dossier avec ce rouleau de papier, c’est un petit mémoire fort curieux, écrit par ce même Goëzmann, dont il vient d’être parlé, et qui révèle, entre autres faits curieux, certaine lettre écrite par lui sous la dictée de la marquise de Santarès et dont les termes sont la reproduction exacte de celle-ci. Cette lettre faisait partie de l’arsenal de calomnies forgé par la marquise de Santarès et dirigé contre madame Taureins, qu’elle espérait tuer en l’écrasant sous la honte. C’est dans ce but qu’elle avait, de concert avec M. Taureins et ce Goëzmann, alors ses instruments aveugles, organisé un guet-apens, dont les détails, mentionnés dans ce mémoire, vous permettront de mesurer le degré de violence et de perversité où peut atteindre celle qui s’est fait une si scandaleuse célébrité sous ses deux noms de guerre, marquise de Santarès et Nanine la Rousse. Le récit de cette effroyable aventure vous montrera cette femme sous son véritable jour et peut-être, après l’avoir lu, le crime odieux dont on l’accuse n’aura-t-il plus rien d’invraisemblable.
— J’ai une petite observation à faire, si vous le permettez, monsieur, dit la marquise au magistrat.
— Parlez, madame.
— M. Portal qui n’est ni parent, ni allié de madame Taureins et qui n’a d’autre motif de s’intéresser à elle que son extrême beauté, et j’avoue que le motif est suffisant, M. Portal n’oublie qu’un détail dans tout ce qu’il vient de dire, mais ce détail a bien son importance.
— Qu’ai-je donc oublié, madame ? demanda Rocambole.
— Vous avez omis de dire que cet écrit entièrement de la main de Goëzmann, c’est vrai, lui a été dicté par vous et sous la gueule d’un revolver.
— Est-ce vrai ? demanda le magistrat à Rocambole.
— C’est vrai jusqu’à un certain point.
— Ah ! fit le juge d’instruction d’un air à la fois surpris et sévère.
— C’est-à -dire que j’ai contraint ce misérable, dont vous lirez les hauts faits dans ce mémoire, à écrire non ce que je lui dictais, mais toute la vérité, tout ce qu’il savait lui-même sur l’infâme complot dont madame Taureins eût été victime sans moi.
— Enfin, il a écrit ce mémoire sous l’empire de la violence, avec un revolver braqué sur lui ?
— Oui, mais madame la marquise de Santarès oublie elle-même un détail : elle oublie de dire dans quelles circonstances s’est passée cette scène, circonstances effroyables, qui font frémir d’horreur et que vous trouverez relatées tout au long dans ce mémoire.
— Écrit en face d’un revolver, ce qui en atténue singulièrement la valeur, répliqua froidement le jeune magistrat.
— Mais, monsieur… reprit vivement Rocambole.
— Pardon, monsieur, interrompit d’un ton bref le juge d’instruction, je ne vois là qu’un incident sur lequel il sera temps de revenir plus tard ; arrivons au fait essentiel, au crime dont M. Taureins a été victime et dont la responsabilité pèse, quant à présent, sur la marquise de Santarès.
Puis, s’adressant à madame Taureins avec une déférence moins marquée qu’à son entrée, nuance qui n’échappa pas à la marquise et dans laquelle elle vit avec joie un revirement en sa faveur :
— Madame, lui dit-il, avez-vous quelque raison de croire que l’empoisonnement dont votre mari a été victime puisse être attribué à madame ?
— Oui, monsieur.
— Quelles sont ces raisons, madame ?
— Une lettre qui l’accuse formellement.
La marquise tressaillit.
Le juge d’instruction ajouta aussitôt :
— Cette lettre est entre vos mains ?
— La voici, monsieur.
Elle la tira de sa robe et la remit au magistrat.
La marquise jeta un regard rapide sur la suscription.
Elle avait reconnu l’écriture.
— Espérons, dit-elle d’un ton indifférent et avant que le magistrat n’ouvrit le papier, espérons que cette lettre n’est pas du malheureux qu’on a contraint, le pistolet sur la gorge, à écrire un mémoire contre moi et qu’elle n’a pas été obtenue par les mêmes moyens.
Le magistrat porta de suite ses regarda sur la signature.
— Elle est signée Goëzmann, dit-il.
— Oh ! alors, dit la marquise avec un sourire dédaigneux, il n’est pas difficile de deviner ce qu’elle contient.
Le front du jeune magistrat s’était légèrement contracté à la vue de cette signature.
Il devenait de plus en plus évident que M. Portal et madame Taureins perdaient du terrain dans son esprit depuis que la marquise avait contraint celui-ci d’avouer la violence dont il avait usé vis-à -vis de Goëzmann pour lui faire écrire un mémoire dirigé contre elle.
— Voici ce que contient cette lettre, dit-il enfin, et, se tournant vers la marquise :
— Écoutez, madame.
Il lut la lettre déjà connue du lecteur, par laquelle Goëzmann accusait la marquise d’avoir donné la mort à M. Taureins par le poison et racontait en même temps la tentative, absolument semblable, faite par celui-ci contre sa femme, crime commis cette fois encore sous l’inspiration de la marquise, et dont lui seul, Goëzmann, avait empêché l’exécution.
Quand le magistrat eut terminé la lecture de cette lettre :
— Il n’y a que cela ? dit la marquise avec un sourire ; en vérité, l’ami de madame s’est contenté de bien peu, et, si ingénieuse que soit sa petite invention d’émeraude empoisonnée, invention pour laquelle il pourrait prendre un brevet, car elle est entièrement neuve, je trouve qu’il a été bien modeste, cette fois, de se contenter d’une lettre pour m’accabler, tandis qu’ayant ce Goëzmann à sa discrétion il pouvait lui dicter un mémoire, comme il l’a déjà fait, toujours sous l’inspiration d’un revolver… ou d’un billet de banque, si ces messieurs ont fait la paix, comme c’est probable.
— Il est certain, monsieur, dit le magistrat à Rocambole, qu’après l’aveu que vous avez déjà fait, cette supposition n’a rien d’invraisemblable, et que je suis fort embarrassé de savoir le cas que je dois faire de cette lettre, mais…
Il s’interrompit et sonna son garçon de bureau.
XXIX
DEUX ÉPOUX ASSORTIS
Le garçon de bureau s’était présenté à cet appel.
— Faites entrer, lui dit le magistrat.
Quand cet homme fut sorti, les trois personnes qui étaient là tournèrent en même temps les yeux vers la porte et la même expression se peignit sur leurs visages.
Toutes trois se posaient évidemment cette question :
— Qui donc peut être là ? qui donc va entrer ?
Enfin le personnage si vivement attendu parut sur le seuil du cabinet.
C’était Goëzmann.
Le juge d’instruction, qui épiait sur les trois physionomies l’effet qu’allait produire cette entrée, reconnut avec surprise que toutes trois trahissaient le même sentiment d’appréhension, de sorte que cet incident, dans lequel il avait cru trouver un indice, ne fit qu’accroître ses doutes et sa perplexité.
Cet homme les inquiétait tous, que fallait-il donc penser ?
C’est qu’en effet tous trois se demandaient avec anxiété ce qu’ils devaient attendre de cet homme dont ils se savaient haïs, qui avait à exercer contre chacun de terribles représailles et qui, d’un mot vrai ou faux, devait faire pencher la balance du côté où allait peser sa haine.
Et puis, à l’impression de crainte qu’ils avaient ressentie, se mêlait le sentiment de profonde stupeur dont ils avaient été saisis à l’aspect de ce personnage qu’ils croyaient en sûreté au delà de la frontière d’Espagne.
De son côté, aux regards étonnés qu’il jetait sur eux, on devinait que Goëzmann était loin de s’attendre à se trouver en pareille compagnie dans le cabinet du juge d’instruction.
Un moment paralysé par la surprise qui l’avait fixé quelques instants sur le seuil, il entra enfin en disant :
— Vous le voyez, je vous avais annoncé mon départ pour l’étranger, mais l’homme propose et Dieu dispose, et il paraît que Dieu avait disposé de moi en faveur de dame Police, car deux de ces messieurs m’ont cueilli délicatement à une table d’hôte de Bordeaux, après m’avoir laissé prendre le café et pousse-café, attention qui n’est pas précisément dans leurs habitudes.
Puis, se tournant vers le jeune magistrat :
— Enfin, monsieur le juge d’instruction, puisque vous tenez absolument à causer avec moi, je ne regrette pas d’avoir fait deux cents lieues pour jouir de cet honneur et me voilà à vos ordres.
— Goëzmann, lui dit le magistrat qui ne l’avait pas quitté des yeux depuis son entrée, d’où viennent donc les deux sillons sanglants qui traversent votre visage ? ne serait-ce point une manière de vous grimer pour vous rendre méconnaissable et échapper aux recherches de la police ?
— Non, monsieur le juge d’instruction, c’est plutôt une espèce de tatouage, car ça a pénétré très-avant dans la peau, et celui qui m’a tatoué de la sorte le voilà , c’est M. Portal.
— Comment donc s’y est-il pris pour…
— Oh ! ça n’a pas été long, deux coups de cravache fortement cinglés, l’un à droite, l’autre à gauche, et j’en avais pour la vie ; c’est le tatouage instantané.
— Ah ! dit vivement le magistrat, il est donc vrai, comme vient de le déclarer madame, que M. Portal s’est porté sur vous à des violences…
— Regrettables… pour moi surtout, oui, c’est vrai.
— Reconnaissez-vous avoir écrit ce mémoire ?
L’Allemand jeta un coup d’œil sur le manuscrit qu’on lui présentait.
— Oui, c’est moi qui ai écrit cela.
— De votre plein gré ?
— Pas tout à fait.
— Ah !
— J’y ai bien été un peu poussé par la vue d’un revolver braqué à six pouces de mon visage.
— Vous entendez, monsieur Portal ?
— Parfaitement, monsieur, répondit tranquillement celui-ci, ce qui n’empêche pas que tout ce que renferme ce mémoire ne soit exactement vrai.
— Qu’avez-vous à répondre à cela ? demanda le magistrat à Goëzmann.
— J’ai à répondre… que je m’expliquerai sur ce point quand monsieur le juge d’instruction m’aura fait connaître le véritable motif pour lequel il m’a fait comparaître devant lui.
— Eh bien, ce motif, c’est la mort de M. Taureins.
— Je m’en doute bien un peu.
— Voici une lettre de vous, par laquelle vous déclarez qu’il est mort par le poison, et que ce poison lui a été administré par la marquise de Santarès.
— Je la reconnais également comme étant de moi, dit Goëzmann.
— Avez-vous écrit librement cette lettre, ou vous aurait-elle été arrachée par les mêmes moyens qui vous ont déterminé à écrire le mémoire ? Pesez bien votre réponse, car elle est de la plus haute importance.
— Oui, j’en comprends toute la portée, dit Goëzmann en promenant lentement son regard sur M. Portal, madame Taureins et la marquise de Santarès.
Une expression diabolique brillait dans ce regard qui, à chaque personnage qu’il fixait, semblait distiller le fiel et la haine.
Ceux-ci, comprenant la soif de vengeance dont il était dévoré, attendaient, avec une inexprimable angoisse, la parole qu’il allait prononcer, ou plutôt l’arrêt qu’il allait rendre, car c’était lui qui allait résoudre la redoutable question d’où dépendaient en ce moment l’honneur de madame Taureins et peut-être la vie de la marquise.
En effet, s’il déclarait que la lettre lui avait été dictée et imposée par M. Portal et de concert avec madame Taureins, dans le but de perdre la marquise, ce que redoutaient Rocambole et Valentine, sachant de quelle ardente haine l’Allemand devait être animé contre eux, les rôles changeaient tout à coup ; d’accusateurs qu’ils étaient, ceux-ci devenaient accusés et allaient être immédiatement poursuivis comme coupables de calomnie et de faux témoignage ; et Dieu sait comment l’avocat de la marquise interpréterait le dévouement de M. Portal pour madame Taureins.
S’il déclarait le contraire, la marquise était perdue, et elle aussi avait de sérieux motifs de craindre de Goëzmann quelque terrible vengeance.
Après une longue pause, pendant laquelle, doué d’une vive pénétration, il était parvenu à deviner le système de défense de la marquise, Goëzmann, promenant toujours son regard de M. Portal à madame Taureins, et de madame Taureins à la marquise, comme s’il se fût demandé sur quelle tête il allait faire éclater sa vengeance, parut enfin avoir pris un parti.
Il se tourna vers le magistrat et, avec un sourire :
— Avant de vous répondre, monsieur le juge d’instruction, dit-il en lui montrant la belle rousse, permettez-moi de vous présenter ma femme, ma légitime épouse, madame la marquise de Santarès.
— Comment ! s’écria le magistrat stupéfait, vous êtes le mari de…
— Cette adorable créature, oui, monsieur.
— Est-ce vrai, madame ?
La marquise était pourpre de honte.
— Oui, monsieur, répondit-elle d’une voix troublée.
— Mais vous ignoriez donc les relations qui existaient entre M. Taureins et votre femme ?
— Non, monsieur, répondit tranquillement Goëzmann.
— Mais alors comment expliquer…
— Ah ! monsieur, c’est que nous sommes des natures d’élite, nous ; nous nous étions élevés au-dessus des considérations vulgaires auxquelles se soumet le commun des mortels ; notre union n’était pas de ce monde, c’était l’union des âmes et, dans cette association qu’on flétrit durement du nom de ménage à trois, j’avais la plus belle part, monsieur, j’avais son cœur !
Goëzmann avait débité cette petite tirade avec une exaltation extatique qui jurait de la façon la plus grotesque avec ses traits hideux et l’expression grossièrement cynique de sa physionomie.
Furieuse de subir une pareille humiliation devant madame Taureins, la marquise se mordait les lèvres jusqu’au sang et n’osait plus relever les yeux.
On peut affirmer qu’en ce moment, elle eût voulu voir le parquet crouler sous ses pieds.
— C’était donc moi quelle aimait, monsieur, reprit l’Allemand, poursuivant son rôle, de même que je l’adorais et n’ai jamais cessé de l’adorer, ma petite Naninette chérie ; elle s’appelle Nanine, mais c’est un petit nom d’amitié que je lui donnais dans l’intimité et qui la rendait folle de bonheur.
Un soupir presque insensible, rauque et sourd comme un râle, sortit des lèvres de la marquise, dont on entendait les dents grincer l’une contre l’autre.
Goëzmann, qui la regardait avec une joie féroce, reprit aussitôt :
— Rien ne saurait vous donner une idée de sa tendresse, monsieur le juge d’instruction ; c’est au point que, la veille du jour où elle devait quitter Paris avec M. Taureins, elle lui déclara nettement qu’elle tenait absolument à ce que je la suivisse en Espagne, que sans moi les millions n’étaient rien pour elle, et que nulle considération humaine ne pourrait la résoudre à se séparer de moi. Ah ! monsieur le juge d’instruction, voilà de ces choses qui vont au cœur et qu’on n’oublie jamais.
Puis, se tournant vers la marquise et lui faisant la bouche en cœur :
— N’est-ce pas, ma Naninette adorée, que tu ne pouvais te passer de ton petit Goëzmann ?
D’écarlate qu’elle était, la marquise devint toute pâle.
Dans le souvenir qu’il venait de rappeler avec un attendrissement ironique, Goëzmann avait fait allusion à l’entretien dans lequel, après lui avoir promis de l’emmener en Espagne, elle avait déclaré à M. Taureins son intention de s’en débarrasser en le faisant arrêter dès le lendemain.
Elle comprit donc avec épouvante qu’entre trois personnes également détestées, c’était elle qu’il avait choisie, c’était sur elle que tombait sa vengeance.
Cependant elle attendit encore, ne perdant pas tout espoir.
Goëzmann reprit :
— J’avais besoin de vous dire tout cela, monsieur le juge d’instruction, pour vous faire comprendre avec quel déchirement de cœur je me vois contraint, pour rendre hommage à la vérité, de persister dans la déclaration que contient cette lettre.
— C’est-à -dire que vous reconnaissez avoir écrit cette lettre de votre plein gré et que vous persistez à accuser la marquise de Santarès d’avoir empoisonné M. Taureins.
— Hélas ! oui monsieur, répondit l’Allemand en prenant une figure désolée.
La marquise se leva d’un bond et, passant subitement de rabattement à la colère.
— Misérable ! s’écria-t-elle, celui qui l’a tué, c’est toi, tu l’as déclaré dans une lettre…
— Que vous ne pouvez produire, madame, lui dit sévèrement le magistrat, or, une femme telle que vous ne brûle pas de pareilles lettres, comme vous prétendez l’avoir fait.
Un éclair de joie passa dans les yeux de l’Allemand à cette révélation.
— Une lettre de moi ! dit-il d’un air stupéfait, mais je ne vous ai jamais écrit, ma belle Naninette.
— Infâme ! infâme ! s’écria la marquise en faisant un pas vers lui, les poings serrés et l’œil étincelant de colère.

— Hélas ! chère petite Naninette à moi, reprit Goëzmann en soulignant chaque mot avec une intention marquée, que je regrette de vous voir dans cette triste situation et que nous serions bien mieux en Espagne tous les deux !
La marquise allait répliquer, mais le magistrat se leva en disant :
— En voilà assez pour aujourd’hui, je vous interrogerai de nouveau dans quelques jours.
XXX
UN FIANCÉ
Il était quatre heures environ, lorsqu’une voiture découverte s’arrêta à la porte de l’hôtel Mauvillars.
Un jeune homme vêtu avec une élégante recherche en descendit et franchit le seuil de l’hôtel.
C’était sir Ralph.
Sous l’air dégagé qu’il affectait, on devinait la contrainte et l’inquiétude.
Il était connu des domestiques de la maison qui tous, dévoués à leurs maîtres et sachant qu’il apportait le malheur dans la famille, le regardaient d’un très-mauvais œil, quand par hasard il se présentait à l’hôtel.
Aussi le vieil Antoine, qui avait vu naître sa jeune maîtresse Tatiane et l’adorait comme si elle eût été sa petite-fille, le reçut-il d’un air presque menaçant lorsqu’il vint le prier de l’annoncer à M. Mauvillars.
Il lui tourna le dos et se dirigea vers le salon sans rien dire.
Puis il ouvrit la porte, l’annonça et s’éloigna en murmurant :
— Vilain oiseau de nuit, va !
Sir Ralph se trouva en face de M. Mauvillars et de son père.
Il salua profondément et attendit avec une appréhension visible qu’on lui adressât la parole.
M. Mauvillars s’était levé :
— Qu’avez-vous à me dire, monsieur ? lui demanda-t-il en le toisant des pieds à la tête.
— Mais, monsieur, répondit sir Ralph, un peu déconcerté par cet accueil, nous sommes à la veille de mon union avec mademoiselle Tatiane, et…
Il s’interrompit, paralysé par la figure glaciale qui se dressait devant lui.
— Et… quoi ! lui demanda froidement M. Mauvillars.
— Eh bien ? monsieur, j’ai pensé que, si près de devenir son époux, je pouvais, je devais même lui présenter mes hommages.
— Ah ! vous avez pensé cela, répliqua M. Mauvillars avec une mordante ironie.
Il saisit un cordon de sonnette qu’il agita deux fois.
Une femme entra.
— Où est votre jeune maîtresse ? lui demanda-t-il.
— Dans sa chambre, monsieur.
— Qu’y fait-elle ?
— Toujours la même chose, monsieur, elle pleure.
— C’est bien, vous pouvez vous retirer.
Sir Ralph comprit que cette femme était la femme de chambre de Tatiane ; mais alors qu’était donc devenue Malvina, qu’il croyait toujours près de la jeune fille ?
Voilà ce qu’il se demandait avec une vive anxiété.
Mais il n’eut pas le temps de réfléchir longuement.
— Vous avez entendu, monsieur, elle pleure, elle pleure toujours, et ce qui la plonge jour et nuit dans le désespoir et dans les larmes, vous le savez bien, c’est la pensée de devenir la femme d’un homme tel que vous. Eh bien, monsieur, croyez-vous le moment favorable pour aller lui présenter vos hommages ?
— C’est bien, monsieur, je me retire, répondit sir Ralph avec une colère concentrée, mais permettez-moi de vous faire observer que tant de hauteur de votre part, tant de dédain de la part de mademoiselle Tatiane sont peut-être bien imprudents au moment où je vais devenir le maître de sa destinée.
M. Mauvillars, qui nous le savons, était d’un tempérament sanguin et irascible, devint rouge de colère et, s’avançant brusquement vers sir Ralph :
— Des menaces ! s’écria-t-il.
— Non, monsieur, répondit froidement sir Ralph, mais un avertissement dont je vous engage à profiter, car dans quelques jours vos droits d’oncle et de tuteur auront cessé et les miens commenceront.
— Et alors ? demanda M. Mauvillars en regardant fixement sir Ralph.
— Alors mon premier soin sera d’emmener ma femme loin d’une famille où je n’ai reçu que des affronts.
— En vérité ! dit M. Mauvillars en se croisant les bras, et où donc comptez-vous l’emmener ?
— En Amérique.
— En Amérique ! s’écria le grand-père, qui se mit à trembler tout à coup à cette pensée.
— Rien que cela ! dit M. Mauvillars avec une impassibilité sous laquelle on sentait gronder l’orage. Ah ! nous aurons élevé une enfant avec des soins et une sollicitude infinis, nous l’aurons si bien enveloppée de notre tendresse, qu’elle a traversé la vie à l’abri des chagrins et sans avoir versé une larme jusqu’au jour funeste où elle vous a rencontré ; nous nous serons nous-mêmes pénétrés des charmes qu’elle répand autour d’elle, à ce point que sa présence nous est aussi indispensable que le rayon de soleil à la plante et qu’il en est parmi nous qui ne survivraient pas à son départ, et tout cela pour que vous l’emportiez loin de nous, en Amérique. Ah ! voilà , votre projet, monsieur ! Eh bien, moi, je vais vous dire le mien, qui s’en éloigne singulièrement.
— Je vous écoute, monsieur, dit sir Ralph avec une indifférence affectée.
— Mon hôtel est assez grand pour contenir deux ménages ; l’aile droite est déjà disposée et meublée du haut en bas pour vous recevoir, vous et Tatiane, car la loi veut que les deux époux demeurent sous le même toit ; vous y demeurerez donc, mais vous aurez, chacun votre appartement, et tout est arrangé de façon à vous laisser une entière liberté, excepté celle de pénétrer chez votre femme. Le tort que vous avez fait à sa réputation exige, pour être réparé, qu’elle porte votre nom, c’est assez de cette limite, vous lui épargnerez celle de votre présence et surtout de votre amour. Voilà ce que j’ai résolu et voilà ce qui se fera. Maintenant, si cette situation froissait votre dignité, je vous offre un moyen d’y mettre fin ; je vous compterai la dot de Tatiane, vous m’en donnerez un reçu avec engagement formel et par écrit de ne jamais reparaître devant elle et de renoncer à tous vos droits d’époux, et alors vous serez parfaitement libre de partir pour l’Amérique, nos vœux vous y suivront.
Sir Ralph avait écouté M. Mauvillars avec une imperceptible ironie sur les lèvres.
— Monsieur Mauvillars, lui dit-il enfin, vous avez habité si longtemps l’Amérique que vous avez oublié la législation française.
— Vous croyez ?
— C’est évident, car vous paraissez ignorer l’article de la loi où il est dit que la femme suivra partout son mari.
— Vous vous trompez, monsieur, cet article m’est connu, il ne me plaît pas de m’y conformer, voilà tout.
— Et vous croyez, monsieur, que je ne saurai pas réclamer l’exécution de la loi qui protège mes droits ?
— J’en suis convaincu, au contraire.
— Et que ferez-vous alors ?
— Je plaiderai.
— La loi est formelle, vous ne trouveriez pas même un avocat pour plaider une pareille cause.
— Qui sait ? en faisant valoir les circonstances toutes particulières qui ont décidé ce mariage et l’indignité tout exceptionnelle du mari.
— Raisons insuffisantes et d’ailleurs dénuées de preuves ; vous perdriez votre cause, si tant est que vous puissiez seulement l’entamer ; voilà ce que je puis vous prédire à coup sûr ; or, encore une fois, monsieur, que feriez-vous ?
— Oh ! quelque chose de bien simple.
— Quoi donc, car la difficulté ne me paraît pas si simple que cela à résoudre ?
— Si la loi me contraignait décidément à vous livrer Tatiane, à vous laisser l’emmener loin de nous, alors, monsieur, convaincu qu’avec un mari de votre espèce ce serait la condamner à un avenir de honte et de malheur, et bien résolu à la sauver à tout prix d’une pareille destinée, je me déciderais à user du seul moyen qui resterait à ma disposition : je vous brûlerais la cervelle.
M. Mauvillars avait prononcé ces derniers mots avec une détermination calme et froide qui fit tressaillir sir Ralph.
— Pardon, monsieur, dit-il enfin, mais je vous ferai observer de nouveau que vous vous croyez toujours à New-York où, après avoir logé une balle dans la tête d’un homme en pleine rue, on peut poursuivre tranquillement son chemin sans être inquiété ; mais il n’en est pas de même en France ; de même qu’il y a ici des lois pour faire respecter les droits du mari, il y en a aussi pour protéger la vie des citoyens, et vous savez de quelle peine on punit l’assassinat.
— Je le sais fort bien, aussi mon revolver contiendrait-il deux balles, l’une pour vous, l’autre pour moi. Vous voyez que tout est prévu et que je suis toujours sûr de sauver Tatiane ?
— En effet, répondit sir Ralph, un moment interdit, mais, avant d’employer de pareils moyens, on réfléchit.
— C’est ce que j’ai fait, j’ai réfléchi ; j’ai beaucoup réfléchi avant de me résoudre à ce parti, mais maintenant que vous avez achevé de me convaincre vous-même qu’il n’y en a pas d’autre, il est bien arrêté dans mon esprit. J’ai reconnu pour Tatiane la nécessité d’être légalement votre femme, mais j’ai juré de la soustraire à la honte et au malheur de vous appartenir, et je tiendrai le serment que je me suis fait à moi-même ; il n’y a pour cela que deux hommes à supprimer, vous et moi, et j’en ai fait le sacrifice. Mais, après cette petite explication, vous n’insistez pas pour présenter vos hommages à Tatiane, n’est-ce pas ? Si donc vous n’avez rien de plus à me dire…
— Je comprends votre invitation, monsieur, répliqua sir Ralph, et je me retire, mais en vous prévenant que je prendrai mes mesures pour faire valoir mes droits.
— Un dernier mot avant de vous laisser partir, lui dit M. Mauvillars, et retenez-le bien. Je vous préviens que, le jour du mariage, toujours comme en Amérique, j’aurai sur moi un revolver et que, dans le cas où, comme vous le dites, vous auriez pris vos mesures pour emmener Tatiane ce jour-là , rien ne pourrait vous sauver de la balle que je vous tiendrai en réserve ; et, maintenant que je vous ai fait connaître mes intentions, je ne vous retiens plus.
Sir Ralph salua et sortit, un sourire de bravade aux lèvres, mais au fond très-désagréablement impressionné, car il se sentait la conscience infiniment trop chargée pour aller demander aide et protection à la justice, qui pouvait fort bien avoir été prévenue à son endroit par les deux détectives américains envoyés à sa poursuite, auquel cas c’eût été aller se jeter littéralement dans la gueule du loup.
En sortant de l’hôtel Mauvillars, il se rendit chez le marchand de vin de la rue Miroménil où nous l’avons vu un jour avec les époux Claude et Malvina, à laquelle ils avaient donné rendez-vous pour avoir avec elle une explication qui, on s’en souvient, avait été entendue de Rocambole.
Il avait été très-inquiet de la voir remplacée près de Tatiane par une autre femme de chambre, et il avait hâte de connaître la raison pour laquelle elle avait quitté son service.
En entrant chez le marchand de vin, il le pria de le servir lui-même dans une salle particulière, ayant quelques mots à lui dire.
— Vous avez toujours pour clients les gens de l’hôtel Mauvillars ? lui demanda-t-il quand ils furent seuls.
— Toujours, répondit le marchand de vin.
— Alors, vous avez dû entendre parler de Malvina, la femme de chambre de mademoiselle Tatiane ?
— J’ai appris qu’elle avait quitté la maison.
— L’a-t-on renvoyée ou est-ce elle-même…
— Renvoyée ; oh ! non, mademoiselle l’aimait trop pour ça ; c’est elle qui est partie un beau matin, laissant une lettre dans laquelle elle prévenait qu’elle ne reviendrait pas.
— Et on ne connaît aucun motif ?…
— Aucun.
— Sait-on où elle est allée ?
— On dit qu’elle est retournée dans sa famille.
— Merci.
Sir Ralph paya cinq francs la bouteille de volnay, à laquelle il n’avait pas touché, et sortit en se disant :
— Il y a là quelque manigance de M. Portal, mais je veux savoir tout de suite à quoi m’en tenir ; allons voir les époux Claude.
XXXI
MAUVAIS PRÉSAGES
Une demi-heure après, la voiture de sir Ralph s’arrêtait à l’extrémité de la rue de Vanves, où il la laissait avec son cocher pour s’engager dans le terrain vague où s’élevait la maison des époux Claude.

Les volets étaient ouverts comme de coutume, mais la porte était également ouverte, ce qui le surprit, car M. et madame Claude n’étaient pas de l’avis de ce philosophe de l’antiquité qui eût voulu que sa maison fût de verre pour que tout le monde pût voir ce qui s’y passait.
Le digne couple avait des raisons particulières pour penser tout différemment.
Sir Ralph entra.
La maison était déserte.
Mais, comme tout y était dans l’ordre, ou, pour mieux dire, dans le désordre habituel, il pensa que les deux époux étaient en ce moment dans quelque cabaret voisin, et il s’assit, convaincu qu’ils ne pouvaient tarder à rentrer, puisqu’ils n’avaient pas pris la précaution de fermer leur porte.
Mais un quart d’heure s’écoula sans que personne parût.
— Voyons, se dit-il alors, peut-être madame Claude est-elle en train de cuver sa chopine d’eau-de-vie.
Il se leva et alla frapper à la porte de la chambre que connaît le lecteur.
Ne recevant pas de réponse, il ouvrit la parle, au risque de trouver madame Claude en négligé.
La chambre était vide comme l’autre pièce.
— Allons, se dit-il, ils sont décidément chez le marchand de vin, attendons.
Et il s’assit de nouveau.
Dix minutes s’écoulèrent encore et sir Ralph commençait à s’impatienter, lorsqu’il vit un individu s’arrêter devant la porte.
À sa mise et à sa tournure il reconnut en lui un naturel du pays, et à l’expression ignoble et abrutie de sa physionomie il pensa que ce devait être un ami des époux Claude.
— Vous êtes du quartier, monsieur ? lui demanda-t-il.
— Oui, monsieur, proche voisin de Claude.
— J’ai entendu parler de ces malheureux, dit sir Ralph en prenant un air digne, on me les a vivement recommandés comme des gens dignes d’intérêt, et je venais leur apporter quelques secours.
— Ah ! dit vivement le bonhomme, vous veniez leur apporter… j’aurais cru le contraire.
— Bah ! dit sir Ralph en souriant, pensiez-vous que je venais les voler par hasard ?
— Non, mais, en voyant entrer chez les Claude un homme si bien, si bien, je me suis dit : Ça ne peut être qu’un huissier.
— Je vous remercie de la bonne opinion que vous aviez de moi, mais je ne la mérite pas, je n’ai pas l’honneur d’être huissier. Mais pourriez-vous me dire où ils sont en ce moment, ces braves gens ?
— Je n’en sais rien ; mais, entre nous, je crains qu’il ne leur soit arrivé malheur.
— Et quel malheur redoutez-vous pour eux ?
— Les persécutions de la police.
— Ah ! dit sir Ralph vivement ému, vous croyez que…
— On le dit.
— Ils avaient donc une mauvaise réputation ?
— Pas du tout, la crème des honnêtes gens, mais ils avaient des envieux.
Cette naïveté eût égayé sir Ralph dans tout autre moment, mais il n’était pas en train de rire.
Il était épouvanté à la pensée de savoir les époux Claude arrêtés.
— Mais, reprit-il en dissimulant son trouble, qui vous fait croire qu’ils sont arrêtés ?
— Dame ! monsieur, voilà déjà deux jours qu’on ne les a vus et que la maison est ouverte à tous vents et à tous venants ; or, on ne laisse pas comme ça son ménage à l’abandon.
— Oui, oui, vous avez raison, murmura air Ralph en regardant fixement devant lui.
Il reprit bientôt :
— Ainsi, on n’a aucune nouvelle d’eux depuis deux jours ?
— Pas la moindre.
— C’est inquiétant, très-inquiétant, dit sir Ralph à voix basse et comme se parlant à lui-même.
Il se leva en disant :
— Allons, je suis arrivé trop tard.
— C’est égal, murmura le bonhomme, en examinant sir Ralph avec un sentiment de profonde admiration, j’aurais bien cru que vous étiez un huissier.
Sir Ralph quitta la demeure des époux Claude en proie aux plus sombres pensées.
Plus il y songeait, plus l’hypothèse d’une arrestation lui semblait vraisemblable.
En effet, comment expliquer autrement la subite disparition des deux époux et le complet abandon de leur maison, restée ouverte, à la discrétion du premier venu ?
Cette perspective était terrible pour lui ; l’un des deux, habilement retourné par un agent de police ou par quelque mouton, pouvait le trahir, sans le vouloir, car ils étaient trop intéressés au succès de ses diverses entreprises pour le dénoncer volontairement.
Mais si Malvina, réfugiée chez eux, comme on l’avait dit, avait été arrêtée elle-même, que n’avait-il pas à redouter de cette jeune fille qui lui en voulait mortellement de l’avoir contrainte à trahir sa maîtresse ?
Et puis une autre pensée le tourmentait. En supposant que la police ne fût pour rien dans cette affaire et que les époux Claude ne fussent pas arrêtés, qui donc avait intérêt à les faire disparaître, sinon M. Portal, dans le but de les mettre à l’abri de son influence et de s’en servir lui-même pour le combattre et déjouer les complots auxquels ils étaient initiés ?
C’est dans ces dispositions d’esprit que sir Ralph arriva à l’hôtel Meurice, où il demeurait depuis quelque temps avec Mac-Field.
Il trouva celui-ci aussi sombre et aussi abattu que lui-même.
— Qu’avez-vous donc ? lui demanda-t-il.
— J’ai de tristes pressentiments.
— Qu’est-il donc arrivé de nouveau pendant mon absence ?
— D’abord, j’ai vu M. Badoir.
— Eh bien ?
— Il était dans un état de stupeur, ou pour mieux dire de stupidité tel que j’ai pressenti aussitôt quelque danger. J’ai voulu le faire parler, mais je n’ai pu tirer de lui que des réponses évasives, incohérentes, pleines de réticences qui m’ont prouvé que je ne me trompais pas et qu’il était sous l’empire d’un trouble profond causé par quelque grave événement. Cet événement, quel était-il ? je ne sais, mais il devait nous intéresser autant que lui-même, puisqu’il est compromis dans toutes nos affaires. D’ailleurs, je l’ai compris à quelques mots qui lui échappaient de temps à autre et dans lesquels perçaient vaguement, exprimés en phrases obscures, énigmatiques et aussitôt démenties, l’avertissement de quelque grand danger et le conseil de m’y soustraire par la fuite. Mais, pressé de s’expliquer et de me dire nettement sa pensée, il me répondit qu’il n’avait rien à m’apprendre, rien à me conseiller et qu’il ne connaissait d’autres dangers que ceux dont nous étions aussi bien instruits que lui-même, puisque c’étaient nous qui les avions créés. Mais j’ai la conviction qu’il est survenu quelque chose de nouveau et de terrible, et que le silence lui a été imposé, sous peine de quelque redoutable châtiment.
— Vous lui avez montré la lettre venue de New-York ?
— Oui.
— Qu’a-t-il dit ?
— L’annonce formelle de la mort et de l’enterrement de Pierre Valcresson, événement qui eût dû le combler de joie, puisqu’il va le mettre incessamment en possession de l’immense héritage si longtemps convoité, cette annonce l’a jeté dans un ahurissement qui ressemblait à de l’idiotisme. Il lisait la phrase, me regardait ensuite, puis roulait autour de lui des yeux effarés, en jetant des exclamations inintelligibles ; bref, il donnait tous les signes d’une épouvante portée jusqu’au délire.
— Oui, vous avez raison, murmura sir Ralph avec inquiétude, il y a là -dessous quelque mystère.
Il reprit après une pause :
— Et les trente mille francs dont j’ai besoin pour la corbeille et autres menus frais ?
— Il les a promis pour demain. Mais ce n’est pas tout, reprit Mac-Field, j’ai un autre sujet d’inquiétude.
— Encore !
— Je vais sonner, un domestique va venir, examinez-le sans qu’il s’en aperçoive.
Il avait sonné tout en parlant.
Le domestique se présenta aussitôt.
C’était un garçon d’une trentaine d’années, les cheveux roux et coupés courts, la barbe entièrement rasée, avec quelque chose de britannique dans la physionomie.
— Monsieur a sonné ? demanda-t-il avec un léger accent.
— Procurez-moi donc le Times, lui dit Mac-Field.
— Tout de suite, milord, répondit le domestique en se retirant.
— Vous l’avez bien observé ? demanda Mac-Field à sir Ralph.
— Parfaitement.
— Et rien ne vous a frappé dans cet homme ?
— Il me semble vaguement avoir vu cette figure-là quelque part.
— Moi de même.
— Mais où donc ?
— Cherchez bien ; ne serait-ce pas hier, dans la soirée ?
— Attendez donc, s’écria tout à coup sir Ralph, n’est-ce point au théâtre des Variétés ?
— Justement.
— Votre voisin de gauche.
— C’est cela.
— Mais avec de gros favoris ?
— Énormes, parbleu !
— Et le même que nous avons revu à la sortie du théâtre, au café de Suède.
— Ce qui nous avait quelque peu inquiétés d’abord.
— Ainsi vous croyez le reconnaître ? reprit Mac-Field devenu tout sombre.
— Oui, à ses yeux jaune clair, à ses sourcils en broussailles.
— Alors, je ne me suis pas trompé, plus du doute maintenant, cet homme est à nos trousses.
— Un des détectives envoyés de New-York à Paris, n’est-ce pas ?
— J’en suis sûr.
— En ce cas, l’autre ne doit pas être loin.
— S’il n’est dans l’hôtel même comme son camarade.
— Alors, il ne s’agit pas de moisir ici.
— Il faut partir à l’instant.
— Mais sans prévenir !
— Naturellement.
— Et notre malle ?
— Demandons une voiture, emportons à la main ce que nous avons de plus précieux, tout ce qui pourrait nous compromettre et nous enverrons prendre la malle tantôt en nous entendant avec le cocher pour dépister ceux qui seraient tentés de le suivre.
— Ça va mal, Mac-Field, dit sir Ralph, il est grandement temps que nous partagions le million de la comtesse de Sinabria et que je devienne le mari de Tatiane, que je saurai enlever en dépit de M. Mauvillars, car elle sera ma sauvegarde contre lui et tous nos ennemis.
XXXII
DEUX DÉCOUVERTES
Un instant après la porte de la chambre s’ouvrait et le domestique rentrait avec le Times à la main.
— Merci, lui dit Mac-Field.
Et, comme le domestique se dirigeait vers la porte :
— Comment vous nomme-t-on, mon ami ? lui demanda-t-il.
— Peters, milord.
— Eh bien, Peters, veuillez nous faire approcher une voiture.
— Il y en a deux dans la cour de l’hôtel, milord.
— Eh bien, retenez-m’en une.
— À l’instant, milord, répondit Peters en s’inclinant.
Et il sortit.
— Vraie touche de domestique ! dit Mac-Field, qui l’avait suivi du regard jusqu’à la porte, il faut avouer qu’il joue bien son rôle. Mais, j’y songe, si c’en était un vrai ! Si je m’étais trompé en croyant reconnaître… Il faut absolument que je sache à quoi m’en tenir, et je le saurai tout à l’heure. Il est d’autant plus important que nous soyons fixés sur ce point, que, si c’est notre détective, son camarade ne peut être loin, et qu’en examinant avec attention toutes les têtes que nous allons rencontrer dans l’hôtel nous pourrions le découvrir.
Il se jeta dans un fauteuil et parut bientôt plongé dans de sombres réflexions.
— N’est-ce pas, lui dit sir Ralph, qui le regardait depuis quelques instants, n’est-ce pas que l’horizon n’est pas couleur de rose ?
— La situation est difficile, inquiétante, mais elle n’a rien de réellement effrayant, répondit Mac-Field ; avec de l’énergie, du sang-froid, de la résolution, nous pouvons sortir vainqueurs des périls qui nous entourent. À partir de cette heure, les événements vont se précipiter autour de nous et dans l’espace de trois jours tout sera dit, le sort aura prononcé irrévocablement, nous serons perdus ou sauvés. Heureusement, quant aux deux grandes affaires sur lesquelles repose notre fortune, nous avons tous les atouts dans la main et le succès est assuré ; je veux parler de votre mariage et du million que la comtesse de Sinabria s’est engagée à vous compter la veille de cette union. L’oncle Mauvillars, en dépit du peu de sympathie que vous lui inspirez et malgré la violente antipathie que ressent pour vous la jolie Tatiane, reconnaît l’impossibilité de vous refuser la main de sa nièce, et il est impossible qu’il découvre le mystérieux moyen grâce auquel vous avez su le forcer à donner son consentement. Quant à la comtesse de Sinabria, elle est prise comme dans les mailles d’un filet, écrasée sous une surabondance de témoignages plus éclatants l’un que l’autre et dont un seul, pris au hasard, suffirait pour prouver sa culpabilité.
Elle est entièrement à notre discrétion ; nulle puissance humaine ne peut la soustraire à notre pouvoir, et, se voyant absolument perdue, elle va tenter des efforts désespérés pour trouver le million qui peut la sauver. Sur ces deux points nous pouvons donc considérer la partie comme gagnée. Nul n’osera même essayer de nous la disputer. Mais la médaille a un revers, et ce revers, c’est les deux détectives dont nous soupçonnons la présence ici ; c’est là notre pierre d’achoppement, le grain de sable qui peut enrayer notre fortune. Il faut donc avant toute chose vérifier ce point capital, car nous ne pouvons faire un pas en avant tant que nous aurons cette épée de Damoclès suspendue sur notre tête. Si nos doutes se réalisent, le parti qui nous reste à prendre est bien simple : attendre tout bêtement que ces messieurs nous pincent, ce qui arriverait tout au moins le jour de la célébration de votre mariage, ou nous débarrasser du seul obstacle qui entrave désormais notre fortune en faisant à ces deux messieurs ce que nous ne voudrions pas qu’il nous fût fait, c’est-à -dire en les supprimant.
Sir Ralph tressaillit.
— Encore ! murmura-t-il.
— Eux ou nous, il faut choisir. Voyez si vous aimez assez la police pour vous élever jusqu’à ce degré d’abnégation.
— Non, certes, mais un nouveau meurtre…
— Le meurtre est inévitable ; la seule question est de savoir quelles seront les victimes, eux dans un coin de Paris, ou vous et moi, à New-York, en place publique et par la corde.
— Allons, le sort en est jeté ; sachons d’abord si nous nous sommes trompés ou non.
Les deux associés quittèrent aussitôt leur appartement, après avoir bourré leurs poches de tout ce qu’ils avaient de précieux ou de compromettant.
— Entrons d’abord au bureau, où j’aperçois le maître de la maison, dit Mac-Field à sir Ralph.
— Pourquoi faire ?
— Vous allez le savoir.
Ils entrèrent.
— Ah ! monsieur, dit Mac-Field au patron, je suis bien aise de vous rencontrer.
Celui-ci s’inclina.
— Je tenais à vous féliciter au sujet du domestique qui nous sert.
— Son nom, milord ? demanda le patron.
— Peters.
— Je suis heureux d’apprendre que vous ayez à vous louer de son service, milord.
— Je n’ai que des éloges à faire de lui ; il doit être attaché à votre maison depuis fort longtemps ?
— Au contraire, milord.
— Ah !
— Il est entré ici…
Il s’interrompit pour consulter sa mémoire :
— Tenez ; reprit-il, le lendemain même du jour où milord venait habiter mon hôtel.
— Tiens, tiens, dit Mac-Field en jetant à sir Ralph un regard d’intelligence.
— Oui, un de mes domestiques étant subitement tombé malade m’a recommandé ce garçon, dont il pouvait me répondre, car ils sont cousins, paraît-il, et, en effet, je n’ai qu’à me louer de lui depuis qu’il est chez moi.
— Je lui ai demandé une voiture.
— Elle vous attend, milord.
Mac-Field et sir Ralph quittèrent le bureau.
— Eh bien, murmura Mac-Field à l’oreille de son ami, que dites-vous de ce domestique qui entre ici juste vingt-quatre heures après nous et de ce cousin qui tombe précisément malade ce jour-là pour lui céder sa place ?
— Je dis qu’il n’y a plus de doute et que nous avons l’ennemi sur nos talons.
— Il n’y a donc plus à hésiter, nous quittons l’hôtel pour n’y plus rentrer.
— Je le crois bien, je logerais plutôt à la belle étoile.
— Et dès demain il faut nous en débarrasser.
— Ainsi que de son camarade ; mais celui-là , nous ne le connaissons pas.
Ils étaient arrivés sous le vestibule.
— Jack, cria une voix, avancez.
Cette voix était celle de Peters.
Au même instant, une voiture élégante, conduite par un cocher couvert d’une livrée confortable, s’avança sous le vestibule et s’arrêta aux pieds de milord.
Celui-ci y prit place, ainsi que sir Ralph, en criant au cocher :
— Au bois !
Le cocher excita son cheval par un claquement de langue et la voiture roula lentement sur l’asphalte du vestibule.
Mais, avant de s’éloigner, Jack avait échangé avec Peters un signe et un clignement d’yeux presque imperceptibles.
La voiture tourna la rue de Rivoli à droite et cinq minutes après elle roulait dans la grande allée des Champs-Élysées.
— Que dites-vous de notre cocher ? demanda alors Mac-Field à sir Ralph.
— Il conduit fort bien.
— Que pensez-vous de lui ?
— Que voulez-vous que j’en pense, sinon qu’il me paraît connaître parfaitement son métier ?
— Il a d’autant plus de mérite à cela que ce métier n’est pas le sien.
— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire que ce cocher n’est autre chose que le camarade de Peters.
— Le second détective ?
— Justement.
— Pas possible.
— Je vous en réponds.
— Comment le savez-vous ?
— Toujours préoccupé de la pensée de connaître le confrère de Peters, je n’ai pas perdu de vue celui-ci à partir du moment où je l’ai vu paraître sous le vestibule ; or, comme nous montions en voiture, il a saisi la minute où je me penchais pour y entrer et a rapidement échangé avec notre cocher quelques signes que j’ai surpris.
— C’est heureux.
— Doublement heureux, en ce que, d’abord, nous sommes sur nos gardes vis-à -vis de cet homme et qu’ensuite nous connaissons maintenant nos deux ennemis.
— Que faire maintenant ?
— Endormir leur défiance en rentrant à l’hôtel Meurice.
— Et puis ?
— Écrire à Collin ou au père Vulcain pour leur assigner un rendez-vous chez un des marchands de vin les plus rapprochés de l’hôtel, car il faut que, demain soir au plus tard, nous ayons fait disparaître ces deux obstacles ; et, quoique je n’aie aucun plan arrêté, il est certain que nous aurons besoin d’un aide.
— Oui, mais où trouver Collin et le père Vulcain ?
— N’avez-vous pas été fréquemment en relations avec eux depuis quinze jours ?
— Oui, et alors je connaissais leur adresse ; ils habitaient ensemble un hôtel garni de la rue de Lorillon.
— Pourquoi ne l’habiteraient-ils plus ?
— Parce que, depuis l’affaire du Ruysdaël, ils ont éprouvé le besoin de changer de domicile.
— Et vous ne connaissez pas leur nouvelle demeure ?
— Non.
Sir Ralph reprit après un moment de réflexion :
— Mais je connais une affreuse gargote de la barrière des Trois-Couronnes dont la maîtresse, séduite par le langage et les manières du vieux modèle, dans lequel elle voit un artiste, a ouvert à celui-ci un crédit illimité ; et si, comme je le suppose, il a déjà mangé avec son ami Collin le prix du Ruysdaël, qu’il aura cédé pour peu de chose au vieux Mardochée, il a dû retourner à la gargote où il a l’œil, pour parler sa langue.
— Quand peut-on le trouver ?
— Le plus sûr est d’y aller à l’heure du dîner.
— À quelle heure dîne-t-on dans ces endroits-là ?
— Toute la soirée ; on dîne d’abord et on boit ensuite.
— Alors il faut y aller tantôt, après notre dîner.
— C’est entendu.
On était arrivé au bois.
Ils approchaient du lac, lorsque leur voiture se croisa avec un cavalier dont la vue fit tressaillir Mac-Field.
— Qui donc vient de passer ? lui demanda sir Ralph.
— Paul de Tréviannes.
— Ah ! oui, le futur époux de la belle madame Taureins.
— Oh ! ce n’est pas encore fait.
— Rien ne s’y oppose plus, puisque M. Taureins lui a fait la surprise de se laisser mourir ; ce n’est plus qu’une question de temps.
— Qui sait ? il suffit d’un duel pour mettre fin à tous les beaux rêves de ces deux amoureux, et… j’y songe sérieusement.
— Ah ! ce pauvre M. de Tréviannes ! dit sir Ralph en souriant.
XXXIII
LES MYSTÈRES DE LA GLOIRE
Le fameux restaurant où le père Vulcain prenait ses repas à l’œil était le plus achalandé de la barrière des Trois-Couronnes.
Il avait pour enseigne : au Sauvage, et était tenu par la veuve Follenfant, dont la vaste corpulence, la tête toute ronde, le visage joufflu et le nez rubicond juraient quelque peu avec son nom.
Femme de tête, quoique sujette aux faiblesses de cœur, la veuve Follenfant avait fait de son établissement un restaurant, un cabaret, une salle de danse et un concert, ce qui expliquait la popularité dont il jouissait à un quart de lieue à la ronde.
À la suite de la première salle, qui servait de restaurant et de cabaret, s’élevait au fond, exhaussée de trois marches au-dessus du niveau de la première pièce, une seconde salle affectée à la danse et au concert.
On y dansait quatre jours par semaine : le lundi, le jeudi, le samedi et le dimanche.
La danse alternait avec le concert, assez bruyant pour contenter les oreilles les plus difficiles, car l’orchestre était composé d’un trombone, d’un cornet à piston, d’une clarinette, d’un flageolet et de huit tambours travaillés par un seul homme, le sauvage.
Ce sauvage, aux formes athlétiques, que dessinait un maillot couleur chair, le menton orné d’une barbe noire qui lui descendait sur la poitrine, le front ceint d’une couronne de plumes éclatantes, l’œil étincelant et le regard terrible, exerçait un puissant prestige sur les femmes, qui se pâmaient d’admiration en le voyant manœuvrer ses huit tambours.
On disait même que l’aimable veuve n’avait pu rester insensible à tant de séductions, et le père Vulcain remarquait avec une sombre mélancolie que, depuis quelque temps, madame Follenfant avait quitté le simple bonnet blanc, pour parer sa tête d’un gracieux bonnet à rubans bleus.
Nous le trouvons en ce moment assis à une table assez éloignée du comptoir de la veuve, qui lui a fait servir un litre à douze à cette distance respectueuse, au lieu de le rapprocher de son comptoir, comme c’était sa coutume avant le jour funeste où son cœur fut troublé par les effets de torse et les regards incendiaires du sauvage.
Comme de coutume, il boit avec Collin en prêtant une oreille distraite à l’étrange mélodie qui se fait entendre au fond, et où s’égrènent, sur le diapason le plus aigu, des chapelets de couacs sortis du bec de la clarinette.
Enfin le sauvage termine par un roulement formidable de gammes ascendantes et descendantes, et enthousiasme les auditeurs, par un finale qui simule parfaitement les éclats du tonnerre.
— Ah ! le gueux ! le gredin ! le va-nu-pieds ! a-t-il du zinc ! s’écrie l’aimable veuve, les traits épanouis et se tordant de ravissement dans son comptoir.
C’était sa manière d’exprimer son enthousiasme et ces petits noms étaient réservés à ceux qui avaient trouvé le chemin de son cœur.
Aussi le jour où le père Vulcain l’avait entendue donner au sauvage, à la suite d’un de ces roulements dont il avait le secret, la douce épithète de va-nu-pieds, il s’était dit : Je suis un homme perdu.
Son pressentiment ne le trompait pas, le lendemain il était relégué à trois mètres du comptoir de l’aimable veuve, et la chopine d’absinthe était remplacée par le litre à douze.
Et, à partir de cette heure fatale, toutes ses poses d’artiste, qui naguère avaient fasciné la trop sensible Follenfant, la laissèrent parfaitement indifférente.
C’est en vain qu’il se renversait en arrière sur sa chaise, les mains dans les poches, la cravate dénouée, le gilet débraillé, le feutre mou négligemment jeté tantôt en arrière, tantôt sur les yeux, tantôt sur l’oreille droite ou sur l’oreille gauche, en vain qu’il imprimait tour à tour à ses traits pâles et ravagés les expressions les plus romantiques, l’amertume, la douleur, la raillerie méphistophélique ou la mélancolie byronienne ; en vain qu’imitant un célèbre compositeur de musique, il poussait le mépris des conventions bourgeoises jusqu’à mettre ses pieds sur la table ; rien n’y faisait, un roulement d’Alcindor, c’était le nom du sauvage, éclipsait toutes ces savantes combinaisons et la veuve Follenfant ne remarquait ni les sourires amers, ni le galant débraillé de l’infortuné modèle.
Les musiciens, ayant quelques instants d’entr’acte, s’étaient précipités, les uns vers le comptoir, les autres vers les tables où les attendaient des amis.
L’un d’eux, sa clarinette à la main, était venu s’asseoir en face de Collin et du père Vulcain.
C’était Arthur, le digne rejeton des époux Claude.
— Le litre est vide, dit-il en jetant un regard sur la bouteille, plus un verre pour les amis ; ah ! je vous reconnais bien là .
Il frappa sur la table.
— Un litre à quinze et c’est moi qui paye, cria-t-il au garçon.
Le garçon partit et revint aussitôt, tenant le litre de la main gauche et tendant la main droite avant de le poser sur la table.
— Noble confiance ! dit Arthur en tirant quinze sous de sa poche.
Puis remplissant les trois verres jusqu’aux bords :
— Allons, ma pauvre vieille, dit-il au père Vulcain, Vénus t’abandonne, jette-toi dans les bras de Bacchus.
Le modèle vida consciencieusement son verre, mais sans se dérider.
— C’est égal, reprit Arthur en jetant un regard du côté de la veuve Follenfant, j’avoue qu’il est difficile de renoncer à une aussi charmante créature. Tenez, contemplez son nez : avez-vous jamais vu un rouge plus vif et plus franc ? Vu comme cela, à distance, sous ce joli bonnet à rubans bleus, on dirait un coquelicot au milieu des bluets ; c’est pas une figure, c’est un tableau champêtre.
— Tais-toi, dit le père Vulcain avec un accent pénétré, oh ! tais-toi, ne me parle pas d’elle.
— Suffit, je m’arrête ; car, moi aussi, j’ai connu les tortures de l’amour.
— Tu as aimé, toi ?
— Hélas !
— Une cuisinière ?
— Non, son premier commis, une laveuse de vaisselle qui s’était fait un nom dans l’art difficile de nettoyer les plats, et qui emporte son secret…
— Dans la tombe ?
— Pas si loin, dans une baraque de saltimbanques, où elle attire la foule par son aimable embonpoint ; elle pèse cent cinquante kilos, elle a fait l’admiration des cours étrangères, elle sait toutes les langues, y compris l’auvergnat, et charme les hommes du monde par son esprit, ses manières exquises et un choix d’expressions qui trahit sa haute naissance ; prix d’entrée : 25 centimes ; pour 50 centimes on est admis à lui prendre les mollets, dont la forme, d’une pureté incomparable, dégote les plus beaux modèles de l’antiquité et fait le désespoir des sculpteurs modernes. Les plus célèbres, MM. Carrier-Belleuse, Dubois, Chapu, Mathieu-Meusnier, ont offert des sommes folles pour les mouler ; mais sa pudeur s’y est toujours refusée. Ce n’est pas tout : sa main a été demandée par différents princes étrangers, et même par plusieurs cercles diplomatiques ; elle les a tous repoussés, car ce qu’elle ambitionne, avant tout, c’est le suffrage du peuple, le vôtre, messieurs. Entrez, entrez, suivez le monde ! entrez, venez voir la Belle Espagnole, qui n’a plus que quelques semaines à passer en Europe, avant de se rendre à la cour du shah de Perse, qui brûle du désir de la voir, car personne n’ignore ici les honneurs tout particuliers qu’on rend à l’embonpoint dans ces contrées tropicales.
Après avoir débité avec emphase ce petit boniment, Arthur ajouta :
— Voilà ce qu’on dit par toute la France de l’ancien objet de ma flamme ; c’est flatteur pour mon amour-propre, et, s’il faut l’avouer, mon seul but, en cultivant la clarinette, est d’aller la rejoindre en m’engageant dans la troupe en qualité de musicien.
— C’est une idée ; quel est ton maître de clarinette ?
— La nature, répondit modestement le gamin.
— Eh bien, ce n’est pas pour te vanter, mais je puis t’affirmer que tu es de première force sur le couac. J’ai entendu bien des clarinettes d’aveugle, mais jamais…
Arthur l’interrompit.
— Je vais vous dire, répliqua-t-il ; dès mes débuts dans cet instrument, je m’aperçus tout de suite qu’un penchant irrésistible m’entraînait vers le couac ; alors je me suis fait ce raisonnement : Arthur, mon ami, ta vocation est là , n’essaye pas d’y résister, au contraire. Tu es ce qu’on appelle dans les arts un tempérament ; au lieu de combattre le couac, affirme-le ; c’est ce que font quelques peintres et certain compositeur allemand, et ça leur réussit ; les imbéciles coupent dedans. On dit d’eux : C’est un tempérament. Imite-les, pousse au couac ; au lieu d’en lâcher un timidement, de temps à autre et malgré lui, multiplie-les avec audace ; alors, au lieu d’y voir une faiblesse, on les prendra pour des variations ; tu seras un audacieux novateur aux yeux de la foule idiote et des prétendus connaisseurs : tu feras école d’abord, et fortune ensuite.
— Ah ! çà , dit Collin en considérant Arthur avec stupeur, où diable vas-tu chercher toutes ces idées-là ?
— Je lis les feuilles et j’écoute les rapins chez lesquels je pose.
— Pour les Ganymède ? demanda Vulcain.
— Non, pour les Tortillard.
— Ça se comprend mieux.
— Ne vous gênez pas, faites comme chez vous. Mais, pour en revenir à mon système, ça m’a réussi ; les artistes viennent m’entendre et je suis discuté. On m’appelle déjà crétin, idiot, gâteux, âne bâté.
Ça marche, ça me fait des prosélytes, ma réputation grandit ; c’est comme ça que tous les tempéraments ont commencé, c’est même comme ça qu’ils s’affermissent ; bref, je suis sur le chemin de la gloire.
Arthur fut interrompu par deux individus en blouse, qui vinrent sans cérémonie s’asseoir à la table où buvaient les trois amis.
Arthur commençait à les regarder de travers, quand il s’écria tout à coup :
— Tiens, c’est sir Ralph.
— Et lord Mac-Field, ajouta Collin.
— Ce n’est pas la peine de le faire savoir à tous ceux qui nous entourent, dit vivement sir Ralph.
— Ravi de vous rencontrer, reprit Arthur.
— Pourquoi cela ? répondit sir Ralph.
— J’ai droit à la prime de cent francs pour propager l’idiotisme ; j’ai complètement réussi : M. Pontif n’est plus un homme, c’est un crétin.
— Je le sais et voilà la somme promise, dit sir Ralph en tirant de son porte-monnaie un billet de banque qu’il remit à Arthur.
Celui-ci l’empocha avec empressement et courut à son orchestre, où se faisaient déjà entendre quelques accords.
— Maintenant, mes enfants, dit sir Ralph à Collin et au vieux modèle, j’ai quelque chose à vous proposer.
— Si c’est une mauvaise action, ça me va, répondit le père Vulcain d’un air rageur ; je suis d’une humeur à tout casser.
XXXIV
UNE IDÉE DE SIR RALPH
Le lendemain soir, vers huit heures, sir Ralph entrait chez un marchand de vin de la rue de la Sourdière.
C’était là qu’il avait donné rendez-vous au père Vulcain, qu’il trouva, en effet, dans un cabinet de l’établissement.
Le vieux modèle était seul, ainsi qu’il avait été convenu la veille.

Toujours mélancolique, mais non moins altéré, il va sans dire qu’il était en tête à tête avec une bouteille d’absinthe, qu’il buvait pure, suivant sa coutume.
— Sir Ralph, dit-il à celui-ci dès qu’il l’aperçut, mon fils est un sans-cœur.
— Je ne dis pas le contraire, répondit sir Ralph.
— Oui, c’est un sans-cœur, reprit le père Vulcain d’une voix quelque peu empâtée, faut pas avoir d’âme pour mettre son père dans la nécessité de voler un tableau pour subvenir à ses besoins. Pousser son père au vol ! quelle dépravation ! Feuilletez l’histoire et même la mythologie, vous n’y trouverez rien de pareil.
— Je ne dis pas non, père Vulcain, vous êtes une victime de l’amour paternel, c’est convenu ; mais ce n’est pas pour vous décerner une couronne de martyr que je suis ici ce soir ; parlons donc de l’affaire pour laquelle je vous ai fait venir.
— Volontiers, sir Ralph, mais d’abord y a-t-il de la braise au bout ?
— Deux cents francs.
— Accepté.
Il reprit on se grattant la tête :
— Serait-il indiscret de vous demander si on éclaire ?
— C’est mon habitude, tenez, voici deux louis.
— Quarante francs ! s’écria le vieux modèle en faisant miroiter les deux pièces d’or à la lueur de la chandelle qui éclairait le cabinet.
— Et le reste immédiatement après l’opération, reprit sir Ralph.
— Bon ! voilà ce que j’appelle des affaires bien faites ; mais il faudrait pourtant m’apprendre en quoi elle consiste, cette opération.
— Naturellement.
Puis, posant sur la table deux objets que n’avait pas remarqués le père Vulcain :
— D’abord, reprit-il, voilà les accessoires dont nous aurons besoin.
Ces objets étaient : une pince en fer et un grand carton noir d’un mètre carré.
— Eh ! bon Dieu ! que voulez-vous faire de cela ? s’écria le modèle.
— C’est ce que je vais vous apprendre.
Et, lui montrant la pince :
— D’abord, êtes-vous de force à manier cela ?
Le père Vulcain prit la pince et la souleva :
— Elle est lourde, dit-il, mais c’est égal, on est de taille à s’en servir. Mais que diable voulez-vous faire de cette pince ?
— Père Vulcain, avez-vous confiance en moi ?
— Vous m’avez toujours payé largement, je ne connais que ça ; vous êtes un homme, vous avez ma confiance.
— Cette confiance est-elle assez grande, assez aveugle pour vous décider à faire tout ce que je vous commanderai, sans même chercher à comprendre !
— Donnez-moi seulement votre parole que ma tête ne court aucun risque dans l’affaire, c’est tout ce que je demande.
— Pas le moindre risque.
— Alors je suis votre homme, allez-y.
— Écoutez-moi donc ; vers le milieu de cette rue, il y a un regard d’égout.
— Pristi ! Vous pouvez vous vanter de savoir votre Paris ; connaître jusqu’aux regards d’égouts de chaque rue. C’est fort.
— Je ne connais que celui-là , c’est le seul dont je m’inquiète. Or, avez-vous remarqué la façon dont les égoutiers enlèvent les plaques de fer qui forment ces regards !
— Avec une pince comme celle-ci, j’ai vu ça cent fois.
— Eh bien, vous savez maintenant à quoi est destinée cette pince.
— Vous voulez que j’ouvre ce regard ? demanda le modèle stupéfait.
— Justement.
— Mais que prétendez-vous ?…
— Vous m’avez promis une confiance aveugle.
— Suffit, muet comme un barbillon ; mais c’est égal, c’est une drôle d’idée.
— Le regard ouvert, vous vous tiendrez là en sentinelle pour empêcher les passants d’en approcher.
— Je crois bien, un saut de dix mètres, ça les gênerait, surtout après les torrents de pluie qui viennent d’inonder Paris et qui ont fait de chaque égout un vrai fleuve, un fleuve jaune, plus jaune que celui de la Chine et plus rapide que les cataractes du Nil. Tomber là -dedans ! Brrr ! Ça vous fait passer des frissons dans le dos, rien que d’y penser.
— Comme divertissement, çà laisse à désirer, j’en conviens ; mais revenons à notre affaire. Vous vous demandez à quoi peut servir ce grand morceau de carton noir, n’est-ce pas ?
— Je me le demande beaucoup.
— Et vous ne devinez pas ?
— Pas le moins du monde.
— Eh bien ; aussitôt le regard ouvert, vous le couvrirez avec ce carton.
— Bah ! fit Vulcain stupéfait.
— Vous comprenez ?
— De moins en moins.
— Peu importe ; l’essentiel est que vous vous conformiez exactement, minutieusement à toutes mes recommandations.
— C’est égal, je voudrais bien savoir…
— Encore ! dit sir Ralph en le regardant fixement.
— Suffit, on tait son bec.
— Vous resterez donc là pour éloigner les passants, mais vous porterez particulièrement v0s regards du côté de la rue Saint-Honoré.
— Bon.
— Vous ne bougerez pas de votre poste jusqu’au moment où vous verrez venir de ce côté, et sur le trottoir près duquel se trouve le regard d’égout, deux hommes qui marcheront d’un pas rapide.
— Après.
— Arrivés à vingt pas de vous, l’un de ces hommes toussera, tenez, comme cela.
Sir Ralph fit entendre une toux sonore et d’un timbre tout particulier.
— Je la reconnaîtrai, dit le père Vulcain. Que faudra-t-il faire alors ?
— Vous éloigner.
— C’est tout.
— Oui, votre rôle sera fini, et le mien commencera.
— C’est bien ; à présent je connais mon affaire et vous pouvez compter sur moi.
— Sortons, car c’est à l’instant même qu’il faut vous mettre à l’œuvre.
Sir Ralph prit la pince, qu’il cacha sous son paletot, le père Vulcain se chargea du carton et ils sortirent tous deux.
— Allons visiter les lieux ensemble, dit sir Ralph au modèle.
Ils tournèrent à gauche en sortant de chez le marchand de vin et se dirigèrent vers la rue Neuve-des-Petits-Champs.
La nuit était si noire et si brumeuse qu’on voyait à peine à dix pas devant soi ; mais la rue, lavée par la pluie abondante qui avait inondé Paris pendant plus de deux heures, était d’une netteté qui permettait de marcher au hasard sans craindre la boue.
— Tenez, voilà ce que nous cherchons, dit sir Ralph au bout de quelques instants.
Et il montra au père Vulcain la plaque de fer ronde qui fermait le regard d’égout.
— Bon ! donnez-moi la pince et venez quand vous voudrez.
— Tenez, dit sir Ralph, qui semblait réfléchir depuis un instant, voilà une maison en construction qui vous rendra un grand service.
— Lequel ?
— Vous allez prendre une vingtaine de moellons et les répandre sur le trottoir sur un espace de dix pas en avant du regard.
— Encore une drôle d’idée !
— Ne cherchez pas à la comprendre, vous savez que c’est inutile. Allons, je vous quitte, à bientôt, et n’oubliez aucune de mes recommandations.
Cinq minutes après sir Ralph rentrait à l’hôtel Meurice, situé à deux cents pas de la rue de la Sourdière.
Il allait gravir l’escalier lorsqu’il s’entendit appeler.
C’était le maître de l’hôtel.
— Monsieur, lui dit-il, je dois vous prévenir que vous allez trouver lord Mac-Field dans un triste état.
— Que lui est-il donc arrivé ? demanda sir Ralph très-inquiet.
— Il s’est trouvé subitement malade, il y a une heure et il est au lit en ce moment, le corps agité par de violents frissons et les traits couverts d’une pâleur effrayante.
— Qu’est-ce que cela peut être, grand Dieu ?
Et il s’élança rapidement dans l’escalier.
Un instant après, il rentrait dans le bureau de l’hôtel, haletant et les traits bouleversés.
— Mon ami me paraît bien mal, monsieur, dit-il au patron, je cours chercher un médecin.
— Il y en a un tout près de l’hôtel, monsieur, si vous voulez qu’on l’aille chercher.
— Merci, nous avons à Paris un médecin américain de nos amis dans lequel lord Mac-Field a la plus grande confiance, c’est celui-là qu’il veut voir et je cours le chercher moi-même. Seulement, comme je connais fort peu les rues de Paris, le soir surtout, je vous prierai de me faire accompagner par un domestique.
— Très-volontiers.
Il allait s’élancer hors de son bureau.
— Ah ! lui dit sir Ralph, je voudrais avoir Peters, il a toute notre confiance.
— Je vais l’appeler.
— Au reste il ne sera pas longtemps absent, notre médecin demeure tout près d’ici, rue de la Sourdière.
XXXV
UN DRAME DANS UN ÉGOUT
Sir Ralph était donc sorti de l’hôtel Meurice avec Peters, qui, pour la circonstance, avait échangé sa livrée contre une jaquette.
— La rue de la Sourdière n’est pas loin d’ici, n’est-ce pas ? demanda sir Ralph au domestique.
— Tout près, milord, répondit celui-ci, convaincu que sir Ralph ne réclamerait pas contre ce titre.
— Tant mieux, car l’état de mon noble ami m’inspire les plus vives inquiétudes.
— Il est certain, répondit Peters, qu’un changement aussi complet en moins d’une heure annonce quelque chose de grave.
— Aussi ai-je hâte de savoir ce qu’en va dire son médecin.
— Tenez, milord, reprit Peters, nous entrons dans la rue de la Sourdière.
— En effet, il me semble la reconnaître, quoique je n’y sois passé qu’en plein jour.
Sir Ralph s’engagea sur le trottoir de gauche, et naturellement Peters l’y suivit.
Au bout de quelques instants, sir Ralph vit se dessiner de loin, à deux pas du trottoir, la silhouette d’un homme dans lequel il reconnut parfaitement le père Vulcain.
On fit cinquante pas encore.
Alors il fut pris d’un accès de toux dont la violence le força à s’arrêter quelques secondes.
Quand il se remit en marche, le père Vulcain avait disparu.
Mais, en plongeant son regard sur tous les points de la rue, il l’aperçut, collé dans l’angle d’une porte qui faisait face à la place qu’il venait de quitter.
La minute fatale avait sonné, on approchait du gouffre au-dessus duquel le vieux modèle avait dû jeter le carton noir pour le rendre invisible.
— Qu’est-ce que c’est que cela ? dit tout à coup sir Ralph, des tas de moellons ; excellente idée pour obtenir des jambes cassées.
Il sauta à droite et continua son chemin sur la chaussée.
Peters fit comme lui.
On fit dix pas encore.
Puis un cri se fit entendre.
Peters avait mis le pied sur le carton et venait de disparaître dans la bouche de l’égout.
Craignant qu’il ne s’accrochât à lui s’il restait à portée de sa main, sir Ralph avait fait un bond de côté au moment où il l’avait vu sur le bord du gouffre.
Puis il s’était arrêté pour l’y voir plonger.
Mais il resta stupéfait en apercevant sa tête au niveau du pavé.
Par un mouvement instinctif, le malheureux Peters avait étendu les bras en sentant le sol manquer sous ses pieds, et les deux mains, s’accrochant à chaque bord, le soutenaient au-dessus de l’abîme.
Malheureusement pour lui, l’ouverture de l’égout était trop grande pour qu’il pût poser les coudes de chaque côté, de sorte que ses bras, tendus dans toute leur longueur, manquaient de force pour soutenir le poids de son corps, qui s’enfonçait lentement au-dessous du niveau de la rue.
Croyant à un accident, l’infortuné se mit à crier :
— Sir Ralph, à moi ! accourez vite ou je suis perdu !… À moi ! à moi ! sir Ralph !
Sir Ralph s’approcha et le regarda.
Il était livide et ses traits, bouleversés par l’épouvante, étaient devenus méconnaissables en quelques secondes.
Il y eut un moment de silence pendant lequel on entendit, dans les sombres profondeurs du gouffre, le clapotement sinistre de l’eau se précipitant avec furie à travers l’égout trop étroit pour la contenir.
— Entendez-vous ce bruit ? dit tranquillement sir Ralph à Peters qui le regardait avec des yeux effarés et pleins d’ardentes supplications, c’est l’eau fangeuse des rues de Paris qui s’engouffre dans l’égout avec la violence et la rapidité vertigineuse des plus impétueux torrents. Fichue mort, n’est-ce pas ? que celle qu’on trouve dans cet étroit boyau, plus noir que l’enfer, plongé dans ces vagues de boue, plus furieuses que celles de l’océan, et qui vous emportent, dans une nuit impénétrable, vers un inconnu effrayant, en vous broyant à chaque pas contre les parois qui sont les falaises de cette mer souterraine ? Eh bien, cette mort sera la vôtre, maître Peters, et vous allez reconnaître tout à l’heure, en plongeant dans ce gouffre infernal, que tout n’est pas rose, dans le noble métier de détective.
Le malheureux comprit tout alors, et il jeta un cri aigu, dans l’espoir d’attirer quelque passant.
— Un second cri, lui dit sir Ralph, et je te fais disparaître d’un coup de pied sur le crâne ; sinon, si tu es gentil, je te laisse t’affaisser tranquillement, peu à peu, à ton aise, jusqu’à ce que, épuisé, à bout de forces, tu fasses le plongeon de toi-même, à ton heure et sans y être contraint. Cela te fera peut-être gagner une minute, ce qui est précieux pour un homme dans ta position, et moi j’y trouverai la joie de voir se prolonger l’agonie de celui qui avait fait quinze cents lieues tout exprès pour me pincer, m’emmener à New-York comme une bête curieuse et donner à mes aimables concitoyens l’amusant spectacle de ma pendaison.
Pendant qu’il parlait, l’infortuné détective s’affaissait de plus en plus.
— Monsieur ! milord ! balbutia-t-il, grâce ! faites-moi grâce et je suis à vous, à vous pour la vie, je serai votre chien, votre esclave ! Oh ! grâce ! grâce !
Et des lueurs d’agonie passaient dans ses yeux.
Et ses doigts crispés se contractaient sur le cercle de fer auquel il se retenait avec l’énergie désespérée que donne la peur de la mort.
Mais ses bras continuaient à se détendre et sa tête descendait toujours par degrés insensibles, mais non interrompus.
De temps à autre, un frisson d’horreur parcourait tout son corps quand il entendait gronder avec fracas, au fond du gouffre noir, le torrent fangeux dont les voix confuses, effroyables sirènes, semblaient l’appeler comme une proie attendue.
En ce moment, une voix s’écria tout à coup au-dessus de lui :
— Ah ! mais non, non, je ne veux pas, je ne veux pas sa mort, j’ai trempé dans l’affaire et il y va de ma tête, je ne veux pas.
C’était le père Vulcain qui s’était approché peu à peu et qui venait de comprendre l’horrible drame qui se passait sous ses yeux.
— Allons, retirez-vous, c’est moi seul que cela regarde et j’en prends toute la responsabilité, lui dit sir Ralph en le repoussant rudement.
— Merci, ce n’est pas vous qui me tirerez de dessous le couteau de la guillotine si on m’y envoie ! s’écria le modèle, ma peau est en jeu, et je vous dis que je ne veux pas de ça.
Et, se précipitant vers l’ouverture de l’égout, il allongea le bras pour saisir le détective au collet.
Celui-ci, dont les oreilles tintaient et dont la raison s’obscurcissait depuis un instant, n’avait rien compris au dialogue qui s’échangeait au-dessus de sa tête.
Entendant deux voix, il avait supposé qu’il avait deux ennemis.
Quand il se sentit toucher l’épaule, l’une de ses mains s’abattit sur le vêtement du modèle, auquel elle s’attacha comme un crampon de fer, tandis que l’autre restait fixée au bord du gouffre.
— Lâchez-moi, mais lâchez-moi donc ! ou nous sommes perdus tous deux ! s’écria tout à coup le père Vulcain d’une voix pleine d’épouvante, lâchez-moi vite, vous m’entraînez avec vous.
Mais, avec cet instinct animal, irraisonné de l’homme qui se sent perdu, le détective croyait avoir trouvé là un moyen de salut, et il ne voulait pas lâcher.
Et le père Vulcain se sentait attirer dans l’abîme par la force irrésistible de ce désespéré.
— Sir Ralph, s’écria-t-il d’une voix affolée, saisissez-moi, retenez-moi, il m’entraîne.
Mais la tête avait déjà disparu dans le gouffre, et sir Ralph ne bougeait pas.
— Tu l’as voulu, imbécile, tire-toi de là si tu peux, répondit sir Ralph ; d’ailleurs, tu en sais trop, tu bois trop et tu causes trop ; va faire un tour dans l’égout, c’est le tombeau des secrets.
Il achevait à peine, quand un cri se fit entendre.
Le père Vulcain venait de disparaître.
Au même instant, sir Ralph voyait cinq ou six personnes déboucher de la rue Saint-Honoré dans la rue de la Sourdière.
Il courut à la plaque de fer qui avait été enlevée par le modèle, la roula jusqu’à la bouche de l’égout et l’y ajusta d’un coup de pied.
Un cri sourd s’éleva du gouffre.
Il y avait dans ce cri un accent si déchirant que sir Ralph en frissonna.
Il jeta un regard sur l’effroyable tombe dans laquelle il venait d’engloutir deux hommes, et au bord de la plaque de fer il crut voir remuer quelque chose.
Il se pencha, et à la lueur du bec de gaz il vit cinq doigts qui, détachés de la main, se contractaient comme les cinq tronçons d’une vipère.
C’était la main du détective qui avait été coupée.

XXXVI
L’AUTRE
Cinq minutes après, sir Ralph était de retour à l’hôtel Meurice.
— Malédiction ! s’écria-t-il en entrant dans le bureau et en se frappant le front d’un air désespéré ; notre ami n’était pas chez lui.
— Prenez le médecin qui demeure près d’ici, lui dit le patron ; milord est si malade que…
— Non, non ! il n’a confiance qu’en notre ami, le docteur Wilson, et je cours à sa recherche.
— Et Peters ?
— Ah ! voilà . On nous a dit que le docteur avait été appelé en même temps par deux malades, dont on nous a donné les adresses en nous assurant que nous le trouverions certainement chez l’un des deux. Le premier demeure à Neuilly et l’autre au boulevard Poissonnière. Pour ne pas perdre de temps j’ai chargé Peters de se rendre à cette dernière adresse, et moi, je suis accouru ici pour savoir d’abord comment se trouve mon ami, puis pour prendre une voiture et courir à Neuilly. Je viens de voir Jack, le cocher qui nous a conduits hier au bois ; il m’attend sur son siège ; je monte savoir des nouvelles de mon ami, et dans cinq minutes nous partons pour Neuilly.
Quittant aussitôt le bureau, il gravit rapidement l’escalier et s’élança dans la chambre de Mac-Field.
Celui-ci était au lit ; son teint était livide, mais son œil était aussi brillant que de coutume et il paraissait fort calme.
— Eh bien, demanda-t-il à sir Ralph, et Peters ?
Sir Ralph alla fermer la porte à double tour ; puis, revenant s’asseoir près de Mac-Field :
— Si jamais nous sommes arrêtés, lui dit-il en baissant la voix par surcroît de précaution, ce ne sera pas par celui-là .
— C’est fait ? demanda Mac-Field avec quelque émotion.
— C’est fait.
— Si vite ?
— Dix minutes après avoir quitté l’hôtel, il faisait le plongeon dans l’égout, et, vu la rapidité du courant qui l’emporte, il doit être loin en ce moment, et dans quel état ! une statue de fange, voilà ce qu’on retrouvera.
— Ce qu’il y a de fâcheux dans cette affaire, c’est qu’on ait été obligé de prendre pour confident et pour complice cet ivrogne de père Vulcain.
— Ah ! dit sir Ralph avec un air singulier je réponds de lui.
— Je ne partage pas votre confiance.
— Vous la comprendrez quand je vous dirai où il est.
— Où est-il donc ?
— Au fond de l’égout, où il voyage côte à côte avec notre ennemi.
— Lui ! le père Vulcain ! s’écria Mac-Field stupéfait, comment se fait-il ?…
Sir Ralph lui raconta ce qui s’était passé.
— Après tout, dit alors Mac-Field, vous avez raison, le mal n’est pas grand, c’est un complice de moins, et un complice ivrogne, c’est toujours fatal. Mais comment expliquer ici l’absence prolongée de ce Peters ?
— C’est fait.
— Comment ?
— Il est à la recherche de notre ami, le docteur Wilson, il est allé d’un côté tandis que je vais de l’autre.
— Fort bien, mais s’il n’est pas rentré dans une heure ou deux au plus, son camarade Jack, qui vous a vus partir ensemble et qui doit guetter son retour, s’inquiétera de lui et pourra bien soupçonner la vérité, ce qui nous mettrait dans un très-vilain cas.
— Dans une heure Jack sera incapable de concevoir le moindre soupçon.
— Quel est donc votre projet à son égard ?
— Il m’attend sur sa voiture pour me conduire à Neuilly, où je cours chercher le docteur Wilson, appelé là par un malade ; le pays doit être désert le soir, le ciel est noir, le vent souffle avec violence et je compte sur des torrents de pluie, toutes circonstances très-favorables et que je mettrai à profit suivant l’inspiration du moment. Vous comprenez que la prudence même exige que Jack ne survive pas à son camarade, dont il nous attribuerait tout de suite la disparition, sachant, par l’affaire Christiani, de quoi nous sommes capables l’un et l’autre et comprenant bien vite que nous avions deviné nos deux ennemis dans le domestique et le cocher de l’hôtel Meurice.
— Oui, certes, dans l’intérêt de notre sécurité, il faut que cet homme disparaisse ce soir même, je comprends cela, mais moi ?
— Que voulez-vous dire ?
— Comment me tirer de là ? Je suis censé cloué au lit par la maladie ; je me suis fait un teint cadavéreux, qu’on serait tenté, sur ma mine, de m’enterrer pendant mon sommeil ; enfin il m’est impossible d’essayer même de sortir, puisqu’on me croit incapable de me tenir sur mes jambes, et pourtant je ne puis rester ici cinq minutes seulement après la disparition de ces deux hommes.
— Pourquoi cela ?
— Parce que, sortis l’un et l’autre avec vous, à un quart d’heure de distance, et ne reparaissant ni l’un ni l’autre, il est impossible qu’on ne voie pas là un double crime, et plus impossible encore que les soupçons ne se portent pas immédiatement sur vous, c’est-à -dire sur nous, car on devinera tout de suite dans ma maladie un stratagème et un acte de complicité.
— Restez dans votre lit et tranquillisez-vous, rien de tout cela n’aura lieu.
— Quoi ! la disparition de Peters…
— S’expliquera tout naturellement, ainsi que celle de Jack.
— Sans que vous soyez compromis ?
— Pas le moins du monde.
— Par exemple, je suis curieux de savoir…
— Écoutez donc ; dans deux heures je rentre à l’hôtel, les traits bouleversés, les vêtements en désordre, déchirés, couverts de boue, et voici ce que je raconte : nous avions parcouru rapidement les Champs-Élysées, l’avenue de la Grande-Armée et nous venions de franchir la barrière lorsque Jack arrête tout à coup sa voiture et me dit : « Milord, si vous voulez descendre, je ne vais pas plus loin ; » je lui demande l’explication de ce caprice. « Je vous la donnerai d’autant plus volontiers, me répond-il, que, Peters ne devant plus rentrer à l’hôtel, le pot aux roses va se découvrir tout de suite. Sachez donc que, depuis notre entrée à l’hôtel Meurice, nous y avons fait différentes opérations dans lesquelles la justice pourrait bien fourrer le nez, ce qui nous procurerait de graves désagréments. Or, nous n’avons pas jugé à propos d’attendre l’intervention de ces messieurs et nous avons pris le parti de filer tous deux le même jour. Si vous vous en souvenez, pour vous accompagner, Peters a quitté sa livrée, qui eût permis à la police de suivre sa piste à travers Paris, et, vêtu comme tout le monde, il a pu circuler librement et se rendre sans crainte en certain endroit convenu d’avance entre nous et où je vais le rejoindre en ce moment ; voilà pourquoi je suis obligé de vous laisser là . »
Indigné de cet aveu, ajouterai-je alors, je veux contraindre Jack à me conduire à l’adresse que je lui avais indiquée, espérant bien rencontrer en chemin quelque gardien de la paix, avec l’aide duquel je l’aurais ramené ensuite, dans sa voiture, à l’hôtel Meurice, mais il refusa de m’obéir. Une dispute d’abord, puis une lutte s’ensuit, dans laquelle j’ai été vaincu, et, quand je me suis relevé, brisé et mes habits en lambeaux, Jack était déjà loin avec sa voiture.
— L’histoire est présentée d’une façon assez vraisemblable, dit Mac-Field après un moment de réflexion, mais…
— Tout se réunit pour qu’il ne s’élève pas le moindre doute sur mon récit, reprit vivement sir Ralph ; jugez-en : ces deux hommes sont étrangers, Anglais ou Américains l’un et l’autre, leur accent ne permet pas de s’y tromper. Ils sont entrés le même jour à l’hôtel, feignant de ne pas se connaître, et enfin Peters n’avait pas le moindre lien de parenté avec le domestique qu’il a remplacé et qui l’a présenté comme son cousin, mensonge dont il sera facile de s’assurer en recherchant et en interrogeant cet ancien domestique, qui ne saurait y persister. En voilà plus qu’il n’en faut, convenez-en, pour prouver que ces deux hommes sont d’audacieux pickpockets qui avaient jeté leur dévolu sur l’un des hôtels les plus importants de la capitale et n’y étaient entrés que pour dévaliser les voyageurs.
— C’est parfait ! s’écria Mac-Field ; votre plan est supérieurement combiné, et vous aurez accompli un véritable tour de force en emmenant et en supprimant coup sur coup deux hommes, dans l’espace d’une heure, sans qu’il en puisse rejaillir le moindre soupçon sur vous.
— Allons, dit sir Ralph en se levant, continuez votre rôle de malade ; moi je vais m’occuper de notre ami Jack.
Il quitta Mac-Field et descendit au rez-de-chaussée.
Jack était déjà sous le vestibule, monté sur son siège et son fouet à la main.
Il paraissait soucieux.
— C’est égal, disait-il à un domestique avec lequel il causait en ce moment, c’est drôle tout de même que ce voyageur soit rentré sans Peters !
— Il paraît qu’il l’a envoyé chercher le médecin au boulevard Poissonnière ; il ne tardera donc pas.
— Je ne dis pas non, mais… enfin, on a beau dire, ça me semble drôle.
Sir Ralph, arrivant en ce moment, mit fin aux observations du cocher.
Il prit place dans la voiture, qui partit aussitôt.
La pluie commençait à tomber et le vent soufflant avec une violence inouïe faisait vaciller la flamme du gaz dans les lanternes et s’engouffrait dans les arbres des Tuileries avec un bruit qui ressemblait au fracas continu des vagues déferlant sur la plage.
— J’aurais commandé ce temps-là tout exprès qu’il ne serait pas mieux réussi, murmura sir Ralph.

Puis un sinistre sourire passa sur ses lèvres, quand il s’aperçut que de rares voitures sillonnaient l’avenue des Champs-Élysées.
Elles devinrent plus rares encore, quand, après avoir tourné l’Arc-de-Triomphe, on entra dans l’avenue de la Grande-Armée.
Alors il tira un revolver de sa poche, l’arma avec précaution et le posa tranquillement près de lui, sur le coussin.
Puis il s’accota commodément dans un coin de la voiture, croisa ses bras sur sa poitrine et attendit.
Un instant après, le vent redoublait de rage et l’eau tombait comme si toutes les cataractes du ciel eussent été tâchées.
La nature entière semblait bouleversée.
C’était un spectacle plein d’une sombre horreur, un effroyable déchaînement de tous les éléments, quelque chose de lamentable et de terrifiant à la fois.
Sir Ralph eût voulu savoir où il était, mais la nuit était si noire et si impénétrable, qu’il lui eût été impossible de s’en rendre compte s’il n’eût aperçu en ce moment le bureau de l’octroi, que rasait la voiture.
Dix minutes après, sir Ralph se dit :
— Nous devons être à deux pas du pont, voilà le moment.
Il ôta son chapeau, prit son revolver d’une main, abaissa une glace de l’autre, passa sa tête par la portière et, s’adressant au cocher :
— Jack, lui cria-t-il.
Celui-ci, aveuglé par la pluie et ruisselant des pieds à la tête comme s’il fût sorti d’un fleuve, tourna la tête.
— Jack, mon ami, lui dit sir Ralph, voulez-vous savoir où est Peters ?
— Mais, milord, je…
— Il roule depuis une heure au fond d’un égout, il meurt étouffé par la fange, et c’est la mort que je réserve à tout détective qui, comme vous et lui, osera s’attaquer à moi. Allons, bon voyage, en route pour l’autre monde, monsieur Jack.
À travers la pluie et les ténèbres le malheureux vit scintiller à six pouces de son visage l’acier du revolver.
Il jeta un cri et fit un brusque mouvement en arrière pour éviter l’arme. Mais deux explosions se firent entendre aussitôt.
Alors il étendit les bras, chancela à droite et à gauche, puis, tombant tout à coup la tête en avant, il disparut de son siège et alla rouler sur la route, où il resta étendu tout de son long.
Le cheval s’était arrêté.
Sir Ralph mit son revolver dans sa poche, descendit de voiture, s’approcha du cocher et, lui posant la main sur le cœur :
— Il respire encore, murmura-t-il, mais la Seine est à deux pas, elle se chargera d’achever la besogne.
Il prit le corps sous les bras, le traîna jusqu’au parapet du pont, l’y posa, non sans peine, puis le lança dans le vide.
On entendit un clapotement.
Puis plus rien.
Tout était dit.

![]()
XXXVII
TRIOMPHE
Mac-Field, réduit à rester au lit pour continuer son rôle, tâchait de s’absorber dans la lecture des journaux pour éloigner de son esprit les soucis dont il était assailli.
Les fenêtres de sa chambre donnant sur les Tuileries, il entendait le vent siffler avec rage et la pluie fouetter ses vitres avec un grésillement sinistre ; mais tout en se disant que ce vent favorisait à merveille les desseins de sir Ralph, il n’en était pas moins inquiet sur le résultat d’une entreprise aussi périlleuse et dont les conséquences pouvaient lui être si fatales.
En effet, si dans la lutte qui allait s’engager sur la route entre lui et le détective, l’avantage venait à rester du côté de celui-ci, son premier soin serait d’accourir à l’hôtel Meurice et d’y faire arrêter le prétendu malade, déjà connu de lui comme complice de sir Ralph dans l’affaire Christiani.
On comprend donc quelles devaient être ses transes et avec quelle anxiété il calculait les minutes qui le séparaient encore du moment où sir Ralph pouvait être de retour à l’hôtel.
Il venait de jeter un coup d’œil au hasard sur un des journaux épars sur son lit, lorsqu’il frissonna tout à coup à la lecture d’un fait divers.
La nouvelle devait être grave, car il en demeura quelques instants comme étourdi.
Puis ce premier saisissement passé, il reprit le journal, qui s’était échappé de sa main, et voulut relire l’article qui l’avait si vivement impressionné.
Mais, au même instant, des pas rapides se firent entendre dans l’escalier et presque aussitôt la porte du petit salon qui précédait sa chambre s’ouvrit avec fracas.
Mac-Field tourna de ce côté un regard effaré.
Qui allait-il voir paraître ?
Jack ou sir Ralph ?
Ce dernier ne pénétrait jamais chez lui avec cette violence.
C’étaient plutôt là les façons de procéder de l’agent de police, à quelque nation qu’il appartînt.
Il s’écoula cinq secondes à peine avant qu’on ouvrît la porte de sa chambre ; mais ce laps de temps lui parut affreusement long.
Elle s’ouvrit enfin et un homme parut sur le seuil.
Alors Mac-Field respira.
C’était sir Ralph.
Mais sir Ralph, presque méconnaissable, sir Ralph couvert de boue, les habits déchirés, la chevelure souillée et en désordre, et ruisselant d’eau de la tête aux pieds.
— Comme vous voilà fait ! s’écria Mac-Field on le voyant ainsi.
— Ne vous ai-je pas prévenu que je reviendrais en cet état ? répondit sir Ralph en se jetant dans un fauteuil.
— C’est vrai, mais c’est plus complet que je ne m’y attendais.
Il reprit aussitôt en baissant la voix :
— Eh bien ?
— Eh bien, Jack n’est pas plus à craindre désormais que son camarade Peters.
— Ah !… que s’est-il passé ?
— Ç’a été simple et rapide ; j’ai attendu que nous fussions près du pont de Neuilly ; une fois là , j’ai armé mon revolver, j’ai mis la tête à la portière, j’ai fait savoir en quelques mots à mon cocher que je n’ignorais ni qui il était, ni dans quel but il était venu à Paris, puis après lui avoir fait part de la perte douloureuse qu’il venait de faire dans la personne de son confrère et ami Peters, je lui ai logé deux balles en plein visage.
— Qu’a-t-il fait alors ?
— Ce que tout autre eût fait à sa place, car il n’avait pas deux partis à prendre, il est allé piquer une tête sur la route, comme dirait un gamin de Paris, et il est resté là , foudroyé, la face plongée dans une boue épaisse, car c’est ainsi, paraît-il, que messieurs les détectives sont destinés à mordre la poussière.
— Quelle imprudence ! Ces deux explosions pouvaient attirer des passants ou des agents.
— Pas un passant, pas un agent ne pouvait être dehors par un temps pareil ; et puis la tempête s’était déchaînée en ce moment avec une telle furie, qu’elle couvrait tous les bruits et que les détonations de mon revolver n’eussent pas été entendues à dix pas.
— Et vous l’avez laissé là sur le chemin ?
— Pas si simple ! ce n’est pas pour rien que j’avais attendu, pour l’exécuter, qu’il fût arrivé à quelques pas du pont.
— Je comprends, vous avez confié son corps à la Seine.
— Qui s’est chargée de lui arracher son dernier soupir, car il n’était pas encore mort quand je l’ai précipité dans le fleuve.
— Et votre petite histoire ?
— Je viens de la débiter telle que je l’avais composée.
— Et comment a-t-elle été accueillie ?
— Avec consternation.
— Nul doute ne s’est élevé ?
— Pas l’ombre, et comme si le ciel lui-même me protégeait dans cette circonstance, un incident inespéré vient attester d’une manière éclatante l’authenticité de mon histoire et prouver jusqu’à l’évidence que ces prétendus domestiques étaient des pickpockets de la plus dangereuse espèce.
— Quel est cet incident providentiel ?
— Deux jours après l’entrée ici de Peters et de Jack, un portefeuille contenant dix mille francs en bank-notes a été soustrait à un voyageur anglais, et ce vol, accompli en plein jour dans la chambre de celui-ci, ne pouvant être attribué qu’à l’un des domestiques de l’hôtel, on était en train de les épier tous depuis quelque temps ; maintenant on est fixé, c’est Jack ou Peters.
— Faisons des vœux pour le vrai coupable.
— À moins qu’il ne se fasse pincer en recommençant, il peut dormir sur ses deux oreilles, il est désormais à l’abri de tout soupçon.
— Tout va bien de ce côté, reprit Mac-Field en changeant de ton, mais sur un autre point les cartes se brouillent.
— Que voulez-vous dire ? demanda vivement sir Ralph.
— Tenez, lisez ce fait divers.
Sir Ralph prit le journal et lut ce qui suit :
« Depuis quelques jours deux individus très-mal famés, les époux Claude, avaient quitté leur maison, une espèce de masure bâtie sur un terrain vague, à l’extrémité de la rue de Vanves. La disparition subite de ce singulier couple, depuis longtemps surveillé par la police, disparition si rapide, qu’il n’avait même pas pris le temps d’emporter un seul meuble, la détestable réputation dont il jouissait dans le quartier, ne tardèrent pas à donner lieu à des bruits qui prirent bientôt assez de consistance pour déterminer la police à intervenir. La maison fut visitée du haut en bas, puis on descendit à la cave où, suivant la rumeur publique, des créatures humaines auraient été enterrées vivantes. D’abord ces fouilles demeurèrent sans résultat, mais comme on allait y renoncer, quelques coups de pioche mirent à découvert un objet informe dans lequel on reconnut bientôt, enveloppé dans de mauvais linges, le corps d’un enfant dont la mort devait remonter à un mois de là . Les époux Claude sont vivement recherchés par la police. »
— Que dites-vous de cela ? demanda Mac-Field à son complice ; voilà un incident moins heureux que celui qui est venu si à propos à l’appui de votre histoire.
— C’est très-inquiétant, répliqua sir Ralph ; la découverte de ce cadavre va mettre toute la police en l’air, et il est douteux que Claude et sa femme puissent lui échapper longtemps.
— Que le destin nous favorise deux ou trois jours encore, dit Mac-Field, et nous sommes sauvés.
Il ajouta :
— Vous avez écrit à la comtesse de Sinabria ?
— Mieux que cela, je lui ai parlé.
— Et le résultat de votre entretien ?
— Des choses peu aimables de son côté, mais mitigées par la promesse du million que j’exige pour ne pas la perdre. Pénétrée de l’impossibilité de se sauver autrement, elle a accompli des miracles pour se procurer cette somme, qu’elle me remettra demain, à trois heures.
— Vous avez sa parole ?
— Formelle et elle n’y manquera pas, car je lui ai juré, de mon côté, que, dans le cas où elle ne serait pas en mesure de la tenir, il me serait impossible de lui accorder un délai, même d’une heure, et que je me verrai contraint alors de révéler immédiatement son secret à son mari. Elle a compris que cette menace était sérieuse, aussi suis-je certain de sortir de chez elle demain avec la somme dans ma poche.
Il y eut un moment de silence.
— Tenez, dit enfin Mac-Field, voulez-vous m’en croire ? Si nous avons la chance que cette affaire se termine ainsi, renoncez à votre mariage et quittons Paris, quittons la France avec cette fortune sans perdre une heure, sans perdre une minute.
— Y songez-vous ? moi renoncer à Tatiane ? jamais !
— Prenez garde, bien des périls nous entourent, ce mariage vous fait de nombreux ennemis, nous avons bien des affaires sur les bras, vingt-quatre heures de plus ou de moins peuvent devenir pour nous une question de vie ou de mort.
— Je vois, au contraire, notre salut dans cette union, répliqua sir Ralph ; car, ainsi que je vous l’ai dit, non seulement le titre de gendre de M. Mauvillars deviendrait pour moi une sauvegarde, mais quelle que soit la haine qu’il me porte, il sera intéressé, dès que je ferai partie de sa famille, à user de tout son pouvoir et de toute son influence, qui sont considérables, dans le cas où je me trouverais compromis.
— Je ne partage pas votre opinion sur ce point ; mon avis est de nous contenter d’un demi-triomphe et de partir au plus vite avec le million de la comtesse de Sinabria. Réfléchissez d’ici à demain, et j’espère que vous vous rendrez à mes raisons.
— Nous verrons.
— Je vous assure que je ne suis pas tranquille, sir Ralph ; je tremble à chaque instant que…
Deux coups répétés à la porte le firent bondir dans son lit.
— Qu’est-ce que c’est que ça ? murmura-t-il en tournant vers la porte des regards inquiets.
— Entrez ! cria sir Ralph, peu rassuré lui-même.
Un domestique parut et introduisit un personnage en disant à sir Ralph :
— C’est le médecin qui demeure à côté de l’hôtel et que milord a dit d’envoyer chercher.
— C’est vrai, répondit celui-ci en échangeant avec Mac-Field un regard qui signifiait :
— Nous en sommes quittes pour la peur.
XXXVIII
UNE COLOMBE EN RÉVOLTE
Le médecin appelé près de Mac-Field avait déclaré son malade atteint d’une fièvre dont il ne pouvait encore déterminer le caractère, et il avait ordonné une potion calmante.
Mac-Field avait vidé la potion dans la cheminée, et s’en était parfaitement trouvé.
Le lendemain il était entièrement rétabli.
Il était en train de s’habiller, tout en causant avec sir Ralph, qui venait d’entrer dans sa chambre, lorsqu’un domestique vint demander, de la part de son patron, des nouvelles de milord.
— Vous voyez, répondit Mac-Field, la potion du docteur a fait merveille, la fièvre a disparu, et je m’habille pour sortir.
Le domestique allait se retirer, quand sir Ralph le rappela.
— Dites-moi, Baptiste, lui demanda-t-il, a-t-on des nouvelles de la voiture de Jack ?
— Oui, milord, répondit Baptiste, un sergent de ville l’a ramenée, il y a une heure.
— Ah !… où l’a-t-il trouvée ?
— À l’entrée du pont de Neuilly, milord.
— Dans un triste état, je pense ?
— Pleine d’eau, et le pauvre cheval si malade qu’on craint bien qu’il ne s’en relève pas.
— Et naturellement aucune nouvelle de Jack ?
— Quant à Jack, on craint qu’il n’ait été assassiné.
Sir Ralph tressaillit.
— Qui a pu donner lieu à une pareille supposition ?
— D’abord malgré la pluie qui a lavé la voiture toute la nuit, on a trouvé de larges traces de sang sur le siège et sur une des roues.
— C’est affreux, s’écria sir Ralph.
— Ce n’est pas tout, le commissaire de police, immédiatement appelé par le sergent de ville qui avait été frappé à la vue de ces taches, s’est mis à étudier le terrain et a retrouvé du sang dans la boue et jusque sur le parapet du pont, ce qui ferait supposer que le meurtrier a traîné le cadavre jusque-là et l’a lancé dans la Seine, espérant anéantir ainsi toute trace de son crime.
— Et a-t-on quelque indice sur le meurtrier ?
— Oui, milord.
Sir Ralph ne put reprendre ses questions qu’après un moment de silence.
— Ah ! dit-il, on a des soupçons…
— Sur Peters, qui, dit-on, n’était qu’un pickpocket déguisé, comme son ami Jack, avec lequel il avait rendez-vous ce même soir. On suppose qu’il a assassiné son complice dans le but de s’approprier, à lui seul, le fruit des vols qu’ils avaient commis ensemble, et le commissaire est convaincu que les choses ont dû se passer ainsi, car comme il l’a dit, c’est toujours comme cela que finissent les associations entre coquins de cette espèce.
— Je suis de l’avis du commissaire, dit Mac-Field en achevant de s’habiller, il a mis le doigt dessus, l’assassin de Jack ne peut être que le complice avec lequel il avait rendez-vous ce soir-là ; il faut avouer, au reste, que le temps était on ne peut plus favorable pour un meurtre.
— Milord a parfaitement raison, répliqua Baptiste, et la preuve, c’est qu’un autre crime a été commis cette nuit.
— Où donc ? demanda vivement sir Ralph.
— Dans le quartier, milord.
— Ah ! si près que cela !
— À deux pas d’ici, et tenez, précisément dans la rue où milord a eu affaire hier soir.
— Rue de la Sourdière ?
— Justement, milord.
— On a trouvé un cadavre dans cette rue ?
— Non, pas un cadavre, mais la preuve palpable d’un crime atroce.
— Et cette preuve ?
— Cinq doigts pris dans la plaque de fer qui ferme la bouche d’un égout.
— Ce qui fait supposer, naturellement, dit sir Ralph d’une voix troublée…
— Qu’un homme a été lancé la nuit dans cet égout.
— Vous avez raison, Baptiste, fit observer Mac-Field, venant en aide à sir Ralph, que son émotion pouvait trahir, ce ne peut être que la nuit, au milieu de la nuit, car il eût été impossible, même très-avant dans la soirée, d’ouvrir un égout et d’y jeter un homme.
— Impossible, c’est l’opinion générale, répondit Baptiste.
— Et, reprit sir Ralph en faisant un effort pour se dominer, aucun indice qui puisse mettre sur la trace des coupables ?
— Au contraire, il y en a plusieurs.
— Ah !… ah ! il y en a plu…
Il ne put achever.
— Oui, d’abord, l’un des cinq doigts avait une bague d’argent avec un mot anglais gravé dessus.
— En effet, dit Mac-Field d’un ton indifférent, c’est un indice, cela.
— Ce n’est pas tout, reprit Baptiste.
— Quoi donc encore ?
— À quelques pas de l’égout, on a trouvé une pince pareille à celle dont se servent les égoutiers, et cette pince, toute neuve, ce qui fait supposer qu’elle a été achetée par le meurtrier tout exprès pour la perpétration du crime, cette pince porte le nom du fabricant qui l’a vendue.
— Mauvaise affaire pour le meurtrier, si on l’attrape, dit Mac-Field, car, confronté avec ce fabricant, il sera tout de suite reconnu, et, devant un témoignage aussi accablant que celui-là , son compte sera bien vite réglé. Mais il faut commencer par le découvrir, et ce ne sera sans doute pas chose facile.
— Peut-être, répliqua Baptiste, une fois l’eau écoulée, c’est-à -dire aujourd’hui même, on va sonder les égouts, on ne peut manquer d’y retrouver le cadavre, envasé à quelque embranchement ; on l’exposera aussitôt à la Morgue, où il sera reconnu, et alors la police, sachant dans quel cercle elle aura à circonscrire ses recherches, ne tardera pas à mettre la main sur le coupable.
— C’est juste, dit Mac-Field, la découverte du cadavre et la reconnaissance de son identité mettent naturellement la police sur la trace du meurtrier qui, confronté alors avec le marchand qui lui a vendu la pince et reconnu par lui, est contraint d’avouer son crime. Oui, oui, c’est un enchaînement logique et fatal auquel le coupable ne peut échapper. Vous me tiendrez au courant de cette affaire, Baptiste, elle est fort curieuse et m’intéresse beaucoup.
— Je n’y manquerai pas, milord, répondit Baptiste en se retirant.
Quand il fut sorti, Mac-Field se retourna vers sir Ralph.
— Eh bien, lui dit-il, que pensez-vous de tous ces indices, de toutes ces lumières qui surgissent de toutes parts ? Comprenez-vous les conséquences que peuvent entraîner la découverte et la reconnaissance du corps de Peters ? Alors toute la fable imaginée par nous et d’où découle naturellement la conviction que ce dernier est l’assassin de Jack, son complice, toute cette fable s’évanouit comme une fumée, et sur qui voulez-vous alors que se portent les soupçons, si ce n’est sur celui qui l’a inventée, après s’être fait conduire d’abord rue de la Sourdière, par Peters, précipité dans l’égout de cette rue, puis à Neuilly, par Jack, assassiné dans ce pays même ?
Sir Ralph était attéré.
— C’est vrai, murmura-t-il avec accablement, je suis perdu si le corps de Peters est trouvé dans l’égout.
— Et même sans cela.
— Comment !…
— La bague trouvée à l’un des doigts de Peters me paraît assez bizarre pour avoir été remarquée par quelqu’un des domestiques de l’hôtel, il n’en faut pas davantage pour qu’on soit convaincu que c’est lui qui a disparu dans l’égout de la rue de ta Sourdière, pour qu’on soupçonne ensuite celui qu’il avait accompagné jusque-là sur sa demande expresse, et pour que celui-ci soit confronté avec le marchand qui a vendu le même jour la pince trouvée à quelques pas de l’égout ; le reste se devine.
— Mon histoire était si bien combinée et elle avait si bien réussi ! s’écria sir Ralph avec un mélange de colère et de désespoir, tout avait été prévu ! Et voilà que cette pince, ces cinq doigts coupés… ah ! on ne songe jamais à tout dans ces moments-là .
— Le sang-froid manque, dit Mac-Field, le sang-froid, la plus précieuse des qualités chez l’homme qui veut réussir par l’audace.
— Voyons, reprit sir Ralph, que faut-il faire maintenant ? que me conseillez-vous ?
— Ce que je vous conseillais hier, partir non pas demain, non pas ce soir, mais à quatre heures, si à trois heures, vous sortiez de l’hôtel Sinabria avec le million promis.
— Oui, oui ; oh ! maintenant j’y suis résolu, car le pavé de Paris me brûle les pieds et j’ai hâte de fouler la terre de Belgique ou d’Angleterre.
— À la bonne heure ! Vous écoutez enfin la raison. Mais me voilà habillé, allons déjeuner au café Riche, nous ferons ensuite une promenade sur le boulevard et vous serez dans les meilleures dispositions du monde pour vous rendre de là chez la comtesse de Sinabria.
— Allons donc déjeuner, répondit sir Ralph, quoiqu’à vrai dire je n’aie guère d’appétit.
— Cela se comprend, mais croyez-moi, ne vous faites pas l’esclave des événements, comptez toujours sur quelque heureux hasard pour sortir des embarras les plus graves, et surtout persuadez-vous bien qu’il n’est rien de tel qu’un bon repas pour vous donner l’entrain et l’audace nécessaires dans les circonstances difficiles.
Sir Ralph se laissa convaincre de cette vérité et deux heures après il sortait du Café Riche dans les meilleures dispositions.
Il était trois heures précises lorsqu’il se présentait à l’hôtel Sinabria. Il trouva François qui se promenait de long en large dans le vestibule du rez-de-chaussée.
— Madame la comtesse ? demanda sir Ralph en allant vivement à lui.
— Madame la comtesse vous attend, répondit celui-ci, et je n’étais là que pour guetter votre arrivée.
Les traits de sir Ralph, très-soucieux au moment où il abordait le cocher, s’éclairèrent tout à coup à ces paroles.
— Allons, murmura-t-il tout en suivant celui-ci, voilà qui est de bon augure.
Ils gravirent l’étage qui conduisait à l’appartement de la comtesse.
Fanny, la femme de chambre, était dans l’antichambre et paraissait attendre elle-même.
— De mieux en mieux, pensa sir Ralph.
— Veuillez me suivre, monsieur, lui dit Fanny en le conduisant vers un petit salon qui lui était bien connu.
La femme de chambre l’y introduisit et le quitta en lui disant qu’elle allait prévenir sa maîtresse.
Il s’assit et attendit, désormais sûr du succès.
Un instant après la porte du petit salon s’ouvrait et il voyait entrer la comtesse de Sinabria.
La jeune femme était très-pâle et paraissait sous l’empire d’une profonde émotion, mais elle parvenait à force d’énergie à dominer cette impression et à ne montrer qu’un visage calme et froid.
— Madame la comtesse, dit sir Ralph en allant à elle d’un air presque souriant, permettez-moi de me féliciter de…
— Trêve de politesses et de banalités, monsieur, lui dit la comtesse d’un ton glacial ; vous venez pour le million que vous m’avez contraint à vous promettre ?
— Mais, madame, répondit sir Ralph un peu déconcerté, en effet, je viens…
— Eh bien, monsieur, la somme que vous exigez de moi, je ne l’ai pas.
Les traits de sir Ralph se rembrunirent tout à coup.
— Vous n’avez pu vous la procurer, madame ? dit-il en changeant de ton et d’accent.
— Je ne l’ai même pas cherchée, monsieur.
— Et la raison, madame ?
— C’est que… j’ai mes pauvres, et je trouve cette aumône-là au-dessus de mes moyens.
— Alors, madame, reprit sir Ralph en pâlissant de colère, vous…
— Je refuse, monsieur, dit la jeune femme en se redressant de toute sa hauteur et en le foudroyant d’un regard du mépris, je refuse et je vous chasse d’ici.
XXXIX
LE BON ET LE MAUVAIS GÉNIE
En voyant se redresser tout à coup fière, hautaine et menaçante à son tour cette timide jeune femme qu’il avait toujours vue effarée et tremblante devant lui, sir Ralph resta quelques instants immobile de stupeur.
Il regardait la comtesse d’un air ahuri et se demandait sérieusement s’il avait bien entendu.
La comtesse ne tarda pas à le tirer du doute.
— Eh bien, monsieur, reprit-elle la main tendue vers la porte, est-ce que vous ne m’avez pas compris ?
Sir Ralph frissonna à cette nouvelle humiliation.
Puis il répondit avec une rage contenue :
— Parfaitement, madame, vous me chassez, c’est fort bien ; mais, avant de quitter votre hôtel, j’ai une petite confidence à faire à M. le comte de Sinabria. Je sais qu’à cette heure il est au bois ou à son cercle, mais je suis patient quand il le faut, j’attendrai son retour.
— Vous n’aurez pas à attendre, monsieur, répliqua la jeune femme, car aujourd’hui, par extraordinaire, M. le comte est chez lui.
— Ah ! fit sir Ralph, qui marchait de surprise en surprise, ah ! M. le comte…
— Est ici, monsieur, et, si vous avez à lui parler, je vais le faire prier de se rendre ici.
— J’ai à lui parler, en effet, madame, dit sir Ralph en regardant fixement la comtesse, et je vous serai fort obligé de vouloir bien le faire appeler.
La jeune femme tira un cordon de sonnette.
Sa femme de chambre parut aussitôt.
— Fanny, lui dit la comtesse, allez prévenir M. le comte que quelqu’un demande à lui parler et l’attend ici.
Accoutumée à voir sir Ralph s’introduire dans l’hôtel avec toutes sortes de précautions et toujours en l’absence du comte, à s’entretenir mystérieusement avec sa maîtresse, qu’il laissait chaque fois tremblante et atterrée, Fanny les regarda tous deux avec l’expression d’une profonde surprise, puis elle sortit en se demandant évidemment ce que tout cela voulait dire.
La conduite de la comtesse était encore bien autrement étrange et inexplicable aux yeux de sir Ralph.
Il lui jetait de temps à autre un regard à la dérobée et ne comprenait rien à l’indifférence hautaine qu’elle conservait dans un pareil moment.
Par un revirement aussi extraordinaire qu’inattendu, le plus désespéré des deux aujourd’hui c’était lui.
Bien décidé à se venger sur la comtesse du cruel désappointement qu’elle lui faisait subir, il se disait néanmoins que cette vengeance ne lui rapporterait absolument rien, tandis que la perte du million sur lequel il avait compté pour mener grand train à l’étranger allait le mettre dans la plus déplorable situation.
Aussi résolut-il de faire une tentative suprême pour éviter une solution qui lui montrait tout un avenir de gêne, toute une vie d’expédients et de périls.
— Madame la comtesse, lui dit-il en se rapprochant d’elle, avez-vous bien réfléchi à la détermination que vous venez de prendre ?
— Oui, monsieur, répondit la jeune femme d’un ton bref.
— Songez que les preuves vous écrasent, les preuves les plus éclatantes, les plus palpables, votre enfant vivant, la déclaration de la sage-femme qui l’a mis au monde, et, par-dessus tout, son inscription sur les registres de l’état civil avec le nom de sa mère, la comtesse de Sinabria, le témoignage redoutable, indestructible, éternel, contre lequel vous ne pouvez rien.
Sir Ralph remarqua qu’en dépit du calme qu’elle affectait la comtesse avait pâli et s’était troublée à ces derniers mots.
Il reprit aussitôt, pour profiter de l’hésitation à laquelle elle se trouvait en proie :
— Écoutez, madame, peut-être n’avez-vous qu’une partie de la somme que j’exigeais de vous et dont j’ai absolument besoin pour sortir d’une situation terrible, que je ne puis vous révéler ; eh bien, je me contenterai de ce que vous pourrez me donner, et je vous promets en échange une discrétion sur laquelle vous pouvez d’autant mieux compter que, dans quelques jours, je serai en route pour l’Amérique, où je suis décidé à me fixer.
— Pour l’Amérique ! s’écria la comtesse, et Tatiane, que vous épousez demain ?
— Je lui ai fait part des raisons qui me déterminaient à prendre ce parti ; elle les approuve et consent à me suivre.
Il ajouta tout à coup :
— M. le comte va arriver, madame, hâtez-vous de prendre un parti ; voyons, que pouvez-vous me donner ?
La jeune femme le regarda en face et répondit d’un ton résolu :
— Rien.
— C’est votre perte certaine, inévitable, que vous décidez là , madame, songez-y.
— Je vous le répète, j’y ai songé.
Des pas se firent entendre en ce moment dans la pièce voisine, puis la porte s’ouvrit.
C’était le comte de Sinabria qui entrait.
Il fit à sir Ralph un de ces saluts vagues et indécis qu’on adresse généralement aux gens qu’on ne connaît pas et qu’on étudie tout en les saluant.
— Mon ami, lui dit la comtesse en lui désignant l’inconnu, sir Ralph Sitson, qui désire avoir avec vous un entretien.
Puis saluant très-poliment sir Ralph, elle sortit.
— Veuillez vous asseoir, monsieur, dit alors le comte du ton froid et digne qui lui était habituel et en approchant un fauteuil de celui sur lequel il prit place lui-même.
Sir Ralph commença à se sentir très-mal à son aise.
Il s’assit lentement tout en jetant des regards furtifs sur le comte, mais plus il l’observait, plus il se sentait glacé.
— Je vous écoute, monsieur, lui dit le comte avec un accent qui ne permettait pas à sir Ralph de retarder davantage.
Peut-être celui-ci regretta-t-il un instant de s’être tant avancé, mais il reconnut en même temps l’impossibilité d’éviter l’explication pour laquelle il était venu tout exprès chez le comte.
Après s’être recueilli un instant, il commença donc l’histoire du drame qui sert d’introduction à notre récit et que nous croyons devoir nous dispenser de raconter une deuxième fois au lecteur.
Ces deux hommes étaient enfermés là depuis un quart d’heure environ, quand on ouvrit la porte après avoir frappé deux coups et sans attendre l’autorisation d’entrer.
C’était Fanny.
— Monsieur le comte, dit-elle, je vous demande pardon de vous déranger, mais il y a là quelqu’un qui demande à être introduit près de vous.
— C’est impossible, répondit le comte avec une vivacité dont la femme de chambre parut très-étonnée, je suis occupé en ce moment.
— C’est ce que j’ai répondu, dit Fanny, mais ce monsieur ne veut rien entendre, il insiste absolument pour être reçu par M. le comte.
— Et moi, je persiste à ne pas le recevoir, s’écria le comte, reportez-lui ma réponse et ajoutez…
— Inutile de rien ajouter, monsieur le comte, dit alors une voix derrière la femme de chambre, me voici, et il faut absolument que je vous parle.
Le comte de Sinabria était très-pâle et paraissait sous l’empire d’une profonde agitation.
Il se leva et d’une voix brève et impérieuse, mais d’un ton toujours mesuré :
— Monsieur, dit-il à l’inconnu, je ne puis vous écouter en ce moment, j’ai avec monsieur un entretien…
— Dont je connais le sujet, interrompit le nouveau venu et auquel il est important que je prenne part dans votre propre intérêt.
— Quoi ! dit le comte, stupéfait, vous prétendez savoir ?…
— Tout ce qui vient d’être dit entre vous et cet homme, monsieur le comte.
— Qui êtes-vous donc, monsieur ?
— Je suis M. Portal, rentier.
— Et moi, monsieur, je vous déclare que vous vous trompez et qu’il est impossible que des faits pareils à ceux qui viennent de m’être révélés soient venus à votre connaissance.
— Je les connais si bien, monsieur le comte, que je les nie et que je m’engage à en prouver la fausseté.
— Ah ! si vous faisiez cela, monsieur, murmura le comte en couvrant de ses mains ses traits pâles et empreints d’un mortel désespoir.
Il ajouta aussitôt :
— Mais c’est impossible, et l’engagement même que vous venez de prendre m’est une preuve certaine que vous ne soupçonnez même pas la nature des douloureuses révélations que je viens d’entendre.
La femme de chambre s’était retirée.
M. Portal alla fermer la porte du salon à double tour, puis, revenant vers le comte :
— Dites-moi, monsieur le comte, dans ces révélations, sous lesquelles je vous vois accablé, ne serait-il point question de M. de Coursol et de madame la comtesse de Sinabria ?
— En effet, répondit le comte en jetant sur M. Portal un regard stupéfait.
— Vous voyez, monsieur, que je suis au courant de l’entretien que vous venez d’avoir avec sir Ralph et que je me rends parfaitement compte de la tâche que j’entreprends en m’engageant à vous prouver la fausseté des faits qu’il vient de vous raconter.
Sir Ralph, qui, lui aussi, avait pâli à la vue de Rocambole, recouvra enfin un peu d’assurance, et, s’adressant au comte :
— Monsieur le comte, lui dit-il, avant de laisser M. Portal s’engager plus avant dans cette étrange entreprise, veuillez donc lui demander quel est le mobile qui le pousse à s’en occuper.
— Je vais vous le dire tout de suite, répondit Rocambole en se tournant vers sir Ralph, je me suis senti de tout temps…
Il se reprit :
« …depuis longtemps une haine ardente contre les coquins et une pitié non moins ardente pour leurs victimes, surtout quand ces victimes étaient faibles, quand elles étaient femmes, c’est-à -dire faciles à se troubler devant les menaces les plus insensées, les plus invraisemblables, faciles à exploiter quand on leur disait, comme le voleur au coin d’un bois, non, « La bourse ou la vie, » mais « la bourse ou le scandale ! » « Un million ou la honte sur votre nom, ou votre déshonneur proclamé devant les tribunaux, d’où vous sortirez souillée, même avec un acquittement ! » Voilà le mobile qui m’a guidé, sir Ralph ; et, maintenant que j’ai répondu à votre question, veuillez donc me dire à votre tour quel intérêt vous trouvez à venir raconter à un mari l’histoire navrante, effroyable que vous venez de faire entendre à M. le comte, cette histoire fut-elle vraie au lieu d’être inventée d’un bout à l’autre, comme je le prouverai.
XL
DEUX LUTTEURS
La question de Rocambole parut embarrasser extrêmement sir Ralph.
— N’est-ce pas qu’il est difficile de trouver un motif excusable à une action aussi infâme ? lui dit Rocambole. Eh bien, puisque vous ne pouvez vous résigner à nous le faire connaître, c’est moi qui vais m’en charger.
S’adressant ensuite au comte :
— Monsieur le comte, lui dit-il, dans la situation que vous occupez dans le monde où vous êtes né et où vous avez toujours vécu, il est des mystères dont on ne soupçonne même pas l’existence, et c’est précisément à un de ces mystères inconnus, invraisemblables à force d’ignominie, que vous allez être initié aujourd’hui. Dans les couches inférieures de la société, il se rencontre des misérables qui, nés sans autres moyens d’existence que les plus mauvais instincts, passent leur vie à vouloir résoudre le difficile problème de jouir de tout sans travailler.
Les plus retors et les plus infâmes à la fois sont ceux qui se mettent à la recherche d’un scandale, d’un secret compromettant, pour faire chanter les gens qui ont cette tache dans leur passé ; mais les maîtres, les malins et les forts entre tous sont les hommes qui, après avoir vainement cherché cette honte et ce scandale dont ils ont besoin pour vivre et mener grand train, savent les inventer et poussent l’audace jusqu’à aller dire à une femme jeune, riche, d’une réputation sans tache : « Madame, j’ai imaginé sur votre compte une histoire des plus scandaleuses : adultère accompli pendant l’absence de votre mari, accouchement mystérieux dans une maison infâme un peu avant le retour du même après une année révolue ; j’ai pris mes renseignements, suppression de l’enfant, témoignage de la sage-femme qui l’a mis au monde, rien n’y manque, et dans mon plan, longuement et minutieusement combiné, il y a tout ce qu’il faut pour vous faire asseoir sur les bancs de la cour d’assises, d’où vous sortirez condamnée probablement, et en tout cas, même en cas d’acquittement, perdue de réputation, car si votre avocat parvient à écarter l’accusation d’infanticide, celle d’adultère restera tout au moins dans l’opinion publique avec des détails qui on doubleront la honte ». Eh bien, monsieur le comte, l’un de ces hommes est là sous vos yeux, et l’histoire qu’il a imaginée pour faire chanter madame la comtesse de Sinabria est si habilement arrangée, semée d’incidents qui lui donnent un tel air de vraisemblance et de réalité, qu’il est parvenu à vous convaincre de la culpabilité de votre femme, si monstrueuses que soient ses inventions.
Sûr du triomphe définitif, sir Ralph avait repris toute son assurance et c’est avec un sourire de défi qu’il écoutait parler M. Portal.
Quant au comte, il portait de l’un à l’autre des regards irrésolus, se demandant évidemment lequel des deux il fallait croire.
Sir Ralph prit la parole :
— Monsieur le comte, dit-il à celui-ci, vous disiez tout à l’heure qu’il était impossible que M. Portal connût l’entretien que nous venons d’avoir ensemble ; il le connaît, cependant, vous le voyez, et dans tous ses détails ; or, une pareille histoire étant de celles qu’on tient rigoureusement secrètes, qui donc peut lui en avoir fait la confidence si ce n’est madame la comtesse ? La seule question est de savoir jusqu’à quel point madame la comtesse aura poussé la franchise, si elle a présenté l’affaire telle que vient de le faire M. Portal, ou si elle lui a fait l’aveu de sa faute en le chargeant de la plaider en grand avocat, c’est-à -dire en niant tous les faits et en les retournant contre son accusateur.
— Madame la comtesse m’a avoué une chose, répliqua M. Portal, c’est qu’elle vous avait rencontré dans le monde où vous porte la nature de vos opérations, que là , à la recherche d’une proie, vous aviez obtenu sur son compte les meilleurs renseignements au sujet de sa fortune, et que bientôt vous étiez venu lui tenir le langage que je viens de rapporter : « Madame, j’ai besoin d’un million, donnez-le moi, sinon je répands dans le monde, avant d’en saisir les tribunaux, l’histoire que je vais vous raconter et qui, si extraordinaire qu’elle soit, ou plutôt par cela même, sera acceptée par quatre-vingt-dix personnes sur cent. »
— Vous entendez, monsieur le comte, dit alors sir Ralph d’un air triomphant, c’est madame la comtesse qui affirme que ce récit est entièrement de mon invention, vous savez maintenant le cas que vous devez faire des paroles de M. Portal.
— Aussi, reprit celui-ci, donnerai-je à M. le comte un conseil qu’il n’hésitera pas à suivre, je l’espère.
— Et ce conseil ? demanda sir Ralph d’un ton ironique.
— C’est de ne croire ni vous ni moi, et de ne s’en rapporter qu’aux preuves.
— Pour le coup, nous sommes d’accord, s’écria sir Ralph, tous les arguments du monde ne signifient rien, les preuves seules méritent considération et je m’engage à les fournir.
— En quoi consistent-elles ? demanda Rocambole à sir Ralph, car remarquez qu’il les faut aussi claires, aussi convaincantes que possible.
— Elles seront d’une évidence si palpable, qu’elles ne laisseront pas le moindre doute dans l’esprit de M. le comte.
— Les avez-vous sur vous, ces preuves ? demanda M. Portal.
— Oh ! non, j’ai mieux que des écrits, genre de témoignage dont il est toujours permis de douter, j’ai la parole même des gens qui ont joué un rôle actif dans le drame conjugal que je viens de raconter à M. le comte.
— Dans un but que vous vous obstinez à ne pas faire connaître, car vous ne pouvez admettre le vrai mobile de votre action, la demande d’un million en échange de votre silence.
— Mon mobile est précisément le vôtre, monsieur, répondit sir Ralph d’un air digne, l’horreur que doit inspirer à toute âme honnête une trahison aussi odieuse que celle dont M. le comte a été la victime.
À ces mots Rocambole partit d’un éclat de rire.
Puis reprenant son sang-froid.
— Pardon, monsieur le comte, dit-il à celui-ci, mais quand on connaît sir Ralph, je vous assure qu’il est impossible de l’entendre exprimer de nobles sentiments sans être pris d’une gaieté folle.
— Fort bien, répliqua celui-ci avec un calme ironique, nous verrons tout à l’heure si vous serez encore en train de rire.
Et se tournant vers le comte de Sinabria :
— Monsieur le comte, lui dit-il, nous partirons quand vous voudrez ?
— Où donc ? demanda le comte.
— Mais à la conquête des preuves promises, je pense, dit Rocambole.
— C’est justement cela, monsieur, répondit sir Ralph.
Le comte sonna.
Fanny parut aussitôt.
— Dites à François d’atteler, lui commanda le comte.
Quand la femme de chambre se fut retirée, il dit à Rocambole :
— Il est un point sur lequel je voudrais avoir de vous une explication, monsieur.
— Parlez, monsieur le comte.
— Le sentiment qui vous a poussé à vous mêler de cette affaire est fort honorable et je veux y croire jusqu’à preuve du contraire ; mais, veuillez donc me dire comment vous avez été mis en relation avec madame la comtesse et surtout comment elle a été amenée à vous confier une affaire aussi grave, à vous qu’elle connaissait à peine.
— En effet, ajouta sir Ralph avec un léger ricanement, c’est fort extraordinaire et même quelque peu incompréhensible, à moins que M. Portal ne fasse le métier dont il m’accusait tout à l’heure et qu’il ne soit connu pour plaider les causes véreuses et tirer les gens d’embarras au plus juste prix, auquel cas il serait tout naturel qu’attirée par sa réputation, madame la comtesse eût été s’adresser à ce spécialiste d’un nouveau genre ; cela expliquerait tout.
— Il y a une autre explication du fait dont vous vous étonnez ; à juste titre, monsieur le comte, reprit Rocambole, et la voici : Je n’avais pas l’honneur de connaître madame la comtesse, et ce n’est pas d’elle que j’ai reçu cette confidence.
— Voilà une explication qui achève de tout embrouiller, répliqua sir Ralph, car, hors madame la comtesse et moi, personne ne connaissait…
— Pardon, interrompit Rocambole, vous oubliez M. de Coursol.
— En effet, dit sir Ralph d’un ton ironique, il était au courant de bien des petits détails…
— Dont un assez ignoble et que vous n’ignorez pas, sir Ralph ; lui aussi, il avait reçu la visite et les propositions d’un misérable, moitié voleur, moitié mendiant, qui lui avait promis de ne pas répandre la petite histoire de son invention, dans laquelle il lui avait donné un assez vilain rôle, s’il voulait bien lui faire l’aumône de cinq cent mille francs. Or M. de Coursol venait d’apprendre et précisément par un de ses amis une aventure du même genre dans laquelle j’avais eu la chance de faire subir au misérable le châtiment que je réserve à monsieur, et c’est lui qui est venu me supplier de combattre les ennemis de madame la comtesse de Sinabria, qui tremblait à la seule pensée du scandale dont on la menaçait, et qu’il voulait soustraire à cette honte. Voilà , monsieur le comte, comment je me suis trouvé en relation avec madame la comtesse, à laquelle je suis allé demander, naturellement, tous les détails dont j’avais besoin pour déjouer les projets de l’infâme gredin qui voulait lui extorquer un million.
Sir Ralph, pâle de colère, allait répliquer, quand Fanny vint prévenir que la voiture attendait M. le comte. On descendit.
— Où allons-nous ? demanda le Comte à sir Ralph au moment de monter en voiture.
— À Aubervilliers.
— Rue ?
— Rue de la Goutte-d’Or, n° 7.
— Qui donc demeure là ? demanda Rocambole.
— Madame Morel.
— Et quel rôle joue madame Morel dans votre drame ?
— Madame Morel est la sage-femme qui a accouché madame…
— C’est bien, dit brusquement le comte.
Il monta le dernier en voiture, en disant à François :
— Rue de la Goutte-d’Or, 7, à Aubervilliers.
XLI
LA SAGE-FEMME DE LA RUE DE LA GOUTTE D’OR
Au bout de trois quarts d’heure, la voiture du comte, emportée par deux excellents chevaux, avait dépassé la barrière de la Villette et roulait sur la route d’Aubervilliers.
— J’y songe, dit alors Rocambole, dans l’histoire qu’il vous a racontée, M. le comte, sir Ralph n’a-t-il pas eu l’idée, aussi ingénieuse que vraisemblable de placer dans un bouge infâme, dans un cabaret fréquenté par des grinches et des escarpes, le lieu choisi par madame la comtesse pour y aller accoucher clandestinement de l’enfant que déjà elle avait l’intention de supprimer aussitôt après sa naissance, car tout est aimable et gracieux au possible dans le petit roman de sir Ralph ?
— En effet, répondit le comte, un cabaret qui a pour enseigne…
— À la Providence.
— C’est cela, et situé dans une rue d’un aspect sinistre.
— La rue du Pont-Blanc.
— Justement.
— Eh bien, si nous commencions par visiter le théâtre où sir Ralph a placé son action ? J’avoue que j’en serais fort curieux ; d’après la description qui m’en a été faite. Cela vous a un goût qui rappelle les Mystères de Paris, roman dont sir Ralph a dû s’inspirer dans son histoire ; et je l’en félicite, car il ne pouvait choisir un meilleur modèle.
— Nous saurons tout à l’heure si je me suis inspiré des Mystères de Paris ou de la vérité seule, répondit sir Ralph avec une indifférence superbe ; quant au cabaret de la Providence, je me proposais d’y conduire M. le comte, après avoir vu la femme Morel ; mais, puisque tel est votre avis, allons d’abord rue du Pont-Blanc.
— Oui, commençons par là , dit le comte avec un accent triste et morne, dans lequel se trahissaient les mortelles angoisses dont il était dévoré depuis une heure.
— Je vais indiquer le chemin à votre cocher, dit sir Ralph.
Il abaissa une glace, se pencha à la portière et indiqua à François le chemin qu’il avait à prendre pour gagner la rue du Pont-Blanc.
Conformément à ces instructions, celui-ci alla tout droit jusqu’au fort ; une fois là , il tourna une rue à gauche et s’arrêta à l’entrée de la première rue à droite, trop impraticable pour qu’il osât s’y engager.
C’était la rue du Pont-Blanc.
— C’est là ? demanda Rocambole à sir Ralph.
— Oui, nous y sommes, répondit celui-ci.
François était descendu de son siège pour ouvrir la portière et abaisser le marchepied.
Quand tous trois furent descendus, sir Ralph dit au comte :
— Veuillez me suivre, c’est à deux pas.
Il prit les devants.
Le comte et Rocambole le suivirent.
Ils avaient fait vingt pas à peine quand sir Ralph s’arrêta et leur dit :
— Voilà le cabaret de la Providence.
L’affreux bouge, abandonné depuis plus de deux mois, était d’un aspect plus repoussant que jamais.
— Mais, fit observer le comte, qui ne put réprimer un frisson à l’aspect de cette hideuse demeure, cette maison n’est pas habitée.
— Elle est abandonnée depuis près de trois mois, répondit sir Ralph.
— Naturellement, répliqua Rocambole avec un sourire ironique, elle devait être abandonnée.
— Vous pouvez vous informer près des voisins, monsieur, dit vivement sir Ralph, ils vous affirmeront qu’elle était habitée, il y a peu de temps.
— Le propriétaire du cabaret a donc changé de domicile ? demanda le comte.
— Il a pris la fuite.
— Pourquoi cela ? à quel propos ?
— À la suite d’un meurtre commis dans son cabaret sur la personne d’un agent de police.
— Mais, vous qui tenez tous les fils de cette affaire, demanda Rocambole à sir Ralph, vous savez où demeure cet homme ?
— Je l’ignore.
— C’est étonnant.
— Nullement, puisque, par suite de ce meurtre, il est recherché par la police.
— De sorte que la maison où madame la comtesse a mis au monde l’enfant, fruit de l’adultère, a été précisément abandonnée quelques jours après, et que, par un hasard non moins extraordinaire, le patron du cabaret, dont le témoignage sur cette affaire eut été si précieux, a disparu comme une fumée et sans qu’il soit possible de retrouver sa trace. Ah ! il faut en convenir, monsieur, vous avez été heureux dans le choix de la maison où vous placez le théâtre principal de votre drame conjugal : une maison abandonnée et un propriétaire introuvable, il était impossible de mieux choisir. Et puis quel quartier ! quelle rue ! quel bouge ! Et, quand, pour compléter ce tableau, on se figure ce cabaret plein de bandits chantant, hurlant, se battant et tombant ivres morts sur le carreau, comme on comprend bien qu’une comtesse ait choisi un tel endroit pour y mettre au monde un enfant destiné à passer tout de suite de vie à trépas au milieu de cette bande de scélérats avinés !
— Rassurez-vous, monsieur, répliqua sir Ralph, je ne fuis pas la lumière, et, si Rascal nous manque, nous avons la sage-femme, dont le témoignage a pour le moins autant d’importance que celui du cabaretier de la Providence.
— Pourvu que la maison où habitait celle-ci ne soit pas incendiée ou écroulée et qu’il ne faille pas faire des fouilles pour la retrouver ! À moins qu’elle ne se soit transformée en citrouille et la sage-femme en souris, ce qui la gênerait beaucoup pour nous donner les renseignements que nous attendons d’elle. Bref, je m’attends à tout, excepté à voir face à face madame Morel.
— Et moi je vous réponds que nous allons la voir et lui parler, répondit sir Ralph à Rocambole.
— Allons, dit celui-ci, mettons-nous donc à la recherche de la sage-femme et espérons que vous serez plus heureux de ce côté qu’au fantastique cabaret de la Providence.
On remonta en voiture.
— Maintenant, dit le comte à François, rue de la Goutte-d’Or.
Et, se tournant vers sir Ralph :
— Veuillez indiquer à François…
— Inutile, répondit celui-ci ; je viens de me renseigner près d’un passant, et je connais mon chemin.
— Partez donc.
Cinq minutes après, il gagnait la place de la mairie et s’engageait dans la rue de Paris, arrivait à la rue de la Goutte-d’Or et s’arrêtait en face de la maison portant le n° 7.
— La maison existe ! s’écria Rocambole d’un air stupéfait.
Il ajouta aussitôt :
— Mais vous allez voir qu’elle ne l’habite plus ou qu’elle n’est pas chez elle en ce moment.
— Cela n’aurait rien de surprenant, sa profession l’appelant souvent dehors, répliqua sir Ralph.
— Parbleu ! fit Rocambole d’un ton railleur.
On descendit de voiture et sir Ralph, l’air sombre et soucieux, s’engagea le premier dans l’allée au fond de laquelle apparaissait vaguement, creusé sous l’escalier, une espèce d’antre d’un aspect sombre et repoussant.
C’était la loge du concierge.
Sir Ralph entrouvrit la porte et demanda en hésitant :
— Madame Morel !
— Au deuxième, porte à droite.
— Elle est chez elle ?
— Oui.
Il se retourna brusquement vers Rocambole.
— C’est ici et elle y est, monsieur Portal, lui dit-il tout rayonnant.
— Quand je l’aurai vue et touchée du doigt, je n’hésiterai pas à le croire, répondit celui-ci.
On gravit deux étages et sir Ralph frappa à la porte de droite, toujours inquiet et craignant que la sage-femme ne fût sortie sans avoir été aperçue du concierge.
Mais la porte s’ouvrit presque aussitôt et une vieille femme se montra sur le seuil.
— Madame Morel, sage-femme ? lui demanda sir Ralph.
— C’est moi, répondit la vieille.
Elle ouvrit sa porte toute grande et sir Ralph entra, suivi du comte et de Rocambole.
La vieille parut surprise en voyant entrer trois hommes chez elle.
— Il s’agit d’un accouchement ? demanda-t-elle.
— Non, madame, lui dit le comte, il s’agit d’un renseignement.
— Si vous voulez vous asseoir, messieurs, dit la sage-femme.
— Merci, madame, c’est l’affaire de deux minutes.
Il reprit d’un ton grave :
— Madame, je commence par vous supplier de bien rappeler vos souvenirs et de répondre avec une entière franchise à la réponse que je vais vous adresser.
— Je vous le promets, monsieur.

— Vous rappelez-vous avoir fait un accouchement le 31 décembre dernier ?
— Comme c’était la veille du premier jour de l’an, je me rappelle très-bien ce que j’ai fait ce jour-là .
— Et alors ? demanda le comte avec un léger tremblement dans la voix.
— Je me souviens que j’ai fait un accouchement ce jour-là .
Un éclair de triomphe passa dans les yeux de sir Ralph.
Rocambole restait impassible, du moins en apparence.
Le comte, lui, avait pâli, et il fut quelques instants sans pouvoir reprendre la parole.
— À quel sexe appartenait l’enfant ? reprit-il enfin.
— C’était un garçon.
C’est ce que lui avait dit sir Ralph.
Il passa lentement la main sur son front et ce fut après une pause plus longue encore que la première qu’il reprit :
— Cet accouchement a eu lieu rue du Pont-Blanc, au cabaret de la Providence.
— Hein ? comment dites-vous ça ? demanda madame Morel.
— Je dis rue du Pont-Blanc.
— Dans un cabaret ?
— Au cabaret de la Providence.
— Je n’ai jamais mis les pieds rue du Pont-Blanc, quant au cabaret de la Providence, dont j’ai entendu parler comme d’un repaire de brigands, je me serais bien gardée d’en passer le seuil ; merci ! des clients comme ça, c’est trop dangereux, je n’en veux pas.
— Quoi ! s’écria le comte en lui saisissant la main avec transport, vous n’avez pas accouché dans ce cabaret une femme jeune, belle, élégante ? vous n’avez pas déclaré vous-même l’enfant à la mairie avec cette mention : père inconnu ; mère, madame la comtesse de Sinabria ?
La sage-femme regarda le comte d’un air ahuri :
— Eh ! miséricorde ! s’écria-t-elle, quel conte me faites-vous là , mon cher monsieur ? une comtesse devenant mère dans ce repaire de bandits ! Ah çà , vous perdez la tête.
— Mais, madame, lui dit sir Ralph, qui avait pâli à son tour, rappelez vos souvenirs. C’est bien vous qui avez accouché cette dame au cabaret de la Providence, c’est vous qui l’avez déclaré comme fils de la comtesse de Sinabria.
— Et moi, s’écria la sage-femme avec une extrême animation, je vous déclare que c’est la première fois que j’entends parler de cette comtesse, que je n’ai jamais franchi le seuil de cet infâme cabaret, que le 31 décembre je n’ai fait qu’un seul accouchement, celui d’une fermière de la rue de Paris, et que, ce jour-là , je n’ai déclaré aucun enfant à la mairie. Voilà la vérité et n’essayez pas de me faire dire autre chose, ce serait inutile.
Les rôles avaient complètement changé.
Sir Ralph était anéanti, paralysé par la stupeur, tandis qu’à son tour le comte était rayonnant de bonheur.
— Allons, monsieur, dit alors Rocambole, madame Morel a répondu à toutes vos questions, il ne nous reste plus qu’à la remercier et à prendre congé d’elle.
— Merci, merci, madame, dit le comte à madame Morel en lui pressant la main avec effusion.
— Merci de quoi ? répondit celle-ci d’un air surpris, j’ai dit la vérité, je ne pouvais pas dire autre chose.
— Messieurs, dit Rocambole en ouvrant la porte.
Tous trois sortirent.
XLII
LES PREUVES
Quand on fut dehors :
— Eh bien, monsieur, dit Rocambole à sir Ralph avec un accent goguenard, que dites-vous de ces deux épreuves ! Vous commencez par nous conduire au cabaret de la Providence, où s’est passé le drame dont votre conscience d’honnête homme vous a poussé à faire confidence à M. le comte, et nous le quittons sans en emporter le moindre indice. Mais, dites-vous, c’est chez la sage-femme que va éclater la lumière, c’est là que les preuves vont se produire si claires et si palpables que le doute ne sera plus permis. En effet, nous sortons de chez la sage-femme avec une preuve écrasante, mais pas précisément dans le sens que vous aviez annoncé. Jusqu’à présent tous vos efforts n’ont abouti à nous prouver qu’une chose, c’est que vous êtes le plus impudent des imposteurs et le plus audacieux des coquins, croyez-moi donc, monsieur, restez-en là et, après ces malheureuses tentatives, faites amende honorable à genoux devant M. le comte, qui peut-être vous méprisera assez pour vous laisser la liberté d’aller vous faire pendre ailleurs, liberté dont vous ne tarderez pas à profiter, je l’espère.
Cet échec imprévu qu’il venait d’éprouver avait tellement stupéfié sir Ralph qu’il en était demeuré quelques instants dans une espèce d’abrutissement.
Il en était sorti peu à peu cependant en écoutant parler Rocambole, et, quand celui-ci eut fini :
— Vous vous pressez un peu trop de triompher, monsieur Portal, répliqua-t-il avec une rage contenue, ce n’est pas moi, c’est cette femme qui vient de mentir effrontément, et cela dans un but que je crois deviner. Elle a compris qu’il y avait un drame mystérieux dans ce qui s’est passé au cabaret de la Providence ; en se voyant interrogée par M. le comte, dans lequel elle a reconnu un personnage haut placé et peut-être un mari trompé, elle a flairé une mauvaise affaire et, dans la crainte d’y être compromise, elle a pensé que le plus prudent était de l’étouffer en niant tout pour innocenter la grande dame dont la perte pouvait entraîner la sienne.
Il ajouta après un moment de réflexion :
— Oui, c’est cela, ce ne peut être que cela.
— Voilà un argument des plus ingénieux, répliqua Rocambole, mais vous avez déjà donné tant de preuves d’imagination que celle-ci ne me surprend pas ; seulement permettez-moi de vous rappeler ce que vous disiez tantôt : les paroles ne signifient rien, les preuves seules ont une valeur et méritent considération.
— Eh bien, j’avais raison en parlant ainsi et je vais vous mettre en face d’un témoignage qui attestera deux choses à la fois : le mensonge de la femme Morel et la parfaite authenticité des faits que j’ai fait connaître à M. le comte.
— Ah çà , voyons, monsieur, dit Rocambole, il faudrait pourtant en finir, nous ne pouvons, M. le comte et moi, passer notre vie à la recherche de preuves qui, déclarées par vous irréfragables, tournent toujours à votre confusion. Je ne connais pas, je ne soupçonne nullement le nouveau témoignage que vous voulez invoquer, je consens cependant à m’y soumettre, et M. le comte y consent comme moi, j’en suis sûr, mais à une condition, c’est que cette épreuve sera la dernière, et, si elle est aussi convaincante que vous le dites, vous n’hésiterez pas à la considérer comme un arrêt définitif et sans appel dans l’affaire que nous plaidons l’un et l’autre.
— C’est entendu, monsieur ; quel que soit le résultat de cette nouvelle épreuve, je m’y soumets d’avance, et si, devant ce dernier témoignage, M. le comte hésite un seul instant à reconnaître la culpabilité de sa femme, je m’engage à rétracter aussitôt tout ce que je lui ai révélé, il y a une heure, et à me proclamer moi-même imposteur et calomniateur.
— Je prends note de cet engagement, en vous faisant remarquer que vous l’eussiez pris tout à l’heure au moment d’entrer chez madame Morel.
— Vous avez raison. Mais, cette fois, je n’ai pas à redouter les petites considérations qui ont effrayé la sage-femme et l’ont empêchée de déclarer la vérité.
— Bah ! vous trouverez bien encore un argument pour expliquer le prétendu mensonge du nouveau témoin auquel nous allons avoir affaire.
— C’est impossible, monsieur ; car, cette fois, ce n’est pas un individu que nous allons interroger, mais une administration.
— Une administration ? demanda Rocambole d’un air inquiet.
— Nous allons nous rendre à la mairie, où nous trouverons inscrits, sur les registres de l’état civil, le jour de la naissance de l’enfant, avec mention du nom de la mère, la comtesse de Sinabria, et du lieu où il est né, rue du Pont-Blanc, n° 5, où est situé le cabaret de la Providence, le tout déclaré par madame Morel, sage-femme rue de la Goutte-d’Or, n° 7 ; et, quand vous aurez lu tout cela sur ces registres, comme je l’ai lu moi-même, alors peut-être serez-vous convaincu enfin de l’imposture de la femme Morel et de l’authenticité de mes révélations au sujet de madame la comtesse.
— Il est certain qu’alors il serait insensé de douter, répondit Rocambole en quittant tout à coup le ton railleur et goguenard qu’il avait pris jusqu’alors vis-à -vis du sir Ralph.
Il reprit aussitôt :
— Et vous affirmez avoir lu cela sur les registres de la mairie ?
— Parfaitement ; or, il s’agit d’un acte officiel dont l’authenticité ne saurait être contestée.
— Je l’avoue.
— Rendons-nous donc à la mairie, dit le comte en montant en voiture et en faisant un signe à François, qui partit dès que Rocambole et sir Ralph furent montés eux-mêmes.
La voiture s’arrêtait quelques minutes après à la porte de la mairie.
On entra dans les bureaux.
— Monsieur, dit le comte à un employé, je voudrais avoir l’extrait d’un acte de naissance.
— La date de la naissance de l’enfant ! demanda l’employé qui, vieilli sous le harnais, connaissait trop le prix des paroles et l’importance de ses fonctions pour dire un mot de plus qu’il n’était rigoureusement nécessaire.
— Le 31 décembre dernier.
L’employé alla prendre un gros registre parmi une quantité d’autres rangés dans un rayon.
— Le nom de l’enfant ? demanda-t-il en ouvrant le registre.
— Vous qui avez lu l’inscription sur ce registre, demanda le comte à sir Ralph, sous quel nom est-il inscrit ?
— Henri, répondit sir Ralph.
— Le nom du père ? demanda l’employé.
— Père inconnu.
— Le nom de la mère ?
— La comtesse de Sinabria, répondit sir Ralph en jetant sur M. Portal un regard triomphant.
— Le nom de la rue où est né l’enfant ?
— Rue du Pont-Blanc, 5.
— 5 ? dit l’employé dont les traits immuables laissèrent soupçonner une vague impression de surprise.
Puis il grommela tout bas en feuilletant son registre :
— Au cabaret de la Providence ? une comtesse !… c’est drôle.
Il tournait les feuillets avec une lenteur et une impassibilité qui exaspéraient le comte, en proie à une inexprimable angoisse et impatient de connaître la vérité renfermée là , dans les pages de ce registre.
L’employé s’arrêta enfin.
— Ah ! voilà , le 31 décembre, dit-il avec sa voix incolore et son calme inaltérable.
— Écoutez, monsieur Portal, dit sir Ralph en se penchant à l’oreille de celui-ci, vous allez être enfin satisfait.
Le regard fixé sur l’employé, Rocambole feignit de ne pas entendre et ne répondit pas.
— Il paraît que vous n’êtes plus en train de rire, reprit sir Ralph.
L’employé, toujours impassible, raffermit ses lunettes sur son nez et lut :
— Le 31 décembre, nous avons deux naissances.
Le comte se laissa tomber sur une banquette.
Il fléchissait sur ses jambes et sentait tout tourner autour de lui au moment de voir éclater sous ses yeux la preuve irrécusable du terrible drame qui lui avait été révélé et dont il avait pu douter jusque-là .
L’employé lut :
— Charles-Pierre-Nicolas Duchamp, fils d’Antoine Duchamp, marchand de vin et de Claudine…
— Ce n’est pas cela, monsieur, passez à l’autre, lui cria sir Ralph.
L’employé regarda plus bas et lut :
— Marie-Laure Lefebvre, fille de Stanislas Lefebvre, fermier, rue de Paris, et de…
— Mais ce n’est pas cela, monsieur, s’écria de nouveau sir Ralph.
— Il n’y en a pas d’autre, monsieur, répliqua l’employé d’un ton sec.
— Comment ! il n’y en a pas d’autre, dit sir Ralph en bondissant vers le registre.
— Croyez-vous que je ne sache pas lire, monsieur ? lui dit l’employé d’un ton rogue.
Sir Ralph, sans s’inquiéter de la colère de l’employé, parcourait le registre avec une impatience fiévreuse.
— Et pourtant, s’écria-t-il en pâlissant, je l’ai lue, cette inscription, je l’ai lue là , à cette place où je lis l’inscription de la naissance de Charles-Pierre-Nicolas Duchamp, et ce qui me l’a gravée dans la mémoire, c’est le nom de Joséphin Rabassol, que je lis là , nom dont la singularité m’avait frappé et au-dessous duquel venait immédiatement l’inscription de Henri, fils de la comtesse de Sinabria, déclaré par madame Morel, sage-femme, et un autre témoin.
Dans un état d’agitation inexprimable, sir Ralph se démenait avec furie et répétait sans cesse en posant le doigt sur le registre :
— C’était là , je vous dis que c’était là , que je l’ai lue, que je crois la voir encore et qu’il y a là …
— Quoi donc ! quoi donc, monsieur ? s’écria le vieillard devenu tout à coup rouge d’indignation ; nous accuseriez-vous de falsifier nos registres, monsieur ?
— Prenez cela comme vous voudrez, monsieur ; mais ce qu’il y a de certain, c’est que l’inscription que nous cherchons était là et qu’elle a disparu pour faire place à une autre.
— C’est matériellement impossible, monsieur, et il faut avoir perdu l’esprit pour soutenir…
— Monsieur, dit tout à coup sir Ralph, les naissances ne sont-elles pas inscrites sur deux registres ?
— Oui, monsieur, deux registres, dont l’un reste ici, tandis que l’autre, au bout de deux ou trois mois, est envoyé à l’Hôtel-de-Ville. Mais, tenez, il n’y est pas encore… le voici, et nous allons bien voir…
— Ah ! je suis rassuré maintenant, s’écria tout à coup sir Ralph, c’est sur celui-là que nous allons trouver…
— C’est douteux, monsieur, puisque l’un est la copie fidèle de l’autre ; cependant nous allons voir.
Il alla prendre un autre registre, le feuilleta rapidement cette fois, car l’indignation le faisait sortir de son caractère, et trouva vite la page qu’il cherchait.
— Tenez, monsieur, dit-il à sir Ralph, voyez vous-même, l’inscription que vous cherchez ne se trouve pas plus sur ce registre que sur l’autre.
Sir Ralph qui suivait ces recherches du regard, savait déjà à quoi s’en tenir.
— C’est vrai, balbutia-t-il en roulant autour de lui des yeux hagards.
XLIII
DÉROUTE
Sir Ralph demeura quelques instants dans un état d’accablement qui semblait lui avoir ôté l’usage de ses facultés.
— Serais-je atteint de folie sans m’en douter ? murmura-t-il enfin en promenant autour de lui des regards inquiets.
— Eh bien ! monsieur, lui dit l’employé, vous avez voulu voir par vos propres yeux, vous avez vu ; êtes-vous enfin convaincu ?
— Monsieur, répondit sir Ralph, revenant à lui peu à peu, je suis convaincu que l’inscription que je croyais trouver là n’y est pas, mais j’ai une conviction non moins fermement arrêtée, c’est qu’elle y était et qu’elle a été effacée, c’est pourquoi je vous supplie d’examiner cette page et surtout ce petit carré avec une minutieuse attention.
— Je le ferai pour vous rendre service, monsieur, répondit l’employé, mais c’est parfaitement inutile, puisque nul que moi ici ne touche à ces registres.
Et il se mit à étudier avec un soin extrême la partie du feuillet que lui désignait sir Ralph.
— Monsieur, lui dit-il après quelques minutes d’examen, je ne vois pas là la moindre trace de grattage, et la netteté de l’écriture, absolument identique à celle qui couvre tout le reste du feuillet, me prouve clairement qu’il n’y a pas eu falsification, comme vous le prétendez. Or je puis en parler pertinemment, puisque cette écriture est la mienne.
— Et pourtant, s’écria sir Ralph en se frappant le front, je vous jure que la naissance du fils de la comtesse de Sinabria était là , à cette même place où je lis aujourd’hui celle de Charles-Pierre-Baptistin Duchamp.
— Enfin, que voulez-vous, monsieur ? le feuillet est sous vos yeux et vous n’y voyez pas ce que vous cherchez, il faut pourtant bien se rendre à l’évidence.
— Monsieur a raison et nous n’avons plus rien à faire ici, sir Ralph, dit Rocambole à celui-ci.
Et, sans attendre sa réponse, il sortit, suivi du comte et bientôt après de sir Ralph lui-même.
— Monsieur, dit le comte à Rocambole en lui pressant la main avec une ardente expression de reconnaissance, vous m’avez rendu un trop grand service pour que je puisse jamais m’acquitter envers vous, mais je ferai pour cela tout ce qui sera en mon pouvoir et je ne serai complètement heureux que le jour où vous m’aurez mis à même de vous être utile.
— Mon Dieu ! monsieur le comte, répliqua Rocambole, vous vous exagérez ce que j’ai fait dans cette circonstance ; je me suis borné à douter de la parole de cet homme et à le convaincre d’imposture en le contraignant à produire les preuves qu’il prétendait posséder ; voilà à quoi se réduit mon rôle dans cette affaire, mais l’innocence de madame la comtesse était trop facile à prouver pour que vous me fassiez un mérite d’y avoir réussi.
— Hélas ! monsieur, répondit le comte, je dois l’avouer à ma honte, cet homme m’avait convaincu ! Je ne songeais nullement à mettre en doute les témoignages sur lesquels il appuyait ses calomnies ; je n’eusse jamais eu la pensée d’aller vérifier ces preuves, et la comtesse eût été impitoyablement condamnée par moi. C’est donc vous, vous seul, qui nous avez sauvés l’un et l’autre en luttant corps à corps avec ce misérable.
Sir Ralph releva la tête en entendant cette épithète résonner à son oreille.
— Pardon, monsieur, lui dit Rocambole, qu’avez-vous donc dit tout à l’heure, au moment où nous quittions la rue de la Goutte-d’Or pour nous rendre ici ? N’avez-vous pas déclaré que, si vous ne fournissiez pas, dans cette dernière épreuve, un témoignage éclatant, irrécusable de tout ce que vous avez avancé, vous vous avoueriez vous-même coupable d’imposture et de calomnie ? Qu’attendez-vous donc pour faire cet aveu ? Après ce qui vient de se passer ici, oseriez-vous nier encore que toute votre histoire ne soit un tissu de mensonges imaginés dans le seul but d’exploiter la faiblesse d’une jeune femme facile à intimider, et de lui arracher un million par la crainte d’un scandale, trop admirablement combiné pour ne pas la frapper d’épouvante et la résoudre à tous les sacrifices ? Oh ! j’en conviens, votre plan est celui d’un homme très-fort, à la fois plein d’audace et profondément habile. Vous vous êtes fait ce raisonnement : en frappant l’imagination de la comtesse que sa jeunesse, sa beauté, sa haute naissance rendront plus accessible que toute autre à la crainte d’un éclat scandaleux, en lui montrant à travers quelles hontes et quelles fanges je vais la traîner aux yeux de tout Paris, soit dans le monde quelle fréquente, soit même devant les tribunaux, en déroulant devant son esprit inexpérimenté toutes les preuves dont je puis appuyer mon accusation : témoignage du patron du lieu infâme où il me plaira de transporter l’action de mon drame, témoignage de la sage-femme, inscription à la mairie de l’enfant d’une autre mère, déclaré fils de la comtesse de Sinabria ; avec une combinaison de cette force, il est impossible que je ne réussisse pas.
Mais supposons que par suite de quelque événement imprévu je vienne à échouer, qu’ai-je à craindre ? Absolument rien. Le comte lui-même, en admettant qu’il soit mis au courant de ma tentative, se gardera bien de me poursuivre, sachant bien qu’il est imprudent d’ébruiter la calomnie, même la plus absurde, et instruit par le mot de Basile à ce propos, qu’il en reste toujours quelque chose. Or, un million à gagner en cas de succès, rien à risquer en cas contraire, pourquoi hésiterais-je à tenter l’aventure ? Et vous l’avez tentée, et une fois pris vous-même dans les filets que vous aviez tendus pour votre victime, une fois mis en demeure de montrer ces preuves imaginées par vous pour effrayer celle-ci, vous avez été effrontément jusqu’au bout ; vous nous avez conduits au cabaret de la Providence, chez madame Morel, à la mairie, et encore, à cette heure, vous continuez votre comédie en feignant la stupeur chaque fois que les preuves annoncées s’évanouissent et tournent contre vous.
— Oui, oui, je suis vaincu et vous avez beau jeu contre moi, murmura sir Ralph, encore tout étourdi du coup qu’il venait de recevoir, mais je ne renonce pas à la partie ; ce que vous appelez imposture et calomnie est l’exacte vérité, l’enfant a été inscrit à la place que j’ai désignée et en a disparu je ne sais comment ; bref, il y a dans toute cette affaire des manigances dont je soupçonne la source et que je saurai bien découvrir, je ne vous dis que cela, monsieur Portal.
— Fort bien, monsieur, répondit celui-ci ; mais, quant à présent, je maintiens la parole que vous nous avez donnée il y a un quart d’heure à peine, et je vous déclare que vous êtes un misérable imposteur.
Il ajouta, en fixant sur sir Ralph son regard pénétrant :
— Mais je fais une réflexion.
— Laquelle ? demanda sir Ralph avec une vague inquiétude.
— Je m’étonne que vous acceptiez si facilement votre défaite, quand vous pouvez mettre sous nos yeux, à l’appui de votre récit une preuve matérielle irrécusable cette fois.
— Je ne vous comprends pas, dit sir Ralph en regardant Rocambole avec un sentiment d’appréhension.
— Du moment qu’un enfant est né, qu’il a été déclaré et inscrit sur les registres de l’état civil, il s’ensuit naturellement que cet enfant existe ; ceci est d’une logique rigoureuse. Comment se fait-il donc que vous ne songiez même pas à nous mettre sous les yeux ce témoignage vivant, irrécusable de la faute de madame la comtesse ?
Sir Ralph resta un instant déconcerté devant cet argument.
Mais il se remit vite, et ce fut d’un ton ironique qu’il répondit :
— À quoi bon ? on ne manquerait pas de dire que j’ai loué cet enfant pour les besoins de ma cause, comme font certaines mendiantes.
— C’est égal, M. le comte pensera comme moi, j’en suis sûr, que c’est bien extraordinaire.
— En voilà assez comme cela, répondit le comte, nous n’avons plus rien à faire avec cet homme, retournons à Paris, car j’ai hâte de revoir la comtesse, envers laquelle je viens de me rendre coupable de torts bien graves, quoiqu’elle doive toujours les ignorer.
Il alla parler à François.
Profitant aussitôt de son éloignement, Rocambole se rapprocha de sir Ralph et lui dit vivement à voix basse :
— Voulez-vous que je vous dise pourquoi vous ne produisez pas l’enfant, sir Ralph ?
— Mais, répondit celui-ci en se troublant, parce que…
— Parce qu’il faudrait l’aller chercher dans la cave des époux Claude, d’où vous le rapporteriez un peu défiguré, n’est-ce pas…
Et il s’éloigna, laissant sir Ralph comme foudroyé.
XLIV
LE SAUVEUR
Rocambole se rapprocha de sir Ralph et lui parlant à voix basse :
— Deux mots pendant que nous sommes seuls, lui dit-il ; oui, la comtesse de Sinabria est devenue mère dans le cabaret de la Providence, où elle avait été transportée de force et par vos ordres ; oui, madame Morel a reçu l’enfant et l’a déclaré à la mairie d’Aubervilliers ; oui, il a été inscrit sur le feuillet et à la place même que vous avez désignée, et il y était encore, il y a trois jours, mais j’ai soufflé sur tous ces témoignages qui eussent été la condamnation, l’éternel malheur d’une femme digne de pitié, et ils se sont évanouis, ou plutôt, ils se sont retournés contre vous. Vous voyez par là ce dont je suis capable et ce qu’on gagne à lutter contre moi.
Et, comme sir Ralph l’écoutait avec un profond sentiment de stupeur :
— Vous vous étonnez de ma franchise et peut-être trouverez-vous ces aveux bien imprudents, reprit Rocambole, mais, si je vous parle ainsi, c’est que je puis le faire en toute sécurité. Dites un mot de ce que je viens de vous révéler, et je dénonce à la justice le meurtrier de l’enfant trouvé, il y a trois jours, dans la cave des époux Claude.
— Mais cet enfant n’a pas été assassiné, je vous le jure, s’écria sir Ralph, atterré par cette menace.
— Pourquoi donc l’avez-vous transporté de Meudon, où vous l’aviez mis en nourrice, à la demeure des époux Claude ? Et pourquoi ceux-ci l’ont-ils enterré dans leur cave ?
— Parce que, l’enfant étant mort de convulsions, j’ai trouvé un égal danger à déclarer et à dissimuler le nom de sa mère, et que, pour éviter de me compromettre, j’ai jugé prudent de l’enfouir dans la maison de Vanves, bien loin de soupçonner qu’on irait le chercher là un jour.
— C’est possible, et je suis porté à vous croire, car vous n’aviez aucun intérêt à supprimer cet enfant, au contraire ; mais la justice, qui est défiante, voit là un crime et en recherche déjà l’auteur ; que je vous désigne, et, vous êtes perdu, car vous avez dans votre dossier des antécédents qui ne plaideraient pas en votre faveur, ne fût-ce que le double meurtre des époux Christiani.
À ces derniers mots, sir Ralph laissa échapper un cri étouffé.
Puis fixant sur Rocambole un regard plein d’anxiété :
— Christiani ! balbutia-t-il, je ne sais ce que vous voulez dire.
— Ah ! vous ignorez cette histoire ; je vous l’apprendrai plus tard, bientôt peut-être car nous ne tarderons pas à nous retrouver face à face.
— Mais, monsieur, je n’ai aucune raison pour me mettre en lutte avec vous désormais, s’écria sir Ralph épouvanté à la pensée de tout ce que venait d’accomplir cet homme : j’ai été vaincu, j’en prends mon parti et vous promets qu’à l’avenir vous n’avez rien à redouter de moi.
— Mais moi, répliqua Rocambole avec un accent ironique, j’ai pris goût au jeu ; s’il vous a plu de le commencer, il ne me convient pas de le laisser là , et je vous le répète, nous nous reverrons bientôt ; allons, au revoir, sir Ralph.
— Quand vous voudrez, monsieur Portal, lui cria en ce moment le comte.
Rocambole se dirigea aussitôt vers la voiture où il prit place à côté du comte, et les chevaux partirent.
— Ah ! s’écria alors celui-ci, que de pardons je vais avoir à demander à ma femme pour avoir ajouté foi à toutes ces calomnies !
Rocambole ne répondit pas.
Il réfléchissait.
Il se disait : Laisser le comte aller se jeter aux genoux de sa femme pour lui demander pardon de l’avoir crue coupable d’une faute… qu’elle a commise, c’est grave. La chose serait sans danger s’il s’agissait d’une Nanine la Rousse ; loin de se troubler elle jouerait la comédie de l’innocence calomniée et profiterait habilement de la circonstance pour fortifier sa position et affermir son empire sur le cœur du coupable ; mais la comtesse est une nature loyale et noble, en dépit de sa chute, il serait possible que la vue de son mari, tombant à ses pieds pour s’accuser, déterminât en elle une explosion de remords et lui arrachât l’aveu complet de la vérité. C’est ce qu’il faut éviter, et il n’y a qu’un moyen, c’est de dissuader le comte de son généreux mouvement.
— Eh bien, monsieur Portal, vous ne me répondez pas, dit le comte frappé du silence de celui-ci, me désapprouveriez-vous ?
— Vous désapprouver ! non, pas précisément, répondit Rocambole, mais enfin je ne ferais pas cela.
— Pourquoi ?
— Mon Dieu ! monsieur le comte, quelque délicatesse que vous y mettiez, vous ne sauriez aborder un pareil sujet sans froisser la susceptibilité de madame la comtesse, sans faire saigner une plaie si douloureuse et si vive encore, que le plus généreux et le plus prudent à la fois est de n’y pas toucher. Voilà du moins mon avis.
Le comte réfléchit un instant.
— Je crois que vous avez raison, dit-il enfin.
Il ajouta :
— Il faudrait pourtant qu’elle sût qu’elle n’a plus rien à redouter de ce misérable.
— Ne trouvez-vous pas que c’est à moi que revient naturellement la mission de l’en instruire, à moi qui, ayant été son confident, son conseil et son appui dans cette affaire, puis seul peut-être lui en parler sans lui causer une impression pénible ?
— Eh bien, soit, chargez-vous donc de lui apprendre ce qui s’est passé.
Pendant que ces événements se passaient à Aubervilliers, la comtesse de Sinabria, enfermée dans sa chambre, était dans des transes dont on peut se faire une idée, quand on songe à tout ce qu’elle avait à redouter de l’expédition qu’entreprenait en ce moment son mari en compagnie de sir Ralph et de M. Portal.
Le lecteur a compris que l’assurance un peu factice qu’elle avait montrée dans sa lutte contre sir Ralph lui avait été inspirée par un entretien préalable avec Rocambole et par la confiance que lui avait inspirée celui-ci dans les moyens qu’il avait de réduire à néant les témoignages sous lesquels elle croyait être écrasée.
Mais, restée seule, elle s’était mise à songer à la puissance de ces témoignages, dont un surtout, l’inscription de la naissance de l’enfant, déclaré fils de la comtesse de Sinabria, lui semblait à la fois indestructible et irrécusable, et alors, frappée de l’impossibilité de combattre de pareilles preuves, elle était tombée dans un profond découragement.
À mesure que le temps s’écoulait, son imagination s’exaltant de minute en minute lui montrait toutes les espérances dont elle s’était bercée un instant s’évanouissant à chaque pas que faisait son mari dans cet odieux pays où elle avait souffert mille morts ; d’abord au cabaret infâme dans lequel elle était devenue mère ; puis chez la sage-femme qui l’avait délivrée ; à la mairie surtout, en ce lieu fatal où son déshonneur était écrit en toutes lettres et à jamais ; et enfin chez la nourrice de son enfant, devant ce témoignage vivant de sa honte ; car, n’ayant jamais su en quel lieu sir Ralph l’avait caché, elle ignorait la mort de l’innocente créature.
Deux heures s’étaient écoulées depuis le départ de son mari : une éternité ! et, depuis longtemps déjà , elle s’écriait sans cesse, en proie à une inexprimable agitation :
— Mon Dieu ! mon Dieu ! ils ne reviennent pas, que font-ils donc ?
Et elle allait et venait, se rejetait dans son fauteuil, recommençait à parcourir sa chambre, en murmurant des paroles incohérentes, parmi lesquelles revenait fréquemment cette phrase :
— Mon Dieu ! que font-ils donc ? Mon Dieu ! que se passe-t-il ? Ils ne reviendront donc pas ?
Elle jetait ces exclamations pour la centième fois peut-être, quand la porte de sa chambre s’ouvrit tout à coup.
C’était Fanny, qu’elle avait chargée de la prévenir dès qu’elle verrait entrer dans la cour de l’hôtel la voiture de son mari.
À sa vue, elle se leva toute droite, devint affreusement pâle et darda sur elle un regard fixe et atterré, sans pouvoir proférer une parole.
— Le voilà ! dit Fanny.
— Déjà ! balbutia la comtesse.
Elle se sentit fléchir sur ses jambes, et il lui sembla qu’un voile tombait sur ses yeux.
Fanny eut à peine le temps de la recevoir dans ses bras.
Elle l’étendit dans le fauteuil qu’elle venait de quitter en lui disant d’une voix basse et rapide :
— Remettez-vous, remettez-vous, madame ; il va entrer à l’instant, et, s’il vous voit dans cet état, vous êtes perdue ; ce trouble vous trahit.
— Alors je suis perdue, Fanny, car je succombe sous le poids de mon émotion ; je n’ai pas la force de me dominer.
On frappa en ce moment.
— C’est lui ! murmura la jeune femme en passant son mouchoir sur son front, où venait de perler une sueur subite ; c’est lui, je me sens mourir. Va ouvrir, Fanny, et reste près de moi ; ne me laisse pas seule.
Fanny courut ouvrir la porte.
C’était Rocambole.
D’un coup d’œil celui-ci devina ce qui se passait, il comprit les tortures sous lesquelles succombait la jeune femme après deux heures de doutes et d’angoisses.
Courant alors à elle et saisissant ses deux mains dans les siennes :
— Remettez-vous, madame, lui dit-il d’une voix basse et émue, vous êtes sauvée.
La comtesse releva la tête et fixant sur lui ses grands yeux bleus, à la fois troublés et rayonnants :
— Sauvée ! Vous dites que je suis sauvée ! murmura-t-elle en serrant nerveusement ses deux mains dans ses doigts crispés.
— Sauvée à tout jamais, madame.
— Mais cet homme ! mon ennemi !
— Sir Ralph ?
— Oui.
— Si vous le rencontrez, regardez-le en face, prononcez seulement mon nom ; et c’est lui qui tremblera devant vous.
— Monsieur ! ah ! monsieur ! s’écria Rita, dont les larmes jaillirent tout à coup, laissez-moi vous remercier à genoux.
Et elle fit un mouvement pour tomber aux pieds de Rocambole.
Celui-ci l’arrêta et, la forçant de se rasseoir :
— Vous m’avez donné l’occasion de sauver à la fois deux personnes d’un désespoir éternel, vous et votre mari, lui dit-il, le plus heureux de nous deux en ce moment, c’est peut-être moi, madame.
XLV
LE CHÂTIMENT
Quand ses terreurs furent entièrement calmées, lorsqu’en outre Rocambole lui eut affirmé qu’elle n’avait pas même à redouter l’embarras où pourrait la mettre un entretien avec son mari sur ce sujet, celui-ci lui ayant déclaré son intention formelle de n’en jamais parler, la comtesse, après une longue hésitation, se décida à adresser à son sauveur une question qui semblait avoir peine à sortir de ses lèvres :
— Monsieur Portal, lui dit-elle en rougissant légèrement, il est un point que nous avons passé sous silence et dont il a dû être question cependant.
— Que voulez-vous dire, madame ?
— Parmi les témoignages qui s’élevaient contre moi, il en est un que cet homme n’a pu oublier, qu’il a dû mettre sous les yeux du comte et que vous avez vu conséquemment.
— De qui voulez-vous parler, madame ?
— Mais de… de mon enfant, répondit Rita avec émotion et en baissant la voix.
Il y eut un moment de silence.
Voyant enfin qu’il ne répondait pas, la jeune femme leva les yeux sur Rocambole et elle fut frappée de la gravité empreinte sur ses traits :
— Eh bien, monsieur, lui dit-elle devenue toute tremblante sans savoir pourquoi, que s’est-il donc passé en face de cet enfant ?
— Nous ne l’avons pas vu, madame.
— Comment sir Ralph n’a-t-il pas songé à le mettre sous les yeux du comte ?
— Il ne le pouvait pas.
Rocambole avait prononcé ces derniers mots avec un accent qui avait fait tressaillir la comtesse.
Elle le regarda fixement et lui dit d’une voix atterrée par l’émotion :
— Vous me faites trembler, monsieur ; pourquoi ne le pouvait-il pas ?
— N’insistez pas, madame, croyez-moi, et contentez-vous de l’heureuse nouvelle que je viens de vous apporter.
— Non, non, vous me cachez quelque chose, monsieur, quelque chose d’affreux, dit la jeune femme d’une voix agitée, mais je veux savoir la vérité, quelle qu’elle soit ; je vous en supplie, parlez donc, est-ce que ?…
Elle s’arrêta tout à coup, puis, se levant brusquement et dardant sur Rocambole un regard effaré :
— Grand Dieu ! balbutia-t-elle, je crains de comprendre votre silence ; est-ce que… est-ce qu’il serait m…
Pour toute réponse, Rocambole laissa tomber sur la comtesse un regard dont l’expression pleine de pitié fut pour elle un trait de lumière.
— Il est mort ! il est mort ! s’écria-t-elle en se laissant retomber sur son fauteuil, où elle se tordit de douleur.
Rocambole ne chercha pas à la consoler par des paroles banales.
Il la laissa pleurer.
— Pauvre enfant ! pauvre enfant ! murmurait la jeune femme, en essuyant les larmes qui ruisselaient sur son visage, quelle destinée a été la sienne ! Venu au monde dans un lieu infâme, au milieu des transes, des larmes, des tortures d’une mère qui se voyait menacée de mort ; privé des baisers de cette mère désespérée, aux bras de laquelle on l’arrache aussitôt né pour le jeter aux mains d’une étrangère, pauvre enfant ! Quel a été son sort ici-bas et pourquoi Dieu a-t-il permis qu’il vît le jour ?
Elle ajouta en levant sur Rocambole un regard plein d’angoisse :
— Et qui sait si sa mort n’est pas le résultat d’un crime ! Pauvre petit ! Quand je songe à l’homme qui s’était emparé de lui, je tremble de…
— Non, madame, répondit vivement Rocambole, rassurez-vous, il est mort comme tant d’autres enfants, emporté par une convulsion.
— Ah ! si sa mère eût été là , elle l’eût disputé à la mort, elle l’eût sauvé ; mais le pauvre petit être n’avait pas de mère près de son berceau, sa faute la condamnait à vivre loin de lui, et c’est lui, lui, innocente victime, qui a porté la peine de cette faute. Ah ! monsieur, il me fallait un châtiment, et Dieu me l’envoie ; je porterai là , au fond du cœur, un deuil éternel.
— Je vous laisse tout entière à votre douleur, madame, lui dit Rocambole, adieu et à bientôt, car j’aurai des comptes à vous rendre et de nouveaux renseignements à vous donner.
Il ajouta au moment de s’éloigner :
— Permettez-moi une recommandation, madame.
— Parlez, monsieur Portal.
— C’est après-demain qu’aura lieu le mariage de mademoiselle Tatiane Valcresson avec sir Ralph, et c’est demain soir, contre la coutume, que M. Mauvillars célèbre cette union par une fête, un bal masqué, ce qui s’explique d’ailleurs par la détermination qu’a exprimée sir Ralph de partir avec sa jeune femme, immédiatement après la cérémonie ; eh bien, madame, croyez-moi, vous qui avez déjà montré tant d’énergie, tant de force de caractère dans les terribles épreuves que vous avez eu à traverser, faites un dernier, un suprême effort pour renfermer votre douleur en vous-même et vous montrer à cette fête calme et souriante aux bras de votre mari.
— Merci, monsieur Portal, merci de votre conseil, je ferai tous mes efforts pour le suivre.
Il pressa la main que lui tendait la comtesse et sortit.
Une demi-heure après, il était de retour rue Amelot.
En entrant dans le petit salon, il se trouva en face d’un tableau qui le fit sourire et lui fit faire tout bas cette réflexion :
— Qui eût jamais cru !…
C’est que ce tableau, fort étrange en effet pour qui connaissait le passé, représentait la petite muette plongée dans un vaste fauteuil, et en face d’elle, assis sur un tabouret, Rascal, l’homme aux bras rouges, les mains en l’air et les doigts occupés par un écheveau de laine que Jeanne dévidait avec une gravité de matrone.
— Je vois que vous êtes bons amis, dit Rocambole à Rascal.
— C’est-à -dire, s’écria celui-ci en jetant sur la muette un regard ravi que cette petite ferait de moi tout ce qu’elle voudrait et que je me demande à toute minute comment j’ai pu la brutaliser autrefois au lieu de l’adorer comme un petit ange.

![]()
— Cela prouve qu’autrefois tu étais un sauvage et qu’aujourd’hui tu es un homme. Mais nous avons à causer, il faut remettre à plus tard cette grave occupation.
Mécontente d’être dérangée, Jeanne se leva d’un bond, enleva l’écheveau des doigts de Rascal, fit comprendre à Rocambole qu’elle n’était pas du tout satisfaite de lui et sortit avec une moue très-prononcée.
XLVI
RÈGLEMENT DE COMPTES
Quand il se vit seul avec Rascal, Rocambole dit à celui-ci :
— J’ai laissé sir Ralph anéanti sous les étonnements successifs que je lui avais préparés et atterré sous la menace de le dénoncer comme le meurtrier de l’enfant trouvé dans la cave des époux Claude, il était loin de soupçonner la source à laquelle j’avais puisé ce dernier renseignement.
— Il voit toujours en moi un instrument dévoué, comme je l’étais à l’époque où nous avons transporté, de Meudon à Vanves, le pauvre petit être, emporté par les convulsions, comme je vous l’ai dit.
— Qu’as-tu appris de neuf aujourd’hui ?
— Un double meurtre accompli sur la personne de deux domestiques de l’hôtel Meurice, où demeurent les deux complices, et dans lequel je crois entrevoir la main de sir Ralph.
— Qui te le fait croire ?
— Il est sorti avec l’un et l’autre successivement, dans l’espace d’une demi-heure ; ni l’un ni l’autre n’a reparu, et l’un des deux a été assassiné près du pont, on en a acquis la certitude.
— Et l’autre ?
— L’autre, au dire de sir Ralph, doit être, à coup sûr, l’assassin de son camarade, ce qui ne me paraît pas prouvé du tout.
— Bon ! j’irai flâner ce soir du côté de l’hôtel Meurice et je tâcherai d’éclaircir ce mystère. En attendant, je vais retourner de suite à Aubervilliers, où j’ai rendez-vous avec trois personnes entre six et sept heures. Veux-tu m’y accompagner ?
— Volontiers, maître.
— Partons donc, la voiture qui m’a amené ici nous attend à la porte.
Un instant après, cette voiture les emportait vers la Villette, et, au bout d’une heure, elle s’arrêtait rue du Fort, à la porte d’un marchand de vin, situé à peu de distance de la rue du Pont-Blanc.
Il passa dans un cabinet réservé, où le suivit le patron de l’établissement dont il paraissait être connu.
— Personne n’est encore arrivé ? lui demanda Rocambole.
— Pas encore, monsieur.
— Rascal, dit-il bas à celui-ci, tu vas rester là , dans la salle commune ; tu introduiras près de moi le premier arrivé et tu feras en sorte que les autres ne causent pas entre eux.
— Compris, répondit celui-ci, faut pas qu’on jabote, ce serait dangereux, j’y aurai l’œil.
Rascal et le marchand de vin sortirent, laissant Rocambole seul dans le cabinet, maigrement éclairé par une chandelle.
Il y était depuis cinq minutes à peine, quand la porte s’entrouvrit, laissant passer la tête de Rascal.
— Qui est arrivé ? lui demanda Rocambole.
— La personne du sexe.
— Fais entrer.
Rascal se retira et une femme franchit le seuil du cabinet.
C’était madame Morel.
Quand elle eut reformé la porte :
— Madame Morel, lui dit Rocambole, tous avez joué votre comédie avec une intelligence, un aplomb, un naturel dignes des plus grands éloges, vous m’avez aidé puissamment dans la mission que je m’étais imposée de réparer le mal qu’avait fait le misérable sir Ralph, et vous avez largement gagné la récompense que je vous ai promise.
Il ouvrit un porte-monnaie, y prit un billet de banque et le remit à la sage-femme, en lui disant :
— Êtes-vous contente ?
Celle-ci ouvrit le billet et ses traits s’épanouirent aussitôt.
— Cinq cents francs ! s’écria-t-elle d’un air aussi ravi que si elle eût vu les cieux s’entrouvrir à ses regards.
— Pour une bonne action, dit Rocambole, ce qui est rare, on ne paye que les mauvaises.
— Oh ! merci, dit madame Morel en faisant une révérence, merci, monsieur…
— Monsieur tout court, répliqua Rocambole, je n’ai pas d’autre nom en ce moment.
Il ajouta, de manière à lui faire comprendre qu’il ne lui restait plus qu’à se retirer :
— Allons, au revoir, madame Morel.
La sage-femme comprit et sortit.
Un instant après, la tête de Rascal reparaissait dans l’entrebâillement de la porte.
— C’est le garçon de bureau, dit-il.
Un homme d’une quarantaine d’années entra.
Il jetait des regards inquiets à droite et à gauche et paraissait fort peu rassuré.
— Ne tremblez donc pas comme cela, lui dit Rocambole, vous n’avez rien à craindre ici ; personne ne peut entendre ce qui se passe entre vous et moi dans ce cabinet.
— C’est que, voyez-vous, monsieur, dit le garçon, j’ai commis un acte bien grave en abusant de la confiance qu’on m’accorde pour apporter ici les deux registres des naissances, sachant bien que c’était pour faire disparaître une inscription ; un faux, monsieur, oui, un faux pour lequel je risquais le bagne.
— Heureusement, répondit Rocambole, tout s’est passé pour le mieux ; vous n’avez fait de mal à personne, au contraire, et cet acte de complaisance va vous sortir de tous les embarras et de tous les dangers que vous créaient vos dettes. En voici la liste, ajouta-t-il en jetant un coup d’œil sur un papier qu’il tira de sa poche, total : treize cents francs.
Il puisa de nouveau au porte-monnaie et remit au garçon de bureau un billet de mille francs et trois de cent francs chaque.
Celui-ci sortit, non moins heureux que la sage-femme, Rascal reparut aussitôt, suivi d’un individu qu’il fit entrer.
Celui-là était M. Robertson, expert, trop expert en écritures, genre de talent dont, on s’en souvient, il avait donné un échantillon à Rocambole en son domicile de la rue du Foin-Saint-Jacques.
— Monsieur Robertson, lût dit Rocambole, vous avez accompli un véritable miracle : le vieil employé de la mairie, après un minutieux examen, a pris votre écriture pour la sienne. Or, voici comment je décompose ma dette vis-à -vis de vous : 1° pour avoir fait le trajet de Paris à Aubervilliers par une soirée froide et pluvieuse, cinq cents francs ; 2° pour avoir passé deux heures dans ce cabinet pour corriger une erreur sur deux registres, mille francs ; 3° retour à Paris par le même temps froid et pluvieux, cinq cents francs, ce qui nous fait un total de deux mille francs, que je vais vous compter à l’instant si vous approuvez mon compte.
— Je l’approuve ! s’écria Robertson avec transport.
— Voilà donc deux billets de mille francs, et bonne chance, monsieur Robertson !
— Et si jamais vous avez besoin de moi… dit celui-ci en empochant les deux billets.
— Soyez tranquille, je me souviendrai de vous.
XLVII
UNE MAUVAISE JOURNÉE
Sir Ralph, lui aussi, avait repris le chemin de Paris, mais dans une triste disposition d’esprit, comme on se l’imagine.
Il arriva vers neuf heures à l’hôtel Meurice, où Mac-Field l’attendait avec une vive impatience.
La première question que lui adressa ce dernier en le voyant entrer trahit tout de suite le principal objet de ses préoccupations.
— Eh bien, lui dit-il, vous avez le million de la comtesse ?
— Nous en sommes loin, répondit sir Ralph en se jetant dans un fauteuil avec l’expression d’un profond découragement.
— Comment ! s’écria Mac-Field stupéfait, elle a refusé ?
— Oui, positivement.
Et de plus, elle m’a chassé.
— Et vous ne l’avez pas menacée de tout révéler à son mari ?
— Je n’y ai pas manqué !
— Eh bien ?
— Eh bien, elle a envoyé elle-même chercher son mari, avec lequel elle m’a laissé en lui disant que j’avais une communication à lui faire.
— C’est prodigieux. Mais qu’avez-vous fait alors ?
— Voyant qu’il n’y avait plus rien à attendre de la femme, j’ai tout dit au mari, dans l’espoir de tirer de lui une bonne somme en m’engageant à ne rien révéler d’une histoire qui devait porter une rude atteinte à sa considération.
— Le coup a dû porter ?
— En plein, et j’allais lui poser mes conditions, lorsqu’un homme se fait annoncer, entre malgré le comte, force celui-ci à l’entendre, déclare qu’il connaît le sujet de notre entretien, et l’engage à prouver que mes prétendues révélations ne sont que d’infâmes calomnies.
— Que vous importaient les déclarations de cet homme ? N’étiez-vous pas en mesure de prouver le contraire ?
— Je le croyais du moins.
— Vous le croyiez ! s’écria Mac-Field ; ah ! çà , à quoi songez-vous donc ? N’aviez-vous pas, à l’appui de vos affirmations, deux témoignages écrasants : la déclaration de la sage-femme d’Aubervilliers et surtout l’inscription de la naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil !
— Oui, oui, j’avais tout cela, la femme Morel, que j’avais vue la veille, était prête à déclarer toute la vérité, et les deux registres de la mairie, que je m’étais fait ouvrir quelques jours après la naissance de l’enfant, contenaient bien l’inscription de cette naissance avec mention de la mère, la comtesse de Sinabria, ainsi déclarée par la femme Morel.
— Eh bien, alors ?
— Eh bien alors, la sage-femme, interrogée par nous, a déclaré n’avoir jamais mis les pieds au cabaret de la Providence, ni entendu parler d’une comtesse de Sinabria.
— La misérable ! elle avait été gagnée.
— Nous courons à la mairie, nous demandons un extrait de l’acte de naissance de l’enfant inscrit sous le nom de Henri, fils de la comtesse de Sinabria, et là … je crus à un accès de folie, cette inscription que j’avais lue de mes propres yeux avait disparu de la place qu’elle occupait sur les deux registres et y était remplacée par une autre.
— Par exemple ! voilà qui passe toute croyance, s’écria Mac-Field atterré.
— Savez-vous qui avait accompli ce miracle ? ajouta sir Ralph ; l’individu qui était entré de force chez le comte pour lui déclarer qu’il n’y avait pas un mot de vrai dans mon histoire.
— Mais quel est donc cet homme ?
— Cet homme, c’est M. Portal.
— Lui ! s’écria Mac-Field avec un sifflement de colère. Ah ! j’avais bien dit qu’il nous serait fatal.
Il ajouta, après une pause :
— Mais comment a-t-il pu faire disparaître de deux registres ?…
— Ah ! voilà ce qu’il ne m’a pas dit ; il s’est contenté de me déclarer qu’il avait soufflé sur mes preuves et les avait fait évanouir.
— Mais c’est un démon que cet homme-là !
— Démon redoutable, dont le nom seul me fait trembler, je l’avoue. Savez-vous les paroles qu’il m’a laissées pour adieu ? Il m’a dit : « À la moindre tentative contre moi ou ceux que je protège, je vous dénonce, vous et votre complice Mac-Field, comme les meurtriers des époux Christiani ».
— Il sait cela ! s’écria Mac-Field.
— Il sait tout, même la mort de l’enfant de la comtesse et son transport dans la maison de Claude, où il vient d’être découvert par la police.
— Vous avez raison, murmura Mac-Field, c’est un ennemi bien redoutable que ce M. Portal.
Il reprit, après un long silence :
— Décidément, sir Ralph, nous traversons à cette heure une phase terrible, car moi aussi j’ai une fâcheuse nouvelle à vous apprendre.
— Ah ! fit sir Ralph en se troublant tout à coup.
— Vous vous rappelez que j’ai prié Baptiste, le domestique de l’hôtel, de nous tenir au courant du drame de la rue de la Sourdière, en lui disant que cette affaire m’intéressait très-vivement ?
— Oui, je me rappelle.
— Eh bien, il est allé avec un camarade chez le commissaire de police, où étaient, il y a quelques heures encore, les cinq doigts trouvés au bord de l’égout.
— Il les a vus ?
— Oui, et son camarade a déclaré qu’il croyait reconnaître l’anneau attaché à l’un de ces doigts comme ayant appartenu à Peters, le domestique anglais disparu depuis deux jours.
— En effet, murmura sir Ralph, voilà qui est mauvais ; cependant cet homme n’a exprimé qu’un doute, et si nous avons la chance que le corps ne se retrouve pas dans les égouts, cet incident perd toute son importance.
— Il a suffi cependant pour donner l’éveil et je sais que le patron de l’hôtel est allé en ce moment à la Morgue, où doit être exposé ce corps, s’il a été retrouvé.
— Si j’y courais moi-même ! s’écria sir Ralph ; il est de la plus haute importance que nous soyons renseignés sur ce point avant tout le monde, afin de prendre nos mesures en conséquence. Si je vois sur les dalles le corps de Peters, nous n’avons qu’un parti à prendre, partir au plus vite, sans perdre une minute.
— Il est peut-être dangereux que l’un de nous se montre par là , répondit Mac-Field ; mais d’un autre côté, il est essentiel, comme vous le dites, que nous sachions au plus vite à quoi nous en tenir.
— Partons, dit sir Ralph, munissez-vous de nos papiers, j’entrerai à la Morgue, en blouse et en casquette, vous m’attendrez aux environs et si je reconnais Peters, nous filons.
Ce plan arrêté, Mac-Field et sir Ralph allaient sortir, lorsqu’on frappa à la porte de la chambre.
Ils échangèrent tous deux un regard plein d’anxiété.
— On sait que nous sommes ici, dit enfin sir Ralph ; refuser d’ouvrir serait une imprudence fort grave et d’ailleurs inutile.
Et il cria :
— Entrez !
La porte s’ouvrit et un homme entra.
Les deux complices furent aussitôt rassurés.
C’était Baptiste.
Il était pâle et semblait être sous le coup d’une vive émotion.
— Monsieur, dit-il à Mac-Field après avoir fermé la porte, vous m’avez recommandé de vous tenir au courant de l’affaire de la rue de la Sourdière, c’est pour ça que je viens.
Mac-Field fit un effort pour ne pas trahir son trouble.
— Ah ! ah ! fit-il d’un air dégagé, nous avons donc du nouveau ?
— Oui, milord.
— Eh bien, contez-nous cela, Baptiste.
— Monsieur, reprit Baptiste, j’arrive de la Morgue, où je suis allé avec mon maître.
— Eh bien, qu’avez-vous vu ?
— Ah ! milord, quelque chose d’horrible.
— Quoi donc ? parlez.
— Il y avait beaucoup de curieux, et cela se comprend, car deux hommes étaient étendus sur les dalles.
— Et ces hommes, demanda vivement Mac-Field, où avaient-ils été trouvés ?
— Dans les égouts.
— Ah ! fit sir Ralph.
— Tous deux ? demanda Mac-Field.
— Tous deux, oui, milord.
— Et demanda sir Ralph en hésitant, est-ce que Peters ?…
— Oui, milord, l’un des deux était Peters.
— Vous l’avez reconnu ?
— Nous l’avons reconnu, mais pas à son visage.
— Comment cela ?

![]()
— Ah ! milord, quel tableau ! lui et son compagnon n’avaient plus de figure, elle avait été rongée par les rats ; et ce qu’il y a d’affreux à penser, c’est qu’ils ont été dévorés ainsi de leur vivant.
— Qui vous fait croire cela ?
— D’abord Peters, quand on l’a trouvé, en tenait un dans ses doigts raidis, ce qui prouve qu’il y a eu lutte, que lui et son compagnon ont du être attaqués par une bande de ces animaux, que l’envahissement subit des égouts avait sans doute chassés vers la bouche dans laquelle avaient été jetés les deux hommes. On suppose que dans leur chute ceux-ci ont dû se cramponner à ces petites barres de fer qui, scellées dans le ciment, forment une espèce d’escalier dans chaque regard d’égout, et que c’est là qu’avant de s’engloutir ils ont eu à soutenir un combat acharné contre une armée de rats affolés, furieux, rendus enragés par le débordement des eaux.
— Vilaine mort, en effet, murmura Mac-Field.
— Mais, fit observer sir Ralph, comment avez-vous pu reconnaître Peters dans un individu dont la figure était dévorée par les rats.
— Nous l’avons reconnu à sa main droite coupée juste à la naissance des doigts.
— Ce qui a dû le gêner dans son combat contre les rats, dit Mac-Field affectant toujours une grande liberté d’esprit ; allons, allons, voilà un homme qui n’a pas eu d’agrément et dont le dernier soupir a manqué de gaieté.
— Oh ! oui, milord, répliqua Baptiste en frissonnant de tous ses membres.
— Alors, reprit Mac-Field, si cet individu est bien réellement Peters, il est clair que ce n’est pas lui qui a assassiné le cocher Jack, comme on l’avait supposé.
— Évidemment, milord.
— Comment explique-t-on la mort de Peters dans un égout ?
— Voilà ; on suppose qu’ils étaient trois associés, trois complices, que le troisième devait se trouver avec Peters au rendez-vous donné à celui-ci par Jack, que, sachant sans doute Peters nanti d’une forte somme, fruit des vols commis en commun, il aura suivi celui-ci jusque chez le docteur où il accompagnait sir Ralph, que, le voyant sortir seul, il aura trouvé le moyen de l’attirer vers cette bouche d’égout, avec le projet arrêté de l’y précipiter, et que dans la lutte il aura été saisi et entraîné par sa victime. Dans l’impossibilité où l’on est d’établir la vérité, voilà , milord, les conjectures auxquelles on s’est arrêté, quant à présent, mais, au moment où je vous parle, mon camarade, celui qui a reconnu la bague d’argent de Peters, est à la préfecture de police, où il a été appelé pour y donner tous les renseignements qui sont à sa connaissance.
— Ah ! dit vivement sir Ralph, la police s’occupe de cette affaire ?
— Oui, milord, et si vous le voulez, puisque cela vous intéresse, dès que mon camarade sera de retour, je l’interrogerai et vous ferai part de ce qu’il m’aura appris.
— Volontiers, répondit Mac-Field, ce pauvre Peters nous a servis quelques jours et il m’inspire la plus vive sympathie.
— Vous n’avez pas besoin de mes services, milord ?
— Pas en ce moment, Baptiste.
Quand celui-ci se fut retiré :
— Eh bien, demanda sir Ralph, que dites-vous de la situation ?
— Voilà mon avis, répondit Mac-Field, la police ne donnera nullement dans la fable d’un troisième complice et de toutes les conjectures qui en découlent : elle sera frappée de ce fait que deux hommes, sortis coup sur coup avec un certain sir Ralph, ont été assassinés l’un et l’autre, et cela dans l’espace d’une demi-heure ; alors, sans laisser percer le moindre soupçon à l’égard de sir Ralph, sans paraître aucunement se préoccuper de lui, elle ouvrira une enquête secrète à l’effet de connaître l’identité de sir Ralph et de Mac-Field d’abord, puis de Peters et de Jack. Cela durera bien trois jours, pendant lesquels nous n’avons rien à redouter. Or, c’est demain soir qu’a lieu la grande soirée des fiançailles, c’est après-demain votre mariage ; acceptez demain soir ce que vous a proposé M. Mauvillars, la dot sans la femme, vous filez immédiatement après la cérémonie, ce à quoi la police ne s’attend pas, et le soir même nous sommes en Belgique, avec la dot en poche.
— Oui, le plan est parfait, répondit sir Ralph.
— Je le crois sûr, mais soyons sur nos gardes et ne nous rendons à la soirée de demain qu’avec un revolver chargé et tout armé dans nos poches.
XLVIII
RETOUR À LA VILLA
Il est temps de revenir à un personnage dont nous n’avons pas parlé depuis bien longtemps et auquel, nous l’espérons du moins, le lecteur a du s’intéresser, c’est Louise Prévôt, la mère de la petite muette.
On sait que, par les soins de Pierre Valcresson, la gracieuse villa de Fontenay-aux-Roses avait retrouvé son éclat et sa splendeur d’autrefois.
Comme alors, les roses grimpantes la couvraient tout entière, tapissaient le toit dans toute son étendue et retombaient de là , comme de longs rideaux, à quelques pieds du sol.
Le jardin aussi était redevenu cet éblouissant fouillis de fleurs, qui rappelait toujours, aux regards charmés des passants, l’image du paradis terrestre.
Et afin que l’illusion fût complète et rappelât à chaque pas le passé au souvenir de la pauvre folle, Pierre Valcresson avait employé le même jardinier, afin qu’il répandît à profusion les mêmes plantes et les mêmes fleurs qui jadis frappaient à toute heure les regards de l’infortunée.
Dans ce milieu enchanté où elle vivait sans cesse, Louise Prévôt avait recouvré rapidement le calme et la sérénité qui lui manquaient depuis longtemps, et sa mémoire, incessamment excitée par l’aspect des objets qu’elle avait eus si longtemps sous les yeux, lui rappelait un à un, par fragments confus d’abord, puis de plus en plus lumineux, des souvenirs auxquels se mêlait parfois l’image de son enfant.
Le lecteur a pu s’étonner de voir Jeanne demeurer près de Rocambole et de Vanda, tandis que son père et sa mère vivaient à la villa de Fontenay. C’est que telle avait été la volonté expresse du médecin qui, craignant l’accumulation des souvenirs et des impressions dans cette tête encore si faible, s’était réservé de juger plus tard du moment où il trouverait opportun de faire venir l’enfant près de sa mère.
Ce jour vint enfin.
L’apaisement s’était fait dans l’âme de la jeune femme, dont le regard plein de douceur et les traits calmes et reposés n’offraient plus aucune trace d’exaltation.
Depuis quelques jours, elle parlait plus fréquemment de son enfant, elle rappelait toutes ses gentillesses, tout son charme et toutes ses grâces naïves avec une émotion de plus en plus accentuée, mais se la représentant toujours enfant, toujours petite et rieuse, étourdie et folle, comme à l’heure où elle s’était effacée de son esprit envahi par la folie.
— Non, mon amie, elle n’est plus ainsi, lui disait souvent Pierre Valcresson, il s’est écoulé bien du temps depuis que tu es malade, depuis le jour où il a fallu l’emmener loin de toi.
Et comme elle ne pouvait se faire à l’idée que son enfant ne fût plus telle qu’elle l’avait toujours connue, telle qu’elle était restée dans sa mémoire, Pierre Valcresson lui avait dit, en lui montrant un arbre de son jardin :
— Tiens, mon amie, tâche de rappeler tes souvenirs, voici un bouleau, aujourd’hui très-gros et donnant beaucoup d’ombrage, qui jadis, c’est Jeanne qui me l’a dit, pouvait tenir dans ses deux petites mains ; eh bien, c’est ainsi que Jeanne s’est développée, c’était alors un arbuste, aujourd’hui c’est un petit arbre.
Puis il lui montrait deux photographies de l’enfant, l’une exécutée autrefois, quand elle avait quatre ans, par un habile photographe chez lequel l’avait conduit sa mère, qui s’en souvenait parfaitement ; l’autre, faite tout récemment, et dont la tête conservait quelques traits de la première, dont elle différait cependant sur beaucoup de points, et il lui disait :
— Voilà notre petite Jeanne telle que tu l’as connue, et la voici telle qu’elle est aujourd’hui.
— Non, non, ce n’est plus elle, disait Louise Prévôt en secouant tristement la tête, on l’a changée, ce n’est plus elle.
Un jour qu’assise sous la tonnelle près de Pierre Valcresson, elle avait avec lui un entretien tantôt sensé et suivi, tantôt mêlé de divagations, elle lui dit tout à coup :
— Je voudrais voir mes deux Jeanne.
Pierre Valcresson, qui portait toujours sur lui les deux portraits, afin de les lui mettre fréquemment sous les yeux, les tira de sa poche et les lui montra.
Elle les contempla longtemps l’un après l’autre, puis posant le doigt sur celui qui datait de quelques jours :
— Oui, dit-elle d’une voix attendrie, oui, elle est bien changée. C’est égal, je sens que je l’aime toujours, et je voudrais la voir.
Et se tournant vivement vers M. Valcresson :
— Où est-elle donc ? demanda-t-elle.
— Elle est chez des amis qui l’aiment et la soignent comme leur propre fille, répondit Pierre.
— Pourquoi pas près de moi ?
— Parce que tu étais malade et qu’il te fallait un repos complet, ma chère Louise.
— Oui, je me rappelle, dit la jeune femme en touchant son front, j’ai été bien malade.
Elle ajouta après une pause :
— Mais je vais bien maintenant, elle peut revenir près de moi.
— Elle viendra demain, mon amie, je vais écrire à cet effet à M. Portal et à madame Vanda, qui ont été un père et une mère pour notre petite Jeanne.
— Je serai bien heureuse de les connaître, dit Louise.
Le lendemain Rocambole recevait une lettre par laquelle Pierre Valcresson le priait de venir dîner avec Vanda et sa chère petite Jeanne, ajoutant qu’il était heureux de lui apprendre que la lumière se faisait de jour en jour dans l’esprit de la pauvre Louise et qu’il croyait pouvoir compter sur une prochaine et complète guérison.
Rocambole s’empressa de communiquer cette nouvelle à Jeanne, qui sauta de joie à la pensée de revoir sa mère, dont Vanda l’entretenait longuement depuis quelque temps, et de courir dans le beau jardin qui se dégageait comme une ravissante vision de ses souvenirs d’enfance.
Toutes ces joies furent doublées encore par la perspective d’une ravissante toilette préparée depuis quelques jours en vue de quelque circonstance solennelle et qu’elle allait mettre pour la première fois à cette occasion.
À trois heures elle était prête et on n’attendait plus que le chapeau.
Enfin, à quatre heures, Rascal qui était parti au pas de course chez la modiste, rentrait rue Amelot avec un carton, qu’il tenait au bout des doigts comme s’il eût été de verre.
Dans sa joie, Jeanne avait embrassé l’homme aux bras rouges.
Il était près de six heures quand Rocambole, Vanda et Jeanne arrivèrent à la villa de Fontenay.
La première personne qu’ils aperçurent en entrant fut Milon, qui, on le sait, s’était constitué le gardien et le protecteur de la pauvre folle pendant les fréquentes absences que Pierre Valcresson était obligé de faire.
— Eh bien, lui dit Rocambole, il paraît que notre chère malade va mieux ?
— Pas depuis ce matin, répondit tristement Milon.
— Qu’est-il donc arrivé ? demanda vivement Vanda.
— Rien de grave ; mais le calme parfait qu’on avait remarqué en elle depuis quelque temps et que le docteur considérait comme un excellent symptôme a disparu tout à coup pour faire place à une sombre agitation. Elle parcourt incessamment la maison du haut en bas et le jardin jusque dans ses moindres recoins, s’arrêtant à chaque instant devant une plante, devant un arbre, devant un banc de pierre et regardant chaque objet avec un mélange de surprise et d’émotion, comme si elle le voyait pour la première fois.
— A-t-on prévenu le médecin ?
— Oui.
— Qu’a-t-il dit ?
— Il est venu, il l’a suivie partout, il a étudié ses gestes, ses regards, ses expressions de physionomie, puis il nous a prévenus qu’il se préparait une grande crise dont il était impossible de prévoir le résultat, mais qui exigeait de notre part une surveillance de tous les instants. Bref, il m’a paru fort inquiet.
— Pauvre femme ! murmura Rocambole, qui sait si ce n’est pas la crise suprême qui se prépare ? Ah ! le cœur ne subit pas impunément de pareilles tortures.
Pierre Valcresson arriva en ce moment.
Ses traits portaient l’empreinte d’une profonde angoisse.
— Milon vous a dit ce qui se passe, n’est-ce pas dit-il à Rocambole.
— Et vous nous en voyez très-affligés.
— N’en laissez rien paraître ; son regard se porte partout avec une expression qui m’inquiète ; observez-vous donc, je vous en prie, et feignez de ne pas vous occuper d’elle.
— Rassurez-vous, nous nous conformerons à votre recommandation.
— Vu l’extrême douceur de la température, j’ai fait dresser la table dans le jardin, près de la maison, afin qu’elle ait toujours sous les yeux un tableau agréable, comme le désire le docteur ; venez donc et mettons-nous à table sans lui adresser la parole.
On passa dans le jardin.
La jeune femme était déjà à table en effet.
Tout le monde y prit place sans faire attention à elle.
Elle, au contraire, portait son regard sur chacun des convives et fixait l’un après l’autre les trois nouveaux venus, comme si elle eût voulu lire au fond de leurs âmes.
Tout à coup elle tira de sa robe deux cartes, les deux portraits de Jeanne, les considéra quelques instants avec une vive émotion, puis, étendant brusquement la main vers la petite muette :
— C’est Jeanne ! s’écria-t-elle.
Elle ajouta en désignant la place qu’occupait Rocambole à ses côtés :
— Pourquoi n’est-elle pas là , près de moi ?
Rocambole se leva en faisant un signe à Jeanne qui vint prendre sa place.
Alors Louise, prenant l’enfant par le menton, lui releva doucement la tête en lui disant :
— Regarde-moi en face, que je voie tes yeux.
Jeanne fixa sur elle ses grands yeux expressifs, à la fois pleins de douceur et de pénétration.
La pauvre folle la regarda longtemps.
Immobile comme si elle eût été de pierre, dardant sur l’enfant son regard ardent et profond, elle rappelait vaguement le sphinx antique posant au voyageur ses redoutables énigmes.
— Oui, oui, balbutia-t-elle enfin d’une voix frémissante et l’œil traversé tout à coup d’un rayonnement extraordinaire, oui je la reconnais, c’est elle, c’est ma petite Jeanne, qui courait dans ce jardin après les papillons.
Puis, passant lentement ses doigts dans les beaux cheveux de l’enfant :
— Et toi, lui demanda-t-elle, me reconnais-tu ?
La petite muette semblait elle-même très-émue.
Ce regard maternel, si profond et si tendre à la fois, elle se le rappelait comme dans un rêve.
Il réveillait en elle tout un passé radieux et vague comme une vision, tout un monde de souvenirs confus et charmants, images insaisissables flottant dans un azur lumineux, fouillis étincelant où se mêlaient étrangement des masses de fleurs, des vols de papillons, des étincellements de soleils, de blanches clartés de lune, des gazouillements d’oiseaux, et planant au-dessus de tous ces enchantements, comme un paradis toujours ouvert, le doux sourire et les grands yeux de sa mère.
Et ces beaux yeux qui avaient rayonné sur toute son enfance elle les reconnaissait en ce moment.
Alors des larmes jaillirent tout à coup de ses yeux et, se jetant au cou de sa mère, elle l’embrassa avec un débordement de tendresse qui bouleversa la jeune femme et la fit sangloter à son tour.
Quelques minutes se passèrent dans ces effusions, puis la jeune femme éloigna l’enfant pour la regarder de nouveau et elle lui dit :
— Tu me reconnais donc ?
Jeanne répondit par un signe de tête affirmatif.
— Pourquoi ne parle-t-elle pas ? demanda Louise Prévôt en promenant son regard autour de la table.
— Elle est muette, répondit Pierre Valcresson.
— Muette ! c’est faux, elle parlait autrefois, je me rappelle sa voix, elle chante encore dans mon cœur et dans mes oreilles.
Elle se tut, parut réfléchir, puis elle murmura en se touchant le front :
— Muette !… Attendez donc, je vous ai entendus raconter un jour une histoire… ou bien, n’est-ce pas plutôt un rêve ?… Oh ! oui, oui, c’est trop horrible, c’était un rêve… Une enfant entraînée dans un repaire de bandits, une horrible vieille, des ciseaux à la main, lui ouvrant la bouche de force, et…
Elle se leva tout à coup ; un profond sentiment d’horreur contracta ses traits, et plongeant dans les yeux de l’enfant un regard brûlant d’angoisse :
— Ouvre ta bouche, que je voie ! lui dit-elle toute frémissante.
Jeanne obéit.
Alors un cri terrible, déchirant, dans lequel éclatait une souffrance surhumaine, s’échappa de la poitrine de l’infortunée.
Elle tomba à la renverse en balbutiant :
— C’est elle ! elle… mon enfant, qui a enduré…
La phrase mourut sur ses lèvres. Elle avait perdu connaissance.
LXIX
LA LUMIÈRE DANS LE CHAOS
Plus de dix minutes s’écoulèrent avant que Louise Prévôt reprît l’usage de ses sens.
On l’avait relevée et étendue dans un large fauteuil que Milon était allé prendre dans la maison.
En revenant à elle, elle promena sur tous ceux qui l’entouraient des regards étonnés ; puis ses grands yeux bleus se portèrent sur le jardin, qu’elle contempla avec l’expression d’un profond ravissement.
Elle demeura ainsi quelques instants dans une espèce d’extase, les traits empreints de cette douce et profonde béatitude qui rayonne sur le visage des convalescents, puis elle murmura d’une voix pénétrante :
— Que tout cela est beau, mon Dieu ! cette terre pleine de fleurs et de parfums, ce ciel tout bleu, cet horizon tout en flammes. Oh ! que tout cela est beau !
Tournant ensuite ses regards vers ceux qui, groupés autour d’elle, la regardaient avec une curiosité inquiète :
— Rassurez-vous, leur dit-elle avec un charmant sourire, la nuit qui enveloppait mon esprit vient de se dissiper tout à coup, et c’est mon enfant, c’est ma chère petite Jeanne qui vient d’opérer ce miracle ; c’est elle qui, déchirant le voile qui obscurcissait ou dénaturait tout autour de moi, a laissé déborder la sensibilité dans mon cœur et la lumière dans mon intelligence. Oh ! je vous reconnais maintenant, vous tous qui passiez devant mes yeux comme des ombres, et dont la voix frappait mon oreille sans éveiller ma pensée ; je vous reconnais bien, monsieur Portal, vous aussi, bonne et charmante Vanda, que je vois aujourd’hui pour la première fois, mais dont j’ai entendu prononcer le nom aussi souvent que celui de Jeanne, dont vous avez été la mère ; je te reconnais, mon excellent Pierre, toi qui as traversé les mers pour apporter le bonheur et le bien-être à ta chère Louise, et toi aussi, pauvre enfant, je te reconnais, toi qu’on m’a enlevée un jour, jour terrible, heure désespérée, où le désespoir tomba comme la foudre dans mon âme, et y fit la nuit. Vous voyez bien tous, enfin, que la pauvre folle a recouvré l’usage de ses facultés, la lucidité de son esprit, et qu’elle voit clair aujourd’hui dans toutes les choses qui s’étaient entassées et emmêlées dans sa pensée, où jusqu’à ce jour elles n’ont formé qu’un sombre et indéchiffrable chaos.
— Louise ! oh ! ma chère et adorée Louise, s’écria Pierre Valcresson, avec une explosion de joie qui transforma tout à coup sa physionomie, triste et grave depuis son retour.
Et ils tombèrent dans les bras l’un de l’autre, pleurant tous deux, et balbutiant des phrases incohérentes dont la confusion même trahissait toute leur tendresse.
— Ah ! s’écria la jeune femme en s’arrachant enfin de ses bras pour attirer à elle son enfant, tout émue elle-même de ce qui se passait sous ses yeux, mon bonheur serait complet maintenant si ma chère petite Jeanne, si jolie, si gracieuse, n’était, pour ainsi dire, rejetée de la société par cette triste infirmité comme je l’étais tout à l’heure encore par…
— Ne rappelons pas ce triste souvenir, lui dit vivement Pierre Valcresson, n’en parle jamais, ma Louise adorée, oublie ces années d’égarement pour ne plus songer qu’au bonheur qui nous attend désormais.
— Et quant à Jeanne, dit à son tour Vanda, ne la plaignez pas trop et ne la croyez pas séparée du monde par cette infirmité, beaucoup moins grave que vous ne pensez. D’abord elle n’est pas privée, comme les autres muets, de la faculté d’entendre, et c’est surtout cette privation qui élève une barrière entre le monde et ces infortunés, et puis elle est si intelligente et s’exprime si clairement par gestes, qu’elle se fait comprendre aussi bien que nous tous par la parole.
— Chère enfant ! ah ! elle ne nous quittera plus maintenant, il faut vous résoudre à nous la rendre, dit Louise en pressant Jeanne contre son sein.
— Ce ne sera pas sans regret, je vous le jure, répondit Vanda, car elle a autant de cœur que d’intelligence et nous l’aimons tous comme si elle était à nous.
Jeanne sourit à ces dernières paroles et envoya de loin une caresse à Vanda.
Puis elle lui fit plusieurs signes que Vanda traduisit à Louise à laquelle ce langage était tout à fait inconnu.
— Elle me dit, expliqua-t-elle, qu’elle consent à se séparer de nous à la condition que nous viendrons la voir.
— Et j’espère bien, moi aussi, que vous lui procurerez souvent ce bonheur.
— Nous l’aimons trop pour y manquer.
— Pauvre chérie ! dit Louise en baisant l’enfant au front, que serait-elle devenue sans vous ! Ah ! quand je songe au monstre entre les mains duquel elle était tombée, à cet odieux Rascal dont j’ai si souvent entendu parler, bourreau sans cœur et sans…
Jeanne prit tout à coup sa mère par la main et la regarda fixement en faisant plusieurs signes de tête négatifs.
— Que veut-elle dire ? demanda Louise étonnée.
— Elle veut dire, répondit Vanda, qu’il ne faut pas dire de mal de Rascal.
— Comment ? s’écria la jeune femme, ce misérable qu’elle avait surnommé l’homme aux bras rouges…
— L’homme aux bras rouges est aujourd’hui son meilleur ami ; il a subi son charme comme tous ceux qui l’approchent, il est devenu son esclave, son chien soumis, attentif à deviner tous ses caprices et toujours prêt à les satisfaire, quels qu’ils soient ; aussi vous voyez comme elle le défend aujourd’hui, elle que son nom seul faisait trembler autrefois.
Pendant ce temps, voici les quelques mots qui s’échangeaient entre Rocambole et Pierre Valcresson :
— Vous rappelez-vous qu’un jour vous m’avez parlé d’un certain Louis Dupré en me racontant la triste histoire de Louise Prévôt ? disait Rocambole.
— Oui, je vous ai dit que cet homme, son mari, était un misérable qui…
— N’en dites plus de mal.
— Pourquoi cela ?
— Je vous avais demandé d’un ton indifférent où demeurait cet homme ; vous me l’avez dit, je suis allé aux renseignements, et…
— Eh bien ?
— Eh bien, il est mort.
— Mort ! répéta Pierre Valcresson avec une émotion qui n’avait rien de triste.
— C’était le seul service qu’il pût rendre à sa femme, il faut lui en savoir gré et n’en plus dire de mal, comme je viens de vous y engager.
— Mort ! murmura M. Valcresson avec une joie contenue, enfin rien ne s’oppose plus à ce que ma chère Louise devienne ma femme !
— Ce sera le couronnement de son bonheur, mais la tête est faible encore, attendez quelque temps avant de lui annoncer cette nouvelle.
L
UN MAUVAIS QUART D’HEURE
Mis en belle humeur par la bonne nouvelle que venait de lui apprendre Rocambole, Pierre Valcresson s’écria en souriant :
— Il me vient une idée maintenant que nous voilà tous heureux, il me semble que ce n’est pas le moment de nous laisser mourir de faim ; si nous dînions ! qu’en dites-vous ?
— L’idée est excellente et je l’approuve, répondit Rocambole.
— Et moi qui oubliais que j’avais des convives ! dit Louise.
— Je vais commander qu’on serve à l’instant même, dit Milon.
Et il courut à la cuisine.
Un instant après une servante arrivait avec la soupière toute fumante et les convives affamés dépliaient leurs serviettes avec un ensemble qui annonçait les dispositions les plus menaçantes à l’endroit des victuailles, quand un bruit extraordinaire, terrifiant, quoiqu’inexplicable, se fit entendre l’autre extrémité du jardin.
Tous les regards se tournèrent aussitôt de ce côté avec un sentiment de vive appréhension.
Au même instant, la petite porte de bois qui fermait le jardin de ce côté sauta en éclats et un groupe informe, si bizarre et si étroitement uni qu’il était impossible d’en distinguer la nature, fit irruption au milieu des fleurs avec la violence brutale et irrésistible d’une trombe.
Bientôt on entrevit deux êtres enroulés l’un dans l’autre et semblant ne faire qu’un, quelque chose de monstrueux qui rappelait vaguement le centaure de la fable.
Seulement, deux bruits distincts et très-différents sortaient de ce groupe indéchiffrable, des cris humains et une espèce de grognement sourd, furieux et sinistre.
— À moi ! à moi ! au secours ! cria enfin une voix affolée, pleine d’épouvante.
Un moment paralysés, les uns par la surprise, les autres par la peur, les convives murmurèrent tout bas :
— Qu’est-ce que c’est que ça ?
— Je vais voir, dit Rocambole, en mettant la main dans la poche de sa jaquette, d’où il tira un revolver qu’il arma aussitôt.
Puis il s’avança vers ce couple indéchiffrable qui caracolait au milieu des fleurs, l’un jetant toujours des cris aigus, désespérés, l’autre ne cessant de faire entendre des grognements étouffés et effrayants.
Quand il ne fut plus qu’à quelques pas, Rocambole jeta un cri à son tour et resta immobile, son arme à la main.
Il paraissait atterré.
Ce qu’il avait sous les yeux c’était une femme et un chien.
La femme venait de rouler dans un parterre de primevères et le chien, se ruant sur elle, lui fouillait la gorge et la figure de ses crocs aigus.
— Tuez-le, je suis perdue ! tuez-le, il est enragé ! criait la femme d’une voix troublée et défaillante.

En effet, une bave blanchâtre bordait la gueule de l’animal, et ses yeux sanglants flamboyaient comme deux charbons ardents.
Rocambole fit encore deux pas en avant, le doigt posé sur la détente du revolver.
Alors il fit une autre découverte non moins extraordinaire que la première.
Cette femme, c’était madame Claude.
— Oh ! tuez-le, tuez-le ! hurla la malheureuse en se jetant la face contre terre, pour éviter les morsures de l’animal furieux.
Rocambole s’approcha du chien, ce qu’il pouvait faire sans danger ; car, acharné sur sa victime, il ne voyait rien autour de lui, et il fit feu à bout portant.
L’animal tomba au milieu des fleurs et roula deux ou trois fois sur lui-même.
Mais il n’était pas mort.
Il tourna vers sa victime sa gueule ensanglantée, fit un effort pour se remettre sur ses pattes et s’élancer de nouveau sur elle, et, n’y pouvant parvenir, il se traîna de son côté en faisant entendre un râle sourd et furieux.
Rocambole lui envoya une seconde balle dans la tête.
Il se tordit quelques instants.
Puis il ne bougea plus.
La femme Claude le regardait avec des yeux démesurément ouverts.
Le sang ruisselait par cinq à six morsures qu’elle avait reçues à la gorge et au visage, et elle l’essuyait machinalement avec ses mains, également déchirées par les crocs du chien.
C’était un spectacle horrible, hideux et effrayant à la fois.
— Oh ! non, non, balbutia-t-elle en proie à une terreur qui secouait tous ses membres et faisait claquer ses dents l’une contre l’autre, non, il n’était pas enragé ; oh ! non, ce serait trop horrible, Dieu ne voudrait pas m’envoyer une mort aussi effroyable.
— Le chien était enragé, lui dit gravement Rocambole, et c’est la Providence elle-même qui t’envoie la mort que tu redoutes tant et que tu as si bien méritée ; c’est elle qui veut que tu expies ici, à cette place, le plus odieux de tes crimes. Tiens, vois-tu là -bas cette femme et cette enfant pressées l’une contre l’autre ? L’enfant est cette douce et innocente créature, cette petite Jeanne que tu as si cruellement mutilée, il y a de cela dix ans, pour la confier ensuite à un saltimbanque ! La femme est la mère de cette enfant. Eh bien, comprends-tu maintenant que cette mort, la plus effroyable que puisse rêver l’imagination, n’est que le juste châtiment de ta barbarie ?
— La rage ! la rage ! murmura la misérable vieille, les traits affreusement contractés ; la seule mort qui me fasse peur, car j’ai vu une fois un malheureux… Ah ! À ce souvenir, je sens mes cheveux se dresser sur ma tête !
Puis, se levant d’un bond :
— Oh ! mais il y a un moyen… on brûle les plaies avec un fer rouge… je cours.
— Les crocs de l’animal ont pénétré dans ta gorge et le virus y circule déjà ; la cautérisation est impossible sur cette partie du corps. Va, tout est inutile, tu es condamnée ; il faut te résigner à expier par cette terrible mort tous les crimes dont tu as souillé ta vie.
La vieille avait écouté ces paroles en frémissant et en roulant autour d’elle des yeux hagards.
Tout à coup elle s’élança à travers le jardin en criant d’une voix étranglée :
— Sauvez-moi ! sauvez-moi !
Et elle disparut ainsi par la petite porte qu’elle avait brisée pour échapper à la poursuite du chien.
LI
UNE MAUVAISE INSPIRATION
Le lecteur qui croyait madame Claude en Belgique avec son digne époux a dû s’étonner de la voir paraître tout à coup à la villa de Fontenay ; une explication est donc nécessaire à ce sujet.
Nous savons que Paul de Tréviannes avait fait remettre par Malvina dix mille francs aux époux Claude, afin de permettre à ceux-ci de se réfugier à l’étranger et de laisser leur fille libre de révéler le mystère de l’odieuse machination de sir Ralph, sans les exposer à la vengeance de celui-ci.
D’abord pris de vertige en se sentant entre les mains une pareille somme, les deux époux résolurent d’exécuter aussitôt la clause qui leur était imposée et à laquelle ils se résignaient d’autant plus facilement que depuis quelque temps, pour les motifs que connaît le lecteur, ils se sentaient très-exposés dans leur maison.
Ils partirent donc.
Mais ils étaient à peine à quelques lieues de Paris, quand madame Claude qui, ainsi qu’on a pu en juger à différentes reprises dans le cours de ce récit, ne s’effrayait pas facilement, dit à son mari, la suite d’un dîner où les liquides n’avaient pas été épargnés :
— Claude, nous sommes deux imbéciles.
— Deux ! c’est peut-être beaucoup dire, répondit Claude ; tu exagères au moins de moitié.
— Ah ! il ne s’agit pas de rigoler, il s’agit de raisonner et de ne pas faire de sottises.
— Voyons, où veux-tu en venir ?
— Nous nous croyons riches parce que nous avons dix mille francs, fichues bêtes ! ne voilà -t-il pas une belle poussée ! Ça peut nous mener deux ou trois ans, et puis après ?…
— Dame, après…
— Nous crèverons de faim ou nous nous ferons condamner aux travaux forcés, n’y a pas de milieu.
— Enfin, où veux-tu en venir ?
— Je veux dire qu’il nous faut au moins quarante mille francs pour vivre de nos rentes en Belgique comme de bons bourgeois et qu’il ne tient qu’à nous de les avoir.
— Comment ça ?
— Eh bien, et M. Badoir ?
— Tiens, c’est vrai tout de même.
— N’est-il pas notre complice dans l’affaire de la comtesse de Sinabria, et n’est-ce pas lui qui nous a livré la petite que j’ai garantie pour toujours contre les dangers du bavardage ?
— Compris ! Il s’agit d’aller lui soutirer une bonne somme.
— Qu’il nous a toujours promise d’ailleurs ; trente mille francs ou le pot aux roses dévoilé à M. le préfet de police, voilà !
Claude réfléchit un instant.
— Ton idée a du bon, mais j’ai peur, dit-il enfin.
— Peur de quoi ?
— De la rousse, parbleu !
— Ils trouveront les oiseaux dénichés.
— Raison de plus, ça va exciter leur défiance, ils vont fouiller la maison, piocher la cave peut-être, et si on trouve le petit !…
— Bah ! qui ne risque rien n’a rien, t’as toujours peur, toi ! D’ailleurs, ce n’est qu’un retard de vingt-quatre heures, voilà tout. Tu te rends demain soir rue Cassette, tu reviens ici avec la somme au milieu de la nuit et nous prenons le chemin de fer à la plus prochaine station au point du jour.
— Oui, oui, ça s’arrange bien comme ça en paroles, mais… enfin j’ai de mauvais pressentiments, j’aimerais mieux me contenter de la petite fortune que nous avons et détaler plus vite que ça.
— Poule mouillée, va !
— C’est bon, je vais suivre ton avis, mais j’ai idée que tu t’en repentiras.
Claude se mit donc en route le lendemain soir, en proie à une vive anxiété.
Madame Claude, elle, était tranquille, insouciante du danger, suivant sa coutume, et à cent lieues de soupçonner de quel prix elle allait payer cette imprudence.
Cependant il l’avait décidée à prendre quelques précautions.
Il avait été convenu qu’ils quitteraient ensemble l’auberge, qu’ils se rapprocheraient de Paris et que Claude laisserait sa femme dans quelque village de la banlieue, où il viendrait la reprendre au milieu de la nuit.
C’est ce qu’ils firent le lendemain.
Comme ils traversaient, à la nuit tombante, un chemin bordé, à droite et à gauche, de carrières abandonnées, Claude dit à sa femme :
— Pourquoi ne pas te cacher là jusqu’à mon retour, au lieu d’aller dans une auberge où tu peux rencontrer quelque gendarme déjà muni de notre signalement ?
Madame Claude approuva ce conseil.
— Oui, c’est prudent, dit-elle, je te conduis encore un bout du chemin et je reviens t’attendre dans cette carrière.
Une immense crevasse formait l’entrée de cette espèce d’antre.
Madame Claude, après avoir accompagné son mari jusqu’à l’entrée de Châtillon, revenait à cette crevasse et y pénétrait avec l’intention de s’y coucher et d’y dormir jusqu’à l’arrivée de Claude, quand un hurlement lugubre se fit entendre dans la carrière, où elle crut voir briller deux prunelles de feu.
Un instant après, elle en sortait brusquement, livide d’épouvante et bondissant à travers champs, poursuivie par un chien aux poils hérissés et à la gueule pleine de bave.
Cette course dura plus d’une demi-heure, au bout de laquelle elle venait tomber, haletante et hors d’haleine, au milieu de la villa de Fontenay.
Pendant que se passait, entre le chien et madame Claude, le drame que nous avons raconté, Claude entrait dans Paris par la route d’Orléans, prenait le boulevard d’Enfer et ne tardait pas à atteindre la rue Cassette.
Au moment où il se présentait chez M. Badoir, celui-ci était en conférence avec sir Ralph, qui venait lui demander les quarante mille francs qu’il lui avait promis pour l’achat de la corbeille de sa future et pour tous les frais qu’il avait à faire dans cette circonstance.
— J’en suis fâché, avait répondu M. Badoir, mais je n’ai pas quarante mille francs dans ma caisse.
— Donnez-m’en trente mille alors, avait dit sir Ralph avec humeur.
— Je ne les ai pas davantage.
— Allons, je m’arrangerai de vingt mille pour demain, reprit sir Ralph, les fournisseurs se contenteront bien d’un à -compte de moitié quand je leur dirai que j’épouse la nièce de M. Mauvillars ; nous verrons plus tard pour le reste.
— Pas plus vingt mille que trente mille, répondit M. Badoir d’un air impassible, ma caisse est complètement à sec.
Alors sir Ralph regarda fixement le banquier, et avec un accent dans lequel vibrait une colère contenue :
— Ah çà , lui dit-il, que se passe-t-il donc, mon cher monsieur Badoir, est-ce que vous voudriez vous moquer de moi ?
— Nullement.
— Et cependant vous persistez dans votre refus ?
— À mon grand regret ; mais j’y persiste.
Sir Ralph pâlit.
— Et vous ne craignez pas ?… s’écria-t-il d’une voix frémissante.
— Je ne crains rien depuis qu’il est décidé que vous épouserez Tatiane.
— Bah ! fit sir Ralph stupéfait.
— Non, car du jour où vous allez avoir une grande fortune et une haute situation, je suis complètement rassuré. Vous vous garderez bien de nuire à la considération de votre associé, trop intimement liée à la vôtre pour que vous ne la respectiez pas désormais.
Sir Ralph se leva brusquement :
— Ah ! c’est ainsi ! s’écria-t-il hors de lui en jetant sur le banquier un regard plein d’éclairs. Ah ! prenez garde, prenez garde, monsieur Badoir !
Et il fit un pas vers celui-ci, les poings serrés, les lèvres blêmes et agitées d’un frisson convulsif.
— Prenez garde vous-même, répliqua froidement M. Badoir ; ne parlez pas si haut, modérez vos gestes et restez à distance, sinon j’appuie sur ce timbre, et ma domestique, qui écoute là , derrière la porte, ouvre la porte qui donne sur la cour et crie à l’assassin !
Sir Ralph allait répliquer, mais un coup de sonnette lui coupa la parole.
Il y eut un moment de silence ; puis on ouvrit la porte après avoir frappé.
C’était la vieille Bretonne.
— Qui a sonné ? lui demanda M. Badoir.
— Quelqu’un qui demande à vous parler, monsieur.
— Je n’ai pas le temps en ce moment.
— La personne prétend que vous la recevrez, dès que vous saurez son nom.
— Et ce nom ?
— M. Claude.
M. Badoir réfléchit un instant.
— Eh bien, oui, qu’il entre, dit-il.
Claude fut introduit.
— Sir Ralph ! s’écria-t-il stupéfait à l’aspect de celui-ci.
— Oui, sir Ralph enchanté de vous rencontrer ici, cher monsieur Claude, répondit celui-ci avec une politesse ironique.
— Qu’avez-vous à me dire ? lui demanda M. Badoir.
— Mais, répondit Claude en jetant du côté de sir Ralph un regard embarrassé, j’aurais voulu vous dire deux mots en particulier.
— Des cachotteries, lui dit sir Ralph, à quoi bon, cher monsieur Claude ; quand on se rencontre chez un banquier, ne sait-on pas l’un et l’autre que c’est pour le même motif, l’argent ; quant à moi, c’est là ce qui m’amène, je vous donne l’exemple de la franchise, parlez donc sans contrainte.
— Eh bien, oui, c’est pour cela aussi que je viens trouver M. Badoir, s’écria Claude d’un ton résolu.
— Je m’en suis bien un peu douté en vous voyant entrer, dit M. Badoir.
— Dame ! monsieur Badoir, je vous ai aidé dans différentes petites opérations qui m’exposent aujourd’hui à bien des désagréments ; je suis fortement recherché, et pas pour le bon motif, aussi ai-je résolu de répondre aux avances de la police par une fuite aussi précipitée que possible. Je m’exporte, moi et ma femme, sur la terre étrangère, mais je serais bien aise d’y adoucir les souffrances de l’exil par une vie aussi agréable que possible au point de vue matériel ; le pain de l’exil étant amer, comme vous savez, je voudrais bien mettre quelque chose dessus, c’est pourquoi vous seriez bien aimable de m’avancer une trentaine de mille francs.
— Sinon ? demanda froidement M. Badoir.
— Sinon, mon premier soin, aussitôt arrivé sur la terre étrangère, serait de faire par écrit la confession de toutes nos peccadilles mutuelles et de l’envoyer à M. le préfet de police.
— C’est singulier, dit en souriant le banquier, même somme et mêmes procédés que sir Ralph ; on dirait que vous vous êtes donné le mot.
— Il n’en est rien, répondit Claude, et je vous jure que la nécessité la plus rigoureuse me force seule à vous adresser cette demande.
— J’ai trop bonne opinion de vous pour en douter, monsieur Claude, mais il n’en est pas moins vrai que vous me mettez le pistolet sur la gorge, et que vous venez me dépouiller du peu qui me reste ; car ma position est loin d’être aussi brillante que vous le pensez l’un et l’autre.
— Et la mienne, donc ! dit Claude.
— Je ne chercherai pas à vous faire revenir sur votre résolution, dit M. Badoir d’un ton résigné, je sens trop bien que tout serait inutile, mais donnez-moi tous deux votre parole qu’après avoir satisfait à votre demande, je n’aurai plus rien à redouter de vous.
— Je vous le jure, s’écria Claude avec transport.
— Moi de même, dit sir Ralph.
— C’est bien, répliqua M. Badoir, je vous connais et je crois pouvoir compter sur vous.
Il prit une clef dans sa poche et alla ouvrir un coffre-fort.
Après avoir introduit la clef dans la serrure et fait jouer, avec une extrême attention, un mécanisme très-compliqué, il s’arrêta tout à coup, se tourna vers ses deux complices d’un air agité et leur dit :
— Non, décidément, je ne peux pas, attendez.
Il sortit, les laissant très-perplexes. Un instant après la vieille Bretonne leur apportait un billet ainsi conçu :
« Je ne me sens pas le courage de me dépouiller moi-même, prenez la somme convenue pendant que je ne suis pas là , cela me briserait le cœur. »
— Voilà bien un trait d’avare ! s’écria sir Ralph.
— C’est égal, c’est un vieux roublard, il pourrait bien être sorti pour nous jouer quelque tour, ne perdons pas de temps, dit Claude.
Il courut au coffre-fort et fit tourner la clef dans la serrure.
Au même instant un craquement étrange se faisait entendre et Claude tombait sur le carreau en jetant un cri déchirant.
Une lame tranchante s’était détachée du haut du coffre-fort et avait coupé net le poignet de Claude, dont la main gisait à ses pieds dans une petite mare de sang.
LII
FOUDROYÉ
Sir Ralph frissonna d’horreur à la vue de cette main gisant à terre et de ce moignon, d’où le sang s’échappait à flots.
Claude, lui, ne se rendait pas compte de ce qui lui arrivait.
— Qu’est-ce qui m’est donc tombé sur le poignet ? murmura-t-il ; j’ai la main tout engourdie.
— Votre main, malheureux ! Voulez-vous la voir ? tenez.
Il prit la main par le bout de l’index et la montra à Claude.
— Hein ? balbutia celui-ci en pâlissant affreusement, ça c’est ma main ! ma main à moi ! oh ! c’est impossible !
Il jeta aussitôt un regard sur son poignet, et alors, de pâle qu’il était, il devint livide.
— C’est vrai ! c’est vrai, dit-il d’une voix défaillante, mon Dieu ! oh ! mon Dieu ! que vais-je devenir ?
— Et, pour comble de malheur, c’est la main droite, dit sir Ralph.
— Je suis perdu, murmura le malheureux, dont les traits exprimaient l’épouvante et l’horreur, je suis perdu.
Il ajouta, en regardant d’un air effaré le sang qui ruisselait de sa plaie et formait déjà une longue rigole sur le carreau :
— Mais voyez donc, tout mon sang s’en va, je vais mourir épuisé si on ne fait pas venir tout de suite un médecin pour me panser.
Tout en contemplant le désespoir du malheureux Claude, tout en frissonnant à la vue du flot de sang qui jaillissait de ce poignet coupé comme d’une fontaine, sir Ralph réfléchissait.
Il se demandait ce qu’il devait faire de cet homme, son complice, et il roulait dans sa tête mille projets qui avaient toujours pour base sa propre sécurité.
— Quant à vous faire soigner ici, lui dit-il, il ne faut pas y songer ; ce n’est pas pour vous dorloter ensuite dans son lit que M. Badoir vient de vous jouer ce mauvais tour.
— Oh ! mais avant tout, s’écria Claude, le regard fixé sur son sang qui coulait toujours, avant tout, arrêtez ce sang, je vous en supplie, enveloppez cette plaie.
— Envelopper, c’est facile à dire, mais où trouver du linge ?
— Tenez, dit vivement Claude, les rideaux qui sont à cette fenêtre.
— Au fait, cela fera parfaitement l’affaire.
C’étaient de grands rideaux de mousseline brodée.
Sir Ralph y courut, les arracha d’une violente secousse, revint aussitôt près de Claude et enveloppa son poignet, non sans lui arracher des cris de douleur.
— Mais s’il me chasse de chez lui cet homme, ce misérable, s’écria Claude d’une voix désespérée, que faire, où aller me faire soigner, maintenant que je n’ai plus de domicile ?
— Dans le seul lieu où l’on puisse vous tirer d’affaire, si la chose est possible, dans un hospice.
— Un hospice ! s’écria Claude avec terreur, y pensez-vous ? Pour moi, à l’heure qu’il est, un hospice est une souricière. Vous ne savez donc pas que j’ai quitté ma maison et que déjà peut-être la rousse…
— Non-seulement je sais cela, mais je sais encore que la police a fait des fouilles dans la cave et qu’on y a trouvé l’enfant ; vous savez, l’enfant de la comtesse.
— Et vous voulez que j’aille dans un hospice ! répliqua Claude atterré à cette nouvelle, mais le premier sentiment qu’on éprouverait à l’aspect d’un misérable habillé comme je le suis et arrivant là avec une main coupée, ce serait la défiance ; le premier personnage qui viendrait me rendre visite après le médecin, ce serait un agent de police, qui ne tarderait pas à savoir qui je suis, et la justice, qui se pique d’humanité, attendrait patiemment que mon poignet coupé fût complètement guéri pour me faire couper la tête. Non, non, il n’en faut pas, de l’hospice.
— Vous avez raison, c’est dangereux ; mais alors où vous conduire ?
— Oh ! quant à ça, sir Ralph, ça vous regarde, répondit Claude d’un air sombre, c’est grâce à vous et à M. Badoir que je suis dans le pétrin, c’est à vous de m’en tirer, sinon je jabote, je fais des aveux complets, et vous savez ce qu’il en résulterait pour vous ?
Sir Ralph laissa tomber sur lui un regard sinistre.
Il venait de trouver une idée.
— Oui, je comprends, dit-il, l’hospice offre de graves inconvénients, il faudrait une maison particulière et j’ai ce qu’il vous faut.
— Une maison où je serai en sûreté ? demanda vivement Claude.
— Parfaitement, un jeune médecin auquel j’ai rendu quelques services et qui, à ma seule recommandation, vous recueillera et vous soignera chez lui sans s’inquiéter de savoir qui vous êtes ni d’où vous venez.
— Quel quartier habite-t-il ?
— Rue Boulart, près du Champ-d’Asile, avec une entrée par cette dernière rue, toujours déserte une fois la nuit tombée.
— Nous ne pouvions trouver mieux, partons donc vite, j’ai hâte d’être chez lui.
Avant de partir, sir Ralph prit à terre la main coupée et la posa au beau milieu du bureau de M. Badoir, sur une grande feuille de papier blanc.

![]()
Puis il aida Claude à se remettre sur ses pieds, lui recommanda de s’appuyer sur son bras, car il était très-affaibli par la perte de son sang, et ils sortirent.
Dans l’antichambre ils rencontrèrent la Bretonne.
— Où est M. Badoir ? lui demanda sir Ralph.
— Sorti, monsieur.
— Vous lui direz que je viendrai bientôt lui exprimer ma reconnaissance pour le service qu’il vient de nous rendre.
— Je ferai votre commission, monsieur.
Une fois dehors, sir Ralph et Claude se dirigèrent vers la place Saint-Sulpice, où ils trouvèrent une voiture.
— Au Champ-d’Asile, près le boulevard d’Enfer, dit sir Ralph au cocher.
Ils étaient arrivés au bout d’un quart d’heure à peine.
Là ils mirent pied à terre, et sir Ralph paya le cocher, qui partit.
— Voici la maison du docteur, dit-il à Claude en lui montrant une fenêtre à laquelle brillait une lumière ; je vais y entrer par la rue Boulart et je reviens.
Il pénétra dans cette rue qui fait le coin de la rue du Champ-d’Asile, y resta cinq minutes et revint vers Claude, qu’il avait laissé appuyé contre le mur du cimetière.
— Fichu endroit pour un homme dans ma position ! murmura celui-ci comme saisi d’un noir pressentiment.
Quand il vit revenir sir Ralph :
— Eh bien ? demanda-t-il avec angoisse.
— Il consent, mais à une condition.
— Laquelle ?
— Avant de vous installer chez lui, avant même de vous laisser passer le seuil de sa porte, il veut voir la plaie et s’assurer qu’il ne court pas le risque de vous voir mourir chez lui.
— Je comprends ça.
— Il va arriver tout de suite, muni d’une petite lanterne, et m’a prié de mettre le poignet à nu pour ne pas perdre de temps.
— Oh ! non, ne perdons pas de temps.
Sir Ralph développa avec précaution les plis du rideau qui entourait le poignet de Claude, qui se trouva bientôt à nu.
Alors il mit la main dans la poche de son pantalon, en tira une fiole lilliputienne, la déboucha, les mains derrière le dos, l’élevant au-dessus du poignet, laissa tomber deux gouttes de son contenu sur la plaie vive.
L’effet de ces deux gouttes fut foudroyant.
Sans pousser un cri, sans même exhaler un soupir, Claude tomba comme une masse au pied du mur et y resta immobile.
Il était mort.
Le liquide dont venait de se servir sir Ralph, qui portait toujours sur lui de quoi se donner la mort par le suicide, pour échapper à la justice, était de l’acide prussique.
— Maintenant, dit-il en s’éloignant, tu ne jaboteras pas.
LIII
L’ENQUÊTE
Il était près de dix heures quand sir Ralph rentra à l’hôtel Meurice, et on se souvient que c’était ce soir-là que devait avoir lieu le bal travesti donné par M. Mauvillars à l’occasion du mariage de sa nièce, fixé au lendemain.
Sir Ralph et Mac-Field devaient se rendre à cette fête vers onze heures.
En entrant prendre sa clef au bureau, sir Ralph aperçut le maître de l’établissement.
— Eh bien, monsieur, lui demanda-t-il, a-t-on quelques indices sur l’identité des deux pauvres diables exposés à la Morgue ?
— Aucun jusqu’à présent, milord ; on est seulement de plus en plus porté à croire que l’un des deux est bien Peters, mon domestique, plusieurs de ses camarades ayant positivement reconnu l’anneau d’argent qui a été trouvé à l’un des doigts coupés.
— Et son complice, sait-on quelque chose sur son compte ?
— Oui, monsieur.
Sir Ralph eut un léger tressaillement.
— Ah ! fit-il, et quel est-il ?
— Un ancien modèle, espèce de rôdeur de barrières, très-connu de la police.
— Alors, c’est un agent qui l’a reconnu ?
— Non, c’est un individu qui, étant entré à la Morgue par pure curiosité, a reconnu cet homme pour l’avoir vu dans plusieurs ateliers de peintres.
— À quoi a-t-il pu le reconnaître, puisqu’il avait la figure à moitié rongée par les rats ?
— À un tatouage qu’il avait au bras, représentant un dieu de l’Olympe.
— Cet homme était son parent, sans doute ?
— Nullement.
— Et c’est à vous, monsieur, qu’il a donné ces détails ?
— Non, c’est au gardien de la Morgue, d’abord, auquel il a laissé son adresse ; puis au magistrat chargé d’instruire cette affaire, qui l’avait fait appeler, et chez lequel je me suis trouvé avec lui. Il a demandé à ce qu’on le mît au courant de tout ce que l’enquête avait pu relever jusque-là , ce que j’ai fait, sur l’invitation du magistrat, pour tout ce qui s’était passé dans mon hôtel, et après avoir tout écouté avec une profonde attention, il a demandé la permission d’exprimer son avis.
— Qu’a-t-il dit alors ? demanda vivement sir Ralph.
— Il a dit, reprit le maître de l’établissement, que, selon lui, il fallait concentrer toutes les investigations sur deux points ; le trajet parcouru par Peters pour se rendre chez le docteur de la rue de la Sourdière en compagnie de sir Ralph.
— Ah ! mon nom a été prononcé ?
— Naturellement.
— Et le second point signalé par cet homme ?
— L’interrogatoire du docteur américain.
— Et vous êtes sûr que cet homme n’est pas un agent ?
— Très-sûr, il a dit devant moi son nom et son adresse, que je me rappelle parfaitement : M. Portal, rue Amelot.
Sir Ralph faillit laisser échapper un cri de surprise à ce nom.
Mais il parvint à se contenir, et il reprit au bout d’un instant :
— Et quelle a été la réponse du magistrat ?
— Il a approuvé M. Portal, et déclaré qu’après les divers interrogatoires qu’il avait fait subir depuis la veille, il pensait comme lui que tout le drame pivotait entre la maison du docteur et la bouche d’égout par laquelle avaient disparu les deux victimes. Son premier soin, dès à présent, sera donc de se faire indiquer la maison du docteur américain chez lequel Peters vous a accompagné.
— Oui, oui, en effet, je comprends, répondit sir Ralph, devenu tout à coup très-soucieux, mais…
Il fut interrompu par l’entrée d’un domestique.
— Une lettre qu’on vient d’apporter, dit celui-ci.
Il la remit à son patron qui, après avoir jeté un coup d’œil sur la suscription, la remit à sir Ralph, en lui disant :
— C’est, pour vous, milord.
Celui-ci la prit et se retira en proie à un sombre pressentiment.
Avant d’entrer dans sa chambre, il passa dans celle de Mac-Field, qu’il trouva chez lui.
Il lui raconta en quelques mots son entretien avec le patron de l’hôtel, puis il ajouta :
— Voici une lettre qui vient d’arriver pour moi, je ne sais pourquoi, mais elle ne me dit rien de bon.
— Lisez vite alors, lui dit Mac-Field.
Sir Ralph déchira l’enveloppe, ouvrit la lettre et lut :
« Monsieur, vous êtes prié de vous rendre demain à quatre heures au cabinet de M. le juge d’instruction Girard. »
— Mauvaise affaire ! murmura Mac-Field.
— Très-mauvaise, répondit sir Ralph, qui avait pâli à la lecture de cette lettre, car ce que va me demander d’abord le magistrat, c’est l’adresse du docteur américain chez lequel je suis allé avec Peters, et, comme ledit docteur n’existe pas…
— Demain, à trois heures, n’est-ce pas ? demanda Mac-Field.
— Oui.
— Voilà ce qu’il y a à faire : demander à M. Mauvillars d’avancer le mariage de deux heures ; tout serait fini à onze heures et nous pourrions partir à deux heures pour la Belgique.
— Oui, mais y a-t-il un train pour cette heure-là ?
— C’est ce dont je m’informerai demain à la première heure.
— En attendant, habillons-nous pour nous rendre au bal, où je veux montrer tout l’entrain et toute la gaieté qui conviennent à un fiancé.
LIV
UNE FÊTE CHEZ M. MAUVILLARS
Précédons de quelques instants Mac-Field et sir Ralph à l’hôtel Mauvillars.
Il est onze heures et il y a déjà foule dans les salons où l’éblouissante lumière des bougies ruisselle sur un merveilleux fouillis de costumes d’une richesse et d’une élégance sans égales, car on se souvient que cette fête était un bal travesti.
Tout le monde était costumé sauf deux personnes, le grand-père et la grand’mère Mauvillars, qui se promenaient tristes et navrés au milieu de cette étincelante cohue pleine de mouvement, de bruit et d’agitation.
M. Mauvillars portait un costume Louis XIV dont l’ampleur et la richesse convenaient parfaitement à sa haute taille et à sa large encolure.
Deux jeunes gens se faisaient remarquer par l’aisance et la distinction avec laquelle ils portaient, l’un, un costume du temps de François 1er, l’autre un costume valaque d’une extrême originalité.
Le premier était Paul de Tréviannes, et le second Jacques Turgis, auquel Rocambole n’avait pas encore fait part de la fin tragique de son père.
Celui-ci, vêtu en gentilhomme espagnol de la cour de Philippe II, accompagnait deux Vénitiennes du seizième siècle, masquées comme lui et qui n’étaient autres que Vanda et madame Taureins.
Au reste, on eût pu deviner celle-ci aux regards émus et admiratifs que Paul de Tréviannes tournait fréquemment de son côté.
Chacun sachant le motif de cette fête, tous les regards cherchaient curieusement le héros et l’héroïne, sir Ralph et Tatiane, qu’on cherchait à reconnaître sous tous les masques.
Mais toutes les conjectures se trouvaient fausses. Madame Mauvillars et Tatiane n’avaient pas encore paru et sir Ralph lui-même était en retard.
La foule était déjà immense, quoiqu’il ne fût que onze heures, comme nous l’avons dit, et à chaque instant il arrivait de nouveaux invités. C’est que, si l’on s’en souvient, M. Mauvillars avait décidé avec la baronne de Villarsay d’inviter à cette fête tous ceux qui assistaient à la sienne et y avaient été témoins de l’entrée de Tatiane au bras de sir Ralph.
Comme tout le monde, mais avec une anxiété que tout le monde ne partageait pas, Jacques Turgis cherchait du regard Tatiane dans la foule, et Paul de Tréviannes l’aidait de tout son pouvoir dans cette tâche difficile, lorsqu’ils furent abordés par Rocambole, qui, passant son bras sous celui de l’artiste, lui dit :
— Tout le monde est à son poste ?
— Tout le monde, répondit Jacques.
— Vous les avez vus ?
— Je les croise de temps à autre et nous sommes convenus de l’endroit où je dois les trouver, le moment venu.
— Très-bien, faites comme moi, veillez sans cesse, car voilà l’heure décisive.
— Comptez sur moi, je suis trop intéressé au succès pour ne pas veiller jusqu’à la dernière minute, et voici mon ami Paul de Tréviannes qui se dévoue corps et âme à notre entreprise, comme si cela le concernait personnellement.
Il reprit en baissant la voix :
— Savez-vous où est Tatiane ?
— Je l’ignore.
— Nous cherchons à la reconnaître dans cette foule, mais j’ai beau étudier toutes les blondes que nous rencontrons, je ne trouve chez aucune le charme particulier et la grâce sans pareille qui la distinguent entre toutes.
— Naturellement, dit Rocambole en souriant.
— Je vous en supplie, reprit Jacques, priez donc M. Mauvillars de vous la désigner. Ce qu’il me refuserait à moi, il le fera pour vous sans hésiter.
— Peut-être ; mais enfin je veux bien tenter la démarche pour mettre fin à votre martyre.
— Merci ; mais tenez, voici justement M. Mauvillars qui s’avance de ce côté.
— J’y cours et je reviens.
Mais, comme il allait aborder M. Mauvillars, une porte s’ouvrit au fond d’une galerie et on y vit paraître deux femmes qui s’avancèrent lentement vers la foule.
Ces deux femmes étaient madame Mauvillars et Tatiane.
Aucun bruit ne s’était fait entendre, et cependant, comme si elle eût attiré à elle tous les cœurs par l’effet de quelque aimant sympathique, l’entrée de Tatiane avait saisi toute l’assemblée.
Tous les regards s’étaient tournés de son côté, toutes les conversations bruyantes avaient cessé comme par enchantement ; puis, au milieu du profond silence qui s’était fait tout à coup à son apparition, un léger murmure s’était élevé, exprimant à la fois deux sentiments : l’admiration et la pitié.

C’est qu’en effet jamais peut-être Tatiane n’avait été si jolie et jamais visage n’avait porté l’empreinte d’une douleur plus profonde et plus navrante.
Ni elle ni sa tante ne s’étaient travesties.
Elle portait une toilette blanche ornée de rubans roses, et son abondante chevelure blonde était semée de roses des haies.
Dans ce costume tout printanier, sa charmante tête apparaissait en ce moment si pâle, si touchante de tristesse et de désespoir contenu, qu’il était impossible de la voir sans se sentir le cœur serré.
La douleur, une douleur mortelle, incurable, s’était pour ainsi dire figée sur ses traits exquis, fixés dans toutes les mémoires avec le sourire plein de charme, la grâce native, l’épanouissement de bonheur et de franchise qui en faisaient le type le plus charmant et le plus parfait de la jeune fille, dégagée de toute peine et traversant la vie avec l’insouciance et la gaieté d’un oiseau.
En la voyant paraître si décolorée sous sa fraîche parure, en la voyant s’avancer si triste au milieu de cette fête, à travers cette foule éblouissante et sous l’éclatante lumière des bougies, l’imagination évoquait involontairement une de ces touchantes victimes que l’antiquité nous montre marchant à la mort, parée de fleurs et couverte d’habits somptueux, pour expier le crime de tout un peuple et apaiser la colère des dieux par le sacrifice de la vie.
— L’avez-vous jamais vue plus merveilleusement belle ? dit en ce moment une voix à l’oreille de Jacques Turgis.
Celui-ci se retourna et reconnut M. Portal.
— Sa tristesse me brise le cœur, lui dit-il d’une voix profondément altérée, je ne vois plus sa beauté, je ne vois que sa souffrance et j’ai peine à me contenir, je crains à chaque instant d’éclater en sanglots. Pauvre Tatiane ! Ah ! c’est trop la faire souffrir, je vous en supplie, monsieur Portal, laissez-moi lui parler, je ne me sens pas le courage de la laisser en proie à cette mortelle tristesse, quand d’un mot je puis la dissiper.
— Impossible, cher monsieur Jacques, répondit Rocambole, sir Ralph a peut-être ici des espions, car il est toujours sur ses gardes, ils observent la physionomie de mademoiselle Tatiane ; s’ils la voyaient se rasséréner quelque peu, il en serait prévenu, il redouterait un piège et ne viendrait peut-être pas, et il faut qu’il vienne. Attendez un peu, quand il en sera temps je vous le dirai.
Tout en traversant la foule, madame Mauvillars s’efforçait de sourire aux nombreux amis qu’elle rencontrait sur son passage.
Mais Tatiane était incapable de cet effort et conservait cette tristesse immuable qui lui donnait l’apparence d’une statue de marbre.
Tout à coup elle s’arrêta, s’appuya fortement sur le bras de sa tante, comme si les forces lui manquaient, et porta son mouchoir à sa bouche.
C’est qu’elle venait d’apercevoir Jacques Turgis, et, à la vue de l’horrible souffrance empreinte sur ses traits pâles et bouleversés, elle aussi avait senti son cœur déborder et elle avait appuyé son mouchoir sur ses lèvres pour empêcher l’explosion d’un sanglot.
Le petit drame qui se jouait entre ces deux cœurs brisés n’avait pas échappé à Paul de Tréviannes.
— Venez, dit-il à Jacques en l’entraînant dans la foule ; vous le voyez, elle succombe sous l’émotion que lui a causée sa rencontre avec vous ; éloignons-nous, nous sommes sur son chemin. Si elle passait près de vous, la pauvre enfant n’y résisterait plus et tomberait inanimée sur le parquet.
Jacques ne pouvait répondre ; il étouffait, mais il comprenait que son ami avait raison, et il se laissa entraîner.
Pendant qu’ils s’éloignaient, deux noms étaient annoncés et retentissaient comme un coup de foudre dans le profond silence qui s’était établi.
Ces noms étaient ceux de lord Mac-Field et de sir Ralph.
Alors, les regards s’étaient tournés de ce côté, la foule s’était ouverte par un mouvement machinal, et un espace libre avait été laissé à sir Ralph, que nul obstacle ne séparait de Tatiane.
Ils se trouvaient tout à coup face à face, à une distance de dix pas à peine.
Pour comprendre l’effet que dut produire cette situation sur ceux qui en étaient témoins, il faut se rappeler que tous ou presque tous avaient assisté à l’apparition étrange, inexplicable de Tatiane et de sir Ralph au bal de la baronne de Villarsay et que chacun voyait là le dénouement naturel de cette prodigieuse aventure.
Cependant l’intérêt était violemment surexcité par le bruit qui s’était répandu que la jeune fille s’était longtemps refusée à ce que M. Mauvillars exigeait comme la réparation obligée du scandale dont son nom avait souffert dans cette circonstance, niant d’abord sa présence au bal de la baronne de Villarsay en compagnie de sir Ralph, affirmant ensuite qu’elle n’avait aucun souvenir de ce fait et prétendant qu’elle avait passé toute cette nuit dans sa chambre.
De sorte que d’un côté la parfaite innocence de Tatiane, que personne ne songeait à révoquer en doute, et de l’autre l’attestation de nombreux témoins qui déclaraient l’avoir vue à ce bal avec sir Ralph et qui tous étaient sympathiques à la jeune fille, entouraient cette affaire d’un mystère qui semblait impénétrable.
Quelle allait donc être l’issue de cet inexplicable drame ?
C’était la question que chacun s’adressait, et tel était l’intérêt qui s’attachait à cette pure et naïve Tatiane, que l’assemblée entière attendait ce résultat avec une véritable angoisse.
Aussi, l’entrée de sir Ralph fut-elle un coup de théâtre pour tous les invités.
Ce dernier inspirait un sentiment absolument contraire à celui que chacun éprouvait pour la jeune fille, et ce sentiment se manifesta par un vague et insensible murmure, quand on le vit s’avancer vers elle, pâle et évidemment en proie à une émotion qui ne faisait qu’accentuer encore le caractère équivoque et répulsif de sa physionomie.
— Ma tante, ah ! ma tante, balbutia Tatiane d’une voix défaillante, en voyant venir à elle celui dans lequel elle voyait son bourreau, je vous en supplie, faites qu’il ne m’adresse pas la parole, je crois que j’en mourrais de honte et de douleur.
Madame Mauvillars n’eut pas le temps de répondre ; sir Ralph était déjà en face d’elle.
— Madame, lui dit-il en s’inclinant profondément, permettez-moi de vous présenter, ainsi qu’à mademoiselle Valcresson, mes respectueux hommages, et veuillez…
— C’est bien, monsieur, interrompit madame Mauvillars, nous acceptons vos hommages, mais, à votre tour, permettez-nous, de saluer les amis qui ont bien voulu se rendre à notre invitation.
Et, passant outre avec Tatiane qu’elle voyait frissonner de tous ses membres, elle laissa sir Ralph stupéfait et atterré sous cet affront.
Il se releva brusquement et demeura un instant tout étourdi, jetant autour de lui des regards effarés et laissant deviner sur ses traits livides la rage dont il était dévoré.
LV
UN NOBLE CÅ’UR
En promenant ses regards autour de lui, sir Ralph avait aperçu M. Mauvillars parmi ceux qui avaient été témoins de l’affront qu’il venait de subir.
Il alla à lui.
— Monsieur Mauvillars, lui dit-il, voudriez-vous m’accorder quelques minutes d’entretien ?
— Très-volontiers, monsieur.
Cette réponse avait été faite avec une politesse à laquelle sir Ralph n’avait pas été accoutumé de la part de son oncle futur.
— Venez, reprit M. Mauvillars, cherchons quelque coin où il nous soit possible de causer sans être entendus.
Ils se frayèrent lentement un passage à travers la foule et parvinrent enfin à un petit salon désert en ce moment, l’entrée de Tatiane dans la salle de bal ayant attiré tous les invités de son côté.
— Voyons, monsieur, dit alors M. Mauvillars à sir Ralph en lui faisant signe de s’asseoir et en se jetant lui-même dans un fauteuil, nous voilà seuls, qu’avez-vous à me dire ?
Sir Ralph eut une inspiration, ce fut de mettre à profit le procédé dont on venait d’user envers lui pour motiver la proposition un peu embarrassante qu’il avait à faire.
— Monsieur Mauvillars, dit-il en prenant une physionomie à la fois digne et résignée, vous avez été témoin de l’humiliation que vient de m’infliger madame Mauvillars devant tous vos invités, affront d’autant plus sanglant pour moi que personne n’ignore ici que cette fête a pour but de célébrer mon mariage avec mademoiselle Tatiane, ma femme dans quelques heures. Je crois inutile de vous répéter que j’aime éperdument votre nièce, mais si violent que soit cet amour, je ne puis lui faire le sacrifice de ma dignité, si cruellement offensée devant tous, je ne puis davantage me résoudre à m’imposer à une jeune fille à laquelle je n’inspire que de l’antipathie et qui vient de m’en donner publiquement la preuve ; c’est pourquoi je me décide à vous faire une proposition qui me brise le cœur, mais que me commande la délicatesse.
— Et cette proposition, monsieur ? demanda M. Mauvillars.
— La voici…
« J’épouserai mademoiselle Tatiane, dit sir Ralph, pour réparer le tort que j’ai fait à sa réputation, et quelques heures après la cérémonie je partirai pour l’Amérique, m’engageant par écrit à ne jamais la revoir et vous laissant même mon consentement à une réparation, si la chose peut se faire ainsi.
— En effet, monsieur, répondit M. Mauvillars avec une imperceptible ironie, il est difficile de se montrer plus délicat, plus noblement susceptible en matière de point d’honneur ; j’accepte donc votre proposition et crois pouvoir affirmer que, de son côté, Tatiane ne la repoussera pas, mais à une condition.
— Dites, monsieur.
— J’espère que votre dignité ne poussera pas les choses jusqu’à renoncer à la dot de celle que vous vous résignez à quitter aussitôt après le mariage ?
— Rien au monde ne pourrait me décider à accepter cette dot, monsieur, reprit sir Ralph avec un geste plein de noblesse, si des raisons…
— Que je vous dispense de me confier… interrompit M. Mauvillars ; vous l’acceptez, c’est tout ce que j’ai besoin de savoir.
— Croyez bien, monsieur…
— Je crois que cela vous est on ne peut plus pénible, mais la question n’est pas là ; demain, immédiatement après la cérémonie, je vous compterai cette dot.
Il fit un mouvement pour se lever.
— Encore un mot, s’il vous plaît, dit sir Ralph.
— Je vous écoute.
— J’ai une grâce à vous demander. Ne pourriez-vous avancer l’heure de cette cérémonie ?
— Quelle est l’heure qui vous conviendrait le mieux ?
— Dix heures au lieu de midi, si toutefois…
— Vous y tenez beaucoup.
— Je l’avoue.
— Ce sera fait comme vous le désirez ; toutes les invitations sont faites pour midi, mais nous avons justement ce soir tous nos amis et toutes nos connaissances, il me sera facile de les prévenir tantôt, au moment du souper, que le mariage est avancé de deux heures.
— Je vous remercie, monsieur Mauvillars.
Celui-ci se leva en disant :
— Sir Ralph, puisque nous nous entendons enfin, et que tout dissentiment a disparu entre nous, je veux réparer, autant que possible, aux yeux de nos invités, le sans-façon un peu blessant, je l’avoue, dont ma femme a usé à votre égard, et si vous le voulez bien, nous allons nous mettre tous deux à une table de jeu.
— Avec grand plaisir, s’écria sir Ralph.
— Je vais m’entendre avec ma femme pour différents détails et je vous rejoins tout à l’heure dans la salle de jeu.
Sir Ralph se trouva très-heureux de la façon dont sa double proposition avait été accueillie par M. Mauvillars, dont la bonne foi ne pouvait être suspectée sur ce point, puisque lui-même lui avait fait une offre pareille quelques jours auparavant.
Il s’empressa donc de chercher Mac-Field pour lui communiquer le résultat de sa démarche.
Il le trouva dans un angle de la salle de bal, l’air très-sérieux et promenant son regard sur tous les groupes avec une attention toute particulière.
— Eh bien ? demanda Mac-Field à sir Ralph.
— Succès complet, répondit celui-ci.
— La dot sans la femme ?
— Oh ! cette proposition a été acceptée avec un empressement peu flatteur pour mon amour-propre.
— Ça, c’est la moindre chose dans la situation où nous sommes.
Il reprit :
— Le chiffre de cette dot ?
— Six cent mille francs.
— L’heure à laquelle elle sera comptée.
— Aussitôt après la célébration du mariage.
— Et a-t-il consenti à avancer…
— Avec le même empressement que le reste. Vous entendrez M. Mauvillars annoncer tantôt que le mariage qui devait être célébré à midi le sera à dix heures.
— Parfait, tout s’arrange à merveille, dit Mac-Field.
— Et cependant je vous trouve soucieux.
— Je le suis en effet.
— Quel motif avez-vous pour…
— D’abord, tout ce qui s’est passé à l’hôtel Meurice.
— Nous serons loin à l’heure où le juge d’instruction m’attendra dans son cabinet.
— Et puis, je lis sur certaines figures je ne sais quoi d’énigmatique que je ne m’explique pas et qui m’inquiète.
— Quelles sont donc ces figures ?
— Jacques Turgis, l’adorateur de Tatiane, Paul de Tréviannes, l’ami de Carlisle, et enfin M. Portal.
— M. Portal ! Il est ici ? s’écria sir Ralph avec émotion.
— Oui ; et, quand je songe avec quelle adresse il a détruit l’un après l’autre tous les témoignages dans lesquels la comtesse de Sinabria était prise comme dans un filet, quand je pense en outre qu’il porte le plus vif intérêt à Jacques Turgis et à Tatiana, quand je le retrouve encore chez le juge d’instruction chargé de poursuivre l’affaire de la rue de la Sourdière, j’avoue que la présence de cet homme ici m’inspire une véritable terreur.
Pendant ce temps M. Mauvillars, après avoir suivi du regard sir Ralph jusqu’au moment où celui-ci avait abordé Mac-Field, s’était engagé dans la foule et était allé trouver Rocambole à une extrémité opposée de la salle.
— Monsieur Portal, lui dit-il, voici le moment venu et je ne vous cacherai pas que je suis extrêmement inquiet ; voyons, pouvez-vous m’affirmer que nous réussirons ?
— Je puis vous affirmer que nous avons toutes les chances pour nous, mais le moyen que nous allons employer n’est pas infaillible.
— Oh ! tenez, monsieur Portal, dit M. Mauvillars d’une voix troublée, ce que vous me dites là me fait frissonner ; si nous allions échouer ! Si au lieu de produire un témoignage éclatant de l’innocence de Tatiane, cette épreuve allait tourner contre elle et aboutir à un résultat absolument contraire !
— Je ne puis le croire.
— Je vais trembler jusque-là .
— Et moi j’espère.
— Au moins ne négligeons rien pour réussir.
— Sur ce point je puis vous rassurer complètement, les précautions les plus minutieuses ont été prises, rien n’a été abandonné au hasard.
— Allons, dit M. Mauvillars avec émotion, le sort en est jeté, dans une heure ma pauvre Tatiane sera sauvée ou perdue à jamais.
Il ajouta :
— Je vais rejoindre sir Ralph, venez bientôt vous-même et veillez à ce que chacun soit à son poste.
— Allez, et ayez confiance, je serai là .
M. Mauvillars quitta Rocambole, qui presque aussitôt vit venir à lui deux jeunes gens.
C’étaient Paul de Tréviannes et Jacques Turgis.
— Nous touchons au moment critique, n’est-ce pas ? lui demanda l’artiste dont tout le corps était agité d’un léger tremblement.
— Oui, répondit Rocambole.
— Mon Dieu ! balbutia Jacques en pâlissant encore, tout notre bonheur, toute notre vie sont renfermés dans ces quelques minutes ; mon Dieu ! si le sort allait tourner contre nous !
Il posa la main sur son front et resta quelques instants comme écrasé sous cette pensée.
— Allons donc ! s’écria Paul de Tréviannes, comment pouvez-vous douter ? Comment pouvez-vous croire que Dieu favorise un pareil misérable et plonge dans un désespoir sans fin deux êtres tels que vous et Tatiane ? L’esprit se révolte à une telle pensée ; croyez-moi donc, mon ami, c’est impossible, c’est impossible.
— Ah ! j’ai besoin de vous croire, répondit Jacques en pressant avec force la main du jeune homme.
Il ajouta, avec une agitation fébrile :
— Et je vous crois ; non, Dieu ne saurait permettre… Je vous crois, mon ami, je vous crois.
— Allez donc, lui dit Rocambole, armez-vous de foi et de courage, ne doutez pas du succès et restez calme et attentif jusqu’à la fin, M. Mauvillars doit être déjà dans la salle du jeu, attablé en face de sir Ralph ; allez, je vous y rejoins tout à l’heure avec nos complices. Une table est préparée avec tout ce qu’il vous faut, près de celle que va occuper M. Mauvillars, tenez-vous de ce côté, vous y prendrez place une fois le moment venu et sur un signe de moi.
Les deux amis s’éloignèrent ensemble, tandis que Rocambole se perdait dans la foule, où il semblait chercher quelqu’un.
Pendant ce temps, deux jeunes femmes, portant de riches costumes, abordaient madame Mauvillars, assise dans un coin de la salle avec Tatiane, qui, immobile, l’œil fixe, absorbée par une pensée dévorante, refusait avec un pâle et triste sourire, tous les danseurs qui venaient l’inviter.
Ces deux jeunes femmes étaient Vanda et madame Taureins.
— Nous ne pouvons les laisser assister seules à ce qui va se passer, avait dit Valentine, emmenons-les avec nous pour les prévenir peu à peu et être à même de les secourir dans le cas où elles perdraient connaissance.
Et Valentine, s’inclinant devant madame Mauvillars, lui avait dit :
— Madame, voulez-vous nous accorder la grâce de parcourir vos salons en votre compagnie ?
Et, comme madame Mauvillars et Tatiane la regardaient avec surprise :
— Nous avons, pour vous adresser cette demande des motifs sérieux et que vous connaîtrez bientôt, reprit madame Taureins avec un gracieux sourire.
— Nous acceptons, n’est-ce pas, ma tante ? dit vivement Tatiane, dont le cœur s’épanouit au sourire de la jeune femme, comme s’il s’en fût dégagé un rayon d’espérance.
Madame Mauvillars se leva et prit le bras de Vanda, tandis que Valentine glissait sous le sien celui de Tatiane, dont elle pressait amicalement la main.
LVI
UNE CONFIDENCE IMPRÉVUE
La salle de jeu formait une espèce de rotonde à laquelle on accédait par six portes donnant les unes sur la salle de bal, les autres sur de larges couloirs, circulant le long d’une immense serre, ouverte aux invités.
Une demi-douzaine de tables y avaient été installées pour les joueurs, dont une occupant juste le milieu de la pièce.
C’est à celle-là qu’étaient venus s’asseoir sir Ralph et M. Mauvillars.
Ce dernier, on le sait, était grand joueur et beau joueur ; aussi, au bout de dix minutes, voyait-on les billets de banque s’entasser et disparaître avec une étonnante rapidité.
Soit que ce jeu d’enfer eût excité la curiosité de l’assemblée, soit pour toute autre cause, on vit bientôt les invités, hommes et femmes, déserter l’un après l’autre la salle de bal, se montrer à toutes les portes de la salle de jeu, puis faire irruption dans la pièce, qui ne tarda pas à être encombrée.
L’orchestre jouait toujours, mais dans le désert.
Tous les regards étaient fixés sur les deux joueurs, et tout l’intérêt de la soirée, même pour les jeunes gens, toujours si avides de danses, semblait s’être concentré là .
Parmi ceux qui se montraient particulièrement absorbés par les diverses péripéties du drame qui les fixait devant cette table de jeu, on pouvait remarquer huit ou dix personnes, la plupart groupées derrière sir Ralph.

C’étaient madame Mauvillars et Tatiane, Vanda et madame Taureins, deux femmes masquées, l’une en domino noir, l’autre en domino rose, M. Portal, puis, assis à une table tout près des deux joueurs, Paul de Tréviannes et Jacques Turgis, tous fixant sur sir Ralph des regards où éclatait une ardente et anxieuse curiosité.
La partie durait depuis vingt minutes, au milieu d’un silence au-dessus duquel planait une vague et indéfinissable émotion, quand on entendit sir Ralph murmurer en abattant une carte :
— À quoi bon ? est-ce que vous ne le savez pas aussi bien que moi ?
— Hein ? lui dit M. Mauvillars.
Sir Ralph ne répondit pas et regarda ses cartes.
Il en abattit une seconde, puis après une pause il reprit :
— Pourquoi insister ? je vous assure que cela m’est désagréable.
M. Mauvillars jeta une carte à son tour, de l’air le plus indifférent et sans paraître avoir entendu.
Il se fit un long silence, pendant lequel sir Ralph, le regard fixé sur ses cartes, ne faisait pas un mouvement.
M. Mauvillars se renversa sur sa chaise et attendit, en proie à une inquiétude qu’il essayait vainement de dissimuler.
Sir Ralph reprit bientôt :
— Je vous répète que je ne comprends rien à ce caprice, et je vous jure que cela me gêne et m’inquiète. On peut m’entendre et alors songez donc à …
Il s’interrompit, mais quelques secondes seulement, puis il reprit ainsi la parole :
— Enfin, puisque vous le voulez absolument, puisque vous m’affirmez qu’il n’y a aucun danger…
Il s’interrompit de nouveau.
Ses traits, légèrement contractés exprimaient une lutte intérieure.
Il abattit machinalement une carte en disant :
— Je m’étais pourtant bien promis de ne jamais raconter cette histoire.
Puis il parut prêter l’oreille et il ajouta :
— Que voulez-vous ? il fallait sortir à tout prix d’une situation horrible ; poursuivis, Mac-Field et moi, pour le meurtre des époux Christiani, il nous fallait une fortune immense et rapide, pour aller mener grand train à l’étranger, sous des noms imposants, seul moyen d’échapper aux recherches de la justice.
À cette révélation imprévue, un frisson parcourut l’assemblée et tous les regards se tournèrent vers Tatiane avec un sentiment d’horreur et de pitié.
Deux hommes souriaient ; c’étaient Rocambole et M. Mauvillars.
Deux autres étaient trop absorbés pour s’abandonner à leurs impressions ; ceux-là étaient Paul de Tréviannes et Jacques Turgis, devant lesquels un domestique venait de déposer du papier, des plumes et de l’encre et qui transcrivaient l’un et l’autre chaque parole qui tombait des lèvres de sir Ralph.
Tous les témoins de cette scène étaient frappés de stupeur en entendant sir Ralph parler ainsi.
On s’accordait à croire qu’il était sous l’empire de quelque hallucination, et, en effet, on ne pouvait guère attribuer qu’à un dérangement d’esprit les propos vrais ou faux qu’il venait de faire entendre.
Cette hypothèse était d’autant plus vraisemblable qu’il semblait, comme on l’a vu, s’entretenir avec un être surnaturel que nul autre que lui ne voyait ni n’entendait.
Cependant, la curiosité n’en était pas moins surexcitée au plus haut point, car son attitude, son langage, son accent n’avaient aucun des caractères de la folie, et l’on croyait généralement qu’il fallait attribuer cette espèce de confession à un délire passager causé par le remords.
Toute l’assemblée, frappée d’immobilité comme par la baguette d’une fée, éperdue, anxieuse, haletante attendait le récit annoncé par sir Ralph, impatiente de l’entendre révéler les terribles secrets que promettait ce début, mais ne soupçonnant guère celui qui allait sortir de ses lèvres.
— Mon Dieu ! reprit enfin sir Ralph d’un ton familier et comme se parlant à lui-même, je n’aurais jamais songé à conquérir cette fortune par un mariage avec mademoiselle Tatiane Valcresson si je n’eusse eu pour complice et entièrement à ma discrétion un de ses proches parents, M. Badoir qui, malgré sa répugnance à donner à sa nièce un pareil mari, ne pouvait refuser de demander sa main pour moi.
Il y eut un nouveau frémissement dans l’auditoire et tous les regards se tournèrent à la fois vers M. Badoir qui, poussé par la foule, se trouvait porté à quelques pas de sir Ralph.
Le banquier était affreusement pâle.
Il murmura d’une voix tremblante :
— C’est faux ! vous voyez bien que cet homme est fou et qu’il divague, il faut lui imposer silence.
— C’est à vous que j’impose silence, monsieur Badoir, dit une voix qui le fit frissonner.
Cette voix était celle de M. Portal.
Sir Ralph reprit :
— Entre autres affaires, dans lesquelles il se trouvait de moitié avec nous, il y avait la tentative d’empoisonnement exercée sur son parent, Pierre Valcresson.
— C’est vrai, dit une voix, celle de Pierre Valcresson, que le hasard avait placé à deux pas de M. Badoir.
Celui-ci n’osa répliquer.
Il courba la tête et roula autour de lui des yeux hagards comme s’il eût cherché une issue pour fuir.
Mais la foule était trop compacte, il fallait y renoncer.
Il le comprit et resta là comme attaché à un pilori, sous les regards de mépris et de dégoût qu’il sentait peser sur lui.
— Malheureusement, poursuivit sir Ralph, mademoiselle Tatiane aimait quelqu’un, Jacques Turgis, le paysagiste, qui, de son côté, l’adorait depuis longtemps, obstacle sérieux, insurmontable, et dont il fallait pourtant se débarrasser. Voici le moyen que j’imaginai pour arriver à ce but : ce jeune artiste avait chez lui une toile de maître d’une grande valeur, un Ruysdaël estimé cent mille francs par le marchand de tableaux qui le lui avait confié pour en faire une copie ; ce tableau, j’eus la pensé de le lui faire voler par son propre…
Jacques devint livide et se sentit défaillir à la pensée d’entendre révéler publiquement la vie et toutes les hontes de son père.
Mais sir Ralph s’était arrêté court ; et, la tête penchée, il semblait écouter quelque voix mystérieuse.
— Soit, dit-il enfin, comme il vous plaira.
Et il reprit :
— J’eus la pensée de le lui faire voler par son propre… modèle, dans l’espoir que ce vol lui serait attribué à lui-même, que l’affaire pourrait aller jusqu’en police correctionnelle ; bref, qu’il serait à jamais déshonoré. Malheureusement, mon plan échoua et il en fut quitte pour subir, de la part de son marchand de tableaux, des conditions draconiennes. C’est alors que je conçus un autre dessein, celui de compromettre mademoiselle Tatiane avec un éclat tel qu’il devint impossible de me la refuser pour femme ; celui-là eut un plein succès ; et je crois pouvoir dire que c’était là un trait de génie. Vous allez en juger.
LVII
OÙ LA LUMIÈRE SE FAIT
Enfin, l’étrange mystère qui pesait d’un poids si lourd sur la pauvre Tatiane allait être dévoilé !
On comprend avec quelles transes, avec quelles angoisses et en même temps avec quelle ardente curiosité la jeune fille attendait le récit d’une aventure dont son esprit cherchait vainement à percer les impénétrables ténèbres.
Ses traits pâles et bouleversés, son regard troublé, ses yeux brillants de fièvre, attestaient avec une navrante éloquence l’anxiété dont elle était dévorée.
Les mêmes impressions se lisaient sur le visage profondément altéré de Jacques Turgis, dont le front livide se perlait de sueur et qui, la plume à la main et le regard fixé sur sir Ralph, attendait tout tremblant les paroles qu’allait faire entendre celui-ci.
C’est que le récit qui allait être fait devant cette espèce de tribunal de l’opinion c’était pour lui cent fois pis qu’un arrêt de vie ou de mort, c’était la honte ou la réhabilitation de Tatiane, de Tatiane qui était là , exposée à tous les regards, et qui pouvait mourir de douleur sous l’ineffaçable souillure que cet homme allait peut-être lui jeter au front.
Outre ceux que nous avons déjà signalés comme particulièrement intéressés à ce qui se passait, il y avait là une personne qui, depuis le moment où sir Ralph avait commencé cette confession aussi extraordinaire qu’imprévue, était en proie aux tortures d’une horrible appréhension, c’était la comtesse de Sinabria.
M. Portal lui avait dit : Venez à cette fête et montrez-vous-y calme et souriante, il faut cela pour dissiper jusqu’à l’ombre du soupçon dans l’âme de votre mari.
Elle avait suivi ce conseil et maintenant elle tremblait à chaque parole qui tombait des lèvres de sir Ralph, qui pouvait détruire en quelques mots les miracles d’habileté accomplis par M. Portal pour la sauver d’une perte inévitable.
C’est au milieu de toutes ces terreurs que sir Ralph commença enfin ce récit, que l’assemblée entière attendait avec une égale perplexité :
— M. Mauvillars ne voulait pas de moi pour neveu, mademoiselle Tatiane Valcresson n’éprouvait pour moi d’autre sentiment qu’une profonde antipathie, et enfin Jacques Turgis était aimé, et j’avais échoué dans la tentative de rendre son mariage impossible en le déshonorant ; devant une pareille situation, tout autre que moi eût renoncé à la lutte ; mais, outre que je ne suis pas facile à décourager, il me fallait absolument l’immense fortune qui formait la dot de la jeune fille ; c’était pour moi et mon complice Mac-Field une question de vie ou de mort. Je cherchai donc résolument les moyens de renverser, ou plutôt de tourner des obstacles qui s’opposaient à cette union, et voilà le plan que j’imaginai.
Par un mouvement spontané, le flot humain qui enveloppait sir Ralph se resserra autour de lui.
Tatiane s’affaissa presque sur madame Taureins, comme si elle succombait sous la violence de son émotion.
C’est que la minute critique était venue, la vérité allait éclater.
Et qu’allait-il en jaillir ?
La mort ou la vie ?
Sir Ralph poursuivit après une pause :
— Un hasard m’avait rendu témoin un jour de la puissance magnétique d’une femme bien connue à Montmartre sous le nom de mère Alexandre. J’allai la trouver et lui proposai de venir magnétiser une jeune fille que j’aimais, dont j’étais aimé, et de la plonger dans un sommeil assez profond pour que je pusse l’emmener, à son insu, au milieu d’une fête de nuit remplie de ses amis et connaissances. Je voulais seulement traverser la salle de bal avec cette jeune fille à mon bras et, par ce scandale, forcer sa famille, hostile à notre union, à m’accorder sa main…
Un murmure d’étonnement accueillit cette révélation inattendue.
— Allons, remettez-vous et relevez la tête, dit tout bas Valentine à Tatiane. Voilà la vérité qui se dégage.
— Il n’a pas encore tout dit, écoutons, écoutons, murmura la jeune fille avec un mélange de crainte et d’espoir dans les yeux.
Sir Ralph reprit ainsi :
— La mère Alexandre, je dois le dire à sa louange, commença par me faire jurer que j’étais aimé de la jeune fille et que mes intentions à son égard étaient pures ; et moi, je dois le déclarer à ma honte, je n’hésitai pas à lui faire tous les serments qu’elle me demandait.
— C’est fort bien, ajouta-t-elle alors, le moyen est ingénieux, je dirai même infaillible en ce qui me concerne. Mais comment pénétrer dans la maison ? comment m’introduire près de la jeune fille pour la magnétiser à son insu ? Comment l’habiller en toilette de bal, la faire sortir et rentrer sans que personne s’en aperçoive ? Voilà des obstacles qui me semblent insurmontables.
— Et qui le seraient, en effet, répliquai-je, si je n’avais dans la place une amie qui les aplanira tous sans la moindre difficulté.
L’amie auquel je faisais allusion, poursuivit sir Ralph, était une jeune fille, Malvina, la femme de chambre de mademoiselle Tatiane, nature honnête, loyale et dévouée, mais dont la famille, peu délicate avait sur la conscience divers petits crimes et délits, parmi lesquels un enfant enfoui au fond de leur cave, l’enfant de la…
Il s’arrêta tout à coup et parut écouter la voix mystérieuse avec laquelle il semblait être en relation.
— C’est bien, dit-il après quelques instants de silence, nous ne parlerons pas de cela ; je me contenterai de dire que cette famille, peu délicate, avait des droits incontestables à l’échafaud, et qu’en menaçant leur fille de les y envoyer, j’obtins d’elle tout ce que je voulus. Or, après m’être entendu avec elle et la mère Alexandre, j’allai prendre celle-ci en voiture, à Montmartre, le soir où mademoiselle Tatiane devait se rendre au bal de la baronne de Villarsay et la conduisis rue de Miroménil, à l’hôtel Mauvillars. Une petite porte donnant sur le jardin, était restée entr’ouverte ; nous entrâmes par là et fûmes aussitôt abordés par Malvina, qui guettait notre arrivée.
Elle vint droit à moi et me dit :
— Écoutez-moi, monsieur, vous me contraignez à trahir ma jeune maîtresse pour laquelle je donnerais mon sang. C’est une infamie, mais je suis forcée de vous obéir et je me résigne, mais à une condition !
— Faites-la moi connaître, dis-je à Malvina.
— Je ne quitterai pas plus ma maîtresse que son ombre à partir de ce moment jusqu’à l’heure où elle rentrera dans sa chambre.
Cette condition me contrariait un peu en ce qu’elle laissait la porte ouverte à une justification que j’eusse voulu rendre absolument impossible, mais je me résignai à la subir, comprenant que la femme de chambre serait intraitable sur ce point.
Cinq minutes après, nous étions tous trois à la porte de la chambre de mademoiselle Tatiane.
Malvina ouvrit cette porte et entra, suivie de la mère Alexandre, tandis que je restais dans l’antichambre.
La jeune fille était endormie ; la mère Alexandre la magnétisa, lui commanda de se lever et aida Malvina à l’habiller.
Celle-ci avait fait venir de chez la couturière, dans la soirée même, et à l’insu de sa maîtresse, une ravissante toilette de bal, si fraîche et si vaporeuse, que lorsqu’au bout d’une heure et demie environ, elle parut enfin, je restai ébloui et charmé comme si j’eusse vu une fée tomber des nues sur la terre.
Elle s’appuyait sur le bras de Malvina et passa devant moi avec un charmant sourire, qui ne la quitta plus de la soirée.
Cinq minutes après elle montait en voiture avec sa femme de chambre et la mère Alexandre, tandis que je m’asseyais à côté du cocher, et au bout d’un quart d’heure nous arrivions chez la baronne de Villarsay.
Elle accepta mon bras de la meilleure grâce du monde et ne parut ni scandalisée, ni même surprise quand, sur mon ordre, le domestique annonça : « Sir Ralph et mademoiselle Tatiane Valcresson. »
Et elle traversa à mon bras la foule stupéfaite, souriant toujours et loin de soupçonner qu’à partir de cette minute elle était à jamais perdue.
La mère Alexandre n’étant pas là pour entretenir le sommeil factice qui la rendait inconsciente de l’acte inouï qu’elle accomplissait en ce moment, il eût été dangereux de rester longtemps et, d’ailleurs, je n’en avais nul besoin ; il suffisait, pour le résultat que je me proposais, qu’on nous eût vus ensemble à cette fête, je me hâtai donc de la quitter, une fois mon but atteint. Je regagnai la voiture qui nous attendait dans la cour de l’hôtel, et nous repartîmes comme nous étions venus, mademoiselle Tatiane avec Malvina et la mère Alexandre, moi sur le siège, à côté du cocher ; puis arrivés à l’hôtel Mauvillars, nous nous séparâmes, la femme de chambre et sa jeune maîtresse pour rentrer chez elle, moi pour reconduire la mère Alexandre à Montmartre. Voilà le récit exact de cette aventure qui a fait tant de bruit, voilà tout le dommage qui en est résulté pour mademoiselle Tatiane, que tout le monde croit perdue et à laquelle, gardée comme elle l’était, il ne m’a pas même été possible de baiser la main.
Sir Ralph ouvrait la bouche pour continuer, mais il s’interrompit tout à coup en disant :
— Eh bien, soit, je m’arrête là , d’ailleurs le reste est insignifiant.

![]()
LVIII
SURPRISE
Quand sir Ralph eut cessé de parler, on eût cru entendre passer dans l’air comme un soupir de soulagement, et l’on vit sur tous les visages un épanouissement de bonheur.
Tatiane était sauvée.
Son innocence, dont personne ne voulait douter tant elle éclatait éloquente et radieuse sur ses traits charmants et naïfs, avait cependant subi l’outrage du doute.
Parmi ceux mêmes auxquels elle inspirait la plus vive sympathie et la confiance la plus absolue, beaucoup, comme la baronne de Villarsay, avaient dû se rendre à l’évidence des faits, trop palpables, trop écrasants pour qu’il fût possible de les révoquer en doute ; aussi la joie fut-elle immense à ce résultat inattendu, chez ceux dont la foi et la pureté de la jeune fille avait dû céder devant le témoignage brutal et indiscutable qui la condamnait.
Et pourtant il restait une espèce de malaise dans tous les esprits.
Une ombre enveloppait encore cette affaire ; chacun se demandait avec une certaine angoisse sous l’empire de quel sentiment ou de quelle mystérieuse pression un homme comme sir Ralph avait pu se résoudre à faire des aveux aussi terribles, aussi compromettants pour lui, et l’assemblée entière appelait de tous ses vœux la lumière sur ce point resté obscur, comprenant qu’alors seulement la réhabilitation de Tatiane serait complète et irrévocablement établie aux yeux du monde.
Ce désir ne devait pas tarder à se réaliser.
On vit tout à coup sir Ralph frissonner des pieds à la tête, puis promener autour de lui des regards étonnés.
Il se demandait évidemment où il était, et cherchait à se rendre compte de ce qui se passait autour de lui.
La mémoire lui revint enfin, et s’adressant à M. Mauvillars qu’il voyait assis devant lui, les cartes à la main :
— Et bien, lui demanda-t-il, où en sommes-nous ?
— Vous allez le savoir, répondit M. Mauvillars avec un accent singulier.
Et se tournant vers Jacques Turgis :
— Veuillez lire à sir Ralph le récit qu’il vient de nous faire.
— Moi ? moi ? s’écria sir Ralph stupéfait, j’ai fait un récit ?
— Très-intéressant et surtout fort instructif.
— Mais quand ? Comment ? À quel propos ? demanda sir Ralph avec une vague inquiétude.
— Quand ? À l’instant même. À quel propos ? C’est ce que vous seul pourriez nous apprendre, car vous avez tout à coup entamé cette histoire en abattant une carte et sans y être invité par personne. Au reste, vous pouvez juger de l’intérêt qu’elle a inspiré à nos invités en les voyant tous réunis ici ; pas un n’est resté dans la salle du bal, et, je puis l’affirmer, pas un n’a regretté la danse en écoutant votre récit.
Sir Ralph était tombé dans un état d’ahurissement qui le rendait comme hébété.
Il attachait sur M. Mauvillars un regard fixe et curieux, et, aux efforts qu’il semblait faire pour comprendre, on eût dit que celui-ci s’exprimait en chinois.
— Au reste, reprit M. Mauvillars, toutes vos paroles ont été transcrites fidèlement, sous les yeux des deux cents témoins qui nous entourent, par MM. Jacques Turgis et Paul de Tréviannes, afin qu’on pût en contrôler l’exactitude par la comparaison des deux manuscrits. Maintenant, M. Turgis, lisez, s’il vous plaît, car sir Ralph n’a pas l’air très-convaincu de ce que je lui dis.
— Écoutez donc ce que vous venez de raconter à l’instant même et devant tout le monde, dit froidement Jacques à sir Ralph, qui semblait toujours sous l’empire d’un rêve.
Et il lut.
À mesure que le récit se déroulait, sir Ralph, passait de la surprise à l’inquiétude et de l’inquiétude à l’épouvante.
Tout à coup il s’écria en proie à une espèce de délire :
— Mais c’est impossible, je n’ai jamais pu conter de pareilles histoires. Tout cela est faux, absolument faux ; et, d’ailleurs, comment admettre que j’eusse pu faire de pareils aveux, en supposant même que tout cela fût vrai ? Ce serait de la folie.
— Je vais vous donner l’explication de ce mystère, dit une voix derrière sir Ralph.
Celui-ci se retourna et se trouva en face du domino rose qui, se démasquant aussitôt, lui montra les traits de la mère Alexandre.
— La mère Alexandre ! s’écria sir Ralph, frappé de stupeur à l’aspect de la magnétiseuse.
— Mais oui, répondit celle-ci avec un sourire de triomphe, la mère Alexandre, que vous avez trompée en lui affirmant que vous étiez aimé de mademoiselle Tatiane ; la mère Alexandre, à laquelle vous aviez fait commettre une mauvaise action et qui, je vous le jure, est bien heureuse aujourd’hui de vous saisir dans les mêmes filets où vous aviez pris cette pauvre enfant.
Sir Ralph roulait autour de lui des regards où se lisaient à la fois la rage et l’épouvante.
Il s’écria enfin en se tournant vers la magnétiseuse :
— Vous êtes une vieille misérable, capable de tout pour de l’argent, vous avez été payée pour me contraindre, par votre puissance infernale, à faire ce récit absurde, invraisemblable, mais vous êtes trop tarée pour qu’on ajoute foi à vos paroles.
— Soit, répondit la mère Alexandre, mais il est question, dans cette histoire, d’un témoin qui est resté près de mademoiselle Tatiane, depuis le moment où nous sommes entrées dans sa chambre, jusqu’à l’heure où elle y a été ramenée, qui m’a vue la magnétiser, lui enlever son libre arbitre, la soumettre à ma volonté, appeler la joie dans son cœur et le sourire sur ses lèvres ; ce témoin, loyal et irréprochable, c’est Malvina, qui a trahi sa maîtresse en pleurant et en vous maudissant, vous le savez.
— Je le sais, et c’est parce qu’elle est loyale et franche qu’elle n’est pas là pour soutenir par son témoignage toutes les fables que vous m’avez forcé à débiter et qui sont consignées là comme autant d’aveux volontaires de ma part.
Alors le domino noir s’avança à son tour devant sir Ralph, et arrachant le masque qui couvrait ses traits :
— Me reconnaissez-vous, sir Ralph ?
Sir Ralph laissa échapper un nouveau cri de surprise en reconnaissant Malvina.
— Malheureuse ! murmura-t-il enfin en baissant la voix, ne craignez-vous pas…
— Je ne crains rien, répondit froidement la jeune fille ; mon père et ma mère n’ont plus à redouter la terrible expiation dont vous les menaciez en cas d’indiscrétion de ma part, ils sont morts l’un et l’autre, et, libre maintenant du joug odieux qui pesait sur ma conscience, je déclare hautement que tout est vrai dans la confession que vous a arrachée madame Alexandre et que vient de lire M. Jacques Turgis.
Sir Ralph comprit, pour le coup, que la partie était perdue, et il ne tenta même pas de répliquer.
Au même instant un individu, qu’il se rappela avoir aperçu à son entrée dans la salle de bal, s’approcha de lui, et, lui touchant familièrement l’épaule :
— Sir Ralph, lui dit-il, une petite malle a été trouvée, il y a deux heures, dans le cabinet qu’avait occupé Peters à l’hôtel Meurice ; et, des quelques papiers qu’elle renfermait, il résulte que cet individu et son camarade, le cocher Jack, étaient deux détectives envoyés de New-York à la poursuite des nommés Mac-Field et sir Ralph ; or jusqu’à ce qu’on ait découvert les véritables assassins de ces deux malheureux, nous allons nous assurer de vous et de votre ami, comme violemment soupçonnés de ce crime.
— Moi ! un assassin ! s’écria sir Ralph.
— On vous calomnie peut-être, reprit l’agent de police, mais il est un lieu dans Paris où tout finit par s’éclaircir, c’est la préfecture de police ; veuillez m’y suivre, et je ne doute pas que votre innocence n’y soit bientôt reconnue.
Sir Ralph était devenu livide.
Il promena de sombres regards sur toute l’assemblée, puis, les traits contractés par une expression de rage qui lui donnait quelque chose du tigre :
— Ah ! s’écria-t-il d’une voix retentissante, vous triomphez, n’est-ce pas ? Vous vous réjouissez tous d’avance à la pensée des tortures que je vais endurer dans l’attente de l’expiation suprême, expiation à laquelle vous vous promettez de venir assister comme à une fête ! Ce sera fort joyeux, en effet, mais en attendant que je vous procure ce spectacle, je veux, en vous quittant, vous laisser à tous un souvenir, à la famille Mauvillars pour sa gracieuse hospitalité et à M. Jacques Turgis pour la peine qu’il a prise d’écrire ce petit mémoire, un gage ineffaçable de ma reconnaissance.
Et tirant de la poche de son habit le revolver qu’il avait emporté, sur le conseil de Mac-Field, il se tourna brusquement vers Tatiane, placée à trois pas de lui, l’ajusta froidement et fit feu.
LIX
DÉVOUEMENT
Au bruit de la détonation, toutes les femmes s’étaient précipitées vers les portes en jetant des cris aigus, et, les issues étant trop étroites pour laisser passer à la fois toute cette foule atteinte de vertige, il y eut un moment une étrange mêlée de robes de soie, de dentelles, de diamants et de cheveux effarés.
Puis l’explosion ne se renouvelant pas et l’encombrement des portes forçant les femmes à rester là , la peur se dissipa peu à peu et chacune alors, rassurée pour son propre compte, songea à Tatiane, sur laquelle avait été dirigée la balle de sir Ralph.
Un cercle s’était fait tout à coup de ce côté, et, au milieu de ce cercle, une femme était étendue sanglante.
Mais, chose étrange et qui frappa de stupeur tous les témoins de cette scène, cette femme n’était pas Tatiane.
C’était Malvina, sa femme de chambre.
Elle avait vu sir Ralph armer son revolver et le diriger sur la jeune fille, et, par un mouvement plus prompt que l’éclair, elle s’était précipitée au-devant de celle-ci au moment même où le misérable appuyait le doigt sur la détente.
Elle avait reçu la balle en pleine poitrine et elle perdait tout son sang, qui coulait à flots sur son domino noir.
Quant à Tatiane, les traits couverts d’une pâleur livide et le corps agité de frissons convulsifs, elle fixait sur la pauvre Malvina un regard plein d’horreur et de pitié.

— De l’air ! de l’air ! j’étouffe, murmura l’infortunée en se débattant sur le parquet.
— Vite, qu’on la transporte dans la serre, s’écria Tatiane.
Trois jeunes gens se présentèrent aussitôt, dont l’un déclara qu’il était médecin et qu’il allait examiner la plaie. Les deux autres étaient Jacques Turgis et Paul de Tréviannes.
Ceux-ci la prirent, l’un par les jambes, l’autre par les épaules, et la transportèrent dans la serre, précédés de Tatiane, de Vanda et de Valentine.
Là , on l’étendit sur un large banc de fer, près d’une fenêtre ouverte, par laquelle entrait l’air frais du dehors.
Puis le jeune médecin s’approcha de la blessée pour écarter les plis de son domino.
Mais Malvina le repoussa doucement en murmurant d’une voix lente et affaiblie :
— C’est inutile, le coup est mortel, je vais mourir, je le sens.
Tournant ensuite vers Tatiane son regard déjà vague et à demi éteint, elle lui fit signe d’approcher.
Tatiane vint s’agenouiller près d’elle, et, les yeux pleins de larmes, elle prit sa main qu’elle pressa avec effusion dans les siennes.
— Ne me plaignez pas, mademoiselle, lui dit Malvina, dont la voix s’affaiblissait de plus en plus, j’ai voulu mourir pour vous… j’avais été si coupable, je vous avais fait tant de mal à vous, si bonne… mais j’ai… payé ma dette, je vous ai sauvée, je meurs heureuse.
Elle se tut un instant.
Ses lèvres venaient de se border d’une écume rougeâtre.
— Oh ! non, ne parlez pas de mort, nous vous sauverons, ma pauvre Malvina, lui dit Tatiane en sanglotant et en la baisant au front.
— Hélas ! murmura le jeune docteur, elle est perdue !
— Non, non, je ne dois pas vivre, balbutia Malvina avec effort, je serais trop malheureuse, je remercie Dieu de m’envoyer la mort.
Elle ajouta d’une voix presque inintelligible et en portant la main à sa poitrine :
— Tenez, prenez cela, prenez-le, mais qu’il ne sache pas… il ne connaît pas mon secret, je veux qu’il l’ignore… il m’a sauvée de la honte… ah ! c’est un grand cœur.
Elle fouillait toujours sa poitrine d’une main tremblante.
— Ah ! le voilà , le voilà , murmura-t-elle avec un douloureux sourire, je l’ai volé chez lui le jour où je suis allée… que de fois je l’ai mouillé de mes larmes !… Aujourd’hui, il est mouillé de mon sang… Tenez, déchirez-le et ne lui dites pas… je veux qu’il ignore toujours que je l’ai aim…
Elle ne put achever.
L’objet qu’elle avait arraché de sa robe s’échappait de sa main en même temps que son dernier soupir s’échappait de sa poitrine.
Cet objet, c’était la photographie de Paul de Tréviannes.
En voyant tomber Malvina sous le coup destiné à sa jeune maîtresse, sir Ralph, déçu dans sa soif de vengeance, fut tenté un instant de la satisfaire à tout prix en envoyant une seconde balle à Tatiane, toujours debout à trois pas de lui.
Mais, frappé en même temps des périls auxquels il était exposé et comprenant qu’à cette heure sa vie dépendait d’une seconde, il renonça aussitôt à sa haine et songea à profiter du trouble et de la panique que venait de produire ce meurtre pour se tirer de la foule et se glisser hors de l’hôtel.
Absorbée par l’affreux spectacle qu’elle avait sous les yeux, c’est-à -dire par la vue de la pauvre Malvina perdant tout son sang, l’assemblée entière avait oublié l’assassin, et celui-ci, se dégageant enfin de la foule qui le laissait passer sans le regarder, allait se diriger vers la porte, quand quelques personnes, frappées de la précipitation avec laquelle il s’éloignait, le reconnurent tout à coup.
— Le meurtrier ! le meurtrier ! s’écrièrent alors cinq ou six voix à la fois.
Tous les regards se tournèrent aussitôt de ce côté et au même instant la foule entière s’élança vers sir Ralph avec la violence d’un flot qui déborde.
Quelques mains s’étendaient déjà sur lui, quand, tirant tout à coup son revolver, il le braqua résolument sur ceux qui l’entouraient en tournant lentement sur lui-même.
Il se fit aussitôt un cercle qui alla rapidement en s’agrandissant, et c’est au milieu du profond silence qui s’était établi tout à coup que sir Ralph s’écria en s’adressant à M. Mauvillars :
— Donnez-moi votre parole que vous allez me laisser sortir libre d’ici et qu’en outre vous m’accompagnerez jusqu’à ce que je me trouve en lieu sûr, sinon je fais feu. Il reste cinq balles dans cette arme, c’est cinq cadavres que je vais faire, cinq corps sanglants qui, tout à l’heure, seront étendus là , sur le parquet.
En parlant ainsi, il continua à tourner lentement et à surveiller avec une extrême circonspection tout le cercle qui l’enveloppait.
M. Mauvillars était en proie à une profonde angoisse.
Venant d’un homme comme sir Ralph, une pareille menace n’était pas à dédaigner.
Accusé de quatre ou cinq meurtres, dont il était évidemment coupable, sa tête était condamnée d’avance.
N’ayant rien à espérer, il n’avait rien à ménager.
Il n’hésiterait donc pas à faire cinq nouvelles victimes, et M. Mauvillars avait pâli à cette pensée.
— Eh bien, soit, répondit-il après un silence, je consens à prendre cet engagement pour éviter de nouveaux malheurs dans ma maison, convaincu d’ailleurs que vous ne perdrez rien pour attendre.
— Ça, répondit sir Ralph toujours en éveil, c’est mon affaire ; tirez-moi d’ici, c’est tout ce que je vous demande et le reste me regarde.
— Allons donc ! s’écria une voix dans la foule, traiter avec un tel misérable, ce serait une honte. Je me charge de lui, moi, je m’en charge seul, et je vais vous montrer tout à l’heure que celui que vous redoutez comme un tigre n’est qu’un lâche chacal.
Sir Ralph avait tressailli à celle voix, qu’il avait reconnue.
C’était celle de M. Portal, cet ennemi implacable qu’il trouvait partout sur son chemin.
Rocambole, car c’était bien lui, sortit de la foule, fit deux pas vers sir Ralph qui, toujours résolu, quoique très-pâle, avait aussitôt braqué son arme sur lui, et, croisant ses bras sur sa poitrine, il appela :
— M. Paul de Tréviannes ! M. Jacques Turgis !
Les deux jeunes gens s’avancèrent vers lui.
— Écoutez, leur dit-il d’une voix calme, je vais m’avancer vers ce misérable ; s’il fait feu sur moi, vous tombez sur lui avec la rapidité de la foudre, vous le désarmez, et alors, retenez bien mes paroles, vous lui fracassez la mâchoire d’une balle et vous le conservez précieusement en cet état pour le bourreau. Vous êtes deux, vous êtes jeunes, forts, braves et agiles, il ne peut vous échapper. Surtout, ne le tuez pas, faites ce que je viens de vous commander.
— Comptez sur nous, répondit Jacques.
— Attention donc ! dit Rocambole.
Et, les bras toujours croisés sur la poitrine, il marcha d’un pas lent et assuré vers sir Ralph.
Un léger frisson avait parcouru tout le corps de celui-ci quand il avait entendu les ordres que venait de donner Rocambole à son sujet, mais il avait paru inébranlable dans sa résolution.
Cependant ses traits se couvraient d’une pâleur de plus en plus livide, à mesure que son ennemi se rapprochait de lui, tandis que celui-ci, calme et impassible, fixait sur lui un regard intrépide.
Immobile et anxieuse, l’assemblée entière frémissait à chaque pas qu’il faisait vers l’arme braquée sur lui.
Mais un imperceptible sourire de dédain avait effleuré les lèvres de Rocambole.
Il avait vu trembler cette arme dans la main du meurtrier et il s’était dit : Il n’osera ! Avec une mâchoire fracassée, outre que l’opération n’a rien d’agréable, nul espoir de salut, nulle possibilité d’évasion ! il s’est dit cela et il n’osera.
Arrivé si près de lui que le revolver touchait sa poitrine, Rocambole, sans faire un mouvement dit à sir Ralph en le regardant toujours en face :
— Eh bien, décidément, tirez-vous ?
Sir Ralph ne répondit pas. Alors Rocambole éleva la main vers l’arme, lentement, sans se presser, l’enleva des mains de son ennemi, la regarda d’un air indifférent, et, se tournant vers Jacques Turgis :
— Monsieur Jacques, lui dit-il, veuillez faire avancer une voiture, nous allons y prendre place avec sir Ralph, auquel nous ferons nous-mêmes les honneurs de la préfecture de police.
Le lecteur s’est demandé sans doute ce qu’était devenu Mac-Field au milieu de tous ces événements.
Mac-Field était resté là jusqu’au moment où sir Ralph, interrompant tout à coup son jeu, s’était mis à raconter l’étrange récit qu’on avait attribué d’abord à un accès de folie.
Stupéfait lui-même en entendant son complice raconter publiquement des faits qu’il avait tant d’intérêt à tenir secrets, Mac-Field, qui connaissait le moyen dont s’était servi sir Ralph pour compromettre Tatiane, ne tarda pas à soupçonner qu’il était à son tour sous l’empire de la même fascination, et, comprenant que la confession provoquée par le mystérieux personnage qui le dominait en ce moment irait jusqu’au bout et ne laisserait rien dans l’ombre, il avait jugé prudent de s’esquiver avant les révélations dans lesquelles il se trouvait lui-même si gravement compromis.
M. Badoir, lui, après avoir subi la torture du pilori tout le temps qu’avait duré le récit de sir Ralph, s’était hâté de mettre à profit la panique qui avait suivi la détonation de son revolver, et, quand le calme fut rétabli, on le chercha vainement ; il avait disparu.
Nous le retrouverons plus tard, ainsi que Mac-Field, dans une action où reparaîtront également deux personnages dont il nous reste quelques mots à dire avant de clore cette première partie ; ces deux personnages sont l’Allemand Goëzmann et sa digne compagne, Nanine la Rousse, dont les redoutables instincts pourront se déployer à l’aise dans le drame terrible qui formera la seconde partie de cette œuvre.
Du cabinet du juge d’instruction où nous les avons laissés, ces deux individus avaient été écroués à Mazas, attendant l’instruction de leur affaire, et, au bout d’un mois, ils venaient s’asseoir sur les bancs de la cour d’assises.
Toutes les célébrités demi-mondaines, naguère amies ou rivales de la belle rousse, tous les fils de famille qui l’avaient connue plus ou moins intimement, et même beaucoup de grandes dames qu’elle avait éclaboussées de son luxe et dont quelques unes l’avaient peut-être admirée au bois ou au théâtre, tous enfin, amis ou ennemis, étaient accourus au curieux spectacle de cette reine du vice qui, après avoir ébloui, fasciné la plus brillante société, venait s’asseoir sur les bancs des malfaiteurs.
Tout ce monde accourut pour contempler sa honte et s’en repaître, ce fut là son véritable châtiment, bien autrement cruel, bien autrement humiliant et dur que les dix ans de travaux forcés auxquels elle se voyait condamnée.
La peine de Goëzmann fut élevée à vingt ans.
On crut que leur carrière était terminée là ; on se trompait, et, comme nous venons de le dire, ils étaient appelés à reparaître dans la société, qui s’en croyait délivrée, et à y exercer l’influence la plus funeste.
C’est dans cette seconde partie que nous retrouverons Rocambole avec toutes les ardeurs et toutes les audaces de sa jeunesse, mêlé à trois ou quatre drames de famille dont il est le pivot, ramassant au besoin ses guenilles de bandit pour faire face à un groupe de redoutables malfaiteurs acharnés à sa perte ou à celle de ses protégés, se multipliant sous les incarnations les plus diverses pour faire face à ces terribles ennemis ; parfois vaincu, jamais abattu, conservant, même en face de la mort, ce calme et cette lucidité d’esprit qui, dans toutes les circonstances, l’ont fait triompher du destin.
LXIII
ÉPILOGUE
À un mois de là , nous trouvons la plupart de nos personnages, presque tous ceux auxquels nous espérons avoir intéressé le lecteur, réunis à l’hôtel de M. Mauvillars, qui les avait invités à dîner ce jour-là .
La table avait été dressée sous une allée de tilleuls, dont le feuillage, d’un vert tendre – on était à la fin de mai – tamisait une brume lumineuse à travers laquelle les convives flottaient comme les personnages d’une féerie dans les vapeurs d’une apothéose.
Ces convives sont : toute la famille Mauvillars d’abord, puis l’oncle Pierre Valcresson, Louise Prévôt, devenue depuis huit jours madame Valcresson et qui a recouvré, avec sa raison, toute sa grâce et toute sa beauté d’autrefois ; Jeanne, qu’on a dû placer près de Tatiane, pour laquelle elle s’est prise d’une véritable passion ; Paul de Tréviannes, madame Taureins, Vanda, M. Portal, la baronne de Villarsay, amie intime de la famille Mauvillars.
Un invité manquait à cette réunion d’intimes et il eût suffi de remarquer le léger nuage qui, de temps à autre, passait sur le beau front de Tatiane pour deviner que celui-là était Jacques Turgis.
Au moment de se mettre à table, M. Mauvillars avait reçu une lettre de l’artiste qui le priait de ne pas l’attendre pour dîner, se trouvant empêché d’y assister par un travail très-pressé.
— Ça c’est très-beau, c’est héroïque, s’était écrié M. Mauvillars, qui estimait énormément les piocheurs et n’hésitait pas à mettre le travail infiniment au-dessus du sentiment.
Une ravissante petite moue de la jolie Tatiane avait exprimé clairement qu’elle ne partageait pas l’enthousiasme de son oncle pour ce genre d’héroïsme, mais il va sans dire qu’elle n’avait osé manifester autrement son opinion à cet égard.
— C’est égal, s’était-elle dit tout bas en se mettant à table, il me semble qu’un amoureux devrait abandonner tous les travaux du monde pour celle qu’il aime.
Puis elle ajouta au plus profond de son cœur et avec un léger soupir :
— S’il est vrai qu’il m’aime autant qu’il le dit !
Elle se mentait bien un peu à elle-même en ayant l’air de douter de cet amour, mais elle n’était pas contente de lui et elle voulait se donner un prétexte de le bouder intérieurement.
Le dîner fut très-gai, mais de cette gaieté douce et charmante qui se dégage des cœurs heureux.
— Il nous manque trois personnes pour que cette petite fête soit complète, dit M. Mauvillars, notre ami Jacques Turgis d’abord, puis nos deux parents, le comte et la comtesse de Sinabria.
— La comtesse, à laquelle la santé de son mari inspire toujours de sérieuses inquiétudes, répondit Rocambole, a voulu quitter Paris pour aller se fixer à Pau, où elle a résolu de se consacrer exclusivement à son cher malade.
— Cette bonne Rita ! dit madame Mauvillars, oh ! c’est une noble et excellente créature et je ne puis que l’admirer ; pourtant, je l’avoue, j’éprouve une espèce de serrement de cœur à la voir renoncer au monde, si jeune et si belle.
— C’est un cœur malade auquel tout est devenu indifférent, le monde surtout, répliqua Rocambole.
On était au dessert.
Quelques instants après, les convives quittaient la table et se dispersaient dans le jardin à leur fantaisie.
Tatiane avait cherché le coin le plus solitaire pour y rêver en liberté.
C’était une espèce de rond-point ombragé par de grands arbres, et auquel aboutissaient plusieurs sentiers pratiqués dans un épais taillis.
Du banc de bois sur lequel elle s’était assise, à travers une échappée pratiquée dans les grands arbres, elle voyait le soleil se coucher à l’horizon et incendier le ciel de ses rayons disparus.
Elle rêvait là depuis dix minutes environ quand elle crut sentir passer sur sa main, qui pendait inerte le long du banc, quelque chose comme une tiède vapeur.
Elle allait la retirer précipitamment, effrayée à la pensée que ce pouvait être quelque reptile, quand une voix timide, tremblante, faible comme un souffle, balbutia tout bas derrière elle ce nom, qui lui parut charmant ainsi murmuré :
— Tatiane !
Oh ! alors elle ne songea plus à retirer sa main.
Ce reptile, ce serpent tentateur, elle le connaissait, et il ne l’effrayait pas ; au contraire, comme sa mère Ève, elle prêtait à ses paroles une oreille complaisante.
— Tatiane ! chère Tatiane ! reprit la voix avec une tendresse un peu plus accentuée.
La respiration de la jeune fille était devenue haletante, car le tentateur, s’enhardissant de plus en plus, avait pressé sur ses lèvres la main que d’abord il osait à peine toucher.
Puis, encouragé par le silence de la jeune fille, il était venu s’asseoir près d’elle et il lui avait dit avec une émotion, qui s’était aussitôt communiquée au cœur de celle-ci :
— Chère Tatiane, je viens de voir M. Mauvillars, je lui ai rappelé sa promesse de m’accorder votre main le jour où votre innocence, dont je n’ai jamais douté, éclaterait à tous les yeux ; il m’a répondu qu’il était prêt à tenir cet engagement, mais à une condition…
Il n’osa achever.
— Et cette condition ? demanda Tatiane d’une voix que l’émotion faisait trembler.
— Eh bien ! c’est que vous m’avoueriez franchement, sans hésiter, sans détour, que… que vous m’aimez.
— Oh ! monsieur Jacques ! balbutia Tatiane en rougissant.
— Chère Tatiane, ce n’est pas moi qui parle, je n’oserais, c’est votre oncle, et songez que, sans cet aveu, il refuse son consentement.
Il y eut un moment de silence.
— Tatiane ! oh ! ma chère et adorée Tatiane, murmura Jacques d’une voix basse et vibrante, eh bien ; écoutez, ne dites pas cela, si c’est trop vous demander, mais pour satisfaire votre oncle, pour cela seulement, dites, oh ! je vous en supplie, dites que vous êtes heureuse de mon amour.
Et, en parlant ainsi, il s’était agenouillé devant elle et il couvrait de baisers ses deux petites mains ; si bien qu’à la fin le cœur de la pauvre Tatiane, bouleversé, éperdu, laissa échapper ces mots :
— Oh ! oui, bien heureuse !
— Eh bien, voilà tout ce que je voulais, dit alors une voix derrière les deux jeunes gens.
Tatiane se retourna en jetant un cri et elle aperçut M. et madame Mauvillars, ainsi que ses deux grands-parents, qui la regardaient en riant de sa confusion.
— Allons, s’écria alors M. Mauvillars en se frottant les mains, vous vous aimez tous deux, voilà qui est clair, et, quand on est atteint de cette maladie-là , il n’y a qu’un moyen de n’en pas mourir, c’est de se marier, ce qui ne traînera pas en longueur, je vous en réponds.
Puis, s’adressant à Jacques, tout rayonnant de bonheur :
— Quant à vous, monsieur l’artiste, je vous préviens que Tatiane vous en veut beaucoup de n’avoir pas tout abandonné pour venir vous asseoir près d’elle à notre table, et, si vous n’avez quelque bonne justification à faire valoir…
— J’en ai une qui, je l’espère, me vaudra mon pardon, répondit Jacques, et si vous voulez me suivre tous…
— Volontiers ; offrez votre bras à Tatiane et marchez devant.
Jacques se hâta d’obéir.
Un instant après on pénétrait dans la maison, et, à l’extrême surprise de Tatiane, Jacques la conduisit à l’appartement de grand-papa et grand’maman Mauvillars, non moins étonnés que leur petite-fille.
Il alla droit au salon, ouvrit la porte et dit :
— Voilà mon excuse, voilà le travail que je voulais achever avant de venir.
Ce travail, c’était le portrait en pied de Tatiane, fait de mémoire par Jacques et posé au milieu d’un panneau entre ceux de ses deux grands-parents.
Il y eut un moment de silence devant cette toile.
Puis le père Mauvillars s’écria tout à coup d’une voix pleine de sanglots :
— Ah ! monsieur Jacques ! monsieur Jacques ! laissez-moi vous embrasser.
Et il se jeta dans ses bras en pleurant.
— Notre chère petite Tatiane ! murmurait pendant ce temps la grand’maman Mauvillars en s’essuyant les yeux, elle ne nous quittera plus, nous l’aurons toujours là , devant nous. Mais vois donc, mon ami, vois comme elle est ressemblante, c’est son charmant sourire, si naïf et si bon ; c’est son beau regard, si loyal et si pur, c’est elle enfin, c’est elle toute vivante.
— Alors, je suis pardonné ? demanda Jacques.
— Je vous adore, lui dit avec feu la grand’mère.
— Et moi je vous aime, lui soupira Tatiane à l’oreille.
FIN DU RETOUR DE ROCAMBOLE
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Janvier 2015
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : MarcV, PatriceC, AlainC, Coolmicro.
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.