
Jean de la Hire
LA ROUE FULGURANTE
Illustrations de P. Santini
Première publication, le Matin, 1907
Première publication en volume, 1908
Édition reproduite, le Livre moderne illustré, 1942
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/
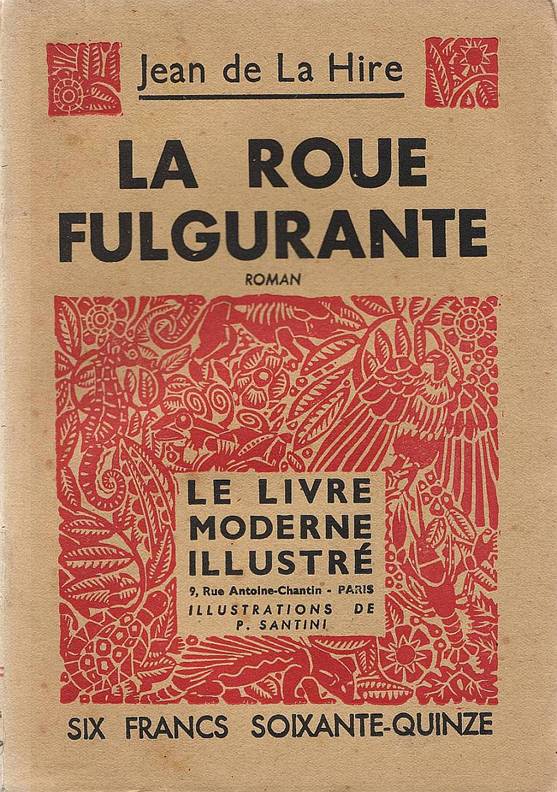
Table des matières
PREMIÈRE PARTIE LES SATURNIENS
CHAPITRE PREMIER OÙ LES HOMMES VOIENT QUELQUE CHOSE QUI NE S’ÉTAIT JAMAIS VU
CHAPITRE II DANS LEQUEL UN HOMME MYSTÉRIEUX FAIT DE MYSTÉRIEUSES PROMESSES
CHAPITRE III OÙ LA ROUE FULGURANTE LIVRE QUELQUES-UNS DE SES SECRETS
CHAPITRE IV OÙ LES DOUCEURS DE L’AMOUR ET LES DOULEURS DE LA FAIM COMMENCENT ENSEMBLE
CHAPITRE V DANS LEQUEL SIX COUPS DE REVOLVER ONT DE TERRIBLES CONSÉQUENCES INATTENDUES
DEUXIÈME PARTIE LA PLANÈTE MYSTÉRIEUSE
CHAPITRE PREMIER QUI SERT DE PEU BANALE INTRODUCTION AU SUIVANT
CHAPITRE II OÙ TERRIENS ET MERCURIENS ENTRENT EN CONFLIT
CHAPITRE III QUI FINIT PAR DEUX ENLÈVEMENTS DISSEMBLABLES
TROISIÈME PARTIE LES MERCURIENS
CHAPITRE PREMIER OÙ DES SCÈNES D’HORREUR ONT POUR DÉNOUEMENT UN ACCIDENT TERRIBLE
CHAPITRE II TOUT OCCUPÉ PAR LES PÉRIPÉTIES D’UNE CHASSE FANTASTIQUE
CHAPITRE III QUI RÉVÈLE DE STUPÉFIANTS PHÉNOMÈNES
CHAPITRE IV OÙ BILD ET BRAD SIGNALENT PRODIGIEUSEMENT LEUR EXISTENCE
QUATRIÈME PARTIE LES ÂMES RÉINCARNÉES
CHAPITRE PREMIER OÙ L’ON RETROUVE UN PERSONNAGE PLUS ÉTONNANT QUE LA ROUE FULGURANTE ELLE-MÊME
CHAPITRE II OÙ L’ON RETROUVE ENCORE UN PERSONNAGE AUSSI INTÉRESSANT QU’AHMED-BEY
CHAPITRE III QUI SEMBLE FOLLEMENT FANTASMAGORIQUE ET QUI N’EST CEPENDANT QUE SCIENTIFIQUEMENT RÉEL
CINQUIÈME PARTIE EN PLEIN MYSTÈRE
CHAPITRE PREMIER OÙ LE DOCTEUR AHMED-BEY LUI-MÊME N’EN SAIT PAS DAVANTAGE
CHAPITRE II QUI SE TERMINE PAR UN SAUT DANS L’INCONNU
CHAPITRE III QUI EST LA TRAGIQUE CONTRE-PARTIE DU PRÉCÉDENT
CHAPITRE IV QUI ÉCLAIRCIT QUELQUES MYSTÈRES ET MET PAUL DE CIVRAC DANS UN EFFROYABLE DILEMME
CHAPITRE PREMIER OÙ M. TORPÈNE MARCHE DE STUPÉFACTION EN STUPÉFACTION
CHAPITRE II QUI RACONTE DE QUEL FAIT AFFOLANT LA MORGUE FUT LE THÉÂTRE
CHAPITRE III OÙ LE DOCTEUR AHMED-BEY TIENT SES FANTASTIQUES PROMESSES
CHAPITRE IV QUI, SANS L’ANDROPLASTIE, SE TERMINE PAR LES FIANÇAILLES PRÉVUES
SEPTIÈME PARTIE LE RADIOTÉLÉPHONOGRAPHE INTERPLANÉTAIRE
CHAPITRE PREMIER OÙ L’ON ASSISTE À DE PRODIGIEUSES RÉALITÉS
CHAPITRE II OÙ L’ON ATTEND, DANS L’ANGOISSE
CHAPITRE III OÙ LE DESTIN CLÔT, PAR UNE CATASTROPHE, LA PORTE DU MYSTÈRE
À propos de cette édition électronique
AVERTISSEMENT
Le roman La Roue Fulgurante a été écrit en 1906. Le Matin le publia en feuilletons dans l’année 1907. La première édition fut donnée par la Librairie Jules Tallandier en 1908. Depuis lors, d’autres éditeurs en ont publié différentes éditions, de divers prix, à nombreux tirages. Néanmoins, Le Matin et l’auteur reçoivent presque quotidiennement, surtout depuis environ un an, des lettres demandant « où l’on peut se procurer » La Roue Fulgurante.
Toutes les éditions antérieures, sauf une seule, dite « populaire », étant épuisées, nous offrons au public une édition définitive.
Nous tenons à déclarer que le texte qui suit est exactement le même que celui que le Matin publiait en 1906. Pas un seul mot n’y a été ajouté. Nous avons pensé que les anticipations dont fourmille ce roman prophétique rendent indispensable cette déclaration.
Mai 1942.
Les Éditeurs.

PREMIÈRE PARTIE
LES SATURNIENS
CHAPITRE PREMIER
OÙ LES HOMMES VOIENT QUELQUE CHOSE QUI NE S’ÉTAIT JAMAIS VU
Ce fut le 18 juin que la chose arriva. L’homme qui, le premier, a vu la Roue Fulgurante, est un capitaine de carabiniers espagnols nommé José Mendès.
Précédé de sa fille Lola et de son valet de chambre Francisco, qui portait sur l’épaule une lourde valise, il descendait tranquillement du fort de Montjuich vers Barcelone. Ces trois personnes allaient prendre à la gare « del Norte » le train de quatre heures cinquante pour Saragosse.
Le chemin, raide et pittoresque, passe à travers les jardins de Miramar, domine de bien haut la mer et les docks à charbon du port marchand, puis dévale brusquement jusqu’au bas de la colline, où il devient une infecte rue.
Il était trois heures du matin. Le soleil n’avait pas encore surgi de la mer orientale ; mais les étoiles commençaient à pâlir devant les clartés montantes de l’aurore. Le capitaine José Mendès fumait un de ces ignobles cigares à bon marché que les Français vantent sans les connaître, et que les Espagnols de bon goût ne touchent jamais. Et il descendait lentement l’abrupt sentier. Un instant, il s’arrêta pour arracher du bas de son pantalon une ronce tenace qui s’y était accrochée. Quand il reprit sa marche, Lola et Francisco étaient à cinquante pas en avant de lui. Gros et de jambes courtes, il ne se hâta pas pour les rejoindre, pensant qu’ils l’attendraient au bas de la descente.
Soudain, un étrange vrombissement lui fit lever la tête, et ce qu’il vit le planta droit et immobile sur ses talons ; il laissa tomber le cigare et ouvrit des yeux extraordinaires.
Imaginez une immense roue de lumière fulgurante ! Elle tournait dans le ciel avec une vertigineuse rapidité ; son moyeu était une boule noire percée de trous d’où jaillissaient des faisceaux lumineux de couleur verte… Cette roue d’éblouissement allait de l’Ouest à l’Est. D’après l’estimation que fit par la suite le capitaine, elle pouvait être à une hauteur de cinq cents mètres au-dessus du castillo de Montjuich. Tout à coup, elle s’arrêta, décrivit un quart de cercle sur elle-même et roula vers la montana Pelada.
Le capitaine pensait qu’elle devait être au-dessus du quartier de Gracia, lorsqu’il entendit comme le fracas de plusieurs tonnerres. Instinctivement, il dirigea ses regards du côté où devait être sa fille. Et il vit, – il n’en croyait pas ses yeux ! – il vit sa fille Lola et son valet Francisco enlevés de terre, emportés vers le ciel, aspirés par la Roue Fulgurante, et tout aussitôt une lueur intense l’éblouit, quelque chose le frappa rudement au front, et il tomba tout de son long sur le sol, où il resta évanoui.
Quand il se réveilla, il se trouva dans un lit d’hôpital. Les portes de la salle étaient grandes ouvertes et à toute minute on apportait des brancards chargés de blessés, dont les gémissements répondaient aux lamentations des infirmiers, plus malheureux, semblait-il, que les moribonds eux-mêmes.
José Mendès sentit une douleur au front. Il y porta sa main droite et toucha un épais bandage. Alors, il se souvint.
– Lola ! Lola ! cria-t-il.
Personne ne fit attention à lui.
– Lola ! ma niña ! ma chérie !…
Ses yeux se gonflèrent de larmes et, tournant la tête à droite et à gauche, il balbutiait :
– Où est-elle ?… Emportée par cette terrible chose de feu, là-haut !…
Et il cria de nouveau :
– Lola ! Lola !
– Silence ! dit un infirmier qui passait.
Parlait-on pour lui ? Peut-être non. Mais, à ce mot, le capitaine comprit que mieux valait se taire, réfléchir, observer et attendre. Il refoula ses larmes, dompta sa douleur, et, après un moment d’inaction, il regarda ses voisins ; l’un râlait, la tête entourée de linges sanglants ; l’autre, assis sur son lit, répondit par un sourire au regard du capitaine. C’était un pâle jeune homme aux cheveux bizarrement roux.
– Qu’est-il arrivé ? demanda l’officier.
– Comment ! vous ne savez pas ?
– Non, j’ai vu dans le ciel une roue de feu, et, comme elle filait vers la montana Pelada, la terre a tremblé et je me suis évanoui…
– Une pierre vous a frappé au front…
– Une pierre, oui, peut-être…
– Moi, j’étais arrivé avec des camarades au coin du paseo de Gracia et de la Gran-Via-Diagonal. Nous sortions de chez des amis, où nous buvions et chantions depuis le dîner. Tout à coup, nous avons vu aussi une roue de feu qui filait, comme vous le dites, vers la montana Pelada… Et voilà que nous avons entendu une espèce de ronflement terrible et… mais vous allez ne pas me croire !…
– Oui ! oui ! parlez !
– Eh bien ! nous avons vu, à cent mètres de nous, tout un pâté de hautes maisons se détacher du sol, s’arracher violemment et monter d’un trait jusqu’à la roue… Ça s’est perdu dans une grande flamme…
– Comme ma fille ! s’écria José Mendès.
– Votre fille était avec vous ?…
– Oui, ma fille Lola et mon valet Francisco… Ils ont été enlevés, dévorés… Ah ! malheur de ma vie !…
– Calmez-vous ! fit le jeune homme assez brusquement. Il ne manque pas de Lola et de Francisco qui ont été enlevés cette nuit, dans Barcelone ! Toujours est-il qu’une grosse pierre m’a frappé aux jambes et, comme vous, je me suis évanoui. Ma blessure est sans gravité, d’ailleurs.
– Des maisons, avez-vous dit ? balbutia José Mendès.
– Oui, des maisons qui ont été aspirées comme des feuilles mortes sur le passage d’un train rapide…
Mais le capitaine eut une nouvelle faiblesse et il retomba inerte sur les oreillers.
Le même jour, à cinq heures du matin, le prodige fut constaté à Christiania, en Norvège, où la roue aspira un tribunal et un couvent, laissant à leur place deux immenses trous de cent mètres au moins de profondeur.
Enfin, à sept heures, ce fut à Astrakan, sur la mer Caspienne, à l’embouchure de la Volga, que la roue infernale enleva un pont comme les machines de nettoyage par le vide enlèvent un fétu de paille.
Le télégraphe et le téléphone répandirent ces nouvelles autour du globe, si bien que le lendemain la plupart des grands journaux des deux parties du monde racontaient ces faits incroyables avec des détails précis.
Le 21 juin, à Bogota, en Colombie, dans un café retentissant du bruit des voix nombreuses et violentes, trois hommes silencieux étaient côte à côte d’un seul côté d’une table isolée dans un coin. Ils lisaient un journal du 19.
C’étaient deux Américains : Arthur Brad et Jonathan Bild, et un Français, Paul de Civrac. À mesure qu’ils lisaient les stupéfiantes nouvelles, ils sentaient grandir tout au fond d’eux-mêmes cette épouvante qui commençait à faire trembler le monde.
Depuis douze jours, ayant voyagé dans l’intérieur, ils n’avaient pas eu un seul journal sous les yeux. Aussi, après avoir lu celui où l’aventure du capitaine espagnol José Mendès était minutieusement relatée, ils passèrent la journée à parcourir toutes les feuilles publiques mises en vente à Bogota. Elles ne leur apprirent rien de nouveau. Toutefois, un magazine illustré, paru la veille, donnait une photographie de la Señorita Lola Mendès, transmise par le télégraphe. La jeune fille était jolie, avec un petit air audacieux très amusant.
Pendant les journées du 19 et du 20, la Roue Fulgurante n’avait fait ni de nouvelles apparitions ni de nouveaux ravages. Consultés par les reporters, les astronomes émettaient l’avis que le phénomène roulait dans les espaces interplanétaires et qu’il ne reviendrait probablement pas dans l’atmosphère terrestre. Les astronomes de Bogota parlèrent de la même manière que ceux des autres observatoires.
Or, à quatre heures de l’après-midi, des crieurs de journaux se répandirent dans les rues de la ville en courant et en hurlant :
– On a revu la Roue Fulgurante à Columbia, dans la Caroline du Sud ! La moitié de la ville est détruite ! Plus de trente mille victimes !
Des camelots brandissaient de petites feuilles rouges, portant imprimées les nouvelles reçues par le télégraphe vingt minutes auparavant. Le public se les arrachait.
Et alors, ce fut dans la ville une teneur sans nom. La Roue Fulgurante allait venir ! Que faire ? Où se cacher ? Des femmes passaient dans la rue par troupes. Elles serraient de petits enfants dans leurs bras et gémissaient longuement. Des hommes se suicidèrent. D’autres couraient avec une valise sur l’épaule. Où allaient-ils ? Un vent de folie bouleversait les cerveaux.
Sur le soir, on envahit la Bourse, où étaient affichés les télégrammes qui arrivaient, par New-York, du monde entier. Une dépêche de Paris annonçait que la Roue avait tracé dans Orléans un énorme fossé, parallèle à la Loire. Un village de la banlieue de Berlin venait d’être anéanti. Le port de Hong-Kong était ravagé. La Roue lumineuse avait happé au passage quarante-trois vaisseaux avec leurs équipages. Tout cela, y compris Columbia, en quatre heures de temps.
Et le problème se posait : une seule Roue, même aussi merveilleuse que celle vue à Barcelone, pouvait-elle, en quatre heures, aller de France en Prusse, puis en Chine, puis en Amérique, ou bien y avait-il autour du globe terrestre plusieurs de ces bolides extraordinaires ?
Et l’on sentait, dans ces dépêches laconiques, l’épouvante qui galopait sur toute la surface de la terre. Nulle défense possible contre la calamité mystérieuse. Comment et avec quoi l’attaquer ?… Et que de questions irritantes, insolubles, par conséquent toutes créatrices d’horreur et de panique ! Qu’était en réalité cette roue lumineuse ? Comment son moyeu, boule noire dans la clarté, ne tournait-il pas avec la roue ? Que contenait cette boule noire ? Des habitants d’une planète ? Saturne peut-être, ou Mars ? Comment étaient-ils ? Et que voulaient-ils ? Se rendaient-ils compte, seulement, du mal qu’ils faisaient à la terre ? De l’horrible guerre sans lutte possible ?
Et l’épouvante folle des hommes grandissait à se chercher des raisons de courage et de sang-froid.
Paul de Civrac, Jonathan Bild et Arthur Brad passèrent la nuit du 21 au 22 à errer dans la ville. À trois heures du matin, ils étaient affamés. Un restaurant vivement éclairé, toutes portes ouvertes, leur apparut. Ils entrèrent. Il était désert, sans les maîtres, sans un valet. Sur une table se trouvait un dîner tout servi auquel personne n’avait touché. Ils s’attablèrent.
Quand la nourriture et le vin les eurent ragaillardis (certainement, ils burent plus que de coutume et leurs idées étaient peu nettes) :
– C’est stupide, dit Jonathan Bild ; nous menons depuis vingt-quatre heures une vie imbécile…
– Juste ! fit Arthur Brad.
– Qu’importe la terreur des autres ? reprit Jonathan. Si les Marsiens, ou les Saturniens, ou les Sélénites…
Paul de Civrac l’interrompit pour remarquer assez naïvement :
– Il doit, en effet, être habité, l’aéronat…
– Dites la roue !
– Appelons la chose la Roue Fulgurante comme tout le monde, voulez-vous ? trancha Jonathan, et, pour plus de commodité, supposons que ce sont des Marsiens…
– Il faudrait d’abord admettre, objecta Brad, que la planète Mars est habitée…
– C’est admis ! s’écria Bild.
Paul acquiesça ; Brad sourit.
– Eh bien ! repartit Bild, si les Marsiens viennent ici, qu’y pouvons-nous ? Le mieux est d’être raisonnables…
– Je suis de votre avis, Jonathan ! dit Paul avec gravité.
– Cependant, risqua Brad, il ne faut pas nous abandonner à la fatalité musulmane. J’ai remarqué que jamais on n’a dit que la Roue Fulgurante ait aspiré l’eau… Rappelez-vous le pont d’Astrakan… le pont seul a sauté, avec toutes ses arches… Pas une goutte de l’eau de la Volga !…
– C’est vrai ! C’est vrai !…
– Alors ! s’écria Brad triomphant, il n’y a de sécurité que sur l’eau…
Et le gros homme alluma une cigarette.
– Où voulez-vous en venir ? fit Bild avec mauvaise humeur.
– Oui ! appuya Civrac, intrigué.
Mais Brad ne répondit tout d’abord que par un irritant sourire énigmatique.
Puis, ayant tiré quatre bouffées de sa cigarette, Arthur Brad répéta :
– Incontestablement, il n’y a de sécurité que sur l’eau. Tandis que tout le monde tremble, descendons le long du Magdalena et embarquons-nous dès qu’il deviendra navigable… À Savanilla, nous fréterons un navire et nous voguerons sur l’Océan, de port en port, jusqu’à ce qu’on n’entende plus parler de ces Saturniens…
– Marsiens ! rectifia Bild.
– Au diable ! Marsiens, Saturniens, Vénusiens, Sélénites… qu’importe ? En vérité, Jonathan…
– Et la roue ?… s’écria Paul, pour empêcher la dispute imminente.
– Si elle vient ? reprit Brad, calmé. Dès que nous la voyons, nous sautons à la mer. Plongeon, nage, plongeon, nage encore… Et, ma foi, c’est bien des chances pour que…
– Adopté ! fit Jonathan, qui frappa la table d’un coup de poing.
Les trois amis paraissaient très excités ; une continuelle envie de rire les secouait.
Ils se levèrent. Comme ils allaient sortir, quatre gaillards déguenillés envahirent la salle ; on les vit faire main basse sur l’argenterie et fracturer la caisse.
– On pille dans Bogota ! fit Brad en riant.
– Et on fusille ! dit Bild.
En effet, des détonations d’armes à feu claquaient, mêlées aux hurlements d’une populace affolée. Quelques maisons flambaient dans les rues où ils passèrent. Un moment, Civrac songea aux valises laissées à l’hôtel. Elles ne contenaient d’ailleurs que du linge, tout l’argent des trois amis étant en lettres de crédit.
« Petite perte ! pensait Paul. Au moins, nous avons les mains libres ; agréable manière de voyager !… »
Il restait un peu en arrière pour allumer une cigarette, puis il rejoignit ses amis, sur l’aspect desquels il ne put s’empêcher de rire ; Jonathan Bild s’enorgueillissait d’être maigre, osseux et long ; Arthur Brad, au contraire, était gras, gros et court.
Ils traversaient une vaste place déserte, à l’extrémité de la ville, lorsque le ciel, où luisaient faiblement des clartés d’aurore, s’éclaira violemment. Paul leva la tête.
– La Roue Fulgurante ! s’écria-t-il.
La terreur dont son corps frissonna rendit à son esprit sa lucidité absolue. Bild et Brad s’arrêtèrent contre lui. Et, les yeux en l’air, ils regardèrent, ahuris.
C’était bien la roue lumineuse à moyeu noir décrite par le capitaine José Mendès. Elle descendit juste au-dessus des trois hommes. Ils se tenaient épaule contre épaule, tremblants… Et, tout à coup, Paul se vit avec horreur soulevé de terre, enlevé dans les airs, attiré… Il perçut vaguement que Bild et Brad étaient aspirés avec lui… Une fulguration l’aveugla, et il perdit connaissance…
CHAPITRE II
DANS LEQUEL UN HOMME MYSTÉRIEUX FAIT DE MYSTÉRIEUSES PROMESSES
Pendant que ces choses stupéfiantes se passaient en Colombie, le monde entier était bouleversé. Surtout en France, où l’esprit public se révolutionne plus facilement qu’en toute autre nation, le peuple s’agitait, poussé par des meneurs pour qui tout est bon à manifestations politiques. Et le gouvernement comprit la nécessité de rassurer l’opinion.
Dans la soirée du 21 juin, le président du Conseil, ministre de l’Intérieur, réunit, en son cabinet de la place Beauvau, une vingtaine de personnages, parmi lesquels on comptait tous les ministres, le général gouverneur militaire de Paris, M. Torpène, préfet de police, l’illustre astronome Constant Brularion et M. le professeur Martial, de l’Académie des sciences. Cette assemblée de sommités politiques, militaires et scientifiques, devait examiner la situation et prendre une décision que ratifierait, le lendemain, le Président de la République.
Après quelques mots émus, d’une imprécision convenable et diplomatique, le ministre de l’Intérieur donna la parole à M. Constant Brularion.
L’astronome, lui, fut succinct et précis.
– Je ne sais rien, nous ne savons rien, personne ne sait rien !… La Roue Fulgurante est un phénomène inconnu jusqu’à ce jour. De quoi se compose cette roue effroyable ? D’où vient-elle ? Où va-t-elle ? Restera-t-elle longtemps dans notre atmosphère ? Si oui, combien de temps ? Sinon, doit-on craindre qu’elle revienne après avoir disparu ?… À ces questions, pas de réponse possible, ni à toutes les autres questions que l’humanité peut se poser au sujet de la Roue Fulgurante…
Il y eut un silence un peu embarrassé.
– Soit ! fit le ministre de la Guerre. Mais si nous ne pouvons pas expliquer la Roue Fulgurante, au moins pouvons-nous la combattre !
– Avec quoi ? répliqua M. Brularion, qui ne put s’empêcher de hausser les épaules. Oui, avec quoi ?
– Les canons…
– Jouets d’enfants, général ! La Roue Fulgurante paraît, ravage et disparaît… Mais elle paraît où ?… quand ?… à quelle hauteur ?… Voilà ce qu’il faudrait savoir d’avance pour pointer vos canons et tirer !…
M. Brularion haussa de nouveau les épaules et, cette fois, avec un irrespect absolu.
La discussion devint alors confuse. Grâce à leurs habitudes de vieux parlementaires, les ministres parlaient volontiers tous à la fois, en exclamations emportées, en interrogations ironiques ou en belles phrases sonores et cadencées, mais, dans la circonstance, vides de sens. M. Martial émit timidement l’hypothèse que la Roue Fulgurante pouvait être une planète minuscule habitée seulement par quelques individus bizarres. C’était probablement ingénieux, mais ça n’empêchait pas la ville d’Orléans d’avoir vu la moitié de ses faubourgs très réellement détruits par les hypothétiques individus de la planète minuscule…
Quand les gosiers furent par trop desséchés et que les ministres jugèrent enfin bon de se taire, M. Torpène, qui n’avait dit mot, leva la main.
– Monsieur le préfet de police a quelque chose à communiquer ? fit assez ironiquement le garde des sceaux, qui n’aimait pas M. Torpène.
– Parlez, mon cher préfet ! s’écria le président du Conseil, ministre de l’Intérieur.
– Messieurs ! dit M. Torpène d’une voix grave et tranquille, un seul homme peut nous donner, avec des explications rationnelles, des moyens efficaces d’agir. Un seul homme sait peut-être ce que signifie, représente et veut dire le mystère de la Roue Fulgurante. Cet homme, le monde entier répète son nom depuis quelques mois ; cet homme, M. Brularion et M. Martial le connaissent parfaitement ; cet homme est à Paris…
– Le docteur Ahmed-bey ! s’écria l’astronome.
– Ahmed-bey ! répéta M. Martial.
– Oui, le docteur Ahmed-bey ! appuya M. Torpène.
Le président du Conseil murmura :
– En effet, je n’y avais pas pensé… Il sait peut-être, lui !…
– Si la chose est dans les limites de l’entendement humain, reprit M. Torpène avec chaleur, si la chose est définissable, Ahmed-bey seul peut la comprendre et la définir… Je vous demande, messieurs, je demande au conseil de me confier la mission d’aller immédiatement consulter le docteur Ahmed-bey et, s’il est possible, de le déterminer à venir parler ici, devant vous…
Le président regarda ses collègues, qui opinèrent gravement du menton.
– Allez donc, mon cher monsieur Torpène, et priez le docteur Ahmed-bey, au nom de la République, de venir dire ici ce qu’il sait, s’il sait quelque chose…
M. Torpène se leva.
Deux minutes après, il sautait dans sa voiture en criant au cocher :
– Chez Ahmed-bey !
Mais qu’était et qui était ce docteur Ahmed-bey, dont la science et la renommée paraissaient immenses autant que son pouvoir devait être redoutable ?
Personnage mystérieux s’il en fut jamais !
Le docteur Ahmed-bey n’habitait Paris que depuis six mois. Tout de suite, il s’était fait connaître comme le plus puissant spirite de son temps. D’où venait-il ? Nul ne le savait. On pouvait seulement constater, à son genre de vie, qu’il était extrêmement riche. Jamais il ne soigna aucun malade, et son titre de docteur, qu’il mettait sur ses cartes, lui était accordé sans qu’on sût d’où il le tenait ou seulement s’il y avait réellement droit.
C’était un homme de quarante ans, de taille élevée, mince, nerveux, au visage émacié, sans barbe ni moustache. Son teint, ses lèvres, la forme de son nez et de toute sa tête décelaient une origine arabe. Mais comme, pas une fois, on ne l’entendit parler de son passé, les curieux devaient s’en tenir aux conjectures, lesquelles n’éclairaient pas les ténèbres du mystère dont s’entourait le docteur Ahmed-bey.
À ses séances de spiritisme, vraiment prodigieuses, et qui se renouvelaient une fois par semaine, avaient bientôt assisté toutes les hautes personnalités scientifiques, littéraires ou politiques en demeure ou de passage à Paris. Quant à M. Torpène, le préfet de police, il était admis dans le cercle des initiés parce qu’il s’intéressait beaucoup, et avec une rare profondeur d’intelligence, aux problèmes spirites et psychiques.
Le docteur Ahmed-bey possédait et habitait un magnifique hôtel en bordure du parc Monceau. En quelques minutes, la voiture du préfet de police arriva devant la grille qui fermait la cour extérieure de l’hôtel. Nuit et jour, deux nègres colossaux veillaient à l’intérieur de la cour. Ils reconnurent le cocher et la voiture, ouvrirent la grille, et M. Torpène s’élança sur le perron.
À sa vue, le valet de garde sous le péristyle s’inclina, puis :
– Monsieur, dit-il, le maître se promène dans le parc… Il me faudra quelques minutes pour le trouver… J’ai l’honneur de prier Monsieur de vouloir bien attendre le maître dans ce salon.
Et le valet ouvrit une porte, tourna un commutateur électrique. Dans un salon vert et or, des lustres brillèrent ; M. Torpène entra.
Trois minutes s’écoulèrent. Le même valet reparut.
– Le maître, dit-il, prie Monsieur de vouloir bien le rejoindre dans le parc…
À cette heure de nuit, le parc Monceau était fermé. Grâce à une autorisation spéciale, le docteur Ahmed-bey pouvait passer de son hôtel dans le parc Monceau, dont il avait, par conséquent, jouissance, seul, depuis minuit jusqu’à sept heures du matin.
M. Torpène trouva le docteur dans l’allée centrale qui va du boulevard Malesherbes à l’avenue Hoche. Il fumait un cigare et se promenait à pas lents, les mains derrière le dos. Les globes électriques du parc étaient éteints, mais la lune brillait en plein ciel et les étoiles scintillaient dans les vastes éclaircies des arbres.
– Bonsoir, mon cher préfet, dit le docteur en tendant la main à M. Torpène.
– Bonsoir, docteur.
Et après avoir serré la main qui lui était présentée, M. Torpène, très ému, ouvrait de nouveau la bouche pour parler ; mais le docteur s’écria :
– Ne prononcez pas d’inutiles paroles !… Je sais pourquoi vous venez !
– Vous savez ?…
– Oui ! Il y a eu conseil des ministres place Beauvau… On y a dit mille sottises au sujet de la Roue Fulgurante…
– C’est exact ! balbutia M. Torpène, stupéfait, mais comment savez-vous ?…
Il y eut un instant de silence. Mais, ne pouvant refréner son impatiente curiosité, le préfet de police répéta :
– Oui, comment savez-vous que les ministres se sont assemblés et qu’ils m’envoient…
– Bah ! jeu d’enfant !… répondit Ahmed-bey.
– Alors, docteur, vous me direz…
– Rien !
– Comment donc ! mais…
– Rien !
Et le docteur, s’arrêtant de marcher, jeta son cigare, se mit brusquement face à face avec M. Torpène, puis, le geste sec :
– Monsieur le préfet de police, je ne sais rien, rien de la Roue Fulgurante… mais je vais savoir autre chose, bientôt… Cela me permettra sûrement d’élucider le mystère et d’éviter à notre globe de nouvelles catastrophes… Il me faut quelques jours… huit… dix… quinze… vingt peut-être !… Quand je saurai, je vous appellerai…
Le docteur se tut un instant et, d’une voix plus grave, il reprit :
– Ce que vous verrez alors sera si extraordinaire, si stupéfiant, si divin, que vous en oublierez même la Roue Fulgurante, monsieur le préfet !…
Il se tut encore, tira un second cigare de sa poche, l’alluma, se remit à marcher en fumant, les mains croisées derrière le dos ; et, d’un ton placide :
– Mon cher monsieur Torpène, officiellement, je n’ai plus rien à vous dire. Mais, si vous vouliez me faire le plaisir de converser avec moi… je ne me coucherai que dans une heure…
M. Torpène connaissait Ahmed-bey. Il savait que le docteur ne prononcerait pas un mot de plus, tant au sujet de la Roue Fulgurante que du mystérieux phénomène promis. Il refoula donc son émotion et sa curiosité pour répondre avec calme :
– Excusez-moi, docteur, si je vous quitte à l’instant. Mais vous devinez l’impatience des ministres et des savants qui m’attendent…
– Allez ! allez ! et souvenez-vous de ce que je vous ai dit…
La déconvenue fut grande, dans le conseil, lorsqu’on eut entendu, de la bouche de M. Torpène, la réponse mystérieuse d’Ahmed-bey. Les ministres recommencèrent à pérorer avec éloquence et confusion, essayant d’étourdir l’épouvante qui les envahissait. M. Martial modifia son hypothèse, M. Brularion haussa les épaules toutes les deux minutes, et M. Torpène se tut.
Enfin, le conseil se mit d’accord sur la note à communiquer aux journaux.
Elle était ainsi conçue :
« Les ministres et quelques personnalités militaires et scientifiques se sont réunis cette nuit, place Beauvau, sous la présidence de M. le ministre de l’Intérieur, président du Conseil. M. Torpène, préfet de police, assistait à la réunion. Après un examen approfondi de la situation créée à la France par la perpétuelle et mystérieuse menace de la Roue Fulgurante, le conseil a décidé de confier à M. le président du Conseil, ministre de l’Intérieur, la rédaction d’une proclamation qui sera lue, aujourd’hui même, par le Président de la République, devant la Chambre des députés et le Sénat, réunis en congrès extraordinaire, et qui sera ensuite affichée dans toutes les communes de France.
« Cette proclamation précédera des mesures pratiques qui seront ordonnées et prises incessamment, sur tout le territoire, avec le concours de l’armée. »
Quand ce beau « communiqué » fut terminé, on en passa des copies aux reporters qui attendaient dans une pièce voisine et qui s’envolèrent aussitôt vers leurs journaux respectifs.
Puis, se congratulant, mais non sans une sourde et atroce inquiétude, non sans quelque honte devant leur impuissance absolue, les membres du conseil extraordinaire se séparèrent.
Les chronomètres marquaient trois heures quarante-sept minutes du matin.
Or, exactement à la même minute, aux deux tiers des antipodes de la place Beauvau, en Colombie, la Roue Fulgurante enlevait comme trois fétus les trois humains dénommés Paul de Civrac, Arthur Brad et Jonathan Bild, de la même manière qu’à Barcelone avaient été enlevés la belle Lola Mendès et son valet Francisco.
CHAPITRE III
OÙ LA ROUE FULGURANTE LIVRE QUELQUES-UNS DE SES SECRETS
Paul de Civrac n’a jamais pu savoir combien de temps avait duré son insensibilité. Quand il reprit conscience de lui-même, son premier acte fut, avant toute réflexion, d’ouvrir les yeux. Mais il les referma brusquement, ébloui.
Il resta ensuite quelques minutes les paupières closes, tâchant de se rendre compte de sa position. Il lui fut impossible de remuer ni tête, ni bras, ni jambes. Il était collé de tout son corps contre une surface plane, les jambes droites, les bras écartés : il sentait sa nuque, ses mains, son dos, ses cuisses, ses jambes et ses talons indissolublement adhérents à une molle matière froide. Sa joue gauche était fouettée par un vent violent et continu. Ses oreilles retentissaient d’un vrombissement énorme. À travers ses paupières fermées, il voyait une uniforme teinte rose, comme quand on tourne son visage et ses yeux clos vers le ciel de midi.
Mais le sang lui battait les oreilles et il éprouvait, à respirer, une difficulté angoissante. Il lui semblait qu’il manquait d’air. Son souffle était dur et court : il haletait, d’ailleurs sans aucun bruit dans la gorge ou dans le nez.
Il ouvrit la bouche, il poussa un cri. Deux autres cris, l’un à droite, l’autre au-dessus de lui, lui répondirent.
– Arthur ! Jonathan ! s’écria-t-il.
– Paul ! Paul !
Bild et Brad vivaient. Mais il fut surpris d’entendre leurs voix et la sienne comme des sons extrêmement lointains et menus, ainsi que cela se produit dans une atmosphère raréfiée. Et cette oppression continuelle dans les poumons !…
« Parbleu ! pensa-t-il, nous sommes hors de la couche d’air respirable qui enveloppe la terre… Si nous continuons à nous en éloigner, c’est la mort…
Alors, doucement, doucement, il ouvrit les yeux, petit à petit, afin de les habituer progressivement à l’éclatante lumière qui les avait d’abord aveuglés. Il mit un quart d’heure à pouvoir seulement les garder à demi-clignés. Or, il ne voyait devant lui que l’immensité du ciel, mais d’un ciel extraordinairement lumineux. Il allait prendre la détermination de faire tourner ses pupilles dans l’orbite, de manière à voir le plus possible autour de lui, lorsqu’il sentit qu’il s’enfonçait lentement dans la matière à la surface de laquelle il était collé.
– Paul ! Paul ! crièrent ensemble les voix invraisemblablement menues de Bild et de Brad.
– Arthur ! Jonathan !
Il finissait à peine cet appel désespéré lorsque la matière sur laquelle il était étendu se déroba sous lui… Il tomba… Des corps humains dévalèrent contre son corps et il se trouva tout à coup assis dans les ténèbres.
Quelque chose meurtrissait son flanc ; de ses mains devenues libres, il tâtait :
C’était un pied humain chaussé d’une grosse botte.
– Paul ! fit une voix à sa gauche.
– Paul ! fit une autre voix derrière lui.
– Jonathan ! Arthur ! s’écria-t-il, vous êtes là ?
– Oui…
– Oui…
– Blessés ?
– Non ; et vous ?
– Moi non plus…
– Je respire difficilement…
– Moi aussi…
– Moi aussi ! Nous sommes dans un air raréfié… C’est douloureux, là, aux poumons…
– Et nos voix ? Remarquez-vous nos voix ?…
En effet, elles étaient de son bizarre, ténu, lointain, si bien qu’ils devaient crier pour n’entendre que quelque chose de chevrotant et d’indécis…
– C’est la raréfaction de l’air… répéta Paul.
– Oui, évidemment…
– Mais, pour Dieu ! où sommes-nous ? fit la voix, fine comme celle d’une petite fille, du grand Jonathan Bild.
– Oui, où sommes-nous ? insista Brad.
– Je ne sais pas, répondit Paul.
Il y eut un moment de silence. Soudain, Bild trancha nettement :
– Nous sommes dans le moyeu de la roue martienne.
– Ou saturnienne ! fit Arthur.
– Avez-vous des allumettes ?… Sapristi, que ma respiration est dure et saccadée !… Est-ce que nous ne finirons pas par nous y habituer, si ça dure ?…
– Oui, certainement, après quelques heures…
Un court silence… deux craquements… une clarté… Paul se retourna vivement, et les visages ahuris de ses compagnons se montrèrent à lui. Bild et Brad tenaient chacun une allumette enflammée. Mais les deux petites flammes étaient pâles, minuscules, sans pouvoir éclairant, et la mince mèche suiffée charbonnait vite… Ils se regardèrent tous les trois sans prononcer un mot. Les allumettes s’éteignirent ensemble.
– Attendez ! dit Paul aussitôt, j’ai mon fusil électrique.
Il tira de sa poche un appareil en forme de porte-cigare. Il pressa un bouton : une petite poire de verre jaillit, brillante… Et il se leva brusquement. Mais, à sa grande stupéfaction, l’effort très normal qu’il donna pour se lever le fit sauter en l’air.
– Où sommes-nous ? répéta Jonathan Bild.
Il se mit debout en même temps qu’Arthur Brad, et Paul les vit bondir tous les deux à un mètre au-dessus de la surface sur laquelle ils étaient d’abord assis. Ils retombèrent sur leurs pieds. Et Paul remarqua que leurs pieds, comme les siens, enfonçaient un peu dans la matière sur laquelle ils étaient posés, comme les pattes d’un oiseau léger enfonceraient dans un édredon.
Leurs faces glabres étaient pâles : les yeux bleus d’Arthur papillonnaient, les yeux noirs de Jonathan étincelaient d’un éclat extraordinaire ; leurs mains tremblaient. Paul fit un pas vers eux, mais ce mouvement le lança d’un coup violent contre le ventre d’Arthur Brad.
– Ah ! mais, dites donc, Paul…
– J’ai compris ! s’écria Paul, ne vous fâchez pas… L’air est raréfié ici… C’est une autre atmosphère que celle de la terre… la densité aussi et la pesanteur sont différentes, comprenez-vous ?… Songez que, d’après les calculs les plus sûrs, un kilogramme terrestre transporté à la surface de Mars ne pèserait plus que trois cent soixante-seize grammes !…
– Trois fois moins !
– Oui !… Eh bien ! c’est à peu près pareil ici… Nous pesons beaucoup moins que sur la terre… et comme nos muscles développent la même force, vous comprenez !…
– Oui… la force musculaire développée pour faire un pas…
– Nous fait faire un bond immense… parfaitement ! Il faudra mesurer nos efforts… éduquer nos muscles…
Paul était orgueilleux de se constater le plus calme des trois. Il eut conscience que la possession du fanal électrique, son sang-froid et sa science spéciale le rendaient le chef de leur petit groupe humain. Et désormais il devait penser, parler et agir comme un chef…
Il est vrai, il se sentait extraordinairement surexcité. Il ne doutait pas que cette excitation qu’il voyait aussi sur les visages de Bild et de Brad ne fût encore causée par l’air ambiant, certainement beaucoup plus riche en oxygène que l’atmosphère terrestre.
– Nous nous y habituerons…
Il lui semblait, en effet, que déjà sa respiration, quoique toujours aussi courte et rude, était moins difficile et presque pas douloureuse. L’assimilation à ce milieu étrange, dans lequel ils devaient vivre longtemps, commençait donc pour eux.
– Ah çà ! voyons ! s’écria Bild, nous direz-vous où nous sommes ?…
– Parbleu ! répondit Paul violemment.
Et, mesurant ses gestes avec circonspection, levant haut la main armée du fanal, il se mit à tout examiner autour d’eux…
L’exploration fut courte. Ils étaient à l’intérieur d’une chambre de forme bizarre. Imaginez une boîte polyèdre à vingt faces, de cinq mètres environ de hauteur ; mettez-vous, à l’intérieur, debout sur une des faces triangulaires, et vous aurez une idée de l’aspect que présentait à leurs yeux leur prison. Car c’était bien une prison. Nulle porte, ni fenêtre, ni ouverture quelconque ne se voyait ; les parois étaient lisses, mais la chose la plus étonnante était la matière dont étaient faites ces parois. On ne peut mieux la dépeindre qu’en la comparant à du brouillard très dense, très épais, de couleur gris sombre : des murs de nuage dense !… Par où avaient-ils été précipités dans cette cellule géométrique ? Mystère.
De la crosse de son revolver, Paul frappa sur les parois qu’il pouvait atteindre. Son revolver et son bras enfonçaient là dedans sans bruit.
Soudain, comme une éclaircie se fait dans un nuage, devant eux s’ouvrit une vaste ouverture par où entra un flot de lumière verte…
Instinctivement, sans une seconde d’hésitation, les trois amis bondirent ensemble par cette ouverture. Mais ils n’avaient pas pensé aux nouvelles conditions de la pesanteur. Leur élan démesuré les emporta très loin et, au lieu de faire quelques pas hors de la cellule, ils restèrent une demi-minute suspendus dans l’air, glissant vers une sorte de dôme gris dans lequel ils furent jetés. Ils pénétrèrent dans un milieu obscur et suffocant qui les rejeta aussitôt comme ferait un sommier élastique. Ils roulèrent pêle-mêle les uns sur les autres, contusionnés, mais sans grand mal. Quand ils se relevèrent, ce fut juste à temps pour voir l’ouverture qu’ils avaient franchie se refermer…
Paul se croyait victime du songe le plus fantastique, et il essuyait d’une main froide son front en sueur, il se frottait les yeux. Mais il avait le revolver dans sa main, et le froid de l’acier passait de sa main dans tout son corps.
Alors, il comprit qu’il était bien éveillé, qu’il vivait dans la réalité, non dans le songe.
Il se sentit une âme toute simple et nue et faible de petit enfant, une âme obéissante et docile, mais follement curieuse. Il s’assit sur ce bizarre parquet qui semblait fait de nuage dense et opaque ; il lui parut qu’il s’étendait sur un divan moelleux. Sa main, lancée avec force, pénétrait dans la matière nuageuse, et il percevait une molle résistance… Bild et Brad s’assirent devant lui.
– Paul, dit Bild, que diable est tout cela ?
– Je ne sais pas… nous observerons… nous réfléchirons…
– On finira par trouver… dit Brad.
La « pièce » dans laquelle ils étaient représentait l’intérieur d’un immense polyèdre ; les faces étaient si nombreuses qu’elle paraissait ronde.
Une lueur verte, diffuse, les éclairait, venant d’où ?… Cette lumière semblait émaner de la matière elle-même qui composait le mur sphérique de leur étrange demeure… demeure absolument vide, d’ailleurs…
– Évidemment, dit Paul, nous sommes dans un nuage…
Mais cela présentait une association d’idées tellement folles qu’il se tut… Il y eut un long silence…
– Je veux être électrocuté, commença Jonathan Bild tout à coup, je veux être électrocuté si…
Mais il se tut, et Brad ricana :
– Jonathan, mon vieux, que tu le veuilles ou non, c’est le commencement d’une électrocution inimaginable… Ces Saturniens… que nous…
– Marsiens ! hurla Bild, furieux.
– Allons, calmez-vous, Arthur ! Jonathan ! cria Paul.
Mais la ténuité de sa voix qu’il avait voulu enfler et faire énergique et vibrante, cette ténuité ridicule le surprit encore et l’arrêta net. Ses deux amis lui semblaient un peu affolés… Il voulait leur montrer combien il était calme et fort, et il se leva pour marcher.
Cette fois, il pensa à la pesanteur presque nulle et il fit des mouvements d’une douceur et d’une prudence extrêmes. Il constata d’ailleurs avec plaisir qu’il respirait de plus en plus aisément, bien que toujours d’un souffle court et inaccoutumé. Malgré l’immensité de la pièce, la déclivité de ses parois polygonales était des plus sensibles. (Représentez-vous bien l’intérieur d’une sphère polyèdre, si les mathématiciens veulent me permettre cette alliance de mots inusités, mais qui fait image.) Or, en marchant, il sentait que son corps, sans cesser d’être perpendiculaire à la surface molle que touchaient ses pieds, restait droit dans le sens des rayons d’une circonférence. Et, marchant toujours, ébahi mais déterminé, Paul se vit bientôt au-dessus de Bild et de Brad, la tête en bas, les pieds contre le « plafond ». Il marcha encore. Il fit ainsi le tour de la salle, comme une fourmi le ferait dans un boulet creux, et il redescendit, devant Bild et Brad stupéfiés, par le côté opposé à sa direction de départ.
Après un long moment de silence et de réflexion, il dit :
– Bien d’autres phénomènes nous surprendront sans doute, dans le monde saturnien…
– Marsien ! fit l’obstiné Jonathan.
– Mais enfin, cria Brad, pourquoi voulez-vous donc tant que nous soyons ici chez un succédané de la planète Mars ?
– Et vous, Brad, pourquoi donc, avec Paul, tenez-vous à ce que la planète Saturne soit pour quelque chose dans notre aventure ?
– Parce que c’est mon idée ! répliqua Brad sèchement.
– Non, ce n’est pas cela, dit Paul avec autorité. Je pense, moi, que la Roue Fulgurante, dans le moyeu de laquelle, selon toute probabilité, nous sommes miraculeusement enfermés…
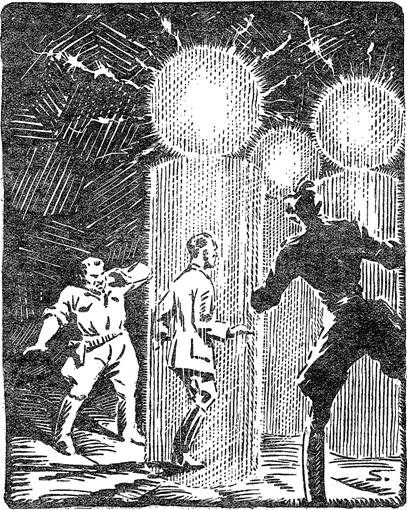
– Miraculeusement, c’est le mot ! interrompit Bild.
– Eh bien ! la Roue Fulgurante vient de la planète Saturne, parce qu’elle en a la forme exacte.
– Oui, Saturne et son anneau ! cria Brad.
– Ça n’est pas une preuve ! fit Bild.
– C’est une probabilité…
– Insuffisante !
– Eh bien ! soit ! s’écria Paul, décidé à tout concilier, nous saurons plus tard si Saturne ou si Mars… Qu’est-ce que cela peut nous faire ?
– Juste ! firent Arthur et Jonathan.
– Qu’il soit marsien ou saturnien ou sélénite, ou même jupitérien… dans ce lieu, les lois de l’attraction, de l’équilibre et de la pesanteur, telles que nous les avons sur la terre, n’existent pas. La matière saturnienne – prenons ce mot provisoirement, voulez-vous ? – la matière saturnienne dont est faite cette paroi polygonale et sphérique exerce une attraction qui lui est propre, puisque j’ai marché là-bas et là-haut sans tomber, et ma tête se trouvant toujours dans la direction du centre de la circonférence ; comme dans le monde terrestre, planétaire et solaire, cette attraction vient de la circonférence !…
– C’est étrange ! fit Bild.
– Je ne vois pas d’autre explication, dit Brad… Essayons, Jonathan !
Ils le levaient et déjà ils se mettaient en marche, lorsqu’un long sifflement perçant déchira les oreilles de Paul. Il eut la sensation de la présence mystérieuse d’un autre être qu’eux. Il mit sa main droite sur l’épaule gauche de Bild, sa main gauche sur l’épaule droite de Brad, et il murmura instinctivement :
– Les Saturniens !
Devant eux, une partie de la paroi s’évanouit comme une épaisse fumée s’ouvre devant un puissant jeu d’eau, et ils virent…
Par l’ouverture subitement ménagée, une colonne lumineuse d’un vert intense entra, puis une autre, puis une troisième… Elles étaient hautes comme un homme de grande taille et, au sommet de chacune d’elles, flottait un globe de lumière blanche, pâle, fantomatique, d’où jaillissaient à tout instant de courtes étincelles crépitantes. Trois têtes de feu opaque au-dessus de la transparence élancée des trois colonnes vertes !…
Tandis que ces apparitions singulières, maintenant rangées en une ligne de front, glissaient devant eux, Paul reculait, tremblant et glacé de peur, et il avait la sensation vague que Bild et Brad reculaient en même temps que lui…
Mais les colonnes s’arrêtèrent, et de chacune d’elles, alternativement, jaillirent des faisceaux d’étincelles avec des crépitements cadencés…
Puis elles se glissèrent de nouveau en avant. Ils les virent – comment exprimer ces choses indicibles ? – ils virent les colonnes les entourer comme un brouillard entoure un arbre, sans les cacher, et ils perçurent que sur leurs têtes ils posaient les trois globes de feu pâle !…
Des faisceaux de longues étincelles jaillirent des globes lumineux avec de rapides crépitements. Puis un long sifflement aigu retentit… Les globes réapparurent devant leurs yeux au sommet des vertes colonnes transparentes et glissèrent vers le point de la paroi d’où ils avaient d’abord surgi.
Pendant que les colonnes vertes se dégageaient des trois amis, Paul était parvenu peu à peu à chasser sa terreur instinctive. Il ouvrit la bouche pour parler ; aucun son ne sortit de sa gorge encore contractée… Il put du moins lever le bras droit, en un geste irréfléchi ; mais, de leur glissement régulier et lent, les colonnes vertes porteuses de globes lumineux reculèrent, s’enfoncèrent, disparurent, et, tout aussitôt, la paroi opaque et nuageuse fut telle qu’elle était auparavant, lisse et nette, sans solution de continuité.
– Paul ! dit Jonathan, n’ai-je pas rêvé ? Est-ce que je ne suis pas fou ? J’ai vu des colonnes de lumière verte, trois…
– Moi aussi, trois ! fit Arthur Brad d’une voix imperceptible.
– Et trois boules de feu blanc…
– De feu blanc, en effet, qui lançaient des étincelles crépitantes…
– Et cela s’est placé sur nos têtes, autour de nos jambes…
– Oui, tout autour de nous trois… Hein ! Paul !…
Paul se tourna vers ses compagnons. Ils étaient livides et leurs yeux brillaient étrangement dans leurs faces exsangues ; leurs lèvres pâles tremblaient…
Sans doute, Paul était-il semblable à eux… Mais il avait conscience de son absolue présence d’esprit, de la possession indiscutable de sa raison. Il n’était pas fou, ni halluciné. Il avait vu, ils avaient vu comme lui : donc, c’était vrai. Les trois colonnes vertes portant les globes de feu pâle existaient, venaient d’exister là, d’agir, oui, d’agir, tout à l’instant…
– Jonathan ! Arthur !… comme vous, j’ai vu… Vous n’êtes pas fous !… Nous sommes dans un monde étrange…
– Avez-vous remarqué que ces colonnes et ces globes de feu n’émettaient ni chaleur, ni lumière rayonnante ?
– Oui, en effet, rien que des étincelles !…
– Mais qu’est-ce que ça peut être ? balbutia Bild.
– Je ne sais pas… ces globes lumineux… on pense à des têtes… et les étincelles crépitantes jaillissaient…
– Oui, jaillissaient, c’est ça !… comme des paroles ou des regards…
– Ah ! des pensées, des volontés matérialisées, agissantes… j’y suis !…
– Parbleu !… l’être pensant concentré, devenu pur fluide…
– Mais c’est inconcevable ! s’écria Brad.
Ce mot venait d’être prononcé, lorsque Paul entendit à sa droite un bruit qui éveilla immédiatement dans son esprit le souvenir des froissements d’un jupon de soie. Il se retourna brusquement et vit, en même temps que la paroi trouée se refermait, une pâle et belle jeune fille debout près d’un homme qui saluait !…
Cette fois, il douta de ses yeux. Il avançait vers la nouvelle apparition, lorsqu’un éclair de mémoire illumina son esprit.
– Ah ! s’écria-t-il. Lola Mendès !…
Et, après les trois colonnes au globe de feu, cela était d’un contraste si fou qu’il éclata de rire. Derrière lui, il entendit les rires nerveux de Bild et de Brad – et ils répétaient entre deux spasmes :
– Ah ! ah ! Lola ! Lola Mendès !…
C’était, en effet, la jeune Espagnole qu’ils avaient devant eux.
CHAPITRE IV
OÙ LES DOUCEURS DE L’AMOUR ET LES DOULEURS DE LA FAIM COMMENCENT ENSEMBLE
À la vue de Lola et de Francisco, ce fut donc, chez les trois hommes, un accès de réelle démence. Il dura peu.
Quand Paul fut fatigué de rire, sa raison lui revint, et il prit soudain la résolution ferme de tout accepter, même les événements les plus illogiquement invraisemblables, comme choses simples et naturelles.
En un clin d’œil, il eut observé la jeune fille et son valet.
Svelte et nerveuse, mais sans maigreur, d’une taille plus élevée que la moyenne, Lola Mendès était vêtue d’un corsage et d’une jupe de drap rouge. Ses mains avaient, comme ses pieds, une élégante finesse. Son cou nu, de forme pleine et de peau fine, était délicatement brun et supportait avec grâce une tête un peu ovale casquée d’admirables cheveux noirs, aux joues d’un blanc mat, au nez droit et fier et les narines bien ouvertes, au front étroit, sous lequel de grands yeux bruns étincelaient entre des cils merveilleusement longs et serrés. Les lèvres étaient d’un rouge vif, un peu épaisses, nettement dessinées. Énergique et langoureuse à la fois, la beauté de Lola Mendès était impressionnante.

À la fois intelligente et ahurie, la laideur du valet Francisco était grotesque.
Plus maigre et plus long que Jonathan Bild lui-même, le gaillard avait des jambes torses, des mains énormes, et il était un peu bossu. Quatre poils de moustache se hérissaient sous son nez de don Quichotte, les pommettes de son visage parcheminé étaient immenses et son crâne chauve luisait comme un œuf d’autruche en plein soleil. Mais, sous des sourcils énormes, brillaient des yeux noirs, très enfoncés dans l’orbite et pétillants d’esprit.
Il se tenait courbé, le poing gauche sur la hanche, la main droite remuant loin du corps un chapeau melon de couleur jaune et les deux pieds unis militairement à côté d’une valise de voyage protégée par un fourreau de drap gris.
Tandis que le valet saluait, la jeune maîtresse regardait, interdite et silencieuse, en une pose des plus embarrassées. Paul sentit la nécessité de parler. Il avait recouvré toute sa vigueur d’esprit et son sang-froid, car la présence dans la Roue Fulgurante de deux êtres humains avait causé dans son organisme et aussi, il le sentait, chez Bild et Brad, une salutaire réaction.
Puis, la beauté de Lola Mendès l’émouvait et lui donnait en même temps l’ardent désir de se montrer valeureux.
– Mademoiselle, dit-il en s’inclinant, vous êtes surprise de m’avoir entendu prononcer votre nom et celui de votre domestique. C’est que votre aventure a été racontée par le capitaine Mendès…
– Mon père vit ? s’écria la jeune fille, dont les joues s’empourprèrent.
– Il vit ; du moins, les journaux terrestres d’hier, 21 juin, l’affirment. Ces journaux nous ont tout appris. Nous les avons lus quelques heures avant d’être enlevés comme vous l’avez été…
– Bien dit, Paul ! firent ensemble Jonathan Bild et Arthur Brad.
– Mademoiselle, continua-t-il, nous sommes maintenant heureux de nous trouver dans cette Roue Fulgurante, puisque vous y êtes… Nous vous serons utiles, peut-être…
– Agissez correctement, Paul ! dit Jonathan. Faites les présentations.
– Faites-les, Paul ! appuya Brad.
Paul se tourna à gauche et attira par le bras son maigre et long compagnon.
– Jonathan Bild, officier de la marine des États-Unis…
Il se tourna à droite et vit que son compagnon gras et court s’était avancé.
– Arthur Brad, professeur d’histoire naturelle à l’université de Boston.
Et, se désignant lui-même en s’inclinant très bas :
– Paul de Civrac, correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres de Paris, lieutenant de l’infanterie coloniale…
Il se releva et ajouta :
– Chargés tous les trois, par les gouvernements américain et français réunis, d’une mission scientifique aux fouilles de Neiva, en Colombie, nous étions de passage à Bogota, lorsque nous avons été enlevés par la Roue Fulgurante.
Paul de Civrac, de taille moyenne, avait environ trente ans ; ses deux amis devaient en avoir deux ou trois de plus. Tandis que par son visage ovale et fin, ses moustaches blondes, ses cheveux noirs, ses yeux bruns et par l’expression de toute sa personne aristocratique et nerveuse, Paul de Civrac se révélait Français de pure race, ses deux amis, Jonathan Bild et Arthur Brad (le premier très grand et très maigre, aux yeux sombres, au visage glabre et sec, aux cheveux châtains en coup de vent ; le second, petit et gros, sans moustache, mais avec une barbiche, les cheveux roux coupés court et les yeux bleus), représentaient les deux types du véritable Américain.
Et les trois amis, si dissemblables physiquement, mais égaux par l’intelligence, le cœur et le courage, se tenaient debout et un peu inclinés devant la jeune fille.
Depuis son exclamation filiale, l’Espagnole n’avait pas prononcé un mot, ni fait un geste. Immenses dans son visage redevenu pâle, ses yeux noirs regardaient avec une expression qui passait peu à peu de la stupéfaction à la confiance. Mais son valet semblait moins ému. Pendant que Paul parlait, il s’était confondu en révérences comiques. Et dès que le jeune homme eut fini, ce fut lui qui répondit, d’une voix de crécelle rendue plus bizarre encore par la ténuité de l’air :
– Señores, soyez les bienvenus dans cette machine du diable ! Moi, je m’y suis fait… et tant que les provisions dureront… (Le drôle jeta un coup d’œil à sa valise.) On voit ici des choses à faire invoquer cent fois par jour le nom de la bienheureuse et secourable Virgen del Pilar !… Mais il y a peu de danger, puisque nous vivons encore… Malheureusement, la Señorita se désole, se lamente, reste triste, effarée…
Il s’approcha de Paul et, mettant une main en cornet autour de sa bouche, ce drôle de Scapin castillan lui dit à l’oreille :
– Entre nous, Señor, j’avais peur que la Señorita devînt folle !… Vous comprenez, cet enlèvement peu commun, les colonnes de lumière verte, les boules de feu… Mais peut-être en avez-vous déjà vu… Oui ?… Bon, alors !… Maintenant, je suis tranquille… la Señorita… eh ! oui, puisque vous êtes là, trois galants caballeros, des hommes en chair et en os, des chrétiens tout comme son père et moi…
Mais il s’interrompit net. La jeune fille avait fait un pas léger en avant et mis sa jolie main sur l’épaule du domestique, qu’elle repoussa doucement en arrière.
– Assez, Francisco, dit-elle d’un ton de commandement.
Et s’adressant à Paul, tandis que ses beaux yeux se mouillaient de larmes et que son admirable gorge palpitait :
– Monsieur, excusez mon émotion… Depuis si longtemps que je suis là, – deux jours, d’après la date que vous avez dite, – je me sentais peu à peu devenir folle… Et quand je vous ai vus, je n’ai pu en croire mes yeux… Maintenant, j’ai toute ma raison… J’accepte votre secours. Vous m’expliquerez… Il y a ici tant de choses étranges et si effrayantes… Mais mon père est vivant, avez-vous dit ?
– Oui, Mademoiselle.
Paul lui rapporta brièvement tout ce qu’il avait lu dans les journaux.
De peur de passer pour fou, il ne raconta pas qu’il avait vu, un an auparavant, le visage de Lola dans une coupe de cristal remplie d’eau. Il se jura même de ne jamais révéler ce fait magique. Mais il se rappela dès lors Ahmed-bey avec un frisson d’épouvante et d’admiration. Tandis qu’il parlait, il se demanda mentalement pourquoi il n’avait pas aussi reconnu Lola en voyant, sur les journaux de Bogota, le portrait de la jeune fille enlevée par la Roue Fulgurante. Il pensa que peut-être ce portrait était mal fait ou sans aucune authenticité.
Et, tout en suivant ces pensées à son esprit, il parlait à haute voix à Lola Mendès. Enfin, il se tut.
– Ainsi, conclut-elle, nous serions dans une espèce de ballon venu de la planète Saturne ?…
– Oui, Mademoiselle, probablement…
– À moins qu’il ne vienne de la planète Mars ! dit l’incorrigible Bild.
Paul haussa les épaules. Et, se mettant très à l’aise en l’exorbitante situation, il agit dans la vaste et bizarre pièce polyédrique comme il aurait agi dans son cabinet de travail.
– Veuillez vous asseoir, Mademoiselle. Tout siège manque, mais le sol de cette salle est si moelleux…
Elle s’assit devant lui, tandis que Bild et Brad se laissaient tomber à leurs côtés et que Francisco se mettait un peu à l’écart.
Les conjonctures étaient si extravagantes que, malgré sa peine et ses inquiétudes, Lola Mendès ne put s’empêcher de sourire. Bild et Brad l’imitèrent. Paul en fit autant. Mais Francisco, moins discret, s’écria :
– Ah ! ah ! voilà qui me donne de quoi m’amuser toute ma vie si…
Un regard de sa jeune maîtresse lui coupa la parole.
Il y eut un moment de silence, pendant lequel Lola Mendès observa les trois amis, tandis qu’ils l’observaient eux-mêmes. Mais, la première, elle parla :
– Où pouvons-nous être, maintenant ?
– Par rapport à la terre ?
– Oui.
– Difficile à conjecturer, dit Brad.
– Impossible, fit Bild.
– Mais, Mademoiselle, demanda Paul, où étiez-vous avant d’entrer ici ?…
– Dans une autre salle, ronde comme celle-ci, mais plus petite.
– Vous étiez venue ici ?… fit Bild.
– Oui, deux fois…
– Comment ? dit Brad.
– Chaque fois qu’un trou s’est ouvert devant nous, expliqua Francisco qui, décidément, voulait se mêler à la conversation, nous sommes passés. La première fois, c’était de la petite chambre ronde dans celle-ci ; la seconde fois, de celle-ci dans une petite chambre ronde… et pareillement dans la suite…
– C’est à notre première venue dans cette grande salle, continua Lola, que nous avons vu des colonnes de feu et des boules avec de petits éclairs… J’ai failli mourir de peur… mais je n’ai eu aucun mal…
– Nous avons vu aussi ! fit Bild.
– Ce sont les Saturniens, probablement, risqua Brad.
Lola ouvrit de grands yeux étonnés.
– Oui, dit Paul à son tour. Nous pensons que ces colonnes sont une matière lumineuse spéciale supportant de purs esprits… des intelligences presque parfaites… des cerveaux, si vous voulez, des cerveaux arrivés à une perfection telle qu’aucun organe ne leur est utile et qu’ils se présentent sous forme de globes de feu… comme certaines apparitions constatées, sur la terre, par les spirites…
– Des âmes, alors ?… balbutia Lola Mendès.
– Oui, des âmes, c’est cela ! s’écria Francisco avec enthousiasme. Ces Saturniens, ou ces Marsiens, seraient des âmes, de pures âmes sans corps…
Mais Paul reprit avec plus de force :
– C’est justement pour cela que je crois à des Saturniens plutôt qu’à des Marsiens. En effet, d’après ce que l’on sait de la planète Saturne, dont les caractéristiques sont les contraires de celles de Mars, la légèreté spécifique des substances et la densité de l’atmosphère y sont telles que les Saturniens sont forcément incapables de demeurer sur le sol… Ils ne peuvent être que des êtres aérostatiques flottant dans l’atmosphère, au-dessus des épaisses et lourdes nuées qui recouvrent leur globe annelé… Et les parois de cette salle, des autres, sont constituées par la nue assemblée, dense, à laquelle les Saturniens donnent la forme qui leur plaît… Et cette nue, cette vapeur nous supportent parce que nous sommes, ici, d’une inconcevable légèreté qui ne pèse rien à la densité de ces vapeurs… Pensez à une fourmi sur un édredon !… Quel monde !… Nos astronomes eux-mêmes, pourtant si rationnels, affirment que, vu les conditions physiques et physiologiques de leur planète, les Saturniens ont des corps d’une impondérable légèreté, transparents, volant sans ailes dans le ciel… sans besoins matériels d’aucune sorte… Élargissez un peu cette conception encore bien humaine ! Et les colonnes de lumière verte et les globes de feu justifient admirablement les timides hypothèses de nos astronomes ! De purs esprits sous forme de lumière… Quel monde !…
– Et leur volonté, pour s’exécuter, dit Arthur Brad, n’aurait besoin que d’être, d’exister… Ces volontés, ce sont les étincelles crépitantes… Par leur force mystérieuse, elles ouvrent, à distance, les parois de cette salle : elles peuvent en modifier les formes…
Ces probabilités étaient si hautement émouvantes que le silence retomba entre eux.
– Mais comment avons-nous été enlevés ? demanda tout à coup la jeune fille.
Paul avait réfléchi à cela ; il répondit :
– La Roue Fulgurante doit avoir besoin de matières pour entretenir son activité radiante. Sans doute, à des moments voulus par les Saturniens, possède-t-elle une force attractive considérable… Ceci explique l’enlèvement des maisons, des terrains, à certains points de son passage… On sait que le mouvement, brusquement interrompu, se transforme en chaleur… C’est une loi physique… les maisons, les rochers, les terres, happés par la roue, prennent feu à son contact, l’alimentent de combustible, de calorique…
– C’est ingénieux ! fit Bild.
– Ce doit être juste ! fit Brad.
– Oui, mais ça n’explique pas pourquoi nous n’avons pas été anéantis comme les maisons du paseo de Gracia, ricana Francisco…
– Peut-être les Saturniens ont-ils calculé et dirigé l’attraction de leur machine de telle sorte que nous ayons été attirés, de biais, sur le moyeu noir de la roue et non sur la roue de lumière…
– Cependant, dit Bild en hésitant, je me demande pourquoi les Saturniens, puisque Saturniens il y a, ont besoin de cette Roue Fulgurante à moyeu habitable ! S’ils sont de purs esprits, comment ne peuvent-ils pas voyager librement dans les espaces interplanétaires sans cette machine bizarre ?…
– Oui, fit Brad, comme la lumière, comme le son, ils pourraient aller…
– En effet, mais sans doute le vide interplanétaire et les atmosphères autres que celle de leur planète d’origine, Saturne, ne conviennent-ils pas à l’existence des Saturniens…
– Ils peuvent donc mourir ? fit Francisco.
– Pourquoi pas ?
– Allons donc ! une âme ne meurt pas !…
– Qu’en savons-nous ? Puis une intelligence, un esprit, n’est pas une âme… Une intelligence, un esprit, un Saturnien, par conséquent, peut mourir.
Il y eut un instant de silence et, tout à coup, Paul de Civrac s’écria :
– Ah ! si nous avions avec nous le docteur Ahmed-bey !
– Ahmed-bey ? fit Jonathan Bild. Qu’est ce personnage qui vaut la peine d’être regretté dans la situation où nous sommes ?
– Ma foi ! risqua Francisco, moi, je regrette tous les habitants de la terre ! S’ils étaient ici, nous ferions la conquête des astres, de Saturne, pour…
– Francisco ! interrompit sévèrement Lola.
– Qui est Ahmed-bey ? demanda Brad avec placidité.
– Un étrange savant, répondit Paul, que j’ai connu à Calcutta, au cours d’un voyage dans l’Inde… Ahmed-bey savait bien des choses… On disait, à Calcutta, qu’il possédait tous les secrets terribles des anciens brahmanes, qui étaient maîtres absolus de la vie et de la mort !…
– Je ne vois pas, grogna Bild, à quoi ce demi-dieu nous servirait ici…
– Hé ! répliqua Paul, il nous expliquerait clairement ce sur quoi nous échafaudons avec peine de vagues conjectures !… Il nous sortirait de cette irritante Roue Fulgurante, peut-être…
Le sceptique Bild haussa les épaules et fit une moue qui prouvait qu’il ne croyait pas, lui, aux exorbitantes facultés dudit docteur Ahmed-bey.
Paul n’osa insister.
Or, quelle n’eût pas été son émotion s’il avait pu savoir qu’à l’instant même, sur la terre, le docteur Ahmed-bey, précisément, pensait à lui, Paul de Civrac, se rappelait leur rencontre à Calcutta et se préparait à aller, de la manière la plus prodigieusement inattendue, au secours des prisonniers de la Roue Fulgurante !
Mais, malgré toutes les merveilles de la transmission des pensées, Paul ne pouvait pas savoir, Paul ne savait pas…
Il se laissa aller à une rêverie où il revoyait avec quelque amertume les épisodes de sa vie terrestre, lorsque, soudain, la voix de la jeune fille, sa compagne désormais, le ramena au présent, à la réalité angoissante du présent.
– Quelles étrangetés ! murmurait Lola… Mais combien de temps cela durera-t-il ? Reviendrons-nous sur la terre ?
– Mystère ! prononça Brad.
– Nous le verrons bien ! dit Bild.
– À moins que nous ne soyons morts de faim d’ici là ! ricana de nouveau le pratique Francisco.
La remarque était si judicieuse que tous les yeux se tournèrent vers le valet.
– Eh ! oui, dit-il. Ces Saturniens, comme vous les appelez, s’ils sont de purs esprits, des âmes, se moquent pas mal d’une tranche de jambon froid, d’un morceau de pain et de trois œufs durs !… Vous ont-ils demandé si vous aviez faim ? Vous ont-ils offert des victuailles ? Non, n’est-ce pas ?… Alors ?… Il est probable que vos Saturniens ne comprennent pas le français, monsieur de Civrac, ni l’anglais, messieurs Jonathan Bild et Arthur Brad, ni l’espagnol, Señorita !… Comment leur ferez-vous entendre, si seulement vous les revoyez, que nous avons besoin, nous, qui ne sommes pas de purs esprits, de nourrir notre corps avec autre chose que des étincelles blanches, des lueurs vertes et du nuage condensé ?… Ah ! caramba ! nous sommes cinq… et je n’ai là des vivres que pour deux jours…
Ce disant, le raisonnable et bouffon Francisco saisit sa valise, la mit sur ses jambes allongées, l’ouvrit et en tira divers paquets qu’il soupesait en murmurant :
– Poulet… jambon… pain… sardines en boîtes… œufs durs… pêches et tomates… encore un litre de vin et une demi-bouteille d’eau minérale… Oui, en se rationnant, il y en a pour nourrir cinq personnes pendant quatre repas… Ah ! j’ai rudement bien fait de désobéir au capitaine et d’emporter des provisions… Il voulait déjeuner et dîner dans les buffets !… Les buffets de Saturne… oui ! ils sont jolis !…
Les paroles du valet n’étaient bouffonnes qu’en apparence. Loin de faire rire, elles inspiraient de bien noires pensées. Elle n’avait rien d’agréable, la perspective d’un long séjour dans cet énigmatique moyeu de la Roue Fulgurante, sans communication possible avec les êtres mystérieux qui l’habitaient, sans ravitaillement probable. Ils se voyaient tous condamnés, pour peu que la situation présente se prolongeât, à la plus horrible des morts, à la mort par la faim et par la soif…
Paul tira tout à coup sa montre : il était midi moins dix minutes. Il y avait donc environ huit heures que Bild, Brad et lui avaient été enlevés par la Roue.
– C’est aujourd’hui le 22 juin, dit-il ; il nous faut établir un calendrier afin que…
– J’en ai un ! fit Brad.
Il montra son portefeuille qui, en effet, était muni d’un calendrier…
– Il n’y a ici ni jour ni nuit, dit Bild. Brad sera donc chargé de tenir son calendrier au courant des heures écoulées…
– Entendu !
– Mademoiselle est servie ! prononça Francisco.
Devant eux, sur la valise ouverte et retournée, le valet avait « mis la table ».
Lola Mendès se servit de la fourchette, du couteau et du verre qui lui appartenaient : Bild, Brad, Francisco et Paul avaient leurs dix doigts et chacun le bon couteau de voyage propre à toutes les besognes, les délicates comme les rudes.
On mangea sans parler. Le repas fut rapide, court et – il faut bien le dire – insuffisant. Mais Francisco rationnait avec autant de prudence que d’équité.
– Et d’un ! fit le valet en refermant la valise ; vous avez encore trois dîners de la même force… Ensuite…
Il fit claquer ses doigts en l’air et, tirant de sa poche du papier et du tabac, il roula une cigarette qu’il alluma…
Bild avait quatre cigares. Il les offrit, et chacun – avec la permission de Lola Mendès – fut bientôt entouré d’un nuage de fumée.
Tout en tirant de son cigare de lentes bouffées, Paul observait la jeune fille. Elle était assise, les jambes droites, les bras croisés, le menton baissé sur la poitrine et soutenu par la main gauche… Elle soupirait et, bientôt, des larmes roulèrent sur ses joues. Très ému, Paul jeta son cigare et s’approcha de Lola.
– Mademoiselle…
Elle tressaillit, leva la tête, essuya ses larmes d’un geste vif, et, d’une voix douce :
– Je pensais à mon père… Mais je dois être forte… Vous ne me verrez plus pleurer.
Elle s’efforça de sourire et, leurs yeux, s’étant rencontrés, ne se détournèrent pas. Ceux de Paul devaient être pleins d’encouragements et de consolations ; ceux de Lola semblaient remercier. Spontanément, Paul lui tendit la main : elle lui donna la sienne et il sentit la légère pression de ses doigts.
– Tout n’est pas perdu, dit-il, je vous sauverai…
Il était étrangement émotionné. Il aurait voulu parler davantage, protester de son dévouement… Mais deux voix brusques lui rendirent tout son calme :
– Nous vous sauverons ! disaient-elles.
C’étaient les voix de Bild et de Brad, debout à côté de Paul, et tendant tous les deux une main à la jeune fille.
D’un joli mouvement, elle se leva et donna sa main gauche à Brad, sa main droite à Bild. Le shake-hand fut net et vigoureux, mais les yeux de Lola ne se détournèrent pas des yeux de Paul, et le jeune homme sentit soudain comme une bouffée de bonheur passer en lui et l’emplir d’un invincible courage…
– Et maintenant, dit Bild, il faut agir…
– Savoir où nous sommes… entrer en relation avec les Saturniens… ajouta Brad.
Paul saisit son revolver et, de la crosse, il se mit à frapper sur les parois, tantôt ici, tantôt là… Mais son revolver et sa main, pénétrant dans la dense vapeur, en étaient rejetés comme par un ressort.
Il se lança, tête baissée, contre la paroi ; mais il se sentit suffoqué dès que sa tête fut dans la vapeur, qui, d’ailleurs, faisant tampon élastique, la rejeta aussitôt en arrière.
Bild et Brad, inactifs, se tenaient de chaque côté de Lola, et ils le regardaient faire, ainsi que Francisco, narquois.
Après une bonne demi-heure d’exercice, Paul remit son revolver à sa ceinture en disant :
– Les Saturniens, s’ils savent ce que nous faisons, ne veulent pas répondre…
– Je pense qu’il faut attendre leur bon caprice ! dit Lola Mendès.
– Attendons !
L’on se rassit : on alluma des cigarettes que roulait Francisco ; on parla, émettant mille conjectures de plus en plus folles… Et les heures s’écoulèrent, mornes et vides. Pas un Saturnien ne se montrait ; le silence était si profond que, pour ne pas l’entendre, ils faisaient toujours quelque bruit des pieds ou des mains, quand ils ne parlaient pas… Et la même question angoissante se répétait sans cesse :
– Où sommes-nous ? Où sommes-nous ?
À huit heures du soir, Francisco cria impassiblement :
– Mademoiselle est servie !
Comme à midi, ils mangèrent vite et peu : ils durent boire beaucoup moins.
– Et de deux ! fit le valet en refermant sa valise.
Lola Mendès s’étendit, et, tandis qu’ils fumaient, elle s’endormit.
– Saint Jacques de Compostelle soit loué ! murmura Francisco ; c’est la première fois que la Señorita peut dormir depuis…
– Dormons aussi, fit Brad.
Et il s’étendit non loin de Lola ; Bild l’imita, puis Civrac, puis Francisco, et, serrés l’un contre l’autre sur l’étrange édredon saturnien, ils s’endormirent, terrassés par les émotions de cette extraordinaire journée.
Or, ayant franchi des milliers et des milliers de lieues depuis qu’elle était sortie de l’atmosphère terrestre, la Roue Fulgurante, comme une comète capricieuse, roulait dans l’infini des espaces interplanétaires, vers le soleil.
CHAPITRE V
DANS LEQUEL SIX COUPS DE REVOLVER ONT DE TERRIBLES CONSÉQUENCES INATTENDUES
La journée du 23 juin fut morne et triste pour les prisonniers de l’énigmatique Roue Fulgurante.
Ils ne virent rien ; pas un bruit ne frappa leurs oreilles ; aucune colonne verte porteuse du globe lumineux n’apparut dans la vaste pièce polyédrique. Il semblait que, lors de leur première apparition, les Saturniens avaient satisfait toute leur curiosité. Où donc se tenaient ces êtres mystérieux ? Qu’y avait-il au delà de cette immuable paroi nuageuse, aux mille faces régulières, sans solution de continuité ? Et cette lumière d’un vert doux, qu’était-ce donc ?
Mystère !
Lola Mendès, Paul de Civrac, Jonathan Bild, Arthur Brad et le valet Francisco agitèrent toutes ces questions, mais de leurs hypothèses ne sortit aucune certitude.
À midi et à sept heures, ils firent les deux repas – les derniers !…
Et de nouveau, après que les hommes eurent fumé sans goût une cigarette, on s’étendit…
Mais comment dormir, avec la pensée que l’on n’aura pas, demain, de quoi manger ? Comment prendre quelque repos, quand l’esprit est torturé par cent questions insolubles et que le cœur est étreint de l’angoisse de l’effrayant mystère ?… Comment fermer les yeux sous cette implacable lumière verte emplissant cette hallucinante pièce sphérique ?…
Aucun des malheureux héros de cette affolante aventure ne put avoir le réconfort du sommeil.
– Au diable les Saturniens ! s’écria Paul le premier, après s’être retourné cent fois entre les omoplates aiguës de Bild et les épaules larges de Brad.
– Au diable ! grommela Jonathan.
– Que la peste les étouffe ! grondait Arthur.
– Ils la craignent peu ! ricana Francisco.
– Mon Dieu ! qu’allons-nous devenir ? gémit Lola Mendès.
Personne n’avait faim ni soif, bien que le dernier repas n’eût pas été des plus abondants ; mais l’appréhension de la faim et de la soif prochaines, et qu’on ne pourrait assouvir, creusait à chacun l’estomac, desséchait la gorge…
– Il faut pourtant sortir de là ! s’écria Bild. Il faut trouver un moyen…
Un long sifflement retentit et, comme la première fois, par une ouverture soudain produite dans la paroi nuageuse, entrèrent trois colonnes vertes portant les globes lumineux.
La jeune femme et les quatre hommes restèrent immobiles.
– Les Saturniens ! souffla Paul inconsciemment.
Les trois colonnes arrêtèrent ensemble leur glissade ; en avant des globes, mille courtes étincelles jaillirent, crépitantes. Puis ces étincelles mêmes ne se manifestèrent plus ; les colonnes affaiblirent un peu le ton vert de leur lueur transparente et les globes lumineux furent d’un blanc opaque, légèrement bleuté, à clarté intérieure, sans radiations.
Les terriens considéraient avec calme les trois immobiles Saturniens… De longues minutes s’écoulèrent…
Soudain, une voix s’éleva :
– Tirez un coup de revolver sur un des globes lumineux ! disait brutalement Francisco.
– Hein ? fit Bild, le regard indécis.
– Oui, reprit le Castillan, canardez une de ces stupides boules… Tenez, celle-là !
Et il désignait du bras tendu le Saturnien du milieu…
– Pourquoi ?
– Parce que ces Saturniens diaboliques feront peut-être quelque chose. En tout cas, ça rompra la monotonie de notre existence actuelle…
– Mais les conséquences ? s’écria Paul. Pensez-vous aux conséquences ?… Savons-nous si… Tout peut crouler !…
– Eh bien ! répliqua Francisco en riant, nous mourrons d’autre chose que de faim ou de soif.
Brad avait écouté sans mot dire. Il saisit son revolver, l’examina.
– Diantre !
– Qu’importe ! dit Francisco… Allez… Feu !…
– Ma foi ! fit Bild.
Et il leva le bras armé.
– Allons, Arthur !
– Allons, Jonathan !
Arthur Brad leva aussi son revolver. Ils avaient des gestes raides de somnambules, des voix étranges, des voix d’hallucinés.
Paul de Civrac les regardait, l’esprit brouillé, tandis que Francisco ricanait. Mais Lola Mendès s’élança vers les deux Américains, se mit entre eux et les Saturniens.
– Non ! non ! s’écria-t-elle. Non ! ne faites pas cela !… Vous nous perdrez tous… Attendons encore… Peut-être les choses changeront-elles assez tôt…
Et, se tournant vers son valet :
– Francisco ! je te défends de donner de mauvais conseils… je te le défends !…
Elle était extrêmement excitée, les joues rouges, le regard brillant.
– Bien, maîtresse, bien ! grommela l’homme, je me tairai… Mais nous n’en mourrons que plus sûrement de faim et…
– Tais-toi ! tais-toi !…
Elle ramena Bild et Brad à côté de Paul, leur fit remettre les revolvers à la ceinture et alla s’asseoir près du Français, qui la couvrit d’un regard où il y avait de l’admiration et aussi l’expression certaine d’un autre sentiment.
Or, les Saturniens disparurent comme ils étaient venus.
Dans un silence absolu, les heures passèrent…
Ce qui devait être la nuit au sens terrestre s’écoula sans apporter aucun changement, puis d’autres heures s’enfuirent avec lenteur, et ce qui devait être le jour s’en alla peu à peu dans le temps…
À huit heures du soir du 24 juin, Francisco dit :
– J’ai faim !
– Moi aussi ! gronda Bild.
– Et j’ai soif ! gronda Brad.
Paul et Lola, seuls, eurent la force de ne pas se plaindre. Paul souffrait davantage de voir souffrir la jeune fille que de son propre besoin.
Il pressait dans les siennes une de ses jolies mains pâles, et il aurait voulu que tout son sang de mâle vigoureux pût passer dans les veines de Lola ! Ce fut encore un long moment de silence.
– Combien de temps pouvons-nous vivre sans manger ni boire ? demanda tout à coup Francisco.
– Cela dépend des forces et du tempérament de chacun, répondit Civrac.
– Si bien, reprit le valet, si bien que la Señorita, la moins forte certainement de nous cinq, succombera la première ?…
Personne ne dit mot. Dans le morne silence, chacun pouvait entendre battre son cœur. Avec un léger soupir, Lola Mendès laissa tomber sa tête sur l’épaule de Civrac.
Au même moment, retentit le sifflement annonçant les Saturniens. Et, en effet, ils reparurent aussitôt. Cette fois, les colonnes vertes surmontées des globes blancs étaient au nombre de quatre… Elles s’arrêtèrent à trois pas du groupe que formaient les Terriens.
Tout d’abord, Paul eut son attention attirée par la venue des Saturniens. Puis il sentit sur son épaule un poids inaccoutumé. Il tourna la tête et vit Lola Mendès pâle, les yeux fermés, les lèvres exsangues.
Francisco, Bild et Brad avaient vu aussi. Ils se levèrent, les traits tirés, l’œil résolu, faisant face aux impassibles Saturniens.
– Elle est évanouie ! dit Paul.
– Eh bien ! non, il faut en finir ! s’écria Francisco avec exaltation. Je préfère nous perdre tous, d’un coup, que voir la Señorita mourir là, peu à peu, devant moi, sans que je puisse rien…
Il saisit le revolver de Paul. Bild et Brad prirent les leurs.
– C’est fou ! c’est fou ! s’écria Paul.
Mais il ne se sentait pas la force d’intervenir.
Ensemble, Bild, Brad et Francisco visèrent une des insupportables boules lumineuses.
– Feu !
Ils tirèrent.
Sans doute avaient-ils manqué leur coup, car leurs mains tremblaient et rien ne se produisait.
– Encore ! encore ! glapit Francisco.
Ils pressèrent ensemble les gâchettes.
Mais une formidable secousse ébranla soudain la chambre polyédrique. Bild, Brad et Francisco tombèrent sur Paul qui, instinctivement, avait serré dans ses bras Lola Mendès… Hurlants, ils s’agrippèrent à Civrac et à Lola… Et la grappe humaine, rejetée à droite et à gauche dans une confusion de lueurs, d’éclairs et de crépitements, fut précipitée par une vaste ouverture de la paroi… les quatre hommes, l’esprit en déroute, n’avaient cependant pas perdu connaissance… Ils eurent une sensation de chute dans un air embrasé… Puis cette sensation s’affaiblit, et ils comprirent qu’ils tombaient doucement… Où ?… Bien que fermés, leurs yeux souffraient d’une lumière intense… Ils suffoquaient…
Puis, une sorte de crépuscule succéda tout d’un coup à la violente clarté. Le contraste fut assez vif pour rendre à Paul de Civrac toute sa présence d’esprit. Il ouvrit les yeux. Et ses pensées se succédèrent, rapides :
« Nous sommes dans un nuage… moins épais que celui de la Roue Fulgurante… Il fait moins chaud… Nous tombons dans un air très dense… si dense qu’il ralentit notre chute… Nous devons être aussi bien plus légers que dans l’atmosphère terrestre… le nuage est passé… »
Alors, sous lui, à une grande profondeur, il vit une prairie rousse, que traversait un cours d’eau jaune comme de l’or… Il suffoquait atrocement… Il crut qu’il allait mourir avant même de s’écraser contre ce sol, là-bas… Il serra davantage Lola sur sa poitrine et, sur les lèvres closes de la jeune fille, il eut la force d’appuyer les siennes en un unique et suprême baiser.
Dans un dernier regard, il embrassa le spectacle : au-dessus de lui, un nuage obscur ; de tous côtés, une sorte de brume transparente ; dessous, la prairie rousse… Et il sentit les ongles de Brad s’enfoncer dans son bras, tandis que les bras de Bild lui serraient les côtes et que les mains de Francisco se crispaient à sa cheville gauche… Une lueur aveuglante, une chaleur insoutenable, une suprême suffocation… il s’évanouit.
Et les cinq corps de la grappe humaine, soudain séparés, continuèrent à tomber lentement vers la terre mystérieuse, indécis, ballottés comme des feuilles de papier jetées de la nacelle d’un ballon…
DEUXIÈME PARTIE
LA PLANÈTE MYSTÉRIEUSE
CHAPITRE PREMIER
QUI SERT DE PEU BANALE INTRODUCTION AU SUIVANT
Jonathan Bild fut le premier qui, après la chute, recouvra ses esprits. Il voulut ouvrir les yeux, mais il fut aveuglé par une clarté violente, si bien qu’il les referma et les abrita de ses deux mains. Il resta longtemps étendu, sans remuer. Son intelligence ahurie ne parvint pas tout d’abord à reconstituer les faits à la suite desquels il se sentait tout endolori. Il éprouvait par tout le corps une intolérable chaleur, et il suffoquait. Peu à peu, cependant, sa mémoire l’éclaira. Il se rappela la nuit de Colombie, la Roue Fulgurante. Lola Mendès et son domestique, les coups de revolver, la chute…
« Bon ! se dit-il, nous sommes tombés sur un astre, une planète probablement… Pourquoi une planète ?… Bah ! nous saurons plus tard. Mais où sont les autres ?… Sacrée lumière !… »
Il avait de nouveau ouvert ses yeux trop brusquement, et il eut la sensation d’un fer rouge passant devant ses prunelles. Dès lors, il fut plus prudent. Peu à peu, entr’ouvrant très lentement les paupières, il réussit à garder les yeux clignés, mais assez ouverts pour y voir parfaitement.
Il se rendit compte alors qu’il était couché sur de hautes herbes rousses à peine courbées par son poids ; cela formait un sommier très élastique. Et le ciel qui était sur sa tête se composait d’énormes nuages verts, condensés, sans une éclaircie qui permît de voir au delà.
Il se souleva sur un coude et cria de toutes ses forces :
– Arthur Brad !
À son grand étonnement, un formidable écho répéta « Arthur Brad » et immédiatement un second écho, puis un troisième, puis vingt autres répétèrent, avec une force décroissante, les trois syllabes sonores. Le plus étrange, c’est que ces échos venaient du ciel, comme s’ils avaient été produits par les bizarres nuages verts.
Mais aucune voix humaine ne succéda au roulement des échos. Arthur Brad ne répondait pas.
Sans renouveler son appel, Jonathan Bild essaya de se lever. Il y parvint, mais après bien des efforts, car tous ses membres étaient comme brisés. Ses pieds et ses jambes, n’offrant pas une aussi grande surface de résistance que tout son corps étendu, s’enfoncèrent dans les herbes rousses. Les pieds reposèrent sur un sol véritablement solide lorsque l’extrémité des herbes rousses fut arrivée au niveau de sa poitrine, et Jonathan Bild était grand ! Quand il se sentit bien d’aplomb, les jambes écartées, les mains en abat-jour au-dessus de ses yeux, il regarda autour de lui.
Il se trouvait à peu près au milieu d’une vaste prairie d’herbes rousses, assez semblables, à part la couleur, à du blé en pleine maturité, mais plus flexibles, plus hautes et plus grosses. Devant lui, cette prairie était limitée par un large ruban jaune – un fleuve d’or – au delà duquel se dressaient des montagnes stériles, noires et brillantes comme de l’ardoise, et dont le sommet se perdait dans les nuages.
À droite, une forêt d’un gris métallique ; à gauche, une autre forêt semblable et, derrière, – car Jonathan Bild se retourna tout d’une pièce, – l’Américain vit des collines arrondies couvertes d’une végétation d’un rouge vif… Et nulle part un animal ; pas un être vivant, insecte, oiseau, bipède ou quadrupède. Et sur ces solitudes immobiles, que pas un souffle de vent n’animait, une lumière et une chaleur plus que tropicales, avec un silence de mort…
« Drôle de pays ! murmura Bild ! mais ces sacrés nuages sont plus déconcertants que tout ! »
Ils étaient verts, ces nuages, d’un vert vif, indéfinissable et ondoyant, sombre dans le milieu, clair sur les bords. Et ils semblaient formidablement épais et lourds, roulant avec pesanteur, lentement, vers les montagnes d’ardoise contre lesquelles ils s’écrasaient, montaient, pour être sans cesse remplacés, sans une éclaircie, par d’autres nuages surgissant d’au delà des collines écarlates. Et la lumière intense, insoutenable à des yeux complètement ouverts, douloureuse même pour les yeux clignés, la lumière qui venait de ce ciel extraordinairement nuageux était verte aussi, d’un vert très clair, qui ne modifiait pas la couleur des objets.
« Qu’il fait chaud ! qu’il fait chaud ! » murmura Bild.
Il lui semblait être dans une fournaise et que son crâne allait éclater sous le bouillonnement du cerveau. Tout son corps ruisselait de sueur. Aussi vite que le lui permettait l’endolorissement de ses membres, Jonathan se débarrassa de sa vareuse et de ses pantalons ; il resta en jersey et en caleçon, avec ses bottes. Il n’en éprouva d’ailleurs aucun soulagement. L’esprit un peu alourdi, il réfléchissait à cette chaleur épuisante, lorsqu’il entendit à sa gauche une voix grêle appelant :
– Jonathan Bild !
Et aussitôt, dans le ciel, les échos répétèrent, en un roulement rapide : « Jonathan Bild !… nathan Bild ! »
– Ah ! mon vieux Brad !
– Jonathan ! Jonathan !
Mais ce fut dans les nuages un tel vacarme d’échos, que l’Américain comprit la nécessité de ne pas crier. Il se tourna donc vers l’endroit d’où était d’abord venue la voix grêle, et il prononça à demi voix :
– Brad, est-ce vous ?
– Oui, c’est moi, Bild.
– Comment êtes-vous ?
– Cassé, cassé partout, mais est-ce que vous me voyez ? Regardez un peu plus à gauche, Bild. Je ne peux pas ouvrir les yeux, mais je devine, à votre voix, de quel côté vous êtes tourné…
Jonathan, d’une enjambée, avait franchi un énorme parterre d’herbes rousses… Il se sentait léger, léger. Soudain, devant lui, il vit, couché tout de son long, sur un matelas d’herbes coupées, le gros corps d’Arthur Brad, au visage apoplectique ruisselant de sueur. L’aspect de Brad était si drôle, avec ses yeux clignotants et sa large bouche ouverte, que Bild ne put s’empêcher de rire à toute gorge.
Quand les échos aériens de ce rire se furent évanouis :
– Du diable ! fit Brad à voix basse ; où sommes-nous ?
– Blessé ? demanda Bild sans répondre.
– Je ne crois pas.
– Essayez de vous lever, Arthur, essayez !
– Il me semble qu’on m’a roué de coups de bâton !
– N’importe, essayez… J’étais comme vous, moi, cassé de partout. Et vous voyez, en réalité, je suis intact. C’est la chute qui…
– Oui, la chute… Aïe !
D’un effort, malgré la douleur dont souffraient tous ses membres, Brad s’était mis debout. Il enfonça jusqu’au menton. Il regarda la prairie rousse, l’immobile fleuve d’or, les montagnes d’ardoise, les forêts gris d’acier, les collines écarlates, puis, longtemps, les hauts, épais et lourds nuages verts…
– Cocasse pays, hein, Bild ?
– Oui, cocasse !
– Mais où sont les autres ?
– Civrac ?
– Oui, Civrac, et Lola Mendès, et Francisco…
– Je ne sais pas ; cherchons-les !
– Cherchons-les… Mais, dites-moi, Bild, j’étouffe… est-ce que vous avez chaud, vous aussi ?
– Je grille…
– Température plus que tropicale, ma foi, Bild…
– Nous devons être dans une planète plus rapprochée du Soleil que la Terre… Et encore ces nuages tamisent la lumière et la chaleur… Sans cela, nous serions rôtis comme un poulet à la broche…
– Au four, Bild, au four ! rectifia le méticuleux Arthur Brad.
Bild haussa les épaules et fit un pas en avant. Mais ce seul pas le transporta au moins à cinq mètres de Brad, qui était resté immobile.
– Ohé ! Jonathan ! vous avez donc chaussé des bottes de sept lieues ! Par Jupiter !
Il bondit lui-même, et ce seul bond l’emporta plus loin que Bild.
– Arthur, fit Jonathan, c’est comme dans la Roue Fulgurante, nous sommes plus légers que sur la Terre.
– Oui, évidemment… Calculons mieux.
À petits pas prudents, ils se rejoignirent. Et comme ils regardaient vers le fleuve jaune, ils virent un être humain, à trois pas d’eux, surgir des herbes rousses, bondir à six mètres en l’air et retomber légèrement.
– Francisco !
– Lui-même ! Mais, par le Santo-Cristo, qu’est-ce que ça veut dire ? Je saute pour me dégourdir et je monte en l’air comme un ballon !… Bonjour, Señores… Pas de mal, vous deux ?
– Non, pas de mal, répondit Brad.
– Moi non plus. Je suis réveillé depuis longtemps… Je vous ai entendu parler… Hein ! ces échos ! qu’en dites-vous ?… Puis, vous avez parlé plus bas… Et j’ai compris, je vous imite, vous voyez ! Mais venez au secours de la señorita. Elle est là, couchée près de M. de Civrac. La Vierge me pardonne ! Je crois que j’étais allongé sur leurs jambes. Nous sommes tombés de haut, caramba !… Tenez !… la Señorita respire et M. de Civrac aussi… J’ai toujours ma gourde, heureusement !
Pendant ce flux de paroles, Bild et Brad se penchaient vers Lola et Civrac étendus côte à côte dans l’herbe rousse. D’une des vastes poches de sa vareuse, Francisco avait tiré une petite gourde en peau de bouc. Il en dévissa le bouchon et mit le goulot entre les lèvres de Lola.
– C’est de l’aguardiente.
– Du cognac ? fit Brad.
– Oui, et du bon ! Ça ressusciterait un mort du temps de Charles-Quint ! Voyez !
Lola toussa, éternua et ouvrit des yeux effarés, qu’elle referma d’ailleurs aussitôt, éblouis qu’ils furent par l’intense clarté tombant des nuages verts.
– Señorita ! Señorita ! vous vivez ! nous vivons tous ! Le Santo-Cristo soit béni !…
Et le pétulant Francisco se tourna vers le corps de Civrac. Mais il ne calcula pas son mouvement, si bien qu’il pirouetta quatre fois sur lui-même.
– Caramba !… c’est de la diablerie !
– Non !… répliqua Brad.
Et il expliqua que, les corps étant sur cette planète inconnue beaucoup plus légers que sur la Terre, l’effort musculaire devait être proportionné à la nouvelle pesanteur.
– Compris ! dit Francisco.
Et, avec une lenteur méticuleuse, il se tourna de nouveau vers Civrac. Le jeune Français mit beaucoup plus longtemps que ses compagnons à recouvrer ses esprits. Le sommet de sa tête était ensanglanté. Il était tombé malheureusement de telle sorte que son crâne avait frôlé une haute pierre. Francisco lava la plaie avec de la salive et y appliqua son mouchoir à peine humecté de cognac. Puis il versa quelques gouttes de cordial entre les lèvres du jeune homme.
Inquiets, Bild et Brad attendaient, ainsi que Lola, qui s’était assise sans peine.
Enfin, Civrac ouvrit la bouche.
– Lola ! Lola ! murmura-t-il.
Il ouvrit aussi les yeux.
Mais, ébloui, il les referma aussitôt, et un grand moment d’assimilation lui fut nécessaire. Clignant un œil, puis l’autre, il les habitua peu à peu à l’intense clarté, et quand il put enfin regarder entre ses paupières mi-closes, il promena ses regards sur ses compagnons et les reposa enfin sur Lola. Alors, ses yeux se dévoilèrent, pétillèrent d’intelligence, de vie revenue, et Civrac sourit.
– Sains et saufs ! murmura-t-il. Tous !
– Oui, tous ! fit Brad.
– Essayez de vous lever ! conseilla Bild.
– Mais où sommes-nous ?
– Nous aurons le temps de chercher à le savoir !… Levez-vous ! Il faut d’abord nous convaincre que vous n’êtes pas blessé…
– Je ne crois pas ! murmura Civrac. Je ne sens qu’un peu de mal à la tête.
– Votre tête a porté sur une pierre, expliqua Francisco, mais la plaie est toute superficielle, ce n’est rien !
Civrac se leva sans peine. Il tendit la main à Lola, qui se mit debout la dernière. Et les cinq Terriens, muets, regardèrent encore autour d’eux.
La chaleur était si intense, l’air si lourd, qu’ils étouffaient et suffoquaient… Pourtant, aucun soleil ne se voyait : il n’y avait que cette terrible lumière d’un vert pâle tombant des gros nuages plus colorés. Et sur tout, partout, régnait un silence extraordinaire, effrayant à force d’être absolu…
– J’étouffe ! fit Lola en dégrafant nerveusement le col de son corsage…
– Moi aussi ! dit Civrac.
Brad et Francisco avaient imité Bild et s’étaient débarrassés, inutilement d’ailleurs de leurs vareuses.
– Allons dans cette forêt grise, là-bas… Peut-être, sous les arbres, fera-t-il moins chaud ! Et nous pourrons examiner notre situation.
– Allons ! répéta Bild. Mais pensez à notre légèreté spécifique.
En deux mots, Civrac expliqua à Lola le phénomène de la pesanteur modifiée. Puis il la prit par la main. Et les cinq Terriens s’élancèrent vers l’une des deux forêts. Bien qu’elle fût éloignée environ de trois kilomètres terrestres, ils l’eurent atteinte en quelques bonds. Chaque saut les tenait suspendus en l’air pendant plus d’une minute, – ils filaient comme s’ils avaient eu des ailes. Cette sensation de planer les faisait rire aux éclats, – tant elle était nouvelle pour eux, – et les échos aériens multipliaient leurs rires jusqu’à l’infini. Puis, ils se sentaient une étrange vitalité, insouciante et joyeuse, dont ils ne se rendaient pas bien compte. Cette surexcitation leur venait sans doute de la grosse proportion d’oxygène contenu dans l’air de cette planète mystérieuse ; et pourtant, bizarre contradiction, cet air avait une telle densité qu’il leur paraissait trop lourd et comme trop matériel à respirer…
À la lisière de la forêt, Civrac s’arrêta soudain, et, se tournant vers ses compagnons :
– Et la Roue Fulgurante ? dit-il.
À cette évocation, tout le monde se leva. Mais il n’y avait que les éternels nuages verts, très élevés et très serrés, glissant lourdement vers les montagnes d’ardoise.
– Nous ne la reverrons plus ! dit Bild.
À ces mots, une désolante impression de solitude étreignit les Terriens. Ils restèrent longtemps silencieux, les regards perdus dans le ciel inaccoutumé par où ils étaient venus sur cette étrange planète. Ils ne reverraient donc jamais la Terre ?… Mais ces terribles pensées ne purent abattre leur courage. Le premier, Paul de Civrac abaissa la tête et reporta ses yeux vers ce sol bizarre sur lequel, désormais, ils devaient vivre.
– Allons, dit-il, ne nous préoccupons plus de la Roue Fulgurante, ni de tout ce que nous avons connu et fait jusqu’à présent. Par une aventure inouïe, nous nous trouvons jetés dans un monde mystérieux. Rien ne prouve qu’il ne nous sera pas hospitalier… Ce champ d’herbes rousses peut être dû au travail d’êtres intelligents… Nous les rencontrerons, et alors…
Il se tut un moment ; puis il reprit avec force :
– Suivez-moi !
Et, tenant toujours dans sa main la main de Lola Mendès, il s’enfonça dans la forêt.
Elle était formée d’arbres bizarres, aux troncs rugueux, et qui rappelaient des colonnes métalliques rongées de rouille. Très haut s’épanouissait, en un bouquet sans grosses branches, un feuillage argenté, assez semblable à celui de l’olivier terrestre, mais qui devait être d’une toute autre matière, car les feuilles qui jonchaient le sol étaient flexibles sous les pas comme des lames d’acier ; elles semblaient, elles aussi, couvertes de rouille. Les arbres étant très nombreux et très pressés, leur feuillage formait un dôme continu, et, sous cette voûte épaisse, des courants d’air circulaient entre les troncs, produisant une fraîcheur relative.
Après avoir marché quelque temps, suivi de ses compagnons et tenant toujours Lola par la main, Paul de Civrac s’arrêta. Les Terriens se trouvaient en pleine forêt et, autour d’eux, il n’y avait que la succession infinie et morne des arbres aux troncs rouillés.
CHAPITRE II
OÙ TERRIENS ET MERCURIENS ENTRENT EN CONFLIT
Malgré les courants d’air et l’ombre, la chaleur était si intense encore dans la forêt que les visages des cinq Terriens ruisselaient de sueur. Ils suffoquaient moins, toutefois, et leur respiration devenait peu à peu normale, sans doute par suite de l’accoutumance de leurs poumons à cet air nouveau. Comme si cet air les nourrissait, ils ne se sentaient aucune faim, bien qu’ils n’eussent rien mangé depuis longtemps.
– Asseyons-nous, dit Paul ; immobiles, nous souffrirons moins de la chaleur. Et tâchons d’examiner avec calme notre situation.
– D’abord, fit Jonathan Bild, quand tout le monde se fut assis, où sommes-nous ? Dans quelle planète ?
– Ce n’est pas dans la Lune ! dit Arthur Brad.
– Ni dans Jupiter ! affirma Paul.
– Ni dans Saturne ! dit Bild.
– Pourquoi ? demanda Lola Mendès.
– Oui, pourquoi ? insista Francisco.
– Parce que les conditions climatériques et atmosphériques des planètes nous étant connues, expliqua Paul, ce que nous trouvons ici ne saurait s’accorder avec ce que nous savons de Jupiter, de Saturne et de la Lune…
– Nous sommes peut-être dans Mars…
– Ou dans Vénus…
– Ou dans Mercure…
– Ne nous éternisons pas sur cette question, dit Paul, elle est d’importance secondaire pour nous… L’avenir, sans doute, y répondra. Ce que nous devons savoir tout d’abord, c’est si nous trouverons, ici, de quoi vivre. L’air, bien que différent de l’air terrestre, est respirable. Puisqu’il y a de l’air et des nuages, il doit y avoir de l’eau : sera-t-elle buvable ?
– Ce doit être de l’eau, dit Bild, ce fleuve jaune qui borde la prairie rousse du côté des montagnes…
– Allons-y donc tout de suite ! s’écria Francisco.
– Non ! dit Paul. Attendons que le jour passe et que la chaleur tombe… À en juger par la direction perpendiculaire des rayons lumineux qui venaient des nuages quand nous étions dans la prairie, il devait être environ midi, au sens terrestre… Bild, vous avez votre chronomètre ?
– Oui.
– Intact ?
– Intact ! répéta Jonathan après avoir examiné sa montre.
– Eh bien ! remontez-le et mettez-le à une heure.
Dans l’absolu silence, on entendit le crissement du remontoir.
– Bon ! fit Paul. Autre chose, maintenant : quelqu’un de vous a-t-il vu un animal ?
– Pas l’ombre d’un ! répondit Brad.
Les autres compagnons secouaient négativement la tête.
– Ils ne sortent peut-être que la nuit ? risqua Lola Mendès.
– C’est possible… ou tout au moins, au crépuscule…
– Alors, fit Jonathan Bild, ne nous épuisons pas en vaines paroles, et, dormons ! Par un phénomène inattendu, nous n’avons plus faim, ni soif, pour le moment… Mais la chute nous a brisés… Dormons ! car je pense que bientôt nous aurons besoin de membres reposés et en bon état.
– Je dors déjà, moi ! grommela Francisco.
– Dormez, dit Paul. Moi, je veillerai. Nous ne savons pas quels dangers nous menacent…
De sa vareuse roulée il fit un oreiller ; il arrangea comme un lit de feuilles métalliques et flexibles – et Lola s’étendit, après un affectueux serrement de main et un sourire de reconnaissance. Quelques minutes après, excepté Paul, tout le monde dormait.
Civrac fit la réflexion qu’à la surexcitation qui, tout à l’heure, animait son esprit et celui de ses compagnons d’aventure, avait succédé, dès qu’on était entré dans la forêt, un calme parfait et même une légère prostration. On avait aussi respiré plus facilement. Cela signifiait donc que l’air de la forêt n’était pas tout à fait le même que celui de la prairie rouge. Étrange phénomène !
Et ce fleuve jaune que Paul avait entrevu, de quel liquide se composait-il ?
Et les herbes rousses de la prairie étaient-elles comestibles ?
Sur le sol de la forêt, il n’y avait pas la plus petite plante, le moindre brin de mousse, rien que le tapis rouillé des feuilles métalliques.
Quelle était donc cette planète ? Et Paul se mit à passer en revue dans son esprit toutes les connaissances astronomiques qu’il avait acquises sur la Terre.
Curieux de tout et lisant beaucoup, il s’était tenu au courant des découvertes, des hypothèses publiées par les astronomes et résumées dans le Bulletin mensuel de la Société astronomique de France.
Et, par voie d’élimination, il arriva vite à trouver que, seule, la planète Mercure répondait pour le moment aux conditions atmosphériques et climatériques qu’il pouvait observer… Mercure ! la plus petite des planètes et la plus rapprochée du Soleil ! celle qui reçoit le plus de chaleur et le plus de lumière !…
Tandis que Paul de Civrac réfléchissait ainsi, une somnolence irrésistible l’envahissait. Ses paupières alourdies se fermaient peu à peu et, s’il n’eût été appuyé du dos au tronc rugueux d’un arbre, il serait tombé en arrière, pris lui aussi par le sommeil. Cependant, sa volonté affaiblie luttait ; il voulait veiller, garder les yeux ouverts, et il promenait autour de lui, énergiquement, des regards inexplicablement vagues…
Mais déjà des rêves se tissaient lentement dans son esprit : il y voyait surtout Lola, une Lola souriante, aux yeux alanguis d’amour, aux lèvres murmurantes de baisers… Et il s’imaginait aussi lui-même sauvant Lola de dangers fantastiques, l’emportant, l’étreignant dans un geste d’amour autant que de protection…
C’est alors que, comme dans l’indéfini du rêve, il vit surgir de derrière un arbre et venir vers lui un être vivant, un animal bizarre et inattendu.
Cela était de la hauteur d’un enfant de douze ans à peu près, de couleur noire et luisante ; un torse rond, supportant, sans cou, une sorte de tête de rat à trompe, et supporté lui-même par une seule jambe… Du milieu du torse, jaillissait un unique, bras, terminé par trois énormes griffes brillantes… Cela s’avançait par sauts ; le genou de l’unique jambe se pliait, puis la cuisse se redressait comme un ressort, et tout l’animal faisait un bond de deux ou trois mètres… Au-dessus de la trompe, qui s’agitait furieusement en tous sens, un œil s’ouvrait, d’un rouge étincelant…
Paul de Civrac regardait venir vers lui ce petit monstre ; il le regardait stupidement, sans conscience d’un danger quelconque ; dans la somnolence où son esprit sombrait, le Terrien s’imaginait être la victime de ces rêves imprécis que l’on fait et que l’on vit avant de s’endormir tout à fait.
L’être fantastique fit soudain deux bonds rapides qui le portèrent juste devant les dormeurs. De son œil embrasé, il les regarda l’un après l’autre, curieusement, puis cet œil se fixa sur Paul… la trompe mobile lança un sifflement aigu et aussitôt, de derrière les arbres où ils s’étaient dissimulés, surgirent trois autres êtres semblables au premier, duquel ils s’approchèrent rapidement. Les bras uniques s’agitaient, les trompes sifflaient, les yeux rouges lançaient des éclairs… Et Paul de Civrac considérait ces quatre monstres avec inconscience…
Mais le premier monopède, soudain, fit un saut, tendit son bras, et ses trois griffes égratignèrent la cuisse de Civrac… Avec un cri d’épouvante, Paul se dressa, conscient alors de la réalité.
Les échos aériens répétèrent son cri en roulements de tonnerre et les quatre monstres, bondissant, disparurent dans la profondeur de la forêt.
– Bild, Brad, Francisco ! hurla Paul, réveillez-vous ! levez-vous ! je les ai vus ! je les ai vus !…

Et il secouait ses compagnons étendus. Grommelants, ils ouvrirent les yeux.
– Quoi donc ! fit Bild, qu’avez-vous vu ?
– Des… des…
– Eh bien ! qu’est-ce qu’il y a ? grogna Brad.
– J’ai vu ! j’ai vu des… des Mercuriens.
– Mercuriens ? pourquoi Mercuriens ?
Et Bild sauta sur ses pieds, en même temps que Brad et Francisco.
– Où sont-ils ? cria l’Espagnol.
– Pourquoi des Mercuriens ? répéta Bild.
– Parce que, répondit Paul, soudain calmé, parce que j’ai réfléchi, pendant que vous dormiez, et que mes réflexions m’ont convaincu que nous étions sur la planète Mercure… Au reste, nous le saurons bientôt d’une manière certaine…
– Comment ?
– Mais les Mercuriens ! les Mercuriens ! criait Francisco en fouillant la forêt du regard.
– Ils sont partis…
– Combien étaient-ils ? demanda Brad.
– Et comment ? fit Bild.
Civrac décrivit sommairement les quatre monstres monopèdes.
– Faisons semblant de dormir, conseilla Jonathan, ils reviendront… Aucun de nous n’a son revolver ?…
– Nous les avons lâchés au moment…
– C’est vrai ! et peut-être que la Roue Fulgurante est détruite…
– J’ai mon couteau ! dit Francisco.
Et il tira de sa ceinture un large et long couteau catalan à cran d’arrêt…
– Rengainez cette arme ! ordonna Civrac. Les Mercuriens ont eu peur de nous ; ils n’avaient d’ailleurs pas de sentiments hostiles… celui qui m’a égratigné la cuisse n’a voulu que me toucher pour voir ce que j’étais… Nous ne devons pas ouvrir les hostilités. Songez que nous ne sommes que quatre hommes contre des myriades d’individus peut-être… Puis, si ces monstres n’étaient que des animaux et non des Mercuriens intelligents ? Il faut attendre… Ne frappons que pour défendre notre vie…
– Vous avez raison, Paul, dit gravement Jonathan Bild.
– Avant de nous coucher, reprit Civrac, buvons un peu de cognac de Francisco, afin de vaincre cette prostration à laquelle nous avons cédé.
– Juste ! fit Brad.
Et la gourde passa de mains en mains.
Paul et Francisco s’étendirent de chaque côté de Lola, toujours endormie, de manière à la défendre de l’attouchement des monopèdes.
Bild et Brad se couchèrent à quelque distance, dans le but de surprendre par derrière quelque Mercurien. Il était entendu qu’on tâcherait de faire un prisonnier. La large et longue ceinture de Francisco servirait à attacher le captif à un arbre…
Une heure s’écoula sans qu’aucun être parût. Entre leurs paupières clignées, les Terriens jetaient leurs regards de tous côtés. Pour se tenir éveillés, ils s’interpellaient de temps en temps à voix basse et se pinçaient mutuellement les bras.
Bild regardait souvent sa montre et faisait connaître d’un chiffre la marche du temps.
Ce fut à quatre heures et quart que Brad, le premier, vit un monopède. Il le signala d’un long soupir convenu, et les quatre Terriens s’appliquèrent à rester immobiles.
Par petits sauts, espacés d’attentes prudentes, le noir Mercurien avançait, le bras en avant, la trompe agitée, l’œil vif… Quand il ne fut plus qu’à six pas des hommes étendus, il siffla de la trompe… Et aussitôt, de derrière les arbres, sortirent d’autres monopèdes… Il y en eut quatre, puis dix, puis douze, puis vingt-deux… Ils se groupèrent, semblèrent se consulter, et les trompes sifflaient alternativement… Enfin, le premier monopède se détacha du groupe et, d’un bond, sauta jusque devant Bild et Brad… Il plia le genou, étendit le bras et toucha doucement de ses trois griffes la poitrine de Bild, puis l’épaule de Brad… les deux Américains ne bougeaient pas, observant entre leurs cils le petit être noir.
Le Mercurien se releva et, de sa trompe, sortit un long sifflement modulé. Aussitôt, quatre monopèdes se détachèrent du groupe et rejoignirent le premier d’un saut. Délaissant Bild et Brad, les cinq êtres noirs entourèrent Francisco, Lola et Paul. Ils s’accroupirent et, de leurs griffes, ils touchèrent avec précaution Paul et Francisco… Ils sifflaient de leurs trompes ; leurs yeux pétillaient ; les têtes de rats sans expression avaient des mouvements rapides… Évidemment, les Mercuriens se communiquaient les impressions nouvelles que leur causaient la vue et l’attouchement de ces êtres inconnus venus ils ne savaient d’où sur leur planète…
Mais comme deux des monopèdes, dirigeant ensemble leur bras vers Lola Mendès, paraissaient vouloir saisir et soulever la tête de la jeune fille, pour examiner sans doute sa chevelure, Paul et Francisco se dressèrent d’un même mouvement, aussitôt imités par Bild et Brad… Et, hurlants, les quatre hommes bondirent sur un monopède qui, en une minute, fut terrassé, roulé dans la ceinture rouge de Francisco et solidement attaché, debout, au tronc d’un arbre…
Au premier cri poussé par les Terriens, tous les Mercuriens, moins le prisonnier, s’étaient enfuis.
– Cocasse individu ! disait Brad, planté devant le monopède attaché à l’arbre…
Furieux, l’œil rouge du Mercurien luisait et roulait dans l’orbite ; sa trompe sifflait et s’agitait fébrilement, et son bras unique, maintenu au coude par un tour de ceinture, cherchait en vain à se dégager.
Lola, éveillée par le bruit, s’était levée ; Paul la mit au courant des faits. Et les cinq Terriens, rangés en demi-cercle autour du captif, l’examinèrent à loisir.
La tête du monopède était exactement semblable à une tête de rat ; la trompe, longue de trente centimètres, prolongeait le museau ; sous la trompe, munie à l’extrémité d’une ventouse à succion, il n’y avait ni bouche, ni menton ; la racine de la trompe fuyait immédiatement pour se joindre au corps lui-même, car cet être étrange n’avait pas de cou ; c’est à peine si le buste s’amincissait à la naissance de la tête ; de chaque côté de la trompe se trouvait, non pas une oreille, mais un appareil auditif assez semblable aux branchies des poissons, enfin, au-dessus de la trompe, en plein crâne, s’ouvrait l’œil unique, énorme et sanglant – et tout aussitôt le crâne tournait, formant nuque…
Le bras unique sortait, en avant, du milieu du torse ; il était d’une longueur disproportionnée. À l’aide de son couteau ouvert, dont il savait l’exacte dimension, Francisco mesura le Mercurien ; voici les diverses longueurs :
Le corps tout entier, du pied au sommet du crâne : 1 m. 20.
La tête seule : 0 m. 20.
Le bras, de la naissance à l’extrémité des griffes : 0 m. 65.
La jambe, du pied à l’endroit où la cuisse prenait fin et où commençait le torse : 0 m. 60.
Le captif était de grosseur proportionnée, plutôt mince et élancé.
Comme sa main, que terminaient trois énormes griffes aiguës, faites d’une matière étrangement métallique, son pied, en forme de sabot de cheval, avait aussi trois griffes, plus courtes, mais plus épaisses, deux en avant et une en arrière, comme l’ergot d’un coq.
Mais la chose la plus prodigieuse, en cette création extra-terrestre, était la contexture même, la matière de son corps ; à palper son bras, sa cuisse, son torse, son crâne, les Terriens eurent la sensation de toucher du bois d’ébène chauffé. Évidemment, la densité de cette chair était supérieure à la densité de la chair humaine ; le corps était plus solidement construit et charpenté et, pourtant, on sentait que sa pesanteur spécifique était inférieure à la pesanteur d’un corps humain de même taille.
Quand toutes ces constatations furent faites, Paul de Civrac dit gravement :
– Nous sommes dans un monde bien différent du nôtre… Plus tard, peut-être, nous l’expliquerons… Pour le moment, il faut songer à vivre…
– Ça ne va pas être commode ! fit Brad.
– Il faudrait entrer en relations amicales avec ces individus ; insinua Bild.
– Comment persuader à celui-ci que nous ne lui voulons pas de mal ? dit Lola.
– Je vais essayer !
Et Paul, écartant ses compagnons, resta seul devant le Mercurien. Il se recula lui-même de trois pas et commença une série de saluts, de gestes amènes, de sourires ; il porta les mains à sa bouche dans le geste de manger ; il se coucha sur le sol et simula l’action de dormir. Puis, se rapprochant du monopède, il montra la voûte des arbres, ramassa une pierre, la jeta en l’air et suivit du doigt tendu sa retombée.
Par cette mimique, il espérait faire comprendre que, tombés du ciel, leur seul désir à eux cinq était de manger et de dormir tranquillement.
Puis il attendit.
Le monopède avait suivi d’un œil courroucé les évolutions de l’homme. Il ne répondit que par un long sifflement.
Alors, Civrac défit le nœud de la ceinture et, peu à peu, délivra le captif. Quand toute la ceinture fut déroulée, il s’écarta…
Libre, le Mercurien commença d’abord par agiter son bras et sa jambe, sans doute ankylosés… Ensuite, il regarda successivement les quatre hommes et plus longtemps la jeune fille… Son œil sanglant n’exprimait rien. Sa trompe siffla cinq petits coups. Et soudain il fléchit le genou, se détendit comme un ressort, sauta, bondit par-dessus la tête de Brad et disparut en quelques secondes dans le mystère de la forêt.
CHAPITRE III
QUI FINIT PAR DEUX ENLÈVEMENTS DISSEMBLABLES
– Adios ! fit Francisco quand le monopède fut parti.
– Pensez-vous qu’il ait compris ? demanda Lola.
– J’en doute ! répondit Civrac.
– Cocasse individu ! grommela Bild.
– Mais, sapristi ! pourquoi est-il en bois ?
– En bois, vous croyez ? fit Brad, sardonique.
– Décidément, disait Paul, comme se parlant en lui-même, je suis de plus en plus convaincu que nous sommes sur la planète Mercure.
– Hein ? Belle conviction, fit Bild, mais d’où vient-elle ?
– L’intensité de la lumière et de la chaleur… Vous savez que Mercure est la planète la plus rapprochée du Soleil… D’autres indices encore… Tenez ! nos astronomes savent, grâce à l’observation comparative des planètes, que, sur Mercure, la densité des matériaux est un tiers plus forte que sur la Terre. De là cette dureté de la chair du monopède, de là ces feuillages quasi métalliques, de là cette résistance des herbes rousses…
– Alors, comment se fait-il que nous ne nous sommes pas écrasés en tombant sur des herbes et un sol aussi durs ? objecta Bild.
– Justement ! répliqua Paul. L’atmosphère de Mercure est beaucoup plus dense que celle de la Terre ; en outre, notre pesanteur est diminuée de moitié ; nous sommes descendus presque aussi mollement qu’une feuille de papier jetée d’une tour. Tout cela me fait penser que cette planète est Mercure… Et voyez là, par cette éclaircie de feuillage…
– Eh bien ?
– Remarquez ce rayon de lumière… Il tombe perpendiculairement, n’est-ce pas ?
– Oui.
– Quelle heure avez-vous ?
– Cinq heures et demie ! fit Bild après avoir consulté sa montre.
– Parfait ! rappelez-vous qu’à une heure la lumière, sur la prairie rousse, tombait des nuages en rayons perpendiculaires… Notre ombre ne se voyait qu’entre nos pieds écartés, vous rappelez-vous ?
– Oui.
– Cela prouve donc que le soleil, qui est au-dessus des nuages, n’a pas changé de place par rapport à nous… Or, savez-vous la dernière opinion de l’astronome français Camille Flammarion ?
– Non !
– La voici, résumée : À cause de sa grande proximité de cette planète le Soleil a, pour ainsi dire, immobilisé le globe de Mercure, comme la Terre l’a fait pour la Lune, en la forçant à lui présenter constamment le même côté. Conséquence : jour éternel sur l’hémisphère ensoleillé, nuit perpétuelle sur l’autre hémisphère et zone crépusculaire assez large entre les deux.
– Je comprends ! s’écria Bild. Nous sommes tombés au centre de l’hémisphère ensoleillé et le Soleil ne se couchera jamais pour nous… Nous sommes immobiles sous lui !… Eh bien ! puisque nous sommes sur Mercure, vive Mercure !…
Et Bild brandit en l’air ses deux énormes mains, tandis que Lola admirait Paul et que Brad et Francisco, assez indifférents à ce qu’ils venaient d’entendre, fouillaient des yeux la forêt…
– Mercure ou non, dit Brad d’une voix sourde qui contrasta avec celle de Bild, Mercure ou non, ce monde ne me réjouit guère… Taisez-vous une minute, et écoutez…
Chacun tendit l’oreille… Et de tous les points de la mystérieuse forêt arrivèrent de légers sifflements, lointains encore, mais continuels et innombrables… leur bourdonnement aigu se rapprochait sans cesse…
– Nous allons avoir sur le dos des milliers de ces petits monstres noirs ! murmura Bild.
– Que faire ? dit Lola Mendès, apeurée…
– Attendons ! fit Paul de Civrac en lui prenant la main…
Il ajouta plus bas, pour elle seule :
– Lola, ne craignez rien, je suis là… Je mourrai plutôt que…
– Merci, Paul ! répondit-elle en rougissant.

Et leurs regards se croisèrent, brillants de confiance et d’amour, d’un amour encore inexprimé en paroles. Malgré le danger menaçant, ils se sentirent tout imprégnés d’un grand bonheur, d’une joie indicible et profonde ; en cette minute, silencieusement, Paul et Lola s’étaient donnés l’un à l’autre…
Les sifflements devenaient de plus en plus forts. Bientôt, ils emplirent l’air et les échos des nuages les centuplèrent…
Et, soudain, dans l’ombre relative de la forêt, un œil rouge brilla, puis vingt, puis cent, puis un nombre incalculable, sans cesse accru… Et l’on entendait le crissement aigu des griffes pédestres sur les feuilles métalliques jonchant le sol.
Le cercle des petits monstres noirs se resserrait sans cesse. Les premiers en ligne n’étaient bientôt plus qu’à dix pas du groupe des Terriens. Aussi loin que pouvaient porter leurs regards, les quatre hommes et la jeune fille voyaient les têtes plates se succéder, des trompes s’agiter et des milliers d’yeux rouges étinceler entre les troncs d’arbres.
– Paul, fit Bild, ils vont nous attaquer.
– Nous n’avons pas d’armes ! fit Brad.
– Eux non plus, dit Francisco.
– Ils ont leurs griffes !
Terrifiée, Lola Mendès se serrait contre Civrac, qui la tenait par la taille. Et le jeune homme frémissait du bonheur d’étreindre Lola bien plus qu’il ne pensait au danger d’une attaque des Mercuriens.
– Que faire ? Que faire ?
– Essayons de parlementer !
Et Civrac, de son bras libre, commença des gestes.
Mais des sifflements aigus déchirèrent l’air : le premier rang des Mercuriens s’élança, suivi par toute l’innombrable foule.
Bild saisit par la jambe un monopède et, s’en servant comme d’une massue, il se mit à frapper devant lui. Brad l’imita. Ils s’ouvrirent ainsi un passage.
– Suivez-nous ! Suivez-nous ! cria Bild.
– À reculons ! hurlait Brad.
Francisco brandissait son couteau catalan et l’enfonçait dans les yeux rouges. Chargeant sur son épaule Lola évanouie soudain, Paul de Civrac la défendait malaisément avec son bras libre. Et tous les deux, à reculons, suivaient Bild et Brad.
Mais que pouvaient quatre hommes contre cette multitude de monstres à griffes ? Dans un vacarme de cris et de sifflements qui se répercutaient indéfiniment dans le ciel, les Mercuriens se ruaient à la suite de Paul et de Francisco. Ceux qui étaient devant Bild et Brad s’écartaient pour éviter leurs coups ; mais ils se rejoignaient derrière eux, si bien que le Français, l’Espagnol et Lola furent bientôt séparés des deux Américains…
Soudain, le couteau de Francisco, portant à faux sur le crâne d’un monopède, se cassa net. La lame tomba. Francisco, instinctivement, voulut se baisser pour la ramasser, mais vingt monopèdes sautèrent sur lui, le saisirent, l’immobilisèrent.
– À moi ! à moi ! criait-il.
– Au secours ! hurlait en même temps Civrac.
Il venait de glisser et de tomber. En un clin d’œil, il fut, lui aussi, maintenu à terre par les monstres. Il entoura Lola de ses deux bras et ne tenta plus de résister. Mais on l’aurait tué plutôt que de lui arracher le corps inanimé de la jeune fille.
Cependant, aux appels de leurs compagnons, Bild et Brad s’étaient retournés. Ils virent l’impossibilité d’aller au secours des captifs. Ils en étaient séparés par une distance de plus de cent mètres et, sur cet espace, les Mercuriens se pressaient, tumultueux, griffes en avant… Chaque monopède abattu était aussitôt remplacé par un autre. Pendant ce temps, les Mercuriens emportaient les captifs toujours plus loin.
– Bild, nous ne les rattraperons pas !
– Non, Brad ! non !
– Le mieux est de nous échapper !
– Nous nous mettrons ensuite à leur recherche.
– Juste !
– Annexe-toi un autre monstre. Brad, le tien est démoli.
– Le tien aussi.
– All right !
Et, jetant l’informe cadavre qui, jusqu’à présent, leur avait servi de massue, chacun d’eux saisit un monopède vivant. Et, le brandissant comme un fléau, ils recommencèrent à frapper.
Ils étaient pourtant couverts de blessures. Les terribles griffes des Mercuriens avaient fait sur leurs bras, leurs cuisses, leurs flancs, de longues et profondes déchirures d’où le sang coulait…
– Vers la prairie rousse, Brad !
– Allons, Bild !
Et les deux hommes, bondissant, frappant, hurlant, se dirigèrent vers la vaste prairie aux herbes rousses. Ils se savaient maintenant plus rapides à la course que les monopèdes. Ils espéraient donc, une fois en terrain découvert, pouvoir échapper plus facilement que dans cette forêt, où les troncs des arbres serrés étaient de continuels obstacles.
Cependant, une centaine de monopèdes emportaient Francisco, Paul et Lola. Ils les avaient garrottés avec une corde fibreuse de couleur jaune. De leurs bras réunis, douze Mercuriens formèrent une sorte de brancard à claire-voie sur lequel était portée la jeune fille ; douze autres transportaient de la même manière Francisco et douze autres Paul de Civrac, qui avait abandonné le corps de Lola quand il comprit que les insensibles brutes l’auraient déchiré avec leurs griffes pour le lui arracher.
Suivant un large sentier aux méandres nombreux, ils allaient vite, silencieux, sans aucun de leurs sifflements. Bientôt, Paul et Francisco, qui perdaient toute leur présence d’esprit, n’entendirent plus le bruit de la bataille que soutenaient Bild et Brad.
– Señor, dit Francisco, où nous mènent-ils ?
– Dans une de leurs villes, sans doute… Car il n’y a plus à en douter : ces horribles monstres sont des êtres intelligents…
– Et Brad et Bild ?
– Hélas !…
– La Señorita est toujours évanouie, Señor.
– Cela vaut mieux ; tu ne lui vois aucune blessure, n’est-ce pas ?
– Aucune… et vous ?
– Je n’ai que deux égratignures à la cuisse droite, mais toi-même ?

– Rien, Señor, rien ! une déchirure à chaque bras… Cela ne vaut pas la peine d’en parler… Mais, dites-moi, Señor, ces moricauds n’ont pas l’air de nous vouloir du mal…
– Pour le moment, non ! Il faut attendre !…
– Attendons ! Que saint Jacques de Compostelle nous protège ! Nous sommes tombés dans un pays infernal !…
Tout à coup, les deux hommes ne virent plus au-dessus d’eux la voûte des arbres.
La clarté soudaine les aveugla et ils sentirent l’horrible chaleur de la lumière crue.
– Señor ! la forêt est finie…
Paul tourna la tête.
– Francisco ! nous sommes au bord du Fleuve d’Or !
Et l’aspect de ce fleuve était si étrange que les deux captifs oublièrent leur situation pour s’étonner et admirer.
À leurs pieds, le long d’une berge basse couverte d’herbes rousses, coulait un stupéfiant liquide : il était d’un jaune brillant, opaque, et ses ondes lourdes roulaient, avec des boursouflures, comme roulerait dans un chenal accidenté un ruisseau d’or en fusion…
Le fleuve avait à cet endroit une largeur d’environ cent mètres ; quant à sa profondeur, elle était inappréciable, puisque le liquide n’avait aucune transparence.
– Señor ! Señor ! regardez ! s’écria Francisco.
Pendant que les deux hommes admiraient le fleuve, les Mercuriens s’étaient rangés, sur la terre, en un triangle compact, les porteurs et les captifs au centre.
Un Mercurien se détachait, seul, à la pointe du triangle tournée dans le sens du courant. Ce Mercurien semblait être un chef, à en juger par sa taille plus haute et par un large anneau d’or flexible qui encerclait sa trompe. Il fit entendre un sifflement prolongé, leva le bras et, aussitôt, d’un même bond, toute la phalange sauta sur le fleuve.
Elle n’enfonça pas dans le liquide.
Mais, portée comme un radeau, entraînée par le courant, elle glissait, avec des ondulations produites par les remous et en faisant du soixante à l’heure…
À la base du triangle des Mercuriens, dix monopèdes étaient alignés perpendiculairement ; ils étaient agenouillés, ceux-là, et ils plongeaient leurs bras, jusqu’au bout, dans le liquide jaune… Et Paul, qui les voyait parfaitement, remarqua qu’ils modifiaient l’inclinaison de leurs bras selon des sifflements divers lancés par le chef dressé à la pointe du triangle…
– Francisco ! dit Paul, avez-vous vu comment ils font gouvernail ?…
– Je vois, je vois, Señor !…
Et l’Espagnol écarquillait ses yeux ahuris, autant que le lui permettait l’intensité de la lumière.
Quand on fut arrivé, en diagonale, au centre du fleuve, les bras des dix monopèdes sortirent du fleuve – et l’on fila dès lors en ligne droite…
Malgré les sollicitations faites à leur curiosité par le paysage et les événements extraordinaires, Paul et Francisco ne perdaient pas de vue Lola Mendès… Elle était toujours évanouie… Mais au moment où, sur les rives, la forêt finissait pour faire place à une prairie d’herbes rousses d’un côté et de l’autre aux premiers escarpements des montagnes d’ardoise, Paul vit que Lola s’agitait sur les bras des porteurs… Presque aussitôt, elle ouvrit les yeux.
– Lola ! cria-t-il, ne vous effrayez pas !…
– Paul !
– Ne vous effrayez pas, je vous en conjure, et ne remuez pas !… Nous sommes prisonniers des Mercuriens… Ils nous emportent je ne sais où, mais ils ne paraissent avoir aucune mauvaise intention à notre égard…
– Qu’est-il arrivé ?… Où est Francisco ?… Où sont Bild et Brad ?
– Señorita, je suis là !… dit l’Espagnol.
Civrac, en quelques mots, raconta la bataille et ses résultats ; il décrivit le passage du sol sur le fleuve… Il achevait à peine de parler lorsque Francisco cria :
– La Roue Fulgurante ! la Roue Fulgurante !…
– Bild et Brad ! s’exclamait en même temps Paul de Civrac…
Les Mercuriens aussi avaient vu le phénomène aérien, car ils se mirent à siffler et à agiter fébrilement trompes et bras.
Et ce qui arriva aussitôt fut la chose vraiment la plus extraordinaire de toute l’exorbitante aventure…
Au milieu de la prairie rousse, Bild et Brad couraient, poursuivis par une foule de Mercuriens… Au-dessus d’eux, à une hauteur difficilement appréciable, la Roue Fulgurante tournait dans, une direction parallèle au cours du Fleuve d’Or.
Et soudain, dominant les sifflements des monopèdes, un grondement retentit, répercuté jusqu’à l’infini par les échos des éternels nuages verts.
La Roue Fulgurante atténua son éclat, et les captifs virent bondir vers la roue, aspirés comme à Bogota, Bild et Brad enlacés, puis une vingtaine de monopèdes gesticulants…
Les corps volants disparurent dans une fulguration de la Roue, et la Roue elle-même, avec l’éclat de mille tonnerres, s’évanouit brusquement en pleins nuages.
Cependant, rapide, le Fleuve d’Or entraînait vers l’inconnu les trois captifs altérés, suants, aveuglés, sur les bras des Mercuriens sifflants.
TROISIÈME PARTIE
LES MERCURIENS
CHAPITRE PREMIER
OÙ DES SCÈNES D’HORREUR ONT POUR DÉNOUEMENT UN ACCIDENT TERRIBLE
La rapide glissade au courant du Fleuve d’Or dura longtemps. L’intensité de la chaleur torride et de l’éblouissante lumière avait abattu Paul de Civrac, Lola et Francisco. Inconscients, les yeux fermés, ils restaient étendus sur les bras de leurs porteurs et ils n’avaient pas la force d’échanger leurs impressions.
De temps en temps, seulement, ils s’appelaient l’un et l’autre et ils tiraient un peu de courage de se constater mutuellement vivants.
Aucun d’eux n’aurait pu dire combien d’heures dura cette agonie dans la chaleur et la lumière ; seule, Lola possédait une montre, mais le petit chronomètre était arrêté, et la jeune fille, les bras liés, ne pouvait pas le retirer de sa ceinture.
Le silence autour d’eux était absolu. À de longs intervalles, ils entendaient seulement le sifflement du monopède à la trompe annelée d’or.
Soudain, la nuit succéda au jour, et la fraîcheur à la torréfiante température. Les trois Terriens ouvrirent les yeux en même temps et virent qu’on venait d’entrer dans un canal souterrain… L’obscurité n’était cependant pas complète. Le Fleuve d’Or, sur lequel on se trouvait toujours, irradiait une clarté jaunâtre. Il était d’un cours encore plus rapide. Les captifs voyaient les parois noires et accidentées du souterrain glisser vertigineusement en arrière. Où les emportait-on, dans cette course folle ?…
– Lola, dit Paul (et sa voix retentit dans les profondeurs de l’insondable tunnel)… Lola, comment êtes-vous ?
– Beaucoup mieux ! Cette fraîcheur me fait du bien… À la chaleur et à la lumière du dehors, j’ai cru mourir…
– Saint Jacques de Compostelle soit béni ! s’écria Francisco, qui signala son contentement par son invocation habituelle. Mais où diable allons-nous ?
Brusquement, la glissade fut arrêtée, les prisonniers perçurent que leurs porteurs sautaient sur la terre ferme… la troupe entière des monopèdes s’enfonça dans un tunnel latéral, et les Terriens virent disparaître derrière eux le reflet jaune du Fleuve d’Or. C’était maintenant la nuit absolue.
– Lola ! cria Paul.
– Je suis là !
– Francisco !
– Présent, Señor !
– Ces monstres y voient dans la nuit, reprit Civrac, comme les animaux nyctalopes…
– Ils ignorent évidemment l’usage de la bougie, de la lampe ou de la torche… murmura Lola Mendès.
– Et probablement l’usage du feu ! Si nous y sommes obligés, et si nous pouvons plus tard chercher notre salut dans la fuite, comment sortirons-nous de ces cavernes ténébreuses ?… Ah ! combien je regrette maintenant d’avoir perdu mon fanal électrique en tombant de la Roue Fulgurante !…
– Señor ! j’ai une boîte d’allumettes dans ma poche ! dit Francisco en riant.
Un sifflement lointain se fit entendre, auquel répondit un sifflement pareil du chef, qui marchait en avant. Paul leva un peu la tête et vit, à quelque distance, une clarté pâle…
– Attendons ! dit-il philosophiquement.
Quelques instants après, la troupe des Mercuriens débouchait dans une salle prodigieusement vaste. Elle était vaguement éclairée par les radiations d’un étroit ruisseau de liquide jaune méandrant sur le sol. Plusieurs fois, d’un bond fait avec ensemble, les porteurs franchirent ce ruisseau lumineux. Et soudain, ils s’arrêtèrent, déposèrent à terre leurs captifs, l’un près de l’autre, les débarrassèrent de leurs liens, s’écartèrent d’eux et se mirent à siffler tous sur un mode parfaitement rythmé…
Puis, comme une volée de bêtes nocturnes, ils se dispersèrent dans l’immense salle souterraine et disparurent par des couloirs dont les orifices faisaient, dans les parois éclairées, d’inquiétants trous de ténèbres.
Les trois captifs, bras et jambes libres, se trouvaient seuls.
Mais cette solitude fut si courte qu’ils n’eurent même pas le temps d’échanger leurs impressions…
En masses serrées, des centaines et des centaines de monopèdes surgirent des trous ténébreux. Ils se pressaient autour des captifs adossés à la paroi rocheuse, et leur demi-cercle devenait de plus en plus compact… leurs yeux rouges brillaient comme de petits phares mouvants, leurs trompes s’agitaient et sifflaient, leurs bras faisaient des gestes saccadés… Mais, tout à coup, sans cause apparente, ce fut, dans cette innombrable foule de monstres noirs, l’immobilité, le silence les plus absolus.
Alors, Lola, Paul et Francisco virent deux monopèdes, sautant sur les têtes de la multitude, s’avancer rapidement vers eux. Par un dernier bond, les deux Mercuriens tombèrent à quatre pas devant les Terriens. Leur trompe était tout entourée d’un flexible fil d’or. Sans doute, c’étaient deux grands chefs du monde mercurien…
Cependant que ces puissants entre les monopèdes se tenaient immobiles et droits, dardant chacun leur unique œil rouge, Paul dit à Lola Mendès, en lui prenant la main :
– N’ayez pas peur…
– Non, Paul, je n’ai pas peur… Il ne peut rien nous arriver de pire que la mort.
– Et c’est ensemble que nous mourrons, Lola ! dit Paul d’une voix grave.
– Merci ! murmura la jeune fille à demi voix.
– Avant qu’une de ces sales bêtes vous touche, Señorita, gronda Francisco, j’en aurai démoli un bon nombre…
– Francisco, pas un geste sans ma permission ! ordonna la courageuse Espagnole.
Mais l’un des chefs mercuriens leva le bras, le laissa retomber, et, aussitôt après, il fit entendre une suite de sifflements brefs et longs, cadencés, séparés par des silences. Il parlait. Mais pouvait-il se figurer que les prisonniers le comprendraient ? Son compagnon lui succéda et, à son tour, siffla longtemps. Puis ils parurent attendre.
Avec lenteur, Paul se leva. Il voulait répondre selon ses moyens. En accompagnant sa parole de gestes expressifs, il dit simplement :
– Nous avons faim et soif.
Puis il se rassit.
Les deux chefs se consultèrent en hochant leur tête de rat, en remuant leur trompe et en sifflant. Puis ils se retournèrent vers la foule et firent un geste.
Les rangs pressés des Mercuriens s’écartèrent, et quatre monopèdes apparurent, rapides, portant une masse noire plus grosse qu’eux. Ils la déposèrent devant les trois Terriens et se retirèrent.
Le cercle de la multitude s’était resserré jusqu’à toucher les deux chefs. Et les milliers d’yeux rouges restaient fixes ; évidemment, on attendait pour voir ce qu’allaient faire les prisonniers.
Cependant, Paul examinait la masse noire qu’on avait jetée devant lui.
– Mais c’est un Mercurien ! s’écria-t-il, sans griffes au bras ni à la jambe et plus gros que les autres…
– Ça m’a tout l’air d’un Mercurien engraissé, dit Francisco.
– Y comprenez-vous quelque chose, Lola ?
– Non !…
Ils réfléchirent un moment et, soudain, Paul murmura :
– J’ai peur de comprendre !…
La conduite des Mercuriens ne devait pas tarder à lui être expliquée.
Devant l’inaction des prisonniers, les deux chefs se consultèrent de nouveau. Puis l’un d’eux s’agenouilla près de la tête du monopède étendu.
Et ce que les Terriens virent alors leur fit pousser un cri d’horreur.
Dans l’œil rouge, dans l’œil énorme et proéminent du monopède étendu sur le sol, le chef agenouillé enfonça d’un coup vif sa trompe à ventouse… Et, tandis que la masse s’agitait convulsivement par cet œil maintenant crevé, d’où dégouttait un liquide blanchâtre, qui était sans doute le sang mercurien, le chef pompait avidement sa nourriture…
– Oh ! Paul ! Paul ! gémit Lola en se cachant le visage dans les mains.
Paul et Francisco étaient figés. Et le Français comprit en un éclair bien des choses. Les Mercuriens se dévoraient entre eux. Sans doute, rien ne vivait sur leur terre ardente, rien qu’eux-mêmes. Ils devaient se reproduire prodigieusement, pulluler comme des rats et des lapins terrestres ; et, pour vivre, autant que pour compenser cette surproduction intensive de leur espèce, les Mercuriens se mangeaient entre eux. Quelles étaient les lois et les coutumes réglementant le choix, la captivité, l’engraissement des victimes nourricières ?… Il aurait fallu vivre longtemps dans le monde mercurien, comprendre son langage, observer ses mœurs pour le savoir. Mais le fait incontestable était là : les Mercuriens se mangeaient entre eux !
Et, comme si le spectacle du chef pompant la vie du captif avait excité les appétits de la foule, il y eut un étourdissant concert de sifflements, de remous tumultueux. D’autres monopèdes, gras et sans griffes, furent apportés dans l’espace vide, devant les Terriens. Et la multitude des monstres se rua… les trompes à ventouses crevaient les yeux, se gonflaient de liquide blanchâtre…
– Paul ! Paul, gémissait Lola…
Fascinés par le spectacle, Paul et Francisco n’avaient pas la force de faire un mouvement.
Et bientôt, les monopèdes nourriciers n’étant sans doute pas assez nombreux en cet endroit, ils virent les Mercuriens de taille relativement grande terrasser d’autres Mercuriens plus petits, les maintenir à terre… Ce fut partout l’assouvissement horrible…
Tout à coup, Paul eut un frisson d’angoisse. Un cri déchirant de Lola venait de frapper ses oreilles et de rompre le charme de la fascination.
– Demonios ! hurla Francisco, on nous enlève…
Lola disparaissait, entraînée par un groupement de monstres. Et les griffes écartaient ses mains, et des trompes pointaient vers ses yeux agrandis par l’effroi…
Paul bondit, armé d’un monopède qu’il venait de saisir par la cheville… Francisco se débattait déjà au milieu du groupe des ravisseurs.
Comment parvinrent-ils à arracher Lola aux êtres immondes ?… Francisco avait enlevé la jeune fille et s’était mis à courir, en bonds énormes, par-dessus les Mercuriens tumultueux, vers le trou noir d’une galerie. Paul le suivait, frappant autour de lui avec des monopèdes qu’il saisissait, qu’il brandissait et qu’il rejetait ensuite lorsque la masse vivante s’était transformée en une informe loque visqueuse.
Tout en fuyant et en frappant, il réfléchissait, avec une étrange acuité d’intelligence et une étonnante rapidité de pensée.
– Francisco ! cria-t-il, nous n’y verrons pas dans la galerie et eux nous verront !
– J’ai mes allumettes ! répondit l’Espagnol, haletant…
– Prends garde de ne pas bondir trop haut… tu te briserais le crâne contre le roc…
– Merci ! j’y penserai…
Ils arrivaient à la galerie. Francisco et son fardeau disparurent dans les ténèbres.
– Crie ! Crie, Francisco ! afin que je ne te perde pas !…
Et, à son tour, il sauta dans le trou de la galerie.
Francisco poussait un cri à chaque bond. Paul le suivait et lui répondait, tout en frappant. Soudain, il s’aperçut qu’il se démenait en vain : il n’avait autour de lui aucun Mercurien. Il jeta l’informe débris de monopède qu’il tenait encore et, préoccupé seulement de ne pas perdre Francisco, il accéléra sa course…
Il entendit la rumeur des sifflements décroître peu à peu, puis elle s’évanouit tout à fait.
– Francisco ! appela-t-il.
– Señor !
– Arrêtons-nous !
– Pourquoi ?
– Je n’entends plus rien… On ne nous poursuit pas.
– Halte ! alors… Là, Señor, me voici… N’allez pas plus loin… Attendez que je dépose la Señorita sur le sol et que j’enflamme une allumette…
– Paul ! Paul ! appela Lola Mendès.
L’excès même du danger l’avait empêchée de s’évanouir.
– Lola ! Êtes-vous blessée ?…
– Non, pas une égratignure… Ah ! quels monstres !… Francisco, tu m’as sauvée…
– Bon, bon Señorita ! Je crois que tout n’est pas fini, demonios !
Une allumette craqua… Une petite flamme bleue jaillit et s’éleva dans l’air, au bout des doigts de Francisco.
Le Français et l’Espagnol se virent alors ensanglantés, les vêtements en lambeaux.
– Mon Dieu ! s’écria Lola, êtes-vous blessés, tous les deux ?…
– Non, des écorchures superficielles… Ce n’est rien… Mais vous, vous ?
À la main droite seulement, Lola souffrait d’une légère égratignure. Mais le bas de sa jupe était déchiqueté.
– Allons, pas de mal ! fit Francisco… Il va falloir se tirer de là… Où sommes-nous ?
Et comme l’allumette s’éteignait, il en fit craquer une autre, les trois fugitifs examinèrent rapidement les lieux. Ils se trouvaient dans une haute et large galerie, aux noires parois d’ardoise.
– Il faut continuer à courir, dit Paul. Surprise par notre résistance et notre fuite, la foule des Mercuriens est sans doute irrésolue… Mais les chefs ne tarderont pas à reprendre leur autorité et à mettre l’ordre ; on va certainement nous poursuivre. Nous avons de l’avance ; il faut l’augmenter encore.
– Partons, dit Lola en se levant.
– Vous sentez-vous la force de courir ?
– Oui.
– D’ailleurs, vous vous mettrez entre Francisco et moi, et nous vous tiendrons chacun par une main… Notre légèreté spécifique est si grande que vous n’aurez aucun effort à faire ; nous vous soulèverons comme une plume, en bondissant nous-mêmes.
– En route ! dit Francisco.
Mais il se frappa le front…
– Nous sommes stupides ! nous allons nous casser les os contre le roc, dans la nuit. Nous avons eu une chance étonnante d’être arrivés sans mal jusqu’ici. Impossible de fuir sans lumière !
Ni Lola, ni Paul n’avaient pensé au danger des ténèbres, dans cette galerie inconnue. Ils se regardèrent, découragés, et les yeux de la jeune fille s’humectèrent de larmes…
– Ah ! si Bild et Brad étaient là, dit Francisco. À quatre, nous pourrions revenir sur nos pas, gagner le Fleuve d’Or et nous laisser emporter par son courant… Il doit ressortir d’un autre côté de la montagne…
– À moins qu’il ne s’abîme dans un gouffre intérieur ! fit Paul.
– Que faire ?…
– Écoutez ! souffla Lola.
Ils retinrent leur respiration… Des sifflements leur parvinrent.
– On nous poursuit !…
– Malheur de malheur ! gronda Francisco.
Paul fit un geste de rage en levant les yeux, comme pour implorer le ciel. Mais, aussitôt, il poussa un faible cri.
– Nous sommes sauvés ! murmura-t-il. Francisco, jette ton allumette qui s’éteint et allumes-en une autre…
Ce fut fait en un clin d’œil.
– Levez la tête, reprit Paul vivement ; regardez… Ce trou, là-haut, avec ces pointes de roches… Sautons… Nous nous agripperons aux pointes, nous entrerons dans le trou…
– Compris ! fit Francisco… Les sales bêtes nous dépasseront et nous reviendrons vers le Fleuve d’Or… Hop !… Señorita, permettez…
De sa main droite, au bout de son bras tendu, il levait l’allumette ; du gauche, il enserra la taille de Lola.
– Sautez le premier, Señor…
Paul bondit, s’accrocha, resta une minute suspendu et, d’un élan, entra dans le trou…
– À moi !
Et Francisco bondit à son tour. L’allumette s’éteignit. Mais l’Espagnol avait bien calculé son élan. Il donna tête la première dans la poitrine de Paul et le renversa ; lui et Lola roulèrent… le roc les arrêta…
– Señor ! souffla Francisco.
– Lola ! fit Paul.
– Je suis là, Paul…
– Vous n’avez pas frappé la pierre ?…
– Non…
– Tout va bien !…
– Oui, silence !
– Et enfonçons-nous bien dans ce trou !…
Ils se massèrent dans le fond de l’excavation et, serrés l’un contre l’autre, ils attendirent…
Les sifflements étaient devenus plus forts. Les voûtes de la galerie résonnaient d’un piétinement lointain de foule, piétinement sec et saccadé, sauts et raclements de griffes sur l’ardoise.
– Les voici souffla Paul.
Bien que leur curiosité de voir passer la multitude des Mercuriens fût ardente, les trois Terriens obéirent plutôt à la prudence. Ils ne se penchèrent pas au bord du trou… Avec des sifflements tumultueux, dans une galopade effrénée, les féroces monopèdes roulaient en fleuve bruyant à quatre mètres au-dessous de l’excavation où étaient réfugiés les êtres, bizarres pour eux, qu’ils poursuivaient. Le bruyant défilé dura longtemps.
Et pendant que les Mercuriens galopaient au-dessous d’eux, les Terriens faisaient de tristes réflexions. Reverraient-ils jamais la terre ? Hélas ! cela leur semblait impossible ! Comment y seraient-ils retournés ? Aucun moyen ne se serait présenté même à l’imagination la plus folle. Le hasard qui les avait fait aspirer par la Roue Fulgurante, ce même hasard qui avait de nouveau emporté Bild et Brad, ce hasard prodigieux se produirait-il encore ? Avoir cette espérance eût été insensé…
Lola, Paul et Francisco se voyaient donc condamnés, jusqu’à leur mort, à errer dans l’étrange monde mercurien, traqués comme des animaux de chasse par les bêtes fauves qu’étaient les monopèdes. Encore, s’ils avaient eu la chance de tomber sur une des vieilles et grandes planètes de l’Univers ! Peut-être y auraient-ils trouvé des êtres intelligents à la manière humaine, savants, bons, policés, hospitaliers ! Mais leur malheureux destin les avait jetés sur Mercure, Mercure que brûlait le Soleil, Mercure désert, Mercure peuplé seulement de monstres inintelligents et féroces qui semblaient ignorer toute science, tout art, toute civilisation…
Qu’aurait-on pu espérer, en effet, de cette horde noire et sifflante qui passait, bondissante, dans la galerie – comme une troupe d’hyènes en chasse ?… Rien ! Il n’y avait plus qu’à attendre, se résigner, d’abord, lutter ensuite, enfin d’être prêt à saisir toute chance de salut qui se présenterait. Les faits produits jusqu’à présent avaient été si extraordinaires qu’ils pouvaient donner lieu aux espoirs les plus extravagants.
Cependant, le vacarme de la chasse diminuait, il s’éloigna ; les sifflements et les bruits de la course se perdirent peu à peu dans les galeries lointaines et le silence retomba du haut des voûtes ténébreuses.
– Ils sont tous passés, dit Francisco.
– Qu’allons-nous faire ? murmura Lola.
– Allons ! dit Paul… Revenons vers le Fleuve d’Or… Et risquons-nous sur le courant… Nous resterons sur les bords, de manière à nous accrocher au rivage si nous voyons la masse liquide se précipiter dans un gouffre… Quel que soit le danger auquel nous allons, il n’est pas pire que celui de rester ici. J’ai vraiment faim, à présent…
– Moi aussi, fit Lola ; j’ai soif surtout.
– Et moi ! gronda Francisco.
– Sortons ! tâchons de revenir à la lumière… même avec la chaleur qui l’accompagne, elle est préférable à ces ténèbres de sépulcre… Et qui sait, peut-être reverrons-nous la Roue Fulgurante ! Dans notre situation, aucun incident nouveau ne peut augmenter notre détresse… Francisco, allume une allumette… Sautons et orientons-nous.
– Un moment, Señor ! fit l’Espagnol. Si vous le permettez, je vais aller en reconnaissance jusqu’à la grande grotte, afin de voir si une troupe de ces sales individus n’est pas restée en arrière de celle qui vient de passer… C’est qu’alors nous serions pris entre deux feux, si j’ose employer cette expression terrienne, comme dirait M. Jonathan Bild !
Paul sourit à l’inaltérable gouaillerie de Francisco, qu’aucune conjoncture, si dangereuse fût-elle, ne pouvait décontenancer. Mais l’avis était trop bon pour ne pas être suivi. D’ailleurs, le jeune homme y vit le moyen inattendu de rester seul avec Lola Mendès, et sa voix tremblait, non de peur, mais d’émotion, lorsqu’il répondit :
– Vous avez raison, Francisco. Allez, et soyez prudent !
– La Señorita est-elle de notre avis ? demanda l’Espagnol.
– Oui, mon ami, oui ! Va ! mais moi aussi je te conjure d’être prudent…
– On le sera, maîtresse, on le sera !
Francisco se ramassa sur lui-même, remit à Paul une allumette enflammée, et, après avoir dit : « Éclairez mon saut, je vous prie, Señor ! » il sauta hors du trou.
À la lueur de l’allumette, Civrac et Lola le virent tomber doucement sur ses pieds, ployer les genoux, se relever, enflammer une autre allumette et partir dans la direction de la grotte.
Paul et Lola étaient seuls !
L’émotion faisait battre leur cœur, et, si l’allumette que tenait encore le jeune homme ne s’était pas éteinte soudain, ils auraient vu leur visage pâlir et ils auraient surpris dans leurs yeux un trouble qui les aurait instruits plus que bien des paroles sur l’état de leur âme…
Sans se chercher, leurs mains se trouvèrent et s’unirent ; sans qu’un mot fût prononcé, leurs lèvres se touchèrent et se confondirent en un long baiser.
Ah ! qu’elles étaient loin, les terreurs du passé, les horreurs de l’heure présente et les appréhensions de l’avenir ! L’amour emportait hors du monde matériel ces deux êtres pleins de force et de vie ! Étaient-ils encore dans la planète Mercure ? Étaient-ils revenus sur la terre ?… Non ! ils flânaient, mains serrées, lèvres unies, dans les espaces indéfinissables que l’amour ouvre magnifiquement aux cœurs dont il s’empare… Ils n’étaient conscients que d’une seule chose : leur bonheur !
Quand leurs lèvres se séparèrent, ce fut pour prononcer la même parole :
– Lola, je vous aime…
– Je vous aime, Paul !
Dans les ténèbres, ils ne pouvaient se voir, mais chacun devinait le regard passionné de l’autre.
– Lola, dit Paul, quand vous m’êtes apparue dans la Roue Fulgurante, il m’a semblé que l’éclaircie dans le mur de nuages par laquelle vous êtes passée, c’était la porte du ciel qui venait de s’ouvrir. Je vous ai aimée tout aussitôt… Et vous, Lola, et vous ?
– Moi, Paul, je ne sais pas… Je pleurais et me désespérais depuis mon incompréhensible enlèvement… Mais quand mes yeux ont rencontré les vôtres, ma peine et ma peur s’en sont allées… Depuis, il me semble que je fais un rêve merveilleux et très doux, un rêve que des éclairs de cauchemar rendent encore plus exquis… Paul !…
Il la sentit qui se laissait aller mollement dans ses bras. Et il l’étreignit avec force en murmurant :
– Lola, Lola, je t’aime… je t’aime… Oh ! que je suis heureux de t’aimer !…
Et il couvrit son visage de baisers, cherchant ses lèvres que, par pudeur de vierge, elle lui dérobait…
Ah ! toute-puissance de l’amour !… Mis en présence par un enchaînement de faits aussi terrifiants qu’invraisemblables ; jetés dans des périls d’autant plus effroyables qu’ils étaient toujours inconnus et nouveaux ; abandonnés dans un monde de surprises terribles et d’épouvantements ; pourchassés par des êtres immondes, innombrables et féroces ; menacés enfin à chaque minute, à chaque pas, à chaque souffle d’une mort sans cesse plus imminente et cruellement diverse, Paul et Lola, dans les bras l’un de l’autre, n’avaient de pensées que de bonheur, de gestes que pour des caresses, de paroles que pour se balbutier leur passion, ils n’avaient de vie que pour s’aimer !…
La Roue Fulgurante, les Saturniens, la planète Mercure, les monopèdes, les scènes atroces et sanglantes, la chasse horrible, le danger continu, la mort embusquée dans les ténèbres : tout cela n’existait pas pour Lola Mendès et Paul de Civrac !
Il n’y avait, dans un monde indéterminé, que deux êtres vivants : eux ! Une seule chose subsistait dans l’univers : leur amour !…
Et lorsque, enfin vaincue, extasiée, Lola présenta ses lèvres aux baisers de Paul, la planète mystérieuse qu’ils habitaient aurait pu éclater comme un obus éclate dans les airs, Paul et Lola ne l’auraient jamais su : ils auraient passé de la vie à la mort sans que leur ravissement en fût troublé pendant un millième de seconde !
– Oh ! Paul ! gémit Lola, je ne savais pas ce qu’est le bonheur !…
– Lola ! Lola !
Et il ne pouvait prononcer d’autres syllabes que celles qui formaient ce nom…
Et de nouveau, avides d’une joie si divine, leurs lèvres s’unissaient, lorsqu’un cri les frappa comme d’un brutal cinglement d’épée. Leur étreinte se dénoua, leurs yeux s’ouvrirent et, dans la profondeur de la galerie faiblement éclairée, ils virent arriver un homme…
– Où sommes-nous ? murmura Lola d’une voix de rêve…
Mais aussitôt elle reprit conscience d’elle-même et de toutes choses, en même temps que Paul criait :
– Francisco ! C’est Francisco !
– En personne, Señor !…
Et sous leurs yeux, l’Espagnol se dressa, levant à bout de bras une allumette enflammée.
– Señorita, la voie est libre… nous pouvons nous sauver… Vite ! sautez tous les deux, et suivez-moi…
Paul et Lola échangèrent un dernier serrement de main, se redonnèrent leur âme dans un regard et, ensemble, ils sautèrent.
Peu d’instants après, les fugitifs arrivaient dans la vaste salle où s’était consommé l’horrible festin des monopèdes. Ils se détournèrent avec horreur des masses noires et flasques qui gisaient çà et là sur le sol.
– Suivons le Ruisseau d’Or, dit Paul.
Ils sortirent de la salle par un étroit couloir au long duquel, laissant une corniche entre la paroi et lui, coulait le ruisseau lumineux.
– Lola, dit Paul, avez-vous votre montre ?
– Oui.
– Voulez-vous me la confier ?
– La voici.
Civrac tourna le remontoir, manœuvra les aiguilles et leur fit marquer midi.
– Nous ne pouvons savoir, dit-il, quelle heure il est, au sens terrestre. Cela n’a d’ailleurs pour nous aucune importance. Je mets la montre à midi. L’instrument nous servira simplement à marquer les heures qui s’écoulent. Cela pourra nous être utile.
Et, avec sa cravate, il attacha solidement la montre à sa ceinture.
Cependant, on marchait toujours. Les aiguilles marquaient midi un quart lorsque les Terriens débouchèrent dans une sorte de rond-point d’où partaient plusieurs galeries et où le ruisseau mêlait son filet de liquide jaune aux masses profondes du Fleuve d’Or.
– Les Mercuriens montent sur ce liquide, dit Paul, et s’y tiennent sans enfoncer, comme sur le sol ferme. Essayons.
Il avança un pied et pressa sur la nappe de l’onde lourde… Il sentit une résistance comparable à celle de l’argile, et il n’enfonça que de quelques centimètres. Mais le liquide jaune était chaud. Chaleur supportable, d’ailleurs.
– Votre main, Lola !… Francisco, faites comme moi.
Et, entraînant la jeune fille, il mit les deux pieds sur l’étrange fleuve. Francisco sautait à la suite de Lola, qu’il tenait aussi par la main. Immédiatement, le courant les entraîna, et ils glissèrent le long des parois rocheuses avec rapidité.
Le canal souterrain où coulait le fleuve avait une largeur d’environ cinquante mètres ; mais sa hauteur était inappréciable. Les radiations jaunes que produisait le liquide lumineux parvenaient à peine à la voûte, qui s’estompait dans l’ombre, très haut, montrant des arêtes aiguës et des masses noires surplombantes…
– Où allons-nous, mon Dieu ? soupirait Lola.
Et son cœur se serrait, car un pressentiment atroce venait de surgir dans son esprit.
Ils glissaient dans l’air, comme portés par un trottoir roulant. Paul et Francisco se tenaient tout près de la paroi, décidés à ralentir et à interrompre la course, si cela devenait nécessaire, en s’accrochant aux arêtes du roc ; dans cette prévision, ils s’étaient entouré leur bras et leur main libres avec tout ce qu’ils avaient pu arracher de leurs vêtements en lambeaux.
Tout à coup, ils s’aperçurent ensemble que leur glissade s’accélérait et que, en aval, à une centaine de mètres environ, le fleuve se divisait en deux branches qui s’enfonçaient dans deux galeries différentes…
– J’ai peur ! soupira Lola Mendès involontairement.
– Arrêtons, Francisco ! cria Civrac.
– Bueno !
Et leurs mains enveloppées touchèrent la paroi.
Mais, tout à leur pensée d’enrayer la marche, ils ne virent pas une forte arête rocheuse qui s’avançait de deux mètres dans le cours du fleuve… Paul, le premier, la heurta. La commotion le culbuta, lui fit lâcher la main de Lola et le lança au milieu du courant. Sans réfléchir, Francisco voulut aller à son secours… Il lâcha lui aussi la main de sa maîtresse et bondit vers Civrac. Mais on était arrivé au point de division du fleuve. Le courant plus rapide entraîna les deux hommes dans une galerie, tandis que Lola continuait, par l’autre, sa glissade désormais solitaire.
– Paul ! Paul ! À moi ! Au secours !
Les cris désespérés de la jeune fille glacèrent d’effroi ses deux défenseurs.
– Lola ! cria Paul en se relevant.
– Demonios ! jura Francisco.
Et il voulut s’élancer, remonter le courant, aller à la fourche, reprendre le bras du fleuve qui emportait la jeune fille. Ce fut en vain. Avec Paul, il fut entraîné par le courant de plus en plus rapide ; un gros remous des lourdes ondes renversa les deux hommes l’un sur l’autre. Pendant un temps inappréciable, ils roulèrent dans les ténèbres, se cherchant, s’agrippant l’un à l’autre, séparés par les remous, se retrouvant encore. Et soudain, une ardente lumière les éblouit ; ils eurent la sensation d’être arrêtés net dans leur course vertigineuse, et quand ils purent se rendre compte de ces choses, ils virent que le flot, à cet endroit tumultueux, les avait jetés sur une berge couverte de fleurs écarlates.
– Lola ! cria Paul, affolé.
À plat ventre, la tête dans ses mains, Francisco sanglotait. Civrac le regarda, stupide, et seulement alors il comprit l’effroyable malheur qui le frappait.
CHAPITRE II
TOUT OCCUPÉ PAR LES PÉRIPÉTIES D’UNE CHASSE FANTASTIQUE
C’était en lui comme un déchirement de tout son être. Lola était perdue. À ce moment, il vit toute l’horreur de cette planète ardente et mystérieuse – et il en eut un frisson d’épouvante. Tant que la jeune fille avait été avec lui, tant qu’il avait pu la conduire, la protéger, la défendre, Paul de Civrac espérait. Quoi ? Il ne le savait pas lui-même. Il espérait peut-être un providentiel retour à la Terre, ou, en tout cas, une assimilation progressive aux conditions de ce monde nouveau… Avec Lola Mendès, il y aurait vécu heureux…
Mais, à présent, Paul de Civrac se laissa aller au désespoir le plus fou. Il tomba sur ce sol brûlant, le déchira de ses ongles, le mordit…
– Lola ! Lola ! criait-il.
Seuls lui répondaient les sanglots de Francisco et les éternels échos des éternels nuages verts…
Mais la douleur humaine a des limites. Succédant à son désespoir insensé, une crise de prostration abattit le jeune homme. La fatigue de son corps aidant, il s’endormit d’un sommeil de mort…
Il se réveilla dans l’inconscience de tout. L’implacable lumière referma ses yeux aussitôt qu’ouverts. Et il entendit une voix qui disait :
– Señor ! Señor !…
Un pénible travail se fit dans son esprit. Peu à peu, il se rappela tout…
– Lola ! murmura-t-il.
– Nous la retrouverons ou j’y perdrai mon sang goutte à goutte !
À ces paroles énergiquement prononcées, Paul rougit de sa faiblesse. Il se souleva sur un coude et, ses yeux s’étant petit à petit habitués à l’intense clarté du jour éternel, il les rouvrit tout à fait. Il vit Francisco assis près de lui. Le visage ordinairement comique de l’Espagnol était si sévère et si grave qu’il impressionnait.
– Nous la retrouverons, Señor…
– Il le faut, Francisco…
Et l’aveu, plus fort que tout, sortit de ses lèvres :
– Je l’aime, Francisco… Je l’aime !…
– Tant mieux, Señor, vous n’en aurez que plus de courage à la chercher… Moi, je l’ai vue naître ; j’ai servi son père pendant vingt-trois ans et je le servirais encore si cette maudite Roue Fulgurante, que l’enfer écrase… Mais laissons le passé !… Il faut être fort… Et d’abord, vous devez manger. Voyez, faites comme moi… Pendant que vous dormiez, j’ai goûté des fleurs rouges. Ce n’est pas bon, mais ça nourrit… On dirait qu’on mange du fer : imitez-moi !
Et, tout en parlant, l’Espagnol cueillait des fleurs rouges, assez semblables à de monstrueux coquelicots, les roulait en boules, jetait ces boules dans sa bouche et mâchait vigoureusement.
Paul suivit le conseil. Il lui sembla qu’il mâchait une poignée de ces pilules ferrugineuses que les médecins de la Terre ordonnent aux anémiques…
– Et boire ? J’ai soif, dit-il, quand il se sentit rassasié.
Francisco montra du doigt le fleuve jaune qui bouillonnait lourdement à quelques pas.
– J’ai essayé aussi, dit-il… Mais ce n’est pas une boisson cela… Avez-vous jamais mis dans votre bouche une goutte de ce mercure qui garnit les thermomètres ? Moi, je l’ai fait plus d’une fois, pour amuser la Señorita, à Barcelone… Eh bien ! ce liquide du Fleuve d’Or donne la même sensation : du mercure qui serait jaune…
– Comment allons-nous faire ?
– Il faut la chercher… Levons-nous…
Le mouvement suivit la parole.
– Et agissons comme des hommes !
Peu à peu, et sous l’influence vivifiante des fleurs rouges, Paul avait repris toute son énergie. Il se leva et, mettant sa main dans celle de son compagnon :
– Francisco, nous retrouverons Lola !
– Je l’espère, señor… Nous allons nous mettre en course… Je pense qu’il faut d’abord continuer à descendre le fleuve. Peut-être le courant qui a entraîné Lola rejoint-il celui-ci à un détour de ces montagnes…
– Tu as raison… Mais nous rencontrerons certainement des Mercuriens ; il nous faut une arme quelconque.
– J’y ai pensé… Marchons jusqu’à ce petit bois gris, là-bas, qui est sur le bord du fleuve… Nous verrons s’il y a moyen de casser deux arbres pour s’en faire des massues… Et j’ai toujours des allumettes ! Si ces arbres sont d’une matière qui brûle, nous aiguiserons des pieux ; ce sera excellent pour enfoncer dans les yeux de ces sales bêtes noires !… Mais vous avez toujours la montre de la Señorita ?… Quelle heure est-il ?
Paul tira la petite montre de sa ceinture. Il ne put la voir sans une émotion qui lui fit monter les larmes aux yeux.
– Onze heures et demie, dit-il.
– Nous étions, à midi de cette montre, dans les souterrains. Nous avons perdu la Señorita une demi-heure plus tard… Bueno.
Et, sans expliquer quelles conclusions il tirait de ces choses, ou même s’il en tirait une conclusion quelconque, Francisco se dirigea vers le bois. En quelques bonds, tous les deux l’eurent atteint.
L’Espagnol ramassa une poignée des feuilles grises tombées à terre, chercha un coin d’ombre et fit craquer une allumette. Il la mit sous les feuilles. Et les fleurs flambèrent vivement, avec une grande flamme blanche…
– Caramba ! cria-t-il.
– Ces feuilles brûlent comme du magnésium ! dit Paul.
– Je ne suis pas si savant, dit Francisco ; elles brûlent, c’est le principal !
– Mais il n’y a pas de branches à ces arbres, reprit Paul. Mettons le feu à un gros amas de feuilles autour de deux troncs de grosseur convenable…
– Oui, Señor.
Quelques minutes après, deux petits feux blancs entretenus avec soin et rapidité (les amas de feuilles flambaient tout d’un coup) avaient communiqué leur incandescence à deux troncs de l’épaisseur des poteaux télégraphiques terrestres… Ils brûlaient en fusant de tous côtés, et très vite. Quand ils les virent branlants, d’une poussée, Paul et Francisco les firent tomber à terre. Et il leur fallut une demi-heure à peine pour appointer, aiguiser à la flamme une extrémité de chacun des troncs : épieux par ce bout, ils étaient massues de l’autre.
Les deux hommes chargèrent ces armes sur leurs épaules sans la moindre peine. Les pieux avaient trois mètres de long, et la matière mi-ligneuse, mi-métallique dont ils étaient faits était compacte, dense et dure : c’est dire toute la lourdeur de ces énormes bâtons. Mais, sur Mercure, la pesanteur des matériaux était diminuée de plus de la moitié du poids qu’ils auraient sur terre. Paul et Francisco maniaient leurs massues sans difficulté.
– Ah ! si Bild et Brad étaient là ! fit Paul avec regret.
– Dieu seul sait où ils sont, dit Francisco. Nous ne les verrons peut-être jamais plus… Peut-être ! car tout est si extraordinaire dans ce monde fou !… Mais, pour le moment, ils ne sont pas là, et nous devons nous passer d’eux. Votre main, Señor… Sautons !
Et, se tenant solidement, Paul et Francisco sautèrent dans le Fleuve d’Or. Il devenait moins boursouflé qu’en amont. Aussi la course était-elle facile, rapide et sans cahots. Les deux hommes, imitant les Mercuriens, se servaient de leurs pieux comme de gouvernails, et ils se maintenaient au milieu du fleuve, dans le courant plus rapide et moins accidenté.
À leur gauche s’étendait une plaine sans limites, toute couverte d’herbe rousse et de fleurs rouges ; ces deux plantes, avec les arbres gris, semblaient être les seules végétations de cette contrée, et peut-être de tout l’hémisphère ensoleillé de la planète. Çà et là, dans la plaine, se dressaient de petits bois.
À leur droite, tombant presque à pic dans le fleuve, s’élevaient de hautes montagnes noires ; leurs sommets se perdaient dans la masse croulante et lourde des nuages verts. Toujours également intense était la lumière que tamisaient ces nuages ; toujours également torride, la chaleur ! mais les deux Terriens s’habituaient à l’une et à l’autre ; seulement, la lumière leur faisait cligner les yeux sans cesse ; et la chaleur avait rôti leurs corps en un vaste « coup de soleil » qui rougit, puis brunit la peau. L’assimilation à ce milieu étrange s’était faite très vite, et bientôt même ils ne devaient prêter aucune attention aux picotements de leur chair torréfiée.
Et tandis qu’ils filaient sur le fleuve rapide, une terrible impression de solitude pesait sur eux. Aussi loin que se portait la vue, rien de vivant n’animait le désert d’herbes rousses et de fleurs rouges. Pas un oiseau, pas une mouche dans les airs, pas un animal sur terre. C’était la mort souveraine. Et le vent, qui, dans les hauteurs de la dense atmosphère, poussait toujours vers les montagnes désolées les énormes nuages verts, le vent ne descendait pas près du sol ; il ne donnait pas, en les agitant, une apparence de vie à ces rigides herbes rousses, à ces immuables fleurs rouges, à ces arbres rouillés portant leur panache figé de feuilles métalliques.
C’était le silence, l’immobilité, la sécheresse du désert et de la mort.
– Mais où donc habitent les Mercuriens ? dit tout à coup Francisco d’une voix qui révélait sa profonde angoisse.
Paul de Civrac ne répondit pas.
Peut-être les Mercuriens habitaient-ils les entrailles ténébreuses de leur planète. Ou bien leurs villes se cachaient-elles, à l’abri de l’éternelle, de l’implacable lumière, dans des vallées étroites, à l’ombre de ces montagnes noires qui se dressaient à pic jusqu’à des hauteurs inconnues. Le paysage, trop lumineux, et pourtant morne, ne révélait aucune culture, aucune vie intelligente… L’étrangeté des prairies d’herbes rousses, la magnificence des champs de fleurs écarlates, la fantasmagorie prodigieuse des nuages verts, tous ces aspects, qui auraient pu être un enchantement, n’étaient que désolation, parce qu’on les sentait inutiles et trop continuellement pareils…
Et sur les berges du fleuve, le paysage ne variait pas ; montagnes noires d’un côté, herbes rousses et fleurs rouges de l’autre, jusqu’à l’infini.
– J’ai soif ! dit Paul. Si nous ne trouvons pas à nous désaltérer, c’est la mort…
– Je le sais, dit Francisco.
Et le silence retomba…
Soudain, comme le fleuve décrivait une courbe brusque, les monotones prairies disparurent, et les Terriens se virent entre deux hautes falaises d’ardoise. Brillantes, elles réfléchissaient crûment la lumière. Et le fleuve encaissé glissait tout d’une masse, sans un flot, sans un bruit…
– Si le courant qui a entraîné Lola sort de la montagne et se joint à celui-ci, dit Paul, nous ne tarderons pas à le rencontrer, car la courbe que nous décrivons va dans sa direction ; pourvu que lui-même ne se détourne pas d’un autre côté !…
Comme il finissait d’énoncer ces réflexions d’une justesse fort problématique, Francisco lui serra la main et murmura :
– Les Mercuriens !
Là-bas, à deux cents mètres en aval, un renfoncement se creusait dans la falaise, formant une plage où gesticulaient une centaine de Mercuriens.
– Ne les frappons que s’ils nous attaquent, dit Paul.
– Oui, Señor.
Déjà, les deux Terriens arrivaient devant la plage. Ils remarquèrent que tout au fond, un large trou se creusait dans la montagne, sans doute une galerie nouvelle…
– Gardons le milieu du courant.
– Oui…
Ils passèrent rapidement devant les Mercuriens. Ils s’attendaient à voir les monopèdes sauter sur le fleuve pour les rejoindre. Mais les monstres noirs à l’œil rouge se contentèrent d’agiter leurs trompes répugnantes, leurs bras à griffes, et de remplir l’air d’un vacarme de sifflements.
Aussitôt après la petite plage, le fleuve eut un coude brusque, comme s’il voulait revenir sur lui-même, et le plus effrayant spectacle s’offrit aux yeux des Terriens.

Des deux côtés du fleuve, la montagne s’écartait un peu, laissant des rives larges où s’élevaient par milliers de petites pyramides d’ardoise. De toutes ces pyramides sortaient des Mercuriens sautant et sifflant, qui se rangeaient tout au bord du fleuve. Et cette immense ville, longue jusqu’à perte de vue, était dans l’ombre ! Elle était dans l’ombre parce que la montagne, de chaque côté, s’élevait en surplombant de plus en plus, jusqu’à presque faire toucher, à une prodigieuse hauteur, ces noires parois… Là-haut, juste au-dessus du fleuve, c’était, entre les deux crêtes des falaises prodigieuses, une étroite et longue bande de lumière et de nuages verts…
Paul et Francisco eurent tout de suite une horrible sensation d’étouffement, bien que la chaleur ambiante eût fort diminué, ainsi que l’intensité lumineuse… Et le spectacle les hypnotisait de ces deux montagnes effroyables surplombant leurs têtes, lorsqu’une bordée furieuse de sifflements les rappela heureusement à eux-mêmes…
L’innombrable foule des Mercuriens, rangée sur les rives, sautait partout sur le fleuve… C’était comme une invasion de bêtes noires sur un chemin d’or… En avant, en arrière, les monopèdes s’élançaient, se pressaient, et leurs deux foules parties des rives se rapprochaient, se resserraient. Elles devaient bientôt ne former qu’une multitude compacte au milieu de laquelle Paul et Francisco seraient pris.
– Cette fois, nous sommes perdus, mais ils sauront ce que ma vie leur coûtera ! dit l’Espagnol en levant sa massue.
– Francisco ! il ne faut pas combattre, il faut nous sauver ! cria Paul. Pensez à Lola…
– Nous sauver ! Comment ? Par où ?… Nous n’avons qu’à mourir… et à beaucoup tuer auparavant !…
– Non, non ! Francisco ! Obéis-moi !…
– Je veux bien, répondit l’Espagnol avec calme… mais commandez…
Et, comme les premiers rangs des Mercuriens n’étaient qu’à quelques pas, il fit avec son pieu un large moulinet qui arrêta net les agresseurs.
Paul l’imita.
Les moulinets continus tenaient en respect les monopèdes. Mais il était évident que cela ne pouvait durer, car si les premiers rangs hésitaient devant le danger, la foule qui se pressait en arrière avançait, poussait, et bientôt toute la multitude s’élancerait en un irrésistible mouvement.
– Francisco, dit Paul, sans ralentir ses moulinets, regarde la montagne, à droite…
– Eh bien !
– Tu vois cette gorge qui s’ouvre là, dans la falaise…
– Oui.
– Elle conduit en haut…
– Et après ?
– Eh bien ! je crois qu’en un seul bond nous serons sur la rive… Ces monstres ne s’attendent pas à cela… Sautons… Nous avons une chance…
– Laquelle ?
– Retomber sur le sol et non sur les têtes des Mercuriens… Justement, là, sur la rive, la foule est clairsemée… Un nouvel élan nous mènera devant la gorge… Ils nous poursuivront, mais nous courons plus vite qu’eux…
– Dieu nous garde !… Sautons !…
– Attention… Tu es prêt ?
– Oui.
– Hop !…
Et, concentrant toutes leurs forces dans leurs jarrets, les deux hommes bondirent… Ils passèrent par-dessus la foule grouillante qui avait envahi le fleuve et allèrent tomber entre deux pyramides, au milieu d’un groupe de Mercuriens qui s’étaient instinctivement écartés.
– Hop ! fit Paul.
– Hop ! répéta Francisco.
Et de nouveau, ils sautèrent…
La vallée sonore retentissait d’horribles sifflements. Avec une furieuse ardeur, toute l’immense foule des monopèdes s’était jetée à la chasse des fugitifs.
– Décidément, ils n’ont pas d’armes, dit Francisco en prenant élan pour un nouveau bond.
– Non, heureusement.
Avec une avance de plus de cent mètres sur les premiers poursuivants, les Terriens se trouvaient devant l’entrée de la gorge. Elle se creusait dans la vertigineuse falaise ; elle montait, en pente raide, mais praticable.
– Nous leur échapperons ! dit Francisco.
– Oui, mais Lola !
– Hélas ! Dieu seul sait où elle est maintenant…
– Et si elle est encore vivante !…
Paul refoula les larmes de désespoir qui gonflaient ses yeux, et, le premier, il s’élança dans la gorge.
Pendant qu’ils bondissaient sans arrêt, les deux hommes entendaient la foule des Mercuriens les poursuivre. Mais ils la distançaient de plus en plus. Le bruit des sifflements s’affaiblissait, puis il ne fut qu’un vague murmure, et enfin on ne l’entendit plus.
À ce moment, Paul et Francisco étaient arrivés à l’extrémité de la gorge, qui débouchait brusquement sur un immense plateau d’ardoise. Le Français avisa une masse surplombante, sous laquelle il y avait un peu d’ombre.
– Reposons-nous là, dit Paul. Je n’en puis plus…
– Le fait est qu’un pareil exercice, dans une telle chaleur !…
– Oh ! que j’ai soif ! que j’ai soif !
Et, suffoquant, leur corps desséché, sans une goutte de sueur, Paul et Francisco se couchèrent dans l’ombre…
Devant eux le plateau noir s’étendait, très loin, jusqu’à une seconde chaîne de montagnes très hautes aux flancs desquelles s’accrochaient et se déchiraient les éternels nuages verts.
– Quelle terre de désolation ! murmura Paul.
– Ils viennent ! souffla Francisco. Écoutez !
Comme sortant des entrailles de la montagne, des sifflements et des bruits d’éboulis arrivaient jusqu’à eux.
– Fuyons encore ! dit Paul en se levant.
– Où ?
– Vers ces montagnes, là-bas…
Et, malgré leur horrible lassitude, dans leur volonté de se sauver pour retrouver Lola, les deux malheureux se remirent à courir en bondissant. Soudain, Francisco s’écria :
– Señor !
– Quoi donc ?
– Voyez là-bas, à gauche. Que je sois manchot si ce n’est pas de la pluie qui tombe sur la montagne.
À ce mot de pluie, et sans penser que, sur cette étrange planète, les produits liquides du ciel pouvaient bien n’être pas de l’eau, Paul sentit un sang nouveau et plus fort circuler dans ses membres.
– Mais oui ! mais oui ! fit-il avec joie, ce doit être de la pluie…
Il y avait, en effet, dans le lointain, comme un rideau de brume à peine transparent : brume plus épaisse que les lointains pluvieux ne le sont sur la terre, et légèrement teintée de vert… Mais ce pouvait être de la pluie, de l’eau !…
– Vite ! vite ! courons là-bas !…
Une frénésie les emportait. Ils bondissaient comme des ballons gonflés de gaz et qui trouveraient une nouvelle légèreté à chaque atterrissage rapide. Tout à coup, ils sentirent une indiscutable fraîcheur.
– Señor, Señor ! c’est de l’eau !
Et Francisco montrait à Paul le dos de sa grosse main brunie : une large goutte d’eau venait de s’y écraser. Presque aussitôt, ils furent sous l’averse. Elle tombait d’un nuage énorme, d’un vert foncé, aux profondeurs noirâtres. Voluptueusement, sans autre pensée que d’aspirer le vivifiant liquide, ils s’étendirent sur le dos, la bouche ouverte, recevant par tout le corps les gouttes de pluie, grosses comme des œufs de pigeon, et qui faisaient sur le sol un bruit crépitant. Et ils buvaient, lentement, mais sans s’interrompre. Et ils sentaient, avec un indicible bonheur, l’eau mouiller leur peau brûlée, s’insinuer par tous leurs pores ouverts…
– Ah ! ah ! gémissait Paul.
Et il se grisait dans la formidable ondée. Leur soif fut enfin apaisée. Ils se redressèrent.
– Francisco, dit Paul avec animation, il faut recueillir de cette eau qui tombe ! Il faut en garder !
– Mais comment ?
– Ta gourde ?
Elle était suspendue à la ceinture de l’Espagnol ; il la détacha, l’ouvrit, et, la présentant à Paul :
– Buvez, il reste encore deux gorgées de cognac, une pour chacun.
Quand la gourde fut vide, il la tint droite dans ses deux mains, goulot en l’air. Elle ne tarda pas à être remplie, car, hélas ! elle était petite.
Et presque aussitôt, le nuage pluvieux passait, emporté par le vent des hauteurs.
Immédiatement, l’implacable lumière et la chaleur remplacèrent la fraîcheur et l’ombre.
– Señor ! Voyez ! voyez là !…
De son bras tendu, Francisco montrait dans l’ardoise une petite excavation où de l’eau était demeurée… les deux hommes virent cette eau se corrompre en une minute, devenir trouble, puis jaunâtre, puis d’un jaune d’or ; elle eut deux bizarres bouillonnements et aussitôt elle se figea, comme de l’or fondu dans une cuvette. Paul la toucha du doigt : elle était résistante et tiède…
– Vite ! vite ! s’écria-t-il, regarde dans la gourde !
Francisco la déboucha, et ils plongèrent leurs yeux dans le goulot. Le petit rond liquide avait bien l’apparence de l’eau. Il la garda pendant les trois minutes durant lesquelles les deux hommes l’observèrent. Mais, ensuite, la surface de l’eau blêmit un peu…
– Rebouche-la ! rebouche-la vite !…
Francisco enfonça le bouchon.
– Je comprends maintenant, fit Paul. L’eau tombée sur le sol se combine avec quelque élément à nous inconnu et se transforme en cette matière jaune, mi-liquide, mi-solide, qui constitue les cours d’eau de la planète. La chaleur et l’air doivent aussi avoir leur influence dans cette combinaison chimique, puisque l’eau de la gourde a commencé à se transformer après trois minutes de contact direct avec l’air du dehors. Mais parce que cette transformation a été incomparablement moins rapide que celle de l’eau demeurée sur le sol, je pense que nous pourrons conserver quelque temps intacte notre petite provision… Et maintenant…
Mais il fut interrompu par Francisco, qui saisit son épieu, se leva d’un saut et cria :
– Señor, les voilà encore ! Ils nous poursuivent !
Là-bas, très loin, dans la direction de la gorge qui montait de la vallée du Fleuve d’Or, apparaissait une masse sombre, mouvante, et qui se rapprochait rapidement.
– Fuyons ! dit Paul.
Et les deux hommes, traqués comme des bêtes, mais forts maintenant et animés de quelque confiance en l’avenir, recommencèrent leur fuite bondissante vers les hautes montagnes encore lointaines…
CHAPITRE III
QUI RÉVÈLE DE STUPÉFIANTS PHÉNOMÈNES
Ils couraient et bondissaient depuis près d’une heure, lorsque Paul de Civrac jeta un grand cri et roula sur le sol. Francisco, qui s’était déjà élancé dans un nouveau saut, fit volte-face et, se penchant au-dessus de son compagnon, qui, avec des efforts, essayait de se relever :
– Qu’est-ce que c’est donc, señor ; vous êtes blessé ?…
Paul étouffa un gémissement de douleur.
– Mon pied droit a porté sur une arête rocheuse… Je me suis peut-être foulé la cheville… Ôte-moi ma botte, Francisco…
Mis à nu, le pied parut seulement un peu tuméfié, à son bord extérieur, sous la cheville. Dans ses larges mains, Francisco le frictionna.
– Ce ne sera rien… un simple froissement des nerfs, sans doute…
– Oui, je l’espère fit Paul. La douleur est déjà moins aiguë… Mais pourrai-je marcher ?…
Soutenu par Francisco, il se leva sur son pied gauche ; mais quand il voulut reposer aussi son pied droit, une intolérable douleur lui arracha un gémissement…
– Il faut vous reposer, dit Francisco. Appuyez-vous sur moi et sautillez jusqu’à cette excavation, là-bas… Nous serons à l’ombre…
Il leur fallut cinq minutes pour faire les cent mètres qui les séparaient du refuge indiqué par Francisco, tandis que, sans l’accident, ils auraient franchi cette distance en deux bonds de quatre secondes.
Une fois qu’il eut fait étendre dans l’ombre son compagnon, Francisco humecta de salive la paume de ses mains et procéda patiemment à un vigoureux massage.
Puis il s’assit près du blessé et dit :
– Dormez !… Les Mercuriens, s’ils nous poursuivent encore, ne seront pas ici avant une bonne demi-heure. Vous serez, je pense, en état de marcher, sinon de courir… Nous sommes au pied de la montagne. Comme vous le voyez, elle n’est pas abrupte et nous l’escaladerons facilement… Et, une fois là-haut, j’espère que nous aurons lassé l’acharnement de ces sales monstres noirs… En tout cas, comme nous serons sur l’autre versant, hors de leur vue, nous pourrons nous cacher dans quelque, caverne et les dépister… Dormez, je veille !… Donnez-moi la montre…
Les aiguilles marquaient quatre heures un quart. Il y avait donc près de cinq heures que les deux hommes marchaient et couraient depuis qu’ils avaient fabriqué leurs massues dans le petit bois de la prairie de fleurs rouges…
Paul s’endormit aussitôt d’un sommeil lourd, peuplé de cauchemars, où Lola et les monopèdes, avec Bild, Brad et la Roue Fulgurante, passaient en tourbillons confus.
Et Francisco veillait. À quatre heures et demie, il entendit dans le grand silence une lointaine rumeur ténue. Dix minutes après, il vit, très loin, se mouvoir la foule, très minuscule à cette distance, des Mercuriens… Comme le plateau sur lequel couraient les monopèdes s’élevait en pente douce vers la montagne au pied de laquelle se trouvaient les fugitifs, Francisco dominait de haut toute l’étendue.
« Hé ! hé ! fit-il, ils commencent à se lasser, les sales monstres ! Ils sont bien moins nombreux… laissons-les venir… À cinq heures, je réveillerai ce pauvre jeune homme… Pourvu que Lola ne soit pas morte ! Ah ! si jamais je dois renoncer à la retrouver, je vais à la ville qui est dans la vallée et je fais un massacre de tout, tant qu’il me restera un souffle de vie… »
L’Espagnol continua de monologuer jusqu’à ce que les aiguilles du chronomètre indiquassent cinq heures.
La foule des monopèdes était encore loin.
– Señor ! appela Francisco, en mettant sa main sur l’épaule de Paul. Señor !…
– Ah ! Qui ?… Lola !
« Pauvre jeune homme ! pensa Francisco. Il aime la Señorita et il en rêve ! Hélas ! la retrouverons-nous jamais ?… »
Il hocha la tête et, tout haut :
– C’est moi, Señor… les sales bêtes arrivent. Il faut partir…
Paul leva vivement la tête.
– Allons ! fit-il, clignant des yeux pour les réhabituer à l’intense clarté…
Mais l’état de son pied n’était guère amélioré. La tumeur avait grossi, noire maintenant et très douloureuse au toucher.
– C’est plus qu’un nerf froissé, dit Paul. Jamais je ne pourrai remettre ma botte…
Sans répondre, Francisco suspendit à sa ceinture la botte inutile, arracha les derniers lambeaux de sa chemise et en entoura soigneusement le pied blessé.
– Là, et maintenant, levez-vous. Appuyé sur moi d’un côté, de l’autre sur votre épieu, vous pourrez marcher tout au moins aussi vite que les Mercuriens… Il nous suffira de garder l’avance que nous avons…
Paul se leva sans trop de peine et, se tenant d’une main à l’épaule de Francisco, de l’autre serrant bien son épieu, il se mit à sautiller sur un pied. Il eut vite saisi le rythme nécessaire des mouvements, et les deux hommes avancèrent avec assez de rapidité.
La montagne était abrupte, mais ravinée. Par celui des ravins qui leur parut le moins difficile, les fugitifs commencèrent la pénible ascension. De temps en temps ils se retournaient et regardaient, au-dessous d’eux, la foule courante des Mercuriens.
– Ils gagnent sur nous !
– Hélas ! oui, gémit Paul, et mon pied me fait souffrir… Bientôt je ne pourrai plus marcher !… Lola ! Qu’est devenue Lola ?…
– Encore un peu de courage, Señor… Nous arrivons !
Paul se raidit contre la fatigue et la douleur, et il s’efforça d’aller plus vite. Ce fut en vain. Les Mercuriens augmentaient sans cesse leur avance. Les deux fugitifs les voyaient s’engouffrer en désordre dans le ravin ; leurs horribles sifflements déchiraient l’air.
– Courage ! courage ! répétait Francisco.
Déjà, entre deux hautes falaises à pic, la gorge s’arrêtait brusquement, pour dévaler sans doute sur l’autre versant de la montagne.
– Encore cinq minutes de marche ! dit-il, encore cinq minutes, Señor !
Mais, vaincu, Paul se laissa tomber. Il tendit à son compagnon une main défaillante et, d’une voix faible :
– Francisco, sauve-toi, pour Lola… Tu la retrouveras et tu lui diras qu’en mourant ma dernière pensée a été pour elle… Va… Ils vont me prendre et me tuer, mais tu peux te sauver… Hâte-toi… Tu diras à Lola que je l’aime et que j’aurais donné ma vie pour la… Mais va ! Va !…
– Par le San Cristo ! s’écria Francisco, vous perdez l’esprit, Señor !… Vous laisser là !… Et que dirait la Señorita, quand je la retrouverai, si je lui apprenais que je vous ai abandonné à la cruauté de ces sales petites bêtes !…
– Tu diras que je t’ai ordonné de me laisser… Obéis… Pars !…
Mais terrassé par la douleur et les fatigues physiques, par les tortures morales qu’il endurait depuis tant d’heures, Paul de Civrac allait s’évanouir, lorsque Francisco, débouchant sa gourde, lui fit boire une grande gorgée d’eau que le rhum avait légèrement aromatisée. Puis, grommelant une invocation à son protecteur ordinaire, le « santissimo » Jacques de Compostelle, il empoigna Paul, le souleva, le chargea sur ses épaules, et, sans écouter les ordres du jeune homme, il se mit à courir.
Il lui fallut à peine plus de cinq minutes pour arriver au point où la gorge, cessant de monter, se frayait un passage entre les hautes falaises et descendait en pente raide.
Accélérant son allure, adroit et léger comme un izard, Francisco se mit à dévaler le sentier abrupt et rocheux.

Il en suivit les nombreux méandres, l’œil vigilant pour éviter les roches éboulées, l’oreille ouverte aux bruits de la montagne… Mais les sifflements des monopèdes ne s’entendaient plus et, soudain, la gorge déboucha sur un étroit plateau.
Et le spectacle brusquement apparu fut si prodigieux, si inconcevable, que Francisco s’arrêta net, en murmurant :
– Demonios ! Quel est ce nouveau pays d’enfer ?…
Il n’entendait pas la voix de Paul qui lui ordonnait de le déposer à terre. À pas lents, il avait repris sa marche et se dirigeait vers l’extrémité de la plate-forme rocheuse… Arrivé presque au bord du précipice, il s’arrêta à nouveau ; alors seulement il entendit Paul. Francisco assit doucement le blessé sur la roche et, embrassant d’un grand geste l’immensité, il dit simplement :
– Regardez, Señor !
Paul, les yeux grands ouverts, n’eut pas la force de parler, tant le spectacle était impressionnant et terrible.
La plate-forme sur laquelle ils se trouvaient était dans une sorte de crépuscule verdâtre, qui commençait juste à l’orée du ravin, lequel, lui, étincelait de l’éblouissante clarté mercurienne.
Un vide énorme se creusait à pic au delà de la plate-forme… Et le fond de ce précipice était une plaine qui s’en allait, se perdait dans l’inconnu… Mais l’étrangeté du spectacle consistait surtout en ceci : le précipice, bien qu’à ciel ouvert, était sombre et crépusculaire ; plus sombre et crépusculaire était la plaine, qui, soudain, sombrait dans la nuit, dans une nuit immobile et fascinante, et cependant trouée de myriades d’étoiles. De cette immensité mystérieusement ténébreuse venait un vent glacé, un vent de nuit et d’hiver.
Paul frissonnait, autant d’horreur que de froid…
– Francisco, je ne me trompais pas… balbutia-t-il… nous sommes bien sur la planète Mercure… Voici, à nos pieds mêmes, puis au fond du précipice, la zone crépusculaire qui s’étend jusqu’à l’hémisphère d’éternelle nuit…
Et, levant la tête, il vit que les nuages, verts et lumineux derrière lui, s’assombrissaient en passant sur sa tête, tombaient plus bas dans l’atmosphère et allaient se perdre, noirs monstres apocalyptiques, dans la région des ténèbres, des glaces éternelles et des épouvantements sans nom… Et là, ils se figeaient en une ligne épaisse au delà de laquelle apparaissait la profondeur de l’infini nocturne fourmillant d’étoiles innombrables…
Francisco s’était assis auprès de Paul, et les deux hommes, les yeux avidement fixés devant eux, grelottaient et claquaient des dents. La chaleur et l’animation de leur course les abandonnaient peu à peu ; la lumière verte ne les réchauffait plus. Sur le versant d’où ils venaient, c’était, à l’abri des vents glacés, une température plus torride que celle des régions équatoriales terrestres ; ici, face à la région que le soleil ne regardait jamais, c’était, dans l’extrême bande de lumière, une température plus glaciale que celle des pôles…
Comme il arrive dans les fortes commotions morales, la douleur physique de son pied blessé n’affectait plus Paul de Civrac… Peu à peu, son énergie et sa présence d’esprit ordinaires chassèrent sa faiblesse et le désarroi qu’avait causé l’impuissance d’échapper aux monopèdes.
Il mit la main sur le bras de Francisco et dit :
– Qu’allons-nous faire ?
Comme s’il se réveillait d’un cauchemar, l’Espagnol regarda le jeune homme avec égarement.
– Qu’allons-nous faire ? répéta Paul. Derrière nous, ce sont les Mercuriens, la captivité, peut-être la mort, mais c’est aussi la lumière, la chaleur, la nourriture, l’espoir de retrouver Lola. Devant nous, c’est le désert absolu, les ténèbres éternelles, les neiges et les glaces, la mort certaine… Qu’allons-nous faire ?…
Francisco balbutia :
– Señor, je ne…
Une horrible bordée de sifflements lui coupa la parole.
Les deux hommes se retournèrent, et ils virent la multitude des Mercuriens massée à l’orée de la gorge, escaladant la falaise, et tous les monopèdes grouillants sifflaient et s’agitaient, pressés dans l’étroit couloir ou accrochés à quelque arête du roc. Mais tous étaient en pleine lumière ou dans l’ombre de la falaise, et aucun ne s’avançait sur la plate-forme crépusculaire…
Muets, les deux Terriens regardaient leurs ennemis et se demandaient la raison de leur arrêt subit, de l’interruption d’une si longue poursuite, alors qu’il suffisait à cent monopèdes de faire dix bonds pour capturer enfin leur proie…
Les Mercuriens n’avançaient pas. Ils s’agitaient, sifflaient, gesticulaient ; mais quand, poussé par ceux qui étaient derrière, l’un d’eux mettait le pied malgré lui sur le plateau sombre, aussitôt il bondissait en reculant, et c’était un vacarme de sifflements aigus, de gestes fous des trompes et des bras. Les yeux rouges des monstres semblaient agrandis et comme tout écarquillés de terreur. Que voyaient-ils donc d’extraordinaire ?
– Francisco, je comprends ! dit Paul avec un élan de vague espoir. Je comprends !… Les Mercuriens redoutent la zone non éclairée de leur planète… Sans doute est-elle, pour eux plus encore que pour nous, la région du danger et de la mort… Vois, ils sifflent après nous, ils nous menacent de leur bras furieux, mais ils n’avancent pas, quand il leur serait maintenant si facile de s’emparer de nous… Francisco, nous sommes ici hors de danger…
– Du danger d’être pris et de voir notre sang sucé par ces vampires, oui, sans doute ! dit l’Espagnol avec calme… Mais pour peu qu’ils restent là, à nous menacer et à nous bloquer, nous mourrons de faim et de froid… Regardez mes lèvres, Señor, je suis sûr qu’elles sont bleues, comme je vois les vôtres… Et nous grelottons tous les deux… Coûte que coûte, il nous faut retourner à la lumière et à la chaleur…
– Oui, il le faut… Pour Lola surtout !…
Et les deux hommes cherchèrent par quel moyen se sauver… Après de longues minutes de réflexion, pendant lesquelles les monopèdes eux-mêmes cessèrent de siffler, Paul murmura :
– Je ne trouve rien.
– Moi non plus.
La situation, cette fois, leur parut à tous deux absolument désespérée.
À trente pas d’eux, dans la gorge et sur les rebords des rochers noirs, tous les monopèdes s’étaient assis comme s’assoient les Mercuriens, c’est-à-dire le genou plié et le bas de leur dos reposant contre la griffe d’arrière de leur pied.
– Ils font le blocus, dit Francisco.
– Ils attendent que nous nous rendions, car même si nous succombons au froid et à la faim, sans bouger, certainement ils ne viendront pas nous chercher ici… Il est évident que le crépuscule relatif qui règne sur le plateau leur cause une insurmontable terreur…
– Après tout, nous pourrions nous rendre, dit Francisco… Ces sales bêtes sont relativement intelligentes. Elles vous ont compris, dans la grotte, quand vous avez expliqué aux deux chefs, par gestes, que nous avions faim… Vous pourriez essayer de leur faire entendre que nous ne ferons aucun mal à personne, si personne ne nous touche…
– C’est difficile à exprimer par gestes…
– Essayez toujours, Señor… C’est le seul moyen que nous ayons, en somme, de nous sauver et de retrouver Lola… Votre pied vous fait toujours mal ?
– Beaucoup moins… la période d’inflammation est passée, je crois que je pourrai toucher le sol…
Paul se leva, essaya son pied endolori. Chaque fois que son talon touchait, il ressentait une douleur sourde, mais enfin il pouvait marcher en s’appuyant sur son épieu.
– Eh bien ! je vais essayer de leur parler, dit-il.
Francisco se leva, aussi.
Machinalement, les deux hommes se tournèrent vers l’immensité des espaces ténébreux, et un cri s’étrangla dans leur gorge, tandis qu’un vacarme de sifflements ébranlait les échos de l’air et que tous les Mercuriens, tumultueux, se levaient en masse…
Là-bas, à droite, dans les ténèbres éternelles, une lueur fulgurante venait d’apparaître soudain, et, comme jaillissant d’un prodigieux phare invisible, elle avançait en large projection électrique tournante, exactement vers la plate-forme crépusculaire.
CHAPITRE IV
OÙ BILD ET BRAD SIGNALENT PRODIGIEUSEMENT LEUR EXISTENCE
Stupéfaits, Paul et Francisco virent la projection s’approcher de la plateforme, l’atteindre, l’inonder de lumière ; ils en furent éblouis ; mais déjà elle passait, jetant la panique dans la foule des monopèdes, qui, pourtant, ne la perçurent pas sur eux-mêmes, puisqu’ils étaient en pleine clarté Mercurienne…
Elle passa, la projection, quitta le plateau, continua sa marche vers la gauche… Très loin elle s’immobilisa une minute, puis elle revint vers le plateau, plus lentement, montant et descendant, reculant, puis avançant de nouveau. Paul et Francisco la suivaient anxieusement des yeux, et ils pensaient aux projecteurs d’un cuirassé terrestre fouillant une rade, la nuit… Un espoir insensé faisait battre leur cœur.
– Qu’est-ce que ça peut être, Señor ? murmura Francisco…
– Je ne sais pas… Un phénomène naturel ?… Et pourtant, cela m’a l’air d’être manœuvré par une intelligence… Mon Dieu ! Mon Dieu !…
Cependant, la projection revenait… Elle touchait le bord du plateau… Elle glissa sur la surface unie du roc crépusculaire… Et quand elle eut enveloppé de sa large clarté les deux hommes immobiles, elle s’arrêta…
Avec une surprise intense, Paul et Francisco virent ce rayon prodigieux, qui venait des lointaines ténèbres mystérieuses, ils virent ce rayon s’amincir jusqu’à n’avoir plus, immédiatement devant eux, qu’un diamètre de un mètre cinquante environ. Et ce rayon, s’abaissant, modifia sa forme et dessina presque aussitôt à leurs pieds, sur l’ardoise noire du plateau, un losange allongé de lumière blanche…
Et de leurs yeux hypnotisés, ils regardaient ce losange lumineux, lorsqu’ils poussèrent ensemble un cri rauque :
– Francisco !…
– Señor !…
– Ne suis-je pas fou ?… Est-ce que je vois ?… balbutiait Paul.
– Et moi ?… Oui… je vois… des lettres…
– Des lettres, Francisco ! Des lettres noires sur ce losange de lumière… Et ça forme des mots… des mots…
– Oui, oui, Señor… Et voyez… d’autres, d’autres encore !…
– Le losange s’élargit… Encore d’autres lettres… d’autres mots.
Fascinés, les deux hommes s’étaient agenouillés devant le losange merveilleux… Et ils attendaient, le cœur battant, les mains tremblantes. Leurs regards affolés ne pouvaient se fixer normalement sur un seul point de la figure géométrique… Ils sautaient d’un mot à l’autre. Soudain, le losange, qui s’agrandissait sans cesse, fut immobilisé et, au bas des lignes de mots noirs qui se détachaient sur la clarté, quatre lettres sombres se dessinèrent d’un coup :
– Bild ! s’écria Paul. Quatre autres lettres aussitôt.
– Brad ! hurla Francisco.
Et les deux hommes, en un accès de joie délirante, tombèrent aux bras l’un de l’autre, s’embrassèrent, en riant et en pleurant, tandis que la foule des Mercuriens, immobile et massée à l’entrée de la gorge, considérait le spectacle de ses milliers d’yeux rouges sans expression.
Quand Paul et Francisco eurent donné libre cours à leur joie désordonnée, la raison leur revint, et Paul dit :
– Nous sommes fous, Francisco, il faut lire…
– Lisez, Señor… moi, je ne peux pas, tout danse devant mes yeux…
Et Paul, penché en avant, lut à haute voix le prodigieux message qui se détachait en noir sur le fond blanc du losange lumineux :
« Sommes dans planète Vénus, où Roue Fulgurante et Saturniens ont été détruits. Intelligence prodigieuse des Vénusiens. Perfectionnement divin de leur science. Vous ont découverts, avec leurs télescopes, dès qu’avez été dans l’hémisphère de nuit mercurienne. Nous vous envoyons, par un de leurs étonnants projecteurs de lumière solaire, ce message. Ne savons pas encore comment vous rejoindre, les Vénusiens ne pouvant pas sortir pour le moment de l’atmosphère de leur planète. Mais dans quarante-huit heures terrestres, nous pourrons envoyer messages à la Terre. Une autre projection est en route et va vous arriver trente-cinq minutes après l’apparition de celle-ci.
« Bild et Brad. »
Paul achevait à peine de lire quand, brusquement, tout s’effaça devant ses yeux. La lumière disparut et il ne vit plus que l’uniforme roche noire.
– Francisco !… s’écria-t-il, angoissé… Je ne vois plus rien !… Avons-nous rêvé ?…
– Mais, Señor, les trente-cinq minutes doivent être passées… Juste ! voici la seconde projection…
En effet, un éclair jaillit des ténèbres lointaines et, sur la roche, un autre losange lumineux s’épanouit et, dans celui-ci, des lettres et des mots s’inscrivirent en noir…
Et Paul et Francisco lurent ensemble :
« Nous enverrons des messages à la Terre ; de notre côté, nous avons l’espoir d’aller vous arracher bientôt à l’inhospitalière surface de Mercure, car trente savants vénusiens travaillent à résoudre le problème de nous envoyer jusqu’à vous. Il ne leur reste à vaincre qu’une petite difficulté provenant de notre pesanteur. Comme nous voyons tout ce qui se passe autour de vous, nous comprenons que le plus grand danger pour vous est de mourir de faim. Vous n’avez d’autre alternative que celle-ci : ou mourir, ou vous nourrir des monopèdes mêmes qui vous bloquent. N’hésitez pas, et brûlez, pour vous réchauffer, les Mercuriens morts. Il vous faut vivre jusqu’à ce que nous puissions aller vous sauver ! Mais où est Lola Mendès ? Prisonnière ou morte ? Attendez une troisième projection. »
Cinq minutes seulement s’écoulèrent avant que la deuxième projection s’évanouît. Et presque aussitôt la troisième parut.
Plus calmes maintenant, et résolus à tout pour conserver leurs forces, leur vie et retrouver Lola, Paul et Francisco lurent ensemble le message noir sur le losange de lumière :
« Ce troisième message sera le dernier de cette première série. Nous ne pourrons vous en envoyer d’autres que dans quatre-vingt-seize heures, quand les Vénusiens auront fait de nouveau provision de radiation solaire suffisante… Pour rester toujours en face de vous, nous sommes sur un appareil vénusien qui demeure immobile au-dessus du globe, Vénus tournant dans l’espace… Nous ne le quitterons que pour envoyer un message à la Terre. Ne perdez pas de vue, tout au moins, le plateau où vous êtes… car si vous retournez dans la zone éclairée de Mercure, nous ne vous verrons plus… Tuez des Mercuriens !… Mais Lola Mendès ? Où est-elle ?… Nous nous refusons à la croire morte… Courage ! Courage ! Vivez et attendez-nous.
« BILD, Br. »
Mais tout à coup, la projection s’évanouit avant même que le nom de Brad eût pu être écrit en entier.
Comme si ces losanges de lumière eussent réchauffé leur corps pendant qu’ils brillaient, les Terriens sentirent, aussitôt que toute projection se fut évanouie, un froid mortel envahir leurs membres.
– Nous allons geler sur place ! s’écria Francisco. Donnons-nous du mouvement ! Vite, aux Mercuriens !

Il saisit son épieu et bondit vers la foule, maintenant silencieuse, des monopèdes. À coups de massue, il brisa les jambes et les bras d’une dizaine de monstres, – tandis que les autres, avec des sifflements de panique, reculaient et s’écrasaient.
Paul avait marché lentement à la suite de Francisco ; il traîna deux monopèdes blessés derrière une arête de roc qui, tout en étant dans la zone crépusculaire, faisait écran contre le vent glacé venant des ténèbres éternelles. Francisco l’eut bientôt rejoint, traînant derrière lui les dix autres Mercuriens qu’il avait agriffés ensemble.
Mais au moment d’obéir complètement aux féroces instructions de Bild et de Brad, les deux hommes frémirent de dégoût – et même de pitié… les Mercuriens étaient bien différents des créatures humaines. Et pourtant, Paul et Francisco sentaient qu’une intelligence vivait derrière cet œil unique et dans ce crâne aplati – un peu de cette étincelle divine qui établit la démarcation entre l’être dont le raisonnement s’exprime par un langage, et l’animal, dont les instincts ne se révèlent que par des actes…
– Francisco, dit Paul… avec d’autres symboles et sous un autre nom, ils adorent peut-être le même idéal que nous, ces Mercuriens.
– Ils sont bien sauvages ! dit Francisco.
– Qu’en savons-nous ? Ils nous considèrent comme des êtres malfaisants et dangereux, et, pourtant, notre plus grand désir serait de vivre en paix dans leurs villes…
– Señor, c’est possible, mais je n’oublie pas qu’ils se dévorent entre eux et qu’ils se sont jetés sur la Señorita sans la moindre provocation, pour…
Francisco eut un geste d’horreur et reprit :
– Je n’oublie pas non plus que nous n’avons pas d’autre alternative… ou boire le sang de ces cadavres et les brûler, ou mourir de faim et de froid… Nous morts, la Señorita est à jamais perdue. Je n’hésite pas…
Et Francisco, brusquement, d’un léger coup de son épieu, creva l’œil vitreux d’un des monopèdes étendus morts devant lui… Un liquide épais et blanc jaillit de la blessure. L’Espagnol se baissa et, appliquant ses lèvres sur le trou ruisselant de sang mercurien, il but.
Paul de Civrac s’était détourné, des nausées lui soulevaient le cœur. Mais il entendit la voix de Francisco qui disait gravement :
– Señor ! Nous avons reçu la vie pour que nous la conservions jusqu’à ce qu’il lui plaise de nous quitter… S’il l’avait fallu, nous serions morts voilà longtemps ! Pensez aux dangers extraordinaires que nous avons courus ! Nous devons maintenant sauver la Señorita et retourner sur la Terre, pour laquelle nous avons été créés. Buvez, Señor, à la seule source de vie qui soit dans ce monde infernal…
Alors, Paul saisit son épieu, creva l’œil d’un Mercurien et se mit à boire le blanc liquide réconfortant… Malgré son dégoût, beaucoup plus intellectuel que physique, il ne perdait pas ses habitudes d’analyse. Et il remarquait, tout en buvant à longs traits, que le sang mercurien, très épais, avait une saveur sucrée et un parfum inconnu, mais agréable… Et c’était comme une régénérescence de tout son corps, le retour merveilleusement rapide des forces…
Pendant ce temps, Francisco avait fait flamber une allumette. Il l’approcha du cadavre maintenant vide de sang, et, avec de légers crépitements, le corps brûlait, lentement, donnant en fusées des flammes blanches d’où radiait une bienfaisante chaleur…
Aucun feu sur la Terre ne ressemblait à cet étrange feu… Il y avait là matière à bien des réflexions. Mais ne souffrant plus de la faim, l’esprit bouillonnant d’espoirs, le cœur vibrant de résolutions encore imprécises, les deux hommes, assis près du cadavre brûlant peu à peu, se réchauffaient avec volupté, sans plus de curiosité intellectuelle, pour le moment, que s’ils avaient été devant une flambée de bois sec…
Ils pensaient à Lola, qu’un pressentiment tenace leur faisait croire en vie… (Ah ! ils la retrouveraient, puisqu’ils pouvaient braver la mort maintenant !) Ils pensaient à Bild et à Brad, à la délivrance possible, probable, certaine, – et ils se réchauffaient, les yeux fixés sur les flammes fusantes, mais les regards perdus en dedans d’eux-mêmes.
Et bientôt une autre pensée, plus tyrannique encore que les précédentes, envahit l’esprit de Paul de Civrac.
D’où venait et pourquoi naissait ce souvenir inattendu ? Par quel phénomène de transmission des pensées Paul se rappela-t-il tout à coup sa rencontre, à Calcutta, avec le mystérieux Ahmed-bey ?…
Il revit le visage émacié de l’énigmatique savant ; il réentendit les paroles hermétiques par lesquelles Ahmed-bey avait prédit son amour pour Lola Mendès.
– Francisco ! s’écria Paul.
– Señor ?…
– Sais-tu à quoi je pense ?
– Mais, Señor, ce doit être à notre chère Señorita…
– Oui, dit Paul ; elle est, en effet, au fond de ma pensée… Mais ce qui, en cet instant, préoccupe mon esprit, est surtout l’idée du docteur Ahmed-bey, tu sais ? ce savant merveilleux que j’ai connu à Calcutta…
Francisco regarda Civrac avec surprise, fit une moue méprisante, et, haussant irrévérencieusement les épaules, il présenta de nouveau ses mains à la flamme du monopède brûlant.
À vingt pas de là, juste à la limite de la zone crépusculaire, dans l’éblouissement de l’éternelle clarté verte venant, à travers les nuages, de l’invisible soleil, la foule des Mercuriens médusés considérait silencieusement ce phénomène naturel que probablement elle ne connaissait pas : le feu.
QUATRIÈME PARTIE
LES ÂMES RÉINCARNÉES
CHAPITRE PREMIER
OÙ L’ON RETROUVE UN PERSONNAGE PLUS ÉTONNANT QUE LA ROUE FULGURANTE ELLE-MÊME
La panique causée sur la Terre par les deux passages de la Roue Fulgurante achevait à peine de se calmer, et les hommes reprenaient confiance en la tranquillité de leur ciel astronomique, lorsqu’une nouvelle stupéfiante éclata comme un coup de foudre, sinon aussi dangereux, tout au moins aussi bruyant et inattendu que le premier.
Ce fut le matin du onzième jour après l’apparition de la Roue Fulgurante au-dessus de la Colombie et sa disparition définitive. Les lecteurs de l’Universel, grand quotidien mondial rédigé en six langues et imprimé à la fois dans toutes les capitales du nouveau et de l’ancien monde, les quatre millions de lecteurs de l’Universel se trouvèrent, en ouvrant leur journal, devant une première page sensationnelle. La manchette, énorme, en occupait le quart ; elle était ainsi conçue :
UN MESSAGE EN PROJECTION
DE LA PLANÈTE VÉNUS.
Suivaient, en grosses lettres, les lignes ci-après :
« Cette nuit, à onze heures trente-quatre, M. Constant Brularion, directeur de l’Observatoire astronomique du bois de Verrières, a vu sur l’étendue plate d’un champ inculte se détacher une projection lumineuse circulaire.
« Depuis quelques nuits, M. Brularion, qui observait la planète Vénus, avait remarqué avec étonnement qu’un rayon lumineux projeté de la planète, et, plus intense que sa clarté ordinaire, se rapprochait de la Terre avec rapidité.
« Et cette nuit, à onze heures trente-quatre minutes, l’extrémité de ce rayon prodigieux a frappé la Terre sur le champ dont il est parlé plus haut.
« Stupéfait du phénomène, M. Constant Brularion sortit de son observatoire, et, arrivé devant le cercle lumineux, il constata que des caractères d’alphabet, un peu flous, mais très lisibles, se détachaient en noir sur la surface éclairée, qui mesurait quatre mètres de diamètre.
« Aidé de trois de ses confrères, le savant astronome prit plusieurs photographies de la projection.
« M. Brularion, qui est, comme nos lecteurs le savent, notre rédacteur astronomique, a communiqué aussitôt une photographie à notre directeur parisien, qui l’a immédiatement télégraphiée et câblée à nos directeurs du monde entier. En voici le fac-similé exact ; nos lecteurs compléteront facilement ce texte par les mots d’importance secondaire qui manquent.
« Nul doute ne peut subsister : c’est là un message de la planète Vénus.
« On voit combien un tel événement, que nous enregistrons avec émotion, est gros de conséquences. Il justifie d’une manière éclatante les théories de M. C. Brularion sur la pluralité des mondes habités.
« Nos lecteurs trouveront demain, à cette même place, un article de notre génial collaborateur, au sujet du message.
« Nous tenons enfin à faire remarquer que, seul, l’Universel fait connaître aujourd’hui à la Terre le prodigieux événement. »
Et ces lignes encadraient jusqu’au bas de la page le fac-similé de la projection.
Le voici :
« Quatre hommes et une femme, enlevés Barcelone et Bogota par Roue Fulgurante, jetés sur planète Mercure. Deux soussignés, repris par Roue, maintenant dans planète Vénus, envoient message sur Terre, par merveilleux appareil emmagasinant et projetant lumière soleil. Femme et deux autres hommes restés à Mercure exposés à mort. Allons nous efforcer les rejoindre, les sauver… Conditions nombreuses font ce message visible cinquante-huit minutes sur Terre, près Observatoire astronomique français, que télescopes vénusiens permettent distinguer… Mêmes conditions font que Vénus pourra envoyer second message dans huit ans, trois mois, huit jours, onze heures, trente-quatre minutes, sens terrestre.
« Arthur BRAD, Jonathan BILD,
citoyens libre Amérique,
momentanément ville des Savants, Vénus. »
Indescriptible fut l’émotion causée sur la Terre. À dix heures du matin, tous les journaux du monde entier publiaient une seconde édition reproduisant la première page de l’Universel. Câbles et fils télégraphiques furent mis à contribution. On fit de rapides enquêtes. Et dès le lendemain, toutes les feuilles imprimées rappelèrent l’enlèvement de la Señorita Lola Mendès et du valet Francisco, à Barcelone, ainsi que la disparition en Colombie, inexplicable jusqu’à présent, maintenant expliquée, de la mission géologique composée de MM. Paul de Civrac, Arthur Brad et Jonathan Bild.
L’article de M. C. Brularion fut lu par l’humanité entière, du moins la portion d’humanité qui savait lire. Il n’apprenait d’ailleurs rien de nouveau, mais il concluait à l’existence de la vie sur toutes les planètes et, naturellement, à l’habitabilité, pour l’homme, de Mercure et de Vénus. Il posait des questions, qui devaient d’ailleurs rester longtemps sans réponse, puisque le message vénusien ne serait pas renouvelé avant un peu plus de huit années.
Qu’était la Roue Fulgurante et qu’était-elle devenue ?
Quelle sorte de mort menaçait Paul de Civrac, Lola Mendès et Francisco, laissés sur Mercure ?
Comment était fait l’appareil vénusien ? et aussi les télescopes qui permettaient d’annihiler la distance de seize millions de lieues qui séparait Vénus de la Terre au moment de la réception du message ?
Et M. C. Brularion terminait ainsi :
« Maintenant surtout, nous sommes frappés du regret que la science humaine ne soit pas encore capable de construire un engin qui nous permettrait d’aller au secours de nos frères prisonniers sur la planète Mercure et de faire avec eux des découvertes vraiment extraordinaires ! »
Or, à huit heures du matin, le jour où l’Universel publia cet article, l’illustre docteur Ahmed-bey déjeunait seul dans la salle à manger de son luxueux hôtel, qui était en bordure du parc Monceau, à Paris. Déjeuner frugal, car il se composait simplement d’une minuscule tasse de café turc. Derrière le maître se tenait, immobile et droit, un serviteur que son costume et son visage décelaient d’origine hindoue. Et, devant Ahmed-bey, le journal l’Universel, soutenu par une carafe, était déplié… Tout en vidant à petits coups espacés sa tasse de café, le docteur lisait…
Quand il fut arrivé à la conclusion de l’article de M. Brularion, il reposa la tasse vide sur une soucoupe et il se frotta les mains, tandis qu’un rire silencieux ridait ses joues émaciées. Puis, se tournant vers l’Hindou impassible, il prononça quelques mots. Le valet sortit. Deux minutes après, un jeune homme entra dans la salle à manger et s’inclina devant Ahmed-bey.
– Monsieur Marlin, dit le docteur, vous irez vous-même inviter à souper de ma part, pour minuit, les personnes dont je vais vous donner la liste. Vous leur direz que je juge leur présence indispensable… Indispensable, entendez-vous ?
– Bien, maître.
– Écrivez.
Et sur une tablette en ivoire qu’il tenait à la main, le jeune homme écrivait au crayon, tandis que le docteur dictait :
– L’astronome Brularion, le docteur Payen, l’abbé Normat, le professeur Martial et M. Torpène, préfet de police. C’est écrit ?
– Oui, maître.
– Vous ferez ces visites ce matin même. Cet après-midi, vous veillerez à ce que le laboratoire soit installé comme pour mes séances de spiritisme… Et téléphonez tout de suite à mon notaire de venir déjeuner avec moi… Allez !
Le secrétaire se retirait, mais son maître le rappela :
– J’oubliais. Sur l’invitation adressée à M. Torpène, vous ajouterez textuellement cette phrase : « le docteur Ahmed-bey a trouvé ce dont il vous a parlé, dans le parc Monceau, pendant la nuit du 21 au 22 juin. »
Et, congédiant d’un geste son secrétaire, le docteur se leva, plia le journal, eut un second sourire silencieux, et il sortit aussi de la salle à manger, mais par une autre porte que celle qu’avaient prise l’Hindou et M. Marlin. Ahmed-bey passa la journée dans son laboratoire, occupé à des besognes mystérieuses dont nul homme ne fut témoin. Il ne s’interrompit que pendant une heure, à midi, pour déjeuner en compagnie de Me Suroit, son notaire, à qui il donna des ordres méticuleux concernant certains placements de fonds.
Le soir, il dîna à huit heures, seul, et très frugalement. Puis, il se retira de nouveau dans son laboratoire, après avoir commandé à l’Hindou de faire attendre les visiteurs au salon jusqu’à ce qu’ils fussent au nombre de cinq et de les introduire ensuite dans la salle à manger, où un souper froid serait servi.
Le laboratoire du docteur Ahmed-bey occupait tout le sous-sol de l’hôtel. C’était une immense pièce, dont le plafond, très élevé, était soutenu par des colonnes de marbre. Tout autour se succédaient de profonds divans au-dessus desquels des rayons nombreux, appliqués au mur, supportaient quatre ou cinq mille livres. Au milieu s’élevait une machine électrique, énorme et un peu effrayante, entourée d’autres machines plus petites et de baquets en porcelaine à demi remplis de liquides de diverses couleurs.
Devant la machine électrique se dressaient deux tables de marbre blanc, assez semblables aux dalles de dissection d’un amphithéâtre.
Trente lustres électriques, à quatre lampes chacun, éclairaient violemment cette vaste salle, et dix radiateurs, à graduation minutieuse, et dix bouches de froid, aussi minutieusement graduées, pouvaient y répandre une chaleur tropicale ou un froid sibérien : froid et chaleur étaient produits par des machines disposées dans un sous-sol inférieur et que des mécaniciens hindous maintenaient nuit et jour en continuelle activité.
Ce jour-là, la température du laboratoire était seulement de douze degrés au-dessus de zéro.
À minuit moins trois minutes, un timbre retentit. Le docteur, qui rêvait couché sur un divan, se leva, passa dans un vestiaire aménagé à l’entrée du laboratoire, et remplaça par une redingote la longue blouse de toile qu’il portait. Puis il se rendit dans la salle à manger, où ses invités l’attendaient.
Après les salutations et congratulations accoutumées, Ahmed-bey plaça M. C. Brularion en face de lui et s’assit entre M. Torpène et l’abbé Normat, savant physiologiste ; le docteur Payen, de l’Académie de médecine, et le professeur chimiste Martial, de l’Académie des sciences, s’assirent de chaque côté de M. Brularion.
– Messieurs, dit Ahmed-bey, pendant que le maître d’hôtel surveillait le passage des hors-d’œuvre, dont on ne se servit d’ailleurs que fort peu, Messieurs, je vous remercie d’avoir répondu à mon invitation si peu préparée. Vous ne le regretterez pas. Ce n’est point à une séance de spiritisme que je vous ai priés cette nuit, mais à un spectacle prodigieux auquel vous ne sauriez vous attendre… Et comme vous aurez besoin, pour le supporter avec calme, de toutes vos forces morales et physiques, je vous conseille de manger selon votre appétit… Vous m’excuserez de ne vous faire boire que de l’eau, mais il importe que vos cerveaux soient d’une lucidité, d’une froideur absolues, et j’ai souvent remarqué qu’un seul demi-verre de vin diminue, – oh ! bien peu ! – mais diminue vraiment ces facultés, même chez l’homme le mieux trempé… Quant à moi, je ne mangerai pas… car ce que je vais faire exige que mon estomac soit complètement vide. Ce matin, j’ai déjeuné avec une frugalité toute cénobite, et je n’ai absorbé que des liquides d’assimilation prompte, facile et complète… Que mon jeûne, cependant, ne vous influence pas… Faites honneur à la cuisine de mon maître-coq indien.
On approuva. Mais malgré la placidité d’Ahmed-bey, qui ne montrait pas la moindre émotion, les cinq convives mangeaient vite ; plus que leur appétit, leur curiosité était éveillée par les paroles de leur amphitryon.
À minuit cinquante, les valets servirent des sorbets et des fruits ; on n’y toucha que du bout des lèvres et, comme une heure sonnait au cartel, Ahmed se leva, imité aussitôt par ses cinq convives.
Hormis le petit discours d’Ahmed-bey au commencement, pas une parole n’avait été prononcée pendant le repas. On savait que c’était une habitude stricte du docteur mystérieux de ne jamais donner d’explications avant ses « expériences ».
– Veuillez me suivre, Messieurs, dans le laboratoire, dit-il en ouvrant une porte.
Ayant traversé un couloir et descendu les trente marches de marbre d’un large escalier, les six hommes entrèrent dans le laboratoire, vivement éclairé par tous les lustres électriques.
– Veuillez vous asseoir, Messieurs, et m’écouter.
Les cinq invités prirent place sur un divan, et Ahmed-bey s’assit devant eux, sur un simple tabouret de bois. Il tira de sa poche un journal, le déplia et lut à haute voix :
« Maintenant surtout, nous sommes frappés de regret que la science humaine ne soit pas encore capable de construire un engin qui nous permette d’aller au secours de nos frères prisonniers sur la planète Mercure et de faire avec eux des découvertes vraiment extraordinaires. »
Le docteur replia le journal et, s’adressant à M. Brularion :
– C’est la conclusion de votre article de ce matin.
L’astronome inclina la tête.
– Eh bien ! reprit Ahmed-bey en souriant, – et ses yeux noirs lancèrent un éclair du fond de l’orbite immense où ils se cachaient, – eh bien ! mon cher astronome, n’ayez pas ce regret !… ou plutôt, n’ayez plus ce regret.
– Que voulez-vous dire ? s’écria M. Brularion, stupéfait.
– Je veux dire que si la science moderne n’a pas découvert et n’est pas près de découvrir un engin capable de vous transporter dans quelque planète…
Ahmed-bey suspendit sa parole, se leva et, majestueux, il reprit :
– La science antique avait trouvé le moyen de supprimer l’espace et les distances pour la volonté de l’homme… Ce moyen permettait à un brahmane, il y a des centaines de siècles, de quitter la Terre pour aller voyager dans les espaces interplanétaires et au delà des étoiles…
– Et ce moyen ? fit l’abbé Normat, tandis que les quatre coinvités attendaient.
– Il a été perdu… répondit Ahmed-bey.
– Mais alors ?
– Je l’ai retrouvé…
Cette parole tomba dans le silence angoissé des cinq savants. Ils connaissaient la mystérieuse profondeur de la science d’Ahmed-bey, son caractère grave, sa méthode rigoureuse dans la recherche de la vérité.
Ils ne pouvaient douter de son affirmation, et une émotion violente les animait…
– Messieurs, reprit Ahmed-bey sans se départir de son calme, vous savez tous que les prêtres du temple de Çakoulna, dans l’Inde antique, entendaient par la désincarnation et la réincarnation des âmes…
– Oui, répondirent ensemble les voix des cinq savants.
– Avec quelques mots, constituant une formule d’incantation révélée par Brahma lui-même, les brahmanes trois fois saints pouvaient séparer l’âme de son corps, gouverner cette âme, la faire voyager à leur gré, la rendre à son corps primitif ou la réincarner dans un autre… En modifiant la formule d’incantation, en la modifiant d’une seule syllabe, les brahmanes pouvaient commander à leur âme propre, et, laissant à terre leur dépouille humaine, s’en aller, en esprit, dans l’infini des ciels astronomiques !… Saviez-vous tout cela, Messieurs ?
– Oui, répondit gravement l’abbé Normat. Mais, pour ma part, je n’y croyais guère !… Je n’y croyais à peine qu’à demi !… Un homme capable de désincarner une âme et de la réincarner est le maître absolu de la vie et de la mort… Un tel pouvoir n’appartient qu’à Dieu !…
– Il appartient à moi ! prononça majestueusement Ahmed-bey.
Il y eut, sur ces terribles mots, un instant de silence solennel. Puis, M. Torpène dit tout à coup, en tressaillant, comme s’il sortait d’un rêve :
– Eh bien ! Monsieur ?…
Le docteur Ahmed-bey eut un sourire et prononça lentement :
– Ce fut à dix-sept ans que je découvris, sous la Grande-Pyramide, une peau de vache tannée, conservée par des procédés inconnus, et couverte d’inscriptions en sanscrit hermétique. Après un an de travail, j’arrivai à déchiffrer l’inscription. Elle m’apprenait ce que je viens de vous dire et que, depuis, j’ai révélé, sans me nommer, au monde savant. Mais elle m’apprenait, en plus, par quels moyens je pourrais parvenir peut-être à découvrir le merveilleux secret de la désincarnation et de la réincarnation des âmes… Une telle lecture fit sur moi une profonde impression. Deux ans après, mon père étant mort en me laissant une immense fortune, je partis pour l’Inde. Je retrouvai le temple de Çakoulna. Je me fis initier aux mystères de Brahma, de Vishnou, de Siva et de Ganéta. J’étudiai les livres sacrés qui remontent aux origines de l’intelligence humaine et je recueillis l’enseignement qui tombait des lèvres desséchées des brahmanes, des stylites, des pénitents sacrés… Tout cela dans le seul but de savoir si l’inscription hermétique ne me trompait pas. Quand je fus convaincu de sa véracité, je me mis enfin à la suprême recherche… Seul, j’ai gravi le Thibet… Seul, j’ai erré dans les jungles qu’habitent en souverains les serpents et les tigres et où les palmiers croissent entre les ruines des temples…
Ahmed-bey, dont la voix était devenue étrangement grave et mélancolique, – quels souvenirs évoquait sa mémoire !… – Ahmed-bey se tut et baissa la tête.
Pendant quelques minutes, les savants respectèrent cette émotionnante rêverie. Mais Ahmed-bey n’avait pas tout dit, et l’on attendait…
– Parlez encore ! s’exclama soudain l’abbé Normat, frémissant d’impatience.
– Eh ! n’ai-je pas tout révélé ! murmura le docteur d’une voix éteinte.
Mais aussitôt, d’un ton net et vibrant, il ajouta :
– Le secret de l’inscription hermétique, je le possède !…
Nul parmi les cinq auditeurs ne douta de la vérité de cette parole extraordinaire. Ils se levèrent ensemble, en proie à une invincible agitation.
– Mais s’il est vrai, s’écria M. Constant Brularion, que ni le temps ni l’espace n’existent réellement pour l’âme telle que nous la connaissons ; s’il est vrai que l’âme désincarnée garde toute la personnalité intellectuelle et morale de l’individu qu’elle animait, vous pouvez donc désincarner votre âme propre et aller vous-même sur Mercure !
– Tout cela est vrai, dit simplement Ahmed-bey, et je vais, en effet, partir pour la planète Mercure.
– Quand ?
– Tout de suite.
Cette affirmation foudroyante fut suivie d’un silence pesant… mais une voix tremblante dit tout à coup :
– Comment ?
– Vous allez voir… répondit Ahmed-bey en souriant. Veuillez reprendre vos places… Quand tout sera fini, vous n’aurez qu’à vous retirer. Mon fidèle intendant Ra-Cobrah, que vous avez vu ici quelquefois, a les ordres nécessaires pour que ma dépouille mortelle soit conservée intacte et attende mon retour. Je vous demande seulement de me jurer, sur votre honneur, le plus profond secret… Rien de ce que je vous ai dit, rien de ce que vous allez voir ne sera révélé ! Monsieur Torpène, vous surtout, gardez le silence, car rappelez-vous que vous êtes venu m’interroger !… Messieurs, jurez !…
– C’est juré ! firent ensemble les cinq hommes en levant la main droite.
– Parfait !
Le docteur frappa du poing fermé sur un gong.
Aussitôt, une porte s’ouvrit et un Hindou richement vêtu parut dans l’encadrement. C’était Ra-Cobrah. Ahmed-bey lui dit quelques mots en une langue inconnue des cinq invités, et Ra-Cobrah disparut. Aussitôt, le thaumaturge se retira dans le vestiaire. Quand il revint, il portait une longue robe de lin, sans manches et sans col ; ses pieds et ses bras se montraient à nu, et sans doute il n’avait sur le corps que ce vêtement de druide…
Il marcha vers un appareil en cuivre et tourna deux petites roues… la température du laboratoire monta vivement à +50°, comme l’indiquaient les thermomètres…
Au même instant, la porte s’ouvrit et neuf serviteurs, visiblement orientaux, entrèrent avec rapidité, formant un étrange cortège.
L’un d’eux était chargé de cinq tuniques de lin qu’il remit aux invités. Ceux-ci quittèrent vite leurs lourds habits et revêtirent les fines tuniques, car sans cette précaution, qu’ils avaient dû prendre déjà plusieurs fois au cours des expériences d’Ahmed-bey, ils auraient suffoqué.
Quatre autres serviteurs portaient un corps d’homme blanc, les quatre derniers portaient un corps de nègre : ils les déposèrent sur les deux dalles de marbre.
– Messieurs, dit Ahmed-bey, le blanc est un cadavre, on me l’a envoyé il y a deux heures de l’hôpital… la mort a frappé cet homme à midi. Quant au nègre, il n’est qu’endormi. C’est un esclave dont je suis le maître, le possesseur absolu et sans contrôle. Avant de désincarner moi-même ma propre âme et de m’envoler vers Mercure, sans l’embarras de mon apparence terrestre, de mon corps actuellement vivant et agissant devant vous, je veux vous montrer ma puissance… Approchez-vous, constatez que ce blanc est mort et que ce nègre est vivant.
Suivi de ses amis, M. Brularion se leva le premier. Et il fut facile aux cinq savants de constater que l’homme blanc n’était plus qu’un cadavre, tandis que le nègre dormait du sommeil hypnotique.
– C’est exact ! dit M. Torpène.
Alors, devant les cinq spectateurs rangés auprès des tables de marbre, Ahmed-bey étendit le bras jusqu’à la colonne la plus voisine et sa main tourna un bouton d’ivoire. Tous les lustres s’éteignirent. Un seul, juste au-dessus des dalles, laissait tomber une clarté de veilleuse. Les contours du laboratoire se perdaient dans une impressionnante obscurité, où, çà et là, comme un œil de monstre, brillait un reflet de cuivre ou un éclat de cristal.
Ahmed-bey commença les passes magnétiques. À mesure que ses mains accomplissaient les gestes traditionnels, ses lèvres murmuraient des incantations millénaires, et ses yeux, agrandis, jetaient des éclairs. Tout son visage se transfigurait…
Avec une indicible émotion, les cinq savants virent bientôt le corps du nègre tressaillir, se convulser, tandis qu’une écume rougeâtre moussait entre ses lèvres… Soudain, le corps noir se redressa, retomba tout du long sur le marbre et, de sa bouche ouverte, sortit une petite étincelle qui resta, hésitante et sautillante, dans l’air… Ahmed-bey fit un grand geste en jetant un cri terrible, et l’étincelle fila d’un trait dans la bouche du cadavre blanc, entre les lèvres duquel elle disparut…
Se détournant du noir, Ahmed-bey renouvela des passes sur la tête du blanc – et on vit alors ce corps nu, qui n’était tout à l’heure qu’un cadavre, frissonner, s’agiter et ouvrir les yeux, des yeux étranges, effarés, pleins encore des mystères de l’au-delà.
Mais Ahmed-bey modifia ses passes : le ressuscité referma les yeux et s’endormit… le thaumaturge fit un mouvement rapide et, de nouveau, les lustres répandirent leur éclatante lumière.
Après quelques minutes d’un lourd silence, Ahmed-bey, qui s’était calmé progressivement, sourit et dit de sa voix normale :
– Maintenant, messieurs, veuillez constater que l’homme blanc est parfaitement en vie et que le nègre est mort… J’ai fait passer l’âme du second dans le corps du premier !
Malgré l’émotion et même l’effroi qui troublait leur intelligence, les cinq savants purent facilement constater qu’en effet l’ancien cadavre vivait et que l’ancien vivant n’était plus qu’un cadavre.
Ahmed-bey, de son poing fermé, frappa le gong. Les huit serviteurs reparurent. Sur un signe de Ra-Cobrah, qui les accompagnait, ils enlevèrent le blanc et le noir et sortirent en courant.
– C’est terriblement merveilleux ! murmura M. Brularion, dont le front ruisselait de sueur froide.
– Mais, que va-t-on faire du mort et du ressuscité ?
– Le mort, répondit tranquillement Ahmed-bey, sera dissous en trois minutes dans un liquide de ma composition : il n’en restera pas un morceau gros comme une tête d’épingle… Quant au blanc, qui est ressuscité, il prendra rang parmi mes domestiques…
– Mais vous lui avez donné une âme de nègre ! s’écria le docteur Payen.
– Sans doute !
– Cette âme se trouvera donc dépaysée singulièrement dans ce corps blanc.
– Pas beaucoup ; le nègre que j’ai tué était domestique ici. Devenu blanc, il continuera ses fonctions. Quant au changement de couleur et de forme de son corps, Ra-Cobrah la lui expliquera par l’intervention miraculeuse des manitous… C’est l’affaire de quelques jours pour que l’âme du noir se trouve à l’aise dans sa nouvelle enveloppe blanche.
– Mais vous avez tué un homme ! dit le préfet de police en essayant de sourire.
– Un crime ! fit M. Martial avec un rire forcé.
– Non ! réplique le thaumaturge, puisque, si j’ai tué un corps humain, j’en ai ressuscité un autre…
– En effet, dit l’abbé, ce n’est qu’une substitution…
Et les cinq amis reprirent leurs places sur le divan.
– À présent, Messieurs, dit Ahmed-bey, redevenu grave, permettez-moi de vous serrer la main et souhaitez-moi bon voyage… Dans cinq minutes, dépouillé de ma lourde enveloppe terrestre, je volerai, âme pure, dans les espaces interplanétaires…
Ces prodigieuses paroles n’étonnèrent pas les cinq auditeurs. Ce qu’ils venaient de voir les avait aguerris. Ils serrèrent la main que leur tendait leur amphitryon, et l’astronome exprima la pensée de tous en disant :
– Nous souhaitons que votre voyage soit court et que vous reveniez… Tâchez de tirer au clair le mystère de la Roue Fulgurante.
– Je reviendrai, dit Ahmed-bey. Quant à la durée du voyage, je l’ignore. Je passerai par Vénus, pour désincarner et emmener avec moi les âmes de MM. Bild et Brad. Ensuite, nous irons tous les trois sur Mercure, où il nous faudra chercher Mlle Lola Mendès, M. Paul de Civrac et Francisco… Nous nous réincarnerons probablement dans des corps mercuriens… Tout dépend donc du temps que nous mettrons à cette recherche…
– Et le temps pour aller d’ici à Vénus, puis à Mercure ?… demanda le docteur Payen.
– En un éclair ! répondit Ahmed-bey. L’âme pure voyage aussi vite que la pensée. Or, votre pensée ne met pas une seconde à se transporter même sur la plus éloignée des étoiles… Et maintenant, Messieurs, je vous demande le plus absolu silence et je me permets de vous rappeler votre parole.
Ayant prononcé ces mots d’une voix impérieuse et grave, Ahmed-bey éteignit encore tous les lustres pour ne laisser allumée que la lampe du milieu en veilleuse.
Il s’étendit aussitôt sur une des dalles de marbre. Il ferma les yeux. De ses lèvres jaillirent d’incompréhensibles paroles. On le vit pâlir, frissonner par saccades de moins en moins fortes, puis rester immobile : une mousse rougeâtre parut entre ses lèvres. Une convulsion l’agita, sa bouche s’ouvrit – et il en sortit une étincelle blanche qui, rapide, dansa un moment devant les yeux des cinq savants médusés, monta vers le plafond – et, soudain, disparut.
Quelques minutes d’un silence tragique s’écoulèrent.
Les cinq amis regardaient le corps d’Ahmed-bey immobile et rigide sur la dalle.
Or, une porte s’ouvrit, et Ra-Cobrah s’avança vers le cadavre de son maître. En passant près d’une colonne, il tourna un bouton électrique, et la vive clarté des lustres illumina de nouveau le laboratoire.
– Messieurs, dit Ra-Cobrah… l’âme du maître est partie… Je vous prie de vouloir bien me laisser donner à son corps les soins prescrits…
Le premier revenu à son sang-froid, le docteur Payen, se leva et se dirigea vers le corps d’Ahmed-bey. Il le palpa, l’ausculta, passa devant ses lèvres un léger miroir de poche, appliqua un stéthoscope à la place du cœur et écouta…
– Mes amis, dit-il d’une voix tremblante, en se tournant vers ses quatre compagnons, cela est incontestable : le corps d’Ahmed-bey, ici couché, est un cadavre… Nous avons vu… Il n’y a plus qu’à attendre…
Et après avoir remis leurs vêtements ordinaires, salués par Ra-Cobrah, les cinq savants sortirent du laboratoire. Précédés par un serviteur hindou, qui reprit les cinq tuniques de lin, ils remontèrent l’escalier, traversèrent un corridor, une vaste antichambre, un jardin, franchirent une grille, et se trouvèrent devant leurs cinq voitures rangées au bord du trottoir. Ils se quittèrent après un serrement de mains, sans un mot, l’esprit bouleversé…
Il était quatre heures du matin, et les premières lueurs de l’aube montaient du côté du Panthéon.
CHAPITRE II
OÙ L’ON RETROUVE ENCORE UN PERSONNAGE AUSSI INTÉRESSANT QU’AHMED-BEY
Or, dans les régions désolées de la planète Mercure, sur le plateau crépusculaire dressé au bord de l’immensité des ténèbres, Paul et Francisco continuaient à lutter contre la mort.
Les dix Mercuriens tués leur fournirent du sang et du feu pendant cinquante-six heures : le sang apaisait la faim et la soif ; le feu diminuait le froid mortel tombant du ciel sombre et venant de l’infini des ténèbres…
Comme l’avant-dernier monopède brûlait :
– Señor, dit Francisco, vous resterez ici pendant que j’irai en chasse. Soixante heures se sont écoulées depuis le dernier message ; nous n’en recevrons d’autre que dans trente-six-heures. Il ne faut pas que nous mourions de froid d’ici là… Vous voyez, pas un de ces monstres n’est demeuré dans la gorge… Quand ils ont vu que nous boirions leur sang et brûlerions leurs corps, ils se sont sauvés… Ils doivent être redescendus dans la vallée… J’y vais. Pendant ce temps, vous brûlerez le dernier… ça vous tiendra chaud jusqu’à mon retour. Moi, je suis agile, je ne risque rien. Vous, avec votre pied encore douloureux, vous ne pourriez pas m’être bien utile. Il vaut donc mieux que vous restiez ici… Dans trois ou quatre heures, je reviendrai et j’apporterai une demi-douzaine de ces monopèdes, comme vous les appelez… Et peut-être rapporterai-je aussi des nouvelles de Lola !
– C’est bien, va ! dit Paul.
Il était absorbé par des pensées si tristes que, sans l’espoir de retrouver et de sauver Lola dès que son pied serait tout à fait guéri, il se serait laissé mourir. La venue de Bild et de Brad lui semblait maintenant fort problématique : il n’osait croire, malgré le merveilleux phénomène des projections, que les Vénusiens trouveraient le moyen de faire voyager Bild et Brad de Vénus à Mercure. Puis, toutes les étranges aventures qu’il avait vécues depuis son enlèvement à Bogota étaient si exorbitantes qu’il se croyait toujours le jouet d’un interminable cauchemar. Et son énergie sombrait peu à peu.
Mais déjà Francisco, qui pensant moins, agissait davantage, avait saisi son épieu et s’était élancé vers la gorge de la montagne.
Avant de sauter sur le versant lumineux du mont, il se retourna vers Paul, et, agitant en l’air son épieu :
– À bientôt, Señor !… cria-t-il.
Et, tandis que les échos aériens répercutaient son cri avec des roulements de tonnerre, il bondit. Adroit, il visait un endroit à vingt ou trente mètres en avant, calculait son élan et partait. C’est à peine s’il touchait le sol ; ses jambes élastiques et nerveuses pliaient, se redressaient, et il dévalait la montagne avec une vertigineuse rapidité… Il eut de nouveau la sensation de l’aveuglante lumière et de la chaleur étouffante ; il suffoquait un peu. Mais il savait que le malaise était passager, et il ne s’en préoccupait pas.
Il traversa sans s’arrêter le vaste plateau où Paul s’était blessé. Pas un Mercurien n’était en vue.
« Ils auront regagné leur ville, au bord du fleuve ! », se dit-il.
Et il se dirigea vers une dépression qui lui parut être l’endroit où la gorge, conduisant, à travers la falaise, jusqu’au bord du Fleuve d’Or, débouchait sur le plateau. Mais, arrivé à cette dépression, il se rejeta violemment en arrière en poussant un cri : devant ses yeux se creusait à pic le précipice tout au fond duquel le Fleuve d’Or miroitait. C’était comme une énorme crevasse dont les deux bords, à cent mètres environ de distance l’un de l’autre, surplombaient l’abîme…
« Demonios ! jura Francisco… j’ai failli sauter là dedans !… »
Mais aussitôt il se rappela qu’il était tombé de bien plus haut, en quittant la Roue Fulgurante ; il réfléchit à sa légèreté propre, à la densité de l’air, à toutes les choses scientifiques que Paul lui avait expliquées, et il se mit à rire de son instinctive frayeur.
« Bah, dit-il gaiement, j’oublie toujours que je ne suis pas sur la Terre. Je ne vais pas me mettre à rechercher le sentier par lequel nous sommes montés… Je vais me jeter là… Je tomberai sur le fleuve… Il fera matelas… Puisque, en tombant de la Roue Fulgurante, je ne me suis fait aucun mal, à plus forte raison le saut du haut de la falaise jusqu’au fond de la vallée est-il sans danger pour moi… Et je serai plus vite arrivé !… Puis, en me voyant survenir de cette manière, les Mercuriens seront tellement ahuris que je pourrai m’emparer sans combat d’une demi-douzaine d’entre eux… Par exemple, échapper aux autres sera moins commode… Mais peut-être qu’ils n’oseront pas me poursuivre… Allons-y ! hop !… »
Et il sauta, en regardant au-dessous de lui.
Il lui sembla que le fleuve montait à sa rencontre… Et il se mit à rire. Mais, aussitôt, il poussa un juron ; il avait sauté trop loin du bord de la falaise, et il allait tomber non sur le fleuve, mais sur le rivage, au milieu ; des maisons pyramidales… Il eut à peine le temps de se rendre compte de cet accident imprévu.
« Si je rencontre le roc ou une maison, se dit-il, je vais tout au moins me casser les chevilles… »
Au même instant, il touchait terre, non des pieds, mais du dos. Il ressentit une violente secousse. Il garda cependant toute sa présence d’esprit.
« Bon, je ne me suis rien cassé… murmura-t-il, quoique le choc ait été dur. »

Et il allait se relever, lorsqu’il vit surgir de tous côtés les monopèdes. Il brandit l’épieu. Mais avant que l’arme fût retombée, vingt griffes lui saisissaient les jambes, les bras, tout le corps… Il se débattit, mais ce fut en vain. Une corde rugueuse l’enserra de toutes parts, immobilisa ses membres, cingla ses flancs, s’enroula autour de son cou… À demi étranglé, il se sentit soulevé, transporté au milieu d’un vacarme de sifflements furieux – et, tout à coup, il se trouva seul, à terre, dans l’obscurité. Un carré de lumière, au ras du sol, disparut : une porte venait de se fermer.
Francisco était prisonnier dans une des maisons pyramidales de la ville mercurienne.
Il fut pris d’abord d’un tel accès de rage qu’il se tordit dans ses liens, essaya inutilement de les mordre, et jeta contre ces ennemis toutes les malédictions dont peut disposer un Espagnol. Mais cette crise d’impuissante colère se calma peu à peu, et Francisco cessa de crier et de jurer, ce qui lui permit d’entendre avec stupéfaction son nom prononcé à voix basse…
– Santa Virgen ! fit-il, qui m’appelle ?
– Francisco, c’est…
– La Señorita !…
– Ne crie pas ainsi, ne crie pas !…
– Señorita ! Señorita ! s’exclamait le pauvre homme.
Et des larmes gonflèrent ses yeux lorsque, dans l’ombre de sa prison, il vit le visage de Lola Mendès se pencher sur lui.
– Señorita ! c’est vous ! vous ! je ne rêve pas ?…
– Non, Francisco, tu ne rêves pas… Je suis enfermée ici depuis longtemps… Mais Paul, Paul, où est-il ?…
– Comment ?… Oh ! détachez-moi vite, Señorita…
– J’ai les mains et les jambes liées, moi aussi… Réponds-moi… Qu’est devenu M. de Civrac ?…
– Sain et sauf, Señorita, sain et sauf dans la montagne… Et il m’attend !… Ah ! s’il savait que vous êtes là ! Il accourrait ! Il viendrait se faire prendre pour être avec vous…
– Tu le crois ? fit Lola.
Et sa voix tremblante décelait son émotion.
– Señorita, répondit Francisco, il ne pense qu’à vous. Mais, dites-moi, comment êtes-vous ici ?…
En quelques mots, Lola Mendès raconta que le Fleuve d’Or l’avait entraînée dans une caverne. Elle y fut saisie par des Mercuriens et mise sous la sauvegarde d’un chef… On remonta le fleuve et elle fut enfermée dans ce cachot. Deux fois par jour, dans un bol de métal jaune, on lui apportait une sorte de crème blanche : elle la buvait en fermant les yeux – pour vivre ! Elle espérait bien que Paul et Francisco la rechercheraient et la délivreraient. Aucun monopède ne l’avait touchée. Parfois, le chef, reconnaissable aux anneaux d’or flexible qui encerclaient sa trompe, entrait dans la hutte ; il refermait la porte derrière lui, s’accroupissait dans l’ombre, sifflait, gesticulait et s’en allait.
Quand Lola Mendès eut fini de parler, Francisco raconta les aventures qu’il avait courues avec Paul. À l’épisode des projections de Bild et de Brad, Lola n’en pouvait croire ses oreilles. Francisco dut répéter trois fois son récit. Et Lola, pleurant de joie, s’écria :
– Mais la blessure de M. de Civrac ?…
– Rien ! Dans quelques heures, le pied sera tout à fait guéri… Mais que va faire maintenant M. de Civrac ?… En ne me voyant pas revenir, va-t-il se mettre à ma recherche ? Ou bien voudra-t-il rester sur le plateau pour attendre les projections ?… Dans ce cas, il souffrira durement de la faim et du froid !…
– Mon Dieu ! mon Dieu ! que faire ? gémissait Lola en tordant ses deux bras que des liens grossiers réunissaient aux poignets…
– Caramba ! si je pouvais me délivrer ! Señorita, avez-vous essayé de déchirer avec les dents ces cordes qui vous attachent ?…
– Oui, mais mes dents sont trop faibles… Je n’ai même pas pu les érailler, ces cordes diaboliques !
– Señorita, j’ai une idée… Il me semble bien que ces cordes sont faites avec des tiges d’herbes rousses entrelacées… Mes dents sont solides… Mais ces monstres m’ont si bien ligoté que je ne peux remuer la tête… Avancez vos bras… mettez vos liens sur mes dents… Là… ne bougez pas !
Et, avec vigueur, Francisco se mit à mordre à pleines canines les cordes qui liaient les mains de Lola… Bientôt, une fibre craqua, puis une autre, puis tout un faisceau de fibres. Francisco redoubla ses coups de dents. Et, tout à coup, les liens tombèrent.
Lola poussa un cri de joie en levant ses mains libres.
– Ah ! si j’avais des allumettes ! fit Francisco. Je les ai laissées à M. de Civrac !… Mais vite, Señorita, cherchez par terre une pierre, un morceau d’ardoise, quelque chose de dur… Vite ! ces bandits noirs ne tarderont pas, sans doute !…
Lola eut vite trouvé sur le sol nu de la hutte un éclat d’ardoise…
– Bravo ! raclez la corde de mon cou… oui… celle-là ! Raclez fort, Señorita ! N’ayez pas peur de m’écorcher, j’ai la peau dure…
Quand Francisco sentit que les fibres étaient limées à moitié, il banda ses nerfs en une tension prodigieuse, et le lien usé cassa net… L’Espagnol pouvait remuer la tête… Et ce fut dès lors l’affaire d’un instant. Avec ses dents, Francisco eut vite délivré ses deux mains. Ses doigts nerveux dénouèrent la corde qui enserrait les jambes de Lola, puis celle qui le garrottait lui-même des pieds à la poitrine…
Et les deux prisonniers se dressèrent ensemble…
– Je n’ai pas d’arme ! gronda Francisco. Ah ! mon épieu ! mon épieu ! comme il nous serait utile maintenant !… Impossible de fuir sans une arme pour nous ouvrir le chemin !… N’y a-t-il rien dans cette cabane ?… N’avez-vous rien vu, Señorita ?
Francisco eut vite fait le tour de leur prison. Elle était carrée à la base, les quatre murs triangulaires se rétrécissaient en montant et se rejoignaient à une hauteur de deux mètres. Le carré, sur le sol, avait trois mètres de côté. Aucun meuble, aucun ustensile, rien ! Sur le sol lisse, quelques éclats d’ardoise, gros comme une pièce de cinq francs.
– Et la porte ! s’écria Lola. De quoi est-elle faite ?
– Un bloc d’ardoise, répondit Francisco. J’y avais déjà pensé… C’est trop incommode à manier… Cependant, puisqu’il n’y a pas autre chose…
Et l’Espagnol se disposait à regarder si la porte était fixée, et comment, lorsque le bloc d’ardoise tomba en dedans… la lumière du dehors envahit la cabane, et les prisonniers purent voir une foule innombrable de monopèdes se presser jusqu’au rivage du fleuve… Sur le seuil, immobile et droit, se tenait le Mercurien avec sa trompe brillante d’anneaux d’or…
Par des gestes et par des sifflements, il manifestait l’émotion que lui causait probablement la vue des jambes et des bras libres de ses prisonniers.
Mais comme les Mercuriens connaissaient maintenant la dangereuse puissance des êtres extraordinaires venus ils ne savaient d’où sur leur planète, aucun monopède n’avançait, et le chef lui-même regardait souvent en arrière pour voir si, en cas d’attaque, la retraite lui serait possible…
Ramassé sur lui-même, presque assis sur ses talons, afin de bien voir par la porte basse ce qui se passait au dehors, Francisco, les poings fermés en avant, réfléchissait. Lola était debout derrière lui, prête à obéir dès qu’il ordonnerait, car, là, c’était la maîtresse qui laissait au domestique le soin de prendre une détermination.
Fuir à travers cette foule ? Sans armes, c’était impossible. D’autant plus impossible que l’ouverture de la porte n’ayant qu’un mètre cinquante environ de hauteur, Francisco et Lola devraient se baisser pour passer. Et avant que, une fois dehors, ils eussent pris leur élan pour sauter plus loin, ils seraient saisis par les griffes, terrassés, peut-être blessés.
Francisco se rendait compte de tout cela, lorsqu’il remarqua un fort remous dans la foule des monopèdes. Des bras gesticulèrent, des sifflements retentirent.
– Qu’est-ce qu’ils vont faire ? grommela Francisco.
Mais, au même instant, les prisonniers virent avec stupéfaction la hutte d’ardoise se soulever, monter en l’air, retomber sur le côté, et ils furent assaillis par derrière. Vingt monopèdes leur sautèrent dessus, les terrassèrent, les ligotèrent avec de nouvelles cordes, et on les porta aussitôt dans une autre maison pyramidale.
Et Francisco comprit : les huttes reposaient simplement sur le sol, sans fondements. Des Mercuriens avaient soulevé celle dans laquelle ils étaient enfermés et d’autres les avaient assaillis par derrière, afin de les capturer à la faveur de la surprise que leur causerait le mouvement inattendu de la maison.
CHAPITRE III
QUI SEMBLE FOLLEMENT FANTASMAGORIQUE ET QUI N’EST CEPENDANT QUE
SCIENTIFIQUEMENT RÉEL
Après quatre heures de solitude, Paul de Civrac s’étonna de ne pas revoir Francisco. L’avant-dernier monopède venait de se consumer entièrement. Le jeune homme enflamma une allumette et mit le feu, par les pieds, au dernier Mercurien qui lui restait. Il ne souffrait pas de la faim, car le sang des monopèdes était une nourriture réconfortante ; il sentait peu le froid, assis contre la roche qui l’abritait du vent et devant le Mercurien qui brûlait avec des flammes fusantes et gaies donnant lumière et chaleur.
Mais l’absence prolongée de Francisco l’inquiétait. Quatre heures passèrent encore. Francisco ne reparaissait pas.
« Je vais descendre jusqu’au grand plateau, se dit Paul. Mon pied est presque guéri ; en faisant attention au terrain, je pourrai marcher encore assez vite… la projection vénusienne ne brillera pas avant vingt-huit heures. J’ai donc le temps. »
Cependant, il attendit que le monopède fût entièrement consumé. Quand la dernière flamme pétilla, puis s’éteignit, il se leva, saisit son épieu et se mit en marche vers l’entrée de la gorge.
Or, il ne remarqua pas qu’au moment où il se levait, deux étincelles blanches avaient accouru de l’infini des ténèbres et que, pendant sa traversée de la plate-forme crépusculaire, il était suivi par deux étincelles minuscules qui flottaient en l’air, sur une ligne horizontale, à la hauteur de ses épaules.
Il marchait. Par bonds mesurés, il descendait l’abrupte gorge, en pleine lumière mercurienne. Et maintenant, s’il s’était retourné, il n’aurait pu voir les deux étincelles, devenues invisibles dans l’intense clarté.
Plus heureux que Francisco, après avoir traversé l’immense plateau qui s’étendait à mi-montagne, il arriva devant l’entrée du sentier abrupt qui dévalait, à travers la noire falaise, jusqu’au Fleuve d’Or.
Il allait s’y engager, lorsque, dans une caverne creusée au bord du sentier, il vit cinq Mercuriens. Il s’arrêta, indécis. Mais les monopèdes bondirent aussitôt vers lui, trompes sifflantes et griffes en avant. Craignant pour sa vie, ou tout au moins pour sa liberté, Paul de Civrac leva son épieu et en assena un coup violent sur chacun des monopèdes qui le pressaient de plus près. Les coups rendirent le même son qu’un heurt de massue sur le bois vert. Deux monstres, frappés, tombèrent. Les trois autres s’enfuirent précipitamment dans le sentier encaissé.
« Décidément, se dit Paul, la guerre sera continuelle. »
Mais comme il venait de la contrée obscure et froide, il était extraordinairement affecté par la chaleur et la lumière ambiantes.
« Reposons-nous ! » murmura-t-il.
Et, après avoir jeté dans l’ombre de la caverne les deux cadavres mercuriens dont un avait la trompe annelée d’or, signe de haut commandement, Paul de Civrac entra et s’assit près d’eux…
Alors, il vit deux étincelles blanches danser devant ses yeux, puis rester immobiles, en ligne horizontale, à un mètre au-dessus des cadavres…
« Tiens, qu’est-ce donc là ?… Quelque nouveau phénomène de ce pays étrange !… »
Il fit de la main droite, vers les étincelles, le geste d’un enfant qui attrape les mouches au vol.
Mais les étincelles, immobiles, parurent passer à travers la chair de sa main…
« Du diable si j’y comprends quelque chose ! dit-il à mi-voix. Un phénomène électrique, sans doute, à moins que… »
Il se tut, intrigué.
Les deux étincelles descendaient lentement vers les trompes des cadavres mercuriens. Paul les suivait des yeux. Il les vit voltiger une minute devant la ventouse de chacune des trompes, et soudain, ensemble, les deux étincelles disparurent.
Mais aussitôt les cadavres mercuriens parurent ressusciter. Ils agitèrent leur bras, leur jambe, ouvrirent l’œil et, d’un brusque mouvement, se levèrent.
– Hein ! quoi ! cria Paul de Civrac, les cheveux dressés sur sa tête, les yeux écarquillés d’effroi.
Et il saisissait son épieu, il reculait…
Mais les deux Mercuriens ressuscites tombèrent à genoux, inclinèrent leur torse noir, allongèrent humblement leur trompe sur le sol, comme pour supplier le Terrien de ne pas se mettre en colère. Et avant que Paul eût pu revenir de son prodigieux étonnement, le monopède à la trompe annelée se leva et, avec des gestes calmes, des mouvements très doux, sans que le jeune homme sentît le raclement des griffes, le Mercurien avait enlevé l’anneau d’or enchâssant un diamant que Paul de Civrac portait à l’annulaire de sa main gauche.
Tenant le diamant entre ses griffes, le monopède se dirigea vers la paroi lisse de la caverne et, devant Paul de Civrac, qui se demandait s’il n’était pas fou et si tout ce qu’il voyait était bien réel, le stupéfiant ressuscité leva le bras et, méthodique, raya la paroi d’ardoise avec une des pointes du diamant… Et ces raies dessinaient des lettres, qui formèrent des mots… Et à mesure que le Mercurien écrivait, Paul de Civrac lisait :
« Je suis le docteur Ahmed-bey, qui vient de la Terre ; l’autre Mercurien ressuscité est Brad, que je suis allé chercher dans Vénus. Tout cela s’est fait par la désincarnation de l’âme, dont je connais la formule et le secret. Bild, entêté, a voulu rester sur Vénus ; il a refusé la désincarnation et a déclaré qu’il retournerait en chair et en os sur la Terre. Nous l’avons donc laissé. Nous ne pouvons vous parler, puisque les Mercuriens n’ont ni gorge, ni langue, ni dents, ni palais, ni aucun organe qui nous permette d’articuler des paroles humaines, mais nous pouvons vous entendre, puisque les Mercuriens ont des oreilles. Nous avons notre âme terrestre avec des corps et des organes mercuriens. Parlez donc ; je vous répondrai en écrivant… Où est Francisco ? Où est Lola ? »
Quelque préparé au merveilleux que fût Paul de Civrac, cette nouvelle aventure était vraiment trop exorbitante et prodigieuse pour que sa raison n’en fût pas un moment ébranlée.
Il passa donc la main sur ses yeux, se leva, s’approcha de la paroi d’ardoise gravée et lut d’un bout à l’autre la singulière inscription. Puis il regarda les deux Mercuriens. Ils se tenaient debout devant lui, agitant doucement leur trompe, et les deux yeux rouges brillaient, non pas férocement ou stupidement, comme Paul les avait toujours vus briller, mais avec une lueur d’intelligence humaine !…
« Allons ! voyons ! je ne suis pas fou ! dit Paul à haute voix, j’ai tué deux monopèdes, j’ai vu deux étincelles entrer dans leurs trompes, les monopèdes ont ressuscité, celui-ci m’a doucement pris mon diamant et s’est mis à tracer des mots… »
Pendant que Paul parlait, le monopède au diamant s’était rapproché de la paroi d’ardoise, et il se mit à graver ceci :
« Non, vous n’êtes pas fou… Nous sommes Ahmed-bey et Brad ! »
« Ahmed-bey que j’ai connu à Calcutta ! s’écria Paul. Est-ce possible ? Ne suis-je pas le jouet d’une hallucination ?… Ahmed-bey ici, sous cette forme !… Et avec Brad !… Mais c’est fou… Pourtant, voilà ces lignes écrites là… Je les vois, je les touche, elles existent !… J’ai toute ma raison… je ne suis pas halluciné… »
Et il balbutiait ces paroles, les yeux écarquillés, les mains tremblantes, tout raidi devant les deux Mercuriens si fantastiquement ressuscites.
Soudain, le jeune homme eut une idée.
– Brad ! cria-t-il, prenez la montre qui est dans ma ceinture ! Aussitôt, le second monopède sauta en avant, avança le bras et saisit d’une griffe, par l’anneau, la montre de Lola.
– Quelle heure est-il ?
Le monopède Brad regarda la montre et, après un geste de son bras, il fit entendre huit sifflements espacés.
Paul reprit la montre et y jeta un coup d’œil : elle marquait huit heures.
– Bon ! cria Paul ; maintenant, prenez cette boîte et faites flamber une allumette.
Une minute après, le monopède Brad élevait en l’air une allumette enflammée.
La démonstration était suffisante. Dans un élan soudain de bonheur fou, Paul de Civrac ouvrit les bras ; Brad s’y jeta, et le jeune homme sentit à son cou la caresse de sa trompe.
Plusieurs minutes s’écoulèrent dans le silence et l’émotion. Et tout à coup, sentant que toute sa présence d’esprit et tout son sang-froid lui étaient enfin revenus, Paul de Civrac parla.
– Je me réserve, dit-il au monopède Ahmed, de vous demander plus tard des éclaircissements sur cette inconcevable aventure et sur le ridicule entêtement de Bild. Et je vous remercie, mon cher docteur, d’avoir répondu – peut-être sans le savoir – à l’appel que, dans la Roue Fulgurante, j’ai crié vers vous !… C’était donc un pressentiment !… Je tiens aussi à savoir ce qu’étaient la Roue Fulgurante et ses habitants si, toutefois, vous l’avez appris. Mais maintenant le temps est trop précieux. Il faut agir, retrouver Lola et Francisco… Écoutez !
Et il décrivit les divers phénomènes du pays mercurien, raconta la perte de Lola Mendès, la fuite devant les monopèdes, le bienheureux incident des projections, les douze monopèdes tués, vidés de leur sang et brûlés, le départ en chasse de Francisco. Et il conclut :
– Je me mettais moi-même à sa recherche. Que faut-il faire, maintenant ?
Ahmed-bey réfléchissait. Par un geste tout humain, il appuyait l’extrémité de sa trompe sur les griffes de son bras, et il tenait l’œil fermé. Brad le regardait. Soudain, il hocha la tête et marcha vers la paroi. Levant son bras aux griffes toujours armées du diamant, il traça ces mots sur l’ardoise :

« Civrac, vous serez notre prisonnier soumis. Gardez cependant votre épieu, il pourra vous être utile. Brad, vous imiterez tous mes gestes et tous mes sifflements. Laissez-moi faire. Nous retrouverons Francisco et Lola Mendès – morts ou vivants. Civrac, guidez-nous jusqu’à la cité des Mercuriens et n’ayez ensuite que les attitudes d’un prisonnier volontaire. »
– Entendu ! fit Paul…
En signe d’acquiescement, Brad inclina sa trompe à plusieurs reprises.
Et l’on se mit à descendre l’abrupt ravin qui menait au Fleuve d’Or et à la ville mercurienne. Pendant le trajet, l’esprit de Paul se posa mille questions, insolubles pour le moment, car les explications qu’aurait pu donner Ahmed-bey pour faire comprendre la désincarnation et la réincarnation des âmes étaient peu commodes à développer par écrit, avec un diamant comme stylo et les rochers d’ardoise comme tablettes. Moins aisées encore à fournir auraient été les révélations de Brad au sujet de la catastrophe de la Roue Fulgurante dans le monde de Vénus et les descriptions de ce monde lui-même. Paul de Civrac se résigna donc à ne rien savoir. D’ailleurs, le sort de Lola Mendès en première ligne, et ensuite celui de Francisco, le préoccupaient assez. Durant son séjour sur la plate-forme crépusculaire, son corps étant forcément inactif, son esprit et son cœur s’étaient nourris de la pensée et de l’image de la jeune, fille. Et, comme il arrive dans les circonstances exemptes de banalité, ses sentiments avaient atteint tout de suite leur complet développement. Il aimait Lola Mendès comme s’il avait vécu avec elle des années de bonheur sans nuage ; et pourtant, c’est à peine si les jeunes gens avaient pu échanger, au milieu des terribles et rapides événements, quelques paroles d’amour, quelques caresses et quelques baisers.
Soudain, Paul de Civrac fut distrait de ses pensées par l’apparition, à un tournant du ravin, de la ville mercurienne. Il s’arrêta et, montrant d’un geste la vallée ouverte à ses pieds, avec le Fleuve d’Or, au milieu et les huttes pyramidales sur les deux rives, le tout dans l’ombre des noires falaises surplombantes, il dit :
– Voilà !
Il s’était arrêté, et les deux faux Mercuriens avec lui.
Alors, sur un geste d’Ahmed-bey, qui fut compris aussitôt que fait, Brad s’empara du bras gauche de Paul, en lui laissant libre la main droite, portant l’épieu. Ahmed-bey se plaça devant le couple, et l’on se remit en marche.
Mais les nouveaux arrivants avaient été vus par les Mercuriens de la cité. Un violent concert de sifflements emplit les airs. Une foule de monopèdes entoura bientôt Ahmed-bey et leur prétendu prisonnier.
Au hasard, Ahmed-bey marchait au milieu des huttes. Il émettait, lui aussi, des sifflements, mais, comme il ne connaissait pas le langage Mercurien, il ne pouvait les espacer, les cadencer, les graduer de manière à former des phrases sensées. Il sifflait en coups secs, égaux, au rythme de sa marche. Arrivé au milieu d’un espace vide entre les huttes, il s’arrêta, immobilisa d’un geste son compagnon et le prisonnier, et leva le bras avec dignité.
Alors, un monopède à trompe cerclée d’or se détacha de la foule et, se plantant devant Ahmed-bey, en qui il reconnaissait sans doute un Mercurien de grade supérieur, il lui tint apparemment un discours, car ses sifflements durèrent plusieurs minutes sans interruption.
Ahmed-bey était embarrassé. Il ne savait comment répondre. Il garda donc un silence prudent et une attitude qu’il croyait digne. Elle devait l’être, en effet, au sens mercurien, car le monopède discoureur n’insista pas. Il se retourna et se mit à marcher. Ahmed-bey le suivit sans hésiter. Brad et Paul emboîtèrent le pas, escortés à peu de distance par la foule sifflante et gesticulante des monstres noirs.
Arrivé à la porte d’une hutte, le chef s’arrêta et se rangea de côté. Délibérément, Ahmed-bey s’arrêta aussi et fit à ses acolytes un geste vif désignant la porte. Brad parut forcer Paul à se courber et tous les trois disparurent dans la hutte, accompagnés par le monopède chef.
Il y eut quelques instants de silence et d’immobilité. Paul accoutumait ses yeux à l’ombre relative de la hutte. Mais quand il put voir clairement autour de lui, il fit un pas de côté, se baissa vivement et, redressé, levant sa main gauche où flottait un lambeau d’étoffe, il cria d’une voix vibrante d’indicible émotion :
– Brad ! Lola est passée ici, voici un morceau de son corsage.
Et deux larmes brillantes jaillirent de ses yeux.
La hutte où le chef avait conduit celui qu’il croyait son collègue était celle où Lola et Francisco furent portés après leur seconde capture… Qu’étaient-ils devenus depuis ?
CINQUIÈME PARTIE
EN PLEIN MYSTÈRE
CHAPITRE PREMIER
OÙ LE DOCTEUR AHMED-BEY LUI-MÊME N’EN SAIT PAS DAVANTAGE
La découverte du lambeau d’étoffe rouge ayant fait partie de la jupe de Lola Mendès avait plongé Paul de Civrac, Ahmed-bey et Brad dans de profondes réflexions. Le chef mercurien qui était entré avec eux avait refermé la porte de la hutte et, accroupi contre eux, il regardait de son œil unique les deux monopèdes, qu’il ne pouvait penser vivifiés par une âme humaine, et leur prisonnier. Évidemment, il ne comprenait rien à leur conduite, ni à leur silence. Mais, comme il convenait devant un supérieur, le chef subalterne se taisait aussi et attendait, sans que son œil manifestât autre chose que la stupidité la plus absolue.
Assis devant Ahmed-bey et Brad demeurés debout, Paul de Civrac ne pouvait détacher ses yeux du morceau de laine rouge qu’il tenait à la main. Mais il sentit une griffe se poser doucement sur son bras. Il leva la tête et reconnut Ahmed-bey. Le docteur monopède se pencha vers le sol et, dans la fine poussière noire accumulée, il traça les lignes suivantes, que Paul lisait à mesure :
« Nous devons rester ici pendant quarante-huit heures au moins. C’est le temps qu’il me… »
Là, le docteur s’arrêta d’écrire, car la place était restreinte. Il effaça les mots, égalisa le sable noir et recommença :
« … faut pour apprendre les mots mercuriens qui me permettront de demander où ont été transportés… »
Il effaça encore et continua, sur le même ton :
« … Lola et Francisco. Je ne vois pas d’autre moyen. Est-ce entendu ? »
– Oui, répondit Paul.
Et le docteur recommença à écrire :
« Restez tranquille, dormez, mangez ce qu’on vous apportera. Brad veillera sur vous, et laissez-moi faire. »
– C’est convenu ! dit Paul. Mais, pendant ce temps, Lola peut être tuée !
Le docteur ne répondit pas. Il regarda Brad, qui avait lu aussi, et qui fit de la trompe un son d’adhésion.
Le Mercurien avait considéré tous ces gestes et mouvements avec une stupéfaction qui se manifestait par son œil agrandi, par l’agitation de sa trompe et de son bras. Mais soudain, Ahmed-bey fit entendre un sifflement impérieux, et le Mercurien s’immobilisa. Le docteur marcha vers la porte, renversa aisément la plaque d’ardoise qui la masquait, et, faisant vers le vrai monopède un signe d’appel, il sortit. Le Mercurien se leva et le suivit docilement. Quel désarroi devait bouleverser son cerveau ! Il avait vu son chef faire des gestes que jamais Mercurien n’avait faits ! Et ce chef ne parlait pas ? Il dédaignait sans doute de s’expliquer…
Suivi de l’obéissant monopède, Ahmed-bey marcha dans la ville Mercurienne. Sur son passage, la foule des petits monstres noirs s’écartait silencieusement. Parfois, des sifflements vibraient. Mais le docteur eut beau écouter, comparer, raisonner, il ne parvint pas à tirer la moindre conclusion des bruits qu’il entendait.
Après une promenade de trois heures, pendant laquelle il traversa plusieurs fois le Fleuve d’Or et fit le tour de toute la cité mercurienne, il regagna la hutte où Paul était enfermé sous la garde de Brad.
Les observations qu’Ahmed-bey avait faites peuvent se résumer ainsi :
La cité se composait de cinq à six mille huttes dressées sans ordre, uniformément pyramidales, et toutes complètement vides.
L’indigène mercurien ne connaissait aucune science, aucun art – si ce n’est celui de construire les huttes avec des plaques d’ardoise soudées les unes aux autres par une sorte d’argile verte, – il ne faisait aucun métier ni aucune culture ; il vivait dans l’inaction la plus absolue. La seule industrie était la fabrication de bols en métal jaune : mais si Ahmed-bey vit, dans les huttes, quelques-uns de ces bols, il ne put savoir d’où ils provenaient.
L’indigène monopède était le seul animal de la planète ; sur le sol ne rampait aucun serpent, nul bipède ni quadrupède n’y marchait ; pas d’insectes ni d’oiseaux dans les airs.
La seule nourriture et boisson du Mercurien était le sang d’un autre Mercurien. En effet, sachant déjà par le récit de Paul que les monopèdes étaient mercurophages, il avait vu, pendant sa promenade, des monstres noirs sucer, par l’œil, le sang d’autres monstres plus gros, à la jambe et au bras mutilés. Il était passé devant une rangée de huttes où il avait vu, couchés sur le sol, les Mercuriens nourriciers, nourris eux-mêmes, gavés continuellement par d’autres Mercuriens qui présentaient à leurs trompes avides des yeux de monopèdes plus petits, informes – des nouveau-nés, sans doute.
Comment se produisaient les naissances ? Quelles lois réglaient le choix des nouveau-nés qui devaient vivre et de ceux qui devaient servir à engraisser les monopèdes nourriciers ? Le docteur ne put jamais le savoir. Sans doute l’aurait-il appris à la longue, si les événements tragiques qui survinrent peu après ne l’avaient empêché de compléter ses observations.
Mais de ce qu’il put voir, il conclut que la reproduction de l’espèce se faisait, sur Mercure, dans des conditions de multiplicité, de facilité et de rapidité extraordinaires – et que la nature avait ainsi pourvu à l’unique besoin des vivants.
Il sut encore comment les Mercuriens mouraient de mort naturelle. En effet, plusieurs fois, il vit, près de lui, un monopède tourner vivement sur son pied, siffler, tomber… Puis, l’œil grand ouvert se gonflait et, soudain, éclatait. Alors, le Mercurien le plus voisin de celui qui était tombé introduisait le bout de sa trompe dans l’œil crevé, buvait le sang blanchâtre, puis s’en allait, satisfait. Et le mort restait là sans que personne s’en préoccupât.
Et le docteur rencontra des cadavres que la vie avait depuis un certain temps abandonnés. Il les toucha : certains étaient durs comme du fer, d’autres flasques comme une outre vide. Le docteur ne put jamais savoir par quelles étapes de décomposition passaient ces cadavres, ou même s’ils se décomposaient.
Quant à la structure intérieure du corps mercurien, Ahmed-bey se proposa de l’étudier en disséquant un cadavre, quand il en aurait le loisir, et s’il trouvait un instrument tranchant propre à cette besogne.
Pendant toute sa promenade, le docteur fut docilement suivi par le monopède chef qui l’avait accueilli le premier. Et, à l’attitude des nombreux indigènes rencontrés, Ahmed-bey comprit qu’il s’était introduit dans le corps d’un Mercurien très puissant et très honoré, peut-être roi de cette contrée mercurienne ou tout au moins de cette cité.
Il bénissait cet heureux hasard qui lui permettrait, sous prétexte de dignité, de ne pas communiquer, par des sifflements incompréhensibles, avec ses sujets, lorsqu’il se vit arrivé devant la hutte où Paul était enfermé. Il la distingua des autres parce que la trace des pas de Paul était encore distincte dans la poussière, devant l’entrée.
Toujours suivi de son satellite, il y pénétra et, d’un geste qui fut aussitôt compris et obéi, il ordonna de relever la plaque d’ardoise de la porte. Comme tout à l’heure, le chef subalterne s’accroupit à l’intérieur, contre cette plaque d’ardoise.
– Quoi de nouveau ? fit Paul avec une visible anxiété.
Le docteur répondit en écrivant sur le sable :
« Je n’espère plus apprendre en peu de temps le langage mercurien. Il faut tenter autre chose. J’ai mon idée. Donnez-moi le lambeau d’étoffe. »
Et quand il tint le haillon rouge dans sa griffe, il se tourna vers le chef. Celui-ci se dressa. Ahmed-bey lui montra le lambeau en émettant un sifflement impérieux.
Mais le Mercurien demeura immobile et stupide. Ahmed-bey agita devant son œil le lambeau rouge, mais cet œil resta vide de toute pensée.
– Il ne comprend pas, dit Paul.
Alors le docteur, tenant toujours l’étoffe dans sa griffe, ouvrit la porte et sortit, en indiquant du geste qu’il voulait être suivi. Le chef obéit ; et Brad et Paul sortirent aussi de la hutte. Et le docteur, élevant en l’air le lambeau écarlate, tendit son bras successivement vers les quatre points de l’horizon. De la foule des monopèdes, des sifflements montèrent dans l’air. Mais le chef ne bougeait pas, et son œil, comme d’ailleurs les yeux de tous les autres monstres, resta stupide…
– Ils ne comprennent pas ! répéta Paul.
Et il jeta un regard à la fois furieux et désespéré sur la foule compacte des monopèdes, sur le lourd Fleuve d’Or toujours pareil, sur les deux versants de la falaise noire qui montaient très haut, ne laissant entre eux qu’une ligne mince par où passait l’éblouissante clarté vert pâle tombant des éternels nuages vert foncé que l’on voyait rouler dans l’infini…
Et le spectacle de cette nature implacable où rien ne vivait que ces petits monstres noirs et cruels, horribles, invraisemblables et répugnants, le spectacle de cette nature immuable et dure dans l’éternelle lumière le remplit d’une sensation d’angoisse apeurée…
– Brad ! s’écria-t-il… Partons d’ici, allons n’importe où ! parcourons en tous sens cette épouvantable planète… Cherchons Lola jusqu’à ce que je meure de désespoir !…
Mais Ahmed-bey le saisit par le bras, l’entraîna dans la hutte et, sur la poussière, il écrivit :
« Courage ! Nous la retrouverons. Prenez votre épieu.
« Partons. Mais soyez un homme !… »
Pendant quelques minutes, Paul de Civrac resta immobile et affaissé devant ces signes. Quand il leva la tête, il vit les yeux de Brad et d’Ahmed-bey, les yeux rouges du monde mercurien qui le regardaient avec une expression tout humaine d’encouragement et d’amitié. Une âme, une âme véritable les animait, ceux-là ! Et il se rappela le prodige de la désincarnation et de la réincarnation… Alors, il eut honte de sa faiblesse et, se redressant, saisissant l’épieu d’une main ferme, il dit résolument :
– Partons !
Au dehors, Ahmed-bey agitant sa trompe annelée d’or, n’eut qu’à marcher pour que la foule des monopèdes s’écartât devant lui. Arrivé sur le bord du Fleuve d’Or, il se retourna. Le chef était toujours là, satellite fidèle. Il le saisit par le bras et le fit ranger près de Paul et de Brad. Puis, avisant deux autres Mercuriens dont la trompe ne s’ornait que d’un seul anneau d’or, il les appela d’un geste et les fit ranger près de leur supérieur. Puis, brusquement, il montra le fleuve et sauta sur ses ondes élastiques et lourdes. Brad, Paul et les trois Mercuriens annelés l’imitèrent. Mais, comme la foule des monopèdes voulait s’élancer aussi, Ahmed-bey l’arrêta d’un sifflement terrible et d’un geste net de son bras tendu… la foule s’immobilisa sur la berge, et le Fleuve d’Or eut bientôt entraîné la petite troupe mi-humaine mi-mercurienne en dehors de la tumultueuse cité.
CHAPITRE II
QUI SE TERMINE PAR UN SAUT DANS L’INCONNU
Paul de Civrac regarda la montre qu’il portait toujours à sa ceinture. Elle était arrêtée. Il la remonta et mit les deux aiguilles à midi.
Il put ainsi se rendre compte qu’une demi-heure entière s’écoula jusqu’au moment où le fleuve, sortant enfin des falaises surplombantes, élargit ses flots lourds et dorés entre deux vastes plaines d’herbe rousse. Paul fixait à cinquante kilomètres à l’heure, au milieu du courant, la rapidité du Fleuve d’Or dans la vallée encaissée : en tenant compte de la position du village, à peu près au milieu de la vallée, celle-ci avait donc environ cinquante kilomètres de longueur.
Quand on fut dans la plaine, la rapidité du fleuve diminua peu à peu, jusqu’à ne plus donner qu’un courant de vingt-cinq kilomètres à l’heure à peu près. Aussi, sans l’ombre des falaises, sans la fraîcheur relative provoquée par l’extrême vélocité de la glissade, la chaleur torride se fit cruellement sentir, non pour Ahmed-bey ni pour Brad, dont le corps mercurien était propre à un tel milieu, mais pour Paul, que son séjour dans la zone crépusculaire avait déshabitué de la haute température des plaines lumineuses. Il dut recommencer à cligner des yeux afin de les habituer à l’aveuglante clarté qui tombait des éternels nuages verts… Derrière ces nuages, qui jamais ne s’ouvraient pour une éclaircie sur l’infini des cieux, le soleil brillait, et avec quel éclat ! Sans les nuages qui tamisaient ses rayons de lumière et de feu, la planète tout entière aurait flambé, éclaté comme un prodigieux engin de pyrotechnie…
La traversée de l’immense plaine rousse dura six heures un quart. À la cinquième heure, les étranges voyageurs virent se profiler au loin des montagnes encore indécises. En même temps, la rapidité du fleuve s’accrut de plus en plus, jusqu’à atteindre environ cent kilomètres à l’heure ! Les rives filaient comme filent les champs et les ravins des deux côtés d’une automobile terrestre lancée à toute vitesse. Inquiet, Paul dit au docteur Ahmed-bey :
– Où diable allons-nous ?… Sûrement, pour acquérir une telle vitesse, le fleuve doit se précipiter, là-bas, du haut de quelque falaise, en une effroyable cataracte…
Ahmed-bey ne put répondre que par un inutile sifflement, mais, du geste, il montra les trois vrais monopèdes. Ceux-là étaient parfaitement tranquilles.
– Je comprends, fit Paul, vous voulez dire que tant que ces monstres conserveront leur placidité, aucun danger ne nous menace. Vous avez raison…
Comme il parlait ainsi, les trois Mercuriens émirent un sifflement aigu et, ensemble, s’étendirent à plat ventre sur le fleuve, la tête en avant et les bras servant de gouvernail pour les maintenir bien au milieu du couvant. Les Terriens remarquèrent, en effet, qu’eux-mêmes tendaient à être séparés les uns des autres par les remous et les bouillonnements du fleuve.
– Imitons-les ! dit Paul.
Les trois monopèdes s’étaient placés en file indienne, la trompe du second enroulée autour du pied du premier et la trompe du troisième enroulée autour du pied du second. Paul se coucha derrière le troisième monopède et s’accrocha des deux mains à son pied. Ahmed-bey et Brad s’échelonnèrent derrière Paul et, sur le Fleuve d’Or, ces six créatures semblaient un bizarre serpent noir aux deux bouts et presque blanc au milieu…
Or, les montagnes se rapprochaient de minute en minute, la vitesse du courant augmentait encore. Pour pouvoir respirer, Paul dut mettre sa tête entre ses deux bras tendus en avant, et, parfois, ses lèvres et son nez frôlaient la surface opaque et tiède du Fleuve d’Or.
Un moment, à un endroit où le fleuve, formant vasque, était un peu calme, il put lever la tête, et il dit :
– Pourvu que cette vertigineuse course à l’abîme nous entraîne vers Lola et Francisco !
Ahmed-bey et Brad lui répondirent par un long sifflement.
Mais les montagnes n’étaient plus qu’à deux ou trois kilomètres. Une vaste excavation s’ouvrait dans leur base abrupte. Les voyageurs y furent soudainement engouffrés, et, autour d’eux, ce fut une obscurité presque complète, où les mystérieuses phosphorescences du fleuve répandaient une pâle clarté de veilleuse.
Les voûtes de ce chenal souterrain se perdaient dans la nuit absolue.
Et quelques minutes après que l’on fut entré dans la montagne, le silence, l’impressionnant silence mercurien, fut étrangement troublé… Sans qu’aucun des Terriens pût savoir d’où cela venait, ils entendirent une sorte de grondement cadencé qui montait et descendait en tonalité comme les voix profondes du vent dans une forêt de pins…
Tout à coup, les trois Mercuriens se mirent à siffler, et leurs sifflements, très aigus, semblaient exprimer l’effroi. Paul sentit que le monopède auquel il était accroché tentait de dégager son pied. Il leva lui-même les yeux et il vit que les deux Mercuriens de tête s’étaient séparés de la chaîne et glissaient vers la paroi gauche du chenal… En une seconde, ils eurent disparu dans un trou où s’enfonçait un bras du fleuve.
– Mes amis ! cria Paul, les deux premiers monstres nous ont quittés ! Celui que je tiens cherche à me quitter aussi ! Il se débat !… mais je ne le lâche pas…
Un grondement plus fort, venant de l’inconnu, lui coupa la parole. Mais aussitôt après, il s’aperçut que le monopède dont il tenait le pied, sans doute résigné, ne s’agitait plus.
– Quelque grave danger nous menace ! cria-t-il. Mon prisonnier ne cherche plus à s’enfuir… Il comprend que nous avons dépassé l’endroit où il aurait pu prendre la direction du salut, comme les deux autres… Que va-t-il arriver ?…
Brad et Ahmed-bey répondirent par leur sifflement habituel, mais ils s’accrochèrent plus solidement encore les uns aux autres.
Les inexplicables grondements rythmés étaient maintenant d’une tonalité creuse, effrayante et toute proche. Le Mercurien de tête ne donnait plus signe de vie…
Et Paul se sentit horriblement seul, exposé à un danger inconnu autant qu’inévitable. Brad et Ahmed-bey n’étaient d’aucun secours, puisqu’ils ne pouvaient parler.
Le malheureux jeune homme, cependant, ne perdait pas son sang-froid ; il se rendait compte que la vélocité du fleuve s’accroissait de minute en minute ; les parois rocheuses, brillantes sous la phosphorescence, filaient de part et d’autre comme des éclairs dans la nuit…
Le grondement, à présent semblable aux éclats d’un tonnerre lointain, le remplissait d’une sensation de crainte inexprimable.
Tout à coup, un cri, un hurlement prolongé, lugubre à glacer le sang dans les veines, un hurlement inouï, vint des profondeurs de l’abîme, et il y eut partout des fulgurations violentes… Et en une intense agonie de terreur dont il fut accablé, Paul vit que le monopède et lui se trouvaient surplombant un précipice de feu, un précipice insondable d’où le hurlement affreux montait… Il se sentit oscillant, basculant au-dessus du gouffre, entraîné d’un coup, et il tomba… Une dernière lueur de pensée lui fit comprendre qu’il s’accrochait toujours au monopède et que ses deux compagnons tombaient avec lui… Et les quatre corps sombrèrent dans l’abîme, tandis que, pour la troisième fois, retentissait le hurlement infernal…
CHAPITRE III
QUI EST LA TRAGIQUE CONTRE-PARTIE DU PRÉCÉDENT
À cinq kilomètres en amont de la chute qui avait englouti Paul, Ahmed-bey, Brad et un seul monopède, le Fleuve d’Or se divisait en deux et une partie de la masse liquide s’enfonçait dans un couloir plus petit que le souterrain principal. C’est par là que les Mercuriens de tête s’étaient échappés. Le courant y devenait tout de suite moins rapide, jusqu’à n’avoir plus que la vitesse normale d’un cheval au petit trot.
Deux heures avant le passage de Paul et de ses compagnons, une grosse troupe de Mercuriens, disposée en triangle, la pointe tournée dans le sens du courant, était arrivée à la bifurcation, avait dévié à l’aide des bras faisant gouvernail et s’était engagée dans le petit couloir. Au milieu de la troupe, debout et se tenant par la main, Lola Mendès et Francisco étaient gardés à vue. Aucun lien ne les garrottait. Mais ils étaient toujours prisonniers, car les rangs pressés des monopèdes étaient infranchissables. D’ailleurs, où s’enfuir, dans ce canal souterrain étroit et peu élevé ?
Par une regrettable fatalité, Lola et Francisco avaient été retirés de la seconde hutte où on les enferma et entraînés sur le courant du Fleuve d’Or une heure à peine après l’arrivée de Paul et de ses deux compagnons dans la cité mercurienne.
Si Paul de Civrac, Ahmed-bey et Brad, comprenant les sifflements des Mercuriens de tête, avaient bifurqué dans le petit bras du fleuve au lieu de se laisser entraîner vers l’abîme, sans doute auraient-ils quelque part rattrapé Lola et Francisco. Mais le destin en avait décidé autrement, et, tandis que Paul et ses compagnons sombraient dans le mystérieux abîme, la jeune fille et son domestique, prisonniers des monopèdes, arrivaient dans une seconde cité mercurienne.
Celle-ci était bâtie dans une sorte d’entonnoir à ciel ouvert que le petit fleuve rencontrait dans son cours ralenti. Tout d’abord, cet entonnoir, aux parois lisses et très hautes, ne paraissait pas avoir d’autres issues que les tunnels d’amont et d’aval du petit fleuve. Mais, avant d’être de nouveau enfermés dans une hutte, en attendant sans doute qu’on eût décidé de leur sort, Lola et Francisco remarquèrent que les flancs de l’entonnoir étaient à des hauteurs médiocres, troués d’excavations et que des gradins grossiers conduisaient du bas des falaises à chacun de ces trous : c’étaient donc les orifices de galeries souterraines traversant la montagne et conduisant peut-être dans les plaines.
La porte de la hutte refermée, Lola et Francisco se trouvèrent seuls.
– Francisco, dit Lola, il faut fuir d’ici : nous orienter si c’est possible, et gagner le plateau où tu as laissé Paul. Même s’il en est parti pour aller à ta recherche, il y reviendra, dans l’espoir que tu y seras retourné toi-même… Il faut fuir… Si nous restons, ces monstres, tôt ou tard, nous crèveront les yeux et boiront notre sang… Je ne veux pas mourir ainsi… Je préfère être tuée en essayant de nous enfuir. Nous aurons au moins tenté jusqu’à l’impossible…
– Señorita, je pense comme vous, répondit Francisco. Mais je n’ai pas d’arme. Attendons que quelqu’un de ces monopèdes, comme dit M. de Civrac, vienne nous visiter. Je l’attraperai par le pied et je m’en servirai comme d’une massue… Et à la grâce de Dieu !
– Je reconnais, dit Lola, que nous avons peu de chances d’échapper… Mais, si je succombe, tu me laisseras et iras aider Paul à attendre la merveilleuse arrivée de Bild et de Brad…
Francisco ne répondit pas, mais il fit comprendre par un seul regard que si Lola périssait, il s’ensevelirait, lui, pour la venger, sous une hécatombe de Mercuriens.
Les deux captifs n’eurent pas longtemps à attendre. Ils gardaient le silence depuis quelques minutes, lorsque la plaque de la porte tomba, et un Mercurien parut dans le carré de lumière. Mais avant qu’il fût entré, Francisco, se glissant lui-même dans la porte, l’avait saisi par le pied, soulevé…
Mais déjà, en dehors de la hutte, Lola était debout près de lui. Il lui tendit sa main libre et, profitant de la stupeur des quelques monopèdes qui se trouvaient là, ils se mirent à bondir ensemble vers la paroi la plus rapprochée. Aussitôt, une bordée de sifflements leur apprit qu’on les poursuivait.
Mais ils avaient de l’avance. Ils arrivèrent au pied de la falaise, et ils se disposaient à l’escalader par les gradins rudimentaires, lorsque, un peu à gauche, Lola vit qu’un mince ruisseau de liquide jaune entrait dans une excavation à ras de terre.
Haletante, elle dit :
– Viens, Francisco, ne montons pas, gardons notre avance, il y a là une galerie plus facile…
– Ah ! oui, c’est de la chance, Señorita ; les autres sont noires, celle-ci sera éclairée par le ruisseau… Au moins, nous y verrons assez pour diriger notre fuite…
Ils se remirent à courir en bondissant, et avant que les monopèdes aient pu leur barrer le passage, ils s’engouffraient dans la galerie. Elle était étroite et peu haute, mais commode à suivre à cause des radiations éclairantes que produisait le ruisseau. Il méandrait sur le sol, et plusieurs fois ils l’enjambèrent. Derrière eux, ils entendaient les sifflements furieux des monopèdes, et ils couraient, encouragés par la certitude que le bruit des sifflements diminuait peu à peu d’intensité ; preuve que les fugitifs mettaient toujours plus de distance entre eux et les poursuivants.
– Señorita, dit tout à coup Francisco sans s’arrêter, le ruisseau devient plus large et file droit. Il coule dans le sens de notre course. Restons immobiles à la surface. Il nous entraînera peut-être plus vite que nous ne courons nous-mêmes…
– Tu as raison, Francisco.
Et la courageuse jeune fille sauta au milieu du ruisseau, qui avait, à cet endroit, environ deux mètres de largeur. Francisco sautait en même temps.
En effet, le courant était très rapide, et la fuite des deux fugitifs en fut accélérée sans la moindre fatigue pour eux.
Ils n’entendaient que faiblement les sifflements des Mercuriens. Et soudain, à un tournant brusque du ruisseau, ils ne les entendirent plus du tout.
Mais leur attention fut aussitôt sollicitée par d’autres bruits. C’était un grondement sourd et rythmé qui montait et descendait en tonalité, comme les voix profondes du vent dans une forêt de pins.
En même temps, à la rapidité croissante avec laquelle filaient en arrière les parois accidentées de la galerie, ils se rendirent compte que la vitesse du courant augmentait dans des proportions inquiétantes.
– Francisco, dit Lola, ces grondements m’effrayent, et j’ai le pressentiment que nous sommes entraînés vers un gouffre. Il faut sauter à terre tout de suite… Vois ! entre le roc et le ruisseau, il y a une corniche : c’est assez large pour marcher… Sautons vite avant que la rapidité du courant soit trop grande…
– Sautons, Señorita… Votre main.
– Tiens.
– Attention… hop !
Leur élan avait été adroitement calculé, car leurs muscles savaient maintenant proportionner leur effort aux conditions de la pesanteur mercurienne. Ils touchèrent donc la corniche au bon endroit. Mais la vitesse acquise les entraîna, et ils faillirent retomber sur les lourdes ondes jaunâtres et brillantes. Ils s’arc-boutèrent, raidirent leurs muscles, s’accrochèrent aux aspérités du roc, et enfin ils s’arrêtèrent. Leurs mains étaient légèrement écorchées, mais, dans l’état de surexcitation nerveuse où ils se trouvaient, ils ne s’en aperçurent même pas.
– Marchons ! dit Lola.
Animée par l’espoir de retrouver Paul de Civrac et d’attendre avec lui l’intervention de Brad et de Bild, la jeune fille avait maintenant autant de force, de courage et de présence d’esprit que Francisco lui-même. Elle avait repris son rang de maîtresse : elle commandait.
La corniche sur laquelle ils marchaient, Francisco derrière Lola, surplombait le ruisseau ; par endroits, elle avait plusieurs mètres de largeur, mais en d’autres elle se rétrécissait jusqu’à laisser juste la place des pieds. Les fugitifs s’accrochaient alors aux aspérités de la paroi et, s’aidant l’un l’autre, favorisés d’ailleurs par leur légèreté spécifique, ils franchissaient avec adresse le mauvais pas. Au-dessous d’eux, sans bruit, le ruisseau bouillonnant glissait avec une vertigineuse rapidité, rendue sensible aux regards des Terriens par les boursouflures intermittentes des ondes lourdes.
Les grondements cadencés avaient progressivement augmenté d’intensité. Ils avaient maintenant la force d’un roulement lointain de tonnerre.
– Qu’est-ce que ça peut être, Francisco ?

– Je ne sais pas, Señorita.
– Peut-être la chute du ruisseau dans un abîme.
– Peut-être.
Mais, dominant les tonitruantes rumeurs, un hurlement de folie, aigu, prolongé, arriva des profondeurs invisibles de la galerie.
– Francisco ! cria Lola.
Elle s’était arrêtée, pâle, une sueur d’angoisse au front, une main tremblante sur l’épaule de Francisco, l’autre crispée sur une arête de la paroi.
– Francisco, balbutia-t-elle, as-tu entendu ?
– Oui, Señorita, oui, répondit l’homme à voix basse.
Et ils restèrent quelques minutes silencieux, immobiles, luttant contre la terreur sans nom qui les envahissait.
Une seconde fois, le hurlement déchiré retentit, comme l’appel désespéré de la sirène d’un navire en perdition dans la tempête et dans la nuit.
– Francisco, il faut aller voir, dit Lola d’une voix à la fois tremblante et résolue. Il ne faut pas rester ici… Marchons.
– Mais, Señorita…
– Marchons… Mon cœur me dit que M. de Civrac est là, là, dans le mystère. Viens !
– Je vous suis, maîtresse !
Et ils se remettaient en marche, lorsqu’ils entendirent derrière eux, mais très loin encore, des bruits aigus.
– Écoute !
Immobilisés de nouveau, ils tendirent l’oreille. Il n’y eut bientôt plus de doute ; les bruits aigus étaient les sifflements mercuriens.
– Tu vois ! fit Lola. On nous poursuit encore… Derrière, c’est la captivité et la mort… Devant, c’est le mystère, mais peut-être Paul… Marchons !…
Et la vaillante jeune fille s’élança immédiatement suivie par Francisco.
Mais tout à coup elle jeta un cri, se cramponna au roc pour arrêter son élan – et elle resta suspendue au-dessus d’un gouffre ouvert sous ses pieds. Francisco avait pu s’arrêter avant. Il n’eut qu’à étendre les bras pour dégager Lola de sa dangereuse suspension et la remettre sur la corniche…
La jeune fille laissa son émotion se calmer, puis, avec Francisco, elle regarda. Quel extraordinaire et terrifiant spectacle !
À leurs pieds, la corniche s’arrêtait net, interrompue brusquement au-dessus d’un abîme indescriptible, d’où montaient les grondements cadencés et, par intervalles, le tragique hurlement. Au-dessous d’eux, à leur droite, le ruisseau se coupait à angle droit pour tomber, tout d’une masse silencieuse et unie, dans le gouffre apocalyptique… Et enfin, là-bas, devant eux, de l’autre côté de l’abîme, ils voyaient tomber aussi un large fleuve d’or, et de ces deux étranges cascades silencieuses d’or fondu émanaient des radiations jaunes, faiblement éclairantes, et, si l’on regardait dans le gouffre lui-même, on ne voyait, à une grande profondeur, qu’une nuée opaque de cette clarté jaune, diffuse, incompréhensible, produite par les « cours d’eau » mercuriens.
Lola et Francisco considéraient avec effroi ce spectacle, lorsque des sifflements plus forts leur rendirent le sentiment de tous les dangers qu’ils couraient.
– Francisco, ils approchent ! dit Lola.
– J’ai une idée, Señorita !
L’Espagnol se mit à plat ventre sur la corniche, la tête penchée sur le gouffre. Il en examinait soigneusement les parois.
– Señorita, dit-il en se relevant, vous n’aurez pas peur ?
– Non !
– Eh bien ! nous allons descendre là… Il est évident que ces masses liquides ont une issue, au fond du gouffre… Même si la mort nous attend en bas, il est encore plus certain que la mort nous guette et arrive derrière nous… Voulez-vous descendre ?

– Descendons ! fit Lola d’un ton résolu.
– Alors, Señorita, montez à cheval sur mes épaules… Serrez mon torse avec vos jambes et, de vos mains, accrochez-vous à toutes les aspérités du roc, comme je le ferai moi-même… Ainsi, nous ne nous quitterons pas… Ou je vous sauverai, ou je périrai avec vous.
Sans répondre, Lola se mit à califourchon sur les épaules de Francisco, qui s’était baissé. Quand il sentit sa jeune maîtresse bien arc-boutée des jambes et des pieds, contre ses flancs, il se releva et, s’agenouillant au bord de l’abîme, il se mit à descendre à reculons le long de la vertigineuse paroi. Par bonheur, elle avait des arêtes nombreuses, des excavations, de minuscules plates-formes, il ne posait ses pieds qu’avec une extrême précaution ; comme Lola, il se cramponnait des deux mains aux aspérités rocheuses.
Soudain, ils entendirent tomber sur eux, de la corniche, des sifflements furieux ! Lola leva la tête ; des Mercuriens gesticulants se penchaient sur l’abîme, mais aucun n’osait s’engager dans la voie périlleuse qu’avaient adoptée les fugitifs.
– Ils ne nous poursuivront pas plus loin ! dit-elle.
– Non ! c’est un péril de moins !
Tandis qu’en haut les sifflements continuaient, d’en bas montaient les terribles grondements cadencés et, par intervalles, l’horrible hurlement incompréhensible…
Lola et Francisco se trouvèrent bientôt dans la buée lumineuse. En haut, en bas, à droite et a gauche, ils ne voyaient que le vague infini de cette buée, semblable aux luminosités du soleil levant dans les légers brouillards du matin, sur la Terre. Devant eux, c’était le roc noir, rugueux… Et ils descendaient toujours. Peu à peu, le bruit des sifflements décrut, puis s’évanouit. Mais les grondements étaient de plus en plus forts et la stridence des hurlements d’agonie devenait insoutenable…
Combien de temps dura la périlleuse descente ? Ni Lola ni Francisco n’auraient pu le dire. Vingt minutes peut-être, peut-être des heures…
Enfin, Francisco parla :
– Señorita, nous sommes sur un large plateau… Mettez pied à terre.
La jeune fille sauta des épaules de Francisco.
Ils étaient, en effet, sur un plateau dont ils ne pouvaient voir les limites à cause du brouillard lumineux. Avec précaution, ils s’avancèrent, le dos tourné à la paroi par laquelle ils étaient descendus. À leur gauche, la cascade du ruisseau s’abîmait dans une vasque, puis la masse liquide coulait rapidement dans un canal. Ils suivirent ce canal, il les mena au bord d’une sorte de lac d’or où les eaux du ruisseau se perdaient. À leur droite, ils voyaient tomber à pic la masse énorme du Fleuve d’Or, et cela sans bruit, comme de l’huile coulant dans l’huile… Et c’est d’en face, maintenant, de l’autre rive du lac sans doute, que venaient les grondements et les hurlements…
– Suivons le bord ! dit Lola.
Et ils se mirent à marcher vers la droite. Soudain, ils se trouvèrent sous la cascade même du grand fleuve. Le liquide d’or, d’un seul tenant, faisait au-dessus d’eux une arche immense zébrée de scintillements plus vifs…
Et tout à coup, ils s’arrêtèrent net, en un énorme sursaut d’émotion ; devant eux, à quatre pas, un corps humain était étendu et deux monopèdes étaient agenouillés auprès de lui…
– Paul ! s’écria Lola en un cri déchirant.
Échappant de la main de Francisco, elle s’élança et s’abattit sur le corps de Paul de Civrac.
– Il est mort ! Il est mort ! gémit-elle.
Et elle étreignait le corps étendu, l’embrassait, délirante de désespoir.
Terrassée elle-même par la surprise, par l’émotion, par la douleur, elle s’affaissa, inanimée.
Francisco s’agenouillait déjà devant sa maîtresse, lorsqu’il se sentit touché à l’épaule. Il se retourna et il vit un monopède, debout, qui lui faisait, de sa griffe, des signes… D’abord, il ne comprit pas. Puis son sang-froid lui revenant peu à peu, il perçut que le monopède désignait Paul de Civrac et faisait ensuite des gestes de dénégation.
– Il n’est pas mort ? dit-il.
Les gestes de dénégation s’accentuèrent.
Alors, Francisco appuya son oreille sur la poitrine de Paul : le cœur battait.
– Saint-Jacques soit loué ! s’écria-t-il ; Señorita, il vit ! il vit !…
Il avait toujours, à la ceinture, sa gourde d’eau aromatisée d’un restant de cognac. Il la déboucha et en versa quelques gouttes entre les lèvres de Lola, puis entre celles de Civrac… Deux minutes passèrent : Lola restait immobile et comme morte, mais Paul s’agita et bientôt ouvrit les yeux.
– Où suis-je ? murmura-t-il.
– Señor ! Señor ! s’écria Francisco.
À cette voix familière, Paul, d’un sursaut, se mit sur son séant. Ses yeux égarés reconnurent Francisco, virent Lola étendue, comme sans vie. La commotion fut si forte qu’il retomba avec un immense soupir.
Mais cette nouvelle faiblesse fut de courte durée… le jeune homme ouvrit encore les yeux, se leva péniblement, marcha vers Lola, regarda longuement la jeune fille, lui mit la main sur le cœur.
– Elle vit… dit-il. Retrouvée… Enfin !… retrouvée…
Et une violente émotion étranglait les mots dans sa gorge. Il fit pourtant un effort de volonté et, plus calme :
– Son évanouissement cessera de lui-même, dit-il. Francisco, comment êtes-vous là ?…
Vivement, en quelques mots, l’Espagnol raconta les faits.
– Mais vous-même, Señor ?
Se tournant vers les deux Mercuriens qui étaient debout à quelques pas, Paul dit gravement :
– Francisco, voici le docteur Ahmed-bey, qui vient de la Terre, et voici notre ami Arthur Brad…
– Señor ! Señor ! balbutia l’Espagnol.
Il croyait que Paul de Civrac avait perdu l’esprit. Le jeune homme devina cette pensée.
– Tu me crois fou, dit-il avec un sourire. Détrompe-toi, Francisco ; écoute !
Et il raconta minutieusement à l’Espagnol tout ce qui était arrivé depuis qu’ils s’étaient séparés. Il expliqua autant qu’il le pouvait la désincarnation et la réincarnation des âmes. Francisco était stupéfait.
Il allait répondre, lorsque le docteur Ahmed-bey s’avança et, sous les yeux des deux hommes, avec le diamant qu’il portait toujours à sa griffe, il traça sur le sol les caractères suivants :
« Il faut que Francisco se laisse désincarner et prenne momentanément ma place dans mon corps mercurien. Ainsi, je pourrai parler et mieux agir dans l’intérêt de nous tous !… »
– Par la Virgen del Pilar ! s’écria Francisco, tout cela est de la diablerie !…
Mais Paul parla. Il démontra à Francisco que l’opération mystique ne présentait aucun danger. Doué du corps de Francisco et de la parole humaine, le docteur Ahmed-bey pourrait plus facilement s’entendre avec lui, Paul, pour agir dans le plus grand intérêt de tous…
– Il réveillera Lola ! conclut Civrac, et il nous sauvera…
– Soit ! dit Francisco résolument ; que dois-je faire ?
– Te coucher par terre et attendre.
– Voilà !
Et l’Espagnol s’étendit.
Mais Ahmed-bey écrivit encore sur le roc, devant les yeux de Paul :
« Expliquez-lui la transformation qui s’opérera dans son être extérieur quand il sera réincarné dans le corps que j’occupe. »
Paul expliqua aussitôt à Francisco qu’il ne pourrait pas parler, mais seulement siffler… Il serait d’ailleurs comme était Brad…
– Bueno ! fit le brave Espagnol, je sifflerai !…
Ahmed-bey se plaça devant le patient et commença ses passes magnétiques. Il sifflait d’une manière étrange, sans doute parce qu’il prononçait mentalement la formule d’incantation. Soudain, le corps de Francisco eut un sursaut et un peu de mousse jaillit de ses lèvres. Aussitôt, le docteur s’étendit auprès de lui et, en même temps, une étincelle sortit de la bouche de Francisco et une autre de la trompe du docteur. Les deux étincelles voltigèrent un moment, puis se croisèrent en un éclair, et celle de Francisco entra dans la trompe du docteur, tandis que celle d’Ahmed-bey disparaissait dans la bouche de l’Espagnol.
Et, deux minutes après, l’ancien corps de Francisco se releva, vivifié par l’âme savante d’Ahmed-bey, tandis que le corps mercurien, qui servait tout à l’heure d’enveloppe à l’âme du docteur, sautait en l’air et allait prendre place, animé par l’âme de Francisco, à côté de Brad.
La transmission des deux âmes était opérée.
CHAPITRE IV
QUI ÉCLAIRCIT QUELQUES MYSTÈRES ET MET PAUL DE CIVRAC DANS UN EFFROYABLE
DILEMME
Sans doute l’âme de Francisco fut-elle d’abord peu à son aise dans le corps mercurien ; le monopède, – devenu Espagnol, – ou plutôt l’Espagnol devenu monopède, se mit à gesticuler de la jambe, du bras et de la trompe, à siffler et à rouler son œil unique de la plus comique façon ; mais l’attitude impassible de Brad lui fit comprendre qu’une âme énergique devait ne s’étonner de rien, et Francisco demeura enfin tranquille.
Quant à l’âme d’Ahmed-bey, elle se trouvait évidemment mieux dans le corps de Francisco ; elle pouvait parler en langage humain.
– Monsieur, dit tout de suite le docteur à Paul, comment vous sentez-vous ?
– Bien ! répondit Civrac en serrant la main que le docteur lui tendait. Cette chute m’avait étourdi, mais grâce à ma légèreté spécifique et à l’élasticité du liquide de ce lac, je n’ai rien de cassé.
– Alors, pensons à Mademoiselle, dont l’évanouissement me paraît trop prolongé.
Et le docteur, sous l’apparence de Francisco, s’approcha de Lola. Paul l’avait déjà précédé. Quant à Brad et à Francisco, ils se tenaient debout à quelque distance ; un peu plus loin se voyait, mort sans doute, le corps du Mercurien qui avait été entraîné malgré lui dans la cataracte du Fleuve d’Or.
Les grondements rythmés retentissaient toujours dans la vaste caverne, dominés de temps en temps par le hurlement effroyable.
Mais tous les esprits étaient préoccupés de l’état de Lola, et l’on prêtait peu d’attention à ces bruits formidables qui devaient être singulièrement expliqués plus tard.
Lola Mendès, étendue sur le sol, dans la mystérieuse clarté produite par les cascades et par le lac, présentait un visage d’une pâleur cadavérique. À la vue de cette pâleur, Paul frémit.
– Docteur ! s’écria-t-il, elle n’est pas morte ?
Ahmed-bey s’était agenouillé devant la jeune fille. Écartant les bords de son corsage, il avait appliqué son oreille droite sur la chaste poitrine de Lola. Et, sans répondre à Paul, il écouta longtemps.
Quand il releva la tête, il murmura :
– C’est étrange !
Et ses yeux exprimaient une immense surprise.
Il prit chacune des deux mains de la jeune fille et les examina minutieusement. Puis il scruta le visage immobile et blanc, aux traits tirés comme celui d’un cadavre.
– C’est étrange ! répéta-t-il.
– Docteur ! je vous en conjure ! supplia Paul.
Ahmed-bey leva de nouveau la tête et, regardant Civrac, dont la pâleur et les yeux effrayés disaient assez l’état d’âme, il murmura :
– Monsieur, comme je vous l’avais prédit à Calcutta, vous aimez cette jeune fille ?
– Je donnerais ma vie pour elle ! s’écria Paul en un juvénile élan.
– Cela ne la sauverait pas, Monsieur, répliqua le docteur froidement. Mais je vous prie de rassembler tout votre courage, toute votre présence d’esprit.
– Elle est morte ! s’écria Paul d’une voix déchirée.
– Non ! fit nettement le docteur.
Et, après un silence, il reprit d’une voix grave :
– Nous nous trouvons devant un cas extraordinaire et que je n’ai vu qu’une seule fois au cours de ma vie terrestre, dans l’Inde… Cette jeune fille vit, quoiqu’elle présente tous les caractères de la mort, tous, moins un seul : son corps restera souple et ne se décomposera pas. Mais son cœur ne bat plus, ses poumons ne fonctionnent plus. Elle est dans un cas de catalepsie des plus rares… Quand se réveillera-t-elle ?… et même se réveillera-t-elle avant de passer de la catalepsie à la mort ?… Si nous étions dans mon laboratoire de Paris, je la sauverais, avec des cordiaux appropriés et un traitement magnéto-électrique. Mais ici, je ne sais pas !
– Oh ! docteur, docteur ! sauvez-la ! s’écria Paul en tombant à genoux devant le corps immobile de la pauvre Lola.
À mesure que le docteur parlait, Brad et Francisco s’étaient rapprochés. Et maintenant, tous les deux suppliaient Ahmed-bey par des gestes et des sifflements. Mais le docteur dit :
– Du calme et du silence, je vous prie ! Écoutez-moi, monsieur de Civrac. Je vais essayer le seul traitement qui soit ici en mon pouvoir, c’est-à-dire désincarner l’âme de Mademoiselle.
Il se tut un instant, puis il reprit :
– Avez-vous pensé de quelle manière nous reviendrons sur la terre ?…
– Non, je l’avoue, balbutia Paul.
– Ce sera très simple. Nous sommes cinq êtres humains sous des apparences diverses et qui ne sont pas les nôtres, excepté vous, monsieur de Civrac, qui avez jusqu’à présent conservé votre corps. Eh bien ! il me suffira d’un effort de volonté pour que nos cinq âmes soient désincarnées à la fois et s’envolent sur la Terre… Moi, je retrouverai mon corps en arrivant dans mon hôtel du parc Monceau. Mais vous quatre, y compris Mademoiselle, vous devrez vous accommoder de corps de rencontre, que nous choisirons les plus adéquats.
Le docteur s’interrompit encore et reprit :
– Avant tout, je dois faire que l’âme de Mademoiselle soit en mon pouvoir et m’entende, pour qu’il me soit possible de la faire obéir et de l’entraîner sur la Terre avec les nôtres. Or, dans l’état cataleptique où se trouve Mademoiselle, son âme, bien que présente, est endormie, confondue dans tout son être… Elle m’entend vaguement, puisque l’être vit. Mais me comprendra-t-elle, afin de pouvoir m’obéir ?… C’est ce que nous allons voir… Brad, apportez ici le corps du Mercurien que nous avons tué.
Brad alla chercher le cadavre du monopède et, sur un geste d’Ahmed-bey, l’étendit à côté de Lola.
Et le docteur, se relevant, alla se placer droit devant les pieds de Lola. Il murmura sur elle des incantations magiques, fit dans l’air les gestes millénaires qui opèrent la captation et la désincarnation des âmes.
Anxieux, une sueur froide au front, les yeux brouillés de larmes, fixés sur le visage de Lola, Paul de Civrac attendait… En face de lui, Brad et Francisco regardaient, immobiles et silencieux.
De longues minutes passèrent. La voix d’Ahmed-bey devenait étrangement sonore et majestueuse, accompagnée par les grondements cadencés de l’abîme et coupée de temps en temps par les hurlements d’agonie.
Et la voix du docteur s’éleva dans les modulations suraiguës, et puis elle se tut sur un cri déchiré…
Mais le visage de Lola Mendès était resté toujours aussi pâle et immobile qu’une figure de marbre.
Ahmed-bey laissa tomber ses bras, baissa la tête et murmura :
– C’est impossible !
Un sanglot lui répondit. Paul de Civrac pleurait, la tête cachée dans ses deux mains tremblantes.
Mais tout à coup, inattendus et terrifiants, de tumultueux sifflements retentirent. Les quatre Terriens se retournèrent ; là-bas, de l’extrémité du plateau, une foule de Mercuriens accourait.
– Il faut fuir ! s’écria le docteur. Il faut leur échapper ! Tout n’est pas perdu pour Lola…
– Mon Dieu ! soupira Paul.
– Non ! non ! je la sauverai, je vous le promets… Je viens d’en trouver le moyen… Il sera terrible ! Mais c’est le seul praticable… En attendant, fuyons ! fuyons !… Suivez-moi tous !
S’étant incarné dans le corps de l’Espagnol, le docteur en avait toute la vigueur. Il enleva Lola Mendès, la chargea sur ses épaules et, d’un bond, sauta au milieu du lac. Paul, Brad et Francisco s’étaient élancés en même temps que lui…
Ils tombèrent en plein tourbillon. D’abord, ils tournoyèrent vertigineusement, mais ils réussirent à s’accrocher les uns aux autres. Puis, un courant les saisit, les entraîna, et, en une minute, la caverne immense et les cascades disparurent… Ils filaient dans un canal souterrain.
Ils percevaient que leur glissade les rapprochait de la source des terribles grondements rythmés et des effroyables hurlements suraigus. À ces épouvantables bruits se mêlèrent bientôt les rafales de sifflements furieux… Et c’était, dans le mystère des immenses grottes invisibles, comme un vacarme de bataille apocalyptique.
Mais, soudain, un courant entraîna les Terriens après un coude brusque, et ils virent alors un spectacle qui les glaça d’horreur, figea leur sang dans les veines et fit trembler leurs membres.
– Un nouveau monde ! Un nouveau monde mercurien ! s’écria Ahmed-bey… Regardez !… Regardez !…
– Ils se battent ! hurla Paul dans l’infernal vacarme.
– Nous sommes perdus !
Le courant les poussait vers le rivage qui, sol d’une grotte inimaginable, tant elle était vaste et s’étendait à perte de vue, était couvert de milliers de Mercuriens noirs se ruant à l’assaut d’une sorte de forteresse dressée très loin, au bord même du Fleuve d’Or.
Cette forteresse était faite d’une matière brillante comme de l’or neuf et taillée à facettes comme un diamant.
Et le sommet de cette forteresse était couronné d’étranges machines incompréhensibles. Très hautes, d’armature compliquée, elles avaient toutes à leur base une sorte d’entonnoir au large pavillon braqué sur les groupes des monopèdes assiégeants. Et de ces entonnoirs, rien d’autre ne sortait, à intervalles égaux, que ce hurlement suraigu qui semblait le cri d’agonie de milliers de créatures humaines.
Mais, à chacun de ces hurlements, il soufflait autour du fort comme une rafale de tempête, et aussitôt, ici et là, un groupe de monopèdes s’illuminait, flambait, fusait, éclatait en un épanouissement d’étincelles.
Quant aux grondements rythmés, plus forts maintenant que les éclats du tonnerre terrestre, ils venaient de l’intérieur de la forteresse elle-même, produits sans doute par la manœuvre automatique des machines extraordinaires.
Qu’étaient donc ces horribles engins de mort ?… Que lançaient-ils ?… Ce qu’ils lançaient par les entonnoirs monstrueux, c’était invisible, invisible comme le vent ! Et pourtant, là-bas, en face, à chaque bordée invisible et bruyante, les monopèdes étaient frappés, incendiés, anéantis !

Était-ce une électricité d’autre nature que celle connue sur la Terre ?… Ou bien n’était-ce qu’un inconcevable et formidable déplacement d’air dirigé comme un projectile ?… Et pourquoi, sans que rien parût les toucher, les monopèdes assaillants éclataient-ils comme des blocs de poudre frappés d’une étincelle ?
Mystères ! insondables mystères !…
– Voyez ! voyez ! s’écria Paul, il y a des êtres au sommet de la forteresse !
– Des Mercuriens !…
– Ils sont jaunes, ceux-là !
– Et plus grands !
– Ils ont deux yeux !…
– Et pas de trompe, pas de bouche !
– S’ils nous voient, nous sommes perdus !
– Ils nous voient ! ils nous voient ! Ils dirigent contre nous leur machine hurlante !…
Paul de Civrac et Ahmed-bey avaient échangé ces cris, ces exclamations, tandis que le courant vertigineux du Fleuve d’Or les entraînait toujours plus près du rivage, vers la forteresse inexplicable.
En une minute de suprême angoisse, ils assistèrent à une de ces batailles titanesques que les habitants des planètes se livrent dans le mystère de leurs éléments inconnus des Terriens. Évidemment, les Mercuriens qui, du haut de la forteresse brillante comme du diamant, lançaient, d’une machine noire incompréhensible, une invisible force qui anéantissait des légions de Mercuriens noirs, les Mercuriens jaunes étaient une autre espèce plus intelligente et plus savante, physiologiquement différente de celle avec laquelle les Terriens s’étaient jusqu’à présent trouvés en rapport.
Quel était le motif de cette bataille souterraine, de cette conflagration des espèces mercuriennes ? Paul, Ahmed-bey et leurs compagnons devaient l’ignorer à jamais.
D’ailleurs, dans l’épouvantable fracas des hurlements suraigus des rafales mortelles, dans les grondements rythmés des machines apocalyptiques, dans les ouragans affolés des sifflements de fureur et de désespoir que jetaient les monopèdes assaillants et toujours vaincus, les fugitifs, horrifiés, ne pensaient qu’à leur mort inévitable et prochaine…
Ils pressentaient que les rafales seraient dirigées de leur côté et qu’ils seraient anéantis en une seconde par ce formidable engin de guerre.
Comment ne devinrent-ils pas fous à cette minute de cauchemar ?
– Lola ! Lola ! s’écria Paul, sanglotant, éperdu.
Et, sans plus penser à la mort inévitable, le jeune homme étreignait Lola, qu’Ahmed-bey soutenait entre ses bras nerveux.
Francisco et Brad, dans leur corps mercurien, ne pouvaient s’exprimer que par des sifflements inarticulés. Ils se serraient contre Ahmed-bey, tremblants.
Et ces hommes si courageux, qui avaient bravé cent fois les plus terribles des morts, étaient enfin vaincus par l’horreur de cette fin inimaginable, dans ce décor d’épouvantements, au milieu de ces batailles de cauchemar que se livraient des monstres mystérieux…
Ahmed-bey, seul, grâce probablement à sa connaissance des choses de l’au-delà, Ahmed-bey restait calme en apparence, bien que son âme frémît, non pour lui-même, mais pour Paul de Civrac et Lola, au destin desquels il s’intéressait maintenant autant qu’au sien propre.
– Courage ! cria-t-il, courage !
Mais aucun de ses compagnons ne l’entendit. Les yeux écarquillés d’effroi, ils virent, comme ils passaient juste en face la forteresse, bâtie, semblait-il, avec des blocs énormes de cristal doré, ils virent une sorte de miroir tourner peu à peu vers eux, du haut de la forteresse, sa face aveuglante… et, à mesure que le miroir tournait, une invisible rafale hurlante tournait, tournait… Inéluctablement, elle s’avançait vers eux, qu’elle toucherait, qu’elle faucherait, qu’elle anéantirait en passant…
– Lola ! Lola ! gémit Paul.
Et il colla ses lèvres sur les lèvres blanches de la jeune fille inanimée… Mais, vaincu par la douleur, il tomba évanoui. Ahmed-bey le vit tomber…
– Couché ! couché ! hurla-t-il.
Il jeta Lola Mendès à côté du corps de Civrac, que le courant entraînait. D’un seul mouvement, il terrassa Brad et Francisco et s’étendit lui-même avec eux… Offrant ainsi toute la surface de leur corps au courant, au lieu de ne donner que la plante des pieds, les Terriens furent entraînés avec plus de rapidité encore…
Et, comme une flèche, ils filèrent sous la rafale, qui passa au-dessus d’eux avec le hurlement suraigu centuplé d’intensité, horrifiant…
Ce fut alors que, soudain, toute la fantasmagorie des flammes et des reflets des cascades disparut, comme en un rêve. À l’aveuglante clarté, aux scintillements éblouissants, succéda une sorte de crépuscule jaunâtre… la torréfiante chaleur fut suivie sans transition d’une fraîcheur relative…
Paul ouvrit les yeux.
– Lola ! Lola ! balbutia-t-il.
Puis, sentant dans ses bras le corps de la jeune fille, qu’il avait saisi instinctivement, il se souvint, recouvra sa présence d’esprit et balbutia :
– Où sommes-nous ?
– Sauvés ! répondit Ahmed-bey.
– Les rafales… les Mercuriens jaunes… la bataille… Oh !…
– Tout cela est loin derrière nous… Quand je vous ai vu tomber, évanoui et entraîné plus vite par le courant du fleuve, mon esprit a été illuminé de la pensée qui nous a sauvés définitivement !… j’ai laissé tomber Lola, j’ai terrassé Brad et Francisco, je me suis couché moi-même, et nous sommes passés sains et saufs dans l’espace vide providentiellement ménagé entre la projection de vent brûlant et la surface du fleuve… Aussitôt, le courant nous a entraînés dans une galerie étroite, où nous sommes maintenant…
– Restons-nous couchés ? demanda Paul.
– Non, levons-nous, afin d’avoir plus facile l’usage de nos bras et de nos mains…
En s’entr’aidant, tous les quatre se mirent sur leurs pieds. Le docteur reprit le corps de Lola, toujours dans le même état de coma mystérieux. Serrés les uns contre les autres, ils voyaient filer rapidement les parois noires de l’étroite galerie.
Peu à peu, grondements et hurlements décrurent d’intensité et, bientôt, on ne les entendit plus. Et ce calme, après ce vacarme, était si étrange et profond que les Terriens doutèrent une minute de la réalité de la bataille Mercurienne, à un épisode de laquelle ils avaient assisté, et dont ils avaient failli être victimes. Mais leurs sens avaient été trop affectés pour qu’ils pussent croire à une hallucination ou à un cauchemar collectif. Et le seul souvenir de ces choses les fit trembler.
– Pensons à l’avenir et non au passé, dit le docteur, qui vit cette impression et l’éprouva d’ailleurs lui-même. Certainement, nous trouverons encore des Mercuriens, car le courant de ce petit fleuve diminue de rapidité, ce qui me fait croire que nous allons bientôt déboucher de la montagne dans la plaine…
– Nous sommes quatre maintenant, dit Paul. Nous saurons échapper à ces monstres, s’ils nous attaquent encore… Pourvu, cependant, que nous ayons affaire aux Mercuriens noirs et non aux Mercuriens jaunes…
– Ah ! fit le docteur, comme je voudrais connaître les mystères de cette déconcertante planète !… Mais nous y reviendrons plus tard ! Nous reviendrons, et alors ce sera sans danger !
Il se tut un instant, rêveur, puis :
– Monsieur de Civrac, dit-il, j’espère d’autant plus nous sauver que je demande seulement un quart d’heure de répit pour désincarner Lola et nous tous ensemble aussitôt après…
– Comment ferez-vous ? demanda Paul. Vous avez parlé d’un moyen terrible…
– Terrible, oui, et hasardeux ! Il nous offre une chance de réussite et quatre-vingt-dix-neuf probabilités d’échec… Mais c’est le seul qui nous reste… Et, dans notre situation, une chance unique sur cent n’est pas à négliger…
– Mais quel est ce moyen ? Quel est-il ?
– Vous le saurez bientôt.
Et le ton dont Ahmed-bey prononça ces paroles fit comprendre à Paul qu’il serait inutile d’insister.
Un quart d’heure s’écoula. Le Fleuve d’Or devenait de moins en moins rapide. Et tout à coup, les Terriens virent au loin l’orifice lumineux du tunnel. Quelques minutes après, ils surgissaient en pleine lumière, au milieu d’une vaste plaine sans limites de trois côtés ; à leur gauche, toutefois, très loin, s’élevaient les montagnes.
– La plaine nous sera fatale, dit Paul. Là, c’est la chaleur et la lumière trop intenses et bientôt les tortures de la soif. Abandonnons le fleuve et tâchons de gagner ces montagnes, là-bas. Nous les escaladerons, et, d’en haut, peut-être verrons-nous de quel côté se trouve la région crépusculaire. Nous y serons à l’abri des Mercuriens autant que de la chaleur et de la lumière. Et nous aurons peut-être la chance de recevoir de la pluie, si nous devons y rester longtemps.
– J’approuve votre idée de gagner les montagnes, répondit Ahmed-bey, mais non pas que la soif soit à redouter. Je ne demande qu’un quart d’heure d’immobilité et, surtout, de l’ombre. Oui, de l’ombre, afin que les âmes désincarnées me soient matériellement visibles. Dans cette lumière intense de la plaine, les pâles étincelles que sont les âmes resteraient invisibles. Dans l’ombre de la zone crépusculaire, ou simplement d’une grotte quelconque, je les verrai – et je pourrai agir pour les capter.
– Alors, quittons le fleuve.
– Oui !
L’ordre fut communiqué à Brad et Francisco, et quelques bonds amenèrent en diagonale les Terriens sur la rive du fleuve. Ahmed-bey portait toujours Lola inanimée ; Paul voulut s’en charger.
– Non ! répliqua le docteur. Vous êtes encore faible et de votre blessure au pied et de votre chute dans la cataracte. Moi, je possède les jambes nerveuses, le torse souple et les muscles solides de Francisco. Je garde Lola Mendès… En avant vers la montagne ! Et le plus vite possible !
Pendant la course, Paul de Civrac regarda plusieurs fois la montre de Lola, qu’il portait toujours à sa ceinture. Mais chaque fois, il vit les aiguilles affolées tourner autour du cadran avec des sursauts, des élans rapides, comme l’aiguille d’une boussole détraquée. Encore un inexplicable effet de la planète Mercure !
On sautait au milieu de champs d’herbes rousses d’une monotonie accablante. Pas un souffle d’air, pas un arbre, pas un animal ; c’était le désert dans une lumière et une chaleur extraordinaires. Heureusement, pas de Mercuriens ! Les fugitifs se reposèrent peu, tant leurs nerfs étaient surexcités. Ils savaient que, selon la parole d’Ahmed-bey, le miracle de leur retour à la Terre était proche. Il fallait arriver soit à une grotte ombreuse, soit dans la zone crépusculaire du globe mercurien. Puis, immédiatement, ce serait le salut ! De telles pensées donnaient des ailes aux Terriens ; bien qu’ils eussent une jambe de moins que Paul et qu’Ahmed-bey, Brad et Francisco se servaient si bien de leur corps mercurien qu’ils couraient en bondissant aussi vite que leurs deux chefs de file.
Mais quand on fut arrivé au bas de la montagne, on constata qu’elle s’élevait à pic, en une muraille lisse de plus de trois cents mètres.
– Côtoyons cette falaise ! dit Ahmed-bey. Nous finirons bien par trouver un ravin, une gorge ou une caverne !
Et il tourna à droite. Pendant deux mortelles heures, les fugitifs suivirent l’abrupte muraille. Au-dessus d’eux, les éternels nuages roulaient lourdement dans le ciel, poussés par des vents qu’on ne sentait pas, et passaient par dessus la montagne, dont la ligne de faîte n’atteignait pas leur hauteur.
Grâce à leur corps mercurien, Brad et Francisco étaient infatigables, mais Ahmed-bey, chargé du poids de Lola, et Paul de Civrac, affaibli par ses récentes aventures, et tous les deux plus sensibles au climat meurtrier de l’étrange planète, commençaient à haleter et à comprendre qu’ils seraient bientôt à bout de forces.
– Cette falaise ne finira donc pas ! fit Ahmed-bey avec colère.
– Je n’en puis plus ! balbutia Paul.
Mais, juste à ce moment, la falaise eut un coude brusque – et les fugitifs s’arrêtèrent, étonnes du spectacle.
En vérité, ce monde mercurien est un monde à continuelles surprises. Devant les yeux des Terriens, s’ouvrait dans la montagne une caverne de proportions colossales. Autant qu’en purent juger Ahmed-bey et Paul, elle devait avoir au moins cinq cents mètres de profondeur sur un kilomètre de largeur et deux cents mètres de hauteur… Et, sur le sol de cette fantastique grotte, s’aggloméraient une quarantaine de huttes pyramidales…
À l’apparition des deux Terriens, suivis des deux faux Mercuriens, quelques monopèdes, qui se trouvaient devant les huttes, se mirent à pousser des sifflements et disparurent derrière les pyramides.
– Francisco ! cria Paul de Civrac, nous sommes tes prisonniers. Nous allons entrer dans une hutte, où tu sembleras nous enfermer. Brad entrera avec nous. Toi, tu es un chef : tu sauras donc, silencieux et digne, empêcher que l’on entre.
D’un mouvement de sa trompe, Francisco fit comprendre qu’il avait entendu et qu’il obéirait…
Et Ahmed-bey, portant toujours Lola, Paul de Civrac derrière lui, Brad surveillant ses prétendus prisonniers, Francisco ouvrant la marche, le groupe s’avança vers la plus rapprochée des huttes.
En même temps, une quarantaine de monopèdes surgissaient de toutes parts, emplissant l’air de sifflements furieux.
– Tiens ! fit Paul, ils ont la peau rouge, ceux-là !…
– C’est vrai ! dit Ahmed-bey ; une autre race mercurienne, sans doute ! Et voyez, leur trompe est moins longue et leur œil est noir…
– Mais ils courent sur nous en ennemis !… s’écria Paul. Ils sont encore d’une autre race que ceux des machines !…
– Diable ! diable !… Heureusement, je n’ai besoin que d’un quart d’heure de tranquillité.
Cependant, les monopèdes rouges, arrivés en fureur à vingt pas du groupe, s’arrêtèrent net. Leurs bras désignaient Paul et Ahmed-bey, leurs yeux exprimaient incontestablement une vive stupeur, et ils ne sifflaient plus… Ces nouveaux Mercuriens devaient être aussi brutes que les noirs, car ils ne ressemblaient en rien aux monopèdes intelligents qui maniaient, dans les grottes profondes, les effroyables et merveilleuses machines.
– Ils nous coupent le chemin de la hutte ! dit Paul.
– Tâchons de passer au milieu d’eux… En avant, Francisco !…
Mais avant que Francisco eût pu faire un saut, vingt monopèdes rouges avaient bondi sur lui, et il tomba… Brad s’élança pour le dégager.
– Je n’y comprends rien… fit Paul.
– Cette race rouge est ennemie de la race noire… souffla vite le docteur. À la hutte ! à la hutte ! Brad et Francisco se tireront d’affaire.
Obliquant à droite, Paul et Ahmed-bey se mirent à courir vers une des cabines pyramidales. Ils y arrivaient, lorsqu’une masse noire bondit au-devant d’eux et, retombant à leurs pieds, ouvrit vivement la porte de la hutte !
– Bravo, Francisco ! cria Paul.
Et suivant Ahmed-bey, qui s’était engouffré le premier avec Lola dans la porte basse, Paul entra. Derrière lui, Francisco et Brad se précipitèrent, la plaque d’ardoise qui fermait intérieurement la porte fut relevée, et Brad et Francisco s’arc-boutèrent contre elle…
Au dehors retentissaient des milliers de sifflements furieux.
Ahmed-bey avait tout de suite déposé Lola sur le sol, au milieu de la hutte. Il s’agenouilla en face d’elle, à ses pieds.
– Monsieur de Civrac, dit-il, agenouillez-vous à gauche de Mademoiselle. Et maintenant, fermez vos oreilles aux bruits extérieurs ; ne pensez pas aux dangers qui peuvent nous menacer encore et dont nous sommes d’ailleurs séparés par l’épaisseur de la porte que soutiennent Brad et Francisco… L’instant est grave. Écoutez-moi !
Dans l’ombre de la hutte, où un peu de clarté n’entrait que par un trou ménagé au sommet de la pyramide, Brad et Francisco, solidement arc-boutés contre la porte, regardaient le docteur de leur œil rouge, Paul, agenouillé contre le flanc de Lola, attendait, l’âme soudain torturée d’une inexplicable angoisse… Étendue, Lola semblait morte, les yeux fermés, les lèvres exsangues, les joues blanches, le front glacé comme un marbre… À ses pieds, agenouillé bien en face d’elle, le docteur, tête baissée, réfléchit une minute.
Le silence était absolu. Au dehors, les sifflements avaient cessé : sans doute les Mercuriens rouges tenaient-ils conseil avant de s’agiter de nouveau.
Mais Ahmed-bey releva la tête, et, d’une voix grave, d’une voix impressionnante, il parla :
– Monsieur de Civrac, je vous ai dit que le seul moyen de retourner sur la Terre est une nouvelle désincarnation de nos âmes. C’est facile pour vous et pour moi, facile pour Brad et Francisco. Je n’ai que quelques gestes à faire, quelques paroles à prononcer, et tous les quatre, âmes pures sous forme d’étincelles, nous serons sur la Terre en un quart de seconde… Mais il n’en va pas de même pour Lola Mendès. L’état de catalepsie rare où se trouve son corps rend son âme incapable de m’obéir et de quitter ce corps à mon commandement… D’autre part, nous ne pouvons emporter Lola Mendès avec son corps : même dans le domaine du merveilleux, il est des impossibilités matérielles…
Le docteur s’arrêta, pâlit un peu, puis :
– Il y a cependant un moyen, un seul…
Il s’arrêta de nouveau, et sa voix tremblait quand il reprit :
– Monsieur de Civrac, ce moyen est terrible et, bien que j’aie l’espoir qu’il réussira, je ne puis en avoir la certitude…
– Parlez, docteur, dit Paul ; quel est ce moyen ?
– Vous êtes maître de tout votre courage ?
– Oui…
– Eh bien !…
Le docteur hésita. Il regarda Paul avec une affectueuse pitié.
– Parlez ! je vous en supplie, gémit le jeune homme.
– Monsieur de Civrac, dit Ahmed-bey d’une voix solennelle, il faut tuer Lola Mendès !…
Paul eut un sursaut de tout son corps ; une sueur froide perla sur son front, et il regarda le docteur avec des yeux égarés.
– Oui, repartit énergiquement Ahmed, il faut tuer Lola froidement, nettement, d’un infaillible coup… Son âme s’échappera de son corps, et c’est alors que j’essayerai de la capter… Monsieur de Civrac, aurez-vous le courage de tuer celle que vous aimez ?…
– Moi !… moi !… balbutia Paul, plus pâle que Lola elle-même.
– Oui, vous, parce qu’aucun de mes compagnons ne pourrait agir avec la promptitude et l’adresse que donnent les mains humaines. Quant à moi, je dois avoir le geste, l’œil, la voix et l’esprit libres pour saisir l’instant précis où l’âme de Lola quittera sa dépouille mortelle… Oui, vous devez tuer ce corps, c’est le seul moyen de ramener son âme sur la Terre !…
Pendant que le docteur parlait, un prompt changement s’était fait dans l’aspect de Paul de Civrac. L’esprit du jeune homme devait avoir compris la nécessité de l’acte inouï. Son visage s’était figé, ses yeux eurent une expression d’énergique volonté, son torse affaissé se redressa.
Pourtant, il était visible qu’un terrible combat se livrait en lui. Il soupirait et ses mains tremblaient.
– Docteur, fit-il d’une voix faible, n’y a-t-il pas d’autre moyen ?
– Non !
– Et si même celui-ci ne réussit pas ?
– L’âme de Lola Mendès s’envolera dans l’autre monde, pour se mêler à l’infini de la Nature !…
Un silence terrible plana sur le corps immobile de la jeune fille. Paul la considéra. Et peu à peu ses mains cessèrent de trembler ; il releva la tête, l’énergie de ses yeux s’accentua et il regarda le thaumaturge.
– Docteur, fit-il d’une voix résolue, je suis prêt à tuer le corps de Lola. Vous m’indiquerez comment je dois procéder pour que la mort soit instantanée, absolue, foudroyante… Mais avant, j’ai une grâce à vous demander…
– Parlez !
– Si l’âme de Lola vous échappe, vous tuerez mon corps de la même manière que j’aurai tué le sien, et vous laisserez fuir mon âme, qui rejoindra la sienne, en se mêlant, comme elle, à l’Infini… Et, si tout est fini pour elle, tout aussi sera fini pour moi… Donnez-moi votre parole…
Le docteur n’hésita pas.
– Monsieur de Civrac, si je ne puis ramener avec nous l’âme de Lola Mendès, je vous jure de n’y pas ramener la vôtre… Vous partirez ensemble pour la vie future… Mais rien ne sera fini pour vous deux, car rien de ce qui est ne peut cesser d’être… Et vous serez confondus ensemble dans le grand Tout !…
– Alors, docteur, je suis prêt. Ordonnez !
Mais il eut un sursaut de peine à la pensée de perdre à jamais la vue de ce corps charmant qui avait été la cause première de son amour pour Lola.
Le docteur comprit cette impression cachée.
– Je lui en donnerai un autre plus beau que celui-ci ! fit-il à demi voix.
Un soupir seul lui répondit.
Et, sous les yeux de Brad et de Francisco, la merveilleuse, la terrifiante tentative s’accomplit.

Le docteur avait tiré de son pantalon – ou plutôt du pantalon de Francisco – la boucle en fer de la martingale. L’ardillon en était très long et très acéré.
– Prenez ceci de la main droite, dit-il à Paul, et tenez solidement la boucle, l’ardillon en avant et très fixe.
– C’est fait ! dit Paul.
– De la main gauche, soulevez le plus que vous pourrez la tête de Lola… Bien !… Appuyez-la de côté sur votre genou… Et maintenant, pouvez-vous compter, à partir de la nuque, les vertèbres de l’épine dorsale ?…
– Oui, très nettement ! souffla Paul.
– Comptez-en quatre de haut en bas…
– Une, deux, trois quatre…
– Eh bien ! maintenant, appuyez la pointe de l’ardillon exactement sur la colonne vertébrale, entre la quatrième et la cinquième vertèbre… au milieu… Votre main ne tremble pas ?…
– Non ! répondit Paul de Civrac, dont la pâleur était celle de la mort.
– Écoutez ! s’écria le docteur. Je vais prononcer les paroles sacrées… À un moment, je devrai proférer trois fois le mot « Siva »… : Quand je le prononcerai une première fois… vous appellerez à vous toute la force de votre esprit et de vos muscles, et quand, une seconde fois, la syllabe « Si » jaillira de mes lèvres, vous enfoncerez l’ardillon… d’un coup net et droit… C’est compris ?
– C’est compris !…
– La Force soit avec vous !… La mort sera foudroyante… si votre main ne tremble pas…
Et, sans attendre davantage, Ahmed-bey commença les passes magnétiques et les incantations sacrées…
Immobiles, l’œil fixe, Brad et Francisco semblaient des cariatides de pierre noire… Blanc comme le suaire d’un fantôme, Paul de Civrac attendait. De la main gauche, il soutenait contre son genou la tête de Lola ; de la main droite, il appuyait sur le cou de la jeune fille l’ardillon luisant et acéré…
Soudain, la voix monotone d’Ahmed-bey s’enfla…
– Brahma, Vichnou… prononça-t-elle.
Puis, lentement :
– Siva…
Paul frémit et se raidit.
– Si…
Un geste sec… l’ardillon pénétra brusquement…
La voix d’Ahmed-bey fut impérieuse et forte comme le tonnerre, et Paul, bouleversé, vit une étincelle jaillir de la bouche entr’ouverte de Lola, monter, scintillante, au-dessus de l’index levé du thaumaturge.
– Brahma soit loué ! murmura le docteur à mi-voix. L’âme de Lola Mendès est à nous…
Mais l’émotion de Paul fut si intense qu’il poussa un cri vibrant et tomba en arrière… Brad et Francisco s’étaient levés…
– Couchez-vous auprès de M. de Civrac ! ordonna le docteur d’une voix sèche.
Les deux faux monopèdes obéirent.
Ahmed-bey lui-même, tenant toujours le bras gauche levé, avec, au-dessus de son index, l’âme flottante et scintillante de Lola, Ahmed-bey lui-même s’étendit à côté de Francisco. De son bras droit allongé, il toucha les trois corps immobiles – et, d’une voix puissante, il recommença les incantations…
Au dehors, des sifflements retentirent soudain. La plaque d’ardoise qui fermait la porte de la hutte tomba sous une poussée extérieure – et des Mercuriens rouges se précipitèrent.
En un clin d’œil, les cinq corps étendus furent enlevés, écartelés, déchirés par les griffes puissantes en mille lambeaux sanglants que la multitude des monstres se disputait, s’arrachait, tandis que les trompes avides, fouillant les chairs pantelantes, se gonflaient de sang humain.
SIXIÈME PARTIE
SUR LA TERRE
CHAPITRE PREMIER
OÙ M. TORPÈNE MARCHE DE STUPÉFACTION EN STUPÉFACTION
Au milieu du laboratoire du docteur Ahmed-bey, dans les sous-sols de l’hôtel du parc Monceau, un homme était debout, les bras croisés, devant une dalle de marbre, sur laquelle reposait un corps humain entouré de bandelettes comme une momie.

Coiffé d’un petit turban brodé d’argent et d’or, vêtu d’une veste courte soutachée et d’un jupon de soie jaune serré aux flancs par un éblouissant châle de cachemire lamé d’or, cet homme, cet Hindou, était Ra-Cobrah, l’intendant du docteur Ahmed-bey.
Après avoir longtemps considéré la matérielle dépouille de son maître, Ra-Cobrah s’assit sur le divan, alluma un narghileh et se mit à fumer, grave et songeur, dans la confuse et faible clarté que répandait une minuscule lampe électrique seule allumée dans l’immense laboratoire, et encore masquée, du côté des dalles de marbre, par un écran de soie noire.
Depuis que le docteur Ahmed-bey, devant les cinq savants, s’était désincarné pour aller sur la planète Mercure, Ra-Cobrah vivait dans le laboratoire, mangeant et dormant sur ce divan large et moelleux, les yeux perdus dans une vague rêverie ou bien fixés sur le corps de son maître, qu’une injection d’un liquide spécial, donnée trois fois par jour, empêchait de se corrompre… Un serviteur apportait ses repas au veilleur – et celui-ci, dans le calme naturel à cette race qui produit les brahmes et les stylites, celui-ci attendait le retour de l’âme envolée.
Cette journée passa comme les autres, dans le silence, la rêverie et l’immobilité, que troublèrent seulement les pas du serviteur apportant la nourriture et les gestes nécessaires pour manger, boire et fumer…
La silencieuse horloge suspendue dans un coin du laboratoire, immédiatement sous la lampe électrique en veilleuse, marquait neuf heures vingt minutes, lorsqu’un bruit inaccoutumé le fit lever en sursaut.
Ç’avait été un crépitement sec, renouvelé cinq fois avec rapidité…
Et à peine debout, l’Hindou vit cinq étincelles rayer l’ombre du laboratoire. Elles allèrent droit vers les tables de marbre et s’arrêtèrent, flottantes, à deux mètres au-dessus de celle qui supportait le corps d’Ahmed-bey.
« C’est le maître ! » dit Ra-Cobrah d’une voix émue.
Et il se prosterna sur le tapis, à genoux, la tête entre ses bras étendus. Puis il se releva, marcha vers la dalle et se mit à défaire avec précaution les bandelettes immaculées dont étaient entourés les membres, le torse, le cou, la tête même du corps sans âme…
Quand le cadavre, qu’une mort soudaine et calme semblait avoir frappé une minute auparavant, fut entièrement nu, Ra-Cobrah lui entr’ouvrit doucement la bouche et se recula de trois pas…
Alors, l’une des cinq étincelles se détacha du groupe merveilleux et, d’un trait, pénétra dans cette bouche ouverte. Presque aussitôt, le corps blanc se colora des teintes de la vie, la bouche se ferma, les yeux s’ouvrirent, un des bras remua, et soudain, se levant avec lenteur, le corps ressuscité se dressa, au pied de la dalle de marbre, devant Ra-Cobrah, prosterné de nouveau.
– Relève-toi, serviteur fidèle ! dit Ahmed-bey gravement…
– Maître ! Que Vichnou et Siva soient glorifiés…
Et, sans autre parole, Ra-Cobrah se releva, déroula un paquet d’étoffes qui se trouvaient sur la seconde dalle et drapa son maître dans une vaste robe de lin vierge. Il lui ceignit les reins d’une large ceinture de soie mauve brodée d’or et lui mit aux pieds des sandales de cuir rouge qu’un ruban de soie retenait aux chevilles.
– C’est bien, Ra-Cobrah, dit Ahmed-bey. J’ai faim…
L’intendant frappa sur un gong. Deux minutes après, huit serviteurs noirs apparurent, portant une table carrée toute servie.
Ahmed-bey s’était déjà assis sur le divan : on plaça la table devant lui et, servi par deux domestiques commandés par Ra-Cobrah, le docteur se mit à manger.
Son appétit était, en effet, considérable. Un potage odorant, une omelette aux asperges, une carpe dorée, un copieux salmis d’alouettes, du gorgonzola, une pêche, des raisins, une tasse de café turc : tel fut le menu de son dîner…
Tant que la table fut devant lui, Ahmed-bey n’émit pas une parole ; mais lorsque, sur un signe de l’intendant, la table fut enlevée et emportée par les serviteurs et que le maître se fut lavé les mains dans une cuvette en argent que lui présentait un esclave à genoux, il dit :
– Ra-Cobrah, éteins les lustres…
L’ordre fut aussitôt exécuté, et la seule lampe électrique servant de veilleuse demeura allumée.
– Bien ! Maintenant, assieds-toi près de moi sur ce divan et oublie que je suis ton maître pour te rappeler seulement que je t’ai jugé digne d’être mon ami… Parlons comme nous l’avons fait plusieurs fois déjà.
Impassible, mais les yeux brillants d’une joie très visible, Ra-Cobrah s’assit sur le même divan qu’Ahmed-bey et, comme lui, prit entre ses lèvres le bout d’ambre terminant un des tuyaux du narghileh que l’esclave sorti le dernier avait allumé avant de disparaître.
– Cobrah, dit le docteur, tu as lu les journaux ?
– Oui, Ahmed.
– Tu sais donc quels étaient les humains perdus dans les astres…
– Sur Vénus, dit Ra-Cobrah, se trouvaient deux Américains, Arthur Brad et Jonathan Bild ; sur Mercure étaient le Français Paul de Civrac et l’Espagnole Lola Mendès avec son valet Francisco…
– Eh bien ! Cobrah ! tu vois ces quatre étincelles ?
– Je les ai vues en même temps que je t’ai vu, Ahmed.
– Compte-les de droite à gauche ; ce sont les âmes de Lola Mendès, de Paul de Civrac, Arthur Brad, Francisco…
– Tu les a sauvées, Ahmed ! dit Ra-Cobrah avec un accent d’orgueil triomphal.
– Je les ai sauvées. Il ne manque que l’âme de Jonathan Bild. Cet homme, têtu comme un Hispano-Américain, a refusé de se laisser désincarner, sous prétexte que son corps lui plaisait trop pour qu’il l’abandonnât et jurant ses grands dieux qu’il reviendrait sur la Terre, grâce à la science des Vénusiens, en chair et en os, avec sa véritable longueur et sa propre maigreur… De plus, Brad et moi, nous rapportons dans notre mémoire les éléments nécessaires pour construire une machine qui nous mettra en communication avec une machine pareille installée par Bild, sur la planète Vénus… Mais cela est l’avenir… Pensons au présent… Ma tâche n’est pas finie… En somme, ce que j’ai fait présentait peu de difficultés. Mais, Cobrah, c’est maintenant que ma tâche devient épineuse et délicate…
– Comment ! fit Ra-Cobrah, visiblement étonné que quelque chose au monde pût être épineux et délicat à faire, quand le docteur s’en mêlait.
– Eh ! oui ! s’écria le thaumaturge. À chacune de ces quatre âmes, il faut que je donne un corps… Comprends-tu, Cobrah ? Il le faut approprié au caractère de chaque âme, ce corps, et se rapprochant autant que possible de celui qui chacune de ces âmes a laissé dans les astres… Eh bien ! Cobrah, où trouver quatre corps qui plaisent à Lola Mendès, à Paul de Civrac, à Brad, à Francisco, quand les âmes pures qu’ils sont maintenant seront réincarnées ?…
Ra-Cobrah était visiblement embarrassé. Ses regards allaient du visage impassible du docteur aux quatre étincelles immobiles dans l’air du laboratoire, à deux mètres au-dessus de la dalle de marbre…
– En effet, dit-il, c’est délicat…
– Il faut d’abord trouver quatre cadavres convenables, dont un de femme…
– Oui.
– Il faudrait que ces quatre cadavres n’eussent pas de famille parmi les vivants…
– Oui, fit Ra-Cobrah, une famille créerait des complications…
– Il faudrait encore bien d’autres choses.
Le docteur se tut et le silence tomba brusquement entre les deux hommes. Il dura longtemps. De chaque bout d’ambre terminant les deux tuyaux du narghileh, Ahmed-bey et Ra-Cobrah tiraient des bouffées de fumée odoriférante qu’ils lançaient gravement vers le haut plafond du laboratoire.
Soudain, Ra-Cobrah laissa tomber à ses pieds le bout d’ambre et, levant les deux bras au ciel, il s’écria :
– Oh ! maître ! maître ! comment n’y avez-vous pas pensé le premier ?
– À quoi donc, Cobrah ?
– Maître, l’androplastie !…
À ce mot, Ahmed-bey resta étonné.
– C’est vrai ! murmura-t-il, c’est pourtant bien simple ! L’androplastie, en effet, tu as raison, Cobrah. Mais comment n’y ai-je pas songé ?
– Ahmed, votre âme est encore toute frappée de son extraordinaire aventure… Elle n’a pas encore retrouvé sa lucidité ordinaire, son génie, maître !…
Et, par un accent d’affectueuse soumission, Ra-Cobrah essayait d’atténuer ce que ces paroles pouvaient avoir d’audacieux.
Mais Ahmed-bey se leva et, prenant les mains de son intendant :
– Brave Cobrah ! dit-il. Tu es bien digne de ma confiance et de mon amitié.
Puis, changeant de ton :
– Il est évident que l’androplastie supprime toute difficulté sérieuse. Il ne s’agit plus que de trouver quatre corps, dont un de femme, qui soient physiquement bien proportionnés, sains, sans tares, et dont tous les organes soient intacts… les morts par asphyxie seraient les plus propres à une réincarnation satisfaisante…
Et, de sa haute voix impérieuse :
– Quelle heure est-il, Cobrah ?
– Sept heures de l’après-midi, maître.
– Que l’on m’apporte, dans la bibliothèque, tous les journaux du soir. Envoie le secrétaire chez M. Torpène, le préfet de police, avec ce message écrit de ta main : « Le maître est revenu, il vous attend, seul, tout de suite. Pouvez-vous venir ? » Dès que M. Torpène se présentera, tu l’introduiras toi-même. Va !
Alors, le docteur alla se placer devant la table de marbre au-dessus de laquelle flottaient toujours les quatre étincelles ; il leva vers elles les deux bras, prononça quelques syllabes mystérieuses. Les étincelles montèrent d’un trait jusqu’au plafond et y demeurèrent, immobiles diamants attachés par un fil invisible.
L’intendant inclina la tête et sortit. Ensuite, le docteur entra dans le cabinet de toilette attenant au laboratoire et revêtit les vêtements modernes qu’il portait le jour de sa désincarnation.
Et quand il remonta le large escalier de marbre qui conduisait au rez-de-chaussée de l’hôtel, Ahmed-bey avait perdu son visage quasi transfiguré de thaumaturge, pour n’avoir plus que la figure impassible, froide et un peu étrange que ses amis lui connaissaient.
La bibliothèque du docteur Ahmed-bey était une vaste pièce, éclairée sur le parc Monceau par un immense vitrage allant du plancher au plafond. Sur les murs s’étageaient des rayons chargés de livres aux riches reliures. Au milieu, se dressait une mappemonde énorme entourée d’une galerie où l’on accédait par quatre escaliers à rampe. Tout autour de la pièce, des divans et des fauteuils profonds étaient disposés, et quelques-uns avaient devant eux des tables de travail munies d’écritoires et de papier blanc…
Ce fut dans un de ces fauteuils que, méditatif, Ahmed-bey attendit le préfet de police. Dès qu’un serviteur lui apporta les journaux du soir, il les déplia vivement et en lut seulement les faits divers. Du crayon bleu qu’il tenait à la main, il marquait d’une accolade certains entrefilets.
Il achevait ce travail énigmatique, lorsqu’une porte s’ouvrit et Ra-Cobrah parut.
– M. le préfet de police ! annonça-t-il.
– Fais entrer !
Et le docteur se leva.
M. Torpène parut, empressé, les mains en avant, très ému.
– Cher docteur ! Vous voilà ! Vous voilà en chair et en os, revenu !
– Oui, revenu, cher Monsieur !
– Seul ?
– Non, les quatre âmes humaines que je suis allé chercher dans les astres sont dans mon laboratoire, soumises à ma volonté.
– Est-ce possible ?
– Cela est ! Mais veuillez donc vous asseoir, ici, je vous prie, près de moi.
– Vous avez dit quatre âmes, cher docteur… N’est-ce pas cinq êtres humains que la Roue Fulgurante a enlevés ?
– En effet.
Et le docteur raconta le singulier entêtement de Jonathan Bild à vouloir demeurer dans Vénus.
– Au reste, conclut-il, cet entêtement sera profitable à la science humaine, puisque nous aurons les moyens de correspondre de vive voix avec Bild…
– Docteur, vous plaisantez !
– Pas le moins du monde… Mais si vous permettez, il ne sera pas question de cela ce soir… Prenez ce fauteuil, je vous en prie.
Et quand les deux hommes se furent assis dans deux fauteuils se faisant face :
– Cher Monsieur, dit le docteur, ce n’est pas le savant spirite Torpène que j’ai voulu voir aujourd’hui, mais M. Torpène, préfet de police.
– Me raconterez-vous ?…
– Je vous raconterai mon voyage, ainsi qu’à tous nos amis rassemblés… Aujourd’hui, j’ai à vous demander de m’aider à parachever l’œuvre que j’ai entreprise…
– Et c’est du préfet de police que vous avez besoin ? fit M. Torpène avec un sourire.
– Du préfet de police, en effet. Voici. J’ai besoin de quatre corps humains frappés depuis peu par une mort spéciale qui n’ait détruit aucun de leurs organes essentiels. La mort par asphyxie ou par immersion sans long séjour dans l’eau remplit ces conditions. Or, dans les faits divers publiés par les journaux du soir, je viens de relever quelques cas de mort qui se sont produits aujourd’hui dans les formes voulues… Voulez-vous jeter un coup d’œil sur les entrefilets marqués au crayon bleu ?… Là, c’est une jeune femme très belle, dit-on, orpheline, qui s’est asphyxiée par le charbon à la suite du mariage de son amant… Il me faudrait ce corps pour réincarner l’âme de Lola Mendès…
– Bien ! bien ! murmura M. Torpène, un peu décontenancé.
– Ici, continua le docteur, imperturbable, nous voyons qu’un jeune homme inconnu, canotant sur la Seine, à Saint-Cloud, s’est noyé par accident… On l’a repêché presque aussitôt et son cadavre attend, chez un cabaretier riverain, qu’on puisse l’identifier… On n’a trouvé aucun papier dans ses vêtements. Il me faudrait ce cadavre pour réincarner l’âme de Paul de Civrac…
– C’est possible, bien possible… fit M. Torpène à voix basse.
– Prenez cet autre journal, je vous prie, dit le docteur avec un sourire un peu narquois… Voyez là ! Un ouvrier italien, sans famille en France, vaincu par la misère, est descendu hier dans un hôtel meublé de la rue Planchat et s’est suicidé bizarrement. On l’a trouvé ce matin pendu à un clou du plafond, dans un corridor, et il serrait entre ses dents l’extrémité du bec de gaz à papillon libre qui éclaire ce corridor. L’examen du médecin appelé aussitôt conclut non à la mort par pendaison, mais à l’asphyxie par le gaz d’éclairage. Le corps a été transporté à l’hôpital Bichat, où il ne sera autopsié que demain. Je pense qu’il fera tout à fait mon affaire pour réincarner l’âme de Francisco…
– En effet, dit M. Torpène, essayant d’être maître de lui, un Italien… Francisco est Espagnol… Ça irait très bien, très bien.
– Je vous remercie, fit le docteur avec une gravité comique. Il ne me reste plus à caser que l’âme d’Arthur Brad. Pour lui aussi, je crois avoir trouvé ce qui convient. Dans un de ces journaux, je viens de lire les détails d’une affaire étrange qui, depuis cinq jours, passionne Paris.
– L’affaire de l’hôtel Fulton ?
– Oui… Voulez-vous me permettre de la résumer d’après ce que j’ai lu ?
– Je la connais minutieusement, fit le préfet de police, mais je ne serais pas fâché d’entendre votre résumé.
– Voici. Il y a six jours, à sept heures du soir, un Anglais, gros et court… Excellent pour Brad, cela, n’est-ce pas, cher Monsieur ?
– Pourquoi ? fit le préfet.
– Parce que Brad est court et gros.
– Ah !
– Je reprends. Il y a six jours, à sept heures du soir, un Anglais arriva en voiture de gare à galerie devant un hôtel de la rue de la Paix. Il demanda une chambre vaste et y fit monter les cinq grosses malles entassées sur la voiture. Le personnel de l’hôtel remarqua que le voyageur portait une lourde chaîne de montre avec un beau chronomètre en or, d’énormes bagues diamantées aux doigts, une épingle de cravate très riche ; il fit avec simplicité un repas copieux arrosé de champagnes chers et envoya chercher une boîte de cigares de grand luxe au bureau spécial qui est près de l’Opéra. Pour payer, il remit un billet de mille francs au garçon, qui rapporta la monnaie et reçut un louis de pourboire. Bref, cet Anglais paraissait colossalement riche aux yeux du personnel et, mus par la curiosité, tous les garçons examinèrent sa fiche d’identité sur laquelle l’Anglais avait inscrit : Edward Penting, Pretoria. Est-ce exact ?
– C’est exact.
– Or, le lendemain matin, on ne vit pas M. Penting sortir de sa chambre. À midi, il n’avait pas encore paru. À quatre heures de l’après-midi, on s’inquiéta. À cinq heures, le gérant frappa inutilement à la porte de la chambre. À cinq heures un quart, par-devant un commissaire de police, la porte était enfoncée. On trouva l’Anglais étendu en chemise sur son lit, mort. Un médecin, appelé, diagnostiqua la mort par le chloroforme. La chaîne de montre et le chronomètre, les bijoux, le portefeuille probablement bourré de bank-notes : tout cela avait disparu. Les vêtements et le linge s’entassaient, dépliés, en désordre. Enfin, la fenêtre de la chambre donnant sur la rue de la Paix était grande ouverte, et on remarqua sur le bord de la croisée une érosion produite comme par le raclement d’une forte corde… C’est tout !
– C’est tout ce que l’on sait, en effet, dit M. Torpène. L’enquête n’a encore rien relevé. Aux télégrammes câblés à Pretoria, on nous a répondu que jamais Edward Penting n’avait été connu dans cette ville. Les malles portaient des étiquettes du Havre, on n’a trouvé que l’employé qui avait enregistré ces malles pour Paris… Et c’est tout.
– Bon ! fit le docteur ; maintenant, suivez-moi bien.
– Je vous écoute, fit M. Torpène, intrigué.
– L’affaire criminelle ne me regarde pas. Je pense d’ailleurs que vous ne trouverez jamais l’assassin au chloroforme, qui est en même temps le mystérieux voleur, – car vous n’avez aucun indice. Mais là n’est pas la question. Ce qui m’intéresse dans cette histoire, c’est que le cadavre d’Edward Penting convient parfaitement à Arthur Brad… Monsieur Torpène, donnez-moi ce cadavre !
– Fichtre ! s’écria le préfet de police en sursautant, mais il ne m’appartient pas !
– Je le sais !
– Il est à la Morgue, et on le conserve intact, en le gardant de la corruption, jusqu’à ce que l’affaire soit éclairée ou classée…
– Évidemment !
– Il m’est tout à fait impossible de retirer ce cadavre de la Morgue !
– Bon !
– Vous me voyez désolé, cher docteur…
– Ne le soyez pas ! En vous disant : « Donnez-moi ce cadavre », je me suis mal exprimé. C’est : « laissez-moi le prendre ! » que je veux dire…
– Hein ?
– Oui, laissez-moi le prendre !
– Comment ferez-vous ?
– Cela me regarde.
– Vous vous exposerez…
– À rien ! Et mon intervention aura deux conséquences excellentes…
– Lesquelles ?
– D’abord, donner un corps convenable à l’âme de Brad.
– Ensuite ?
– Ensuite, un grand service rendu à la police française. Les journaux se moquent de vous, monsieur Torpène, Eh bien ! je forcerai les journaux au silence.
– Et comment ?
– Oh ! d’une manière bien simple, Edward Penting, ressuscité, déclarera qu’il n’était qu’endormi – on sera bien obligé de le croire – et que toute cette affaire n’avait pour but que de tenter une expérience scientifique. Il fera des excuses à la police française pour les ennuis causés et donnera vingt mille francs aux pauvres de Paris…
– Mais c’est fou !
– Non ! On sera bien forcé de se rendre à l’évidence, puisque ce sera le prétendu mort lui-même qui parlera… Donc, vous me donnez carte blanche ?…
– Je ne sais si…
– Vous auriez peur de…
– De rien ! fit nettement M. Torpène. Agissez comme vous l’entendrez, puisque vos agissements ne causeront de tort à personne…
– Parfait ! s’écria le docteur.
Et, se levant :
– Cher monsieur Torpène, je vous demande donc de faire le nécessaire pour que les corps de la jeune ouvrière asphyxiée, du jeune homme noyé et de l’Italien pendu soient tous les trois transportés cette nuit même à l’hôpital de la Pitié, d’où je me charge de les apporter ici.
– Entendu ! j’ai pris les notes nécessaires.
– Et pour vous remercier, continua le docteur, je vous convierai à la réincarnation de Brad.
– Quand ?
– Demain, à midi.
– Où ?
– À la Morgue, parbleu !
– J’y serai.
– Quant à la réincarnation de Lola Mendès, de Paul de Civrac et de Francisco, je l’opérerai la nuit prochaine, en présence de vous et de nos amis habituels.
– Bien, docteur ! je vous quitte.
Et M. Torpène se leva.
– À demain, à midi, à la Morgue !
– Entendu.
Et le préfet de police se dirigeait vers la porte, suivi par le docteur. Mais, tout à coup, il se retourna, et, mettant la main sur l’épaule d’Ahmed-bey :
– Pourtant, docteur, dit-il, permettez, il me vient une objection.
– Faites-la !
– Ces âmes que vous allez réincarner… Mlle Lola Mendès, Francisco, M. Paul de Civrac, Brad…
– Eh bien ?
– Ils ont une famille… des amis… des intérêts… Ils auront changé, de corps, de visage… On ne voudra pas les reconnaître…
– Vous oubliez l’androplastie ! fit le docteur avec placidité.
– L’androplastie ? répéta M. Torpène, embarrassé.
– Mais oui !… Connaissez-vous la rhinoplastie ?…
– Sans doute ! fit le préfet en souriant. C’est une opération chirurgicale qui a pour but de refaire un nez lorsque cet organe a été détruit.
– Juste, et le mot vient du grec : rhis, rhinos, nez, et plastos, forme. Eh bien ! décomposez le mot androplastie. Vous trouverez qu’il vient aussi du grec : aner, andros, homme, et plastos, forme. L’androplastie est donc une opération chirurgicale qui a pour but de refaire un visage – puisque le visage c’est l’homme – quand ce visage a été détruit ou quand, plus simplement, on veut modifier les traits et l’expression d’un visage déjà existant…
– Et l’androplastie ?… balbutia M. Torpène, un peu effaré.
– Je la pratique, cher Monsieur. Elle m’a été enseignée dans les temples sacrés et mystérieux de l’Inde, où l’on modèle les corps comme l’on y pétrit les âmes. Vous comprenez qu’il me sera facile de retrouver des photographies de Lola Mendès, de Paul de Civrac, d’Arthur Brad et même de Francisco… Je modèlerai à chacun, sur leur corps nouveau, une tête semblable à l’ancienne, voilà tout. C’est une affaire d’adresse, de patience et de temps. Alors, c’est entendu… Je compte que mes trois cadavres seront à la Pitié, vers minuit…
– Oui… oui… évidemment.
– Et que vous serez à la Morgue demain à midi.
– À la Morgue, parfaitement, à midi…
Et M. le préfet de police, stupéfié, sortit de l’hôtel du docteur Ahmed-bey.
CHAPITRE II
QUI RACONTE DE QUEL FAIT AFFOLANT LA MORGUE FUT LE THÉÂTRE
Il était midi moins dix, le lendemain, lorsque M. Torpène entra sous le péristyle de la Morgue. Le gardien de service reconnut les traits populaires du préfet de police, qu’il accompagna aussitôt dans un bureau attenant à la salle d’exposition des cadavres.
– À midi, fit M. Torpène, qui connaissait la méticuleuse ponctualité d’Ahmed-bey, à midi, un monsieur arrivera sous le péristyle. Il est grand, sec, brun, sans moustache, ni barbe. Vous l’introduirez ici immédiatement.
Le gardien s’inclina, fit le salut militaire et tourna les talons. Il alla se poster sur le seuil de la Morgue. Et le premier coup de midi retentissait à une horloge voisine lorsque le gardien vit une automobile de maître s’arrêter devant lui et un homme en descendre, dont le signalement correspondait à la succincte description faite par M. Torpène.
Deux minutes après, le docteur Ahmed-bey serrait la main du préfet de police.
– Eh bien ! dit le haut fonctionnaire, les trois cadavres de cette nuit sont-ils chez vous ? En êtes-vous satisfait ?
– Très satisfait ! répondit le docteur. La jeune ouvrière est extrêmement jolie et son corps est un des plus beaux que j’aie jamais vus : l’âme de Lola Mendès n’aura rien perdu au change. Le canotier est un gars solide, bien musclé, quoique svelte : Paul de Civrac en sera ravi. Quant à l’Italien, il a au front une cicatrice en diagonale qui le défigure un peu ; pourtant, Francisco gagnera beaucoup à être réincarné, car, si je m’en souviens, sa première apparence corporelle manquait de grâce. Donc, tout va bien. Nous sommes seuls ?
– Oui.
– Ce bureau communique avec la salle publique d’exposition ?
– Nous n’avons qu’à ouvrir cette porte, répondit M. Torpène en se levant et en montrant de la main une porte peinte en jaune brun.
– Bien. Vous permettez ? Je vais fermer la fenêtre, afin que nous ne recevions qu’un peu de clarté par cette porte, que nous rouvrirons.
– Faites.
Le docteur ferma la fenêtre, contrevents et vitres, dont il tira aussi le rideau. Et, dans l’obscurité qui régna aussitôt dans la pièce, M. Torpène vit une étincelle flotter à cinquante centimètres au-dessus de la tête d’Ahmed-bey.
– Vous regardez l’âme d’Arthur Brad ? fit celui-ci.
– Oui, docteur.
– Je vous laisse seul avec elle un moment. Je vais considérer le cadavre d’Edward Penting.
Le thaumaturge prononça deux mots mystérieux ; puis il marcha vers la porte par laquelle il était entré, et l’étincelle ne l’accompagna pas. Elle demeura, immobile et scintillante, au milieu de la pièce !
Et M. Torpène, confus d’admiration, murmurait :
« Quel terrible pouvoir possède Ahmed-bey ! S’il lui plaisait, il pourrait bouleverser le monde ! L’humanité peut se féliciter que cet homme ne soit pas né avec des instincts criminels !… »
Cependant, le docteur était arrivé dans le couloir public, qu’un châssis vitré, protégé à distance par une barrière, sépare de la salle où, sur une vaste dalle inclinée, sont rangés les cadavres anonymes ou mystérieux, que des appareils frigorifiques maintiennent congelés, afin d’en assurer la conservation.
Dans le vaste couloir, à cette heure de sortie des ateliers pour le repas de midi, circulait une foule compacte. Elle se composait d’ouvriers et d’ouvrières, d’employés, de vagabonds, qu’attirait surtout la curiosité de voir le corps de cet Anglais énigmatique dont l’histoire incompréhensible emplissait depuis six jours les colonnes des journaux.
Patiemment, le docteur se mit à la queue du défilé et arriva peu après devant le vitrage. Sur la dalle, il y avait cinq cadavres. Le docteur jeta un coup d’œil distrait sur les deux premiers. Mais au troisième, il s’arrêta et s’accouda carrément à la balustrade.
Le corps d’Edward Penting semblait un corps simplement endormi. Gros, court, le ventre proéminent, les jambes droites et fortes, les pieds énormes, tout vêtu d’un complet gris à carreaux vert pâle, un col de chemise rabattu, non empesé, entouré par une cravate rouge au nœud en régate, il offrait un bon visage placide ; la bouche et les yeux étaient normalement fermés, et, sans la caractéristique pâleur de la mort, qui marbrait le front et les joues, sans le pincement spécial du nez, ce cadavre aurait paru vivant.
Autour du docteur immobile, hommes et femmes échangeaient des réflexions stupides, simples ou saugrenues, lançaient des lazzis sur ce cadavre bedonnant ou sur les autres plus hideux, avaient de petits rires nerveux ou des murmures d’horreur, et tout cela faisait un bruit continu de foule qui parle à demi voix, se pousse, piétine et passe.
« C’est parfait ! » fit à voix basse le docteur.
Et jetant sur le cadavre un dernier coup d’œil, sur la foule un regard et un sourire de froide ironie, Ahmed-bey retourna auprès de M. Torpène.
À la place même que le docteur venait de quitter, un jeune homme et une jeune fille s’accoudèrent, sans faire attention aux murmures des gens qui les suivaient et qu’ils empêchaient de voir commodément le fameux cadavre. Ils se donnaient le bras et avaient cet air de joie spéciale qui anime les visages de l’étudiant et de l’ouvrière aux premiers jours d’une liaison amoureuse.
– Hein ! dis ! fit la jeune fille, qui avait une jolie frimousse rose tout auréolée de fins cheveux blonds sur lesquels se posait de travers un chapeau cloche orné d’énormes cerises, dis, Fernand, c’est celui-là qu’on a tué au chloroforme ?
– Oui, mon petit ! répondit le jeune homme en souriant.
– C’est drôle ! reprit la jeune fille, on ne dirait pas qu’il est mort !… Il n’a pas l’air d’avoir souffert !… Regarde, comme il a une tête tranquille… C’est commode, le chloroforme, tu ne trouves pas ?…
– Oui, oui… on débouche le flacon sous son nez… ou bien on le verse sur un mouchoir qu’on s’attache comme un bâillon… et ça y est…
– Quand tu ne m’aimeras plus, fit la petite folle en riant, j’achèterai du chloroforme…
– On ne t’en vendra pas.
– Penses-tu !…
Et, avec un haussement d’épaules, la jeune fille tourna la tête vers son ami.
– Tiens ! s’écria celui-ci, tu as vu ?
– Quoi donc ?
– Comme une étincelle électrique qui a filé, là, au-dessus de la tête de l’Anglais…
– Cette blague !…
– Je te dis que si !
– En effet, Monsieur, dit un homme grave debout près de l’étudiant, j’ai vu, comme vous, une étincelle…
Et la foule s’arrêta, se pressa, s’interrogeant. Tout contre la balustrade, l’étudiant, l’ouvrière et le monsieur grave, résistaient à la poussée et regardaient le cadavre de l’Anglais…
Soudain, l’ouvrière poussa un cri aigu et tendit le bras, en hurlant d’une voix sifflante :
– Sa bouche ! sa bouche !… Regardez, là, là !…
– Hein ! quoi ? Mais c’est vrai !…
– Les yeux, maintenant, les yeux !…
Et pâle, tremblante, la jeune fille se dressait, clouée à la balustrade par la surprise et la terreur.
Derrière elle, la foule grossissait ; il en sortait des cris, des jurons…
– Ils s’ouvrent !… s’écria le monsieur grave.
Et, se retournant, il voulut s’enfuir. Mais la foule l’écrasa contre la balustrade.
– Ah !… ah !… s’écria la jeune fille d’une voix déchirante… Il se lève !…
Un long cri d’horreur éclata sous les voûtes du péristyle… Ceux qui avaient vu le cadavre ouvrir les yeux et se lever lentement voulaient s’enfuir, et ils luttaient contre ceux qui arrivaient du dehors et qui n’avaient rien vu. Il y eut des cris fous, des coups échangés, des sanglots de terreur… Évanouie, la jeune fille s’affaissa entre des jambes, fut piétinée, tandis qu’une bousculade emportait son ami effrayé. Comme cassé en deux, le monsieur grave, perclus d’horreur, les yeux écarquillés, s’accrochait du ventre à la balustrade… Et c’était partout une bagarre dans la panique des gens qui voulaient fuir et la fureur de ceux qui voulaient voir…
Et les curieux qui n’avaient pas tourné le dos au vitrage furent obligés de ne rien perdre du terrifiant spectacle…
Ce cadavre d’Anglais, devant lequel tout le peuple de Paris avait défilé, qui était depuis six jours sur la dalle glacée de la Morgue, ce cadavre avait soudain remué les lèvres, ouvert les yeux, agité doucement les jambes. Et maintenant, il se levait lentement, comme ankylosé par sa longue immobilité.
Il s’assit sur le bord de la dalle et promena autour de lui un regard effaré… De la main droite, il toucha le corps étendu le plus près de lui… Et, de nouveau, son regard décrivit un demi-cercle… Puis ses yeux, agrandis par l’étonnement, par une indicible émotion, s’arrêtèrent sur la foule qui, derrière le vitrage, montrait des faces crispées et verdies par l’horreur, des corps convulsés par la lutte, des jambes, des bras et des têtes mêlées…
Et le cadavre ressuscité regardait cela de ses yeux fixes, lorsqu’une voix impérieuse cria derrière lui :
– Arthur Brad !
Alors, une résolution soudaine l’anima. Il sauta sur le sol, tourna le dos à la foule affolée, fit le tour de la dalle et marcha vers une porte qu’il voyait ouverte. Quand il l’eut franchie, la porte se referma, poussée par le docteur Ahmed-bey.
– Monsieur Torpène, dit le docteur Ahmed-bey, je vous présente Arthur Brad dans sa nouvelle dépouille mortelle.
Pâle, extrêmement ému, le préfet de police s’inclina.
– Monsieur Brad, je suis le docteur Ahmed-bey, que vous avez connu sur Vénus et Mercure sous les diverses formes qu’il a été obligé de prendre.
– Enchanté de vous connaître ainsi ! répliqua Brad avec un accent anglais très prononcé.
– Comment vous trouvez-vous ?
– Assez bien de ma personne ! fit Brad en se regardant des pieds à la moustache. Mais j’ai froid et j’ai faim…
– Cela ne m’étonne pas ! dit M. Torpène, qui avait recouvré sa présence d’esprit. Vous êtes depuis six jours sous l’influence de l’appareil frigorifique, et il est évident que vous n’avez rien mangé pendant ce temps-là.
– Où sont Paul de Civrac, Lola Mendès et Francisco ?
– Chez moi ! fit le docteur. Ils ne sont pas encore réincarnés… Vous assisterez à…
– Bon ! bon ! interrompit Arthur Brad.
Et un pli d’inquiétude barrait son front. Il regardait de tous côtés et ouvrait la bouche comme pour parler, mais il hésitait.
– Qu’avez-vous ? dit M. Torpène.
– Vous allez trouver cela enfantin, balbutia Brad, mais je voudrais bien voir ma figure… Vous comprenez… c’est de quelque importance… Il n’y a pas de miroir, ici ?…
– Vous en trouverez chez moi, monsieur Brad ! dit le docteur en riant. Mais que votre visage ne vous inquiète pas. Je vous le modèlerai de telle sorte qu’il sera semblable en tout à celui que vous aviez avant votre désincarnation, si, toutefois, vous tenez à ressembler absolument à votre ancienne forme…
– Non ! ça m’est égal… Je n’ai pas de famille, et peu m’importe que mes amis trouvent que j’ai changé… mais je ne voudrais pas être trop laid, vous comprenez !…
Les trois hommes éclatèrent de rire.
– Monsieur Torpène, est-ce que vous nous accompagnez ? dit le docteur.
– Non ! Je dois rester ici pour accomplir certaines formalités nécessitées par la résurrection inattendue de M. Edward Penting…
– Edward Penting ? fit Arthur Brad en levant les sourcils.
– Oui, c’est le nom du corps dont vous usez actuellement, monsieur Brad… le docteur vous racontera… Ces formalités accomplies, j’irai chez vous, docteur, pour vous faire signer, ainsi qu’à Brad, une déclaration. Et nous rédigerons la note à envoyer aux journaux… Mais ne vous laissez pas interviewer !…
– Soyez tranquille, mon cher ami, répondit le docteur. Mon automobile est à deux pas d’ici et mon chauffeur est adroit… Nous éviterons les journalistes, si quelqu’un d’eux est déjà arrivé… À tout à l’heure !
– À tout à l’heure !
– Monsieur Brad, dit Ahmed-bey, allons déjeuner !…
– Avec plaisir, docteur !
Ayant serré la main de M. Torpène, les deux hommes sortirent du bureau. Sous le péristyle, ils furent arrêtés par un officier de paix accompagné de plusieurs sergents de ville. Le couloir public était dégagé, et la foule s’entassait au dehors, sur le trottoir… À la vue d’Edward Penting, le gardien qui était à côté de l’officier de paix fit un bond en arrière en criant :
– C’est lui ! C’est lui !…
– Monsieur l’officier, dit le docteur aussitôt, le préfet de police vous attend là, dans le bureau… Veuillez me donner quatre hommes pour dégager mon automobile, nous sommes pressés !
Cela était dit d’une voix si imposante d’autorité que l’officier de paix n’hésita pas une seconde à obéir. Il donna des ordres à un brigadier et disparut vers le bureau : accompagné de quatre hommes, le brigadier alla dégager la chaussée devant l’automobile. Et, la foule écartée, la voiture démarra. Elle eut bientôt disparu au coin du quai.
CHAPITRE III
OÙ LE DOCTEUR AHMED-BEY TIENT SES FANTASTIQUES PROMESSES
Quatre heures après l’extraordinaire scène de la Morgue, l’édition du soir de l’Universel – section parisienne – était criée dans toute la ville par des milliers de camelots.
Elle portait en première page la manchette suivante :
LE MYSTÈRE DE L’HÔTEL FULTON
ÉMOUVANT COUP DE THÉÂTRE
Edward Penting ressuscité !… – Il n’était qu’endormi ! « C’est, dit-il, une simple expérience ! » – Il sait où sont ses bijoux et ses valeurs. – Il donne 20.000 francs aux pauvres de Paris ! – « L’affaire est classée ! » conclut M. le préfet de police.
Suivait un long article racontant en détail la résurrection, mais de la manière qu’il avait plu au docteur Ahmed-bey qu’elle fût racontée.
Et, en dernière heure, on lisait encore, au sujet du mystère de l’hôtel Fulton, le communiqué suivant :
« On nous assure que M. Edward Penting, le mystérieux ressuscité, est un ami de M. le docteur Ahmed-bey, dont le monde entier connaît la science extraordinaire et la compétence dans l’ordre des faits en apparence surnaturels. Cela explique bien des choses !
« En quittant la Morgue, M. Ahmed-bey, qui a assisté à la « résurrection », est rentré, en compagnie de M. Edward Penting, à son hôtel du parc Monceau. L’éminent docteur et le mystérieux ressuscité ont déclaré se refuser à toute interview.
« Toutefois, M. le docteur Ahmed-bey a bien voulu nous promettre que, dans quelques semaines, il expliquera lui-même à la presse tout le mystère, afin que la presse communique cette explication au monde entier.
« Il n’y a donc plus qu’à attendre. Attendons… »
L’article de tête et l’entrefilet de « Dernière heure » furent reproduits par tous les journaux du soir dans Paris et, le lendemain matin, par tous les journaux du monde…
Et ce fut pendant cette nuit où les courants des fils téléphoniques, télégraphiques et transatlantiques ne furent pas interrompus une minute, où les stations de télégraphie sans fil des deux hémisphères restèrent sur le qui-vive, ce fut pendant cette nuit que s’accomplit, dans l’hôtel du docteur Ahmed-bey, la scène la plus émouvante peut-être de toute cette aventure.
À minuit, dans le laboratoire, étaient assis sur les divans les cinq personnages qui avaient assisté à la désincarnation du docteur Ahmed-bey, c’est-à-dire : M. Torpène, le savant astronome C. Brularion, l’abbé Normat, le docteur Payen et M. Martial.
Ils avaient été conduits là par Ra-Cobrah, qui les laissa, en leur annonçant que son maître ne tarderait pas à venir.
Ils l’attendaient avec impatience, car, excepté M. Torpène, aucun d’eux n’avait revu le docteur. Ils ne connaissaient même son retour sur la terre que par les allusions que faisaient les journaux du soir à la présence d’Ahmed-bey à la scène de résurrection de la Morgue.
L’impatience et l’émotion des cinq personnages étaient telles qu’aucun d’eux ne pouvait parler.
Devant eux, sous l’éclatante lumière des lustres, trois corps étaient étendus sur les dalles de marbre.
L’un, seul sur une seule dalle, était un corps de jeune fille, que revêtait un riche peignoir de soie blanche ; ses pieds étaient chaussés de pantoufles de cuir rouge ; elle avait au cou un beau collier de corail, et sa chevelure noire, très belle, était coquettement peignée.
La seconde dalle supportait deux corps masculins : l’un était vêtu d’un complet smoking ; l’autre, d’un costume veston d’étoffe bleue ; ils étaient l’un et l’autre soigneusement rasés ; mais le premier portait la moustache, tandis que le second en était privé.
Soudain, une des portes du laboratoire s’ouvrit, et on entendit la voix du docteur Ahmed-bey :
– Entrez, capitaine, entrez, et ne vous étonnez de rien.
– Bien, Monsieur, bien ! j’ai vu des choses si extraordinaires que…
Et le « capitaine », qui venait de prononcer ces mots avec un fort accent espagnol, se montra aussitôt à la pleine lumière du laboratoire.
Ahmed-bey le suivait. Il le prit familièrement par le bras et l’amena devant les cinq invités, qui s’étaient tous levés :
– Messieurs, dit-il, j’ai l’honneur de vous présenter le capitaine José Mendès, père de Mlle Lola, dont j’ai ramené l’âme de la planète Mercure !
Et le docteur présenta au capitaine chacun des cinq savants. Puis il ajouta :
– Hier soir, j’ai téléphoné à Barcelone, à l’état-major de la place, où le capitaine se trouvait de service. J’ai pu lui parler. Je ne lui ai dit que quelques mots, mais ils ont suffi pour que le capitaine prît aussitôt le train. Il est arrivé voilà deux heures. J’ai tenu à le mettre au courant de mes opérations et de mes actes, passés et prochains. C’est la cause de mon retard à venir vous retrouver, Messieurs.
Chacun s’inclina, tous se rassirent, et le capitaine, dont les mains tremblaient d’émotion et qui était plus pâle que les cadavres étendus sur les dalles, le capitaine prit place à côté de M. Torpène.
Alors seulement, M. Brularion, M. Martial, l’abbé Normat et le docteur Payen osèrent parler. Ils commencèrent ensemble :
– Mais, docteur…
Et, voyant qu’ils parlaient tous à la fois, ils n’en dirent pas davantage.
– Messieurs, dit Ahmed-bey en souriant, ne m’interrogez pas. Plus tard, je vous raconterai mes aventures. Vous avez vu mon âme quitter mon corps, dont vous avez, j’en suis sûr, constaté après mon départ l’état cadavérique… Maintenant, vous revoyez ce même corps bien vivant devant vous. Tenez-vous momentanément satisfaits, je vous prie, en ce qui me concerne, et assistez en silence aux prodiges qui vont s’accomplir sous vos yeux. Vous en serez les témoins et les contrôleurs, et votre témoignage sera précieux quand je jugerai bon de révéler au public mon pouvoir et mes actes.
Les cinq hommes inclinèrent la tête.
– Capitaine, reprit Ahmed-bey d’une voix plus grave, domptez l’émotion bien naturelle qui vous agite, et veuillez considérer de près ce cadavre de jeune fille…
José Mendès se leva et, tous les traits contractés, mais ferme et droit, il marcha vers la dalle. Il regarda le visage marmoréen et dit :
– C’est dans ce corps que vous allez faire entrer l’âme de ma Lola ?…
– Oui.
– Si je fais taire mes préférences paternelles, reprit le capitaine, je reconnais que c’est là une belle jeune fille… plus belle certainement que ne l’était la mienne, bien que sa beauté fût célèbre à Barcelone. Mais ces yeux, qui doivent être noirs, auront-ils le regard de ma Lola ?…
– Ils l’auront, Monsieur, car le regard n’est que l’expression de l’âme…
– Ces lèvres auront-elles son sourire ?…
– Vous en jugerez, fit le docteur. Au reste, vous savez que par l’androplastie, dont je vous ai expliqué les effets, je peux modeler ce visage jusqu’à le rendre exactement semblable à celui sous lequel vous vous représentez votre fille… Mais c’est une opération très longue, très délicate, et qui n’est pas sans douleur pour l’opéré… Je ne l’exécuterai que si l’âme de Lola, parlant par cette bouche, m’en exprime le désir et si vous-même m’en donnez l’ordre formel…
– Ce que voudra Lola, répondit simplement le capitaine, je le voudrai…
Mais, tandis que José Mendès allait se rasseoir, une porte s’ouvrit et une grosse silhouette se dessina dans l’encadrement.
– Messieurs ! fit Ahmed-bey, je vous présente Arthur Brad, sous les espèces d’Edward Penting.
À ces mots, une curiosité ardente fit lever brusquement M. Brularion, M. Martial, l’abbé Normat et le docteur Payen ; seul, M. Torpène, souriant, restait assis.
Arthur Brad s’avança tranquillement et les quatre savants, avec José Mendès, considéraient de toute la force de leurs yeux cet homme qui avait été enlevé par la Roue Fulgurante, dont le corps primitif se momifiait sur la planète Vénus et dont le corps actuel était, quelques heures plus tôt, un cadavre d’Anglais assassiné mystérieusement ! De telles associations d’idées eussent rendu fous bien des gens. Mais nos savants n’étaient pas de ceux qui se laissent bouleverser le cerveau par des faits ou des idées. Ensemble ils tendirent la main à Arthur Brad, qui reçut et donna quatre vigoureux shake-hands. Quant au capitaine, il s’était de nouveau assis : il pensait surtout à sa fille.
– Et maintenant, Messieurs, dit Ahmed-bey, quand tout le monde eut pris place sur les divans, bien en face des dalles de marbre, je vous demande d’observer et de ne pas parler.
Il entra dans le cabinet de toilette et en sortit peu après, vêtu d’une longue robe de lin. En passant près d’une colonne, il tourna un bouton. Les lustres furent éteints. Seule brilla, au-dessus des dalles, une petite lampe électrique à verre vert.
Ahmed-bey leva le bras vers la voûte, et l’on put voir alors trois blanches étincelles descendre d’un trait et s’arrêter au-dessus des trois cadavres.
Raidi par l’émotion, le capitaine Mendès s’était levé ; il avait avancé d’un pas, et il se tenait debout, immobile, les yeux fixés sur l’étincelle qui flottait au-dessus du cadavre de la jeune fille.
Cependant, Ahmed-bey avait commencé ses incantations et ses gestes sacrés. Sa voix s’enflait, s’élevait jusqu’à s’arrêter net sur un long cri déchirant, et alors l’étincelle brilla plus vive, fila d’un trait, flotta une seconde autour des lèvres de la morte et, tout à coup, disparut.
Aussitôt le docteur, à voix basse, murmura des mots incompréhensibles, et ses mains faisaient sur la tête de la jeune fille des passes magnétiques.
Haletants, tous les spectateurs s’étaient levés. Ils virent le jeune visage se colorer d’une teinte rosée, ils virent la gorge se soulever doucement et s’abaisser.
– Lola ! cria soudain Ahmed-bey, Lola Mendès, m’entendez-vous ?
– Je vous entends… soupira la jeune fille ressuscitée.
– Lola, reprit le docteur, vous souvenez-vous de la planète Mercure ?…
– Je me souviens… Oh ! quelle horreur !
Et une expression de souffrance crispa le joli visage.
– Lola ! dit encore le docteur, j’ai voulu que votre âme soit ramenée sur la Terre…
– Est-ce possible ? gémit l’endormie.
– Cela est ! Vous dormez… maintenant, vous allez vous réveiller… Mais vous aurez un visage et un corps différents de ceux que vous aviez jadis…
– Ah ! soupira la jeune fille. Comment cela peut-il se faire ?
– Tout vous sera expliqué… Mais, écoutez-moi bien !
– J’écoute !
– Vous allez voir devant vous, en vous réveillant, le capitaine José Mendès…
– Mon père !…
Un sanglot étouffé retentit dans le solennel silence qui avait suivi l’exclamation de la jeune fille : le capitaine José Mendès pleurait…
– Oui, votre père ! dit Ahmed-bey.
Puis, après un silence :
– Et maintenant, Lola, reprit le docteur, je vous enjoins de vous souvenir de tout ce que je viens de vous dire !
– Je me souviendrai !
– C’est bien ! Je vais vous réveiller !
Et il ajouta, d’un ton plus bas, en se tournant vers les spectateurs :
– À présent, je suis sûr que les émotions qui la frapperont à son réveil ne lui feront aucun mal.
De ses mains étendues, il fit des passes magnétiques, et Lola Mendès ouvrit les yeux, des yeux agrandis, effarés, tout pleins encore des mystères de l’au-delà.
– Levez-vous, Lola ! ordonna doucement Ahmed-bey.
La jeune fille s’assit sur le bord de la dalle et promena autour d’elle un regard indécis.
– Lola ! Lola ! cria le capitaine.
Et il s’avançait, les bras en avant.
La ressuscitée sauta sur le parquet, et, tout en larmes, se jeta dans les bras de son père.
Et pendant qu’ils s’embrassaient, éperdus, Ahmed-bey les poussait doucement vers la porte du grand escalier de marbre. Là, Ra-Cobrah et deux serviteurs les attendaient. Selon les ordres du maître, ils dirigèrent respectueusement le père et la fille jusqu’au haut de l’escalier et les firent entrer dans un petit salon. Et ils les laissèrent seuls, afin que, peu à peu, le capitaine, instruit par Ahmed-bey, apprît à sa fille par quelle suite de miracles elle se retrouvait sur la terre et dans un corps qui n’était pas le sien.
CHAPITRE IV
QUI, SANS L’ANDROPLASTIE, SE TERMINE PAR LES FIANÇAILLES PRÉVUES
Cependant, la première émotion passée, et sur un geste du docteur, M. Torpène et ses amis, ainsi qu’Arthur Brad, s’étaient assis de nouveau sur les divans.
Et aussitôt, Ahmed-bey réincarna l’âme de Paul de Civrac dans le corps habillé d’un smoking, en même temps qu’il réincarnait l’âme de Francisco dans le corps vêtu d’un costume veston.
Les spectateurs de cette scène affolante étaient dans un état d’esprit indescriptible : leur raison se refusait à croire à une réalité dont leurs sens, pourtant, ne pouvaient douter. Et leur raison elle-même dut s’incliner devant l’évidence, lorsque Paul de Civrac et Francisco parlèrent !
Quelques minutes suffirent à Paul et à Francisco pour se rendre compte de ce qui était arrivé. Leurs facultés mentales leur rappelèrent leur désincarnation sur la planète Mercure – et ils furent tout à fait à leur aise dès qu’Ahmed-bey, les présentations faites, leur eut raconté en quelques mots l’origine de leurs corps actuels, celle du corps d’Arthur Brad, ainsi que l’émouvante réincarnation de Lola.
Il avait conclu en disant :
– J’ai choisi du mieux que j’ai pu votre « guenille » présente, monsieur de Civrac, et la vôtre aussi, Francisco. Toutefois, si votre nouveau visage ne vous plaît pas, je peux vous le modeler à la ressemblance de l’ancien.
– Comment ? fit Paul de Civrac.
Le docteur expliqua l’opération de l’androplastie.
– Eh bien ! non, dit Paul… J’en ai assez des choses extraordinaires ! Il me tarde de revivre ma simple vie d’homme comme tout le monde. Toute ma famille se compose d’un frère et d’une sœur : je leur expliquerai l’aventure inouïe, et ils m’aimeront autant sous ma nouvelle apparence que sous l’ancienne… Cependant, il est une personne qui jugera en dernier ressort : si mon visage ne lui plaît pas, il faudra recourir à l’androplastie, docteur… Mais avez-vous un miroir ici ? Je ne serais pas fâché de faire connaissance avec moi-même… avant de vous demander de me présenter à Mlle Mendès.
Souriant, Ahmed-bey conduisit Paul de Civrac au cabinet de toilette et l’y laissa.
– Moi, Monsieur, j’étais si laid que je ne puis qu’avoir gagné au change. Je garderai ma nouvelle figure quelle qu’elle soit… Quant au corps, je vois bien qu’il est mieux fait que celui que me donna ma pauvre mère… Les muscles ne sont peut-être pas aussi solides, mais la bonne nourriture et l’exercice arrangeront cela… Il ne me reste donc, Monsieur le docteur, qu’à vous remercier… Mercure n’était pas un pays pour un Espagnol et pour un chrétien… Mais, sans vous commander, j’aurais bien du plaisir à revoir le capitaine et la Señorita… Est-ce que, au moins, elle est aussi belle qu’avant ?…
– Je crois que oui, Francisco. D’ailleurs, vous allez en juger.
Et se tournant vers Paul, qui revenait du cabinet de toilette :
– Eh bien ! Monsieur de Civrac, votre portrait vous convient-il ?
– Il me convient, docteur, et je vous remercie… Mais je raserai ma moustache et je ferai couper mes cheveux d’une autre manière…
– Alors, pas d’androplastie ?
– Non ! pas d’androplastie.
– Francisco non plus n’en veut pas !
– Il a raison ! Il est très bien sous sa peau nouvelle. Le mieux de nous tous est certainement Arthur Brad.
– Dommage que Bild ne soit pas ici, dit Brad… Il ne se serait pas embêté… Mais, docteur, quoique j’aie bien déjeuné et bien dîné, j’ai faim.
– Moi aussi, fit Paul.
– Et moi ! souffla Francisco.
– Messieurs, il est quatre heures du matin, fit Ahmed-bey. On peut encore souper à cette heure-là.
À ces mots, une porte s’ouvrit et la voix de Ra-Cobrah prononça :
– Le maître est servi !
– Que vous disais-je, Messieurs !… Monsieur de Civrac, Brad, veuillez me suivre. Vous aussi, Francisco ; aujourd’hui, vous n’êtes pas l’ordonnance du capitaine Mendès, mais son invité… Quant à vous, Messieurs (et le docteur se tourna vers le groupe formé par M. Torpène, M. Brularion et leurs amis), vous connaissez le chemin de la salle à manger… C’est autour de la table que nous parlerons science, astronomie et aventures !
Et l’on s’engagea dans l’escalier. En haut, M. Torpène et ses amis passèrent d’un côté, tandis qu’Ahmed-bey conduisait Civrac, Brad et Francisco dans le petit salon où avaient été amenés le capitaine et sa fille.
À l’apparition des quatre hommes, Lola Mendès et son père se levèrent de la causeuse où ils étaient assis.
Ahmed-bey prit la main de Lola, celle de Paul et, sans mot dire, mit les deux jeunes gens en face l’un de l’autre sous la pleine lumière du lustre…
Il y eut une minute de silence, d’observation passionnée, de bonheur fou, d’émotion contenue. Lola pleurait ; Paul s’efforçait en vain d’arrêter les larmes qui embrumaient ses yeux. Et tout à coup, saisissant les deux mains de la jeune fille, le jeune homme fit un pas en avant et déposa, sur le front pur qui se levait vers lui, le plus ardent et le plus chaste des baisers…
À travers les regards des yeux corporels, les âmes immortelles s’étaient reconnues.
– Capitaine Mendès, fit Paul de Civrac d’une voix tremblante, en se tournant vers le père de Lola, j’ai l’honneur de vous demander la main de mademoiselle votre fille.
– Mon père, fit Lola, je vous prie de m’accorder pour époux M. Paul de Civrac…
Le capitaine, les yeux humides de larmes, s’avança vers les fiancés et, les étreignant ensemble :
– Dieu vous a vraiment unis dans le ciel, dit-il ; vous serez, sur la terre, mes deux enfants !…
– Viva el Señor capitan ! s’écria une voix de stentor.
Tous se retournèrent vers la porte, où un grand diable se tenait debout, la bouche encore ouverte du cri proféré.
– Francisco ! dit le capitaine.
– Lui-même, Señor, bien qu’un peu changé à son avantage !… Mais la Señorita saura dire si elle veut toujours que je la serve ainsi.
– Si je le veux, Francisco !…
C’est alors qu’Arthur Brad sortit du coin où il s’était mis pendant les effusions familiales. Gros, plus gros même que dans la Roue Fulgurante, il s’avança, et, s’inclinant devant Lola Mendès autant que le lui permettait sa rotondité :
– Mademoiselle, dit-il, laissez-moi vous présenter mes vœux de bonheur – et à vous, mon cher Civrac, mes félicitations…
– Mais c’est Arthur Brad ! s’écria Lola.
Mutine, elle présenta sa joue, où l’Américain mit un baiser de père.
– Dommage, fit-il, dommage que ce sacré têtu de Jonathan Bild ne soit pas là…
– Monsieur Brad, nous en parlerons à table ! dit le docteur.
Il offrit le bras à Lola Mendès, et, quelques minutes après, tous les hôtes d’Ahmed-bey étaient réunis autour d’une table que présidait gracieusement la belle Lola.
Pendant les premiers services, on parla peu. Puis, le docteur, qui était le moins affamé des convives, raconta succinctement ses aventures. Paul de Civrac raconta les siennes, ainsi que Brad et Francisco. Les récits se coordonnèrent et se relièrent facilement les uns aux autres.
– Quant aux observations purement scientifiques, dit le docteur, elles feront l’objet d’un mémoire que le supplément scientifique de l’Universel publiera bientôt et que M. de Civrac et M. Brad rédigeront avec moi… Là, d’ailleurs, ne se borne pas notre tâche. Dès demain, je vais, avec M. Brad et quelques praticiens mécaniciens, commencer la construction de la machine qui nous mettra en rapports avec Jonathan Bild, demeuré, sur la planète Vénus… Je serai heureux, Messieurs, de vous voir assister le plus possible à nos travaux… Je vous le répète, la science, plus encore que nous, a besoin de votre témoignage.
– Une machine, dites-vous ? fit M. Brularion.
– Oui, une machine semblable en tous points à celle dont Bild est muni sur Vénus… Une fois notre appareil établi, nous communiquerons avec Bild, comme la station de télégraphie sans fil de la tour Eiffel, par exemple, communique avec la station de Bizerte…
– Mais de la Terre à Vénus, il y a de onze à seize millions de lieues, aux époques où nous pouvons le mieux observer la planète…
– Cela n’a aucune importance, répliqua le docteur, et le nom seul que Bild et les Vénusiens donnent à leur machine suffira pour vous rassurer…
– Ils l’appellent donc ?…
– Le radiotéléphonographe interplanétaire.
– Je comprends le sens de ce mot, dit M. Brularion ; pourtant, je ne vois pas du tout la machine…
– Mais pourquoi se fatiguer à construire cette machine ? fit Francisco. Au moyen de la désincarnation, Monsieur le docteur, vous pouvez aller dans Vénus et en revenir…
– Moi, oui ! répondit Ahmed-bey. Moi seul, avec les hommes dont je voudrais bien me faire accompagner. Cela n’est pas suffisant pour la science, car le but de la science est de servir également toute l’humanité. C’est ce que fera notre machine… Si je ne puis pas livrer le secret de la désincarnation et de la réincarnation des âmes, nous devons, au contraire, selon la volonté des Vénusiens et de Bild, donner à qui le voudra les moyens scientifiques – sinon matériels – de construire une machine semblable à la nôtre… Et ce ne sera qu’un pas. Bild et les Vénusiens sont tout près de trouver le moyen de venir sur la terre : c’est même pour cela que Bild n’a pas voulu se laisser désincarner.
– L’Académie des Sciences a de belles séances en perspective, dit l’abbé Normat.
– Et Paris, dit Ahmed-bey en regardant Civrac et Lola silencieux, isolés dans un bonheur absolu, un admirable mariage à l’horizon !
Ce fut le mot de la fin.
Les savants se levèrent et prirent congé, emportant des secrets dont ils ne devaient parler que quand Ahmed-bey les aurait lui-même révélés publiquement. Lola Mendès, le capitaine Civrac et Francisco furent conduits aux chambres que leur hôte leur avait fait préparer au premier étage de l’hôtel.
Ce serait le surlendemain seulement que commenceraient les travaux du radiotéléphonographe qui devait mettre la Terre en relations avec le monde de Vénus et avec Jonathan Bild.
SEPTIÈME PARTIE
LE RADIOTÉLÉPHONOGRAPHE INTERPLANÉTAIRE
CHAPITRE PREMIER
OÙ L’ON ASSISTE À DE PRODIGIEUSES RÉALITÉS
Il fallut exactement trente-huit jours pour construire le radiotéléphonographe. Et cependant, le docteur Ahmed-bey n’avait rien négligé pour que les travaux fussent rapidement menés.
Son immense fortune lui permit d’engager cent ouvriers mécaniciens choisis parmi les meilleurs ; il obtint que l’usine du Creusot, chargée de livrer les pièces métalliques à monter, s’acquittât en douze jours d’une commande dont l’importance aurait demandé, avec un client ordinaire, vingt fois plus de temps.
Ce fut sur le plateau de Gravelle, dans un vaste terrain découvert, que l’on construisit la tour à coupole mobile qui devait contenir la machine. Dans un hangar voisin, on assembla les pièces venues du Creusot. À droite de la tour se dressaient trois mâts métalliques de cent vingt mètres de hauteur ; ils supportaient des antennes à peu près semblables à celles d’un poste de télégraphie sans fil, mais ces antennes étaient faites d’un alliage de cuivre, d’or et d’argent : elles étaient à grande surface et formaient comme une pyramide de fils renversée.
Dès que fut terminée l’installation de la machine dans la tour, le docteur Ahmed-bey et Arthur Brad signèrent tous les deux une invitation ainsi conçue :
« M… est prié de vouloir bien se rendre, après-demain jeudi, à neuf heures du soir, au laboratoire du plateau de Gravelle, pour assister à la première expérience du radiotéléphonographe entre la Terre et la planète Vénus… À ce moment, Vénus, étoile du soir, sera près de sa conjonction inférieure et, par conséquent, très rapprochée de la Terre, ce qui favorisera les communications. »
Ce billet fut envoyé à M. Torpène, à M. Brularion, à l’abbé Normat, au docteur Payen, à M. Martial, et, en outre, à chacun des présidents des cinq Académies et des deux Chambres, et enfin au directeur des services parisiens de l’Universel.

Ces treize personnages arrivèrent presque en même temps, qui en automobile, qui en hippomobile, à la porte de la tour… Ils furent reçus par Francisco et introduits dans un cabinet de travail qui occupait tout le rez-de-chaussée de la tour et où se trouvaient déjà le capitaine Mendès, Lola et Paul de Civrac, dont le mariage devait avoir lieu dans quinze jours. M. Torpène fit les présentations. Presque aussitôt apparurent le docteur Ahmed-bey et Arthur Brad, tous les deux en cotte courte d’ouvriers. Ils descendaient de la chambre des machines, installée au-dessus du cabinet de travail.
– Messieurs, dit le docteur, veuillez me suivre.
Il ouvrit la porte par laquelle il était venu et, précédé de Brad, s’engagea dans un escalier tournant.
Deux minutes après, les dix-neuf personnes, y compris Francisco, se trouvaient dans une immense salle ronde, extrêmement haute, au plafond en dôme, qu’éclairaient vivement quatre globes électriques.
Dans une partie de cette salle, dix-sept fauteuils étaient rangés contre le mur, en un seul rang mi-circulaire.
– Messieurs, dit Ahmed-bey en montrant de la main les fauteuils, veuillez vous asseoir.
M. Torpène avait déjà placé Lola Mendès et Paul de Civrac dans les deux fauteuils du milieu ; tous les autres personnages s’assirent de chaque côté, sans penser aux préséances. Seuls, Ahmed-bey et Arthur Brad restèrent debout.
– Voici le radiotéléphonographe interplanétaire, fit simplement le docteur.
Et sa main tendue montrait, au beau milieu de la salle, une chose brillante, énorme et fantastique.
La machine se divisait en deux corps, nettement séparés par un espace vide de deux mètres de largeur. Elle était calée sur une estrade de marbre blanc où l’on accédait de tous côtés par trois marches.
Le corps de droite de la machine se composait d’abord d’une grande caisse de cèdre luisant posée sur une caisse plus longue de bois d’ébène, qui reposait elle-même sur le marbre. De la caisse supérieure sortaient des fils métalliques d’un blanc jaunâtre qui allaient faire un tour sur des tiges de porcelaine plantées sur les bords de la caisse inférieure ; puis ces fils, tortillés sur eux-mêmes, allaient s’enrouler à d’autres tiges de porcelaine fixées sur un plateau d’ébène et disparaissaient. Du milieu de ce plateau d’ébène s’élevait une colonne de cuivre de dix mètres de hauteur et qui se terminait, au bout, par deux énormes bobines à électro-aimant. Près de cette colonne était dressée une potence de bois d’ébène de cinq mètres de hauteur, à laquelle pendait une sorte de toupie de cuivre d’où sortait un fil métallique recouvert d’une enveloppe isolante et qui allait se perdre dans le mur de la salle… Enfin, sous la toupie, était disposé un transmetteur téléphonique.

Même pour un savant mécanicien, cette machine gigantesque était incompréhensible. C’est la pensée qu’après cinq minutes de silencieux examen exprima M. Brularion, approuvé par les graves hochements de tête du vénérable directeur de l’Académie des sciences.
Ahmed-bey sourit.
– Et cependant, dit-il, cette machine de droite rappelle assez l’appareil transmetteur Ducretet, de télégraphie sans fil… Mais c’est l’énormité des proportions qui vous a déroutés… Vous devez aussi y ajouter ce transmetteur téléphonique.
– Ceci est donc le corps transmetteur de la machine à supprimer l’espace, si j’ose m’exprimer ainsi ? fit M. Martial.
– Oui, répondit le docteur. Et ceci est le corps récepteur.
Il montrait la machine de gauche.
Elle était moins énorme et plus simple. Sur une caisse d’ébène, des piliers de porcelaine soutenant des bobines à électro-aimant, des commutateurs, et, enfin, un appareil complet de récepteur téléphonique auprès duquel s’épanouissait un pavillon énorme de phonographe.
– Si je ne me trompe, dit M. Torpène, c’est, en somme, l’appareil complet, perfectionné, agrandi de télégraphie sans fil uni à l’appareil téléphonique et au phonographe.
– Parfaitement ! dit Ahmed-bey. Et tout cela est terrestre ; mais ce qui est vénusien, ce sont les fils métalliques composés avec un alliage ; d’or et de platine dont Jonathan Bild, sur Vénus, m’a donné la formule ; ce qui est vénusien, ce sont les limailles employées ici et dont je révélerai la composition dans mon mémoire à l’Académie des sciences. Je ne vous ai pas convoqués aujourd’hui pour vous faire une conférence, mais seulement pour que vous assistiez à la première communication établie entre la Terre et la planète Vénus…
Il s’arrêta une minute, puis il reprit :
– À peu près comme par la télégraphie sans fil, nous enverrons des ondes, non pas hertziennes, mais lumineuses, de la lumière solaire emmagasinée dans cette machine par le procédé vénusien… Et à ces ondes, Bild nous en enverra d’autres en réponse. Le procédé d’envoi et de réception est d’ailleurs très simple. Je parlerai dans ce transmetteur téléphonique et, dans la machine, les vibrations de ma voix produiront des forces qui délivreront la lumière solaire emmagasinée ; elles la délivreront avec plus ou moins d’intensité, selon l’intensité des vibrations elles-mêmes. Et ces ondes lumineuses, par ces fils d’ici et les antennes du dehors, iront jusqu’à l’appareil vénusien, où Bild les recevra, comme nous recevrons celles qu’il nous enverra… Et ces ondes, que Bild nous enverra en parlant devant sa machine, nous les recevrons ici, par les antennes du dehors… Dans le corps récepteur de notre machine, elles se transformeront en vibrations qui émouvront les mécanismes de ce téléphone, lequel, à son tour, influencera ce phonographe d’où sortira, nette et claire, Messieurs, la voix de Jonathan Bild.
À mesure que le docteur parlait, sa propre voix était devenue grave et vibrante. Elle s’arrêta sur le nom de Bild avec un éclat de triomphe.
Les invités furent soudain envahis d’une intense émotion, à la commune pensée de ce miracle réalisé : les paroles de deux hommes s’échangeant à travers des millions de lieues d’espace interplanétaire.
Il y eut un long et profond silence.
– Messieurs ! reprit tout à coup Ahmed-bey d’un ton plus calme, Arthur Brad va parler à Jonathan Bild…
Alors, le docteur pressa un bouton : les globes électriques s’éteignirent ensemble et le dôme de la tour disparut avec un crissement métallique… le ciel nocturne, le ciel étoilé de cette belle nuit d’été, apparut aux invités, qui avaient levé la tête…
– Regardez là-haut, dit le docteur, vous verrez filer dans le firmament les ondes lumineuses…
Cependant Arthur Brad s’était placé debout devant l’appareil téléphonique transmetteur du corps droit de la machine.
– Docteur, dit-il, faites le signal d’appel…
Ahmed-bey avait la main sur un levier de porcelaine. Il appuya. Le levier tomba. Il y eut dans la machine un sifflement aigu. Les étincelles crissantes zébrèrent l’obscurité de l’immense pièce ronde, et soudain, là-haut, dans le ciel, un zigzag lumineux, aveuglant, parut, brilla, pâlit, s’évanouit !…
Sous la lumière d’une petite lampe électrique suspendue au milieu d’un écran demi-circulaire, Ahmed-bey regardait sa montre à secondes, et il comptait à haute voix :
– Dix… vingt… trente. Un ! Dix… vingt… trente. Deux !… Dix… vingt… trente. Trois !… Dix… vingt… trente. Quatre !… Messieurs, Jonathan Bild est averti… Avant cinq minutes, nous en serons avisés…
Et dans le silence qui suivit ces paroles, on entendit la voix de M. Camille Brularion qui disait :
– Et si Jonathan Bild est mort ?
– Il ne l’est pas, répondit froidement le docteur.
– Comment le savez-vous ?
Il y eut une minute de silence, et la même voix froide d’Ahmed-bey répliqua :
– Je me suis désincarné hier – et mon âme a été visiter Jonathan Bild sur la planète Vénus…
Une sorte de frisson passa dans les épaules des spectateurs noyés au fond de l’ombre… Et nul n’osa plus parler.
Comme Ahmed-bey, d’un geste, montrait le ciel, tout le monde, de nouveau, leva la tête.
Et soudain, un zigzag lumineux, encore vague, parut dans la nuit. Il se précisa aussitôt, passa dans un éblouissement, disparut… Au même instant, des étincelles pétillèrent et une sonnerie électrique retentit dans le corps gauche de la machine.
– Bild est prêt ! dit le docteur. Parlez, Brad !…
Et sans qu’un souffle vînt du rang des fauteuils, dans le silence de la tour, devant les machines qui semblaient, dans l’ombre, des monstres apocalyptiques accroupis, Arthur Brad prononça lentement des paroles qui allaient retentir, à dix millions de lieues, à travers le vide des espaces interplanétaires, aux oreilles de Jonathan Bild et des Vénusiens…
La portion du ciel circonscrite, en haut, par le cercle de la tour, se zébrait à chaque seconde de zigzags lumineux d’envergures et d’intensités différentes…
Et soudain, Brad se tut.
Il y eut cinq minutes d’un silence plus profond que le silence de la mort.
Puis, d’autres zigzags, venant de l’infini… apparurent… Des étincelles crépitèrent dans la tour et, du pavillon phonographique, sortirent ces paroles retentissantes :
– Jonathan Bild et trente savants vénusiens à la Señorita Lola Mendès et à vous tous, salut !…
CHAPITRE II
OÙ L’ON ATTEND, DANS L’ANGOISSE
Ce fut, dans le monde entier, une stupéfaction qui dépassait de beaucoup la panique causée par la Roue Fulgurante et l’étonnement produit par le message en projection survenu quelques jours plus tôt.
Le premier, au matin de l’extraordinaire nuit, l’Universel, sous la signature de l’astronome Constant Brularion, publia le compte rendu de la séance du laboratoire de Gravelle ainsi que le texte in extenso de la conversation de Brad le Terrien et du Vénusien Jonathan Bild.
Tous les grands journaux du monde donnèrent dans la journée même une seconde édition, reproduisant les prodigieuses nouvelles de l’Universel, qui avaient été câblées, télégraphiées, téléphonées de partout à partout dans la matinée.
Les observatoires, les académies, les sociétés savantes s’émurent. On organisa des congrès nationaux, puis, avec une surprenante rapidité, un congrès mondial scientifique, qui tint ses assises à Paris, dans la grande salle du Trocadéro.
Cependant, des polémiques s’engageaient dans les journaux. La plupart des grands périodiques du monde, tous les journaux français prirent parti pour l’Universel et acceptèrent sans discuter la véracité de ses informations interplanétaires. Mais d’autres périodiques et journaux nièrent les faits, parlèrent de fumisterie, de légèreté et de crédulité.
Ils traitaient Ahmed-bey de « spirite affolé », Brad, Paul et Francisco de saltimbanques, Lola de femme « peu recommandable » et, pour eux, Bild n’avait jamais existé. Quant à Brularion, on l’appelait « astronome pour salon de coiffure », et M. Torpène devenait un « policier échappé de Charenton ».
Mais l’Universel ne s’émouvait pas pour si peu. Jusqu’au 11 juillet, date à laquelle Vénus devait passer juste entre la Terre et le Soleil et où, pour des raisons astronomiques, les communications devaient être interrompues, l’Universel publia chaque jour le compte rendu in extenso des communications interplanétaires.
Bild n’eut pas d’aventures à raconter. La planète Vénus était peuplée d’une seule race d’êtres formant une nation unique divisée en deux classes : la classe des travailleurs intellectuels et la classe des travailleurs manuels. Pas d’artistes. L’art, dans Vénus, était remplacé par la science. Tel ouvrier, de la classe inférieure, passait dans la classe supérieure après avoir inventé quelque appareil ou quelque machine propre soit à faciliter la vie vénusienne, soit à hâter la solution du principal problème de la science qui était de communiquer avec les habitants des autres planètes…
Dans une telle société, dont le gouvernement était composé d’un conseil de dix membres composé en nombre égal d’individus des deux classes élus par des assemblées régionales, Jonathan Bild recevait une hospitalité généreuse. Les Vénusiens ne ressemblaient en rien aux hommes. Leur corps était une charpente osseuse uniquement destinée à soutenir un assemblage de muscles et de nerfs ; ils n’avaient pas de jambes, mais d’immenses ailes, qu’ils abaissaient et tenaient parallèlement rigides pour se reposer sur le sol. Leur forme et leur taille étaient celles d’un immense oiseau. Mais ils avaient deux bras, ou plutôt deux tentacules, garnis de milliers de longues et fortes ventouses ; et ils s’en servaient, comme de mains multiples, avec une adresse et une rapidité prodigieuses. Leur tête n’était, à proprement parler, qu’un fanal ; une boîte osseuse et sphérique, dont une moitié s’ouvrait en un œil immense, et dont l’autre moitié contenait, humainement parlant, un cerveau, siège de l’intelligence. Ils n’avaient point la parole ni l’ouïe comme nous les entendons.
Ils se « parlaient » par l’œil – dont l’énorme pupille variait de forme, de couleur et d’intensité lumineuse, selon toutes les modulations de la pensée… Mais, en plus de ce langage visuel, ils avaient un langage écrit, composé de signes analogues à ceux de la télégraphie. Morse terrestre et qu’ils traçaient sur des tablettes d’or avec un poinçon de matière incassable et colorante. Les signes fondamentaux étaient au nombre de quatorze, mais ils affectaient des milliers de variations à peine visibles à l’œil humain et, souvent, un seul signe exprimait une pensée qu’un homme n’aurait pu rendre qu’avec plusieurs phrases…
Bild était arrivé assez vite à comprendre le langage visuel et à s’assimiler l’alphabet graphique. Les Vénusiens lui parlaient avec l’œil et il répondait au moyen des tablettes d’or et du poinçon…
Avec les radiotélégrammes de Jonathan Bild, l’Universel composait donc tous les jours le feuilleton le plus extraordinaire et le plus passionnant que jamais journal ait publié…
Le 10 juillet au soir, ce feuilleton prit fin.
Mais au Congrès mondial scientifique qui s’ouvrit le lendemain même au Trocadéro, le docteur Ahmed-bey lut son mémoire tout entier consacré à la machine à supprimer l’espace. Il ne dit qu’un mot de la désincarnation des âmes, se bornant là-dessus à en appeler au témoignage de M. Torpène, de M. Brularion, de l’abbé Normat, du docteur Payen et du professeur Martial. Ces messieurs jouissaient dans le monde scientifique d’une telle réputation d’intelligence, de probité, de sagesse et de bon sens, que nul doute ne se manifesta.
Dès le lendemain de l’ouverture du Congrès, les journaux opposants cessèrent leurs polémiques et s’inclinèrent enfin devant la vérité. Par les soins d’une commission financière et scientifique, un livre fut publié. Il contenait in extenso le mémoire du docteur Ahmed-bey, contresigné par Arthur Brad et Paul de Civrac, le compte rendu de la première séance du Congrès international, la description et les plans du radiotéléphonographe et le texte complet des conversations interplanétaires de Bild et de Brad. Cet ouvrage fut tiré à des millions d’exemplaires, traduit en vingt-trois langues et répandu dans le monde entier.
Sa conclusion était celle-ci :
« Dans son dernier radiotéléphonographe, Jonathan Bild a annoncé que, au moment exact de la conjonction inférieure de la Terre et de Vénus, il s’embarquerait, avec six Vénusiens, dans un appareil voyageur que les savants venaient de terminer. Ce serait, au sens terrestre, le 11 juillet, à neuf heures du soir. La distance de la Terre à Vénus étant alors à peu près de onze millions de lieues, et l’appareil vénusien faisant dix mille lieues à l’heure en moyenne, Bild compte arriver sur la Terre quarante-cinq jours vingt heures après son départ de Vénus. Ce serait donc le 26 août, à cinq heures de l’après-midi, que l’appareil voyageur vénusien touchera le sol terrestre. En quel lieu de notre globe ? Nous l’ignorons. Les personnes qui ont lu ces lignes sont instamment priées de signaler au bureau télégraphique le plus voisin tout ce qui pourra leur paraître anormal dans le ciel ou sur la Terre Vers la date du 26 août prochain. »
Cela était signé : Ahmed-bey, Arthur Brad, Paul de Civrac, et contresigné par trente des plus célèbres savants du monde, y compris M. Torpène.
Ce livre, intitulé la Terre et Vénus, parut en même temps dans toutes les capitales de la Terre, le 15 juillet. On le répandit à profusion, gratuitement. Les journaux le signalèrent chaque jour et en publièrent chaque jour aussi la conclusion.
Et la Terre entière attendit.
Cependant, à Paris, au milieu d’une énorme affluence où toutes les aristocraties se mêlaient à l’enthousiaste démocratie, fut célébré le mariage de Lola Mendès avec Paul de Civrac. Arthur Brad et Ahmed-bey étaient les témoins de Lola, M. Torpène et Francisco ceux de Paul de Civrac. Et l’immense foule put contempler enfin cette jeune fille et ce jeune homme qui avaient laissé leur corps primitif dans la planète Mercure – car toute l’histoire des désincarnations et des réincarnations successives avait été publiée la veille dans les journaux, sous la signature d’Ahmed-bey et avec l’autorisation officielle de M. Torpène et la ratification formelle du gouvernement français.
Ahmed-bey, Arthur Brad et Francisco ne furent ni moins admirés ni moins acclamés.
Et dans l’esprit de la multitude, confondu dans la même et unique pensée, s’implanta dès lors la certitude que tout était possible, l’humanité commençait à se sentir Dieu.
Ce fut dans un appartement réservé de l’hôtel d’Ahmed-bey que les nouveaux mariés habitèrent, en attendant qu’une villa fût construite sur le terrain du laboratoire interplanétaire de Gravelle. Paul de Civrac, le lendemain de son mariage, fut nommé directeur de ce laboratoire par le gouvernement français, à qui Ahmed-bey en avait fait don. Arthur Brad accepta d’être chef des communications interplanétaires ; le capitaine José Mendès demanda la liquidation de sa pension de retraité et Francisco devint l’intendant de la nouvelle famille. Quant à Bild, on l’attendait pour lui confier la fondation et la direction d’un laboratoire pareil à celui de Paris et que le gouvernement des États-Unis faisait édifier, avec le radiotéléphonographe, aux environs de New-York.
Pendant la nuit du 25 au 26 août, peu d’hommes civilisés dormirent sur la Terre, et, dans la journée du 26, les travaux habituels furent abandonnés. Dans les villes et les campagnes, sur les toits et les terrasses des maisons, sur les places publiques et dans les rues, en pleins champs, au sommet des montagnes, des hommes veillaient, tournant des télescopes, des lunettes astronomiques, des longues-vues, de simples jumelles, vers tous les points du ciel…
Tous les bureaux télégraphiques et téléphoniques du monde entier étaient sur le qui-vive ; les hauts fonctionnaires des P. T. T. de chaque nation demeuraient en permanence à leurs bureaux…
Une telle attente fiévreuse s’expliquait par autre chose que par la curiosité. En effet, avant de se séparer, les délégués gouvernementaux du Congrès mondial scientifique avaient voté une prime de dix millions de francs à répartir entre l’individu qui, le premier, signalerait l’appareil vénusien à un bureau de poste, les employés de ce bureau et les chefs de service de la ligne, au départ et à l’arrivée de chaque bureau transmetteur. Tous les télégrammes devaient être transmis immédiatement par les voies les plus directes au bureau central de Paris et envoyés, de là, au poste télégraphique installé près du laboratoire de Gravelle.
Dans le laboratoire même se tinrent en permanence, avec Ahmed-bey, Arthur Brad, Paul de Civrac et Lola, José Mendès et Francisco, les délégués de toutes les grandes sociétés savantes du monde, à raison d’un par société. Il y avait aussi des représentants des gouvernements, des directeurs de journaux, une nuée de reporters… Tout le monde mangeait et logeait dans les maisons avoisinant les terrains du laboratoire : les locataires du moment sous-louaient à des prix fous les appartements, les logements, les simples chambres… Une société de constructions démontables édifia dans un champ une sorte de vaste caravansérail contenant deux mille places – qui fut envahi en trois heures…
Le premier télégramme arriva le 25 août, à deux heures du matin. Il disait : « Honolulu. Machine vénusienne apparente dans le ciel. – David GLENKO. »
– Il faut attendre la confirmation de la nouvelle et la description de la machine, dit Ahmed-bey. Les illusions d’optique seront innombrables !…
En effet, de minute en minute, d’autres télégrammes arrivèrent. Et bientôt, les cent récepteurs installés ne chômèrent pas un instant. D’heure en heure, les employés étaient remplacés et les télégrammes étaient apportés au cabinet de travail où se tenaient Ahmed-bey, Brad et Civrac, avec cinquante interprètes. L’appareil vénusien paraissait sur tous les points du globe terrestre… Partout on le voyait ! Partout il allait tomber…
Les heures passèrent dans une activité fiévreuse.
– Il faut attendre que parmi ces milliers de correspondants, disait Ahmed-bey, l’un d’eux nous confirme son précédent télégramme, parle du point d’atterrissage de l’appareil et décrive même succinctement l’appareil lui-même… Jusque-là, illusions, illusions d’optique…
La nuit et la journée du 25, la nuit du 26 elle-même n’apportèrent rien de concluant… le 26, à neuf heures du matin, on avait déjà reçu seize mille huit cent quatre-vingt-quinze télégrammes, mais aucun correspondant, en ayant envoyé un premier, n’en avait envoyé un second…
Dans la journée du 26, l’affluence des dépêches diminua.
– La lumière du jour n’est pas aussi propice que la nuit aux illusions imaginatives, dit en souriant Ahmed-bey. D’ailleurs, ce n’est qu’à partir de cinq heures du soir, d’après les renseignements de Bild et nos calculs, que la chose doit certainement arriver…
La journée s’écoula sans aucune confirmation d’un précédent télégramme. Dès sept heures du soir, le nombre des dépêches s’accrut de minute en minute…
– Le projecteur est prêt ? demanda le docteur Ahmed-bey à Brad.
– Oui.
– Les microphones.
– Aussi.
Au sommet de la tour, on avait installé un projecteur électrique tournant qui devait s’allumer dès que l’arrivée de l’appareil vénusien serait indubitable. Et quatre microphones, d’une énorme puissance, devaient jeter aux quatre coins du compas les paroles annonciatrices indiquant l’heure et le lieu du merveilleux atterrissage…
Or, toute la soirée et toute la nuit du 26 au 27 s’écoulèrent sans que le projecteur brillât, sans que retentît la voix de cuivre des phonographes…
Le 26, à huit heures du matin, Ahmed-bey, Brad et Paul de Civrac s’étendirent sur des matelas, dans le cabinet de travail même, et tombèrent dans un profond sommeil. Ils n’avaient pas dormi depuis quarante-huit heures. Francisco, assis près d’eux, avait ordre de les réveiller dès que les pointeurs qui numérotaient et classaient les télégrammes en recevraient un redoublant une signature déjà vue…
À neuf heures, Lola et son père survinrent. Ils s’assirent dans le cabinet et, en causant avec Francisco, près des dormeurs, ils attendirent…
Mais la journée tout entière passa : rien !
À six heures du soir, le nombre des télégrammes reçus et classés était de trois cent cinquante-neuf mille.
Mais tous étaient de signatures différentes. Pas une seule confirmation.
Ayant dormi, mangé et pris quelques instants d’exercice physique dans la cour entourant les bâtiments du laboratoire, à neuf heures du soir du 27, Ahmed-bey, Brad et Paul s’assirent de nouveau dans le cabinet de travail.
Dix heures sonnèrent, puis onze heures, puis minuit…
– Pourvu que Bild et les Vénusiens ne se soient pas trompés dans leurs calculs, dit Paul de Civrac. La moindre erreur les aurait envoyés dans l’infini des espaces interplanétaires…
– Oui, fit Brad, si leur appareil n’est pas dirigeable une fois lancé… Mais s’il est dirigeable, ils peuvent réparer, en cours de route, toute erreur de lancement ou de direction…
– À moins que des lois d’attraction inconnues les aient détournés, murmura le docteur, en lisant des yeux le quatre cent vingt-deux millième télégramme.
Mais aussitôt, il poussa un cri étouffé et s’écria :
– Écoutez !
Et, dans l’émotion soudaine que son cri avait provoquée, il lut :
« Observatoire astronomique Gaurisankar, Himalaya, 27 août, trois heures. Bolide incandescent arrive sur Terre, sur ligne de Vénus. Télégrammes suivront quart d’heure par quart d’heure. – Archibald SIMPSON. »
– Cette fois, dit Arthur Brad, je crois que voilà Jonathan Bild ; j’ai connu à Boston Archibald Simpson, c’est l’astronome le plus froid et le plus circonspect du monde entier…
– Je le sais, fit Ahmed-bey. C’est pour cela que son télégramme m’a frappé…
– Attendons, conclut Paul.
Et, un quarts d’heure après, un second télégramme d’Archibald Simpson.
« 27 août, trois heures un quart. Bolide grossit. »
– À trois heures un quart, astronomiquement, en comptant de minuit ordinaire, il fait nuit au Gaurisankar, dit Paul.
– Et jour ici, fit Brad.
Mais aussitôt, d’autres télégrammes, venus des antipodes, confirmèrent les informations d’Archibald Simpson. Celles-là même cessèrent sur ce dernier télégramme :
« Bolide n’est plus dans mon horizon. »
Mais alors, aux télégrammes nouveaux qui arrivaient, on aurait pu suivre la marche du bolide relativement au mouvement de rotation de la Terre…
Et soudain, Ahmed-bey se leva :
– Arrêtez tout ! cria-t-il.
Les appareils cessèrent de fonctionner.
– Allumez le projecteur ! ordonna Ahmed-bey dans le silence absolu qui s’était fait…
Brad pressa un bouton électrique, sur la table.
– C’est fait ! dit-il.
Et alors, Ahmed-bey lut d’une voix forte et vibrante le télégramme suivant :
« Observatoire de Verrières, 28 août, quatre heures trente-cinq matin. Appareil tombé carrefour Obélisque bois Verrières. J’y vais immédiatement. – BRULARION. »
Cinq minutes après, tandis que les microphones centuplant la sonorité de la voix du docteur, répétaient trois fois chacun, au Sud, au Nord, à l’Est, à l’Ouest, la nouvelle tant attendue, deux automobiles emportaient à toute vitesse, vers le carrefour de Verrières, près Paris, Ahmed-bey, Brad et M. Torpène, Paul de Civrac, Lola, son père et Francisco. Dix minutes après, le plateau de Gravelle était désert ; automobiles, hippomobiles et bicyclettes filaient sur les routes à toute allure, emportant la foule curieuse, haletante et enthousiasmée.
CHAPITRE III
OÙ LE DESTIN CLÔT, PAR UNE CATASTROPHE, LA PORTE DU MYSTÈRE
Du poste à coupole de son observatoire de Verrières, M. Brularion remarqua dans le ciel un phénomène anormal, au commencement de la nuit du 27 au 28 août. C’était un point lumineux grossissant imperceptiblement et s’approchant de la Terre avec rapidité. M. Brularion ne voulait point compromettre sa renommée par une annonce prématurée de l’appareil vénusien, il préférait ne pas gagner la prime et n’expédier un télégramme qu’à coup sûr…
Sans communiquer son observation aux astronomes qui se trouvaient autour de lui, il suivit dans le ciel la marche du phénomène.
À quatre heures du matin, le savant n’avait plus de doute. Mais il mettait son orgueil à n’envoyer à Gravelle qu’un seul télégramme et qu’il fût définitif. Quand l’objet, comme incandescent, tomba sur un point délimité du bois de Verrières, alors seulement M. Brularion se tourna vers les astronomes et dit d’une voix calme :
– Messieurs, l’appareil vénusien est arrivé.
Ce fut un beau vacarme. On demandait des renseignements sur la forme de l’appareil, le lieu exact où il avait atterri. Mais M. Brularion descendit au poste télégraphique de l’Observatoire et envoya le télégramme fameux au docteur Ahmed-bey. Puis il expédia un autre télégramme au général Durland, qui commandait les troupes mises sur pied à Versailles en prévision du service d’ordre à organiser autour de l’appareil vénusien. D’ailleurs, toutes les garnisons du monde entier étaient sur le qui-vive, car on ne pouvait savoir d’avance à quel endroit de la Terre tomberait le phénomène.
Puis, montant dans son automobile et suivi, dans d’autres voitures, de tous ses confrères, M. Brularion se rendit au carrefour de l’Obélisque. Le trajet dura trois minutes.
Aidés par les chauffeurs des voitures, les astronomes établirent, autour de la clairière de l’Obélisque, un barrage de fortes cordes que gardèrent quelques soldats amenés de l’Observatoire, où un poste avait été établi…
Dans la clairière, à quatre mètres des grands arbres qui en marquent le centre, une chose monstrueuse gisait, présentant l’aspect d’une cloche à gaz fracassée, avec ses montants tordus ; tout autour, la terre avait jailli et formait des monticules… Une chaleur terrible se dégageait de la machine et empêchait d’approcher à moins de quinze pas.
– Je crois bien, dit M. Brularion, que nous n’allons trouver là dedans que des corps en bouillie et les membres carbonisés…
Et les astronomes, rangés contre la corde, à l’intérieur de l’enceinte, hochèrent la tête avec inquiétude.
Cependant, autour de la corde, extérieurement, une foule sans cesse grossissante se pressait, et il en montait un grand murmure de conversations faites à demi voix. C’étaient des gens qui, à deux ou trois kilomètres à la ronde, avaient vu tomber le phénomène.
Soudain, des trompes retentirent – la foule s’écarta, et le docteur Ahmed-bey, suivi de ses amis, sauta dans l’enceinte. Presque aussitôt des chasseurs à cheval arrivèrent, puis un bataillon de fantassins montés en croupe d’un escadron de cuirassiers, commandés par le général Durland lui-même. Le service d’ordre fut établi solidement – et l’énorme foule des curieux dut rester immobile en dehors de l’enceinte, dans laquelle se pressaient les savants, les personnages officiels. Au premier rang, le plus près possible de la machine vénusienne, se tenaient, en un groupe distinct, Ahmed-bey, Arthur Brad, Paul et Lola, Francisco, M. Brularion, le général Durland et M. Torpène. Tous les cœurs battaient d’une intense émotion.
– Il faut attendre, dit Ahmed-bey, que cette masse de métal, échauffée par son passage dans notre atmosphère, soit complètement refroidie…
Et l’on attendit, en considérant la chose déconcertante, dans l’inquiétude de n’y trouver que la mort…
Au bout d’une heure, Ahmed-bey avait enfin pu s’approcher des masses désordonnées de métal jusqu’à pouvoir les toucher.
– Général, dit-il, veuillez avoir l’obligeance de faire avancer le génie.
Un ordre fut crié, transmis, et cinquante soldats du génie, commandés par un jeune capitaine, s’échelonnèrent autour de la machine. Guidés par Ahmed-bey, le général et le capitaine dirigeaient en personne les travaux.
D’abord, on déblaya, on enleva les monticules de terre ; puis on cassa, on tordit, on enleva le plus possible les poutres de métal enchevêtrées qui entouraient la cuve centrale… Et celle-ci apparut libre enfin, faite d’un métal grisâtre, qui fut reconnu pour du platine ; elle était énorme, enfoncée de travers dans la terre, profondément bossuée par endroits, intacte en d’autres.
Sur une parole d’Ahmed-bey, le silence le plus absolu fut ordonné à la foule. Et tout le monde écouta. De l’intérieur de la cuve, il ne venait aucun bruit. Saisissant la pioche d’un soldat, Ahmed-bey frappa sur le métal des coups rythmés, semblables à cet appel des mineurs employé dans les mines à charbon. Mais rien ne répondit. Le docteur laissa s’écouler cinq minutes, et il frappa de nouveau : en vain.
– Messieurs, dit-il alors à haute voix, cette cuve doit avoir une porte, actuellement fermée. Il faut la trouver, l’ouvrir…
– Elle peut être placée dans la partie de la cuve enfoncée dans le sol, dit Arthur Brad.
– En ce cas, nous éventrerons la cuve elle-même…
On se mit à l’œuvre. Des cordes furent jetées par-dessus la cuve, assujetties à des piquets – et des soldats, Ahmed-bey lui-même, Arthur Brad, Paul de Civrac, se suspendirent aux cordes, escaladèrent la cuve de tous côtés, l’examinèrent minutieusement.
Mais partout, la cuve était sans solution de continuité, sans plaques boulonnées, également lisse sur toute sa surface visible, comme un boulet de fer.
L’on se retrouvait à terre, découragés, lorsqu’un cri retentit :
– Un trou ! là ! un trou !
Et un soldat du génie, brandissant sa pioche, tout couvert de terre, sortit d’un petit fossé qu’il avait creusé le long de la paroi de la cuve. On courut et, en effet, Ahmed-bey vit un trou, dégagé par le soldat de la terre qui l’obstruait. Il était parfaitement circulaire et avait quarante centimètres de diamètre. Grâce à lui, on put se rendre compte que les parois de la cuve avaient vingt centimètres d’épaisseur.
– Un fanal d’automobile allumé ! cria le docteur.
Et vivement il ôta son veston, ses souliers. Le capitaine du génie apportait le fanal.
– Vous me le passerez quand je serai là dedans, dit Ahmed-bey.
Et souple, les bras en avant enserrant la tête, Ahmed-bey se glissa dans l’ouverture. On l’y vit disparaître tout entier, puis une de ses mains reparut : elle saisit le fanal et l’emporta…
Le général dut encore réclamer le silence. Ne voyant rien, n’entendant rien, la foule énorme des spectateurs se fâchait. Les soldats suffisaient à peine à la maintenir. Alors, le capitaine monta sur la cuve elle-même et cria les nouvelles.
– Et maintenant, conclut-il, taisez-vous et ne bougez pas. On vous mettra au courant…
La multitude applaudit et, par une corde tendue, le capitaine se laissa glisser jusqu’au sol.
Cependant, groupés autour du trou mystérieux, Arthur Brad, Paul, Lola, Francisco, M. Brularion, M. Torpène, les autres savants et personnages officiels attendaient dans une ardente inquiétude. Le soleil, montant au-dessus des arbres, inondait la clairière d’une joyeuse clarté. La cuve reluisait, énorme, difforme et toujours incompréhensible, monstre extra-terrestre que les cordes tendues semblaient retenir au sol…
Un quart d’heure s’écoula.
Soudain, la tête d’Ahmed-bey s’encadra dans l’ouverture circulaire. On entendit ces simples paroles :
– Envoyez-moi huit gaillards vigoureux portant chacun un fanal, une clef anglaise, un marteau et un ciseau à froid… Monsieur de Civrac… Brad, veuillez les accompagner, et vous-même, monsieur Torpène et monsieur Brularion, si la gymnastique ne vous répugne pas…
– Vous les avez vus ? dit le général.
– Non ! la cuve n’est qu’une carcasse… au milieu se trouve le véritable appareil vénusien, relié à la cuve par des arcs-boutants… L’appareil est parfaitement carré, muni de hublots, me semble-t-il, et d’une porte. Mais tout est hermétiquement clos. Entrez !
La tête d’Ahmed-bey disparut, et Arthur Brad se glissa dans le trou ; puis ce fut Paul de Civrac, puis M. Brularion, suivi de M. Torpène, ensuite huit soldats du génie ; le dernier fit passer du dehors les fanaux aux sept autres et s’engouffra aussitôt…
Alors, les personnes restées à l’extérieur, devant le trou, entendirent des coups de marteau, des crissements, des heurts sonores qui se répercutaient dans les airs…
Puis le silence.
Une angoisse, maintenant, passait sur les groupes des personnages officiels et des savants, sur le cordon des troupes, sur la foule entière. On pouvait entendre le bruissement de la brise dans les arbres. Mais cette absence solennelle de tout bruit humain fut de courte durée ; bientôt, un murmure monta de la foule entassée – et ce murmure allait croissant, troué d’éclats de voix, de cris…
Le capitaine allait de nouveau escalader la cuve pour réclamer encore le silence, lorsque la tête d’Ahmed-bey parut à l’ouverture circulaire. Ordinairement pâle, ce visage était blême, aux yeux écarquillés par l’émotion.
– Général, dit le docteur d’une voix blanche, faites avancer une douzaine d’hommes, avec des couvertures… ils en trouveront sur les automobiles… Vite ! vite !
Ce fut un subit affolement.
– Mais qu’y a-t-il, qu’y a-t-il donc ?
– Sont-ils morts ?
– Et Jonathan Bild ?
– Il y a des Vénusiens ? Combien ?
– Comment sont-ils exactement ?
– Mais Jonathan Bild ? Jonathan Bild ?
Ahmed-bey ouvrait la bouche pour parler, quand douze soldats arrivèrent, chargés de toutes les couvertures de voyage et des pelisses qu’ils avaient pu trouver.
– Passez tout ! ordonna le docteur.
Et lui-même disparut.
Méthodiquement, les soldats firent passer par le trou les couvertures et les pelisses, puis, rangés, ils attendirent, tandis que le capitaine, debout sur la cuve, haranguait, instruisait, calmait la foule qui devenait houleuse…
Et soudain, elle se tut et s’immobilisa d’elle-même, comme si ces milliers de cerveaux avaient senti la présence de la mort et du mystère.
Le docteur Ahmed-bey sortit le premier de la cuve, il fit un signe aux soldats, qui reçurent et dégagèrent une masse longue enveloppée dans une couverture. Aussitôt que cette masse fut posée sur le sol, Ahmed-bey, agenouillé près d’elle, la découvrit, et on vit alors le corps d’un homme grand et maigre, pâle, les yeux fermés.
– Jonathan Bild ! murmura Lola, les yeux gonflés de larmes.
– Il n’est pas mort, dit le docteur.
D’une des poches de son gilet, il tira un minuscule flacon, le déboucha, en versa tout le contenu sur un mouchoir et appliqua le linge mouillé sur les narines et les lèvres de Jonathan Bild.
Puis, se relevant :
– Général, dit-il, j’espère le sauver. Veuillez faire dégager le chemin qui conduit à l’observatoire de M. Brularion… Capitaine, mon automobile !…
– Que faudra-t-il faire ensuite ? demanda le général.
– Recevoir les corps enveloppés dans les couvertures et qu’on va passer à ces soldats. Ne pas les découvrir et les faire transporter immédiatement à l’Observatoire. Puis, faire garder ce carrefour de manière que personne ne s’approche de la machine…
– Mais, dites-nous… risqua M. Martial.
– Plus tard ! plus tard ! Lisez demain L’Universel. Au revoir, général ! À bientôt, Messieurs ! Madame, vous venez avec moi. Paul nous rejoindra dans un quart d’heure, avec Brad et Francisco.
Et, précédé par quatre soldats portant Jonathan Bild inanimé sur la couverture tendue, Ahmed-bey, donnant la main à Lola et suivi par le général, marcha vers son automobile. Sorti de la cuve, M. Brularion le rejoignit le capitaine avait fait dégager le chemin de l’observatoire, Et, entre deux haies d’une foule bruissante, l’automobile s’élança.
Le lendemain, en première page, l’Universel publiait les rapides informations documentaires que voici :
JONATHAN BILD ET LES VÉNUSIENS
LA JOURNÉE D’HIER
« Dans notre édition d’hier soir, nous avons raconté l’arrivée de la machine vénusienne et les événements qui s’étaient produits jusqu’à deux heures de l’après-midi. À ce moment, la machine était gardée par tout un régiment d’infanterie échelonné en plusieurs cordons, entre lesquels circulaient les officiers et les gardes républicains à cheval. Nous donnons plus loin la description de cette machine, d’après le docteur Ahmed-bey lui-même.
« À ce moment aussi, Jonathan Bild était encore dans un état d’inquiétante insensibilité. Disons tout de suite que Jonathan Bild, grâce aux soins du docteur Ahmed-bey et du professeur Martial, est enfin revenu à lui à quatre heures vingt-cinq minutes. Il a ouvert les yeux, a balbutié quelques mots incompréhensibles, puis il s’est endormi, sous l’influence d’un cordial qui lui avait été injecté dans ce but. Son sommeil dure encore à l’heure où nous écrivons ces lignes. Mais l’état général de ses organes et leur reprise de fonctionnement normal font espérer qu’à son réveil, qui se produira aujourd’hui vers midi, Jonathan Bild pourra se lever, manger et parler. Son corps ne porte aucune blessure et on ne pense pas qu’il se soit produit des lésions intérieures. Son réveil est attendu par tout le monde avec une impatience fébrile, car seul Jonathan Bild pourra donner au monde les éclaircissements souhaités sur la planète Vénus, l’appareil vénusien et les Vénusiens eux-mêmes.
« En effet, les Vénusiens sont tous morts. Ils étaient six dans la machine avec Jonathan Bild. On connaît, par nos précédentes relations, la forme corporelle des Vénusiens. Comment sont-ils morts ? Et quand ? Est-ce pendant le voyage de Vénus à la Terre ? Est-ce en atterrissant ? Est-ce plus tard ? Le docteur Ahmed-bey l’ignore et seul Jonathan Bild pourra peut-être nous renseigner à ce sujet…
« Mais de quoi les Vénusiens sont-ils morts ? Là encore, c’est le mystère. Leurs corps, couverts non de plumes d’oiseau, comme l’ont écrit sans raison plusieurs de nos confrères, mais d’une peau rugueuse et blanche, sans poils, ni plumes, ni duvet, leurs corps sont devenus, en une heure de temps, d’informes masses gélatineuses ; les os eux-mêmes et les organes se sont dissous : c’est à peine si l’on peut distinguer la forme et la membrure des ailes, assez semblables aux ailes de notre chauve-souris. Quant aux yeux, – l’œil immense du Vénusien, – ils ont été les premiers à se décomposer ; ils ne forment plus avec le cerveau, dans la boîte crânienne amollie, qu’un petit dépôt de matière graisseuse et corrompue…
« C’est en vain que le docteur Ahmed-bey, à l’aide de liquides orientaux dont il a le secret, a essayé, par des injections répétées, d’arrêter cette extraordinaire décomposition… À l’heure où nous écrivons ces lignes, les six Vénusiens venus sur notre planète ne sont plus, tous ensemble, qu’un petit amas de pourriture…
« Passons maintenant à la machine.
« Nous devons nous borner à en donner la description sans chercher à en expliquer les dispositions et le mécanisme ; nos ingénieurs mécaniciens les plus savants, et notamment M. Louis Delaforge, directeur technique de l’École nationale de mécanique et d’électricité, l’ont examinée avec soin et ont avoué n’y rien comprendre.
« La machine vénusienne se compose de deux parties bien distinctes :
« La première est une énorme cuve cylindrique, assez semblable à nos cloches à gaz, de vingt mètres de hauteur sur dix mètres de diamètre, avec vingt centimètres d’épaisseur ; elle était entourée de montants et d’une armature extérieure en métal qui se sont complètement brisés et disloqués dans la chute ; cette cuve, les montants et l’armature, sont en platine pur ; c’est dire, au point de vue terrestre, leur immense valeur marchande, puisque le platine est pour nous un métal plus précieux que l’or.
« La seconde partie, enclose au centre de la cuve, où elle est soutenue par des arcs-boutants élastiques, en un métal rouge dont la composition nous est encore inconnue, consiste en une caisse de platine parfaitement carrée de cinq mètres de côté ; elle est trouée de cinq hublots à fermeture hermétique, sans vitres, et d’une porte cintrée à fermeture également hermétique, ce qui fait une ouverture pour chaque côté de la caisse. L’intérieur en est moelleusement capitonné d’un métal plus élastique que ne l’est le caoutchouc. Là, sont rangés, boulonnés aux parois, des instruments et des appareils dont seul Jonathan Bild pourra nous expliquer le fonctionnement. Un de ces appareils a été reconnu cependant comme étant destiné à produire l’oxygène et à absorber l’azote de l’air. Dans un coffre, on a découvert une provision de biscuits qui semblent être une viande concentrée – mais de quel animal, cette viande ? Voilà ce que Jonathan Bild seul encore pourra nous dire… Sans doute était-ce de ces biscuits que Bild se nourrissait, puisque nous savons que les Vénusiens vivent uniquement de l’absorption d’une sorte de gaz qu’ils fabriquent sur leur planète…
« Aujourd’hui, on commence la construction d’un hangar autour et au-dessus de la machine vénusienne. Elle n’est pas transportable ; les savants continueront l’examen sur place.
« Voilà tout ce que nous savons pour le moment.
« Notre édition du soir donnera de nouveaux détails. »
Et cet article était certifié exact par quatre signatures : Ahmed-bey, Arthur Brad, Brularion, Torpène.
Dans son édition du soir, l’Universel annonçait seulement que Jonathan Bild était réveillé, dispos, à peine courbaturé, et qu’il se trouvait dans la machine vénusienne, donnant des explications à MM. Ahmed-bey, Arthur Brad, Brularion, Torpène et Delaforge, qui, avec quelques autres savants, examinaient l’énorme appareil.
Et le journal concluait :
« Nous donnerons demain ces sensationnelles explications. »
Sensationnel, en effet, mais non pas comme l’attendait le public, fut l’Universel du lendemain.
En manchette de la première page s’étalaient ces lignes émouvantes :
EFFROYABLE CATASTROPHE
« Hier, à neuf heures quarante-cinq du soir, la machine vénusienne a sauté, se détruisant elle-même, émiettant le hangar qui la recouvrait et ravageant le bois de Verrières autour du carrefour de l’Obélisque. Trente-quatre soldats tués, vingt-deux blessés.
« MM. Ahmed-bey, Jonathan Bild, Arthur Brad, Torpène, Brularion et Delaforge ont été anéantis.
« La cause de la catastrophe reste un mystère…
« On l’attribue cependant aux gaz spéciaux dont les Vénusiens se nourrissent. Ces gaz étaient, paraît-il, emmagasinés dans des coffres sous une pression formidable.
« On ne peut savoir comment et par quoi a été provoquée l’explosion.
« À ce soir les détails. »
Mais les détails promis n’apprirent rien de nouveau. Seuls des voyageurs interplanétaires, Paul de Civrac, Lola et Francisco avaient échappé à la catastrophe. Heureusement pour eux, ils étaient restés, pendant cette première journée d’études, au laboratoire de Gravelle. Ils ne devaient se rendre à la machine que le lendemain.
On ne put retrouver les corps des victimes, célèbres ou inconnues. Les lambeaux informes et sanglants de chair et de membres humains que l’on ramassa dans toute l’étendue du bois n’étaient pas identifiables. On porta morts tous les disparus.
Et c’était pour la science humaine une irréparable perte. Toutes les questions irritantes que le monde se posait au sujet des choses et des faits devaient rester sans réponse.
Sur la Roue Fulgurante elle-même et sa disparition supposée au-dessus de Vénus, on ne savait rien, Brad n’ayant jamais voulu parler avant que Bild lui-même l’y autorisât. Tous les beaux projets de communication, interplanétaire furent abandonnés. En effet, au moyen du radiotéléphonographe de Gravelle, Paul essaya d’envoyer des messages à Vénus. Mais il n’en reçut pas, soit que les situations astronomiques des deux astres fussent défavorables, soit qu’aucun des savants vénusiens de la mystérieuse planète ne connût les formes humaines de l’expression de la pensée. Bild n’était plus dans Vénus pour écouter et pour répondre, ni les six savants vénusiens qui avaient travaillé avec lui au radiotéléphonographe.
Et après plusieurs mois de discussions dans les sociétés savantes et dans les journaux, le silence se fit peu à peu sur l’extraordinaire aventure dont la Roue Fulgurante fut le point de départ et Ahmed-bey le héros le plus extraordinaire.
Le mystère, un mystère impénétrable, enveloppa toutes choses : la Roue Fulgurante, la désincarnation des âmes, la vie vénusienne. C’est à peine si l’on épilogua autour d’un livre où Paul de Civrac racontait ses aventures et celles de ses compagnons dans l’incompréhensible Roue Fulgurante et sur la planète Mercure.
Et, dans le laboratoire de Gravelle abandonné, le radiotéléphonographe se rouillait, inutile.
D’ailleurs, quelque temps après qu’eut paru le livre de Paul de Civrac, le monde fut détourné des préoccupations interplanétaires. Une effroyable guerre jeta les uns contre les autres les peuples de race blanche et les peuples de race jaune. Elle dura dix ans. La victoire ne parut définitive d’aucun côté, mais la géographie politique de la Terre en fut bouleversée… On vit s’établir les États-Unis d’Europe en face de la Confédération asiatique.
L’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud ne formeront qu’une seule nation, méfiante et rogue, entre l’Europe et l’Asie… Et tandis que l’Asie faisait peu à peu la conquête de l’Océanie, que l’Europe s’annexait l’Afrique, l’Amérique, immense et isolée, s’acharnait à augmenter sa puissance et sa richesse intérieures dans un égoïsme terrible dont elle devait mourir.
Paul de Civrac et Lola virent cette transformation de la Terre, mais sans y prendre part. Ils vivaient dans une île perdue de l’océan Indien, où s’étaient réfugiés les derniers sages de Bénarès et de Calcutta ; ils étaient uniquement occupés à rechercher, sur la bouche des brahmanes et dans les livres sacrés des temples, le secret de la désincarnation et de la réincarnation des âmes, qui s’était perdu avec Ahmed-bey.
Le capitaine José Mendès et Francisco étaient morts, à peu de temps l’un de l’autre, aussitôt après l’installation dans l’île de l’océan Indien.
Rien n’attachait plus Paul et Lola sur la terre. Indifférents aux agitations de leurs semblables, ils s’épuisaient à rechercher le merveilleux secret qui leur permettrait de retourner sur Mercure, d’aller sur Vénus, de voyager sans péril dans ce monde interplanétaire où ils souffrirent tant et dont, par une contradiction bien humaine, ils avaient maintenant la nostalgie. Peut-être en était-il ainsi parce que, hors de la Terre, ils avaient commencé de s’aimer…
Le prisonnier qui a aimé dans la prison oublie les horreurs de la captivité pour ne se rappeler que les félicités de l’amour.
Mais Paul et Lola moururent sans avoir trouvé le secret de la désincarnation des âmes ; du moins avaient-ils acquis, par leurs recherches, la sagesse des anciens brahmanes, qui enseignaient ce précepte et y conformaient leur existence matérielle :
La terre est pour l’homme un point de transition entre deux infinis.

