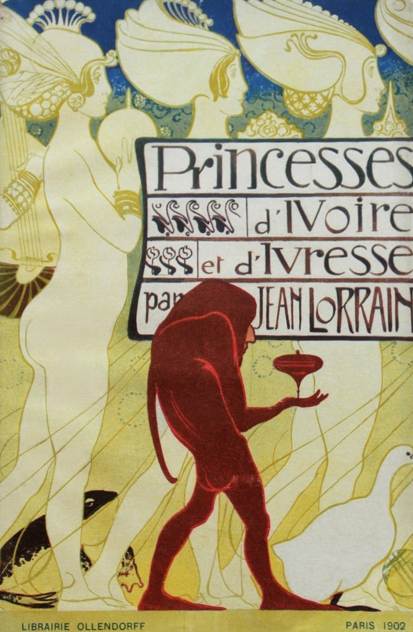
Jean Lorrain
PRINCESSES D’IVOIRE ET D’IVRESSE
1902
PRÉFACE DE L’AUTEUR
LES CONTES
Par les ciels mouillés de décembre, tandis que les passants enlaidis par le froid se hâtent et se heurtent à l’angle des trottoirs, et que la bise tourmente avec des férocités de chatte les guenilleux attardés au pavé dur des routes, combien il serait doux de pouvoir redescendre le passé, de pouvoir redevenir enfant et, blotti près des braises rougeoyantes, dans la tiédeur des chambres closes, quel repos et quelle fraîcheur ce serait aux pauvres yeux éraillés par la vie de se reprendre au charme des vieux livres d’images, des vieux livres d’étrennes illustrés de jadis, et de pouvoir croire encore aux contes !
Ces contes de fées, qu’on a remplacés aujourd’hui par des livres de voyages et de découvertes scientifiques, ces merveilleuses histoires qui parlaient au cœur à travers l’imagination et préparaient à la pitié par d’ingénieux motifs de compassion pour de chimériques princesses, dans quelle atmosphère de féerie et de rêve, dans quel ravissement de petite âme éblouie et frémissante ont-elles bercé les premières années de ma vie ! et comme je plains au fond de moi les enfants de cette génération, qui lisent du Jules Verne au lieu de Perrault, et du Flammarion au lieu d’Andersen ! Les pratiques familles de ces bambins-là ne savent pas quelle jeunesse elles préparent à tous ces futurs chevaucheurs de bicyclettes. Il n’est pas au monde émotion un peu délicate qui ne repose sur l’amour du merveilleux : l’âme d’un paysage est tout entière dans la mémoire, plus ou moins peuplée de souvenirs, du voyageur qui le traverse, et il n’y a ni montagnes, ni forêts, ni levers d’aube sur les glaciers, ni crépuscules sur les étangs pour qui ne désire et ne redoute à la fois voir surgir Orianne à la lisière du bois, Thiphaine au milieu des genêts et Mélusine à la fontaine.
Qui ignore Homère, Théocrite et Sophocle peut-il souhaiter vraiment visiter la Grèce et la Sicile ? Et pour aimer cette vaste coupe de saphir liquide, qu’est la Méditerranée, du délicat amour que lui portait Paul Arène, ne faut-il pas avoir entendu un peu plus que le chant des cigales autour des mâs dans les bois d’oliviers, un peu plus que les cris des marins provençaux dans les vergues ? C’est le souvenir de Parthénope qui fait la baie de Naples enivrante, et si la Méditerranée, chaque hiver, voit revenir dans ses stations tant d’indifférents et de sceptiques, c’est que l’azur transparent de ses vagues a jadis caressé et roulé dans son onde la nudité de nacre et d’algue des Sirènes.
Il faut donc aimer les contes et d’où qu’ils viennent, de Grèce ou de Norvège, de Souabe ou d’Espagne, de Bretagne ou d’Orient. Ce sont les amandiers en fleurs des jeunes imaginations ; le vent emporte les pétales, la vie dissémine le rêve, mais quelque chose est resté qui, malgré tout, portera fruit et ce fruit-là parfumera tout l’automne. Qui n’a pas cru enfant ne rêvera pas jeune homme ; il faut songer, au seuil même de la vie, à ourdir de belles tapisseries de songe pour orner notre gîte aux approches de l’hiver : et les beaux rêves même fanés font les somptueuses tapisseries de décembre.
Il faut donc aimer les contes, il faut s’en nourrir et s’en griser comme d’un vin peu dangereux et léger, mais dont la saveur âpre sous un faux goût de sucre insiste et persiste, et c’est cette saveur-là qui, le repas fini, enchante le palais et permet au convive écœuré de la table parfois d’y demeurer.
Pour moi, je l’avoue, je les ai adorés et d’une adoration presque sauvage, les contes aujourd’hui proscrits et dédaignés ; et c’étaient des contes brumeux, trempés de lune et de pluie, semés de flocons de neige, des contes du Nord, car je n’ai connu, moi, que très tard dans la vie l’enchantement ensoleillé du Midi.
C’est au bord de l’Océan remueur et glauque perpétuellement strié d’écume, dans une petite ville de la côte assiégée par le vent d’ouest que j’ai passé toute mon enfance. Dès novembre, ce n’étaient que grains et bourrasques et, durant les nuits, de lourds paquets de mer couraient le long des jetées avec de sinistres hou, hou, hou de chouettes géantes. Les contes que nous rapportaient des matelots barbus, gainés jusqu’à mi-cuisses dans des bottes ruisselantes, sentaient comme eux l’embrun, la neige fondue, le goudron et la mer ; il y était plus question de nuits que d’aurores et de naufrages au clair de lune que de gaies chevauchées dans les matins vermeils ; mais j’adorais leur mélancolie, où voletait, comme au ras des vagues, un merveilleux un peu naïf, fait d’espérance et de détresse, une poésie d’âme simple terrifiée par l’aveugle force des éléments, mais attendrie de nostalgie et malgré tout soutenue par la foi au retour.
Et puis ces contes hallucinants, dont les personnages galopaient toute la nuit dans mes rideaux, signalaient la rentrée des Terre-Neuviers dans le port, le retour des hommes au logis, et c’était toute une joie dans la ville. C’était le moment ou jamais des réunions du soir, des visites d’une maison à l’autre par les rues mal éclairées, la saison des veillées devant l’âtre autour des bolées de cidre chaud, du cidre nouveau qu’on buvait mêlé de cannelle tout en se gavant de marrons ; et ce qu’on y contait de belles histoires à ces veillées-là !
Chez nous, elles avaient lieu à la cuisine ; la cuisinière avait toujours un fils ou un mari à Terre-Neuve ; la femme de chambre, un frère, un cousin ou un soupirant pour le bon motif en Islande et, l’ouvrage fini, c’était un usage presque établi dans la bourgeoisie de la ville de faire une place au coin du feu aux parents des femmes de service, le premier mois de leur séjour à terre, et ce n’était guère en effet, car ils naviguaient neuf mois, les pauvres, et encore combien en restait-il là-bas !
Au salon on recevait le capitaine du navire, l’armateur associé, les directeurs d’assurances venus pour quelque sinistre, et pendant que les hommes causaient affaires, quelque jolie main serrée au poignet d’une gourmette d’or feuilletait indolemment les pages illustrées d’un album de contes, de contes de fées dont une douce voix de femme nous expliquait les images ; car nous approchions du jour de l’an et les cadeaux commençaient. Mais combien aux livres cartonnés et dorés sur tranches, combien à leurs belles estampes je préférais les récits ânonnés à la cuisine, au milieu des domestiques tremblantes, par des hommes en vareuse et en béret. Leurs histoires à eux me semblaient bien plus vraies, d’une fantaisie à la fois plus vivante et plus lointaine et, parmi ces récits de matelots, un surtout m’enchantait, un nostalgique et frissonnant conte du Nord que j’ai retrouvé depuis dans Andersen, mais qui, dans la bouche de ces rudes gens de Terre-Neuve, prenait la sauvage intensité d’une chose vécue et rencontrée, car ils l’avaient certainement croisée sur la mer inquiète, au cours de leurs périlleuses traversées, cette pâle Reine des Neiges dont le souvenir m’obsède et me captive encore.
Oh ! cette Reine des Neiges, debout dans la rougeur immense de son éternel palais vide ! Que je l’aimais et la redoutais à la fois, cette reine pétrifiée, comme léthargique, des abeilles blanches, cette vierge auguste des blêmissantes visions du pôle ! cette voyageuse immobile et planante des longues et claires nuits d’hiver ! la Reine des Neiges et son traîneau de brume spectrale.
Dans mon imagination terrifiée je la voyais passer impassible, très haut dans le ciel, au milieu d’un blanc tourbillon d’abeilles floconnantes ; d’énormes corbeaux noirs voletaient autour d’elle, criant la faim, criant l’hiver ; à ses épaules un grand manteau de rayons de lune flottait démesurément long dans la nuit, et par les fortes gelées, pour moi c’était encore elle qui venait, du bout de ses doigts raidis, dessiner sur les vitres les grandes fleurs fantasques et les arborescences du givre, et j’avais toujours peur, à minuit, de voir surgir aux carreaux de ma fenêtre ses yeux éteints et son front lumineux, car j’avais attentivement écouté la légende et je savais que, lorsque la Reine des Neiges vous regarde, son âme est ailleurs et ses yeux ne vous voient pas : elle est là-bas, là-bas, bien au-delà de l’océan Arctique, dans les banquises du pôle, là-bas, bien au-delà des détroits et des mers,
Dans l’éternel palais de neige
Où dorment les futurs hivers !
Et puis avec l’adolescence me vint la curiosité des princesses de contes, la curiosité et l’amour aussi, un amour pieux, un peu craintif, d’enfant de chœur pour la Madone, une espèce de dévotion adorante.
Ne ressemblaient-elles pas à la Vierge Mère du Christ et n’étaient-elles pas toutes un peu Madones avec leur blancheur immaculée et leur geste hiératique de cueilleuses de lys ?
Toutes de brocarts d’argent et de satins luisants bossués de perle, elles jaillissaient, pareilles à des floraisons étranges, sous des ciels d’orage ou de détresse ; des nuées s’y échevelaient en forme de guivres et de dragons d’or pâle au-dessus de clochers dentelés et de tours. Tantôt des troncs d’arbres millénaires, au fond des forêts enchantées, les faisaient plus lointaines que dans le clair-obscur brasillant des vitraux des cathédrales ; tantôt elles se dressaient au bord des mers, devant des horizons nostalgiques et d’une tristesse infinie, surgies, on eut dit, de l’écume et rivées au rocher comme des madrépores où des faces de songe auraient fleuri. D’autres, tels des oriflammes éployés dans le vent, tordaient des silhouettes tragiques au-dessus des charniers et des champs de bataille et toutes se ressemblaient.
Qu’elles fussent d’Asie, d’Égypte ou de Bohême, qu’elles fussent saintes bienheureuses en Courlande ou magiciennes au bord des fjords, elles s’évoquaient toutes les unes les autres comme la Vierge Noire de Notre-Dame d’Afrique impose au souvenir la Vierge de cristal de Notre-Dame des Neiges et je les aimais toutes d’une égale ferveur, dévot en elles à la Vierge du Merveilleux.
De tous les contes entendus, lus et feuilletés dans mon enfance sont nées ces princesses d’ivoire et d’ivresse : elles sont faites d’extase, de songe et de souvenirs. Il en est d’ensoleillées, plus précises et plus vivantes, princesses d’ambre et d’Italie ; il est même des princes dans le nombre, mais si délicats, si chimériques, si androgynes dans leur adolescence de jeunes dieux qu’ils en sont presque des princesses, princes de nacre et de caresse ; d’autres figures, plus mystérieuses celles-là, apparaissent enfin çà et là, sous le clair de lune et la neige floconnante, dans la magie glacée des nuits d’hiver… Captives dans des châsses de verre, telles des martyres bienheureuses, elles descendent à la dérive les eaux lentes des fleuves ou dorment sous les coraux blancs des forêts immobilisées par le gel : des gnomes vêtus de vert les gardent et ce sont les reines de givre et de sommeil, les albes princesses de l’Hiver.
Or, en feuilletant ces pages de regrets et de féerie, si le lecteur rencontre un ou deux contes qui se ressemblent, tel les Filles du vieux duc et la Légende des trois princesses ou la Princesse au sabbat et la Princesse aux miroirs, qu’il ne voie dans ces coïncidences que les reflets d’un même rêve à travers des atmosphères différentes, les échos d’un même thème musical interprété par des instruments de divers pays !
La fable est la même, les conteurs ont brodé !… la diversité des textes ne prouve qu’une fois de plus la beauté du symbole et la vieillesse du conte, la vieillesse, cette noblesse des récits.
Jean LORRAIN.
PRINCESSES D’IVOIRE ET D’IVRESSE
LA PRINCESSE AUX LYS ROUGES
C’était une austère et froide enfant de rois : seize ans à peine, des yeux gris d’aigle sous de hautains sourcils, et si blanche qu’on eût dit ses mains de cire et ses tempes de perles. On l’appelait Audovère.
Fille d’un vieux roi guerrier toujours occupé de lointaines conquêtes, quand il ne bataillait pas à la frontière, elle avait grandi dans un cloître, au milieu des tombeaux des rois de sa race, et sa première enfance avait été confiée à des nonnes : la princesse Audovère avait perdu sa mère à sa naissance.
Le cloître, où elle avait vécu les seize ans de sa vie, était situé dans l’ombre et le silence d’une séculaire forêt ; le roi seul en savait le chemin, et la princesse n’avait jamais vu d’autre face d’homme au monde que celle de son père.
C’était un lieu sévère, à l’abri des routes et des passages de bohémiens, et rien n’y pénétrait que la lumière du soleil, et encore n’y venait-elle qu’affaiblie à travers la voûte épaissie des feuillages des chênes.
À la vesprée, la princesse Audovère sortait parfois hors de l’enceinte du cloître et se promenait à pas lents, escortée de deux rangs de processionnantes nonnes. Elle était sérieuse et pensive, comme accablée sous le poids d’un fier secret, et si pâle qu’on eût dit qu’elle allait bientôt mourir.
Une longue robe de laine blanche à l’ourlet brodé de larges trèfles d’or traînait sur ses pas, et un cercle d’argent ciselé assujettissait sur ses tempes un léger voile de gaze bleue ou s’atténuait la nuance de ses cheveux. Audovère était blonde comme le pollen des lys et le vermeil un peu pâli des vieux vases d’autel.
Et c’était là sa vie. Calme et le cœur empli d’une espérante joie, comme une autre eût attendu un retour de fiancé, elle attendait au cloître le retour de son père ; et c’était son passe-temps et ses plus douces pensées que de songer aux batailles, aux périls des armées et aux princes massacrés dont triomphait le roi.
Autour d’elle, en avril, les hauts talus se fleurissaient de primevères, ils s’ensanglantaient d’argile et de feuilles mortes à l’automne ; et, toujours froide et pâle dans sa robe de laine blanche bordée de trèfles d’or, en avril comme en octobre, en juin ardent comme en novembre, la princesse Audovère passait, toujours silencieuse, au pied des chênes roux ou verts.
L’été, il lui arrivait parfois de tenir à la main de grands lys blancs poussés dans le jardin du cloître, et elle était si frêle et blanche elle-même qu’on eût dit qu’elle était leur sœur. En automne, c’étaient des digitales qu’elle tourmentait entre ses doigts, des digitales violacées cueillies dans l’orée des clairières ; et le rose malade de ses lèvres ressemblait à la pourpre vineuse des fleurs, et, chose étrange, elle n’effeuillait jamais les digitales, mais elle les baisait souvent, comme machinale, tandis que ses doigts semblaient prendre plaisir à déchiqueter les lys. Un sourire cruel entr’ouvrait alors sa bouche, et l’on eût dit qu’elle accomplissait quelque rite obscur correspondant à travers les espaces à quelque œuvre lointaine, et c’était en effet (les peuples l’ont su plus tard) une cérémonie d’ombre et de sang.
À chaque geste de la princesse vierge étaient liées la souffrance et la mort d’un homme. Le vieux roi le savait bien. Il détenait loin des yeux, dans ce cloître ignoré, cette virginité funeste et la princesse complice le savait bien aussi : d’où son sourire, quand elle baisait les digitales ou déchirait les lys entre ses beaux doigts lents.
Chaque lys effeuillé était un corps de prince ou de jeune guerrier frappé dans la bataille, chaque digitale baisée une blessure ouverte, une plaie élargie livrant passage au sang des cœurs ; et la princesse Audovère ne comptait plus ses lointaines victoires. Depuis quatre ans qu’elle connaissait le charme, elle allait prodiguant ses baisers aux vénéneuses fleurs rouges, massacrant impitoyablement les beaux lys de candeur, donnant la mort dans un baiser, prenant la vie dans une étreinte, funèbre aide de camp et mystérieux bourreau du roi son père. Chaque soir le chapelain du couvent, un vieux barnabite aveugle, recevait l’aveu de ses fautes et l’absolvait ; car les fautes des reines ne damnent que les peuples, et l’odeur des cadavres est un encens au pied du trône de Dieu.
Et la princesse Audovère n’avait ni remords ni tristesse. D’abord elle se savait pure par l’absolution, et puis les champs de bataille et les soirs de défaite, où râlent avec d’infâmes moignons, brandis vers le ciel rouge, des agonies de princes, de routiers et de gueux plaisent à l’orgueil des vierges : les vierges n’ont pas pour le sang l’horreur angoissée des mères – les mères toujours frissonnantes pour des fils bien-aimés – puis Audovère était surtout la fille de son père.
Un soir (comment avait-il pu gagner ce cloître ignoré ?), un misérable fugitif venait s’abattre avec un cri d’enfant à la porte du saint asile ; il était noir de sueur et de poussière et son pauvre corps troué saignait par sept plaies. Les nonnes le recueillirent et l’installèrent au frais, plus encore par terreur que par pitié, dans la crypte des tombeaux.
On déposa près de lui une cruche d’eau glacée pour qu’il y pût boire à sa soif, et un goupillon trempé d’eau bénite avec un crucifix pour l’aider à passer de vie à trépas ; car il hoquetait déjà, la poitrine étranglée d’un commencement d’angoisse. À neuf heures, au réfectoire, la supérieure fit réciter pour le blessé la prière des morts, les nonnes un peu émues regagnèrent leurs cellules et puis le couvent tomba dans le sommeil.
Audovère seule ne dormait pas, elle songeait au fugitif. Elle l’avait à peine entrevu traversant le jardin au bras des deux vieilles sœurs et une pensée l’obsédait : cet agonisant était certainement un ennemi de son père, quelque fuyard échappé au massacre, dernière épave échouée en ce couvent de quelque effroyable panique. La bataille avait dû se livrer dans les environs, plus près que ne le soupçonnaient les nonnes, et la forêt devait être à cette heure pleine d’autres fuyards, d’autres misérables saignant et geignant ; et toute une humanité souffrante et laide de sanie et de moignons envelopperait d’ici l’aube l’enceinte du cloître, où l’accueillerait l’indolente charité des sœurs.
On était alors en plein juillet et de longues plates-bandes de lys embaumaient le jardin ; la princesse Audovère y descendit.
Et, à travers les hautes tiges baignées de clair de lune et dressant dans la nuit comme d’humides fers de lance, la princesse Audovère s’avança et se mit lentement à effeuiller les fleurs.
Mais, ô mystère ! voici que s’exhalèrent des soupirs et des râles, que pleurèrent des plaintes. Les fleurs, sous ses doigts, avaient des résistances et des caresses de chair ; un moment quelque chose de chaud lui tomba sur les mains qu’elle prit pour des larmes, et l’odeur des lys écœurait, singulièrement changée, devenue fade et lourde, leurs coupes emplies d’un délétère encens.
Et, quoique défaillante, acharnée à sa tâche, Audovère poursuivait son œuvre meurtrière, décapitant sans pitié, effeuillant sans relâche calices et boutons ; mais plus elle en abattait, plus les fleurs renaissaient innombrables. C’était maintenant comme un champ de hautes fleurs rigides, dressées hostiles sous ses pas, une véritable armée de piques et de hallebardes épanouies sous la lune en quadruples pétales, et, cruellement lasse, mais prise d’un vertige, d’une rage de destruction, la princesse allait toujours, déchiquetant, meurtrissant, broyant tout devant elle, quand une étrange vision l’arrêta.
D’une gerbe de fleurs plus hautes, une transparence bleuâtre, un cadavre d’homme émergea. Les bras étendus en croix, les pieds crispés l’un sur l’autre, il étalait dans la nuit les plaies de son flanc gauche et de ses mains saignantes ; une couronne d’épines s’éclaboussait de boue et de sanie à l’entour de ses tempes, et la princesse effarée reconnut le misérable fugitif recueilli le soir même, le blessé agonisant de la crypte. Il souleva péniblement une paupière tuméfiée et d’une voix de reproche : « Pourquoi m’as-tu frappé ? Que t’avais-je fait ! » dit-il.
On retrouva le lendemain la princesse Audovère étendue, des lys entre ses mains et serrés sur son cœur, les yeux révulsés, morte. Elle gisait au travers d’une allée, à l’entrée du jardin, mais autour d’elle tous les lys étaient rouges. Ils ne refleurirent jamais blancs dans l’avenir. Ainsi mourut la princesse Audovère pour avoir respiré les lys nocturnes d’un cloître, en un jardin de juillet.
LA PRINCESSE DES CHEMINS
Dans la plus belle salle de son palais le Roi a conduit par la main la mendiante. Là, entre les hautes colonnes d’onyx et de porphyre, dont le poli s’enfonce et grandit dédoublé dans le luisant des dalles, il l’a fait monter sur l’estrade du trône qu’entoure une galerie d’or, une galerie telle la grille ajourée d’un chœur de cathédrale, et doucement, avec des yeux de prière, avec des gestes de pitié attendrie il l’y a fait asseoir. Et la mendiante a obéi. Résignée et muette dans son humble robe grise à trous, elle s’est laissée tomber sur les coussins du trône, a croisé l’un sur l’autre l’ivoire taché de sang de ses pauvres pieds nus ; et ses cheveux dénoués, du marron roux des châtaignes, encadrent de bandeaux un front si divinement calme et deux grands yeux si profondément purs que nul parmi les courtisans du Roi et les hauts dignitaires ne s’est étonné du choix de son seigneur.
Ô magique pouvoir d’une beauté ineffable, ô charme sûr et plus fort que l’ambition et que l’orgueil des grands, d’un pardonnant visage fait de souffrance et de douceur !
Elle n’avait eu qu’à paraître au tournant de la route ensoleillée et morne, les pieds nus dans la poussière et le vent des haies dans ses haillons, pour entrer comme un coup de couteau dans le cœur du roi. Elle était si triste et si lasse, debout dans la chaleur accablante du jour, avec derrière elle la monotone et jaune nappe des blés, si lasse et pourtant si courageuse aussi ; et dans son geste, qui demandait l’aumône, sa main tendue gardait une fierté.
Le Roi avait cru voir apparaître devant lui l’âme errante du peuple, la souffrance des humbles et des petits, mais l’âme du peuple demeurée haute, celle qui mendie et ne se vend pas ; et puis cette flamme bleue du regard vigilante et triste, le Roi ne l’avait jamais vue dans les yeux d’aucune femme, non en vérité dans aucun œil humain, pas plus sous les paupières fardées des prostituées que dans les prunelles de caresse et d’oubli des dames de sa cour ; et, le front bas devant la vagabonde, il avait pris sa main et, ébauchant le geste de poser la couronne sur ce front d’humiliée, il s’était écrié : « Celle-ci sera ma Reine, j’en donne ma parole au doux seigneur Éros », et tous les serviteurs, leudes et vassaux du trône, avaient baissé la tête, acquiesçant à ce choix, comprenant son amour.
Et maintenant, dans le silence de la haute salle fraîche, le Roi se tient assis en face de la mendiante. Il la regarde ardemment, immobile et comme en oraison. Il la regarde et l’humble pauvresse affaissée sur le trône, elle, regarde de ses larges yeux purs, d’une infinie tristesse, par la fenêtre ouverte, le ruban de la route en fuite entre les blés et les nuées légères d’un ciel blanc de chaleur.
Oh ! ces yeux de mélancolie qui déjà s’enfoncent dans le passé et regrettent !
Ces yeux, aveuglé par la joie et visionnaire d’amour, le Roi ne les voit pas. Assis, un genou ployé vis-à-vis l’estrade où rêve et s’alanguit la dame de ses désirs, il la boit avidement du regard, étouffe entre ses lèvres de tumultueuses paroles, balbutie, la gorge serrée et sans voix ; et sa couronne pend entre ses mains inertes qui le font plus pareil à quelque statue dans une armure d’acier niellé qu’à un être vivant.
Au-dessus de sa tête, symbole d’un fervent espoir, une branche verdoie à travers la clôture d’or ajouré du trône.
Et le roi guerrier regarde la pauvresse ; et la mendiante, accablée, déjà reine, regarde au loin, ailleurs…
Ô méprise éternelle, ô cruelle ironie des bienfaits d’Éros !
Accoudés au rebord de la galerie supérieure, tout en haut, dans les frises de la salle, deux pages musiciens chantent ; deux dangereux pages à la beauté enfantine et perverse, l’air de deux filles sous leurs lourdes chevelures en boucles ; et la haute salle s’emplit en sourdine de leur très tendre, très passionnée et très douce chanson.
Jeune aujourd’hui, vieille demain !
Lève les yeux et, dans ta main
Posant ton front, écoute et pleure !
Aime aujourd’hui, tôt viendra l’heure
Où ceux qui te disaient : toujours
N’auront plus pour toi de pensée.
La peau couleur de cendre, à ton tour délaissée,
Tu verras, talons nus, s’effarer les Amours.
Va, livre donc ta bouche à la bouche amoureuse
De ton amant ; la vie est creuse
Et l’amour seul l’emplit, qu’il soit blond, roux ou brun
Et tôt finit le désir de chacun.
Dans le verger, l’herbe est haute et fleurie.
Sous les pommiers laisse, puisqu’il t’en prie,
Ton doux seigneur s’étendre et pâmer près de toi.
Vois, son haleine brûle ; qu’un même et tendre émoi
Vous fasse palpiter cœur contre cœur ensemble !
Comme une fleur énorme, entre les arbres tremble
L’ardente lune ; et minuit opportun
A pour vous deux sonné l’heure des fièvres.
Va laisse mordre et becqueter tes lèvres,
Tôt est fané le désir de chacun.
Tôt viendra l’heure où, dans les herbes folles,
S’effeuilleront et les douces paroles,
Et les serments, et les tendres aveux,
Tels des boutons de rose en tes cheveux,
Près de ta rose oreille.
Tôt viendra l’heure où ta toison vermeille
Sur ton front blême apparaîtra de sel…
De sel amer, et, comme un vieil autel
Abandonné, tu fléchiras dans l’ombre,
Douce, en songeant aux caresses sans nombre
Dont te couvraient l’amant roux et le brun !
Tôt est fané le désir de chacun.
Tu compteras tous tes jours et tes heures,
Les mots qu’ils te disaient, leurs baisers et les leurres
Du Temps, aux noms vivants substituant des morts,
Et tu diras combien l’un était désirable,
Et l’autre aimant, et combien exorable
Et douce respirer la douce vie alors !…
Aussi, jusqu’à ce que l’Aube vienne et sépare
La nuit ardente et le jour enlacés,
D’étreinte et de sanglots, ah ! ne sois pas avare
Et ne compte plus tes baisers !
Aime-moi, serre-moi, prolonge mon délice
Jusqu’au jour, ouvre grands, tout grands tes yeux charmeurs,
Repose-toi plus près, appuie à ton front lisse
Mon front moite et dis-moi que tu meurs !
Oh ! mon sang se retire et tout mon cœur défaille ;
Je hennis en humant l’odeur de nos péchés,
Et de tués d’amour comme un soir de bataille,
Tous les chemins d’amour cette nuit sont jonchés !
Et, dans le silence, les douces voix s’appellent et se répondent l’une après l’autre, égrenant les périlleux conseils de leur ardente supplication d’amour.
Aime aujourd’hui, tôt viendra l’heure
Où ceux qui te disaient toujours
N’auront plus pour toi de pensée.
Morose et triste prophétie dont les regards extasiés du Roi proclament et répudient hautement le mensonge, mais dont paraît bien se soucier, en effet, la fille errante des grands chemins.
Assise sur le trône, elle ne voit pas plus le prince en adoration à ses pieds qu’elle n’entend la brûlante requête entremetteuse des deux pages penchés à la galerie des frises, au-dessus de sa tête.
Comme une hallucination la possède et, dressée dans une sorte d’extase, ses grands yeux de clarté fixant on ne sait quelle nostalgique vision, d’une main elle s’appuie aux coussins de soie violacée de l’estrade et de l’autre tient, serré sur sa poitrine, un bouquet de fleurs des champs. Deux campanules bleues gisent tombées sur les marches du trône, deux campanules du bleu de ses yeux de voyante, qu’emplit le bleu mystique d’on ne sait quel horizon.
Au fond, dans l’encadrement de la fenêtre ouverte, un chaud paysage de soleil et de récoltes apparaît tout gris de poussière, comme à travers les barreaux d’une geôle.
LA PRINCESSE AU SABBAT
La princesse Ilsée n’aimait que les miroirs et les fleurs. Ce n’étaient, dans tout le palais, que reflets de corolles et de pétales ; de larges nénuphars baignaient, jour et nuit, dans l’eau de grands vases d’albâtre et c’était, dans les hauts vestibules ornementés de marbre et de bronze vert, une éternelle veillée de calices et de feuilles rigides d’une humide pâleur. La princesse Ilsée n’avait jamais regardé ni les hommes ni les femmes ; elle se mirait dans les yeux de tous, comme dans une eau plus bleue et plus profonde et les prunelles de son peuple étaient pour elle autant de vivants et souriants miroirs.
La princesse Ilsée n’aimait qu’elle-même. Debout durant de longues heures devant l’étain figé des glaces, elle passait son temps à tresser de fils d’or et de perles la soie mouvante de sa chevelure ou bien à sertir d’anneaux et de bracelets la gracilité de ses bras nus, déjà sertie elle-même dans des robes de soie orfévrée et fleurie, dont elle commandait les dessins à des tisseurs éthiopiens, qui ne devaient jamais revoir leur pays.
La princesse Ilsée était nonchalante, indolente avec une grâce longuement apprise devant ses précieux miroirs. Toute sa somptueuse existence se passait à se baigner, à se parfumer, à se peigner, à se parer, à essayer des bijoux, des tuniques et des voiles, à se sourire à elle-même et à rêver la robe nouvelle, l’attitude imprévue ou l’étoffe inconnue qui la distinguerait de la foule et la ferait différente des autres femmes. C’était, en somme, une petite créature assez futile, férocement égoïste et follement éprise d’elle-même, mais elle portait à ravir les tuniques transparentes des îles Canaries, les colliers de coquillages de l’Extrême-Orient, et personne dans le royaume ne possédait une taille aussi souple : la princesse Ilsée n’aimait que les miroirs et les fleurs.
Un matin, qu’elle délassait ses membres délicats dans l’eau glacée des piscines, elle s’avisa de regarder plus curieusement que de coutume les deux monstres de bronze accroupis sur le bord du bassin et dont la gueule échancrée vomissait une perpétuelle fusée d’eau : elle ne les avait jamais remarqués. C’étaient deux grenouilles énormes, presque humaines de physionomie et d’un vert unique, d’un vert de bronze patiné par le temps avec de gros yeux cerclés d’or, deux yeux de verre allumés d’une lueur jaune ! La fantaisie d’un des ancêtres d’Ilsée en avait orné l’immense salle de bains, et, sculptés par un prestigieux artiste au nom maintenant oublié, les deux monstres immobiles semblaient vivre sur leurs degrés de marbre, mieux, ils y vivaient de l’intense vie chimérique des chefs-d’œuvre.
Et la princesse Ilsée s’éprit aussitôt de ces monstres. Sa beauté délicate s’affinait au voisinage de leur hideur et, d’instinct, elle résolut d’emplir les salles de son palais de monstrueuses grenouilles de métal et de faïence à l’image de celles des piscines.
Les princesses de légende et les reines de mythologie étaient toutes représentées, avec, auprès d’elles, un animal fabuleux : Léda se renversait sous un cygne, Europe tordait sa nudité sur la croupe d’un taureau, une biche aux cornes d’or se cabrait sous la main de Diane, la reine Mellisinte était peinte conduisant en laisse un souple lévrier, la princesse Ariane allongeait son beau corps sur les reins d’un tigre, un paon rouait sa roue ocellée de saphirs derrière la reine Junon, Blancheflore trônait, les pieds nus posés sur un lion ; Blismode enlaçait dans ses bras une licorne, sainte Catherine foulait du talon une tarasque. Elle, la princesse Ilsée, aurait auprès d’elle une grenouille. Dame Vénus avait bien ses colombes et la vierge Pallas un hibou !
Une grenouille ! Sa frêle nudité, sertie de samit et d’orfroi, jaillirait plus fine encore auprès du monstre ; et tout le palais, des orfèvres et des sculpteurs ayant été mandés, s’emplit de fabuleux batraciens.
Ce fut un pullulement de grenouilles. Il y en eut dans toutes les salles, il y en eut de vertes comme des jeunes pousses, de bleues comme l’azur du ciel ; il y en eut de fer, il y en eut de cuivre, il y en eut même de terre vernissée, car des potiers reçurent des commandes, et tous les céramistes du royaume s’appliquèrent à cuisiner dans leurs fours tous les reflets de l’arc-en-ciel. Il y eut des grenouilles couleur de lune, d’autres comme couvertes de lentilles d’eau, d’autres enfin laiteuses comme des verres de Venise avec des ventres striés d’or. Le monstre de sa chambre était d’argent bruni avec des yeux d’émeraude et celui de son oratoire d’une matière inconnue, transparente comme du jade, avec des prunelles de turquoises ; et, auprès de chaque monstre immobile, la princesse Ilsée prenait des attitudes, s’alanguissait plus souple, sûre de sa beauté, pour ainsi dire, avivée et accrue par la laideur de la grenouille accroupie à ses côtés. D’invraisemblables robes, brodées sur fond vert de flèches d’eau, d’iris et d’anémones, la déshabillaient, la faisaient plus nue que la nudité même, et, couronnée d’herbes fluviales, elle se plaisait à demeurer ainsi devant l’eau morte des miroirs.
On eut dit une princesse enchantée et c’était son plaisir de le croire, car, plus amoureuse d’elle-même que ne le fut jadis Narcissus, elle s’imaginait un peu être la filleule des fées et sa délicate petite personne lui inspirait un respect infini.
Or les fées lui jouèrent un tour.
Une tiède journée de septembre, comme elle errait sous les ifs taillés de son parc, au bord d’une allée d’eau ornée de place en place de grenouilles de marbre (car elle aimait, au cours de ses longues promenades, accouder sa langueur au dos luisant des monstres), elle aperçut, surnageant à la surface du canal, de larges calices d’un bleu pâle comme elle n’en avait jamais vu : c’étaient des espèces de lotus d’un bleu d’émail avec des pistils de lumière. D’énormes feuilles en forme de cœur flottaient autour des merveilleux calices et la princesse Ilsée désira ces fleurs.
Elle descend précipitamment quelques marches et se penche pour les cueillir ; les calices bleuâtres sont trop loin, mais une barque est là qui dort à l’attache, la proue au milieu des floraisons d’azur. Ilsée n’hésite pas, elle entre dans le bateau, mais l’amarre d’elle-même se dénoue, les fleurs de rêve s’enfoncent, les feuilles disparaissent et la barque file à la dérive dans un paysage qu’Ilsée ne reconnaît plus. C’est un fleuve qui l’emporte à travers des campagnes, d’immenses plaines bordées de peupliers. Ilsée joint les mains et s’effare.
Comme elle est loin déjà de l’ancien parc aulique, déjà loin de la ville et du château des aïeux ! Vers quelle terre enchantée l’entraîne cette barque ? Ilsée, qui croit aux fées, commence à les craindre ; mais voici qu’apparaissent des îles. Des troncs de saules s’échevellent au milieu de plantes d’eau, un enfant grotesque est assis sur le bord. Coiffé d’une capuche écarlate, une longue baguette de coudrier à la main, l’enfant nain veille sur un troupeau coassant de grenouilles qui sautèle à ses pieds. « Paix, rainettes ! » chevrote la voix monotone du petit berger et la princesse Ilsée a peur de voir sa barque aborder dans l’île, car elle a reconnu, d’après la légende, l’enfant sorcier qui garde les crapauds ; mais l’île maudite est déjà loin, la barque file, file toujours plus rapide ; elle côtoie maintenant les oseraies d’une autre île où d’étranges faneuses fourragent à coups de fourche de pâles meules de foin. Ce sont de grandes femmes haillonneuses avec des faces hâves couronnées de mèches grises ; elles insultent Ilsée avec des rires muets et lancent rageusement vers le ciel le foin qui s’éparpille ; et voici que le ciel se couvre, des nuages hostiles en forme de flammèches zèbrent l’horizon et l’orage éclate. C’est une pluie torrentielle à la fois tiède et glacée, la merveilleuse robe orfévrée est perdue, la pluie redouble sur les épaules de la frissonnante princesse, l’île des faneuses est déjà loin.
Ilsée trempée d’eau s’est jetée à genoux au fond de la barque, la barque secouée, ballottée par les vagues grossies et crépitantes sous l’averse, et voici qu’une autre île se profile dans la brume, une île plantée de sombres châtaigniers. Une petite chaumière apparaît accroupie sous les branches. La barque aborde et voici qu’une petite vieille avenante sort de la chaumine, à la rencontre d’Ilsée. La pluie a cessé, et, trottinante sous un large chaperon orné de roses trémières, la bonne vieille accueille l’infortunée princesse ; elle brandit sa béquille et entraîne la belle dans son logis. Il est tout fleuri de tournesols et percé de petites fenêtres où des nains sont peints sur fond d’or, et Ilsée, que la vieille déshabille, sèche et essuie devant un grand feu, ne remarque ni son menton poilu, ni le pied bot qu’elle cache sous sa robe. La nuit tombe et la princesse, debout toute nue devant la cheminée, se sent oindre et frotter d’une étrange pommade ; elle pense défaillir à l’odeur, mais se ranime d’épouvante à l’aspect de son hôtesse à croupetons, elle aussi toute nue devant l’âtre et s’oignant, seins ridés, cuisses maigres et ventre flasque.
« Bouc en haut, bouc en haut ! » Des voix éclatent sur le toit, le foyer flambe, la bûche pète et deux manches à balai, descendus à grand bruit on ne sait d’où, par quel trou, s’ébrouent, hennissent et caracolent. « Bouc en haut, bouc en haut… Ah ! si je te tenais, Philippe… Escovette, escovette. » Et la princesse épantouflée et transie se sent enlever par les cheveux.
C’est, sous un ciel pluvieux qu’éclaire une lune verte, un vol éperdu de sorcières.
Jeunes et vieilles, maigres et grasses, laides et jolies, des nudités se cabrent, descendent en tourbillons, échevelées, hurlantes, et vont s’abattre là-bas sur la forêt ; des bêtes aussi volètent dans l’espace. Un hibou la frôle de ses ailes ; un singe à bec de poule virevolte autour de sa tête, un escarbot pétarade et fiente en passant. Au-dessous d’elle, dans les ravins, par les sentes des bois, c’est un acheminement de foule grouillante ; ce sont des boiteux, des bossus, des ventriloques et des malandrins ; on dirait la ruée de tout un pays à quelque pèlerinage, une levée en masse de saltimbanques et de jongleurs vers quelque effrayante kermesse : « Sabbat ! Sabbat ! » c’est le Sabbat. Tous les disgraciés de la nature sont là, houlant en file serrée par la campagne lunaire ; des stropiats pareils à des crapauds sautèlent par les chemins, des montreurs d’ours dansent dans les carrefours. La princesse Ilsée se sent mourir : un essaim de dindons ébouriffés l’enveloppe, une queue de rat l’effleure, un renard la flaire, une vipère ailée comme un coq la fouette, et, tenaillée par des griffes, baisée, mordue, léchée et chevauchée par mille bêtes invisibles, la princesse Ilsée s’éveille avec un grand cri.
Elle est dans sa chambre de stuc et de panneaux de verre. Ilsée saute échevelée de son lit, la grenouille d’argent bruni aux yeux d’émeraudes gît en morceaux sur le tapis, et, à peine remise d’une pareille alerte, la princesse Ilsée court à son miroir.
Horreur ! Cet affreux cauchemar la terrasse-t-il encore ? La haute glace reflète le lit en désordre et la chambre déserte et la princesse Ilsée ne s’y retrouve pas. Elle fuit la chambre maléficiée et court à travers le palais interroger tous les autres miroirs. Dans chaque pièce, la grenouille de métal, de faïence ou de terre cuite est en morceaux et chaque miroir interrogé ne répond plus.
La princesse Ilsée ne retrouva jamais son image ; elle l’avait laissée au Sabbat : les fées lui jouèrent ce tour pour la punir de son orgueil. Il faut se défier des fleurs qui flottent sur les eaux et des visages qui sourient dans les glaces.
La princesse Ilsée aimait trop les miroirs et les fleurs.
LES FILLES DU VIEUX DUC
Conte pour Liano.
Depuis l’aube les trois filles du gouverneur se tenaient à la large fenêtre qui dominait la campagne, et déjà le soleil, sombré dans un écroulement de nuages roses, avait disparu de l’horizon.
Dans la vaste chambre, tendue de tapisseries de soie, un groupe de suivantes tourmentait doucement les cordes de théorbes et de grands archiluths ; toute la cour octogone était remplie d’un vague et délicat murmure, mais les trois sœurs ne l’entendaient pas. Leurs regards comme leurs pensées étaient bien au-delà des remparts crénelés de la ville, bien au-delà des champs de seigle et des cultures maraîchères des villages voisins, regards et pensées fixés au loin, très loin, vers les montagnes bleues où s’était enfoncé, avec ses chariots à roues pleines, ses petits chevaux maigres à crinières tressées et ses bandes guenilleuses d’enfants grimaciers et voleurs, le dernier passage de bohémiens.
Depuis un mois qu’ils défilaient par groupes de vingt-cinq à cent compagnons, au pied de la ville bien gardée dans sa triple enceinte avec, entre chaque créneau, une éclosion de têtes curieuses de bourgeois, les trois jeunes duchesses, mieux gardées encore dans la haute citadelle que gouvernait leur père, avaient vu parader, soit à pied, soit à cheval, cambrant le torse et dressant haut la tête, plus d’un seigneur d’Égypte à noire toison crépue et à face de bronze illuminée de larges prunelles d’or. Depuis un mois, amusées par la grimace et les jongleries de ces gueux, elles avaient abandonné la grande fenêtre à balcon de leur parloir, qui donnait sur la place du Marché et faisait face à la cathédrale. Elles avaient adopté la double ogive de leur oratoire et y passaient désormais leurs beaux matins et leurs vesprées et leurs longs soirs, occupées à guetter sur la route, de l’autre côté des fossés d’eau croupie, les regards de métal et le sourire à dents blanches des jeunes bohémiens.
Et dans toute la ville les femmes, celles des artisans comme celles des bourgeois, avaient pour ces païens d’Égypte la curiosité des duchesses. Il en était ainsi tous les printemps, quand ces maudits chevaucheurs du Sabbat, dévalant on ne sait d’où, des marches de Bulgarie ou des provinces de Bohême, qui sait ? peut-être de plus loin encore, fondaient sur le pays, comme nuées de sauterelles, sur les pas, on eut dit, de leur aïeul Attila. Leurs étroites faces de Maures et leurs longs yeux obliques révolutionnaient les femelles ; elles quittaient toutes, qui le rouet et la quenouille, qui la buanderie, l’église ou le cellier pour aller s’entasser aux remparts, et là elles se poussaient du coude et riaient comme figues mûres à l’aspect des enfants nus de ces bandits. Heureux les maris quand elles ne s’aventuraient pas, devenues libres à la façon des gouges, jusqu’au beau milieu de leur camp, parmi les tentes et les chariots.
Eux, les mécréants, mettaient au pillage les manoirs et les fermes, lâchaient leurs chevaux paître en pleines récoltes, égorgeaient le pourceau dans l’étable et le coq au poulailler, jetaient des sorts aux femmes grosses qui, dans les neuf mois, accouchaient de chrétiens bruns comme des olives et velus à la façon des boucs ; vendaient aux garçons des philtres pour énamourer les filles et soutiraient aux femmes l’argent des maris. C’était, en échange de beaux écus sonnants, de grossiers bijoux d’argent martelé, anneaux pour nouer l’aiguillette, enchaîner la fidélité, et amulettes contre la fièvre dont crevaient inévitablement les patients : horoscopes équivoques tirés par des bouches de vieilles édentées au fond d’un chaudron empli d’on ne sait quel brouet puant, paquets d’herbes sèches et grands jeux de maître Alber manigancés au moyen de tarots et mille autres momeries qui fondaient comme en un creuset le bel et bon or des bourgeois, le monnayé comme l’orfévré, disparu tout à coup des bahuts et des cachettes, en un mois envolé, englouti dans la besace obscène de ces bandits pouilleux.
Et c’était ainsi depuis des années. Dès les premières pervenches aux talus, ils apparaissaient dans la campagne, à cheval, à pied, faméliques et fiers, un havresac à l’arçon de leurs selles, le chaudron, la fourchette de fer avec le plat d’étain, toute leur fortune enfin, sur l’échine pliée des femelles, les vieux avec les petits nus, comme des dieux impurs, entassés sur les chariots ; et toute cette tourbe chantait, dansait joyeuse sous la pluie, le vent et le soleil, raclant de la guzla avec d’allègres coups de talons qui les faisaient bondir et pirouetter, les belles filles surtout, comme autant d’étincelles.
Leurs stridents éclats de rire et leurs trépignements fous envoûtaient les carrefours. À la première étoile qui s’allumait au ciel, ils commençaient leur branle pour le continuer autour de grands feux bien avant dans la nuit, et les routes n’étaient plus sûres à cause de tous ces vagabonds cheminant par le pays.
Et ce printemps enfin, à la requête des échevins et des marchands, le duc-gouverneur avait interdit à tous la sortie hors des portes durant tout le passage de ces maudits païens et, tout ce beau mois d’avril, ils avaient défilé de l’autre côté des douves et campé sous les remparts, épiés du haut des chemins de ronde et des échauguettes des veilleurs par les yeux de convoitise des femmes de bourgeois et des filles d’artisans, toutes dans leur cœur dépitées et marries contre le duc et son édit.
Tout ce beau mois d’avril, où les épines sont fleuries et les chemins de campagne embaumés par la neige des pommiers, avec du soleil partout sur les flèches d’eau de l’étang comme dans les jeunes pousses des saules, il leur avait fallu garder le logis, demeurer assises au coin de l’âtre à tirer l’aiguille ou filer la laine au lieu de courir par les prés cueillir la primevère ; et la consternation était dans les maisons nobles de la ville haute comme dans les taudis des faubourgs. Elle était aussi dans le palais où les duchesses avaient coutume de faire mander, une fois durant leur passage, les plus fins musiciens des nomades et d’écouter, toute une journée, leur violoneries et leurs chansons ; mais le duc inflexible avait interdit l’entrée de la ville aux bohémiens, comme il avait défendu toute sortie de l’habitant vers leurs chariots et leurs tentes, et les jeunes duchesses en avaient conçu contre leur père un ressentiment, qui montait de jour en jour à mesure que les hordes d’Égypte s’espaçaient, plus rares, sur les routes ; car une rumeur s’était répandue, venue des campagnes environnantes, et circulait maintenant dans la ville que les bohémiens, mécontents de l’interdit, feraient désormais un grand tour lors de leur prochain passage, éviteraient dorénavant la cité aux portes closes et c’était la dernière fois qu’ils avaient fait halte à l’ombre des murailles et désormais on ne les verrait plus.
Il y avait déjà deux jours que le dernier chariot de la dernière tribu s’était enfoncé lentement dans l’or du crépuscule et le bleu du paysage avec des raclements endiablés de guitare et des gambades d’adolescents nus. Depuis c’était le silence troublé seulement par les pépiements d’un nid, le silence accablant des campagnes que réveillera seule la faulx des moissonneurs et c’était la route déserte serpentant et décroissant à travers les lieues avec la tache d’un passant rare, apparu comme une fourmi, et au loin, très loin, la veillée des montagnes, immuablement debout sur le ciel pâle et gardant l’horizon.
C’était le troisième soir et, depuis l’aube, les trois filles du gouverneur se tenaient à la fenêtre ouverte, qui donne sur les champs et dans la vaste chambre, tout à l’heure emplie du babil et des chansons en sourdine des suivantes, les archiluths et les théorbes s’étaient tus ; car le soleil, déjà depuis deux heures, avait sombré derrière les cimes violettes et la lune montante, enfin surgie d’un petit bois de cyprès, baignant de vif argent les blêmes tapisseries du gynécée ducal. Les trois sœurs y étaient demeurées seules, l’heure du repas ayant attiré les suivantes aux cuisines.
Et l’aînée des duchesses, qui s’appelait Bellangère et était très blanche, très grande et très sérieuse avec des cheveux châtains et de très beaux yeux noirs, se tourna lentement vers ses sœurs, Yvelaine la blonde et Mérilde la rousse et, sans leur dire un mot, un doigt sur la bouche, leur fit un signe mystérieux ; et toutes deux prises d’un tremblement pâlirent et se serrèrent contre elle. Un son de viole provocant et charmeur chantait gaiement dans la campagne, puis une voix, mais une voix de rêve tant elle était pure, attirante et triste, une voix de source, une voix de lune, une voix de fleur qui chanterait pleura, et les deux jeunes filles baissant la tête, dociles, suivirent leur sœur.
Elles descendirent dans la haute salle aux voûtes blasonnées où leur père soupait, enfoncé jusqu’au cou dedans une chaire massive, à la clarté de cires pendues à la muraille. Il soupait là, le museau de ses danois posé sur ses genoux, et des valets d’armes corsetés et coiffés de fer étaient rangés autour de lui, attendant ses ordres. Elles entrèrent, pareilles à trois fées, et la vieille salle obscure s’éclaira d’une aurore ; car elles étaient presque nues dans de longues robes bruissantes de soie alourdies de pierreries, et leurs chevelures, ointes de parfums, rousse chez Mérilde et blonde chez Yvelaine, luisaient comme des flammes hors des bordures de perles de béguins de brocart ; elles appuyèrent leur poitrine et leurs seins au dossier de la stalle, passèrent leurs bras nus autour du cou du duc et, serrées contre lui dans des poses suppliantes, avec des sourires, des câlineries de doigts, des mots de caresse emplirent son hanap d’un breuvage que la silencieuse Bellangère avait apporté. Elles y trempèrent en jouant leurs lèvres roses, puis avec mille baisers, Yvelaine à genoux devant son père, Mérilde à moitié assise sur le bras de la stalle, imposèrent au duc jusqu’à trois rasades, tandis que Bellangère, son amphore à la main, se tenait droite derrière lui.
Et quand le duc se fut assoupi, le hanap circula autour de la table. Les mains fines des duchesses l’offraient aux capitaines et aux soldats, et les yeux s’allumaient sous les rudes capulets de fer et les cicatrices s’avivaient au coin des tempes et sur les joues, rendant les visages pareils à des masques ; car les jeunes duchesses, les épaules jaillies hors de leur corsage, riaient des lèvres et des prunelles aux valets comme aux seigneurs, appuyaient leurs doigts blancs sur les bouches et, parmi les gestes hardis et des ébauches d’étreinte, avaient l’air, en vérité, de trois jeunes courtisanes. Au loin, dans la nuit limpide, la viole chantait, la voix pleurait toujours.
Et peu à peu tous les hommes d’armes de la suite du duc s’assoupirent : ils ronflaient, qui la tête sur la table, qui le buste écroulé dans un angle de mur et, dans le corps de garde, les sentinelles dormaient aussi, enivrés par le passage des trois duchesses, et dans toute la citadelle montait comme un râle ; un sommeil magique y tenait tous les hommes anéantis.
Au loin, très loin, par les clairières irisées, les sentiers lumineux et les claires broussailles de la forêt lunaire c’était les hennissements et le galop sonore de trois chevaux détalant, hop… sous bois, et c’était un fracas de hautes branches brisées, et dans un chuchotis effaré de jeunes feuilles, un gazouillis de nids réveillés au passage, des petits cris d’oiselets en émoi, mais une voix joyeuse, une voix qui n’était plus plaintive rassurait et les branches et les nids et les feuilles, et à cette voix-là répondaient dans la nuit, pareils à des trilles, les chansons et les rires de trois autres voix.
Et quand le petit jour se leva sur le château ducal, les suivantes s’arrêtèrent éperdues au seuil du gynécée : les trois duchesses avaient disparu. On trouva la poterne, qui donnait sur la campagne, grande ouverte avec la sentinelle encore debout auprès, le torse appuyé contre l’arceau, mais une dague au cœur. Elle avait été poignardée par une des trois jeunes filles, Bellangère, Yvelaine ou Mérilde ? une main inconnue avait, comme un défi, suspendu une guzla bohémienne et une branche de genêt au blason de la porte… Tous les hommes de la garnison, mis sur pied, eurent beau fouiller le pays, on ne retrouva jamais la trace des duchesses ; jamais plus, d’ailleurs, ne passa par la ville la bande de bohémiens.
Depuis l’aube naissante, les trois filles du duc se tenaient à la fenêtre.
LA PRINCESSE AUX MIROIRS
I
Dans la caverne, toute de fissures et d’excavations bleuâtres, c’étaient, ébauchées dans du vague, des choses terrifiantes et sans nom : des formes accroupies en rond autour d’une chaudière, des rougeoiements de braise, des rampements de monstres, des pestilences et des vapeurs. Des chapiteaux de colonnes et des figures sculptées apparaissaient, çà et là, dans le schiste des voûtes, car l’antre était une ancienne crypte. Il avait jadis abrité des momies royales. C’était moins un antre qu’un sépulcre et un effroi millénaire emplissait ces longues enfilades de galeries souterraines où flottaient encore des mânes de Pharaons.
Et la princesse Illys n’avait craint ni de troubler ce mystère, ni d’affronter les fantômes.
Pour arracher aux sorcières numides le secret ou le philtre qui devait garder impérissable son impérieuse et fragile beauté, elle n’avait pas hésité. Elle avait traversé le désert et, tout éblouie encore, sous ses longs voiles de gaze violette, du fauve éclat des sables, elle avait pénétré dans cette ombre et était descendue, frissonnante et charmée, dans le clair-obscur hallucinant de l’antre.
Elle avait osé cela, la frêle et nonchalante princesse d’Égypte, et ses joueuses de harpe et ses joueuses de flûte, tout son cortège bruissant de soieries, de joyaux et de musique de jeune reine d’Orient, les talons teints de henné des unes, les doigts agiles des autres et tous ces seins nus et toutes ces jeunes nuques et la nacre de tous ces torses et de tous ces genoux, et la pourpre de toutes ces bouches et tout le soleil et toute la parure et toute la gaieté de sa jeune cour somptueuse et futile, le brocart vert des robes d’eunuques et les flabellums de plumes d’ibis rose de ces huit suivantes, qui étaient huit princesses indoues à la gorge enserrée dans de fines mailles d’or, et le parfum des encensoirs et le cliquetis de leurs chaînettes et la molle retombée des traînes, qui jasent sur les degrés de marbre comme les jets d’eau dans les vasques, tout ce faste, toute cette splendeur et toute cette joie étaient descendus avec Illys dans les ténèbres de la caverne ; et, rayonnante et irradiée sous les enseignes et les hautes piques ornées de touffes de poil de ses gardes gaulois, Illys, casquée d’or et mitrée de perles, Illys, pareille à une idole sous les pendeloques de turquoise et d’opales ruisselant de ses tempes à la pointe de ses seins, Illys plus belle de n’être qu’entrevue, Illys au milieu du prosternement adorant des sorcières, Illys, debout au milieu de l’escalier où s’étageait sa cour, avait eu ce suprême orgueil et cette sublime joie de se sentir devenir déesse et de vivre une minute d’éternité dans le resplendissement de sa chair et dans la gloire de sa beauté, exaltée à tous les yeux par la Terreur et le Désir. Un lourd manteau ocellé de jaune et d’azur, topazes et saphirs, descendait sur ses pas de marche en marche, la faisait pareille à une Isis de jade au milieu de la roue d’un paon gigantesque.
Et toute à l’ivresse de son triomphe, Illys n’avait remarqué ni le ricanement des sorcières haillonneuses ni leurs prunelles luisantes. Sûre de sa puissance, elle avait tendu à leurs baisers le grand lotus de béryls et d’opales qui lui servait de sceptre, et puis, faisant avancer ses esclaves, elle leur avait offert le contenu de ses coffrets. En échange du philtre de l’éternelle beauté, oui ! et les sorcières avaient ri, leurs yeux avaient soudain flambé dans les ténèbres, ronds et vitreux comme des yeux d’orfraies. Avec des ricanements d’hyènes les sorcières avaient refusé. Ce qu’elle leur demandait là n’avait point de prix, et malgré les remontrances averties de son astrologue et malgré les prières chuchotées à l’oreille et les beaux bras nus jetés à ses épaules, implorants et frôleurs, de Mandosia, son esclave favorite, Illys, toute à sa chimère et à son désir, avait promis aux magiciennes ce que leurs bouches d’ombre lui avaient demandé : en échange de l’herbe qui conserve à jamais la jeunesse, une de ses nuits, oui ! Une de ses nuits de princesse vierge, passée au milieu d’elles en échange de la beauté éternelle.
« Viens nous rejoindre à minuit dans la chaîne libyque. Là, dans la pierraille et les lentisques, sur les hauts plateaux où l’aloès lui-même dépérit et se dessèche dans l’air rare et trop pur, tu cueilleras l’herbe magique qui garde inaltérable la jeunesse du visage et la beauté des formes. » Et devant des miroirs soudain surgis de l’ombre, Illys ravie d’orgueil, Illys palpitante de joie à l’aspect d’adorables visages de jeunesse et de gloire, masques irritants d’un avenir incorruptible et d’une puissance impérissable, Illys engluée par son désir et prise au piège, Illys princesse d’Égypte et chrétienne pourtant, mais un peu oublieuse d’avoir été baptisée, Illys, dernière fille issue de cent Pharaons épiques, avait promis aux sorcières numides de les rejoindre à minuit sur les hauts plateaux de la chaîne libyque ; et les sorcières avaient ri comme des hyènes et leurs prunelles avaient soudain flambé dans leurs faces de terre, vitreuses et vertes comme des prunelles d’orfraies.
II
« Et à votre entrée, princesse, ces fuites livides dans l’ombre et ce rampement à ventre lourd et flasque, on aurait dit, d’un colossal crapaud. – Des chimères tout cela, tu avais peur et la crainte engendre les fantômes. – Charmion et Œnoë l’ont vu comme moi. Il y avait des linceuls pendus dans un coin et des os de mort dans un vase de bronze. Ces magiciennes font là œuvre maudite ; n’allez pas à leur rendez-vous, princesse. – Et ma parole, j’ai promis, peureuse Mandosia, et parole royale n’est pas propos de petite esclave, j’irai. – Que les dieux alors nous protègent, car ces femmes avaient un air qui n’annonce rien de bon : elles sentaient la terre et le cadavre. – Bah ! ce sont des femmes du désert, elles ont la couleur du sable, je n’en ferai point ma cour. Mais vois comme les montagnes meurent dans le rose incendie des lointains ! le ciel est vert comme une turquoise. Ah ! pouvoir se parer des joyaux du couchant ! et ma beauté ne se couchera jamais quand j’aurai cueilli l’herbe sacrée. Chaque soir, à la mort du soleil, je pourrai exalter mon orgueil de cette sûre pensée : Nul désormais ne me verra vieillir. Mais congédie-moi ces danseuses ! Elles tourbillonnent comme du blé dans un crible et leurs robes flottantes ronflent comme autant d’abeilles : c’est énervant et puis cette petite Adysia est trop belle, les eunuques mêmes la regardent. Je la ferai crucifier quelque jour. »
Ainsi jasent à la nuit tombante la princesse Illys et sa petite esclave Mandosia. Les nudités des danseuses se sont disséminées dans l’ombre, dans l’ombre claire et bleuissante des nuits d’Égypte, le soir est léger comme une bouffée d’encens. Illys et son esclave causent à la terrasse du haut palais bâti par les Ptolémées, le palais aux murailles peintes de fresques vertes et décorées d’hiéroglyphes qui racontent les amours de Memnon et les gloires d’Osiris. Des sphinx rêvent accroupis dans l’entrecolonnement des piliers et des guirlandes de lotus relient entre eux chaque pilastre. Ils se fanent lentement et embaument la nuit ; lentement leurs pétales pleuvent sur les coussins où se déploie le corps divin d’Illys, et leur fraîcheur la fait frissonner sous ses voiles. Illys a dépouillé ses joyaux et, anxieuse, le coude à la rampe de granit, Illys attend l’heure où la lune se lèvera sur les monts de Libye et fera miroiter les sables. Illys alors quittera le palais, la ville, la banlieue et rejoindra les magiciennes.
Au pied de la terrasse, c’est le bruit de pas et d’armes heurtées de la première ronde de nuit. « Chut ! ne fais pas de bruit, petite Mandosia, tais-toi. Ne nous fais pas remarquer par ces hommes. Mon manteau est prêt, mes sandales ? Tu m’accompagneras jusqu’à la sortie des faubourgs… Comme la lune est lente à se lever ce soir. Cette nuit ne finira jamais. Chut ! tu peux parler, ils sont partis ; tu disais donc ? »
III
Sous la lune énorme et rouge la princesse Illys se hâte à travers les sables ; la nuit est étouffante et la solitude luit infiniment triste, blanche et triste comme une plaine de sel. Au loin, sur le ciel livide, les monts de Libye ont l’air d’une muraille de camphre et le paysage est d’une détresse sans bornes, d’une dévastation rare. Çà et là, une tige d’aloès se dresse comme un bras desséché et, çà et là, un bloc de rocher émerge du sable dont le profil informe inquiète et regarde ; et la princesse Illys regrette presque et sa folle équipée et sa visite aux magiciennes.
Mais voici que la lune s’éteint et avec elle le paysage. Le désert est maintenant couleur de cendre et, dans un ciel de bitume, c’est un masque plâtreux qui roule et pleure, comme à regret, une clarté terne et froide ; à l’horizon, les montagnes sont du gris funèbre des linceuls ; et voici que sous ses pas le sable se remue et se soulève, des êtres sans nom y pullulent : des crapauds, des nains ou de tout jeunes crocodiles. Non, le Nil est trop loin ! Cela grouille, cela rampe, cela chemine, cela parfois sautille et il y a des moignons de manchots, des béquilles de stropiats, des troncs de culs-de-jatte et même des pinces de crabes. Il y a des yeux ronds et fulgurants de pieuvres et des dos flasques et mous de reptiles, il y a des ventres plissés et jaunâtres, il y a des écailles de serpents et des becs cliquetant d’ibis, le désert est un marécage. Illys se sent tenaillée par des griffes, mordue par des mâchoires, léchée par des langues et baisée par des bouches et Illys veut fuir. Elle se hâte et s’enfonce dans la mollesse effroyable et mouvante d’une foule satanique et bestiale, elle tournoie sur elle-même et, instinctive, jette ses bras au cou d’un sphinx de jaspe vert qui se trouve tout à coup à cheminer à côté d’elle ; et le sphinx hennit et brusquement détale et s’enlève à travers les espaces, loin au-dessus de la foule grouillante et silencieuse, et la princesse s’évanouit.
Illys est revenue à elle. Elle marche maintenant, elle marche, c’est-à-dire qu’on l’entraîne à travers la pierraille d’un sentier de montagne, un raide chemin taillé à même le roc, où son pied trébuche. Illys est aveugle ; un bandeau meurtrit ses paupières, un bâillon emplit sa bouche et, rudement secoués par deux compagnons invisibles, Illys est conduite, inerte d’épouvante, vers elle ne sait quel lieu d’horreur ou de supplice, dans de l’inconnu et dans de la nuit. Et tout à coup des huées, des rires qui strident et qui menacent, des injures qui cinglent et des hourras de joie, la frénésie triomphante d’un soir d’émeute, les cris forcenés de tout un peuple en rut qui tient son roi captif ; et le bandeau lui est ôté des yeux, le bâillon de la bouche. Dans un cirque de roches fantasques, au-dessus de nuées accrochées aux flancs de la montagne, Illys reconnaît, sans les avoir jamais vus, les hauts plateaux de la chaîne libyque. Une foule innombrable l’entoure : haillonneuses, fourmillantes de serpents, coiffées, les unes, de chauves-souris posées comme des fleurs parmi leurs chevelures, les magiciennes sont là, hurlantes et menaçantes, les griffes tendues vers elle, les yeux pleins de phosphore : les magiciennes de Thessalie, les magiciennes de Thrace et les magiciennes d’Égypte, les sorcières libyques et les magiciennes du Nil. Il y en a même du pays gaulois, dont la nudité blanche a revêtu des peaux de bête ; il y en a de l’Inde, dont le corps gracile finit, comme celui des idoles, en bec de poule et en tête d’épervier : les unes aboient comme des chiens, les autres sanglotent comme des louves ; il y en a qui ont des trompes d’éléphant au milieu de leur visage et cette trompe s’enroule autour de leurs jambes et vient flairer, à la place de leur sexe, une étrange petite tête de mort. D’autres ont de longs bas noirs, qui montent jusqu’à mi-cuisses et font leur chair neigeuse sous la petite vipère rouge qui les mord au genou, celles-là ont sur le front de longues herbes de ténèbres et dans ces ténèbres d’énormes pavots écarlates et qu’on dirait vivants, tant ils sont mobiles et charnus ; et toute cette foule effrénée l’enveloppe, la saisit et l’entraîne à travers les roches et les précipices, les sommets et les vallées et Illys à moitié morte se sent flotter et voler avec elles, à travers l’espace, dans la nacre effrangée de vapeurs.
Au-dessus des forêts de palmiers et par des cimes blanches de neige, la triple et quadruple et sextuple ronde du sabbat l’emporte. Jeunes et vieilles, maigres et grasses, laides et jolies, mais toutes terrifiantes, des nudités se cabrent, descendent en trombe, remontent en jets, tourbillonnent, s’enlacent et forniquent ; des bêtes volètent aussi dans l’espace ; des hiboux frôlent Illys de leurs ailes, des singes la chatouillent, des boucs l’assaillent, une queue de rat l’effleure, des museaux la flairent, et tandis que la fouettent des vipères ailées comme des coqs, un nain à jambes grêles, à tête énorme, lui propose en ricanant sa main et une étrange fleur de tournesol ; à ses pieds, à des lieues sous elle, c’est, à travers l’échevèlement les nuées, le calme sommeil des villes au bord des fleuves et des forêts dans les ravins.
Et maintenant, ce n’est plus un nain qui est auprès d’Illys. Un monstrueux corbeau l’a prise sous son aile ; il est mitré comme un évêque et chapé comme un prêtre à l’autel ; il tient dans une patte un grimoire où il marmotte en croassant un horrible évangile. Une grenouille en surplis nage dans l’espace à leur suite, pâmée d’extase et les yeux blancs, et toute une escorte de moines éparpille ses frocs autour d’elle et ces moines sont des cigognes encapuchonnées, des cigognes qui psalmodient un psaume, démoniaques pénitents.
La princesse Illys se réveilla à l’aube dans la chambre haute du palais des Ptolémée, mais les miroirs ne lui montrèrent plus jamais le péché de sa beauté. Vainement chercha-t-elle ses yeux et son sourire. Illys ne retrouva jamais son image, elle l’avait laissée au sabbat. Les sorcières d’Égypte lui jouèrent ce tour pour la punir de son orgueil. Il faut se défier des magiciennes et des visages qui sourient dans les glaces.
PRINCES DE NACRE ET DE CARESSE
NARKISS
Conte pour mon ami Lalique.
I
Sur ma table, de la gueule ouverte d’un lourd poisson de grès des tiges et des calices s’élancent, des iris anglais comme touchés d’une lueur, des iris blancs d’un blanc d’azalée, transparents comme de la nacre, des iris blancs plus beaux que des orchidées, lumineux, violents et fantasques, et puis, pêle-mêle, dans un jaillissement de jet d’eau, des longs cornets d’arums et d’énormes effeuillements de pivoines blanches, des fleurs qui semblent de la chair et de la soie, avec, çà et là, les graminées de reines des prés et la tache jaune d’anthémis pareilles à des étoiles et, dans le clair-obscur de la haute pièce aux persiennes closes, les fleurs, que semble vomir la gueule du monstre, prennent dans leur immobilité une vie surnaturelle. Ce ne sont plus des fleurs, mais des objets d’art, des objets d’art animés et doués d’une singulière puissance occulte. Les iris ont l’air d’être découpés dans du jade et les gros boutons de pivoines, gonflés de lourds pétales, s’ouvrent en larges coupes comme des lotus blancs. En vérité, elles sont surnaturelles dans le silence du cabinet de travail, ces fleurs jaillissantes et figées dans leur splendeur de choses précieuses et blanches. Un mystère est en elles, le mystère des sèves et le mystère de l’eau, une étrange clarté s’émane aussi d’elles ; toute la haute pièce sombre s’éclaire de leurs corolles translucides ; ces fleurs !… Elles savent toutes les histoires des sources et des étangs, toutes les églogues des dessous de bois et toutes les idylles des prairies, mais elles connaissent aussi toutes les énigmes et tous les stupres des très anciennes religions, elles ont décoré l’autel de tant de dieux et grisé de leurs parfums les sanglots de tant d’agonies : corolles et symboles, depuis les longues théories des victimes au pied des bûchers de l’Inde védique jusqu’aux hécatombes de taureaux en Sicile, elles ont enguirlandé toutes les fêtes et tous les supplices, fleuri les cérémonies de l’Égypte isiaque et les vieux temples de l’Inde et les jeux du cirque de la Rome des Césars. Elles sont violentes, triomphantes et cruelles ; elles renaissent d’elles-mêmes et se nourrissent de sang ; par cela même, elles sont divines. Elles sont luxurieuses aussi ; toutes ont la forme d’un sexe, toutes, depuis les pivoines aux corolles béantes comme des bouches, jusqu’aux arums dont le long pistil d’or, rigide et dardé dans l’enroulement du calice, a l’obscénité phallique adorée des peuples d’Orient.
Et c’est un vieux conte d’Orient, une antique histoire d’Égypte qu’impose à mon souvenir la fastueuse et pâle apothéose des longs iris de jade, des rigides arums et des larges pivoines pareilles à des lotus, car ils devaient jaillir ainsi, dans un tumulte hostile de feuilles et de tiges, les liliums de neige, les iris nacrés et les monstrueux nymphéas de la légende de Narkiss, tous les sinistres et lumineux calices nourris du sang des sacrifices et, telles des fleurs-vampires, flottant sur l’eau croupie du Nil, au pied du vieux temple et du grand escalier où le jeune Pharaon, nudité rayonnante de gemmes, de corolles et d’ivoires orfévrés, venait au crépuscule promener ses pieds lents.
Narkiss ! oui, le Narcisse égyptien dont, cet hiver, un drogman arabe m’a narré la légende bien plus tragique et combien plus belle que l’aventure de l’éphèbe grec amoureux de son image et se mourant, indifférent au tendre appel des nymphes, penché sur l’eau d’une source, envoûté par lui-même et captif d’un miroir.
Narcisse, fils de Céphise et de Liriope, était si beau que toutes les nymphes l’aimaient, mais il n’en écouta pas une : Écho, ne pouvant le séduire, en sécha de douleur. Tirésias prédit aux parents de ce jeune homme qu’il vivrait tant qu’il ne se verrait pas. Revenant un jour de la chasse, il se regarda dans une fontaine et devint si épris de lui-même qu’il mourut de langueur et fut métamorphosé en fleur.
Ce Narcisse-là, c’est celui du dictionnaire de la Fable et des Métamorphoses d’Ovide, le frêle et blême adolescent dont tous les musées d’Allemagne et d’Italie et jusqu’à notre Luxembourg possèdent, sculptées ou peintes, l’attendrissante image et les grâces fragiles, faites de charme androgyne et de langueur poitrinaire.
Irritante énigme d’un être humain qui serait fleur, quel est l’artiste que ne tenterait point ce mystère ! et tous ont aimé la lividité de ce front lourd, ce front gonflé comme un calice sur ce cou grêle comme une tige et le poids de cette tête déjà épanouie et devenue végétale sur cette épaule exsangue et ce torse aminci en longue hampe de fleur.
Si mélancolique qu’il soit, le mythe n’en demeure pas moins gracieux dans sa tristesse éplorée, mais souriante. Le conte du Narkiss égyptien est autrement terrible. Narkiss, prince d’Égypte et fils et petit-fils d’innombrables Pharaons, était d’une beauté surhumaine ; le sang d’Isis était en lui comme dans ceux de sa race depuis de si longs siècles, mais, dernier descendant d’une fastueuse lignée, la divinité de la grande aïeule avait refleuri en lui avec une telle splendeur que sa mère avait, dit-on, adoré son berceau et des crimes avaient aussitôt entouré sa naissance. Ses nourrices jalouses s’étaient entr’égorgées, les animaux eux-mêmes étaient sensibles à sa beauté ; des lions rôdaient autour de la ville, venus des profondeurs des sables à la suite des caravanes, car des nomades campaient maintenant, nuit et jour, sous les murs de Memphis dans l’espérance de voir un sourire du petit roi ; plus loin, c’étaient des troupeaux de chacals et de hyènes par prudence arrêtés sur les hauteurs environnantes et guettant, attirés, eux aussi, par une présence merveilleuse et n’attendant qu’une occasion pour fondre sur la cité et forcer les portes. Des nuées d’ibis roses, depuis que l’enfant était là, s’étaient abattues sur les jardins des riches ; ils lissaient leurs plumes, de l’aube au soir, avec de longs claquements de bec, et les palmiers des villas semblaient baigner dans une aurore éternelle. On avait doublé les sentinelles aux murailles, établi quatre guetteurs sur chacune des tours et toujours, des sables du désert comme des lointaines campagnes, la foule des bêtes et la foule des hommes processionnaient vers Memphis ; des tentes occupaient toute la plaine et des longues embarcations tout le fleuve, et, la nuit, au clair de lune, les crocodiles du Nil rampaient hors de la vase et escaladaient les degrés des terrasses en pleurant. Leurs longues gueules voraces heurtaient le bronze des portes et leurs écailles bruissaient étrangement dans l’ombre, le long des parapets qu’avaient déserté les éléphants, car l’odeur des sauriens est si infâme qu’elle fait reculer même les grands fauves et une épouvante était dans tout le palais.
Dans la cité on se massacrait : des intrigues ensanglantaient les temples. Dehors c’était le siège et dans la rue l’émeute. La femme du Pharaon, orgueilleuse de ses entrailles, avait fait étrangler son mari et proclamer l’enfant roi : toutes les femmes et tout le peuple étaient pour elle contre le parti des prêtres et des anciens. Le Pharaon mort avait eu la jalousie de son fils et c’est pour sauver Narkiss que la mère avait risqué l’horrible meurtre. L’enfant vivait, et sa beauté hallucinante grandissait d’heure en heure au milieu des tumultes et des cris des factions, des menaces, des complots et des piques brandies des révoltes. Il devenait beau et fort parmi les horreurs d’un siège aggravé de la peste et de la famine amenées par les nomades et tant de foules diverses campés sous les remparts. Le ciel, au-dessus de la cité et à dix lieues au delà, était noir de vols d’oiseaux de proie ; les fauves seuls ne mouraient pas de faim et, la nuit, c’étaient les affreuses lamentations des sauriens rôdant sur les terrasses et, tout à coup, leurs rires sinistres quand ils happaient quelque esclave au passage, car les crocodiles ne se nourrissent pas de cadavres ; et c’était la première partie du récit du drogman.
C’est alors que les prêtres d’Isis se réclamant de la déesse s’étaient emparés de l’enfant néfaste. Ils l’avaient enlevé à la reine et, ayant dérobé sous un long voile noir la prestigieuse beauté de Narkiss, ils l’avaient mis parmi les leurs, puis, sous le prétexte d’une fête religieuse et d’un pèlerinage à l’un de leurs temples, ils emmenèrent un jour le Pharaon hors de Memphis, loin de la surveillance de ses gardes, et de là, d’étape en étape, conduisirent le petit-fils d’Isis dans une retraite sûre, un vieux sanctuaire autrefois consacré à Osiris et dont les ruines gigantesques, les ruines de trois temples, retournaient déjà depuis huit siècles à la nature, ensevelies sous les lianes, les prèles, les acanthes et les hauts papyrus d’un bras mort du Nil.
Au retour, ils racontèrent au peuple qu’Isis leur était apparue. La déesse avait rappelé le Pharaon enfant auprès d’elle, Narkiss leur serait rendu quand il aurait vingt ans ; la mère du roi, détrônée puisqu’elle n’avait plus de fils, entrait dans un collège de prêtresses et les usurpateurs gouvernaient en son nom ; ils gouverneraient plus tard sous celui de Narkiss.
Leur intérêt était de ménager sa vie, de l’élever à leur guise, loin du peuple et des conseils des grands, dans ces temples de solitude et, l’enfant une fois formé à leur image, devenu leur instrument et leur chose, de cette âme royale, enfin maniable et souple, de ce fils de déesse devenu un des leurs ils feraient le Pharaon de leur choix, ils replaceraient l’exilé sur le trône et continueraient de régner sur l’Égypte au nom du pieux et religieux Narkiss, le petit-fils d’Isis esclave de ses prêtres, et ainsi Isis gouvernerait Isis.
Et Narkiss grandit, libre parmi la nature, à l’ombre des vieux temples : des lieues et des lieues, des centaines de lieues de sable le séparaient maintenant de Memphis. Le sanctuaire d’Osiris s’élevait aux derniers confins du désert. Après le troisième temple c’était le bras mort du Nil et la région des marécages. Narkiss vivait là, sauvagement nu dans sa beauté resplendissante et pareil aux idoles ; il les frôlait au passage, le long des rampes et des terrasses restées debout. Elles lui ressemblaient étrangement, polies par les siècles, sveltes et droites comme lui dans leur immobilité lapidaire et fleurie de scarabées de turquoise incrustés dans le granit de leurs seins ; elles semblaient veiller sur Narkiss comme sur l’enfance d’un des leurs et Narkiss en effet n’était-il pas une petite idole !
Il avait d’Isis les larges yeux hallucinants, les immenses yeux aux prunelles de nuit où palpitent l’eau des sources et le feu des étoiles. D’Isis il avait la face étroite et longue, le menton accusé et la pâleur nacrée, la pâleur transparente et comme rayonnante qui dénonce aux initiés la Déesse sous ses voiles. La nuit, sous les hauts palmiers balancés par la brise, sa nudité éclairait les ténèbres, et les Anubis à tête d’épervier souriaient sur leur socle, quand au cliquetis de ses longs pendants d’oreille le petit Pharaon s’avançait, grave et lent. Narkiss était toujours scintillant de joyaux et fardé comme une femme. En cultivant sa terrible beauté les très vieux prêtres eunuques, commis à sa garde et chargés d’efféminer en lui un futur tyran, obéissaient moins à un ordre qu’à l’occulte puissance d’un don des dieux enivrant et fatal : Narkiss résumait en lui toute la beauté d’une race.
Mince et souple avec de droites épaules et une taille étroite, il s’effilait aux hanches pour s’épanouir au torse et portait aux aines le signe de la lyre ; il était la Grâce et la Force. Tressés de perles oblongues et d’algues bruissantes, trois pendentifs coulaient de sa ceinture, tous trois d’inégale longueur. À ce pagne mouvant, d’instinct, il ajoutait des brindilles de feuilles et des fleurs et, quand, ainsi vêtu de joyaux bougeurs et de pétales humides, il faisait halte au crépuscule sur une des plates-formes ruinées des temples pour respirer le vent et contempler les sables que la nuit faisait bleus comme la mer, toute l’oasis tressaillait des racines des vieux arbres et, pour ce front d’enfant, l’haleine des solitudes s’élevait plus vivace, devenue le vent du large, comme pour saluer un jeune dieu du désert.
II
Le jour, il sommeillait étendu sur des nattes dans les hautes salles dallées du premier sanctuaire : revêtues de mosaïques et décorées à hauteur d’homme de symboles et d’hiéroglyphes sur fond d’or, elles luisaient dans l’ombre, comme éclatantes d’un humide émail ; de lourds piliers trapus et peints de vermillon en soutenaient encore les coupoles, les plafonds ne s’étaient effondrés que par places et, par les fissures, des lianes et des traînées de feuilles avaient glissé. Çà et là, dans de la vie et de la lumière, des coulées de fleurs pendaient en stalactites molles où palpitaient des ailes et des couleurs, des rais de soleil tombaient obliques où tournoyaient des mouches bourdonnantes ; et Narkiss accoudé sur des piles de coussins, Narkiss, les cils mi-clos sous la caresse soyeuse des moustiquaires, regardait le soleil ruisseler dans les corolles, écoutait les mouches vibrer dans le silence en égrenant tantôt les grains d’un collier d’ambre, en écrasant tantôt le calice froid d’un lys contre sa peau moite de fard ; et c’étaient, par la chaleur torride des longs étés d’Égypte, les journées accablées, somnolentes et vides du petit Pharaon.
Elles se ressemblaient toutes, monotones, interminables, étouffantes et énervantes de trop de parfums et de torpeur ; ainsi l’avait voulu le collège d’Isis.
On le nourrissait de riz et d’herbes cuites, car on redoutait la chaleur de son sang. Narkiss ne savait déchiffrer aucun des rouleaux de papyrus consultés nuit et jour par les prêtres. Les paupières teintes d’antimoine et les dents frottées de souak, il vivait là dans une sublime ignorance de sa naissance et de son destin ; nuit et jour, l’œil vigilant de ses gardiens l’épiait, leur oreille était, nuit et jour, aux écoutes. Ils ne cultivaient que sa beauté, sa beauté et son inconscience, et, telle une idole repue, Narkiss se laissait adorer et servir par l’attentif et timide troupeau de vieux eunuques geôliers. Ils ne l’approchaient que rarement, émus malgré eux par sa beauté terrible ; le sang d’Isis était en lui, et, en obéissant au Grand Prêtre, ils se sentaient vaguement sacrilèges d’efféminer ainsi le petit-fils des dieux ; et, dans sa nudité cuirassée de pierreries, toute sa chair frissonnante au contact des gemmes froides, Narkiss s’alanguissait aux heures chaudes du jour dans le clair-obscur des hautes salles ruinées, instinctivement épris des lumineux échevèlements de fleurs coulant aux trous des voûtes, animalement attardé à d’intimes caresses de son corps appuyé contre les nattes fraîches, et c’était, privée de tout exercice, l’existence oisive et se dépravant peu à peu d’un jeune et précoce animal.
À ces heures-là, parfois des songes hantaient ses rêveries impubères, des images imprévues se dressaient devant lui, visions ressouvenues d’une hérédité céleste. Pour les retenir, Narkiss crispait les poings et fermait les paupières, le menton exhaussé et les lèvres tendues vers le mystère inconnu du baiser, et alors des sons de harpe, des appels de flûte résonnaient, voluptueusement tendres ; de délicats arpèges, promenés comme des caresses, prolongeaient son extase, précisaient ses visions, et Narkiss, exaspéré, s’éveillait dans un spasme… et chaque fois, à ces réveils, c’était dans quelque coin de la salle un effarement de robes de lin, comme une fuite à pas précipités de coupables, des résonances de harpes étouffées, toute une panique de musiciens surpris.
Les prêtres gardiens de l’enfant avaient épié encore une fois de plus, et les siestes de Narkiss l’exténuaient de plus en plus ; sa force se fanait dans l’accablement de ces journées brûlantes, et le jeune Pharaon ne trouvait un peu de fraîcheur et de calme qu’à la tombée du crépuscule, à l’heure où le désert bleuit aux approches de la nuit. Narkiss quittait alors le sanctuaire et, tout scintillant de fleurs et de joyaux, s’aventurait sur les terrasses. Il y rôdait encore la nuit. La nuit avait pour lui les fraîcheurs apaisantes, de maternelles caresses. Divine comme lui, la nuit aimait et consolait l’enfant ; le long des journées torrides et aveuglantes, Narkiss se sentait instinctivement captif dans ces hautes salles hantées de musiques et d’odeurs ; la nuit, il se sentait libre, redevenu lui-même et, la nuit, il aimait ces vieux temples qui lui pesaient, le jour, comme un pays d’exil… Ces temples !
Ils revêtaient une telle beauté sous l’enchantement du clair de lune, dans le bleuissement d’acier des nuits d’Égypte.
Une architecture inconnue surgissait de leurs ruines : les colonnades s’étaient relevées, les portiques se prolongeaient à l’infini sur les sables miroitants comme une mer de métal, des palmiers jaillissaient comme en bronze, chimériques ; et c’étaient à perte de vue, entre le désert et le Nil, des rangées de sphinx et d’Anubis à tête d’épervier démesurément agrandis ; des escaliers montaient, tournoyaient en spirales, menant on ne sait où, d’autres descendaient de terrasse en terrasse et des idoles aux yeux d’argent étaient debout sur chaque marche, sommeillantes et veillant ; des fleurs ressemblaient à des visages, il y avait des gestes immobiles dans la courbe des plantes et des parfums virides et plus vivaces ranimaient Narkiss au lieu de l’engourdir. Au ciel, une lune transparente comme un globe de jade roulait si mollement dans le silence que Narkiss à la regarder se sentait défaillir comme sous une caresse lente, une caresse plus profonde et plus large, une caresse immense qui coulait dans son être, telle une musique et tel un flot de miel.
La nuit aussi, la morne solitude du désert se peuplait ; les hyènes et les chacals, attirés par les déchets des sacrifices, venaient rôder au pied des ruines. Ils pénétraient à pas de velours jusqu’au pied des terrasses, et les taillis de l’oasis étaient pleins de sourds froissements ; puis la silhouette errante de Narkiss les amenait plus près des temples et, comme autant de topazes, leurs prunelles jaunes éclairaient la nuit. Narkiss les regardait sans crainte, fixement ; parfois, un tigre se hasardait ou même un lion, et toutes les ténèbres puaient le fauve, et Narkiss regardait le tigre comme le lion.
Il sentait qu’il attirait et fascinait les bêtes et un grand orgueil l’enivrait, une grande force aussi, la conscience de sa puissance de domination.
Puis après les fauves vinrent des femmes, de lentes et souples formes voilées avec des grands yeux sombres qui luisaient comme l’eau sous des gazes transparentes. D’abord isolées l’une après l’autre, puis en nombre, par groupes de cinq et six, puis tout un troupeau, elles vinrent se poser au bas de la terrasse et, immobiles sous la lune, le regardèrent longtemps ; des apparitions ou des nomades ? Narkiss, lui aussi, les contemplait longuement ; elles ressemblaient aux visions de ses journées somnolentes, il les aima tant qu’elles gardèrent leurs voiles, mais quand, avec de grands gestes, elles eurent, l’une après l’autre, écarté la draperie qui les faisait fantômes et montré le mystère épilé de leur ventre, Narkiss détourna la tête et, dédaigneux, ne les regarda plus.
Elles revinrent plusieurs soirs : pendant tout un mois, elles s’acharnèrent à reparaître. Les plaintes des hyènes et des femmes amoureuses emplirent l’oasis d’un gémissement aigu et puis, un soir, elles ne revinrent plus. Parfois, de loin en loin, une forme enveloppée rôdait pendant deux ou trois nuits et puis, lassée, s’évanouissait dans les sables. Narkiss, indifférent, préférait se mesurer de l’œil avec les bêtes ; ses yeux hallucinants attiraient les femmes et les lions. Isis se révélait et s’affirmait en lui.
Isis ! Narkiss ne s’était jamais vu. Si Narkiss avait pu contempler son image, il aurait vu le visage d’Isis et les prêtres, qui voulaient gouverner par Isis et ne voulaient plus être gouvernés par elle, redoutant l’heure où Narkiss se connaîtrait lui-même, retardaient de jour en jour le moment de la révélation. En apprenant sa beauté le Pharaon apprendrait sa force, son origine et sa puissance ; il fallait lui ôter toute énergie avant sa fatidique rencontre avec lui-même, il fallait faire une idole et non un roi du Pharaon. C’est dans ce but qu’on l’avait déjà enlevé à sa mère, soustrait au peuple et dérobé aux conseils des grands.
Les grands miroirs d’acier, qui restent nuit et jour suspendus aux colonnes des temples, miroirs sacrés où Osiris et Isis viennent mirer tour à tour leur gloire, Osiris le jour et Isis la nuit, avaient été soigneusement enlevés et descendus dans les cryptes. L’ambition des prêtres avait osé le sacrilège et, sous les portiques désormais veufs de l’auguste reflet des dieux, Narkiss avait pu vivre pendant quinze ans sans rencontrer son image ; il y aurait vu resplendir la beauté de son aïeule, qui l’eût instruit de son pouvoir.
On lui avait toujours également dérobé le spectacle des sacrifices, les sanglants holocaustes de taureaux dus au culte d’Osiris. On craignait pour les fils des dieux la vue du sang ; elle eût sûrement réveillé en lui les instincts de domination et de meurtre qui sont l’apanage des rois. À ces sacrifices que le Pharaon devait ignorer on affecta le troisième temple, le plus vieux de tous les sanctuaires, le plus délabré aussi, celui dont les assises baignaient dans le Nil, embourbées dans un marécage dont la vase déjà fétide s’englua désormais de charognes. C’est là qu’au milieu des ruines, entre vingt piliers écroulés et envahis d’une végétation sauvage, se célébrèrent désormais les cérémonies d’autel : c’est là qu’aux heures chaudes du jour, pendant les siestes savamment prolongées de l’enfant, le seul prêtre mâle de ce troupeau d’eunuques égorgeait le bélier, le taureau et parfois le captif promis à l’exigence d’Apis, et le bras mort du Nil était pourri de sang. Des aromates brûlaient, nuit et jour, aux quatre coins du temple pour en écarter les miasmes, une haie de nopals en défendait l’entrée ; la formidable odeur du charnier eût d’ailleurs suffi pour éloigner l’enfant et le seul ordre qu’il eût jamais reçu était de ne jamais dépasser le second temple.
Narkiss était du reste indifférent et fier, il avait l’orgueilleuse incuriosité des inconscients et des brutes. La haie des nopals lui apparaissait farouche et laide, un relent de pourriture émanait des ruines interdites, et Narkiss aimait le parfum des fleurs, l’odeur des fards et des essences, l’éclat des gemmes rutilantes et l’humidité froide des grands lotus charnus. Narkiss ignorait le regard de ses yeux et la couleur du sang.
Et m’ôtant de la bouche le bout d’ambre du narghilé, Ali, à demi agenouillé à mes pieds, se relevait avec un grand salut de l’écroulement de tapis et de coussins où nous fumions assis, lui contant, moi rêvant. – Assez fumé le kief pour aujourd’hui, sidi. Crépuscule, c’est l’heure où le désert est bleu, bleu comme dans l’histoire de Narkiss. Viens faire un tour dans l’oasis. Jamais Tripoli n’est plus beau que vu de l’oasis au soleil couchant. – Et c’est tout ton récit, il ne finit pas, ton conte ! – Je te dirai plus tard. Tu es tout pâle, tu as trop fumé le kief. Il faut prendre l’air ; les chevaux sont sellés, Kadour est venu à la porte, il m’a fait signe. – Je sais. Je te dirai plus tard, ce soir, si tu veux, comment Narkiss mourut au bord du Nil, dans les ruines du troisième temple, au milieu des lotus et des lys aux tiges gonflées de sang. »
III
Une nuit qu’il errait à travers les ruines, de colonnade en colonnade et de terrasse en terrasse, Narkiss vint, sans même y songer, jusqu’à l’enceinte du troisième temple. La haie de nopals en dérobait aux yeux les assises et, sous les lourds entablements des portiques, les hauts piliers de marbre vert, soudain jaillis devant lui sans base apparente, semblaient une architecture de rêve, un enchantement du clair de lune, un mirage des sables soudainement épanoui. Narkiss pénétra dans le temple. D’abord, il crut défaillir : une atmosphère pestilentielle y régnait, lourde d’odeurs de sang et de charogne, lourde de parfums de fleurs et de parfums d’aromates aussi ; des lotus effeuillés jonchaient les dalles et aussi les larges pétales rouges d’une fleur inconnue de Narkiss. Des trépieds de bronze s’échelonnaient autour d’une grande table d’onyx ; du nard, du benjoin et de la myrrhe s’y consumaient lentement et de longues spirales de fumée bleuâtre se déroulaient, comme des voiles, dans l’air chaud. Narkiss s’arrêta : la grande table d’onyx était rouge par places, rouge et humide comme si on y eût écrasé des monceaux des étranges fleurs de pourpre dont Narkiss avait aimé la pluie de pétales ; les parois en luisaient lisses et sombres, claires pourtant comme l’eau des gemmes de ses colliers, et, bien que lavé d’essences par les prêtres, tout l’autel exhalait dans cet air saturé d’aromates un relent spécial qui dilatait les narines de Narkiss. Une émotion neuve allumait ses prunelles, gonflait sa poitrine, étreignait son cœur ; il eût toujours voulu demeurer là sous la haute colonnade aérienne, tant elle s’effilait hardie dans les ténèbres bleuissantes, toujours là au milieu des vapeurs violacées des trépieds, dans ces parfums de meurtre, de lotus et d’encens. Il fit trois fois le tour de l’autel, posa ses mains sur la table humide et instinctivement y appuya sa tête ; ce fut comme une accalmie ; mais, deux trépieds s’étant éteints, la puanteur des marécages cingla tout à coup plus forte, la pestilence du Nil domina dans le temple et, suffoqué par l’haleine du fleuve, Narkiss se reprit brusquement.
Pour échapper à ces odeurs de vase et de pourriture il se hâta vers une issue ; de l’eau miroitait, lointaine, derrière une colonnade, et une fraîcheur venait aussi du même côté, comme exhalée par la floraison blanche de magnolias géants ; on eût dit une veillée de blancheurs dans la nuit et, sans le savoir, l’enfant descendit vers le Nil.
Vingt blocs de malachite, vingt marches descellées et lépreuses de mousse y conduisirent le Pharaon ; et là, entre une double rangée de sphinx accroupis sous de molles retombées de lianes, le petit-fils d’Isis, qui ne s’étonnait de rien, joignit les mains sur son collier d’émeraudes : effarement et joie, le petit-fils d’Isis fit halte, ouvrit la bouche et l’admiration étrangla son cri.
Dans un jaillissement éperdu de tiges, de feuilles et d’ombelles, c’étaient le rut, la fièvre de sève, le grouillement de vie, la fermentation de germe et la menace épanouie d’une végétation exaspérée, surchauffée, triomphante, gigantesque et hostile… des fleurs plus grosses que des régimes de dattes, des plantes plus hautes que des palmiers ; des végétaux translucides, comme gonflés d’une sève lumineuse, des transparences d’aigue-marine et de jade et des enroulements de serpents aboutissant à des fusées de corolles et de pétales, à des retombées de pluies d’étoiles ; des champs entiers de papyrus éclaboussés de morceaux d’astres, des calices inconnus de forme et de couleur, d’une rigidité de métal, d’autres ronds et blancs, boutons de merveilleux lotus pareils à des œufs d’autruche et nimbés de feuilles énormes ; et tout cela se tordait, se cambrait, s’échevelait, s’enlaçait, s’étouffait, se joignait pour se fuir, se fuyait pour se joindre, figé dans la netteté d’une découpure de bronze sur la pâle étendue de mornes marécages, apparus sous la lune comme un miroir d’argent.
Un vieux portique s’effritait à quelques pas de là, dédoublant dans l’eau morte sa silhouette ruinée et, avec lui, le séculaire escalier des sphinx se dédoublait aussi entre des papyrus et de larges nénuphars. Jaillis du charnier, tiges et calices avaient dans l’ombre d’étranges lueurs bleuâtres.
C’était là qu’après les sacrifices la négligence des hiérodules venait noyer sommairement les corps mutilés des victimes. On n’offrait à Osiris que la tête et le cœur des taureaux immolés, à Osiris que la virilité des béliers et des captifs ; charognes et cadavres étaient traînés de l’autel jusqu’au vieil escalier et, de là, submergés dans les boues du fleuve, et ses eaux putrides étaient grasses de sang. Les mouches et les moustiques y pullulaient au soleil, guettés par des crapauds et d’immondes lézards à tête de tortue ; la nuit, c’étaient sur le charnier des vols de chauves-souris et de pâles lampyres, et c’est à cette ignominie, à cette floraison de meurtre et de sanie qu’aboutissait la rêverie divine du petit Pharaon.
Le charnier ! Il n’en sentait plus l’haleine effroyable ; le charnier ! sa pourriture immonde, ses charognes d’animaux échouées au travers des marches, ses reptiles endormis à la surface des feuilles, ses serpents enroulés aux hautes tiges trop vertes, parmi la purulence des troncs d’arbre et parmi la phosphorescence des fleurs, l’enfant ne les voyait plus.
Les yeux hallucinés, les prunelles agrandies, les doigts des mains écartés et leurs paumes tendues droit devant lui, Narkiss, enivré, descendait vers l’eau. Autour de Narkiss la fragilité des iris, la féminité des lotus et l’obscénité des arums, phallus d’ambre dardés dans des cornets d’ivoire, éclairaient comme des flammes, tour à tour de jade, d’opale ou de béryl. Sous le reflet de la lune les lampyres semblaient des pierreries errantes par la nuit, des reptiles luisaient comme autant d’émaux sur les feuilles. Au loin, c’était le resplendissement métallique du Nil et, dans cette magie du clair-obscur, dans cet enchantement des ténèbres et de l’eau, de la corruption, et des fleurs et des feuilles, mystérieuse et mouvante tapisserie tissée par les sèves et la nuit, Narkiss ébloui, ne voyait qu’une fleur, une imprévue, une inconnue fleur de rêve, une longue et souple tige nacrée comme une perle, balancée d’un mouvement rythmique et dont le délicieux calice, modelé comme un visage, souriait à mesure qu’il descendait vers elle, et le fixait avec des yeux humains, à mesure qu’elle montait vers lui.
Étrange floraison du Nil, elle avait jailli à sa venue entre les feuilles du nélumbo et les tiges soyeuses des papyrus. Une fleur, n’était-ce pas plutôt quelque divinité des eaux ignorée à Memphis et régnant dans ces régions mal connues ? Un être humain n’aurait pu vivre ainsi dans l’eau, dans cette boue, captif des lianes et des roseaux… Quelque fille de roi peut-être, enchantée là par des démons, car elle était comme lui scintillante de pierreries… Des joyaux et des corolles bougeaient le long de ses cuisses pâles, des lueurs s’allumaient sur sa peau à l’entour de son cou et, comme lui, la créature apparue portait un diadème fait de trois cercles d’émail reliés entre eux par des petits lotus d’or et des scarabées de turquoise… Comme lui, elle avait le gras de l’épaule droite mordu par un serpent de métal dont la queue s’enroulait jusqu’à son poignet frêle, et sa main droite, comme la sienne, semblait ruisseler sous une gloire de bagues ! Mais plus limpides que toutes les gemmes de son front et de ses doigts, deux prunelles de vie, d’un bleu d’eau nocturne, s’irradiaient immenses entre ses paupières et, sans les avoir jamais vus, Narkiss reconnut les yeux hallucinants et fixes de la figure magique surgie à sa rencontre. Le Pharaon se prosterna sur les marches et le petit-fils d’Isis adora Isis.
Dans le fond bourbeux du charnier, la fleur à face humaine continuait de sourire.
Alors, Narkiss se releva et, les mains jointes, les yeux dardés vers l’hallucinante image, en extase, le Pharaon franchit la dernière marche de l’escalier des sphinx et pénétra dans le marais.
La carcasse d’un bœuf égorgé, qui pourrissait là sur une dalle, pressée une seconde sous son pied nu, suinta ; un filet de sang rose gicla sur la vase, un serpent dérangé dans son sommeil se déroula. À la surface de l’eau, c’étaient, inondées de lueurs bleues par les baisers de la grande déesse, la gloire nocturne des arums et la splendeur nacrée des nymphéas.
Le lendemain, aux premiers rais de l’aube, les prêtres d’Osiris trouvèrent le petit Pharaon mort, enlisé dans la boue, au milieu des cadavres et de l’immense pourriture amoncelée là depuis des siècles. Debout dans la vase, Narkiss avait été asphyxié par les exhalaisons putrides du marécage mais, enfoncé jusqu’au cou dans le cloaque, il dominait de la tête les floraisons sinistres écloses autour de lui en forme de couronne ; et, telle une fleur charmante, son visage exsangue et fardé, sa face adolescente au front diadémé d’émaux et de turquoises se dressait droite hors de la boue et sur ce front mort des papillons de nuit s’étaient posés, les ailes étendues, et dormaient.
Isis avait reconnu Isis, Isis avait rappelé à elle le sang d’Isis.
Ainsi mourut, par une claire nuit de juin, Narkiss, petit-fils de la grande déesse et prince du royaume d’Égypte.
HYLAS
Les contes que tu dis seraient-ils un mensonge,
Le charme survivrait de les avoir rêvés.
Il marchait depuis des heures sur la route poudreuse, ses pieds délicats s’écorchaient aux cailloux. Il avait fui le palais comme dans un songe ; dans sa précipitation à suivre la négresse qui lui en avait ouvert les portes, dans sa joie à descendre derrière elle les escaliers obscurs qui tournaient en spirale dans le cœur humide de la roche, il n’avait pas pris soin aux lourds bijoux qui meurtrissaient maintenant ses orteils. Tout à son allégresse d’être libre, il avait couru droit devant lui à travers la rase campagne, la silencieuse et morne campagne accablée de ses lourdes journées d’août et voilà que maintenant, dans la solitude ensoleillée de ces plaines, devant la monotone et grise somnolence de ces bois d’oliviers et de ces vastes champs de blé noir, une peur le prenait de la liberté.
D’abord, il avait couru en relevant sa robe d’hyacinthe, dont les lourdes franges d’or battaient sur ses mollets. Maintenant, le front pâle et les lèvres sèches, il se traînait plus qu’il ne marchait à travers la campagne. Les anneaux ciselés de ses chevilles bruissaient et, à chaque pas, s’enfonçaient dans sa chair ; la sueur coulait à larges gouttes sur ses joues et l’étoffe de sa tunique ample collait à ses épaules trempées, tandis que ses longs cheveux noirs, d’où avait chu le diadème, pendaient défrisés et souillés de poussière sur ses yeux, pour la première fois étonnés de souffrir.
Où allait-il ? Il n’en savait rien lui-même, n’étant jamais, depuis sa plus tendre enfance, sorti des hautes salles pavées de mosaïque et rafraîchies de jets d’eau parfumée du palais. Jamais, si ce n’est pour aller s’accouder, certains soirs, entre les dieux à tête d’épervier des terrasses et, de là, regarder longuement, sous la surveillance de deux eunuques noirs, le soleil se coucher derrière les montagnes de la Cyrénaïque.
C’était là qu’il avait entendu pour la première fois une voix merveilleuse s’élever dans son âme, un soir, au crépuscule, devant la mélancolique splendeur du soleil tombé à l’horizon. Le ciel était d’un vert bleuissant de turquoise et le soleil avait sombré depuis longtemps derrière la haute muraille violette des monts, que leurs crêtes illuminées brillaient encore dans l’ombre rose, du même rose que ses talons frottés de fard, et la voix avait parlé de pays inconnus et de forêts profondes, de sources froides dans le clair-obscur de grands bois hantés de rires et de voix ; et un désespoir avait pris l’enfant de vivre ainsi renfermé sous les voûtes peintes du château royal en même temps que l’envie folle de revoir la région lointaine, qu’il se souvenait maintenant avoir connue en d’autre temps, et depuis lors il avait pris plaisir à écouter la voix.
Des bois, des fraîcheurs vertes où des rayons, feuille à feuille, s’égrènent, de larges fleurs bleues, comme des messages exténués en apportaient parfois et dont les calices, arrosés nuit et jour, se fanaient lentement dans des vases, ces fleurs bleues se balançant en guirlandes autour d’énormes arbres en plein air, dans l’ombre chantante et parfumée de hauts roseaux jaseurs, dans le mystère de forêts hantées d’oiseaux et de formes fuyantes… et les visions évoquées grandissaient despotiques, s’imposaient à l’enfant, revenaient obsédantes à chaque crépuscule, à l’heure où, sortant des étuves, il venait s’accouder devant la rase campagne, dans l’entrecolonnement de porphyre et de jaspe des portiques sacrés, dressant sur les terrasses leurs pilastres de bronze hérissés de palmes d’or.
Si bien qu’il avait fui, saisissant avec joie la première occasion offerte et, quand la négresse, un doigt noir posé sur le sourire en émail blanc de sa bouche, s’était introduite dans la salle basse où il sommeillait et que d’un geste muet elle lui avait indiqué les plaines sablonneuses et les hautes montagnes poudroyant au loin, au fond de la grande baie fermée d’un treillage de métal, il n’avait eu aucun mouvement de stupeur ni de crainte et, comme tous les intuitifs, rassuré par ce geste qui lui montrait et le pays rêvé et la fuite, il s’était levé en silence et, le sourire aux lèvres, il avait suivi, confiant, à travers les souterrains et les cryptes, la bonne messagère de liberté.
Où était-il, maintenant ? Il avait beau se retourner en arrière, la citadelle royale, où s’était écoulée son enfance, avait disparu, balayée, effacée de l’horizon comme les dessins en sable de couleur tracés, tous les matins, sur les dalles du palais par la main des esclaves. Effacées la citadelle et ses hautes murailles, où s’étageaient des temples ; effacée la roche abrupte aux parois lisses et luisantes, où s’accrochaient, pareilles à des chauves-souris gigantesques, les tours en brique rouge du palais et celle dite des Cygnes et celle dite d’Hercule et celle d’Astarté, où était située sa chambre : sa chambre lambrissée de briques roses et vertes, brillantes et vernissées comme des pierres précieuses, et dont la large baie treillagée de lances dominait le ravin.
Tout avait disparu, fondu comme de la cire à la chaleur intense sous l’éclat du ciel blanc ; les épis crépitaient sur les chaumes et, dans le silence assourdi des crécelles des cigales, l’enfant fuyait toujours dans la direction des montagnes, exténué, poudreux, les pieds saignants, l’air, dans sa robe violette constellée de joyaux et sous les bracelets pesants de ses bras nus, d’une petite idole échappée de son temple. La voix avait-elle donc menti, la voix qui promettait des jonchées de fleurs bleues et des tapis de mousse à l’ombre de grands arbres ? Et le désespoir du fugitif et sa terreur grandissante s’augmentaient, à chaque pas, du recul incessant des monts cyrénaïques fuyant, à chaque pas, devant lui.
Le ciel de blanc est devenu rouge ; un immense incendie embrase la crête des monts, l’air a fraîchi. Au pied de hauts roseaux soyeux et bruissants, longs panaches argentés où s’enroule le vert ruban des feuilles, l’enfant s’est étendu ; ses bras morts de fatigue reposent sur la mousse, et dans l’eau froide de la source trempent et saignent, jusqu’à la cheville, ses pieds enfin redevenus blancs ; de larges iris bleus, une lueur dans leur calice humide, palpitent comme des ailes à la brise du soir et tout un tourbillon d’éphémères vibre et ronfle, tel une poignée de froment dans un van. La voix n’a pas menti, l’enfant tient son rêve et l’ombre de la montagne l’enveloppe, maternelle, comme d’un manteau de fraîcheur.
De ses yeux étonnés et ravis Hylas admire, contemple et reconnaît le paysage entrevu, deviné dans ses songes, ivresse de jeune dieu retrouvant enfin l’Olympe après l’exil.
Et cependant, un regret lui tenaille le cœur et l’obsède, celui du vieux palais où, pareil à quelque fils de roi, quoique esclave, il a grandi, obscur, dans la tiédeur des odorantes étuves et la solitude fraîche des grandes salles pavées et tendues de nattes. Des jets d’eau y chantaient, jour et nuit, dans des vasques, et lui, abandonné aux soins d’eunuques et de maîtres baigneurs aux mains douces comme des mains de femmes, il passait les longues journées, demi-nu sous des voiles, les coudes aux coussins, à se teindre les paupières avec du kôhl et à parfumer son visage et ses bras : c’étaient des fards d’Égypte et des essences rares, entêtantes et subtiles, apportées à grands frais de la lointaine Asie dans des buires d’argent. Les soirs, un vieux mage à tête d’oiseau de proie venait s’asseoir auprès de lui et lui contait des histoires. Il n’était question que d’amours entre les hommes et les dieux ; des héros beaux comme l’aurore chevauchaient des dragons et traversaient les mers pour venir délivrer des nymphes aux yeux couleur de vagues, qui étaient aussi des princesses ; la foudre s’y déguisait en cygne pour séduire une reine ; la lune y descendait du ciel pour baiser sur les lèvres un berger endormi et des voix chantaient sous l’eau pour attirer et coucher dans la Mort un éphèbe au poil blond, qui s’appelait Hylas comme lui. Hylas aimait surtout cette dernière histoire. La voix qui l’avait appelé hors de la citadelle, dans la fraîcheur de ces lieux inconnus, voulait-elle l’ensevelir dans la source ? Mais la joie de l’enfant était telle de respirer à l’air libre, loin des hautes murailles où son enfance s’était alanguie prisonnière, qu’il en oubliait ses vagues terreurs et ne pouvait s’empêcher de sourire ; car il songeait en lui-même à ses leçons de musique et de danse esquivées pour le lendemain et pour les autres jours qui suivraient, car, tous les matins, après qu’on l’avait baigné, parfumé et coiffé comme une femme, deux Grecs, deux captifs, étaient introduits près de lui qui, sous l’œil inquiet d’un eunuque, lui apprenaient, l’un, à chanter des vers en touchant de la lyre, et l’autre, à danser en cadence en renversant son torse et en relevant sa robe comme une courtisane.
Et l’enfant avait horreur de ces leçons.
Quelle étrange vie était la sienne dans cette prison somptueuse et morne et pour quelle destinée l’élevait-on ainsi ? Parfois, une ou deux fois par mois au plus, des Noirs, les reins cerclés d’un pagne, pénétraient chez lui comme une trombe et, dans une bousculade, s’aplatissaient, le ventre contre terre, devant les pas d’un homme de très haute stature, dans la force de l’âge, qui marchait sur les corps humains étendus en vivant tapis. C’était un homme très beau, d’une étrange pâleur avec une barbe noire très frisée et luisante d’essences ; des colliers d’ambre, d’émeraudes et de jade s’entrechoquaient sur sa poitrine ; de longues pierres vertes tremblaient à ses oreilles comme des larmes et sous ses paupières brunes, frottées aussi de fard, son œil brillait très dur, plein d’un immense ennui. Dans ses cheveux noirs et calamistrés s’étageait une tiare et l’enfant avait peur de cet homme accablé de bijoux, qui le regardait longtemps sans mot dire, le caressait parfois d’un geste de sa main, toute pesante de bagues, appuyée sur sa nuque et puis se retirait silencieux, comme il était venu.
Les autres l’appelaient le Roi. Le Roi, et c’étaient dans leurs yeux des regards d’angoisse et dans leurs voix des tremblements de terreur ; le Roi, c’était le tout-puissant. Cet homme pouvait tout : voilà pourquoi Hylas avait fui !…
LA FIN D’UN JOUR
À la mémoire de Jean Lombard.
L’émeute triomphante avait traversé le palais et, sous les hautes coupoles désertes, éclairées par le jour jaune et bleu des vitraux, des flaques de sang rougeoyaient, çà et là, humides et luisantes, où des pas avaient glissé portant plus loin à travers les galeries des empreintes sanglantes.
Un grand silence pesait sur l’Hebdomon, un silence de mort coupé par de lointaines clameurs, les cris de joie de la fraction des Verts écrasant des Bleus dans quelque coin de la ville haute ou, qui sait, assiégeant peut-être le Patriarche dans Sainte-Sophie, vouée à l’exécration des Kaloyers.
Le palais, tout à l’heure encore envahi par une foule ignoble et bigarrée de marchands de poissons, de bateliers de la Corne d’Or, de portefaix, de cochers du cirque et, accourus là, mêlés aux orthodoxes rebelles, de Syriaques, de juifs vêtus de noir et jusqu’à des nomades chaussés de sandales reliées au mollet par des cordons de paille, le palais avait échappé au pillage. La fureur populaire allait droit au meurtre, au massacre et, sans s’attarder aux richesses entassées là depuis des siècles par les Justinien et les Théodose, courait à travers Byzance, avide d’exécutions, saoule de carnages, ivre de vieilles rancunes et de vengeances promptes.
C’était donc une enfilade de hautes salles solitaires, les unes languidement drapées d’étoffes au fleurage or et vert, les autres peintes de haut en bas d’icônes saintes, où un Jézous monumental, vêtu d’une tunique rose semée de croix de perles, bénissait d’un geste hiératique des paons et des agneaux et jusqu’à des licornes s’entremêlant dans d’étranges feuillages à des panthères bondissantes ; plus loin, c’étaient des Panaghias géantes dans la dalmatique ocellée de pierreries des impératrices byzantines, le front comme elles astré d’émeraudes et de rubis avec, derrière leur face rose à la fois pure et pleine, le resplendissement d’une auréole énorme ; et l’image sacrée grandissait jusqu’aux voûtes, sous le brasillement opalin des rosaces et, autour de la Vierge pure, d’innombrables têtes d’Anges et de Dominations s’entassaient foisonnantes, dans un arc-en-ciel d’ailes de toutes les nuances, mosaïques précieuses incrustées à même le ciment des murailles enduites d’un vernis d’or et, partout, dans les couloirs voûtés aux draperies tombantes à peine effleurées par des jours troubles de vitraux, comme dans les salles en demi-cintre aux coupoles plafonnées de peintures irradiant d’évangéliques figurations, c’était un entassement d’objets rares et précieux aux coruscations scintillantes, des lampadaires et des lampiers, des stalles incrustées de métaux, des évangéliaires historiés, nacre et ivoire, des châsses feuillagées dans de l’argent et dans de l’or, des coffrets de cuivre battu bossués de gemmes et d’admirables reliquaires. Tout cela étincelait vaguement dans le silence et le mystère d’interminables pièces tout à coup apparues dans l’embrasure des tapisseries, restées glissées sur leurs tringles d’argent ; et, dans le somptueux abandon de ce palais qu’une inconcevable panique avait fait vide en plein jour, çà et là, à l’angle d’un pilier de jaspe et de porphyre ou sous le retable de quelque icône sainte, une forme humaine se silhouettait renversée dans les plis d’une chlamyde, et c’était alors quelque spatuaire ou silentiaire égorgé là par les rebelles ou bien c’étaient les deux pieds raidis d’un eunuque tombé dans sa robe verte ; et, dans toute la longueur de l’Hebdomon, des cadavres s’échelonnaient ainsi de place en place, un ou deux par salle, aplatis, les gardes dans leurs cottes de fer imbriquées, les serviteurs enroulés dans un flot de draperies, tous avec à la nuque ou sous l’aisselle une rouge entaille par où stillait du sang ; et les rouges flaques humides et luisantes se multipliaient ainsi à l’infini sous les hautes coupoles et les mosaïques des plafonds. C’étaient avec la lueur d’un tronçon de glaive ou l’orbe lauré d’or d’un casque jonchant par intervalles le dallage des salles, c’étaient là les seules traces de l’effréné passage des Bleus à travers la demeure du basileus autocrator.
Dehors, sous le ciel implacablement pur des villes d’Orient, l’émeute avait tu ses huées. Des rumeurs s’éteignaient et, soulevant doucement les vélums de soie violette, une brise fraîche venue de la Corne d’Or circulait sous les portiques, pénétrait dans le palais, et, avec elle, un parfum entêtant de laurier-rose et d’héliotrope : les parfums du jardin impérial s’étageant en terrasses en face de la mer.
À ce moment une petite tête ronde et crépue, une face noire et camuse, largement éclairée par un sourire à dents blanches et comme trouée par deux grands yeux d’émail, se hasarda, hésitante, de dessous un monceau d’étoffes, un flot de soies orfévrées s’écrasant au travers d’un haut coffret de santal. La tête regarda prudemment autour d’elle, puis un torse maigre, patiné comme un vieux bronze, s’étira lentement, les paumes des mains à plat sur le carrelage, et l’enfant, s’étant mis debout, fouilla d’un bref regard la longue enfilade des salles.
C’était un petit esclave nègre d’origine chrobate, employé aux cuisines. Lors de l’invasion de l’Hebdomon par la populace et du massacre des serviteurs, il était, dans la panique, prestement grimpé des communs jusque dans les appartements de la haute domesticité et là s’était tapi, couché à plat ventre dans ce coin de salle crépusculaire, où la vertigineuse irruption de l’émeute l’avait épargné. Maintenant, svelte et nu, l’oreille aux aguets, prêt au moindre bruit à s’aplatir sur le pavage, l’enfant noir arpentait avec d’infinies précautions les hautes pièces silencieuses. Une curiosité de jeune animal lui faisait flairer et palper chaque cadavre, mais bientôt il ne s’y arrêta plus. Il les évita même, faisant un détour pour ne point se heurter à leurs chairs déjà froides et, quand par hasard leur rigidité barrait l’embrasure d’une porte, alors il joignait ses petits pieds nus et, prenant son élan, il sautait par-dessus.
Au loin, Byzance était toujours tranquille. Par un mystère inexpliqué, un silence de mort pesait sur la ville et l’enfant poursuivait à travers l’Hebdomon sa promenade solitaire, les yeux écarquillés aux splendeurs des Jézous et des Panaghias, déjà indifférent aux morts. Il arrivait ainsi à une porte trilobée fermée par une haute draperie plongeante, un épais brocart hyacinthe au fleurage d’or et d’argent mat, et l’ayant soulevée, l’enfant s’arrêta.
Cette fois, il y en avait trop.
Éclairée par les jours d’une haute coupole, une salle s’ouvrait en rond jusqu’à un fond en conque, décorée d’une magie de mosaïques ; des rosaces de malachite, d’onyx et de sardoine y alternaient avec d’immenses paons de pierreries incrustés dans le mur ; çà et là, de grands lys de cornaline s’érigeaient en faisceaux vers la voûte, et cinq degrés de jaspe s’arrondissaient au fond de la salle, devant un retrait en conque aux nervures recouvertes d’une épaisse couche de nacre. Au sommet des degrés régnait une étrange cathèdre, toute droite, aux accotoirs de bronze, au dossier en forme de tiare ; autour d’elle un écroulement de draperies écarlates et d’étoffes violâtres comme glacées d’argent, épinglées d’aigles d’or.
Et, du seuil de la porte jusqu’aux marches du trône, s’étalait cette fois une jonchée de cadavres ; la salle en était pleine. Ils étaient tombés si serrés, les uns contre les autres, que le pied d’un enfant n’aurait pas trouvé place pour s’y poser.
C’était d’abord, comme une moisson de roseaux, toute une rangée d’eunuques tombés là, la face contre terre, dans leurs longues robes de soie verte ; puis c’étaient les dalmatiques en tapisserie orgueilleusement nuancée, représentant des scènes bibliques, des hégoumènes et des archimandrites massacrés, et, çà et là, glissées des crânes, des toques pointues à plumes de héron et des calottes ourlées de perles, des coiffures d’oints sacrés et de grands dignitaires.
Ils étaient tous affalés, frappés par derrière, acculés contre le trône vers lequel se figeait leur fuite, et des grumelots de sang se caillaient sur le mou de leurs chairs, des chairs glaireuses et blettes de prélats châtrés et de gras affranchis, gros ventres débordants, larges croupes d’eunuque se renflant sous l’étoffe et qu’un coup de pied, en passant, eût crevées.
Pareils à des pastèques trop mûres, ces bedonnants cadavres s’entassaient et montaient jusqu’au fond de la salle, sur les marches du trône. Là, telle une floraison de gigantesques lys, s’épanouissait toute une hécatombe de candidats et de cubiculaires renversés, la poitrine en avant et la tête en arrière, dans un rigide enchevêtrement de hautes lances et de larges glaives d’or. Eux étaient tombés en combattant, en rangs serrés autour du trône, et leurs faces rudes rayées de moustaches fauves, leurs yeux grands ouverts sous l’orbe d’or du casque criaient encore plus haut que leurs cuirasses suintantes et rouges l’héroïsme de leur trépas. Au-dessus de toute cette chair égorgée et commençant déjà à sentir, dans l’étouffante obscurité de cette salle mystérieuse et muette, étincelant çà et là de vagues scintillements, la cathèdre du trône offrait ce spectacle de stupeur qu’elle était vide.
À ce moment, une énorme clameur s’élevait autour de l’Hebdomon, une atroce clameur de triomphe, comme partie de tous les quartiers de Byzance. Elle se prolongeait, répercutée par tous les échos réveillés des galeries, et l’enfant noir, s’étant instinctivement rué en dehors de la salle vers une des baies du portique extérieur, vit et comprit pourquoi la cathèdre du trône était vide sous la haute coupole remplie d’immobiles cadavres d’eunuques, d’hégoumènes, d’épiscopes sacrés et de soldats au mufle de lion.
Là-bas, tout là-bas, au pied de l’Hippodrome dressant sur le bleu de la Corne d’Or l’ovale de son promenoir ajouré de colonnes et peuplé de statues, une place s’ouvrait, fourmillante d’une foule hurlante et bigarrée, une foule incessante dévalant à chaque seconde des angles des rues et du quadrilatère des places et partout, sur les terrasses des maisons, sur le pourtour des coupoles d’églises jusque sur les neuf dômes de Sainte-Sophie, accroupie comme une colossale sentinelle au pied des murs du Grand Palais, des écharpes, des bras levés et des têtes innombrables ondulaient en apothéose dans l’ambre blond du crépuscule, et des milliers de cris aigus fusaient rythmés d’applaudissements.
Du bord des quais de la Corne d’Or, dressée comme une mer de lapis liquide sur le lumineux horizon, jusqu’aux terrasses des demeures voisines s’étageant en gros cubes grisâtres au pied des jardins de l’Hebdomon, hurlait et grouillait une ivresse de peuple, un emmêlement fou : hommes, femmes, enfants, hissés, poussés, montés jusqu’aux entablements des corniches au-dessus des têtes, des bannières et des croix pointaient désordonnément ; et tous ces yeux regardaient l’Hippodrome, et toutes ces mains acclamaient, tendues vers la place des Jeux. Un homme du peuple à face de tigre venait d’y escalader le piédestal de marbre de la statue équestre de Justinien. Les bras vernissés de sang jusqu’au-dessus des coudes, l’air d’un boucher, l’homme grimpait maintenant le long des brodequins écaillés d’or de l’empereur de bronze et, d’autres mains sanglantes lui ayant tendu d’en bas une coupe énorme où surnageait une étrange fleur, l’homme à profil de bête érigeait cette coupe toute droite dans le bleu du ciel et, avec un rire, l’offrait à Justinien.
Et la foule exhalait un grand cri et l’enfant noir se cramponnait à la soie des vélums pour ne pas trébucher.
Dans la coupe, ainsi offerte au fondateur de la dynastie Esclavonne, il avait reconnu, les yeux révulsés et tristes, la bouche dédaigneusement béante et tirée aux coins par une surhumaine douleur, la tête exsangue de l’Augusta.
Déchevelée et morne, elle semblait pleurer dans son sang, nimbée encore aux tempes des saphirs et des sardoines de l’impérial Sarikion.
LÉGENDES DES TROIS PRINCESSES
Conte pour Mlle Marguerite Moréno.
Elles avaient nom Tharsile, Argine et Blismode. Bien que toutes trois de mères différentes, elles se ressemblaient et se rappelaient l’une l’autre par l’étroitesse longue de leurs pieds, le délié presque inquiétant de leurs doigts et la transparence nacrée de leur peau, une peau comme infiltrée de pâle azur par le bleu de leurs veines : caractères propres à la race des vieux rois vikings, anciens païens aujourd’hui baptisés, dont elles étaient, épanouies, les dernières fleurs.
Mais Tharsile se distinguait par de longs yeux bleus presque noirs et de lourdes tresses brunes toujours ointes d’essences et son amour immodéré des parfums ; Argine, au contraire, avait l’œil gris et perçant d’un aigle sous de fins sourcils, comme tracés au pinceau ; ses cheveux d’un blond si pâle, qu’on l’eût crue coiffée d’une vieille orfèvrerie dédorée, étincelaient toujours de rubis et d’escarboucles ; elle marchait comme ployée sous le poids d’étranges et barbares joyaux, c’était là son caprice ; tandis que la dernière, Blismode, châtaine rousse aux larges prunelles violettes emperlées de rosée sous de battantes paupières aux longs cils, ne se plaisait qu’aux fleurs et parmi les cygnes au cou cerclé d’or des vieux parcs.
Tharsile aimait les somptueux brocarts et les draps de soie tissée d’argyrose et de perles, Argine les étoffes de pourpre, satins cramoisis, samits écarlates, et aussi les longues robes vertes, où semble miroiter le reflet trouble des vagues. Blismode au contraire n’apparaissait drapée que dans de souples et molles soieries blanches à peine ramagées de fines arabesques d’or ; et toutes trois, élevées sévèrement par un vieux roi guerrier et soupçonneux, n’avaient jamais quitté l’enceinte du palais, où, passives et hautaines, elles attendaient, chacune, le fiancé royal qu’avait choisi leur père, soit en chantant au lutrin de vieilles proses latines, soit en brodant, les longues soirées d’hiver, des hennins pour Madame la Vierge ou des nappes d’autel.
Durant les longs jours d’été, les trois princesses avaient coutume d’aller s’asseoir dans le verger de leur père et d’y dormir à l’ombre d’un grand pommier, de neige rose en avril et en août d’or vert. Le verger, situé à l’extrémité du parc, était entouré de grands murs, l’herbe en était brillante, des violettes et des jonquilles, et parmi les corolles, au murmure de l’air tout vibrant d’abeilles, Tharsile, Argine et Blismode dormaient.
Elles dormaient la tête posée entre les racines de l’arbre, et les lointains parterres, tout fleuris de lys jaunes, d’angéliques géantes et de roses trémières, leur envoyaient dans des sautes de brise des songes délicieux nés de l’âme des fleurs. Les gardes veillaient sur elles en dehors des murs, mais aucun d’eux ne connaissait le visage des princesses ; des pages aveugles les servaient et, hors ces faces murées, les trois filles du roi n’avaient jamais vu visage d’homme.
D’aucun, non, puisque la face usée du vieux jardinier du domaine royal leur était familière. C’était un pauvre être cassé et courbé par les ans, quasi tombé en enfance et que l’indifférence du roi supportait dans l’enclos sacré. Il logeait, à l’extrémité du verger, dans une misérable cabane adossée au mur et, non loin de sa logette, se dressait un très ancien puits à la margelle verdie, au petit toit d’ardoise ornementé de ferronnerie et dont l’eau étrangement froide et pure attirait souvent les trois princesses : elles se faisaient un jeu de manœuvrer elles-mêmes les seaux du vieux puits, d’en faire crier la poulie et les chaînes et, quand elles avaient longuement bu l’eau glacée, il leur arrivait parfois de rester longtemps après penchées sur le trou et d’en éveiller anxieusement l’écho ; puis elles s’envolaient avec un grand bruit de jupes derrière les troncs rugueux des pommiers et le vieillard, sorti à leurs cris de son humble logette, croyait avoir rêvé.
Une vesprée de juin plus chaude que les autres, il leur arriva de faire une singulière rencontre auprès de leur puits : un jeune homme inconnu, presque un enfant encore dans sa sveltesse juvénile, s’y tenait appuyé. Presque nu dans des haillons de toile qui le couvraient de la ceinture aux genoux, il éblouit à la fois Tharsile, Argine et Blismode du radieux éclat d’une triomphante beauté ; il était grand et élancé avec de larges épaules et de musculeux bras nus, il les tenait croisés sur sa poitrine et sa chemise de grosse toile bâillait, entr’ouverte sur un cou puissant. Un jeune athlète… sa chair mordue par le hâle était partout duveteuse et dorée. Il croisait nonchalamment, l’une sur l’autre, les plus belles jambes du monde et, fier comme un jeune animal, inclinait vers les trois princesses une petite tête embroussaillée, un délicat visage à lourde chevelure jaune, aux yeux pétris de malice et pourtant pénétrés d’une adorable langueur.
Les trois princesses cillèrent, interdites devant le regard profond de ses prunelles d’émeraude. Avec une intuition charmante il manœuvra le câble du puits, en remonta les seaux et leur offrit à boire ; puis, une voix l’ayant appelé de la cabane, il s’inclina, toujours sans un mot, sourit et disparut. Il laissait au bord de la margelle trois fleurs fraîchement coupées : un iris bleu, un pavot rouge et un asphodèle.
Tharsile prit l’iris, Argine le pavot et Blismode le thyrse violacé de l’asphodèle en fleur ; mais, la nuit suivante, chacune des princesses eut un rêve et, dans ce rêve identique et bizarrement le même, chacune se promenait dans un mystérieux jardin de lumière et rencontrait, légèrement appuyé sur la vasque d’airain d’une jaillissante fontaine, un inconnu d’une grâce divine et nu comme un Éros ; un Éros aux yeux bandés avec deux queues de paon ocellées aux épaules en guise d’ailes, qui leur souriait et leur offrait des fleurs.
Le lendemain, Blismode, Argine et Tharsile revinrent errer au verger paternel et, vers le soir, hasardèrent leurs pas du côté du vieux puits, mais elles n’y retrouvèrent pas l’inconnu. C’était un petit-neveu du vieux jardinier venu à pied du fin fond des campagnes pour s’enrôler dans la milice royale, et les soldats du roi étaient venus dès l’aube le prendre et l’avaient emmené avec eux ; et Tharsile, celle dont un iris bleu embaumait le corsage, tomba dans une mortelle langueur.
Comme elle dépérissait de jour en jour, le roi s’émut et, sur les conseils des mires, se décida à envoyer la princesse dans un pays de bois et de montagnes ; Argine et Blismode accompagnèrent leur sœur. Une vieille citadelle à demi démantelée, dominant trente lieues de forêts et cinquante lieues de montagnes neigeuses, devint leur palais d’exil ; un torrent grondait avec un bruit de forge sous les arches d’un pont jeté sur le ravin, et une bruyante sapinière frémissait, comme un orgue, à deux cents pieds au-dessous des créneaux où les belles rêveuses allaient s’accouder le soir. À l’horizon c’étaient les glaciers tour à tour bleuâtres et rouges, de braise ardente ou d’acier froid.
Et la brune Tharsile aux yeux d’un bleu languide pâlissait d’heure et heure et ne voulait pas guérir. Une nuit que l’insomnie la tourmentait encore davantage et qu’elle songeait, accoudée à sa fenêtre, le regard aux étoiles et le vide dans le cœur, elle tressaillit soudain à des bruits de chansons, de guzlas et de violes fredonnant, très loin, dans la forêt. C’était quelque musique de bohémiens en marche et, parmi toutes ces voix reprenant en chœur de vagues refrains, une entre autres l’attirait, délicieusement pure et triste, qu’elle n’avait jamais entendue et qu’elle reconnaissait pourtant. La voix s’était depuis longtemps éteinte qu’elle l’écoutait encore : le froid de l’aube la surprit attentive, penchée au-dessus des mélèzes du ravin.
Le lendemain, la princesse interrogea adroitement ses sœurs sur les musiques entendues. Argine et Blismode la regardèrent avec stupeur ; mais, à quelque temps de là, un hasard ayant appris aux princesses que le petit-neveu du jardinier, le joli éphèbe entrevu dans le parc, avait déserté l’armée du roi pour suivre des bohémiens, Tharsile ne douta plus un instant que la voix entendue n’était pas rêvée. Sa mélancolie devint plus profonde et puis, un matin, en pénétrant dans sa chambre, ses suivantes et ses sœurs ne la trouvèrent plus. Qu’était devenue la rêveuse malade ? Toute recherche fut inutile : elle s’était évanouie comme fumée.
Ainsi disparut Tharsile, la brune fille aînée du vieux roi.
Argine et Blismode eurent beau protester de leur innocence, elles ne purent jamais se disculper à ses yeux. Les deux princesses disgraciées furent envoyées dans un lointain couvent de la province, un cloître de clarisses situé à l’extrémité du royaume, sur les hauts plateaux des falaises qui bordent la mer. C’était un pays âpre et dur, tout en landes d’ajoncs et de bruyères, aux mornes étendues perpétuellement balayées par le vent d’ouest et dont les ciels gris et bas pesaient comme un couvercle : pays au soleil rare et comme hanté de spectres dans la brume et le vent.
Les deux princesses exilées n’y avaient pour toute distraction, entre tant de messes et de prières, que d’aller rôder escortées de processionnantes nonnes par les bruyères et les ajoncs ; parfois il leur arrivait de pousser jusqu’au bord de la falaise et d’y regarder, à trois cents pieds au-dessous d’elles, de misérables forçats occupés à extraire la marne et à creuser un pénible chenal dans le roc durci par la mer. Les hommes ainsi vus n’apparaissaient pas plus hauts que leurs petits doigts ; ils peinaient dans l’écume et l’embrun, le torse et les bras nus, et les deux princesses se souvenaient vaguement de la nudité du beau jeune homme rencontré dans le verger jadis, et il fallait presque les arracher à ce spectacle mélancolique.
Un jour d’été qu’elles étaient venues promener leur ennui au-dessus du chenal, grande fut leur surprise de n’y plus voir l’équipe des travailleurs ; mais à leur place, éparpillés parmi les roches, des groupes d’hommes aux membres durs et blancs, évidemment des barbares, séchaient leur nudité au soleil ; d’autres émergeaient, à demi engloutis dans les vagues, et sous l’effort de leur bras musculeux dressaient au-dessus du flot des torses éblouissants ; une rangée de vaisseaux s’immobilisait au large ; les pirates avaient jeté l’ancre et se livraient aux délices du bain.
Les nonnes effarées voulaient regagner le cloître en toute hâte, mais Argine et Blismode ne pouvaient détacher leurs yeux des beaux barbares nus, Argine surtout qui croyait reconnaître l’un d’entre eux, le plus svelte, le plus beau de tous sous sa longue crinière étalée au soleil, leur chef, évidemment. Le lendemain, quand la supérieure indignée pénétra dans la cellule d’Argine, elle n’y trouva plus la princesse. Comme Tharsile, Argine avait disparu.
Quant à Blismode, rappelée en toute hâte auprès du roi son père et enfermée dans la plus haute tour du château royal, d’étranges pressentiments l’agitaient. Un pirate hardi tenait, disait-on, la campagne et marchait à grandes journées sur la ville dont il allait établir le siège avec une horde innombrable de païens. Il emmenait, disait-on, dans ses chariots de guerre, deux princesses captives et heureuses de l’être, deux royales amoureuses qui, pour lui, avaient trahi leur patrie et leur race et dont on ne prononçait pas le nom ; mais Blismode avait pressenti que c’étaient là ses sœurs, comme elle avait deviné que le beau pirate à la rousse crinière était le divin adolescent blond au bouquet d’asphodèle, de pavot et d’iris.
En effet, les tentes du camp ennemi entourèrent bientôt les remparts de la ville et Blismode, étiolée et captive, passait maintenant ses journées au sommet de sa tour, appelant la défaite des siens et redoutant en même temps une victoire dont elle se savait le trophée ; mais le siège traîna en longueur. La ville, ravitaillée par des souterrains secrets, se riait de la famine et, un beau soir d’automne, par un crépuscule de turquoise, Blismode s’éteignit doucement entre les mains de ses femmes, ses yeux agrandis dardés sur le camp barbare, en pressant sur son cœur l’asphodèle séchée du beau pirate Amour, du barbare Ennemi.
CONTE DU BOHÉMIEN
Conte pour Aurel.
Aux approches d’avril, le bruit se répandit dans toute la contrée qu’un étrange chanteur, un invisible et mystérieux musicien, s’était établi dans la forêt des Ardennes. Il vivait là au plus épais des halliers avec les oiseaux et les bêtes des bois et c’était, depuis sa venue, parmi les ravins, les ronds-points des clairières et l’ombre verte des venelles, une effervescence, une floraison de muguets et de primevères, une frénésie de rut inassouvi et une telle joie de vivre qu’on entendait, de l’aube au soir, délirer les nids dans les branches et bramer toutes les nuits les cerfs au clair de lune.
Comme une mer montante de sève et de désir déferlait désormais dans la forêt feuillue, des râles exaspérés agonisaient dans l’air qui troublaient le pays.
C’étaient dans l’atmosphère lourde et chargée d’orage la guitare et la voix de l’étrange musicien. Sa chanson montait dans la fraîcheur des aubes mauves et roses et dans la tristesse enflammée des soirs, infiniment douce et pure, infiniment triste aussi tandis que trilles et pizzicati pétillaient, fusaient et s’égrenaient, étincelles et perles, sous les doigts du guitariste. L’accompagnement, tout de gaieté railleuse, méprisait et bafouait, la tendresse ardente de la voix implorait et pleurait et c’était une mélancolie de plus, cette raillerie de guitare babillarde sur cet appel passionné et poignant. Dans la forêt tout à coup envahie de surgissantes hampes d’asphodèles et de digitales, par les chemins devenus en quelques semaines impénétrables sous un jet imprévu de viornes et de lianes, c’était un débordement de vie, d’herbes folles, de fleurs épanouies au milieu d’un concert énamouré et fou d’éperdus rossignols : les trente lieues de forêt chantaient, riaient, aimaient, tout à coup enchantées ; la voix du musicien s’y lamentait toujours.
Et une fièvre tenait tout le pays. La nuit surtout, la voix de l’invisible chanteur prenait des sonorités inattendues, délicieuses, grisantes. On ne pouvait plus faire un pas dans les campagnes sans tomber sur des maltôtiers et des mauvais garçons couchés dans les sillons ou les fossés des routes ; ils venaient là par bandes autour de la forêt et veillaient jusqu’à l’aube, attentifs et charmés. Les filles s’échappaient des villages et les bouviers des fermes pour venir écouter de plus près ; des jeunes soldats désertaient ; le tocsin sonnait jusqu’au lever du jour dans les couvents pour ramener à Dieu les âmes en péril, et des vieux moines blanchis dans le jeûne et la prière s’arrêtaient tout à coup la nuit au fond des cloîtres pour fondre en larmes en songeant au passé.
Et un grand trouble agitait tous les cœurs. C’était par les bourgs un souffle déchaîné de stupre et d’adultère ; des femmes abandonnaient le logis pour suivre des voyageurs, on ne rencontrait plus le long des haies que filles et garçons accouplés ; les rustres des champs en proie à de vagues tristesses laissaient les terres en jachère, les artisans des villes erraient le long des jours à travers la campagne, et les routes n’étaient plus sûres à cause de tant de vagabonds éparpillés dans la province. Ce damné musicien envoûtait tout le pays, liesse et paresse pour la canaille, détresse et deuil pour la noblesse et les bourgeois.
Tant et si bien que le duc de Lorraine, en sa bonne ville de Metz, s’en émut et prit le parti de délivrer son peuple de ce maudit sorcier chanteur. Nul ne l’avait jamais vu. C’était, disait-on, un tout jeune bohémien égaré loin de sa tribu et qui, lors du dernier passage des seigneurs d’Égypte par les marches de Lorraine, s’était fixé dans les Ardennes et y chantait désespérément jour et nuit… Peut-être son nostalgique appel serait-il quelque soir reconnu d’un des siens. Mais farouche comme une bête fauve et sûrement passé maître en l’art des sortilèges, il s’était jusqu’alors dérobé à tout regard ; et d’ailleurs une crainte superstitieuse protégeait sa retraite et, depuis qu’il chantait dans la forêt fleurie, nul n’osait plus y pénétrer. Et cela durait depuis des mois.
Une belle nuit de mai, le duc de Lorraine se mit en campagne avec un gros de cavaliers. Il emmenait avec lui l’évêque de Nancy et douze membres du chapitre en cas de charmes à rompre et d’exorcismes à opérer. Ils marchèrent deux jours et, le second soir, parvinrent à la lisière de la forêt. Depuis l’aube, ils ne rencontraient que pèlerins processionnant sur les routes et que filles folles errant le long des haies avec des yeux perdus d’amour. Alors dans le crépuscule une voix douce et pure chanta, et le duc et ses compagnons inclinèrent malgré eux et leurs fronts et leurs lances sur l’encolure de leurs chevaux tout à coup arrêtés ; on aurait dit que leurs moelles se fondaient dans leurs os et un froid délicieux les étreignit au cœur.
Mais l’évêque de Nancy récita la prière de saint Bonaventure et, s’étant signés, le duc et ses gens d’armes entrèrent dans la forêt. Ils y errèrent toute la nuit sous la lune montante, égarés et charmés par la voix qui tantôt chantait à gauche, puis reprenait à droite et semblait errer de ci de là ; le givre des pommiers sauvages embaumait, des vapeurs nocturnes flottaient devant leurs yeux, pareilles à des robes ; parfois des pieds nus apparaissaient sur la mousse, parfois de soyeux contacts les touchaient ; mais c’étaient des illusions que le prélat de Nancy déjouait vite. La voix triste et pure du chanteur inconnu pleurait et suppliait toujours, mais maintenant plus distincte et plus proche et, par les taillis baignés de vif-argent de la forêt soudain agrandie, ils marchaient, bizarrement émus, sous un linceul odorant de pétales, avec des précautions et des gestes de chevaliers-oiseleurs.
Tout à coup la voix égrena comme un rire d’une limpidité d’eau et le cortège, stupéfié, fit halte.
Le bohémien était là ! Debout au bord d’une source, il se penchait follement sous un froid rayon de lune et, sa guitare à la main, se mirait dans l’onde, enivré de sa propre image, comme entraîné et fléchi vers l’eau par le poids de ses cheveux, une coulée de soie jaune chimériquement longue, et les joyeux arpèges pétillaient sous ses doigts.
Les cavaliers du duc fondirent sur lui comme sur une proie, le garrottèrent avant qu’il eût poussé un cri et le jetèrent, pieds et poings liés, sur la croupe d’un cheval ; l’évêque de Nancy avait ramassé la guitare. Au petit jour, le duc et sa suite sortaient de la forêt et regagnaient Metz par des chemins de traverse. Durant les trois jours du voyage, le bohémien capturé ne proféra pas un mot ; de temps en temps, on lui mettait une gourde aux lèvres et on le faisait boire et, comme sa prestigieuse beauté eût pu intriguer les passants, on l’avait couvert d’un manteau. À la troisième aurore, la petite troupe atteignit Metz et le palais ducal.
L’étrange musicien y vécut deux mois, muré dans un silence farouche, presque libre sous la surveillance de trois gardes, le regard morne, absent, déroutant toutes les conjectures et troublant les hommes et les femmes par une beauté quasi divine.
C’était un jeune et svelte garçon de dix-sept ans au plus, aux bras graciles et aux jambes musclées, imposant avec sa démarche souple et ses mouvements agiles l’idée d’un fier et dangereux animal ; une longue chevelure blonde lui flottait sur les reins et comme un rictus retroussait par moment sa lèvre un peu bestiale ; mais l’abîme de ses yeux étonnait.
Le duc, à la fois effrayé et charmé, l’avait pris en amitié ; c’était un objet d’art de plus dans le château ducal. Le bohémien y errait le long des journées de salle en salle, les bras croisés, sans desserrer les dents ; parfois il s’arrêtait devant une fenêtre ouverte et regardait longtemps les nuages, puis il reprenait sa promenade inquiète, épié de loin par l’œil des courtisans.
On l’avait paré des plus riches vêtements et on lui avait rendu sa guitare, mais à peine avait-il semblé la reconnaître et l’instrument muet traînait dans toutes les chambres, à la portée de sa main, sans qu’il daignât l’honorer d’un regard ; et le duc en était pour ses frais et les courtisans pour leur peine. L’enivrante chanson, qu’il chantait naguère éperdument pour les gueux de routes et les misérables, ce maudit bohémien la refusait à son maître et aux grands de la cour ; la voix triste et pure s’était à jamais tue, et la fille du duc, qui se consumait du désir de l’entendre, en devint mélancolique et tomba en langueur.
De mâle rage, le duc fit jeter dans un cul de basse-fosse ce musicien du diable, lui et sa guitare, puis il quitta Metz pour son château des bois, car l’été s’avançait et la chaleur se faisait grande.
Or à quelque temps de là, par une orageuse nuit d’août, un des geôliers de la prison de ville entendit s’élever des cachots du donjon une voix infiniment douce et triste. Une tumultueuse musique l’accompagnait, frémissante, stridente et joyeuse aussi ; c’était comme une eau mélodieuse qui montait dans la tour et battait les murailles, une poignante musique, en vérité, faite d’éclats de rire et de larmes, et le geôlier, qui ne l’avait jamais entendue, reconnut la voix du bohémien. Il descendit les escaliers quatre à quatre et, bousculant les sentinelles accourues toutes pour écouter la voix et sanglotant d’angoisse, assises sur les marches, il se précipita vers le judas grillé du damné musicien.
Le prisonnier, debout dans son cachot, y chantait éperdument, les doigts crispés sur sa guitare. Une lune énorme, fantasque, d’un jaune d’or riait aux barreaux de la fenêtre, étamant comme un miroir l’eau d’une large écuelle posée à terre ; et, penché sur le reflet de l’astre, le bohémien s’y mirait et chantait à gorge déployée, enveloppé de la tête aux pieds dans la nappe jaune de ses cheveux.
Il chanta toute la nuit sous les yeux des gardiens entassés frissonnant au judas de la porte, et sur la place, au pied des murs de la prison, le bas peuple ameuté montrait le poing aux sentinelles, s’arrachait les cheveux et défaillait d’amour.
Le bohémien chanta tout le jour et, vers le soir, une grande rumeur s’éleva de la campagne et le gouverneur de la citadelle, étant monté sur la tour du guetteur, vit que les champs étaient noirs de foule, d’une foule processionnant lentement vers la ville ; on eût dit une armée en marche. Il en venait des quatre points de l’horizon. C’étaient les gueux de routes, les va-nu-pieds et les rustres, toute la légion des misérables accourus à l’appel de leur chanteur ; ils l’avaient enfin retrouvé et cheminaient depuis l’aube, ivres de colère et de joie, et le crépuscule était plein de terribles menaces, de piques et de faulx brandies sous le ciel rose ; un souffle de panique balayait la campagne et les citadins, tassés sur les remparts, écoutaient, effarés, s’approcher et grossir l’effroyable clameur.
Le bohémien chantait toujours.
Le duc, prévenu en toute hâte, atteignait en deux jours de marche les rebelles campés aux portes de la ville, la garnison faisait une sortie et les gueux mal vêtus, mal armés étaient aisément écrasés. Ce fut une atroce tuerie sans pitié, sans merci : plus de trente mille morts demeurèrent sur le terrain et parmi eux des femmes, des enfants, car les malheureux étaient venus là par couples, par familles comme à un pèlerinage, et la campagne autour de Metz était rouge de sang. Le duc coucha le soir même dans sa ville où l’émeute grondait encore, mais quand on vint chercher le bohémien pour le torturer et le brancher, son cachot était vide, il avait disparu.
Mais à quelques jours de là, comme le supérieur des frères de la Miséricorde rôdait avec quelques-uns des siens sur le champ de bataille pour y recueillir et ensevelir les morts, une captieuse musique éclatait tout à coup au-dessus du charnier et, ayant levé la tête, le moine aperçut un jeune et svelte garçon qui chantait et riait, la guitare à la main, debout sur un tertre encombré de cadavres.
Un ciel de braise et d’or saignait à l’horizon et, drapé jusqu’aux reins dans une chevelure de flamme, le musicien jetait avec son chant de vibrants éclats de rire et se mirait, penché sur une flaque de sang.
Et le moine ensevelisseur reconnut le bohémien, le bohémien Amour qui chante dans les bois pour les déshérités et les gueux, se tait dans les palais, se mire dans la Mort et n’aime que lui-même, l’Amour libre et sauvage comme la solitude.
PRINCESSES D’AMBRE ET D’ITALIE
À mon ami Octave Uzanne.
LA PRINCESSE OTTILIA
La jeune fille se souleva machinalement d’entre les coussins de soie pâle où elle songeait accoudée et, s’étant approchée de la haute fenêtre ouverte, regarda longtemps du côté de la ville, au-dessus des ombrages du parc royal.
Dans la vaste chambre tendue de tapisseries de soie un groupe de suivantes tourmentait doucement les cordes de théorbes et de grands archiluths, emplissant toute la cour octogone d’un vague et délicat murmure que la jeune fille n’entendait pas, car la princesse Ottilia était muette, muette de naissance et sourde aussi, comme il arrive presque toujours en ces pénibles cas ; et, murée dans son infirmité, il y avait déjà plus de vingt-cinq années qu’elle vivait retranchée de la vie, sans autre communication avec ses semblables que quelques gestes vagues à la longue adoptés par ceux qui la servaient, et elle était triste sous ses longs habits de brocart ciel ramagé de fleurs d’or ou ses lourdes gaines de drap de soie violettes brodées de dragons verts, deux nuances qu’entre toutes elle affectionnait, si triste qu’on ne l’avait jamais vue sourire ; et ses grands yeux couleur d’eau morte, sans rêve et sans pensée, brillaient sous ses belles paupières du terne éclat des pierres fausses.
Elle était la fille aînée du roi de Sicile, pauvre créature infirme issue d’un mariage entre cousins, un morne mariage politique, et sa naissance avait fait répudier sa mère.
Le roi n’aimait guère cette princesse au regard absent et à la bouche close, dont l’immobile et placide beauté ne s’animait jamais. Il l’avait fait élever dans une partie isolée du palais, désormais interdite au personnel de la cour ; et les profonds ombrages du parc réservé entouraient et dérobaient à tous le donjon de marbre rose où la douce Ottilia avait grandi et commençait à se faner lentement au milieu d’un troupeau désœuvré de suivantes.
Les tournois et les cours d’amour et, à défaut de fêtes aussi galantes, le spectacle toujours nouveau de la mer et de ses horizons, le mouvement du port, l’entrée et la sortie des glissantes galères et la turbulence en gaieté du bas peuple, le long des môles et du chenal, auraient peut-être distrait la dolente princesse, mais le roi avait comme honte de cette infirme ; elle déshonorait sa race, et, confinée dans sa tour de marbre et son jardin obscur, la pâle Ottilia n’en sortait que rarement pour assister à quelque royale cérémonie du trône, où sa prestigieuse beauté en imposait au peuple.
Ces jours-là, le vieux roi consentait à regarder sa fille. Assise dans une pose hiératique au milieu des musiques sacrées, du frissonnement des bannières et des splendeurs de métal et de soie des cortèges guerriers, elle apparaissait vraiment royale ; l’immobilité de son visage était comme une gloire de plus. Elle semblait née pour trôner sous un dais, au milieu des fumées d’encens et des retombées de fleurs des fêtes liturgiques, sous les hautes voûtes des cathédrales, et le monarque orgueilleux daignait se reconnaître sous l’or et les pierreries et les lourdes hermines des robes d’apparat.
Mais c’étaient là heures rares et de courte durée. Tout le cœur du roi était à son fils, au prince qu’il avait eu d’un second mariage après la disgrâce de la mère d’Ottilia, un fier et beau dauphin âgé déjà de vingt ans et qui, fantasque, plein de sang et de fougue, emplissait la ville et le royaume du scandale de ses caprices, amusant le peuple et effarant le bourgeois du faste de ses maîtresses et de ses favoris.
La princesse Ottilia voyait encore plus rarement ce jeune frère. Peu soucieux d’aller s’enfermer des heures avec cette muette au regard de fantôme et aux gestes de rêve, le dauphin déclarait préférer les vivantes aux figures peintes des fresques. Cette sœur éternellement grave l’épeurait, et la pauvre abandonnée n’avait guère d’autre passe-temps que de feuilleter les lourdes pages enluminées de vieux missels, d’échantillonner des tapisseries à personnages ou de recevoir la visite de tisseurs d’étoffes et de joailliers qui venaient lui soumettre, les uns des combinaisons de dessins et de nuances, les autres des modèles d’agrafes, de bracelets de colliers, et c’étaient là les rares heures claires de sa solitude.
Dans le gynécée assombri de vitraux les suivantes, qui se mouraient d’ennui, musiquaient en sourdine pour essayer de se distraire, ou tantôt se pinçaient dans les coins à la mode des pucelles amoureuses, mais, pouffant de rire ou grattant leurs instruments à cordes, la royale sourde-muette ne les entendait pas.
Elle était toujours debout à la fenêtre, les deux mains appuyées sur le rebord de marbre, mais ses regards lointains ne cherchaient plus à distinguer les dômes et les campaniles derrière les hauts ombrages des palmiers et des cyprès. La princesse Ottilia regardait maintenant, singulièrement attentive, au pied même de la tour, au milieu des massifs étoilés de clématites et de jasmins.
Trois hommes venaient d’entrer dans le jardin, trois jeunes hommes et tous trois inconnus, un seigneur et deux musiciens. C’étaient un joueur de flûte et un joueur de viole, une viole particulière dont les sons vibrants et pénétrants ne s’exhalent que sous l’archet, dite viole d’amour. Le jeune seigneur s’était assis sur un banc circulaire et, déployant un parchemin manuscrit qu’il avait à la main, faisait un signe aux deux autres, et la princesse, qui du haut de sa fenêtre les apercevait tous trois comme au fond d’un puits, reculés et singulièrement blêmes dans l’ombre bleue des cyprès, voyait le joueur de flûte porter son instrument à sa bouche et l’autre musicien appuyer sa viole au défaut de l’épaule.
Le jeune seigneur rythmait la mesure, oscillait du buste et, penché en avant, indiquait les reprises, suivait le mouvement et, la bouche grande ouverte, chantait évidemment en dodelinant de la tête des paroles qu’elle n’entendait pas.
Ils répétaient quelque aubade, quelque galant concert destiné à une belle dame adorée du jeune homme au manuscrit. Ils avaient choisi ce lieu solitaire pour répéter en toute sécurité leur sérénade d’amour et, à en croire la face enivrée du seigneur, sa prunelle humide et son air d’extase, tout, paroles et musique, devait être de sa composition.
Et plus cruellement que jamais la princesse regrettait de n’entendre ni les sons, ni de saisir le sens délicat des mots. Tout dans ce jeune inconnu, son attitude passionnée, sa pâleur ardente et jusqu’à sa sveltesse souple et son regard noyé, attirait ; elle aurait aussi voulu connaître la dame de la cour à laquelle s’adressait le tendre épithalame, car il ne pouvait être question pour elle d’aubade ni de chanson ; et le galant savait bien ce qu’il faisait en choisissant pour répéter son œuvre ce jardin solitaire de princesse sourde-muette… Sourde-muette ! et une angoisse lui étreignait le cœur.
Une des suivantes, s’étant alors approchée de la fenêtre, vit les trois hommes quitter le jardin, mais reconnaissait le jeune seigneur.
C’était Beppino de Fiesoles, le favori actuel du prince, et qui, dit-on, cumulait tous les emplois à la cour, même celui d’amant de cœur de la belle duchesse Catarina d’Aydagues, maîtresse alors du dauphin.
La nuit suivante, la princesse Ottilia revit en songe le bel inconnu et les deux musiciens du jardin ; mais, nouveauté qui tenait du miracle, de douces sonorités emplissaient son oreille, une musique délicieuse l’envahissait toute, qui l’abîmait dans une stupeur joyeuse, la ravissait d’extase et la faisait dans la même minute défaillir et renaître avec des chaleurs soudaines et puis des frissons d’agonie dans sa chair enfin épanouie.
Le lendemain, vers les quatre heures, une sensation de caresse et de douceur jusqu’alors inéprouvée la dressait tout à coup de sa stalle et l’amenait presque inconsciente à la fenêtre qui donnait sur le parc.
Les trois hommes de la veille y étaient déjà, le beau Beppino de Fiesoles assis sur le banc et les deux musiciens debout devant lui. Flûte et viole d’amour y rythmaient la mesure d’une langoureuse chaconne et, sur l’air de danse à la fois ardent et maniéré, le seigneur Beppo exhalait de suppliantes paroles, blâmes et éloges mêlés en l’honneur d’une dame ; et la sourde royale en comprenait le sens et s’en sentait attristée dans son âme, car rimes et musique s’adressaient à une tout autre qu’elle ; et son cœur, tout à coup initié à la vie, devinait que c’était une requête d’amour.
Les vers du seigneur florentin célébraient les cheveux de soie et de soleil d’une belle insensible à la chair ambrée et transparente comme celle des raisins ; ils célébraient, ces vers, la rose humide et fraîche des lèvres d’une dame aux prunelles d’acier pareilles à des dagues ; et, sans connaître le sens des mots, la princesse Ottilia se savait des cheveux luisants et noirs, un teint mat, et deux prunelles du bleu des turquoises malades lui souriaient au fond de son miroir.
Elle venait instinctivement de le prendre à portée de sa main sur une table et s’y contemplait. Quand elle vint à plonger de nouveau ses yeux dans le jardin, elle vit que le jeune homme avait levé la tête et la regardait. À son tour, la princesse Ottilia se sentit rougir et se recula.
Elle n’en revint pas moins le lendemain s’accouder à la croisée. Le seigneur Beppo et ses deux musiciens étaient déjà installés dans le bosquet de cyprès et viole d’amour et flûte soupiraient langoureusement.
Mais, ô miracle ! la musique n’était point la même. Elle implorait plus persuasive et plus tendre, et la princesse sourde l’entendait ; les vers aussi avaient changé. Ils ne célébraient plus les yeux gris d’une rousse au teint d’ambre, mais les prunelles d’aigue-pâle et d’eau morte d’une beauté lunaire aux cheveux de ténèbres.
Le chanteur chantait, les yeux fixés sur elle, et la princesse enivrée ne consultait plus son miroir.
La nuit, ses songes étaient pleins de visions délirantes.
À quelque temps de là, un soir que le prince Alexandre, étendu sur des carreaux de velours de Gênes et des tapis de Scutari, attardait ses longues mains nonchalantes dans les tresses soyeuses de la belle Catarina : « Et que devient notre seigneur Beppo ? » demandait indifféremment la duchesse.
Le prince héritier de Sicile, la langue épaissie par l’ivresse : « Notre Beppo doit avoir quelque folie en tête. Il nous néglige fort – ne le trouvez-vous pas ? – depuis ces derniers temps.
— Et pourquoi se donnerait-il la peine de nous faire sa cour ? N’est-il pas le favori, le mignon chéri de Votre Altesse ? Vous l’avez fait comte, gouverneur de Sardaigne. Il puise à pleines mains dans vos coffres et peut aspirer à tout. N’a-t-il pas rêvé de faire de moi sa maîtresse ?
— Comment ! il a osé ?…
— Et toute une semaine il n’a tenu qu’à lui. N’est-il pas après vous, monseigneur, le cavalier le plus accompli du royaume ? Mais notre Florentin a des visées plus hautes ; il fait entendre les sourdes et parler les muettes.
— Qu’entendez-vous par là ?
— Rien, monseigneur, que toute la cour ne sache, excepté Sa Majesté et vous. Allez donc vous promener demain, vous et vos gens, à l’heure de la sieste, dans le jardin privé de la princesse.
— Ottilia, ma sœur ? Belle duchesse d’Aydagues, Catarina ma mie, c’est la hache pour vous si vous avez menti. »
À deux nuits de là, la princesse Ottilia eut un affreux cauchemar. Le beau comte de Fiesoles, assisté de ses exécutants, lui donnait sa quotidienne aubade. La chanson montait, ardente et passionnée, et elle, penchée à la haute fenêtre, le buvait du regard et défaillait de joie à l’entendre ainsi la requérir d’amour… quand tout à coup le beau chanteur lui apparaissait tout pâle dans l’ombre soudain plus dense des cyprès. Il chancelait et pâlissait encore, et sa voix s’était tue ; la viole aussi était devenue muette ou bien elle-même était redevenue sourde. Et la princesse s’éveillait toute froide, avec une grande angoisse au cœur.
Le lendemain, à son réveil, un page à la livrée du roi demandait à être introduit et déposait pour elle dans les mains de ses femmes un curieux coffret de Venise enrichi de gemmes et d’émaux. La princesse l’ouvrait en grande hâte et y trouvait, posée sur un coussin de soie, la tête chaude encore, aux grands yeux révulsés, du Florentin Beppo. À cette vue, une forte fièvre la prit qui l’emporta dans la soirée.
Ainsi mourut la princesse Ottilia pour avoir écouté chanter la viole d’amour.
GRIMALDINE AUX CRINS D’OR
Regnier Grimaldi, sire de Monaco, revenant de conquérir Londres pour le Roy de France et regagnant ses États par étapes à travers le duché de Bourgogne et le royaume de Provence, avait fait halte en Avignon. Notre Saint-Père le Pape y tenait alors sa cour en grande liesse de sonneurs de sonnets et de ramageurs de ballades, mimes et baladins et autres troubadours, et, parmi ces espèces dits Compagnons du Gai Savoir et dont la compagnie est un péché de gens d’Église, se trouvait un certain Galeas Alesti, Florentin d’origine et poète de hasard, qui, le soir, à la table de Sa Sainteté, vint célébrer en s’aidant de la mandoline la beauté d’une Gênoise incomparable et déjà fameuse dans toute la Provence et les Marches d’Italie par sa chevelure souple, blonde et longue, la plus merveilleuse toison de femme qu’on eût jamais vue sur les côtes de la Méditerranée depuis celle de sainte Marie-Magdeleine, laquelle, comme chacun sait, est la patronne de la Provence et repose en la grotte de la Sainte-Baume, dans les solitudes parfumées du plan d’Aups, à mi-flanc du Pilon.
Isabelle Asinari était le nom de cette beauté casquée d’or rouge, comme le duc Achilleus lui-même, proclamaient les vers du Florentin :
Et qui portait sur sein de lait
Soleil d’août en mantelet…
ajoutait en broderie certain rondel de ménestrel tourangeau, un petit histrion de Languedoil égaré, venu on ne sait comment à la Cour des Papes. Bref, cette Isabelle Asinari faisait délirer tous les gratteurs de cordes et chasseurs de chimères du palais d’Avignon. Son nom et son éloge étaient sur toutes les bouches et le sire de Monaco, comme tout bon Provençal fervent dévot de sainte-Magdeleine, s’étant enquis de cette Asinari rivale en chevelure de la pécheresse aimée de Notre-Seigneur, se trouva féru d’étrange curiosité et peut-être de naissant amour, quand il eut appris que cette Isabelle Asinari était fille pieuse, sage et vivait honnêtement à Gênes, dans la maison de son père, marchand de ferraille dans le quartier du port.
Il désira connaître cette fille casquée d’or rouge comme un héros d’Homère, et, prenant congé de Sa Sainteté, il quittait Avignon dans la nuit, gagnait en grande impatience le port de Marseille, y frétait galère et, sans même toucher barre à son rocher de Monaco, cinglait vers Gênes, déjà, le pauvre, en mâle fièvre d’amour.
Grimaldi trouvait la belle au logis paternel, assise au rouet et filant. La maison du Gênois donnait sur le port et la petite salle, où se tenait sa fille, s’éclairait d’une fenêtre d’où l’on voyait la mer. Or, quand le Monaco fut introduit dans cette salle, tout le bleu du ciel et tout le bleu du large entraient par la petite baie de la croisée ouverte à cause de la chaleur ; un grand lys rouge, posé dans un vase au coin de la fenêtre, frissonnait et tremblait, lumineux, dans la brise, et la fille du Génois, front pur et face étroite aux longues paupières baissées, se tenait immobile sous ses cheveux d’or roux, créature d’ivoire, tant sa peau était mate, sur cet azur intense où flambait une fleur. Et le Grimaldi trouva que les poètes n’avaient pas menti.
Non, le Florentin n’avait pas menti, ni le rondel du poète tourangeau non plus, ni eux, ni les autres. Fine et pâle avec ses cheveux et ses longs cils baissés, Isabelle Asinari était belle comme la statue d’une sainte enchâssée dans le bleu d’un vitrail, mais son vitrail, à elle, c’était tout l’azur de la Méditerranée. Ainsi auréolée, souriante et les yeux clos, on eût dit qu’Isabelle dormait, et Grimaldi, une angoisse au cœur, la regardait en silence, quand la belle, ayant levé lentement, très lentement ses paupières, Grimaldi, tombé sur les genoux, salua la jeune fille comme un Maure aurait salué l’Aurore, le front sur la dalle et les bras écartés.
Pour Grimaldi, une aube venait d’éclore : l’aube d’amour s’était levée. Ce fut une minute d’éternité… mais, comme Grimaldi était aussi dévot aux saintes que fervent amoureux des belles filles, il demandait la main d’Isabelle à son père et, comme il était un très puissant seigneur et de haute lignée et insolemment riche, il obtenait d’épouser le lendemain même la fileuse aux cheveux fauves, qui, toute rose des tempes à la naissance du cou (mais on la devinait rose aussi ailleurs), avait déjà laissé prendre à l’impatient Regnier le bout de ses doigts roses, qu’il mangeait de baisers.
Ce furent des noces magnifiques dont la splendeur étonna le siècle ; puis, les noces célébrées, le Grimaldi emmenait sa femme sur son rocher de Monaco. Les Monégasques saluaient, éblouis, eux pourtant habitués au plus radieux soleil, le radieux avènement de la plus blonde princesse, un dicton courait le pays consacrant la beauté de la nouvelle épouse. « C’est maintenant à Monaco que l’aurore de Gênes se lève », et puis Regnier reprenait la mer et sa vie de corsaire au service des Lys de France, et la blonde Asinari demeurait un peu triste en face de la mer bleue, dans la solitude embaumée et fleurie de cactus de son rocher nimbé de tours.
Tout amoureux qu’on fût alors, on était d’abord au service du Roy et les Lys passaient avant l’amour.
Or, pendant une de ces courtes trêves durant lesquelles Anglais et Français reprenaient un peu haleine, un soir que Monaco se trouvait à Paris, chez Madame la Reine, et que les courtisans, beaux fils et mignons de couchette, adonisés, lustrés et fleurant fines odeurs dans des justaucorps de soie miroitante, y faisaient assaut de hâbleries, d’amoureuses vantardises et de tapageuses vanités, tous rengorgés dans l’orgueil de leurs succès, – et détaillaient, complaisants, les beautés miraculeuses et secrètes de leurs mies, chacun renchérissant sur l’autre, tous plus vains que des merles et de la main caressant leurs colliers ; comme le Grimaldi assis à l’écart assistait, assez morose et les lèvres serrées, à toutes ces forfanteries : « Et toi, Monaco ! faisait Madame la Reine en interpellant l’homme sombre, tu n’as donc pas de belle à nous vanter et, vaillant comme tu es, tu vis donc sans amour au cœur que tu demeures là avec cet œil absent et cette bouche cousue ? Quoi ! n’aimerais-tu pas les dames, Monaco ? Voilà qui serait vilain pour un brave comme toi ! » À quoi le Regnier, avec un dédaigneux hochement de tête : « Et qu’aurai-je à répondre à Votre Majesté ? Dans mon pays, les femmes ont le balancement des vagues dans les hanches avec tout le soleil dans leur sourire et dans les yeux le bleu changeant de la mer. Je suis de Provence, Madame ! » Et comme tous ces merles et papegeais de courtisans ricanaient sur ce Monaco amoureux de toutes les femmes de sa Provence et qui n’en avait pas une à lui : « La princesse de Monaco, Messeigneurs, est si belle, que pour l’aller quérir à Gênes, chez son père qui vendait du fer, je frétai galère en port de Marseille et oncques ne l’avais jamais vue, mais sa réputation de beauté avait traversé la mer. La princesse de Monaco est célèbre sur toutes les côtes de Provence et d’Italie et, entre autres trésors et raretés, jamais femme au monde ne posséda plus longue et souple chevelure blonde depuis sainte Marie-Magdeleine… C’est du moins le dicton de mon pays d’azur. J’ai répondu, Messieurs ! » À quoi Madame la Reine, un peu piquée, car elle n’était pas peu fière, elle aussi, d’assez longs et souples cheveux d’or : « En vérité, Monaco, tu me rends curieuse de connaître cette chevelure fameuse et magnifique. Ne pourrais-tu nous amener cette lumineuse toison à la cour ? » Le Grimaldi s’était levé droit devant le trône de la gracieuse Reine : « Les désirs de Sa Majesté sont des ordres. Je vais donc, Madame, vous chercher ces cheveux que vous désirez voir. » Et, sur un grand salut, il quittait le palais, escorté jusqu’au seuil par un subit silence.
Et il fut absent deux longs mois et les courtisans, qu’il avait mortifiés, de reprendre et leur arrogance et leur clabaudage : « Ce Monaco avait commandé sûrement cette princesse à chevelure de fée à quelque sorcière de sa Provence. » Quel masque allait-il leur amener ? « Quelque moricaude, sans doute, ces Provençales ! ou quelque mauresque achetée à des pirates ! » Et les médisances suivaient leurs cours et Madame la Reine commençait à prêter l’oreille aux malicieux propos, car elle était femme, quoique reine, et d’humeur rieuse et dénigrante, quand, une belle vesprée d’août, les hérauts de service annoncèrent soudain Regnier Grimaldi.
La blonde Majesté se levait de son trône. Le Monaco était seul : « Seul ! Monaco, te serais-tu joué de nous ? » Seul, non, car deux valets vêtus de ses couleurs suivaient le Grimaldi, portant par ses poignées un lourd coffret de fer recouvert de velours de Venise cramoisi.
Ils déposaient le coffret devant le trône et, Monaco l’ayant ouvert, il en tirait une lourde et longue coulée de soie dorée, luisante, lisse et fluide, un pesant écheveau d’or vif, une nappe de lumière et d’ambre parfumée (on aurait dit, tissée, la fraîcheur de l’aurore) et tout le palais obscur en fut éclairé.
Monaco, debout, peignait du bout de ses doigts bruns la toison de clarté.
La Reine, elle, avait compris : « Je t’avais demandé la princesse et non sa chevelure. Monaco, comment as-tu pu commettre ce sacrilège, toi, ce meurtre et ce crime de lèse-beauté ! Quoi ! tu as pu raser les cheveux de ta femme ? »
Alors, le Grimaldi : « Sa Majesté m’avait demandé de lui amener la chevelure et non la princesse. D’abord, la femme est pour moi seul, je la garde. Vous avez désiré connaître les cheveux, le vœu de ma douce Reine n’est-il pas exaucé ? »
Et comme la reine, les mains jointes d’extase, les yeux agrandis, éblouie, ne cessait de répéter : « Raser de tels cheveux, mais c’est un sacrilège, un meurtre, Monaco, un crime de lèse-beauté !
— Que Sa Majesté se rassure, interrompit le terrible homme, je n’en ai coupé qu’une touffe ! »
LA MARQUISE DE SPOLÈTE
Les minnesingers cajoleurs
Aux douces chansons
Avec l’accord
Du jet d’eau qui pleure
Au verger en fleurs,
Les joueurs de cor
Et les échansons,
Enfin, tous ceux qui sont,
Jadis ! passés en merveilleux décor
Et passeront encor…
Les varlets qui vont mourir
Aux prisons des tours,
Et les servants d’amour
Venus tour à tour
Avec des fleurs, des sourires,
Et des roses de Timour,
Et puis les lansquenets,
Et les chevaliers de Tyr,
Tous ceux que la ronde a menés,
Et ramènera toujours…
Mais toi,
Tes lèvres et tes cheveux
Et tes roses aux doigts,
Et tes aveux
Le soir auprès du feu,
Mais toi,
Et les soirs de mai.
Les soirs aimés,
Tout cela est fini, vois
Et ne reviendra jamais.
Tristan KLINGSOR.
Bartholoméo Giovanni Salviati, marquis de Spolète et duc de Vintimille, de la vieille famille des Salviati, qui fournit des doges à Venise et des gouverneurs à Florence, était déjà vieux de cinquante années et veuf depuis quinze ans de Maria Lucrezia Belleverani, les Belleverani de Naples, alliés aux familles ducales de Modène et de Parme et même à la maison de Médicis, quand il épousait en secondes noces, lui, déjà ridé et chenu, Simonetta Foscari, belle jeune fille de vingt ans, dans toute la fleur d’une éblouissante puberté. Cette Simonetta Foscari, Florentine de race et d’instincts, du sang des vieux Foscari, si terribles à leur propre patrie, les Foscari des émeutes, des complots, des amours tragiques et des trahisons, lignée de criminels et de voluptueux, où les hommes, beaux comme des courtisanes, et les femmes, belles comme des archanges, fournirent des mignons au fort Saint-Ange et des papesses au Vatican, n’était point faite pour démentir un proverbe populaire en Italie sur l’insolente beauté de ceux et de celles de sa maison. Les Foscari si beaux qu’ils tenteraient Dieu, blasphémait alors et blasphème encore, dans toute la Toscane, un dicton quasi sacrilège.
Une anonyme figure d’un élève du Vinci, et qui pourrait bien être la Foscari de cette histoire (car le catalogue des Ufizzi l’intitule Portrait de la Marquise de Spolète), a transmis jusqu’à nous sa périlleuse beauté. Reléguée dans une petite salle obscure du musée, le hasard seul ou bien alors une volonté avertie peut découvrir la précieuse toile, mais je défie bien quiconque a contemplé une fois cette petite tête altière de pouvoir jamais l’oublier.
Du renflement du front à la nuque violente, c’est une petite tête courte, impérieuse, obstinée, une petite tête de volonté qui serait presque mauvaise sans la langueur des yeux aux trop lourdes paupières, deux longs yeux d’ombre où la prunelle, étrangement reculée sous l’arcade sourcilière, a des lueurs rousses de topaze brûlée ; bouche sinueuse aux lèvres ciselées ; nez droit et court aux narines qui se dilatent, les méplats du visage accusés et nets, comme sculptés à même d’une pierre dure, c’est un masque à la fois impérieux et tenace de jeune aventurier et de princesse sensuelle, une tête d’une jeunesse et d’une ardeur effrayante dans leur intensité. La coiffure est faite de ces lourdes torsades, entrelacées de perles et de gemmes verdâtres, dont l’école Toscane casque tous ses fronts de femme ; le cou très féminin, vipérin presque dans sa gracilité longue et que l’on sent voulue, jaillit comme une tige d’un corsage largement échancré et collant aux épaules, un damas safrané d’un très heureux accord avec le ton rouillé des yeux et de la chevelure ; la chair mate, avec, dans la lumière, des transparences verdâtres, évoque à la fois des mollesses de cire et des duretés de métal, et pourtant la peinture est plutôt mauvaise. Le visage, qu’on sent seul ressemblant, est gâté par des détails de convention, des routines d’école, tels que le cou trop long et la chevelure rousse, car cette femme si pâle devait être brune et cette tête courte aux prunelles humides devait s’appuyer sur un cou renflé… mais telle que nous l’ont léguée les siècles, cette figure obsède, elle inquiète et vous poursuit à travers les autres tableaux du catalogue, et par l’anonymat du peintre et du modèle… élève du Vinci ? Quel était cet élève ?… Marquise de Spolète, qui était cette marquise, et quelle fut sa vie ?… obsédante surtout par l’énigme tangible d’une beauté que l’on sent volontairement altérée… Marquise de Spolète, il m’a plu, moi, d’identifier en elle l’héroïne de la tragique histoire que voici.
Simonetta Foscari, épousée pour sa royale beauté et sa jeunesse triomphante, apportait dans cette rude petite cour des Vintimille les élégances raffinées, les mœurs libres et les somptuosités d’une princesse florentine.
C’étaient dans la petite ville de frontière, jusqu’alors plus accoutumée à la soldatesque d’une garnison, des ribambelles de poètes jongleurs et de musiciens, toute une suite d’artistes enlumineurs de missels, modeleurs de cire et même diseurs de jolis riens, sonneurs de sonnets et ramageurs de ballades, comme il en pullulait alors en Lombardie et en Toscane à la solde des puissants et des riches : tous venus à la suite de la nouvelle duchesse, esclaves de sa fortune, les uns féaux de sa beauté et la plupart de ses largesses. La vieille forteresse s’emplit d’un bruit de voix rieuses, de frôlements de soie et d’instruments jaseurs ; on n’y entendait jadis que bris de gobelets et heurts de hallebardes et, le long des veillées d’armes, chocs des dés et des cornets.
Ce furent désormais, de l’aube au soir et surtout du soir à l’aube, des pizzicati de mandolines, des sanglots comme râlés de guitares et des vers de poètes, tantôt rythmés, tantôt balbutiés en extase par des voix caresseuses qui défaillaient d’amour. Il y eut des décamérons dans les vieilles salles basses, jusqu’ici réservées aux lansquenets ; les murailles nues s’ornèrent de fresques. La jeune duchesse fit venir des peintres de Fiesoles et des sculpteurs de la Romagne, et son image sous les traits, tantôt d’une nymphe, tantôt d’une sainte canonisée, embellit les couloirs et les cours du palais.
Andréa Salviati, le fils du duc et de Maria-Lucrezia Belleverani, l’enfant du premier mariage, en abandonnait de dépit la cour paternelle. C’était un chétif et maigre adolescent assez disgracié de sa personne et d’un caractère taciturne ; il tenait de sa mère cette humeur hautaine et chagrine. Il en avait les beaux yeux d’un vert sombre, et c’était le seul charme de ce visage tourmenté d’avorton. C’étaient ces yeux-là que rencontrait, à Vintimille, le jour même de son arrivée, la hautaine et nonchalante Simonetta ; le fils de la Napolitaine et la Florentine croisèrent leurs regards comme deux épées, mais du choc l’étincelle ne jaillit pas. Politique, comme toutes celles de sa race, la jeune duchesse s’efforça de gagner à sa cause le fils de l’étrangère ; elle se fit maternelle, câline, prometteuse même, mais ne put fléchir l’hostilité grandissante d’Andréa. Alors, déjà lassée d’avance d’une lutte inutile, elle dédaigna cette fuyante conquête et retourna à ses plaisirs. Ce fut, au milieu d’une cour de musiciens, de peintres et de poètes, le règne absolu, voluptueusement despotique et fantasque d’une reine d’amour ; le duc épris laissait faire. Sourd à toutes les observations, passionnément aveugle, il répondait à toutes les malveillances par un seul mot : « C’est une Foscari », et le fait est que tous ces beaux jeunes hommes, tous Florentins comme elle, étaient plus pour Simonetta des animaux familiers, des jouets et des bouffons, que des êtres de sa race ; son orgueil la gardait contre la chaleur de son sang, et puis ses caprices se succédaient sans trêve : le favori de la veille était le lendemain en disgrâce. Quand l’un d’eux avait cessé de plaire, elle le chassait ou le mariait à une de ses suivantes. Guillaume de Borre, un troubadour provençal égaré à Vintimille et comblé pendant deux mois d’honneurs, avait dû fuir nuitamment et gagner à marche forcée la frontière pour ne pas épouser une vieille Piémontaise employée aux cuisines, qu’une lubie de la duchesse tout à coup lui imposait : la soudaineté de ses fantaisies déroutait tout soupçon.
Andréa Salviati, dépité, avait quitté Vintimille pour écumer la mer et tenir en échec les vaisseaux pirates qui dévastaient alors les côtes de Messine à Aigues-Mortes ; il était entré par forfanterie et rancune filiale au service du roi de Sicile, ennemi et parent de son père.
Le vieux duc, de plus en plus subjugué par sa jeune femme, vivait maintenant confiné dans l’ancienne partie du château en compagnie d’astrologues et d’alchimistes, créatures de la duchesse dévouées corps et âme à sa cause et qui (c’était la rumeur populaire) égaraient à plaisir dans les périlleuses recherches des sciences maudites la raison du vieux seigneur… Il fallait bien maintenant occuper l’attention de Bartholoméo, aveugler le vieil aigle amoureux, lui dérober enfin les déportements de la « Levrette », comme on appelait dans Vintimille la fine et souple fille des Foscari, au milieu de sa meute de dogues génois et de lévriers toscans, chiens couchants, chiens couvreurs.
Car le scandale était aujourd’hui public ; pis, il avait franchi la frontière et faisait la joie de la Provence, après celle de l’Italie ; la duchesse s’était débauchée. C’était une courtisane qui régnait maintenant à la cour des Salviati et, parmi tant de favoris, menu fretin qu’expédiait à la semaine le lacet des étrangleurs ou le poison des alchimistes, trois cependant, trois Italiens alliés dans le même intérêt de leur salut et de leur crédit, se partageaient les faveurs ducales : Beppo Nardi, un poète élevé à la cour d’Avignon et sonneur de sonnets de l’école de Pétrarque, svelte et fin cavalier au profil de camée, au glabre et fier visage toujours encapuchonné de velours écarlate, et dont la muse, aussi souple que son échine, célébrait chaque matin la glorieuse jeunesse de Simonetta ; Angelino Barda, musicien gratteur de mandoline, compositeur, à ses heures, de langoureuses canzones qu’il accompagnait d’une voix assez fraîche, d’origine napolitaine, celui-là. Brun comme une olive avec de larges yeux d’un blanc bleuâtre, d’ardentes lèvres sèches, des lèvres de fièvre et de volupté du noir violacé des mûres.
On disait cet Angelino de Naples singulièrement inventif en modes de plaisir ; et Petruccio d’Arlani, enfin, peintre-sculpteur à la manière de Michel-Ange, une brute superbe, musclé comme un athlète, aux noirs cheveux drus et crespelés sur une petite tête d’Antinoüs : Petruccio d’Arlani, un ancien pâtre, disait-on, descendu des Abruzzes dans les ateliers de Rome où il avait posé comme modèle, légendaire étalon des grandes dames romaines, qu’une ironie du Vatican, une idée d’après boire du Pape à la fin d’un souper aurait adressé à la cour de Vintimille entre deux légats et un nonce comme spécimen de l’art romain… Le ragazzo étant très beau, la duchesse l’avait gardé.
Son talent de sculpteur ne dépassait pas, d’ailleurs, les figurines de cire. Il avait déjà commis, d’après la Foscari, trois bustes de Pallas Victrix que la duchesse avait, chaque fois, impitoyablement saccagés, démolis ; mais comme le bélître avait un cou de taureau et des reins puissants, Simonetta le gardait toujours auprès d’elle dans l’espoir qu’un chef-d’œuvre éclorait quelque jour sous ses doigts de brute apprivoisée.
Et la Florentine continuait d’apprivoiser le pâtre des Abruzzes en compagnie de Nardi le poète et de Barda le Napolitain… Airs de guitare, sirventes et sonnets, bustes de cire peinte, c’était là l’atmosphère de volupté savante et de langueur heureuse de la cour de la belle duchesse au bord de la mer bleue, miroitante et pâmée entre les lauriers-roses et les palmiers des grèves, devant le grandiose et vaporeux décor de la vallée de la Roya.
Et Bartholoméo Salviati laissait faire. Les mires et les physiciens accaparaient le duc et de cette belle intelligence, de cette volonté sûre et prompte, de tout ce caractère de décision et d’audace du vieux capitaine enfin, si terrible autrefois aux ennemis de la patrie italienne, il ne restait plus qu’un vieillard en proie au plus dangereux entourage, un homme retourné à l’enfance ou presque. Ainsi l’avait voulu la jeune duchesse. Dix ans avaient suffi à Simonetta pour capturer le vieil aigle et en faire un hibou de laboratoire. Il ne quittait plus maintenant les fourneaux et les cornues au milieu desquels la belle Foscari l’avait confiné, et quand, par hasard, il sortait hors de la partie haute du palais qu’il avait adoptée, c’était pour assister, sur la prière de sa jeune femme, à quelque fête, comédie ou ballet, par elle organisée, et consacrer ainsi d’une présence auguste le luxe et les licences installés dans sa cour.
Et, sûrs de l’impunité, les favoris s’enhardirent, et l’audace de la duchesse osa même plus encore. Grisée par la flatterie et les encens, la Levrette eut la folie du scandale, elle voulut affirmer, afficher dans un éclat son adultère et ses amants… femme folle de son corps est bientôt dénuée de sens ; et, perdant toute prudence, conseillée par on ne sait quel mauvais génie, cette aventureuse Simonetta ne résolut rien moins que de paraître elle-même sur la scène devant toute la cour, à côté de ses trois favoris, qui tiendraient un rôle auprès d’elle, et cela dans une comédie ou ballet de circonstances, où s’affirmerait le talent de chacun d’eux.
C’était bravade de femme enivrée de puissance, défi d’orgueil et cri pâmé d’amour, et, pourtant, le projet fut arrêté et l’œuvre élaborée de longue date. La duchesse de Vintimille commanda la pièce à Nardi, la musique à Barda, mais en imposa le sujet ; Petruccio d’Arlani, peintre-sculpteur à ses ordres, se chargea des costumes et des décors, toutefois dirigé par elle. La Florentine ne s’en remettait à personne ; elle inspirait, fidèle en cela aux traditions des princesses de son pays ; et les plus sublimes artistes n’eussent été entre ses mains que d’obscurs collaborateurs.
Ce n’était ni le cas de Beppo Nardi, poète assez médiocre, ni celui d’Angelino de Naples, si parfait musicien, piètre compositeur ; quant à ce bélître de Petruccio, il n’avait ni goût, ni idée, ayant trop longtemps gardé ses chèvres sur les pentes de ses montagnes natales, mais la duchesse avait de l’imagination et de l’ingéniosité pour trois ; et quand le Nardi et le Barda lui apportèrent, enfin terminée, la Mort de saint Jean-Baptiste, qu’elle leur avait commandée, Simonetta cria au chef-d’œuvre, car, à travers les concetti d’une poésie toute d’assonances et de préciosité, elle avait reconnu son idée première, et les fades mélodies du Napolitain n’altéraient pas trop la belle horreur du drame qui avait tenté cette âme tragique. La duchesse jetait un collier d’or au cou d’Angelino, mettait le gros rubis d’une bague au doigt de Beppo Nardi, et tous deux, enthousiasmés, baisaient la main de Son Altesse ; le poète, comme le musicien, avait respecté le plan donné par elle, ses favoris avaient obéi.
La mort de saint Jean-Baptiste, la décollation du Précurseur, la légende de luxure et de sang dont toute la Renaissance italienne a eu comme l’obsession, Hérode et Salomé, les terribles figures qui ont tenté tous les peintres de cette époque et dont les musées nous ont légué la dangereuse hantise, voilà le sujet vers lequel avait été droit cette voluptueuse et tenace Foscari. Parmi tant d’héroïnes de la Bible et de la Fable, Salomé l’avait requise entre toutes ; et elle, née princesse à Florence et de par son mariage duchesse et marquise, c’était l’impudique princesse de Judée qu’il lui plaisait d’évoquer, d’incarner, de vivre un soir devant son peuple.
Cette petite fille qui danse, toute nue, devant un vieux roi libertin et obtient une tête ennemie par la mystérieuse offrande de son sexe, voilà le personnage qu’elle voulait être. C’était à la réalisation de cette chimère que se plaisait sa perversité, et qui sait si cette curieuse imagination d’Italienne n’avait pas été séduite par un rapprochement possible entre l’âge avancé de l’Hérode légendaire et la vieillesse anticipée de son mari !
C’était la mise en scène de la faiblesse sénile d’Hérode, mais réduite par un cerveau de femme à une vengeance de petite fille dépitée. La duchesse l’avait conçue en deux tableaux : d’abord la rencontre de Salomé et du Précurseur dans un des corridors du palais, le saint prisonnier entre deux gardes, la princesse peut-être moins apitoyée que curieuse, offrant d’abord à boire, puis tendant une fleur à l’ascète ; le refus dédaigneux du saint et, Salomé insistant, la fureur prophétique et l’anathème de Jean appelant le feu du ciel sur la tentatrice. Le second tableau montrait Hérode sur son trône, au milieu des dignitaires de sa cour, et puis c’était, sur son ordre, Salomé introduite et priée de danser, le sanglant marché débattu entre le tyran et la petite princesse ; puis, la danse meurtrière une fois exécutée, Hérode tenait sa promesse et le bourreau apportait sur un plat la tête du saint.
La Foscari distribua les rôles : Beppo Nardi, le poète, remplirait celui d’Hérode. Angelino de Naples, avec son ardente tête émaciée, serait le Précurseur ; sa maigreur, ses yeux luisants le désignaient pour incarner le farouche mangeur de sauterelles. Quant à Petruccio d’Arlani, sa haute taille et sa musculature énorme indiquaient assez son rôle, il serait le bourreau. C’est lui qui se tiendrait immobile, le cimeterre à la main, derrière le saint agenouillé pendant toute la danse ; c’est lui qui, saisissant le prophète aux épaules, l’emmènerait hors scène ; c’est lui, enfin, dont le bras musculeux, jailli de derrière un pilier, poserait la tête sanglante de saint Jean sur le plat… et, avec une joie enfantine, la passion fébrile et la science des détails que les femmes apportent en ces sortes de choses, la duchesse de s’occuper aussitôt des costumes, de la mise en scène et de la décoration de la salle, en quête d’étoffes d’Orient et de velours précieux… Des scribes, sur son ordre, écrivirent à Venise ; des marchands juifs furent mandés de Gênes pour soumettre à son choix des tapis de Damas et des soieries de Tyr. On fit venir à prix d’or des danseurs de Bergame, qui réglèrent les temps du pas de Salomé et apprirent à la duchesse à se mouvoir et onduler sur place, secouée de frissons brefs de la nuque aux talons, puis à oser des torsions de hanches et de subits renflements de seins, comme une almée des pays barbaresques… L’orchestre de la cour fut renforcé de quinze musiciens. Les vieilles tapisseries de la famille Salviati, représentant la vie de la Vierge, sortirent des coffres de bois de camphre où on les conservait, car elles étaient d’un prix inestimable et on ne les en tirait que pour les grandes fêtes, pour les mariages des ducs et les baptêmes des enfants mâles et encore des premiers-nés. La duchesse fit plus encore ; elle voulut la cour intérieure du palais comme salle de spectacle et, taillant à même les remparts de la citadelle, fit démolir vingt mètres de murailles qui dominaient la mer. Les pics et les pioches entamèrent les vieux blocs de granit qu’avait posés Uberto le Fort ; une grande baie s’ouvrit, lumineuse et bleue, sur l’infini du golfe, à une hauteur de vingt mètres, dans l’épaisseur même du mur ; ce fut là le théâtre. Les merveilleuses tapisseries des Salviati se drapèrent autour des estrades, s’empilèrent dans la cour, à l’ombre du donjon et des échauguettes, et, enfin, le jour du spectacle arriva.
Simonetta avait choisi le jour même de l’anniversaire de ses noces pour ce fastueux scandale. Un dais de brocart aux couleurs du duc se dressait en face de la scène, juste au milieu des estrades, réservé au vieux Bartholoméo et à sa suite de savants. Or, le spectacle était annoncé pour trois heures et la foule, entassée aux gradins, toute de têtes brunes et de vêtements clairs, s’impatientait, houleuse, et les places du duc restaient vides. Après une attente de trois quarts d’heure, la foule s’exaspérant, trépignante, l’orchestre entamait un concerto de violes et de flûtes et les tapisseries de la baie s’écartaient. Le duc Bartholoméo venait de faire savoir à la duchesse qu’elle n’eût pas à l’attendre, et qu’elle eût à commencer sans lui. Pris d’une faiblesse au moment de quitter ses appartements, il lui demandait dix minutes pour se remettre et viendrait certainement dans un quart d’heure au plus assister à la danse de Salomé ; il désirait vivement admirer la duchesse dans cette danse, l’admirer et l’applaudir ; et le spectacle commençait dans une légère angoisse, car, vraiment, la belle Simonetta n’avait jamais poussé l’audace si loin.
Sur la scène, debout contre une vieille verdure de Flandre, simulant les fresques d’un corridor, c’était, drapée de lourdes étoffes d’Asie, enturbanée de longs voiles bleuâtres, la silhouette onduleuse et fine de la duchesse en princesse de Judée. Elle tendait tour à tour à saint Jean-Barda une rose, puis une coupe et l’enveloppait, amoureuse et lascive, de la nudité de ses beaux bras… Puis les tapisseries retombaient ; et, dans la salle improvisée, aucun duc n’avait encore paru. C’étaient maintenant, chuchotées aux oreilles des femmes, des indiscrétions sur la surprise que le second tableau réservait : une effroyable tête de cire modelée par d’Arlani d’après Barda lui-même, la ressemblance du musicien peinte et coloriée avec le sang du supplice et la lividité de la mort, et que la duchesse offrirait à tous à la fin du tableau, triomphalement exhaussée sur un plat.
Et, les tapisseries s’étant relevées, ce fut, sur le bleu du ciel et sur le bleu du golfe emplissant de clarté toute la cour du palais, la vision d’Hérode, de Nardi lourd de pourpre et coiffé d’une mitre, installé sur un trône avec, autour de lui, nettement découpé sur le ciel et la mer, tout un rang de seigneurs et d’esclaves. La haute stature du sculpteur presque nu les dominait tous ; un d’Arlani superbe dans l’étalage de ses muscles et de son torse, ceint d’une étoffe blanche à partir des reins seulement… et, sur des pizzicati de mandolines, sur un rythme léger et sautillant, on eût dit, de clochettes, sur une musique étrange, en vérité, mêlée çà et là d’appel de flûtes et de langueurs raclées de guzlas, Salomé faisait son entrée… Salomé, c’est-à-dire la duchesse Simonetta gainée dans un étroit fourreau de soie verte, une soie mordorée et luisante comme une peau de couleuvre, avec, çà et là, épanouies, d’énormes rosaces de jais noir.
Un étroit gorgerin, émeraudes et saphirs, lui écrasait les seins et, les épaules et les bras nus jaillis comme des fleurs hors de cette gaine bleuâtre, chacun de ses mouvements découvrait ses aisselles et chacun de ses pas le haut de ses jambes nues, car l’étroite robe verte s’ouvrait, fendue jusqu’à la hanche, heureusement alourdie par d’épaisses franges d’or.
La face aux yeux agrandis et bleuis par le kôhl, d’une pâleur de morte sous le fard, hallucinait comme un masque ; de lourdes pendeloques tremblaient sur le front, apparu tout étroit sous les cheveux coiffés en tiare, un cône de ténèbres alourdi de poudre bleue et, tel un firmament, constellé d’étoiles d’or. Elle s’avança raidie, comme figée dans sa parure et ses orfèvreries, et d’une opale, posée entre ses seins, pendait au bout d’un fil de perles, plus bas que le nombril, presque à la naissance du sexe, une grande fleur d’émail.
Elle dansa et, dans ses grands yeux fixes, dans son sourire muet montait comme une épouvante ; et, suivant la direction de ce regard, toute la salle, qui la buvait des yeux, se retourna. Le duc venait de prendre place. Le vieux Bartholoméo venait de s’asseoir sous son dais et, près de lui, debout dans une pose de respect, le poing sur la hanche, mais l’œil plein de menace, se tenait Andréa, Andréa Salviati, le proscrit, l’exilé, le fils tombé en disgrâce, l’ennemi de retour.
C’était lui que regardait Simonetta. Hérode sur son trône, saint Jean agenouillé derrière la danseuse, le bourreau debout auprès de sa victime avaient baissé la tête. Les yeux droits fixés devant elle, comme hallucinée, Simonetta dansa, mais quand, suivant son rôle, la danse enfin terminée, elle se tournait vers Hérode pour lui demander la tête du blasphémateur, un grand cri jaillit de toutes les poitrines et la duchesse, la bouche grande ouverte, elle, ne put pas trouver un cri dans sa gorge.
Le duc venait de se lever, une main sur l’épaule de son fils et de l’autre avait fait un signe… trois têtes coupées gisaient aux pieds de Simonetta. Des soldats, apostés parmi les figurants, avaient strictement exécuté l’ordre : un triple coup de hache avait décapité saint Jean, le bourreau et Hérode, un même châtiment avait frappé Nardi, d’Arlini et Barda.
« Ils ont payé », ce fut les seules paroles du duc en se retirant.
Le soir de cette même journée, une femme se réveillait, revenait à elle dans les ténèbres vacillantes d’une cellule illuminée de cierges, une cellule à la porte et à la fenêtre murées, car la condamnée, qui gisait là inerte, ne devait jamais en sortir. À ses pieds, trois têtes sanglantes s’entassaient sur un plat, trois têtes de jeunes hommes aux prunelles révulsées, aux cheveux hérissés demeurés droits d’effroi, trois têtes livides sous leur fard ; et la femme, encore toute scintillante de joyaux et de soie, ayant fait un instinctif mouvement de recul, fit glisser de sa robe un parchemin scellé aux armes des Salviati, et Simonetta Foscari, ayant pris dans ses mains l’écrit tombé à terre, le déplia et lut cet adieu d’un vieillard :
« Vous les avez aimés vivants, aimez-les morts, madame. Il vous a plu de vivre avec eux et pour eux, il vous sera doux de mourir avec eux que vous avez fait mourir » ; et la duchesse, ayant tourné la page, trouvait ces lignes consolatrices : « Et moi aussi je vous ai aimée, Simonetta ; je m’en souviens et j’ai pitié. Leurs lèvres sont empoisonnées. »
MASQUES DANS LA TAPISSERIE
À Gabriele D’Annunzio.
L’INUTILE VERTU
Voilà trois longs jours qu’il chevauchait le long des dunes fleuries de chardons pâles, aucune voile ne blanchissait à l’horizon : c’était, de l’aube au soir, la monotone immensité d’une mer calme, d’une mer sans ride, couleur d’ardoise, sous le morne éclat d’un ciel blanc ; parfois, son cheval s’arrêtait brusque, les sabots en avant, et hennissait vers la mer, et, dans un soyeux effarement d’ailes, des goélands dérangés de quelque trou de falaise tournoyaient très haut dans l’air, puis s’évanouissaient, et le sable roux se moirait de leur ombre.
Et le jeune homme ne relevait même pas la tête. Le front grave sous le vol déployé de l’aigle de son casque, il cheminait pensif au pied de la falaise. C’était une haute muraille de schiste courant ainsi depuis des lieues le long de la mer triste ; des herbes desséchées presque mauves pendaient comme des chevelures à mi-flanc du roc, des chevelures mortes, et quelques rares oiseaux de mer, seuls, les habitaient.
Le soir, les falaises devenaient roses, les dunes elles-mêmes s’enflammaient dans l’incendie du couchant et le jeune homme, mettant pied à terre, laissait son cheval brouter les chardons bleus des sables et cherchait à tromper sa propre soif, sa faim aussi, en mordant à même la chair salée de quelques coquillages. Et puis sous la lune montante il poursuivait son chemin.
Dans le cloître où il avait été élevé sur l’ordre de la reine sa mère, il avait fait le vœu de retrouver, mort ou vif, le chevalier au poil clair auquel il devait la vie. Bertram était le fruit d’une faute.
Bâtard adultérin de la reine d’Aquitaine, il avait été couvé et nourri comme l’idée même de la vengeance ; la princesse adultère avait juré de faire retrouver par le fils de sa luxure l’infidèle amant qui l’avait abandonnée. Un couvent de Barnabites avait vu grandir le jeune prince ; la reine avait présidé à son éducation, invisible, masquée, inconnue de ce fils qu’elle destinait à un dénouement tragique. Les moines avaient élevé l’enfant durement, dans la haine de l’amour, de la femme et de tout ce qui rit et fleurit sous le ciel ; le jeûne et la prière avaient fait une âme rude à ce fils de reine. Bertram portait un cilice sous son armure damasquinée et une triple corde de chanvre serrée autour de ses reins. Et puis, un beau matin, enivré d’un philtre, la paume des mains et la plante des pieds frottées de sang de louve, on avait lâché le jeune vengeur à travers la campagne. « Tu reconnaîtras l’homme qui fit ton enfance obscure et mortifiée à la triple émeraude qui brille enchâssée dans le cimier de son casque. Que son poil soit de neige ou d’or, frappe et tue, et tu auras vengé et ta vie humiliée et ta mère et ta race et ton Dieu. »
Ces fatidiques paroles, une voix de rêve les avait prononcées dans la chapelle du couvent où Bertram avait passé sa veillée d’armes ; une forme dissimulée dans l’ombre avait dicté l’arrêt, et le lendemain, dès l’aube, Bertram avait gagné la campagne, ganté, cuirassé, masqué d’argent niellé du cimier de son casque à l’étoile de ses éperons, avec, au-dessus de son morion, le double éclair d’or fauve d’un aigle énorme battant des ailes.
Montée dans le clocher du couvent, une femme l’avait suivi longtemps des yeux dans la rougeur du jour naissant ; quand la silhouette du jeune aventurier eut disparu, dans la bruyère, la reine était allée se prosterner devant le maître-autel et la nuit l’avait surprise, marmonnant et priant.
Et, maintenant qu’il chevauchait sous le clair de lune argentant la mer calme, le souvenir d’étranges rencontres opprimait le jeune guerrier.
Ç’avait été d’abord, le troisième soir après son départ du cloître, l’apparition de ces trois jeunes filles à la lisière d’un bois, les trois filles du vieux seigneur, comme elles s’étaient nommées elles-mêmes en le saluant familièrement par son nom. Assises à l’entrée de la forêt, elles s’étaient levées à sa vue et avaient cherché à enguirlander de fleurs la bride de son palefroi. Elles étaient inviteuses et enjouées avec des chaperons d’anémones sur leurs tresses mouvantes et elles semblaient nues sous leurs tuniques neuves de soie ramagée. Debout dans la rosée, elles l’avaient enveloppé de leur groupe comme d’une ronde légère ; et de leur attitude, de la caresse de leurs regards, de leur voix, de leurs bras souples et frais avaient tenté de le retenir ; mais lui avait poussé rudement son cheval en avant au risque de les renverser ; les elfes des prairies ont la coutume d’apparaître ainsi, le soir, aux voyageurs, et il avait piqué des deux sous la ramure, farouche, volontairement sourd à leur appel.
Il avait chevauché deux nuits et deux jours dans la forêt de chênes, et puis les hauts ombrages avaient fait place à de vastes clairières, les clairières à de mornes plaines traversées de rideaux de trembles ; des étangs y miroitaient entre les grandes herbes et des vapeurs y flottaient nuit et jour, tissant autour d’équivoques troncs de saules des apparences de linceuls ; puis, il était entré dans un pays de tourbières et de marécages, où le sol noirâtre cédait sous les pas. Et, une nuit sans lune qu’il longeait un de ces marais lugubres, son palefroi s’était tout à coup cabré sous lui et Bertram, ayant levé les yeux, avait aperçu, debout sur l’eau plombée, une nudité surnaturelle et livide.
C’était un corps de femme d’une effrayante pâleur, mais une étrange extase noyait ses yeux et son sourire ; elle avait surgi comme un feu follet au-dessus d’une touffe de nénuphars et souriait enivrée, comme tordue dans un spasme, les seins cabrés, la bouche ouverte, un petit miroir d’argent à la main.
Une lune imprévue avait jailli en même temps derrière les oseraies et, comme toute nacrée de reflets, la morte bienheureuse barrait le passage au jeune homme, lui tendant à la fois et sa bouche bleuie et l’argent du miroir. Un vieux saule ébranché avait tout à coup reflété dans l’étang la silhouette d’un faune, et le jeune guerrier, ayant repoussé avec horreur le cadavre impudique, une énorme grenouille avait sautelé brusque d’entre les herbes et plongé dans l’eau blême avec un bruit mat.
Et Bertram, tout en marchant le long des sables, songeait à tous ces sortilèges, à tous ces pièges et à toutes ces illusions.
Que lui voulaient ces masques de l’ombre, ces figures errantes dans la nuit, et quel était le symbole de toutes ces tentations ?
Et il s’avisa qu’une galère silencieuse, dont il n’avait perçu ni le froissement des voiles, ni le battement des rames, longeait la grève en même temps que lui ; les hautes mâtures, les agrès et les vergues se détachaient en transparence dans les ténèbres, et on eût dit un navire de songe, car il glissait sur l’eau plus qu’il ne fendait la vague et tout semblait sommeiller à son bord. Pas un matelot sur le pont. Bâtiment à l’abandon ou vaisseau fantôme ? La vague ne clapotait même pas autour de ses flancs et, couleur de cendre, il s’avançait mystérieusement, côte à côte avec lui, et Bertram se serait cru le jouet de quelque autre vision s’il n’avait distingué, accoudé à la proue, un immobile vieillard, le pilote sans doute, et dont les doigts tourmentaient une lyre, mais une lyre enchantée, car les cordes touchées ne rendaient aucun son.
Et quand parut le jour, Bertram se trouva dans un pays tout de vallonnements et de petites collines coupées de haies vives et de clos de pommiers : le vaisseau fantôme, la grève de sable rose et la haute falaise s’étaient évanouis, et le jeune aventurier, qui commençait à ne plus s’étonner de rien, piqua des deux à travers les pâtures et les haies d’aubépine de cette campagne de vergers. C’était d’ailleurs la plus profonde solitude. On y sentait la mer proche à la nuance du ciel, balayé de nuages, et aux pommiers tordus par le vent, et il chevauchait déjà depuis cinq longues heures dans une espèce de chemin creux, quand une belle dame lui apparut.
Elle était toute vêtue d’un brocart semé de feuilles de tremble, et svelte et droite comme un lis, montait à cru une licorne, une élégante et fabuleuse bête de rêve au poil luisant comme du métal.
La dame à la licorne portait sur ses cheveux noirs un casque d’or surmonté d’une petite couronne, et, tel un chevalier, tenait une lance en arrêt.
Elle barra le passage au jeune sire et, tandis qu’elle le menaçait de sa lance, elle démentait sa mauvaise intention d’un sourire et désignait du doigt à Bertram une énorme rose rouge saignant à sa ceinture ; mais lui n’avait que son idée de meurtre en tête ; il écartait du revers de l’épée la lance en fin acier de la belle guerrière et passait outre.
La belle dame lui fouettait au passage la figure avec la rose de son gorgerin, mais c’est une rose sèche qui s’effeuilla et le jeune homme, s’étant retourné surpris, ne vit plus qu’une vieille femme qui fuyait au galop sur un âne. « Encore quelque embûche du Mauvais ! » pensa-t-il en lui-même et il poursuivait sa route un peu triste, un peu plus las.
Il arrivait enfin devant une espèce d’auberge ; une branche de pin en ombrageait la porte et trois belles filles se tenaient devant le seuil. Les seins libres dans des casaquins de bure, nu-tête et pieds nus, elles riaient, robustes, dans le chaud crépuscule. L’une filait à la quenouille ; l’autre, penchée sur une auge de pierre, y faisait rouir du chanvre ; quant à la troisième, à la vue du jeune homme, elle rentrait précipitamment dans l’auberge, mais pour en ressortir avec une cruche de vin. Elle offrit à boire à Bertram et les deux autres le pressaient de descendre.
Elles sentaient la sueur, le pain et la lavande, mais Bertram les repoussa. Elles rentrèrent alors avec de grands éclats de rire, fermèrent la porte de l’auberge, et le jeune homme demeura seul sur le grand chemin.
Or, sa monture s’était approchée de l’auge pour y boire et, comme le palefroi s’y abreuvait, Bertram qui s’était penché en avant poussa un cri.
L’aventurier royal venait de s’apparaître à lui-même, le fond de l’auge avait fait miroir, et c’est une face de vieil homme qui lui souriait, la face d’un vieux guerrier à longue barbe blanche, au regard las et triste, au pardonnant sourire ; une blême face de jadis ceinte d’un casque d’or où larmaient trois émeraudes, et Bertram reconnut l’homme qu’il devait frapper.
C’est lui-même alors qu’il devait tuer en frappant son image, et, le cœur étreint d’une tristesse infinie, Bertram comprit qu’il était devenu vieux. Ces cheveux blancs étaient les siens, ces yeux ternes, hélas ! étaient devenus ses yeux et il comprit, trop tard, qu’il avait couru à une impossible aventure. Il faut vivre sa vie sans dédaigner l’amour, la volupté, le plaisir et même l’occasion qui passe, et il s’était leurré d’un mirage trompeur, comme le pilote du silencieux navire… Et il ne fallait plus songer à retourner en arrière… car toute heure fuit, irréparable.
MÉLUSINE ENCHANTÉE
I
Si doucement enivrait les regards,
Resplendissait de blancheur si divine,
Que son peuple la chassa de sa ville, la belle Mélusine,
À cause de ses yeux couleur d’aigue-marine,
Des feux rosés de sa poitrine
Et des beaux cheveux roux sur son long col épars.
Longtemps loin des cités, qu’entourent les remparts,
Par les forêts erra la belle Mélusine,
Effarée et pleurant ; sa robe de brocart
Se déchirait aux taillis d’aubépines
Et ses pieds nus saignaient parmi les herbes fines
Des clairières des bois, où paissent les brocards.
Elle parvint ainsi dans le pays des fées,
Dans les landes d’or où verdoient les houx,
Et là ses yeux bleus virent que les loups
La suivaient en troupe, et que les nuées
Errantes, la lune et jusqu’aux hiboux,
S’arrêtaient au ciel quand par les champs roux
Elle faisait halte…
Raymondin de Lusignan s’éveilla. Le petit bois de frênes, où il s’était endormi, pleurait doucement sous la pluie et à l’horizon noyé de brumes les landes de bruyère s’étendaient à perte de vue ; la voix qui chantait s’était tue ; aussi loin qu’il pouvait promener son regard, c’était le silence et la solitude.
Depuis combien d’heures dormait-il là dans ce bouquet de bois sauvage et qu’étaient devenus les gens de sa suite ? Comme un grand trouble s’était fait en lui, et, assis dans la bruyère, il se tâtait curieusement les bras et les côtes, les tempes moites de sueur, inconsciemment heureux de cette pluie.
Si doucement enivrait les regards,
Resplendissait de blancheur si divine,
Que son peuple la chassa de sa ville, la belle Mélusine !
La chanson le poursuivait et, ses doigts ayant rencontré le cor d’ivoire pendu à sa ceinture, voilà que maintenant il se souvenait d’avoir traversé la bruyère en plein soleil dardant, sur le coup de midi. Une étrange torpeur, un invincible accablement l’y avait saisi et il y avait cédé, puisqu’il s’y retrouvait assis, sept heures après, au crépuscule, le front nu sous l’averse et le cœur obsédé d’un nom qu’il n’avait jamais entendu : Mélusine ! Mélusine ! ce nom si doux qu’il semblait caresser les lèvres comme des lèvres et griser la pensée comme un philtre. Il était pourtant bien seul ; personne dans les dix lieues de genêts et de bruyères fuyant, grises de pluie, vers les coteaux qui fermaient l’horizon, et la chanson bourdonnait encore à ses oreilles, la chanson et la voix timbrée qui la chantait. À ce moment, avec un brusque effroi d’ailes, une corneille s’enlevait au-dessus de sa tête et Lusignan se rappelait alors une petite vieille loqueteuse et ridée, rencontrée ramassant des branches sèches au pied moussu des frênes, à l’heure même où il entrait dans le bois.
Une vieille femme à midi, au crépuscule une corneille !
Lusignan, grand chasseur de loups et tueur de sangliers, savait juste réciter en latin un Ave et un Pater ; il les disait à l’instant même, flairant dans ce long sommeil quelque piège de fées.
Les légendes ne les font-elles pas danser, la nuit, dans l’air violemment embaumé des landes de genêts comme dans la brume clair de lunée des étangs et, s’étant dévotement signé trois fois, le comte se levait, d’un haussement d’épaules secouait la pluie restée sur son bliaud de pourpre et, s’orientant d’après les dernières lueurs du couchant, piquait droit devant lui à travers la bruyère, du côté de son burg.
II
« Et les fées jalouses l’ont changée en serpent ; son impérieuse beauté, qui charmait les oiseaux du ciel et les bêtes errantes dans les bois, épouvante aujourd’hui la solitude.
« Transformée en hydre monstrueuse, elle sommeille le long des jours au soleil, repliée en rond sur elle-même dans l’herbe roussie des landes ; la nuit, elle rampe tristement dans la pierraille argentée par la lune des torrents desséchés, et ses sifflements de regrets éveillent les échos de ravins en ravins.
« Où cela ? Très loin et tout près, ici et là, dans le pays des fées, qui veillent invisibles sur leur prisonnière, dans les landes d’or, où verdoient les houx et que vous avez cent fois traversées sans soupçonner que les malignes dames riaient dans la broussaille, assises en cercle autour de vous.
« Dans le pays des fées, où l’hydre ensorcelée attend depuis cent ans le chevalier hardi qui, l’étreignant des deux mains à la tête, osera baiser ses lèvres visqueuses où réside la mort.
« Les fées jalouses l’ont changée en serpent ; son impérieuse beauté, qui charmait les oiseaux du ciel et les bêtes errantes dans les bois, épouvante aujourd’hui la solitude.
« Seules les lèvres d’un homme rompront l’enchantement, mais le héros promis, l’hydre l’attend encore. Quand dans la rousse bruyère accablée de chaleur le serpent léthargique se dressera-t-il sur sa queue en sifflant, étreint au cou par son libérateur ? Quand la vierge, enfin délivrée, jaillira-t-elle nue comme une perle et blanche comme l’écume hors de l’écaille du monstre ?
« Le charme est dans la beauté qui sommeille, captive en la gaine squameuse et bruissante de l’hydre ; la délivrance est dans le baiser du héros à l’âme assez trempée pour boire le poison et affronter la mort.
« À celui-là puissance et nombreuse lignée, à celui-là fortune et renommée, il fondera héroïque et princière maison. »
Et la voix s’éteignait comme étouffée dans l’épaisseur du mur. Raymondin, qui dormait, les bras en croix sur la poitrine, dans le grand lit de chêne blasonné à ses armes, se dressait moite sur son séant. Cette voix de songe n’avait pas prononcé un nom et pourtant une conviction le poignait, que la chanson parlait de Mélusine, Mélusine encore et Mélusine toujours. Il prêtait l’oreille et, croyant entendre des voix marmonner sous la fenêtre, il se levait, courait pieds nus sur les dalles jusqu’à l’étroite verrière donnant sur la campagne et brusquement en ouvrait le vantail : dehors l’aube se levait à peine, une aube blême et froide de fin d’octobre : un linceul de brume flottait sur la vallée devenue semblable à une mer de vapeurs, çà et là quelques sommets de collines en émergeaient à demi sombrés.
Et Lusignan, s’étant penché en dehors, apercevait debout dans le brouillard, au pied même du donjon seigneurial, une sorte de mendiant à la barbe et à la chevelure tressées comme celles des bohémiens.
Des boucles de cuivre aux oreilles, drapé dans un manteau d’étoffe à larges raies, il appuyait ses mains sur un bâton et, l’œil étincelant sous de broussailleux sourcils, il chuchotait, la bouche pleine de paroles confuses, et semblait, à ses gestes, parlementer avec des soldats que lui, Lusignan, ne pouvait voir, mais supposait de garde à la poterne.
Et Lusignan appelait et donnait ordre qu’on lui amenât immédiatement le vieillard. Son écuyer revenait presque aussitôt, tête basse ; il n’avait vu personne au pied de la tour. Monseigneur avait dû être le jouet de quelque songe, la sentinelle de garde à la poterne du burg n’avait entrevu qui que ce fût depuis la veille au soir.
Dépité, Raymondin retournait à la fenêtre. L’équivoque mendiant à la barbe tressée n’y était plus ; vision du petit jour, il s’était évanoui dans la brume.
C’est alors que le doux sire tombait dans une profonde mélancolie.
À partir de ce jour tout ce qui l’intéressait auparavant, le maniement des armes, le tir à l’arc, la joute à la lance et jusqu’au plaisir de la chasse, chasses au faucon à travers plaines et battues dans les forêts profondes pour le cerf et le sanglier, tout ce qui était la joie de sa vie de jadis cessa soudain de l’occuper. Il errait le long des jours, veule et morne, à travers les campagnes, inattentif au pas de sa jument, la laissant aller à l’aventure à travers les broussailles comme à travers les récoltes, plus pareil à un fantôme chevauchant en expiation quelque bête de rêve, qu’à un honnête et loyal chevalier. Les soirs, il rentrait harassé et s’asseyait, sans desserrer les lèvres, à la table seigneuriale où il n’écoutait même plus le bénédicité du chapelain ; le dimanche, c’est à peine s’il entrait à l’église. Il ne savait plus ni s’agenouiller, ni s’asseoir et ses amis ne le reconnaissaient plus. Il maigrit, devint hâve et pâle, laissa croître sa chevelure et sa barbe : elles débordèrent, poussiéreuses et touffues, de dessous son casque et, la nuit, il se levait en sursaut pour arpenter, sous le vent comme sous la pluie, le chemin de ronde des remparts ; on eût dit qu’il écoutait des voix, et les sentinelles redoutaient de le voir passer, à minuit, auprès d’elles, marmottant des paroles confuses ; et dans le pays l’opinion s’affirmait que des gens de Bohême lui avaient jeté un sort.
Or, à une année de là, par une accablante journée d’août, comme il revenait au crépuscule d’une de ses courses lointaines et sans but dans lesquelles il consumait désormais sa vie, sa jument, qu’il laissait aller la bride sur le cou selon son habitude, avait un brusque soubresaut qui l’éveillait de sa torpeur ; il se dressait en selle et ouvrait grands les yeux. À quelques pas devant lui, dans la vaste plaine nue, trois femmes ou plutôt trois formes de femmes s’agitaient et semblaient danser autour d’un grand feu d’herbes sèches. L’air de vieilles mendiantes sous des loques singulièrement lumineuses, elles secouaient frénétiquement de maigres bras nus au-dessus de la flamme et avec de sauvages éclats de rire, qu’on entendait moins qu’on ne les devinait aux contorsions de leurs corps, elles tournoyaient dans la fumée, comme transparentes, plus claires que l’atmosphère même de cette claire journée d’été, couleur d’ambre sur la rougeur enflammée du soir.
Elles prononçaient trois fois son nom et s’évaporaient dans l’air, et Lusignan songeait alors à la petite vieille du bois de frênes, puis au mendiant bohémien entrevu au petit jour à la poterne du burg.
Mais quelle était la troisième ? Car il avait bien reconnu les deux autres, mais ce qu’il ne reconnaissait pas et ce qu’il s’épouvantait de ne pas reconnaître, c’était la contrée où sa jument l’avait conduit. Ces mouvements de terrain, ces arbres grêles à fleur du sol et cette chaîne de montagnes à l’horizon lui étaient inconnus ; une grande tristesse le prenait dans cette solitude ennemie. Il n’était plus dans la plaine immense de tout à l’heure, il avait devant lui une lande inculte et ravinée, fleurie de chardons nains et de hautes fleurs mauves avec, çà et là, des décombres de temple et de fûts de colonne jonchant le terrain ; et quoiqu’il n’y eût pas un souffle de vent dans l’air, les mauves d’un rose mort et les chardons hostiles frissonnaient tristement sur un ciel rouge et vert, d’un vert de plaie et d’un rouge de sang.
Et, ayant poussé sa monture en avant, sa jument cette fois refusa d’obéir et Lusignan, s’étant penché pour voir l’obstacle, aperçut à ses pieds le serpent.
D’un vert pailleté d’or, qui sous le ventre devenait de l’azur, l’hydre sommeillait enroulée sur elle-même sur un lit de feuilles sèches : sa tête triangulaire et fabuleusement petite bâillait, montrant dans sa gueule noire un triple rang de dents aiguës, et six lourds colliers bossués de pierreries l’étreignaient de place en place pour indiquer qu’elle était de naissance royale. Sa tête reposait sur un grand lis de pourpre et Lusignan, ayant mis pied à terre, attachait sa jument à un cyprès voisin, s’approchait à pas de loup et, saisissant brusquement le serpent à la tête, de toute la force de ses bras le soulevait à hauteur de ses lèvres et, malgré son dégoût, appliquait sa bouche à la gueule du monstre.
Brusquement éveillée, l’hydre avec un sifflement aigu s’était furieusement enroulée autour du doux seigneur. Elle avait enlacé l’homme et lui broyait les côtes de tout le poids de ses anneaux ; elle lui tenait les pieds serrés avec sa queue et lui figeait au ventre le froid de ses écailles.
Et sous l’affreuse étreinte et sous la langue fourchue qui dardait en menace, le guerrier oppressé défaillait et, glacé, buvait à pleines lèvres la bave et le venin du monstre : il les but par trois fois.
Alors, à travers la solitude, les hautes mauves s’effeuillèrent éperdues, et les chardons flambèrent d’un éclat métallique. Avec un long, long cri, la vierge délivrée avait surgi nue hors de l’enveloppe hideuse, et jeté ses bras au cou de son vainqueur, puis tout à coup elle avait baissé les yeux, ses grands yeux couleur d’ombre, devenue toute rose, rose depuis l’orteil de ses pieds nus jusqu’à la fraîche églantine de ses seins. Mélusine avait honte, se voyant sans vêtement.
Lusignan jetait alors son manteau de guerrier sur l’éclatante nudité de la vierge et, la baisant sur la moue de ses lèvres, l’asseyait en croupe derrière lui. La jument s’ébrouait et, vibrant de désir, le cœur inondé d’allégresse, le fier seigneur emportait sa rougissante proie par la rose bruyère du paysage redevenu familier.
Dans la broussaille les voix des fées chantaient : « À Lusignan puissance et nombreuse lignée ! À Lusignan fortune et renommée ! À Lusignan guerrière et royale maison ! » Le soleil tout à fait sombré avait disparu de l’horizon et un dernier rayon oblique allumait, comme un point d’or, la chevelure rousse de Mélusine, allant en croupe derrière son maître fonder la race des Lusignan.
MANDOSIANE CAPTIVE
La princesse Mandosiane avait six cents ans. Depuis six siècles elle vivait, brodée sur velours avec un visage et des mains de soie peinte ; elle était toute vêtue de perles avec un gorgerin si lourd de broderies qu’il en bossuait, et les arabesques de sa robe tramée d’argyrose étaient de l’or le plus fin.
Un manteau d’outremer fleuragé d’anémones s’agrafait sur sa poitrine par de véritables pierreries, et des cabochons de saphir ourlaient le bas de sa robe.
Elle avait figuré longtemps dans les processions et les fêtes royales. On la sortait alors, hissée à la hampe d’une bannière, et l’éclat de ses joyaux mettait les reines et le bas peuple en joie. C’étaient les temps heureux où par les rues pavoisées, sous le frisson des banderoles flamboyantes, on acclamait la princesse Mandosiane. Puis on la rentrait cérémonieusement dans le trésor de la cathédrale et on la faisait voir aux étrangers en échange de beaucoup d’or.
C’était aussi une merveille que cette miraculeuse princesse. Elle était née du rêve et du travail obstiné de vingt nonnes qui, pendant cinquante ans, avaient peiné à tirer des écheveaux de soie et d’argent la délicieuse et hiératique figure.
Ses cheveux étaient de soie jaune ; on avait incrusté à la place de ses prunelles deux tourmalines du plus beau bleu et elle tenait une gerbe de lis de velours blanc appuyée sur son cœur.
Puis l’ère des processions passa ; les trônes s’abolirent, les rois disparurent, la civilisation marchait, et la princesse de perles et de soie peinte demeura désormais confinée dans l’ombre de la cathédrale.
Elle passait là ses jours dans le clair-obscur d’une crypte avec un tas de choses bizarres grimaçant dans les angles. C’étaient de très anciennes statues, des hanaps à côté de ciboires, de vieux ornements d’église, des chapes encore raides et comme moirées de soleil et qui s’éteignaient lentement dans la nuit, avec des calices dans lesquels on n’officiait plus.
Il y avait aussi un vieux Christ adossé dans un coin et tout voilé de toiles d’araignées, et jamais on n’ouvrait la porte de la chapelle souterraine. Toutes ces vieilles choses dormaient là, enterrées, oubliées, et un grand désespoir prit la princesse Mandosiane au cœur.
Et elle prêta l’oreille aux conseils de la souris rouge, une insidieuse petite souris vive comme l’éclair et tenace et volontaire, qui déjà depuis des années l’obsédait. « Et pourquoi t’obstiner à demeurer captive, cuirassée dans toutes ces perles et ces broderies qui t’enserrent ? Ce n’est pas une vie que la tienne. Tu n’as jamais vécu, même au temps où tu resplendissais sous le ciel bleu des fêtes carillonnées, acclamée par l’ivresse des foules, et maintenant, tu le vois, c’est l’oubli, c’est la mort. Si tu voulais, avec mes dents pointues je déferais un à un les points de soie et de cordonnet d’or qui te tiennent fixée depuis six cents ans immobile dans ce velours miroité qui n’a plus, entre nous, grand éclat. Cela te fera peut-être un peu mal, surtout quand je découdrai près du cœur, mais je commencerai par les longs contours, ceux des mains et ceux du visage, et tu pourras déjà t’étirer et te mouvoir, et tu verras comme c’est bon de respirer et de vivre ! Belle comme tu l’es, avec ton visage de princesse de conte et riche des fabuleux trésors dont resplendit ta robe, tu te feras habiller chez les plus grands faiseurs, on te prendra pour la fille d’un banquier et tu épouseras pour le moins un prince français.
« Tu as sur toi pour des millions de pierreries ! Viens ! laisse-moi te délivrer, tu révolutionneras le monde.
« Si tu savais comme c’est bon d’être libre, de respirer dans le vent à pleins poumons et de suivre sa seule fantaisie ! Tu es bardée dans ces opales et ces saphirs, comme un chevalier dans une armure, et tu n’as même jamais combattu. Je connais des chemins, qui conduisent au pays du Bonheur. Laisse-toi épanouir hors de ta gaigne de broderies ; nous ferons le tour du monde ensemble et je te promets un trône et l’amour d’un héros. »
Et la princesse Mandosiane consentit. La petite souris rouge commença aussitôt son œuvre meurtrière ; ses dents sciaient, coupaient, limaient dans le velours mangé par les mites ; des perles tintaient en tombant une à une, et, les nuits au clair de lune comme par les beaux ciels de soleil, dans la crypte éclairée d’un jour de soupirail, la souris rouge coupait, mangeait, s’occupait toujours.
Quand elle attaqua le fameux gorgerin de nacre et de perles, la princesse Mandosiane eut l’impression d’un froid aigu au cœur.
Depuis plusieurs jours déjà, elle se sentait comme frissonnante et plus légère et, singulièrement souple au milieu de tous ces points défaits, elle ondulait dans l’étoffe, comme animée d’un souffle, et attendait, ravie, que la souris eût accompli son œuvre.
À la dent du rongeur s’enfonçant dans sa poitrine, la pauvre princesse de paillons et de soie, cette fois, défaillait toute. Ce fut comme une coulée de cendre sur les dalles de l’obscure chapelle, la tombée molle de floconneuses soies, de galons déchiquetés et de lumineuses chiffes ; quelques cabochons roulèrent comme des grains de blé, et le vieux velours miteux de la bannière se déchira du haut en bas.
Ainsi mourut la princesse Mandosiane pour avoir écouté les insidieux conseils d’une petite souris.
ORIANE VAINCUE
Oriane la fée était l’effroi du pâtre,
Vaguement entrevus dans son antre bleuâtre,
Dormaient, las et charmés, des preux casqués d’orfroi.
La lune pénétrait dans la caverne, pailletant de lueurs bleuâtres les parois de la roche incrustées de mica ; une mouvante tombée de lierre en obstruait l’entrée, piquée çà et là de larges fleurs de clématites, pareilles à des étoiles : inextricables et souples mailles de feuilles et de corolles à travers lesquelles la clairière et la forêt apparaissaient toutes blanches du blanc frissonnement de l’astre sur les cimes pâles des châtaigniers.
Soutenue par trois pilastres de basalte, la grotte s’enfonçait dans un clair-obscur de songe, envahie de toute part de gui, de chèvrefeuille et de hautes fougères dont les palmes dentelées brillaient étrangement ; partout, des fissures des voûtes, des crevasses des piliers et de celles du sol, une inquiétante végétation avait jailli. C’étaient des ronces, des églantines, des traînées de houblon, d’écumantes ciguës et de larges bardanes aux feuilles de velours glauque ; et tout cela s’enchevêtrait, grimpait, retombait, s’étreignait plante à plante et rampait sur la mousse, palpitant vaguement du tremblement des tiges et de la vie des sèves sous le bleu clair de lune glissé là du dehors.
Parfois, dans les châtaigniers de la clairière susurrait un bruissement léger qui était la respiration de la forêt dormante, puis la brise allait plus loin tourmenter quelques nids dans les halliers, et un grand hennissement déchirait le silence : un troupeau de cavales sauvages passait au galop, la croupe moirée sous la lune, entre les feuilles remuées.
La forêt était remplie de ces troupeaux de cavales et d’étalons indomptés ; ils la sillonnaient dans tous les sens avec un grand bruit de branches fracassées. Ils erraient à l’aventure, le poitrail blanc d’écume et la crinière éployée, rassemblés autour du plus vieil étalon de la bande et, les nuits de printemps, à l’époque du rut, ils combattaient furieusement jusqu’à l’aube et se mordaient au ventre avec des hennissements : les nids s’en effaraient dans les taillis et les chevreuils dans les fourrés, et la forêt était inabordable à cause de ses innombrables chevaux sauvages qui la gardaient, prompts à se ruer sur l’homme et à le piétiner.
Dans la caverne, les ronces et les hautes fougères continuaient de sommeiller, des gouttelettes d’argent perlaient aux feuilles des chèvrefeuilles éclairés par la lune. Dans les mailles du lierre les fleurs des clématites semblaient s’ouvrir plus grandes ; et comme des flocons de givre brillaient épanouis dans les touffes de ronces, sous lesquelles des lueurs s’allumaient maintenant d’ors rougeâtres et d’aciers ; et voilà que dans l’enchevêtrement des épines et des bardanes jaillissait une magique floraison d’épées. C’étaient des glaives celtiques à la poignée énorme, des épées gothiques à deux tranchants, toutes droites, des épées sarrasines à la lame recourbée, des lances anglo-saxonnes et jusqu’à des framées.
Et voilà que surgissaient aussi, comme oubliés là après une bataille, des arcs détendus, des carquois et des flèches piquées, çà et là, dans les branches comme d’hostiles fleurs ; et voici que les ronces balançaient maintenant au-dessus du sol des boucliers et des casques où la lune se reflétait ainsi que dans des miroirs ; des pétales s’y effeuillaient d’églantines charmées et, sous cette flore de fer, émergeaient lentement, extasiées dans l’ombre, des faces de guerriers endormis.
Crânes tondus ras et lourdes boucles blondes, profils camards et sourires lippus de hardis païens à la peau basanée, longues paupières laissant filtrer le regard bleu, à jamais immobile, de quelque fils de race normande, épaules trapues de guerriers goths, torses minces et musclés de cavaliers saxons, barbes chenues de vieux routiers et visages imberbes et roses, presque angéliques, de jeunes pages, ils sont bien cent endormis là dans la grotte aux reflets métalliques, sous la flore d’acier de leurs armes à jamais captives des lierres et des ronces, les chevaliers et les barons, les paladins et les pirates, les rois chrétiens et les chiens mécréants, les éphèbes au poil blond et les vieux écuyers ; un même rêve enchante leurs yeux clos et nimbe leurs fronts d’extase. Étendus dans cent diverses poses, les uns renversés en arrière, les autres, la tête enfouie dans leurs bras et le ventre contre terre, tous ont gardé le même geste d’adorante et de délirante prière, car tous joignent leurs mains et l’on sent qu’ils ont dû tous s’endormir, la prunelle fixée sur la même vision, avec aux lèvres le même nom imploré, Oriane !
Et voici qu’évoquée et rendue enfin tangible par le désir de ses amants, Oriane elle-même apparaît dans l’ombre ensorcelée de la grotte et l’illumine en y apparaissant.
Debout dans une auréole de lueurs laiteuses et frissonnantes, tel le halo dont se cerne la lune dans les ciels pluvieux, elle appuie sa nudité de fée aux brisures transparentes d’une cathèdre de glace ; des stalactites l’environnent et trois marches de cristal étalent leur humidité glauque à ses pieds. Tout en elle a des reflets de neige et de nacre ; la blême et pesante chevelure, qui lui bat les talons, a l’imperceptible nuance d’or du givre que les feux de l’aube effleurent, et toute sa nudité brille comme une perle, une fabuleuse perle dont l’orient à peine rose chatoierait à la pointe des seins, à l’ongle de l’orteil comme au fin bout des doigts pour s’aviver plus rose, d’un rose de fleur qui s’ouvre, à la place des lèvres, là où gît le baiser.
Captive de leurs désirs comme ils sont, eux, captifs de sa beauté, Oriane se cambre et se meut lentement sous sa chevelure de clair de lune, s’étire, voluptueuse, puis se penche éblouie vers un petit miroir ovale qu’elle tient d’une main ; opale mystérieuse au fond de laquelle apparaît et s’évanouit tour à tour le visage de prière de chacun des guerriers.
Depuis combien d’années Oriane les retient-elle, immobiles et muets, retranchés de la vie, presque devenus fantômes dans les ronces et les ciguës de son antre ? Les uns depuis cent ans, les autres depuis cinquante ; il y en a là qui dorment depuis vingt hivers, d’autres depuis un mois. C’est tout un siècle d’amour et de convoitises éperdues qui sommeille là, au fond de la forêt, vaguement apaisé dans un rêve qui les supprime du monde et les défend contre la mort. Chacun de tous ceux qui dorment là, extasiés et les mains jointes, est venu un beau matin d’avril ou quelque tiède soirée d’automne, le casque au front et l’espoir au cœur, heurter du plat du glaive au seuil de la caverne ; là, ils ont mis pied à terre, ont attaché leur cheval à quelque chêne-liège et puis, balbutiant d’amour, ils sont entrés.
Et le cheval fatigué, las d’attendre, après avoir tondu les feuilles de l’arbre et l’herbe du pré, a rompu son entrave, a fui par la forêt ; il est redevenu sauvage, et, la jument du jouvenceau y ayant rencontré le palefroi du chevalier, les troupeaux de cavales et d’étalons galopent aujourd’hui hennissants, la croupe moirée sous la lune, par la forêt nocturne qu’éveillent des grands bris de branches mortes.
Or, cette belle nuit de juillet, au milieu de la rêverie de la forêt en fleurs et de l’adoration sommeillante de ses amants, Oriane est triste ; là-bas les troupeaux de cavales ont beau hennir, elle sait que la forêt n’est plus inabordable et que les temps sont révolus. Un héros incorruptible, élevé par les moines dans la haine et l’horreur de la femme, un fier adolescent au cœur farouche et aux mains pures vient d’y pénétrer. Il a déjà franchi la lisière du bois et, ferme en selle, casqué et cuirassé d’argent mat, triste et terne sous le ciel lunaire comme la terne lune elle-même, il s’avance lentement, mais sûrement, à travers l’herbe courte des chemins et la folle avoine des clairières, les clairières embaumées de sa forêt où elle n’ira plus voltiger, abeille en plein midi et libellule au crépuscule, car le cruel éphèbe apporte dans sa main droite la délivrance et dans sa gauche la mort.
La délivrance pour ceux-là, la mort pour elle, pis que la mort, la vieillesse qui est bien la mort des femmes et des fées, puisqu’elle éteint l’amour et navre le désir.
Et Oriane se penche pour se sourire une dernière fois encore sur le miroir d’opale qui déjà se ternit ; et pourtant qu’a-t-elle fait à ces moines ? elle, le charme et l’enchantement des regards et la joie de la nature, qu’elle fût rayon, corolle, aile vibrante ou femme, qu’a-t-elle fait pour qu’on lui ait suscité ce dur vainqueur ? Les temps étaient révolus et contre celui-là tous ses pièges seraient vains ! Oriane le sait d’avance, car il s’en vient vers elle, endurci de haine et flambant de rancune, en justicier et en vengeur. Il détestait et abhorrait sa beauté qui avait fait les autres esclaves, et c’est moins pour les délivrer que pour la punir qu’il avait entrepris ce périlleux voyage ; car, au fond de son cœur, il méprisait ces héros qu’une femme avait pu vaincre, et sa haine pour elle s’exaspérait encore de son mépris pour leur lâcheté ; et le cruel adolescent s’approchait d’heure en heure. Un hibou complice le guidait par les bois, voletant devant lui d’arbre en arbre.
Debout sur son trône de glace, du fond de sa grotte crépusculaire, Oriane entendait ululer l’affreux oiseau nocturne, elle entendait s’écarter les branches, le pommeau de l’épée heurter contre la selle ; et chaque pas du cheval retentissait dans son cœur.
Certes, elle eût pu l’égarer par de subtils mirages, des illusions et de vaines apparences, retarder sa marche à travers d’inextricables et subits taillis et d’imprévus marais, elle-même aurait pu se dérober sous quelque forme fuyante, bête fauve, oiseau ou fleur, mais à quoi bon ! Les temps étaient révolus, elle était vaincue d’avance. C’était le Christ qui marchait avec cet enfant, le Christ ennemi de la joie, de la volupté et de l’amour. C’était lui qui avait suscité contre elle ce bourreau à visage d’archange et voilà que deux larmes perlaient aux yeux pâles de la fée et que se ternissait tout à fait l’éclat de son miroir. La douce Oriane se savait sans défense, elle aimait son vainqueur.
À ce moment une immense clarté s’irruait dans la grotte. Du tranchant de son glaive un homme venait de déchirer le mouvant rideau de lierre qui en gardait le seuil.
Comme lamellée d’argent par la lune, une svelte silhouette noire se dressait sur la clairière, une silhouette casquée, où un hibou vivant posé sur le cimier éployait deux grandes ailes : Amadis.
Alors, ayant porté son olifant en corne d’aurochs à sa bouche, Amadis corna trois fois de toute la force de ses poumons et, prenant son épée par la lame, la portant en forme de croix devant lui, il pénétra dans l’antre. « Par le Christ tout-puissant et Notre-Dame la Vierge, que les yeux, qu’a troublés le Maudit, se dessillent et que se lèvent, libres enfin, les héros chrétiens que retient endormis le poids des maléfices », et, les corps étendus là s’étant levés avec un grand bruit de ferrailles, Amadis vit que, sous leurs armures rouillées et disjointes, les êtres apparus parmi les fleurs et les plantes avaient tous ou des faces verdâtres de cadavres ou des crânes de squelettes luisants ; et Amadis malgré lui recula. Avec un sinistre cliquetis des tibias s’accrochaient à des fémurs, et des chairs blettes s’écrasaient avec un bruit mou sous des étreintes de doigts crispés et secs ; une odeur de charogne écœurait, l’atroce vision ne durait qu’un moment. Après un vain grouillement pour se mettre debout, les larves des preux étaient retombées dans les broussailles ; maintenant des cadavres s’y liquéfiaient lentement. L’exorcisme d’Amadis n’avait éveillé que de la pourriture depuis longtemps déjà en proie aux vers ; et le charme rompu avait laissé couler, telle une digue crevée, une humanité mûre pour la tombe. Un seul, un squelette resté assis sur son séant, ricanait d’un rire muet sous un rayon de lune, les vertèbres prises dans une églantine en fleur.
Debout au milieu du charnier, Amadis se sentait mortellement triste. Alors Oriane : « À quoi a servi ton courage ? Ils rêvaient et vivaient de leurs rêves. Celui-ci savait bien ce qu’il faisait en te menant ici. » Et de sa main tremblotante et ridée, déjà devenue la main d’une vieille femme, la fée désignait le hibou : « Tu lui as préparé sa pâture. » Alors Amadis la regarda ; pauvre Oriane ! Sa chevelure était devenue grise et, racornie, édentée, toussotante, ployée en deux, brisée, l’air d’un spectre elle-même avec sa peau couleur de cendre et ses yeux blancs de taies entre des cils saignants, Oriane, cette nudité tout à l’heure encore nacrée comme une perle, tendait vers le héros un long bras de sibylle et d’une voix dolente : « Et moi, que t’avais-je fait ? J’avais l’âge de leurs illusions et leurs désirs me faisaient jeune. Belle de leur amour, je souriais à leur rêve et mon sourire les gardait contre la mort en leur souriant. Aujourd’hui le nombre des années oubliées près de moi et le poids de leurs regrets m’accablent, leur réveil m’a vieillie de mille ans et me voici durant mille années condamnée à vivre hideuse et triste la vie que chacun d’eux devait vivre ici-bas. Ô malheureux enfant, la dernière illusion qu’avaient encore les hommes fleurissait dans ces bois et c’est toi qui l’as tuée. » Le temps de l’entendre, elle avait disparu.
Dans la clairière le petit jour se levait. Une lueur triste éclairait les cadavres entassés pêle-mêle dans la grotte, et, penché sur la tête d’un mort, le hibou fouillait curieusement du bec la place de deux yeux autrefois pleins d’azur, devenus maintenant deux trous noirs et immondes.
LE PRINCE DANS LA FORÊT
LA GARDIENNE
Est-ce un conte lu jadis ou bien un rêve de mon enfance dont le décor et les personnages me hantent ? Mais c’est une obsession qui va jusqu’au malaise et, sans pouvoir préciser dans quel livre de légendes ou quel recueil d’histoires de fées j’ai vu l’hallucinante et mystérieuse image, le souvenir partout me sollicite et me revient d’une forêt obscure et surtout très haute, haute comme une cathédrale avec ses fûts de bouleaux polis comme des piliers, et çà et là des bouquets de sapins aux troncs baignés de lueurs bleuâtres et des dessous de bois illuminés, même en plein jour, comme d’un somnolent clair de lune.
Étrange forêt en vérité. Les pas n’y faisaient aucun bruit ; comme de l’azur filtrait entre les branches hautes et, sur le sol jonché d’aiguilles de pin, pas un brin de mousse, pas une fleur ; parfois un chimérique calice bleu ardait entre deux arbres, quelque iris de songe éclos là dans le calme véritablement inquiétant de ces bois, mais de près ce n’était plus qu’un palet de lumière tombé des voûtes ou quelque rugueuse écorce éclaboussée de soleil ; car tout devenait bleu dans cette forêt de songe et de silence, un silence dont la sonorité absente angoissait.
Le Prince y errait déjà depuis des heures, entré là comment ? Il n’en savait rien lui-même ; si, il se rappelait maintenant, à la poursuite d’un geai siffleur sautillant de branche en branche et d’arbre en arbre à l’extrémité de son parc.
Charme du gazouillis de l’oiseau, séduction de la rêverie à laquelle il n’était pas enclin cependant, il était sorti des grilles et s’était trouvé presque aussitôt dans cette forêt silencieuse et bleuâtre qu’il n’avait jamais vue, et pourtant il connaissait le pays à plus de vingt lieues à la ronde, étant grand chevaucheur et chasseur de bêtes fauves. Le geai siffleur, lui, avait disparu. Il n’y avait pas d’oiseaux dans la forêt ; elle était profondément calme et sombre et ce grand silence avait d’abord rassuré le Prince, le propre des lieux enchantés étant l’apparition de pieds nus sur la mousse et des bruits d’éclats de rires, de musiques lointaines et de voix insidieuses et jeunes : rien de tout cela au pied de ces bouleaux géants espacés les uns des autres comme les colonnes d’un temple, mais à la longue cette symétrie effrayait et ce grand calme finissait par vous étreindre au cœur ; et puis cette solitude d’arbres lui était complètement inconnue. Comme un immense madrépore, elle avait surgi tout à coup devant lui ; cela tenait du sortilège et du cauchemar et la forêt devait être très grande, courir pendant des lieues et des lieues de pays, car il y avait des heures qu’il y marchait, accablé par le calme effrayant de ces bois sans oiseaux, aux feuillages immobiles et où la vie des sèves semblait comme figée, où pas une saute de vent ne bruissait dans les cimes, où pas un bûcheron n’apparaissait au loin dans les cépées profondes, car la forêt était déserte et la détresse de cet abandon était telle qu’il eût préféré le danger de n’importe quelle rencontre à cet étrange solitude.
Et, comme une terreur grandissante commençait à baigner ses tempes d’une sueur, une figure tout à coup s’érigea devant lui : une tête d’angoisse, ardente et triste, aux yeux d’un navrement infini, flambants et vides, avec sur toute la face amaigrie et sur les lèvres aux coins crispés une expression indicible de souffrance et de pitié.
Une énorme couronne d’épines, la couronne même que les peintres religieux tressent autour du front du Sauveur, s’irradiait derrière elle, géante ; et dans le nimbe livide la face, toute creusée de larmes, s’encadrait comme une hostie, d’une pâleur de morte, mais de morte bienheureuse, car on ne sait quelle extase transfigurait tout ce frêle visage de douloureuse apparition. Elle se tenait droite sur le fond d’outre-mer d’un bouquet de sapins et d’une main défaillante appuyait sur sa robe, à la place du cœur, une gerbe de chardons des dunes d’un bleu livide, dont les feuilles glauques étaient tiquetées de sang ; et toute sa face suppliciée resplendissait dans la couronne d’épines comme d’une flamme bleue, du bleu même de ses yeux d’un azur enivrant.
Le prince s’était arrêté, ébloui, terrifié et pourtant charmé.
Alors, d’une voix grave et profonde :
« Tu ne me reconnais pas, étant trop jeune encore pour m’avoir déjà rencontrée. Ceux qui m’ont connue, hélas ! eux ne s’y trompent pas et je n’ai point besoin de leur apparaître dans tout le faste de ma triste splendeur pour les voir tomber aussitôt à genoux et m’implorer, les pauvres, avec des cris d’enfant et des sanglots de femme. Je suis la gardienne de cette forêt, moi seule peux t’en faire sortir, te reconduire à la vie, au monde, à tout ce qui n’est point décevance et mirage. J’ai plus de dix mille ans et pourtant je ne vieillirai jamais, le sang de mes plaies me fera toujours jeune : mon nom est la Douleur. »
Le Prince instinctivement s’était agenouillé, buvant du regard cette imprévue jeune femme dont les pieds nus semblaient ne pas toucher le sol.
Elle alors, posant sur le front du prince une frêle main étonnamment pesante : « Et tu ignores jusqu’au nom de la forêt où le geai siffleur t’a conduit, car tu n’as pénétré ici, toi, ni sur les pas de l’Amour ni sur ceux de la Jeunesse. C’est par distraction que tu as cédé au sortilège et c’est pour cela même que je puis te sauver. Tu es dans la forêt du Rêve. Ces grands bois de songe et de silence, dont l’auguste tranquillité t’effraie, tu les regretteras pourtant toute ta vie ; leur souvenir décevant te hantera jusqu’à ton dernier jour et pourtant bénis ma rencontre, car, une heure encore et tu pouvais à jamais t’y endormir.
« Combien j’en ai réveillés dans mes courses inquiètes, qui sans moi s’engouffraient dans l’éternel sommeil ! Auprès de combien suis-je arrivée trop tard et puis, je l’avoue, par pitié combien en ai-je laissé souvent dormir, tant le reflet du rêve transfigurait leurs pauvres visages, et pour ceux-là, les voyant si heureux dans l’inanité de leurs songes, j’ai hésité et passé mon chemin sans appuyer mon doigt sur leurs paupières closes, craignant pour eux les cruautés de l’avenir. »
Et la Douleur, avec une voix toute mouillée de tendresse : « Mais déjà tes yeux lassés se ferment, pauvre enfant. Réponds, fais un effort, es-tu prêt à me suivre ? Je puis te sauver encore, mais je ne puis te rendre à la réalité sans d’affreuses angoisses, es-tu prêt à souffrir ? »
Et comme le Prince, cette fois muet d’épouvante, baissait la tête sans trouver une parole : « Je ne suis pas une vaine apparition venue pour t’arracher des larmes, je suis la réalité même de la vie, mon nom est la Douleur, et je n’ai pas menti pour t’effrayer, pauvre être. Cette forêt de mystère est plus peuplée que tu ne le crois. Regarde. »
Et, la figure bleuâtre ayant d’un grand geste étendu la main, les profondeurs de la forêt resplendirent tout à coup d’un morne blémissement ; et, mêlés à l’ivoire d’ossements et de crânes, des corps, qui pouvaient être aussi bien des hommes endormis que d’immobiles cadavres, apparurent au milieu des travées, et la forêt du Rêve devint en une minute comme une crypte de Mort.
D’un bond le Prince s’était relevé : « Emmène-moi, emmène-moi, je te suis, compatissant fantôme, je ne peux plus supporter les sinistres visions qui surgissent à ta voix. »
Et la Douleur, avec une immense pitié dans ses yeux pleins de larmes : « Et les pieds tout saignants, les paumes percées de clous, la chair trouée de plaies, tu ne te plaindras pas ? » Et le Prince ayant fait signe que non : « Viens » ; et la Douleur, étreignant dans sa main le poignet du jeune homme, l’entraînait par le clair-obscur des bouleaux et des pins, mais lui déjà ne l’écoutait plus. Il s’était arrêté, le regard en extase, pour contempler de lumineuses formes de femmes qui venaient d’apparaître dans les cimes des arbres. Comme accrochées par leurs grandes ailes entre les branches et les feuillages, telles des vierges pendues, elles peuplaient les voûtes hautes de la forêt et leurs robes flottantes mettaient dans les verdures comme de neigeuses traînées de givre.
« Les Rêves », chuchotait mystérieusement la Douleur et, posant un doigt sur ses lèvres : « Ne les réveille pas. »
Mais déjà un mélodieux frémissement d’ailes courait très haut, dans les ramures et, les yeux éperdus, fixés maintenant sur les vertigineuses figures, sans même remarquer que la plupart d’entre elles ressemblaient à des mortes avec leurs paupières closes et leurs faces de cire, comme reculées sous le repliement de leurs ailes d’ombre, sans voir que quelques-unes enfin, grimaçantes et vertes, cachaient des visages de vieilles sous de membraneux ailerons de chauve-souris, le Prince, tout à coup sombré dans on ne sait quelle merveilleuse extase, dégageait son poignet de l’étreinte de la Douleur, se laissait glisser à ses pieds sur le sol et d’une voix déjà sommeillante : « Va-t’en, j’ai peur de la robe toute sanguinolente, peur de tes yeux de folle tout brûlés par les larmes, va-t’en, je veux dormir. »
Et la Douleur, une fois de plus résignée, prenait sa course à travers la forêt dont elle est la gardienne.
LE PRINCE DE LA FORÊT
HIC FELICITAS
Les raisonnables auront duré,
Les passionnés auront vécu.
CHAMFORT.
Le prince s’éveilla. Combien de temps avait duré son rêve ? Une heure, un siècle ? D’un regard surpris il embrassa le paysage, qu’il ne reconnaissait plus. La haute, la profonde forêt de sapins et de bouleaux au sol feutré baigné d’ombres bleuâtres, ses sous-bois terrifiants de silence, tout avait disparu. Il s’était endormi dans les ténèbres glauques d’une forêt de Dodone, il se retrouvait assis au revers d’une colline à l’herbe courte et rase, dévalant doucement vers une vallée immense ; des mamelons boisés, plutôt que des coteaux, en fermaient l’horizon, et sur toute cette nature déjà touchée et rouillée par l’automne rôdait une tiédeur fade de feuilles humides et de fruits mûrs, une odeur d’une sensualité tendre et triste, comme une saveur de chair meurtrie, de fleur fanée et de gland de chêne, qui est l’odeur même d’octobre et peut-être celle de la tombe.
Un ciel d’un bleu pâle, ouaté de gros nuages blancs à brisures de nacre, pesait comme un couvercle au-dessus des collines ; trois petits étangs de forme irrégulière fumaient au creux de la vallée ; des vapeurs violettes, pareilles à des écharpes, flottaient doucement sur les roseaux des bords, et sous ce ciel blanc et moite les trois lacs endormis, telles trois grandes opales, luisaient du morne éclat des eaux lentes.
Un grand calme, une quiétude attendrie s’exhalaient du paysage, mais de vagues rumeurs, éclatant tout à coup, faisaient dresser l’oreille au prince et le secouaient de sa torpeur. C’était comme un bruit grandissant, monotone et lugubre, de corneilles croassantes et le prince, s’étant levé à demi de son lit d’herbes sèches, vit que les assourdissantes clameurs montaient d’une forêt de hêtres déjà dépouillée par l’automne : ses frondaisons rougeâtres barraient tout un coin de vallée et de hautes cimes d’un or malade se détachaient à mi-flanc des collines, toutes noires de corbeaux.
Leurs croassements retentissaient maintenant à travers la campagne, incessants, colères et rauques : parfois un grand cri de détresse, déchirant au milieu du vacarme, le traversait ; et un grand vol d’oiseaux noirs, s’élevant d’un point de la forêt, planait un instant au-dessus pour aller s’abattre plus loin ; puis, leur bavarde et sempiternelle querelle reprenait plus bruyante et c’était, d’un bout à l’autre de la vallée, comme un énorme commérage de tracassantes sorcières dont la monotonie à la longue angoissait.
Et le prince en éprouvait un malaise ; le calme de ce décor n’était qu’apparent, il le sentait bien maintenant. Un charme de malaria montait de ces lacs ; la molle atmosphère de cette journée tiède, ce ciel doux et blanc, cette vallée endolorie étaient empoisonnés. Comme un relent de pourriture germait dans l’odeur même des feuilles et des faines, des miasmes flottants l’écœuraient, et puis ce bruit grandissant de bataille, cette forêt peuplée de bêtes croassantes l’inquiétaient. À quelle besogne sinistre pouvaient bien se livrer ces hordes tourbillonnantes de corbeaux ?
L’odeur de corruption du paysage lui semblait venir maintenant de la forêt. Quelles étaient enfin ces clameurs de détresse éclatant de temps à autre au-dessus du silence des lacs, mais si vite étouffées comme à coup de griffes et de becs ? D’innombrables ailes noires enténébraient de deuil les bois et le ciel ; et, rempli d’une horreur secrète, le prince se demandait tout bas quelles agonies et quelles scènes de carnage pouvaient bien recéler dans ses frondaisons jaunes cette étrange forêt aux senteurs de charnier !
Et comme il se penchait en avant, essayant, mais en vain, de fouiller du regard ce coin de vallée bruyante, une forme de femme, grande et svelte, apparaissait un peu au-dessous de lui. Elle gravissait les pentes et marchait d’un pas léger : ses pieds un peu longs, chaussés de soie violâtre, appuyaient à peine de l’orteil sur l’herbe séchée. C’était la démarche à talons soulevés, rapide et souple, que les poètes grecs prêtent aux déesses, et tout en effet était d’une immortelle dans cette jeune femme harmonieuse et fine à la gorge droite, aux hanches dures et aux bras fermes et blancs.
Une robe d’étoffe molle flottante sur les reins, d’un gris très doux de cendre, la moulait à la taille, et, maintenant qu’elle était toute proche, le prince admirait des rosaces d’argent brodées à même la robe, avec, autour du cou, un hausse-col de perles et comme une cuirasse de gemmes à l’entour des seins.
C’était un gorgerin d’un travail bizarre, tout en plaques d’or vert bossuées d’opales et de topazes roses, d’un rose atténué, presque mort et qui, piqué çà et là de grosses perles, lui mettait à la taille comme un resplendissement lunaire, un scintillement limpide et froid. Les mêmes pierreries laiteuses s’entassaient en colliers jusqu’à ses oreilles et gainaient de reflets ses épaules et ses bras. Sans ses cheveux d’un blond très pâle couronnés d’anémones de perles et flottant en nappe autour d’elle, on eût dit une princesse guerrière, mais la physionomie d’indolente insouciance démentait le costume, en dépit du profil d’une pureté hautaine et des belles lèvres sinueuses : un vague sourire en atténuait le dédain.
Malgré l’éblouissante fraîcheur des joues et de la bouche c’était une figure effacée, comme reculée hors la réalité, apparue dans une brume ; et ses prunelles d’une nuance indéfinie, sans profondeur et sans chaleur, avaient le terne éclat d’un bijou triste.
Elle était somptueuse, élégante et sans charme.
Elle passa rapide auprès du prince et, l’effleurant presque de sa robe : « Viens-tu ? lui jetait-elle dans un demi-sourire. Que fais-tu là ? Suis-moi. » Et comme le prince, à demi soulevé sur les genoux, la regardait avec des yeux surpris : « Allons ! hâte-toi, je n’ai pas de temps à perdre, ajoutait-elle en le touchant légèrement à l’épaule, crois-moi, suis mon conseil, ne te laisse pas surprendre par les miasmes nocturnes de cette vallée funeste. Dès le soleil tombé, ces bois et ces étangs dégagent un froid de mort. Mais je ne puis m’arrêter davantage. On m’attend là-haut, au château du Bonheur. – Au château du Bonheur ! s’écriait le jeune homme. – Et je puis t’y conduire ; moi seule en connais le chemin. Je suis la sûre guérisseuse des souffrances passées, des maux encore présents et des futures alarmes. Je clos les plaies du souvenir. Mon baiser cicatrise et mon toucher durcit et raffermit les misérables corps, comme il trempe les âmes contre les coups possibles du destin ; je déjoue et défie l’avenir. Mais lève-toi et marche à mes côtés, si quelque souci te reste encore de ton salut et si tu n’es pas un de ces lâches exténués d’illusions et de rêves comme il en vient ici, amoureux du néant et désirant mourir. » Et comme le prince impressionné par sa parole brève s’était enfin levé et marchait auprès d’elle, curieux de cette étrangère si certaine du Bonheur : « Le monde a dix mille ans vécu de mon souffle robuste. La Grèce m’adorait ; ses villes et ses ports m’honoraient dans des temples jusqu’en Asie Mineure et Rome elle-même m’a dressé des autels. J’ai eu à mes pieds des consuls, des tribuns, des débauchés fameux, des empereurs laurés d’or ; j’ai eu des poètes au front couronné de violettes et jusques à des philosophes ; des sages m’ont proclamée leur fille et, quoique bannie un moment par le Christ, ma puissance est éternelle. Depuis, je l’ai chassé à mon tour du sanctuaire des cœurs ; je suis la santé de la vie ; on m’appelle l’Indifférence. »
Le prince la contemplait avec des yeux avides : « Et tu connais, dis-tu, le chemin du Bonheur ? tu sais où il réside et se dérobe à nos yeux misérables ? – Oui, répondait l’étrangère au gorgerin d’opales, je connais le palais du repos et du calme. Mais voici que pointent déjà ses terrasses derrière ces hauts cyprès, devant nous, sur la côte. » Et le prince tremblait : « Quoi ! ce péristyle à colonnes de marbre et ces bustes de bronze dans des niches revêtues de métal, cette villa italienne au sommet de cette colline, toute blanche dans ce jardin de pins et de cyprès, ce serait là le havre désiré par toute créature, le château du Bonheur ? – Ou celui de l’Oubli, regarde ! »
Ils se trouvaient debout sous un blanc péristyle, devant une immobile rangée de bustes, et dans ces hautes figures verdâtres le prince retrouvait les traits de philosophes connus ; les noms de Zénon, de Platon, d’Épictète et de Pythagore affluaient sur ses lèvres ; mais d’aveugles prunelles d’argent mat, tels des regards de spectre, dormaient sous leurs paupières et le prince avait peur.
Autour de lui régnait un jardin symétrique aux étroites allées à bordures de buis. C’étaient des feuillages rigides et comme vernissés d’orangers d’Espagne, de lauriers de Turbie, puis des cônes obscurs de pins et de cyprès ; une cour dallée de marbre blanc et noir s’ouvrait rectangulaire avec, juste à son centre, une fontaine d’eau vive, qui jaillissait très haut et retombait en nappe dans une vasque de jaspe ornementée aux angles de masques de bronze vert.
Et dans ce jardin luisant un jeune homme d’une pâleur bouffie dormait, le corps inerte, le coude appuyé au bord de la vasque et les reins tassés sur un banc en hémicycle dominé d’une haute stèle, où ces deux mots étaient écrits : Hic felicitas. L’eau débordant de la vasque usée coulait sur le damier noir et blanc des dalles, et une glaciale humidité, une fraîcheur moisie mettaient sur ces marbres et dans ce jardin obscur une atmosphère de cave. Mais le sommeil du jeune homme était si profond qu’il ne sentait pas l’eau courir sur ses pieds et pénétrer les semelles de ses brodequins de feutre blanc, car il était tout de blanc vêtu, comme une fiancée, et ses mains exsangues et fines tenaient ouvert sur ses genoux un grand livre à fermoir d’émail. Des pavots desséchés d’une transparence de nacre s’échappaient, tels des signets, d’entre les pages ; des cheveux d’un blond d’or, d’une singulière souplesse, coulaient comme une eau sur ses épaules grasses ; et sur ce front appesanti, presque au niveau des paupières blêmes, une invisible main avait posé une couronne d’énormes nénuphars.
Alors l’Indifférence : « Hic felicitas. Veux-tu lui ressembler ? Tu dormiras comme lui. On n’est heureux au monde que lorsqu’on oublie le monde. Ici, c’est le dédain des baisers et des larmes, des douleurs et des joies. Cette eau murmurante et toujours renouvelée noie jusqu’au souvenir. Nous détenons ici le secret du bonheur ; la vie nous trompe, trompons la vie. Ici c’est le bon gîte où l’on peut à son aise et s’asseoir et faire halte et dormir. » Mais le prince sentait une stupeur envahir tout son être ; une horreur le glaçait. Ce jeune homme endormi, comme enterré vivant dans la clarté verdâtre et la fraîcheur de tombe de ce jardin luisant, l’inertie de cadavre de cette chair bouffie, pourrissant là dans l’eau courante, tout cela l’épouvantait. Sous sa couronne de nénuphars on eût dit un noyé, et le prince en lui-même songeait à la vallée d’automne et au mystère des trois étangs.
Il n’articula pas une parole, mais sa compagne avait compris. Elle haussait légèrement les épaules : « Soit. Retourne donc aux corbeaux, au charnier de la forêt où les oiseaux de proie dépècent à coups de bec les vaines Illusions, les Illusions, tes sœurs et tes maîtresses. Retourne au bord des lacs aux miasmes empoisonnés où s’ébauchent les rêves, mais ne te plains pas si les corbeaux de la vallée t’arrachent les prunelles de leurs orbites sanglantes : tu l’auras voulu. Va donc, souffre, saigne, retourne à la Douleur, au Mensonge, à la Vie, pleure dans tes larmes jusqu’aux dernières gouttes de sang de ton cœur ! Mais quand, la chair trouée par les griffes des bêtes, les pieds meurtris et pleins d’ulcères, tu rôderas aveugle et désolé dans la forêt du Meurtre, sous le vol justicier des corbeaux, au pied de tes sœurs suppliciées, tes chères Illusions enfin crucifiées aux troncs des hêtres par le Destin vengeur, n’espère pas oublier et revenir ici pour y trouver le calme. Va-t’en ! il est déjà trop tard. »
Silencieux et pensif, le prince redescendait déjà vers la vallée. Il avait repris le chemin des étangs.
CONTE DES FAUCHEURS
C’était un grand mur blanc dans un sentier fleuri d’orties. La muraille blanche et nue, sans un lierre, courait depuis des lieues dans la campagne ; des moucherons vibraient dans l’air chaud et un pesant soleil d’août faisait chuchoter la vie des insectes et des herbes.
Il y avait déjà des heures que Raymondin longeait cette vieille muraille de moellon et de plâtre. Elle avait surgi devant lui, comme il sortait de la ville, au faîte même de la colline toute de sainfoin et de luzerne. Sur le plateau hanté de papillons bleuâtres (on eût dit des campanules errantes dans l’espace), il avait fait halte pour regarder en bas, à ses pieds, la ville avec ses toits, ses remparts, ses clochers et le ruban moiré de son fleuve dans l’orbe noir des vieux ponts, et il s’était appuyé contre le vieux mur pour revivre un peu de sa vie qu’il laissait là dans la vallée.
C’étaient vingt ans de son enfance, vingt ans qu’il avait dormis, comme ivre, dans la claire gaieté d’un été d’or, et la ville amie lui était apparue avec ses rues, ses carrefours, ses nuits de pâles rêveries, ses jours calmes et monotones, sa cathédrale au portail, on eût dit, tendu de toiles grises et son chemin de croix qui grimpe entre des haies en fleurs ; et Raymondin s’était senti tout ému en se souvenant dans quel pré, à la lisière de quel bois fleurit, avant ou après les foins, telle primevère ou telle scabieuse préférée, et il avait pleuré au beau jour d’aujourd’hui comme aux jours d’hier, debout contre le grand mur blanc et, sans voir un lézard gris endormi sur une pierre à la portée de sa main, du revers de sa manche il avait essuyé ses yeux en disant fièrement : « Cette heure est la mienne et je l’emporte avec moi. »
Et il s’était mis à suivre le grand mur sous le pesant ciel d’août et tout à coup, par le sentier si touffu d’herbes qu’il ne l’entendit pas venir, Raymondin avait aperçu un vieillard, un vieil homme haut et droit, qui avait surgi là, dans la solitude, comme une vision de chaleur. Il se tenait debout, tête nue, et semblait un qu’on a déjà connu ; il y avait comme une tristesse d’adieu dans son sourire, et, sourd et muet (car il ne parlait pas), d’un grand geste il montrait à Raymondin l’horizon et cela avec une clé de fer forgé qu’il avait à la main.
Et, pour la première fois, Raymondin avait eu un frisson. Un effroi lui était venu que ce mur blanc ne fût celui d’un cimetière, mais aucune cime de cyprès ou de saule n’en dépassait le faîte ; il s’était rassuré aussitôt et s’apprêtait à passer outre, quand d’un geste familier le grand vieillard l’avait arrêté, et Raymondin avait vu qu’ils étaient tous deux au pied d’une petite tour.
Une petite tour enclavée dans le mur et qui ne le dépassait guère que de la hauteur de son toit de tuile, une petite tour ronde au ciment écorché montrant le rouge des briques, et le vieillard avait ouvert la porte de cette tour. Une pelle et une pioche y luisaient dans la pénombre, jetées l’une sur l’autre en croix, et les poids d’une vieille horloge y balayaient presque le sol, descendus tous deux en bas ; mais le balancier allait et venait dans l’ombre, et, silencieusement, l’homme rencontré avait remonté l’horloge en manœuvrant les poids.
Soixante-dix. Sept fois il avait ouvert toutes grandes ses pauvres vieilles mains avec un bon sourire. Soixante-dix ans, il avait soixante-dix ans et, chaque jour de sa vie, il était venu avec sa grande clé rouler la chaîne de l’horloge pour qu’elle vécût encore un jour.
Et comme, le cœur ému, Raymondin faisait le geste de prendre dans les siennes les mains du vieil homme, il s’aperçut qu’il avait disparu. Lui-même n’était plus dans le sentier d’orties, mais devant un immense champ de blé, de l’autre côté du mur.
C’étaient de grands épis roux dressant à l’infini leurs chaumes immobiles contre un ciel violacé de chaleur ; ils semblaient flamber dans l’ardeur intense et étendaient sous l’œil du jeune homme comme une nappe incandescente de métal ; et sur les épis une faux volait, une faux luisante et moirée comme l’aile d’un corbeau, et cette aile allait et virait aux mains d’un faucheur invisible ; mais les épis se couchaient par gerbes sous le vol de la faux et Raymondin avait peur.
La faux travailla longtemps, silencieuse, et tout à coup Raymondin vit qui la manœuvrait.
C’était, drapé de lumière comme dans un linceul, un squelette tragique, un agile et frétillant squelette au crâne miroitant couronné d’immortelles ; et les bleuets et les coquelicots riaient gaiement entre ses deux fémurs.
L’or des blés encore droits derrière lui mettait entre ses vertèbres comme une lueur et Raymondin reconnut la Faucheuse.
La Mort, la bonne travailleuse, la Mort qui fauche sans paroles et dont la moisson est toujours belle, car elle fauche à larges coups.
Et une horreur avait étreint le jeune homme à la gorge de voir, tel un automate, la Faucheuse se démener au milieu des blés roux ; elle s’activait dans le silence ensoleillé de ces campagnes, quand tout à coup, près du squelette, avait surgi un bel adolescent nu.
Nu comme la beauté, nu comme le matin, nu comme l’ignorance, une faucille d’or à la main, l’Amour (car c’était lui) cueillait des fleurs et une chanson gazouillait sur sa bouche, tel un chant d’alouette, et sa bouche rouge, d’un rouge humide d’intérieur de fruit, la bouche où les dents mettaient de la nacre, s’appuyait de temps à autre au calice d’une fleur.
L’Amour cueillait et baisait les bleuets, les bleuets qui sont bleus comme des regards de jeunes filles ; l’Amour glanait et baisait les coquelicots, les coquelicots qui sont rouges comme des blessures et, chose étrange, sous sa faucille d’or les tiges des fleurs coupées pleuraient une sève plus vermeille et plus chaude que les épis fauchés par la main de la Mort.
La Mort fauche et l’Amour glane :
Elle dans son blanc linceul ;
Lui, jeune et beau comme une femme,
Sans épouvante marche seul ;
Il marche et chante sans épouvante,
Et la Mort fauche devant lui,
Avec sa faux qui luit et luit.
Et comme, inconsciemment transi d’effroi, Raymondin ânonnait la vieille chanson, voilà que le décor changea, les blés s’évanouirent et ce furent sous un ciel gris d’automne les interminables sillons d’un long champ de labour ; et, parmi les mottes de terre grasse déferlant entre les touffes de chaume pâle, la travailleuse de tout à l’heure reparut, mais dirigeant cette fois une charrue.
Le squelette faucheur était devenu laboureur. Un blême crépuscule l’enveloppait d’une lueur triste, des oiseaux de passage fuyaient dans les nuées et, sur ses pas, le bel adolescent nu marchait encore ; il marchait avec des épis et des bleuets dans les cheveux, tout fier de la moisson dernière, le même chant aux lèvres et, dans ce morne coucher de soleil, il semait, il semait à travers les vieux sillons, et son geste divin, son geste d’espérance emplissait de courage et d’une foi nouvelle toute l’immense détresse de l’horizon.
Quand la Mort laboure, l’Amour sème.
Et comme l’Amour chantait, Raymondin comprit qu’il ne fallait plus pleurer, car aimer, c’est mourir et renaître ; qu’il ne faut pas redouter de connaître sa vie, mais la regarder bien en face et la faire selon la vision du jour ; que chaque minute vécue appartient à la faux de la Mort, comme chaque ivresse passée à la faucille de l’Amour et que leurs instruments de meurtre ne sont, après tout, que leurs ailes.
L’Amour fauche avec son aile,
Avec son aile fauche la Mort.
Et Raymondin se retrouvait devant la petite tour, au pied du grand mur blanc ; l’horloge y bruissait encore, mais la nuit était presque venue, et Raymondin, écartant les orties étrangement poussées durant son rêve, reprenait le chemin de la ville et du vallon.
CONTES DE GIVRE ET DE SOMMEIL
À Joris-Karl Huysmans.
LA PRINCESSE SOUS VERRE
I
C’était une délicate et belle petite princesse aux membres menus et jolis comme ceux d’une figurine de cire ; sa peau transparente était si tendre qu’on l’eût dit animée par une flamme de cierge, une flamme vacillante, éteinte au moindre vent et, sous ses épais bandeaux du marron luisant des châtaignes, elle dégageait, la petite princesse, une si prenante et si froide impression de blancheur qu’à son nom de Bertrade on avait ajouté le surnom de « la pâle » (on, c’était le bas peuple), tandis que son père, un vieux roi belliqueux toujours occupé à guerroyer contre les païens dans les Marches du Nord, l’avait baptisée sa petite rose de Noël ; et des neigeuses fleurs en effet Bertrade avait bien la fragilité morbide, le charme frêle et l’éclat apaisé, comme amorti par l’hiver.
Elle avait eu une enfance un peu assombrie dans ce château de pays de bois et de marais, où son père l’avait fait élever par des gouvernantes à faces de béguines, loin du tumulte de la cour.
Sa mère, une princesse d’Occitanie qui n’avait jamais pu se consoler d’avoir quitté le royaume aux grèves d’or, était morte quelques mois après sa naissance ; et ce deuil précoce avait à jamais enténébré de mélancolie cette royale petite enfance désormais confiée à des mains mercenaires.
Elle était née si chétive et si pâle qu’on avait longtemps craint qu’elle ne survécût pas à sa mère. Épousée presque sans apport pour la grande beauté de sa chair de lait et de ses longs yeux un peu égarés, du bleu verdissant des turquoises, cette fille d’empereur, à peine arrivée en Courlande, y était tombée dans une étrange langueur ; un incurable regret la minait, disait-on, des horizons de mâts, de vergues et de voilures qu’elle avait là-bas sous les yeux, au pied même des terrasses du palais impérial, dans la ville éternellement pavoisée de banderoles et d’étendards de l’exarque son père. On n’a pas été impunément élevée au bord de la mer, et les rumeurs de l’Océan, les cris des matelots en partance, les mille et une clameurs d’un port manquaient à cette belle fleur marine qui, transplantée dans cette morne et plate Courlande, toute de tourbières et de forêts, s’y était rapidement fanée de nostalgie, étiolée de regret.
Son horreur pour les horizons de sapins et d’étangs de son nouveau royaume était devenue telle que dans les derniers mois de sa vie elle avait fait murer jusqu’à mi-hauteur les fenêtres à meneaux de sa chambre, cette chambre de brocart et de vieilles tapisseries, dont elle ne devait plus sortir que les bras croisés sur un crucifix et les pieds raidis dans un cercueil ; et les dolentes journées des derniers temps de sa grossesse et les heures saignantes de ses relevailles, elle les avait passées dans le clair-obscur de la chambre assombrie, les yeux fixés sur un grand miroir placé très haut, vis-à-vis les fenêtres à moitié condamnées, et qui ne reflétait que les nuées errantes et les aspects changeants du ciel.
Sa rêverie ainsi volontairement abusée pouvait se croire encore en Occitanie, sous les firmaments balayés de nuages à cassures de nacre des bords de la mer.
Cette obsession d’exilée avait abrégé ses jours, c’était du moins le bruit accrédité dans le peuple ; mais chez les grands on parlait d’un breuvage néfaste et de la haine d’une princesse du sang, jadis honorée des faveurs du roi et qui avait rêvé de s’asseoir sur la pourpre ; la jeune reine aurait payé de sa vie la rancune d’une rivale. Le poison, qu’on lui aurait versé, devait supprimer avec elle l’enfant dont elle était grosse ; mais soit que les doses eussent été mal calculées, soit que le ciel ait eu la pitié de ces deux cadavres pour un même cercueil, la reine seule était morte et Bertrade avait survécu.
C’était d’ailleurs une cour assez sinistre et pleine d’histoires étranges que cette cour de Courlande : en même temps que Bertrade y grandissait délicate et frêle aux mains des gouvernantes, dans le calme du château des Bois, le roi y faisait élever à la cour un sien neveu, fils d’un frère aîné, le frère même dont il occupait le trône, mort assez singulièrement dans une embuscade de chasse.
Le prince Noir (c’était ainsi qu’on appelait le prince Otto dans le peuple) était un assez taciturne jeune homme, de cinq années plus âgé que Bertrade, et dont l’incohérente et bizarre conduite autorisait plus d’un mauvais propos.
Aussi pâle que sa royale cousine, mais d’une maigreur souple et robuste, il promenait dans les palais de la haute ville, comme dans les bouges du vieux port, un svelte corps d’écuyer toujours sanglé de droguet noir. Il passait des pires débauches, de celles dont on peut à peine parler, aux pratiques de la piété la plus ardente ; on citait de lui des actes de charité presque divine à côté de faits d’une cruauté sauvage, et c’était à la fois le plus effréné libertin du royaume et le plus doux des jeunes moines enlumineurs de manuscrits de toutes les provinces ; car, dans son inexplicable sauvagerie, il lui arrivait parfois de se retirer tout un long mois dans un cloître et d’y mener la vie des postulants.
Ses regards fixes et durs, d’une froideur d’onyx, disaient assez son âme violente. On ne lui avait pas versé de breuvage à lui, mais une rumeur populaire voulait qu’il expiât à sa façon une vengeance de bohémiens. Un zingaro dont, par caprice, il avait pour une nuit confisqué la maîtresse et qu’il avait fait (ce sont là jeux de princes) ensuite rouer de coups, lui avait donné à quelque temps de là une singulière aubade. Insinué on ne sait comment jusqu’aux appartements du prince (il y a toujours de la diablerie dans ces histoires de Bohême), ce misérable, au lieu de planter sa dague au cœur de son ennemi, lui avait toute la nuit chanté des airs de son pays en s’accompagnant d’un violon maléficié, un violon ou une guzla dont les cordes étaient faites de cheveux de pendu. L’âme du supplicié, quelque bandit de sa tribu branché aux bois de justice, avait toute la nuit torturé le sommeil du prince et, depuis ce cauchemar, la raison d’Otto avait sombré dans l’inconnu.
Le vieux roi, accablé par tant de désastres, haussait les épaules et laissait dire, mais avait dû renoncer à tout projet d’union entre le prince et sa cousine. Il avait pourtant longtemps caressé ce dessein d’unir au bel Otto sa petite rose de Noël, mais il eût été cruel de livrer cette délicate et délicieuse Bertrade à ce fou maniaque et imprévu.
La princesse avait alors seize ans. Elle n’avait pas seulement de sa mère l’ovale un peu souffrant de la face, les épaules tombantes, où le bleu des veines transparaît sous la peau, et le regard poignant des prunelles lointaines, d’un vert d’eau de fleuve chez la morte, d’un violet d’améthyste chez Bertrade. De la reine elle avait aussi hérité une sorte de mélancolie inquiète qui lui faisait rechercher, de préférence aux entretiens à la fenêtre et aux promenades en plein air, le clair-obscur des chambres et les vagues soliloques devant les miroirs ; ses plaisirs favoris étaient de s’enfermer durant de longues heures dans quelque haute salle tendue de tapisseries, dont les personnages de laine et de soie finissaient par s’animer insensiblement sous ses yeux. Si elle regardait le soleil, c’était à travers le chaton des bagues, dont on chargeait ses doigts effilés, et on l’avait souvent surprise, au clair de lune, s’amusant à faire ruisseler dans la lumière astrale l’eau chatoyante de ses colliers.
Dans toute la nature elle ne paraissait aimer que les reflets. L’eau aussi l’attirait et les seules fleurs, dont elle souffrît la présence, étaient l’iris et le nénuphar ; elle aimait au crépuscule à s’attarder aux bords glacés des sources et dans le brouillard fiévreux des étangs, mais à tout au monde elle préférait les interminables et silencieuses haltes devant l’étain figé des glaces ; l’âme de sa mère semblait l’y retenir, remontée des ténèbres à la surface équivoque des miroirs.
C’est alors que doucement et, sans que rien eût pu faire prévoir cette fin précoce, s’éteignit ou plutôt s’endormit entre les mains de ses suivantes la princesse Bertrade ; elle était dans le sixième mois de sa seizième année et, la veille encore, avait passé la journée dans un couvent de clarisses, où les nonnes lui avaient fait grande fête. Au retour, dans l’or brûlant du crépuscule, elle avait fait arrêter sa litière au milieu des blés mûrs pour écouter la voix d’un moissonneur qui chantait ; le lendemain, elle était morte.
En l’absence du roi prévenu par courrier, les gouvernantes en pleurs baignèrent et parfumèrent d’essences ce pur et blanc cadavre, le vêtirent de moire et de brocart d’argent, puis, ayant peigné et natté la soie luisante de ses cheveux, la couronnèrent de roses de perles et de moelle de roseaux, comme on en voit aux statues des madones. Elles joignirent sur un grand lis de filigrane d’or ses petites mains étincelantes de bagues, chaussèrent ses pieds de pantoufles de vair et, prosternées au pied d’un double rang de cierges, attendirent en grande douleur.
Mais, quand le roi accablé de chagrin et d’années pénétra dans la chambre ardente, accompagné de l’évêque Afranus crossé, mitré d’or et la dalmatique violette aux épaules, avec, sur leurs pas, un cortège en deuil d’archidiacres et de médecins, on découvrit que celle qu’on croyait morte n’était qu’endormie, mais de quel étrange et lugubre sommeil ! Rien ne put la rappeler à la vie, ni les prières des prêtres, ni toutes les tentatives des maîtres mires et physiciens. Trois jours durant, elle demeura exposée sur un grand échafaud drapé de velours blanc, au beau milieu de la cathédrale ; durant trois jours, des messes furent célébrées sans interruption par l’évêque et son clergé ; trois jours durant, les chants de Pâques entonnés par tout le peuple tassé dans les bas-côtés de la basilique retentirent avec le tonnerre des orgues, et la princesse ne se réveilla pas.
Des pétales de roses s’amoncelaient, telle une neige montante, au pied de la haute estrade, l’orient des perles de ses colliers miroitait sur le blanc de son cou ; autour d’elle c’était la clarté de mille et mille cierges, autour d’elle des vapeurs d’encens déroulaient leurs spirales bleuâtres, et, lointaine, comme inaccessible et apparue en rêve derrière leurs brumes mouvantes, la princesse gisait immobile : elle dormait toujours au milieu des brocarts, des cires allumées, des psaumes et des fleurs.
Elle ne vivait ni ne mourait.
C’est alors que l’évêque Afranus eut une inspiration du ciel. Qui sait si le soleil, le grand air, la bise et la pluie, la force même des éléments ne feraient pas ce que l’Église et ses chants liturgiques n’avaient pu obtenir ? Il fit donc construire pour ce doux corps tombé en léthargie un étroit et long cercueil de verre aux huit angles ornés de lys d’argent ciselé ; on y coucha la princesse endormie sur un lit de soie capitonnée, et le vieux prélat décida que, tous les jours que Dieu ferait, on promènerait Bertrade à dos de brancardiers à travers les bourgs et les campagnes avec haltes dans toutes les chapelles et tous les couvents du royaume ; un long cortège de pénitents et de fidèles en prière suivrait toujours le corps royal, Dieu prendrait peut-être enfin en pitié leur douleur ; la nuit, la châsse voyageuse reposerait dans le chœur des églises ou dans la crypte des cloîtres.
II
Alors ce fut par le royaume attristé un défilé d’interminables processions. On ne rencontra plus désormais par les routes que diacres en surplis et moines en cagoules psalmodiant des proses de lamentations ; ce n’étaient partout à l’orée des champs, comme à l’entrée des bourgs, que prunelles ardentes et faces extatiques, que mains jointes et pieds nus : femmes du peuple, artisans, rustres et laboureurs accourus en grande ferveur sur le passage de la princesse.
Par les plaines jaunes de moissons, comme par les haies fleuries d’avril, de longues silhouettes encapuchonnées apparaissaient tout à coup aux carrefours ; de grandes bannières de soie molle sombraient, telles de hautes voilures, au-dessus des récoltes ; des odeurs de myrrhe et d’encens se mêlaient aux senteurs de la terre. C’était, au milieu des encensoirs et des cires flambantes, la châsse royale qui passait.
Toute blême dans la pâleur de ses brocarts et de ses moires, les paupières closes sous sa couronne de roses de perles, on eût dit une immobile Notre-Dame des Larmes, toute de soie et de filigranes ; et les parois limpides de la bière hexagone luisaient au soleil d’août comme de l’eau gelée. En novembre, il arrivait que les cierges s’éteignaient brusquement sous la pluie, les hautes croix d’argent chancelaient aux mains engourdies des porteurs, la bise s’engouffrait aux bannières, et devant le blanc cercueil crépitant sous la grêle, femmes nobles et manants s’agenouillaient pêle-mêle dans la boue des ornières et, en toute saison, le glas pleurait sans trêve sur les campagnes hallucinées.
C’était, d’un bout de l’année à l’autre, une suite ininterrompue de lents et somptueux pèlerinages ; toutes les églises, tous les couvents du pays étaient visités. La châsse royale ne réintégrait la capitale du royaume que deux fois par an, la semaine avant Noël et celle d’avant Pâques, grandes fêtes de l’Église où une opinion accréditée dans le peuple voulait que l’évêque Afranus donnât la communion à la princesse enchantée. Il soutenait ainsi, disait-on, par la miraculeuse substance de l’hostie ce léthargique et doux cadavre, cet exsangue et royal corps de vierge qui ne pouvait ni revivre ni mourir ; mais c’étaient là rumeurs populaires. La « Princesse sous verre », c’est ainsi qu’on appelait maintenant Bertrade, demeurait bien exposée à la vénération des fidèles, en plein chœur de la cathédrale, du dimanche des Rameaux jusqu’au mardi de Pâques et toute la semaine qui précédait Noël, mais on n’avait jamais vu l’évêque s’approcher de l’auguste châsse. Une fois par an seulement, le dimanche des Rameaux, six ursulines, choisies parmi les plus jeunes de tous les couvents du royaume, étaient admises à toucher le cercueil royal et à changer sur le front de la morte sa couronne de perles et de moelle de roseaux.
Les fêtes terminées, la princesse et son cortège reprenaient le cours de leurs pérégrinations sous le soleil et sous la pluie, et c’était déjà la cinquième année de ces pèlerinages inutiles. En dépit des prévisions de l’évêque, la Princesse sous verre n’avait pas plus remué la soie raidie de ses paupières que le froid ivoire de ses belles mains ; le vieux roi son père, tombé dans une espèce de torpeur stupide, devenu presque indifférent de douleur, avait abandonné son camp des frontières pour se cloîtrer dans le château des Bois, le château bâti au milieu des marais, où s’était éteinte, il y avait plus de vingt ans, la princesse d’Occitanie, mère de Bertrade, et où Bertrade, sa petite rose de Noël, devait si singulièrement s’endormir seize années et six mois plus tard. Le vieux monarque vivait désormais là, dans la nuit des hautes pièces aux fenêtres murées, seul en face du passé surgissant quelquefois de l’eau morte des miroirs, sortant à peine de sa retraite pour assister, deux fois par an, dans la ville, à l’exposition de la Princesse sous verre au beau milieu de la cathédrale.
De là, il rentrait dans son château, dans son oubli ; des ministres régnaient pour lui.
Quant au prince Otto, il avait, lui aussi, presque entièrement disparu. À la suite d’un bizarre accident, de l’incendie d’un de ses châteaux d’été, où les plus belles courtisanes du royaume avaient toutes péri d’une mort horrible, son humeur était encore devenue plus farouche ; et moitié par remords, moitié par terreur de la haine populaire qui l’accusait d’avoir mis le feu lui-même, il s’était retiré dans les forêts de l’Ouest, parmi les solitudes boisées de la frontière, celles-là même qu’avoisinent le nord de la Souabe et les marches de Bohème. L’incendie, qu’une odieuse rumeur l’accusait d’avoir allumé au cours d’une fête offerte au duc héritier de Livonie, et au milieu de laquelle les plus belles femmes de ce temps avaient trouvé la mort, avait achevé d’égarer sa raison. Réfugié au fond de bois impénétrables avec une poignée de mauvais garçons, il y menait, disait-on, la vie de chef de bande, celle en somme des hauts barons du siècle, détroussant le passant, tuant l’oiseau dans l’air, pillant le juif et le marchand, forçant la bête dans sa tanière et le manant en son taudis ; et tous les pauvres gens tremblaient devant le prince Noir devenu le prince Rouge.
Un dernier exploit d’Otto comblait la mesure.
Au cours d’une de ses expéditions à main armée, embuscade ou partie de chasse, on ne savait trop, puisqu’il était suivi de ses chiens, le prince s’était rencontré à la lisière d’un bois avec le lent cortège de cierges et de croix qui accompagnait la princesse. La vue des cires flambantes réveilla-t-elle en lui le souvenir de son crime ou le maléfice du bohémien ne fut-il pas plutôt exaspéré par les chants liturgiques ? Mais un subit accès de fureur le saisit et, l’écume aux lèvres, vociférant des anathèmes, il fonça tout à coup, lui, sa meute et ses gens, sur la pieuse escorte, culbutant moines et moinillons, piétinant pêle-mêle sous les chevaux cabrés femmes et porteurs de cires, de christs et de bannières. Ce fut une panique atroce, une débandade épouvantable à travers la consternation des campagnes ; les brancardiers terrifiés abandonnèrent précipitamment la châsse de verre qui se brisa, et le corps délicat de Bertrade, à demi sorti de son cercueil, glissa hors de son lit de soie pâle dans la boue grasse du chemin. Il y demeura toute la nuit, exposé à la pluie de novembre ; on le retrouva le lendemain, au petit jour, au milieu des chandeliers d’argent et des longues bannières jetés par les fuyards au travers de la route, immobile et pâle sous ses brocarts flétris et les éclats poudreux de sa couronne de perles. Le prince Otto éperdu d’horreur avait fui devant son sacrilège ; le fragile et doux corps de la Princesse sous verre était donc demeuré douze heures à l’abandon. Quand les gens du roi prévenus en toute hâte accoururent sur les lieux pour relever la châsse et ramener la princesse au palais, ils reculèrent tous épouvantés : deux rigoles de sang trempaient et raidissaient la moire de sa robe, ses bras fuselés, qui se croisaient, la veille encore, sur un lys de filigrane d’or, laissaient pendre maintenant deux informes moignons où du sang se caillait. En animaux féroces qu’étaient les chiens danois et les dogues à nez court du cruel prince Otto, cette meute digne de son maître s’était, dans cette chasse donnée à des prêtres, à des femmes et à des enfants, offert une curée que n’eût point désavouée le chasseur Noir, elle avait dévoré les mains de la princesse.
L’hallali valait la curée.
Et le sang coulait, tiède et rouge, en dépit des yeux clos et de la face blémie : la princesse vivait toujours.
À cette nouvelle, une indignation souleva tout le royaume, le vieux roi sortit enfin de sa torpeur et décréta dans un édit la mise à prix de la tête du prince, l’évêque Afranus obtint du pape un bref interdisant l’eau, le pain et le sel au sacrilège Otto et à ses compagnons. Des gibets se dressèrent à tous les carrefours : les complices du prince Noir, poursuivis et traqués, y balancèrent leurs cadavres ; seul le prince Noir échappa, passé à temps à l’étranger, réfugié on ne sait dans quelle retraite, évanoui, à jamais disparu.
La Princesse sous verre réintégra, pour n’en jamais sortir, l’étroit vaisseau de la cathédrale. Hissée très haut au-dessus du maître-autel, au pied même du grand Christ ouvrant ses deux paumes percées sur les stalles du chœur, elle demeura désormais offerte à la vénération des foules dans une châsse scellée à même la muraille, une châsse, cette fois, toute en cristal de roche aux angles enrichis d’anémones d’opales, et qui luisait, incendiée de reflets, avec des prismes d’arc-en-ciel au milieu des pierreries brasillantes de vitrail de deux grandes rosaces.
Les cierges brûlaient leur flamme au-dessous d’elle, au-dessous d’elle se balançait, tel un oiseau énorme, la grande lampe du chœur et, vertigineuse, lointaine, elle apparaissait comme un point de lumière aux yeux éblouis des fidèles, morte-vivante retranchée de la vie et déjà de plain-pied avec l’éternité, déjà si près des nervures des voûtes, déjà si loin dans les hauteurs. On avait recouvert d’un drap d’or ses pauvres mains mutilées et, désormais cachée jusqu’au menton sous le somptueux linceul, on eût dit une vraie morte bien plus qu’une princesse endormie ; et les gens avaient peur quand durant les offices leurs yeux venaient à rencontrer sa petite tête de cire posée sur les coussins, hors du splendide amas d’étoffes.
Les pieds troués du Christ semblaient pleurer sur elle le sang de leurs blessures ; depuis longtemps déjà le vieux roi était mort.
III
Et des années s’écoulèrent et d’autres rois moururent. Une autre dynastie régnait sur la Courlande, des collatéraux éloignés du feu roi, qui n’avaient jamais connu la princesse Bertrade et le farouche Otto, vagues étrangers pour lesquels la martyre royale, enfermée dans sa châsse aérienne, n’était qu’une étrangère, une vague héroïne de conte. Des gens très âgés se souvenaient bien d’avoir assisté dans leur enfance à des cérémonies étranges, mais les forfaits du prince Otto s’associaient malencontreusement à ces souvenirs, ils obsédaient la mémoire du peuple ; et la famille régnante, alors dans toute la gloire et l’insolent orgueil de la Courlande unie et pacifiée, découvrit un beau jour que cette morte, juchée au milieu des bannières du chœur, avait trop longtemps attristé de son spectre les hosannas de triomphes. Cette Princesse sous verre enténébrait la cathédrale : on croyait toujours, sous cette châsse funèbre, assister à l’office des morts, et cette face de cadavre apparue dans le clair-obscur des voûtes changeait en De profundis les plus beaux Te deum ; et puis, du vivant du vieux roi, n’avait-elle pas assez longtemps épouvanté les villes et les campagnes par le sombre apparat de ses dolents cortèges, l’errante Princesse sous verre toujours par voies et par chemins ! La Courlande hallucinée n’était pas, après soixante ans de repos, encore remise de ce cauchemar ; pourquoi éterniser à jamais dans l’esprit des foules l’abominable souvenir d’une cour de fous et de maniaques, de reines ensorcelées et de princes criminels ? La mémoire d’un règne aussi tragique ne pouvait que nuire à la prospérité des autres règnes, ce serait une délivrance pour tous le jour où ce cercueil enchanté ne serait plus là.
Ce que veut l’empereur, le pape le bénit, ce que veut le roi, les prêtres l’encensent.
Une nuit, la châsse de cristal où reposait Bertrade fut descendue des voûtes. Pauvre Bertrade la pâle, l’évêque Afranus n’était plus là pour la défendre.
Il y a longtemps qu’il dormait, lui aussi, sous les dalles du chœur, en compagnie des autres prélats rangés, la crosse en main, sur de hauts sarcophages dans la crypte de la cathédrale. À la place même où la Princesse sous verre étincelait, planante, au-dessus des fidèles, les armes de la famille régnante s’étalèrent entre les étendards et les trophées de guerre, et le peuple applaudit ce blason héraldique écrasant de l’or de son cimier le divin tabernacle et la prière des cierges.
Une chapelle latérale avait reçu la châsse de Bertrade. Elle y vieillit dans l’ombre, objet des dévotions de quelques pauvres vieilles femmes, des survivantes de l’ancien règne qui peu à peu ne vinrent plus. Sainte sans miracles qui ne guérissait ni les lépreux ni les paralytiques, elle tomba bientôt dans l’abandon ; les petits clercs chargés d’entretenir la lampe devant sa splendeur spectrale se firent, eux aussi, négligents : les parois de cristal devinrent poussiéreuses, les opales des angles se ternirent, des araignées y tendirent leurs toiles, et ce fut comme un second suaire filé autour de la Princesse sous verre par le silence et par l’oubli.
Les moires et les soies qui la touchaient jaunirent, les fleurs de perles s’égrenèrent, et dans la moisissure et le délabrement de la pauvre chapelle une angoisse grandit autour de cette morte fantôme apparue, telle une poupée de cire, sous un linceul d’orfroi et des gazes raidies. Une longue ogive aux vitres dépolies versait en toute saison un morne jour d’hiver sur la nappe de l’autel et, posé à même le retable, le cercueil de verre y luisait tristement, tel un bloc de glace où se serait figé un cadavre. On n’allumait jamais les cierges, jamais diacre n’y célébrait de messe et les dévotes attardées à quelque autel voisin redoutaient, une fois la nuit tombée, de passer devant la chapelle et à cause de cette morte et à cause de cette plaie sous ce suaire, qui peut-être saignait toujours.
Et comme de mauvais prêtres, pour complaire aux princes régnants, parlaient de sorcellerie et citaient des histoires de vampires retrouvés frais et gras dans leur fosse, les yeux clos comme ceux de la princesse et comme elle, paraissant dormir, le haut clergé s’émut et résolut de dérober cette fille de roi aux soupçons populaires : il fallait rendre aussi et le plus tôt au culte la chapelle suspecte ; un scrupule pourtant arrêtait le chapitre, on ne pouvait sans sacrilège enterrer ce corps léthargique qui peut-être n’avait point cessé de vivre, on s’arrêta à ce projet : déposer la châsse royale sur une barque et confier l’une et l’autre au courant du fleuve, à la merci de Dieu.
La châsse fut transportée par une nuit sans lune sur la berge, au milieu des oseraies qui s’étendent derrière la cathédrale ; la princesse y fut furtivement embarquée à bord d’un bateau plat sous les yeux de l’évêque, assisté de trois diacres. Des feuillages de houx et des branches de pins formaient un lit de verdure autour d’elle, car Noël était proche et le houx et le pin chassent le Mauvais Esprit ; puis l’évêque donna une dernière absoute, on poussa la barque dans le courant du fleuve et la morte exilée se mit doucement à descendre.
Ils la suivirent longtemps des yeux et, quand ils la crurent enfin hors de la ville, ils rentrèrent précipitamment dans l’église et y célébrèrent une messe basse qui mit en repos leur conscience.
Au loin, très loin, vers le château des Bois, sous le vent froid de la nuit, la Princesse sous verre descendait les eaux lentes qui serpentent et se traînent au milieu des marais.
Elle vogua ainsi durant des lieues et des lieues entre les berges désolées par l’hiver : les roseaux séchés tintaient mélancoliquement sous la bise aigre, de gros nuages gris fuyaient éperdus dans le ciel, et, les nuits d’étoiles, de grandes ombres noires s’enlevaient lourdement au-dessus des étangs ; elles tournoyaient un instant avec des cris plaintifs à l’entour de la barque et puis fuyaient au loin comme en grande détresse, et rien n’était plus triste au-dessus des eaux pâles que ces appels d’oiseaux sauvages ; et la Princesse sous verre continuait de glisser sur le fleuve, indolente, entre les rives engourdies par le gel ; et personne n’accourait pour saluer son passage, elle dont les pèlerinages pieux avaient jadis soulevé tout le pays. L’épais brouillard des soirs et le givre des aubes la baignaient tour à tour, et sous la pluie, le vent, le verglas et la neige, la châsse de cristal, reluisante et lavée, avait l’éclat des anciens jours.
L’antique château des Bois de sa première enfance la vit rôder ainsi, toute une longue journée, au milieu des marais qui l’entourent, mais le vieux gardien, qui seul eût pu la reconnaître, était devenu aveugle ; on n’ouvrait plus à cause de ses yeux perdus les épais volets des croisées et la Princesse sous verre passa sans un salut à l’ombre de ses tours.
Et les rives recommencèrent plus mornes, plus plates et plus glacées à mesure qu’elles s’enfonçaient vers le Nord ; c’étaient des étendues de boue durcie où d’innombrables tiges de roseaux ondulaient à perte de vue, et pas un filet de fumée ne montait vers le ciel. Elle parvint ainsi l’avant-veille de Noël dans une solitude éclatante et figée, toute de tourbières et d’étangs et là, parmi les oseraies brunes et de vastes champs de flèches d’eau jaunies, les eaux du fleuve commencèrent à se prendre, et la barque s’arrêta à cause des glaçons.
Une infinie détresse pesait sur ce paysage dont l’air semblait gelé et muet ; on était à la veille de Noël et pas un son de cloche ne vibrait sur les plaines et pourtant les toits et le clocher, qui pointaient à quelques pas de là au-dessus d’un rideau de roseaux secs et blêmes, étaient bien les toits et le clocher d’un couvent.
Étrange moustier, en vérité, ce couvent d’hommes engourdi par l’hiver dans ce morne et dolent paysage, et dont pas une sonnerie, pas un chant liturgique ne réveillait la torpeur à la veille de la plus grande fête de l’Église, à la veille de Noël.
Étrange couvent ! Depuis plus de quarante années déjà on n’y sonnait plus les cloches, on n’y chantait plus de psaumes et, comme tombé en léthargie, il se taisait au milieu du silence assoupi des marais. Telle était la formelle volonté de son prieur, un plus étrange vieillard à la barbe toute blanche et qui bientôt allait mourir.
Une sombre légende voulait qu’en d’autres temps, du vivant du précédent abbé, un proscrit, un inconnu à face de bandit, fût venu demander asile dans ce monastère alors tout sonore et d’oraisons et d’Angélus ; l’homme accueilli y avait fait grande pénitence, y édifiant frères et novices par l’austérité de ses jeûnes et l’ardeur de ses flagellations. À son lit de mort, le précédent abbé l’avait désigné pour son successeur : le vote des moines avait ratifié ce choix. Mais depuis lors, au chœur comme dans le clocher, toute voix s’était tue, la prose des cantiques se lisait à voix basse, et, depuis quarante ans, toute cloche était muette. Le nouvel abbé avait imposé le silence à la communauté, la règle déjà étroite avait sous lui redoublé de rigueur ; et dans l’observance exacte de la règle, dans le jeûne, dans la veille, la prière et la pauvreté, le prieur actuel, un grand pécheur, disaient les uns, un grand seigneur, disaient les autres, attendait pour mourir que la voix des cloches immobiles éclatât dans l’espace, car, le jour où sonneraient les cloches, luirait pour lui l’heure de miséricorde et son passé lui serait pardonné.
Cette nuit-là, sous la neige qui commençait à voleter par les préaux, les moines quittèrent un à un leurs cellules et se rendirent au chœur pour la messe de minuit ; c’était désormais une messe basse sans hymnes d’allégresse, sans chants de bienvenue. Le prieur y descendit le dernier, si cassé, si vieux, si chargé de chagrins, de remords et d’années qu’il fallait deux moines pour le soutenir ; il y entra, les yeux éteints, la face si hâve et si tirée sous les flots de sa longue barbe qu’on eût dit un cadavre aux mains de deux frères ; mais à peine eurent-ils paru tous les trois sous le porche qu’une claire et joyeuse sonnerie les salua dans les airs : toutes les cloches en branle carillonnaient dans le clocher, et tous les moines sentirent une surprise exquise se fondre dans leur cœur.
Ils sortirent tous en grande hâte hors de l’enceinte du cloître et se répandirent en joie sur la berge pour voir quel ange du Seigneur était descendu dans la tour ; le prieur ébloui les suivait, appuyé sur ses aides, les deux mains en avant, tâtonnantes. Les cloches sonnaient seules à toute volée, mais au milieu du fleuve, arrêtée par les glaces, la Princesse sous verre rayonnait étincelante d’une surnaturelle clarté ; autour d’elle la neige floconnait douce et lente, et, sous le translucide reliquaire de cristal, son front transparaissait couronné de roses de Noël, non plus factices, mais fraîches écloses.
Son corps bienheureux avait rejeté son linceul, et, le sourire aux lèvres, ses longues paupières closes, elle dormait, tenant entre ses mains redevenues pures et belles, ses pauvres mains jadis dévorées par les chiens, une énorme gerbe de roses rouges, du rouge même du sang de ses plaies.
Et le prieur, étant tombé à genoux, comprit que Bertrade était morte, qu’elle avait pardonné, et que lui aussi allait mourir.
À lui, son cruel bourreau, à lui, le farouche Otto, le sinistre prince Noir devenu le prince Rouge, aujourd’hui moine et repentant, elle venait en signe d’absolution apporter la gerbe éclatante et vermeille, les roses symboliques écloses de ses plaies, les fleurs de son sang.
Il essaya de faire amener la barque au rivage, mais la glace se rompait sous les pas des frères lais, les harpons tombaient à l’eau, et il fut impossible de l’atteindre. Toute la nuit, le prince Otto la passa en prière, à genoux sur la berge, sous la neige tombante ; on avait allumé de grands feux ; les moines rangés autour chantaient tour à tour l’Hosanna et le Miserere ; sur le couvent en fête les cloches sonnaient toujours.
Aux premières lueurs de l’aube, les glaces se fondirent, la barque merveilleuse descendit les eaux lentes, puis disparut à un tournant du fleuve.
NEIGHILDE
D’après Andersen.
Neighilde au loin parfois voyage.
Un traîneau doublé de frimas
L’emporte au-dessus d’un nuage
À travers de meilleurs climats.
Comme un point au milieu des nues,
On voit filer au ciel neigeux,
Au-dessus des troupeaux de grues,
Neighilde et son traîneau brumeux.
Les vieux loups assis dans la neige
Hurlent au coin du bois désert,
Et les corbeaux lui font cortège,
Criant la faim, criant l’hiver.
À travers le vent, les bourrasques,
Elle va de ses doigts gelés
Cueillir les grandes fleurs fantasques
Dont les carreaux sont étoilés.
L’enfant couché dans la mansarde
Transi de peur entre ses draps,
Croit que Neighilde le regarde ;
Elle ne le voit même pas.
Elle est là-bas dans la Norvège,
Là-bas bien au-delà des mers,
Dans l’éternel palais de neige
Où dorment les futurs hivers.
Le petit Péters dormait dans la splendeur gelée du palais de Neighilde, au beau milieu de la salle des fêtes, figé dans la transparence d’un énorme pilier ; il dormait là, recroquevillé sur lui-même, son bonnet fourré rabattu sur les yeux, ses petites mains enfoncées dans ses moufles, devenu pareil à une toute petite chose, telle une relique dans une châsse de verre ! Autour de lui c’était la morne féerie, toute de pâleurs et d’éblouissements roses, toute de stalactites et d’icebergs du palais qu’enflammait une aurore boréale ; d’autres salles s’ouvraient à l’infini, désespérément vastes et vides, désespérément blanches aussi ; le vent du pôle y courait comme un fou et, nuit et jour, la neige y voletait floconnante, chassée et refoulée aux angles par les Rafales du vent du nord.
C’étaient les gardiennes du palais. Embusquées aux seuils, elles empêchaient avec leurs haleines coupantes la neige et le gel d’en murer les portes, et tel un madrépore immense, mille aiguilles de glace s’effilaient dans la nuit, rigides et géantes, riches de tous les feux et de tous les reflets changeants de l’arc-en-ciel. Spectral et splendide, le palais de Neighilde flamboyait comme un prisme au milieu du silence et des banquises du Pôle amoncelées par l’hiver.
Éternel hiver, éternelle détresse, éternel incendie de la nuit embrasée par les aubes boréales, et le petit Péters vivait dans cette détresse, dans cette solitude et dans ce silence, noir et raidi de froid sous ses fourrures rêches, mais insensible à la souffrance, devenu glaçon lui-même depuis que Neighilde avait passé sa main de givre sur son cœur ; indifférent à tout en vérité, halluciné par la splendeur des vastes salles éclatantes et vides et le vertige effarant de leurs voûtes, pleines de ténèbres et d’étoiles.
Depuis combien d’années était-il là ? Le petit Péters ne le savait plus. Il avait perdu la notion du temps en perdant la mémoire. Neighilde, en lui touchant le cœur, avait éteint toute flamme en lui ; il ne se souvenait plus ni de la ville de Norvège où il avait joué enfant sur la grande place toute retentissante de claquements de fouets et de cris, il ne se souvenait plus du vieux faubourg aux rues obscures et si étroites que les pauvres gens des mansardes allaient se visiter par des ponts de planches jetés d’une maison à l’autre ; et dans cette ville et dans ce faubourg pourtant, au cinquième étage d’une vieille et haute maison d’artisan, vivait une bonne aïeule à la voix chevrotante que le petit Péters avait intimement connue, une bonne aïeule à la tête chenue et qui, le long des grises journées d’hiver, la quenouille à la main, racontait des légendes à deux petits enfants accroupis à ses pieds devant l’âtre et qui déjà s’aimaient d’amour.
Et le petit Péters avait été l’un de ces enfants. Le petit Péters avait longtemps vécu dans la lointaine et populeuse ville de Norvège toute retentissante de claquements de fouets et de cris. Gamin emmitouflé avec d’autres gamins engoncés de fourrures, avait-il assez souvent patiné sur la grande place encombrée de traîneaux pendant les mois d’hiver ; mais Péters avait oublié son nom et le nom de l’aïeule, et le nom de la rue, et le nom de la ville où la neige floconnait six mois de l’année sur douze, mouchetant de molles choses blanches l’uniformité du ciel gris.
Oh ! l’essaim blanc des gros flocons neigeux dans l’air muet, toujours plus dru, toujours plus dense, avec quelle curiosité amusée il le regardait alors danser, le nez collé aux vitres de la petite fenêtre, dans le logis de la bonne aïeule, cette petite fenêtre toute fleurie en juin de pois de senteur et de capucines, toute ramagée de givre en hiver !… Et les récits de la vieille grand-mère appelaient ces flocons des abeilles blanches, disaient que ces abeilles-là avaient aussi une reine comme les abeilles d’or de l’été, mais que c’était une reine de glace avec des rayons de lune gelés aux épaules en guise d’ailes et un long manteau de givre fourré de neige brumeuse, que sa ruche était au-delà des pôles et que c’était, construit en glaçons, un morne palais immobile, tout de pâleurs et de splendeurs, un énorme palais spectral aux hautes salles désertes, aux éclatantes coupoles transparentes et rigides, éternellement incendié par les aurores boréales.
Et cette reine s’appelait Neighilde, et le petit Péters l’aimait et la redoutait. Oh ! cette reine pétrifiée et comme léthargique des abeilles d’hiver, cette vierge auguste des blémissantes visions du Pôle, le petit Péters l’avait aimée et l’avait beaucoup redoutée en même temps, car la voix cassée de l’aïeule la faisait aussi voyageuse et errante et, par les nuits de décembre, il pouvait arriver, en regardant le ciel, d’y voir apparaître le traîneau de la reine.
Oh ! cette reine des Neiges avec son cénacle de vieux loups assis au bord des fiords et hurlant à la mort, de quelle angoisse délicieuse, de quelle terreur poignante elle emplissait alors l’âme du petit Péters.
Il était maintenant son captif. À force de l’aimer, il avait attiré le regard mort de la reine, et Neighilde avait voulu pour elle et à elle seule la petite âme du petit Péters. Blotti contre le sein royal, enfoui dans le givre d’une glaciale poitrine, Péters avait connu les affres et les effrois des voyages à travers les nues, au-dessus des villes, des détroits et des mers ; de grands vols de cigognes s’étaient effarés devant lui, devant lui des troupeaux de sorcières s’étaient dispersés en criant dans des vapeurs d’orages, et des matelots s’étaient signés, sur des nefs, en voyant passer à travers les voilures l’éperon du traîneau qui l’emportait.
Il avait vu fuir à ses pied des tours de cathédrales, des gargouilles de beffrois et de gigantesques saints Michel dorés soufflant de la trompette au haut des campaniles, des citadelles sur des monts, des abbayes dans des vallées, des fleuves sous des ponts et d’autres fleuves dans des campagnes ; et toujours de grosses abeilles blanches tournoyaient autour d’eux, très haut dans le ciel pâle ; autour d’eux d’énormes corbeaux cinglaient à tire-d’ailes, tandis qu’à l’avant du traîneau deux énormes poules blanches volaient, silencieuses ; et le petit Péters avait dit un Pater, mais Neighilde l’avait baisé au front et le petit Péters avait oublié ses prières, un grand froid l’avait saisi, et de douleur il avait voulu appeler Gerda, Gerda, la petite fille qui dans le vieux logis du faubourg, au milieu des cendres de l’âtre, écoutait avec lui les récits de l’aïeule ; mais Neighilde avait posé sa main sur le cœur de Péters, et Péters ne s’était plus souvenu du nom de Gerda ni du nom de sa ville, ni du nom de la grand’mère, ni de son nom à lui, mais il avait soudain cessé d’avoir froid. Un bien-être l’avait envahi, en même temps que la lune flambait, comme agrandie, plus ronde parmi des nuées de nacre, et que le manteau de Neighilde flottait démesurément long parmi un vol plus dense d’énormes oiseaux de nuit : et dans de la mollesse et de la tiédeur, le petit Péters s’était endormi.
Il ne s’était pas réveillé depuis.
C’est alors que Gerda pénétra dans la salle. Gerda était la petite fille qui, les longs soirs d’été, assise au rebord du toit de leur haute maison, sur un petit banc fabriqué par eux, et pour eux posé entre les deux fenêtres, regardait avec Péters voler les hirondelles et flotter dans la brise les fleurs de chèvrefeuilles.
Accroupie aux pieds de l’aïeule, elle avait plus d’une fois écouté le conte de Neighilde et croyait, comme Péters, à l’existence des abeilles blanches et à la féerie gelée du palais de Neighilde, là-bas au delà du Pôle, au pays de l’hiver. Elle aimait Péters d’amour et quand il avait disparu, elle s’était mise à sa recherche et pour le retrouver avait quitté la ville, la bonne aïeule en sa mansarde et le vieux logis du faubourg.
Elle s’était mise en route en chantant un cantique, riche de sa confiance et de son petit cœur brave, et, pour retrouver le petit ami perdu, avait interrogé le fleuve et les roseaux, la campagne et les fleurs et dans l’immense univers monotone et triste, elle avait cheminé des heures et des jours, des mois et des années sans jamais se lasser, étant encore à l’âge de l’espoir.
Et la nature et le triste univers avaient pris cette enfant en pitié… Pour la conduire au pays des fées une barque s’était détachée du rivage ; pour la laisser passer des vieux saules tordus s’étaient subitement redressés, des grenouilles magiciennes lui avaient souhaité la bienvenue et dans une île réputée dangereuse une vieille, un peu sorcière, l’avait accueillie, accorte et pourtant inquiétante sous un immense chaperon de roses jaunes. Gerda avait même désarmé les fées. Sous le peigne d’or qui en lissant ses cheveux devait endormir sa mémoire, elle avait gardé le souvenir ; des fleurs exilées dans le fond de la terre avaient jailli sous ses larmes, des pervenches avaient parlé et Gerda avait appris de leurs corolles, qui sont des bouches, où se cachait le petit Péters ; et Gerda avait repris sa route dans le morne et triste univers.
Une vieille corneille lui avait servi de guide. Conseillée par elle, elle avait su plaire à un fils de roi, mais elle avait en même temps intéressé une princesse et pu échapper au périlleux honneur de l’emploi de favorite ; les songes qu’elle inspirait avaient protégé sa fuite, et à la nuit tombante elle avait pu s’esquiver du palais, mais d’autres dangers l’attendaient et d’autres aventures. Des brigands s’étaient emparés d’elle dans l’horreur nocturne d’une forêt ; elle avait été emmenée prisonnière dans leur caverne, elle y avait pantelé sous le couteau d’une ogresse ; mais, sauvée par miracle par la fille des brigands, une affreuse petite sauvagesse prise au charme de ses grands yeux bleus et de sa peau blanche, Gerda avait retrouvé sa liberté et gagné sur le dos d’un renne la plate étendue des steppes et les confins du royaume de Neighilde.
Elle y errait depuis des mois sous le ciel bas et la bise aigre, renvoyée de hutte en hutte et recommandée par les sorcières laponnes aux sorcières finnoises, puis son renne fidèle avait dû l’abandonner, son renne après sa vieille corneille, et toute seule, grelottante dans sa robe de drap cramoisi et sous son gros bonnet de cygne, elle avait hardiment pénétré sur le territoire de Neighilde. La reine était alors absente, appelée à cause des gelées en Sicile, dont les amandiers étaient en péril (elle était allée assurer la récolte), et malgré les rafales en sentinelles aux portes, leurs faces de givre et leurs haleines coupantes, Gerda était entrée dans le palais.
Après la vingtième salle elle trouvait Péters endormi, captif dans son pilier de glace, s’agenouillait sous la neige tourbillonnante et entonnait doucement le cantique qu’ils chantaient jadis tous les deux dans la mansarde aux petites fenêtres ramagées de verglas, dans la vieille maison du faubourg.
Noël a fleuri, blanc de roses blanches
Et voici venir le petit Jésus.
Et le pilier s’était fendu du haut en bas, le petit Péters par la fissure bleuâtre était venu glisser tout endormi jusqu’aux pieds de Gerda, qui lui avait jeté ses bras autour du cou.
Le houx et le gui verdoient branche à branche,
Les plus humbles fronts sont ce soir élus ;
Noël a fleuri, blanc de roses blanches
Et voici venir le petit Jésus.
Et sous la tiédeur des larmes, le glaçon où s’était figé le cœur du petit Péters ayant fondu, Péters se réveillait, retrouvait la mémoire, reconnaissait Gerda, balbutiait un Pater, le nom de la bonne aïeule et celui de sa ville et celui de sa rue, et, la main dans la main de sa petite amie, fuyait à grands pas le palais de Neighilde. Ils gagnèrent ainsi tous les deux la banquise et la steppe et enfin la campagne, la campagne déjà verte des orges de mars, la campagne déjà bleue des pervenches d’avril, et partout, sur la route, les clochers des villages reprenaient en refrain l’humble et divin cantique :
Les cœurs ont fleuri pleins de roses blanches
Et voici venir le petit Jésus.
LA PRINCESSE NEIGEFLEUR
I
Quand la reine Imogine sut que la princesse Neigefleur n’était pas morte, que le lacet de soie qu’elle lui avait serré elle-même autour du cou ne l’avait qu’à demi étranglée et que les gnomes de la forêt avaient recueilli ce doux corps léthargique dans un cercueil de verre, pis, qu’ils le gardaient invisible dans une grotte magique, elle entra dans une grande colère : elle se dressa toute droite dans la stalle de cèdre où elle songeait, assise dans la plus haute chambre de sa tour, déchira dans toute sa longueur sa lourde dalmatique de brocart jaune enrichie de lys et de feuillages de perles, brisa contre terre le miroir d’acier qui venait de lui apprendre l’odieuse nouvelle et, saisissant de male rage par la patte de derrière le crapaud enchanté qui lui servait pour ses maléfices, elle le lança à toute volée dans la flamme de l’âtre où il fit frisst, grisst et prisst et s’évapora comme feuille sèche.
Cela fait, un peu calmée, elle ouvrit les vantaux de la haute fenêtre, dont les mailles de plomb enserraient des nains sonnant du cor, et se pencha sur la campagne. Elle était toute blanche de neige et, dans l’air froid de la nuit, de lents flocons éparpillés, comme de l’ouate, tendaient tout l’horizon d’une étrange hermine dont les mouchetures inversées auraient été blanches sur fond noir. Une grande rougeur incendiait la neige au pied de la tour, et la reine savait que c’était le feu des cuisines, des cuisines royales où les marmitons préparaient le festin du soir, car cela se passait le dimanche même de l’Épiphanie et il y avait grande fête au château ; et cette malfaisante reine Imogine ne put s’empêcher de sourire dans la noirceur de son âme, car elle savait qu’à ce moment même rôtissait pour la bouche du roi un paon merveilleux, dont elle avait traîtreusement remplacé le foie par un salmigondis d’œufs de lézards et de jusquiame, pharmaque horrible qui devait achever d’égarer les esprits du vieux monarque et bannir à tout jamais de cette chancelante mémoire le doux souvenir de la princesse Neigefleur.
Cette frêle et doucereuse petite masque de Neigefleur, pourquoi s’avisait-elle aussi, avec ses grands yeux bleu faïence et son insipide face de poupée, de la surpasser en beauté, elle, la merveilleuse Imogine des Îles d’Or ? Il avait fallu qu’elle vînt dans ce mauvais petit royaume d’Aquitaine pour s’entendre crier à tue-tête et à toute heure du jour et par le vent des haies et par les roses des parterres et jusque par son miroir, un miroir véridique animé par les fées : « Ta beauté est divine et charme les oiseaux et les hommes, grande reine Imogine, mais la princesse Neigefleur est plus belle que toi ! » La petite peste ! Alors elle n’avait plus eu ni trêve ni répit ; il n’y avait pas eu de vilenies dont elle n’eût, en vraie marâtre, accusé la petite princesse pour la perdre dans l’esprit du roi. Mais le vieil imbécile, aveuglé de tendresse, n’écoutait que d’une oreille, tout féru qu’il fut de passion sensuelle pour sa beauté de reine magicienne. Les poisons eux-mêmes n’avaient aucune prise sur ce frêle petit corps d’enfant : son innocence ou les fées la protégeaient. Elle se souvenait encore avec rage du jour où, n’y pouvant tenir, elle avait fait déshabiller par ses femmes l’épeurée petite princesse et fustiger ses frissonnantes épaules jusqu’au sang ; elle voulait voir enfin entamée et gâtée par les verges cette éblouissante nudité, et les verges, aux mains des mégères, s’étaient changées en plumes de paon qui n’avaient fait qu’effleurer et frôler la peau de la vierge frémissante.
C’est alors qu’exaspérée de dépit, elle avait résolu sa mort. Elle l’avait étranglée de ses mains royales et fait transporter durant la nuit à la lisière du parc, prête à accuser du meurtre quelque troupe de bohémiens. Bonheur inespéré ! elle n’avait même pas eu à servir cette belle invention au roi : les loups s’étaient chargés de l’affaire ; la princesse Neigefleur avait simplement disparu et l’orgueilleuse marâtre triomphait, quand voilà que son miroir magique interrogé la navrait. Elle s’en était vengée, il est vrai, en le brisant à l’instant même, mais elle était bien avancée, puisque sa rivale vivait endormie sous la garde tutélaire des nains !
Et très perplexe, elle allait prendre au fond d’une armoire une tête desséchée de pendu, qu’elle consultait dans les grandes occasions, et, l’ayant posée sur un grand livre ouvert au milieu d’un pupitre, elle allumait trois cierges de cire verte et s’abîmait dans des pensées sinistres.
II
Elle cheminait maintenant très loin, très loin, très loin du palais endormi, dans le grand silence de la forêt gelée, la forêt pareille à un immense madrépore ; elle avait jeté sur sa robe de soie blanche une limousine de laine brune, qui la faisait ressembler à quelque vieux sorcier, et, son fier profil en retrait sous la sombre capuche, elle se hâtait au pied des chênes énormes, dont les troncs blancs de neige apparaissaient eux-mêmes comme de grands pénitents. Il y en avait qui, avec leurs branches dressées haut dans l’ombre, semblaient la maudire de toute la force de longs bras décharnés ; d’autres, écrasés dans d’étranges attitudes, paraissaient agenouillés sur le bord de la route ; on eût dit sous des cagoules de givre des moines en prière et tous processionnaient bizarrement, les mains singulièrement jointes et raidies au-dessus de la neige où les pas amortis n’éveillaient aucun bruit : il faisait presque doux dans la forêt, le gel l’avait assoupie, et la reine, tout entière à son projet, précipitait sa course silencieuse, les pans de son manteau hermétiquement ramenés sur on ne sait quel objet, qui vaguement remuait et vagissait.
Un enfant de six mois, qu’elle avait dérobé en passant dans la chambre d’une femme de service et qu’elle emportait par cette calme et douce nuit d’hiver pour l’égorger à minuit sonnant, ainsi qu’il est prescrit, à un carrefour de routes… Les elfes ennemis des gnomes accourraient tous pour boire le sang tiède et elle les charmerait avec sa flûte de cristal, la flûte à trois trous des sûres incantations magiques. Une fois charmés, les elfes obéissants la conduiraient par le dédale de la forêt transie à la grotte des nains. L’entrée en était visible et béante, toute cette nuit bénie de l’Épiphanie, comme durant toute la nuit de Noël. Ces deux nuits-là, tout enchantement demeure suspendu par la toute-puissante grâce de Notre-Seigneur ; et toute caverne et cachette souterraine de gnomes, gardiens de trésors enfouis, s’ouvre accessible aux pas humains. Elle entrerait dans l’antre en dispersant avec son émeraude la troupe effarée des kobolds, s’approcherait du cercueil de verre, en forcerait la serrure, en briserait les parois au besoin et frapperait au cœur sa rivale endormie ; elle ne lui échapperait pas cette fois.
Et comme elle se hâtait, ruminant sa vengeance, sous les fins coraux blancs et les arborescences de la forêt givrée, des psaumes et des voix s’élevèrent tout à coup, une vibration de cristal courut à travers les branches engourdies, toute la forêt frémit comme une harpe, et la reine, immobilisée de stupeur, vit s’avancer un singulier cortège.
C’était, sous ce ciel nuageux d’hiver, dans l’étincelant décor d’une clairière de neige, des dromadaires et des chevaux racés et fins, et puis des palanquins de soie bariolée et brillante, des étendards surmontés de croissants, des boules d’or enfilées à de longs fers de lance, et des litières et des turbans. Des négrillons tout à fait diaboliques dans leur gandoura de soie verte piétinaient peureusement la neige, des anneaux allumés de pierreries tintaient à leurs chevilles et, sans l’émail éclatant de leur rire, on eût dit de petites statues de marbre noir. Ils se pressaient sur les pas de majestueux patriarches diadémés de molles étoffes rayées d’or ; la gravité de leur hautain profil se continuait dans la soyeuse écume de longues barbes blanches, et d’immenses burnous de soie, du blanc argenté de leurs barbes, s’ouvraient sur de lourdes robes d’un bleu de nuit ou d’un rose d’aurore, toutes fleuries de pierreries et d’arabesques d’or ; et les palanquins, où de vagues femmes voilées s’entrevoyaient comme dans un rêve, oscillaient au dos des dromadaires, et la lune, qui venait de se lever, miroitait au revers de soie des étendards. Des parfums pénétrants et musqués de cinname, de benjoin et de nard s’exhalaient en minces tourbillons bleuâtres ; des ciboires tout bossués d’émaux brillaient entre des doigts d’un noir d’ébène en guise de cassolettes, et, sous la lune montante, les psaumes éclataient, moins chantés que gazouillés en douce langue orientale, comme enroulés dans la gaze des voiles et la fumée des encensoirs.
La reine, arrêtée derrière un tronc d’arbre, avait reconnu les Rois mages, le roi nègre Gaspar, le jeune cheik Melchior et le vieux Balthazar ; ils allaient, comme il y a deux mille ans, rendre à l’Enfant divin leur adorant hommage.
Ils étaient déjà passés.
Et la reine, livide sous son manteau de berger, songeait trop tard que, la nuit de l’Épiphanie, la présence des Mages en marche vers Bethléem rompt le pouvoir des maléfices, qu’aucun sortilège n’est possible dans l’air nocturne comme imprégné de la myrrhe des encensoirs.
Elle avait donc fait un voyage inutile. Inutiles devenaient les lieues dévorées par elle dans la forêt fantôme ; à recommencer sa périlleuse équipée par le froid et la neige. Elle voulut faire un pas et retourner en arrière, mais l’enfant, qu’elle tenait serré dans son manteau, pesait étrangement sur son bras ; il était devenu d’une lourdeur de plomb, il la figeait là immobilisée dans la neige, la neige étrangement amoncelée autour d’elle et où ses pieds raidis ne pouvaient avancer.
Un horrible charme la tenait prisonnière dans la forêt spectrale : c’était la mort certaine si elle ne pouvait en rompre le cercle. Mais qui viendrait à son secours ? Tous les mauvais esprits restent prudemment tapis dans leurs retraites durant cette lumineuse nuit d’Épiphanie ; seuls les bons esprits, amis des humbles et des souffrants, s’y risquent à rôder encore, et cette insidieuse reine Imogine eut l’idée d’appeler les gnomes à son aide, les bons petits seigneurs, tout de vert vêtus et chaperonnés de primevères, qui avaient recueilli Neigefleur ; et, les sachant enfantinement épris de musique, elle eut la force de tirer sa flûte de cristal de dessous son manteau et de la porter à ses lèvres.
Elle défaillait sous le poids de l’enfant devenu pareil à un bloc de glace ; ses pieds crispés dans la neige bleuissaient, devenaient noirs, et ses lèvres violettes trouvaient encore des sons mélancoliques et doux, d’une tristesse poignante et d’une volupté tendre, douloureux et captivants adieux d’une âme à l’agonie ; résignée, elle tentait encore dans une vague espérance un inutile appel.
Et, tandis que tout le mensonge de sa vie s’apitoyait sur ses lèvres, ses yeux fouillaient avidement le clair-obscur de la clairière, l’ombre des arbres, les sillons tortueux des racines et jusqu’aux souches laissées par les bûcherons : équivoques profils de végétaux où les gnomes d’abord se manifestent.
Tout à coup la reine tressaillit. De tous les points de clairière une multitude d’yeux brillants la fixaient : c’était comme un cercle d’étoiles jaunes refermé sur elle. Il y en avait entre chaque arbre, il y en avait dans les racines des chênes, il y en avait loin, il y en avait tout près, et chaque paire d’yeux fulgurait phosphorescente, à mi-hauteur d’homme, dans la nuit.
C’étaient les gnomes… enfin ! et la reine étouffait un cri de joie qui se figeait presque aussitôt d’épouvante : elle venait d’apercevoir deux oreilles pointues au-dessus de chaque paire d’yeux, au-dessous de chaque paire d’yeux un museau velu et un retroussement de babines à dents blanches.
Sa flûte magique n’avait appelé que les loups.
On retrouva le lendemain son corps dépecé par les bêtes : ainsi mourut par une claire nuit d’hiver la méchante reine Imogine.
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
https://groups.google.com/g/ebooksgratuits
Adresse du site web du groupe :
https://www.ebooksgratuits.com/
—
Mars 2025
—
— Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : Jean-Marc, DanièleH, Coolmicro.
— Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
— Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l’original. Nous rappelons que c’est un travail d’amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.