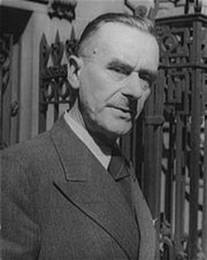
Thomas Mann
LA MONTAGNE MAGIQUE
Tome 2
(1924)
Traduit de l’allemand par Maurice Betz
Table des matières
DU ROYAUME DE DIEU ET DE LA DÉLIVRANCE PERVERSE
COLÈRE BLEUE ET SURPRISE PÉNIBLE
À propos de cette édition électronique
CHAPITRE VI
CHANGEMENTS
Qu’est-ce que le temps ? Un mystère ! Sans réalité propre, il est tout-puissant. Il est une condition du monde phénoménal, un mouvement mêlé et lié à l’existence des corps dans l’espace, et à leur mouvement. Mais n’y aurait-il point de temps s’il n’y avait pas de mouvement ? Point de mouvement s’il n’y avait pas de temps ? Interrogez toujours ! Le temps est-il fonction de l’espace ? Ou est-ce le contraire ? Ou sont-ils identiques l’un à l’autre ? Ne vous lassez pas de questionner ! Le temps est actif, il produit. Que produit-il ? Le changement. « À présent » n’est pas « autrefois », « ici » n’est pas « là-bas », car entre les deux il y a mouvement. Mais comme le mouvement par lequel on mesure le temps est circulaire, refermé sur lui-même, c’est un mouvement et un changement que l’on pourrait aussi bien qualifier de repos et d’immobilité ; car l’« alors » se répète sans cesse dans l’« à présent », le « là-bas » dans l’« ici ». Comme, d’autre part, on n’a pu, malgré les efforts les plus désespérés, se représenter un temps fini et un espace limité, on s’est décidé à « penser » le temps et l’espace comme éternels et infinis, apparemment, dans l’espoir d’y réussir, sinon parfaitement, du moins un peu mieux. Mais en postulant ainsi l’éternel et l’infini, n’a-t-on pas logiquement et mathématiquement détruit tout le fini et tout le limité ? Ne l’a-t-on pas relativement réduit à zéro ? Une succession est-elle possible dans l’éternel, et, dans l’infini, une juxtaposition ? Comment mettre d’accord ces hypothèses auxiliaires de l’éternel et de l’infini, avec des concepts comme la distance, le mouvement, le changement, et ne serait-ce que la présence de corps limités dans l’univers ? On peut se le demander.
Hans Castorp se posait ces questions, et d’autres semblables. Son cerveau, dès son arrivée en-haut, s’était montré disposé à de telles indiscrétions et à de telles finasseries, et, par une jouissance périlleuse, mais immense, chèrement payée depuis lors, il avait peut-être été particulièrement exercé à de telles questions et encouragé aux spéculations téméraires. Il s’interrogeait lui-même, et le bon Joachim, et la vallée couverte depuis des temps immémoriaux d’une neige épaisse, bien que d’aucune de ces instances il ne pût rien attendre qui ressemblât à une réponse, – il est difficile de dire de laquelle il pouvait le moins attendre. À lui-même, il ne faisait que poser ces questions, parce qu’il n’y connaissait pas de réponse. Quant à Joachim, il était presque impossible d’éveiller en lui un intérêt pour de pareils objets, car, ainsi que Hans Castorp l’avait dit un soir en français, il ne pensait à nulle autre chose qu’à devenir soldat dans la plaine et poursuivait une lutte acharnée avec cet espoir qui tantôt s’approchait, tantôt se gaussait de lui et s’évanouissait à nouveau dans le lointain, et à cette lutte, il se montrait depuis peu disposé à mettre fin par un coup de force. Oui, le bon, le patient, le régulier Joachim, si complètement imbu des idées de service et de discipline, succombait à des tentations de révolte, il protestait contre « l’échelle Gaffky », ce système d’examen d’après lequel on établissait et on chiffrait au laboratoire dans le sous-sol, ou au « labo », comme on disait d’ordinaire, le degré d’infection d’un patient par les bacilles : selon qu’on découvrait ceux-ci en quelques exemplaires ou bien en quantités innombrables dans le tissu analysé, le numéro de l’échelle Gaffky était plus ou moins élevé, et tout dépendait de ce chiffre. Car, sans erreur possible, il exprimait les chances de guérison avec lesquelles son titulaire pouvait compter ; le nombre de mois ou d’années que l’on devait encore passer ici était aisé à déterminer au moyen de ce chiffre, depuis la petite visite de politesse de six mois jusqu’au verdict « à vie », lequel, si on lui appliquait les mesures ordinaires du temps, pouvait d’ailleurs se réduire à fort peu de chose. C’est donc contre cette échelle Gaffky que Joachim s’insurgea. Il renia ouvertement toute foi en son autorité ; non pas tout à fait ouvertement, non pas précisément à la face des supérieurs, mais devant son cousin et même à table. « J’en ai assez, je ne me laisse pas duper plus longtemps, dit-il à voix haute, et le sang monta à son visage bronzé. Il y a quinze jours, j’avais 2 à l’échelle Gaffky, une bagatelle, les meilleures perspectives, et voici que j’ai 9, que je suis littéralement infesté, et il ne peut plus être question de départ. Que le diable comprenne où j’en suis, ce n’est plus supportable. Tout en haut, à Schatzalp, il y a un homme, un paysan grec, ils l’ont envoyé d’Arcadie, c’est un agent qui l’a envoyé, – un cas désespéré, phtisie galopante, l’exitus peut se produire d’un jour à l’autre, mais jamais de sa vie notre homme n’a eu de bacilles dans sa salive. Par contre, le gros commandant belge qui est parti bien portant lorsque je suis arrivé, avait été Gaffky N° 10, cela avait littéralement grouillé chez lui, et pourtant il n’avait eu qu’une toute petite caverne. Je me moque de Gaffky. J’arrête les frais et je rentre chez moi même si cela doit être ma mort. » Ainsi parla Joachim ; et tous furent péniblement affectés de voir le jeune homme si doux, si posé, dans un tel état de rébellion. Hans Castorp, en entendant Joachim menacer de tout lâcher et de partir pour la plaine ne put s’empêcher de se souvenir de certaines paroles qu’il avait entendu prononcer en français, de la bouche d’un tiers. Mais il garda le silence. Pouvait-il proposer en exemple à son cousin sa propre patience, comme faisait Mme Stoehr qui exhortait vraiment Joachim de ne pas faire la mauvaise tête d’une manière aussi blasphématoire, mais de se résigner en toute humilité, et de prendre pour modèle la constance dont elle, Caroline, faisait preuve, en persévérant en ces lieux et en s’interdisant avec fermeté de reprendre chez elle, à Cannstatt son rôle de maîtresse de maison, afin de pouvoir rendre quelque jour à son mari une épouse complètement et définitivement guérie ? Non, Hans Castorp n’osait trop le faire, et d’autant moins que, depuis le Carnaval, il se sentait des scrupules à l’égard de Joachim. C’est-à-dire : sa conscience lui disait que Joachim devait voir en certains faits dont ils ne parlaient pas, mais que Joachim connaissait sans nul doute quelque chose de pareil à une trahison, une désertion et une infidélité. Et cela par rapport à deux yeux ronds et bruns, aux accès de rire mal justifié et à un certain parfum d’orange dont il subissait les effets cinq fois par jour, mais devant quoi il baissait sévèrement et pudiquement les yeux vers son assiette… Et même dans la résistance muette que Joachim avait opposée à ses spéculations et à ses divagations sur le « temps », Hans Castorp crut reconnaître un peu de cette rigueur militaire qui contenait un reproche à son égard. Quant à la vallée, à la vallée hivernale, couverte d’une épaisse couche de neige, à laquelle Hans Castorp, dans son excellente chaise-longue, posa également ces questions transcendantes, ses pics, ses cimes, ses parois et ses forêts brunes, vertes et rougeâtres restaient immobiles et muets dans la durée, tantôt étincelants dans l’azur profond, tantôt enveloppés de brumes dans le flux silencieux du temps terrestre, tantôt rougeoyant sous le soleil qui les quittait, tantôt d’un éclat adamantin et dur dans la magie du clair de lune ; mais ils étaient toujours sous la neige, depuis six mois immémoriaux et qui pourtant s’étaient évanouis en un clin d’œil, et tous les pensionnaires déclaraient qu’ils ne pouvaient plus voir la neige, qu’elle leur répugnait, que l’été déjà les avait comblés à cet égard, mais que des masses de neige, au jour le jour, des monceaux de neige, des coussins de neige, des pentes de neige, cela surpassait les forces humaines, c’était mortel pour l’esprit et le cœur. Et ils mettaient des lunettes de couleur, vertes, jaunes et rouges, sans doute pour garantir leurs yeux, mais davantage encore pour leur cœur.
Il y aurait vraiment six mois que la vallée et les montagnes seraient sous la neige ? Il y en avait même sept ! Le temps passe tandis que nous contons, – notre temps à nous, celui que nous consacrons à cette histoire, mais aussi le temps profondément antérieur de Hans Castorp et de ses compagnons de sort, là en haut dans la neige, et il produit des changements. Tout était en train de s’accomplir ainsi que Hans Castorp l’avait, pour l’indignation de M. Settembrini, prédit en quelques mots rapides le jour du Carnaval, en rentrant de Platz : non pas précisément que le solstice d’été eût été déjà tout proche, mais Pâques avait traversé la blanche vallée, avril s’avançait, la perspective de la Pentecôte s’ouvrait ; bientôt le printemps éclaterait, avec la fonte des neiges. Non pas de toutes les neiges : sur les sommets du Sud, dans les crevasses rocheuses de la chaîne du Raetikon, au Nord, il en restait toujours, sans parler de celle qui tomberait aussi tous les mois de l’été, mais qui ne resterait pas. Et cependant la révolution de l’année promettait à coup sûr du nouveau et du décisif avant peu, car depuis cette nuit de Carnaval pendant laquelle Hans Castorp avait emprunté un crayon à Mme Chauchat, le lui avait ensuite rendu, et avait, sur le désir qu’il en exprima, reçu en échange quelque chose d’autre, un souvenir qu’il portait dans sa poche, six semaines déjà s’étaient écoulées – deux fois autant que Hans Castorp avait dû primitivement en passer ici.
Six semaines s’écoulèrent en effet depuis le soir où Hans Castorp avait fait la connaissance de Clawdia Chauchat et puis était remonté dans sa chambre avec un tel retard sur le strict Joachim ; six semaines depuis le jour suivant qui avait amené le départ de Mme Chauchat, son départ provisoire pour le Daghestan, très loin, à l’Est, au delà du Caucase. Que ce départ fût de caractère provisoire, que ce ne fût pas un départ pour de bon, que Mme Chauchat eût l’intention de revenir, elle ne savait trop quand, mais qu’elle voulût ou dût revenir un jour, de cela Hans Castorp avait reçu des assurances, directes et verbales, qui lui avaient été données non point lors du dialogue en langue étrangère que nous avons rapporté, mais dans l’intervalle de temps que, pour notre part, nous avons laissé s’écouler sans mot dire, durant lequel nous avons interrompu le cours lié au temps, de notre récit et pendant lequel nous n’avons laissé régner que lui, la durée pure. De toute façon, le jeune homme avait reçu ces assurances et ces affirmations consolantes avant qu’il ne fût retourné au N° 34 ; car le lendemain il n’avait plus échangé une parole avec Mme Chauchat, l’avait à peine vue, l’avait aperçue deux fois de loin : au déjeuner, lorsque en robe de drap bleu et en jaquette de laine blanche, elle était une dernière fois venue à table en faisant claquer la porte et en marchant de son pas gracieusement glissant – le cœur de Hans Castorp avait alors battu dans le gosier, et seule la surveillance sévère que Mlle Engelhardt avait exercée sur lui l’avait empêché de cacher sa figure dans ses mains, – et ensuite, à trois heures de l’après-midi, lors de son départ, auquel il n’avait pas, à proprement parler, assisté, mais qu’il avait observé d’une fenêtre du couloir qui donnait vue sur le chemin d’accès au sanatorium.
Cet événement s’était déroulé tout comme Castorp, depuis son séjour ici, l’avait déjà plusieurs fois vu se dérouler : le traîneau ou la voiture s’arrêtait près de la rampe, le cocher et le garçon d’étage chargeaient les bagages, des pensionnaires du sanatorium, les amis de celui qui, guéri ou non, reprenait le chemin du pays plat pour y vivre ou y mourir, ou tout bonnement ceux qui manquaient leur service pour laisser agir sur eux cet événement, se rassemblaient devant le portail : un Monsieur de l’administration, en redingote, parfois même les médecins étaient présents, et puis le partant sortait, le visage le plus souvent rayonnant, saluant avec bonne grâce les curieux qui l’entouraient et restaient en arrière, et puissamment stimulé, pour l’instant, par l’aventure… Cette fois-ci donc ç’avait été Mme Chauchat qui était sortie, souriante, les bras chargés de fleurs, dans un long manteau de voyage, rugueux et garni de fourrure, avec un grand chapeau, escortée par M. Bouliguine, son compatriote à la poitrine creuse, qui faisait avec elle une partie du voyage. Elle aussi semblait pleine d’une animation joyeuse, comme tout partant l’était – par la seule perspective d’un changement d’existence, indépendamment du fait que l’on partait avec l’autorisation du médecin, ou que l’on n’interrompait son séjour que par un dégoût désespéré, à ses risques et périls, et la conscience inquiète. Ses joues avaient rougi, elle bavardait sans arrêt, probablement en russe, tandis qu’on lui enveloppait les genoux d’une couverture de fourrure… Il n’était pas venu que des compatriotes ou des commensaux de Mme Chauchat, mais beaucoup d’autres pensionnaires encore étaient présents : le docteur Krokovski avait, dans un mâle sourire, découvert ses dents jaunes au milieu de sa barbe, la grand’tante avait offert de la compote à la voyageuse, de la « petite compaute », comme elle avait coutume de dire, c’est-à-dire de la marmelade russe ; l’institutrice s’était trouvée là ; le Mannheimois restait à quelque distance, aux aguets, le regard trouble ; ses yeux affligés avaient glissé le long de la maison où ils avaient découvert Hans Castorp à la fenêtre du corridor et, troublés, s’étaient un instant arrêtés sur lui… Le docteur Behrens ne s’était pas montré ; sans doute, avait-il déjà pris congé de la voyageuse à une autre occasion, et en particulier… puis, au milieu des signes et des appels de tout cet entourage, les chevaux avaient tiré, et les yeux obliques de Mme Chauchat avaient, à leur tour, – tandis que le mouvement du traîneau avait rejeté le haut de son corps sur les coussins, – encore une fois parcouru en souriant la façade du Berghof, et la durée d’une fraction de seconde s’étaient arrêtés sur le visage de Hans Castorp… Ainsi laissé en arrière, il avait couru tout pâle dans sa chambre, sur sa loggia, pour voir encore une fois de là-haut le traîneau qui, dans un tintement de grelots, avait glissé sur le chemin de Dorf : il s’était ensuite jeté sur une chaise et avait tiré de la poche intérieure de sa veste le souvenir, le gage, qui cette fois n’avait pas consisté en quelques copeaux de bois d’un brun rougeâtre, mais bien en une petite plaque au cadre étroit ; plaque de verre que l’on devait tenir devant la lumière pour y découvrir quelque chose : le portrait intérieur de Clawdia qui était sans visage, mais qui révélait l’ossature délicate de son torse enveloppé avec une transparence spectrale des formes de sa chair, ainsi que les organes du creux de sa poitrine…
Combien de fois l’avait-il contemplé et pressé sur ses lèvres durant le temps qui s’était écoulé depuis lors en apportant des changements ! Par exemple, le temps avait apporté l’accoutumance à la vie, en l’absence de Clawdia Chauchat, séparée de lui par l’espace – et cela plus vite qu’on ne l’eût cru : le temps d’ici n’était-il pas d’une nature particulière et spécialement organisé à l’effet de créer l’habitude, ne fût-ce que l’habitude de ne pas s’habituer ? Il n’y avait plus lieu de s’attendre au claquement de la porte au commencement des cinq formidables repas, car il ne se produisait plus ; c’était ailleurs, à une distance énorme, que Mme Chauchat claquait à présent des portes – manifestation de sa nature qui était mêlée et liée à sa maladie, de même que le temps l’est aux corps dans l’espace, – sa maladie et rien de plus… Mais si elle était invisible et absente, elle était pourtant à la fois invisible et présente pour l’esprit de Hans Castorp ; elle était le génie de ce lieu, qu’il avait reconnu et possédé en une heure néfaste et d’une criminelle douceur, en une heure à laquelle ne pouvait s’appliquer aucune petite chanson paisible du pays plat, et dont il portait depuis neuf mois la silhouette spectrale sur son cœur si violemment épris.
À cette heure mémorable, ses lèvres tremblantes avaient balbutié, dans une langue étrangère et dans sa langue natale presque inconsciemment et d’une voix étranglée, bien des choses excessives : des propositions, des offres, des projets et des résolutions insensés auxquels toute approbation avait été à bon droit refusée : il avait voulu accompagner le génie par delà le Caucase, le suivre, l’attendre au lieu que le libre caprice du génie choisirait comme prochain domicile, pour ne plus jamais se séparer de lui ; il avait fait d’autres propositions aussi irresponsables. C’est que ce que le jeune homme simple avait remporté de cette heure de profonde aventure n’avait été que l’ombre d’un gage et la possibilité qui touchait à la vraisemblance que Mme Chauchat revînt ici pour un quatrième séjour tôt ou tard, selon que la maladie, qui lui rendait la liberté en déciderait. Mais que ce fût tôt ou tard, avait-elle encore dit lorsqu’ils avaient pris congé l’un de l’autre, Hans Castorp serait certainement « depuis longtemps parti très loin » ; et le sens dédaigneux de cette prophétie lui eût encore été plus insupportable s’il n’avait pas eu la ressource de se dire que certaines prophéties ne sont pas faites afin qu’elles se réalisent, mais bien afin qu’elles ne se réalisent pas, tout comme si on voulait les conjurer. Des prophètes de cette sorte raillent l’avenir en lui prédisant ce qu’il sera, pour qu’il ait honte de prendre vraiment telle figure. Et si le génie, au cours de la conversation que nous avons rapportée et en dehors d’elle, l’avait appelé un « joli bourgeois au petit endroit humide », ce qui avait été quelque chose comme la traduction de l’expression de Settembrini : « enfant gâté de la vie », on pouvait se demander à juste titre quel élément de ce mélange se montrerait le plus fort : le bourgeois ou l’autre… De plus, le génie n’avait pas pris en considération que lui-même était plusieurs fois parti et revenu, et que Hans Castorp, lui aussi, pourrait revenir au bon moment, bien qu’en réalité il ne persévérait ici que dans le but de ne plus devoir revenir : chez lui, comme chez tant d’autres, c’était la raison de sa présence.
Une des prophéties pour rire de cette soirée de carnaval s’était réalisée : Hans Castorp avait eu une mauvaise courbe de température, elle était montée abruptement et il l’avait inscrite avec une gravité solennelle ; après un léger fléchissement, elle s’était prolongée au niveau d’un haut plateau légèrement ondulé et maintenue constamment au-dessus du niveau des températures auxquelles il était habitué auparavant. C’était une fièvre anormale dont le degré et la persistance, d’après le docteur Behrens, n’étaient pas en rapport avec les symptômes locaux. « Vous êtes encore plus intoxiqué qu’on ne pourrait vous en croire capable, mon petit ami, dit-il. Allons, essayons toujours les injections ! Cela vous fera de l’effet. Dans trois, quatre mois vous serez comme un poisson dans l’eau, si les choses s’arrangent au gré du soussigné. » Ainsi se trouva-t-il que Hans Castorp devait se présenter deux fois par semaine, le mercredi et le samedi, après la promenade matinale, en-bas, au « labo », pour qu’on lui fît son injection.
Les deux médecins administraient ce remède à tour de rôle, mais le conseiller le faisait en virtuose, d’un seul coup, en vidant la seringue en même temps qu’il piquait. D’ailleurs, il ne se souciait pas de l’endroit où il piquait, de sorte que la douleur était parfois diabolique et que le point restait longtemps encore dur et brûlant. De plus, l’injection portait atteinte à l’état général de l’organisme, ébranlait le système nerveux comme un tour de force sportif ; et cela témoignait de la puissance de ce remède, laquelle se trahissait aussi par le fait que, sur le moment, il commençait par faire monter la température. C’est ce que le conseiller avait prédit, et c’est ce qui arriva, selon la règle et sans qu’il y eût rien à reprendre à ce phénomène prévu. C’était vite terminé, dès que votre tour était venu ; en un tournemain on avait reçu son contre-poison sous la peau de la cuisse ou du bras. Mais quelquefois, lorsque le conseiller y était justement disposé et que son humeur n’était pas troublée par le tabac, il s’engageait, quand même, à l’occasion de cette injection, une petite conversation, que Hans Castorp s’arrangeait pour diriger à peu près comme suit :
– Je garde toujours un bon souvenir de notre agréable goûter chez vous, docteur, l’année dernière, en automne, que le hasard nous avait valu. Hier encore – ou était-ce plus tôt ? – j’ai rappelé ce souvenir à mon cousin…
– Gaffky sept, dit le conseiller. Dernier résultat. Ce garçon ne veut décidément pas se désintoxiquer. Et avec cela, jamais il ne m’a autant talonné et tiraillé que ces derniers temps avec ses idées de départ, pour aller traîner le sabre, le gamin ! Il me reproche ses cinq petits trimestres, avec des jérémiades comme si c’étaient des siècles qu’il avait passés ici ! Il veut s’en aller, coûte que coûte, vous l’a-t-il dit aussi ? Vous devriez quelque jour le chapitrer sérieusement, de votre propre chef, et avec fermeté. Ce garçon-là se crèvera s’il avale trop tôt votre sympathique brouillard, là-haut, à droite. Ces foudres de guerre ne sont pas forcés d’avoir beaucoup de jugeotte, mais vous, le plus posé des deux, le civil, l’homme de culture bourgeoise, vous devriez lui remettre la tête à l’endroit avant qu’il ne fasse des sottises.
– C’est ce que je fais, docteur, répondit Hans Castorp sans cesser de diriger la conversation. C’est ce que je fais assez souvent quand il se rebiffe ainsi, et je pense qu’il se fera une raison, mais les exemples que l’on a sous les yeux ne sont pas les meilleurs ; c’est là ce qui gâte les choses. Il se produit toujours des départs, – des départs pour le pays plat, spontanés et sans véritable justification, et cela a quelque chose de tentateur pour les caractères faibles. Par exemple, récemment. Qui donc est parti récemment ? Une dame de la table des Russes bien, Mme Chauchat. Pour le Daghestan, a-t-on raconté. Mon Dieu, le Daghestan, je ne connais pas le climat, peut-être est-il moins défavorable que chez nous, là-haut, au bord de la mer. Mais c’est quand même le pays plat, à notre sens, encore que, géographiquement, il soit peut-être montagneux, je ne suis pas très ferré là-dessus. Comment vivre là-bas, sans être guéri lorsque les principes élémentaires vous manquent et que personne ne sait rien de notre règle d’ici, ni comment on reste étendu et prend la température ? D’ailleurs, je crois qu’elle veut revenir de toute façon ; elle me l’a dit incidemment. Comment en sommes-nous donc arrivés à parler d’elle ? – Ah ! oui, ce jour-là nous vous avons rencontré au jardin, docteur, – vous en souvenez-vous ? – c’est-à-dire, c’est vous qui nous avez rencontrés, car nous étions assis sur un banc, je sais encore lequel, je pourrais vous le désigner exactement, nous étions assis là et nous fumions. Je veux dire : je fumais, car mon cousin, chose bizarre, ne fume pas. Justement, vous fumiez aussi, et nous nous sommes offert l’un à l’autre nos marques préférées, cela me revient justement. Votre Brésil était excellent, mais il faut le traiter comme un jeune poulain, sinon il vous arrive quelque chose comme à vous après vos deux Havane, lorsque vous avez failli danser votre dernière danse, la poitrine houleuse, – comme tout a bien fini, on a bien le droit d’en rire. Des Maria Mancini, j’en ai d’ailleurs à nouveau commandé quelques centaines à Brème, je suis décidément très attaché à cette marque, elle m’est sympathique à tous égards. Il est vrai que le port et la douane les font revenir assez cher, et si vous vous avisez de prolonger encore ma cure pour un temps assez long, je suis capable de me convertir à un tabac d’ici – on voit aux vitrines des cigares tout à fait jolis. Et puis vous nous avez montré vos tableaux, je m’en souviens comme si c’était aujourd’hui et j’en ai éprouvé un grand plaisir. J’étais vraiment dérouté à voir ce que vous osiez tenter avec de la peinture à l’huile ; jamais je n’aurais eu ce courage. N’avons-nous pas vu aussi le portrait de Mme Chauchat, avec la peau rendue d’une façon vraiment magistrale. Je puis bien le dire : je fus enthousiasmé. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore le modèle, ou de vue seulement, et de nom. Depuis, très peu de temps avant son dernier départ, j’ai encore tout juste fait sa connaissance personnelle.
– Qu’est-ce que vous me racontez là ! répondit le conseiller ; et c’est exactement ce qu’il avait répondu (le rapprochement s’impose) lorsque Hans Castorp lui avait annoncé avant sa première consultation qu’il avait du reste aussi un peu de fièvre. Et il ne dit rien de plus.
– Mais oui, mais oui, j’ai fait sa connaissance, insista Hans Castorp. Je sais d’expérience qu’il n’est pas tellement facile de faire des connaissances ici en haut, mais entre Mme Chaulât et moi cela a fini par se faire et par s’arranger encore en dernière heure, une conversation nous a…
Hans Castorp aspira l’air entre les dents.
– Pff, fit-il en arrière. C’était sûrement un nerf très important que vous aurez touché par hasard, docteur. Oh ! oui, oui, cela fait un mal infernal. Merci, un peu de massage fait du bien… Oui, une conversation nous a rapprochés.
– Tiens !… Et alors ? fit le conseiller.
Il posait cette question en hochant la tête avec la mine de quelqu’un qui s’attend à une réponse très élogieuse et qui, de son côté, met, d’avance, dans la question, la confirmation de l’éloge prévu.
– Je suppose que mon français a un peu laissé à désirer, se déroba Hans Castorp. D’où l’aurais-je pris, du reste ? Mais au bon moment il vous passe toute sorte de choses par la tête, et nous nous sommes quand même très convenablement compris.
– Je vous crois. Eh bien ! fit le conseiller, réitérant son invite. Et il ajouta de lui-même :
« Mignonne, hein ? »
Hans Castorp, fermant son bouton de col, était debout, les jambes et les coudes écartés, la tête levée vers le plafond.
– Ce n’est après tout rien de nouveau, dit-il. Deux personnes ou même des familles vivent dans une station balnéaire pendant des semaines sous un même toit, à distance. Un jour, ils font la connaissance l’un de l’autre, s’apprécient sincèrement, et voilà qu’il se trouve que l’un des deux est sur le point de partir. J’imagine que de tels regrets se produisent souvent. Et dans ces cas-là, on voudrait tout au moins garder un certain contact, entendre parler l’un de l’autre, que ce soit par correspondance. Mais Mme Chauchat…
– Voui, elle ne veut sans doute pas ? rit le conseiller, jovial.
– Non, elle n’a pas voulu en entendre parler. Ne vous écrit-elle pas non plus, de temps en temps, de ses lieux de séjour ?
– Mais jamais de la vie ! répondit Behrens. Voilà une idée qui ne lui viendrait jamais. D’abord, par paresse ; et puis, comment écrirait-elle donc ? Je ne sais pas lire le russe. Je le baragouine à la rigueur, en cas de besoin, mais je ne saurais en lire un traître mot. Et vous non plus, n’est-ce pas ? Bon, et quant au français et à l’allemand, notre petite chatte les miaule sans doute délicieusement, mais quant à écrire, on la trouverait bien embarrassée. L’orthographe, cher ami ! Oui, il faut donc vous faire une raison, mon garçon. Elle revient toujours, de temps en temps. Question de technique, affaire de tempérament, comme je vous l’ai dit. L’un s’en va et doit ensuite revenir, l’autre reste d’affilée un temps assez long pour n’avoir plus jamais besoin de revenir. Mais si votre cousin s’en va, – dites-lui bien cela – il est fort possible que vous soyez encore ici pour assister à son retour solennel…
– Mais, docteur, combien de temps pensez-vous donc que je… ?
– Que vous ? Que lui ! Je pense qu’il ne restera pas en bas aussi longtemps qu’il sera demeuré en haut. C’est ce que, honnêtement je pense pour ma part, et c’est ce que vous serez bien aimable de lui répéter pour moi.
C’est en des termes semblables que ces conversations se déroulaient, d’ordinaire, conduites avec rouerie par Hans Castorp, encore que le résultat en eût été minime et incertain. Car, en ce qui concernait le temps qu’il faudrait rester pour assister au retour d’un malade parti prématurément, la réponse avait été ambiguë, et quant à la jeune femme absente, il n’en avait rien donné. Hans Castorp n’apprendrait rien d’elle aussi longtemps que le mystère de l’espace et du temps les séparerait ; elle n’écrirait pas, et ne lui donnerait pas davantage l’occasion de le faire. Pourquoi, du reste, se fût-elle comportée autrement, à bien y réfléchir ? N’avait-ce pas été une idée très bourgeoise et pédante de sa part que de suggérer qu’ils pourraient s’écrire, alors qu’autrefois il avait bien senti qu’il n’était même pas nécessaire ni souhaitable qu’ils se parlassent l’un à l’autre ? Et lui avait-il vraiment « parlé », au sens que donne à ce mot l’Occident civilisé, ce soir de Carnaval, à son côté, ou n’avait-il pas plutôt parlé en langue étrangère, comme en rêve, d’une manière aussi peu civilisée que possible ? Pourquoi dès lors écrire, sur du papier à lettres ou sur des cartes postales, comme il en envoyait parfois chez lui, en pays plat, pour rendre compte des résultats variables des consultations ? Clawdia n’avait-elle pas raison de se sentir dispensée d’écrire, en vertu de la liberté que lui accordait la maladie ? Parler, écrire, affaire éminemment humaniste et républicaine, en effet, l’affaire du sieur Brunetto Latini qui avait écrit ce livre sur les vertus et les vices, qui avait éduqué les Florentins, qui leur avait enseigné à parler, et l’art de gouverner leur République selon les règles de la politique…
Cela ramena les pensées de Hans Castorp à Lodovico Settembrini et il rougit comme il avait rougi autrefois lorsque l’écrivain était entré à l’improviste dans sa chambre de malade, en donnant tout à coup la lumière. Hans Castorp eût sans doute pu lui poser ses questions concernant les mystères transcendants, encore que tout au plus par manière de provocation et de taquinerie, non pas avec l’espoir d’obtenir une réponse de l’humaniste qui n’avait souci que des intérêts terrestres. Mais, depuis la soirée du carnaval et la sortie mouvementée de Settembrini du salon de musique, un certain éloignement s’était produit dans les relations entre Hans Castorp et l’Italien, éloignement qui tenait à la mauvaise conscience de l’un, à la profonde déception pédagogique de l’autre, et qui avait pour conséquence qu’ils s’évitaient mutuellement, et que pendant des semaines entières ils n’échangèrent pas la moindre parole. Hans Castorp était-il encore un « enfant gâté de la vie » aux yeux de M. Settembrini ? Non, car sans doute était-il abandonné par celui qui cherchait la morale dans la Raison et dans la Vertu… Et Hans Castorp boudait M. Settembrini, il fronçait les sourcils et retroussait les lèvres lorsqu’ils se rencontraient, tandis que le regard noir et brillant de l’Italien reposait sur lui avec un reproche muet. Néanmoins, cet entêtement boudeur se dissipa aussitôt, lorsque le littérateur lui adressa la parole, pour la première fois, après plusieurs semaines, encore que ce ne fût qu’en passant et sous forme d’allusions mythologiques si subtiles qu’il fallait une culture occidentale pour les démêler. C’était après le dîner ; ils se rencontrèrent dans l’embrasure de la porte vitrée qui avait cessé de claquer. Ayant rejoint le jeune homme et se disposant, par avance, à se séparer aussitôt de lui, Settembrini dit :
– Eh bien, ingénieur, comment avez-vous trouvé la grenade ?
Hans Castorp sourit, joyeux et troublé.
– C’est-à-dire… Qu’entendes-vous par là, Monsieur Settembrini ? Des grenades ? Mais on n’en a pas servi. Jamais de ma vie, je n’ai… Si, un jour, j’ai bu du sirop de grenadine avec de l’eau de Seltz. C’était par trop douceâtre.
L’Italien, qui l’avait déjà dépassé, tourna la tête et articula :
– Des dieux et des mortels ont parfois visité le royaume des ombres et trouvé le chemin du retour. Mais les habitants des enfers savent que quiconque goûte aux fruits de leur empire leur reste voué à jamais.
Et il poursuivit sa route, dans ses éternels pantalons à carreaux clairs et laissa derrière lui Hans Castorp qui devait être « écrasé » par le sens de ces propos, et qui l’était vraiment, bien que, à la fois irrité et amusé par la supposition qu’il pût l’être, il murmurât à part lui-même :
– Latini, Carducci, et tutti quanti, fiche-moi la paix !
Néanmoins, il se sentait agréablement ému par cette première parole qui lui avait été adressée ; car, malgré le trophée et le souvenir macabre qu’il portait sur son cœur, il était attaché à M. Settembrini, il tenait à son commerce, et la pensée d’être à jamais rejeté et abandonné par lui eût quand même pesé sur son âme plus cruellement que n’eût fait le sentiment de l’élève qu’on eût laissé à l’écart en classe ou de quelqu’un qui eût profité de tous les avantages de la honte, comme M. Albin… Cependant il n’osait pas, quant à lui, adresser la parole à son mentor et celui-ci laissa de nouveau passer des semaines avant de s’approcher et de nouer conversation avec l’élève indocile. Ceci eut lieu lorsque, par les vagues marines du Temps, au rythme éternellement monotone, Pâques eut été jeté sur le rivage et fêté au Berghof, scrupuleusement, ainsi que l’on fêtait là-bas toutes les étapes et coupes, afin d’éviter un pêle-mêle trop désordonné. Au premier déjeuner chaque pensionnaire trouva à côté de son couvert un petit bouquet de fleurs, au deuxième déjeuner chacun reçut un œuf colorié et, pour le dîner, la table de festin était décorée de petits lièvres en sucre et en chocolat.
– Avez-vous jamais voyagé sur mer, lieutenant, ou vous, ingénieur ? demanda Settembrini lorsque, après le repas, tenant son cure-dents, il s’approcha dans le hall de la petite table des cousins… Comme la plupart des pensionnaires, ils avaient abrégé aujourd’hui d’un quart d’heure la cure de l’après-midi, pour s’installer ici devant un café et une fine.
« Ces petits lièvres et ces œufs coloriés me font penser à la vie sur un de ces grands paquebots, devant un horizon vide depuis des semaines, dans le désert salin, en des conditions dont le confort parfait ne fait que superficiellement oublier la monstrueuse étrangeté, tandis que dans les régions profondes de la sensibilité, la conscience de cet état étrange continue à vous ronger comme une angoisse secrète… Je retrouve ici l’esprit dans lequel, à bord d’une telle arche, on observe pieusement les fêtes de la terre ferme. C’est le fait de gens qui sont en dehors du monde, un souvenir sentimental évoqué d’après le calendrier… Sur le continent, ce serait Pâques aujourd’hui, n’est-ce pas ? Sur le continent on célèbre aujourd’hui l’anniversaire du Roi, et nous le faisons aussi, tant bien que mal, nous aussi nous sommes des hommes. N’est-ce pas ainsi ?
Les cousins l’approuvèrent. En vérité, c’était ainsi. Hans Castorp, touché de ce qu’on lui eût adressé la parole, et éperonné par sa mauvaise conscience, loua cette remarque sur tous les tons, la trouva spirituelle, intéressante, littéraire, et appuya M. Settembrini de toutes ses forces. Certainement et tout à fait comme M. Settembrini l’avait exprimé sous une forme si plastique, le confort à bord d’un grand paquebot faisait oublier les circonstances et leur caractère hasardeux, et, s’il lui était permis de développer cette idée pour son propre compte, il y avait même une certaine frivolité et une provocation dans ce confort accompli, quelque chose de semblable à ce que les anciens avaient appelé « hybris[1] » (pour complaire à son interlocuteur, il alla jusqu’à citer les anciens, ou quelque chose comme : « Je suis le roi de Babylone »[2], bref, une forfaiture.) Mais d’autre part, le luxe à bord d’un paquebot intégrait (« intégrait ! ») quand même un aussi grand triomphe de l’esprit et de l’honneur humains. Car, par le fait que l’homme transportait ce luxe et ce confort sur l’écume salée, et les y affirmait hardiment, il posait en quelque sorte son pied sur la nuque des forces élémentaires ; et cela impliquait la victoire de la civilisation humaine sur le chaos, s’il lui était permis de se servir de cette expression.
M. Settembrini l’écouta attentivement, les pieds et les bras croisés, tout en caressant avec grâce, de son cure-dents, sa moustache retroussée.
– Cela vaut d’être souligné, dit-il. L’homme n’émet aucune affirmation de caractère général tant soit peu suivie sans se trahir tout entier, sans y mettre involontairement tout son Moi, sans y représenter, en quelque sorte par une parabole, le thème fondamental et le problème essentiel de sa vie. C’est ce qui vient de vous arriver, ingénieur. Ce que vous avez dit là venait en effet du fond de votre personnalité, et cela a également exprimé d’une manière poétique la situation momentanée de cette personnalité : c’est toujours encore un état expérimental…
– Placet experiri[3], dit Hans Castorp en approuvant de la tête et en riant, avec un c italien.
– Sicuro, s’il s’agit en l’occurrence de la passion respectable de connaître le monde, et non pas de libertinage. Vous avez parlé de « hybris ». Vous vous êtes servi de cette expression. Mais la hybris de la raison contre les puissances occultes est l’humanité la plus haute, et si elle appelle la vengeance des dieux jaloux, per esempio lorsque l’arche de luxe échoue et coule à pic, c’est là une fin des plus honorables. L’acte de Prométhée lui aussi était de l’hybris, et sa torture sur le rocher scythe est à nos yeux le plus sacré des martyres. Mais qu’en est-il de cette autre hybris, de la perdition trouvée dans l’expérience perverse faite avec les forces de la déraison et avec les ennemis de l’espèce humaine ? Y a-t-il de l’honneur à cela ? Peut-il y avoir de l’honneur dans une telle conduite ? Si o no ?
Hans Castorp remua la cuiller dans sa petite tasse, bien qu’elle fût vide.
– Ingénieur, ingénieur, dit l’Italien en hochant la tête, et le regard de ses yeux noirs et pensifs devint fixe, ne craignez-vous pas le tourbillon du deuxième cercle de l’enfer qui entraîne et secoue les pécheurs de la chair, les malheureux qui ont sacrifié la raison à la luxure ? Grandio ! Lorsque je me représente de quelle façon vous culbuterez sous le souffle infernal, je pourrais retomber raide d’affliction, comme tombe un cadavre…[4]
Ils rirent, heureux de l’entendre plaisanter et dire des choses poétiques. Mais Settembrini ajouta :
– Le soir de Carnaval, en buvant du vin, vous en souvenez-vous, ingénieur ? vous avez, pour ainsi dire, pris congé de moi. Si, c’était quelque chose de semblable. Eh bien, c’est aujourd’hui mon tour. Tel que vous me voyez ici, messieurs, je suis sur le point de vous dire au revoir. Je quitte cette maison.
Tous deux manifestèrent la plus vive surprise.
– Pas possible, ce n’est qu’une plaisanterie, s’écria Hans Castorp, comme il s’était écrié déjà en une autre circonstance. Il était presque aussi effrayé que ce jour-là. Mais Settembrini répondit :
– En aucune façon. C’est comme je vous le dis. Et d’ailleurs vous êtes plus ou moins préparé à cette nouvelle. Je vous avais déclaré qu’à l’instant où tout espoir de pouvoir retourner dans un délai plus ou moins fixe dans le monde du travail serait perdu, j’étais résolu à lever ma tente pour m’établir durablement quelque part dans le village. Que voulez-vous ? Cet instant est arrivé. Je ne peux pas guérir ; la cause est entendue. Je peux prolonger mon existence, mais uniquement ici. Le verdict, le verdict définitif est : « à perpétuité » : le docteur Behrens l’a prononcé avec la bonne humeur qui lui est propre. Bon, je tire mes conclusions. J’ai loué un logement, je suis en train d’y transporter mes modestes biens, les instruments de mon métier littéraire… Ce n’est même pas loin d’ici, à Dorf, nous nous rencontrerons, certainement, je ne vous perdrai pas de vue, mais comme commensal, j’ai l’honneur de prendre congé de vous.
Telle avait été la communication de Settembrini le dimanche de Pâques. Les cousins s’en étaient montrés extraordinairement émus. Longuement encore, et à plusieurs reprises, ils avaient parlé au littérateur de sa décision : des conditions dans lesquelles il suivrait le traitement de son propre chef, du transport et de la continuation de ce vaste ouvrage encyclopédique dont il avait assumé la charge : de cette vue d’ensemble de tous les chefs-d’œuvre des belles-lettres, du point de vue des conflits issus de la souffrance et de leur élimination ; enfin de sa future installation dans la maison d’un épicier, d’un « marchand d’épices », comme disait M. Settembrini. Le marchand d’épices, rapportait-il, avait loué l’étage supérieur à un tailleur pour dames originaire de Bohême qui, de son côté, prenait des sous-locataires… Ces conversations étaient déjà du passé. Le temps avançait et il avait entraîné maints changements. Settembrini, en effet, n’habitait plus le sanatorium international Berghof, mais chez Lukacek, le tailleur pour dames ; cela, depuis quelques semaines. Son départ avait eu lieu non pas en traîneau, mais à pied. En un pardessus jaune et court dont le col et les parements étaient bordés de fourrure, et accompagné d’un commissionnaire qui transportait sur une brouette le bagage littéraire et terrestre de l’écrivain ; on l’avait vu s’éloigner en agitant sa canne, après que, sous le dernier portail, il eut encore pincé la joue d’une serveuse du dos de ses deux doigts… Avril, nous l’avons dit, était déjà pour une bonne part, aux trois quarts, relégué dans l’ombre du passé, que l’on était encore en plein hiver : le matin, dans la chambre, on avait à peine six degrés au-dessus, dehors il faisait un froid de neuf degrés au-dessous, l’encre se congelait la nuit lorsqu’on laissait l’encrier sur le balcon, en un bloc de glace, en un morceau de charbon. Mais le printemps approchait, on le sentait ; le jour, lorsque le soleil brillait fort, on en avait déjà, dans l’air, çà et là, comme un léger et très doux pressentiment ; la période de la fonte des neiges était proche, et cela comportait des changements qui s’accomplissaient sans arrêt au Berghof. Rien n’y faisait, ni l’autorité, ni la parole vivante du conseiller qui combattait dans les chambres et dans la salle à manger, à toutes les consultations, à chaque visite et à chaque repas, le préjugé courant de la fonte des neiges.
Étaient-ils donc venus pour faire des sports d’hiver ? Ou avaient-ils besoin de neige, de neige glacée ? Une saison défavorable, la fonte des neiges ? C’était la plus favorable de toutes ! Il était prouvé que c’était à cette époque-là de l’année que la proportion des malades alités dans la vallée était la plus faible. Partout au monde les conditions de climat pour les malades des poumons étaient en cette période plus défavorables que justement ici. Quiconque avait une lueur de bon sens devait attendre et tirer parti de l’effet endurcissant des conditions actuelles de la température. Ensuite, on était d’attaque, immunisé contre tous les climats du monde, à condition que l’on attendît d’être complètement rétabli ; et ainsi de suite… Mais le conseiller avait beau parler, le préjugé de la fonte des neiges était solidement ancré dans les têtes, la station se vidait ; il est bien possible que ce fût l’approche du printemps qui s’agitait dans le corps des hommes et qui rendait inquiets et avides de changement des gens sédentaires… Quoi qu’il en fût, les « faux départs », les « départs en coup de tête » se multipliaient, et même à Berghof, jusqu’à devenir inquiétants. C’est ainsi que Mme Salomon, d’Amsterdam, malgré la satisfaction que lui procuraient les examens médicaux et les occasions qui s’offraient ainsi à elle d’étaler sa lingerie de dentelles la plus fine, partit contre toute règle, sans autorisation, non pas qu’elle allât mieux, mais parce qu’elle allait plus mal. Les débuts de son séjour ici remontaient à très loin avant l’arrivée de Hans Castorp : il y avait plus d’un an qu’elle était arrivée, avec une affection très légère pour laquelle on lui avait ordonné trois mois. Après quatre mois, on avait considéré que « dans quatre semaines elle serait sûrement rétablie », mais six semaines plus tard il n’avait plus été question de guérison : il fallait, lui avait-on dit, qu’elle restât encore au moins quatre mois. Et cela avait continué ainsi, et après tout, ce n’était pas un bagne ici, ni une mine sibérienne. Mme Salomon était restée et avait montré sa lingerie la plus fine. Mais comme, à la dernière consultation on lui avait, eu égard à la fonte des neiges, accordé un nouveau supplément de cinq mois, à cause d’un sifflement à gauche en haut et d’incontestables fausses notes sous l’épaule gauche, elle avait perdu patience et, tout en protestant et en insultant Dorf-Platz, le fameux bon air, le sanatorium international Berghof et les médecins, elle partit pour retourner chez elle, à Amsterdam, dans sa ville humide et pleine de courants d’air.
Était-ce raisonnable ? Le docteur Behrens haussa les épaules et leva les bras, puis les laissa retomber bruyamment sur ses cuisses. En automne, au plus tard, dit-il, Mme Salomon serait de retour – et ce serait alors pour toujours. Aurait-il le dernier mot ? Nous le verrons, car nous sommes encore retenus en ce lieu de plaisir pour une période suffisante de temps terrestre. Mais le cas Salomon n’était nullement unique de son espèce. Le temps entraînait des changements, il l’avait toujours fait, mais jamais d’une manière aussi frappante. La salle à manger montrait des lacunes, des vides à toutes les sept tables, à la table des Russes bien comme à la table des Russes ordinaires, aux tables longitudinales comme aux tables transversales. Non pas précisément que l’on eût pu tirer de ce fait des conclusions définies sur le nombre des pensionnaires de la maison. Comme toujours, il y avait eu aussi des arrivées ; les chambres étaient bien occupées, mais il s’agissait de pensionnaires qui, par leur état avancé, étaient privés de la liberté de leurs mouvements. Dans la salle à manger, disions-nous, plus d’un pensionnaire faisait défaut grâce à une liberté de mouvement d’une autre sorte qui, elle, subsistait encore. Plus d’un manquait même d’une manière particulièrement profonde et creuse, comme le docteur Blumenkohl qui était mort. Sa figure avait de plus en plus pris cette expression de dégoût ; puis il s’était alité pour une longue période et ensuite il était mort, personne n’aurait pu dire exactement quand ; la chose avait été traitée avec tous les égards et la discrétion convenables. Une lacune ! Mme Stoehr était assise à côté de la lacune, et elle en avait peur. C’est pourquoi elle se transporta de l’autre côté de la table, à côté du jeune Ziemssen, à la place de Miss Robinson qui était partie guérie, en face de l’institutrice, voisine de gauche de Hans Castorp, qui était restée ferme à son poste. Pour le moment, elle était seule de ce côté de la table, les trois autres places étaient libres. Rasmussen qui, de jour en jour, était devenu plus abruti et plus fatigué, était couché et passait pour moribond ; et la grand’tante avec sa nièce et Maroussia à l’opulente poitrine étaient parties en voyage, – nous disons : « parties en voyage », comme tout le monde disait, parce que leur retour prochain était chose convenue. Dès l’automne, elles reviendraient. Pouvait-on appeler cela un départ ? On serait si près du solstice d’été après que serait passée la Pentecôte qui était toute proche ; et une fois la journée la plus longue de l’année venue, cela diminuerait très rapidement, on irait vers l’hiver ; bref, la grand-tante et Maroussia étaient déjà presque de retour, et c’était heureux, car la rieuse Maroussia n’était nullement guérie ; l’institutrice avait entendu parler de tumeurs tuberculeuses que Maroussia aux yeux bruns portait dans son opulente poitrine et que l’on avait déjà dû opérer à plusieurs reprises. Lorsque l’institutrice en parla, Hans Castorp avait jeté un regard rapide vers Joachim qui avait penché sur son assiette sa figure tachetée.
L’alerte grand’tante avait offert à ses compagnons de table, c’est-à-dire aux cousins, à l’institutrice et à Mme Stoehr, un souper d’adieu au restaurant, un festin où l’on servit du caviar, du champagne et des liqueurs, et durant lequel Joachim s’était montré très calme, n’avait prononcé que quelques mots d’une voix presque blanche, de sorte que la grand’tante, dans son affectueuse familiarité, avait voulu lui donner courage : elle l’avait même tutoyé en négligeant les usages civilisés : « Ça n’a pas d’importance, petit père, ne t’en fais pas, bois, mange et parle, nous reviendrons bientôt, avait-elle dit. Nous allons tous manger, boire et bavarder sans penser aux choses tristes. Dieu fera venir l’automne avant que nous y ayons pensé, juge toi-même s’il y a lieu de te chagriner. »
Le lendemain matin, elle avait distribué comme souvenirs des boîtes bariolées de « petite compaute » à presque tous les habitués de la salle à manger, et ensuite elle avait entrepris le petit voyage avec les jeunes filles.
Et Joachim, qu’en était-il de lui ? Était-il affranchi et soulagé depuis ce départ, ou son âme souffrait-elle de pénibles privations en face de ce côté de la table qui était vide ? Son impatience insolite et subversive, sa menace de faire un « faux départ » si on le menait plus longtemps par le bout du nez, tenaient-elles à l’absence de Maroussia ? Ou fallait-il plutôt ramener le fait que malgré tout, il n’était pas encore parti, et qu’il prêtait l’oreille à l’éloge du dégel par le directeur, à cet autre fait que Maroussia à l’opulente poitrine n’était pas partie pour de bon, mais seulement pour un petit voyage, et qu’au bout de cinq petites fractions du temps d’ici elle reviendrait ? Il y avait de tout un peu dans sa conduite ; chacune de ces raisons jouait dans la même mesure. Hans Castorp s’en doutait sans qu’il en parlât jamais avec Joachim. Car il s’en abstenait aussi strictement que Joachim évitait de prononcer le nom d’une autre absente qui, elle aussi, était partie pour un petit voyage.
Cependant, à la table de Settembrini, à la place même de l’Italien, qui donc y était assis depuis peu, en compagnie de pensionnaires hollandais dont l’appétit était si formidable que chacun d’entre eux se faisait encore servir outre les cinq services du dîner quotidien et dès avant le potage, trois œufs sur le plat ? C’était Antoine Carlovitch Ferge, le même qui avait couru l’aventure infernale du choc à la plèvre. Oui, M. Ferge avait quitté son lit ; même sans pneumothorax son état s’était amélioré à un tel point qu’il passait la plus grande partie de la journée sur pied et habillé, et avec sa moustache touffue et bonasse, avec sa pomme d’Adam saillante, non moins sympathique, il prenait part aux repas. Les cousins bavardaient quelquefois avec lui dans la salle à manger et dans le hall, et les promenades obligatoires, ils les faisaient aussi en sa compagnie lorsque le hasard le voulait, pleins d’affection pour ce martyr ingénu qui déclarait n’entendre absolument rien aux choses élevées et qui, ceci dit, parlait très agréablement de la fabrication du caoutchouc et de lointaines contrées de l’empire russe, la Géorgie, Samara, tandis qu’ils piétinaient dans le brouillard, à travers la bouillie d’eau et de neige.
Car les chemins étaient vraiment à peine praticables, ils étaient en pleine déliquescence, et les brouillards fermentaient. Le conseiller disait, il est vrai, que ce n’était pas du brouillard, mais bien des nuages ; toutefois c’était là jouer sur les mots, de l’avis de Hans Castorp. Le printemps menait un rude combat qui, avec cent rechutes dans l’amertume de l’hiver, se prolongea pendant des mois jusqu’en juin. En mars déjà, lorsque le soleil luisait, on avait eu peine à supporter la chaleur sur le balcon et sur la chaise-longue malgré vêtements légers et parasol, et il y avait des dames qui, dès ce moment, avaient cru à la venue de l’été et dès le petit déjeuner avaient arboré des robes de mousseline. Elles avaient pour excuse, dans une certaine mesure, le caractère particulier du climat, qui favorisait la confusion, par le mélange météorologique des saisons ; mais il y avait aussi dans cette étourderie beaucoup de myopie et de manque d’imagination, cette sottise d’êtres ne vivant que dans le présent, incapables de penser qu’autre chose peut venir, – et surtout une grande soif de changements, une impatience qui dévore le temps. Le calendrier disait mars ; c’était le printemps, autant dire l’été, et l’on déballait les robes de mousseline pour se montrer dans ces atours avant que vînt l’automne. Et il venait, en quelque sorte. En avril des jours gris, froids et humides, vinrent, dont la pluie incessante se changea en neige, en une neige nouvelle et tourbillonnante. Les doigts gelèrent dans la loggia, les deux couvertures de poil de chameau reprirent leur service, il se fallut de peu que l’on eût eu recours au sac de fourrure. L’administration se décida à chauffer et tout le monde se plaignait d’être privé de son printemps. Vers la fin du mois il y avait partout une épaisse couche de neige ; mais ensuite vint le Fœhn[5], prévu, pressenti par des pensionnaires avertis et sensibles : Mme Stoehr, ainsi que Mlle Lévi au teint d’ivoire, non moins que la veuve Hessenfeld le sentirent unanimement encore avant que le moindre petit nuage ne se montrât au-dessus du sommet de la montagne de granit au Midi. Mme Hessefeld aussitôt inclina aux crises de larmes, la Lévi s’alita, et Mme Stoehr, découvrant d’un air têtu ses dents de lièvre, exprimait d’heure en heure la crainte superstitieuse d’une syncope ; car on prétendait que le Fœhn les favorisait et les provoquait. Une chaleur incroyable régnait, le chauffage s’éteignit, on laissa pendant la nuit la porte du balcon ouverte, et pourtant le matin on avait onze degrés dans la chambre. La neige fondit comme par enchantement, elle devint translucide, poreuse et se troua ; elle s’écroula là où elle était amoncelée, elle semblait se recroqueviller sous terre. C’était partout un suintement, un égouttement, une infiltration, un écoulement et une chute dans la forêt, et les remparts des routes, les tapis pâles des prés disparurent, encore que les masses eussent été par trop copieuses pour qu’elles pussent disparaître rapidement. Il y eut des phénomènes étranges, des surprises printanières au cours des promenades dans la vallée, féeriques, jamais vues. Une étendue de pré était là, à l’arrière-plan se dressait le cône du Schwarzhorn encore tout couvert de neige, avec le glacier de la Scaletta également couvert de neige épaisse, à droite dans le voisinage, et le terrain aussi avec sa meule de foin quelque part, était encore sous la neige, quoique la couche fût déjà mince et clairsemée, interrompue çà et là par des renflements rugueux et sombres du sol, partout transpercée d’herbe sèche. C’était là tout de même, parut-il aux promeneurs, une couche de neige assez irrégulière, que montrait ce pré : au loin, vers les versants boisés, elle était plus épaisse, mais en avant, sous les yeux de ceux qui l’examinaient, cette herbe hivernale, sèche et décolorée n’était encore qu’éclaboussée, tachetée, fleurie de neige. Ils la regardèrent de plus près, ils se penchèrent, étonnés. Ce n’était pas de la neige, c’étaient des fleurs, des fleurs de neige, une neige de fleurs, de petits calices à tiges courtes, blancs, d’un blanc bleuâtre, c’était du crocus, parole d’honneur, jailli par millions du pré où s’infiltrait l’eau, si serré que l’on avait très facilement pu le tenir pour de la neige, dans laquelle il se perdait en effet au loin, sans transition.
Ils rirent de leur erreur, rirent de joie devant ce miracle qui s’était accompli sous leurs yeux, de cette adaptation gracieuse, timide de la vie organique qui, la première, se hasardait de nouveau à surgir. Ils en cueillirent, examinèrent et considérèrent les formes délicates des calices, en ornèrent leurs boutonnières, les emportèrent chez eux, en disposèrent dans leurs verres d’eau, dans leurs chambres, car la rigidité inorganique de la vallée avait duré longtemps, – très longtemps, encore qu’elle eût paru courte.
Mais la neige de fleurs fut recouverte de vraie neige, et il n’en alla pas autrement des soldanelles bleues, ni des primevères jaunes et rouges qui suivirent. Oui, le printemps avait du mal à se frayer un chemin et à triompher de l’hiver d’ici. Dix fois il était repoussé avant qu’il pût prendre pied sur ces hauteurs, – jusqu’à la prochaine irruption de l’hiver, avec des tempêtes blanches, un vent glacé et le chauffage central. Au commencement de mai (car voici que le mois de mai était déjà arrivé, tandis que nous parlions des perce-neige), au commencement de mai ce fut véritablement une torture d’écrire dans la loggia, ne fût-ce qu’une carte postale, tant une véritable humidité de novembre vous endolorissait les doigts ; et les cinq arbres et demi à feuilles de la région étaient nus comme les arbres de la plaine en janvier. Pendant des journées entières la pluie durait, elle tomba durant une semaine, et sans les vertus apaisantes du type de chaise-longue dont on usait ici, il eût été extrêmement dur de passer, en plein air, tant d’heures de repos dans cette vapeur de nuages, la figure humide et la peau rigide. Mais en réalité c’était à une pluie de printemps que l’on avait affaire, et plus elle durait, plus elle se trahissait comme telle. Presque toute la neige fondait sous elle ; il n’y eut plus de blanc, tout au plus ici et là un gris glacé et sale, et à présent les prés commençaient vraiment à verdir.
Quel doux bienfait pour l’œil, ce vert de pâturage après le blanc infini ! Et il y avait encore là un autre vert qui surpassait en délicatesse et en gracieuse mollesse le vert de l’herbe nouvelle. C’étaient les jeunes touffes d’aiguilles des mélèzes. Hans Castorp, dans ses promenades réglementaires, manquait rarement de les caresser de la main et d’en effleurer sa joue, tant elles étaient irrésistiblement caressantes dans leur délicatesse et leur fraîcheur. « On pourrait devenir botaniste, dit le jeune homme à son compagnon, en vérité on pourrait être tenté par cette science, rien que par le plaisir que l’on prend à ce réveil de la nature, après un hiver passé dans nos parages. Dis donc, mais c’est de la gentiane que tu vois là en-bas de la pente, et ceci est une sorte de violette jaune que je ne connaissais pas. Mais ici nous avons des renoncules, de la famille des renonculacées, pleine, me semble-t-il, bissexuée d’ailleurs, tu vois là cette quantité d’étamines et un certain nombre d’ovaires, une andrœcie et un gynécée, autant que je me souvienne. Je crois décidément que je vais m’acheter un ou deux bouquins de botanique pour m’instruire un peu mieux dans ce domaine de la vie et de la science. Que la vie, tout à coup, devient bariolée !
– Ce sera encore plus beau en juin, dit Joachim. La flore de ces prés, est d’ailleurs, célèbre. Mais je ne crois tout de même pas que je l’attendrai. Sans doute tiens-tu cela de Krokovski, de vouloir étudier la botanique ?
De Krokovski ? Que voulait-il dire ? Ah ! oui, c’était parce que le Dr Krokovski s’était, au cours de sa dernière conférence, posé en botaniste. Car ceux-là se tromperaient à coup sûr qui supposeraient que les changements entraînés par le temps eussent fait cesser jusqu’aux conférences du Dr Krokovski. Tous les quinze jours, il les prononçait, tout comme auparavant, en redingote, sinon chaussé de sandales, qu’il ne portait qu’en été, et qu’il porterait donc bientôt de nouveau, chaque deuxième lundi, dans la salle à manger, comme autrefois lorsque Hans Castorp, barbouillé de sang, était arrivé en retard, en ses derniers jours. Pendant neuf mois, l’analyste avait parlé de l’amour et de la maladie, jamais beaucoup à la fois, par petites doses, en des causeries d’une demi-heure ou de trois quarts d’heure, il déployait ses trésors de savoir et de pensée, et chacun avait l’impression qu’il ne serait jamais forcé de s’arrêter, que cela pourrait continuer ainsi indéfiniment. C’était une sorte de « Mille et une nuits » bimensuelle se poursuivant d’une fois à l’autre, et bien faite comme le conte de Shéhérazade, pour contenter un prince curieux et l’empêcher de commettre des actes de violence. Dans son abondance sans bornes, le sujet du Dr Krokovski faisait penser à l’entreprise à laquelle Settembrini avait prêté son concours, à l’Encyclopédie des Souffrances ; et l’on pouvait juger de sa variété par ce fait que le conférencier avait même parlé récemment de botanique, exactement : de champignons… D’ailleurs, il avait peut-être un peu changé de sujet ; il était plutôt question à présent de l’amour et de la mort ce qui donnait lieu à bien des considérations en partie délicatement poétiques, en partie impitoyablement scientifiques. C’est donc dans cet ordre d’idées que le savant en était arrivé, avec son accent traînant à l’orientale, et son r lingual, à parler de la botanique, c’est-à-dire des champignons, de ces créatures de l’ombre, opulentes et fantastiques, de nature charnelle, très proches du règne animal. On trouvait dans leur structure des produits de l’assimilation de l’albumine, de la substance glycogène, de l’amidon animal par conséquent. Et le docteur Krokovski avait parlé d’un champignon célèbre depuis l’antiquité classique, à cause de sa forme et des vertus qu’on lui prêtait, – une morille dont le nom latin comportait l’épithète de impudicus, et dont la forme faisait penser à l’amour, mais dont l’odeur rappelait la mort, car c’était de toute évidence une odeur cadavérique que l’impudicus dégageait lorsque le liquide visqueux, verdâtre et glaireux qui portait les spores s’égouttait de sa tête en forme de cloche, mais les ignorants prêtaient à ce champignon une vertu aphrodisiaque.
Allons bon, cela avait été un peu fort pour les dames, avait jugé le procureur Paravant qui, grâce au soutien moral de la propagande du docteur Behrens, tenait tête ici à la fonte des neiges. Et Mme Stoehr aussi, qui tenait bon avec autant de force de caractère, et qui faisait front contre toute tentation d’un faux départ, avait dit à table que Krokovski avait quand même été un peu « obscur » avec son champignon classique. « Obscur », dit la malheureuse, profanant sa maladie par d’aussi formidables lapsus. Mais Hans Castorp s’étonna surtout que Joachim fît allusion au Dr Krokovski et à sa botanique ; car, en somme, il était aussi peu question entre eux de l’analyste que de la personne de Mme Chauchat ou de Maroussia. Ils ne parlaient pas de lui, ils préféraient dédaigner en silence son action et son existence. Mais cette fois-là, Joachim avait nommé l’assistant d’un ton de mauvaise humeur, la même mauvaise humeur avec laquelle il venait de dire qu’il ne se résignerait pas à attendre la flore des pâturages. Le bon Joachim, peu à peu semblait perdre son équilibre ; sa voix vibrait de surexcitation, il ne montrait plus du tout la même douceur et le même esprit réfléchi qu’autrefois. Le parfum d’orange lui manquait-il ? Cette duperie de l’échelle Gaffky le poussait-elle au désespoir ? Ne réussissait-il plus à se mettre d’accord avec lui-même et à décider s’il attendrait l’automne ou s’il prendrait un « faux départ » ?
En réalité c’était à autre chose encore que tenait ce tremblement énervé dans la voix de Joachim et le ton presque sarcastique de son allusion à la conférence botanique de l’autre jour. De cela, Hans Castorp ne savait rien, ou plutôt il ne savait pas que Joachim en savait quelque chose, car lui-même, cet enfant gâté de la vie et de la pédagogie, il ne le savait que trop. Bref, Joachim avait surpris certains détours de son cousin, il l’avait épié et pris en flagrant délit d’une trahison semblable à celle dont il s’était rendu coupable le mardi gras, d’une nouvelle infidélité, aggravée du fait qu’elle était devenue habituelle.
Le rythme éternellement monotone du temps qui passe, l’organisation invariable de la journée normale toujours la même, se ressemblant à elle-même au point qu’on eût pu les confondre et s’embrouiller, toujours identique à elle-même, éternité si immobile que l’on avait peine à comprendre comment elle pouvait entraîner des changements… cet ordre invariable comportait, comme tout le monde s’en souvient, la tournée du docteur Krokovski, entre trois heures et demie et quatre heures de l’après-midi, à travers toutes les chambres, c’est-à-dire par les balcons, de chaise-longue en chaise-longue. Combien de fois la journée normale du Berghof s’était-elle répétée depuis le jour lointain où Hans Castorp, dans sa position horizontale, s’était irrité de ce que l’assistant l’évitât par un grand détour et ne le prît pas en considération ! Depuis longtemps déjà, de visiteur il était devenu un camarade. Souvent, le docteur Krokovski l’interpellait par ce mot, lors de sa visite de contrôle, et encore que ce terme militaire, dont il prononçait l’r avec un accent exotique en ne frappant qu’une seule fois de sa langue le devant du palais, s’accordât très mal avec sa physionomie ; comme Hans Castorp l’avait fait observer à Joachim, il ne convenait cependant pas mal à sa manière énergique, d’une mâle gaieté et qui engageait à une confiance joyeuse, aspect que sa pâleur de brun démentait il est vrai dans une certaine mesure, et qui avait donc quand même un caractère quelque peu équivoque.
– Eh bien, camarade, ça va, ça marche ? disait le docteur Krokovski en venant de la loggia du couple russe et en s’approchant du chevet de Hans Castorp. Et le malade, si cavalièrement abordé, les mains jointes sur la poitrine, souriait toujours de nouveau, d’un sourire aimable et tourmenté, de cette interpellation abominable, en regardant les dents jaunes du docteur qui apparaissaient dans sa barbe noire. « Bien reposé ? poursuivait le docteur Krokovski. La courbe baisse ? Elle monte aujourd’hui ? Allons ça ne fait rien, ça s’arrangera encore d’ici le mariage. Au revoir ! » Et avec ce mot qui avait également un son abominable, parce qu’il le prononçait comme « à r’voir », il poursuivait déjà son chemin en passant chez Joachim : il ne s’agissait que d’une tournée, d’un rapide coup d’œil de contrôle, et de rien de plus.
Parfois, il est vrai, le docteur Krokovski s’attardait quelque peu, bavardait, – massif et large d’épaules, souriant d’un air mâle –, avec le camarade, de la pluie et du beau temps, des arrivées et des départs, de l’état d’esprit du malade, de sa bonne ou de sa mauvaise humeur, de sa situation personnelle aussi, de ses origines et de ses espérances, jusqu’à ce qu’il eût dit : « À r’voir » et continué son chemin. Et Hans Castorp, les mains jointes derrière la tête pour changer, en souriant lui aussi, répondait à tout cela, avec un sentiment pénétrant de répulsion, sans doute, mais il répondait. Ils parlaient à mi-voix ; bien que la paroi de verre ne séparât pas complètement les loges, Joachim ne pouvait rien comprendre de la conversation de l’autre côté, et, du reste, il ne le chercha pas le moins du monde. Il écoutait son cousin se lever de sa chaise-longue et entrer avec le docteur Krokovski dans la chambre, sans doute pour lui montrer sa feuille de température ; et la conversation, là-bas, se poursuivait encore un bon moment, à en juger par le retard avec lequel l’assistant pénétrait par le corridor chez Joachim.
De quoi causaient les camarades ? Joachim ne le demandait pas ; mais si quelqu’un d’entre nous ne prenait pas exemple sur lui et posait la question, il y aurait lieu de faire remarquer combien nombreux sont les sujets et les prétextes d’échanges intellectuels entre hommes et camarades dont les conceptions portent une empreinte idéaliste et dont l’un, au gré de sa formation, est arrivé à considérer la matière comme le péché originel de l’esprit, comme une dangereuse végétation de celui-ci, tandis que l’autre, comme médecin, est habitué à enseigner le caractère secondaire de la maladie organique. Combien de vues, nous disons-nous, devaient être échangées et discutées sur la matière considérée comme une dégénérescence de l’immatériel, sur la vie comme impudicité de la matière, sur la maladie, forme dépravée de la vie. On pouvait parler, en prenant texte des conférences en cours, de l’amour comme puissance pathogène, de la nature métaphysique de la tare, des taches anciennes et fraîches, des poisons solubles et des philtres d’amour, de l’explication de l’inconscient, des bienfaits de l’analyse psychique, de la transformation du symptôme, – qu’en savons-nous ?… nous qui nous bornons à hasarder ces propositions et ces conjectures, la question étant posée de savoir de quoi le docteur Krokovski et le jeune Hans Castorp pouvaient bien s’entretenir.
D’ailleurs, ils ne bavardaient plus, c’était passé, cela n’avait duré que peu de temps, quelques semaines. En dernier lieu, le docteur Krokovski ne restait guère avec ce patient plus longtemps qu’avec les autres. « Eh bien, camarade ! » et « à r’voir », c’est à quoi se bornait à présent le plus souvent sa visite. Mais, en revanche, Joachim avait fait une autre découverte, celle précisément qu’il ressentait comme une trahison de Hans Castorp. Il l’avait faite tout à fait involontairement, sans que, en sa droiture militaire, il eût le moins du monde tenté de le surprendre : on peut nous en croire ! Un mercredi, il avait tout simplement été, pendant sa première cure de repos, appelé dans le sous-sol, pour se faire peser par le baigneur, et c’est alors qu’il vit la chose. Il descendait l’escalier, l’escalier proprement recouvert de linoléum qui donnait vue sur la porte de la salle de consultations, de côté et d’autre de laquelle étaient situés les deux cabinets de radioscopie, à gauche le cabinet de radioscopie organique, et à droite, après le tournant, le cabinet psychique, situé une marche plus bas, avec la carte de visite du docteur Krokovski à la porte. Mais à mi-hauteur de l’escalier Joachim s’arrêta, car Hans Castorp, venant de son injection, quittait justement le cabinet de consultations ; des deux mains il ferma la porte par laquelle il était rapidement sorti, et sans regarder autour de soi, il tourna à droite, vers la porte où la carte de visite était fixée au moyen de punaises, et l’atteignit en quelques pas silencieux. Il frappa, se pencha en frappant et approcha l’oreille du doigt qui frappait. Et comme l’« entrez » barytonal avec l’r exotique et le son nasal déformé avait retenti dans la cellule, Joachim vit son cousin disparaître dans la pénombre de la crypte analytique du docteur Krokovski.
ENCORE QUELQU’UN
Des journées longues, les plus longues à proprement parler, par rapport au nombre de leurs heures de soleil ; car leur durée astronomique ne changeait rien à leur célérité, ni à celle de chacune en particulier, ni à celle de leur fuite monotone. L’équinoxe du printemps était déjà passé depuis trois mois, le solstice d’été était arrivé, mais l’année naturelle, ici, suivait le calendrier avec retard : à présent seulement, ces tout derniers jours, ç’avait été définitivement le printemps, un printemps sans la moindre lourdeur estivale, aromatique, transparent et léger, avec un azur au rayonnement argenté et une flore des prés d’un éclat bigarré.
Hans Castorp retrouva sur les pentes les mêmes fleurs dont Joachim lui avait si aimablement placé quelques derniers spécimens dans sa chambre pour lui souhaiter la bienvenue : des achillées et des campanules ; cela signifiait que pour lui l’année avait achevé son cours. Mais quelles n’étaient pas les variétés de vie organique – étoiles, calices et clochettes ou formes irrégulières emplissant l’air ensoleillé d’un arôme sec – qui surgissaient de l’herbe d’émeraude des pentes et des étendues de pâturages ? Des lychnides et des pensées sauvages en quantité, des pâquerettes, des marguerites, des primevères en jaune et en rouge, plus belles et plus grandes que Hans Castorp croyait en avoir jamais vu en pays plat, pour autant qu’il y avait pris garde là en bas ; de plus les soldanelles avec leurs clochettes cillantes, bleues, pourpres et roses, une spécialité de cette sphère.
Il cueillit un peu de toutes ces choses gracieuses, emporta chez lui des bouquets entiers, dans une intention sérieuse, et non pas tant pour décorer sa chambre que pour une sévère étude scientifique qu’il s’était proposée. Il s’était procuré un attirail de botaniste, un traité de botanique générale, une petite pelle maniable pour déterrer les plantes, un herbier, une loupe grossissante ; et avec tout cela, le jeune homme s’occupait dans sa loggia, de nouveau en tenue estivale, un des costumes qu’il avait autrefois apportés avec lui en arrivant ; cela aussi signifiait que l’année avait accompli sa ronde.
Il y avait des fleurs fraîches dans plusieurs verres d’eau, sur les tablettes des meubles de la chambre, sur le petit guéridon, à côté de l’excellente chaise-longue. Des fleurs à demi fanées, mais encore pleines de suc se trouvaient éparpillées sur la balustrade du balcon, répandues sur le sol de la loggia, tandis que d’autres, soigneusement aplaties entre des feuilles de buvard qui absorbaient leur humidité, étaient comprimées par des pierres, pour que Hans Castorp pût fixer avec du papier collant ses préparations plates et sèches dans son album. Il était couché, les genoux pliés, et, de plus, l’un croisé sur l’autre, et tandis que le dos du manuel retourné grand ouvert formait sur sa poitrine comme le faîte d’un toit, il tenait la lentille épaisse de la loupe entre ses simples yeux bleus et une fleur dont il avait en partie retranché la corolle avec son couteau de poche, afin de mieux pouvoir étudier le réceptacle, et qui sous la forte loupe se gonflait en une forme bizarre et carnée. Les anthères déversaient là, à l’extrémité de leurs filaments, leur pollen jaune, de l’ovaire surgissait le style cicatrisé, et lorsqu’on en faisait une coupe, on pouvait regarder le canal délicat par où les grains et les utricules de pollen étaient amenés en une excrétion sucrée dans le creux de l’ovaire. Hans Castorp compta, examina et compara ; il étudiait la structure et la position des pétales, du calice et de la corolle, des organes mâles et femelles ; il s’assurait que tout ce qu’il voyait correspondait aux reproductions schématiques ou directes, il constatait avec satisfaction l’exactitude scientifique dans la structure des plantes qu’il connaissait, et essayait ensuite de déterminer, à l’aide du Linné, par section, groupe, espèce, famille et genre, les plantes qu’il n’eût pas su nommer. Comme il avait beaucoup de temps, il fit quelques progrès en fait de méthode botanique en partant de la morphologie comparée. Sous la plante séchée dans l’herbier, il calligraphia le nom latin que la science humaniste lui avait galamment donné, il ajoutait ses caractéristiques et les montrait au bon Joachim qui manifestait de la surprise.
Le soir il contemplait les astres. Il avait été pris d’intérêt pour la révolution de l’année, lui qui pourtant avait déjà passé sur terre quelque vingt ans et ne s’était jamais soucié de ces choses. Si nous-mêmes nous sommes servis d’expressions telles que « l’équinoxe du printemps », c’était dans son esprit et en tenant compte de ses habitudes nouvellement acquises. Car tels étaient les termes que depuis quelque temps il aimait à répandre autour de lui, et il étonnait son cousin également par ses connaissances dans ce domaine.
– À présent, le soleil est sur le point d’entrer dans le signe de l’Écrevisse, commençait-il au cours d’une promenade. Es-tu au courant ? C’est le premier signe estival du Zodiaque, comprends-tu ? Nous passons à présent par-dessus le Lion et la Vierge vers le point de l’automne, l’un des points équinoxiaux, vers la fin de septembre, lorsque le soleil rejoint de nouveau l’équateur du ciel, comme il en a été récemment en mars, lorsque le soleil est entré dans le signe du Bélier.
– Ça m’a échappé, dit Joachim bougon. Qu’est-ce que tu me racontes là ? Le Bélier ? Le Zodiaque ?
– En effet, le Zodiaque, zodiacus. Les antiques constellations : le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, et ainsi de suite, comment ne s’y intéresserait-on pas ? Elles sont douze, c’est ce que tu dois tout au moins savoir, trois pour chaque saison, les signes ascendants et les signes descendants, l’orbite des constellations que le soleil traverse, – grandiose à mon avis ! Figure-toi que dans un temple égyptien on les a trouvées peintes en fresque, un temple à Aphrodite par-dessus le marché, non loin de Thèbes. Les Chaldéens eux aussi les connaissaient déjà, songe un peu, ce vieux peuple de mages. Arabes sémites, très savants en astrologie et en prophétie, ils ont déjà étudié la ceinture céleste où courent les planètes et l’ont divisée en ces douze constellations, la dodekatemoria telle qu’elle nous a été transmise. C’était grandiose. C’est ça, l’humanité !
– À présent tu dis « humanité », comme Settembrini.
– Oui, comme lui, ou un peu autrement. Il faut la prendre comme elle est, mais c’est grandiose. Je pense avec beaucoup de sympathie aux Chaldéens, lorsque je suis allongé ainsi et que je regarde les planètes qu’ils connaissaient déjà presque, car ils ne les connaissaient pas toutes, si intelligents qu’ils aient été. Mais celle qu’ils ne connaissaient pas, je ne la vois pas non plus. Uranus n’a été découvert que récemment, à la longue-vue, voici cent vingt ans.
– Récemment ?
– C’est ce que j’appelle récemment, si tu le permets, en comparaison des trois mille années écoulées depuis l’époque chaldéenne. Mais lorsque je suis étendu ainsi et que je regarde les planètes, ces trois mille années deviennent elles aussi un « récemment », et je pense familièrement aux Chaldéens qui les ont vues eux aussi, et qui y ont entendu quelque chose, et c’est cela l’humanité.
– Bon, ça va bien, tu as des idées grandioses, il me semble ?
– Tu dis grandioses, et je dis familières, ce sera comme tu voudras. Mais lorsque le soleil sera entré dans la constellation de la Balance, dans trois mois environ, les jours auront de nouveau diminué suffisamment pour que le jour et la nuit soient égaux. Ensuite ils diminuent de nouveau jusqu’à Noël, cela tu le sais bien. Mais veux-tu, s’il te plaît, réfléchir à ceci : pendant que le soleil traverse les signes de l’hiver, le Capricorne, le Verseau et les Poissons, les jours augmentent déjà de nouveau. Car voici qu’approche de nouveau le point du printemps, pour la trois millième fois depuis les Chaldéens, et les jours augmentent de nouveau jusqu’à l’année suivante, lorsque revient le commencement de l’été.
– Bien entendu !
– Non, c’est une illusion. En hiver les jours augmentent et lorsque vient le plus long, le 21 juin, au début de l’été, cela diminue déjà de nouveau, ils deviennent plus petits et l’on s’avance vers l’hiver. Tu trouves cela naturel, mais si on le considère autrement que sous ce jour naturel, on peut être saisi d’angoisse sur le moment, et on est prêt à se cramponner à n’importe quoi. Il semble que Till Ulenspiegel ait disposé les choses ainsi pour que, au début de l’hiver, le printemps commence en réalité, et au début de l’été, l’automne… On est mené par le bout du nez, entraîné en rond par l’espoir de quelque chose qui est de nouveau un point d’inflexion… On tourne en rond. Car tous ces points d’inflexion dont se compose le cercle sont sans étendue, le point d’inflexion peut être mesuré, il n’y a pas durée de direction et l’éternité n’est pas « tout droit, tout droit ! » mais « carrousel, carrousel ».
– Arrête !
– Fête du solstice, dit Hans Castorp, le solstice d’été ! Feux, la Saint-Jean et rondes, la main dans la main, autour de la flamme des bûchers ! Je ne l’ai jamais vu, mais il paraît que c’est ainsi que les hommes primitifs fêtent la première nuit d’été avec laquelle commence l’automne, le midi et le sommet de l’année, à partir desquels elle redescend ; ils dansent et tournent et jubilent. Sur quoi jubilent-ils dans leur simplicité primitive, peux-tu comprendre cela ? Pourquoi sont-ils si joyeux ? Parce que l’on descend à présent vers les ténèbres, ou peut-être parce que l’on avait monté jusqu’à présent et que le tournant est arrivé, l’inévitable point solsticial, le minuit de l’été, le sommet, mélancolique dans son présomptueux excès de force ? Je dis cela comme cela est, avec les mots qui me viennent. C’est un orgueil mélancolique et une mélancolie orgueilleuse qui font jubiler les hommes naturels et danser autour de la flamme ; ils le font positivement par désespoir, si l’on peut dire, en l’honneur du mouvement en rond et du retour éternel sans ligne de direction et où tout se répète.
– Ce n’est pas moi qui le dirais, murmura Joachim, je t’en prie ne me l’impute pas. Mais ce sont vraiment des choses lointaines dont tu t’occupes le soir lorsque tu es étendu.
– Oui, je ne veux pas nier que tu t’occupes plus utilement de ta grammaire russe. Mais dis donc, tu vas prochainement parler cette langue tout à fait couramment. Ce serait naturellement un grand avantage pour toi s’il y avait la guerre, ce dont Dieu nous garde !
– Nous garde ? Tu parles comme un civil. La guerre est nécessaire. Sans guerres le monde ne tarderait pas à pourrir, a dit Moltke.
– Oui, il est vrai qu’il a une tendance à cela. Et cela je peux te l’accorder, reprit Hans Castorp, et il était sur le point de revenir aux Chaldéens qui avaient également fait la guerre et qui avaient conquis Babylone, bien qu’ils fussent Sémites et presque des Juifs, lorsque tous deux s’aperçurent que deux promeneurs qui marchaient tout près devant eux tournaient la tête vers eux, ayant entendu leurs voix et troublés dans leur propre conversation.
C’était sur la grande route, entre le Casino et l’Hôtel Belvédère, au retour vers Davos Dorf. La vallée était parée de ses vêtements de fête, de couleurs tendres, claires et gaies. L’air était délicieux. Une symphonie de gais arômes de fleurs des champs emplissait l’atmosphère pure, sèche et ensoleillée.
Ils reconnurent Lodovico Settembrini à côté d’un étranger ; mais il semblait que de son côté il ne les reconnût pas ou qu’il ne désirât pas de rencontre, car il détourna rapidement la tête et s’absorba en gesticulant dans sa conversation avec son compagnon en essayant même d’avancer plus vite. Il est vrai que lorsque les cousins le saluèrent à sa droite par de gais signes de tête, il feignit la plus grande surprise, avec des « sapristi ! » et des « Que diable ! » mais il paraissait à présent vouloir ralentir le pas et laisser les deux autres passer en avant, ce qu’ils ne comprirent pas, parce qu’ils ne voyaient aucune raison à cela. Sincèrement satisfaits de le rencontrer de nouveau après une longue séparation ils s’arrêtèrent près de lui, et lui secouèrent la main, en s’informant de sa santé et tout en considérant dans une attente polie son compagnon. Ils l’obligèrent ainsi à faire ce qu’apparemment il eût préféré éviter, mais ce qui leur semblait la chose la plus naturelle et la plus indiquée du monde, c’est-à-dire à leur présenter ce compagnon. Quand déjà on se remettait en marche, Settembrini désigna donc ces Messieurs les uns à l’autre par un geste de présentation et par des paroles gaies, et les engagea à se serrer la main devant sa poitrine.
Il apparut que l’étranger, qui pouvait avoir l’âge de Settembrini, était son voisin : le second sous-locataire du tailleur pour dames Lukacek, un nommé Naphta, autant que le comprirent les jeunes gens. C’était un petit homme maigre, rasé, et d’une laideur si aiguë, on serait presque tenté de dire : si corrosive que les cousins s’en étonnèrent vraiment. Tout était acéré en lui : le nez courbe qui dominait son visage, la bouche aux lèvres minces et serrées, les verres convexes de ses lunettes, d’ailleurs légèrement construites, qui défendaient ses yeux gris clair, et même le silence qu’il gardait et d’où l’on pouvait conclure que sa parole serait nette et logique. Il était tête nue, ainsi qu’il convenait, et en veston, très élégamment vêtu du reste : son costume de flanelle bleu foncé, à rayures blanches, était de bonne coupe, d’une élégance discrètement adaptée à la mode, ainsi que le constatèrent d’un regard expert d’hommes du monde les cousins qui à leur tour essuyèrent un examen analogue de leur propre personne, mais plus rapide et plus perçant de la part du petit Naphta. Si Lodovico Settembrini n’avait pas su porter sa bure usée et ses pantalons à carreaux avec tant de grâce et de dignité, sa personne eût désagréablement tranché sur cette compagnie distinguée. Mais elle tranchait d’autant moins que les pantalons à carreaux avaient été fraîchement repassés, de sorte qu’au premier regard on aurait pu les tenir pour presque neufs : œuvre de son propriétaire sans nul doute, se dirent les jeunes gens. Mais si l’affreux Naphta était, pour la qualité et le cachet mondain de ses vêtements, plus proche des cousins que de son voisin, non seulement son âge plus avancé le rapprochait de ce dernier plutôt que des jeunes gens, mais autre chose encore qui pouvait se ramener le plus facilement au teint de chacun des deux couples ; les uns étaient bruns et rougis par le soleil, tandis que les autres étaient pâles. Le visage de Joachim s’était bronzé encore davantage dans le courant de l’hiver, et celui de Hans Castorp luisait, tout rose, sous sa raie blonde ; mais sur la pâleur latine de M. Settembrini que soulignait si noblement sa moustache noire, la lumière solaire n’avait exercé aucune action, et son compagnon, bien qu’il eût les cheveux blonds, – il était d’ailleurs d’un blond cendré, métallique et incolore, et portait ses cheveux longs et rejetés en arrière – avait également le teint blanc et mat des races brunes. Deux d’entre les quatre portaient des cannes ; c’étaient Hans Castorp et Settembrini. Car Joachim, pour des raisons militaires, s’en passait, et Naphta, après qu’on l’eut présenté, joignit aussitôt ses mains derrière le dos. Elles étaient petites et frêles, ces mains, de même que ses pieds étaient très gracieux, répondant d’ailleurs à sa stature. On ne pouvait être surpris qu’il eût l’air enrhumé, non plus que d’une certaine façon faible et inefficace qu’il avait de tousser.
Settembrini avait aussitôt surmonté la nuance de gêne ou de mauvaise humeur qu’il avait manifestée en apercevant les jeunes gens. Il montra la meilleure humeur du monde et présenta ses trois compagnons les uns aux autres avec force plaisanteries, en désignant par exemple Naphta comme « princeps scholasticorum ». « La joie, dit-il, tenait brillamment séance dans la salle de sa poitrine », comme L’Arétin s’était exprimé, et c’était le mérite du printemps, d’un printemps qui pour sa part l’enchantait. Ces messieurs devaient savoir qu’il reprochait bien des choses à ce monde d’en-haut, tant il avait souvent exprimé le souhait de le quitter. Mais, honneur à ce printemps de la haute montagne ! Il était capable de vous réconcilier passagèrement avec toutes les horreurs de cette sphère. Il y manquait tout ce que le printemps de la plaine avait de troublant et d’excitant. Pas de bouillonnement dans la profondeur, pas d’arômes humides, pas de lourdes buées. Mais de la clarté, de la sécheresse, de la gaîté et une grâce amère. Cela répondait à son goût et c’était superbe ! Ils allaient tous quatre en un rang irrégulier, l’un à côté de l’autre, autant que possible, mais tantôt, lorsque les promeneurs qui rentraient passaient auprès d’eux, Settembrini devait se tenir à droite, voire descendre sur la chaussée, tantôt leur alignement se rompait, par le fait que l’un ou l’autre restait en arrière. Naphta par exemple, à gauche, ou Hans Castorp qui avait pris place entre l’humaniste et son cousin Joachim. Naphta poussait des rires brefs, avec une voix assourdie par le rhume qui faisait penser au son d’une assiette fêlée que l’on frappe du doigt. En désignant l’Italien de la tête, il dit avec un accent traînant :
– Écoutez donc le Voltairien, le rationaliste. Il loue la nature parce que, même dans les circonstances les plus fécondes, elle ne vous étourdit pas par des vapeurs mystiques, mais garde une sécheresse classique. Comment s’appelait donc l’humidité en latin ?
– Humor, s’écria Settembrini par-dessus son épaule gauche. L’humour, dans les considérations sur la nature de notre professeur, consiste en ceci, qu’à l’instar de sainte Catherine de Sienne, il pense aux plaies du Christ lorsqu’il voit des primevères rouges.
Naphta répondit :
– Ce serait plutôt de l’esprit que de l’humour. Mais cela n’en signifierait pas moins faire passer son esprit dans la nature. Elle en a besoin.
– La nature, dit Settembrini, en baissant la voix, non plus par-dessus son épaule, mais comme en descendant le long d’elle, n’a en aucune façon besoin de votre esprit. Elle est elle-même esprit.
– Vous ne vous ennuyez pas avec votre monisme ?
– Ah ! vous convenez donc que c’est à plaisir que vous divisez le monde, que vous séparez Dieu et la nature.
– Cela m’intéresse de vous entendre parler de plaisir à propos de ce à quoi je pense, lorsque je dis passion et esprit.
– Songez que vous, qui employez de si grands mots pour des besoins si frivoles, me traitez parfois de rhéteur.
– Vous persistez à estimer qu’esprit signifie frivolité. Mais, s’il est d’origine dualiste, il n’y peut rien. Le dualisme, l’antithèse, c’est le principe moteur, passionné, dialectique et spirituel. Il est vrai que c’est de l’esprit que de voir le monde séparé en deux masses contraires. Tout monisme est ennuyeux. Solet Aristoteles quaerere pugnam.
– Aristote ? Aristote a transporté dans les individus la réalité des idées générales. C’est du panthéisme.
– Faux ! Si vous prêtez aux individus un caractère substantiel, si vous transportez par la pensée l’essence des choses hors du général dans le phénomène individuel, comme l’ont fait Thomas et Bonaventure en bons aristotéliciens, vous avez écarté le monde de toute union avec l’idée la plus haute ; il reste en dehors du divin, et Dieu est transcendant. C’est cela le moyen âge classique, Monsieur.
– Moyen âge classique, voilà une exquise combinaison de mots.
– Je vous prie de m’excuser, mais je fais appel à l’idée de classique là où elle est à sa place, c’est-à-dire partout où une idée atteint son sommet. L’antiquité n’a pas toujours été classique. J’enregistre chez vous une antipathie contre la… liberté des catégories, contre l’absolu. Vous ne voulez pas non plus l’esprit absolu. Vous voulez que l’esprit soit le progrès démocratique.
– J’espère que nous sommes d’accord que l’esprit, si absolu soit-il, ne pourra jamais être l’avocat de la réaction.
– Mais il est toujours l’avocat de la liberté !
– Vous dites : mais ? La liberté est la loi de l’amour humain, elle n’est ni nihilisme, ni ressentiment.
– Choses que vous craignez apparemment.
Settembrini leva les bras au ciel. La querelle resta en suspens, Joachim, étonné, regardait l’un après l’autre, tandis que Hans Castorp, les sourcils froncés, tenait les yeux fixés sur le sol. Naphta avait parlé sur un ton coupant et catégorique, bien que c’eût été lui qui avait défendu la liberté la plus large. Surtout sa manière de répondre : « c’est faux », en serrant les lèvres pour prononcer l’f et en pinçant ensuite la bouche, était désagréable. Settembrini lui avait donné la réplique tantôt gaiement, tantôt en mettant dans ses paroles une belle chaleur, notamment lorsqu’il lui avait rappelé les conceptions fondamentales qu’ils avaient en commun. À présent, tandis que Naphta se taisait, il commença à expliquer aux cousins l’existence de cet inconnu en répondant au besoin qu’ils pouvaient éprouver de quelques éclaircissements après cette discussion avec Naphta. Celui-ci laissa faire sans le moins du monde s’en occuper. Il enseignait les langues anciennes dans les classes supérieures du Fridericianum, expliqua Settembrini, qui, selon l’usage italien, mit en valeur aussi pompeusement que possible la situation de celui qu’il présentait. Le destin de M. Naphta était semblable au sien propre. Amené ici, voici cinq ans, par son état de santé, il avait dû se convaincre qu’il avait besoin de ce séjour pour un temps très long ; il avait quitté son sanatorium et s’était établi chez Lukacek, le tailleur pour dames. L’institut d’éducation de Davos avait été assez avisé pour s’assurer le concours du remarquable latiniste qu’était M. Naphta, ancien élève d’une institution catholique… Bref, Settembrini faisait plutôt grand cas de l’affreux Naphta, bien que, un instant plus tôt, il eût engagé avec lui une discussion abstraite qui allait se poursuivre sans retard.
En effet, Settembrini en vint aussitôt à donner à M. Naphta des explications sur les cousins, ce qui fit apparaître qu’il lui avait déjà parlé d’eux auparavant. C’était donc là le jeune ingénieur « de trois semaines » chez lequel le docteur Behrens avait trouvé un endroit humide, et c’était là, cet espoir de l’armée prussienne, le lieutenant Ziemssen. Et il parla de l’impatience de Joachim, et de ses projets de voyage pour ajouter que l’on ferait incontestablement tort à l’ingénieur, si on ne lui prêtait pas la même impatience de retourner à son travail.
Naphta fit la grimace. Il dit :
– Ces messieurs ont là un tuteur éloquent. Je me garde bien de mettre en doute la fidélité avec laquelle il interprète vos pensées et vos désirs. Travail, travail, je vous en prie, tout à l’heure il me traitera d’ennemi du genre humain, d’inimicus humanae naturae, si j’ose évoquer des temps où cette fanfare n’aurait pas produit son effet, à savoir des temps où le contraire de son idéal était infiniment plus honoré. Bernard de Clairvaux a enseigné une hiérarchie de la perfection dont M. Settembrini ne se doute même pas. Voulez-vous savoir laquelle ? Son état inférieur, il le place dans « le moulin », le second aux « champs », mais le troisième, et le plus louable, – écoutez bien, Settembrini ! – était le « lit de repos ». Le moulin, c’est le symbole de la vie extérieure pas mal choisi. Le champ désigne l’âme de l’homme laïque que laboure le prêtre et le directeur spirituel. Ce degré est déjà plus digne. Mais au lit…
– Assez ! nous savons, s’écria Settembrini. Messieurs, le voici qui va vous démontrer l’usage et l’utilité de l’alcôve !
– Je ne vous savais pas prude, Lodovico. Lorsqu’on vous voit faire de l’œil aux jeunes filles… Que devient donc l’innocence païenne ? Le lit est le lieu où l’amant se joint à l’aimée, et il est pris comme le symbole de l’éloignement contemplatif du monde et de la créature à l’effet de la communion avec Dieu.
– Pouh, andate, andate ! se défendit l’Italien, presque en pleurant.
On rit. Mais ensuite Settembrini poursuivit avec dignité :
– Ah non, je suis un Européen d’Occident. Votre hiérarchie est du pur Orient. L’Orient a horreur de l’action. Lao Tsé enseigne que la fainéantise est plus profitable que toute chose entre le ciel et la terre. Si tous les hommes avaient cessé d’agir, le repos et le bonheur parfait régneraient sur terre. La voilà votre communion !
– Qu’est-ce que vous nous dites là ? Et la mystique occidentale ? Et le quiétisme qui compte Fénelon parmi ses adeptes, et qui enseignait que toute action est une faute, parce que vouloir être actif c’est offenser Dieu qui entend seul agir ? Je cite les propositions de Molinos. Il semble pourtant que la possibilité spirituelle de trouver le salut dans le repos soit universellement répandue dans l’humanité.
Hans Castorp intervint ici. Avec le courage de l’ingénuité, il se mêla à la conversation et observa en regardant en l’air :
– Éloignement, contemplation ! Ce sont des mots qui signifient quelque chose, qu’on entend volontiers. Nous vivons ici dans un éloignement assez considérable, il faut le dire. Nous sommes étendus à cinq mille pieds d’altitude sur nos chaises-longues particulièrement confortables, et nous regardons le monde et la créature, et nous nous faisons toutes sortes d’idées. Si j’y réfléchis et si je m’efforce de dire la vérité, le lit, je veux dire la chaise-longue, m’a en dix mois plus avancé et m’a donné plus d’idées que le moulin en pays plat, pendant toutes ces années passées ; c’est indéniable.
Settembrini le regarda de ses yeux noirs au scintillement attristé.
– Ingénieur, dit-il, oppressé, Ingénieur !
Et il prit Hans Castorp par le bras et le retint un peu, en quelque sorte pour le convaincre derrière le dos de l’autre, dans le privé.
– Combien de fois vous ai-je dit que chacun devrait savoir ce qu’il est et penser comme il lui sied. L’affaire de l’Occidental c’est, en dépit de toutes les propositions du monde, la Raison, l’analyse, l’action et le Progrès, non pas le lit, où se vautre le moine.
Naphta avait écouté. Il parla en se retournant vers eux :
– Le moine ? Ce sont les moines qui ont cultivé le sol européen ! C’est grâce à eux que l’Allemagne, la France et l’Italie ne sont plus des forêts vierges et des marécages, mais sont couvertes de blé, portent des fruits et produisent du vin. Les moines, Monsieur, ont très bien travaillé.
– Ebbé, alors…
– Je vous en prie. Le travail du religieux n’était ni un but en soi, c’est-à-dire un narcotique, ni n’a tendu à faire progresser l’univers, ou recherché des avantages commerciaux. C’était un exercice purement ascétique, une partie de la discipline de pénitence, un remède. Il défendait contre la chair, il tuait la sensualité. Il portait par conséquent – permettez-moi de le retenir – un caractère absolument anti-social. C’était l’égoïsme religieux le plus pur de tout mélange.
– Je vous suis très reconnaissant de vos éclaircissements et je suis heureux de voir le bienfait du travail faire ses preuves même contre la volonté de l’homme.
– Oui, contre son intention. Nous ne relevons ici rien de moins que la différence entre l’utile et l’humain.
– Je remarque avant tout avec regret que vous divisez déjà de nouveau le monde en deux principes.
– Je regrette de m’être exposé à votre mécontentement, mais il faut distinguer et ordonner les choses et dégager l’idée de homo dei de tous éléments impurs. Vous autres Italiens, vous avez inventé le métier du changeur et les banques ; que Dieu vous le pardonne ! Mais les Anglais ont inventé la doctrine économique de la Société, et cela, le génie de l’homme ne le leur pardonnera jamais.
– Oh, le génie de l’humanité a également inspiré les grands penseurs économistes de ces îles. Vous vouliez dire quelque chose, ingénieur ?
Hans Castorp assura que non, mais dit néanmoins, – cependant que Naphta comme Settembrini l’écoutaient avec une certaine impatience :
– Vous devez par conséquent vous complaire au métier de mon cousin, Monsieur Naphta, et comprendre sa hâte de l’exercer… Je suis, quant à moi, un civil incurable, mon cousin me le reproche assez souvent. Je n’ai même pas fait mon service militaire et je suis vraiment un enfant de la paix ; je suis quelquefois allé jusqu’à songer que j’aurais parfaitement pu devenir ecclésiastique, – demandez-le plutôt à mon cousin, je me suis plusieurs fois exprimé dans ce sens. Mais, en tant que je laisse de côté mes préférences personnelles – et peut-être, n’ai-je même pas précisément besoin de m’en écarter si complètement – j’ai beaucoup de compréhension et de sympathie pour l’état militaire. C’est, il est vrai, un métier diablement sérieux, un métier « ascétique », si vous voulez, – vous vous êtes à l’instant servi de cette expression – et l’on peut toujours s’attendre dans l’exercice de ce métier à avoir affaire à la mort – dont en somme on s’occupe également beaucoup dans l’état de prêtre (de quoi d’autre s’y occuperait-on ?). C’est de là que l’état militaire tient la bienséance et la hiérarchie et l’obéissance et l’honneur espagnol, si je puis ainsi m’exprimer, et il est assez indifférent que l’on porte un col raide d’uniforme ou une collerette amidonnée ; ce qui importe c’est l’ascétisme, comme vous vous êtes tout à l’heure si justement exprimé… Je ne sais pas si je réussis à vous faire comprendre les pensées que…
– Si, si, dit Naphta, et il jeta un coup d’œil à Settembrini qui tournait sa canne et contemplait le ciel.
– Et c’est pourquoi je pense, poursuivit Hans Castorp, que les penchants de mon cousin Ziemssen doivent vous être sympathiques, d’après tout ce que vous dites. Je ne pense pas du tout ici au « trône et à l’autel » et à de telles combinaisons par quoi beaucoup de gens, tout bonnement attachés à l’ordre et simplement bien pensants justifient quelquefois la solidarité. Je veux dire ceci que le travail de l’état militaire, c’est-à-dire le service, – dans ce cas on parle de service – se fait sans aucun but de lucre et n’a aucun rapport avec la doctrine économique de la société, comme vous disiez. C’est pourquoi les Anglais n’ont que peu de soldats, quelques-uns pour les Indes et quelques-uns chez eux pour les parades militaires…
– Il est inutile que vous poursuiviez, ingénieur, l’interrompit Settembrini. L’existence militaire, – je puis dire cela sans vouloir offenser le lieutenant – est moralement indiscutable, car elle est purement formelle, sans contenu propre. Le type du soldat par excellence est le mercenaire qui se laisse enrôler en faveur de telle ou telle cause. Bref, il y a eu les soldats de la contre-réforme espagnole, le soldat de l’armée révolutionnaire, le soldat napoléonien, le garibaldien, il y a eu le soldat prussien. Laissez-moi parler du soldat lorsque je sais pour quoi il se bat.
– Il n’en est pas moins vrai que le fait de se battre reste une caractéristique évidente de son état, tenons-nous-en là, répliqua Naphta. Il est possible qu’elle ne suffise pas selon vous à rendre cet état « intellectuellement discutable », mais elle le place dans une sphère qui échappe entièrement à l’acceptation bourgeoise de la vie.
– Ce qu’il vous plaît d’appeler « acceptation bourgeoise de la vie », répondit M. Settembrini, du bout de ses lèvres, tandis que les commissures de sa bouche se tendaient sous la moustache troussée et que son cou se dévissait bizarrement, en biais et par petites secousses, de son col, sera toujours prêt à défendre, sous quelque forme que ce soit, les idées de Raison, de Morale et leur influence légitime sur de jeunes âmes chancelantes.
Un silence suivit. Les jeunes gens regardèrent devant eux avec embarras. Après quelques pas, Settembrini, qui avait placé sa tête et son cou dans leur position normale, dit :
– Il ne faut pas vous étonner, ce Monsieur et moi, nous nous querellons souvent, mais en toute amitié et sur la base de maintes conceptions communes.
Ce fut un soulagement ! C’était chevaleresque et humain de la part de M. Settembrini. Mais Joachim, qui avait également de bonnes intentions et qui voulait poursuivre la conversation d’une manière inoffensive, dit quand même, comme si quelque chose l’y poussait, et en quelque sorte contre son vouloir :
– Nous parlions par hasard de la guerre, mon cousin et moi, tout à l’heure, en marchant derrière vous.
– Je l’ai entendu, répondit Naphta. J’avais entendu ce mot et je m’étais retourné. Faisiez-vous de la politique ? Discutiez-vous la situation générale ?
– Oh non, rit Hans Castorp. Comment en arriverions-nous là ? À mon cousin que voici, sa profession interdit véritablement de s’occuper de politique, et quant à moi, j’y renonce volontairement, je n’y entends absolument rien. Depuis que je suis ici, je n’ai même pas ouvert un journal…
Settembrini, comme il l’avait déjà fait autrefois, jugea cette indifférence blâmable. Il se montra parfaitement averti des événements importants et les jugea favorablement, parce que les choses prenaient selon lui un tour profitable à la civilisation. L’atmosphère générale de l’Europe était pénétrée de pensées de paix, de pensées de désarmement. L’idée démocratique était en marche. Il assura qu’il possédait des renseignements confidentiels d’après lesquels les Jeunes-Turcs achevaient précisément leurs derniers préparatifs en vue d’un coup d’État. La Turquie, État national et constitutionnel, quel triomphe de l’humanité !
– Libéralisation de l’Islam, railla Naphta. Parfait ! Le fanatisme éclairé, très bien ! D’ailleurs, ceci vous regarde, se tourna-t-il vers Joachim. Si Abdul Hamid tombe, c’en est fini de votre influence en Turquie et l’Angleterre se pose en protecteur… Je vous conseille de prendre tout à fait au sérieux les relations et les informations de notre Settembrini, dit-il aux deux cousins et c’était assez impertinent de sa part, car il paraissait les croire capables de ne pas prendre au sérieux M. Settembrini. Il est bien renseigné sur les questions nationales et révolutionnaires. Dans son pays, on entretient d’excellentes relations avec le comité anglais des Balkans. Mais que deviendront les conventions de Réval, Lodovico, si vos Turcs progressistes réussissent ? Édouard VII ne voudra plus laisser aux Russes l’accès des Dardanelles, et si l’Autriche se résout quand même à une politique active dans les Balkans…
– Elles sont bonnes, vos prophéties de catastrophes, protesta Settembrini. Nicolas aime la paix. On lui doit les conférences de La Haye qui restent des faits moraux de premier ordre.
– Mon Dieu, après son petit échec en Orient, la Russie devait bien s’accorder quelque répit.
– Fi, Monsieur ! Vous ne devriez pas vous moquer du désir de perfectionnement social de l’Humanité. Le peuple qui contrarie de tels efforts s’exposera indubitablement au bannissement moral.
– Pourquoi la politique serait-elle faite, sinon pour donner aux uns et aux autres l’occasion de se compromettre moralement ?
– Vous êtes un adepte du pangermanisme ?
Naphta haussa ses épaules qui n’étaient pas tout à fait de la même hauteur. En sus de sa laideur, sans doute était-il aussi un peu asymétrique.
Il dédaigna de répondre. Settembrini conclut :
– De toutes façons, c’est cynique, ce que vous dites là. Dans les généreux efforts que fait la démocratie pour s’imposer sur un plan international, vous ne voulez voir que de la ruse politique…
– Vous voudriez sans doute que j’y visse de l’idéalisme, ou même de la religiosité ? Il s’agit des derniers et faibles restes de l’instinct de conservation dans un système du monde condamné. La catastrophe doit venir, elle vient par tous les chemins et de toutes les manières. Prenez la politique britannique ! Le besoin qu’a l’Angleterre de s’assurer le glacis indien est légitime. Mais les conséquences ? Édouard sait aussi bien que vous et moi que les gouvernants de Pétersbourg doivent prendre une revanche de leur défaite de Mandchourie et qu’ils ont le besoin pressant de détourner la révolution. Et pourtant il oriente vers l’Europe – il le lui faut bien – les tendances de la Russie à l’expansion, éveille des rivalités endormies entre Pétersbourg et Vienne.
– Ah, Vienne ! vous vous souciez de cet obstacle opposé à la marche du monde, apparemment, parce que vous voyez dans l’empire vermoulu dont elle est la capitale, la momie du saint empire germanique !
– Et moi je vous trouve russophile, apparemment par sympathie humaniste pour le césaro-papisme.
– Monsieur, la démocratie a encore plus à attendre du Kremlin que de la Hofburg, et c’est une honte pour le pays de Luther et de Gutenberg…
– De plus, c’est sans doute une sottise. Mais cette sottise elle-même est un instrument de la fatalité…
– Oh ! allez donc, avec votre fatalité. La raison humaine n’a besoin que de vouloir être plus forte que la fatalité, et elle l’est.
– On ne veut jamais que son destin. L’Europe capitaliste veut le sien.
– On croit à la venue de la guerre lorsqu’on ne l’abomine pas assez.
– Votre répugnance est logiquement incomplète aussi longtemps que vous ne la faites pas partir de l’État lui-même.
– L’État national est le principe de ce monde-ci, que vous voudriez identifier avec le diable. Mais faites les nations libres et égales, protégez les petites et les plus faibles de l’oppression, faites la justice, faites des frontières nationales…
– La frontière du Brenner, je sais. La liquidation de l’Autriche. Si seulement je savais comment vous comptez la réaliser sans guerre…
– Et je ne sais vraiment pas quand j’aurais jamais condamné les guerres nationales…
– Ai-je bien entendu ?
– Non, il faut que je confirme les dires de M. Settembrini sur ce point, intervint Hans Castorp dans la discussion qu’il avait suivie tout en marchant, en considérant attentivement, la tête penchée tour à tour vers l’un ou vers l’autre, les interlocuteurs. Mon cousin et moi, nous avons déjà eu quelquefois l’avantage de nous entretenir de ces choses et d’autres analogues avec M. Settembrini, c’est-à-dire, bien entendu, que nous l’écoutions développer et préciser ses opinions. Et je puis donc vous confirmer (et mon cousin s’en souviendra), que M. Settembrini nous a plus d’une fois parlé avec un grand enthousiasme du principe du mouvement et de la rébellion et de l’amendement du monde, qui en somme n’est pas un principe si absolument pacifique, me semble-t-il, et il nous a dit que ce principe devra faire encore de grands efforts avant d’être partout vainqueur, et avant que se réalise la bienheureuse République universelle. Telles ont été ses paroles, encore qu’elles fussent naturellement beaucoup plus plastiques et plus littéraires que les miennes ; cela va de soi. Mais ce que je sais et ce que j’ai retenu littéralement, parce que, en ma qualité de civil obstiné, cela m’avait véritablement effrayé, c’est qu’il a dit une fois que ce jour ne viendrait pas sur des pattes de colombe, mais sur des ailes d’aigle (ce sont les ailes d’aigle qui m’ont effrayé, si je me souviens bien), et que Vienne devrait être battue, si l’on voulait ouvrir la voie au bonheur. On ne peut donc pas dire que M. Settembrini ait condamné la guerre en général. Ai-je raison, monsieur Settembrini ?
– À peu près, dit l’Italien, brièvement, en balançant sa canne, la tête détournée.
– Grave, sourit vilainement Naphta. Vous voici convaincu de tendances guerrières par votre propre disciple. Assument pennas ut aquilae[6].
– Voltaire lui-même a approuvé la guerre civilisatrice et l’a recommandée à Frédéric II contre les Turcs.
– Au lieu de cela, il s’est allié avec eux, hé hé ! Et puis la République universelle ! Je néglige de demander ce que deviendra le principe du mouvement et de la rébellion, si le bonheur et l’union sont réalisés. À cet instant la rébellion redeviendrait un crime…
– Vous savez parfaitement, et ces Messieurs le savent, qu’il s’agit du progrès de l’Humanité supposé infini…
– Mais tout mouvement est circulaire, dit Hans Castorp. Dans l’espace et dans le temps ; c’est ce qu’enseignent les lois de la conservation de la masse et celles de la périodicité. Mon cousin et moi, nous en parlions à l’instant. Peut-il donc être question de progrès, lorsqu’on est en présence d’un mouvement fermé sans direction continue ? Lorsque je suis étendu le soir et que je regarde le Zodiaque, c’est-à-dire la moitié qui en est visible, et que je pense aux vieux peuples sages…
– Vous feriez mieux de ne pas vous creuser la tête ni de rêver, ingénieur, mais de vous fier résolument aux instincts de votre âge et de votre race qui doivent vous pousser à l’action. Votre formation scientifique, elle aussi, doit vous incliner vers l’idée de progrès. Vous voyez en des périodes indéterminées la vie se développer de l’infusoire jusqu’à l’homme, vous ne pouvez pas douter que des possibilités de perfectionnement encore infinies soient ouvertes à l’homme. Mais si vous vous en tenez aux mathématiques, vous conduisez votre mouvement circulaire de perfection en perfection, et vous vous réconfortez à la doctrine de notre dix-huitième siècle, d’après laquelle l’homme a été bon, heureux et parfait, et n’a été déformé et abîmé que par les erreurs sociales, et afin qu’il devienne de nouveau bon, heureux et parfait, grâce à un travail de révision critique sur la structure de la société, nous ne manquerons pas de…
– M. Settembrini omet d’ajouter, intervint Naphta, que l’idylle rousseauiste est une adaptation maladroite et rationaliste de la doctrine chrétienne de l’état initial de l’homme, ne connaissant ni péché ni société, de son origine divine et de son union intime avec Dieu, laquelle doit de nouveau se réaliser. Mais la reconstitution du royaume de Dieu après la dissolution de toutes les formes terrestres est située en un point où la terre et le ciel, où ce qui est accessible et ce qui échappe aux sens, se touchent ; le salut est transcendant, et quant à votre république universelle capitaliste, mon cher docteur, il est bien étrange de vous entendre parler à son propos d’« instinct ». L’être instinctif est absolument du côté de ce qui est national, et Dieu lui-même a implanté aux hommes l’instinct naturel qui les a incités à se séparer les uns des autres en États différents. La guerre…
– La guerre, s’écria Settembrini, même la guerre, Messieurs, a été déjà forcée à servir le progrès, comme vous devrez me le concéder si vous vous rappelez certains événements de votre époque préférée, je veux dire : les croisades. Ces guerres civilisatrices ont favorisé le plus heureusement du monde les rapports économiques et commerciaux des peuples et ont réuni l’humanité occidentale sous le signe d’une idée.
– Vous êtes très tolérant envers l’idée. Je veux donc rectifier vos dires, d’autant plus courtoisement, en vous apprenant que les croisades, en dehors de l’impulsion qu’elles ont donnée au commerce, ont exercé une influence dans un sens rien moins qu’international, mais au contraire ont enseigné aux peuples à se distinguer les uns des autres, et ont favorisé le développement de l’idée d’État national.
– Très exact, pour autant que vous envisagez les rapports des peuples avec le clergé. Oui, à ce moment le sentiment de l’honneur de l’État national a commencé de se fortifier, à l’encontre de la présomption hiérarchique…
– Et pourtant ce que vous appelez présomption hiérarchique n’est pas autre chose que l’idée d’union des hommes sous le signe de l’esprit.
– Nous connaissons cet esprit et nous n’avons qu’en faire.
– Il est évident qu’avec votre manie nationale vous avez horreur du cosmopolitisme invincible de l’Église. Si seulement je savais comment vous voulez concilier avec cela votre répugnance à l’endroit de la guerre ! Votre culte de l’État à l’antique doit faire de vous un partisan d’une conception juridique positive, et comme tel…
– Invoquez-vous le droit ? Dans le droit des peuples, Monsieur, l’idée de droit naturel et de raison humaine universelle reste peut-être la plus vivante…
– Bah, votre droit des peuples n’est une fois de plus qu’une forme corrompue du Jus divinum, qui n’a ni affaire avec la nature ni ne repose sur la révélation…
– Ne discutons pas sur les mots, professeur ! Appelez tranquillement Jus divinum[7], ce que je révère comme droit naturel et droit des peuples. L’essentiel est qu’au-dessus des droits positifs des États nationaux s’élève un droit supérieur, généralement valable, qui permet de trancher par des arbitrages des questions d’intérêts contestées.
– Par des tribunaux d’arbitrage ! La belle phrase ! Par un tribunal bourgeois d’arbitrage qui tranche les problèmes de la vie, qui établit la volonté de Dieu et qui détermine l’histoire ! Bon, voilà pour les messages des colombes ! Et que deviennent les ailes de l’aigle ?
– La vertu civique…
– Mon Dieu, la vertu civique ne sait pas ce qu’elle veut ! Les voilà qui combattent la diminution de la natalité, qui exigent que le taux de l’instruction et de la préparation professionnelle des enfants soit réduit. Et cependant, on étouffe dans la foule, et toutes les professions sont tellement débordées que la lutte pour la gamelle est plus terrifiante que toutes les guerres des temps passés. Des stades et des cités-jardins ! Amélioration de la race ! Mais à quoi bon la rendre plus vaillante, si le progrès et la civilisation veulent qu’il n’y ait plus de guerres ? La guerre serait le moyen contre tout cela et pour tout cela. Pour l’amélioration de la race et même contre la crise de la natalité.
– Vous plaisantez. Ce n’est plus sérieux. Notre conversation tourne court et elle le fait au bon moment. Nous sommes arrivés, dit Settembrini et, de sa canne il désigna aux cousins la maisonnette, devant la porte de clôture de laquelle ils s’arrêtaient. Elle était située près de l’entrée de Dorf, sur la route, dont ne la séparait qu’un étroit jardinet, et elle était modeste. La vigne vierge aux racines dénudées entourait la porte de la maison et étendait une de ses branches tordues et appuyées au mur, vers la fenêtre du rez-de-chaussée à droite, qui était la vitrine d’une petite épicerie. Le rez-de chaussée appartenait à l’épicier, déclara Settembrini. Le logement de Naphta se trouvait au premier étage chez le tailleur, et lui-même demeurait sous le toit. C’était un studio paisible.
Témoignant tout à coup d’une amabilité surprenante, Naphta exprima l’espoir que de nouvelles rencontres suivraient celle-ci.
– Venez nous voir, dit-il. Je dirais : Venez me voir si le docteur Settembrini ici présent n’avait des droits plus anciens à votre amitié. Venez dès que vous voudrez, dès que vous aurez envie d’un petit colloque. J’apprécie les échanges d’idées avec la jeunesse. Peut-être ne manqué-je pas, moi non plus, de toute tradition pédagogique… Si notre maître ex cathedra (il désigna Settembrini) prétend réserver à l’humanisme bourgeois les dons et la vocation pédagogiques, il faut les contredire. À bientôt donc !
Settembrini fit des objections. Il en découvrait de nombreuses. Les jours du lieutenant ici étaient comptés, et l’ingénieur redoublerait de zèle dans l’observation de son régime, pour le rejoindre au plus tôt dans la plaine.
Les jeunes gens donnèrent raison à tous les deux, d’abord à l’un, puis à l’autre. Ils avaient accueilli l’invitation de Naphta par des révérences et, l’instant d’après, ils corroborèrent les réserves de Settembrini par des mouvements de la tête et des épaules. Ainsi, toutes les possibilités demeuraient ouvertes.
– Comment l’a-t-il appelé ? demanda Joachim, lorsqu’ils remontèrent le chemin en lacets qui les conduisait au Berghof.
– J’ai compris : « maître ex cathedra », dit Hans Castorp, et je suis justement en train d’y réfléchir. Sans doute est-ce une blague quelconque ; ils se donnent de curieux surnoms. Settembrini a appelé Naphta princeps scholasticorum, ce n’est pas mal non plus. Les scolastiques, c’étaient en somme les docteurs du moyen âge, des philosophes dogmatiques, si tu veux. Hum ! Du reste, on a parlé plusieurs fois du moyen âge, ce qui m’a fait souvenir que Settembrini a dit dès le premier jour que bien des choses lui paraissaient relever du moyen âge ici, chez nous. C’est à propos d’Adriatica von Mylendonk qu’il a dit cela, à cause de son nom. Et comment l’as-tu trouvé ?
– Le petit ? Pas bien. Il a dit des choses qui m’ont plu. Les tribunaux d’arbitrage sont naturellement une invention de froussards. Mais lui-même ne me plaît guère, et à quoi sert qu’il dise de bonnes choses, s’il est lui-même un type équivoque ? Et il est équivoque, c’est ce que tu ne peux pas nier. Déjà cette histoire du « lieu de communion » était vraiment équivoque. Et par-dessus le marché il a un nez de Juif, regarde-le bien ! d’ailleurs il n’y a guère que les Sémites pour être aussi malingres. Aurais-tu sérieusement l’intention de rendre visite à cet homme ?
– Naturellement, nous irons le voir, déclara Hans Castorp. Pour ce qui est de son physique, c’est le soldat qui parle en toi. Mais les Chaldéens avaient le même genre de nez, et ils étaient diablement malins, pas seulement en fait de sciences occultes. Naptha, lui aussi, a quelque chose d’un occultiste, il ne m’intéresse pas médiocrement. Je ne veux d’ailleurs pas prétendre que je l’aie pénétré dès aujourd’hui. Mais si nous le rencontrons assez souvent, nous finirons peut-être par le comprendre, et il n’est pas impossible que notre intelligence en général y gagne.
– Ah, mon ami, tu deviens de plus en plus intelligent ici avec ta biologie, avec ta botanique et avec tes points solsticiaux insaisissables. Et dès le premier jour, tu t’es intéressé au Temps. Et pourtant nous sommes ici pour devenir mieux portants et non pas plus malins, mieux portants et tout à fait bien portants, pour qu’ils puissent enfin nous remettre en liberté et nous renvoyer guéris en pays plat.
– « Sur les montagnes demeure la liberté ! » chanta Hans Castorp frivolement. Dis-moi donc ce que c’est que la liberté, continua-t-il en parlant. Naphta et Settembrini, eux aussi, en ont discuté tout à l’heure, et ils n’ont pas réussi à s’entendre. « La liberté est la loi de l’amour des hommes », dit Settembrini et cela fait penser à son aïeul, le carbonaro. Mais si courageux qu’ait été le carbonaro, et si courageux que soit notre Settembrini…
– Oui, il est devenu inquiétant lorsqu’on en est arrivé à parler du courage personnel.
– … Je n’en crois pas moins qu’il redoute bien des choses dont le petit Naphta n’a pas peur, comprends-tu, et que sa liberté et son courage sont sujets à caution. Crois-tu qu’il aurait le courage de se perdre ou même de se laisser dépérir ?
– Pourquoi commences-tu à parler français ?
– Comme cela… L’atmosphère ici est tellement internationale. Je ne sais pas qui devrait le mieux s’y complaire : Settembrini à cause de sa république bourgeoise, universelle, ou Naphta avec son cosmopolitisme hiérarchique. J’ai fait très attention, comme tu vois, mais je n’ai pas tout compris, j’ai trouvé au contraire que la confusion était grande qui résultait de leurs discours.
– C’est toujours ainsi, tu trouveras toujours que parler et avoir des opinions, cela ne donne lieu qu’à de la confusion. Ne te l’ai-je pas dit ? Ce qui importe, ce n’est pas du tout quelles opinions l’on a, mais de savoir si on est un brave homme. Le mieux est de n’avoir pas d’opinion du tout et de faire son service.
– Oui, tu peux dire cela, toi, en lansquenet que tu es, menant une existence purement formaliste. Chez moi, c’est autre chose, je suis civil, je suis en quelque sorte responsable. Et cela m’excite de voir une telle confusion, que l’un prêche la république internationale et abomine en principe la guerre mais soit tellement patriote qu’il réclame à tout prix la frontière du Brenner, – tandis que l’autre tient l’État pour une œuvre de Satan et vante sur tous les tons le rapprochement universel, mais un instant plus tard défend le droit de l’instinct naturel, et se moque des conférences de la paix. Tu dis que nous sommes ici non pas pour devenir plus intelligents, mais pour guérir. On doit pouvoir concilier les deux, mon bon, et, si tu ne le crois pas, tu tombes dans le dualisme, et cela c’est toujours une grande faute, je tiens à te le faire remarquer.
DU ROYAUME DE DIEU ET DE LA DÉLIVRANCE PERVERSE
Hans Castorp déterminait dans sa loge une plante qui, à présent que l’été astronomique avait commencé, et que les jours se faisaient plus courts, végétait en de nombreux endroits : l’achillée ou aquilegia, une variété de renonculacées qui poussait en arbrisseau, à longue tige, avec des fleurs bleues, violettes et rouge brun et des feuilles herbiformes assez grandes. La plante poussait çà et là, en quantité, mais surtout dans ce coin paisible où, voici bientôt un an, il l’avait vue pour la première fois ; cette lointaine gorge boisée, pleine de la rumeur de son torrent, avec un sentier et un banc où avait pris fin sa promenade d’autrefois, promenade prématurée et peu profitable et où il retournait de temps à autre.
Ce n’était pas du tout si loin lorsqu’on faisait cette promenade d’une manière moins aventureuse qu’il ne l’avait faite en ce temps-là. Lorsqu’on gravissait une partie de la pente au-dessus de la piste des luges de Dorf on atteignait la partie pittoresque du sentier qui, serpentant à travers la forêt, franchissait sur des ponts de bois la piste de bobsleigh venant de Schatzalp, à condition de marcher sans détours, sans chant ni pauses causées par l’épuisement, en une vingtaine de minutes ; et lorsque Joachim était retenu à la maison par les devoirs du service, par une consultation, la radiographie, la prise de sang, l’injection ou l’obligation de se faire peser, Hans Castorp partait, quand il faisait beau, après le second déjeuner, parfois dès après le premier, et quelquefois même il mettait à profit les heures entre le thé et le dîner pour visiter son endroit favori, le même où s’il avait été pris jadis d’un terrible saignement de nez, pour s’asseoir sur le banc, écouter, la tête penchée, le bruit du torrent, et considérer le paysage, ainsi que cette multitude d’achillées bleues qui fleurissaient de nouveau au fond du vallon.
Ne venait-il que pour cela ? Non, il se tenait là, pour être seul, pour se souvenir, pour récapituler les impressions et les aventures de tant de mois, pour réfléchir à tout cela. Elles étaient nombreuses et diverses, et difficiles à ordonner, ces impressions car elles lui apparaissaient enchevêtrées et se confondant de beaucoup de façons, de sorte que le plus tangible pouvait être à peine séparé de ce que l’on n’avait que pensé, rêvé ou imaginé. Mais toutes étaient de nature aventureuse, à tel point que son cœur, aisément ému, comme il l’avait été ici dès le premier jour, s’arrêtait et martelait, lorsqu’elles s’emparaient de lui. Ou bien la constatation raisonnée que l’achillée de ce vallon où, à un moment de vitalité affaiblie, Pribislav lui était jadis apparu en chair et en os, ne fleurissait pas « toujours encore » mais « déjà de nouveau », et que ses « trois semaines » deviendraient sous peu une année entière, suffisait-elle à alarmer d’une manière si étrange son cœur impulsif ?
D’ailleurs, il ne saignait plus du nez sur le banc du torrent, c’était passé, cela. Son acclimatation dont Joachim lui avait dès le début annoncé la difficulté, et qui était en effet apparue difficile, avait fait des progrès. Après onze mois on pouvait la considérer comme terminée et il y avait à peine lieu d’attendre encore du nouveau dans cet ordre d’idées. Les réactions chimiques de son estomac s’étaient régularisées et adaptées, le Maria Mancini avait recouvré toute sa saveur, les nerfs de ses muqueuses sèches depuis longtemps percevaient de nouveau aisément le bouquet de ce produit avantageux qu’il commandait toujours encore à Brème lorsque ses provisions touchaient à leur fin, bien que des cigares tentateurs s’offrissent aux vitrines de la station internationale. Maria n’assurait-il pas une sorte de liaison, entre lui qui avait été transporté au loin, et le pays plat, la lointaine patrie ? Ces rapports ne se maintenaient-ils et ne se conservaient-ils pas de cette manière plus efficacement que par des cartes postales par exemple, qu’il envoyait de temps à autre là-bas, à ses oncles et qui s’étaient espacées d’autant plus que, adoptant les conceptions locales, il s’était mieux approprié la manière prodigue d’en user avec le temps ? C’étaient le plus souvent des cartes postales, parce que plus plaisantes, avec de jolies vues de la vallée sous la neige ou sous ses aspects estivaux, et elles n’offrent que tout juste la place nécessaire pour faire part des derniers diagnostics des médecins, du résultat d’une consultation mensuelle ou générale, dans les termes dans lesquels on formule ces diagnostics à l’usage des parents, c’est-à-dire pour annoncer, par exemple, qu’on avait constaté au moyen des observations tant acoustiques qu’optiques un mieux incontestable, mais que le malade n’était pas encore désintoxiqué et que la légère hausse de la température qu’il avait toujours provenait des quelques petits points qui subsistaient encore, mais qui disparaîtraient certainement tout à fait pour peu qu’il patientât afin de n’être pas obligé de revenir plus tard. Il pouvait avoir la certitude que l’on n’attendait pas de lui des travaux épistolaires plus étendus ; ce n’était pas à un milieu humaniste et éloquent qu’il s’adressait ; les réponses qu’il recevait n’étaient guère plus expansives. Elles accompagnaient le plus souvent les subsides en espèces qu’on lui faisait parvenir de chez lui, les revenus de son patrimoine qui, dans la monnaie de ce pays, devenaient si considérables qu’il n’avait jamais épuisé ses ressources lorsqu’un nouvel envoi le touchait, et ces réponses consistaient en quelques lignes dactylographiées, signées James Tienappel, avec des souvenirs et des vœux de guérison du grand-oncle, et parfois aussi de Pierre le navigateur.
Le conseiller avait cessé depuis quelque temps de lui faire des injections, manda Hans Castorp aux siens. Elles ne profitaient pas à ce jeune malade, elles lui donnaient des maux de tête, lui faisaient perdre l’appétit et du poids, le fatiguaient, avaient commencé par faire monter sa température, et par la suite ne l’avaient pas fait baisser. La fièvre brûlait, sensation subjective de chaleur sèche, sous son teint rosé, rappelant que l’acclimatation, pour ce rejeton de la plaine et de sa météorologie humide, ne consistait quand même qu’en ce qu’il s’habituait à ne pas s’habituer, ce qui était d’ailleurs le cas de Rhadamante lui-même qui avait toujours les joues bleues. « Il y en a beaucoup qui ne s’habituent jamais », avait dit Joachim dès le début, et cela semblait être le cas de Hans Castorp. Car le tremblement de la nuque, qui avait commencé à l’importuner peu après son arrivée, n’avait pas non plus cessé, mais se produisait, qu’il marchât ou causât ; même ici, sur les hauteurs, en ce refuge, fleuri de bleu, de son aventureuse songerie, ce tic se produisait si fatalement qu’il s’était presque habitué à appuyer son menton à la manière digne de Hans Lorenz Castorp, non sans être amené à penser incidemment au faux col du vieillard, succédané de la collerette d’apparat, à la courbure or pâle de la cuvette baptismale et à d’autres affinités encore qui le ramenaient de nouveau aux réflexions sur son propre complexe de vie.
Pribislav Hippe ne se montrait plus en chair et en os comme voici onze mois. L’acclimatation de Hans Castorp était achevée, il n’avait plus de visions, son corps immobile n’était plus étendu sur le banc, tandis que son Moi s’attardait en des régions lointaines ; il n’y avait plus de tels incidents. La netteté vivante de ce souvenir, lorsqu’il l’évoquait, se tenait en des limites normales et saines ; et à cette occasion Hans Castorp tirait volontiers de la poche de sa veste le souvenir en verre qu’il conservait dans une enveloppe double, serrée, à son tour, dans son portefeuille : une petite plaque qui, lorsqu’il la tenait horizontalement, miroitait, noire et sans transparence, mais qui, élevée vers la lumière du ciel, s’éclaircissait et trahissait des choses humanistes : l’image transparente du corps humain, la structure des côtes, la forme du cœur, l’arc du diaphragme et les poches du poumon ; de plus, les os du bras et de la clavicule, tout cela entouré de l’enveloppe pâle et embuée de cette chair de laquelle Hans Castorp avait déraisonnablement goûté la semaine de Carnaval. Quoi d’étonnant que son cœur impulsif s’arrêtât et précipitât son rythme lorsqu’il considérait ce souvenir, et il continuait ensuite à « tout » récapituler et revivre, appuyé au dossier rudimentaire du banc, les bras croisés, la tête inclinée vers l’épaule, parmi le murmure du torrent, et en face de l’achillée en fleurs.
La forme supérieure de la vie organique, celle de l’homme, lui apparaissait comme par certaine nuit de gel et de lumière astrale, lors de ses savantes études, et bien des questions et des distinctions se rattachaient pour le jeune Hans Castorp à cette vue intérieure, questions dont le bon Joachim était dispensé de s’occuper, mais dont il avait commencé à se sentir responsable comme civil, bien qu’elles ne se fussent jamais posées à lui-même là-bas, en pays plat, et qu’il ne les y eût jamais découvertes. Mais ici, où l’on considérait du haut de ce point perdu, à cinq mille pieds d’altitude, le monde et la créature, il y réfléchissait, sans doute aussi parce que son corps était surexcité par des toxines solubles dont la chaleur sèche le brûlait au visage. Il pensait à ce propos à Settembrini, au « joueur d’orgue » et pédagogue, dont le père avait vu le jour en Grèce, qui voyait la mission suprême de l’homme dans la politique, la rébellion et l’éloquence et consacrait la pique du citoyen sur l’autel de l’Humanité. Il pensait au camarade Krokovski et aux pratiques auxquelles il s’adonnait depuis quelque temps avec le psychanalyste dans la chambre noire. Il réfléchissait à la nature double de l’analyse, se disait combien elle est favorable à l’action et au progrès, combien elle est apparentée à la tombe et à son anatomie suspecte. Il évoquait les images des deux grands-pères, le rebelle et le fidèle, qui étaient vêtus de noir pour des raisons différentes, et il mesurait l’un à l’autre. Il se livrait encore à des considérations sur des complexes aussi vastes que la Forme et la Liberté, l’Esprit et le Corps, l’Honneur et la Honte, le Temps et l’Éternité, et il éprouvait un bref et impétueux vertige, à la pensée que l’achillée fleurissait de nouveau et que l’année se refermait sur elle-même.
Il avait un mot singulier pour ces graves opérations de la pensée en cette retraite pittoresque : il l’appelait « gouverner », se servait de ce mot d’enfant, de cette expression de jeux, pour cette distraction qu’il aimait, bien qu’elle fût liée à de la terreur, à du vertige et à toutes sortes de tumultes de son cœur, et qu’elle augmentât la chaleur de son visage. Mais il ne trouva pas malséant que l’effort qu’exigeait cette activité l’obligeât à appuyer son menton ; car cette attitude correspondait bien à la dignité que lui prêtait intérieurement le fait de « gouverner », en face de la forme humaine qui lui apparaissait.
« Homo Dei », c’est ainsi que l’affreux Naphta avait appelé la créature supérieure lorsqu’il prenait sa défense contre la doctrine anglaise de la société. Quoi d’étonnant si Hans Castorp se jugeait tenu, en vertu de sa responsabilité de civil, et dans l’intérêt de son « gouvernement », de faire avec Joachim une visite au petit homme ? Settembrini ne s’en montra guère enchanté, Hans Castorp avait assez de finesse et de sensibilité pour s’en rendre nettement compte. La première rencontre déjà avait été désagréable à l’humaniste ; il s’était apparemment efforcé de l’empêcher et avait voulu par prudence pédagogique épargner aux jeunes gens, à lui, Hans Castorp, en particulier – ainsi se disait le rusé enfant terrible – la rencontre avec Naphta, bien que lui-même il fréquentât chez ce dernier et discutât avec lui. Ainsi sont faits les éducateurs ! Eux-mêmes s’accordent ce qui est intéressant en estimant qu’ils sont « d’âge » à y tenir tête ; mais ils l’interdisent à la jeunesse et demandent qu’elle ne se sente pas « d’âge » à en faire autant. Heureusement il n’appartenait en aucune façon au joueur d’orgue de défendre quoi que ce soit au jeune Hans Castorp ; il n’avait même pas tenté de le faire. Le disciple n’avait besoin que de cacher son jeu et de feindre la naïveté pour que rien ne l’empêchât de donner aimablement suite à l’invitation du petit Naphta, ce à quoi il n’avait pas manqué ; et Joachim s’était joint à lui, bon gré mal gré, quelques jours après leur première rencontre, un dimanche après-midi après la cure principale.
Il y avait quelques minutes du Berghof jusqu’à la maisonnette décorée de vigne vierge. Ils entrèrent, laissèrent à leur droite la porte d’accès à l’épicerie, gravirent l’étroit escalier qui les conduisit devant la porte de l’étage, à côté du timbre de laquelle ne figurait qu’un écriteau portant le nom de Lukacek, tailleur pour dames. Un jeune garçon leur ouvrit, vêtu d’une sorte de livrée et de molletières, un petit domestique, aux cheveux coupés ras et aux joues rouges. Ils s’informèrent de M. le professeur Naphta et comme ils n’étaient pas munis de cartes, lui déclinèrent leurs noms qu’il alla annoncer à M. Naphta. (Il ne mentionna pas le titre.) La porte de la chambre située en face de l’entrée était ouverte sur l’atelier de tailleur, où Lukacek, quoique ce fût jour férié, était assis sur une table, et cousait, les jambes repliées. Il était pâle et chauve ; sa moustache noire pendait avec une expression amère, sous un nez courbé et trop grand.
– Bonjour, dit Hans Castorp.
– Grutsi, répondit le tailleur en patois, bien que ce langage suisse ne s’accordât ni avec son nom, ni avec son apparence, et sonnât faux et bizarre.
– Toujours au travail ? poursuivit Hans Castorp en hochant la tête… N’est-ce pas dimanche ?
– Travail urgent, répondit Lukacek, brièvement, et il continuait à coudre.
– C’est sans doute quelque chose de chic, conjectura Hans Castorp ; on en aura besoin d’urgence pour une soirée ou quelque chose d’analogue.
Le tailleur laissa pendant quelque temps cette question sans réponse, il coupa son fil avec ses dents et en enfila un nouveau. Ensuite, il fit oui de la tête.
– Est-ce que ce sera réussi ? demanda encore Hans Castorp. Y mettrez-vous des manches ?
– Oui, des manches, c’est pour une vieille, répondit Lukacek, avec un accent bohémien très marqué. Le retour du petit domestique interrompit cette conversation poursuivie sur le pas de la porte. M. Naphta priait ces messieurs d’entrer, annonça-t-il, et il ouvrit une porte aux jeunes gens, deux ou trois pas vers la droite, tout en soulevant au-dessus d’eux une double draperie. Les visiteurs furent reçus par Naphta qui les attendait, en pantoufles à rubans, debout sur un tapis d’un vert de mousse.
Les deux cousins furent surpris par le luxe du cabinet de travail éclairé par deux fenêtres qui les avait accueillis et même éblouis par cette surprise. Car l’indigence de la maisonnette, de son escalier, de son corridor lamentable ne faisait pas le moins du monde prévoir cela, et prêtait par contraste à l’élégance de l’intérieur de Naphta un caractère féerique qu’elle n’avait nullement en réalité, et qu’elle n’aurait certainement pas eu aux yeux de Hans Castorp et de Joachim Ziemssen. Quoi qu’il en soit, il était distingué, voire luxueux, et même, en dépit du bureau et des bibliothèques, il ne gardait pas en réalité le caractère d’un cabinet de travail. Il y avait là trop de soie lie de vin ou pourpre : les draperies qui cachaient les vilaines portes, et de même le tissu recouvrant le mobilier qui était disposé d’un des côtés étroits, en face de la deuxième porte, devant une tapisserie qui s’étendait sur le mur presque entier. C’étaient des fauteuils aux bras tors et capitonnés, groupés autour d’une table ronde incrustée de métal, derrière laquelle se trouvait un canapé du même style, chargé de coussins en velours de soie. Les bibliothèques occupaient la largeur du mur, à côté des deux portes. Elles étaient, de même que le bureau ou plus exactement que le secrétaire, munies d’un abattant cintré qui avait trouvé place à côté des fenêtres, sculptées en acajou, avec des portes vitrées derrière lesquelles était tendue de la soie verte. Mais dans l’angle, à gauche du groupe de fauteuils, on apercevait une œuvre d’art, une grande sculpture en bois peint posée sur un socle drapé de rouge, quelque chose qui vous effrayait intérieurement, une pietà, ingénue et expressive jusqu’au grotesque. La Madone en bonnet, avec des sourcils froncés et une bouche oblique, tordue par sa plainte, l’Homme des douleurs sur ses genoux, une sculpture primitive aux proportions arbitraires, à l’anatomie violemment exagérée et qui témoignait de l’ignorance du sculpteur, le chef hérissé d’épines, le visage et les membres maculés, et dégouttant de sang, de grosses grappes de sang coagulé à la blessure du flanc et aux stigmates des paumes et des pieds. Cette pièce curieuse prêtait à la chambre tendue de soieries un accent particulier. Le papier peint, lui aussi, qui était visible au-dessus des bibliothèques et à côté des fenêtres, avait été apparemment choisi par le sous-locataire : le vert de ses bandes verticales était le même que celui de l’épais tapis qui était étendu sur la carpette rouge clouée au plancher. Le plafond seul restait bas, froid et craquelé. Mais un petit lustre de Venise en descendait. Les fenêtres étaient voilées de stores crème qui touchaient au plancher.
– Nous venons vous relancer pour un petit colloque, dit Hans Castorp tandis que ses yeux se fixaient plutôt sur la pieuse et terrifiante figure de l’angle de la pièce, que sur l’habitant de cette chambre singulière qui constatait avec gratitude que les cousins avaient tenu parole. Il voulut les conduire avec de petits gestes accueillants de sa main droite vers les fauteuils recouverts de soie, mais Hans Castorp, comme magnétisé, alla droit au groupe sculpté et s’arrêta en face de lui, les mains sur les hanches, la tête penchée.
– Qu’est-ce que vous avez donc là ? dit-il doucement. Mais c’est terriblement bien. A-t-on jamais vu une pareille souffrance ? C’est quelque chose d’ancien, naturellement.
– Quatorzième siècle, répondit Naphta. Probablement d’origine rhénane. Cela vous impressionne ?
– Énormément, dit Hans Castorp. Cela ne peut du reste manquer de faire une énorme impression à quiconque le regarde. Je n’aurais jamais supposé que quelque chose pût être à la foi aussi laid – excusez-moi – et aussi beau.
– Les productions d’un monde de l’âme et de l’expression répondit Naphta, sont toujours laides à force de beauté et belles à force de laideur, c’est la règle. Il s’agit d’une beauté spirituelle non de la beauté de la chair, qui est absolument stupide. D’ailleurs, elle est aussi abstraite, ajouta-t-il. La beauté de la chair est abstraite. Il n’y a guère que la beauté intérieure qui ait de la réalité, celle de l’expression religieuse.
– Vous avez discerné et déduit cela avec beaucoup de justesse, dit Hans Castorp. Quatorzième ? répéta-t-il. Treize cent et quelques. Oui, c’est le moyen âge comme on le trouve dans les livres, je reconnais en quelque sorte l’image que je m’étais faite ces temps derniers du moyen âge. Je n’en savais rien, somme toute car je suis un homme du progrès technique, pour autant que ma personne peut entrer en ligne de compte. Mais ici, sur les hauteurs, l’idée du moyen âge m’a traversé l’esprit en plusieurs circonstances. La doctrine économique de la société n’existait pas encore à ce moment-là, voilà qui est clair. Comment donc a pu s’appeler l’artiste ?
Naphta haussa les épaules.
– Qu’importe ? dit-il. Nous ne devrions pas nous en inquiéter, puisque au temps où cette œuvre a vu le jour, on ne s’en est pas inquiété non plus. Cette œuvre n’a pas pour auteur je ne sais quel monsieur individuel, mais elle est anonyme et créée en commun. Elle remonte d’ailleurs à un moyen âge très avancé, époque gothique, signum mortificationis. Vous ne trouvez plus là cette tendance à atténuer et à pallier que l’on a montrée à l’époque romane dans les représentations du Crucifié : pas de couronne royale, pas de triomphe majestueux sur le monde et le martyre de la mort. Tout ici décèle franchement la souffrance et la faiblesse de la chair. Seul, en effet, le goût gothique est proprement ascétique et pessimiste. Vous ne connaissez sans doute pas le traité d’Innocent III, De miseria humanae conditionis[8], un morceau plein d’esprit. Il remonte à la fin du douzième siècle, mais c’est cet art-ci seulement qui en donne l’illustration.
– Monsieur Naphta, dit Hans Castorp après un soupir, chacune des paroles que vous soulignez en parlant m’intéresse. Signum mortificationis, avez-vous dit. Je me rappellerai cela. Et tout à l’heure vous avez dit quelque chose « d’anonyme et créé en commun » à quoi il me semble qu’il faudrait également réfléchir. Vous avez malheureusement raison de supposer que je ne connais pas l’ouvrage de ce pape (je suppose qu’Innocent III est un pape). Ai-je bien compris ? Avez-vous bien dit que cet écrit était à la fois ascétique et facétieux ? Je dois avouer que je n’avais jamais imaginé que ces choses pouvaient aller ensemble, mais en y pensant je comprends. Naturellement, des considérations sur la misère humaine donnent l’occasion de se livrer à bien des plaisanteries aux dépens de la chair. Peut-on trouver cet ouvrage dans le commerce ? Peut-être en rassemblant tout mon latin, réussirai-je à le lire ?
– Je possède ce livre, répondit Naphta en désignant de la tête une des bibliothèques. Il est à votre disposition. Mais n’allons-nous pas nous asseoir ? Vous verrez aussi bien la Pietà de ce canapé. Mais voici qu’arrive notre petit goûter…
C’était le jeune domestique qui apportait le thé, avec un joli panier décoré d’argent où se trouvait un gâteau coupé en tranches. Mais derrière lui, par la porte ouverte, qui était-ce donc qui entrait d’un pas ailé, avec un fin sourire, des « saperlipopette » et des « accidenti » ? C’était M. Settembrini, domicilié à l’étage au-dessus, qui était descendu dans l’intention de tenir compagnie à ces messieurs. Par sa petite fenêtre, dit-il, il avait vu arriver les cousins, et il avait vite achevé une de ses pages encyclopédiques qui coulait justement de sa plume, pour s’inviter à son tour. Rien n’était plus naturel que sa venue. Son intimité ancienne avec les habitants de Berghof l’autorisait à les rejoindre, et, de plus, ses rapports et son commerce avec Naphta étaient, malgré de profondes divergences d’opinions, de toute évidence, très suivis, de sorte que l’hôte lui souhaita la bienvenue sans gêne ni surprise. Cela n’empêcha pas que Hans Castorp éprouvât nettement une double impression de cette arrivée. D’une part, il lui sembla que Settembrini était survenu pour ne pas les laisser, lui et Joachim (ou tout simplement lui), seuls avec le vilain petit Naphta, et pour créer par sa présence un contre-poids pédagogique ; d’autre part, il était visible qu’il saisissait volontiers cette occasion de quitter un instant sa mansarde pour la chambre tendue de soieries de Naphta et pour prendre un thé bien servi. Il frotta ses mains jaunâtres au dos velu, avant de se servir, et mangea avec un appétit indéniable, sans dissimuler sa satisfaction, les minces rondelles du gâteau veiné de chocolat.
La conversation continua de rouler sur la Pietà, parce que Hans Castorp restait attaché par le regard et la parole à cet objet, tout en se tournant vers M. Settembrini, comme pour le mettre en contact critique avec cette œuvre d’art, bien que la répugnance de l’humaniste pour cet objet se trahît suffisamment par la mine avec laquelle il se retourna vers la sculpture ; car en s’asseyant, il avait tourné le dos à cet angle de la pièce. Trop poli pour dire tout ce qu’il pensait, il se borna à critiquer ses défauts dans les proportions et les formes physiques du groupe, des manquements à la vérité naturelle qui étaient loin de lui sembler touchants parce qu’ils ne provenaient pas de l’impuissance d’un artiste primitif, mais témoignaient d’une mauvaise volonté, d’un principe foncièrement hostile à la nature, – ce que Naphta confirma méchamment. Certes, il ne pouvait être question de maladresse technique. C’était l’esprit qui s’émancipait consciemment de la nature et qui, en refusant de s’y soumettre, proclamait son mystique dédain de la chair. Mais lorsque Settembrini déclara que cette façon de négliger la nature et son étude était peu humaine et commença d’opposer à l’absurde culte de l’informe, auquel s’étaient voués le moyen âge et les époques qu’il avait imitées le patrimoine gréco-latin, le classicisme, la forme, la beauté, la raison et la gaieté naturelle, qui seuls étaient appelés à favoriser la cause de l’homme, Hans Castorp intervint et demanda ce qu’il fallait penser dans ces conditions de Plotin qui avait rougi de son corps, – c’était établi – et de Voltaire qui, au nom de la raison, s’était révolté contre le scandaleux tremblement de terre de Lisbonne ? Absurde ? Cela avait été absurde, mais lorsqu’on réfléchissait bien à tout cela, on pouvait, à son avis, conclure que l’absurde pouvait être fort honorable au point de vue de l’esprit et que l’absurde hostilité de l’art gothique envers la nature avait été, en somme, tout aussi honorable que l’attitude des Plotin et des Voltaire, car elle exprimait le même affranchissement du destin et des faits, le même orgueil indocile qui refusait d’abdiquer devant la force stupide, autrement dit devant la Nature…
Naphta éclata d’un rire qui faisait penser à l’assiette fêlée dont il a déjà été question et qui s’acheva dans un accès de toux. Settembrini dit avec distinction :
– Vous faites tort à notre hôte en montrant tant d’esprit, et vous lui témoignez mal votre reconnaissance pour cette exquise pâtisserie. La reconnaissance est-elle du reste votre affaire ? Ce disant, j’admets que la reconnaissance consiste à ne faire qu’un bon usage des cadeaux que l’on a reçus…
Comme Hans Castorp rougissait, l’Italien fut assez aimable pour ajouter :
– On vous connaît comme un farceur, ingénieur. Votre manière de railler amicalement le bien ne me fait nullement douter que vous y soyez attaché. Vous savez, bien entendu, que ne peut être qualifié d’honorable que la révolte de l’esprit contre la nature, révolte qui a en vue la dignité et la beauté de l’homme, mais non pas celle qui, si elle ne vise pas à l’abaisser et à le déshonorer, y parvient néanmoins. Vous savez, d’ailleurs, à quelles atrocités inhumaines, à quelle intolérance sanguinaire a donné lieu l’époque à laquelle cette œuvre d’art qui est là derrière moi doit son existence. Je n’ai besoin que de vous rappeler ce type effroyable de juge d’hérétiques, la figure sanglante d’un Conrad de Marbourg, et son infâme fureur de prêtre comme tout ce qui s’opposait au règne du surnaturel. Vous êtes très éloigné de considérer l’épée et le bûcher comme des instruments d’altruisme…
– Par contre, répliqua Naphta, c’est dans un esprit d’altruisme qu’a travaillé la machine grâce à laquelle la Convention a débarrassé le monde des mauvais citoyens. Tous les châtiments de l’Église, même le bûcher, même l’excommunication, ont été entrepris pour sauver l’âme de la damnation éternelle, alors que l’on ne pourrait en dire autant de l’enthousiasme destructeur des Jacobins. Je me permets de faire remarquer que toute justice inquisitoriale et sanglante qui n’est pas issue d’une foi en un au-delà est une bestiale sottise. Et quant à la dégradation de l’homme, son histoire coïncide exactement avec celle de l’avilissement de l’esprit bourgeois. La Renaissance, le siècle des lumières, la science naturelle et les doctrines économiques du dix-neuvième siècle n’ont négligé d’enseigner rien, absolument rien, qui n’eût été en quelque manière propre à favoriser cette dégradation, à commencer par la nouvelle astronomie, laquelle a fait du centre de l’univers, de la scène illustre où Dieu et Satan se disputaient la créature, une quelconque petite planète, et qui a provisoirement mis fin à la grandiose situation cosmique de l’homme sur laquelle l’astrologie se fondait du reste également.
– Provisoirement ?
L’expression de M. Settembrini, lorsqu’il posa cette question avait elle-même quelque chose d’un juge d’hérétiques et d’un inquisiteur qui attend que celui qui parle se compromette par des paroles indubitablement coupables.
– Sans doute. Pour quelques centaines d’années, confirma froidement Naphta. Si tous les signes ne sont pas trompeurs, la scolastique va être réhabilitée à cet égard aussi, la procédure est déjà en train. Copernic sera battu par Ptolémée. La thèse héliocentriste se heurte de plus en plus à une résistance de l’esprit dont les entreprises mèneront sans doute au but. Il est probable que la science se verra contrainte par la philosophie à rendre à la terre toute la majesté que lui attribuait le dogme religieux.
– Comment ? Qu’est-ce à dire ? Résistance de l’esprit ? Contraint par la philosophie ? Mener au but ? Quelle espèce de volontarisme s’exprime par votre voix ? Et la science inconditionnelle ? La connaissance pure ? La Vérité, Monsieur, qui est si intimement liée à la liberté, et dont les martyrs dont vous voulez faire des insulteurs de la terre resteront au contraire l’éternel ornement de cet astre ?
M. Settembrini avait une manière énergique d’interroger. Il était assis là, le torse droit, et faisait tomber ses paroles d’homme d’honneur sur le petit M. Naphta, enflant sa voix si puissamment, que l’on entendait bien combien il était certain que la réponse de l’adversaire ne pourrait être qu’un silence confondu. Tout en parlant, il avait tenu entre ses doigts un morceau de gâteau fourré, mais il le déposa sur son assiette, car, après avoir posé de telles questions, il ne voulait plus y mordre.
Naphta répondit avec un calme inquiétant :
– Cher ami, il n’y a pas de connaissance pure. La légitimité de la conception religieuse de la connaissance qui peut se résumer par la parole de saint Augustin : « Je crois afin de connaître » est absolument incontestable. La foi est l’organe de la connaissance ; l’intellect est secondaire. Votre science sans prémisses est un mythe. Il y a toujours une foi, une conception du monde, une idée, bref une volonté, et c’est affaire de la Raison de l’interpréter, de la démontrer, toujours et dans tous les cas. Il s’agit d’aboutir au Quod erat demonstrandum[9]. Déjà la conception de la preuve contient, psychologiquement parlant, un élément volontaire très net. Les grands scolastiques du douzième et du treizième siècle étaient d’accord dans leur conviction qu’en philosophie rien ne pouvait être vrai qui était faux devant la théologie. Laissons de côté la théologie, si vous voulez, mais une humanité qui ne reconnaîtrait pas que rien ne peut être vrai dans la science naturelle de ce qui est faux aux yeux du philosophe ne serait pas une humanité. L’argumentation du Saint-Office contre Galilée se réduisait à ceci que ses principes étaient philosophiquement absurdes. Il ne peut y avoir argumentation plus décisive.
– Eh, eh, les arguments de notre pauvre grand Galilée se sont montrés plus solides. Non, parlons sérieusement, professore ! Répondez, devant ces deux jeunes gens si attentifs, à cette question : Croyez-vous à une vérité, vérité objective et scientifique, que la loi la plus haute de toute morale nous ordonne de rechercher et dont les triomphes sur l’autorité constituent la glorieuse histoire de l’esprit humain ?
Hans Castorp et Joachim détournèrent leurs têtes de Settembrini, vers Naphta, le premier plus vite que le second. Naphta répondit :
– Un tel triomphe n’est pas possible, car l’autorité, c’est l’homme, son intérêt, sa dignité, son salut, et entre eux et la vérité, il ne peut y avoir de conflit. Ils se confondent.
– La vérité serait par conséquent…
– Est vrai ce qui convient à l’homme. En lui, toute la nature est concentrée, lui seul a été créé dans toute la nature, et toute la nature n’est faite que pour lui. Il est la mesure des choses, et son salut est le critère de la vérité. Une connaissance théorique qui ne se rapporterait pas pratiquement à l’idée du salut de l’homme est si complètement dépourvue d’intérêt, qu’il faudrait lui dénier toute vérité et se refuser à l’admettre. Les siècles chrétiens étaient complètement d’accord sur l’insignifiance de la science naturelle en ce qui regarde l’homme. Lactance, que Constantin le Grand donna pour précepteur à son fils, demanda même ouvertement quelle béatitude il s’assurerait par le fait de savoir où est la source du Nil ou ce que les physiciens radotaient sur le ciel. Répondez-lui donc ! Si l’on a préféré la philosophie platonicienne à toute autre, c’est parce qu’elle n’avait pas pour objet la connaissance de la nature, mais la connaissance de Dieu. Je puis vous donner l’assurance que l’humanité est en train de revenir à ce point de vue et de se rendre compte que la tâche de la science véritable n’est pas de courir après des connaissances funestes, mais d’éliminer systématiquement ce qui est nuisible ou même simplement insignifiant au point de vue de l’idée, en un mot de faire preuve de flair, de mesure, et de savoir choisir. Il est puéril de croire que l’Église a pris la défense des ténèbres contre la lumière. Elle a eu trois fois raison de déclarer coupable une connaissance qui avait la prétention d’être non hypothétique, c’est-à-dire une connaissance qui négligeait de tenir compte de l’élément spirituel et de la fin dernière qui est le salut. Et ce qui a plongé l’homme dans les ténèbres et l’y plongera de plus en plus, c’est au contraire la science naturelle, « sans prémisses » et aphilosophique.
– Vous enseignez là un pragmatisme, répondit Settembrini, que vous n’avez besoin que de transposer sur le plan politique pour vous rendre compte de toute sa nocivité. Est bon, vrai et juste ce qui convient à l’État. Son salut, sa dignité, sa puissance, tel est le critère moral. Bien ! ceci ouvre la porte à tous les crimes, et la vérité humaine, la justice individuelle, la démocratie, tant pis pour elles !
– Je vous convie à user d’un peu de logique, répondit Naphta. Ou bien Ptolémée et la scolastique ont raison, et le monde est limité dans le temps et dans l’espace : s’il en est ainsi, la divinité est transcendante, l’opposition entre Dieu et le monde existe, et l’homme, lui aussi, est un être dualiste. Le problème de son âme consiste dans le conflit entre le physique et le métaphysique, et tout ce qui est social demeure secondaire. Je ne peux tenir pour conséquent que ce genre d’individualisme-ci. Ou bien vos astronomes de la Renaissance ont trouvé la vérité, et l’univers est infini : dans ce cas il n’y a pas de monde transcendant, il n’y a pas de dualisme ; l’au-delà est intégré dans l’en-deçà, l’opposition entre Dieu et la nature disparaît, et comme dans cette hypothèse la personnalité humaine n’est plus le lieu où s’affrontent deux principes ennemis, elle est une et harmonieuse, et par conséquent le conflit intérieur de l’homme tient uniquement au conflit entre les intérêts de l’homme et de la collectivité, et le but de l’État ce qui est parfaitement païen, devient la règle morale. C’est l’un ou l’autre.
– Je proteste, s’écria Settembrini, le bras allongé en tendant sa tasse de thé vers son hôte. Je proteste contre cette insinuation que l’État moderne signifie l’asservissement diabolique de l’individu. Je proteste pour la troisième fois contre cette alternative vexatoire entre le prussianisme et la réaction gothique, devant laquelle vous prétendez nous placer. La Démocratie n’a pas d’autre sens que celui d’un correctif individualiste de tout absolutisme de l’État. La Vérité et la Justice sont les insignes royaux de la morale individuelle, et en cas de conflit contre l’intérêt de l’État elles peuvent même prendre l’apparence de puissances hostiles à l’État, alors qu’en réalité elles tendent au bien supérieur disons-le : au bien supraterrestre de l’État. La Renaissance serait l’origine de l’idolâtrie de l’État ! Quelle logique bâtarde ! Les conquêtes, – je le dis en insistant sur le sens étymologique, – conquêtes de la Renaissance et du siècle des lumières, Monsieur, s’appellent la personnalité, les droits de l’homme, la liberté !
Les auditeurs respirèrent, soulagés, car ils avaient retenu leur souffle durant la grande réplique de M. Settembrini. Hans Castorp ne put même s’empêcher de frapper de la main sur le bord de la table, encore qu’avec une certaine réserve. « C’est épatant ! » dit-il entre les dents, et Joachim aussi se montra très satisfait, bien que le prussianisme eût été mentionné en termes défavorables. Mais ensuite tous deux se retournèrent vers l’interlocuteur qui venait d’être victorieusement repoussé, et Hans Castorp le fit avec une telle impatience qu’il appuya le coude sur la table et son menton sur le poing, à peu près comme il l’avait fait en dessinant les petits cochons, et qu’il regarda attentivement et de tout près la figure de M. Naphta.
Celui-ci était assis, calme et tranchant, ses mains maigres sur ses genoux. Il dit :
– Je cherche à introduire un peu de logique dans notre conversation et vous me répondez par des phrases généreuses. Je ne laissais pas de savoir que la Renaissance avait mis au monde tout ce que l’on appelle libéralisme, individualisme, humanisme bourgeois. Mais tout cela me laisse froid, car la conquête, l’âge héroïque de votre idéal est depuis longtemps passé, cet idéal est mort, ou tout au moins il agonise, et ceux qui lui donneront le coup de grâce sont déjà devant la porte. Vous vous appelez, sauf erreur, un révolutionnaire. Mais si vous croyez que le résultat des révolutions futures sera la Liberté, vous vous trompez. Le principe de la Liberté s’est réalisé et s’est usé en cinq cents ans. Une pédagogie qui, aujourd’hui encore, se présente comme issue du siècle des lumières et qui voit ses moyens d’éducation dans la critique, dans l’affranchissement et le culte du Moi, dans la destruction de formes de vie ayant un caractère absolu, une telle pédagogie peut encore remporter des succès momentanés, mais son caractère périmé n’est pas douteux aux yeux de tous les esprits avertis. Toutes les associations vraiment éducatrices ont su, depuis toujours, ce qui importait en réalité dans la pédagogie : à savoir l’autorité absolue, une discipline de fer, le sacrifice, le reniement du moi, la violation de la personnalité. En dernier ressort, c’est méconnaître profondément la jeunesse que de croire qu’elle trouve son plaisir dans la Liberté. Son plaisir le plus profond, c’est l’obéissance.
Joachim se redressa. Hans Castorp rougit. M. Settembrini, agité, tourmentait sa jolie moustache.
– Non, poursuivit Naphta, ce n’est pas l’affranchissement et l’épanouissement du moi qui sont le secret et l’exigence de ce temps. Ce dont il a besoin, ce qu’il demande, ce qu’il aura c’est la Terreur.
Il avait prononcé ce dernier mot plus bas que les précédents, sans un mouvement du corps ; seuls les verres de ses lunettes avaient lancé un éclair. Ses trois auditeurs avaient tous les trois tressailli, jusqu’à Settembrini qui se ressaisit aussitôt en souriant.
– Est-il permis de s’informer, demanda-t-il, qui ou quoi (vous voyez, je ne fais qu’interroger, je ne sais même pas ce que je dois vous demander), qui ou quoi doit selon vous recourir à cette… – c’est vraiment à contrecœur que je répète ce mot, – à cette terreur ?
Naphta restait assis, calme, tranchant, les yeux miroitants. Il dit :
– Je suis à vos ordres. Je ne crois pas me tromper en supposant que nous sommes d’accord pour admettre un état originel et idéal de l’humanité, un état sans organisation sociale ni recours à la force, une vie en Dieu, où il n’y avait ni domination ni service, ni loi, ni peine, pas d’injustice, pas d’union charnelle, pas de différences de classes, pas de travail, pas de propriété, mais l’égalité, la fraternité, la perfection morale.
– Très bien. Je suis d’accord, déclara Settembrini. Je suis d’accord, sous réserve de l’union charnelle, qui, de toute évidence, a toujours existé puisque l’homme est un vertébré supérieur et n’est pas différent des autres êtres…
– Comme vous voudrez. Je constate notre accord de principe, en ce qui concerne l’état primitif, paradisiaque, indemne de justice, proche de Dieu, état que le péché originel a compromis. Je crois que nous pouvons encore nous tenir compagnie un bout de chemin, en ramenant l’État à un contrat social qui, tenant compte du péché, a été conclu pour protéger l’homme contre l’injustice et en plaçant là l’origine du pouvoir souverain.
– Benissimo, s’écria Settembrini, Contrat social. C’est le siècle des lumières, c’est Rousseau. Je n’aurais pas cru…
– Je vous en prie. Nos chemins se séparent ici. Du fait que tout pouvoir et toute puissance appartenaient primitivement au peuple et que celui-ci a transmis son droit de légiférer et tout le pouvoir à l’État, au Prince, votre école conclut avant tout que le peuple a le droit de se soulever contre la royauté. Tandis que nous…
– « Nous ? » se dit Hans Castorp, intéressé. Qui sont ces « nous » ? Il faut absolument que je demande plus tard à Settembrini qui Naphta désigne par « nous ».
– Quant à nous, dit Naphta, peut-être non moins révolutionnaires que vous, nous avons, de tous les temps, conclu en premier lieu à la prééminence de l’Église sur l’État laïque. Car si la non-divinité de l’État n’était pas inscrite sur son front, il suffirait de rappeler justement ce fait historique qu’il repose sur la volonté du peuple, et qu’il n’est pas, comme l’Église, d’origine divine, pour établir qu’il est, sinon œuvre du Malin, du moins un moyen de fortune, un remède insuffisant au péché et à la détresse.
– L’État, Monsieur…
– Je sais ce que vous pensez de l’État national. « L’amour de la patrie et l’infini désir de gloire passent avant tout le reste. » C’est du Virgile. Vous le corrigez par un peu d’individualisme libéral, et c’est la démocratie ; mais ceci ne modifie en rien vos rapports de principe avec l’État. Vous n’êtes pas choqué de ce que son âme est l’argent. Ou prétendriez-vous le contester ? L’antiquité était capitaliste parce qu’elle était étatiste. Le moyen âge chrétien a clairement distingué le capitalisme immanent de l’État laïque. « L’argent sera le souverain », c’est une prophétie du XIe siècle. Niez-vous qu’elle se soit littéralement réalisée et que la vie en soit devenue démoniaque sans rémission ?
– Cher ami, vous avez la parole. Je suis impatient de faire la connaissance du grand Inconnu qui portera avec lui la Terreur.
– Curiosité plutôt téméraire pour un représentant d’une classe de la société qui est le support d’une Liberté qui a fait périr le monde. Je puis à la rigueur renoncer à vos répliques, car je connais l’idéologie politique de la bourgeoisie. Votre but est l’imperium démocratique, la tension du principe de l’État national à l’universel, l’État universel. L’empereur de cet empire ? Nous le connaissons. Votre utopie est effroyable, – et pourtant en ce point nous nous rencontrons en quelque sorte. Car votre république universelle capitaliste, l’État universel, est la transcendance de l’État laïque, et nous sommes d’accord pour croire qu’à un état originel parfait de l’humanité correspond un état final parfait situé à la même distance que l’horizon. Depuis les jours de Grégoire le Grand, fondateur de l’État de Dieu, l’Église a considéré qu’il était de son devoir de ramener l’homme sous le gouvernement de Dieu. Le pape a prétendu à la souveraineté non pas pour lui-même ; sa dictature au lieu et place de Dieu n’était qu’un moyen d’atteindre le salut final, une forme de transition de l’État païen au royaume céleste. Vous avez déjà parlé à ces jeunes gens des actes sanglants de l’Église, de son intolérance qui châtie – tout à fait à tort, car le zèle religieux, bien entendu, ne peut être pacifiste, et Grégoire a prononcé cette parole : « Maudit soit l’homme dont l’épée épargne le sang. » Que le pouvoir est mauvais, nous le savons. Mais le dualisme du bien et du mal, de l’en-deçà et de l’au-delà, de l’esprit et de la puissance doit être, – pour que le royaume vienne, – passagèrement suspendu par un principe qui réunisse l’ascèse et le pouvoir. C’est là ce que j’appelle la nécessité de la Terreur.
– Mais qui ? Mais qui donc ?
– Vous le demandez ? L’existence d’une doctrine de la société qui signifie la victoire de l’homme sur l’économisme, et dont les principes et les buts coïncident exactement avec ceux du royaume chrétien de Dieu aurait-elle échappé à votre manchesterianisme ? Les Pères de l’Église ont appelé « mien » et « tien » des mots funestes et ont dit que la propriété privée était de l’usurpation et du vol. Ils ont condamné la propriété parce que, d’après le droit naturel et divin, la terre est commune à tous les hommes et que, par conséquent, elle produit aussi ses fruits pour l’usage général de tous. Ils ont enseigné que seule la cupidité, conséquence du péché originel, invoque les droits de la propriété et a créé la propriété privée. Ils ont été assez humains, assez ennemis du négoce pour considérer toute activité économique en général comme danger pour le salut de l’âme, c’est-à-dire : pour l’humanité. Ils ont haï l’argent et les affaires d’argent, et ils ont appelé la richesse capitaliste l’aliment de la flamme infernale. Le principe fondamental de la doctrine économique, à savoir que le prix résulte de l’équilibre entre l’offre et la demande, ils l’ont méprisé de tout cœur, et ils ont condamné les actes de ceux qui tirent parti des circonstances, comme une exploitation cynique de la détresse du prochain. Il y a eu une exploitation encore plus criminelle à leurs yeux : celle du temps, – le méfait qui consiste à se faire payer une prime pour le simple écoulement du temps, autrement dit, l’intérêt, et à abuser ainsi pour son propre avantage et aux dépens de son prochain, d’une institution divine, valable pour tous, le temps.
– Benissimo, s’écria Hans Castorp qui, dans son enthousiasme, se servit de la formule d’approbation de Settembrini. Le temps, une institution divine valable pour tous… C’est capital…
– En effet, poursuivit Naphta. Ces esprits humains ont jugé répugnante la pensée d’un accroissement automatique de l’argent ; ils ont qualifié d’usure toutes les affaires de placement et de spéculation, et ils ont déclaré que tout riche était ou bien un voleur ou l’héritier d’un voleur. Ils sont allés plus loin. Ils ont considéré comme Thomas d’Aquin, le commerce en général, l’affaire purement commerciale, l’achat et la revente à profit, sans transformation, amélioration de l’objet de ces opérations, comme un métier honteux. Ils n’inclinaient pas à faire grand cas du travail comme tel, car ce n’est qu’une affaire morale, non pas religieuse, il se fait au service de la vie, non pas au service de Dieu. Et dès lors qu’il ne devait s’agir que de la vie et de l’économie, ils ont exigé qu’une activité productive fût la condition de tout avantage économique et la mesure de l’honorabilité. Étaient estimables à leurs yeux le paysan, l’artisan, mais non pas le commerçant, ni l’industriel. Car ils ont voulu que la production s’adaptât au besoin et ils ont eu horreur de la production en grandes quantités. Or donc, tous ces principes et cette échelle des valeurs économiques sont ressuscités après des siècles dans le mouvement moderne du communisme. L’accord est complet jusque dans la revendication de souveraineté que formule le travail international contre le règne international du commerce et de la spéculation, le prolétariat mondial qui oppose à présent l’humanité et les critères du règne de Dieu à la pourriture bourgeoise et capitaliste. La dictature du prolétariat, cette condition du salut politique et économique de ce temps, n’a pas le sens d’une domination pour la domination et en toute éternité, mais celui d’une suspension momentanée du conflit entre l’esprit et le pouvoir, sous le signe de la croix, le sens d’une victoire sur le monde terrestre par le moyen de la domination du monde, le sens de la transition, de la transcendance, le sens du règne. Le prolétariat a repris l’œuvre de Grégoire le Grand, son zèle pieux s’est renouvelé en lui, et pas plus que le saint il ne pourra empêcher sa main de verser le sang. Son devoir est d’instituer la terreur pour le salut du monde, pour atteindre ce qui fut le but du Sauveur : la vie en Dieu, sans État ni classes.
Tel fut le discours tranchant de Naphta. La petite compagnie garda le silence. Les jeunes gens regardèrent Settembrini. C’était à lui qu’il appartenait de réagir. Il dit :
– Étonnant ! Certes, j’avoue que je suis bouleversé, je ne m’attendais pas à cela. Roma locuta. Et comment ! Et comment a-t-elle parlé ! Sous nos yeux, elle a exécuté un hiératique saut périlleux : s’il y a une contradiction dans cette épithète, elle l’a « provisoirement suspendue ». Ah oui ! Je répète : c’est étonnant. Pensez-vous, professeur, que des objections puissent venir à l’esprit, des objections simplement du point de vue de la logique ? Vous vous êtes efforcé tout à l’heure de nous faire comprendre un individualisme chrétien reposant sur la dualité de Dieu et du Monde, et de nous prouver sa prééminence sur toute morale déterminée par la politique ? Quelques minutes plus tard, vous poussez le socialisme jusqu’à la dictature et à la terreur. Comment faites-vous rimer cela ?
– Des contradictions, dit Naphta, peuvent rimer. Il n’y a guère que le médiocre et les demi-mesures qui ne riment jamais. Votre individualisme, comme je me suis déjà permis de vous le faire remarquer tout à l’heure, est un compromis, une concession. Il corrige votre morale païenne de l’État par un peu de christianisme, par un peu de « droit de l’individu », par un peu de prétendue liberté, c’est tout. Un individualisme, par contre, qui part de l’importance cosmique, de l’importance astrologique de l’âme de l’individu, qui entend l’humain non pas comme un conflit entre le Moi et la société, mais comme le conflit entre le Moi et Dieu, entre la chair et l’esprit, un tel individualisme s’accorde fort bien avec la communauté la plus étroite.
– Il est anonyme et collectif, dit Hans Castorp.
Settembrini le regarda avec de grands yeux.
– Taisez-vous, ingénieur, commanda-t-il avec une sévérité qu’il fallait mettre sur le compte de sa nervosité et de la tension de son esprit. Instruisez-vous, mais ne produisez pas. C’est une réponse, dit-il en se retournant vers Naphta. Elle me console mal, mais c’en est une. Envisageons toutes les conséquences… Avec l’industrie, le communisme chrétien renie la technique, la machine, le Progrès. Avec ce que vous appelez la forme commerciale, l’argent et les affaires d’argent auxquels l’Antiquité a accordé un rang bien supérieur à ceux de l’agriculture et de l’artisanat, il nie la Liberté. Car il est clair, il saute aux yeux que par là, de même qu’au moyen âge, tous les rapports privés et publics se trouveront paralysés, même – j’ai peine à le dire – la personnalité. Si le sol est seul à nourrir, lui seul accorde la Liberté. Les artisans et les paysans, si honorables qu’ils puissent être, s’ils ne possèdent pas de sol, sont les serfs de celui qui en possède. En effet, jusque tard dans le moyen âge, la grande masse, même dans les villes, se composait de serfs. Vous avez au cours de votre conversation donné à entendre bien des choses sur la dignité humaine. Et cependant vous défendez une morale économique à laquelle sont liés l’asservissement et la dégradation de la personnalité.
– On pourrait discuter sur la dignité et la dégradation, répliqua Naphta. Mais pour commencer, je me sentirais satisfait si ces conjonctures vous amenaient à envisager la liberté non pas tant comme un beau geste que comme un problème. Vous constatez que la morale économique chrétienne dans sa beauté humaine entraîne le servage. Je constate au contraire que la cause de la liberté, la cause des villes, comme on peut dire d’une manière plus concrète, si morale et élevée qu’elle doive être, est historiquement liée à une dégénérescence profondément inhumaine de la morale économique, à toutes les horreurs du commerce et des spéculations modernes, au règne satanique de l’argent, des affaires.
– Je constate que vous ne battez pas en retraite, mais que vous vous avouez clairement et sans équivoque possible partisan de la réaction la plus noire.
– Le premier pas vers la liberté et l’humanité véritables consisterait à s’affranchir de ce tremblement de peur devant l’idée de « réaction ».
– Bon, suffît, déclara Settembrini d’une voix qui tremblait légèrement, en repoussant sa tasse et son assiette qui étaient du reste vides, et en se levant de son sopha tendu de soie. Cela suffit pour aujourd’hui, c’est assez pour un jour, il me semble. Professeur, nous vous remercions de votre savoureux goûter et de cette conversation très spirituelle. Mes amis du Berghof que voici doivent aller à leur cure, et je voudrais, avant qu’ils ne s’en aillent, leur montrer ma tanière là-haut. Venez. Messieurs ! Addio padre !
À présent il était allé jusqu’à appeler Naphta « padre ». Hans Castorp en prit note en fronçant les sourcils. On laissa Settembrini organiser le départ et disposer des cousins, sans demander si Naphta ne voudrait pas se joindre à eux. Les jeunes gens prirent congé, remercièrent leur hôte et furent invités à revenir. Ils s’en furent avec l’Italien, non sans que Hans Castorp eût emprunté l’ouvrage « De miseria humanae conditionis », un volume relié vétuste et poussiéreux. Le peu amène Lukacek était toujours encore assis sur sa table, travaillant à la robe à manches destinée à la « vieille » lorsqu’ils passèrent devant sa porte pour gagner la mansarde par l’escalier qui tenait presque de l’échelle. En réalité, ce n’était d’ailleurs nullement un étage. C’étaient tout simplement les combles avec les poutres nues, immédiatement sous les bardeaux, avec l’atmosphère d’été d’un grenier, son odeur de bois chaud. Mais ce grenier contenait deux mansardes, et le capitaliste républicain les habitait, elles servaient de studio et de chambre à coucher au bel esprit, collaborateur de la Sociologie des Souffrances. Il les montra gaiement à ses jeunes amis, les appela son compartiment isolé et intime, afin de leur suggérer les mots exacts dont ils pourraient se servir en faisant son éloge, ce qu’ils firent en effet d’un commun accord. C’était tout à fait charmant, dirent-ils tous deux, c’était discret et intime, tout juste comme il l’avait dit. Ils jetèrent un coup d’œil dans la petite chambre à coucher où un petit tapis fait de morceaux mis bout à bout servait de descente de lit, puis ils examinèrent le cabinet de travail qui n’était pas moins sommairement aménagé, mais qui faisait en même temps parade d’un ordre presque froid. Des chaises lourdes et anciennes, au nombre de quatre, avec des sièges en paille, étaient disposées symétriquement de côté et d’autre de la porte, et le canapé, lui aussi, était appuyé contre le mur, de sorte que la table ronde, couverte d’un tapis vert sur laquelle était placée en guise d’ornement, ou pour un rafraîchissement à coup sûr inoffensif, une carafe d’eau surmontée d’un verre, se trouvait isolée au milieu de la pièce. Des livres reliés ou brochés étaient appuyés obliquement les uns contre les autres sur une petite étagère, et près de la lucarne ouverte se dressait, haut sur pied, un pupitre d’une construction légère, avec, devant lui, un petit tapis de feutre, juste assez large pour qu’on pût s’y tenir debout. Hans Castorp prit place un instant, à titre d’essai, à l’établi sur lequel M. Settembrini étudiait les belles-lettres selon un dessein encyclopédique et au point de vue des souffrances humaines ; il appuya son coude sur le plan incliné et déclara que c’était discret et sympathique. C’est ainsi, dit-il, que le père de Lodovico avait dû se tenir à Padoue devant son pupitre avec son nez si fin et long, et il apprit qu’en effet c’était le pupitre du défunt savant qu’il avait sous les yeux, que les chaises de paille, la table et même la carafe d’eau provenaient de lui, voire même que les chaises de paille avaient encore appartenu au grand-père carbonaro et avaient meublé à Milan son cabinet d’avocat. C’était impressionnant. La physionomie des chaises prenait quelque chose de politique et de révolutionnaire aux yeux des jeunes gens, et Joachim quitta la sienne sur laquelle il s’était assis, sans se douter de rien, les jambes croisées, pour la considérer avec méfiance, et ne s’y rassit plus. Quant à Hans Castorp, debout au pupitre de Settembrini aîné, il songeait au fils qui y travaillait à présent, en confondant dans les belles-lettres la politique du grand-père avec l’humanisme du père. Puis tous trois repartirent. L’écrivain avait proposé de raccompagner les cousins.
Ils se turent pendant un bout de chemin, mais leur silence même concernait Naphta, et Hans Castorp pouvait attendre : il était sûr que M. Settembrini en viendrait à parler de son compagnon, et même qu’il les avait accompagnés à cet effet. Il ne se trompait pas. Après un soupir qui lui servit d’élan, l’Italien commença :
– Messieurs, je voudrais vous mettre en garde.
Comme il fit une pause, Hans Castorp demanda très naturellement avec une surprise feinte : « Contre quoi ? » Il aurait pu tout au moins demander : « Contre qui ? » Mais il préféra cette forme impersonnelle, pour témoigner de toute son innocence, bien que Joachim lui-même eût parfaitement compris.
– Contre la personnalité dont vous venez d’être les hôtes, répondit Settembrini, et dont je vous ai fait faire, bien malgré moi, la connaissance. Vous savez que le hasard l’a voulu. Je n’ai pu m’en dispenser ; mais j’en porte la responsabilité et elle me pèse. Mon devoir est de préserver tout au moins votre jeunesse des dangers spirituels que vous courez dans vos rapports avec cet homme, et de vous prier, par ailleurs, de maintenir en de sages limites les relations que vous aurez avec lui. Sa forme est logique, mais sa nature est confusion.
– C’est vrai, en effet, dit Hans Castorp, je ne me suis pas précisément senti à l’aise avec Naphta ; ses paroles avaient parfois quelque chose d’un peu étrange. On aurait presque dit à un moment donné qu’il prétendait vraiment affirmer que le soleil tourne autour de la terre. Mais, en somme, comment auraient-ils pu, eux, les cousins, penser qu’il dût être imprudent d’entrer en rapports avec un ami de M. Settembrini ? Ne venait-il pas de dire que c’était par son intermédiaire qu’ils avaient connu Naphta ? Ne l’avaient-ils pas rencontré en sa compagnie, ne se promenait-il pas avec M. Naphta et n’allait-il pas sans façon prendre le thé chez lui ? Tout cela ne prouvait-il pas que…
– Certes, ingénieur, certes. La voix de M. Settembrini était douce et résignée, bien qu’elle trahît un léger tremblement. On peut m’objecter cela, et c’est pourquoi vous me l’objectez. Bien je vous rends volontiers compte de mon attitude. Je vis sous le même toit que ce Monsieur, il est difficile de ne pas le rencontrer, un mot entraîne l’autre, on fait connaissance. M. Naphta est un homme de tête, c’est rare. C’est une nature discursive, je le suis aussi. Me condamne qui voudra, mais je fais usage de la possibilité qui m’est offerte de croiser le fer de l’idée avec un adversaire de force égale. Je n’ai personne ni près ni loin… Bref, cela est vrai : je vais chez lui, il entre chez moi, nous nous promenons ensemble. Nous discutons. Nous nous querellons jusqu’au sang, presque chaque jour, mais j’avoue que le charme de nos relations tient précisément à l’antinomie de nos pensées. J’ai besoin de friction, les convictions ne vivent pas lorsqu’elles n’ont pas l’occasion de combattre, et je suis pour ma part solidement établi dans les miennes. Mais comment pourriez-vous dire la même chose des vôtres, vous, lieutenant, ou vous, ingénieur ? Vous n’êtes pas cuirassé contre les mirages intellectuels, vous risquez de mettre à mal votre esprit et votre âme sous l’influence de ces finasseries mi-fanatiques mi-sournoises.
– Certes oui, dit Hans Castorp ; sans doute, son cousin et lui étaient des natures plus ou moins menacées. C’était l’histoire des enfants terribles de la vie, il comprenait. Mais on pouvait opposer à cela Pétrarque avec sa devise, M. Settembrini savait ce qu’il voulait dire, et de toute façon c’était intéressant d’entendre ce que M. Naphta débitait : il fallait être juste, ce qu’il disait du temps communiste pour l’écoulement duquel personne ne devait toucher prime avait été remarquable, et lui, Hans Castorp, s’était encore vivement intéressé à certaines remarques sur la pédagogie que sans doute il n’eût jamais entendues sans Naphta…
M Settembrini pinça les lèvres, et Hans Castorp se hâta d’ajouter que, lui-même, il s’abstenait, bien entendu, de prendre parti et qu’il avait simplement trouvé intéressant ce que Naphta avait dit de la nature de la jeunesse. « Mais expliquez-nous donc une chose, poursuivit-il. Ce M. Naphta, – je dis : ce Monsieur pour indiquer que je ne sympathise pas nécessairement avec lui, qu’au contraire j’observe à son égard une stricte réserve mentale…
– En quoi vous faites bien, s’écria Settembrini, reconnaissant.
– Ce M. Naphta nous a donc dit une foule de choses contre l’argent, l’âme de l’État comme il s’exprime, et contre la propriété privée qui serait du vol, bref contre la richesse capitaliste, dont il a dit, je crois, qu’elle alimentait le feu du purgatoire, – c’est bien ainsi, me semble-t-il, qu’il s’est exprimé, – et il a loué sur tous les tons la condamnation de l’usure par le moyen âge. Et pendant ce temps lui-même… Excusez-moi, mais il me semble qu’il doit… C’est une surprise véritable, lorsqu’on entre chez lui. Toute cette soie…
– Oui, oui, sourit Settembrini, la tendance de ses goûts est très caractéristique.
– … les beaux meubles anciens, se rappela Hans Castorp, la Pietà du quatorzième siècle… le lustre vénitien… le petit chasseur en livrée… et le gâteau au chocolat à volonté… Il faut tout de même que pour sa personne…
– M. Naphta, répondit Settembrini, est pour sa personne aussi peu capitaliste que moi.
– Mais ? demanda Hans Castorp. Car la réponse que vous m’avez faite comporte un « mais », Monsieur Settembrini.
– Eh bien, ces gens-là ne laissent jamais mourir les leurs de faim.
– Qui ? « ces gens-là » ?
– Ces pères.
– Pères ? Pères ?
– Mais, ingénieur, je veux dire : les jésuites.
Il y eut une pause. Les cousins manifestèrent la plus vive surprise. Hans Castorp s’écria :
– Que diable, sacré nom de nom de… Cet homme est un jésuite ?
– Vous l’avez deviné, dit M. Settembrini finement.
– Non, non, jamais de ma vie je n’aurais… Qui pourrait songer à cela ? C’est pour cela que vous lui avez donné le titre de « padre » ?
– C’était une petite exagération de politesse, repartit Settembrini. M. Naphta n’est pas père. La faute en est à la maladie pour le moment il n’a pas encore atteint ce grade. Mais il a fait son noviciat et il a prononcé les premiers vœux. La maladie l’a obligé à interrompre ses études théologiques. Ensuite, il a fait encore quelques années de service dans une maison de l’ordre c’est-à-dire comme surveillant, maître d’études, gouverneur des jeunes élèves. Cela convenait à ses penchants pédagogiques. Et c’est encore ce penchant qu’il suit en enseignant le latin, ici au Friedricianum. Il est ici depuis cinq ans. Il n’est plus certain qu’il puisse quitter cet endroit. Mais il est membre de l’ordre et si même il n’y était attaché que par un lien encore plus lâche, il ne manquerait de rien. Je vous ai dit que pour sa personne, il était pauvre, je veux dire qu’il ne possède rien. Naturellement, c’est la règle ! Mais l’ordre dispose de richesses immenses et a soin des siens, comme vous le voyez.
– Sacré… tonnerre, murmura Hans Castorp. Et moi qui n’ai pas même su ni même imaginé qu’une chose pareille pût encore sérieusement exister ! Un jésuite ! Ah ! c’est cela ?… Mais dites-moi donc une chose : s’il est si bien pourvu et soigné par ces gens-là pourquoi diable demeure-t-il… ? Je ne veux certainement pas médire de votre logement, Monsieur Settembrini. Vous êtes très bien installé chez Lukacek, c’est si intime, si sympathique. Mais je veux dire que si Naphta a un si gros sac, pour me servir d’un terme vulgaire, pourquoi n’habite-t-il pas un autre appartement faisant meilleure figure, avec une entrée convenable et de grandes pièces dans une maison distinguée ? Cela a vraiment quelque chose de mystérieux et d’aventureux, la manière dont il est installé dans ce trou avec toutes ces soieries…
Settembrini haussa les épaules.
– Ce doivent être des considérations de tact et de goût qui ont déterminé son choix. Je pense qu’il satisfait sa conscience anticapitaliste en habitant une chambre de pauvre, et qu’il trouve une compensation dans la manière dont il l’habite. La discrétion, elle aussi, doit être en jeu. On n’affiche pas sur tous les murs avec quel soin le diable pourvoit à vos besoins. On adopte une façade assez discrète derrière laquelle on s’abandonne librement à son goût d’ecclésiastique pour les soieries…
– Très étrange, dit Hans Castorp. Absolument nouveau et très captivant pour moi, je l’avoue. Non, nous vous devons vraiment beaucoup de gratitude, Monsieur Settembrini, pour nous avoir fait faire sa connaissance. Voulez-vous m’en croire que nous retournerons encore souvent chez lui. C’est entendu. De telles relations élargissent l’horizon d’une manière inattendue et donnent vue sur un monde dont on ne soupçonnait même pas l’existence. Un vrai jésuite ! Et lorsque je dis vrai cela me fait penser à ce qui me traverse l’esprit et à ce que je voulais encore vous demander : Est-ce bien régulier ? Je sais bien que vous pensez que rien n’est régulier avec quelqu’un qui doit ses ressources au diable. Mais ce que je voulais dire, c’était poser la question suivante : est-il donc en règle en tant que jésuite (c’est cela qui me passe par la tête) ? Il a débité des choses – vous savez ce que je veux dire – sur le communisme moderne et sur le zèle pieux du prolétariat qui ne reculera pas devant le sang, bref des choses, je n’en dis rien de plus, mais votre grand-père, avec sa pique de citoyen, eût été auprès de tout cela un agneau innocent, passez-moi l’expression. Est-ce donc possible, cela ? A-t-il reçu l’agrément de ses supérieurs ? Cela s’accorde-t-il avec la doctrine romaine en faveur de laquelle l’ordre doit intriguer dans le monde entier ? N’est-ce pas – le mot m’échappe – hérétique, irrégulier, incorrect ? Je pense à cela à propos de Naphta et j’aimerais bien savoir ce que vous en croyez.
Settembrini sourit.
– Très simple. M. Naphta est, en effet, et tout d’abord jésuite, il l’est vraiment et complètement. Mais en second lieu il est un homme d’esprit – sinon je ne chercherais pas sa compagnie – et, comme tel, il tend à de nouvelles combinaisons, adaptations, accommodations et variations conformes à l’époque. Vous m’avez vu très surpris par ses théories. Il ne s’était jamais confié à moi aussi complètement. Je me suis servi de l’excitant que constituait en quelque manière votre présence, pour le pousser à dire en somme son dernier mot. C’était assez baroque et assez atroce…
– Oui, oui. Mais pourquoi n’est-il pas devenu père ? et n’avait-il pas l’âge de le devenir ?
– Ne vous ai-je pas dit que c’était la maladie qui l’en avait provisoirement empêché ?
– Bien, mais ne croyez-vous pas que, s’il est premièrement un jésuite, et deuxièmement un homme d’esprit avec des combinaisons, que cette deuxième qualité complémentaire provient de la maladie ?
– Qu’entendez-vous par là ?
– Non, non, Monsieur Settembrini. Je veux dire tout simplement : il a une tache humide et cela l’a empêché de devenir père. Mais ses combinaisons l’en auraient sans doute elles aussi empêché, et par conséquent les combinaisons et la tache humide sont en quelque sorte du même ordre. Il est, à sa manière, quelque chose comme un enfant terrible de la vie, un joli jésuite avec une petite tache humide.
Ils avaient atteint le sanatorium. Sur la plate-forme devant la maison, ils s’arrêtèrent encore une fois avant de se séparer, formèrent un petit groupe tandis que quelques pensionnaires qui flânaient autour du portail les regardaient causer. M. Settembrini dit :
– Encore une fois, mes jeunes amis, je vous mets en garde. Je ne puis vous empêcher de cultiver une connaissance que vous avez faite si votre curiosité vous y incite. Mais cuirassez de méfiance votre cœur et votre esprit, ne manquez jamais d’opposer une résistance critique à cet homme. Je vous le définirai d’un mot. C’est un voluptueux !
Les visages des cousins changèrent d’expression. Puis Hans Castorp demanda :
– Un quoi ? Permettez, n’appartient-il pas à un ordre ? Autant que je sache, certains vœux doivent être prononcés, et de plus il est si malingre et un tel gringalet…
– Vous parlez en étourdi, ingénieur, répondit M. Settembrini. Cela n’a rien à voir avec la constitution chétive, et, en ce qui concerne les serments, il y a des dispenses. J’ai parlé dans un sens plus large et plus spirituel pour lequel je m’attendais à trouver précisément chez vous une certaine compréhension. Vous rappelez-vous encore le jour où je suis allé vous voir dans votre chambre ? Il y a terriblement longtemps de cela. Vous vous acquittiez précisément de votre période de lit obligatoire après avoir été admis.
– Bien entendu. Vous êtes entré au crépuscule et vous avez allumé la lumière. Je m’en souviens comme…
– Bon, ce jour-là, nous en sommes arrivés à parler, comme, Dieu merci, cela se produit encore quelquefois, de sujets plus relevés. Je crois même que nous avons parlé de la mort et de la vie, de la majesté de la mort, pour autant qu’elle est une condition et un complément de la vie, et de l’aspect grimaçant qu’elle prend lorsque l’esprit commet l’affreux tort de l’isoler en tant que principe. Messieurs, poursuivit Settembrini, en se rapprochant des jeunes gens, le pouce et le médius de la main gauche tendus vers eux comme une fourchette, pour concentrer leur attention et levant d’un geste d’admonestation l’index de la main droite… « Rappelez-vous que l’esprit est souverain, que sa volonté est libre, qu’il détermine l’univers moral ! Si, dualiste, il isole la mort, celle-ci, par cette volonté de son esprit, devient en réalité, actu, vous me comprenez, une puissance en soi opposée à la vie, un principe hostile, la grande séduction, et son empire est celui de la volupté. Vous me demandez : pourquoi de la volupté ? Je vous réponds : parce qu’elle délie et affranchit, parce qu’elle est l’affranchissement, non pas l’affranchissement du mal, mais l’affranchissement pervers. Elle dissout les mœurs et la morale, elle affranchit de la discipline et de la tenue, elle libère en vue de la jouissance. Si je vous mets en garde contre cet homme dont je ne vous ai fait faire la connaissance qu’à contre-cœur, si je vous exhorte à ceindre trois fois vos cœurs de critique dans vos rapports et vos discussions avec lui, c’est parce que toutes ses pensées sont de nature voluptueuse, parce qu’elles sont placées sous la protection de la mort, une puissance des plus dévergondées, comme je vous l’ai dit autrefois, ingénieur – je me rappelle parfaitement mon expression, je me rappelle toujours les expressions précises et fortes que j’ai trouvé l’occasion de formuler – une puissance dirigée contre la civilisation, le progrès, le travail et la vie, et contre le souffle méphitique de laquelle c’est le plus noble devoir de l’éducateur de protéger les jeunes âmes.
On ne pouvait mieux parler que M. Settembrini, plus clairement, ni plus élégamment. Hans Castorp et Joachim Ziemssen le remercièrent beaucoup de ce qu’il leur avait fait entendre, prirent congé de lui et gravirent la rampe du portail du Berghof, tandis que M. Settembrini retournait à son pupitre d’humaniste, un étage au-dessus de la cellule tendue de soie de Naphta.
C’est le cours de la première visite des cousins chez Naphta que nous avons rapporté ici. Depuis lors, deux ou trois autres visites l’avaient suivie, dont une en l’absence de M. Settembrini ; et celles-ci aussi alimentaient les réflexions du jeune Hans Castorp lorsque la forme supérieure nommée homo dei apparaissait à son œil intérieur, qu’il était assis dans le lieu fleuri de bleu de sa retraite et qu’il « gouvernait ».
COLÈRE BLEUE ET SURPRISE PÉNIBLE
Ainsi arriva le mois d’août et, parmi ses premiers jours, l’anniversaire de l’arrivée de notre héros était heureusement passé inaperçu. C’était heureux qu’il fût passé : le jeune Hans Castorp l’avait vu approcher avec une certaine inquiétude. Telle était, d’ailleurs, la règle. On n’aimait pas beaucoup les anniversaires d’arrivée ; ni les pensionnaires d’un an, ni les malades de plusieurs années n’en avaient cure, et tandis que, par ailleurs, on ne négligeait pas le moindre prétexte pour célébrer les fêtes et boire à la santé les uns des autres, tandis que l’on multipliait les occasions de réjouissance générale marquant le rythme et la pulsation de l’année à l’aide de toutes sortes de prétextes personnels et privés, et que les anniversaires de naissances, les examens généraux, les départs autorisés ou non, et d’autres événements encore étaient fêtés au restaurant par des festins au champagne, cet anniversaire-ci était voué au silence, on glissait sur lui, on oubliait même d’y prendre garde, et l’on pouvait se dire avec confiance que les autres ne s’en souviendraient pas du tout si exactement. On tenait sans doute aux divisions du temps ; on observait le calendrier, la succession des jours, leur retour apparent. Mais mesurer et compter le temps qui, pour chaque individu, était lié à l’espace, ici en haut, compter par conséquent le temps personnel et individuel, c’était là affaire des débutants et des hôtes de passage ; les anciens s’en tenaient à cet égard à l’absence de toute mesure, à l’éternité imperceptible, au jour qui était toujours le même, et chacun par délicatesse supposait chez l’autre un désir qu’il éprouvait lui-même. On eût jugé tout à fait maladroit et brutal de dire à quelqu’un qu’il était là juste depuis trois ans : de telles choses n’arrivaient pas. Mme Stoehr elle-même, quelques défauts qu’elle pût avoir par ailleurs, avait sur ce point de l’éducation et du tact ; jamais elle n’aurait commis une telle bévue. Sa maladie, l’état fiévreux de son corps s’alliaient, sans doute, à une profonde ignorance. Récemment encore, à table, elle avait parlé de « l’affectation » des pointes de ses poumons, et lorsque la conversation avait porté sur des événements historiques, elle avait déclaré que les dates historiques n’avaient jamais été son « anneau de Polycrate » ce qui avait sidéré un instant ses voisins. Mais il eût été inimaginable qu’elle rappelât en février l’anniversaire de sa venue au jeune Ziemssen, bien qu’elle y eût probablement pensé. Car sa malheureuse tête était naturellement pleine de dates et de choses inutiles, et elle aimait à faire les comptes des autres ; mais l’usage la muselait.
Il en fut donc ainsi le jour de Hans Castorp. Sans doute, à table, avait-elle essayé une fois de cligner des yeux d’une manière significative, mais comme elle avait rencontré un visage sans regard, elle s’était hâtée de battre en retraite. Joachim, lui aussi, avait gardé le silence, bien qu’il se souvînt sans doute du jour où il avait cherché à la gare de Dorf son cousin qui venait lui rendre visite. Mais Joachim, naturellement peu enclin à parler, beaucoup moins bavard en tout cas que Hans Castorp s’était montré ici, sans parler des humanistes et jacasseurs de leur entourage, Joachim donc avait observé ces temps derniers un mutisme particulier et frappant. Il ne s’exprimait plus que par monosyllabes, mais un travail se faisait derrière son masque. Il était clair que pour lui d’autres images étaient liées à celle de la gare de Dorf, que l’image de l’arrivée et de l’attente… Il entretenait une correspondance active avec le pays plat. Des décisions mûrissaient en lui. Il faisait des préparatifs qui approchaient de leur terme.
Le mois de juillet avait été chaud et clair. Mais au commencement du mois nouveau, le temps se fit mauvais, une humidité froide régna, une pluie mêlée de neige, puis, de la neige sans erreur possible, et ce temps dura, coupé de quelques belles journées d’été, jusque par delà la fin du mois, jusqu’en plein septembre. Au début, les chambres gardèrent encore la chaleur de la période d’été qui avait précédé ; on y avait dix degrés, ce qui passait pour confortable. Mais bientôt il fit de plus en plus froid et l’on fut heureux de voir tomber la neige qui couvrit la vallée, car la chute de la neige – la chute de la neige, la baisse de température à elle seule n’y eût pas suffi – décida l’administration à chauffer, d’abord la salle à manger, puis également les chambres, et lorsque, venant de sa cure et débarrassé de ses deux couvertures, on quittait la loggia, on pouvait tâter de ses mains humides et raides les radiateurs vivants, dont l’haleine sèche à la vérité accusait encore la rougeur des joues.
Était-ce l’hiver, cela ? Les sens n’échappaient pas à cette impression, et l’on se plaignait que l’on eût été « volé de son été », bien que l’on s’en fût, somme toute, dépouillé soi-même, aidé par des circonstances naturelles et artificielles, par un gaspillage intérieur et extérieur du temps. La raison disait qu’on aurait encore de belles journées d’automne ; peut-être même se suivraient-elles en série et seraient d’une splendeur si chaude que ce ne serait pas leur faire trop d’honneur que de leur accorder ce nom, – à condition de faire abstraction de l’orbite du soleil déjà plus allongée et de sa disparition plus rapide. Mais l’action, sur l’état d’âme, de l’aspect de ce paysage d’hiver était plus forte que toutes les consolations. On se postait devant la porte fermée de son balcon et on considérait avec répugnance ces tourbillons : c’était Joachim qui se tenait ainsi ; d’une voix oppressée il dit :
– Est-ce que ça va recommencer à présent ?
Hans Castorp, derrière lui, dans la chambre, répondit :
– Ce serait un peu trop tôt, cela ne peut être définitif, mais il est vrai que cela vous a un aspect effroyablement définitif. Si l’hiver consiste en de l’obscurité, de la neige, du froid et des radiateurs chauds, c’est de nouveau l’hiver, il n’y a pas moyen de le nier. Et si l’on considère que nous sortons à peine de l’hiver, que la fonte des neiges est à peine passée, – de toute façon il semble, n’est-ce pas ? que nous venions tout juste d’avoir le printemps – on peut se sentir momentanément écœuré, j’en conviens. C’est dangereux pour l’optimisme chez l’homme : laisse-moi t’expliquer ce que je veux dire. Je veux dire ceci, que tout le monde est normalement organisé de telle façon qu’il répond aux besoins de l’homme et convient à sa joie de vivre, c’est ce qu’il faut admettre. Je ne veux pas aller jusqu’à dire que l’ordre naturel, par exemple, disons-le tout de suite, la grandeur de la terre, le temps qu’elle met à tourner sur elle-même et autour du soleil, le rythme cosmique, si tu veux, soient calculés sur nos besoins : ce serait impertinent et niais, ce serait de la téléologie, comme disent les philosophes. Mais il y a tout simplement ceci que notre besoin et les faits naturels généraux et fondamentaux s’accordent, Dieu merci – je dis : Dieu merci, parce que c’est vraiment une occasion de louer Dieu – et lorsqu’en pays plat l’été ou l’hiver arrivent, l’été ou l’hiver précédents sont passés tout juste depuis un temps assez long pour que l’été ou l’hiver nous soient à nouveau les bienvenus et c’est à quoi tient notre plaisir de vivre. Mais, ici, sur nos sommets, cet ordre et cet accord sont troublés, premièrement parce que, ici, il n’y a pas du tout de saisons véritables, comme tu en as toi-même un jour fait la remarque, mais rien que des jours d’hiver pêle-mêle et sens dessus dessous, ensuite parce que ce n’est pas du tout du temps qui passe ici, de sorte que l’hiver suivant lorsqu’il revient n’est pas du tout nouveau, mais est toujours le même ; et c’est là ce qui explique le déplaisir avec lequel tu regardes par la fenêtre.
– Merci, dit Joachim, et maintenant que tu l’as expliqué, tu es, je crois, si satisfait que, par-dessus le marché, tu es content de la chose elle-même, quoiqu’elle… Eh bien non, dit encore Joachim, j’en ai assez, dit-il, c’est une cochonnerie. Toute cette histoire est une formidable et dégoûtante cochonnerie, et si pour ton compte… Moi je…
Et d’un pas rapide il quitta la chambre, fit même claquer la porte, et si tous les signes n’étaient pas trompeurs, des larmes étaient montées à ses beaux yeux doux.
L’autre, gêné, demeura en arrière. Il n’avait pas pris au sérieux certaines décisions de son cousin aussi longtemps que celui-ci s’était répandu en menaces verbales. Mais à présent que quelque chose couvait secrètement sous les traits de Joachim, et qu’il se conduisait comme il venait de le faire à l’instant, Hans Castorp prenait peur parce qu’il comprenait que ce militaire était homme à passer aux actes, il avait peur jusqu’à en pâlir, pour tous deux ; pour lui-même et pour l’autre. Fort possible qu’il aille mourir, pensa-t-il, et comme c’était là, à coup sûr, un savoir de troisième main, le tourment d’un soupçon ancien et jamais apaisé s’y mêla, tandis qu’il pensait encore : Est-il possible qu’il me laisse seul ici, moi qui ne suis venu que pour lui rendre visite ? Pour ajouter : ce serait fou et effrayant, ce serait tellement fou et effrayant que je sens ma figure se glacer et mon cœur faire des siennes, car si je reste seul ici – et c’est ce qui arrivera s’il s’en va ; il est tout simplement exclu que je parte avec lui, – s’il en est ainsi – mais voici que mon cœur s’arrête complètement – c’est pour toujours et à jamais, car je ne retrouverai jamais plus à moi seul le chemin de la plaine…
Telles furent les réflexions effrayantes de Hans Castorp. Encore dans le courant de la même après-midi il devait acquérir une certitude sur le cours des choses à venir ; Joachim s’ouvrit de son dessein, les dés tombèrent, il y eut combat et décision.
Après le thé ils descendirent dans le souterrain éclairé, pour l’examen mensuel. On était au début de septembre. En entrant dans l’atmosphère sèche de la salle de consultations, ils trouvèrent le docteur Krokovski, assis à sa place devant le secrétaire, tandis que le conseiller, le visage très bleu, les bras croisés, était appuyé au mur, tenant d’une main le stéthoscope duquel il se tapotait l’épaule. Il bâilla vers le plafond :
– Bonjour, les enfants, dit-il d’une voix fatiguée, et il manifesta de diverses façons encore une humeur assez déprimée, de la mélancolie, une résignation totale.
Sans doute, avait-il fumé ! Mais il avait eu aussi des ennuis positifs dont les cousins avaient entendu parler : des incidents de sanatorium d’un genre suffisamment connu : une jeune fille, nommée Ammy Noelting, qui, entrée pour la première fois l’automne précédent, et renvoyée après neuf mois, en août, comme guérie, était revenue avant la fin de septembre parce qu’elle « ne s’était pas sentie bien » chez elle, qui en février avait été à nouveau jugée complètement rétablie et avait été rendue au pays plat, mais qui depuis la mi-juillet avait repris sa place à la table de Mme Iltis ; cette Ammy, donc, avait été surprise à une heure du matin avec un malade nommé Polypraxios, le même Grec qui, le soir de Carnaval, avait fait sensation par l’élégance de ses jambes, un jeune chimiste dont le père possédait au Pirée une usine de produits colorants ; elle avait été surprise dans sa chambre par une amie égarée par la jalousie, laquelle avait pénétré dans la dite chambre par le même chemin que Polypraxios, c’est-à-dire en passant par le balcon, et qui, déchirée par la douleur et la colère, à cette découverte, avait poussé des cris effrayants, avait tout mis en branle, de sorte que cette affaire s’était ébruitée. Behrens avait dû les renvoyer tous trois, l’Athénien, la Noelting et l’amie, et il venait de discuter cette désagréable affaire avec son assistant, dont Ammy, ainsi que la rivale, avaient du reste suivi le traitement particulier. Durant l’examen, il continua de parler de cette affaire sur un ton de mélancolie et de résignation ; car il était un virtuose si accompli de l’auscultation qu’il était capable d’explorer l’intérieur d’un homme, tout en parlant d’autre chose et en dictant à son assistant ce qu’il avait constaté.
– Oui, oui, gentlemen, cette sacrée libido, dit-il. Vous, ces choses-là vous amusent encore, naturellement. Vésiculaire. Mais un chef d’établissement comme moi peut en avoir plein la lampe, oui, c’est ce que vous pouvez… Assourdi… Ah oui, vous pouvez m’en croire. Que voulez-vous que j’y fasse, si la phtisie est inséparable d’une certaine concupiscence ? Légère rugosité. Ce n’est pas moi qui en ai disposé ainsi, mais avant de s’être avisé de rien, on est là comme un tenancier de cabanons. Souffle court sous l’épaule gauche. Nous avons bien l’analyse, nous avons la confession, merci bien, bon appétit ! Plus cette bande de râleurs se confie, plus elle devient libertine. Moi, je préconise les mathématiques. Mieux ici le bruit a disparu. S’occuper de mathématiques, dis-je, c’est meilleur remède contre la concupiscence. Le procureur Paravant qui a été fortement tenté, s’est jeté dessus, il en est arrivé maintenant à la quadrature du cercle et cela le soulage beaucoup. Mais la plupart sont trop bêtes ou trop paresseux pour cela, – que Dieu leur pardonne ! Vésiculaire. Voyez-vous, je sais parfaitement que les jeunes gens se détraquent et tournent mal assez facilement ici et autrefois j’ai essayé d’intervenir contre la débauche. Mais dans ces cas-là, il m’est parfois arrivé qu’un frère ou un fiancé quelconque m’ait demandé en face en quoi cela pouvait bien me regarder. Depuis, je ne suis plus que médecin. Léger râle à droite, en haut.
Il en avait fini avec Joachim, il glissa son stéthoscope dans la poche de sa blouse et frotta ses deux yeux de son énorme main gauche, comme il avait coutume de faire lorsqu’il « n’y était plus » et qu’il devenait mélancolique. À moitié machinalement et tout en bâillant, entre temps, il récita sa petite leçon :
– Allons, Ziemssen, toujours gai ! C’est vrai que tout ne se passe pas encore exactement comme c’est écrit dans le livre de physiologie. Ça cloche encore ici et là ; et avec Gaffky vous n’avez pas encore complètement réglé vos petites affaires, vous avez même progressé récemment d’un numéro dans l’échelle, c’est 6 cette fois-ci. Mais il n’y a pas de quoi vous frapper. Lorsque vous êtes arrivé ici, vous étiez plus malade, je peux vous le mettre par écrit, et si vous restez encore cinq ou six petits meis, savez-vous qu’on disait autrefois : meis, et non pas : mois ? C’est beaucoup plus gentil. J’ai décidé de ne plus jamais dire que meis…
– Monsieur le conseiller, commença Joachim… Il était debout, le torse nu, dans une attitude rigide, la poitrine saillante, les talons joints, et son visage était aussi tacheté que le jour où Hans Castorp, en certaine circonstance, avait remarqué pour la première fois que c’était ainsi que le visage bronzé de son cousin pâlissait.
– Si vous faites, poursuivit Behrens, en précipitant son élan, si vous faites encore la moitié d’une bonne petite année votre service vous êtes un homme fait, vous pouvez prendre Constantinople d’assaut, vous marcherez si bien qu’on vous fera généralissime dans les Marches…
Dieu sait ce qu’il aurait encore radoté dans son état de moindre résistance si la tenue imperturbable de Joachim, sa volonté évidente de parler, et de parler avec courage, ne lui avaient pas fait perdre le fil.
– Monsieur le conseiller, dit le jeune homme, je me permets de vous informer que j’ai décidé de partir.
– Allons donc ! Vous voulez devenir voyageur ? Je croyais que vous vouliez un jour, lorsque vous serez guéri, vous faire soldat.
– Non, il faut que je parte maintenant, monsieur le conseiller. Il faut que je fasse mon service.
– Quoique je vous dise que dans six mois je vous autoriserai sans faute à partir, mais qu’avant six mois je ne peux vous rendre votre liberté ?
La tenue de Joachim devenait de plus en plus militaire. Il rentra l’estomac et dit, brièvement, d’une voix étouffée :
– Je suis ici depuis plus d’un an et demi, monsieur le conseiller. Je ne saurais attendre plus longtemps. Monsieur le conseiller dit primitivement : trois mois. Ensuite ma cure a été prolongée, chaque fois de trois ou de six mois, et je ne suis toujours pas bien portant.
– Est-ce ma faute ?
– Non, monsieur le conseiller. Mais je ne peux pas attendre plus longtemps. Si je ne veux pas manquer le moment opportun, je ne peux pas attendre ici d’être complètement guéri. Il faut que je descende dès à présent. J’ai encore besoin d’un peu de temps pour m’équiper et faire d’autres préparatifs.
– Vous agissez d’accord avec votre famille ?
– Ma mère est d’accord. Tout est convenu. J’entre le premier octobre comme aspirant au soixante-seizième.
– À vos risques et péril ? demanda Behrens, et il le regarda de ses yeux injectés de sang.
– À vos ordres, monsieur le conseiller, répondit Joachim, dont les lèvres tressaillirent.
– Allons, ça va bien, Ziemssen.
Le conseiller changea d’expression, son attitude se détendit et il rendit la main à tous les égards.
– Ça va bien, Ziemssen. Rompez. Partez et bon voyage ! Je vois que vous savez ce que vous voulez, vous prenez la chose sur vous, c’est donc affectivement votre affaire, et non pas la mienne, à partir du moment où vous en prenez la responsabilité. Chacun pour soi. Vous voyagez sans garantie, je ne réponds de rien. Mais, Dieu nous garde, cela peut très bien marcher. C’est un métier en plein air que vous allez exercer. Il est parfaitement possible qu’il vous convienne et que vous vous tiriez d’affaire.
– Parfaitement, monsieur le conseiller.
– Allons, et vous, le civil, vous voulez sans doute faire partie du pèlerinage, jeune homme ?
C’était Hans Castorp qui devait répondre. Il était là, aussi pâle qu’il y avait un an, lors de la consultation, à la suite de laquelle il était resté ici. Il était immobile comme ce jour-là, et de nouveau on voyait distinctement le battement de son cœur contre les côtes. Il dit :
– Je voudrais faire dépendre cela de votre jugement, docteur.
– De mon jugement ? Bien.
Behrens le tira à lui par le bras, frappa et ausculta. Il ne dicta pas. Cela alla assez vite. Lorsqu’il eut fini, il dit :
– Vous pouvez partir.
Hans Castorp bégaya :
– C’est-à-dire… comment ? Suis-je donc bien portant ?
– Oui, vous êtes bien portant. La tache à gauche, en haut, ce n’est plus la peine d’en parler. Votre température n’en dépend pas. D’où elle provient, c’est ce que je ne peux pas vous dire, j’admets qu’elle ne signifie pas grand’chose. Si cela vous plaît, vous pouvez partir.
– Mais… docteur… Je pense que pour l’instant vous ne parlez pas tout à fait sérieusement ?
– Pas sérieusement ? Comment donc ? Que vous figurez-vous donc ? Que pensez-vous de moi, en somme, c’est ce que je voudrais bien savoir. Pour qui me prenez-vous ? Pour un marchand de soupe ?
C’était un accès de colère furieuse. La couleur bleue du visage du conseiller avait tourné au violet, par l’afflux d’un sang enflammé, le pli de sa lèvre s’était accentué sous la petite moustache, de telle sorte que les canines supérieures saillaient ; il avançait la tête comme un taureau, ses yeux larmoyaient, humides et sanguinolents.
– Je vous en prie, cria-t-il. D’abord je ne suis pas du tout tenancier. Je suis un employé ici. Je suis médecin. Je ne suis que médecin, vous m’entendez ? Je ne suis pas un entremetteur ! Je ne suis pas un signor Amoroso du Toledo dans la belle Napoli, vous m’entendez bien ? Je suis un serviteur de l’humanité souffrante ! Et si vous vous êtes fait une autre idée de ma personne, vous pouvez aller tous les deux au diable, vous pouvez aller vous faire pendre où vous voudrez, à votre choix. Bon voyage !
À grands pas allongés il quitta la chambre, par la porte qui donnait dans la salle de radioscopie, et la fit claquer derrière lui.
Cherchant conseil, les cousins se tournèrent vers le docteur Krokovski, mais ce dernier était plongé et perdu dans ses paperasses. Ils se dépêchèrent donc de se rhabiller. Dans l’escalier, Hans Castorp dit :
– Mais c’était effrayant, cela. L’avais-tu déjà vu dans cet état ?
– Non, jamais dans cet état. Ce sont des accès de folie césarienne. La seule chose à faire, c’est de les subir sans perdre son sang-froid. Naturellement, il était déjà surexcité par l’affaire de Polypraxios et de la Noelting. Mais as-tu remarqué, poursuivit Joachim – et l’on se rendait compte que la joie d’avoir eu gain de cause montait en lui et lui oppressait la poitrine – as-tu remarqué comme il s’est dégonflé et a capitulé lorsqu’il a compris que je parlais sérieusement ? Il suffit de se montrer énergique et de ne pas se laisser endormir. À présent j’ai en quelque sorte une permission, il a dit lui-même que je me tirerais peut-être d’affaire, et dans huit jours c’est pour nous le départ ; dans trois semaines je serai en uniforme, rectifia-t-il en laissant Hans Castorp hors de cause, et en limitant son optimisme joyeux à sa propre personne.
Hans Castorp garda le silence. Il ne dit plus rien de la « permission » de Joachim, ni de la sienne propre, dont on eût pu parler également. Il se prépara pour la cure de repos, mit le thermomètre dans la bouche ; en quelques mouvements rapides et sûrs, avec une maîtrise accomplie, conformément à la pratique consacrée dont personne n’avait la moindre notion en pays plat, il s’enroula dans les deux couvertures en poil de chameau, puis il resta immobile, rouleau impeccable, sur son excellente chaise-longue, dans l’humidité froide de cet après-midi de l’automne commençant.
Les nuages de pluie étaient bas, le drapeau de fantaisie, au jardin, avait été amené, des restes de neige étaient accrochés aux branches du sapin. De la salle de repos d’en bas, où avait retenti il y a longtemps pour la première fois la voix de M. Albin, un léger bruit de conversations monta vers l’oreille du jeune homme qui faisait son service, et dont les doigts et le visage devinrent rapidement raides de froid et d’humidité. Il en avait l’habitude et il savait gré à ce genre de vie, le seul qu’il pût encore imaginer, de l’avantage qu’il accordait d’être étendu ainsi à l’abri et de pouvoir songer à tout.
C’était chose résolue, Joachim partirait. Rhadamante lui avait donné congé, non pas selon le rite, non pas comme s’il était bien portant, mais en l’approuvant à moitié, en rendant hommage à sa vaillance. Il descendrait par le chemin de fer à voie étroite jusqu’à Landquart, et puis à Romanshorn et ensuite par delà le lac profond et vaste que le cavalier du poème franchissait sur sa monture, et à travers toute l’Allemagne s’en retournerait chez lui. Il vivrait là-bas dans le monde du pays plat, au milieu d’hommes qui n’avaient aucune idée de la manière dont il fallait vivre, qui ne savaient rien du thermomètre, de l’art de s’empaqueter, du sac de fourrure, des trois promenades quotidiennes, de… il était difficile de dire, il était difficile d’énumérer tout ce dont ils ne savaient rien en bas, mais l’idée que Joachim, après avoir vécu en haut pendant plus d’un an et demi, devrait vivre parmi les ignorants, cette idée qui ne concernait que Joachim et qui ne le concernait, lui, Hans Castorp, que de très loin, et en quelque sorte à titre d’hypothèse, le troublait tellement qu’il ferma les yeux et fit de la main un geste de défense. « Impossible, impossible ! » murmura-t-il.
Dès lors que c’était impossible, continuerait-il donc de vivre ici, seul et sans Joachim ? Oui. Combien de temps ? Jusqu’à ce que Behrens le renvoyât comme guéri, et cela sérieusement, non pas comme aujourd’hui. Mais premièrement c’était là une date que l’on ne pouvait prévoir qu’en faisant, comme Joachim l’avait fait un jour, le geste de l’incalculable, et deuxièmement cette chose impossible deviendrait-elle dès lors plus possible ? Le contraire plutôt était vrai. Et il fallait en convenir loyalement ; une main lui était tendue, à présent que l’impossible n’était peut-être pas encore aussi impossible qu’il le deviendrait plus tard. Un soutien s’offrait à lui et un guide, grâce au départ en coup de tête de Joachim, pour le ramener au pays plat que, de lui-même, il risquait de ne jamais plus retrouver, de toute éternité. La pédagogie humaniste l’exhorterait instamment à saisir cette main et à accepter ce guide si la pédagogie humaniste apprenait cette occasion. Mais M. Settembrini n’était qu’un représentant de choses et de puissances intéressantes, qui toutefois n’étaient pas seules à exister, qui n’étaient pas absolues, et il en était de même de Joachim. Il était militaire, lui. Il partait presque à l’instant où Maroussia à la poitrine opulente allait revenir (tout le monde savait en effet qu’elle devait rentrer le 1er octobre), tandis qu’à lui, au civil Hans Castorp, le départ semblait, au fond et en bref, impossible parce qu’il devait attendre Clawdia Chauchat, du retour de laquelle on ne savait encore absolument rien. « Ce n’est pas ma manière de voir », avait dit Joachim lorsque Rhadamante lui avait parlé de désertion, ce qui, sans conteste, n’avait été à l’égard de Joachim que sottises et radotages du conseiller obnubilé. Mais pour lui, le civil, il en allait quand même autrement. Pour lui (oui, sans aucun doute, il en était ainsi !) et c’était pour dégager cette considération décisive du vague de ses sentiments, qu’il s’était étendu aujourd’hui dans ce froid humide. Pour lui c’eût été vraiment une désertion que de saisir l’occasion et de partir en coup de tête, ou presque en coup de tête, pour le pays plat, une désertion en présence des responsabilités qui lui étaient apparues tandis qu’il contemplait l’image de cet être supérieur nommé Homo Dei, une trahison à l’égard des devoirs de son « gouvernement », accablants et irritants, surpassant ses forces, mais enchanteurs et aventureux, auxquels il se vouait ici, dans sa loge et dans le vallon fleuri de bleu.
Il tira le thermomètre de sa bouche, aussi violemment qu’il l’avait fait un autre jour déjà, après s’être servi pour la première fois du gracieux instrument que l’infirmière en chef lui avait vendu et il le regarda avec la même avidité. Le mercure avait sensiblement monté, il marquait 37,8, presque 9.
Hans Castorp rejeta les couvertures, sauta sur pied, fit quelques pas rapides dans la chambre, jusqu’à la porte du couloir, et revint. Puis, de nouveau en position horizontale, il appela doucement Joachim et s’informa de sa température.
– Je ne la prends plus, répondit Joachim.
– Eh bien, j’en ai moi, du tempus, dit Hans Castorp mettant ce mot, à la suite de Mme Stoehr, au même genre qu’autobus. Sur quoi Joachim garda le silence, derrière sa paroi de verre.
Plus tard il ne dit rien non plus, ni ce jour, ni le suivant : il ne s’informa pas des projets du cousin et de ses décisions qui, étant donné la rapidité du délai, devaient se révéler d’elles-mêmes : par des actes ou par l’abstention de certains actes ; et ce fut de cette seconde manière qu’il les apprit. Il semblait avoir opté pour le quiétisme, d’après lequel agir c’est offenser Dieu qui s’en réserve seul le privilège. Quoi qu’il en fût, ces jours-ci, l’activité de Hans Castorp s’était réduite à une visite chez Behrens, à un entretien que Joachim connaissait et dont il était possible de calculer sur ses cinq doigts le cours et le résultat. Son cousin avait dû déclarer qu’il se permettait d’accorder plus de poids aux nombreuses exhortations anciennes du conseiller à attendre la guérison complète, pour n’être pas obligé de revenir, qu’à une parole inconsidérée, prononcée en une minute de mauvaise humeur ; il avait 37°8, il ne pouvait pas se considérer comme libéré en bonne forme, et s’il ne fallait pas interpréter la parole prononcée l’autre jour par le conseiller comme une relégation que lui qui parlait n’avait pas le sentiment d’avoir encourue, il avait décidé, après mûre réflexion et en désaccord conscient avec son cousin, il avait décidé de demeurer encore ici, et d’attendre sa désintoxication complète. Sur quoi le conseiller avait dû répondre : « Parfait » et « Sans rancune ! » et : cela, c’était parler raison, et : il avait tout de suite vu que Hans Castorp avait plus de talent pour la maladie que ce galopin et ce traîneur de sabre. Et ainsi de suite.
Tel devait avoir été le cours de la conversation d’après les conjectures approximatives de Joachim. Il ne dit donc rien, mais se borna à constater en silence que Hans Castorp ne se joignait pas à ses préparatifs de voyage. D’ailleurs, le bon Joachim était bien assez absorbé par ses propres soucis. Il ne pouvait vraiment pas s’occuper davantage du sort de son cousin. Une tempête agitait sa poitrine, on le pense bien. Heureux encore qu’il ne prît plus sa température et qu’il eût cassé son instrument en le laissant tomber, prétendait-il ; s’il l’avait prise, il aurait eu peut-être des surprises troublantes, surexcité, tantôt brûlant d’une ardeur sombre, tantôt pâle de joie et d’impatience comme il l’était. Il ne pouvait plus rester étendu ; toute la journée, Hans Castorp l’entendait aller et venir dans sa chambre. À toute heure, quatre fois par jour, cependant qu’au Berghof régnait la position horizontale. Un an et demi ! Et à présent descendre au pays plat, chez soi, vraiment au régiment, encore qu’avec une demi-permission ! Ce n’était pas une bagatelle, à aucun point de vue, Hans Castorp le sentait en entendant son cousin aller et venir sans repos. Il avait vécu ici dix-huit mois, parcouru le cercle complet de l’année, et puis encore une fois la moitié, s’était profondément accoutumé, attaché à cet ordre, à cette règle de vie inaltérable qu’il avait observée pendant sept fois soixante-dix jours, en toute saison, et voici qu’il rentrait chez lui, à l’étranger, chez les ignorants ! Quelles difficultés d’acclimatation devaient le menacer là-bas ! Et pouvait-on s’étonner que la grande agitation de Joachim ne fût pas seulement faite de joie, mais aussi d’angoisse, de la souffrance d’une séparation de choses si profondément habituelles ! Sans même parler de Maroussia.
Mais la joie l’emportait. Le cœur et la bouche du bon Joachim en débordaient. Il ne parlait que de lui-même, il se désintéressait de l’avenir de son cousin. Il disait combien tout serait neuf et frais, la vie, lui-même, le temps, chaque jour, chaque heure. Il aurait de nouveau un temps stable, de lentes et importantes années de jeunesse. Il parla de sa mère, tante par alliance de Hans Castorp, qui avait des yeux aussi doux et noirs que Joachim, de sa mère qu’il n’avait pas vue durant tout ce séjour à la montagne, parce que, l’attendant de mois en mois, de semestre en semestre, elle ne s’était jamais résolue à rendre visite à son fils. Il parlait avec un sourire enthousiaste du serment au drapeau qu’il allait bientôt prêter – c’était en présence du drapeau, à l’étendard lui-même que dans les circonstances les plus solennelles, on prêtait ce serment. « Allons donc ! dit Hans Castorp, sérieusement ? À une hampe de bois ? Au morceau de tissu ? » Oui, en effet ! Et, dans l’artillerie, à la pièce, en manière de symbole. « En voilà des mœurs romantiques, observa le civil, sentimentales et fanatiques, pourrait-on dire. » Sur quoi Joachim, fier et heureux, hocha la tête avec approbation.
Il s’absorbait dans les préparatifs : il régla sa dernière note à l’administration et commença à faire ses bagages dès la veille de la date qu’il s’était fixée lui-même. Il emballa les vêtements d’été et d’hiver et fit coudre par le portier d’étage le sac de fourrure et les couvertures en poil de chameau dans de la toile de sac : peut-être pourrait-il s’en servir aux grandes manœuvres. Il commença à faire ses adieux. Il fit des visites d’adieu à Naphta et à Settembrini, – seul, car son cousin ne se joignit pas à lui et ne s’informa pas davantage des appréciations que Settembrini avait formulées sur le départ prochain de Joachim et sur le fait qu’il n’était pas question du départ de Hans Castorp. Qu’il eût dit : « tiens, tiens ! » ou : « pas possible ! » ou les deux à la fois, ou : « poveretto », peu lui importait.
Puis vint l’avant-veille du départ, le jour où Joachim s’acquitta pour la dernière fois de tout, de chaque cure, de chaque promenade, et où il prit congé des médecins et de l’infirmière en chef. Et le jour lui-même arriva : les yeux brûlants et les mains froides, Joachim vint au petit déjeuner, car il n’avait pas fermé l’œil de la nuit, il mangea du reste à peine et lorsque la naine annonça que les bagages étaient chargés, il sauta de sa chaise pour prendre congé de ses compagnons de table. Mme Stoehr, en lui disant adieu, versa des larmes, les larmes faciles et sans amertume de l’ignorante, mais derrière le dos de Joachim, par un signe de tête à l’institutrice, et en balançant avec une grimace sa main aux doigts écartés, elle exprima par un jeu de physionomie des plus vulgaires ses doutes sur la légitimité du départ et sur les chances de salut de Joachim. Hans Castorp la vit, qui vidait sa tasse debout pour suivre incontinent son cousin. Il fallait encore distribuer des pourboires et répondre dans le vestibule au compliment officiel du représentant de l’administration. Comme toujours, des pensionnaires étaient présents pour assister au départ : Mme Iltis, avec son « stérilet », Mlle Lévi au teint d’ivoire, Popoff, le dépravé, avec sa fiancée. Ils firent des signes avec leurs mouchoirs lorsque la voiture, freinée à la roue de derrière, dévala la rampe. On avait offert des roses à Joachim. Il était coiffé d’un chapeau. Hans Castorp, pas.
La matinée était splendide, c’était la première journée de soleil après tant de mauvais temps. Le Schiahorn, les Tours Vertes, la cime du Dorfberg se dessinaient, repères inchangés, sur l’azur, et les yeux de Joachim reposaient sur eux. Presque dommage, dit Hans Castorp, que le temps soit devenu si beau justement pour le départ. Il y avait de la méchanceté là-dedans et une impression finale assez réconfortante facilitait la séparation. Sur quoi Joachim observa qu’il n’avait nul besoin qu’elle lui fût facilitée, et que c’était là un temps parfait pour faire son instruction, il en aurait aussi bien besoin en bas. Ils ne parlèrent plus guère. Il est vrai qu’il n’y avait plus grand’chose à dire, vu les circonstances. Et, de plus, le portier boiteux était assis devant eux sur le siège, à côté du cocher.
Haut perchés, secoués sur les coussins durs du cabriolet, ils avaient franchi le cours d’eau, la voie étroite, et suivaient la route irrégulièrement bordée de maisons et parallèle aux rails, puis ils s’arrêtèrent sur la place pierreuse devant la gare de Dorf, qui n’était guère qu’une sorte de hangar. Hans Castorp reconnut tout avec effroi. Depuis son arrivée, voici treize mois, à la nuit tombante, il n’avait pas revu la gare. « Mais c’est ici que je suis arrivé » dit-il, fort inutilement, et Joachim répondit simplement : « Oui, c’est ici », et il paya le cocher.
L’actif boiteux s’occupa de tout, du billet, des bagages. Ils étaient debout l’un près de l’autre sur le quai, près du train en miniature, à côté du petit compartiment capitonné de gris, où Joachim avait réservé sa place par son manteau, son plaid roulé et ses roses. « Eh bien, va donc prêter ton serment romantique ! » dit Hans Castorp, et Joachim répondit : « On n’y manquera pas ! » Quoi de plus ? Ils se chargèrent l’un l’autre des dernières salutations, pour ceux d’en bas, pour ceux d’en haut. Puis Hans Castorp ne fit plus que tracer avec sa canne des dessins sur l’asphalte. Lorsqu’on cria : « En voiture ! », il sursauta, regarda Joachim, et celui-ci le regarda. Ils se donnèrent la main, Hans Castorp eut un sourire vague ; les yeux de l’autre étaient graves et le regardaient avec une insistance triste. « Hans ! » dit-il. Grand Dieu ! y avait-il jamais eu au monde chose aussi pénible ? Il appelait Hans Castorp par son prénom. Il ne lui disait pas « Toi » ou : « Dis donc », comme ils avaient toujours fait, mais voici que, rompant avec toutes leurs habitudes de raideur et de réserve, il l’appelait avec une exubérance troublante par son prénom ! « Hans ! » disait-il, et avec une appréhension pressante il serrait la main de son cousin, qui ne pouvait pas ne pas se rendre compte que la nuque de Joachim, énervé par l’insomnie et fiévreux de partir, tremblait comme il lui arrivait à lui lorsqu’il « gouvernait », « Hans, dit-il d’un ton pressant, suis-moi bientôt ! » Puis il sauta sur le marchepied. La portière se ferma, il y eut un coup de sifflet, les wagons s’entre-heurtèrent, la petite locomotive tira, le train partit. Par la portière, le voyageur agitait son chapeau ; l’autre, resté en arrière, agitait la main. Seul, le cœur remué, il demeura encore un long moment. Puis il remonta lentement le chemin par lequel Joachim, voici longtemps, l’avait conduit au Berghof.
ASSAUT REPOUSSÉ
La roue tournait. L’aiguille avançait. L’orchis et l’achillée avaient achevé leur fleuraison, l’œillet sauvage, lui aussi. Les étoiles, d’un bleu si profond, de la gentiane, le colchique pâle et vénéneux apparaissaient de nouveau dans l’herbe humide, et au-dessus des forêts s’allumait une lueur rougeâtre. L’équinoxe d’automne était passé, la Toussaint était en vue, et pour les consommateurs de temps les plus exercés approchaient déjà l’Avent, la journée la plus brève, et la fête de Noël. Mais de belles journées d’octobre se suivaient encore, des journées de l’espèce du jour où les cousins avaient vu les tableaux à l’huile du conseiller.
Depuis le départ de Joachim, Hans Castorp n’était plus assis à la table de la Stoehr, à celle que le Dr Blumenkohl avait quittée pour mourir et où Maroussia étouffait autrefois dans son mouchoir parfumé à l’orange une gaieté sans raison. De nouveaux pensionnaires étaient assis là, absolument inconnus. Mais notre ami qui avait accompli le deuxième mois de sa deuxième année, s’était vu attribuer par l’administration une nouvelle place, à une table voisine, placée en travers de l’autre, plus près de la porte de gauche de la véranda, entre son ancienne table et la table des Russes bien, bref, à la table de Settembrini. Oui, c’est à l’ancienne place de l’humaniste que Hans Castorp était maintenant assis, de nouveau à l’extrémité de la table, en face de la place du médecin, laquelle, à chacune des sept tables, restait réservée au conseiller et à son assistant.
À ce haut bout de la table, à gauche de la place d’honneur du médecin, un Mexicain bossu, le photographe amateur, était assis sur plusieurs coussins. Son expression était celle d’un sourd, par suite de son isolement linguistique, et à côté de lui était placée la vieille demoiselle transylvanienne qui, ainsi que Settembrini l’avait déjà déploré, accaparait tout le monde par des propos sur son beau-frère, bien que personne ne sût ni ne voulût rien savoir de cet individu. Une petite canne au pommeau d’argent de Toula, posée en travers, derrière sa nuque, canne dont elle se servait également dans ses promenades de service, on la voyait à certaines heures de la journée bomber sa poitrine plate, le long de la balustrade de son balcon, par des exercices respiratoires. Un Tchèque était assis en face d’elle, que l’on appelait M. Wenzel, parce que personne ne savait prononcer son nom de famille. M. Settembrini en son temps s’était parfois efforcé de prononcer la suite variée de consonnes dont se composait ce nom, – certes pas pour de bon, mais pour faire gaiement la preuve de son impuissance distinguée de Latin devant ce fouillis sauvage de sons. Bien qu’il fût gras comme une marmotte et qu’il se distinguât par un appétit remarquable même chez les gens d’ici, le Tchèque annonçait depuis quatre ans qu’il allait mourir. Pendant la réunion du soir il jouait parfois sur une mandoline décorée de rubans les chansons de son pays et parlait de ses plantations de betteraves à sucre où travaillaient de jolies filles. Dans le voisinage plus proche de Hans Castorp venaient ensuite, des deux côtés de la table, les époux Magnus, brasseurs à Halle. Une atmosphère de mélancolie enveloppait ce couple, parce que tous deux perdaient des substances dont l’assimilation est essentielle, M. Magnus faisait du sucre, Mme Magnus, de l’albumine. La pâle Mme Magnus en particulier semblait n’avoir pas le moindre espoir, une vacuité de l’esprit se dégageait d’elle comme une haleine de cave, et presque plus expressément encore que l’inculte Mme Stoehr, elle représentait cette synthèse de la maladie et de la bêtise qui avait moralement choqué Hans Castorp, blâmé pour cela par M. Settembrini. M. Magnus était d’un esprit plus éveillé et plus volubile, encore qu’il ne le fût que de la manière qui avait excité l’impatience littéraire de Settembrini. De plus, il était coléreux et se disputait souvent avec M. Wenzel sur des sujets politiques ou autres. Car les aspirations nationales du Bohémien l’irritaient, et le Tchèque, par surcroît, se proclamait partisan de l’antialcoolisme et jugeait avec une sévérité de rigoriste la profession du brasseur, tandis que celui-ci, la tête rouge, défendait les propriétés incontestablement hygiéniques de la boisson à laquelle ses intérêts étaient si intimement liés. En de telles circonstances M. Settembrini était intervenu autrefois avec un humour conciliant. Mais Hans Castorp, à sa place, se sentait moins adroit et ne pouvait revendiquer assez d’autorité pour le remplacer.
Il n’avait de relations personnelles qu’avec deux de ses voisins de table : A. K. Ferge, de Pétersbourg, son voisin de gauche, était l’un, le brave souffre-douleurs qui, sous la touffe de sa moustache rouge brun parlait de la fabrication des caoutchoucs et de contrées lointaines, du cercle polaire, de l’hiver éternel au Cap Nord, et qui faisait parfois une petite promenade en compagnie de Hans Castorp. Mais l’autre, qui se joignait à eux en tiers aussi souvent que possible, et qui avait sa place au bout supérieur de la table, à côté du bossu mexicain, était le Mannheimois au cheveu rare et aux dents gâtées nommé Wehsal, Ferdinand Wehsal, commerçant de son métier, de qui les yeux avaient toujours été suspendus avec un désir si trouble à la gracieuse personne de Mme Chauchat et qui, depuis Carnaval, recherchait l’amitié de Hans Castorp.
Il le faisait avec ténacité et humilité, avec un dévouement servile, qui avait pour l’intéressé quelque chose de répugnant et d’effrayant parce qu’il en comprenait le sens ambigu, mais auxquels il s’efforçait de répondre d’une manière humaine. Le regard calme (car il savait que le moindre froncement de sourcils suffisait à effrayer le malheureux qui reculait et se faisait petit), il supportait les manières serviles de Wehsal qui saisissait chaque occasion de s’incliner devant lui et de lui faire des grâces, tolérait même que celui-ci portât parfois en promenade son pardessus, – il le portait sur le bras avec une certaine ferveur – supportait enfin la conversation du Mannheimois dont les propos étaient tristes. Wehsal se plaisait à poser des questions comme celle de savoir s’il était raisonnable de déclarer son amour à une femme que l’on aimait, mais qui ne voulait rien entendre de vous. « La déclaration sans espoir, qu’en pensaient ces Messieurs ? » Lui, pour sa part, en faisait le plus grand cas, il affirmait qu’une félicité indicible y était liée. Si, en effet, l’acte de l’aveu éveillait de la répugnance et comportait beaucoup d’humiliation, il vous rapprochait quand même pour un moment de l’objet de votre amour, il introduisait celui-ci dans la confidence, dans l’élément de votre propre passion, et encore que tout fût terminé, la perte éternelle n’était pas payée trop cher par le bonheur désespéré d’un instant ; car l’aveu est une violence faite, et plus est grande la répugnance qu’on lui oppose, plus il procure de jouissance. Ici une ombre passa sur le visage de Hans Castorp, qui fit reculer Wehsal ; ce nuage, à la vérité, tenait plutôt à la présence du bon Ferge auquel, comme il le soulignait souvent, tous les objets élevés et difficiles étaient absolument étrangers, qu’à la pruderie et à l’austérité de notre héros. Comme nous nous efforçons toujours de ne le montrer ni pire ni meilleur qu’il n’est, nous tenons à préciser que le pauvre Wehsal insista un soir en tête à tête avec lui et en termes discrets pour que Hans Castorp lui confiât quelques détails des événements et des expériences de certaine nuit de Carnaval, que Hans Castorp donna suite à cette prière avec une tranquille bienveillance sans que, le lecteur peut nous en croire, ce dialogue à voix basse eût rien comporté de libertin ni de vil. Néanmoins, nous avons des raisons de le laisser de côté et de nous taire devant nos lecteurs, et nous nous bornons à ajouter que Wehsal, à partir de ce jour, porta le pardessus de l’aimable Hans Castorp avec un dévouement redoublé.
Tenons-nous-en là, en ce qui concerne les nouveaux compagnons de table de Hans. La place à sa droite était libre, elle n’avait été occupée que passagèrement, pendant quelques jours, par un visiteur tel qu’il l’avait été lui-même, par un parent, par un invité et un messager du pays plat, comme on pouvait le dire, en un mot, par l’oncle de Hans, James Tienappel.
C’était une véritable aventure qu’un représentant et un envoyé de son pays fût tout à coup assis à côté de lui, portant encore dans le tissu de son costume anglais l’atmosphère de l’ancien, du révolu, de la vie passée, d’un monde extérieur profondément enfoui. Mais les choses avaient dû en arriver là. Depuis longtemps, Hans Castorp avait compté en silence sur une telle offensive du pays plat et il avait même très justement prévu quelle personne serait chargée de cette reconnaissance, ce qui n’avait pas été très difficile à prévoir, car Peter le navigateur n’entrait guère en ligne de compte, et il était établi que pour le grand-oncle Tienappel lui-même dix chevaux ne suffiraient pas à le traîner en ces contrées dont la pression atmosphérique lui inspirait toutes les craintes. Non ce serait James qui serait chargé de s’enquérir de l’absent ; Hans Castorp l’avait même attendu plus tôt. Mais depuis que Joachim était rentré seul et qu’il avait dû rendre des comptes dans le cercle de la famille, le moment de l’attaque était venu, et Hans Castorp ne manifesta donc pas la moindre surprise lorsque, tout juste quatorze jours après le départ de Joachim, le concierge lui remit un télégramme qu’il ouvrit sans se douter de rien et qui contenait la nouvelle de l’arrivée toute prochaine de James Tienappel. Celui-ci avait affaire en Suisse et s’était décidé par la même occasion à tenter une petite excursion jusqu’à l’altitude de Hans. Il annonçait son arrivée pour le surlendemain.
« Bon », pensa Hans Castorp. « Parfait », se dit-il. Et il ajouta même intérieurement quelque chose comme : « Je t’en prie ! »
« Si tu te doutais ! » dit-il en pensant à l’arrivant. Bref, il accueillit la nouvelle avec un grand calme, la transmit d’ailleurs au docteur Behrens et à l’administration, fit réserver une chambre, – celle de Joachim était encore disponible, – et le surlendemain, vers l’heure à laquelle lui-même était arrivé, c’est-à-dire vers huit heures du soir (il faisait déjà nuit), il partit dans le même cabriolet dans lequel il avait accompagné Joachim pour la gare de Dorf, afin de chercher le messager du pays plat qui venait voir où en était la situation.
Le teint rubicond, sans chapeau, en veston, il se tenait sur le quai, lorsque le train entra en gare, devant la portière de son parent, qu’il invita à descendre. Le consul Tienappel – James était vice-consul, et suppléait aussi très honorablement le vieux dans ses fonctions officielles, – frileusement enveloppé dans son pardessus d’hiver (en effet, la soirée d’octobre était très fraîche, et il s’en fallait de peu que l’on parlât d’un temps clair de gel, même vers le matin il allait sûrement geler…) descendit de son compartiment, se montra joyeusement surpris et le manifesta sous les formes un peu minces et très civilisées de l’Allemand du Nord-Ouest, salua son neveu en insistant sur la satisfaction qu’il éprouvait à lui trouver si bonne mine, fut dispensé par le portier boiteux du souci de ses bagages et escalada avec Hans Castorp le siège haut et dur du véhicule. Sous un ciel plein d’étoiles ils se mirent en route, et Hans Castorp, la tête rejetée en arrière, l’index en l’air, commentait pour son oncle-cousin les sphères célestes, décrivait par la parole et le geste telle ou telle constellation scintillante, et appelait les planètes par leurs noms, tandis que l’autre, plus attentif à la personne de son compagnon qu’à l’univers stellaire, se disait à part soi que tout cela était malgré tout bien possible et qu’il n’était pas nécessairement fou de parler maintenant et si vite des étoiles, alors que l’on aurait pu s’entretenir de tant d’autres sujets plus urgents. Depuis quand connaissait-il donc si bien ces sphères lointaines ? demanda-t-il à Hans Castorp ; sur quoi celui-ci répondit qu’il s’était acquis ce savoir pendant les soirées de sa cure de repos, sur le balcon, au printemps, en été, en automne et en hiver. – Comment, la nuit, on était étendu sur le balcon ? – Eh ! oui. Et le consul non plus n’y manquerait pas. Il n’aurait pas d’autre ressource.
« Certainement, bien entendu ! » dit James Tienappel, avec amabilité, et il se sentit un peu intimidé. Son frère de lait parlait avec un calme uniforme. Sans chapeau, sans pardessus, il se tenait là dans la fraîcheur presque glacée de ce soir d’automne. « Tu n’as donc pas du tout froid ? » lui demanda James, car lui-même tremblait sous le drap épais de son manteau, et son langage avait à la fois quelque chose de précipité et de paralysé qui trahissait que ses dents avaient tendance à claquer. « Nous n’avons pas froid ici », répondit Hans Castorp, tranquille et bref.
Le consul n’en finissait pas de le regarder en dessous. Hans Castorp ne s’informa ni des parents, ni des amis de là-bas. Il accueillit en remerciant avec calme les salutations que James lui transmit, même celles de Joachim qui était déjà au régiment et qui rayonnait de bonheur et de fierté. Il ne s’informa pas autrement des événements du pays. Inquiété par il ne savait quoi, sans qu’il eût pu dire si cela émanait de son neveu, ou si cela tenait à son propre état physique, James regardait autour de lui, sans distinguer grand’chose du paysage de la haute vallée, et il aspira profondément l’air, qu’il déclara excellent tout en l’expirant. Certainement, répondit l’autre, ce n’était pas pour rien qu’il était aussi célèbre. Cet air avait des vertus puissantes. Bien qu’il accélérât la combustion générale, le corps y assimilait de l’albumine. Cet air était capable de guérir les maladies que tout homme portait en soi à l’état latent, mais il commençait par favoriser sensiblement leur éclosion, et, par une impulsion organique générale, il en provoquait en quelque sorte la joyeuse explosion. – « Comment cela, joyeuse ? » Mais certainement ! N’avait-il pas remarqué que l’explosion d’une maladie avait quelque chose de plaisant, qu’elle constituait en quelque sorte une fête du corps ? – « Oui, bien entendu », se hâta de répondre l’oncle, dont la mâchoire inférieure s’affaissait, et il annonça qu’il pourrait rester huit jours, c’est-à-dire une semaine ; sept jours par conséquent, peut-être six seulement. Comme il constatait que, grâce à un séjour qui s’était du reste prolongé au delà de toute attente, Hans Castorp s’était parfaitement et remarquablement rétabli, il supposait que son neveu se joindrait à lui et rentrerait en même temps.
– Eh ! eh ! comme tu y vas, dit Hans Castorp.
L’oncle James parlait absolument comme des gens d’en bas. Il n’avait qu’à regarder un peu autour de lui, qu’à s’acclimater un peu, et ses idées changeraient d’elles-mêmes. Il s’agissait d’obtenir une guérison définitive. Le définitif ; c’était ce qui importait, et récemment encore, Behrens lui avait administré six mois. Sur ce, l’oncle l’appela : « Mon petit », et lui demanda s’il était fou. « Tu es donc complètement marteau ? » demanda-t-il. Voici que ce séjour de vacances avait duré une année et quart, et il envisageait encore une demi-année ? Au nom de Dieu Tout-puissant, avait-on donc tout ce temps devant soi ? – Mais Hans Castorp rit tranquillement et brièvement, la tête levée vers les étoiles. Oui, le temps ! Sur ce point justement, sur le temps humain James devrait commencer par rectifier les conceptions qu’il avait apportées avec lui, avant d’avoir droit à la parole. Dans l’intérêt de Hans, il dirait dès demain un mot sérieux au docteur, promit Tienappel. « Fais-le, dit Hans Castorp. Il te plaira. C’est un caractère intéressant, à la fois énergique et mélancolique. » Puis il désigna les lumières du sanatorium Schatzalp et parla incidemment des cadavres que l’on transportait par la piste de bobsleigh.
Ces Messieurs dînèrent ensemble au restaurant du Berghof après que Hans Castorp eût conduit son hôte dans la chambre de Joachim pour qu’il pût faire un bout de toilette. La chambre avait été désinfectée à l’H2CO, dit Hans Castorp, aussi sérieusement que si, au lieu d’un départ en coup de tête, il y avait eu non un exodus, mais un exitus. Et comme l’oncle s’informait du sens de cette expression : « Jargon, dit le neveu, expression locale, dit-il. Joachim a déserté, il a déserté pour rejoindre le drapeau, ces choses-là existent. Mais dépêche, pour que tu puisses encore manger chaud. » Et ils prirent donc place dans le restaurant confortable et chauffé, à une table surélevée. La naine les servit avec empressement et James fit venir une bouteille de bourgogne qui fut servie dans un panier. Ils entrechoquèrent leurs verres et la douce ardeur du vin les pénétra. Le cadet parla de la vie d’ici, dans la suite des saisons, de certains événements de la salle à manger, du pneumothorax, dont il expliqua le processus en citant le cas du bon Ferge, et en s’étendant sur la nature mauvaise du choc à la plèvre, sans omettre les trois syncopes différentes dans lesquelles M. Ferge prétendait être tombé, l’hallucination de l’odorat qui dans son choc avait joué un rôle, et le rire dont il avait éclaté en s’évanouissant. Il faisait tous les frais de la conversation. James mangea et but beaucoup, comme il en avait l’habitude, avec un appétit que le changement d’air et le voyage avaient encore aiguisé. Néanmoins, il s’interrompait parfois, restait assis, la bouche pleine, en oubliant de mâcher, le couteau et la fourchette posés en angle obtus sur son assiette, et considérait Hans Castorp, sans se détourner, apparemment sans s’en rendre compte, et sans que celui-ci parût le remarquer. Des veines gonflées se dessinaient sur les tempes du consul Tienappel, couvertes de minces cheveux blonds.
Il ne fut pas question des événements de chez eux, ni de choses personnelles et familiales, ni de la ville, ni des affaires, ni de la maison Tonder et Wilms : chantier, fabrique de machines et forge qui attendaient toujours l’entrée du jeune stagiaire, ce qui, naturellement, était si loin d’être son unique souci que l’on pouvait se demander si même elle l’attendait encore. James Tienappel avait, sans doute, fait allusion à tous ces sujets durant leur course en voiture et plus tard encore, mais ils avaient été écartés et gisaient morts, après s’être heurtés à l’indifférence tranquille, résolue et naturelle de Hans Castorp, à un quelque chose en lui d’intangible et de distant, qui faisait penser à son insensibilité à l’égard de la fraîcheur de la soirée d’automne et à cette parole : « Nous n’avons pas froid ici. » Et c’était pourquoi, peut-être, son oncle, parfois, le considérait si fixement. Il fut question aussi de la supérieure, des médecins, et des conférences du docteur Krokovski. Il se trouvait que James pouvait assister à l’une d’entre elles s’il restait huit jours. Qui avait dit au neveu que l’oncle serait disposé à assister à la conférence ? Personne. Mais il tenait pour acquis, avec une assurance si placide, que c’était chose entendue, que la seule pensée de ne pas y assister dut forcément apparaître à l’autre comme une impossibilité, et que l’oncle s’efforça d’écarter tout soupçon à ce sujet par un : « Certainement, bien entendu ! » empressé. Tel était l’effet de cette puissance confusément perçue ! mais impérieuse qui inclinait inconsciemment M. Tienappel à regarder à ce moment son neveu, la bouche ouverte, car la voie respiratoire du nez s’était obstruée, bien que le consul ne se sût pas enrhumé. Il écoutait son parent parler de la maladie qui constituait ici l’intérêt professionnel de tous, et des dispositions que l’on pouvait avoir pour elle. Il fut mis au courant du propre-cas de Hans Castorp, sans gravité, mais lent à guérir, à l’effet que produisaient les bacilles sur les cellules des conduits respiratoires, sur les alvéoles du poumon, de la formation de tubercules et de la sécrétion des toxines, de la décomposition des cellules et de la caséation au sujet de laquelle la question était de savoir si elle s’arrêterait à une pétrification calcaire et par une cicatrisation conjonctive ou si elle se développerait en foyers plus étendus, si elle creuserait des cavernes de plus en plus profondes et si elle détruirait l’organe. Il entendit parler de la forme furieusement accélérée et galopante de ce processus qui en quelques mois, voire en quelques semaines, conduisait à l’exitus, entendit parler de la pneumotomie, opération que le conseiller exécutait d’une façon magistrale, de la résection du poumon que l’on pratiquerait demain ou prochainement sur une grande malade nouvellement arrivée : une Écossaise autrefois charmante qui avait été atteinte de la gangraena pulmonum, de la gangrène pulmonaire, de sorte qu’une pourriture d’un noir verdâtre l’envahissait et qu’elle respirait toute la journée de l’acide phénique vaporisé, pour ne pas perdre la raison par dégoût d’elle-même – et tout à coup il arriva que le consul, sans s’y attendre et à sa plus grande confusion éclata de rire. Il partit à pouffer, se reprit et se domina presque avec effroi, toussa et s’efforça de dissimuler de toute manière cette velléité absurde, rassuré, en même temps qu’inquiété à nouveau en constatant que Hans Castorp ne s’occupait pas le moins du monde d’un incident qui ne pouvait pas lui avoir échappé, mais le négligeait avec une inattention qui n’était ni due au tact, ni à des égards de politesse, mais qui semblait être de l’indifférence pure, une tolérance déterminée par une insensibilité inquiétante comme si, depuis longtemps, il avait désappris l’étonnement en présence de tels incidents. Mais, soit que le consul voulût prêter après coup à son accès d’hilarité une apparence de raison et de justification, soit à quelque autre propos, il entama tout à coup une conversation, « entre hommes », et, les veines des tempes gonflées, commença à parler d’une certaine chanteuse de cabaret, une vraie enragée, qui faisait justement fureur dans le quartier Saint-Paul, et dont les charmes et le tempérament qu’il dépeignit à son cousin tenaient en haleine le monde masculin de la république hambourgeoise. Sa langue s’empâtait, durant ces histoires, mais il n’avait pas besoin de s’en inquiéter, car la tolérance impassible de son voisin s’étendait apparemment à ce phénomène aussi. Cependant, peu à peu, il finit par sentir si nettement l’immense fatigue du voyage, que, vers dix heures et demie, il proposa de monter et qu’à part soi, il ne fut que médiocrement satisfait de rencontrer encore dans le hall le docteur Krokovski de qui il avait été question à plusieurs reprises, qui avait lu le journal à la porte d’un des salons et à qui son neveu le présenta. En réponse aux paroles énergiques et alertes que le docteur lui adressa, le consul ne sut presque répondre que : « Certainement, bien entendu ! » et il se sentit heureux lorsque Hans Castorp, ayant annoncé qu’il viendrait le prendre le lendemain matin à 8 heures pour le petit déjeuner, eût quitté par le balcon la chambre désinfectée de Joachim, pour la sienne propre, et qu’avec son habituel cigare du soir, il put se laisser tomber dans le lit du déserteur. Il s’en fallut de peu qu’il allumât encore un incendie, car à deux reprises il s’endormit, son cigare allumé entre les lèvres.
James Tienappel, que Hans Castorp appelait tantôt « oncle James », tantôt « James » tout court, était un monsieur haut sur jambes, d’une quarantaine d’années, vêtu de tissu anglais et d’un linge d’une fraîcheur de pétales, avec des cheveux clairsemés d’un jaune canari, des yeux bleus placés l’un très près de l’autre, une moustache couleur paille, taillée et en partie rasée, et des mains parfaitement soignées. Époux et père depuis quelques années, sans qu’il eût dû quitter pour cela la villa spacieuse du chemin de Harvestehude, marié à une jeune fille de son monde qui était aussi civilisée et fine que lui, qui parlait le même langage léger, rapide et d’une politesse aussi aiguisée que lui-même, il était là-bas un homme d’affaires très énergique, circonspect et froidement réaliste, malgré toute son élégance ; mais dans un milieu ou d’autres mœurs régnaient, en voyage, par exemple en Allemagne du Sud, son caractère prenait quelque chose de prévenant et de précipité, une complaisance polie et empressée à se renier soi-même qui ne témoignait de rien moins que d’un manque de foi en sa propre culture, mais plutôt de la conscience qu’il avait de ses limites ainsi que du désir qu’il éprouvait de dissimuler son particularisme aristocratique et de ne rien laisser paraître de sa surprise, même au milieu de formes d’existence qu’il trouvait incroyables. « Naturellement, certainement, bien entendu », s’empressait-il de dire, pour que personne ne s’avisât de penser qu’il était fin, mais borné. Venu ici avec une mission, il est vrai, précise et concrète, à savoir avec l’intention et la charge de redresser énergiquement la situation, de « dégeler » son jeune parent attardé, comme il s’exprimait lui-même intérieurement, et de le ramener au bercail, il avait quand même conscience d’opérer sur un terrain étranger ; et, dès le premier instant, il avait senti qu’un monde et une sphère particuliers, avec ses usages établis, l’accueillaient ici, qui non seulement ne cédaient pas devant sa propre assurance, mais qui le dominaient à tel point que son énergie d’homme d’affaires entrait immédiatement en conflit avec sa bonne éducation, en un conflit des plus graves, car dans cette sphère nouvelle une force pesait sur lui qui véritablement l’oppressait.
C’est là justement ce que Hans Castorp avait prévu lorsqu’il avait intérieurement répondu au télégramme du consul par un : « Je t’en prie », mais il ne faut pas croire qu’il eût consciemment tiré parti contre son oncle de la force de résistance du monde qui l’entourait. Pour en agir ainsi, il s’était depuis trop longtemps fondu dans ce milieu, et ce ne fut pas lui qui se servît de cette force contre l’agresseur, mais le contraire eut lieu, de sorte que tout s’accomplit avec la simplicité la plus naturelle, à partir de l’instant où un premier pressentiment de la vanité de son entreprise émanant de la personne de son neveu eût vaguement touché le consul, jusqu’à l’issue de l’aventure, que Hans Castorp ne put, il est vrai, s’empêcher d’accompagner d’un sourire mélancolique.
Le premier matin, après le petit déjeuner, au cours duquel l’habitué avait présenté le nouveau venu à sa table, Tienappel apprit de la bouche du docteur Behrens qui, grand et haut en couleur, suivi de son assistant pâle, était entré dans la salle, en ramant des mains, pour la parcourir avec son « Bien reposé ? » de pure rhétorique matinale, il apprit, disions-nous, non seulement que ç’avait été une excellente idée à lui de venir tenir un peu compagnie à son neveu solitaire, mais encore qu’il avait bien fait dans son intérêt personnel parce que, de toute évidence il était totalement anémique. – Anémique, lui, Tienappel ? – Allons donc, et comment ! dit Behrens, et de l’index il abaissa la paupière inférieure du consul. « Au plus haut degré ! » dit-il. Monsieur l’oncle se montrerait tout à fait avisé en s’installant confortablement pour quelques semaines, de tout son long, sur son balcon et en prenant à tous points de vue son neveu pour exemple. Dans son état le plus malin était de se comporter comme si l’on était atteint d’une légère tuberculosis pulmonum, qui d’ailleurs existait chez tout le monde. « Certainement, bien entendu ! » dit vite le consul et il regarda encore un moment la bouche ouverte et avec un empressement poli le docteur qui s’éloignait, la nuque saillante, avec des mouvements de nageoires, cependant que son neveu restait auprès de lui, paisible et blasé. Puis ils firent la promenade prescrite jusqu’au banc du ruisseau, et ensuite James Tienappel prit sa première heure de repos, guidé par Hans Castorp qui, en sus du plaid dont l’oncle était muni, lui prêta une de ses couvertures en poil de chameau – lui-même, en raison de ce beau temps d’automne, avait assez d’une seule couverture – et en lui enseignant fidèlement, mouvement par mouvement, l’art traditionnel de s’enrouler. Même après que le consul fut déjà soigneusement enroulé et lissé en momie, il défit encore une fois le tout, pour lui faire répéter de son propre chef toute la procédure, le professeur se bornant à corriger les erreurs, et il lui enseigna en outre à fixer l’ombrelle de toile à la chaise longue et à l’orienter par rapport au soleil.
Le consul faisait des plaisanteries. L’esprit du pays plat était encore fort en lui, et il se moquait de tout ce qu’il apprenait, de même qu’il s’était moqué de la promenade réglementaire après le petit déjeuner. Mais, lorsqu’il vit le sourire placide et incompréhensif par lequel son neveu accueillait ces plaisanteries, sourire où se peignait toute l’assurance close de cette sphère morale particulière, il eut peur, il eut peur pour son énergie d’homme d’affaires, et décida de provoquer le plus tôt possible la conversation décisive avec le conseiller sur le cas de son neveu, dès l’après-midi même, tant qu’il pourrait encore la mener à bien avec les forces et l’esprit apportés d’en bas. Car il sentait que ceux-ci fondaient, que l’esprit du lieu concluait avec sa bonne éducation une alliance dangereuse contre lui.
Il sentait encore que le docteur Behrens lui avait conseillé fort inutilement de se soumettre à cause de son anémie aux usages des malades : cela allait de soi, on ne pouvait, semblait-il, imaginer aucune possibilité différente, et un homme bien élevé comme lui ne pouvait dès le début discerner dans quelle mesure le calme et l’assurance imperturbables de Hans Castorp créaient seulement cette apparence, ou dans quelle mesure cette impossibilité existait réellement en soi. Rien ne pouvait être plus naturel que de faire suivre la première cure de repos du deuxième déjeuner plus copieux, duquel la promenade jusqu’à Platz découlait de toute évidence, après quoi Hans Castorp emballait de nouveau son oncle. Il l’emballait, c’était le mot. Et au soleil d’automne, sur une chaise-longue dont le confort était absolument incontestable, voire digne d’être célébré, il le laissait étendu tel que lui-même était étendu, jusqu’à ce que la vibration du gong invitât à un déjeuner en commun qui fut de premier ordre, et tellement copieux que la cure générale qui suivait en devenait moins une obligation extérieure qu’une nécessité intime à quoi on se pliait par conviction personnelle. Cela continua ainsi jusqu’au formidable souper et jusqu’à la réunion du soir dans le salon autour des instruments optiques. Il n’y avait absolument rien à objecter à un emploi du temps qui s’imposait avec une logique si persuasive, et qui n’aurait offert aucune prise aux objections quand même les facultés critiques du consul n’eussent pas été diminuées par un état qu’il ne voulait pas précisément appeler un malaise, mais qui se composait de fatigue et d’excitation combinées avec des impressions de chaleur et de froid.
Pour provoquer l’entretien avec le conseiller que James Tienappel désirait avec impatience, on avait emprunté la voie hiérarchique. Hans Castorp avait adressé la demande au baigneur, et celui-ci l’avait transmise à la supérieure, dont le consul Tienappel fit la connaissance singulière dans la circonstance suivante : elle parut sur son balcon où elle le trouva étendu et où, par l’étrangeté de sa conduite, elle mit à une lourde épreuve la politesse du consul, gisant sans défense sous ses couvertures enroulées.
Sa Seigneurie, apprit-il, était invitée à bien vouloir patienter quelques jours, le conseiller était occupé : opérations, consultations générales… L’humanité souffrante passait avant, d’après les principes chrétiens, et comme il était supposé bien portant, il fallait bien qu’il s’habituât à n’être pas ici le n° 1, mais à rester à son rang et à attendre son tour. Autre chose, s’il comptait solliciter une consultation, ce qui ne lui paraîtrait pas, à elle, Adriatica, autrement surprenant, il n’était besoin que de le regarder comme ceci, dans les yeux ! Ils étaient troubles, incertains, et tel qu’elle le voyait étendu devant elle, il apparaissait bien que tout n’était pas absolument en ordre chez lui, que tout n’était pas très net. Mais qu’il n’aille pas se méprendre sur le sens de ses paroles ! S’agissait-il donc, conclut-elle, d’une demande de consultation ou d’une conversation de caractère personnel ? Bien entendu d’un entretien personnel, assura l’homme allongé. Dans ce cas, il devait attendre jusqu’à ce qu’on prît jour avec lui. Le conseiller n’avait que rarement du temps à consacrer à des conversations personnelles.
Bref, tout alla autrement que James l’avait imaginé ; et cette conversation avec la supérieure ébranla sensiblement son équilibre. Trop civilisé pour dire impoliment à son cousin, dont le calme inébranlable témoignait de ce qu’il était en plein accord avec les procédés d’usage ici, combien cette femme lui paraissait effroyable, il ne hasarda que prudemment la remarque que la supérieure était sans doute une dame très originale, ce que Hans Castorp admit à moitié, après avoir jeté en l’air un regard vaguement interrogateur ; à son tour il demanda si la Mylendonk avait vendu un thermomètre à son oncle.
– Non. À moi ? C’est sa branche, ça ? répondit l’oncle.
Mais le pire était, comme on pouvait le lire distinctement sur le visage de son neveu, qu’il n’eût même pas été étonné si ce qu’il présumait était effectivement arrivé. « Nous n’avons pas froid, ici », pouvait-on lire sur ce visage. Mais le consul avait froid, il avait sans cesse froid, bien que la tête lui brûlât, et il se dit que si, effectivement, la supérieure lui avait offert un thermomètre il l’aurait certainement refusé, mais qu’il aurait sans doute eu tort, parce que, en homme civilisé, on ne pouvait se servir du thermomètre d’une autre personne, par exemple de celui de son neveu.
Ainsi passèrent quelques jours, quatre ou cinq. La vie du messager marchait sur des roulettes – sur des rails que l’on avait posés à son intention, et desquels il semblait impossible de s’écarter. Le consul faisait des expériences, recevait des impressions que nous ne voulons pas épier plus longtemps. Un jour, dans la chambre de Hans Castorp, il prit sur la commode une petite plaque de verre noir qui, parmi d’autres objets personnels par quoi son habitant avait décoré son home propret, reposait sur un petit chevalet sculpté et qui, exposée à la lumière, se trouva être un négatif photographique. « Qu’est-ce que c’est donc que cela ? » demanda l’oncle en le considérant… La question était justifiée. Le portrait était sans tête, c’était le squelette d’un torse humain, dans une enveloppe nébuleuse de chair – un torse féminin d’ailleurs, comme on pouvait le voir. « Ça ? Un souvenir ! », répondit Hans Castorp. Sur quoi l’oncle dit : « Pardon », replaça la plaque sur le chevalet et s’en écarta vite. Ce n’est là qu’un exemple de ses expériences et impressions durant ces quatre ou cinq jours. Il assista également à une conférence du docteur Krokovski, parce qu’on ne pouvait pas même songer à s’en dispenser. Quant à l’entretien particulier avec le docteur Behrens qu’il avait sollicité, il reçut satisfaction le sixième jour. On le convoqua et il descendit après le petit déjeuner dans le souterrain, décidé à échanger avec cet homme quelques paroles fermes sur son neveu et sur le temps qu’il perdait ici.
Lorsqu’il remonta, il demanda d’une voix amenuisée :
– A-t-on jamais entendu chose pareille ?
Mais il était clair que Hans Castorp avait déjà entendu chose pareille, que même ceci ne lui faisait ni froid ni chaud ; le consul coupa donc court, et aux questions sans impatience que son neveu lui posait, ne répondit que par : « Rien, rien ! », mais manifesta à partir de cet instant une nouvelle habitude, celle de regarder obliquement vers en haut, les sourcils froncés et les lèvres pointues, puis de tourner brusquement la tête et de fixer son regard dans la direction opposée… La conversation avec Behrens avait-elle suivi, elle aussi, un cours différent de celui que le consul avait prévu ? Avait-il, à la longue, été question, non seulement de Hans Castorp, mais aussi de lui-même, James Tienappel, de sorte que la conversation avait perdu son caractère d’entretien personnel ? L’attitude du consul le faisait supposer. Il se montrait très dispos, il bavardait beaucoup, riait sans raison et donnait du poing une bourrade dans la hanche de son neveu en s’écriant : « Ma vieille branche ». Entre temps, son regard se fixait brusquement ici et là. Mais ses yeux suivaient aussi des directions plus précises à table comme aux promenades réglementaires, et lors de la réunion du soir.
Au début, le consul n’avait pas accordé d’attention particulière à une certaine Mme Redisch, épouse d’un industriel polonais qui était assise à la table de Mme Salomon, pour l’instant absente, et de l’écolier vorace à lunettes ; et en effet, ce n’était qu’une dame de salle de cure pareille aux autres, d’ailleurs une brune courtaude et opulente, pas des plus jeunes, déjà un peu grisonnante, mais avec un double menton gracieux, et des yeux noirs et vifs. En aucune façon, elle n’aurait pu se mesurer sous le rapport de l’éducation avec l’épouse du consul Tienappel, là-bas, au pays plat. Mais le dimanche soir, dans le hall, le consul avait, grâce à une robe noire à paillettes, décolletée, découvert que Mme Redisch avait des seins, des seins de femme d’un blanc mat, très comprimés, et dont la séparation était visible très bas, et cette découverte avait ébranlé et enthousiasmé cet homme raffiné et d’âge mûr jusqu’au tréfonds de l’âme, comme si c’était là chose absolument neuve, insoupçonnée et inouïe. Il chercha et fit la connaissance de Mme Redisch, s’entretint longuement avec elle, d’abord debout ensuite assis, et alla se coucher en fredonnant. Le lendemain, Mme Redisch ne portait plus de toilette noire à paillettes, mais une robe montante ; le consul n’en savait pas moins ce qu’il savait et il demeura fidèle à ses impressions. Il tentait de rencontrer la dame aux promenades réglementaires pour marcher à côté d’elle, en bavardant, tourné vers elle d’une manière particulièrement charmante et seyante. Il buvait à sa santé à table, à quoi elle répondait en faisant briller dans un sourire les capsules d’or qui recouvraient plusieurs de ses dents, et, au cours d’une conversation avec son neveu, il déclara qu’elle était vraiment « une femme divine », après quoi il se remit à fredonner. Tout cela, Hans Castorp le subissait avec une indulgence paisible et comme s’il devait en être ainsi. Mais cela ne semblait guère consolider l’autorité de son parent et aîné et cela s’accordait assez mal avec la mission du consul.
Le repas, durant lequel Mme Redisch le salua de son verre levé – et cela à deux reprises, d’abord au poisson et ensuite au sorbet –, était le même que le docteur Behrens prit à la table de Hans Castorp et de son invité. (À tour de rôle il prenait en effet ses repas à chacune des sept tables, et partout un couvert lui était réservé à l’extrémité de la table.) Ses mains énormes jointes sur son assiette, il était assis avec sa moustache retroussée, entre M. Wehsal et le bossu mexicain auquel il parlait l’espagnol – car il possédait toutes les langues, même le turc et le hongrois – et il regarda de ses yeux bleus larmoyants, injectés de sang, le consul Tienappel saluer de son verre de bordeaux Mme Redisch, par-dessus la table. Plus tard, dans le cours du repas, le conseiller prononça une petite conférence, encouragé à cela par James qui, par-dessus toute la longueur de la table, posa à l’improviste la question suivante : Que devenait l’homme lorsqu’il se décomposait ? Le conseiller, dit-il, avait naturellement étudié tout ce qui concernait le corps, le corps était sa spécialité, il était en quelque sorte le prince du corps, si l’on pouvait s’exprimer ainsi, et il devait donc raconter ce qui se passait lorsque le corps se décomposait.
– Avant tout, votre ventre éclate, répondit le conseiller, en s’appuyant sur les coudes, penché sur ses mains jointes. « Vous êtes là sur vos copeaux et sur votre sciure, et les gaz, comprenez-vous, montent, ils vous gonflent, comme de vilains garnements font avec les grenouilles qu’ils remplissent d’air. Pour finir, vous êtes un vrai ballon, et puis votre ventre ne supporte plus la pression et il crève. Patatras ! Vous vous allégez sensiblement, vous faites comme Judas lorsqu’il tomba de sa branche, vous vous videz. Voui, et après cela vous redevenez tout à fait comme il faut. Si l’on vous accordait une permission, vous pourriez retourner voir vos parents survivants sans les choquer particulièrement. On appelle cela avoir cessé d’empester. Si ensuite on se rend à l’air libre, on est quand même encore un type tout à fait convenable, comme les citoyens de Palerme qui sont pendus dans les couloirs souterrains des capucins de Porta Nuova. Secs et élégants, ils sont pendus là et jouissent de l’estime générale. L’important c’est d’avoir cessé d’empester.
– Bien entendu ! dit le consul. Je vous remercie infiniment. Et le lendemain matin il avait disparu.
Il n’était plus là, parti par le tout premier train pour la plaine, naturellement non sans avoir tout réglé. Qui aurait pu supposer le contraire ? Il avait réglé sa note, avait versé son dû pour la consultation qui avait eu lieu ; en toute discrétion, sans en souffler un traître mot à son parent, il avait préparé ses deux valises – sans doute cela s’était-il fait le soir, ou vers le matin, à une heure encore nocturne – et lorsque Hans Castorp, vers le moment du premier déjeuner, pénétra dans la chambre de son oncle, il la trouva vide.
Les mains sur les manches, il dit : « Tiens, tiens ! » Il arriva alors qu’un sourire mélancolique se dessina sur ses traits. « Ah oui ? » dit-il, et il hocha la tête. Ici quelqu’un avait levé le pied. En coup de tête, dans une hâte silencieuse, comme s’il devait profiter d’un instant de résolution et surtout ne pas manquer cet instant, il avait jeté ses affaires dans la valise et était parti : seul, non pas accompagné, non pas après avoir rempli son honorable mission, mais trop heureux encore d’en réchapper sain et sauf : bourgeois fuyant vers le drapeau du pays plat. Allons, bon voyage, oncle James !
Hans Castorp ne laissa voir à personne qu’il n’avait rien su du départ imminent de son parent et visiteur, surtout pas au boiteux qui avait accompagné le consul jusqu’à la gare. Il reçut une carte postale du lac de Constance qui l’informait que James avait été, par un télégramme, rappelé de toute urgence et pour affaires dans la plaine. Il n’avait pas voulu déranger son neveu. Un mensonge de pure forme. Bon séjour, à l’avenir ! « Était-ce une raillerie ? En ce cas, c’était une moquerie assez forcée, jugea Hans Castorp, car l’oncle n’avait certainement pas pensé à plaisanter lorsqu’il était parti précipitamment, mais il avait constaté en lui-même, il avait pensé, blême de terreur, que si, dès maintenant, après un séjour d’une semaine, il retournait au pays plat, il aurait pendant quelque temps là-bas l’impression qu’il était faux, peu naturel, et interdit de ne pas faire après le premier déjeuner une promenade réglementaire, et de ne pas s’allonger horizontalement en plein air, enveloppé de couvertures selon le rite, mais de se rendre au lieu de cela à son bureau. Et cette constatation effrayante avait été la raison immédiate de sa fuite.
Ainsi s’acheva la tentative faite par le pays plat pour s’emparer de nouveau de Hans Castorp qui s’en était évadé. Le jeune homme ne se dissimula pas que l’échec complet qu’il avait prévu était d’une importance décisive pour ses rapports avec les gens de là-bas. Cela signifiait que le pays plat renonçait à lui en haussant les épaules ; mais pour lui cela signifiait la liberté parfaite qui peu à peu avait cessé de faire frémir son cœur.
OPERATIONES SPIRITUALES
Léon Naphta était originaire d’un petit bourg, dans le voisinage de la frontière de Galicie et de Volhynie. Son père dont il parlait avec estime, – il paraissait conscient d’être suffisamment éloigné de son ancien milieu pour pouvoir le juger avec bienveillance, – avait été schohet, boucher rituel, – et combien ce métier avait été différent de celui qu’exerçait le boucher chrétien qui était un commerçant et un artisan ! Il n’en était pas de même du père de Léon. Celui-ci était fonctionnaire, un fonctionnaire qui relevait du sacerdoce. Élu par le rabbin pour ses pieuses aptitudes, autorisé par lui à abattre le bétail d’après la loi de Moïse et conformément aux préceptes du Talmud, Élie Naphta, dont les yeux bleus avaient eu, à en croire le portrait que traçait de lui son fils, un rayonnement d’étoiles, et avaient été tout chargés d’une sereine spiritualité, avait en lui-même dans tout son être quelque chose de sacerdotal qui rappelait qu’aux temps anciens, abattre le bétail avait été l’emploi du prêtre. Lorsque Léon, ou Leib, comme on l’avait appelé dans son enfance, avait vu son père remplir ses fonctions rituelles, avec le secours d’un formidable aide, jeune homme de type juif, mais véritable athlète, à côté duquel le frêle Élie, avec sa barbe blonde, paraissait encore plus fragile et plus délicat, lorsqu’il l’avait vu brandir contre l’animal ligoté et bâillonné, mais non pas étourdi, son grand coutelas consacré, et lui porter une entaille profonde dans la région de la vertèbre cervicale, tandis que l’aide recueillait le sang fumant qui jaillissait, en des écuelles aussitôt pleines, le jeune garçon avait considéré ce spectacle de ce regard d’enfant qui par-delà les apparences sensibles pénètre jusqu’à l’essentiel, d’un regard qui était bien celui du fils d’Élie aux yeux étoilés. Il savait que les bouchers chrétiens étaient tenus d’étourdir leurs bêtes d’un coup de massue ou de hache avant de les tuer, et que cette prescription leur avait été faite afin d’éviter aux animaux un traitement trop cruel ; tandis que son père, bien qu’il fût tellement plus délicat et plus sage que ces rustauds, bien qu’il eût des yeux étoilés comme aucun d’entre eux, agissait selon la loi, en portant à la créature non étourdie le coup qui l’égorgeait, et en la laissant perdre son sang jusqu’à ce qu’elle s’écroulât. Le jeune Leib avait le sentiment que la méthode de ces lourdauds de goy était déterminée par une sorte de bonté nonchalante et profane par laquelle le même honneur n’était pas rendu à cet acte sacré que par la cruauté solennelle dont usait son père, et l’idée de piété s’était liée chez lui à celle de cruauté, de même que, dans son imagination, l’aspect et l’odeur du sang qui jaillissait étaient liés à l’idée de ce qui est sacré. Car il voyait bien que son père n’avait pas choisi ce métier sanglant par le même goût brutal qui y avait incliné de jeunes et vigoureux chrétiens, voire même son propre aide juif, mais pour des raisons spirituelles, – malgré sa fragilité physique, et en quelque sorte, dans le sens de ses yeux étoilés.
En effet, Élie Naphta avait été un rêveur et un penseur, non seulement un explorateur de la Thora, mais encore un critique des Écritures, dont il discutait des principes avec le rabbin en se querellant assez souvent avec lui. Dans sa contrée, – et non pas seulement chez ses coreligionnaires – il avait passé pour un être d’une espèce particulière, pour quelqu’un qui en savait plus long que les autres, – en partie par dévotion, mais d’autre part d’une manière qui pouvait n’être pas tout à fait régulière et qui, de toute façon, ne correspondait pas à l’ordre établi. Il y avait en lui quelque chose d’irrégulier propre aux sectaires, quelque chose d’un confident de Dieu, d’un Baal-Schem ou d’un Zaddik, c’est-à-dire d’un thaumaturge, d’autant plus qu’il avait, en effet, guéri un jour une femme d’une éruption, qu’une autre fois il avait guéri un jeune garçon de convulsions, et cela par du sang et des versets. Mais précisément cette auréole d’une piété quelque peu téméraire, dans laquelle l’odeur du sang jouait un rôle, avait causé sa perte. Car, à l’occasion d’un mouvement populaire et d’une panique furieuse provoquée par le meurtre inexpliqué de deux enfants de Chrétiens, Élie avait péri d’une mort effrayante : on l’avait trouvé crucifié avec des clous à la porte de sa maison incendiée, après quoi sa femme, bien qu’elle fût phtisique et alitée, avait quitté le pays, avec son fils Leib et ses quatre cadets, tous criant et gémissant, les bras levés.
Non entièrement dépourvue de ressources grâce à la prévoyance d’Élie, la famille éprouvée avait trouvé un asile dans une petite ville du Voralberg, où Mme Naphta avait obtenu, dans une filature de coton, un emploi, dont elle s’acquitta aussi longtemps que ses forces le lui permirent, cependant que les aînés de ses enfants allaient à l’école primaire. Mais, si les disciplines intellectuelles de cette école suffisaient au tempérament et aux besoins des frères et sœurs de Léon, cela ne fut guère le cas de l’aîné. De sa mère, il tenait le germe de la phtisie, mais de son père, outre la petite taille, il avait hérité une intelligence exceptionnelle, des dons intellectuels qui ne tardèrent pas à s’allier à des instincts plus ambitieux, à la nostalgie poignante de formes de vie plus aristocratiques, et qui lui inspirèrent un besoin passionné de s’élever au-dessus de ses origines. En dehors de l’école, l’adolescent de quatorze ou quinze ans avait formé son esprit, impatiemment et sans suite, à l’aide de livres qu’il avait su se procurer, et dont il avait alimenté son intelligence. Il pensait et formulait des choses qui amenaient sa mère maladive à courber la tête entre les épaules et à lever ses deux mains maigres. Par sa manière, par ses réponses, il attira durant l’enseignement religieux l’attention du rabbin du canton, un homme pieux et savant qui fit de lui son élève particulier et qui satisfit son besoin de forme par un enseignement hébreu et classique, ses besoins de logique en l’initiant aux mathématiques. Mais la sollicitude du brave homme devait être mal récompensée ; il ne tarda pas à se rendre compte qu’il avait réchauffé un serpent dans son sein. On ne s’accorda plus, il y eut entre le maître et l’élève des frictions religieuses et philosophiques qui s’aggravèrent de plus en plus ; et l’honnête docteur eut beaucoup à souffrir de la rébellion intellectuelle, du penchant à la critique et au scepticisme, de l’esprit de contradiction, de la dialectique tranchante du jeune Léon. Il s’ajouta à cela que l’ingéniosité et l’esprit séditieux de Léon avaient fini par prendre un caractère révolutionnaire : la connaissance qu’il avait faite du fils d’un membre socialiste du Reichstag, et de ce démagogue lui-même, avait orienté son esprit vers la politique, avait dirigé sa passion de logicien dans un sens hostile à la société. Il prononçait des paroles qui faisaient se dresser les cheveux sur la tête du bon talmudiste, féru de loyalisme, et qui achevèrent de mettre fin à l’entente entre le maître et l’élève. Bref, les choses en étaient arrivées au point où Naphta avait été maudit et à jamais banni de son cabinet de travail, et cela précisément à l’époque où sa mère, Rachel Naphta, était mourante.
C’est en ce temps aussi, peu après le décès de sa mère, que Léon avait fait la connaissance du père Unterpertinger. Le jeune homme, âgé de seize ans, était assis, solitaire, sur un banc du parc du Margaretenkopf, une éminence à l’ouest de la petite ville, au bord de l’Ill, d’où l’on jouissait d’une vue étendue et claire sur la vallée du Rhin. Il était assis là, perdu en des pensées amères et tristes sur son destin, sur son avenir, lorsqu’un professeur de l’institution jésuite « l’Étoile matutine » qui se promenait dans le parc, prit place à côté de lui, posa son chapeau, croisa les jambes sous sa soutane de prêtre mondain, et après avoir lu quelque temps son bréviaire, engagea une conversation qui se poursuivit avec beaucoup d’animation et qui devait décider du destin de Léon. Le jésuite, un homme d’expérience, d’une excellente éducation, pédagogue par passion, connaisseur et pêcheur d’hommes, écouta avec attention les premières phrases sarcastiques et clairement articulées par lesquelles le minable jeune juif répondait à ses questions. Une spiritualité aiguë et tourmentée se dégageait du jeune Naphta, et, en pénétrant plus avant, le jésuite se heurta à une science et à une élégance de pensée que l’apparence négligée du jeune homme faisait paraître d’autant plus surprenantes. On parla de Karl Marx, dont Léon Naphta avait étudié le Capital dans une édition populaire, et de là on passa à Hegel, qu’il avait assez lu ou sur lequel il avait assez lu pour formuler quelques remarques frappantes. Soit par une tendance générale au paradoxe, soit dans une intention de politesse, il appela Hegel un penseur « catholique » ; et lorsque le père, en souriant, lui demanda, sur quoi il pouvait bien fonder pareil jugement, puisque Hegel, en sa qualité de philosophe prussien de l’État, devait être considéré comme essentiellement et spécifiquement protestant, il répondit que justement ce mot, « philosophe de l’État » confirmait qu’au sens religieux, sinon, naturellement, au sens dogmatique et ecclésiastique, il était fondé à parler du catholicisme de Hegel. Car (Naphta affectionnait tout particulièrement cette conjonction, elle prenait quelque chose de triomphant et d’impitoyable dans sa bouche, et ses yeux scintillaient, derrière les verres de ses lunettes, chaque fois qu’il pouvait l’insérer dans une phrase), car le concept de la politique était psychologiquement lié au concept du catholicisme, ils formaient une catégorie qui embrassait tout ce qu’il y avait d’objectif, d’actif, de réalisable, d’agissant et d’efficace. À cette catégorie s’opposait la sphère piétiste, protestante, issue du mysticisme. C’est dans le jésuitisme, ajouta-t-il, que la nature pédagogique et politique du catholicisme se traduisait à l’évidence ; cet ordre avait en effet toujours considéré l’art de la politique et l’éducation comme ses domaines propres. Et il cita encore Gœthe qui, plongeant ses racines dans le piétisme et incontestablement protestant, avait eu un côté nettement catholique, grâce à son réalisme et à sa doctrine de l’action. Il avait défendu la pratique de la confession, et, en tant qu’éducateur, s’était presque montré jésuite.
Que Naphta eût dit ces choses parce qu’il y croyait, parce qu’il les trouvait spirituelles, ou qu’il voulût plaire à son interlocuteur, en sa qualité de pauvre hère qui doit flatter et qui calcule avec précision ce qui peut le servir ou le desservir, toujours est-il que le père s’était intéressé moins à la sincérité de ces paroles qu’à l’intelligence qu’elles trahissaient, et la conversation s’était poursuivie. Le jésuite n’avait pas tardé à apprendre les conditions de l’existence personnelle de Léon, et la rencontre avait pris fin sur l’invitation adressée par Unterpertinger à Léon de venir le voir à l’institution.
C’est ainsi que Naphta avait pu mettre le pied sur le territoire de la Stella Matutina dont l’atmosphère scientifique et le niveau social élevé avaient depuis longtemps excité son imagination et sa nostalgie. Bien plus : grâce à cette tournure des choses il s’était assuré un nouveau maître et protecteur, mieux disposé que le précédent à encourager et à apprécier sa nature, un maître dont la bonté naturellement froide tenait à son expérience de la vie et dans le milieu duquel il éprouvait le plus vif désir de pénétrer ! À l’instar de beaucoup de Juifs spirituels, Naphta était d’instinct à la fois révolutionnaire et aristocrate ; socialiste, et en même temps possédé par le rêve d’accéder à des formes d’existence nobles et distinguées, exclusives et ordonnées. La première parole que lui avait arrachée la présence d’un théologien catholique, bien qu’elle se fût présentée comme une pure analyse comparée, avait consisté en une déclaration d’amour pour l’Église romaine qu’il estimait comme une puissance à la fois noble et spirituelle, c’est-à-dire antimatérielle, antiréelle, hostile au monde, et, par conséquent révolutionnaire. Et cet hommage était sincère et partait du fond de son être, car, ainsi qu’il l’expliqua lui-même, le judaïsme, grâce à son orientation vers le terrestre et l’objectif, grâce à son socialisme et à son esprit politique, était infiniment plus proche de la sphère catholique, lui était infiniment plus apparenté que le protestantisme, dans sa subjectivité mystique et individualiste, de sorte que la conversion d’un juif à la religion catholique constituait une évolution spirituelle beaucoup plus aisée que celle d’un protestant.
Brouillé avec le pasteur de sa communauté religieuse primitive, orphelin et abandonné, en outre impatient de respirer un air plus pur, de connaître des formes d’existence auxquelles ses dons lui donnaient droit, Naphta, qui avait depuis longtemps atteint la majorité légale, était si impatiemment prêt à franchir le seuil de la nouvelle confession que son initiateur se vit dispensé de la peine de gagner ce cerveau exceptionnel à sa religion. Encore avant qu’il reçût le sacrement du baptême, Léon avait, à l’instigation du père, trouvé dans la Stella un asile provisoire, sa nourriture matérielle et spirituelle. Il s’y était transporté en abandonnant avec la plus grande tranquillité d’âme et avec l’insensibilité de l’aristocrate de l’esprit, ses frères cadets à l’assistance publique et au sort que justifiaient leurs dons médiocres.
Le domaine de l’institution était étendu, de même que ses bâtiments qui pouvaient accueillir quatre cents internes. Il comprenait des forêts et des pâturages, une demi-douzaine de terrains de jeux, des fermes, des étables pour des centaines de têtes de bétail. L’institution était à la fois un pensionnat, une propriété modèle, une académie sportive, une pépinière de savants et un temple des muses. Car on y jouait sans cesse des pièces de théâtre et on y faisait de la musique. La vie y était à la fois seigneuriale et claustrale. Par la discipline et par l’élégance qui y régnaient, par sa gaieté discrète, par sa spiritualité, par son organisation minutieuse, par la précision de l’emploi du temps, elle flattait les instincts les plus profonds de Léon. Il était infiniment heureux. Il prenait ses excellents repas dans un vaste réfectoire, où le silence était la règle, de même que dans les couloirs de l’institution, et au milieu duquel un jeune préfet, assis devant un haut pupitre, faisait la lecture à haute voix. Son zèle à l’étude était ardent, et, malgré sa faiblesse, il faisait tous ses efforts pour tenir sa place, l’après-midi, dans les jeux sportifs. La piété avec laquelle il écoutait chaque matin la première messe et prenait part le dimanche à la grand-messe, devait réjouir les pères-pédagogues. Sa tenue et ses manières ne les satisfaisaient pas moins. Les jours de fête, l’après-midi, après avoir goûté de gâteaux et de vin, il allait se promener en uniforme gris et vert, avec un col montant, des pantalons rayés et une casquette.
Une reconnaissance émerveillée le pénétrait en présence des égards dont il jouissait en ce qui touchait son origine, son christianisme récent, sa situation personnelle en général. Personne ne semblait savoir qu’il bénéficiait d’une bourse dans l’établissement. Les règles de la maison détournaient l’attention, de ses camarades de ce fait qu’il n’avait pas de famille, pas de foyer. Il n’était permis à personne de recevoir des envois de victuailles ou de friandises. Ceux qui arrivaient malgré cela étaient répartis entre tous, et Léon lui aussi en recevait sa part. Le cosmopolitisme de l’institution empêchait que la race du jeune juif apparût d’une manière frappante. Il y avait là de jeunes étrangers, des Américains du Sud portugais qui paraissaient plus « juifs » que lui, et ainsi la notion s’en perdait. Le prince éthiopien qui avait été reçu en même temps que Naphta avait même un type de Maure crépu, mais néanmoins très distingué.
Dans la classe de rhétorique, Léon exprima le désir d’étudier la théologie pour appartenir un jour à l’ordre s’il en était digne. Dès lors, on avait transféré sa bourse du deuxième pensionnat, dont le régime était plus modeste, dans le « premier ». Il était maintenant servi à table par des domestiques, et sa chambre touchait d’un côté à celle d’un comte silésien von Harbuval et Chamaré, de l’autre à celle d’un marquis di Rangoni Santa Croce, de Modène. Il réussit brillamment ses examens et, fidèle à sa décision, quitta l’institution pour le noviciat du Tisis voisin, pour une vie d’humilité serviable, de discipline muette et d’entraînement religieux qui lui procurait des plaisirs de l’esprit empreints des conceptions fanatiques d’autrefois.
Cependant sa santé en souffrit ; elle souffrit moins directement de la dureté du noviciat qui ne laissait pas d’accorder des répits au corps, qu’en raison de sa vie intérieure. Malgré leur sagacité et leur ingéniosité, les procédés pédagogiques dont il était l’objet contrariaient ses dispositions personnelles et les stimulaient en même temps. Au cours des opérations spirituelles auxquelles il consacrait ses jours et encore une partie de ses nuits, durant tous ces examens, ces exercices et ces contemplations, par un esprit de chicane malicieux et passionné, il s’empêtrait dans mille difficultés, contradictions et contestations. Il était le désespoir – en même temps que la grande espérance – de ses directeurs spirituels à qui il faisait tous les jours ressentir tous les feux de l’enfer par sa fureur dialectique et par son manque d’ingénuité. « Ad haec quid tu ?[10] » demanda-t-il derrière ses verres de lunettes scintillants. Et il ne restait au père, pris à court, d’autre ressource que de l’exhorter à la prière, pour qu’il gagnât la paix du cœur : « Ut in aliquem gradum quietis in anima perveniat[11]. » Mais cette « paix » consistait, lorsqu’on l’obtenait, en un émoussement complet de la vie personnelle, elle vous réduisait à n’être plus qu’un simple instrument ; c’était la paix du cimetière dont le frère Naphta pouvait étudier les signes extérieurs inquiétants dans mainte physionomie au regard creux dans son entourage et à laquelle il ne réussirait, lui, à atteindre, qu’au prix de la ruine corporelle.
La haute tenue intellectuelle de ses supérieurs se traduisait dans le fait que ces réserves et ces objections ne faisaient pas tort à l’estime dont il jouissait auprès d’eux. Le père provincial lui-même le convoqua à la fin de sa deuxième année de noviciat, s’entretint avec lui, consentit à l’accueillir au sein de l’ordre ; et le jeune scolastique, qui avait reçu quatre ordinations inférieures, et fait également les vœux « simples », et qui désormais appartenait définitivement à la société, se rendit au Collège de Falkenbourg, en Hollande, pour commencer ses études de théologie.
Il avait alors vingt ans, et trois ans plus tard, sous l’influence d’un climat dangereux et de ses efforts intellectuels, son mal héréditaire avait fait de tels progrès qu’il n’eût pu persévérer qu’au péril de sa vie. Une hémorragie alarma ses supérieurs et, après que, plusieurs semaines, il eut flotté entre vie et mort, ils le renvoyèrent, à peine rétabli, dans ses foyers. Dans la même institution dont il avait été l’élève, il trouva un emploi comme préfet, surveillant des élèves internes et professeur d’humanités et de philosophie. Ce stage était d’ailleurs dans la règle, mais d’ordinaire on retournait après quelques années de service au Collège pour continuer ses sept années d’études théologiques et les terminer. Cela ne fut pas accordé au frère Naphta. Il continua d’être malade ; le médecin et les supérieurs jugèrent que le service en ce lieu, en plein air, avec les élèves et des occupations agricoles, lui convenait provisoirement. Il reçut bien le premier degré supérieur et gagna le droit de chanter l’Épître à l’office solennel du dimanche, droit que d’ailleurs il n’exerça pas, d’abord parce qu’il n’avait pas le moindre sens musical, et en second lieu parce que la fragilité extrême de sa voix le rendait tout à fait inapte à chanter. Il n’alla pas au-delà du sous-diaconat, et n’atteignit ni au diaconat ni à l’ordination de prêtre ; et comme l’hémorragie se renouvela, que la fièvre ne voulait pas prendre fin, il dut faire aux frais de l’ordre une cure prolongée ; il avait élu domicile à Davos et ce séjour touchait déjà à sa septième année. À peine était-ce encore une cure. C’était devenu une condition indispensable à la sauvegarde de sa vie, nécessité rendue moins pénible par son activité de professeur de latin au lycée des malades…
Ces choses et d’autres détails plus amples et plus précis, Hans Castorp les apprit, au cours de leurs conversations, de la bouche de Naphta lui-même, lorsqu’il lui rendait visite, dans sa cellule tendue de soie, seul ou bien en compagnie de ses voisins de table Ferge et Wehsal, qu’il avait présentés à Naphta ; ou c’était lorsqu’il le rencontrait durant sa promenade et s’en retournait en sa compagnie vers Dorf, qu’il les apprenait au petit hasard, par bribes ou sous forme de récits cohérents, et, non seulement, il les trouvait pour sa part fort curieuses, mais encore il incitait Ferge et Wehsal à les trouver telles, ce à quoi ils ne manquaient pas : le premier, il est vrai, en spécifiant que toutes les choses élevées lui étaient étrangères (car seule l’aventure du choc à la plèvre l’avait entraîné au-delà des contingences humaines les plus humbles, le deuxième, par contre, avec une sympathie visible pour la carrière fortunée d’un homme parti de très bas, et à laquelle la maladie qu’ils avaient en commun avait posé un obstacle pour en arrêter l’essor démesuré.
Hans Castorp pour sa part regrettait cette interruption, et il pensait avec orgueil et appréhension à son Joachim, l’homme d’honneur qui, par un effort héroïque, avait déchiré les rets résistants du verbiage de Rhadamante et qui s’était enfui vers son drapeau à la hampe duquel Hans Castorp imaginait qu’il devait se cramponner à présent, levant trois doigts de sa main droite pour prêter le serment de fidélité. Naphta avait, lui aussi, fait serment à un drapeau, lui aussi s’était mis sous sa protection comme lui-même s’exprimait lorsqu’il renseignait Hans Castorp sur la règle de son ordre ; mais, apparemment, avec ses idées et ses combinaisons particulières il lui était moins fidèle que Joachim au sien. Cependant, Hans Castorp, lorsqu’il prêtait l’oreille, lui, civil et enfant de la paix au ci-devant ou futur Jésuite, il se sentait confirmé dans son opinion que chacun des deux devait avoir de la sympathie pour l’état et le métier de l’autre, et le ressentir comme apparenté au sien propre. Car c’étaient des castes militaires ; l’une comme l’autre, et cela à maints égards : sous le rapport de l’ascétisme aussi bien que de la hiérarchie, de l’obéissance et de l’honneur espagnol. Ce dernier surtout régnait dans l’ordre de Naphta, lequel était d’ailleurs d’origine espagnole et dont la règle des exercices spirituels, une sorte de contre-partie de celui que Frédéric de Prusse avait par la suite imposé à son infanterie, avait été primitivement rédigée en langue espagnole, ce qui amenait Naphta à se servir fréquemment d’expressions espagnoles dans ses récits et ses communications. C’est ainsi qu’il parlait des dos banderas, des deux bannières, autour desquelles les armées s’assemblaient en vue de la grande bataille : celle de l’Enfer et celle de l’Église, l’une dans la région de Jérusalem où commandait Jésus, le capitan general de tous les justes, l’autre dans la plaine de Babylone dont Lucifer était le caudillo ou le chef de bande…
L’institution de l’« Étoile matutine » n’avait-elle pas été une véritable école de cadets, dont les élèves, groupés par « divisions », avaient été tenus d’observer vaillamment une bienséance mi-ecclésiastique, mi-militaire, une combinaison de « faux col amidonné » et de « collerette espagnole », si l’on pouvait s’exprimer ainsi ? L’idée d’honneur et de noblesse qui jouait un rôle si brillant dans le métier de Joachim, avec quelle netteté, pensait Hans Castorp, n’apparaissait-elle pas dans celui dans lequel Naphta avait malheureusement, à cause de sa maladie, fait une carrière si courte ! Si on l’en croyait, cet ordre ne se composait que d’officiers extrêmement ambitieux qui n’étaient animés que de la seule pensée de se distinguer dans le service. (Insignes esse disait-on en latin.) D’après la doctrine et la règle du fondateur et premier général, de Loyola l’Espagnol, ils rendaient plus de services, de plus magnifiques services que tous ceux qui n’agissaient que par bon sens. Bien plus, ils accomplissaient leur œuvre, ex supererogatione, au-delà de leur devoir, non pas seulement en résistant à la rébellion de la chair (rebellioni carnis), ce qui n’était en somme rien de plus que le fait de tout homme sain et de bon sens mais en combattant les tendances à la sensualité, à l’amour-propre et à l’amour de la vie, même en des choses qui étaient permises au vulgaire. Car agir en combattant l’ennemi, agere contra, attaquer par conséquent, était plus honorable que se borner à se défendre (resistere). Affaiblir et briser l’ennemi, disait le règlement de service de campagne ; et son auteur, Loyola l’Espagnol, était, une fois de plus, complètement d’accord avec le capitan general de Joachim, Frédéric de Prusse et sa règle de guerre : « Attaquer ! attaquer ! Foncer sur l’ennemi ! Attaquez donc toujours ! »
Mais ce qui était surtout commun à l’univers de Naphta et à celui de Joachim, c’était leur sentiment à l’égard du sang versé et leur axiome qu’il ne fallait pas s’en abstenir : c’est en cela surtout que comme mondes, comme ordres et comme états ils s’accordaient strictement, et pour un enfant de la paix il était très intéressant d’entendre Naphta parler des types de moines guerriers du moyen âge, qui, ascètes jusqu’à l’épuisement et cependant avides de conquêtes spirituelles, n’avaient pas épargné le sang pour avancer l’avènement de l’État de Dieu, celui du règne du surnaturel sur la terre ; de templiers combatifs qui avaient jugé plus méritoire la mort dans la bataille contre les mécréants que la mort dans leur lit, et qui avaient estimé qu’être tué ou tuer pour l’amour de Jésus-Christ n’était pas un crime, mais la gloire suprême. Il était heureux que Settembrini n’entendît pas ces discours ! Le joueur d’orgue n’aurait pas manqué d’y couper court en embouchant la trompette de la paix ; il y avait bien dans son propre programme la guerre sainte, nationale et civilisatrice, contre Vienne, qu’il acceptait, et Naphta reprenait équitablement cette passion et cette défaillance de l’adversaire par le sarcasme et le mépris. Du moins, toutes les fois que l’Italien s’échauffait à exprimer de pareils sentiments. Naphta affichait un cosmopolitisme chrétien, disait tantôt que tous les pays étaient sa patrie, tantôt qu’aucun d’entre eux ne l’était, et répétait d’un ton tranchant la parole d’un général de l’ordre, nommé Nickel, d’après lequel l’amour de la patrie était « une peste et la mort certaine de l’amour chrétien ».
Bien entendu, c’était au nom de l’ascétisme que Naphta traitait le patriotisme de peste, car que n’entendait-il pas sous ce mot ? Qu’y avait-il qui ne contrariait pas, à son avis, l’ascétisme et le royaume de Dieu ? Non seulement l’attachement à la famille et au pays, mais encore à la santé et à la vie : c’est précisément cet attachement qu’il reprochait à l’humaniste lorsque celui-ci prêchait la paix et le bonheur ; il l’accusait en le querellant d’aimer la chair, d’amor carnalis, d’aimer les commodités personnelles, amor commodorum corporis, et il lui déclarait en pleine figure que c’était une irréligion de philistin que d’accorder la moindre importance à la vie et à la santé. Cela avait été dit au cours de la grande controverse sur la santé et la maladie qui s’engagea, un jour, déjà très près de Noël, durant l’aller et retour d’une promenade dans la neige jusqu’à Platz, au sujet de ces divergences, à laquelle tous prirent part : Settembrini, Naphta, Hans Castorp, Ferge et Wehsal, tous légèrement fiévreux, à la fois étourdis et excités à force de marcher et de causer dans le froid glacial des altitudes ; tous, ils étaient secoués de frissons ; que leur rôle fût actif comme celui de Naphta et de Settembrini, ou passif et se limitât à de brèves interventions, tous y prenaient part avec un zèle si ardent que, oubliant tout, ils s’arrêtaient souvent, formant un groupe profondément absorbé qui gesticulait, parlait à tort et à travers, et obstruait le passage sans s’occuper des étrangers qui devaient les contourner à moins qu’ils ne s’arrêtassent également et prêtassent une oreille surprise à ces divagations à perte de vue.
La discussion avait eu pour point de départ Karen Karstedt, la pauvre Karen aux bouts de doigts sanguinolents qui était morte récemment. Hans Castorp n’avait rien appris de l’aggravation subite de son état, ni de son exitus ; sinon, il aurait assisté en camarade à son enterrement, d’autant plus qu’il avouait son goût pour les obsèques en général. Mais la discrétion d’usage avait fait qu’il apprit trop tard le départ de Karen et qu’elle était déjà entrée dans le jardin du bambino au bonnet de neige posé de travers pour prendre une position définitivement horizontale. Requiem aeternam… Il dédia à sa mémoire quelques paroles amicales, ce qui amena Settembrini à s’exprimer en termes railleurs sur l’activité charitable de Hans, sur ses visites chez Leila Gerngross, chez l’industrieux Rotbein, chez Mme Zimmerman la « trop pleine », au présomptueux fils de « Tous les deux » et à la malheureuse Natalie von Mallinckrodt ; et à se moquer encore des fleurs coûteuses par lesquelles l’ingénieur avait rendu hommage à toute cette bande misérable autant que ridicule. Hans Castorp, là-dessus, avait fait remarquer que les bénéficiaires de ses attentions, à l’exception provisoire de Mme de Malinckrodt et du jeune Teddy, étaient effectivement décédés, sur quoi M. Settembrini demanda si par hasard cela les rendait plus respectables. Mais n’y avait-il pas pourtant quelque chose, riposta Hans Castorp, que l’on appelait le respect chrétien devant la détresse ? Et avant que Settembrini eût pu le rappeler à l’ordre, Naphta commença à parler de pieux excès de la charité qu’avait connus le moyen âge, de cas étonnants de fanatisme et d’exaltation dans les soins donnés aux malades : des filles de rois avaient baisé les plaies puantes de lépreux, s’étaient volontairement exposées à la contagion de la lèpre, avaient appelé leurs roses les ulcères qui se formaient sur leur corps, avaient bu l’eau où s’étaient lavés des malades purulents et avaient déclaré ensuite que rien ne leur avait jamais semblé meilleur.
Settembrini fit semblant d’avoir envie de vomir. C’était moins ce qu’il y avait de physiquement répugnant dans ces images et ces représentations qui lui retournait l’estomac, que le monstrueux égarement dont témoignait une telle conception de la charité active. Il se redressa en une attitude de dignité tranquille en parlant de formes modernes de la charité humanitaire, de la victoire remportée sur les maladies contagieuses et en opposant l’hygiène, les réformes sociales et les hauts faits de la science médicale à toutes ces horreurs.
Mais ces choses honorables et bourgeoises, répondit Naphta, n’auraient été que de peu d’utilité aux siècles qu’il venait d’évoquer ; ils auraient servi aussi peu aux malades et aux misérables qu’aux bien-portants et aux heureux qui s’étaient montrés charitables, moins par pitié que pour le salut de leur âme. Car une réforme sociale couronnée de succès aurait privé les uns d’un moyen de se justifier, les autres, de leur état sacré. C’est pourquoi le maintien de la pauvreté et de la maladie était dans l’intérêt des deux parties, et cette conception restait valable aussi longtemps qu’il était possible de s’en tenir au point de vue purement religieux.
Un point de vue crasseux, déclara Settembrini, et une conception dont il hésitait à s’abaisser jusqu’à combattre la niaiserie. Car l’idée de la pauvreté sacrée, de même que ce que l’ingénieur avait répété de très peu personnel sur le « respect chrétien du malheur », était de la blague, était pure illusion, intuition fallacieuse, lapsus psychologique. La pitié que l’homme bien portant témoignait au malade, et qu’il poussait jusqu’au respect, parce qu’il ne pouvait pas imaginer comment il aurait pu supporter le cas échéant de telles souffrances, cette pitié était très exagérée, elle n’était pas du tout due au malade, et elle était le résultat d’une erreur de raisonnement et d’imagination, dans la mesure même où l’homme bien portant prêtait au malade sa propre manière de vivre, et s’imaginait que le malade était en quelque sorte un homme bien portant qui devait supporter les tortures d’un malade, – ce qui est une profonde méprise. Le malade, en effet, était un malade, avec le caractère particulier et la sensibilité modifiée qu’impliquait la maladie ; celle-ci altère l’homme de façon qu’il s’adapte à elle ; il y a là des phénomènes de sensibilité atrophiée, des états d’inconscience, des étourdissements bienfaisants, toutes sortes de subterfuges et d’expédients spirituels et moraux, dont le bien-portant, dans sa naïveté, oublie de tenir compte. Le meilleur exemple en était donné par toute cette racaille de poitrinaires qu’on voyait ici, avec leur légèreté, leur bêtise et leur débauche, avec leur manque d’empressement à récupérer la santé. Bref, si l’homme bien portant, qui faisait montre de cette pitié respectueuse, était lui-même malade et non plus bien portant, il se rendrait compte que la maladie est en effet un état particulier mais nullement un état honorable, et qu’il l’a prise beaucoup trop au sérieux.
Ici, Antoine Carlovitch Ferge protesta et prit la défense du choc à la plèvre contre les diffamations et les manques d’égards. Comment ? Qu’est-ce à dire ? Pris trop au sérieux, son choc à la plèvre ? Merci bien, à la bonne heure ! Sa pomme d’Adam vaillante et sa moustache joviale montaient et descendaient, et il se révoltait de ce qu’on dédaignât ce qu’il avait subi. Il n’était qu’un homme simple, représentant d’une compagnie d’assurances, et toutes les choses élevées lui étaient étrangères ; cette conversation dépassait déjà de beaucoup son horizon. Mais si M. Settembrini voulait par hasard impliquer le choc à la plèvre dans ce qu’il avait dit, – cet enfer de chatouillement, avec cette puanteur sulfureuse et les trois syncopes de couleurs différentes, – il était obligé de protester et de dire mille fois merci. Car dans ce cas-là il n’avait pas été question le moins du monde de sensibilité diminuée, d’étourdissements charitables ni d’erreurs d’imagination, mais c’était la plus grande et la plus dégoûtante saloperie sous le soleil, et quiconque n’en avait pas fait l’expérience comme lui, ne pouvait d’une telle infamie avoir la moindre…
– Mais oui, mais oui, dit Settembrini. L’accident de M. Ferge devient de plus en plus grandiose à mesure que le temps passe, et il finit par le porter autour de la tête comme une auréole. Quant à lui, Settembrini, il faisait peu de cas des malades qui prétendaient avoir droit à l’admiration. Lui-même était malade, et pas légèrement ; mais, sans qu’il y mît la moindre affectation, il était plutôt tenté d’en avoir honte. D’ailleurs, il parlait d’une manière impersonnelle, philosophique, et ce qu’il avait fait observer sur les différences entre la nature et les sensations du malade et de l’homme bien portant était parfaitement fondé, il suffisait à ces messieurs de penser aux maladies mentales, aux hallucinations par exemple. Si un de ses compagnons actuels, l’ingénieur par exemple, ou M. Wehsal, devait apercevoir ce soir dans le crépuscule feu monsieur son père dans un angle de la chambre qui le regarderait et lui parlerait, ce serait là pour la personne en question une véritable énormité, un élément bouleversant et troublant au suprême degré qui le ferait douter de ses sens, de sa raison, et le déciderait à évacuer aussitôt sa chambre et à se faire soigner les nerfs. N’avait-il pas raison ? Mais la plaisanterie consistait justement en ceci que cela ne pouvait en aucune façon arriver à ces messieurs puisqu’ils étaient sains d’esprit. Si pareille chose leur arrivait, ils ne seraient plus sains, mais malades, et ne réagiraient plus comme un homme bien portant, c’est-à-dire par l’effroi et en prenant la fuite, mais ils accepteraient cette apparition comme si elle était tout à fait normale et ils engageraient une conversation avec elle, comme c’était précisément le cas des hallucinés. Et croire que l’hallucination constituait pour ceux-ci un sujet d’épouvante saine, c’était justement là l’erreur d’imagination que commettait le non-malade.
M. Settembrini parlait d’une manière bien comique et plastique du père défunt dans le coin de la chambre. Tous furent forcés de rire, y compris Ferge, bien qu’il se sentît blessé par le dédain que l’on montrait pour son aventure infernale. L’humaniste, de son côté, tira parti de cette animation pour commenter et motiver plus longuement le peu de cas qu’il faisait des hallucinés et, en général, de tous les pazzi. Ces gens, dit-il, se permettaient trop de choses, et souvent, il ne tiendrait qu’à eux de contenir leur démence comme lui-même avait pu l’observer pendant des visites qu’il avait faites dans des asiles d’aliénés. Car, lorsqu’un médecin ou un étranger paraissaient sur le seuil, l’halluciné arrêtait le plus souvent ses grimaces, ses discours et ses gesticulations, et se tenait convenablement aussi longtemps qu’il se savait observé pour se laisser ensuite aller de nouveau. La démence signifiait donc incontestablement dans beaucoup de cas un laisser-aller, en ce sens qu’elle servait à des natures faibles de refuge et d’abri contre un grand chagrin ou contre un coup du sort que de tels hommes ne se jugeaient pas capables de supporter en toute lucidité. Mais tout le monde pourrait en dire autant, et lui-même, Settembrini, avait déjà ramené, tout au moins passagèrement, à la raison, bien des fous par son seul regard, et en opposant à ces divagations une attitude impitoyablement logique.
Naphta eut un rire sarcastique, tandis que Hans Castorp protesta qu’il croyait à la lettre ce que M. Settembrini lui avait dit. Lorsqu’il se figurait comment celui-ci avait dû sourire sous sa moustache et avait dû regarder dans les yeux du faible d’esprit, avec une raison aussi inflexible, il comprenait bien que le pauvre diable avait dû rassembler ses sens et faire honneur à la clarté, encore que, naturellement, il dût avoir éprouvé la venue de M. Settembrini comme un dérangement assez mal venu. Mais Naphta, lui aussi, avait visité des asiles d’aliénés et il se souvenait d’être passé par le pavillon des agités, où des scènes et des images s’étaient présentées à lui, devant lesquelles, mon Dieu, le regard raisonnable et l’influence salutaire de M. Settembrini n’auraient sans doute servi de rien : des scènes dignes de Dante, des images grotesques de l’angoisse et du tourment ; des fous accroupis tout nus dans leur bain, prenant toutes les poses de l’angoisse, de l’épouvante et de la stupeur, quelques-uns criant leur douleur, d’autres, les bras levés et bouche bée, poussant des rires où tous les éléments de l’enfer s’étaient mêlés…
– Ah, ah ! dit M. Ferge, et il prit la liberté de rappeler son propre rire qui lui avait échappé lorsqu’il était tombé en syncope.
En bref, la pédagogie impitoyable de M. Settembrini aurait dû plier bagage devant les visions du pavillon des agités ; devant elles le frisson d’un recueillement religieux aurait quand même été une réaction plus humaine que ces prétentions moralisatrices de la raison que notre lumineux chevalier du soleil et vicaire de Salomon se plaisait ici à opposer à la démence.
Hans Castorp n’eut pas le temps de s’occuper des titres que Naphta venait de nouveau de décerner à M. Settembrini. Il se proposa d’y revenir à la première occasion. Mais pour le moment la conversation se poursuivait, absorbait toute son attention. Car Naphta commentait précisément avec sévérité les tendances générales qui déterminaient l’humaniste à rendre par principe tous les honneurs à la santé et à diminuer et déshonorer autant que possible la maladie, point de vue qui témoignait naturellement d’un désintéressement remarquable et presque louable, puisque M. Settembrini était lui-même malade. Mais son attitude, que sa dignité exceptionnelle n’empêchait pas de reposer sur l’erreur, résultait d’une estime et d’une déférence à l’égard du corps qui n’auraient été justifiées que si le corps s’était encore trouvé dans son état originel, plus proche de Dieu, au lieu de se trouver dans un état de dégradation, in statu degradationis. Car, créé immortel, il avait été voué, par suite de la corruption de la nature par le péché originel, à la perversité et au dégoût ; il était mortel et périssable, il n’était rien de plus qu’une prison de l’âme, propre tout au plus à éveiller le sentiment de la honte et de la confusion, pudoris et confusionis sensum, comme disait saint Ignace.
C’est ce sentiment, s’écria Hans Castorp, que l’humaniste Plotin avait notoirement exprimé. Mais M. Settembrini, rejetant le bras par-dessus la tête et hors de l’articulation scapulaire, l’engagea à ne pas confondre les points de vue et à se borner plutôt à écouter.
Cependant Naphta expliquait le respect que le moyen âge chrétien avait témoigné à la misère du corps, par l’approbation religieuse qu’il avait accordée à la souffrance de la chair. Car les ulcères du corps ne rendaient pas seulement évidente sa déchéance, mais encore ils correspondaient à la vénéneuse perversité de l’âme d’une manière édifiante et satisfaisante pour l’esprit, tandis que la beauté du corps était un phénomène trompeur et offensant pour la conscience, phénomène que l’on faisait bien de repousser en s’humiliant profondément devant l’infirmité. Quis me liberabit de corpore mortis hujus ? Qui me délivrera du corps de cette mort ? C’était la voix même de l’esprit qui était, à jamais, la voix de l’humanité véritable.
Non, c’était une voix nocturne, d’après l’opinion que M. Settembrini avança avec émotion, la voix d’un monde auquel le soleil de la vertu et de l’humanité n’était pas encore apparu. Certes, il avait gardé, bien qu’intoxiqué quant à sa personne physique, un esprit assez sain et non pestiféré pour faire pièce au clérical Naphta sur le problème du corps et pour se moquer agréablement de l’âme. Il poussait la présomption jusqu’à célébrer le corps de l’homme comme le véritable temple de Dieu, sur quoi Naphta déclara que ce tissu n’était pas autre chose que le voile tendu entre nous et l’éternité, ce qui eut pour effet que Settembrini lui interdit définitivement de se servir du mot « humanité » ; et ainsi de suite…
Avec des visages figés par le froid, tête nue, marchant dans leurs caoutchoucs, tantôt sur la couche de neige dure, crissante et couverte de cendres, qui surélevait le trottoir, tantôt labourant des pieds la neige compacte et molle de la chaussée, – Settembrini vêtu d’un paletot d’hiver dont le col et les revers de castor semblaient galeux à force d’être usés mais qu’il portait avec élégance, Naphta dans une pelisse noire, complètement fermée, tombant jusqu’aux pieds, et qui, entièrement doublée de fourrure, n’en laissait rien apparaître, – ils discutaient de ces principes avec l’ardeur la plus passionnée, et il arrivait souvent qu’ils ne s’adressassent pas l’un à l’autre, mais à Hans Castorp, auquel l’orateur exposait son point de vue, en ne désignant son adversaire que de la tête ou du pouce. Il marchait entre les deux adversaires, tournant la tête d’un côté, puis de l’autre, approuvait tantôt celui-ci, tantôt celui-là ; ou, s’arrêtant, le haut du corps obliquement rejeté en arrière et gesticulant avec sa main gantée de chevreau, il faisait une remarque personnelle, bien entendu tout à fait insuffisante, tandis que Ferge et Wehsal tournaient autour des trois autres, tantôt les devançant, tantôt restant en arrière, ou marchaient sur le même rang jusqu’à ce que des passants brisassent leur alignement.
Sous l’influence de ces remarques, la conversation glissa vers des sujets plus concrets, et porta rapidement tour à tour et en éveillant l’intérêt croissant de tous, sur les problèmes de l’incinération, du châtiment corporel, de la torture et de la peine de mort. Ce fut Ferdinand Wehsal qui mit sur le tapis le châtiment corporel et cette idée s’accordait avec sa tête, parut-il à Hans Castorp. On ne fut pas surpris que M. Settembrini se répandît en paroles élevées et invoquât la dignité humaine contre ce procédé aussi blâmable en pédagogie qu’en droit pénal ; on ne fut pas davantage surpris, mais néanmoins ahuri par tant de sinistre audace, quand Naphta se prononça en faveur de la bastonnade. Selon lui, il était absurde de divaguer à ce propos sur la dignité humaine, car la véritable dignité tient de l’esprit, non pas de la chair ; et, comme l’âme humaine n’était que trop facilement encline à tirer du corps toute sa joie de vivre, les souffrances qu’on lui infligeait étaient un moyen très recommandable de lui gâter le plaisir des sens, et de la rejeter en quelque sorte de la chair vers l’esprit, pour que celui-ci reprît son pouvoir sur elle. C’était un reproche parfaitement absurde que de considérer le châtiment corporel comme particulièrement humiliant. Sainte Élisabeth avait été flagellée jusqu’au sang par son confesseur Conrad de Marbourg ; selon la légende, « son âme en avait été ravie jusqu’au troisième chœur » ; et elle-même avait frappé de verges une pauvre vieille qui avait trop sommeil pour se confesser. Était-il possible que l’on se permît d’appeler inhumaines ou barbares les flagellations auxquelles s’étaient livrés les membres de certains ordres et sectes, et d’une façon générale les personnes sentant profondément, afin de fortifier en eux le principe de l’esprit ? L’idée que l’interdiction par la loi des châtiments corporels dans les pays qui se jugeaient avancés constituait un véritable progrès, était une conviction qui, pour être inébranlable, n’en paraissait que plus comique.
Il fallait du moins admettre ceci, dit Hans Castorp, que dans cette opposition entre la chair et l’esprit, la chair incarnait sans aucun doute le principe mauvais et diabolique – ha ha, incarnait, puisque la chair faisait naturellement partie de la nature – naturellement de la nature, pas mal non plus ! – et que la nature, dans son opposition à l’esprit, à la raison, était décidément mauvaise, mystiquement mauvaise, pouvait-on dire, si l’on se hasardait à faire cette observation en s’appuyant sur sa culture et sur ses connaissances. Ce point de vue admis, il n’était que logique de traiter le corps en conséquence, c’est-à-dire de lui appliquer les moyens de châtiment que l’on pouvait également désigner comme mystiquement mauvais, si l’on se risquait encore une fois à une remarque personnelle. Et peut-être, si M. Settembrini avait eu à son côté sainte Élisabeth, lorsque la faiblesse de son corps l’avait empêché de se rendre au congrès progressiste de Barcelone…
On rit ; et, comme l’humaniste voulut protester, Hans Castorp parla vite des coups que lui-même avait reçus autrefois : au lycée qu’il avait fréquenté, cette peine était encore plus ou moins en usage dans les classes inférieures, on avait eu des houssines, et, encore que les maîtres, pour certaines considérations sociales, n’eussent pas porté la main sur lui, il avait cependant reçu un jour une volée de coups d’un condisciple plus fort que lui, d’un grand voyou, avec la canne flexible, sur le haut des cuisses et sur ses mollets vêtus seulement de bas, et cela lui avait fait un mal affreux, infâme, inoubliable, véritablement mystique ; avec des sanglots d’une ferveur honteuse, les larmes avaient coulé de colère et de désespoir, et Hans Castorp avait lu par la suite que dans les maisons de réclusion les pires bandits et les assassins les plus robustes pleurnichaient comme de petits enfants lorsqu’on leur administrait la bastonnade.
Tandis que M. Settembrini cachait sa figure de ses deux mains qui étaient gantées d’un cuir très râpé, Naphta demanda avec un sang-froid d’homme d’État comment l’on aurait pu dompter des criminels récalcitrants, sinon au moyen du chevalet et du bâton qui étaient donc tout à fait à leur place et répondaient au style d’une maison de réclusion ; une maison de réclusion humanitaire était une transaction esthétique, un compromis, et M. Settembrini, bien qu’il fût un orateur amoureux de belles phrases, n’entendait, au fond, rien à la beauté. Quant à la pédagogie, si l’on en croyait Naphta, la conception de dignité humaine de ceux qui voulaient en exclure les châtiments corporels prenait son point de départ dans l’individualisme libéral de l’époque bourgeoise et humanitaire, dans un absolutisme éclairé du Moi qui était sur le point de s’éteindre et de faire place à des idées sociales nouvelles et moins douillettes, à des idées d’assouplissement et de soumission, de contrainte et d’obéissance qui n’allaient pas sans une cruauté sacrée et qui amèneraient même à envisager d’un regard nouveau le châtiment de notre cadavre.
D’où l’expression : Perinde ac cadaver[12], railla Settembrini, et comme Naphta fit observer que, dès lors que Dieu livrait pour le punir notre corps à la honte abominable de la pourriture, ce ne devait être pas un crime de lèse-majesté que d’administrer au même corps une volée de coups, on en arriva subitement à parler de l’incinération.
Settembrini la célébra. Il était possible de remédier à cette honte, dit-il joyeusement. Des considérations utilitaires en même temps que des mobiles idéalistes avaient déterminé l’humanité à y remédier. Et il déclara qu’il prenait part aux préparatifs d’un congrès international pour l’incinération qui se tiendrait probablement en Suède. On projetait d’exposer un crématoire modèle, construit d’après toutes les expériences faites jusqu’à présent ainsi qu’un columbarium, et il était à prévoir que ce congrès exercerait une influence vaste et encourageante. Quel procédé suranné et baroque que l’enterrement, étant données les conditions de la vie moderne ! L’extension des villes ! Le refoulement des cimetières – ces lieux de repos, disait l’étymologie ; – vers la périphérie ! Le prix des terrains ! Le caractère prosaïque des obsèques causé par la nécessité de se servir des moyens de transport modernes ! Sur toutes ces choses, Settembrini excellait à faire des observations sensées. Il plaisanta la figure du veuf inconsolable qui allait chaque jour en pèlerinage sur la tombe de sa chère morte pour s’entretenir avec elle sur les lieux. Pour une telle idylle, il fallait avant tout disposer du bien le plus précieux de la vie, à savoir du temps en quantité surabondante, et d’ailleurs, les opérations en série d’un cimetière central moderne ne manqueraient pas de le guérir de cette sensiblerie traditionnelle. La destruction du cadavre par le feu, quelle notion pure hygiénique et digne, voire héroïque, c’était là ! Au lieu de le livrer à une lamentable décomposition et à l’assimilation par des organismes inférieurs. Le sentiment lui-même trouvait plus aisément son compte dans ce nouveau procédé qui répond à ce besoin humain de durer. Car ce qui était détruit par le feu, c’étaient les parties changeantes du corps, qui même de son vivant étaient renouvelées par la nutrition ; par contre celles qui prenaient le moins part à ce courant et qui accompagnaient l’homme presque sans se modifier à travers son existence d’adulte étaient aussi celles qui persistent dans le feu, elles formaient les cendres, et, en les recueillant, les survivants gardaient la partie impérissable du défunt.
– Très joli, dit Naphta, oh, c’était très, très joli. La partie impérissable de l’homme, les cendres.
Naphta, rétorqua l’orateur, prétendait, bien entendu, maintenir l’humanité dans son attitude irrationaliste à l’égard des faits biologiques, il maintenait la conception religieuse primitive pour laquelle la mort était un fantôme effrayant faisant naître des frissons si mystérieux qu’il était interdit de diriger sur ce phénomène le regard de la claire raison. Quelle barbarie ! L’épouvante devant la mort remontait à des époques très basses de la civilisation où la mort violente avait été la règle, et le caractère effrayant qu’avait en effet celle-ci était longtemps demeuré lié, dans le sentiment de l’homme, à l’idée de mort en général. Mais, de plus en plus, grâce au développement de la science générale de l’hygiène et grâce aux progrès de la sécurité personnelle, la mort naturelle devenait la norme, et pour le travailleur moderne la pensée d’un repos éternel après un affaiblissement normal de ses forces n’avait plus rien d’effrayant, mais apparaissait au contraire comme normale et souhaitable. Non, la mort n’était ni un fantôme ni un mystère ; c’était un phénomène simple, rationnel, physiologiquement nécessaire et souhaitable, et c’eût été frustrer la vie que de s’attarder plus que de raison à contempler la mort. C’est pourquoi on avait projeté de compléter le crématoire modèle et le columbarium, c’est-à-dire en quelque sorte la salle de la mort, par une salle de vie, où l’architecture, la peinture, la sculpture, la musique et la poésie s’allieraient pour détourner les sens du survivant de l’expérience de la mort, d’une douleur obtuse et d’un deuil inactif, vers les bienfaits de la Vie…
Le plus tôt possible, railla Naphta. Pour qu’il ne pousse pas trop loin le culte de la mort, pour qu’il n’aille pas trop loin dans son respect devant un fait aussi simple, sans lequel il n’y aurait, il est vrai, ni architecture, ni peinture, ni sculpture, ni musique, ni même poésie.
– Il déserte pour joindre le drapeau, dit Hans Castorp songeur.
– L’inintelligibilité de votre remarque, ingénieur, lui répondit Settembrini, laisse cependant transparaître son caractère blâmable. Il faut que l’expérience de la mort soit en dernier ressort l’expérience de la vie, sinon, ce n’est qu’une histoire de revenants.
– Placera-t-on dans la salle de vie des symboles obscènes comme sur les sarcophages anciens ? demanda Hans Castorp avec tout son sérieux.
– De toute façon, les sens y seraient comblés, assura Naphta. En marbre et en peinture, le goût classique étalerait le corps, ce corps pétri de péchés que l’on sauvait de la pourriture, ce qui n’avait rien de surprenant, puisque, à force de tendresse pour lui, on ne voulait même plus le laisser fustiger…
Ici, Wehsal intervint et amena la conversation sur les tortures ; et cela lui seyait particulièrement. Que pensaient ces messieurs de la « question » ? Lui, Ferdinand, n’avait jamais négligé, au cours de ses voyages d’affaires, les occasions de visiter en des centres de culture ancienne ces endroits discrets où l’on avait pratiqué cette manière d’explorer les consciences. C’est ainsi qu’il connaissait les chambres de tortures de Nuremberg, de Ratisbonne, car, dans l’intérêt de sa formation intellectuelle, il les avait visitées et étudiées de près. En effet, pour l’amour de l’âme, on avait porté là des atteintes assez peu délicates au corps, de toutes sortes de manières ingénieuses. La poire enfoncée dans la bouche ouverte, la fameuse poire, qui n’était déjà pas une friandise, et puis le silence avait régné, un silence des mieux remplis…
– Porcheria, murmura Settembrini.
Ferge dit que tout hommage rendu à la poire et au silence bien rempli, on n’avait quand même rien su inventer de plus dégoûtant que de vous tâter la plèvre.
Et l’on avait fait cela pour le guérir !
« L’âme endurcie, la justice offensée ne justifient pas moins une suppression passagère de la miséricorde. En outre, la torture n’avait été qu’un résultat du progrès rationaliste… »
Visiblement, Naphta divaguait !
Mais non, il ne s’égarait pas ! M. Settembrini était un bel esprit, et l’histoire de la procédure au moyen âge n’était sans doute pas pour l’instant entièrement présente à son souvenir. Elle s’était en effet progressivement rationalisée, et cela de telle sorte que Dieu avait été peu à peu exclu de la jurisprudence et remplacé par des notions de pure raison. Le jugement de Dieu était tombé en désuétude, parce qu’on avait dû se rendre compte que le plus fort était vainqueur même lorsqu’il avait tort. Des gens de l’espèce de M. Settembrini, des sceptiques, des critiques avaient fait cette observation et avaient obtenu que l’inquisition qui ne comptait pas sur l’intervention de Dieu en faveur de la vérité, mais qui tendait à obtenir de l’accusé l’aveu de la vérité, fût substituée à l’ancienne manière naïve d’exercer la justice. Pas de condamnation sans aveu ! Aujourd’hui encore il suffisait d’écouter la voix publique : cet instinct était profondément enraciné ; si serré que fût l’enchaînement des preuves la condamnation était jugée illégale lorsque l’aveu faisait défaut ! Comment l’obtenir ? Comment déterminer la vérité, par delà toutes les apparences, par delà de simples soupçons ? Comment pénétrer dans le cerveau, dans le cœur d’un homme qui la dissimulait, qui refusait de la livrer ? Lorsque l’esprit était récalcitrant, il ne restait que la ressource de s’adresser au corps que l’on pouvait toujours atteindre. La torture, comme moyen d’obtenir l’aveu indispensable, était exigée par la raison. Mais c’était M. Settembrini qui avait réclamé et introduit le recours à l’aveu, et par conséquent il était également l’auteur de la torture.
L’humaniste pria ces messieurs de n’en rien croire. C’étaient là des plaisanteries diaboliques. Si tout s’était passé comme M. Naphta le prétendait, si vraiment la raison avait inventé cette chose effroyable, cela prouvait tout au plus combien elle avait toujours besoin d’être soutenue et éclairée, et combien peu les adorateurs de l’instinct naturel avaient raison de craindre que tout ne se passât jamais trop raisonnablement sur terre. Mais son honorable contradicteur s’était certainement égaré. Cette justice abominable ne pouvait avoir été inspirée par la vertu, pour la bonne raison que son fonds avait été la croyance en l’enfer. On n’avait qu’à regarder les musées et les chambres de tortures, pour être convaincu que ces manières de pincer, d’étirer, de visser et de roussir étaient apparemment issues d’une imagination puérile et aveuglée, du désir d’imiter pieusement ce qui se pratiquait dans les lieux du châtiment éternel, dans l’au-delà. Du reste, on avait même cru aider le malfaiteur ! On avait admis que sa propre âme en peine aspirait à l’aveu et que seule la chair, comme principe du mal, s’opposait à son vouloir. De sorte que l’on avait même cru lui rendre un service charitable en brisant sa chair par la torture. Égarement d’ascètes…
Les anciens Romains n’avaient-ils pas commis la même erreur ?
– Les Romains ? Ma che !
Et pourtant, eux aussi auraient connu la torture comme forme de procès.
Impasse logique… Hans Castorp s’efforça de glisser en jetant de son propre chef, et comme si ce pouvait être son affaire de diriger une telle conversation, le problème de la peine de mort dans le débat. La torture avait été supprimée, bien que les juges d’instruction eussent toujours leurs moyens de mater les accusés. Mais la peine de mort semblait immortelle, il ne semblait pas que l’on pût s’en passer. Les peuples les plus civilisés la conservaient. Les Français avaient fait de très mauvaises expériences avec leurs déportations. On ne savait vraiment pas ce que l’on devait pratiquement faire de certaines créatures anthropoïdes, hormis les raccourcir d’une tête.
Ce n’étaient pas des « créatures anthropoïdes », rectifia M. Settembrini. C’étaient des hommes comme lui, l’ingénieur, et Settembrini lui-même ; simplement, ils manquaient de volonté, et ils étaient les victimes d’une société mal organisée. Et il parla d’un grand criminel, plusieurs fois assassin, qui relevait du type que les avocats généraux ont, dans leurs réquisitoires, l’habitude de qualifier de « bestial », de « bête à visage humain ». Or cet homme avait couvert le mur de sa cellule de vers. Et ces vers n’étaient nullement mauvais ; ils étaient même meilleurs que ceux qu’il arrivait à des avocats généraux de rimer.
Cela jetait un jour singulier sur l’art, répondit Naphta. Mais en dehors de cela, ce n’était nullement digne d’attention.
Hans Castorp avait cru que M. Naphta se déclarerait partisan de la peine de mort.
Naphta, dit-il, était sans doute tout aussi révolutionnaire que Settembrini, mais il l’était dans un sens conservateur. C’était un révolutionnaire de la conservation.
Mais l’univers, sourit M. Settembrini, très sûr de lui, passerait à l’ordre du jour, par-dessus cette révolution de la réaction anti-humaine. M. Naphta préférait suspecter l’art que reconnaître qu’il pouvait restituer la dignité de l’homme jusqu’au plus réprouvé d’entre les hommes. Il était impossible de gagner une jeunesse en quête de lumière à un tel fanatisme. Une Ligue Internationale dont le but était la suppression de la peine de mort dans tous les pays civilisés venait de se former. M. Settembrini avait l’honneur d’en être membre. On n’avait pas encore choisi l’endroit où se tiendrait le prochain congrès, mais l’humanité pouvait avoir la certitude que les orateurs qui s’y feraient entendre seraient cuirassés d’arguments. Et il invoqua les arguments, parmi lesquels celui de la possibilité, qui subsistait toujours, d’une erreur judiciaire et donc d’un assassinat légal ; comme l’espoir subsistait toujours que le criminel s’amendât. Il cita même : « La vengeance m’appartient » et déclara aussi que l’État, si l’amélioration de l’homme lui importe plus que la violence, ne pouvait pas rendre le mal par le mal, et rejetait l’idée de « châtiment » après que, sur la base d’un déterminisme scientifique, il avait combattu celle de culpabilité.
Après quoi la « jeunesse en quête de lumière » vit Naphta successivement tordre le cou à chacun de ces arguments. Il se gaussa de la crainte de verser le sang et du respect pour la vie humaine que manifestait le philanthrope. Il affirma que le respect de la vie individuelle ne relevait que des époques bourgeoises les plus plates et les plus philistines, mais que, en des circonstances tant soit peu passionnées, pour peu qu’une seule idée qui dominait celle de sécurité, une seule idée impersonnelle, et par conséquent superindividuelle fût en jeu, – et c’était là le seul état digne de l’homme et par conséquent normal dans un sens plus élevé, – la vie individuelle serait non seulement sacrifiée sans hésitation à la visée supérieure, mais encore exposée volontairement et sans hésitation par l’individu lui-même. La philanthropie de monsieur son adversaire, dit-il, tendait à enlever à la vie tous ses accents pesants et mortellement sérieux ; elle tendait à châtrer la vie, même par le déterminisme de sa prétendue science. Or, la vérité était que, non seulement le concept de la culpabilité ne pouvait pas être aboli par le déterminisme, mais encore qu’il n’en apparaissait que plus lourd et plus effrayant.
Ce n’était pas mal. Désirait-il par hasard que la victime infortunée de la société se sentît sérieusement coupable, et marchât de son plein gré vers l’échafaud ?
Mais, sans aucun doute ! Le criminel était pénétré de sa faute comme il était pénétré de soi-même. Car il était tel qu’il était, et il ne pouvait ni ne voulait être différent, et c’était là justement sa faute. M. Naphta transportait la culpabilité et le mérite du domaine empirique dans le domaine métaphysique. Il est vrai que l’acte était déterminé, il n’y avait pas pour lui de libre arbitre, mais il y en avait un pour l’être. L’homme était et restait ce qu’il avait voulu être jusqu’à son anéantissement. Il avait tué au prix de sa vie. Qu’il mourût, puisqu’il expiait par là la jouissance la plus profonde.
– La jouissance la plus profonde ?
– La plus profonde.
L’autre pinça les lèvres. Hans Castorp toussota. Wehsal laissait pendre de travers sa mâchoire inférieure. M. Ferge soupira. Settembrini observa avec finesse :
– On le voit bien, il y a une manière de généraliser une question qui donne au sujet une nuance personnelle. Vous auriez envie de tuer ?
– Cela ne vous regarde pas. Mais si je l’avais fait, je rirais à la face d’une ignorance humanitaire qui serait disposée à me nourrir de lentilles jusqu’à la fin naturelle de mes jours. Cela n’a aucun sens que l’assassin survive à l’assassiné. Ils auront participé, comme deux êtres ne le font qu’en une autre circonstance unique et analogue, l’un subissant, l’autre agissant, à un mystère qui les lie à jamais. Leurs destins sont inséparables.
Settembrini avoua froidement que l’organe lui faisait défaut pour un tel mysticisme de la mort et du meurtre, et qu’il ne le regrettait pas. Il n’avait rien à objecter aux dons religieux de M. Naphta, lesquels surpassaient incontestablement les siens, mais il constatait qu’il ne l’enviait pas. Un besoin insurmontable de propreté l’écartait d’une sphère, où ce respect du malheur dont une jeunesse en quête d’expérience avait parlé tout à l’heure régnait apparemment non seulement sous le rapport physique, mais encore sous le rapport moral, bref, d’une sphère où la vertu, la raison et la santé ne comptaient pour rien, mais où les vices et la maladie jouissaient de la plus haute considération.
Naphta confirma qu’en effet la vertu et la santé n’étaient pas des états religieux. On avait beaucoup gagné, dit-il, lorsqu’on avait clairement établi que la religion n’avait absolument rien de commun avec la raison et la morale. Car, ajouta-t-il, elle n’avait rien à voir avec la vie. La vie reposait sur des conditions et des catégories qui ressortissaient tantôt à la doctrine de la connaissance, tantôt au domaine moral. Les premières s’appelaient le temps, l’espace, la causalité ; les secondes, morale et raison. Toutes ces choses étaient non seulement étrangères et indifférentes à l’être religieux, mais encore lui étaient hostiles ; car c’étaient justement elles qui formaient la vie, la prétendue santé, c’est-à-dire la manière d’être philistine et bourgeoise par excellence, dont l’univers religieux était précisément le contraire absolu, voire absolument génial. Lui, Naphta, ne voulait d’ailleurs pas dénier d’une façon absolue à la sphère de la vie la possibilité de donner naissance au génie. Il existait une manière d’être bourgeoise non dépourvue de triviale grandeur, une majesté philistine que l’on pouvait juger digne de respect, à condition de se souvenir que, dans sa dignité carrée et massive, les mains dans le dos et la poitrine bombée, elle était l’irréligion incarnée.
Hans Castorp leva l’index comme à l’école. Il ne voulait heurter aucune opinion, dit-il, mais il était apparemment question ici du progrès, du progrès humain, et par conséquent jusqu’à un certain point, de la politique et de la république oratoire, et de la civilisation de l’Occident civilisé ; et il voulait simplement dire que la différence ou, si M. Naphta y tenait absolument, l’opposition entre la vie et la religion, devait être ramenée à l’opposition entre le temps et l’éternité. Car le progrès n’avait lieu que dans le temps ; dans l’éternité, il n’y avait pas de progrès, non plus que de politique et d’éloquence. On y appuyait en quelque sorte la tête sur l’épaule de Dieu et l’on fermait les yeux. Et c’était là la différence entre la religion et la morale, confusément exprimée.
Sa manière naïve de s’exprimer, dit Settembrini, était moins inquiétante que sa crainte de heurter les opinions d’autrui et que sa tendance à faire des concessions au diable.
Allons donc ! il y avait belle lurette qu’ils avaient discouru sur le diable, M. Settembrini et lui, dit Hans Castorp. « O satana, o ribellione ! » À quel diable aurait-il donc fait ces concessions ? À celui de la rébellion, du travail et de la critique, ou bien à l’autre ? On était vraiment en péril mortel : un diable à droite, un diable à gauche ; comment diable s’y prendre pour passer ?
Ce n’était pas la bonne manière, dit Naphta, de caractériser la situation telle que M. Settembrini voulait la voir. Ce qui était décisif dans sa conception de l’univers, c’est qu’il faisait de Dieu et de Satan deux personnes et deux principes distincts, et qu’il plaçait « la vie », exactement à la manière du moyen âge, entre eux comme enjeu de leurs luttes. Mais, en réalité, ils ne formaient qu’un et s’opposaient de concert à la vie, à la vie bourgeoise, à l’éthique, à la raison, à la Vertu, – comme le principe religieux qu’ils représentaient ensemble.
– Qu’est-ce que c’est que ce micmac répugnant ? – che guazzabuglio proprio stomachevole, s’écria Settembrini. Le mal et le bien, la sainteté et le crime, tout cela mélangé ! Sans jugement, sans volonté ! Sans le pouvoir de réprouver ce qui est réprouvé ! M. Naphta savait-il ce qu’il niait en confondant Dieu et le Diable en présence de cette jeunesse, et en niant le principe moral au nom de cette dualité abominable ? Il niait la valeur, toute échelle de valeurs, c’était effrayant à dire. Ainsi donc, il n’y avait ni bien ni mal, il n’y avait que l’univers sans ordre moral. Il n’y avait pas davantage d’individu dans sa dignité critique, il n’y avait que cette communauté absorbant et nivelant tout, l’anéantissement mystique en elle ! L’individu…
Que M. Settembrini se prît une fois de plus pour un individualiste, quelle chose exquise ! Mais pour l’être, il fallait connaître la différence entre la moralité et la félicité, ce qui n’était nullement le cas chez Monsieur notre moniste et illuminé. Là où la vie était stupidement considérée comme une fin en soi et là où l’on ne s’inquiétait pas du tout d’un sens et d’une fin qui la dépasseraient, régnait une éthique sociale, une morale de vertébrés, mais non pas l’individualisme, lequel ne trouvait sa place que dans le seul domaine religieux et mystique, dans le prétendu « univers sans ordre moral ». Qu’était-elle et que voulait-elle donc, la morale de M. Settembrini ? Elle était liée à la vie, partant uniquement utile, partant non héroïque a un degré pitoyable. Elle n’excitait que pour que l’on devînt vieux et heureux, riche et bien portant par elle, un point c’était tout. Et cette plate doctrine de la raison et du travail, on la tenait pour une éthique ! Quant à lui, Naphta, il se permettait à nouveau de la qualifier comme une conception bourgeoisement mesquine de la vie.
Settembrini l’engagea à se modérer, mais sa propre voix vibrait de passion, lorsqu’il déclara insupportable que M. Naphta parlât sans cesse de la « conception bourgeoise de la vie », Dieu sait pourquoi, sur un ton d’aristocrate dédaigneux, comme si le contraire – et l’on savait ce qu’était le contraire de la vie – avait été par hasard plus distingué !
Nouvelles reparties, nouvelles boutades ! À présent ils en étaient arrivés à la noblesse, à la question de l’aristocratie. Hans Castorp, échauffé et épuisé par le froid et par la multitude des problèmes, incertain même en ce qui touchait l’intelligibilité ou le caractère hasardé et fiévreux de ses propres expressions, confessa, les lèvres ankylosées, qu’il s’était depuis toujours représenté la Mort avec une collerette espagnole amidonnée, ou tout au moins en petite tenue, avec un faux col à pointes rabattues, la vie, par contre, avec un simple petit col droit… Mais lui-même s’effraya de ce qu’il entrait, dans ses dires, de rêves et d’ivresse les faisant déplacés dans une conversation ; et il assura que ce n’était pas cela qu’il avait voulu dire. Mais n’en allait-il pas ainsi qu’il y avait des gens, certaines gens que l’on ne pouvait pas se représenter comme morts, et cela justement parce qu’ils étaient absolument quelconques ? Ce qui voulait dire : ils paraissaient tellement faits pour la vie qu’il vous semblait qu’ils ne pourraient jamais mourir, qu’ils n’étaient pas dignes de recevoir la consécration de la mort.
M. Settembrini exprima l’espoir qu’il ne se trompait pas en supposant que Hans Castorp ne disait ces choses que pour qu’on le contredît. Le jeune homme le trouverait toujours disposé à le secourir quand il était en proie à de pareilles tentations. « Faits pour la vie », disait-il ? Et il se servait de ce mot dans un sens péjoratif ! « Digne de vivre » ! C’est cette expression qu’il ferait bien de substituer à l’autre, et ses idées s’enchaîneraient alors dans un ordre véridique et beau. « Digne de vivre » et aussitôt, par l’association la plus naturelle et la plus légitime l’idée d’« agréable à vivre » surgirait, si étroitement apparentée à l’autre terme que l’on pourrait dire que, seul, ce qui était véritablement digne de vivre était aussi véritablement aimable. Or, ces deux qualités réunies, la courtoisie et la dignité, formaient ce que l’on appelait la noblesse.
Hans Castorp trouva cela charmant et tout à fait intéressant. M. Settembrini, dit-il, l’avait aisément conquis par sa théorie plastique. Car on pouvait dire ce que l’on voulait – et certaines choses pouvaient être avancées, par exemple que la maladie était une forme d’existence supérieure et qu’elle avait quelque chose de solennel – une chose était certaine, à savoir que la maladie accentuait l’élément corporel, qu’elle ramenait l’homme complètement à son corps, et que, par conséquent, elle nuisait à la dignité de l’homme jusqu’à l’anéantir en le réduisant au seul corps. La maladie était par conséquent inhumaine.
– La maladie est parfaitement humaine, reprit aussitôt Naphta ; car être homme, c’est être malade. En effet, l’homme est essentiellement malade, c’était le fait qu’il était malade qui justement faisait de lui un homme, et quiconque voulait le guérir, l’entraîner à faire la paix avec la nature, « à retourner à la nature » (alors qu’en réalité il n’avait jamais été naturel), tout ce qui s’exhibait aujourd’hui en fait de prophètes régénérateurs, végétariens, naturistes, nudistes et ainsi de suite, toute espèce de Rousseau par conséquent ne cherchait pas autre chose que de le déshumaniser et de le rapprocher de l’animal. L’humanité ? La noblesse ? C’était l’esprit qui distinguait l’homme, – cet être éminemment détaché de la nature, et qui s’y sentait nettement opposé – de toute autre forme de vie organique. C’était donc à l’esprit, à la maladie, que tenait la dignité de l’homme, sa noblesse. « Bref, il est d’autant plus homme qu’il est plus malade, et le génie de la maladie est plus humain que le génie de la santé. » Il était surprenant que quelqu’un qui jouait au philanthrope fermât les yeux sur de telles vérités fondamentales de l’humanité. M. Settembrini ne jurait que par le progrès. Comme si le progrès, pour autant qu’il existait, n’était pas uniquement dû à la maladie, c’est-à-dire au génie qui n’était pas autre chose que la maladie. Comme si tous les hommes bien portants n’avaient pas toujours vécu sur les conquêtes de la maladie. Il y avait eu des hommes qui avaient consciemment et volontairement pénétré dans la maladie et la folie, pour conquérir à l’humanité des connaissances qui allaient devenir de la santé après avoir été conquises par la démence, et dont la possession et l’usage, après ce sacrifice héroïque, ne seraient pas plus longtemps subordonnés à la maladie et à la démence. C’était là la véritable crucifixion…
– Hé, hé, pensa Hans Castorp, le voilà bien mon jésuite fantaisiste avec ses combinaisons et son interprétation de la crucifixion. On voit fort bien pourquoi tu n’es pas devenu père, joli jésuite à la petite tache humide. Eh bien, rugis donc, lion, se tourna-t-il intérieurement vers Settembrini. Et celui-ci « rugit » en déclarant que tout ce que Naphta venait de soutenir n’était que mirage, bavardage et confusion. « Dites-le donc, cria-t-il à son adversaire, dites-le donc sous votre responsabilité d’éducateur, dites franchement devant cette jeunesse qui se forme que l’esprit est maladie. En vérité, vous les encouragerez ainsi à l’esprit, vous les gagnerez à la foi ! Déclarez d’autre part que la maladie et la mort sont nobles, mais que la santé et la vie sont vulgaires – c’est la méthode la plus sûre pour encourager l’élève à servir l’humanité ! Davvero, è criminoso ! » Et en preux chevalier il prit la défense de la noblesse, de la santé et de la vie, de celle que donnait la nature, et qui n’avait pas besoin de s’inquiéter de manquer d’esprit. La forme ! proclamait-il, et Naphta, disait alors avec emphase : le logos ! Mais l’autre qui ne voulait rien savoir du logos disait « la raison », tandis que l’homme du logos défendait « la passion ». Tout cela était confus. « L’objet » disait l’un, et l’autre : « le Moi ». Enfin il fut même question de « l’art » d’un côté et de « la critique » de l’autre, et toujours de nouveau de la « nature » et de « l’esprit », et de savoir lequel des deux était le principe le plus noble, et du « problème de l’aristocratie ». Et cependant rien ne s’ordonnait ni ne s’éclaircissait, car non seulement tout s’opposait, mais encore tout se confondait, et non seulement les interlocuteurs se contredisaient l’un l’autre, mais encore ils se contredisaient eux-mêmes. Settembrini avait bien souvent fait l’éloge de la critique, alors qu’à présent il représentait le contraire, à savoir l’art, comme le principe noble ; et tandis que Naphta s’était plus d’une fois posé comme le défenseur de « l’instinct naturel » contre Settembrini qui avait traité la nature de « force stupide », comme un fait brutal et un destin aveugle, devant laquelle la raison et l’orgueil humain n’avaient pas le droit d’abdiquer, il se tournait maintenant du côté de l’esprit et de la « maladie », en quoi l’on pouvait trouver de la noblesse et de l’humanité, tandis que l’autre se posait en avocat de la nature et de sa saine noblesse, sans se souvenir de la nécessité de s’en affranchir. La discussion sur l’objet et le moi n’était pas moins embrouillée ; c’était ici que la confusion, qui d’ailleurs était partout la même, devenait tout à fait irrémédiable, et cela au point que plus personne ne savait lequel des deux était, en réalité, l’homme pieux et lequel l’homme libre. Naphta interdisait à Settembrini, en termes sévères, de se nommer un « individualiste », car il niait la contradiction entre Dieu et la nature, il n’entendait pas le problème de l’homme, par le conflit de la personnalité, que celui des intérêts particuliers et des intérêts généraux, et il s’était ainsi posé sur le terrain d’une morale bourgeoise, liée à la vie, et ayant la vie pour but, il tendait sans héroïsme aucun à l’utilitaire, et découvrait dans la raison d’État la loi morale ; tandis que lui, Naphta, sachant parfaitement que le problème de l’homme reposait sur le conflit entre le réel et le surnaturel, représentait le véritable individualisme, l’individualisme mystique, et était en réalité l’homme de la liberté et du moi. Mais s’il était ainsi, pensait Hans Castorp, qu’en était-il « de l’anonymat et de la communauté », pour ne citer à titre d’exemple qu’une seule contradiction ? Qu’en était-il d’autre part des points importants qu’il avait touchés dans son entretien avec le père Unterpertinger sur le catholicisme du philosophe Hegel, sur le lien intime entre les concepts de « politique » et de « catholicisme » et sur la catégorie de l’objectif qu’ils formaient ensemble ? L’art de la politique et l’éducation n’avaient-ils pas été le domaine particulier de l’activité de l’ordre de Naphta ? Et quelle éducation ! M. Settembrini était certainement un pédagogue zélé, zélé jusqu’à en être importun ; mais, sous le rapport de l’objectivité ascétique et dédaigneuse du moi, ses principes ne pouvaient en aucune façon rivaliser avec ceux de Naphta. Ordre absolu ! Discipline de fer ; coercition ! obéissance ! terreur ! Cela pouvait avoir son côté honorable, mais cela ne tenait que peu de compte de la dignité de l’individu. C’était le règlement militaire de Frédéric de Prusse et de Loyola l’Espagnol, pieux et austère jusqu’au sang ; à propos de quoi l’on arrivait à se demander comment, en somme, Naphta pouvait aboutir à cet absolu sanguinaire puisqu’il avait avoué ne croire à aucune connaissance pure et à aucune science sans hypothèse, bref, ne pas croire à la vérité, à la vérité objective, scientifique que, selon Lodovico Settembrini, la loi suprême de toute morale humaine était de découvrir. C’était pieux et austère de la part de M. Settembrini, tandis qu’il semblait que Naphta se laissât nonchalamment aller jusqu’à ramener la vérité à l’homme et à la réduire à ce qui lui convenait le mieux ! N’était-ce pas une conception bourgeoise et un utilitarisme de philistin de faire dépendre ainsi la vérité de l’intérêt de l’homme ? Ce n’était pas là, à y regarder de près, une objectivité de fer, il y avait là-dedans plus de liberté et de subjectivisme que Léon Naphta ne l’eût voulu, encore que ce fût de la « politique » dans un sens assez semblable à la formule de M. Settembrini : selon laquelle « la liberté était la loi de l’amour du prochain ». Cela revenait apparemment à lier la liberté à l’homme tout comme le faisait Naphta. C’était décidément se montrer plus dévot que libre, mais que devenait cette différence lorsqu’on adoptait pareilles définitions. Ah, ce monsieur Settembrini ! Ce n’était pas en vain qu’il était un littérateur, c’est-à-dire le petit fils d’un homme politique et le fils d’un humaniste. Il se préoccupait généreusement de critique et des beautés de l’émancipation, et croisait les jeunes filles dans la rue en fredonnant, tandis que le tranchant petit Naphta était lié par des vœux sévères. Et, pourtant, celui-ci était presque un libertin, à force d’indépendance, et cet autre un enragé de la vertu, si l’on voulait. M. Settembrini avait peur de l’esprit absolu et voulait à tout prix identifier l’esprit avec le progrès démocratique, épouvanté par le libertinage religieux du militaire Naphta qui mélangeait Dieu et le Diable, la sainteté et le crime, le génie et la maladie et qui ne connaissait pas de jugement de valeur, pas de jugement de la raison, pas de volonté. Qui donc était libre, qui donc était pieux, qu’était-ce qui déterminait le véritable état et la véritable position de l’homme ? Était-ce l’anéantissement dans la communauté qui absorbait et nivelait tout qu’il fallait préférer, ou bien le « sujet critique » chez lequel la légèreté et l’austérité vertueuse du bourgeois entraient en conflit ? Hélas, les principes et les motifs s’opposaient constamment, les contradictions intimes s’accumulaient et notre pékin devait prendre la responsabilité si difficile, non seulement de décider entre les contraires, mais encore de les tenir nettement séparés, comme des préparations, de sorte que la tentation devenait grande de se jeter la tête la première dans l’univers moralement désordonné de Naphta. C’était l’entrecroisement et l’enchevêtrement général, la grande confusion, et Hans Castorp croyait voir que les adversaires auraient été moins acharnés si, durant leur querelle, cette confusion n’avait pesé sur leur âme.
On était monté ensemble jusqu’au Berghof, puis les trois pensionnaires avaient raccompagné les externes jusque devant leur maisonnette, et on resta encore longtemps debout dans la neige, tandis que Naphta et Settembrini se querellaient en bons pédagogues, comme Hans Castorp le savait bien, pour contribuer à la formation d’une jeunesse en quête de lumières. Pour M. Ferge c’était là des sujets beaucoup trop élevés, comme il donna plusieurs fois à entendre et Wehsal manifestait peu d’intérêt, depuis qu’il n’était plus question de bastonnade et de torture. Hans Castorp la tête penchée, creusait la neige avec sa canne et réfléchissait à la grande confusion.
Enfin on se sépara. On ne pouvait pas rester éternellement debout, et l’entretien se prolongeait au delà de toute limite. Les trois pensionnaires du Berghof s’en retournèrent chez eux et les deux pédagogues rivaux durent rentrer ensemble dans leur maisonnette, l’un pour gagner sa cellule tendue de soie, l’autre sa chambrette d’humaniste, avec son pupitre et sa carafe d’eau. Mais Hans Castorp s’en fut sur sa loge de balcon, les oreilles pleines du brouhaha et du cliquetis d’armes des deux armées qui, s’avançant de Jérusalem et de Babylone sous les dos banderas se rencontraient en une mêlée confuse.
NEIGE
Cinq fois par jour les occupants des sept tables exprimaient un mécontentement unanime du temps qu’il faisait cet hiver. On jugeait qu’il ne remplissait que très insuffisamment ses devoirs d’hiver de la haute montagne, qu’il ne fournissait pas les ressources météorologiques auxquelles cette sphère devait sa réputation dans la mesure garantie par le prospectus, à laquelle les anciens étaient habitués et que les nouveaux s’étaient attendus à trouver. On enregistrait de graves défaillances du soleil, du rayonnement solaire, de ce facteur important de guérison et sans le concours duquel la guérison se trouvait inévitablement retardée… Et quoi que M. Settembrini pût penser de la sincérité avec laquelle les hôtes de la montagne travaillaient à leur rétablissement et souhaitaient leur retour au pays plat, de toute façon ils réclamaient leur dû, ils voulaient en avoir pour leur argent, pour celui que payaient leurs parents et leurs époux, et ils murmuraient dans les conversations à table, en ascenseur et dans le hall. Aussi la direction générale comprenait-elle parfaitement qu’il lui incombait de remédier à cette situation et de la compenser par d’autres avantages. On fit l’acquisition d’un nouvel appareil de « soleil artificiel », parce que les deux appareils que l’on possédait déjà ne suffisaient plus aux demandes de ceux qui voulaient se faire bronzer par l’électricité, ce qui seyait bien aux jeunes filles et aux femmes, et prêtait aux hommes, malgré leur existence horizontale, un aspect magnifique de sportifs conquérants. Même, cette apparence donnait des avantages réels ; les femmes, bien que pleinement renseignées sur l’origine technique et le caractère factice de cette virilité, étaient assez sottes ou rusées, assez entichées d’illusion, pour se laisser enivrer et séduire par ce mirage. « Mon Dieu », disait Mme Schœnfeld, – une malade rousse, aux yeux rouges et qui venait de Berlin, – Mon Dieu, disait-elle le soir, dans le hall, à un cavalier aux jambes longues et à la poitrine creuse qui, sur sa carte de visite, libellée en français, se donnait pour un « Aviateur diplômé et enseigne de la marine allemande », qui était pourvu du pneumothorax, et qui endossait d’ailleurs son smoking pour le déjeuner et l’enlevait le soir, en assurant que tel était l’usage dans la marine, « Mon Dieu ! disait-elle, en regardant goulûment l’enseigne, comme vous êtes admirablement bruni par le soleil artificiel ! On dirait un chasseur d’aigles, ce lascar ! » « Prenez garde à vous, ondine, chuchota-t-il à son oreille, dans l’ascenseur (et elle en eut la chair de poule), vous me payerez vos regards séducteurs ! » Et par les balcons, par delà les parois de verre mat le lascar et chasseur d’aigles rejoignait l’ondine.
Néanmoins il s’en fallait de beaucoup que le soleil artificiel fût considéré comme une compensation véritable à la carence de l’astre. Deux ou trois belles journées de soleil par mois – des journées qui rayonnaient il est vrai d’un profond bleu de velours, derrière les cimes blanches, avec un scintillement de diamant et une exquise brûlure dans la nuque des hommes, en dissipant la grisaille du brouillard et son voile épais, – deux ou trois journées depuis des semaines, c’était trop peu pour l’état d’âme de gens dont le destin justifiait l’exceptionnel besoin de réconfort et qui comptaient en leur for intérieur sur un pacte qui, en échange du renoncement aux plaisirs et aux tourments de l’humanité du pays plat, leur garantissait une vie sans doute inerte, mais tout à fait facile et agréable, insoucieuse jusqu’à la suppression du temps et favorisée sous tous les rapports. Il n’était guère utile au conseiller de rappeler combien, même dans ces conditions, la vie au Berghof était loin de rappeler le séjour dans une mine sibérienne, et par quels avantages l’air de ces sommets, rare et léger comme il l’était, de l’éther pur pour ainsi dire, pauvre en éléments terrestres, en éléments mauvais ou bons, préservait ses hôtes, même en l’absence du soleil, de la fumée et des exhalaisons de la plaine. La mauvaise humeur se répandait et les protestations se multipliaient, les menaces de départs en coup de tête étaient à l’ordre du jour, et il arrivait qu’elles se réalisassent, malgré l’exemple du retour récent et affligeant de Mme Salomon dont le cas n’avait primitivement pas été grave, encore qu’il s’améliorât lentement, mais qui, à la suite du séjour que la malade avait de son propre chef fait dans les courants d’air de l’humide Amsterdam, était devenu incurable.
Au lieu du soleil, on eut de la neige, de la neige en quantité, des masses de neige si formidables que, de sa vie, Hans Castorp n’en avait vu autant. L’hiver dernier n’avait pourtant pas laissé à désirer à cet égard, mais son rendement avait été faible par rapport à celle du nouvel hiver. Par sa quantité monstrueuse, démesurée, elle contribuait à vous faire prendre conscience du caractère périlleux et excentrique de cette région. Il neigeait au jour le jour et pendant des nuits entières : une neige fine, sans tourbillons, mais il neigeait. Les rares sentiers praticables semblaient des chemins creux encaissés entre des murailles de neige plus hautes qu’un homme de côté et d’autre, avec des plaques d’albâtre qui étaient agréables à voir, scintillantes, cristallines et granuleuses et qui servaient aux pensionnaires du Berghof à se transmettre par l’écrit et par le dessin toutes sortes de nouvelles, de plaisanteries et d’allusions piquantes. Mais même entre ces remparts on marchait encore sur une épaisseur de neige assez considérable, bien que l’on eût creusé profondément, et l’on s’en rendait compte aux endroits mouvants et aux trous où le pied enfonçait tout à coup, enfonçait facilement jusqu’au genou : il fallait prendre garde de ne pas se briser une jambe. Les bancs avaient disparu, engloutis. Un morceau de dossier émergeait encore ici ou là de cette tombe blanche. En bas, dans le village, le niveau des rues était si étrangement modifié que les boutiques au rez-de-chaussée des maisons étaient devenues des caves où l’on descendait du trottoir par des marches taillées dans la neige.
Et il continuait de neiger sur les masses amoncelées, au jour le jour par un froid moyen – dix à quinze degrés au-dessous de zéro – qui ne vous pénétrait pas jusqu’à la moelle ; on le sentait peu, comme s’il n’avait fait que cinq, ou même deux degrés, l’absence de vent et la sécheresse de l’air l’atténuaient. Il faisait très sombre le matin ; on déjeunait à la lumière artificielle des lustres en forme de lune, dans la salle aux voûtes gaiement coloriées. Dehors était le néant gris, le monde plongé dans une ouate blafarde qui se pressait contre les vitres, comme emballé dans la vapeur des neiges et dans le brouillard. Invisible, la montagne ; tout au plus distinguait-on de temps en temps quelque chose des sapins les plus proches ; ils étaient là, chargés de neige, se perdaient rapidement dans la brume ; et, de temps à autre, un pin, se déchargeant de son excès de poids, répandait dans la grisaille une poussière blanche. Vers dix heures, le soleil paraissait comme une fumée vaguement éclairée au-dessus de la montagne, c’était une vie pâle et fantomatique, un reflet blafard du monde sensible dans le néant du paysage méconnaissable. Mais tout restait dissous dans une délicatesse et une pâleur spectrales, exempt de toute ligne que l’œil aurait pu suivre avec certitude ; les contours des cimes se perdaient, s’embrumaient, s’en allaient en fumée. Les étendues de neige éclairées d’un jour pâle qui s’étageaient les unes derrière les autres, conduisaient le regard vers l’informe. Et il arrivait alors qu’un nuage éclairé, semblable à une fumée, flottât longuement sans changer de forme devant une paroi rocheuse.
Vers midi, le soleil, perçant à moitié la brume, s’efforçait de dissoudre le brouillard dans l’azur. Mais il était loin d’y réussir quoique l’on perçût momentanément un soupçon de bleu de ciel, et que ce peu de lumière suffît à faire scintiller de reflets adamantins le paysage déformé par cette aventure de neige. Vers cette heure-là il cessait généralement de neiger, tout comme pour permettre une vue d’ensemble du résultat obtenu, et les rares journées intermittentes de soleil, quand le tourbillon faisait relâche et que l’incendie tout proche du ciel s’efforçait de fondre l’exquise et pure surface de la neige nouvelle, semblaient elles aussi poursuivre le même but. L’aspect du monde était féerique, puéril et comique. Les coussins épais, floconneux, comme fraîchement battus, qui reposaient sur les branches des arbres, les bosses du sol sous lesquelles se dissimulaient des arbres rampants ou des saillies rocheuses, l’aspect accroupi, englouti, comiquement travesti du paysage produisait un monde de gnomes, ridicule à voir et comme tiré d’un recueil de contes de fées. Mais si la scène proche où l’on se déplaçait péniblement prenait un aspect fantastique et cocasse, c’étaient des impressions de grandeur et de sainteté qu’éveillait le fond plus lointain : l’architecture étagée des Alpes couvertes de neige.
L’après-midi, entre deux et quatre heures, Hans Castorp était couché dans sa loge de balcon et, bien empaqueté, la nuque appuyée sur le dossier de son excellente chaise-longue, ni trop haut ni trop bas, il regardait par-dessus la balustrade capitonnée, la forêt et la montagne. La forêt de sapins, d’un vert noir, couverte de neige, escaladait les pentes ; entre les arbres, le sol était partout capitonné de neige. Au-dessus s’élevait la crête rocheuse, d’un gris blanchâtre, avec d’immenses étendues de neige, qu’interrompaient çà et là quelques rocs plus sombres et des pics qui se perdaient mollement dans les nuées. Il neigeait doucement. Tout se brouillait de plus en plus. Le regard, se mouvant dans un néant ouaté, inclinait facilement au sommeil. Un frisson accompagnait l’assoupissement, mais ensuite il n’y avait pas de sommeil plus pur que ce sommeil dans le froid glacé, dont aucune réminiscence inconsciente du fardeau de la vie n’effleurait le repos sans rêves, parce que la respiration de l’air rare, inconsistant et sans odeur ne pesait pas plus à l’organisme que la non-respiration du mort. Lorsqu’on le réveillait, la montagne avait complètement disparu dans le brouillard de la neige et il ne s’en dégageait plus de temps en temps, pour quelques minutes, que des fragments, une cime, une arête rocheuse, qui se voilaient presque aussitôt. Ce jeu silencieux de fantômes était des plus divertissants. Il fallait s’appliquer à une attention très aiguë pour surprendre cette fantasmagorie de voiles dans ses transformations secrètes. Sauvage et grande, dégagée du brouillard se découvrait une chaîne rocheuse dont on ne voyait ni le sommet ni le pied. Mais pour peu qu’on la quittât un instant des yeux elle s’était évanouie.
Des tempêtes de neige se déchaînaient parfois, qui empêchaient absolument que l’on se tînt sur la galerie parce que la neige tourbillonnante envahissait le balcon lui-même, en recouvrant tout le plancher et les meubles, d’une couche épaisse. Car il y avait aussi des tempêtes dans cette haute vallée entourée de montagnes. Cette atmosphère si inconsistante était agitée par des remous, elle s’emplissait d’un tel grouillement de flocons que l’on ne voyait plus à un pas devant soi. Des rafales d’une force à vous couper le souffle imprimaient à la neige un mouvement sauvage, tourbillonnant et oblique, elles la chassaient de bas en haut, du fond de la vallée vers le ciel, la faisaient mousser en une folle sarabande ; ce n’était plus une chute de neige, c’était un chaos d’obscurité noire, un monstrueux désordre, outrance phénoménale d’une région en dehors de la zone modérée et où seul le nivereau qui surgissait tout à coup par bandes entières, pouvait s’orienter.
Mais Hans Castorp aimait cette vie dans la neige. Il trouvait qu’elle s’apparentait à beaucoup d’égards à la vie des grèves maritimes : la monotonie sempiternelle du paysage était commune aux deux sphères ; la neige, cette poussière de neige profonde, floconneuse et immaculée, jouait ici le même rôle qu’en bas le sable d’une blancheur jaunâtre ; leur contact ne salissait pas ; on faisait tomber de ses chaussures et de ses vêtements cette poussière blanche et froide, comme là, en bas, la poudre de pierre et de coquillage du fond de la mer, sans qu’elle laissât une trace ; et la marche dans la neige était pénible comme une promenade à travers les dunes, à moins que l’ardeur du soleil eût superficiellement fondu la surface, et que la nuit l’eût durcie. On y marchait alors plus légèrement et plus agréablement que sur un parquet, aussi légèrement et aussi agréablement que sur le sable lisse, ferme, aspergé et élastique de la lisière de la mer.
Mais cette année c’étaient des chutes massives qui limitaient pour tous, à l’exception des skieurs, les possibilités de se mouvoir à l’air libre. Les tranche-neige travaillaient ; mais ils avaient du mal à dégager les sentiers les plus fréquentés et la grande route de la station, de sorte que les rares chemins qui restaient praticables et qui débouchaient aussitôt dans une impasse, étaient très fréquentés par des gens bien portants et des malades, par des indigènes et des pensionnaires des hôtels internationaux. Or, les lugeurs butaient dans les jambes des piétons, des dames et des messieurs qui rejetés en arrière, les pieds en avant, poussant des cris d’avertissement dont le ton témoignait combien ils étaient pénétrés de l’importance de leur entreprise, glissaient sur leurs petits traîneaux d’enfant le long des pentes, en s’emmêlant et en chavirant, pour remonter, aussitôt arrivés en bas, en traînant à la corde leur jouet à la mode. De ces promenades Hans Castorp était plus que rassasié. Il avait deux désirs : le plus fort était d’être seul avec ses pensées et ses rêveries, dont sa loge de balcon lui aurait peut-être, encore que d’une façon superficielle, permis l’accomplissement. Quant à l’autre, lié au premier, c’était le besoin de prendre un contact plus intime et plus libre avec la montagne dévastée par la neige pour laquelle il s’était pris de sympathie, et ce vœu ne pouvait s’accomplir aussi longtemps qu’il était celui d’un piéton désarmé et sans ailes ; car il se serait aussitôt enfoncé jusqu’à la poitrine dans cette blancheur s’il avait essayé de pousser au delà des sentiers usuels, creusés à la pelle, et dont il avait de toutes parts tôt fait d’atteindre le terme.
Hans Castorp décida donc un jour de s’acheter des skis, durant ce second hiver qu’il passait ici, et d’apprendre à s’en servir, dans la mesure où l’exigeait le besoin réel qu’il éprouvait. Il n’était pas un sportif ; il ne l’avait jamais été, faute de dispositions physiques ; du reste, il ne faisait pas semblant de l’être, comme c’était le cas de nombreux pensionnaires du Berghof, qui, pour se conformer aux usages du lieu et à la mode, se déguisaient sottement, – les femmes notamment, Hermine Kleefeld, par exemple, qui, bien que la gêne respiratoire fît constamment bleuir la pointe de son nez et ses lèvres, aimait à paraître au lunch en pantalons de laine, et s’étendait dans cet attirail, après le repas, les genoux écartés, dans un fauteuil d’osier du hall, d’une manière assez inconvenante. Si Hans Castorp avait sollicité l’autorisation du conseiller pour son projet extravagant, il se serait à coup sûr heurté à un refus. Le sport était absolument interdit à la communauté des malades, au Berghof comme partout ailleurs, dans les établissements du même ordre ; car l’atmosphère qui en apparence pénétrait si facilement dans les poumons, imposait aux muscles du cœur des efforts suffisants ; et, en ce qui concernait Hans Castorp, sa remarque nonchalante sur « l’habitude de ne pas s’habituer », était restée pleinement valable pour lui, et la tendance fiévreuse que Rhadamante attribuait à une tache humide, persistait obstinément. Sinon, qu’eût-il encore cherché ici ? Son désir et son projet étaient donc contradictoires et déplacés. Mais il fallait tâcher de le comprendre. Ce qui le poussait, ce n’était pas l’ambition d’égaler les fats de la vie au grand air, ni les sportifs par coquetterie qui auraient, si la mode l’avait voulu, apporté le même zèle prétentieux à jouer aux cartes dans une chambre étouffante. Il se sentait d’une manière absolue membre d’une autre communauté beaucoup moins libre que le petit peuple des touristes ; et, d’un point de vue plus large et plus nouveau encore, en vertu d’une certaine dignité distante et imposant la retenue, il avait le sentiment que ce n’était pas son affaire de s’ébattre à la légère comme ces gens-là, et de se rouler dans la neige comme un fou. Il ne projetait pas d’escapades, il avait bien l’intention de garder la mesure et Rhadamante eût parfaitement pu le lui permettre. Mais comme le jeune homme prévoyait qu’on le lui défendrait quand même au nom du règlement général, Hans Castorp décida d’agir à l’insu du conseiller.
Lorsque l’occasion s’en offrit, il fit part à M. Settembrini de son projet. M. Settembrini faillit l’embrasser de joie. « Mais oui, mais oui, naturellement, ingénieur, faites cela pour l’amour de Dieu ! Ne consultez personne et faites-le ; c’est votre ange gardien qui vous a soufflé cela ! Faites-le tout de suite, avant que vous n’en ayez perdu la salutaire envie. Je vais avec vous, je vous accompagne dans le magasin, et, séance tenante, nous allons acheter ensemble ces ustensiles bénis ! J’aimerais, moi aussi, vous accompagner en montagne, courir avec vous, des skis ailés aux pieds, comme Mercure, mais cela ne m’est pas permis… Eh ! permis ! je le ferais bien, quand même cela ne me serait « pas permis », mais je ne le peux pas, je suis un homme perdu. Vous, par contre… cela ne vous fera pas de mal, pas le moindre mal, si vous êtes raisonnable, et si vous n’allez pas trop fort. Allons, et même si cela vous faisait un peu de mal, c’est quand même votre bon ange qui… Je n’en dis pas davantage. Quelle excellente idée ! Vous êtes ici depuis deux ans, et vous êtes encore capable d’une telle idée ! Ah non, votre fond est bon, il n’y a pas de raison de douter de vous. Bravo, bravo ! Vous faites un pied de nez à votre prince des ombres, là-haut. Vous achetez ces skis, vous les faites envoyer chez moi ou chez Lukacek, ou chez mon marchand d’épices, en bas, dans notre maisonnette. Vous venez les chercher là-bas, pour vous exercer, et vous glissez sur la surface des neiges… »
Ainsi fit-il. Sous les yeux de M. Settembrini qui se posa en connaisseur difficile, bien qu’il n’eût aucune notion des sports, Hans Castorp fit, dans une maison spécialisée de la grande rue, l’emplette d’une paire de jolis skis de bois de frêne, vernis en brun clair avec de magnifiques courroies et des pointes recourbées. Il acheta également des bâtons à pointes de fer et à disques, et ne se laissa pas dissuader de tout emporter lui-même, sur son épaule jusque chez Settembrini, où l’on eut tôt fait de s’entendre avec l’épicier sur les conditions du dépôt de cet équipement. Déjà renseigné, pour avoir souvent observé les skieurs, Hans Castorp commença seul, loin du grouillement des terrains d’exercices, à faire tant bien que mal son apprentissage sur une pente presque dégagée, non loin du sanatorium Berghof et, de temps à autre, M. Settembrini le regardait faire, d’une certaine distance, appuyé sur sa canne, croisant gracieusement les jambes, saluant par des bravos les progrès du jeune homme. Tout allait bien, lorsque Hans Castorp, descendant le tournant de la route déblayée vers Dorf pour déposer ses skis chez l’épicier, rencontra un jour le conseiller. Behrens ne le reconnut pas, quoique l’on fût en plein jour et que le débutant faillît buter contre lui. Le docteur s’enveloppa dans un nuage de fumée de cigare et passa.
Hans Castorp apprit que l’on acquiert rapidement une pratique dont on éprouve le besoin profond. Il ne prétendait pas devenir un virtuose. Ce dont il avait besoin, il l’eut appris en l’espace de quelques jours sans s’échauffer ni s’essouffler. Il avait soin de joindre les pieds comme il faut et de laisser des traces parallèles, il apprit comment au départ l’on se sert du bâton, pour se diriger, il apprit à franchir d’un seul élan, les bras levés, de menus obstacles, de petites éminences, soulevé et replongeant comme un bateau sur une mer agitée, et à partir de son vingtième essai il ne tombait plus lorsque, en pleine course, il freinait à la Télémark, une jambe tendue en avant, et ployant le genou de l’autre. Peu à peu il étendait le nombre de ses exercices. Un jour, M. Settembrini le vit disparaître dans un brouillard blanchâtre, lui lança entre ses mains creuses un conseil de prudence, puis rentra satisfait en son cœur de pédagogue.
Il faisait beau dans cette montagne, sous le signe de l’hiver, il y faisait beau non pas d’une manière douce et agréable, mais de même que le désert sauvage de la Mer du Nord est beau par un vigoureux vent d’ouest. Il n’y avait pas, il est vrai, de fracas de tonnerre ; au contraire, un silence de mort régnait, mais qui éveillait des sentiments tout à fait voisins du recueillement. Les longues semelles flexibles de Hans Castorp le portaient dans beaucoup de directions : le long du versant gauche vers Clavadel, ou à droite en passant devant Frauenkirch et Glaris, derrière lesquels l’ombre du massif de l’Amselfluh se dessinait dans le brouillard ; également dans la vallée de Dischma, ou derrière le Berghof en montant dans la direction du Seehorn boisé, dont la cime neigeuse s’élevait seule au-dessus de la limite des arbres, et de la forêt de Drusatscha, derrière laquelle on apercevait la silhouette pâle de la chaîne du Rhaeticon couverte d’une neige épaisse. Il se faisait transporter avec ses patins de bois par le funiculaire jusqu’à Schatzalp et se promenait paisiblement là-haut, exalté à deux mille mètres de hauteur, sur les plans inclinés et miroitants d’une neige poudroyante qui, par temps clair, offrait une vue étendue et sublime sur le paysage de ses aventures.
Il se réjouissait de sa conquête qui remédiait à son impuissance et qui surmontait presque tous les obstacles. Elle l’entourait de la solitude désirée, de la solitude la plus profonde que l’on pût imaginer, d’une solitude qui remplissait le cœur d’un éloignement distant des hommes. Il y avait là, par exemple, d’un côté, une gorge avec des sapins, dans le brouillard de la neige, et de l’autre côté montait une pente rocheuse, avec des masses de neige formidables, cyclopéennes, voûtées et bossuées, qui formaient des cavernes et des calottes. Le silence, lorsqu’il s’arrêtait pour ne pas s’entendre lui-même, était absolu et parfait, une absence de sons ouatée, inusitée, jamais rencontrée, et n’existant nulle part ailleurs. Nul souffle n’effleurait les arbres, ne fût-ce que le plus légèrement du monde, il n’y avait pas un murmure, pas une voix d’oiseau. C’était le silence éternel que Hans Castorp épiait lorsqu’il restait debout ainsi, appuyé sur son bâton, la tête inclinée sur l’épaule, la bouche ouverte ; et doucement, sans arrêt, la neige continuait de tomber, de tomber tranquillement, sans un bruit.
Non, ce monde, en son silence insondable, n’avait rien d’hospitalier ; il admettait le visiteur à ses risques et périls, il ne l’accueillait pas, en somme, il tolérait son intrusion, sa présence d’une manière peu rassurante, sans répondre de rien, et c’était l’impression d’une menace muette et élémentaire, non pas même d’une hostilité, mais d’une indifférence meurtrière qui s’en dégageait. L’enfant de la civilisation, étranger de formation et par ses origines à cette nature sauvage, est plus sensible à sa grandeur que son rude fils, qui a dû compter avec elle dès son enfance et qui vit avec elle sur un pied de familiarité banale et calme. Ce dernier connaît à peine la crainte religieuse avec laquelle l’autre, fronçant les sourcils, affronte la nature, crainte qui influe sur tous ses rapports intimes avec elle, et entretient constamment dans son âme une sorte de bouleversement religieux et une émotion inquiète. Hans Castorp, dans son chandail en poil de chameau à longues manches, dans ses bandes molletières et sur ses skis de luxe, se sentait fort téméraire d’épier ainsi ce silence originel de la nature sauvage et silencieusement meurtrière de l’hiver, et l’impression de soulagement qu’il éprouvait, lorsque, sur le chemin du retour, les premières habitations humaines reparaissaient à travers l’atmosphère voilée, lui faisait prendre conscience de son état d’esprit précédent et l’instruisait de ce que, des heures durant, une terreur secrète et sacrée avait dominé son cœur. À Sylt, en pantalons blancs, assuré, élégant et respectueux, il était resté au bord des formidables brisants comme devant une cage de lion derrière les barreaux de laquelle la bête féroce montre sa gueule béante aux terribles crocs. Puis il s’était baigné, tandis qu’un gardien prévenait du danger par un appel de sa trompe ceux qui témérairement essayaient de franchir la première vague, de s’approcher de la tempête menaçante ; et le dernier déferlement de la cataracte vous touchait encore la nuque comme un coup de patte de fauve. Le jeune homme avait connu là-bas le bonheur enthousiaste de légers contacts amoureux avec des puissances dont l’étreinte l’eût détruit. Mais ce qu’il n’avait pas éprouvé, c’était la velléité de pousser ce contact enivrant avec la nature meurtrière jusqu’à la limite de l’étreinte complète, c’était le désir de se hasarder, faible mortel, encore qu’armé et suffisamment pourvu par la civilisation, si avant dans l’énorme et le terrible, ou tout au moins d’éviter si longtemps de le fuir que, dans cette aventure, il risquait de frôler l’instant critique, l’instant où toute limite serait dépassée et où il ne s’agirait plus d’écume et d’un léger coup de patte, mais de la vague elle-même, de la gueule, de la mer.
En un mot : Hans Castorp montrait du courage là-haut, s’il faut entendre par courage devant les éléments non pas un sang-froid obtus en leur présence, mais un don conscient de soi-même et une victoire remportée par la sympathie pour eux, sur la peur de la mort. Sympathie ? En effet, Hans Castorp éprouvait, en son étroite poitrine civilisée, de la sympathie pour les éléments ; et à cette sympathie tenait la nouvelle conscience qu’il avait prise de sa propre dignité, à considérer la tourbe des lugeurs, ainsi que le sentiment qu’une solitude plus profonde et plus grande, moins confortable que le balcon de son hôtel était convenable et désirable pour lui. Du haut de son balcon il avait contemplé les sommets plongés dans le brouillard, la danse de la tempête de neige, et il avait eu honte jusqu’au fond de l’âme de rester un spectateur abrité derrière le rempart du confort. C’est pourquoi – et non point par prétention de sportif, ni par allégresse physique et spontanée, – il avait appris à faire du ski. S’il ne se sentait pas en sûreté là-haut, dans la grandeur et le silence de mort de ce paysage – et cet enfant de la civilisation ne s’y sentait en effet pas du tout à l’aise, – son esprit et ses sens avaient déjà auparavant fait connaissance de l’énorme et de l’étrange. Un entretien avec Naphta et Settembrini n’était guère plus rassurant ; il conduisait également hors des sentiers battus et vers les périls les plus graves ; et si l’on pouvait parler d’une sympathie de Hans Castorp pour la grande sauvagerie de l’hiver, c’est parce qu’il éprouvait, en dépit de sa pieuse terreur, que ce paysage était le décor le plus convenable pour mûrir les complexes de sa pensée, que c’était là un séjour indiqué pour quelqu’un qui, sans trop savoir comment il en était arrivé là, était accablé de la charge de « gouverner » des pensées qui concernaient l’état et la position de l’Homo Dei.
Il n’y avait personne ici pour prévenir l’imprudent du danger en soufflant dans son cor, à moins que M. Settembrini eût été cet homme lorsque, dans le cornet de ses mains creuses, il avait appelé Hans Castorp qui s’éloignait. Mais le jeune homme était plein de sympathie et de courage, il ne se souciait pas plus de l’appel derrière lui qu’il ne s’était soucié de celui qui avait retenti à ses oreilles certain soir de Carnaval : « Eh ingegnere, un po di ragione, sa ! » Encore toi, Satana-pédagogue avec ta ragione et ta ribellione, pensa-t-il. D’ailleurs, je t’aime bien. Tu as beau être un hâbleur et un joueur d’orgue de barbarie, tu es plein de bonnes intentions, des meilleures intentions, et je t’aime mieux que le petit jésuite et terroriste tranchant, le tortionnaire et flagellant Espagnol avec ses lunettes à éclairs, bien qu’il ait presque toujours raison lorsque vous vous querellez, – lorsque vous vous disputez en pédagogues ma pauvre âme, comme Dieu et le diable faisaient de l’homme au moyen âge.
Les jambes poudrées de neige, il gravissait, appuyé sur ses cannes, quelque blanche hauteur dont les étendues, pareilles à des draps, montaient par terrasses, de plus en plus hautes, conduisant on ne savait où ; il semblait qu’elles ne menaient nulle part ; leur partie supérieure se perdait dans le ciel qui était aussi blanc et brumeux qu’elles et dont on ne savait pas où il commençait ; aucune cime, aucune crête n’était visible, c’était un néant brumeux vers quoi Hans Castorp avançait, et comme, derrière lui, aussi, le monde, la vallée habitée par les hommes ne tarda pas à se refermer également à sa vue, comme aucun son ne lui parvenait plus de là, sa solitude, son isolement devinrent, avant qu’il s’en fût douté, aussi profonds qu’il avait pu le désirer, profonds jusqu’à l’effroi qui est la condition préalable du courage. Praeterit figura hujus mundi[13], se dit-il à lui-même, en un latin qui n’était pas d’un esprit humaniste. Cette expression lui venait de Naphta. Il s’arrêta et se retourna. De toutes parts on ne voyait plus rien, hormis quelques minuscules flocons de neige, qui de la blancheur des altitudes descendaient vers la blancheur de la terre, et le silence alentour était grandiose et impassible. Tandis que son regard se heurtait de toutes parts au vide blanc qui l’aveuglait, il sentit son cœur battre, agité par la montée, ce muscle du cœur dont il avait entrevu, avec une audace peut-être criminelle, la forme animale et le mécanisme, parmi les éclairs crépitants du cabinet de radioscopie. Et une sorte d’émotion le saisit, une sympathie simple et fervente pour son cœur, le cœur de l’homme qui bat, si seul sur ces hauteurs, dans le vide glacé, avec sa question et son énigme.
Il s’avançait, de plus en plus haut, vers le ciel. Parfois il enfonçait la partie supérieure de son bâton à pointe dans la neige et voyait une lueur bleue jaillir de la profondeur du trou, et poursuivre le bâton lorsqu’il le retirait. Cela l’amusait ; il pouvait rester longtemps arrêté pour reproduire toujours de nouveau ce petit phénomène optique. C’était une étrange et délicate lumière des montagnes et des profondeurs, d’un bleu verdâtre, claire comme la glace, et pourtant ombreuse et mystérieusement attirante. Elle le faisait penser à la couleur et à la lumière de certains yeux, de deux yeux bridés, ceux de son destin, et que M. Settembrini avait, du point de vue humaniste, qualifié de fentes tartares et d’« yeux de loup des steppes », de deux yeux qu’il avait contemplés autrefois, et qu’il avait inéluctablement retrouvés, des yeux de Hippe et de Clawdia Chauchat. « Volontiers, dit-il à mi-voix dans le silence. Mais ne me le casse pas : Il est à visser, tu sais. » Et, en pensée, il entendait derrière lui d’éloquentes exhortations à être raisonnable.
Sur sa droite, à une certaine distance, la forêt se perdait dans le brouillard. Il se tourna dans cette direction pour avoir un but terrestre devant les yeux, au lieu d’une transcendance blanchâtre, et tout à coup il glissa sans avoir le moins du monde vu venir une déclivité du sol. L’aveuglante monotonie l’empêcha de rien reconnaître de la forme du terrain. On ne voyait rien ; tout se fondait sous les yeux. Des obstacles tout à fait imprévus le soulevaient. Il s’abandonnait à la pente, sans distinguer à l’œil son degré d’inclinaison.
Le bois qui l’avait attiré, était situé au-delà de la gorge où il venait de descendre sans s’en rendre compte. Son fond, couvert d’une neige molle, s’inclinait du côté de la montagne, comme il s’en rendit compte lorsqu’il la suivit un instant dans cette direction. Il descendait. Les pentes de part et d’autre s’élevaient de plus en plus, comme un chemin creux, le pli du terrain semblait le conduire au sein de la montagne. Puis les pointes de son véhicule se redressèrent de nouveau ; le terrain remontait, bientôt il n’y eut plus de paroi latérale à gravir ; la course sans chemin de Hans Castorp conduisait de nouveau, par une étendue ouverte de montagnes, vers le ciel.
Il vit la forêt de sapins d’un côté, derrière et sous lui, il prit cette direction, et atteignit en une descente rapide les sapins chargés de neige qui, disposés en forme de coin, s’avançaient comme une avant-garde de la forêt, disparaissant plus bas dans le brouillard, dans l’étendue libre. Sous leurs branches, il fuma une cigarette en se reposant, l’âme toujours un peu oppressée, tendu et angoissé par le silence trop profond, par cette solitude aventureuse, mais fier de les avoir conquis par son courage, conscient des droits que sa dignité lui donnait sur ce paysage.
C’était l’après-midi, vers les trois heures. Aussitôt après le repas il s’était mis en route, décidé à manquer une partie de la grande cure de repos et le goûter, et dans l’intention d’être de retour avant la tombée de la nuit. Il se sentit heureux à la pensée qu’il avait encore devant lui plusieurs heures pour vagabonder librement à travers ces sites grandioses. Il avait un peu de chocolat dans la poche de ses breeches, et un petit flacon de porto dans la poche de sa veste.
Il pouvait à peine distinguer où en était le soleil, tant le brouillard était épais autour de lui. En arrière, du côté de la vallée, venant de l’angle montagneux que l’on ne voyait plus les nuages s’obscurcirent, le brouillard de plus en plus bas paraissait s’avancer. Il semblait que ce fût de la neige, que l’on dût s’attendre à plus de neige encore, pour répondre à quelque besoin urgent, que l’on dût s’attendre à une vraie tempête de neige. Et, en effet, les petits flocons silencieux tombaient déjà plus abondants.
Hans Castorp s’avança pour en recueillir quelques-uns sur sa manche et, naturaliste-amateur, il les considéra d’un œil exercé. Ils semblaient de minuscules lambeaux informes, mais il avait eu assez souvent leurs pareils sous son excellente loupe, et il savait parfaitement de quels précieux et précis petits joyaux ils se composaient, des bijoux, des étoiles, des agrafes de diamants, comme le joaillier le plus appliqué n’eût pas su en composer de plus riches et de plus minutieusement sertis ; cette légère et floconneuse poudre blanche dont les masses pesaient sur la forêt, couvraient l’étendue et par-dessus laquelle se portaient ses raquettes de bois, était, à la vérité, très différente sur la grève de la mer dans son pays du sable auquel elle faisait penser. On savait, en effet, que ce n’était pas de grains de pierre qu’elle se composait, mais de myriades de parcelles d’eau, concentrées en une multitude uniforme et cristalline, de parcelles de la substance inorganique qui faisait surgir le plasma vital, le corps des plantes et de l’homme – et parmi ces myriades d’étoiles magiques, dans leur impénétrable splendeur sacrée, invisible et nullement destinée au regard humain, aucune n’était semblable à l’autre ; une ardeur infinie d’inventeur dans la transformation et le développement raffiné d’un seul et même thème fondamental, de l’hexagone à côtés et à angles égaux, régnait là ; mais en eux-mêmes, chacun de ces froids produits était d’une uniformité absolue et d’une régularité glaciale, et c’était même là ce qu’il y avait d’inquiétant, d’antiorganique et d’hostile à la vie ; ils étaient trop réguliers, la substance organisée ne l’était jamais au même degré, la vie répugnait à une précision si exacte qu’elle jugeait mortelle, c’était le mystère même de la mort et Hans Castorp croyait comprendre pourquoi des constructeurs de temples de l’antiquité avaient exprès, et en secret, prévu certaines infractions à la symétrie dans la disposition de leurs colonnades.
Il prit son élan, glissa sur ses skis, descendit le long de la lisière de la forêt, sur l’épaisse couche de neige de la pente, vers le brouillard, se laissa entraîner, montant et glissant, et continua d’errer, sans but et sans hâte, à travers l’étendue morte, qui, avec ses terrains ondulés, avec sa végétation sèche qui se composait des taches d’arbres de pins, avec son horizon limité par de douces éminences, ressemblait si étrangement à un paysage de dunes. Hans Castorp hochait la tête avec satisfaction lorsqu’il s’arrêtait et se repaissait de cette ressemblance ; et la chaleur de son visage, son envie de frissonner, l’étrange et enivrant mélange d’excitation et de fatigue qu’il éprouvait, il les supportait avec sympathie, parce que tout cela le faisait penser intimement à des impressions familières que lui avait également dispensées l’air marin, qui fouettait les nerfs et qui, lui aussi, était saturé d’éléments soporifiques. Il prenait avec satisfaction conscience de son indépendance ailée, de son libre vagabondage. Il n’y avait devant lui aucun chemin qu’il eût été obligé de suivre, il n’y en avait pas davantage derrière lui pour le ramener là d’où il était venu. Il y avait eu, au début, des poteaux, des bâtons, des jalons plantés dans la neige, mais Hans Castorp n’avait pas tardé à se libérer intentionnellement de cette tutelle, parce que tout cela le faisait penser à l’homme à la trompette, et ne lui semblait pas correspondre à ses rapports intimes avec la grande solitude sauvage de l’hiver.
Derrière des éminences rocheuses couvertes de neige entre lesquelles il passa, tournant tantôt à droite, tantôt à gauche, s’étendaient un plan incliné, puis un plan horizontal et puis ce fut la haute montagne dont les gorges et les défilés, mollement capitonnés, paraissaient accessibles et tentants. Oui, la tentation des lointains et des altitudes, des solitudes qui s’ouvraient toujours de nouveau, était forte dans le cœur de Hans Castorp, et au risque de s’attarder, il pénétrait toujours plus avant dans le silence sauvage, dans l’étrange, dans la sphère périlleuse, sans se soucier de ce que, entre temps, sa tension et son angoisse intérieures se fussent changées en une véritable peur à l’aspect de l’obscurité prématurée et croissante du ciel, qui étendait comme des voiles gris sur la contrée. Cette peur lui fit comprendre que, jusqu’à ce moment, il s’était secrètement efforcé de perdre même le sens de l’orientation, et d’oublier dans quelle direction étaient situés la vallée et le bourg, et il y avait réussi aussi complètement qu’il avait pu le souhaiter. Du reste, il pouvait se dire que, s’il rebroussait chemin aussitôt et que, s’il descendait toujours à val, il atteindrait rapidement la vallée, sinon exactement le Berghof. En ce cas il arriverait trop tôt, n’aurait pas employé tout son temps, tandis que, si la tempête de neige le surprenait, il était en effet probable qu’il ne retrouverait plus le chemin du retour. Mais il se refusait à prendre prématurément la fuite, de quelque poids que pesât sur lui la peur, sa crainte sincère des éléments. Ce n’était guère là agir en sportif ; car le sportif engage la lutte avec les éléments aussi longtemps qu’il s’en sent le maître ; il reste prudent, et c’est être sage que de céder. Mais ce qui se passait dans l’âme de Hans Castorp, on ne pouvait le désigner que d’un mot : défi ! Et quoique ce mot implique des sentiments blâmables, même si – ou surtout si – la velléité criminelle qu’il désigne est liée à une peur sincère, on peut cependant comprendre, pour peu que l’on réfléchisse humainement, qu’au tréfonds de l’âme d’un jeune homme et d’un homme qui a vécu pendant des années à la façon de notre héros, bien des choses s’amassent et s’accumulent, qui, un jour ou l’autre, font explosion en un : « Allons donc ! » ou en un : « Viens-y donc ! » spontanés, pleins d’une impatience exaspérée, bref, se traduisent par un défi et un refus opposé à la prudence raisonnable. Et c’est donc ainsi qu’il y alla carrément, sur ses longues pantoufles, qu’il glissa encore le long de cette pente, et remonta sur le coteau suivant où se dressait, à quelque distance, un chalet de bois, un fenil ou une marcairie, au toit chargé de fragments de rocher, tourné vers la montagne suivante, dont le dos était hérissé de sapins, et derrière lequel de hautes cimes s’échafaudaient dans une brume confuse. Devant lui, la paroi parsemée de quelques groupes d’arbres se dressait roide ; mais, en obliquant vers la droite, on pouvait la contourner à moitié par une pente modérée, pour passer derrière elle et voir ce qui viendrait après. C’est donc à cette exploration que Hans Castorp commença par s’appliquer, après que, devant la plate-forme du chalet, il fut encore descendu dans un ravin plus profond dont la pente s’inclinait de droite à gauche.
Il venait à peine de reprendre la montée, lorsque, – ainsi qu’on avait pu le prévoir, – la tourmente de neige et la tempête éclatèrent de la plus belle manière ; bref, la tempête de neige était là qui avait depuis longtemps menacé, si l’on peut parler de « menace » à propos de ces éléments aveugles et ignorants, qui ne tendent nullement à nous anéantir, ce qui par comparaison eût été relativement réconfortant, mais auxquels les conséquences de leur action étaient indifférentes de la manière la plus exorbitante.
« Hé, là-bas, pensa Hans Castorp, et il s’arrêta lorsque le premier coup de vent passa à travers l’épais tourbillon de neige et l’atteignit. En voilà un souffle, il vous glace la moelle. »
Et en effet ce vent était d’une espèce tout à fait détestable : le froid effrayant qui régnait – environ vingt degrés au-dessous de zéro, – n’était insensible et ne paraissait doux que lorsque l’air dépourvu d’humidité était calme et immobile comme d’habitude ; mais aussitôt qu’un coup de vent l’agitait, il vous entaillait la chair comme à coups de couteau, et lorsqu’il en était comme à présent, – car le premier coup de vent qui avait balayé la neige n’avait été qu’un précurseur, – sept fourrures n’auraient pas suffi à mettre vos os à l’abri d’une épouvante mortelle et glaciale ; or, Hans Castorp ne portait pas sept fourrures, mais un seul chandail de laine qui, en d’autres circonstances, lui avait parfaitement suffi et qui lui avait même pesé au moindre rayon de soleil. D’ailleurs, la bourrasque le battait de côté et dans le dos, de sorte qu’il n’était pas recommandable de retourner et de le recevoir en pleine figure ; et comme cette considération se mêlait à son obstination et au « allons donc ! » résolu de son âme, le fol jeune homme continuait toujours d’avancer entre les sapins clairsemés, afin de parvenir de l’autre côté de la montagne qu’il avait entrepris de gravir.
Mais ce n’était pas un plaisir, car l’on ne distinguait rien de la danse des flocons qui, sans qu’on les vît tomber, emplissaient tout l’espace de leur multitude tourbillonnante et dense ; les vagues glacées qui la traversaient faisaient brûler les oreilles d’une douleur aiguë, paralysaient les membres et engourdissaient les mains, de sorte que l’on ne savait plus si l’on tenait encore son bâton ferré, ou non. La neige, par derrière, pénétrait sous son collet, fondait le long de son dos, se posait sur ses épaules, et couvrait son flanc droit. Il lui semblait qu’il allait se figer ici en un bonhomme de neige, son bâton raide à la main. Sa situation était insupportable, malgré les conditions relativement favorables : pour peu qu’il se retournât, ce serait pis ; et pourtant le chemin du retour apparaissait comme une tâche difficile, qu’il eût mieux valu entreprendre sans tarder.
Il s’arrêta donc, haussa les épaules avec colère, et retourna ses skis. Le vent contraire lui coupa aussitôt la respiration, de sorte qu’il exécuta encore une fois ce demi-tour compliqué, pour reprendre haleine avant d’affronter à nouveau, mieux préparé, l’ennemi impassible. La tête baissée et en ménageant prudemment son souffle, il réussit à se mettre en marche dans la direction opposée, surpris, bien qu’il se fût attendu au pire, par la difficulté de la marche, qui tenait avant tout à ce qu’il était aveuglé et n’arrivait pas à souffler. À tout moment, il était contraint de s’arrêter, premièrement pour reprendre haleine à l’abri de l’ouragan, ensuite parce que, la tête baissée et les yeux clignotants, il ne voyait rien dans cette obscurité blanche, et devait prendre garde de ne pas se heurter à des arbres, de ne pas s’enfoncer à travers des obstacles. Les flocons lui volaient en quantité à la figure, et y fondaient, de sorte que sa peau se glaçait. Ils volaient dans sa bouche où ils fondaient avec un goût faiblement aqueux, ils volaient contre ses paupières qui se fermaient convulsivement, ils inondaient ses yeux et lui coupaient la vue, qui, du reste, ne lui eût servi de rien, parce que le champ visuel était voilé d’un rideau si épais, et que toute cette aveuglante blancheur paralysait de toute manière le sens de la vue. C’était dans le néant blanc et tourbillonnant qu’il regardait, lorsqu’il se forçait à voir. De temps à autre seulement des fantômes du monde phénoménal en émergaient : un buisson de pins nains, la vague silhouette du fenil auprès duquel il venait de passer.
Il le laissa derrière lui, et s’efforça de trouver le chemin du retour, par-delà le coteau où se dressait le chalet. Mais il n’y avait pas de chemin. Garder une orientation, l’orientation approximative de la maison et de la vallée, était davantage une question de chance que d’intelligence, parce que, si l’on réussissait à voir la main devant ses yeux, on ne voyait même pas jusqu’aux pointes de ses skis ; et quand même on les aurait mieux vues il n’en aurait pas moins été extrêmement difficile de progresser, en raison de tant d’obstacles : la figure pleine de neige, le vent adverse qui vous coupait le souffle, qui vous empêchait d’aspirer comme d’expirer, et vous obligeait à tout moment à vous détourner pour reprendre haleine. On se demande qui serait parvenu à avancer ainsi. Quant à Hans Castorp, – et il n’en eût pas été différemment d’un autre, plus fort que lui, – il s’arrêtait, il haletait, clignotait en exprimant l’eau de ses cils, il tapotait pour faire tomber la cuirasse de neige qui s’était étendue sur lui, et avait le sentiment que c’était une présomption insensée de prétendre avancer en de telles conditions.
Hans Castorp avançait quand même, c’est-à-dire il se déplaçait. Mais se déplaçait-il utilement, se déplaçait-il dans la bonne direction, et n’eût-il pas été moins hasardeux pour lui de rester où il était (mais ceci semblait tout aussi impraticable), c’est ce qu’on pouvait se demander. La vraisemblance théorique inclinait dans le sens contraire, et, pratiquement parlant, il sembla bientôt à Hans Castorp que ce n’était pas le bon chemin qu’il suivait, à savoir : le coteau plat que, montant du ravin, il avait gagné à grand’peine, et qu’il s’agissait avant tout de gravir à nouveau. La partie plate avait été trop courte, il montait déjà de nouveau. Apparemment, l’ouragan qui venait du Sud-Ouest de la région de l’entrée de la vallée, l’avait détourné de son chemin par sa furieuse pression contraire. C’était une fausse avance qui depuis quelque temps déjà l’épuisait. À l’aveuglette, enveloppé d’une nuit tourbillonnante et blanche, il pénétrait à grand’peine plus avant dans cette menace indifférente.
« Tu parles ! » dit-il entre les dents, et il s’arrêta. Il ne s’exprima pas d’une façon plus pathétique, bien qu’il eût un instant le sentiment qu’une main de glace s’étendait vers son cœur qui sursauta et battit ensuite contre ses côtes, à coups aussi rapides que le jour où Rhadamante avait découvert chez lui une tache humide. Car il comprenait qu’il n’avait pas le droit de prononcer de grands mots et de faire de grands gestes, puisque c’était lui-même qui avait lancé le défi, et que tout ce que la situation avait d’inquiétant ne venait que de lui. « Pas mal », dit-il, et il sentit que ses traits, les muscles qui commandaient l’expression de son visage n’obéissaient plus à l’âme et n’étaient plus capables de rien exprimer, ni crainte, ni colère, ni mépris, car ils étaient gelés. « Et alors ? » Descendre par ici, obliquement, et suivre cette saillie, tout droit, exactement contre le vent. « C’est plus vite dit que fait », poursuivit-il, haletant et à mots entrecoupés, mais en réalité parlant à mi-voix, tout en se remettant en marche. Pourtant il faut que quelque chose se fasse, je ne peux pas m’asseoir et attendre, sinon, je serai bientôt recouvert par ces masses hexagonales et uniformes, et Settembrini, s’il arrivait avec son petit cor pour me chercher, me trouverait accroupi ici, les yeux vitreux, un bonnet de neige posé de travers sur la tête… Il remarqua qu’il se parlait à lui-même, et d’une manière assez étrange. Il se l’interdit donc, mais recommença, bien que ses lèvres fussent si lourdes qu’il renonçait à s’en servir, et parlait sans consonnes labiales, ce qui lui rappela une situation déjà ancienne et une circonstance où il en avait été de même. « Tais-toi, et tâche d’avancer », dit-il, et il ajouta : « Il me semble que tu radotes, et que tu n’as plus le cerveau très clair, c’est grave à tous les égards. »
Mais que ce fût grave au point de vue des chances qu’il avait d’en réchapper, c’était là une simple constatation critique, venant comme d’une personne étrangère, désintéressée encore que préoccupée. Pour sa part naturelle, il était fort enclin à s’abandonner à cette confusion qui voulait prendre possession de lui avec la fatigue croissante, mais il prenait conscience de cette tendance et s’attardait à méditer sur elle. « C’est la conscience altérée de quelqu’un qui se trouve pris dans une tempête de neige et qui ne retrouve plus son chemin, pensait-il tout en peinant et il prononçait des phrases décousues, hors d’haleine, en évitant par discrétion des expressions plus claires. Les gens qui en entendent parler ensuite s’imaginent que c’est effroyable, mais oublient que la maladie – et mon état est en quelque sorte une maladie – dresse son homme de façon à pouvoir s’entendre avec lui. Il y a des phénomènes de sensibilité diminuée, des étourdissements bienfaisants, des expédients naturels, oui parfaitement… Mais il faut les combattre, car ils sont à double face, ils sont équivoques au suprême degré ; veut-on les apprécier, tout dépend du point de vue. Ils sont profitables et bienfaisants lorsque le chemin est à jamais perdu, mais ils sont très malfaisants et dangereux pour peu qu’il soit encore question de retrouver son chemin, comme chez moi qui ne songe pas, qui, dans mon cœur aux battements tumultueux, ne songe nullement à me laisser recouvrir par cette cristallométrie stupide et régulière… »
En effet, il était déjà sensiblement éprouvé et combattait un commencement de confusion dans ses perceptions, d’une manière elle-même confuse et fiévreuse. Il ne s’effraya pas, comme il eût dû, en homme bien portant, s’effrayer lorsqu’il s’aperçut qu’il avait de nouveau dévié de sa voie plane, cette fois apparemment dans le sens de la pente du coteau. Car il se laissa glisser, ayant le vent obliquement contre lui, et bien que pour le moment mieux eût valu ne pas se laisser aller, cela lui semblait plus commode. « Ça ira, pensa-t-il. Je reprendrai la bonne direction un peu plus bas. » Et c’est ce qu’il fit, ou crut faire, ou ne le crut pas lui-même ; ou (ce qui est encore plus inquiétant), il commençait à lui être indifférent de le faire ou de ne pas le faire. Tel était l’effet des absences d’esprit équivoques qu’il ne combattait que mollement. Ce mélange de fatigue et d’émotion qui formait l’état ordinaire et familier d’un hôte dont l’acclimatation consistait à ne pas s’habituer s’était si nettement déclaré qu’il ne pouvait plus être question de lutter par la réflexion contre ces absences. Pris de vertige, il tremblait d’ivresse et d’excitation à peu près comme il l’avait fait après son entretien avec Naphta et Settembrini, mais infiniment plus fort ; et ainsi lui arriva-t-il de justifier sa paresse, dans la résistance qu’il opposait à ces absences somnolentes, par des réminiscences de certaines discussions et que, malgré sa révolte méprisante contre l’idée de se laisser recouvrir par ces masses uniformes et hexagonales, il balbutiait quelque chose en lui-même, dont le sens ou le non-sens était le suivant : le sentiment du devoir qui l’engageait à combattre ces pertes de connaissance suspectes n’était pas de la pure éthique, c’était une mesquine conception bourgeoise de l’existence et le fait d’un philistin irreligieux. Le désir et la tentation de s’étendre et de se reposer assiégeaient son esprit sous la forme suivante : il se disait que c’était comme pendant une tempête de sable dans le désert où les Arabes se jetaient sur leur face et tiraient le burnous par-dessus la tête. Seul, le fait qu’il n’avait pas de burnous et que l’on ne pouvait pas bien tirer un chandail de laine par-dessus sa tête lui semblait une objection valable à une telle conduite, bien qu’il ne fût pas un enfant et que par beaucoup de récits il sût assez exactement comment l’on est gelé à mort.
Après un départ d’une vitesse moyenne sur un terrain plutôt plat, il montait de nouveau, et la pente était assez raide. Il se pouvait qu’il ne fît pas fausse route, car le chemin qui menait à vallée devait lui aussi monter par endroits, et quant au vent, il avait sans doute tourné capricieusement, car Hans Castorp l’avait de nouveau dans le dos, et il y trouvait un avantage. Était-ce la tempête qui le courbait en avant ou était-ce ce plan déclive voilé par un crépuscule de neige, blanc et tendre, qui exerçait une attraction sur son corps ? On n’aurait besoin que de lui céder, de s’abandonner à cette attirance, et la tentation était grande, aussi grande, dangereuse, typique, qu’elle passait pour être ; mais cette notion n’enlevait rien à sa force vivante et effective. Cette attirance se targuait de droits particuliers, elle ne voulait pas se laisser ranger parmi les données générales de l’expérience, elle ne voulait pas s’y reconnaître, elle se déclarait unique et incomparable dans son insistance, – sans pouvoir nier, il est vrai, qu’elle était une inspiration émanant d’un certain côté, une suggestion venant d’un être en vêtements d’un noir espagnol, avec une collerette ronde et plissée d’une blancheur de neige, image à laquelle se rattachaient toutes sortes d’impressions sombres, jésuitiques, tranchantes et hostiles à l’humanité, toutes sortes de souvenirs de torture et de bastonnade, choses dont M. Settembrini avait horreur, mais par quoi il ne faisait que se rendre ridicule, avec sa rengaine d’orgue de barbarie et sa ragione…
Mais Hans Castorp se comporta vaillamment et résista à la tentation de se laisser aller. Il ne voyait rien, il luttait et avançait ; utilement ou non, il peinait pour sa part et se déplaçait au mépris des liens qui lui pesaient et dont la tempête glacée chargeait de plus en plus ses membres. Comme la montée devenait trop raide, il tourna de côté, sans trop s’en rendre compte, et suivit ainsi pendant quelque temps la pente. Ouvrir ses paupières convulsées était un effort dont il avait éprouvé l’inutilité, ce qui n’encourageait guère à le renouveler. Néanmoins, il voyait de temps en temps quelque chose : des pins qui se rapprochaient, un ruisseau ou un fossé dont la noirceur se dessinait entre les rebords de neige qui la surplombaient ; et lorsque, pour changer, il descendit de nouveau une pente, affrontant d’ailleurs une fois de plus le vent, il aperçut en avant de lui, à quelque distance, flottant librement, en quelque sorte balayée par des voiles confus, l’ombre d’une bâtisse humaine.
Aspect bien venu et consolant ! Il avait vaillamment peiné malgré tous les obstacles, jusqu’à ce qu’il eût revu des constructions de main d’homme qui l’avertissaient que la vallée habitée devait être proche. Peut-être y avait-il des hommes là-bas, peut-être pourrait-on entrer chez eux, sous leur toit attendre la fin de la tourmente, et en cas de besoin se procurer un compagnon ou un guide, si l’obscurité naturelle était tombée dans l’intervalle. Il marcha vers cette chose presque chimérique et qui souvent manquait de disparaître dans l’obscurité de l’heure. Il dut encore fournir une ascension épuisante contre le vent, pour l’atteindre, et se convainquit, arrivé là, avec des sentiments de révolte, d’étonnement, d’effroi et de vertige, que c’était la hutte bien connue, le fenil au toit chargé de pierres que, par toutes sortes de détours et au prix des plus vaillants efforts, il avait regagné.
Que diable ! De lourds jurons tombèrent des lèvres raidies de Hans Castorp qui omettait les sons labiaux. Pour s’orienter, il tourna autour de la hutte, en s’aidant de son bâton, et constata qu’il l’avait de nouveau atteinte par derrière et que par conséquent, durant une bonne heure, selon son estimation, il s’était livré à la plus pure et à la plus inutile sottise. Mais c’est ainsi que cela se passait, c’est ainsi que l’on pouvait le lire dans les livres. On tournait en rond, on s’échinait, en s’imaginant avancer, cependant que l’on décrivait en réalité quelques vastes et stupides détours qui vous ramenaient au point donné comme la trompeuse orbite de l’année. C’est ainsi que l’on s’égarait, c’est ainsi que l’on ne se retrouvait pas. Hans Castorp reconnut le phénomène traditionnel avec une certaine satisfaction, encore qu’avec effroi. Il se frappa les cuisses, de colère et de stupéfaction, parce que l’expérience s’était reproduite si ponctuellement dans son propre cas particulier, individuel et présent.
Le chalet désert était inaccessible, la porte était fermée, on ne pouvait y entrer d’aucun côté. Hans Castorp résolut néanmoins d’y demeurer provisoirement, car le rebord du toit donnait l’illusion d’un certain abri, et la hutte elle-même, du côté orienté vers la montagne où Hans Castorp se réfugia, offrait réellement une certaine protection contre la tempête lorsqu’on appuyait son épaule contre le mur grossièrement charpenté, car, par suite de la longueur des skis, il n’était pas possible de s’adosser. Accoté de biais il restait debout, après qu’il eut enfoncé son bâton à côté de lui dans la neige, les mains dans les poches, le collet de son chandail de laine relevé, se tenant en équilibre sur la jambe avancée, il laissa, les yeux clos, reposer sa tête qui lui tournait sur le mur de rondins, ne regardant que de temps à autre par-dessus son épaule par-delà le ravin, vers la paroi rocheuse, de l’autre côté, qui apparaissait parfois confusément à travers le voile de neige.
Sa situation était relativement confortable. « Au besoin je pourrais rester ainsi toute la nuit, se dit-il, pourvu que je change de temps à autre de pied, que je me couche en quelque sorte sur l’autre côté, et naturellement que je me donne un peu de mouvement dans l’intervalle, ce qui est indispensable. J’ai beau être extérieurement engourdi, j’ai quand même accumulé de la chaleur intérieure grâce au mouvement que je me suis donné, et mon excursion n’a donc pas été complètement inutile, encore que je me sois perdu et que j’aie tourné tout autour de la hutte… « Perdu », de quelle expression me suis-je donc servi ? Elle n’est pas du tout nécessaire, elle ne correspond pas à ce qui m’est arrivé, je m’en suis servi tout à fait arbitrairement parce que je n’ai pas encore la tête très claire ; et pourtant c’est à certains égards, un mot juste… Il est heureux encore que je puisse supporter cela, car cette tourmente, cet ouragan de neige, ce tourbillon chaotique peuvent parfaitement durer jusqu’à demain matin, et même s’il ne dure que jusqu’à la tombée de la nuit, ce serait assez grave, car, la nuit, le danger de se perdre est aussi grand que dans la tempête de neige… Il devrait déjà faire nuit, vers six heures, tant il me semble avoir gâché de temps en tournoyant. Quelle heure est-il donc ? »
Et il chercha sa montre, bien qu’avec ses doigts raides et morts il ne lui fût nullement facile de déterrer dans ses vêtements sa montre en or, à couvercle et à monogramme, qui faisait tic-tac, vivante et fidèle à son devoir, ici, dans cette solitude désolée, semblable en cela à son cœur, au cœur humain si touchant dans la chaleur organique de son thorax.
Il était quatre heures et demie. Que diable, il était presque la même heure lorsque la tempête avait commencé. Devait-il croire qu’il n’avait erré que pendant un quart d’heure ? « Le temps m’a paru long », pensa-t-il. « C’est ennuyeux de se perdre, semble-t-il. Mais à cinq heures ou à cinq heures et demie, il fait complètement nuit ; c’est un fait qui subsiste. La tempête cessera-t-elle auparavant, assez tôt pour m’éviter de me perdre à nouveau ? Sur ce, je pourrais prendre une gorgée de porto pour me redonner des forces. »
Il avait emporté cette boisson pour dilettantes, uniquement parce qu’on la trouvait au Berghof en des flacons plats, et parce qu’on la vendait aux excursionnistes, sans que l’on eût, il est vrai, pensé à ceux qui, contre la règle, s’égareraient dans la montagne, par la neige et le froid, et qui attendraient la nuit dans de telles conditions. Si son esprit avait été plus lucide, il aurait dû se dire que, au point de vue des chances de retour, c’était presque ce qu’il eût pu prendre de plus mauvais.
Et de fait il se le dit, après avoir pris quelques gorgées qui produisirent un effet tout semblable à celui qu’avait produit la bière de Kulmbach, le soir de son arrivée, lorsque, tout en tenant des discours désordonnés sur des sauces de poisson et autres sujets semblables, il avait choqué Settembrini, M. Lodovico, le pédagogue qui par son regard exhortait à la raison les fous qui se laissaient aller, et dont Hans Castorp entendait précisément l’agréable appel de cor à travers les airs, signe que l’éloquent éducateur s’approchait à marches forcées pour tirer de cette folle situation l’élève préféré, l’enfant gâté de la vie, et pour le ramener… Ce qui naturellement était absurde et ne provenait que de la bière de Kulmbach qu’il avait bue par mégarde. Car, premièrement, M. Settembrini n’avait pas du tout de cor, il n’avait que son orgue de barbarie appuyé sur une jambe de bois, et dont il accompagnait le jeu en levant vers les maisons ses yeux humanistes ; et, deuxièmement, il ne savait et ne remarquait absolument rien de ce qui se passait, puisqu’il ne se trouvait plus au sanatorium Berghof, mais chez Lukacek, le tailleur pour dames, dans sa petite mansarde à la carafe d’eau, au-dessus de la cellule de soie de Naphta, et n’avait pas plus le droit ni le moyen d’intervenir qu’autrefois, la nuit de Carnaval, lorsque Hans Castorp s’était trouvé dans une position aussi folle et aussi grave, quand il avait rendu à la malade Clawdia Chauchat son crayon, son porte-mine, le porte-mine de Pribislav Hippe… Qu’en était-il du reste de sa « position » ? Pour être dans une position, il fallait être « posé » quelque part, et non pas debout, pour que ce mot prît son sens juste et propre, au lieu d’un sens purement métaphorique. La position horizontale, telle était la situation qui convenait à un membre aussi ancien de la société des gens d’en haut. N’était-il pas habitué à être étendu en plein air, par la neige et le froid, la nuit comme le jour ? Et il s’apprêtait à se laisser choir, lorsque la conscience le pénétra, le saisit en quelque sorte au collet, et le maintint sur pieds, de ce que les balbutiements de sa pensée sur la « position » devaient être également mis sur le compte de la bière de Kulmbach, qu’ils ne provenaient que de son envie impersonnelle, passant pour typiquement dangereuse, de s’étendre et de dormir, laquelle était sur le point de le séduire par des sophismes et des jeux de mots.
« J’ai commis là une maladresse, reconnut-il. Le porto n’était pas indiqué, ces quelques gorgées m’ont excessivement alourdi la tête, elle me tombe pour ainsi dire sur la poitrine et mes pensées ne sont plus que divagations et plaisanteries douteuses auxquelles je ne dois pas me fier. Non seulement les pensées qui me traversent l’esprit sont douteuses, mais encore les remarques critiques que je fais sur elles, c’est cela le malheur. « Son crayon », c’est-à-dire « son crayon à elle », et non pas le sien à lui, on ne dit « son » que parce que crayon est au masculin, tout le reste n’est que plaisanterie. Je ne sais même pas pourquoi je m’arrête à cela. Alors que, par exemple, je devrais m’inquiéter beaucoup plus du fait que ma jambe gauche sur laquelle je m’appuie, rappelle d’une manière frappante la jambe de bois de l’orgue de barbarie de Settembrini qu’il pousse toujours devant soi du genou, sur le pavé, lorsqu’il s’approche de la fenêtre et qu’il tend son chapeau de velours pour que la fillette là-haut y jette une pièce. Et, en même temps, je me sens en quelque sorte attiré par des mains immatérielles vers la neige, pour m’y coucher. Il n’y a que le mouvement qui puisse remédier à cela. Il faut que je me donne du mouvement pour me punir d’avoir bu de la bière de Kulmbach et pour assouplir ma jambe de bois. »
D’un mouvement d’épaule il se détacha du mur. Mais à peine se fut-il éloigné du fenil, à peine eut-il fait un pas en avant, que le vent l’assaillit comme un coup de faux, et le repoussa vers l’abri du mur. Sans doute était-ce là le séjour auquel il était réduit et dont il devait provisoirement se satisfaire ; et il avait la faculté de s’appuyer, pour changer, sur l’épaule gauche, en se tenant sur sa jambe droite, tout en agitant un peu l’autre pour la ranimer. Par un temps pareil, se dit-il, on reste chez soi. On peut s’accorder un peu de changement, mais il ne faut pas prétendre à du nouveau, il ne faut pas s’exposer au vent. Tiens-toi tranquille et laisse pendre ta tête, puisqu’elle est si lourde. Le mur est bon, les poutres sont en bois, une certaine chaleur semble même s’en dégager, pour autant qu’il peut, ici, être question de chaleur ; une discrète chaleur naturelle ; peut-être n’est-ce que de l’imagination, peut-être est-ce subjectif… Ah ! tous ces arbres ! Oh ! ce vivant climat des hommes vivants ! Quel parfum !…
C’était un parc qui était situé en-dessous de lui, sous le balcon sur lequel il était sans doute debout, un vaste parc d’une luxuriance verdoyante, des arbres à feuilles, des ormes, des platanes, des hêtres, des érables et des bouleaux, légèrement dégradés dans la coloration de leurs feuillages frais, lustrés, et dont les cimes étaient agitées d’un léger murmure. Un air délicieux, humide, embaumé par les arbres soufflait. Une chaude buée de pluie passa, mais la pluie était éclairée par transparence. On voyait très haut dans le ciel l’air rempli d’un égouttement luisant d’eau. Comme c’était beau ! Oh ! souffle du sol natal et plénitude du pays bas, après une privation si longue ! L’air était plein de chants d’oiseaux, plein de sifflements flûtés, de gazouillements, de roucoulements et de sanglots d’une douce et gracile ferveur, sans que le moindre oiseau fût visible. Hans Castorp sourit, respirant avec reconnaissance. Mais tout cependant se faisait encore plus beau. Un arc-en-ciel se tendit obliquement par-dessus le paysage, complet et net, une pure splendeur, d’un éclat humide, avec toutes ses couleurs qui, onctueuses comme de l’huile, coulaient sur la verdure épaisse et luisante. C’était comme de la musique, comme un son de harpes mêlées à des flûtes et des violons. Le bleu et le violet surtout, coulaient merveilleusement. Tout s’y fondait, s’y perdait magiquement, se métamorphosait, toujours plus beau et plus nouveau. C’était comme ce jour, voici bien des années, que Hans Castorp avait été admis à entendre un chanteur fameux dans le monde entier, un ténor italien dont le gosier avait répandu sur les cœurs des hommes le réconfort d’un art plein de grâce. Il avait attaqué sur une note aiguë qui avait été belle dès le commencement. Mais peu à peu, d’instant en instant, cette harmonie passionnée s’était élargie, s’était dilatée et épanouie, s’était éclairée d’une lumière de plus en plus rayonnante. Un à un, des voiles que d’abord on n’avait pas perçus étaient en quelque sorte tombés ; il y en avait encore un qui, se figurait-on, allait finir par découvrir la lumière suprême et la plus pure, et puis un tout dernier voile encore, et puis un autre, suprême, qui laissa paraître une telle profusion d’éclat et de splendeur baignée de larmes qu’une sourde rumeur de ravissement, ayant résonné comme une objection ou une contradiction, s’était élevée de la foule, et que lui-même, le jeune Hans Castorp, avait été secoué de sanglots. Il en était ainsi à présent de son paysage qui se métamorphosait, qui se transfigurait progressivement. L’azur envahissait tout… Les voiles limpides de la pluie tombaient : une mer apparaissait, une mer, c’était la mer du Sud, d’un bleu profond et saturé, scintillante de lueurs d’argent, une baie merveilleuse, ouverte d’un côté en une buée légère, à moitié cernée de chaînes de montagnes d’un bleu de plus en plus mat, parsemée d’îles, où des palmiers surgissaient, ou sur lesquelles on voyait luire de petites maisons blanches parmi les bois de cyprès. Oh ! oh ! assez ! C’était tout à fait immérité. Qu’était-ce donc que cette béatitude de lumière, de profonde pureté du ciel, de fraîcheur d’eau ensoleillée ? Hans Castorp n’avait jamais vu cela, n’avait jamais rien vu de semblable. Il avait à peine tâté légèrement du Midi, à l’occasion de brefs voyages de vacances. Il connaissait la mer farouche, la mer blafarde, et y était attaché par des sentiments puérils et vagues, mais il n’avait jamais été jusqu’à la Méditerranée, jusqu’à Naples, jusqu’en Sicile ou jusqu’en Grèce, par exemple. Néanmoins, il se souvenait. Oui, chose étrange, il revoyait, il reconnaissait tout cela. « Mais oui, c’est bien cela ! » s’écria une voix en lui, comme s’il avait porté depuis toujours et sans le savoir ce bienheureux azur ensoleillé, comme en se le cachant à soi-même. Et ce « depuis toujours » était vaste, infiniment vaste, comme la mer ouverte à sa gauche là où le ciel la teintait en une nuance d’un violet tendre.
L’horizon était haut, l’étendue semblait monter, ce qui provenait de ce que Hans voyait le golfe d’en haut, d’une certaine altitude. Les montagnes s’avançaient en promontoires, couronnées de forêts, entrant dans la mer, elles reculaient en demi-cercle, du milieu du paysage qu’il apercevait jusqu’à l’endroit où il était assis, et plus loin ; c’était sur une côte rocheuse qu’il était assis, sur des marches de pierre chauffées par le soleil. Devant lui le rivage descendait, moussu et pierreux, en blocs étagés, couvert de broussailles, vers la grève basse, où les galets formaient entre les roseaux des baies bleuâtres, de petits ports et de petits lacs. Et cette contrée ensoleillée, et ces hautes rives à l’accès facile, et ces bassins riants, entourés de falaises, de même que la mer au large, jusqu’aux îles où des barques allaient et venaient, tout était peuplé. Des hommes, des enfants, du soleil et de la mer s’y mouvaient et s’y reposaient, gais et raisonnables, une belle et jeune humanité, si agréable à contempler qu’à leur vue le cœur de Hans Castorp se dilatait douloureusement et avec amour.
Des jeunes gens, des adolescents s’ébattaient avec des chevaux, couraient, la main aux rênes, à côté des animaux qui hennissaient et rejetaient la tête, tiraient sur les longues guides des chevaux rétifs, ou bien, les montant sans selle, battant des talons nus les flancs de leurs montures, les poussaient dans la mer, cependant que les muscles de leur dos jouaient au soleil sous leur peau bronzée et que les appels qu’ils échangeaient, ou adressaient à leurs bêtes, avaient pour quelque raison comme une sonorité magique. Au bord d’une des baies où la rive se réfléchissait comme dans un lac des montagnes, et qui pénétrait très avant dans la terre, des jeunes filles dansaient. L’une d’entre elles, dont les cheveux ramassés au-dessus de la nuque en un nœud avaient un charme particulier, était assise, les pieds dans un creux du terrain, et jouait sur une flûte de pâtre, les yeux fixés par-dessus ses doigts mobiles sur ses compagnes qui, en de longs vêtements flottants, isolées, les bras ouverts et souriantes, ou par couples, les tempes gracieusement rapprochées, dansaient, tandis que, dans le dos de celle qui jouait de la flûte, derrière ce dos blanc, long, délicat et que les mouvements de ses bras faisaient onduler, d’autres sœurs étaient assises, ou se tenaient enlacées, et regardaient tout en causant paisiblement. Plus loin, de jeunes hommes s’exerçaient à tirer à l’arc. C’était une vision heureuse et amicale que de voir les aînés enseigner aux adolescents maladroits aux chevelures bouclées la manière de tendre la corde en appuyant sur la flèche, de les voir viser avec leurs élèves, les soutenir lorsque le choc en retour de la flèche vibrante les faisait chanceler en riant. D’autres pêchaient à la ligne. Ils étaient étendus sur le ventre, sur les rochers plats du rivage, et trempaient leur ligne dans la mer, bavardant paisiblement, la tête tournée vers leur voisin qui, le corps allongé en une position oblique, lançait très loin son appât. D’autres encore étaient occupés à pousser une barque haute dans la mer, avec ses mâts et ses vergues, tirant, poussant et s’arc-boutant. Des enfants jouaient et jubilaient entre les brise-lames. Une jeune femme, étendue de tout son long, regardant en arrière, d’une main relevait sa robe fleurie entre les seins, en étendant l’autre au-dessus d’elle vers un fruit entouré de feuilles qu’un homme aux hanches étroites, debout à son chevet, lui offrait et lui refusait jouant de son bras tendu. Les uns étaient adossés à des niches rocheuses, d’autres hésitaient au bord du bain en croisant les bras, les mains sur les épaules, en éprouvant de la pointe du pied la fraîcheur de l’eau. Des couples se promenaient le long du rivage et près de l’oreille de la jeune fille était la bouche de celui qui la conduisait familièrement. Des chèvres à longs poils sautaient de roche en roche, gardées par un jeune pâtre qui était debout sur une éminence, une main sur la hanche, s’appuyant de l’autre sur un long bâton, un petit chapeau au bord relevé en arrière posé sur ses boucles brunes.
« Mais c’est ravissant ! » pensa Hans Castorp, c’est tout à fait réjouissant et captivant ! Comme ils sont jolis, bien portants, intelligents et heureux ! Mais quoi ! Ils ne sont pas seulement beaux mais ils sont encore intelligents et intérieurement aimables. C’est là ce qui me touche et ce qui me rend presque amoureux ; l’esprit et le sens immanent à leur être, voudrais-je dire. L’esprit dans lequel ils sont réunis et vivent ensemble ! » Il entendait par là cette grande affabilité ; et les égards égaux pour tous que se témoignaient ces hommes du soleil dans leur commerce : un respect léger et voilé d’un sourire qu’ils se témoignaient les uns aux autres, presque insensiblement, et pourtant en vertu d’une idée qui s’était faite chair, d’un lien de l’esprit qui, manifestement, les reliait tous ; une dignité et une sévérité même, mais toute résolue en gaîté et qui les guidait dans leurs actes et leurs abstentions comme une influence spirituelle et inexprimable d’une gravité nullement sombre et d’une piété raisonnable, encore qu’elle ne manquât pas de toute solennité cérémonieuse. Car là-bas, sur une pierre ronde et moussue, était assise une jeune mère qui avait dégrafé sur une épaule sa robe brune et qui étanchait la soif de son enfant. Et quiconque passait auprès d’elle la saluait d’une manière particulière qui résumait tout ce qui restait si expressivement inexprimé dans la conduite générale de ces hommes : les jeunes gens, en se tournant vers la mère et en croisant légèrement, rapidement et comme pour la forme, les bras sur leur poitrine et en inclinant la tête avec un sourire, les jeunes filles par une génuflexion ébauchée, semblable au geste de celui qui passe devant le maître-autel. Mais en même temps ils lui faisaient de cordiaux, de joyeux et vifs signes de tête, et ce mélange de dévotion formaliste et d’amitié enjouée, en même temps que la lente douceur avec laquelle la mère, qui aidait au bambin à téter sans peine en appuyant de l’index sur son sein, levait les yeux, et remerciait d’un sourire celle qui lui rendait hommage, achevèrent de ravir Hans Castorp. Il ne se lassait pas de regarder et il se demandait néanmoins avec angoisse s’il avait le droit de regarder, si le fait d’épier ce bonheur ensoleillé et civilisé n’était pas répréhensible, pour lui qui se sentait dénué de noblesse, laid et balourd.
Il semblait qu’il n’y avait pas à hésiter. Un bel éphèbe, dont la longue chevelure rejetée d’un côté avançait légèrement sur le front et retombait sur la tempe, se tenait, exactement au-dessous de son siège, les bras croisés sur la poitrine, à l’écart de ses compagnons, ni triste ni boudeur, mais tout simplement à l’écart des autres. L’adolescent l’aperçut, leva le regard vers lui, et ses yeux passèrent du guetteur aux images de la grève, et revinrent à lui, épiant le guetteur. Mais, tout à coup, il regarda par-dessus sa tête dans le lointain, et aussitôt le sourire de courtoisie fraternelle et aimable qui était commun à tous disparut de son beau visage à moitié puéril, aux lignes sévères ; sans qu’il eût froncé les sourcils, une gravité apparut sur sa figure, une gravité de pierre sans expression, insondable, quelque chose de fermé et de mortel qui saisit Hans Castorp, à peine rassuré, d’une frayeur pâle, non sans qu’il pressentît obscurément sa signification.
Lui aussi tourna la tête… De puissantes colonnes sans socles, faites de blocs cylindriques dans les fentes desquels perçait de la mousse, se dressaient derrière lui, les colonnes du portique d’un temple sur les marches duquel il était assis. Le cœur gros il se leva, gravit les marches par le côté et pénétra dans le portique profond, poursuivit sa marche par une voie dallée, qui lui donna aussitôt accès sur un nouveau parvis. Il le traversa, et voici qu’il avait devant lui le temple, énorme, verdâtre et rongé par le temps, avec un socle de gradins roides et un fronton large qui reposait sur les chapiteaux de colonnes puissantes, presque trapues, mais s’amincissant vers le haut, et de l’assemblage desquels saillait parfois un bloc arrondi. Avec peine, en s’aidant de ses mains et en soupirant, car son cœur se serrait de plus en plus, Hans Castorp escalada les hauts gradins et gagna la forêt de colonnes. Celle-ci était très profonde, il s’y promena comme entre les troncs de la forêt de hêtres, en évitant à dessein le milieu. Mais il y revenait toujours, et il se trouva, à l’endroit où les rangées de colonnes s’écartaient, en face d’un groupe de statues, de deux figures de femmes en pierre, sur un socle, la mère et la fille, semblait-il : l’une, assise, plus âgée, plus digne, très clémente et divine, mais les sourcils plaintifs, au-dessus de ses yeux vides et sans pupille, dans une tunique plissée, ses cheveux ondulés de matrone couverts d’un voile ; l’autre, debout, enlacée maternellement par la première, avec un visage rond de jeune fille, les bras et les mains joints et cachés dans les plis de son péplum.
Tandis que Hans Castorp considérait le groupe, son cœur, pour des raisons obscures, se faisait plus lourd, plus angoissé, plus chargé de pressentiments. Il osait à peine – et il le fallait pourtant – contourner ces figures pour franchir derrière elles la deuxième double rangée de colonnes ; la porte de bronze du sanctuaire était ouverte et les genoux du malheureux vacillèrent devant le spectacle que découvrit son regard. Deux femmes aux cheveux gris à demi nues, aux seins pendants et aux tétines aussi longues que des doigts, se livraient là dedans, entre les flammes des brasiers, à d’effrayantes manipulations. Au-dessus d’un bassin elles déchiraient un petit enfant, le déchiraient en un silence sauvage, avec leurs mains – Hans Castorp voyait les fins cheveux blonds barbouillés de sang – et en dévoraient les morceaux en faisant craquer les petits os friables dans leurs bouches, tandis que le sang coulait de leurs affreuses lèvres. Un frisson glacé immobilisa Hans Castorp. Il voulut couvrir ses yeux de ses mains, mais n’y réussit pas. Il voulut s’enfuir et ne le put pas. Mais voici qu’elles l’avaient aperçu tout en poursuivant leur abominable besogne ; elles agitèrent derrière lui leurs poings sanglants et l’injurièrent sans voix, avec la pire grossièreté, en termes obscènes, et cela dans le patois du pays de Hans Castorp. Il se sentit mal, plus mal que jamais. Désespérément il voulait s’arracher à cet endroit, et tel qu’en faisant cet effort il était tombé accoté à la colonne, tel il se retrouva ayant encore dans l’oreille cet affreux chuchotement criard, agrippé à son fenil dans la neige, couché sur un bras, la tête appuyée, les pieds chaussés de skis étendus devant lui.
Ce n’était cependant pas encore un véritable réveil ; il clignota seulement, soulagé d’être débarrassé de ces atroces mégères, mais il ne distinguait pas clairement – ni ne s’en souciait beaucoup – s’il était appuyé à une colonne de temple ou à un fenil, et son rêve se poursuivait en quelque sorte, non plus en images, mais en pensées d’une manière non moins osée et bizarre.
« Il me semblait bien que c’était un rêve, radotait-il en lui-même. Rêve tout à fait charmant et effroyable. Au fond, je le savais tout le temps et je me suis tout fabriqué moi-même, le parc et la belle humidité, et ce qui est venu ensuite, le beau comme le laid, je le savais presque d’avance. Mais comment peut-on savoir et se fabriquer une chose pareille, enchantement et épouvante ? Où ai-je pris ce beau golfe couvert d’îlots et ensuite l’enceinte du temple vers laquelle m’ont dirigé les regards de cet agréable jeune homme qui était seul ? On ne rêve pas seulement avec sa propre âme, me paraît-il, mais on rêve de façon anonyme et commune, encore qu’à sa propre manière. La grande âme dont tu n’es qu’une parcelle rêve à travers toi, à ta manière, de choses qu’en secret elle rêve toujours de nouveau – de sa jeunesse, de son espérance, de son bonheur, de sa paix… et de sa scène sanglante. Me voici appuyé à ma colonne, et j’ai encore dans mon corps les vrais vestiges de mon rêve, le frisson glacial qui m’a parcouru devant la cène sanglante, et aussi la joie du cœur, la joie que j’ai éprouvée devant le bonheur et les pieux usages de l’humanité blanche. Il me revient, je l’affirme, il me revient de droit d’être étendu ici et de rêver de telles choses. J’ai beaucoup appris chez les gens d’ici sur la déraison et la raison. Je me suis perdu avec Naphta et Settembrini dans les montagnes les plus dangereuses. Je sais tout de l’homme. J’ai scruté sa chair et son sang, j’ai restitué à la malade Clawdia le crayon de Pribislav Hippe. Mais quiconque connaît le corps, connaît la vie, connaît la mort. Et ce n’est pas là tout, c’est tout au plus un commencement, si l’on se place au point de vue pédagogique. Il faut y ajouter l’autre aspect, l’envers. Car tout l’intérêt que l’on éprouve pour la mort et la maladie n’est qu’une forme de l’intérêt que l’on éprouve pour la vie, comme le prouve du reste la faculté humaniste de médecine qui s’adresse en un latin si courtois à la vie et à sa maladie, et qui n’est qu’une variété de cette unique, de cette grande et pressante préoccupation que je veux appeler en toute sympathie par son nom : c’est l’enfant gâté de la vie, c’est l’homme, son état et sa position… Je le connais assez bien, j’ai beaucoup appris chez ceux d’en haut, je suis monté très haut au-dessus du pays plat, au point d’en avoir presque perdu le souffle ; mais du pied de ma colonne j’ai une vue qui ne me semble pas mauvaise… J’ai rêvé de l’état de l’homme et de sa communauté polie, intelligente et respectueuse, derrière laquelle se déroule dans le temple l’affreuse scène sanglante. Combien ils étaient courtois et charmants les uns à l’égard des autres, les hommes du soleil, avec, dans le fond, cette atroce chose ! Ils en tirent une conclusion fine et fort galante. Je veux en mon âme rester avec eux et non pas avec Naphta, du reste pas davantage avec Settembrini ; tous deux sont des bavards. L’un est sensuel et pervers et l’autre n’embouche jamais que le petit cor de la Raison et s’imagine pouvoir y ramener même les fous ; quel manque de goût ! C’est de l’esprit primaire et de l’éthique pure, c’est de l’irréligion, voilà qui est entendu. Mais je ne veux pas non plus me ranger au parti du petit Naphta, à sa religion qui n’est qu’un guazzabuglio de Dieu et du Diable, du Bien et du Mal, tout juste bon pour que l’individu s’y précipite la tête la première, afin de sombrer mystiquement dans l’universel. Ah, ces deux pédagogues ! Leurs querelles et leurs désaccords ne sont eux-mêmes qu’un guazzabuglio et un confus fracas de bataille dont ne se laisse pas étourdir quiconque a le cerveau libre et le cœur pieux. Et ce problème de l’aristocratie avec leur noblesse ! Vie ou mort, maladie, santé, esprit et nature. Sont-ce là des contraires ? Je demande : sont-ce là des problèmes ? Non, ce ne sont pas des problèmes, et le problème de leur noblesse n’en est pas un. La déraison de la mort relève de la vie, sinon la vie ne serait pas vie, et la position de l’Homo Dei est au milieu avec la déraison et la raison, de même que sa position est entre la communauté mystique et l’individualisme inconsistant. Voilà ce que j’aperçois de ma colonne. Dans cette position, il lui faut avoir avec lui-même des rapports raffinés, galants et aimablement respectueux, car lui seul est noble, mais les contraires ne le sont pas. L’homme est maître des contradictions, elles existent grâce à lui et, par conséquent, il est plus noble qu’elles. Plus noble que la mort, trop noble pour elle, et c’est la liberté de son cerveau. Plus noble que la vie, trop noble pour elle, et c’est la piété dans son cœur. Voici que j’ai rimé un songe poétique sur l’homme. Je veux m’en souvenir. Je veux être bon. Je ne veux accorder à la mort aucun pouvoir sur mes pensées ! Car c’est en cela que consistent la bonté et la charité, et en rien d’autre. La mort est une grande puissance. On se découvre et l’on marche d’un pas rythmé, sur la pointe des pieds, lorsqu’on l’approche. Elle porte la collerette de cérémonie du passé et on s’habille sévèrement et tout de noir, en son honneur. La raison est sotte en face de la Mort, car elle n’est rien que Vertu, tandis que la Mort est la liberté, la déraison, l’absence de forme et la volupté. La volupté, dit mon rêve, non pas l’amour… La Mort et l’amour, c’est une mauvaise rime, de mauvais goût, une rime fausse ! L’amour affronte la Mort ; lui seul, non pas la vertu, est plus fort qu’elle. Lui seul (pas la vertu), inspire de bonnes pensées. La forme, elle aussi, n’est faite que d’amour et de bonté : la forme et la civilisation d’une communauté intelligente et amicale, et d’un bel État humain – avec le sous-entendu discret de la cène sanglante. Oh, voilà qui est rêvé avec clarté et bien « gouverné » ! Je veux y penser. Je veux garder dans mon cœur ma foi en la Mort, mais je veux clairement me souvenir que la fidélité à la mort et au passé n’est que vice, volupté sombre et antihumaine lorsqu’elle commande à notre pensée et à notre conduite. L’homme ne doit pas laisser la Mort régner sur ses pensées au nom de la bonté et de l’amour. Et ceci pensé, je m’éveille… Car j’ai suivi mon rêve jusqu’au but. Depuis longtemps, je cherchais cette parole : à l’endroit où Hippe m’est apparu, dans ma loge et partout. Mes recherches m’ont entraîné ensuite dans les montagnes couvertes de neige. Mais voici que je la tiens. Mon rêve me l’a clairement révélée, de sorte que je la sais à jamais. Oui, j’en suis ravi et comme réchauffé. Mon cœur bat fort et sait pourquoi. Il ne bat pas seulement pour des raisons physiques, il ne bat pas comme les ongles d’un cadavre continuent à pousser, il bat humainement, et vraiment il se sent heureux. C’est un philtre, cette parole de rêve, meilleur que le porto et que l’ale, cela me coule à travers les veines comme l’amour et la vie, pour que je m’arrache à mon sommeil et à mon rêve, dont je sais naturellement qu’ils mettent en grave péril ma jeune vie… Ouverts ! Les yeux ouverts ! Ce sont tes membres, à toi, ces pieds-là dans la neige ! Rassemble-les, et debout ! Tiens… Il fait beau ! »
Elle était terriblement malaisée, la délivrance des liens qui l’enserraient et qui cherchaient à le maintenir à terre ; mais l’élan qu’il avait pris était plus fort. Hans Castorp se jeta sur un coude, tendit énergiquement les genoux, tira, s’appuya et se redressa. Il piétina la neige avec ses planches, se frappa les côtes des bras, et secoua les épaules en jetant des regards animés et curieux ci et là, et vers le ciel, où un bleu pâle se montrait entre les voiles minces des nuages gris-bleu qui glissaient doucement et qui découvraient l’étroite faucille de la lune. Léger crépuscule. Pas de tempête, pas de neige ! La paroi rocheuse de l’autre côté, avec son dos hérissé de sapins, était visible, pleinement et clairement, elle reposait en paix. L’ombre montait jusqu’à mi-hauteur ; l’autre moitié était délicatement éclairée de rose. Que se passait-il donc, et comment se comportait le monde ? Était-ce le matin ? Et Hans Castorp avait-il passé la nuit dans la neige, sans mourir de froid comme on pouvait le lire dans les livres ? Aucun de ses membres n’était mort, aucun ne se cassait avec un bruit sec, tandis qu’il piétinait, se secouait et battait autour de lui, à quoi il s’occupait tout en s’efforçant de réfléchir à sa situation. Ses oreilles, les pointes de ses doigts, ses orteils étaient sans doute engourdis, rien de plus que ce qui lui était déjà souvent arrivé en hiver, lorsqu’il restait étendu dans sa loge. Il réussit à tirer sa montre. Elle marchait. Elle ne s’était pas arrêtée comme elle avait coutume de faire lorsqu’il oubliait de la remonter. Elle ne marquait pas encore cinq heures, même de loin. Il s’en fallait de douze ou treize minutes. Étonnant ! Était-il donc possible qu’il ne fût resté étendu, ici, dans la neige, que dix minutes, ou un peu plus, et qu’il eût inventé pour lui-même tant d’images heureuses et effrayantes et tant de pensées téméraires, cependant que le tumulte hexagonal se dissipait aussi vite qu’il était survenu ? Et puis, il avait eu une chance incontestable, au point de vue du retour. Car, à deux reprises, ses songes et ses fables avaient pris une tournure telle qu’il avait sursauté, ranimé du coup, d’abord d’effroi, ensuite de joie. Il semblait que la vie eût de bonnes intentions à l’endroit de son enfant gâté et égaré.
Quoi qu’il en soit, et que l’on fût au matin ou dans l’après-midi (mais sans nul doute, on en était toujours au début de la soirée), il n’y avait rien dans les circonstances ni dans son état personnel qui eût pu empêcher Hans Castorp de rentrer chez lui ; et c’est ce qu’il fit. D’un élan magnifique, en quelque sorte à vol d’oiseau, il descendit vers la vallée où les lumières brûlaient déjà lorsqu’il arriva, bien que les restes d’un jour conservé par la neige lui eussent pleinement suffi. Il descendit par le Brehmenbuhl, le long du Mattenwald, et fut arrivé vers cinq heures et demie à Dorf où il déposa son attirail sportif chez l’épicier, se reposa dans la cellule mansardée de M. Settembrini et lui rendit compte de la tempête de neige par laquelle il s’était laissé surprendre. L’humaniste se montra fort alarmé. Il lança la main par-dessus sa tête, gronda énergiquement l’imprudent qui avait couru un tel danger et alluma séance tenante la lampe à alcool qui faisait entendre de petites explosions, pour préparer du café au jeune homme épuisé, un café dont la force n’empêcha pas Hans Castorp de s’endormir sur sa chaise.
L’atmosphère très civilisée du Berghof l’entourait une heure plus tard de son souffle caressant. À dîner, il montra un bel appétit. Ce qu’il avait rêvé commençait à pâlir. Le soir même il ne comprenait plus très bien ce qu’il avait pensé.
EN SOLDAT ET EN BRAVE
Hans Castorp ne cessa de recevoir de brèves nouvelles de son cousin, d’abord bonnes, exubérantes, puis, moins favorables, enfin des nouvelles qui dissimulaient mal quelque chose de très triste. La série des cartes postales commença par le message joyeux qui rapportait l’arrivée de Joachim au régiment et la cérémonie romantique au cours de laquelle, comme Hans Castorp s’exprima sur la carte postale qu’il envoya en réponse à son cousin, il avait fait serment de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Puis cela continua gaiement : les étapes d’une carrière facile et favorisée, aplanie par un attachement passionné au métier et par la sympathie des chefs, étaient retracées, suivies de salutations et de souhaits. Comme Joachim avait étudié pendant quelques semestres à l’université, on l’avait dispensé des cours à l’école de guerre et exempté du service d’aspirant. Promu sous-officier pour le nouvel an, il envoya une photographie qui le montrait avec ses galons. Chacun de ses rapports succincts rayonnait du ravissement qu’il éprouvait à subir l’esprit d’une discipline de fer durcie par le sentiment de l’honneur, mais qui tenait compte quand même, avec un rude humour, de la faiblesse humaine. Il y avait des anecdotes sur la conduite romantique et embrouillée qu’avait à son égard son sergent, un vieux soldat hargneux et fanatique qui voyait malgré tout dans ce jeune et faillible subordonné le chef sacro-saint de demain (en effet Joachim était déjà admis au mess des officiers). C’était cocasse et féroce. Puis il fut question de l’admission à l’examen d’officier. Au commencement d’avril Joachim était nommé lieutenant.
Il n’y avait pas, de toute apparence, d’homme plus heureux, il n’y en avait pas dont la nature et les désirs auraient pu tirer une satisfaction plus pure de cette forme d’existence. Avec une sorte de volupté pudique il racontait comment, dans sa splendeur toute neuve, il avait pour la première fois passé devant l’Hôtel de Ville, et avait, d’un signe de la main, mis au repos le factionnaire qui s’était immobilisé pour lui rendre les honneurs. Il parla des petits désagréments et des satisfactions du service, de camarades étonnants et sympathiques, de la fidélité malicieuse de son ordonnance, d’incidents comiques pendant l’exercice et à l’heure de l’instruction, de revues et de repas de corps. Incidemment il était aussi question d’événements mondains, de visites, de dîners, de bals. Mais jamais de sa santé.
Il en fut de la sorte, jusqu’au début de l’été. Il annonça alors qu’il était alité, que, malheureusement, il avait dû se porter malade : grippe, affaire de quelques jours. Au début de juillet il reprit son service, mais vers le milieu du mois il était de nouveau « flapi », se plaignit amèrement de sa « poisse » et trahit sa crainte de ne pouvoir être à son poste pour les grandes manœuvres, au commencement d’août, qu’il avait attendues avec une impatience joyeuse. Sottises que tout cela ! En juillet, il était parfaitement bien portant, le resta pendant des semaines, jusqu’à ce qu’une consultation s’imposât, que les maudites oscillations de sa température avaient rendue nécessaire et dont tout allait dépendre. Sur le résultat de cette consultation Hans Castorp resta longtemps sans nouvelles, et lorsqu’il en reçut ce ne fut pas Joachim qui écrivit, – soit qu’il ne fût pas en état de le faire, soit qu’il eût honte – mais ce fut sa mère, Mme Ziemssen, qui envoya un télégramme. Elle annonça que Joachim avait pris un congé de quelques semaines, jugé indispensable par les médecins. Haute montagne recommandée, départ immédiat prescrit, prière réserver deux chambres. Réponse payée. Signé : tante Louise.
C’est à la fin de juillet que Hans Castorp parcourut cette dépêche sur sa loge de balcon, la lut et la relut encore. Il hocha légèrement la tête, et non pas seulement la tête, mais tout le haut du corps et dit entre ses dents : « Tiens, tiens, tiens ! ! ! Pas possible, pas possible, pas possible ! Joachim revient. » Une joie soudaine le pénétra. Mais presque aussitôt il se calma et pensa : « Hum, hum, grave nouvelle. On pourrait même dire : jolie surprise ! Diable, cela a été vite ! Déjà mûr pour le pays ? La mère vient avec lui. (Il dit : « la mère », non pas « tante Louise » son sentiment des parentés s’était insensiblement atténué, de sorte qu’il se sentait presque un étranger.) C’est une circonstance aggravante. Et tout juste avant les grandes manœuvres auxquelles ce cher garçon brûlait de prendre part ! Hum, hum ! Il y a dans tout cela une forte dose de vilenie, et d’une vilenie sarcastique ; c’est là un fait antiidéaliste. Le corps triomphe, il veut autre chose que l’âme et il s’impose pour la confusion des gens présomptueux qui enseignent qu’il est soumis à l’âme. Il semble qu’ils ne sachent pas ce qu’ils disent, car s’ils avaient raison, cela jetterait un jour douteux sur l’âme dans un cas comme celui-ci. Sapienti sat[14], je sais ce que je veux dire. Car la question que je soulève, c’est justement de savoir dans quelle mesure c’est une erreur de les opposer l’un à l’autre, dans quelle mesure ils sont au contraire d’accord et jouent une partie concertée. Mais voilà une idée qui, heureusement pour les présomptueux, ne leur viendra pas. Mon bon Joachim, qui voudrait rien te reprocher à toi et à ton zèle excessif ? Tu es loyal, mais à quoi sert la loyauté si le corps et l’âme se sont mis d’accord ? Serait-il possible que tu n’aies pas oublié certains parfums rafraîchissants, une gorge opulente et un rire sans raison qui t’attendent à la table de la Stoehr ?… Joachim revient, se dit-il de nouveau, et il tressaillit de joie. Il arrive en un mauvais état, sans doute, mais nous serons de nouveau à deux, et je ne serai plus ici tout à fait livré à moi-même. Voilà qui est bien. Il est vrai que tout ne sera pas exactement comme autrefois. Sa chambre n’est-elle pas occupée ? Mrs. Mac Donald tousse sourdement et naturellement elle tient à la main la photographie de son jeune fils, ou l’a posée devant elle sur sa petite table. Mais c’est le stade final, et si la chambre n’est pas déjà réservée. On pourra du reste en retenir provisoirement une autre. Le 28 est libre, sauf erreur. Je vais tout de suite aller à l’administration, et notamment chez Behrens. En voilà une nouvelle, triste à certains points de vue, épatante à d’autres, mais en tout cas une nouvelle formidable ! Je vais tout juste attendre encore le camarade « Je vous salue », qui doit passer tout à l’heure, car il est déjà trois heures et demie. Je vais lui demander s’il estime que même dans ce cas le phénomène physique doit être considéré comme secondaire… »
Encore avant l’heure du thé, il se rendit au bureau de l’administration. La dite chambre, qui donnait sur le même corridor que la sienne, était disponible et l’on trouverait également à caser Mme Ziemssen. Il se hâta d’aller chez Behrens. Il le trouva au « labo », un cigare à la main, tenant de l’autre une éprouvette d’un contenu de couleur douteuse.
– Docteur, savez-vous ? commença Hans Castorp.
– Oui, qu’on ne décolère pas, répondit le pneumotomiste. Voilà ce Rosenheim, d’Utrecht, dit-il, et de son cigare il désigna l’éprouvette. Gaffky 10. Et voici que Schmitz, le directeur d’usine, vient criailler et se plaindre parce que Rosenheim a expectoré en se promenant, avec Gaffky 10. Je dois le secouer. Mais si je lui lave la tête, il se met dans tous ses états, car il est follement susceptible et il occupe trois chambres avec toute sa famille ; je ne peux pas le mettre à la porte, sinon j’aurai affaire à la direction générale. Vous voyez dans quels conflits on se trouve impliqué à tout moment, on a beau vouloir suivre son chemin, en paix et sans reproche.
– Bête d’histoire ! dit Hans Castorp avec la compréhension de l’habitué et de l’ancien. Je connais ces Messieurs. Schmitz est à cheval sur les convenances, tandis que Rosenheim se néglige plutôt. Mais peut-être y a-t-il entre eux des points de friction ailleurs que sur le seul terrain de l’hygiène, il me semble tout au moins. Schmitz et Rosenheim sont tous deux amis de Dona Perez, de Barcelone, de la table de la Kleefeld. C’est là qu’il faut sans doute chercher l’origine de cette querelle. Je vous conseillerais de rappeler d’une manière générale les prescriptions qui sont en cause et pour le reste de fermer l’œil.
– Naturellement que je le ferme. Je ne fais que cela ; à force de le fermer, j’en ai presque un blépharospasme. Mais qu’est-ce que vous me voulez, vous ?
Et Hans Castorp déballa sa nouvelle à la fois triste et épatante.
Ce n’est pas que le conseiller s’en soit montré surpris. Il ne l’aurait été dans aucun cas, mais il ne le fut pas du tout en l’occurrence parce que Hans Castorp, interrogé à ce sujet ou de son propre chef, l’avait tenu au courant de la santé de Joachim ; et avait informé Behrens dès le mois de mai que son cousin gardait le lit.
– Tiens, tiens, dit Behrens. Allons bon ! Qu’est-ce que je vous avais dit ? Qu’est-ce que je vous avais dit, textuellement, non pas dix, mais cent fois ? Vous voilà servi ! Pendant neuf mois il a eu son bon plaisir et son paradis ! Mais dans un paradis qui n’est pas désintoxiqué, il n’y a point de salut ; c’est ce que notre évadé n’a pas voulu croire quand le vieux Behrens le lui disait. Mais il faut toujours en croire le vieux Behrens, sinon on est fichu et on vient trop tard à résipiscence. Le voilà qui a obtenu le grade de lieutenant, c’est vrai, rien à dire. Mais à quoi cela lui sert-il ? Dieu regarde au fond des cœurs, il ne s’occupe ni du rang ni de l’état, nous sommes tous devant lui dans notre nudité, le général comme le simple soldat… » Il commença à s’embrouiller, se frotta les yeux de sa main énorme dont les doigts tenaient le cigare, et pria Hans Castorp de ne pas le retenir plus longtemps cette fois-ci. Un logis pour Ziemssen devait être facile à trouver, et lorsque le cousin arriverait, il chargeait Hans Castorp de le fourrer au lit sans retard. Quant à lui, Behrens, il ne reprochait jamais rien à personne, il ouvrait paternellement ses bras et il était prêt à tuer le veau gras pour le fils prodigue.
Hans Castorp envoya une dépêche. Il raconta à droite et à gauche que son cousin allait revenir, et tous ceux qui connaissaient Joachim en étaient attristés et heureux, l’un et l’autre ! sincèrement, car le caractère loyal et chevaleresque de Joachim lui avait gagné la sympathie générale, et le jugement ou le sentiment inexprimé de nombreux malades était qu’il avait été le meilleur d’entre eux tous. Nous ne visons personne en particulier, mais nous croyons que plus d’un éprouva une certaine satisfaction en apprenant que Joachim devait revenir de l’état militaire à la position horizontale, et que malgré toute sa correction il allait de nouveau être « des nôtres ». On sait que Mme Stoehr avait prévu cela dès le début. Elle se trouva confirmée, dans le scepticisme vulgaire qu’elle avait manifesté lors du départ de Joachim pour le pays plat, et elle ne dédaigna pas de s’en vanter. « Mauvais, mauvais ! » fit-elle. Elle s’était tout de suite rendu compte que cela allait mal et elle voulait espérer que Ziemssen n’eût pas, dans son entêtement, attigé son affaire (« attigé », dit-elle dans sa vulgarité sans bornes). Mieux valait donc, quand même, rester au bercail, comme elle avait fait, bien qu’elle aussi eût ses intérêts en pays plat, à Cannstatt : un mari et deux enfants. Mais elle savait se dominer… Ni Joachim ni Mme Ziemssen ne donnèrent plus de leurs nouvelles. Hans Castorp resta dans l’ignorance de l’heure et du jour de leur arrivée. Pour la même raison il ne les attendit pas à la gare, mais trois jours après l’expédition du télégramme de Hans, ils se trouvèrent tout simplement là, et le lieutenant Joachim parut avec un rire excité à côté de la chaise-longue réglementaire de son cousin.
Ce fut à l’heure où commençait la cure de repos du soir. Le même train les avait amenés, par lequel Hans Castorp était arrivé ici, il y avait des années qui ne furent ni brèves ni longues, mais privées de durée, très riches en événements, et néanmoins nulles et inconsistantes, et la saison elle aussi, était la même, c’était même exactement la même : un des tout premiers jours d’août. Donc Joachim entra joyeusement, – oui, pour l’instant y montrait une agitation incontestablement joyeuse – chez Hans Castorp, ou plus exactement il passa de la chambre, qu’il avait parcourue au pas gymnastique, sur le balcon, et salua son cousin en riant, le souffle court, saccadé et assourdi. Il avait de nouveau accompli le lointain voyage, à travers les pays divers, par-dessus le lac semblable à une mer, et puis en montant par d’étroits sentiers, et voici qu’il était là, comme s’il n’était jamais parti, salué par son parent qui s’était à moitié redressé de la position horizontale à grands renforts de « hallo » et de « pas possible ». Son teint était coloré, soit par la vie en plein air qu’il avait menée, soit des conséquences du voyage. Directement, sans même s’enquérir d’abord de sa chambre, il était accouru au numéro trente-quatre, pour saluer le compagnon de ses jours anciens, lesquels étaient redevenus présents, cependant que sa mère était occupée à faire un peu de toilette. Ils comptaient dîner dans dix minutes, naturellement au restaurant, Hans Castorp pourrait bien encore manger avec eux, ou tout au moins boire un doigt de vin. Et Joachim entraîna son cousin au numéro vingt-huit où il se passa ce qui était arrivé le soir de la venue de Hans, mais c’était l’opposé : Joachim, bavardant fiévreusement, se lava les mains dans le lavabo étincelant, et Hans Castorp le regarda, étonné du reste, et en quelque sorte déçu de voir son cousin en civil. Son état militaire ne se trahissait en rien dans sa tenue. Il se l’était tout le temps représenté comme officier en uniforme, et voici qu’il était là, dans son complet gris uni, comme n’importe qui. Joachim rit et le trouva naïf. Ah non, son uniforme, il l’avait laissé là-bas. Hans Castorp devait savoir que l’uniforme était une chose à part. On n’entrait pas n’importe où en uniforme. « Ah voilà ! Merci du renseignement », dit Hans Castorp. Mais Joachim ne paraissait pas avoir conscience du sens offensant que l’on pouvait donner à son explication. Il s’informa des personnes et des événements au Berghof, non seulement sans la moindre présomption, mais encore avec l’attendrissement et la sollicitude de quelqu’un qui revient. Puis Mme Ziemssen parut par la porte de communication, salua son neveu de la manière que beaucoup de personnes affectent en de telles circonstances, c’est-à-dire comme si elle était joyeusement surprise de le trouver ici, avec une expression qui du reste était assombrie par une sorte de mélancolie, par la fatigue et un chagrin muet qui se rapportait apparemment à Joachim. Ils descendirent.
Louise Ziemssen avait les mêmes beaux yeux noirs que Joachim. Ses cheveux, également noirs, mais déjà sensiblement mêlés de fils blancs, étaient maintenus par un filet presque invisible, et cela s’accordait avec toute sa manière d’être, qui était réfléchie, mesurée avec grâce, discrète avec douceur, et qui, malgré une évidente simplicité d’esprit, lui prêtait une dignité agréable. Il était clair, – et Hans Castorp ne s’en étonna pas du reste, – qu’elle ne comprenait pas la gaieté de Joachim sa respiration accélérée et sa parole précipitée, phénomènes qui contredisaient sans doute l’attitude qu’il avait eue là-bas et qui étaient en effet mal appropriés à sa situation ; et elle en était en quelque sorte choquée… Ce retour lui paraissait triste et elle croyait devoir y conformer sa tenue. Elle ne pouvait pas se faire aux impressions de Joachim, aux sensations tumultueuses du retour qui emportaient momentanément dans une vague d’ivresse tout ce qui s’y opposait, et que le fait de respirer de nouveau cet air, notre air incomparablement léger, inconsistant et échauffant d’en haut, exaltait sans doute encore. Ces sensations étaient pour elle impénétrables. « Mon pauvre petit », pensait-elle, tout en regardant le pauvre petit s’abandonner avec son cousin à une joie débordante, réveiller mille souvenirs, poser mille questions, et rire des réponses qu’on lui faisait, en se rejetant au fond de son siège. Plusieurs fois elle dit : « Mais voyons, mes enfants ! » Et ce qu’elle finit par dire devait être joyeux, mais avait un accent de surprise et presque de blâme : « Joachim, vraiment, il y a longtemps que je ne t’ai plus vu ainsi. On dirait que nous devions revenir ici pour que tu sois de nouveau comme le jour de ta promotion. » Sur quoi, il est vrai, la gaîté de Joachim tourna court. Sa bonne humeur tomba, il reprit conscience de son état, se tut, ne toucha pas à l’entremets, bien que ce fût un soufflé au chocolat des plus appétissants, avec de la crème fouettée (au contraire Hans Castorp lui faisait honneur quoiqu’une heure à peine se fût écoulée depuis la fin de son substantiel dîner), et finit par ne plus du tout lever les yeux, apparemment parce qu’il y avait des larmes.
Telle n’avait certainement pas été l’intention de Mme Ziemssen. C’était plutôt par égards pour les convenances qu’elle avait voulu obtenir un peu de sérieux et de modération, ignorant que tout ce qui est moyen et mesuré était étranger à ce lieu, et que l’on n’y pouvait choisir qu’entre deux extrêmes. Lorsqu’elle vit son fils accablé de la sorte, elle faillit elle-même fondre en larmes, et elle sut gré à son neveu des efforts qu’il fit pour remonter son fils, profondément attristé. En ce qui touchait les pensionnaires, disait-il, Joachim trouverait beaucoup de changement et pas mal de nouveau, mais pour le reste, les choses avaient suivi durant son absence leur cours ordinaire. Il y avait longtemps que la grand’tante, avec sa compagnie, était de retour. Ces dames étaient assises comme toujours à la table de Mme Stoehr. Maroussia riait beaucoup et de tout son cœur.
Joachim garda le silence. Mais ces paroles rappelèrent à Mme Ziemssen certaine rencontre et des salutations qu’elle devait transmettre avant de l’oublier : la rencontre avec une dame, assez sympathique encore qu’elle voyageât seule, et que la ligne de ses sourcils fût un peu trop régulière. Ils l’avaient rencontrée à Munich, où l’on avait passé un jour entre deux trajets nocturnes et, au restaurant, elle s’était approchée de leur table, pour saluer Joachim. Une ancienne voisine de sanatorium… Et elle demanda à Joachim de lui rappeler le nom de la dame… ?
– Mme Chauchat, dit doucement Joachim. Elle séjournait, pour le moment, dans une station balnéaire de l’Allgau et elle se proposait de passer l’automne en Espagne. Pour l’hiver, elle reviendrait sans doute ici. Elle les avait chargés de son meilleur souvenir.
Hans Castorp n’était plus un enfant, il dominait les nerfs vasculaires, qui auraient pu faire pâlir ou rougir son visage. Il dit :
– Ah, c’était elle ? Tiens, elle est donc revenue du fond de son Caucase ? Et elle veut aller en Espagne ?
La dame avait cité un endroit dans les Pyrénées.
– Une jolie femme, ou tout au moins charmante. Une voix agréable, des mouvements agréables. Mais des manières libres et négligées, dit Mme Ziemssen. Elle nous a accostés tout simplement, comme de vieux amis, elle nous a questionnés, elle a bavardé avec nous, bien que Joachim, m’a-t-il dit, n’ait en somme jamais fait sa connaissance. Bizarre !
– C’est l’Orient et c’est la maladie, répondit Hans Castorp. Il ne fallait pas appliquer à ces choses-là les mesures de la civilisation humaniste ; ce serait une erreur. Justement, Mme Chauchat avait l’intention de se rendre en Espagne ! Hum, l’Espagne était dans la direction opposée, aussi loin de la moyenne humaniste, non pas du côté nonchalant, mais du côté rigide ; ce n’était pas absence de forme, mais excès de forme, la mort considérée comme forme, non pas la dissolution de la mort, mais l’austérité de la mort, noire, distinguée et sanglante, l’Inquisition, la collerette empesée, Loyola, l’Escurial… Il serait intéressant de savoir comment Mme Chauchat se plairait en Espagne. Sans doute y perdrait-elle l’habitude de claquer des portes, et peut-être verrait-on s’y établir un certain équilibre humain entre les deux camps antihumanistes. Mais lorsque l’Orient allait en Espagne il pouvait également en résulter un terrorisme farouche…
Non, il n’avait ni rougi ni pâli, mais l’impression que ces nouvelles inattendues de Mme Chauchat lui avaient produite se traduisit en paroles qui ne pouvaient appeler d’autre réponse qu’un silence gêné. Joachim était moins effrayé. Il se souvenait des subtilités extravagantes de son cousin. Mais la plus grande stupéfaction se peignit dans les yeux de Mme Ziemssen ; elle ne se comporta pas autrement que si Hans Castorp avait prononcé des paroles de la plus grossière inconvenance, et après un silence pénible elle se leva de table avec des mots destinés à mettre fin à cette situation gênante. Avant qu’ils ne se séparassent, Hans Castorp leur fit part des instructions du conseiller ; Joachim devait de toute façon rester au lit demain jusqu’à ce qu’on l’eût ausculté. Pour la suite, on verrait. Puis, les trois parents s’étendirent chacun de leur côté dans leurs chambres ouvertes sur la fraîcheur de cette nuit d’été en haute montagne, chacun avec ses pensées, Hans Castorp tout à la perspective du retour de Mme Chauchat qu’il pouvait espérer dans un délai de six mois.
Et ce pauvre Joachim était donc rentré dans son « pays » pour une petite cure complémentaire que l’on avait jugée opportune. Cette expression de « cure complémentaire » était apparemment le mot d’ordre donné en pays plat et l’on s’en servit également ici. Le conseiller Behrens lui-même adopta l’expression quoiqu’il commençât par administrer à Joachim, dès le premier jour, quatre semaines de repos au lit : elles étaient nécessaires pour obvier au plus grave, pour l’aider à s’acclimater et pour régulariser quelque peu les sautes de sa température. Il sut, par ailleurs, éviter d’assigner une durée précise à la petite cure complémentaire. Mme Ziemssen, raisonnable, sensée, ne se berçant nullement d’espérances exagérées, proposa – en l’absence de Joachim – l’automne, le mois d’octobre par exemple, comme date éventuelle de départ, et Behrens l’approuva ; du moins, il déclara qu’à ce moment-là on serait certainement plus avancé qu’aujourd’hui. D’ailleurs, il lui produisit une impression excellente. Il était fort galant, disait « chère Madame », en la regardant loyalement de ses yeux larmoyants et injectés de sang, et usait si bien du langage imagé des étudiants allemands que, malgré toute sa tristesse, elle finissait par en rire. « Il est entre les meilleures mains » dit-elle, et repartit pour Hambourg huit jours après son arrivée puisqu’il ne pouvait être sérieusement question de soins à donner et d’autant plus que Joachim avait là un parent pour lui tenir compagnie.
– Réjouis-toi : c’est pour l’automne, dit Hans Castorp lorsqu’il se fut assis au n° 28, au chevet de son cousin. Le vieux s’est quand même engagé jusqu’à un certain point. Tu peux t’en tenir là et y compter. Octobre, c’est le bon moment. Beaucoup de gens à ce moment-là vont en Espagne et toi, tu retournes auprès de ta bandera, pour te distinguer brillamment.
Son occupation quotidienne était de consoler Joachim surtout d’avoir manqué en venant ici le grand jeu militaire qui commençait en ces jours d’août, car c’était là surtout ce dont il ne s’accommodait pas ; et il manifestait véritablement du mépris pour cette maudite faiblesse à laquelle il avait succombé au dernier moment.
– Rebellio carnis[15], dit Hans Castorp. Que veux-tu y faire ? Le plus vaillant officier n’y peut rien, et même saint Antoine en a su quelque chose. Mon Dieu, il y a chaque année des manœuvres, et puis tu connais notre temps d’ici. Ce n’est pas du temps du tout ; tu n’as pas été absent assez longtemps pour ne pas en retrouver rapidement le rythme – et en un tournemain ta petite cure complémentaire sera passée.
Néanmoins le sens du temps avait été renouvelé trop sensiblement chez Joachim par son séjour en pays plat pour qu’il n’eût pas quand même eu peur de ces quatre semaines qui l’attendaient. Mais on l’aidait de toutes parts à les franchir ; la sympathie que, de tous côtés, l’on témoignait à son caractère si digne, se traduisit par des visites venant de près et de loin. Settembrini vint, compatit, se montra charmant, et comme il avait toujours appelé Joachim lieutenant, il lui donna le titre de capitano. Naphta, lui aussi, rendit visite au malade, et toutes les vieilles connaissances de la maison parurent peu à peu, en profitant d’un petit quart d’heure de liberté, entre les heures de service, pour s’asseoir au bord de son lit, répéter l’expression « petite cure complémentaire » et se faire raconter ses aventures : les dames Stoehr, Lévi, Iltis et Kleefeld, les MM. Ferge, Wehsal et d’autres encore. Certains lui apportèrent même des fleurs. Lorsque les quatre semaines furent écoulées, il se leva parce que sa fièvre avait suffisamment baissé pour qu’il pût aller et venir, et il reprit sa place dans la salle à manger, à côté de son cousin, entre Hans Castorp et l’épouse du brasseur Mme Magnus, en face de M. Magnus, à l’angle de la table et à la place même que l’oncle James et plus tard Mme Ziemssen avaient occupée quelque temps.
Ainsi les jeunes gens vécurent-ils de nouveau côte à côte, comme autrefois ; même, pour que la situation antérieure ressuscitât encore plus complètement, Joachim reprit possession de son ancienne chambre, après que Mrs. Mac Donald eut, le portrait de son petit garçon dans les mains, rendu le dernier soupir, – son ancienne chambre, à côté de celle de Hans Castorp, bien entendu, après qu’elle eut été consciencieusement désinfectée avec du H2CO. En réalité, et au point de vue sentimental, il en allait toutefois ainsi que c’était désormais Joachim qui vivait aux côtés de Hans Castorp et non plus Hans Castorp auprès de son cousin. C’était le premier qui était maintenant l’habitant sédentaire dont Joachim ne faisait que partager l’existence, momentanément et en visiteur. Car Joachim s’efforçait avec une fermeté rigide de garder en vue le délai fixé pour octobre, bien que certaines parties de son système nerveux central ne se résignassent pas à suivre une conduite conforme à la norme humaniste et que sa peau restât brûlante et sèche.
Ils reprirent également leurs visites chez Settembrini et chez Naphta, ainsi que leurs promenades avec ces deux hommes liés par leur antagonisme ; lorsque A. K. Ferge et Ferdinand Wehsal y prenaient part, ce qui était souvent le cas, ils étaient six ; et ces adversaires dans le domaine de l’esprit poursuivaient alors leurs joutes incessantes dont nous ne saurions rendre compte d’une manière explicite sans nous perdre dans un dédale désespérant – exactement comme ils le faisaient eux-mêmes tous les jours, devant un public assez nombreux, encore que Hans Castorp tendît à considérer sa pauvre âme comme le principal enjeu de leurs débats dialectiques. Il avait appris par Naphta que Settembrini était franc-maçon – ce qui lui avait fait une impression non moins vive que la confidence de l’Italien sur les accointances de Naphta avec les jésuites et l’origine de ses ressources. De nouveau il éprouva de la surprise en apprenant qu’il existait vraiment encore des choses aussi fantastiques, et avec insistance il interrogea le terroriste sur l’origine et la nature de cette curieuse institution qui célébrerait dans quelques années son deux-centième anniversaire. Si Settembrini parlait de la nature intellectuelle de Naphta derrière le dos de son voisin, en mettant pathétiquement en garde contre elle, comme contre quelque chose de diabolique, Naphta, derrière le dos de l’autre, se moquait, par contre, cordialement et sans emphase, de la sphère que l’autre représentait, en donnant à entendre que tout cela était bien suranné et arriéré : ce libéralisme bourgeois de l’avant-veille, qui n’était pas autre chose qu’un pitoyable fantôme de l’esprit, mais qui s’abandonnait encore à l’illusion bouffonne d’être animé d’une vie révolutionnaire. Il disait : « Que voulez-vous, son grand-père était carbonaro, ce qui veut dire : charbonnier. C’est de lui qu’il tient cette foi de charbonnier en la Raison, la Liberté, le Progrès de l’Humanité, et toute cette malle pleine d’idéologies de vertus bourgeoises et classiques, toutes rongées par les mites ! Voyez-vous, ce qui trouble le monde c’est la disproportion entre la rapidité de l’esprit et la balourdise, la lenteur, l’incroyable paresse et force d’inertie de la matière. Il faut convenir de ce que cette disproportion pourrait servir d’excuse à un esprit qui se désintéresse du réel, car il est dans la règle que les ferments qui provoquent en réalité les révolutions lui répugnent depuis longtemps. En effet, l’esprit mort répugne davantage à l’esprit vivant que des basaltes qui, tout au moins, n’ont pas la prétention d’être de l’esprit et de la vie. De tels basaltes, vestiges de réalités anciennes que l’esprit a laissées si loin derrière lui qu’il se refuse à y lier encore le concept du réel, se conservent par inertie et par leur persistance pesante et morte empêchent malheureusement les idées arriérées de se rendre compte à quel point elles le sont. Je m’exprime d’une façon générale, mais vous appliquez vous-même ces généralités à certain libéralisme humanitaire qui croit toujours se trouver dans une situation héroïque face au despotisme et à l’autorité. Cela sans parler des catastrophes, hélas, par lesquelles il voudrait prouver qu’il vit, de ces triomphes attardés et tapageurs qu’il prépare et qu’il rêve de pouvoir fêter un jour. À la seule pensée de tout cela, l’esprit vivant pourrait mourir d’ennui, s’il ne savait pas qu’à la vérité c’est lui seul qui l’emportera, et qui profitera de catastrophes pareilles, lui qui allie des éléments du passé aux éléments les plus futurs de l’avenir en vue d’une véritable révolution… Comment va votre cousin, Hans Castorp ? Vous savez que j’ai beaucoup de sympathie pour lui.
– Merci, Monsieur Naphta. Je crois que tout le monde a de la sympathie pour lui, c’est un si brave garçon. M. Settembrini, lui aussi, l’aime bien, encore que, naturellement, il doive désapprouver un certain terrorisme exalté qu’implique le métier de Joachim. Mais vous m’apprenez qu’il est un frère de la Loge ? Voyez-moi ça ! Cela me rend songeur, je l’avoue, cela éclaire sa personne d’un jour nouveau, et m’explique bien des choses. Place-t-il, à l’occasion, ses pieds en angle droit, et donne-t-il des poignées de mains d’une certaine manière ? Je n’ai rien remarqué de tel…
– Je pense que notre bon frère trois points, doit avoir dépassé le stade de tels enfantillages. Je présume que le cérémonial des loges a dû s’adapter assez difficilement à la sécheresse de l’esprit bourgeois de ce temps. On aurait honte du rituel d’autrefois, comme d’un charlatanisme déplacé, pas tout à fait à tort, car, en définitive, il serait vraiment malséant de travestir en Mystère le républicanisme athée. Je ne sais pas par quelles apparitions terrifiantes on a mis à l’épreuve la constance de M. Settembrini, si on l’a conduit, les yeux bandés, par toutes sortes de couloirs et si on l’a fait attendre sous des voûtes sombres, avant que se soit ouverte devant lui la loge, pleine de lumières et de reflets. Si on l’a catéchisé solennellement, et qu’en présence d’une tête de mort et de trois lumières, on ait menacé d’épées sa poitrine nue ? il faut que vous le lui demandiez, à lui-même mais je crains que vous ne le trouviez peu loquace, car, quand même tout cela se serait déroulé d’une façon plus bourgeoise, il n’en a pas moins dû faire serment de silence.
– Faire serment ? De silence ? Tout de même !
– Certainement. De silence et d’obéissance.
– D’obéissance aussi ? Écoutez, professeur, il me semble alors qu’il n’aurait plus aucune raison de se montrer choqué du terrorisme et de l’exaltation que comporte le métier de mon cousin. Silence et obéissance ! Jamais je n’aurais cru qu’un homme aussi libéral que Settembrini pourrait se soumettre à des conditions et à des serments aussi espagnols. Je flaire véritablement quelque chose de militaire et de jésuitique dans la franc-maçonnerie.
– Vous flairez juste, répondit Naphta. Votre baguette magique tressaute et frappe un coup. L’idée d’association est en général inséparable de l’idée d’absolu. Par conséquent, elle est terroriste, c’est-à-dire antilibérale. Elle décharge la conscience individuelle et, au nom du but absolu, sanctifie tous les moyens, même les plus sanglants, même le crime. On a des raisons de supposer que dans les loges maçonniques l’union des frères était symboliquement scellée par le sang. Une union n’est jamais contemplative, elle est toujours, et par sa nature même, organisatrice dans un sens absolu. Vous ignoriez, sans doute, que le fondateur de l’ordre des Illuminés, qui a failli se confondre pendant quelque temps avec la franc-maçonnerie, était un ancien membre de la société de Jésus ?
– J’avoue que je n’en savais rien…
– Adam Weisshaupt a organisé son association secrète et humanitaire exactement d’après le modèle de l’ordre des jésuites. Lui-même était franc-maçon, et les frères les plus respectés de la loge de ce temps étaient des illuminés. Je parle de la deuxième moitié du dix-huitième siècle que Settembrini n’hésitera pas à vous caractériser comme une époque de décadence de sa ghilde. Mais en réalité ç’a été l’époque de sa plus haute floraison, comme du reste celle de toutes les associations secrètes, le temps où la franc-maçonnerie fut réellement animée d’une vie supérieure, d’une vie dont par la suite des hommes de l’espèce de notre philanthrope l’ont de nouveau expurgée. Notre ami eût-il vécu à cette époque, l’eût taxée de jésuitisme et d’obscurantisme.
– Et était-ce justifié ?
– Oui, si vous voulez. La libre pensée triviale avait ses raisons d’en juger ainsi. C’était le temps où nos pères s’efforcèrent d’animer l’association d’une vie catholique et hiératique, et où a prospéré, à Clermont, en France, une loge de jésuites-maçons. C’est en outre le temps où l’esprit des Roses-Croix a pénétré dans les loges, une confrérie très singulière, dont vous pouvez vous rappeler qu’elle a joint des desseins purement rationalistes, progressistes, politiques et sociaux, à un culte singulier des sciences secrètes de l’Orient, de la sagesse hindoue et arabe et de la magie naturelle. La réforme et le redressement de beaucoup de loges maçonniques se sont alors accomplis dans le sens de l’observance stricte, dans un sens nettement irrationaliste et mystérieux, magique et alchimique, auquel les grades écossais de la maçonnerie doivent leur existence. Des grades de chevaliers que l’on a ajoutés à l’ancienne hiérarchie militaire d’apprentis, de compagnons et de maîtres, des grades de grands maîtres d’un caractère presque sacerdotal et tout pénétrés des mystères des Roses-Croix. Il s’agit là d’un retour à certains ordres spirituels de chevaliers du Moyen âge, celui des templiers en particulier, vous savez, ceux qui prêtaient au patriarche de Jérusalem un serment de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Aujourd’hui encore un grand maître de la hiérarchie maçonnique porte le titre de « grand-duc de Jérusalem ».
– Tout cela est du nouveau pour moi, Monsieur Naphta ! Vous me faites découvrir les ficelles de notre bon Settembrini… « Grand-duc de Jérusalem » n’est pas mal. Vous devriez, à l’occasion, l’appeler ainsi en manière de plaisanterie. Il vous a appelé l’autre jour « doctor angelicus ». Cela vaut une revanche.
– Oh ! il y a une quantité d’autres titres, également significatifs, pour les grands maîtres et templiers de la stricte observance. Nous avons là un Maître parfait, un chevalier de l’Orient, un Grand Prêtre, et le trente et unième grade s’intitule même : Prince auguste du mystère royal. Remarquez que tous ces noms trahissent des rapports avec le mysticisme oriental. La réapparition du templier elle-même ne signifie pas autre chose que la reprise de pareils rapports, l’irruption de ferments irrationnels dans un univers d’idées progressistes, raisonnables et utilitaires. La franc-maçonnerie y a gagné un nouveau charme et un éclat nouveau qui expliquent le succès qu’elle a eu en ce temps. Elle a attiré tous les éléments qui étaient las du rationalisme du siècle, de son libéralisme humanitaire, éclairé et délayé, et qui étaient avides de philtres plus puissants. Le succès de l’ordre fut tel que les philistins se plaignirent de ce qu’il détournait les hommes du bonheur conjugal et de la dignité féminine.
– Allons, professeur, s’il en est ainsi, je comprends que M. Settembrini ne se rappelle pas volontiers cette époque de floraison de son ordre.
– Non, il ne se souvient pas volontiers qu’il y a eu des temps où son ordre s’était attiré toute l’antipathie que le libéralisme, l’athéisme, la raison encyclopédique vouent d’ordinaire au complexe Église, catholicisme, moine, moyen âge. Vous avez entendu que l’on a taxé les francs-maçons d’obscurantisme…
– Pourquoi ? Je voudrais que vous me disiez comment cela a pu arriver ?
– Je vais vous le dire. L’observance stricte signifiait un approfondissement et un élargissement des traditions de l’ordre tout en situant son origine historique dans le monde des mystères, dans les prétendues ténèbres du moyen âge. Les grands maîtres des loges étaient des initiés de la physica mystica, ils étaient en possession d’une science magique de la nature, c’étaient en somme surtout de grands alchimistes…
– Il faut maintenant que je fasse un grand effort pour me rappeler ce que signifie au juste le mot « alchimie ». L’alchimie, n’est-ce pas faire de l’or, la pierre philosophale, aurum potabile… ?
– Sans doute, au sens populaire. Mais dans un langage un peu plus savant, ce mot signifie épuration, transmutation, transsubstantiation en une forme plus élevée, amélioration, par conséquent, le Lapis philosophorum, le produit androgyne du soufre et du mercure, la res bina, la prima materia[16] bisexuée n’était rien de plus, rien de moins que le principe de la transmutation, du développement vers une forme supérieure, par des influences extérieures, – une pédagogie magique, si vous voulez.
Hans Castorp garda le silence. Clignotant des paupières, il regardait en l’air.
– La crypte surtout, poursuivit Naphta, était un symbole de transmutation alchimiste.
– Le tombeau ?
– Oui, le lieu de la décomposition. Elle est le principe fondamental de tout hermétisme. Le tombeau n’est pas autre chose que le vase, la cornue de cristal précieusement conservée où la matière est poussée jusqu’à sa dernière métamorphose, jusqu’à sa suprême épuration.
– Hermétisme est bien dit, Monsieur Naphta. Hermétique, cela me plaît. C’est un véritable mot de magie, avec des associations d’idées indéterminées et lointaines. Excusez-moi, mais il faut toujours que je pense à nos bocaux de conserve que notre gouvernante de Hambourg, – elle s’appelle Schalleen, sans madame ni mademoiselle, Schalleen tout court, – conserve dans son garde-manger, par rangées, sur les rayons, des bocaux hermétiquement fermés. Ils sont là, alignés, pendant des mois et des années, et lorsqu’on en ouvre un, au fur et à mesure des besoins, le contenu en est tout à fait frais et intact ; les mois, les années n’ont rien pu leur faire, on peut en manger tel quel. Il est vrai que ce n’est là ni de la chimie ni de la purification, c’est simplement de la conservation, d’où le nom de conserve. Mais ce qu’il y a de magique là-dedans, c’est que cette conserve ait échappé au temps ; elle en a été hermétiquement séparée, le temps est passé à côté d’elle, elle n’a pas eu de temps, elle est restée en dehors de lui sur son rayon. Allons, voilà pour les bocaux de conserve ! Je n’en ai pas tiré grand’chose. Veuillez m’excuser. Je crois que vous vouliez me renseigner plus exactement.
– À condition que vous le désiriez. Il faut que l’apprenti soit avide de savoir et impavide, pour parler dans le style de notre sujet. Le tombeau a toujours été le symbole principal du pacte d’alliance. L’apprenti, le blanc-bec qui désire être admis au savoir, doit prouver son courage devant les terreurs de la tombe. L’usage de l’ordre veut qu’à titre d’épreuve, il y soit conduit et qu’il y demeure, pour en sortir ensuite, guidé par la main d’un frère inconnu. D’où ce labyrinthe de couloirs et de voûtes sombres que le novice devait traverser, l’étoffe noire dont était tendue la loge de l’observance stricte, le culte du cercueil qui jouait un rôle si important dans le cérémonial de la consécration et de la réunion. Le chemin du mystère et de la purification était environné de dangers. Il conduisait à travers des angoisses, à travers le royaume de la pourriture, et l’apprenti, le néophyte c’est la jeunesse avide des miracles de la vie, impatiente de se voir douée d’une vie surnaturelle, guidée par des hommes masqués qui ne sont que des ombres du mystère.
– Je vous remercie beaucoup, professeur Naphta. C’est parfait ! C’est donc cela, la pédagogie hermétique. Il ne peut y avoir aucun mal à ce que je sois renseigné sur ces choses-là.
– D’autant moins qu’il s’agit là d’une introduction aux choses ultimes, à la confession absolue du transcendant, c’est-à-dire au but. L’observance maçonnique alchimiste a, durant les décennats suivants, conduit beaucoup d’esprits nobles et inquiets à ce but, – je n’ai pas besoin de vous le nommer, car il ne peut pas vous avoir échappé que les hauts grades écossais ne sont qu’un équivalent de la hiérarchie sacrée, que la sagesse alchimiste du maître franc-maçon s’accomplit dans le mystère de la métamorphose, et que les directives secrètes que la loge a données à ses adeptes se retrouvent aussi nettement dans l’initiation ecclésiastique, de même que les jeux symboliques du cérémonial maçonnique se retrouvent dans le symbolisme liturgique et architectural de notre sainte Église catholique.
– Ah, voilà !
– Pardon, ce n’est pas tout. Je me suis déjà permis d’observer que ce n’est qu’une interprétation historique que de faire remonter les origines des loges à l’honorable corporation des maçons. Du moins l’observance stricte a-t-elle donné à la franc-maçonnerie des fondements humains beaucoup plus profonds. Le rite des loges a en commun avec les mystères de notre Église certains rapports avec les solennités occultes et les excès sacrés propres à l’humanité la plus reculée… Je songe, en ce qui concerne l’Église, aux agapes, et à la sainte cène, à la manducation de la chair et du sang, à quoi correspondent à la loge…
– Un instant, un instant, si vous voulez bien me permettre une remarque. Dans cette existence d’une communauté fermée qui est celle de mon cousin, il y a de même des agapes. Il m’en a souvent parlé dans ses lettres. Naturellement, sauf qu’on s’y saoule un peu, tout s’y passe très correctement, on ne va même pas aussi loin qu’aux banquets d’étudiants…
– … à quoi correspondent à la loge le culte du tombeau et du cercueil sur lequel j’ai tout à l’heure attiré votre attention. Dans les deux cas, nous sommes en présence d’un symbolisme des choses ultimes et suprêmes, d’éléments d’une religiosité primitive et orgiaque, de sacrifices nocturnes et effrénés en l’honneur de la mort et du devenir, de la métamorphose et de la résurrection… Vous vous rappelez que les mystères d’Isis, de même que ceux d’Éleusis, étaient célébrés de nuit et dans d’obscures cavernes. Or, il y a eu et il y a encore beaucoup de réminiscences égyptiennes dans la maçonnerie, et beaucoup de sociétés secrètes se sont appelées les alliances éleusines. Il y a eu là des fêtes des loges, des fêtes des mystères éleusins et aphrodisiens où la femme finissait quand même par intervenir, des fêtes des roses auxquelles faisaient allusion les trois roses bleues du tablier de maçon, et qui, semble-t-il, devaient s’achever en bacchanales.
– Mais voyons donc, qu’entends-je, professeur Naphta ? Et tout cela, c’est de la franc-maçonnerie ? Et c’est à tout cela que notre ami Settembrini, un esprit si clair…
– Vous vous montreriez injuste envers lui ! Non, Settembrini ne sait plus rien de tout cela. Ne vous ai-je pas dit que la loge a été débarrassée, par ses semblables, de tous les éléments d’une vie supérieure ? Elle s’est humanisée, modernisée, grand Dieu ! Elle est revenue des égarements de ce genre à l’Utilité, à la Raison et au Progrès, à la lutte contre les princes et les calotins, bref à une conception sociale du bonheur. On s’y entretient de nouveau de la nature, de la vertu, de la mesure et de la patrie. Je suppose que l’on y parle même de ses affaires. Bref, c’est la mesquinerie bourgeoise sous forme d’un cercle…
– Dommage ! Dommage pour les fêtes des roses ! Je demanderai à Settembrini s’il n’en sait vraiment rien.
– L’honnête chevalier de l’équerre ! railla Naphta. Songez qu’il ne lui a pas été si facile de se faire admettre dans le chantier du Temple de l’Humanité, car il est pauvre comme un rat d’église, et l’on n’y exige pas tellement une culture supérieure, une culture humaniste s’il vous plaît, qu’une fortune suffisante pour pouvoir payer les droits d’entrée et les cotisations annuelles qui ne sont pas négligeables. De la culture et de la fortune, voilà le bourgeois ! Vous tenez là les fondements de la République libérale universelle !
– En effet, rit Hans Castorp, les voici en évidence sous nos yeux.
– Néanmoins, ajouta Naphta après un silence, je voudrais vous conseiller de ne pas prendre trop à la légère cet homme et sa cause, je voudrais même vous engager, puisque nous sommes en train d’en parler, à vous tenir sur vos gardes. Le démodé n’est pas encore l’équivalent de l’innocent. Pour être borné, on n’est pas nécessairement inoffensif. Ces gens ont mis beaucoup d’eau dans leur vin qui fut jadis généreux, mais l’idée d’alliance elle-même demeure assez forte pour supporter d’être diluée ; elle conserve des vestiges d’un mystère fécond, et l’on peut aussi peu douter que les loges ont leurs mains dans le jeu du monde que l’on peut hésiter à croire que derrière cet aimable M. Settembrini se dissimulent des puissances dont il est l’affilié et l’émissaire…
– L’émissaire ?
– Oui, un faiseur de prosélytes, un pêcheur d’âmes.
« Et quelle espèce d’émissaire es-tu donc, toi ? » songea Hans Castorp. À haute voix, il dit :
– Je vous remercie, professeur Naphta. Je vous suis sincèrement obligé de votre conseil. Savez-vous ce que je vais faire ? Je vais monter encore un étage pour autant qu’il peut encore être question d’étage à cette hauteur, et je vais tâter le pouls à ce frère maçon déguisé. Il faut qu’un apprenti soit avide de savoir et impavide. Naturellement, il faut aussi qu’il soit prudent… Avec des émissaires, il est évident que la prudence est de mise.
Il pouvait sans crainte continuer de s’instruire auprès de Settembrini, car celui-ci n’avait rien à reprocher à M. Naphta sous le rapport de la discrétion et n’avait du reste pas semblé particulièrement soucieux de faire un mystère de ses rapports avec cette compagnie harmonieuse. La Rivista della Massoneria Italiana était ouverte sur sa table. Hans Castorp n’y avait simplement pas pris garde jusqu’à ce moment. Et lorsque, éclairé par Naphta, il eut dirigé la conversation vers l’art royal, comme si les rapports de Settembrini avec la franc-maçonnerie n’avaient jamais fait l’ombre d’un doute, il ne s’était heurté qu’à un semblant de réserve. Sans doute, y avait-il des points sur lesquels le littérateur ne se livrait pas, et au sujet desquels il gardait les lèvres closes avec une certaine ostentation. Apparemment il était lié par ces serments terroristes dont Naphta avait parlé : cachotteries qui ne s’étendaient qu’aux usages extérieurs et à sa propre position au sein de cette étrange organisation. Mais pour le reste, il en parlait même d’abondance et traçait au curieux un tableau important de l’étendue de sa ligue qui était représentée presque dans le monde entier par vingt mille loges et cent cinquante grandes loges, et qui s’étendait même jusqu’à des civilisations comme celle de Haïti et à la république nègre de Libéria. Il citait aussi toutes sortes de grands noms dont les porteurs avaient été des francs-maçons, ou l’étaient présentement. Il nomma Voltaire, Lafayette et Napoléon, Franklin et Washington, Mazzini et Garibaldi, et, au nombre des vivants, le roi d’Angleterre lui-même ; il énuméra en outre nombre d’hommes qui avaient la charge des affaires publiques d’États européens, membres de gouvernements et de parlements.
Hans Castorp manifesta son respect, mais aucun étonnement. Il en était de même dans les associations d’étudiants, dit-il. Celles-ci aussi vous rapprochaient pour la vie, et savaient caser leurs adhérents ; et même, lorsqu’on n’avait pas été membre d’une association on réussissait difficilement dans les administrations. Aussi, n’était-ce pas très avisé de la part de M. Settembrini de faire à ces premiers rôles un mérite de leurs accointances avec la loge ; car il fallait admettre, au contraire, que, si tant de postes importants avaient été occupés par des francs-maçons, cela ne prouvait en somme que la puissance de la loge qui certainement avait sa main dans le jeu universel plus que M. Settembrini ne voulait l’avouer franchement.
Settembrini sourit. Il s’éventa même avec le cahier de la Massoneria qu’il tenait à la main. On pensait sans doute lui tendre un piège ? demanda-t-il. Peut-être voulait-on l’entraîner à des confidences imprudentes sur la nature politique, sur l’esprit essentiellement politique de la loge ? « Rouerie inutile, ingénieur ! Nous admettons la politique sans réserve, ouvertement. Nous faisons peu de cas de la haine que quelques sots – ils sont installés dans votre pays, ingénieur, presque nulle part ailleurs, – vouent à ce mot et à ce titre. Le philanthrope ne peut même pas admettre de différence entre la politique et la non-politique. Il n’y a pas de non-politique, tout est politique.
– Un point c’est tout ?
– Je sais bien qu’il y a des gens qui jugent bon d’attirer l’attention sur la nature primitivement apolitique de la franc-maçonnerie. Mais ces gens jouent avec les mots et tracent des frontières qu’il est grand temps de reconnaître comme imaginaires et stupides. Premièrement, les loges espagnoles, tout au moins, ont eu dès l’origine une orientation politique…
– Je pense bien.
– Vous pensez très peu de chose, ingénieur. Ne vous imaginez pas pouvoir penser beaucoup de choses par vous-même. Mais efforcez-vous plutôt d’assimiler et d’utiliser, – je vous en prie dans votre intérêt comme dans l’intérêt de votre pays et de l’Europe, – ce que je suis en train de vous inculquer en second lieu. Secundo, en effet, l’idée maçonnique n’a jamais été apolitique, en aucun temps, elle n’a pas pu l’être, et si elle a cru l’être, elle s’est trompée sur sa propre nature. Que sommes-nous ? Des maçons et des manœuvres qui travaillent à une construction. Tous poursuivent un but unique, la meilleure part du tout c’est la loi fondamentale de la fraternité. Quelle est cette meilleure part ? Qu’est-ce que cet édifice ? L’édifice social méthodiquement construit, le perfectionnement de l’humanité, la nouvelle Jérusalem. Que viennent faire là-dedans la politique et la non-politique ? Le problème social, le problème de la vie en société est lui-même politique, entièrement politique, uniquement politique. Quiconque se consacre à ce problème – et celui qui s’y déroberait ne mériterait pas le nom d’homme, – relève de la politique, de la politique intérieure comme de la politique extérieure, et comprend que l’art du franc-maçon est l’art de gouverner…
– De gouverner…
– … que la franc-maçonnerie des illuminés a connu le grade de régent…
– Très bien, Monsieur Settembrini. L’art de gouverner, le grade de régent, voilà qui me plaît. Mais dites-moi une chose : êtes-vous chrétiens, vous tous, dans votre loge ?
– Perché ?
– Excusez-moi, je veux poser la question autrement, sous une forme plus générale et plus simple. Croyez-vous en Dieu ?
– Je vous répondrai : pourquoi me posez-vous cette question ?
– Je n’ai pas voulu vous tenter tout à l’heure, mais il y a une histoire biblique, où quelqu’un tente le Seigneur en lui présentant une pièce de monnaie romaine, et reçoit cette réponse qu’il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il me semble que cette manière de distinguer nous donne la différence entre la politique et la non-politique. S’il y a un Dieu, on doit pouvoir faire cette différence. Les francs-maçons croient-ils en Dieu ?
– Je me suis engagé à vous répondre. Vous parlez d’une unité que l’on s’efforce de créer, mais qui, au grand regret des hommes de bonne volonté, n’existe pas encore. La ligue universelle des francs-maçons n’existe pas. Si elle est réalisée – et je répète que l’on travaille avec une application silencieuse à cette grande œuvre, sa confession religieuse sera, elle aussi, sans nul doute, unifiée, et elle sera conçue dans les termes suivants : « Écrasez l’infâme ! »
– D’une façon obligatoire ? Mais ce serait de l’intolérance !
– Je doute que vous soyez capable de discuter le problème de la tolérance, ingénieur. Mais tâchez de vous rappeler que la tolérance devient un crime lorsqu’on en fait preuve à l’égard du mal.
– Dieu serait donc le mal ?
– La métaphysique est le mal. Car elle n’est bonne à rien qu’à endormir l’activité que nous devons consacrer à la construction du temple de la société. Aussi le Grand Orient de France a-t-il depuis longtemps donné l’exemple en effaçant le nom de Dieu de tous ses actes. Nous, les Italiens, avons suivi l’exemple…
– Comme c’est catholique !
– Vous dites ?
– Je trouve cela catholique à outrance que de rayer Dieu !
– Que voulez-vous dire par là ?
– Rien de particulièrement intéressant, Monsieur Settembrini. Ne faites pas attention à mon bavardage. J’ai eu un instant l’impression que l’athéisme était énormément catholique et que l’on ne biffât Dieu que pour pouvoir être d’autant mieux catholique.
Si M. Settembrini resta coi après ces mots, ce ne fut évidemment que par méthode pédagogique. Il répondit après un silence convenable :
– Ingénieur, loin de moi le désir de vous tromper ou de vous blesser dans votre protestantisme. Nous avons parlé de tolérance… Il est superflu de souligner que j’éprouve à l’endroit du protestantisme plus que de la tolérance, une profonde admiration pour son rôle historique d’opposant contre l’étranglement de la conscience. L’invention de la typographie et la Réforme sont et demeurent les mérites les plus éminents de l’Europe centrale dans la cause de l’Humanité. C’est hors de doute. Mais, après ce que vous venez de dire, je ne doute pas que vous me compreniez exactement, si je vous fais observer que ce n’est là qu’un aspect de la question et qu’il y en a un second. Le protestantisme comporte des éléments… La personnalité de votre réformateur elle-même comportait des éléments… Je pense à des éléments de quiétisme et de contemplation hypnotique qui ne sont pas européens, qui sont étrangers et hostiles à la loi de la vie sur ce continent actif. Regardez-le donc bien, ce Luther ! Considérez les portraits que nous avons de lui, ceux de sa jeunesse et les autres, ceux de sa maturité ! Quel est donc ce crâne ? Que signifient ces pommettes, et cette étrange position des yeux ? Mon ami, c’est l’Asie ! Je ne serais pas surpris, je ne serais pas du tout surpris si un élément wando-slavo-sarmate se trouvait être en jeu, et si la personnalité, d’ailleurs formidable – qui songerait à le nier ? – de cet homme signifiait qu’un des plateaux si dangereusement équilibrés de votre pays avait été fatalement surchargé d’un poids formidable : le plateau oriental, qui jusqu’à nos jours fait voltiger vers le ciel le plateau occidental…
De son pupitre d’humaniste, près de la lucarne, devant lequel il était jusqu’à présent resté debout, M. Settembrini s’était approché de la table ronde avec la carafe d’eau, s’était approché de son élève qui était assis sur le canapé appuyé contre le mur, sans s’adosser, les coudes sur les genoux et le menton posé sur sa main.
– Caro, dit M. Settembrini. Caro amico ! Il faudra prendre des décisions, des décisions d’une portée inappréciable pour le bonheur et l’avenir de l’Europe, et il appartiendra à votre pays de les prendre. Elles devront s’accomplir dans son âme. Placé entre l’Est et l’Ouest, il devra choisir définitivement et en pleine conscience entre les deux sphères qui se disputent sa nature, il devra se décider. Vous êtes jeune, vous prendrez part à cette décision, vous serez appelé à l’influencer. Bénissons donc le destin qui vous a guidé en ces contrées effroyables, mais qui en même temps me donne l’occasion d’exercer une influence sur votre jeunesse malléable, par ma parole qui n’est pas tout à fait inexperte ni tout à fait impuissante, et de vous faire sentir les responsabilités que vous portez, que votre pays porte aux yeux de la civilisation…
Hans Castorp était assis, le menton dans son poing. Il regardait dehors, par la lucarne, et dans ses yeux bleus et simples on pouvait lire la résistance de sa pensée. Il garda le silence.
– Vous vous taisez, dit M. Settembrini, ému. Vous et votre pays, vous laissez planer sur ces choses un silence réticent, un silence si opaque qu’il ne permet de porter aucun jugement sur sa profondeur. Vous n’aimez pas la parole, ou vous ne savez pas vous en servir, ou vous la tenez sacrée d’une manière peu communicative, et le monde articulé ne sait ni n’apprend où il en est avec vous. Mon ami, c’est dangereux. La langue, c’est la civilisation même… Toute parole, même la plus contradictoire, est une obligation… Mais le mutisme isole. On soupçonne que vous tenterez de briser votre solitude par des actes. Vous ferez marcher votre cousin Giacomo (M. Settembrini, pour plus de commodité, avait coutume d’appeler Joachim « Giacomo »), vous ferez avancer votre cousin Giacomo hors de votre silence et « il en abattra deux à grands coups, et les autres s’enfuiront ».
Comme Hans Castorp se mit à rire, M. Settembrini, lui aussi, sourit, satisfait tout au moins momentanément de l’effet produit par ses paroles plastiques.
– Bon, rions ! dit-il. Vous me trouverez toujours disposé à la gaieté, « le rire est un rayonnement de l’âme », dit un penseur grec. Aussi avons-nous dévié de notre sujet vers des choses qui, je vous l’accorde, sont liées aux difficultés auxquelles se heurtent nos travaux préparatoires en vue d’une Ligue universelle maçonnique, à des difficultés que l’Europe protestante notamment nous oppose…
M. Settembrini continua de parler avec chaleur de l’idée de cette Ligue universelle qui était née en Hongrie et dont la réalisation, qu’il y avait lieu d’espérer, était destinée à conférer à la franc-maçonnerie un pouvoir qui déciderait du sort de l’univers. Il montra en passant des lettres qu’il avait reçues de hauts dignitaires étrangers de la Ligue sur cette question, une lettre autographe du grand maître suisse, le frère Quartier la Tente, du trente-troisième grade, et il commenta le projet que l’on avait de faire de l’espéranto la langue universelle de la Ligue. Son zèle s’éleva dans la sphère de la haute politique, il fit le tour de l’Europe, et pesa les chances de la pensée révolutionnaire républicaine dans son propre pays, en Espagne, au Portugal. Il prétendit également entretenir une correspondance avec des personnes placées à la tête de la grande loge de ce dernier royaume. Là-bas les choses approchaient sans aucun doute d’une période décisive. Que Hans Castorp pensât à lui si, très prochainement, les événements s’y précipitaient ! Hans Castorp promit de le faire.
Il convient d’observer que ces causeries maçonniques qui s’étaient déroulées entre l’élève et chacun des deux mentors, séparément, s’étaient produites encore dans la période précédant le retour de Joachim. La discussion à laquelle nous arrivons maintenant eut lieu après son retour et en sa présence, neuf semaines après son arrivée, au début d’octobre, et Hans Castorp garda le souvenir de cette réunion sous un soleil d’automne devant le Casino de Platz, avec des boissons rafraîchissantes sur la table, parce que Joachim lui inspira ce jour-là un souci secret, par des apparences et des symptômes qui d’habitude ne sont pas un objet de souci, à savoir par des maux de gorge et de l’enrouement, d’inoffensives gênes par conséquent, mais qui apparurent au jeune Castorp sous un jour quelque peu singulier, à la lumière, peut-on dire, qu’il croyait remarquer tout au fond des yeux de Joachim, de ces yeux qui avaient toujours été doux et grands, mais qui ce jour-là, et pas avant, s’étaient agrandis et approfondis d’une certaine manière indéfinissable, avec une expression rêveuse et – il faut ajouter ce mot étrange – menaçante, s’ajoutant à cette silencieuse luminosité intérieure déjà mentionnée et qui n’avait pas précisément déplu à Hans Castorp, – bien au contraire elle lui plaisait même beaucoup, mais lui causait néanmoins de l’appréhension. Bref, il n’est pas possible de parler de ces impressions d’une manière autre que confuse, en se conformant à leur caractère.
En ce qui concerne la conversation, la controverse, – naturellement une controverse entre Naphta et Settembrini, – elle était une chose à part, et ne ressemblait que d’assez loin à leurs entretiens particuliers avec Hans Castorp sur la franc-maçonnerie. En dehors des cousins, Ferge et Wehsal y assistaient également, et tous étaient grandement intéressés, bien que tous ne fussent pas à la hauteur du sujet ; M. Ferge souligna expressément qu’il ne l’était pas. Mais une discussion qui est menée comme si la vie en était l’enjeu, en même temps qu’avec esprit et brio, comme s’il ne s’agissait pas de la vie, mais d’un concours élégant, – tel était le caractère de toutes les discussions entre Settembrini et Naphta, – une pareille discussion est intéressante en soi, même pour ceux qui n’y entendent pas grand’chose et qui n’en mesurent que confusément la portée. Même des auditeurs tout à fait étrangers, assis par hasard dans le voisinage, prêtaient l’oreille au débat, les sourcils levés, captivés par la passion et par la grâce du dialogue.
Cela se passait, comme il a été dit, devant le Casino, l’après-midi, après le thé. Les quatre pensionnaires du Berghof y avaient rencontré Settembrini, et par hasard Naphta s’était joint à eux. Ils étaient tous assis autour d’une petite table de fer devant des apéritifs à l’eau, anis et vermouth. Naphta, qui prenait ici son goûter, s’était fait servir du vin et des pâtisseries, ce qui était apparemment une réminiscence de son noviciat, Joachim humectait souvent sa gorge malade de citronnade, qu’il buvait très forte et très acide, parce que cela contractait les tissus et le soulageait. Quant à Settembrini, il buvait tout simplement de l’eau sucrée, mais il la buvait au moyen d’une paille, avec une grâce appétissante, comme s’il avait dégusté le plus précieux rafraîchissement. Il plaisanta :
– Qu’entends-je, ingénieur ? Quelle est la rumeur qui est parvenue à mes oreilles ? Votre Béatrice va revenir ? Votre guide à travers les neuf sphères tournantes du paradis ? Allons, je veux espérer que, malgré cela, vous ne dédaignerez pas complètement la main amicale de votre Virgile ! Notre Ecclésiaste que voici vous confirmera que l’univers du medio evo n’est pas complet s’il manque au mysticisme franciscain le pôle contraire de la connaissance thomiste. On rit de tant de plaisante pédanterie, et l’on regarda Hans Castorp, qui, riant lui aussi, leva son verre de vermouth à la santé de « son Virgile ». Mais on aura peine à croire quel inépuisable conflit d’idées devait découler, durant l’heure suivante, des propos, inoffensifs encore que recherchés, de M. Settembrini. Car Naphta, en quelque sorte provoqué, passa aussitôt à l’attaque, et s’en prit au poète latin que Settembrini adorait notoirement, jusqu’à le placer au-dessus d’Homère, tandis que Naphta avait déjà plus d’une fois manifesté le dédain le plus tranché à son égard comme à l’égard de la poésie latine en général, et saisit à nouveau avec malice et promptitude l’occasion qui s’offrait. Ç’avait été un préjugé du grand Dante, dit-il, d’entourer de tant de solennité ce médiocre versificateur, et de lui accorder dans son poème un rôle si élevé, encore que Lodovico prêtât sans doute à ce rôle une signification par trop maçonnique. Qu’avait-il donc eu de particulier ce lauréat-courtisan, et ce lécheur de bottes de la maison Julienne ce littérateur de métropole et ce rhéteur d’apparat, dépourvu de la moindre étincelle créatrice, dont l’âme, s’il en avait possédé une eût certainement été de deuxième main, et qui n’avait pas du tout été un poète, mais un Français en perruque poudrée de l’époque d’Auguste.
M. Settembrini ne douta pas que son honorable contradicteur possédât des moyens de concilier son mépris de la période romaine de haute civilisation avec ses fonctions de professeur de latin. Mais il lui semblait nécessaire d’attirer l’attention de M. Naphta sur la contradiction plus grave où il s’engageait par de tels jugements, car ils le mettaient en désaccord avec ses siècles préférés, lesquels non seulement n’avaient pas méprisé Virgile, mais encore avaient rendu justice assez ingénument à sa grandeur en faisant de lui un magicien et un sage.
C’est bien vainement, répliqua Naphta, que M. Settembrini appelait à son secours l’ingénuité de cette jeune et victorieuse époque qui avait prouvé sa force créatrice jusque dans la « démonisation » de ce qu’elle surmontait. D’ailleurs, les docteurs de la jeune église ne s’étaient pas lassés de mettre en garde contre les mensonges des philosophes et des poètes de l’antiquité et en particulier contre la souillure de l’éloquence voluptueuse de Virgile. Et de nos jours, où une ère s’achevait de nouveau, et où une aube prolétarienne poignait, l’heure était vraiment favorable pour partager leurs sentiments ! M. Lodovico pouvait être persuadé – pour trancher la question, – que lui, Naphta, se livrait à sa profession privée à quoi il avait été fait allusion, avec toute la reservatio mentalis convenable. Ce n’est pas sans ironie qu’il participait à un système d’éducation classique et oratoire auquel le plus grand optimiste ne pouvait promettre plus que quelques dizaines d’années d’existence.
– Vous les avez étudiés, s’écria Settembrini, vous les avez étudiés à la sueur de votre front, ces vieux poètes et philosophes, vous avez essayé de vous approprier leur précieux héritage, de même que vous avez utilisé le matériel de constructions antiques pour vos maisons de prières. Car vous avez bien senti que vous ne seriez pas capables de produire une nouvelle forme d’art par les propres forces de votre âme prolétarienne, et vous avez espéré battre l’antiquité avec ses propres armes. Il en sera ainsi de nouveau, il en sera ainsi toujours ! Votre jeunesse inculte devra se mettre à l’école de ce que vous voudriez vous persuader à vous-mêmes et à d’autres de dédaigner ; car sans culture vous ne pourriez vous imposer à l’humanité, et il n’y a qu’une seule culture : celle que vous appelez la culture bourgeoise et qui est la culture humaine ! Et vous osez chiffrer par décennats le temps qui reste à vivre aux humanités ? La politesse seule empêchait M. Settembrini de partir d’un rire aussi insouciant que moqueur. Une Europe qui savait administrer son patrimoine éternel passerait en toute tranquillité d’âme à l’ordre du jour de la raison classique – au mépris des apocalypses prolétariennes qu’il plaisait à certains d’imaginer.
Mais c’est justement de cet ordre du jour, répondit Naphta d’un ton mordant, que M. Settembrini ne semblait pas très bien informé. Car la question que son contradicteur trouvait bon de tenir pour tranchée d’avance, était précisément à l’ordre du jour, celle de savoir si la tradition méditerranéenne, classique et humaniste, était une affaire de l’humanité entière et par conséquent chose humaine et éternelle, ou si elle n’avait été qu’un état d’esprit et l’accessoire d’une époque, de l’époque bourgeoise et libérale, et si elle allait mourir avec elle. Il appartenait à l’Histoire d’en décider, mais, en attendant, M. Settembrini ferait bien de ne pas se laisser bercer dans la certitude illusoire que cette décision pourrait être favorable à son conservatisme latin.
C’était une insolence particulière du petit Naphta d’appeler M. Settembrini, le serviteur déclaré du Progrès, un « conservateur ». Tous l’éprouvèrent, et avec une amertume particulière celui que cette flèche venait d’atteindre et qui tournait sa moustache retroussée, tout en cherchant une réplique, laissant ainsi à son ennemi le temps de se livrer à de nouvelles incursions contre l’idéal de la culture classique, contre l’esprit littéraire et rhétoricien de l’école et de la pédagogie européenne, contre son souci d’un formalisme grammatical qui n’était qu’un accessoire de la domination de la classe bourgeoise, mais qui était depuis longtemps pour le peuple un objet de risée. Oui, l’on ne se doutait pas à quel point le peuple se moquait de nos titres de docteur et de tout notre mandarinat universitaire et de l’école primaire obligatoire, de cet instrument de la dictature bourgeoise des classes, dont on usait dans l’illusion que l’instruction du peuple était la culture scientifique délayée. Le peuple savait depuis longtemps où chercher, ailleurs que dans ces pénitenciers officiels, la culture et l’éducation dont il avait besoin dans sa lutte contre le règne vermoulu de la bourgeoisie, et les moineaux sifflaient sur les toits que notre type d’école, tel qu’il est issu de l’école monastique du moyen âge, constituait un anachronisme et une vieillerie ridicule, que personne au monde ne devait plus sa culture proprement dite à l’école, et qu’un enseignement libre et accessible à tous par des conférences publiques, par des expositions et par le cinéma était infiniment supérieur à tout enseignement scolaire.
Dans le mélange de révolution et d’obscurantisme que Naphta servait à ses auditeurs, lui répondit Settembrini, la part obscurantiste prédominait d’une manière peu appétissante. La satisfaction qu’il éprouvait à trouver Naphta aussi soucieux d’instruire le peuple, était quelque peu compromise, par sa crainte que ne prédominât chez lui une tendance instinctive à plonger le peuple et le monde dans les ténèbres de l’analphabétisme.
Naphta sourit. L’analphabétisme ? On se figurait sans doute avoir prononcé là un mot vraiment effrayant, on était persuadé avoir montré la tête de la Gorgone, persuadé que tout le monde en pâlirait comme il sied. Lui, Naphta, regrettait de devoir ménager à son contradicteur une déception en lui apprenant que la terreur des humanistes devant l’idée d’analphabétisme l’égayait tout bonnement. Il fallait être un littérateur de la Renaissance, un homme du Secento, un Mariniste, un bouffon de l’estilo culto pour attribuer aux disciplines de la lecture et de l’écriture une importance pédagogique aussi exagérée, au point de se figurer que partout où cette connaissance ferait défaut régneraient les ténèbres de l’esprit. M. Settembrini se rappelait-il que le plus grand poète du moyen âge, Wolfram von Eschenbach, avait été un illettré ? À cette époque, il eût passé pour honteux en Allemagne d’envoyer à l’école un garçon qui ne voulait pas devenir prêtre, et ce dédain aristocratique et populaire des arts littéraires avait toujours été un témoignage de noblesse véritable, tandis que le littérateur, ce vrai fils de l’humanisme et de la bourgeoisie, savait sans doute lire et écrire, ce que ne savaient pas ou ce que savaient mal le gentilhomme, le guerrier et le peuple, mais, en dehors de cela, il ne savait rien ni n’entendait rien à rien au monde, il n’était qu’un farceur, qui administrait la parole et qui abandonnait la vie aux honnêtes gens, et c’était sans doute pourquoi il gonflait la politique elle-même de rhétorique et de belle littérature, ce qui, en langage de parti, s’appelait radicalisme et démocratie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite…
Sur quoi M. Settembrini revint à l’attaque.
– C’est avec une trop grande témérité, s’écria-t-il, que son adversaire étalait son goût pour la barbarie fervente de certaines époques, en raillant l’amour de la forme littéraire, sans laquelle, en effet, nulle humanité n’aurait été ni possible ni imaginable, non certes, au grand jamais ! Noblesse ? Seul un haïsseur du genre humain pouvait baptiser de ce nom l’absence du verbe, le matérialisme brutal et muet. Seul était noble un certain luxe, la generosità, qui consistait à accorder à la forme une valeur humaine propre, indépendante de son contenu, le culte de la parole comme d’un art pour l’art, – cet héritage de la civilisation gréco-latine, – que les humanistes, les uomini litterati avaient, tout au moins, rendu au monde roman, ce culte qui avait été la source de tout idéalisme plus large et substantiel, même de l’idéalisme politique.
« Parfaitement, monsieur ! Ce que vous voudriez avilir en séparant la parole de la vie n’est pas autre chose qu’une unité supérieure dans le diadème de la beauté ; et de quel côté se trouvera la jeunesse généreuse dans la bataille entre la Littérature et la Barbarie, voilà une question qui ne me cause nulle inquiétude. »
Hans Castorp qui n’avait accordé à la conversation qu’une attention à moitié distraite parce que la personne du guerrier en présence, représentant de la vraie noblesse, ou plus exactement l’expression nouvelle de ses yeux l’occupaient, sursauta parce qu’il se sentit interpellé et mis en cause par les dernières paroles de M. Settembrini, mais il fit ensuite une tête comme le jour où Settembrini avait voulu solennellement l’obliger à choisir entre l’Orient et l’Occident, c’est-à-dire une figure récalcitrante, pleine de réserves mentales, – et garda le silence. Ils réduisaient tout à l’absurde, ces deux-là, comme c’était sans doute indispensable lorsqu’on voulait se disputer, et ils se querellaient avec acharnement autour d’alternatives extrêmes alors qu’il lui semblait bien que quelque part, entre ces exagérations, entre cet humanisme éloquent et cette barbarie illettrée devait se trouver quelque chose que l’on pouvait aborder dans un esprit conciliant comme purement humain. Mais il n’exprima pas sa pensée, pour ne pas irriter les deux esprits, et, plein de réticences, il les laissa s’enferrer de plus en plus et s’aider mutuellement dans leur hostilité, aller de cent en mille, à partir du moment où Settembrini avait déclenché la discussion par sa petite plaisanterie sur le Latin Virgile.
Il défendait toujours la parole, il la brandissait, il la faisait triompher. Il se posa en gardien du génie littéraire, glorifia l’histoire des lettres, à partir de l’instant où pour la première fois un homme, pour donner de la durée à son savoir et à sa manière de sentir, avait tracé des mots sur une pierre. Il parla du dieu égyptien Thot, qui n’avait fait qu’un avec l’Hermès-Trismégiste de l’hellénisme, et qui avait été vénéré comme l’inventeur de l’écriture, comme le protecteur des bibliothèques et l’animateur de tous les efforts de l’esprit. En paroles il ploya le genou devant ce Trismégiste, Hermès l’humaniste, le maître de la palestre, à qui l’humanité devait le don précieux du verbe celui de la rhétorique discursive, et il amena ainsi Hans Castorp à faire la remarque suivante : ce dieu natif d’Égypte avait donc sans doute été un politicien et avait joué en grand le même rôle que le sieur Brunetto Latini qui avait fait plus particulièrement l’éducation des Florentins et qui leur avait enseigné l’art de la parole, ainsi que celui de gouverner la République d’après les règles de la politique, – sur quoi Naphta répondit que M. Settembrini truquait un peu, et qu’il avait fait de Thot-Trismégiste un portrait par trop flatté. Car cela avait été plutôt une divinité simiesque consacrée à la lune et aux âmes, un babouin surmonté d’un croissant, et, sous le nom de Hermès, avant tout un dieu de la mort et des morts : le dompteur et le conducteur des âmes que les dernières périodes de l’antiquité avaient déjà transformé en un magicien, et dont le moyen âge cabaliste avait fait le père de l’alchimie hermétique.
Dans la pensée de Hans et dans le chantier de son imagination tout allait sens dessus dessous. Il y avait la Mort drapée de son manteau bleu, et elle était un rhéteur humaniste ; lorsqu’on considérait de plus près le dieu pédagogue de la littérature et l’ami des hommes, on trouvait un singe accroupi qui portait sur son front les signes de la nuit et de la magie… Il faisait des signes de dénégation, et abritait ensuite ses yeux des mains. Mais dans les ténèbres où il s’était réfugié dans son désarroi, la voix de Settembrini retentissait, qui continuait de célébrer la littérature. Non seulement la grandeur contemplative, mais la grandeur active elle aussi, s’écria-t-il, y avait toujours été liée ; et il nomma Alexandre, César, Napoléon, il cita Frédéric de Prusse et d’autres héros, même Lassalle et Moltke. Il ne se laissa pas détourner de son raisonnement lorsque Naphta voulut l’entraîner en Chine où régnait l’idolâtrie la plus bouffonne de l’alphabet, où l’on devenait généralissime parce que l’on savait tracer à l’encre de Chine quarante mille hiéroglyphes, ce qui eût tout à fait répondu à l’état d’esprit d’un humaniste. Eh ! Naphta savait parfaitement qu’il ne s’agissait pas de dessiner à l’encre de Chine, mais de la littérature considérée comme impulsion donnée au monde, de son esprit (pauvre railleur !) lequel était l’esprit tout court, le miracle de la fusion de l’analyse et de la forme. C’était cet esprit qui éveillait l’intelligence à tout ce qui est humain, qui s’efforçait de combattre les préjugés stupides et de les anéantir, qui purifiait, anoblissait et amendait le genre humain. En créant l’extrême raffinement moral et la sensibilité la plus subtile, il initiait les hommes, loin de les fanatiser, au doute, à la justice, à la tolérance. L’effet purificateur et sanctificateur de la littérature, la destruction des passions par la connaissance et par la parole, la littérature considérée comme un acheminement vers la compréhension, vers le pardon et vers l’amour, la puissance libératrice du langage, l’esprit littéraire comme le phénomène le plus noble de l’esprit humain en général, le littérateur comme homme parfait, comme saint… C’est sur ce ton d’exaltation, en cantique de louange, que monta l’apologie de M. Settembrini. Mais, hélas ! son contradicteur non plus n’était pas tombé sur la tête ; il sut interrompre la salutation angélique par des objections caustiques et brillantes, en optant pour le parti de la conservation et de la vie, contre l’esprit de la décomposition qui se dissimulait derrière cette duplicité séraphique. La fusion miraculeuse, qui avait arraché des trémolos à M. Settembrini, n’était autre chose qu’un leurre et un mirage, car la force que l’esprit littéraire se targuait de concilier avec le principe de l’examen et de la discrimination n’était qu’une forme apparente et mensongère, n’était pas une forme authentique, naturelle, et qui avait grandi normalement, n’était pas une forme vivante. Le prétendu réformateur du monde avait sans doute sur les lèvres les mots de purification et de sanctification, mais en réalité cela aboutissait à une émasculation de la vie ainsi anémiée ; plus encore : l’esprit, le zèle du théoricien profanaient la vie, et quiconque voulait détruire les passions voulait le néant pur, pur en effet, puisque pur est le seul adjectif que l’on puisse à la rigueur encore adjoindre au néant. Mais c’est en cela justement que M. Settembrini, le littérateur, montrait bien ce qu’il était, c’est-à-dire un homme du progrès, du libéralisme et de la révolution bourgeoise. Car le progrès était du pur nihilisme, et le citoyen libéral était proprement l’homme du néant et du démon, et même il niait Dieu, l’absolu au sens conservateur et positif, en prêtant serment à l’absolu opposé et démoniaque, et en se croyant encore un modèle de piété avec son pacifisme meurtrier. Mais il n’était rien moins que pieux, il était au contraire un traître à la vie, devant l’Inquisition et la sainte Vehme de laquelle il méritait d’être traduit… et cætera.
C’est par de pareilles pointes que Naphta réussit à donner au chant d’apothéose une tournure diabolique et à se représenter lui-même comme l’incarnation de l’amour austère et de l’esprit conservateur, de sorte qu’il redevenait purement et simplement impossible de distinguer où était Dieu et où le Diable, où la Mort, et où la Vie. On nous croira sur parole que son contradicteur était de taille à lui répondre : et cette réponse, qui fut remarquable, lui en valut une autre, non moins bonne, après quoi cela continua encore un bon moment, et l’entretien dévia vers un ordre de problèmes dont il a déjà été question plus haut. Mais Hans Castorp n’écouta pas plus avant, parce que Joachim avait dit entre temps qu’il avait l’impression très nette d’avoir pris froid et qu’il ne savait pas trop quelle conduite il adopterait, puisque les refroidissements n’étaient pas « reçus » ici. Les duellistes n’avaient prêté aucune attention à cette parole mais Hans Castorp, comme nous l’avons montré, veillait d’un œil soucieux sur son cousin, et il se retira avec Joachim au beau milieu d’une réplique ; on allait voir si le reste du public, composé de Ferge et de Wehsal, donnerait une impulsion pédagogique suffisante à la suite du débat.
En cours de route, il tomba d’accord avec Joachim qu’en matière de refroidissements et de maux de gorge il fallait emprunter la voie hiérarchique, c’est-à-dire charger le baigneur de prévenir la supérieure, à la suite de quoi l’on finirait quand même par faire quelque chose pour le malade. Ainsi firent-ils, et ils firent bien. À la porte de Joachim, alors que Hans Castorp se trouvait par hasard dans la chambre de son cousin, elle s’informa de sa voix criarde des désirs et des plaintes du jeune officier. « Maux de gorge, enrouement ? répéta-t-elle, jeune homme, quelles frasques vous permettez-vous là ? » Et elle entreprit de regarder le malade d’un œil pénétrant, sans que leurs yeux se rencontrassent jamais, ce en quoi Joachim était d’ailleurs parfaitement innocent : c’était le regard de la supérieure qui se dérobait obstinément. Mais pourquoi tentait-elle toujours de nouveau cette entreprise, alors que l’expérience lui avait montré qu’il ne lui était pas donné de la réussir ? À l’aide d’une sorte de chausse-pied en métal, qu’elle tira de la poche de sa ceinture, elle inspecta le gosier du patient, tandis que Hans Castorp, pour l’éclairer, avait approché la veilleuse de la table de nuit. Tout en examinant, haussée sur la pointe des pieds, la luette de Joachim, elle l’interrogeait :
– Dites donc, mon maître et seigneur, avez-vous jamais avalé de travers ?
Que pouvait-on répondre à cela ? Durant l’examen, il n’y avait même pas moyen du tout de répondre. Mais, lors même qu’elle eut fini, on restait fort embarrassé. Naturellement, dans la vie, il avait avalé de travers, une ou deux fois, en mangeant et en buvant ; mais c’était le sort de tous les hommes et ce n’était sans doute pas cela qu’elle avait voulu dire par sa question. Il dit : Comment cela ? Il ne se souvenait pas que cela lui fût arrivé récemment.
« Allons, bon ! » fit-elle. Ce n’était qu’une idée qui lui avait passé par la tête. Il s’était donc refroidi, dit-elle, à la surprise des cousins, puisque le mot « refroidissement » était, d’habitude, interdit dans la maison. Pour examiner sa gorge de plus près, on ferait peut-être bien d’avoir recours au laryngoscope du conseiller. En partant, elle laissa du formaminte, ainsi qu’une bande et un carré de gutta-percha pour faire des compresses pendant la nuit ; et Joachim usa de l’un et de l’autre, prétendit même être sensiblement soulagé grâce à ces applications, et continua donc à les pratiquer d’autant plus que son enrouement ne voulait pas céder au traitement, qu’il devint même plus sensible les jours suivants, bien que les maux de gorge disparussent parfois presque complètement.
D’ailleurs, son refroidissement avait été purement imaginaire. Le diagnostic se trouva exactement conforme au résultat des examens du conseiller, qui avait retenu le vaillant Joachim pour une petite cure complémentaire, avant qu’il pût de nouveau courir sous les drapeaux. Le terme d’octobre avait passé en toute discrétion. Personne ne perdit un mot à son sujet, ni le conseiller ni les cousins entre eux : silencieux et les yeux baissés, ils franchirent cette date. D’après ce que Behrens dicta lors de la consultation mensuelle à son assistant, l’expert en psychologie, et d’après ce que montrait la plaque photographique il était trop clair que tout départ n’eût été qu’un coup de tête alors qu’il s’agissait cette fois-ci de persévérer avec une discipline de fer dans le service qu’il s’était imposé jusqu’à ce qu’il eût définitivement acquis une solidité à toute épreuve ; ce n’est qu’alors qu’il pourrait reprendre son service en pays plat et tenir son serment d’officier.
Tel était le mot d’ordre sur lequel on prétendait en silence être parfaitement d’accord. Mais en réalité aucun d’entre eux n’était tout à fait sûr que l’autre crût vraiment à cette explication et lorsqu’ils baissaient les yeux l’un devant l’autre, c’était dans ce doute, et cela n’arrivait pas sans que leurs yeux se fussent auparavant rencontrés. Or, cela advenait souvent depuis certain entretien sur la littérature, pendant lequel Hans Castorp avait pour la première fois distingué cette lueur nouvelle au fond des yeux de Joachim, ainsi que leur expression singulièrement « menaçante ». Cela arrivait surtout à table : par exemple, lorsque Joachim, toujours enroué, avalait brusquement et violemment de travers, et avait peine à reprendre haleine. C’est alors, et tandis que Joachim haletait derrière sa serviette et que Mme Magnus, sa voisine, selon une vieille pratique lui frappait le dos, que leurs yeux se rencontraient d’une manière qui troublait et effrayait Hans Castorp plus que l’incident lui-même, qui pouvait naturellement arriver à n’importe qui ; et ensuite Joachim fermait les siens et, la figure enfouie dans sa serviette, quittait la table et la salle à manger pour finir de tousser dehors.
Souriant, bien qu’encore légèrement pâle, il revenait au bout de dix minutes, avec, sur les lèvres un mot d’excuse, à cause du dérangement qu’il avait causé aux autres ; comme auparavant, il prenait part au formidable repas et ensuite on oubliait même de revenir, ne fût-ce que par une remarque sur cet incident banal. Mais lorsque, quelques jours plus tard, – cette fois ce n’était plus à dîner, mais lors du déjeuner également copieux, – le même fait se produisit, d’ailleurs sans que des yeux se fussent rencontrés, du moins ceux des cousins, car Hans Castorp, penché sur son assiette, continuait de manger avec une indifférence apparente, il fallut quand même, le repas fini, prononcer quelques mots à ce sujet, et Joachim pesta contre cette sacrée mégère, la Mylendonck qui par sa question saugrenue lui avait mis la puce à l’oreille, lui avait suggéré cela, que le diable m’emporte cette sorcière ! Oui, c’était apparemment de la suggestion, dit Hans Castorp, c’était amusant de le constater au milieu du désagrément que l’on en éprouvait. Et Joachim, maintenant qu’il avait appelé la chose par son nom, se défendit dorénavant avec succès contre cette sorcellerie, se surveilla à table et n’avala pas de travers plus souvent que des gens non ensorcelés : cela ne se reproduisit que neuf ou dix jours plus tard, à quoi il n’y avait en somme rien à redire.
Cependant, il fut convoqué chez Rhadamante en dehors des heures et de son tour habituels. La supérieure l’avait dénoncé et sans doute n’avait-elle pas eu tort. Car, dès lors qu’il y avait un laryngoscope dans la maison, cet enrouement persistant qui à certaines heures dégénérait en une véritable aphonie, et aussi ces maux de gorge qui reparaissaient dès que Joachim négligeait d’assouplir son gosier par des moyens qui activaient la salive, paraissaient des raisons suffisantes de tirer de l’armoire cet instrument ingénieusement combiné, sans compter que, si Joachim n’avalait plus de travers qu’à intervalles normaux, il n’en était ainsi que grâce aux précautions qu’il prenait en mangeant, de sorte qu’aux repas il était presque régulièrement en retard sur les voisins.
Le conseiller donc mira, refléta et regarda profondément et longtemps dans le gosier de Joachim, après quoi le malade, à la prière expresse de Hans Castorp, se rendit aussitôt dans la loge de celui-ci pour rendre compte de la visite. Cela avait été très pénible et l’avait beaucoup chatouillé, rapporta-t-il en un demi-murmure, parce que c’était justement la cure de repos principale et que le silence était de rigueur ; et pour finir, Behrens avait bafouillé toutes sortes de choses sur un état d’irritation et avait dit qu’il faudrait procéder chaque jour à des badigeonnages. Dès le lendemain il commencerait de cautériser, le temps de préparer le médicament. Donc, de l’irritation et des cautérisations. Hans Castorp, la tête pleine d’associations d’idées qui allaient loin et qui se rapportaient à des personnes très éloignées, comme au concierge boiteux et à cette dame qui s’était tenue l’oreille pendant toute la semaine et que l’on avait pu complètement rassurer, avait encore des questions sur les lèvres, mais ne se décida pas à les énoncer, et résolut de les poser au conseiller entre quatre yeux. En attendant, il se borna à exprimer devant Joachim sa satisfaction de ce que ce petit désagrément fût maintenant soumis à un contrôle et que le conseiller eût pris l’affaire en main. C’était un chic type, et il ne manquerait pas d’arranger les choses. Sur quoi Joachim approuva de la tête sans regarder l’autre, lui tourna le dos et passa dans sa loge.
Que se passait-il avec l’honnête Joachim ? Ces derniers jours son regard était devenu incertain et timide. Récemment encore, la supérieure Mylendonck s’était heurtée, dans sa tentative de le pénétrer, à son regard doux et sombre ; mais, si elle s’était avisée de tenter à nouveau sa chance, on n’aurait vraiment pas su dire comment la chose se serait passée. Quoi qu’il en fût, il évitait de telles rencontres, et lorsqu’elles se produisaient quand même (car Hans Castorp le regardait souvent), on ne se sentait pas mieux à l’aise. Oppressé, Hans Castorp resta dans son compartiment, agité par la tentation d’interroger aussitôt le patron. Mais ce n’était pas possible, car Joachim l’aurait entendu se lever, et il fallait donc remettre ce projet et rejoindre Behrens dans le courant de l’après-midi.
Mais il n’y réussit pas. C’était très étrange ! Il ne réussit absolument pas à atteindre le conseiller, ni le soir même, ni pendant les deux journées suivantes. Naturellement, Joachim le gênait un peu, puisqu’il ne devait s’apercevoir de rien, mais cela ne suffisait pas à expliquer pourquoi Hans Castorp ne pouvait amener cette rencontre et ne trouvait pas moyen de mettre la main sur Rhadamante. Hans Castorp le cherchait et s’informait de lui dans toute la maison, on l’envoyait où il serait certain de le rencontrer, mais il ne le trouvait jamais. Behrens assista à un repas, mais se trouva assis très loin, à la table des Russes ordinaires, et s’esquiva avant le dessert. Plusieurs fois Hans Castorp crut le tenir par un bouton, il le vit dans l’escalier et dans les couloirs, causant avec Krokovski, avec la supérieure, avec un malade, et le guetta. Mais à peine avait-il détourné les yeux, que Behrens n’était plus là.
Le quatrième jour seulement, il atteignit son but. Du haut de son balcon, il vit au jardin celui qu’il poursuivait, occupé à donner des instructions au jardinier. Il se débarrassa rapidement de sa couverture et descendit en courant. La nuque ronde, le conseiller ramait vers son appartement. Hans Castorp se mit au trot et se permit d’appeler, mais ne fut pas entendu. Enfin, hors d’haleine, il parvint à arrêter son homme.
– Qu’est-ce que vous venez chercher ici ? l’apostropha le conseiller, les yeux larmoyants. Dois-je vous faire remettre un exemplaire spécial du règlement de la maison ? Autant que je sache, c’est la cure de repos. Ni votre courbe ni votre plaque ne vous donnent un droit particulier de jouer au grand seigneur. Il faudrait faire installer ici un épouvantail qui menacerait d’embrocher les gens qui prennent des libertés au jardin entre deux et quatre ! Que voulez-vous, en somme ?
– Monsieur le conseiller, il faut absolument que je vous parle un instant !
– Je m’aperçois que vous vous êtes mis cela en tête depuis quelque temps déjà. Vous me poursuivez exactement comme si j’étais la femme de vos rêves. Que me voulez-vous ?
– Ce n’est qu’au sujet de mon cousin, monsieur le conseiller, excusez-moi ! On le badigeonne à présent… Je suis persuadé que tout est pour le mieux ainsi. Cela est sans doute inoffensif ? C’est ce que je voulais tout bonnement me permettre de vous demander.
– Vous voulez toujours que tout soit inoffensif, Castorp, vous êtes ainsi fait. Vous êtes très capable de vous occuper même des choses qui ne soient pas absolument inoffensives, mais vous les traitez comme si elles l’étaient, et vous croyez par là complaire à Dieu et aux hommes. Vous êtes une sorte de froussard et d’hypocrite, mon garçon, et lorsque votre cousin vous traite de pékin, c’est encore un fameux euphémisme.
– Tout cela est possible, monsieur le conseiller. Naturellement, les faiblesses de mon caractère sont évidentes. Mais c’est justement parce qu’elles sont pour l’instant hors de cause, que je voulais vous demander depuis trois jours déjà, simplement ceci…
– … que je vous dore la pilule. Vous voulez m’importuner et m’ennuyer pour que je vous encourage dans votre damnée hypocrisie, et pour que vous puissiez dormir en toute innocence, pendant que d’autres gens veillent au grain.
– Mais, monsieur le conseiller, vous êtes très sévère avec moi. Je voulais, au contraire…
– Oui, la sévérité n’est justement pas votre affaire. Votre cousin est un type bien différent, d’une autre trempe que vous. Lui sait à quoi s’en tenir. Il le sait, mais il se tait, vous m’entendez. Il ne s’accroche pas aux basques des gens pour se faire débiter des fadaises et des propos réconfortants. Lui, savait ce qu’il faisait et ce qu’il risquait, et c’est un gaillard qui s’entend à garder de la tenue et à la fermer, ce qui est un art viril, mais ce qui n’est malheureusement pas l’affaire d’aimables phénomènes bipèdes tels que vous. Mais je vous le dis, Castorp, si vous faites ici des scènes et si vous poussez des cris et si vous vous abandonnez à vos sentiments de civil, je vous mets à la porte. Car ici les hommes veulent rester entre eux, vous me comprenez.
Hans Castorp garda le silence. Lui aussi se tachetait à présent, lorsqu’il changeait de couleur. Il était trop bronzé pour pâlir tout à fait. Enfin il dit, les lèvres tremblantes :
– Je vous remercie beaucoup, monsieur le conseiller. Je suis d’ailleurs fixé maintenant, car je suppose que vous ne me parleriez pas si… – comment dire ? – si solennellement, si le cas de Joachim n’était pas sérieux. Du reste, je n’incline pas du tout aux scènes et aux hauts cris, vous me jugez mal. Et s’il s’agit de se montrer discret, je saurai tenir ma place, c’est ce que je crois pouvoir vous affirmer.
– Vous aimez sans doute bien votre cousin, Hans Castorp ? demanda le conseiller en saisissant tout à coup la main du jeune homme, et en le regardant, d’en-dessous, de ses yeux bleus et larmoyants, aux cils blanchâtres…
– Que voulez-vous que je vous dise, monsieur le conseiller ? Un si proche parent, un si bon ami, et mon camarade, ici.
Hans Castorp eut un bref sanglot et posa un pied sur la pointe, en tournant le talon vers l’extérieur.
Le conseiller se hâta de lâcher sa main.
– Allons, alors soyez gentil avec lui pendant ces six ou huit semaines, dit-il. Abandonnez-vous à votre goût naturel pour l’inoffensif, c’est sans doute ce qui lui sera le plus agréable. Et puis je suis là, moi aussi, je suis là pour arranger la chose aussi élégamment et aussi confortablement que possible.
– Larynx, n’est-ce pas ? dit Hans Castorp en faisant un signe de tête au conseiller.
– Laryngea, confirma Behrens. Destruction rapide. Et la muqueuse du pharynx, elle aussi, est en bien vilain état. Il est possible que les cris de commandement au régiment aient créé là un locus minoris resistentiae[17]. Mais il faut toujours que nous nous attendions à de telles diversions. Peu de chances, mon garçon ; à la vérité, aucune. Mais naturellement on essaiera tout ce qui est utile et coûteux.
– La mère…, dit Hans Castorp.
– Plus tard, plus tard. Cela ne presse pas encore. Faites avec tact et goût, en sorte qu’elle soit mise au courant par étapes. Et maintenant, fichez-moi le camp à votre poste. Sinon, il s’en apercevrait. Et cela doit lui être pénible de sentir qu’on parle ainsi de lui derrière son dos.
Chaque jour Joachim allait se faire badigeonner. C’était un bel automne. En pantalons de flanelle blanche, sous la veste bleue, il arrivait souvent en retard aux repas, en revenant de son traitement, correct et martial, saluait brièvement, d’une façon aimable et virile, en s’excusant de son inexactitude et prenait place pour son repas qu’on lui préparait maintenant à part, parce qu’il n’aurait plus réussi à suivre les menus ordinaires sans risquer d’avaler de travers ; on lui servait des potages, des hachis et de la bouillie. Les voisins de table eurent bientôt compris la situation. Ils répondaient à son salut avec une politesse et un empressement marqués, en l’appelant « lieutenant ». En son absence, ils interrogeaient Hans Castorp, et des autres tables aussi, on venait et on l’interrogeait. Mme Stoehr vint en se tordant les mains et se lamenta trivialement. Mais Hans Castorp ne répondit que par monosyllabes, reconnut le sérieux de l’incident, mais nia jusqu’à un certain point son extrême gravité, le fit pour l’honneur, dans le sentiment qu’il n’avait pas le droit d’abandonner Joachim prématurément.
Ils se promenaient ensemble, ils franchissaient trois fois par jour la distance prescrite, à laquelle le conseiller avait très précisément limité Joachim, pour qu’il évitât une dépense inutile de forces. À gauche de son cousin, marchait Hans Castorp. Autrefois ils avaient marché ainsi ou bien autrement, comme cela se trouvait, mais à présent Hans Castorp se tenait de préférence à sa gauche. Ils ne parlaient pas beaucoup, ils prononçaient les paroles que la journée normale du Berghof amenait sur leurs lèvres, et rien de plus. Sur le sujet qui était en suspens entre eux, il n’y avait rien à dire, surtout entre gens enclins à la pudeur et qui ne s’appellent par leurs prénoms qu’en des circonstances extrêmes. Pourtant, le besoin de s’épancher se levait par instants, prêt à déborder, dans la poitrine de civil de Hans Castorp. Mais c’était impossible. Ce qui avait afflué douloureusement et tumultueusement retombait, et il restait muet.
Joachim marchait à côté de lui, la tête baissée. Il regardait à terre comme s’il considérait le sol. C’était si étrange : le voici qui marchait ici, net et correct, il saluait les passants à sa manière chevaleresque, il gardait de la tenue et de la bienséance comme toujours – et il appartenait à la terre. Mon Dieu, nous lui appartenons tous, tôt ou tard. Mais si jeune et avec une si bonne et joyeuse volonté de servir sous le drapeau, c’est quand même amer de lui appartenir à si bref délai ; plus amer et plus incompréhensible pour un Hans Castorp qui sait, et qui marche à côté de lui, que pour l’homme de la terre lui-même, dont le savoir réticent et discret est en somme d’une nature très académique, n’a au fond pour lui qu’une réalité très affaiblie et semble être moins son affaire que celle des autres. En effet, notre mort est plus encore affaire des survivants que de nous-même ; que nous nous en souvenions ou non pour le moment, cette parole d’un sage malicieux est en tout cas valable pour l’âme : aussi longtemps que nous sommes, la mort n’est pas, et lorsque la mort est, nous ne sommes pas ; par conséquent, il n’y a entre la mort et nous aucun rapport réel ; elle est une chose qui ne nous regarde absolument pas, qui regarde tout au plus le monde et la nature, et c’est en effet pourquoi tous les êtres l’envisagent avec un grand calme, une indifférence, une irresponsabilité et une innocence égoïstes. Hans Castorp trouva beaucoup de cette innocence et de cet égoïsme dans la manière d’être de Joachim durant ces semaines, et il comprit que son cousin savait sans doute, mais qu’il ne lui était pas pour cela difficile d’observer sur ce savoir un silence convenable, parce que ses rapports intérieurs avec cette connaissance étaient encore lointains et théoriques, ou que, pour autant qu’ils entraient pratiquement en ligne de compte, ils étaient réglés et déterminés par une notion saine de la destinée, état d’esprit qui admettait aussi peu de commenter ce savoir que tant d’autres fonctions inconvenantes dont la vie a conscience et qui la conditionnent, mais qui ne l’empêchent pas d’observer les bienséances.
Ils marchaient ainsi et gardaient le silence sur maintes choses naturelles, mais auxquelles il eût été malséant de toucher. Même les plaintes de Joachim, proférées d’abord avec animation et colère, sur son regret de manquer les manœuvres et le service militaire en général, s’étaient tues. Mais pourquoi, au lieu de cela, et malgré toute son innocence, l’expression d’une timidité trouble reparaissait-elle dans ses yeux doux, cette incertitude qui eût sans doute donné la victoire à la supérieure si elle avait renouvelé sa tentative ? Était-ce parce qu’il savait que ses joues se creusaient et que ses yeux grandissaient ? Car c’est ce qui se produisait à vue d’œil, durant ces semaines, bien plus encore que cela avait été le cas lors de son retour du pays plat, et son teint brun devenait de jour en jour d’un jaune plus blafard. Comme s’il avait conçu des raisons d’avoir honte et de se mépriser lui-même, dans un milieu qui, à l’instar de M. Albin, ne se souciait pas d’autre chose que de jouir des avantages infinis de la honte. Devant quoi et devant qui se baissait et se dérobait son regard autrefois si franc ? Comme elle est étrange, cette pudeur devant la vie de la créature qui se réfugie dans une cachette pour crever, persuadée qu’elle ne peut attendre de la nature extérieure aucun respect ni aucune pitié devant sa douleur et sa mort, persuadée avec raison, puisque les troupes d’oiseaux migrateurs, non seulement n’honorent pas leurs compagnons malades, mais les expédient avec colère et mépris à coups de bec. Telle est la nature à l’ordinaire ; mais une pitié et un amour profondément humains gonflaient le cœur de Hans Castorp lorsqu’il voyait cette pudeur instinctive dans les yeux du pauvre Joachim. Il marchait à sa gauche, il le faisait expressément ; et comme Joachim commençait à tenir mal sur ses jambes, il le soutenait lorsqu’il s’agissait par exemple de monter la petite pente d’un pré, en surmontant pour cela sa raideur naturelle et en posant pour cela son bras sur lui ; et même, il omettait de retirer son bras des épaules de Joachim jusqu’à ce que celui-ci les secouât avec un peu d’irritation et dit :
– Dis donc, si tu laissais ça ? On dirait que nous sommes deux ivrognes, à nous voir marcher !
Mais vint un instant où le regard trouble de Joachim apparut à Hans Castorp sous un autre jour, et ce fut lorsque Joachim reçut l’ordre de garder le lit, au début de novembre ; la neige était épaisse. En effet, à ce moment-là, il lui était devenu trop difficile d’absorber même des hachis et des bouillies, parce qu’il avalait de travers à chaque deuxième bouchée. Le passage à une nourriture exclusivement liquide était indiqué, et en même temps Behrens ordonna un repos continu au lit, pour épargner les forces du malade. C’était donc la veille du jour où Joachim se mit au lit, le dernier soir où il était sur pied que Hans le trouva… le trouva en conversation avec Maroussia, cette Maroussia qui riait sans raison, Maroussia au petit mouchoir à l’orange et à la poitrine extérieurement si bien conformée. C’était après le dîner, durant la réunion du soir, dans le hall. Hans Castorp s’était arrêté au salon de musique et sortit pour chercher Joachim ; il le trouva en face de la cheminée en faïence, à côté du siège de Maroussia. C’était dans un fauteuil à bascule qu’elle était assise ; de la main gauche posée sur le dossier, Joachim le tenait incliné en arrière, de sorte que Maroussia, de sa position couchée, avec ses yeux bruns et ronds, le regardait dans la figure qu’il penchait sur elle tout en parlant doucement et à mots entrecoupés, tandis qu’elle haussait les épaules en souriant de temps à autre et avec une animation dédaigneuse.
Hans Castorp s’empressa de faire un pas en arrière, non sans avoir observé que d’autres pensionnaires encore suivaient la scène, comme cela se fait, d’un œil amusé, inaperçus de Joachim, ou tout au moins sans qu’il voulût y prendre garde. Ce spectacle : Joachim se confiant sans réserve à cette Maroussia à la poitrine opulente, à la table de laquelle il avait été assis si longtemps sans échanger une seule parole avec elle, devant la personne et l’existence de qui il avait baissé les yeux avec une expression sévère à la fois raisonnable et honnête, bien que sa figure pâlît et se tachetât lorsqu’il était question d’elle, bouleversa Hans Castorp plus que tous les signes d’affaiblissement qu’il avait observés ces semaines dernières chez son cousin. « Oui, il est perdu », pensa-t-il, et il s’assit en silence au salon de musique pour laisser à Joachim le temps de ce qu’il s’accordait encore ce dernier soir.
À partir de là, Joachim prit définitivement la position horizontale, et Hans Castorp l’annonça à Louise Ziemssen, lui écrivit sur son excellente chaise-longue qu’il devait ajouter maintenant à ses précédentes communications occasionnelles que Joachim s’était alité, et que, sans qu’il en eût rien dit, l’on pouvait lire dans ses yeux le désir que sa mère fût auprès de lui, et que le docteur Behrens appuyait expressément ce désir inexprimé. Cela aussi, il l’ajouta délicatement et clairement. Et ce ne fut donc pas miracle que Mme Ziemssen eût recours aux moyens de communication les plus rapides pour rejoindre son fils : trois jours après le départ de cette lettre, alarmante malgré tous les ménagements, elle arriva ; Hans Castorp la chercha en traîneau à la station de Dorf, par une tempête de neige, et, debout sur le quai, apprêta son visage avant que le petit train n’arrivât, pour ne pas effrayer tout de suite la mère, mais pour que celle-ci ne lût pas davantage dans son premier regard une gaieté trompeuse.
Combien de fois de telles rencontres devaient-elles déjà avoir eu lieu, combien de fois s’était-on élancé les uns vers les autres, et celui qui descendait du train avait-il épié avec angoisse et insistance les regards de celui qui l’accueillait ! Mme Ziemssen donnait l’impression d’être venue à pied de Hambourg jusqu’à Davos. La figure échauffée, elle serra la main de Hans Castorp contre sa poitrine, regardant autour d’elle comme avec crainte, et posa des questions pressées et en quelque sorte secrètes, qu’il éluda en la remerciant d’être venue si vite : c’était fameux, et comme Joachim serait heureux ! Oui, il était malheureusement recouché jusqu’à nouvel ordre, c’était à cause de la nourriture liquide qui naturellement ne laissait pas d’influencer l’état de ses forces. Mais en cas de besoin il y avait encore d’autres ressources, par exemple l’alimentation artificielle. D’ailleurs, elle en jugerait elle-même.
Elle en jugea ; et, debout à côté d’elle, Hans Castorp à son tour se rendit compte. Jusqu’à cet instant les changements qui s’étaient accomplis pendant ces dernières semaines sur Joachim n’avaient pas été, pour lui, si apparents ; les jeunes gens n’ont jamais un œil pour de telles choses. Mais à présent, à côté de la mère venue du dehors, il le considérait en quelque sorte avec ses yeux à elle, comme s’il ne l’avait pas vu depuis longtemps, et il reconnut clairement et nettement ce que, sans aucun doute, elle aussi reconnaissait, mais ce que, de tous les trois, Joachim savait certainement le mieux, c’est-à-dire qu’il était un moribond. Il tenait la main de Mme Ziemssen dans la sienne, qui était aussi jaune et émaciée que sa figure dont, par suite de l’amaigrissement général, les oreilles – cette légère contrariété de ses bonnes années – se détachaient plus sensiblement qu’autrefois, en l’enlaidissant fâcheusement ; mais hormis ce défaut, sa face semblait plutôt virilement embellie malgré l’empreinte de la souffrance, grâce à l’expression de sérieux et de sévérité, voire aussi de fierté qu’elle portait, bien que ses lèvres surmontées de la petite moustache noire parussent par trop pleines en regard des ombres des joues creuses. Deux plis s’étaient creusés dans la peau jaunâtre de son front, entre les yeux qui, bien que profondément enfoncés dans les orbites osseuses, étaient plus beaux et plus grands que jamais, et dans lesquels Hans Castorp pouvait regarder sans déplaisir. Car, depuis que Joachim était couché, tout trouble, toute inquiétude et toute incertitude en avaient disparu, et seule cette lueur aperçue autrefois était visible dans ses profondeurs sereines et obscures ; il est vrai qu’y paraissait aussi cette « menace ». Il ne sourit pas, en tenant la main de sa mère et en lui chuchotant un bonjour et en lui souhaitant la bienvenue. Il n’avait pas davantage souri lorsqu’elle était entrée, et cette immobilité figée de sa mine disait tout.
Louise Ziemssen était une femme courageuse. Elle ne se laissa pas aller à sa douleur à la vue de son vaillant enfant. Stoïque, se contenant, comme le filet à peine visible contenait ses cheveux, flegmatiquement et énergiquement, – comme on l’était dans son pays, avions-nous dit, – elle assuma le soin de Joachim, comme éperonnée par son aspect à une combativité maternelle et animée de cette foi que, s’il y avait encore quelque chose à sauver, sa force et sa vigilance seules y réussiraient. Ce ne fut certainement pas pour sa propre commodité, mais par goût pour les convenances qu’elle consentit quelques jours plus tard à ce que l’on fît également venir une infirmière auprès du grand malade. C’était sœur Bertha, en réalité Alfreda Schildknecht, qui parut avec sa valise noire au chevet de Joachim ; mais ni le jour ni la nuit l’énergie jalouse de Mme Ziemssen ne lui laissa grand’chose à faire, et sœur Bertha avait beaucoup de temps pour rester à l’affût, dans le corridor, le cordon de son binocle derrière l’oreille.
La diaconesse protestante était une âme prosaïque. Seule dans la chambre avec Hans Castorp et avec le malade qui ne dormait nullement, mais reposait sur le dos, les yeux ouverts, elle était capable de dire :
– Non, vraiment je n’aurais jamais rêvé qu’un jour je serais encore appelée à soigner un de ces Messieurs jusqu’à sa mort.
Hans Castorp, effrayé, lui montra le poing avec une expression sauvage, mais elle comprit à peine ce qu’il voulait, bien éloignée, et avec raison, de la pensée qu’il convenait d’avoir des égards pour Joachim, et d’un esprit beaucoup trop objectif pour supposer que quelqu’un, et à plus forte raison le principal intéressé, pût se bercer d’illusions sur le caractère et l’issue de ce cas. « Tenez, disait-elle, en versant de l’eau de Cologne sur un mouchoir et en le tenant sous le nez de Joachim, donnez-vous encore un peu de bon temps, monsieur le lieutenant. »
Et en effet c’eût été alors peu raisonnable de vouloir en conter au bon Joachim, à moins que ce fût pour exercer sur lui une influence tonifiante comme Mme Ziemssen l’entendait lorsqu’elle parlait d’une voix forte et émue de sa guérison. Car deux choses étaient claires, et l’on ne pouvait s’y tromper : premièrement, que Joachim allait à la mort, en toute conscience, et deuxièmement qu’il le faisait en paix lui-même et satisfait de lui. Ce n’est que la dernière semaine, à la fin de novembre, lorsque la faiblesse du cœur devint sensible, qu’il s’oublia pendant des heures entières, entouré d’un voile d’espérances consolantes quant à son état. Il parlait alors de son retour prochain au régiment et de la part qu’il prendrait aux grandes manœuvres, dont il croyait qu’elles se poursuivaient encore. C’est précisément à ce moment-là que le conseiller Behrens renonça à donner de l’espoir aux proches et déclara que la fin n’était plus qu’une question d’heures.
C’est un phénomène aussi mélancolique que fatal que cette illusion oublieuse et crédule en laquelle tombent même les âmes viriles durant la période où le processus destructeur approche en réalité de sa fin, phénomène impersonnel, normal et plus fort que toute conscience individuelle, au même point que la tentation du sommeil qui séduit l’homme qui va mourir de froid, ou que l’erreur de l’égaré qui tourne en rond en revenant sur ses propres pas. Hans Castorp, que le chagrin et le déchirement de son cœur n’empêchaient pas de considérer ce phénomène avec objectivité, y rattachait des considérations, gauchement exprimées encore que lucides, dans ses entretiens avec Naphta et Settembrini, lorsqu’il leur rendait compte de l’état de son parent, et il s’attira le blâme de ce dernier en disant que la conception courante d’après laquelle la crédulité philosophique et la confiance dans le bien étaient un témoignage de santé, tandis que le pessimisme et la sévérité à l’endroit du monde seraient un signe de maladie, reposait apparemment sur une erreur ; sinon, l’état final et désespéré ne pourrait favoriser un optimisme inquiétant auprès duquel l’humeur sombre qui l’avait précédé apparaissait comme une manifestation de vie saine et vigoureuse. Dieu merci, il put en même temps apprendre à ces amis compatissants que Rhadamante laissait subsister un espoir au sein même de cette situation désespérée, en prophétisant malgré la jeunesse de Joachim, un exitus doux et sans souffrances.
– Une idyllique affaire de cœur, chère Madame, disait-il en tenant la main de Louise Ziemssen dans ses deux énormes pattes en forme de pelles et en la regardant d’en-dessous avec des yeux larmoyants et injectés de sang.
« Cela me fait plaisir, cela me fait infiniment plaisir que cela prenne un cours cordial, si je puis dire, et qu’il n’ait pas besoin d’attendre l’œdème de la langue et d’autres vilaines choses ; ainsi bien du tintouin lui sera épargné. Le cœur cède rapidement, tant mieux pour lui, tant mieux pour nous, nous pouvons faire tout notre devoir avec la seringue de camphre, sans beaucoup de risque de l’exposer encore à des complications prolongées. Il dormira beaucoup en dernier lieu et il fera des rêves agréables, c’est ce que je crois pouvoir vous promettre, et si, en tout dernier lieu il ne devait pas justement dormir, il aura quand même un trépas court et sans douleurs, ça lui sera égal, croyez-m’en. Au fond, il en est presque toujours ainsi. Je connais la mort, je suis un de ses vieux employés ; croyez-m’en : on la surestime. Je puis vous le dire : ce n’est presque rien du tout. Car tout ce qui, dans certaines circonstances, précède cet instant en fait de tracasseries, on ne peut pas très bien considérer que cela fait partie de la mort ; c’est tout ce qu’il y a de plus vivant et qui peut conduire à la vie et à la guérison. Mais de la mort, personne qui en reviendrait ne saurait rien vous dire qui en vaille la peine, car on ne la vit pas. Nous sortons des ténèbres et nous rentrons dans les ténèbres. Entre ces deux instants il y a des choses vécues, mais nous ne vivons ni le commencement ni la fin, ni la naissance ni la mort, elles n’ont pas de caractère subjectif, en tant qu’événements elles ne relèvent que du domaine de l’objectif. Voilà ce qu’il en est. »
Telle était la manière de réconforter du conseiller. Espérons qu’elle fit quelque bien à la raisonnable Mme Ziemssen. Et ses assurances se confirmèrent en effet assez complètement. Joachim, affaibli, dormit pendant de longues heures, durant ses derniers jours, il rêva aussi à ce qu’il lui était agréable de rêver, c’est-à-dire, supposons-nous, qu’il vit dans ses songes le pays plat et la vie militaire ; et lorsqu’il s’éveillait et qu’on lui demandait comment il se sentait, il répondait toujours, quoique indistinctement, qu’il se sentait bien et heureux, quoiqu’il n’eût presque plus de pouls et qu’il finît par ne plus sentir la piqûre de la seringue d’injection : son corps était insensible, on aurait pu le brûler et le pincer que cela n’aurait déjà plus concerné le bon Joachim.
Malgré cela, depuis l’arrivée de sa mère, de grands changements s’étaient encore accomplis chez lui. Comme il lui était devenu pénible de se raser et qu’il avait cessé de le faire depuis huit ou dix jours, mais que sa barbe était très forte, sa figure cireuse aux yeux doux était maintenant encadrée d’un collier de barbe noire, d’une barbe de guerrier, comme les soldats la laissent pousser en campagne et qui, de l’avis de tous, lui prêtait d’ailleurs une beauté virile. Oui, Joachim, de jeune homme, était soudain devenu un homme mûr, à cause de cette barbe et sans doute pas seulement à cause d’elle. Il vivait vite comme un mécanisme d’horloge qui se défend, il franchissait au galop les âges qu’il ne lui était pas accordé d’atteindre dans le temps, et durant les dernières vingt-quatre heures il devint un vieillard. La faiblesse de son cœur causait une enflure de la face, qui donna à Hans Castorp l’impression que la mort devait être tout au moins un effort très pénible, encore que Joachim, grâce à bien des obscurcissements et des éclipses de la conscience, ne parût pas s’en apercevoir. Mais cette enflure atteignait surtout les lèvres, et le dessèchement ou l’énervement de l’intérieur de la bouche contribuait visiblement à faire marmotter Joachim comme un vieillard ; il s’irritait de cette gêne. S’il n’y avait pas eu cela, disait-il en balbutiant, tout eût été pour le mieux, mais c’était un fichu embêtement.
Ce qu’il entendait en disant que « tout irait pour le mieux » n’était pas tout à fait clair. La tendance de son état à l’équivoque apparaissait d’une manière frappante ; plus d’une fois il proféra des choses à double sens. Il paraissait savoir et ne pas savoir, et déclara une fois, apparemment secoué par un frisson d’anéantissement, en hochant la tête et avec une certaine contrition, que « jamais il n’avait été aussi mal en point ».
Puis, son attitude devint distante, sévère, inabordable, même incivile ; il ne se laissait plus atteindre par aucune fiction ni aucun palliatif, il n’y répondait plus, il regardait devant lui d’un air absent. Surtout après que le jeune pasteur, que Louise Ziemssen avait fait appeler, et qui, au regret de Hans Castorp, ne portait pas de rabat amidonné mais un simple petit collet, eut prié avec lui, son attitude prit une empreinte officielle et il n’exprima plus de désirs que sous forme d’ordres brefs.
À six heures de l’après-midi il fut pris d’une manie bizarre : avec la main droite, dont son petit bracelet cerclait le poignet, il passa plusieurs fois dans la région de la hanche en la levant un peu et en la ramenant vers lui sur la couverture, d’un geste qui raclait ou ratissait, comme s’il attirait ou recueillait quelque chose.
À sept heures il mourut. Alfreda Schildknecht se trouvait dans le couloir, la mère et le cousin étaient seuls présents. Il s’était affaissé dans son lit et il ordonna brièvement qu’on le soulevât. Tandis que Mme Ziemssen, enlaçant du bras les épaules de son fils, se conformait à cet ordre, il dit avec une certaine hâte qu’il devait immédiatement rédiger et remettre une demande de prolongation de son congé, et tandis qu’il disait cela le « bref trépas » s’accomplit, observé par Hans Castorp avec recueillement, à la lumière de la petite lampe de chevet voilée de rouge. Son œil tourna, l’inconsciente tension de ses traits disparut, l’enflure pénible des lèvres s’évanouit à vue d’œil, et le muet visage de notre Joachim retrouva la beauté d’une jeunesse virile. C’était fini.
Comme Louise Ziemssen s’était détournée en sanglotant, ce fut Hans Castorp qui, de la pointe de l’annulaire, abaissa les paupières de celui qui n’avait plus ni souffle ni mouvements, et ce fut lui qui joignit doucement ses mains sur la couverture. Puis, lui aussi, se leva et pleura, laissa couler sur ses joues les larmes qui avaient tellement brûlé l’officier de marine anglais, ce liquide clair qui coule partout dans le monde si abondamment, si amèrement et à toute heure, au point qu’on a donné à la vallée terrestre un nom poétique qui rappelle ce produit alcalin et salé des glandes que le bouleversement nerveux d’une douleur qui nous transperce, de la douleur physique comme de la douleur morale, arrache à notre corps. Il savait que ce liquide contenait également un peu de mucine et d’albumine.
Le conseiller vint, prévenu par sœur Bertha. Une demi-heure plus tôt il s’était encore trouvé là et avait donné au mourant une injection de camphre ; il n’avait manqué que l’instant du « bref trépas »…
« Voui, en voilà un pour qui ça y est », dit-il simplement en se redressant et en détachant son stéthoscope de la poitrine silencieuse de Joachim. Et il serra les mains des deux parents en leur faisant un signe de tête. Ensuite, il resta encore un instant avec eux, considérant le visage immobile de Joachim, encadré d’une barbe de guerrier.
– Grand fou, grand risque-tout, dit-il par-dessus l’épaule en désignant de la tête celui qui reposait. Il a voulu forcer les choses, vous comprenez ; naturellement, son service, là-bas, n’a été que contrainte et violence, il a fait son service dans la fièvre, quand même et malgré tout ! Le champ d’honneur, vous comprenez, il a pris la clef du champ d’honneur, le déserteur. Mais l’honneur a été la mort pour lui, et la mort – vous pouvez à volonté retourner les choses, a certainement dit maintenant : « J’ai bien l’honneur ! » Grand fou, va, grand écervelé ! Et il s’en fut, grand et courbé, avec sa nuque saillante.
Le transport de Joachim dans sa ville natale était chose décidée, et la maison du Berghof s’occupait de tout ce qui était nécessaire et de ce qui paraissait convenable et de mise. La mère et le cousin n’eurent à s’inquiéter de rien. Le lendemain, dans sa chemise de soie à manchettes, parmi les fleurs répandues sur la couverture, reposant dans une clarté mate et neigeuse, Joachim était devenu encore plus beau qu’aussitôt après le trépas. Toute trace d’effort avait maintenant disparu de sa figure ; refroidie, elle avait pris sa forme silencieuse la plus pure. Ses cheveux noirs et légèrement bouclés tombaient sur un front immobile et jaunâtre qui paraissait pétri dans une matière noble et délicate, entre la cire et le marbre, et dans la barbe, également crépue, les lèvres ondulaient, pleines et fières. Un casque antique eût convenu à cette tête, comme le firent remarquer plusieurs visiteurs qui vinrent prendre congé.
Mme Stoehr pleura avec enthousiasme à la vue de ce qu’était devenu celui qui fut Joachim.
– Un héros, un héros ! s’écria-t-elle plusieurs fois, et elle déclara qu’il fallait absolument jouer à ses obsèques la symphonie « érotique » de Beethoven.
– Taisez-vous donc ! siffla Settembrini à son côté.
Il se trouvait dans la chambre en même temps qu’elle et était visiblement ému. Des deux mains il désigna Joachim aux visiteurs présents en les conviant à la contrition. Un giovanotto tanto simpatico, tanto stimabile, s’écria-t-il à plusieurs reprises.
Naphta ne put s’abstenir, tout en conservant son attitude recueillie et sans regarder l’Italien, de dire d’une voix basse et mordante :
– Je suis heureux de voir que, en dehors de la Liberté et du Progrès, vous avez aussi du sens pour les choses sérieuses.
Settembrini encaissa. Peut-être avait-il conscience d’une supériorité de la position de Naphta sur la sienne, supériorité provisoire qui tenait aux événements ; peut-être était-ce cette supériorité momentanée de l’adversaire qu’il avait tenté d’équilibrer par la vivacité de ses regrets et qui lui fit garder le silence lors même que Léon Naphta, tirant parti des avantages passagers de sa position, observait d’un ton coupant et sentencieux :
– L’erreur de la littérature consiste à croire que seul l’esprit rend convenable. C’est plutôt le contraire qui est vrai. Il n’y a de convenance que là où il n’y a point d’esprit.
« Allons, pensa Hans Castorp, voilà encore un de ces oracles de Pythie ! Si l’on serre les lèvres après l’avoir formulé, cela peut intimider sur le moment… »
Dans l’après-midi vint le cercueil de plomb. Un homme qui était arrivé en même temps donna à entendre que c’était son rôle à lui seul de placer Joachim dans ce somptueux récipient décoré d’anneaux et de têtes de lion. C’était un parent de l’entrepreneur de pompes funèbres auquel on avait fait appel, vêtu de noir dans une sorte de redingote courte, et qui portait à sa main plébéienne une alliance dont le cercle jaune était en quelque sorte creusé dans la chair et en était presque recouvert. On était tenté d’admettre qu’une odeur de cadavre se dégageait de son habit de gala, ce qui n’était qu’un préjugé. Néanmoins cet homme émit la prétention du spécialiste que tout son travail devait s’accomplir derrière les coulisses et qu’il ne convenait d’exposer aux regards des survivants que des tableaux pieux et édifiants, ce qui éveilla la méfiance de Hans Castorp et ne répondait nullement à ses intentions. Il engagea sans doute Mme Ziemssen à se retirer, mais ne se laissa pas expulser à coups de compliments. Il resta et prêta main-forte. Il empoigna le corps sous les épaules et aida à le porter du lit dans le cercueil, sur le drap et sur le coussin galonné duquel la dépouille de Joachim fut étendue, haute et solennelle, entre des flambeaux que la maison Berghof avait fournis.
Mais le lendemain un phénomène se produisit qui décida Hans Castorp à se séparer et à se détacher intérieurement de la forme à abandonner décidément le champ au professionnel, au piètre gardien de la piété. En effet, Joachim dont l’expression avait été jusqu’à présent si grave et si loyale, avait commencé de sourire dans sa barbe de guerrier, et Hans Castorp ne se dissimula pas que ce sourire avait une tendance à dégénérer : il inspirait au témoin une hâte soudaine. Et, mon Dieu, il fut en somme heureux quand on vint le chercher, que le cercueil dût être fermé et vissé. Surmontant ses habitudes de raideur innée, Hans Castorp effleura délicatement des lèvres, en signe d’adieu, le front glacé de son Joachim d’autrefois, et malgré toute sa méfiance à l’égard de l’homme de la coulisse il quitta docilement la chambre avec Louise Ziemssen.
Nous laissons tomber le rideau, pour l’avant-dernière fois. Mais tandis qu’il s’abaisse, nous allons encore, en notre esprit, avec Hans Castorp qui est resté sur la haute montagne, regarder au loin, en prêtant l’oreille, vers un humide cimetière du pays plat, où une épée scintille et s’abaisse, où des commandements retentissent et où une triple décharge – trois saluts héroïques – crépite au-dessus du tombeau de soldat de Joachim Ziemssen.
CHAPITRE VII
PROMENADE SUR LA GRÈVE
Peut-on raconter le temps, le temps en lui-même, comme tel et en soi ? Non, en vérité, ce serait une folle entreprise. Un récit, où il serait dit : « Le temps passait, il s’écoulait, le temps suivait son cours » et ainsi de suite, jamais un homme sain d’esprit ne le tiendrait pour une narration. Ce serait à peu près comme si l’on avait l’idée baroque de tenir pendant une heure une seule et même note, ou un seul accord, et si l’on voulait faire passer cela pour de la musique. Car la narration ressemble à la musique en ceci qu’elle « accomplit » le temps, qu’elle « l’emplit convenablement », qu’elle le « divise », qu’elle fait en sorte qu’« il s’y passe quelque chose », – pour citer, avec la piété mélancolique que l’on voue aux paroles de défunts, des expressions familières à feu Joachim, des paroles qui ont retenti il y a fort longtemps – et nous ne sommes pas certains que le lecteur se rende clairement compte depuis combien de temps. Le temps est l’élément de la narration comme il est l’élément de la vie : il y est indissolublement lié, comme aux corps dans l’espace. Le temps est aussi l’élément de la musique, laquelle mesure et divise le temps, le rend à la fois précieux et divertissant, en quoi, comme il a été dit, elle s’apparente à la narration, qui, elle aussi (et d’une tout autre façon que la présence immédiate et éclatante de l’œuvre plastique, qui n’est liée au temps qu’en tant que corps), n’est qu’une succession, est incapable de se présenter autrement que comme un déroulement, et a besoin de recourir au temps, même si elle essayait d’être tout entière présente en un instant donné.
Ce sont là des choses évidentes. Mais il n’est pas moins clair qu’il y a une différence entre la narration et la musique. La durée musicale n’est qu’un fragment du temps humain et terrestre où elle se déverse pour l’anoblir et l’exalter indiciblement. Au contraire, la narration comporte deux espèces de temps : en premier lieu son temps propre, la durée musicale et effective qui détermine son écoulement et son existence ; en second lieu le temps de son contenu, qui se présente en une perspective d’aspect si différent que le temps imaginaire du récit peut ou bien coïncider presque complètement avec sa durée musicale, ou bien en être infiniment éloigné. Un morceau de musique intitulé : « Valse des cinq minutes » dure cinq minutes. C’est en cela et en rien d’autre que consiste son rapport avec le temps. Mais un récit dont l’action durerait cinq minutes pourrait, quant à lui, s’étendre sur une période mille fois plus longue, pourvu que ces cinq minutes fussent remplies avec une conscience exceptionnelle ; et il pourrait néanmoins sembler très court, quoique, par rapport à sa durée imaginaire, il fût très long. D’autre part, il est possible que la durée des événements relatés dépasse à l’infini la durée propre du récit qui les présente en raccourci, nous disons « raccourci », pour indiquer un élément illusoire, ou pour nous exprimer tout à fait clairement, un élément morbide qui se manifeste en ce que le récit se sert d’un charme hermétique et d’une perspective exagérée, rappelant certains cas anormaux et de toute évidence orientés vers le surnaturel, de l’expérience réelle. On possède des journaux de fumeurs d’opium qui témoignent que, sous l’empire du stupéfiant, ils ont, pendant la brève période du transport, vécu des rêves qui s’étendaient sur dix, sur trente, sur soixante années, ou qui même dépassaient toutes les limites possibles d’une expérience humaine du temps, des rêves, par conséquent, dont la durée imaginaire dépassait leur propre durée, et où s’accomplissait un raccourci incroyable de l’expérience du temps, une accélération des images telle que l’on eût cru, comme s’exprime un mangeur de hachisch, que l’on avait retiré du cerveau enivré « quelque chose comme le ressort d’une montre cassée ».
C’est un peu à la manière de ces rêves artificiels que le récit peut traiter le temps. Mais comme il peut le « traiter », il est clair que le temps, qui est l’élément du récit, peut également devenir son objet. Si ce serait trop dire que d’affirmer que l’on puisse « raconter le temps », ce n’est pas, malgré tout, une entreprise aussi absurde qu’il nous avait semblé de prime abord que de vouloir évoquer le temps dans un récit, de sorte que l’on pourrait attribuer un double sens qui tiendrait singulièrement du rêve, au qualificatif de « roman du temps ». C’est un fait que nous ne venons de soulever la question de savoir s’il est possible de raconter le temps, que pour avouer que c’était bien là notre dessein dans l’histoire en cours. Et si nous nous sommes demandé en passant si les auditeurs réunis autour de nous se rendent encore clairement compte combien de temps s’est écoulé jusqu’à l’heure présente, depuis que l’honnête Joachim – décédé depuis – a jeté dans la conversation telle remarque sur la musique et sur le temps, laquelle témoigne du reste d’une certaine progression de son être vers l’alchimie, puisque des remarques de ce genre ne répondaient pas, en somme, à sa nature, nous n’aurions nullement été fâché d’apprendre que, sur le moment, on n’était pas précisément au clair là-dessus. Nous n’en aurions pas été fâché, voire même nous en aurions été satisfait, pour cette simple raison que nous avons naturellement intérêt à ce que l’on partage les sentiments de notre héros, et que celui-ci, Hans Castorp, n’était plus du tout fixé sur ce point, ne l’était plus depuis longtemps. Cela fait partie de son roman, de ce « roman d’un temps », qu’on l’entende dans un sens ou dans l’autre.
Combien de temps Joachim avait-il en somme vécu avec Hans Castorp jusqu’à son départ en coup de tête ? Combien de temps avait-il vécu avec lui en tout et pour tout ? Quand, pour s’en tenir au calendrier, avait eu lieu ce premier départ en coup de tête ? Combien de temps Joachim avait-il été absent ? Quand était-il revenu ? Combien de temps Hans Castorp lui-même avait-il séjourné ici, jusqu’à ce que Joachim revînt, puis sortît du temps ? Combien de temps, pour laisser de côté Joachim, Mme Chauchat avait-elle été non-présente ? Depuis combien de temps était-elle de nouveau là (car elle était de nouveau là), et combien de temps terrestre Hans Castorp avait-il vécu au Berghof jusqu’à ce qu’elle fût revenue ? À toutes ces questions, – en supposant qu’on les lui eût posées, ce que personne ne faisait du reste, et ce que lui-même ne faisait pas davantage parce qu’il appréhendait sans doute de se les poser, – Hans Castorp n’aurait su répondre qu’en tambourinant du bout des doigts sur son front, il n’aurait su le dire au juste, phénomène aussi inquiétant que certaine incapacité de dire à M. Settembrini son propre âge, qu’il avait ressentie dès le premier soir de son arrivée ; voire, aggravation de cette impuissance, car à présent il ne savait décidément plus du tout quel âge il avait.
Cela peut sembler étrange, mais cela est si loin d’être inouï ou invraisemblable, que, dans certaines conditions, cela pourrait arriver à chacun d’entre nous. Rien, ces conditions se réalisant, ne pourrait nous empêcher de perdre toute conscience du cours du temps, et par conséquent de notre âge. Ce phénomène est possible puisque nous ne possédons aucun organe intérieur pour percevoir le temps, puisque nous sommes donc incapables, d’un point de vue absolu, de déterminer le temps, par nous-mêmes et sans l’aide de repères extérieurs, avec une précision même approximative. Des mineurs ensevelis, privés de toute possibilité d’observer la succession du jour et de la nuit, ont évalué, lorsqu’on eut réussi à les sauver, à trois jours le temps qu’ils avaient passé dans l’obscurité, entre l’espérance et le désespoir. Or, ils étaient restés ensevelis dix jours. On pourrait croire que dans leur angoisse, le temps aurait dû leur sembler long. Mais il s’était réduit à moins d’un tiers de sa durée objective. Il semble donc qu’en des conditions extraordinaires, l’impuissance humaine tende plutôt à vivre le temps en raccourci qu’à l’évaluer trop largement.
Sans doute, personne ne conteste que Hans Castorp n’eût éprouvé, s’il l’avait voulu, aucune difficulté réelle à échapper par un calcul à cette incertitude, de même que le lecteur le pourrait faire sans peine si la confusion répugne à son esprit sain. En ce qui concerne Hans Castorp, il ne s’y sentait, peut-être, pas non plus particulièrement à l’aise, mais il ne se souciait pas de faire le moindre effort pour se dégager de cette confusion, ni pour mesurer la durée de son séjour. Ce qui l’en empêchait, c’était une inquiétude de sa conscience, bien que ce fût évidemment la pire inconscience que de ne pas prendre garde au temps.
Nous ne savons pas s’il faut faire valoir pour sa défense que les circonstances favorisaient tout particulièrement son manque de bonne volonté, pour ne pas parler franchement de sa mauvaise volonté. Lorsque Mme Chauchat fut de retour (tout autrement que Hans Castorp l’avait imaginé, mais de cela il sera question plus loin), l’Avent était une fois de plus passé, et la journée la plus courte, le commencement de l’hiver, par conséquent, astronomiquement parlant, était tout proche. Mais en réalité, si l’on négligeait les divisions théoriques et si l’on ne tenait compte que de la neige et du froid, on avait de nouveau eu l’hiver, depuis un temps incalculable ; même, cet hiver n’avait été que passagèrement interrompu par de brûlantes journées d’été, avec un azur d’une profondeur si exagérée qu’il touchait au noir, par des journées d’été comme il s’en produisait en plein hiver, pour peu que l’on oubliât la neige, car, en somme, il tombait aussi de la neige pendant tous les mois d’été. Combien de fois Hans Castorp s’était-il entretenu avec feu Joachim de cette grande confusion qui mélangeait les saisons, qui les confondait, qui privait l’année de ses divisions et la faisait paraître brève avec lenteur, ou longue dans sa rapidité, de sorte que, selon une parole que Joachim avait prononcée voici fort longtemps avec dégoût, il ne pouvait plus du tout être question de temps. Ce qui en réalité était mélangé et confondu dans cette grande confusion, c’étaient les impressions ou les consciences successives d’un « encore » ou d’un « déjà de nouveau », et cette expérience compliquée était une véritable sorcellerie par laquelle Hans Castorp avait été séduit, au détriment de son moral, dès la première journée passée ici, à savoir durant ces cinq formidables repas, dans la salle à manger peinte en couleurs gaies, où il avait été pris d’un premier vertige de ce genre – relativement inoffensif.
Depuis lors, cette illusion des sens et de l’esprit avait pris des proportions plus grandes. Le temps, même lorsque la sensation subjective en est affaiblie ou abolie, a une réalité objective dans la mesure où il est actif, où il produit des changements. C’est une question pour penseurs professionnels – et ce n’est que par présomption juvénile que Hans Castorp s’était un jour risqué à se la poser – de savoir si la boîte de conserve hermétique rangée sur son rayon est en dehors du temps. Mais nous savons que le temps accomplit son œuvre même sur le dormeur. Un médecin certifie le cas d’une jeune fille de douze ans qui s’endormit un jour et demeura endormie pendant treize ans : elle ne resta pas une fillette de douze ans ; mais se réveilla jeune femme, s’étant développée dans l’intervalle. Comment pourrait-il en aller autrement ? Le mort est mort et il est passé de la vie au néant : il a beaucoup de temps, c’est-à-dire qu’il n’en a pas du tout, personnellement parlant. Cela n’empêche pas que ses ongles et ses cheveux poussent encore et qu’en somme… Mais nous ne voulons pas rappeler l’expression cavalière dont Joachim s’était servi un jour à ce propos et dont Hans Castorp, en homme du pays plat, s’était alors formalisé. Ses cheveux et ses ongles à lui aussi poussaient, ils poussaient vite, semblait-il, car il était souvent installé, enveloppé de la serviette blanche, dans un des fauteuils du coiffeur de la grand’rue de Dorf et se faisait couper les cheveux, parce que des franges s’étaient une fois de plus formées autour de ses oreilles. En somme, il était toujours installé là, ou, plutôt, lorsqu’il y était assis, bavardant avec le garçon adroit et empressé qui faisait son œuvre après que le temps avait accompli la sienne, – ou encore lorsqu’il était debout près de la porte du balcon et raccourcissait ses ongles au moyen des petits ciseaux et des limes tirées de son joli nécessaire de velours, – il se sentait tout à coup pris, avec une sorte d’effroi auquel se mêlait un singulier plaisir, de certain vertige, d’un vertige qui mêlait l’étourdissement à l’illusion, d’une impuissance à distinguer l’« encore » et le « de nouveau », dont le mélange et la coïncidence produisent le « toujours » et l’« à jamais » situés en dehors du temps.
Nous avons souvent assuré que nous ne voulions pas le rendre meilleur, mais pas davantage pire qu’il n’est, et nous n’allons donc pas dissimuler qu’il s’efforçait souvent de racheter sa complaisance blâmable à l’égard de certaines tentations mystiques, provoquées même consciemment et intentionnellement par des efforts en sens contraire. Il pouvait rester assis, sa montre à la main, sa montre en or plate et lisse, dont il avait levé le couvercle au monogramme gravé, et regarder son cadran de porcelaine, orné de deux rangées de chiffres arabes en noir et en rouge, sur lequel les deux aiguilles en or finement et somptueusement ciselées s’écartaient l’une de l’autre, et où la mince aiguille des secondes faisait son tour, avec un tic-tac affairé, dans sa petite sphère particulière. La petite aiguille suivait son chemin en trottinant, sans s’occuper des chiffres qu’elle atteignait, touchait, dépassait, dépassait de beaucoup, approchait et atteignait de nouveau. Elle était insensible aux buts, aux divisions, aux jalons. Elle aurait dû s’arrêter un instant à 60, ou tout au moins signaler en quelque manière que quelque chose venait d’y prendre fin. Mais à la manière dont elle se hâtait de franchir ce chiffre, pas autrement que le moindre trait non chiffré, on reconnaissait que tout le chiffrage et les subdivisions n’étaient qu’inscrits en surcharge, et qu’elle ne faisait que marcher, marcher toujours… Hans Castorp remettait donc sa montre dans sa poche, et abandonnait le temps à son propre sort.
Comment rendre sensible à d’honnêtes esprits du pays plat ces transformations qui s’opéraient dans l’économie intime du jeune aventurier ? L’échelle de ces identités vertigineuses grandissait. Si, avec un peu de complaisance, il n’était pas facile de détacher le présent d’un hier, d’un avant-hier, ou d’un avant-avant-hier qui avaient ressemblé au jour présent comme un œuf à l’autre, on pouvait être d’autant plus tenté et plus capable de confondre son présent actuel avec le présent d’un mois ou d’une année révolus, et de laisser se perdre les uns et les autres dans un « toujours ». Mais pour autant que l’on prenait distinctement conscience du « encore », du « de nouveau » et du futur, on pouvait être tenté d’élargir le sens des termes relatifs du « hier » et du « demain », par quoi l’« aujourd’hui » s’affirme et écarte le passé et l’avenir, et tenté d’appliquer ces mots à des périodes plus longues. Il ne serait pas difficile de concevoir des êtres, habitant par exemple des planètes plus petites que la nôtre, qui administreraient un temps en miniature, et pour la vie « brève » desquels le trottinement agile de notre aiguille des secondes aurait toute la lenteur compassée de l’heure qui avance. Mais on pourrait également se représenter des êtres à l’espace desquels serait lié un temps d’une étendue formidable, de sorte que les conceptions du « à l’instant » ou du « peu s’en faut », du « hier » et du « demain » prendraient dans leur existence une importance infiniment élargie. Ce serait là, disons-nous, non seulement possible ; mais, du point de vue d’un relativisme tolérant et selon le proverbe : « À chaque pays ses usages », cela devrait être tenu pour légitime, normal et respectable. Mais que penser d’un fils de la terre – et qui, par surcroît, est à un âge pour lequel un jour, une semaine complète, un mois, un semestre devraient encore jouer un rôle important, et apportent dans la vie tant de changements et de progrès, – que penser d’un fils de la terre qui, un jour, prendrait l’habitude vicieuse, ou céderait tout au moins de temps à autre au plaisir de dire « hier » et « demain », au lieu de « voici un an » ou « l’année prochaine » ? Il n’est pas douteux qu’il y aurait lieu de parler, en l’occurrence, d’« égarement et de confusion » et que la plus vive inquiétude s’en trouverait justifiée.
Il y a sur terre des concours de circonstances, des ambiances ou paysages (si l’on peut parler de « paysage » dans le cas qui nous occupe), dans lesquels une telle confusion et un tel effacement des distances dans le temps et dans l’espace se produisent en quelque sorte naturellement et à juste titre, en progressant jusqu’à une indifférence vertigineuse, de sorte qu’un plongeon dans cette magie peut être admis, tout au moins pendant les heures de vacances. Nous voulons parler de la promenade au bord de la mer, – un état dont Hans Castorp ne se souvenait pas sans la plus vive sympathie, comme nous savons déjà qu’il retrouvait volontiers et avec reconnaissance dans la vie sur la neige le souvenir des dunes de chez lui. Nous espérons que l’expérience et les souvenirs du lecteur nous serviront à nous faire comprendre, quand nous évoquerons cette merveilleuse solitude. L’on marche et l’on marche… Jamais l’on ne rentrera à temps d’une telle promenade, car on a perdu le temps et il vous a perdu. Ô mer, nous sommes assis loin de toi et tout en contant, nous tournons vers toi nos pensées, notre amour, en t’invoquant nommément et à voix haute. Tu dois être présente dans notre récit, comme tu l’as toujours été et comme tu le seras toujours en secret… Désert sibilant, tendu de gris-pâle, plein d’humidité amère, dont un goût salin reste à nos lèvres. Nous marchons, sur un sol légèrement élastique, parsemé d’algues et de petits coquillages, les oreilles enveloppées de vent, de ce grand vent, vaste et doux, qui parcourt l’espace librement, sans frein ni malice, et qui étourdit doucement notre cerveau, nous marchons, nous marchons et nous voyons les langues d’écume de la mer, poussée en avant et qui reflue de nouveau, s’étendre pour lécher nos pieds. Le ressac bouillonne, vague sur vague se heurte avec un son clair et assourdi, et bruit comme une soie sur la grève plate, ici comme là-bas, et plus loin, sur les bancs de sable, et cette rumeur confuse, remplissant tout, et qui bourdonne doucement, ferme notre oreille à toute autre voix du monde. On se suffit profondément à soi-même, on oublie consciemment… Fermons les yeux, à l’abri pour l’éternité ! Mais non, voyez, là-bas, dans l’étendue gris-vert et écumeuse qui se perd en de puissants raccourcis jusqu’à l’horizon, voyez, une voile ! Là-bas ? Quel là-bas est-ce ? À quelle distance ? Proche ou lointain ? On ne le sait pas. On ne sait quel vertige trouble notre jugement. Pour dire quelle distance sépare ce bateau de la rive, il faudrait savoir quelle est sa taille. Petit et proche, ou grand et lointain ? Notre regard est incertain, car nous n’avons pas d’organe ni de sens qui nous renseigne sur l’espace… Nous marchons, nous marchons. Depuis combien de temps ? Jusqu’où ? Qu’en savons-nous ? Rien ne change notre pas, « là-bas » est pareil à « ici », « tout à l’heure », est semblable à « maintenant » et à « ensuite » : le temps se noie dans la monotonie infinie de l’espace, le mouvement d’un point à l’autre n’est plus un mouvement, il n’y a pas de temps.
Les docteurs du moyen âge prétendaient que le temps était une illusion, que son écoulement qui fait succéder l’effet à la cause ne tenait qu’à la nature de nos sens, et que le véritable état des choses était un présent immuable. S’était-il promené au bord de la mer, le docteur qui, le premier, conçut cette pensée, goûtant sur ses lèvres la légère amertume de l’éternité ? Quoi qu’il en soit, nous répétons que c’est d’une exceptionnelle école buissonnière que nous parlons ici, d’un effet du loisir, qui pénètre le moral d’un homme aussi vite que le repos dans le sable chaud rend la santé au corps. Exercer la critique sur les moyens et les formes de la connaissance humaine, mettre en question leur validité serait un parti pris absurde, méprisable et haineux, si jamais un autre sens était lié à une telle attitude que le désir d’assigner à la raison des limites qu’elle ne saurait franchir sans se rendre coupable de négliger sa fonction. Nous ne pouvons que témoigner de la reconnaissance à un homme comme M. Settembrini d’avoir présenté au jeune homme dont le destin nous préoccupe et qu’il avait interpellé à l’occasion comme un « enfant terrible de la vie », d’avoir présenté à Hans Castorp, disons-nous, – et avec une énergie toute pédagogique – la métaphysique comme « le mal », et nous honorons le mieux la mémoire d’un mort qui nous est cher en disant que le sens, la fin et le but du principe critique ne peut et ne doit être qu’une seule chose, à savoir l’idée du devoir, et le devoir de vivre. Plus encore : si la sagesse légiférante a tracé par la critique des limites à la raison, elle a aussi planté sur ses frontières même le drapeau de la vie, et elle a proclamé que c’est le devoir militaire de l’homme de faire son service sous ce drapeau. Faudrait-il excuser le jeune Hans Castorp, et admettre qu’il avait été confirmé dans son administration vicieuse du temps et dans son jeu dangereux avec l’éternité, par le fait que ce que certain hâbleur mélancolique avait appelé « l’excès de zèle » de son cousin, le militaire, avait entraîné un exitus letalis ?
MYNHEER PEEPERKORN
Mynheer Peeperkorn, un Hollandais d’un certain âge, était depuis quelque temps l’hôte de la maison du Berghof qui, avec le meilleur fondement, portait sur son enseigne l’épithète « internationale ». La nationalité légèrement colorée de Peeperkorn – car c’était un Hollandais colonial, un habitant de Java, un planteur de café – ne suffirait pas à nous décider à l’introduire, lui, Pieter Peeperkorn (c’est ainsi qu’il s’appelait, c’est ainsi qu’il se désignait lui-même : « Maintenant Pieter Peeperkorn va se délecter d’un doigt d’eau-de-vie », avait-il coutume de dire), ne suffirait pas, disons-nous, à nous décider à l’introduire sur le tard dans notre histoire… Car, grand Dieu ! quelle variété de teints et de nuances la société de l’excellente institution, dont le conseiller docteur Behrens assurait la direction médicale avec sa faconde polyglotte, n’offrait-elle pas déjà ? Ce n’était pas assez que, récemment, une princesse égyptienne eût séjourné ici, – celle-là même qui avait jadis offert au conseiller un remarquable service à café et des cigarettes au Sphinx, – un personnage sensationnel aux doigts garnis de bagues et jaunis par la nicotine, aux cheveux coupés courts et qui, en dehors des principaux repas auxquels elle assistait en toilette parisienne, se promenait en costume masculin et en pantalons repassés. Elle se souciait d’ailleurs fort peu du monde masculin et ne témoignait une faveur à la fois paresseuse et violente qu’à une Juive roumaine qui s’appelait tout bonnement Mme Landauer, bien que le procureur Paravant négligeât les mathématiques pour l’amour de Son Altesse, et dans son ardeur amoureuse, eût été bien près de tourner au bouffon. Ce n’était donc pas assez, disons-nous, de sa présence personnelle, car il se trouvait même dans sa petite suite un eunuque nègre, un homme faible et souffreteux, mais qui, malgré ce défaut fondamental volontiers raillé par Caroline Stoehr, semblait tenir à la vie plus que personne et se montrait inconsolable de l’image qu’offrait la plaque de son intérieur lorsqu’on eut radiographié son corps noir.
Comparé à de telles figures, Mynheer Peeperkorn pouvait sembler presque incolore. Et, bien que ce chapitre de notre récit pourrait porter, comme un précédent chapitre, le titre « Encore quelqu’un », ce n’est pas une raison de redouter qu’un nouveau fauteur de confusion spirituelle et pédagogique n’entre ici en scène. Non, Mynheer Peeperkorn n’était nullement homme à introduire dans le monde un trouble intellectuel. C’était un tout autre homme ainsi que nous allons le voir. Que sa personne ait néanmoins causé chez notre héros un état de trouble extrême, c’est ce que l’on comprendra, quand on saura ce qui suit :
Mynheer Peeperkorn arriva à la gare de Dorf par le même train du soir que Mme Chauchat, et il rejoignit par le même traîneau qu’elle le Berghof où il dîna au restaurant en sa compagnie. Ce n’était pas seulement une arrivée simultanée, c’était une arrivée en commun, et cette communauté, qui s’affirmait, par exemple, dans le fait que Mynheer se vit désigner sa place à la table des « Russes bien », à côté de la jeune femme et en face de la place du docteur, à l’endroit où le professeur Popoff s’était autrefois livré à des démonstrations équivoques, cette communauté justement troubla le bon Hans Castorp, qui n’avait rien prévu de tel. Le conseiller lui avait annoncé à sa manière le jour et l’heure du retour de Clawdia. « Allons, Castorp, mon vieux, avait-il dit. La patience et la fidélité sont récompensées. Après-demain la petite chatte se glissera de nouveau parmi nous, on me l’annonce par télégramme. » Mais que Mme Chauchat ne dût pas venir seule c’est ce dont il n’avait rien laissé entendre, peut-être parce que lui-même n’avait pas su qu’elle et Peeperkorn arriveraient ensemble et faisaient un couple. Du moins feignit-il la surprise lorsque le jour de cette arrivée commune, Hans Castorp lui demanda, en quelque sorte, des comptes.
– Comment pourrais-je vous dire où elle a encore pêché ce numéro-là ? déclara-t-il. Une rencontre de voyage dans les Pyrénées, je suppose. Voui, il faudra bien vous en accommoder, vous le Céladon déçu, rien à faire. Inséparables, comprenez-vous ! Il semble qu’ils fassent bourse commune. L’homme est immensément riche, d’après ce que j’entends dire. Roi du café retiré, vous savez, un valet de chambre malais, un train de vie tout à fait magnifique. D’ailleurs, il ne vient certainement pas pour son plaisir, car outre une polyblennie d’origine alcoolique, il semble que nous soyons en présence d’une fièvre contractée sous les tropiques, d’une fièvre intermittente, comprenez-vous : ça traîne terriblement. Il faudra que vous le preniez en patience.
– Je vous en prie, je vous en prie, dit Hans Castorp de haut. « Et toi ? pensa-t-il. Comment te sens-tu ? Tu n’es pas non plus tout à fait désintéressé, quand on songe à autrefois (et si tous les signes ne trompent pas), espèce de veuf aux joues bleues, avec ta peinture à l’huile si réaliste. Tu as l’air de te gausser de moi, me semble-t-il, et pourtant nous sommes des compagnons de malheur, en quelque sorte, par rapport à Peeperkorn. »
– Type curieux, décidément, une physionomie originale, dit-il avec un geste qui dessinait le personnage. Vigoureux et malingre, telle est l’impression qu’il produit, telle est du moins l’impression que j’ai eue de lui, au petit déjeuner. Vigoureux et en même temps malingre, c’est par ces adjectifs, me semble-t-il, qu’il faut le caractériser, bien que d’habitude ils se contredisent. Il est sans doute grand et large et se carre volontiers, les mains dans les poches verticales de ses pantalons, – elles ont été coupées verticalement, ai-je remarqué, non pas latéralement, comme c’est le cas chez vous et moi, et d’une manière générale dans les classes supérieures de la société, – et lorsqu’il est là, debout, et parle du palais, avec son accent hollandais, il a incontestablement quelque chose de très vigoureux. Mais sa barbe est clairsemée, elle est longue et clairsemée au point que l’on croit pouvoir en compter les poils, et ses yeux sont petits et pâles, presque incolores, je n’y peux rien, et il a beau essayer toujours de les écarquiller, ce qui lui a valu les rides du front si marquées qui montent d’abord le long de ses tempes, puis traversent horizontalement son front, – son haut front rouge, savez-vous, autour duquel ses cheveux blancs sont longs, mais rares, – ses yeux restent quand même petits et pâles, il a beau les écarquiller… Et son gilet montant lui donne un air d’ecclésiastique bien que la redingote soit à carreaux. Telle est l’impression que j’ai eue ce matin.
– Je vois que vous l’avez pris en point de mire, répondit Behrens, et que vous avez bien observé notre homme dans ses particularités, ce que je trouve raisonnable, car il faudra bien que vous vous accommodiez de son existence.
– Oui, c’est ce que nous ferons sans doute, dit Hans Castorp.
Nous lui avons laissé le soin de tracer une image approximative de ce nouveau pensionnaire si inattendu, et il ne s’est pas trop mal tiré d’affaire. Il est même probable que nous n’aurions pas fait sensiblement mieux. Il est vrai que son poste d’observation avait été des plus favorables : nous savons que, durant l’absence de Clawdia, il avait été placé dans le proche voisinage de la table des « Russes bien », et comme la sienne était parallèle à celle-ci – avec cette seule différence que l’autre était un peu plus près de la porte de la véranda, – et que Hans Castorp, de même que Peeperkorn, occupait les côtés étroits situés vers l’intérieur de la salle, ils étaient en quelque sorte placés l’un à côté de l’autre, Hans Castorp un peu en retrait du Hollandais, ce qui facilitait une inspection discrète, tandis qu’il voyait Mme Chauchat de trois-quarts. Il conviendrait peut-être de compléter son intelligente esquisse en ajoutant que la lèvre supérieure de Peeperkorn était rasée, que son nez était grand et charnu, que sa bouche était également grande, et avait des lèvres irrégulières, comme déchirées. De plus, ses mains étaient sans doute assez larges, mais pourvues de longs ongles pointus, et il s’en servait tout en parlant, – car il parlait sans arrêt, sans que Hans Castorp saisît nettement le sens de ses paroles, – faisant des gestes recherchés, qui tenaient l’attention en suspens, les gestes délicatement nuancés, raffinés, précis et civilisés d’un chef d’orchestre, pliant l’index pour former un cercle avec le pouce, ou la main plate, – large, mais aux ongles pointus, – étendue, protectrice, apaisante et réclamant l’attention, pour aussitôt décevoir cette attention souriante qu’il avait obtenue par l’inintelligibilité de paroles si puissamment préparées, ou, sinon vraiment la décevoir, du moins pour la changer en un joyeux étonnement. Car la force, la délicatesse et l’importance significative de cette préparation compensaient largement les paroles qui faisaient défaut ; cette gesticulation satisfaisait par elle-même, divertissait, voire comblait les auditeurs. Parfois même cette parole n’était pas du tout prononcée. Il posait doucement sa main sur l’avant-bras de son voisin de gauche, un jeune savant bulgare, ou sur celui de Mme Chauchat, à sa droite levait ensuite cette main, obliquement, en réclamant le silence et l’attention pour ce qu’il s’apprêtait à dire, et, les sourcils froncés de façon que les rides qui formaient un angle droit entre son front et les coins extérieurs de ses yeux se creusaient comme sur un masque, il regardait sur la nappe, devant celui qu’il avait ainsi appréhendé, tandis que ses grandes lèvres déchirées semblaient sur le point de formuler des choses de la plus haute importance. Mais au bout d’un instant il rendait son souffle, renonçait à parler, et d’un signe semblait commander « Repos » ; sans avoir rien proféré, il retournait à son café qu’il s’était fait servir exceptionnellement fort, dans son propre filtre à café.
Lorsqu’il l’avait bu, il procédait comme suit. De la main il rabattait la conversation, obtenait le silence ainsi que le chef d’orchestre apaise le désordre des instruments que l’on accorde, et rassemble son monde par un geste impérieux et raffiné avant d’attaquer l’ouverture. Sa grande tête entourée de mèches blanches, avec ses yeux pâles, les formidables rides du front, sa longue barbe et sa bouche dénudée et douloureuse, produisait évidemment un effet tel que tout le monde se soumettait à son geste. Tous se taisaient, le regardaient en souriant, attendaient, et, ici et là, quelqu’un lui faisait un signe de tête avec un sourire encourageant. Il disait à voix basse :
– Mesdames et messieurs… Bien. Tout va bien. Classé ! Voulez-vous cependant envisager et ne pas perdre de vue un seul instant que… Mais sur ce point, motus. Ce qu’il m’incombe d’exprimer est moins cela, que, avant toute chose et en premier lieu ceci que nous avons le devoir, que la plus inviolable… – je le répète, et je mets tout l’accent sur cette expression – que l’exigence la plus inviolable se pose qui… Non, non, mesdames et messieurs, ce n’est pas ainsi ! Il n’en est pas ainsi de… Quelle erreur il serait de votre part de penser que je… Classé, mesdames et messieurs ! Parfaitement classé. Je nous sais d’accord sur tout cela, et donc au fait !
Il n’avait rien dit ; mais sa tête apparaissait si incontestablement significative, son jeu de physionomie et de gestes était si résolu, si insistant et si expressif, que tous, et même Hans Castorp qui écoutait, crurent avoir entendu des choses infiniment importantes ; tout en se rendant compte qu’aucune communication réelle ne leur avait été faite, ils n’avaient cependant le sentiment d’aucun vide. Nous nous demandons quelle eût été l’impression d’un sourd ? Peut-être se serait-il désolé, parce qu’il aurait jugé à tort de la teneur du discours d’après l’expression de l’orateur et se serait figuré que son infirmité lui avait fait perdre un bien précieux. De tels gens inclinent à la méfiance et à l’amertume. En revanche, un jeune Chinois, à l’autre extrémité de la table, qui ne comprenait que très peu l’allemand, et qui n’avait rien compris, mais qui avait entendu et vu, témoigna sa satisfaction joyeuse par l’exclamation : « Very well ! », et alla jusqu’à applaudir.
Et Mynheer Peeperkorn en arriva « au fait ». Il se redressa, il dilata sa large poitrine, il boutonna sa redingote à carreaux sur son gilet fermé, et sa tête blanche était royale. Il fit signe à une servante, – c’était la naine, – et bien qu’elle fût très occupée, elle obéit aussitôt à son geste autoritaire, et se présenta, le pot à lait et la cafetière à la main, à côté de sa chaise. Elle non plus ne put s’empêcher de lui faire, en souriant de sa grande figure vieillotte, un signe encourageant, suggestionnée par son regard pâle sous les formidables rides, par sa main levée, dont l’index s’unissait en un cercle avec le pouce, tandis que les trois autres doigts se dressaient dominés par les lances pointues des ongles.
– Mon enfant, dit-il, parfait ! Tout est parfait jusqu’ici. Vous êtes petite. Qu’est-ce que cela me fait ? Au contraire ! J’y vois un avantage. Je rends grâce à Dieu que vous soyez comme vous êtes, et grâce à votre petite taille si caractéristique… Laissons cela ! Ce que je désire de vous est également petit, petit et caractéristique. Avant tout, comment vous appelez-vous ?
Elle bégaya en souriant et dit ensuite que son nom était Émérentia.
– Parfait ! s’écria Peeperkorn en se rejetant contre le dossier de sa chaise et en allongeant le bras vers la naine. Il s’exclama ainsi avec un accent comme s’il eût voulu dire : « Que voulez-vous donc ? Tout est pour le mieux » ! Mon enfant, poursuivit-il, très sérieusement et presque avec sévérité, cela surpasse toutes mes espérances. Émérentia ! Vous le prononcez avec modestie, mais ce nom, rapproché de votre personne… Bref, cela ouvre les plus belles perspectives. Cela vaut la peine que l’on s’y attache et que l’on y suspende son cœur… Sous sa forme diminutive – vous m’entendez, mon enfant, – sous sa forme caressante, on pourrait dire Rentia. Emmy également serait réchauffant, pour l’instant je m’en tiens sans hésitation à Emmy. Donc, Emmy, mon enfant, écoute bien : un peu de pain, ma chère. Halte ! Arrête ! Qu’aucun malentendu ne s’insinue entre nous. Je vois dans ton visage relativement grand que ce danger… Du pain, Rintinette, mais pas du pain cuit, nous en avons ici des quantités sous toutes sortes de formes. Du pain brûlé, mon ange. Du pain du bon Dieu, du pain transparent, ma petite forme caressante, et ce à l’effet de nous délecter. Je ne suis pas très certain que le sens de ce mot… Je proposerai d’y substituer : pour ranimer notre cœur, si nous ne courions pas à nouveau le danger que l’on donne un sens frivole… Classé, Rentia, classé et liquidé. C’est bien plutôt au sens du devoir et d’une obligation sacrée. À celui, par exemple, de la dette morale qui m’incombe de témoigner à ta petitesse caractéristique… Un genièvre, ma chère. Pour me délecter, voulais-je dire. Du Schiedam, ma petite Émérentia. Hâte-toi et apporte-le-moi.
– Un genièvre d’origine, répéta la naine, qui tourna sur elle-même dans l’intention de se débarrasser de son pot et de sa cafetière, qu’elle déposa sur la table de Hans Castorp, à côté de son couvert à lui, parce qu’elle ne voulait pas importuner M. Peeperkorn. Elle s’empressa, et la commande fut aussitôt exécutée. Le verre était si plein que le « pain » coulait de toutes parts et mouillait l’assiette. Peeperkorn prit le verre entre l’index et le médius et l’éleva au jour. « Ainsi donc, déclara-t-il, Pieter Peeperkorn se délecte d’un doigt d’eau-de-vie ! » et il avala le blé distillé, après l’avoir un instant mâché. « Maintenant je vous regarde tous d’un œil réconforté. » Et il prit sur la nappe la main de Mme Chauchat, la porta à ses lèvres, puis la posa, en laissant encore un instant sa main sur celle de la jeune femme.
Un homme singulier, une personnalité imposante encore que difficile à pénétrer… La société du Berghof s’intéressait vivement à lui. On disait qu’il s’était récemment retiré du commerce des denrées coloniales et qu’il avait mis sa fortune au sec. On parlait de son splendide hôtel à La Haye et de sa villa à Scheveningue. Mme Stoehr l’appelait un « magnard d’argent » (un « magnard », la terrible femme !) et faisait à ce propos allusion à un collier de perles que Mme Chauchat portait depuis son retour avec sa robe du soir, et qui, de l’avis de Caroline, pouvait difficilement être considéré comme un témoignage de la galanterie de son époux de Transcaucasie, mais provenait certainement de la « bourse de voyage commune ». En même temps, elle clignait des yeux, désignait d’un mouvement de tête Hans Castorp et faisait une moue comique en raillant sans égards son infortune, car ni la maladie ni la souffrance ne l’avaient affinée. Il garda de la tenue. Il rectifia même le lapsus de la bonne dame, non sans esprit. La langue lui avait fourché, dit-il. Magnat, non pas magnard. Mais l’expression n’était pas trop mal choisie, car apparemment Peeperkorn possédait en effet quelque chose comme un pouvoir… magnétique. Il répondit de même avec une indifférence assez bien feinte à Mlle Engelhart l’institutrice, lorsque, rougissant faiblement, souriant de travers et sans le regarder, elle lui demanda si le nouveau pensionnaire lui plaisait. Mynheer Peeperkorn était une « personnalité estompée » dit-il, une personnalité sans doute, mais « plutôt estompée ». L’exactitude de cette appréciation témoignait de son objectivité et par conséquent de son calme. Elle fit perdre l’avantage à l’institutrice. Quant à Ferdinand Wehsal et à son allusion grimaçante aux circonstances inattendues dans lesquelles Mme Chauchat était revenue, Hans Castorp lui prouva qu’il est des regards dont la signification sans équivoque ne le cède en rien aux paroles les plus nettement articulées. « Lamentable personnage ! » dit le regard dont il mesura le Mannheimois, cela, sans qu’il fût possible de se méprendre le moins du monde sur sa signification, et Wehsal reconnut ce regard, l’encaissa, approuva même de la tête en montrant ses dents gâtées ; mais à partir de cet incident il renonça quand même à porter au cours de leurs promenades avec Naphta, Settembrini et Ferge, le pardessus de Hans Castorp.
Mon Dieu, Hans Castorp pouvait le porter lui-même, il préférait même qu’il en fût ainsi, et ce n’était que par amabilité qu’il l’avait de temps à autre abandonné à ce pauvre diable. Mais personne de nous ne s’y est trompé : en réalité Hans Castorp avait été durement touché par ces événements si imprévus qui ruinaient tous ses préparatifs intimes en vue du moment où il allait revoir l’objet de son aventure de Carnaval. Plus exactement, ils rendaient ces préparatifs inutiles, et c’était là le plus humiliant.
Les intentions de Hans Castorp avaient été les plus délicates et les plus sensées ; il avait été loin de tout emportement balourd. Il n’avait pas songé, par exemple, à aller attendre Clawdia à la gare, et c’était une chance encore qu’il eût tout d’abord écarté cette pensée ! Mais la question s’était posée d’une façon tout à fait générale de savoir si une femme, à qui la maladie accordait une liberté si large, voudrait croire à la réalité des événements fantastiques d’une lointaine nuit de rêve, de mascarade et de conversation en langue étrangère, et si elle désirerait qu’on la lui rappelât. Non, pas d’indiscrétion, pas de prétentions maladroites ! Même en admettant que ses rapports avec la malade aux yeux bridés eussent dépassé de loin les bornes de la raison et de la civilisation occidentale, il n’en convenait pas moins d’observer pour la forme les règles de la civilisation la plus accomplie, et, pour l’instant, de feindre jusqu’à l’oubli. Un salut d’homme du monde, d’une table à l’autre, pour commencer ; rien de plus ! Plus tard, lorsque l’occasion s’en présenterait, une visite mondaine, pour s’informer d’un ton léger de l’état de la malade, depuis l’autre jour… Et ils se seraient retrouvés véritablement, à leur heure ; et ce serait comme une récompense accordée pour cette maîtrise de soi chevaleresque. Mais, comme il a été dit, cette délicatesse apparaissait nulle et caduque, par le fait que tout caractère volontaire, et partant tout mérite, lui étaient enlevés. La présence de Mynheer Peeperkorn excluait par trop complètement toute possibilité tactique de se départir d’une extrême réserve. Le soir de l’arrivée, Hans Castorp avait vu de sa loge le traîneau monter au pas le tournant de la route, et dans ce traîneau, sur le siège duquel était juché le domestique malais, petit homme jaune, avec un col de fourrure à son pardessus et coiffé d’un melon, l’étranger avait été assis, le chapeau sur la tête, et à côté de lui s’était trouvée Clawdia. Cette nuit-là Hans Castorp n’avait guère dormi. Le matin il n’avait pas eu de peine à apprendre le nom de ce troublant compagnon et, par dessus le marché, la nouvelle que tous deux avaient occupé au premier étage des appartements luxueux et contigus. Puis était venu le premier déjeuner, et à son poste de bonne heure, très pâle, il avait attendu que la porte vitrée se fermât avec fracas. Mais le cliquetis ne s’était pas produit. L’entrée de Clawdia s’était faite en silence, car derrière elle Mynheer Peeperkorn avait refermé la porte. Grand, large d’épaules, le front haut, sa tête puissante entourée des flammes blanches de sa chevelure, il avait emboîté le pas à sa compagne de voyage qui, de son habituelle démarche féline, en avançant la tête, s’était approchée de sa table. Oui, c’était bien elle, inchangée ! Contrairement à son dessein et oubliant tout, Hans Castorp l’embrassa d’un regard qui trahissait l’insomnie. C’était bien sa chevelure d’un blond roussâtre, nullement frisée avec art, mais roulée en une simple natte autour de la tête, c’étaient ses « yeux de loup des steppes », la courbe de sa nuque, ses lèvres qui semblaient plus pleines qu’elles n’étaient, par suite de la saillie des pommettes qui déterminait une flexion gracieuse des joues… Clawdia ! pensa-t-il en frémissant, et il regarda le compagnon inattendu, non sans rejeter la tête, signe de défi railleur devant la grandiose apparition de ce masque, non sans s’efforcer de tout cœur à se moquer de l’assurance du propriétaire actuel que certain passé rendait assez douteux : ou plutôt un passé certain, moins vague que tels tableaux peints par un amateur et qui avaient réussi à l’inquiéter lui-même… Mme Chauchat avait aussi conservé sa manière de faire, en souriant, face à la salle, avant de s’asseoir, de se présenter en quelque sorte à la compagnie, et Peeperkorn la secondait en laissant s’accomplir la petite cérémonie, debout derrière elle, pour prendre place, ensuite, à son bout de table, à côté de Clawdia.
Il n’avait plus été question de salut d’homme du monde, d’une table à l’autre. Lors de la « présentation », les yeux de Clawdia avaient glissé sur la personne de Hans Castorp comme sur tout l’endroit où il se trouvait, pour se perdre au fond de la salle ; lors de la rencontre suivante dans la salle à manger il n’en avait pas été autrement ; et après chaque repas qui passait sans que leurs yeux se fussent rencontrés autrement qu’avec une indifférence aveugle et distraite de la part de Mme Chauchat, il devenait d’autant plus impossible de placer le salut d’homme du monde. Durant la brève union du soir, les compagnons de voyage se tinrent dans le petit salon : ils étaient assis l’un à côté de l’autre sur le sopha, au milieu de leurs voisins de table, et Peeperkorn, dont le visage grandiose, très rouge, se détachait de la blancheur flamboyante de ses cheveux et de sa barbe, vidait la bouteille de vin rouge qu’il s’était fait servir à dîner. Car à chacun des principaux repas il buvait une bouteille, voire une bouteille et demie ou même deux de vin rouge, sans parler du « pain » par lequel il commençait son petit déjeuner. Cet homme princier avait apparemment un besoin extraordinaire de se réconforter. Ce réconfort, il se l’accordait également sous forme d’un café très corsé qu’il buvait plusieurs fois par jour, non seulement le matin, de bonne heure, mais également l’après-midi. Il le buvait dans une grande tasse, aussi bien après le repas que pendant, en même temps que le vin. L’un et l’autre, apprit Hans Castorp, étaient bons contre la fièvre, sans parler de leur effet délectable, excellents contre sa fièvre intermittente qui, dès le second jour, le retint pour plusieurs heures dans sa chambre et au lit. C’était une fièvre quarte, dit le conseiller, parce que le Hollandais en était pris à peu près tous les quatre jours : c’était d’abord un claquement des dents, puis une ardeur brûlante suivie de transpiration. Et son mal avait encore pour effet la dilatation de la rate.
VINGT-ET-UN
Ainsi passait le temps : ce furent des semaines, au moins trois ou quatre semaines, si nous les évaluons, car nous ne pouvons en aucune façon nous fier au jugement et au sens que Hans Castorp avait du temps. Elles glissaient sans apporter de nouveaux changements, elles attisaient chez notre héros une colère, devenue habituelle, contre certains événements imprévus qui lui avaient imposé une réserve méritoire ; contre le fait qui se nommait lui-même Pieter Peeperkorn lorsqu’il absorbait un doigt d’eau-de-vie ; contre l’existence gênante de cet homme princier, imposant et indistinct, gênante en effet et d’une manière autrement agressive que celle de M. Settembrini ne l’avait jamais été. Des rides de mécontentement et d’irritation se dessinaient verticalement entre les sourcils de Hans Castorp, et sous ces plis, il considérait cinq fois par jour la jeune femme, malgré tout, heureux de pouvoir la regarder, et plein de mépris pour la présence toute-puissante de quelqu’un qui ne soupçonnait pas combien équivoque était le passé de sa compagne.
Mais un soir, comme il arrivait parfois sans raison particulière, la réunion du soir dans le hall et les salons avait pris une tournure plus animée que d’ordinaire. On avait fait de la musique – des airs tziganes, exécutés avec brio par un étudiant hongrois – après quoi le conseiller Behrens, qui s’était également montré avec le docteur Krokovski pour un petit quart d’heure, avait obligé un des pensionnaires à jouer au piano la mélodie du « Chœur des pèlerins », tandis que lui-même passait sur les registres aigus du clavier une brosse, parodiant ainsi le violon. Cela fit rire. Au milieu de vifs applaudissements, hochant la tête avec bienveillance comme surpris de sa propre gaieté, le conseiller quitta le salon. Mais la réunion se prolongea, on continua de faire de la musique, sans qu’elle exigeât une attention trop concentrée, on s’installa pour une partie de dominos ou de bridge, on commanda des boissons ; les uns se divertissaient à l’aide des jouets optiques, d’autres plaisantaient ci et là. Les habitués de la table des « Russes bien » s’étaient, eux aussi, mêlés aux groupes du hall et du salon de musique. On vit Mynheer Peeperkorn paraître en plusieurs endroits, on ne pouvait pas ne pas le voir, sa tête majestueuse dominait son entourage, triomphait par sa force royale et imposante, et, si ceux qui l’entouraient n’avaient été attirés d’abord que par sa réputation de richesse, c’était sa personnalité qui, seule, les retenait. Ils étaient là souriants, l’approuvaient de la tête, l’encourageaient, oublieux d’eux-mêmes. Fascinés par son œil pâle sous les formidables plis du front, tenus en suspens par l’insistance des gestes raffinés de ses ongles oblongs, et sans le moins du monde éprouver une déception devant l’inintelligibilité, l’incohérence, la gratuité de ce qui suivait.
Si, dans cette circonstance, nous nous mettons en quête de Hans Castorp, nous le trouverons dans le salon de lecture et de correspondance où jadis (ce jadis est vague ; le conteur, le héros et le lecteur ne sont plus tout à fait au clair sur son degré d’éloignement) des confidences importantes lui furent faites sur l’organisation du progrès de l’Humanité. On était plus tranquille ici. Quelques personnes seulement s’y trouvaient avec lui. Un malade écrivait sous une suspension électrique, à l’un des bureaux doubles. Une dame, qui portait deux lorgnons sur le nez, feuilletait, près de la bibliothèque, un volume illustré. Hans Castorp se tenait assis à proximité du passage ouvert qui conduisait au salon de musique, le dos tourné à la portière, un journal en mains, sur le siège qui se trouvait là, une chaise Renaissance recouverte de peluche, si l’on tient à ces détails, avec un dossier haut et droit, sans accoudoirs. Le jeune homme tenait son journal comme on le tient pour lire, mais il ne lisait pas ; la tête baissée, il écoutait au contraire la musique qui arrivait jusqu’à lui à travers le bruit des conversations, tandis que ses sourcils sombres témoignaient que cela aussi, il ne le faisait que d’une oreille distraite et que ses pensées suivaient des voies moins musicales. Elles suivaient les chemins épineux de la déception que lui avaient causée des événements qui se raillaient d’un jeune homme patient au bout d’une longue attente, des chemins pleins de révoltes amères ; parfois il était sur le point de jeter son journal sur cette chaise mal commode qui se trouvait là par hasard, de franchir cette porte et la porte du hall, et de quitter cette réunion manquée pour la solitude glaciale de son balcon, pour une solitude à deux : lui et Maria Mancini.
– Et votre cousin, monsieur ? demanda derrière lui, au-dessus de sa tête, une voix. C’était une voix enchanteresse pour son oreille, laquelle était prédestinée à trouver infiniment agréable ce timbre voilé et un peu rauque. C’était l’idée même de la jouissance poussée jusqu’à sa limite extrême, c’était la voix qui avait dit il y avait longtemps : « Volontiers, mais ne le casse pas ! » c’était une voix irrésistible, une voix fatale, et s’il ne se trompait pas, elle s’était informée de Joachim.
Il laissa lentement tomber son journal et leva un peu le visage, de sorte que sa tête ne se trouva appuyée plus haut que sur la vertèbre cervicale posée sur le dossier roide. Il ferma même un peu les yeux, mais les rouvrit aussitôt pour les lever obliquement vers en haut, dans la direction qui était donnée à son regard par la position de sa tête, n’importe où, dans le vide. Le brave garçon ! On eût dit que son expression était presque celle d’un voyant et d’un somnambule. Il souhaita qu’elle lui posât encore une fois la question, mais il n’en fut rien. Il n’était donc même pas sûr qu’elle fût encore debout derrière lui lorsque, après un temps assez long, avec un regard étrange, et à mi-voix, il répondit :
– Il est mort. Il a fait du service dans la plaine, et il est mort.
Lui-même remarqua que la première parole prononcée entre eux et qui portait un accent était le mot « mort ». Il remarqua en même temps que, faute d’être familiarisée avec sa langue, elle choisissait des expressions trop légères pour ses condoléances lorsqu’elle dit derrière et par-dessus lui :
– Aïe ! Comme c’est dommage ! Tout à fait mort et enterré ? Depuis quand ?
– Depuis quelque temps déjà. Sa mère l’a emporté avec elle. Une barbe de guerrier avait poussé à son menton. On a tiré trois salves d’honneur au-dessus de sa tombe.
– Il les avait bien méritées. Il a toujours été un brave. Il était plus brave que beaucoup d’autres, que certains autres.
– Oui, il était brave. Rhadamante a toujours parlé de son excès de zèle. Mais son corps ne voulait rien savoir. Rebellio carnis, disent les Jésuites. Il était toujours très porté vers les choses du corps, en tout bien, tout honneur. Mais son corps qui avait laissé le déshonneur pénétrer en lui s’est moqué de son excès de zèle. Il est d’ailleurs plus moral de se perdre soi-même que de se préserver.
– Je vois bien que nous sommes toujours encore un propre à rien philosophe. Rhadamante, qui est-ce ?
– Behrens. Settembrini l’appelle ainsi.
– C’est cet Italien qui… ? Je ne l’aimais pas. Il n’était pas assez humain (la voix prononçait le mot « humain » d’un accent traînant, nonchalant et avec une sorte de paresse rêveuse). Il était orgueilleux. Il n’est plus là ? Je suis sotte. Je ne sais pas ce que c’est : Rhadamante ?
– Quelque chose d’humaniste. Settembrini n’habite plus ici. Nous avons longuement philosophé, ces temps derniers, lui, Naphta et moi.
– Qui est Naphta ?
– Son antagoniste.
– S’il est son antagoniste, je voudrais faire sa connaissance. Mais ne vous avais-je pas dit que votre cousin mourrait s’il essayait d’être soldat dans la plaine ?
– Oui, tu le savais.
– Qu’est-ce qui vous prend ?
Silence prolongé. Il ne rétracta rien. Il attendit, la vertèbre appuyée contre le dossier raide, avec un regard de voyant, que la voix se fît de nouveau entendre, se demandant de nouveau si elle était encore derrière lui, craignant que la musique confuse qui venait de la pièce voisine n’eût couvert le bruit de ses pas qui s’éloignaient. Enfin il entendit de nouveau :
– Et monsieur n’est même pas allé à l’enterrement de son cousin ?
Il répondit :
– Non, je lui ai dit adieu ici, avant qu’on ne l’ait bouclé, parce qu’il commençait à sourire. Tu ne peux pas imaginer combien son front était froid.
– Encore ? Quelle manière de parler à une femme que l’on connaît à peine ?
– Dois-je parler en humaniste ou en être humain ? (Malgré lui, il prononça, à son tour, ce mot d’une manière traînante et somnolente, à peu près comme quelqu’un qui s’étire et qui bâille).
– Quelle blague ! Vous êtes tout le temps resté ici ?
– Oui. J’ai attendu.
– Quoi ?
– Quoi ? Mais toi !
Un rire éclata au-dessus de sa tête, poussé en même temps que le mot « fou ! ».
– Moi ? On ne t’aura pas laissé partir.
– Si, Behrens m’aurait un jour laissé partir, dans un accès de colère, mais ce n’eût été qu’un faux départ. Car outre les vieilles cicatrices d’autrefois, de mon temps de collège, tu sais, il y a là, la tache fraîche que Behrens a découverte et qui me donne de la fièvre.
– Toujours encore de la fièvre ?
– Oui, toujours encore. Presque toujours. Par intermittences. Mais ce n’est pas de la fièvre intermittente.
– Des allusions ?
Il garda le silence. Il fronça les sourcils d’un air sombre au-dessus de son regard de voyant. Au bout d’un instant, il demanda :
– Et où as-tu été, toi ?
Une main frappa le dossier du siège.
– Mais c’est un sauvage ! Où j’ai été ? Partout. À Moscou. (La voix dit « Mooscou », avec un accent traînant analogue à celui qu’elle avait eu en prononçant le mot « humain »), à Bakou, dans des stations thermales allemandes, en Espagne…
– Oh, en Espagne, comment était-ce ?
– Comme ci, comme ça. On voyage mal. Les gens sont des demi-nègres. La Castille est très sèche et dure. Le Kremlin est plus beau que ce château ou ce cloître, là-bas, au pied de la montagne…
– L’Escurial ?
– Oui, le château de Philippe. Un château inhumain. J’ai de beaucoup préféré la danse populaire en Catalogne, la sardana, accompagnée de la cornemuse. J’ai moi-même dansé. Tout le monde se donnait la main et l’on danse en rond. Toute la place est pleine de monde. C’est charmant. C’est humain. Je me suis acheté un petit bonnet bleu, comme tous les hommes et garçons du peuple en portent, c’est déjà presque un fez : la boïna. Je la porte pour ma cure de repos et à d’autres occasions. Monsieur jugera si elle me va bien.
– Quel monsieur ?
– Celui qui est assis ici, sur cette chaise.
– Je pensais : Mynheer Peeperkorn.
– Il en a déjà jugé. Il dit qu’elle me va à ravir.
– Il a dit cela ? Il a fini par dire cela ? Il a terminé la phrase de façon qu’on ait pu le comprendre ?
– Ah, il paraît que nous sommes de mauvaise humeur. Nous voudrions être méchant, mordant, nous essayons de nous moquer de gens qui sont plus grands et meilleurs et plus humains que nous-même, y compris notre… ami bavard de la Méditerranée, notre maître grand parleur… Mais je ne permettrai pas qu’à propos de mes amis…
– As-tu encore mon portrait intérieur ? interrompit-il avec un accent mélancolique.
Elle rit.
– Il faudra que je le cherche un jour.
– Je porte le tien sur moi. Et j’ai un petit chevalet sur ma commode où, pendant la nuit…
Il n’eut pas le temps d’achever sa phrase. Peeperkorn était debout devant lui. Le Hollandais avait cherché sa compagne de voyage ; il était entré par la portière, et il était posté devant la chaise de celui avec lequel il l’avait vue bavarder. Il était là comme une tour, si près des pieds de Hans Castorp que celui-ci comprit qu’en dépit de son somnambulisme il s’agissait à présent de se lever et d’être poli. Il eut du mal à se lever de sa chaise entre eux deux ; il dut se lever en faisant un pas de côté, de sorte que les personnages du drame se trouvèrent former un triangle la chaise placée au milieu d’eux.
Mme Chauchat satisfit aux convenances de l’Occident civilisé en présentant ces messieurs l’un à l’autre. Un ami d’autrefois dit-elle, en parlant de Hans Castorp, un ami d’un précédent séjour. L’existence de M. Peeperkorn n’appelait aucun commentaire. Elle le nomma, et le Hollandais, – son œil pâle dirigé sur le jeune homme, sous l’arabesque des plis pensifs de son front et de ses tempes d’idole – tendit sa main dont le large dos était taché de son.
« Une main de capitaine », pensa Hans Castorp, « si l’on omet les ongles pointus ». Pour la première fois, il subissait l’effet immédiat de la vigoureuse personnalité de Peeperkorn. « Personnalité » ; on pensait toujours à ce mot en sa présence ; on savait tout à coup ce que c’était qu’une personnalité, lorsqu’on le voyait, oui, bien plus, on était convaincu qu’une personnalité ne pouvait pas avoir une apparence différente. Et ce sexagénaire large d’épaules, au visage rouge et aux mèches blanches, avec cette bouche douloureuse et déchirée et cette barbe qui pendait, longue et étroite sur le gilet fermé d’ecclésiastique, écrasait sous son poids le frêle jeune homme. D’ailleurs, Peeperkorn était la gentillesse même.
– Monsieur, dit-il. Absolument. Non, permettez-moi, absolument ! Je fais ce soir votre connaissance, la connaissance d’un jeune homme qui inspire confiance, je le fais en toute conscience, monsieur, je suis absolument au fait. Vous me plaisez. Je… s’il vous plaît ! Classé ! Vous me revenez.
Il n’y avait rien à objecter. Ses gestes élaborés étaient par trop péremptoires. Hans Castorp lui plaisait. Et Peeperkorn tira de cela des conclusions qu’il exprima par des allusions et que la bouche de sa compagne de voyage précisa charitablement.
– Mon enfant, dit-il, tout va bien. Mais qu’en pensez-vous… ? Je vous prie de ne pas vous méprendre. La vie est courte, notre capacité de répondre a ses exigences… Il en est ainsi que… Ce sont des faits, mon enfant. Des lois. Des intangibles. Bref, mon enfant, bref, c’est parfait.
Il fit durer son geste expressif qui invitait à prendre une décision, déclinant toute responsabilité pour le cas où, malgré sa proposition, une faute grave serait commise.
Mme Chauchat était apparemment exercée à discerner le sens de ses désirs. Elle dit :
– Pourquoi pas ? Nous pourrions peut-être rester ensemble encore un peu, jouer à un jeu et boire une bouteille de vin. Qu’attendez-vous ? se tourna-t-elle vers Hans Castorp. Remuez-vous ! Nous n’allons pas rester à nous trois. Il faut que nous trouvions de la compagnie. Qu’y a-t-il encore au salon ? Invitez qui vous trouverez ! Cherchez quelques amis sur les balcons. Nous convierons le docteur Ting-Fou de notre table.
Peeperkorn se frotta les mains.
– Absolument, dit-il, excellent, parfait ! Dépêchez-vous, jeune homme ! Obéissez ! Nous formerons un cercle. Nous jouerons, nous mangerons et nous boirons. Nous sentirons que nous… Absolument, jeune homme !
Hans Castorp monta en ascenseur au deuxième étage. Il frappa à la porte de A. K. Ferge, lequel, de son côté, alla chercher Ferdinand Wehsal et M. Albin, sur la chaise-longue, dans la salle de repos d’en bas. On avait encore trouvé dans le hall le procureur Paravant et les époux Magnus, au salon, Mme Stoehr et Hermine Kleefeld. On dressa une vaste table de jeu sous le lustre du milieu, et on l’entoura de chaises et de guéridons. Mynheer saluait chacun des invités qui se présentait, d’un regard pâle et courtois, sous l’arabesque de son front attentif et plissé. On s’installa au nombre de douze, – Hans Castorp entre l’hôte majestueux et Clawdia Chauchat –, on chercha des cartes et des jetons (car on s’était mis d’accord pour faire une partie de vingt-et-un), et à sa manière imposante Peeperkorn commanda à la naine que l’on avait appelée, du vin blanc, un Chablis de 1906, trois bouteilles pour commencer, ainsi que quelques sucreries, tout ce qu’il y aurait moyen de trouver en fait de fruits secs et de fruits confits. La manière dont il se frotta les mains en accueillant ces bonnes choses que l’on servit témoigna de sa vive satisfaction, et par l’incohérence imposante de ses propos il tentait d’exprimer ses sensations, à quoi il réussissait parfaitement dans ce sens qu’il faisait éprouver à tous l’ascendant de sa personnalité. Il posait les deux mains sur les avant-bras de ses voisins, levait son index pointu et réclamait et obtenait avec un succès complet l’attention de tous pour la splendide couleur dorée du vin dans les coupes, pour le sucre que suaient les raisins de Malaga, pour une sorte de petites bretzels salées et parsemées de grains de pavot qu’il appela divines en étouffant dans le germe, par un geste péremptoire et élaboré toute contradiction qui aurait pu s’élever contre sa parole énergique. Ce fut lui qui, le premier, prit la banque ; mais bientôt il la céda à M. Albin parce que, à tout prendre, ce souci nuisait au plaisir qu’il goûtait à s’épancher librement.
La chance, visiblement, lui importait peu. On jouait pour rien à son avis. Sur sa proposition on avait fixé l’enjeu minimum à cinquante centimes, mais c’était beaucoup pour la plupart des joueurs. Le procureur Paravant, ainsi que Mme Stoehr, rougissaient et pâlissaient tour à tour, et celle-ci surtout était en proie à de terribles luttes intérieures lorsque la question se posait de savoir si à dix-huit elle achèterait encore. Elle poussait des cris aigus lorsque M. Albin, avec un calme d’habitué, lui jetait une carte qui, d’emblée, faisait crouler ses calculs audacieux, et Peeperkorn en riait cordialement.
– Criez, criez, Madame, disait-il. C’est un son perçant, plein de vie et qui vient du fond de… Buvez, délectez à nouveau votre cœur…
Et il lui versait du vin, il en versait encore à son voisin et à lui-même, il commandait trois autres bouteilles et buvait à la santé de Wehsal et de la calamiteuse Mme Magnus parce que l’un et l’autre semblaient avoir un besoin particulier d’être ragaillardis. Rapidement, le vin, en effet merveilleux, colora les visages, à l’exception de celui du docteur Ting-Fou qui restait invariablement jaune avec des pupilles de rat d’un noir de jais, et qui, avec une chance insolente, risquait des mises très élevées. Les autres ne voulaient pas demeurer en reste. Le procureur Paravant, le regard noyé, provoqua le destin en mettant dix francs sur une carte d’ouverture qui ne promettait que médiocrement, surenchérit en pâlissant et gagna le double de sa mise, parce que M. Albin, se fiant à tort à un as qu’il tenait, avait fait doubler tous les enjeux. C’étaient là des émotions qui ne se bornaient pas à la personne de celui qui se les procurait. Tout le cercle y prenait part, et même M. Albin qui rivalisait de froide circonspection avec les croupiers du casino de Monte-Carlo dont il prétendait être un habitué, ne maîtrisait qu’à grand’peine sa fièvre. Hans Castorp, lui aussi, jouait gros jeu ; de même, la Kleefeld et Mme Chauchat. On passa aux « tours », on joua au « chemin de fer », à « Ma tante, ta tante », et à la dangereuse « Différence ». Jubilations et explosions de désespoir, éclats de colère et crises de rires hystériques, provoqués par l’excitation que la chance fantasque exerçait sur les nerfs, se succédaient, et les uns et les autres étaient authentiques, sérieux, ils n’auraient pas été différents s’il s’était agi d’événements de la vie réelle.
Néanmoins ce n’était pas seulement le jeu, pas principalement le jeu qui déterminait chez tous cette tension de l’âme, cette ardeur des visages, cette dilatation des yeux brillants ou ce que l’on aurait pu appeler l’effort que faisait la petite société, son état de tension douloureuse, de concentration extrême. En réalité, tout cela tenait à l’influence d’une nature de chef qui se trouvait parmi l’assistance, à la « personnalité » qui était parmi eux, à celle de Mynheer Peeperkorn qui tenait la direction dans sa main aux gestes magnifiques et qui faisait subir à tous la fascination de l’heure par le spectacle du grand jeu de sa physionomie, par son regard pâle sous les plis monumentaux de son front, par la parole et l’insistance de sa mimique. Que disait-il ? Ce n’étaient que des choses très confuses, et qui devenaient plus indistinctes à mesure qu’il avait bu davantage. Mais on était suspendu à ses lèvres, on regardait fixement, en souriant, les sourcils levés, le cercle que formaient son pouce et son index, et au-dessus duquel les autres doigts se dressaient comme des lances, tandis qu’un travail expressif se faisait dans son visage princier, et, sans résister, on se soumettait à une servitude sentimentale qui dépassait de beaucoup la mesure de passion dont ces gens se seraient d’ordinaire cru capables. Cette servitude dépassait les forces de certains. Tout au moins Mme Magnus se trouva-t-elle mal. Elle faillit s’évanouir, mais refusa obstinément de regagner sa chambre, et se contenta de s’allonger sur la chaise longue où on lui plaça une serviette mouillée sur le front et d’où elle revint pour rejoindre le cercle, après avoir pris quelque repos.
Peeperkorn prétendit expliquer sa défaillance par une alimentation insuffisante. En paroles d’une incohérence significative, l’index levé, il abonda dans ce sens. Il fallait manger, manger convenablement pour pouvoir se défendre, c’est ce qu’il donna à entendre, et il commanda de quoi restaurer ses invités, une collation, de la viande, des sandwiches, de la langue fumée, de la poitrine d’oie, du rôti, du saucisson, et du jambon, des plats et des plats de bonnes choses qui, garnis de coquilles de beurre, de radis et de persil, ressemblaient à des parterres de fleurs. Mais bien qu’on leur fît honneur (en dépit du dîner que l’on venait de faire et dont la solidité était hors de doute), Mynheer Peeperkorn déclara après quelques bouchées que ce n’étaient là que « bagatelles », et cela avec une colère qui témoignait combien les sautes de sa nature de maître étaient imprévisibles et inquiétantes. Même, il prit le mors aux dents lorsque quelqu’un s’avisa de défendre la collation. Sa tête puissante s’enfla et il frappa du poing sur la table en déclarant que tout cela n’était que de la « foutaise », sur quoi l’on se tut avec gêne, puisque, en somme, l’hôte et donateur avait après tout le droit de juger ce qu’il offrait.
D’ailleurs, si étrange qu’elle pût sembler, cette colère convenait parfaitement à la physionomie de M. Peeperkorn, ainsi que Hans Castorp dut le reconnaître. Elle ne le défigurait nullement, ne le diminuait pas, faisait de l’effet, dans son étrangeté que personne n’osait même en son for intérieur mettre en rapport avec les quantités de vin que l’on avait bues ; il parut si grand et si princier que tous courbèrent la tête et que chacun se garda de reprendre ne fût-ce qu’une bouchée, des plats de viande. Ce fut Mme Chauchat qui apaisa son compagnon de voyage. Elle caressa sa large main de capitaine qui, après le coup de poing, était restée étendue sur la table, et lui dit d’une voix câline que l’on pouvait parfaitement commander autre chose, un plat chaud, s’il le voulait, et s’il y avait encore moyen d’obtenir cela du chef.
– Mon enfant, dit-il. Bien.
Et sans effort, en gardant toute sa dignité, il trouva une transition de sa folle colère à un état plus modéré, en baisant la main de Clawdia. Il désirait des omelettes pour lui et les siens, pour chacun une bonne omelette aux herbes afin que l’on pût suffire aux exigences de l’heure. Et en même temps que la commande, il envoya à la cuisine un billet de cent francs, pour décider le personnel à se remettre au travail malgré l’heure tardive.
Il avait d’ailleurs complètement recouvré sa bonne humeur lorsque l’omelette fumante parut, servie sur plusieurs plats, jaune serin et mouchetée de vert, dégageant dans la pièce une odeur chaude et doucereuse d’œufs et de beurre. On fit honneur au plat, en même temps que Peeperkorn et sous sa surveillance, car, par des paroles incohérentes et des gestes autoritaires, il contraignait chacun à jouir avec attention, voire avec ferveur, de ce don de Dieu. Il fit verser du gin hollandais, une tournée complète, et les obligea tous à absorber avec un recueillement attentif ce liquide clair qui dégageait un arôme sain de blé, avec un léger rappel de genièvre.
Hans Castorp fumait. Mme Chauchat, elle aussi, grillait des cigarettes à bout en carton qu’elle tirait d’un étui de laque russe, orné d’une troïka, que, pour sa commodité, elle avait posé sur la table, et Peeperkorn ne blâmait pas ses voisins de se livrer à ce plaisir, mais lui-même ne fumait pas, ne fumait jamais. S’il se faisait bien comprendre, la consommation du tabac relevait, selon lui, des jouissances trop raffinées auxquelles on ne pouvait s’adonner qu’aux dépens de la majesté des dons simples de la vie, de ces dons et de ces exigences auxquels notre sensibilité réussissait à peine à suffire.
– Jeune homme, disait-il à Hans Castorp, en le fascinant de son regard pâle et de son geste élaboré, jeune homme, la simplicité, le sacré ! Bon, vous me comprenez. Une bouteille de vin, un plat d’œufs fumant, un alcool de blé pur et transparent, si nous accomplissons cela et si nous en jouissons une bonne fois, si nous l’épuisons, nous satisfaisons vraiment au… Absolument, monsieur. Classé ! J’ai connu des gens, des hommes et des femmes, des cocaïnomanes, des fumeurs de hachisch, des morphinomanes. Bien, cher ami, parfait ! Nous ne devons juger personne. Mais ces gens-là avaient absolument failli à ce qui est simple, grand, à ce qui est issu de Dieu… Classé, mon ami ! Condamné, maudit ! Ils n’y avaient en rien satisfait. Oui, jeune homme, comment était donc votre nom ? Bon, je l’ai su, je l’ai oublié… Ce n’est pas dans la cocaïne, ce n’est pas dans l’opium, ce n’est pas dans le vice que consiste le vice. Le péché qui ne peut être pardonné, c’est…
Il s’interrompit. Grand et large, tourné vers son voisin, il demeura en un silence puissamment expressif qui vous forçait à comprendre, l’index dressé, avec sa bouche déchiquetée sous la lèvre supérieure glabre et rouge, légèrement blessée par un coup de rasoir. Les plis mobiles de son front dénudé, entouré de flammes blanches, étaient douloureusement froncés ; ses petits yeux pâles étaient dilatés par quelque chose comme de l’effroi, – sembla-t-il à Hans Castorp, – à la pensée du crime, de ce grand péché, de cette défaillance impardonnable à laquelle il avait fait allusion et dont il enjoignait en silence à l’interlocuteur de sonder l’horreur, avec toute la puissance de fascination qui émanait de sa nature de souverain… Un effroi abstrait, pensa Hans Castorp, mais aussi quelque chose comme une terreur personnelle qui le concernait lui-même, cet homme princier. Une crainte par conséquent, non pas une crainte mesquine et petite, mais quelque chose comme une terreur panique, semblait à cet instant surgir du fond de son être et Hans Castorp était trop porté au respect – malgré toutes les raisons qu’il pouvait avoir de nourrir encore envers le majestueux compagnon de voyage de Mme Chauchat des sentiments hostiles, – pour ne pas être ébranlé par une telle observation.
Il baissa les yeux et hocha la tête, pour donner à son auguste voisin la satisfaction d’avoir été compris.
– C’est très vrai, dit-il. Cela peut être un péché et un signe d’insuffisance, de se complaire aux raffinements, sans avoir suffi aux dons simples et naturels de la vie qui sont grands et sacrés. Telle est votre opinion, si je vous ai bien compris, Mynheer Peeperkorn, et bien que cette idée ne me soit pas encore venue à moi-même, je puis vous approuver avec conviction du moment que vous attirez mon attention sur ce point. D’ailleurs, il doit arriver assez rarement que l’on rende tout leur dû à ces avantages sains et simples de la vie. La plupart des hommes sont certainement trop négligents, trop distraits, trop peu consciencieux et trop usés intérieurement pour s’y adonner pleinement. Sans doute en est-il ainsi.
Le formidable Hollandais parut très satisfait.
– Jeune homme, dit-il, parfait ! Voulez-vous me permettre, – pas un mot de plus. Je vous prie de boire avec moi, de vider votre verre, en entrelaçant nos bras. Ceci ne veut pas dire que je vous propose de nous tutoyer fraternellement… C’est-à-dire : j’étais sur le point de le faire ; mais je réfléchis que ce serait un peu précipité. Très probablement, je vous en donnerai la permission dans un temps très… Comptez-y. Mais si vous désirez et persistez à…
Hans Castorp se déclara d’accord avec l’ajournement que Peeperkorn venait de suggérer.
– Bien, mon ami, bien, camarade. Insuffisance, bien ! Bien et effrayant ! Pas assez consciencieux, très bien. Les dons, pas bien ! Les exigences. Les exigences sacrées de la vie qui est femme, à l’endroit de l’honneur et de la force.
Hans Castorp se rendit compte tout à coup que Peeperkorn était complètement ivre. Mais son ivresse elle-même n’était ni vile ni humiliante, ce n’était pas un état déshonorant, elle se confondait avec la majesté de sa nature en un phénomène grandiose et qui commandait le respect. Bacchus, lui aussi, songea Hans Castorp, s’est appuyé dans son ivresse sur ses compagnons enthousiastes sans rien perdre de sa nature divine, et, somme toute, ce qui importait, c’était de savoir qui était ivre, une personnalité ou un tisserand. Il se garda jusqu’au plus secret de lui-même de manquer le moins du monde de respect à cet écrasant compagnon de voyage dont les gestes s’étaient relâchés et dont la langue balbutiait.
– Mon frère que je tutoie, dit Peeperkorn, rejetant en arrière son corps puissant, en proie à une ivresse libre et fière, le bras étendu à plat sur la table qu’il frappait légèrement de son poing mollement rassemblé, que je tutoierai, dans un avenir prochain… un prochain avenir, lorsque la réflexion… Bien. Classé. La vie, jeune homme, est une femme étendue, avec des seins rapprochés et gonflés, avec un grand ventre lisse et mou entre les hanches saillantes, avec des bras minces, des cuisses rebondies et des yeux mi-clos, qui dans sa provocation magnifique et moqueuse exige notre ferveur la plus haute, toute la tension de notre plaisir de mâle qui lui tient tête ou qui est fichu – fichu, jeune homme, comprenez-vous ce que cela veut dire ? La défaite du sentiment devant la vie, c’est l’insuffisance pour laquelle il n’y a pas de grâce, pas de pitié et pas de dignité, mais qui est impitoyablement et sardoniquement maudite, classée, jeune homme, et vomie… La honte et le déshonneur sont des mots pâles pour cette ruine et cette faillite, pour cet effrayant ridicule. C’est la fin, le désespoir infernal, le crépuscule du monde…
Tout en parlant, le Hollandais avait rejeté son corps puissant de plus en plus en arrière, tandis que sa tête royale s’inclinait vers sa poitrine comme s’il allait s’endormir. Mais au dernier mot il prit un élan et laissa tomber d’un coup lourd son poing relâché, sur la table, de sorte que le frêle Hans Castorp, rendu nerveux par le jeu et le vin, sursauta et considéra le maître avec un respect effrayé. « Crépuscule du monde », comme ces mots lui seyaient ! Hans Castorp n’avait pas souvenir de les avoir jamais entendus prononcer ailleurs que pendant la leçon de religion et ce n’était pas par hasard, pensa-t-il, car à quel homme parmi ceux qu’il connaissait ce mot foudroyant aurait-il pu convenir, lequel était à l’échelle de cette parole ?
Le petit Naphta aurait pu sans doute s’en servir à l’occasion. Mais c’eût été de l’usurpation et du bavardage, tandis que dans la bouche de Peeperkorn ce mot foudroyant prenait toute sa puissance écrasante, vibrante du son des trompettes, bref toute sa grandeur biblique.
« Mon Dieu, c’est une personnalité ! éprouva-t-il pour la centième fois. Je suis tombé sur une personnalité, et c’est le compagnon de voyage de Clawdia ! » Lui-même, assez obnubilé, faisait tourner sur la table son verre de vin sur lui-même, l’autre main dans la poche de son veston, en clignant d’un œil à cause de la fumée de la cigarette qu’il tenait du coin des lèvres. N’aurait-il pas dû garder le silence après qu’une personnalité autorisée eût prononcé des paroles foudroyantes ? À quoi bon faire encore entendre sa voix sèche ? Mais, habitué à la discussion par ses éducateurs démocratiques – tous deux, de nature démocratique, bien que l’un se défendît de l’être, – il se laissa entraîner à un de ses commentaires ingénus. Il dit :
– Vos remarques, Mynheer Peeperkorn (quelle expression était-ce là : « vos remarques » ! Fait-on des remarques sur la fin du monde ?) Vos remarques ramènent mes pensées à cette conclusion sur quoi nous étions tout à l’heure tombés d’accord à propos du vice, à savoir que c’est une offense faite aux dons simples et comme vous dites, sacrés de la vie, ou comme je préférerais dire, aux dons classiques, aux dons de « grand format », en quelque sorte, de leur préférer les dons tardifs et raffinés, les raffinements auxquels on « s’adonne », comme l’un de nous s’est exprimé tout à l’heure, tandis qu’on se « voue » aux autres ou qu’on leur « sacrifie ». Mais c’est ici qu’il me semble également trouver l’excuse – pardonnez-moi, je suis une nature qui incline à l’excuse, bien que l’excuse manque de format comme je le sens très nettement – l’excuse donc du vice, et justement dans la mesure où il provient d’une insuffisance, comme vous dites. Vous avez dit, sur la terreur de l’insuffisance, des choses d’un tel format que vous m’en voyez sincèrement frappé. Mais je crois que l’homme vicieux, loin d’être insensible à ces terreurs, leur rend pleinement justice, en ceci que la défaillance de sa sensibilité devant les dons classiques de la vie le pousse au vice, ce qui n’est pas et n’a pas besoin d’être une offense à la vie, puisque cet état peut aussi bien être considéré comme un hommage rendu à la vie, en ceci, notamment, que les raffinements constituent, somme toute, des moyens d’ivresse et d’exaltation, des stimulantia, comme on dit, des soutiens et des réconforts de la sensibilité, en sorte que la vie est malgré tout leur but et leur sens, l’amour de la sensibilité, le besoin de remédier à l’insuffisance de cette… je veux dire…
Que racontait-il là ? N’était-ce pas assez d’impertinence démocratique de dire « l’un de nous », alors qu’il s’agissait d’une personnalité et de lui ? Puisait-il le courage de se montrer aussi insolent dans certains faits du passé qui jetaient un jour douteux sur certains droits de propriété ? Quelle mouche l’avait piqué pour qu’il décidât par surcroît de s’engager dans une analyse également impertinente du « vice » ? Il pouvait tâcher à présent de se tirer d’affaire ; car il était clair qu’il avait provoqué un orage.
Tandis que son invité parlait, Mynheer Peeperkorn était demeuré dans sa position adossée, la tête penchée, de sorte que l’on aurait pu douter si les paroles de Hans Castorp parvenaient à sa conscience. Mais, peu à peu, tandis que le jeune homme se troublait, il commença à se redresser, de plus en plus haut, dans toute sa grandeur, en même temps que sa tête majestueuse s’enflait en rougissant, que les arabesques de son front se levaient et se tendaient et que ses petits yeux se dilataient, chargés d’une pâle menace. Un accès de colère, auprès duquel celui qu’il avait eu tout à l’heure n’avait été qu’un léger mouvement d’humeur, se dessinait. La lèvre inférieure de Mynheer Peeperkorn se serrait avec une expression de terrible courroux contre la lèvre supérieure, de telle sorte que les commissures des lèvres s’abaissèrent et que le menton fut poussé en avant, et lentement son bras droit se leva de la table jusqu’à hauteur de sa tête et au delà, faisant le poing, prenant un élan grandiose pour détruire d’un seul coup ce bavard démocrate qui, épouvanté et en même temps aventureusement réjoui par cette image d’une colère royale et expressive qui se déployait devant lui, avait peine à cacher sa crainte et son désir de prendre la fuite. Il dit, le devançant en toute hâte :
– Naturellement, je me suis très mal exprimé. Tout cela est une question d’échelle, rien de plus. On ne peut pas appeler vice ce qui a des proportions. Le vice n’a jamais d’envergure. Les raffinements n’en ont pas. Mais de tout temps l’homme, avide de grands sentiments, a disposé d’un moyen de s’enivrer et de s’enthousiasmer qui lui-même est un des dons classiques de la vie, qui porte le caractère du simple et de la sainteté, un remède de grand format, si je puis ainsi dire, le vin, un présent divin aux hommes comme l’ont déjà dit les anciens peuples humanistes, l’invention philanthropique d’un dieu auquel est en quelque sorte liée la civilisation, permettez-moi de le rappeler. Car, ne dit-on pas que c’est grâce à l’art de planter la vigne et de presser le raisin que l’homme est sorti de son état de sauvagerie, a conquis la civilisation ? Et, aujourd’hui encore, les peuples chez lesquels pousse le vin ne passent ou ne se tiennent-ils pas pour plus civilisés, que ceux qui n’en ont point, les Cimmériens, ce qui mérite certainement d’être relevé ? Car cela signifie que la civilisation n’est nullement affaire de raison et de clairvoyance ou d’élocution, mais bien plutôt d’enthousiasme, d’ivresse et de sentiment de délectation. N’est-ce pas votre avis sur ce point, si vous me permettez de vous poser la question ?
Un malin, ce Hans Castorp ! Ou, comme M. Settembrini l’avait exprimé avec une finesse d’écrivain, un « plaisantin ». Imprudent et même impertinent dans ses rapports avec des personnalités, mais non moins adroit lorsqu’il s’agissait de se tirer du pétrin ! Voici que tout d’abord et dans la situation la plus brûlante, et forcé d’improviser, il avait réussi à sauver l’honneur de la boisson avec beaucoup d’élégance, après quoi, tout incidemment, il avait parlé de la civilisation, dont en effet l’attitude effrayante et primitive de Peeperkorn ne témoignait plus guère ; et, enfin, il avait combattu cette attitude et l’avait fait apparaître déplacée en posant une question à celui qui l’avait assumée d’une façon aussi grandiose, une question à laquelle il était impossible de répondre le poing levé. Le Hollandais mitigea en effet son attitude d’antédiluvienne colère ; peu à peu son bras se rapprocha de la table, sa tête désenfla ; « tu as de la chance », pouvait-on lire dans son visage qui n’était plus menaçant que conditionnellement et rétrospectivement ; l’orage se dissipait, et, par surcroît, Mme Chauchat se mêla à la conversation en attirant l’attention de son compagnon de voyage sur la compagnie qui avait perdu son entrain.
– Cher ami, vous négligez vos invités, dit-elle en français. Vous vous consacrez trop exclusivement à ce Monsieur, avec qui vous avez sans doute des affaires importantes à régler. Mais pendant ce temps le jeu a presque cessé et je crains que l’on ne s’ennuie. Voulez-vous que nous levions la séance ?
Peeperkorn se retourna aussitôt vers la tablée. C’était exact : la démoralisation, la léthargie, le marasme avaient gagné du terrain, les invités s’occupaient de choses et autres comme des écoliers sans surveillance. Plusieurs étaient sur le point de s’endormir. Peeperkorn reprit aussitôt les rênes qu’il avait abandonnées.
– Mesdames et Messieurs, s’écria-t-il, l’index levé – et ce doigt pointu était comme une épée qui donnait un signal ou comme un drapeau, et son appel, pareil au : « Que me suive qui n’est pas un lâche ! », du chef qui arrête une déroute. Aussi l’intervention de sa personnalité les ranima-t-elle aussitôt. On se redressa, les visages fatigués se ranimèrent et l’on répondit en hochant la tête, en souriant au regard pâle de l’hôte puissant sous le dessin de son front d’idole. Il les fascina tous et les exhorta de nouveau à faire leur service en joignant la pointe de l’index et celle du pouce et en dressant les autres doigts avec leurs longs ongles. Il étendit sa main de capitaine, d’un geste protecteur et comme pour endiguer un flot, et de ses lèvres à la déchirure douloureuse s’échappèrent des paroles dont la confusion saccadée exerça, grâce à l’appui de sa personnalité, l’influence la plus puissante sur les esprits.
– Mesdames et Messieurs. Bien ! La chair, Mesdames et Messieurs, il en est ainsi que… Classé. Non, permettez-moi. « Faible », c’est là ce qu’on peut lire dans l’Écriture. « Faible », c’est-à-dire : qui incline à se dérober aux exigences. Mais je fais appel à vous. Bref, et bel et bien, Mesdames et Messieurs, je fais appel. Vous me direz : le sommeil. Bien, Mesdames et Messieurs, parfait, excellent. J’aime et j’honore le sommeil. Je vénère sa volupté profonde, douce et délectable. Le sommeil est du nombre – comment disiez-vous, jeune homme ? – des dons classiques de la vie, du premier, du tout premier… Je vous en prie, Mesdames et Messieurs, du meilleur… Mais veuillez vous en rappeler : Gethsémané. « Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et leur dit : Demeurez ici et veillez avec moi. » Vous rappelez-vous ? « Et il vint chez eux et les trouva endormis et dit à Pierre : « Ne pouvez-vous donc pas veiller une heure avec moi ? » Intense, Mesdames et Messieurs, saisissant, émouvant ! « Et vint, mais les trouva endormis, et leurs yeux étaient pleins de sommeil. Et il leur dit : Hélas, voulez-vous donc dormir et reposer ? Voyez, l’heure est venue… » Mesdames et Messieurs, bouleversant, déchirant !
En effet, tous étaient saisis et troublés jusqu’au fond de l’âme. Il avait joint les mains devant sa poitrine, sur sa barbe étroite, et avait baissé obliquement la tête. Son regard pâle s’était presque brisé, en même temps que cette solitaire et mortelle tristesse lui était montée aux lèvres. Mme Stoehr sanglota, Mme Magnus poussa un profond soupir. Le procureur Paravant se vit obligé, en qualité de représentant, et en quelque sorte de délégué de la société, d’adresser à voix basse quelques paroles à l’honorable hôte, pour l’assurer de l’empressement de tous. Il devait y avoir une erreur. On était frais et alerte, gai, joyeux et à lui de tout cœur. C’était une soirée de fête si belle, si extraordinaire, tous le comprenaient et l’éprouvaient, et personne ne songeait provisoirement à faire usage de ce bien de la vie qu’est le sommeil. Mynheer Peeperkorn pouvait compter sur ses invités, sur chacun d’entre eux.
– Parfait, excellent, s’écria Peeperkorn, et il se redressa. Ses mains se séparèrent et montèrent en s’ouvrant, étendues et droites, les paumes tournées vers l’extérieur comme pour une ! prière païenne. Sa physionomie grandiose qui, il y avait un instant, était animée d’une douleur gothique, fleurissait, opulente et gaie ; une petite fossette de sybarite se dessina même sur sa joue. « L’heure est venue… » Et il se fit donner la carte, ajusta son lorgnon d’écaille dont l’arc barrait son front et commanda du champagne, trois bouteilles de Mumm et Cie, Cordon rouge, très sec. De plus, les petits fours, de délicieuses petites friandises en forme de cône, glacées au sucre colorié, faites de la pâte la plus délicate, fourrées de crème au chocolat et à la pistache, servies sur de petites serviettes de papier dentelé. Mme Stoehr s’en léchait les doigts. M. Albin délivra avec une négligence de connaisseur le premier bouchon de sa cage de fil de fer, retira le bouchon de la forme d’un champignon, de son col décoré, avec un claquement de pistolet d’enfant, et le fit sauter au plafond, après quoi, selon la tradition élégante, il enveloppa la bouteille d’une serviette pour verser le vin. La noble écume mouilla la nappe du guéridon. On fit tinter les coupes et l’on vida d’un trait le premier verre, on s’électrisa l’estomac de ce picotement glacé et parfumé. Les yeux scintillaient. On avait interrompu le jeu sans que l’on eût jugé nécessaire de ranger les cartes et l’argent. La compagnie s’abandonnait à une délicieuse paresse en poursuivant un bavardage sans suite dont les éléments étaient fournis à chacun par un état de sensibilité accrue ; propos qui, à leur état primitif, avaient annoncé une beauté suprême, mais qui, en cherchant leur expression, dégénéraient en une sorte de galimatias fragmentaire et pesant, mi-indiscret et mi-intelligible, qui eût choqué tout homme de sang-froid qui serait survenu, mais que les intéressés subissaient sans peine parce que tous se laissaient bercer par le même état d’irresponsabilité. Mme Magnus elle-même avait les oreilles rouges et assura qu’elle sentait la vie monter en elle, ce qui ne parut pas réjouir M. Magnus. Hermine Kleefeld s’adossait à l’épaule de M. Albin en lui tendant sa coupe pour qu’il lui versât à boire. Peeperkorn, dirigeant la bacchanale avec ses gestes pointus, veillait au ravitaillement et au renouvellement des réserves. Après le champagne, il fit venir du café, du moka double, qu’il accompagna de nouveau de « pain » et de liqueurs douces, apricot brandy, chartreuse, crème de vanille et marasquin pour les dames. On servit ensuite des filets de poisson marinés et de la bière, enfin du thé, aussi bien du thé chinois que de la camomille, pour ceux qui ne préférèrent pas s’en tenir au champagne et aux liqueurs, ou revenir à un vin sérieux, comme Mynheer lui-même qui, après minuit, était revenu avec Mme Chauchat et Hans Castorp à un vin rouge suisse d’un genre naïf et pétillant, dont il vidait avec une soif véritable un gobelet après l’autre.
À une heure, la séance durait encore, prolongée en partie par une ivresse de plomb, en partie par le plaisir singulier de perdre ainsi le repos nocturne, en partie par l’effet de la personnalité de Peeperkorn, ou encore pour ne pas suivre l’exemple de saint Pierre et des siens, personne ne voulant se rendre coupable d’une pareille faiblesse. À parler d’une manière générale, les femmes paraissaient moins menacées à cet égard. Car, tandis que les hommes, rouges ou blêmes, étendaient les jambes et gonflaient leurs joues en buvant de plus en plus rarement, d’une manière toute machinale, les femmes se montraient plus énergiques. Hermine Kleefeld, ses coudes nus appuyés sur le plat de la table, les joues dans ses mains, montrait en riant Ting-Fou, qui gloussait, la blancheur de ses dents, tandis que Mme Stoehr, le menton serré contre la gorge, flirtait par-dessus l’épaule en s’efforçant de ramener le procureur à la vie. Avec Mme Magnus on en était arrivé à ceci qu’elle avait pris place sur les genoux de M. Albin et qu’elle lui tirait les lobes des deux oreilles, ce qui semblait plutôt soulager M. Magnus. Antoine Carlovitch Ferge fut invité à raconter l’histoire du choc à la plèvre, mais il bafouillait au point qu’il n’y réussit pas, et avoua honnêtement son impuissance, qui décida les autres à se remettre à boire. Wehsal versa tout à coup des larmes amères, venues d’une profondeur de sa détresse, où sa parole n’était pas capable de donner accès à ses semblables, mais on le remit moralement sur pied au moyen de café et de cognac ; c’est alors que par ses gémissements, par son menton plissé et frémissant d’où dégouttaient les larmes, il éveilla l’intérêt de Peeperkorn qui, l’index dressé et fronçant l’arabesque de ses sourcils, attira l’attention générale sur l’état de Wehsal.
– Voilà qui est…, dit-il. Voilà qui est tout de même… Non, permettez-moi : sacré ! Essuie-lui le menton, mon enfant. Prends ma serviette ! Ou plutôt non, laisse-le. Lui-même y renonce. Mesdames et Messieurs… Sacré ! Sacré dans tous les sens, au sens chrétien comme au sens païen. Un phénomène de tout premier… Du plus grand… Non, non…
Les paroles explicatives par lesquelles il accompagna son intervention, avec force gestes précis quoique légèrement burlesques, étaient toutes accordées sur ce « voilà qui est tout de même… ». Il avait une manière à lui de joindre en un cercle son index plié et son pouce, de les tenir au-dessus de son oreille et de détourner sa tête, obliquement et avec ironie, qui éveillait des sentiments semblables à ceux qu’éveillerait un prêtre vénérable d’un culte étranger qui, troussant sa robe sacerdotale, se mettrait à danser avec une grâce bizarre devant l’autel des sacrifices. Puis, largement assis dans une attitude grandiose, étreignant la chaise voisine, il les forçait tous, à leur surprise, à s’enfoncer avec lui dans une évocation vivante et saisissante du matin, d’un matin d’hiver glacé et sombre, lorsque la lumière jaunâtre de notre lampe de chevet se reflète dans la vitre de la fenêtre parmi des branchages dépouillés qui se dressent, dehors, dans un brouillard glacé et matinal, dur comme le croassement de corbeau. À force d’allusions, il réussit à rendre si forte cette froide apparition du jour que tous frissonnèrent, d’autant plus qu’il évoqua aussi l’eau glacée que l’on faisait couler de bon matin de l’éponge sur la nuque, et qu’il appela lustrale. Ce n’était qu’une digression, un apologue qui enseignait l’attention aux choses de la vie, un impromptu fantastique, qu’il délaissa aussitôt pour revenir avec une insistance sentimentale vers cette heure nocturne qui s’écoulait dans une atmosphère de fête. Il se montra épris de tout son entourage féminin, sans choix ni préférence et sans accorder la moindre attention à la personne. Il fit à la naine des propositions telles que le visage trop grand et vieillot de cette créature infirme se creusa de plis grimaçants. Il dit à Mme Stoehr des amabilités d’un calibre tel que cette femme, naturellement vulgaire, fit jouer ses épaules encore plus que d’habitude, et poussa ses airs affectés jusqu’à la folie. Il pria Hermine Kleefeld de lui donner un baiser sur sa grande bouche déchirée et coqueta même avec l’infortunée Mme Magnus, tout cela en dépit de son dévouement tendre à l’égard de sa compagne de voyage dont il portait souvent avec une ferveur galante la main à ses lèvres. « Le vin, disait-il. Les femmes… C’est… quand même… Permettez-moi… Le crépuscule du monde… Gethsémané… »
Vers deux heures, la nouvelle courut que « le vieux » – c’est-à-dire le docteur Behrens – approchait en marche forcée des salons. Une panique éclata aussitôt chez les pensionnaires fatigués. Des chaises et des seaux à glace tombèrent. On prit la fuite par la bibliothèque. Peeperkorn, saisi d’une colère royale en voyant se dissoudre si brusquement sa fête de la vie, frappa du poing et traita les fuyards d’esclaves peureux, mais Hans Castorp et Mme Chauchat réussirent pourtant à l’adoucir dans une certaine mesure par la réflexion que cette réception qui avait duré environ six heures devait, malgré tout, prendre fin. Il prêta également l’oreille à un rappel de la sainte délectation du sommeil et consentit à se laisser mener au lit.
– Soutiens-moi, mon enfant ! soutiens-moi de ton côté, jeune homme ! dit-il à Mme Chauchat et à Hans Castorp. Ils soutinrent donc son corps pesant lorsqu’il se leva de sa chaise, lui offrirent leurs bras, et suspendu à l’un et à l’autre, il marcha à grands pas, sa tête puissante inclinée sur une de ses épaules et poussant de côté tantôt l’un, tantôt l’autre de ses guides par les oscillations de son pas, il se mit en route pour prendre du repos. Sans doute était-ce au fond un luxe royal qu’il s’accordait en se faisant guider et soutenir de la sorte. Sans doute, s’il l’avait fallu, aurait-il pu marcher seul. Mais il dédaignait cet effort qui aurait pu tout au plus signifier qu’il entendait dissimuler au public son ivresse, alors que non seulement il n’en rougissait pas, mais encore s’y complaisait avec une grandeur magnifique, et se divertissait royalement à pousser en titubant, à droite et à gauche, ses guides serviables. Lui-même dit tout en marchant :
– Mes enfants… Sottises… Naturellement, on n’est pas du tout… Si cet instant… Vous devriez voir… Ridicule…
– Ridicule ! confirma Hans Castorp. Bien entendu ! On rend au don classique de la vie ce qui lui revient en titubant sans vergogne en son honneur. Mais sérieusement… Moi aussi, je tiens quelque chose, mais malgré ma prétendue ivresse, j’ai clairement conscience d’avoir l’honneur exceptionnel de conduire au lit une personnalité marquante. Si faible est sur moi l’effet de l’ivresse, sur moi qui pourtant, sous le rapport du format, ne saurais supporter une comparaison…
– C’est bon, petit bavard ! dit Peeperkorn, et en titubant il le poussa contre la rampe de l’escalier, tout en entraînant avec lui Mme Chauchat.
De toute évidence, le bruit de l’approche du conseiller n’avait été qu’une fausse alerte. Peut-être la naine fatiguée l’avait-elle répandu pour mettre fin à la réunion. Dans ces conditions, Peeperkorn s’arrêta et voulut revenir sur ses pas pour continuer à boire. Mais de part et d’autre on l’en dissuada et il se laissa donc entraîner.
Le valet de chambre malais, ce petit homme à cravate blanche et chaussé de soie noire, attendait son maître dans le corridor, devant la porte de l’appartement, et l’accueillit avec un salut en posant une main sur sa poitrine.
– Embrassez-vous, ordonna Peeperkorn. Pour finir, embrasse cette femme ravissante sur le front, dit-il à Hans Castorp. Vous n’y verrez pas d’inconvénient et vous lui rendrez son baiser. Faites-le à ma santé et avec ma permission, dit-il.
Mais Hans Castorp s’y refusa.
– Non, Sire, dit-il. Excusez-moi, cela ne va pas. Peeperkorn, appuyé sur son domestique, fronça l’arabesque de ses sourcils et voulut savoir pourquoi cela n’allait pas.
– Parce que je ne peux pas échanger de baisers sur le front avec votre compagne de voyage, dit Hans Castorp. Je vous souhaite une bonne nuit ! Non, ce serait à tous points de vue une pure sottise !
Et comme Mme Chauchat, elle aussi, se dirigeait vers la porte de sa chambre, Peeperkorn laissa s’éloigner le jeune homme récalcitrant, en le suivant toutefois encore des yeux pendant un moment, par-dessus sa propre épaule et celle du Malais, les sourcils froncés, surpris de cette insubordination que sa nature de souverain n’était pas habituée à rencontrer.
MYNHEER PEEPERKORN (suite)
Mynheer Peeperkorn résida au sanatorium Berghof durant tout cet hiver – durant les mois d’hiver qui restaient – et jusqu’au printemps, de sorte que l’on finit par faire ensemble une excursion très mémorable, – Settembrini et Naphta, eux aussi, y prirent part, – dans la vallée de Fluela, jusqu’à la cascade. « De sorte que l’on finit encore par faire ? » Il ne resta donc pas plus longtemps ? – Non, pas plus longtemps, – Il partit donc ? – Oui et non. – Oui et non ? Ne faites pas le mystérieux, s’il vous plaît. Nous saurons bien garder notre calme. Le lieutenant Ziemssen lui aussi est décédé, sans parler de tant d’autres danseurs de la mort, moins honorables. Peeperkorn l’indistinct fut donc emporté par sa fièvre maligne ? – Non, pas par la fièvre, mais pourquoi tant d’impatience ? C’est une condition de la vie et de la narration que tout ne s’y passe pas à la fois, et il conviendrait tout de même de respecter les formes de la connaissance humaine que nous devons à Dieu ! Rendons du moins au temps les honneurs que la nature de notre histoire nous permet de lui rendre ! C’est d’ailleurs bien peu de chose, nous allons de plus en plus clopin-clopant ou, si c’est là une image trop auditive, nous filons tout doucement. Une petite aiguille mesure notre temps. Elle trottine comme si elle mesurait les secondes alors qu’elle indique, Dieu seul sait quoi, chaque fois que, froidement et sans arrêt, elle franchit son point culminant. Il y a des années que nous sommes en haut – voilà qui est certain – nous avons le vertige, nous faisons un songe artificiel sans opium ni hachisch, le tribunal des mœurs nous condamnera, et cependant nous opposons à dessein à cette terrible obnubilation beaucoup de lucidité et d’acuité logique. Ce n’est pas par hasard, on voudra le reconnaître, que nous nous sommes entourés de cerveaux comme Naphta et Settembrini, au lieu de n’en être réduits qu’à des Peeperkorn indistincts, et ceci nous amène, il est vrai, à une comparaison qui, à beaucoup d’égards, et particulièrement sous le rapport de l’échelle, tourne à l’avantage de ce personnage tardivement survenu. Hans Castorp en convenait à part lui, lorsqu’il était étendu dans sa loge, et lorsqu’il devait s’avouer que les deux éducateurs trop articulés qui avaient partagé entre eux sa pauvre âme se rapetissaient en présence de Pieter Peeperkorn, de sorte qu’il était tenté de les qualifier, comme avait fait celui-ci avec une condescendance railleuse, de « petits bavards », et qu’il jugea très heureux que la pédagogie hermétique le mît encore en contact avec une personnalité aussi marquée.
C’était une question à part qui ne troublait pas Hans Castorp dans ses jugements de valeur, que cette personnalité eût surgi en qualité de compagnon de voyage de Clawdia Chauchat et qu’elle fût par conséquent un formidable obstacle. Nous le répétons, il ne se laissa pas détourner de son estime sincère et de sa sympathie parfois un peu hardie pour un homme d’envergure, pour cette simple raison que celui-ci faisait bourse commune avec la femme à laquelle Hans Castorp avait emprunté un crayon la nuit de Carnaval. Ce n’était pas dans sa manière, et ce disant, nous admettons parfaitement que plus d’un ou plus d’une des personnes de notre auditoire seront choquées par un tel manque de tempérament et préféreraient qu’il eût haï et évité Peeperkorn, et que dans son for intérieur il n’eût parlé de lui que comme d’un vieil imbécile et d’un ivrogne radoteur, au lieu de lui rendre visite lorsqu’il était en proie à ses fièvres erratiques, de s’asseoir au bord de son lit, de bavarder avec lui – ce mot, naturellement, ne s’appliquait qu’aux paroles de Hans Castorp, non pas aux grandioses effusions de Peeperkorn – et de s’exposer à l’action de cette personnalité avec la curiosité d’un voyageur qui veut s’instruire. Il agissait ainsi, et nous le rapportons, indifférent au risque que quelqu’un se souvienne à ce propos de Ferdinand Wehsal, qui avait porté le pardessus de Hans Castorp. Mais ce souvenir ne prouve rien. Notre héros n’était pas un Wehsal. Les profondeurs de la détresse n’étaient pas son fait. En somme, il n’était pas un héros, c’est-à-dire que la femme ne déterminait pas ses rapports avec le sexe masculin. Fidèle à notre principe de ne le faire ni meilleur ni pire qu’il n’était, nous constatons qu’il refusait tout simplement – non pas consciemment et expressément, mais tout naïvement – de se laisser détourner par des influences romanesques de la justice qu’il entendait rendre à son propre sexe, et du sens qu’il avait des avantages qu’il tirerait de ce commerce pour sa culture. Ceci peut déplaire aux femmes. Nous croyons savoir que Mme Chauchat s’en irrita malgré elle. Telle ou telle remarque pointue qu’elle laissa échapper et que nous ne manquerons pas de signaler le faisait supposer, mais peut-être était-ce justement cette qualité qui faisait de lui un sujet si propice aux disputes des pédagogues.
Pieter Peeperkorn était souvent malade. On ne s’étonnera pas d’apprendre qu’il l’avait été le lendemain de cette première soirée consacrée aux cartes et au champagne. Presque tous les autres invités de cette réunion prolongée et fatigante étaient mal en point, sans en excepter Hans Castorp qui avait un violent mal de tête, mais qui ne se laissa pas détourner de rendre visite à son hôte de la veille. Il se fit annoncer à Peeperkorn par le Malais qu’il trouva dans le corridor du premier étage et on l’invita à entrer.
Il pénétra dans la chambre à coucher du Hollandais par un salon qui le séparait du salon de Mme Chauchat, et il trouva qu’elle se distinguait du type moyen des chambres du Berghof par ses dimensions et par l’élégance de son confort. Il y avait là des fauteuils recouverts de soie et des tables aux pieds torses ; un épais tapis couvrait le parquet, et les lits n’étaient pas davantage de l’espèce des habituels lits de mort, ils étaient même magnifiques : en cerisier poli avec des ornements de cuivre, ils avaient un ciel de lit commun, sans rideaux ; ce n’était qu’un petit baldaquin qui les unissait en les protégeant.
Peeperkorn était étendu dans l’un des deux lits, il y avait des livres, des lettres et des journaux sur sa courte-pointe de soie rouge et il lisait le Telegraaf à l’aide de son lorgnon. Sur la chaise, auprès de lui, était posé un plateau de café et, à côté de produits pharmaceutiques, une bouteille de vin rouge à moitié vide – c’était le vin naïf et pétillant d’hier soir – se trouvait sur la petite table de nuit. À la discrète surprise de Hans Castorp ; le Hollandais portait non pas une chemise blanche, mais une chemise de laine à manches longues, sans col rabattu, découpée autour du cou et boutonnée aux poignets, qui adhérait aux larges épaules et à la puissante poitrine du vieillard. La magnificence de sa tête sur le coussin était encore accrue, exaltée au delà de la sphère bourgeoise par cette tenue qui prêtait à sa figure un caractère mi-populaire et ouvrier, mi-éternel et sculptural.
– Absolument, jeune homme, dit-il en saisissant son lorgnon d’écaille par son arc et en le déposant. Je vous en prie… Pas du tout. Au contraire !
Et Hans Castorp s’assit près de lui et dissimula sa surprise compatissante (mais n’était-ce pas plutôt une véritable admiration à quoi l’équité le forçait ?) sous un bavardage amical et animé que Peeperkorn secondait avec une incohérence grandiose et une gesticulation insistante. Le Hollandais n’avait pas bonne mine, il semblait jaune, très souffrant et atteint. Vers le matin il avait eu un violent accès de fièvre et la fatigue qui en résultait se combinait avec les suites de l’ivresse.
– Hier soir nous sommes allés un peu fort, dit-il. Non, permettez… Trop fort ! Vous êtes encore… Bien, ça n’a pas d’importance… Mais à mon âge et dans un état aussi menaçant… Mon enfant, se tourna-t-il avec une sévérité tendre, niais résolue vers Mme Chauchat qui entrait précisément, venant du salon, tout va bien, mais je vous répète qu’il eût mieux valu prendre garde, que l’on aurait dû m’empêcher…
Quelque chose comme un orage de colère royale s’annonçait dans ses traits et dans sa voix. Mais il suffisait de se représenter la tempête qui aurait éclaté si on avait sérieusement prétendu l’empêcher de boire pour mesurer toute la déraison et l’injustice de son reproche. Mais de telles inconséquences faisaient sans doute partie de la grandeur. Aussi sa compagne de voyage n’y fit-elle nulle attention en saluant Hans Castorp qui s’était levé, sans du reste lui tendre la main, mais en l’invitant par un sourire et des signes de tête à rester assis, à ne se laisser « en aucune façon » déranger dans son tête-à-tête avec Mynheer Peeperkorn… Elle s’occupa de toutes sortes de choses dans la chambre, donna au valet de chambre l’ordre d’emporter le plateau du déjeuner, disparut un instant, et reparut sur la pointe des pieds pour prendre un instant part à la conversation, et même, si nous voulons rendre l’impression vague de Hans Castorp, pour la surveiller un peu. Naturellement ! Elle avait pu revenir au Berghof en compagnie d’une personnalité de grand format. Mais dès lors que celui qui l’avait si longtemps attendue ici, témoignait, d’homme à homme, tout le respect dû à cette personnalité, elle manifestait de l’inquiétude et même un peu d’aigreur avec ses « surtout » et ses « en aucune façon ». Hans Castorp en sourit tout en se penchant sur ses genoux pour dissimuler son sourire, et en même temps il brûlait de joie intérieure.
Peeperkorn lui versa un verre de vin, de la bouteille posée sur la table de nuit. Dans de telles conditions, dit le Hollandais, le mieux était de reprendre les choses au point où on les avait interrompues la nuit dernière, et ce vin pétillant remplissait absolument l’office de l’eau de seltz. Il but à la santé de Hans Castorp, et celui-ci, tout en buvant, regardait la main de capitaine, tachée de son et aux ongles pointus, serrée aux poignets par le bouton de la chemise de laine, lever le verre, les lèvres larges et déchirées en toucher le bord, et le vin couler le long de ce gosier d’ouvrier ou de statue qui montait et descendait. Ensuite, ils s’entretinrent encore du médicament qui était placé sur la table de nuit, de ce jus brun dont Peeperkorn avala une cuillerée entière que Mme Chauchat lui tendit après le lui avoir rappelé. C’était un fébrifuge, qui contenait surtout de la quinine. Peeperkorn le fit goûter à son visiteur pour qu’il appréciât le goût caractéristique, d’une saveur amère, de cette préparation, et il fit l’éloge de la quinine, qui était bienfaisante non seulement parce qu’elle détruisait les germes et exerçait une influence salutaire sur la chaleur naturelle mais qui devait encore être appréciée comme tonique ; elle réduisait l’élimination de l’albumine, elle favorisait l’alimentation, bref c’était une boisson délectable, un véritable médicament qui réveillait, fortifiait et ranimait, d’ailleurs également un stupéfiant : on pouvait facilement prendre une petite paille, dit-il, en plaisantant d’une façon grandiose, comme hier, des doigts et du chef, semblable de nouveau à un prêtre païen qui danserait.
Oui, une matière magnifique, cette écorce antifébrile. Il n’y avait du reste pas encore trois siècles que la pharmacologie de notre continent en avait pris connaissance, et il n’y avait pas encore cent ans que la chimie avait découvert l’alcaloïde auquel tenaient ses vertus, à savoir la quinine, – découvert, et jusqu’à un certain point analysé. Car la chimie ne pouvait pas prétendre qu’elle eût parfaitement élucidé la constitution de ce médicament, ni qu’elle fût capable de la produire artificiellement. Notre pharmacologie faisait du reste bien de ne pas trop présumer de sa science, car il en allait de même dans beaucoup de domaines : elle savait certaines choses du dynamisme, des effets produits par les corps, mais la question de savoir à quoi il fallait exactement ramener ces effets l’embarrassait assez souvent. Le jeune homme n’avait qu’à étudier la toxicologie : sur les propriétés élémentaires qui déterminaient les effets de ce que l’on appelait les toxiques, personne ne saurait le renseigner ! Il y avait là par exemple les venins des serpents sur lesquels on ne savait pas autre chose que ceci, à savoir que ces sécrétions animales étaient tout simplement des combinaisons de l’albumine, qu’ils se composaient de différents albuminoïdes, lesquels ne produisaient leur effet foudroyant que du fait d’un dosage déterminé, c’est-à-dire, en fait, absolument indéterminé. Dans la circulation du sang ils produisaient des effets dont on ne pouvait que s’étonner, puisque l’on n’était pas accoutumé à rapprocher l’albumine du poison. Mais les matières étaient ainsi faites que toutes contenaient à la fois la vie et la mort. Toutes étaient à la fois des remèdes et des poisons, la médication et la toxicologie étaient une seule et même chose, on guérissait par des poisons et ce que l’on tenait pour une force vitale, pouvait dans certaines conditions tuer par un spasme unique, dans l’espace d’une seconde.
Il parla avec beaucoup d’insistance et avec une cohérence exceptionnelle des poisons et des antitoxines, et Hans Castorp l’écoutait, penché, en hochant la tête, moins absorbé par le contenu de ces discours qui semblaient tenir à cœur à M. Peeperkorn qu’à étudier en silence des manifestations de sa personnalité, lesquelles, en dernier ressort, étaient aussi inexplicables que les effets du venin des serpents. Le dynamisme, c’était l’important dans le monde de la matière, tout n’était que dynamisme, disait Peeperkorn, le reste était conditionné par lui. La quinine, elle aussi, était un médicament-poison plus puissant que tout autre. Quatre grammes de quinine vous rendaient sourd, vous donnaient le vertige, vous coupaient la respiration, vous troublaient la vue comme de l’atropine, vous enivraient comme de l’alcool, et les ouvriers qui travaillaient dans les usines de quinine avaient des yeux enflammés, des lèvres enflées, et souffraient d’éruptions. Et il commença à parler du cinchone, du quinquina des forêts vierges des Cordillères, où se trouvait la patrie de cet arbre, à trois mille mètres d’altitude, et d’où l’on avait rapporté son écorce en Espagne, à une époque si tardive, sous le nom de « poudre des pères jésuites », cette écorce dont les indigènes de l’Amérique du Sud connaissent depuis longtemps les vertus. Il décrivit les formidables plantations de cinchone que le gouvernement hollandais possédait à Java et d’où chaque année des millions de livres de ces écorces rougeâtres et semblables à de la cannelle étaient embarquées pour Amsterdam et pour Londres. Les écorces et, en général, le tissu des plantes sylvestres, de l’épidémie jusqu’au cambium, possédaient d’extraordinaires vertus dynamiques, pour le bien comme pour le mal. Les peuples de couleur étaient très supérieurs aux nôtres sous le rapport de la connaissance des drogues. Sur plusieurs îles, à l’est de la Nouvelle-Guinée, les jeunes gens se préparaient un philtre d’amour au moyen de l’écorce d’un certain arbre qui était probablement un arbre vénéneux comme l’antiaris toxicaria de Java, lequel, pareillement au mancemilier, empoisonnait par son exhalaison l’air autour de lui et étourdissait mortellement les hommes et les animaux. Ils broyaient donc l’écorce de cet arbre, mélangeaient la poudre ainsi obtenue avec des rognures de noix de coco, enroulaient ce mélange dans une feuille, et le faisaient cuire. Durant son sommeil, ils aspergeaient de ce liquide la cruelle qu’ils courtisaient, et elle s’éprenait aussitôt de celui qui l’avait aspergée. Parfois c’était l’écorce de la racine qui possédait le pouvoir, comme c’était le cas d’une liane de l’archipel malais, nommée strychnos Tieuté, au moyen de laquelle les indigènes préparaient, en y ajoutant du venin de serpent, l’Upas radcha, une drogue qui, introduite dans la circulation du sang, par exemple au moyen d’une flèche, amenait instantanément la mort, sans que personne sût dire au jeune Hans Castorp comment cela se produisait.
On savait uniquement que, sous le rapport du dynamisme, l’upas était voisin de la strychnine, et Peeperkorn qui avait achevé de se redresser dans son lit et qui portait, de temps à autre, de sa main un peu tremblante de capitaine, son verre de vin à ses lèvres déchirées, pour boire d’un air altéré de grandes gorgées, parla du strychnos de la côte du Coromandel, dont les baies orange, – la noix vomique – contenaient l’alcaloïde le plus dynamique, la strychnine, parla à voix basse et les sourcils levés, de ces branches cendrées, de ce feuillage extraordinairement brillant et des fleurs d’un jaune verdâtre de cet arbre, de sorte que le jeune Hans Castorp eut sous les yeux une image à la fois triste et hystériquement bariolée, et qu’en somme il se sentit un peu mal à l’aise.
Mme Chauchat intervint alors dans la conversation, en faisant remarquer que cela fatiguait Peeperkorn et lui donnerait de nouveau de la fièvre. Quelque regret qu’elle eût d’interrompre l’entrevue, elle devait prier Hans Castorp de s’en tenir là pour aujourd’hui. Il obéit naturellement, mais souvent encore, après un accès de fièvre quarte, durant les mois qui suivirent, il s’assit au chevet de cet homme princier, tandis que Mme Chauchat, surveillant discrètement l’entretien ou y prenant part, allait et venait ; et même les jours où Peeperkorn n’avait pas de fièvre, Hans Castorp passait maintes heures avec lui et sa compagne de voyage parée de perles. Car, lorsque le Hollandais n’était pas alité, il manquait rarement de réunir après le dîner un petit choix variable de pensionnaires du Berghof, pour le jeu, le vin et toutes sortes d’autres choses délectables soit au salon, soit au restaurant, et Hans Castorp avait sa place d’habitué entre la nonchalante jeune femme et l’homme magnifique. On faisait également ensemble des promenades à l’extérieur, auxquelles prirent part ; MM. Ferge et Wehsal et par la suite Settembrini et Naphta, les adversaires en esprit que l’on n’avait pu manquer de rencontrer et que Hans Castorp se sentit véritablement heureux de pouvoir présenter à Peeperkorn, ainsi qu’à Clawdia Chauchat, sans se soucier le moins du monde de savoir si cette présentation et ces rapports seraient agréables, ou non, aux deux antagonistes, et dans la conviction secrète qu’ils avaient besoin d’un objet pédagogique et qu’ils préféreraient faire bon accueil à ses compagnons indésirables que renoncer à débattre devant lui leurs controverses.
En effet, il ne se trompait pas dans le sentiment que les membres de son cercle bigarré d’amis s’habitueraient tout au moins à ne pas s’habituer les uns aux autres : il y avait, bien entendu, entre eux des tensions, des incompatibilités, voire même une hostilité tacite, et nous nous étonnons nous-même que notre insignifiant héros ait su les grouper autour de lui. Nous nous l’expliquons par une sorte d’affabilité enjouée et vivante qui lui faisait tout trouver « intéressant », et que l’on pourrait appeler un caractère liant dans ce sens que non seulement elle le liait aux personnes et aux personnalités les plus diverses, mais encore qu’elle les liait dans une certaine mesure entre elles.
Singuliers entrelacs de rapports mutuels ! Nous sommes tenté de faire apparaître un instant leurs fils embrouillés tels que Hans Castorp lui-même, durant ces promenades, les considérait d’un œil rusé et bienveillant. Il y avait là le malheureux Wehsal, qui brûlait de désir pour Mme Chauchat, et adulait bassement Peeperkorn et Hans Castorp, l’un à cause de sa souveraineté présente, l’autre en raison du passé. Il y avait là de son côté Clawdia Chauchat, la malade et la voyageuse à la démarche nonchalante et gracieuse, la serve de Peeperkorn, et cela certainement par conviction bien qu’elle fût quelque peu inquiète et secrètement agacée de voir le chevalier d’une lointaine nuit de carnaval sur un tel pied d’intimité avec son maître et seigneur. Cette irritation ne faisait-elle pas penser à celle qui se manifestait dans ses rapports avec Settembrini ? Avec ce beau parleur et cet humaniste qu’elle ne pouvait pas souffrir et qu’elle jugeait présomptueux et inhumain ? Avec l’ami et l’éducateur du jeune Hans Castorp à qui elle eût volontiers demandé quelles avaient été les paroles qu’il avait lancées avec dédain, dans cet idiome méditerranéen qu’elle comprenait aussi peu que lui sa langue à elle, au jeune Allemand si convenable, à ce joli petit bourgeois de bonne famille à la tache humide, lorsqu’il avait été autrefois sur le point de se rapprocher d’elle. Hans Castorp, amoureux, comme on a coutume de dire, « par-dessus les oreilles », non au sens badin de cette expression, mais ainsi que l’on aime lorsque cet amour est défendu et insensé et qu’il n’y a pas moyen de chanter à ce propos de paisibles chansonnettes du pays plat, tristement amoureux par conséquent et par là même dépendant, soumis, souffrant et servant, était cependant homme à conserver jusque dans l’esclavage assez de malice pour se rendre parfaitement compte de la valeur que son dévouement pouvait, malgré tout, garder aux yeux de la malade aux pas glissants et aux yeux enchanteurs de Tartare : une valeur sur laquelle l’attitude de M. Settembrini à son égard pouvait attirer l’attention de Mme Chauchat, cette attitude qui ne confirmait que trop ouvertement ses soupçons parce qu’elle était en effet aussi distante que pouvait le permettre la politesse humaniste. Mais le pire, ou, aux yeux de Hans Castorp, l’avantage c’était que ses relations avec Naphta desquelles elle avait beaucoup attendu ne lui offraient guère de compensation. Sans doute, ne se heurtait-elle pas ici à la fin de non-recevoir que M. Lodovico lui opposait, et les conditions étaient plus favorables à la conversation : ils s’entretenaient quelquefois à part, Clawdia et le petit homme tranchant, de livres, de problèmes de philosophie politique qu’ils s’accordaient à traiter dans un esprit extrémiste. Mais une certaine réserve aristocratique dans la prévenance que lui témoignait le parvenu comme font tous les parvenus, ne fut pas sans lui être sensible. Le terrorisme espagnol de Naphta s’accordait au fond assez mal avec l’humanité vagabonde et nonchalante de Mme Chauchat. Et il s’ajoutait à cela un élément encore plus subtil, une hostilité légère et à peine perceptible à son égard qu’avec un flair féminin elle sentait émaner des deux adversaires, de Settembrini comme de Naphta ; (de même que son chevalier de carnaval la sentait parfaitement), et qui tenait aux rapports que tous deux avaient avec lui, Hans Castorp. C’était la mauvaise humeur de l’éducateur à l’endroit de la femme, élément troublant et gênant, cette hostilité secrète et originelle qui les rapprochait parce que leur discorde était neutralisée par leurs sentiments communs de pédagogues.
N’entrait-il pas également un peu de cette hostilité dans l’attitude que les deux dialecticiens adoptaient à l’égard de Pieter Peeperkorn ? Hans Castorp croyait le remarquer, peut-être parce qu’il l’avait malicieusement prévu, et qu’en somme il avait été assez impatient de réunir le bègue magnifique et ses deux « conseillers de gouvernement », comme il s’exprimait parfois en plaisantant, et d’étudier l’effet de cette confrontation. Mynheer était moins magnifique au dehors que dans la maison. Le large chapeau de feutre qu’il enfonçait sur son front et qui couvrait ses longues mèches blanches, les larges dessins de son front, rapetissait ses traits, les recroquevillait en quelque sorte, et enlevait même de la majesté de son nez qui rougissait. En outre, il était plus imposant lorsqu’il restait immobile que lorsqu’il marchait : il avait l’habitude de porter à chacun de ses pas courts, tout le poids de son corps et jusqu’à sa tête, du côté du pied qu’il portait en avant, ce qui faisait penser à un bon vieillard plutôt qu’à un roi. Enfin, il ne marchait pas dressé de toute sa hauteur, mais affaissé sur lui-même. Néanmoins il dominait d’une bonne tête tant M. Lodovico que le petit Naphta, et ce fait n’était pas le seul par quoi sa présence pesait sur l’existence des deux politiciens, aussi fort que Hans Castorp l’avait prévu.
C’était une pression, une diminution, un préjudice venant de la comparaison qui s’imposait, – sensibles à l’observateur malicieux, mais certainement également sensibles aux intéressés, tant aux deux hommes chétifs et trop articulés qu’au bègue magnifique. Peeperkorn traitait Naphta et Settembrini avec une politesse et une attention extrêmes, avec un respect que Hans Castorp aurait qualifié d’ironique si le sentiment très net que cette attitude ne se conciliait pas avec l’idée d’un homme de grand format ne l’en avait pas empêché. Les rois ne connaissent pas l’ironie, pas même au sens d’un procédé de rhétorique direct et classique, encore bien moins dans un sens plus compliqué. Et c’était donc plutôt une raillerie à la fois subtile et magnifique qui, sous une apparence de sérieux un peu exagéré, caractérisait la conduite du Hollandais à l’endroit des amis de Hans. « Oui, oui, disait-il par exemple, en les menaçant du doigt, détournant la tête avec des lèvres qui souriaient d’un air moqueur. Ce sont… ce sont… Mesdames et Messieurs, j’attire votre attention… Cerebrum, cérébral, vous m’entendez ! Non… non, parfait, extraordinaire, c’est, il apparaît quand même… » Ils se vengeaient en échangeant des regards qui, après s’être rencontrés, se levaient désespérément au ciel, et qui cherchaient les yeux de Hans Castorp. Mais celui-ci se dérobait.
Il arrivait que M. Settembrini demandât directement des comptes à son élève et manifestât ainsi son inquiétude de pédagogue.
– Mais, au nom de Dieu, ingénieur, ce n’est qu’un stupide vieillard ! Que lui trouvez-vous d’extraordinaire ? Peut-il vous servir en quoi que ce soit ? Je ne comprends plus. Tout serait clair – sans être particulièrement louable – si vous le tolériez simplement, si vous ne cherchiez par son intermédiaire que la compagnie de celle qui est momentanément sa maîtresse. Mais il est impossible de ne pas se rendre compte que vous vous occupez de lui presque plus que d’elle. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre…
Hans Castorp se mit à rire.
– Absolument, dit-il. Parfait. Il se trouve que… Permettez-moi… Bien ! (Et il s’efforça d’imiter les gestes de Peeperkorn.) Oui, oui, rit-il encore. Vous trouvez cela stupide, Monsieur Settembrini, et de toute façon, c’est peu clair, ce qui, à vos yeux, est certainement pire que stupide. Ah, la bêtise ! Il y a tant d’espèces différentes de bêtise ! Et l’intelligence n’en est pas la meilleure… Hé, hé, il me semble que voilà une formule bien tournée, j’ai fait un mot. Comment vous plaît-il ?
– Beaucoup. J’attends avec impatience votre premier recueil d’aphorismes. Peut-être est-il encore temps de vous prier de tenir compte de certaines considérations auxquelles nous nous sommes un jour livrés sur le danger que le paradoxe présente pour l’homme.
– Je n’y manquerai pas, Monsieur Settembrini. Je n’y manquerai certes pas. Non, je ne fais pas du tout la chasse aux paradoxes, avec ce mot que j’ai trouvé. Je voulais simplement vous montrer quelles difficultés l’on éprouve à discerner la bêtise et l’intelligence. C’est si difficile à distinguer, cela se confond… Je le sais bien, vous haïssez le guazzabuglio mystique et vous êtes pour la valeur, pour le jugement, pour le jugement de valeur, en quoi je vous donne tout à fait raison. Mais distinguer la bêtise de l’intelligence, c’est quelquefois un parfait mystère et on doit malgré tout avoir le droit de s’occuper de mystères, en admettant que ce soit avec le désir sincère de les pénétrer dans la mesure du possible. Je vais vous poser une question ; je vais vous demander : Pouvez-vous nier qu’il nous mette tous dans sa poche, tous, autant que nous sommes ? Je m’exprime vulgairement, et pourtant, autant que je puisse m’en rendre compte, vous ne pouvez pas le nier. Il nous met tous dans sa poche et il tient de quelque part, je ne sais d’où, le droit de se moquer de nous. D’où ? Comment ? Pourquoi ? Naturellement pas grâce à son intelligence. Je vous accorde qu’il peut à peine être question d’intelligence. C’est un homme de confusion et de sensibilité, la sensibilité est pour ainsi dire sa marotte… excusez cette expression triviale. Je veux dire : ce n’est pas à force d’intelligence qu’il nous met dans sa poche, ce n’est pas pour des raisons qui relèvent de l’esprit, vous protesteriez et, en effet, ce n’est pas cela. Mais ce n’est pas davantage pour des raisons physiques. Ce n’est pas à cause de ses épaules de capitaine, ni d’une force musculaire et brutale, ni parce qu’il pourrait abattre chacun de nous d’un coup de poing. Il ne pense pas du tout à ce qu’il en serait capable et lorsqu’il lui arrive d’y penser, il suffit de quelques paroles civilisées pour le calmer… Ce n’est donc pas pour des raisons physiques. Et pourtant, sans aucun doute, le corps joue un rôle dans tout cela, non pas au sens de la force musculaire, mais dans un autre sens, dans un sens mystique – la chose devient mystique dans la mesure où le corps y joue un rôle – et l’élément physique se change en élément spirituel, ou inversement, en sorte qu’on ne les distingue plus l’un de l’autre, qu’on ne distingue plus la bêtise de l’intelligence, mais l’effet est là, le dynamisme ; – et il nous met dans sa poche. Et nous ne disposons que d’un mot pour exprimer cela, nous disons : personnalité. C’est sans doute avec raison que l’on se sert de ce mot, nous sommes tous des personnalités, morales et juridiques, ou ce que vous voudrez. Mais ce n’est pas cela que je veux dire. Je veux parler d’un mystère qui est au-delà de l’intelligence et de la bêtise, et dont il doit être permis de se préoccuper, soit pour le pénétrer dans la mesure du possible, soit encore pour notre édification. Et si vous êtes pour les valeurs positives, la personnalité est, en définitive, une valeur positive, plus positive que la bêtise et l’intelligence, positive au premier chef, positive d’une façon absolue, comme la vie, bref, c’est une valeur de la vie, et elle est vraiment faite pour que l’on s’y intéresse particulièrement. Voilà ce que j’ai cru devoir dire, en réponse à ce que vous avez dit au sujet de la bêtise.
Depuis quelque temps, Hans Castorp ne se troublait ni ne s’embrouillait plus au cours de tels épanchements et il ne restait plus en plan. Il menait sa réplique à terme, laissait tomber sa voix, mettait un point final et allait son chemin comme un homme, bien qu’il rougît encore et qu’en secret il redoutât un peu le silence qui suivrait ses paroles et durant lequel on lui laissait le temps d’en avoir honte. M. Settembrini fit durer ce silence ; puis il dit :
– Vous niez de faire la chasse aux paradoxes. Mais vous savez parfaitement qu’il ne me plaît pas davantage de vous voir à la chasse aux mystères. En faisant de la personnalité un mystère, vous courez le risque d’incliner à l’idolâtrie. Vous vénérez un masque. Vous voyez une mystique où il n’y a que mystification. Nous sommes en présence d’une de ces formes creuses et trompeuses par quoi le démon du corps et de la physionomie se plaît parfois à nous berner. Vous n’avez jamais fréquenté dans des milieux de comédiens ? Vous ne connaissez pas ces têtes de mimes qui réunissent les traits de Jules César, de Gœthe et de Beethoven, et dont les heureux possesseurs, dès qu’ils ouvrent la bouche, s’avèrent les plus lamentables hères qui soient sous le soleil ?
– Bien ! un jeu de la nature, dit Hans Castorp. Mais ce n’est pas seulement un jeu de la nature, ce n’est pas qu’une duperie. Car, dès lors que ces hommes sont des acteurs, il faut qu’ils aient du talent, et le talent est supérieur à l’intelligence et à la bêtise, lui aussi est une valeur de la vie. Mynheer Peeperkorn lui aussi, a du talent, quoique vous en disiez, et grâce à son talent, il nous met tous dans sa poche. Placez dans un angle d’une pièce M. Naphta, et faites-lui prononcer une conférence qui soit du plus haut intérêt, sur Grégoire le Grand et sur le règne de Dieu. Dans l’autre angle de la pièce se trouve Peeperkorn, avec sa bouche étrange et ses sourcils froncés qui ne dit que : « Absolument… permettez ! Classé ! » Vous verrez bien : les gens feront le cercle autour de Peeperkorn, tous, sans exception, et Naphta restera tout seul avec son intelligence et son royaume de Dieu, quoiqu’il s’exprime avec une netteté telle que cela vous pénètre jusqu’à la moelle.
– Vous n’avez pas honte d’adorer ainsi le succès ? demanda M. Settembrini. Mundus vult decipi[18]. Je ne demande pas que l’on s’assemble autour de M. Naphta. C’est un esprit pernicieux fait pour nous égarer. Mais je suis tenté de prendre parti pour lui en présence de la scène imaginaire que vous décrivez, et que vous semblez approuver d’une manière blâmable. Vous pouvez mépriser la clarté, la précision, la logique, le langage humain et articulé. Vous pouvez leur préférer je ne sais quel galimatias de charlatanisme intuitif – et vous êtes un homme perdu…
– Mais je vous assure qu’il sait parler d’une manière très cohérente lorsqu’il s’anime, dit Hans Castorp. Il m’a parlé récemment de drogues dynamiques et d’arbres vénéneux asiatiques. C’était si intéressant que cela en devenait sinistre, et, d’autre part, c’était moins intéressant en soi qu’en raison de l’effet produit par sa personnalité. C’est ce qui le rendait à la fois intéressant et sinistre…
– Naturellement, nous connaissons votre faible pour les choses asiatiques. C’est vrai, je ne peux pas vous servir des miracles de ce genre, répondit M. Settembrini avec tant d’amertume que Hans Castorp se hâta de déclarer que les avantages qu’il devait à l’enseignement de M. Settembrini étaient d’un tout autre ordre et qu’il ne venait à l’esprit de personne de se livrer à des comparaisons qui feraient tort à l’une et à l’autre des parties. Mais l’Italien fit mine de dédaigner cette politesse. Il poursuivit :
– De toute façon, vous me permettrez, ingénieur, d’admirer votre objectivité et votre quiétude d’esprit. Elle frise le grotesque, vous en conviendrez. Car les choses, telles qu’elles se présentent… Ce lourdaud, somme toute, vous a pris votre Béatrice… J’appelle les choses par leur nom… Et vous ? C’est sans précédent.
– Différences de tempérament, Monsieur Settembrini. Différences de race quant à la galanterie chevaleresque et à l’ardeur du sang. Naturellement, vous, en homme du Midi, vous auriez recours au poison et au poignard, ou en tout état de cause, vous donneriez à l’aventure un caractère mondain et passionné, bref, vous agiriez en coq. Ce serait certainement très viril, très viril et galant. Mais chez moi c’est tout différent. Je ne suis pas viril au point de ne voir dans le rival que le mâle amoureux de la même femme, je ne le suis peut-être pas du tout, mais il est certain que je ne le suis pas de cette manière que j’appelle malgré moi « mondaine » je ne sais trop pourquoi. Je me demande en mon cœur si j’ai rien à lui reprocher. M’a-t-il fait sciemment un tort quelconque ? Or, une offense doit être faite avec intention, sinon elle n’est plus une offense. Et quant au « tort », il faudrait que je m’en prenne à elle. Or, je n’en ai pas le droit, je n’en ai pas le droit, d’une façon générale, et particulièrement en ce qui regarde Peeperkorn. Car, premièrement, il est une personnalité, ce qui compte pour les femmes, et deuxièmement il n’est pas un civil comme moi, mais une sorte de militaire comme mon cousin, c’est-à-dire qu’il a un point d’honneur, une marotte, c’est le sentiment, la vie… Je dis des sottises, mais je préfère bafouiller un peu et n’exprimer qu’à moitié des choses difficiles que de sortir toujours les mêmes lieux communs impeccables et traditionnels. Peut-être est-ce aussi quelque chose comme un trait militaire dans mon caractère, si je puis ainsi dire…
– Dites-le, dites-le, approuva M. Settembrini. Ce serait en tout cas là un trait de caractère qu’il faudrait louer. Le courage de se connaître et de s’exprimer, c’est la littérature, c’est l’humanisme.
Sur ces paroles ils se séparèrent en des termes passables. M. Settembrini avait donné à la fin du débat un tour conciliant et avait d’excellentes raisons de le faire. Sa position, en effet, n’était pas inattaquable et il n’eût pas été prudent de sa part de pousser trop loin la sévérité. Une conversation qui portait sur la jalousie était un terrain un peu glissant pour lui. À un moment donné, il aurait dû répondre que, du point de vue de sa veine pédagogique, ses rapports avec l’homme n’étaient pas non plus d’un ordre purement social, et que dès lors le souverain Peeperkorn marchait sur ses brisées au même titre que Naphta et Mme Chauchat. Et, en définitive, il ne pouvait espérer soustraire son élève à l’influence et à la supériorité naturelle d’une personnalité à laquelle il pouvait échapper aussi peu que son partenaire dans ces joutes intellectuelles.
Ils s’en tiraient le mieux lorsque la conversation portait sur des sujets élevés, lorsqu’ils discutaient et retenaient l’attention des promeneurs par un de leurs débats à la fois élégants et passionnés, académiques, mais menés sur un ton comme s’il s’agissait de questions d’une actualité brûlante et d’une importance vitale, débats dont ils faisaient presque seuls tous les frais, car, tant qu’ils duraient, le « grand format » présent était en quelque sorte neutralisé, parce qu’il ne pouvait y prendre part que par des exclamations de surprise, des froncements de sourcils et des incohérences obscures et moqueuses. Mais même dans ces conditions il exerçait une pression, jetait son ombre sur la discussion, de sorte qu’elle paraissait perdre de son éclat ; il l’altérait, lui opposait quelque chose, d’une manière sensible à tous et peut-être inconsciente, ou consciente seulement jusqu’à un certain degré ; manière qui ne favorisait aucune des deux causes et qui faisait perdre à la querelle son importance capitale et même, – nous hésitons à le dire – qui la faisait paraître vaine. Ou bien : la subtile controverse poursuivie à outrance se rapportait secrètement, d’une manière souterraine et indéterminée, au « format » qui marchait à leur côté et son magnétisme en affaiblissait la portée. On ne saurait caractériser autrement ce phénomène mystérieux et fort désagréable pour les deux adversaires. Il en résultait que, si Pieter Peeperkorn n’avait pas été là, on eût été forcé de prendre parti d’une manière beaucoup plus nette – en se rangeant, par exemple, du côté de Léon Naphta qui défendait le caractère révolutionnaire de l’Église contre la thèse de M. Settembrini, lequel ne voulait voir dans cette puissance historique que la protectrice des forces obscures du conservatisme, et qui prétendait que toutes les tendances favorables à la vie et à l’avenir, toutes les puissances de révolution et de renouvellement étaient issues des principes éclairés, scientifiques et progressistes, de l’époque glorieuse de la renaissance de la civilisation antique, et persistait dans cette profession de foi avec un bel élan de la parole et du geste. D’un ton froid et tranchant, Naphta se fit alors fort de montrer – et il le montra avec une évidence aveuglante, – que l’Église, incarnation du principe de l’ascétisme religieux, est, en substance, très loin de vouloir être la défense et l’appui de ce qui veut demeurer, de la culture humaine par conséquent, des préceptes juridiques de l’État, qu’au contraire elle a constamment inscrit sur son drapeau le principe révolutionnaire le plus radical, le bouleversement le plus complet, et qu’en somme tout ce qu’on juge digne d’être conservé, tout ce que les faibles, les lâches, les conservateurs, les bourgeois essayent de maintenir – l’État et la Famille, l’art et la science profanes – a toujours été en opposition consciente ou inconsciente avec l’idée religieuse, avec l’Église dont la tendance initiale et dont le but invariable est la dissolution de tous les ordres temporels et la réorganisation de la Société d’après le modèle du royaume idéal et communiste de Dieu.
M. Settembrini prit ensuite la parole, et, grand Dieu ! il en fit bon usage. Une telle confusion de l’idée révolutionnaire, luciférienne, avec la révolte générale de tous les mauvais instincts, dit-il, était déplorable. L’esprit novateur de l’Église avait pendant des siècles consisté à poursuivre par l’inquisition la pensée féconde, à l’étrangler, à l’étouffer dans la fumée de ses bûchers, et voici qu’aujourd’hui elle se faisait proclamer révolutionnaire par ses messagers, en prétendant que son but était de remplacer la Liberté, la Civilisation et la Démocratie par la dictature de la plèbe et par la barbarie. Eh ! en effet c’était là un exemple effarant de conséquence contradictoire, de contradiction conséquente…
Naphta objecta que son contradicteur ne laissait pas de commettre des contradictions analogues. Démocrate, à l’en croire, il s’exprimait d’une manière fort peu égalitaire et ne témoignait guère de sympathie pour le peuple ; il manifestait au contraire une prétention d’une outrecuidance aristocratique et blâmable en qualifiant de « plèbe » le prolétariat universel appelé à une dictature provisoire. Mais où il se montrait démocrate, c’est face à l’Église, qui, en effet, il fallait en convenir avec fierté, était la puissance la plus noble de l’histoire de l’humanité – noble au sens suprême et le plus élevé, au sens de l’esprit. Car l’esprit ascétique – si l’on pouvait se servir d’un tel pléonasme – l’esprit de la négation et de l’anéantissement du monde était la noblesse par excellence, le principe aristocratique à l’état pur ; il ne pouvait devenir populaire, et de tout temps l’Église avait, au fond, été impopulaire. Pour peu qu’il se fût livré à quelques investigations d’ordre littéraire sur la civilisation du moyen âge, M. Settembrini eût découvert la violente antipathie que le peuple – le peuple au sens le plus large – éprouvait à l’égard de l’état ecclésiastique ; il y avait là, par exemple, certaines figures de moines, imaginées par des poètes populaires, qui avaient déjà opposé d’une manière très luthérienne le vin, la femme et la chanson à l’idée de l’ascétisme. Tous les instincts de l’héroïsme profane, tout l’esprit guerrier, et de plus la poésie galante avaient été en conflit plus ou moins avoué avec l’idée religieuse et, partant, avec la hiérarchie. Car tout cela était le « siècle » et l’esprit plébéien en comparaison à la noblesse spirituelle représentée par l’Église.
M. Settembrini remercia son contradicteur d’avoir bien voulu rafraîchir sa mémoire. Le personnage du moine Ilsan dans le « Jardin des Roses » était en effet savoureux à la face de l’aristocratisme du tombeau que l’on célébrait ici, et s’il n’était pas, lui, un partisan du réformateur allemand auquel il avait été tout à l’heure fait allusion, on le trouverait néanmoins prêt à défendre avec ardeur tout l’individualisme démocratique qui était à la base même de sa doctrine contre toute forme de féodalité spirituelle et d’accaparement de la personnalité.
– Eh ! Eh ! s’écria tout à coup Naphta. Son interlocuteur voulait-il insinuer que l’Église était trop peu démocratique, qu’elle n’avait pas le sens de la valeur de la personnalité humaine ? Et que faisait-il de la tant humaine absence de préjugés du droit canon qui n’avait, – tandis que le droit romain avait fait dépendre l’exercice du droit de la possession de l’état de citoyen, tandis que le droit germanique l’avait lié à la nationalité et à la liberté personnelle, – exigé que l’appartenance à la communauté de l’Église et la fidélité au dogme, qui s’était affranchi de toutes les considérations sociales et publiques et avait déclaré les esclaves, les prisonniers de guerre et les serfs capables de tester et d’hériter !
Cette assertion, fit observer Settembrini d’une voix mordante, aura sans doute été maintenue non sans l’arrière-pensée de la « dîme canonique » prélevée sur chaque testament. Au surplus, il parla de « démagogie cléricale » ; ramena à une volonté de puissance dénuée de scrupules le fait que l’Église soulevait l’Achéron quand les dieux se détournaient d’elle, et affirma, en outre, que ce qui importait à l’Église c’était apparemment la quantité des âmes plus que leur qualité, ce qui permettait de conclure à un profond manque de noblesse spirituelle.
L’Église, manquer de noblesse ? Naphta attira alors l’attention de M. Settembrini sur l’aristocratisme inflexible dont s’inspirait le principe de l’hérédité de la tare : la transmission d’une faute grave aux descendants qui, démocratiquement parlant, étaient pourtant innocents ; l’opprobre qui, pendant toute leur vie, pesait par exemple sur des enfants naturels privés de tout droit. Mais l’Italien le pria de ne pas insister parce que ses sentiments humains se révoltaient contre un tel état de choses, et de plus parce qu’il était las des détours et que, dans les artifices de l’apologétique de son adversaire, il reconnaissait le culte absolument infâme et diabolique du néant qui voulait être appelé esprit et qui prétendait faire de l’impopularité avouée du principe ascétique quelque chose de légitime et de sacré.
Ici Naphta demanda la permission d’éclater de rire. Parler du nihilisme de l’Église ! Du nihilisme du système de gouvernement le plus réaliste dans l’histoire du monde ! Le Souffle de l’ironie humaine avec laquelle l’Église faisait à la chair des concessions incessantes, cachant sous une condescendance avisée les dernières conséquences du principe et laissant régner l’esprit comme influence régulatrice sans heurter trop sévèrement la nature, n’avait donc jamais effleuré M. Settembrini ? Il n’avait donc pas davantage entendu parler de cette subtile conception de l’« indulgence » qui s’étendait même à un sacrement, celui du mariage, lequel n’était nullement un bien positif comme les autres sacrements, mais simplement une défense contre le péché, accordé pour modérer la convoitise des sens et l’intempérance, de sorte que le principe ascétique, l’idéal de la chasteté, y était maintenu sans que l’on eût heurté la chair avec une rigueur peu diplomatique ?
Comment M. Settembrini pouvait-il dès lors ne pas s’élever contre cette abominable conception du « politique », contre ce geste d’une indulgence et d’une prudence présomptueuses que l’esprit – ou ce qui se présentait comme tel – s’arrogeait d’accomplir à l’égard de son contraire, prétendu coupable, qu’il convenait de traiter « politiquement », alors qu’en réalité il n’avait nul besoin de cette indulgence empoisonnée ; contre la maudite duplicité d’une conception du monde qui peuplait l’univers de démons, tant la vie que son contraire présomptueux, l’esprit : car si l’une était le mal, l’autre aussi, en tant que négation pure, devait l’être. Il rompit une lance en faveur de l’innocence de la volupté, – ce qui fit penser Hans Castorp à la petite mansarde d’humaniste avec son pupitre, ses chaises de paille et la carafe d’eau, – tandis que Naphta, affirmant qu’il n’y avait pas de volupté sans péché et que la nature avait tout lieu d’avoir la conscience inquiète devant l’esprit, définissait la politique de l’Église et l’indulgence de l’esprit comme de « l’amour », afin de réfuter le nihilisme du principe ascétique, (et Hans Castorp jugea que ce mot « amour » s’accordait fort mal avec l’apparence du tranchant et maigre petit Naphta…).
Et cela se poursuivit à perte de vue : nous connaissons déjà le jeu, Hans Castorp le connaissait aussi ; comme lui, nous avons un instant prêté l’oreille pour observer l’aspect que prenait une de ces joutes péripatéticiennes dans l’ombre de la « personnalité » qui accompagnait les promeneurs et comment cette présence faisait baisser secrètement le débat. Il en était ainsi qu’une secrète nécessité de tenir compte de cette présence éteignait l’étincelle qui, de temps en temps, jaillissait – en produisant cette sensation de découragement qui nous saisit lorsqu’un courant électrique est coupé. Bon ! C’était ainsi ! Il n’y avait plus de crépitement entre les contraires, point d’éclair, point de courant ; cette présence que l’esprit comptait neutraliser, neutralisait au contraire l’esprit, Hans Castorp s’en apercevait avec surprise et curiosité.
Révolution et conservation ! Et on regardait Peeperkorn. On le voyait marcher, pas tellement majestueux, de son pas un peu fléchissant, et son chapeau sur le front ; on voyait ses lèvres larges, irrégulièrement déchirées, et on l’entendait dire en désignant plaisamment les interlocuteurs de la tête : « Oui, oui, oui ! Cerebrum, cérébral, vous comprenez ? C’est… Il apparaît d’autre part… » Et voici : il n’y avait plus de courant. Ils cherchèrent ailleurs, ils eurent recours à des charmes plus opérants, ils en vinrent au « problème aristocratique », à la popularité et à la noblesse. Pas d’étincelle ! Comme par magie, la conversation prenait un tour personnel. Hans Castorp voyait le compagnon de voyage de Clawdia étendu dans son lit sous la courte-pointe de soie rouge, dans sa chemise de tricot sans col, mi-ouvrier âgé, mi-buste impérial, et après quelques faibles sursauts le ressort de la dispute se brisait. Tensions plus fortes ! Négation et culte du néant, d’une part, affirmation éternelle et amour de l’esprit pour la vie, de l’autre. Que devenaient le ressort, l’éclair et le courant lorsqu’on regardait Mynheer, ce qui se produisait immanquablement du fait d’une attraction secrète ? Bref, ils faisaient défaut, et Hans constatait que ce n’était là ni plus ni moins qu’un mystère. Pour son recueil d’aphorismes il pouvait retenir qu’un mystère ne s’exprime que par les mots les plus simples, ou qu’il demeure inexprimé. Pour exprimer cependant celui dont il s’agit on pouvait tout au plus dire tout bonnement que Pieter Peeperkorn, avec son masque royal et ridé, avec sa bouche défigurée par une grimace amère, était le pour et le contre, que l’un et l’autre semblaient lui convenir et s’annuler en lui lorsqu’on le regardait : ceci et cela, l’un et l’autre. Oui, ce stupide vieillard, ce zéro souverain ! Il paralysait le nerf de la controverse, non pas en embrouillant les choses par des biais tortueux comme Naphta ; il n’était pas ambigu comme ce dernier, il l’était d’une manière toute différente, d’une manière positive, ce mystère chancelant qui, de toute évidence, était non seulement par delà la bêtise et l’intelligence, qui était par delà tant d’autres antithèses que Settembrini et Naphta évoquaient en vue d’obtenir la haute tension nécessaire à leur but pédagogique. La personnalité, semblait-il, n’était pas éducatrice, et pourtant quelle trouvaille elle était pour quelqu’un qui voyageait pour se former ! Comme c’était étrange d’observer cette duplicité d’un roi lorsque les querelleurs en vinrent à parler du mariage et du péché, du sacrement de l’indulgence, du péché et de l’innocence de la volupté ! Il penchait sa tête sur son épaule et sa poitrine, ses lèvres douloureuses s’ouvraient, la bouche lasse et plaintive béait, les narines se tendaient et se dilataient comme s’il souffrait, les plis du front montaient et les yeux s’écarquillaient en un pâle regard souffrant ; une image de l’amertume ! Et voici que, au même instant, cette mine de martyr devenait voluptueuse. L’inclinaison oblique de la tête se faisait malicieuse, les lèvres encore ouvertes souriaient impudiquement, la fossette de sybarite, que nous avions observée en d’autres circonstances apparaissait sur sa joue, le prêtre païen et dansant était là, et tandis que, de la tête, il désignait railleusement cette direction intellectuelle, on l’entendait dire : « Tiens, tiens, tiens, parfait ! C’est… ce sont… voilà bien de nouveau… Le sacrement de la volupté, comprenez-vous ? »
Néanmoins, comme nous l’avons dit, les amis et maîtres destitués de Hans Castorp étaient encore dans une situation relativement favorable lorsqu’ils pouvaient se chamailler. Ils étaient alors dans leur élément, tandis que l’« homme de grand format » n’y était pas, et encore on pouvait être indécis quant au rôle qu’il jouait dans ces cas. Mais la situation était nettement à leur désavantage lorsqu’il ne s’agissait pas plus longtemps d’esprit, de mots et de spiritus, mais de choses terrestres et pratiques, bref de questions et d’objets qui mettent à l’épreuve les natures de souverain. Alors c’en était fait d’eux, ils s’effaçaient dans l’ombre, devenaient insignifiants, et Peeperkorn tenait le sceptre, déterminait, décidait, commandait, déléguait et ordonnait… Quoi d’étonnant qu’il cherchât à ramener les choses à cet état et à sortir de la logomachie ? Il souffrait aussi longtemps qu’elle régnait, ou tout au moins lorsqu’elle régnait longtemps ; mais il n’en souffrait pas par vanité, Hans Castorp en était certain. La vanité n’a pas d’envergure et la grandeur n’est pas vaniteuse. Non, la soif de réalités palpables qu’avait Peeperkorn tenait à d’autres raisons, à sa « crainte » pour le dire très simplement et très grossièrement, à ce zèle et à ce point d’honneur que Hans Castorp avait invoqués à l’encontre de M. Settembrini et qu’il avait voulu présenter comme un trait en quelque sorte militaire.
– Messieurs, disait le Hollandais en levant sa main de capitaine aux ongles pointus d’un geste impérieux de conjuration. Bien, Messieurs, parfait, remarquable. L’ascétisme, l’indulgence, la volupté… Je voudrais… Absolument ! Très important. Très discutable. Mais permettez-moi, je crains que nous ne nous rendions coupables d’un grave… Nous nous dérobons, Messieurs, nous nous dérobons d’une manière injustifiable aux plus sacrés…
Il respira profondément.
« Cet air, Messieurs, cet air annonciateur du Fœhn que nous respirons aujourd’hui, pénétré d’un délicat arôme printanier, tout chargé de pressentiments et de souvenirs, nous ne devrions pas l’aspirer pour l’expirer sous forme de… Je vous en prie instamment : nous ne devrions pas faire cela. C’est une offense. C’est à lui seul que nous devrions vouer notre entière et complète… Classé, Mesdames et Messieurs. Et que ce ne soit que pour célébrer dignement ses vertus, nous devrions, de cette poitrine… Je m’interromps, Mesdames et Messieurs. Je m’interromps en l’honneur de ce… » Il était resté debout, resté en arrière, projetant l’ombre de son chapeau sur ses yeux, et tous suivirent son exemple. « J’attire, dit-il, votre attention vers cette altitude, vers cette grande altitude, sur ce point noir et tournoyant là-haut, au-dessus de ce bleu extraordinaire qui tourne au noir… C’est un oiseau de proie, un grand oiseau de proie. C’est, si tout ne me… Messieurs, et vous, mon enfant, c’est un aigle. J’attire décidément votre attention sur lui. Voyez-vous ! Ce n’est ni une buse ni un vautour. Si vous étiez aussi presbyte que je le deviens à mesure que j’avance en… Oui, certainement, mon enfant, à mesure que j’avance en… Oui, certainement, mon enfant, à mesure que j’avance. Mes cheveux sont blancs, certainement. Vous verriez aussi nettement que moi la forme arrondie des ailes. Un aigle, Mesdames et Messieurs, un aigle impérial. Il tourne au-dessus de nous, dans le bleu, il plane sans un coup d’ailes à une altitude grandiose, et de ses yeux puissants et perçants, sous les orbites saillantes, il guette certainement… L’aigle, Mesdames et Messieurs, l’oiseau de Jupiter, le roi de son espèce, le lion des airs ! Il a un vêtement de plumes et un bec en acier qui n’est durement recourbé qu’à sa pointe ; il a des serres d’une force inouïe, des griffes repliées vers l’intérieur, celles de devant forment une ceinture de fer avec celles de derrière, plus longues. Regardez, comme ceci ! » Et de sa main de capitaine aux ongles pointus il tenta de représenter les serres de l’aigle. « Compère, que tournes-tu et guettes-tu là ? se retourna-t-il vers l’oiseau. Fonce, crève-lui la tête et les yeux de ton bec d’acier, déchire-lui le ventre, à la créature que Dieu… Parfait ! Classé. Il faut que tes serres s’embrouillent dans les intestins et que ton bec dégoutte de sang. »
Il était dans l’enthousiasme, – et c’en était fait de l’intérêt des promeneurs pour les antinomies de Naphta et de Settembrini. Du reste, l’apparition de l’aigle, sans que l’on eût besoin d’en parler, continua d’influencer les décisions et les initiatives qui suivirent, sous la direction de Mynheer. On rentra, on but et on mangea, à une heure tout à fait indue, mais avec un appétit qu’excitait secrètement le souvenir de l’aigle. On se régala et l’on fit ripaille, comme on faisait souvent même en dehors du Berghof, sur l’instigation de Mynheer partout où cela se trouvait, à Platz, à Dorf, dans une auberge de Glaris ou de Kloster, où l’on se rendait par le petit train, en excursion. On consommait les dons classiques de la vie sous les ordres de Peeperkorn, du café à la crème avec du pain de campagne ou du fromage succulent, accompagné d’un exquis beurre des Alpes, avec des marrons chauds et du vin rouge de la Valteline à volonté. Et Peeperkorn accompagnait ces repas improvisés de paroles incohérentes avec grandeur, ou invitait Antoine Carlovitch Ferge à parler, ce brave martyr à qui tous les sujets élevés étaient étrangers, mais qui savait parler très pertinemment de la fabrication des caoutchoucs russes : on mélangeait à la masse de caoutchouc du soufre et d’autres matières, et les chaussures finies étaient « vulcanisées » à une température de plus de cent degrés. Il parla aussi du cercle polaire, car ses voyages d’affaires l’avaient conduit plusieurs fois jusque dans les régions arctiques ; du soleil de minuit et de l’hiver éternel au Cap Nord. Là-bas, proférait-il de son gosier noueux et de dessous sa moustache tombante, le paquebot lui avait semblé minuscule en comparaison des rochers formidables et de la nappe gris d’acier de la mer. Et des zones de lumière jaune étaient apparues au ciel, cela avait été l’aurore boréale. Et tout lui avait semblé une fantasmagorie, à lui, Antoine Carlovitch, tout le paysage, et lui-même.
Voici pour M. Ferge, le seul dans cette petite compagnie qui fût tout à fait étranger aux rapports réciproques entre ses compagnons. Mais en ce qui touche précisément ces rapports il y a lieu de relater deux brefs entretiens, deux conversations bizarres, en tête à tête, qu’eut en ce temps notre peu héroïque héros avec Clawdia Chauchat et avec son compagnon de voyage. Avec chacun en particulier, l’une dans le hall, après dîner, tandis que le « gêneur » était en proie à la fièvre, l’autre une après-midi, au chevet de Mynheer.
Le hall, ce soir-là, était plongé dans la pénombre. La réunion ordinaire avait été brève et sans entrain, les pensionnaires s’étaient retirés de bonne heure dans leurs loges de balcon pour la cure du soir, pour autant qu’ils ne faisaient pas l’école buissonnière en dansant ou en jouant, là-bas, dans le monde extérieur. Une seule lampe brûlait quelque part, au plafond de la pièce morte, et les salons voisins n’étaient guère mieux éclairés. Mais Hans Castorp savait que Mme Chauchat, qui avait pris son dîner sans son maître, n’était pas encore remontée au premier, qu’elle était restée seule au salon de lecture et de correspondance, et c’est pourquoi lui aussi avait tardé à monter. Il était resté assis plus au fond du hall, pourtour surélevé par une marche plate et séparé de la partie centrale par quelques piliers blancs revêtus de bois. Il était assis devant la cheminée de faïence, dans un fauteuil à bascule semblable à celui où Maroussia s’était balancée le soir où Joachim avait eu avec elle son unique entretien, et fumait une cigarette comme c’était admis tout au moins à cette heure-là.
Elle vint, il entendit ses pas, le frou-frou de sa robe derrière lui, elle était à côté de lui, s’éventait avec une lettre qu’elle tenait par un coin de l’enveloppe, et dit de sa voix de Pribislav :
– Le concierge est parti. Donnez-moi donc un timbre-poste.
Elle portait ce soir une robe de soie foncée et légère, une robe au décolleté rond et aux manches bouffantes qui se boutonnaient étroitement autour des poignets. Il aimait cela. Elle s’était parée de son collier de perles, qui scintillait d’un éclat pâle dans la pénombre. Il leva les yeux vers le visage de Tartare. Il répéta :
– Timbre ? Je n’en ai pas.
– Comment, pas ? Tant pis pour vous. Vous n’êtes pas en mesure de rendre service à une femme ?
Elle serra les lèvres et haussa les épaules.
« Cela me déçoit. Je vous croyais au moins soigneux et consciencieux. Je m’étais figurée que vous aviez dans un compartiment de votre portefeuille de petits assortiments de timbres rangés par espèces. »
– Non. Pour quoi faire ? dit-il. Je n’écris jamais de lettres. À qui en écrirais-je ? Très rarement, une carte postale, que j’achète tout affranchie. À qui écrirais-je des lettres ? Je n’ai personne. Je n’ai plus du tout de rapports avec le pays plat, j’ai perdu le contact. Nous avons dans notre chansonnier populaire une chanson qui dit : « Je suis perdu pour le monde ». C’est mon cas.
– Eh bien, alors, donnez-moi tout au moins une cigarette, homme perdu, dit-elle en s’asseyant en face de lui, près de la cheminée, sur le banc recouvert d’un coussin de toile, en croisant les jambes et en étendant la main. « De cela, au moins, vous devez être pourvu. » Et, négligemment, sans le remercier, elle prit une cigarette dans l’étui d’argent qu’il lui tendait et l’alluma au briquet qu’il fit jouer devant sa figure penchée en avant. Ce paresseux « donnez donc ! » et le fait d’accepter sans remercier trahissaient la nonchalance de la femme gâtée ; il prenait en outre le sens d’une communauté humaine, ou plus exactement « humai-ai-ne », d’une simplicité toute naturelle, à la fois sauvage et douce, à prendre et à donner. Il critiqua ce geste avec une amoureuse sollicitude, puis il dit :
– Oui, toujours ! En effet de cela tout au moins je suis toujours pourvu. Comment s’en passerait-on ici ? N’est-ce pas ? On appelle cela une passion si on dit des choses pareilles. Je dois vous avouer franchement que je ne suis pas du tout un homme passionné, mais j’ai des passions, des passions flegmatiques.
– Cela me rassure au plus haut degré, dit-elle, soufflant tout en parlant la fumée qu’elle avait aspirée, d’apprendre que vous n’êtes pas un homme passionné. Du reste, comment le seriez-vous ? Vous ne seriez plus vous-même. La passion, c’est vivre pour l’amour de la vie. Or, il est connu que vous autres vivez pour les sensations que la vie vous donne. La passion, c’est l’oubli de soi. Mais vous n’êtes préoccupé que de vous enrichir. C’est ça. Vous ne vous doutez pas que c’est un abominable égoïsme et que vous apparaîtrez un jour comme un ennemi de l’humanité.
– Allons, allons ! Tout de suite, ennemi de l’humanité ? Que dis-tu là, Clawdia, d’une manière aussi générale ? À quoi de précis et de personnel penses-tu en disant que nous ne nous soucions pas de la vie, mais de nous enrichir ? Vous autres les femmes, vous ne moralisez pas d’habitude dans le vide. Oh ! la morale, tu sais, voilà plutôt un sujet de discussion pour Naphta et Settembrini. Il relève du domaine de la grande confusion. Peut-on savoir si l’on vit pour soi-même ou pour l’amour de la vie ; quelqu’un peut-il le savoir de science certaine ? Je veux dire qu’il n’y a pas de limite précise entre l’un et l’autre. Il y a des sacrifices égoïstes et des égoïsmes dévoués… Je crois qu’il en est ici comme partout dans l’amour. Sans doute est-ce immoral que je ne puisse pas attacher d’importance à ce que tu me dis au sujet de la morale, et que je sois avant tout heureux que nous soyons réunis comme nous ne l’avions été qu’une seule fois jusqu’à présent, et plus jamais depuis que tu es de retour. Et que je puisse te dire combien te vont bien ces manchettes qui serrent tes poignets, et cette soie mince, qui flotte autour de tes bras, – tes bras que je connais…
– Je m’en vais.
– Ne t’en va pas, je t’en prie. Je tiendrai compte des circonstances et des personnalités.
– C’est ce que l’on devrait tout au moins pouvoir attendre d’un homme sans passion.
– Oui, tu vois… Tu te moques et tu me grondes lorsque je… Et tu veux partir quand…
– Vous êtes prié de parler d’une manière moins décousue si vous désirez être compris.
– Tu ne me laisseras donc pas bénéficier d’un peu de ton habileté à compléter les phrases inachevées ? C’est injuste, dirais-je, si je ne comprenais pas qu’ici la justice n’a rien à voir.
– Oh non, la justice est une passion flegmatique, à la différence de la jalousie, par laquelle les gens flegmatiques se ridiculisent à coup sûr.
– Vois-tu ! Ridicule ! Accorde-moi donc mon flegme. Je te le répète : comment me tirerais-je d’affaire sans lui ? Comment aurais-je par exemple supporté d’attendre ?
– Comment ?
– De t’attendre.
– Voyons, mon ami. Je ne vais pas relever la forme sous laquelle avec un entêtement un peu fou vous vous adressez à moi. Vous finirez bien par vous en fatiguer. Et, en somme, je ne suis pas d’une pruderie de bourgeoise susceptible.
– Non, car tu es malade. La maladie te donne toute liberté. Elle te rend… halte ! il me vient à l’esprit un mot dont je ne me suis jamais servi. Elle te rend géniale.
– Nous parlerons une autre fois de génie. Ce n’est pas ce que je voulais dire. Je demande une chose. Vous n’essaierez pas de prétendre que je sois pour rien dans votre attente – si vraiment vous avez attendu – que je vous y aie encouragé, que je vous y aie même autorisé… Vous allez me certifier immédiatement et expressément que c’est bien le contraire…
– Mais volontiers, Clawdia, certainement. Tu ne m’as pas engagé à attendre. J’ai attendu spontanément. Je comprends parfaitement que tu attaches de l’importance à cela…
– Même vos concessions ont quelque chose d’impertinent. D’ailleurs, vous êtes un homme impertinent, Dieu sait comment cela se fait. Non seulement dans vos rapports avec moi, mais aussi en d’autres circonstances. Même votre admiration, votre subordination a quelque chose d’impertinent. Croyez-vous que je ne le voie pas ? Je ne devrais même pas du tout vous parler à cause de cela, et aussi parce que vous avez la hardiesse de parler d’attente. Il est injustifiable que vous soyez encore ici. Depuis longtemps vous devriez de nouveau être à votre travail, sur le chantier, ou je ne sais où…
– À présent tu parles sans génie et selon les conventions, Clawdia. Du reste, ce n’est qu’une manière de parler. Pas plus que Settembrini, tu ne peux le penser. Vous dites cela, je ne peux pas le prendre au sérieux. Je ne partirai pas en coup de tête comme mon pauvre cousin qui, ainsi que tu l’avais prédit, est mort après avoir essayé de faire son service en pays plat, et qui le savait bien lui-même qu’il mourrait, mais qui a préféré mourir plutôt que continuer ici le service de la cure. Bon, il n’était pas soldat pour rien. Mais je ne suis pas soldat, moi. Je suis un civil, pour moi ce serait déserter que faire comme lui et vouloir à tout prix, malgré l’interdiction de Rhadamante, servir en pays plat le progrès et faire besogne utile. Ce serait la plus grande ingratitude et la plus grande infidélité envers la maladie et le génie, et envers mon amour pour toi, dont je porte les cicatrices anciennes et les blessures récentes, et envers tes bras que je connais, encore que je concède que je ne les ai connus qu’en rêve, au cours d’un rêve génial, de sorte qu’il n’en résulte, bien entendu, pour toi aucune conséquence, aucune obligation, ni aucune limitation de ta liberté…
Elle rit, la cigarette aux lèvres, ses yeux tartares se plissèrent, et appuyée contre la boiserie, les mains posées sur le banc, et une jambe croisée sur l’autre, elle balança son pied dans le soulier de vernis noir.
– Quelle générosité ! Oh là là, vraiment. C’est exactement comme ceci que je me suis toujours représenté un homme de génie, mon pauvre petit !
– Laisse donc, Clawdia. Naturellement, de par mon origine, je suis aussi peu un homme de génie qu’un homme de grand format ; bon Dieu, c’est bien clair. Mais c’est par le hasard, – j’appelle cela : le hasard – que j’ai été transporté si haut, dans ces régions géniales… Bref, tu ignores, sans doute, qu’il existe quelque chose comme la pédagogie alchimico-hermétique, la transsubstantiation en une espèce supérieure, la sublimation par conséquent, si tu veux bien me comprendre. Mais naturellement un corps qui se montre capable d’un tel développement devait quand même avoir, pour commencer, quelques qualités propres. Et ce que j’avais en moi, c’est, – je le sais exactement, – que depuis longtemps j’étais familiarisé avec la maladie et avec la mort et que, tout enfant encore, j’ai eu la folie de t’emprunter un crayon, tout comme ici, la nuit de Carnaval. Mais l’amour déraisonnable, est génial, car la mort, tu sais, est le principe génial, la res bina, le lapis philosophorum[19], et c’est aussi le principe pédagogique, car l’amour pour ce principe conduit à l’amour de la vie et de l’homme. C’est ainsi ; je l’ai découvert dans ma loge de balcon et je suis enchanté de pouvoir te le dire. Il y a deux routes qui mènent à la vie. L’une est la route ordinaire, directe et honnête. L’autre est dangereuse, elle prend le chemin de la mort, et c’est la route géniale.
– Tu es un philosophe détraqué, dit-elle. Je ne veux pas prétendre que je comprenne tout dans tes drôles de pensées allemandes, mais cela semble humai-ain, ce que tu dis, et tu es certainement un bon garçon. D’ailleurs tu t’es réellement conduit en philosophe, il faut te laisser cela.
– Trop en philosophe, à ton goût, Clawdia, n’est-ce pas ?
– Laisse les impertinences ! Cela devient ennuyeux. C’était stupide d’attendre et je ne t’y avais pas autorisé. Mais tu ne m’en veux pas d’avoir attendu inutilement ?
– C’était un peu dur, tu sais, Clawdia, même pour un homme aux passions flegmatiques. Dur pour moi, et dur de ta part, d’être revenue ensemble avec lui, car naturellement tu savais par Behrens que j’étais ici et que je t’attendais. Mais ne t’ai-je pas dit que je considérais notre nuit comme une nuit de rêve, et que je te reconnaissais toute ta liberté ? Finalement, je n’ai pas attendu en vain, car tu es de nouveau ici, nous sommes assis l’un près de l’autre comme autrefois, j’entends ta voix merveilleusement aiguë et depuis si longtemps familière à mon oreille, et sous cette soie flottante sont tes bras que je connais, bien que ton compagnon de voyage repose là-haut, en proie à la fièvre, le grand Peeperkorn qui t’a donné ces perles…
– Et avec lequel tu t’entends si bien pour l’enrichissement de ta personnalité :
– Tu ne dois pas m’en vouloir, Clawdia. Settembrini m’a grondé pour la même raison, mais ce n’est qu’un préjugé mondain. Je gagne à fréquenter cet homme : c’est une personnalité. Il est vrai qu’il est âgé. Je comprendrais néanmoins que, comme femme, tu l’aimasses infiniment. Tu l’aimes donc beaucoup ?
– Tout hommage rendu à ta philosophie, mon petit Hans allemand, dit-elle en lui caressant les cheveux, je ne trouve pas humain de te parler de mon amour pour lui !
– Mais Clawdia, pourquoi pas ? Je crois que l’humanité commence là où les gens sans génie se figurent qu’elle s’arrête. Parlons donc tranquillement de lui. Tu l’aimes passionnément ?
Elle se pencha en avant pour jeter le bout de sa cigarette de côté, dans la cheminée, et demeura assise, les bras croisés.
– Il m’aime, dit-elle, et son amour me rend fière et reconnaissante et dévouée à lui. Tu dois comprendre cela, ou bien tu ne serais pas digne de l’amitié qu’il t’accorde… Son sentiment m’a forcée à le suivre et à le servir. Comment en serait-il autrement ? Juge toi-même ! Crois-tu possible de résister à son sentiment ?
– C’est impossible, confirma Hans Castorp. Non, bien entendu, c’est absolument impossible. Comment une femme réussirait-elle à passer outre à son sentiment, à son angoisse de sentir, à l’abandonner en quelque sorte à Gethsémané ?…
– Tu n’es pas bête, dit-elle, et ses yeux bridés prirent un aspect fixe et songeur. Tu es intelligent. L’angoisse de sentir…
– Il ne faut pas beaucoup d’intelligence pour se rendre compte que tu dois le suivre, quoique son amour ait quelque chose d’angoissant, ou, plus exactement, parce qu’il doit avoir quelque chose d’angoissant.
– C’est exact… Angoissant. On a beaucoup de soucis avec lui, beaucoup de difficultés…
Elle avait pris sa main et jouait inconsciemment avec ses phalanges, mais elle leva subitement les yeux en fronçant les sourcils, et demanda :
– Halte ! N’est-il pas vil de parler de lui comme nous le faisons ?
– Certes, non, Clawdia. Non, loin de là ! Ce n’est bien certainement qu’humain. Tu aimes ce mot, tu le prononces avec un accent entraînant, je l’ai toujours entendu avec intérêt dans ta bouche. Mon cousin Joachim ne l’aimait pas pour des raisons militaires. Il disait que ce mot signifiait indolence, laisser-aller, et si on l’interprète ainsi, comme un guazzabuglio de tolérance sans bornes, j’aurais moi-même quelques objections à formuler, je le reconnais. Mais lorsqu’il a le sens de liberté, de génie et de bonté, c’est une grande chose, que nous pouvons tranquillement invoquer pour la défense de notre conversation sur Peeperkorn et sur les soucis et difficultés qu’il te cause. Elles résultent naturellement de son point d’honneur, de sa peur de ne pas suffire au sentiment, qui lui fait aimer à ce point les sources classiques de la vie et tout ce qui délecte, nous pouvons en parler en tout respect, car tout chez lui est de grand format, d’un format grandiose et royal ; et nous ne nous abaissons pas, ni ne l’abaissons, en parlant de cela humainement.
– Il ne s’agit pas de nous, dit-elle. Elle avait de nouveau croisé les bras. Ce ne serait pas être femme, si, pour l’amour d’un homme, pour l’amour d’un homme de grand format, comme tu dis, et qui nous porte un sentiment allant jusqu’à l’angoisse, on n’acceptait même pas de s’abaisser.
– Absolument, Clawdia. Très juste. L’humiliation, elle aussi, finit par avoir du format, et la femme peut parler du haut de son humilité à ceux qui n’ont pas de format royal avec autant de dédain que tu l’as fait tout à l’heure à propos des timbres-poste, sur le ton sur lequel tu as dit : « Vous devriez tout au moins être soigneux et consciencieux. »
– Tu est susceptible. Laissons cela. Nous allons envoyer au diable la susceptibilité. Es-tu d’accord ? Moi aussi, je me suis quelquefois montrée susceptible, je veux bien l’admettre puisque ce soir nous sommes assis ici, l’un près de l’autre. Je me suis irritée de ton flegme, et de ce que tu t’entendais si bien avec lui, pour l’amour de ton expérience égoïste de la vie. Et, pourtant, cela m’a fait plaisir, et je t’ai été reconnaissante de ce que tu lui aies témoigné du respect… Il y avait beaucoup de loyauté dans ta conduite, et bien qu’elle s’accompagnât d’un peu d’impertinence, j’ai dû, en définitive, t’en tenir compte.
– Voilà qui est très gentil de ta part.
Elle le regarda.
– Il semble que tu sois incorrigible. Je vais te le dire : tu es un malin. Je ne sais pas si tu as de l’esprit. Mais tu es certainement plein de malice. Bon, du reste, on peut s’en accommoder. On peut même avoir de l’amitié pour toi. Veux-tu que nous soyons bons amis et que nous formions une alliance pour lui, comme on conclut parfois des alliances contre quelqu’un. Me donnes-tu la main là-dessus ? J’ai souvent peur… J’ai parfois peur d’être seule, de me sentir intérieurement seule, tu sais… Il est angoissant… J’ai parfois peur qu’il ne finisse mal… J’en frémis quelquefois… J’aimerais tant avoir un homme bon auprès de moi… Enfin, si tu veux le savoir, c’est peut-être pour cela que je suis revenue ici avec lui…
Ils étaient assis, genou contre genou, lui dans le fauteuil à bascule et penché en avant, elle sur la banquette. Elle avait serré la main de Hans Castorp en prononçant ces dernières paroles tout contre son visage. Il dit :
– Auprès de moi ? Oh, comme cela est beau ! Oh, Clawdia, c’est si inattendu. C’est chez moi que tu es venue avec lui ? Et tu prétends que j’ai été sot d’attendre, que je l’ai fait sans permission et inutilement ? Ce serait très maladroit de ma part de ne pas apprécier l’offre de ton amitié, de l’amitié pour lui avec toi…
Alors elle l’embrassa sur la bouche. C’était un baiser russe, de l’espèce de ceux que l’on échange dans ce vaste pays plein d’âme, aux sublimes fêtes chrétiennes, comme une consécration de l’amour. Mais comme c’étaient un jeune homme notoirement « malin » et une jeune femme ravissante, au pas glissant, qui l’échangeaient, cela nous fait penser malgré nous à la manière si adroite, mais un tantinet équivoque, dont le docteur Krokovski parlait de l’amour, dans un esprit légèrement vacillant, de sorte que personne n’avait jamais su avec certitude si c’était un sentiment pieux, ou quelque chose de charnel et de passionné. L’imitons-nous, ou Hans Castorp et Clawdia Chauchat l’imitaient-ils dans leur baiser russe ? Mais que dirait le lecteur, si nous nous refusions tout bonnement à aller au fond de cette question ? À notre avis, il serait sans doute de bonne analyse, mais, pour reprendre l’expression de Hans Castorp, « très maladroit » (et ce serait vraiment témoigner peu de sympathie pour la vie), si on voulait distinguer nettement entre la piété et la passion. Que signifie ici « nettement » ? Que veut dire « incertitude » et « équivoque » ? Nous ne cacherons pas que nous nous moquons franchement de ces distinctions. N’est-ce pas bon et grand que la langue ne possède qu’un mot pour tout ce que l’on peut comprendre sous ce mot, depuis le sentiment le plus pieux jusqu’au désir de la chair ? Cette équivoque est donc parfaitement « univoque », car l’amour le plus pieux ne peut être immatériel, ni ne peut manquer de piété. Sous son aspect le plus charnel, il reste toujours lui-même, qu’il soit joie de vivre ou passion suprême, il est la sympathie pour l’organique, l’étreinte touchante et voluptueuse de ce qui est voué à la décomposition. Il y a de la charité jusque dans la passion la plus admirable ou la plus effrayante. Un sens vacillant ? Eh bien, qu’on laisse donc vaciller le sens du mot « amour ». Ce vacillement, c’est la vie et l’humanité, et ce serait faire preuve d’un manque assez désespérant de malice que de s’en inquiéter.
Tandis que les lèvres de Hans Castorp et de Mme Chauchat se rencontrent ainsi dans un baiser russe, nous obscurcissons notre petit théâtre pour passer à un nouveau tableau. Car il va être question de la seconde des deux entrevues dont nous avons promis de rendre compte, et après avoir donné de la lumière, la lumière trouble d’une journée de printemps qui touche à sa fin, à l’époque de la fonte des neiges, nous apercevons notre héros dans une situation devenue pour lui habituelle, assis au chevet du grand Peeperkorn, en conversation respectueuse et amicale avec lui. Après le thé de quatre heures, servi dans la salle à manger, où Mme Chauchat avait paru seule, – comme aussi aux trois précédents repas, – pour entreprendre aussitôt après une course de shopping à Platz, Hans Castorp s’était fait annoncer chez le Hollandais pour une de ces visites au malade dont il avait pris l’habitude, autant pour lui témoigner son attention que pour jouir lui-même de la compagnie de sa personnalité, bref pour des raisons aussi incertaines que vivantes. Peeperkorn déposa le Telegraaf, jeta son lorgnon d’écaille sur le journal après qu’il l’eût enlevé de son nez en le tenant par l’étrier, et tendit au visiteur sa main de capitaine, cependant que ses larges lèvres déchirées se mouvaient confusément avec une expression douloureuse. Comme d’habitude, il y avait à sa portée du vin rouge et du café. Le service à café était posé sur la chaise, tachée de brun par l’usage qu’on en avait fait : Mynheer avait pris son café de l’après-midi, fort et chaud, avec du sucre et de la crème, et il transpirait. Sa figure, entourée de mèches blanches, avait rougi, et de petites gouttes perlaient à son front et au-dessus de la lèvre supérieure.
– Je transpire un peu, dit-il. Soyez le bienvenu, jeune homme ! Au contraire. Prenez place. C’est un signe de faiblesse, lorsque, aussitôt après avoir absorbé une boisson chaude… Voulez-vous me… Précisément. Le mouchoir. Merci beaucoup.
D’ailleurs, la rougeur de son visage cédait peu à peu et faisait place à la pâleur jaunâtre qui couvrait d’ordinaire le visage de l’homme magnifique après un accès de fièvre. La fièvre quarte avait été forte cette après-midi, dans les trois phases, la phase froide, la phase brûlante et la phase humide, et les petits yeux pâles de Peeperkorn avaient un regard fatigué sous l’arabesque de son front d’idole. Il dit :
– C’est… absolument, jeune homme… Le mot « appréciable » me semble… Absolument. C’est très aimable à vous de ne pas oublier un vieillard malade et de lui…
– Rendre visite ? demanda Hans Castorp… En aucune façon, Mynheer Peeperkorn. C’est moi qui dois vous témoigner ma reconnaissance de pouvoir m’asseoir un instant auprès de vous, j’en tire infiniment plus de profit que vous, je viens pour des raisons purement égoïstes. Mais quelle qualification singulière et inexacte de votre personne : « Un vieillard malade. » Personne ne pourrait deviner qu’il s’agît de vous. N’est-ce pas une image tout à fait fausse ?
– Bien, bien, répondit Mynheer, et il ferma pour quelques instants les yeux, sa tête majestueuse reposant sur le coussin, le menton levé, ses doigts aux longs ongles joints sur sa large poitrine royale qui se dessinait sous la chemise de tricot. C’est bien, jeune homme, ou plutôt, vous avez de bonnes intentions, j’en suis persuadé. C’était agréable hier après-midi. Oui, hier après-midi encore, en ce lieu hospitalier – j’ai oublié son nom – où nous avons mangé de cette délicieuse mortadelle avec des œufs brouillés et ce bon petit vin du pays…
– C’était magnifique, confirma Hans Castorp. Nous y avons pris un plaisir presque défendu, le chef du Berghof aurait été ulcéré s’il nous avait vus. Bref, nous étions sans exception tout à fait en train. C’était de la mortadelle authentique ; M. Settembrini en était touché, il l’a mangée, les yeux pour ainsi dire humides. Car c’est un patriote, comme vous devez le savoir, un patriote démocrate. Il a consacré sa hallebarde de citoyen sur l’autel de l’humanité, pour que la mortadelle ne paye pas de douane à l’avenir à la frontière du Brenner.
– C’est sans importance, déclara Peeperkorn. Il est un homme chevaleresque, gai et loquace, un cavalier, quoiqu’il n’ait pas souvent l’avantage de changer de costume.
– Il n’en change jamais, dit Hans Castorp. Il n’a jamais cet avantage. Je le connais depuis longtemps et nous sommes liés d’une vieille amitié, c’est-à-dire qu’il s’est intéressé à moi d’une manière dont je lui sais gré, parce qu’il a estimé que j’étais un « enfant gâté de la vie » – c’est une expression dont nous nous servons et dont le sens n’est pas très évident – et qu’il s’efforce d’exercer sur mes défauts une influence profitable. Mais jamais je ne l’ai vu dans d’autres atours, été comme hiver, que dans ces pantalons à carreaux et dans cette redingote râpée. D’ailleurs, il porte ses vieux habits avec une correction remarquable, tout à fait en homme distingué, je vous donne absolument raison sur ce point. C’est un triomphe sur la pauvreté que la manière dont il porte ses vêtements, et quant à moi, je préfère cette pauvreté à l’élégance du petit Naphta qui ne m’a jamais semblé très catholique. C’est même une élégance du diable, et ses ressources sont d’origine ténébreuse, je suis quelque peu renseigné sur sa situation.
– Un homme distingué, répéta Peeperkorn, sans s’arrêter à la remarque sur Naphta, quoiqu’il ne soit pas – permettez-moi cette réserve – tout à fait sans préjugés. Madame, ma compagne de voyage, ne l’apprécie pas particulièrement, comme vous avez dû, probablement, vous en apercevoir. Elle s’exprime sur son compte sans sympathie, vraisemblablement parce que l’attitude qu’il a envers elle suppose certains préjugés. Pas un mot, jeune homme. Je suis loin, en ce qui concerne M. Settembrini et vos sentiments d’amitié à son égard, de vouloir… Classé ! Je ne songe pas à prétendre qu’il ait jamais sous le rapport de la courtoisie qu’un cavalier doit à une femme… Parfait, cher ami, absolument sans reproche. Mais il y a quand même une limite, une réserve, une certaine ré-cu-sa-tion, qui rend l’humeur de Madame, humainement parlant, très…
– Compréhensible. Qui la rend intelligible. Qui la justifie pleinement. Excusez-moi, Mynheer Peeperkorn, de terminer moi-même votre phrase. Je puis m’y risquer parce que j’ai conscience d’être parfaitement d’accord avec vous. Surtout si l’on considère combien les femmes – vous allez sourire de m’entendre parler à mon âge d’une manière aussi générale des femmes – combien, dans l’attitude qu’elles ont à l’égard de l’homme, elles dépendent de l’attitude que l’homme a envers elles ; et il n’y a là rien d’étonnant. Les femmes, c’est ainsi que je voudrais formuler cette pensée, sont des créatures qui réagissent, sans initiative propre, nonchalantes, au sens de passivité… Laissez-moi, s’il vous plaît, vous développer ce point de vue d’une manière un peu plus complète. La femme, autant que j’aie pu m’en rendre compte, se considère dans les affaires amoureuses, en premier lieu comme un objet ; elle se laisse approcher, elle ne choisit pas librement, elle ne devient le sujet de l’amour, le sujet qui choisit qu’après que l’homme a fait son choix, et même à ce moment-là, permettez-moi d’ajouter cela, son libre arbitre – en admettant qu’il ne s’agisse pas d’un cœur par trop déshérité, mais ceci même ne peut passer pour une condition absolue – son libre arbitre donc est très limité et diminué par le fait qu’elle-même a été choisie. Mon Dieu, ce doivent être des lieux communs que je débite là, mais lorsqu’on est jeune, tout vous paraît naturellement nouveau, très nouveau et étonnant. Vous demandez à une femme : « L’aimes-tu donc ? » « Il m’aime tant ! », répond-elle en levant ou en baissant les yeux. Figurez-vous une réponse pareille dans la bouche de l’un de nous. (Excusez-moi de nous mettre ainsi sur le même plan.) Peut-être y a-t-il des hommes qui devraient répondre ainsi, mais ne sont-ils pas nettement ridicules, des jocrisses de l’amour, pour m’exprimer d’une manière épigrammatique. Je voudrais savoir quel cas la femme fait d’elle-même lorsqu’elle répond ainsi. Estime-t-elle qu’elle doit à l’homme un dévouement sans bornes, à l’homme qui accorde à une créature aussi inférieure la grâce de son amour, ou voit-elle, dans l’amour que l’homme a pour sa personne, un signe infaillible de sa perfection ? Je me suis parfois demandé cela en passant, durant mes heures de repos.
– Vérités éternelles, faits classiques ; vous touchez, jeune homme, par votre petite parole adroite, à des sentiments sacrés, répondit Peeperkorn. L’homme se grise de son désir, la femme demande et attend d’être grisée par le désir de l’homme. De là provient pour nous l’obligation au sentiment ; de là l’effroyable honte de l’insensibilité, de l’impuissance à éveiller le désir de la femme. Prenez-vous un verre de vin rouge avec moi ? Je bois. J’ai soif. La dépense d’humidité a été considérable aujourd’hui.
– Je vous remercie beaucoup, Mynheer Peeperkorn. Il est vrai que ce n’est pas mon heure ; mais je boirai volontiers une gorgée à votre santé.
– Eh bien ! prenez le verre, il n’y en a qu’un. Je me servirai du gobelet. Je pense que ce n’est pas offenser ce petit vin pétillant que de le boire dans un récipient aussi humble.
Il versa, aidé par son visiteur, d’une main légèrement tremblante de capitaine, et, altéré, vida le vin rouge de son verre sans pied dans son gosier de statue, exactement comme si ç’avait été de l’eau claire.
– Voilà qui délecte, dit-il. Vous ne buvez plus ? Alors, permettez que je me serve encore une fois… Il répandit un peu de vin en se servant pour la seconde fois. Le drap qui était rabattu sur sa couverture fut taché de rouge. « Je répète, dit-il, le doigt levé, tandis que le verre de vin tremblait dans son autre main, je répète : c’est pourquoi nous avons l’obligation religieuse de sentir. Notre sensibilité, comprenez-vous, est la force virile qui éveille la vie. La vie somnole. Elle veut être éveillée pour les noces ivres avec le sentiment divin. Car le sentiment, jeune homme, est divin. L’homme est divin dans la mesure où il est sensible. Il est la sensibilité de Dieu. Dieu l’a créé pour sentir à travers lui. L’homme n’est rien que l’organe par lequel Dieu accomplit ses noces avec la vie réveillée et enivrée. S’il manque à la sensibilité, il manque à Dieu, c’est la défaite de la force virile de Dieu, c’est une catastrophe cosmique, une terreur inimaginable… »
Il vida son verre.
– Permettez que je vous débarrasse de votre verre, Mynheer Peeperkorn, dit Hans Castorp. Je suis votre raisonnement pour mon plus grand profit. Vous développez là une théorie théologique par laquelle vous attribuez à l’homme une fonction religieuse très honorable, encore que peut-être quelque peu unilatérale. Il y a, si vous me permettez d’en faire la remarque, dans votre manière de voir un rigorisme qui est assez angoissant, pardonnez-moi ! Toute austérité religieuse est naturellement angoissante pour des gens d’un format plus modeste. Je ne songe pas à vous reprendre, mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit de certains « préjugés » que, d’après vos observations, M. Settembrini opposerait à Madame votre compagne de voyage. Il y a longtemps que je connais M. Settembrini, il y a fort longtemps, depuis des jours et des années. Et je puis vous assurer que ses préjugés, pour autant qu’ils existent réellement, n’ont nullement un caractère mesquin et petit-bourgeois. Il serait ridicule de penser pareille chose. Il ne peut s’agir là que de préjugés de grand style, et par conséquent d’un caractère impersonnel, de principes pédagogiques généraux au sujet desquels M. Settembrini, pour vous l’avouer ouvertement, m’a, en ma qualité d’« enfant gâté de la vie »… Mais ceci nous entraînerait trop loin. C’est une question par trop vaste que je ne pourrais résumer en deux mots…
– Et vous aimez Madame ? demanda tout à coup Mynheer ; et il tourna vers son visiteur son visage royal, à la bouche plaintivement déchirée et aux petits yeux pâles, sous l’arabesque des plis du front… Hans Castorp eut peur. Il balbutia :
– Si je… C’est-à-dire… Je respecte naturellement Mme Chauchat déjà en sa qualité de…
– Je vous en prie, dit Peeperkorn en étendant sa main comme pour refouler, de son geste, la réponse de Castorp. Laissez-moi, poursuivit-il après avoir fait de la place pour ce qu’il avait à dire, laissez-moi répéter que je suis loin de reprocher à ce monsieur italien d’avoir jamais manqué aux règles de la courtoisie. Je n’élève ce reproche contre personne, contre personne. Mais une chose me frappe… En ce moment, je me réjouis plutôt… Bien, jeune homme. C’est tout à fait bel et bien. Je m’en réjouis, cela ne fait aucun doute, cela m’est véritablement agréable. Et pourtant je me dis… Bref, je me dis : Vous connaissez Madame depuis plus longtemps que moi. Vous avez déjà partagé son précédent séjour en ce lieu. De plus, c’est une femme pleine de charmes et je ne suis qu’un vieillard malade. Comment se fait-il… Comme je suis souffrant, elle est descendue cette après-midi seule et sans compagnon, pour faire des achats en bas, au village. Ce n’est pas un malheur. Non, certainement pas. Mais il n’est pas douteux que… Dois-je expliquer par l’influence – comment disiez-vous tout à l’heure ? – des principes pédagogiques de signore Settembrini que vous n’ayez pas suivi l’élan chevaleresque… Je vous prie de bien m’entendre. Littéralement…
– Littéralement, Mynheer Peeperkorn. Oh non ! mais pas du tout. J’agis absolument de mon propre chef. Au contraire, M. Settembrini, à l’occasion, s’est même… Je vois ici des taches de vin sur votre drap, Mynheer Peeperkorn. Ne devrait-on pas… ? Nous avions coutume de jeter du sel dessus lorsqu’elles étaient fraîches…
– C’est sans importance, dit Peeperkorn sans détourner les yeux de son visiteur.
Hans Castorp pâlit.
– Il en va, dit-il avec un sourire forcé, tout de même un peu autrement que d’habitude. L’esprit qui règne ici, voudrais-je dire, n’est pas un esprit conventionnel. C’est le malade, homme ou femme, qui a la priorité. Les préceptes de la galanterie s’effacent derrière cette règle. Vous êtes passagèrement indisposé, Mynheer Peeperkorn. C’est une indisposition aiguë, une indisposition qui importe. Votre compagne de voyage est relativement bien portante. Je crois donc agir tout à fait dans l’esprit de Madame en la représentant quelque peu auprès de vous durant son absence – pour autant qu’il peut ici être question de représentation, ha ! ha ! – au lieu de vous représenter auprès d’elle et de lui offrir de l’accompagner au village. Et de quel droit imposerais-je à votre compagne de voyage mes offices de cavalier servant ? Je n’ai pour le faire ni titres ni mandat. Je dois dire que j’ai beaucoup de sens pour les situations de droit positives. Bref, je trouve ma situation correcte, elle répond à la situation générale, elle répond notamment aux sentiments sincères que j’éprouve pour votre personne, Mynheer Peeperkorn, et je crois donc avoir donné une réponse satisfaisante à votre question (car c’est sans doute une question que vous m’avez posée).
– Une réponse très agréable, répondit Peeperkorn. Je prête l’oreille avec un plaisir involontaire à vos petits mots agiles, jeune homme. Ils franchissent tous les obstacles et donnent aux choses une forme aimable. Mais satisfaisante ? Non. Votre réponse ne me satisfait pas complètement. Excusez-moi de vous causer par là une déception. « Rigoriste », cher ami, vous vous êtes tout à l’heure servi de ce mot en parlant de certaines conceptions que j’ai formulées. Mais dans vos paroles aussi il y a une certaine rigueur, quelque chose de sévère et de forcé qui ne me semble pas correspondre à votre nature, bien que j’aie déjà fait sur votre conduite des observations analogues. C’est le même air contraint que vous avez à l’égard de Madame pendant nos entreprises et nos promenades communes – et vous ne les avez à l’égard de personne d’autre – et dont vous me devez l’explication ; c’est un devoir, c’est une obligation, jeune homme. Je ne me trompe pas. Mon observation s’est trop souvent confirmée, et il est improbable que d’autres ne l’aient pas faite, avec cette différence que ces autres observateurs possèdent vraisemblablement l’explication du phénomène.
Bien qu’il fût épuisé par la fièvre, Mynheer parlait cet après-midi en un style exceptionnellement précis et serré. Pas la moindre incohérence. Assis sur son séant, les épaules formidables, sa magnifique tête tournée vers son visiteur, il tenait un bras étendu sur la couverture du lit, et sa main de capitaine, tachée de son, qui se dressait au bout de sa manche de laine, formait le cercle que dominaient ses doigts pointus, tandis que sa bouche articulait les mots avec une acuité aussi précise et aussi plastique que M. Settembrini eût pu le souhaiter, en roulant les r, des mots tels que « vraisemblablement » et « observation ».
– Vous souriez, poursuivit-il. Vous détournez la tête de côté et d’autre en clignant des yeux. Vous semblez vous creuser vainement la cervelle, et pourtant, il n’est pas douteux que vous sachiez ce que j’entends dire, et de quoi il s’agit. Je ne prétends pas que vous n’adressiez pas quelquefois la parole à Madame, ou que vous omettiez de lui répondre, lorsque la conversation l’exige. Mais je répète que vous subissez une certaine contrainte, plus exactement que vous vous dérobez, que vous évitez, lorsqu’on y regarde de plus près, une certaine forme. Pour autant que vous entrez en ligne de compte, on a l’impression qu’il s’agit d’un pari, que vous avez partagé une philippine avec Madame et qu’aux termes d’une convention, vous n’avez pas le droit de lui adresser directement la parole. Vous évitez régulièrement et sans exception de vous adresser à elle, vous ne lui dites jamais « vous ».
– Mais Mynheer Peeperkorn… Quelle philippine serait-ce donc ?…
– Permettez-moi d’attirer votre attention sur ce fait dont vous-même avez sans doute pris conscience, à savoir que vous venez de pâlir jusqu’aux lèvres.
Hans Castorp ne leva pas les yeux. Penché en avant, il considérait attentivement la tache rouge sur le drap.
« Il fallait en arriver là, pensait-il. C’est à cela qu’il voulait en venir. Je crois que j’ai moi-même fait tout ce qui dépendait de moi, pour que nous en arrivions là. Dans une certaine mesure, j’ai presque tendu à cela, je m’en rends compte maintenant. Ai-je vraiment pâli à ce point ? C’est bien possible, car à présent il faut que cela plie ou que cela casse. On ne sait pas ce qui va arriver. Puis-je encore mentir ? Ce serait bien possible, mais je ne veux pas. Je m’en tiens provisoirement à cette tache de sang, à cette tache de vin, sur le drap. »
Au-dessus de lui, l’autre se taisait également. Le silence dura deux ou trois minutes, il permit de se rendre compte quelle étendue ces minuscules unités pouvaient prendre en de telles circonstances.
Ce fut Pieter Peeperkorn qui reprit la conversation.
– C’est le soir où j’eus l’avantage de faire votre connaissance, commença-t-il d’une voix chantante, et sa voix tomba comme si ce n’était que la première phrase d’une longue histoire. Nous avions organisé une petite fête, nous avions bu et mangé, et dans un état d’âme réjoui, dans un état de hardiesse et d’abandon humains nous gagnions nos lits bras dessus, bras dessous, à une heure avancée de la nuit. Il arriva alors qu’ici, devant ma porte, en prenant congé, l’idée me vint de vous inviter à effleurer de vos lèvres le front de la femme qui vous avait présenté à moi comme un bon ami d’autrefois, et de lui laisser le soin de répondre sous mes yeux à cet acte, en signe de la festivité de l’heure. Vous repoussâtes sans plus ma suggestion, vous la repoussâtes en disant que vous trouviez absurde d’échanger avec ma compagne de voyage des baisers sur le front. Vous ne contesterez pas que ce fût là une explication qui appelle elle-même une explication, que vous me devez encore aujourd’hui. Êtes-vous disposé à vous acquitter de cette dette ?
« Ah ! tu avais donc également remarqué cela ? » pensa Hans Castorp et il se consacra plus attentivement encore aux taches de vin en grattant l’une d’elles de la pointe recourbée du médius. « Au fond, j’ai en effet désiré ce jour-là que tu t’en aperçusses, sinon je n’aurais pas dit cela. Mais à présent, qu’adviendra-t-il ? Mon cœur bat assez fort. Assisterons-nous à un royal accès de colère de premier ordre ? Sans doute ferais-je bien de m’inquiéter de son poing qui me menace peut-être déjà ? Décidément, je me trouve là dans une situation très singulière et des plus critiques. »
Tout à coup il sentit la main de Peeperkorn saisir son poignet droit.
« À présent il me prend le poignet droit, pensa-t-il. Allons, je suis ridicule, me voilà assis comme un chien mouillé. Me suis-je rendu coupable d’aucune faute envers lui ? Pas le moins du monde. Premièrement, c’est son mari qui a le droit de se plaindre. Et, ensuite, tels autres. Et ensuite, moi. Et lui n’a, que je sache, aucun droit de se plaindre. Pourquoi, dès lors, mon cœur bat-il ? Il est grand temps que je me redresse et que je le regarde franchement, encore que respectueusement, dans sa figure souveraine.
Ainsi fit-il. La face princière était jaune, les yeux jetaient un regard blafard sous les lignes tordues du front, l’expression des lèvres déchirées était amère. Ils lurent l’un dans les yeux de l’autre, le grand vieillard et l’insignifiant jeune homme, tandis que l’un continuait à tenir le poignet de l’autre. Enfin Peeperkorn dit doucement :
– Vous avez été l’amant de Clawdia lors de son précédent séjour ?
Hans Castorp laissa encore une fois tomber la tête, mais la redressa aussitôt et dit après avoir respiré profondément :
– Mynheer Peeperkorn ! Il me déplaît au plus haut point de vous mentir et je m’efforce de l’éviter dans la mesure du possible. Ce n’est pas facile. Je me vanterais si je confirmais votre affirmation, et je mentirais si je la démentais. Voici ce qu’il en est : J’ai vécu longtemps, très longtemps dans cette maison avec Clawdia, pardonnez-moi, avec votre actuelle compagne de voyage, sans lui avoir été présenté. Nos rapports n’avaient rien de mondain, ou tout au moins mes rapports avec elle, dont je veux dire que l’origine est plongée dans l’obscurité. Dans ma pensée, je n’ai jamais appelé Clawdia autrement que tu, et il en a été de même, dans la réalité. Car le soir où je me suis affranchi de certains liens pédagogiques dont il a été brièvement question tout à l’heure et où je me suis approché d’elle, – sous un prétexte que m’avaient inspiré des souvenirs lointains – était un soir de mascarade, un soir de Carnaval, un soir sans responsabilité, un soir où le tutoiement était de mise, et au cours duquel le « tu » a pris tout son sens d’une manière à peine consciente et comme dans un songe. C’était en même temps la veille du départ de Clawdia.
– « Tout son sens », répéta Peeperkorn. Vous avez très gentiment… Il lâcha Hans Castorp et commença à se masser des paumes de ses mains de capitaine aux longs ongles les deux côtés de la figure, les arcades sourcilières, les joues et le menton. Puis il joignit les mains sur le drap taché de vin et inclina la tête de côté, le côté gauche tourné vers son voisin, de sorte qu’on eût dit qu’il se détournait de lui.
– Je vous ai répondu aussi exactement que possible, Mynheer Peeperkorn, dit Hans Castorp, et je me suis efforcé consciencieusement de ne dire ni trop, ni trop peu. Il s’agissait avant tout pour moi de vous faire remarquer que vous êtes en quelque sorte libre de tenir compte ou non de cette soirée vouée au « tu » et au départ, que c’était une soirée située en dehors de tout ordre et presque du calendrier, un hors-d’œuvre pour ainsi dire, une soirée supplémentaire, un soir d’année bissextile, le 29 février, et que je n’aurais fait par conséquent qu’un demi-mensonge si j’avais nié votre constatation.
Peeperkorn ne répondit pas.
– J’ai préféré, reprit Hans Castorp après une pause, j’ai préféré vous dire la vérité, au risque de perdre votre bienveillance, ce qui, à parler tout à fait franchement, eût été pour moi une perte sensible, je puis bien dire : un coup, un rude coup, que l’on pourrait comparer au coup qu’a été pour moi l’arrivée de Mme Chauchat lorsqu’elle ne vint pas seule, mais comme votre compagne de voyage. J’ai couru ce risque parce que c’était depuis longtemps mon désir que tout fût clair entre nous – entre vous, pour qui j’éprouve des sentiments de respect si profond, et moi – cela m’a semblé plus beau et plus humain – vous savez comment Clawdia prononce ce mot avec sa voix si merveilleusement voilée, en l’étirant si délicieusement – que le silence ou la feinte, et à ce point de vue j’ai éprouvé un grand soulagement lorsque, tout à l’heure, vous avez constaté cela.
Pas de réponse.
– Encore une chose, Mynheer Peeperkorn, il y a encore une chose qui m’a fait désirer de pouvoir vous dire la vérité : c’est l’expérience personnelle que j’ai faite d’une incertitude irritante et de demi-suppositions dans ce sens. Vous savez à présent avec qui Clawdia a passé, vécu et accompli – disons accompli – un vingt-neuf février, avant que la situation de droit tout à fait positive se soit établie entre vous, la situation tout à fait positive devant laquelle ce serait pure folie de ne pas s’incliner. Pour ma part, je n’ai jamais pu acquérir une telle certitude, bien qu’il ne m’eût pas échappé que, pour peu que l’on soit amené à envisager de telles choses, on doit somme toute admettre que l’on a pu avoir des prédécesseurs ; et bien que je susse en outre que le conseiller Behrens qui, vous le savez peut-être, fait en amateur de la peinture à l’huile, ait peint d’elle en de nombreuses séances un portrait remarquable, qui rendait le grain de la peau avec une vérité qui, soit dit entre nous, m’a rendu assez perplexe. Cela m’avait donné beaucoup de tourment et d’ennui, et aujourd’hui encore je me creuse la cervelle à ce sujet.
– Vous l’aimez encore ? demanda Peeperkorn, sans changer de position, c’est-à-dire en détournant la tête… La grande chambre plongeait de plus en plus dans la pénombre.
– Excusez-moi, Mynheer Peeperkorn, répondit Hans Castorp, les sentiments que j’éprouve à votre égard, des sentiments de profond respect et d’admiration, me feraient paraître peu séant de vous parler de mes sentiments à l’égard de votre compagne de voyage.
– Et les partage-t-elle ? demanda Peeperkorn à voix basse. Les partage-t-elle aujourd’hui encore ?
– Je ne dis pas, répondit Hans Castorp, je ne dis pas qu’elle les ait jamais partagés. Cela semble peu probable. Nous avons effleuré tout à l’heure ce sujet de manière théorique, lorsque nous avons parlé des réactions de la nature féminine. Il n’y a naturellement pas grand’chose à aimer en moi. Quel format ai-je donc ? Jugez-en vous-même. S’il se produit par hasard un… un… vingt-neuf février, cela tient uniquement au fait que la femme peut se laisser séduire par le choix que l’homme a fait d’elle… Encore voudrais-je ajouter que j’ai l’impression de me vanter et de manquer de goût en parlant de moi comme d’un « homme »… Par contre, Clawdia est certainement une femme.
– Elle a suivi son sentiment, murmura Peeperkorn de ses lèvres déchirées.
– Comme elle l’a fait dans votre cas avec beaucoup plus d’obéissance, dit Hans Castorp, et comme, selon toute vraisemblance, elle l’avait déjà fait dans nombre d’autres cas ; sur ce point il ne saurait y avoir de doute pour quiconque est placé dans cette situation…
– Halte, dit Peeperkorn, toujours encore détourné, mais avec un geste du plat de la main vers son interlocuteur. Ne serait-il pas vil de parler ainsi d’elle ?
– Je ne pense pas, Mynheer Peeperkorn. Non, je crois pouvoir vous rassurer complètement. Ne parlons-nous pas de choses humaines – en prenant le mot « humain » au sens de liberté et de « génialité » – excusez ce mot un peu recherché, mais je me le suis récemment approprié parce que j’en ai eu besoin.
– Bien, continuons, ordonna Peeperkorn avec douceur.
Hans Castorp, lui aussi, parla doucement, assis sur le bord de sa chaise, contre le lit, penché vers le royal vieillard, les mains entre ses genoux.
– Car elle est une créature géniale, dit-il, et le mari par delà le Caucase – vous savez sans doute qu’elle a un mari au delà du Caucase – lui accorde cette liberté géniale, soit par stupidité, soit par intelligence, je ne connais pas ce garçon. De toute façon, il fait bien de lui accorder cette liberté, car c’est au principe génial de la maladie qu’elle doit d’être ainsi, et quiconque est dans la même situation, fera bien de suivre son exemple et de ne pas se plaindre, ni pour le passé ni à l’avenir…
– Vous ne vous plaignez pas ? demanda Peeperkorn et il tourna son visage vers lui… Il semblait blême dans la pénombre ; les yeux étaient blafards et las sous les lignes de son front d’idole, la grande bouche déchirée était entr’ouverte, comme celle d’un masque tragique.
– Je ne pensais pas, répondit Hans Castorp modestement, qu’il pût s’agir de moi. Je m’efforce d’obtenir que vous ne vous plaigniez pas et qu’en raison d’événements passés, vous ne me retiriez pas votre bienveillance.
– Néanmoins, dit Peeperkorn, j’ai dû, sans le savoir, vous causer une peine profonde.
– Si c’est une question, répondit Hans Castorp, et si je réponds oui, cela ne signifie en tout cas en aucune façon que je n’apprécie pas l’immense avantage d’avoir fait votre connaissance, car cet avantage est inséparablement lié à cette déception.
– Je vous remercie, jeune homme, je vous remercie. J’apprécie la gentillesse de vos menus propos. Mais si nous faisons abstraction de nos relations personnelles…
– Il est difficile de le faire, dit Hans Castorp, et je ne saurais en faire abstraction en répondant sans prétention aucune oui à votre question. Car le fait que Clawdia soit revenue en compagnie d’une personnalité de votre envergure ne pouvait naturellement qu’augmenter et aggraver le mal qui résultait pour moi du fait qu’elle fût revenue en compagnie d’un autre homme. Cela m’a causé beaucoup de chagrin et cela m’en donne aujourd’hui encore, je ne le nie pas, et c’est à dessein que je m’en suis tenu autant que possible à l’aspect positif de l’aventure, à ma sincère vénération pour vous, Mynheer Peeperkorn, ce qui n’allait pas sans un peu de méchanceté pour votre compagne de voyage. Car les femmes n’aiment pas beaucoup que leurs amants s’entendent.
– En effet, dit Peeperkorn, et il dissimula un sourire, en passant sa main creuse sur la bouche et le menton, comme s’il craignait que Mme Chauchat ne le vît sourire. Hans Castorp lui aussi sourit discrètement, puis l’un et l’autre hochèrent la tête, en plein accord.
– Cette petite vengeance, poursuivit Hans Castorp, me revenait en somme, car, pour autant que j’entre en ligne de compte, j’avais vraiment quelque droit de me plaindre, non pas de Clawdia, ni de vous, Mynheer Peeperkorn, mais de ma vie et de mon destin. Et puisque j’ai l’honneur de jouir de votre confiance et que cette heure de crépuscule est à tous égards si singulière, je veux, tout au moins par allusions, vous en parler quelque peu.
– Je vous en prie, dit Peeperkorn poliment, sur quoi Hans Castorp poursuivit :
– Je suis ici, depuis assez longtemps, depuis des jours et des années, je ne sais pas exactement depuis quand, mais depuis des années de vie, c’est pourquoi j’ai parlé de « vie » et je reviendrai tout à l’heure, le moment venu, sur le destin. Mon cousin, auquel je voulais rendre une petite visite, un militaire plein de braves et de loyales intentions, ce qui ne lui a servi de rien, est mort, m’a été enlevé, et moi, je suis toujours ici. Je n’étais pas militaire, j’avais une profession civile, comme vous le savez peut-être ; une profession solide et raisonnable qui contribue, paraît-il, à la solidarité internationale, mais je n’y ai jamais été particulièrement attaché, je vous le confie, et cela pour des raisons dont je ne peux dire que ceci qu’elles demeurent obscures. Elles touchent aux origines de mes sentiments à l’égard de votre compagne de voyage – c’est à dessein que je l’appelle ainsi pour marquer que je ne songe nullement à ébranler vos droits positifs – de mes sentiments pour Clawdia Chauchat et de notre tutoiement que je n’ai jamais renié depuis que j’ai rencontré pour la première fois ses yeux et qu’ils ont eu raison de moi, qu’ils ont eu déraisonnablement raison de moi, comprenez-vous ? C’est pour l’amour d’elle et en défiant Settembrini, que je me suis soumis au principe de la déraison, au principe génial de la maladie auquel j’étais, il est vrai, assujetti depuis toujours, et je suis demeuré ici, je ne sais plus exactement depuis quand. Car j’ai tout oublié, et rompu avec tout, avec mes parents et ma profession en pays plat et avec toutes mes espérances. Et lorsque Clawdia est partie, je l’ai attendue, je n’ai cessé de l’attendre ici, de sorte que je suis définitivement perdu pour le pays plat et qu’aux yeux de ses habitants je suis autant dire mort. C’est à cela que je pensais en parlant de « destin » et c’est pourquoi je me suis permis d’insinuer que j’avais en somme le droit de me plaindre de ma situation et de mon droit lésé. Il m’est arrivé de lire une histoire – non, c’est au théâtre que je l’ai vue – l’histoire d’un brave jeune homme (il était du reste militaire comme mon cousin) qui a affaire à une ravissante gitane, ravissante, avec une fleur derrière l’oreille, une femme fatale et sauvage ; et il en tomba amoureux au point de dérailler complètement, de tout lui sacrifier, de déserter, de devenir contrebandier et de se déshonorer à tous points de vue. Lorsqu’il en fut arrivé là, elle se fatigua de lui et s’en fut avec un matador, une personnalité écrasante avec une splendide voix de baryton. Cela finit ainsi : le petit soldat, blanc comme craie, et la chemise ouverte, la poignarda devant le cirque, ce qu’elle avait du reste véritablement provoqué. Je raconte cette histoire tout à fait hors de propos. Mais, en fin de compte, pourquoi me revient-elle à l’esprit ?
Lorsque Hans Castorp avait parlé de « poignard », Mynheer avait légèrement changé de position. Il avait reculé en tournant brusquement sa figure vers son visiteur et avait regardé ses yeux d’un air interrogateur. Il se redressa, s’appuya sur son coude et dit :
– Jeune homme, j’ai entendu, et je suis maintenant au fait. Permettez-moi, sur la foi de vos communications, une loyale explication. Si mes cheveux n’étaient pas blancs et si je n’étais pas affligé d’une fièvre maligne, vous me verriez prêt à vous donner satisfaction, d’homme à homme, l’arme à la main, pour le tort que je vous ai inconsciemment causé et en même temps pour celui que ma compagne de voyage vous a fait et dont je vous dois également compte. Parfaitement, Monsieur. Vous me verriez prêt. Mais vu l’état actuel des choses, vous me permettrez de vous soumettre une autre proposition. C’est la suivante. Je me souviens d’un instant d’exaltation, tout au début de nos relations – je m’en souviens, bien que j’eusse fait honneur à la bouteille – d’un instant donc où, agréablement touché par votre caractère, j’ai été sur le point de vous proposer de nous tutoyer fraternellement, mais où j’ai senti aussitôt que c’eût été un peu prématuré. Bien, je m’en rapporte aujourd’hui à cet instant, j’y reviens, je déclare que le délai que nous avions envisagé est écoulé. Jeune homme, nous sommes frères, je déclare que nous le sommes. Vous avez parlé d’un tutoiement au sens complet de ce mot. Le nôtre aussi aura toute la plénitude de son sens, le sens d’une fraternité dans le sentiment. La satisfaction que l’âge et la maladie m’empêchent de vous donner par les armes, je vous l’offre sous cette forme, je vous l’offre au sens d’un traité fraternel d’alliance comme on les conclut parfois dans le monde contre un tiers, mais que nous voulons conclure dans le sens d’un sentiment commun pour quelqu’un. Prenez votre verre, jeune homme, tandis que je prendrai mon gobelet, sans vouloir porter pour cela la moindre atteinte au mérite de ce petit vin nouveau…
Et de sa main légèrement tremblante de capitaine, il remplit les verres, aidé par Hans Castorp, respectueux et bouleversé.
– Servez-vous, répéta Peeperkorn. Croisez le bras avec moi et buvez ainsi. Videz votre verre. Parfait, jeune homme. Classé. Voici ma main. Es-tu content ?
– Bien entendu, ce n’est là qu’une façon de parler, Mynheer Peeperkorn, dit Hans Castorp qui avait eu un peu de mal à vider le verre d’un seul trait et qui essuyait ses genoux avec son mouchoir parce qu’il avait répandu un peu de vin. Je dirais plutôt que je suis infiniment heureux et que je ne comprends pas encore comment j’ai pu être honoré d’une telle faveur. À parler franc, c’est comme un rêve. C’est un immense honneur pour moi, je ne sais pas comment je puis l’avoir mérité, d’une manière tout à fait passive en tout cas, pas autrement, et l’on ne peut pas s’étonner que, pour commencer, il me semble un peu aventuré de me servir de cette formule nouvelle, si je bute contre elle, surtout en présence de Clawdia qui, en sa qualité de femme, pourrait bien n’être pas tout à fait d’accord avec ces résolutions.
– Laisse-moi faire, ceci me regarde, répondit Peeperkorn, et le reste n’est qu’affaire d’exercice et d’habitude ! Et maintenant, jeune homme, va-t’en. Quitte-moi, mon fils. Il fait sombre, le soir est depuis longtemps tombé, notre amie peut revenir d’un instant à l’autre, et il vaudrait peut-être mieux que vous ne vous rencontriez pas à présent.
– Je te salue, Mynheer Peeperkorn, dit Hans Castorp, et il se leva. Vous voyez, je surmonte mon appréhension légitime et je m’exerce à cette forme d’une folle témérité. C’est vrai, il fait nuit. J’imagine que, si M. Settembrini entrait en ce moment, il allumerait la lumière pour que la raison et les usages de la société entrent avec lui ; c’est son faible. À demain. Je m’en vais d’ici, joyeux et fier comme je ne l’aurais jamais rêvé ! Bonne guérison ! Tu vas avoir maintenant au moins trois jours sans fièvre pendant lesquels vous suffirez à toutes exigences. Cela me fait plaisir comme si j’étais Toi. Bonne nuit !
MYNHEER PEEPERKORN (fin)
Une cascade est toujours un but d’excursion attrayant et nous avons peine à expliquer que Hans Castorp qui avait un penchant particulier pour l’eau qui tombe n’ait pas encore rendu visite à la pittoresque chute d’eau dans la forêt de la vallée de Fluela. Aux temps de Joachim, les scrupules de son cousin, qui n’avait pas vécu ici pour son plaisir et qui, sans jamais perdre de vue le but précis de son séjour, avait limité leur rayon visuel à l’entourage immédiat du Berghof pouvaient lui servir d’excuse. Et après sa mort Hans Castorp avait observé dans ses rapports avec cette région, si l’on excepte ses promenades en ski, la même uniformité conservatrice, dont le contraste avec l’étendue de ses expériences intimes et de ses devoirs de « gouvernement » n’avait pas été sans charme pour le jeune homme. Il approuva cependant avec vivacité le projet envisagé par ce petit cercle d’amis de sept personnes (en le comptant lui-même), qui constituait son entourage le plus immédiat, d’une promenade en voiture jusqu’à ce site si réputé.
On était en mai, le mois du bonheur, si l’on se fiait aux niaises petites chansons du pays plat, un mois assez frais et sans douceur, ici, sur les sommets ; la fonte des neiges pouvait, du moins, être considérée comme terminée. Sans doute la neige était-elle plusieurs fois tombée ces jours-ci par gros flocons, mais il n’en restait rien, qu’un peu d’humidité. Les masses compactes de l’hiver avaient fondu et disparu à quelques vestiges près. Ce monde verdoyant, redevenu praticable, était comme une tentation pour tout esprit entreprenant.
Au surplus, les relations du groupe avaient souffert de la maladie de son chef, Peeperkorn le Magnifique, dont la fièvre maligne n’avait voulu céder ni aux effets du climat extraordinaire ni aux antidotes d’un médecin aussi remarquable que le conseiller Behrens. Il avait longtemps gardé le lit, non seulement les jours où la fièvre quarte exerçait cruellement ses droits. La rate et le foie lui donnaient du fil à retordre comme le conseiller l’avait confié en particulier aux proches du malade. Son estomac non plus n’était pas dans un état tout à fait classique, et Behrens ne manqua pas de faire allusion aux dangers d’un affaiblissement chronique que courait dans ces conditions même une nature aussi puissante.
Durant ces semaines, Mynheer Peeperkorn n’avait présidé qu’une seule ripaille nocturne et l’on avait également renoncé aux promenades, sauf à une seule, qui fut courte. D’ailleurs Hans Castorp éprouva, soit dit entre nous, ce relâchement de la communauté de leur clan, dans une certaine mesure, comme un soulagement, car il était gêné ! Cela le gênait d’avoir fraternisé avec le compagnon de voyage de Mme Chauchat. En fait, dans leurs conversations communes, il en résultait les mêmes contraintes, les mêmes dérobades, et, comme s’il s’était agi d’une philippine, il évitait certaines formes, ainsi que cela avait été le cas avec Clawdia. Il évitait par de bizarres circonlocutions de s’adresser directement à Peeperkorn toutes les fois qu’il n’y avait pas moyen d’avaler le « tu ». C’était le même dilemme, ou le dilemme opposé à celui qui pesait sur sa conversation avec Clawdia en présence d’autres personnes ou en la seule présence de son maître et qui, grâce à la satisfaction qu’il avait reçue de celui-ci, s’était amplifié au point de l’embarrasser doublement.
Or donc, le projet d’une excursion à la cascade était à l’ordre du jour. Peeperkorn lui-même en avait fixé le but et il se sentait tout dispos en vue de cette entreprise. C’était le troisième jour après un accès de sa fièvre quarte ; Mynheer fit savoir qu’il comptait en profiter. Sans doute n’était-il pas paru aux premiers repas dans la salle à manger et, comme il faisait très souvent depuis quelque temps, s’était fait servir seul avec Mme Chauchat dans son salon. Mais, dès le petit déjeuner, le concierge boiteux avait transmis à Hans Castorp l’ordre de se tenir prêt pour une promenade une heure après le déjeuner, de communiquer cet ordre à MM. Ferge et Wehsal, de prévenir en outre Settembrini et Naphta que l’on passerait les prendre, et de commander enfin deux landaus pour trois heures.
Vers cette heure on se retrouva devant le portail du Berghof. Hans Castorp, Ferge et Wehsal attendaient leurs seigneuries en s’amusant à caresser les chevaux qui, de leurs babines noires, humides et larges, prenaient des morceaux de sucre sur leurs paumes. Les compagnons de voyage ne parurent sur le perron qu’avec un léger retard. Peeperkorn, dont la tête royale était devenue plus étroite, salua, debout auprès de Clawdia, dans un raglan long et un peu usé, en soulevant son chapeau mou et rond, et ses lèvres articulèrent un bonjour général, mais imperceptible. Puis il échangea une poignée de main avec chacun des trois hommes qui s’avancèrent à la rencontre du couple jusqu’au bas de l’escalier.
– Jeune homme, dit-il à Hans Castorp en lui posant sa main gauche sur l’épaule, comment vas-tu, mon fils ?
– Merci infiniment ! J’espère que l’on va bien de part et d’autre, répondit le jeune homme…
Le soleil brillait, c’était une belle journée claire, mais l’on avait quand même bien fait de revêtir les pardessus de demi-saison. Il était probable que l’on sentirait la fraîcheur en voiture. Mme Chauchat, elle aussi, portait un manteau chaud à ceinture, en une étoffe pelucheuse à grand carreaux, et même une petite fourrure autour des épaules. Elle avait rabattu sur le côté le bord de son chapeau de feutre par une voilette olive nouée sous son menton, ce qui lui allait à ravir, de sorte que la plupart de ses compagnons éprouvèrent comme une souffrance, à l’exception de Ferge, le seul qui ne fût pas amoureux d’elle. Et son détachement eut pour conséquence que, dans la répartition provisoire des places jusqu’à ce que l’on eût cherché les invités du dehors, ce fut lui qui se vit attribuer la place du premier landau en face de Mynheer et de Madame, tandis que Hans Castorp, non sans avoir cueilli un sourire moqueur sur les lèvres de Clawdia, monta avec Ferdinand Wehsal dans le deuxième équipage. La personne fluette du valet de chambre malais prenait part à l’excursion. Avec un panier volumineux sous le couvercle duquel dépassaient deux cols de bouteilles et qu’il rangea sous le siège de derrière du premier landau il était apparu à la suite de ses maîtres, et à l’instant où il croisa les bras à côté du cocher, le signe fut donné aux chevaux et, tous freins serrés, les voitures descendirent le chemin tournant.
Wehsal avait, lui aussi, remarqué le sourire de Mme Chauchat, et, montrant ses dents gâtées, il en parla en ces termes à son compagnon de promenade :
– Avez-vous vu, dit-il, comme elle se moque de vous parce que vous êtes obligé de monter dans la même voiture que moi ? Oui, quand on a le mal, on a aussi la honte. Est-ce que cela vous irrite et vous dégoûte tant d’être assis à côté de moi ?
– Faites donc attention, Wehsal et ne parlez pas d’une manière aussi basse, le réprimanda Hans Castorp. Les femmes sourient à la moindre occasion, pour le plaisir de sourire. Il ne sert à rien de se faire chaque fois des idées là-dessus. Pourquoi vous aplatissez-vous toujours ainsi ? Vous avez comme nous tous vos qualités et vos défauts. Par exemple, vous jouez très joliment le « Songe d’une nuit d’été », ce qui n’est pas à la portée de tout le monde. Vous devriez de nouveau essayer un de ces jours.
– Oui, répondit le misérable, vous me parlez du haut de votre grandeur, et vous ne vous doutez pas de l’impertinence de vos paroles consolantes, ni que vous m’humiliez davantage encore en me parlant ainsi. Il vous est facile de parler et de consoler du haut de votre socle, car si aujourd’hui vous êtes dans une situation un peu ridicule, vous avez quand même eu votre tour, et vous avez été au septième ciel, grand Dieu ! vous avez senti ses bras et sa nuque, et tout cela, grand Dieu ! cela me brûle la gorge et le creux de l’estomac, lorsque j’y pense et vous considérez mes tortures en pleine conscience des avantages dont vous avez bénéficié…
– Ce n’est pas très joli ce que vous dites là, Wehsal. C’est même repoussant au dernier degré, je n’ai pas besoin de vous le cacher puisque vous me reprochez d’être impertinent, et il est bien possible que vous fassiez exprès d’être repoussant ; vous vous efforcez véritablement de soulever le dégoût et vous ne cessez pas de vous tordre. Êtes-vous donc vraiment si follement amoureux d’elle ?
– Terriblement, répondit Wehsal en secouant la tête. Il n’est pas possible de dire quels tourments j’endure, dans la soif et le désir que j’ai d’elle, je voudrais pouvoir dire que ce sera ma mort, mais on ne peut ni vivre ni mourir avec cela ! Durant son absence, cela avait commencé d’aller mieux, je la perdais peu à peu de vue. Mais depuis qu’elle est de nouveau ici et que je l’ai chaque jour sous les yeux, cela me prend quelquefois, au point que je me mords le bras, que je gesticule dans le vide et que je ne sais plus que faire. Cela ne devrait pas exister, une chose pareille, mais on ne peut pas souhaiter que cela ne soit pas ; lorsque cela vous tient, on ne peut pas souhaiter que cela ne soit pas, ce serait abolir sa propre vie qui est amalgamée avec cela, et on ne le peut pas : à quoi servirait de mourir ? Après, oui, avec plaisir ! Dans ses bras, très volontiers ! Mais avant, c’est idiot, car la vie c’est le désir, c’est le désir de vivre, qui ne peut pas se retourner contre lui-même, c’est ainsi, oh damnation, que nous sommes toujours de nouveau pincés. Et quand je dis « damnation », ce n’est qu’une manière de parler, je le dis comme si j’étais un autre, moi-même je ne peux pas le penser. Il y a tant de tortures, et quiconque subit une torture veut en être délivré, veut absolument et à tout prix en être délivré, voilà son but. Mais on ne peut être délivré de la torture du désir charnel qu’à condition de l’assouvir, il n’y a pas d’autre moyen, on ne peut l’être à aucun autre prix. C’est ainsi, et quand cela ne vous tient pas, on n’y pense pas autrement, mais quand cela vous tient, on comprend Notre-Seigneur Jésus-Christ et les larmes vous coulent des yeux. Dieu du Ciel ! quelle chose singulière que notre chair désire ainsi la chair, simplement parce que ce n’est pas la nôtre, et qu’elle appartient à une âme étrangère ! Comme c’est étrange, et, lorsqu’on y regarde de plus près, comme c’est au fond peu de chose, en sa timide dilection ! On pourrait dire : si elle ne veut rien de plus, qu’on le lui accorde au nom de Dieu ! Qu’est-ce que je demande donc, Castorp ? Est-ce que je veux l’assassiner ? Est-ce que je veux verser son sang ? Je ne veux que la caresser ! Castorp, mon cher Castorp, excusez-moi de gémir ainsi, mais ne pourrait-elle pas se donner à moi ? Il y a tout de même là-dessous quelque chose de plus élevé, je ne suis pas une bête, après tout, à ma manière, je suis, malgré tout, un homme ! Le désir de la chair va en tout sens, il n’est pas lié, il n’est pas fixé, et c’est pourquoi nous l’appelons bestial. Mais lorsqu’il est fixé sur une personne humaine avec un visage, nos lèvres parlent d’amour. Ce n’est pas seulement son torse que je désire, ou la poupée de chair de son corps, car si son visage était d’une forme tant soit peu différente, je cesserais peut-être de la désirer tout entière, et, en vérité, il apparaît bien que c’est son âme que j’aime et que je l’aime avec mon âme. Car l’amour pour un visage, c’est l’amour de l’âme…
– Qu’est-ce qui vous prend donc, Wehsal ? Vous êtes tout à fait hors de vous et vous êtes parti là, Dieu sait sur quel ton…
– Mais d’un autre côté, c’est là justement le malheur, poursuivit le pauvre homme, le malheur c’est justement qu’elle ait une âme, qu’elle soit un être humain pourvu d’un corps et d’une âme. Car son âme ne veut rien savoir de la mienne, et son corps ne veut donc rien savoir du mien. Quelle tristesse et quelle misère ! et c’est pour cela que mon désir est condamné à la honte et que mon corps doit se tordre éternellement. Pourquoi ne veut-elle rien savoir de moi, ni par le corps ni par l’âme ? Ne suis-je donc pas un homme ? Un homme répugnant n’est-il pas un homme ? Je le suis au plus haut degré, je vous le jure, je serais capable de prouesses sans précédent, si elle m’ouvrait le royaume de délices de ses bras, qui sont si beaux parce qu’ils font partie du visage de son âme. Je lui donnerais toutes les voluptés du monde, Castorp, s’il ne s’agissait que des corps, et non des visages, s’il n’y avait pas son âme maudite, qui ne veut rien savoir de moi, mais sans laquelle je ne désirerais peut-être pas du tout son corps. C’est ça cet enfer breneux de tous les diables et c’est pourquoi je m’y tords éternellement…
– Wehsal, pst, plus bas, voyons ! Le cocher vous comprend. Il fait exprès de ne pas tourner la tête, mais je vois par son dos qu’il écoute.
– Il comprend et il écoute, Castorp ! La voilà de nouveau, cette sacrée histoire, avec son caractère et ses particularités ! Si je parlais de palingénésie ou… d’hydrostatique, il n’y comprendrait rien, il n’écouterait pas et ne s’y intéresserait pas du tout, car ce ne serait pas populaire. Mais l’affaire la plus haute, la plus importante et la plus effroyablement secrète de notre chair et de notre âme, vous le voyez, c’est en même temps la chose la plus populaire, tout le monde s’y entend et peut se moquer de celui que cela tient et pour qui le jour est une torture de volupté, la nuit un enfer de honte. Castorp, mon cher Castorp, laissez-moi gémir un peu, car songez un peu à mes nuits ! Chaque nuit je rêve d’elle, hélas, que ne rêvé-je pas, la gorge et le creux de l’estomac m’en brûlent lorsque j’y pense. Et cela finit toujours par des gifles, elle me donne des gifles ou me crache en pleine figure, le visage de son âme convulsé par le dégoût, elle crache sur moi et à ce moment je m’éveille, baigné de sueur, de honte et de plaisir…
– Allons, Wehsal, vous allez tâcher de vous taire, à présent, et de tenir votre langue jusqu’à ce que nous soyons arrivés chez l’épicier et que quelqu’un monte avec nous. Voilà ce que je propose et voilà ce que je vous ordonne. Je ne veux pas vous blesser et je vous accorde que vous êtes dans de vilains draps, mais on raconte dans notre pays l’histoire d’un quidam qui fut puni de la manière suivante : en parlant il lui sortait des serpents et des crapauds de la bouche, à chaque mot un serpent ou un crapaud. L’histoire ne dit pas comment il s’est tiré d’embarras, mais j’ai toujours supposé qu’il avait dû finir par la fermer.
– Mais c’est un besoin de l’homme, dit Wehsal d’un ton pitoyable, c’est un besoin de l’homme, mon cher Castorp, de parler et de soulager son cœur lorsqu’on est dans de tels draps.
– C’est même un droit de l’homme, Wehsal, si vous y tenez. Mais à mon avis il y a des droits dont on fait mieux de ne pas user.
Ils se turent donc, ainsi que Hans Castorp en avait décidé, et d’ailleurs ils furent bientôt arrivés devant la maisonnette festonnée de vigne vierge de l’épicier. Naphta et Settembrini étaient déjà dans la rue, l’un dans son paletot fatigué et bordé de fourrure, l’autre dans un pardessus jaunâtre de demi-saison qui était piqué sur toutes les coutures et qui lui donnait des allures de gandin. On se fit des signes, on se salua tandis que les voitures tournaient, et ces messieurs montèrent : Naphta comme quatrième, dans le premier landau, à côté de Ferge ; Settembrini, de brillante humeur, pétillant de joyeuses plaisanteries, se joignit à Hans Castorp et à Wehsal. Celui-ci céda d’ailleurs sa place au fond de la voiture, et M. Settembrini l’occupa, dans l’attitude d’un promeneur du corso, avec une nonchalance distinguée.
Il célébra l’agrément de la promenade, de ce mouvement du corps qui goûte un repos confortable dans un décor changeant ; il témoigna à Hans Castorp des sentiments affectueusement paternels et tapota même la joue de Wehsal en l’invitant à oublier son propre Moi antipathique pour admirer ce monde lumineux qu’il désignait de sa main droite, gantée d’un cuir râpé.
Ils firent une excellente promenade. Les chevaux, tous quatre au chanfrein blanc, vifs, trapus, au poil lisse et bien nourris, trottaient d’un pas ferme sur une bonne route qui n’était pas encore poussiéreuse. Des fragments de rocher, dans les joints desquels poussaient de l’herbe et des fleurs, s’approchaient parfois d’eux, des poteaux télégraphiques reculaient, des forêts montaient les talus, des courbes gracieuses se dessinaient vers lesquelles on se dirigeait, que l’on gravissait. Elles tenaient la curiosité en haleine, et des chaînes de montagne, par endroits encore couvertes de neige, continuaient de poindre dans le lointain, en plein soleil. On eut bientôt perdu de vue le paysage familier de la vallée, le déplacement du décor quotidien produisant sur l’esprit un effet réconfortant. Bientôt on s’arrêta à la lisière de la forêt. On voulait poursuivre d’ici l’excursion à pied et gagner le but, un but que l’on percevait, depuis quelque temps déjà, encore que faiblement et sans en avoir tout de suite pris conscience. Tous distinguèrent un bruit lointain, un bruissement, un bourdonnement et un mugissement qui, par instants, se perdait de nouveau, mais auquel les promeneurs s’invitaient les uns les autres à prêter l’oreille, et que l’on écoutait toujours de nouveau, immobile.
– Pour le moment, dit Settembrini qui était souvent venu jusqu’ici, le bruit a l’air assez timide. Mais sur place en cette saison il est brutal. Nous ne nous entendrons plus parler.
Ils pénétrèrent donc dans la forêt par un sentier couvert d’aiguilles humides ; en avant, Pieter Peeperkorn, appuyé sur le bras de sa compagne, son feutre noir sur le front, et le pas un peu vacillant ; au milieu, Hans Castorp, sans chapeau, comme tous les autres messieurs, les mains dans ses poches, la tête inclinée, et regardant autour de lui tout en sifflotant légèrement ; ensuite Naphta et Settembrini, ensuite Ferge et Wehsal, et enfin le Malais seul, qui portait le panier du goûter. On parlait de la forêt.
Cette forêt n’était pas comme les autres. Elle offrait un aspect pittoresque, singulier, voire exotique, mais en tout cas lugubre. Elle regorgeait d’une sorte de lichen moussu, elle en était toute tapissée, tout enveloppée ; en longues barbes incolores, le tissu feutré de la plante parasite pendait de branches capitonnées et enserrées dans ce réseau, on ne voyait presque plus les aiguilles, on ne voyait que des guirlandes de mousse, et cela défigurait pesamment et bizarrement la forêt qui offrait un aspect maladif et enchanté. La forêt ne se portait pas bien, elle souffrait d’une rogne luxuriante, qui menaçait de l’étouffer, telle était l’opinion générale, tandis que la petite troupe avançait sur le sentier couvert d’aiguilles, ayant dans l’oreille le bruit de la cascade dont on s’approchait, ce vacarme et ce sifflement, qui devenait peu à peu un véritable fracas et semblait devoir confirmer la prédiction de Settembrini.
Un tournant du chemin donna vue sur la gorge rocheuse et boisée qu’un pont enjambait, où tombait la cascade, et en même temps qu’on l’aperçut, le bruit parut augmenter : c’était un vacarme infernal. Les masses d’eau tombaient verticalement, en une seule cascade qui était haute d’au moins sept ou huit mètres et assez large, et elles dévalaient ensuite les rochers. Elles s’abattaient avec un bruit insensé où semblaient se mêler tous les sons et toutes les tonalités possibles, le fracas du tonnerre et le sifflement, le beuglement, le hurlement, la fanfare, le craquement, le crépitement, le grondement et le son de cloche, vraiment, on en était presque assourdi. Les visiteurs s’étaient approchés du rocher glissant et contemplaient, éclaboussés par un souffle humide, enveloppés par une buée d’eau, les oreilles emplies et comme capitonnées par le vacarme, – tout en échangeant des regards et en hochant la tête avec un sourire intimidé, – ce spectacle, cette catastrophe continue, faite d’écume et de fracas, dont le grondement dément et excessif les étourdissait, leur faisait peur et leur causait des illusions de l’ouïe. On croyait entendre derrière soi et de toutes parts des cris d’alarme et des menaces, des trompettes et de rudes voix d’hommes.
Groupés derrière Mynheer Peeperkorn – Mme Chauchat se trouvait parmi les cinq messieurs, – ils regardaient avec lui dans le flot. Ils ne distinguaient pas son visage, mais ils le virent découvrir sa tête blanche et dilater sa poitrine à l’air frais. Ils communiquaient les uns avec les autres par des regards et des signes, car les paroles, même si on les avait dites à l’oreille, auraient été assourdies par le tonnerre de la chute. Leurs lèvres formulaient des paroles d’étonnement et d’admiration qui n’étaient pas perçues. Hans Castorp, Settembrini et Ferge convinrent par des signes de tête d’escalader le haut de la gorge au fond de laquelle ils se trouvaient, de gagner la passerelle supérieure et de considérer l’eau de ce point de vue. Ce n’était pas malaisé. Une montée roide de marches étroites taillées dans le roc, conduisait en quelque sorte à un étage supérieur de la forêt ; ils l’escaladèrent, l’un derrière l’autre, mirent le pied sur la passerelle et, du milieu du pont suspendu au-dessus de la courbe de la cascade, appuyés à la rampe, ils firent signe à leurs amis d’en bas. Puis ils le traversèrent, descendirent avec effort de l’autre côté et reparurent aux yeux de ceux qui étaient demeurés en arrière, au delà du torrent qu’un deuxième pont franchissait plus bas.
L’échange de signaux concernait à présent le goûter. De plusieurs parts on estimait qu’il convenait de s’éloigner de la zone bruyante afin que l’on pût jouir de ce repas en plein air, non pas en sourds et en muets, mais l’ouïe délivrée. On dut toutefois se rendre compte que Peeperkorn était d’un avis opposé. Il secoua la tête, désigna plusieurs fois de l’index le fond de la gorge, et ses lèvres déchirées, qui s’ouvraient avec effort, articulaient un « ici ! ». Dès lors, que faire ? Sur ces questions de gouvernement il était chef et maître. Le poids de sa personnalité aurait emporté la décision, même s’il n’avait pas été, comme toujours, l’organisateur et l’initiateur de l’entreprise. Ce « format » a toujours été tyrannique, autocratique, et le restera. Mynheer voulait goûter devant la cascade, dans le bruit de tonnerre, tel était son entêtement souverain, et quiconque ne voulait pas se priver de goûter, devait rester. La plupart étaient mécontents. M. Settembrini, qui vit s’évanouir toute possibilité d’un échange humain, d’un bavardage ou d’un débat démocratique et bien articulé, lança la main au-dessus de sa tête en un geste de désespoir et de résignation. Le Malais s’empressa d’exécuter les ordres de son maître. Il y avait là deux pliants qu’il dressa contre la paroi rocheuse pour Mynheer et Madame. Puis il étendit à leurs pieds, sur une nappe, le contenu du panier : des tasses à café et des verres, des Thermos, de la pâtisserie et du vin. On se pressa pour la distribution des vivres. On prit ensuite place sur des rochers, sur la balustrade du pont, tenant à la main sa tasse de café chaud, l’assiette à gâteau sur ses genoux, et l’on goûta en silence dans le vacarme.
Peeperkorn, le col de son manteau relevé, le chapeau posé à terre à côté de lui, but du porto dans un gobelet d’argent à monogramme qu’il vida plusieurs fois. Et tout à coup il se mit à parler. Curieux homme ! Il était impossible qu’il entendît même sa propre voix, et, à plus forte raison, les autres ne pouvaient-ils comprendre une seule syllabe de ce qu’il faisait entendre sans qu’on l’entendît. Mais il levait l’index, allongeait le bras gauche en tenant le gobelet de la main droite, levait obliquement sa paume et l’on voyait son visage royal mû par des paroles, et sa bouche articuler des mots qui n’avaient point de son, comme s’ils avaient été prononcés dans un espace vide d’air. Tous pensèrent qu’il renoncerait bientôt à cet effort inutile, que l’on considérait avec un sourire gêné, mais il continuait de parler avec des gestes fascinants de sa main gauche, qui forçaient l’attention, malgré le vacarme assourdissant, en dirigeant ses petits yeux fatigués et pâles, mais écarquillés avec effort sous les plis froncés du front, tantôt vers l’un, tantôt vers l’autre de ses spectateurs, de sorte que celui auquel il s’adressait était chaque fois obligé d’approuver de la tête, les sourcils levés, la bouche ouverte, approchant une main creuse de l’oreille, comme s’il avait été possible de remédier en quelque manière à une situation aussi désespérée. Voici qu’il alla jusqu’à se lever ! Le gobelet à la main, dans son manteau de voyage fripé, dont le col était relevé et qui tombait presque sur ses pieds, tête nue, son haut front plissé d’idole entouré des flammes de ses cheveux blancs, il était debout contre le rocher, et son visage s’animait cependant que, d’un geste doctoral, il dressait le cercle de ses doigts, accompagnant son toast muet et confus du signe impérieux de l’exactitude. On reconnaissait à ses gestes et on lisait sur ses lèvres certains mots qu’on avait l’habitude d’entendre dans sa bouche. « Parfait ! » et « classé ! » – rien de plus. On voyait sa tête se pencher, une amertume déchirait ses lèvres, il n’était plus que l’image de la douleur. Puis on voyait fleurir sur ses joues sa fossette polissonne de sybarite, on avait l’illusion qu’il dansait en troussant sa robe, c’était de nouveau l’impudeur sacrée d’un prêtre païen. Il leva son gobelet, lui fit décrire un demi-cercle devant les yeux de ses invités, et le vida en deux ou trois gorgées, jusqu’au fond en le renversant entièrement. Puis, allongeant le bras, il tendit l’objet au Malais qui le prit, la main sur sa poitrine, et donna le signal du départ.
Tous s’inclinèrent devant lui pour le remercier, en s’apprêtant à se conformer à son ordre. Ceux qui étaient accroupis à terre sautèrent sur pieds, ceux qui étaient adossés à la balustrade se redressèrent. Le frêle Javanais en chapeau raide et en manteau à col de fourrure ramassa les reliefs du repas et la vaisselle. Dans le même ordre de marche dans lequel ils étaient venus, ils rejoignirent par le sentier humide et couvert d’aiguilles, à travers la forêt méconnaissable par le lichen, l’endroit de la route où les voitures attendaient.
Hans Castorp prit place, cette fois-ci, avec le maître et sa compagne. Il était assis en face du couple, à côté de l’excellent Ferge à qui les choses élevées étaient complètement étrangères. On ne parla presque pas durant ce retour. Mynheer restait là, les mains posées à plat sur le plaid qui enveloppait ses genoux et ceux de Clawdia, et laissait tomber sa mâchoire inférieure. Settembrini et Naphta descendirent et prirent congé avant que la voiture eût traversé les rails et le cours d’eau. Wehsal resta seul dans la seconde voiture pour remonter la route du Berghof, puis ils se séparèrent devant le portail.
Le sommeil de Hans Castorp était-il resté pendant cette nuit d’une légèreté particulière, par suite d’une alarme intérieure dont son âme ne savait rien, mais grâce à quoi il avait perçu l’atteinte très légère à l’habituel silence nocturne du Berghof ? Et l’ébranlement à peine sensible de la maison par un pas lointain avait-il suffi à l’éveiller et à le faire se dresser, en pleine conscience, sur son coussin ? En effet, il s’était éveillé quelque temps avant que l’on frappât à sa porte, ce qui eut lieu un peu après deux heures du matin. Il répondit aussitôt, nullement somnolent, avec toute son énergie et sa présence d’esprit. C’était la voix haute et mal assurée d’une infirmière employée dans la maison qui le priait de la part de Mme Chauchat de descendre immédiatement au premier. Avec une énergie accrue il répondit qu’il venait, sauta de son lit, enfila ses vêtements, rejeta de la main les cheveux de son front et descendit sans hâte ni lenteur, incertain non point du « quoi », mais bien du « comment » de l’heure.
Il trouva grande ouverte la porte du salon de Peeperkorn, ainsi que celle de la chambre à coucher du Hollandais où brûlaient des lumières. Les deux médecins, la supérieure de Mylendonk, Mme Chauchat et le valet de chambre malais s’y trouvaient. Celui-ci n’était pas vêtu comme d’habitude, mais portait une sorte de costume national, une blouse à larges rayures, aux manches longues et amples, une robe bariolée au lieu de pantalons et un bonnet conique en étoffe jaune sur la tête ; il portait en outre sur sa poitrine des amulettes, se tenait immobile, les bras croisés, à gauche de la tête du lit où Pieter Peeperkorn était allongé, sur le dos, les mains étendues. Tout pâle, Hans Castorp en entrant parcourut la scène des yeux. Mme Chauchat lui tournait le dos. Elle était assise sur un fauteuil bas, au pied du lit, le coude appuyé sur la courte-pointe, le menton dans sa main, les doigts creusant la lèvre inférieure, et elle regardait dans la figure de son compagnon de voyage.
– ’Soir, mon ami, dit Behrens qui s’était entretenu à mi-voix avec le docteur Krokovski et la supérieure, et il hocha la tête d’un air mélancolique, retroussant sa petite moustache. Il était en blouse de médecin, le stéthoscope sortait de sa poche, il portait des pantoufles brodées et un col bas. « Rien à faire ! » ajouta-t-il à mi-voix. « Travail soigné. Approchez-vous donc. Jetez-moi là-dessus un regard de connaisseur et vous m’accorderez que l’on a consciencieusement prévenu toute intervention médicale. »
Hans Castorp s’approcha du lit sur la pointe des pieds. Les yeux du Malais surveillaient chacun de ses mouvements, le suivaient sans que l’indigène tournât la tête, de sorte que le blanc apparaissait. Par un regard de côté, il constata que Mme Chauchat ne s’occupait pas de lui, et il resta debout, dans une attitude caractéristique, appuyé sur une jambe, les mains jointes sur le ventre, la tête penchée obliquement, dans une contemplation respectueuse et pensive. Peeperkorn était couché sous la couverture en soie rouge, dans sa chemise de tricot, comme Hans Castorp l’avait souvent vu. Ses mains étaient enflées et d’un bleu qui tournait au noir ; il en était de même de certaines parties de sa figure. Cela le défigurait sensiblement, bien que ses traits royaux n’eussent pas changé par ailleurs. Le dessin de son haut front d’idole entouré de mèches blanches, – quatre ou cinq rides horizontales qui descendaient en angle droit des deux côtés des tempes, creusées par la tension habituelle de toute une vie, – apparaissait fortement, même au repos, au-dessus des paupières baissées. Les lèvres à la déchirure arrière étaient entr’ouvertes. Le bleuissement indiquait un arrêt brusque, un enrayement violent et apoplectique des fonctions vitales.
Hans Castorp demeura un instant recueilli, s’interrogeant sur la situation. Il hésitait à changer d’attitude, attendant que la « veuve » lui adressât la parole. Comme elle ne le faisait pas, il préféra ne pas la déranger et se retourna vers le groupe des autres personnes qui étaient postées derrière son dos. Le conseiller fit un signe de tête dans la direction du salon. Hans Castorp l’y suivit.
– Suicidium ? demanda-t-il à mi-voix, avec un calme professionnel.
– Pardi ! répondit Behrens avec un geste méprisant, et il ajouta : « Et comment ! Au superlatif. Avez-vous jamais vu ce genre d’article de luxe ? » demanda-t-il, en extrayant de la poche de sa blouse un petit étui de forme irrégulière d’où il tira un menu objet qu’il présenta au jeune homme. « Pas moi. Mais cela vaut d’être vu. On ne sait jamais tout. C’est d’une ingéniosité fantasque. Je le lui ai retiré de la main. Attention ! S’il vous en tombe une goutte sur la peau, vous risquez des brûlures. »
Hans Castorp retourna dans ses doigts le mystérieux objet. Il était en acier, en ivoire, en or, en caoutchouc, et d’un aspect très bizarre. On voyait deux pointes de fourchette recourbées et très aiguës, en acier, une partie médiane légèrement ondulée, en ivoire serti d’or, sur laquelle les pointes étaient dans une certaine mesure articulées, et cela se terminait par une sorte de poire en caoutchouc rigide.
– Qu’est-ce que c’est ? demanda Hans Castorp.
– Ça, répondit le docteur Behrens, c’est une seringue à injections. Ou, d’un autre point de vue, c’est un mécanisme qui reproduit les dents du serpent à lunettes. Vous comprenez ? Vous ne semblez pas saisir, dit-il, comme Hans Castorp, abasourdi, ne quittait pas des yeux le bizarre instrument. Voilà les dents. Elles ne sont pas tout à fait massives, elles sont traversées par un tube capillaire, par un canal très fin dont vous pouvez voir nettement l’embouchure, ici, sur le devant, un peu au-dessus des pointes. Naturellement, ces petits tubes sont également ouverts à l’autre extrémité, ils communiquent avec l’ouverture de la poire en caoutchouc qui fait corps avec la partie médiane en ivoire. Au moment de la morsure les dents se rétractent légèrement, on s’en rend compte, et exercent sur le réservoir qui alimente les canaux une légère pression, de sorte qu’à l’instant précis où les pointes pénètrent dans la chair, la dose est précipitée dans la circulation du sang. Cela paraît très simple, quand on a l’objet sous les yeux. Mais il fallait y penser. Sans doute l’a-t-on fabriqué d’après ses propres indications.
– Certainement, dit Hans Castorp.
– La dose ne peut pas avoir été très considérable, poursuivit le conseiller. La quantité a dû être remplacée par…
– … le dynamisme, compléta Hans Castorp.
– Si vous voulez. Nous dénicherons bien ce que c’est. On peut attendre avec une certaine curiosité le résultat de l’analyse, cela nous donnera sans doute l’occasion d’apprendre du nouveau. Voulez-vous parier que notre exotique, le serviteur là derrière, qui s’est mis cette nuit sur son tralala, pourrait nous renseigner très exactement ? Je suppose que c’est un alliage de poisons animaux et végétaux, le fin du fin, de toute façon, car l’effet a dû être foudroyant. Tout indique que cela lui a immédiatement coupé le souffle : paralysie du centre respiratoire, comprenez-vous, asphyxie rapide, probablement sans efforts ni douleur.
– Dieu le veuille ! dit Hans Castorp pieusement. Avec un soupir il rendit l’inquiétant petit instrument au conseiller et retourna dans la chambre à coucher.
Seuls, le Malais et Mme Chauchat s’y trouvaient encore. Cette fois Clawdia leva la tête vers le jeune homme lorsqu’il s’approcha de nouveau du lit.
– Vous aviez le droit d’être appelé, dit-elle.
– C’est très aimable à vous, dit-il, et vous avez raison. Nous nous tutoyions. J’ai honte jusqu’au fond de l’âme d’en avoir rougi devant les gens, et d’avoir eu recours à des circonlocutions. Vous avez été près de lui pendant ses derniers instants ?
– Le domestique m’a prévenue lorsque tout a été fini.
– Il était d’un si grand format, reprit Hans Castorp, qu’il éprouvait la défaillance du sentiment devant la vie comme une catastrophe cosmique, comme une honte devant Dieu. Car il se tenait pour l’organe nuptial de Dieu, savez-vous. C’était une royale folie… Lorsqu’on est ému, on a le courage de se servir d’expressions qui paraissent grossières et impies, mais qui sont plus solennelles que des paroles brevetées de recueillement.
– C’est une abdication, dit-elle. Était-il au courant de notre folie ?
– Je n’ai pas pu la dénier, Clawdia. Il l’avait devinée après que j’eusse refusé de vous embrasser devant lui sur le front. Sa présence en ce moment est plus symbolique que réelle, mais voulez-vous me permettre de le faire, maintenant ?
D’un mouvement bref elle leva le front vers lui, les yeux fermés, comme pour un hochement de tête. Il porta ses lèvres à son front. Les yeux bruns d’animal du Malais surveillaient la scène, tournés de leur côté, en montrant le blanc de leur cornée.
LA GRANDE HÉBÉTUDE
Une fois de plus nous entendons la voix du docteur Behrens. Écoutons bien ! C’est peut-être la dernière fois que nous l’entendrons. Cette histoire elle-même aura une fin ; son temps le plus long est passé, ou plutôt : la durée de son contenu a pris un tel élan qu’il n’y a plus moyen de l’arrêter et que sa durée musicale, elle aussi, touche à sa fin, de sorte que nous n’aurons peut-être plus l’occasion de prêter l’oreille à la voix allègre et aux locutions proverbiales de Rhadamante. Il disait à Hans Castorp :
– Castorp, vieille branche, vous vous ennuyez. Vous faites une gueule impossible, je lis chaque jour la mauvaise humeur sur votre front. Vous êtes un type blasé, Castorp, vous êtes gâté par les sensations, et si on ne vous propose pas tous les jours une nouveauté de premier ordre, vous bougonnez et vous boudez pendant tout le temps des vaches maigres. Ai-je raison ou ai-je tort ?
Hans Castorp garda le silence, et cette attitude témoignait qu’en effet il devait faire assez sombre en lui.
– J’ai raison comme toujours, se répondit Behrens à lui-même. Et avant que vous propagiez ici le poison du mécontentement, vous, citoyen frondeur, vous allez voir que vous n’êtes pas du tout abandonné de Dieu et des hommes, que les autorités ont l’œil sur vous, qu’elles ne vous ont pas perdu de vue, mon cher, et qu’elles cherchent sans trêve ni repos à vous divertir. Allons, blague à part, mon petit. Il m’est venu une idée, Dieu sait si j’ai passé des nuits d’insomnie avant de trouver quelque chose qui vous convienne ! On pourrait parler d’une illumination, et le fait est que j’attends beaucoup de mon idée, c’est-à-dire ni plus ni moins que votre désintoxication et votre départ triomphal à une date d’une proximité insoupçonnée.
« Vous faites de grands yeux », poursuivit-il après une pause calculée, bien que Hans Castorp n’ouvrît pas du tout les yeux, mais le regardât d’un air assez somnolent et distrait, « et vous ne vous doutez pas de ce que le vieux Behrens veut dire. Voici comment je l’entends. Il y a quelque chose qui ne marche pas chez vous, c’est ce qui n’aura pas échappé à votre honorée aperception. Ça ne marche pas dans ce sens que vos phénomènes d’intoxication ne correspondent plus depuis longtemps à votre état local, incontestablement très amélioré. Ce n’est pas d’hier que j’y réfléchis. Nous avons là votre dernière photo. Approchons un peu de la lumière cet objet magique. Vous voyez, le pire chicaneur et broyeur de noir, comme dit notre souverain, ne trouverait plus grand’chose à relever ici. Plusieurs foyers sont complètement résorbés, le nid s’est rétréci et plus nettement délimité, ce qui, – en savant que vous êtes, vous ne l’ignorez pas – est un indice de guérison. Cet état de choses n’explique pas très bien l’irrégularité de votre température, mon garçon. Et le médecin se voit obligé de chercher d’autres causes.
Le mouvement de tête de Hans Castorp exprima une curiosité polie, sans plus.
– Vous allez naturellement penser, Castorp, que le vieux Behrens devra convenir que le traitement a été manqué. Mais vous auriez fait un pas de clerc, et vous ne vous seriez montré à la hauteur ni de la situation ni du vieux Behrens. Votre traitement n’a pas été manqué, mais il n’en est pas moins possible qu’il soit resté trop unilatéral. La possibilité m’est apparue que vos symptômes ne se ramènent pas exclusivement à la tuberculosis, et je déduis cette probabilité du fait qu’en effet il n’y a plus du tout lieu aujourd’hui de les expliquer ainsi. Il faut que vos troubles aient une autre origine. Selon moi, vous avez des « coques ».
« D’après ma conviction profonde, répéta le conseiller en accentuant son affirmation, après avoir recueilli le hochement de tête qui s’imposait de la part de Hans Castorp, vous avez des streptos, ce qui n’est du reste pas une raison d’être épouvanté.
(Il ne pouvait pas être question d’épouvante. La physionomie de Hans Castorp exprimait plutôt une sorte de reconnaissance ironique, soit de la perspicacité qui se révélait à lui, soit de la nouvelle dignité dont le conseiller l’investissait par hypothèse.)
– Il n’y a pas là de quoi être pris de panique, reprit celui-ci, variant ses paroles d’encouragement. Des coques, tout le monde en a. Chaque imbécile a des streptos. Vous n’avez pas lieu d’en être fier. Depuis quelque temps, nous savons même que l’on peut parfaitement avoir des streptocoques dans le sang, et ne montrer aucun symptôme visible d’infection. Nous sommes en présence de ce fait que beaucoup de nos confrères ignorent encore, à savoir que le sang peut contenir des tubercules sans qu’il en résulte rien. Nous ne sommes même pas loin de supposer que la tuberculose pourrait n’être qu’une maladie du sang.
Hans Castorp trouva cela très remarquable.
– Par conséquent, lorsque je dis : des streptos, reprit Behrens, il ne faut pas, bien entendu, vous représenter l’image connue d’une maladie grave. L’analyse bactériologique du sang montrera si ces petits corps de mon ressort se sont vraiment installés chez vous. Mais ce n’est que le traitement par le streptovaccin – il y aurait lieu de l’envisager s’il en était ainsi – qui nous apprendra si telle est l’origine de votre état fébrile. Voilà la route qu’il conviendra de suivre, cher ami, et, comme je vous l’ai déjà dit, j’escompte un résultat tout à fait inattendu. La tuberculose a beau traîner parfois indéfiniment, il arrive également que l’on guérisse très vite des maladies de cette nature, et si vraiment vous réagissez à ces injections, dans six semaines vous vous sentirez comme un poisson dans l’eau. Que dites-vous de ça ? Le vieux Behrens veille-t-il au grain, hein ?
– Ce n’est pour le moment qu’une hypothèse, répondit Hans Castorp, sans entrain.
– Une hypothèse qui peut se confirmer, une hypothèse très féconde, répliqua le conseiller. Vous vous rendrez compte à quel point elle est féconde lorsque vous verrez pousser les coques sur nos cultures. Demain après-midi nous vous mettons en perce, Castorp, nous vous saignerons d’après toutes les règles de l’art des barbiers de village. C’est déjà en soi un plaisir et cela ne peut qu’avoir sur le corps et l’âme les effets les plus heureux…
Hans Castorp se déclara disposé à cette diversion et remercia le conseiller de l’attention qu’on lui avait accordée. La tête penchée sur l’épaule, il regarda s’éloigner Behrens. L’intervention du patron s’était produite exactement à l’instant critique. Rhadamante avait interprété avec assez de justesse le jeu de physionomie et l’état d’esprit du pensionnaire du Berghof, et sa nouvelle expérience était faite – elle était même expressément destinée à cela, il ne l’avait nullement caché – pour aider Hans Castorp à franchir le point mort où il était arrivé depuis quelque temps, ainsi qu’on pouvait le conclure de son expression qui rappelait très précisément celle qu’avait eue feu Joachim lorsque certaines décisions farouches et certains défis s’étaient préparés en lui.
Il faut dire plus. Non seulement lui, Hans Castorp, paraissait arrivé à un tel point mort, mais il lui semblait qu’il en allait de même du monde entier, de tout, de « l’ensemble », ou plutôt : il lui semblait particulièrement difficile de distinguer en l’occurrence le particulier du général. Depuis la fin excentrique de ses rapports avec certaine personnalité, depuis les troubles de toutes sortes que cette fin avait jetés dans la maison, depuis que Clawdia Chauchat avait à nouveau quitté la communauté de ceux d’en-haut, depuis l’adieu qu’avaient échangé, dans l’ombre tragique d’un grand renoncement, par respect pour le défunt, la jeune femme et le frère de son maître et souverain, depuis ce tournant donc, il semblait au jeune homme que quelque chose clochait dans le monde et la vie ; comme si tout allait de plus en plus mal et qu’une anxiété croissante l’eût saisi ; comme si un démon s’était emparé du pouvoir, un démon dangereux et bouffon, qui depuis longtemps avait joué un rôle assez important, mais qui venait de proclamer son autorité sans réserves, inspirant une terreur mystérieuse et suggérant des pensées de fuite, un démon qui avait nom : hébétude.
On jugera que le conteur charge sa palette d’une manière par trop romantique en associant le mot d’hébétude avec le principe démoniaque et en affirmant qu’ils produisaient une terreur mystique. Et cependant ce n’est pas une fable, et nous nous en tenons très exactement à l’aventure personnelle de notre simple héros, aventure dont nous avons, il est vrai, connaissance d’une manière qui échappe à tout contrôle, et laquelle prouve que l’hébétude peut dans certaines circonstances prendre ce caractère et inspirer de tels sentiments. Hans Castorp regarda autour de lui… Il ne voyait que des choses lugubres, inquiétantes, et il savait ce qu’il voyait : la vie en dehors du temps, la vie insoucieuse et privée d’espoir, la vie, dévergondage d’une stagnation active, la vie morte.
Elle était active, cette vie, à sa manière. Des occupations de toutes sortes s’y côtoyaient ; mais de temps à autre l’une d’elles dégénérait en une mode furieuse à laquelle tout le monde sacrifiait avec fanatisme. C’est ainsi que les photographies d’amateurs avaient toujours tenu une place importante dans le monde du Berghof. Deux fois déjà – car lorsqu’on demeurait assez longtemps en haut, on pouvait voir se répéter de telles épidémies, – cette passion avait tourné pendant des semaines et des mois à la folie générale, de sorte qu’il n’y avait personne qui, la mine inquiète, la tête penchée sur un appareil appuyé au creux de l’estomac, ne fît pas ciller un objectif, et qu’on n’en finissait plus de faire circuler des épreuves à table. Depuis longtemps la chambre noire qui était à la disposition des pensionnaires ne suffisait plus aux besoins. On voilait les fenêtres et les portes des balcons des chambres avec des rideaux noirs ; et l’on manipulait à la lumière rouge, dans des bains chimiques, jusqu’à ce qu’un incendie faillît éclater et que l’étudiant bulgare de la table des Russes bien manquât d’être réduit en cendres, après quoi les autorités interdirent cet exercice dans les chambres. D’ailleurs on ne tarda pas à se désintéresser de la simple photographie. Les photographies au magnésium et les photographies en couleurs, d’après les procédés de Lumière, furent lancées. On se repassait des portraits de personnes qui, surprises par l’éclair du magnésium, les yeux fixes, les visages blêmes et convulsés, semblaient des cadavres de gens assassinés que l’on aurait dressés là, debout et les yeux ouverts. Et Hans Castorp conservait une plaque encadrée de carton qui, lorsqu’on la regardait par transparence, le montrait entre Mme Stoehr et Mlle Lévi au teint d’ivoire, dont la première portait un chandail bleu-ciel, la seconde un chandail pourpre, avec un visage cuivré et parmi des soucis jaunes dont l’un fleurissait sa boutonnière, sur un fond de prairie d’un vert vénéneux.
Il y avait encore la manie de collectionner les timbres qui, pratiquée en tout temps par certains pensionnaires, devenait par moments une folie générale. Tout le monde collait, échangeait, trafiquait. On était abonné à des revues de philatélie, on correspondait avec des maisons spéciales de tous pays, avec des associations et des amateurs, on consacrait des sommes invraisemblables à l’achat de certains timbres rares, et c’était même le cas de pensionnaires à qui leur situation de fortune ne permettait que difficilement de séjourner pendant des mois et des années dans ce luxueux établissement.
Cette épidémie durait jusqu’à ce qu’un autre snobisme prît le dessus et que le bon ton voulût que l’on amassât et que l’on dévorât des quantités de chocolat, des marques les plus variées. Tout le monde avait des lèvres brunes, et les produits les plus appétissants de la cuisine du Berghof n’étaient plus appréciés par des estomacs qu’avaient bourrés et gâtés le Milka aux noix, le chocolat à la crème d’amandes, les napolitains Marquis et les langues de chat mouchetées d’or.
Les dessins de petits cochons exécutés les yeux fermés, – divertissement inauguré un soir de carnaval par la plus haute autorité, et auquel on s’était souvent livré depuis lors, – mirent à la mode des jeux de patience géométriques, auxquels était par instants voué l’effort mental de tous les pensionnaires du Berghof et dont relevaient jusqu’aux dernières pensées et aux suprêmes manifestations d’énergie des moribonds. Pendant des semaines la maison était sous le signe d’une figure compliquée qui ne se composait pas de moins de huit grands et petits cercles et de plusieurs triangles inscrits l’un dans l’autre. Il s’agissait de dessiner cette figure en un seul trait ; mais la plus haute maîtrise consistait à accomplir ce travail, les yeux bandés pour de bon, ce à quoi, en négligeant quelques insignifiantes fautes d’esthétique, le procureur Paravant fut seul à réussir, lui qui était particulièrement atteint de cette manie de précision.
Nous savons qu’il se consacrait aux mathématiques, nous l’avons appris de la bouche du conseiller lui-même, et nous connaissons la pudique origine de cette lubie, dont nous avons déjà entendu célébrer les effets calmants. Elle émoussait l’aiguillon de la chair, et si tout le monde avait imité l’exemple du procureur, certaines mesures de précaution que l’on avait dû prendre récemment auraient sans doute été superflues. Elles consistaient principalement dans la fermeture de tous les passages des balcons, entre la balustrade et les parois de verre opaque, par de petites portes dont le baigneur tirait la clef, pour la nuit, avec un jovial sourire. Depuis lors, les chambres du premier étage, qui donnaient sur la véranda, étaient très recherchées, parce que l’on pouvait, ayant franchi la balustrade, aller de loge en loge, en passant par le toit de verre. Mais s’il n’y avait eu que le procureur, on n’aurait sans doute aucunement eu besoin de recourir à cette nouvelle discipline. La périlleuse tentation à laquelle l’apparition de certaine Fatma égyptienne avait exposé Paravant était depuis longtemps surmontée, et ç’avait été la dernière qui avait agité ses sens. Avec une ferveur redoublée il s’était jeté dans les bras de la déesse aux yeux clairs dont le conseiller avait célébré la puissance calmante en termes si édifiants, et le problème qui, jour et nuit, occupait sa pensée, auquel il apportait cette persévérance, cette ténacité sportive qu’il avait dépensées autrefois, – avant de prendre un congé qui menaçait de devenir une retraite définitive – à convaincre de leur crime de malheureux pécheurs, ce problème n’était autre que la quadrature du cercle.
Le fonctionnaire dépaysé avait acquis dans le cours de ses études la conviction que les preuves par lesquelles la science prétendait avoir établi l’impossibilité de cette construction, n’étaient pas solides, et que la providence ne l’avait éloigné de l’humanité inférieure du monde des vivants, et ne l’avait transporté ici, que parce qu’elle l’avait élu pour transporter ce but transcendant dans le domaine des possibilités terrestres. C’est en quoi il voyait sa mission. Il traçait des cercles et calculait partout où il se trouvait, il couvrait des quantités incroyables de papier, de figures, de lettres, de chiffres, de symboles algébriques, et sa figure bronzée, la figure d’un homme en apparence tout à fait bien portant, avait l’expression absente et butée du maniaque. Sa conversation concernait exclusivement, et avec une effrayante monotonie, le seul nombre proportionnel pi, cette fraction désespérante que le génie inférieur d’un calculateur nommé Zacharias Dase avait un jour calculée jusqu’à la deux centième décimale, et cela par simple luxe, parce que deux mille décimales n’auraient pas davantage épuisé les chances d’obtenir une précision irréalisable. Tout le monde fuyait le penseur tourmenté, car tous ceux qu’il réussissait à empoigner devaient subir le flux de paroles passionnées destinées à les rendre sensibles à la honte et à la souillure que constituait pour l’esprit humain l’irrationalité irrémédiable de cette proportion mystique. L’inutilité des multiplications éternelles du diamètre par pi pour déterminer la périphérie du carré au-dessus du rayon, pour déterminer l’aire de la surface de ce cercle, faisait passer le procureur par des accès de doute. Il se demandait si, depuis le temps d’Archimède, l’humanité n’avait pas inutilement compliqué la solution du problème, et si cette solution n’était pas en réalité d’une simplicité puérile. Comment ? ne pouvait-on pas redresser la ligne circulaire ? On ne pouvait donc pas changer chaque ligne droite en un cercle ? Parfois Paravant croyait être tout près d’une révélation. On le voyait souvent, le soir sur le tard, assis à sa table, dans la salle à manger vide et mal éclairée. Il disposait soigneusement un morceau de fil en forme de cercle, puis, par surprise, retirait brusquement en une ligne droite ; ensuite, accoudé, il se perdait en une songerie amère. Le conseiller l’encourageait parfois dans sa marotte mélancolique, et l’y entretenait systématiquement. Le malheureux s’adressa aussi à Hans Castorp, une première fois, puis à nouveau, parce qu’il avait rencontré chez celui-ci une sympathie amicale pour le mystère du cercle. Il démontrait au jeune homme l’impasse pi, au moyen d’un dessin très précis sur lequel il avait, au prix d’un effort inouï, enfermé un cercle entre un polygone extérieur et un polygone intérieur, aux côtés minuscules et innombrables, avec le maximum d’approximation auquel l’homme pouvait atteindre. Mais le reste, la courbe qui échappait d’une manière éthérée et spirituelle à la rationalisation et au calcul, cela, disait le procureur, la mâchoire inférieure tremblante, cela, c’était pi. Hans Castorp, malgré toute son affabilité, montrait moins d’intérêt pour pi que pour son interlocuteur. Il dit que c’était une duperie, conseilla à M. Paravant de ne pas se surexciter trop sérieusement à cette poursuite, et il lui parla des points d’inflexion sans étendue dont se composait le cercle, depuis son commencement qui n’existait pas jusqu’à la fin qui n’existait pas davantage, ainsi que de la mélancolie présomptueuse de l’éternité, qui, sans durée de direction, se poursuivait en elle-même ; il parla de tout cela, avec une dévotion si calme qu’il exerça passagèrement une influence apaisante sur le procureur.
D’ailleurs, la nature de l’excellent Hans Castorp l’inclinait à accueillir les confidences de plus d’un de ses compagnons qui étaient en proie à quelque idée fixe et souffraient de ne pas trouver de compréhension auprès des autres pensionnaires qui prenaient la vie à la légère. Un ancien sculpteur originaire de la province autrichienne, un homme déjà âgé, à la moustache blanche, au nez crochu et aux yeux bleus, avait conçu un plan financier (et l’avait calligraphié en soulignant à l’encre de Chine les passages importants) qui consistait en ceci : chaque abonné à un journal devait être tenu de livrer le premier de chaque mois une quantité correspondant à quarante grammes de vieux papier par jour, ce qui ferait par an environ quatorze mille grammes, en vingt ans plus de deux cent quatre-vingts kilogrammes, et ce qui représentait, en évaluant le kilogramme à vingt pfennigs, une valeur de 57,60 marks allemands. 5 millions d’abonnés, ainsi continuait le mémoire, fourniraient donc en vingt ans la somme formidable de 288 millions de marks, dont les deux tiers seraient déduits du prix de leur nouvel abonnement, tandis que le surplus, un tiers, soit environ 100 millions de marks, serait consacré à des œuvres humanitaires, soit à financer des sanatoria populaires pour malades du poumon, à encourager des talents indigents, et ainsi de suite. Le plan était élaboré d’une façon très complète. Son auteur avait même représenté par des graphiques le barème, d’après lequel l’organisme chargé de recueillir le papier devait en calculer tous les mois la valeur, et jusqu’aux formulaires perforés qui serviraient de quittance pour les sommes versées. Le projet était justifié et fondé à tous points de vue. Le gaspillage insensé et la destruction du papier de journal que les gens non avertis livraient aux égouts et au feu était une haute trahison à l’égard de nos forêts, une atteinte portée à notre économie nationale. Épargner le papier, économiser le papier, c’était épargner et économiser de la cellulose, les forêts, le matériel humain qu’exigeait la fabrication de la cellulose et du papier. Comme le vieux papier de journal pouvait, par la production de papier d’emballage et de carton, acquérir une valeur quadruple, il pourrait devenir l’objet de taxes fiscales avantageuses pour l’État et les municipalités et les lecteurs de journaux seraient dégrevés d’autant de leurs contributions. Bref, le projet était bon, il était en somme irréfutable, et s’il avait quelque chose de sinistre, et de gratuit, de chagrin, voire de bizarre, cela ne tenait qu’au fanatisme exorbitant avec lequel l’ancien artiste poursuivait et défendait, à l’exclusion de tout autre, un projet économique, qu’en réalité lui-même prenait si peu au sérieux qu’il ne faisait pas la moindre tentative de le réaliser. Hans Castorp écoutait notre homme, la tête penchée, approuvait, lorsque son interlocuteur défendait devant lui, en paroles fiévreuses et ailées, sa panacée, et analysait en même temps la nature du mépris et de la répugnance qui l’empêchaient de prendre le parti de l’inventeur contre un monde étourdi.
Quelques pensionnaires du Berghof étudiaient l’espéranto et se plaisaient à s’entretenir quelque peu à la table dans ce charabia artificiel. Hans Castorp les regardait d’un air sombre, jugeant du reste dans son for intérieur qu’ils n’étaient pas les pires. Il y avait depuis quelque temps un groupe d’Anglais qui avaient introduit le jeu de société suivant : l’un de ceux qui y prenaient part posait à son voisin la question que voici : Did you ever see the devil with a night-cap on ? L’autre répondait : No ! I never saw the devil with a night-cap on ; après quoi il posait au suivant la même question, et ainsi de suite, l’un après l’autre. C’était effrayant !
Mais le pauvre Hans Castorp se sentait encore plus mal à l’aise à la vue des faiseurs de réussites que l’on pouvait observer partout dans la maison, et à toute heure du jour. Car la passion de ce délassement s’était récemment manifestée à un point tel qu’elle avait littéralement envahi la maison, et Hans Castorp avait d’autant plus de raison d’en être péniblement touché que lui-même était parfois une victime, et peut-être la plus gravement atteinte, de cette épidémie. C’était la réussite des onze qui l’avait ensorcelé : ce jeu qui consiste à disposer trois rangées de trois cartes, et à couvrir deux cartes, qui ensemble font onze points, ainsi que les trois figures, lorsqu’elles se présentent, jusqu’à ce qu’une chance adorable dénoue la partie. On a peine à admettre que l’âme puisse être stimulée jusqu’à l’ensorcellement par des gestes aussi simples. Néanmoins, Hans Castorp, pareil à tant d’autres, tentait cette chance, et en éprouvait le contre-coup, les sourcils froncés, parce que les excès ne sont jamais joyeux. Livré aux caprices du démon des cartes, subjugué par cette faveur fantastique et changeante qui tantôt multipliait dans un vol léger et bien heureux les couples de onze points, les rencontres du valet, de la reine et du roi, de sorte que le jeu était déjà donné tout entier avant que la troisième série fût terminée (triomphe passager qui ne faisait qu’aiguillonner les nerfs à de nouvelles tentatives), tantôt refusait jusqu’à la neuvième et dernière carte toute possibilité de couverture ou contrariait au dernier moment par un arrêt brusque un succès presque assuré, il faisait des réussites, partout et à toute heure du jour, la nuit sous les étoiles, le matin en pyjama, à table et même en rêve. Il en frémissait, mais il continuait, de sorte que la visite de M. Settembrini qui survint un jour, le « dérangea » comme cela avait toujours été le rôle de l’Italien.
– Accidente ! dit le visiteur, vous vous tirez les cartes, ingénieur ?
– Pas précisément, je tire les cartes tout court, je me débats avec le hasard abstrait. Son versatile caprice m’intrigue : tantôt c’est la plus aimable serviabilité, tantôt une incroyable résistance. Ce matin, en me levant, j’ai réussi trois fois coup sur coup, dont une fois en deux séries, ce qui est un record. M’en croirez-vous si je vous dis que je tire maintenant pour la trente-deuxième fois sans avoir réussi une seule fois, ne serait-ce que la moitié du jeu ?
M. Settembrini le regarda, comme il avait fait si souvent déjà durant ces trois petites années, d’un œil noir et attristé.
– De toute façon vous me paraissez préoccupé, dit-il. Il ne semble pas que je doive trouver ici un réconfort dans mes soucis, et un baume pour le conflit intime qui me tourmente.
– Conflit ? répéta Hans Castorp, et il tira une carte.
– La situation mondiale me trouble, gémit le franc-maçon. L’entente balkanique se réalisera, ingénieur, toutes les informations l’indiquent. La Russie y travaille fiévreusement, et la pointe de la combinaison est dirigée contre la monarchie austro-hongroise, sans la destruction de laquelle aucun point du programme russe ne peut se réaliser. Comprenez-vous mes scrupules ? Je hais Vienne de tout mon cœur, vous le savez. Mais est-ce une raison pour accorder au despotisme sarmate l’appui de mon âme, lorsqu’il est sur le point de porter la torche incendiaire dans notre très noble continent ? D’un autre côté, une collaboration diplomatique, même occasionnelle, de mon pays avec l’Autriche m’atteindrait comme un déshonneur. Ce sont des scrupules de conscience que…
– Sept et quatre, dit Hans Castorp. Huit et trois. Valet, dame, roi. Mais tout va bien. Vous me portez bonheur, Monsieur Settembrini.
L’Italien se tut. Hans Castorp sentit ses yeux noirs, le regard profondément attristé de la raison et du sens moral, mais il continua encore un instant à couvrir des cartes, avant d’appuyer la joue sur sa main et de lever les yeux vers son mentor qui était debout devant lui, avec la mine impénitente et faussement innocente d’un petit polisson.
– Vos yeux, dit celui-ci, s’efforcent en vain de cacher que vous savez fort bien où vous en êtes arrivé.
– Placet experiri, fut l’impertinente réponse de Hans Castorp, et M. Settembrini le quitta ; après quoi, resté seul, le jeune homme demeura quelque temps encore, la tête appuyée sur sa main, assis à sa table au milieu de la chambre blanche, sans se remettre à tirer des cartes et, au fond de lui-même, pris d’effroi devant cet état sinistre et incertain dans lequel il voyait le monde, devant le sourire grimaçant de ce démon et de ce lieu simiesque sous le pouvoir insensé et effréné duquel il se voyait placé et dont le nom était « la Grande Hébétude ».
Nom grave et apocalyptique, bien fait pour inspirer une anxiété secrète. Hans Castorp était assis, et de la paume de ses mains, il se frottait le front et la région du cœur. Il avait peur. Il lui semblait que « tout cela » ne pouvait pas bien finir, que cela finirait par une catastrophe, par une révolte de la nature patiente, par un orage, par une tempête qui nettoierait tout, qui romprait le charme pesant sur le monde, qui entraînerait la vie par-delà le « point mort », et que la période de cafard serait suivie d’un terrible jugement dernier. Il avait envie de fuir, nous l’avons déjà dit, et c’était donc une chance que les autorités eussent l’œil sur lui, comme on l’a appris, qu’elles eussent lu la vérité dans ses traits et qu’elles eussent pris soin de le distraire par de nouvelles et fécondes hypothèses.
Sur un ton de joviale roublardise, l’autorité suprême avait déclaré être sur la trace des causes véritables de la température irrégulière de Hans Castorp, de causes auxquelles, à en croire ce témoignage scientifique, il serait si facile de remédier que la guérison, le départ légitime pour le pays plat semblaient promis pour une date prochaine. Le cœur du jeune homme battait, assailli par des impressions multiples, lorsqu’il tendit son bras à la prise de sang. Clignant des yeux et pâlissant légèrement, il admira la merveilleuse couleur de rubis de son suc vital, qui monta et emplit le récipient transparent. Le conseiller lui-même, assisté du docteur Krokovski et d’une infirmière, accomplit cette petite opération dont la portée était si grande. Ensuite une série de journées passèrent, que domina pour Hans Castorp le désir de savoir si le sang donné, analysé en dehors de lui, tiendrait le coup aux yeux de la science.
Naturellement il n’avait pas encore eu le temps de germer, commença par dire le conseiller. Malheureusement, jusqu’à présent, on n’avait encore rien découvert, dit-il plus tard. Mais vint le matin où, à l’heure du petit déjeuner, il s’approcha de Hans Castorp qui avait maintenant sa place à la table des Russes bien, en haut de cette table où avait siégé autrefois certaine haute personnalité qu’il avait tutoyée, et lui annonça avec force félicitations que le streptocoque avait enfin été incontestablement découvert dans une des cultures préparées. C’était à présent un problème de calcul des probabilités d’établir si les phénomènes d’intoxication devaient être ramenés à la petite tuberculose qui existait incontestablement ou aux streptocoques que l’on avait trouvés, dans une proportion du reste également modeste. Lui, Behrens, se proposait d’examiner la chose de plus près. La culture n’avait pas encore pris tout son développement. Il la lui montra au « labo » : c’était une gelée rouge de sang, sur laquelle on distinguait de petits points gris. C’étaient les coques (mais le dernier imbécile venu a des coques, de même que des tubercules, et si l’on n’avait pas eu les symptômes, il n’y aurait pas eu lieu d’accorder la moindre importance à cette constatation).
Séparé de Hans Castorp, sous les yeux de la science, le sang coagulé du jeune homme continuait de faire ses preuves. Vint le matin où le conseiller rapporta en termes d’une émotion stéréotypée : les coques s’étaient développés non seulement sur une des cultures, mais sur toutes les autres ils avaient fini par germer en grandes quantités. Il n’était pas certain que tous fussent des streptocoques ; mais il était plus que probable que les phénomènes d’intoxication provenaient d’eux, quoique l’on ne pût savoir exactement ce qu’il fallait mettre sur le compte de la tuberculose dont il avait été incontestablement atteint et dont il n’était pas encore complètement guéri. Quelle conclusion tirer de cela ? Un auto-vaccin de streptocoques ! Le pronostic ? Extraordinairement favorable. D’autant plus que la tentative ne comportait aucun risque, ne pourrait en aucune façon lui faire de mal. Car le sérum était tiré du propre sang de Hans Castorp, de sorte que l’injection n’introduirait dans son corps aucun élément de maladie qui ne s’y trouvait déjà. En mettant les choses au pire, le traitement serait sans effet. Effet zéro. Mais dès lors que le malade devait de toute façon rester ici, pouvait-on appeler cela un cas grave ?
Nullement, Hans Castorp ne voulait pas aller jusque-là. Il se soumit au traitement, bien qu’il le jugeât ridicule et déshonorant. Ces vaccinations avec son propre sang lui paraissaient une diversion affreusement déplaisante, une sorte d’inceste ignominieux avec lui-même, stérile et inutile. Ainsi jugeait-il dans son hypocondrie d’ignorant ; il n’eut raison que sous le rapport de l’inutilité (mais sous ce rapport, pleinement et sans réserves). La diversion dura des semaines. Elle semblait parfois lui faire du mal, ce qui ne pouvait être qu’une erreur, parfois elle semblait profitable, ce qui par la suite apparut également être une erreur. Le résultat fut zéro, sans qu’on l’eût du reste expressément qualifié et proclamé comme tel. L’entreprise se perdit dans le vague et Hans Castorp continua de faire des réussites, face à face avec le démon dont le règne absolu sur son esprit devait trouver une fin violente.
FLOTS D’HARMONIE
Quelle acquisition et quelle innovation du Berghof allait délivrer notre vieil ami de sa manie des cartes, pour le jeter dans les bras d’une autre passion plus noble, quoique en somme non moins étrange ? Nous sommes sur le point de le rapporter, tout animé des charmes secrets de notre sujet et sincèrement impatient de les dispenser au lecteur.
Il s’agissait d’un complément aux jeux de société du grand salon, imaginé et décidé par le comité de la maison, et acquis à grands frais dont nous n’allons pas faire le compte, mais dans un souci qu’il nous faut qualifier de généreux, par la direction de cette institution à coup sûr très recommandable. Serait-ce donc quelque jouet ingénieux de l’espèce de la boîte stéréoscopique, du kaléidoscope en forme de longue-vue et du tambour cinématographique ? Oui et non. Car, premièrement, ce n’est pas un appareil optique, mais un appareil acoustique, que l’on trouve un soir, à la surprise générale, au salon de musique. Et de plus on ne pouvait lui comparer, ni pour le genre, ni pour le rang, ni pour sa valeur, ces amusettes faciles. Ce n’était pas un puéril et monotone appareil de prestidigitation dont on se lasserait bientôt et que l’on ne toucherait plus pour peu que l’on eût trois semaines à son actif. C’était une corne d’abondance qui dispensait des jouissances artistiques bienheureuses ou mélancoliques. C’était un instrument de musique, c’était un phonographe.
Notre première crainte est que ce mot ne soit pris dans un sens indigne et périmé, et qu’il n’évoque une idée qui correspond à une forme surannée et dépassée de ce à quoi nous pensons, mais non à l’objet véritable que les essais inlassables d’une technique vouée aux muses ont amené au plus noble degré de perfection. Mes bons amis ! Certes, ce n’était pas cette misérable boîte à manivelle qui, autrefois, surmontée du disque et de l’aiguille, prolongée par un difforme pavillon de trompette, emplissait, du haut d’une table d’auberge, des oreilles sans prétention d’un beuglement nasillard. Le coffret peint en noir mat qui, un peu plus profond que large, relié par un câble de soie au contact du courant électrique, reposait avec une sobre distinction sur un petit meuble à rayons, n’avait plus rien de commun avec cette machinerie grossière et antédiluvienne. On ouvrait le couvercle qui se relevait gracieusement et qu’un petit levier de cuivre maintenait automatiquement en une position oblique et protectrice, et l’on apercevait dans un renfoncement plat la plaque tournante tendue de drap vert et bordée de nickel, ainsi que l’axe, également nickelé, qui pénétrait dans le trou du disque d’ébonite. On remarquait en outre, à droite et en avant, sur le côté, un dispositif chiffré à la manière d’une montre, qui permettait de régler la vitesse, à gauche le levier par lequel on mettait en marche ou arrêtait le mouvement ; enfin l’on voyait à gauche, en arrière, le coude tors et articulé, en nickel, avec le résonateur arrondi et plat, dont la vis était destinée à tenir l’aiguille. On ouvrait encore les battants de la porte située en avant de l’appareil, et l’on apercevait une sorte de persienne formée de petites lattes obliques en bois verni, rien de plus.
– C’est le dernier modèle, dit le conseiller qui était entré en même temps que les pensionnaires. Dernière acquisition, mes enfants. Première qualité extra, on ne fabrique rien de mieux dans le genre.
Il prononça ces mots avec une drôlerie extrême, à la manière d’un camelot illettré vantant une marchandise.
– Ce n’est ni un appareil, ni une machine, poursuivit-il, en tirant une aiguille d’une petite boîte en fer-blanc bariolé et en la fixant. C’est un instrument, c’est un Stradivarius, un Guarneri ; il possède des qualités de résonance et de vibration du raffinement le plus choisi. La marque est Polyhymnia, ainsi que vous l’apprend l’inscription que vous trouvez à l’intérieur du couvercle. Fabriqué en Allemagne, pas vrai ? C’est nous qui faisons le mieux dans ce genre, et de bien loin. La vraie musique sous une forme moderne et mécanique. L’âme allemande up to date. Et voici la bibliothèque, ajouta-t-il en désignant une petite armoire où s’entassaient les albums au dos épais. Je vous remets toute la sorcellerie pour votre bon plaisir, mais je la recommande à la protection du public. Voulez-vous qu’à titre d’essai nous donnions une audition ?
Les malades l’en prièrent instamment, et Behrens prit un de ces livres magiques, muets, mais pleins de substance, tourna les lourdes pages, tira un disque d’une des chemises cartonnées dont les découpures rondes laissaient apparaître les titres en couleur, et l’ajusta. D’un geste de la main, il établit le courant, attendit deux secondes, jusqu’à ce que l’appareil eût pris une vitesse normale, et appliqua avec soin la petite pointe de l’aiguille d’acier sur le rebord du disque. On entendit un léger crissement. Il referma le couvercle, et au même instant, par la porte ouverte de l’instrument, entre les fentes de la jalousie, et même venant de tous les coins du coffret, éclata une folie instrumentale, une mélodie joyeuse, bruyante et pressante, les premières mesures sautillantes d’une ouverture d’Offenbach.
Bouches bées, tous écoutaient en souriant. On n’en croyait pas ses oreilles, tant étaient pures et naturelles les roulades des bois. Un violon, un solo de violon préluda d’une façon fantastique. On distinguait le coup d’archet, le trémolo des cordes, le suave passage d’un registre à l’autre. Il trouva sa mélodie, la valse, le « hélas, je l’ai perdue ». L’harmonie de l’orchestre appuyait discrètement l’air caressant, et c’était un délice de l’entendre se répéter, en un tutti, repris avec tous les honneurs par l’ensemble. Naturellement, ce n’était pas tout comme si un véritable orchestre avait joué ici même, dans la pièce. La perspective du son était rétrécie, bien que son corps, pour le reste, ne fût pas altéré. On eût cru – s’il est permis de hasarder pour un phénomène de l’ouïe une comparaison tirée du domaine de la vue – on eût cru considérer un tableau à travers une jumelle retournée, de sorte qu’il paraissait éloigné et rapetissé, sans rien perdre de la netteté de son dessin, de la luminosité de ses couleurs. Le morceau de musique, pétillant et éclatant de talent, se déroula avec tout le brillant d’une invention pleine d’esprit. La fin était pure turbulence, un galop qui commençait avec des hésitations cocasses, un cancan impertinent qui évoquait la vision de hauts de forme agités en l’air, de genoux lancés en avant et de dessous moutonnants, et qui n’en finissait pas de finir dans son comique triomphal. Puis le mouvement s’arrêta de lui-même. C’était tout. On applaudit de bon cœur.
On réclama autre chose, et on l’obtint ; une voix humaine s’échappa du coffret, à la fois mâle, douce et puissante, accompagnée par un orchestre. C’était un baryton italien au nom célèbre, et à présent il ne pouvait plus être question ni d’un voile ni d’un éloignement quelconques. Le magnifique organe résonnait en son étendue naturelle, avec toute sa force, et si l’on passait dans l’une des pièces voisines où l’on cessait de voir l’appareil, on eût dit que l’artiste en personne était présent dans le salon, sa musique à la main, et chantait. Il chantait dans sa langue un morceau de bravoure tiré d’un opéra : « E il barbiere. Di qualità, di qualità ! Figaro quà, Figaro là ; Figaro, Figaro, Figaro ! » Les auditeurs manquèrent mourir de rire de son parlando en fausset, du contraste entre cette voix d’ours et cette volubilité à se fouler la langue. Les plus compétents pouvaient suivre et admirer son phrasé et sa technique respiratoire. Maestro de l’irrésistible, virtuose dans le goût italien du da capo, il filait l’avant-dernière note, celle qui précédait la tonique finale, en s’avançant, semblait-il, vers la rampe, la main levée, eût-on dit, de telle sorte que l’on éclatait en bravos prolongés avant qu’il eût fini. C’était parfait.
Et l’on entendit autre chose encore. Un cor de chasse exécuta avec un soin remarquable des variations sur une chanson populaire. Une soprano fit retentir le staccato et les trilles d’un air de la Traviata, avec la fraîcheur et la précision les plus séduisantes. Le fantôme d’un violoniste de renom mondial joua, comme derrière des voiles, avec un accompagnement de piano, sec comme une épinette, une romance de Rubinstein. Du coffret magique qui bouillonnait doucement, s’échappaient des sons de cloches, des glissando de harpes, des fanfares et des roulements de tambours. Enfin on joua des disques de danse. On possédait déjà quelques spécimens de cette importation des plus récentes, dans le goût exotique d’un cabaret de port : le tango, appelé à faire de la valse viennoise une danse d’aïeux. Deux couples, qui connaissaient le pas à la mode, le produisirent sur le tapis. Behrens s’était retiré après avoir recommandé de ne se servir qu’une fois de chaque aiguille et de traiter les disques « exactement comme des œufs frais ». Hans Castorp prit la charge de l’appareil.
Pourquoi lui, justement ? Cela s’était fait tout seul. Brièvement et à voix basse, il avait repoussé ceux qui, après le départ du conseiller, avaient voulu s’occuper de changer les aiguilles et les disques, d’établir ou d’interrompre le courant. « Laissez-moi faire ! », avait-il dit en les écartant et, indifférents, ils lui avaient cédé la place, premièrement parce qu’il paraissait s’y entendre depuis longtemps, ensuite parce qu’ils se souciaient peu de se rendre utiles à la source du plaisir, au lieu de se laisser dispenser commodément et sans responsabilité aussi longtemps que cela ne les ennuierait pas.
Il n’en était pas de même de Hans Castorp. Lorsque le conseiller avait présenté la nouvelle acquisition, il s’était tranquillement tenu au fond de la pièce, sans rire, sans applaudir, mais suivant chaque morceau avec une attention soutenue, en tourmentant, selon son habitude, de deux doigts un de ses sourcils. En proie à une certaine agitation, il avait plusieurs fois changé de place, était allé dans la bibliothèque pour écouter de plus loin, et, les mains dans le dos, l’expression absorbée, avait fini par s’arrêter auprès de Behrens, l’œil sur le coffret, observant le maniement facile du phonographe. Quelque chose disait en lui : « Halte, halte, attention ! Quel événement ! Il m’est arrivé quelque chose. » Le pressentiment le plus précis d’une passion, d’un enchantement et d’un amour à venir l’animait. Le jeune homme du pays plat, que la flèche d’Amour a touché en plein cœur, au premier regard qu’il a jeté sur une jeune fille, n’éprouve pas d’autres sentiments. La jalousie commanda aussitôt les actes de Hans Castorp. Propriété commune ? La curiosité nonchalante n’a ni le droit ni la force de posséder. « Laissez-moi faire ! », dit-il entre ses dents, et tous s’en accommodèrent. Ils dansèrent encore un peu sur des morceaux légers qu’il fit tourner, ils réclamèrent un morceau de chant, un duo d’opéra, la barcarolle des Contes d’Hoffmann qui charma leurs oreilles, et lorsqu’il rabattit le couvercle, ils s’en furent, superficiellement excités, et bavardant, à leur cure ou au lit. C’était bien à quoi il s’était attendu. Ils laissèrent tout traîner, les boîtes d’aiguilles ouvertes et les albums, les disques répandus. Cela leur ressemblait ! Il fit mine de les suivre, mais quitta en secret leur file dans l’escalier, retourna au salon, ferma toutes les portes et y demeura la moitié de la nuit, profondément absorbé.
Il se familiarisait avec la nouvelle acquisition. Il examinait, sans être dérangé, le trésor de disques, le contenu des lourds albums. Il y en avait douze, de deux formats, contenant chacun douze disques ; et comme beaucoup de ces plaques noires, gravées concentriquement, étaient à double face – non seulement parce que beaucoup de morceaux s’étendaient sur le disque tout entier, mais aussi parce qu’un grand nombre de plaques portaient deux morceaux différents – c’était là un domaine de belles possibilités que l’on avait peine à embrasser dès l’abord, et dont la richesse vous troublait. Il en joua bien le quart d’un cent, en se servant d’aiguilles en sourdine, pour ne pas déranger les autres et ne pas être entendu la nuit, mais c’était à peine la huitième partie de ce qui s’offrait de toutes parts et le conviait à des essais tentants. Pour le moment il se contenta de parcourir les titres, d’essayer de temps à autre un de ces graphiques circulaires et muets, en l’incorporant au meuble pour le faire résonner. À l’œil nu, ils ne se distinguaient, ces disques d’ébonite, que par leurs étiquettes colorées, et par rien de plus. L’un ressemblait à l’autre, était couvert partout, ou presque partout, de cercles concentriques. Et pourtant le fin tracé de ces lignes contenait toute la musique imaginable, les inspirations les plus heureuses de tous les domaines de l’âme, dans une interprétation de premier ordre.
Il y avait là une quantité d’ouvertures et de mouvements appartenant à l’univers de la symphonie sublime, joués par des orchestres fameux, dont les chefs étaient désignés par leurs noms. Ensuite, une longue série d’airs, chantés avec accompagnement de piano par des chanteurs de grand opéra, dont les uns étaient les produits conscients et élevés d’un art personnel, les autres, de simples chansons populaires, d’autres encore tenaient en quelque sorte le milieu entre ces deux genres, en ce sens que tout en étant composés avec un art savant, ils avaient été sentis et inventés dans l’esprit et selon le cœur du peuple, avec une authentique et profonde piété. Ces dernières étaient donc des chansons populaires artificielles, si l’on peut ainsi dire, sans vouloir amoindrir leur ferveur par cette épithète « artificiel ». Il en était une en particulier, que Hans Castorp avait connue dès son enfance, et à laquelle l’attachait maintenant un amour plein de rapports mystérieux et dont il sera encore question.
Qu’y avait-il encore, ou, plus exactement, que n’avait-on pas ? Il y avait des opéras en nombre infini. Un chœur international de chanteurs et de cantatrices célèbres, accompagnés en sourdine par un orchestre discret, prêtait le don divin de ses voix exercées à l’exécution d’airs et de duos, de scènes entières d’ensemble qui représentaient les régions et les époques les plus différentes du théâtre lyrique : de la sphère de beauté méridionale, à la fois généreusement et frivolement passionnée, du monde populaire allemand, tantôt espiègle, tantôt satanique, du grand opéra français et de l’opéra-comique. Était-ce tout ? Oh, non ! car venait ensuite la série des musiques de chambre, des quatuors et des trios, des solos de violon, violoncelle, flûte, des airs de concert avec accompagnement de violon ou flûte, les numéros de piano seul, sans parler des simples divertissements, des couplets et des disques utilitaires où l’on avait enregistré les airs de petits orchestres de danse, et qui appelaient une aiguille plus rude.
Hans Castorp explorait, rangeait tous ces disques, en transmettait certains, manipulant tout seul l’instrument qui les éveillait à une vie sonore. La tête brûlante, il alla se coucher à une heure aussi tardive qu’après le premier banquet organisé par Pieter Peeperkorn, de joyeuse et fraternelle mémoire, et, de deux à sept heures, il rêva du coffret magique. En rêve, il voyait le disque mobile tourner autour de son axe ; si rapidement qu’il en devenait invisible et silencieux, en un mouvement qui ne consistait pas seulement en un tournoiement vertigineux, mais encore en une sorte d’ondulation latérale très singulière, par laquelle le coude articulé qui portait l’aiguille subissait une vibration élastique, et comme respiratoire, bien faite, comme on pouvait le croire, pour rendre le vibrato et le portamento des archets et de la voix humaine. Mais il restait incompréhensible, dans le rêve comme en l’état de veille, comment, en suivant une ligne fine comme un cheveu, au-dessus d’une boîte de résonance, on pouvait, par la simple vibration d’une lamelle, reproduire la riche composition des corps sonores qui emplissaient en songe l’oreille du dormeur.
De bon matin il retourna au salon, encore avant l’heure du déjeuner, et, les mains jointes, assis sur une chaise, il fit chanter dans le coffret, par un magnifique baryton, avec accompagnement de harpe : « Si dans ce noble cercle je regarde autour de moi… » La harpe avait un son parfaitement naturel, c’était un jeu de harpe authentique et nullement amoindri que le coffret rendait, en même temps que la voix humaine qui s’enflait en respirant et en articulant, chose vraiment étonnante ! Et il n’y avait rien de plus tendre au monde que le duo d’un opéra italien que Hans Castorp exécuta ensuite – que cette intimité humble et fervente entre le ténor de renom mondial qui figurait si souvent dans les albums et une petite soprano suave et transparent comme du verre, que son « Da mi il braccio, mia piccina », et la petite phrase simple, douce, d’un jet mélodique continu, par laquelle elle lui répondait…
Hans Castorp sursauta lorsque la porte s’ouvrit derrière lui. C’était le conseiller qui venait voir : dans sa blouse de médecin, le stéthoscope débordant de sa poche, il resta un instant debout, la main sur la poignée de la porte, et salua d’un signe de tête l’alchimiste. Celui-ci répondit par-dessus l’épaule à ce hochement de tête, après quoi la figure du chef, avec ses joues bleues et sa petite moustache troussée d’un seul côté, disparut derrière la porte, qui se referma, et Hans Castorp se consacra de nouveau à son petit couple d’amoureux invisible et harmonieux.
Plus tard, dans le courant de la journée, après le déjeuner, après le dîner, il eut des auditeurs, un public qui se renouvelait, si on ne le considérait pas lui-même comme faisant partie du public, et si on le tenait pour le dispensateur du plaisir. Personnellement il inclinait à interpréter ainsi son rôle, et les pensionnaires le laissèrent faire, dans ce sens qu’ils admirèrent dès le début, en silence, qu’il se fût aussi résolument institué le gardien et l’administrateur de cette institution publique. Il n’en coûtait guère à ces gens ; car, malgré leur ravissement superficiel, lorsque cette idole ténorisante s’enivrait de mélodie et d’éclat, lorsque la voix bienheureuse s’épandait en cantilènes et dans les arts sublimes de la passion, malgré ce ravissement manifesté à voix haute, ils étaient sans amour, et par conséquent tout disposés à abandonner le souci à quiconque voulait l’assumer. C’était Hans Castorp qui veillait sur le trésor de disques, qui inscrivit le contenu des albums à l’intérieur du couvercle de chacun d’eux, de sorte que l’on avait aussitôt sous la main tout morceau demandé, et c’était lui qui maniait l’instrument. On le vit bientôt manipuler avec des gestes exercés, brefs et délicats. En effet, qu’auraient fait les autres ? Ils auraient abîmé les disques, en se servant d’aiguilles usées, ils les auraient laissés traîner sans enveloppe sur les chaises, ils se seraient livrés à des farces stupides avec l’appareil, en faisant jouer un morceau noble à la vitesse et sur le ton cent dix, ou en plaçant l’aiguille sur zéro, pour produire un tirili hystérique ou des gémissements étouffés. Ils avaient déjà fait tout cela. Ils étaient malades, mais grossiers. Et c’est pourquoi, au bout de quelque temps, Hans Castorp confisqua tout simplement la clef de l’armoire qui contenait les disques et les aiguilles, de sorte qu’il fallait l’appeler lorsqu’on voulait faire jouer le phonographe.
Tard dans la soirée, après la réunion du soir, après le départ de la cohue, était sa meilleure heure. Il restait alors au salon, ou y retournait en secret, et y faisait de la musique, seul, jusqu’au profond de la nuit. Il n’avait pas à craindre de troubler le sommeil de la maison, car la portée de sa musique de fantômes s’était révélée très réduite : autant les vibrations produisaient des effets étonnants dans la proximité de leur source, autant elles faiblissaient vite, frêles et d’une puissance tout apparente, comme ce qui tient du fantôme, lorsqu’on s’en éloignait. Hans Castorp était seul entre ses quatre murs, avec les merveilles du coffret, avec les productions florissantes de ce petit cercueil taillé dans un bois à violon, de ce petit temple noir et mat, devant la porte à deux battants duquel il était assis sur sa chaise, les mains jointes, la tête sur l’épaule, la bouche ouverte, et il se laissait inonder par l’harmonie.
Les chanteurs et les cantatrices qu’il entendait, il ne les voyait pas, leur forme humaine était en Amérique, à Milan, à Vienne, à Saint-Pétersbourg, elle pouvait bien y demeurer, car ce qu’il avait d’eux était le meilleur d’eux-mêmes, c’était leur voix, et il appréciait cette épuration, ou cette abstraction, qui restait assez perceptible aux sens pour lui permettre d’exercer un bon contrôle humain, en éliminant tous les inconvénients d’une trop grande proximité personnelle, surtout lorsqu’il s’agissait de compatriotes, d’Allemands. L’élocution, le dialecte, l’origine exacte de l’artiste, il les distinguait parfaitement, le caractère de la voix le renseignait sur la qualité d’âme de chacun, et le degré de leur intelligence se traduisait par la manière dont ils tiraient parti des possibilités d’un effet, ou au contraire les négligeaient. Hans Castorp se fâchait lorsqu’il les voyait faillir à leur rôle. Il souffrait aussi et se mordait les lèvres de dépit, lorsque la reproduction technique comportait des imperfections ; il était assis comme sur des charbons ardents lorsque, dans le cours d’un disque souvent joué, un chant devenait criard ou rauque, ce qui était facilement le cas pour les voix de femmes, si ingrates. Mais il supportait cela, car l’amour doit savoir souffrir. Parfois il se penchait sur son instrument qui tournait en respirant, comme sur une gerbe de lilas, la tête dans le nuage de sons ; ou il se tenait debout devant le coffre ouvert, goûtant le plaisir souverain du chef d’orchestre en indiquant à un cuivre d’un geste de la main l’instant exact où il devait attaquer. Il avait ses disques préférés dans la collection, quelques numéros de chant et d’instruments qu’il ne se lassait jamais d’entendre. Nous ne saurions négliger de les citer.
Un petit groupe de disques présentait les scènes finales de l’opéra pompeux, débordant de génie mélodieux, qu’un grand compatriote de Settembrini, le vieux maître de la musique dramatique méridionale, avait composé sur la commande d’un souverain oriental dans la deuxième moitié du siècle précédent, pour une circonstance solennelle, à l’occasion de la remise d’un monument destiné à rapprocher les peuples. Hans Castorp savait à peu près de quoi il s’agissait, il connaissait dans ses grandes lignes le sort de Radamès, d’Amnéris et d’Aïda, qui chantaient pour lui en italien dans le coffret, et il comprenait donc assez bien ce qu’ils chantaient, l’incomparable ténor, le contralto princier, avec ce splendide changement de timbre dans le médium, et le soprano argentin. Il ne comprenait pas tout, mais un mot, de temps à autre, grâce à sa connaissance des situations et à sa sympathie pour ces situations, grâce à une sympathie affectueuse qui augmentait à mesure qu’il jouait ces quatre ou cinq disques, et qui était presque déjà devenu un sentiment amoureux.
D’abord, Radamès et Amnéris avaient une explication : la princesse faisait amener devant elle le prisonnier, lui qu’elle aimait et souhaitait ardemment sauver pour elle, quoiqu’il eût renié la patrie et l’honneur pour l’amour d’une esclave barbare, tandis que, comme il disait « au tréfonds du cœur l’honneur était resté intact ». Mais cette intégrité intérieure en dépit de sa lourde faute ne lui servait de rien, car son crime manifeste le livrait au tribunal sacré auquel tous les sentiments humains sont étrangers et qui n’aurait certainement aucun ménagement pour lui s’il ne se décidait pas en dernier lieu à abjurer son amour pour l’esclave et à se jeter dans les bras du contralto royal qui, du seul point de vue acoustique, le méritait pleinement. Amnéris luttait de toutes ses forces pour le ténor si harmonieux, mais tragiquement aveuglé et détourné de la vie, qui chantait toujours de nouveau : « Je ne peux pas », et « En vain ! », lorsqu’elle le suppliait désespérément de renoncer à l’esclave, parce que sa vie était en jeu. « Je ne peux pas ! » – « Écoute encore une fois, renonce à elle ! » – « En vain. » Un mortel aveuglement et le plus brûlant chagrin d’amour s’alliaient en un duo qui était d’une extraordinaire beauté, mais qui ne laissait aucun espoir. Amnéris accompagnait de ses cris de douleur les formules effrayantes du tribunal sacré qui résonnaient sourdement dans les profondeurs et dont l’infortuné Radamès n’avait cure.
– Radamès, Radamès, chantait avec insistance le grand prêtre, et sous la forme la plus violente il lui représentait son crime de trahison.
– Justifie-toi, commandaient tous les prêtres en chœur.
Et comme le grand prêtre faisait observer que Radamès gardait le silence, tous, en une caverneuse unanimité, concluaient à la félonie.
– Radamès, Radamès, reprenait le président. Tu as quitté le camp avant la bataille.
– Justifie-toi, reprenait le chœur. – « Voyez, il se tait », constatait pour la seconde fois le dirigeant du débat, nettement prévenu contre le coupable, et dès lors toutes les voix des juges se réunissaient cette fois dans le verdict : « Félonie ! »
– Radamès, Radamès, entendait-on pour la troisième fois l’impitoyable accusateur. Tu as trahi ton serment à la patrie, à l’honneur et au roi. – « Justifie-toi » résonnait à nouveau le chœur. Et « Félonie ! » reconnaissait définitivement et avec effroi le corps des prêtres après qu’on lui eut fait remarquer que Radamès restait complètement muet. L’inéluctable allait donc s’accomplir ; le chœur, dont les voix s’étaient, dès l’origine, accordées, allait annoncer au misérable que son sort était décidé, qu’il mourrait de la mort des maudits, qu’il entrerait vivant dans le tombeau, sous le temple de la divinité courroucée.
Il fallait tant bien que mal imaginer soi-même l’indignation d’Amnéris devant cette cruauté cléricale, car la suite faisait défaut ; mais Hans Castorp dut changer de disque, ce qu’il fit avec des gestes silencieux et brefs, les yeux baissés, et lorsqu’il se fut rassis pour prêter l’oreille, ce fut déjà la dernière scène du drame qu’il entendit, le duo final de Radamès et d’Aïda, chanté au fond de leur tombe souterraine, tandis que, au-dessus de leurs têtes, des prêtres fanatiques et cruels célébraient leur culte, ouvraient les mains et faisaient entendre une litanie assourdie.
« Tu in questa tomba ? » éclatait la voix, d’une séduction indicible, à la fois douce et héroïque, de Radamès, effrayé et ravi… Oui, elle l’avait rejoint, la bien-aimée, pour l’amour de qui il avait perdu la vie et l’honneur, elle l’avait attendu ici pour se faire emmurer avec lui, pour mourir avec lui, et les chants qu’ils échangeaient à ce propos, parfois interrompus par la sourde rumeur de la cérémonie qui se déroulait au-dessus de leurs têtes, ou dans lesquels ils s’unissaient, c’étaient ces chants qui, en réalité, avaient ému jusqu’au fond de l’âme l’auditeur solitaire et nocturne, tant à cause de la situation que de l’expression musicale. Il était question du ciel dans ces chants, mais eux-mêmes étaient célestes, et ils étaient chantés divinement. La ligne mélodique que les voix de Radamès et d’Aïda, séparément et confondues, ne se lassaient pas de retracer, cette courbe simple et bienheureuse qui, se jouant autour de la tonique et de la dominante, montait de la tonique longtemps prolongée un demi-ton avant l’octave, et, après une rencontre fugitive avec celle-ci, se tournait vers la quinte, semblait à l’auditeur la plus merveilleuse des béatitudes qu’il eût jamais connues. Mais il aurait été moins enthousiasmé par les sons, s’il n’y avait eu la situation des héros qui achevait de rendre son âme sensible à la douceur qui s’en dégageait. C’était si beau qu’Aïda eût rejoint Radamès qui était perdu, pour partager en toute éternité avec lui son sépulcral destin ! Avec raison, le condamné protestait contre le sacrifice d’une vie aussi charmante, mais à travers son tendre et désespéré « No, no troppo sei bella », transparaissait l’enchantement qu’il éprouvait de cette union in extremis avec celle qu’il avait cru ne jamais revoir, et Hans Castorp n’avait besoin d’aucun effort d’imagination pour sentir nettement cet enchantement, cette reconnaissance. Mais ce qu’il éprouvait, ce qu’il comprenait, et ce dont il jouissait par-dessus tout, tandis que, les mains jointes, il considérait la petite jalousie noire entre les auvents de laquelle tout ceci fleurissait, c’était l’idéalité triomphante de la musique, de l’art, du cœur humain, la haute et irréfutable sublimation qu’ils faisaient subir à la vulgaire laideur de la réalité. Il suffisait de se représenter de sang-froid ce qui se passait là. Deux enterrés vivants, les poumons pleins d’air vicié, allaient périr ici, ensemble, ou, chose pire, l’un après l’autre, tenaillés par la faim, et ensuite la décomposition accomplirait sur leurs corps son œuvre innommable, jusqu’à ce que deux squelettes reposassent sous la voûte, dont chacun serait tout à fait indifférent et insensible au fait d’être étendu seul ou en compagnie d’un autre. Tel était l’aspect réel et objectif des choses, un côté de ces choses dont l’idéalisme du cœur ne tenait aucun compte, que l’esprit de la beauté et de la musique reléguait triomphalement dans l’ombre. Pour les chœurs d’opéra de Radamès et d’Aïda, le sort réel qui les menaçait n’existait pas. Avec félicité, leurs voix s’élançaient à l’unisson, assurant que le ciel s’ouvrait à présent devant eux, et que, devant eux, rayonnait la lumière de l’éternité. Le pouvoir consolant de cette sublimation faisait un bien infini à l’auditeur et contribuait beaucoup à l’attacher tout particulièrement à ce numéro de son programme habituel.
Il avait coutume de se reposer de ces effrois et de ces extases en écoutant un autre morceau qui était bref, mais d’une magie concentrée, d’un contenu beaucoup plus placide que le précédent l’était, une idylle, mais une idylle raffinée, peinte et formée par les moyens à la fois discrets et compliqués de l’art le plus moderne : un morceau d’orchestre, sans chant, un prélude symphonique d’origine française, réalisé avec un appareil orchestral relativement simple par rapport aux ressources de l’époque, mais baigné de tous les fluides d’une savante et moderne technique sonore, et subtilement fait pour capturer l’âme dans un réseau de rêverie.
Le rêve que faisait Hans Castorp en écoutant ce morceau était le suivant : Il était couché sur le dos, dans un pré ensoleillé et parsemé de fleurs étoilées de toutes les couleurs. Il avait un petit tertre sous sa tête, tenait une jambe repliée, l’autre croisée sur elle, à quoi il faut ajouter que c’étaient des pieds de bouc qu’il croisait. Ses doigts jouaient, pour son propre plaisir (car la solitude du pré était complète), sur une petite flûte de bois, qu’il tenait dans sa bouche, une clarinette ou un chalumeau, dont il tirait des sons paisibles et nasillards, l’un après l’autre, au hasard, et pourtant dans une ronde parfaite, et ce nasillement insouciant montait vers le ciel bleu, sous lequel les feuillages fins et légèrement agités par le vent de quelques bouleaux et frênes scintillaient au soleil. Mais ce sifflotement monotone et contemplatif, nonchalant et à peine mélodique, ne restait pas longtemps la seule voix de la solitude. Le bourdonnement des insectes dans l’air chaud et estival, au-dessus de l’herbe, le soleil lui-même, le vent léger, le balancement des cimes, le scintillement des feuillages, toute la paix doucement agitée de l’été autour de lui devenait un mélange de sons qui donnait un sens harmonique et toujours de nouveau surprenant à son naïf jeu de chalumeau. L’accompagnement symphonique s’effaçait quelquefois et se taisait ; mais Hans Castorp aux pieds de bouc continuait de souffler et réveillait de nouveau par la naïve uniformité de son jeu la magie sonore et coloriée de la nature, qui, après une nouvelle interruption, finissait par déployer pour un instant, en se dépassant elle-même, toute sa plénitude imaginable, tenue jusqu’alors en réserve, par l’intervention successive de voix instrumentales toujours nouvelles et toujours plus aiguës, – pour un instant fugitif dont la délicieuse perfection portait en elle l’éternité. Le jeune faune était très heureux sur son pré ensoleillé. Il n’y avait pas ici de « Justifie-toi », point de responsabilité, pas de tribunal sacré ou militaire appelé à se prononcer sur un homme qui avait oublié l’honneur et s’était perdu. Ici, c’était l’oubli qui régnait, la bienheureuse immobilité, l’état innocent de l’absence de temps. C’était le dévergondage en toute tranquillité d’esprit, la négation, en un rêve d’apothéose, de tout impératif occidental de l’action, et l’apaisement qui s’en dégageait rendait ce disque précieux entre tous à notre musicien nocturne.
Il y avait encore là un troisième morceau… En réalité, c’étaient de nouveau plusieurs disques, formant une suite, un tout, car l’air de ténor qu’il comportait, occupait à lui seul une page entière dont le dessin circulaire s’étendait jusqu’au centre. C’était de nouveau un morceau français, tiré d’un opéra que Hans Castorp connaissait bien, qu’il avait plusieurs fois entendu et vu au théâtre, et à l’action duquel il avait même fait un jour allusion dans le courant d’une conversation, et même d’une conversation très décisive… C’était le deuxième acte, dans la taverne espagnole, une auberge assez vaste, une sorte de bouge décoré de châles et d’une douteuse architecture mauresque. La voix chaude, un peu rude, mais racée et prenante, déclara vouloir danser devant le sergent, et déjà l’on entendait claquer les castagnettes. Mais au même instant, trompettes et clairons sonnaient à plusieurs reprises un signal militaire qui fit sursauter le gars. « Attends un peu ! » s’écriait-il, dressant les oreilles comme un cheval. Et comme Carmen demandait : « Et pourquoi, s’il te plaît », « N’entends-tu pas ? » s’écriait-il, tout étonné qu’elle n’en fût pas frappée autant que lui-même. C’étaient les clairons de la caserne qui sonnaient la retraite. « Il me semble, là-bas… », disait-il, en langage d’opéra. Mais la Tzigane ne pouvait comprendre cela, et surtout ne voulait pas le comprendre. Tant mieux, disait-elle, et c’était mi-sottise, mi-insolence ; ils n’avaient plus besoin de castagnettes, le ciel lui-même leur envoyait de la musique pour danser, et donc : Lalala ! Il était hors de lui. Sa propre et douloureuse déception s’effaçait complètement devant ses efforts pour lui faire entendre de quoi il s’agissait et qu’aucun amour au monde ne pouvait l’emporter sur ce signal. Comment était-il donc possible qu’elle ne comprît pas une chose aussi fondamentale et aussi absolue ? « Il faut que je rentre au quartier, pour l’appel », s’écria-t-il, désespéré de l’ignorance de la femme qui lui faisait le cœur plus gros qu’il n’était déjà. Mais il fallait entendre la réponse de Carmen ! Elle était furieuse, elle était indignée jusqu’au tréfonds de l’âme, sa voix n’était plus qu’amour déçu et irrité. Ou ne faisait-elle que semblant ? « Au quartier ? Pour l’appel ? » Et que faisait-il de son cœur ? Et son cœur si tendre, si bon, qui, dans sa faiblesse, – oui, elle l’avouait : dans sa faiblesse – avait été prêt à amuser monsieur ! « Ta ra ta ta ! » et en un geste de farouche moquerie elle portait sa main devant sa bouche pour imiter le clairon. « Ta ra ta ta ! » Et cela suffisait ! Il sursautait, l’imbécile, et voulait s’en aller. À la bonne heure, va-t’en ! Elle lui tendait son shako, son sabre, sa giberne ! « Et va-t’en, mon garçon, retourne à ta caserne ! » Il implorait sa pitié. Mais elle continuait de le railler amèrement, en faisant semblant d’être lui, qui au son des clairons, avait perdu la tête. Ta ra ta ta, à l’appel ! Grand Dieu, il arriverait trop tard. Eh bien, va-t’en, puisqu’on sonne l’appel ; c’est tout naturel pour toi, espèce d’imbécile, de me laisser ainsi à l’instant où j’allais danser. « Eh voilà son amour ! »
Situation torturante ! Elle ne comprenait pas. La femme, la gitane ne pouvait et ne voulait pas comprendre ! Elle ne le voulait pas, car, sans aucun doute, dans sa fureur, dans ses sarcasmes il y avait quelque chose qui dépassait l’instant présent et l’élément personnel, une haine, une hostilité profonde contre le principe qui par la voix des clairons français – ou des cors espagnols, – appelait le petit soldat amoureux, quelque chose dont son ambition naturelle, impersonnelle et son désir le plus fervent seraient de triompher. Elle possédait un moyen très simple : elle affirmait que s’il s’en allait, elle ne l’aimerait plus. Et c’était là justement ce que José, là-dedans, au fond du coffret, ne supportait pas d’entendre. Il la conjurait de le laisser parler. Elle ne voulait pas. Alors il la força à l’écouter : c’était un instant d’un satané sérieux, des sons tragiques s’élevaient de l’orchestre, un motif sombre et menaçant, qui, Hans Castorp le savait, se prolongerait à travers tout l’opéra, jusqu’à la catastrophe finale, et qui formait aussi l’introduction pour l’air du petit soldat, le nouveau disque qui allait suivre.
« La fleur que tu m’avais jetée… »
José chantait cela merveilleusement. Hans Castorp jouait parfois ce disque séparément, en dehors du contexte familier, et l’écoutait toujours avec la sympathie la plus attentive. Les paroles de cet air ne valaient pas grand’chose, mais l’expression suppliante des sentiments était émouvante au plus haut point. Le soldat chantait la fleur que Carmen lui avait jetée à leur première rencontre et qui avait été son bien le plus cher lorsqu’il fut mis aux arrêts à cause d’elle. Il avouait, profondément remué, qu’il avait à certains instants maudit son sort parce qu’il lui avait fait rencontrer Carmen. Mais aussitôt il avait amèrement regretté ce blasphème et il avait prié Dieu à genoux de lui accorder de la revoir. « Te revoir » – et ce « te revoir » était dans le même ton aigu par lequel il avait commencé tout à l’heure « Et dans la nuit je te voyais. » – La revoir… – et à présent toute la magie instrumentale qui pouvait être propre à peindre la douleur, la nostalgie, la tendresse éperdue, le tendre désespoir du petit soldat, éclatait dans l’accompagnement, – alors elle avait surgi devant son regard, dans tout son charme fatal, de sorte qu’il avait clairement et nettement senti qu’« elle s’était emparée de tout son être » (« emparée » avec une appoggiature sanglotée d’un ton entier sur la première syllabe), que c’en était fait de lui pour toujours. « Toi, ma joie, mon bonheur », chantait-il désespérément, sur une mélodie qui se répétait et que l’orchestre reprenait encore une fois plaintivement, mélodie qui, partant du ton fondamental, montait de deux intervalles et retournait avec ferveur vers la quinte inférieure. « Car tu n’avais eu qu’à paraître », assurait-il d’une manière superflue et démodée, mais infiniment tendre, escaladait ensuite la gamme jusqu’au sixième degré pour ajouter : « qu’à jeter un regard sur moi », laissait retomber sa voix de dix tons, et prononçait, bouleversé, son « Et j’étais une chose à toi » dont la fin était douloureusement prolongée par un accord d’une harmonie variable, avant que le « toi » se fondît avec la précédente syllabe dans l’accord fondamental.
– Oui, oui ! disait Hans Castorp avec une mélancolie reconnaissante, et il jouait encore la finale où tous félicitaient le jeune José de ce que sa rixe avec l’officier lui eût coupé toute possibilité de retour, de sorte qu’il devait déserter, comme Carmen, à son effroi, l’y avait naguère convié.
Le ciel ouvert, la vie errante,
Pour pays l’univers, pour loi, sa volonté,
Et surtout la chose enivrante,
La liberté, la liberté !
chantaient-ils en chœur (on les comprenait parfaitement).
– Oui, oui ! dit-il encore une fois, et il passa à un quatrième morceau qui lui était non moins cher.
Nous sommes aussi peu responsable de ce que ce fût de nouveau un morceau français, que du reproche qu’on pourrait lui faire de ce qu’ici encore l’esprit militaire régnât. C’était un air intercalé, un solo de chant, une prière du Faust de Gounod. Quelqu’un paraissait, quelqu’un d’archi-sympathique, qui s’appelait Valentin, mais que Hans Castorp nommait autrement en son for intérieur, à qui il donnait un nom mélancolique et plus familier dont il identifiait très complètement le porteur avec la personne qu’il entendait dans la boîte, bien que celle-ci eût une voix infiniment plus belle. C’était un baryton puissant et chaud, et son chant se divisait en trois parties ; il se composait de deux strophes, très semblables l’une à l’autre, qui étaient d’un caractère pieux, tenues presque dans le style d’un choral protestant, et d’une strophe centrale d’une hardiesse chevaleresque, guerrière, frivole, mais néanmoins fervente, et c’était là ce qu’elle avait de proprement français et militaire. L’invisible chantait :
Comme vous, pour longtemps, je vais quitter ces lieux…
et dans cette conjoncture il adressait sa prière au Seigneur des cieux pour que, durant cette absence, il protégeât sa sœur chérie. Il partait en guerre, le rythme changeait, devenait entreprenant, le chagrin et le souci pouvaient aller au diable, lui, l’invisible, voulait se jeter avec une hardiesse et une ferveur toutes françaises au plus chaud de la bataille et au plus épais de la mêlée. Mais si Dieu m’appelle au ciel, chantait-il, de là-haut, « je veillerai sur toi ». Ce « toi » désignait sa sœur ; mais il touchait néanmoins Hans Castorp jusqu’au fond de l’âme, et cette émotion ne le quittait pas jusqu’à la fin du morceau.
Ce disque ne présentait pas d’autre intérêt. Nous croyons devoir en traiter brièvement parce que Hans Castorp avait pour lui une préférence si vive, mais aussi parce que, en une autre circonstance, assez étrange, il jouera encore un rôle. Pour le moment, nous en arrivons à un cinquième et dernier morceau de ce choix restreint des disques préférés, un morceau qui n’a, il est vrai, plus rien de français, qui est même particulièrement et spécifiquement allemand. Il s’agit non pas d’un trio d’opéra, mais d’un lied, d’un de ces lieds, chefs-d’œuvre tirés du fond populaire qui doivent précisément leur spiritualité et leur humanité particulière à cette double origine… Pourquoi tant de détours ? C’était le « Tilleul » de Schubert, c’était tout simplement : « Près du puits, devant le portail », cette chanson à tous familière.
Un ténor la chantait, avec accompagnement de piano, un garçon plein de tact et de goût, qui savait traiter son sujet à la fois simple et sublime avec beaucoup d’intelligence, de sens musical et de justesse dans la déclamation. On n’ignore pas que l’admirable chanson est dans la bouche du peuple et des enfants un peu différente de sa forme artistique. Ils la simplifient le plus souvent, la chantent d’un bout à l’autre par strophes, sur la mélodie principale tandis que dans l’original cette ligne populaire est modulée en bémol dès la deuxième des strophes de huit lignes, pour revenir au dièse avec le cinquième vers, qu’elle est ensuite interrompue d’une façon très dramatique lors des « vents froids » et du chapeau qui s’envole, et qu’elle ne reparaît qu’aux quatre derniers vers de la troisième strophe qui sont répétés pour que la chanson s’achève. L’inflexion particulièrement prenante de la mélodie se reproduit trois fois, dans sa deuxième moitié modulée, la troisième fois par conséquent lors de la reprise de la dernière demi-strophe, « Voici bien des heures… » Cette inflexion magique que nous ne saurions cerner d’assez près par les mots, accompagne les fragments de phrases : « Tant de chères paroles », « Comme s’ils me faisaient signe », « Loin de cet endroit », et la voix de ténor, claire et chaude, si experte à ménager le souffle, inclinant à un sanglot plein de mesure, la chantait chaque fois avec un sens si intelligent de la beauté de cette phrase qu’elle touchait le cœur de l’auditeur, d’autant plus que dans les lignes : « Vers lui toujours encore », « Tu trouves ici la paix », l’artiste savait renforcer son effet par des sons d’une extraordinaire ferveur. Mais au dernier vers répété, à ce « Tu trouverais ici la paix », il chantait le « trouverais », la première fois avec une plénitude nostalgique, la seconde fois dans un trémolo ténu.
Voilà pour la chanson et la manière dont elle était interprétée. Nous pouvons, à la rigueur, nous flatter d’avoir réussi à faire comprendre à peu près à nos auditeurs la sympathie intime que Hans Castorp éprouvait pour les numéros préférés des programmes de ses concerts nocturnes. Mais faire entendre ce que ce dernier numéro, ce que ce lied, ce vieux « Tilleul », signifiait pour lui, c’est là en vérité une entreprise de l’espèce la plus délicate, et la plus grande prudence nous est commandée dans l’intonation si nous ne voulons pas compromettre notre dessein au lieu de le servir.
Nous présenterons les choses comme suit : un objet qui relève de l’esprit, c’est-à-dire un objet qui a une signification, est « significatif » par cela justement qu’il dépasse son sens immédiat, qu’il exprime et expose une chose d’une portée spirituelle plus générale, tout un monde de sentiments et de pensées qui ont trouvé en lui leur symbole plus ou moins parfait, ce qui donne précisément la mesure de sa signification. L’amour même qu’on éprouve pour un tel objet, est en lui-même « significatif ». Il nous renseigne sur celui qui éprouve ce sentiment, il caractérise ses rapports avec ces choses essentielles, avec ce monde que l’objet symbolise et qui, consciemment ou inconsciemment, est aimé à travers cet objet.
Nous croira-t-on que notre simple héros, après tant de petites années de développement hermétique et pédagogique, était entré assez profondément dans la vie de l’esprit pour prendre conscience de la « signification » de son penchant et de l’objet de ce penchant ? Nous affirmons et nous narrons que c’était bien le cas. Le lied en question signifiait beaucoup pour lui, tout un monde, un monde qu’il devait sans doute aimer, car, sinon, il n’aurait pas été aussi entiché de l’objet qui le symbolisait. Nous mesurons nos paroles, lorsque nous ajoutons, – peut-être d’une façon un peu obscure, – que sa destinée aurait été différente si son âme n’avait pas été tout particulièrement accessible aux charmes de la sphère sentimentale et, en général, de l’attitude spirituelle, que cette chanson résumait avec une ferveur si mystérieuse. Mais ce destin précisément avait entraîné des sensations, des aventures, des découvertes, avait posé en lui des problèmes de « gouvernement », qui l’avaient mûri pour une critique pleine de pressentiments exercée sur ce monde, sur le symbole de ce monde, cependant digne de toute son admiration, sur cet amour qui était le sien : des expériences qui étaient bien faites pour mettre toutes ces choses en question.
Mais il faudrait vraiment n’entendre absolument rien aux choses de l’amour pour supposer que de tels doutes puissent faire tort à l’amour. Au contraire, ils lui donnent son piment. Ce sont eux qui ajoutent à l’amour l’aiguillon de la passion, de sorte que l’on pourrait véritablement définir la passion comme un amour qui doute. En quoi consistaient donc les doutes de conscience et de gouvernement de Hans Castorp en ce qui touche la légitimité de son penchant pour cette chanson enchanteresse et pour son univers ? Quel était ce monde qui s’ouvrait derrière elle et qui, d’après le pressentiment de sa conscience, devait être le monde d’un amour interdit ?
C’était la Mort.
Mais n’était-ce pas pure folie ! Quoi, un lied aussi merveilleux ? Un pur chef-d’œuvre, né dans les profondeurs dernières et les plus sacrées de l’âme populaire, un trésor hors de prix, image de toute ferveur, le charme même ! Quelle vilaine calomnie !
Eh oui, cent fois oui, c’était fort joli, c’est ainsi sans doute que tout honnête homme devait parler. Et pourtant, derrière cette production adorable, se dressait la Mort. Elle entretenait des rapports avec cette chanson que l’on pouvait aimer, non sans se rendre compte obscurément qu’un tel amour était jusqu’à un certain point illicite. Dans sa nature propre et primitive, elle pouvait ne comporter nulle sympathie pour la Mort, au contraire quelque chose de très populaire et de vivant. Mais la sympathie que l’esprit éprouvait pour elle était de la sympathie pour la Mort. La pure piété, l’ingénuité de son début, il ne les contestait nullement. Mais à la suite venaient les produits des ténèbres.
Qu’est-ce qu’il nous contait là ? Vous ne l’en auriez pas dissuadé. Des produits des ténèbres. De ténébreux produits. Un esprit de tortionnaire et de misanthrope vêtu de noir espagnol, avec la collerette ronde et la luxure en guise d’amour, tout cela découlait de cette piété au regard si franc.
En vérité, le littérateur Settembrini n’était pas l’homme auquel Hans Castorp faisait une confiance absolue, mais il se rappelait tels enseignements que son mentor lucide lui avait naguère dispensés, il y avait longtemps, au début de sa carrière hermétique, sur la propension spirituelle au recul vers certains mondes, et il jugea bon d’appliquer avec précaution cette leçon à son objet. M. Settembrini avait qualifié cette tendance de « maladie ». La conception elle-même de ce monde et la période spirituelle qu’il représentait devaient sans doute sembler « maladives » à son sens pédagogique. Mais comment était-ce possible ? L’adorable lied nostalgique de Hans Castorp, la sphère sentimentale dont il relevait, et son penchant pour cette sphère seraient donc « maladifs » ? Pas le moins du monde ! Ils étaient ce qu’il y avait de plus paisible et de plus sain. Mais c’était un fruit qui, tout à l’heure, frais et éclatant de rêve, inclinait extraordinairement à la décomposition, à la pourriture, et, pur délice de l’âme lorsqu’on le goûtait au bon moment, répandait, l’instant après, la pourriture et la perdition au sein de l’humanité qui en jouissait. C’était un fruit de la Vie, conçu par la Mort et qui produisait la Mort. C’était un miracle de l’âme, le plus haut peut-être au point de vue d’une beauté dénuée de conscience, et béni par elle, mais qui pour de valables raisons était considéré avec méfiance par l’œil de quiconque aimait la vie organique, et avait conscience de sa responsabilité, c’était un objet auquel, à écouter le verdict de la conscience, il convenait de renoncer.
Oui, renoncement et maîtrise de soi, telle pouvait bien être la nature de la victoire sur cet amour, sur cette magie de l’âme aux conséquences ténébreuses ! Les pensées de Hans Castorp, ou ses demi-pensées chargées de pressentiments, prenaient leur vol, tandis que, dans la nuit et la solitude, il était assis devant son petit cercueil à musique – et ces pensées volaient toujours plus haut, au-delà de sa raison ; c’étaient des élucubrations d’alchimiste… Oh ! il était puissant, le charme de l’âme. Nous étions tous ses fils, et nous pouvions accomplir de grandes choses dans le monde en le servant. On n’avait pas besoin de plus de génie, mais de beaucoup plus de talent que l’auteur de la chanson du « Tilleul » pour donner, comme artiste de la magie de l’âme, des proportions gigantesques à cette chanson, et lui conquérir le monde entier. Sans doute pouvait-on fonder même sur elle des empires, des empires terrestres par trop terrestres, très rudes et aptes au progrès, nullement nostalgiques, où la chanson se corrompait en devenant de la musique de phonographe électrique. Mais son meilleur fils devait quand même être celui qui passait sa vie à se dominer lui-même et qui mourait en ayant sur les lèvres le nouveau mot d’amour qu’il ne savait pas encore prononcer. Elle valait qu’on mourût pour elle, la chanson magique ! Mais qui mourait pour elle, en réalité ne mourait déjà plus pour elle ; il n’était un héros que parce que, au fond, il mourait déjà pour une chose nouvelle, pour la nouvelle parole de l’amour et de l’avenir que recelait son cœur…
Tels étaient donc les disques préférés de Hans Castorp.
DOUTES SUPRÊMES
Les conférences d’Edhin Krokovski avaient, dans le cours de ces courtes années, pris une orientation imprévue. Toujours, ses recherches, qui portaient sur l’analyse des sentiments et la vie des songes, avaient été empreintes d’un caractère souterrain et sombre. Mais depuis quelque temps, par une transition à peine sensible au public, elles s’étaient orientées dans le sens des mystères de la magie et ses conférences bi-mensuelles, dans la salle à manger – principale attraction de la maison, orgueil du prospectus – ces conférences, prononcées en redingote et en sandales, à une table couverte d’un tapis, avec un accent exotique entraînant, devant le public attentif du Berghof, – elles ne traitaient plus de l’activité amoureuse larvée et de la retransformation de la maladie en le sentiment rendu conscient, elles traitaient des occultes étrangetés de l’hypnotisme et du somnambulisme, des phénomènes de la télépathie, du songe révélateur et de la seconde vue, des miracles de l’hystérie, et ces commentaires élargissaient l’horizon philosophique au point qu’apparaissaient aux yeux des auditeurs des énigmes telles que les rapports de la matière et de l’esprit, – l’énigme même de la vie que l’on semblait avoir plus de chances de résoudre en prenant le chemin inquiétant de la maladie que celui de la santé.
Nous mentionnons ces faits parce que nous estimons qu’il est de notre devoir de confondre les esprits superficiels qui prétendaient que le docteur Krokovski ne s’était voué aux problèmes occultes qu’afin de préserver ses conférences de la monotonie, par conséquent – et sans plus – pour entretenir la curiosité. Ainsi opinaient ces détracteurs que l’on rencontre partout. Il est vrai qu’aux conférences du lundi les messieurs secouaient leurs oreilles avec plus d’entrain que d’habitude, pour mieux entendre, et que Mlle Lévi ressemblait peut-être encore plus qu’autrefois à la figure de cire qui cacherait un ressort dans son sein. Mais ces effets étaient aussi légitimes que le développement qu’avaient pris les idées du savant, et dont il pouvait défendre non seulement la rectitude logique, mais encore le caractère inéluctable. C’est vers ces contrées ténébreuses et étendues de l’âme humaine qu’il avait toujours orienté ses recherches, vers ces contrées que l’on désigne sommairement par le mot de subconscient, quoique l’on ferait peut-être mieux de parler d’une supraconscience, puisque, de ces sphères, provient parfois un savoir qui dépasse de beaucoup la conscience de l’individu et suggère la pensée qu’il pourrait y avoir des liens et des rapports entre les régions inférieures et obscures de l’âme individuelle et une âme universelle omnisciente. Le domaine du subconscient, « occulte » au sens propre de ce mot, serait donc également occulte au sens plus étroit de ce mot et serait une des sources d’où jaillissent les phénomènes que l’on appelle tant bien que mal ainsi. Ce n’était pas tout ! Quiconque considère le symptôme organique de la maladie comme le résultat de sentiments refoulés hors de la vie consciente de l’âme et ainsi hystérisés, reconnaît par là même le pouvoir créateur des forces psychiques dans le domaine de la matière, un pouvoir que l’on est obligé de considérer comme la deuxième source des phénomènes magiques. Idéaliste du pathologique, pour ne pas dire : idéaliste pathologique, il se verra parvenu au point de départ de raisonnements qui aboutissent infailliblement au problème de l’être en général, c’est-à-dire au problème des rapports entre l’esprit et la matière. Le matérialiste, fils d’une philosophie de la force pure, s’obstinera à expliquer l’esprit comme un produit phosphorescent de la matière. L’idéaliste au contraire, partant du principe de l’hystérie créatrice, inclinera et ne tardera pas à résoudre dans un sens exactement opposé le problème de la primauté. En somme, c’est la vieille querelle de savoir ce qui a existé d’abord : la poule ou l’œuf, cette querelle qui se trouve si extraordinairement embrouillée par ce double fait que l’on ne peut imaginer ni un œuf qu’une poule n’ait pondu, ni une poule qui ne soit sortie de l’œuf que son existence postule.
Ce sont donc ces questions que le docteur Krokovski commentait depuis quelque temps dans ses conférences. Il en était arrivé là par un développement organique, légitime et logique, nous ne saurions trop y insister, et nous ajouterons en outre qu’il s’était engagé dans de telles considérations longtemps avant que l’apparition d’Ellen Brand les fît passer dans le domaine empirique et expérimental.
Qui était Ellen Brand ? Nous avons failli oublier que nos auditeurs l’ignorent, tandis que son nom nous est naturellement familier. Qui elle était ? Au premier regard, presque personne ! Une aimable enfant de dix-neuf ans, nommée Elly, d’un blond de filasse, une Danoise, qui n’était même pas de Copenhague, mais originaire tout simplement d’Odense, en Fionie, où son père faisait le commerce du beurre. Elle-même était entrée dans la vie pratique ; depuis quelques années déjà elle était restée assise, employée de la succursale de province d’une banque de la capitale, sur un tabouret tournant, devant de gros livres, avec une manche de lustrine au bras droit, – ce qui lui avait donné de la température. Le cas était sans gravité, tout au plus pouvait-on dire qu’il était suspect, quoique Elly fût effectivement délicate et, apparemment anémique, de plus incontestablement sympathique de sorte que l’on passait volontiers la main sur ses cheveux blonds, et en effet, le conseiller n’y manquait jamais lorsqu’il parlait à la jeune fille dans la salle à manger. Une fraîcheur nordique l’enveloppait, une chasteté cristalline, une atmosphère enfantine et virginale, tout à fait charmante, de même que le regard grand et pur de ses yeux bleus d’enfant, et que son langage qui était aigu, clair et fin : un allemand quelque peu maladroit, avec de petites fautes typiques de prononciation. Ses traits n’avaient rien de particulier. Son menton était un peu court. Elle était assise à la table d’Hermine Kleefeld qui la chaperonnait.
C’est donc cette petite jeune fille, cette Elly Brand, cette aimable petite cycliste et comptable danoise qui se trouvait dans des conditions que personne n’eût jamais rêvées à première ou deuxième vue de sa claire personne mais qui, quelques semaines après son arrivée ici, commencèrent d’apparaître et que la tâche du docteur Krokovski fut de découvrir dans toute leur étrangeté.
Des jeux de société, au cours de la réunion du soir, frappèrent en premier lieu l’attention du savant. On s’exerçait à des devinettes, puis on cherchait des objets cachés, en s’aidant du piano dont on jouait plus haut à mesure que l’on s’approchait de la cachette, plus bas, lorsqu’on se fourvoyait. Et on finit par même exiger de celui qui, durant la délibération, avait dû attendre devant la porte, d’exécuter avec exactitude certaines actions compliquées, par exemple de changer les bagues de deux personnes, d’inviter quelqu’un par trois révérences à danser, de prendre un livre déterminé dans la bibliothèque, pour le remettre à telle ou telle personne, et ainsi de suite. Il est à remarquer que des jeux de cette sorte n’avaient pas été jusqu’à présent dans les habitudes du Berghof. On ne put établir par la suite qui en avait donné la première idée. Ce n’avait certainement pas été Elly. Néanmoins, on n’en était arrivé là qu’en sa présence.
Ceux qui prenaient part aux jeux – ils étaient presque tous de vieilles connaissances, et parmi eux se trouvait Hans Castorp, – se montraient plus ou moins adroits, ou tout à fait incapables. Mais l’aptitude d’Elly Brand apparut extraordinaire, surprenante, inconvenante. Son ingéniosité assurée dans la recherche des cachettes, saluée par des applaudissements et des rires admiratifs, avait paru plausible ; mais on commença de garder un silence surpris lorsqu’elle en vint aux actions compliquées. Aussitôt entrée, elle exécutait tout ce qu’on lui avait secrètement prescrit, avec un doux sourire, sans une hésitation, sans même avoir besoin de la musique. Elle cherchait dans la salle à manger une pincée de sel, la répandait sur la tête du procureur Paravant, le prenait ensuite par la main, et le conduisait au piano, où elle jouait avec son index le commencement de la chanson « Un oiseau s’envole ». Puis elle le ramenait à sa place, lui faisait une révérence, prenait un tabouret, et s’asseyait à ses pieds, exactement comme on l’avait imaginé, à grand renfort d’imagination.
Elle avait donc écouté !
Elle rougit. Avec un véritable soulagement, en la voyant confondue, on commença de la gronder en chœur, lorsqu’elle assura : Non, non, pas du tout, ce n’était pas ce que l’on pensait. Ce n’était pas dehors, ce n’était pas derrière la porte, qu’elle avait écouté, non, certes pas !
Pas dehors ? pas derrière la porte ?
– Oh non, excusez-moi !
Elle écoutait ici même, dans la salle ; à peine entrée, elle ne pouvait s’empêcher de le faire.
Elle ne pouvait s’empêcher ? Dans la salle ?
Quelque chose le lui soufflait, dit-elle. On lui soufflait ce qu’elle devait faire, doucement, mais très nettement et distinctement.
C’était un aveu apparemment. Elly avait dans un certain sens conscience d’avoir commis une faute, elle avait trompé. Elle aurait dû dire qu’elle n’était pas faite pour un tel jeu, parce qu’on lui soufflait tout. Un concours perd tout sens commun, lorsque l’un des concurrents possède des avantages surnaturels. Au sens sportif du jeu, Ellen était, du coup, disqualifiée, isolée au point que plus d’un eut un frisson dans le dos en entendant son aveu. Plusieurs voix à la fois réclamèrent le docteur Krokovski. On courut le chercher et il vint : trapu, avec un sourire jovial, tout de suite à la page, invitant par toute son apparence à une confiance joyeuse. On lui avait annoncé, hors d’haleine, que des choses tout à fait anormales étaient arrivées, qu’une voyante avait surgi, une jeune fille qui entendait des voix. Tiens, tiens ! Et puis après ? Du calme, mes amis ! Nous allons voir. C’était son terrain et son domaine, mouvant et marécageux pour tous, mais sur lequel il s’avançait avec une sympathie assurée. Il questionna, il se fit raconter la chose. Tiens, tiens, voyez-moi ça ! « C’est ainsi que vous êtes, mon enfant ? » Et comme tout le monde le faisait volontiers, il posa sa main sur la tête de la petite. Il y avait là beaucoup de raisons de se montrer curieux, mais pas la moindre raison de s’effrayer. Il plongea ses yeux bruns et exotiques dans l’azur clair de ceux d’Ellen Brand, tout en la caressant doucement de sa main, par-dessus l’épaule et jusqu’au bras. La jeune fille répondait à son regard par un regard de plus en plus pieux, c’est-à-dire qui se levait de plus en plus vers lui parce que sa tête s’inclinait lentement vers la poitrine et l’épaule. Lorsque ses yeux commencèrent à tourner, le savant fit devant le visage de la jeune fille un mouvement de la main, après quoi il déclara que tout allait pour le mieux, et envoya toute la compagnie très excitée faire sa cure du soir, à l’exception d’Elly Brand avec qui il voulait encore « bavarder » un instant.
Bavarder ! On pouvait imaginer ce que cela donnerait. Personne ne se sentit à l’aise lorsque le joyeux camarade Krokovski prononça ce mot. Tous se sentirent parcourus jusqu’au tréfonds d’eux-mêmes d’un frisson, y compris Hans Castorp, lorsqu’il eut regagné avec un grand retard son excellente chaise longue, et se rappela comment le sol s’était dérobé sous ses pas lors des prouesses inconvenantes d’Elly et de l’explication embarrassée qu’elle en avait donnée, au point qu’un certain malaise, une anxiété physique, un léger mal de mer l’avaient gagné. Il n’avait jamais éprouvé un tremblement de terre, mais il se dit que des impressions analogues de frayeur devaient y être attachées, en mettant à part la curiosité que les aptitudes fatales d’Ellen Brand lui inspiraient en outre : une curiosité qui impliquait le sentiment de sa vanité, – c’est-à-dire la conscience que le domaine vers quoi elle s’avançait en tâtonnant était inaccessible à la raison – et par conséquent la question de savoir si elle n’était qu’oiseuse ou si elle était aussi coupable, ce qui ne l’empêchait du reste pas de demeurer ce qu’elle était, à savoir de la curiosité. Hans Castorp avait, comme tout le monde, entendu pas mal de choses sur les phénomènes occultes ou surnaturels. Nous avons, du reste, fait allusion à certaine grand-tante, dont la légende mélancolique lui était parvenue. Mais jamais ce monde, dont il constatait l’existence avec un désintéressement théorique, ne s’était présenté à lui d’aussi près. Hans Castorp n’avait jamais fait d’expériences dans ces domaines, et son antipathie contre de telles expériences, révolte de son goût, révolte esthétique, révolte par orgueil humain – si nous pouvons nous servir d’expressions aussi prétentieuses en parlant de notre héros si complètement dépourvu de prétention – égalait presque la curiosité qu’elles éveillaient en lui. Il pressentait, il pressentait clairement et nettement que ces expériences, quel que soit le cours qu’elles allaient prendre, ne pourraient jamais être que de mauvais goût, inintelligibles et indignes de l’homme. Néanmoins il brûlait de s’y livrer. Il comprenait que l’alternative « oiseux ou coupable », ce qui, en tant qu’alternative était déjà assez déplaisant, en réalité n’était pas du tout une alternative, parce que ces deux termes coïncidaient et que le scepticisme de la raison n’était qu’une forme extra-morale de cette interdiction. Mais le placet experiri, qu’il avait emprunté à une personne qui eût sans doute désapprouvé de telles tentatives dans les termes les plus plastiques, restait ancré dans l’esprit de Hans Castorp ; son sens moral coïncidait avec sa curiosité, avait sans doute toujours cadré avec elle : avec la curiosité illimitée de qui voyage pour former son esprit, laquelle, lorsqu’elle avait approché le mystère de la personnalité, n’avait pas été très éloignée du domaine qui s’ouvrait à présent ; et cette curiosité prenait un aspect de valeur militaire, en n’évitant pas les choses défendues lorsqu’elles se présentaient. Hans Castorp résolut donc de rester à son poste et de ne pas s’éloigner si l’on allait s’engager dans de nouvelles aventures.
Le docteur Krokovski avait fait interdire sévèrement de se livrer désormais en dehors de sa présence à des expériences sur les dons secrets de Mlle Brand. Il avait réquisitionné l’enfant pour la science, il tenait avec elle des séances dans sa caverne analytique, il l’hypnotisait, paraît-il, il s’efforçait de développer ses aptitudes latentes, de les discipliner, d’explorer sa vie psychique antérieure, Hermine Kleefeld, l’amie maternelle et le chaperon de la jeune fille, en faisait du reste autant et elle apprenait sous le sceau du secret toutes sortes de choses qu’elle répandait sous le même sceau dans toute la maison, jusque dans la loge du concierge. Elle apprit, par exemple, que la personne ou la chose qui avait soufflé à la petite durant le jeu les gestes qu’elle devait faire s’appelait Holger. C’était l’adolescent Holger, un esprit, qui lui était familier, un être défunt et éthéré, quelque chose comme un ange gardien de la petite Ellen. C’était donc lui qui avait trahi l’idée de la pincée de sel et de l’index de Paravant ? – Oui, ses lèvres invisibles avaient caressé l’oreille d’Ellen, l’avaient doucement chatouillée, et, la faisant presque sourire, elles lui avaient soufflé le secret. – Sans doute lui avait-il été très agréable autrefois de se faire souffler ses leçons à l’école lorsqu’elle ne les avait pas préparées ? À cette question, Ellen n’avait pas répondu. Peut-être n’était-ce pas permis à Holger, dit-elle plus tard. Il lui était interdit de se mêler de choses aussi sérieuses, et sans doute n’avait-il lui-même pas su les leçons.
On apprit encore qu’Ellen avait eu depuis sa plus tendre enfance, à des intervalles plus ou moins longs, des apparitions visibles et invisibles. – Que signifiait : apparitions invisibles ? – Par exemple ceci : jeune fille de seize ans, elle était, un jour, assise seule au salon de la maison de ses parents, devant une table ronde, avec un ouvrage manuel, en plein après-midi, et à côté d’elle, sur le tapis, était couché le dogue de son père, la chienne Freia. La table était couverte d’un tapis bariolé, d’un de ces châles turcs comme les vieilles femmes les portent, pliés en pointe. Diagonalement, les pans dépassant légèrement, il était étendu sur le plat de la table. Et tout à coup Ellen avait vu que le pan en face d’elle s’était lentement enroulé ; tranquillement, soigneusement et régulièrement, il avait été roulé, jusque vers le milieu de la table, de sorte que le rouleau avait fini par devenir assez long ; et pendant que ceci s’était passé, Freia, sursautant furieusement, les pattes de devant raides et le poil hérissé, s’était dressée sur ses cuisses, puis s’était précipitée en hurlant, dans la pièce voisine, s’était cachée sous le canapé et pendant une année entière on n’avait plus réussi à la faire entrer au salon.
– Était-ce Holger qui avait roulé le châle ? demanda Mlle Kleefeld. La petite Brand ne le savait pas.
– Et qu’aviez-vous pensé lorsque cela s’était produit ? Mais comme il était absolument impossible de penser quoi que ce soit à ce sujet, Elly n’avait rien pensé de particulier. En avait-elle parlé à ses parents ? Non. C’était bizarre. Quoi qu’il n’y eût rien de particulier à penser à ce sujet, Elly avait quand même eu le sentiment que dans ce cas, comme en d’autres cas analogues, elle devait garder le silence et s’en faire un secret jaloux et pudique. Avait-il été lourd à porter, ce secret ? Non, pas particulièrement lourd. Que pouvait peser une couverture qui se roulait ? Mais une autre chose lui avait pesé davantage. Par exemple ceci :
Il y avait un an, toujours dans la maison de ses parents, à Odense, elle était sortie de bon matin de sa chambre, qui était située au rez-de-chaussée, et avait voulu traverser le vestibule et gravir l’escalier pour se rendre dans la salle à manger et préparer le café, comme elle en avait l’habitude, avant l’arrivée de ses parents. Elle était déjà parvenue jusqu’au palier du tournant de l’escalier lorsque, sur ce palier, au bord de ce palier, tout contre les marches, elle avait vu sa sœur aînée, qui s’était mariée en Amérique, en chair et en os. Elle était apparue vêtue d’une robe blanche et, chose étrange, avait porté sur sa tête une couronne de nymphéas arundinacés, ses mains avaient été jointes sur son épaule et elle avait fait un signe de tête. « Comment, Sophie, c’est toi ? » s’était écriée Ellen, pétrifiée, mi-joyeuse mi-effrayée. Sophie avait encore une fois hoché la tête, puis s’était évanouie. Elle était devenue transparente. Bientôt elle n’avait plus été perceptible qu’autant qu’un courant d’air chaud, et enfin plus du tout, de sorte que la voie avait été libre pour Ellen. Mais ensuite on avait appris qu’à la même heure sa sœur Sophie était morte, à New-Jersey, d’une cardite.
Allons, estima Hans Castorp lorsque la Kleefeld lui raconta l’aventure, voilà qui avait tout de même un certain sens, cela pouvait se justifier. L’apparition ici, la mort là-bas, on pouvait tout au moins distinguer un certain rapport entre les deux. Et il consentit à prendre part à une séance de spiritisme, à une partie de verres tournants que l’on avait décidé d’organiser, par impatience, en dépit des défenses jalouses du docteur Krokovski.
On n’avait admis que quelques personnes à la séance, dont le lieu était la chambre de Hermine Kleefeld : outre l’hôtesse, Hans Castorp et la petite Brand, il n’y avait guère que les dames Stoehr et Lévi, ainsi que M. Albin, le Tchèque Wenzel et le docteur Ting-Fou. Le soir, sur le coup de dix heures, on se réunit discrètement, et l’on inspecta en chuchotant les préparatifs qu’Hermine avait faits. Sur une table ronde de taille moyenne, au milieu de la chambre, on avait posé un verre à pied, retourné. Au bord de la table, à intervalles convenables, on avait placé de petits jetons en os qui servaient d’habitude au jeu, et sur lesquels on avait tracé à l’encre les vingt-cinq lettres de l’alphabet. Hermine Kleefeld commença par servir le thé que l’on accueillit avec reconnaissance parce que, malgré la puérilité inoffensive de l’entreprise, les dames Stoehr et Lévi se plaignaient d’avoir les extrémités froides et des palpitations. Après que l’on se fût réchauffé, on prit place autour de la petite table, et, dans un éclairage rose et tamisé (l’hôtesse, pour créer une atmosphère appropriée, avait éteint le plafonnier et n’avait laissé brûler que la petite lampe voilée de la table de nuit), chacun, d’un doigt de sa main droite, appuya légèrement sur le pied du verre. Ainsi le prescrivait la méthode. On attendit l’instant où le verre commencerait à se déplacer.
Cela pouvait arriver facilement, car la table était lisse, le rebord du verre poli, et la pression qu’exerçaient les doigts tremblants, si léger que fut le contact, suffirait à la longue, en se produisant naturellement d’une manière inégale, plutôt verticale ici, plutôt latérale là-bas, à déplacer le verre. Sur la périphérie de son champ il rencontrerait des lettres, et si celles qu’il heurterait composaient des mots et donnaient un sens, ce serait là un phénomène d’une complexité assez trouble, un mélange d’éléments conscients, mi-conscients et tout à fait inconscients, déterminé par la volonté de certains participants – qu’ils s’avouassent ou non leur intervention, – et du concours obscur et de la connivence secrète d’une collaboration souterraine de tous en vue de résultats en apparence étrangers, résultats auxquels les velléités obscures de chaque individu prendraient une part plus ou moins large, et sans doute celles surtout de la charmante petite Elly. Cela, tous au fond le savaient d’avance, et Hans Castorp, selon sa manière, alla même jusqu’à le dire tandis que l’on attendait, assis en rond, les doigts tremblants. Et en effet, les extrémités froides et le battement de cœur de ces dames, de même que la gaieté oppressée des messieurs, ne provenaient que de ce qu’ils le savaient, de ce qu’ils s’étaient rassemblés dans le silence de la nuit en vue de se livrer à un jeu malpropre avec leur nature, de scruter avec une curiosité craintive des parties inconnues de leur Moi, et attendaient ces apparitions ou ces demi-réalités que l’on appelle magiques. Ce n’était guère que pour prêter à l’expérience une certaine forme que l’on admettait que les esprits de défunts s’adressaient à l’assemblée au moyen du verre. M. Albin s’offrit à prendre la parole et à négocier avec les esprits qui pourraient répondre à l’appel, parce que, autrefois déjà, il avait assisté à des séances de spiritisme.
Vingt minutes et plus passèrent. Les sujets de conversation s’épuisaient, la première tension se relâchait. On soutenait le coude droit de la main gauche. Le Tchèque Wenzel était sur le point de s’endormir. Ellen Brand, son petit doigt légèrement appuyé, tenait son grand et pur regard d’enfant fixé par-dessus les objets proches, sur la lueur de la petite table de nuit.
Tout à coup le verre oscilla et échappa aux mains des personnes assises autour de la table. Elles eurent peine à le suivre des doigts. Il glissa jusqu’au bord de la table, le suivit un bout de chemin, et revint ensuite en ligne droite, à peu près jusqu’au milieu. Ici il rebondit encore une fois, puis se tint tranquille.
La frayeur de tous avait été mi-joyeuse, mi-anxieuse, – d’une voix plaintive, Mme Stoehr déclara qu’elle préférait s’en arrêter là, mais on lui signifia qu’elle eût dû se décider plus tôt et qu’elle n’avait qu’à se tenir tranquille. Les choses semblaient aller de l’avant. On stipula que pour dire oui ou non, le verre n’aurait pas besoin de heurter les lettres, mais qu’il pourrait se contenter de frapper un ou deux coups.
– Un esprit est-il présent ? s’informa M. Albin, la mine sévère, en regardant par-dessus les têtes dans le vide. Il y eut une hésitation. Puis le verre frappa un coup et répondit oui.
– Comment t’appelles-tu ? demanda M. Albin d’un ton presque rude, en soulignant l’énergie de son exorde par un hochement de tête.
Le verre se déplaça. Il courut résolument et en zigzag d’un jeton à l’autre, en revenant toujours entre temps vers le milieu de la table ; il rejoignit l’h, l’o, le l, il parut alors épuisé, mais se reprit, joignit encore le g, l’e et le r. On s’en doutait un peu. C’était Holger en personne, l’esprit Holger qui avait connu l’histoire de la pincée de sel, etc., mais qui s’était gardé de se mêler des devoirs scolaires. Il était là, il planait dans les airs, il entourait notre petit cercle. Qu’allait-on faire de lui ? Une certaine hébétude régnait. On délibéra doucement et en quelque sorte en sous-main pour savoir quelles questions il convenait de poser. M. Albin décida de demander quelle avait été la profession et l’occupation de Holger, de son vivant. Il posa la question comme tout à l’heure, sur le ton d’un interrogatoire, sévèrement, les sourcils froncés.
Le verre garda un instant le silence. Puis, en oscillant et en butant, il se dirigea vers le p, s’éloigna et désigna l’o. Qu’est-ce que cela allait donner ? L’impatience était grande. Le docteur Ting-Fou exprima avec un rire étouffé la crainte que Holger n’eût été un pompier. Mme Stoehr éclata d’un rire hystérique sans interrompre le travail du verre qui, cliquetant et claudicant, glissa vers le t, et toucha une seconde fois l’e. Il avait épelé le mot « poète ».
Comment, diable, Holger avait été un poète ? Inutilement et comme par orgueil, le verre frappa un coup, confirma par un battement. – Un poète lyrique ? demanda la Kleefeld en prononçant l’y comme un u, ainsi que Hans Castorp le fit remarquer avec impatience… Mais Holger ne semblait pas disposé à donner de telles précisions. Il ne fit pas de nouvelles réponses. Il se borna à répéter la précédente, il l’épela encore une fois, rapidement, nettement et clairement.
Bien, bien, donc un poète. L’embarras s’accrut, un bizarre embarras, causé par le fait que ces manifestations troublantes émanant des régions obscures de la vie intérieure de chacun touchaient, bien que d’une fallacieuse façon, à la réalité extérieure. On voulut alors savoir si Holger se sentait heureux dans cet état ! Le verre, songeur, frappa le mot : « résigné ». Ah, oui, résigné. Naturellement, on n’y aurait pas pensé soi-même, mais puisque le verre épelait ce mot, on trouva cela vraisemblable et bien dit. Et depuis combien de temps Holger se trouvait-il dans cet état de résignation ? De nouveau il arriva quelque chose à quoi personne n’eût pensé, quelque chose qui semblait être dit en rêve. « Durée rapide » – Très bien ! On eût pu dire aussi bien « rapidité durable », c’était un oracle de poète ventriloque venant du monde extérieur ; Hans Castorp surtout le jugea excellent. Une durée rapide, c’était l’élément du temps où vivait Holger ; naturellement il devait répondre par un oracle, sans doute avait-il désappris les paroles et les mesures d’une réunion terrestre. – Qu’allait-on encore lui demander ? La Lévi avoua sa curiosité d’apprendre quel était, ou quel avait été l’aspect de Holger. Était-ce un beau jeune homme ? Questionnez-le vous-même, ordonna M. Albin, qui jugeait une curiosité de ce genre au-dessous de sa dignité. Elle demanda donc en le tutoyant si l’esprit Holger avait des boucles blondes.
– De belles boucles, brunes, brunes, répondit le verre, en épelant expressément à deux reprises le mot « brunes ». Une animation joyeuse régnait dans le cercle. Les dames se montraient franchement amoureuses. Elles envoyaient des baisers obliquement vers le plafond. Le docteur Ting-Fou dit en riant sous cape que Mister Holger devait donc être assez fat.
Mais voici que le verre devint tout à coup fou de colère. Il parcourut la table en tous sens, comme enragé, frappa des coups furieux ; puis il se renversa et roula sur les genoux de Mme Stoehr qui, mortellement pâle, les bras ouverts, le considérait. Avec beaucoup de précautions et d’excuses on le ramena à sa place. On gronda le Chinois. Comment avait-il pu se permettre de telles remarques ? Voilà à quoi vous exposait l’impertinence. Mais que faire si Holger était irrité, s’il était parti et s’il allait se refuser désormais à prononcer la moindre parole ? On insista en termes persuasifs auprès du verre. N’allait-il pas consentir à composer une poésie ? N’avait-il pas été poète avant d’avoir plané dans la durée rapide ? Ah, comme ils étaient tous désireux de connaître un poème qu’il eût composé ! Ils en jouiraient de tout cœur.
Et voici que le verre répondit : Oui. En effet, ce coup semblait bienveillant et conciliant. Et alors l’esprit Holger commença de composer, il composa sans réfléchir, au moyen de cet appareil compliqué, Dieu sait combien de temps ! Il semblait qu’il n’allait plus jamais se taire. C’était un poème tout à fait surprenant que faisait entendre l’esprit ventriloque, tandis que son entourage le répétait avec admiration, c’était une chose magique, sans bornes comme la mer dont il était surtout question : alluvions étendues le long de la grève étroite de la baie arrondie du pays des îles aux dunes escarpées. Oh ! voyez comme l’immensité verte s’estompe et se perd dans l’éternel, là où, sous de larges bandes de brouillard, dans un carmin trouble et des lueurs laiteuses, le soleil de l’été tarde à se coucher. Nulle bouche ne saurait dire quand ni comment le reflet argenté et mobile de l’eau se change en un pur éclat de nacre, en un jeu ineffable de couleurs, l’éclat pâle, multicolore et opalin de la pierre de lune qui couvre tout… Hélas, secrètement, comme elle a surgi la magie paisible s’est évanouie. La mer sommeillait. Mais les traces légères du départ du soleil demeurent. Jusqu’au plus profond de la nuit il ne fera pas sombre. Un demi-jour spectral règne dans la forêt de pins sur les dunes et fait rayonner le sable blanc des profondeurs comme de la neige. Trompeuse forêt d’hiver dans le silence que traverse en craquant le vol pesant d’un hibou ! Sois notre séjour pour l’heure ! Le pas si doux, la nuit si haute et tendre ! Et lentement, là-bas, respire la mer, et chuchote, s’étirant dans le songe. Désires-tu la revoir ? Approche-toi donc des pentes blafardes des dunes et monte en t’enfonçant dans cette chose molle qui coule fraîchement dans tes chaussures. Dure et touffue, la terre descend en pente raide vers les galets de la grève et les vestiges du jour hantent encore le bord de l’étendue qui devient indistincte… Assieds-toi là-haut, dans le sable ! Quelle fraîcheur mortelle, quelle douceur de soie et de farine ! Cela coule dans ta main fermée en un jet mince et incolore, et forme un petit tas. Reconnais-tu cet écoulement ? C’est la fuite silencieuse à travers le passage étroit du sablier, de l’instrument grave et fragile qui orne la cellule de l’ermite. Un livre ouvert, un crâne, et dans son cadre légèrement charpenté, le mince et double verre soufflé, où un peu de sable, emprunté à l’éternité, va son train mystérieux et sacré, exprimant le temps… »
C’est ainsi que l’esprit Holger en était arrivé dans son improvisation « lurique », par d’étranges associations d’idées, de la mer de son pays natal à un ermite et à l’instrument de sa contemplation ; en des paroles d’une hardiesse rêveuse qui étonnèrent prodigieusement l’assistance, il parla encore de maintes choses humaines et divines, en les épelant lettre par lettre. À peine avait-on trouvé le temps de placer des applaudissements ravis, que déjà il avait effleuré en zigzags mille autres matières, et il ne s’arrêtait pas : au bout d’une heure on n’apercevait pas encore la fin de ces inépuisables effusions poétiques qui traitaient des douleurs de l’enfantement et du premier baiser des amants, de la couronne de la souffrance et de la bienveillance paternelle et grave de Dieu, qui plongeaient dans la vie secrète de la créature, qui se perdaient dans les temps, les pays et les espaces stellaires, qui firent même allusion aux Chaldéens et au Zodiaque, et qui auraient certainement duré toute la nuit si les évocateurs n’avaient pas fini par détacher leurs doigts du verre et n’avaient pas déclaré, avec les plus vifs remerciements à Holger, que c’était assez pour ce jour-là, que tout cela avait été d’une splendeur insoupçonnée, et que ce serait pour eux un éternel regret que personne n’ait transcrit le poème qui allait inéluctablement tomber dans l’oubli, qui même était déjà, pour la plus grande partie, tombé dans l’oubli, par suite d’un certain manque de consistance propre aux rêves. La prochaine fois on ne manquerait pas de convier à temps un secrétaire, et l’on se rendrait compte de l’effet que cela pourrait produire, conservé noir sur blanc, et récité d’une façon suivie. Mais pour l’instant, et avant que Holger se replongeât dans la résignation de sa durée rapide, il serait tout à fait aimable de bien vouloir répondre à telle question précise, on ne savait pas encore à laquelle. On le priait de dire tout d’abord si, le cas échéant, il serait en principe disposé à avoir l’extrême complaisance de répondre.
« Oui » fut la réponse. Mais voici que l’on était perplexe : que fallait-il demander ? C’était comme dans les contes, lorsque la fée ou le nain vous permettent de poser une question, et que l’on court le risque de gaspiller très inutilement cette précieuse possibilité. On désirait savoir beaucoup de choses, et c’était courir une responsabilité que de choisir. Comme personne n’arrivait à prendre une décision, Hans Castorp, un doigt contre le verre, la joue gauche appuyée sur son poing, dit qu’il désirait savoir combien de temps durerait son séjour ici, séjour auquel il avait primitivement assigné une durée de trois semaines.
Bon, puisque l’on ne trouvait rien de mieux, on demanda à l’esprit de répondre à cette première et quelconque question en puisant dans le trop-plein de son savoir. Après quelque hésitation, le verre frappa sur la table. Il débitait quelque chose d’assez étrange qui semblait sans rapport avec la question, et qu’il ne paraissait pas possible d’interpréter. Il épela la syllabe « va » puis les mots « à travers », et on ne savait pas trop que conclure, lorsqu’il parla encore de la chambre de Hans Castorp, de sorte que l’on pouvait interpréter la réponse comme un ordre donné à celui qui avait posé la question de traverser sa chambre. – Traverser sa chambre ? Traverser le numéro trente-quatre ? Que signifiait cela ? Tandis que l’on restait là à délibérer en secouant la tête, un formidable coup de poing ébranla tout à coup la porte.
Tous restèrent pétrifiés. Était-ce une attaque brusquée ? Le docteur Krokovski était-il venu interrompre la séance interdite ? On se regardait, confondus, on s’attendait à voir paraître le médecin abusé. Mais au même instant un second coup fut frappé au milieu de la table, également un coup de poing, comme pour faire comprendre que le premier coup avait été de même frappé, non du dehors, mais de l’intérieur de la chambre.
Ç’avait été une mauvaise plaisanterie de M. Albin ! Il nia en donnant sa parole d’honneur, et tous étaient d’ailleurs à peu près certains, même sans cette parole d’honneur, que personne d’entre eux n’avait frappé ce coup. Ç’avait donc été Holger ? Ils regardèrent Elly dont l’attitude calme venait au même instant de frapper tout le monde. Elle était assise, appuyée contre le dossier de son siège, les poignets abandonnés, les pointes des doigts sur le bord de la table, la tête penchée sur l’épaule, les sourcils levés, mais sa petite bouche rétrécie, légèrement abaissée par un sourire qui avait quelque chose d’à la fois dissimulé et d’innocent, et de ses yeux bleus d’enfant qui ne voyaient rien, elle regardait obliquement dans le vide. On l’appela, sans qu’elle donnât signe de vie. Au même instant, la petite lampe de la table de nuit s’éteignit.
S’éteignit ? Mme Stoehr, que l’on ne pouvait plus retenir, poussa des hi et des hou, car elle avait entendu le déclic du commutateur. La lumière ne s’était pas éteinte, elle avait été éteinte par une main que l’on désignait avec beaucoup de ménagements, en disant que c’était une main étrangère. Était-ce la main de Holger ? Il s’était montré jusqu’à présent si doux, si discipliné et si poétique ! Mais voici que sa nature tournait à la polissonnerie et à la turbulence. Qui pouvait assurer qu’une main qui donnait des coups de poing dans la porte et les meubles et qui avait l’insolence d’éteindre la lumière ne saisirait pas aussi bien quelqu’un par la gorge ? Dans l’obscurité on réclama des allumettes, une lampe de poche. La Lévi hurla qu’on lui avait tiré les cheveux sur le front. Dans sa peur folle, Mme Stoehr n’eut pas honte de prier Dieu à haute voix. « Notre père, cette fois-ci encore… » cria-t-elle et, gémissant, implora le Seigneur de vouloir donner le pas à la grâce sur la justice, bien que l’on eût tenté l’enfer. Ce fut le docteur Ting-Fou qui eut la pensée raisonnable de tourner le commutateur, de sorte que la chambre se trouva aussitôt éclairée. Tandis que l’on constatait que la lampe de la table de nuit ne s’était en effet pas éteinte par hasard, qu’elle avait été éteinte, et qu’il n’était besoin, pour la rallumer, que de répéter humainement le geste qui avait été accompli par des moyens occultes, Hans Castorp éprouva personnellement une surprise qu’il pouvait considérer comme une attention à son égard des ténébreux enfantillages qui s’accomplissaient ici. Sur ses genoux il trouva un objet léger, « le souvenir » qui avait autrefois effrayé son oncle, lorsqu’il l’avait trouvé sur la commode de son neveu : le dispositif de verre qui montrait l’intérieur de Clawdia Chauchat, et que Hans Castorp, quant à lui, n’avait certainement pas introduit dans cette chambre. Il le serra dans son portefeuille sans faire le moindre bruit autour de ce phénomène. On était occupé d’Ellen Brand qui était toujours assise à sa place, dans l’attitude que nous avons décrite, le regard aveugle, avec une expression bizarrement affectée. M. Albin souffla dans sa figure et imita le petit geste de la main par lequel le docteur Krokovski l’avait éventée, sur quoi elle reprit ses sens, et – on pouvait se demander pourquoi, – versa quelques larmes. On la caressa, on la consola, on l’embrassa sur le front et on l’envoya se coucher. Mlle Lévi se déclara prête à passer la nuit avec Mme Stoehr parce que la pauvre femme était effrayée au point de ne plus oser regagner son lit. Hans Castorp, sa plaque dans la poche de son veston, ne fit pas d’objections lorsque les autres hommes proposèrent de finir cette soirée interrompue en allant prendre une fine dans la chambre de M. Albin, car il trouvait que des incidents de ce genre exerçaient, non pas sur le cœur ou l’esprit, mais sur les nerfs de l’estomac, un effet aussi prolongé que ceux du mal de mer dont on ressent encore pendant des heures entières, sur la terre ferme, les vertiges et les nausées.
Pour le moment sa curiosité était assouvie. Le poème de Holger ne lui avait pas semblé mauvais, mais il avait pourtant eu le sentiment si net de la vanité et du manque de goût de tout cela, qu’il estima que mieux valait s’en tenir à ces quelques étincelles de la flamme infernale qui l’avaient effleuré. M. Settembrini, comme bien l’on pense, le conseilla dans le même sens, lorsque Hans Castorp l’entretint de ses expériences.
« Il ne manquait plus que cela, s’écria-t-il. Oh ! misère de misère ! » Et il déclara sans plus que la petite Elly était une fieffée friponne.
Son élève ne dit ni oui ni non. Il déclara en haussant les épaules que l’on n’avait pas fait le départ entre le réel et l’équivoque, et que par conséquent l’on ne pouvait pas non plus se prononcer sur l’imposture. Peut-être n’y avait-il pas entre les deux de limites certaines. Peut-être y avait-il des transitions entre l’un et l’autre, des degrés différents de réalité au sein d’une nature muette et neutre, degrés de réalité rebelles à toute appréciation qui comportait forcément un jugement moral. Que pensait M. Settembrini du mot « fantasmagorie », de cet état où des éléments du rêve et des éléments de la réalité formaient un mélange qui était moins étranger à la nature qu’à nos rudes pensées quotidiennes ? Le mystère de la vie était réellement insondable : quoi d’étonnant, dès lors, qu’il en surgît parfois des fantasmagories qui… Et ainsi de suite, dans la manière aimablement conciliante et assez molle de notre héros.
M. Settembrini lui lava la tête comme il convenait, réussit en effet à fortifier momentanément la conscience de Hans Castorp, et obtint quelque chose comme une promesse de ne plus participer à de telles ignominies. « Respectez, demanda-t-il, l’homme qui est en vous, ingénieur ! Fiez-vous à la pensée claire et humaine, abhorrez ces convulsions du cerveau, ce bourbier de l’esprit. Fantasmagorie ? Mystère de la vie ? Caro mio ! Là où le courage moral d’opter et de distinguer entre l’imposture et la vérité faiblit, c’en est fini de la vie en général, du jugement, de la valeur, de l’action qui redresse, et le processus de décomposition du scepticisme moral a commencé son œuvre effroyable. L’homme est la mesure des choses, dit-il encore. Son droit est imprescriptible de se prononcer sur le bien et le mal, sur la vérité et sur l’apparence mensongère, et malheur à celui qui aurait l’audace de vouloir le détourner de la foi en ce droit créateur ! » Mieux valait être noyé, une meule au cou, dans le puits le plus profond !
Hans Castorp approuva de la tête et commença en effet par se tenir à l’écart de ces expériences. Il apprit que le docteur Krokovski organisait dans son souterrain analytique des séances avec Ellen Brand auxquelles étaient admis quelques pensionnaires privilégiés. Mais il déclina avec indifférence l’invitation qui lui fut faite, ce qui naturellement ne l’empêcha pas d’apprendre certaines choses, de la bouche des spectateurs et du docteur Krokovski, relativement au succès obtenu. Des manifestations de force de l’espèce de celles qui s’étaient produites involontairement et brutalement, dans la chambre de Hermine Kleefeld – coups frappés contre la table et contre le mur, extinction de lampes, et autres manifestations plus significatives, – furent tentées et exercées au cours de ces réunions, de manière systématique et avec toutes les garanties possibles d’authenticité, après que le camarade Krokovski eût hypnotisé la petite Elly selon toutes les règles de l’art, et l’eût transportée dans un état de rêve éveillé. Il s’était montré qu’un accompagnement musical facilitait ces exercices, et le phonographe était donc déplacé ces soirs-là, réquisitionné par le cercle magique. Mais comme le Tchèque Wenzel, qui assurait en ces circonstances le service de l’instrument, était un bon musicien qui ne le maltraiterait pas ni ne l’abîmerait, Hans Castorp pouvait sans inquiétude lui confier le phonographe. Il mettait à la disposition des spirites pour cet usage particulier un album spécial de disques dans lequel il avait réuni toutes sortes d’airs légers, danses, petites ouvertures et autres flonflons qui faisaient parfaitement l’affaire puisque Elly n’exigeait nullement des tons plus élevés.
C’est avec cet accompagnement, rapporta-t-on à Hans Castorp, qu’un mouchoir s’était envolé de lui-même, ou plutôt avait été soulevé par une « griffe » dissimulée dans ses plis, que le panier à papier du docteur était monté au plafond, que le pendule d’une horloge avait été arrêté et remis en marche « par personne », qu’une clochette avait été agitée, – et autres niaiseries troubles du même genre. Le savant directeur des expériences avait l’avantage de pouvoir leur donner des noms grecs d’un tour scientifique et très imposant. C’étaient là, expliqua-t-il dans ses conférences et ses conversations personnelles, des phénomènes « télécinétiques » et le docteur les rangeait dans une catégorie de phénomènes que la science avait baptisés du nom de matérialisations et auxquels tendaient ses efforts dans les tentatives auxquelles il se livrait sur Ellen Brand.
Dans son langage, il s’agissait là de projections biopsychiques des complexes subconscients dans l’objectif, de processus dont il fallait chercher la source dans la constitution médiale, dans l’état de somnambulisme, et que l’on pouvait considérer comme des images de rêve objectivées, en ceci qu’une faculté idéoplastique de la nature s’y manifestait, une aptitude de la pensée à attirer dans certaines conditions la matière et à s’y revêtir d’une réalité éphémère. Cette matière se dégageait du corps du médium, pour prendre en dehors de lui, et passagèrement, des formes biologiques et vivantes d’extrémités, de mains, qui accomplissaient justement ces actes insignifiants et étonnants dont on était le témoin dans le laboratoire du docteur Krokovski. Dans certaines circonstances ils étaient même visibles et palpables, ces membres ! Leurs formes se conservaient dans la paraffine et le plâtre. Mais dans d’autres conditions on allait encore plus loin. Des têtes, des visages individualisés d’homme, des fantômes complets se réalisaient devant les yeux de ceux qui se livraient aux expériences, ils entraient même en certains rapports avec eux, – et ici la doctrine du docteur Krokovski paraissait se dédoubler, elle commençait à loucher et à prendre un caractère instable et équivoque, analogue à celui qu’avaient eu ses expectorations sur « l’amour ». Car, désormais, il n’y avait plus moyen d’éviter des malentendus, et d’observer plus longtemps un détachement scientifique envers les sensations subjectives du médium et de ses aides passifs, réfléchies dans le réel. Désormais, tout au moins pour une part, des entités provenant du dehors et de l’au-delà se mêlaient aux jeux. Il s’agissait peut-être – mais on ne l’avouait pas tout à fait – d’êtres non viables, de créatures qui mettaient à profit la faveur douteuse et secrète de l’instant pour retourner dans la matière et se manifester à ceux qui les appelaient, bref il s’agissait de l’évocation des esprits des morts.
Tels étaient donc les résultats auxquels tendait le camarade Krokovski dans le travail qu’il accomplissait avec son groupe. Trapu et souriant cordialement, invitant à une confiance joyeuse, il s’y appliquait ; toute sa personne ramassée était très à l’aise dans le visqueux, dans le suspect, dans le sous-humain, et il était par conséquent un bon guide dans ces régions, même pour des gens timides et pleins de doute. Aussi le succès semblait-il lui sourire, grâce aux dons extraordinaires d’Ellen Brand qu’il s’appliquait à développer et à éduquer. Des mains matérialisées avaient touché certaines personnes présentes. Le procureur Paravant avait reçu de la transcendance une bonne gifle et en avait donné quittance avec une hilarité scientifique, voire même avait poussé la curiosité jusqu’à tendre l’autre joue, sans égard pour ses qualités d’homme de monde, de juriste et de vieux monsieur qui l’auraient obligé à prendre une attitude tout autre si le coup avait eu une origine vivante. A. K. Ferge, ce simple martyr, à qui toutes les choses élevées étaient étrangères, avait tenu un jour dans sa propre main la main d’un de ces esprits et avait pu s’assurer de l’exactitude et de la plénitude de sa forme, après quoi ce membre lui avait échappé d’une manière qu’il n’est pas possible de décrire exactement, bien qu’il eût tenu bon dans les limites du respect. Il fallut un temps assez long – presque deux mois et demi, à raison de deux séances par semaine – avant qu’une main originaire de cet au-delà, éclairée d’une lueur rougeâtre par une petite lampe voilée de papier rouge, – la main d’un jeune homme, avait-il semblé, – fût apparue à tous les regards, tâtonnant sur la table, et eût laissé sa trace dans un pot de grès plein de farine. Mais il n’advint que huit jours plus tard qu’un groupe de collaborateurs du docteur Krokovski, M. Albin, Mme Stoehr, les Magnus parurent vers minuit avec tous les signes d’un enthousiasme grimaçant et d’une extase fiévreuse, dans la loge de balcon de Hans Castorp, et, à lui qui somnolait dans le froid mordant, firent part à bâtons rompus que le Holger d’Elly s’était montré, que sa tête était apparue au-dessus de l’épaule de la somnambule, qu’en effet il avait de « belles boucles brunes, brunes » et qu’il avait souri avec une douceur et une mélancolie inoubliables avant de disparaître.
« Comment, pensa Hans Castorp, cette noble douleur s’accordait-elle avec la conduite de ce Holger, avec ses enfantillages banals et ses frivoles polissonneries, par exemple avec cette gifle dénuée de mélancolie que le procureur avait encaissée ? Il ne fallait pas apparemment exiger ici une logique parfaite dans le caractère. Peut-être était-on en présence d’un état d’âme analogue à celui du petit bossu de la chanson, de sa méchanceté chagrine et pitoyable. Les admirateurs de Holger ne semblaient pas réfléchir à tout cela. Ce qui leur tenait à cœur, c’était de décider Hans Castorp à renoncer à son abstention. Il fallait absolument qu’il assistât à la séance suivante, à présent que tout allait si bien.
Car Elly avait promis dans son sommeil de faire paraître la prochaine fois n’importe quel défunt que l’on réclamerait dans le cercle.
N’importe lequel ? Hans Castorp se tenait quand même sur la réserve. Mais le fait que ce pût être « n’importe quel mort » le préoccupa cependant au point que, dans les trois jours suivants, il en vint à changer de résolution. Pour dire tout à fait vrai, il ne lui fallut pas trois jours mais quelques minutes. Le changement dans son esprit s’accomplit à l’heure solitaire où il faisait une fois de plus tourner au salon de musique certain disque où se trouvait imprimée la personnalité archi-sympathique de Valentin, tandis que, sur sa chaise, il prêtait l’oreille à cette prière du brave qui prenait congé, qui avait hâte de partir pour le champ d’honneur et qui chantait :
Comme vous, pour longtemps je vais quitter ces lieux…
Alors, comme il en était chaque fois qu’il entendait ce chant, une émotion, que certaines possibilités rendaient aujourd’hui plus fortes et condensaient en désir, souleva la poitrine de Hans Castorp, et il pensa : « Que ce soit coupable et oiseux, ou non, ce serait d’une étrangeté touchante, et une aventure bien désirable. Et, tel que je le connais, il ne m’en voudra pas s’il n’y est pour rien. » Et il se rappela l’indifférent et libéral « Je t’en prie, je t’en prie ! » qu’il avait jadis reçu pour réponse, dans le laboratoire de radioscopie, lorsqu’il avait cru devoir demander la permission de certaines indiscrétions optiques.
Le lendemain matin, il annonça qu’il prendrait part à la séance prévue pour le soir, et, une demi-heure après le dîner, il rejoignit les autres qui, bavardant sans anxiété, en habitués du surnaturel, descendaient au sous-sol. Ce n’étaient que des vétérans établis depuis longtemps dans la maison, comme le docteur Ting-Fou, et le Tchèque Wenzel, qu’il rencontra dans l’escalier et ensuite dans le cabinet du docteur Krokovski : à savoir MM. Ferge, Wehsal et le procureur, ces dames Lévi et Kleefeld, sans parler de celles qui lui avaient annoncé l’apparition de la tête de Holger, et du médium Elly Brand.
L’enfant nordique se trouvait déjà sous la garde du docteur lorsque Hans Castorp franchit la porte ornée d’une carte de visite. À côté de Krokovski qui, vêtu de sa blouse de travail noire, la tenait paternellement enlacée, elle attendait les visiteurs, en bas des marches qui descendaient du plan du souterrain dans l’appartement de l’assistant, et les saluait en sa compagnie. De toutes parts ces échanges de salut étaient d’une cordialité gaie et insoucieuse. On semblait vouloir à dessein écarter toute oppression et toute solennité. On parlait à tort et à travers, à haute voix et en plaisantant, on échangeait des bourrades, et de toute manière on manifestait son insouciance. Dans la barbe de Krokovski, ses dents jaunes apparaissaient à tout moment, avec certaines expressions cordiales et rassurantes, tandis qu’il répétait son « Je vous salue » et elles apparurent surtout lorsqu’il souhaita la bienvenue à Hans Castorp qui était silencieux et dont l’expression semblait hésitante. « Courage, mon ami ! » semblait dire le hochement de tête du docteur tandis qu’il serrait la main du jeune homme, presque avec rudesse. « Pourquoi nous faire grise mine ? Il n’y a ici ni sournoiserie, ni bigoterie ; il n’y a ici que la bonne humeur virile d’une recherche scientifique sans préventions. » Abordé par cette pantomime, l’autre ne s’en sentit pas plus à l’aise. Lorsqu’il avait pris sa résolution nous l’avions vu évoquer le souvenir du cabinet de radioscopie. Mais cette association d’idées ne suffit pas à caractériser son état d’âme. Ce dernier faisait penser bien plus à l’étrange et inoubliable mélange de hardiesse et de nervosité, de curiosité, de mépris et de ferveur, auquel il avait été en proie voici bien des années, lorsque, un peu gris, il s’était rendu pour la première fois avec des camarades dans une maison close du quartier Saint-Paul.
Comme on était au complet, le docteur Krokovski se retira avec deux assistants – qui étaient cette fois Mme Magnus et Mlle Lévi au teint d’ivoire, – dans la pièce voisine, pour fouiller le médium, tandis que Hans Castorp attendait, avec les neuf autres invités la fin de cette procédure qui se répétait régulièrement et toujours sans résultat, avec une rigueur scientifique, dans le cabinet de travail et de consultations du docteur. L’endroit lui était familier, depuis les heures de bavardage qu’il avait pendant quelque temps passées ici avec l’analyste, à l’insu de Joachim. C’était un cabinet médical de consultations comme beaucoup d’autres, avec son bureau, son fauteuil au dossier cintré, et le fauteuil destiné au malade, sur la gauche, derrière la fenêtre, avec sa bibliothèque de part et d’autre de la porte latérale, avec sa chaise longue en toile cirée, placée obliquement dans l’angle droit de la pièce, et séparée du bureau par un paravent à plusieurs feuilles, avec sa vitrine à instruments dans le même angle, le buste d’Hippocrate dans un autre coin, et l’eau-forte d’après « l’Anatomie » de Rembrandt au-dessus du poêle au gaz, dans le mur de droite. Mais on pouvait constater certaines modifications opérées dans un but particulier. La table ronde en acajou qui, d’habitude, entourée de sièges, avait sa place au centre de la pièce, sous le lustre électrique, au milieu du tapis rouge qui couvrait presque entièrement le plancher, avait été reculée vers l’angle gauche, là où se trouvait le buste de plâtre, et à un point excentrique, tout près du poêle qui était allumé et dégageait une chaleur sèche, se trouvait un petit guéridon couvert d’un tapis léger, qui supportait une petite lampe voilée de rouge, et en outre une seconde ampoule, également enveloppée de tissu rouge et blanc. Sur le guéridon et à côté de lui se trouvaient encore quelques objets bien connus : la clochette, ou plus exactement deux cloches de construction différente : une cloche à battant et un timbre sur lequel il fallait frapper ; de plus, l’assiette de farine, le panier à papier. Une douzaine environ de chaises et de fauteuils de types différents entouraient la table en un demi-cercle, dont une extrémité se trouvait au pied de la chaise-longue, et dont l’autre était située assez exactement au milieu de la chambre, sous le lustre. C’est ici, à proximité du dernier siège, à peu près à mi-chemin de la porte de communication, que l’on avait placé le meuble du phonographe. L’album, avec ses musiquettes, était posé sur une chaise. Tel était l’ordre prévu. On n’avait pas encore allumé les lampes rouges. Le lustre dispensait une lumière blanche et éclatante. La fenêtre, vers laquelle était tourné le côté étroit du bureau, était cachée par un rideau sombre devant lequel était encore tiré un store crème, orné de dentelles.
Au bout de dix minutes, le docteur sortit du cabinet, avec les trois dames. L’apparence de la petite Elly s’était modifiée. Elle ne se montrait plus dans ses vêtements, mais dans une sorte de costume de séance, une espèce de peignoir en crêpe blanc qui était maintenu autour de la taille par une cordelière, et qui dégageait ses bras minces. Comme sa poitrine de jeune fille se dessinait sous ce vêtement, mollement et sans soutien, il paraissait qu’elle n’était que très peu vêtue sous cette robe.
On la salua avec vivacité. « Allo, Elly ! Comme elle est charmante ! Une vraie fée ! Travaille bien, mon ange. » Elle sourit de ces exclamations et de son costume, dont elle savait qu’il lui seyait. « Contrôle préalable négatif », annonça le docteur Krokovski. « À l’œuvre donc, camarades ! » ajouta-t-il avec son r exotique qu’il produisait en ne touchant son palais qu’une fois, et Hans Castorp, désagréablement affecté par ce dernier mot, était sur le point de prendre, comme les autres qui, avec des « allo », des bavardages et des tapes sur les épaules, commençaient d’occuper les chaises en demi-cercle, n’importe quelle place, lorsque le docteur s’adressa personnellement à lui.
– C’est à vous, mon ami, dit-il, à vous qui séjournez en quelque sorte en invité ou en novice au milieu de nous, que je voudrais ce soir accorder des droits particuliers. Je vous charge de contrôler notre médium. Nous pratiquons ce contrôle comme suit.
Et il pria le jeune homme de s’approcher d’une des extrémités du demi-cercle, du côté voisin de la chaise-longue et du paravent, où Elly, la tête tournée davantage vers la porte d’entrée aux marches que vers le milieu de la chambre, avait pris place sur un fauteuil de rotin ordinaire, s’assit sur un autre fauteuil semblable, en face d’elle, et saisit ses mains, en serrant les deux genoux de la jeune fille entre les siens.
« Imitez-moi », ordonna-t-il, et il fit asseoir Hans Castorp à sa place. Vous conviendrez que l’isolement est parfait. Par surcroît de précaution, on vous aidera. Mademoiselle Kleefeld, puis-je vous pr-rier ? » Et la jeune femme, mobilisée avec une politesse si exotique, se joignit au groupe, en maintenant de ses deux mains les poignets fragiles d’Elly.
Il n’était pas toujours possible pour Hans Castorp d’éviter de regarder dans le visage, si proche du sien, de la jeune enfant prodige qu’il tenait si étroitement emprisonnée. Leurs yeux se rencontraient, mais ceux d’Elly déviaient et s’abaissaient de temps à autre, exprimant une pudeur que la situation expliquait parfaitement ; – et, en même temps, elle souriait d’une manière un peu affectée, la tête oblique et les lèvres légèrement pointues, comme cela avait été le cas lors de la séance du verre. Du reste cette minauderie évoqua chez son surveillant un autre souvenir plus lointain. C’est ainsi à peu près, lui revint-il à l’esprit, que Karen Karstedt avait souri lorsque, avec Joachim, ils étaient restés debout auprès du tombeau encore intact du cimetière de Dorf…
On s’était assis en demi-cercle. Il y avait treize personnes, sans compter le Tchèque Wenzel qui avait l’habitude de se consacrer à l’instrument Polyhymnia, et qui, après avoir préparé l’appareil, dans le dos des spectateurs assis au milieu de la chambre, prit place sur un tabouret. Il avait aussi sa guitare à côté de lui. Sous le lustre, là où la rangée de fauteuils s’arrêtait, le docteur Krokovski s’établit après avoir allumé les deux lampes rouges et éteint le plafonnier. Une obscurité doucement rougeoyante régnait à présent dans la pièce, dont les régions et les recoins plus lointains n’étaient plus du tout accessibles aux regards. En somme, seul le dessus de la table et son entourage immédiat étaient éclairés faiblement d’une lueur rougeâtre. Durant les minutes suivantes on vit à peine ses voisins. Très lentement, les yeux s’habituaient à l’obscurité et apprenaient à tirer parti de la lumière qui leur était accordée, et que le flamboiement de la cheminée renforçait dans une certaine mesure.
Le docteur consacra quelques paroles à cet éclairage, déplora son insuffisance du point de vue scientifique. Il fallait se garder de les interpréter comme un moyen de créer une atmosphère, comme une mystification. Malheureusement, pour le moment, en dépit de sa bonne volonté, on n’avait pu organiser un meilleur éclairage. La nature des forces qui entraient ici en ligne de compte et qu’il s’agissait d’étudier, était telle qu’elles ne pouvaient se développer ni exercer une action efficace à la lumière blanche. C’était une condition dont il fallait provisoirement tenir compte. Hans Castorp se déclara satisfait. L’obscurité faisait du bien. Elle atténuait l’étrangeté de la situation dans son ensemble. Au surplus, pour justifier l’obscurité, il se rappela celle où l’on s’était pieusement concentré dans la salle de radioscopie, et dans laquelle on avait baigné ses yeux de jour, avant de « voir ».
Le médium, continua le docteur Krokovski, poursuivant son introduction qui, de toute évidence, s’adressait particulièrement à Hans Castorp, n’avait plus besoin que lui, le médecin, l’endormît. Ainsi que Castorp s’en apercevrait, elle tombait d’elle-même en transe et ceci fait, son esprit gardien, le fameux Holger, parlait à travers elle ; et c’était à lui aussi, non pas à elle, qu’il fallait adresser ses vœux. Du reste, c’était une erreur qui pouvait provoquer des échecs, de croire qu’il fallait concentrer par la volonté et de force ses pensées sur le phénomène que l’on attendait. Au contraire, une attention à moitié distraite et un bavardage insouciant étaient indiqués. Il recommanda surtout à Hans Castorp de veiller infailliblement sur les extrémités du médium.
– Que l’on forme la chaîne ! conclut le docteur Krokovski, ce que l’on fit, en riant, lorsque dans l’obscurité on ne trouvait pas tout de suite les mains de ses voisins. Le docteur Ting-Fou, voisin d’Hermine Kleefeld, posa sa main droite sur l’épaule de la jeune femme, et tendit la gauche à M. Wehsal qui venait après lui. À côté du docteur étaient assis M. et Mme Magnus, auxquels se joignit A. K. Ferge qui, si Hans Castorp ne se trompait pas, tenait dans sa droite la main de Mlle Lévi au teint d’ivoire, et ainsi de suite. « Musique », ordonna le docteur Krokovski. Et le Tchèque, dans le dos du docteur et de ses voisins, mit ce mécanisme en mouvement et posa l’aiguille. « Causons ! » commanda de nouveau Krokovski, tandis que retentissaient les premières mesures d’une ouverture de Milloecker. Et, docilement, on s’efforça de mettre une conversation en train qui ne traitait de rien de notable, de l’état de la neige, cet hiver, du menu du dernier repas, d’une arrivée, d’un départ normal ou en coup de tête, conversation qui, à moitié couverte par la musique s’arrêtait et se renouait, ne se prolongeant qu’artificiellement. Ainsi passèrent quelques minutes.
Le disque n’était pas encore terminé lorsque Elly eut un violent sursaut. Un tremblement la parcourut, elle soupira, le haut de son corps se pencha en avant, de sorte que son front toucha celui de Hans Castorp, et en même temps ses bras commencèrent d’exécuter, avec ceux du surveillant, de bizarres mouvements de pompe, en avant et en arrière.
– Transe, annonça l’experte Hermine Kleefeld. La musique se tut. La conversation s’interrompit. Dans le silence brusquement tombé on entendit le baryton mou et traînant du docteur poser cette question :
– Holger est-il présent ?
Elly trembla de nouveau. Elle vacilla sur sa chaise. Puis Hans Castorp sentit que, des deux mains, elle serrait fortement et rapidement les siennes.
– Elle me serre les mains, annonça-t-il.
– Il, rectifia le docteur. C’est lui qui vous les a serrées. Il est donc présent. Nous te saluons, Holger, poursuivit-il avec onction. Sois le bienvenu de tout cœur, compagnon ! Et laisse-moi te le rappeler. La dernière fois que tu as séjourné parmi nous, tu nous as promis d’évoquer n’importe quel défunt que nous te nommerions, que ce soit un frère ou une sœur, et de le faire apparaître à nos yeux mortels. Es-tu disposé à remplir aujourd’hui ta promesse et t’en sens-tu capable ?
De nouveau Elly frissonna. Elle gémit et hésita à répondre. Lentement elle porta ses mains à son front, ainsi que celles de son voisin, et les y laissa un instant reposer. Puis elle chuchota tout contre l’oreille de Hans Castorp un : « Oui » brûlant.
Le souffle de ce mot dans son oreille causa à notre ami ce chatouillement de l’épiderme que l’on appelle ordinairement « chair de poule », et dont le conseiller lui avait un jour expliqué l’origine. Nous parlons d’un chatouillement pour distinguer l’impression purement physique de la réaction de l’âme. Car il ne pouvait être question chez lui d’une frayeur. Ce qu’il pensait était à peu près ceci : « Allons, en voilà une qui va fort ! » Mais en même temps il se sentait ému, voire bouleversé : c’était un sentiment qui provenait d’un trouble causé par ce fait trompeur qu’une jeune fille dont il tenait les mains venait de souffler un « oui » à son oreille.
– Il a dit « oui », rapporta-t-il, et il avait honte.
– À la bonne heure, Holger, dit le docteur Krokovski. Nous te prenons au mot. Nous tous avons confiance que tu feras loyalement ce qui est en ton pouvoir. On va tout de suite te nommer le cher mort que nous souhaitons voir se manifester. Camarades, s’adressa-t-il à la compagnie, prononcez-vous ! Qui de vous a un désir à remplir. Qui l’ami Holger doit-il vous montrer ?
Un silence suivit. Chacun attendait que le voisin parlât. Tels d’entre eux s’étaient sans doute demandés ces jours derniers où et à qui allaient leurs pensées. Mais c’est toujours une chose compliquée et délicate que de faire revenir des morts, c’est-à-dire de souhaiter leur retour. Au fond, pour le dire franchement, on ne peut pas du tout le souhaiter. C’est une erreur de le faire. Le désir en est aussi impossible que la chose elle-même ; et on s’en apercevrait si la nature abolissait pour une fois cette impossibilité.
Et ce que nous appelons la douleur n’est peut-être pas tant le regret que nous éprouvons de cette impossibilité de voir les morts revenir à la vie que de notre impuissance à le souhaiter.
C’est là ce qu’ils éprouvaient tous, confusément, et bien qu’il ne s’agît pas ici d’un retour sérieux et pratique dans la vie, mais d’un agencement purement sentimental et théâtral, au cours duquel on ne devait que voir le défunt, et que le cas fût par conséquent anodin, ils avaient pourtant peur du visage de celui auquel ils pensaient, et chacun eût volontiers laissé à son voisin le droit de formuler un souhait. Hans Castorp, lui aussi, bien qu’il crût entendre le complaisant et libéral : « Je t’en prie, je t’en prie », de certaine heure obscure, se contint et, au dernier moment, il était assez disposé à laisser le pas à un autre. Mais comme cela durait trop longtemps, il dit, la tête tournée vers le président de la séance, d’une voix voilée :
– Je voudrais voir feu mon cousin Joachim Ziemssen.
Ce fut une délivrance pour tous. De tous les présents, seuls le docteur Ting-Fou, le Tchèque Wenzel et le médium n’avaient pas connu personnellement celui que l’on voulait évoquer. Les autres, Ferge, Wehsal, M. Albin, le procureur, M. et Mme Magnus, Mme Stoehr, Mlle Lévi et Hermine Kleefeld manifestèrent à voix haute et joyeuse leur approbation, et même le docteur Krokovski fit un signe de tête satisfait, bien que ses rapports avec Joachim eussent toujours été froids, celui-ci s’étant montré peu docile à l’analyse.
– Très bien, dit le docteur. Tu entends, Holger ? Dans la vie celui que nous avons nommé t’était inconnu. Le reconnais-tu dans l’au-delà des choses et es-tu prêt à le ramener vers nous ?
Grande attente. La somnambule chancela, gémit et frémit. Elle semblait chercher et lutter ; retombant d’un côté, puis de l’autre, elle chuchotait des paroles inintelligibles, tantôt à l’oreille de Hans Castorp, tantôt à celle de la Kleefeld. Enfin, Hans Castorp sentit la pression des deux mains qui signifiait « oui », il en rendit compte, et…
– Fort bien, s’écria le docteur Krokovski. Au travail, Holger. Musique ! s’écria-t-il. Conversation ! Et il rappela encore une fois que l’on servait les besoins de la cause, non pas en concentrant sa pensée et en se représentant de force ce que l’on attendait, mais par une attention vague et sans contrainte.
Et maintenant suivirent les heures les plus étranges que notre héros eût vécues jusqu’ici ; et bien que la suite de ses destinées ne soit pas tout à fait connue, bien que nous devions le perdre de vue à un point donné de notre histoire, nous sommes tenté d’admettre que ce furent les plus étranges qu’il ait jamais vécues.
Ce furent des heures, plus de deux, nous le disons tout de suite, en y comprenant une brève interruption du travail de Holger, ou plus exactement de la jeune Elly, qui allait commencer maintenant, de ce travail qui traîna effroyablement en longueur, de sorte que l’on fût sur le point de douter que l’on obtiendrait un résultat et qu’en outre, par pure pitié, on se sentît assez souvent tenté de l’abréger, en renonçant à aboutir, car il semblait qu’il surpassât, à faire pitié, les forces frêles auxquelles il était imposé. Nous autres hommes, lorsque nous ne fuyons pas la vie, avons tous éprouvé dans certaine circonstance cette pitié intolérable que – chose dérisoire ! – personne n’admet, et qui est probablement tout à fait déplacée, cet « assez » indigne qui nous échappe, quoi qu’il soit indispensable d’en finir malgré tout. On a déjà compris que nous parlons de notre situation d’époux et de père, de l’acte d’enfanter auquel la lutte d’Elly ressemblait en effet d’une manière si frappante et si indiscutable que même ceux qui ne le connaissaient pas encore, devaient le reconnaître. C’était le cas du jeune Hans Castorp qui, puisque lui non plus ne s’était pas dérobé à la vie, apprit à connaître sous cet aspect cet acte plein d’un mysticisme organique. Sous quel aspect ? Et dans quel dessein ? Et dans quelles conditions ? Il n’est pas possible de qualifier autrement que de scandaleux les caractères et les détails de cette chambre d’accouchée sous la lumière rouge, autant en ce qui concerne la juvénile personne de l’accouchée dans son peignoir flottant et avec ses bras nus, que quant aux autres circonstances, à cette continuelle musique légère de phonographe, à ce bavardage artificiel que le demi-cercle s’efforçait d’entretenir par ordre, aux encouragements joyeux qui en partaient sans cesse pour la lutteuse. « Allons, Holger ! Du courage ! Ça va marcher. Ne lâche pas le coup. Holger, vas-y ! Un petit effort, tu y arriveras ! » Et nous n’exceptons nullement ici la personne de« l’époux » – si nous pouvons considérer Hans Castorp qui avait formulé le souhait, comme l’époux – l’époux donc qui tenait les genoux de la « mère » entre les siens, qui tenait aussi dans les siennes les mains, ces mains aussi humides qu’avaient été autrefois celles de la petite Leila, de sorte qu’il devait sans cesse renouveler son étreinte pour qu’elles ne lui échappassent pas.
Car la cheminée au gaz, dans le dos de la jeune fille, dégageait de la chaleur.
Sacre mystique ? Oh non, on se comportait bruyamment et sans délicatesse dans la pénombre rouge à laquelle les yeux s’étaient peu à peu habitués suffisamment pour embrasser à peu près la chambre. La musique, les cris faisaient penser aux méthodes qu’emploie l’armée du salut pour galvaniser ses auditoires, y faisaient penser même ceux qui, comme Hans Castorp, n’avaient jamais assisté à une fête religieuse de ces fanatiques joyeux. La scène paraissait mystique, mystérieuse, pieuse non pas dans un sens de fantasmagorie, mais uniquement dans un sens naturel, organique, et nous avons déjà dit grâce à la parenté intime avec quelle autre image. Pareillement aux douleurs de l’enfantement, les efforts d’Elly se produisaient après des périodes de répit pendant lesquelles elle était affaissée sur l’appui de son siège, dans un état d’inconscience que le docteur Krokovski qualifiait de « transe profonde ». Puis elle sursautait de nouveau, gémissait, se jetait de côté et d’autre, repoussait ses surveillants, luttait avec eux, chuchotait des paroles ardentes et dépourvues de sens à leurs oreilles, semblait vouloir expulser quelque chose d’elle-même, en se jetant de côté, grinçait des dents et allait jusqu’à mordre la manche de Hans Castorp.
Cela dura une heure et plus. Puis le directeur de la séance estima qu’il était dans l’intérêt général de faire un entr’acte. Le Tchèque Wenzel qui, pour changer, avait en dernier lieu ménagé le phonographe et avait très adroitement fait chevroter et vibrer la guitare, déposa son instrument. En soupirant, on dénoua ses mains. Le docteur Krokovski se dirigea vers le mur pour allumer le lustre. La clarté blanche jaillit, aveuglante, et tous ces yeux habitués à la nuit clignotèrent stupidement. Elly somnolait, penchée en avant, le visage presque sur ses genoux. On la voyait singulièrement active, faisant des gestes qui semblaient familiers aux autres, mais que Hans Castorp observa avec attention et surprise : pendant quelques minutes, sa main creuse alla et vint dans la région de la hanche, elle l’éloignait et la ramenait à elle, comme pour puiser ou ratisser quelque chose. Puis, en plusieurs sursauts, elle reprit conscience, clignota, elle aussi au jour, avec des yeux stupides et endormis, et sourit.
Elle sourit, avec une coquetterie un peu lointaine. La pitié que l’on avait éprouvée pour ses peines semblait en effet gaspillée. Il ne paraissait pas qu’elle en fût particulièrement épuisée. Peut-être ne s’en souvenait-elle pas du tout. Elle était assise dans le fauteuil des malades, derrière le bureau voisin de la fenêtre, entre lui et le paravent qui entourait la chaise-longue ; elle avait placé son siège de façon à pouvoir appuyer son bras sur la table, et regardait devant elle dans la chambre. Elle resta ainsi, effleurée par des regards émus, saluée de temps à autre par un signe de tête encourageant, silencieuse pendant toute la récréation qui dura quinze minutes.
C’était une véritable récréation – apaisée et pleine d’une douce satisfaction du travail accompli. Les étuis de cigarettes de ces messieurs claquèrent. On fumait à l’aise, par groupes, on discutait ci et là du caractère de la séance. Il se fallait de beaucoup que l’on eût désespéré d’obtenir un résultat. Il y avait des indices faits pour écarter un tel découragement. Ceux qui s’étaient trouvés à l’autre extrémité du demi-cercle, près du docteur, s’accordaient à dire qu’ils avaient plusieurs fois et distinctement senti ce souffle frais qui, lorsque des phénomènes se préparaient, partait de la personne du médium dans une certaine direction. D’autres prétendaient avoir remarqué des phénomènes lumineux, des taches blanches, des agglomérations mobiles de forces qui étaient apparues à plusieurs reprises devant le paravent. Bref, il ne fallait pas laisser l’effort se relâcher. Pas de pusillanimité ! Holger avait donné sa parole et l’on n’avait aucune raison de douter de lui.
Le docteur Krokovski donna le signal de la reprise de la séance. Lui-même ramena Elly à son siège de torture, en lui caressant les cheveux, cependant que les autres regagnaient leurs places. Tout se passa comme auparavant ; Hans Castorp demanda, il est vrai, à être remplacé dans son rôle de surveillant, mais le président s’y opposa. Il importait, dit le docteur Krokovski, d’accorder à celui qui avait formulé le désir, la garantie matérielle immédiate que toute manipulation frauduleuse du médium était pratiquement impossible. Hans Castorp reprit donc son étrange position face à Elly, la lumière se fit rouge sombre. La musique reprit. Après quelques minutes Elly sursauta de nouveau, fit les mêmes gestes de traction et cette fois ce fut Hans Castorp qui annonça la « transe ». Le scandaleux accouchement se poursuivait.
Avec quelle peine effrayante il s’accomplissait ! Il ne semblait pas qu’il voulût s’accomplir, et le pouvait-il ? Quelle folie ! Où trouver la maternité ? La délivrance… comment et de quoi ? « Au secours, au secours ! » gémissait l’enfant, tandis que ses douleurs menaçaient de dégénérer en cette crise dangereuse que de savants accoucheurs appellent l’éclampsie. Entre temps, elle appelait le docteur, le priait de lui apposer ses mains. Il le fit en l’encourageant jovialement. Magnétisée, si toutefois elle l’était, elle se trouva fortifiée pour de nouvelles luttes.
Ainsi s’écoula la deuxième heure, tandis que, tour à tour, la guitare chevrotait et le gramophone jetait les airs de l’album léger dans l’espace à l’éclairage duquel les yeux déshabitués du jour s’étaient de nouveau à peu près accoutumés. C’est alors qu’il y eut un incident ; ce fut Hans Castorp qui le provoqua. Il émit une suggestion, exprima un désir et une pensée qu’il avait eus dès le début et qu’il eût dû, à vrai dire, formuler plus tôt. Le visage dans ses mains que l’on maintenait, Elly était en « transe profonde » et M. Wenzel était sur le point de changer de disque ou de le retourner, lorsque notre ami dit d’un air résolu qu’il avait une proposition à faire, sans importance d’ailleurs. Néanmoins il pensait que son adoption pourrait être de quelque utilité. Il y avait là… ou plus exactement : la collection de disques de la maison contenait un numéro du « Faust » de Gounod, la prière de Valentin, un baryton avec orchestre ; c’était très suggestif. Il estimait que l’on devrait essayer de jouer ce morceau.
– Et pourquoi cela ? demanda le docteur, dans la pénombre.
– Affaire d’atmosphère, affaire de sensibilité, répondit le jeune homme. L’esprit du dit morceau est très particulier. Il s’en était rendu compte à l’essai. À son avis il n’était pas impossible que cet esprit et ce caractère abrégeassent le processus qu’il s’agissait de mener à bien ici.
– Le disque est-il là ? s’informa le docteur.
Non, il n’était pas là. Mais Hans Castorp pourrait facilement le chercher.
– À quoi songez-vous ?
Krokovski déclina aussitôt cette proposition : comment ? Hans Castorp voulait aller et venir, et puis reprendre le travail interrompu ? C’était l’inexpérience qui parlait par sa bouche. Non, c’était tout simplement impossible. Tout serait détruit, tout serait à recommencer. Son souci d’exactitude scientifique lui interdisait d’admettre des allées et venues. La porte était fermée. Lui, le docteur, en portait la clef dans sa poche. Bref, si ce disque n’était pas sous la main, il fallait… Il parlait encore lorsque le Tchèque, debout près du phonographe, intervint :
– Le disque est ici.
– Ici ? demanda Hans Castorp.
– Oui, ici. Prière de Valentin. « Faust » s’il vous plaît. Il s’était trouvé par hasard dans l’album des morceaux légers, et non dans l’album vert n° II, où était sa place normale. Par hasard, par extraordinaire, par une négligence heureuse, il se trouvait parmi les « morceaux divers », et il n’y avait qu’à le jouer.
Que dit Hans Castorp de cela ? Rien. Ce fut le docteur qui dit : « Tant mieux ! » et quelques voix répétèrent cette parole. L’aiguille grinça, le couvercle s’abaissa. Et une voix virile commença, parmi des accords de choral :
Ô toi, sainte médaille,
Qui me vient de ma sœur,
Au jour de la bataille,
Pour écarter la mort…
Personne ne parlait. On prêtait l’oreille. À peine le chant eut-il commencé, que les efforts d’Elly changèrent de caractère. Elle avait sursauté, elle tremblait, gémissait, ahanait, pompait et portait de nouveau ses mains humides et glissantes à son front. Le disque tournait. Vint la strophe intermédiaire, au rythme changé, le passage de la bataille et du danger, hardi, pieux et français. La fin suivit, la reprise appuyée par l’orchestre, d’une sonorité puissante : Comme vous pour longtemps je vais quitter ces lieux…
Hans Castorp avait fort à faire avec Elly. Elle se cabrait, aspirait l’air de son gosier contracté, s’affaissait sur elle-même avec de longs soupirs ; puis elle resta immobile. Inquiet, il se pencha sur elle lorsqu’il entendit Mme Stoehr piailler d’une voix gémissante :
– Ziem-ssen !
Il ne se redressa pas. Il eut dans la bouche un goût amer. Il entendit une autre voix, basse et froide, répondre :
– Je le vois depuis longtemps.
On était arrivé au bout du disque, le dernier accord des cuivres avait résonné. Mais personne n’arrêtait l’appareil. Grattant à vide, l’aiguille continuait à tourner au milieu du disque. Alors Hans Castorp leva la tête, et sans chercher, ses yeux prirent la bonne direction.
Il y avait dans la chambre quelqu’un de plus que tout à l’heure. Là-bas, à l’écart de la compagnie, à l’arrière-plan, où les vestiges de la lumière rouge se perdaient presque dans la nuit, de sorte que les yeux avaient peine à la percer si avant, entre le côté large du bureau et le paravent, sur le fauteuil tourné vers la chambre où Elly s’était reposée pendant la récréation, Joachim était assis. C’était Joachim, avec les cavités pleines d’ombre de ses pommettes, avec la barbe de guerrier de ses derniers jours, où ses lèvres ondulaient, si pleines et si fières. Il était adossé et tenait une jambe croisée sur l’autre. Sur son visage émacié on distinguait, bien qu’un couvre-chef y jetât son ombre, l’empreinte de la souffrance, et aussi l’expression de gravité et d’austérité qui l’avait si virilement embellie. Deux plis barraient son front, entre les yeux qui étaient profondément enfoncés dans les orbites osseuses, mais cela ne portait pas atteinte à la douceur du regard de ces grands et beaux yeux sombres, qui était dirigé, calme et avec une interrogation amicale, sur Hans Castorp, sur lui seul. Son petit défaut d’autrefois, les oreilles décollées, était reconnaissable sous son couvre-chef, sous l’étrange couvre-chef que l’on ne connaissait pas. Le cousin Joachim n’était pas en civil ; son sabre semblait appuyé à sa jambe croisée, il tenait la poignée à la main et l’on croyait distinguer quelque chose comme un étui de revolver à sa ceinture. Mais ce n’était pas un véritable uniforme qu’il portait. On n’y remarquait rien de clair, ni de bariolé, il avait un col rabattu et des poches sur les côtés, et quelque part, assez bas, on distinguait une croix. Les pieds de Joachim semblaient grands et ses jambes très minces, elles étaient enroulées dans des molletières, d’une manière plus sportive que militaire. Et qu’en était-il du couvre-chef ? On eût dit que Joachim avait placé une gamelle sur sa tête et l’avait fixée sous son menton par une jugulaire. Mais cette coiffure produisait un effet antique et martial, elle était seyante et étrange : on eût dit d’un lansquenet.
Hans Castorp sentit le souffle d’Ellen Brand sur ses mains. À côté de lui, il entendait la respiration de Hermine Kleefeld qui s’accélérait. On ne percevait rien d’autre que le frottement incessant de l’aiguille grattant le disque qui continuait à tourner, que personne n’arrêtait. Il ne se retourna vers aucun de ses compagnons, il ne voulut rien voir ni savoir d’eux. Penché en avant, par-dessus ses mains, la tête sur ses genoux, il regardait fixement à travers la pénombre rouge le visiteur, sur le fauteuil. Un instant, son estomac parut vouloir se révulser. Sa gorge se contracta et poussa quatre ou cinq sanglots convulsifs et fervents. « Pardonne-moi ! » murmura-t-il en lui-même, puis ses yeux débordèrent, de sorte qu’il ne vit plus rien.
Il entendit chuchoter : « Adressez-lui la parole ! » Il entendit le baryton du docteur Krokovski l’appeler solennellement et gaiement par son nom et réitérer son invitation. Mais au lieu d’y répondre, il retira ses mains de dessous le visage d’Elly et se leva.
De nouveau le docteur Krokovski prononça son nom, cette fois, sur un ton de sévère admonestation. Mais Hans Castorp, en quelques pas, avait gagné la porte d’entrée et, d’un geste bref, il tourna le commutateur et donna de la lumière blanche.
Elly Brand sursauta sous un choc violent. Elle se débattit dans les bras d’Hermine Kleefeld. Le fauteuil, là-bas, était vide.
Hans Castorp marcha vers Krokovski qui protestait, debout. Il voulut parler, mais aucune parole ne s’échappa de ses lèvres. Avec un brusque mouvement de tête, il tendit la main. Lorsqu’il eut reçu la clef, il adressa au docteur plusieurs signes de tête menaçants, fit demi-tour et sortit de la pièce.
LA GRANDE IRRITATION
À mesure que les petites années passaient, un nouvel esprit commença à régner dans la maison du Berghof ; Hans Castorp n’était pas sans se rendre compte qu’il était l’œuvre du démon malfaisant que nous avons nommé plus haut. Avec la curiosité et le détachement du voyageur, qui n’a souci que de s’instruire, il avait étudié ce démon, voire même, avait trouvé en soi des aptitudes inquiétantes à prendre une large part au culte monstrueux que son entourage lui consacrait. Son tempérament ne l’inclinait guère à sacrifier à l’esprit qui régnait désormais, après avoir du reste existé toujours, çà et là, en germe ou en symptômes. Néanmoins, il remarqua avec effroi, que lui aussi cédait, dès qu’il se laissait un peu aller, dans ses airs de tête, ses propos et sa tenue, à une infection à laquelle personne autour de lui ne pouvait se soustraire.
Que se passait-il donc ? Qu’y avait-il dans l’air ? Un esprit de querelle. Une crise d’irritation. Une impatience sans nom. Une tendance générale à des discussions envenimées, à des explosions de rage, voire à des bagarres. Des contestations acharnées, des criailleries sans objet ni mesure, éclataient chaque jour entre des individus ou des groupes entiers, et la caractéristique de ces accès était que ceux qui n’y avaient pas de part, au lieu de se sentir repoussés par l’état des coléreux ou d’apaiser les querelles, y prenaient au contraire une part active et sympathique, et s’abandonnaient au même vertige. Les gens pâlissaient et se mettaient à trembler. Les yeux brillaient de colère, les bouches se tordaient passionnément. On enviait à ceux qui étaient justement en action le droit et le prétexte qu’ils avaient de crier. Un désir lancinant de faire comme eux torturait l’âme et le corps, et quiconque n’avait pas la force de se réfugier dans la solitude était irrémédiablement entraîné dans le tourbillon. Les conflits oiseux, les accusations réciproques, en présence des conciliateurs qui, eux-mêmes, se laissaient aller avec une effrayante facilité à une grossièreté hurlante, se multipliaient au Berghof, et ceux qui sortaient de la maison, l’esprit à peu près calme, ne pouvaient pas savoir dans quel état ils rentreraient. Une habituée de la table des Russes bien, une jeune femme originaire de la province de Minsk, très élégante et assez légèrement atteinte, – on ne lui avait prescrit que trois mois, – descendit un jour au village pour faire des emplettes à la chemiserie française. Mais elle s’y prit d’une colère si violente contre la vendeuse qu’elle rentra, en proie à la plus grande agitation, eut une hémorragie foudroyante, et fut désormais inguérissable. On fit appeler son mari, à qui l’on annonça qu’elle était condamnée à demeurer ici pour toujours.
Voilà un exemple de ce qui se passait. C’est à contre-cœur que nous en citerons d’autres. Peut-être certains d’entre nos auditeurs se souviennent-ils encore de ce collégien ou de cet ancien collégien aux lunettes rondes de la table de Mme Salomon, de ce chétif jeune homme qui avait l’habitude de transformer les mets sur son assiette en une sorte de hachis et de l’engloutir, appuyé sur la table, en essuyant quelquefois avec sa serviette les verres épais de ses lunettes. Il en avait agi de la sorte, pendant tout ce temps, toujours collégien ou ancien collégien, avait dévoré et s’était essuyé les yeux, sans qu’il y ait eu lieu d’accorder une attention autre que toute passagère à sa personne. Mais nouvellement, un beau matin, au premier déjeuner, il fut pris d’un accès imprévu de colère, qui attira l’attention générale et fit se lever toute la salle à manger. On entendit du bruit à la table à laquelle il était assis. Tout pâle, il criait, en s’adressant à la naine qui était debout près de lui. « Vous mentez, cria-t-il, d’une voix glapissante. Le thé est froid. Le thé que vous m’avez apporté est glacé, je n’en veux pas, goûtez-le donc vous-même avant de mentir, vous me direz si ce n’est pas de la lavasse tiède et si un homme convenable peut boire cela. Comment osez-vous me servir du thé glacé, comment la pensée a-t-elle pu vous venir que vous pourriez me présenter cette bibine tiède avec la moindre chance de me la voir absorber ? Je n’en veux pas, je ne le boirai pas », hurla-t-il, et il commença à frapper des deux poings sur sa table, en faisant cliqueter et danser toute la vaisselle qui s’y trouvait. « Je veux du thé chaud, du thé bouillant, c’est mon droit devant Dieu et les hommes. Je n’en veux pas, je veux du thé brûlant, je veux crever si j’avale une seule gorgée… Maudit avorton ! » hurla-t-il tout à coup, d’une voix stridente, en rejetant en quelque sorte d’un geste le mors qui l’avait encore contenu et en se laissant entraîner avec enthousiasme jusqu’à la liberté extrême de la folie furieuse. Il leva les poings contre Émérentia et lui montra littéralement les dents ; il écumait ! Puis il continua de marteler la table, de frapper du pied et de hurler « Je veux », « Je ne veux pas », tandis que la salle offrait le spectacle habituel. Une sympathie terrible était tendue vers le collégien délirant. Plusieurs personnes avaient sursauté et le considéraient, en serrant eux aussi les poings, grinçant des dents, le regard flamboyant. D’autres restaient assis, pâles, les yeux baissés, et tremblaient. Ils restaient encore dans cet état, longtemps après qu’on eut remplacé le thé du collégien qui, épuisé, ne songeait plus à le boire.
Qu’était-ce que cela ?
Un homme entrait dans la communauté du Berghof, un ancien négociant, âgé de trente ans, fiévreux depuis un temps assez long et qui, des années entières avait erré d’établissement en établissement. Cet homme était un ennemi des Juifs, un antisémite, il l’était par principe et en faisait un sport, avec un entêtement joyeux. Cette attitude d’opposition qu’il avait empruntée par hasard, était l’orgueil et le contenu de sa vie. Il avait été négociant, il ne l’était plus, il n’était plus rien au monde, mais il était resté un ennemi des Juifs. Il était très sérieusement malade, il avait une toux très grasse, et, entre deux accès, il semblait que son poumon éternuât avec un son aigu, court, isolé, inquiétant. Mais il n’était pas Juif, et c’était là ce qu’il avait de positif. Son nom était Wiedemann, c’était un nom chrétien, ce n’était pas un nom impur. Il était abonné à une revue intitulée : « Le Flambeau Arien », et il tenait des propos comme celui-ci :
– J’arrive au sanatorium X. à B… Je suis sur le point de m’installer dans la salle de cure. Qui aperçois-je à ma gauche, sur une chaise-longue ? M. Hirsch. Qui est couché à ma droite ? M. Wolff ! Naturellement je suis aussitôt reparti », etc.
– Il ne te manque vraiment que cela, se dit Hans Castorp, avec antipathie.
Wiedemann avait un regard myope et soupçonneux. On eût dit véritablement, et sans que ce soit là une image, qu’il avait sur le nez un pompon vers lequel il louchait méchamment, et par delà lequel il ne voyait plus rien. La fausse idée qui le chevauchait était devenue une méfiance chatouilleuse, une incessante manie de persécution qui le poussait à tirer au clair toute impureté cachée ou masquée qui pouvait se tenir dans son voisinage et la vouer à l’opprobre. Il taquinait, suspectait et bavait sans cesse. Bref, il passait ses journées à clouer au pilori tout être vivant qui ne possédait pas le seul avantage dont lui-même pût s’enorgueillir.
Or l’état d’esprit en ce lieu que nous venons de décrire aggrava extraordinairement la maladie de cet homme. Et comme il ne pouvait manquer de rencontrer, ici même, des êtres affligés de cette tare, dont lui, Wiedemann, était quitte, cet état général conduisit à une scène lamentable à laquelle Hans Castorp dut assister, et qui nous servira de nouvel exemple de ce qu’il nous incombe de décrire.
Car il y avait là un autre homme : il n’y avait rien à démasquer chez lui, son cas était clair. Cet homme s’appelait Sonnenschein, et comme on ne pouvait avoir un nom plus répugnant, la personne de Sonnenschein, dès le premier jour, fut le pompon suspendu devant le nez de Wiedemann vers lequel il louchait avec une myopie méchante et vers lequel il étendait la main, moins pour le chasser que pour le balancer, afin d’en être irrité davantage.
Sonnenschein, négociant comme l’autre, était lui aussi sérieusement malade et maladivement susceptible. Un homme aimable, pas sot, et même gai de nature ; il haïssait, lui aussi, Wiedemann à cause de ses taquineries et de ses allusions, jusqu’à en tomber malade, et une après-midi, tout le monde accourut dans le hall, parce que Wiedemann et Sonnenschein s’y étaient pris par les cheveux avec une violence bestiale et déchaînée.
C’était un spectacle attristant et abominable. Ils se colletaient comme des gamins, mais avec un désespoir d’adultes qui en sont réduits à une telle extrémité. Ils se griffaient la figure, se prenaient le nez et la gorge, tout en tapant l’un sur l’autre, ils s’étreignaient, se roulaient, en proie à une colère noire, crachaient l’un sur l’autre, se donnaient des coups de pieds, poussaient, tiraillaient, frappaient et écumaient. Des employés du bureau qui étaient accourus séparèrent à grand peine les deux combattants agrippés l’un à l’autre. Wiedemann bavant et saignant, le visage stupide de colère, présentait le phénomène curieux des cheveux hérissés. Hans Castorp n’avait jamais vu cela et n’avait pas cru que ce fût possible. Les cheveux de M. Wiedemann se dressaient sur sa tête, raides et droits, et c’est dans cet état qu’il s’éloigna en courant, tandis que l’on conduisait M. Sonnenschein, dont un œil disparaissait sous un bleu et qui avait un trou sanglant dans la couronne des cheveux noirs et bouclés qui entouraient sa tête, au bureau où il s’écroula et pleura amèrement dans ses mains.
Voilà ce qui s’était passé entre Wiedemann et Sonnenschein. Tous ceux qui les avaient vus, en tremblèrent pendant des heures. En face d’une telle misère, c’est pour nous un bienfait de pouvoir narrer une véritable affaire d’honneur qui se déroula également pendant cette période et qui méritait il est vrai ce titre jusqu’au ridicule, grâce à la solennité formaliste avec laquelle elle fut traitée. Hans Castorp n’assista pas aux différentes phases de cette affaire, mais fut renseigné sur son cours embrouillé et dramatique, par des documents, des déclarations et des procès-verbaux qui furent répandus en copies, non seulement au Berghof, au village, dans le canton et dans le pays, mais encore à l’étranger et jusqu’en Amérique, et qui furent communiqués même à des personnes manifestement incapables d’éprouver pour elle l’ombre d’un intérêt. C’était une affaire polonaise, une affaire de point d’honneur, qui avait éclaté au sein du groupe polonais qui s’était récemment formé au Berghof, d’une toute petite colonie qui occupait la table des Russes bien (Hans Castorp, notons-le au passage, n’était plus assis à cette table. À mesure que le temps passait, il avait été tour à tour à la table d’Hermine Kleefeld, puis à celle de Mme Salomon, et enfin à celle de Mlle Lévi). Cette compagnie avait un vernis si élégant et si mondain qu’il suffisait de froncer les sourcils pour que l’on pût s’attendre à tout : il y avait là un couple, une demoiselle qui entretenait avec un des messieurs d’étroites relations d’amitié, et d’autres hommes du monde. Ils s’appelaient : de Zutavski, Cieszynski, de Rosinski, Michel Lodygovski, Léon d’Asarapétian, et d’autres noms encore. Au restaurant du Berghof, au champagne, un certain Japoll avait donc, en présence de deux autres gentlemen, émis au sujet de l’épouse de M. de Zutavski ainsi que de l’amie de M. Lodygovski, nommée Mlle Krylof, des allégations qu’il n’est pas possible de répéter ici. Il s’ensuivit des démarches, des actes et des formalités que relataient les textes qu’on avait distribués et expédiés au loin. Hans Castorp lut :
« Déclaration, traduite de l’original polonais.
« Le 27 mars 19… M. Stanislas de Zutavski s’est adressé à MM. le Dr Antoni Ciezsynski et Stefan de Rosinski, pour les prier de se rendre en son nom chez M. Casimir Japoll, et de lui demander une réparation conforme au code d’honneur pour « les graves offenses et diffamations dont M. Casimir Japoll s’est rendu coupable à l’égard de Mme Jadwiga de Zutavska, au cours d’une conversation avec MM. Janusz Téofil Lénart et Léon d’Asarapétian. »
« Lorsque M. de Zutavski a eu indirectement connaissance de l’entretien mentionné ci-dessus, et ayant eu lieu à la fin de novembre, il a aussitôt fait le nécessaire pour obtenir une certitude complète sur l’état de faits et sur la nature de l’offense dont il a été l’objet. Hier, 27 mars 19…, la diffamation et l’offense ont été établies par la bouche de M. Léon d’Asarapétian, témoin immédiat de la conversation au cours de laquelle les paroles offensantes et les insinuations ont été prononcées. M. Stanislas de Zutavski a dès lors jugé opportun de s’adresser aux soussignés pour leur donner mandat d’engager sans délai contre M. Casimir Japoll la procédure conforme aux lois de l’honneur.
« Les soussignés font la déclaration suivante :
1. – En vertu d’un procès-verbal établi par l’une des parties le 9 avril 19…, lequel procès-verbal a été établi à Lemberg par MM. Zdzislaw Zygulski et Tadeusz Kadyi, dans l’affaire de M. Ladislas Goduleczny contre M. Casimir Japoll ; de plus, en raison de la déclaration du jury d’honneur du 18 juin 19…, rédigée à Lemberg au sujet de la dite affaire, lesquels documents s’accordent pleinement à constater que : « à la suite de ses manquements réitérés aux exigences de l’honneur, M. Casimir Japoll ne peut plus être considéré comme un gentleman. »
2. – Les soussignés tirent des faits articulés ci-dessus les conclusions qui s’imposent, et constatent que M. Casimir Japoll ne saurait plus en aucune façon accorder une réparation pour ses actes.
3. – Les soussignés estiment pour leur part qu’il est inadmissible d’engager une procédure d’honneur contre un homme qui a failli à l’honneur, ni d’intervenir dans une telle procédure.
« En raison de cet état de choses les soussignés attirent l’attention de M. Stanislas de Zutavski sur le fait qu’il est vain d’engager contre M. Casimir Japoll une procédure d’honneur, et lui conseillent d’assigner ce dernier en justice, afin d’empêcher qu’une personnalité qui n’est plus en mesure d’accorder une réparation, ainsi que c’est le cas de M. Casimir Japoll, lui cause de nouveaux préjudices. (Daté et signé : Dr Antoni Cieszynski, Stefan de Rosinski.)
Hans Castorp lut encore :
« Procès-verbal
« des témoins de l’incident entre MM. Stanislas de Zutavski et Michel Lodygovski, d’une part ;
« et de MM. Casimir Japoll et Janusz Téofil Lénart d’autre part, incident s’étant produit au bar du Kurhaus de D…, le 2 avril 19… entre 7 h.½ et 7 h.¾ du soir.
« Attendu que M. Stanislas de Zutavski, en vertu de la déclaration de ses représentants, MM. le Dr Antoni Cieszynski et Stefan de Rosinski dans l’affaire de M. Casimir Japoll du 28 mars 19… est arrivé après mûre réflexion à la conviction que les poursuites judiciaires contre M. Casimir Japoll qui lui avaient été recommandées ne pourraient constituer une réparation suffisante « des graves offense et diffamation » de son épouse Jadwiga,
« attendu que l’on était en droit de redouter que, le moment venu, M. Casimir Japoll ne comparût pas en justice et que les poursuites ultérieures contre lui, en sa qualité de sujet autrichien, fussent rendues non seulement difficiles, mais, en fait, impossibles,
« attendu, en outre, qu’une condamnation en justice de M. Casimir Japoll ne saurait effacer l’offense par laquelle M. Casimir Japoll a essayé de déshonorer calomnieusement le nom et la maison de M. Stanislas de Zutavski et de son épouse Jadwiga,
« M. Stanislas de Zutavski a choisi la voie la plus directe et, d’après sa conviction et en raison des circonstances données, la plus opportune, après avoir appris indirectement que M. Casimir Japoll se proposait de se rendre ce jour en l’endroit susnommé,
« et, le 2 avril 19…, entre 7 h.½ et 7 h.¾ du soir, en présence de son épouse Jadwiga et de MM. Michel Lodygowski et Ignace de Mellin, il a plusieurs fois giflé M. Casimir Japoll qui, en compagnie de M. Janusz Téofil Lénart et de deux femmes inconnues, consommait des boissons alcooliques au bar américain du Kurhaus susdit.
« Aussitôt après, M. Michel Lodygovski a giflé M. Casimir Japoll en ajoutant que c’était en raison des graves offenses qu’il avait faites à Mlle Krylof et à lui-même.
« Aussitôt après, M. Michel Lodygovski a giflé M. Janusz Téofil Lénart pour le tort causé à M. et Mme de Zutavski, après quoi :
« sans perdre un instant, M. Stanislas de Zutavski, a giflé à plusieurs reprises M. Janusz Téofil Lénart pour avoir calomnieusement souillé son épouse ainsi que Mlle Krylof.
« MM. Casimir Japoll et Janusz Téofil Lénart sont demeurés complètement passifs pendant tous ces incidents.
« Daté et signé : « Michel Lodygowski, Ign. de Mellin. »
L’état d’esprit commun ne permit pas à Hans Castorp de rire de ce feu roulant de gifles officielles, comme il eût sans doute fait en d’autres temps. Il trembla en lisant, et la correction inattaquable des uns, le déshonneur crapuleux et veule des autres, tels qu’ils apparaissaient aux yeux du lecteur de ces documents, l’émurent profondément, par leur contraste, assez peu vivant, mais impressionnant. Il en allait ainsi de tout le monde. De toutes parts on étudiait passionnément l’affaire d’honneur polonaise, et on la commentait en serrant les dents. Une réplique de M. Casimir Japoll, sous la forme d’un factum, refroidit un peu les esprits. Japoll arguait que de Zutavski avait parfaitement su que lui, Japoll, avait été autrefois disqualifié par un quelconque et prétentieux freluquet, et que toutes les démarches que de Zutavski avait entreprises n’avaient été qu’une comédie, parce qu’il avait su d’avance qu’il n’aurait pas besoin de se battre. D’autre part, de Zutavski n’avait renoncé à le poursuivre que pour la bonne raison, que tout le monde et lui-même connaissaient parfaitement, que sa femme Jadwiga l’avait gratifié de toute une collection de cornes, ce que Japoll se flattait d’établir aisément en justice, où la déposition de Mlle Krylof ne serait pas moins édifiante. Au surplus, il n’était établi qu’en ce qui le concernait, lui, Japoll, qu’une réparation ne pouvait être accordée, mais ce n’était pas le cas de l’autre partenaire de l’entretien incriminé, et Zutavski ne s’en était pris à lui que pour ne courir aucun risque. Quant au rôle que M. Asarapétian avait joué dans toute cette affaire, mieux valait n’en point parler. Mais en ce qui concernait la scène au bar du Kurhaus, il convenait de signaler que lui, Japoll, était un homme de constitution plutôt faible, quoiqu’il eût la réplique assez vive et parfois spirituelle. Or, de Zutavski, accompagné de ses amis et de la Zutavska, qui était une femme extraordinairement vigoureuse, avait joui d’une supériorité d’autant plus grande, que les deux petites dames qui se trouvaient en sa compagnie à lui, Japoll, et en la compagnie de Lénart, étaient des créatures sans doute gaies, mais aussi craintives que des poules. Et dès lors, pour éviter une épouvantable bagarre et un scandale public, il avait engagé Lénart, qui avait voulu se défendre, à se tenir tranquille et à supporter ces passagers contacts mondains avec MM. de Zutavski et de Lodygovski, d’autant plus qu’ils n’avaient pas été douloureux et que leurs voisins les avaient pris pour d’amicales taquineries.
Ainsi se défendait Japoll qui, naturellement, n’avait pas grand-chose à sauver. Ses rectifications ne réussissaient à ébranler que superficiellement le beau contraste entre l’honneur et la lâcheté, tel qu’il résultait des constatations de la contrepartie, et cela d’autant plus qu’il ne disposait pas des moyens techniques dont usa le parti Zutavski pour répandre son point de vue, et qu’il ne sut distribuer que quelques copies à la machine de sa réplique. Par contre, les procès-verbaux que nous avons cités parvinrent à tout le monde, et, comme dit, des gens même complètement étrangers à cette affaire les reçurent. Par exemple, ils étaient également parvenus à Naphta et à Settembrini. Hans Castorp vit ces documents entre les mains de ses amis, et il remarqua à sa surprise qu’eux aussi les étudiaient avec des mines concentrées et étrangement absorbées. Il avait espéré que M. Settembrini tout au moins formulerait à leur propos les gaies plaisanteries dont, par suite de l’état d’esprit général intérieur, il ne trouvait pas lui-même la force. Mais l’épidémie qui sévissait avait atteint jusqu’à l’esprit clair du franc-maçon avec une force qui lui enlevait toute envie de rire et le rendait sérieusement accessible aux excitations et aux coups de fouet de cette affaire de gifles. De plus, son état de santé qui empirait, lentement mais régulièrement, avec des mieux passagers et décevants, l’assombrissait, lui, l’homme de la vie ; et il maudissait son état, il en avait honte et se méprisait furieusement, mais n’en devait pas moins, à cette époque, garder le lit tous les quelques jours.
Naphta, le voisin et l’adversaire de Settembrini, n’allait guère mieux. Dans son organisme cette maladie progressait, qui avait été la cause physique – ou faut-il dire : le prétexte ? – de l’interruption de sa carrière dans les ordres, et l’altitude ni la rareté de l’air où il vivait, ne pouvaient enrayer le développement du mal. Lui aussi restait souvent au lit ; la fêlure de sa voix devenait plus sensible lorsqu’il parlait, et, à mesure que sa fièvre montait, il se montrait plus tranchant et plus mordant. Ces résistances idéologiques contre la maladie et la Mort, dont l’écrasement par ces sournoises puissances de la nature était si douloureux au cœur de M. Settembrini, devaient être étrangères au petit Naphta, et il accueillait donc l’aggravation de son état physique non pas dans la tristesse, mais avec une gaieté sarcastique, une combativité sans pareille, un besoin de critique, de négation et de perturbation spirituelles, qui irritaient dangereusement la mélancolie de l’autre et aiguisaient chaque jour leurs querelles intellectuelles. Naturellement, Hans Castorp ne pouvait parler que de celles auxquelles il assistait. Mais il était à peu près sûr de n’en manquer aucune, et il avait le sentiment que sa présence à lui, l’objet de leur zèle pédagogique, était nécessaire pour amorcer des controverses importantes. Et, s’il n’épargnait pas à M. Settembrini le chagrin que l’Italien éprouvait à l’entendre déclarer intéressantes les méchancetés de Naphta, il devait néanmoins accorder que ces dernières finissaient par dépasser toute mesure, et souvent les limites d’un esprit sain.
Ce malade n’avait pas la force ou la bonne volonté de s’élever au-dessus de la maladie, et il voyait le monde entier sous le signe du mal. À la grande colère de M. Settembrini, qui eût le plus volontiers engagé son élève à quitter la chambre, ou qui lui eût bouché les oreilles, il déclarait que la matière était une étoffe beaucoup trop grossière pour que l’esprit pût s’y incarner. C’était une folie d’y prétendre. À quoi aboutissait-on ? À une grimace ! Le résultat pratique de la Révolution française tant vantée était l’état bourgeois capitaliste. C’était du propre ! On espérait l’amender en généralisant cette abomination. La République universelle, ce serait le bonheur, sûrement ! Le progrès ? Mon Dieu, c’était ce fameux malade qui changeait sans cesse de position, parce qu’il espérait ainsi trouver un soulagement. Le désir inavoué, mais au fond partout répandu, de voir éclater une guerre, était l’expression de cet état. Elle viendrait, cette guerre, et c’était heureux, bien qu’elle dût apporter tout autre chose que ce que prévoyaient ses auteurs. Naphta méprisait l’état bourgeois préoccupé de sa sécurité. Il saisit l’occasion d’exprimer son point de vue à ce sujet, un jour d’automne que l’on se promenait sur la grande route et que, la pluie s’étant mise à tomber, tout le monde, comme sur commandement, ouvrit des parapluies. C’était là, à ses yeux, un symbole de la lâcheté et de la mollesse triviale qui étaient le résultat de la civilisation. Un accident et un « méné tékel » comme le naufrage du paquebot « Titanic » ramenait l’homme à ses origines ; mais c’était en même temps un véritable réconfort. Là-dessus, à grands cris, on avait réclamé plus de sécurité dans les moyens de transports. D’une façon générale, on manifestait la plus grande indignation dès que la sécurité paraissait menacée ; c’était lamentable, et cette faiblesse humanitaire s’accordait très gentiment avec la sauvagerie bestiale et l’infamie du champ de bataille économique que constituait l’État bourgeois. Guerre, guerre ! Il y consentait, et cette impatience générale de la faire lui paraissait presque honorable.
Mais à peine M. Settembrini introduisait-il dans la conversation le mot de « justice » et recommandait-il ce principe élevé comme un moyen préventif contre des catastrophes intérieures et extérieures, il apparaissait que Naphta qui, récemment encore, avait jugé que l’esprit était trop pur pour que l’on dût jamais réussir à lui donner une forme terrestre, mettait en doute cet esprit même, et s’efforçait de le dénigrer. Justice ! Était-ce là une idée si digne d’admiration ? Était-ce un principe divin, un principe supérieur ? Dieu et la nature étaient injustes, ils avaient leurs favoris, ils procédaient par sélection, ils accordaient à l’un des avantages dangereux et préparaient à l’autre un sort facile et banal. Et l’homme doué de volonté ? À ses yeux, la justice était, d’une part, une faiblesse qui le paralysait, elle était le doute lui-même, et, d’autre part, c’était une fanfare qui appelait l’homme à des actions irréfléchies. Puisque l’homme, pour rester dans le domaine moral, devait sans cesse corriger la « justice » dans ce sens-ci, par la « justice » dans ce sens-là, que restait-il du caractère absolu de ce principe ? D’ailleurs on était « juste » contre un point de vue ou contre un autre. Le reste n’était que libéralisme et il n’y avait plus personne qui donnât dans ce panneau. La justice n’était, bien entendu, qu’un mot creux de la rhétorique bourgeoise, et avant de passer à l’action il fallait avant tout savoir de quelle justice on entendait parler : de celle qui voulait accorder à chacun ce qui lui appartenait, ou de celle qui voulait donner la même chose à tous.
Nous avons choisi à tout hasard un exemple de ces débats sans issue, pour montrer comment Naphta essayait de troubler toute raison. Mais c’était pire encore lorsqu’on en venait à parler de la science, à laquelle il ne croyait pas. Il n’y croyait pas, disait-il, parce que l’homme était absolument libre d’y croire ou de ne pas y croire. Elle était une foi, comme toutes les autres, mais plus stupide et plus malfaisante que toute autre, et le mot « science » lui-même était l’expression du réalisme le plus stupide qui n’avait pas honte d’accepter ou de faire circuler, comme de l’argent comptant, les reflets infiniment douteux des objets dans l’intellect humain, et d’en tirer le dogmatisme le plus désolant et le plus dépourvu d’esprit que l’on eût jamais inculqué au genre humain. L’idée d’un monde matériel, existant en soi, n’était-elle pas la plus ridicule de toutes les contradictions ? Or, la science naturelle moderne, en tant que dogme, reposait uniquement sur cette hypothèse métaphysique que les formes de la connaissance qui nous sont propres, l’espace, le temps et la causalité, formes dans lesquelles se déroulait le monde phénoménal, étaient des conditions réelles qui existaient indépendamment de notre connaissance. Cette affirmation moniste était l’impertinence la plus audacieuse que l’on eût jamais commise envers l’esprit. L’espace, le temps et la causalité, en langage moniste, cela s’appelait : évolution et c’était là le dogme central de la pseudo-religion des libres penseurs et des athées, par quoi l’on pensait détrôner le premier livre de Moïse et opposer un savoir éclairé à une fable abêtissante, comme si Haeckel avait assisté à la genèse. Empirisme ! Voulait-on dire que la théorie de l’atmosphère cosmique était exacte ? Prétendait-on que l’atome, cette jolie plaisanterie mathématique de la « plus petite parcelle indivisible » était prouvé ? La doctrine de l’infinité de l’espace et du temps reposerait sur l’expérience ? En effet, pour peu que l’on montrât un peu de logique, ces dogmes de l’infinité et de la réalité de l’espace et du temps vous mèneraient à des expériences et à des résultats tout à fait réjouissants, à savoir : au néant. On serait forcé de convenir que le réalisme était le véritable nihilisme. Pourquoi ? Pour cette simple raison que le rapport de n’importe quelle mesure avec l’infini était égal à zéro. Il n’y a pas de mesure dans l’infini, il n’y a ni durée ni changement dans l’éternité. Dans l’infini spatial, dès lors que toute distance est mathématiquement égale à zéro, on ne saurait même pas concevoir deux points situés l’un à côté de l’autre, encore moins un corps, encore moins un mouvement. Cela, Naphta le constatait, pour répondre à l’effronterie avec laquelle la science matérialiste présentait ses calembredaines astronomiques, son bavardage inconsistant sur « l’univers », comme une connaissance absolue. Infortunée humanité qui, par un étalage présomptueux de chiffres nuls, s’était laissé suggérer le sentiment de sa propre nullité, s’était laissé priver du sens pathétique de sa propre importance ! Car on pouvait encore admettre que la raison et la connaissance humaines s’en tinssent au domaine terrestre et que dans cette sphère elles traitassent comme réelles leurs expériences avec l’objet et le subjectif. Mais lorsqu’elles passaient outre et s’engageaient dans les énigmes éternelles, en se livrant à de la prétendue cosmologie, à de la cosmogonie, la plaisanterie allait trop loin et la présomption devenait sinistre. Quelle stupidité blasphématoire, au fond, que de vouloir mesurer la « distance » de la terre à une étoile quelconque en trillions de kilomètres, ou en années-lumière, et de s’imaginer que par de telles fanfaronnades de chiffres, on pouvait donner à l’esprit humain une vue sur la nature de l’infini et de l’éternité, alors que ni l’infini n’avait absolument rien de commun avec la distance, ni l’éternité avec la durée et les étendues de temps, alors que, loin d’être des conceptions relevant des sciences naturelles, elles signifiaient au contraire l’abolition de ce que nous appelons la nature. En vérité, il préférait encore mille fois la naïveté d’un enfant qui croyait que les étoiles étaient des trous dans la toile du ciel, à travers lesquels transparaissait la lumière éternelle, au bavardage creux, insensé et présomptueux que commettait la science moniste en traitant de « l’univers cosmique ».
Settembrini lui demanda si, pour sa part, il expliquait de la sorte l’existence des étoiles. À quoi Naphta répondit qu’il réservait à son scepticisme toute humilité et toute liberté. On pouvait de nouveau déduire de cette affirmation quelle idée il se faisait de la « liberté » et où une telle conception pouvait mener. Et M. Settembrini avait, hélas, tout lieu de craindre que Hans Castorp trouvât de telles billevesées dignes de considération !
Naphta guettait méchamment les occasions qui s’offraient de dévoiler les faiblesses du progrès vainqueur de la nature, et de déceler à ses représentants et à ses pionniers les rechutes humaines dans l’irrationnel. Les aviateurs, disait-il, étaient le plus souvent des individus assez louches et déplaisants, surtout très superstitieux. Ils emportaient à leur bord des mascottes, un corbeau, ils crachaient trois fois de côté et d’autre, ils mettaient les gants de prédécesseurs heureux. Comment une déraison aussi primitive se conciliait-elle avec les conceptions philosophiques sur lesquelles s’appuyait leur profession ? Il s’amusait de cette contradiction, elle lui donnait satisfaction ; il s’y attardait… Mais nous cueillons dans l’inépuisable des exemples de l’humeur agressive de Naphta, alors que nous n’avons qu’à nous en tenir aux choses les plus réelles.
Un après-midi de février, ces messieurs tombèrent d’accord de prendre leur vol pour Monstein, à une heure et demie de traîneau du lieu de leur vie quotidienne. Il y avait là Naphta et Settembrini, Hans Castorp, Ferge et Wehsal. Ils partirent dans deux traîneaux à deux chevaux, Hans Castorp avec l’humaniste, Naphta avec Ferge et Wehsal (le dernier sur le siège à côté du cocher), à quatre heures, bien emmitouflés, du domicile des externes, et accompagnés du son de grelots qui traverse si agréablement le silencieux paysage de neige ; ils suivirent la route qui longe le versant de droite, en passant devant Frauenkirch et Glaris, vers le sud. La neige venait rapidement à leur rencontre, de sorte qu’il ne resta bientôt plus au-dessus de la chaîne du Rhaetikon qu’une bande d’azur pâle. Le froid était vif, la montagne embrumée. La route qu’ils suivaient, étroite corniche, entre le mur et l’abîme, montait, raide, dans la forêt de sapins. On avançait au pas. Des lugeurs qui dévalaient la pente, venaient souvent à leur rencontre et étaient forcés de descendre en les approchant. Derrière les tournants on entendait l’avertissement grêle de grelots étrangers, des traîneaux attelés de deux chevaux l’un derrière l’autre, passaient, et il fallait se montrer prudent en doublant. Près du but, une belle vue s’ouvrit sur une partie rocheuse de la route de Zugen. Les promeneurs sortirent les couvertures devant la petite auberge de Monstein qui s’intitulait « Kurhaus » et, laissant les traîneaux en arrière, firent encore quelques pas, pour avoir vue vers le sud-est sur le Stulsergrat. Le mur immense, de trois mille mètres de hauteur, était voilé de brouillard. Çà et là surgissait un pic haut comme le ciel ; supraterrestre, d’un éloignement qui faisait penser à un Walhalla, saintement inaccessible, il émergeait du brouillard. Hans Castorp admira vivement ce spectacle et exigea que les autres fissent de même. Ce fut lui qui, avec des sentiments d’humilité, prononça le mot « inaccessible », et donna ainsi l’occasion à M. Settembrini de faire observer que, naturellement, on avait déjà réussi l’ascension de ce pic. D’ailleurs, cela n’existait pour ainsi dire plus, « l’inaccessible », il n’y avait aucun point de la nature où l’homme n’eût pas déjà posé le pied. C’était là une petite exagération et une vantardise, répliqua Naphta. Et il cita le Mont Everest qui avait opposé jusqu’à présent un refus glacial à la témérité des hommes, et qui semblait vouloir demeurer longtemps encore dans cette attitude de réserve. L’humaniste se fâcha. Ces messieurs retournèrent au Kurhaus devant lequel se trouvaient quelques traîneaux étrangers dételés, rangés à côté des leurs.
On pouvait se loger ici. Au premier étage, il y avait des chambres d’hôtel, avec des numéros. C’était là aussi qu’était située la salle à manger, d’aspect rustique et bien chauffée. Les excursionnistes commandèrent un goûter à l’aubergiste empressé : du café, du miel, du pain blanc et du pain de poires, la spécialité de l’endroit. On envoya du vin rouge aux cochers. Des visiteurs suisses et hollandais étaient assis aux autres tables.
Nous étions tenté de dire qu’à celle de nos cinq amis la chaleur du café bouillant et excellent avait donné naissance à une conversation plus élevée, mais ce serait se montrer inexact, car cette conversation consistait en réalité en un monologue de Naphta qui, après quelques mots prononcés par les autres, en fit tous les frais, un monologue conduit d’une manière très étrange, et choquant du point de vue des convenances, parce que l’ancien jésuite se tournait uniquement vers Hans Castorp, l’instruisant amicalement, mais tournait le dos à M. Settembrini qui était assis de l’autre côté, et négligeait également les deux autres voisins.
Il eût été difficile de formuler le sujet de son improvisation, que Hans Castorp accompagnait de hochements de tête à demi approbateurs. Sans doute ne portait-elle pas sur un objet unique, mais se mouvait arbitrairement dans le domaine de l’esprit, effleurant une foule de problèmes et tendant somme toute à établir d’une manière décourageante l’ambiguïté des phénomènes spirituels de la vie, la nature incertaine et l’inutilité pour la lutte des grands principes que l’on en déduisait, tout en montrant dans quels vêtements chatoyants l’absolu apparaissait ici-bas.
Tout au plus aurait-on pu ramener sa conférence au problème de la liberté, qu’il traitait comme dans l’intention de l’embrouiller davantage. Il parla entre autres du romantisme et du double sens fascinant de ce mouvement européen du début du XIXe siècle, devant lequel les concepts de réaction et de révolution s’évanouissaient, pour autant qu’ils ne se réunissaient pas en un nouveau concept plus haut. Car c’était bien entendu très ridicule de vouloir lier l’idée révolutionnaire exclusivement à celles de progrès et de civilisation victorieuse. Le romantisme européen avait été avant tout un mouvement de libération anti-classique, anti-académique, dirigé contre l’ancien goût français, contre l’ancienne école de la raison, dont elle avait raillé les défenseurs comme de vieilles perruques.
Et Naphta s’en prit aux guerres de libération, aux enthousiasmes de Fichte, à ce mouvement de révolte enivrée et lyrique contre une tyrannie insupportable, laquelle malheureusement, eh ! eh !, était précisément représentée par la liberté, c’est-à-dire par les idées de la révolution. Très drôle ! En chantant à tue-tête on avait pris son élan pour abattre la tyrannie révolutionnaire en faveur de la férule réactionnaire des princes ; et c’était là ce qu’on avait fait pour la liberté.
Il engageait le juvénile auditeur à se rendre compte de la différence, ou plus exactement du contraste entre la liberté extérieure et intérieure, et en même temps à examiner la question délicate de savoir quelle servitude était la plus (eh ! eh !) et laquelle la moins compatible avec l’honneur d’une nation.
La liberté était en réalité une conception plus romantique que progressiste, car elle avait en commun avec le romantisme l’inextricable entrelacement de besoins humains d’extension et d’une accentuation passionnément restrictive du Moi. La tendance individualiste à l’affranchissement avait préparé le culte historique et romantique du national, qui était d’essence guerrière et que qualifiait d’obscurantisme le libéralisme humanitaire, bien que lui-même préconisât également l’individualisme, mais pour des raisons bien différentes. L’individualisme était romantique, il relevait du moyen âge dans sa conception de l’importance infinie et cosmique de l’individu, d’où l’on pouvait déduire la doctrine de l’immortalité de l’âme, la doctrine géocentriste et l’astrologie. D’autre part, l’individualisme était l’affaire de l’humanisme libéralisant qui inclinait à l’anarchie et voulait de toutes façons empêcher que le cher individu fût sacrifié à la collectivité. Cela aussi, c’était de l’individualisme, l’individualisme c’était l’un ou l’autre, le même mot exprimait bien des choses.
Mais il fallait convenir que l’exaltation de la liberté avait suscité les plus brillants adversaires de la liberté, les champions les plus spirituels du passé, dans la lutte contre le progrès destructeur et impie. Et Naphta cita Ardnt qui avait maudit l’individualisme et porté aux nues la noblesse, il cita Goerres, l’auteur de la Mystique Chrétienne. Et la mystique n’avait-elle rien de commun avec la liberté ? N’avait-elle pas été anti-scolastique, anti-dogmatique, anti-cléricale ? On était obligé, il est vrai, de considérer la hiérarchie comme une puissance libérale, car elle avait opposé un rempart à la monarchie absolue. Mais le mysticisme à la fin du moyen âge avait affirmé sa nature libérale, en se faisant le précurseur de la Réforme, – de la Réforme, eh ! eh ! – qui, de son côté, était un tissu indissoluble de liberté et de réaction moyenâgeuse…
Le geste de Luther… eh ! oui, il avait l’avantage de démontrer à l’évidence et avec rudesse la nature problématique de l’action elle-même, de l’action en général. L’auditeur de Naphta savait-il ce que c’était qu’un acte ? Un acte, ç’avait été, par exemple, l’assassinat du conseiller d’État Kotzebue par l’étudiant Sand. Qu’était-ce qui avait, pour s’exprimer en criminaliste, « armé la main » de Sand ? L’enthousiasme pour la liberté, bien entendu. Mais si l’on y regardait de plus près, ce n’était plus en réalité cet enthousiasme, ç’avaient été bien plutôt un fanatisme de la morale et la haine contre une frivolité contraire à l’esprit national. Il est vrai que, d’autre part, Kotzebue avait été au service de la Russie, c’est-à-dire au service de la Sainte-Alliance ; et Sand l’avait donc quand même poignardé pour l’amour de la liberté, ce qui, d’autre part, semblait toutefois invraisemblable, étant donné qu’il avait compté des jésuites au nombre de ses meilleurs amis. Bref, quel que pût être l’acte, il était de toutes façons un mauvais moyen de rendre sensible sa pensée, et il ne contribuait guère à mettre au clair des problèmes spirituels.
– Puis-je m’informer si vous serez bientôt au bout de vos équivoques ?
M. Settembrini avait posé cette question sur un ton tranchant. Il était resté assis, il avait tambouriné des doigts sur la table, il avait tourmenté sa moustache. À présent, c’en était assez. Il était à bout de patience. Il se redressait, bien qu’assis : très pâle, il s’était en quelque sorte dressé sur la pointe des pieds, de façon que ses cuisses seules touchaient encore le siège et c’est ainsi que de son œil brillant et noir il affronta l’ennemi qui s’était retourné vers lui avec une surprise feinte.
– Comment vous a-t-il plu de vous exprimer ? fut la question par laquelle Naphta lui répondit…
– Il m’a plu, dit l’Italien, et il avala de la salive, il m’a plu de vous faire savoir que je suis résolu à vous empêcher d’importuner une jeunesse sans défense par vos équivoques !
– Monsieur, je vous invite à prendre garde à vos paroles.
– Monsieur, il n’est pas besoin d’une telle invitation. J’ai l’habitude de surveiller mes paroles, et celles que je prononce répondent exactement aux circonstances lorsque je dis que votre manière de dérouter une jeunesse naturellement hésitante, de la séduire et de la débiliter moralement, est une infamie, et ne saurait être assez sévèrement châtiée en paroles…
En prononçant le mot « infamie », Settembrini frappa du plat de la main sur la table et, ayant repoussé sa chaise, acheva de se dresser, ce qui engagea aussitôt tous les autres à faire de même. Aux autres tables on dressait l’oreille : à l’une d’elles seulement, car les promeneurs suisses étaient déjà repartis et seuls les Hollandais écoutaient, la mine perplexe, la discussion qui éclatait.
Tout le monde s’était donc dressé debout, à notre table : Hans Castorp, les deux adversaires, et en face d’eux, Ferge et Wehsal. Tous les cinq ils étaient pâles, leurs yeux étaient dilatés et leur bouche tressaillait. Les trois compagnons désintéressés n’auraient-ils pas dû tenter d’intervenir dans un sens conciliant, de détendre la situation par une plaisanterie, de tout arranger par une exhortation bienveillante ? Cette tentative, ils ne la faisaient pas. Leur état d’esprit les en empêchait. Ils restaient debout et ils tremblaient et, malgré eux, leurs mains faisaient le poing. Même A. K. Ferge, à qui – il l’avait expliqué, – toutes les choses élevées étaient absolument étrangères et qui, par avance, renonçait complètement à mesurer la portée de la querelle, lui aussi était convaincu qu’il s’agissait de plier ou de rompre et que, entraîné soi-même dans le débat, on ne pourrait que laisser les choses suivre leurs cours. Sa moustache touffue et joviale montait et descendait violemment.
Tout était silencieux, et l’on entendit donc Naphta grincer des dents. Ce fut pour Hans Castorp une expérience analogue à celle des cheveux hérissés de Wiedemann. Il avait cru que ce n’était qu’une manière de parler et que, dans la réalité, cela ne se produisait jamais. Mais voici que Naphta grinçait vraiment des dents dans le silence. C’était un bruit terriblement désagréable, sauvage et aventureux, mais qui n’était pas moins le signe d’une certaine et effrayante maîtrise de soi, car loin de crier, il dit doucement avec une sorte de demi-rire haletant :
– Infamie ? Châtier ? Les ânes vertueux deviennent-ils méchants ? La police pédagogique de la civilisation va-t-elle tirer l’épée ? Voilà qui est un succès, pour commencer, – facilement obtenu, comme j’ajoute avec dédain, car une raillerie, combien légère, a dressé sur ses ergots le sens moral vigilant ! Le reste se fera tout seul, monsieur. Et le « châtiment », lui aussi. J’espère que vos principes de civil ne vous empêchent pas de savoir ce que vous me devez, car, s’il en était ainsi, je me verrais forcé de mettre ces principes à l’épreuve par des moyens qui…
En voyant M. Settembrini se raidir, il reprit :
– Ah ! je vois, ce ne sera pas nécessaire. Je vous gêne, vous me gênez. Bien, nous réglerons donc ce petit différend à l’endroit qui convient. Pour l’instant, une chose encore. Dans votre crainte dévotieuse pour l’État scolastique de la Révolution jacobine, vous considérez ma manière de faire douter la jeunesse, de bousculer les catégories et de dépouiller les idées de leur dignité académique et de leur apparence de vertu, comme un crime contre la pédagogie. Cette crainte n’est que trop justifiée, car c’en est fait de votre humanité, je vous en donne l’assurance, c’en est fait et bien fini. Elle n’est déjà plus aujourd’hui qu’une vieille perruque, un objet classique et démodé, un ennui de l’esprit qui fait bâiller et que la nouvelle révolution, la nôtre, monsieur, s’apprête à jeter au rebut. Lorsque, éducateurs, nous suscitons le doute, un doute plus profond que votre modeste civilisation l’avait jamais rêvé, nous savons bien ce que nous faisons. Ce n’est que du scepticisme extrême, du chaos moral que se dégage l’absolu, la terreur sacrée dont l’époque a besoin. Cela dit pour ma justification et pour votre gouverne, le reste se décidera ailleurs. Vous recevrez de mes nouvelles.
– Et vous trouverez à qui parler, monsieur, cria Settembrini derrière Naphta qui quitta la table et courut au porte-manteau, pour s’emparer de sa pelisse. Puis le franc-maçon se laissa durement retomber sur sa chaise et comprima son cœur sous ses mains.
– Distruttore ! cane arrabbiato ! bisogna ammazzarlo ! s’écria-t-il, à bout de souffle.
Les autres restaient toujours dressés autour de la table. La moustache de Ferge continuait à monter et à descendre. Wehsal avait tordu sa mâchoire inférieure. Hans Castorp appuya son menton à la manière de son grand-père, car sa nuque tremblait. Tous réfléchissaient combien peu l’on s’était attendu en partant à de telles choses. Tous, sans excepter M. Settembrini, songeaient en même temps que c’était une chance que l’on fût arrivé dans deux traîneaux et non pas dans un seul, commun à tous. Cela facilitait, en attendant, le retour. Mais quoi ensuite ?
– Il vous a provoqué en duel, dit Hans Castorp, le cœur oppressé.
– En effet, répondit Settembrini, et il jeta un regard vers celui qui était debout à côté de lui, pour se détourner aussitôt et appuyer sa tête sur sa main.
– Vous acceptez ? voulut savoir Wehsal.
– Vous me le demandez ? répondit Settembrini, et il le considéra, lui aussi, un instant… Messieurs, poursuivit-il, s’étant entièrement ressaisi, je déplore l’issue de notre partie de plaisir, mais tout homme doit s’attendre dans la vie à de tels incidents. Je désapprouve théoriquement le duel, je tiens à me conformer à la loi. Mais dans la pratique, c’est autre chose ; et il y a des situations où… des contrastes qui… Bref, je suis à la disposition de ce monsieur. Il est heureux que j’aie fait un peu d’escrime dans ma jeunesse, quelques heures d’exercice m’assoupliront le poignet. Partons ! Il faudra s’entendre pour le reste. Je suppose que ce monsieur a déjà donné l’ordre d’atteler.
Pendant le retour et plus tard encore, Hans Castorp avait des instants où il se sentait pris de vertige devant l’étrangeté inquiétante de ce qui s’annonçait, surtout lorsqu’il apparut que Naphta ne voulait rien savoir ni de fleuret, ni d’épée, qu’il persistait à demander un duel aux pistolets, et que, en effet, il avait le choix de l’arme, puisque, aux termes du Code d’honneur, il était l’offensé. Le jeune homme, disons-nous, passait par des moments où il réussissait à affranchir dans une certaine mesure son esprit des filets où tous étaient pris et de l’obnubilation par le malaise général, et où il se disait que c’était de la folie et qu’il fallait l’éviter.
– S’il y avait une véritable offense ! s’écria-t-il dans la conversation avec Settembrini, Ferge et Wehsal que Naphta avait pris pour témoin dès son retour et qui menait les négociations entre les parties. Une injure de caractère bourgeois et mondain ! Si l’un avait traîné l’honorable nom de l’autre dans la boue, s’il s’agissait d’une femme ou de n’importe quelle fatalité analogue et palpable de la vie, au sujet desquelles il n’est pas possible de trouver un compromis. Bon, dans de tels cas le duel est la dernière ressource indiquée, et lorsqu’on a satisfait à l’honneur, et que la chose s’est passée avec quelques ménagements et que l’on peut dire : « les adversaires se sont quittés réconciliés », on peut même dire que c’est là une bonne institution, salutaire et efficace dans certains cas compliqués. Mais qu’a-t-il fait ? Je ne veux pas le moins du monde prendre sa défense, je demande seulement en quoi il vous a offensé ? Il a bousculé les catégories. Il a, ainsi qu’il s’exprime, dépouillé certaines notions de leur dignité académique. C’est par là que vous vous êtes trouvé offensé… Admettons, que ce soit avec raison…
– Admettons ? répéta M. Settembrini, et il le dévisagea…
– Avec raison, avec raison ! Il vous a offensé par là. Mais il ne vous a pas insulté. Il y a une différence, permettez-moi ! Il s’agit de choses abstraites, de choses de l’esprit. On peut offenser par des choses de l’esprit, mais on ne saurait guère insulter ainsi qui que ce soit. C’est un axiome que tout jury d’honneur admettrait, je puis vous l’assurer, Dieu me soit témoin. Et c’est pourquoi ce que vous lui avez répondu en parlant d’« infamie » et de « châtiment sévère » n’est pas davantage une insulte, car c’est dans un sens symbolique que vous avez entendu vous exprimer, cela est resté dans le domaine de l’esprit et n’a rien de commun avec le domaine personnel qui peut seul comporter quelque chose comme une insulte. L’esprit ne peut jamais être personnel, c’est le complément et l’interprétation de l’axiome, et c’est pourquoi…
– Vous vous trompez, mon ami, répondit M. Settembrini, les yeux fermés. Vous vous trompez, premièrement en admettant que les choses de l’esprit ne puissent pas prendre un caractère personnel. Vous ne devriez pas penser cela, dit-il, et il sourit bizarrement, finement et douloureusement. Mais vous faites surtout erreur dans votre appréciation de l’esprit en général, que vous croyez apparemment trop faible pour donner naissance à des conflits et à des passions de l’âpreté de ceux que suscite la vie réelle, et qui ne laissent pas d’autre issue que celle d’une passe d’armes. All’incontro ! L’élément abstrait, purifié, idéal est parfois aussi l’absolu, c’est par conséquent l’élément de la plus extrême rigueur et qui comporte des possibilités beaucoup plus immédiates et plus radicales de haine, d’opposition absolue et irréductible, que le commerce social. Pouvez-vous vous étonner de ce qu’il conduise même plus directement et plus impitoyablement que ce dernier à l’opposition entre le Moi et le Toi, à une situation véritablement extrême, à celle du duel, de la lutte physique ? Le duel, mon ami, n’est pas une « institution » comme une autre. C’est la dernière ressource, le retour à l’état de nature primitif, à peine légèrement atténué par certaines règles d’un caractère chevaleresque qui sont très superficielles. L’essentiel de cette situation c’est son élément nettement primitif, le corps à corps, et il appartient à chacun de se tenir prêt pour cette situation, si éloigné qu’il se sente de la nature. On peut y être exposé chaque jour. Quiconque n’est pas capable de défendre l’idée en payant de sa personne, par son bras, par son sang, n’en est pas digne, et il s’agit de rester un homme, tout spiritualiste que l’on soit.
Voici que Hans Castorp avait reçu sa leçon. Que pouvait-on répondre ? Il se tut, en proie à une songerie accablée. Les paroles de M. Settembrini semblaient calmes et logiques, et pourtant elles paraissaient déplacées et peu naturelles dans sa bouche. Ses pensées n’étaient pas ses pensées, comme d’ailleurs ce n’était pas lui qui avait eu l’idée du combat singulier, qu’il avait empruntée au terroriste, au petit Naphta. Elles étaient l’expression du trouble causé par le malaise général et dont la belle intelligence de M. Settembrini était devenue l’esclave et l’instrument. Comment, l’esprit, parce qu’il était rigoureux, devait impitoyablement conduire au dénouement bestial par le combat singulier ? Hans Castorp s’élevait contre une telle conception, ou s’efforçait de le faire, pour découvrir à son effroi que lui non plus ne le pouvait pas. En lui aussi, il agissait, le malaise moral ; il n’était pas homme, lui non plus, à s’en dégager. Un souffle effrayant et décisif lui venait de cette région de son souvenir où Wiedemann et Sonnenschein se roulaient dans une lutte bestiale et désespérée, et il comprenait en frissonnant qu’à la fin de toutes choses il ne restait que le corps, les ongles, les dents. Mais oui, mais oui, il fallait bien se battre, car ainsi on pouvait du moins préserver cette atténuation de l’état de nature par un code chevaleresque… Hans Castorp offrit à Settembrini ses offices de témoin.
Son offre fut déclinée. Non, cela n’allait pas, cela ne pouvait aller, lui répondirent M. Settembrini d’abord, avec un sourire qui était fin et douloureux, puis, après une brève réflexion, Ferge et Wehsal, qui trouvèrent, eux aussi, sans justifier leur manière de voir par des raisons définies, qu’il n’était pas possible que Hans Castorp prît parti dans ce combat. Peut-être pourrait-il y assister comme arbitre, car la présence d’un témoin impartial faisait partie, elle aussi, selon l’usage, des atténuations chevaleresques à la bestialité. Même Naphta se prononça dans ce sens, par la bouche de son mandataire Wehsal, et Hans Castorp se déclara satisfait. Témoin ou arbitre, quoi qu’il fût, il avait la possibilité d’influer sur les modalités du combat, ce qui se montra être une nécessité cruelle.
Car Naphta était hors de lui, et ses propositions dépassaient toute mesure. Il réclama cinq pas de distance et l’échange de trois balles en cas de besoin. Le soir même de la brouille, il fit transmettre cette folie par Wehsal, qui s’était fait entièrement le porte-parole et le représentant de ses intérêts farouches, et persistait avec la plus grande ténacité à exiger de telles conditions, moitié par ordre, moitié par goût personnel. Naturellement, Settembrini ne trouva rien à objecter, mais Ferge comme second, et l’impartial Hans Castorp en furent outrés, et celui-ci se montra même grossier à l’endroit du misérable Wehsal. N’avait-il pas honte, demanda Hans Castorp, de déballer de telles insanités, alors qu’il s’agissait d’un duel purement abstrait, qui ne reposait sur aucune injure réelle ? Des pistolets, c’était déjà assez vilain, mais ces détails meurtriers par-dessus le marché ? C’était vraiment la fin de tout point d’honneur, et il eût été encore plus simple de tirer par-dessus son mouchoir. Ce n’était pas sur lui, Wehsal, que l’on allait tirer à cette distance, c’est sans doute pourquoi il prononçait si aisément des paroles sanguinaires ; et ainsi de suite… Wehsal haussa les épaules, indiquant sans une parole que l’on était dans une situation extrême, et par là il désarma en quelque sorte la partie adverse qui était tentée de l’oublier. Cependant, au cours des allées et venues du lendemain, on réussit avant tout à réduire le nombre des balles à une seule, puis à régler la question de la distance de telle façon que les combattants seraient placés à quinze pas l’un de l’autre et qu’ils auraient le droit d’avancer de cinq pas avant de tirer. Mais cela aussi, on ne l’obtint qu’en échange de l’assurance qu’aucune tentative de réconciliation ne serait plus faite. Par ailleurs, on n’avait pas de pistolets.
M. Albin en avait. En dehors du petit revolver étincelant par lequel il se plaisait à effrayer les dames, il possédait encore une paire de pistolets d’ordonnance d’origine belge, qui reposaient dans un étui commun : des brownings automatiques à poignées en bois brun, qui contenaient les chargeurs, des mécanismes de tir en acier bleuté et des canons luisants sur les embouchures desquels saillaient, petits et fins, les crans de mire. Hans Castorp les avait vus un jour, quelque part, chez le jeune farceur et contre sa propre conviction, en toute candeur, il s’offrit à les lui emprunter. Ainsi fit-il, sans dissimuler le but de cette démarche, mais en invoquant la discrétion sur l’honneur et en faisant appel avec un succès facile à la foi de gentilhomme du jeune farceur. M. Albin lui apprit même à charger et tira avec les deux armes quelques coups à blanc.
Tout cela exigea du temps, et il s’écoula ainsi deux jours et trois nuits avant la rencontre. Le lieu de rendez-vous avait-été proposé par Hans Castorp. C’était l’endroit pittoresque, fleuri de bleu en été, où il se retirait pour « gouverner » ses songeries, qu’il avait suggéré de choisir. C’est ici que, le troisième matin qui suivit la querelle, dès qu’il ferait assez clair, l’affaire trouverait son dénouement. Ce n’est que la veille, assez tard, que Hans Castorp, qui était très agité, s’avisa qu’il était nécessaire d’emmener un médecin sur le terrain.
Il délibéra aussitôt avec Ferge sur ce point, qui se révéla extrêmement difficile à résoudre. Rhadamante avait sans doute été membre d’une corporation d’étudiants, mais il était impossible de solliciter le concours du chef de l’établissement, en vue d’une pareille illégalité, d’autant plus qu’il s’agissait de malades. D’une façon générale, on avait peu de chances de trouver ici un médecin qui serait prêt à assister deux malades gravement atteints dans un duel au pistolet. Quant à Krokovski, il n’était même pas certain que ce cerveau exalté fût très capable de panser une blessure.
Wehsal, qui fut consulté, annonça que Naphta s’était déjà exprimé dans ce sens qu’il ne voulait pas de médecin. Il n’allait pas sur le terrain pour se faire oindre et panser, mais pour se battre, et cela très sérieusement. Ce qui viendrait ensuite lui était indifférent et s’arrangerait tout seul. Cela semblait une déclaration de mauvais augure, mais Hans Castorp s’efforça de l’interpréter comme si Naphta estimait à part soi que l’on n’aurait pas besoin d’un médecin. Settembrini n’avait-il pas, lui aussi, fait dire par Ferge qu’on avait délégué chez lui, que la question ne l’intéressait pas ? Il n’était pas tout à fait déraisonnable d’espérer que les adversaires pouvaient être secrètement d’accord dans leur intention de ne pas verser de sang. On avait dormi deux nuits sur cette querelle et l’on en dormirait encore une troisième. Cela refroidit, cela clarifie, un certain état d’esprit ne laisse pas d’être transformé par le cours des heures. De grand matin, le pistolet à la main, aucun des combattants ne serait plus l’homme qu’il avait été le soir de la querelle. Ils agiraient tout au plus mécaniquement et contraints par le sentiment de l’honneur, non pas d’après leur volonté libre et agissante, par plaisir et conviction, comme ils en auraient agi sur-le-champ ; et il devait être possible de prévenir en quelque manière un tel reniement de leur moi actuel, au profit de ce qu’ils avaient été un jour.
Hans Castorp n’avait pas tort dans ses réflexions, il avait raison, mais d’une manière qu’il n’eût jamais imaginé, même en songe. Il avait parfaitement raison, pour autant que M. Settembrini était en cause. Mais s’il avait soupçonné dans quel sens Léon Naphta aurait modifié ses desseins avant l’instant décisif, ou à cet instant décisif, même les conditions intimes d’où tout ceci résultait ne l’auraient pas empêché de s’opposer à ce qui allait se passer.
À sept heures, le soleil était encore loin de poindre au-dessus de la montagne, mais un jour fumeux paraissait péniblement lorsque Hans Castorp quitta le Berghof après une nuit agitée, pour se rendre sur le terrain. Des servantes qui nettoyaient le hall le regardèrent, étonnées. Le portail était déjà ouvert ; sans doute Ferge et Wehsal, ensemble ou séparément, étaient-ils déjà sortis, l’un pour aller chercher Settembrini, l’autre pour accompagner Naphta sur le terrain. Lui, Hans, allait seul, parce que sa qualité d’arbitre ne lui permettait pas de se joindre aux parties.
Il marchait machinalement et sous le faix des circonstances. C’était bien entendu une nécessité pour lui d’assister à la rencontre. Il était impossible de se tenir à l’écart et d’attendre le résultat au lit : premièrement parce que… (mais ce premier point il ne le développa pas), en second lieu parce qu’on ne pouvait pas laisser les choses suivre leur cours. Dieu merci, il n’était encore rien arrivé de grave et il n’était pas besoin qu’il arrivât rien de grave, c’était même improbable. On avait dû se lever à la lumière artificielle et il fallait se réunir à présent, sans avoir déjeuné, par un froid glacial, en plein air, c’était là ce dont on avait convenu. Mais ensuite, sous son influence à lui, Hans Castorp, les choses prendraient sans aucun doute une tournure heureuse et favorable, d’une manière que l’on ne prévoyait pas encore et que mieux valait ne pas essayer de deviner, puisque l’expérience enseignait que même les événements les plus insignifiants se déroulent autrement que l’on ne se l’était représenté par avance.
Néanmoins, c’était le matin le plus désagréable dont il pût se souvenir. Sans vigueur et fatigué par l’insomnie, Hans Castorp ne pouvait s’empêcher d’un claquement de dents nerveux, et même à une faible profondeur de son être il était fort tenté de se méfier des apaisements qu’il se donnait à lui-même. C’étaient des temps si bizarres… La dame de Minsk que sa colère avait détruite, le potache furibond, Wiedemann et Sonnenschein, l’affaire des gifles polonaises s’agitaient tumultueusement dans son cerveau. Il ne pouvait pas imaginer que sous ses yeux, en sa présence, deux hommes pussent tirer l’un sur l’autre, s’ensanglanter. Mais lorsqu’il songeait à ce qui s’était produit sous ses propres yeux entre Wiedemann et Sonnenschein, il se méfiait de lui-même et de son univers, et il frissonnait dans son pardessus doublé de fourrure, tandis que, malgré tout, une certaine conscience du caractère extraordinaire et du pathétique de la situation, en même temps que les éléments fortifiants de l’air matinal, l’exaltaient et l’animaient.
C’est en proie à des sentiments et à des pensées aussi mélangés qu’il gravit la pente dans le demi-jour qui s’éclaircissait peu à peu, en passant par Dorf et par la plate-forme de la piste de bobsleigh, et que, suivant le sentier étroit, il atteignit la forêt toute couverte de neige, traversa les pontons de bois sous lesquels passait la piste, et marcha sur un chemin que les empreintes de pieds plutôt que la pelle avaient frayé, entre les troncs d’arbres. Comme il marchait vite, il rejoignit bientôt Settembrini et Ferge. Ce dernier portait d’une main la cassette aux pistolets sous sa pèlerine. Hans Castorp n’hésita pas à se joindre à eux, et, à peine était-il à leur côté, qu’il aperçut également Naphta et Wehsal qui n’avaient qu’une faible avance.
– Matinée froide, au moins dix-huit degrés, dit-il dans une bonne intention, mais lui-même s’effraya de la frivolité de ses paroles, et il ajouta : « Messieurs, je suis persuadé… »
Les autres gardèrent le silence. Ferge laissait sa moustache sympathique monter et s’abaisser. Au bout d’un moment, Settembrini s’arrêta, prit la main de Hans Castorp, y posa encore l’autre main et dit :
– Mon ami, je ne tuerai pas. Je ne le ferai pas. Je m’exposerai à sa balle, c’est tout ce que l’honneur peut me commander. Mais je ne tuerai pas, fiez-vous à moi.
Il lâcha la main et continua de marcher, Hans Castorp était profondément ému, mais dit après quelques pas :
– C’est très généreux de votre part, Monsieur Settembrini, mais d’autre part… Si, de son côté…
M. Settembrini se borna à hocher la tête. Et comme Hans Castorp se disait que, si l’un ne tirait pas, l’autre se déciderait difficilement à ne pas faire de même, il estima que tout s’annonçait bien et que ses suppositions commençaient à se confirmer. Il sentit son cœur devenir plus léger.
Ils traversèrent la passerelle qui franchissait la gorge, où descendait en été le torrent qui était maintenant gelé et silencieux, et qui contribuait si vivement au pittoresque de l’endroit. Naphta et Wehsal allaient et venaient dans la neige, devant le banc capitonné d’épais coussins blancs sur lequel Hans Castorp avait dû naguère, entouré de souvenirs si extraordinairement vivants, attendre la fin d’un saignement de nez. Naphta fumait une cigarette, et Hans Castorp se demanda s’il avait envie d’en faire autant, mais il n’en éprouva pas le moindre désir, et en conclut qu’à plus forte raison ce devait être de l’affectation chez l’autre. Avec la satisfaction qu’il éprouvait toujours en ce lieu, il regardait autour de lui, dans l’intimité hardie de sa vallée qui, sous la neige et la glace, n’était pas moins belle qu’au temps de sa floraison bleue. Le tronc et les branches du pin qui se dressait en travers du paysage étaient également chargés de neige.
– Bonjour, Messieurs, prononça-t-il d’une voix claire, avec le désir d’introduire dès l’abord un ton naturel dans la réunion, lequel contribuerait à dissiper les nuages. Mais il n’eut pas de succès, car personne ne lui répondit. Les saluts échangés consistaient en révérences muettes qui étaient raides jusqu’à devenir presque invisibles. Néanmoins, il resta résolu à faire servir sans retard à un résultat favorable le mouvement de son arrivée, la rapidité cordiale de son souffle, la chaleur que lui avait communiquée la marche rapide à travers la matinée d’hiver, et il commença :
– Messieurs, je suis convaincu…
– Vous développerez une autre fois vos convictions, l’interrompit froidement Naphta. Les armes, s’il vous plaît, ajouta-t-il avec la même attitude hautaine. Et Hans Castorp, interdit, dut regarder Ferge tirer l’étui fatal de dessous son manteau, Wehsal s’approcher et prendre un des pistolets pour le transmettre à Naphta. Settembrini reçut l’autre de la main de Ferge. Puis il fallut s’écarter, Ferge à voix basse les en pria et commença de mesurer les distances et de les marquer : la limite extérieure, en traçant du talon de courtes lignes dans la neige, les barrières intérieures par deux cannes, la sienne et celle de Settembrini.
Le débonnaire martyr, à quoi s’employait-il là ? Hans Castorp n’en croyait pas ses yeux. Ferge avait de longues jambes et faisait de grandes enjambées, de sorte que quinze pas firent une bonne distance, encore qu’il y eût là les sacrées barrières qui vraiment n’étaient pas loin l’une de l’autre. Certainement, il était plein de bonnes intentions. Mais pourtant, quel trouble mental subissait-il pour faire des préparatifs aussi sinistres ?
Naphta, qui avait jeté son manteau de fourrure dans la neige, de sorte qu’on en voyait la doublure en loutre, prit pied, le pistolet à la main, sur une des limites extérieures, à peine fut-elle tracée, et tandis que Ferge était encore occupé à tracer d’autres lignes de démarcation. Lorsqu’il eut terminé, Settembrini se mit, à son tour, en position, laissant ouvert son paletot garni de fourrure et râpé. Hans Castorp s’arracha à sa léthargie et s’avança encore une fois rapidement :
– Messieurs, dit-il, anxieux, pas d’excès de hâte ! C’est, malgré tout, mon devoir…
– Taisez-vous, s’écria Naphta, sur un ton tranchant. Je demande le signal.
Mais personne ne donnait de signal. On s’était mal concerté sur ce point. Sans doute fallait-il dire « allez-y ! » mais on n’avait pas réfléchi que c’était l’affaire de l’arbitre de formuler cette effrayante invitation, ou tout au moins il n’en avait pas été question. Hans Castorp demeura muet et personne ne se substitua à lui.
– Nous commençons, déclara Naphta. Avancez, Monsieur, et tirez ! cria-t-il à son adversaire et il commença d’avancer lui-même, le bras tendu, le pistolet dirigé vers Settembrini à hauteur de la poitrine, spectacle incroyable ! Settembrini fit de même. Au troisième pas – l’autre, sans tirer, était déjà arrivé à la barrière – il leva son pistolet très haut et pressa sur la détente. La détonation sèche éveilla un écho multiple. Les montagnes se lançaient et se relançaient le son, la vallée en retentissait et Hans Castorp se dit que l’on allait ameuter les gens.
– Vous avez tiré en l’air, dit Naphta en se maîtrisant et en abaissant son arme.
Settembrini répondit :
– Je tire où il me plaît.
– Vous allez tirer une deuxième fois.
– Je n’y songe pas. C’est votre tour.
M. Settembrini, la tête levée, regardant vers le ciel, s’était placé légèrement de profil et sur le côté, ce qui était touchant à voir. On remarquait nettement qu’il avait entendu qu’il ne fallait pas se présenter à son adversaire sur toute sa largeur, et qu’il s’inspirait de ce conseil.
– Lâche ! cria Naphta en faisant par ce cri cette concession au sentiment humain qu’il faut plus de courage pour tirer que pour laisser tirer sur soi. Il leva son pistolet d’une manière qui n’avait plus rien à voir avec un combat et il se tira une balle dans la tête.
Spectacle lamentable et inoubliable ! Il tituba et s’effondra, tandis que les montagnes jouaient à la pelote avec ce bruit sec, il roula quelques pas en arrière, en lançant les pieds en avant, il décrivit de tout son corps un mouvement tournant à droite, et tomba, la figure dans la neige.
Tous restèrent un instant immobiles. Settembrini, après qu’il eut jeté loin de lui son arme, fut le premier penché sur son adversaire.
– Infelice, s’écria-t-il. Che cosa fai, per l’amor di Dio ?
Hans Castorp l’aida à retourner le corps. Ils virent le trou noir et rouge à côté de la tempe. Ils virent un visage que le mieux était de couvrir du mouchoir de soie dont un bout débordait de la poche du veston de Naphta.
LE COUP DE TONNERRE
Pendant sept ans, Hans Castorp demeura chez ceux d’en-haut. Ce n’est pas un chiffre rond pour adeptes du système décimal, mais un bon chiffre, maniable à sa manière, une étendue de temps mythique et pittoresque, peut-on dire, plus satisfaisant pour l’âme que par exemple une sèche demi-douzaine. Il avait pris ses repas à toutes les sept tables de la salle à manger, à chacune pendant une année environ. En dernier lieu il se trouva assis à la table des Russes ordinaires, avec deux Arméniens, deux Finnois, un Boucharien et un Kurde. Il était assis là, avec une barbiche qu’il s’était laissé pousser, une petite barbiche d’un blond de paille, de forme assez indéterminée, que nous sommes obligé de considérer comme un témoignage d’une certaine indifférence philosophique à l’égard de son apparence extérieure. Même nous devons aller plus loin, et rattacher cette tendance à négliger sa personne à une tendance analogue que le monde extérieur manifestait à son égard. Les autorités avaient cessé de s’ingénier à trouver des diversions pour lui. En dehors de la question matinale touchant son sommeil – question de pure rhétorique et qui était d’ailleurs posée sous une forme collective – le conseiller ne lui adressait plus très souvent la parole, et Adriatica von Mylendonk (elle avait un orgelet très mûr à l’époque dont il est question) ne le faisait que tous les quelques jours. À considérer les choses de plus près, cela n’arrivait même que très rarement, ou jamais. On le laissait en paix, un peu comme un écolier qui jouit de ce privilège particulièrement amusant de n’être plus interrogé, de n’avoir plus rien à faire, parce qu’il est entendu qu’il doublera sa classe, et parce qu’on ne s’occupe plus de lui. Forme orgiaque de liberté, ajoutons-nous, en nous demandant à part nous-même s’il peut y avoir une liberté d’une autre forme et d’une autre espèce. Quoi qu’il en soit, il y avait ici quelqu’un sur qui les autorités n’avaient désormais plus besoin de veiller, parce qu’il était certain qu’aucun défi, aucune résolution subversive ne mûriraient plus dans sa poitrine, un homme sûr et définitivement acclimaté, qui depuis longtemps n’aurait plus su où aller, qui n’était même plus capable de concevoir l’idée d’un retour en pays plat… Une certaine insouciance à l’égard de sa personne n’apparaissait-elle pas déjà dans le fait qu’on l’avait placé à la table des Russes ordinaires ? Et ce disant nous n’entendons d’ailleurs pas faire la moindre critique à l’égard de la table ainsi dénommée ! Il n’y avait entre les sept tables aucune différence tangible. C’était une démocratie de tables d’honneur, pour nous exprimer hardiment. Les mêmes repas formidables étaient servis à toutes ; Rhadamante lui-même y joignait parfois ses mains énormes sur son assiette, lorsque le tour de cette table venait ; et les représentants des diverses races qui y mangeaient étaient d’honorables membres de l’humanité, encore qu’ils n’entendissent pas le latin et qu’ils ne mangeassent pas avec des manières exagérément gracieuses.
Le temps qui n’était pas de l’espèce du temps mesuré par les horloges des gares dont les aiguilles avancent par secousses, de cinq minutes en cinq minutes, mais plutôt de celle du temps des très petites montres dont le mouvement d’aiguilles demeure invisible, ou de l’herbe qu’aucun œil ne voit pousser, quoiqu’elle pousse incontestablement, le temps, – une ligne composée de points sans étendue (et sans doute Naphta, qui avait trouvé une mort si tragique, aurait-il demandé comment des points sans étendue peuvent former une ligne), – le temps donc avait continué, à sa manière rampante, invisible, secrète et pourtant active, d’entraîner des changements. Le jeune Teddy, pour ne citer qu’un exemple, un beau jour – mais naturellement il n’est pas possible de dire quel jour, – un beau jour ne fut ainsi plus tout jeune. Les dames ne pouvaient plus le prendre sur leurs genoux, lorsqu’il se levait parfois, échangeait le pyjama contre un costume de sport, et descendait. Insensiblement, la situation s’était retournée, c’était maintenant lui-même qui les prenait sur ses genoux en de telles circonstances, ce qui faisait à l’un et aux autres autant de plaisir, peut-être même davantage. Il était devenu un adolescent, Hans Castorp ne s’en était pas rendu compte, mais il le voyait à présent. D’ailleurs ni le temps ni la croissance ne profitèrent à l’adolescent Teddy, il n’était pas fait pour cela. Ses jours étaient comptés ; dans sa vingt et unième année Teddy mourut de la maladie à laquelle il s’était montré accueillant et l’on désinfecta sa chambre. Nous rapportons cela d’une voix calme puisqu’il n’y avait pas grande différence entre son nouvel état et son état antérieur.
Mais il y eut des cas de mort plus importants, des cas de mort en pays plat qui regardaient notre héros de plus près, ou qui tout au moins l’auraient autrefois regardé de plus près. Nous voulons parler du récent décès du vieux consul Tienappel, grand-oncle et tuteur de Hans, dont le souvenir s’était déjà fait vague. Il avait évité avec soin des conditions de pression atmosphérique contraires à son tempérament, et il avait laissé à l’oncle James le soin de s’y couvrir de ridicule ; mais il n’avait pu à la longue échapper à l’apoplexie, et la nouvelle de son départ, d’une brièveté télégraphique, mais conçue en termes discrets – plus encore par égards pour le défunt que pour le destinataire du message, – était un jour parvenue jusqu’à l’excellente chaise-longue de Hans Castorp, après quoi il avait acheté du papier à lettres bordé de noir et avait écrit aux oncles-cousins, que lui, l’orphelin de père et mère, qui devait se considérer comme orphelin pour la troisième fois, était d’autant plus désolé qu’il lui était défendu et interdit d’interrompre son séjour ici, pour accompagner le grand-oncle à sa dernière demeure.
Ce serait enjoliver les choses que de parler de deuil, et pourtant les yeux de Hans Castorp eurent ces jours-là une expression plus pensive que d’habitude. Ce décès qui ne l’aurait en aucun cas ému profondément et dont d’aventureuses petites années avaient réduit à presque rien la portée sentimentale, signifiait la rupture d’un nouveau lien avec la sphère inférieure ; il achevait de rendre complète ce que Hans Castorp appelait à juste titre la liberté. En effet, en ce temps dont nous parlons, tout rapport avait cessé entre lui et le pays plat. Il n’écrivait plus de lettres et n’en recevait plus. Il ne faisait plus venir de Maria Mancini. Il avait trouvé ici une marque qu’il appréciait et à laquelle il se montrait aussi fidèle qu’à son ancienne amie : un produit qui eût aidé même les explorateurs du Pôle à franchir dans la glace les étapes les plus pénibles, et en possession duquel il pouvait rester étendu comme au bord de la mer, et tenir indéfiniment le coup. C’était un cigare fabriqué avec un soin particulier, nommé « Serment du Rutli », un peu plus compact que le Maria, d’un gris de souris, entouré d’une bague bleutée, très docile et doux de caractère, et qui se consumait si régulièrement, en une cendre compacte d’un blanc de neige où apparaissaient les veines de la robe qu’il eût pu tenir lieu de sablier à celui qui le fumait et qu’il rendait en effet ce service à Hans Castorp, qui ne portait plus de montre. La sienne, un jour, était tombée de sa table de nuit, et il avait négligé de la faire remettre en marche pour les mêmes raisons pour lesquelles il avait depuis longtemps renoncé à l’usage de calendriers, que ce fût pour en arracher chaque jour le feuillet échu, ou pour se renseigner sur la succession des jours et des fêtes : dans l’intérêt de sa « liberté », par conséquent, pour favoriser sa promenade sur la grève, cette immobilité « pour toujours et à jamais », ce charme hermétique auquel il s’était montré accessible et qui avait été l’aventure fondamentale de son âme, au courant de laquelle s’étaient déroulées toutes les aventures alchimiques de ce simple sujet.
C’est ainsi qu’il restait étendu, et c’est ainsi qu’une fois de plus, au plein de l’été, de la saison de son arrivée, pour la septième fois – il ne le savait pas – l’année accomplissait sa révolution, lorsque… lorsque retentit…
Mais la réserve et la pudeur nous interdisent de renchérir en narrateur zélé sur ce qui retentit et arriva alors. Surtout pas de vantardises, ici, pas d’histoires de chasseur ! Modérons notre voix pour annoncer que retentit alors le coup de tonnerre que nous connaissons tous, cette explosion étourdissante d’un mélange funeste d’hébétude et d’irritation accumulées, un coup de tonnerre historique qui, disons-le à voix basse et avec respect, ébranla les fondements de la terre, – et qui est pour nous le coup de tonnerre qui fait sauter la montagne magique et qui met brutalement à la porte notre dormeur éveillé. Ahuri, il est assis sur l’herbe, et se frotte les yeux comme un homme qui, en dépit de maintes admonestations, a négligé de lire les journaux.
Son ami et mentor méditerranéen s’était efforcé de lui en tenir lieu dans une faible mesure et avait eu à cœur de renseigner son enfant terrible sur les événements d’en-bas. Il n’avait toutefois rencontré que peu d’attention chez un élève qui, tout en se plaisant à rêver et à gouverner les ombres spirituelles des choses, n’avait jamais accordé d’attention aux choses elles-mêmes, dans sa propension orgueilleuse à tenir les ombres pour les choses et à voir en ces dernières des ombres, ce dont nous ne saurions le blâmer sévèrement puisque les rapports entre les deux ne sont pas définitivement éclaircis.
Il n’en était plus comme le jour lointain où M. Settembrini, après avoir soudain allumé la lumière, s’était assis au bord du lit de Hans Castorp, étendu horizontalement, et s’était efforcé de l’influencer favorablement par rapport aux problèmes de la vie et de la mort. C’était lui, à présent, qui était assis, les mains entre les genoux, au chevet de l’humaniste, dans le petit cabinet, ou qui, près de sa chaise longue, dans le studio intime et mansardé, avec les chaises du carbonaro et la carafe d’eau, tenait compagnie à l’Italien, et écoutait poliment ses considérations sur la situation mondiale, car M. Lodovico n’était plus que rarement sur pied. La fin pénible de Naphta, l’acte terroriste de son adversaire tranchant et désespéré, avait porté un rude coup à la nature sensible de l’Italien ; il ne pouvait pas s’en remettre, il souffrait depuis lors d’une grande faiblesse. Il avait interrompu sa collaboration à la « Pathologie sociologique », ce lexique de toutes les œuvres des belles-lettres qui avaient pour objet la souffrance humaine, n’avançait plus, la Ligue attendait en vain ce volume de son Encyclopédie. M. Settembrini se vit contraint de borner à une propagande orale sa collaboration au progrès du genre humain, et les visites amicales de Hans Castorp lui en offraient précisément l’occasion qui, sans elles, ne se serait pas présentée.
Il parlait d’une voix faible, mais longuement, agréablement et du fond du cœur, du perfectionnement social de l’humanité. Son verbe était porté par des ailes de colombes, mais dès qu’il parlait de la réunion des peuples affranchis en vue du bonheur commun, sans qu’il le voulût ou le sût probablement lui-même, il s’y mêlait quelque chose comme un bruissement de vol d’aigles, et cela tenait incontestablement à la politique, à ce legs de son grand-père qui, joint à l’héritage humaniste du père, avait pris en lui, Lodovico, la forme des belles-lettres, de même que l’humanité et la politique s’unissaient dans le toast à la civilisation, dans cette pensée qui alliait la douceur de la colombe à la témérité de l’aigle, pensée qui attendait son jour, l’aube des peuples où la réaction serait battue et où la sainte alliance de la démocratie civique serait fondée… Bref, il y avait là des contradictions. M. Settembrini était humanitaire d’une manière plus ou moins consciente, mais en même temps et par là même il était militariste. Il s’était conduit avec humanité à l’occasion d’un duel avec l’affreux Naphta, mais, dans les grandes choses, là où le sentiment humain s’alliait avec enthousiasme à la politique, pour proclamer la victoire et le règne de civilisation, et où l’on consacrait la hallebarde du citoyen sur l’autel de l’humanité, il devenait douteux qu’il restât, du moins théoriquement, disposé à épargner le sang. Même, l’état d’esprit général était tel que, dans les belles dispositions d’esprit de M. Settembrini, la hardiesse d’aigle l’emportait de plus en plus sur la douceur de la colombe.
Souvent ses rapports avec les grandes constellations du monde étaient contradictoires, troublés et embarrassés par maints scrupules. Récemment, voici deux ans ou un an et demi, la collaboration diplomatique de son pays avec l’Autriche, contre l’Albanie, avait troublé le cours de ses idées – cette collaboration qui le satisfaisait parce qu’elle était dirigée contre un pays à demi asiatique, contre le knout et les bastilles tsaristes, et qui en même temps le tourmentait comme une mésalliance avec l’ennemi héréditaire, avec le principe de la réaction et de l’asservissement des peuples. L’automne dernier le grand emprunt russe émis en France en vue de la construction d’un réseau de voies ferrées en Pologne avait éveillé en lui des sentiments également mêlés. Car M. Settembrini appartenait au parti francophile de son pays, ce qui ne peut pas surprendre si l’on considère que son grand-père avait accordé aux journées de la révolution de juillet la même importance qu’à la création du monde ; mais cette entente de la République éclairée avec la Byzance scythe suscitait chez lui malgré tout une gêne morale, une oppression qui se changeait malgré tout en une espérance joyeuse lorsqu’il pensait à la portée stratégique de ce réseau de voies ferrées. C’est alors qu’eut lieu l’assassinat de l’archiduc, qui fut pour tous, hormis pour certains dormeurs allemands, l’annonce d’une tempête, un signe pour ceux qui savaient et au nombre desquels nous sommes fondés à compter M. Settembrini. Sans doute, Hans Castorp le voyait-il frémir en tant qu’individu, devant un tel acte de terrorisme, mais il voyait aussi sa poitrine se soulever à la pensée que c’était là un acte qui délivrait un peuple et qui était dirigé contre l’objet de sa haine, encore qu’il fallût y voir le résultat d’intrigues moscovites, ce qui causait à Settembrini un certain malaise, mais ne l’empêcha pas de qualifier d’offense faite à l’humanité et de crime effroyable l’ultimatum que la monarchie adressa trois semaines plus tard à la Serbie, en raison des conséquences à venir qu’il distinguait, lui, l’initié, et qu’il saluait, le souffle haletant.
Bref, les impressions de M. Settembrini étaient très composites, comme la fatalité qu’il voyait se précipiter et sur laquelle il essaya à mots couverts d’éclairer son élève, quoiqu’une sorte de politesse nationale et de pitié l’empêchassent d’exprimer toute sa pensée. Les jours des premières mobilisations, de la première déclaration de guerre, il avait pris l’habitude de tendre les deux mains à son visiteur et de serrer les mains de l’autre d’une manière qui allait au cœur du nigaud, sinon à son cerveau. « Mon ami, disait l’Italien. La poudre, l’imprimerie, il est incontestable que vous avez inventé cela, autrefois. Mais, si vous vous figurez que nous marcherons contre la Révolution… Caro… »
Durant les jours de l’attente la plus accablante, pendant lesquels les nerfs de l’Europe restèrent tendus par une véritable torture, Hans Castorp ne vit pas M. Settembrini. Les atroces nouvelles montaient à présent directement des profondeurs du pays plat jusque dans sa loge de balcon, elles ébranlaient la maison, emplissaient la salle à manger de leur odeur de soufre qui oppressait la poitrine, et même les chambres des grands malades et des moribonds. C’étaient ces instants où le dormeur allongé dans l’herbe, ne sachant pas ce qui lui arrivait, se redressait lentement avant de se mettre sur son séant et de se frotter les yeux… Nous allons développer cette image pour rendre compte de son état d’âme. Il ramena ses jambes, se leva et regarda autour de lui. Il se vit exorcisé, sauvé, délivré, – non par ses propres forces, ainsi qu’il dut le constater à sa confusion, mais expulsé par des forces élémentaires et extérieures pour qui sa délivrance était tout accessoire. Mais encore que son petit destin se perdît dans le destin général, une certaine bonté qui le visait personnellement, une certaine justice divine par conséquent, ne s’y exprimaient-elles pas malgré tout ? La vie prenait-elle encore une fois soin de son enfant gâté, non pas d’une manière légère, mais de cette manière grave et sévère, au sens d’une épreuve qui, dans ce cas particulier, ne signifiait peut-être justement pas la vie, mais trois salves d’honneur pour lui, le pécheur. Et il tomba donc à genoux, le visage et les mains levés au ciel, qui était sombre et chargé de vapeurs de soufre, mais qui du moins n’était plus la voûte caverneuse de la montagne des péchés.
C’est dans cette position que M. Settembrini le trouva. Nous parlons, cela s’entend, par parabole, car en réalité, nous le savons, la réserve de notre héros excluait des attitudes aussi théâtrales. Dans la froide réalité, le mentor le trouva occupé à faire ses malles, car, depuis l’instant de son réveil, Hans Castorp s’était vu entraîné dans le tourbillon des départs précipités dont le coup de tonnerre avait donné le signal dans la vallée. Le pays d’en-haut ressemblait à une fourmilière prise de panique. Le petit peuple de ces hommes glissait à une profondeur de cinq mille pieds, sens dessus dessous, vers le pays plat éprouvé, surchargeant les marchepieds du petit train pris d’assaut, en laissant derrière lui, s’il le fallait, les bagages qui encombraient les quais de la gare, – de la gare grouillante et qui sentait le brûlé comme si la foudre y avait éclaté d’en-bas, – et Hans Castorp se précipitait à leur suite. Lodovico l’étreignit dans ce tumulte – à la lettre, il le serra dans ses bras et l’embrassa comme un Méridional (ou comme un Russe), sur les deux joues, – ce qui ne laissa pas, malgré toute son émotion, de gêner notre voyageur. Mais il faillit perdre contenance lorsque M. Settembrini, au dernier moment, l’appela par son prénom, l’appela « Giovanni », en négligeant la forme usitée dans l’Occident civilisé, c’est-à-dire en le tutoyant.
– E cosi in giù, dit-il, in giù finalmente. Addio, Giovanni mio ! J’aurais préféré te voir partir en d’autres circonstances ; mais soit ! Les dieux en ont disposé ainsi, et pas autrement. C’est au travail que je pensais te voir retourner, mais voici que tu vas combattre parmi les tiens. Mon Dieu, c’était ton lot, et non pas celui de notre lieutenant. C’est la vie… Bats-toi bravement, là où ton sang t’y oblige. Personne ne peut faire davantage, à présent. Mais pardonne-moi si j’emploie le reste de mes forces à entraîner mon pays dans la lutte, du côté où l’esprit et des intérêts sacrés lui commandent de se porter. Addio !
Hans Castorp glissa sa tête entre dix autres têtes qui comblaient le cadre de la portière. Par-dessus elles il fit un signe d’adieu. M. Settembrini, lui aussi, agita sa main droite, tandis que, de la pointe de l’annulaire de la gauche, il effleurait délicatement le coin de l’œil.
*
Où sommes-nous ? Qu’est-ce que cela ? Où nous a transportés le songe ? Crépuscule, pluie et boue, rougeur trouble du ciel incendié. Un sourd tonnerre résonne sans arrêt, emplit l’air humide, déchiré par des sifflements aigus, par des hurlements rageurs et infernaux, dont le cheminement s’achève en un fracas d’éclatements, d’éclaboussements, de craquements et de flamboiements, de gémissements et de cris, de cymbales entrechoquées et qui menacent de se briser, en un crépitement qui pousse à la hâte, plus vite, de plus en plus vite… Il y a là-bas une forêt hors de laquelle se déversent des essaims gris qui courent, tombent et bondissent. Une ligne de coteaux s’étire devant l’incendie lointain, dont la rougeur se condense parfois en flammes mouvantes. Autour de nous, des champs onduleux, bouleversés, détrempés. Une route boueuse est couverte de branchages, semblable à une forêt ; un chemin de campagne, sillonné et défoncé, s’élance en courbe vers la colline, des troncs d’arbres se dressent dans la pluie froide, nus et ébranchés… Voici un poteau indicateur ; inutile de l’interroger ! La pénombre nous en voilerait l’inscription, quand même l’écriteau ne serait pas déchiqueté par un éclat qui l’a transpercé. Est ou Ouest ? C’est le pays plat, c’est la guerre. Et nous sommes des ombres timides au bord du chemin, confus de jouir de la sécurité des ombres, peu disposés à nous répandre en vantardises et en histoires de chasseur, amenés ici par l’esprit de notre récit, pour regarder dans le visage simple de l’un de ces camarades en gris, qui courent, qui se précipitent, que talonne le crépitement saccadé, qui s’essaiment hors de la forêt, du compagnon de tant de petites années, du brave pécheur dont nous avons si souvent entendu la voix, pour regarder une dernière fois ce visage avant de le perdre de vue.
On les a amenés, les camarades, pour donner sa vigueur dernière à la bataille qui a duré toute la journée, et dont l’objet est la reprise de ces positions sur la colline, et des deux villages qui brûlent là-bas, enlevés avant-hier par l’ennemi. C’est un régiment de volontaires, du sang jeune, des étudiants pour la plupart qui ne sont pas depuis longtemps sur le front. Ils ont été alertés la nuit, ils ont voyagé jusqu’au matin et ont marché sous la pluie jusqu’à la fin de l’après-midi, par de méchants chemins… Ce n’étaient pas des chemins du tout : les routes étaient encombrées, on a passé par champs et par marécages, perdant sept heures, sous les capotes trempées, en tenue d’attaque, et ce n’était pas une partie de plaisir ; car si l’on ne voulait pas perdre ses bottes, il fallait presque à chaque pas se pencher et, le doigt dans l’oreille de la chaussure, tirer son pied de la terre qui clapotait. Il leur a donc fallu une heure pour traverser le petit pré. Les voici, leur sang jeune a tenu bon, leurs corps excités et déjà épuisés, mais tendus par leurs plus profondes réserves vitales, ne s’inquiètent ni du sommeil ni de la nourriture dont on les a privés. Leurs visages mouillés, éclaboussés de boue, encadrés par la jugulaire, brûlent sous les casques tendus de gris et qui ont glissé en arrière. Ils sont enflammés par l’effort et la vue des pertes qu’ils ont éprouvées en traversant la forêt marécageuse. Car l’ennemi, averti de leur approche, a dirigé un feu de barrage de shrapnells et d’obus à gros calibre sur leur route, un feu qui a déjà éclaté dans leurs groupes en pleine forêt et qui fouette en piaillant, en éclaboussant et flamboyant, le vaste champ raviné.
Il faut qu’ils passent, les trois mille garçons enfiévrés, il faut qu’ils décident, comme renforts par leurs baïonnettes, de l’issue de cet assaut contre les tranchées et les villages en flammes, derrière la chaîne de collines, et qu’ils poussent l’attaque jusqu’à un point fixé par l’ordre que leur chef porte dans sa poche. Ils sont trois mille, pour qu’ils soient encore deux mille lorsqu’ils déboucheront devant les collines et les villages ; tel est le sens de leur nombre. Ils forment un corps composé de telle façon que même après de graves pertes, ils puissent encore agir et vaincre, saluer la victoire par un « hourra » échappé de mille gosiers, sans souci de ceux qui se seront isolés en tombant. Plus d’un s’est perdu, est tombé durant cette marche forcée pour laquelle il était trop jeune et trop frêle. Il a pâli et chancelé ; serrant les dents, il a exigé de soi une résistance virile, mais il a cependant fini par rester en arrière. Il s’est encore traîné un instant le long de la colonne de marche, mais une compagnie après l’autre l’a dépassé et il a disparu, il est resté étendu là où il n’était pas bon de rester. Et puis était venue la forêt qui les avait tronçonnés. Mais ceux qui s’essaiment en avant sont toujours nombreux ; une troupe de trois mille peut supporter une prise de sang sans être réduite au néant… Déjà ils inondent le terrain détrempé, fouetté par les éclats, la route, le chemin, les champs spongieux ; nous, les ombres-spectateurs, au bord du chemin, nous sommes au milieu d’eux. À la lisière de la forêt, on met baïonnette au canon, avec des gestes exercés, le clairon clame avec insistance, le tambour roule et frappe de son tonnerre plus sourd, et ils s’élancent en avant, tant bien que mal, avec des cris rauques, les pieds comme alourdis par un cauchemar, parce que les mottes de terre collent comme du plomb à leurs bottes grossières.
Ils se jettent à plat ventre sous les projectiles sifflants, pour bondir et reprendre leur course en avant, avec les cris brefs de leur jeune courage, parce qu’ils n’ont pas été atteints. Ils sont touchés, ils tombent, battant des bras, touchés au front, au cœur, aux entrailles. Ils sont couchés, le visage dans la boue, et ne bougent plus. Ils sont couchés, le dos soulevé par le sac, l’occiput enfoncé dans la terre, et griffent l’air de leurs mains. Mais la forêt en envoie d’autres qui se jettent à terre, et bondissent et avancent en trébuchant, hurlants ou muets, entre ceux qui sont demeurés en arrière.
Ah, toute cette belle jeunesse avec ses sacs et ses baïonnettes, ses manteaux boueux et ses bottes ! On pourrait avec une imagination humaniste et enivrée de beauté rêver d’autres images. On pourrait se représenter cette jeunesse : menant et baignant des chevaux dans une baie, se promenant sur la grève avec la bien-aimée, les lèvres à l’oreille de la douce fiancée, ou s’apprenant avec une amicale gentillesse à tirer l’arc. Au lieu de cela, elle est couchée, le nez dans cette boue de feu. C’est une chose admirable et dont on reste confondu qu’elle s’y prête joyeusement, encore qu’en proie à des terreurs inouïes et a une inexprimable nostalgie de ses mères, mais ce ne devrait pas être une raison de la mettre dans cette situation.
Voici notre ami, voici Hans Castorp ! De très loin déjà nous l’avons reconnu à la barbiche qu’il s’est laissé pousser à la table des Russes ordinaires. Il brûle, transpercé par la pluie, comme les autres. Il court, les pieds alourdis par les mottes, le fusil au poing. Voyez, il marche sur la main d’un camarade tombé, sa botte cloutée enfonce cette main dans le sol marécageux criblé d’éclats de fer. C’est pourtant lui. Comment ? Il chante ? Comme on fredonne devant soi, sans le savoir, dans une excitation hébétée et sans pensée, ainsi il tire parti de son haleine entrecoupée et chantonne pour lui-même :
Ich schnitt in seine Rinde
So manches liebe Wort…
Il tombe. Non, il s’est jeté à plat ventre, parce qu’un chien infernal accourt, un grand obus brisant, un atroce pain de sucre des ténèbres. Il est étendu, le visage dans la boue fraîche, les jambes ouvertes, les pieds écartés, les talons rabattus vers la terre. Le produit d’une science devenue barbare, chargé de ce qu’il y a de pire, pénètre à trente pas de lui obliquement dans le sol comme le diable en personne, y explose avec un effroyable excès de force, et soulève à la hauteur d’une maison un jet de terre, de feu, de fer, de plomb et d’humanité morcelée. Car deux hommes étaient étendus là, c’étaient deux amis, ils s’étaient réunis dans leur détresse : à présent ils sont confondus et anéantis.
Oh honte de notre sécurité d’ombres ! Partons ! Nous n’allons pas raconter cela ! Notre ami a-t-il été touché ? Un instant il a cru l’être. Une grosse motte de terre a frappé son tibia, sans doute a-t-il eu mal, mais c’est ridicule. Il se redresse, il titube, avance en boitant, les pieds alourdis par la terre, chantant inconsciemment :
Und sei – ne Zweige rauschten
Als rie – fen sie mir zu…
Et c’est ainsi que, dans la mêlée, dans la pluie, dans le crépuscule, nous le perdons de vue.
Adieu, Hans Castorp, brave enfant gâté de la vie ! Ton histoire est finie. Nous avons achevé de la conter. Elle n’a été ni brève ni longue, c’est une histoire hermétique. Nous l’avons narrée pour elle-même, non pour l’amour de toi, car tu étais simple. Mais en somme, c’était ton histoire, à toi. Puisque tu l’as vécue, tu devais sans doute avoir l’étoffe nécessaire, et nous ne renions pas la sympathie de pédagogue qu’au cours de cette histoire nous avons conçue pour toi et qui pourrait nous porter à toucher délicatement de la pointe du doigt le coin de l’œil, à la pensée que nous ne te verrons ni ne t’entendrons plus désormais.
Adieu ! Tu vas vivre maintenant, ou tomber. Tes chances sont faibles. Cette vilaine danse où tu as été entraîné durera encore quelques petites années criminelles et nous ne voudrions pas parier trop haut que tu en réchapperas. À l’avouer franchement, nous laissons assez insoucieusement cette question sans réponse. Des aventures de la chair et de l’esprit qui ont élevé ta simplicité t’ont permis de surmonter dans l’esprit ce à quoi tu ne survivras sans doute pas dans la chair. Des instants sont venus où dans les rêves que tu gouvernais un songe d’amour a surgi pour toi, de la mort et de la luxure du corps. De cette fête de la mort, elle aussi, de cette mauvaise fièvre qui incendie à l’entour le ciel de ce soir pluvieux, l’amour s’élèvera-t-il un jour ?
FINIS OPERIS.
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse
du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Février 2011
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : YvetteT, Jean-Marc, MichelB, PatriceC, Coolmicro et Fred.
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.