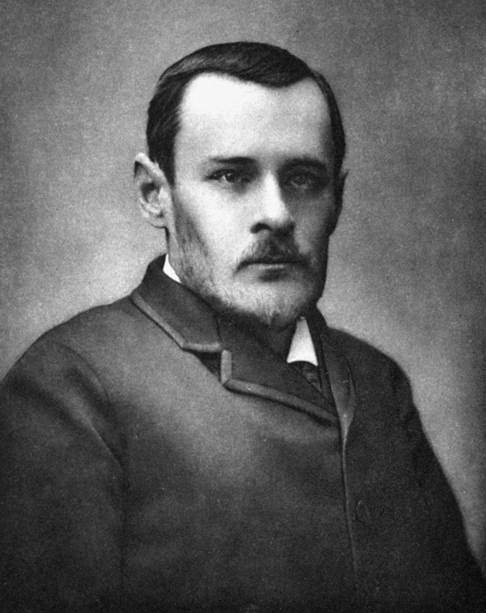
Georges Ohnet
LA TÉNÉBREUSE
LES BATAILLES DE LA VIE
(1901)
PREMIÈRE PARTIE
I
Dans son cabinet de la rue Saint-Dominique, le ministre de la guerre se promenait de long en large, le sourcil froncé, mâchonnant sa moustache, plus rouge encore que d’habitude, et tournant entre ses doigts son monocle, avec une fébrilité qui promettait un accueil peu cordial au premier qui se hasarderait à paraître devant lui. Ses officiers, sans doute, savaient à quoi s’en tenir sur les causes de sa mauvaise humeur, car un silence profond régnait dans les bureaux voisins, et seuls les oiseaux du jardin troublaient de leurs disputes voletantes et effrontées la solitude du grand chef. Il parut, au bout d’un instant de marche agitée, perdre tout à fait patience, et gagnant la cheminée, il toucha du doigt le bouton de la sonnette. Aussitôt un huissier, la mine inquiète, apparut :
— Le colonel Vallenot est-il rentré ? dit le ministre, avec le ton dont il aurait commandé : « Sabre en main, chargez ! »
Le serviteur se courba comme s’il voulait disparaître sous le tapis, il balbutia d’une voix éteinte :
— Monsieur le ministre, je ne crois pas… je vais m’informer…
Le général devint pourpre. Un premier juron éclata comme un obus, puis un second, le troisième fut inutile. La porte s’était refermée. Le serviteur avait fui.
— Qu’est-ce que ce sacré Vallenot peut bien faire depuis le temps qu’il est parti ? murmura le ministre en reprenant sa promenade furieuse… Ah ! je suis bien servi ! Sacre…
Il n’eut pas le loisir d’achever, l’huissier radieux venait de rouvrir la porte et d’annoncer :
— Monsieur le colonel Vallenot.
Un homme de cinquante ans, grand, svelte, l’œil bleu, la moustache blonde, entra vivement, et après une inclination à son chef, du ton d’un familier :
— Il paraît que vous vous impatientez, mon général ?… J’ai trouvé un officier me guettant dès la porte du ministère… C’est que cela n’a pas été une petite affaire… Et je vous jure que je n’ai pas flâné…
— Au fait ! interrompit avec impatience le ministre. Vous arrivez de Vanves ?
— Oui, mon général.
— Seul ?
— Non. J’avais emmené avec moi un de nos agents. Le plus habile de ceux que nous employons… Vous ne m’en aviez pas donné l’ordre, mais j’ai pris sur moi de me servir de cet homme…
— Vous avez bien fait. Mais êtes-vous sûr de sa fidélité ?
— Autant qu’on peut l’être… C’est un ancien sous-officier… D’ailleurs, je ne lui ai pas révélé le but véritable de mon enquête… Il ne sait rien de ce qui nous préoccupe. Il doit croire uniquement qu’il a été mon auxiliaire dans la recherche des causes d’une catastrophe encore mal expliquée… Nous sommes donc couverts de son côté…
— Eh bien ! Quel a été le résultat de vos recherches ?
— Mon général, si vous le voulez bien, nous allons diviser l’enquête en deux parties. Dans l’une nous rangerons les faits matériels, dans l’autre les circonstances morales… L’affaire est plus compliquée que vous ne l’aviez pensé au premier abord, et quand je me serai expliqué, il est probable que vos perplexités, au lieu de diminuer, augmenteront…
— Sacrebleu !…
Il s’assit à son bureau, appuya son menton dans sa main et faisant signe au colonel de se placer dans un fauteuil près de lui :
— Allez, je vous écoute.
— La maison habitée par le général de Trémont est située au haut du village de Vanves, à peu de distance du fort. C’est même la garde de nuit qui a donné l’alarme et la garnison qui a organisé les premiers secours, quand l’incendie a commencé. De l’habitation il ne reste pour ainsi dire rien. L’explosion des matières explosibles, contenues dans le laboratoire, a désorganisé les fondations mêmes et l’effet a été formidable. Des pierres lancées en l’air ont été retrouvées à plus de deux kilomètres et les jardins environnants, qui appartiennent à des maraîchers, ont été criblés de débris… S’il y avait eu des maisons, les dégâts auraient été très grands…
Le ministre interrompit :
— Les effets de la mélinite, en résumé ?
— Oh ! mon général, bien autre chose ! Centuplez les effets de la poudre qui nous sert à charger nos obus et vous aurez, peut-être, l’équivalent de la puissance destructive révélée par l’explosion du laboratoire du général de Trémont…
Le ministre hocha la tête :
— Oui. C’était bien ce qu’il m’avait dit la dernière fois que je l’ai vu au comité d’artillerie. Il était sur la trace d’une découverte qui devait donner à nos canons une supériorité tellement écrasante que nous devenions pour bien longtemps les maîtres de la victoire. La lutte contre nous aurait été marquée par de tels massacres, accomplis avec une absolue précision, que notre suprématie militaire redevenait certaine. Est-ce pour cela que la catastrophe s’est produite ?
— Ainsi mon général, vous admettez donc que la malveillance peut ne pas être étrangère à cet événement ?
— Je n’admets rien, Vallenot, et je soupçonne tout… Quand vous aurez fini de me renseigner, nous causerons… Poursuivez…
— Eh bien ! mon général, à notre arrivée nous avons trouvé, suivant les ordres expédiés tout de suite du ministère, un cordon de troupes gardant les abords de la propriété… Il y avait déjà là trois ou quatre cents personnes du pays, rassemblées et bavardant, sans compter une vingtaine de journalistes, venus en voiture ou à bicyclette, et qui, à eux seuls, faisaient plus de bruit que le reste des assistants. Ils maugréaient de ce qu’on ne les laissait pas pénétrer sur le lieu de l’explosion, dans les décombres encore fumants de la villa… Mais il y avait, pour commander le service d’ordre, un petit lieutenant raidillon qui avait envoyé promener les réclamants avec une indépendance toute militaire. Il est probable que nous aurons une mauvaise presse, mais en attendant on nous aura fichu la paix. C’est déjà quelque chose… À l’intérieur il n’y avait que le secrétaire de la préfecture de police, le procureur de la République et le chef de la sûreté… Nous arrivions, mon agent et moi, au bon moment. Les perquisitions commençaient…
— Où ça ? Dans la maison ?
— Sur l’emplacement de ce qui avait été la maison, et qui offrait aux regards un trou béant, au fond duquel apparaissait une cave, dont la voûte s’était effondrée et où une pièce de vin défoncée faisait une mare rouge. De l’escalier plus une trace. Les marches avaient disparu. Les pierres étaient rompues en morceaux gros comme des œufs de pigeon… Jamais je n’aurais pu me figurer un émiettement pareil… Et, caprice incroyable du cataclysme, un pan de muraille qui avait dû être celui d’une buanderie, restait debout, avec une fenêtre étroite dans les barreaux de fer de laquelle une loque était retenue. Tous nous avions regardé en même temps cet unique vestige échappé au désastre, et le chef de la sûreté, plus prompt, s’était approché avec précaution de ce pan de mur qui menaçait ruine. Du bout de sa canne levée, il toucha le haillon informe qui pendait, le fit tomber, le ramassa avec une exclamation de surprise et, revenant vers nous, vivement le plaça sous nos yeux. C’était un bras encore revêtu de sa manche de chemise et de sa manche d’habit, coupé à la hauteur du coude, tout sanglant et à la main noircie, comme calcinée.
— Oh ! voilà qui est extraordinaire, s’exclama le ministre.
— C’était surtout sinistre, mon général, poursuivit le colonel Vallenot. J’ai vu bien des morts sur le champ de bataille, bien des blessés dans les ambulances… À Gravelotte j’ai vu la tête de mon chef d’escadrons, emportée par un éclat d’obus, rouler à mes pieds et cligner des yeux dans la poussière… J’ai trouvé au Tonkin des soldats coupés en quatre par les Pavillons-Noirs et qui grimaçaient encore de leur torture… Jamais je n’ai été impressionné comme par ce bras d’homme posé sur une pierre et qui restait seul vestige du drame que nous essayions de reconstituer et de comprendre. Le procureur de la République reprit le premier son sang-froid et dit : « Messieurs, voici une importante pièce de conviction… Ce bras a été évidemment lancé à travers ces barreaux par l’explosion. Mais à qui appartenait-il ? Est-ce un des bras du malheureux général de Trémont ? – Le général n’habitait pas seul la villa, fit observer le chef de la sûreté. Il avait une cuisinière et un domestique. Écartons tout de suite l’hypothèse de la servante. C’est un bras d’homme. Donc il appartenait au général ou à son valet de chambre. – À moins que… » Il y eut un silence. C’était notre agent qui, pour la première fois, venait de parler. Le procureur de la République se tourna vers lui et dit : — « Eh bien ! achevez. — À moins qu’il n’appartienne à l’auteur de la catastrophe lui-même. »
— Ah ! dit le ministre. Ce garçon, lui aussi, supposait donc que l’événement pouvait avoir une cause criminelle…
— Oui, mon général, et en même temps qu’il parlait, de très près, avec une attention extrême il examinait la main noircie et charbonnée. Délicatement il écarta les doigts, avec un petit effort il retira de l’annulaire une bague que nul de nous n’avait remarquée et triomphalement l’agitant en l’air : « Si cet anneau appartient au général nous serons fixés. Sinon, nous posséderons sans doute un indice précieux qui permettra de débrouiller cette affaire. »
— Un anneau, sacrebleu ! Je ne me rappelle pas avoir jamais vu d’anneau à Trémont ! Non, j’en jurerais, il n’avait porté de sa vie un bijou, et une bague moins que quoi que ce fût… Un homme qui maniait des acides, depuis le matin jusqu’au soir, c’eût été une absurdité !… Aucun métal n’aurait résisté à l’action oxydante des matières qu’il employait pour ses travaux… Mais quelle espèce d’anneau était-ce, Vallenot ?
— Une alliance, mon général. Frotté avec la peau d’un gant, le cercle d’or brilla débarrassé de la suie qui le ternissait. Notre agent la mania un instant puis avec son ongle, il opéra une pression qui sépara l’anneau en deux : — « Voyez, messieurs, s’écria-t-il. Dans l’intérieur il y a des lettres gravées. Quoi qu’il arrive, nous tenons une preuve. »
— C’est vraiment un habile homme, Vallenot, que ce garçon, dit le ministre, jusqu’à présent je ne vois que lui qui ait montré de l’initiative… Il faudra lui donner une gratification.
— Mon général, attendez, nous ne sommes pas au bout. Le procureur de la République avait pris l’alliance et l’examinait. Il la mit tranquillement dans sa poche, en disant : « Nous approfondirons cela plus tard. » Et nous restâmes tous le nez en l’air, un peu décontenancés par l’étrange intervention du magistrat qui décevait si complètement notre curiosité. En y réfléchissant, peut-être avait-il raison de réserver pour l’instruction les éclaircissements qui devaient résulter de cette découverte et de ne pas rendre publiques des preuves qui pouvaient avoir une importance décisive. Mais s’il voulait conserver le secret de son enquête, il jouait de malheur, car, à la même minute, notre agent poursuivant ses investigations avait enlevé la double manche qui recouvrait le bras mutilé et avait mis la chair à jour. Cette fois, il n’était plus possible de nous cacher ce qu’il venait de trouver. Entre le poignet et la saignée, sur l’avant-bras, un tatouage bleu apparaissait, représentant un cœur enflammé autour duquel se lisaient ces noms : Hans und Mina et au-dessous ce mot : Immer, qui veut dire en allemand : Toujours. « — Messieurs, dit le procureur de la République, en ajustant son lorgnon, je vous demande la discrétion la plus complète. Un mot redit sur ce que nous venons de découvrir peut avoir les plus graves conséquences. Peut-être sommes-nous en présence d’un attentat anarchiste. Peut-être aurons-nous à rechercher une ingérence étrangère… L’affaire prend des proportions tout à fait imprévues… Il est probable qu’un crime a été commis. »
— Diable ! diable ! fit le ministre. Dites donc, Vallenot, voilà une fichue affaire ! Peut-être faudrait-il prévenir tout de suite le président du conseil…
— Mon général, le secrétaire du préfet de police a dû le faire. En voyant la façon dont tournaient les choses et sans attendre la fin de l’enquête, il est monté en voiture et s’est fait conduire place Beauvau…
— Le premier point, c’est d’empêcher la presse de dire des bêtises. Si nous avons maille à partir avec des agents étrangers, car les travaux de Trémont étaient soupçonnés en Europe, il est de la plus haute importance que l’éveil ne soit pas donné, afin que nous puissions essayer de prendre les auteurs de cette coupable tentative.
— C’est ce que nous avons pensé, mon général, et, tout de suite, des dispositions ont été prises en conséquence. Il fallait absolument lancer l’opinion publique sur une fausse piste. Donc la version d’un accident fortuit s’imposait. Il a été séance tenante arrêté que toutes les communications faites aux journaux le seraient dans ce sens. Le général de Trémont serait une sorte d’original, s’occupant de recherches chimiques pour le commerce, et ayant, par son imprudence, amené la catastrophe qui lui coûtait la vie.
— Pauvre Trémont ! Un si sérieux et si noble savant ! Enfin… La raison d’État doit tout primer. Mais c’est dur de contribuer à calomnier un vieux et brave camarade !…
— Mon général, interrompit le colonel Vallenot avec un sourire, ne vous hâtez pas de vous contrister. La suite des événements vous réserve des surprises qui atténueront, je n’en doute pas, vos regrets.
— Qu’est-ce que vous prétendez ? fit le rude soldat en fronçant le sourcil. Vous n’allez pas me dire du mal d’un ami d’enfance, d’un compagnon de guerre ?…
— Dieu m’en garde, mon général. Je me bornerai à vous rapporter les faits sur lesquels vous m’avez commandé de vous informer. Si j’ai le malheur de vous déplaire, ce n’est pas à moi que vous vous en prendrez ; vous êtes trop juste pour cela…
— Qu’est-ce que signifient ces réticences ? Allez jusqu’au bout, colonel, et parlez librement…
— Ainsi ai-je l’intention de faire, mon général. Donc le secrétaire du préfet de police venait de se charger de fournir la version arrêtée par nous aux nombreux reporters qui piétinaient, tenus en respect par le cordon de troupes, et d’aller avertir le ministre de l’intérieur pour le cas où on aurait besoin de la sûreté générale, lorsqu’un grand brouhaha se produisit dans la direction du village. Des cris, des appels se faisaient entendre. Déjà le lieutenant s’apprêtait à aller voir ce qui se passait quand un homme, forçant la ligne des factionnaires, accourut vers nous, nu-tête, les traits bouleversés et poussant des exclamations désolées : « Mon maître ! Oh ! mon Dieu ! Mon bon général ! Mais qu’est-il arrivé à la maison ? Pas pierre sur pierre ! » Il s’arrêta, se laissa tomber sur les décombres et se mit à pleurer amèrement. Nous le regardions en silence, émus par sa douleur, troublés par son langage et pressentant un éclaircissement heureux et prompt de la situation obscure où nous étions. — « Qui êtes-vous, mon ami ? », questionna le procureur de la République. L’homme releva la tête, passa la main sur ses yeux pour essuyer ses larmes et nous montra une figure intelligente et résolue : « — Le brosseur du général, monsieur, son serviteur depuis vingt ans… Ah ! si j’avais été là, ce malheur aurait peut-être été évité ! Au moins je serais mort avec lui ! »
— C’était Baudoin ! s’écria le ministre. Le brave garçon a échappé ! Ah ! c’est bien heureux… Par lui, on va savoir quelque chose !
— Oui, mon général, mais ce quelque chose, reprit le colonel, ne sera pas l’éclaircissement que nous espérions. Au contraire.
— Comment ! au contraire ?…
— Vous allez en juger. La veille, vers six heures, le général de Trémont était dans son jardin, en train de se promener après une journée de travail passée dans son laboratoire, lorsqu’un petit bleu lui fut apporté par le télégraphiste de Vanves. Il le lut, marcha pendant quelques instants la tête penchée sur sa poitrine, comme s’il méditait profondément, puis il appela Baudoin : « — Tu vas partir pour Paris, lui dit-il, j’ai une commande pressée à faire chez mon marchand de produits chimiques, place de la Sorbonne. Tu lui remettras cette lettre, puis tu iras chez M. Baradier, à qui tu donneras de mes nouvelles… Tu dîneras, et si tu veux passer ta soirée au théâtre, je te le permets, voilà cent sous pour te payer une place… Alors tu reviendras demain matin avec les produits. »
Baudoin, qui sait ce que parler veut dire, comprit que son général l’éloignait de la maison pour douze heures. Il en fut mécontent, parce que, dit-il, ce n’était pas la première fois que cela se produisait, et toujours dans les mêmes circonstances : un petit bleu arrivant, et aussitôt la résolution de faire place nette.
Cependant le général ne donnait pas campos à la cuisinière dont il se méfiait moins sans doute que de son brosseur, cette femme ayant l’habitude de se coucher de très bonne heure, et par cela même la surveillance qu’elle pouvait exercer étant presque nulle. Le général avait donc besoin périodiquement d’être seul. Et il prenait soin d’écarter le serviteur fidèle sur lequel il était en droit de compter d’une façon absolue. Pourquoi ? Voilà ce qui taquinait Baudoin, et avait excité son mécontentement. Il avait si peu l’habitude de dissimuler sa pensée à son maître que celui-ci remarqua sa maussaderie subite, et lui dit : « — Qu’est-ce qu’il y a ? Ça t’ennuie que je t’envoie à Paris ? Tu es bien à plaindre d’aller t’amuser ? — Je ne tiens pas à m’amuser, avait dit Baudoin, je tiens à faire mon service. — Eh bien ! tu le fais ton service, puisque tu obéis à la consigne que je te donne d’aller me chercher des produits dangereux à manier, dont j’ai besoin, et de faire une commission de ma part à mon ami Baradier… Et puis, suffit ! J’ai besoin de toi demain matin et pas ce soir… — On obéira, mon général. — C’est bien heureux ! »
Mais Baudoin n’était pas content et une sourde inquiétude le travaillait. Il alla à la cuisine et dit à la cuisinière : « — La dernière fois que le général m’a envoyé à Paris, qu’est-ce qui s’est passé dans la soirée ? Le général a-t-il dîné comme d’habitude ? S’est-il enfermé dans son cabinet, ou a-t-il été dans le jardin ? S’est-il couché de bonne heure ? Aucun fait extraordinaire ne vous a-t-il frappée ? »
Cette femme lui déclara qu’elle ne savait rien, n’avait rien remarqué et fut très étonnée de ses questions. Il vit qu’elle était à cent lieues de soupçonner quoi que ce fût et n’insista pas davantage. Mais quoique profondément respectueux des volontés de son maître, l’intérêt qu’il lui portait le détermina à manquer, dans une certaine mesure, à l’obéissance, et il résolut de feindre un départ, puis de se poster au dehors, de façon à voir ce qui se passerait une fois que le général serait sûr qu’il n’avait plus d’observateur gênant à redouter. Il faisait un temps d’une douceur délicieuse. Pas un souffle d’air, et les jardins pleins de roses répandaient des senteurs exquises à la tombée du jour.
Baudoin, après s’être habillé, alla prendre congé de son maître, reçut de lui la liste des achats à faire chez le marchand de produits, un mot pour son ami Baradier, et partit. Il alla jusqu’au chemin de fer, dîna près de la gare, dans un petit bouchon, et à la nuit déjà close retourna du côté de la maison de son maître. Il n’osa pas rentrer dans le jardin, craignant d’être aperçu par le général. Il se glissa dans un enclos maraîcher, dont le propriétaire était son ami, et se cacha dans une petite cahute servant à serrer les outils.
De là, il pouvait surveiller les abords de la villa et le long d’une haie touffue, approcher jusqu’au mur de la propriété du général. Il s’assit, alluma sa pipe et attendit. Il était près de huit heures, quand sur la route le roulement d’une voiture se fit entendre. À travers la haie, Baudoin, embusqué, regarda de tous ses yeux. À la clarté des lanternes il vit passer un coupé de maître attelé de deux chevaux. Un instinct l’avertit que cette voiture amenait celui ou ceux que le général attendait. Il suivit au pas de course jusqu’au mur de la villa, et arriva juste au moment où le coupé s’arrêtait, devant la porte. – Mais il n’était pas seul à guetter, car à peine les chevaux, soufflant encore de la longue côte, avaient-ils stoppé, que la haute stature du général se montra dans la nuit. En même temps une main impatiente ouvrait la portière et une voix masculine disait avec un fort accent étranger : « Ah ! général, vous avez pris la peine de venir au-devant de nous ? » M. de Trémont répliqua seulement : « La baronne est-elle là ? — Oui, sans doute, répondit une voix de femme, en pouvez-vous douter ?… » L’homme mit pied à terre le premier. Mais le général ne lui laissa pas le soin d’aider sa compagne à descendre ; il s’élança avec la vivacité d’un amoureux qui reçoit sa belle, et enlevant presque la visiteuse dans ses bras, il s’écria avec une ardeur extraordinaire : « Venez, madame, vous n’avez rien à craindre, personne ne peut vous voir… » L’homme dit de sa voix gutturale, avec un gros rire : « — Ne vous occupez pas de moi, je vous suis… » Et tous les trois disparurent dans le jardin. Baudoin, saisi, n’eut que le temps d’appliquer sur le mur une échelle qui se trouvait là. Quand il fut en mesure de regarder dans le jardin de son maître, les allées étaient vides, mais la grande fenêtre du laboratoire flambait dans la nuit. Le brave garçon se dit : « Que faire ? Entrer dans la maison ? Espionner mon général ? Ne pas obéir à ses ordres ? Et pourquoi ? N’a-t-il pas le droit de recevoir qui lui plaît ? Que vais-je m’imaginer ? Est-il probable que les gens qu’il accueille soient suspects ? Et comment alors les accueillerait-il ? Leur voiture les attend à la porte, preuve qu’ils ne vont pas rester longtemps et rentrer à Paris tout à l’heure. Je suis là à me casser la tête pour rien sans doute. Et je manque gravement à mon maître. Je n’ai qu’une chose à faire, c’est de lui obéir. » Il descendit de son échelle, suivit la haie, sortit de l’enclos et gagna le chemin de fer. Il exécuta de point en point les prescriptions de son maître, à cela près que le marchand de produits chimiques étant fermé quand il arriva il dut y retourner le lendemain matin, avant de repartir, et ne revint à Vanves que pour trouver les abords de la propriété du général occupés par la troupe, la villa en ruines et son maître disparu au milieu de la catastrophe.
Le colonel Vallenot se tut. Un silence, que troublait seul le pépiement des oiseaux dans les grands arbres, régna dans le cabinet du ministre. Le vieux soldat, accoudé à son bureau, le menton dans sa main, réfléchissait. Au bout d’un instant, il poussa un soupir :
— Voilà qui est tout à fait surprenant. Et c’est là, à n’en pas douter, qu’est la clef de l’affaire. Ces deux personnages inconnus, dont l’un à l’accent étranger, qui viennent mystérieusement la nuit, chez Trémont, et dont la visite est suivie d’un cataclysme effroyable, qu’est-ce que cela signifie ? À quoi cela répond-il ? Sommes-nous en présence d’un accident ou d’un crime ? Et s’il y a crime, pourquoi ?
Il se leva et marcha vers la fenêtre d’un air soucieux, puis il revint machinalement à son bureau, se rassit, et regardant de nouveau le colonel :
— Et puis, Vallenot, après le récit de ce brave garçon, que s’est-il passé ? Qu’a-t-on fait ?
— Mon général, on avait fait venir une escouade de soldats du fort et, sous la surveillance de la police, les décombres étaient fouillés avec soin. Mais on ne trouvait rien. La destruction avait été vraiment absolue. À l’exception du pan de mur encore debout, on ne sait comment, il ne restait pas un morceau de quoi que ce fût entier. Pourtant, au bout de deux heures d’exploration dans des débris, d’où se dégageait une odeur très accentuée de fulminate de mercure, la corvée mit à jour un coffret de fer aux charnières disloquées et au fond curieusement percé de milliers de trous, comme si, avec une tarière, on l’avait vrillé méthodiquement…
— Ça c’est un effet de l’éclatement, interrompit le ministre. Vous savez que nous avons dans nos schrapnels des cas de rupture semblable… Et voici un fait à noter… Il est possible que l’explosion initiale se soit produite dans ce coffret. On l’a gardé ?
— Il a été remis au procureur de la République.
— Il faudra voir si nous n’aurons pas à le réclamer, afin de procéder à une analyse des substances qui ont amené la déflagration… Mais achevez vos explications… Qu’est devenue la voiture qui stationnait à la porte ?
— La voiture a dû repartir avant l’accident. Pas trace d’elle sur la route, aux abords de la villa. Et les employés de l’octroi, interrogés, déclarent que, vers onze heures, un coupé à deux chevaux est rentré dans Paris. Le gabelou, qui a rempli les formalités d’usage, se souvient que c’est une femme qui, à sa question : « Avez-vous quelque chose à déclarer ? » a répondu : « Rien ». Quant à l’explosion, il résulte des rapports de la garde du fort qu’elle a eu lieu vers trois heures du matin.
— L’homme à l’accent étranger serait donc resté après le départ de la voiture ?
— C’est infiniment probable.
— Vous n’en êtes donc pas sûr ?
— Je n’ai pas attendu la fin de l’enquête. Je suis parti pour vous apprendre ce que je savais, laissant derrière moi notre agent, avec la consigne de revenir directement au ministère quand les dernières constatations seraient faites.
— Mais peut-être est-il là ? Sonnez donc.
Le colonel Vallenot toucha le bouton électrique. L’huissier parut.
— Laforêt est-il revenu ?
— Il arrive à l’instant, mon colonel.
— Amenez-le ici.
Un pas ferme, une porte close avec précaution, une toux sonore, et au port d’armes, la tête militairement levée, l’agent se présenta devant ses chefs.
Le ministre examina un instant la physionomie martiale et franche de l’homme. Puis d’un ton bref :
— Le colonel Vallenot m’a rapporté tout ce qui s’est passé jusqu’à son départ de Vanves. Complétez son récit par ce que vous avez pu apprendre ensuite. Asseyez-vous, Vallenot.
— Monsieur le ministre, dit l’agent, j’irai tout de suite au plus important : le corps du général de Trémont a été retrouvé…
— Dans les ruines ? demanda le colonel Vallenot.
— Non, mon colonel, dans le jardin… On ne s’était occupé que de la maison et de ses débris. C’est en explorant les massifs, que tout près de la petite grille d’entrée, le corps du général a été découvert…
— Quoi ! L’explosion l’aurait projeté jusque-là ?
L’agent répondit :
— Le corps du général n’a point été projeté par l’explosion. Il est resté à la place où il a été frappé d’un coup de couteau à la clavicule gauche… Le général était mort quand l’explosion a eu lieu, et certainement celui qui l’a causée est l’assassin.
— L’homme à l’accent étranger ?…
— Le compagnon de la visiteuse que le général appelait : baronne ?
L’agent ne sourcilla pas à ces questions anxieuses. Il parut réfléchir, pendant une seconde, puis il dit :
— Oui, celui qui a laissé son bras dans les décombres de la villa, et qui, en forçant le coffret, n’a échappé à la mort que par miracle. Le nommé Hans, enfin.
— Mais comment avancez-vous qu’il a échappé à la mort ? demanda le ministre.
— Parce que j’ai retrouvé sa trace hors du jardin, sur la route qu’il a suivie en l’arrosant de son sang… Il faut que cet homme soit doué d’une énergie indomptable pour avoir eu la force de se sauver, mutilé comme il l’était, de gagner les champs et là, sans doute, de trouver quelque voiture de maraîcher ou de champignonniste qui l’aura recueilli et ramené à Paris… Mais cela, c’est une enquête accessoire à faire et une piste à trouver…
— Alors, reprit le ministre, pour vous, c’est l’homme, qui est venu avec la femme, qui a tué le général ?
— Oui, monsieur le ministre, et très probablement lorsque le général les reconduisait à la voiture… C’est à deux pas de la porte que le coup a été fait. Le sable est piétiné comme s’il y avait eu une lutte, et le corps du général a été emporté derrière le massif. La trace des jambes qui traînaient est très visible. La femme a peut-être aidé… En tout cas, le meurtre accompli, elle est partie. L’homme, lui, est resté. Il a dépouillé le général de ses clefs, qui ne le quittaient jamais, et qu’on n’a pas retrouvées. Il lui a pris sa montre et son portefeuille, pour faire croire à un assassinat ayant le vol pour mobile, puis il est entré dans la villa et a travaillé dans le laboratoire… C’était au laboratoire qu’il avait affaire…
— Comment le savez-vous ?
— Par un propos du valet de chambre Baudoin. Il paraît qu’un jour, pendant qu’il rangeait dans le cabinet du général, celui-ci était entré, descendant du laboratoire. Il avait fait un tour dans la pièce, en se frottant les mains, puis il avait dit entre haut et bas : « Cette fois, c’est la fortune ! Nous verrons ce que Hans dira… » Or, le général, depuis huit jours, était acharné à une expérience, qui avait manqué déjà, et dont il attendait de grands résultats… À différentes reprises, auparavant, il avait éloigné son brosseur et certainement pour recevoir la nuit les visiteurs mystérieux.
— Bon, admettons ce que vous avancez sur le compte de l’homme, dit le ministre pris par l’intérêt des explications de son agent. Mais que faut-il, selon vous, penser du rôle joué par la femme ?
— Ça, monsieur le ministre, c’est beaucoup plus clair, et les indices, les preuves mêmes, abondent. Il est permis de croire que la galanterie a fait les frais de l’aventure, et que le général de Trémont, dont le goût pour les femmes était bien connu, a été victime de ses faiblesses de cœur. Je ne sais rien des secrets du général, j’ignore quelles recherches il faisait dans son laboratoire. Les journaux, cependant, à différentes reprises, ont parlé de ses travaux. Il était membre de l’Académie des sciences, et sa réputation de savant était bien établie. Supposons, pour un instant, que M. de Trémont ait fait une découverte intéressant l’avenir des armées européennes et qu’une puissance ait voulu se renseigner sur la valeur de son invention, se la procurer peut-être… Ne savons-nous pas que les femmes ont été, trop souvent, les meilleurs agents politiques employés dans notre pays ? Le général est malgré son âge, resté galant… On lui détache une femme jeune, jolie, intelligente. Il la rencontre par hasard, s’en éprend. Mais la dame est surveillée ; elle est tenue à de grandes précautions – Elle ne peut recevoir son adorateur chez elle… Il faut qu’elle aille chez lui… Un ami complaisant, un parent, un frère peut-être, sous le couvert de la science, s’entremet et favorise les entrevues en accompagnant la belle, afin de dérouter un jaloux… Pendant que le vieil amoureux marivaude, le compagnon bénévole observe, prend ses mesures, questionne habilement, obtient la confiance de celui à qui il rend service. L’amour endort les craintes. Un doux sourire et des yeux caressants poussent aux imprudences. Et une belle nuit, le général de Trémont, qui sans doute a parachevé sa découverte, est visité par le couple inconnu. La femme tente d’obtenir le secret ; elle n’y parvient pas. Alors, l’homme, à la dernière extrémité, se décide à frapper. Le général tombe sous le poignard. La complice s’enfuit. L’assassin rentre avec les clefs, fouille le laboratoire, essaie d’ouvrir le coffret où sont les précieux produits. Mais la poudre redoutable, maladroitement maniée, venge celui qui l’a créée et, dans une explosion dévorante, anéantit à la fois la formule et celui qui essayait de la dérober. Voilà, monsieur le ministre, comment il est possible de reconstituer les événements qui vous occupent. Mais je ne me fais pas illusion, ceci n’est qu’une version. Il peut y en avoir d’autres et de plus sûres, sinon de plus vraisemblables. Ce qui n’est pas douteux, c’est que le général de Trémont a été assassiné, que le meurtrier était une des deux personnes reçues cette nuit à la villa et que l’explosion consécutive au crime a été causée par l’imprudence de celui que nous pouvons nommer Hans et qui a été grièvement blessé.
Le ministre et le colonel Vallenot se regardèrent un instant, en silence, puis le ministre dit à l’agent :
— Je vous remercie. Ne vous occupez plus, jusqu’à nouvel ordre, de cette affaire qui est dans les mains de la justice civile. Si nous avons un supplément d’information à prendre, je vous ferai appeler. Allez. C’est bien ! Et pas un mot à qui que ce soit.
L’agent Laforêt s’inclina, salua militairement, et, avec la même tranquille précision, sortit du cabinet ministériel. Derrière lui, les deux chefs demeurèrent absorbés, repassant dans leur esprit les péripéties de ce drame, qui matériellement devenait clair, mais restait moralement si obscur. Les précautions prises par les deux complices, l’homme et la femme, paraissaient si bien réglées, qu’il était douteux qu’on pût apprendre la vérité sur leur compte. Un espoir restait : le blessé qui, avec son bras coupé, pouvait être retrouvé à demi-mort d’épuisement sur la route. En interrogeant les habitants de la commune, les marchands des halles, il était admissible que l’homme fût découvert. Déjà, sans doute, la police était en mouvement et avait lancé ses meilleurs limiers.
— Sacré Trémont ! dit le ministre. Savez-vous, Vallenot, qu’il était mon aîné. Il a pris sa retraite comme général de brigade avant la limite d’âge pour se livrer plus aisément à ses recherches scientifiques, et cela parce qu’il avait de grands besoins d’argent. Les femmes, mon cher, on n’imagine pas quel fléau c’est pour un officier. Toutes les carrières ratées, toutes les boulettes commises, toutes les bordées tirées, depuis le lieutenant jusqu’au grand chef, c’est pour les femmes !
— Les femmes, oui, c’est bien cela, dit le colonel Vallenot. Et nous sommes arrivés juste au point où je voulais en venir, lorsque je vous disais, mon général, au commencement de mon rapport, qu’après examen des faits matériels, nous nous occuperions des considérations morales que comporte cette affaire… L’examen des faits est terminé. Il y a eu mort d’homme, probablement tentative de vol, et enfin destruction complète d’une maison habitée… Mais dans quelles conditions tous ces actes criminels ont-ils été accomplis ?
— Eh ! parbleu ! C’est là surtout ce qu’il faut rechercher ! Je comprends bien votre pensée… Vous voyez dans cette affaire autre chose qu’un attentat criminel. Vous soupçonnez une machination d’un ordre spécial, très délicat, très vétilleux, très dangereux même…
— Oui, mon général, parce qu’en ce cas nous n’avons pas les mains absolument libres pour en rechercher les causes, gênés que nous sommes par la diplomatie, par la politique et souvent même par des complicités si inattendues que nous sommes obligés de louvoyer d’abord, de reculer ensuite et finalement de renoncer à sévir… Voulez-vous, mon général, que je vous énumère les affaires dans lesquelles nous n’avons pu aboutir depuis quelques années ?
— Tant d’espionnage que de trahison ?
— Oui, mon général.
— C’est inutile. Je suis assez renseigné sur la situation pour me douter de ce que vous possédez dans les archives… Combien y a-t-il de temps que vous êtes au ministère, Vallenot ?
— Mon général, j’y ai passé dix ans, dans différents postes, entrecoupés de périodes d’activité dans les régiments… Je connais bien les différents services. Nous n’avons jamais cessé d’être exploités par l’étranger avec une habileté, une audace et une persévérance contre lesquelles se sont brisés tous nos efforts… Et toujours, les fuites les plus importantes ont été provoquées par des femmes. Aussi lorsque le domestique du général de Trémont a parlé de cette visiteuse nocturne ai-je été tout de suite en éveil…
— Expliquez-vous.
— Mon général, cette femme mystérieuse qui passe, laissant derrière elle des ruines et du sang, ce n’est pas, j’en jurerais, la première fois que nous avons à nous occuper d’elle. Sa manière de procéder est toujours la même : elle jette son dévolu sur un homme qu’elle sait en mesure de lui livrer un secret important, et elle le séduit, l’affole, jusqu’à ce qu’il ait trahi. Après, elle le rejette comme un débris embarrassant. Redoutable créature, si j’en juge par les résultats qu’elle a déjà obtenus, et puissante corruptrice. Nul cœur n’est à l’abri de ses habiles tentations. Elle s’entend à graduer les doses de son poison d’amour, et les plus nobles esprits, les plus rudes consciences, les plus solides courages fléchissent et capitulent sur un signe d’elle. Vous rappelez-vous le malheureux commandant Cominges, qui s’est brûlé la cervelle un soir, sans que, dans le public, on ait pu savoir pourquoi ? La femme avait passé, Cominges était devenu son serviteur. Et une partie de notre mobilisation avait été connue. Cominges a juré, avant de se tuer, que les documents avaient été volés chez lui pendant qu’il était chez cette femme. Il avait eu le grave tort de les emporter du bureau pour y travailler, le tort plus grave encore de dire qu’il les possédait… Mais le pauvre garçon, il croyait à sa maîtresse… C’était un homme d’honneur, un brave soldat. Un coup de pistolet régla l’affaire…
— Comment s’appelait la femme ?
— Mme Ferranti… Elle prenait, pour voir Cominges, de minutieuses précautions, soi-disant à cause de sa famille… Un de nos agents cependant la connaissait. Il mourut dans les six mois d’un accident… Il était, un soir, sur l’impériale d’un wagon, revenant d’Auteuil… On le trouva assommé sous un tunnel… Il avait penché la tête, sans doute…
— Fichtre !
— L’année suivante, le petit capitaine Fontenailles – un charmant garçon que nous aimions tous – était entraîné par une femme, que ses camarades appelaient « la Ténébreuse », parce qu’on ne la voyait jamais, à donner des explications sur le chiffre… Comprenant la gravité de sa conduite, il allait tout avouer à son chef, qui parvenait à réparer l’imprudence commise en changeant la grille. Le capitaine Fontenailles partait pour le Tonkin, où il se faisait tuer bravement à l’attaque de Bac-Ninh… Sa faute était payée…
— Et la femme toujours la même ?
— C’était l’opinion de tous ces messieurs. La Ferranti de Cominges était la Ténébreuse de Fontenailles… Et la Mme Gibson de l’affaire des aérostats, sans parler de ce que nous n’avons pas connu et de ce qui nous a été incomplètement révélé… Toujours la même Ténébreuse, avec son même procédé : la corruption. Et derrière elle les ruines, les larmes, le sang.
— Depuis combien de temps fait-elle donc ce petit commerce ?
— Mon général, il y a certainement dix ans. Et sous toutes ses incarnations, elle est restée insaisissable. On ne la reconnaît qu’à sa marque professionnelle.
— C’est une fameuse coquine ! Il faudrait tâcher de la pincer !
— Rien de moins aisé. Son coup fait, elle plonge et disparaît. C’est l’anguille qui se faufile dans la vase, où elle reste tapie jusqu’à ce que l’eau soit redevenue calme. Elle s’arrange pour couper toute communication derrière elle. C’est sa manière. Vous allez voir : dans cette affaire nouvelle, nous allons nous débattre dans le vide. On cherchera pendant quelque temps. On ne trouvera aucun indice. Les complices se seront terrés comme l’auteur principal. Peu à peu les recherches se ralentiront, et on s’occupera d’autre chose. C’est ainsi que cela se termine habituellement, à moins…
— À moins ?… Ah ! vous avez encore une espérance !
— À moins que, cette fois, le complice blessé ne nous permette de trouver une trace… Que nous ayons un bout de fil conducteur, et je vous jure bien, mon général, qu’il faudra que nous aboutissions à un résultat… Ne fût-ce que pour venger nos pauvres camarades !
— Et pour prévenir le retour de pareils accidents ? Car enfin, Vallenot, vous m’avouerez qu’il est un peu fort que l’étranger connaisse nos affaires les plus secrètes comme si on les traitait sur la place publique.
— Nous connaissons tout aussi bien celles de l’étranger, mon général, fit avec un air moins refrogné le colonel Vallenot. En résumé, nous sommes régulièrement à deux de jeu. Et il en a toujours été ainsi. En même temps que la Russie se procurait, en 1812, les états de troupes de l’empereur, Caulaincourt envoyait à Napoléon les cuivres gravés de la carte de Russie… Je cite ce fait ancien, pour ne pas faire d’allusion aux événements contemporains… Mais en somme et à tout prendre, mon général, nos secrets ne sont guère des secrets… Et si, à la guerre, on ne comptait que sur le mystère des préparations…
— Il faudrait commencer alors par supprimer la presse, grogna le ministre.
— Et c’est impossible ! dit Vallenot. Mais, dans le cas tout spécial qui nous occupe, il y a une œuvre de salubrité à entreprendre, et il faudra tout faire pour la mener à bien…
— Eh ! c’est la justice que cela regarde maintenant.
— Officiellement, mon général, mais dans notre coin, nous pouvons chercher aussi, discrètement, et je ne m’en ferai pas faute…
— Colonel, la morale de l’affaire, c’est que les militaires donnent trop dans la galanterie !
— Mon général, dit Vallenot en riant, si vous connaissez un moyen de réglementer cela, vous me le direz.
— Quand on pense que ce vieux Trémont !… À soixante ans ! Il est vrai qu’il n’en paraissait pas plus de cinquante ! Vert, droit, solide ! Le voilà bien avancé maintenant ! Et dans quelle situation laisse-t-il sa fille ?
— Le général de Trémont était veuf ?
— Oh ! Depuis longtemps. C’est son excuse ! Mais il a une fille, encore au couvent. Dix-huit ans et aucune dot. Heureusement, Baradier est là…
— Est-ce que c’est Baradier et Graff, le banquier ?
— C’est lui-même. Un ancien combattant de 1870, patriote bon teint, je vous le garantis, et dont le fils Marcel, très gentil garçon, sorti de l’École centrale, a travaillé avec le général de Trémont… Marcel Baradier s’occupait surtout de recherches sur les teintures végétales, à cause des tissages de laine que son père possède dans l’Aube. Mais le général lui ouvrait son laboratoire et il est probable qu’il lui a donné connaissance de ses travaux. Par ce jeune homme, on pourra savoir bien des choses, je pense.
— Très riche, la famille Baradier ?
— Très riche. Fortune réalisée, et qui s’augmente tous les jours par l’industrie et la banque. C’est Graff, le beau-frère de Baradier, qui est plus spécialement affecté aux affaires financières et Baradier qui s’occupe des fabriques. Mais l’un et l’autre sont à la besogne dès le matin. Et les millions s’entassent sur les millions, malgré la rivalité de la maison Lichtenbach qui tire à boulets rouges sur la maison Baradier et Graff.
— Rivalité d’industrie ?
— Oh ! mieux que cela ! Haine personnelle qui remonte loin et a été couvée furieusement… On dit que Lichtenbach a voulu autrefois épouser Mlle Graff, et qu’il n’a jamais pu dévorer l’affront que Graff lui a fait en n’accueillant pas sa demande et en donnant sa sœur à son ami Baradier… Il y a entre ces deux familles toute une série de différends et de griefs accumulés qui les fait irréconciliables.
— En tout cas, mon général, vous ne voyez pas de corrélation entre ces inimitiés et la mort du général de Trémont ?…
— En aucune façon… Lichtenbach est un catholique pratiquant, très inféodé au parti orléaniste et incapable, je crois, d’une action louche… Et puis, que pourrait lui importer que Trémont vécût ou mourût ?
— Les recherches du général n’auraient-elles pu être d’un sérieux intérêt pour la maison Lichtenbach ?
— Sans doute ! Mais il est certain pour nous que Trémont s’occupait surtout, dans ces derniers temps, de la fabrication d’une poudre de guerre dont vous avez vu, dans l’explosion de Vanves, les effets formidables… Il est vrai que la poudre en question pouvait devenir une source de très grands bénéfices par l’application qui en aurait été faite à l’industrie avec une autre formule moins brisante. Ainsi pour les mines, les terrassements et les fouilles de carrières, elle aurait certainement remplacé la dynamite… Il y avait là une fortune, et Trémont le savait bien… Mais tout cela, mon cher, s’est évanoui en fumée et le général a gardé son secret.
— À moins qu’il ne l’ait communiqué au fils de M. Baradier…
— Parbleu ! ce serait curieux !
Trois heures sonnèrent dans le silence. Le ministre se leva et prit son chapeau, ses gants et sa canne.
— Vous partez, mon général.
— Oui, je vais aller chez Baradier pour causer avec lui de toutes ces affaires… Mme Baradier s’occupait spécialement de Mlle de Trémont ; je tiens à porter moi-même à cette enfant l’expression de mes regrets… J’aimais son père… C’était mon camarade de promotion… Nous avions fait campagne au Mexique et sur la Loire ensemble, et, à la retraite du Mans, Trémont nous avait tous sauvés par une admirable mise en batterie à l’arrière-garde qui avait arrêté net la poursuite des Prussiens… Un brave soldat !… sacrebleu ! et qui méritait de tomber sur un champ de bataille ! Mais il y a la chance… Tout le monde n’a pas une mort de choix !… Allons, à demain, Vallenot… Et si vous apprenez quelque chose de nouveau, téléphonez-moi…
Le colonel accompagna son chef jusqu’au grand escalier, le salua et rentra dans les bureaux.
II
Rue de Provence, dans un vieil hôtel situé au fond d’une vaste cour, est installée depuis plus de cinquante ans la maison de banque Baradier et Graff. À la suite de la guerre de 1870, dans les affaires, on a pris l’habitude de désigner cet établissement financier sous le nom de société d’Alsace-Lorraine. On dit même tout court « la Lorraine ». Officiellement Baradier et Graff n’acceptent pas cette dénomination, mais, dans leur particulier, l’allure protestataire qu’elle donne à leur maison les flatte et les réjouit. Ce sont de bons et ardents patriotes. Jamais depuis l’annexion ils ne sont retournés à Metz. Mais ils n’ont voulu vendre aucune de leurs propriétés. Ils ont gardé un pied sur le sol arraché à la France, comme s’ils ne doutaient point d’y rentrer un jour, ainsi que des maîtres après une longue et triste absence. Baradier est un homme de cinquante-cinq ans, gros, court, rougeaud, à physionomie joyeuse, éclairée par un œil bleu clair. Graff est grand, mince, brun, l’air rébarbatif, les cheveux longs derrière les oreilles, le visage glabre, antithèse complète de son associé au physique comme au moral. Car Baradier avec sa mine avenante est un homme autoritaire et pratique, tandis que Graff avec son aspect froid et réservé a la sensibilité et la fantaisie d’un poète.
Admirablement appareillés du reste, l’imagination de l’un étant modérée par la prudence de l’autre, et ce qu’il y a d’un peu rude dans la volonté du premier étant mitigé par la bienveillante douceur du second. Dans le monde financier cette dissemblance si heureuse est bien connue. Et jamais client, ayant échoué auprès de Baradier, n’est sorti de la maison, sans passer par le cabinet de Graff, pour faire appel à sa médiation, et sans obtenir un : « laissez-moi faire, j’arrangerai cela » premier baume sur la plaie du mécontentement, suivi, dans la plupart des cas, d’un accommodement profitable aux deux parties. Car à la longue, les deux compères sont arrivés à tirer avantage des différences de leur caractère, et Baradier se donne des airs de tout casser, sachant bien que Graff arrivera par derrière pour avoir le plaisir de tout raccommoder.
Le gros et jovial Baradier a deux enfants, un fils de vingt-six ans et une fille de dix-huit, admirablement élevés par leur mère. Quant au sentimental et lugubre Graff, il est resté célibataire. Ce sera, dit Marcel Baradier, gaiement, le plus bel oncle à succession de France. De fait, le frère de Mme Baradier aime les deux enfants comme s’ils étaient siens et chaque fois que Marcel commet quelque grave sottise, c’est toujours à l’oncle Graff qu’il s’adresse pour arranger les choses, son père étant « plutôt dur à la détente ». Baradier père et Baradier fils ont eu malheureusement plus d’une fois maille à partir ensemble. Marcel, né dans le luxe, promptement renseigné sur la valeur marchande de son nom, n’a pas toujours causé à sa famille autant de satisfaction qu’elle aurait pu le souhaiter. « Rien de grave, comme dit l’oncle Graff, des affaires d’argent ! »
C’est ainsi que le taciturne et modeste banquier, qui n’a aucun besoin et ne saurait pas dépenser un sou en dehors de son budget à autre chose que des charités, appelle les dettes que le jeune Marcel lui donne l’occasion de payer périodiquement. Quand son neveu vient le trouver le soir, chez lui, après dîner, avant qu’il soit parti pour le Cercle des Chemins de fer, où il va se livrer aux douceurs d’un bridge modéré, l’oncle Graff sait tout de suite de quoi il retourne. Il prend son aspect le plus mélancolique, s’enfonce dans son grand fauteuil, regarde d’un œil voilé son héritier un peu ennuyé, et d’une voix caverneuse demande :
— Quoi encore ?
Et pendant que Marcel développe son thème habituel : Guigne extraordinaire aux courses, ou déveine noire au baccarat, à moins que ce ne soit : passion frénétique pour une petite blonde des Variétés qui lui est disputée par un riche étranger, Graff regarde le fils de sa sœur, et, sans écouter un mot de ce que lui raconte le jeune homme, se dit : Est-il gentil garçon ! Comment, avec un physique pareil, ne ferait-il pas de sottises ? Il est recherché partout pour sa bonne grâce et son entrain. Il n’a que vingt-six ans ; jamais il ne s’amusera plus jeune. Et n’est-ce pas tout naturel qu’il s’amuse ? Pourquoi est-ce que Baradier et Graff, toute la journée, alignent dans leur cabinet des colonnes de chiffres, font la banque, l’escompte, le change, et s’inquiètent de ce qui se passe à la Bourse de Londres, ainsi qu’à celle de Berlin, tout en surveillant celle de Paris, si ce n’est pas pour que ce joli blond, élégant, distingué, charmant, se donne du bon temps, pendant qu’ils travaillent ? Va, mon petit Marcel, prends du plaisir, pour ton oncle qui n’en a jamais pris et qui ne saurait pas en prendre. Il est ton intendant, sois son grand seigneur de maître. Aime les jolies filles, qu’au fond de sa pensée il a rêvé de séduire, mais devant lesquelles il a toujours rougi, embarrassé. Va aux courses, dans une belle voiture aux chevaux piaffants, et rivalise avec les fils de famille les plus huppés ; tes moyens, qui sont ceux de la maison Baradier, te le permettent. Seulement, pas trop de dissipation au jeu, pas trop d’emballement dans les paris, parce que c’est une vilaine passion, qui fait tort même à ceux qui peuvent s’y livrer. Pour le surplus, ne te gêne pas, va, mon prince, et grand merci à toi, qui viens faire à ton vieil oncle le plaisir de lui demander un service.
Mais toutes ces réflexions, qui lui gonflaient le cœur d’une satisfaction complète, l’oncle Graff les gardait pour lui. Tout haut, il disait, avec un reste d’accent lorrain dont il n’avait jamais pu se défaire :
— Mon petit Marcel, tu es stupide ! Tu te fais carotter par un tas de panés et de drôlesses. Ça n’est pas comme ça qu’on se conduit quand on est le fils de Baradier et Graff. Si ton père apprenait ta conduite, il serait furieux et tu en entendrais de belles ! Qu’est-ce que tu veux que je lui réponde, quand il m’accuse d’encourager ta mauvaise conduite ? Il a raison. Et moi j’ai tort de te donner de l’argent dont tu fais un si mauvais usage. Je finirai par te couper les vivres. Sais-tu ce que tu as reçu de moi, depuis le commencement de l’année ?
Et comme le célibataire faisait le geste de fouiller dans son bureau, Marcel, avec un effroi suppliant, s’écriait :
— Oh ! oncle Graff, ce sera la dernière fois !
— C’est que c’est toujours la dernière fois ! répliquait le brave homme. Enfin !… Elle est donc bien jolie cette petite ? Raconte-moi ça !
Alors Marcel, avec un dithyrambe amoureux, enflammait l’âme tendre du vieux célibataire et finissait par obtenir de lui tout ce qu’il pouvait désirer.
L’oncle Graff, cependant, avait une excuse. Marcel Baradier, s’il commettait quelques sottises, ne négligeait pas pour cela son travail. Admirablement doué, le jeune homme avait, comme en se jouant, poussé très loin ses études. C’était un de ces blonds résistants et tenaces que les marches de l’Est ont de tout temps fournis à la France pour en faire l’élite de ses soldats. Lui, le métier militaire ne l’avait pas tenté. Il avait résisté au général de Trémont qui désirait le diriger sur l’École Polytechnique et le pousser dans l’artillerie. Il avait préféré l’École Centrale et le laboratoire de chimie du général. Sous la surveillance de l’ami de son père, il avait fait des recherches intéressantes sur les colorations minérales et procuré à Baradier la joie de dire : « Nous avons pour nos fabriques des procédés de teinture trouvés par mon fils et qui sont uniques. »
C’était un des grands arguments de l’oncle Graff, quand il avait à détendre Marcel, un jour de crise : « Tu sais bien toi-même que ton fils est un homme remarquable, et que nos tissages lui doivent beaucoup ! » Ce à quoi Baradier répliquait avec fureur : « Oh ! s’il voulait devenir sérieux ! Ce ne sont pas les moyens qui lui manquent ! Mais il ne les emploie pas assez ! C’est un gaillard qui travaille un mois par an, et qui emploie les onze autres à faire des sottises ! »
Cependant, depuis quelque temps, Marcel paraissait s’être rangé, ou bien il était absorbé par des travaux qui l’intéressaient plus que de coutume. Il avait renoncé à paraître au cercle, il ne sortait presque plus le soir, et si ce n’était que, le dimanche, il allait encore aux courses, on aurait pu le croire tout à fait assagi. Baradier et Graff aussi surpris l’un que l’autre suivaient cette transformation, le père avec intérêt, l’oncle avec inquiétude. Ils s’en étaient ouverts au général qui leur avait dit :
— Ce garçon est véritablement extraordinaire ; avec lui, vous aurez des à-coups continuels, mais ne vous tourmentez pas, ce sera un homme supérieur. Il est doué ! Il s’acharne en ce moment à fixer un procédé de photographie en couleurs. Il a déjà obtenu de surprenants résultats. Laissez-le aller, ne le contrariez pas. Vous verrez !
Graff avait triomphé bruyamment, et Baradier en sourdine. Quant à Marcel, il ne s’était même pas aperçu de l’émotion de ses parents. Il avait à peu près complètement disparu de Paris. Depuis trois semaines il vivait près de Troyes, à la fabrique d’Ars, enfermé dans le laboratoire, ne venant que pour embrasser sa mère et courir à Vanves pour rendre compte au général des progrès de son travail. Le vieux chimiste et le jeune inventeur passaient alors des journées délicieuses à vérifier des formules, à pratiquer des expériences. L’un communiquait ses calculs pour le dosage des poudres, et l’autre expliquait ses superpositions de plaques pour arriver à des clichés parfaits. Puis ils déjeunaient ensemble, et le général, aussi chaud de cœur que le jeune homme, racontait ses anciennes fredaines et peut-être aussi les nouvelles à son compagnon d’études, lui soutirait des confidences sur ses amours, enviant la jeunesse, admirant la force et l’intelligence de ce beau garçon, aussi parfaitement créé pour l’étude que pour le plaisir.
L’existence, pour les Baradier et Graff, en dépit des quelques orages causés par les caprices de Marcel se serait donc écoulée heureuse, si la destinée ne les avait pas mis aux prises avec Lichtenbach. Moïse, le chef de la maison, fils d’un ferrailleur juif de Passy-sur-Moselle, avait été en pension autrefois, à Metz, avec Graff. Le père Graff, qui était brasseur, faisait des affaires avec Lichtenbach, « le marchand de peaux de lapins », comme il l’appelait en riant, et lui vendait tous ses verres cassés, tous ses tonneaux en mauvais état. Il le croyait pauvre et aimait à lui faire gagner de l’argent. On voyait, dans les rues de Metz, Moïse Lichtenbach passer à pied, conduisant par la tête un vieux cheval gris traînant une carriole, dans laquelle le ferrailleur entassait les marchandises les plus diverses, mais toutes de rebut. C’était une sorte de chiffonnier en gros, qui débarrassait les ménagères des ustensiles qui, ne servant plus, gênaient dans la maison. Il achetait bon marché, mais ne prenait rien gratis. Et quand, presque honteux de lui faire emporter des tuyaux de poêle rongés par le feu, des coquemards fendus, des pelles cassées, des tapis troués, et même de la vieille paille ou des copeaux d’emballage, on lui disait : Père Moïse, acceptez ça pour la peine de le transporter. Il répondait : Non ! non ! Tout a une valeur. Je paye peu, mais je paye !
C’était son point d’honneur de payer. Beaucoup levaient les épaules, et riaient de lui, pensant : Vieux fou ! Que peut-il faire de ces débris-là ? Ils avaient tort. Tout avait une valeur, comme l’assurait Moïse, et on en eut la preuve lorsque après la guerre le bonhomme quitta Metz et vint s’installer à Paris rue de la Chaussée-d’Antin, dans une petite boutique au-dessus de la porte de laquelle il avait fait peindre cette enseigne : Lichtenbach, changeur. C’était dans ce comptoir modeste, que le ferrailleur de Passy, quittant la terre lorraine devenue pays d’Empire, avait installé son nouveau négoce, cessant d’acheter et de vendre de la ferraille, pour acheter et vendre de l’argent. Mais un grave événement s’était produit qui n’avait pas peu contribué à l’exode de la famille Lichtenbach, de Passy à Paris, et au changement de commerce du vieux Moïse.
Les premiers coups de canon de la guerre, tirés à Forbach, avaient été, pour la plupart des habitants de la banlieue messine, le signal du départ. Seuls les fermiers et les paysans attachés étroitement à la terre étaient restés dans les villages. Tout ce qui était libre de ses actions avait chargé ses malles sur des voitures et gagné les villes pour se mettre à l’abri de l’ennemi dont l’arrivée était annoncée par les défaites et les désastres. Les routes du côté de Thionville, de Metz, de Verdun étaient couvertes de charrettes et de troupeaux. Le plus grand nombre des fugitifs se dirigeait vers l’intérieur, s’éloignait à marches forcées de l’invasion qui, selon les espoirs conservés, devait s’arrêter brisée devant les places fortes de l’Est. Contrairement à la poussée générale, Moïse, décidé à quitter Passy, n’avait pas pris la direction du centre de la France. Au lieu de s’éloigner de l’envahisseur, il avait marché vers lui, et laissant tout ce qui, dans ses magasins, était encombrant et sans valeur, il était arrivé à Metz avec six fourgons soigneusement fermés, et s’était installé dans une petite ruelle près de la cathédrale, avec sa femme et son fils Elias.
Moïse avait été accueilli avec sympathie. À force de le voir parcourir la ville, escortant sa carriole et son vieux cheval, tout le monde le connaissait. Des loustics dirent : Le père Moïse est un malin. Si Metz est assiégé il achètera les éclats d’obus allemands, comme ferraille et continuera « son petit commerce. » Mais ils se trompaient. Le vieux fer n’était pas ce qu’ambitionnait maintenant Lichtenbach. Il avait deviné que la grande place de guerre rigoureusement bloquée se défendrait énergiquement, que les vivres y deviendraient bientôt rares pour la population civile, et que celui qui disposerait à un moment donné de denrées alimentaires de luxe, ferait, en les vendant cher, un bénéfice considérable.
Il avait donc entré dans la ville, sur ses six fourgons, et soigneusement rangé dans sa cave, de l’eau-de-vie, du café, du sucre, des jambons et une dizaine de tonneaux de sel. Il avait employé une partie de ce qu’il possédait d’argent liquide à se procurer cet approvisionnement et avait attendu les événements. Pendant ce temps-là toute la jeunesse lorraine partait. Les garçons, qui n’étaient pas enrôlés dans l’armée ou dans la mobile, étant encore mineurs, s’engageaient pour combattre l’envahisseur. Le vieux sang guerrier bouillonnait dans les cœurs français, et le fils Graff revenait de la mairie, une cocarde à son chapeau, lorsqu’il avait rencontré sur la place Elias Lichtenbach qui se promenait en fumant sa pipe.
Cent fois, depuis de longues années, pendant que le père Moïse stationnait à la porte de Graff pour charger de la ferraille, ou acheter des peaux de lièvres et de chevreuils, tués par le brasseur le dimanche, les deux gamins avaient joué ensemble. Le petit Antoine emmenait le jeune Elias dans le jardin et, à eux deux, au grand courroux de Mme Graff, ils dévalisaient les espaliers chargés de raisin vert. Souvent ils jouaient aux billes, et Elias avait beau s’y prendre de toutes les manières possibles, jamais il n’arrivait à échanger ses billes de verre contre les billes d’agate d’Antoine. C’était le seul enfant de la ville qu’il n’eût pas réussi à exploiter. Un jour même, Antoine plus malin, parvint à faire prendre par Elias un vieux sabre cassé en échange de six callots de marbre tout neufs. Et Moïse dut constater avec humiliation que le fils de Graff avait roulé le fils de Lichtenbach.
Il est vrai que, ce jour-là, Catherine Graff était présente et que, pour éblouir la sœur de son camarade, Elias avait fait montre d’une largesse inaccoutumée. Cette petite fille déjà avait le don de troubler le jeune garçon.
En voyant passer son compagnon de jeu, tout fier de sa détermination patriotique, Elias avait retiré sa pipe de sa bouche, et dit :
— Où vas-tu, comme ça, Antoine ?
— Rejoindre à Châlons le 27e de ligne.
— Quoi ! tu t’es engagé ?
— Oui, comme tous les garçons de mon âge. Est-ce que tu ne vas pas en faire autant ?
— Je ne sais pas, mon père ne m’a rien commandé encore.
— Est-ce que tu dois attendre les ordres de ton père, pour faire ton devoir ?
Elias s’était gratté la tête sous sa casquette ; son visage avait exprimé l’incertitude et l’embarras :
— Mais c’est qu’il a besoin de moi pour son commerce.
— La France aussi a besoin de toi, et plus impérieusement que ton père.
— Je n’ai que dix-neuf ans.
— Et moi je n’en ai pas vingt.
— Oui, tu as raison ; je vais rentrer et parler à mon père.
— Si je ne te revois pas, adieu.
— Et bonne chance.
Elias, plus ému qu’il ne l’avait jamais été, regagna la boutique paternelle, et trouva, dans la cave, le vieux Moïse en train de mettre, lui-même, de l’eau-de-vie en bouteille. Il oubliait, par mégarde, un quart d’eau dans chaque litre, après l’avoir soigneusement lavé. Peut-être était-ce l’unique raison du lavage. Le fils fut chaleureusement accueilli par son père. Lichtenbach remplit un gobelet et le tendant à son héritier :
— Goûte ce cognac, il est vraiment agréable ! Le litre se vendra douze francs comme un sou, dans quelque temps. Il n’y a que nous qui en boirons pour rien, garçon !
— Vous peut-être, père, dit Elias avec émotion, vous en boirez, mais moi…
— Comment, toi ? Qu’est-ce que cela signifie ?
— Serai-je auprès de vous, quand le prix de cette bonne liqueur aura tant monté ?
— Et où seras-tu, s’il te plaît ?
— Où vont tous les jeunes garçons de la ville : à l’armée !
— À l’armée, toi, Elias ? Et pourquoi faire ?
— Pour me battre, comme les autres.
Le père Moïse, à la lueur de la chandelle qui éclairait la cave, regarda son fils avec un ahurissement complet. Il n’en croyait pas ses oreilles. Il reprit :
— Te battre ? Et à quel propos ?
— Mais pour défendre le pays…
— Quel pays ?
— Mais la France, où j’ai vécu, où j’ai été élevé, dont je parle la langue, où sont tous nos clients, tous mes amis.
Le père Lichtenbach hocha la tête et demeura un instant silencieux. Puis il dit d’un ton tranchant :
— Mon garçon, nous faisons du commerce dans ce pays-ci, mais nous n’y sommes pas nés. J’étais en Suisse, avec ta mère, à Genève, quand tu es venu au monde. Moi je suis originaire du Hanovre et ta mère est Badoise. Tu ne figures sur aucun registre officiel, et tu es parfaitement libre de faire ce qui te plaît. Nous sommes allemands par la naissance, français par les habitudes et les relations quotidiennes, nous n’appartenons pas plus à un parti qu’à l’autre. Et tout ce que nous pouvons faire de mieux, c’est de ne pas nous mêler de la querelle. Qu’aurions-nous à y gagner ? Des coups, pour toi, la douleur pour nous. Et le monde serait bien avancé, quand Elias Lichtenbach se serait fait tuer habillé en soldat, et que le vieux Moïse serait tout seul pour finir sa vie ? Sait-on seulement pour quoi tous ces gens-là se massacrent ? Le savent-ils eux-mêmes ? Ils se sont disputés, comme des buveurs, au sortir de la brasserie, le dimanche, quand ils ont quelque chose de trop dans la cervelle. Et les voilà qui se ruent les uns contre les autres. Qu’est-ce que les Allemands t’ont fait pour que tu veuilles les combattre ? Et qu’est-ce que cela te rapportera d’avoir défendu les Français ?
— Mais, mon père, tous les jeunes gens s’en vont. Antoine Graff, que j’ai rencontré, a sa feuille de route…
— C’est un imbécile !
— Mais le fils du rabbin Zaccharias part aussi…
— Grand bien lui fasse !
— Demain il n’y aura plus en ville que les infirmes. Je serai seul, et l’on me montrera au doigt.
Le vieux Moïse soupira :
— Oui, tu as de l’amour-propre : tu as été élevé dans les écoles de France, où on raconte de grandes histoires sur l’honneur. Tout ça, vois-tu, Elias, et souviens t’en toute ta vie : ce sont des blagues ! Il n’y a d’honneur qu’à payer ce qu’on doit, et à faire face à ses échéances. En dehors de cela, tout est faux, crois-en ton père. Les légendes patriotiques sont inventées pour conduire les hommes à la boucherie en chantant la Marseillaise. Il n’y a là que des mots sonores avec lesquels on trompe l’humanité, dans l’intérêt des Souverains ou des États. Il ne faut pas se laisser prendre à ces artifices-là. On est dupe. Et, après, aucun des malins, qui ont poussé les autres en avant, et qui se sont soigneusement ménagés eux-mêmes, ne trouve une parole pour vous plaindre. J’ai vu le monde, je connais la vie. Défie-toi de l’enthousiasme. C’est ce qu’il y a de plus dangereux et de plus faux sur la terre.
Il y eut un silence, dans la cave toute sombre où le visage seul des deux hommes était rougi par la vacillante flamme de la chandelle. Le bruit de l’eau-de-vie, gouttant dans le baquet, au-dessous de la chantepleure du tonneau, se faisait seul entendre. Et les ténèbres froides qui enveloppaient Elias commençaient à calmer l’ardeur dont il brûlait en venant retrouver son père. Le vieux Moïse continua au bout d’un instant.
— Du reste, je comprends que tu sois ennuyé de rester seul ici, quand tous ceux que tu connais s’en vont. Tu partiras aussi. Mais tu as autre chose à faire que de risquer ta peau ou d’essayer d’endommager celle des autres. Il y a gros à gagner dans les fournitures. D’ici à peu de temps, tout le pays d’Alsace et de Lorraine va être envahi. Les armées auront de la peine à vivre… Les armées françaises, bien entendu, car les Allemands, qui sont vainqueurs, ne manqueront de rien. Il faut s’occuper de rassembler des vivres du côté de Châlons, vers Paris. Tu n’es pas majeur, tu ne dois donc rien à personne, et d’ailleurs les services que tu peux rendre seront cent fois supérieurs à ceux de ces nigauds qui vont se mettre un fusil sur l’épaule. Je veux te prouver ma confiance, et te donner les moyens de montrer ce que tu vaux. Viens ici, et éclaire moi…
Moïse alla dans un coin de sa cave. Il dérangea deux tonneaux, creusa, avec une bêche, un trou dans le sol et découvrit une caisse cerclée de fer. Il la souleva avec effort, prit dans sa poche un trousseau de clefs, ouvrit la serrure et montra à son fils l’intérieur plein de rouleaux soigneusement rangés. Il déchira le papier qui enveloppait un des rouleaux et en répandit le contenu dans la main de son fils. C’étaient des pièces de vingt francs.
— Il y a là, dit Moïse, quarante mille francs en or. Tu es vigoureux, tu vas emporter la caisse. Demain, dès la première heure, tu prendras le chemin de fer et tu partiras pour Troyes. Tu déposeras tes fonds chez Baradier, le banquier, et tu n’accepteras pas de billets de banque ni de traites en échange. Avant peu, l’or fera prime et tu bénéficieras de l’agio. Avec les capitaux que je mets à ta disposition, achète des moutons et des bœufs, et offre à l’intendance de lui fournir de la viande. Dans le désarroi où l’invasion va mettre la culture, les troupeaux se vendront à soixante-quinze pour cent de perte. Dans l’embarras où l’armée va se trouver pour vivre, les fournisseurs revendront avec cent pour cent de bénéfice. Comprends-tu l’affaire ? Marche sur ces données-là. Et tu feras plus, en contribuant à nourrir les troupes, que si tu tournais et virais en culotte rouge sous la conduite d’un stupide caporal. Toi aussi, tu vas partir pour défendre ton pays. Et ne manque pas de te rendre, ce soir, à la brasserie pour le crier bien haut.
— Mais si quelqu’un me demande dans quel corps je servirai, que répondre ?
— Tu diras : Je me dirige sur Rhetel. Là, on disposera de moi.
— Bien père.
— Prends la caisse par une des poignées, pour la monter au magasin.
— Laissez-moi faire.
Il saisit à deux bras le lourd coffre plein d’or, le chargea sur sa robuste épaule, et précédé par Moïse qui levait sa chandelle pour éclairer l’escalier, il emporta sans fléchir toute la fortune paternelle.
La double combinaison imaginée par Lichtenbach réussit, comme toutes les conceptions simples. Dans Metz assiégé et bondé de troupes, les denrées emmagasinées ne tardèrent pas à faire prime. Le sel que Moïse comptait vendre médiocrement lui procura une surprise. Il dépassa le sucre, comme valeur. Le manque de sel causa de vives souffrances aux soldats dégoûtés par la viande de cheval. L’eau-de-vie dûment baptisée fut aussi d’un bon rapport. Mais les bénéfices du père Moïse ne le consolaient pas d’être sans nouvelles de son héritier. La dernière lettre d’Elias, distribuée le soir de la bataille de Borny, annonçait l’arrivée du jeune homme à Paris. Il avait laissé trente mille francs en or dans la maison Baradier à Troyes, et se disposait à gagner Orléans, ne se jugeant pas en sûreté à Paris, qui allait infailliblement se trouver investi.
Il avait fait entrer cinq mille moutons dans la ville. Mais il ne croyait pas devoir continuer les affaires avec le gouvernement qui était « trop serré et trop regardant ». À partir de ce 14 août, plus un mot. Et dans ses nuits d’insomnie, quand il écoutait le canon de Saint-Julien ou de Plappeville qui tonnait à longs intervalles, le père Moïse songeait avec amertume que son fils était bien jeune, bien inexpérimenté, qu’il pouvait se laisser voler, et que la somme qu’il lui avait confiée représentait vingt ans de pérégrination sur les routes de Lorraine, à côté de la carriole et du cheval gris, pour acheter toutes les ferrailles de la province. Il avait cependant cette consolation de penser que son Elias ne prenait pas part aux terribles et sanglantes batailles dont l’annonce venait, douloureuse et désespérée à travers les avant-postes, jusque dans la ville assiégée. Il voyait ses voisins et ses pratiques passer la tête basse s’interrogeant avec inquiétude.
— Quelles nouvelles ? Avez-vous appris quelque chose sur votre fils ? Où est-il ? Pourvu que tous nos garçons ne soient pas morts !
Lui, au moins, pouvait répondre : je ne sais rien, tout en étant à peu près tranquille. Mais les autres ? Le père Graff surtout faisait peine. On crut qu’il allait devenir fou. Un soir, il s’était promené nu-tête, dans la ville, par un froid glacial, disant à tous ceux qu’il rencontrait : « Si Antoine ne revient pas, c’est moi qui l’aurai tué ! J’avais bien besoin de l’envoyer à la guerre ! Il n’avait pas l’âge. Il devrait être ici, près de moi. On s’est battu, tous ces temps-ci, autour de Paris. J’ai le pressentiment que mon fils est mort ! » Et il pleurait à chaudes larmes. On dût le ramener de force chez lui, où la petite Catherine épouvantée se serrait dans les jupes de sa mère. Moïse, en lui-même, se félicitait de la prudente détermination qu’il avait imposée à Elias et s’efforçait de gémir avec les autres sur les dangers courus par toute cette forte et si vaillante jeunesse donnée à la défense de la patrie.
Un soir, en rentrant chez eux, les habitants du quartier de la cathédrale trouvèrent des voitures d’ambulances dans les rues et des infirmiers installant des blessés chez les particuliers. Les hôpitaux encombrés n’avaient plus de lits disponibles. Tous les appartements vides avaient été réquisitionnés et, maintenant, l’autorité militaire s’adressait au patriotisme des messins pour loger les victimes de la dernière sortie. Chez Moïse, un capitaine des voltigeurs de la garde venait d’être apporté, et Graff recueillait un capitaine d’artillerie, M. de Trémont. En ramenant sa batterie des coteaux de Servigny, le jeune officier avait reçu une balle dans la cuisse.
Le souci de la santé de son blessé, les remèdes à lui donner, firent une heureuse diversion aux inquiétudes obsédantes du père d’Antoine. En voyant ce beau garçon, qui s’était battu héroïquement et qui, soigné avec sollicitude, allait guérir dans sa maison, Graff se reprit à espérer. Il se dit : Pourquoi mon fils, s’il est blessé, n’aurait-il pas la même chance que le capitaine de Trémont ? On a rapporté celui-ci de bien loin, avec son coup de feu dans la cuisse, et il ne s’en trouvera pas plus mal dans six semaines. Tous ceux qui sont touchés à la guerre ne meurent pas. Antoine reviendra je le sens maintenant. Et il se ranimait, il renaissait à l’espérance. Le capitaine, soutenu par Graff et sa femme, commençait à pouvoir quitter son lit, et après le dîner, le soir, il leur racontait ses expéditions en Algérie et au Mexique. Il expliquait à ses hôtes les raisons pour lesquelles la France avait le dessous, dans cette désastreuse campagne, attribuant tous les avantages des Allemands à leur organisation remarquable, et à la perfection de leur matériel.
— Voyez-vous, tout l’avenir de la guerre est dans l’outillage. Nous succombons devant les canons se chargeant par la culasse qui ont, dès la première rencontre, pris le dessus et marqué leur supériorité sur nos pièces rayées. L’effet moral subi par les troupes a été décisif. La première chose à faire, après la guerre, ce sera la mise à l’étude de bouches à feu nouveau modèle, et d’explosifs à puissance destructive formidable. La question des poudres sera capitale. Voilà quel devra être le but de nos efforts à nous autres artilleurs…
Il expliquait avec une remarquable clarté tout ce que la chimie moderne offrait d’éléments pour les combinaisons savantes qui devaient donner la victoire à celui des adversaires qui saurait le plus scientifiquement assurer le massacre et la mort. Et, dans le silence nocturne de la grande place de guerre assiégée par l’ennemi vainqueur, déjà les vaincus s’occupaient de préparer la revanche.
Le siège prit fin, et tous les braves soldats qui auraient défendu Metz jusqu’à la mort furent livrés vivants à l’ennemi. Les drapeaux conquis par la famine allèrent former des trophées de victoire en Allemagne. Paris tomba à son tour, puis les dernières armées de la France, refoulées à travers les neiges ensanglantées, moins lasses de mourir qu’épuisées de combattre, s’arrêtèrent à la voix du pays. Et de cet immense champ de bataille de deux cents lieues carrées, la clameur de triomphe des vainqueurs se mêla au cri de désespoir des vaincus. Peu à peu les nouvelles arrivèrent, de deuil pour les uns, de joie pour les autres. Bien des disparus, parmi les braves garçons qui étaient partis si ardents et si fiers, beaucoup de prisonniers hâves et tristes, de blessés souffreteux et épuisés.
Graff, un matin, dans sa salle à manger, prenait le café au lait avec sa famille et le capitaine de Trémont, resté en convalescence à Metz, lorsque la porte de la rue s’ouvrit en sonnant, puis un pas rapide ébranla les marches de l’escalier, et le père, la mère et la petite Catherine se regardèrent soudain en pâlissant. Ils n’échangèrent pas une seule parole, pendant qu’ils écoutaient tout tremblants cette montée hâtive, et comme joyeuse. Ils avaient tous été frappés par cette même pensée : celui qui accourt ainsi vers nous, depuis la porte sans rien demander à personne, qui entre en maître et grimpe quatre à quatre les marches familières, c’est Antoine ! Ils n’eurent pas le temps d’en penser davantage, la porte s’ouvrit, un grand gaillard barbu, noir, maigre, terrible, qu’ils ne reconnaissaient pas, mais dont les joues en un instant furent inondées de larmes, apparut devant eux :
— Mon père ! Catherine ! Maman !
Les Graff se levèrent fous de joie, car à la voix ils ne pouvaient plus se méprendre, et l’enfant tant pleuré, tant attendu, fut saisi, embrassé, caressé, au milieu des cris, des sanglots, des questions et des exclamations des parents, des servantes et du capitaine souriant devant ce tableau de famille. Enfin Antoine s’arracha aux étreintes des siens, et ses premiers mots furent ceux-ci :
— Mon Dieu ! que j’ai faim !
Il jetait, en parlant ainsi, des regards de naufragé sur le café au lait, sur le kouglouf. En un tour de main il fut installé, servi, bourré, si bien qu’il dut demander grâce. Alors les explications commencèrent, et les récits, coupés de questions : Qu’était devenu celui-ci ? Et celui-là, que lui était-il arrivé ? Ramenait-on le gros un tel ? Et des morts, et des blessés, et des disparus, le tout scandé des signes de croix des femmes, et des hélas ! des hommes. Lui, Antoine, après avoir combattu à Sedan, s’être échappé par Mézières, avait gagné les places du Nord, où avec Faidherbe il avait fait toute la campagne. Il y avait trois mois qu’il n’avait couché dans un lit. Mais il s’était battu à Pont-Noyelles, à Bapaume et à Saint-Quentin. Il avait eu la chance de ne rien attraper et revenait sergent-major, mais dégoûté du métier des armes pour le restant de sa vie. Son père lui dit :
— C’est fini, cette affaire-là ! Jamais plus tu ne recommenceras ! Notre malheureux pays est écrasé, il va falloir peut-être vingt ans pour remettre les choses en ordre. Ah ! mon pauvre Antoine que j’ai donc mal dormi pendant six mois ! Je puis dire que je n’ai pas eu une heure de tranquillité depuis que tu es parti ! Mais te voilà ! Tout est oublié !
Et alors les récits de recommencer. Le capitaine de Trémont interrogeait le jeune soldat sur les épisodes de la campagne du Nord, et Antoine ne tarissait pas sur les vertus du calme et inlassable Faidherbe, sur la bravoure de ses camarades, et sur les services rendus par un engagé volontaire, comme lui, François Baradier, le fils d’un banquier de Troyes, qui lui avait sauvé la vie, en l’arrachant aux mains des Prussiens de Manteuffel, le soir de Bapaume, dans une ferme incendiée par les obus, où il était cerné avec une douzaine de lignards.
— Il viendra vous voir, il me l’a promis, et vous apprécierez cet aimable et courageux garçon.
— Ton sauveur ! Il sera le bienvenu ! Mais laisse-moi te regarder. Mon pauvre enfant ! Qui t’aurait reconnu ! Tu as l’air d’un brigand ! Je t’aurais rencontré : tu m’aurais fait peur !
Toute la journée ce fut chez les Graff un défilé de parents et d’amis accourant féliciter la famille, admirer le revenant, écouter le centième récit de l’épisode du soir de Bapaume, et des chopes de bière, des verres de kirsch qui avaient porté au comble l’émotion de Graff, sobre à son ordinaire, mais ce jour-là, débridé et éperdu.
Le lendemain, autre émotion dans le quartier. Elias Lichtenbach arriva dans un cabriolet attelé d’un fort cheval, gros, gras, frais, la mine solennelle, et tout aussitôt, après avoir à peine pris le temps d’embrasser sa famille, entra en conférence à la Commandature, avec les autorités allemandes. Le bruit se répandit promptement que le fils Lichtenbach était chargé d’une mission par le gouvernement de Bordeaux et qu’il était devenu, pendant la guerre, un influent personnage. Il s’agissait, en réalité, d’une question de ravitaillement par les frontières de l’Est. Et le délégué à la guerre, qui avait pu apprécier les services rendus par Elias, son habileté d’intermédiaire, et sa souplesse au milieu des difficultés, avait expédié son agent au quartier général ennemi. Il en arrivait avec des instructions, assez gonflé de son importance, et toisant, superbe, ses compatriotes fatigués par les privations, mais furieux de la défaite.
Après les premières heures d’étonnement, la curiosité se donna carrière. D’où venait-il cet Elias si frais et si rubicond ? Seul, de tous ceux qui étaient partis en même temps que lui, il reparaissait en bon point et l’œil clair. Les autres étaient hâves et farouches. On s’enquit. Mais, dès les premières questions, les représentants du gouvernement répondirent avec circonspection que M. Lichtenbach avait rendu au pays d’éminents services, et que le délégué à la guerre le patronnait avec une bienveillance pleine d’estime. Quels services ? Ce fut Baradier fils, qui en arrivant à Metz, pour faire visite à Antoine et à sa famille, commença à éclairer de quelques lumières la conduite obscure du glorieux Elias.
Le sergent Baradier, roux de poil, râblé, sanguin, l’œil bleu, était aussi ferme de caractère qu’Antoine était doux. Il plut par sa franchise et se trouva tout de suite à l’aise dans ce milieu de braves gens. Vingt-quatre heures ne s’étaient pas écoulées qu’il était compère et compagnon avec le capitaine de Trémont, et qu’il avait groupé tous les engagés volontaires de Metz, dans un banquet, pour fêter leur retour. Elias avait eu la tranquille audace de souscrire comme tous ses camarades, et s’était présenté à l’hôtel de l’Ours pour prendre part à la fête. Mais il avait été accueilli froidement. Tous ceux qui étaient présents là, quoiqu’en bourgeois, parce que l’autorité allemande avait défendu les uniformes, savaient d’où ils venaient, où ils avaient servi, à quels combats ils avaient été blessés. Seul Elias se perdait dans les explications vagues. À l’entendre, il aurait été partout : à l’armée de Chanzy, à l’armée de Bourbaki, au camp de Conlie, et près de Garibaldi. Ce don d’ubiquité étonnait. Mais le sergent Baradier se chargea d’en fournir une explication plus claire que toutes celles dans lesquelles se renfermait Elias.
— Est-ce que vous n’êtes pas le Lichtenbach qui faisait des affaires avec la maison Baradier de Troyes ? demanda-t-il à brûle-pourpoint au fils du père Moïse. Est-ce que ce n’est pas vous qui ramassiez des moutons dans les Ardennes, et les faisiez passer par la Belgique pour les amener en France ?
— Oui, c’est moi, dit Elias avec circonspection.
— Eh bien ! Il n’est pas étonnant que vous ayez été de tous côtés, pendant la guerre, puisque vous achetiez partout de la viande pour le compte de l’intendance…
Comme Elias se troublait et pâlissait :
— Remarquez que je ne vous le reproche pas. Je le constate seulement. Ces messieurs paraissaient ne pas comprendre votre rôle, tout à l’heure. Je le leur explique. M. Lichtenbach est un patriote à sa façon. Au lieu de combattre, il s’occupait à nourrir les combattants. C’était un emploi utile, sinon glorieux.
— Mais je risquais ma peau, comme les autres, s’écria Elias, rouge de colère. Si les Allemands m’avaient pris, ils m’auraient fusillé !
— Il est même bien extraordinaire qu’ils vous aient laissé circuler si facilement, à travers leurs lignes, car ce n’est pas par la confiance qu’ils pèchent. Et les commodités que vous avez trouvées auprès d’eux pourraient paraître singulières…
— Que prétendez-vous dire ? clama Elias.
— Rien que ce que je dis, reprit froidement Baradier. Mais si vous voulez que j’ajoute quelque chose, je ferai remarquer que rester à l’abri des coups, pendant que les autres se battent, ne se priver de rien et être au chaud, quand les camarades meurent de froid et de misère, ne voir dans les malheurs du pays qu’une occasion de faire fortune, ce n’est pas ce qu’on peut appeler le comble de l’héroïsme !
— Vous m’insultez !
— Je suis prêt à vous en faire réparation.
— Bon ! Vous aurez affaire à moi !
— Ne criez pas. Je suis facile à trouver. J’habite chez M. Graff, et je suis le fils de M. Baradier, votre banquier de Troyes. Maintenant en voilà assez sur ce sujet.
Instantanément Elias se trouva seul, et ne vit plus que des dos. Il jeta sur son adversaire un mauvais regard, et sortit. Derrière lui, il entendit Graff qui s’écriait :
— Maintenant que nous sommes entre bons patriotes. À la santé de la France !
Le lendemain, Baradier attendit avec le capitaine de Trémont et son ami Graff, que Lichtenbach se manifestât. Rien ne vint. Le prudent Elias parut bien décidé, ayant évité les coups pendant la guerre, à ne pas risquer d’en recevoir pendant la paix. Mais, comme par hasard, M. Baradier à Troyes reçut, dans sa maison, un supplément de vingt hussards Hessois à loger et à nourrir, et le père Graff fut mandé, trois fois dans la même semaine, à la Commandature pour répondre à des dénonciations le montrant comme tenant des propos insultants pour l’armée allemande. Baradier enfin reçut avis d’avoir à quitter Metz, dans les douze heures.
Il était assurément possible que le hasard seul fût cause du surcroît de charges subi par le banquier de Troyes, et l’expulsion de Baradier pouvait être la conséquence du banquet, où les têtes s’étaient échauffées un peu plus que de raison. Mais le père Graff demeura convaincu que le fils de son voisin Lichtenbach était un agent de l’ennemi, et que ce gros coquin l’avait purement et simplement dénoncé. Cependant Elias lui tirait son chapeau dans la rue, avec une déférence toute particulière, et il n’était d’avances qu’il ne fit à Antoine.
Le doux et taciturne héritier de la maison Graff évitait autant que possible son ancien camarade. Il ne lui rompait pas carrément en visière, parce que son tempérament ennemi de la violence s’y opposait. Mais il n’échangeait que de rares paroles, quand il ne pouvait pas le fuir, et évitait de faire des affaires avec lui. La maison Graff emmagasinait de grandes quantités de laine, et les vendait aux filateurs de la Champagne et des Ardennes. Les Baradier qui venaient d’acheter une usine à Ars étaient de leurs gros clients. Elias, qui continuant en grand le commerce paternel, achetait et vendait tout ce qui est susceptible d’une transaction commerciale, avait fait souvent des offres aux Graff pour des laines d’Allemagne. Toujours ceux-ci avaient décliné ses offres. Malgré cette mauvaise volonté si évidente, Elias ne se rebutait pas et, avec la ténacité qui est une des vertus de sa race, il venait périodiquement visiter Graff et son fils pour tâcher d’amorcer un marché.
Ce fut ainsi qu’après deux ans passés par Mlle Graff dans un des meilleurs pensionnats de Nancy, un beau matin, Elias se trouva en face d’elle dans le jardin, pendant qu’il attendait Antoine. Il demeura stupéfait et ébloui. L’enfant s’était changée en une jeune fille, grande, souple et charmante, avec des yeux noirs, des cheveux blonds et un teint éclatant. Il n’osa lui parler, et ne sut que s’incliner sur son passage. En rentrant chez son père, il lui raconta sa rencontre et, avec un luxe de comparaison biblique, il dépeignit la jeune fille comme Rebecca apparaissant à Jacob. Il ne laissa point ignorer à son père qu’il venait de recevoir le coup de foudre, et que s’il fallait comme le pasteur chez Laban, servir chez Graff, pour obtenir d’être son gendre, il s’y résignerait par amour pour la belle Élise.
Le vieux Moïse lui fit observer qu’étant juif et les Graff étant chrétiens, il n’avait aucune chance d’être agréé par eux, sans préjudice des préventions qu’ils manifestaient contre lui, depuis les affaires de la guerre. Mais Elias répliqua que sa religion ne lui tenait pas à la peau et qu’il ne mourrait pas pour abjurer. Que, sous ce rapport, il donnerait par sa conversion de flatteurs avantages à la religion catholique. En ce qui touchait au commerce fait pendant la campagne, le moment serait mal choisi pour le lui reprocher, où Metz était devenu pays d’Empire. Qu’au surplus il avait gagné assez d’argent par son savoir faire pour qu’on ne fît pas le renchéri avec lui, et qu’un garçon de vingt-deux ans, qui mettrait quatre cent mille francs sur la table, le jour du contrat, n’était pas un prétendant dont on pouvait faire fi si facilement.
Moïse, qui n’était pas étouffé par les scrupules, mais qui voyait juste, prédit à son fils qu’il entamait là une négociation fâcheuse. Il ne lui déconseilla pas de changer de religion, puisqu’il lui paraissait utile de le faire. Mais il lui attesta qu’il n’obtiendrait pas plus Mlle Graff, comme chrétien que comme juif, et qu’il recueillerait seulement la honte de son apostasie. Rien ne fit. Elias avait une volonté de fer. Il émerveilla l’archevêché par sa résolution, l’édifia par sa piété, se le concilia par ses largesses, et, avec une habileté remarquable, mit dans ses intérêts toute la haute dévotion catholique. À l’heure où le piétisme allemand entrait en lutte, dans les provinces conquises, avec le clergé à tendances nettement protestataires, la conversion d’Elias fut un événement politique.
Si le Stathalter n’avait pas été si exactement renseigné sur les sentiments de Lichtenbach père et fils, il aurait pu s’émouvoir. Il fit juste assez d’opposition pour que le patriotisme d’Elias se relevât d’une pointe de persécution. S’il avait moins été connu, il aurait pu devenir populaire. Il n’en fut pas moins refusé avec éclat par la famille Graff, et, comme pour accentuer l’affront qui lui était fait, dans les six mois qui suivirent, la belle Élise épousa l’ancien sergent Baradier. En même temps le bruit se répandit que la famille Graff quittait la ville. Antoine suivait son beau-frère à Paris et entrait avec lui dans la maison de banque de Baradier aîné.
Ce fut trop d’émotions pour Elias. Il perdit le sommeil, les fleurs de son teint pâlirent et, comme il venait de rencontrer les Graff, qui se rendaient au chemin de fer escortés par tous leurs amis, il rentra chez son père, et se trouva mal dans l’arrière-boutique. Le vieux Moïse épouvanté coucha son fils, appela le médecin, et apprit, avec désolation, que le nouveau converti avait des chances de mourir, à brève échéance, dans le sein de l’Église catholique. Un délire furieux s’était emparé de lui, pendant lequel il se livrait, avec des vendeurs et des acheteurs imaginaires, à des marchés fabuleux, ou défilaient tous les approvisionnements dont il s’était chargé pendant la guerre. Moïse l’entendit, avec stupéfaction, faire prix pour des viandes, des farines, des souliers, des draps, des cartouches, des cigares, des canons, du sucre, le tout entremêlé de pots-de-vin, de remises, et de Trink-Geld et de drawbachs, qui donnaient un bien curieux aperçu des tripotages auxquels s’était mêlé l’agent de la défense nationale. Elias ne retrouvait une apparence de raison que pour vomir des torrents d’injures et de menaces contre les Baradier et les Graff. Il ne se calmait que quand son père lui disait avec persistance :
— Oui, Elias, tu te vengeras de ces gredins ! Tu les ruineras, tu les écraseras !
Alors un sourire heureux passait sur les lèvres du malade, il dormait quelques heures et se réveillait en meilleur état. Si Elias ne mourut pas, on peut affirmer que ce fut l’intensité de sa haine qui le sauva. Les projets de revanche ne cessèrent pas de hanter ce cerveau incendié par la fièvre, et quand, avec étonnement le médecin déclara que le jeune homme entrait en convalescence, les premiers mots qu’Elias prononça furent : Tant mieux ! Les Baradier et Graff auraient été trop heureux si j’étais mort !
Les Baradier et Graff, pour dire le vrai, ne se souciaient aucunement des rancunes qu’ils avaient si violemment excitées. Ils avaient pris la direction de la maison de l’oncle Baradier, qui se retirait après fortune faite, et guidaient sagement les travaux des vingt employés qui alignaient des chiffres, depuis le matin jusqu’au soir, dans les bureaux de la rue de Provence. Ils avaient donné laborieusement de l’extension aux affaires, conservé et augmenté les filatures de laines, dont s’occupait plus spécialement Graff. Marcel Baradier et sa sœur Amélie étaient nés. Le bonheur complet semblait favoriser cette famille si unie, lorsque Elias Lichtenbach, le vieux Moïse mort, était venu s’installer à Paris.
Une métamorphose singulière s’était opérée en lui. Du frais, gras et glorieux Elias, rien ne restait. La première fois que Baradier et son rival se rencontrèrent à la Bourse, le banquier ne reconnut pas Lichtenbach. Il fallut qu’on le lui nommât pour qu’il sût à qui il avait affaire. Il vit un homme voûté, maigre, compassé, le front dégarni, les yeux froids, abrités derrière des lunettes d’or. La voix même était changée. M. Lichtenbach parlait peu, ne disant que des mots essentiels, ne livrait jamais plus d’un doigt à la main qui se tendait vers lui, et demeurait impassible devant les plus importantes nouvelles. Seule une contraction des mâchoires trahissait son émotion, donnant un caractère de férocité singulière à sa physionomie.
L’entrée en matière de Lichtenbach avec la maison Baradier et Graff fut significative. Il lui fit perdre trois cent mille francs, en une matinée, sur un marché de laines conclu à la Bourse de Troyes. Elias vendit des laines de Hongrie à un si bas cours que Baradier et Graff trop engagés à la hausse durent se liquider rapidement pour limiter leurs risques. Ce fut le premier bon jaillissant du nuage. Il illumina la situation. Désormais un ennemi toujours en éveil guettait la maison Baradier et s’apprêtait à la frapper dans ses parties vulnérables. Les mauvaises intentions de Lichtenbach, pour être dissimulées, n’en étaient pas moins certaines. Tout les trahissait. Continuellement les Baradier se sentaient surveillés. Et cette guerre sourde en excitant leurs facultés de résistance n’était pas improductive pour eux.
Attaqués, ils s’ingénièrent à se défendre, prirent leurs précautions, et ne livrèrent plus rien au hasard. Leur ennemi était bien puissant et dangereux. Inféodé au parti catholique, le plus intransigeant commanditaire du journal clérico-royaliste le Panache blanc, reçu dans les maisons les plus fermées de l’aristocratie, Lichtenbach par la rude austérité de ses manières, la hardiesse de ses conceptions, avait pris une grande autorité dans un parti où les prêtres seuls ont de la ténacité et de la vigueur. Marié en Alsace et resté veuf avec une fille, qu’il faisait élever au Sacré-Cœur, dans les principes de la plus rigide dévotion, Elias était le type du renégat devenu plus chrétien que le Pape. Il se montrait aussi plus royaliste que le Roi, et effrayait souvent l’entourage intime du Prétendant par une ardeur combattive qui n’hésitait pas à conseiller l’action immédiate à des partisans dont une campagne dans les salons occupait suffisamment les loisirs, et qui ne demandaient pas du tout à risquer leur repos dans les aventures d’une Restauration fort problématique.
Mais si on redoutait Lichtenbach, on le caressait, le choyait, et c’était un homme dont l’influence mondaine était aussi occulte que certaine. Il rendait aux grandes familles ruinées des services d’argent inappréciables. Au lieu de recommencer les folies de l’Union générale et de dresser des batteries financières contre le gouvernement établi, il divisait ses tentatives, les répartissait sur un grand nombre d’affaires, mettait la main dans tous les syndicats d’Europe et, au moyen des capitaux groupés par lui, imprimait aux spéculations diverses un mouvement, dont il savait profiter, et surtout faire profiter les autres.
En apparence, il était sans besoins. La simplicité de sa vie paraissait portée à la plus extrême limite. Il vivait dans un hôtel de la rue Barbet-de-Jouy, noir triste et silencieux, avec des domestiques amenés par lui de Lorraine, et qui parlaient plus allemand que français. Il ne recevait jamais, allait dans le monde tous les soirs, jouait le whist, ce qui semblait être sa seule dépense. Ses bureaux étaient installés rue du Quatre-Septembre, et occupaient deux étages d’une maison en face de la Bourse. C’était là qu’il recevait, même ses nobles clients. Presque jamais la porte cochère de l’hôtel de la rue Barbey ne s’ouvrait pour d’autre voiture que pour son coupé à deux chevaux. Il allait beaucoup à pied, voûté, silencieux, lugubre, semblant compter les pas qu’il faisait. On ne lui connaissait pas de maîtresse et il n’avait que quarante-cinq ans. Jamais il ne souriait à une femme. Il s’inclinait, avec des airs de crainte, comme si le sexe était pour lui une cause d’épouvante. La petite duchesse de Bernay, qui avait pu, grâce à des spéculations conduites par le sévère Elias, payer ses dettes et se remettre à flot, avait dit un jour follement à son amie, la marquise de Prémeur :
— Il faudra décidément que je sache ce que pense, au juste, ce cher Lichtenbach. Vraiment il est d’une réserve presque humiliante avec les femmes. Est-ce pudeur ou insuffisance ?
Elle flirta, pendant quelques soirs, devant tous ses amis, avec Elias sans parvenir à le dégeler. Puis brusquement elle cessa de s’occuper de lui. Aux questions ironiques de son entourage elle répondit évasivement :
— J’ai perdu mon temps ! Rien à faire !
Mais il fut à remarquer que, par la suite, le train de maison de la jeune femme changea, qu’elle fit de grandes dépenses, et qu’en même temps qu’elle cessait de plaisanter avec le financier, elle se montrait de plus en plus à l’aise dans ses finances. Il en arriva de même pour quelques femmes du monde, toujours très jeunes et très jolies. Elias, glacé, sombre et silencieux, continuait à spéculer aux quatre coins du monde, à conseiller le Prince, à inspirer son journal et à prouver aux Baradier et Graff, ainsi qu’à tous ceux qui les touchaient de près ou de loin, qu’il aurait la rancune aussi longue que la vie.
III
En arrivant rue de Provence, le ministre de la guerre descendit de son coupé avec la vivacité d’un jeune homme, traversa la cour, entra dans les bureaux et, de sa voix de commandement, s’adressant au garçon de bureau :
— M. Baradier est-il là ?
Le garçon de bureau instinctivement rapprocha les deux talons, se mit à la position du soldat sans armes et répondit :
— Oui, mon général. Je vais annoncer, mon général…
Il fit demi-tour, pendant que le ministre arpentait d’un pas nerveux l’antichambre où, derrière des vitrages, les dépêches Havas affichées donnaient le cours de toutes les Bourses de l’Europe. Une porte s’ouvrit brusquement, un homme gros et roux se précipita les mains tendues.
— Ah ! c’est vous, mon général ! Vous avez pris la peine… Entrez donc dans mon cabinet.
Graff apparaissait déjà à la perspective. Le ministre passa et sitôt la porte fermée :
— Eh bien ! mes pauvres amis ? Quel événement !
— Ah ! dit Graff, en avançant un fauteuil, nous en sommes bouleversés, Baradier et moi… Asseyez-vous donc, mon général, je vous prie…
— Par qui avez-vous été avertis ?
— Par Baudoin, qui était venu coucher ici, hier soir, et qui est arrivé effaré cet après-midi, apportant la lugubre nouvelle. Mais qu’est-ce qu’il y a là-dedans ? Les circonstances, dans lesquelles cette catastrophe s’est produite, sont encore plus graves que le malheur lui-même. Graff et moi, nous nous interrogeons, nous discutons, sans réussir à résoudre cet effrayant problème…
— Si Marcel était là, encore ! gémit l’oncle Graff. Il nous aiderait. Il connaît si bien les dessous de l’existence de Trémont, ses manies, ses habitudes, ses faiblesses…
— Ses faiblesses ? interrogea le ministre. Une femme ? Voilà ce que vous voulez dire, n’est-ce pas ?
— Oui, mon général.
— Vous prenez le petit côté de l’affaire, dit le vieux soldat avec fermeté. Il ne s’agit point d’une passade. Il y a plus qu’une intrigue galante, dans ce qui nous occupe. La femme, oui, parbleu ! elle a eu un rôle… Mais elle n’a été que l’agent, peut-être inconscient, d’une tentative soigneusement préméditée et hardiment exécutée…
— Dans quelle intention ? demanda Baradier. Dites tout, mon général, mettons nos soupçons en commun pour tâcher d’arriver à une lumière complète.
— Eh ! C’est clair ! C’est aux découvertes faites par Trémont qu’on s’attaquait. Et, dans cette abominable manœuvre qui a eu pour conclusion le meurtre d’un homme que nous aimions, d’un savant remarquable, je vois – je vous le dis à vous, mais que cela ne sorte pas de nous trois, – je vois la main de l’étranger.
Il y eut un silence. Graff et Baradier se regardaient inquiets et comme indécis. Mais le fougueux Baradier ne put retenir longtemps la pensée qui le travaillait.
— Et nous, mon général, il nous semble reconnaître, dans le coup qui a été porté à notre ami, une intention haineuse à la fois contre lui et contre nous…
— Baradier, intervint Graff, tu vas trop vite et trop loin ! Comment peux-tu aventurer de semblables paroles rien que sur des présomptions ?
— Ah ! Tu trembles toujours ! s’écria Baradier. Tu es toujours garrotté par tes scrupules ! Sacrebleu ! Je sens là une trahison ! Je devine une infamie ! Je… Tiens, laisse-moi tranquille ! Je jurerais que Lichtenbach est dans l’affaire !
— Tu n’as pas le droit de parler comme tu le fais ! s’écria Graff, levé cette fois et frémissant d’émotion. Comment insinuer qu’un homme sur lequel il n’y a rien à dire, au point de vue professionnel, ni au point de vue moral, a trempé dans un crime, et cela parce qu’il est notre ennemi ?… C’est abominable ! C’est insensé ! Enfin, tu n’es pas juste !
Baradier, tout bouillonnant, se leva à son tour, marcha dans le cabinet en parlant d’une voix entrecoupée.
— Mon général, voilà deux heures que nous nous disputons comme ça, Graff et moi, et ce nigaud-là, tout ce qu’il trouve à me répondre, c’est que je ne suis pas juste ! Comme si on avait à se préoccuper d’être juste, quand un instinct impérieux vous crie : voilà le coupable. On ne le voit pas : il est bien masqué, bien caché, il n’a paru en rien. On ne le découvrira probablement pas. Mais c’est lui, tout de même, qui a fait le coup, parce que son intérêt, d’accord avec sa haine, était de le faire ! Non ! Ce Graff, avec sa justice, son humanité, sa philanthropie, on n’imagine pas, comme il est bête, par moments !
Malgré la gravité de la situation les interlocuteurs ne purent s’empêcher de rire. Graff dit en pliant son grand corps :
— Merci !
Le ministre intervint alors pour mettre un peu d’ordre dans le débat :
— Voyons, Baradier, expliquez-vous. Ce ne sont pas de vagues pressentiments qui peuvent suffire, comme le dit votre beau-frère, pour asseoir une accusation. Des présomptions conduisent à des recherches. Et si la culpabilité ressort des informations prises, alors on marche. Du reste, je vous ferai observer que la justice est saisie, qu’une instruction est commencée et que si vous avez à fournir des preuves…
— C’est impossible ! interrompit Baradier. À vous, je montre le fond de ma pensée. À un juge d’instruction, je ne répéterais pas ce que j’ai avancé tout à l’heure.
— Là ! triompha Graff. Quand je le disais !
— Il faudrait pour que je sortisse de ma réserve, que des découvertes se produisissent telles que les preuves, d’ordre tout moral sur lesquelles je m’appuie, eussent des coïncidences matérielles… Mais ne croyez pas à une reculade de ma part. Je chercherai et si je trouve…
— Tu ne trouveras pas. Si ce que tu soupçonnes est vrai, nous avons affaire à plus fort que nous.
— C’est ce qu’il faudra voir !
Le général intervint encore :
— Le Lichtenbach, dont vous parlez, est bien le grand brasseur d’affaires, inféodé au parti clérico-royaliste ?
— C’est lui-même.
— Et vous le croyez capable d’un crime ?
— Je le crois capable de tout.
— Vous n’ignorez pas qu’il est très puissant au ministère et qu’il obtient ce qu’il veut.
— Il est très puissant en tous lieux. On peut dire de lui que c’est un homme qui a le bras long.
— Mais quel intérêt aurait-il eu à essayer de circonvenir Trémont d’abord et ensuite à le faire disparaître ?
— Eh bien ! mon général, et les recherches sur les explosifs ? Lichtenbach est à la tête du syndicat français des exploitations minières. Il a en Russie, en Autriche, en Espagne, des intérêts considérables. Or composer une poudre, facile à diriger, dans ses effets, innocente à manier, d’un prix de revient très modique. – Et c’étaient là tous les avantages de la poudre Trémont, ainsi qu’il résultait de la notice lue par le général à l’Académie des sciences, il y a six mois – n’y avait-il pas là de quoi tenter la convoitise d’hommes d’affaires à l’affût de tous les progrès rémunérateurs ?… On avait fait à Trémont des offres magnifiques. Mais c’était une maison anglaise qui avait entamé la négociation. Le général avait refusé d’entrer en pourparler… On était revenu à la charge de différents côtés… C’est alors qu’il s’était ouvert à Graff et à moi de son intention de fonder une société d’exploitation exclusivement française. Il mettait une sorte d’amour-propre à faire profiter son pays de sa découverte…
— Brave homme ! Cela ne m’étonne pas de lui !
— Il savait bien qu’il avait trouvé une occasion de faire fortune. Il s’en réjouissait. Mais il ne voulait pas que l’argent étranger y fût pour quelque chose… Et puis, il poursuivait en même temps la réalisation d’une formule de poudre de guerre. Et il ne voulait pas lancer l’affaire commerciale, avant d’avoir donné son explosif nouveau au gouvernement. Il nous disait : Les deux poudres en même temps. Celle qui nous fera riches, et celle qui nous fera vainqueurs, afin que l’on me pardonne les bénéfices que je tirerai de la première, en faveur de la puissance que la seconde assurera à notre armée.
— Oui. Il y avait eu déjà des expériences secrètes, avec sa poudre de guerre. Et jamais, mes collègues et moi, nous n’avions vu pareil effet de destruction. Rien n’aurait pu tenir devant une artillerie tirant des projectiles chargés de la sorte ! C’était, sur des étendues considérables, l’anéantissement de tout ce qui offrait une surface résistante. Et un pareil secret s’est évanoui en fumée ! C’est un grand malheur pour la France !
L’œil de Graff se voila, sur sa bouche mélancolique passa comme un sourire. Il fit un geste de doute et dit :
— Eh ! Eh ! qui sait ?
— Comment qui sait ?
— Oui… Il n’est pas très sûr que le secret soit perdu ! Quelqu’un possède peut-être en double la formule du général.
— Et qui donc ? s’écria le ministre…
Graff se frotta les mains et répondit :
— Mon neveu !
— Marcel ? Il vous en a parlé ?
— Pas plus tard qu’il y a huit jours.
À ces paroles, Baradier pâlit. Il se tourna vers son beau-frère avec un air désolé :
— Malheureux ! Ne laisse jamais soupçonner cela ! Ne répète point à d’autres que nous ce que tu viens de dire ! On a tué Trémont ! Veux-tu qu’on nous tue mon fils ?
— Ah ! ça, Baradier, je vous ai connu plus courageux ! s’écria le général. Avez-vous peur de votre ombre maintenant ? Vous imaginez-vous que si votre hypothèse est vraie, et je ne suis pas loin de la partager, les gens qui ont fait le coup vont être disposés à recommencer, sans délai ? Nous avons du temps devant nous pour agir, et nous sommes prévenus. Que diable pourrait-on craindre ? En ce moment les auteurs de l’attentat sont terrés soigneusement, car ils ne peuvent douter que la police les recherche. Rassurez-vous donc, et causons à cœur ouvert.
— Mon cher général, si la possession du secret des poudres a été fatale à Trémont, que l’on rêvait de dépouiller seulement, que ne devra pas craindre Marcel Baradier, si c’est l’ennemi acharné de tous les siens qui conduit la terrible intrigue ? À Trémont, si on avait pu lui voler ses formules on aurait fait grâce de la vie. Marcel n’a aucune pitié à attendre, parce que c’est Graff et moi, parce que c’est sa mère que l’on atteindra en le frappant.
— Nous serons là, pour le défendre, dit Graff d’une voix tremblante. Je ne suis pas méchant, mais je me sens capable de toutes les férocités pour empêcher qu’on fasse du mal à mon neveu !
— Vous comprenez bien, dit le général, que si la police n’a aucun indice sur ce que vous soupçonnez, mon premier soin va être de l’informer…
— Il serait plus prudent de ne pas le faire, interrompit Baradier. Si c’est, comme nous le pensons, Lichtenbach qui a dirigé toute cette épouvantable machination, vous pouvez être sûr d’avance qu’on ne la pénétrera pas. Lui et ses complices sont à l’abri de toute responsabilité. La femme, qui paraît avoir été l’agent d’amorçage, aura disparu. L’homme au bras coupé sera soigné, dans un coin, discrètement, à l’étranger peut-être, et le cocher de la voiture, qui a conduit les complices à Vanves, est un affidé de la bande. On ne trouvera rien, soyez-en convaincu. Et le juge d’instruction peut se préparer à classer l’affaire.
— Je le crois comme vous. Mais ce n’est pas une raison pour ne point chercher. D’abord, si Lichtenbach est surveillé, peut-être découvrira-t-on quelque preuve. Mais çà, c’est l’affaire de la préfecture. Parlons d’autre chose. Le général de Trémont laisse, en mourant, sa fille seule, sans appui.
— Pardon, général. Nous sommes là pour la recueillir et la consoler.
— Oui, mon cher ami, je sais que cette enfant peut compter sur vous… Mais elle reste sans fortune. Trémont n’avait que bien peu de chose à lui. Sa retraite était le plus clair de son bien…
— Rassurez-vous. Elle ne manquera jamais de rien. Ma femme est allée, dès ce matin, la chercher au Sacré-Cœur, et l’a amenée ici… Elle ne quittera plus ma fille, et sera traitée comme si elle portait mon nom…
— Je vais toujours lui faire allouer une pension par le ministère…
— Si vous voulez, mais se sera pour l’acquit de votre conscience. Elle n’aura besoin de quoique ce soit. Je me charge d’elle, comme si elle était mon enfant…
— Ne pourrais-je lui parler ? Sera-t-elle en état de me recevoir ?
— Elle a beaucoup de chagrin, mais elle est très calme. Graff va aller la prévenir que vous êtes ici…
L’oncle sortait. Baradier s’approcha du général comme s’il craignait que les murailles pussent entendre ses paroles :
— De vous à moi et en dehors de Graff, qui est un sentimental et un bavard, avons-nous, en cette circonstance, affaire à l’étranger ?
— Comment le savoir, tant qu’on n’aura pas mis la main sur les coupables ? Et, même si on les découvre, comment tirer cela au clair ? Jamais on n’a de certitudes, les agents de l’étranger se tenant toujours à l’abri des responsabilités directes, et d’ailleurs étant désavoués s’ils se laissent prendre. Nous n’aurons jamais que des probabilités. Notre matériel d’artillerie et nos explosifs sont et seront encore, pendant longtemps, un objet d’inquiétude pour les puissances rivales. On connaît bien notre outillage, mais nous perfectionnons continuellement nos projectiles. Il est certain que l’artillerie qui se serait servi de la poudre Trémont aurait eu un avantage écrasant… D’où la tentative faite contre l’inventeur, évidemment…
— Ainsi vous attacheriez un grand prix à posséder la formule trouvée par le général ?
— Un très grand prix. Ce serait rendre à notre pays un service immense que de l’en faire bénéficier.
Baradier devint grave. Il baissa le front, puis avec résolution :
— Mon général, je suis un bon patriote. J’ai combattu pour la France jusqu’à la dernière heure de la guerre. Tous les miens, Lorrains de Metz se sont expatriés pour ne pas vivre au milieu de nos vainqueurs. S’il fallait donner ma vie pour le pays, je n’hésiterais pas. Je ferai plus, je risquerai la vie de mon fils. Si Marcel connaît le secret de Trémont, je vous jure que vous aurez la poudre.
Un éclair de joie brilla dans les yeux du vieux soldat. Sa moustache frissonna. Il tendit la main à Baradier, et d’une voix tremblante :
— Vous êtes un brave homme ! Je vous remercie !
Et comme la porte s’ouvrait, il fit un hum sonore, et reprit son calme. Mme Baradier et Mlle de Trémont entraient précédant Graff. Toujours svelte et élégante, Mme Baradier montrait quelques fils d’argent dans sa belle chevelure blonde. Mais le regard clair, la bouche éclatante rappelaient la jeune fille qu’avait aimée Elias Lichtenbach. Mlle de Trémont vêtue du costume bleu du couvent, mince et brune, offrait dans un visage comme étonné par le chagrin la grâce charmante de ses seize ans. Elle s’avança, sans gaucherie, vers l’ami de son père. Mais aux premiers mots que le vieux soldat lui adressa, des larmes emplirent ses yeux et silencieusement coulèrent jusqu’à sa lèvre. Elle écoutait avec une satisfaction âpre les paroles consolantes et élogieuses consacrées à celui qui venait de disparaître, et son hochement de tête semblait un acquiescement résigné et douloureux aux amertumes de la vie qui commençait pour elle.
Son père, hélas, elle l’avait si peu connu. Resté veuf, de bonne heure, il avait dû confier le soin de veiller sur sa fille, à de graves et pieuses femmes. Elle n’avait donc pas joui, ou bien peu, de la douceur du foyer familial. Sa mère ne lui avait laissé qu’un souvenir attendri et effacé, comme ces doux pastels d’autrefois que le temps décolore. Geneviève cherchait souvent à se rappeler le son de sa voix. Et, dans le fond de sa mémoire, elle ne la retrouvait pas. Quelle tristesse ! Elle n’avait jamais senti sur son cœur la caressante tiédeur d’une affection toujours présente. L’isolement au milieu d’étrangers, bienveillants et sages, tel avait été son lot, jusqu’au jour où la mort avait brisé le lien si fragile qui la rattachait encore à son père. Et quelle lamentable fin, au milieu de cette catastrophe stupéfiante et terrible à la fois, qui la faisait orpheline, et souillait sa pensée en deuil d’idées de violence et de massacre.
Elle n’avait même pas cette suprême consolation de se dire que celui qu’elle pleurait avait eu une mort sereine. Soldat, il n’était pas tombé sur un champ de bataille, savant il n’avait pas succombé victime de ses recherches. Il mourait assassiné lâchement et bassement par des bandits. Elle entendit que le ministre lui déclarait qu’elle pouvait compter sur sa protection. Elle remercia en balbutiant et, étourdie par ses pensées, aveuglée par ses larmes, elle sortit du cabinet avec Mme Baradier, le cœur navré d’avoir compris plus nettement, par les condoléances qu’on lui adressait, l’étendue de son malheur.
Reconduit par Baradier et Graff, silencieux et attristés, le ministre dans l’antichambre trouva le domestique du général de Trémont, qui l’attendait. Le vieux chef regarda avec intérêt le serviteur, dont la figure énergique et finaude lui plaisait :
— Eh bien ! mon pauvre Baudoin, voilà un grand malheur.
— Une grande canaillerie, mon général.
— On t’avait écarté, mon brave, sans quoi tout cela ne serait pas arrivé !
— Ah ! Mon général, sauf votre respect, c’est le cotillon qui a tout perdu à la maison.
— Bon ! Bon ! Ce n’est plus l’heure de parler de ça.
— Excusez, mon général, ce n’est pas manque de déférence pour mon maître défunt. Mais si on ne s’occupe pas de rechercher la coquine, qui a tout conduit dans l’affaire, on ne trouvera rien, et mon général ne sera pas vengé.
— Mais la connais-tu, toi, la femme ?
— Ah ! si je l’avais connue, je serais mort aussi !
Baradier, Graff et le ministre échangèrent un regard. Ce que Baudoin disait là était la confirmation si nette des craintes de Baradier au sujet de son fils, que la menaçante puissance de la femme mystérieuse s’imposa instantanément à la pensée du ministre. Il en avait déjà tant connu, et par lui et par ses prédécesseurs, de ces aventurières, toujours en quête d’une spéculation à tenter, d’une intrigue à conduire, d’un secret à dérober, depuis les vendeuses de croix d’honneur jusqu’aux fouilleuses de tiroirs officiels. Il les aurait pu nommer. Et l’expérience du passé : toutes les imprudences commises, toutes les folies avérées, était là pour prouver la vérité de ce que déclarait ce dévoué et naïf Baudoin. Le ministre reprit :
— Comment veux-tu qu’on trouve la femme, si personne ne l’a connue que celui qui est mort ?
— Mon général, j’ai entendu sa voix, hier soir, et je réponds bien que, si jamais elle parlait devant moi, je ne m’y tromperais pas…
— Ah ! la voix, mon pauvre garçon, une voix entendue, un seul instant, et prononçant quelques paroles… Comment oser accuser quelqu’un sur un si faible indice ?… Sais-tu qu’il y a des voix si semblables qu’on s’y trompe, même quand on est familier avec ceux qui les possèdent ?… Si tu n’as pas d’autre preuve à fournir que celle-là, mon pauvre Baudoin, tu feras mieux de te tenir tranquille…
— Nous verrons, mon général.
— Ah ! tu es têtu ?
— Un peu, mon général.
— Eh bien ! Qu’est-ce que je peux faire pour toi ? Tu as été bon soldat, serviteur dévoué… J’imagine que ton maître m’aurait recommandé de ne pas t’abandonner… Veux-tu entrer comme huissier au ministère ?
— Merci, mon général. M. Baradier m’a proposé de me prendre chez lui et j’ai accepté… Mais si mon général voulait être très bon pour moi…
— Eh bien ! Parle…
— Mon général me dirait le nom de l’agent du ministère qui a fait l’enquête… Il m’a paru que c’était un solide et un fameux ! Je voudrais causer avec lui.
— Il s’appelle Laforêt. Mais garde ce nom-là pour toi. J’ai assez de confiance pour te le dire. Il ne faudrait pas cependant qu’il fût connu.
— Mon général peut être tranquille ; un tombeau pour la discrétion !
— Allons ! Bonjour !
Le ministre donna la main à Baradier et à Graff, regagna son coupé et partit. Quand les deux associés rentrèrent dans le vestibule, Baudoin, à qui ils désiraient parler, avait disparu.
À peine en possession du nom de l’agent, Baudoin avait pris son chapeau, et sortant par les communs de l’hôtel, il s’était dirigé vers le ministère. Dès l’entrée il s’était informé. Ancien soldat, il savait parler aux militaires. Un planton rencontré dans le vestibule lui avait indiqué le bâtiment où il fallait s’adresser. Au fond de la cour, escalier C. Là, le concierge l’avait arrêté ; on ne pénétrait pas dans les bureaux sans autorisation. Il n’en avait pas. Il fallait en demander une.
— Mais je voudrais parler seulement à M. Laforêt…
Le concierge le regarda d’un air soupçonneux, puis il dit :
— M. Laforêt ?… On ne le trouve pas au ministère. Voyez à son domicile particulier…
— Quel est-il ?
— Renseignez-vous.
Il était bien évident pour Baudoin qu’il se heurtait à une consigne. Il savait qu’il n’y avait pas à aller contre. Il salua, remercia et sortit. Dans la rue Saint-Dominique, au coin de la rue Martignac, il avisa un petit café. Il y entra pour réfléchir, et peut-être se renseigner, comme l’y avait engagé le concierge. Il poussa la porte et pénétra dans la première salle. Quatre négociants du quartier, sous l’œil complaisant du patron, jouaient à la manille. Dans une salle, au fond, sur un billard vu de biais, des billes roulaient. Les joueurs se voyaient confusément chaque fois qu’ils passaient devant la porte. Une galerie paraissait assister à la partie. Peut-être une poule était disputée par des amateurs.
— Monsieur désire ? dit le garçon.
— Un bock… Mais dites-moi, vous avez donc une académie de billard ici ?
— Ah ! monsieur, nous avons de forts joueurs… Quelques-uns de ces messieurs du ministère viennent tous les soirs… Et M. Trousset, sous-chef, est un amateur qui pourrait piger avec les plus malins de Paris et même de l’étranger !
— Ah ! Vraiment ? Et peut-on regarder la partie ?
— Si monsieur le veut, je porterai le bock de monsieur dans l’autre salle.
Baudoin déjà franchissait la porte. L’arrière-boutique, très vaste, contenait deux billards, séparés par des banquettes et des tables. Sur l’un se disputait le match, qui avait attiré une vingtaine d’assistants. Sur l’autre un cazin réunissait une demi-douzaine de participants. Baudoin s’assit et examina. L’un des joueurs était un gros réjoui, qui accompagnait ses carambolages et ceux de son adversaire de plaisanteries déjà usées en province. L’autre grand, brun, sec, était M. Laforêt lui-même. Baudoin se frappa sur la cuisse, prit une cigarette dans sa poche, et s’écria au grand étonnement de son voisin :
— La veine y est !
Regardé curieusement, il se tut, alluma sa cigarette et huma sa bière. Le gros réjoui dit à son adversaire, en clignant de l’œil :
— Les billes sont dans le coin. À nous la belle américaine !
Là-dessus il fit une série de dix-sept carambolages et manqua le dix-huitième. Laforêt sans se démonter reprit la queue, mais il ne put marquer que cinq points. Son adversaire fit claquer sa langue :
— Je joue pour quinze, mon enfant, je crois que vous pouvez écrire à votre famille !
Il gagna sans le moindre effort, baissa ses manches de chemise qu’il avait relevées jusqu’aux coudes, enfila sa redingote et tendit la main à son adversaire :
— Sans rancune, aucune ?
— Vous avez très bien joué, monsieur Moussin, dit Laforêt. À bientôt ma revanche.
— Quand vous voudrez.
Laforêt, avec une complète indifférence, s’approcha de Baudoin, dit très haut :
— Garçon, un bitter.
Et, se penchant vers le brosseur du général :
— Est-ce que vous me cherchez ?
— Oui. Vous m’avez donc reconnu ?
— C’est mon état de reconnaître les gens. Est-ce qu’il y a du nouveau ?
— Non, mais il faut que je cause avec vous.
— Bon !
Les curieux passaient peu à peu, dans la salle du devant, plus gaie et plus claire. Les joueurs de cazin, seuls, restaient à tourner autour de leur billard. Baudoin et Laforêt se trouvèrent isolés :
— Vous pouvez parler ici, personne ne s’occupera de nous. Allez, je vous écoute.
— Eh bien ! Voilà : ce matin, quand je vous ai vu au milieu de tous les personnages qui étaient présents, j’ai eu l’impression que vous étiez un homme sur lequel on pouvait compter et que, s’il était nécessaire de s’adresser à quelqu’un, pour une besogne difficile ou dangereuse, il n’y aurait pas de risque avec vous d’être lâché… Me suis-je trompé ?
— Non.
— Je ne sais pas si je fais erreur, mais il me semble que vous n’êtes pas dans les mêmes conditions que les agents qui sont embrigadés à la préfecture, et qui doivent exclusivement leurs services à l’administration. Vous êtes, comment dirai-je ? une espèce de volontaire de la police, un irrégulier, enfin qui donne des renseignements à sa manière, et comme il lui plaît. Libre par conséquent d’avoir de l’initiative…
Laforêt l’interrompit :
— Si c’est au sujet de l’affaire de Vanves, que vous vous adressez à moi, je vous arrête tout de suite : mon chef m’a ordonné de ne plus m’en occuper jusqu’à nouvel ordre. Le parquet est en possession de l’instruction… Chacun son département. Nous ne nous en mêlerons plus, provisoirement…
— Alors si je vous demandais de m’éclairer de vos conseils ?…
— On peut toujours donner des conseils.
— Eh bien ! La police va chercher les auteurs du crime dont mon maître a été la victime. Mais moi je voudrais chercher de mon côté…
— Qui vous en empêche ?
— Ah ! il faut savoir s’y prendre. On ne s’improvise pas chasseur… Par quel bout dévider cet écheveau là ?…
— Voyons. Votre patron avait-il de la famille ?
— Une fille.
— Elle n’avait aucun intérêt à le faire disparaître ?
— Aucun, au contraire !
— Lui connaissiez-vous une maîtresse ?
— Comment l’affirmer ? Il était si défiant ! La femme qui venait chez lui ne se présentait qu’en grand mystère, à la nuit, et il m’éloignait.
— C’est la femme qui est venue hier soir ?
— Oui.
— Connaissiez-vous des ennemis à M. de Trémont ?
— Non.
— Quelqu’un avait-il des raisons de lui nuire ?
— Dans un certain sens. Oui.
— D’où proviennent vos soupçons ?
— Oh ! De mes observations personnelles, confirmées par la conviction d’un ami de mon maître…
— Homme offrant des garanties ?
— Absolues.
— Eh bien ! C’est de ce côté-là qu’il faut chercher.
— Si vous saviez à quelles difficultés je vais me heurter.
— Il n’y a que cela d’intéressant. Comme c’est malin de prendre un charbonnier qui a assommé sa femme à coups de bûches, dans son arrière-boutique, ou un coiffeur qui a coupé le cou à sa maîtresse avec un de ses rasoirs ! Ce qui passionne, c’est la lutte, la poursuite, la nécessité de ruser, d’inventer. Nous autres policiers, nous sommes tous des gens d’imagination, et les romanciers nous font souvent rire par la pauvreté de leurs combinaisons.
— C’est que vous avez l’amour du métier. Ce n’est pas comme moi. Je ne suis pas curieux. Je ne désire pas apprendre ce que je ne connais pas. Et si je n’avais la rage au cœur d’avoir vu massacrer mon maître que j’aimais tant, je me garderais bien de mettre le doigt dans les affaires des autres. Mais venger mon général c’est, il me semble une consigne qu’il me donne. S’il a eu le temps de se reconnaître au moment où il a été frappé, il a dû penser : ah ! si Baudoin était là ! Il me défendrait jusqu’à la mort. Vous voyez bien qu’il faut que je retrouve ses meurtriers. Je n’aurai pas de repos avant d’y avoir réussi.
Laforêt était devenu pensif. Au bout d’un instant il dit :
— Vous êtes un brave garçon. Mais vous n’avez pas le tour de main qu’il faut pour débrouiller, si c’est possible, une affaire comme celle-là. Vous allez tout gâcher, en mettant sur leurs gardes, les gens que vous soupçonnez. Ne bougez pas. Attendez. La patience est la première vertu d’un policier. Le temps, est un auxiliaire précieux. Dans les premiers moments un criminel prend des précautions, il se méfie. Peu à peu, avec le sentiment de la sécurité, sa prudence diminue, il se risque, il se découvre, et c’est là qu’on a belle pour le prendre. Au lieu de vous mettre en campagne, restez inactif. Si vous avez affaire à des gens puissants et déterminés, soyez sûr qu’ils vont vous surveiller comme leur intérêt l’exige. Vous ferez plus pour le succès de votre partie, en leur laissant croire que vous ne les soupçonnez pas qu’en manœuvrant contre eux, sans savoir comment les confondre. Rentrez chez vous, prévenez ceux qui, comme vous, désirent venger le général et attendez les événements. Soyez sûr qu’il s’en produira un qui vous mettra sur la piste. Alors, marchez hardiment. Et, si vous avez besoin de moi, venez me trouver ici, vers cinq heures. Vous m’y rencontrerez régulièrement. Mon chef sera peut-être disposé à me permettre de travailler avec vous.
Baudoin se leva :
— C’est bien. Je vais suivre votre conseil. Si vous avez encore quelque chose à me dire, faites-moi prévenir chez MM. Baradier et Graff.
— Les banquiers de la rue de Provence ?
— Oui.
— Eh ! Le patron est allé chez eux, tantôt, en quittant le ministère… Je l’ai su par le cocher… Bon ! Tout s’arrangera très bien, quand le moment sera venu. Au revoir.
Les deux hommes se serrèrent la main et Baudoin reprit le chemin de la maison Baradier.
Marcel, appelé par dépêche, venait d’arriver d’Ars. Il était enfermé avec son père et son oncle, en grande conférence. Mme Baradier même avait été éloignée. Marchant de long en large, dans le cabinet, Marcel répondait brièvement aux questions qui lui étaient posées. Grand, svelte, blond, avec de longues moustaches et des yeux bleus, il offrait le type lorrain dans toute sa robuste pureté. C’était un magnifique garçon et le regard de l’oncle Graff le suivait avec une satisfaction attendrie.
— Enfin qu’est-ce que Trémont t’a dit la dernière fois que tu l’as vu ?
— Nous n’avons, au point de vue scientifique, parlé que de mes recherches sur l’aniline.
— Pas un mot de ses poudres ?
— Il m’avait confié déjà tout ce qu’il avait d’acquis, comme résultat. Je partageais son avis que l’essentiel était trouvé. Il n’y avait plus à apporter, dans la confection des explosifs, que des détails de manipulation, des tours de main…
— Et tu connaissais ses formules ?
— Je les connais toutes.
— Tu pourrais les reconstituer ?
— Sans aucune difficulté.
— Voilà ce que je craignais, s’écria Baradier avec émotion.
— Comment ! Ce que tu craignais ? Mais c’est un grand bonheur pour tout le monde. Pour Geneviève, dont la fortune est assurée, pour l’armée qui possédera la poudre Trémont, et pour la mémoire du général, qui bénéficiera de la gloire attachée à une découverte aussi importante…
— Eh bien ! moi, dit Baradier, d’une voix tremblante, je te supplie, au nom de nous tous et de toi-même, de ne pas souffler mot, provisoirement, à qui que ce soit, de ce que tu viens de nous révéler. C’est une affaire de vie ou de mort. Tant que les gens qui ont tué Trémont ne seront pas découverts, poursuivis et punis, il n’y aura pas de sécurité pour ceux qui pourront être soupçonnés de posséder son secret scientifique. C’est pour le lui dérober qu’on l’a frappé. Au nom du ciel, cache soigneusement que tu as reçu les confidences de notre ami…
— Calme-toi, dit le jeune homme en souriant, nul ne le sait que mon oncle et toi. Je n’ai pas envie de le crier sur les toits. Mais je ne renonce pas à en tirer parti, à un moment donné, même s’il y a des risques à courir.
— Nous non plus. Mais poursuivons notre examen. Trémont était très libre avec toi. Il te parlait de sa vie intime… Il faisait volontiers le sous-lieutenant, et te racontait ses aventures…
— Pauvre homme ! C’était sa faiblesse. De cœur, il n’avait pas vieilli. Son imagination était restée inflammable. Il s’emballait avec une facilité sans pareille… Et souvent je me voyais obligé de le gronder doucement. De nous deux, c’était lui le mauvais sujet.
— Et pourtant !… grogna Baradier.
— Oui, dit en riant Marcel, je ne puis pas me donner comme un modèle de sagesse.
— Et dans ces derniers temps ne t’avait-il rien raconté ?
— Non. Il paraissait préoccupé, et se livrait moins que d’habitude. Peut-être lui avait-on recommandé une discrétion particulière et s’y croyait-il tenu ? Mais il ne me disait pas, en se frottant les mains, à la fin d’un déjeuner, suivant la formule de ses habituelles confidences : « Mon cher, vois-tu, une petite femme délicieuse ! » Elles étaient toujours délicieuses, quelles qu’elles fussent ! Il avait des modistes, des danseuses, des cocottes, des petites bourgeoises, toutes délicieuses ! Je ne vous cacherai pas que cette rage d’amour, à soixante ans, m’écœurait un peu et que je ne provoquais pas des récits dont l’enthousiasme me paraissait d’une sénilité indigne du noble esprit de notre ami. En le trouvant réservé et muet, dans ces derniers temps, je ne l’ai donc pas poussé à parler. Il se taisait et j’aimais mieux ça.
— Quel dommage ! C’était le seul moment où il eût été utile qu’il s’expliquât !
— C’est toujours ainsi.
— N’avait-il pas fait de connaissances masculines nouvelles ? N’as-tu surpris aucun nom ?
— Il ne m’a parlé que d’un savant étranger, avec lequel il était entré en relations et qu’il donnait pour un homme extraordinaire… Il le soupçonnait d’être nihiliste, et cela le taquinait… Mais il s’exprimait sur son compte avec admiration…
— C’était un russe ?
— Je l’ignore… Il l’appelait Hans…
— Hans ! s’écria Baradier. Mais c’est le nom de l’homme au bras coupé ! C’est le nom qui est gravé sur l’anneau que portait au doigt celui qui a provoqué l’explosion de la maison de Vanves… Voilà un premier éclaircissement… Ainsi le général connaissait ce Hans ? Mais Hans c’est un nom allemand ?
— Ce n’est même qu’un prénom allemand… Mais vous n’ignorez pas qu’il y a beaucoup de Russes qui sont d’origine allemande… Si le Hans en question est l’auteur de la catastrophe, le but qu’il se proposait d’atteindre, en s’introduisant auprès du général, pouvait être l’obtention des formules de l’explosif trouvé par lui… Mais alors comment avait-il eu connaissance des découvertes que le général tenait rigoureusement secrètes ?
Graff qui n’avait point parlé, écoutant, rêveur, les observations échangées par son beau-frère et son neveu, agita la main pour demander le silence, et lentement, comme s’il suivait le fil très ténu d’une idée encore fugitive :
— Vous vous égarez. Les mobiles auxquels ont obéi les auteurs du crime – car ils sont certainement plusieurs – sont d’un ordre beaucoup plus élevé que vous ne le supposez. Vous cherchez ou des voleurs, essayant de s’approprier une découverte fructueuse, ou des révolutionnaires, à l’affût d’un puissant moyen d’extermination. Tout cela est vulgaire. Vous avez affaire à de plus grands criminels. Le soin qu’ils ont pris de détrousser Trémont, après l’avoir tué, prouve que ses meurtriers ont voulu donner le change. Quand on a une maison à piller, on ne s’attarde pas à chiper une montre et un porte-monnaie. Les allures mystérieuses des gens qui ont fait le coup sont celles de conspirateurs politiques et ce qui achève de donner à la machination sa valeur spéciale, c’est la présence d’une femme. Toutes les entreprises intéressant la politique étrangère, depuis un siècle, ont été conduites par des femmes. À mon point de vue, voici en gros ce qui a dû se passer. Un État ou plusieurs États européens ont eu connaissance des travaux entrepris par Trémont. Ses communications à l’Institut ont pu suffire pour donner l’éveil. Immédiatement on a cherché les moyens de s’introduire dans son intimité et de capter sa confiance. Le caractère de notre ami a été étudié, on l’a su facile aux entraînements amoureux. On lui a détaché une jeune, jolie et habile femme qui a servi d’intermédiaire, bientôt, entre le général et le sieur Hans. Ce dernier n’est pas un Russe, c’est quelque Badois. La femme est une espionne au service de nos ennemis. L’homme, introduit dans la place par la femme, a échoué dans sa tentative de s’emparer, par la ruse, des secrets de Trémont. Alors il a eu recours à la force. Mais soyez sûrs que le coup était risqué dans un intérêt bien plus élevé que vous ne le supposez. Vous voyez un Lichtenbach, dans l’affaire. Vous croyez que c’est à son profit que l’inconnue et le Hans jouaient une si périlleuse partie ? Vous lui donnez plus d’importance qu’il n’en a. Il faut chercher plus haut. Ou plutôt il ne faut pas chercher. Car on ne trouvera plus rien.
— Je ne prétends pas, répliqua Baradier, que ce que Graff explique n’ait pas quelque apparence de vraisemblance. Graff est un homme d’imagination. Il va souvent chercher midi à quatorze heures. Mais dans la circonstance présente, il faudrait être hardi pour affirmer qu’il se trompe. Peut-être y a-t-il, à la fois, de son hypothèse et de la mienne dans la réalité des faits. Ce qui n’est point douteux, c’est que les auteurs de ce coup audacieux sont des gens qui ne reculent devant rien. Donc soyons prudents et n’ayons pas l’air de les soupçonner. Vivons comme nous avons l’habitude de le faire. Abstenons-nous, en apparence, de toute participation à l’œuvre de la justice. Si l’instruction aboutit nous aurons satisfaction, sans nous en être mêlés. Si elle ne trouve rien, comme c’est probable, il sera toujours temps pour nous d’agir. J’estime que des criminels habiles et de sang-froid sont presque impossibles à découvrir. Ce n’est que par leur imprudence qu’ils donnent prise sur eux. C’est quand ils commenceront à ne plus se tenir sur leurs gardes qu’il y aura chance de recueillir quelque indice de leur culpabilité. Donc, attendons. C’est la plus prudente et la plus habile tactique. Marcel va retourner à Ars…
— Pas avant d’avoir vu Geneviève…
— Sans doute. Tu dîneras avec nous, tu coucheras ici, et tu prendras le train demain matin. Ta mère et ton oncle ne seront pas fâchés de te posséder un peu.
— Et mon père ? demanda le jeune homme en souriant.
— Et ton père, aussi. Je monte, avec toi, chez ta mère. Graff, tu restes au bureau.
— Jusqu’après la signature. Je rentre chez moi et je reviens dîner.
Le père et le fils gagnèrent, par un escalier intérieur, les appartements privés, et, avec étonnement, dans le vestibule trouvèrent un grand valet de pied qui attendait assis sur une banquette.
— Il y a une visite chez ta mère, dit Baradier. Comment cela se fait-il ? Ce n’est pourtant pas son jour de réception.
Ils passèrent par un couloir, entrèrent dans le petit salon de Mme Baradier. Auprès de la fenêtre, assise, son ouvrage dans les mains, mais ne travaillant pas, elle était pensive.
— Comment, tu es là ? dit Baradier. Je te croyais occupée à recevoir…
— La personne qui est ici ne venait pas pour moi.
— Qu’est-ce que cela signifie ? Ce n’est pas pour Amélie. Alors c’est donc pour Mlle de Trémont ?
— C’est en effet pour elle, répondit Mme Baradier, d’un air gêné.
— Mais qu’est-ce que tu as ? demanda le banquier. Il se passe quelque chose d’extraordinaire. Explique toi…
— Ce qui se passe est, en effet, très extraordinaire. La personne qui est ici est une camarade de Geneviève, qui est venue tout exprès du couvent pour lui témoigner son affection et qui est venue seule, suivie d’un homme de confiance, parce que son père n’aurait pas pu se présenter ici…
Le visage de Baradier s’empourpra, ses sourcils se froncèrent :
— C’est donc ?… interrogea-t-il.
Sa femme ne le laissa pas continuer. Ils s’étaient compris d’un regard :
— Oui, mon ami, c’est Mlle Lichtenbach.
Il y eut un silence. Marcel était allé auprès de sa mère, et l’embrassait, regardant du coin de l’œil Baradier qui, arrêté devant la cheminée, s’efforçait d’assigner à l’étrange démarche de la fille de son ennemi sa portée véritable.
— Comment est-elle cette demoiselle Lichtenbach ? demanda Marcel.
— Je l’ai à peine regardée, je te l’avoue, mon enfant. Quand on me l’a annoncée, j’ai été un peu saisie. J’avais Amélie et Geneviève auprès de moi. Je les ai laissées au salon aussitôt que cette jeune fille est entrée. Il m’a paru qu’elle était grande, assez jolie de figure. C’est surtout sa voix qui m’a frappée, une voix claire, douce, charmante.
— Ce n’est pas celle de son père, alors, grommela Baradier.
— Et combien y a-t-il de temps qu’elle est ici ?
— Une demi-heure, au moins.
— Et ma sœur est en tiers, entre Geneviève et Mlle Lichtenbach ?
— Elle ne pouvait pas ne point rester. C’eût été une affectation d’hostilité tout à fait déplacée. Les haines des parents, je l’espère, ne font point forcément partie de l’héritage des enfants…
— Maman, ce que tu dis là est contraire à toute tradition poétique. Vois Roméo et Juliette… Sans les haines héréditaires, que devient la littérature ? Elles font partie du bagage romanesque. Sapristi ! Ne le diminuons pas ! Il s’amincit assez tous les jours !
Baradier, sans écouter son fils, suivait toujours sa pensée. Il murmura :
— Qu’est-elle venue faire ici ? Et pourquoi Lichtenbach l’a-t-il laissée venir ?
— Veux-tu que j’aille le lui demander ? dit gaîment Marcel.
— Tâche d’être sérieux, s’il te plaît, s’écria le banquier. Il ne s’agit pas de plaisanter !
— Oh ! je le sais bien ! Vous ne plaisantez pas souvent ici ! Je vous demande un peu de quoi vous allez vous bouleverser ? Voilà ma mère qui est pâle, et toi qui es rouge ! Tout cela parce qu’une jeune fille est venue consoler sa camarade de pension ! Y a-t-il là quelque chose d’extraordinaire ?
Baradier regarda son fils de travers, et avec irritation lui répliqua :
— Tu es un serin. Laisse-moi tranquille ! Tu n’es pas capable de comprendre !
Marcel s’inclina avec une ironique déférence :
— Grand merci ! Il ne te faut rien pour ça ?
Mais Baradier n’eut pas le temps de se fâcher tout à fait. La porte du salon s’était ouverte et Amélie avait paru sur le seuil :
— Maman, avant de se retirer, Mlle Lichtenbach voudrait te dire adieu.
— Eh mais, je la trouve très bien élevée, cette jeune personne-là, dit Marcel à voix basse. Tu y vas, maman ? Ma foi, je t’accompagne. Il faut que je voie comment elle est.
Vainement Baradier furieux commanda à son fils :
— Marcel, reste ici, je te défends…
Déjà le jeune homme, riant, s’était glissé derrière sa mère, dans le salon.
— Jamais ce garçon-là n’aura le sens commun ! gémit Baradier. Et la porte fermée, il s’assit à la place que venait de quitter sa femme, prêtant vaguement l’oreille au bruit des voix qui parvenait maintenant jusqu’à lui.
Dès le premier coup d’œil, Marcel Baradier remarqua que Mlle Lichtenbach avait une tournure élégante, et un visage d’une grande douceur. À l’examen, il ne la trouva pas jolie. Ses traits étaient irréguliers. Mais son visage était éclairé par des yeux d’un bleu limpide qui rayonnaient la franchise et la bonté. Elle se tenait debout, svelte et droite, dans son uniforme sombre, le ruban bleu sur la poitrine. À Mme Baradier, qui lui présentait Marcel, elle répondit par une inclination respectueuse, et de sa voix délicieuse elle dit :
— J’ai tenu, madame, à ne point sortir de chez vous, sans vous offrir mes remerciements pour votre gracieux accueil. J’ai, pour Mlle de Trémont, une vive affection. Nous avons vécu, depuis un an, côte à côte. Et je compatis à sa peine comme si le malheur qui l’a frappée nous était commun… C’est un grand soulagement pour moi, au moment où j’ai le chagrin d’être séparée d’elle, de la savoir près de vous qui l’aimez… J’espère que vous voudrez bien lui permettre de vous parler de moi, afin qu’elle ne m’oublie pas trop vite, et qu’elle fasse, qui sait, pénétrer dans votre esprit, un peu de la sympathie que son cœur contient pour moi…
Marcel était encore sous le charme de cette voix prononçant ces douces paroles, lorsque les yeux clairs se posèrent sur lui, lumineux et profonds. Il leur rendit un regard, curieux et un peu hardi peut-être, car aussitôt ils se voilèrent de leurs paupières. En même temps une légère rougeur, comme accompagnée d’un frissonnement, passa sur ce visage souriant qui soudain devint grave.
— Je vous remercie, mademoiselle, des sentiments que vous exprimez pour notre chère Geneviève et pour nous-même, dit Mme Baradier. Soyez sûre que nous la laisserons libre de ses affections.
Mlle Lichtenbach s’inclina, fit un gracieux signe de tête à Amélie, et, comme elle passait devant Marcel, s’entendit, avec un trouble très visible, dire par le fils de la maison :
— Souffrez, mademoiselle, que je vous reconduise.
Il ouvrit la porte du salon, et prenant la mante que la jeune fille avait laissée dans le vestibule, il lui en couvrit les épaules. Puis l’accompagnant, devant sa mère et sa sœur stupéfaites, il descendit avec elle, suivi par le valet de pied, l’escalier qui conduisait à la grande cour. Là, avec une liberté pleine de grâce, il dit, marchant à côté de Mlle Lichtenbach :
— Le départ de Mlle de Trémont va vous faire juger sans doute un peu triste votre séjour au couvent, mademoiselle ?
— Oh ! J’espère que Geneviève ne m’oubliera pas, et viendra me voir…
— Et puis, il est probable que vous ne resterez pas longtemps vous-même au Sacré-Cœur…
— Je suis, comme était Mlle de Trémont, seule avec mon père… Geneviève, en Mme Baradier, va retrouver une mère… Et moi…
Elle ne continua pas sa phrase. Mais Marcel comprit bien la tristesse de la pensée. Moi, je resterai abandonnée, comme je l’ai été pendant toute mon enfance. Ma jeunesse s’écoulera entre les tristes murailles d’un couvent, sous la surveillance froide et méthodique de religieuses excellentes, mais incapables de me donner la chaleur d’affection dont j’aurais besoin pour être heureuse. Mon amie me quitte et toute la douceur de ma vie s’en va.
Ce fut si mélancolique et si résigné que Marcel en fut ému. Il regarda la jeune fille avec intérêt. Ils étaient arrivés auprès du coupé, dont le valet de pied ouvrait la portière.
— Non, mademoiselle, dit Marcel, soyez sûre que Geneviève de Trémont ne vous oubliera pas.
Il fixa ses yeux sur le visage de Mlle Lichtenbach, qui, au grand jour de la rue, s’offrait délicat et fin dans sa grâce pudique, puis s’inclinant il ajouta un peu plus bas :
— Je ne crois pas que vous soyez de celles qu’on puisse oublier.
Mlle Lichtenbach salua avec un sourire, et montant dans la voiture, elle dit au domestique :
— À la maison.
Aucune parole de plus ne fut échangée pendant que le valet de pied grimpait sur le siège et que le cocher rassemblait ses rênes. Marcel, tête nue sur le trottoir de la rue de Provence, regardait par la glace du coupé cette jeune fille qu’il ne connaissait pas une heure avant, et qui lui apparaissait simple et touchante. Mlle Lichtenbach baissait le front, mais un sourire persistait sur ses lèvres. La voiture partit et le charme fut rompu.
Reprenant le chemin de la maison, Marcel se dit : Si le père est une canaille, c’est bien dommage pour la fille, car elle est délicieuse ! Il continua sa marche et comme il ouvrait la porte des bureaux : Après tout, pensa-t-il, elle n’est pas responsable de ce qu’a pu faire monsieur son père. Il entra dans le cabinet paternel et conclut : Et puis, au fond, tout ça m’est égal. Il est infiniment probable qu’elle et moi, nous ne nous retrouverons jamais en présence. Alors qu’elle soit ce qu’elle voudra ! Néanmoins il ne put écarter cette idée que Mlle Lichtenbach, fille de l’ennemi déclaré de Baradier et Graff, était une personne tout à fait particulière, et qui, où qu’elle fût, ne passerait jamais inaperçue.
— Eh bien ! lui dit son père, qui guettait son retour. Tu te mets en frais pour cette petite personne ! Qu’est-ce que tu ferais donc de plus pour une princesse ?
— Mais rien, répondit tranquillement le jeune homme.
— Veux-tu avoir la bonté de m’expliquer pour quelle raison tu t’es livré à ces démonstrations vis-à-vis de la fille de notre ennemi ?
— Pour l’unique raison qu’elle est la fille de votre ennemi.
— C’est peut-être très chevaleresque, mais cela me paraît stupide.
— Est-ce que tu as l’intention de mêler les femmes à tes querelles ?
— Je voudrais voir comment Lichtenbach traiterait ta mère et ta sœur si elles tombaient jamais sous sa coupe !
— Espérons que nous ne le verrons jamais. Mais de ce que Lichtenbach serait capable, d’après toi, de se conduire comme un drôle, s’ensuit-il que les Baradier et Graff soient tenus de se comporter comme des pleutres ? Demande à mon oncle ce qu’il en penserait ?
— Eh ! Ton oncle est un vieux sentimental. Et ce n’est pas avec des sentiments qu’on lutte contre un gredin comme Lichtenbach. Depuis une heure, je me creuse la cervelle pour découvrir les motifs de l’intervention de sa fille… Car c’est assurément lui qui a eu l’idée de cette visite… Évidemment il a voulu nous donner le change par une démonstration affectueuse envers Mlle de Trémont. Mais c’est justement cette affectation de sympathie qui me met en éveil… Oh ! Ce Lichtenbach est dans l’affaire ! J’en jurerais ! Sa haine, son intérêt, tout l’y poussait. Mais comment le prouver ?
— La justice est saisie.
— Oh ! La justice ! Est-ce qu’elle découvre les crimes ? Sais-tu ce que le conseiller Barentin, qui est une lumière à la chambre criminelle de la cour de cassation, me disait dernièrement ? Sur cent crimes commis, il n’y en a pas vingt-cinq dont on découvre les auteurs. Et encore c’est par leur imprudence. Mais des gens riches, puissants, froids, calculant bien leurs coups sont presque sûrs de l’impunité.
— Mon cher père, si toute la machine judiciaire, mise en branle pour découvrir un meurtrier, est impuissante à le saisir, par ses gendarmes, ses agents, ses procureurs et ses juges, comment voudrais-tu que Baradier et Graff y pussent réussir ? À l’impossible nul n’est tenu. Il faut un peu de philosophie, dans la vie. Nous réparerons le crime commis, dans la mesure de nos forces : toi en protégeant Mlle de Trémont, ma mère en l’aimant, et moi, en lui assurant la fortune que lui promettait son père. Pour le surplus, laissons faire aux Dieux.
— Laissons faire aux Dieux ! grogna Baradier. Laissons faire plutôt au Diable ! Rappelle-toi ce que je te dis, Marcel. Aux différends entre Lichtenbach et ton oncle, Trémont a été mêlé, j’ai été mêlé, ta mère a été mêlée. Lichtenbach est de ces hommes vindicatifs qui font payer les fautes à ceux qui les ont commises, et à leurs descendants… Trémont est frappé, notre tour viendra à tous…
— Non, mon père, le tour d’aucun de nous ne viendra, dit Marcel avec énergie, parce que je te le jure, à la première menace, à la moindre tentative, j’irai, moi, au Lichtenbach, et je réglerai tous nos comptes avec lui en une seule fois.
L’oncle Graff, rasé de frais, élégamment vêtu, rentrait dans le bureau. Baradier fit signe à son fils de se taire, et tous trois montèrent chez Mme Baradier.
IV
Dans son cabinet aux sévères et froides boiseries peintes en gris, Elias Lichtenbach, assis devant un large bureau Louis XIV, causait à voix basse, comme s’il craignait d’être entendu, avec un prêtre nonchalamment étendu dans un fauteuil profond. Le banquier, à la mourante lueur du soleil entrant par la croisée, montrait une tête osseuse et revêche, grisonnante, aux yeux saillants et aux lèvres minces soigneusement rasées. Ce n’était plus le rubicond et plantureux Elias des années anciennes. Les préoccupations de la vie avaient séché la fleur de jeunesse sur les joues, labouré de rides le front insouciant. Les mâchoires étaient toujours proéminentes, mais durcies et maigres, elles étaient inquiétantes, comme celles d’un puissant et féroce carnassier. Les mains velues, posées sur le bureau, longues et prenantes, étaient révélatrices de l’âpreté au gain. Une calotte noire couvrait le front dégarni de Lichtenbach. Son interlocuteur était un ecclésiastique jeune, élégant, au visage gracieux et fin. Il parlait avec une pointe d’accent méridional qui donnait à sa voix une sonorité joyeuse, que Lichtenbach s’efforçait de modérer par des recommandations inutiles :
— L’affaire, disait le jeune prêtre, sera très belle. Les terrains que nous avons en vue n’ont, actuellement, aucune valeur, ce sont des landes et des marais. L’acquisition se fera en votre nom, et quand nous aurons signé un bail emphytéotique avec vous, nous nous mettrons aussitôt à construire… Il faudra une avance de trois cent mille francs…
— Cela n’offrira aucune difficulté, dit Lichtenbach, j’ai des prêteurs tout disposés.
— Sans aller bien loin, n’est-ce pas ? fit le jeune prêtre, en montrant d’un ironique coup d’œil le tiroir du bureau sur lequel le banquier étendait ses mains redoutables.
— Non, monsieur l’abbé, pas loin, en effet, mais pas ici, cependant… J’ai pour principe de ne jamais avancer de fonds que sur valeurs immédiatement réalisables. Or, l’affaire que vous venez de développer devant moi ne présente aucune garantie actuelle… Mais il n’importe. Pourvu que je vous trouve des capitaux…
— C’est l’essentiel, en effet. Pourtant nous ne voulons avoir à compter qu’avec vous… Ces messieurs ne placent point légèrement leur confiance. Ils vous la donnent, parce qu’ils sont sûrs de vous… Mais ils ne l’étendraient pas à des inconnus.
— Ces messieurs, comme toujours, n’auront affaire qu’à moi, dit Lichtenbach avec déférence. Je sais ce que je leur dois. Ils me trouveront toujours à leur service.
— Donc, aussitôt les terrains achetés et mis à notre disposition, nous construisons, et nous faisons pratiquer les fouilles qui révéleront la présence dans le sous-sol des gisements de minerai dont je vous ai parlé. Brusquement la valeur du sol décuplera. Vous revendrez une faible partie des terrains, et, avec le bénéfice, nous nous trouverons, sans bourse délier, avoir payé l’établissement de notre Communauté.
— Si la teneur du minerai est telle que vous me l’avez affirmée, l’exploitation concédée à une société vous rapportera des revenus importants pendant de longues années.
— C’est sur quoi Monseigneur a compté lorsqu’il a reçu le rapport de l’ingénieur chargé par nous des sondages… Oh ! nous avons besoin de beaucoup d’argent pour mener à bien notre œuvre, soupira le jeune prêtre… La religion est attaquée avec une telle violence, que si nous nous bornons à la défendre, nous sommes perdus. Il faut porter la guerre sur le terrain ennemi…
— C’est mon avis, et vous voyez, monsieur l’abbé, que mon journal s’y emploie avec zèle…
— Oui, vous marchez bien. Mais votre Panache blanc n’est pas assez purement doctrinaire : On s’y occupe trop de spéculations et d’entreprises. Cela sent trop la Bourse dans vos colonnes…
— Monsieur l’abbé, répliqua rudement Elias, je ne possède pas, comme ces messieurs, l’art de faire des affaires sans qu’il y paraisse. Mais j’apprendrai à leur école.
— Allons ne faites pas le jésuite, mon cher Lichtenbach, dit le jeune prêtre d’un air léger. Nous savons apprécier vos services… Vous en avez eu la preuve, vous l’aurez encore… Ah ! qu’est-ce que ce blessé qu’on a recueilli chez nous, à Issy, hier ? Il était fort mal en point, le pauvre diable ! Il s’est recommandé de vous…
Elias devint blême. Il fit un geste alarmé et d’une voix sourde :
— Plus bas ! monsieur l’abbé. Plus bas ! Je vous en prie… Que personne ne se doute…
— Eh ! Comme vous voilà troublé ! Rassurez-vous… M. le Supérieur et moi, seuls, avons eu les confidences de ce malheureux… Il a parlé fort peu du reste. Il était épuisé par les efforts qu’il a dû faire pour se traîner jusqu’à notre porte… Le frère portier qui l’a reçu a aussitôt prévenu le Supérieur. Il était quatre heures du matin… Toute la confrérie était aux matines… On a donc pu, sans que personne le vît, introduire le blessé, dans le pavillon d’entrée… Il était temps… Aussitôt couché, il a perdu connaissance.
— Qui le soigne ?…
— Notre Supérieur lui-même, qui a des connaissances très étendues en médecine… Du reste, le bras du blessé a été coupé comme par un thermo-cautère, et il n’y a eu qu’à faire un pansement… Cet homme a montré un courage héroïque… Mais maintenant il est dévoré par la fièvre, et il parle…
— Que dit-il ?
— Oh ! Des choses extraordinaires et fort mélangées… Il est, à la fois, question d’un camp retranché dans les Vosges et d’une poudre de guerre aux vertus supérieures… Il s’agit de lever les plans de l’un et de se procurer la formule de l’autre…
— Et ne nomme-t-il personne ?
— Il prononce le nom d’une femme, qu’il appelle tantôt Sophia, et tantôt la baronne. Il la consulte, la rudoie et va jusqu’à l’insulter, tour à tour… Elle paraît être sa complice dans quelque œuvre obscure.
— S’est-il expliqué plus clairement ?
— Non, il s’est mis à battre la campagne… Et il est impossible de rien comprendre à ce qu’il raconte… Du reste, le frère portier seul et notre Supérieur l’ont approché aujourd’hui et vous n’avez rien à craindre…
Elias poussa un soupir de soulagement :
— Monsieur l’abbé, croyez que je ne crains rien pour moi, mais je crains beaucoup pour d’autres… Je suis engagé dans de grandes entreprises internationales, vous ne l’ignorez pas. Et les intérêts qui sont remis à mes soins représentent non seulement d’immenses capitaux, mais encore d’innombrables vies humaines. J’ai donc le devoir d’être très prudent.
Le jeune prêtre eut un geste de protestation. Son visage devint grave :
— Je ne veux rien savoir de cela, monsieur Lichtenbach. Ces messieurs, vous ne l’ignorez pas, sont français et rien que français. Tout ce qui se passe au delà des frontières leur est étranger. Pour un peu, je dirais hostile. En dehors de la France, que nous aimons d’une tendresse profonde et éclairée, que nous voulons sauver de la corruption révolutionnaire, nous ne reconnaissons que le Pape, Souverain de tous les catholiques et notre chef aveuglément obéi. Gardez vos secrets. Nous les respecterons, parce que vous nous servez. Mais n’attendez de nous aucune aide pour faire réussir des entreprises qui ne concourraient pas à faire triompher la cause à laquelle nous nous sommes voués : la monarchie et la religion. Pour le reste, vous nous trouverez neutres. C’est tout ce que vous pouvez attendre de nous.
— Vous a-t-on chargé de me le dire ? demanda Elias avec angoisse.
— Non, mon cher Lichtenbach, on ne m’a chargé que de vous entretenir de l’affaire des terrains…
— Merci, monsieur l’abbé… Dites à ces messieurs que j’enverrai, dès demain, un homme de confiance à Grasse pour terminer, et que le mois ne s’écoulera pas avant que nous ne soyons en possession.
— C’est bien…
Le jeune abbé se levait. Il s’arrêta et d’un ton négligent :
— Ah ! j’oubliais… Avez-vous entendu raconter cette affreuse catastrophe, qui a eu lieu à Vanves ? L’explosion nous a fait trembler à Issy… Ne connaissiez-vous pas ce général de Trémont ?
Lichtenbach se voûta, plus creux, plus noir, et répondit en balbutiant :
— Oui, monsieur l’abbé, je l’ai connu, autrefois…
— C’était, paraît-il, un dangereux maniaque, faisant des expériences chimiques, qui devaient fatalement le conduire à la mort… Personnage d’une douteuse moralité, du reste, si l’on en croit le bruit public, et qui, malgré son âge avancé, se livrait à de dégradantes débauches… Ce n’est pas une perte… On dit qu’il a été assassiné et volé, avant que sa maison sautât… Voilà ce que cela rapporte de chercher des poudres !… Allons, au revoir, mon cher Lichtenbach… Quand vous voudrez voir le blessé, vous me préviendrez, je vous mènerai près de lui, en cachette…
Lichtenbach ne répondit pas. Il reconduisit son visiteur, avec une affectation de respectueuse humilité, jusqu’au haut du grand escalier de son hôtel. Là il se courba, comme devant un maître et dit :
— Assurez ces messieurs, je vous prie, monsieur l’abbé, de tout mon dévouement.
— Bon ! Bon ! Ils en sont sûrs, répliqua d’un ton léger le jeune prêtre. Et lentement il descendit les degrés de pierre et disparut.
Lichtenbach pensif rentra dans son cabinet. L’obscurité était peu à peu venue. À la place que venait de quitter l’abbé, une forme féminine s’offrait, étendue dans le fauteuil. Une voix fraîche et sonore dit :
— Il fait noir, comme dans un four, chez vous, Lichtenbach, donnez donc un peu de lumière.
— Quoi, vous êtes là, baronne, s’écria le banquier avec empressement.
— Oui, j’arrive. C’est le petit abbé d’Escayrac qui sort de chez vous ?
Lichtenbach avait tourné le commutateur de l’électricité. Une lumière dorée, tombant du plafond, éclaira la visiteuse sans façon, qu’Elias venait d’appeler : Baronne. C’était une jeune femme blonde, d’une grande beauté : fier profil, yeux bleus, front intelligent, mais avec une expression de dureté dans la bouche mince aux lèvres rouges, et dans le menton volontaire. Elle était vêtue d’une toilette noire très élégante et coiffée d’une capote de dentelles qui donnait plus d’éclat à ses cheveux fauves. Les pieds chaussés de vernis noirs étaient charmants.
— Vous êtes chez moi depuis longtemps ? demanda Elias préoccupé.
— Mais non, je vous l’ai dit : j’arrive. Votre domestique m’a introduite dans le salon, et je suis entrée en entendant partir votre visiteur. Rassurez-vous, je n’ai pas écouté ce qu’il vous a dit.
— Oh ! je ne me défie pas de vous !
— Si, vous vous défiez de moi, comme de tout le monde. Je ne vous en blâme pas. C’est de la prudence. Quoique vous n’ayez rien à craindre de moi, pas plus que moi de vous, du reste.
— Oh ! Baronne, vous savez que je vous appartiens complètement, se récria Lichtenbach.
— Oui, oui, et vous ne seriez pas fâché que la réciproque fût vraie, n’est-ce pas ? interrompit la jeune femme avec un sourire railleur.
Le visage blême d’Elias se colora d’une flamme ; il s’approcha de la baronne, et lui prit la main qu’il pressa entre ses doigts :
— Si vous vouliez, pourtant, Sophia…
Elle retira sa main, agita sa petite tête d’un air de dédain et répliqua :
— Oui, mais je ne veux pas, voilà !
— Ne voudrez-vous jamais ?
— Qui peut le savoir ? Si je suis un jour très embarrassée, comme vos femmes du grand monde, je viendrai peut-être aussi cogner à la caisse… Est-ce que vous me donneriez de l’argent, Lichtenbach, si j’en avais besoin ?
Elle regardait, en parlant ainsi, le banquier, avec des yeux diaboliques et un sourire prometteur. Celui-ci, dès qu’on parlait d’argent, redevenait lui-même. Il posa sa patte sur le genou de la jolie femme, et dit avec assurance :
— Je vous donnerai ce dont vous aurez besoin.
— Vous vous engagez beaucoup. Prenez garde ! Et puis, tenez-vous tranquille. Le moment n’est pas venu.
Elle se reculait un peu, en parlant ainsi, pour se soustraire à la familiarité de Lichtenbach. Celui-ci soupira :
— Ah ! Sophia, vous êtes une terrible coquette… Vous ne prenez plaisir qu’à affoler les hommes.
— Moi ? Vous perdez le sens, Lichtenbach. M’avez-vous jamais vue m’occuper d’un homme, sans que mon intérêt me le commandât ? Et c’est vous qui me dites des niaiseries pareilles. On croirait que vous ne me connaissez pas !
— Si, je vous connais bien. Je vous connais même mieux que vous ne le croyez, car il y a des parties de votre existence, encore si courte, et pourtant si étonnamment remplie, que vous laissez dans une obscurité favorable, mais que j’ai su pénétrer. Vous êtes bien habile, bien hardie, bien rouée. Mais moi, je suis bien tenace, bien patient. J’ai le flair de ce que je dois savoir, et j’ai les moyens de m’informer. Je sais donc très bien ce que vous êtes aujourd’hui, madame la baronne Grodsko. Mais je sais aussi ce que vous étiez avant…
Une lueur jaillit des yeux de Sophia, et ses lèvres se contractèrent, donnant ainsi à sa physionomie un caractère de méchanceté effrayante. Elle regarda audacieusement Elias, et, d’une voix sèche, elle dit :
— Tiens ! tiens ! Racontez-moi donc ça. Je suis curieuse de connaître les histoires que vous avez apprises sur mon compte. Si elles sont vraies, je vous l’avouerai, parole d’honneur. Si elles sont fausses, vous pourrez casser aux gages vos informateurs. Quand on a des espions à sa solde, il faut toujours tâcher de les avoir sûrs et intelligents.
— Les miens ne me trompent jamais. Ils n’ont pas d’intérêt à mentir.
— Nous verrons bien. Donc…
— Donc avant de devenir la femme du baron Elmer Grodsko, noble hongrois, qui s’est brouillé avec sa famille pour vous épouser, vous dansiez et vous chantiez, sur le théâtre de Belgrade, dans une troupe de passage, dirigée par un Valaque, moitié ruffian, moitié escroc, qui paraissait être votre amant. C’est là que le baron Elmer, revenant de Varna, vous vit, vous aima et vous enleva, après avoir abattu d’un coup de revolver maître Escovisco, qui le poursuivait avec un poignard pour l’égorger…
Les lèvres de la jeune femme se plissèrent, ses yeux eurent un regard de dédain. Elle dit :
— Voilà tout ce que vous savez ? Vous ne remontez pas plus loin que le théâtre de Belgrade et l’affaire Escovisco ? Vous faites alors bien du bruit pour peu de chose !
— Oh ! je procédais par ordre. Je puis remonter plus loin, si vous le souhaitez, et vous parler de la mort étrange et mystérieuse de Mme Ferranti, une charitable personne de Trieste, qui vous avait recueillie mourante de misère dans la rue, et prise à son service. Vous aviez seize ans. Votre bienfaitrice avait un fils. Le jour de la mort de sa mère, qui passa pour avoir été empoisonnée, sans qu’on en eût la preuve certaine, le jeune Ferranti partait avec vous, emportant l’argent comptant, les titres négociables et les bijoux de la morte… Était-ce vous, ou lui, qui aviez donné à Mme Ferranti la tasse de thé qu’elle a bu avant de se coucher pour ne se relever jamais ?
— Oh ! mon Dieu ! Ce n’est ni lui ni moi. C’est une vieille domestique, qui était depuis vingt ans dans la maison. Elle l’a avoué du reste, et comme il n’y avait point de preuves contre elle, ni contre qui que ce fut d’ailleurs, elle a été relâchée…
— Quant à vous, vous étiez partie pour Venise avec votre amant, et vous meniez là joyeuse vie. Ah ! il avait une jolie façon de porter le deuil de sa mère, le fils Ferranti ! Ce fut au café Florian, sur la place Saint-Marc, qu’un soir qu’il était gris, ce jeune niais se prit de querelle avec un major autrichien qui le lendemain, au Lido, lui mit six pouces de fer dans le ventre, ce dont il mourut.
— C’est vrai. Pauvre Ferranti ! C’était un gentil garçon, qui valsait à ravir, mais qui aimait trop l’absinthe… C’est cela qui l’a tué, bien plutôt que la stoccata du major Brüzelow… Un bel homme, dont les moustaches faisaient le tour de la tête, mais bête comme son sabre, et aussi dangereux. C’est lui qui me força à quitter Venise, où je me plaisais tant ! Je n’avais plus le droit de parler à un homme, sans qu’il le provoquât. Il aurait défié toute la ville ! Il me fallut partir…
— La police autrichienne y fut pour quelque chose, n’est-il pas vrai ?
— J’ai toujours exécré les Tedeschi, et ils me l’ont bien rendu !
— Encore maintenant, vous ne pouvez pas rentrer en Autriche ?
— C’est cet imbécile de Grodsko qui en est cause !
— Et que devient-il cet excellent Grodsko qui a fait mourir sa mère de chagrin pour vos beaux yeux ?
— Cet excellent Grodsko est à Vienne, en été, à Monte-Carlo, en hiver. Et, l’hiver ou l’été, il joue pour se distraire, et, quand il a perdu, il boit pour se consoler.
— Il perd régulièrement ?
— De sorte qu’il boit toujours.
— Voilà déjà, si je sais compter, quelques cadavres à votre actif, ma belle amie, sans parler des désespoirs, des deuils et des hontes. Vous avez eu une existence bien remplie, quoique vous n’atteigniez guère qu’à la trentaine.
— Vingt-huit ans, depuis la semaine dernière, rectifia froidement la baronne.
— Vous avez marché sur l’humanité, comme sur un tapis, pour arriver à vos fins qui étaient le luxe, le plaisir, et la domination. Et vous voilà, aujourd’hui, plus brillante, plus aimée, plus puissante que jamais, forte que vous êtes d’une volonté qui ne recule devant rien, et d’une conscience qui se prête à tout. Est-ce exact ?
Elle regarda audacieusement Lichtenbach, et tirant de sa poche un étui en argent ciselé, elle y prit une cigarette d’Orient qu’elle alluma avec une tranquillité parfaite, elle souffla la fumée, puis, d’une voix douce, répondant à la question :
— Très exact, quoique incomplet. Je suis bien plus redoutable que vous ne le dites. Et vous le savez très bien, mais vous craignez de me déplaire en me dépeignant telle que je suis en réalité. Vous avez bien tort. J’ai un tel mépris pour l’humanité, que vous ne pouvez me froisser en déclarant que je suis prête à en tirer parti comme d’une marchandise. Les hommes, pour moi, ne sont pas plus intéressants que des bêtes destinées à l’abattoir. Ils servent à me nourrir, à m’enrichir ; ils peinent et meurent pour cela. C’est leur fonction, apparemment, puisqu’ils ne peuvent se soustraire à cette destinée, et qu’à mesure qu’un a disparu, un autre se présente pour le remplacer. Vous allez dire que je suis une destructrice. C’est possible. Il y a, de par le monde, des êtres nés pour le travail, le sacrifice et la souffrance, comme il y en a d’autres créés irrémédiablement pour la paresse, l’égoïsme et la jouissance. C’est la nature qui a tout fait. L’instinct se manifeste, pour les uns, conduisant au servage, pour les autres, menant à la tyrannie. Exploités et exploitants, bêtes de somme et bêtes de proie. N’est-ce pas la seule classification sociale qui ait le sens commun ? Regardez autour de vous, Lichtenbach, c’est une règle invariable : un troupeau de niais conduits, tondus, égorgés par quelques audacieux. Allez-vous me reprocher d’être de ceux qui égorgent, quand vous êtes de ceux qui tondent ? Nous sommes à deux de jeu, mon cher ; seulement, moi j’ai l’audace de l’avouer, tandis que vous avez l’hypocrisie de le taire. Mais nous marchons vers un but pareil, qui est l’exploitation humaine pour notre plus grand profit et notre meilleur agrément. Voilà ! Si ce n’est pas vrai, prenez la parole et réfutez-moi.
Elle avait parlé sans élever la voix, et le ton calme, avec lequel ces terribles théories avaient été exposées par cette bouche charmante, contrastait si singulièrement avec le cynisme féroce de l’aveu, que Lichtenbach, qui, cependant, paraissait sans illusion sur sa belle et dangereuse partenaire, en resta un instant décontenancé. Il n’avait pas beaucoup de scrupules, ce vendeur de toute marchandise, qui avait débuté par rançonner son pays, à l’heure des désastres, et qui continuait à spéculer sur les misères, les tares et les infamies sociales. Mais il se trouvait en face d’une créature plus hardie, plus violente, sinon plus redoutable que lui. Et il pesait, dans sa pensée, les périls qu’elle pouvait lui faire courir et les avantages qu’elle devait lui apporter. Instrument admirable que cette jolie, fine et peu scrupuleuse femme. Il savait ce dont elle était capable, mais il ne voulait pas s’engager aussi loin qu’elle, sans nécessité. Il était riche, lui, puissant. Les aventures, qui offraient à la baronne Sophia ses plus sûrs moyens d’existence, n’étaient pas exploitables pour lui. Autres affaires, celles d’un homme à la veille d’être député, peut-être ministre, et celles de cette cosmopolite industrieuse, battant monnaie avec de la boue et du sang. Il redevint froid. Il avait dit assez de sottises, au début de l’entretien. Le moment était venu de mitiger la confiance de la belle Sophia, et de lui faire comprendre qu’il y avait, entre elle et lui, une barrière formée de millions et de respectabilité.
— À tout prendre, dit-il, ma chère baronne, il y a du vrai dans ce que vous venez d’énoncer, encore que la forme en soit un peu exotique. Vous avez le cynisme oriental, pompeux et déclamatoire. Tout ce que vous avez déclaré, il y a un instant, peut se formuler en peu de mots très simples : l’inégalité humaine est immuable. Il y a des imbéciles et des malins. Les premiers sont exploités par les seconds, sous la surveillance de la gendarmerie et le contrôle de la loi. Vous n’avez pas fait une assez grande part, dans votre théorie, à la loi et aux gendarmes. Je ne saurais trop vous engager à en tenir plus de compte. Ils sont un des facteurs très importants du problème que vous passez votre vie à résoudre. Si vous les considérez comme quantité négligeable, un de ces matins, cela vous jouera un tour.
Elle eut un rire dédaigneux :
— Les petits poissons restent dans les mailles du filet, les gros le déchirent et passent. Je ne crains rien, ni personne, que moi-même. Moi seule, suis capable de me faire du tort. Mais je n’y songe guère.
— Pour l’instant. Mais vous avez connu des heures d’insécurité. On m’a raconté qu’il y a deux ans, à Londres…
Sophia devint sombre. Un pli creusa son front. Elle jeta brusquement sa cigarette dans la cheminée et, d’une voix changée :
— Oui, j’ai fait des sottises, j’étais amoureuse. Et une femme qui aime devient aussi stupide qu’un homme.
— Il s’agissait d’un comédien, si je ne me trompe, le beau Stevenson…
— Oui, Richard Stevenson, le rival d’Irving…
— Vous en avez été folle. Et il vous trompait pour une petite ballerine de l’Alhambra. Alors, un soir, vous avez trouvé moyen d’attirer la fille à bord d’un yacht, que vous aviez loué et qui stationnait sur la Tamise. Depuis, on n’a plus jamais entendu parler d’elle…
— Ah ! Vous connaissez cette anecdote ? Vous êtes vraiment bien renseigné. Et savez-vous aussi que Stevenson à qui, dans une crise de fureur, j’avais déclaré qu’il ne reverrait plus jamais cette sale fille, m’a battue avec sa canne, jusqu’à me laisser pour morte sur la place ?
— La canne donnée par le prince de Galles, sans doute ? C’était flatteur ! Ce qui ne vous empêcha pas d’être, deux jours plus tard, à l’Empire, au premier rang, pour applaudir votre brutal galant…
— Oui, j’aimais ce misérable, comme je sais aimer, à la façon des panthères qui saignent des coups de griffes de leurs mâles et les mordent, elles-mêmes, jusqu’à l’égorgement… C’est fini, heureusement, et me voilà tranquille.
Lichtenbach se mit à rire :
— Tranquille ! Diable ! Que faites-vous donc du beau Césare Agostini ?
— Oh ! Celui-là c’est un joujou… On ne peut pas vivre seule, n’est-ce pas ? Il faut avoir quelqu’un à qui s’intéresser… Mais Césare, c’est une distraction. Ce n’est pas une passion…
— Il vous coûte cher, cependant ?…
— Oh ! Incroyablement ! Ces Italiens sont des bourreaux d’argent. Celui-là connaît une bonne manière de s’en procurer, et dix meilleures de le dépenser. Il est joueur, d’abord, et puis il ne peut pas voir une belle bague sans se la payer… Mais il a aussi ses petits mérites… Il tire le pistolet et l’épée d’une façon supérieure…
— C’est un bravo tout simplement…
— À votre service, mon cher, si vous avez un homme du monde à faire disparaître.
— Il est intrépide ?
— Il est surtout sûr de son coup. Essayez-en, vous serez satisfait…
Lichtenbach se rembrunit, comme toutes les fois qu’on abordait un sujet qui ne lui plaisait pas, et d’un ton rogue, il dit :
— Je vous suis obligé, je ne travaille pas dans le drame. La comédie me suffit.
— Cela vous plaît à dire ! Vous êtes encore de ces bons apôtres qui montrent les coups, les font exécuter, et puis, après, disent d’un air candide : « Moi, je n’y suis pour rien ! » N’êtes-vous point de l’affaire de Vanves, je vous prie ?
Cette fois Elias fut tout à fait mécontent :
— Silence ! De grâce. À quoi pensez-vous de crier à tue-tête ? Sommes-nous seuls dans la maison ?
Elle se mit à rire :
— Eh bien ! Vous m’amusez, par exemple ! Voilà une heure que vous racontez mes histoires, sans aucune précaution, et vous vous effarez parce que je fais une toute petite allusion aux vôtres… Vous voulez bien me compromettre, mais être compromis, non pas ? Très gentil !
— Eh ! Ma fille est ici, et je ne me soucie pas…
— Qu’elle vous connaisse sous votre aspect véritable. Car vous êtes une vraie canaille, vous, Lichtenbach, et de la plus vilaine espèce, celle qui tient à sauver les apparences, même avec ses complices… Est-ce que vous croyez que vous me ferez jamais illusion, hein ? Votre jésuitisme ne m’impressionne pas, votre lubricité m’est connue. Il n’y a pas de plus atroce personnage que vous. Et vous tenez à passer pour un homme vertueux !
Lichtenbach, blême de peur et de colère, fit un geste de supplication :
— Baronne ! En vérité, vous voulez me mettre hors de moi…
— Non ! Ce serait trop laid ! Restez en vous-même, bon Lichtenbach, honnête Lichtenbach. Vous voyez que je suis exquise pour vous. Je baisse le ton. Ma voix n’est plus qu’un murmure. Penchez-vous pour m’entendre. J’ai besoin de cent mille francs, ce soir, pour faire emporter Hans et le transporter à Genève… Il pourra supporter le voyage… Cesare est allé le voir…
— Vous croyez qu’il survivra ? demanda Lichtenbach.
— Oui, ça vous contrarie. Vous aimeriez mieux être débarrassé de lui. Rassurez-vous, il est homme à avaler sa langue, comme font les nègres, plutôt que de trahir un compagnon. D’ailleurs, que sait-il ? Que vos intérêts marchaient parallèlement avec les nôtres et que, s’il avait trouvé les formules de l’explosif pour le commerce, vous les auriez payées aussi cher que ceux, pour qui nous marchions nous auraient acheté la poudre de guerre. Le coup est raté. Hans est estropié. Mais vous êtes à l’abri de tout soupçon, grâce à moi…
Elle prit un temps, regarda Elias avec tranquillité et dit :
— C’est cent mille francs, à compte.
— À compte ?
— Oui, à compte. Et ne lésinez pas. On vous a tué le général de Trémont, que vous haïssiez. Combien donneriez-vous pour les Baradier et Graff ?
— Rien ! rien ! gémit Lichtenbach. Que dites-vous là ? Quels projets me prêtez-vous ? Moi, avoir souhaité la mort du général de Trémont, et vouloir du mal aux Baradier et Graff ? Vous vous égarez ! C’est de la démence ! Certes, ce sont mes ennemis. Ils m’ont fait du mal ! Mais de là à un crime… Oh ! Jamais ! Jamais ! S’ils mouraient, oh ! je considérerais que c’est une faveur du ciel, mais avancer leur dernier instant, d’un jour, d’une heure, d’une minute, moi, Dieu puissant…
— D’Abraham, de Jacob et de Moïse ! Oui, mon bon renégat ! Mon vieil Elias, mon brave Lichtenbach ! dit la baronne avec un regard de mépris… Oui, vous voulez bien accepter les faveurs de la Providence, incarnée pour vous sous les traits de la baronne Grodsko, mais vous n’acceptez pas de paraître la mettre en mouvement. Toujours l’hypocrisie ! Vous ne demandez rien, mais vous acceptez tout ! Eh bien ! On vous exaucera sans prières !
— Baronne ! Au nom du ciel, ne me compromettez pas, sans mon aveu ! Ne marchez pas sans instructions !
— Ah ! ah ! Vous voilà tout effaré ! Vous me rappelez le vieux Trémont, quand je maniais ses produits chimiques, après le dessert… Il était bien amoureux, le brave homme… Il tremblait pour moi : « Ne touchez pas à cela, c’est la mort ! » Pendant ce temps-là, avec de la cire, j’essayais de prendre l’empreinte de la serrure du coffret de fer que Hans a su ouvrir, mais qui lui a si bien amputé le bras… Et pour rien ! Le coffret en sautant a anéanti le secret au milieu des flammes… Mais quelqu’un l’a ce secret. Il faudra bien que je le retrouve… Et de quelque manière que cela soit, je m’en emparerai…
— Que vous a-t-on donc promis, si vous le livrez ?
Elle le regarda en riant :
— Vous êtes bien curieux ! Soyez tranquille. Amour-propre professionnel à part, car enfin on n’aime pas à échouer dans une mission de cette importance, l’affaire en vaut la peine… En attendant, mes cent mille francs, hein !
Lichtenbach ouvrit un tiroir, prit dix liasses de billets de banque et les tendit à la baronne :
— Les voici.
— Merci. À présent, Lichtenbach, que diriez-vous si c’était le jeune Marcel Baradier qui était dépositaire des formules du vieux Trémont ?
Elias se redressa avec une vivacité soudaine :
— Quoi ! Que supposez-vous là ? Qui vous fait penser ?
— Ah ! ah ! ah ! Cannibale, vous venez de sentir la chair fraîche ? Vous voilà tout ragaillardi. Vous devez faire cette mine là, quand vous avez, ici, pimpante et sentant bon, une de ces femmes du monde qui se pâment sans défense à l’aspect de votre coffre-fort…
— Baronne, vous me faites mourir d’angoisse…
— Vous en avez l’air. Eh bien ! Je ne dirai plus que vous êtes un vieux passionné. Jamais, quand vous essayiez de me persuader que vous m’adorez, vous n’avez fait des yeux pareils ! Ah ! la haine, hein ! Lichtenbach, c’est un sentiment bien autrement fort que l’amour ?
Il ne répondit pas. Rien ne comptait, maintenant, que la supposition que soudain Sophia venait d’émettre. Tout ce qui ne se rapportait pas à ce fait, que le fils de son ennemi mortel était peut-être le détenteur du secret si ardemment cherché, disparaissait à ses yeux. Si cela pouvait être ! Si, revanche du sort, il trouvait l’occasion d’écraser ceux qu’il haïssait de toutes ses forces, et, en même temps, de leur arracher des mains une fortune. Il revint plus ardent à la baronne :
— Qui vous donne à supposer que le général avait fait des confidences à Marcel Baradier ?
— Ils se voyaient constamment, d’abord, le jeune homme était admis dans le laboratoire, et c’était une faveur exceptionnelle. Il y travaillait, je le sais, avec Trémont qui n’avait confiance qu’en lui. Enfin l’inventeur a parlé devant moi. Si mystérieux que soit un homme, si fermé, si farouche, il vient fatalement une heure où il faut qu’il s’épanche. Le général n’aurait jamais rien laissé pénétrer de ses projets, à un homme, fût-ce son meilleur ami. Il était soupçonneux comme un renard… Mais, après dîner, un bon cigare dans les dents, et quand je le regardais d’une certaine façon, il éprouvait le besoin de m’éblouir, et comme ça ne pouvait être ni par sa jeunesse ni par sa beauté, c’était par son génie qu’il essayait de me séduire. Il a ainsi, en plusieurs fois, lâché beaucoup de petites choses, qui, réunies et coordonnées par une bonne mémoire, ont formé une grosse certitude…
— Ainsi tout ne serait pas perdu ?
— Rien n’est jamais perdu !
— Et alors, baronne, qu’allez-vous faire ?
— Vous le saurez quand j’aurai intérêt à vous le dire.
— Vous n’avez pas confiance en moi ?
— Sous quel prétexte aurais-je confiance en vous ? Je vous connais, mon brave homme. Vous me servirez jusqu’au jour où vous trouverez plus avantageux de me desservir…
— Moi !
— Vous, Elias Lichtenbach, mais ça m’est égal. Je vous tiens.
— Avez-vous l’espoir de réussir ?
— J’ai toujours l’espoir de réussir. Regardez-moi donc, s’il vous plaît.
Elle renversait la tête dans un mouvement d’une grâce voluptueuse, qui mettait en valeur la souplesse de sa taille, la rondeur palpitante de sa gorge. Elle sourit et ses yeux, ses lèvres, eurent une expression d’ardeur passionnée, qui fit courir un frisson dans les veines de Lichtenbach. Qui ne désirerait cette sensuelle et enivrante créature ? Et, la désirant, qui pourrait résister à son charme impérieux ? Elle connaissait bien l’étendue de son pouvoir. Sur un signe d’elle les hommes se changeaient en esclaves. Et elle était la magicienne qui déchaînait les appétits luxurieux, les frénésies mortelles et conduisait les êtres éperdus à la folie, à la honte et au crime.
— Oui, vous réussirez quoi que vous entrepreniez murmura Lichtenbach, fasciné.
— Pas d’exagération ! Je ne suis pas infaillible, vous l’avez bien vu puisque Trémont m’a échappé… Mais tout ce qu’un être humain peut faire pour réussir, je le ferai. Ayez donc confiance. Et soyez calme.
Un roulement de voiture sous la voûte de la porte cochère, un piétinement de chevaux annoncèrent le retour de Mlle Lichtenbach.
— C’est ma fille qui rentre, dit le banquier.
— Elle est donc chez vous, en ce moment ?
— Elle a désiré assister aux obsèques du général de Trémont dont la fille est son amie…
Un sourire plissa les lèvres de la baronne :
— Hasard ou précaution ?
— Hasard, dit Lichtenbach, avec un ton glacé. Elles sont au Sacré-Cœur l’une et l’autre. Elles se sont trouvées en présence et se sont plu…
— Et maintenant que vous en êtes averti, vous vous prêtez à cette intimité ?
— Je ne contrarie jamais ma fille.
— C’est vrai. J’oubliais : vous êtes un bon père, vous, Lichtenbach. C’est la dernière concession que vous ayez faite à l’humanité. C’est par là que vous êtes encore vulnérable. Prenez garde !
— Ma fille est un ange, qui prie pour moi. Je ne crains rien. Elle a la sagesse, la douceur et la grâce de sa mère.
— Et elle vous croit un bon, brave et honnête père de famille. Si on l’éclairait un jour sur votre compte !
Elias se dressa menaçant et redoutable :
— Qui pourrait le faire ?
— Un de vos ennemis. Vous en avez. Eh ! Eh ! Un de vos amis, peut-être. Le monde est si méchant.
— Malheur à celui-là, dit sourdement Lichtenbach, sa hardiesse lui coûterait cher.
La baronne se levait. Elle fit un tour, comme indécise, puis elle demanda :
— Avant de partir, peut-on la voir Mademoiselle votre fille ?
Lichtenbach la regarda fixement, puis il répondit avec rudesse :
— Non !
— Et pourquoi ça ?
— Parce que c’est inutile.
— Craignez-vous que je la corrompe rien qu’en lui adressant dix paroles ?
— Peut-être.
— Bravo ! Eh bien ! au moins vous êtes franc.
Lichtenbach dressa sa haute taille, et rendant en un seul instant à Sophia toutes les insolences qu’elle lui prodiguait depuis une heure :
— Mlle Lichtenbach ne doit rien avoir de commun avec la baronne Grodsko.
Sophia eut un geste d’insouciance :
— Très bien ! Chacun son idée. Au revoir, Lichtenbach.
Elle allait vers le vestibule. Il l’arrêta.
— Pas par là.
Il ouvrit une porte cachée sous une tenture :
— Descendez par cet escalier. Vous ne rencontrerez personne.
— Il n’y a pas d’oubliettes en bas ? dit-elle en riant.
— Non. Il n’y a que la loge du concierge.
— Adieu ! Sans rancune.
— Il ne manquerait plus que cela ! Vous avez sur vous pour cent mille francs d’indulgence ! Au revoir !
Elle disparut. Il revint devant son bureau, rêveur. Cette femme, si dangereusement perverse, le troublait toujours, quoiqu’il la connût bien.
Un coup frappé à la porte le tira de sa réflexion. Il alla ouvrir et son visage s’éclaira. C’était sa fille qui venait le voir.
— Je ne te dérange pas ? dit-elle avec un peu d’inquiétude.
— Non, ma mignonne, jamais. Ta visite s’est bien passée ?
— Très bien. J’ai vu des gens excellents.
Lichtenbach ne prononça pas une parole, mais son regard se baissa vers le plancher. Il ne voulut pas que sa fille en surprît l’expression.
— Madeleine est bien heureuse, dans sa détresse, de trouver des amis aussi dévoués. Mme Baradier est parfaite. Elle va garder cette pauvre chérie auprès d’elle. Et, quoique son départ du couvent soit bien affligeant pour moi, puisqu’il nous sépare, je me réjouis de la savoir dans un milieu de chaude affection. Elle va y renaître.
— Tu es bonne, ma petite Marianne.
— Le malheur qui atteint Madeleine est si grand ! Que peut-il arriver à un enfant de plus affreux que de perdre ses parents ? Et quand, comme elle et comme moi, on n’a plus de mère…
La voix de la jeune fille trembla, des larmes brillèrent dans ses yeux. Lichtenbach pâlit, mais continua de fixer ses regards vers la terre.
— C’était cette conformité de situation qui nous avait, dès le premier jour, rapprochées l’une et l’autre. Notre tristesse commune avait été la source de notre affection. Il nous avait semblé qu’étant moins aimées que les autres, nous devions nous chérir plus. Elle avait, pour son père, la même tendresse que j’ai pour toi. Il paraît que c’était un grand savant… Le connaissais-tu ?
Il fallait répondre. La voix d’Elias chevrota :
— Non. J’ai seulement entendu parler de lui.
— C’était l’ami intime de M. Baradier et le parrain de son fils Marcel. Ils le pleurent tous…
Les paupières baissées de Lichtenbach se relevèrent brusquement et son regard perspicace interrogea la jeune fille :
— Qui t’a raconté tout cela ?
— Mlle Baradier et Madeleine.
— Tu as causé avec Mlle Baradier ?
— Et avec sa mère.
— Et avec le fils aussi, peut-être ?
L’âpreté soudaine du ton, la netteté des questions de Lichtenbach troublèrent Marianne. Elle s’interrompit étonnée :
— Mais, papa, je t’assure que tout le monde a été charmant pour moi… M. Marcel Baradier m’a reconduite jusqu’à la porte de la maison, m’a mise en voiture… N’est-ce pas tout naturel ?
— Oui, oui, c’est tout naturel… Mais répète-moi bien tout ce qu’ils t’ont dit… N’a-t-on pas parlé de moi ?
— Pas une fois. Ton nom n’a même pas été prononcé. J’en ai été surprise, car la famille Baradier doit te connaître… Vous avez habité, autrefois, la même ville…
— Oui, nous habitions la même ville, et ensemble nous l’avons quittée… Mais pas pour marcher dans le même chemin… Car, je dois te le dire, nous étions en mauvais accord… Mon père et les Graff avaient eu des difficultés ensemble. Et Graff est le beau-frère de Baradier…
— Tout cela est si ancien que c’est, sans doute, oublié.
— Non, ma fille, dit gravement Elias, rien ne s’oublie.
— Serais-tu donc mal disposé pour les amis de Madeleine ?
— T’aurais-je laissée aller chez eux, s’il en était ainsi ?
— Alors ce seraient donc eux qui auraient de mauvais sentiments à ton égard ? Tu es si bon que c’est certainement injuste. Il y a quelque malentendu et vous ne vous connaissez pas bien.
— Si, mon enfant. Nous nous connaissons très bien, et de longue date, et toujours nous avons été opposés les uns aux autres. Tu es grande fille maintenant, et tu dois apprendre ce que te réserve la vie. Eh bien ! Du côté des Baradier et Graff tu n’as rien à attendre de favorable. Toutes les fois que tu te trouveras en contact avec eux, défie-toi. J’étais décidé à t’éclairer, un jour, sur la situation que cette hostilité invétérée a créée entre nous. Autant vaut que ce soit tout de suite. C’est pour que tu ne puisses pas m’accuser de t’avoir caché une parcelle de vérité que je t’ai autorisée à entrer dans la maison où a été recueillie Mlle de Trémont. Tu as pu voir ainsi les Baradier, tu as pu aussi te convaincre que je peux traiter avec eux de puissance à puissance. Ton grand-père Lichtenbach a beaucoup souffert par eux, autrefois. C’était un brave homme dont les commencements avaient été modestes. Ils l’ont humilié, tourmenté. Moi-même, pauvre petit trafiquant, il n’est pas de calomnies qu’ils n’aient répandu sur mon compte. Mais je les ai mis au pas, et je leur ai fait payer leurs insolences envers le vieux Lichtenbach. Tout ceci se passait avant que nous ayons quitté la Lorraine, et tu n’étais pas née. Tu vois que ce n’est pas d’hier. Mais ces haines de clocher laissent des ferments presque indestructibles dans le cœur. Ce qui remonte à l’enfance et à la jeunesse reste gravé plus sûrement dans la mémoire que ce qui date de l’âge mûr. Les Baradier et Graff sont venus à Paris, moi aussi, plus tard. Nous avons été séparés par la vie, plus complètement que par des espaces immenses, car dans cette grande cité, de rue à rue, de quartier à quartier, on est plus éloigné que de province à province. Et cependant jamais nous ne nous sommes oubliés. Les Baradier et Graff sont pour les Lichtenbach l’ennemi héréditaire. Souviens-toi bien de cela, mon enfant, et que ce soit la règle de ta conduite, dans toutes les circonstances.
Marianne regarda son père avec inquiétude :
— M’engages-tu donc à épouser ta querelle ?
— Dieu m’en garde ! Je t’aime trop pour risquer ta tranquillité, et je ferai tout pour te tenir à l’abri des chocs qui pourraient te faire souffrir. Je t’ai ouvert les yeux, parce qu’il faut que tu saches discerner, à un moment donné, les causes de certains événements, et la valeur de certaines paroles. Maintenant repose-toi sur moi du soin d’assurer ta sécurité et ton bonheur.
— Ne pourrais-je donc plus voir Madeleine ?
— Pourquoi ? Si tu ne vas plus à elle, qui l’empêchera de venir à toi ?
— Je serai au couvent.
— Tu n’y seras pas toujours.
La jeune fille leva sur son père des yeux de tendresse suppliante :
— Ah ! si tu voulais me garder près de toi, comme je serais contente ?
Le visage d’Elias s’éclaira d’une expression de douceur et de joie :
— Que ferais-tu ici ? demanda-t-il d’un air bonhomme.
— Je tiendrais ta maison. Ton ménage en a bien besoin, soit dit sans te critiquer. Une femme ne laisserait pas cette superbe maison dans un abandon maussade et glacé. Avec si peu de choses on arrangerait à merveille les appartements pour te les rendre confortables et plaisants. Et puis, tu n’aurais plus à t’occuper que de tes affaires, et tu verrais comme tout irait mieux. Ce n’est pas le rôle d’un homme de commander à des servantes… Ne serais-tu pas satisfait d’avoir auprès de toi une affection sans cesse en éveil pour te soigner et te plaire ? Voilà que j’ai dix-huit ans, on ne sait plus quoi m’apprendre au couvent. Et c’est moi, bientôt, qui vais donner des leçons aux élèves. Suis-je venue au monde pour être répétitrice au Sacré-Cœur ? Tu as une fille, ce n’est pas pour les autres, c’est pour toi. Pourquoi t’en prives-tu ?
Elle l’enlaçait, l’enguirlandait, le pressait, en parlant ainsi, et l’âme paternelle d’Elias s’échauffait délicieusement à ces caresses. Cet homme si dur, si âpre, si féroce, retrouvait des sentiments généreux et tendres sous le regard de son enfant. Il laissa échapper un soupir :
— Si je t’écoutais, ne commettrais-je pas une imprudence ? Il faut être seul pour marcher dans sa force et sa sécurité.
— Mais que crains-tu ? On dirait à t’entendre que tu es en état de guerre avec des ennemis qui te guettent. La vie est-elle si pleine de périls, et n’est-on pas protégé dans le monde ?
Elias sourit :
— Pour les esprits simples rien n’est menaçant et redoutable. Ils ne voient pas. Pour les observateurs sagaces tout est dangereux et inquiétant. Regarde la mer, tu ne distingueras, au premier coup d’œil, qu’une surface immense toute bleue, miroir du ciel, sillonnée par les barques et ridée par le vent. Penche-toi vers le fond, perce la couche profonde, tu verras des récifs affreux et insoupçonnés, des monstres effrayants aux aguets. Les débris, les épaves, les vestiges lamentables des navires et des marins te prouveront que les dangers sont incessants, les catastrophes quotidiennes et que, pour s’en garer, il faut une prudence sans cesse attentive. Il en est de même du monde, que tu crois sûr, et de la vie que tu juges facile. La surface est unie, engageante, les dessous sont monstrueux et terrifiants. Mais je suis là pour veiller, rassure-toi. Près de moi tu seras à l’abri du danger et puisque tu désires rester dans ma maison, qui est la tienne, restes-y, chère enfant. Ta présence assurera la joie de mes vieux jours.
Il tendait les bras, elle se jeta sur sa poitrine avec un cri de reconnaissance. Lichtenbach, un peu honteux de son attendrissement, se ressaisit et d’un ton bref :
— Eh bien ! voilà qui est entendu. Je vais envoyer chercher ton trousseau et toutes tes affaires au couvent et tu t’installeras dès ce soir…
— Oh ! pour mon trousseau, cher père, je crois qu’il ne vaut pas la peine que nous le reprenions. Les sœurs en disposeront pour leurs charités… Il n’y a que mes petits souvenirs personnels auxquels je tiens… Tu me donneras de l’argent, n’est-ce pas, pour que je laisse une belle aumône aux excellentes femmes qui m’ont élevée ?
— Mais tu es riche, ma mignonne, fit Elias en souriant. Tu as la fortune de ta mère que j’ai fait fructifier… Et je te rendrai des comptes…
Marianne s’approcha et, se haussant jusqu’à la figure de son père, elle l’embrassa tendrement en disant :
— Voilà ta quittance.
V
Dans son cabinet, tendu de vert, meublé de chêne, éclairé par une fenêtre donnant sur le quai, le beau M. Mayeur, juge d’instruction, assis près de la cheminée, pendant que son greffier distrait, bâillait devant sa table, achevait d’interroger un des agents chargés des recherches sur l’affaire de Vanves. Il était bien ennuyé, M. Mayeur. Investi de la confiance du parquet, préposé aux affaires sensationnelles, il avait l’habitude de faire de l’effet, sans se donner beaucoup de mal. Les résultats étaient obtenus, avec régularité et comme par enchantement. Le hasard semblait collaborer avec lui. On le citait comme le juge d’instruction le plus heureux. Et il avait pris l’habitude de son bonheur. Quand l’affaire de Vanves lui avait été distribuée, il avait eu un sourire de confiance et son greffier s’était frotté les mains avec un air de commisération pour les coupables.
— Encore de pauvres bougres pour qui ça ne va pas traîner !
Or, ça traînait. Depuis huit jours, M. Mayeur multipliait les investigations, lançait limiers sur limiers, citait les témoins, remplissait les commissions rogatoires. Il n’aboutissait à rien. Il se mouvait, suivant son expression, dans un brouillard épais, dont il n’arrivait point à sortir. Chaque soir, le Procureur le faisait appeler et, en rangeant ses papiers, lui demandait d’un air narquois :
— Eh bien ! Mayeur, où en sommes-nous ?
Et le juge, habitué au succès, se voyait dans l’obligation de répondre :
— Monsieur le Procureur, nous en sommes à chercher toujours, sans trouver encore.
— Ah ! Ah ! Diable ! Une semaine déjà d’écoulée, depuis l’attentat… Vos chances diminuent… Le crime tout frais se découvre plus facilement. À mesure que le temps passe, les fausses pistes s’offrent, l’instinct s’obscurcit, le flair s’émousse… Ah ! ah ! Mauvais ! J’attendais de vous un meilleur résultat ! Vous êtes mieux inspiré, d’habitude.
— Mais il n’y a rien. Monsieur le Procureur. Rien ! Dans cette maudite affaire, rien n’apparaît !…
— Comment ! Rien n’apparaît ? Vous avez le cadavre de la victime, la maison en ruines, et le bras coupé de l’assassin ! Que faites-vous de ce bras coupé ? Il est révélateur !
— Pour l’instant, il est dans l’appareil frigorifique, grogna M. Mayeur, voilà ce que j’en fais ! Mais cadavre, maison, bras, tout ce que vous venez de m’énumérer, autant de preuves qui ne me donnent rien. On dirait qu’un génie malfaisant a passé par là, apportant la mort, la mutilation et l’effondrement, puis a fait le vide derrière lui… C’est à se casser la tête !
— Doucement, Mayeur, il y a assez de dégâts comme ça ! dit le Procureur en souriant. Gardez votre tête, pour mener à bien votre instruction. Ayez de la persévérance. Ah ! Vous avez été gâté par la réussite… Mais ne vous découragez pas. Il ne faut qu’un moment pour découvrir la vérité.
Ce qui mettait M. Mayeur au supplice, c’est qu’il se rendait parfaitement compte du plaisir secret causé à tous ses collègues par son insuccès. Il sentait que la robe de conseiller, si près de sa main, avant cette détestable affaire de Vanves, s’éloignait. Un juge, qui aurait raté une instruction aussi importante, pouvait-il être nommé à la Cour, au mépris de tout avancement normal, puisqu’il n’avait plus, comme suprême justification, son invariable chance ? Et dans son cabinet, assis, tournant le dos au jour, la tête baissée vers la cheminée, pendant que son greffier se démontait la mâchoire à force de bâiller, M. Mayeur, d’un ton dolent interrogeait, pour l’acquit de sa conscience, un des agents envoyés par lui à la recherche, et qui revenaient toujours bredouille :
— Et ni dans les carrières, ni dans les jardins maraîchers, ni sur la route de Paris, aucun indice, aucune trace du passage de l’homme blessé ?
— Non, Monsieur le juge. J’ai fait tous les cabarets où vont les carriers et les maraîchers de la région. Nul n’a pu me donner un renseignement utile… On dirait que le meurtrier a été anéanti dans la catastrophe…
— Non ! Puisqu’on suit sa marche jusqu’à trois cents pas de la propriété Trémont et que là, au bord d’un champ, la traînée de sang très visible, qu’il laissait derrière lui, tout à coup disparaît… A-t-il donc retrouvé, à cet endroit, des complices qui l’attendaient ? L’a-t-on emporté ? Et comment ? Et où ? C’est toujours l’obscurité profonde !
— Les auteurs du crime ne sont pas des professionnels, quoique le général ait été dépouillé des objets de valeur qu’il portait sur lui… Ce n’est donc pas dans notre clientèle qu’on les trouvera. Et c’est de là que vient toute la difficulté…
Le juge fit un geste de mécontentement, comme pour attester qu’il le savait de reste. Il tira sa barbe blonde, retroussa ses moustaches, et poussa un soupir. Il dit à son agent :
— Retirez-vous et envoyez-moi le domestique du général, le nommé Baudoin, que j’ai convoqué à nouveau…
L’agent salua et sortit. Au bout d’un instant la porte se rouvrit et la figure résolue et finaude de l’ordonnance se montra. Il était déjà en sympathie avec le greffier, qui lui adressa un bienveillant signe de tête. Le juge renfrogné et maussade dit :
— Monsieur Baudoin, asseyez-vous. Je vous ai dérangé, une fois de plus, pour tirer au clair certains détails qui sont encore incompréhensibles pour moi…
— Monsieur le juge, je me dérangerai tant qu’il le faudra, et sans regrets, du moment qu’il s’agit de mon général. Ah ! Si je pouvais vous aider efficacement dans votre tâche, j’en serais bien heureux !
Le juge chiquenauda sa cravate d’un air vexé. Comment ce domestique pourrait-il éclaircir une affaire que lui, Mayeur, ne parvenait pas à débrouiller ? Enfin ! Il avait cette mauvaise chance qu’il lui fallait subir, maintenant, les apitoiements des témoins. Le greffier parut tout ragaillardi par l’humiliation de son patron. Il y avait vraiment assez longtemps qu’il l’assommait de sa suffisance ! Une bonne veste le rendrait moins sûr de lui, et il ménagerait un peu plus son subordonné qu’il avait toujours l’air de considérer comme un imbécile. Rage, mon bonhomme, rage ! Ce n’est pas ça qui avancera ton instruction. Et le greffier bâilla une fois de plus, désespérément.
— Cette femme, que vous avez vue descendre de voiture à la porte de la maison, le soir du crime, était-elle grande ou petite ?
— Plutôt grande. Mais comme elle était enveloppée dans un manteau très ample, il me serait difficile de préciser. Elle m’a paru svelte, à la façon dont elle est descendue de voiture.
— Et son compagnon ?
— Oh ! Son compagnon, je l’ai vu distinctement. C’était un homme vigoureux à barbe épaisse, le teint clair, l’air brutal. Il était coiffé d’un chapeau de feutre gris et vêtu d’un complet foncé. Il avait un fort accent étranger, et…
— Supposez-vous que ce soit l’homme que votre maître appelait Hans ? interrompit le juge.
— Ce ne pouvait être un autre. Le général ne recevait personne, à l’exception de ses amis : les messieurs Baradier et Graff… Et il fallait que les gens qui vinrent à différentes reprises, le soir, à la villa, soient de la fameuse canaille, pour qu’il ne me laisse pas rester auprès de lui.
— À quoi attribuez-vous cette précaution prise par M. de Trémont de vous éloigner ?
— À la certitude qu’il avait de me voir flairer les manigances de la dame et de son acolyte…
— Alors, pour vous, c’est une intrigue féminine qui est le fond de l’affaire ?
— En apparence, oui.
— Et en réalité ?
— On a voulu voler, au général, ses procédés de fabrication pour les poudres nouvelles…
— La femme, alors, n’aurait été qu’une intermédiaire galante ?
— Une intermédiaire, non. On savait bien que le général ne consentirait jamais à un marché… Une amorceuse, oui. Je ne l’ai pas vue, la femme, mais je l’ai sentie… Chaque fois qu’elle est venue, elle a laissé le cabinet du général imprégné d’un parfum tout à fait particulier et qui était d’une douceur molle et grisante… Oh ! Je le reconnaîtrais entre cent, ce parfum ! Et la voix de la femme aussi, caressante et séduisante, comme son odeur !… Ah ! mon pauvre maître ! Quand elle venait, cette coquine, il piétinait d’inquiétude, et il lui montait des rougeurs au visage… On sentait qu’il était impatient de la tenir, là, près de lui… Et elle le savait bien ! Elle connaissait son pouvoir. Quand elle est arrivée, la dernière fois, et que le général lui a exprimé le bonheur qu’il avait de la voir, après l’avoir attendue longtemps et avoir craint qu’elle manquât à sa promesse, il aurait fallu l’entendre lui répondre : « En doutiez-vous, général ? » pendant qu’il l’enlevait dans ses bras, comme une maîtresse adorée. Monsieur le juge, cette femme-là, voyez-vous, était capable de tout : d’affoler un brave homme, au cœur chaud, comme mon maître, de lui verser le poison de ses regards et de ses sourires, aussi bien que de le faire froidement tuer, pour une cause que j’ignore… Et, quant à l’homme, le Hans, ce n’était qu’un agent d’exécution… Instruit, puisque le général tenait compte de son opinion et pouvait causer avec lui de ses découvertes, mais n’ayant pas le même rang social que sa complice. Lui, c’était un individu vulgaire, grossier même. Et il a fallu tout le prestige de la femme pour le faire accepter par M. de Trémont, qui était si aristocrate.
— Et vous n’avez jamais eu l’occasion de savoir, par la cuisinière qui restait, elle, dans la maison, ce qui se passait quand vous étiez parti ?
— Cette brave fille était très bornée. En dehors de son service, il n’y avait pas grand’chose à tirer d’elle. C’est pour cela que M. de Trémont ne s’en défiait pas. Cependant, à différentes reprises, elle a vu la femme, et elle m’a dit que c’était un miracle de beauté… Jeune, blonde, des yeux à la perdition de son âme et de celle des autres… Elle a parlé, avec le général, dans une langue étrangère. Or le général ne partait qu’anglais et italien…
— Et cette fille a-t-elle surpris, dans l’attitude du général et de la visiteuse, des indices de relations amoureuses ?…
— Ah ! Monsieur, l’inconnue était la maîtresse du général, j’en réponds. L’avant-dernière fois que mon maître m’a éloigné, quand je suis revenu, le lendemain, et que j’ai fait l’appartement, j’ai trouvé sur le tapis de la chambre de M. de Trémont, des épingles à cheveux perdues. Ce n’était pas en faisant la conversation que la dame s’était décoiffée à ce point-là !
— Votre maître était-il riche ?
— Non, monsieur, il avait une fortune très modeste : vingt mille francs de rente, environ. Mais ses découvertes valaient de l’or… C’étaient ces découvertes que la coquine visait… Et, pendant qu’elle était dans la chambre du général, le complice fouillait probablement les papiers et furetait dans les produits…
— Jamais vous n’avez trouvé aucun papier ayant trait aux relations du général avec cette femme ?
— Jamais.
— Les petits bleus, que le général recevait, lui annonçant l’arrivée de ses visiteurs, que devenaient-ils ?
— Le général les brûlait lui-même. Je l’ai vu le faire. Ah ! toutes les précautions étaient prises par cet honnête homme pour ne pas compromettre sa belle Baronne… Dieu sait qu’il l’adorait ! Il tremblait, comme un collégien, à l’idée de la voir !
— Et cependant il ne lui a pas livré le secret de ses recherches.
Le visage de Baudoin devint grave :
— Ah ! c’est que son secret, il le réservait à la France. Ça, je le lui ai entendu dire plus d’une fois, quand il avait fait une expérience dont il était content : « Baudoin, mon brave, quand notre artillerie aura cette poudre-là, nous ne craindrons plus personne. » Certes le général était bien affamé de cette femme. Il l’aimait passionnément. Mais il aimait encore bien plus son pays. Et, entre elle et lui, il n’aurait pas hésité. C’est, du reste, certainement la raison pour laquelle il est mort. On n’a pas pu obtenir de lui son secret, de bon gré, alors on a essayé de le lui prendre de force.
Le greffier ne bâillait plus. Il écoutait Baudoin avec un intérêt sympathique, tout en écrivant sa déposition. Il la rédigeait en gros, car c’était bien la troisième fois que le blond et élégant M. Mayeur se faisait répéter ces choses par l’ordonnance du général, comme s’il espérait découvrir, dans les paroles encore entendue, un sens spécial qui lui permettrait de démêler la vérité. Et toujours cette intrigue amoureuse, recouvrant la criminelle tentative, dont il ne parvenait pas à juger la portée. Affaire de politique internationale ? Coup d’espionnage ? Ou, tout simplement, audacieuse entreprise de rapt d’un produit commercial d’une considérable valeur ? Mais à quelque hypothèse qu’il s’arrêtât, c’était l’obscurité des causes, l’ignorance des détails, le mystère impénétrable, dont il enrageait, et qui allait compromettre sa carrière. Il eut un geste de lassitude, et tirant sa barbe avec ennui :
— Oui, les précautions des coupables ont été bien prises. Le général est mort, la servante est morte, et vous, on vous avait éloigné… L’homme au bras coupé a disparu, comme s’il s’était engouffré dans les entrailles de la terre. Et la femme inconnue se rit de nos recherches.
Baudoin hocha la tête :
— Monsieur le juge, tant qu’on essaiera de la trouver, elle se cachera, et on ne découvrira rien. Si l’affaire me regardait, je sais bien ce que je ferais…
M. Mayeur, dans sa détresse, leva vers le brave garçon un regard de curiosité. Lorsqu’il ne savait plus à quel parti s’arrêter, à quel expédient se raccrocher, lui, le juge d’instruction connu pour les ressources de son imagination et la variété de ses procédés, un simple témoin affectait de comprendre la situation, et d’indiquer comment on en pourrait sortir. Il fut sur le point de le foudroyer de son dédain autoritaire, en l’engageant à se mêler de ce qui le regardait, puis il pensa qu’après tout, un avis n’était pas à négliger et qu’il serait toujours temps de le mépriser. Il dit, d’un air railleur, pour sauvegarder son prestige :
— Et que feriez-vous, je vous prie, monsieur Baudoin ?
— Ma foi, monsieur le juge, je vous demande de m’excuser. Je vais peut-être lâcher une sottise. Mais si j’avais la direction des recherches, au lieu de mettre la police en mouvement de tous les côtés, de demander des renseignements aux militaires et aux civils, je ne bougerais plus. Je ferais le mort. Je répandrais le bruit que j’abandonne la poursuite, et je m’occuperais d’autre chose… Vous n’êtes pas sans savoir ce qui se passe, dans un grenier où il y a des souris, quand on y entre. Au premier bruit, tout est au trou… Si l’on reste immobile, après un petit moment, on voit les souris qui s’aventurent et qui recommencent leurs courses et leurs tours, comme avant… Eh bien ! je crois qu’il en serait de même pour ceux que nous cherchons… Car, pardon si je me mêle à vous, dans la circonstance, mais je suis enragé aussi pour trouver les gredins qui ont tué mon maître, et si je puis contribuer à les faire prendre, ce sera le plus beau jour de ma vie.
M. Mayeur maintenant ne regardait plus dédaigneusement l’ordonnance du général. Il lui souriait d’un air aimable. Ce garçon venait, en une seconde, de lui fournir le moyen de sortir à son avantage des embarras de cette maudite affaire. Quand son procureur allait lui dire, le soir même, d’un ton goguenard : « Eh bien ! mon cher Mayeur, où en êtes-vous de votre instruction ? Toujours rien ? » Au lieu de lui répondre d’une voix dépitée : « Rien, en effet, monsieur le Procureur », avouant ainsi non seulement l’impuissance à trouver, mais encore l’absence de combinaisons pour chercher, il allait pouvoir lui répliquer : « Cette affaire a été mal engagée, je me propose de tout reprendre ab ovo. Nous avons maille à partir avec des gens extrêmement forts. Je me réserve de manœuvrer dans un sens tout différent. » Cette fois, il n’avait plus l’apparence d’un incapable, à qui on a confié une tâche trop difficile pour ses minces facultés. Il se ménageait une retraite honorable ; il gagnait du temps. Tout était là.
Il reprit sa gravité gourmée.
— Il sera toujours assez tôt pour prendre ce parti. Mais j’ai encore à ma disposition beaucoup d’autres moyens de faire la lumière.
Son greffier, la plume dans la bouche, ne se gênait plus pour rire. Oh ! il en avait un toupet, ce Mayeur ! Lorsqu’il était aux abois, prêt à tourner en bourrique, sans une idée dans la tête, joué, berné par les coupables, dont il ne soupçonnait quoique ce soit, il se donnait encore les gants de prétendre « faire la lumière » ! Non ! De la lumière ! C’était à se tordre ! Il fit un clin d’œil à Baudoin et secoua bruyamment son pupitre.
M. Mayeur, comme s’il eût deviné l’hostilité sournoise de son subordonné, lui dit :
— Voyez donc, je vous prie, si M. le colonel Vallenot est venu du ministère de la guerre…
Le greffier se détira, montra son porte-cigarettes à Baudoin avec une grimace qui signifiait : je vais en griller une, et sortit. Derrière lui, M. Mayeur se leva, et mit le verrou à la porte, puis revenant à Baudoin :
— J’ai voulu que nous soyons seuls pour aborder le sujet qui me préoccupe. La moindre indiscrétion, dans une affaire si délicate, pourrait tout perdre. Vous m’avez, tout à l’heure, donné un avis qui peut être utile à suivre. Mais vous ne m’avez pas montré le fond de votre pensée. Vous êtes mieux informé que vous ne l’avez paru jusqu’à présent. Peut-être ne sont-ce que des soupçons qui vous travaillent. Mais vous en savez plus que vous n’en racontez. Cependant je suis sûr que vous êtes fort décidé à aider la justice et à poursuivre énergiquement les meurtriers de votre maître. Pourquoi n’avez-vous pas en moi une confiance entière ?… Je joue une bien grosse partie. Facilitez-m’en le gain. En somme, nous marchons vers le même but… Allons, monsieur Baudoin, soyez franc… Vous croyez avoir un moyen de découvrir les coupables ?
Baudoin leva la tête, regarda le juge dans le blanc des yeux, le vit ardent et passionné pour l’œuvre entreprise. Il pensa qu’il avait réellement en lui un allié, et que le secret professionnel garantissait sa discrétion, il se décida à parler :
— Eh bien ! oui, j’ai un moyen, je le crois, d’arriver à mettre la main sur ces scélérats…
— Quel est-il ?
— Jurez-moi d’abord que ce que je vais vous dire ne sortira pas de nous deux ?
— Mais… voulut protester le juge.
— C’est à prendre ou à laisser, déclara rudement Baudoin. Je joue ma peau, dans cette histoire-là, et d’autres que moi y exposeront leur vie… Je me tais, si vous ne me donnez pas votre parole d’honneur de ne répéter à âme qui vive ce que je vais vous confier.
— Même pas à mon chef ?
— Pas même au Bon Dieu ! Rien ! rien ! Et à personne ! Est-ce entendu ? Ai-je votre parole ?
— Vous l’avez. Eh bien ?
— Eh bien ! Comme je vous l’ai indiqué, le général n’avait, en matière de recherches scientifiques, confiance qu’en un jeune homme, qu’il aimait comme son enfant, le fils de M. Baradier… J’ai lieu de croire que les formules de M. de Trémont, M. Marcel les possède. Si donc les brigands que nous cherchons ont seulement le soupçon que, de ce côté-là, on pourrait à nouveau essayer le coup qui a manqué avec le général, aussitôt rassurés sur le résultat des poursuites en cours, ils se remettront à l’ouvrage… C’est là que ma tâche va commencer. Je me fais attacher au service de M. Marcel, par son père, et je ne le quitte pas d’un pouce… J’ai un copain, de plus, qui a la triture de ces manigances-là dans les premiers numéros, je l’embauche. Et, à nous deux, nous organisons une surveillance de tous les instants. Si la manœuvre recommence, nous la laissons se développer, prêts à intervenir au bon moment. Voilà mon plan. C’est pour cela que j’ai osé, tout à l’heure, vous insinuer de paraître abandonner la partie. Vous comprenez qu’avec des gaillards comme ceux avec qui nous allons jouer, il peut y avoir de la casse. J’aimerais autant que ce fût pour quelque chose. C’est pour cela que je vous ai demandé votre parole d’être muet. Maintenant, faites ce qu’il faudra pour me donner un coup de main, et soyez sûr que le jour où le pain sera enfourné, je vous avertirai pour que vous veniez le retirer tout cuit.
Le juge d’instruction réfléchit un moment, puis il dit :
— Tout ceci est en dehors des usages judiciaires, mais la situation est exceptionnelle. Avant tout, il faut réussir. Si, comme je le pressens, nous avons en face de nous des criminels déterminés, ils n’en sont pas à leur coup d’essai, et peut-être allons-nous ramasser toute une bande. Exécutez donc le projet que vous m’avez indiqué et, à la moindre difficulté, venez me trouver, pour que je porte toutes les forces de la justice à votre aide. Il suffira de me montrer le bout du fil pour que j’aille jusqu’au nœud de la question…
— Bien, soyez tranquille. Vous aurez de mes nouvelles, quand il en sera temps. Silence, voici votre greffier qui revient.
Le greffier heurtait à la porte fermée. Le juge alla ouvrir. Le colonel Vallenot, dans l’ombre du couloir, dressait sa taille svelte de militaire en bourgeois. M. Mayeur s’empressa au-devant de lui.
— Colonel, je vous prie, entrez donc et prenez la peine de vous asseoir…
Il se tourna vers Baudoin :
— Eh bien ! M. Baudoin, vous pouvez vous retirer. Je ne crois pas avoir besoin de vous, maintenant, avant un temps assez long. Si vous vous absentez, cependant, laissez votre adresse chez M. Baradier, afin que la citation que je vous adresserai puisse vous toucher.
L’ordonnance s’inclina devant le magistrat, fit au colonel le salut militaire, et sortit. Derrière lui, M. Mayeur revint à Vallenot, tout souriant : il n’admettait pas que son découragement se manifestât en public :
— Monsieur le ministre de la guerre se porte bien ? Il a prononcé un substantiel et vif discours à la Chambre, hier…
— Oui, on lui cherche chicane, mais il est de taille à se défendre. Il parle sec… Et ça réussit toujours avec les parlementaires…
— Imperatoria brevitas, nasilla le juge.
Il prit un temps, changea de physionomie et demanda mielleusement :
— Et ces recherches, aboutissent-elles ?
Le colonel répliqua rudement :
— À peu près comme les vôtres.
M. Mayeur eut un pâle sourire :
— Ah ! ah ! Nous n’avançons pas alors ?
— Je dirais que nous reculons, si je ne craignais de vous désobliger.
— C’est l’exacte vérité, en apparence, dit Mayeur d’un air entendu.
— Ah ! Auriez-vous découvert quelque chose ? fit Vallenot intrigué.
— Je ne puis m’expliquer, mais patientez. Vous aurez une surprise.
— Sacrebleu ! Le patron en serait ravi. Cette affaire l’a mis dans un état de nerfs, bien pénible pour tout le personnel. Il ne décolère pas. On ne sait plus par quel bout le prendre.
— Mais revenons à vos investigations à l’étranger. Qu’ont-elles produit ?
— Nous avons la certitude que, s’il y a eu une tentative faite pour se procurer les formules du général Trémont, la triplice n’y est pour rien. Nos informateurs, sur ce point là, sont tous d’accord. Depuis les dernières affaires d’espionnage, les gouvernements ont donné l’ordre à leurs agents d’observer la plus grande réserve… S’il y a eu vraiment une manœuvre, ce ne peut être que pour le compte des Anglais… Vous n’ignorez pas que leur matériel d’artillerie est tout à fait arriéré. Ils essayent de se remettre à la hauteur. Et comme, pour ces marchands, il est bien plus simple d’acheter un procédé que de l’inventer, il ne paraît pas impossible que ce soit pour leur compte qu’on ait marché… Il va sans dire qu’ils réprouveraient, s’ils les connaissaient, les moyens employés pour les servir… Mais ils n’auront jamais l’air de les connaître. Ce sont des gens pour qui l’apparence est tout. On peut être aussi coquin qu’on veut, pourvu qu’on ait l’air d’être honnête. Ça s’appelle le cant, chez eux ; chez nous : l’hypocrisie. Mais, pardon, je m’égare…
— Il n’y a pas de mal. En résumé, des suppositions, aucune preuve certaine…
— Aucune. Il y a à Paris ou en France, à l’état ambulant, allant de villes d’eaux en stations hivernales, une demi-douzaine de femmes connues pour leurs intrigues internationales, qui auraient pu être soupçonnées d’avoir joué le rôle de la baronne près du pauvre général de Trémont. Les unes étaient absentes de Paris, les autres étroitement surveillées. La plupart, d’ailleurs, font partie de notre contre-espionnage et auraient su nous prévenir, tout en touchant les subventions de l’étranger. Donc de ce côté-là, rien. En ce qui concerne Hans, un rapport de police venu de Lausanne signale l’arrivée à Genève d’un blessé dont le bras a été amputé. L’homme est un badois, nommé Fichter, et c’est dans une tréfilerie des environs de Besançon qu’il a été estropié. Il n’a donc pu être, en même temps, dans le Jura et à Vanves. Son signalement cependant se rapporte admirablement à celui donné par le domestique Baudoin. Il faudrait pour que ce Fichter fût l’homme recherché que le patron de la tréfilerie ait donné des certificats de complaisance, ou qu’une substitution ait eu lieu, en cours de route, entre les deux hommes ? Tout cela est bien improbable. Et, vous le voyez, l’obscurité est plus complète que jamais.
— Oui, oui, oui, chantonna le juge, avec un tel air de penser à autre chose que le colonel le regarda avec stupéfaction.
— Vous prenez ça tranquillement ! dit Vallenot.
— Il ne faut jamais s’agiter ; ça ne sert à rien.
— Vous ne désespérez donc pas ?
— Y a-t-il de quoi ?
— Dame !
— Non ! non ! non ! reprit-il sur le même ton d’indifférence qui avait si fort étonné son interlocuteur. C’est au moment où l’on croit tout perdu que le succès arrive.
— Vous avez de la chance, vous autres, dans la magistrature ! Ce n’est pas comme ça dans l’armée. Quand on attend Grouchy, c’est toujours Blücher qui vient !
— Nous verrons bien !
— Qu’allez-vous faire ?
— Je vais laisser dormir cette affaire-là, pendant quelque temps. Elle n’est pas à point.
— En d’autres termes vous la classez.
— Oui, je la classe, provisoirement.
— Votre provisoire est un définitif, c’est l’abandon.
Le juge regarda gravement Vallenot, et, à la stupéfaction profonde de son greffier, il dit avec humilité :
— Si aucun incident nouveau ne survient, c’est en effet l’abandon.
— Dois-je en informer le ministre ?
— Je vous en prie. En même temps assurez-le de tout mon dévouement. J’aurais voulu mieux faire. Cela m’a été impossible. Mais tout n’est pas perdu, à mon avis. Et nous verrons plus tard.
Le colonel debout, un peu déconcerté par cette solution inattendue, prenait congé. Il hocha la tête :
— Fichue commission que vous me donnez là. Je vais être reçu comme un chien dans un jeu de quilles.
— Bah ! vous êtes le favori. Je ne me désole pas pour vous. Moi, je vais chez le Procureur de la République. Il ne grognera pas, lui, au contraire. Il va railler. Mais qu’importe ! Attendons la fin ! Rira bien qui rira le dernier.
Il serra la main du colonel, le reconduisit jusqu’au couloir et revint à son bureau. Il signa diverses feuilles que lui présentait son greffier. Celui-ci travaillé par la curiosité dit :
— Alors, vraiment, monsieur, c’est fini, cette affaire ? Vous renoncez ?
— Il ne faut pas s’entêter contre l’impossible, dit Mayeur négligemment. On ne construit pas une maison sans échafaudage… Or il n’y a rien, dans le dossier, rien pour guider l’instruction. Je ne suis pas assez fort pour inventer ce que j’ignore. Il est déjà assez difficile de tirer bon parti des preuves certaines.
Une moue de pitié plissa les lèvres du greffier. Tant que le juge avait manifesté la tranquille assurance du succès, il l’avait, en son for intérieur, critiqué violemment. Maintenant que son patron se montrait modeste et simple, il le couvrait de son dédain. Un pauvre homme, allons ! décidément, qui n’avait de brio que dans la victoire, mais qui se laissait aller à l’abandon dès les premières difficultés.
— Mettez, je vous prie, le dossier dans ma serviette. Je descends au parquet, dit le juge ; et puis, vous pouvez vous en aller. Il est cinq heures. À demain.
Le colonel Vallenot, pendant ce temps-là, roulait en fiacre dans la direction du ministère. Comme il entrait dans l’antichambre de son chef, il se croisa avec Baudoin qui sortait du cabinet du ministre. Il l’arrêta au passage :
— Vous venez de voir le général ?
— Oui, mon colonel.
— Il n’est pas de bonne humeur, hein ?
— Mais si, mon colonel. Je crois que si vous voulez le trouver encore dans son cabinet, vous ferez bien de vous presser.
— Comment, il s’en va ?
— Je lui ai entendu dire qu’il allait faire un tour à la Chambre…
— Vous aviez quelque chose à lui demander, Baudoin ?
— Non, mon colonel. Je voulais lui parler de l’affaire de mon général…
— Ah ! Et à quel point de vue ?
— À ce point de vue que le clampin de juge n’avance à rien, et qu’il me paraît en train de lâcher pied…
— Vous avez dit ça au ministre ?
— Il n’y a pas cinq minutes.
— Et comment a-t-il accueilli cette communication ?
— Il a siffloté, puis il a conclu : « Après tout, c’est peut-être préférable. »
Le colonel Vallenot regarda Baudoin pour s’assurer qu’il ne se moquait pas de lui, puis il leva les épaules, comme quelqu’un qui ne comprend plus, et il déclara d’un air vexé :
— Bon ! Bon ! Si c’est de cela qu’il retourne, n’en parlons plus ! Moi aussi, j’aime mieux ça !
Il fit un signe amical à l’ancien soldat :
— Bonsoir, Baudoin, si vous avez besoin de quelque chose dans la maison, adressez-vous à moi. Nous aimions tous M. de Trémont.
Et il passa en mâchant sourdement : Je crois que tout le monde perd la tête dans ce moment-ci !
Baudoin dévalait par le grand escalier. Il sortit dans la rue, après avoir été serrer la main au concierge, et se dirigea vers le petit café où, d’un air paterne, à l’heure de l’absinthe, Laforêt regardait les joueurs de billard se disputer des poules avec acharnement. L’agent était à sa place accoutumée. Il causait en fumant sa pipe avec un rentier du voisinage qui lui racontait ses ennuis de ménage :
— Oui, monsieur, une femme toujours dehors et qui n’a jamais assez d’argent. Il lui faudrait les caves de la Banque à sa disposition… Et quand j’ai le malheur de lui adresser une remontrance, des cris à ameuter les locataires de la maison… Impossible de garder une bonne, elle ne veut pas les payer, et, quand elle n’est pas contente, des gifles ! J’ai déjà été cité plusieurs fois devant le juge de paix, à cause de ses violences… La vie qu’elle me fait est un enfer !
— Divorcez ! énonça brièvement Laforêt.
— Mais le plus clair de ce que nous possédons vient d’elle !
— Alors supportez-la !
— Je ne peux plus !
— Eh bien ! faites-lui ce qu’elle fait à vos bonnes : giflez-la !
— Ah ! non ! Fichtre ! Elle me le rendrait !
L’arrivée de Baudoin interrompit la consultation. Le rentier malheureux se leva et dit :
— Je n’ai un peu de tranquillité qu’ici !
— Eh ! C’est déjà quelque chose. Sans adieu, cher monsieur. Et tout à votre service, si je puis vous être utile.
Baudoin s’était assis. Laforêt se pencha vers lui :
— Qu’est-ce qu’il y a ?
— Du nouveau. J’ai besoin de vous. Mais ne restons pas ici.
L’agent se leva, prit sa canne, salua la dame du comptoir, en habitué qui a son ardoise, et emmena Baudoin :
— Où allons-nous ?
— Dans un endroit où nous ne serons ni dérangés, ni écoutés.
— Alors venez avec moi.
Ils marchèrent du côté de la Seine. Arrivés sur le quai, Laforêt avisa un escalier de pierre qui descendait vers la berge. Un tas de pavés, près d’une guérite de conducteur des ponts et chaussées, offrait ses gradins. Sous l’ombre des vieux ormes qui tordaient leurs rameaux noueux au-dessus du fleuve rapide et limoneux, ils s’assirent. Le jardin des Tuileries étendait devant eux, sur l’autre bord, ses massifs de verdure. Des chalands débarquaient du sable, à cinquante mètres sur leur gauche. Des mouches passaient actives, chargées de voyageurs, et le roulement des voitures sur la chaussée sonore assourdissait un peu les paroles.
— Ici, nous sommes sûrs que, seuls, les oiseaux ou les poissons entendront nos confidences, dit Laforêt. Je vous recommande cet endroit, quand vous aurez à causer secrètement avec quelqu’un. Il n’y a même pas de pêcheurs à la ligne. Ils sont tous au midi… Ça mord mieux qu’au nord… C’est inexplicable, mais c’est certain ! Voyons votre histoire, à présent.
— Eh bien ! Après trois semaines de recherches, en pure perte, le juge d’instruction est obligé d’avouer qu’il n’est pas plus avancé que le premier jour. Il est clair que, livré à ses seules forces, le pauvre homme ne sortira pas de cette affaire. Du reste, je la donne au plus malin : il ne se montrera pas plus expéditif. On est en face du vide. Les coupables ont fait le plongeon. Tout a disparu. Allez donc mettre la main sur des ombres ! La morale de la chose est que notre magistrat va cesser de s’occuper des poursuites et que me voilà libre d’aller où il me plaira, puisque je ne serai pas exposé à passer mes journées dans un couloir du Palais, en tête-à-tête avec le municipal de service. Donc je pars.
— Ah ! Et où allez-vous ?
— Retrouver le fils de mon patron, M. Baradier, qui est à la fabrique près de Troyes, en Champagne… Le pays s’appelle Ars, il y a des sources alcalines et une station thermale où vont beaucoup de malades, tous les étés…
— Est-ce que c’est pour soigner vos douleurs que vous rejoignez votre maître ?
— Non ! c’est pour veiller sur lui. J’ai causé avec son père, depuis que je suis dans la maison, et j’ai appris bien des choses. Notamment que M. Baradier est informé que son fils a reçu des communications du général de Trémont et que, pour se procurer les fameuses formules, c’est maintenant à lui qu’il faut s’adresser. M. Baradier donnerait, je crois, bien de l’argent pour que son fils ne soit pas entré dans le laboratoire du général. Mais c’est fait. Il n’y a plus à y revenir. Et la seule chose importante, maintenant, c’est de défendre le jeune homme. C’est à moi que ce soin a été confié. M. Baradier m’a dit : Baudoin, je n’ai que ce fils-là, et quoi qu’il ne soit pas aussi raisonnable qu’il le faudrait, j’y tiens, vois-tu, mon garçon. Je ne veux donc pas qu’il lui arrive du mal. Aussitôt que tu seras libre, tu iras le retrouver et tu ne le quitteras plus.
— Mais pourquoi ce jeune homme, riche, mondain, aimé de sa famille, s’enferme-t-il, tout seul, dans un trou de province ? Pourquoi ne reste-t-il pas à Paris, au milieu des siens ?
— Pour beaucoup de raisons. La meilleure, c’est que son père a trouvé plus prudent qu’il fût à Ars qu’à Paris. À la campagne on voit de loin. La surveillance est plus facile. Et puis, M. Marcel, d’après ce que j’ai compris, a fait de grosses folies, il n’y a pas longtemps, pour une femme très belle qui l’a mené, comme ces coquines-là mènent les fils de famille, et alors il est comme qui dirait en pénitence. Son père lui a coupé le crédit, et, sans l’oncle Graff, notre héritier serait tout à fait à sec. Enfin, le jeune Marcel est un homme à caprices. En ce moment, il est acharné à chercher un procédé chimique pour la teinture des laines et comme, tout écervelé qu’il est, il a, ainsi que le disait mon général, des qualités scientifiques extraordinaires, son travail suffit à le retenir loin de toutes distractions.
— C’est un original.
— Et le meilleur jeune homme qu’on puisse rencontrer. Généreux, gai, pas fier… Ah ! il vous plaira, quand vous le connaîtrez.
— Je le connaîtrai donc ?
— Pour sûr.
— Et comment ?
— Voilà. Aussitôt que j’ai su que j’allais pouvoir m’éloigner, j’ai couru au ministère, pour en avertir le grand chef. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire et je lui ai demandé, dans l’intérêt de la réussite, de vous autoriser à vous joindre à moi, quand j’aurai besoin de vous…
— Il me faut un congé.
— Vous n’aurez qu’à passer au cabinet, le colonel Vallenot aura reçu des instructions. Vous recevrez votre feuille de route.
— Bon. Et qu’est-ce que j’aurai à faire après ?
— C’est ce que les circonstances nous indiqueront. Pour moi, voyez-vous, mon vieux, j’ai la conviction que la catastrophe dont mon pauvre général a été la victime, n’est que le début d’un drame. Il se passera encore des événements graves, et il faut que nous nous mettions en mesure de les empêcher d’être désastreux pour les braves gens que l’on vise. Il y a de gros intérêts en jeu. Nous aurons probablement à mettre le nez dans des choses pas belles. Mais après, n’est-ce pas, on se lavera les mains. Le tout est de réussir. Ah ! ça, vous devez savoir vous changer la figure…
Laforêt sourit :
— Soyez tranquille. Le jour où vous me donnerez rendez-vous, je serai exact, mais je ne réponds pas que vous me reconnaîtrez quand vous me verrez.
— C’est ce qu’il faut. Moi, je suis un peu bête pour ce qui touche à la comédie. Il n’y a pas à compter sur moi pour jouer un double rôle. Mais je tiendrai convenablement le mien qui sera celui de chien de garde.
— Eh bien ! tout est convenu alors ?
— Il me semble. Quand j’aurai à vous écrire, je vous adresserai ma lettre au ministère.
— C’est ça. Remontons, maintenant.
Ils regagnèrent l’escalier qui les avait conduits au bord de l’eau, et sur le quai, ils se serrèrent la main :
— À bientôt donc.
— Au revoir.
Laforêt se dirigea vers la rue Saint-Dominique, Baudoin traversa le pont de la Concorde, et, par la rue de Richelieu et les boulevards, retourna rue de Provence. MM. Baradier et Graff étaient dans leur bureau en compagnie du caissier de la maison qui leur faisait signer des « broches » pour les recouvrements. En passant les effets, à mesure, à ses patrons, indistinctement, le brave homme parlait :
— Ces messieurs savent-ils que la Société des explosifs Commerciaux, dont M. Lichtenbach est président, ne va plus que d’une jambe ? Les actions ont dégringolé au marché en banque. Il paraît qu’il y a une Compagnie américaine qui lui taille des croupières.
— Oui, je sais cela, dit Graff. Les Américains ont trouvé un produit dont la composition est très simple, et qui coûte cinquante pour cent de moins que la dynamite. Ils ont déjà pour l’Australie et le sud de l’Afrique des commandes considérables. C’est la raison de la dégringolade de la Société Lichtenbach. C’était prévu depuis un an.
— Rassurez-vous, Bernard, dit Baradier à son caissier, ce n’est pas Lichtenbach qui sera touché, ce seront les actionnaires. Il a dû se faire une forte contre-partie en Bourse, afin de ne rien perdre. Vous n’avez plus de signatures à nous demander ?
— Non, monsieur.
— Eh bien ! Bernard, fermez votre caisse et allez-vous-en ; à demain.
— Bonsoir, messieurs.
Baradier se leva et s’adossant à la cheminée.
— Tu vois, dit-il à son beau-frère. Voilà, pour des gens avertis comme nous, la preuve évidente que si Trémont a été tué, c’était autant pour lui dérober son secret commercial que son secret militaire. Comprends-tu, maintenant, quel intérêt il y avait et il y aurait encore pour Lichtenbach à être possesseur de la formule d’un explosif, qui coûterait moins cher que le produit américain dont la découverte ruine la Société française, et aurait autant d’effet sous un volume cent fois moindre. Car voilà la valeur de la découverte faite par Trémont et que Marcel m’a expliquée. Alors si Lichtenbach devenait maître, par un moyen quelconque, de la formule inconnue, il n’aurait qu’à la déposer, à prendre un brevet, et à faire racheter par dessous main toutes les actions de sa société tombée actuellement à vil prix. Le lendemain du jour où il aurait fait sa rafle, il vendrait à la Société reconstituée la propriété de l’explosif nouveau, et ce seraient des millions qui entreraient dans sa caisse. Sans parler de l’avenir réservé à l’affaire.
— Oui, ce serait un joli coup et digne de lui. Il pourrait abandonner à ses acolytes les bénéfices à tirer de la poudre de guerre, car ils seraient peu de chose comparés à ceux du produit commercial. Les États ont pour habitude de mal rémunérer les philanthropes qui leur donnent le moyen de procéder triomphalement au massacre universel.
— Oh ! ne t’y trompe pas, Marcel prétend que cette découverte faite par Trémont a des effets effrayants. C’est une pâte qui, suivant la façon dont elle est préparée, détone d’une façon formidable, ou brûle sans qu’on puisse l’éteindre, même dans l’eau.
— Le feu grégeois ?
— Quelque chose qui y ressemble. Mais comme un canon d’aujourd’hui ressemble aux bombardes du XIVe siècle. Des torpilles chargées avec cette pâte, et qui s’allumeraient au moyen d’un mécanisme bien gradué, pourraient envelopper un navire, à volonté et en un instant, d’une trombe de flammes.
— Mais ce serait la suppression de toute suprématie navale !…
— Ah ! ah ! Tu as compris ! Mon cher ami, crois-tu qu’il y ait une sécurité réelle pour le possesseur d’un tel secret ? Il faudrait qu’un État fût gouverné par des anges, pour que tout ne fût pas mis en œuvre, afin de se procurer le monstrueux pouvoir d’anéantir tous ses ennemis et d’asservir tous ses rivaux. Voilà pourquoi Trémont est mort, et pourquoi j’ai perdu le sommeil, en pensant que mon fils a notoirement travaillé avec lui et peut être soupçonné de connaître ce mystérieux agent de destruction et de grandeur.
— Fais-le voyager. Envoie-le hors de France.
— Il y serait bien plus en danger. Là où il court le moins de risques, c’est chez nous, au milieu de gens qui nous connaissent. Ah ! je voudrais bien qu’il se fût débarrassé de ce lourd fardeau. Je l’ai supplié d’aller trouver le ministre et de lui donner les formules du général. On aurait annoncé, dans tous les journaux, que Marcel Baradier avait remis au Comité technique des poudres les notes relatant les expériences du général de Trémont. Il était dégagé, dès lors, et ne courait plus aucun risque… Sais-tu ce qu’il m’a répondu ?
— Raconte un peu.
— Avec une tranquille et souriante assurance, il m’a dit : mon cher père, la poudre du général a encore besoin d’un petit perfectionnement… Je sais ce qu’il voulait faire… Il me l’a expliqué. Je continuerai donc ses expériences et, quand le « point de sauce » sera parfait, je donnerai les formules à l’État, suivant sa volonté nettement exprimée, et je constituerai une Société avec l’explosif du commerce pour enrichir la fille de mon maître.
— Il est crâne, ce petit ! s’écria Graff avec émotion. Il sait pourtant bien ce qu’il risque !…
— Je me suis enroué à le lui démontrer. Mais c’est un sacré Lorrain : il a une tête de fer ! À tous mes arguments il a opposé une imperturbable résistance. Moi seul, a-t-il dit, puis mener à bien l’affaire. Si je donne les notes du général au Comité technique, il y aura un des gaillards, dont il est composé, qui s’emparera de la découverte et s’en fera de la gloire. À moins qu’il ne trouve moyen de gâcher l’invention par des adjonctions absurdes, ce qui est, au fond, le plus probable. Quant au produit commercial, si j’ouvre la bouche, avant d’avoir pris toutes les garanties nécessaires, il est dérobé en un clin d’œil et la fille du général est spoliée. Pour toutes ces raisons, et quelques autres encore, dont l’une est que cela m’amuse, je ne renoncerai pas à continuer l’œuvre que j’ai entreprise.
— Mais tu y joues ta vie !
— Est-elle si précieuse ? Tu passes ton temps à me crier que je suis un scélérat, que je te ruine, en attendant que je te déshonore. Eh bien ! Vous serez débarrassés d’un fils coupable et ingrat !
Graff frappa ses mains l’une contre l’autre :
— Tu vois ! Tu vois ! C’est là le résultat de ta dureté pour cet enfant ! Tu n’as que de mauvaises paroles à lui adresser ! Comment veux-tu qu’il t’écoute ensuite ?
— Ah ! Laisse-moi tranquille ! cria Baradier, pâle d’angoisse. Je suis assez tourmenté de ce qui m’arrive ! Tu ne vas pas m’en rendre responsable, par dessus le marché ! J’aime Marcel autant que tu l’aimes. Seulement, je ne suis pas toujours à le caresser, à le flagorner, à le bourrer d’argent ! S’il n’y avait eu que toi, pour lui prêcher la bonne conduite, nous serions bien ! Tu n’as jamais su qu’encourager ses mauvais penchants ! Tout ce qu’il a fait de mal, c’est de ta faute !
— Oui ! C’est moi qui l’y ai excité ! Je l’ai prêché d’exemple ! s’écria Graff. J’ai été son mauvais génie, tout le monde sait ça ! Vraiment, Baradier, je me demande si tu ne deviens pas fou ?
Baradier se promena avec agitation, puis il revint à son beau-frère, lui mit la main sur l’épaule et d’une voix tremblante :
— C’est vrai ! Je crois que je perds la tête. Pardonne-moi. C’est l’inquiétude qui me bouleverse. Nous n’avons que ce garçon-là, Graff. Pense à ce que nous deviendrions si la destinée voulait…
Graff se leva vivement :
— Tais-toi ! Ça porte malheur de prévoir les désastres. Il ne faut pas même admettre que cela puisse être. Mais, malgré tout, je ne puis blâmer Marcel de faire ce qu’il considère comme son devoir. S’il agissait autrement, il ne serait ni un Baradier, ni un Graff. Il se conduit comme un brave garçon. Seulement il faut veiller sur lui et le défendre contre ses propres imprudences.
Au même moment, à la porte du cabinet, deux coups furent frappés. Baradier alla ouvrir, et voyant Baudoin sur le seuil :
— Ah ! tu arrives à propos, toi. Entre. Et d’abord explique-nous où en sont les choses au Palais.
— Au Palais, monsieur, les choses en sont à zéro. Le juge d’instruction ne trouve rien. Les coupables ont fait le vide derrière eux. Autant essayer de saisir le vent.
— Alors ?
— Alors, M. Mayeur, au désespoir, ne pouvant pas arrêter les criminels, se contente d’arrêter les recherches et va classer l’affaire.
— En voilà une idée ! Est-elle de lui ?
— Non, monsieur.
— Quel est l’imbécile qui a pu la lui souffler ?
— C’est moi.
— Je te fais mon compliment. Tu as bien travaillé ! Les gredins, qui ont tué ton maître, se croyant assurés de l’impunité, vont recommencer leurs exercices…
— J’y compte bien !
— Mais, Marcel ? Animal ! Mon fils ? Qu’est-ce qu’il va devenir, dans tout ça ? Y as-tu pensé, seulement ?
— Je n’ai pensé qu’à lui. Me voici libre. Je pars, si vous le permettez, et ce soir, à minuit, je suis à Ars. La nouvelle de l’abandon de l’affaire ne paraîtra pas, dans les journaux, avant deux jours… J’aurai déjà organisé ma surveillance, là-bas. Et je vous jure qu’il n’arrivera rien à M. Marcel, ou bien alors c’est qu’on aura commencé par moi.
— Comme c’est rassurant ! grogna Baradier. Mais que faire, avec un enragé comme mon fils ? Où qu’il soit, il court des risques ! Ah ! maudite poudre ! Trémont avait bien besoin de lui raconter ses inventions ! Si cet explosif est aussi dangereux pour ceux contre lesquels on s’en servira, que pour ceux qui l’auront fabriqué, il y aura de belles tueries à la prochaine guerre !
Baudoin laissa passer avec philosophie ces récriminations paternelles. Il en comprenait la justesse. Mais avait-il le moyen de faire plus que de se dévouer pour défendre celui qui pouvait être, à un moment donné, si gravement menacé. Lorsque M. Baradier, ayant usé son mécontentement, se rassit consterné, Graff se décida à parler à son tour :
— En somme, dit-il, le vin est tiré, il faut le boire. L’important est de ne pas s’empoisonner avec. Un homme averti en vaut deux. La situation n’est pas la même que pour le général. Avec un peu de prudence, il sera facile de mener les choses à bien. Tout vient à point à qui sait attendre !
— En as-tu fini, avec tes proverbes, qui ne riment à rien ! cria Baradier, rendu à son exaspération par l’optimisme de son beau-frère. Sans tant de paroles, il suffit de donner à Baudoin pour consigne de prévenir la gendarmerie, s’il voit quoi que ce soit de suspect autour de Marcel… J’ai plus de confiance dans la force armée que dans la Providence, moi !
— Si c’est pour dire des absurdités pareilles que tu m’interromps, riposta Graff, tu aurais aussi bien fait de garder le silence. Que Marcel travaille. Plus vite il aura terminé, plus tôt il sera à l’abri. Jusque-là, Baudoin, je te le confie.
— Soyez tranquille, monsieur Graff, je vous réponds de lui corps pour corps. Et je ne m’en fie pas qu’à moi. Je vais faire venir un copain qui, à lui seul, en vaudra dix ! Je ne vous en dis pas plus. Fiez-vous à moi !
— Oui, mon brave garçon, je me fie à toi, s’écria Baradier.
— Alors, ça va bien ! dit Baudoin en se frottant les mains. Avez-vous quelque chose à faire dire à M. Marcel ?
— Qu’il soit raisonnable. Et qu’on l’aime bien. Et qu’il pense à nous !
— Au fait, as-tu de l’argent, pour ton voyage ?
— J’ai ce qu’il me faut, monsieur, je vous remercie. Au revoir donc, je suis bien votre serviteur.
Il salua et sortit. Derrière lui, le père et l’oncle restèrent silencieux, graves, réfléchissant. Enfin Graff se leva et dit :
— Il n’arrivera rien de mal. Je le sens, j’en suis sûr. Et tu sais que je ne me suis jamais trompé. Toutes les fois que nous avons reçu un mauvais coup, dans les affaires, j’en ai eu d’avance la perception très nette. Rassure-toi, Baradier, nous nous en tirerons sans avaries.
Le père, soucieux, répondit :
— Le ciel t’entende ! Mais du moment qu’il y a une femme dans le jeu, avec Marcel je ne suis pas tranquille ! Ah ! Si c’était toi, ou moi, parbleu, il n’y aurait pas de danger ! Mais, ce jeune fou !
— Ce ne sont pas les plus vieux qui sont les plus sages. Vois Trémont !
— Enfin ! À la grâce de Dieu !
Il tendit la main à son beau-frère :
— Et puis ne nous disputons plus. Ça n’avance à rien et ça nous fait de la peine !
— Eh ! Secoue-moi tant que tu voudras, vieille bête !… s’écria Graff avec émotion. Je m’en moque, et ça te soulage ! Mais sois assez discret pour ne rien dire à ta femme. Il est inutile qu’elle se tourmente.
Ils sortirent du bureau, et dans la cour ils virent alerte, presque joyeux, Baudoin sa valise à la main, qui partait.
DEUXIÈME PARTIE
VI
Ars est une petite ville de six mille âmes, à quatre lieues de Troyes, arrosée par la rivière de la Barse, et adossée aux collines que couronne de ses brousses et de ses sapinières la forêt de Bossicant. Le chemin de fer passe dans la vallée, desservant Vandœuvre et ses mines de fer, Bar et ses carrières de pierre. Des vignes s’étendent au Midi, sur les coteaux marneux. Les sources abondantes d’Ars et l’établissement thermal sont à un kilomètre de la ville, sur la route de Lusigny.
C’est en faisant des sondages, pour trouver du minerai dans des terrains qui n’en contenaient point, que M. Révérend, ingénieur en chef, a fait jaillir inopinément les eaux alcalines et ferrugineuses, qui pourraient faire concurrence, à la fois, à celles de Plombières et à celles d’Aix. Mais Ars est trop près de Paris, pour que les malades puissent avoir confiance dans les vertus curatives de ses sources. La station n’est fréquentée que par de petites gens et les hôteliers peu nombreux n’ont point l’habitude d’écorcher les voyageurs. Sur la côte, vers les bois de Bossicant, quelques villas perdues dans les arbres sont, chaque année, à la disposition des malades riches. Elles sont modestes, tranquilles, offrent aux hôtes méditatifs les détours solitaires et riants de la forêt. La fabrique de MM. Baradier et Graff, filature et tissage, est située sur la Barse, dont le courant rapide fait tourner les machines dynamo qui fournissent la force et la lumière. La maison d’habitation est séparée des ateliers par une vaste cour et par un beau jardin. La route de Vandœuvre passe devant la grille, et, de l’autre côté de la route, dans des prairies où toute l’année paissent les vaches et les chevaux, court le chemin de fer qui, par Chaumont, rejoint la frontière allemande. Ars est un centre ouvrier assez important. Les carrières et les mines occupent une partie de la population masculine.
La fabrique Baradier et Graff donne du travail à deux cents hommes, à cent femmes, et à beaucoup d’enfants. Le directeur de l’établissement, M. Cardez, est un lorrain de Metz, venu en France avec ses patrons, qui s’est marié dans le pays et, resté veuf avec deux grands garçons, vieillit, attaché à son devoir, excellent pour les ouvriers, mais de caractère taciturne et qui impose dans les ateliers une discipline quasi militaire. Ses fils sont, l’un dans l’armée, l’autre sous-directeur des usines de La Barre.
C’est un brave homme, n’offrant pas beaucoup de ressources, et que Marcel Baradier a pris, dès sa jeunesse, l’habitude irrespectueuse d’appeler « l’ours ». Jamais l’ours et Marcel ne se comprendront. Il y a, entre ce bon comptable et ce capricieux savant, la même distance qu’entre Pascal, inventeur de la brouette, et l’ouvrier qui devait la rouler docilement. Marcel aime bien Cardez, quoi qu’il le plaisante. Cardez respecte le fils de son patron, mais déplore qu’il soit si léger et si frivole. Ces deux hommes pourraient vivre en présence, pendant des années, sans que la moindre affinité se manifeste entre eux. Ils sont, comme le dit Marcel en riant, l’un négatif, l’autre positif. Cardez n’aime pas beaucoup que Marcel s’installe à l’usine, parce que sa présence est pour les ouvriers une cause de trouble. Le fils du patron écoute trop facilement les plaintes et les réclamations du personnel. La discipline des ateliers en souffre. L’ordre militaire cesse de régner. Et Cardez, plus ours que jamais, ne cesse pas de déblatérer sur ce qu’il appelle « les encouragements donnés au mauvais esprit des travailleurs. »
Les recherches de Marcel sur la coloration des laines laissent le directeur assez sceptique. Il ne trouve pas urgent de changer ce qui se fait depuis tant d’années et réussit fort bien. Un atelier de teinture lui a toujours paru tout à fait inutile. Les filés bruts, tels qu’on les fabrique depuis des années dans l’usine, et qui se vendent si régulièrement, suffisent amplement à l’activité de l’industrie. Et toutes ces inventions nouvelles, qui coûtent très cher, ne servent, suivant lui, qu’à apporter du trouble dans le fonctionnement d’une affaire en pleine prospérité. Le laboratoire, situé au bout du jardin, au bord de l’eau, dans un pavillon isolé, est l’objet des railleries du directeur qui le nomme le capharnaüm.
Depuis que Marcel était venu s’installer à Ars, contrairement à son habitude il avait à peine paru à l’usine.
Il s’était enfermé dans le capharnaüm où, disait Cardez, « il cuisinait » on ne savait quelle « popote chimique ». Quand il n’était pas enfermé dans le pavillon, Marcel prenait un fusil, son chien, et s’en allait battre les taillis de la côte, en lisière de la forêt de Bossicant. Baradier et Graff possédaient là, trois cents hectares de friche et de mauvais bois, extrêmement pittoresques, assez giboyeux, et des pentes desquels la vue s’étendait presque jusqu’à Troyes, par la ravissante vallée de la Barse. Certains plateaux de Bossicant rappelaient l’Écosse par l’âpre sauvagerie du site, la sèche aridité des bruyères, et la fraîcheur de l’air limpide.
À mi-chemin de la cavée, qui d’Ars montait vers le plateau, une villa en forme de chalet, enfouie sous les arbres, s’élevait, point rouge dans la verdure. Elle était triste, silencieuse et presque toujours inhabitée, à cause de son éloignement de la ville et de sa proximité des bois. Un matin, en passant devant la maison solitaire, Marcel constata avec surprise que les volets en étaient ouverts et qu’une domestique balayait sur la porte. Il allait se délasser, en chassant un lièvre, de la tension d’esprit qu’avaient exigée toute la matinée des calculs très compliqués.
La servante lui parut, par sa tenue presque élégante, étrangère au pays. Elle appartenait à quelque malade, sans doute, qui venait faire une cure d’eau et d’air. Marcel n’était point curieux et s’éloigna.
Il était trois heures, lorsqu’il parvint sur le plateau. Il le traversa nonchalamment. Il avait plus envie de flâner que de marcher. Cependant quelques voix données par son chien, excellent corniau habitué à mener le gibier comme un briquet, attirèrent son attention. Il glissa deux cartouches dans son fusil, et gagna le bord des pentes où, dans un fourré de bouleaux et d’herbes jaunes, la bête de chasse tournaillait sans prendre de parti. Au bout d’un court instant, grimpant le revers d’un talus à une trentaine de mètres, Marcel aperçut un lapin qui se décidait à gagner pays. Il l’ajusta, le coup partit, et, comme un paquet, la bête foudroyée roula au bas du raidillon. Le chien n’était pas loin. Il arriva, saisit le lapin par le râble, le lâcha, le reprit mieux, et d’un jarret vigoureux le rapporta à son maître.
Marcel débarrassa le chien triomphant, mit son gibier dans un carnier léger qu’il portait en bandoulière, désarma son fusil, et considérant qu’il avait assez fait de besogne pour le moment, il s’assit au pied d’un sapin, sur le sable, et resta à rêver, en regardant les lointains bleus de la forêt du Grand-Orient. Dans le lourd silence bourdonnant des bois un engourdissement délicieux s’empara de son corps, et sa pensée plus active, comme séparée de tout lien matériel, se mit à vagabonder. Il revit la maison de la rue de Provence, où son père et l’oncle Graff se disputaient si souvent à son sujet, et le salon de sa mère où Amélie, près de Mlle de Trémont vêtue de noir, travaillait paisiblement.
Puis il évoqua l’image d’une jolie femme, rousse, passant dans une élégante victoria attelée de deux chevaux fringants. Et il la vit qui lui souriait. D’un geste de son ombrelle elle lui faisait signe de venir la retrouver. Mais lui, tristement, ne répondait pas. Alors il entendit la voix de celle qu’il regrettait. Elle était moqueuse et tendre à la fois. Quoi ! mon petit Marcel, c’est fini ? On ne te verra plus. Ta famille a mis le holà et t’a coupé les vivres. L’oncle Graff, lui-même, s’est déclaré résolu à ne plus ouvrir sa caisse ? Que va-t-on devenir si les fils de famille ne peuvent plus suivre leurs penchants et, pour quelques dizaines de mille francs de plus ou de moins encourent la malédiction paternelle ! La vie était douce pourtant et joyeuse près de moi. Tu ne paraissais pas regretter le temps que tu perdais. Et moi, je t’aimais follement, car tu es un bien aimable garçon, et très généreux et très fou ! C’est lord Audley, à qui tu m’avais disputée, qui est maintenant mon seigneur et maître. Ma vie a continué pareille à ce qu’elle était, un peu plus brillante peut-être, parce que mon anglais est en possession de sa fortune, et la dépense sans qu’on le censure et le retienne. J’ai toujours le joli hôtel de l’avenue Kléber, où nous avons passé de si doux moments. La manucure vient encore, le vendredi, et me fait des propositions déshonnêtes de la part de jolis garçons qui voudraient bien être aimés par moi. Comme lord Audley m’est indifférent, j’écoute, à présent, la manucure, et je trompe mon insulaire, ce que je n’ai jamais fait de ton temps. Tu as eu bien tort de me quitter, mon coco, car je te trouvais si gentil que, si tu voulais revenir, je redeviendrais sage. Mais tu es loin, ton père a liquidé ton passif, qui était sérieux, et tu as promis d’être désormais aussi sérieux que ton passif. Adieu donc, mon petit Marcel. Il faut hélas ! beaucoup d’argent aux femmes. Même quand elles vous aiment. Car elles ne vivent pas de l’air du temps. Et la jolie rousse s’éloigna, en riant, au trot de son bel attelage, et, au détour d’une avenue, Marcel ne la vit plus.
Un aboiement de son chien, couché près de lui, interrompit, à ce moment, son rêve. Il cligna des yeux comme aveuglé par la lumière. Un pas trottinant sur les feuilles le fit détourner, et tout près, dans un sentier du bois, il aperçut un petit chien terrier, gros comme les deux poings, portant sur le front dans ses mèches soyeuses un nœud de ruban, qui s’avançait vers lui. Un peu plus loin, le suivant, marchait à pas lents une femme vêtue de noir. Il n’eut pas le temps d’examiner la nouvelle arrivante. Le petit chien, avec un glapissement furieux, venait de s’élancer sur le corniau, avec l’audace inconsciente d’un rat attaquant un tigre. Une douce voix cria : Bob ! En pure perte. Le chien de Marcel relevé venait de fondre sur son minuscule adversaire, et, d’un coup de son large poitrail, de le rouler dans la poussière.
— Bob ! Oh ! mon Dieu ! s’écria avec anxiété la promeneuse en s’élançant légère sur le lieu du massacre.
Marcel entendit la plainte, vit deux yeux admirables, brillants au milieu d’un pâle visage, il n’attendit pas davantage et, sautant sur son chien, il l’enleva par la peau du cou et le jeta en arrière. Puis, prenant le terrier encore haletant du choc, mais intact depuis les poils frisés de sa queue frétillante jusqu’au nœud de ruban de son front, il le montra à la dame avec un sourire :
— Rassurez-vous, madame, votre animal féroce est sain et sauf. Mais il était temps ! Excusez-nous, je vous prie, et considérez que nous n’avons pas été les agresseurs.
La promeneuse mit le chien sous son bras, lui donna une tape, en disant d’une voie grondeuse :
— Oh ! che bestia ! Una mosca che uste ingorare uno lupo !
Marcel pouvait la voir, maintenant, à loisir pendant qu’elle corrigeait tendrement son terrier, et il demeurait saisi d’admiration devant la suave beauté de l’inconnue. Un visage d’un ovale parfait encadré de cheveux dorés, des yeux bruns, languissants et doux, une bouche sinueuse et vermeille. L’air chaste et timide d’une jeune fille. Cependant elle était habillée de crêpe et en grand deuil, comme une veuve. Elle dirigea ses regards vers Marcel, et avec une grâce tranquille :
— Mille remerciements, monsieur, pour votre utile intervention. Et tous mes regrets à votre pauvre chien, qui était dans son droit et qui a été secoué pour n’avoir fait que se défendre.
— Il n’y a aucune comparaison à faire, madame, dit Marcel, entre cette charmante petite bête de luxe, et ce pataud habitué aux ronces et aux épines. Il a la peau dure. Mais je serais désolé d’avoir arrêté votre promenade… Vous pouvez marcher, à loisir, dans ces bois. Je vais attacher mon chien.
La jeune femme inclina la tête en signe de remerciement :
— Je suis chez vous, monsieur, si je comprends bien vos paroles… Je vous prie de m’excuser. Je suis étrangère, et j’habite le pays, seulement depuis deux jours, avec mon frère… Je ne connais personne qui ait pu me renseigner sur ce que j’ai le droit de faire…
— Ici, madame, tout ce qui vous plaira… Vous habitez sans doute la villa de la Cavée…
— Oui, monsieur…
— Cette promenade est à votre porte… Ces bois sont habituellement peu fréquentés par les promeneurs… Venez-y tant qu’il vous sera agréable…
Elle murmura d’un air un peu gêné :
— Mille grâces…
Elle salua, et, d’un pas lent et souple, qui mettait en valeur sa taille ravissante, elle s’éloigna. Marcel resta un instant immobile, à la suivre des yeux. Puis il siffla son chien, le caressa comme pour lui demander pardon de l’avoir rudoyé injustement, et pensif, regagna la fabrique. Il dîna, fuma dans le jardin jusqu’à neuf heures, se coucha et dormit sans rêver à la jolie rousse qui lui avait coûté si cher, et qu’il regrettait pourtant quelquefois.
Le lendemain il ne sortit pas. Il travaillait dans son laboratoire quand la porte s’ouvrit brusquement et Baudoin parut.
— Tiens ! Vous voilà ? dit le jeune homme. Est-ce que c’est mon père qui vous envoie ?
— Oui, monsieur, je suis chargé par toute la famille de vous apporter ses meilleures tendresses… Et puis je viens m’installer auprès de vous.
— Pourquoi faire ?
— Pour vous servir.
— Ah ! Et bien ! mon brave Baudoin, installez-vous. Ma foi, ce ne sera pas trop de votre présence ici, pour que les choses marchent convenablement. Les Champenois sont de braves gens, mais pas très débrouillards…
— Nous allons vous arranger tout ça.
Il tourna dans le laboratoire, regardant avec attention les objets qui se trouvaient sur la table, les alambics qui déroulaient leurs spirales de cuivre sur le fourneau.
— Et c’est dans cette pièce que vous travaillez ? Qui est-ce qui range ici ?
— Personne. Je ne veux pas qu’on y entre.
— Cela se voit. Moi je vous nettoierai vos ustensiles. Je connais la manière de leur parler. Est-ce que vous vous occupez des affaires du général ?
— Pas depuis que je suis arrivé. J’ai été pris par d’autres soins… Mais je vais m’y mettre… Je ne suis pas fâché que vous soyez ici, parce que vous me donnerez un coup de main, si j’ai besoin d’être aidé… Tenez, Baudoin, voilà des teintures vertes, roses et bleues, que j’ai fixées dernièrement, et qui donneront aux laines une couleur inaltérable.
Il maniait, en parlant ainsi des écheveaux d’un ton robuste et harmonieux, les étirant à la clarté du jour, en faisant jouer tous les reflets.
— C’est ce pauvre général qui m’avait donné l’idée de ces travaux. Ah ! S’il s’était contenté de faire des recherches industrielles, nous l’aurions encore bien vivant, bien portant, et il aurait fait fortune. Mais il dédaignait ces trouvailles productives. Il ne pensait qu’à l’État… Il ne voulait travailler que pour lui.
— Dame ! monsieur Marcel, depuis le temps qu’il le servait, il en avait pris l’habitude.
— Eh bien ! mon brave Baudoin, allez vous installer. Vous commencerez votre service ce soir.
Marcel resta dans son laboratoire, mais désœuvré, comme si une sourde préoccupation le travaillait intérieurement. Il s’assit dans un large fauteuil de cuir, qu’il avait baptisé gaîment le fauteuil de l’alchimiste, et, la fenêtre ouverte, pour laisser entrer le soleil, il resta à rêver, les yeux fixés sur les coteaux, comme si dans leurs taillis verdoyants il cherchait à découvrir la fine silhouette d’une promeneuse en deuil. Mais la distance était grande, les bois de Bossicant discrets, et il s’étira, dolent et ennuyé, jusqu’à cinq heures.
Il descendit dans le jardin, se promena le long des plate-bandes de rosiers, s’arrêta au bord de la rivière et s’occupa, très sérieusement, à regarder, sous les eaux claires comme du cristal, un brochet qui chassait des gardons, passant noir et rapide, tandis que les fuyards, afin d’éviter la redoutable poursuite, jaillissaient hors du courant, ainsi que des flèches d’argent. La cloche d’entrée, en sonnant, l’arracha à son occupation, et il vit s’avancer vers lui, sous la conduite du concierge, un grand jeune homme élégamment vêtu, très beau de visage, avec des yeux bleus, une moustache frisée sur une bouche souriante. En approchant, il mit le chapeau à la main, salua avec beaucoup de déférence et dit avec un accent italien chantant et nasillard :
— C’est à M. Marcel Baradier que j’ai le plaisir de parler ?
— Oui, monsieur, dit Marcel en examinant l’étranger, avec un intérêt soudain. Qui me vaut l’honneur de votre visite ?
Le jeune homme d’un oblique coup d’œil s’assura que le concierge s’éloignait, puis avec une désinvolture non exempte de hauteur :
— Monsieur, permettez, puisque je n’ai personne pour me nommer à vous, que je présente moi-même. Je suis le comte Cesare Agostini, des Princes de Briviesca. J’habite avec ma sœur le chalet de la Cavée, et je viens vous remercier de la bonne grâce avec laquelle vous avez hier favorisé sa promenade…
— Monsieur, dit Marcel, il n’y a là rien que de très naturel. Le hasard m’avait conduit sur le chemin de Madame votre sœur. Elle est étrangère au pays. Elle paraissait triste et cherchait la solitude… Autant qu’il dépendait de moi, j’ai cherché à lui complaire. Voilà tout.
Le comte Cesare s’inclina avec grâce. Son joli visage s’assombrit et avec un accent plaintif il reprit :
— Ma sœur est triste, en effet : elle a eu de grands chagrins… Elle s’est épuisée à soigner un mari plus âgé qu’elle de beaucoup, et qu’elle a eu la douleur de perdre, il y a quelque temps… C’est pour réparer sa santé qu’elle est venue dans cette vallée chercher le calme, le silence… On nous a aussi beaucoup recommandé les eaux d’Ars… Mais c’est surtout de grand air que ma sœur a besoin, après être restée enfermée, pendant de longs mois, auprès d’un moribond…
Le bel italien hocha la tête, à diverses reprises, en disant :
— Oh ! C’est bien douloureux ! Bien douloureux !
— Et vous venez d’Italie, avec Madame votre sœur ? demanda Marcel.
— Non ! dit Cesare. Mme Vignola habitait Paris, où je suis venu la rejoindre, récemment… Nous retournerons à Naples, où nous nous fixerons. Mais à l’automne seulement… Ah ! C’est bien douloureux ! Bien douloureux !
Marcel vit que le comte Cesare ne paraissait pas désireux de prendre congé, et comme il trouvait de l’intérêt à ce qu’il lui racontait, il conduisit le visiteur jusqu’à une tonnelle où des sièges rustiques s’offraient, à l’abri des rayons du soleil à son déclin.
— Prenez la peine de vous asseoir, monsieur, je vous prie…
L’italien choisit un fauteuil, sans façon, s’installa, tira de sa poche un étui en or ciselé et le tendant à Marcel :
— Une cigarette ?
— Volontiers.
Ils commencèrent à fumer et le tabac sembla rendre Cesare encore plus loquace :
— Cette villa que ma sœur habite est fort écartée. Le pays est-il sûr ?
— Très sûr. Madame votre sœur n’a rien à craindre de qui que ce soit.
— Tant mieux ! Je ne compte pas rester longtemps auprès d’elle. Mes affaires me rappellent à Paris, et l’idée de la laisser seule, avec sa femme de chambre et une fille de service, qui m’est inconnue, me tourmentait, je ne vous le cache pas. Est-ce qu’il n’y a jamais plus de monde à Ars ?
— À cette époque de l’année, jamais. La saison des eaux ne commence guère qu’en juin et nous ne sommes qu’en avril… Dans deux mois, les hôtels seront pleins et les routes seront parcourues par toutes les pataches du pays… C’est le moment que je choisirai pour m’en aller…
— Vous n’habitez pas toute l’année ici ?
— Non, je n’y séjourne même qu’à intervalles assez éloignés… Ma résidence est à Paris… Je ne viens à Ars que pour affaires…
— Vous avez une très importante industrie ?
— C’est une des grosses fabriques du département… Mon grand-père l’a fondée… C’est le berceau de notre famille et la source de notre fortune… Aussi mon père, qui est banquier, n’a jamais voulu céder l’établissement et a continué à s’en occuper, quoiqu’il ait des intérêts bien plus considérables engagés dans d’autres entreprises…
— Je vois que c’est à vous qu’il a confié le soin de gérer l’usine…
— Non pas. Il y a un directeur qui représente mon père… Moi je ne suis rien, ici, que le fils du patron… Je ne me mêle, en aucune façon, de la gestion du tissage… J’ai un laboratoire, et comme je suis un peu chimiste, je fais des expériences… Mais tous les gens du pays vous diront que je suis un amateur, pas sérieux du tout, et que je dépense pour plus d’argent de produits que mes prétendues découvertes ne rapporteront jamais.
Il riait gaîment, en parlant ainsi, et le bel italien se mit à l’unisson. Il dit de sa voix chantante :
— Ah ! les fils de famille, sont toujours mal jugés. Il est extrêmement difficile, quand on est riche, de se faire prendre au sérieux comme travailleur. De ce qu’on n’a pas besoin d’argent, les gens concluent volontiers qu’on est incapable d’en gagner… Et cependant pourquoi un homme riche n’aurait-il pas du génie ?
— Oh ! monsieur, que deviendraient, alors, les pauvres diables ?
— Mais, reprit le comte Cesare avec un geste gracieux, vous affectez vous-même de mépriser ces travaux, quoi qu’ils soient peut-être très intéressants ?…
— À peu près autant que les expériences d’un teinturier… Je fais macérer des laines, dans des cuves de couleur, et je cherche à fixer les teintes d’une manière inaltérable, afin que les étoffes qu’on vendra dans l’avenir ne « passent plus », comme on dit, au vent, à la pluie, ou à la lumière… Les tapisseries qu’on pose sur les meubles, aujourd’hui, ou sur les murailles, à peine en place, c’est un déjeuner de soleil : elles ne sont déjà plus ! Les étoffes anciennes duraient, cependant. Elles existent encore. Nos pères avaient des procédés de teinture supérieurs aux nôtres, et pourtant la chimie moderne nous offre de grandes ressources… Voilà, monsieur, à quoi je travaille… C’est bien terre à terre, comme vous voyez…
— Évidemment, ce n’est pas la pierre philosophale ! Mais toute recherche a sa valeur… Avez-vous obtenu des résultats satisfaisants ?
Marcel s’inclina railleusement :
— Monsieur, je suis très sensible à votre politesse. Vous voulez me prendre par mon faible… Les inventeurs sont toujours enclins à parler de leurs travaux, pensez-vous, et je vais rendre à ce garçon la monnaie des prévenances qu’il a eues pour ma sœur… Vous seriez bien attrapé, sans doute, si je prenais votre curiosité au sérieux et si je vous montrais mes échantillons ?…
Le regard de l’Italien se voila, il baissa la tête et d’une voix contrite :
— Je suis vraiment désolé que vous ne croyiez pas à la sincérité de mes paroles… Tout ce que vous m’avez dit m’a intéressé véritablement. Je ne suis pas aussi frivole, sans doute, que vos compatriotes, et puisque vous paraissez me mettre au défi d’examiner vos travaux avec satisfaction, je vous demande de me faire la faveur de me les montrer… À moins toutefois que vous n’ayez voulu plaisanter, ce que j’aurais parfaitement pu ne pas comprendre, ne saisissant pas toujours toutes les finesses de votre langue. Au quel cas je vous demande de m’excuser.
— Parbleu ! non ! J’étais tout à fait sérieux, dit Marcel gaîment. Et je continue à croire que vous serez puni de votre curiosité… Mais puisque vous me la manifestez avec un peu d’insistance, prenez la peine de me suivre. Je vais vous ouvrir mon laboratoire…
— Grand merci ! s’écria Cesare. J’avais craint de vous contrarier…
— Et en quoi ? Vous croiriez à des choses merveilleuses, si je ne vous montrais mes pauvretés… Seulement prenez garde de vous salir… Tout n’est pas ici d’une rigoureuse propreté…
Il ouvrait la porte du pavillon et faisait entrer le comte dans la première pièce lambrissée, précédant le laboratoire, et qui lui servait de cabinet de travail. Une rougeur monta aux tempes de Cesare. Il regarda vivement autour de lui. Sur un bureau Louis XVI, adossé à la muraille, des papiers étaient épars, couverts de chiffres. Un tiroir entr’ouvert laissait apercevoir des boîtes de formes et de couleurs diverses, étiquetées avec soin. Une table massive supportait des bocaux sur le verre dépoli desquels se lisaient ces indications : acide sulfurique, nitro-benzine, acide picrique. Et toute une série de chlorates. L’Italien désignant la table dit :
— Eh ! voici des produits qui ne vous servent pas pour vos teintures ?…
— Non fit Marcel d’un air évasif. Çà, c’est pour autre chose…
Et, comme son visiteur s’approchait, la main tendue vers un des bocaux :
— Ne touchez pas à ces flacons, c’est dangereux… Si, par hasard, vous renversiez ce qu’ils contiennent, nous pourrions, vous et moi, être fort incommodés… Venez plutôt par ici.
Il lui ouvrait la porte du laboratoire. Là, il l’installa dans le fauteuil de l’alchimiste, près la fenêtre, et lui dit :
— Ici vous pouvez fumer, si vous voulez, c’est sans inconvénients… Rien ne peut s’allumer, ni éclater.
— Ah ! tandis que dans la pièce voisine ? demanda nonchalamment l’Italien.
— Dans la pièce voisine, si vous jetiez une allumette, mal à propos, vous pourriez faire sauter toute la fabrique… Et nous avec.
— Diavolo ! Je ne fumerai pas, même ici, cher monsieur, je n’ai pas envie de sortir de chez vous à travers le toit.
Il se laissa montrer avec patience, par Marcel, ses beaux échantillons de laine teinte. Il l’écoutait, en apparence, attentivement, mais son intelligence en éveil, ses yeux perçants, sous ses paupières à demi fermées, s’occupaient de cette « autre chose » dont Marcel avait parlé si brièvement. Mais rien ne paraissait se rapporter, dans le laboratoire, à cette mystérieuse besogne qui exigeait la manipulation de produits si redoutables.
— Il faudra dit l’Italien, que vous me donniez de ces belles laines d’une si riche et si harmonieuse couleur. Je les porterai à ma sœur, qui brode comme une fée… Elle en fera quelque magnifique ouvrage, qui charmera sa solitude, et vous verrez ainsi l’effet de vos couleurs artistement employées.
— Je vous les porterai, moi-même, si vous m’y autorisez, déclara Marcel.
— Mais comme il vous plaira… Nous sommes toujours rentrés vers cinq heures. Seulement pressez-vous, si vous désirez me trouver encore dans le pays, car je vais partir bientôt…
— Eh bien ! Demain, si vous voulez…
— Soit ! Demain.
L’Italien se leva. Il fit le tour du laboratoire, et s’approcha de la fenêtre qui donnait sur la rivière.
— Eh ! Vous êtes sur l’eau, ici… Vous pourriez pêcher, sans même descendre dans votre jardin… Vous ne craignez pas qu’on entre chez vous, par là ? Il suffirait d’un bateau à quelques maraudeurs, pour pénétrer dans ce pavillon.
— Qui diable en aurait l’idée ? s’écria Marcel. Et qu’y viendrait-on prendre ? Il n’y a rien. Et on ne l’ignore pas… Les gens du pays sont du reste fort honnêtes…
— Mais, à la fabrique, n’avez-vous pas des ouvriers étrangers ?
— Rarement. Quelques belges… ou des Luxembourgeois… Le moins que nous pouvons, car ils sont difficiles à mener.
— Vous n’habitez pas un pavillon isolé ? Vous n’y couchez jamais ?
— Non ! Il n’y a pas de logement… Un grenier, au-dessus de ce rez-de-chaussée, et c’est tout… Moi, j’habite la maison qui fait face à celle du directeur… C’est petit, mais très confortable… Mon oncle Graff y a vécu longtemps…
— Vous êtes heureux d’avoir des attaches de famille, fit Cesare avec un geste mélancolique. Ma sœur et moi nous sommes seuls… Des difficultés d’intérêt nous ont brouillés avec les Briviesca… M. Vignola n’avait point de parents… Il faut que nous nous soyons tout, l’un à l’autre…
— Mme votre sœur est jeune et charmante. Elle peut se remarier.
— Elle n’y pense guère… Après toutes les tristesses que lui a causées son union avec M. Vignola, elle n’aspire plus qu’au calme et au repos… Oh ! Elle a tant souffert ! Ce malheureux Vignola, impotent, ravagé par la maladie, était d’une jalousie folle. Il ne supportait pas que sa femme s’écartât de lui, pour une heure. Constamment il voulait l’avoir devant les yeux… Il lui a laissé, en mourant, une grande fortune… Faible compensation pour toutes les tortures qu’il lui a fait endurer ! Enfin ! Il est mort ! Paix à sa mémoire.
— Mme votre sœur n’a pas d’enfant ?
— Non, Monsieur, et c’est son plus grand regret.
L’image de la jeune femme en noir, se promenant mélancolique dans les bois de la côte, s’évoqua devant Marcel. Bien jolie pour être inconsolable de la perte d’un vieux mari ! Quel âge pouvait-elle avoir ? Vingt-cinq ans, peut-être, tout au plus, et nulle connaissance de la vie, si ce n’est la douleur et la tristesse. Cesare se levait et, de sa voix chantante, prenait congé. Marcel le reconduisit, à travers le jardin, jusqu’à la grille et là avec un cordial sourire :
— À demain, donc, Monsieur, et offrez mes hommages à Mme votre sœur.
L’Italien parti, Marcel se dirigeait vers la fabrique, lorsque venant à lui, il aperçut M. Cardez, rouge encore plus qu’à l’ordinaire et les sourcils froncés.
— Ah ! M. Marcel, dit-il, j’allais chez vous… J’ai des embêtements et je suis vraiment bien aise que vous soyez à l’établissement, pour vous rendre compte, par vous-même, et renseigner MM. Baradier et Graff.
— Qu’est-ce qu’il y a donc ?
— Il y a que les teinturiers et les débourreurs ne sont pas contents de leurs heures de travail et menacent de se mettre grève.
— Bon ! Voilà du nouveau !
— Du nouveau ! Non, il y a plus de trois semaines que ça couve et je voyais l’affaire se manigancer… J’espérais que, la saison d’été arrivant et les heures de jour étant plus nombreuses, on pourrait s’arranger. Mais en voilà bien une autre ! Maintenant il ne s’agit plus d’augmenter le travail. Au contraire : ils veulent travailler moins et gagner davantage.
— Ah ! Et leur prétention est-elle justifiée ?
Le directeur se ramassa comme un dogue qui va mordre, et jetant un regard indigné sur le fils de son patron :
— Est-ce que les prétentions des ouvriers sont jamais justifiées ? Ces gens-là n’ont qu’un programme : le minimum de travail et le maximum de salaire.
— Eh bien ! mais ils sont comme tous les autres hommes, dit tranquillement Marcel.
— Ah ! monsieur, laissez dire cela à leurs meneurs, ne le dites pas vous-même.
— Pourquoi donc ?
— Parce qu’avec des théories philanthropiques et des tendances au laisser-aller, bientôt nous ne serions plus maîtres de nos usines et qu’on nous en mettrait dehors !…
Marcel regarda gravement le directeur et répliqua :
— Je suis tout à fait d’un avis opposé au vôtre. Je pense que si l’on traitait les ouvriers, comme des associés, on obtiendrait d’eux plus de travail et plus de discipline… Il y a un grand malentendu entre le capital et le travail. Ils se traitent en ennemis, réciproquement, quand ils devraient marcher de concert ainsi que des alliés…
— Eh ! C’est du socialisme !
— Non ! C’est de la coopération, tout simplement.
— Et savez-vous, dit Cardez, en regardant Marcel d’un air narquois, quel est, en particulier, le véritable motif du mécontentement des teinturiers ?
— Leur véritable motif ? Leurs griefs manifestés ne sont donc que prétexte ?
— Parfaitement. Ces ouvriers, dont le sort vous intéresse, ne sont que duplicité. Ils ne montrent jamais le fond de leur pensée… Eh bien ! les teinturiers, dans leurs conciliabules secrets, déblatèrent contre vos inventions et ce sont vos nouveaux procédés de teinture qui les mécontentent !
— Ah ! les imbéciles !
Le visage grognon de Cardez eut une expression de triomphe :
— Quand je vous le disais ! Voilà des procédés qu’ils ne connaissent pas encore et ils prétendent qu’en les cherchant vous avez eu pour but de simplifier la main-d’œuvre et, par conséquent, de vous passer des ouvriers… Alors ils poussent à la grève, pour obtenir des concessions sur le travail et sur le salaire…
— Ils sont mal conseillés. Il suffirait de leur expliquer les choses pour les leur faire comprendre. Ils verraient alors que, loin de leur nuire, les perfectionnements apportés par moi dans la fabrication sont tout à leur avantage…
— Ils ne l’admettront jamais.
— Et, si je le leur prouve ?
— Les meneurs leur prouveront le contraire.
— Par qui donc sont-ils excités ?
— Par des Belges…
— Mettez-les dehors !
— Ah ! Ce serait tout à fait imprudent ! Il vaut mieux patienter, négocier et tâcher d’arriver à une entente… Ces gens-là sont du pays Wallon et, quand ils ont un verre d’eau-de-vie blanche de trop dans la tête, on peut tout craindre d’eux… C’est un de ces Belges qui, l’an dernier, a donné des coups de couteau à son contre-maître… Ils sont bons ouvriers, mais méchants comme la gale… Il n’y a pas péril en la demeure… C’est une affaire à suivre de près… Maintenant, si vous voulez les réunir et leur parler, vous verrez ce que vous pourrez en faire…
Il ricanait, en parlant ainsi. Marcel comprenait bien que, fort de son expérience, le directeur pensait : Va te frotter à ces brutes, mon petit blanc-bec, tu apprendras à les connaître. Fais-leur de beaux discours, pour expliquer qu’il est à leur avantage de travailler bien sagement, afin que tu aies de beaux bénéfices au terme de l’année, pendant qu’ils auront, eux, joint difficilement les deux bouts de leur modeste budget. Essaie d’obtenir leur approbation. Après, tu viendras me raconter ce que tu auras obtenu. À moins de leur donner ton usine et des capitaux pour la faire marcher, et peut-être même de leur garantir des dividendes, tu ne les contenteras pas !
Marcel ne voulut pas discuter plus longtemps avec Cardez. Il jugeait nécessaire de ne pas affaiblir l’autorité du directeur, dans un moment de crise. Il résolut de lui prêter le plus large concours, pour éviter les difficultés qu’il prévoyait :
— Vous pouvez être sûr, M. Cardez, que tout ce que je pourrai faire pour vous aider, vous n’aurez qu’à me l’indiquer. Il est possible que nous n’ayons pas les mêmes idées sur la façon de régler les questions ouvrières. Mais ce n’est pas lorsque le feu est à une maison qu’il faut discuter sur le système des pompes avec lesquelles on peut le plus sûrement éteindre l’incendie. Le mieux est de se servir de celles qu’on a sous la main. Faites donc ce que vous jugerez convenable. Avez-vous prévenu mon père ?
— Non, certes. Je n’ai pas l’habitude de tourmenter ces messieurs avec le récit des difficultés de l’exploitation. Si la situation s’aggrave, il sera temps.
— Très bien ! Alors, attendons.
À la même heure, le comte Cesare Agostini arrivait à la villa de la Cavée, et, le jardinet traversé, entrait dans un petit salon du rez-de-chaussée, où la jeune dame en deuil, étendue sur une chaise longue, parcourait un roman d’un œil distrait. Le soleil à son déclin entrant par la fenêtre, dorait de ses rayons le visage de la liseuse. Ce n’était plus la mélancolique et timide veuve rencontrée dans le bois de la côte. Sa coiffure, relevée sur le front donnait à son délicat profil toute sa fierté hardie. Le regard était vif et ferme. La bouche souriait éclatante. Au bruit des pas de Cesare, la jeune femme jeta son livre, se dressa sur ses pieds avec vivacité, et d’un ton joyeux :
— Eh bien ! caro mio, vous voilà revenu ? Êtes-vous satisfait de votre ambassade ?…
— Autant qu’il est possible. J’ai vu notre pigeon. Il tend l’aile de lui-même. Vous n’aurez pas de mérite à plumer ce garçon-là, Sophia !
Elle se mit à rire :
— Je ne tiens pas à avoir de mérite. Le succès me suffit. Je me passe de la gloire. Alors vous avez trouvé le terrain bien préparé ?
— Je crois que les distractions manquent dans le pays, et que votre apparition dans les bois a produit son effet sur notre Marcel.
— Alors il viendra ?
— Pas plus tard que demain… Je lui ai annoncé que je partais… Vous aurez donc le champ libre, pour faire vos exercices… Menez-moi cette affaire-là rondement… Vous avez une revanche à prendre…
— Eh ! mon cher, le coup a manqué, la première fois, par le stupide entêtement de Hans. S’il m’avait laissé libre d’agir à ma guise, le général m’aurait offert ses formules sur un plat d’argent, et à genoux… Hans a tout voulu brusquer, et le vieux Trémont, si amoureux qu’il fût, a eu de la défiance. Fichue aventure, où notre ami a perdu un bras et où nous avons failli être tous compromis ! Ce qu’il y a de plus bête, c’est que le général avait dit à Hans en lui montrant le coffret d’acier… Un beau coffret de chez Fichet, avec une de ces admirables serrures si compliquées, qui ne servent à rien du tout : « Regardez, mon cher, il est impossible d’ouvrir ceci sans ma permission… Tous mes secrets sont dedans… En levant ce couvercle on trouverait toutes mes formules… Mais il y a la manière de le lever… On peut y laisser sa vie. » Eh ! Eh ! Il disait vrai le vieux Trémont ! Il avait fait de son coffret une sorte de bombe à renversement… Il fallait savoir le manier… Hans s’en est aperçu… Et encore il se méfiait ! Il avait pris la précaution de sortir sur le perron de la maison, et c’est là qu’il s’escrimait à ouvrir la boîte d’acier… Ah ! caro mio, quand l’explosion s’est produite, la terre a tremblé… J’étais, avec la voiture, déjà rentrée dans Paris… La commotion a été si forte que les glaces du coupé en ont vibré… Moi, j’ai pensé : voilà mon Hans qui a tout cassé… Je ne croyais pas si bien dire… La maison était détruite… Et il est impossible de comprendre comment Hans, qui avait réussi à ouvrir la serrure du coffret, et qui, couché par terre, à vingt mètres derrière un arbre, tirait le couvercle avec une corde, redoutant, et à juste titre, quelque diablerie, n’a pas été mis en charpie…
— Mais puisque la serrure du coffre était ouverte, comment l’explosion s’est-elle produite ?
— C’est quand le couvercle s’est soulevé que tout a éclaté. Le coffre s’est-il renversé ? Il était cependant bien lourd… Y avait-il une manière spéciale de le placer en l’ouvrant, pour empêcher de partir une amorce de fulminate ? Y avait-il un mouvement d’horlogerie disposé d’une certaine manière ? Tout n’est que conjectures. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’en une seconde, le coffre, les formules, les poudres, la maison, le bras de Hans et nos espérances, tout a été perdu ! Il a fallu l’énergie extraordinaire de notre ami pour qu’il ne fût pas surpris par les gens qui, de tous côtés, arrivaient… Et je vous prie de croire que tant que je n’ai pas été sûre qu’il était hors d’atteinte, je n’ai pas été fière…
— Ah ! Vous êtes une femme de tête, Sophia, et vraiment courageuse et habile… Maintenant il s’agit de réparer une première défaite et de mettre à quia ce jeune nigaudinos de fils de famille.
— Rapportez-vous-en à moi… Il m’a paru gentil ce garçon…
— Il n’est pas mal. N’allez pas vous en toquer, au moins !
Elle se mit à rire :
— J’ai autre chose à faire… Et puis, Cesare, est-il donc si facile de vous trouver un rival ?
Le bel Italien hocha la tête :
— Vous êtes si bizarre, Sophia. N’est-ce pas ce qui est difficile justement qui vous tente ?
— Une scène de jalousie, Cesare, entre nous ? dit Sophia avec un ironique reproche. Ne nous connaissons-nous pas assez pour être blasés sur nos qualités et sur nos défauts ? Serai-je jalouse le jour où je vous aurai marié avec la fille richissime de Lichtenbach ? Vous vivrez, cependant, avec une autre femme ? Mais qu’est-ce que cela pourra me faire, si votre cœur est à moi ? Prendrez-vous de l’ombrage, si je suis obligée de donner de ma personne pour obtenir que le jeune Marcel me livre tout ce qui lui appartient et surtout ce qui ne lui appartient pas ? Ma beauté, mon cher, est un capital dont il s’agit de tirer le plus gros intérêt possible. L’important, c’est que vous touchiez les dividendes. Pour le surplus, fermez les yeux et laissez-moi libre. D’ailleurs cela ne vous servirait à rien d’agir autrement. Vous n’ignorez pas que je n’ai jamais fait que ce qui m’a plu, même avec des seigneurs autrement redoutables que vous !
— La ! La ! Sophia, ne vous excitez pas. Tout à l’heure, si je ne vous arrête, vous allez me menacer. Ah ! Vous avez une terrible volonté !
— Oui. Et en ce moment, ma volonté, c’est de mettre le jeune Baradier dans ma poche.
— Le pauvre diable ! Vous y réussirez trop facilement !
— Plaignez-le donc, maintenant, je vous en prie !
Ils se mirent à rire tous les deux, puis la jeune femme demanda :
— Vous avez visité le logis ?
— Oui. Sans le moindre effort, j’ai obtenu l’entrée du laboratoire.
— Qu’y avez-vous vu de particulier ?
— Pas mal de toiles d’araignées, beaucoup de fioles cassées et des baquets de couleurs variées dans lesquels trempaient des laines…
— Et rien qui ressemble aux poudres que nous cherchons ?
— Rien du tout. Je dois dire que, dans une des pièces du pavillon, notre jeune homme m’a prévenu charitablement que si je touchais à un seul des flacons qui se prélassaient sur la table, il en pourrait résulter quelque catastrophe… C’est donc là qu’il manipule ses produits, ou qu’il les recèle… Dans la pièce voisine, il n’y a rien de suspect. Il m’a dit : ici vous pouvez fumer, si vous voulez, c’est sans danger…
— Ceci est bon à savoir.
— Pensez-vous donc à aller chez lui ?
— Je ne pense à rien et je pense à tout. Sait-on jamais quels moyens d’exécution on emploiera. La sagesse consiste à en préparer plusieurs, de façon à n’être pas pris au dépourvu. Je me suis engagée à livrer les formules du général de Trémont. C’est pour moi, en même temps qu’une question d’intérêt, une affaire d’amour-propre. Je n’admets pas de ne point réussir dans une entreprise. Nos amis de l’étranger me considéreraient comme une non-valeur si j’échouais, et vous savez ce que me vaut leur appui. Tant que l’influence dont je dispose existera, le baron Grodsko se tiendra à l’écart et ne s’occupera pas de moi. Que je cesse d’être protégée demain, et Dieu sait quels comptes j’aurais à lui rendre !…
Césare regarda la jeune femme avec surprise :
— Eh ! vous êtes presque émue !… Vous le craignez donc celui-là ?
Sophia devint grave :
— Je ne crains personne au monde, vous le savez bien, mais Grodsko est un homme terrible, surtout quand il n’est pas ivre…
— Ajoutons vite qu’il l’est toujours. Est-ce parce qu’il aime à boire ?
— Non ! c’est pour oublier.
— Oublier quoi ? Vous ?
— Peut-être.
— Il vous a passionnément aimée ?
— Comme tous les autres…
— Combien y a-t-il de temps que vous ne l’avez vu ?
— Quelques années.
— Et il est toujours à Monte-Carlo ?
— En hiver. En été il habite Vienne.
— Et à Monte-Carlo ou à Vienne, il boit ?
— Et il joue. Mais il a une façon de boire qui lui laisse toute sa lucidité, de sorte qu’il peut jouer.
— Et il gagne ?
— Souvent. Mais qu’est-ce que cela peut lui faire ?
— Il est si riche que le gain lui est indifférent ? Heureux homme !
— Grodsko est possesseur de tout un district, en Moravie… Il a des forêts, des montagnes et des villages… Les forêts fournissent les plus beaux sapins de l’Europe… Les montagnes sont trouées de mines d’où l’on extrait l’étain et le cuivre… Quant aux villages, Grodsko, s’il levait les paysans de son domaine, pourrait, en cas de guerre, fournir deux régiments…
— Et vous avez quitté ce nabab ?
— Pour un garçon qui n’avait que sa jolie figure, oui, mon cher…
— Et qu’est-ce qu’il a dit de ça, Grodsko ?
— Il n’a rien dit. Il s’est mis à notre poursuite, nous a rejoints et a tué l’homme.
— Quant à vous…
— Moi, j’avais gagné la frontière, où j’attendais mon amant…
— Et ce fut Grodsko qui arriva.
— Ce fut Grodsko qui arriva.
— Il s’en suivit ?
— Une explication, au cours de laquelle ayant osé lever la main sur moi, je lui plantai dans le bras un des couteaux qui étaient sur la table où je venais de déjeuner…
— Exquises relations ! Il se tint pour satisfait ?
— Non. Il me lia et me ramena à Vienne dans sa voiture… C’est là que je réussis à lui échapper, grâce à des influences irrésistibles… Il m’en coûta cher pour reconquérir ma liberté… Mais, à compter de ce jour-là, je n’eus plus rien à craindre, et pus courir le monde à ma fantaisie…
— Quel est le grand personnage qui vous rendit ce service ?
Sophia regarda le bel Italien avec un air railleur, elle fit claquer ses doigts comme des castagnettes et répondit :
— Si on vous le demande, vous direz que vous n’en savez rien !…
— Vous n’avez pas confiance en moi, Sophia ?
— Je n’ai confiance en personne. À peine en moi-même. Sachez-moi gré de ma franchise. Je pourrais vous raconter des histoires, vous dire que ce fut le ministre de la police qui me donna la clef des champs, ou un archiduc, ou un ambassadeur étranger… ou les trois réunis… Tenez seulement pour certain que j’ai contracté des obligations envers ceux qui m’ont servie, et que je les sers à mon tour.
— Ils ont fait une bien bonne affaire, quelque obligation que vous leur ayez ! Une alliée telle que vous ! En est-il au monde une autre qui vous vaille ? Vous avez le génie de la corruption, et je ne crois pas qu’une conscience soit assez forte pour vous résister. Tout ce que vous entreprendrez, s’il s’agit de séduire et de charmer, vous le réussirez. Ah ! votre puissance est bien grande et bien redoutable !
Sophia sourit amèrement, son front se releva et son visage prit une expression menaçante :
— Toute ma puissance réside dans mon mépris de l’humanité. Je crois les hommes capables de tout. La seule question est de trouver le moyen de les faire agir. J’ai vu les plus braves en face de la mort, devenir effarés et tremblants à l’idée d’être privés de leur jouissance. Les plus rigides au point de vue de l’honneur, mis aux prises avec le besoin, devenaient accessibles à toutes les compromissions. Pour faire d’un homme probe un voleur, il suffit d’un sourire de femme. Pour entraîner le plus doux des êtres à faire couler le sang, il ne faut qu’exciter sa jalousie. Ces pauvres hères qui peuplent la terre agissent inconscients de l’influence qui les mène. Ils s’agitent, pantins dont les ficelles sont tirées par des mains hardies et ils accomplissent à volonté les actions sublimes ou les actions infâmes. Ils se dressent en plein ciel dans l’admiration universelle, ou se vautrent dans la boue et dans le sang, au milieu des cris d’horreur et de réprobation. Et qu’a-t-il fallu pour cela ? Une influence, favorable ou perverse, une ficelle tirée du bon côté ou du mauvais. Et l’homme, agent irresponsable d’une destinée qu’il subit, sans pouvoir la modifier, est traité de héros ou de brigand, conduit au triomphe ou jeté au ruisseau.
— Mais la vertu, Sophia, l’amour du bien ?
— Ce sont des accidents, mon ami. N’en faites pas des règles générales. La plupart des gens sont vertueux, parce qu’ils n’ont pas eu l’occasion d’être des scélérats. Mais ne doutez pas qu’ils en eussent été, et de très réussis, très facilement ! L’âme humaine, Cesare, est un terrain tout préparé pour le vice et le crime. C’est une question d’ensemencement. Eh bien ! moi, je suis une semeuse, vous l’avez dit, j’excelle à faire lever la graine de corruption. Le jeune Marcel Baradier va être mon champ d’expérience !
— Grand bien lui fasse !
— S’il s’était contenté d’être filateur, ou banquier, rien de ce qui se prépare pour lui ne serait arrivé. Il aurait vécu tranquille et heureux. Mais il a fait de la chimie. Et voilà ce qui a tout gâté.
Le soleil était tombé derrière la colline. L’obscurité avait envahi le petit salon. Sophia et Cesare ne se distinguaient plus nettement dans les ténèbres grandissantes. Et il semblait que leur voix fût aussi devenue plus sombre. La jeune femme se leva et dit :
— Allons ! Assez de philosophie. Qu’est-ce que tout cela prouve ? Ce sont des mots. Et la fortune n’est pas à ceux qui parlent, mais à ceux qui agissent.
VII
Depuis quinze jours qu’il était installé à l’usine, Baudoin, avec étonnement, avait vu Marcel passer d’une tranquillité parfaite à une agitation extrême. Le jeune homme, qui employait la plus grande partie de son temps dans le pavillon à travailler ou à rêver, brusquement s’était mis à sortir, dès le déjeuner, pour ne rentrer que le soir, à la nuit tombée. Le laboratoire avait été délaissé, l’usine livrée à Cardez, sans contrôle. Et, fait plus significatif, la tenue de Marcel avait changé comme ses habitudes. Plus de costume campagnard : chapeau mou et gros souliers. Une élégance simple, des soins raffinés. Et avec cela une physionomie toute différente de celle qu’il avait auparavant : l’œil clair, la lèvre épanouie, jusqu’à la voix qui se faisait plus vibrante. Baudoin pensa : il y a de la femme là-dessous.
Il avait l’expérience acquise auprès du général de Trémont. Il connaissait cette tension de nerfs, cette animation intime qui perce dans les moindres mouvements. Il savait ce que voulait dire le petit sifflotement satisfait, et la marche sonore sur le parquet avec une allure fébrile et conquérante. Il y avait de la femme ! Il devenait impossible d’en douter. Baudoin fut préoccupé. Dans ce pays écarté, comment diable son maître s’y était-il pris pour trouver l’occasion de s’enflammer ? Il commença une enquête discrète.
Il avait fait la connaissance du patron du Lion d’Or, le principal hôtel d’Ars, un ancien cuisinier, qui avait servi et portait volontiers, le dimanche, à sa boutonnière un ruban jaune et bleu rapporté du Tonkin. Baudoin causait avec lui, en prenant un amer, et se faisait raconter les histoires du pays. Il le questionna : y avait-il des étrangers dans le pays ? Son hôtel contenait-il de nouveaux arrivants ? Voyait-on quelques jolies femmes se promener dans la ville ?
Le patron, à toutes ces demandes, fournit une réponse catégorique. Rien de ce qui logeait chez lui, ni chez ses concurrents, ni dans Ars, ne pouvait être suspecté, même par une imagination complaisante, d’avoir causé l’agitation de Marcel. Le Lion d’Or hébergeait quatre familles, deux ménages. Mais pas une des femmes, qui en faisaient partie, n’était de tournure ni de visage à tourner les cervelles. Les promenades de la ville n’avaient vu passer aucune jupe assez distinguée pour que le fils des Baradier et Graff eût risqué un pas à sa poursuite. Restait à chercher dans les environs.
— Il y a, dit le patron, un jeune monsieur et une jeune dame à la villa de la Cavée. Mais ils sont en grand deuil l’un et l’autre, ne viennent point en ville, et vivent de la façon la plus retirée. Ils ont commandé trois fois des voitures, pour se promener dans les environs. La jeune dame n’a jamais paru à Ars, et je ne saurais vous dire si elle est jolie ou laide. Mon cocher, qui les a conduits, dit qu’ils sont très tristes, très polis et se disent : vous. Il croit que c’est le frère et la sœur… En tout cas, ils ne sont pas français.
Baudoin n’en obtint pas davantage. Mais c’était suffisant. Il se promit de surveiller discrètement son maître, pour s’assurer du but de ses promenades. Le deuil et la tristesse de la jeune femme ne lui paraissaient pas une raison pour que son maître ne devînt pas amoureux. Au contraire. D’instinct il se défiait de ces gens qui se disaient frère et sœur et qui étaient étrangers.
Le lendemain, son ami du Lion d’Or lui dit :
— J’ai des nouvelles à vous donner des gens de la villa. Le jeune homme est parti ce matin. Il a demandé une voiture et s’est fait conduire au chemin de fer. Il allait à Paris, son bagage a été enregistré par le cocher… La jeune dame est seule.
Baudoin remarqua que, ce jour-là, son maître rentra plus tard que d’habitude, et, sur le veston qu’il venait de quitter, il découvrit des petits brins de mousse, comme si Marcel s’était assis dans les bois. Le lendemain, vers deux heures le jeune homme sortit. Baudoin qui avait pris ses dispositions pour le surveiller, partant d’avance, l’attendait au bas de la Cavée, pour s’assurer que c’était bien dans cette direction qu’il allait. Assis sous la tonnelle d’un cabaret, aux portes de la ville, il ne perdait pas de vue la route d’Ars qui monte vers les bois de Bossicant. Au bout d’une demi-heure d’attente, il vit arriver d’un bon pas, sa canne sous le bras, Marcel, vêtu d’un costume gris, ganté, coiffé d’un joli chapeau de paille, le teint animé et l’œil brillant.
— Toi, mon ami, pensa Baudoin, tu vas retrouver ta belle ! Tu ne marcherais pas à une si vive allure, s’il ne s’agissait que d’herboriser sur la colline.
Il laissa le jeune homme prendre de l’avance, puis, avec précaution, il le suivit. C’était bien à la villa que se rendait Marcel. Depuis qu’il avait été présenté à Mme Vignola, sa vie était complètement bouleversée. Il ne songeait plus ni à la chimie, ni à l’usine, ni à sa famille. Rien n’existait plus pour lui que la ravissante italienne. Si l’oncle Graff avait pu voir son neveu, il aurait dit : « Bon ! voilà encore mon animal pincé ! Il a reçu le coup de foudre ! » C’est qu’il le connaissait bien cet état fébrile qui rendait Marcel incapable de penser à autre chose qu’à sa belle, et capable de toutes les folies pour arriver à la posséder.
Mais la marque particulière de l’amour, chez cet inflammable garçon, était la rigueur raisonnée avec laquelle il poursuivait la conquête de celle qu’il voulait obtenir. Il était ingénieur et mathématicien jusque dans la passion. Il ne négligeait rien, profitait de tout pour pousser ses approches et la cour qu’il faisait était un véritable siège. « Le beau de son affaire, » disait encore l’oncle Graff, « c’est que chaque fois qu’il aime une femme nouvelle, il oublie toutes les précédentes, la considère comme la plus belle qu’il y ait au monde et jure qu’il n’a jamais adoré qu’elle. » Ce genre d’amoureux est extrêmement dangereux en ce qu’il est possédé par une illusion dont la force ne décroît pas, et que l’expérience des folies anciennes ne sert à rien pour le préserver de folies nouvelles.
Il avait suffi à Mme Vignola d’une demi-journée, passée avec Marcel sous les yeux de son frère, pour s’emparer de la pensée du jeune homme. Elle s’était montrée si charmante et si modeste, si pudique et si enjôleuse que Cesare, qui savait cependant de quoi était capable cette remarquable comédienne, en avait éprouvé de la stupeur. L’art de tromper poussé à cette perfection devenait du génie. Et, en vrai dilettante, le bel Italien avait suivi les phases progressives du manège de sa prétendue sœur. Les deux heures que Marcel avait vécues à la villa s’étaient écoulées avec la rapidité d’un rêve. Et l’amoureux avait dû se retirer, comme il croyait à peine être arrivé depuis un instant.
Il est vrai que Mme Vignola s’était mise au piano, à la prière de son frère, et d’une voix grave, pénétrante, expressive, avait chanté des airs dalmates, en grande artiste. Marcel, excellent musicien, lui-même, avait accompagné la jeune femme, puis offert des partitions qu’il conservait à Ars pour occuper les soirées solitaires. À sa prière, Cesare avait retardé son départ, et l’après-midi du lendemain s’était passé dans les bois de Bossicant, à errer par les sentiers étroits, à respirer l’air vif du plateau, à s’asseoir dans des clairières écartées, et à causer familièrement. Le soir Cesare avait montré à Marcel en souriant le visage animé et rose de sa sœur :
— Voyez comme la distraction lui fait du bien. Elle n’est déjà plus reconnaissable. Ah ! si elle pouvait chaque jour oublier ainsi ses chagrins, la santé lui reviendrait bien vite avec la force et la gaîté.
— Ne partez pas, restez ! avait répondu Marcel.
— Eh ! ce n’est pas moi qui la distrais ainsi, dit étourdiment le bel Italien.
Il se reprit, parut regretter d’avoir parlé si franchement :
— Les étrangers, voyez-vous, obtiennent bien plus facilement que les familiers des changements heureux dans les dispositions d’esprit de ceux qui souffrent.
— Mais Mme votre sœur n’est point souffrante ! Voyez-la marcher, devant nous, de ce pas alerte et souple.
— Oui, elle est en ce moment soutenue par ses nerfs… Ce soir elle tombera dans la mélancolie et dans la prostration. Je ne pourrai pas tirer d’elle une parole…
— Si vous m’autorisiez à venir la voir, et si elle voulait bien me le permettre, je me ferais un plaisir de lui tenir compagnie…
L’Italien, avec effusion, serra les mains de Marcel :
— Je vous remercie de tant de bonté… Mais ce serait trop attendre de vous… La pauvre Anetta lasserait bien vite votre patience… C’est une enfant capricieuse… Vous ne la connaissez pas encore…
Ils n’eurent pas le loisir de continuer, Mme Vignola se retournait vers eux et les interrogeant de son clair regard :
— Que complotez-vous là, tous les deux ?
— Le comte Cesare, madame, me délègue ses pouvoirs sur vous, pendant son absence, dit Marcel gaîment. Il me rend responsable de l’état de votre esprit. J’ai donc charge, à compter de demain, de votre bonne ou de votre mauvaise humeur. Mais il faudra que vous vous prêtiez à ma tyrannie…
Elle s’arrêta, sa physionomie devint grave, et, de sa voix prenante et un peu basse, elle dit :
— Oui, il a raison. Il ne faut pas m’abandonner. Quand je suis seule, ma tête travaille douloureusement, et j’ai des pensées noires… Soyez un ami pour moi… Cesare reviendra promptement et nous reprendrons nos courses dans les bois… Jusque-là, venez à la villa… Vous y serez toujours bien accueilli…
Le comte Agostini était parti, et Marcel, comme il y avait été invité par la belle Anetta, venait à la Cavée.
À mesure qu’il approchait, il hâtait le pas. Sa marche devint si rapide qu’une rougeur monta à ses tempes. Il eut voulu avoir des ailes pour rejoindre plus vite celle qui l’attendait. Cependant en arrivant à la villa, il ralentit brusquement le pas. Il avait de loin entendu la voix de Mme Vignola qui s’élevait dans le silence du jardin. Elle chantait, seule dans le salon, les fenêtres ouvertes, et la mélodie passionnée, qu’elle nuançait avec un art et un sentiment admirables, avait fait frémir Marcel d’une âpre jalousie. C’était la cantilène des Bohémiens de Marackzy, le grand artiste hongrois, mort de chagrin en pleine possession du génie et de la gloire :
Viens sur ma lèvre parfumée,
Rose frémissante et pâmée,
Trempée encore des pleurs d’amour,
Cueillir le baiser, dont la flamme
Fera de mon cœur à ton âme
Jaillir…
Le chant s’interrompit, comme brisé par des sanglots. Il sembla à Marcel que le cœur de la chanteuse venait de se rompre sous l’effort d’un chagrin mystérieux. Il ne put se contenir et, s’élançant dans le jardin, il gagna le salon. Au piano Mme Vignola était assise encore. Accoudée, sa belle tête pâle appuyée sur sa main, elle pleurait amèrement. À cette vue, Marcel poussa un cri de douleur qui fit lever brusquement la jeune femme. Elle agita son front, parut honteuse d’avoir été surprise ainsi, et tendant la main à Marcel :
— Excusez-moi… Je ne devrais jamais chanter, quand je suis seule… Ces harmonies bouleversent mon cœur en me rappelant des souvenirs trop douloureux…
— Mon Dieu ! Mais qu’est-ce donc ?… Dites ! Ayez confiance en moi.
— Non ! non ! Ne le demandez pas…
Elle ferma le piano et imposant à son visage une expression riante :
— Ne parlons pas de moi. Occupons-nous de vous.
Elle regarda Marcel et d’un ton d’affectueux reproche :
— Comme vous avez chaud ! Vous êtes venu trop vite… Et cette côte est si rude !… Je vous gronderai à mon tour, si vous n’êtes pas plus raisonnable… Ne restons pas dans le salon ; il y fait une fraîcheur qui vous serait mauvaise… Venez dans le jardin.
Il la suivit docilement. Ils marchèrent dans les petites allées du minuscule parterre. Puis ils s’assirent sous des lilas en fleurs, et, dans l’ombre odorante, ils causèrent, parlant de tout excepté de ce à quoi ils pensaient réellement.
Sur la route Baudoin n’avait pas perdu de vue son maître. Lorsque Marcel était entré à la villa, le serviteur s’était approché avec précaution. Le chant de Mme Vignola ayant cessé dès l’apparition de Marcel, Baudoin n’en put donc rien entendre. Il se garda bien de passer devant la porte. Il prit un sentier qui suivait le mur, et qui, du côté des bois, était adossé à un talus assez élevé, couronné de grands arbres. Il gagna le fourré, gravit la pente, et, logé derrière un buisson, il découvrit en partie le jardin. Les lilas, sous lesquels causaient Anetta et Marcel, poussaient au pied du monticule que Baudoin avait choisi comme observatoire. À une trentaine de mètres de distance le jeune homme et la belle veuve étaient assis, tournant le dos.
Baudoin pensa : Qu’est-ce que c’est que cette diablesse de femme-là ? Elle est toute vêtue de noir. Elle a l’air jeune, et sa taille est charmante. On peut dire que M. Marcel a un nez de renard pour dénicher les poulettes. Dans ce pays perdu, au moment où la saison des voyageurs n’est pas encore commencée, une jupe paraît à l’horizon, et aussitôt mon gaillard part en campagne, et le voilà déjà intime dans la maison. Il n’y a pas, fichtre, plus d’une semaine qu’il a manifesté son premier trouble ! Ah ! il ne perd pas son temps ! Mais ne lui a-t-on pas facilité les abords et abrégé les préliminaires ? Qu’est-ce que vient faire, dans nos alentours, cette jeune étrangère, et quel intérêt a-t-elle à se mettre en communication immédiate avec M. Marcel ? De quoi parlent-ils là, sous mes yeux ? Assurément ce n’est pas d’affaires ! Alors c’est donc d’amour ? Et de quoi saurait-il être question entre ce beau garçon et cette jolie femme ? Mais l’amour, c’est comme l’appât au bout d’une ligne. Le poisson ne voit que l’appât. L’hameçon est dessous bien caché, et se fait sentir au bon moment.
Pendant qu’il monologuait, les deux causeurs poursuivaient leur entretien. Ils étaient immobiles, l’un près de l’autre et le son même de leurs paroles ne parvenait pas jusqu’à Baudoin. Au bout d’une heure, ils se levèrent et la jeune femme se tourna du côté du surveillant. Il l’examina avec admiration, car rarement figure plus belle s’était offerte à ses regards. Mais il dût constater qu’il ne l’avait encore jamais vue jusqu’à ce jour. D’ailleurs quelle ressemblance eut-il cherché ? L’autre femme, celle de Vanves, il ne l’avait aperçue que dans l’ombre, et point de façon à la reconnaître. Il n’avait d’autres indices sur elle que son parfum favori si caractéristique, et le son de sa voix qui lui vibrait encore à l’oreille.
Il pensa : si je pouvais entendre parler celle-ci. En trois paroles je saurai bien la reconnaître. Il eut derrière son buisson un mouvement de joie. Le couple, marchant lentement, avait pris une allée circulaire qui longeait le mur du jardin et passait au pied du monticule, à dix pas de l’endroit où se cachait Baudoin. Ils venaient d’un pas cadencé, parlant, sans se douter que quelqu’un fût aux écoutes. Et l’ancien soldat, comme un chasseur à l’affût qui voit approcher la proie convoitée, le cœur battant, les yeux un peu brouillés, tendait l’oreille avec toute l’attention dont il était capable. Il entendit Marcel qui disait, continuant la conversation commencée :
— Maintenant que vous êtes libre, penseriez-vous à reprendre ces anciens projets ?
Et la femme, d’une voix caressante, avec un accent italien :
— À quoi bon ? Maintenant je suis vieille. J’ai vingt-sept ans… Ma vie est finie. Les succès artistiques n’auraient aucun prix pour moi… Chanter sur un théâtre, en public, me livrer à tous les regards ?… Oh ! non ! Je n’y songe plus…
— Et cependant vous auriez des triomphes !
— Pour qui ?
Ils passèrent et Baudoin fouillant sa mémoire, rappelant ses souvenirs, dut s’avouer à lui-même que la femme en deuil n’avait pas le même organe, ni la même prononciation que l’autre, celle qui apportait la mort avec elle. Il vit disparaître les deux promeneurs dans la maison, puis il entendit le piano qui résonnait, et la voix pure, chaude et poignante de la jeune femme s’éleva, jetant au silence des bois des accents mélodieux. Alors Baudoin descendit du monticule, reprit le sentier et, par la Cavée, rentra à Ars songeur et préoccupé. En passant devant le bureau des postes et télégraphes il entra, prit une feuille de papier et écrivit cette dépêche :
« Laforêt, Ministère de la guerre, rue Saint-Dominique, Paris. Venez Ars près Troyes. Me demanderez usine. Baudoin. »
Il paya, assista au départ de son télégramme, et, un peu soulagé, rentra chez son maître. À sept heures Marcel arriva. Il dîna sans prononcer une parole, et aussitôt le repas terminé se retira dans son laboratoire où Baudoin l’entendit marcher assez avant dans la nuit.
Pendant ce temps-là, Mme Vignola assise dans son petit salon, une cigarette d’Orient entre ses belles lèvres, se tirait les cartes, sous l’œil complaisant de sa femme de chambre. Confidente, plutôt que servante, c’était une petite brune, sèche et brûlée comme un rocher du midi, que Sophia avait auprès d’elle depuis dix ans. Elle se nommait Milona, mais jamais on ne l’appelait que Milo. Elle avait vu le jour dans les Carpathes, au milieu d’un campement tzigane. Sa mère était morte sur un revers de fossé, la laissant âgée de douze ans, dans un abandon misérable et exposée aux entreprises d’un brigand de la troupe, qui s’était énamouré de la grâce précoce de cette enfant.
Sophia, passant par Trieste, au cours de sa vie aventureuse avait assisté, dans la cour de l’auberge où elle était descendue, à une discussion agrémentée de couteaux mis au vent, entre Milona et son féroce soupirant. La petite tenait tête hardiment au zingaro qui voulait la contraindre à le suivre, et aux menaces vociférées en langue rôme, elle répondait par un énergique non, soutenu d’un insolent regard. Toute la bande des écumeurs de routes, seuls parents que Milona se connut, appuyait les prétentions du jeune bandit. Mais Milona continuait à refuser lorsque le chef de la troupe, dont l’emploi principal était de voler les poules dans les villages, s’était avancé et, barbe grise, cheveux blancs bouclés, type admirable de patriarche, avait essayé de raisonner la fillette.
Sophia, accoudée à sa fenêtre, jouissait du spectacle, avec un commencement de sympathie pour cette fière enfant qui ne voulait pas subir les caprices de l’homme. Elle paraissait comprendre la langue que parlaient entre eux ces gens, et souriait aux expressions colorées de leur discours :
— Milona, disait le vénérable voleur de volailles, tu n’agis pas comme tu le dois. Tu repousses Zambô, qui est un de nos enfants et qui t’aime, parce que tu as écouté ce petit hussard hongrois qui t’a suivie hier jusqu’ici et te conte des douceurs. Tu sais pourtant que c’est un chien, ennemi de notre race, qui te prendra, puis te rejettera, sans même une récompense pour prix de ton amour. C’est à moi que ta mère t’a laissée en mourant, j’ai payé pour te nourrir, je t’ai appris à tirer les cartes, à lire dans la main, à composer les philtres d’amour. Vas-tu te montrer ingrate et refuser d’être la femme de mon petit neveu Zambô ?
— Je ne l’aime pas ! dit sèchement la fillette.
— Mais il t’aime, lui.
— Peu m’importe !
— Mais si tu lui résistes, il te tuera.
— C’est mon affaire !
— Vas-tu donc quitter notre troupe ?
— Oui. J’ai assez de vivre nourrie par le vol et vêtue de haillons !…
— Alors, paye pour être libre.
— Je n’ai pas d’argent. Attendez un jour, le hussard m’en donnera plein les mains.
À ces mots, le noir Zambô fit un mouvement terrible vers l’enfant. Il hurla :
— Que ce soit ta dernière parole !
Et brandissant un long coutelas, il se jeta sur Milona. À ce moment précis, la baronne Sophia fit entendre un sifflement qui attira l’attention de toute la bande et, parlant dans la langue de ces brigands :
— En voilà assez ! Je vais faire appeler la police. Tu réclames de l’argent à cette petite, toi, le vieux, là bas ?
— Oui. Votre seigneurie.
— Combien ?
— Vingt ducats d’or…
— Voleur !
— Pas moins, Excellence !
Une bourse tomba dans la cour, aux pieds du patriarche, qui la ramassa avec la prestesse d’un jongleur. Il compta, s’inclina la main sur le cœur et dit à Milona :
— Remercie ta noble bienfaitrice. Elle a payé : tu es libre !
— Monte ici, petite, dit Sophia.
Sans attendre, Milona suivie par les vociférations de son galant déconcerté, s’élança dans l’auberge. La fenêtre de la baronne se referma, pendant que les Zingares avec des paroles véhémentes et des gestes exagérés essayaient de faire comprendre à Zambô que les filles sont beaucoup moins rares que les ducats et que, si son amour lui restait pour compte, la caisse de la troupe se trouvait garnie pour un an. Depuis cette rencontre, Milona s’était attachée à sa libératrice, d’une façon farouche. Elle l’avait aidée dans ses haines, servie dans ses amours et, excepté les terribles secrets que Sophia ne confiait à personne, elle savait tout de la vie de sa maîtresse.
Sophia souffla une bouffée bleue, et hésita devant la combinaison de ses cartes :
— Roi de cœur, neuf de pique et valet de trèfle, dit Milona posément, en désignant les tarots du bout de son doigt… Puis encore dame de trèfle, valet de cœur et sept de pique… La réponse est toujours la même. Vous ne réussirez pas !
Sophia leva ses beaux yeux hardis sur sa confidente et, de sa voix naturelle, qui n’était pas celle dont elle parlait avec l’accent italien :
— Il faut cependant que je réussisse. Il le faut, Milo, entends-tu !
— Voulez-vous essayer l’épreuve du vase d’eau ?
— Oui. Il y a longtemps que nous ne l’avons faite.
Milona prit un cornet de cristal dans lequel trempaient des fleurs. Elle jeta le bouquet à ses pieds, et soufflant les bougies d’un candélabre, elle n’en laissa qu’une allumée. Sur la table, elle plaça le cornet, de façon à ce qu’il fut éclairé par derrière. Puis elle tira une des longues épingles d’or, qui retenaient son chignon, et s’accroupissant sur un tabouret, elle trempa la tige de métal au fond du vase et commença à psalmodier un chant bizarre. Dans l’eau pénétrée par la lumière, des remous irisés se formèrent, et les deux femmes, attentives, suivirent des yeux les lignes brisées et fuyantes, les gouttelettes diamantées, les spirales brillantes de l’eau agitée par l’aiguille d’or. Milona chantait :
L’eau n’est que trouble et mystère, la lumière est certitude et vérité. Que la lumière pénètre l’eau et lui arrache ses secrets… Tourne aiguille, luit rayon, eau divise-toi…
— Regarde, Milo, regarde, s’écria Sophia avec émotion. L’eau devient rouge, dans ses replis il y a comme du sang !…
Milona chantait toujours :
— Le sang, c’est la force et la vie. Le sang du cerveau, c’est la victoire. Le sang du cœur, c’est l’amour. Tourne aiguille. Rougis, sang. Fais vaincre et fais aimer !
Sophia, à genoux près de la table, dans la demi-obscurité, scrutait, ardente et anxieuse, le vase de cristal où l’eau tourbillonnait sous la pression de l’aiguille d’or, à la lueur du flambeau :
— Vois ! Vois encore ! s’écria-t-elle, l’eau devient verte ! Elle brille comme de l’émeraude…
— L’émeraude est couleur d’espérance, et l’espérance c’est la joie de la vie… Tourne aiguille, eau sois glauque comme les yeux des sirènes, que l’on suit jusqu’à la mort !
Milona retira son aiguille d’or. L’eau, tranquille, cessa de tournoyer contre les parois du vase de cristal, elle prit d’abord une teinte grise, puis devint sombre…
— Milo ! cria Sophia éperdue, maintenant l’eau est noire ! C’est un signe de deuil ! Qui donc mourra ?
La servante, sans répondre, ralluma les bougies du candélabre, prit le vase de cristal et par la fenêtre jeta l’eau qui venait de servir à l’expérience, puis elle cracha avec colère, dans la nuit :
— Meure qui vous fera obstacle ! dit-elle rudement. Le destin annonce l’amour, le bonheur et la mort. Vous avez le droit de ne pas poursuivre l’entreprise commencée. Les tarots disent que vous ne réussirez pas. L’eau prédit la mort ! Mais pour qui ? C’est ce que nous ne pouvons savoir. Arrêtez-vous, il en est temps encore.
Sophia marcha silencieuse dans le salon, puis s’arrêta devant Milona qui restait pensive :
— Crois-tu aux prédictions que tu fais ?
— Oui.
— Les as-tu vues se réaliser toujours ?
— Oui.
— Le vieil homme, qui t’a vendue à moi, dans l’auberge de Trieste, et qui t’avait appris à lire dans les cartes, dans l’eau, et dans le feu, croyait-il à son art ?
— Oui.
— Avait-il vu et as-tu vu, toi-même, ceux à qui des prédictions funestes étaient faites, renoncer à leurs entreprises ?
— Quand ces entreprises étaient difficiles et importantes, jamais !
— Ceci revient à dire que les êtres hardis ne voulaient pas écouter la prudence, et essayaient de violenter le destin.
— C’est cela.
Sophia alluma une cigarette :
— À quoi bon la supériorité de la pensée, l’irréductibilité de l’audace et l’intransigeance du courage, si l’on se conduit avec la lâcheté du commun des mortels ? Il n’y a d’intéressant, Milo, que ce qui est difficile, sinon impossible ! Doit-on vivre comme les bourgeois, quand on a une âme de souveraine ? Non ! Au prix de ce qui peut arriver, il faut suivre son instinct, manifester sa volonté. Tu me connais, Milo, tu sais que je ne m’arrête devant rien, quand j’ai pris une résolution. Comment donc, tout à l’heure, m’as-tu dit : renoncez, il en est temps encore ?
— Et vous, dit gravement Milona, pourquoi, puisque vous êtes si ferme dans vos desseins, consultez-vous les cartes, et demandez-vous à l’eau son secret ?
Sophia se prit à sourire :
— C’est juste, ce que tu dis là. Mais vois-tu, petite, les humains sont toujours les humains, c’est-à-dire des êtres accessibles à la crainte et à la superstition. Ne vois-tu pas les médecins, qui savent cependant combien leur art est précaire et impuissant, appeler à leur chevet d’autres médecins, quand ils sont malades. Concession à la faiblesse humaine, Milo. Mais l’on n’en pense pas moins !
— Et toutes ces recherches, en l’honneur de ce jeune homme, qui est venu tous ces jours-ci et que l’Agostini vous a amené ?
— L’Agostini, comme tu dis si irrévérencieusement, m’a amené ce jeune homme, parce que je lui ai commandé de me l’amener. Ne sais-tu pas qu’il m’obéit sans discuter ?
— Oh ! il ne discutera jamais. Mais il pourrait bien, un jour, ne plus obéir.
— Tu ne l’aimes pas, ce pauvre Cesare, dit gaiement Sophia.
— Il est faux et il est lâche. Si celui-là essaie de vous frapper, ce sera dans le dos.
— Il m’aime !
— Et vous, l’aimez-vous ?
— Peut-être. Mais ce n’est pas sûr. Pourquoi dis-tu qu’il est lâche ? Tu sais pourtant qu’il s’est admirablement battu, à Palerme, avec le marquis Belverani…
— Parce qu’il se savait le plus fort, ou le plus habile, et que l’autre l’avait souffleté devant cinquante personnes, au cercle, en l’accusant de tricher au jeu… Et c’était vrai : il trichait !
— Personne ne le dira plus, maintenant qu’il a tué un homme à cause de cela ! Et puis, la preuve qu’il ne triche pas, c’est qu’il perd toujours…
— Vous en savez quelque chose !
— Ah ! que ferais-je de mon argent, si je ne le lui donnais pas ?
— C’est juste ! L’argent est vil. Il ne doit servir qu’à contenter les caprices. Il ne vaut que par les plaisirs qu’il procure. Par lui-même, il n’est pas plus précieux que les cailloux de la route. Le jeune homme qui vient maintenant vous en donnera-t-il, ou lui en donnerez-vous ?
— Je crois qu’il n’en accepterait pas, Milo, dit Sophia en riant. Tu es une vraie barbare. Tu ne comprends que la corruption. Il y a d’honnêtes gens sur la terre, petite. Ceux-là on ne peut pas les payer pour obtenir d’eux ce que l’on souhaite. Il faut les séduire.
— Voilà donc pourquoi vous chantez quand il est là. Vous allez le rendre fou, comme tous les autres. Il est pourtant gentil et il a l’air si doux !
— C’est vrai qu’il est charmant. Mais c’est un ennemi, Milo, et s’il découvrait qui je suis, et ce que je cherche, je courrais les plus grands dangers…
— Alors l’Agostini l’a donc amené ici pour qu’il se perde ?
— Quelque chose comme cela.
— Et il vous aime déjà ?
— Follement.
— Vous l’a-t-il dit ?
— Pas encore. Mais je n’ai qu’un mot à prononcer, ou un geste à faire, pour qu’il tombe à mes genoux.
— Ah ! votre pouvoir sur les hommes est irrésistible. Mais prenez garde, vous serez prise, un beau soir, à votre tour. Et ce sera terrible !
— J’ai aimé, tu le sais bien. Et l’amour n’a plus aucune sensation à me révéler.
— Vous avez aimé avec l’imagination, vous avez aimé avec les sens, vous n’avez jamais aimé avec le cœur.
— Qu’en sais-tu ?
— Puisque tous ceux que vous avez aimés ont été vos victimes, c’est que votre cœur n’a jamais été pris. L’amour sincère et pur n’est point un bourreau. Il protège et se dévoue. Mais vous n’avez eu affaire, jusqu’ici, qu’à des aventuriers et c’était vraiment justice de les traiter comme ils avaient l’habitude de traiter les autres… Le jour où vous mettrez l’Agostini à la porte, vous pourrez m’appeler pour la lui ouvrir. Ce sera de grand cœur !…
— Ce jour-là n’est pas encore venu.
— Tant pis.
Sophia d’un air lassé agita la tête, et Milona comprit qu’il ne fallait pas pousser plus avant le badinage. Elle dit :
— Je vais aller fermer tous les volets. Maîtresse, avez-vous besoin de moi ?
— Non. Tu peux éteindre partout. Je vais écrire. Quand je monterai, tu m’entendras.
Elle se plaça près de la table, prit un élégant buvard timbré d’un tortil de baronne, et, sur du papier parfumé, elle commença, d’une grande écriture masculine, à tracer des lignes :
« Mon cher Cesare. J’ai mis le temps à profit, depuis que vous êtes parti, et je pense que, de votre côté, vous n’êtes pas resté inactif. Faites-moi savoir comment s’arrangent vos affaires du côté des Lichtenbach. Ici tout est à la passion la plus pure. Notre jeune Marcel est arrivé aujourd’hui débordant de lyrisme et m’a surprise chantant avec des sanglots dans la voix. Milona, qui le guettait du mur de la route, m’avait signalé son approche et je lui ai joué la grande scène de désespérance, avec un succès étourdissant. Il a paru fou de douleur en voyant couler mes larmes. Vous savez que je pleure à volonté, et de la façon la plus séduisante. Je crois bien qu’il aurait voulu passionnément boire mes pleurs. Mais il était déjà dans une ivresse suffisante. Il faut ménager les gradations. Je l’ai emmené dans le jardin, sur le banc du massif de lilas, parce qu’en plein air les démonstrations amoureuses sont beaucoup plus difficiles, et là, je l’ai fait causer. C’est un véritable enfant. Il est d’une simplicité qui déconcerte et d’une candeur qui fait sourire. Je n’aurai vraiment pas assez de mérite à triompher de tant d’innocence. Cet agneau tendra la gorge pour le sacrifice. Et nous aurons nos formules, de bon gré, ou je me trompe fort. Je me repose du reste délicieusement dans ce pays perdu et je ne m’ennuie pas une minute. Il y a longtemps que je n’ai eu le temps de méditer, emportée que j’étais par mon existence aventureuse, et j’ai fait, sur mon propre compte, des réflexions qui m’ont étonnée. Je crains que les jouissances, les satisfactions, les plaisirs, auxquels j’ai tout sacrifié jusqu’ici ne soient qu’une des faces de la vie et qu’il y en ait une autre, que je ne soupçonne pas, et qui soit beaucoup plus séduisante et plus belle. En écoutant, cet après-midi, le jeune Marcel me parler de son père, de sa sœur et de sa mère, avec une grâce délicate et tendre, je me suis prise à ressentir un peu de mélancolie. Tous ces gens-là sont de bons et honnêtes gens. Ils sont heureux de s’aimer, ils seraient prêts à se faire les plus grands sacrifices les uns aux autres. Il n’y a rien de plus simple, de plus droit et de plus monotone que leur vie. Et il est indiscutable qu’ils y trouvent le bonheur.
« C’est cet agneau de Marcel qui est le mauvais sujet de la famille. Périodiquement son père le menace de sa malédiction, parce qu’il a pris une culotte un peu forte au baccara, ou qu’il a fait une saignée à la caisse pour quelque demoiselle trop exigeante. Et le pauvre enfant en est malade de chagrin, pendant huit jours. Il va s’enfermer à Ars, comme un anachorète au désert. Là, il se mortifie en travaillant au laboratoire, en mangeant une cuisine déplorable, et en se disputant avec le directeur de la fabrique, qui paraît être un mauvais coucheur. C’est à ses périodes de repentir qu’ont été dues les intéressantes découvertes sur la teinture des laines, et autres fariboles industrielles qui, paraît-il, ont de la valeur, et qu’il m’a expliquées, un peu trop longuement pour mon goût.
« Mais c’est égal, il est gentil et il a du feu. Croiriez-vous qu’il m’a demandé mon âge ? Pauvre petit, je suis plus vieille que lui. Je ne serais pas étonnée qu’il nourrît l’idée de m’épouser. Cesare, dépêchez-vous de faire fabriquer un état civil complet pour Mme Vignola, car on ne sait pas ce qui peut arriver, au train dont vont les choses. Mais non, mon cher, je plaisante, n’allez pas prendre de l’ombrage de ce que je vous conte sur ce pauvre garçon. Je le mène par un fil, qu’il ne sent ni ne voit, vers la servitude absolue. Et quand il m’aura livré son secret, comme ont fait jusqu’ici tous ceux auxquels je me suis attaquée, je disparaîtrai. Et les voiles de crêpe de Mme Vignola rejetés, il n’existera plus que la baronne Sophia, en laquelle je défie bien mon amoureux de retrouver la gémissante et élégiaque veuve qu’il courtise en ce moment. Vous voyez que, sans ennui, je m’occupe de nos affaires. Sans répugnance, faites-en autant de votre côté. La petite Lichtenbach sera archi-millionnaire. Cela vaut qu’on sache lui dire : je vous aime. Mille baisers, Cesare. Sempre t’amero. Sophia. »
Elle cacheta sa lettre, étouffa un bâillement, prit une cigarette et se disposait à monter dans sa chambre, quand trois coups légers frappés du dehors contre les volets la firent tressaillir. Elle écouta, debout, le sourcil froncé. Au bout d’un instant, les coups se renouvelèrent. Elle ouvrit un tiroir, saisit un revolver et délibérément allant à la fenêtre elle l’entrebâilla, puis parlant contre le volet fermé, avec son accent italien :
— Qui est là ?
Une voix sourde répondit :
— C’est moi, Hans, ne craignez rien, Sophia.
Elle pâlit un peu, remit le revolver dans le tiroir, et sans répondre sortit du salon. Elle alla à la porte d’entrée, tira les verrous, ouvrit sans bruit. Un homme de haute taille entra. Sans un mot échangé, elle le guida vers le salon, puis referma la porte avec soin. L’homme jeta le feutre qui couvrait sa tête, et une hardie et rude figure apparut en pleine lumière. Il était large des épaules et en apparence d’une vigueur athlétique. Une barbe rousse couvrait le bas de son visage éclairé par des yeux verdâtres.
Il s’assit, regarda Sophia profondément et dit :
— Qui est avec vous, ici ?
— Milona.
— Et Agostini, où est-il ?
— Parti pour Paris. Et vous, d’où venez-vous ?
— De Genève. C’est Lichtenbach qui m’a envoyé votre adresse.
— Par où êtes-vous entré ?
— Par dessus le mur.
— Avec votre bras blessé ?
— Mon bras est guéri.
Il l’étendit avec un sourire menaçant. Et ce bras était entier. Un gant couvrait la main. Il poursuivit :
— Les suisses sont de très adroits mécaniciens. Ils m’ont fabriqué un avant-bras articulé, qui manœuvre comme un bras naturel. La main est en acier. Elle vaut le meilleur coup-de-poing américain. Une tape de cette main, Sophia, peut assommer un homme.
Il soupira :
— C’est égal, ce bras-là ne vaut pas l’ancien. Il ne fera pas la même besogne, mais ceux qui m’ont mutilé ne l’emporteront pas en paradis. Ils me paieront mon sang et ma chair !
Son visage avait pris une expression féroce et il grinçait des dents en parlant ainsi. Sophia, grave, répondit :
— Ne vous étiez-vous pas payé d’avance ? Quand vous avez été frappé, le général de Trémont était mort. C’était peut-être lui qui se vengeait !
— Que le diable le brûle ! Le vieil entêté ! Il n’avait qu’à s’exécuter, quand vous lui demandiez si gentiment le secret de sa cassette. Rien de cela ne serait arrivé !
— Hans, c’est vous qui avez voulu aller trop vite ! Vous avez détruit toutes mes combinaisons, par votre brutalité. Si vous m’aviez laissé huit jours de plus, le pauvre fou m’aurait livré son secret, son honneur et le reste. Votre intervention lui a donné l’éveil, il a secoué son engourdissement et tout a été perdu !
— Sang Dieu ! Ne me faites pas de reproches ! Cette erreur m’a coûté assez cher ! Mais ici, où en êtes-vous ?
— Si vous me laissez agir à ma guise, je réussirai.
— Bien ! Bien ! Faites. Mais je prépare, de mon côté, une petite diversion qui ne sera pas inutile. Et puis cela fera plaisir à Lichtenbach…
— De quoi s’agit-il ?
— D’un coup de chien, à la fabrique, avec les ouvriers.
— Vous travaillez donc toujours dans le socialisme ?
— Plus que jamais. C’est l’avenir. Les foules inconscientes et brutales aux mains de quelques meneurs hardis, qui s’assureront la domination universelle ?
— Pour combien de temps ?
— Eh ! le temps de tout détruire dans cette société exécrable et pourrie !
— Pour quoi mettre à la place ?
— Ça, c’est le secret des temps. La révolution vous l’apprendra.
— Je hais vos opinions et ceux qui les soutiennent…
— Je sais, je sais, interrompit Hans, avec un gros rire. Vous êtes une aristocrate, vous, Sophia, et l’égalité n’est pas dans vos cordes. Il vous faut le luxe, l’éclat, la supériorité… Et qui vous dit que nous ne vous les donnerions pas ? Nous voulons le nivellement, mais pour ceux qui s’élèvent au-dessus de nous. Avez-vous jamais vu un troupeau marcher sans berger et sans chien ? Comment donc les nations vivraient-elles sans chef ? L’important est de commander. Et pour cela il faut arracher le pouvoir à ceux qui le détiennent de par certains privilèges que nous prétendons supprimer, parce que nous n’en jouissons pas. Une fois que le pouvoir sera dans nos mains, il faudra des flots de sang et des torrents de feu pour nous le reprendre. Mais qui donc essaierait ? Il n’y a que les révolutionnaires qui aient de l’énergie, parce qu’ils sont entraînés par la passion. La révolution, c’est le seul moyen de parvenir par des voies rapides. Je ne suis rien aujourd’hui, je veux être tout demain. Et je supprime, pour arriver à mon but, tout ce qui me fait obstacle. Voilà, en langage clair, ce que signifient toutes les tirades amphigouriques des apôtres de l’humanité. Ils n’aiment qu’eux, ne pensent qu’à eux. Et cela suffit !
Sophia se mit à rire :
— Ce sont des brigands. Et vous en êtes un autre. Mais vous savez, Hans, prenez garde : les gens que vous rêvez de dépouiller ne se laisseront pas faire aussi facilement que vous le croyez. Ils ont inventé la gendarmerie qui est une bien jolie sauvegarde… Mais qu’est-ce que vous préparez à ces pauvres Baradier et Graff ?
— Je fais, depuis quinze jours, travailler l’opinion des ouvriers par des gens à moi. Je vais leur mettre leur fabrique sens dessus dessous… Ça les occupera… Ils ont les yeux beaucoup trop ouverts sur ce que nous faisons… Je ne sais pas qui renseigne ces mâtins-là, mais ils semblent lire dans le jeu de Lichtenbach, comme si c’était le journal…
— Lichtenbach est si lâche ! Il a fait encore quelque sottise… J’ai envoyé Cesare auprès de lui, autant pour le surveiller que pour courtiser sa fille… Mais on ne donne pas de cœur à qui n’en a pas…
— Il paraît que les actions de la Société des Explosifs, étaient si bien tombées, grâce à la campagne de baisse entreprise par Lichtenbach, que le rachat de tout le paquet allait pouvoir être opéré dans les conditions les meilleures… Lorsque brusquement, sans raison, la coulisse s’est mise, sur le marché en Banque, à acheter à tour de bras, et les actions ont fait un bond énorme. Lichtenbach a tenu ferme, mais il avait affaire à plus fort que lui. La débâcle a été enrayée. Il a bu, lui personnellement un bouillon sérieux à la liquidation. Et, informations prises, ce sont les Baradier et Graff qui ont formé un syndicat, avec un grand nombre de porteurs de la Société menacée, afin de résister à l’écrasement de la valeur. Le bruit court dans le monde des affaires que, grâce à un brevet nouveau, vous entendez Sophia, la prospérité de l’affaire est assurée dans l’avenir… C’est la concurrence directe à Lichtenbach, c’est le défi porté à nous-même. La guerre est engagée, il faut donc la soutenir, et remporter la victoire. Voilà pourquoi je viens. Car vous me faites l’effet, tous, de musarder et de marivauder.
— Ah ! Pas de coup de force, Hans, n’est-ce pas ? dit Sophia avec fermeté. Nous sommes en bonne voie. Il ne s’agit pas de tout brouiller encore. Vous n’avez plus qu’un bras à perdre, mon cher, n’en abusez pas.
Le visage de Hans se contracta :
— Vous êtes gaie, Sophia, vous en avez de bonnes ! Je n’ai plus qu’un bras, c’est vrai, mais c’est le meilleur, rassurez-vous. Et malheur à ceux qui passeront à sa portée !
— Alors vous venez vous installer ici ?
— Avec votre permission.
— Vous allez bien me gêner.
— Rassurez-vous, je ne sortirai que la nuit. Je ne suis pas l’homme de la pleine lumière. Les ténèbres me connaissent mieux. Faites vos affaires. Moi je ferai les miennes. Je ne vous demande qu’une chambre sous les toits, où je puisse écrire et dormir dans le jour. Milona seule saura que je suis ici. Et en elle, on peut avoir toute confiance.
— Oui. À moins qu’on ne veuille me nuire.
— Et qui diable pourrait y penser ? En tous cas ce n’est pas moi, tant que nous marcherons d’accord.
Ils échangèrent un regard. Et dans leurs yeux se lisait le souvenir des complicités anciennes. Sophia, la première, se détourna en faisant un geste d’acquiescement :
— Suivez-moi donc.
Elle ouvrit la porte et guida celui qu’elle paraissait à la fois redouter et haïr.
VIII
Baudoin achevait de faire le ménage dans le pavillon habité par Marcel lorsqu’il s’entendit appeler par le concierge de l’usine. Il parut à la fenêtre. Le fonctionnaire de la porte leva sa casquette avec déférence et dit :
— M. Baudoin, il y a devant la grille un particulier qui demande à vous parler…
— Bon, je descends.
Il était trois heures de l’après-midi, Marcel venait de prendre le chemin des bois. Baudoin était maître au logis. Il acheva de ranger les meubles. Il ferma la fenêtre, enleva son tablier et gagna la cour. Arrivé à l’entrée de l’usine, il vit, marchant dans la rue, un homme roux à collier de barbe inculte, vêtu d’une blouse et chaussé de gros souliers. Le concierge lui montra la personne d’un air dédaigneux, et dit :
— C’est cet individu-là !
Au même moment l’homme roux se retourna et, voyant Baudoin, vint à lui la figure souriante et la main ouverte. Le brosseur avec étonnement regardait s’approcher cet inconnu, fouillant ses souvenirs, ne parvenant pas à mettre un nom sur ce visage et se disait : Qui diable est-ce ? Voilà un garçon qui se trompe ! Mais arrivé tout près, l’homme dit :
— Bonjour M. Baudoin.
Et Baudoin reconnut Laforêt. Il le prit par le bras, l’emmena le long du mur des jardins, dans la direction de la grande route, puis sûr de n’être entendu de personne :
— Enfin ! vous voilà ! Vous êtes joliment arrangé ! Je ne vous ai pas deviné avant que vous me parliez.
— Ne restons pas en plein air. Il n’est pas bon qu’on nous voie ensemble. Y a-t-il un cabaret où on puisse causer, tranquilles et isolés ?
— Allons au Soleil d’Or. Le patron me connaît, il nous donnera une petite salle où nous ne serons pas dérangés. C’est un ancien soldat, on peut compter sur lui.
— Bon ! Allons.
Attablés devant une bouteille de bière les deux hommes commencèrent les confidences :
— Il était grand temps pour vous d’arriver, dit Baudoin. Il y a ici du nouveau. La solitude de M. Marcel a été troublée par l’apparition de deux étrangers, soi-disant le frère et la sœur, baragouinant l’italien, et qui, dès la première semaine de leur séjour, ont trouvé moyen d’entrer en relations avec mon patron.
— Qu’est-ce que c’est que la femme ?
— Ah ! si je ne me trompe, c’est une mâtine très forte, dans le genre de celle qui avait été détachée au pauvre général et qui l’avait si bien empaumé…
— Et l’homme ?
— Inconnu. Première apparition. Ça se dit comte. Un rastaquouère plus que probablement. Joli garçon. Je n’ai fait que l’apercevoir de loin.
— Et la sœur ?
— Femme superbe ! Une blonde avec des bandeaux à la vierge. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. En grand deuil et des airs de Mignon regrettant sa patrie… Qu’est-ce qu’elle peut bien venir tenter ici ?
— Nous allons tirer ça au clair, si c’est possible !
— Moi, vous comprenez, je ne puis rien faire. On me connaît. Je suis brûlé. Au premier pas, à la première manifestation, c’est comme si je disais à ces gens-là : attention, je vous surveille. Ils se mettent en défense et adieu ! J’ai déjà risqué une reconnaissance assez hasardeuse de la maison où ils habitent et de ses alentours. Mais, je ne peux pas recommencer sans risquer de me faire pincer par M. Marcel, et, s’il m’interroge, qu’est-ce que je peux lui répondre ? L’avertir de ce qui se manigance autour de lui, c’est couper court à l’intrigue qui se prépare, peut-être, et qui va nous donner l’occasion de mettre la main sur les brigands que nous cherchons. Et ne pas l’avertir, c’est l’exposer à de bien grands périls ! Je roule toutes ces idées-là dans ma tête, depuis quelques jours, et plus je réfléchis, plus je suis hésitant. Aussi j’avais hâte de vous voir arriver. Vous allez me donner un conseil d’abord, et ensuite aviser aux moyens de défendre M. Marcel, s’il vient à être menacé.
— Procédons par ordre. Où se trouve située la maison que ces gens-là habitent ?
— Elle est facile à reconnaître. Elle est à mi-chemin d’Ars aux bois de Bossicant. On la désigne sous le nom de Villa de la Cavée. Il est impossible de s’y tromper. Elle est isolée sur la côte…
— Je serai, demain, installé à sa porte.
— Et comment ?
— C’est mon affaire. Vous verrez comment on s’y prend pour surveiller les gens sans en avoir l’air.
— Mais il n’y a pas une habitation à un kilomètre à la ronde.
— Ça n’empêchera rien. Comment vit la dame en question ?
— Très retirée. Elle ne sort que pour se promener dans les bois. Jusqu’à ces jours derniers, seule, ou avec son frère, maintenant avec mon maître.
— Ça chauffe, alors ?
— Ça flambe, même !
— Bon !
— Et qu’est-ce que vous pensez qu’il faut faire en ce qui concerne M. Marcel ?
— Rien.
— Ne pas le prévenir ?
— Sous aucun prétexte. Quel danger court-il ? Je vais veiller sur lui, au dehors. Vous ouvrirez l’œil, à l’intérieur. On n’a réellement point intérêt à le menacer. Si, comme c’est probable, car c’est la tactique ordinaire, on lui a détaché une jolie femme pour tâcher de l’amadouer, tout ce qu’il risque c’est de s’échauffer pour une coquine. Sera-ce la première fois que cela lui arrivera ? Vous ne le pensez pas. Ni moi non plus. Il n’en mourra pas pour avoir marivaudé avec la gaillarde que vous m’avez dépeinte. Et nous, pendant ce temps-là, nous allons tendre quelques chausse-trappes pour tâcher de prendre nos flibustiers. Ce n’est pas la même femme qui venait à Vanves, vous en êtes sûr ?
— Elle n’a pas la même voix, ni le même accent. Mais peut-on être sûr de quelque chose, avec des gens de cette force-là ! Quant à l’homme, je réponds que ce n’est pas lui. Je l’ai entrevu, l’homme de Vanves. Il avait la tête de plus que le criquet italien. Et son parler était bien particulier… Oh ! celui qui a tué mon général, je le reconnaîtrais tout de suite ! Et si jamais il me tombe sous la main !
Il serrait les poings en parlant ainsi, et ses yeux s’enfonçaient sous ses sourcils. Laforêt le calma d’un geste :
— Pas de colère ! Avant tout, dans l’affaire qui nous occupe, il faut savoir résister à un premier mouvement. Supposons que vous vous trouviez brusquement en face de cet homme, que feriez-vous ?
— Je lui sauterais à la gorge, et il ne s’échapperait pas, j’en jure Dieu !
— Sottise ! il faudrait affecter de ne pas le reconnaître. Le suivre, savoir où il gîte, et le surveiller pour le ramasser avec ses complices. Je vous en prie, mon cher Baudoin, convenons bien de tout cela, à l’avance. Car si nous faisons de la police de sentiment, nous ne réussirons à rien.
Baudoin soupira.
— Vous avez raison, mais comme je trouverais dur de ne pas me payer tout de suite la peau du gredin ! Enfin, vous avez l’expérience. On vous obéira.
— Maintenant, cherchons un moyen de correspondance. Il ne faut pas qu’on nous voie communiquer ensemble, à l’avenir. Tenez, quand j’aurai besoin de vous parler, j’irai près de la porte d’entrée de la fabrique et, avec du crayon rouge, sur le montant de pierre de la grille, côté gauche j’écrirai un jour et une heure. Par exemple : mardi, 4 h. Alors vous vous arrangerez pour venir dans ce cabaret et vous m’y retrouverez. Vous, si vous avez besoin de me voir, vous en ferez autant sur l’autre pilier, côté droit de la grille. Chacun le sien. Je passerai tous les matins et tous les soirs par là, pour voir s’il y a à vous appeler ou à vous rejoindre.
— Entendu.
— Adieu, maintenant. En sortant d’ici nous ne nous connaissons plus. Je vous laisse payer. Je pars le premier. Bonne chance ! Et du sang-froid.
— On en achètera, car on n’en a guère !
À la même heure, dans les bois de la côte, Marcel se promenait avec Mme Vignola. Le petit chien terrier courait dans les grandes herbes, le long du sentier, et le passage était si étroit que le jeune homme et la belle veuve se serraient l’un contre l’autre, afin d’éviter le froissement des branches qui poussaient vigoureuses, piquées de feuilles odorantes encore poissées de sève. Une langueur tiède émanait de la terre échauffée par les premiers soleils printaniers. Et dans l’air doux, parmi les taillis qui les enveloppaient du mystère de leurs verdures naissantes, ils allaient, silencieux, l’esprit engourdi et le cœur satisfait. Arrivés au bord du plateau, sur un éperon rocheux qu’ombrageaient de grands frênes, ils s’arrêtèrent.
Toute la vallée d’Ars s’étendait devant eux. La petite ville était couchée à leurs pieds, au bord de la rivière coulant paresseuse entre les berges gazonnées des prairies, sur le vert cru desquelles les vaches ruminant marquaient leurs taches fauves et blanches. Les toits de tuile de l’usine, sa grande cheminée au panache de noire fumée, les enclos où s’étendaient les séchoirs, l’église et les maisons, capricieusement groupées, formaient un tableau calme, riant et délicieux. La jeune femme, du bout de son ombrelle, montrant à son compagnon les différents points du panorama, se faisait nommer les pays, les établissements, les villages. C’était comme une prise de possession qu’elle faisait de la contrée, sous les auspices de Marcel. Il le lui fit remarquer en souriant :
— Vous vous renseignez, comme si vous aviez l’intention de vous fixer dans notre province…
— C’est une habitude que j’ai, dit-elle. J’aime à savoir où je suis, à me renseigner sur les alentours. Les choses n’acquièrent de signification et d’intérêt, pour moi, que quand je suis fixée sur leur nom et leur destination. Ainsi, vous me montrez, là-bas, une ligne de chemin de fer qui passe dans la plaine. En tant que chemin de fer, je n’y attache point de valeur, il me laisse indifférente. Vous ajoutez : c’est la voie qui de Troyes va à la frontière par Belfort… Aussitôt, mon esprit travaille, et la représentation précise, qui lui est donnée de la chose, l’attache à cette chose même… Je ne suis pas poétique du tout, comme vous voyez…
— Vous me paraissez avoir une intelligence très particulière…
— Et qui n’est point trop d’une femme, avouez-le ?
— Il est vrai que je vous trouve singulièrement peu futile. Mais n’est-ce pas une qualité ?
— En tout cas, convenez que ce n’est pas une grâce ?
— Oh ! vous en avez tant d’autres !
— Je ne vous demandais pas un compliment.
— Puisqu’il est fait. Acceptez-le tout de même.
Elle le regarda, avec un air de naïf contentement, puis agita la tête :
— Vous n’êtes pas raisonnable. Et vous manquez à nos conventions. Il a été entendu entre nous que vous me traiteriez comme un camarade, moyennant quoi je vous permettrais de m’accompagner dans mes promenades, et de venir chez moi librement… Mais vous êtes un français, et il vous est impossible de renoncer complètement à la galanterie.
— Un Italien serait-il donc resté si longtemps, auprès de vous, sans vous dire que vous êtes charmante ?
— Oui, si je le lui avais défendu. Mais il l’aurait pensé davantage !
— Qu’en savez-vous ? dit Marcel avec feu. Allez-vous me croire indifférent, parce que vous obéissant trop bien, je m’en suis tenu, avec vous, à de bien simples et très froides galanteries ? Ne jugez pas de mes sentiments par mes paroles. Ils sont bien différents les uns des autres…
— Vous ne me connaissez que depuis huit jours…
— En faut-il plus pour aimer à jamais ?
— À jamais ! Quel engagement ! Et si vite pris…
— Et si facile à tenir, quand on vous connaît, après vous avoir vue !
— Et qui ne peut avoir de conséquences, puisque je dois partir, bientôt, et m’en aller bien loin…
— Qui vous force à donner suite à des projets formés dans les heures premières de la tristesse et de la solitude ? Est-il sage de décider de toute sa vie, en un instant, quand on a votre âge, et que l’avenir réserve tant de compensations et de revanches ? À vingt-quatre ans, croire tout perdu parce que les fatalités de l’existence vous ont séparé d’un époux, qui aurait pu être votre père ? Mais alors que vous songez à ne plus vivre, votre vie est à peine commencée.
— Oui, tout ce que vous dites là, mon frère me l’a dit à maintes reprises. C’est l’ordre habituel des choses. Après une affection défaillante, une tendresse nouvelle. Mais quelle misère de se prêter à ces arrangements sociaux, et de subir ces destinations inattendues ! Un cœur ne se balaie pas, pourtant, comme un appartement, pour d’autres locataires. Il reste, de celui qui l’a occupé, des souvenirs qui ne s’effacent pas si vite. Et n’est-ce pas une sorte de profanation, pour une âme délicate, de se laisser pénétrer à nouveau quand elle croyait si bien être fermée, pour toujours !
— Je vais vous riposter comme vous l’avez fait tout à l’heure : Pour toujours ! Quel engagement ! Et si légèrement pris ! Est-ce que vous pouvez être sûre de le tenir ? Laissez faire la vie. Elle marche, elle agit, en dépit de ce que vous décidez sans tenir compte de son action irrésistible. Elle vous montrera bien que rien n’est définitif, en ce monde, même la plus sincère douleur.
Elle resta un assez long moment silencieuse, les yeux baissés, laissant son compagnon la regarder tout à son aise. Et il admirait la gracieuse inflexion de sa taille souple, la courbe élégante de ses épaules moulées dans une robe noire toute simple, la grâce juvénile et comme étonnée de son délicieux visage. Elle paraissait à peine vingt ans. Un fin duvet veloutait ses joues. On eut dit un fruit savoureux et tentant. Enfin elle soupira et reprit :
— Mais vous, qui me faites de si vives protestations, si je vous écoutais, que de chagrins ne me préparerais-je pas pour l’avenir ? Vous ne dépendez pas de vous seul, comme moi, qui n’ai plus qu’un frère, si indulgent et si facile à me complaire. Vous avez une famille, qui vous rappellera. Vous quitterez ce pays-ci. Où irez-vous ?
— Je rentrerai à Paris, où j’habite ordinairement. Et qui vous empêche de vous y installer vous-même ? Vous avez des intérêts en Italie ? Eh bien ! Votre frère s’en chargera, et vous n’aurez plus à vous occuper que d’être heureuse.
— Paris me fait peur. Son immense mouvement me trouble, comme l’agitation de la mer. Il me semble qu’il est impossible d’y vivre calme.
— Comme vous vous trompez ! L’agitation de Paris est factice. La surface seule est troublée. Les couches profondes, ainsi que dans la mer, dont vous parliez à l’instant, sont tranquilles et les tempêtes de la surface ne les bouleversent jamais. Il est, dans la ville, des coins paisibles, pleins de verdure, de lumière et de fleurs, où la vie coule lente et douce. On vous en trouverait un, choisi avec un soin tendre, et vous y apprendriez la quiétude des jours sans tristesse et sans fièvre. Loin du bruit, près de la distraction, n’ayant qu’un pas à faire pour participer aux raffinements du goût et aux jouissances intelligentes, vous connaîtriez ce qu’il y a de plus précieux au monde : une retraite embellie par un amour délicat et sincère.
— Voilà un tableau bien séduisant et vous êtes un habile metteur en scène. Y a-t-il un peu de féerie dans votre cas ? Possédez-vous la baguette d’un enchanteur pour disposer ainsi de la destinée des êtres ? Vous accordez les personnages et les décors à votre fantaisie. Mais si l’on vous écoutait, seriez-vous libre de réaliser votre programme ? Vous me paraissez compter sans votre entourage. Que diraient de cet arrangement, vos parents, vos amis…
— Oh ! Ils l’accepteraient, n’en doutez pas. Si vous saviez comme ils m’aiment. Et comme tout ce qui serait une preuve de modération et de sagesse de ma part, serait accueilli par eux avec joie ! Mon père, avec ses dehors un peu brusques, est le meilleur homme de la terre. Il ne s’émeut de ce que je puis faire que par affection pour moi et par souci de mon avenir. Jamais il n’a prononcé une parole égoïste, dans nos jours de querelle. Il subordonne sa satisfaction, sa tranquillité même, à mon intérêt. Et c’est quand il voyait qu’un écart de conduite, une légèreté d’esprit, qu’il jugeait nuisibles, allaient me faire du tort, qu’il sévissait contre moi. Il m’aime exclusivement. Et s’il était sûr que mon bonheur pourrait être assuré, dans des conditions honorables, il y sacrifierait, sans hésiter, le sien. Quant à ma mère, c’est le devoir, la vertu et la bonté…
Elle pinça les lèvres et dit avec une soudaine sécheresse, comme si ce luxe d’éloges la fatiguait :
— Voilà des sentiments bien admirables ! N’êtes-vous donc pas un bon fils, que vous avez pu vous trouver en désaccord, même passager, avec des parents si parfaits ?
Marcel sourit :
— Je ne suis pas un méchant fils, mais je n’ai pas toujours été un garçon raisonnable.
— Que vous a-t-il manqué pour l’être ?
— D’aimer sérieusement.
Elle leva son doigt fin et menaça Marcel :
— Vous m’offrez, je le crains, un assez mauvais sujet !
— N’allez pas me juger mal, parce que j’ai parlé avec franchise. Ce ne serait ni bienveillant, ni même juste. Car vous vous feriez, en toute sincérité, une fausse idée de moi.
Elle dit légèrement :
— Allons ! Je vois bien décidément que vous êtes un modèle !
— Vous vous moquez, à présent ! Quelle mobilité d’esprit vous avez, et comment espérer vous convaincre ?…
— Eh ! mon cher monsieur, aviez-vous pensé qu’en un clin d’œil et un tour de phrase vous alliez me séduire ? Je suis plus rebelle alors que vous ne l’avez cru. Supposiez-vous que l’influence du printemps, dans ce charmant paysage, le désœuvrement de la solitude, la longueur des soirées, joints à vos grâces particulières, m’auraient réduite rapidement à vous écouter sans résistance ? Vous allez un peu bien vite… Et ma mélancolie n’est pas si prompte aux distractions ! Là ! Ne faites pas une figure navrée. Je vous parle sans sévérité et même avec gentillesse. J’aurais pu prendre une attitude offensée, car enfin vous m’offrez votre cœur avec une absence de précautions complète. Mais dans ce pays perdu, n’est-ce pas, on se sent plus près de la nature. Il est aisé de revenir à des mœurs presque primitives, et, ma foi, sans se préoccuper des usages et des formes, de dire les choses tout uniment ?… Remettez-vous, on vous pardonne, mais à la condition que vous ne recommencerez pas.
Stupéfait en écoutant la jeune femme parler avec cette railleuse vivacité, Marcel se demandait si c’était la triste et langoureuse veuve qui sanglotait au piano en chantant les tendres mélodies. Sa physionomie pétillait de malice et ses yeux caressants démentaient la froideur de ses paroles. Elle présentait un assemblage si irritant de décence et de rouerie, de pudeur et de sensualité, que Marcel ne savait plus que penser. Il entendait la bouche prononcer des paroles sévères et en même temps le regard se faisait plus propice. Il craignait de déplaire à Mme Vignola en persistant à lui parler d’amour, et un instinct secret le poussait à la prendre dans ses bras, et à fermer ces lèvres trop raisonnables sous ses baisers. La cloche de l’église d’Ars, en sonnant l’Angélus du soir, changea le cours de leurs idées. La jeune femme se leva vivement en s’écriant :
— Déjà six heures ! Comme le temps passe ! Vous me faites faire des folies ! On ne va pas, chez moi, savoir ce que je suis devenue.
— Vous y êtes seule !
— Et ma domestique…
— Cette maugrabine extraordinaire que vous appelez Milo…
— N’en dites pas de mal, vous lui plaisez.
— Grand merci de cette faveur !
— Oh ! ne l’obtient pas qui veut. Elle vous sourit quand vous arrivez. C’est comme mon chien qui vous lèche… Il n’en est pas ainsi pour tout le monde.
— Oui, je charme la servante et le chien… Mais la maîtresse me dédaigne.
— Oh ! La maîtresse… C’est elle qui commande. Et les autres obéissent.
— Eh bien ! J’obéirai donc.
Elle lui sourit avec une grâce charmante, puis, sifflant le petit terrier qui s’était éloigné dans la bruyère, lentement, aux côtés de Marcel, elle reprit le chemin de la villa. Comme ils arrivaient devant la porte, ils virent un homme occupé à ranger, sur la route, des pierres qu’un tombereau avait déposées le matin. Une masse, un masque grillagé étaient posés près de sa veste sous un abri en paille. Il tira poliment sa casquette aux deux promeneurs, et, sans paraître s’occuper d’eux, continua sa besogne. Mme Vignola parut contrariée de cette installation si proche de sa maison. Elle regarda attentivement l’homme, et sitôt la porte du jardin fermée :
— Qu’est-ce que cet individu se propose de faire là ? demanda-t-elle.
— Mais de casser des cailloux, selon toute vraisemblance, dit Marcel. C’est un tâcheron qui va travailler le long de la route, pendant quelque temps.
— Restera-t-il longtemps devant chez moi ?
— Quelques jours, peut-être.
— Il a une mauvaise figure. N’y a-t-il rien à craindre de ces gens-là ?
— Rien du tout, que le bruit de leur masse frappant la pierre. Mais de la maison vous ne l’entendrez pas.
Mme Vignola ne parut pas convaincue de ce que lui affirmait Marcel. Une ombre de préoccupation obscurcissait son front.
— Si vous êtes si contrariée de la présence de ce pauvre diable, dit le jeune homme, voulez-vous que je demande au conducteur des ponts et chaussées de le faire déménager ? Il ira travailler cent mètres plus haut, ou cent mètres plus bas. J’ai assez de crédit pour obtenir ce déplacement.
— Gardez-vous-en bien. Je m’habituerai à sa présence. Le déranger ? Non pas ! Après tout, il faut qu’il gagne sa vie…
Elle tendait la main à Marcel, en souriant. Il la garda un instant dans les siennes, et, doucement :
— Vous ne m’en voulez pas ?
— Non.
— Vous me permettez de revenir demain ?
— Je désire que vous reveniez.
— Vous me laisserez vous dire que je vous aime ?
— Si cela vous fait tant de plaisir…
Ils se turent. La nuit tombait. Une molle obscurité planait sur les massifs du jardin. Ils étaient moins seuls cependant que sur la lande de Bossicant, et c’était cela peut-être qui les rendait plus téméraires. Marcel attira par la main, qu’il serrait tendrement, la jeune femme plus près de lui, sans qu’elle fît de résistance. Le tissu de la robe noire frôla l’épaule de Marcel. Il sentit la tiède pression de la poitrine d’Anetta. Il leva les yeux sur elle et la vit pâle, les yeux noyés de langueur. Une fièvre le saisit. Son bras gauche entoura la taille souple qui se renversa. Une bouche frémissante, d’où s’exhalait un soupir, se trouva près de ses lèvres. Il sentit la jeune femme qui s’attachait à lui et, pendant une seconde dévorante, il perdit la notion des êtres et des choses.
Il fut rappelé à lui-même par un cri douloureux et par un effort de résistance. Il releva ses paupières fermées dans l’extase et vit Anetta qui fuyait vers la maison. Sur le seuil elle s’arrêta, le regarda un instant, comme si elle cherchait ce qu’elle allait lui dire. Il fit un pas pour la rejoindre. Mais un geste de supplication l’arrêta. De ses doigts, placés sur sa bouche, il adressa un baiser à celle qui le possédait si complètement, et docile il partit.
Une désagréable surprise l’attendait à son arrivée à la fabrique. Les grilles habituellement ouvertes étaient closes. Et des groupes stationnaient dans la rue, murmurants, affairés, qui s’écartèrent à son approche, pour se reformer plus loin avec un aspect hostile. Ce que le directeur lui avait dit, les jours précédents, des dispositions mauvaises des ouvriers lui revint à l’esprit. Il avait oublié les difficultés d’affaires, dans son emportement à vaincre les résistances d’amour. Il entra chez le concierge et demanda :
— Qu’est-ce qui se passe donc ? Pourquoi cette fermeture de grilles ? Et que signifient ces conciliabules dans la rue ?
— Ah ! monsieur Marcel, c’est rapport aux ennuis avec les ouvriers… Ils ont cessé le travail, à trois heures, aujourd’hui, et ils sont partis dans les cabarets avec les grévistes des établissements de Troyes, qui sont venus les débaucher…
— Il n’y a pas eu de violences ?
— Non, monsieur Marcel. Mais M. le directeur a demandé plusieurs fois après vous…
— Je vais chez lui.
Il se dirigea vers les bureaux. À travers les volets fermés, une raie de lumière annonçait la présence de M. Cardez dans son cabinet. Marcel entra. Le directeur assis devant son bureau écrivait. À la vue du fils de son patron, il se leva vivement, et sans attendre d’être questionné :
— Eh bien ! que vous avais-je dit, M. Baradier ? Ils sont en pleine révolte… Et sans le moindre motif plausible ! Pour faire comme les camarades ! Je les ai vainement raisonnés, amadoués, rien n’a servi ? Ce sont des machines ! Ils sont montés par des meneurs, et marchent systématiquement ! Ah ! Les ouvriers ! Vous qui vous intéressez à eux, vous allez apprendre à les connaître !
— Quelles mesures avez-vous prises ?
— J’ai fermé les portes, pour qu’on n’entre pas chez nous sans notre permission, ou sans encourir une responsabilité pénale. Et j’attends. Une délégation des ouvriers m’est annoncée.
— Mais sous quel prétexte ont-ils cessé le travail ?
— Ils demandent la suppression du balayage, de l’allumage, la fourniture des aiguilles à un prix inférieur…
— Est-ce juste ?
— C’est nouveau.
— Mais est-ce juste ?
— Mon Dieu ! Sans doute on pourrait leur faire ces concessions, mais après celles-là, ce seront d’autres. Leurs revendications composent un chapelet qu’ils voudront nous faire égrener jusqu’au bout. Nous n’en sommes qu’au commencement. Est-il sage de céder tout de suite et complètement ?
— Pourquoi ne pas se donner à leurs yeux un mérite de la bonne volonté ?
— Ils la prendront pour de la faiblesse.
Marcel demeura pensif.
— Ainsi ce sont les tisseurs de Troyes qui sont en grève et qui entraînent nos ouvriers ?
— Ils sont allés à Sainte-Savine, hier, et à Ars aujourd’hui. Mais ils ont fait assez de bruit ! Vous étiez bien occupé pour n’avoir rien entendu…
— J’étais absent, dit Marcel avec embarras.
— Du reste vous auriez été présent que les choses n’auraient pas changé… Le siège de ces gens-là est fait… On vous aurait insulté, comme moi, et voilà tout…
— Insulté ? se récria Marcel.
— Tenez ! Écoutez !
Dans la nuit une rumeur s’élevait, faite des voix rudes de la foule, et chantant une sorte de Marseillaise ouvrière.
Les patrons, les damnés patrons,
Un beau matin, nous les verrons
Accrochés au bout d’une branche !
En se sentant morts à moitié,
C’est alors qu’ils crieront pitié !
Mais nous leur répondrons : Dimanche !
Retroussez vos manches, lurons !
Bientôt va commencer la danse.
Ayons la victoire, ou mourons
Pour notre indépendance !
Une clameur aiguë, cris de femmes et d’enfants, suivit ce menaçant refrain, puis une huée formidable :
— À bas Cardez ! À bas le directeur ! À la potence !
— Les entendez-vous ? dit Cardez : à la potence ! Tout simplement ! Et que leur ai-je fait ? Rien que d’exiger d’eux un travail consciencieux et le respect du règlement. À la potence ! S’ils croient m’effrayer avec leurs menaces, ils se trompent. Un ancien soldat, comme moi, ne s’intimide pas si facilement. D’ailleurs, ils crient mais ils n’agiront pas. Ce sont des braillards !
— Avez-vous prévenu mon père et mon oncle ? demanda Marcel.
— J’ai téléphoné à ces messieurs. Ils ont dû se mettre en rapport avec le préfet, pour assurer la protection de l’usine et le respect de la liberté du travail. Mais alors il faudra de la troupe. Et, avec les champenois, on ne sait pas où on ira si la troupe s’en mêle. Nous avons à Ars de bons gendarmes, qui sont connus et respectés, je pense que cela devrait suffire.
— Craignez-vous donc un conflit ?
— Je ne crains rien. Mais je dois tout prévoir. Nos ouvriers d’Ars, je vous l’ai dit, sont plus bruyants que mal intentionnés… Mais il y a les étrangers, les entraîneurs, avec lesquels il faut compter…
— L’émeute est une force aveugle et sourde… Cent hommes sont impossibles à détromper. S’ils crient tous à la fois, comment s’entendre ?
— C’est bien là-dessus que comptent les entrepreneurs de grèves ! Le tumulte, la violence. Mais je recevrai demain la délégation des ouvriers et, avec elle, il sera, je l’espère, possible de raisonner.
— Je vous assisterai.
— Si vous voulez.
— Peut-il se produire une manifestation hostile, ce soir ?
— Non. Rien avant demain.
— Alors, je vais dîner. Bonsoir.
Baudoin l’attendait. En lui servant son repas, le bon serviteur, à qui Marcel tolérait une certaine familiarité, tournait autour de la table, au lieu de s’en aller à la cuisine. Il examinait son maître et semblait chercher à lire sur son visage ses secrètes impressions. Il avait fort à faire, depuis quelques jours. Jamais le mutisme du jeune homme n’avait été plus complet. Il revivait dans la solitude les heures passées auprès de la belle Italienne et pas un instant d’ennui n’était possible pour lui. Il demeurait taciturne, mais le visage éclairé par un rayonnement intérieur : foyer de joie qui illuminait sa pensée. Cependant, si absorbé qu’il fût, l’insistance de Baudoin à rester planté devant lui, comme un point d’interrogation, frappa Marcel. Il le regarda un instant, puis :
— Qu’est-ce que vous avez donc, ce soir, Baudoin ? demanda-t-il. Vous paraissez tout ébouriffé…
— On le serait à moins… Monsieur sait que les ouvriers parcourent le pays en menaçant de tout casser à la fabrique ?…
— Eh bien ! Est-ce que vous avez peur ?
— Ma foi, non, monsieur, pas pour moi en tout cas !
— Et pour qui donc alors ?
— Pour monsieur. Lorsque j’ai quitté Paris, M. Baradier m’a donné comme consigne de bien soigner monsieur. S’il arrivait quelque chose, je ne serais pas brillant… C’est ça qui m’ébouriffe, comme dit monsieur.
— Il n’y a rien à faire, Baudoin, qu’à attendre.
— Je demande pardon à monsieur, mais il y aurait quelque chose de très préférable : ce serait de prendre le chemin de fer…
— Et de laisser l’usine de mon père, exposée aux violences de ses ouvriers ?
— L’usine de M. Baradier, oui, sans doute, elle est précieuse, mais pas tant que le fils de M. Baradier…
— Soyez tranquille, Baudoin, on ne fera rien, ni à moi, ni à l’usine… Que diable ! Il y a des lois… Les gens d’Ars ne sont pas des sauvages…
— Monsieur, les gens de Troyes, non plus, ne sont pas des sauvages, ceux de Sainte-Savine non plus, et cependant, ils ont cassé tout, ce matin, chez MM. Tirot et Malapeyre.
— De mauvais patrons !
— Il n’y a ni mauvais ni bons patrons. Il y a des patrons ! La présence de monsieur n’est pas indispensable ici. Monsieur devrait aller passer huit jours à Paris.
— On dira que je me suis sauvé ! Et le père Cardez, qui ne m’aime déjà pas beaucoup, dira que je ne suis bon qu’à faire des expériences de laboratoire, et encore ! Mais que, quand il s’agit de défendre l’usine, on ne me trouve plus ! Non ! non ! Je suis dans le pays, c’est un hasard, mais je subirai ce hasard. Et je tâcherai même d’en tirer parti pour le bien général.
— Alors, monsieur pensera à prendre les précautions nécessaires ?
— Quelles précautions ?
— Avoir un bon revolver sur lui, d’abord.
— En voilà une idée ! Mais à quoi me servirait une arme, mon brave Baudoin ? Si j’ai affaire à une foule, je ne pourrai pas me défendre… Si je n’ai affaire qu’à un ou deux hommes, je ne serai pas en danger…
— Au moins, si monsieur a ici des choses précieuses, qu’il les mette en sûreté.
Ils se regardèrent. Il y eut un silence. Marcel avait compris ce que voulait dire le serviteur du général. Il devint grave :
— C’est aux poudres que vous faites allusion, n’est-ce pas, Baudoin ?
— Oui, monsieur, c’est aux poudres. Je sais que monsieur en possède les formules. Je sais que monsieur a travaillé dans son laboratoire. Rien ne peut-il y être dérobé qui mette en possession du secret, celui qui aurait l’audace de faire le coup ?
— On peut prendre les poudres, Baudoin, on peut dérober même les formules. On ne trouvera pas le secret. Il y a un tour de main, que le général m’a révélé, et qui, seul, constitue la valeur définitive de la découverte.
— C’est pourtant pour s’en emparer qu’on a tué mon maître…
— Non, Baudoin, on l’a tué, parce qu’il a refusé de dire comment il opérait pour le dosage… C’est la fureur de se trouver déçu qui a poussé le bras du meurtrier… Il a cru qu’il pourrait suppléer au génie de l’inventeur, et trouver les mélanges lui-même. Il a voulu violer le mystère, brutaliser la science. C’est alors qu’il a été frappé…
— Ne peut-il essayer de recommencer ?
— Est-il vivant encore seulement ? Mais, voyons Baudoin, songez-vous à établir une relation, même éloignée, entre les troubles qui mettent le pays sens dessus dessous, et cette affaire des poudres ?…
— Je ne sais rien, je ne songe à rien, mais je me méfie de tout ce qui a une apparence louche… Il y a des étrangers à l’usine… Ce sont eux qui mènent les grévistes… L’étranger était dans l’affaire des poudres. Mon Dieu ! Monsieur, je suis peut-être stupide… Mais je donnerais beaucoup pour être à Paris, avec monsieur…
— Vous avez de l’imagination, Baudoin.
— Alors puisque je vois que monsieur est décidé à ne tenir aucun compte de ce que je lui dis, je demande à monsieur de me donner la clef du laboratoire… J’y veillerai le jour, j’y coucherai la nuit… Je serai ainsi plus tranquille…
— Eh bien ! Baudoin, c’est entendu… Vous prendrez la clef dans ma chambre, sur la cheminée… S’il ne faut que cela pour vous tranquilliser, c’est facile…
— Monsieur, cela ne me tranquillisera pas tout à fait, mais cela me fera plaisir.
Là-dessus, le dîner étant fini, Marcel sortit dans le jardin et s’en fût faire les cent pas au bord de la rivière. La soirée était fraîche et pas un nuage ne voilait les étoiles dans le ciel. Une rumeur, par instants, s’élevait venant des cabarets de la ville, où les ouvriers célébraient la grève en buvant rasades. Une tristesse assombrit l’esprit de Marcel, à la pensée des femmes et des enfants qui attendaient, dans les pauvres logements, la rentrée du père, pour le repas du soir, pendant que, entraîné par les railleries des habiles, par les menaces des violents, l’ouvrier s’attardait devant la table chargée de verres, criant dans la fumée des pipes et buvant les liqueurs qui rendent fou. Quelle misère serait la suite de cette interruption dans le travail ! Les petites économies des sages s’en iraient, les dettes des imprévoyants grossiraient. Et de tout ce tumulte, de toute cette agitation, excités par des meneurs hypocrites, il ne résulterait que des sévérités et de la rancune.
Il détourna sa pensée de ces maux, auxquels il était impuissant à remédier, et la dirigea vers la villa de la Cavée. Là, en même temps que lui, Anetta se promenait dans son jardin. Il la vit, solitaire et rêveuse, passant dans l’allée tournante. À quoi songeait-elle, sinon à lui, dont le cœur était rempli d’elle ? Leurs âmes n’étaient-elles pas à l’unisson, et ce baiser suave, si délicieusement rendu, n’était-il pas la preuve qu’elle se donnait comme il s’était donné lui-même. Il frissonna de plaisir, dans le silence et la fraîcheur nocturnes. Il se dit : si j’allais la rejoindre. Elle ne m’attend pas. Mais que penserait-elle de mon empressement à la revoir ? L’heure insolite, l’isolement où elle est, ne lui permettraient-ils pas de juger ma venue offensante. Et plus elle est sans défense, plus ne dois-je pas la respecter ? Oh ! elle m’aime, je le sens. Vais-je par ma précipitation gâter tout le bonheur que l’avenir me promet ?
Ainsi, dans sa tendresse sincère, Marcel se préoccupait de ménager les susceptibilités de celle qui lui avait tendu le redoutable piège où il était irrémédiablement pris. S’il eut pu pénétrer dans la villa de la Cavée et gagner silencieusement le salon, il aurait pu entendre Sophia et sa suivante dalmate échanger leurs impressions, pendant qu’à califourchon sur une chaise, le terrible Hans fumait en les écoutant d’un air ironique :
— Mais, madame, que ferez-vous de ce pauvre garçon, quand vous aurez obtenu de lui ce que vous voulez ?
— Sois tranquille. Il ne m’embarrassera pas. Il est doux et charmant. Il pleurera mon départ. Mais il n’est pas au point où je veux l’amener…
— Ce que nous appelons, nous autres chimistes, le point d’incandescence, dit Hans de sa voix rude. Nous savons ce que c’est, quand vous vous en mêlez, Sophia… C’est, pour le jeune Zypiatine, le moment où affolé, il a livré les horaires de la concentration sur la frontière d’Afghanistan ; pour le pauvre Stenheim, l’heure où il a volé, au ministère de la guerre, le plan de défense de l’Herzégovine, et pour notre ami le beau Cesare Agostini…
— Ne parlez pas de Cesare, interrompit la jeune femme, en fronçant le sourcil.
— Eh ! Pourquoi donc ? Le coup qu’il a fait est un des plus beaux qui soient. Et s’il essayait de repasser la frontière italienne, je crois qu’il irait pourrir dans une forteresse de Sardaigne, la plus ignorée, la plus sombre, et la plus sourde… Car il n’est pas de ceux qu’on se risque à faire passer en jugement, même à huis-clos. Il en sait trop long !… Il est certain que le petit blondin champenois, que vous vous apprêtez à tondre, est un agneau pascal comparé aux gaillards que vous avez conduits à leur perte, sans sourciller, jusqu’ici… Mais prenez garde Sophia, je vous connais bien… Vous n’êtes pas dans votre assiette, en ce moment, et vous avez des silences, des rêvasseries, des préoccupations, qui ne m’annoncent rien de bon ! Seriez-vous sur le point de faire une sottise ?
Sophia tressaillit. Elle leva ses yeux clairs sur Hans, et avec une soudaine rudesse :
— Que prétendez-vous dire ?
— Ah ! Ah ! Cela vous intéresse ! Je n’en suis pas surpris. Vous êtes trop intelligente, pour vous faire illusion à vous-même. Et vous devez bien vous rendre compte qu’il se passe dans votre esprit quelque chose d’anormal. Vous avez eu, l’autre jour, une façon de me déclarer que vous entendiez que pas un cheveu de la tête du jeune Baradier ne tombât, qui m’a donné fort à réfléchir… Je vous ai vue, ce soir, quand vous êtes rentrée, dans un état de langueur qui n’est pas naturel à une femme aussi pratique que vous. Habituellement, quand vous avez joué un rôle, vous reprenez votre tournure d’esprit, votre expression de visage et votre netteté de parole, comme si, ayant enlevé un masque, vous vous retrouviez vous-même. Il n’en est pas ainsi, cette fois… Vous subissez des influences extérieures… Enfin, tranchons le mot, vous me paraissez en train de vous toquer de ce petit jeune homme !
— Moi ! s’écria Sophia, presque avec colère.
— Oui, vous, Sophia, baronne Grodsko, connue ici sous le nom de Mme Vignola. Et, entendez-vous, ma chère, ce serait une bêtise pommée !
— Vous êtes fou, Hans.
— Je ne demande pas mieux que de me tromper. Mais j’ai le nez diablement creux ! Écoutez, Sophia, nous avons tous nos petites faiblesses. Je ne m’étonnerais pas que ce garçon vous plût. Je m’étonnerais, par exemple, énormément que vous eussiez la pensée de le lier à vous. Rien ne serait plus dangereux pour nous, pour lui, et pour vous-même. Si vous avez un caprice pour lui, eh bien, l’instant est propice, la villa est isolée, et je ne vous cacherai pas, même, que si vous écartiez le jeune Marcel de l’usine, cela servirait mes projets… Mais point de passion, n’est-ce pas ? Une passade… Juste ce qu’il faudra pour exécuter notre projet, obtenir des révélations, vous offrir une heure de bon temps, et puis adieu ! Voilà comment je comprends les choses !
— Et voilà comment je les comprends moi-même, dit froidement la jeune femme.
— Alors, ça va bien. Si vous êtes raisonnable, rien à craindre et tout à espérer. Tu entends ça, toi, Milo. Si ta maîtresse a des velléités de donner dans la faribole, tu seras là pour lui rappeler ses engagements.
— Je suis là pour lui obéir, dit Milona, avec un noir regard, et non pour lui commander. Quant à vous, ne vous avisez jamais de me donner un ordre.
— Et pourquoi donc, s’il te plaît, jeune sauvage ?
— Parce qu’une fille comme moi peut abandonner sa liberté pour suivre qui elle chérit, mais n’est point faite pour servir qui elle déteste.
— Ceci revient à dire que nous ne sommes pas une paire d’amis, ma petite, goguenarda Hans avec un gros rire. À ton aise. On ne force pas les inclinations.
Milona le toisa, leva les épaules, en prononçant quelques paroles dans une langue rude. Elle sortit.
— Qu’a-t-elle dit, dans son diable de langage romaïque ?
— Elle a dit : Puisses-tu mourir brûlé par la fièvre, sans qu’on te jette un verre d’eau, fils de louve.
— Grand merci de la gracieuseté. Ma canne fera un jour connaissance avec ton dos, ma charmante.
— Ne vous en avisez jamais, Hans, elle vous répondrait à coups de poignard.
— Délicieuses relations ! Mais je ne crains personne, vous le savez bien. Et si cette jeune drôlesse se rebellait, je me chargerais de la mettre à la raison. Ah ! çà, parlons de choses plus sérieuses. Avez-vous des nouvelles de Cesare ?
— Il m’écrit qu’il revient de Londres où les affaires financières marchent bien. Nos amis anglais sont, vous le savez, des gens pratiques. Ils ont monté une affaire au capital de cinquante millions. Il faudra qu’on leur donne un monde, pour leur argent. Et ils l’auront ! Quand ils devraient faire égorger cent mille hommes pour réussir.
— Ils réussiront. Quand on base ses calculs sur la sottise et la crédulité humaines, on ne peut pas échouer. C’est en cela que les affaires financières sont d’un si misérable intérêt.
— Vous, au fond, vous n’avez d’estime que pour la force. Vous avez un tempérament de condottiere du XIVe siècle. Vous êtes égaré dans notre société de pleutres, et vous devez étouffer dans notre civilisation si étroite. Voyons. Hans, puisque nous causons, ce soir, avec une apparence de franchise, qu’êtes-vous et d’où venez-vous ? Il y a cinq ans que je vous ai rencontré et je ne vous connais pas plus que le premier jour. Nos intérêts nous lient, mais de vous tout m’échappe. On vous nomme ordinairement Hans et quelquefois Fichter, vous semblez être allemand, mais vous parlez le Russe et l’Espagnol admirablement. Je vous ai vu accomplir des actions abominables, et pourtant vous n’êtes pas cruel sans nécessité. Vous essayez de vous procurer de grosses sommes d’argent, et je ne vous vois pas de besoins dispendieux. Où vont toutes vos ressources ? Quel but vous proposez-vous ? Quelle mystérieuse et souterraine besogne accomplissez-vous ? Car ce que vous faites avec nous, n’est qu’une faible partie de votre travail. Vous avez des affidés qui ne sont pas à nous, et brusquement vous disparaissez pour exécuter des œuvres que nous ignorons. Je soupçonne quelquefois que nous ne sommes, nous autres, que des instruments dans votre main, et que nous collaborons, sans nous en douter, à l’exécution d’un plan d’ensemble, qui embrasse toute l’humanité. Je me suis demandé si vous n’étiez pas le chef visible d’une énorme et terrible fédération internationale, qui, à un moment donné, et partout en même temps, allumera la révolution.
Hans sourit, hocha la tête d’un air approbateur, puis de sa voix railleuse, il dit :
— Il n’y a vraiment que les femmes pour avoir le tact fin et le sens net des choses ! Ah ! Vous avez pensé, Sophia, à chercher ce que je pouvais être en réalité. Eh bien ! Ma chère, vous avez eu plus de curiosité qu’un Lichtenbach ou qu’un Agostini, sans parler des autres, car jamais aucun d’eux n’a essayé de voir plus loin que ce que je lui montrais. C’est bien, Sophia, c’est bien ! Vous m’intéressez, mon enfant. Vous n’êtes pas une sotte.
Il se leva, prit la jolie femme par la taille, l’approcha de lui, et mit un baiser amical sur son front, puis la regardant de près, comme pour faire entrer les paroles plus avant dans son cerveau :
— Maintenant, ne vous avisez pas de faire des études psychologiques sur moi. Vous perdriez votre temps. Sachez que je suis Hans Fichter pour vous, et ne serai jamais autre. Mais soyez sûre que je ne suis pas que Hans Fichter. Vous avez cherché ma personnalité avec une clairvoyance amusante. Mais vous ne la découvrirez jamais et cela très heureusement pour vous, car vous ne survivriez pas une minute à votre découverte. Oui, mon enfant, j’ai, autour de moi, trop de gens intéressés à ce qu’on ne me gêne pas, pour que quelqu’un, qui s’aviserait de m’espionner, puisse vivre. Mais ne vous figurez pas que je suis une espèce de génie du mal, de maître des âmes révoltées, d’arbitre des transformations sociales à venir. Vous feriez fausse route. Mon pouvoir est grand, mais il n’est pas souverain. Je suis un des nombreux soldats d’une cause qui triomphera par tous les moyens, et je ne reconnais pas de chef !
— Hans, s’écria Sophia, vous parlez comme les nihilistes de mon pays. J’ai connu un jeune étudiant nommé Séwénikof, qui faisait de la propagande à Moscou, parmi les moujicks, et qui tenait un langage presque semblable au vôtre. Un beau jour, il a disparu.
— Oui, ma chère, comme vous disparaîtriez, si vous répétiez un mot des choses, pourtant bien simples et inoffensives, que je viens de vous dire. Savez-vous ce que c’était que votre Séwénikof, que je n’ai jamais rencontré, mais que je connais du reste, comme si je le voyais : c’était un agent provocateur. Il a été supprimé. Cela arrive tous les jours. Aussi soyez prudente, Sophia. Je vous aime beaucoup. Je serais désolé qu’il vous arrivât quelque ennui. Mais je n’y pourrais rien. Là-dessus, bonsoir.
— Vous allez vous coucher ?
— Non. Je sors. J’ai rendez-vous avec mes hommes, à Ars. Ne les avez-vous pas entendu brailler, ces imbéciles d’ouvriers, toute la journée ? Oh ! quel troupeau ! Voilà des gens qui ne se doutent guère qu’ils marchent, qu’ils pérorent et qu’ils menacent, parce que cela me plaît et que cela m’est utile.
— Soyez prudent, vous-même !
— Ah ! ce que je fais là est un jeu d’enfant.
Il alluma un cigare et sortit. Le jardin était noir. Il marcha, sans bruit, sur la bordure du gazon et, dans la nuit, on eut dit une ombre. Arrivé à la porte, il l’ouvrit sans qu’elle grinçât, et, avec une précision de clown, il la ferma dans son dos, de façon à être collé contre le panneau de bois, pour qu’on ne pût l’apercevoir de la route. Il resta un instant immobile, garanti par l’épaisseur des chambranles de pierre. Puis il avança la tête, et regarda autour de lui, comme s’il avait la faculté de voir dans l’obscurité. Au bout d’un moment, il s’engagea sur la route et se dirigea vers Ars. Il eut été impossible à quelqu’un, venant derrière lui, de croire qu’il était sorti du jardin de la villa.
Quand il fut à une centaine de mètres de distance, silencieusement les branches d’un buisson s’écartèrent, de l’autre côté du chemin, et un homme, à son tour, sauta le fossé de la route. Celui-là était le casseur de pierres, qui travaillait depuis quelques jours à la Cavée. Il régla son pas sur celui de Hans et descendit avec lui vers la ville.
IX
Baudoin, en quittant Marcel, après avoir obtenu de lui l’autorisation de veiller sur le laboratoire était sorti sur la route. Il faisait nuit. Il prit sa pipe, la bourra, puis, s’arrêtant près du pilier qui servait à la correspondance de Laforêt, il frotta une allumette. À sa lueur il examina le plâtre, et découvrit cette inscription au crayon rouge : ce soir, neuf. L’ancien soldat alluma sa pipe, regarda sa montre et murmura :
— Ce soir, neuf heures. Ça y est. Je puis aller retrouver mon homme.
Il se dirigea vers l’auberge. Elle n’était pas sombre et silencieuse, comme à l’ordinaire. Une clarté vive rayonnait par la porte vitrée, et des profondeurs de la salle une rumeur s’élevait. Baudoin s’approcha d’une des fenêtres du rez-de-chaussée, dont les volets étaient clos, et écouta. Une voix confuse montant et descendant, comme si quelqu’un prêchait, se faisait entendre, coupée de temps à autres par des exclamations et des cris. Un moment elle se fit plus haute et plus violente, et un tonnerre roula dans la salle, comme si toutes les tables étaient frappées en même temps par des poings robustes.
— Fichtre ! dit Baudoin, m’est avis que la place n’est pas saine pour quelqu’un de la direction. Les grévistes sont réunis au Soleil d’or et ils paraissent écouter avec faveur un de leurs habituels enfileurs de phrases…
Il fit le tour de la maison, gagna la porte de la cour, et chercha une issue pour entrer dans la cuisine, où devait se trouver le patron, son ami. Une main se posa sur son épaule, il se retourna et reconnut Laforêt arrivé sans bruit, près de lui.
— Je vous guettais, dit l’agent. L’établissement est plein de monde… Je pensais que vous viendriez par ici… Ne restons pas au milieu de la cour… Il y a quantité d’yeux ouverts, cette nuit, autour de nous…
— Où allons-nous ?
— Montons dans ma chambre.
Un escalier extérieur conduisait à une galerie de bois qui courait le long du premier étage. Du premier étage l’escalier gagnait les combles. C’était sous le toit que Laforêt avait pris une chambre, la plus misérable de l’établissement et telle qu’elle convenait pour un pauvre tâcheron. Il ouvrit sa porte, et fit signe à Baudoin de s’asseoir sur son lit, puis il leva la tabatière, qui éclairait sa mansarde, et regarda sur le toit pour s’assurer que personne n’y était en observation. Il laissa retomber le châssis de fer, puis à voix basse :
— Parlez-moi dans le tuyau de l’oreille. De chaque côté de ce logement il y a des chambres. Les cloisons sont minces, on entend tout ce qui s’y dit. À droite, couche la servante de l’auberge et, tous les soirs, le cocher vient la retrouver… Je les entends qui débinent leurs patrons à qui mieux mieux.
Il rit silencieusement :
— On ne se doute pas de tout ce qu’on peut apprendre en se donnant la peine d’écouter avec attention.
— Pourquoi m’avez-vous convoqué ? souffla Baudoin.
— Parce qu’il y a du nouveau à la Cavée. La dame n’est plus seule. Il y a un homme dans la maison.
— Quel homme ? Un brun, joli garçon, mince, parlant italien ?
— Non. Un grand, fort, blond, avec toute sa barbe, et qui a un accent étranger, plutôt allemand…
Les yeux de Baudoin brillèrent dans l’ombre. Il serra la main de Laforêt avec force et d’une voix tremblante :
— L’avez-vous bien vu ?
— Comme je vous vois.
— A-t-il ses deux bras ?
— Il a ses deux bras.
Baudoin poussa un soupir de découragement :
— Alors, ce n’est pas lui ! Ah ! J’avais espéré un moment…
— Que c’était l’homme de Vanves ?… Le reconnaîtriez-vous donc si on vous le montrait ?
— Si on me le montrait, non peut-être, car je ne l’ai vu que dans l’obscurité, mais si je l’entendais, oh ! oui, à n’en pas douter, entre mille…
— Eh bien ! je vais pouvoir, je l’espère, vous donner cette satisfaction. L’homme est ici.
— Dans l’auberge ?
— Au premier, dans une chambre, avec trois autres. Des messieurs, des chefs, qu’on a fait sortir de la salle commune, quand il est arrivé. Car il n’a eu aucun rapport avec la masse des ouvriers. Il ne communique qu’avec l’état-major. Je l’ai filé depuis la villa, jusqu’ici. Ah ! c’est un madré compère. Il m’a fait faire du chemin. Il a changé trois fois de direction, et essayé deux fois de me donner le change. On eût dit qu’il me sentait sur ses talons. Et cependant je le suivais avec une précaution extrême. Il est allé au Café de la Gare, où il a bu un bock, puis il est sorti par la porte de service, après être entré par la porte de la place. Je me méfiais, j’avais fait le tour. De là il est allé à la gare même, a traversé la salle d’attente, et a gagné le quai. Le long du quai il s’est promené, dans la nuit, jusqu’au hangar du magasinage. Là il a trouvé une barrière ouverte ; il est rentré dans la ville et est venu, tout droit, au Soleil d’Or. En ce moment, il est au-dessous de nous, en conférence avec ses camarades…
— Et comment vous y prendrez-vous, pour me mettre à même de l’entendre ? souffla Baudoin.
— Vous allez voir. Mais d’abord qu’est-ce que ce gaillard-là peut venir faire à la villa de la Cavée ?
— Oh ! c’est pour M. Marcel, voyez-vous, j’en suis sûr. Je sens des menaces partout autour de nous. Pourquoi l’usine est-elle troublée, quand jamais il n’y a eu l’ombre d’une difficulté entre des patrons excellents et des ouvriers bien traités ? Tout çà a pour cause la même affaire. Quand je vous ai appelé, j’ai su ce que je faisais. L’Italienne est ici pour M. Marcel, l’homme nouvellement arrivé aussi, et tout, tout est mis en œuvre par les brigands qui ont déjà tué mon général !
— Eh bien ! Nous allons tirer ça au clair. C’est mon état. Et je ferai joliment plaisir au ministre, si je réussis à pincer ces gens-là… Car voyez-vous, Baudoin, si vous ne vous trompez pas, les affaires d’ici sont la suite des tentatives de Vanves, nous avons affaire à une bande, qui n’en est pas à son coup d’essai, et qui a eu déjà maille à partir avec nous… Mais allons au plus pressé… Connaissez-vous la gymnastique ?
— Ancien moniteur à l’école de la Faisanderie…
— Excusez du peu ! Alors on n’a rien à vous apprendre, si c’est vous qui démontrez aux autres… Emboîtez-moi le pas…
Il souleva le châssis à tabatière, posa le pied sur une chaise et monta sur le toit. Baudoin l’imita. Un large chéneau contournait le bâtiment. Ils le suivirent. La nuit était sans lune. Ils gagnèrent la face donnant sur la cour, et, au-dessous d’eux, à six mètres, Laforêt fit remarquer à son compagnon un petit toit de zinc en contre-bas du premier étage. C’était la couverture d’un appentis servant de sellerie.
— Voici la chose. Nos gens sont dans la chambre dont la fenêtre éclairée est située au-dessus de ce toit. Il s’agit de descendre là, sans être aperçu, sans faire de bruit. Du toit on doit voir dans l’intérieur, et pour sûr on entend.
Baudoin se pencha sur la cour obscure, cherchant un moyen de descendre.
— Comment y aller ? Six mètres, et pas d’échelle…
Laforêt lui montra dans un angle du mur un renflement :
— Il y a le tuyau de fonte qui sert à l’écoulement des eaux…
— C’est, ma foi, vrai… Et bien ! Allons-y…
— Mettez vos souliers dans votre poche…
Ils se déchaussèrent, puis l’agent enjamba le cheneau, se suspendit par les mains, saisit le tuyau et, écartant les genoux dans l’angle de la muraille pour se soutenir par le frottement, il commença à glisser silencieusement. Baudoin penché sur le toit surveillait l’opération avec une anxieuse curiosité. Il ne craignait pas que Laforêt manquât de vigueur ou d’adresse. Il se demandait si le tuyau ne manquerait pas de solidité. Les crampons de scellement détachés, tuyau et homme tombaient à grand bruit. L’alarme était donnée dans l’auberge pleine de monde. Les conséquences d’un tel accident pouvaient être désastreuses. Mais il n’eut pas une longue inquiétude. Au bout de quelques secondes d’exercice, Laforêt avait pris pied sur le toit et s’était couché à plat ventre.
Baudoin alors imitant sa manœuvre, souple et vigoureux, était arrivé sans encombre. Étendu sur le toit, à côté de Laforêt, il avait repris haleine, puis voyant son compagnon ramper sur le zinc, il l’avait suivi. Parvenu au bas de la fenêtre du logement, où se tenait le conciliabule, il s’était mis à genoux, et sa tête dépassant à peine le rebord de pierre, il avait regardé. À travers la mousseline du rideau les formes apparaissaient confuses, comme des silhouettes de lanterne magique mal mise au point. Suivant la place qu’il occupait, plus ou moins éloignée de la lumière, chacun des trois hommes réunis dans la chambre se montrait gigantesque ou rapetissé. L’un d’eux s’était levé et marchait de long en large, et selon qu’il se rapprochait ou s’éloignait de la fenêtre, une voix parvenait distincte ou inintelligible aux oreilles de Laforêt. Celui-ci, sans se retourner, attira Baudoin à lui, puis la bouche contre sa joue :
— On voit mal, mais on entend. Avancez-vous et écoutez.
Baudoin se glissa près de lui, et le menton au ras de la pierre il tendit toutes ses facultés pour découvrir ce qu’il cherchait avec une si âpre curiosité. Ce n’était pas l’homme qui marchait, dont la voix se faisait entendre. Celui qui parlait était assis près d’une table et paraissait feuilleter des papiers. Il était difficile de distinguer le sens de ce qu’il disait. Cependant des mots parvenaient plus nets au dehors : « Pas d’intérêt à la violence… sans résultat… Effaroucher les ouvriers… Éveiller l’attention du pouvoir… » Il était cependant aisé de comprendre qu’il était en désaccord avec celui qui marchait, comme pour apaiser son agitation, sans gestes, la tête baissée, subissant impatiemment la controverse. Tout à coup le marcheur s’arrêta et d’une voix sourde il dit :
— Je le veux !
L’autre répliqua, et, toujours à cause de l’éloignement, ses paroles n’arrivaient que hachées jusqu’aux écouteurs :
— Intérêt général… mauvaise conception…
Le marcheur avait repris sa promenade de fauve, à travers la chambre, et il écoutait son contradicteur qui parlait.
Une fois encore il s’arrêta et dit :
— Je le veux !
Laforêt souffla :
— Est-ce lui ? Reconnaissez-vous sa voix ?
— Non ! dit Baudoin avec anxiété, je ne la reconnais pas.
L’homme assis replia ses papiers, les mit dans sa poche et déclara :
— Alors il n’y a qu’à obéir !
Le marcheur alla à la table, frappa sur l’épaule de l’opposant qui capitulait et, avec un accent jovial :
— À la bonne heure ! Il a fallu bien des efforts ! Agissons donc ! Personne ne s’en repentira !
Et il éclata de rire.
Laforêt sentit la main de son compagnon qui se crispait sur son bras, et en même temps Baudoin murmura avec un accent d’affreuse angoisse :
— C’est lui ! Oh ! C’est lui ! Voilà son rire !
Il fit un mouvement pour se redresser. Laforêt le contraignit à rester courbé près de lui.
— Écoutez encore ! Assurez-vous que vous ne vous trompez pas.
— C’est lui ! Je ne peux pas me tromper ! Son rire ! Ah ! Son rire, tel que je l’ai entendu, le soir du crime, quand il est descendu de voiture…
— Alors, c’est fini. Ne restons pas là, où tout est danger inutile à présent pour nous.
Il se laissa glisser jusqu’au bord du toit de zinc. Au bas du mur, haut à peine de trois mètres, s’étendait un tas de fumier. Les deux hommes se rechaussèrent, et silencieusement sautèrent dans la cour. Là ils s’arrêtèrent. La porte de l’auberge était fermée, mais Laforêt savait comment on parle aux serrures et, une seconde plus tard, lui et son camarade étaient dans la rue.
— Qu’est-ce que vous allez faire, maintenant, dit Baudoin. Les gendarmes sont à deux pas. Hésiterez-vous à coffrer ce brigand-là ?
— Bon ! dit Laforêt, c’est une solution. Et puis ?
— Comment et puis ?
— Oui. Nous le tenons. Rien n’est plus facile que de le prendre. On attend qu’il sorte, on le mène chez le commissaire de police. Et alors ?
— Alors on l’accuse du crime commis à Vanves, on le livre à l’instruction, on le convainc et il est condamné.
— Vraiment ! On le convainc ? Vous croyez ça, vous ? Un homme tel que celui à qui nous avons affaire ? On le prendra au dépourvu ? Il n’aura pas un bon alibi pour prouver qu’il était à deux cents lieues de Vanves le soir du crime ? Et quels témoins aurez-vous pour le convaincre ? Vous, tout seul, et il n’y a pas cinq minutes, vous hésitiez encore à le reconnaître. Et pendant que nous aurons cet oiseau-là sous les verrous, pour arriver à être obligés, peut-être, de le relâcher, tous les autres prendront leur vol. Ce sera bien travaillé !
— On ne peut cependant pas se croiser les bras et laisser cette canaille-là s’en aller librement.
— Cette canaille-là est en train de manigancer ici quelque tour de sa façon, et ce n’est pas au moment où il va entrer en scène qu’il faut interrompre la pièce… Et la belle dame de la Cavée, et le prétendu frère ? Et tous ces gredins, qui travaillent en ce moment à ruiner l’établissement Baradier et Graff ? Vous ne vous y intéressez donc pas ? Ils sont pourtant bons à observer. Et, d’un seul coup, nous irions leur apprendre que le pot aux roses est découvert ? Vous ne le voudriez pas !
— Rester spectateur inactif de toutes ces machinations ?
— Spectateur, oui, pour le moment. Inactif, jamais ! Je ne suis pas venu de Paris à Ars exclusivement pour casser des pierres sur la route. Je fais mon métier. Et je veux le faire bien.
— Mais ne puis-je au moins prévenir M. Marcel ?
— Sous aucun prétexte ! Son premier mouvement serait de faire une scène épouvantable à sa belle, et tout serait perdu. Au nom de Dieu, ne mettons pas dans nos confidences les gens passionnés ! Il n’y a rien à attendre d’eux que des bêtises !
— Mais si M. Marcel donne dans quelque piège ?
— Eh ! ne craignez donc pas tant pour lui ! Voilà un homme bien malheureux d’avoir à coqueter avec une jolie femme, qui lui accordera tout ce qu’il voudra, et même un peu plus, s’il sait s’y prendre…
— Ah ! ce n’est pas là ce qui le gêne. Et c’est un coureur fini !
— Eh bien ! laissez-le courir. S’il a de bonnes jambes il arrivera toujours quelque part. On ne l’avalera pas tout cru ! Pendant ce temps-là, moi je file le grand brigand qui est là-haut, et je ne le lâche plus, jusqu’au moment où j’ai tout ce qu’il me faut pour le mettre dans les pattes de votre juge qui se morfond à Paris… Est-ce convenu ?
— Il le faut bien !
— Alors allez à vos affaires, et laissez-moi aux miennes.
Ils se serrèrent la main, et dans l’obscurité se séparèrent. L’auberge close et éclairée retentissait de chants et de cris, alternant avec la cadence des chopes frappant le bois des tables. L’usine, au loin, dressait sa masse sombre, sous le ciel parsemé d’étoiles. Au moment où Baudoin passait devant la loge du concierge, celui-ci l’arrêta et avec un accent de joie il lui dit :
— M. Graff vient d’arriver !
L’oncle Graff, inquiet de ce que Cardez avait téléphoné, n’avait fait ni une ni deux, il avait laissé Baradier continuer une très importante opération engagée à la Bourse, sur les actions de la Société des explosifs, et, prenant le train, il avait débarqué à l’usine. Marcel qui se promenait au bord de la rivière, en fumant, avait vu l’excellent homme s’avancer le long des parterres, et s’était jeté joyeusement à son cou.
— Comment, oncle Graff, c’est vous ?
— Oui, mon petit, j’ai voulu me rendre compte un peu ce qui se passe ici. Je viens de causer avec Cardez. Maintenant je sais à quoi m’en tenir… Parlons de toi… Comment vas-tu ? Qu’est-ce que tu fais ? Sans reproches, tu n’envoies pas souvent de tes nouvelles. Ta mère n’est pas contente. Elle me disait encore hier soir : « il ne s’occupe pas de nous. Il ne pense pas à nous ! Il ne nous aime pas ! »
— Moi ! s’écria Marcel. Par exemple !
— Dame, mon petit, comment veux-tu que cette pauvre femme ait des illusions ? Tu ne la gâtes pas ! Ah ! les enfants, je sais bien que ce n’est pas pour leurs parents qu’ils vivent, c’est pour eux-mêmes. Mais enfin, ils pourraient tout de même faire un peu, de temps en temps, pour ceux qui les ont élevés, soignés, chéris…
— Mon oncle, vous me faites beaucoup de chagrin, s’écria Marcel avec émotion. Quoi ! C’est ainsi que mon silence a pu être interprété ? Pour obéir à mon père, je viens m’enfermer à Ars, pendant des semaines. Je crois lui donner ainsi des gages de mon bon vouloir, après quelques sottises, un peu chaudes, commises par moi…
— Trois cent mille francs de dettes, mon petit Marcel, sans compter ce que je t’avais donné à l’insu de tes parents, en combien de temps, hein ?
— Ah ! oncle Graff, pourquoi revenir là-dessus ?
— Oui, tu l’as si bien oublié, toi !
Marcel eut un sourire :
— Vous, oncle Graff, vous êtes indulgent, vous comprenez la jeunesse !
— Je n’ai pourtant jamais été jeune ! Ah ! mon petit, j’avais toutes les aspirations en moi. J’aurais adoré le plaisir, le luxe, les femmes, mais j’avais l’air d’un marguiller très triste. On se serait moqué de moi ! Je n’étais pas né pour jouer les jeunes premiers, j’ai refusé l’emploi des comiques…
— Et vous vous êtes consacré avec éclat aux financiers ! Bon oncle Graff, c’est vous qui payez, quand votre serin de neveu fait des frasques ! Ah ! je vous aime bien aussi, oncle Graff !
Il l’avait pris par les épaules, et le serrait contre lui. Le vieil homme, les yeux mouillés, regardait avec tendresse ce beau garçon qui lui souriait. Il agita la tête, toussa pour dissiper son émotion, puis il dit :
— Oui, oui, tu as de l’affection pour moi, je le sais… Et bien ! Veux-tu me faire plaisir ? Écris une gentille petite lettre à ta mère…
— Je vous le promets, oncle Graff, demain matin, et, par dessus le marché, une à mon père…
— Allons ! Tu es un brave enfant !… Ah ! ça, dis donc, ça n’a pas l’air d’aller ici ! Est-ce que ces bougres de grévistes vont nous débaucher nos ouvriers ?
— Ça en prend bien la tournure. Mais Cardez n’est pas adroit avec son monde. Il parle raide. Il est bon homme, au fond, et, dans la forme, il ressemble à un tyran…
— Je vais m’occuper des négociations, moi-même. Je verrai demain le syndicat… Et toi, qu’est-ce que tu fais ? As-tu travaillé !
— Beaucoup ! J’ai trouvé le vert pâle et le jaune d’or, que je cherchais… Vous verrez mes échantillons…
— Et l’autre affaire ?
Il baissa la voix comme inquiet.
— Les poudres ?
— Les formules sont éprouvées, et le succès est assuré.
— As-tu fait des expériences ?
— Oui, oncle Graff, et terribles par leur simplicité. Je suis allé porteur d’un mince bourrelet de l’explosif du commerce, sur la côte de Bossicant. J’ai entouré le pied d’un chêne centenaire avec le bourrelet. J’ai provoqué l’inflammation, et, presque sans bruit, sans fumée, l’arbre immense coupé au ras du sol, comme avec une faux formidable, s’est couché dans la bruyère.
— Personne ne t’a vu ?
— Personne. Le lendemain le garde m’a dit : « Ah ! M. Marcel, il est arrivé un grand malheur. Le vieux chêne de la Mare plate a été, cette nuit, brisé par la tempête. C’est curieux, comme ça casse ces vieux arbres ! Le vent est un fameux bûcheron ! » Et il est de fait que rien ne peut donner idée de la puissance destructive de cette poudre. J’ai voulu l’éprouver à nouveau, et, cette fois, pour briser un rocher. Je suis allé dans l’ancienne carrière de pavés de la route de Sainte-Savine. J’ai placé un pétard, pareil à celui qui m’avait servi pour le chêne, dans une excavation. Il y avait bien trois cents mètres de terre et de grès à faire sauter. Je me suis retiré à la nuit, après avoir mis le feu. Il ne devait plus passer personne dans ce quartier-là, jusqu’au matin. Je ne craignais donc pas d’accident. La détonation a été extrêmement faible. J’étais à un kilomètre. Je l’ai à peine entendue. Le lendemain je suis revenu pour me rendre compte de l’effet… Effrayant ! Le cube entier avait été soulevé et, dans le sous-sol, un trou de six mètres en forme d’entonnoir avait été creusé… Je prétends qu’avec une charge convenable, on ferait sauter une montagne… Tenez, oncle Graff, si les Espagnols avaient la fantaisie de détruire Gibraltar, je parie qu’avec cette poudre, ils y réussiraient… Ce serait un beau spectacle, hein ? toute cette masse : rochers, parapets, casemates, canons et le reste, allant se promener dans la mer !
— As-tu rédigé ces formules ?
— Non, pas jusqu’à présent.
— Eh bien ! Rédige-les, et donne-les moi. Je les emporterai à Paris et les déposerai aux Brevets… Le moment est venu de s’en servir.
— Vous aurez cela demain matin, oncle Graff, c’est l’affaire de rien.
— Vois-tu, ton père et moi, depuis quelque temps, nous mettons à exécution un projet qui est gros de conséquences. Baradier, qui a le flair des affaires, s’est rendu compte des manœuvres de Lichtenbach. Ce vieux gredin faisait vendre à découvert des actions des Explosifs, et avait amené à rien cette valeur. Nous nous demandions pourquoi la dépréciation allait sans cesse en augmentant lorsque le hasard nous a donné la preuve que c’était Lichtenbach qui manœuvrait pour ruiner la société, afin de la reconstituer à son profit… Il opérait par les soins de sept ou huit coulissiers. Mais l’un d’eux a commis une indiscrétion qui nous a, en un instant, mis au fait. Alors ton père, qui a de l’estomac, n’a pas hésité, il a fait acheter tout ce que Lichtenbach vendait, et la baisse d’abord enrayée, la hausse est venue. Nous sommes, à l’heure présente, porteurs de deux cent mille actions des Explosifs achetés à bas prix, et qui, demain, si le brevet de la nouvelle poudre est déposé et acquis par la société, vont dépasser le pair. C’est un coup de partie formidable. Si nous réussissons, la fortune de la famille est décuplée. Nous aurons réussi contre Lichtenbach, le coup qu’il voulait faire aux actionnaires des Explosifs. Il perdra ce que nous gagnerons. Et, cette fois, je crois que nous en aurons fini avec lui.
— Eh bien ! oncle Graff, vous aurez demain les formules, et vous pourrez en faire ce que vous voudrez.
— La fortune de Mlle de Trémont, mon petit, tout simplement, et la nôtre par surcroît.
— Ah ! N’êtes-vous pas assez riche ?
— Si. Moi je le suis assez, mais ton père est un ambitieux. Il veut le maximum en tout. Il prétend qu’il n’y a pas de raisons pour que les fortunes françaises ne soient pas aussi considérables que les fortunes américaines.
— Ah ! Les Vanderbilt et les Astor, qui le préoccupent ! Quelle faiblesse !
— Mon ami, tu ne peux pas comprendre cette ivresse de la réussite qui s’empare des cerveaux les plus calmes. Tu sais si ton père est un homme simple. Il dépense moins d’argent que toi… Mais ce n’est plus une affaire de jouissance, c’est une question d’arithmétique…
— Eh ! Je sais bien. Mais c’est cela qui est mauvais. Il vaudrait mieux être moins riche et dépenser plus d’argent. Quel argument vous fournissez à ces socialistes, qui viennent, en ce moment, nous chercher noise ! Comment voulez-vous justifier à leurs yeux un pareil entassement de capitaux, à la disposition d’un seul, tandis que la masse peine, souffre et se prive ? Voyez-vous, oncle Graff, la seule excuse des gens très riches, c’est de dépenser beaucoup, pour faire passer leur trop plein dans la circulation générale… Je voudrais voir mon père jeter l’argent par les fenêtres, puisqu’il en a tant. Ceux qui sont dans la rue le ramasseraient et leur misère serait un instant soulagée. Je voudrais qu’il commandât des statues aux sculpteurs, des tableaux aux peintres, qu’il fît rouler toute cette richesse qui s’entasse dans ses coffres. Mais comment voulez-vous que je m’intéresse à toutes ces actions de telle ou telle société ? Qu’est-ce que représente, pour moi, ce papier si ce n’est le travail de tout un peuple d’ouvriers, qui peine pour produire des dividendes qui enrichiront les actionnaires. Oncle Graff tout ça n’est ni moral, ni équitable, ni humain ! Et je crois qu’un prodigue, comme moi, est la juste rançon, au point de vue social, d’un thésauriseur comme mon père !
— Mais, mon petit Marcel, le travail de ton père enrichit le pays, et son épargne le fortifie. Ce sont les ressources des gens riches qui alimentent la vigueur d’une nation aux heures périlleuses… Ton père est un citoyen utile par son épargne, aussi bien qu’un inventeur par son génie, ou qu’un général par ses talents. C’est ton père qui donnera à l’inventeur des fonds pour réaliser sa trouvaille, et qui paiera les canons, les fusils perfectionnés du soldat… Chacun a sa fonction, dans la vie, comme dans la société. Et je t’assure que celle de ton père n’est pas des plus méprisables…
— Oncle Graff, je vous parle sentiment, vous me répondez économie politique. Il est impossible que nous tombions d’accord. J’ai raison, et vous aussi. Seulement nous ne parlons pas de la même chose.
— Et puis, vois-tu, mon petit, nous ne sommes pas de la même génération. Les idées changent plusieurs fois par siècle, et les pères ne raisonnent pas comme les enfants. Ton père et moi nous avons vu la guerre, l’invasion, la ruine, et nous nous souvenons de ce qu’a coûté la rançon. Cela nous a rendu parcimonieux, pour le restant de nos jours. Toi, tu es venu au monde quand la prospérité avait reparu, tu as été élevé sous l’impulsion des idées républicaines. Tu as un autre fonds de pensées que nous. Tu es égalitaire. Nous, vois-tu, je te le dis, tout bas, nous ne le sommes pas du tout. Mon père m’a inspiré le respect des castes. J’ai moins de considération pour un commerçant que pour un industriel, j’estime plus un avocat, un magistrat, ou un notaire, qu’un peintre ou qu’un homme de lettres. On ne me refera pas, je suis ainsi. Je m’aperçois bien que les idées se modifient autour de moi, mais c’est fini, je mourrai impénitent. Ta génération n’a pas le sens de la vénération, comme la nôtre. Tu te crois sur le même pied qu’un homme âgé, décoré, célèbre, et tu le traites familièrement. C’est une chose qui me serait impossible. De même qu’il ne m’entre pas dans l’esprit que le contre-maître de l’usine puisse me considérer comme son égal et me taper sur le ventre… Il est possible que ce soit toi et tes camarades qui ayez raison. Je ne le crois pas, cependant. En tout cas, nous verrons comment seront vos enfants, si vous en avez, car la famille, c’est encore une institution qui est bien démodée.
— Comme vous m’en dites ! Ah ! Vous en avez une façon de discuter, sans avoir l’air d’y toucher ! Papa, lui, m’aurait déjà appelé trois fois imbécile, et ne m’aurait donné aucun argument. Vous, c’est une autre manière, et, quand je vous écoute, je ne suis plus aussi sûr d’avoir raison. Et puis, vous êtes si bon, oncle Graff, que je ne me sens pas capable de vous tenir tête longtemps !
— Ah ! Petite canaille, tu m’enjôles, tu m’enguirlandes, tu me fais faire tout ce que tu veux et tu le sais bien. Au fond, tu es joliment roublard et je crois que tu nous roules très bien tous !…
— Oh ! oncle Graff !
— Voyons, tu n’es pas si gentil que ça pour rien, dit en riant le vieux célibataire. Est-ce que tu as une carotte à me tirer ?…
— Ma foi, non ! Et tout ce que je vous ai dit là, c’est pour le plaisir !
— Ah ! Tu es vraiment un brave petit homme ! Tu as de fichus moments ! Mais tu as quelques bons quarts d’heure ! Alors tu es sage, pour l’instant ?
Marcel leva les yeux vers le ciel et dit avec tranquillité :
— Et le moyen de faire autrement ici ?
— Avec ça que tu es gêné pour découvrir des occasions ? Je crois, ma parole, que si l’on t’enfermait dans une île déserte, tu trouverais moyen d’y devenir amoureux, et d’y faire des dettes ?
— Oui, mais qui les paierait, si l’oncle Graff n’était pas là ?
— Je crois que tu te moques de moi, polisson !
— Non, je suis très sérieux et très raisonnable, je ne sors pas de mon laboratoire, si ce n’est pour me promener dans les bois, et je n’ai pas dépensé vingt-cinq francs depuis que je suis ici.
— Il faut que les femmes soient vraiment laides !…
— Le fait est qu’elles ne sont pas belles !
Une violente clameur s’élevant du côté de la ville, coupa court à la conversation. Des lueurs passaient dans la nuit. Des chants éclatèrent, en même temps qu’un piétinement sourd de troupeau en marche se faisait entendre sur la route. Et la Marseillaise ouvrière, hurlée par des centaines de voix, insulta de nouveau l’écho de la fabrique. C’étaient, à la sortie du cabaret, les ouvriers accompagnés de leurs femmes, qui à travers la ville endormie jetaient aux bourgeois épouvantés les menaces de la révolte et de la violence. Marcel et l’oncle Graff, arrêtés, dans l’ombre du jardin écoutaient et regardaient le flot vociférant qui s’écoulait, agitant des torches faites de branches de sapins. Et c’était la fumée et la flamme des incendies planant au-dessus de la foule qui vouait les patrons à la mort. L’oncle Graff tendit le bras vers la rue et dit :
— Tu entends ce qu’ils chantent, ces gens là… « Tous les patrons nous les pendons ! » Et il n’y en a pas un qui, s’il était malade ou infirme, n’aurait le droit de compter sur nous pour adoucir sa misère ou sa souffrance… Nous leur avons fondé des cités ouvrières où ils sont logés, des maisons d’école où leurs enfants sont instruits, des infirmeries où ils sont soignés, des sociétés coopératives où ils trouvent tout à bas prix… Il n’y a que le cabaret que nous n’avons pas voulu leur donner et c’est là qu’ils vont puiser leurs inspirations haineuses contre nous ! C’est l’alcool qui est leur maître et celui-là est sans pitié. Il ne leur fera pas grâce !
La queue de la colonne achevait de défiler. Soit qu’à travers la nuit ils eussent aperçu les deux hommes dans le jardin de l’usine, soit qu’ils voulussent seulement leur jeter au hasard leurs cris de rébellion et de rancune, les derniers qui passaient, les plus ivres, les plus misérables, ou les plus infortunés, braillèrent avec un aigre ensemble : À bas les patrons ! À bas les exploiteurs ! Puis le silence se rétablit peu à peu. L’oncle Graff alors secouant tristement la tête, dit :
— Allons, exploiteur, viens nous coucher !
Et ils se dirigèrent vers la maison.
Le lendemain matin, l’oncle Graff fut en mouvement de bonne heure. Il alla retrouver Cardez, pour se concerter avec lui. Marcel se dirigea vers son laboratoire. Il avait promis la formule des poudres, il voulait la rédiger à loisir. En entrant, il trouva Baudoin qui rangeait les ustensiles de chimie. Il admira l’ordre inusité qui régnait dans le capharnaüm.
— C’est parfait, dit-il, voilà une pièce qui, depuis longtemps, n’avait pas été aussi propre. La poussière ne doit pas savoir ce que cela veut dire d’être ainsi dérangée… Mais vous ferez bien, Baudoin, de ne toucher à aucun produit… Il y en a, ici, de fort dangereux…
— Oh ! monsieur, ça me connaît ! J’en ai assez manié du temps de mon pauvre général. J’ai toujours obéi à la consigne qu’il m’avait donnée : « Une fois pour toutes, ne mélange jamais rien ». Et ce n’est pas après ce qui est arrivé à Vanves que je me hasarderais à tripoter les produits…
— Vous avez couché dans le pavillon, Baudoin ?
— Oui, monsieur Marcel. J’ai arrangé un lit dans le grenier ; je suis très bien. Et comme ça, je ne me fais pas de mauvais sang… Tant qu’il y aura dans le pays de mauvaises figures, je dormirai là, d’un seul œil…
— Je crois, Baudoin, que les gens auxquels vous faites allusion en veulent à la fabrique plutôt qu’au laboratoire…
— On ne sait pas, monsieur Marcel. Il y a bien du mélange, allez, dans la société qui nous est arrivée depuis quelques jours…
— On croirait que vous avez découvert des choses extraordinaires…
Baudoin baissa le nez. Il craignit d’en avoir trop dit et se rappela les conseils prudents de Laforêt.
— Oh ! moi, je ne suis pas assez malin pour ça, mais je vous engage à vous méfier, monsieur Marcel… N’ayez confiance en personne… En personne !
Il sortit, laissant Marcel frappé de son insistance. Que signifiait l’avis mystérieux que lui donnait son serviteur ? En savait-il plus long qu’il n’en voulait dire ? À qui faisait-il allusion en disant : à personne. La svelte et charmante silhouette de Mme Vignola s’évoqua devant lui. Était-ce d’elle qu’il devait se méfier ? Il la revit nonchalante et rêveuse, promenant sa tristesse dans les bois de Bossicant. Qu’avait-il à craindre d’elle ? Quel danger pouvait-elle lui faire courir, si ce n’est celui de l’adorer sans obtenir du retour ? Ah ! c’était là, en effet, un bien grave et sérieux péril ! Le plus redoutable qu’il entrevit en ce moment et contre lequel il se sentait sans force. L’aimer, sans parvenir à l’attendrir. Que deviendrait-il, si une telle infortune était la sienne ? Il n’y pensait point sans une sorte d’affolement, tant la jeune femme était déjà maîtresse de son esprit et de son cœur. Il tourna, pendant quelques minutes, dans le laboratoire, soucieux, le front penché, et ne s’arrêta qu’en entendant la porte s’ouvrir. C’était l’oncle Graff.
— Tu sais que nous avons rendez-vous avec le syndicat des ouvriers, ce matin à dix heures ?
— Oui, je ne l’ai pas oublié.
— Qu’est-ce que tu as ? Tu n’es pas dans ton assiette. Est-ce qu’il t’arrive des ennuis ?
— Pas du tout. Je suis préoccupé de la situation, tout simplement. Vous avez causé avec Cardez. Qu’est-ce qu’ils veulent, en somme, les ouvriers ?
— Ah ! bien des choses ! D’abord travailler moins et être payés plus. Ensuite, nommer eux-mêmes les contre-maîtres… Administrer la caisse de retraites et de secours… Ne plus subir de retenue pour l’assurance contre les accidents… Mon Dieu ! Sur tous ces points-là, on peut s’entendre, et je suis disposé à y mettre beaucoup du nôtre… Mais il va se formuler une suprême exigence qui peut rendre toute conciliation impossible.
— Laquelle ?
— On va nous demander le renvoi de Cardez, qui est accusé par les ouvriers de toutes les sévérités de réglementation que la discipline d’un grand établissement comporte…
— Renvoyer le directeur ? Mais, demain, ils demanderont notre renvoi à nous-mêmes !
— Eh ! mon petit, n’est-ce pas la pure et simple doctrine collectiviste ? L’usine aux ouvriers, la terre aux cultivateurs, c’est-à-dire la dépossession du patron et du propriétaire. Nous y marchons.
Marcel dit froidement :
— On ne peut céder sur ces points-là. Abdiquer toute autorité, ne plus être le maître chez soi ? À aucun prix et sous aucun prétexte. Être bon pour les travailleurs, certes ! Mais être leur dupe ? Jamais !
— Allons ! fit en souriant l’oncle Graff, ne te monte pas. Tu vas toujours à l’extrême. Hier, tout feu tout flamme par la révolution, ce matin plein d’énergie réactionnaire. Il faut un juste milieu, et c’est le point exact où je suis. Je ne désespère pas de faire triompher le bon sens et la raison. Mais je voudrais bien obtenir de toi une chose…
— Laquelle ?
— C’est que tu ailles te promener et que tu n’assistes pas à la réunion.
— Par exemple ! se récria Marcel. Voilà une idée qui n’est pas de vous, oncle Graff. C’est Cardez qui vous a soufflé cela !
— Eh bien ! oui, c’est Cardez. Il se méfie de ton impétuosité et il craint que tu ne te contiennes pas assez. Il connaît tes idées…
— L’imbécile ! Qu’il s’occupe donc des siennes ! Comment, après nous avoir aliéné l’esprit de nos ouvriers par des réformes inutiles, il a l’aplomb de demander que le fils de la maison n’assiste pas à un débat où ses intérêts matériels et moraux sont engagés ?… Et il pense que j’accepterai cette éviction ? Il me connaît décidément bien peu !
— Mais si, moi, je tenais à ce que tu ne fusses pas présent.
— Et pourquoi ?
L’oncle Graff se gratta le front. Il hésita un instant, puis enfin se décida à parler.
— Je ne voulais pas te dire toutes mes raisons… Apprends donc que la réunion de ce matin peut entraîner des désordres graves… Nous avons été avertis que les ouvriers, très montés, n’admettraient pas de refus à leurs sommations… Bref, on craint des violences…
— Eh bien ! Raison de plus pour que je sois là !
— Si j’y consens, vois quelle responsabilité j’assume vis-à-vis de ton père !
— Mais qu’est-ce que vous pensiez donc que je ferais ?
— Que tu prendrais sagement le train, pour retourner à Paris…
— Et que je vous laisserais tout seul vous débattre au milieu de ces furieux ? Vous avez une jolie opinion de moi !
— Voyons, mon petit Marcel, ne nous fâchons pas. Moi, je suis un vieil homme, qu’on aime assez. Je me débrouillerai bien. Mais si j’ai à te surveiller, c’est double besogne… Je t’assure que tu me gêneras énormément… Tu n’as aucune fonction ici. Tu n’y es qu’un inventeur, et il y a tout un groupe d’ouvriers qui te voit d’un mauvais œil à cause de tes travaux sur les teintures… Ils prétendent que tu veux leur retirer leur gagne-pain, en fabriquant mécaniquement ce qu’ils font à la main… Je t’assure, Marcel, que j’ai de bonnes raisons de t’éloigner, et que si tu étais raisonnable, tu m’obéirais…
— Eh bien ! Oncle Graff, je ne suis pas raisonnable. Vous le savez depuis longtemps. Je l’ai prouvé en maintes circonstances, je le prouverai encore aujourd’hui. Me critiquera qui voudra. Je m’en moque. Je ne vous quitterai pas d’un pouce. Je me tiendrai à côté de vous, bien tranquille, sans vous donner de distractions. Mais je veux être là, parce que c’est mon droit et mon devoir d’y être. Et puis, si je n’y étais pas, dans quelque temps, vous vous diriez : « Après tout, il m’a obéi bien facilement, Marcel, quand je lui ai intimé d’avoir à s’en aller. Ce jeune garçon-là n’est fou que pour le plaisir. Il ne l’est pas pour le danger ! »
Le vieil homme écoutait son neveu, en le regardant de côté. Sa figure soucieuse peu à peu s’éclairait à la chaleur des paroles de Marcel. Il le blâmait sans doute de ne pas vouloir lui obéir, mais il l’approuvait de se montrer à la fois crâne, dévoué et affectueux. Oh ! surtout affectueux ! Dans le cœur tendre du célibataire, les protestations de Marcel vibraient délicieusement. Il se sentait aimé par cet enfant, qu’il chérissait comme un fils, et tout son mécontentement se fondait dans une exquise sensation de bonheur. Il ne consentit pas à avouer une satisfaction si peu en accord avec les volontés exprimées. Il se refrogna et se fit maussade, mais son œil riait, pendant que sa bouche grondait :
— Très bien ! Je ne peux pas te contraindre. À ton aise ! S’il arrive quelque malheur, à cause de toi, on saura à qui s’en prendre…
— Oncle Graff, nous périrons ensemble ! s’écria gaiement le jeune homme. Quelle plus brillante fin puis-je espérer, et le beau fait-divers !
— Il ne manquerait plus que cela !
— Quelles précautions allez-vous prendre pour que nous ne soyons pas dévorés par le lion populaire ?
— Aucune ! Je suis convaincu qu’avec un déploiement de forces, nous n’arriverions à rien de bien. J’ai fait prier l’autorité de ne pas déranger la troupe… Ne voulait-elle pas nous envoyer des dragons ! Pourquoi pas de l’artillerie ?
— Et qui sont les délégués auxquels nous aurons à répondre ?
— Ils sont huit. Mais c’est le fameux Balestrier qui mène la bande et qui porte la parole.
— C’est un garçon intelligent. Seulement il a lu trop de livres qu’il n’a pas su comprendre. C’est un collectiviste de café.
— Les autres sont de braves gens, montés par leurs camarades de Troyes, et que je crains de trouver d’autant plus violents qu’ils n’y sont pas naturellement disposés. Ils prennent une attitude et jouent un rôle…
— Nous les jugerons à l’œuvre.
Il attira son oncle vers la table du laboratoire, et lui désignant un récipient en verre d’assez médiocre grandeur :
— Tenez, oncle Graff, regardez ce bocal. Eh bien ! En y jetant une allumette enflammée je pourrais, en une seconde, anéantir tous ces manifestants…
— C’est donc la fameuse poudre ?
— C’est elle-même.
— Montre-là moi.
Marcel prit le bocal, le déboucha, et versa dans sa main des petits copeaux bruns. Une odeur de camphre se répandit dans la pièce.
— C’est la poudre de guerre. Elle est en lamelles mais je puis la fabriquer en pastilles. Alors elle ressemble à des boutons de culotte dans lesquels il n’y aurait pas de trous. En lamelles, elle est plus commode pour le chargement des gros projectiles. En pastille elle convient mieux aux douilles de cartouche. Non comprimée, elle brûle comme du papier d’Arménie, sans fumée et avec une odeur de Santal… Voulez-vous voir ?…
— Non ! dit vivement l’oncle Graff. Je n’aime pas beaucoup que tu manies ces substances-là… Est-ce qu’on sait ! Ça peut éclater, sans qu’on s’y attende !
— Pas du tout ! C’est impossible ! Et comme cette poudre sent le camphre on pourrait la mettre dans les habits, l’été, pour empêcher les mites de les abîmer…
Il riait. L’oncle Graff à demi rassuré, le força à reposer son bocal sur la table :
— Et la poudre du commerce ?
— Il n’y en a pas de fabriquée. Mais la formule est dans ce tiroir, toute rédigée…
— Alors, avec cette formule, on peut exploiter la découverte de Trémont ?…
— On le peut. À la condition de savoir comment s’en servir… Mais ça, c’est mon secret, et je ne le révélerai qu’au moment de commencer l’exploitation. Les sortes de produits employées, avec les dosages, sont spécifiées. Il ouvrit le tiroir et prit une feuille de papier sur laquelle étaient, en tête, écrits ces mots : Formule poudre n° 1, puis des lignes de mots en abréviations avec des chiffres. Il la tendit à son oncle, mais celui-ci ne la prit pas.
— Laisse-la dans ce tiroir. Je n’en ai pas besoin, en ce moment. Tu me la donneras ce soir, après notre conférence. J’écrirai alors à ton père et lui enverrai ce papier.
— Comme vous voudrez, dit Marcel.
Il remit la feuille dans le tiroir et le ferma. L’oncle Graff sortait :
— Je vais chez Cardez, si tu as besoin de me voir, c’est là que tu me trouveras.
Marcel, resté seul, marcha dans le laboratoire, s’approcha de la fenêtre ouverte et regarda sur la rivière, qui coulait au pied du mur, un pêcheur installé dans un bateau amarré au milieu du courant, et qui amorçait sa place avec du blé cuit. Un large chapeau de paille couvrait sa tête, une blouse grise ballonnait dans son dos. Il ne parut même pas voir Marcel. Il bourra sa pipe, l’alluma, et commença à tremper sa ligne amorcée d’une pelote de vers. Au bout d’un court instant, il fut touché, ferra vivement et amena un chevesne dont le ventre d’argent brilla dans le bateau. Marcel, amusé, s’assit sur le rebord de la fenêtre. Il y avait un bon quart d’heure qu’il suivait la pêche très heureuse de l’homme à la blouse, lorsque la porte du laboratoire s’ouvrit et Baudoin parut. Il avait l’air contraint. Il vint jusqu’à son maître et, comme à regret, dit :
— M. Marcel, il y a, chez le concierge, quelqu’un qui vous demande.
— Qui ça ?
Baudoin fit la grimace :
— Une espèce de femme de chambre.
Marcel se leva vivement. Il pensa : c’est Milona qui vient de la part de Mme Vignola. S’est-il passé quelque chose ? Déjà il était dehors.
Baudoin le suivit du regard avec mécontentement :
— Comme il y court ! Ah ! Elle le tient bien, la coquine ! Et cette suivante, avec sa mine de bohémienne. Tout ça c’est du vilain monde !
Marcel, arrivant devant la loge du concierge, y avait trouvé Milona, comme il le prévoyait. Il l’attira à l’écart et demanda anxieux :
— Il n’est rien arrivé à Mme Vignola ?
Milo eut un tranquille sourire :
— Non. Puisque me voici. Mais ma maîtresse est inquiète pour vous. Elle a entendu les cris, les menaces, et aperçu les feux, dans la nuit. Elle sait ce que c’est que les coups de folie du peuple. Elle veut vous voir, pour que vous lui expliquiez ce que signifie ce tumulte, et que vous la rassuriez…
— Puis-je y aller en ce moment, Milona ?
— Elle vous attend.
Il eut un mouvement de joie.
— Partez donc. Il ne faut pas qu’on nous voie traverser le pays ensemble. Dans quelques minutes, je vous suis. Annoncez-moi à votre maîtresse.
Milo s’inclina avec une sorte de déférence hautaine. Elle eut un regard presque tendre pour le jeune homme et dit :
— Ne tardez pas. Elle n’est contente que quand vous êtes là !
Marcel étouffa un cri de joie :
— Oh ! Milona. Que vous a-t-elle confié ?
— Rien ! Si elle m’avait fait une confidence, je ne la trahirais pas. Mais je la vois bien, quand elle est seule, puis quand elle est avec vous… Elle n’est plus la même… Venez ! Elle a pleuré ce matin.
Elle fit un signe de la tête, posa son doigt sur ses lèvres, et s’éloigna.
Marcel la regarda partir. Son cœur battait à l’étouffer, des flammes passaient devant ses yeux. Il avait tout oublié, l’usine, la grève, le danger, son oncle Graff, ses belles résolutions. Il ne pensait plus qu’à la radieuse blonde qui l’attendait à la villa solitaire, et il y courait de toutes les forces de sa jeunesse et de son amour.
X
Dans le salon obscur, Marcel et Mme Vignola, assis très près l’un de l’autre, causaient devant la fenêtre. Il était dix heures. Dans le ciel d’un bleu limpide, le soleil déjà haut rayonnait, et ses chaudes clartés, tamisées par les branches, arrivaient caressantes et douces jusqu’aux deux amants. De sa voix grave Mme Vignola parlait.
— Ainsi, même en ce petit pays perdu, au milieu des bois, loin des villes, pas de tranquillité complète.
— Vous jouez de malheur. Jamais les gens d’Ars n’avaient montré pareille turbulence. D’ordinaire ce sont des êtres paisibles et inoffensifs. S’ils ont des réclamations à formuler, ils le font avec modération et politesse, sûrs d’avance d’obtenir ce qu’ils souhaitent. On ne sait quel vent de folie a soufflé sur eux !…
Mme Vignola eut un sourire :
— Ils ont sans doute reçu de mauvais conseils… Mais tout cela importe peu ! L’essentiel c’est que vous ne soyez pas en butte aux violences de ces forcenés. Quand je les ai entendus, hier soir, crier leurs menaces de mort, j’ai tremblé…
— Vous vous intéressez donc un peu à moi ?…
— Pouvez-vous le demander ?
Il prit avec ardeur une belle main qui ne lui fut pas disputée :
— Eh bien, écoutez, Anetta, moi je ne sais pas comment j’ai pu trouver un peu de joie à la vie, alors que je ne vous connaissais pas. Il me semble que je n’existe que depuis un mois…
Elle le menaça de son doigt blanc gracieusement levé :
— Taisez-vous ! Je sais que vous avez eu déjà beaucoup d’aventures. N’essayez pas de me tromper, comme toutes celles à qui vous avez dit que vous les aimiez…
— Oh ! je n’ai pas aimé… Je le comprends bien maintenant !
— Marcel, de grâce, soyez sincère et ne me leurrez pas ! J’ai beaucoup souffert jusqu’à ce jour. Mais c’était parce que j’avais le cœur indifférent et vide… J’ai peur de souffrir, maintenant, parce que j’aimerai…
— Non, ayez confiance en moi… Je vous ferai oublier toutes vos tristesses passées… Vous êtes si jeune et l’avenir peut être si beau… Je vous veux toute à moi… Votre deuil prendra fin. Vous redeviendrez libre de votre destinée, et si vous voulez m’autoriser à parler à votre frère…
La jeune femme eut un geste effrayé :
— À Cesare ? Vous voudriez lui dire ?… Gardez-vous en bien. Vous ne le connaissez pas ! Il deviendrait, en un instant, votre plus mortel ennemi !
— Et pourquoi cela ?
— Ah ! C’est triste à penser et plus triste encore à dire. Cesare est sans fortune, et moi, par M. Vignola, je suis riche… Si je me séparais de mon frère, si je cessais d’être libre, il serait sans ressources… Comment lui faire accepter la médiocrité ? Il est si malheureux de ne pouvoir faire honneur à sa naissance ! Car nous sommes d’une famille princière. Les Briviesca ont régné à Padoue… Et un Agostini fut tyran de Parme… Mais la ruine est venue et le comte Cesare n’a que la solde d’un capitaine de cavalerie… Piètre situation, pour un homme de son caractère !… Aussi, depuis que je suis veuve, a-t-il pris la direction de mes biens… Il y trouve, je crois, des avantages et j’en suis contente… Car il est bon et je l’aime…
— S’il en est ainsi, donnez-lui ce qui vous appartient. Ai-je besoin de votre fortune ? De vous, je ne veux que vous… Laissez au comte Cesare tout votre avoir. Je serai riche, moi aussi, et si je le voulais, demain, je pourrais vous rendre, et au delà, tout ce que vous auriez sacrifié pour être à moi…
Elle parut étonnée, ses beaux yeux s’animèrent riants, ses lèvres s’épanouirent.
— Expliquez-moi comment ?
Lui, charmé, ne conçut aucun soupçon. Il ne vit que la bouche exquise et les doux regards qui l’interrogeaient.
— Je suis en possession d’un secret industriel, qui peut bouleverser les conditions économiques du travail dans les mines… Le bénéfice, assuré, ne m’appartiendra pas en totalité, mais j’en aurai ma part. Et cette seule part sera immense… On ne peut rien sans moi… Je suis seul détenteur des procédés de fabrication. Une société va exploiter les brevets de cette découverte, et c’est la fortune, entendez-vous, Anetta, la fortune énorme, immédiate, foudroyante.
— Oh ! Parlez ! Parlez, ami cher…
— Vous êtes la première personne à qui j’en dis autant… Mais à vous puis-je rien cacher ? Vous me demanderiez mon honneur, je vous le donnerais… D’ailleurs que craindre de vous, bonne, simple et désintéressée ? Oui, je suis détenteur d’un secret de gloire et de puissance… La gloire sera pour l’inventeur et je serais heureux d’avoir contribué à le faire célèbre… À ceux qui auront organisé et rendu pratique son œuvre, une puissance financière incalculable appartiendra…
Mme Vignola interrompit Marcel :
— Mais si vous disparaissiez, ami, si un malheur vous arrivait, si, dans ces tumultueuses bagarres qui sont dirigées contre vous, on vous frappait… Que deviendrait cette œuvre ? Imprudent ! Vous n’avez sans doute pas plus pensé à protéger votre précieux secret que votre chère vie.
Elle se pressait contre lui, en parlant ainsi et son visage exprimait l’angoisse. Elle brûlait Marcel de son souffle, elle le grisait de son regard, elle le caressait de ses mains appuyées à l’épaule.
— Non ! dit-il, détrompez-vous… J’ai pris la précaution de rédiger ce matin la formule de cette merveilleuse invention…
— Vous l’avez sur vous ? demanda-t-elle, comme effrayée.
— Non rassurez-vous, chère, je l’ai laissée dans mon laboratoire… On ne peut la détruire maintenant. Mon oncle Graff saurait la prendre dans le tiroir de mon bureau s’il m’arrivait malheur. Mais il ne peut rien m’arriver, puisque je vous aime. Et je dois réussir, triompher, si vous m’aimez !…
Elle eut un geste d’abandon heureux :
— En doutez-vous, après les paroles prononcées par moi ? Et comment ne vous aimerais-je pas, sincère et fantasque comme vous l’êtes. C’est votre jeune folie qui m’a plu. Vous êtes si différent de ceux auprès desquels j’ai vécu jusqu’ici. Pensez que ma vie s’est écoulée d’abord auprès de mes vieux parents, rigides et sévères, dans une froide et sombre maison de Milan. Puis mon mari, si bon, mais si âgé, n’a pu, malgré son désir de me plaire, mettre à l’unisson de mes vingt ans sa vieillesse raisonneuse et glacée. Je n’ai connu que la tristesse et l’ennui… Et c’est d’aujourd’hui seulement que je m’éveille et m’anime. Il me semble que j’étais jusqu’à cet instant, comme la princesse endormie du conte de fée… Vous êtes venu à moi, et maintenant mes yeux s’ouvrent à la beauté du jour, mes oreilles entendent la douceur des paroles tendres et, avec un inexprimable ravissement, je nais au bonheur.
La meilleure comédienne n’aurait pas nuancé avec plus d’art les captieuses paroles murmurées par la jeune femme dans les bras de Marcel. Elle détournait son visage, comme pour en cacher la rougeur, et son corps souple, semblait frémir d’amoureuse ivresse. Lui, affolé par ces aveux, brûlé par les désirs que la redoutable séductrice savait si bien inspirer, roula sa tête enfiévrée sur l’épaule d’Anetta. Un parfum puissant et voluptueux émanant de ce corps à la fois vigoureux et délicat acheva de troubler sa raison. Il murmura éperdu :
— Je t’adore !
À ce moment, elle tourna la tête pour le regarder, pour lui répondre peut-être. Leurs bouches se rencontrèrent et se nouèrent dans un baiser dévorant. Le silence planait autour d’eux. Le salon était obscur, mystérieux. Les mains tremblantes de Marcel s’enlacèrent autour d’une taille qui pliait. Et dans un grand soupir de volupté triomphante, cœur à cœur, lèvres à lèvres, ils s’abandonnèrent. Le temps avait passé, sans qu’ils eussent d’autre souci que de s’aimer et de s’en être reconnaissants, l’un à l’autre, lorsque par-dessus l’étendue verdoyante des bois, au milieu du calme de la maison discrète, une rumeur s’éleva, grandissante, et des tintements de cloche, sonnant le tocsin, se firent entendre. Du fond de son extase, Marcel perçut ces bruits, mais il ne voulut pas secouer l’engourdissement qui le retenait dans les bras d’Anetta. Ce fut elle qui, la première relevée, s’écria :
— Qu’est cela ?
Il reprit aussitôt possession de lui-même, et tendant l’oreille :
— On dirait des cris, du côté d’Ars, et des appels…
Il se dressa, courut vers la fenêtre et, tremblant déjà d’une angoisse secrète :
— Mais c’est le tocsin ! Y a-t-il donc le feu ?… Mon Dieu ! Que se passe-t-il ? J’ai tout oublié !
Anetta eut un regard de langueur heureuse.
— Le regrettez-vous ?
Il la saisit, la pressa contre lui.
— Une pareille heure, je l’aurais payée de ma vie !… Mais vous savez à quels risques nous étions exposés à Ars, et je tremble qu’en mon absence les événements ne se soient précipités…
Mme Vignola ouvrit la porte et cria :
— Milo…
La servante parut. Elle n’attendit pas qu’on l’interrogeât, elle parla tout de suite :
— Maîtresse, il se passe quelque chose à Ars… On entend des cris, les cloches sonnent et une grande fumée s’élève au-dessus des arbres… Du toit on doit voir…
— J’y monte ! cria Marcel.
— Je vous rejoins… Accompagne-le, dit-elle à Milona.
Mais au lieu de les suivre la jeune femme s’approcha du petit bureau, où elle avait l’habitude d’écrire, prit une feuille de papier et traça quelques lignes rapides. Déjà des pas retentissaient dans l’escalier. Marcel pâle et bouleversé reparut :
— Le feu doit être à l’usine. Oh ! Anetta, j’ai tout oublié près de vous… Adieu, je pars…
— Marcel, souvenez-vous que vous êtes à moi…
Elle l’avait repris dans ses bras et le retenait, avec un air d’épouvante :
— Chère, il le faut… Que penserait-on de moi ? Vous me reverrez ce soir… Laissez-moi m’en aller…
— Soit. Mais Milona va vous suivre, pour me rapporter des nouvelles. Jurez-moi que vous serez prudent…
Un dernier baiser, et déjà il courait dans le jardin. Anetta se tourna vers la servante et lui tendant le billet qu’elle venait d’écrire :
— Cours à Ars… Sur la rivière, dans un bateau, tu verras Hans habillé en paysan… Donne-lui ce papier et reviens aussitôt… Va ! Milo… Cette fois, nous allons réussir !
— Et le jeune homme, maîtresse ?… Qu’en ferez-vous ?
Elle devint soucieuse et pencha son beau visage :
— Je n’en sais rien encore, Milo… Je crois que je l’aime !
La servante eut un pâle sourire et dit :
— Pauvre petit ! Il est bien gentil !
Et silencieusement elle disparut.
Marcel courait sur la route. Au tournant de la Cavée, il découvrit la ville et l’usine. Des magasins d’approvisionnements une haute colonne de noire fumée montait vers le ciel, et des flammes commençaient à jaillir du toit.
— Ah ! Les misérables ! cria le jeune homme. Ils ont mis le feu ! Et l’oncle Graff ? Mon Dieu ! Pourvu qu’il ne lui soit rien arrivé !
Il activa sa course, qui devint extraordinairement rapide. Il était jeune, vigoureux, et éperonné par la crainte et la colère. Une masse de curieux stationnait dans la rue, contenue par les gendarmes. Marcel troua les groupes comme un boulet, bouscula le brigadier et entra, essoufflé et ruisselant, dans la cour. Les ouvriers faisaient la chaîne, pour alimenter la pompe de la ville. La pompe de l’usine recevait l’eau du réservoir de la machine à vapeur. En voyant arriver le fils de leur patron, les ouvriers crièrent empressés :
— Ah ! monsieur Marcel ! Enfin vous voilà !
— Comment le feu a-t-il été mis ? cria le jeune homme haletant.
Il y eut un silence. Il fonça sur eux, terrible. Ils étaient deux cents. Il était seul :
— C’est vous, canailles ! C’est vous, qui avez brûlé l’établissement qui vous fait vivre !
Ils protestèrent tous tumultueusement :
— Non ! monsieur Marcel, ce n’est pas nous ! On ne l’aurait pas voulu ! On réclamait, mais on n’est pas des gueux ! Il y a des étrangers ici !… Ce n’est pas nous !
Il se calma devant leurs excuses :
— Où est mon oncle Graff ?
Un contremaître s’avança consterné.
— Ah ! monsieur Marcel, nous n’avons pas pu l’empêcher d’y aller.
— Où ?
— Dans le bâtiment de l’administration, avec M. Cardez et votre domestique. Ils ont voulu aller chercher les livres et la caisse…
— Mais l’administration est en feu ? hurla le jeune homme avec désespoir. Et si vous ne les avez pas retenus de force, vous ne les avez pas au moins accompagnés ?
Un écroulement qui se fit dans le bâtiment enflammé lui coupa la parole. Des millions d’étincelles jaillirent du brasier, et une poussière noire voila le ciel. C’était le toit du magasin qui tombait.
— Comment aller jusqu’à eux, maintenant ? dit le contremaître navré. Ils sont bloqués entre le tissage et l’approvisionnement. Et tout flambe !
— Par le toit de l’usine…
L’ouvrier hocha la tête avec découragement :
— Qui osera ?
— Moi !
— Mais c’est la mort !
— Eh bien ! Je la risquerai avec eux !
— Nous ne vous laisserons pas aller ! Que dirait votre père ?
— Et que dirait-il, si je n’y allais pas ?
Hors de lui, Marcel s’empara d’une hache et se précipita dans l’usine. Une chaleur âcre et violente le saisit à la gorge. Il ne s’arrêta pas. Il grimpa l’escalier qui conduisait à la porte de la comptabilité. Mais il dut s’arrêter devant un mur de flammes. Il grimpa plus haut, sortit sur le toit, courut le long d’un chéneau, entra dans le grenier plein de fumée, et, respirant à peine, il gagna la partie du bâtiment située au-dessus des bureaux. Le feu ne l’avait pas encore atteinte. Il s’arrêta. Si Cardez et l’oncle Graff étaient dans la comptabilité, ils se trouvaient cernés, à droite et à gauche, par l’incendie. Ils ne pouvaient donc sortir que par dessous ou par dessus. Il n’hésita pas. À grands coups de hache, il commença à trouer le plancher. Il entendit qu’on l’appelait sur le toit. Il cria, sans cesser de travailler :
— Par ici ! Dans le grenier !
C’étaient le contre-maître et trois braves qui venaient le rejoindre avec des pics et des leviers. Ils se mirent à l’ouvrage. Marcel, avec sa hache, semblait avoir la force de dix hommes, coupait les solives comme des roseaux. Le plâtre sautait, les carreaux de brique ricochaient. Un trou s’ouvrit dans le plancher. Marcel, à plat ventre, cria de tous ses poumons :
— Oncle Graff, Cardez, Baudoin… Êtes-vous là ?
Une voix étouffée parvint jusqu’à lui :
— Ah ! c’est toi, mon enfant… Oui, nous sommes là… Dépêche. Nous n’en pouvons plus… La fumée nous asphyxie… Et nous ne pouvons pas ouvrir la fenêtre, à cause des flammes !
— Prenez garde à vous…
Avec le levier, il élargit le trou d’une pesée formidable. Alors il vit la fumée monter comme par une cheminée d’appel. Et les trois hommes, qui n’avaient pas lâché leurs registres et leurs portefeuilles, lui apparurent attendant résignés la délivrance ou la mort. C’était la délivrance qui venait. Une corde descendit par le trou.
— Baudoin, attachez solidement mon oncle sous les bras… Y êtes-vous ?
— Oui.
— Tirez, vous autres.
La corde, hâlée par des bras impatients, remonta, et noir de suie, blanc de plâtre, suffoqué, tremblant, heureux, l’oncle Graff fut happé par Marcel. Ils s’étreignirent, sans parler, mais des larmes coulaient de leurs yeux sur leur visage. Cardez et Baudoin, par le même chemin, remontaient, hissés par les sauveteurs.
— Ah ! ça, dit Marcel, pendant que nous y sommes, vous n’avez rien de plus à prendre, dans les bureaux ? J’y redescends, si vous voulez…
— Non ! cria l’oncle Graff retrouvant la parole. Nous avons la caisse et les livres… Ça suffit ! L’usine est assurée. Et puis, maintenant, je m’en moque !
— Alors, en retraite, cria Marcel, ça s’épaissit dans le grenier.
La fumée roulait plus noire et des flammes crépitaient. Marcel, aidant l’oncle Graff, reprit le chemin du cheneau. De la cour, on les aperçut revenant sains et saufs. Une immense acclamation s’éleva, dominant le ronflement du feu. Mais la place était mauvaise, ils gagnèrent l’usine, où déjà les pompiers s’installaient à leur suite pour préserver les bâtiments encore intacts. Dans la cour, l’oncle Graff se laissa tomber sur un ballot de laine, pâlit et faillit se trouver mal. Il était à bout de forces.
— Un verre d’eau, cria Marcel.
En un instant, il eut une carafe. Il aurait demandé n’importe quoi : on se fut empressé pour lui obéir. Respectueuse du courage et du dévouement, la foule le regardait avec tendresse. Les mêmes gens qui criaient, la veille : « À bas les patrons ! » étaient prêts à crier : « Vive monsieur Marcel ! » C’est qu’il venait de faire ce que nul d’entre eux n’avait osé risquer, et que dans leur conscience, ils le sentaient plus brave, meilleur, et qu’ils l’admiraient.
— Cardez, emportez tous vos registres et votre argent chez vous, dit Marcel. Et nous, oncle Graff, allons chez moi. Vous devez avoir besoin de vous remettre.
— Non ! Je suis mieux… Je commence à retrouver ma respiration… Ah ! mon petit Marcel, tu es arrivé à temps… Un quart d’heure de plus, tu nous trouvais morts tous les trois !
— J’étais assez malheureux de n’avoir pas été là, pour vous accompagner !
— Mais si tu avais été avec nous, tout était perdu ! Nous périssions ! Ton absence a été providentielle ! C’est grâce à ton intervention que nous avons été sauvés… Sans toi, c’était fini !
— Mais qu’est-il donc arrivé ?
— Nous n’y comprenons rien encore ! Nous étions chez Cardez, enfermés avec les délégués, depuis une heure. Nous discutions leurs propositions, et je dois dire que la conclusion d’un accord paraissait fort douteuse, lorsque tout d’un coup nous avons été interrompus par les cris de : « Au feu ! » C’étaient les ouvriers réunis dans la cour, en attendant leurs délégués, qui venaient de voir une fumée épaisse sortir de l’approvisionnement. Certes, ils étaient mal disposés. Quand nous avions traversé la cour, devant eux, pour aller à la direction, ils nous avaient accueilli par un silence hostile. Pas une tête découverte. Chez nous, sur notre propre terrain, de véritables ennemis. En un instant, l’incendie les a retournés. Ils sont devenus comme fous, en voyant brûler la fabrique… En somme, ces gens-là ne sont pas foncièrement mauvais… Ils s’élançaient de tous les côtés, en criant : « Les pompes ! » Ils ont pris des tuyaux, ils ont fait la chaîne avec ardeur. Et quand ils m’ont vu paraître avec Cardez, ils criaient : « Monsieur Graff, ce n’est pas nous ! Sur nos femmes et nos enfants, ce n’est pas nous ! » Il y a plus. Un instant après, un des étrangers qui sont ici, depuis huit jours, un Luxembourgeois nommé Verstraet, ayant été surpris à rôder autour des bâtiments, ils l’ont à moitié assommé, l’accusant d’avoir mis le feu. Il a fallu le leur arracher des mains.
Marcel écoutait, sombre, le récit de l’oncle Graff. Il rapprochait cet incendie des singulières craintes manifestées, à différentes reprises, par Baudoin sur la sécurité du laboratoire. Il entendait le serviteur dire : Il y a ici des gens qui ont de mauvaises figures, en ce moment. Les ouvriers disaient aussi : « Il y a des étrangers ! » Un mystère planait sur toutes ces choses. Instinctivement Marcel se sentait enveloppé par un réseau de menaces et de haines. Était-ce donc toujours ce secret du général de Trémont qui attirait le désastre sur tous ceux qui en étaient détenteurs ? Il chercha des yeux Baudoin. Il avait disparu. Le feu diminuait d’intensité. Les pompes versant des torrents d’eau sur l’approvisionnement avaient éteint les balles de laine. Les bâtiments de l’usine ne paraissaient pas gravement atteints. La perte se localisait. Le capitaine de pompiers d’Ars, plombier de son état, s’écarta pour un instant de la mêlée et vint, rouge et tenant son casque à la main, parler à l’oncle Graff et à Cardez :
— Eh bien, messieurs, nous nous en tirerons à meilleur compte qu’on ne l’aurait cru… Plus des deux tiers de l’usine sont à l’abri, maintenant… Je crois qu’on peut souffler… Ah ! pendant une heure, ça a été chaud !
— Oui, sans M. Marcel, dit Cardez, nous ne causerions pas avec vous, monsieur Prévost.
— Il a été admirable, ce jeune homme ! fit le capitaine. Ah ! Ni mes hommes, ni moi, nous n’avons eu l’idée de faire ce qu’il a fait… Pour le courage on l’aurait bien eu… Mais il fallait penser à trouer le plafond… Il n’a pas perdu la tête… Tout est là !
Au même moment, une voix pleine d’angoisse se fit entendre et du laboratoire, Marcel pâle, bouleversé, accourut criant :
— Oncle Graff… Venez vite !
— Qu’y a-t-il donc ? dit Cardez.
— Restez ! Restez ! Mon oncle seul ! répliqua le jeune homme.
L’oncle allongea les jambes et le suivit. Sur le seuil, déjà, apparaissait Baudoin, prêt à barrer le chemin aux importuns.
— Entrez… Mon Dieu ! Entrez ! dit Marcel en poussant devant lui le vieillard… Baudoin, fermez la porte et mettez la clef en dedans…
— Mais, tu me fais bouillir, cria l’oncle Graff. Qu’est-il arrivé encore ?
— Voyez !
Arrêtés sur le seuil du capharnaüm, les trois hommes regardaient atterrés. Le désordre d’un combat bouleversait la vaste pièce. Le grand fauteuil de cuir gisait, renversé. Un rideau à demi arraché de la fenêtre encore ouverte sur la rivière pendait à son bâton brisé. Les bocaux, les cornues, les alambics piétinés, écrasés, tordus, jonchaient le plancher. Sur la table une tache de sang s’élargissait humide, comme si quelqu’un fût tombé là pour y mourir. Des gouttes rouges avaient éclaboussé les papiers. Le tiroir de la table était béant.
— Que s’est-il passé ? demanda l’oncle Graff à voix basse, comme avec crainte.
— Fouillez dans le tiroir, oncle Graff, dit Marcel. Cherchez la formule que j’y ai placée devant vous.
— Eh bien ?
— Elle n’y est plus ! On l’a dérobée ! Cherchez le flacon où était enfermée la poudre de guerre et qui était sur la table ? Disparu !…
— Volé ? Mais par qui ?
— Par qui a été mis le feu à l’usine ? Quel est ce sang qui rougit le plancher ? Et par quelle main criminelle a-t-il été versé ? Oncle Graff, nous avons déchaîné contre nous des inimitiés formidables. Voyez ce qui se passe autour des inventions de M. de Trémont… Il y a une bande de scélérats à l’œuvre, depuis des mois, pour dérober ces secrets à tout prix et sans reculer devant rien ! Mon père le devinait, lui qui ne voulait pas me laisser m’occuper de cette découverte, Baudoin le savait qui me demandait à veiller dans le laboratoire. Il a fallu l’incendie pour le contraindre à quitter son poste, et sans doute, s’il était resté ici, ce serait son sang qui aurait coulé… Mais qui est celui qui a versé ici le sien ?
— Voyons, mon enfant, je t’en prie, calme-toi, dit le vieux Graff, effrayé par l’exaltation grandissante de son neveu. Parlez, vous, Baudoin, expliquez ce que vous savez…
— Monsieur Graff, je sais qui a été frappé ici, je sais aussi qui a frappé. La victime est un homme dévoué à notre cause, celui qui, dès la première heure, avait éventé les coupables. Et il n’a pu empêcher le vol d’être commis, s’il n’a pas arrêté le voleur, c’est qu’on l’a tué.
— Et celui qui a frappé ?
— Ah ! Celui-là, dit l’ancien brosseur, il n’en est pas à son coup d’essai. C’est un déterminé bandit. C’est à son instigation que tous les troubles qui ont agité le pays, se sont produits. C’est lui qui a fait allumer l’incendie. C’est lui qui a poignardé le général de Trémont. C’est l’homme de Vanves, enfin, c’est Hans !
— Comment le savez-vous ?
— Parce que je l’ai vu. Laforêt, l’agent du ministère, que j’avais fait venir, pour surveiller les gens que je soupçonnais suspects, et qui a payé sans doute de sa vie son dévouement et son zèle, l’avait suivi, hier soir, et, avec moi, l’a observé une partie de la nuit. Nous avons assisté à ses conciliabules avec les chefs de la grève, à l’auberge du Lion d’or. Nous l’avons entendu faire ses recommandations, donner ses ordres… C’est à lui que les malheureux ouvriers, égarés par les déclamations des meneurs, obéissaient sans le savoir. C’était lui, ce brigand, qui de loin, à l’écart, obscurément, dirigeait l’émeute, ordonnait le pillage et l’incendie !
— Mais comment a-t-il pu savoir que la formule écrite était dans la table du laboratoire ? Comment a-t-il pu entrer ici ?
— Il est entré ici, parce que j’avais couru au feu et abandonné mon poste. Il a eu des indications précises…
Baudoin s’arrêta, il jeta sur son jeune maître un regard d’angoisse :
— Ah ! Monsieur Marcel, dois-je vous le dire ? Et allez-vous me le pardonner ?…
Marcel blêmit. Cependant il dit d’une voix forte :
— Parlez, je le veux.
— Eh bien ! cet homme, depuis huit jours, logeait dans la villa de la Cavée…
— Impossible ! cria Marcel. Hans ? Ce bandit ?
— Monsieur Marcel, reprit Baudoin courageusement, mais avec une infinie tristesse, je l’y ai vu. Laforêt l’y a surveillé, pendant une semaine. Il habitait dans les combles et ne sortait que la nuit.
— Et je ne m’en suis pas douté. Je n’ai rien soupçonné ! s’écria le jeune homme avec une stupeur douloureuse. Mais qu’est-ce donc que cette femme qui était là depuis six semaines ? Et quelle comédie atroce jouait-elle vis-à-vis de moi ?
— Ah ! murmura l’oncle Graff. Une femme ! Encore une femme ! Incorrigible enfant !
Marcel, assis près de la table, sur un escabeau, le front dans ses mains, cherchait à rassembler ses idées. Frappé en plein rêve, il tombait du ciel pur, où il planait, dans la boue et le sang.
— Mais, voyons, c’est impossible, reprit-il la voix tremblante. Comment, pourquoi, m’aurait-elle si atrocement dupé ? Avait-elle besoin de me rendre fou d’elle ? Non, je ne puis la croire coupable. Pas une de ses paroles n’a menti. Ses regards étaient francs ! Non ! non ! Vous vous trompez, vous la calomniez ! Et si même l’homme est un misérable, elle, du moins, n’est pas complice ! Elle est une victime, comme nous. Si on a essayé de me faire du mal, c’est qu’elle n’a pas eu l’autorité ou la force de s’y opposer. Et si elle le sait, elle pleure comme moi, en ce moment !
Des sanglots étouffèrent ses protestations désespérées et, la tête abattue sur la table ensanglantée, il pleura amèrement. L’oncle Graff respecta sa douleur. Il emmena Baudoin près de la fenêtre, et lui dit à voix basse :
— Que croyez-vous qui se soit passé dans le laboratoire après votre départ ?
— Laforêt, qui surveillait notre homme, a dû le suivre jusqu’ici. À la faveur du tumulte, Hans est entré dans la cour de l’usine. Il a gagné le pavillon et y a pénétré. Laforêt l’aura surpris, pendant qu’il fouillait le tiroir. Une lutte terrible alors s’est engagée entre Hans, qui est un colosse, et Laforêt qui est très vigoureux. Hans s’est sans doute servi d’une arme pour se débarrasser de son adversaire. Laforêt, assommé ou étourdi, est tombé sur la table. Hans l’a saisi alors et l’a traîné vers la fenêtre… Il s’est accroché au rideau, qui a été arraché. Le poids devait être lourd, car le bâton est brisé…
— Et alors ? demanda anxieusement l’oncle Graff.
— Alors Hans a précipité le malheureux Laforêt par la fenêtre… Voyez la rivière est haute. Le courant l’aura emporté… On le retrouvera, peut-être, dans la vanne du moulin de Sainte-Savine…
— Et la femme, Baudoin ? souffla le vieillard avec circonspection.
— Oh ! La femme, monsieur Graff… Est-ce celle de Vanves ? Je n’en sais rien. Elle n’a ni sa voix, ni son parfum… Mais une voix se modifie, un parfum se change… Ce qui ne varie pas c’est la rouerie, l’adresse, la séduction. Et celle-là a tout ce qu’il faut pour affoler un homme : la beauté, la distinction, la grâce… Regardez M. Marcel qui pleure. Ce n’est pas le crime, ce n’est pas le vol, qui le mettent dans cet état-là. C’est la douleur de soupçonner celle qu’il adore, et la crainte d’être obligé de la haïr !
— Pauvre petit ! Il n’a pas mérité de souffrir… Il a été bien courageux ! Sans lui, Baudoin, nous ne serions pas sur nos pieds !
— Mais, sans la coquine, tout cela ne serait pas arrivé. Elle sait bien ce qu’elle fait et à qui elle s’adresse. Ce n’est pas vous qu’elle aurait entrepris de séduire ou de corrompre… Elle aurait vu d’avance que votre tranquille raison vous mettrait à l’abri de ses entreprises… Mais le général, mais M. Marcel… Des hommes à femmes, monsieur Graff… Oh ! Elle ne s’y est pas trompée… Si elle avait eu le temps, ou si elle avait voulu… Le vieillard et le jeune homme lui auraient d’eux-mêmes livré leur secret…
L’oncle Graff étonné d’une si complète perspicacité chez ce brave garçon, le regarda avec intérêt.
— Ah ! monsieur, vous êtes étonné de m’entendre parler comme çà… Je n’ai pas inventé ce que je vous dis. C’est mon général, dans ses jours de raison, qui me faisait ces raisonnements-là… Il s’accusait, il se blâmait… Il savait bien qu’un cotillon l’aurait mené au bout du monde… « Ah ! Baudoin, rageait-il… Je n’ai jamais suivi aveuglément que le jupon et le drapeau ! »
— Et ça l’a mené à la mort ! Estimons-nous encore heureux que notre Marcel n’ait pas été aussi durement traité ! Il souffre, il est malheureux… Mais il a vingt-cinq ans et, à cet âge-là, on se console de tout… Tandis que si ces brigands nous l’avaient tué… Ah ! Son père semblait deviner le danger que courait notre pauvre petit… Il le croyait plus en sûreté à Ars, au milieu des ouvriers. Et vous voyez comme il s’est trompé…
— Ah ! La bonne chienne de chasse a su le dépister. Et, dans ce désert, elle n’en a été que plus forte…
— Que va-t-elle faire, maintenant ?
— Disparaître avec ses acolytes…
— Sont-ils donc plusieurs ?
— Il y a un frère, soi-disant… Un joli garçon brun… La servante, qui est venue, ce matin, chercher M. Marcel… Et puis le Hans… Sans compter ceux que nous ne connaissons pas… Une bande, monsieur, vous pouvez en être sûr ! Et il ne se commet pas une canaillerie, une trahison, dans ce pays-ci, sans que ces gredins-là y mettent la main ! Laforêt me le disait : « La France est exploitée par l’étranger… Pour des inconnus, on fait, dans les bureaux du Gouvernement, ce qu’on ne ferait pas pour des français. Et il suffit qu’un individu se présente, avec de l’accent et une décoration multicolore, pour qu’on lui ouvre tous les tiroirs et tous les cartons !… » Peuple de jobards ! Monsieur Graff, et qui se croit pourtant bien malin !
Marcel revenait vers eux. En quelques minutes, son visage s’était creusé, des rougeurs marbraient ses joues, et ses yeux avaient une expression douloureuse :
— Oncle Graff, dit-il, le moment n’est pas bien choisi pour se désoler… Il faut agir. Peut-être pouvons-nous encore rejoindre l’audacieux scélérat qui est venu tuer et voler ici… Donnez son signalement au parquet, mettez la gendarmerie en mouvement… Quant à moi, je vais à la villa, pour apprendre la vérité…
L’oncle Graff secoua anxieusement la tête :
— Mon enfant, c’est mal connaître les gens auxquels nous avons affaire, que d’espérer qu’ils auront perdu une seconde pour se mettre à l’abri…
— Comment pourraient-ils se croire soupçonnés ?
— Eh ! Le coup est fait ! Ils n’ont plus qu’à filer !
Marcel eut un geste de protestation.
— Oui, reprit le vieillard avec douceur, tu te dis : mais pourquoi, elle, serait-elle partie ? Va-t-elle me quitter sans me revoir ? Pauvre petit, tu as encore des illusions ! Tu ne comprends pas que toutes les tendresses qu’on t’a faites étaient calculées, intéressées, que tu n’étais qu’une proie… Et tu espères encore que la belle t’attend… Eh bien ! nous allons y aller, mon enfant, tous les trois… Et nous verrons bien ce que valaient les protestations auxquelles tu t’es laissé prendre… En attendant, prévenons les autorités… Mais, crois-moi, ne parlons pas des poudres… Ne visons que le meurtre. On prendra aussi bien l’homme, si on doit le prendre, ce dont je doute… Et nous réserverons notre secret… Ah ! nous avons affaire à plus forts que nous ! Ne te fais pas de reproches… Tout était trop bien combiné… D’une façon ou d’une autre tu devais succomber… Heureusement la vie est sauve.
— Merci, oncle Graff, vous essayez de me consoler… Mais je m’en voudrai mortellement, si vous avez raison… Venez…
Ils sortirent dans la cour. L’incendie était vaincu, les ouvriers avaient cessé d’alimenter la pompe de la ville. La chaîne était rompue. La pompe à vapeur de l’usine, seule, arrosait encore les décombres. En voyant approcher les trois hommes la foule fit silence. Les fronts se découvrirent. Le malheur avait ranimé la sympathie. Le dévouement imposait le respect. Cardez vint au devant de ses patrons :
— Monsieur Graff, les ouvriers demandent que vous leur parliez. Ils ne veulent pas rester sous le coup d’un soupçon…
Graff s’avança simple et grave :
— Mes amis, dit-il, je vous connais trop pour vous accuser du crime qui a été commis ici. Je sais que vous avez la tête vive, mais que vous êtes d’honnêtes gens… D’ailleurs, à quoi aurait servi cette destruction stupide, sinon à vous mettre sur le pavé et à vous faire mourir de faim ?… Au moment où le feu a pris dans l’usine, nous étions, vos délégués et nous, sur le point de nous entendre. Après le bon vouloir que vous venez de montrer, en concourant à sauver l’établissement, je ne peux plus admettre qu’une seule solution à notre débat. C’est celle qui vous est la plus favorable. Je vous accorde donc ce que vous me demandiez…
Une clameur immense, de joie et de reconnaissance, jaillit de cinq cents poitrines. Les casquettes voltigèrent au bout des bras. Graff leva la main. Instantanément le silence se rétablit :
— Je vous prie de vous souvenir que c’est à votre directeur, autant qu’à moi, que vous devez le résultat obtenu… S’il est sévère pour la discipline, c’est qu’il en sent la nécessité dans l’intérêt du travail… Mais personne ne défend mieux votre bien-être que cet homme excellent…
— Vive M. Cardez !
L’oncle Graff sourit :
— Allons ! Vous êtes de grands enfants ! Hier, vous vouliez le pendre… Avec moi, du reste ! Aujourd’hui vous l’acclamez… Vous êtes plus justes, en ce moment. Souvenez-vous de ce qui vient de se passer… Et quand vous aurez quelque chose à nous demander, ne commencez pas par nous menacer de mort. Maintenant, rentrez chez vous, et, demain matin, à l’heure habituelle, au travail !
La foule s’écoula dans un respectueux silence. Avec son habituelle mobilité, elle bénissait ceux qu’elle avait maudits. À la merci de ses instincts, toujours généreux et toujours bons, quand on les laissait se développer librement, elle se félicitait de l’issue heureuse de cette journée qui aurait pu être si tragique, et se retirait joyeuse de reprendre le labeur qu’elle avait honni comme un esclavage.
XI
Pendant que Milona courait dans la direction d’Ars, sa maîtresse rentrait paisiblement dans le salon où, si délicieusement, elle s’était donnée à Marcel. Elle s’assit sur le canapé, posa sa tête sur les coussins, et, indifférente à ce qui se passait autour d’elle, revécut en pensée les heures qui venaient de s’écouler. Bien douces, et telles qu’elle en avait peu connu dans sa vie d’aventures, ces heures passionnées et brûlantes, où l’amour à la fois naïf et hardi du jeune homme l’avait rafraîchie et comme purifiée. Quelle différence avec le laisser aller cynique et cauteleux d’un Cesare Agostini ! Une nausée lui montait aux lèvres en les comparant l’un à l’autre. L’amant complaisant et besogneux, sachant fermer les yeux à propos, quand il s’agissait des intérêts mystérieux qu’il poursuivait, ou de son avantage personnel, et ce tendre, simple et sincère amoureux, qui ne voyait qu’elle, ne désirait qu’elle et se livrait à plein cœur.
Elle se rappela les railleuses recommandations de Hans : « Craignez de vous prendre à votre propre piège et d’aimer ce jeune homme ». Avait-il donc lu dans sa pensée, le redoutable compagnon qui foulait l’humanité aux pieds, et qui se souciait de respecter la joie et le bonheur, comme la grêle de respecter la moisson ? Et quand cela serait ? N’avait-elle pas le droit de céder à un caprice ? Était-elle une esclave attachée à la fortune des obscurs et menaçants aventuriers qui poursuivaient à travers le monde une besogne formidable ? Ou bien y avait-il égalité entre elle et eux, pour le danger, pour le succès et pour le plaisir ? Qui pourrait la contraindre à faire ce qui lui déplairait, et qui donc surtout oserait l’essayer ? Elle se savait aussi dangereuse qu’aucun d’eux. Ils n’ignoraient pas non plus sa force et son audace. S’il fallait mesurer ses griffes aux leurs, on verrait qui l’emporterait.
Elle sourit et son visage s’éclaira d’une grâce délicieuse. Qui aurait, dans cette jeune femme, aux traits délicats et purs, coiffée de ses simples cheveux blonds en virginal bandeau, retrouvé la hautaine, hardie et railleuse Sophia Grodsko ? Qu’aurait dit Lichtenbach en la voyant, et qu’auraient pensé tous ceux qui l’avaient connue, inconstante, vicieuse, fatale à tous ceux qui l’avaient aimée, et qu’elle avait conduits à la ruine, au déshonneur, ou à la mort. Un jeune homme, le moins remarquable de tous ceux qu’elle avait rencontrés peut-être, avait obtenu ce triomphe de la rendre inquiète et songeuse, à l’idée de ce qui pouvait advenir de lui. Et le suivant, dans son esprit, sur la route de la ville, elle se demandait si elle n’aurait pas mieux fait de le garder auprès d’elle, que de le laisser courir vers son usine menacée, et surtout du côté où se tenait aux aguets Hans, plus redoutable que tous les fléaux réunis.
Elle se leva et, déjà repentante d’avoir eu si peu de décision, elle délibérait si elle n’allait pas, elle aussi, se diriger vers Ars, pour se rendre compte de ce qui s’y passait. La prudence l’arrêta. Elle voulut voir, cependant, et monta au second étage de la villa, sur un balcon d’où la vue s’étendait, par dessus les arbres, vers la vallée. Là elle jugea promptement que le danger, s’il avait jamais existé, n’avait fait que décroître. La fumée diminuait, de flammes plus aucune, le brouhaha qui montait de la ville s’apaisait, les cloches de l’église cessaient de tinter et le clairon lugubre des pompiers s’était tu. Elle allait redescendre lorsqu’elle vit Milona qui ouvrait la porte du jardin. La servante suivit l’allée d’un pas rapide et comme inquiet. Sophia eut le pressentiment d’une fâcheuse nouvelle et vivement elle siffla. Milo gravit les marches, essoufflée, elle arriva jusqu’à sa maîtresse :
— J’ai fait votre commission, dit-elle, j’ai trouvé Hans. Il a lu votre billet et me l’a rendu. Le voici…
— Bien… Mais ce n’est pas tout. Qu’y a-t-il ?
— L’Agostini est derrière moi. Il a débarqué à Ars tout à l’heure…
Sophia fronça le sourcil. Une légère rougeur monta à ses pommettes. Elle prit une allumette dans un étui d’argent, la frotta et alluma le papier que Milona lui rapportait. Pensive, elle en regarda les cendres voler aux vents. Puis elle demanda :
— Comment vient-il ?
— En voiture. Écoutez : les grelots du cheval sonnent dans le chemin creux…
La voiture s’arrêta devant la porte. Cesare sauta à terre. Le voiturier ne s’éloigna pas. Sophia descendait l’escalier lentement. Elle se trouva dans le vestibule, pour recevoir le bel italien. Il s’avançait les yeux brillants, la bouche épanouie. Elle lui tendit la main négligemment et d’un air d’indifférence.
— Eh bien ! Cara, dit-il, voilà comment vous m’accueillez, après quinze jours d’absence ?
— Taisez-vous, dit-elle avec fermeté, il ne s’agit pas de balivernes. L’instant est grave… Hans, sans doute, en ce moment, risque sa vie pour s’emparer des poudres…
— Avez-vous donc réussi auprès du jeune nigaud ?…
— Vous le voyez de reste… Vous le saurez mieux plus tard…
— Diavolo !
Il sortit et cria :
— Milo, dites à ce cocher d’attendre…
Il revint :
— Qui sait si nous n’aurons pas besoin de lui, tout à l’heure… J’ai vu, en passant, la ville à l’envers, et le feu chez nos bons amis de la filature… Est-ce de votre invention, cet accident ?
— Je crois que c’est Hans qui a arrangé la chose…
— Toujours gai ! Il aime la mise en scène… Mais je déjeunerais volontiers : je suis parti de Paris, à la hâte…
— Milona va vous servir.
Ils passèrent dans la salle à manger. La table était encore préparée. Cesare s’assit :
— Mettez-vous près de moi, ma belle Sophia… Le temps m’a semblé long loin de vous… J’ai vainement essayé de me distraire…
— En quoi faisant ?
— Ah ! En essayant de gagner quelque argent au jeu. Mais c’est comme une fatalité. La chance m’est hostile. Je ne puis toucher une carte sans perdre…
— Beaucoup ?
— Eh ! Trop ! Toujours trop ! Je m’emballe facilement, vous le savez… Et rien n’est funeste comme la passion, quand ce n’est pas pour une femme !
— Enfin, combien ? demanda Sophia avec impatience.
Le bel italien répondit en souriant :
— Mais rien, cara. J’avais l’argent !
— Qui donc vous l’avait donné ?
— Lichtenbach. Il fallait bien l’habituer à mes petites fantaisies… Quand il sera mon beau-père, j’aurai souvent recours à lui…
— Prenez garde. Il est homme à se lasser…
— On ne le lui permettra pas.
— Sa caisse n’est pas inépuisable…
— Vous badinez. Il la remplit à mesure. Je sais quelle est la source où il puise.
— Vraiment ! Qui vous a renseigné ?
— Mon parent, le très révérend monsignor Boldi, que j’ai vu à Paris, ces jours-ci. Le Lichtenbach en plus de ses capitaux, est fidéi-commissaire des congrégations… Je ne m’étonne plus qu’il soit si puissant. C’est un personnage qui dispose de sommes immenses et d’une influence presque sans bornes… Seulement, ce n’est pas un homme d’action… Et il tremble toujours. Vous auriez ri, si vous aviez vu sa terreur, quand j’ai fait allusion à sa situation de banquier des Ordres… Ah ! Cara, il avait le front couvert de sueur… Que peut-il donc redouter ?
— De ses commettants, rien. De vous, tout. Il a dû le voir, sans doute ?
— Oh ! mon Dieu, que d’affaires, pour si peu de choses !… Une bagatelle de quarante mille francs… Maudit baccara ! Mais il ne joue pas, lui, Lichtenbach… Si ce n’est à la Bourse… Et là, il gagne toujours !
— Savoir !
— Eh ! Aurait-il aussi la déveine ?
— Nous sommes en train de travailler pour qu’il ne l’ait plus !
— L’affaire des poudres ?
— Oui… Mais écoutez…
Elle tendait l’oreille, anxieuse, à un bruit du dehors. Elle prit dans un bahut un petit revolver qu’elle glissa dans sa poche, et dit :
— Êtes-vous armé ?
— Toujours, mais que craignez-vous ?
— Attendez…
Dans le silence, un léger sifflement retentit singulièrement modulé. Les traits de Sophia se détendirent :
— C’est Hans !
Un pas rapide se fit entendre sur le sable de l’allée. La porte du salon s’ouvrit, puis Milona introduisit le colosse. Il était toujours vêtu de son costume sordide de pêcheur. Il jeta son chapeau par terre, enleva sa blouse, retira son pantalon de toile, ses gros souliers, sans plus se soucier de la présence de Sophia, puis il cria :
— Milo, mes habits…
Il posa sur la table un récipient en verre et une feuille de papier et dit avec un grimaçant sourire :
— Voici la chose.
— Vous avez enfin réussi ?
Sophia et Cesare s’émurent. Ils s’approchèrent, avec une sorte de respect, et regardèrent à travers le bocal les lanières brunâtres de la poudre qui avait déjà coûté tant de sang :
— Oui. La voilà ! Cette petite fiole et ce papier représentent encore la vie d’un homme.
— Vous avez été surpris ?
— Oui. Et j’ai tué.
— Qui cela ? cria Sophia devenue livide.
— Rassurez-vous, chère belle, ce n’est pas votre tourtereau.
Il échangea avec Cesare un coup d’œil qui rendit instantanément l’Italien attentif. Son insouciante légèreté disparut. Son visage devint dur et froid.
— C’est un importun que j’avais à mes trousses, depuis longtemps reprit Hans. Une mouche du ministère… Nous n’en étions pas à notre première rencontre… Il a failli me prendre, il y a trois ans, à Lyon, au moment de l’affaire du sergent-major… Je l’avais marqué à exécuter… C’est fait !
— Mais ne va-t-on pas s’en apercevoir ?
— Et puis ? L’affaire est dans le sac. Nous n’avons plus qu’à prendre le large. On ne réclame jamais un agent, vous le savez bien. Celui-là va mariner, avec sa tempe fêlée, dans la petite rivière, jusqu’à ce qu’on le repêche. Nous, pendant ce temps-là, nous serons de l’autre côté de la frontière…
Milona entra, apportant des vêtements élégants, un feutre gris et des souliers jaunes. Sans cérémonies Hans s’habilla.
— Le voiturier qui est à la porte, vous a-t-il vu entrer ici ? demanda Sophia.
— Pas si sot que de me montrer à lui. J’ai pris par le bout du jardin, le mur est bas. C’est fort commode. Je reprends le même chemin. Vous, mes enfants, je vous engage à vous donner de l’air. Vous savez que nous sommes appelés à Venise. Le premier arrivé attendra les autres… Moi, là-bas, je redeviens le major Fraser…
Il mit dans un sac de cuir son récipient de verre et le papier plié, tendit la main à Agostini, adressa un sourire à Sophia, et disparut comme il était venu. L’Italien donna du pied dans la défroque de Hans et dit :
— Milo, il faut faire disparaître tout cela, mon enfant…
— Dans le fourneau de la cuisine, fit de sa voix grave la Dalmate.
— Et vous, ma Sophia, quelles sont vos intentions ? Vous avez entendu ce qu’a dit notre noble ami. Je crois que le mieux que nous ayons à faire est de partir…
La jeune femme ne répondit pas. Elle passa dans le salon, d’un pas traînant, comme si elle cherchait laborieusement la forme dans laquelle il lui convenait le mieux de s’expliquer. Elle s’assit, prit une cigarette, et enfin regardant le bel italien debout devant elle :
— Je pense que vous ferez très bien de repartir en effet… Vous n’avez aucune raison de rester ici. Quant à moi, disparaître brusquement ce serait exciter les soupçons et commettre la pire des maladresses…
— Mais ne va-t-on pas vous soupçonner, si vous restez ? Et alors ne pourra-t-on pas agir contre vous ?
— Me soupçonner ! Et comment ? Qui le pourrait ? Ai-je fait quoi que ce soit, qui puisse exciter la défiance ? Marcel Baradier, seul, est entré ici, seul il me connaît…
— Mais il vous a sans doute donné, à vous seule, les renseignements à la faveur desquels Hans a pu mener à bien son entreprise…
— Il me les a donnés, il y a deux heures… L’exécution a été pour ainsi dire, concomitante avec la révélation. Par quel miracle pourrais-je, moi, qui n’ai pas bougé d’ici, avoir renseigné celui qui est entré dans le laboratoire, et s’est débarrassé de son surveillant ?… Il ne parlera pas, celui-là, puisqu’il est mort ! On trouvera le laboratoire dévalisé… Eh bien ! n’y a-t-il pas eu aujourd’hui à la fabrique assez de mouvements divers, auxquels de nombreux coquins se sont trouvés mêlés, pour qu’on aille mettre à mon actif un mauvais coup qui peut être si vraisemblablement porté à leur compte ? Que je parte, on me soupçonne. Oui, cette fois-là, on me peut soupçonner. Pourquoi ai-je fui ? Comment n’ai-je pas laissé d’explication de mon départ ? Que suis-je devenue ? Et alors que suis-je et qui suis-je ? Autant de questions qui se posent, et qui sont mauvaises. Tandis que si je reste bien tranquillement avec Milona, le jeune Marcel revient ici, m’y trouve calme et sereine, je lui donne le change et tout est sauf… N’est-ce pas bien combiné.
Cesare sourit, et d’une voix railleuse :
— Très bien combiné, trop bien, même !
Sophia fronça le sourcil :
— Qu’est-ce à dire ?
Il s’approcha d’elle, et, avec des allures souples et légères de chat faisant encore patte de velours :
— N’avez-vous plus confiance en moi, cara ? Pourquoi essayez-vous de m’abuser ?
— En quoi, je vous prie ?
— Vous ne me dites pas la vérité. C’est la première fois, depuis que nous nous aimons, Sophia…
Elle pinça les lèvres et pâlit un peu :
— Mon cher Cesare, n’en demandez pas si long… Faites ce que je vous dis de faire, comme vous l’avez toujours fait, jusqu’à ce jour. Vous ne vous en êtes pas mal trouvé, n’est-il pas vrai ? Eh bien ! poursuivez.
— Non !
Ce refus claqua sec, comme un soufflet.
— Ah ! Et pourrait-on savoir les raisons qui vous déterminent ?
— Les mêmes que celles qui vous décident. Vous ne voulez pas venir avec moi, à cause du jeune Marcel Baradier. Moi c’est à cause de lui que je veux que vous m’accompagniez.
— Seriez-vous jaloux ?
— Je le suis.
— Voilà qui est très nouveau et vous m’en voyez surprise !
— C’est la diversité des sensations qui fait l’agrément de la vie !
— Alors vous croyez ?…
— Que ce jeune blondin a su vous plaire plus qu’il n’était prévu dans notre programme. Or, si j’étais disposé à vous laisser le séduire dans l’intérêt de nos affaires, je ne suis pas enclin à vous permettre de flirter avec lui pour l’amour de l’art. La comédie est finie, baissons le rideau, et ne continuons pas la scène d’amour dans la coulisse.
— Vous êtes un amant fort pratique, Cesare…
— Ne le saviez-vous pas ?
— J’ai été une maîtresse très généreuse…
— Je vous en rends grâces…
— Mais, je prétends n’agir qu’à ma fantaisie, qui aujourd’hui, n’est point de vous obéir !
Ils se toisèrent, ainsi que deux lutteurs qui vont en venir aux prises. Cesare, l’œil étincelant de colère, les lèvres retroussées sur ses dents blanches. Sophia très calme et les paupières baissées, comme si elle se défiait de son regard. L’Italien fit un effort sur lui-même, adoucit l’expression de son visage, et parlant avec une bonhomie affectée :
— Voyons, cara, ne nous fâchons pas. Causons de bonne amitié. Nous avons toutes les raisons du monde d’être indulgents l’un pour l’autre : nous nous connaissons si bien. Dites-moi ce que vous avez résolu. Je n’en suis pas à un effort près pour vous complaire. Est-ce une semaine de liberté que vous voulez ? Après ces huit jours, prenez-vous l’engagement de venir nous retrouver à Venise ? Mon Dieu ! nous pouvons être complaisants les uns pour les autres. Je connais l’humaine faiblesse. Si vous avez un caprice, eh bien ! satisfaites-le. Je me figurerai que je ne suis que le frère de Mme Vignola et, quand je retrouverai Sophia, je ne lui garderai pas rancune de son coup de folie. Est-ce cela qu’il faut pour vous contenter ?
Elle étira ses beaux bras et dit en soupirant :
— Je ne sais.
— Mais il faut que je sache, moi.
— Êtes-vous devenu stupide, Cesare, que vous parlez à la baronne Grodsko, comme à une bourgeoise quelconque ? On dirait que vous avez oublié ce qu’elle est quand sa fantaisie l’entraîne… Vous me faites de la peine, mon ami. La fréquentation de Lichtenbach vous abrutit. Il faudra cesser de le voir. Vous me paraissez bourgeois et popote, et vieux jeu !
— Vous vous moquez de moi !
— Non !
— Vous refusez de me promettre de venir me rejoindre ?
— Quand j’ai quitté Zypiatine pour vous, me suis-je embarrassée de lui ?
— Vous avouez donc que vous voulez me quitter ? grinça l’Italien qui blêmit.
— Mon cher, vous saurez cela plus tard. Pour le moment, j’ai une envie immodérée de ne plus vous voir…
— Ah ! cette fois, vous parlez franc ! Mais oubliez-vous que nous avons bien des secrets terribles en commun ?
— Je ne l’oublie pas plus que je ne vous engage à vous en souvenir.
— Ce qui veut dire ?
Les paupières de Sophia se relevèrent et de ses yeux jaillit un regard dont Agostini fut ébloui :
— Ce qui veut dire que si, pour ma sécurité, il fallait que vous disparaissiez, je ne donnerais pas cher de votre existence…
— Vous me menacez de mort ?
— Imbécile ! Vous savez bien que si vous aviez le malheur de dire un mot qui pût éclairer sur nos entreprises, il y a cinq personnes, au moins, qui vous tueraient à l’instant…
— Mais les affaires de l’association ne sont pas vos affaires à vous, et vous n’ignorez pas que je connais les unes aussi bien que les autres…
— Écoutez, Cesare, des gens comme nous, sous peine de se perdre, doivent marcher d’accord. Toute dissension les met à la merci de leurs adversaires. Il faut que nous nous servions les uns les autres avec une abnégation complète. Toute exigence égoïste détruit le faisceau des forces qui doivent concourir au succès commun.
— Eh ! Avez-vous la prétention d’imposer l’insensibilité à des gens qui vivent avec une intensité cent fois plus grande que les autres humains ? Vous oubliez que je vous aime, moi, et que je vous veux, entendez-vous, Sophia, sans concurrence et sans partage…
— Et comment vous y prendrez-vous pour me contraindre, je vous prie ?
— D’une façon très simple. Je ferai savoir à Marcel Baradier ce que vous avez fait, avant de vous consacrer aux investigations internationales et aux curiosités diplomatiques, et nous verrons si sa tendresse pour vous résistera, par exemple, au récit de l’anecdote de Ségovie…
Sophia devint si pâle que Cesare eut peur, lui-même, de l’impression qu’il avait produite. Elle grinça des dents, piétina comme une bête traquée, saisit le revolver, qu’elle avait pris à l’arrivée de Hans, et le braquant sur l’Italien :
— Ah ! canaille, tu ne trahiras plus personne !
Mais, avec une agilité extraordinaire, Agostini sauta sur elle, lui leva le bras en l’air, pour que le coup ne put pas l’atteindre, et tordant sans pitié ce blanc poignet de femme, il s’empara de l’arme qu’il mit dans sa poche avec tranquillité. Puis regardant Sophia d’un air résolu :
— Passons-nous au poignard, pendant que nous y sommes ?
Elle se laissa tomber sur un siège :
— Chien ! Tu as osé lever la main sur moi ! Tu en seras puni.
— Bon ! C’est entendu. Je me soumets d’avance à la punition, mais ne continuons pas à perdre notre temps à des fadaises. Est-il admissible que l’homme, qui a été choisi par la comtesse Grodsko pour être son compagnon d’existence, se laisse berner comme un petit garçon ? Je suis le mâle, Sophia, ne l’oubliez pas ! Je vous autorise à me haïr, je vous défends de me mépriser ! Voilà la première fois que nous mesurons nos griffes. Vous pouvez constater que les miennes sont plus dures que les vôtres. Ne recommencez pas la lutte, car je vous traiterais sans galanterie !
Elle secoua la tête, regarda sa main meurtrie et dit, déjà plus soumise :
— Vous m’avez fait mal, Cesare !
— À qui la faute ? Ma parole, je crois que vous avez eu un moment de folie ! Vous me bravez en face, pour ce godelureau ! Savez-vous que je vais le tuer !
— Je vous le défends ! cria-t-elle, avec force.
— Je serai enchanté de vous obéir, dit-il galamment. Je ne demande qu’à vous complaire. Entre nous deux, il y a une différence. Moi je suis plein d’égards pour vous, je vous traite comme une souveraine, tandis que tout, dans votre attitude, dans votre langage, dans votre ton, me ravale au rang d’un laquais ! Est-ce convenable ?
Elle ne répondit pas. Il fit quelque pas, puis se rapprochant d’elle :
— Jamais je ne vous ai vue emballée à ce point, dit-il avec une douceur raisonnante et comme compatissante. Que diable ce garçon vous a-t-il donc appris ? Je dois me défier de vous désormais, moi qui avais en vous une foi complète ! Est-il possible de croire que, tout à l’heure, vous avez songé à me casser la tête ? Et après, s’il vous plaît, qu’auriez-vous fait de mon corps ? Votre amoureux serait arrivé. Il aurait trouvé du sang partout et un cadavre au milieu du salon ? Comment lui auriez-vous expliqué la chose ? Vous voyez bien, Sophia, que vous avez eu une crise de démence. Et tout cela, pour qui et pourquoi ? C’est à en rougir ! Mettez en balance, avec les petits plaisirs d’amour que vous rêvez, les immenses intérêts qui vous sollicitent, et, de bonne foi, décidez si les uns peuvent l’emporter sur les autres ? Vraiment, il faut que les femmes soient, par moment, possédées du diable pour qu’une créature d’élite telle que vous ait pu en venir à des extravagances pareilles !
Il la regardait du coin de l’œil, en développant son argumentation, et la physionomie qu’il lui voyait ne le satisfaisait pas encore. Il poursuivit :
— Nous n’avons et ne pouvons avoir de force qu’en nous appuyant les uns sur les autres. Moi, je compte sur votre beauté, et vous, vous devez vous fier à mon adresse et à mon courage. Partout où nous passons, votre rôle est de séduire. Le mien est de vous défendre. Y ai-je jamais manqué ? Lorsque le colonel de Bredmann, l’an dernier, à Vienne, a tenu sur votre compte, par dépit, des propos qui ont paru déplacés, ai-je hésité à le provoquer et à lui mettre le lendemain, au Prater, six pouces de sabre dans la gorge ? Je dois confesser que vous, de votre côté, vous aviez alimenté, avec une générosité charmante, la déveine qui me poursuivait sans relâche au Cercle de la noblesse… Échange de bons procédés. Vous l’argent, moi le respect. Voilà ce que nous nous garantissions l’un à l’autre. Et, pendant ce temps-là, nous faisions nos affaires, hein ? Et avec quel succès ! Vous en souvenez-vous ? N’était-ce pas mieux que de nous disputer ? Allons, Sophia, allons, ne restez pas ainsi à faire des yeux blancs. Je sais que vous avez de la rancune. Mais n’en ayez pas plus que moi, diavolo ! Réveillez-vous. Parlez. Répondez-moi…
Elle parut secouer son engourdissement. Elle regarda encore une fois ses doigts rougis, avec un amer sourire, puis :
— Eh bien ! Ordonnez, puisque c’est vous qui êtes le maître !
Il fit claquer ses lèvres avec un air mécontent :
— Ah ! je n’aime pas cela ! Vous allez jouer les victimes résignées, à présent. Ce n’est pas là ce que je veux. Il faut que vous agissiez de votre plein gré. Je crois vous avoir démontré que vous tourniez le dos à la vraie route et qu’il était temps de faire volte-face. En êtes-vous sûre ? N’ai-je pas raison ?
— On n’a jamais raison quand on est le plus fort !
— Ah ! Que voilà une jolie réponse de femme !… Eh bien ! Sophia, j’en suis fâché, mais je ne vous donnerai pas contre moi l’avantage de vous imposer une résolution. Je vous laisse libre de faire ce que vous voudrez. Restez, partez, cela vous regarde. Vous savez ce que vous risquez d’un côté et de l’autre. Abandonnez un ami éprouvé, pour un galant fort douteux. À votre aise. Moi, je pars. Je n’ai pas envie de me laisser ramasser dans cette maison, comme un renard dans un poulailler… Je vous donne dix minutes, pour vous résoudre et faire vos paquets… Je vais fumer une cigarette dans le jardin. Décidez, vous-même, de votre avenir.
Il sortit. Un éclair de haine brilla dans les yeux de Sophia. Elle se leva, poussa un douloureux soupir, puis murmura :
— Il a raison !
Elle appela Milona. La servante parut.
— La malle, à l’instant. Nous partons, dit-elle d’une voix brève.
— Bien, maîtresse.
Sophia tourna un instant dans le salon, puis elle s’assit devant le petit bureau, prit une feuille de papier bordé de deuil et écrivit :
« Mon Marcel adoré. Quand vous reviendrez ici, vous ne m’y trouverez plus. Mon frère, à qui j’ai été dénoncée – par qui ? je l’ignore – est arrivé furieux et m’emmène loin de vous. Ne cherchez jamais à me revoir. Gardez dans votre cœur le souvenir de mes baisers. Moi, j’emporte le goût délicieux des vôtres sur mes lèvres. Adieu, mon chéri d’un jour, regretté toute la vie. Anetta. »
Elle cacheta l’enveloppe, la plaça bien en vue sur la table du salon et, après avoir jeté un regard autour d’elle, d’un pas ferme elle descendit dans le petit jardin. Cesare se promenait dans l’allée circulaire où elle avait marché lentement, le soir, en causant, aux côtés de Marcel. Un soupir gonfla son cœur. Mais son parti était pris et elle n’était point femme à reculer.
— Eh bien ? demanda l’Italien.
— Eh bien ! Vous m’avez convaincue. Je m’en vais avec vous.
— À la bonne heure. Je vous retrouve. Il y a eu une éclipse momentanée. Mais le soleil lui-même a les siennes !
— J’étais folle, en effet, dit-elle d’une voix railleuse. Comprenez-vous que je m’étais toquée de ce petit Baradier…
— Je le comprends très bien, concéda-t-il avec grâce. Il est fort gentil. Mais chaque chose a son temps. Et puisque vous aviez obtenu, à la faveur de cette intrigue, le résultat si âprement poursuivi par Hans, il n’y avait plus qu’à plier bagage. Et c’est ce que vous faites avec votre raison coutumière… Vous m’avez surpris, tout à l’heure, je l’avoue, par votre résistance… C’était la première fois que je vous voyais sentimentale. Et cette crise de tendresse idyllique me paraissait incompréhensible. Pouvez-vous m’expliquer, maintenant, ce qui s’est passé ?
— Oh ! C’est très simple. J’ai trouvé dans ce garçon une affection franche, naïve et désintéressée, qui m’a rafraîchie. Il m’a semblé qu’après une course dans un désert desséché, je découvrais une source limpide où personne n’avait bu avant moi, et je me suis arrêtée au bord, j’ai regardé ce clair cristal, et l’image qu’il m’a renvoyée était si différente de moi-même que j’en ai été étonnée et ravie. J’ai pensé que, peut-être, j’allais trouver un calme repos et une délicieuse régénération, et cesser, pour un temps, d’être la Sophia qui a tant connu d’hommes et tant couru d’aventures, pour devenir, aux yeux d’un enfant ardemment épris, une simple femme sans calcul et sans détours. Ma bouche allait-elle désapprendre le mensonge, mes yeux la tromperie, mon corps tout entier la perversité ? Quel rêve, et si près de se réaliser ! Quel bonheur inattendu, ruiné en un instant par votre réapparition. Ah ! je vous ai maudit, Cesare, j’avais maudit Hans. Mais que faire et comment m’arracher à ma destinée ? J’ai été insensée de croire que, dans mon cœur, pouvait se développer un amour sincère, comme si une petite fleur des champs pouvait pousser dans un marécage ! Allons ! N’y pensons plus, reprenons notre tâche. Et malheur à la société ! C’est elle qui va payer ma désillusion !
— Voilà qui est parler ! Je vous retrouve ! Mais toutes les rocamboles que vous me racontiez, c’était d’un romanesque déplorable ! « Son amour m’a refait une virginité ! » Voilà où vous en étiez ! Et à vous installer dans un village, comme la dame aux Camélias pour vivre d’œufs frais avec Armand Duval ! Il y aurait de quoi rire ! Tenez ! Voilà Milona qui vous apporte votre chapeau et votre manteau…
— Faites charger les bagages par le cocher.
Sophia, impassible en apparence, regarda passer sa malle, ses sacs, et la paisible maison se vider. Comme Cesare était sur la porte du jardin et l’appelait, elle jeta autour d’elle un dernier coup d’œil, porta sa main à ses lèvres, et à tout ce qui l’avait vu vivre avec Marcel : arbres verdoyants, gazons tendres, murailles discrètes, bancs où ils s’étaient assis, oiseaux qui avaient chanté sur leurs têtes, ciel qui avait resplendi sur leur bonheur, elle adressa un rapide baiser.
— Y sommes-nous ? demanda l’Italien.
— Me voici.
— Nous ne partirons pas par Ars. La ville est trop agitée. Ce brave cocher va nous conduire à Sainte-Savine. Là nous prendrons l’express pour Paris.
— Comme il vous plaira.
— Allons ! Vivement.
Elle monta dans la calèche. Milona s’installa sur la banquette devant sa maîtresse. Un claquement de fouet, un bruit de grelots, et, au tournant de la côte, tout disparut.
Il était quatre heures, lorsque l’oncle Graff, ayant réglé la marche des recherches relatives à Laforêt, donné des ordres pour l’aménagement des ateliers où devait reprendre le travail, enfin pourvu à tout ce qui pressait d’une façon absolue, vint retrouver son neveu pour se rendre avec lui à la villa de la côte.
Baudoin, un bon revolver dans la poche, partit en éclaireur. Marcel et l’oncle, à cent pas, le suivirent. Ils avaient perdu l’excitation de la lutte, du danger, et commençaient à envisager froidement la situation.
Elle n’était pas riante. L’audace et la violence de leurs ennemis s’étaient manifestées avec trop peu de précautions pour que tout ne fût pas à redouter d’eux, si la lutte se poursuivait. Or, en ce moment, ils paraissaient triompher. Ils venaient de s’emparer du trésor scientifique dont l’application industrielle leur vaudrait une incalculable fortune. Ils devaient donc exulter. Mais quelle ne serait pas leur déconvenue, quand ils passeraient aux essais d’utilisation de la formule volée ? Marcel l’avait dit : il y avait, pour obtenir l’explosif dans toute sa puissance, et avec ses qualités spéciales de destruction, un tour de main trouvé par le général de Trémont, et dont il demeurait seul détenteur. On pouvait essayer d’appliquer la formule. Si on ne savait pas comment employer les doses, le succès ne répondrait pas aux espérances conçues. Or le voleur, l’assassin, qui avait pénétré dans le laboratoire, avait bien soustrait le précieux papier, mais comme l’écu d’or de la légende, qui se changeait en feuille sèche, le document n’allait-il pas rester inutile ?
L’oncle Graff ruminait ces choses, tout en allongeant le pas, aux côtés de Marcel. Il ne lui en disait rien. À quoi bon ? Le jeune homme savait tout cela de reste. Mais il n’en demeurait pas moins acquis que les brigands acharnés à la conquête du secret avaient déjà tué deux hommes, mis le feu à la fabrique, pour arriver à leurs fins. Et qu’en constatant, encore une fois, qu’ils avaient échoué, ils allaient recommencer la lutte, et acheter la victoire au prix de quels sacrifices ? Dans ces conditions-là il n’y avait pas à reculer, il fallait risquer beaucoup pour tâcher d’arrêter un retour offensif, ne pas hésiter, si la belle inconnue était complice des crimes commis, à la garder à vue, à l’interroger, à la livrer au besoin à la justice, pour tâcher d’éclaircir cette louche et dangereuse affaire. Ils arrivaient au bois, et la maison n’était plus qu’à cent mètres. Baudoin dit :
— Je vais faire le tour du jardin et me porter du côté du bois, pour que, si quelqu’un cherche à fuir, je puisse lui couper la retraite…
— Non, dit Marcel, restons réunis…
Au même moment, une vieille femme, qui traînait un fagot de bois mort, parut sur le chemin. Elle sourit de sa bouche édentée, et s’arrêtant pour souffler :
— C’est-y à la jeune dame de la villa, que vous avez affaire ? dit-elle à Marcel… Si c’est ça…
— Eh bien ?
— Si c’est ça, vous ne la trouverez point… Elle s’en allait, il y a une heure, en voiture, avec ses paquets, vers Sainte-Savine… C’est Cacheu, du Lion d’or, qui la conduisait…
— Partie ! cria Marcel avec stupeur.
— C’était à présumer, dit l’oncle Graff. Le coup est fait !
— Impossible ! Elle ! Elle !
— Pauvre jeune homme ! La promenade avec la jeune dame lui était plaisante, murmura la vieille.
Elle hocha sa tête coiffée d’une marmotte, accepta quarante sous que l’oncle Graff lui glissait dans la main, et s’éloigna dans la direction du faubourg, traînant son fagot avec un bruit de feuilles froissées. Marcel était déjà entré dans la villa. Dès le seuil, il eut le cœur serré. La porte de la maison demeurait ouverte, comme si, dans la hâte de la fuite, on n’avait pas pris le temps de la clore, et surtout comme si elle n’avait plus rien à garder ou à retenir. Il traversa le jardin, pénétra dans le vestibule, appela :
— Milona !… Anetta !…
Rien ne répondit. Le silence, l’obscurité, le vide. Il passa dans le salon, et là, sur la table, il aperçut une lettre. Il s’en saisit, l’ouvrit, la dévora d’un regard, s’assit pour la relire encore, finit par la comprendre et resta le front bas, les tempes bruissantes, comme en présence d’un désastre. L’oncle Graff le trouva là. Il avait déjà parcouru la maison, et acquis la certitude qu’elle était abandonnée. Baudoin, sous la fenêtre, s’était assis dans le jardin. Devant l’angoisse, la pâleur, le désordre, où il voyait son cher enfant, le vieil homme s’attendrit. Son cœur romanesque s’émut, il posa la main affectueusement sur la tête du jeune homme, lui caressa doucement les cheveux avec un geste tendre, et apercevant la lettre serrée entre ses doigts inertes :
— Elle t’a écrit ?
À ces mots si simples, mais qui réhabilitaient presque la fugitive, en constatant qu’elle n’avait pas oublié son amour, Marcel éclata en sanglots, et le visage caché dans ses mains, tendit silencieux le papier. L’oncle Graff s’approcha de la fenêtre, chaussa son nez d’un lorgnon, et lut, puis il resta songeur. Marcel, reprenant possession de lui-même pour défendre celle qu’il aimait, se leva alors, et avec supplication :
— Oncle Graff, dites, cette lettre est-elle d’une femme qui ment ? Ses protestations ne paraissent-elles pas sincères ? A-t-elle une part de complicité dans les crimes commis ? L’accusez-vous de m’avoir abusé, et de rire de moi ? Ou bien n’est-elle qu’une victime et ne subit-elle pas une rigoureuse tyrannie de la part des monstres qui nous menacent ? Cette lettre, oncle Graff, cette lettre… Oh ! ne crie-t-elle pas le désespoir, et ne confirme-t-elle pas l’amour ?
— Cette lettre paraît sincère, dit le vieil homme posément. Je ne puis pas méconnaître que la douleur y éclate, et que celle qui l’a écrite était visiblement contrainte quand elle a quitté cette maison. C’est une preuve qu’elle t’aime et te regrette… Mais est-ce une preuve qu’elle n’est pas coupable et la complice des autres ?
— Oh ! oncle Graff, le croyez-vous possible ?
— Je le crois possible, je crains que cela ne soit, mon petit Marcel, et ce serait plus grave que tout, car si cette femme t’aime… Et comment ne t’aimerait-elle pas, puisqu’elle te connaît, mon bon et cher enfant ?… Oh ! si cette femme t’aime, je me sens pris d’inquiétudes plus violentes que jamais… Car elle peut essayer de te revoir, et alors…
Le visage de Marcel s’illumina d’espoir :
— Oh ! Si vous disiez vrai !
— Ah ! Mon cher petit, se lamenta l’oncle, tu vois comme j’avais raison de craindre. À la pensée seule que cette femme pourrait vouloir te retrouver, te revoir, voilà que déjà tu rayonnes de joie… Et c’est, à n’en pas douter, une scélérate… Oh ! charmante, je n’en disconviens pas, puisqu’elle t’a séduit, mais bien dangereuse tout de même, car enfin… Marcel, si c’est la femme de Vanves…
— Impossible !
— Ne dis pas : impossible ! Tu n’en sais rien. Ces femmes-là, vois-tu, sont si redoutables ! Dans les affaires comme celle qui nous occupe, ce sont des espèces de Protées femelles, qui prennent toutes les apparences, les plus diverses et les plus déconcertantes, pour tromper les yeux et dérouter les soupçons. Aventurières cosmopolites, vivant de la sottise humaine, espionnes, à la piste des secrets d’État, corruptrices, mettant les consciences en coupes réglées. Tu n’ignores pas que ces femmes sont insinuantes, captieuses, galantes, belles la plupart du temps… Et celle-ci…
— Oh ! non ! non !
L’oncle Graff insista avec autorité.
— Et celle-ci, bien habile, bien dangereuse, plus dangereuse que toutes les autres, a pu jouer son jeu près de toi, en même temps qu’elle satisfaisait un caprice… Voyons, Marcel, sois raisonnable, ne te laisse pas aveugler… Pourquoi, l’homme de Vanves était-il chez elle caché ? Pourquoi les poudres ont-elles été soustraites du laboratoire, pourquoi aussitôt le cambriolage accompli, la maison s’est-elle vidée et les habitants ont-ils fui ? Car ce n’est pas un départ, c’est une fuite. Vois la rapidité, la soudaineté de la résolution prise. Ce matin, pas question, ou bien alors elle t’aurait trompé, puisqu’elle ne t’a rien annoncé, et qu’elle t’attendait ce soir. En tout ceci, se trahit le crime et se montre la duplicité… Tu as été abusé par des paroles tendres, et, pendant ce temps-là, les autres, les complices, tuaient et volaient…
Marcel eut un geste de colère :
— Si j’en avais la preuve !
L’oncle Graff le regarda fixement :
— Eh bien ! Qu’est-ce que tu ferais ?
— Ah ! Je me vengerais, je vous le jure ! Toute ma tendresse se tournerait en haine. Si les paroles qui m’ont pris le cœur étaient mensongères, je me déchirerais le cœur, plutôt que d’y garder cet amour empoisonné ! Si cette femme n’était pas une victime, ce serait un monstre. Et, par ce qu’il y a au monde de plus sacré, je la punirais !
Le vieil homme regarda son neveu avec satisfaction.
— Eh ! mon Dieu ! On ne t’en demande pas tant ! Oublie-la seulement. Et surtout prends la résolution de ne pas retomber dans ses filets, si tu la retrouves jamais.
Au même moment, la porte s’ouvrit et Baudoin parut. Il tenait à la main un livre. Il s’avança d’un air mystérieux et dit :
— Il fait bon chercher à fond. On ne cherche jamais assez…
Il rit, en parlant ainsi, et agita le livre :
— Si je m’étais borné à jeter un coup d’œil sur la chambre de la dame, je n’aurais point trouvé ceci.
— Qu’est-ce donc ? demanda l’oncle Graff.
— Un livre, un simple livre.
Déjà Marcel l’avait pris. Il regarda le titre : l’Enfant de volupté…
— Oui, elle lisait ce volume, ces jours-ci.
— Ah ! Le livre par lui-même ne signifie rien. Un roman, en langue étrangère, cela va de soi, reprit Baudoin… Il était tombé dans la ruelle du lit, du côté du mur. Dans la hâte du départ, elle ne l’a pas vu et il est resté là… Mais il contenait quelque chose.
Le brosseur leva entre ses doigts un papier et le montra curieusement à ses maîtres :
— Cette enveloppe de lettre, déchirée en deux, et pliée, pour servir de signet… À qui appartient-elle, cette enveloppe, sinon à la personne qui la détient et s’en sert ?… Or, sur la partie qui est pliée, il y a une ligne d’écriture, et cette ligne d’écriture est une adresse…
— Une adresse !…
— Voyez.
Il donna le papier à Marcel, et, sur la mince bande, caché par la pliure, le jeune homme lut tout haut ce nom : Madame la baronne Grodsko… Le bas de l’enveloppe, sur lequel était écrit sans doute la rue, le numéro et la ville, avait disparu. Mais sur le haut, un timbre gras, apposé par la poste mentionnait : Wien, avril, 18.
Le reste était effacé.
— La baronne Grodsko, répéta Marcel. Mais elle portait le nom de Anetta Vignola…
— Ah ! dit l’oncle Graff, ces femmes-là changent de nom comme de robe… Par quelle incroyable et imprudente insouciance a-t-elle gardé cette enveloppe. Et comment cette lettre, venue de Vienne il y a quinze jours, était-elle ici ?… Elle lui aura été envoyée sous enveloppe à son nom du moment…
Baudoin prit alors la parole.
— Je me permettrai de faire remarquer que la femme, qui est venue chez mon maître le soir du crime, était appelée par lui : Baronne…
Marcel fut frappé. Il pâlit :
— C’est vrai, murmura-t-il à voix basse, mais quel rapport existe-t-il entre Anetta Vignola et la baronne Grodsko ?
— C’est ce qu’il faudra chercher, car c’est le fil qui peut-être va nous guider dans l’obscurité où nous nous débattons. Du courage, mon enfant. Si la femme que tu regrettes est celle que nous supposons, si elle a commis ou aidé à commettre tant d’infamies…
— Ah ! Oncle Graff, c’est alors la dernière des créatures, et je serai sans pitié pour elle.
— Bien !
L’oncle serra la main du neveu avec une compatissante approbation :
— Maintenant nous n’avons plus rien à faire ici. La maison nous a livré un peu du secret. À nous de découvrir le reste.
Les trois hommes sortirent dans le jardin, après avoir avec soin refermé les portes, et lentement retournèrent à Ars.
TROISIÈME PARTIE
XII
Dans son vaste et sévère cabinet, Lichtenbach assis devant la cheminée écoutait le jeune Vertot, son agent de change, qui parlait avec volubilité :
— Les Baradier et Graff ne pourront pas soutenir leur position sur les Explosifs pendant longtemps encore… À la Bourse on est déjà étonné qu’ils ne se soient pas allégés. La liquidation prochaine sera décisive… Ou ils s’entêteront. Et alors ils peuvent sauter du coup… Ou bien ils lâcheront le paquet… Et quelle dégringolade !
Un mince sourire contracta la bouche du banquier :
— J’attends ça, avec curiosité…
— Mon Dieu, mon cher patron, je ne vous cache pas que, dans le monde des affaires, on dit : c’est un duel entre la maison Baradier et Graff et la maison Lichtenbach… Une des deux y passera…
— Je le sais, mais je ne crains rien…
— Moi qui ai travaillé pour vous dans cette opération-là, je connais votre marche… Jusqu’ici elle est admirable… En somme, vous avez vendu tout ce que les Baradier ont acheté…
— Oui, mon ami, et j’ai leur argent, de même qu’ils ont mes titres… Maintenant Vertot, soyez attentif à ce qui va se passer… Les Explosifs qui sont au plus haut, rapidement tomberont au plus bas…
— En êtes-vous sûr ?
— Sûr et certain.
— Mais pourquoi ?
— Parce qu’une Société rivale est en voie de formation, qui possède les brevets d’un produit destiné à remplacer, dans un très bref délai, toutes les poudres de mine et autres dynamites employées jusqu’ici, et qui coûtera cinquante pour cent de moins, dans le commerce… Qu’en dites-vous ?
— Je dis que c’est foudroyant !
— C’est le mot juste. Lisez, ce soir, mon journal, vous y verrez le premier article d’une série destinée à annoncer la nouvelle découverte. À la suite la presse bien stylée et largement arrosée, emboîtera le pas… Et en avant les cymbales et la grosse caisse ! Ce sera le signal de la baisse pour les Explosifs. Je veux d’ici à deux mois, voir Baradier et Graff à plat !
— Oh ! Ils ont les reins solides !
— Nous verrons.
— Alors vous m’engagez à vendre, pour mon compte, des Explosifs ?
— À partir de demain, vendez à tour de bras. Il y a cinq cents francs à gagner par titre ! Vous allez voir le mouvement commencer… Tous mes ordres, à moi, seront exécutés par les places étrangères… Profitez de l’occasion !
— Je n’aurai garde d’y manquer !
— Sauvez-vous, maintenant, je suis à l’heure. Ma fille m’attend pour sortir…
— Mon cher patron, grand merci et tous mes respects.
L’agent de change partit. Lichtenbach ne se leva même pas pour le reconduire. Il songeait. Une lettre envoyée de Venise lui était parvenue, qui, d’une part, lui causait une grande satisfaction, de l’autre, lui apportait une certaine inquiétude. Sophia Grodsko lui disait : « La poudre de guerre est un triomphant succès. Les expériences faites à la Spezzia et à Trieste ont donné des résultats prodigieux pour les canons de la marine. Des plaques de blindage en acier Siemens, de 0,30, ont été percées, comme du papier. Nous avons touché deux millions. Le reste viendra ensuite. L’affaire est grosse de magnifiques conséquences. Il n’en va pas aussi bien pour la poudre du commerce. Hans a travaillé, depuis quinze jours, à Swalbach, avec Prunier, de Zurich. Il a éprouvé une vive déception. Tous les essais tentés ont été insuffisants. Ils ont manipulé les produits de différentes manières. Rien n’a donné un bon résultat. L’explosif ne vaut pas plus que la dynamite. Il coûte moins cher il est vrai, mais nous sommes bien loin de ce qu’on espérait et de ce qui doit être. Car il faut qu’il y ait un secret de fabrication qui nous est inconnu. Hans le cherche et ne désespère pas de le trouver. Mais, jusqu’à présent, fiasco. Ne vous découragez pas. Et sachez-moi gré de vous dire l’entière vérité. Agostini vous envoie ses meilleurs souvenirs et vous annonce que vous allez recevoir votre brevet de baron… »
Lichtenbach grommela :
— Baron ! Cela me fera une belle jambe, si l’affaire rate !
Il se leva, fit un geste de défi :
— Elle ne ratera pas ! Hans est un chimiste habile. Il trouvera… Et puis, au besoin, je me retournerai. On ne me prendra pas si facilement au dépourvu…
Il sourit. Sa fille entrait. Ce n’était plus la petite pensionnaire vêtue de l’uniforme bleu du couvent, mais une élégante et gracieuse parisienne. Le banquier la regarda avec satisfaction :
— Tu es déjà prête ?
— Mais oui, père. Il était convenu que nous sortirions à quatre heures…
— C’est juste. Et tu me mènes ?
— À la vente des orphelins d’Alsace-Lorraine… Tu ne peux pas y manquer…
— J’aurais pu envoyer mon offrande…
— Mais moi, je dois y paraître… La mère Sainte-Alix tient un comptoir avec d’anciennes camarades à moi… Et je lui ai bien promis de venir…
— Allons-y donc.
Ils partirent. Dans la salle des Agriculteurs de France, la vente avait lieu. Dès l’entrée un murmure de voix, un piétinement de foule. Des faisceaux de drapeaux, dans un massif de verdure un buste de l’Alsace en marbre avec une écharpe de crêpe sur la poitrine. Et, pour faire les honneurs, la femme du président du conseil, député des Vosges, entourée d’un comité de dames appartenant au monde officiel. De jeunes commissaires allaient, venaient, dans la foule des vendeuses, guidant vers les comptoirs les personnages d’importance. Un canapé double occupait le milieu, entre les deux rangées de boutiques, où les noms les plus connus des familles d’Alsace et de Lorraine étaient représentés par des grand’mères en cheveux blancs, irréductibles protestataires chassées par la conquête, et d’élégantes jeunes femmes, rieuses et insouciantes, élevées ou nées dans l’exil et trouvant la France belle, la vie agréable, même loin de la terre natale.
Lichtenbach et Marianne, accueillis à leur arrivée avec empressement, s’arrêtèrent un instant dans le groupe officiel. Là le prestige du financier, l’autorité du directeur de journal s’exerçaient sans contrepoids. Ce n’étaient que sourires et plus les opinions étaient républicaines, plus les grâces se faisaient onctueuses pour le réactionnaire qu’était Lichtenbach. Timide, Marianne avec inquiétude cherchait des yeux le comptoir où la mère Sainte-Alix vendait.
Un jeune commissaire, empressé à guider une si riche héritière, se mit aux ordres de la jeune fille, et parmi les acheteuses qui passaient, les vendeuses qui caquetaient, Marianne parvint à la boutique où ses anciennes camarades, entourant la religieuse, tenaient l’article de vêtement de pauvres, et débitaient des brassières de vingt-neuf sous, à cinq francs, sans la moindre difficulté. Geneviève de Trémont, en deuil, dirigeait le rayon de la bonneterie. Elle embrassa son amie :
— Tu es toute seule ?
— Oh ! non, mon père est resté à causer un instant avec la femme d’un sénateur…
— Il va te laisser ici pendant quelque temps ?
— Je ne sais pas. Il ne lui serait peut-être pas commode de revenir me prendre…
Elle se tourna vers la religieuse qui tenait la caisse :
— Êtes-vous contente de vos affaires, ma mère. La recette est-elle bonne ?
— Nous avons fait trois mille francs depuis midi, mon enfant. Mais il est bientôt cinq heures… Et dans une heure tout sera fini… Il nous reste un tiers de nos marchandises…
— Eh bien ! ma mère, tout ce que vous n’aurez pas vendu, ce soir, vous me l’enverrez, dit simplement la jeune fille.
— Oh ! mon enfant, que de reconnaissance !… Mais que pensera votre père ?
Mlle Lichtenbach eut un paisible sourire :
— Mon père ? Il ne me contrarie jamais. D’ailleurs, je suis riche…
Elle montra une bourse aux mailles gonflées d’or.
— Et si cela ne suffit pas, papa me fera une avance…
— Tiens ! Regarde en face de nous, dit Geneviève de Trémont, de l’autre côté du passage. C’est le comptoir de Mme Baradier. Amélie est là…
Marianne rougit avec embarras. Elle se souvenait des paroles de son père remémorant ses différents avec les Baradier et Graff. Quels rapports pouvaient s’établir entre ces familles ennemies ? Et soudain le visage souriant de Marcel Baradier, blond, fin, élégant, s’évoqua à son souvenir. L’inimitié des parents ne liait donc pas les enfants, puisqu’il avait si gracieusement accueilli la fille de Lichtenbach, quand elle était venue rue de Provence ? Elle dirigea ses yeux du côté que Geneviève lui indiquait et, près du comptoir où Mme Baradier et Amélie vendaient, appuyé contre le montant de bois de la boutique, Marianne reconnut celui à qui elle pensait. Il souriait en causant avec un vieil homme qui achetait un vase en faïence d’une laideur peu ordinaire. Il le lui prit des mains, en fin de compte, le replaça gaîment dans l’étalage, et de sa place Marianne l’entendit qui disait :
— C’est la troisième fois, oncle Graff, que nous le vendons et qu’on nous le laisse !… On veut bien le payer, mais il est si affreux que personne ne se décide à l’emporter.
Le vieil homme remit son porte-monnaie dans sa poche et dit :
— Maintenant, où est le comptoir de Mlle de Trémont ?
— Allons-y ensemble. C’est tout à fait ce qu’il vous faut : trousseaux et layettes, oncle Graff… Indispensable pour les célibataires !
— Garnement !
Ils traversèrent. Là, soudain Marcel devint sérieux. Il avait reconnu Mlle Lichtenbach. Elle aussi l’avait vu venir, et, tremblante, elle n’osait le regarder. L’oncle Graff, avec sa bonhomie ordinaire, s’était approché :
— Eh bien ! mademoiselle Geneviève, qu’est-ce que vous allez me vendre ? Des capuchons et des jupes pour le premier âge ? Combien la douzaine ?
— Soixante francs, parce que c’est vous, monsieur Graff… Et vous nous les laisserez, si vous voulez…
— Je ne demande pas mieux… Car tout ce vestiaire m’embarrasserait fort…
— Nous donnerons ce que vous abandonnerez à l’œuvre de la Sainte-Enfance… Et après vous, s’il nous reste quelque chose dans la boutique, voici une de nos amies qui le prendra.
— Qui est cette jeune demoiselle ? demanda l’oncle.
— Mlle Marianne Lichtenbach…
Graff eut un haut-le-corps. Sa figure changea d’expression. Il murmura :
— La fille de…
Et comme il faisait un pas en arrière, il entendit une voix douce qui disait :
— Sur le terrain de la charité, monsieur, il n’y a plus d’ennemis, mais seulement des concurrents, à qui fera le plus de bien.
— Vous avez parfaitement raison, mademoiselle, répliqua le vieil homme en s’inclinant, et je veux mettre, sans tarder, votre précepte en pratique…
Il se pencha vers la religieuse et demanda froidement :
— Combien tout ce qui figure à l’étalage ?
— Mais, monsieur, balbutia la mère Sainte-Alix interdite.
— Est-ce assez de deux mille francs ?
— Oh ! C’est pour rien ! fit une voix chantante. J’en donne quatre mille !
Et le comte Cesare Agostini, souriant, élégant, l’œil clair et la moustache retroussée, apparut aux côtés de Mlle Lichtenbach.
— Votre père m’a envoyé auprès de vous, mademoiselle, dit-il en s’inclinant. Il nous rejoint à l’instant et vraiment il n’aurait pas toléré qu’on vous enlevât, pour un prix si modique, l’honneur de votre générosité…
Il parcourut du regard le cercle des assistants et, reconnaissant Marcel, il affecta une joyeuse surprise :
— Eh ! monsieur Baradier… Je suis vraiment charmé de la rencontre… Depuis que je n’ai eu le plaisir de vous voir, il vous est arrivé des ennuis… J’ai appris cela, en passant pour venir chercher ma sœur… J’ai beaucoup regretté de ne pouvoir m’arrêter pour vous dire toute la part que nous prenions à vos embarras. Vous avez été si accueillant et si gracieux pour nous dans votre charmant pays…
Il parlait sans la moindre gêne, avec une audace dont Marcel restait stupéfait. Il regardait Agostini et se demandait s’il ne rêvait pas, si ce personnage désinvolte et tranquille, qui s’adressait à lui au milieu de cette assemblée de charité, en plein Paris, sans faire mine de fuir, était bien l’homme qu’il soupçonnait de l’avoir mystifié à Ars, d’être, sans doute, le complice des incendiaires et des meurtriers, et tout au moins le compagnon d’intrigues de cette énigmatique femme dont le souvenir emplissait encore son cœur. Il secoua son étonnement et répliqua :
— Et votre aimable sœur, Mme Vignola…
— Ah ! la pauvre Anetta, interrompit Césare, elle est à Venise pour ses ennuyeuses affaires de famille… Mais elle viendra probablement à Paris, cet été, pour assister à mon mariage…
— Ah ! vous vous mariez, monsieur le comte ?…
— Oui, M. Lichtenbach a bien voulu m’agréer…
Cette nouvelle de l’alliance d’Agostini avec Lichtenbach produisit un effet électrique. Marcel reprit à l’instant même toutes ses facultés.
Il toisa l’Italien, et avec un ironique sourire :
— Ah ! vous allez entrer dans la famille de M. Lichtenbach ? Cela devait être, et il eût été dommage que cela ne fût pas !…
— Je ne comprends pas très bien, répliqua Cesare.
— Si. Vous comprenez très bien. Et si vous aviez besoin d’un supplément d’informations, demandez-le à madame votre sœur.
— Mais, monsieur, dit avec arrogance l’Italien. Voilà d’étranges paroles…
— Chacun fait ce qu’il peut : tout le monde ne peut pas se montrer étrange dans ses actes.
Agostini allait répondre et, menaçants, les deux hommes se dressaient en face l’un de l’autre, quand une main se posa sur le bras de l’Italien en même temps que la voix de Mlle Lichtenbach disait :
— Monsieur le comte, venez donc, je vous prie, par ici… Mon père vous cherche…
Cesare jeta à Marcel un coup d’œil de défi, puis, avec une flatteuse humilité, s’adressant à la jeune fille :
— Vos moindres désirs sont pour moi des ordres, mademoiselle, et c’est ma joie de vous obéir… Mais je retrouverai monsieur…
Le front de Marianne se plissa. Son regard devint d’une fermeté grave et elle déclara :
— Je vous le défends !
— C’est fort bien. Vous avez tout pouvoir.
Lichtenbach les rejoignait. Il passa devant Graff sans paraître le voir.
— Que m’a-t-on dit, comte, fit-il en s’adressant à Agostini. Vous venez de surenchérir pour payer les vêtements de pauvres qui restent dans cet étalage… Et cela jusqu’à quatre mille francs ? Quelle misère ! Vous avez eu affaire, en vérité, à de piètres concurrents !…
Il fit la moue, et coula vers Marcel et l’oncle Graff un regard dédaigneux :
— J’ai connu autrefois des adversaires plus tenaces… La bataille de l’argent les a beaucoup calmés…
Il se tourna vers la religieuse et écrivant quelques mots sur un carnet :
— Tenez, ma sœur, voici un chèque de dix mille francs.
— Eh ! que vous donnerai-je pour cela ? demanda la sœur Sainte-Alix stupéfaite.
— Vos prières, dit humblement Elias.
On s’était groupé autour du comptoir, on écoutait. Un murmure d’approbative admiration partit de la foule et vint caresser les oreilles de Lichtenbach. Agostini s’exclama avec emphase :
— C’est un don magnifique !
— Viens, ma fille, dit Elias.
Marianne embrassa Geneviève de Trémont et, baissant la tête pour ne pas voir Marcel, elle suivit son père avec Agostini. Comme elle passait devant l’oncle Graff, elle l’entendit qui murmurait :
— Dix mille francs de prières ! À vingt sous par gredinerie, il y gagne !
Le vieil homme n’eut pas le loisir d’épancher davantage sa mauvaise humeur. Marcel venait de l’interrompre :
— Pas si haut, oncle Graff, sa fille pourrait vous entendre. Pauvre enfant ! Ce n’est pas sa faute, à elle !
Le cœur de Marianne se serra et plus triste de l’humiliante indulgence du neveu pour elle, que du rude mépris de l’oncle pour son père, elle s’éloigna.
Depuis qu’il était de retour à Paris, Marcel était rentré dans les bonnes grâces de M. Baradier. Le récit entrepris par l’oncle Graff de l’incendie des bâtiments et du sauvetage opéré par son neveu avait été à l’âme du vieux Lorrain. Le danger couru par son beau-frère, Cardez et Baudoin, l’avait fait frémir d’inquiétude, l’intervention de son fils, à la minute décisive, lorsque les plus braves reculaient devant le danger, avait soulevé son enthousiasme. Il avait embrassé Marcel et dit à Mme Baradier et à Amélie qui pleuraient :
— Eh bien ! Vous avez l’air stupéfait. Doutiez-vous donc que cet enfant, parce qu’il a commis quelques sottises, ne fut pas un solide et brave garçon ? Pour moi, j’étais bien sûr qu’à l’occasion, il se comporterait comme il l’a fait ! C’est justement parce que je savais ce dont il était capable, que je le traitais sévèrement quand il s’écartait du droit chemin. Mais, sacrebleu ! C’est un Baradier.
Et de l’embrasser encore. Le soir il répéta à sa femme, quand ils furent seuls :
— Je suis vraiment bien content de Marcel. Graff m’a raconté de lui des choses qui m’ont réellement touché. Je commence à espérer que, sa légèreté et sa fougue une fois passées, il sera un homme remarquable. Il ne lui manque que de l’ordre… Mais cela viendra. Il a de l’intelligence, il a du cœur… Maintenant, il faudrait le marier !
— Il n’a que vingt-cinq ans…
— C’est ce qu’il faut ! Se marier jeune, comme je l’ai fait, avec une bonne femme, voilà qui assure la vie… Quelle attitude a-t-il vis à vis de Geneviève ?
— Il la traite comme sa sœur, ni plus, ni moins.
— Pas un petit brin de flirt ?
— De sa part à elle, je croirais à une arrière-pensée. Mais de son côté à lui, je ne sais rien…
— Interroge donc discrètement Amélie…
— J’y penserai.
Les préoccupations de M. et Mme Baradier échappèrent complètement à Marcel. Il songeait à tout excepté au mariage. Le retour dans sa famille lui avait paru très doux. Il aimait tendrement ses parents. Même au moment de ses écarts de jeunesse les plus vifs, il n’avait jamais cessé d’habiter la maison paternelle, il ne se sentait pas heureux quand il n’était pas chez son père, soit à Ars, soit à Paris. Le fils d’exilé avait peut-être, plus fort que d’autres, le sentiment de la possession. Il avait entendu tant de fois l’oncle Graff et Baradier regretter la maison de Metz, le pays, les amis, les habitudes, que les liens qui l’attachaient au toit paternel s’étaient resserrés et que, loin des siens, il lui manquait quelque chose d’essentiel. Sans doute la gronderie affectueuse de son père et le sourire consolant de sa mère.
Depuis son retour, il passait presque tout son temps hors des bureaux, sortait peu le soir et travaillait à une besogne dont l’oncle Graff était le seul confident. M. Baradier, très préoccupé de la tournure que prenait l’affaire des Explosifs ne confiait ses inquiétudes qu’à son associé. Mais l’oncle Graff, avec une bonhomie tranquille, répliquait :
— Il est utile d’avoir l’œil ouvert, mais ne nous exagérons pas le danger. Tout s’arrangera, j’en ai le ferme espoir…
— Eh ! Attends-tu un miracle ? grommelait Baradier. Voilà les actions Explosifs qui baissent, malgré tous nos efforts pour les soutenir… Le bruit s’est répandu hier, à la Bourse, qu’un brevet venait d’être pris, en Angleterre, en Allemagne et en France, par un nommé Dalgetty, un anglais, pour un procédé dont on dit merveille et qui enfoncerait la dynamite… On va jusqu’à affirmer que cette substance est si maniable, si inoffensive, malgré sa puissance, qu’on songe à s’en servir pour actionner les machines… Ce serait la suppression de la vapeur, du gaz et du pétrole, pour les moteurs… Une révolution ! Si le quart de ceci est vrai, nous sommes perdus ! C’est sans doute une application des formules de Trémont, et le Dalgetty est l’homme de paille des voleurs qui les ont dérobées.
— C’est possible ! murmura l’oncle Graff avec tranquillité.
— Et tu ne trouves rien d’autre à dire ? cria Baradier furieux. On nous vole, on nous égorge, et tu te résignes ?
— Je ne me résigne pas, mais j’attends le procédé Dalgetty à l’usage. Il se peut fort bien que ce soit, en effet, l’explosif Trémont. Mais il se peut aussi que ce ne soit pas cela… Et si ce n’est pas cela, ce n’est rien du tout.
— Mais si nous sommes ruinés, en attendant ?
— Nous remonterons sur notre bête, après.
— Mais c’est ce brigand de Lichtenbach qui mène cette campagne contre nous. On me l’écrit de Bruxelles et de Londres…
— Laisse-le marcher. Plus il s’avancera, plus il sera maltraité pendant la déroute.
— Je voudrais bien savoir ce qui te donne cette confiance ?
— Marcel. Ton fils ! Ce petit homme, qui est plus fort, à lui tout seul, que Trémont, toi, moi et les autres. Tu verras ! Tu verras !
— Enfin ! Ne peux-tu au moins me dire ?…
— Rien ! Laisse manœuvrer Dalgetty, laisse baisser les actions. Ne les vends pas, surtout ; garde imperturbablement le paquet… Rira bien qui rira le dernier.
Le calme et l’assurance de l’oncle Graff impressionnaient Baradier, sur le moment. Mais après, dans son cabinet, en face de son courrier, qui ne lui apportait que de mauvaises nouvelles, il était repris de peur et se ravageait la cervelle. Il savait que Marcel travaillait. Il le voyait aller au laboratoire des Arts-et-Métiers, dont un de ses anciens maîtres était titulaire. Mais qu’y manipulait-il ? Sans doute quelque perfectionnement de la poudre Trémont, peut-être tout simplement le dosage exact des produits. Car qui prouvait, après tout, qu’il le connaissait, ce dosage, qui était l’invention même du général ? Et Baradier, rouge, tourmenté par le sang, prenait son chapeau, sortait à pied et marchait pour éviter la congestion.
Le soir, à l’heure du dîner, il retrouvait Marcel au salon entre sa mère et sa sœur, ou jouant du piano avec Geneviève de Trémont. Car il était excellent musicien, ce fils à qui la nature avait prodigué ses dons. Et l’oncle Graff, mélomane passionné, étendu au fond d’un fauteuil, dodelinait de la tête, d’un air ravi, en écoutant quelque lied de Schubert ou quelque concerto de Schumann. Il montrait à Baradier, entré sur la pointe du pied, le tableau aimable des deux jeunes gens, jouant à quatre mains, actionnés à leur exécution, soignant les rentrées, et murmurait :
— Un couple tout formé. Elle brune, lui blond. Croisement parfait ! Et, pour fortune, les poudres du général.
— Autant dire de la fumée ! grognait Baradier.
— Non ! Puisqu’elle n’en fait pas ! riait l’oncle Graff.
Il y avait dans la sécurité de son associé, si défiant en affaire cependant, une sorte d’inconscience qui étonnait Baradier. Il était évident que Marcel cuisinait quelque chose d’extraordinaire que Graff connaissait et qui promettait des résultats extraordinaires. Mais quoi ? Et puis avec les brigands qui couraient le monde à la recherche de coups à faire, sous le regard indulgent du gouvernement, était-on sûr de rien ? Et il rageait. C’était déjà quelque chose. Cela l’occupait.
Baudoin, lui, n’était pas demeuré inactif. Sa première visite avait été pour le colonel Vallenot. Il l’avait trouvé au ministère de la guerre, très préoccupé d’une interpellation que devait subir le ministre de la part d’un député socialiste, qui se plaignait qu’on ne laissait pas pénétrer dans les casernes les journaux anarchistes. Comment faire l’éducation du peuple, si on refusait au soldat le droit de connaître pourquoi il devait mépriser ses chefs ? Le bon colonel était hérissé comme un sanglier. Depuis la veille, il n’avait pas cessé d’être houspillé par le patron très embêté lui-même, et qui passait sa mauvaise humeur sur son chef de cabinet. Vallenot avait repassé ça à son premier directeur, qui avait arrosé tous les chefs de bureau. Et de grades en grades, hiérarchiquement, l’irritation du ministre était retombée jusqu’au concierge. Celui-ci avait donné une raclée à son chien, qui n’y avait rien compris. C’était la seule différence qu’il y avait eu entre l’animal et les fonctionnaires.
— Qu’est-ce que vous voulez ? grogna le colonel quand Baudoin lui eut, les talons sur la même ligne, fait le salut militaire. Voir le ministre ? Ah ! Bien ! Vous en auriez de la chance ! Si vous entrez, je ne réponds pas que vous sortirez ! Et pour quoi lui dire encore ? Que l’agent qu’il vous avait prêté a disparu ? Car voilà trois semaines qu’on est ici sans nouvelles de lui…
— J’en apporte.
— Ah ! Qu’est-ce qu’il est devenu ?
— Il est mort.
— Fichtre ! Et comment ça ?
— On l’a tué !
— Qui ça : on ?
— Les mêmes gens qui ont tué le général de Trémont.
— Et dans quel but ?
— Toujours le même : s’emparer des secrets de mon maître.
— Et y sont-ils parvenus ?
— Oui.
— Et alors ils ont la formule des poudres ?
— Ils l’ont !
— Eh bien ! Voilà une belle affaire ! Nous nous doutions de quelque chose au service des renseignements. Nous avions reçu avis de l’étranger que des essais avaient été faits avec une poudre sans fumée extraordinaire.
— C’est celle-là.
Le colonel Vallenot ne pensait plus à l’interpellation. Il se tirait la moustache avec fureur. Enfin il demanda :
— Et le pauvre Laforêt, quand a-t-il été frappé ?
— Il y a près de quinze jours. Mais nous n’avons eu la preuve de sa mort que plus tard. Le pauvre garçon avait été précipité dans la rivière. Le courant l’avait entraîné dans le bief d’un moulin. Il est resté accroché sous l’eau, à quelque pilotis, pendant longtemps. Et ce n’est que dernièrement qu’il est remonté à la surface. On l’a sorti, exposé, reconnu et inhumé, comme il convenait à un vieux soldat et à un honnête homme. Il dort, dans le cimetière d’Ars, bien tranquille maintenant, sous l’herbe verte.
— Et ceux qui l’ont tué ?
— Ah ! c’est pour cela que je venais parler au ministre. Je les connais, ces gueux-là !
Vallenot fit un bond.
— Ces espions ? Vous savez qui ils sont ?
— Et vous aussi, sans doute, mon colonel, car ils n’en sont pas à leur coup d’essai. Et le ministère a déjà dû avoir maille à partir avec eux… Ce sont des professionnels de la trahison !
Le colonel se leva et la physionomie changée :
— Ah ! parbleu ! Cette fois, voilà une diversion à laquelle le patron ne résistera pas ! Je me risque à entrer dans son cabinet, sans être appelé… Oui ! Il est capable d’en retrouver sa bonne humeur ! Attendez-moi là.
Il ouvrit une porte et sortit. Baudoin, debout près de la cheminée, resta quelques minutes l’oreille tendue à un bourdonnement de voix qui venait de la pièce voisine, puis brusquement la porte se rouvrit et une voix mâle appela :
— Baudoin !
L’ancien soldat s’avança et, sur le seuil du cabinet, il aperçut le ministre debout, le sourcil froncé, la figure plus rouge encore que d’habitude.
— Avancez ! dit le grand chef.
Baudoin entra. Le général en redingote noire, pantalon gris, fit quelques pas dans le cabinet. Vallenot, dans l’embrasure de la fenêtre, attendait :
— Vous avez appris, m’a dit le colonel, des choses très importantes sur la mort de M. de Trémont et de mon agent ?…
— Oui, mon général.
— Vous croyez connaître les scélérats qui ont fait le coup ?
— Oui, mon général.
— Racontez-moi ça !
— Oui, mon général. Mais je demande la permission de ne parler que devant vous. C’est un secret qui intéresse la vie de personnes qui me sont trop chères pour que je puisse le confier à un autre que vous…
— Même au colonel Vallenot ?
— Mon général, dit froidement Baudoin, un secret qui appartient à plusieurs, n’est plus un secret. Je le confierai au colonel ou à vous.
— Bien, mon ami, vous avez raison. Retirez-vous, colonel Vallenot. Il n’y a dans ceci d’offense pour personne. Et ce brave garçon est aussi un prudent garçon. Je l’approuve.
Vallenot sourit, salua. Il était visible qu’il eût bien voulu rester. Mais son chef ordonnait. Il rentra dans son bureau, détendu, rassuré sur la fin de la journée. Le vent avait tourné : le ministre n’était plus à la tempête. Au bout d’un quart d’heure, un coup de téléphone le fit sursauter. Il ajusta l’auditeur à son oreille. Le ministre disait :
— Apportez-moi le dossier Z n° 3, de l’armoire secrète.
Vallenot ouvrit un grand coffre fort en fer, fouilla un cartonnier et prit une liasse jaune qu’il porta dans le cabinet de son chef. Baudoin était debout devant le bureau, et le général, très attentif, s’accoudait, attendant. Vallenot se retira. Nouveau quart d’heure d’attente. Puis nouveau coup de téléphone :
— Envoyez-moi le capitaine Rimbert, qui s’est occupé de l’affaire de Valence.
Vallenot murmura :
— Fichtre ! Ce n’est pas rien, tout ça !
Il sonna son garçon de bureau et donna des ordres, puis il attendit patiemment. Une demi-heure, cette fois. Puis la porte du cabinet ministériel s’ouvrit. Et Baudoin, conduit par le général lui-même, sortit. Le patron maintenant paraissait satisfait. Il dit :
— Eh bien ! Baudoin, c’est entendu comme ça, n’est-ce pas ?
— Oui, mon général.
— Vous prierez M. Marcel Baradier de venir me parler.
— Oui, mon général.
— Et n’hésitez pas à m’avertir, si vous apprenez la moindre chose.
— Oui, mon général.
— À bientôt. Venez, Vallenot.
Baudoin sortit. Le ministre rentra dans son cabinet où se tenait debout le jeune capitaine Rimbert.
— Colonel, vous allez, je vous prie, me faire vous-même un résumé des affaires Espurzheim et vicomte de Fontenailles… Je crois que nous tenons la coquine qui a si bien roulé tous mes prédécesseurs, et qui m’a mystifié moi-même quand j’étais ministre, il y a deux ans… Ah ! Si je peux avoir ma revanche, je la prendrai bonne !
— Il s’agit alors de la femme qui a porté successivement le nom de Mme Ferranti, avec Espurzheim… dit le colonel.
— Et de comtesse de Vervelde, avec ce pauvre Fontenailles, ajouta le capitaine Rimbert.
— La Ténébreuse, enfin, résuma le ministre.
— Oh ! elle nous a coûté des peines, des démarches et de l’argent, la gueuse, sans pouvoir arriver à la prendre !
— Eh bien ! messieurs, nous allons essayer de la pincer, cette fois-ci. Préparez-moi les notes que je vous ai demandées, colonel. Et vous, capitaine Rimbert, pas un mot !
Le colonel et le capitaine sortirent. Le ministre, rasséréné, se frottait les mains. Quant à Baudoin, il avait enfilé les quais, et, comme quatre heures sonnaient, il arrivait au Palais de Justice. Il traversa la salle des pas perdus, monta au second étage et s’arrêta devant le cabinet de M. Mayeur. Il avait fait, dans le couloir du juge d’instruction, plus d’une station en compagnie du garçon de bureau et du garde municipal. Ils le traitaient tous les deux comme un ancien camarade et l’accueillirent avec joie.
— Tiens ! Vous voilà ? dit le garçon de bureau. Est-ce que vous êtes témoin dans une autre affaire ?
— Ma foi, non, je viens parler tout simplement au juge… Est-ce qu’il est occupé ?
— Toujours ! Il a en ce moment la bande des voleurs de tableaux… Ceux qui ont dévalisé l’hôtel d’un marquis, aux Champs-Élysées… Et puis le reste !
— Est-ce qu’on peut lui parler ?
— Aussitôt qu’il va sonner, je le préviens que vous êtes là… Ah ! Il est de mauvaise humeur ! Je ne sais pas ce qu’il a, avec le procureur… Ils passent leur temps à se dire des choses désagréables !…
Un coup de sonnette vibra. La porte s’ouvrit et, entre les gardes, trois hommes de mine patibulaire, glabres et vertes figures de voyous parisiens dévorés par l’absinthe, sortirent en traînant les pieds, lançant autour d’eux des regards fureteurs. Mais il n’y avait ni portes, ni fenêtres par lesquelles on pût sauter pour gagner le large. Ils s’en allèrent par l’escalier qui conduit à la souricière.
Le garçon de bureau dit :
— M. Baudoin, voulez-vous prendre la peine d’entrer… M. Mayeur vous attend.
L’ancien soldat pénétra dans le cabinet. Le greffier, l’air en dessous, l’examina avec curiosité. M. Mayeur, avec un sourire incertain, désigna un siège, rangea des papiers, se tourna d’un air rogue vers son greffier et dit :
— Vous pouvez vous en aller… Mettez tous les dossiers en ordre. À demain.
Le greffier fit une grimace qui pouvait être, au choix, prise comme une politesse ou comme une insolence, et se retira. M. Mayeur, las sans doute d’interroger, se borna à fixer ses yeux sur Baudoin, l’invitant du regard à s’expliquer.
— Monsieur le juge, dit l’ancien brosseur, j’ai pris l’engagement, quand vous m’avez reçu la dernière fois, de vous informer de tout ce qui se produirait de nouveau concernant l’affaire de Vanves. Je viens tenir ma promesse.
— Est-il donc survenu quelque événement de nature à éclaircir l’affaire ?
— Il en est survenu plusieurs.
— Qui sont ?
— Un incendie, un meurtre, un vol.
La physionomie de M. Mayeur s’illumina :
— Et où ces crimes ont-ils été commis ?
— À Ars, dans l’Aube.
La figure du magistrat s’assombrit, comme si on eut éteint la clarté intérieure qui la faisait rayonner. Il dit :
— Dans l’Aube ? Ce n’est pas dans notre ressort. Cela ne nous regarde pas.
— Je vous demande bien pardon. Cela vous regarde. Attendu que les gens qui ont commis ces crimes sont les mêmes gens qui ont l’affaire de Vanves à leur actif, et que c’est pour cette première affaire, dont les autres ne sont que la conséquence, qu’ils sont recherchés.
— Les connaissez-vous donc à présent ? s’écria le juge.
— Je les connais.
— Savez-vous où les saisir ?
— Non ! Mais je vous en indiquerai les moyens.
— Alors l’affaire si déplorablement arrêtée, il y a deux mois, va reprendre ? Elle sortira des cartons où elle est classée ! Et peut-être nous pourrons aboutir ?
— Sans hésitation, je vous atteste que nous aboutirons, si vous faites le nécessaire.
— Moi ? s’écria M. Mayeur, le visage empourpré par l’agitation. Moi ! Après tous les tracas que j’ai eus, les humiliations que j’ai endurées…
Il sentit qu’il se découvrait. L’homme passionné, ardent, s’effaça, le magistrat calme et froid reparut. Il poussa un soupir, leva les mains, comme pour en faire descendre le sang, prit un coupe-papier, le pétrit afin de dépenser le reste de son énervement et d’une voix assurée :
— Racontez-moi tout, par le menu.
Baudoin reprit, un par un, tous les événements dont Ars avait été le théâtre. Il s’attacha à dépeindre le personnage de Mme Vignola, l’étrange figure d’Agostini, et enfin expliqua l’intervention redoutable de Hans. Le juge l’écoutait impassible, prenait de courtes notes, au fil du récit. Le temps passait, le soleil descendait et rougissait les flots de la Seine, l’obscurité tombait, le juge avait cessé d’écouter et commençait à interroger.
— Ainsi, ce Cesare Agostini est à Paris ?
— M. Graff, l’oncle de M. Marcel, l’a vu, et M. Marcel lui a parlé. Il est, paraît-il, fiancé à la fille du banquier Lichtenbach.
— Lichtenbach ? Un homme dans sa situation, ayant sa fortune, ses relations ? Est-ce possible ?
— Vous le verrez bien ! Si vous voulez savoir où demeure l’Agostini, faites surveiller le Lichtenbach. Tout ça, c’est compère et compagnon !…
— Et la femme Vignola ?
— Agostini vous mènera à son gîte. Et quand vous tiendrez la Vignola, vous arriverez jusqu’à Hans, jusqu’aux autres complices, s’il y en a… Et je le crois ! C’est une bande !
— Et que fera M. Marcel Baradier ?
— Il agira de son côté. Ne vous occupez pas de lui. Il ne veut pas paraître dans cette affaire-là. Question de scrupules ! On a eu les bonnes grâces d’une femme. Si canaille soit-elle, on désire ne participer en rien à ce qui peut lui faire du tort. Ça se comprend de reste.
— Mais si quelque tentative est faite contre lui ? Ne souhaite-t-il pas que je prenne des mesures pour le protéger ?
— Non. Il est assez grand garçon pour se protéger lui-même. Et puis, je suis là.
— Laforêt aussi était là.
— Enfin, c’est la volonté de mon maître. N’en faites pas plus qu’on ne vous en demande. Je crois que vous pouvez être satisfait du résultat… Ça a coûté cher ! Mais, si on en sort, si mon général et le pauvre Laforêt sont vengés, on pourra dire : quitte !
— Soit ! dit le juge. Et si j’ai besoin de vous, monsieur Baudoin, où vous trouverai-je ?
— Chez mon maître, M. Baradier.
— À merveille. Maintenant que vous avez si bien travaillé, à mon tour. Ces gens-là ne se seront pas moqués de la justice impunément.
— Ah ! il y a longtemps qu’ils s’en moquent, si j’en crois ce que j’ai pu comprendre au ministère de la guerre.
— Je me mettrai en rapport avec ces messieurs. Nous marcherons de concert. Bon courage et bon espoir, monsieur Baudoin : l’affaire recommence.
Baudoin, reconduit par le juge, sortit dans le couloir, serra la main à ses camarades de l’antichambre et s’en alla. Il rentra tout droit rue de Provence et monta à l’appartement de Marcel. Le jeune homme habitait, à l’entresol, trois pièces, dans un corps de bâtiments en retour. Un escalier le desservait, descendant à la cour directement. Marcel pouvait ainsi sortir en toute liberté. Le concierge était seul dans le secret de ses habitudes.
Ce soir-là, il était assis, dans son petit salon, et étudiait, avec une attention extrême, un dessin de machine sur lequel il avait tracé des modifications au crayon. En entendant Baudoin entrer, il posa son épure sur la table, regarda le brosseur et demanda :
— Vous en arrivez ?
— Oui, monsieur Marcel.
— Vous avez vu le ministre ?
— Oui, monsieur Marcel. Il a sauté en l’air, aux premières paroles. Il veut absolument vous voir. Il prétend que la dame en question est une espionne de la plus dangereuse espèce, qui se moque de la police depuis au moins six ans. Cette femme-là aurait sur la conscience un tas d’infamies…
— Ce n’est pas ce que je vous demande, interrompit Marcel avec vivacité. Vont-ils prendre des mesures pour surveiller l’Agostini et ses camarades, s’il en a…
— Le ministre m’a dit que c’était l’affaire de la Sûreté, et il m’a engagé à voir M. Mayeur… J’en sors… Ah ! celui-là, il ne s’endormira pas sur le rôti… Il a, dès que j’ai été parti, pris ses mesures avec la préfecture… Il en a avalé des couleuvres, à propos de cette affaire maudite… Il est actionné contre ses auteurs ! Ce n’est rien de le dire !
— Bien.
Le tintement d’une cloche, dans la cour, interrompit le colloque. C’était l’annonce du dîner que, par une habitude patriarcale, on sonnait tous les soirs, comme on avait l’habitude de le faire en province. Marcel enleva son veston, passa une jaquette et se dirigea par un couloir intérieur, vers le salon. Comme il y entrait, son père, l’oncle Graff, les deux jeunes filles et Mme Baradier étaient déjà debout pour passer dans la salle à manger. Le luxe de la maison était solide, mais non éclatant. Du confortable, point d’ostentation. Deux domestiques servaient. Le menu était abondant et soigné sans raffinement. On sentait en tout une forte et large simplicité bourgeoise. D’habitude, le dîner était l’heure où tous racontaient les événements de la journée. Ce soir-là, on eut dit que chacun avait décidé de se taire. Pourtant Graff, vers le rôti, se hasarda à dire :
— La Bourse a été meilleure aujourd’hui.
— Joliment ! grogna Baradier.
Le silence retomba plus lourd. Mais l’oncle qui avait une patience lorraine, reprit :
— J’ai reçu de Cardez une lettre m’annonçant qu’on est au second étage des bâtiments neufs… L’assurance a bien payé… En somme, tout s’arrange au mieux.
— Les ouvriers sont-ils plus tranquilles ? demanda Mme Baradier.
— Les pauvres gens ! Ils regrettent ce qu’ils ont fait. Mais ils n’en sont pas responsables ? Ah ! Les meneurs ! Les entrepreneurs de grèves ! La peste.
— A-t-on étudié l’emplacement plus large, pour une machine à vapeur nouvelle ? interrogea Baradier, qui oubliait sa mauvaise humeur dès qu’on parlait d’affaires.
— Mon père, intervint Marcel, je te demande d’ajourner ce projet… Il peut survenir telle circonstance qui fasse que le système de force employé à l’usine soit radicalement changé… Il faut donc patienter un peu.
— Encore les chimères et les turlutaines ! Quelque inapplicable invention de rêveur !
— Non, répliqua chaleureusement le jeune homme. Aucune chimère ! Une belle turlutaine, par exemple ! Et qui, si elle réussissait !… Ma chère Geneviève, ce serait la gloire de votre père, car il est le premier qui ait eu l’idée de cette invention, et certes, si elle se réalise, comme je le crois, elle portera son nom.
— C’est donc ce à quoi tu t’occupes depuis un mois ? demanda Baradier avec curiosité.
— Depuis deux ans, mon père. C’était sur cette application de la puissance détonante réglée de la poudre Trémont – vous entendez bien : réglée, tout est là – que je travaillais avec le général. Nous étions bien près d’atteindre le but, quand il a disparu. Mais j’étais en possession de tous les dessins, plans et calculs faits par nous, et j’ai continué l’œuvre, tout seul…
— Et tu crois avoir réussi ?
— Je le crois.
— Et à quoi arriveras-tu avec ta machine ?
— À remplacer le charbon, le pétrole, l’électricité même, dans la production de la force. C’est-à-dire à supprimer les soutes dans les bâtiments de guerre, ce qui leur permettrait d’augmenter indéfiniment leur rayon d’action, à débarrasser les locomotives de leur tender, et à permettre à toutes les industries de laisser l’emploi du charbon à la métallurgie et au chauffage.
— Oh ! Oh ! fit Baradier, et tu remplaces le charbon, le pétrole, l’électricité, par quoi ?
— Ça, cher père, c’est ce que je te dirai le soir du jour où des brevets auront été pris pour tous les pays du monde.
— Et quand les prendras-tu ces brevets ?
— Demain, si tu veux m’avancer les quarante mille francs nécessaires ?
— Je te les donne, moi, s’écria l’oncle Graff, avec feu. J’ai confiance.
— Qui vous dit que je ne sois pas prêt à ouvrir ma caisse ? reprit Baradier. Rien que pour honorer la mémoire de Trémont, je le ferais.
— Eh bien ! mon père, je te garantis que jamais tu n’auras placé d’argent à un si gros intérêt, dit joyeusement Marcel. C’est une découverte à bouleverser l’industrie, et si simple !…
— Comme toutes les bonnes inventions !
Baradier resta un instant silencieux, puis :
— Mais l’invention de cette machine est liée à la découverte des poudres Trémont ?
— Oui, mon père.
— Et les poudres, on les a volées ?
Un triste sourire passa sur les lèvres de Marcel :
— Oui, mon père, on a volé les poudres… La poudre de guerre, par exemple, et c’est un très grand malheur. Car le général voulait doter la France de ce merveilleux produit, qui aurait assuré à notre armée une supériorité de plusieurs années sur les autres armées d’Europe. Puis tu sais comme vont les choses : les étrangers auraient travaillé, ils auraient découvert ou acheté notre secret. Et le niveau se serait rétabli. Il n’y aura de supériorité pour personne, puisque la formule de la poudre de guerre Trémont sera donnée, demain, par moi, au ministre. Ce sera l’égalité. Et s’il y a la guerre, la valeur et l’intelligence devront se charger d’assurer la victoire. Quant à la poudre du commerce. C’est une autre affaire. On a pu en dérober la formule, la fabriquer même, mais je défie bien qu’on trouve le moyen de s’en servir pour l’usage que je lui destine.
— Il y a un secret ?
— Oui, mon père, trouvé par moi, en travaillant avec M. de Trémont, et par reflet du hasard. C’est en quoi consiste la merveille de cette poudre qui, dans des conditions ordinaires, est brisante comme nulle autre, s’enflamme par simple frottement, en un mot, est d’un usage très dangereux ; et qui, employée selon notre méthode, obéit, se discipline, règle ses effets dynamiques jusqu’à faire marcher une pendule, si cela me plaisait.
Tous, autour de la table, écoutaient, les yeux fixes, muets d’émotion en pensant à la grandeur de l’œuvre, et au destin misérable de son initiateur. M. Baradier rompit le silence.
— Tu auras demain ton argent. Et si l’affaire vaut seulement la centième partie de ce que tu promets, Geneviève sera riche et Trémont illustre !
— Quant à la société des Explosifs, ajouta Graff entre haut et bas, je crois qu’elle est dans le sac ! S’il y a un bouillon à boire, c’est à Lichtenbach qu’il est réservé !
XIII
Il y avait cinq mois que Marcel avait pris, vis-à-vis de son père, l’engagement de rompre avec ses compagnons de plaisir, de renoncer à son existence de fête, de ne plus mettre le pied au Cercle et de travailler à faire oublier les folies qu’il avait faites. Scrupuleux observateur de sa parole, il s’était retiré à Ars, ne paraissant que rarement à Paris. Il avait travaillé d’un tel cœur que les résultats de son effort étaient indiscutables. Le ministre, à la suite de l’entretien qu’il avait eu avec Marcel, s’était exprimé devant Baradier sur le compte du jeune savant, avec une telle chaleur, que le père avait désarmé. Toutes les interdictions acceptées avec patience, avaient été levées et, non sans satisfaction, ce beau garçon de vingt-six ans avait repris ses habitudes.
La première fois qu’il était entré au Cercle, il y avait été accueilli à bras ouverts par ses camarades jeunes et vieux :
— Mais que devenez-vous donc ? mon cher, on ne vous voit plus ! Est-ce que vous avez voyagé ? Est-ce que c’est la petite Machin, qui vous a chambré ainsi ? Avez-vous, dans le silence et la méditation, réparé la joyeuse culotte ? Enfin, que vous est-il arrivé ?
À ce bouquet de questions, Marcel avait répondu avec bonne grâce qu’il avait voyagé, en effet, mais seul, sans la petite Machin, aimable personne qui, en résumé, ne valait pas ce qu’elle coûtait…
— En est-il une qui vaille ce qu’elle coûte ? dit mélancoliquement le gros Stapoulo, qui est notoirement l’homme le plus trompé que connaisse la galanterie parisienne.
Marcel ajouta qu’il avait aussi beaucoup réfléchi sur la vicissitude des banques, et qu’il était arrivé à cette conviction que le baccara n’offrait de profit qu’à la cagnotte ; qu’en conséquence, il était parfaitement décidé à ne plus jouer qu’au bridge où, au moins, on avait, en perdant, la satisfaction d’enrichir des camarades.
— Que de fois j’ai entendu tenir ce langage, dit le baron de Vergins, ancien chambellan de l’Empereur. Et si vous restez devant la table de baccara seulement un quart d’heure, vous n’y résisterez pas !
— Allons-y tout de suite, vous verrez bien.
Ils passèrent dans la grande salle. Sous les hauts plafonds, une grise buée de tabac flottait comme un brouillard.
De chaque côté de la large pièce, une table verte, autour de laquelle se pressaient les pontes maussades, tandis que le banquier, attentif, taillait.
— Tiens ! Vous avez deux tables de baccara, maintenant ? remarqua Marcel.
— Oui. C’est une innovation. À l’une, le minimum de ponte est de un louis ; à l’autre, il est de dix francs. De sorte que, quand un ponte a été rincé à la grande table, il va à la petite essayer de se refaire, quitte à retourner après à la grande reperdre ce qu’il a regagné.
— Très ingénieux ! C’est un double crible ! De la sorte, rien n’échappe !
Il s’approcha de la grande table et son regard, aussitôt, devint fixe. En face de lui, taillant la banque, il venait de reconnaître Agostini. Impassible, le sourire sur les lèvres, les mains gracieuses, une fleur à la boutonnière, il distribuait les cartes aux deux tableaux. Il ne vit pas Marcel. De sa voix chantante, il demanda :
— Cartes ?…
Il donna. Abattit une bûche pour son compte, perdit des deux côtés et lança à droite et à gauche, avec infiniment d’adresse, des jetons multicolores pour payer les pontes. S’adressant au baron de Vergins et à Stapoulo, Marcel dit :
— Qui est le banquier ?
— Le comte Cesare Agostini.
— Nouveau dans le cercle ?
— Temporaire… Aimable garçon, fin tireur, beau joueur.
— Heureux ?
— Ah ! non ! Il a une guigne noire. C’est le plus gros perdant du moment…
— Vous avez eu de bons renseignements sur lui ?
— C’est le prince de Cystriano et Beltrand qui l’ont présenté… Ce sont des parrains très sérieux. Du reste, la famille Agostini est bien connue. Ce sont des cadets de grande famille italienne : les ducs de Briviesca…
— Pourquoi reçoit-on tant d’étrangers au cercle ? dit Marcel d’un air mécontent.
— Eh ! mon cher, il n’y a qu’eux qui y viennent ! Le cercle vit d’eux, pour ainsi dire. Ils y sont comme à l’hôtel, je le sais bien… C’est embêtant pour nous… Mais qu’y faire ? Le budget de la maison a des exigences.
— Lui connaît-on de la famille à Paris ? demanda Marcel. Une femme, une sœur ?
— Non. Il est célibataire, et jamais on ne l’a rencontré avec une femme.
Marcel alors détourna la conversation, s’écarta de la table de jeu, quitta ses deux compagnons, sous un prétexte, et gagna le salon de correspondance. Il prit un annuaire et, écrite à la main, il trouva cette indication récente : Comte Cesare Agostini, 7, rue du Colysée. Il avait ainsi son adresse : c’était déjà quelque chose. Mais que savait-il, sachant cela ? Rien. C’était, sur le compte de la femme mystérieuse : Anetta ou Sophia, Mme Vignola ou la baronne Grodsko, à moins qu’elle ne fut encore une autre, qu’il aurait voulu être renseigné. Que lui était Agostini, à cette créature infiniment charmante qui, soudain, s’était métamorphosée en un monstre de dangereuse perversité ? Son frère, réellement ? Son complice, à n’en pas douter. Il voulait savoir. Au prix du plus grand danger, il était décidé à fixer son doute.
Il s’était assis dans un large fauteuil de cuir, le dos tourné à la porte, presque invisible. Deux membres du cercle, placés à des tables, écrivaient laborieusement leur correspondance sur le papier de la maison. La fraîcheur de ce lieu silencieux, le tic-tac monotone de la pendule, engourdissaient la pensée de Marcel. Un murmure de paroles éloignées le berçait. Il demeura un assez long temps à rêvasser confusément.
Soudain, il tressaillit et tendit l’oreille. La voix d’Agostini venait de se mêler au bourdonnement de la conversation, et claire, nasillarde, arrivait jusqu’à lui :
— Je perds encore deux mille louis… Avec les mille d’hier, cela va pas mal…
Il rit. Un des causeurs conseilla :
— Vous devriez vous tenir tranquille, pendant quelques jours, Agostini : il ne faut pas s’entêter à la guigne…
— Eh ! Si je ne jouais pas, qu’est-ce que je ferais ?… Je n’ai que le jeu !
— Et la belle dame de l’Opéra, à qui vous avez présenté, l’autre soir, le colonel Derbaut ?…
Un battement de cœur étouffa Marcel. Il eut le pressentiment que la femme dont on parlait et à qui Cesare avait conduit un officier était celle qui le préoccupait si violemment. Il concentra toute son attention pour ne rien perdre de ce qui se disait. Mais Agostini avait sans doute baissé le ton. Il ne pût percevoir sa réponse. L’autre reprit :
— Si elle n’est que votre compatriote, je demande à faire sa connaissance. Vous me devez cela, comte…
Agostini rit, mais ne s’engagea pas. Et Marcel se disait : Sa compatriote ? Une italienne ? C’est Anetta. J’en suis sûr. Quelle besogne est-elle revenue faire ici, avec ce brigand ?… Encore l’armée en jeu, puisqu’elle s’est laissé amener le colonel Derbaut, qui est à l’état-major de la place… Il avait perdu le fil des propos échangés, pendant ce temps-là. Mais une deuxième phrase lui apprit tout ce qu’il avait intérêt à connaître :
— Alors, ce soir, à l’Opéra ?
— C’est entendu.
Le silence se rétablit. Les membres du cercle continuaient à écrire, comme de bons plumitifs. Marcel se leva. Il avait la certitude maintenant de revoir la prétendue sœur d’Agostini. Elle n’était pas en Italie, comme l’aventurier avait eu l’audace de le lui affirmer à la vente de charité. Elle était à Paris, au cœur des intrigues, et déjà travaillant, sans souci du passé, à quelque œuvre malfaisante. Car, sur son passage, elle semait la corruption, l’infamie et la mort. Brusquement dans le souvenir de Marcel s’évoqua l’image riante, suave et tendre de Mme Vignola, avec son sourire rose, ses yeux limpides, et ses blonds bandeaux de vierge. Était-ce possible que celle qui montrait ce délicieux et candide visage fût un monstre ? Oh ! Bien redoutable alors ! Comment se défier de cette exquise douceur qui émanait de toute sa personne ? Et cependant ne l’avait-elle pas trahi ? N’avait-elle pas révélé la présence des documents secrets dans le laboratoire ? Et cela avec une rapidité qui tenait du prodige et qui attestait une adresse peu compatible avec l’honnêteté. Mais ses baisers n’avaient-ils pas été sincères ? Ne s’était-elle pas donnée avec une ardeur qui excluait toute tromperie ? Elle ne mentait pas quand elle criait d’amour entre ses bras, entraînée par la passion, vaincue par la volupté et vibrante, tremblante, éperdue d’ivresse et de joie. Elle n’avait pas trompé, dans cette heure dévorante, où il sentait son cœur battre, ses bras le serrer, ses lèvres frémir et se glacer comme dans la mort. Il était inutile de se livrer avec cette furie, si elle n’y était pas entraînée par son désir. Alors ? Comment concilier d’une part cette duplicité avec cette franchise ? Pourquoi le traitait-elle en ennemi, à l’heure même où elle le caressait comme le plus adoré des amants ? Quand elle faisait le mal, obéissait-elle à une influence étrangère, néfaste, criminelle ? Et quand elle se montrait aimante, suivait-elle le libre instinct de son cœur ? Il eut voulu l’innocenter de tous les soupçons qui pesaient sur elle. Mais était-ce possible ?
Il quitta le cercle, rentra à la maison de Banque et trouva, dans le cabinet de son père, l’oncle Graff qui lisait attentivement un journal du soir. Le vieil homme se leva en voyant entrer son neveu et lui tendant la feuille imprimée :
— Tiens ! Mon petit, on s’occupe de notre affaire dans la presse… Voici un compte rendu de la séance de l’Académie des sciences où le professeur Marigot a lu sa note sur la poudre Trémont…
Marcel prit le journal avec indifférence. Sans même y jeter un coup d’œil il le posa sur le bureau.
— Voilà tout ce que cette nouvelle t’inspire ? s’écria l’oncle. Tu n’es pas plus curieux que cela de savoir l’effet produit par la communication officielle de Marigot ? Eh bien ! mon cher, je vais te l’apprendre. Le Globe consacre tout un feuilleton à la découverte, qu’il qualifie de considérable, et prévoit, à brève échéance, une révolution dans l’emploi des forces motrices. Par contre le Panache blanc, journal de Lichtenbach, se livre à une charge à fond de train contre l’invention, qu’il qualifie d’éhontée falsification, insinuant que c’est tout simplement le procédé Dalgetty, sans aucun changement dans le dosage des produits.
— Ça, c’est du toupet ! ne put s’empêcher de dire Marcel.
— Maintenant, ceci est le meilleur… À la Bourse, le bruit s’est répandu que la Société des Explosifs était en possession des brevets Trémont, et les actions ont commencé à monter, malgré les efforts désespérés des baissiers… Notre situation est donc sauvée, et par contre, celle de Lichtenbach devient terrible !
— Vous ne pensez pas que je vais m’en émouvoir ?
— Je ne le pense pas, en effet. Mais je t’annonce que ton père, qui depuis trois mois ne dormait plus, est guilleret et souriant. Il est allé tantôt à Aubervilliers voir un terrain de trois hectares, qu’on nous propose, et qui serait tout à fait convenable pour construire une usine.
— Mon père va être à son affaire, lui qui a la bâtisse dans le sang…
— Ton père est heureux. Mais il l’est par-dessus tout de te devoir ce brillant résultat. Il n’est pas expansif. Mais c’est un esprit très enthousiaste et un cœur très chaud. Il est flatté, jusqu’au plus intime de son amour-propre, de constater que tu es un homme de grande valeur… Jusqu’à présent on n’a parlé que de Trémont… Mais quand on saura que c’est toi qui as mis l’affaire au point, quand ton nom sera prononcé, et cela ne tardera guère, tu verras ton père s’épanouir…
Marcel ne répondit pas. Il fit quelques pas, dans le cabinet, d’un air si distrait que l’oncle Graff s’écria :
— Quel drôle de garçon tu fais ! Tu devrais pourtant être content de tout ce que je te raconte là… Et tu ne m’écoutes qu’à peine… Qu’est-ce que tu as ?
Le jeune homme secoua la tête et s’efforça de sourire :
— Je n’ai rien, oncle Graff. Je vous laisse aller. Que voulez-vous que je réponde ?
— Ah !… C’est que tu ne te doutes peut-être pas des projets que Baradier a formés pour toi. Il me les expliquait ce matin : Nous allons mettre Marcel à la tête de l’usine, comme directeur… Il sera, en même temps, un des administrateurs délégués de la Société des Explosifs que nous allons reconstituer complètement… Sais-tu, petit, que c’est une énorme situation que tu vas avoir, à vingt-six ans… Et ton père ajoutait : S’il veut se marier, je n’aurai plus rien à désirer… Il m’aura satisfait en tout… Hein ? Qu’en dis-tu ?… Je crois qu’il pense pour toi à Geneviève de Trémont… Qu’est-ce que tu as à répondre à cela ?
Marcel répliqua tranquillement :
— Rien du tout, oncle Graff.
Le vieil homme se leva, prit Marcel par les épaules, le regarda attentivement puis :
— Oui, oncle Graff. Non, oncle Graff. Rien, oncle Graff… Voilà tout ce que je réussis à tirer de toi, depuis une heure… Tu me trompes. Il y a quelque chose que tu ne m’avoues pas… Marcel, tu as revu la femme d’Ars ?
Cette fois le jeune homme dégela :
— Non ! Je ne l’ai pas vue… s’écria-t-il avec vivacité. Mais je sais qu’elle est à Paris. Je sais où je la rencontrerai ce soir… Oncle Graff, j’aurai le mot de cette énigme vivante…
— Eh ! mon enfant, le mot est tout trouvé : c’est une gueuse ! Ah ! que tu me tourmentes, en me disant que tu t’occupes encore de cette femme-là ! Prends bien garde ! Tu sais comme elle et ses compagnons sont dangereux ! Rappelle-toi le pauvre général, et ce brave garçon qui a été tué à Ars… Que diable vas-tu encore t’inquiéter de cette gourgandine ?… Préviens tout bonnement la police. On l’arrêtera et tout sera dit.
— Si j’étais sûr qu’elle est aussi coupable que vous le soupçonnez, oui, c’est ce que je ferais. Encore qu’il ne soit jamais bien brillant de livrer une femme…
— De la chevalerie, avec de pareilles gens ?
— Mais, j’ai des doutes, oncle Graff. Je ne puis me résoudre à la condamner. Il faut que je l’entende…
— Oui ! Enfin, tu veux la revoir ! Ne me raconte pas de billevesée, je ne suis pas une si vieille bête. Je sais ce que sont les choses. Elle te tient au cœur, à la peau, à tout ce que ces coquines-là savent émouvoir dans un homme… Et tu vas risquer de te faire assommer, ou égorger, dans un coin, pour le plaisir d’être roulé, une fois de plus, par une farceuse !
— Oncle Graff, on ne me tuera pas à l’Opéra. C’est là que je compte la rencontrer, ce soir…
— Est-ce bien vrai ?
— Avez-vous disposé de votre fauteuil d’orchestre ?
— Non.
— Eh bien ! Donnez-le-moi.
— Jure que tu ne feras aucune extravagance, que si cette femme veut que tu l’accompagnes, tu ne la suivras pas ?
— Non, je ne peux pas promettre cela. Si elle me fait seulement un signe de tête, je la suis, même au diable !…
— Tu vois ! Tu vois !
— Mais je vous réponds de ne pas y rester… Je suis sur mes gardes… Un Agostini ne me tuera pas comme un pigeon…
— Emporte un bon revolver.
— Soyez-en sûr.
— Ah ! mon Dieu ! Moi qui étais si content ! gémit le vieil homme. Voilà les émotions qui recommencent… Si tu emmenais Baudoin avec toi ?
— Sous aucun prétexte. Mais rassurez-vous, je ne cours point de risques, pour le moment. Plus tard nous aviserons.
L’arrivée de Baradier coupa court à l’entretien. Marcel passa chez lui pour s’habiller, avant de dîner en famille.
Ce soir-là, on jouait la Walkyrie, à l’Opéra. Lorsque Marcel arriva à l’orchestre, le second acte commençait. Les querelles de ménage de Wotan, ce Jupiter scandinave, avec Fricka, à qui ne manque que le paon, n’intéressaient que médiocrement le jeune homme. Il se retourna, appuya le coude sur le dossier de son fauteuil et regarda dans la salle. Lentement, comme à regret, les premières loges se remplissaient. On sentait que les abonnés ne se décidaient à venir que parce qu’ils avaient payé très cher pour cela. Les secondes et troisièmes loges étaient bondées. À ces places plus modestes on écoutait, on s’enthousiasmait. À l’amphithéâtre du haut, ce n’étaient que têtes tendues, et penchées vers la scène. Le véritable public amateur et artiste était là.
Mais ce n’étaient pas des observations critiques, sur la capacité musicale des différents auditeurs d’un chef-d’œuvre, que Marcel cherchait. C’était un visage de femme. Et nulle part, ni aux premières, ni aux secondes loges, ni à l’amphithéâtre, il ne voyait apparaître le fin profil de Mme Vignola. Deux baignoires, à la droite de l’acteur, restaient encore inoccupées. Et Marcel retourné maintenant vers la scène, guettait du coin de l’œil les deux carrés vides qui faisaient, dans la ligne dorée, brillante et vivante, deux points d’ombre morne.
Vers la fin de l’acte, un bruit de porte ouverte attira son attention. Il vit le fond d’une des baignoires s’éclairer, puis une forme vague parut dans l’encadrement de velours. La porte se referma, le fond redevint obscur, et une femme vêtue de blanc, décolletée, des perles admirables autour de son cou, s’avança sur le devant de la loge. Elle était assise de trois quarts et Marcel n’apercevait d’elle distinctement que sa nuque opulente, surmontée d’un casque de cheveux noirs. Marcel ne distinguait point son visage, mais quel rapport entre cette brune vigoureuse, et la blonde et languissante Anetta ? De la force, où il avait trouvé de la grâce. Non, ce n’était pas elle.
Il se détourna avec ennui. Mais, comme le rideau tombait au milieu des acclamations et que les artistes reparaissaient en scène pour saluer, la spectatrice fit un léger mouvement qui la plaça de face, et, plein de stupeur, Marcel reconnut le regard de celle qu’il aimait. À tout il aurait pu se tromper, mais pas à cette langueur des yeux qui formait, avec le sourire railleur et le front impérieux, un si délicieux contraste. Il l’examinait attentivement, sans qu’elle se sût observée, car elle n’avait pas jeté un coup d’œil sur la salle, et maintenant il la retrouvait. Mais comme il fallait bien la connaître et quelle douleur dans cette constatation !
Le fait seul de cette métamorphose n’était-il pas le plus complet des aveux ? Pourquoi, si elle n’avait pas à dépister les curiosités, ce changement de la coiffure, de la couleur des cheveux, de l’expression du visage ? Quelle comédie jouait-elle ? Quand la jouait-elle ? Était-ce à Ars qu’elle était maquillée, teinte, déguisée ? Était-ce à l’Opéra ? Et qui voulait-elle abuser ? Lui, hier ? Ou, ce soir, une dupe, un amant, un inconnu qu’elle attendait, qu’on allait lui amener, et à qui elle se livrerait, comme elle s’était livrée dans la petite villa de la Cavée ?
Marcel, à cette pensée, souffrit atrocement. Il se leva. Ses voisins sortaient. Mme Vignola n’était plus sur le devant de la baignoire, et, dans le fond, des formes confuses se remarquaient. C’était peut-être le moment où l’Agostini amenait le collègue du cercle, qui avait si instamment demandé au comte de le présenter à sa belle compatriote. Marcel compta les baignoires. C’était la quatrième après le passage. Il sortit dans le couloir, se dissimula derrière une colonne, et guetta.
La durée de cette attente lui paraissait interminable. Les passants qui allaient et venaient l’irritaient. Il répondit à quelques saluts, évita des poignées de mains. Il était au supplice. Enfin la porte de la baignoire s’ouvrit et livra passage à Agostini et à un homme âgé, l’air digne, rosette à la boutonnière. Le comte et son compagnon se dirigèrent vers le grand escalier en causant, passèrent devant Marcel qui tournait le dos, et disparurent. Alors le jeune homme s’élança. Il fit signe à l’ouvreuse, et sitôt la porte ouverte, il se glissa.
La spectatrice était assise sur le canapé du salon de la loge. Il referma vivement la porte, et s’avança vers elle. Elle tourna la tête, regarda celui qui entrait, ne sourcilla pas, et d’un ton tranquille dit :
— Vous vous trompez de loge, monsieur.
Il répliqua ironiquement :
— Non, madame, je ne me trompe pas, c’est bien ici que je viens, si je suis en présence de Mme Vignola, à moins que ce ne soit de la baronne Grodsko…
À ces mots, un bouleversement effrayant se fit dans la physionomie de la jeune femme. Ses yeux pâlirent et ses lèvres tremblèrent.
— Quel nom avez-vous prononcé ? murmura-t-elle d’une voix mal assurée.
— Un des vôtres, apparemment ! Car vous en changez, d’après ce que je vois, suivant la situation, comme vous changez de visage, suivant les hommes.
— Je ne comprends pas ce que vous prétendez dire. Encore une fois, vous faites erreur, retirez-vous…
— Non pas ! J’attendrai que le comte Agostini revienne. Devant lui nous nous expliquerons. Il ne pourra pas nier son identité, lui. Et la sienne aidera à reconstituer la vôtre.
Elle se leva et ne se donnant plus la peine de nier :
— Et il vous tuera ! Malheureux, partez d’ici, partez sans un instant de retard, sans un mouvement d’hésitation. Vous ne savez pas quels dangers vous courez !
— Je le sais parfaitement. Le général de Trémont est mort, l’agent de police Laforêt est mort. Bien d’autres, sans doute, qui avaient résisté à vos fantaisies ou à vos entreprises sont morts. Et si je ne cède pas, moi aussi, vous essaierez de me faire tuer. Mais je saurai, avant, qui vous êtes et ce que vous êtes.
Le visage de la femme devint sombre, elle leva son beau bras, et tragique :
— Ne l’essayez pas ! Vous n’y pourriez réussir !
— J’ai déjà commencé, cependant, dit-il avec rage. Espionne, voleuse, comédienne… oui, comédienne, menteuse jusque dans l’amour !
Elle ne parut pas avoir entendu les autres injures qu’il lui jetait au visage. Une seule l’avait frappée : « Menteuse jusque dans l’amour ! » Elle rougit, saisit le bras de Marcel, approcha de son visage ses yeux qui flambaient dans l’obscurité :
— Non ! Je n’ai pas menti ! Ne crois pas cela ! Oh ! ne m’accuse point d’avoir menti dans l’amour. Je t’aimais ! Peux-tu t’y être trompé ? Accuse-moi de ce que tu voudras ! Que m’importe ! Nous ne devons plus nous revoir ! Entends-tu : jamais nous ne nous retrouverons ensemble. Crois donc ce que je te jure : Je t’aimais. Je t’aime encore ! Je n’ai jamais aimé personne autant que toi. Et c’est parce que je t’aime que je ne veux plus te revoir. N’essaie pas de comprendre. Ne cherche pas à savoir mes secrets. Ils te seraient mortels, tu le disais tout à l’heure, et tu avais raison. Contente-toi de ce que tu as eu de moi et de ne pas l’avoir payé de ta vie. Deviens aveugle, quand je passerai à tes côtés, sourd, si l’on te parle de moi. N’entre pas dans mes ténèbres. Oh ! mon Marcel, si cher, si peu de temps, si tendrement aimé. Va-t’en ! Mais ne me soupçonne plus de t’avoir menti. Je disais vrai, dans tes bras, sur tes lèvres, je…
Elle s’interrompit. Des larmes brillèrent dans ses yeux, ses lèvres blanchirent, ses bras enlacèrent Marcel. Il se sentit pressé sur une gorge frémissante, il fut aveuglé par un brûlant regard, il frémit au contact d’une bouche ardente qui le mordait dans une rage de volupté. Il entendit, à travers des soupirs, le mot : Adieu ! Un bras vigoureux le poussa vers la porte, l’étreinte se desserra. Et étourdi, affolé, il se retrouva dans le couloir, au milieu des spectateurs qui rentraient. La sonnette d’avertissement tintait. Il prit son paletot et chancelant, comme ivre, il obéit à la maîtresse mystérieuse : il partit.
Il ne doutait plus. Il avait entendu le cri sincère : je t’aime encore ! Non ! Elle ne mentait pas, quand elle criait sa tendresse. À quoi bon d’ailleurs puisqu’elle l’éloignait d’elle furieusement, avec l’effroi passionné d’une femme qui tremble qu’on ne lui tue son amant. C’était donc une volonté étrangère, et supérieure à la sienne, qui l’avait contrainte à le séduire, et qui maintenant encore agissait sur elle, pour quelle obscure besogne ? Il l’ignorait et devait l’ignorer toujours.
Sur la place de l’Opéra, il se retrouva plus calme. L’air lui fit du bien. Mais le souvenir de ces yeux pâmés, de cette voix frémissante, lorsqu’elle le tenait enlacé, dans la loge, lui revint avec une contraction douloureuse au cœur. Ah ! quelle femme ! Et quelles joies il perdait ! Car il l’avait à peine possédée, et, retenue par le rôle de chasteté qu’elle jouait, ses élans, ses ardeurs avaient été contenus. Et cependant il en tremblait encore.
Mais c’était un monstre de perversité. Il le lui avait dit, sans qu’elle protestât. Elle avait certainement sur la conscience plusieurs complicités de meurtres, si sa blanche et délicate main n’avait pas trempé elle-même dans le sang. Elle était la metteuse en œuvre des tentatives louches, l’émissaire des hostilités menaçantes, et la maquignonne des vénales trahisons. Sa beauté, sa grâce, son intelligence, autant d’appâts qui lui servaient à engluer les dupes. Son amour, un moyen. Qui n’avait-elle pas dû aimer ? À volonté, elle se donnait pour arriver à ses fins. Son corps, une marchandise qu’elle livrait pour affoler les hommes et obtenir leur influence, leurs secrets, leur honneur. Et c’était cela qu’il avait eu, lui aussi, et c’était cela qu’il regrettait !
Une révolte souleva son cœur. Il se dit : je suis vraiment par trop lâche ! L’attrait qu’exerce cette femme sur moi m’enlève le sens moral. Je me laisse aller à la désirer au moment où elle me paraît si méprisable ! Et je l’ai à peine connue ! Qu’aurait-elle donc fait de moi si elle m’avait soumis à sa dangereuse faculté de perversion ? Elle m’a aimé. C’est pour cela qu’elle s’est détournée de moi et qu’elle n’a pas voulu me corrompre. Il se mit à rire nerveusement, et pensa : Bientôt, je vais être obligé de lui devoir de la reconnaissance ! Et c’est une misérable, une infâme créature. Oui ! Mais elle est si belle !
Et, en proie à ces pensées contradictoires, il arriva rue de Provence, rentra et se coucha. Le lendemain matin, il fut étonné de se réveiller sous l’œil de son oncle Graff. Il était huit heures. Il avait dormi sans rêves. Le vieil homme inquiet n’avait pas cessé de se retourner dans son lit. Il n’avait pas pu résister, à la pointe du jour, au désir de s’assurer que rien n’était arrivé à Marcel. Et, depuis un bon moment, il le regardait sommeiller. Il voulut interroger le jeune homme, mais il le trouva évasif et imprécis. Alors, renonçant à rien tirer de lui, il passa chez Baradier pour demander une tasse de café au lait. Car il était sorti à jeun, et mourait de faim.
Le même matin, dans le cabinet de Lichtenbach, vers dix heures, Agostini et Hans étaient en tête à tête avec le banquier. Le comte Cesare fumait sa cigarette avec une mine songeuse. Hans impassible écoutait Elias qui parlait d’une voix plus sourde encore qu’à l’ordinaire :
— La situation, pour vous, est assurément sérieuse, disait-il, mais pour moi elle devient très grave. Sur la foi de vos renseignements, je me suis engagé dans une campagne de baisse qui devait mettre dans mes mains la Société des Explosifs, en me permettant de racheter les actions à vil prix. Il se trouve que mes concurrents directs, mes ennemis acharnés, les Baradier et Graff, ont exécuté la contre-partie de mon opération, et que tous mes efforts, pour leur faire lâcher prise, ont été impuissants. Je ne comprenais pas les causes de leur ténacité. Je les connais aujourd’hui. La notice lue à l’Académie des sciences me donne l’explication de leurs calculs. Ils sont en possession du secret que vous n’avez pas trouvé. Le moyen d’exploiter la poudre Trémont, ils le possèdent. Et le brevet Dalgetty ne vaut rien ! Voilà le résultat de toutes vos menées. Vous avez de quoi être fiers !
— Combien cela va-t-il vous coûter ? demanda froidement Agostini.
— Comment ! s’écria avec fureur le banquier, combien cela va me coûter ? Mais presque tout ce que je possède ! Vous prenez philosophiquement les choses, vous ! C’est aisé de dire à un homme qu’on a ruiné : combien cela vous coûte-t-il ? Est-ce que je peux compter sur mon physique, pour me faire des rentes, moi ? Il faut que je travaille, pour avoir de l’argent ! Et voilà quarante ans que c’est ainsi !
— Allons, Lichtenbach, dit Hans, ne pleurez pas. Nous savons que vous boirez un bouillon, si l’affaire rate définitivement. Mais il vous restera quelques petites choses… Je prends votre fond de sac, pour dix millions, si vous voulez !
— Stupides coquins que vous êtes, cria Elias, savez-vous ce que c’est que dix millions ? Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas ! Votre sale affaire, conduite comme par des ânes, me coûte le labeur de la moitié de ma vie, et plus encore : ma fierté ! Car moi, qui ai toujours accablé les Baradier et Graff, qui leur ai fait, en toutes circonstances, sentir la griffe, je suis à leur merci ! Et tout cela, parce que vous avez manœuvré comme des pots ! Votre fameuse Sophia, elle a été brillante, dans toute cette intrigue-là ! Une mangeuse d’hommes, qui n’a jamais manqué son coup. Une fleur de pourriture, qu’il suffit de respirer pour être intoxiqué, tant elle exhale de ferments corrupteurs. On lui donne un petit jeune homme à séduire. Pour elle, c’est un jeu d’enfant ! Et la voilà qui demeure inactive, impuissante, qui ne peut ou ne veut rien tirer de lui. Le secret reste inviolable, et moi, pendant ce temps-là, je perds tout mon argent ! Idiots ! Scélérats stupides ! Me le rendrez-vous mon argent ? Je ne connais rien au monde de plus méprisable qu’un bandit imbécile ! Et c’est ce que vous êtes, tous les deux, et votre Sophia par-dessus le marché !
Hans ne sourcilla pas. Agostini devenu sombre jeta sa cigarette d’un geste sec, puis :
— Il y a du vrai, dans ce que vous dites, Lichtenbach. Aussi je vous pardonne vos insolences. Sans cela, je vous les aurais fait payer cher…
— Laissez-moi donc tranquille ! Je me moque de vous ! gronda Elias.
— Vous avez tort, reprit l’Italien avec un mauvais regard. Un comte Cesare Agostini n’est pas né pour être offensé gratuitement par un Lichtenbach…
— Gratuitement ! Je vous crois ! Ce serait la première fois que vous feriez quelque chose de gratuit !
— Allons ! La paix dit Hans avec autorité. Nous ne sommes pas ici pour échanger des fleurettes, mais pour chercher une solution… Il est certain que la baronne nous a claqué dans la main. Nous en savons le pourquoi, mais trop tard. Elle s’est toquée bêtement du petit jeune homme et elle n’a accompli sa mission qu’à moitié. Elle a eu peur, en le faisant causer pour avoir le fin fond de sa pensée, qu’il ne la méprisât plus tard. Des giries ! Enfin le coup est raté. Le jeune homme est maintenant sur ses gardes. Il ne dira plus rien. À moins que je ne me charge, moi, en dernière analyse, de le questionner. Mais ce sera la suprême ressource. Gardons cette poire pour la soif. Pour l’instant, la situation est la suivante : Nous avons un brevet excellent, car il est pareil, pour la composition de la poudre, à celui pris au nom de Trémont. Mais nous ignorons le tour de main de la mise en œuvre. Notre poudre est un explosif brutal. La poudre Trémont est un explosif gradué. Là est la véritable valeur de la découverte. Dans ces conditions, nous pouvons faire élever des revendications par Dalgetty et accuser les exploitants du brevet Trémont, postérieur au nôtre, de contrefaçon. Bruit, scandale, procès, chantage. Voilà les procédés d’action. Ceci peut servir de moyen pour obtenir une transaction.
— Comment cela ? demanda Lichtenbach, très intéressé.
— Envoyez aux Baradier et Graff un ambassadeur bien choisi, pour leur offrir la paix.
— Ils n’accepteront pas !
— Qu’en savez-vous ? Le tout est de la leur convenablement proposer, de leur concéder des avantages matériels et moraux, afin d’arriver à une fusion des deux affaires.
— Ce serait le salut ! Et même le triomphe ! s’écria Lichtenbach. Que je les tienne, seulement ! Et je me charge de les rouler !
— Je m’en rapporte à vous ! Ah ! Vous renaissez à la vie, vieux farceur…
— Ah ! c’est que l’idée d’être la dupe de Baradier et Graff me tue !… Toute mon existence aurait donc été inutile ! Je n’ai eu qu’une préoccupation, depuis que je suis à Paris : leur nuire ! Et renoncer à cette jouissance ! Ce serait trop dur ! Mais qui leur envoyer ?
— Un prêtre, souffla Agostini.
— L’abbé d’Escayrac, s’il veut me rendre ce service ! Oh ! c’est une idée admirable. Il sait manier les consciences et pétrir les esprits. Mais que faire offrir aux Baradier et Graff ?
— Tout ce que vous supposerez qu’ils pourront décemment accepter… Qu’est-ce que ça vous coûte ? Vous le reprendrez plus tard ! N’avez-vous pas une fille ? Elle est soigneusement élevée et aimable, à ce qu’on m’a dit…
— Eh bien ?
— Offrez-la au petit Baradier, avec une dot énorme… Si la Sophia veut s’employer ! vis-à-vis du jeune homme, elle vous manigancera cette affaire-là !
Mais, cette fois, Agostini manifesta les symptômes d’un violent mécontentement. Il frappa avec force sur la table et regardant ses deux compères avec des yeux meurtriers :
— Eh bien ! Et moi ? Qu’est-ce que je deviens dans cette combinaison ? Oubliez-vous que Mlle Lichtenbach m’est promise ?
— On vous la dépromettra, répliqua froidement Hans.
— Avez-vous la prétention de vous moquer de moi ?
— Je ne me moque jamais des gens inutilement.
— Alors, c’est sérieux ! Vous songez à renverser tous mes projets ?
— Qu’est-ce qu’ils vaudront vos projets, si Lichtenbach est à plat ? Et puis, jeune étourneau, vous n’avez donc jamais regardé maître Elias ? Croyez-vous qu’il soit homme à s’embarrasser de vous, si vous ne lui servez plus à rien ? Vous avez déjà baissé de plusieurs crans dans son estime. Ne faites pas d’histoires, maintenant. S’il faut s’arranger avec vous, on vous offrira de l’argent… Je sais où en trouver…
Le bel Italien mit la main sur son cœur :
— Mais quelle compensation pourra être assez large pour me consoler ?
— Oui, fleur de courtoisie, ricana Hans. Nous savons que votre âme est aussi tendre qu’elle est délicate !
Lichtenbach, taciturne depuis qu’il avait été question de sa fille, reprit la parole :
— Un Baradier épouser une Lichtenbach ? Est-ce que c’est possible ! Jamais les Baradier et Graff n’y consentiront… Et, moi-même, je devrais protester de toutes mes forces contre un pareil projet…
Il demeura un instant silencieux, comme absorbé par ses souvenirs, puis il dit lentement :
— Ma fille cependant ne déparerait pas la famille. Ce sont d’honnêtes gens ! Et elle, c’est une enfant fière et charmante… S’ils consentaient pourtant ! Ma fille serait sûre d’un avenir heureux. Elle vivrait paisible et considérée. Ces Baradier sont d’honnêtes gens ! S’ils acceptaient ma fille, comme la leur, ils la traiteraient bien. Et elle ne serait pas la proie d’un aventurier ! Je les hais bien, je leur veux du mal, pour toutes les humiliations qu’ils m’ont infligées… Mais s’ils acceptaient ma fille !
Une larme glissa sur la joue du dur Elias. Larme plus précieuse qu’un diamant, car c’était la tendresse paternelle qui la faisait couler. Hans interrompit cette effusion. Il n’était pas l’homme des attendrissements prolongés :
— Ainsi vous adoptez mon plan ? Vous faites une tentative conciliante auprès de nos adversaires. Vous leur offrez ce que vous voudrez, cela vous regarde, et si vous réussissez, nous fusionnons les deux brevets. Il n’y a que vous qui paraissez. Mais naturellement vous nous réservez notre part… Vous voyez que le jeune comte Cesare a déjà les dents longues… Est-ce entendu !
— C’est entendu.
— Alors, serviteur !
Hans et Agostini partirent. Elias se promena rêveur dans son cabinet, puis, il ouvrit une porte et, par ses appartements, se rendit chez sa fille. Près de la fenêtre donnant sur le jardin, Marianne travaillait. Elle se leva en voyant paraître son père. Vêtue d’un peignoir bleu garni de guipures, ses cheveux blonds coiffés en bandeaux, elle avait un air de virginale douceur qui gonfla d’attendrissement le cœur de son père. Il s’assit, l’attira près de lui, et, avec une bonhomie affectueuse qu’elle ne lui connaissait pas, il causa avec elle :
— Voilà déjà du temps passé depuis que tu t’es installée auprès de moi. Es-tu satisfaite ? Et les choses vont-elles à ton gré ?
— Je serais bien ingrate, si je n’étais pas contente. Tu me laisses conduire ta maison comme il me plaît. Mais j’espère que tu n’es pas mécontent, toi-même…
— Non, chère petite. Et je voudrais que nous restions toujours ainsi… Mais tu sais qu’il faudra nous séparer un jour…
Marianne devint grave et son sourire s’attrista :
— Un jour lointain, n’est-ce pas ? Rien ne presse…
— Tu te marieras… Est-ce que cela ne te plaira pas de te marier ?
— Cela dépendra du mari…
Il y eut un silence. Ce rude manieur d’hommes, qu’était Elias, se sentit gêné devant cette enfant dont il avait disposé par calcul. Il n’osa pas lui parler d’Agostini qu’il avait amené, présenté, prôné encore la veille. Ce fut Marianne qui se chargea de préciser la situation :
— Je suis un peu troublée, je l’avoue, de la faveur avec laquelle tu accueilles ici ce jeune Italien, le comte Agostini, et de la façon dont tu me parles de lui…
— Mais, mon enfant, voulut expliquer Lichtenbach.
Marianne l’interrompit avec gentillesse :
— Non ! Laisse-moi dire. Après tu feras, à ton aise, l’éloge de ton candidat… Mais permets-moi de te parler à cœur ouvert… Les manières de ton protégé m’inquiètent. Elles ne paraissent pas franches. Il est trop complimenteur et trop épanoui. Je le trouve suspect, cet homme, qui a toujours le sourire et la louange à la bouche. Et puis sa voix sonne faux à l’oreille. Et son regard froid et méchant dément toutes les grâces de sa physionomie et la douceur de sa parole… Enfin, cher père, il est étranger. N’y a-t-il plus de Français à marier en France, pour aller chercher un fiancé, pour ta fille, de l’autre côté de la frontière ? Il est comte, mais je ne tiens pas à porter un titre. Il ne travaille pas, et je voudrais n’épouser qu’un homme occupé… Papa, est-ce que tu tiens beaucoup à ton comte Cesare ? Si tu voulais me faire plaisir et me marier selon mon goût, tu me choisirais un autre prétendant… Ta fille, ce n’est pas rien. Tu me l’as laissé entendre souvent, avec un peu trop d’insistance, peut-être, car j’aurais pu prendre de moi-même une idée avantageuse. Mais, heureusement, je suis raisonnable et modeste. Ne me donne pas à un homme désœuvré, ambitieux et méchant… Si tu veux que je sois sans préoccupations, renvoie le bel Italien… Ce n’est pas lui qu’il me faut !
Lichtenbach sourit avec bonhomie, et dit :
— Qui est-ce ?
Marianne rougit et ne répondit pas.
— Ah ! Ah ! reprit Lichtenbach. Nous avons un secret. Il faut le confier à notre père… Est-ce que tu as rencontré quelqu’un qui te plaise, fillette ? Dis-moi tout, sans crainte… Tu sais bien que je ne ferai que ce que tu voudras… Si Agostini te déplaisait, que ne le déclarais-tu plus tôt ! Voyons ! Parle…
Elle baissa la tête et dit :
— Non ! Non ! C’est inutile. Je n’ai qu’un désir, c’est de rester près de toi, comme je suis… Je me trouverai très heureuse…
— Tu ne me dis pas la vérité, s’écria Lichtenbach, avec agitation. Il faut me la dire. Penses-tu donc qu’il y ait des difficultés ? Oui ?… De qui s’agit-il ? Est-ce un garçon que je connais ?
— Mon père, laissons cela, déclara Marianne… J’ai eu tort d’aborder ce sujet… Il ne peut être que pénible, pour toi et pour moi… Tu m’avais prévenue… Mais trop tard… Il ne sera plus jamais question de ceci entre nous, je te le promets…
— Tu ne me tiendrais pas un autre langage, s’il s’agissait de mon plus grand ennemi… Est-ce que ce serait ?…
Il ne prononça pas le nom de Baradier. Mais Marianne le devina sur ses lèvres. Elle leva les yeux sur son père, comme pour lui demander pardon de cette espèce de trahison. Mais elle ne lui vit pas sur le visage l’expression irritée et menaçante qu’elle redoutait. Il était pensif et calme. Il resta un instant silencieux. Puis, avec beaucoup de mesure, il demanda :
— C’est de Marcel Baradier que nous nous occupons, n’est-ce pas ? Oui. C’était bien lui. J’ai eu tort de te laisser aller voir Geneviève de Trémont… C’est une imprudence que j’ai commise… C’est fait, c’est fait. Il n’y a plus à y revenir. Il faut tâcher d’arranger les choses.
— Arranger les choses !… balbutia Marianne.
— Oui, mon enfant chérie. Il faut essayer… Je ne suis pas un bourreau… Tout m’est possible, quand il s’agit de ta satisfaction…
— Vous oublieriez vos rancunes ?
— Je tâcherai que les Baradier oublient les leurs…
— Oh ! mon père ! Oh ! cher père !
Elle lui sauta au cou avec un tel élan de joie que Lichtenbach en pâlit de honte. Il eut, pour la première fois de sa vie, la sensation bien nette de ce que c’était qu’une canaillerie, et, sans doute, parce qu’il prenait sa fille pour dupe. En même temps, il eut le sentiment que les fautes commises pendant toute une vie se capitalisent, et qu’il faut, à une heure marquée, en payer les intérêts en monnaie d’humiliation et de souffrance. Il regarda Marianne avec une tristesse attendrie et dit, sincère :
— Ah ! C’est si sérieux que cela ? Eh bien, mon enfant, je ferai tout au monde pour que tu sois heureuse.
Il l’embrassa, rentra dans ses bureaux, demanda sa voiture et s’en fut chez l’abbé d’Escayrac.
XIV
Mme Baradier, vers cinq heures, venait de rentrer et lisait dans son petit salon pendant que sa fille Amélie et Geneviève de Trémont travaillaient près d’une table en causant gaîment, lorsque le domestique entra et dit :
— Madame, il y a là un prêtre qui demande à parler à madame.
Mme Baradier, dame patronnesse de plusieurs œuvres, très charitable par goût et par nécessité de position, était continuellement sollicitée et ne faisait point de différence entre les religieux et les laïques. Elle les recevait avec une égale bienveillance. Elle ordonna donc de faire entrer, et comme le visiteur introduit s’avançait, elle le salua, lui indiqua un siège et l’invita à s’expliquer. Du premier coup d’œil elle avait distingué un visage fin, intelligent, une bouche sérieuse et prudente. L’aspect général était celui d’un prêtre un peu mondain et très soigné. Les premières paroles ne firent que confirmer ce jugement.
— Madame, dit le visiteur, je me nomme l’abbé d’Escayrac, je suis secrétaire de l’établissement hospitalier d’Issy, consacré aux blessés indigents et placé sous le haut patronage de monseigneur l’Évêque d’Andropolis.
— Supérieur des Absolutionistes, si je ne me trompe…
— Vous ne vous trompez pas, madame.
— Que puis-je, monsieur l’abbé, pour votre œuvre ?
— Madame, vous pouvez beaucoup… Mais tout d’abord…
Ici l’abbé baissa la voix :
— Sans doute aurai-je des renseignements d’une particulière importance à vous communiquer et il conviendrait peut-être, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, que nous fussions seuls…
— Comme il vous plaira, monsieur l’abbé…
Les jeunes filles étaient bien stylées. Sur un simple regard de Mme Baradier, elles se levèrent, saluèrent avec déférence et sortirent.
— Parlez librement, maintenant, monsieur l’abbé…
— Je sais, madame, combien vous êtes animée d’un zèle vraiment chrétien, reprit le prêtre, et c’est sur la certitude que toute œuvre apostolique doit trouver une aide sérieuse auprès de vous qu’est basée ma démarche… Nous sommes, vous ne l’ignorez pas, entièrement dévoués au service des malheureux… La misère, la maladie, le vice lui-même, sollicitent exclusivement notre attention et notre intérêt… Un criminel est pour nous un frère que nous essayons de relever, comme nous nous efforçons de sauver un malade… Bien des malheurs, beaucoup de fautes, nous sont ainsi révélés… Nous sommes les confidents des tares physiques les plus douloureuses et des déchéances morales les plus lamentables… À toutes nous prêtons notre secours. Souvent nous servons d’intermédiaires entre ceux qui peuvent punir et ceux qui voudraient être épargnés… Nous ne sommes jamais sourds au repentir et nous tâcherons d’en faire profiter notre sainte religion…
Il parlait avec une onction grave et d’une voix insinuante, tournant les obstacles, se faufilant à travers les difficultés, préparant son terrain, et peu à peu s’efforçant de gagner à sa cause l’esprit de la femme, afin de se faire d’elle une alliée contre le mari. Il allait prudemment, sans se découvrir encore, et Mme Baradier étonnée de ce préambule, commençait, dans son bon sens de lorraine pratique, à se demander où ce jeune et sympathique catéchiste prétendait la mener. Elle voulut obtenir quelque lumière :
— Soyez sûr, monsieur l’abbé, que vous nous trouverez, moi et les miens, on ne peut mieux disposés pour votre œuvre… Est-ce un secours pécuniaire que vous désirez ?
— Nos pères, madame, vous seront reconnaissants de tout ce que vous voudrez faire pour eux. Ils ont à Damas une maison très utile, mais très lourde, que je recommande à votre générosité… Mais ce n’est point de cela qu’il s’agit… Nous avons, dans ces temps derniers, fondé dans le Var un établissement important, où nous nous proposons, à l’imitation d’ordres révérés et puissants, de créer un établissement industriel… Nous avons trouvé, pour faciliter nos efforts, des concours précieux… Nous sommes pleins de gratitude envers ceux qui nous ont été bienfaisants, et l’occasion se présentant de leur rendre service, j’ai été moi, très humble, désigné pour venir vous apporter les paroles conciliantes d’un homme qui, depuis de longues années, est en état d’hostilité avec votre famille, mais qui veut finir sa vie dans la concorde et la paix…
Mme Baradier, depuis un instant, manifestait de sérieux symptômes d’inquiétude. Elle voyait l’entretien prendre une tournure qui ne lui plaisait pas. Elle était bonne femme, mais très positive. Elle coupa carrément la parole à l’aimable abbé d’Escayrac, et d’un ton net :
— De qui s’agit-il, je vous prie, monsieur l’abbé ? Le nom de l’homme expliquera, je crois, beaucoup mieux la chose…
Le jeune prêtre sourit et, avec un regard suppliant de martyr chrétien dans le cirque :
— Je suis un ministre de charité, de douceur et de pardon, madame, il s’agit de M. Lichtenbach…
— Je m’en doutais.
— Dois-je craindre que sa personnalité rende toute entente impossible, même dans l’intérêt de la religion ?
— Ce n’est pas à moi qu’il appartient de prendre une résolution pareille, monsieur l’abbé. Et je ne puis oublier qu’il y a, dans cette maison, deux hommes qui, seuls, ont qualité pour répondre : mon mari et mon frère… Souffrez que je les prévienne et que je vous les envoie…
— Je suis à votre discrétion, madame.
— Non, monsieur l’abbé, ne parlez pas ainsi. Quoiqu’il advienne, soyez sûr que tous, ici, nous apprécierons, comme il convient, la démarche conciliante que vous avez acceptée… Nous saurons faire la différence entre le mandant et le mandataire…
Elle salua, avec une demi-génuflexion, le prêtre, et sortit. L’abbé resta immobile sur son fauteuil, réfléchissant. Son visage était impassible. Il remplissait une mission utile doublement à son ordre. Aucune préoccupation étrangère à sa tâche religieuse ne le troublait. Il savait ce que valait Elias. Mais l’esprit évangélique ne lui permettait pas de négliger le sauvetage d’un homme même méprisable. Le Christ n’avait-il pas subi le baiser de Judas ? Le souverain Pontife ne lavait-il pas les pieds des mendiants les plus sordides ? Et puis l’intérêt de l’Église commandait. La porte se rouvrit. Ce fut l’oncle Graff qui parut. Il était seul. Il vint au jeune abbé, le salua.
— Ma sœur, Mme Baradier, vient de me prévenir de votre présence, monsieur l’abbé. Mon beau-frère Baradier est retenu dans nos bureaux, par la liquidation de quinzaine… Il me charge de l’excuser auprès de vous… Du reste, j’ai ses pleins pouvoirs. Expliquez-vous donc…
— Mme Baradier ne vous a-t-elle pas dit ?…
— En gros et en hâte… Vous venez à nous de la part de Lichtenbach ? Bon ! Cela ne nous étonne pas. Ce n’est pas un gaillard héroïque. Tant qu’il a été le plus fort, il a tapé sur nous. Maintenant qu’il a le dessous, il essaie d’arrêter le jeu… Voyons ce qu’il veut.
M. d’Escayrac eut un sourire :
— Il y a plaisir à causer avec vous. On sait tout de suite où on va.
— Eh bien ! puisque vous le savez, monsieur l’abbé, allez-y.
— Monsieur, le hasard a fait que votre maison et la maison Lichtenbach se sont rencontrées sur le même terrain, au sujet de l’exploitation d’un brevet…
— Vous appelez ça le hasard ? Bon ! Bon ! Quant au « même terrain » il y a du vrai, puisque pour se procurer le brevet dont vous me parlez, on a fait sauter une maison : celle d’un de nos amis ; incendié une usine : la nôtre ; assassiné deux hommes et risqué d’en tuer plusieurs autres… C’est un terrain arrosé de sang, monsieur l’abbé… Mais c’est en effet le « même terrain » abominable !
Le prêtre croisa les mains avec une expression d’horreur :
— Monsieur, je ne savais rien de ce que vous me révélez… Et si ce n’était pas vous qui me tenez un pareil langage, je croirais que vous n’êtes pas dans votre bon sens… Il est impossible que celui, au nom de qui je me présente, ait commis les actes affreux que vous lui reprochez…
— Entendons-nous, dit l’oncle Graff avec vivacité. Je n’accuse pas Lichtenbach d’avoir versé le sang. Il en est incapable, pour beaucoup de raisons, dont la meilleure est qu’il ne l’oserait pas… Mais le brevet, dont vous me parlez a été extorqué par des moyens qui sont bien ceux que je viens de vous indiquer… On vous a fourvoyé, monsieur l’abbé, dans une mauvaise entreprise. Mais vous avez affaire, en nous, à des gens trop respectueux de la religion pour que vous ayez à craindre aucune responsabilité. Vous pouvez vous expliquer sans détours. Tout ce qui sera dit entre nous ne sortira pas d’ici. Et après tout, qui sait ? peut-être cet entretien aura-t-il un résultat utile.
— Je n’en doute pas, reprit avec chaleur l’abbé très troublé. Oh ! Monsieur, quelle satisfaction pour moi, d’avoir à débattre les intérêts qu’on m’a confiés avec un homme aussi sage et aussi bienveillant que vous. Loué soit Dieu ! Entendons-nous, si c’est possible, pour un complet apaisement. Si vous saviez tout ce que j’appréhende ! Et, en conscience, M. Lichtenbach n’est pas aussi responsable de ce qui se passe que vous le supposez. Il n’est pas le maître. Il a à compter avec des personnes puissantes, qui ne désarmeront pas et qui recourront, je le crains bien, aux pires moyens, pour avoir raison de vous.
— Nous ne craignons rien !
— Il y a des armes empoisonnées qui jettent bas le plus invulnérable. Il suffit d’une piqûre de venin. Craignez, monsieur, les manœuvres auxquelles des adversaires aux abois peuvent avoir recours… Je vous parle sincèrement. J’ignorais le passé. Mais j’ai été épouvanté de ce qu’on m’a laissé entrevoir pour l’avenir…
— Qui çà ? Lichtenbach ?
— Il était effrayé lui-même… Il m’a prié, en grâce, de venir vous trouver, ne sachant que moi dont le caractère lui pût offrir une garantie de discrétion suffisante. Je vous atteste qu’en lui vous n’avez plus affaire à un ennemi… Il est prêt à vous en donner toutes les preuves…
— Il vous trompe, Monsieur l’abbé… Vous avez été sa dupe. Il est à bas, c’est pour cela qu’il met les pouces. Nous le connaissons bien. Mais à tout péché miséricorde, après tout… Que veut-il ?
— Il vous offre un accord. La fusion complète des deux entreprises, par l’exploitation des deux brevets… Le Dalgetty est antérieur au Trémont, on ne fondera aucune prétention sur cette antériorité. Les deux découvertes, à peu près similaires, seront considérées comme égales.
— Comment donc ! s’écria l’oncle Graff, il est bien bon, Lichtenbach. Il y en a une sérieuse et une dérisoire. L’une est authentique et l’autre fausse. Le brevet Trémont est le produit du travail et de l’intelligence. Le brevet Dalgetty est le résultat de la fraude et du vol…
— Bon et cher monsieur, s’écria l’abbé inquiet, les déclarations officielles feront foi… On ne peut aller contre un fait… Le Dalgetty a été déposé par une compagnie anglaise, avant le Trémont.
— Eh ! qu’est-ce que cela peut nous faire ! Le Dalgetty est sans valeur. Et ils en sont sûrs, ceux qui vous envoient. Sans cela ils ne vous auraient pas dérangé ! Nous les tenons, vous dis-je : ils ne peuvent rien. Leur brevet ne vaut pas l’argent qu’ils ont dépensé pour le prendre… Voilà pourquoi ils veulent fusionner avec nous… Mais nous nous battons, Lichtenbach et nous, depuis des mois, sur la Société des Explosifs… Nous tenons le bon bout, il le sait bien… Il va falloir qu’il se liquide… Et alors ?…
— Il offre de cesser sa campagne à la baisse…
— Il ne peut plus la continuer.
— Il propose de prendre pour moitié, en les payant immédiatement, les actions des Explosifs dont vous êtes porteurs…
— Je vous crois : elles monteront de deux cents francs du coup !
— Il est prêt à vous donner un gage de sa coopération franche et désormais invariable…
— Voyons lequel ?
— Si vous aviez, dans votre famille, une personne appartenant à sa famille à lui ; si, par une alliance, vos intérêts devenaient communs, n’auriez-vous pas une garantie absolue de son sincère désarmement ?
Graff pâlit, mais il se domina, et désireux de pénétrer à fond la pensée de leur adversaire, il dit :
— Quelle serait cette personne dont il s’agit du côté de Lichtenbach ?
— Mlle Marianne, sa fille…
— Et du nôtre ?
— Votre neveu, M. Baradier.
— Oui. On unirait les deux jeunes gens, et Baradier, Graff et Lichtenbach ne formeraient plus qu’une seule famille…
— Je ne sais pas si vous connaissez Mlle Lichtenbach… C’est une jeune fille charmante, élevée dans les sentiments les plus chrétiens, et qui offrirait à monsieur votre neveu les garanties les plus sérieuses de bonheur… Ce serait une joie pour nous d’avoir contribué à la réconciliation d’adversaires anciens, séparés par des querelles sans doute faciles à oublier, au milieu d’une satisfaction générale… Au lieu des hostilités, la concorde ; et plus de menaces, plus de craintes… Une prospérité commune et complète ! Allons, bon et estimé monsieur, prononcez les paroles de rédemption et d’espérance, faites un effort sur votre orgueil, et donnez à tous le bon exemple de la douceur et de la charité.
Graff avait écouté silencieusement les onctueuses paroles du prêtre. Son front baissé, ses yeux clos, laissaient croire à l’abbé d’Escayrac qu’il agissait victorieusement sur la pensée du vieil homme. Il y eut un instant de silence. Puis l’oncle montra un visage sombre, des regards attristés, et d’une voix ferme, il dit :
— Monsieur l’abbé, dans le cimetière de Metz, il y a des Graff qui sortiraient de leurs tombes, si un de leurs descendants s’avilissait au point d’épouser la fille d’un Lichtenbach !
— Monsieur ! s’écria l’abbé éperdu de surprise.
— Vous ne savez donc pas ce que c’est que les Baradier et Graff pour leur proposer de s’allier à un Lichtenbach ? Vous ne savez donc pas ce que c’est que Lichtenbach ? Il n’y a pas, entre la Lorraine et Paris, un kilomètre de sol qui n’ait été arrosé de sang français par la faute de ce misérable ! Espion pour conduire l’ennemi à la victoire, fournisseur pour le nourrir, quand nos troupes mouraient de faim, il s’est engraissé de la guerre, enrichi de la trahison. Il a vendu ses frères de France : les Juifs, qui se battaient dans nos rangs et qui sont morts comme de braves gens, ce double Judas ! Et quand il a eu reçu les deniers de sa trahison, il s’est fait chrétien, pour souiller une religion nouvelle, par l’intransigeance dégoûtante de son zèle d’apostat ! Voilà ce que c’est que Lichtenbach, monsieur l’abbé. Faut-il vous dire, maintenant, ce que c’est que Graff et Baradier ?
— Oh ! je le sais ! Cher et honoré monsieur, je le sais ! Il n’y a qu’une voix sur votre honorabilité et votre patriotisme… Mais, grand Dieu ! Tant d’animosité, tant de rancunes ! Est-ce là ce que je vais être obligé de rapporter à celui qui m’envoie ?
— Dites-lui qu’il est un impudent coquin, d’avoir chargé un homme aussi respectable que vous d’une mission pareille. Déclarez-lui que notre mépris pour lui n’est égalé que par sa haine pour nous. Attestez-lui que nous ne le craignons d’aucune manière. S’il veut calomnier, nous répondrons ; s’il songe à plaider, nous plaiderons ; s’il ose frapper, nous nous défendrons. Dans ce cas, malheur à lui !
— Monsieur ! supplia l’abbé d’Escayrac, vous m’épouvantez. Réfléchissez ! La colère est mauvaise conseillère.
— Monsieur l’abbé, je suis très calme. Vous ne me connaissez pas. Je ne me mets jamais en colère. Si je m’y mettais, ce serait terrible ! Mais pour cela, il faudrait beaucoup de choses !
— Dois-je donc me retirer ainsi ? Songez que je vous sais exposés aux plus grands dangers.
— Je vous remercie de nous en avertir. Nous nous garderons…
— Est-ce votre dernière parole ?
— Non, monsieur l’abbé. Jamais un prêtre n’est entré chez nous sans emporter, pour lui-même et pour ses œuvres, un témoignage de notre respectueuse déférence et de notre humble piété…
L’oncle prit dans sa poche un carnet de chèques, écrivit quelques mots, et tendant la feuille de papier à son visiteur :
— Pour vos pauvres, monsieur l’abbé…
— Oh ! C’est une libéralité princière… s’écria le prêtre.
— Ne nous avez-vous pas dit que vous avez une maison à Damas ? Vous y enseignez, sans doute, avec notre langue, l’amour de notre pays… Nous sommes lorrains, monsieur l’abbé, par conséquent, exilés… Tout ce qui concourt à grandir la France, nous intéresse donc doublement.
L’abbé d’Escayrac s’inclina très bas devant l’oncle Graff.
— Je prierai pour vous, monsieur, et de tout mon cœur.
— Merci, monsieur l’abbé, dit l’oncle avec un sourire. Mais priez surtout pour Lichtenbach.
Et, ouvrant la porte, il reconduisit le prêtre.
Le même jour, vers neuf heures, après le dîner, Lichtenbach descendit de son coupé à l’entrée du boulevard Maillot, du côté de la barrière. La nuit était claire, les massifs du Bois argentés par la lune enlevaient sur le ciel clair leurs masses sombres. Le banquier pressait le pas, non sans souci, car l’endroit était désert et propice aux rôdeurs. Au bout d’une centaine de mètres, il s’arrêta devant la grille tapissée de lierre d’une villa et sonna. Quelques instants s’écoulèrent, puis une petite porte tourna sur ses gonds sans bruit, et une femme se montra avec précaution. C’était Milona. Elle reconnut le banquier, s’effaça sans prononcer une parole et le fit pénétrer dans un jardin qui s’étendait devant la maison.
— Madame est chez elle ? demanda Elias.
— Elle vous attend, dit la dalmate de sa voix gutturale.
— Bien. Ces messieurs sont-ils arrivés ?
— Depuis une heure.
Ils marchaient le long d’une plate-bande dont les fleurs embaumaient dans la nuit. Un perron s’offrit, que Lichtenbach gravit, suivant toujours la servante. Ils parvinrent dans une antichambre obscure. Là, Milona prit à Lichtenbach son chapeau et son pardessus. Elle ouvrit une porte et, des ténèbres, Elias passa brusquement à la clarté d’un salon, aux volets et aux rideaux hermétiquement clos. Assis à une table, Hans et Agostini, jouaient au piquet, en buvant des grogs. Sur un divan, Sophia dans un élégant déshabillé blanc, était à demi étendue. Les deux hommes levèrent à peine la tête en entendant entrer Lichtenbach. La baronne se redressa lentement, fit un signe de tête gracieux et dit :
— Mettez-vous près de moi. Ils finissent leur partie. Comment donc êtes-vous venu ? Je n’ai pas entendu rouler votre voiture.
— Je l’ai laissée près de la Porte Maillot…
— Tant de précautions ? Vous vous défiez de votre cocher…
— Je me défie de tout le monde.
— Et si un rôdeur vous avait sonné la tête sur le trottoir, pour vous apprendre à voyager seul la nuit dans ces parages ?
Elias entr’ouvrit la poche de côté de sa redingote et montra la crosse d’un revolver.
— J’avais de quoi causer avec lui, dans sa langue.
— Ah ! Vous ne voyagez pas sans interprète ?
— Je ne peux pas me laisser tuer pour vingt francs. Ce serait trop bête !
La conversation fut interrompue par une interjection de Cesare, qui furieux jetait les cartes à la volée sur la table. Hans riait silencieusement, en faisant sur une feuille de papier un calcul rapide.
— Mon petit, vous y êtes de trente-cinq louis… Vous perdez quatorze cents points !…
— C’est à croire à de la jettatura, grinça le bel Italien. Depuis que ce Marcel Baradier m’a regardé, je ne peux plus toucher une carte sans perdre, à n’importe quel jeu !
Il jeta un mauvais regard du côté de Sophia et dit :
— Ça finira !
— Allons ! La paix ! commanda Hans, avec autorité. Voilà bien de la musique pour peu de chose ! À vous de causer père la Caisse. Votre jésuite de d’Escayrac a-t-il vu nos gens ?
— Il les a vus.
— Eh bien ?
— Ils refusent.
— Qu’est-ce qu’ils refusent ? Spécifiez. Est-ce votre fille ou notre affaire ?
Elias rougit, ses yeux s’allumèrent sous ses paupières tombantes. Sa voix cependant n’accusa ni colère, ni chagrin.
— Ils refusent mon alliance et votre coopération. Tout enfin !
— Donner wetter ! gronda Hans. Sont-ils fous ?
— Non. Ils sont dans leur complet bon sens. Ils savent que vous n’avez rien et qu’ils ont tout. Et ils le prouvent, en vous envoyant promener.
— Vous prenez ça tranquillement, s’écria le comte Cesare. Je vous ai connu moins résigné.
— Je n’ai pas l’habitude de me battre contre les moulins à vent. Vous m’avez embringué dans une affaire absurde et dangereuse. J’en sors, voilà tout.
— En y laissant des plumes.
— Comme vous dites. Mais le moins possible. Je me suis déjà retourné et j’ai opéré une contrepartie.
— Vieille fripouille ! Vous finirez par gagner de l’argent, là où nous perdons tout ! répliqua Agostini, pâle de colère.
— Si j’en gagne, c’est que je serai moins bête que vous, qui ne savez qu’en dépenser…
Hans se mit à rire. Et comme Agostini faisait mine de se fâcher, il lui posa la main sur le bras, et le contraignit à rester assis.
— Le père la Caisse a raison, mon petit. Et il vous a bien rivé votre clou. Mais il ne s’agit pas de faire comme les chevaux, quand il n’y a pas de foin au râtelier, et de se battre. Étudions un peu la situation, pour voir ce qu’on en peut tirer encore. Et d’abord, qu’est-ce que dit la beauté ? Jusqu’à présent elle n’a point parlé. Elle doit cependant avoir une opinion. Honneur aux dames. À elle de s’exprimer la première. Allez, Sophia, nous vous buvons.
La baronne parut se réveiller. Elle cligna ses beaux yeux, comme pour en chasser une vision importune. Ses sourcils se froncèrent et dédaigneusement elle dit :
— Je n’ai pas pour habitude de m’acharner sur des opérations mal conçues. J’ai mieux à faire que de peiner sur des raccommodages. Vous savez ce que je vous ai toujours déclaré, depuis le soir de Vanves. Il y a un guignon sur cette affaire-là ! On ne la réussira pas. Vous en avez, en somme, tiré la moitié de ce que vous désiriez : la poudre de guerre est acquise. Suivez l’exemple que vous donne Lichtenbach : ne courez pas après votre argent, coupez-vous un bras et passons à autre chose.
— Coupez-vous un bras ! grogna Hans, c’est facile à dire ! Je suis déjà manchot, moi ! Non ! Tonnerre ! Mon bras est coupé ! Si c’était le vôtre, Sophia, vous y attacheriez plus de prix ! Je ne lâcherai pas, comme ça, une affaire qui me coûte si cher… Il faut qu’on me le paye, mon bras ! Et je ne me couperai pas l’autre !
— Eh bien ! quel est votre projet ? demanda la baronne avec impatience.
— Oh ! il est très simple ! Vous allez, ma chère belle, vous arranger pour renouer connaissance avec le petit Marcel Baradier. Il a trop peu tâté de vous pour n’avoir pas le désir de recommencer. On connaît l’étoffe, on sait qu’elle s’impose. Amenez-moi le jeune homme, ici, un de ces soirs. Il connaît le secret de la fabrication. Ou bien, il vous le livrera de bon gré, ou bien, moi, je me charge de le lui faire livrer de force.
Il y eut un silence. Les mains de Lichtenbach s’agitèrent nerveusement, la physionomie du comte Cesare exprima une satisfaction féroce. Sophia demeura impassible.
— Eh bien ! Qu’en dites-vous ? demanda Hans d’un ton jovial. Je crois que voilà un petit programme qui promet. Simple à préparer, facile à exécuter… Hein, Sophia ?
— Aussi simple et aussi facile que le coup de Vanves ! déclara la baronne froidement. Mais cette fois je suis prévenue et je pourrai m’y opposer. Vous ne nous compromettrez pas, une seconde fois, par de nouvelles brutalités. J’en ai assez de me voir accolée à des gens qui opèrent comme des Terreurs de Grenelle ou de Vaugirard. J’ai horreur de la violence, surtout quand elle est inutile. Je n’ai jamais réussi que par la ruse. Je ne changerai pas ma manière !
— Eh ! Qui vous empêche de ruser ? Obtenez le renseignement dont on a besoin. C’est tout ce qu’on exige de vous.
— Je ne m’occuperai plus de cette affaire !
— Ah ! Prenez garde ! cria Agostini. Vous ne me donnerez pas le change. Je sais fort bien, moi, pourquoi vous refusez de nous aider à reprendre le jeune Marcel… Vous craignez pour lui… Voilà tout !
— Et quand cela serait ?
— Eh bien ! Vous calculez mal. Car, moi, je vous jure, vous entendez, que si vous ne marchez pas, comme Hans le demande, je m’engage, sous huit jours, à chercher querelle à ce godelureau, et à vous l’embrocher comme un poulet !
— Libre à vous, dit Sophia d’un air indifférent. Vous vous méprenez complètement sur mes sentiments. Je ne m’occupe plus du tout de M. Baradier. Je n’ai pas l’intention de le revoir jamais. Vous risquerez donc simplement, et en pure perte, un coup d’épée qu’il peut très bien vous donner, tout cela parce que vous vous entêtez à vouloir réussir une opération manquée dès le principe… Je vous dis qu’il faut l’abandonner. Nous nous brûlons ici, pour rien. Nous finirons par avoir la police sur le dos, et vous savez que nos amis n’aiment pas les complications diplomatiques. Occupons-nous de l’affaire des fournitures anglaises… Il y a là à gagner sans risques… Un bon renseignement, qui permettra de constater les fraudes dans les livraisons, nous rendra du crédit, ici, pour longtemps… Laissez l’affaire des poudres, croyez-moi : elle est finie !
Hans ne répondit pas. Il parut réfléchir. Puis, avec une feinte bonhomie :
— Après tout, vous avez peut-être raison. En tout cas, nous ne pouvons rien sans vous. Et, puisque vous refusez de nous servir, il n’y a plus qu’à suivre votre conseil et à lâcher prise.
Lichtenbach poussa un soupir de satisfaction, mais il n’exprima pas son contentement. Il lui semblait que l’attitude conciliante, soudainement prise par Hans, était pleine de réticences. Il voulut connaître toute la pensée de son redoutable partenaire et pour cela il jugea utile de dissimuler la sienne :
— Allons ! N’en parlons plus ! Je passerai ce que l’affaire me coûte, par profits et pertes. Mais c’est dommage de n’avoir pu trouver le tour de main de la fabrication… Il y avait gros à gagner !… Enfin.
Hans pinça les lèvres et ne répondit pas à ces regrets. Agostini se tourna d’un air gracieux vers Lichtenbach :
— Et mon mariage, qu’est-ce qu’il devient ?
— Ce que devient l’affaire, répliqua rudement Elias : rien. Tant valait l’une, tant vaut l’autre ! Vous n’avez plus de dot, mon joli garçon. Je vous prenais avec la poudre Trémont… Maintenant il ne vous reste plus que de la poudre aux yeux !
— Ah ! c’est ainsi que vous me traitez ! Je puis vous en faire repentir !
— Et moi je puis vous faire mettre hors de France, en vingt-quatre heures, entendez-vous !
— Ah çà, intervint Hans, cette maudite poudre est un dissolvant incroyable. Elle jette la zizanie entre nous. Et si cette situation dure, elle va nous brouiller tous. En voilà assez ! Puisque la Beauté refuse de s’allier avec la Force, il n’y a qu’à se résigner. Un point c’est tout !
— Allons-nous-en, dit Lichtenbach, il est déjà tard.
— Nous vous accompagnerons jusqu’à la barrière, pour qu’il ne vous arrive rien, père la Caisse. Les espaces ne sont pas sûrs, dans ce quartier-ci, la nuit… Bonsoir, Sophia, à un de ces jours.
— Bonsoir…
Elle tendit languissamment sa main blanche que le redoutable manchot toucha de sa main de fer immuablement couverte d’un gant.
— Vous ne me gardez pas, Sophia ? demanda gracieusement Agostini, qui voulait faire sa paix avec son utile amie.
— Non, mon cher, dit nettement la baronne. Vous m’avez donné sur les nerfs. Je ne vous supporterais pas… Bonne nuit.
Elle sonna. Milona parut.
— Éclaire ces messieurs, Milo.
Silencieusement ils sortirent, conduits par la dalmate qui tenait une lanterne ronde, avec laquelle elle jalonnait les détours sinueux de l’allée conduisant à la petite porte dissimulée dans le lierre. Elle leur ouvrit et disparut. Ils s’en allèrent par l’avenue Maillot, le long du fossé du bois, silencieux, et comme préoccupés. Brusquement, Hans s’arrêta, et d’une voix sourde :
— Elle se fiche de nous, la Sophia ! Mais ça ne se passera pas comme elle le croit. J’ai eu l’air de céder, pour mieux la tromper. Voici maintenant ce que nous allons faire, si vous m’en croyez. Cesare écrira un mot, avec une écriture déguisée, au jeune Marcel Baradier, pour lui donner un rendez-vous au boulevard Maillot, le soir, vers dix heures. Je serai présent, avec du monde sûr. Je me charge d’introduire le pigeon dans le colombier. Et, une fois là, il faudra bien que Sophia s’emploie, que cela lui plaise ou non. C’est toujours le plan que j’ai indiqué tout à l’heure et qu’elle a repoussé. Je ne lui demande pas la permission de l’exécuter, voilà toute la différence…
— Mais, dit Cesare, si le Baradier ne venait pas.
— Eh bien ! Il ne viendrait pas. Mais, vous qui connaissez la baronne, vous admettez qu’on ne vienne pas à un de ses rendez-vous d’amour ? Il y courra comme au feu, mon garçon. Et quand nous le tiendrons là…
— Que ferez-vous ? demanda Lichtenbach d’une voix grelottante.
— Ça, c’est notre affaire ! Mais rapportez-vous-en à nous pour délier la langue de ce joli jeune homme !
— Des violences ?
— Une persuasion irrésistible…
— Et s’il vous dénonce, en sortant ?
— Pourvu qu’il parle avant, il aura le loisir de causer après.
Lichtenbach frémit. Il sentit que Hans était décidé à tuer Marcel Baradier, et que le bandit poursuivait un double but : posséder le secret et se venger de sa mutilation.
— Vous savez, dit-il, je n’en suis plus. À compter de maintenant, je répudie toute participation à vos actes. Je ne veux même pas connaître le résultat de votre opération… Vous me paraissez frappés de démence…
— Eh ! Croyez-vous que nous ayons jamais compté sur vous, pour autre chose que des avances de fonds ? dit railleusement le comte Cesare. Vous avez été notre poule aux œufs d’or, mais maintenant vous ne voulez plus pondre, allez au diable !
— Ne rusez donc pas avec nous, Lichtenbach, fit Hans. Vous savez bien que si nous réussissons, le brevet Dalgetty aura son plein effet. Par conséquent vous participerez aux bénéfices. Votre déclaration n’est donc qu’une nouvelle hypocrisie ! Vous repoussez les responsabilités, vous réservant d’accepter les bénéfices. Allez, vieil ami, on ne vous les marchandera pas !
Ils arrivaient à la place où stationnait la voiture de Lichtenbach. Agostini ouvrit la portière d’un air gracieux :
— Sans rancune, mon prince, et de bons rêves.
Lichtenbach monta, la voiture partit. Pendant qu’il roulait sur l’avenue de la Grande-Armée, le banquier pensait : tout est péril dans ma situation. Si je laisse Hans poursuivre son entreprise, je puis être compromis de la façon la plus grave. Les Baradier n’hésiteront pas à m’accuser. Si j’ai la hardiesse de contrecarrer les projets de Hans, et qu’il le sache, il me dénoncera. C’est le moins que je puisse attendre de lui. Maudit soit le jour où je me suis embarqué avec ces gens-là ! Mais comment prévoir, qu’ils recourraient à des moyens aussi dangereux ? La baronne ne me l’a jamais laissé entrevoir. Elle-même s’y est opposée… Ah ! cette situation est inextricable ! Si je prévenais Sophia ? Mais cela me découvre du côté de Hans, qui me soupçonnera tout de suite de l’avoir trahi. Et cela ne me couvre pas du côté des Baradier… Est-ce donc eux qu’il faut avertir ? Oui, si je leur rends le service de les renseigner discrètement sur le danger que peut courir leur héritier, je m’assure leur gratitude efficace… Ils sont incapables, en tout cas, de me vendre… Et c’est peut-être le salut ! Restent Hans et Agostini… Quelle responsabilité sera la mienne vis-à-vis d’eux ! Et ils sont capables de tout ! Dans quel guêpier me suis-je fourré !
Arrivé à sa porte, il n’avait pas encore résolu le difficile problème qui consistait pour lui à trahir ses amis de la veille, sans s’en faire des ennemis du lendemain, et à tirer son épingle du jeu, au moment où la partie devenait si scabreuse.
Pendant ce temps-là M. Mayeur, sur les indications de Baudoin, complétées par les renseignements du colonel Vallenot, avait marché. Le juge, qui réussissait toujours, avait à cœur de reconquérir aux yeux de ses supérieurs sa réputation d’infaillibilité. Il mettait à débrouiller cette difficile affaire tout son amour-propre. Il avait abandonné les instructions commencées. Ses prévenus languissaient au secret. Rien n’avait d’intérêt pour lui que ce qui concernait la baronne, Agostini et Hans. Depuis huit jours, il savait par le menu ce qu’était le comte Cesare. Il avait reçu des notes très complètes sur le personnage. Fort bien né, appartenant à une famille illustre, le seigneur Agostini avait dû quitter l’armée italienne, après une affaire d’honneur où il avait quelque peu assassiné son adversaire. Une vétille : un pistolet qui était parti avant le signal. Les témoins avaient mal pris la chose. Cesare mécontent, après quelques provocations inutiles, s’était expatrié, et depuis, il vivait sur le pied de deux cent mille francs de rentes, sans posséder d’autres ressources qu’un joli physique.
Quant à Hans il était impénétrable et introuvable. On connaissait le logis d’Agostini, point celui de Hans. On croyait avoir rencontré dans une réunion anarchiste un homme dont le signalement répondait à celui du bandit. Mais il n’avait pas le même accent, passait pour russe, et préparait un attentat contre le petit roi d’Espagne. Filé par l’agent, à la sortie de la réunion, où d’ailleurs sur deux assistants il y avait au moins un mouchard, le prétendu Hans s’était brusquement retourné, et, d’un seul coup, avait à moitié assommé son incommode poursuivant. Puis il avait disparu.
Quant à la baronne, par Agostini, on était arrivé tout droit à son habitation du boulevard Maillot. L’hôtel avait été loué tout meublé. Elle vivait là très tranquille, sous le nom de Mme de Frilas. M. Mayeur, ayant expédié un habile agent à Nice au baron Grodsko, avait obtenu sur Sophia un dossier complet. La haine et le mépris avaient coulé des lèvres du mari de l’aventurière. Grodsko, après boire, avait raconté tout ce qu’il savait, et ce n’était probablement encore qu’une partie de la vérité. Il s’était attendri en causant avec l’agent, devenu son ami à la table de jeu.
— Voyez-vous, cette femme-là mérite cent fois la mort ! Vous ne pouvez vous imaginer ce dont elle est capable. Comme je lui ai assuré ma fortune par une donation, elle a essayé à plusieurs reprises de me faire assassiner pour hériter de moi. Je n’ai dû la vie qu’à l’idée que j’ai eue de lui faire croire que j’étais ruiné. Maintenant qu’elle n’a plus d’intérêt à me supprimer, je puis espérer vivre… Je l’ai adorée, cette misérable, comme tous ceux qui l’approchent… Il n’est pas de femme plus séduisante. Elle mettrait à mal un saint, si elle voulait… Je ne crois pas qu’on puisse lui résister… En Autriche, elle s’est fait ouvrir les portes de sa prison par le juge même chargé d’instruire contre elle, dans une affaire de détournement qui devait lui valoir la réclusion perpétuelle… C’est un ange et un monstre à la fois… Vous entendez bien ce que je dis d’elle et ce que j’en pense. Eh bien ! je n’oserais pas, moi, qui vous parle, affronter sa présence… Je ne jurerais pas qu’elle ne serait pas capable de me faire commettre encore quelque folie ! Gardez-vous d’elle… C’est la créature la plus dangereuse qu’il y ait ! Vous me demandez si elle a porté le nom de Mme Ferranti, de comtesse Schlosser, de Mme Gibson… Je n’en sais rien… Mais c’est probable, s’il y avait quelque scélératesse à exécuter au moyen de ces divers avatars. Elle a une imagination diabolique, et ne recule devant rien.
Nanti de ses notes, M. Mayeur s’était rendu au ministère de la guerre, pour les communiquer au colonel Vallenot et lui demander le résultat de son enquête personnelle. Introduit aussitôt dans le cabinet du ministre, le magistrat avait vu confirmer par des détails supplémentaires les résultats acquis de son instruction. À mesure que la lumière se faisait sur la personnalité des acteurs du drame, la gravité de l’affaire entamée se confirmait plus nettement. On se trouvait, à n’en pas douter, en présence d’une association d’espionnage international, travaillant, depuis au moins dix ans, pour le compte de gouvernements étrangers et les exploitant peut-être tour à tour, en les trahissant au profit les uns des autres.
Il était possible que l’Europe entière eût été dupée, par ces habiles scélérats, en la personne de ses ministres les plus importants. Et il n’était rien moins que sûr que des révélations extraordinaires ne sortiraient point d’un procès intenté à des gens qui devaient être en possession de secrets, armés de documents, et garantis par la connaissance approfondie de certaines tares gouvernementales. On en avait référé en haut lieu. Dès le premier abord, des scrupules diplomatiques s’étaient manifestés. On était en bons rapports avec tous les États européens. Les relations avaient une tendance à se faire plus amicales. Des traités de commerce étaient en préparation. Enfin l’Exposition, trêve consentie par le monde entier, allait rapprocher tous les peuples. Était-il bien opportun de soulever les voiles qui entouraient des manœuvres, à coup sûr déplorables en elles-mêmes, mais qui deviendraient plus déplorables encore par leur divulgation ? Il y fallait penser mûrement.
Et comme c’était aisé, quand la situation était brûlante ! Quand le moindre faux mouvement pouvait donner l’éveil aux coupables et les faire disparaître !
M. Mayeur en pâlissait de contrainte. Le rude et intègre soldat, qui occupait le ministère, en jurait dans sa moustache. Mais comment se soustraire à des nécessités politiques aussi impérieuses ? Le colonel Vallenot, le premier, eut le courage de parler net :
— Il est, dès à présent, certain, mon général, que nous tenons la Ténébreuse, comme nos agents la nomment. C’est bien la femme dont je vous parlais, il y a quelques mois, au début des recherches. Celle des affaires Cominges, Fontenailles, etc. La coquine est au bout de notre bras. Nous n’avons qu’à faire un geste : elle est à nous. Allons-nous la laisser échapper ? Croyez-vous cela possible ?
— Eh ! Ce sont ces sacrés formalistes, avec leur politique, qui font des histoires ! grogna le vieux chef. Si j’étais seul pour décider, ça ne traînerait pas ! Mais ces parlementaires, ces avocats, ces ergoteurs m’ahurissent. Je ne me retrouve moi-même qu’au milieu de mes officiers ! Qu’est-ce que vous dites, vous, monsieur le Juge ?
— Je déclare, monsieur le ministre, que je suis prêt, moi, à signer le mandat d’arrêt et à le porter au parquet…
— Eh ! Votre chef vous arrêtera ! Savez-vous, Vallenot, ce qu’il faudrait : un bon coup de filet sur la maison de Neuilly, habilement préparé… Les brigands résisteraient… Alors les agents n’iraient pas, je suppose, se laisser tuer comme des serins ? On profiterait de la bagarre pour massacrer tout ! La femme avec. C’est une chienne enragée.
M. Mayeur eut un mince sourire.
— C’est un peu trop militaire, mon général… Il ne s’agit point d’un assaut, mais d’une descente de police. La justice ne s’accommode pas de ces formes expéditives…
— Alors, faites ce que vous voudrez et ne nous demandez pas notre avis. Voulez-vous que je vous tire votre bonne aventure : avec tous les atouts dans la main, vous allez vous laisser faire capot !
Au même instant la porte s’ouvrit et l’huissier apporta une carte au colonel Vallenot. Celui-ci la passa au ministre, qui s’écria :
— Marcel Baradier ! Faites-le entrer ! Il arrive à propos.
Le jeune homme paraissait, il s’inclina devant le grand chef qui lui tendait la main, salua le colonel, le juge, et sans préambule :
— Mon général, j’ai pris l’engagement de vous tenir au courant de ce qui se produirait de nouveau, je viens tenir ma promesse. Et je suis bien aise que M. le juge d’instruction soit présent…
— Eh bien ! mon petit, expliquez-vous…
— J’ai reçu ce matin, mon général, la lettre que voici.
Il posa sur le bureau une feuille de papier, que le ministre examina avec attention :
— Pas de chiffre, un format courant, du papier très ordinaire, une écriture évidemment contrefaite, et aucune signature. Voyons maintenant la teneur : « Si vous avez le désir de revoir celle que vous savez, et qui vous aime toujours, allez ce soir, à dix heures, place de l’Étoile, au coin de l’avenue Hoche… Une voiture sera arrêtée. Montez dedans, le cocher ne vous demandera aucune indication, et vous conduira où vous êtes attendu. »
— Bien… Excepté qu’il n’y est point question de vous bander les yeux, le procédé est classique… Qu’avez-vous résolu de faire ?
— J’irai au rendez-vous.
— Ah ! ah ! Et sans appréhension ?
— Ça, mon général, c’est une autre affaire. Mais, avec ou sans appréhension, j’irai. Je suis résolu à avoir le mot de cette énigme, et je l’aurai.
Le juge intervint doucement :
— Laissez-moi vous faire observer, monsieur, que votre résolution est imprudente au premier chef… Il y a quatre-vingt-dix-neuf chances sur cent, pour qu’on essaye de vous attirer dans un piège… Je sais de quoi sont capables les gens à qui vous voulez vous confier si facilement… Je ne saurais trop vous déconseiller de donner suite à votre projet. Nous avons eu déjà assez de malheurs à déplorer, depuis le commencement de cette infernale instruction. N’ajoutez pas à nos regrets en vous exposant à des dangers probables, pour un résultat incertain…
— Si c’est elle qui m’écrit, je n’ai rien à craindre.
— Fichtre ! s’écria le général, vous êtes bien affirmatif !
Marcel répondit doucement :
— Vous pouvez avoir sur cette femme l’opinion que vos renseignements vous ont permis de vous former… Moi, je ne puis oublier l’accent de sincérité de ses paroles… Menteuse avec les autres, elle a été véridique avec moi… Traîtresse pour tout le monde, je ne le conteste pas, mais, pour moi, fidèle et dévouée.
— Voilà ! s’écria le général, voilà ! Il est convaincu de ce qu’il dit ! Est-elle forte, cette mâtine-là ! Elle leur persuade à tous qu’elle est sincère avec eux. Et tous la croient ! Mais, sacrebleu, mon ami, vous m’avez raconté, à moi-même qu’elle vous avait joué une comédie abominable, qu’elle vous avait soutiré des explications sur les documents enfermés dans votre laboratoire, et que, pendant qu’elle vous embrassait, elle faisait prévenir un complice pour qu’il pût vous dévaliser à loisir. Ce n’est pas moi qui ai inventé cette histoire-là ! C’est vous qui me l’avez racontée, que diable ! Je ne suis pas encore gâteux ! Et vous, vraiment, vous êtes d’une confiance qui confine à la naïveté.
— Mon général, je n’ai rien à répondre. Vous avez raison. Mais, malgré tout, je vous atteste que je peux compter sur elle, et que, si c’est de sa part qu’on vient me chercher, je n’ai rien à craindre…
— Mais si c’est de la part des autres ? Si c’est un guet-apens qui vous est préparé par les gredins qui gravitent autour de cette belle fille ? Allez-vous, comme une alouette, vous mirer dans ses yeux, pour vous faire canarder par ses complices.
— J’en courrai la chance !
Le vieux soldat frappa sur son bureau :
— Vous êtes brave ! J’aime cette crânerie ! Vallenot, voilà un joli garçon ! Le diable m’emporte, si dans mon temps, je n’en aurais point fait autant à sa place ! Eh bien ! C’est entendu, allez-y. Mais nous, de notre côté, nous allons prendre des mesures de précaution, pour que vous soyez appuyé et défendu, s’il y a lieu.
— Ah ! mon général, je vous en prie, ne vous occupez de rien ! Pas d’intervention, cela perdrait tout ! Si je vais à un rendez-vous d’amour, je n’ai pas besoin qu’on m’escorte et qu’on me protège. Si je vais à un guet-apens, soyez sûr que ceux qui l’ont préparé ont l’œil ouvert et qu’ils s’apercevront de vos préparatifs. Vous augmenterez donc le danger que j’aurai à courir, sans que je profite de votre aide… Si j’ai une chance de me tirer d’affaire, c’est d’aller là, seul, ou avec un homme à moi, mais sans police… Je serai armé, soyez tranquille… Et on ne viendra pas à bout de moi très aisément…
— Savez-vous où habite la dame ? questionna curieusement le juge.
— Non, monsieur. On ne me le dit pas dans la lettre, comme vous avez pu le voir.
M. Mayeur, d’un clignement d’œil, recommanda le silence au colonel et au ministre, puis il dit du ton le plus mesuré :
— Mon cher monsieur, je ne trouve pas vos raisons dénuées de sens. Je vous ai fait entendre les conseils de la prudence. Je ne puis vous imposer de les suivre. Il vous plaît d’aller à ce rendez-vous. Allez-y donc. Et ne craignez point que j’intervienne, pour vous faire courir des dangers supplémentaires. Mais, comme il faut toujours envisager le côté pratique des choses, quel résultat poursuivez-vous, en obéissant à la convocation de cette redoutable personne ? Est-ce un éclaircissement moral, ou une satisfaction purement matérielle ?
— Monsieur, dit gravement Marcel, le général de Trémont était mon ami, sa mort n’est point vengée. On a incendié notre filature et risqué de nous brûler dedans, mon oncle Graff, mon domestique et moi. Ce crime n’est point puni. On a assassiné un brave homme qui nous aidait a surveiller les coupables, et ce bon serviteur a disparu en pure perte. C’est la lumière sur tous ces faits que je vais chercher au péril de ma vie. Et je vous donne ma parole que, quand je serai édifié, rien ne pourra m’empêcher de châtier les criminels, soit que je vous les livre, soit que je les frappe moi-même. Entre eux et moi, c’est un duel. Ils le savent et je le sais. Nous verrons qui l’emportera.
— C’est bien, monsieur, je vous remercie. Je n’ai plus qu’à vous souhaiter bonne chance.
Marcel salua, serra la main des trois hommes, et, comme il sortait, il entendit le vieux chef qui disait avec émotion :
— Sacrebleu ! c’est un vrai Baradier, ce petit-là ! Il a du sang ! Mais il s’aventure beaucoup !
Aussitôt la porte refermée, l’attitude du calme M. Mayeur changea. Il se leva avec agitation et s’écria :
— Eh bien ! mon général, l’occasion que vous demandiez de prendre tous ces scélérats d’un seul coup de filet, la voilà. Vous ne doutez pas plus que moi qu’il s’agisse d’attirer M. Baradier dans la maison du boulevard Maillot, pour exercer sur lui je ne sais quelle contrainte ? Vous disiez tout à l’heure : « il faudrait amener ces gens-là à résister, et les massacrer. » Sans aller jusque là, je crois que nous allons avoir un bon flagrant délit qui simplifiera bien toute notre procédure.
— Mais vous avez promis à ce garçon de ne pas vous mêler de ses affaires ! se récria le colonel Vallenot.
— Aussi, ne vais-je pas m’en mêler. Je le laisse faire à sa guise. Il ne sera pas suivi. Les gens, vers lesquels il se dirige, ne seront pas filés. Je laisse à nos adversaires toute leur sécurité et partant toute leur audace. Mais je ne me désintéresse pas de ce qui se prépare. Ce serait vraiment trop bête ! Je ne veux pas, comme le jeune Baradier, faire de la chevalerie avec des bandits. Voici le plan que j’ai conçu : le rendez-vous est pour dix heures, je ne bouge pas avant. Il fera nuit. Vous connaissez la situation du boulevard Maillot, un fossé le sépare du bois de Boulogne. Cachette admirable pour embusquer des agents qui entrent par le bois et qu’on ne peut voir se rendre à leur poste. J’ai sous la main un brigadier de la Sûreté, qui est aussi intelligent que résolu. Je lui donne mes instructions. Il attend silencieux et aux aguets. Ou M. Baradier a raison, et il va à un rendez-vous d’amour. Et mes hommes en sont quittes pour une nuit passée en plein air. Ou M. Baradier se trompe, et il va au-devant d’un danger réel. Alors, vous le lui avez entendu déclarer : il sera armé, il se défendra. Au premier cri, au premier coup de feu, mes hommes envahissent la maison et font main-basse sur tout ce qui s’y trouve. Si on les menace, ils résistent ; si on les frappe, ils ripostent. Et l’affaire, que la diplomatie le veuille ou non, du moment qu’il y a flagrant délit, doit suivre son cours.
— En tout cas, vous ne laissez pas égorger ce petit Marcel. Et surtout vous tâchez de mettre la main sur la femme…
— Qu’en pensez-vous, mon général ?
Le vieux soldat interrogé regarda le juge, puis son chef de cabinet. Il vit Vallenot impassible et reprit sa physionomie officielle :
— Vous ne me demandez pas mon avis, je suppose ? Toutes ces opérations judiciaires ne sont pas de ma compétence… Nous avons causé, mon cher juge, rien de plus. Agissez comme bon vous semblera, moi je n’ai rien à vous dire.
Le magistrat hocha la tête avec un sourire railleur, puis prenant son chapeau :
— Oh ! je sais ! Tant que le coup de main n’aura pas été exécuté, personne ne voudra en être… S’il réussit, oh ! alors, il n’y aura plus que moi qui n’y serai pour rien ! Mais peu importe ! C’est mon devoir. Je n’hésite pas ! Votre serviteur, mon général.
Et il s’en alla reconduit par le colonel Vallenot.
XV
Il était neuf heures et demie environ, et l’oncle Graff ayant dîné rue de Provence, comme d’habitude, s’apprêtait à partir pour rentrer chez lui. Il descendait par l’escalier des bureaux, afin de prendre dans son cabinet des papiers dont il avait besoin pour terminer un compte, lorsque Baudoin s’avança vers lui d’un air mystérieux et à voix basse lui dit :
— Il y a là deux dames, dont l’une demande à parler à M. Marcel. Je lui ai fait connaître que M. Marcel n’avait pas dîné à la maison. Elle a paru très contrariée et m’a prié alors de lui dire où elle pourrait le retrouver…
— Qu’est-ce que c’est que cette femme-là ? interrogea l’oncle.
— Oh ! Monsieur, une personne très bien !… L’autre doit être la gouvernante ou la dame de compagnie…
— Où sont-elles ?
— Dans l’antichambre.
— Allumez dans mon cabinet, et faites-les y entrer.
Baudoin s’élança. L’oncle Graff continua à descendre en murmurant :
— Qu’est-ce que c’est encore que cette histoire-là ? Toujours des femmes, avec ce petit mâtin de Marcel ! Quelque maîtresse qui vient faire des simagrées…
Il entra dans son cabinet. Debout, près de la porte, une jeune femme vêtue de noir, voilée et fort émue, attendait. L’oncle Graff fut bien disposé par le premier aspect. Il offrit un siège et dit avec bonté :
— Vous avez demandé à voir mon neveu, madame ?… Mais il n’est pas ici… La raison qui vous amène exige-t-elle sa présence ? Ne puis-je, à son défaut…
Il ne put achever. La jeune femme avait fait un geste de supplication :
— Monsieur, il s’agit d’une question de vie ou de mort…
— Pour qui ? demanda vivement l’oncle Graff.
— Pour votre neveu !
— Comment en êtes-vous informée ? Et qui donc êtes-vous ?
La visiteuse répondit aussitôt :
— Je suis Mlle Lichtenbach, monsieur, je me mets à votre discrétion.
Et, en même temps, elle enleva son voile. L’oncle Graff stupéfait reconnut la fille de son ennemi. Elle était pâle et tremblante, mais résolue. Il se rapprocha d’elle et questionna anxieux :
— Qui vous envoie ?
Elle répliqua avec fermeté :
— Mon père.
Elle arrêta d’un regard les commentaires de l’oncle :
— Il a pensé que s’il se présentait lui-même, peut-être vous ne le recevriez pas. Et il y a urgence. Monsieur votre neveu court, en ce moment peut-être, le plus grave danger. Et mon père, qui vient de l’apprendre, m’a chargée de vous en avertir.
— Mais comment est-il renseigné ? reprit Graff avec défiance.
— Ah ! Monsieur, commencez par prendre des mesures pour secourir M. Marcel, dit Marianne avec feu. Après, vous vous édifierez, tout à votre aise… Il court un danger terrible, vous dis-je…
— De la part de qui ?
— De la part des mêmes gens qui ont tué le général de Trémont. Voilà ce que je suis chargée de vous apprendre. Et cela doit vous éclairer suffisamment… Mon père a été mis au courant de ces menées, qui lui font horreur, et qu’il vous dénonce. Agissez, sans perdre une minute… La nuit ne s’écoulera pas peut-être sans qu’un crime nouveau ait été commis !
— Mais où aller, pour s’opposer à ces abominables projets ? s’écria l’oncle Graff gagné par l’émotion de la jeune fille.
— Je vais vous l’expliquer… Attendez que je me souvienne bien de ce qui m’a été dit…
Elle passa la main sur son front, avec un geste douloureux :
— Ah ! c’est cela… Une femme, qu’il a connue à Ars…
— L’Italienne ?
— Oui, sans doute. Ce doit être elle. Il l’a aimée, et on sait qu’il serait heureux de la revoir…
Elle s’arrêta. La pâleur de son visage augmenta. Ce qu’elle racontait là paraissait la torturer :
— Alors on lui a écrit, pour lui donner un rendez-vous… Et, dans une maison écartée, ce soir, on l’attend… Mais ce n’est pas celle qu’il espère retrouver, ce sont des scélérats, prêts à toutes les violences pour le contraindre à révéler un secret qui leur échappe… Comprenez-vous maintenant ?
— Oui, très bien. Mais la maison, où est-elle située ?
— Tenez, voici l’adresse écrite sur ce papier.
Graff lut rapidement :
— Boulevard Maillot, 16 bis. Et vous dites qu’on l’attendait vers dix heures ?
— Vers dix heures.
Comme évoquée par ces paroles, l’heure sonna à la pendule.
— Ah ! mon enfant, s’écria l’oncle, pourquoi n’êtes-vous pas venue plus tôt… Arriverai-je à temps ?
— Nous n’avons pas perdu une seconde. Le hasard seul a mis mon père au courant de ces projets… On se défie maintenant de lui autant qu’on pourrait se défier de vous-même… Il encourt une redoutable responsabilité !…
Graff sonna. Baudoin parut.
— Vivement, Baudoin, une voiture. Vous m’accompagnerez. Avez-vous un bon revolver ?
— Oui, monsieur.
— Prenez-le. Du train, et pas un mot à qui que ce soit. Je vous retrouve dans la cour. Dix heures !… Nous arriverons quand même… Et s’ils ont fait du mal à l’enfant, malheur à eux !…
Baudoin était déjà parti. Marianne immobile regardait l’oncle Graff faire ses préparatifs. Il prit une liasse de billets de banque, un revolver, une canne armée d’une lourde pomme d’acier. Puis il parut se souvenir que Mlle Lichtenbach était là. Il vint à elle et avec effusion :
— Mon enfant, je vous remercie du service que vous nous rendez… que votre père nous rend… Voilà qui efface bien des choses… Dites-lui qu’il peut compter sur ma discrétion absolue. Jamais nul ne saura par qui j’ai été prévenu du danger que court mon pauvre Marcel…
— Oh ! Monsieur, s’écria Marianne, les yeux pleins de larmes, sauvez-le, c’est tout ce qu’il faut !
Graff regarda la jeune fille, vit son visage bouleversé par l’angoisse, ses mains jointes pour une prière. Il se rappela les propositions de l’abbé d’Escayrac et la rencontre de Marcel avec Marianne à la vente des Alsaciens-Lorrains. Le soupçon que la fille de Lichtenbach était entraînée par un sentiment plus vif que la pitié, pénétra dans son esprit. Il soupira. Sa vieille âme romanesque s’émut, et parlant avec une douceur respectueuse :
— Il apprendra, mademoiselle, ce que vous avez risqué pour lui… Je sais tout ce qu’a dû vous coûter la démarche que vous faites… Car il a fallu que vous vous expliquiez avec votre père, et vous avez pu comprendre bien des choses que vous auriez dû toujours ignorer… Merci encore, avant que Marcel vous remercie lui-même…
Marianne eut un triste sourire :
— Je rentre demain au couvent, monsieur, et sans doute pour toujours. La vie est désolante et affreuse… Monsieur votre neveu ne me rencontrera plus jamais !
Elle remit son voile, passa devant Graff, rejoignit sa compagne dans le vestibule, et après un salut silencieux disparut dans la cour. Graff ne s’attarda pas davantage, il s’élança dans la rue, comme le coupé de Mlle Lichtenbach s’éloignait. Baudoin près d’un fiacre, la portière ouverte, attendait. Graff sauta dans la voiture et dit :
— À la Porte Maillot… Et toi, mon garçon, monte à côté de moi, nous avons à causer tous les deux, pendant le trajet. Cocher, cent sous, si nous arrivons avant vingt minutes…
— Le canard est bon ! Roulez ! cria le cocher. Et le fiacre partit à fond de train.
Marcel ne s’était jamais senti si calme que le soir où il s’acheminait vers la place de l’Étoile, pour chercher la voiture qui devait le conduire à son rendez-vous. Il avait dîné au cercle, causé très librement avec ses camarades, fumé un excellent cigare dans la grande salle en regardant jouer au bridge. À neuf heures et demie, il avait pris congé, et, sa canne sous le bras, il avait monté à pied l’avenue des Champs-Élysées, respirant avec délices les parfums des massifs rafraîchis par la nuit. Il allait d’un pas cadencé dans la tranquillité de la large avenue. Sur la chaussée, des voitures descendaient vers Paris, trouant l’obscurité des clartés de leurs lanternes. Sous le couvert des arbres, Marcel était presque seul.
Il pensait, avec curiosité, à ce qui l’attendait au rendez-vous. Étaient-ce, comme le lui avait laissé craindre le juge d’instruction, des gens malintentionnés ? Était-ce, et combien plus probable, la femme énigmatique dont il soupçonnait l’infamie, mais dont il connaissait l’amour ? La brune et somptueuse beauté de la spectatrice de l’autre soir, à l’Opéra, se confondait, dans son souvenir, avec le charme suave et blond de l’habitante de la Cavée. Mais que ce fut l’une ou l’autre, il la retrouvait toujours aussi passionnée, aussi ardente, avec cet abandon sincère qui protestait contre les accusations de duplicité que tous, et lui-même, portaient contre elle. Et c’était la saveur délicieuse de ses lèvres nouées à sa bouche, la palpitation éperdue de son cœur quand elle l’avait serré dans ses bras, l’effroi et la joie de ses regards en l’apercevant à son entrée dans la loge.
C’était tout cela qui lui donnait la résolution ferme et froide d’aller au rendez-vous pour obtenir enfin le mot de cette vivante énigme. Il avait vingt-cinq ans, il se sentait vigoureux, se savait brave, il pensait qu’on ne viendrait pas à bout de lui si facilement et il était prêt à affronter tous les dangers de l’entreprise. Il arriva à la place de l’Étoile, vit au coin de l’avenue Hoche une voiture qui stationnait. Il s’approcha, l’examina : coupé de cercle, sans aucune marque distinctive, cocher à demi endormi sur son siège. Il dit :
— Vous attendez quelqu’un ?
— Oui, monsieur.
— Ce quelqu’un, c’est moi.
— Bien.
Il monta. La voiture partit, enfila l’avenue de la Grande-Armée, tourna à la Porte Maillot, roula encore deux minutes, puis s’arrêta dans une avenue obscure, à la porte d’un jardin. Marcel descendit. La voiture partit. Aussitôt une petite porte dissimulée dans le lierre s’ouvrit, et un valet en livrée parut. Marcel le suivit vers une maison qui se dressait sombre, avec une seule fenêtre faiblement éclairée au premier étage. Il gravit les marches d’un perron, entra dans une antichambre dont la porte était garnie de volets qui ne laissaient passer aucune lumière au dehors. Le domestique monta silencieusement un escalier, et introduisit Marcel dans un boudoir tendu d’étoffe claire. Une lampe électrique posée sur la table éclairait la pièce. Sans bruit son guide se retira, et le jeune homme se trouva seul.
Il écouta dans le silence de la maison. Aucun mouvement, aucune parole. Il posa son chapeau et attendit. Soudain, dans la pièce voisine, une exclamation retentit, un pas rapide glissa sur le parquet, une porte sous tenture s’ouvrit brusquement, et, le visage crispé par une émotion violente, Sophia parut sur le seuil. Elle ne dit pas un mot, mais ses regards exprimaient la terreur. De la main elle prit Marcel par le poignet, l’attira dans la pièce d’où elle sortait, et qui était une chambre à coucher, tourna vivement la clef dans la serrure, poussa les verrous d’une autre porte et saisissant le jeune homme dans ses bras, parlant bas, la bouche contre son oreille :
— Malheureux ! Comment êtes-vous venu ici ?
En même temps, et sans qu’elle parût avoir la force de s’en défendre, ses lèvres s’étaient attachées au cou de Marcel, et elle l’embrassait follement, frémissante, éperdue de crainte et de joie. Il lui répondit en souriant, mais sans lui rendre ses caresses :
— N’est-ce donc pas vous qui m’avez appelé ?
— Moi ! Grand Dieu ! Je donnerais dix ans de ma vie, entendez-vous, pour que vous ne soyez pas, en ce moment, dans cette maison… Ah ! les misérables ! Ils m’ont trompée ! Ce sont eux qui ont tout fait, malgré moi ! Contre moi !
— Ces misérables, qui sont-ils ? demanda Marcel, avec fermeté, en se détachant de Sophia.
— Ah ! ne m’interrogez pas ! Je ne puis, ni ne dois parler ! Les dangers que vous courez ici, sont déjà assez grands. S’ils soupçonnaient que j’ai pu vous révéler quoi que ce soit, il n’y aurait plus aucun espoir de vous sauver…
— Plaisantez-vous ? dit Marcel avec ironie. Croyez-vous agir sur mon imagination, avec des histoires de brigands ? Nous sommes en plein Paris, à deux pas du mouvement de la ville. Il y a des sergents de ville dans les rues. Et on ne se trouve pas, comme cela, exposé à des périls inévitables… D’ailleurs, rassurez-vous, je suis très bien armé, et si ceux que vous paraissez redouter pour moi veulent me menacer, j’ai là de quoi leur répondre…
— Pauvre enfant ! Vous ne les connaissez pas !
— Madame, votre frère serait-il parmi eux ?
Elle lui mit les mains sur la bouche, ses belles mains blanches, à la chair douce. Il se tut. Elle le reprit, le serra avec ardeur, les yeux pleins de larmes, balbutiant d’une voix changée :
— Oh ! Marcel ! Marcel !…
Elle blêmit, s’attacha à lui pour ne pas tomber, et, sans souffle, roula sa tête brune et parfumée sur l’épaule de celui qu’elle adorait.
Du dehors, un coup sec frappé sur le bois de la porte les rappela à la réalité :
— Écoute, dit Sophia…
Elle s’approcha de la porte, fit, en une langue étrangère, une question brève, à laquelle on répondit aussitôt. Elle parut rassurée et ouvrit en disant à Marcel.
— C’est Milo.
Milona entra et la porte fut refermée soigneusement.
— Ce sont eux qui t’envoient ? demanda Sophia.
— Oui, maîtresse.
— Je n’irai pas.
— Ils l’avaient prévu.
— Alors ?
— Ils m’ont chargé de vous répéter ce qu’ils exigent du jeune maître.
— Tais-toi ! Je ne veux pas qu’il le sache !
— Aimez-vous mieux qu’ils montent et qu’ils le tuent ?
Il y eut un silence. Sophia, avec un gémissement affreux, se tordit les bras. La rage impuissante, le désespoir exaspéré, bouleversaient son admirable visage.
Elle grinça des dents, s’élança vers la cheminée, y prit un poignard court et aigu, qu’elle brandit avec une adresse redoutable :
— Milo, tu ne m’abandonneras pas ?
— Vous le savez bien. Je mourrai pour vous !
— Marcel est armé ; nous sommes donc trois ! Oh ! Je le défendrai jusqu’au dernier soupir !
— Contre eux ? dit Milona. L’espérez-vous ? N’est-ce pas impossible ! Qui leur résisterait ? Ils sont en bas, dans la salle à manger, qui attendent prêts à tout !
— Oh ! mon Dieu ! Je suis folle ! Je les connais cependant ! Ah ! Marcel, imprudent, pourquoi êtes-vous venu vous mettre à leur merci ?
Elle jeta son poignard, s’assit accablée, la tête entre les mains et pleura. Marcel très calme, se tournant alors vers la Dalmate :
— Mais que veulent-ils de moi, en résumé ?
Milona interrogea sa maîtresse du regard. Sophia, immobile, ne lui défendant plus de parler, la servante s’expliqua :
— Ils veulent le secret, le fameux secret qui donne la valeur à la poudre qu’ils vous ont volée.
Marcel sourit, il fronça dédaigneusement les sourcils :
— Ah ! C’est là ce qui les met à l’envers. Je ne suis pas fâché d’être sûr qu’ils n’ont point su découvrir ce qu’ils ont tant d’intérêt à connaître… Milona, vous pouvez leur répondre qu’ils ne l’apprendront jamais de moi !
— C’est ce que nous verrons avant peu ! cria rageusement Agostini, derrière la porte.
— Ah ! Vous écoutiez, canaille, dit Marcel d’une voix vibrante. J’en suis bien aise, cela simplifie les choses ! Dites à vos acolytes que je ne les crains pas. J’ai sur moi une bonne arme qui me répond de la vie de six hommes… S’ils le veulent, je vais ouvrir la porte, et nous allons commencer la danse.
— Réfléchissez d’abord, répliqua une voix gutturale, celle de Hans. Il sera toujours temps de faire une sottise…
— Qui est celui-là ? demanda Marcel. Il paraît moins stupide que l’autre.
— On dirait que vous nous connaissez, railla le bandit. Patience ! Vous avez une demi-heure, pour vous décider. Si, dans trente minutes, vous ne nous avez pas donné satisfaction, je me charge, moi, de vous faire parler… La nuit est humide, il y a un bon feu qui chauffe en bas !
Sans précaution, désormais, des pas se firent entendre descendant l’escalier. Milona, silencieuse, sortit. Marcel et Sophia restèrent en présence. La pendule marquait dix heures dix minutes.
— Vous les avez entendus, dit Sophia. Maintenant vous savez ce qu’ils se proposent. Ils veulent votre secret…
— Eh bien ! Je le leur ai déclaré : ils ne l’auront pas…
Il regarda la jeune femme et sous ses yeux il la vit doucement frissonner. Il marcha vers elle, lui posa la main sur l’épaule, et lui parlant de tout près :
— Mais je veux connaître le vôtre…
— Le mien ? s’écria la jeune femme avec un geste d’épouvante.
— Oui. Qui vous êtes, ce que vous êtes. Je vous ai aimée, et je ne sais même pas votre nom. Je risque ma vie, ce soir, pour vous, et je ne sais si vous êtes une coupable ou une victime. Êtes-vous Mme Vignola ou la baronne Grodsko, ou les deux, et encore d’autres ? Car si je croyais tout ce qu’on rapporte, sur votre compte, vous seriez une sorte de Protée femelle, qui change de nom et de visage, et de voix, et cela dans les intentions les plus criminelles… Dois-je vous plaindre ou vous exécrer ? On dit que vous êtes un monstre. Votre âme est-elle donc aussi abominable que votre visage est charmant ? Vous m’avez interrogé, il y a un instant, sur les raisons qui m’avaient amené ici. C’était pour apprendre ce que je vous demande. Je veux, entendez-vous, je veux savoir quelle femme vous êtes…
Elle sourit, navrée :
— Une triste femme, qui t’aime et qui se perd pour toi…
— Paroles en l’air ! Que vous sont des bandits qui nous gardent à vue ? Quels actes atroces avez-vous commis ensemble ? Je veux tout savoir. Allons ! La vérité ! Vous dites que vous m’aimez ? La seule preuve que j’exige de cet amour, c’est votre sincérité.
Elle cria, le visage caché dans ses mains :
— Jamais ! Je te ferais horreur !
— C’est donc vrai, que vous êtes une effroyable créature ?
— Oh ! ne m’insulte pas ! Tais-toi ! Mon doux Marcel. Que je n’entende pas tomber de tes lèvres de menaçantes et injurieuses paroles ! Les autres, que m’importe ! Mais toi ! Oh non ! Que je sois atroce pour toute la terre, si je trouve encore dans ton cœur un petit coin où je ne serai pas méprisée !
— Vous le méritez donc ce mépris ?
Elle ne lui répondit pas. Il sentit la colère lui tendre les nerfs. Le sang lui monta aux tempes. Mais il demeura absolument maître de lui.
— Vous ne voulez pas parler ? Alors je vais interroger ceux qui sont en bas. Ils se feront, je crois, un plaisir de me renseigner sur vous…
Il marchait vers la porte. Elle bondit, le retint éperdûment, le força à s’asseoir et se mit à genoux à ses côtés :
— Insensé ! Tu ne crois donc pas encore au danger que tu cours ? Reste là, près de moi, c’est ta seule chance de salut…
Il la regarda jusqu’au fond des yeux et reprit son interrogatoire :
— Qui êtes-vous ?
Elle ne répondit pas, lui enlaça le cou de ses bras, lui mit, en souriant, sa bouche près de la moustache, et tout doucement, avec une caresse voluptueuse, l’effleura de ses belles lèvres. Il frissonna, mais ne se laissa pas égarer par les amoureuses tentatives. Il répéta :
— Qui êtes-vous ?
Elle gémit.
— Impitoyable ! Que t’ai-je fait ?
— Tu m’as volé mon amour.
Elle rit, d’un air égaré, en montrant ses dents éclatantes :
— Oh ! Tu ne me le reprendras pas ! Tu peux me haïr, si tu veux, mais les souvenirs de la petite villa et des bois de Bossicant sont à moi. Et, même morte, ils demeureraient à moi !
— Si tu ne parles pas, c’est que tu sais bien que je te mépriserais tant que, de ce passé de bonheur, il ne resterait rien dans mon souvenir, si ce n’est du dégoût !
Elle se redressa orgueilleuse :
— Pauvre Marcel, tu te trompes, tu m’aimerais encore ! Et tu en souffrirais tellement que je ne veux pas, que c’est pour cela, uniquement, que je ne veux pas te répondre. Nul ne m’a jamais dédaignée… Tu sais bien ce qu’est mon amour. Tu me le demanderais encore, même si je t’avouais que je suis une criminelle et une infâme ! Et tu te souillerais alors, mon chéri, mon adoré. Tu m’aimerais encore, mais tu ne serais plus le doux Marcel, que j’ai préféré à tout, pour qui je donnerais ma vie. Je te verrais à la fois ardent et amer, enivré et mauvais. Je ne le supporterais pas ! Non ! non ! Cesse de m’interroger… Si cela me plaisait, rien ne pourrait te détacher de moi. Je connais bien mon pouvoir. Je te ferais ma confession entière et, après, tu reviendrais, comme avant, dans mes bras… Mais tu serais honteux de ton plaisir, malheureux de ta faiblesse. Toutes tes joies seraient empoisonnées. Voilà pourquoi je me tais. Au lieu de me le reprocher, remercie m’en. C’est la première fois que je suis généreuse. Mais je n’ai aucun mérite, puisque c’est pour toi !
Elle le regardait, en parlant ainsi, et sous la caresse de ses yeux, Marcel sentait toutes ses résolutions se dissoudre, une langueur l’enivrait et il perdait la faculté de vouloir. Il pensa : elle a raison. Je lui appartiens bien plus que je ne le crois moi-même. Je serais sans doute capable de la complaisance dégradante dont elle me menace. Je sais, à n’en pas douter, qu’elle a commis les actes qui lui sont reprochés. Elle n’avoue rien, mais elle ne nie pas. Trémont est mort par elle, Laforêt aussi. Elle a trempé dans l’assassinat, le vol, l’incendie. Elle a vécu, agi, menti, sous vingt noms différents, elle s’est donnée à tous ceux qu’il lui a été utile de séduire. C’est une fille, qui s’est prostituée pour les plus infâmes motifs. Il n’y a pas, dans l’égout du vice, de plus sale créature qu’elle. Et je ne la rejette pas loin de moi, elle me dompte, m’affole… Non ! non ! Je ne le veux pas… Il fit un effort pour se relever, pour repousser la corruptrice. Elle le serra plus étroitement. Il l’entendit qui murmurait d’une voix à laquelle on ne résistait pas :
— La mort est autour de nous… Oublions tout ce qui n’est pas notre désir et notre joie… Ne pense plus, ne cherche plus à te torturer le cœur… En un instant, je puis te payer de toutes tes angoisses et t’emporter dans un rêve délicieux.
Il voulut l’écarter encore. Mais deux lèvres de volupté étouffèrent ses dernières paroles de refus. Et dans un grand soupir, il s’abandonna.
Le temps avait passé, le mépris du danger s’était fait absolu, le silence heureux régnait, profond, autour des deux amants, lorsqu’un tumulte violent arracha Marcel des bras de l’ensorceleuse. C’étaient, dans la maison, un bruit de pas, et, au dehors, des cris d’appel.
Une porte battit, tout à coup, comme si elle avait été arrachée de ses gonds, puis un coup de feu éclata. En même temps une voix forte se fit entendre, bien connue de Marcel :
— À moi, Baudoin, à moi !
Puis une autre détonation, et des jurons éclatèrent. Marcel, debout, cria :
— C’est mon oncle Graff… Mon Dieu ! On le tue !
— Reste ! N’y va pas ! supplia Sophia, en essayant de le retenir.
Il ne lui répondit même pas. Il s’élança dans le corridor, trouva l’escalier et, au milieu d’une demi-obscurité, aperçut dans le vestibule au rez-de-chaussée un groupe de trois hommes luttant contre Graff qui, enlacé, à demi étouffé essayait en vain de se servir de son revolver. Devant la porte d’entrée Hans et Baudoin étaient aux prises. Le brave serviteur avait le front rayé d’une balafre sanglante. Mais il avait pris le terrible manchot à bras le corps et le maintenait non sans peine.
Par dessus la rampe, Marcel ajusta un des trois hommes qui étranglaient l’oncle Graff. Le coup partit, l’homme tomba. Au même moment une détonation éclata derrière Marcel, et une balle lui cingla l’oreille. Le temps de se retourner, il se trouva en face d’Agostini, qui s’apprêtait à redoubler. D’un coup sec, il releva l’arme, saisit l’Italien par la ceinture, l’enleva comme un paquet, et avec une rage qui doublait sa vigueur, il le lança dans la cage de l’escalier. Le joli Cesare tournoya, en poussant un hurlement d’épouvante, s’abattit sur la rampe de fer forgé et resta plié, comme un pantin cassé, battant de ses jambes les marches qu’il arrosait de sang.
À cet exploit, Hans impuissant à frapper Marcel, qui descendait quatre à quatre les marches, rugit de fureur. Il secoua Baudoin avec une telle énergie qu’il lui fit lâcher prise. Il le mit sous son genou et déjà son bras de fer était levé, lorsque Marcel fondant sur lui, l’abattit d’un coup de pied dans le ventre. Mais le colosse se releva aussitôt. Il s’accula dans un coin et reprenant des forces, il cria :
— À moi, les autres !
Mais les autres avaient, maintenant, trop à faire. La police, attirée par les détonations, envahissait la maison. L’oncle Graff dégagé, arriva avec son revolver. Mais Baudoin d’une voix rauque cria :
— Monsieur Graff, laissez-le moi, il m’appartient ! C’est lui qui a tué mon général.
Le brosseur prit au vieil homme sa canne à pomme d’acier, dédaignant une arme à feu, qui aurait fait le combat inégal, et s’élança contre Hans. Le bandit blasphéma, se sentant perdu, il frappa un coup de son poing de fer, mais n’atteignit que le vide. Baudoin s’était vivement jeté de côté. La canne tournoya, la pomme d’acier s’abattit et Hans frappé à la tempe roula sur les dalles, assommé comme un bœuf. Ce fut le signal de la déroute. À un sifflement, les trois hommes qui résistaient encore sautèrent par les fenêtres, et s’évanouirent comme des ombres dans le jardin.
— Tout est cerné, ne vous occupez pas d’eux, cria le brigadier de la sûreté, qui rassemblait son monde. Ramassons les blessés et les morts.
L’oncle Graff voulut s’élancer vers Marcel, l’embrasser, le questionner, s’assurer qu’il était sain et sauf. Il ne trouva devant lui que Baudoin qui essuyait avec son mouchoir le sang et la sueur qui coulaient à la fois de son front. Marcel, aussitôt qu’il avait été sûr de l’issue de la lutte, n’avait plus pensé qu’à Sophia. Le danger, écarté pour lui, devenait terrible pour elle. La police, qui avait rétabli la situation en intervenant, pour le sauver, allait se manifester pour la perdre. Il remontait plus vite qu’il n’était descendu. Le temps qui lui appartenait était court, il le sentait.
Il se jeta dans la chambre, dont la porte était restée ouverte. Il poussa les verrous sur Sophia, avec autant de crainte qu’elle les avait poussés sur lui. Elle était restée debout, pensive, appuyée à la cheminée, comme se désintéressant des événements qui s’accomplissaient à l’étage inférieur. Milona était près d’elle, et lui avait sans doute appris la défaite de ses compagnons. Marcel s’élança, ardent et effrayé, vers elle :
— La police est dans la maison, ne le savez-vous pas ? Comment êtes-vous encore ici ?
— Je t’attendais, répliqua Sophia tranquillement.
— Mais vous vous perdez !
— Que t’importe ?
— Mais je n’y consens pas ! Je ne peux supporter l’idée que vous souffrirez, que vous serez menacée, tourmentée pour m’avoir défendu…
Le visage de Sophia s’éclaira.
— Veux-tu donc encore de moi ?
Il répondit avec fermeté :
— C’est impossible ! Vous le savez bien ! Après ce qui est entre nous ! Je ne dois plus vous revoir ! Je ne le puis ! Il ne le faut pas ! Pour vous-même…
Elle reprit son insouciance.
— Alors, abandonne-moi à mon sort !
— Non ! Je ne le veux pas non plus ! Vous, perdue à cause de moi, lorsque… Voulez-vous torturer ma pensée par un souvenir affreux ?
— Oh ! Mon Marcel, je voudrais te plaire, t’aimer, te posséder. Voilà le bonheur que je paierais bien cher…
Elle lui souriait, avec des larmes dans les yeux, si belle qu’il frémit encore. Il se détourna :
— Malheureuse ! Qu’allez-vous devenir ?
Elle lui montra une bague, dont le chaton était fait d’un grain d’or ciselé :
— Regarde ce grain d’or, il contient la liberté avec la mort. Dans un verre d’eau, son contenu versé… et tout est fini, sans souffrance…
Elle tendit la main vers un plateau qui contenait une carafe et un verre :
— Je te le défends ! cria Marcel éperdu.
Elle le regarda d’un air terrible, le visage resplendissant d’une ardeur plus qu’humaine :
— Rien, sans toi, dit-elle. Tout, avec toi ! Décide.
Il eut un cri de révolte :
— C’est impossible !
Elle eut un triste sourire :
— Réfléchis ! Tu sais ce que je suis. Je vivrai, si tu y tiens, mais pour être à toi… Je viendrai, quand tu me désireras. Je ne t’importunerai pas… Mais je te veux… Oh ! Toutes les expiations, tous les sacrifices, toutes les douleurs, pour être encore à toi !
Des pas ébranlèrent les marches de l’escalier. Marcel dit épouvanté :
— Ils viennent ! Ils vont te prendre ! Par grâce, si tu peux encore te sauver, va-t’en donc !
— Laisse-les venir. Ils ne me prendront que si je le veux bien… Je n’ai rien à craindre que de toi, c’est de toi seul que je dépends… Veux-tu que je vive ? Jure-moi que tu me reverras.
À cette minute précise, les pâles visages du général de Trémont, du pauvre Laforêt, et Agostini mort, et Hans étendu sur la pierre rouge de sang, s’évoquèrent devant Marcel, et il éprouva une insurmontable horreur. Il baissa la tête, sans répondre. Un léger choc contre le verre, le fit retourner. Il vit Sophia qui buvait. Il s’élança vers elle, lui arracha des mains le verre vide. Elle lui sourit et dit :
— Trop tard !
— Ouvrez ! Ouvrez ! crièrent derrière la porte des voix fortes.
Sophia eut encore la force de dire :
— Ouvre, Milona, maintenant.
La Dalmate obéit. Les yeux de Sophia se voilèrent, une pâleur s’étendit sur ses joues. Milona terrifiée n’eut que le temps de la soutenir : elle tomba avec un grand soupir et ses noirs cheveux déroulés lui couvrirent le visage, comme d’un voile funèbre.
— Où est la femme ? cria dans l’escalier la voix de M. Mayeur, qui arrivait essoufflé et triomphant. On ne l’a pas laissée fuir, j’espère ?
Il parut avec l’oncle Graff et resta pétrifié sur le seuil de la chambre.
Marcel montra au juge Sophia, qui achevait de mourir, et dit :
— La voilà !
La Ténébreuse, toujours insaisissable, s’était réfugiée, cette fois, dans les éternelles ténèbres.
XVI
L’échauffourée du boulevard Maillot fut prudemment passée au compte des drames de la jalousie. Une femme, que deux hommes se disputaient, et les rivaux s’entretuant sur le cadavre de la belle, tel fut le thème fourni aux rédacteurs de faits divers. Leur imagination fit le reste. Paris se passionna pendant douze heures pour cette magnifique tuerie dont les horreurs lui furent d’autant mieux décrites que nul n’avait été admis à les voir. La maison fut mise sous les scellés, et le triste M. Mayeur seul en fouilla les recoins obscurs. Il n’y trouva rien qui pût l’éclairer sur l’identité de Hans. Ni le service anthropométrique, ni les plus vieux limiers de police, ne découvrirent quoi que ce fût sur la personnalité mystérieuse du redoutable scélérat. C’était bien lui, l’homme au bras coupé, qui avait paru à Vanves avec Sophia dans la nuit où la maison du général avait été détruite. Mais qu’était-il d’autre ? La police internationale interrogée resta muette. Elle ne savait rien, ou ne voulait rien dire.
Sophia et Agostini, étaient connus. Les princes de Briviesca se chargèrent de renseigner le magistrat sur le mauvais sujet dont ils étaient fort aises de se voir débarrassés. Le comte Grodsko n’en pouvait raconter plus qu’il n’en avait confié à l’agent qui était allé le questionner à Monte-Carlo. Le juge d’instruction enragé de ne rien trouver, songea un instant à incriminer Lichtenbach. Il le manda à son cabinet, l’interrogea, essaya d’obtenir sur son compte quelques révélations de Baradier et Graff. Mais ceux-ci ne chargèrent point, comme on l’espérait leur vieil ennemi. Rivalité d’affaires, chicanes de banque, en somme rien qui fut délictueux. Ou bien alors il fallait faire cerner la place de la Bourse, de midi à trois heures, et arrêter tous ceux qui poussaient des cris affreux sous les colonnes. D’ailleurs, en haut lieu, on était intervenu immédiatement en faveur de Lichtenbach, et le juge d’instruction dut comprendre sans retard qu’il faisait fausse route. L’affaire de Vanves fut donc définitivement, cette fois, classée parmi les énigmes judiciaires.
Mais si ces tragiques événements ne devaient pas avoir de conséquences matérielles pour Lichtenbach ils en eurent de morales rapides et graves. Dans la huitaine qui suivit la mort d’Agostini et de Sophia, Mlle Lichtenbach entra au couvent des Augustines de la rue Saint-Jacques. Elle avait eu un entretien de deux heures avec son père. On la vit sortir, pâle mais résolue, du cabinet du banquier. Elias la suivait, courbé, tremblant, les joues trempées de larmes. Sur le palier, il essaya d’arrêter sa fille de ses mains suppliantes. Il balbutia :
— Mon enfant ! Ne sois pas inflexible !
Marianne baissa le front et dit :
— Je le voudrais, mon père. Mais comment arriver à racheter tout ce passé ?
Elle ne se retourna pas, descendit l’escalier de pierre, au bas duquel l’attendait la voiture qui devait la conduire rue Saint-Jacques. Elias poussa un gémissement et se pencha sur la rampe de fer. Un instant il parut près de se précipiter. Il cria d’une voix déchirante :
— Marianne… Marianne…
Elle leva la tête. Il lui tendit les bras en gémissant :
— Je n’ai que toi au monde ! Vas-tu donc oublier ton père ?
La jeune fille eut un triste hochement de tête, mais ne se rendit pas. Quelle explication terrible avait eu lieu entre le père et l’enfant ? Qu’avait dû avouer Lichtenbach, pour que Marianne se montrât ainsi irréductible ? Elle fit le signe de la croix, comme pour fortifier son cœur défaillant. Sa pâleur devint plus grande et d’une voix ferme elle dit :
— Je ne vous oublierai pas, mon père. Je prierai pour vous.
Elle monta dans la voiture, un roulement sous la voûte de l’hôtel, puis le silence, et Lichtenbach se trouva seul.
Il rentra à pas lents, dans son cabinet, et s’assit inactif et rêveur.
Il ne renonça cependant pas aux affaires. Il sembla au contraire y apporter une ardeur plus vive. Sa position sur les Explosifs liquidée, il se releva par une campagne foudroyante sur les mines d’or. Jamais ses opérations ne furent plus brillantes et plus heureuses que pendant les six mois qui suivirent le départ de sa fille. On eût dit que la douleur lui avait ramené la chance. Tout ce qu’il entreprenait réussissait. Il n’y paraissait prendre du reste aucune joie, et physiquement changeait beaucoup. Il ne pouvait plus monter les marches de la Bourse sans s’arrêter, et sa respiration était haletante. Il n’allait plus dans le monde. La petite duchesse de Bernay dit un jour :
— Que devient donc le cher Elias ? On m’a raconté qu’il était souffrant. Aurait-il le chagrin de se perdre ?
Rien n’était plus exact que ce pronostic si légèrement formulé. Un soir de l’hiver, en entrant, le valet de chambre trouva Elias penché sur son bureau et semblant dormir. Le domestique lui parla. Point de réponse. Effrayé il s’approcha, toucha son maître. Le banquier demeura immobile. Sa main tenait une courte lettre de sa fille, encore trempée de larmes. Il était mort, victime du seul sentiment qui le rendît vulnérable : son amour paternel.
Six mois plus tard, dans le cabinet de la rue de Provence, à la tombée du jour, l’oncle Graff et Marcel étaient assis. La signature du courrier terminée, Baradier venait de remonter chez lui.
L’obscurité envahissait peu à peu la pièce, et, enfoncés dans leurs fauteuils, ne parlant pas, le neveu et l’oncle n’apparaissaient plus que comme de vagues silhouettes. Les employés étaient partis, le silence régnait dans les bureaux.
— Oncle Graff est-ce que vous dormez ? demanda Marcel.
— Non, mon petit, je réfléchis.
— À quoi ?
— À ce qui nous est arrivé, depuis un an… Ce n’est pas rien !
— Vous pouvez le dire. Et quel est le résumé de vos réflexions ?
— C’est que nous avons eu une chance du diable ; que nous avions affaire à des gens qui devaient cent fois triompher de nous, et que manifestement nous avons été protégés par la Providence.
— Oncle Graff, vous êtes un peu incohérent : la chance du diable, d’un côté, la protection de la Providence, de l’autre… Tout ça ne va pas très bien ensemble !
— Oh ! Tu es sceptique, toi. C’est ta génération qui veut ça ! Vous ne croyez plus à rien.
— Je ne crois pas au hasard, non, dit ironiquement Marcel. Puis il ajouta avec une gravité soudaine : mais je crois à la ferme volonté des êtres… Et si nous avons été protégés, comme vous le dites, et, comme c’est vrai, du reste… C’est qu’on l’a voulu… Sans cela…
Il y eut un silence. L’obscurité était maintenant complète.
— On l’a voulu… répéta l’oncle Graff. C’est à cette femme que tu fais allusion ?
— C’est à « cette femme » en effet. C’est elle qui a fait échouer le plan de ses acolytes, et qui m’a sauvé…
— Parce qu’elle t’aimait ?…
— Parce qu’elle m’aimait.
L’oncle Graff soupira dans l’ombre, il bourra sa pipe, l’alluma, et dit :
— C’est la première fois que nous causons ensemble de cette malheureuse, depuis les événements… Ça ne te contrarie pas que je t’en parle ?
— Pas du tout.
— Eh bien ! Explique-moi un peu ce qui s’est passé entre vous pour qu’une coquine de cette volée se soit sacrifiée pour un garçon qu’elle rêvait de duper d’abord et de dépouiller ensuite… Car tu ne doutes pas qu’elle ait eu ces projets à ton égard ?…
— Je n’en doute pas.
— C’était une gaillarde, qui en avait vu de toutes les couleurs, n’est-ce pas, et qui en amour était comme ces ivrognes au gosier brûlé par les apéritifs, à qui il faut du vitriol pour leur procurer une sensation… Et pourtant…
— Et pourtant elle s’était éprise d’un petit jeune homme tel que moi… Eh bien ! C’était probablement parce que j’étais un petit jeune homme. Et que je la changeais de ses gredins… Une tasse de lait à un ivrogne, pour continuer votre comparaison…
— Et elle s’est tuée, sous tes yeux, pour toi ?
— Oui, oncle Graff, parce que je ne voulais pas lui promettre de la revoir.
— Et pourtant tu l’aimais ?
— Je l’aimais et elle me faisait horreur !… Si je l’avais revue, elle m’aurait conquis, possédé, perdu… Entendez-vous : perdu ! Je l’ai senti, à cette minute suprême. Moi honnête garçon, fils d’honnêtes gens, si j’étais resté soumis à l’influence de cette femme abominable et délicieuse, je suis sûr qu’elle aurait fait de moi un scélérat. Je ne l’ai pas voulu !
Il y eut un nouveau silence.
— Elle était bien belle et bien séduisante, n’est-ce pas ? demanda l’oncle Graff.
— La beauté et la séduction même… Une nature admirable, née pour être reine ou courtisane…
— Et crois-tu qu’elle aurait pu fuir, si elle l’avait voulu ?
— J’en suis sûr. Vous vous rappelez bien que, pendant les perquisitions qui ont été faites après la bagarre, la police a trouvé dans la cave un passage voûté qui communiquait avec une maison située sur l’avenue de Neuilly. C’est par là que les comparses se sont sauvés… Elle n’avait qu’à descendre par le petit escalier intérieur… En une minute elle était à l’abri… Il a fallu plus de deux heures pour enfoncer la porte de la cave.
— Ces gens-là avaient, dans leur coquinerie, des facultés d’organisation remarquables. Quelles forces perdues pour la société ! Les honnêtes gens sont toujours un peu bêtes…
— On ne peut cependant pas faire gérer les affaires publiques par des bandits, sous prétexte qu’ils sont plus malins…
L’oncle Graff soupira :
— Et penses-tu quelquefois à cette femme ?
— Continuellement.
— Tu la regrettes ?
— Ne s’est-elle pas dévouée pour moi ?
— Alors, c’est pour cela que tu es devenu si sérieux depuis six mois ?
— Oui, oncle Graff.
— Tu avais du chagrin ?
— J’en ai encore.
— Et puis, tu étais très occupé par la mise en train de l’affaire des Explosifs…
— Il y avait aussi cela…
— Sais-tu ce que tu devrais faire, maintenant, si tu étais raisonnable ?
— Je le sais très bien, mon père m’en a déjà parlé hier. Et c’est sans doute parce que je l’ai fraîchement accueilli, que vous revenez à la charge aujourd’hui…
— Eh bien ! oui, mon enfant. Il serait raisonnable de profiter du moment où tu es libre, rangé, sage, pour te marier…
— Avec Geneviève de Trémont ?
— Oui. C’est elle que ton père et ta mère t’ont toujours destinée… Tu leur ferais plaisir en l’épousant.
Marcel ne répondit pas. Il était immobile dans son fauteuil. La pipe de l’oncle Graff s’était éteinte. Le silence et l’obscurité devinrent funèbres. Après un instant, Marcel dit :
— Lorsque Mlle Lichtenbach vint ici, pour vous avertir qu’on m’avait tendu un guet-apens, elle était bouleversée…
— Hors d’elle-même.
— Et vous avez pensé, en la voyant, que son extraordinaire émotion était causée par l’intérêt particulier qu’elle prenait à moi… Vous me l’avez dit, du moins.
— Sans doute. Je m’y étais engagé vis-à-vis d’elle… Et puis, elle m’avait plu, cette enfant… Elle n’était pas banale… Et ce qu’elle a fait, le lendemain de cette aventure, m’a confirmé dans la bonne opinion que j’avais d’elle…
— Son entrée au couvent ?
— Oui, son départ de la maison de sa vieille canaille de père…
— Il est mort. Laissons-le en paix. D’autant plus qu’il est probablement mort du mépris et de l’horreur qu’il inspirait à sa fille.
— C’est vrai.
— De sorte qu’en somme, si Mlle Lichtenbach a disparu du monde, c’est à cause de moi. Cette enfant aura été payée de son dévouement et de sa tendresse par la perte de tout ce que la vie pouvait lui réserver d’heureux et elle est destinée à mourir pauvre, sous la laine grise, les cheveux rasés, en soignant les miséreux.
— Oui.
— Oncle Graff, est-ce que vous êtes d’avis que les enfants sont responsables des fautes de leurs parents ?
Le vieil homme ne répondit pas. Il s’agita dans son fauteuil, et le fourneau de sa pipe rallumée rougeoya dans l’ombre.
— Vous ne me répondez pas ? reprit Marcel. Vous êtes donc embarrassé ?
— Très embarrassé. À cette même place, un jour, j’ai dit à un envoyé de Lichtenbach, qui offrait la main de sa fille pour toi, que tous les Graff se lèveraient dans leur tombe si un Baradier épousait une Lichtenbach…
— Quoi ! s’écria Marcel avec émotion. Une pareille démarche fut faite ? Et vous ne me l’avez jamais dit ?
— À quoi cela aurait-il servi ? Tu comprends dans quels sentiments nous étions à cette époque, puisque j’ai fait cette réponse un peu emphatique et très bête… Ton père… Oh ! ton père aurait mieux aimé te voir… non pas mort, mais au diable, pour longtemps, que de te savoir allié à un Lichtenbach. Pense donc ! Le général venait d’être tué… La fabrique flambait encore ! Non ! non ! C’était impossible…
— Et aujourd’hui, oncle Graff ?
— Quoi ! Est-ce que tu y penses ? demanda le vieux sentimental d’une voix tremblante.
— J’y pense si bien, dit Marcel avec fermeté, que si Mlle Lichtenbach ne consent pas à devenir ma femme, je ne me marierai jamais.
— Mais pourquoi ? Pourquoi ? L’aimes-tu donc ?
— Je suis pour elle plein de respect et de reconnaissance… Elle m’a sacrifié tout ce qu’elle pouvait sacrifier en ce monde. Je suis son débiteur. Si vous avez, comme je le crois, de la tendresse pour moi, vous êtes ses débiteurs aussi. Les Baradier et Graff ne sont pas gens à ne pas payer leurs dettes, même s’il doit en coûter quelque chose à leur amour-propre.
Au même moment un léger claquement se fit entendre. C’était la porte qui se fermait :
— Qui est là ? demanda Graff vivement.
— C’est moi, calme-toi, répondit la voix de Baradier…
— Tu nous écoutais ?
— Non ! j’arrive. Mais j’ai entendu vos dernières paroles… Est-ce que vous tenez à rester dans le noir ?
En même temps il tournait le commutateur, et la lumière se répandit à flots. Les trois hommes se regardèrent un instant : ils étaient graves, mais avec une nuance de contentement. Baradier ne baissait pas le front avec cet air de foncer sur l’obstacle, que son fils et son beau-frère lui connaissaient bien. Il était recueilli. Il fit quelques pas, s’assit sur le bureau et dit :
— Quelle différence y aurait-il entre nous et des gens de rien, si nous ne savions pas être reconnaissants ? Il ne suffit pas de paraître honnêtes et délicats, aux yeux du monde, il faut être, pour soi-même, sans reproche aucun.
Il regarda son fils avec satisfaction, son visage rouge blêmit d’une émotion profonde :
— Ce garçon a vraiment parlé comme un Baradier et Graff. Il faut faire ce qu’il a dit.
Les trois hommes tressaillirent à ces simples paroles qui sacraient le successeur du nom digne de ses devanciers. Des larmes d’orgueilleuse joie brillèrent dans les yeux de l’oncle. Marcel ne répondit pas, mais il se jeta dans les bras de son père.
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
Adresse du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Mars 2024
—
— Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : JacquesB, YvetteT, PatriceC, AlainC, Coolmicro
— Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
— Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l’original. Nous rappelons que c’est un travail d’amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.