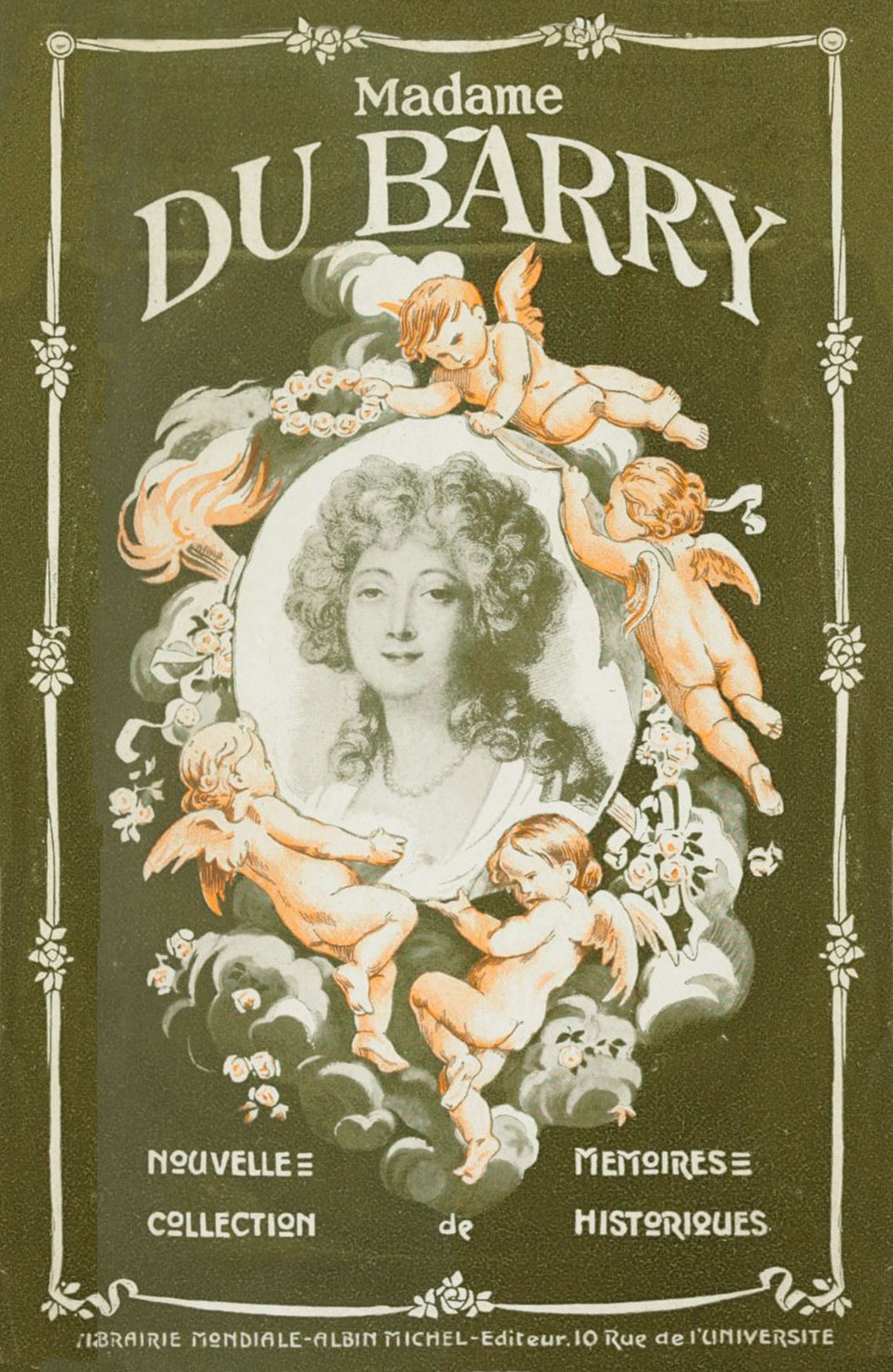
Mathieu-François Pidansat de Mairobert
Élisabeth Brossin de Méré
MADAME DU BARRY
ANECDOTES DE PIDANSAT
MÉMOIRES DE FAVROLLE
Introduction et notes de Maurice Vitrac
et Arnould Galopin
INTRODUCTION[1]
C’est au mois de septembre 1775, et probablement à Londres que parut la première édition des Anecdotes sur la comtesse du Barry[2]. Bien que l’ancienne favorite, déchue de ses grandeurs passées, vécût alors, exilée et comme prisonnière, à l’abbaye du Pont-aux-Dames, le souvenir de ses triomphes était trop récent pour que le livre ne fît point éclat.
Il était, au reste, curieux, plein de renseignements précis mêlés de gravelures. Comme par-dessus la tête de la maîtresse, il atteignait très directement le roi défunt et ne se pouvait vendre que sous le manteau, le danger de le posséder accrut encore son succès. On rechercha qui pouvait en être l’auteur, et on l’attribua assez généralement à Thévenot de Morande. Thévenot ayant en effet publié à Londres, quatre ans plus tôt, sous le titre de Gazetier – cuirassé, un très violent pamphlet contre la favorite, il semblait assez naturel de lui attribuer la paternité du nouveau livre[3]. En fait, il n’en était rien, et bien que cette attribution ait été longtemps acceptée, et jusque par Barbier, il est assuré que Morande n’a pas écrit les Anecdotes. Outre, en effet, que le livre n’est point de sa manière, des documents contemporains établissent qu’au jour de la publication, et depuis de longs mois, il était à la solde du gouvernement français. Une lecture plus attentive du livre, divers rapprochements, et quelques circonstances qui lui sont extérieures, l’ont fait de nos jours attribuer très généralement à Pidansat de Mairobert. Comme les raisons de cette attribution sont tirées surtout de la vie de Mairobert et du milieu où il a vécu, il n’est pas indifférent de connaître d’abord l’une et l’autre.
On voit très distinctement, sur les plans du XVIIIe siècle, l’emplacement qu’occupait alors l’enclos du couvent des Filles-Saint-Thomas. C’est assez exactement celui de la place de la Bourse actuelle. Au centre, sur la rue Vivienne, s’ouvrait une large cour au fond de laquelle s’élevait l’église conventuelle ; au coin de droite, entre la rue des Filles-Saint-Thomas et les jardins, avait été bâti un hôtel, dépendant du couvent, mais loué à des particuliers. Il était occupé depuis 1730 au moins, et le fut jusqu’en 1771, par Mme Doublet de Breuillepont, fille d’un fermier général et veuve d’un ancien secrétaire des commandements du Régent, et par Bachaumont, son ami, qu’elle aimait à l’égal d’un fils, car elle avait, en 1730, 53 ans, lui 40, et l’avait en partie élevé. L’appartement de Bachaumont, au second étage, était assez exigu ; celui de Mme Doublet, au premier, comprenait, par contre, outre des pièces particulières, une bibliothèque nombreuse, une salle à manger luxueuse et un très vaste salon, pièces de réceptions restées communes. Riches l’un et l’autre, Mme Doublet fort apparentée à la magistrature et Bachaumont lié avec tout ce que Paris contenait de délicats lettrés et d’artistes, leur salon constituait une des réunions les plus curieuses d’une époque qui en compta beaucoup. Leurs amis forment un monde fort mêlé. Il y a le groupe des parlementaires : l’abbé Chauvelin, Nicolaï, le marquis d’Aiguilles, Baille et le juriste éminent qu’est le président de Meynières ; le groupe des ministres ou des apprentis ministres : de Bernis, le comte d’Argental, Pont de Veyle, l’abbé Xaupi et le marquis d’Argens ; des savants : le physicien Dortous de Mairan et le médecin Falconet ; des érudits comme les Lacurne de Sainte-Palaye et Mirabaud ; d’autres encore, gais buveurs et joyeux drilles, Piron, Voisenon, l’abbé Prévost et cet abbé Legendre, frère de Mme Doublet, que son canonicat occupe moins que les chansons bacchiques. Divers liens unissent ces esprits si divers et qu’on s’étonne de trouver assemblés. C’est d’abord une curiosité toujours en éveil, un souci des moindres événements de la vie publique, surtout un fond d’idées politiques communes. C’est un salon de libéraux, de patriotes, ainsi qu’on disait alors, qui haïssent le parti jésuite, l’intolérance et l’absolutisme, gens d’esprit très droit qui ont épousé fortement la cause des Parlements qui est celle des libertés nécessaires. Il suffit de lire le dialogue du président de Meynières avec Mme de Pompadour, pour juger de la dignité, de l’honnêteté morale de cette bourgeoisie française, anoblie dans l’exercice des charges publiques et qui a bu, sans s’y griser, à la coupe des philosophes.
Ce n’était, au reste, point là un salon ouvert et de libre accès. Si l’on en croit la tradition, ce fut assez vite une manière de cénacle, de physionomie curieuse. Qu’on imagine un grand salon : une trentaine de fauteuils sont rangés en bon ordre le long des murs, chacun surmonté d’un portrait, et, au milieu de la pièce, une table supporte deux registres. Telle est la Paroisse, nom sous lequel les habitués désignent d’ordinaire le salon de Mme Doublet. Chaque jour, à une heure fixée, chacun des paroissiens arrive, s’assied gravement dans un fauteuil, au-dessous de son propre portrait, et la causerie commence. Encore n’est-ce point, à proprement parler, une causerie, mais plutôt une série de récits ; l’un vient du Parlement, un autre de Versailles, des Académies, des théâtres ou du Palais-Royal, apportant l’écho de ces mondes divers. Les nouvelles connues, discutées quant à leur origine et à leur certitude, l’un des paroissiens, Bachaumont à ce qu’on assure, les résume et les inscrit suivant leur degré de créance sur l’un ou l’autre des registres.
On sait que, dès 1738, en furent tirées des copies manuscrites qui couraient Paris, voire les provinces, parfois à la grande colère de l’autorité. Ce serait de ces registres qu’on aurait extrait, plus tard, le recueil publié sous le titre de Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des Lettres et plus connu sous le nom de Mémoires de Bachaumont. Ce dernier est-il réellement l’auteur des quatre premiers volumes, ainsi qu’on l’assure d’ordinaire ? C’est ce qu’il serait difficile d’affirmer. Au moins est-il assuré que, Bachaumont étant mort en 1771, ils furent publiés et continués par un commensal de la maison, Mathieu-François Pidansat de Mairobert.
C’est, en effet, dans ce milieu que Pidansat de Mairobert aurait grandi. Pourquoi, né à Chaource, d’une famille champenoise, le 20 février 1727[4], serait-il venu enfant chez Mme Doublet ? On l’ignore, pour l’heure, très complètement. On peut supposer que Pidansat, fils, frère et filleul d’avocats au Parlement fut, par eux, mis en relation avec les magistrats habitués de la Paroisse. Cela n’explique pas les liens très étroits qui, suivant la tradition, l’auraient attaché à Mme Doublet. Il est possible, d’ailleurs, qu’on ait exagéré leur intimité : c’est ce qu’on peut inférer d’une lettre de Voltaire au comte d’Argental où il parle de Pidansat comme d’un qui « trotte » pour M. de Bachaumont et auquel il songe à s’adresser finalement ayant besoin d’un commissionnaire qui lui expédierait du café, du chocolat, de mauvais livres et des nouvelles. Il est, en tout cas, impossible d’admettre que Pidansat ait jamais élevé la prétention, qu’on lui attribue, d’être le fils de Bachaumont et de Mme Doublet. Peut-être, et c’est ce qui a pu créer une confusion, les termes de papa et de maman par lesquels tous les paroissiens les désignaient, et qu’il employait à coup sûr, ont-ils donné à penser à quelque contemporain.
Si on ne sait rien de la jeunesse de Pidansat de Mairobert, nous avons, sur son caractère, à vingt ans, une information précise, l’opinion même de son frère, un avocat peu connu[5]. C’est un curieux de nouvelles, de petits vers, de satires, un grand collectionneur de gazettes clandestines et qui va par le monde et dans des lieux publics, contant les derniers bruits, débitant à tout auditeur complaisant des vers frondeurs et des chansons, laissant même très volontiers supposer qu’il en est l’auteur. Il est, pour avoir débité chez Procope une pièce contre Mme de Pompadour et assuré que la cour n’a d’autre plaisir qu’à dévorer le peuple », arrêté à 7 heures du matin, le 4 juillet 1749, fouillé et mis à la Bastille. On a trouvé sur Mairobert des poésies suspectes, mais on perquisitionne à son domicile, rue des Cordeliers, sans résultat. Le lieutenant de police Berryer l’interroge et, comme il se refuse à déclarer de qui il tient ces vers, on le laisse sous les verrous. Ce n’est qu’un an plus tard, le 27 juin 1750, qu’un ordre, signé d’Argenson tout comme l’était la lettre de cachet, le rend à la liberté. Mairobert plonge à nouveau dans l’inconnu et ce n’est que près de quinze ans plus tard qu’on le retrouve, sollicitant la protection de M. de Choiseul-Praslin[6].
Il assure le tout-puissant ministre qu’il a été, en 1749, fort injustement détenu à la Bastille, et appuie son dire du témoignage de M. Duval, alors secrétaire de la lieutenance de police. Au reste, son innocence a été plus que reconnue « par l’usage que le ministre daigna faire, dès ce temps, de ses faibles talents ». Cela revient à dire que Pidansat est, depuis 1730, employé par la police et désire un emploi plus relevé. M. de Choiseul ne paraît pas pressé de satisfaire son ambition et il propose à l’abbé de Voisenon, un des paroissiens et qui s’est entremis, d’envoyer Pidansat comme écrivain au port de Rochefort. Quelques mois après, Pidansat est nommé au poste recherché de secrétaire du roi. À quelles sollicitations ou à quelle arrière-pensée obéit M. de Choiseul ? Car la fortune de Pidansat ne s’arrête point-là, il devient, par la suite, secrétaire des commandements du duc de Chartres, l’un des amis très particuliers de Choiseul, enfin, censeur royal.
Comment l’ancien ami des poètes critiques est-il chargé de les censurer ? Comment l’ancien client de Berryer a-t-il, à ce qu’on assure, l’oreille des lieutenants de police Sartine et Lenoir ? C’est ce qu’on ne pourrait décemment expliquer. Fait étrange encore, c’est à l’abri de cette fonction délicate de censeur qui semble le rendre insoupçonnable, que l’ancien prisonnier de la Bastille se risque à publier les Mémoires secrets et les Anecdotes sur Mme du Barry. Cède-t-il à sa manie des petites nouvelles et à son goût de la satire ? Évidemment non. Pidansat est un espion de police, écrit Grimm ; peut-être ; au moins l’a-t-il été. Mais il est devenu autre chose : une créature de Choiseul et un libelliste à ses gages. Cela seul explique sa rapide fortune et son impunité. Comme censeur, il se montre l’ami des philosophes ; nouvelliste, il soutient la cause des parlements ; historien, il écrit contre Mme du Barry : dans les trois cas, il défend la politique du parti de Choiseul et sans doute obéit aux sollicitations et aux ordres d’un ministre qui, le premier, a connu tout le parti qu’on pouvait tirer des libelles et des chansons. Ce qui est certain, c’est que, étant l’auteur et l’éditeur des Mémoires, Pidansat l’est aussi des Anecdotes, car les deux livres sont de même pensée, de même style, se répètent ou s’inspirent visiblement. Il faut conclure qu’on doit attribuer à Pidansat de Mairobert ces deux livres.
Que sont ces Anecdotes ? Un travail à la documentation précieuse duquel il n’est que juste de rendre hommage. L’énorme compilation de M. Vatel sur Mme du Barry tend à les présenter comme un pamphlet et une œuvre de haine. C’est beaucoup dire. Grimm, qui est un juge avisé, écrit, au contraire, de ce livre qu’il approche de la vérité, qu’il donne un portrait fidèle de Mme du Barry, « cette femme douce, simple, insouciante, légère, guidée souvent par un instinct assez heureux et mêlant, avec moins d’art que d’ingénuité, la décence à l’étourderie, l’inconséquence à la bonté. » C’est, en effet, l’image de la favorite qu’évoque l’œuvre de Pidansat. L’auteur, bien loin que d’être haineux, raconte plus qu’il ne juge et écrit sur un ton d’enjouement qui n’est pas simulé. Son livre n’est, à y regarder de près, que le reflet de l’opinion des contemporains informés.
Mme du Barry ne fut point populaire, en dépit qu’en ait M. Vatel, qui fut presque amoureux de son héroïne et céda, en sa tentative apologétique, à des sentiments chevaleresques. Ce que les contemporains, jusque-là très respectueux du trône, ne purent admettre, c’est que Louis XV ait été, durant des années, esclave d’une passion qu’ils jugeaient dégradante. Certes, en un siècle léger et en notre pays de France, il ne déplaît pas qu’un prince ou qu’un roi soient galants, tout au contraire, mais on exige d’eux qu’ils sachent choisir. Rien ne sert d’ergoter sur les origines de Mme du Barry : elle fut très authentiquement la fille naturelle d’une cuisinière et probablement d’un moine paillard. Il est puéril de vouloir témoigner qu’elle ne fut point une fille publique : qu’importe jusqu’où est descendue une femme qui s’est notoirement vendue à qui la pouvait payer ? C’est cette fille pourtant que le roi de France a imposée à la cour, logée dans l’appartement de Mesdames, à qui il a donné le pas sur ses petits-enfants. Les favorites sont jugées, en général, avec peu de justice, parce que, appartenant de toute nécessité à un parti, on les soupçonne d’en épouser les passions. Mme du Barry a subi le commun destin. Si son impopularité a été générale, cela tient à plusieurs causes. Outre qu’elle a causé, au moins en partie, la déchéance de la royauté, elle s’est trouvée, malgré qu’elle en ait eu en opposition avec Choiseul, le seul ministre populaire du règne. Derrière elle, se sont groupés au contraire les d’Aiguillon, les Maupeou, les La Vauguyon, tous les chefs du parti absolutiste et jésuite, honni de l’opinion.
Il se trouve ainsi que la femme la moins soucieuse de politique et qui n’eut d’autre souci que d’être belle et de plaire, fut le bouc émissaire des fautes et des crimes de la monarchie. Aujourd’hui, au recul des années, on peut lui rendre cette justice qu’elle ne méritait point l’insulte : le coupable n’était pas elle, mais le roi. Bien mieux, pour être tout à fait juste et si on ne peut l’estimer vraiment, on ne peut la juger indigne de sympathie. Elle fut jolie et très douce ignorant la haine et volontiers secourable, sans orgueil et, aux heures même de son triomphe, simple et naturelle. Elle a eu une fin douloureuse, ayant gardé le goût de la vie après être morte à l’amour, ignorant que pour ses pareilles il n’est de belles destinées que celle de la petite danseuse antique : plaire et mourir.
Donnons-lui un regret, mais point de larmes : la tempête révolutionnaire a abattu de plus hautes et de plus nobles têtes.
LIVRE I
ANECDOTES
SUR
Mme LA COMTESSE DU BARRY
PREMIÈRE PARTIE
L’origine de Mme la comtesse du Barry est inconnue, comme celle des grands fleuves qui sont peu de chose à leur source et ne méritent l’attention des voyageurs que lorsque, grossis dans leur cours, ils en imposent par leurs eaux majestueuses, ou plutôt, comme celles des familles illustres et des peuples les plus anciens qui se perd dans la nuit des temps, elle est mêlée à beaucoup de fables et d’obscurité.
Voici pourtant ce qu’en raconte M. Billard-Dumouceaux, son parrain, qui s’en est ouvert dans les commencements de la fortune de cette dame, mais qui, depuis, par prudence ou par ordre supérieur, est devenu très réservé à cet égard.
Il était, dit-il, à la tête d’une partie des vivres, dans la guerre de 1744.
Ses affaires l’obligèrent de passer par Vaucouleurs, petite ville de Champagne qui se glorifie de la naissance de la Pucelle, et qui ne se vantera pas moins de celle de Mme la comtesse du Barry.
En sa qualité de matador de la finance, il était logé chez le directeur des aides.
Pendant son séjour, la femme d’un des suppôts de la ferme accoucha. C’était un de ces petits commis appelés « rats de cave », parce qu’ils y vont souvent pour visiter les vins et autres boissons : il se nommait Gomart de Vaubernier.
La femme du directeur avait promis d’être marraine ; elle pria M. Dumouceaux de tenir avec elle la fille qui venait de naître. Celui-ci, naturellement galant et enjoué, répondit à cette politesse avec beaucoup d’empressement.
L’enfant fut baptisée sous le nom de Marie-Jeanne[7].
La cérémonie se ressentit de l’opulence du parrain : elle fut magnifique pour le lieu et se termina, suivant l’usage, par une grande distribution de dragées et de bonbons ; puis il partit sans s’inquiéter beaucoup si la nouvelle âme qu’il venait de racheter à Dieu ne retournerait pas bientôt au diable.
La Providence, qui veillait sur l’enfant de plus près que son parrain, ménagea à ce dernier l’occasion de reprendre des sentiments plus conformes au nouveau titre qu’il avait acquis et plus dignes de son christianisme et de son humanité.
Plusieurs années après son retour à Paris, on lui annonce un matin une femme qui demande à lui parler. Il la fait entrer : elle se présente avec un enfant ; il ne reconnaît ni l’une ni l’autre.
Il demande à la mère qui elle est ; elle se jette à ses genoux en fondant en larmes ; elle lui apprend qu’elle est la nommée Gomart, dont il a tenu la fille et qu’il voit devant ses yeux sa filleule.
Celle-ci attire les regards du parrain. Outre la gentillesse naturelle à son âge, elle avait des grâces particulières ; il l’embrasse, il la caresse, il s’informe comment sa mère se trouve à Paris.
Mme Gomart lui dit qu’elle a perdu son mari ; que l’emploi qu’il exerçait ne lui ayant pas donné l’occasion d’économiser, elle s’était trouvée par cette mort dans un état misérable ; que, dénuée de ressources à Vaucouleurs, elle était venue dans la capitale pour y chercher à vivre, et se mettre en condition quelque part.
Le sort de la mère intéresse M. Dumouceaux, mais l’enfant surtout s’attire sa bienveillance.
Il donne douze francs à Mme Gomart en lui disant de revenir à la fin de chaque mois, de lui amener sa filleule, et qu’il lui en fournira autant toutes les fois pour sa première éducation, c’est-à-dire pour lui apprendre d’abord à lire et à écrire. Il lui promet, du reste, de chercher à la placer.
On ne sait trop au juste ce que la mère devint dans ces premiers temps, et la mémoire de M. Dumouceaux est en défaut sur cet article.
Il se ressouvient seulement d’avoir fourni constamment les secours qu’il avait promis, et au-delà.
Il paraît que la mère s’en appropriait une partie ; du moins, l’argent n’a-t-il pas fort avantageusement tourné au genre d’éducation que le parrain voulait procurer à sa filleule, car elle ne lit pas bien, écrit fort mal. On a vu un placet apostillé ou griffonné de la manière suivante : Recomandé par Mme la comtesse Dubarry.
Cette lacune, au reste peu importante, ne fut pas longue.
M. Dumouceaux avait, dans ce temps-là, pour maîtresse Mlle Frédéric, courtisane très renommée et dont il était éperdument amoureux.
La veuve Gomart se trouvant sans condition, il la plaça pour cuisinière chez sa maîtresse.
Il faisait d’une pierre deux coups, et en rendant service à cette pauvre femme, il se ménageait un espion favorable à sa jalousie.
Il fut question de savoir ce qu’on ferait de la fille, déjà grandelette et précoce pour son âge. M. Billard, parent de M. Dumouceaux, caissier des postes, et qui était dans la ferveur d’une dévotion naissante, proposa de la mettre à Sainte-Aure, communauté sous la direction de l’abbé Grisel qui en était en quelque sorte le fondateur[8].
On loua son zèle, ses offres furent acceptées, et il se chargea de payer la pension de l’enfant pendant qu’elle serait dans cette maison religieuse pour y faire sa première communion, et se mettre en état d’entrer ensuite en métier.
Nous perdons de vue un instant ce trésor précieux renfermé dans la communauté de Sainte-Aure, où la petite fille se formait aux exercices du couvent, qu’on sait n’être pas toujours des exercices spirituels, et nous nous livrons à quelques réflexions sur cette première partie de sa vie.
Il résulte du chaos bien débrouillé de sa naissance :
1° Qu’elle n’est pas bâtarde, puisqu’elle avait un père apparent, et que, suivant les lois, Pater is est quem nuptiae demonstrant.
2° Qu’elle est encore moins fille d’un moine. Cette fable est appuyée sur un bon mot de M. de Choiseul qui aimait mieux, en l’accréditant, jeter ainsi du ridicule et de l’infamie sur Mme la comtesse du Barry, dont la faveur commençait alors, que de rendre témoignage à la vérité, car il la savait tout aussi bien que qui que ce fût.
Un jour qu’il était question des ordres religieux à la table de ce ministre, et qu’on les maltraitait de propos : « Ne parlons pas mal des moines, dit le duc, ils nous font de beaux enfants. »
3° Que, quoique son père ne fût pas dans un état brillant, on peut dire qu’elle n’est pas née dans la fange, et qu’elle pourrait même, ainsi qu’on l’a prétendu depuis son élévation, être issue d’une famille ancienne, soit par les Gomart, soit par les Vaubernier.
Nous laissons aux généalogistes le soin de trouver la filiation, et nous revenons à la suite de nos anecdotes.
Mlle Frédéric se douta qu’on lui donnait une surveillante en la personne de sa cuisinière et, soit que sa conduite ne fût pas bien nette, soit qu’elle regardât cette précaution comme une insulte faite à sa fidélité, elle résolut de s’en débarrasser le plus tôt possible.
Une maîtresse a facilement, quand elle le désire, et souvent sans le vouloir, occasion de chercher noise à un domestique. Il s’en présenta une, et même très grave, de faire une bonne querelle à la veuve Gomart.
Un Picpus, nommé Père Ange, venait souvent la voir à Courbevoie, où M. Dumouceaux avait une maison de campagne dans laquelle il avait logé Mlle Frédéric pour la belle saison.
Celle-ci ne crut pas qu’un moine pût s’introduire dans une maison que pour séduire la maîtresse ou la servante.
Quoique la cuisinière ne fût pas un morceau ragoûtant, elle ne douta pas qu’il ne fût encore très friand pour le Picpus ; et les caresses qu’il faisait librement à la mère ainsi qu’à la petite fille lorsqu’elle venait de la communauté voir sa maman, donnèrent au soupçon tout l’air de la réalité.
La courtisane en porta ses plaintes à son amant : elle déclara qu’elle ne pouvait souffrir un pareil scandale sous ses yeux. M. Dumouceaux en fit des reproches vifs à la veuve Gomart qui jura et protesta qu’il ne se passait rien de criminel entre le moine et elle ; que c’était son beau-frère, qualité qui autorisait ses visites et ses amitiés ; ce dont ne voulut rien croire Mlle Frédéric, accoutumée à toutes ces ruses de fille, à ces parentés factices ; elle cria, elle fit le diable, comme aurait pu faire une dévote.
Il fallut que la cuisinière sortît et cherchât fortune ailleurs.
D’un autre côté, il revenait beaucoup de rapports fâcheux de la communauté de Sainte-Aure sur le compte de la jeune enfant ; c’était un petit lutin qui faisait enrager ses camarades et les religieuses, le tempérament la tourmentait déjà, et l’on eut toutes les peines du monde à la retenir dans la réserve et le recueillement qu’exigeait l’acte de religion qu’on voulait lui faire faire.
Mlle Frédéric ne fut pas satisfaite qu’après avoir renvoyé la mère, elle n’eût décrié la fille dans l’esprit de M. Dumouceaux. L’aurore de celle-ci, qui commençait à poindre, annonçait dès lors à cet astre naissant la plus brillante carrière : et la première, qui touchait à son couchant, craignit d’en être éclipsée.
Elle connaissait toutes les dispositions du parrain à la galanterie, et elle voulut lui ôter la tentation de lui faire infidélité en faveur de la filleule.
Elle exigea qu’il abandonnât cette famille dévergondée, indigne de ses bontés.
Ce parrain était faible et doux ; il ne voulait point de querelle avec sa maîtresse ; mais il ne put se résoudre à délaisser tout à fait la veuve Gomart ; il lui donnait des secours en cachette, et sans la voir beaucoup, d’autant qu’elle entra pour lors chez Mme de…
Mme de… aimait les enfants et s’en amusait à la campagne où elle passait une grande partie de l’année. Les connaissances de Mme de..., surtout en hommes, s’en amusaient encore mieux, et entre ceux-ci, M. l’abbé d’Usson de Bonnac, depuis évêque d’Agen, ainsi que M. de Marcieu, alors colonel, aujourd’hui maréchal-de-camp.
Le premier plaisait fort à la pétulance de Manon (c’est ainsi qu’on la nommait dans cette maison), parce qu’il l’agaçait ; ce qu’elle lui rendait bien.
Un jour (et nous tenons cette anecdote de M. de Marcieu lui-même) que ce dernier avait un habit neuf, en passant sur un pont, il se trouva tout couvert de boue ; il regarda et vit en embuscade la petite Manon qui riait comme une folle. Il courut à elle dans son premier mouvement de colère, il la troussa et allait lui donner le fouet d’importance, lorsque l’enfant lui demanda grâce en l’assurant qu’elle s’était méprise ; qu’elle n’en voulait qu’à ce petit vilain abbé de Bonnac, qu’elle ne serait pas fâchée d’être fessée, si elle avait réussi.
L’ingénuité de ce propos désarma le militaire, qui l’embrassa de tout son cœur.
Qu’on nous permette une digression sur la suite de cette aventure qui, en confirmant la vérité, fait beaucoup d’honneur à la franchise du caractère de Mme du Barry.
C’est toujours M. de Marcieu qui parle.
Il raconte que depuis l’élévation de cette dame, ayant bien vérifié qu’elle était la Manon même qu’il avait failli fouetter, il s’était empressé d’aller lui faire sa cour. Que dans le dessein de se faire reconnaître d’elle pour peu qu’elle lui en fournît l’occasion, il avait jugé le moment de sa toilette le plus favorable.
Qu’en conséquence, il s’était mis le dernier de la file, de façon pourtant que sa figure fût bien réfléchie dans le miroir devant lequel la comtesse était alors, et qu’il pût voir les mouvements du visage de Mme du Barry ; qu’ayant remarqué qu’en jetant les yeux sur lui, elle avait souri comme à quelqu’un de connaissance, il s’était hasardé à un premier geste sur son habit qui ne signifiait rien vis-à-vis de toute autre personne, mais qui pouvait lui rappeler la boue dont elle l’avait sali ; que le sourire ayant parfaitement répondu à son intention, il en était venu au point de retracer la fustigation en se donnant de petites claques d’une main sur le dos de l’autre ; qu’enfin, elle avait presque éclaté ; et pour lui témoigner, sans que les spectateurs s’en doutassent, qu’elle était parfaitement au fait de la scène muette qu’il venait de jouer, elle lui avait demandé s’il était toujours lié avec M. l’évêque d’Agen.
De cette anecdote bien constatée, on peut conjecturer que Manon était déjà fort délurée, quand elle sortit de chez Mme de…
Malgré son extrême jeunesse, on voit qu’elle était déjà très apprivoisée avec les hommes ; et sans fixer au juste l’époque, ni nommer l’heureux mortel qui a eu ses premières faveurs, on peut croire que ce fut quelque malin abbé ou quelque brillant colonel. Du moins, serait-ce un miracle si, aussi jolie et aussi mal gardée qu’elle l’était par sa mère, elle eût échappé saine et sauve aux séductions du premier, ou à l’argent du second.
En général, c’est un point fort difficile à saisir dans la vie d’une femme, parce qu’il se passe ordinairement dans l’obscurité d’une nuit profonde, parce qu’elle seule, à bien parler, pourrait l’assigner, et qu’elle rougirait trop souvent de nommer le héros.
On connaît ce refrain de chanson si joli, si vrai, si naturel : « Souvent la farine se donne et le son se vend. »
Quoi qu’il en soit, comme cet événement est peu important dans la vie de Manon, qu’il ne tient même en rien à sa grandeur suivante, nous ne disserterons pas plus longtemps sur ce chapitre.
Nous ajouterons seulement que, si par une grâce spéciale de la Providence, cette vertu si recherchée était sortie victorieuse de tant de tentations, de tant d’assauts, la beauté naissante qui en était pourvue entra bientôt dans un lieu où l’honnêteté, la laideur même, ne sont pas toujours en sûreté.
Vers 1760, la veuve Gomart, fondant de grandes espérances sur sa fille, ramassa le peu d’argent qu’elle avait économisé qui, joint aux bienfaits du parrain et de Mme de… servit à placer Manon chez le sieur Labille, marchand de modes.
Ce métier, fort honnête en lui-même, est devenu, de notre temps, si décrié qu’une mère sage et prudente évite de le donner à une jeune et jolie personne. L’introduire en pareil endroit, c’était l’exposer beaucoup.
Il est à présumer que la cuisinière, déjà au fait du train de Paris, ne l’ignorait pas.
On ne sait si c’est pour pouvoir exécuter plus librement un dessein caché qu’elle fit alors changer de nom à sa fille ; mais suivant la tradition, celle-ci ne porta chez le sieur Labille que celui de Lançon.
C’est ainsi, pour nous conformer à cette époque, que nous l’appellerons dorénavant.
Mlle Lançon donc se trouve à merveille de son nouveau domicile.
Une boutique de modes ne peut que flatter infiniment les goûts d’une fille qui entre dans le monde et qui n’a encore rien vu.
C’est véritablement le temple de la coquetterie.
On lui fait passer tour à tour en revue les étoffes les plus riches et les plus précieuses ; les parures les plus élégantes et les plus recherchées, les fanfreluches, les pompons, les ajustements, les ornements si délicieux pour une femme, tout ce que l’aiguille ou le fuseau peuvent produire d’exquis.
Comment une jeune nymphe résisterait-elle à tant de charmes !
C’est Achille entouré d’armes pour la première fois.
D’ailleurs, si ce spectacle doit nécessairement éveiller la vanité dans un cœur novice, y faire naître l’amour du luxe et de la frivolité, on verra par le détail des occupations journalières d’une fille de modes, qu’elle ne peut à la longue échapper à la corruption des mœurs de ses semblables.
En effet, son art consiste non seulement à façonner les diverses productions de nos manufactures nationales, ou des étrangères, mais encore à les faire tourner au profit des passions du sexe qui l’emploie.
Il faut qu’elle s’évertue sans relâche, tantôt à enfler l’orgueil de la fastueuse, tantôt à aiguiser les traits de la coquette, ou bien à donner plus d’ardeur à l’amoureuse, plus de tendresse à la voluptueuse, plus d’énergie à la jalouse, plus de lascivité à la courtisane.
La beauté peut recevoir des grâces, la gentillesse du feu ; la laideur, des déguisements, des tempéraments, des adoucissements.
Toutes les femmes briguent le triomphe ; en un mot, chacune a sa manière.
Il n’est pas jusqu’à la dévote qui ne désire trouver grâce devant les yeux de son directeur.
En outre, la sorte de pratique qui circule dans tous ces ateliers de la galanterie et de la frivolité, ne contribue pas peu à faire tourner la tête des ouvrières qu’on y occupe.
C’est une demoiselle échappée du couvent qu’il est question de dresser à l’art de plaire ; il faut captiver, avec le secours de la parure l’époux qu’on lui destine ; c’est une nouvelle mariée qu’on veut présenter à la cour et qui, dans son cœur, formant déjà le désir de séduire le monarque, s’évertue en tous sens pour trouver le moyen de rendre ses attraits encore plus enchanteurs ; c’est surtout une actrice, une chanteuse, une danseuse, une beauté qui naguère était leur camarade, qui aujourd’hui roule sur un char superbe, et qui fait contribuer à l’embellissement de ses charmes les diverses parties du monde ; c’est enfin un petit-maître qui vient commander des présents pour sa maîtresse, et qui glisse, en passant, des douceurs à ces prêtresses subalternes de Vénus.
Elles n’entendent continuellement parler que de fêtes, de bals, de comédies, d’amour.
Et si quelquefois elles sont obligées de prêter leur ministère à des décorations lugubres, c’est encore pour les rendre moins tristes, pour y jeter des grâces.
Une veuve qui commande son deuil exige qu’on entrevoie dès lors qu’elle n’est pas destinée toute sa vie à ces crêpes funèbres ; que, sous ces enveloppes grossières, on découvre la métamorphose d’une beauté qui en doit éclore plus aimable et plus radieuse.
À ces séductions qui entrent par tous les sens dans le cœur d’une fille de modes, qu’on ajoute les efforts plus actifs de ces duègnes, émissaires du libertinage, qui, la regardant déjà comme une victime dévouée aux plaisirs, lui font sourdement les offres les plus flatteuses, soit par elles-mêmes, soit en faveur d’un cavalier galant dont les yeux de concupiscence seront tombés sur la jeune enfant, et l’on conclura qu’il est moralement impossible que celle-ci ne succombe à l’exemple général.
Il n’est donc pas étonnant que Mlle Lançon ait subi le sort des autres.
Sa figure la mettait dans le cas d’être sollicitée plus souvent que ses pareilles, et son caractère étourdi facilitait les ouvertures.
Son désir d’avoir pour dépenser, son attachement extrême à la parure et aux colifichets offraient les moyens naturels de se faire écouter à quiconque l’eût voulu tenter.
D’ailleurs, elle n’avait personne dont les conseils pussent la préserver du danger ; et sa mère qui aurait dû veiller sur elle, sans être assez dépravée pour la vendre, souhaitait intérieurement que sa fille fît fortune n’importe comment, s’imaginant, ainsi qu’on l’a dit, qu’il en rejaillirait quelque chose sur elle.
C’est dans ces circonstances qu’une fameuse entremetteuse, la surintendante en titre des plaisirs de la ville et de la cour, apprit par ses marcheuses (on nomme ainsi dans les termes du métier les suppôts femelles de pareilles femmes), l’apparition d’un nouveau sujet chez le sieur Labille.
Cette éloquente séductrice était la dame Gourdan[9].
Elle avait succédé aux Florences, aux Paris, noms immortels dans les fastes de Cythère, et sans être parvenue à la même célébrité, elle exerçait avec distinction ses fonctions nécessaires dans la capitale.
Elle les remplissait toujours, à la satisfaction des amateurs. Elle avait la confiance des ministres, des prélats, des magistrats graves, des gros financiers, des libertins les plus délicats et les plus usés.
Il était peu de seigneurs qui ne voulussent recevoir une maîtresse de sa main, tant elle était renommée pour ses leçons dans l’art des voluptés.
Elle écrémait, pour ainsi dire, sans cesse, la fleur des grisettes de Paris, elle les décrassait, elle les formait, elle les stylait, elle les poussait et les faisait parvenir en proportion de leurs talents et de leurs attraits.
Dès que Mme Gourdan eut toisé de son coup d’œil Mlle Lançon, le sujet lui parut digne de ses soins.
Elle conçut tout ce qu’elle pourrait valoir entre ses mains et dressa en hâte ses pièges pour enlacer une si bonne proie.
Nous allons rapporter le récit que fit de cette chasse galante la dame Gourdan elle-même. Nous retrancherons seulement les expressions impropres, les termes trop énergiques.
Aux peintures trop fortes, nous substituerons des images plus honnêtes.
C’est elle qui parle : « Je fus bientôt instruite par mes marcheuses qu’il y avait une nouvelle débarquée chez Labille, extrêmement jolie ; je m’y rendis sous prétexte d’acheter quelques chiffons de femme.
« J’aperçus la plus belle créature qu’il soit possible de voir de ses deux yeux.
« Cela pouvait avoir seize ans, était faite à ravir ; une taille leste et noble, un ovale de visage dessiné comme avec le pinceau, des yeux grands, bien fendus, le regard en coulisse, ce qui les rendaient plus amoureux, une peau d’une blancheur éblouissante, jolie bouche, petit pied, des cheveux qui n’auraient pas tenu dans mes deux mains.
« Je jugeai par cet extérieur ce que devait être le reste ; je ne voulus pas manquer une pareille acquisition.
« Je m’approchai d’elle sans affectation : je lui glissai dans la main mon adresse sur une carte avec un petit écu, en lui disant à voix basse et de façon à n’être entendue que d’elle, « de venir chez moi dès qu’elle aurait le moment, que c’était pour son bien…
« Je suis femme et je sais comment on s’y prend pour exciter la curiosité des filles : je me doutai bien que mon propos, accompagné d’une petite générosité, ne manquerait pas son effet.
« Dès le lendemain, qui était un dimanche, je vis arriver chez moi Mlle Lançon.
« Elle me dit qu’elle avait prétexté d’aller à la messe ; je la caressai beaucoup, je la fis déjeuner, je lui demandai si elle se plaisait où elle était.
« Elle me répondit qu’elle n’était pas mal, que ce métier-là lui convenait mieux que tout autre, mais qu’en général elle n’aimait pas le travail, qu’elle voudrait plutôt continuellement rire et folâtrer ; qu’elle enviait le sort de toutes les dames qu’elle voyait entrer dans sa boutique, toujours bien parées, accompagnées de beaux cavaliers, allant à la comédie, au bal.
« Je lui répliquai qu’elle avait raison, qu’une jolie fille comme elle n’était pas faite pour rester assise sur une chaise à manier l’aiguille et gagner peut-être, au bout de quelques années, vingt ou trente sous par jour ; que cela ne pouvait convenir qu’à une malheureuse et laide ouvrière qui ne pouvait faire mieux.
« Alors je l’embrassai vivement, je la conduisis dans mes appartements ; je lui fis visiter mes boudoirs galants.
« Je la fis ensuite passer dans une garde-robe où je lui ouvris plusieurs armoires, je lui déployai des toiles de Hollande, des dentelles, des perles, du taffetas, du gros-de-Tours, des bas de soie, des éventails, des diamants.
« — Eh bien ! m’écriai-je, mon enfant, voulez-vous vous attacher à moi ? Vous aurez de tout cela ; vous mènerez la vie qui vous fait envie ; vous serez tous les jours au spectacle ou dans les fêtes, vous souperez avec ce que la cour et la ville ont de plus grand et de plus agréable.
« Vous verrez les princes, les généraux d’armée, les ministres, les gens de robe, les gens d’église… tous ne travaillent que pour venir se délasser chez moi…
« En même temps, je pris le prétexte de lui faire essayer un déshabillé divin et tout neuf préparé là pour une demoiselle qui devait venir faire un souper le soir même.
« Après avoir fait l’enfantillage de la revêtir de l’ajustement en question où elle aurait voulu rester sur-le-champ, je lui fis entendre que cela ne se pouvait faire ainsi ; que, n’ayant encore eu aucune aventure sur le compte, n’étant pas notée à la police, je courrais risque de la faire enlever avec moi si je la gardais dans ma maison, qu’il fallait qu’elle retournât chez Labille, jusqu’à ce que je trouvasse quelqu’un qui voulût l’entretenir ; qu’elle pourrait, en attendant, venir furtivement chez moi.
« Je lui mis dans la poche un écu de six francs et je convins avec elle d’une femme que je lui dépêcherais quand j’en aurais besoin et qui, sans parler, au moyen de signes convenus, saurait se faire entendre.
« Elle sauta d’aise à mon col et se retira.
« Il y avait alors à Paris une assemblée du clergé. Un prélat dont je tairai le nom (car dans notre état il faut avoir la discrétion d’un confesseur), un prélat donc me sollicitait depuis longtemps de lui présenter quelque novice. Je n’avais encore pu le satisfaire. Il nous est bien permis d’employer les filles de bonne volonté qui se présentent, mais nous ne pouvons débaucher personne.
« Mlle Lançon me parut propre à cette destination.
« J’écrivis à Monseigneur que j’avais son affaire, que Sa Grandeur pouvait se présenter, qu’elle serait contente.
« Il me donna son jour et je fis avertir de bonne heure ma petite amie. Je l’instruisis du rôle qu’elle devait jouer, ou plutôt je lui dis que, sans vouloir lui arracher son secret, ni entrer dans ce qu’elle pouvait savoir, il fallait qu’elle fût absolument ignorante sur tout, même sur le propos.
« Je la fis parfumer, on la coiffa élégamment, on l’habilla de même ; elle était enchantée de se voir aussi brillante. Je la mis alors en présence du prélat, après avoir touché cent louis pour cette fleur.
« Il en fut vraisemblablement très émerveillé puisqu’il voulait l’entretenir, mais l’assemblée ayant fini, il fut obligé de retourner brusquement dans son diocèse.
« Pour me concilier la petite de plus en plus, je lui donnai des chemises, une robe, je lui conseillai de faire croire à ses camarades qu’elle avait gagné à la loterie, afin d’éviter tout soupçon de libertinage ; mais je n’avais que faire de l’instruire à cet égard : elle était aussi fine que moi.
« Cependant, je l’avais prise par son faible ; mes petits cadeaux lui avaient donné la faculté d’être habituellement propre et bien mise.
« Elle m’aimait singulièrement, elle m’appelait « sa bonne maman », elle riait comme une folle quand je lui proposais de faire la novice, puis au moment de jouer la comédie, elle reprenait son air Agnès et en imposait aux plus habiles.
« Après l’église, la noblesse, la robe, la haute finance, j’étais à la veille de la lancer dans la bourgeoisie, lorsqu’un contre-temps inévitable dans nos maisons déconcerta mes projets et m’obligea de me séparer de Mlle Lançon.
« Dumouceaux, une de mes anciennes pratiques, mais que j’avais perdu de vue depuis son union avec la Frédéric, venait de perdre cette maîtresse.
« Il eut recours à moi et me demanda quelque fillette fraîche et gentille.
« Il payait bien.
« Je jetai les yeux sur Mlle Lançon.
« Mon usage est toujours de céler aux demoiselles le nom de ceux à qui elles ont affaire, pour ne pas trahir la confiance de ces derniers.
« J’en use de même envers les petites grisettes qui viennent chez moi, pour ne pas leur faire tort, et, d’ailleurs, pour me conserver toujours mon droit de présentation : ainsi rien ne pouvait prévenir la catastrophe qui se préparait.
« Au jour marqué, j’abouche ma protégée avec mon paillard.
« D’abord ils ne se reconnaissent point, puis ils s’observent comme surpris de se rencontrer ; je vois les feux de la concupiscence s’éteindre soudain dans les regards de Dumouceaux et faire place à ceux de la colère ; la Lançon jette un cri et s’évanouit.
« — Infâme ! s’écrie Dumouceaux, aurais-je cru vous trouver ici ? Sont-ce là les leçons que vous avez reçues à « Sainte-Aure ? On avait bien raison de juger que vous « feriez une libertine ! »
« Il s’avance en même temps comme pour souffleter cette malheureuse fille. Je me jette entre eux deux, ne sachant ce que cela voulait dire.
« Je m’empare du furieux : je fais venir du secours pour la jeune personne, et j’entraîne mon vieux coquin dans une autre pièce.
« Dès le premier moment, j’avais appréhendé qu’il ne rejaillît quelque chose sur moi de cette aventure : que Dumouceaux n’eût déjà eu affaire à la prétendue novice et que son indignation ne vînt de se voir dupe d’elle et de moi.
« Je compris bientôt par l’explication qu’il me donna, que je n’étais pour rien dans la querelle. Il m’apprit que c’était sa filleule et tout le reste de l’histoire que l’on sait.
Cela m’enhardit à prendre la défense de l’enfant.
« Je lui jurai que c’était la première fois qu’elle venait chez moi, qu’elle m’avait été produite par une de mes marcheuses, que son ingénuité devait lui faire voir qu’elle n’était point accoutumée à venir en pareil lieu, qu’elle n’y avait été entraînée que par la surprise, qu’elle ignorait absolument le mal…
« — Oui, oui, elle ignore le mal, répondit le parrain en « m’interrompant avec un ricanement de rage ! Elle le « connaissait dès le couvent ! »
« Je vis qu’il était dangereux de heurter cet homme dans son sens, je lui accordai tout qu’il voulut, en me retranchant à protester que je ne lui avais rien appris et qu’elle entrait de ce seul instant dans ma maison.
« Il se calma un peu ; il en résulta un long colloque sur Mlle Lançon et sur sa mère, à qui nous imputâmes toute la faute.
« Quand je le crus rassis, après lui avoir promis que puisqu’il s’intéressait à cet enfant, elle ne remettrait plus les pieds chez moi, je fus la chercher sous prétexte de consoler son parrain, mais, en effet, pour lui faire la langue et l’instruire de la tournure que j’avais donnée à cette rencontre.
« Je la ramenai, mais ce furent de nouveaux reproches de ce vieux pécheur.
« Elle crut s’excuser naïvement en répondant :
« — Mais, mon parrain, y aurait-il du mal à venir dans « un lieu où vous êtes ? »
« Ce sarcasme aigrit l’amour-propre de Dumouceaux au point qu’il rentra dans toute sa fureur et que, vomissant les plus fortes imprécations contre sa filleule, contre la mère et contre moi, la petite fille s’enfuit pour se soustraire au courroux plus terrible de son parrain qui la menaçait de sa canne.
« Il la poursuivit en criant qu’il l’abandonnait à son malheureux sort ainsi que sa coquine de mère, qu’il ne voulait plus entendre parler de l’une ni de l’autre, qu’elles se donnassent bien garde de se présenter même à sa porte.
« Pendant ce temps, j’avais retenu ce furibond…
« Il se retourna vers moi : « – Et vous, abominable appareilleuse, si j’apprenais que cette dévergondée revienne ici, je vous fais mettre à l’hôpital ainsi qu’elle ! »
« Il me quitta sur ces mots sans vouloir rien écouter.
« Sa filleule a eu une si cruelle peur de cette scène, qu’elle n’a osé venir me voir dans ce temps-là.
« Mais elle a eu de la reconnaissance pour moi, même de l’estime ; depuis qu’elle a été sa maîtresse, elle a encore eu recours à ma protection ; elle est venue faire quelques escapades ici, mais qui n’ont rien produit de remarquable.
« Je l’ai vue lorsqu’elle était avec du Barry. Celui-ci me la prêtait quelquefois pour des jours de gala. Je lui aurais trouvé cent occasions de la faire bien entretenir ; elle m’en a prié souvent lorsqu’elle était mécontente de ce vilain homme, et puis, au fait et au prendre, elle n’osait le quitter, il semblait qu’il l’eût ensorcelée. Au reste, il la réservait pour une meilleure destinée, et il a bien fait. »
Ici finit la narration de l’abbesse Gourdan.
Il paraît que le bonhomme Dumouceaux lui avait tenu rigueur et lui avait ôté tout à fait sa pratique.
Elle attribuait les accès convulsifs où elle l’avait dépeint à son humiliation de se trouver, en une maison de joie, vis-à-vis de sa filleule et d’en recevoir une leçon ; peut-être aussi à un dépit secret et jaloux en la voyant si belle, de ne s’être pas réservé les prémices, qu’il eût pu obtenir facilement, à un choc de passions enfin qui se combattaient chez lui dans cet instant, puisqu’il ne pouvait satisfaire sa paillardise sans déchoir de cette autorité que sa qualité de parrain lui donnait sur sa pupille et que, pour faire valoir celle-ci, il était forcé de contenir ses désirs libertins.
Quoi qu’il en soit des motifs de cette étrange scène, nous tirerons du récit de Mme Gourdan quelques nouvelles indications pour la défense de Mme du Barry.
Nous la justifierons en partie sur l’accusation sinon calomnieuse, du moins exagérée, d’avoir passé sa jeunesse dans des lieux mal famés.
On voit qu’elle n’y entra que par curiosité et non par un goût décidé pour le dérèglement ; qu’elle n’y fut même conduite par aucune vue sordide d’intérêt, qui dirige tant de ses camarades, mais par cet attrait si pardonnable du sexe pour la parure et l’éclat ; qu’en un mot, si elle a développé depuis de très grandes connaissances dans l’art des voluptés, elle en avait puisé les leçons dans son cœur plutôt que dans la conversation des matrones-professes du métier.
Elle les avait reçues de ce tempérament fougueux qui l’avait dominée dès l’âge le plus tendre.
Mais revenons à la suite de nos anecdotes.
Un autre témoin oculaire et acteur dans l’histoire de Mlle Lançon va nous fournir de quoi remplir le reste de cette partie de sa vie chez M. Labille : c’est M. Duval, commis de la marine, qui logeait alors dans la même maison et y occupait un petit logement de garçon au quatrième, immédiatement au-dessous de celui où couchaient les filles de mode.
Il était à la fleur de l’âge, d’une assez belle figure, riche, élégant dans son vêtement, et très propre à donner dans l’œil d’une jeune personne.
Une nuit qu’il rentrait pour se coucher, il fut très surpris de voir sur sa porte un portrait qui n’y était pas lorsqu’il était sorti.
Il approche sa bougie, il l’examine, il déchiffre une figure grossièrement dessinée, mais dont les traits avaient trop de ressemblance avec les siens pour qu’il ne fût pas persuadé être l’original que l’on avait voulu esquisser.
Une telle découverte ne put que flatter infiniment son amour-propre ; mais, en vain, chercha-t-il quel pouvait être l’auteur de cette galanterie. Il ne trouva ni nom ni billet dessous. Il l’enleva cependant et la porta dans sa chambre.
On peut conjecturer tout ce que son imagination enchantée lui suggéra à cette occasion : il se rappela l’origine de la peinture et se plut à croire qu’une nouvelle Dibutade avait été guidée par l’amour dans cette déclaration ingénieuse.
À l’âge qu’il avait, tout se figure en beau : les désirs s’allument aisément, l’espoir les nourrit, et on se laisse aller aux plus douces illusions.
Il n’en fallut pas tant pour enflammer son sang et lui ôter toute envie de dormir.
Sur le matin, comme fatigué de tant d’agitation, il commençait à s’assoupir, un frémissement léger qu’il entend le réveille en sursaut ; il écoute, il soupçonne que le bruit vient de la porte ; il se lève, il y va, et regarde par le trou de la serrure, il aperçoit une jeune personne occupée à recoller un second dessin ; il ouvre brusquement la porte, mais plus leste que lui, la femme jette un cri et regagne le haut de l’escalier.
Il ne doute pas alors que ce ne soit une des filles de mode de Labille, d’autant qu’il savait que la dame son épouse donnait des leçons de dessin aux demoiselles de chez elle qui y avaient quelques dispositions.
Il retrouve son même portrait à la place du précédent et rentre se coucher.
Il rêve aux moyens de s’éclaircir plus amplement du fait.
Il convient qu’il fallait qu’il fût amoureux dès lors pour mettre tant de mystère dans une explication qui pouvait se prendre d’une façon très simple.
Amoureux de qui, cependant, sinon d’un être fantastique, au moins d’un objet qu’il connaissait si peu qu’il aurait pu se trouver à côté de lui sans le savoir.
Peut-être sa réserve doit-elle s’imputer à sa délicatesse de ménager la réputation d’une jeune personne, que plus d’éclat dans cette découverte aurait mise en butte aux médisances de ses camarades et à l’animadversion de M. Labille.
Notre Céladon imagina de faire prendre une tournure romanesque à cette aventure. Il remit le soir le portrait à la porte, après avoir écrit au-dessous, avec un crayon, en gros caractères : Je voudrais bien connaître l’auteur de ce portrait.
Il fut servi à souhait.
À son tour, il vit sa figure couverte d’une autre aussi mal dessinée : c’était celle d’une demoiselle, qu’à travers des coups de crayon grossiers, il jugea devoir être très jolie.
On lisait au bas : « C’est moi. » Il comprit sans difficulté que c’était l’image du peintre femelle qu’il cherchait.
Pour le coup, il trouva un objet sur lequel fixer son imagination et son premier soin, dès qu’il fut habillé, fut d’entrer dans la boutique du marchand de modes pour voir s’il reconnaîtrait l’original de ce dessin.
En commandant un nœud d’épée, il envisagea successivement toutes les ouvrières et un léger sourire de Mlle Lançon lui fit retrouver en elle les traits de l’esquisse imparfaite qui l’avait frappé.
Si celle-ci lui avait déjà chatouillé le cœur, qu’on juge de l’impression que fit sur lui l’objet même si séduisant !
Il attendit la nuit avec impatience pour continuer la conversation énigmatique.
Il écrivit, cette fois, tout simplement sur sa porte : « Quand mon peintre pourra-t-il m’achever de plus près ? »
La réponse ne tarda pas ; il lut quelques heures après : « Votre peintre ira déjeuner chez vous dimanche, à neuf heures ; laissez votre porte entr’ouverte. »
Il ne manqua pas de riposter et de griffonner au même endroit : « On soupire après vous, cela sera exécuté. » Tous deux vraisemblablement attendirent le jour et l’heure du rendez-vous avec une égale impatience.
Au terme indiqué, Mlle Lançon se glisse dans l’appartement du jeune homme. Celui-ci referme promptement la porte, et dans l’ivresse de sa joie, se croit déjà en possession de la plus charmante créature du monde.
Il avait adroitement fait disposer d’avance les divers apprêts du déjeuner et s’était mis ainsi à l’abri des importuns.
On va voir, non sans surprise, ce qui se passa entre nos deux amants.
Le tête-à-tête fut vif et délicieux, mais ne devint pas aussi intéressant que l’avait espéré l’amant.
Il jugea bientôt que cette grisette était plus folle qu’amoureuse, et quoiqu’il lui fût aisé de s’apercevoir qu’elle était douée d’un tempérament très fougueux, il reconnut que sa coquetterie savait le maîtriser.
En un mot, elle lui déclara que jamais homme ne serait parfaitement son amant qu’il ne fût disposé à l’entretenir.
Ainsi se passa cette entrevue en folâtrant.
Du reste, la jeune fille prouva à ce petit-maître audacieux qu’elle n’était point effarouchée de lui et qu’elle était bonne pour résister à ses entreprises.
Elle lui réitéra souvent ses visites, et toujours avec le même ton négatif.
Un jour qu’il la pressait plus vivement, elle rompit la glace :
« — Je t’aime, lui dit-elle, je voudrais te rendre heureux, je le désire presque autant que toi. Tu sens bien que ce n’est pas par vertu que je te résiste, mais une prévoyance sage qui me garantit et de tes séductions et de tes raisonnements.
« Je ne vois qu’un moyen de te contenter : c’est de m’entretenir, et que ce grand mot ne t’effraie pas.
« Tu n’es pas riche, tu me l’as dit, tu peux le devenir : tant mieux, mais ne songeons qu’au présent.
« Tu en as assez pour me prendre avec toi, me loger, nourrir, chauffer, éclairer. Je ne te demande que cent francs par mois, argent sec pour mon habillement et mes menus plaisirs.
« Cette façon de vivre sera un paradis pour moi auprès de celle que je mène.
« Je n’aime point le travail, encore moins la boutique. Je me sens faite pour commander et non pour obéir.
« S’il survient des enfants, tu en auras soin ou nous les mettrons aux Enfants-Trouvés, si c’est trop lourd, jusqu’à ce que nous puissions les reprendre, car j’ai des dispositions à être bonne mère.
« Au reste, le premier qui sera las de l’autre l’en avertira.
« Dans ce cas, tu continueras en honnête homme à me garder à ta charge, jusqu’à ce que j’aie trouvé à me pourvoir ; si j’en crois mon étoile, ce ne sera pas difficile. Nous nous séparerons donc bons amis et nous vivrons de même. »
Tel fut le discours remarquable de cette petite ouvrière où l’on reconnaît une âme libre, indépendante, et qui se prophétise, comme par instinct, née pour un meilleur sort.
Il faut convenir, au reste, qu’il serait difficile de raisonner plus sûrement d’après un plan aussi extravagant.
Aussi n’eut-il pas lieu.
Dans l’intervalle de cette intrigue, M. Duval avait fait la connaissance d’une dame de qualité.
C’était une de ces vieilles routières, plus dangereuses pour un jeune homme que la fille la plus séduisante, qui l’attaquent dans tous les sens et flattent également son amour et sa vanité.
Celui-ci fut émerveillé d’avoir inspiré de la passion à une comtesse (car elle ne manqua pas de lui faire accroire qu’elle en ressentait en sa faveur).
Il se persuada d’autant mieux qu’il ne voyait rien en soi capable d’intéresser si le cœur de cette amante nouvelle n’eût parlé pour lui.
Il ne savait pas qu’elle était ruinée et que sa bourse, quoique médiocre, était le grand objet des désirs de cette bonne dame.
Elle n’eut garde de lui parler aussi ingénument que Mlle Lançon, ni de lui tenir constamment rigueur. Il entra donc en pleine possession, et la jeunesse suppléant chez lui à l’illusion des charmes de sa maîtresse, s’il ne la trouva pas aussi fraîche, aussi élastique que la grisette, le nom, la qualité, l’amour pur et généreux de cette beauté surannée le dédommagèrent amplement à ses yeux de quelques appas qu’il perdait de l’autre côté.
D’ailleurs, il assure qu’une multitude de petits signes imperceptibles dont Mlle Lançon avait le bas des joues parsemé lui avait toujours répugné.
Pour mieux s’assurer sa proie, la douairière imagina de proposer à son amant de venir demeurer avec elle et de faire ménage commun, c’est-à-dire qu’il y mit bientôt tout son pécule, le grand avantage qu’elle en espérait, outre celui de le soustraire aux charmes d’une concurrence qu’elle redoutait, car il avait eu la faiblesse ou la vanité de lui avouer le sacrifice qu’il lui faisait.
M. Duval déménagea donc sourdement, mais, pour satisfaire à la probité ou pour s’enorgueillir aux yeux de la fille de modes de sa superbe conquête, il crut devoir l’instruire par un mot d’écrit de son évasion et de sa rupture.
C’est ce qui lui attira cette réponse, très mal orthographiée, paraît-il, et presque illisible.
On voit aisément que celle qui l’a écrite n’était pas accoutumée à envoyer des billets doux, mais on y trouve une énergie, un bon sens, une sensibilité qui prouvent combien le langage du cœur est supérieur à l’éloquence facile d’un auteur à son pupitre : « Tu m’apprends que tu me quittes pour une personne de qualité, pour une grande dame avec qui tu vas vivre.
« Il me semble que ta vanité se complaît beaucoup à me faire part de cette nouvelle.
« Je ne sais si ton cœur est d’accord, mais j’en doute.
« Je sais que l’amour ne connaît point de telles distinctions ; qu’il divise toutes les femmes en deux classes : les belles et les laides.
« Je sais encore mieux qu’une jeune fille de seize ans a toujours mieux valu, vaut et vaudra toujours mieux qu’une grosse mère de quarante-cinq ans, fût-elle issue du sang des Bourbons.
« Penses-y bien : je te laisse vingt-quatre heures pour le temps de la réflexion et compte que tu ne retrouveras pas deux fois la même chose.
« Ne crois pas que je sois embarrassée.
« J’ai un autre amoureux qui vaut mieux que toi pour la figure : il est plus jeune, plus frais, il est beau comme Adonis ; tu vas dire : Fi ! quand je t’annoncerai que c’est un coiffeur. Mais les grandes dames, qui se piquent de s’y connaître, préfèrent souvent leurs laquais à leurs maris.
« Demande à la tienne, si elle regardait au rang, serais-tu son préféré ?
« Celui-ci m’offre la foi de mariage ; je n’en veux point parce que je serais tentée de le tromper le lendemain ; sinon, il consent à me mettre dans mes meubles, à manger avec moi tout ce qu’il a amassé et nous verrons de plus loin : tant que nous nous aimerons, cela ira toujours bien.
« Adieu encore un coup ; songes-y, j’ai du faible pour toi en ce moment ; il sera bientôt passé, et c’est en vain que tu voudras y revenir quand tu seras dégoûté de ta femme de qualité ; le perruquier t’aura supplanté, tu en enrageras et j’en rirai. »
M. Duval, qui ne sentait pas, en effet, le prix du bonheur auquel il renonçait, ne tint pas grand compte de ces menaces et perdit absolument de vue Mlle Lançon.
Il ignorait ce qu’elle était devenue et n’avait garde de croire que Mme la comtesse du Barry, lorsque son « exaltation » fut annoncée, était cette grisette qu’il avait eue en sa possession et qu’il avait dédaignée.
Ce fut quelqu’un à qui il avait conté son aventure dans le temps, qui avait suivi les différentes métamorphoses de la fille de modes, et qui, le rencontrant lors de la première faveur de cette dame, lui demanda quand il irait à Versailles, le pria de lui accorder sa protection et, après l’avoir turlupiné longtemps, lui donna enfin l’explication.
La nouvelle lui parut si extraordinaire qu’il voulut la vérifier par lui-même.
Mme du Barry n’était pas encore présentée, mais demeurait au château.
Elle avait déjà toutes les distinctions d’une favorite.
Il vient à Versailles dans l’espoir d’examiner si elle est, en effet, la demoiselle Lançon qu’il a connue.
On lui dit que le meilleur temps pour la voir est celui de la messe.
Il se rend à la chapelle à l’heure où elle devait y aller.
Instruit de l’endroit où elle se plaçait, il se poste de façon à ne pas lui échapper et à l’envisager lui-même à son aise.
Elle arrive, mais si fort emmitouflée qu’il ne put rien distinguer.
Elle avait une « Thérèse » rabattue sur la figure : il désespérait de réussir lorsque, avant de se mettre à genoux, elle relève son voile et porte ses regards à l’entour d’elle comme pour découvrir tout ce qui l’environne.
Cet intervalle assez court permit pourtant à M. Duval, qui était fort près de cette dame, de la reconnaître parfaitement, quoique bien changée, surtout à ces signes qui lui avaient tant déplu.
Il s’aperçut parfaitement qu’elle le regardait. Puis elle baissa les yeux, son voile retomba et elle se prosterna devant l’autel. Un instant après, elle se relève et porte uniquement un coup d’œil sur lui comme par réminiscence d’un objet qu’on remet confusément, et lui, de regarder la terre.
Le visage de Mme du Barry se recouvre pour la seconde fois ; il ne put la revoir de ce jour, et depuis il n’a eu aucune occasion de se présenter à elle, en sorte qu’il est bien certain d’avoir frappé les regards de cette dame, mais il doute qu’elle se soit exactement remis qui il était et rappelé leurs anciennes privautés.
Pour débrouiller le chaos des premières années de la jeunesse de notre héroïne, nous sommes obligés de changer souvent d’autorités.
Trois commères, voisines, amies et confidentes de la mère, vont nous guider dans l’époque de cette vie, depuis son évasion de chez le sieur Labille jusqu’au moment où elle devint maîtresse du comte du Barry.
L’une est la dame Chevalier, femme d’un sculpteur, l’autre est la nommée Constant, chaudronnière, et la troisième la dame Pascali, prêteuse sur gages.
Nous chercherons à concilier leurs rapports lorsqu’ils seront opposés et à démêler le plus vrai lorsqu’ils seront contradictoires. Nous aurons égard au caractère, à l’intelligence et aux vues de chacune, suivant le devoir d’un historien véridique, impartial et perspicace.
La première, jalouse et envieuse, nous paraît tout présenter du mauvais côté et cherche à dégrader deux femmes dont le destin brillant l’offusque et auxquelles elle se croit bien supérieure par son état.
La seconde, toujours liée avec la mère et protégée par la fille, voit tout en beau et, ne pouvant disconvenir des faits les plus connus, répare autant qu’elle peut les bruits injurieux à la réputation de deux divinités bienfaisantes dont elle reçoit journellement des faveurs.
La dernière, plus spirituelle, plus fine, mieux éduquée, est, ce me semble, dans le point le plus propre à mieux juger. N’ayant rien obtenu, elle n’est liée par aucune obligation ; mais ne désespérant pas d’avoir, elle se tient sur la réserve et se garde bien d’avancer rien de faux ou de révéler des choses qu’on saurait ne pouvoir venir que d’elle.
Commère de la demoiselle Vaubernier, qui a tenu un de ses enfants avec un directeur des Fermes, lorsqu’elle menait une vie bourgeoise chez sa mère, elle a, par cette alliance, acquis des droits à une protection qu’elle compte faire valoir lorsqu’elle trouvera le moment favorable Mécontente en même temps qu’un lien aussi fort n’ait pas eu son effet, elle a des moments d’humeur où la vérité perce d’une manière d’autant plus satisfaisante qu’elle voit bien et a une connaissance du cœur humain au-dessus des réflexions d’une femme de cet état. C’est donc elle à qui, dans le cas du doute ou de la contradiction, nous nous en rapporterons le plus.
Nous reprenons le fil des événements.
Le coiffeur qui faisait la cour à Mlle Lançon se nommait Lamet[10].
Il avait deux sœurs chez une marchande de modes, voisine du sieur Labille : celles-ci avaient fait connaissance avec la première au moyen du voisinage et de la conformité du métier. De là, liaison du frère qui, d’abord, en coiffant pour s’amuser leur jeune camarade, s’était facilement enlacé dans cette belle chevelure et avait conçu pour celle qui la portait une passion vive, au point qu’il lui offrit de l’épouser. Elle le refusa, comme nous l’avons vu dans sa lettre au sieur Duval, mais consentit de vivre avec lui.
Il était fort employé : il avait gagné environ mille écus d’argent comptant qu’il avait devant lui ; il n’était pas mal meublé, ainsi que les gens de son état qui commencent par mettre toute leur fortune en mobilier.
Il l’installa dans son appartement et en était trop amoureux pour ne pas la rendre maîtresse absolue de tout.
Celle-ci crut être dans un petit paradis : elle n’avait encore rien eu à elle, l’état misérable de sa mère ne lui avait jamais offert le coup d’œil même d’une propriété future.
Elle s’imagina donc posséder un royaume et se conduisit comme si cette opulence nouvelle n’eût jamais dû finir.
Que de plaisirs à la fois elle ressentit ! Elle a convenu depuis que les deux plus grands étaient celui de ne rien faire et celui d’être sans cesse occupée à se parer.
La boutique lui avait toujours déplu souverainement et une fois arrivée, elle aime tellement la toilette, qu’elle ne marche point sans quatre femmes de chambre toujours prêtes à satisfaire et à varier ses goûts et ses fantaisies à cet égard.
Ses cheveux étaient le genre de beauté qu’elle soignait le plus. Elle ne pouvait être mieux tombée !
Non seulement elle épuisait l’art de son amant en cette partie, mais celui de ses confrères plus habiles.
Ils faisaient souvent assaut chez elle, à qui bâtirait le mieux ce galant édifice.
Un baiser de leur reine était le prix du vainqueur, et l’on juge combien le sieur Lamet s’évertuait pour ne pas le laisser cueillir par d’autres.
Quelquefois aussi, elle leur suggérait des idées, elle imaginait, elle créait, elle réformait leur goût.
C’est ainsi que sont venus les chignons adoptés depuis par le public, lorsqu’elle a été dans le cas de faire exemple, et connus sous le nom de chignons à la du Barry ou chignons lâches, c’est-à-dire tellement disposés que, quoique ramenés sur la tête, il se forme un vide entre elle et eux, comme si on les eût relevés à la hâte et sans dessein.
Cette coiffure, où le travail est artistement caché, annonce dans la femme qui s’en sert une mollesse, une négligence, un abandon bien à propos à réveiller les désirs, à encourager les téméraires, en sorte que les honnêtes femmes ou du moins les femmes dévotes et austères ne l’ont point adoptée.
Le Greluchon lui est dû encore : c’est une longue et grosse épingle dont le bouton est ordinairement un diamant.
Quand on est poudré, on le pose du côté gauche et il traverse les cheveux jusqu’au chignon, où il s’enfonce en excédant par la tête en avant.
Il semble annoncer une femme sujette aux démangeaisons et qui a toujours ce secours prêt au besoin pour ne pas déranger sa coiffure.
L’allégorie soutenue à laquelle peut prêter ce signal emblématique, l’indécence du nom qui ne se connaît que chez les courtisanes et qui annonce l’amant secret et favorisé et qui profite lorsque l’autre en titre paie, a fait absolument rejeter cet ornement qui n’est usité que chez les filles.
Mlle Lançon, après avoir travaillé à l’embellissement de sa tête, ne négligeait point les autres parties de son corps.
Elle n’avait été, jusque-là, vêtue qu’en grisette, c’est-à dire proprement, mais sans rien de recherché ni de magnifique, sans affectation.
Sa nouvelle position la mettant dans le cas de ne plus se gêner, elle voulut égaler les plus superbes courtisanes, du moins du côté des robes et de l’ajustement. L’argent du pauvre Lamet fut bientôt écorné.
Il fallut ensuite se montrer au bal, au spectacle, aux promenades. C’était chaque jour quelque bombance, quelque partie de campagne, et quoique les camarades du coiffeur y contribuassent de temps en temps, en moins de trois mois les fonds amassés furent mangés, on fit des dettes ; les créanciers, de mauvaise humeur, saisirent les meubles, et l’entreteneur, négligeant d’ailleurs ses occupations, comme il arrive à tous ceux épris d’une passion forte, se trouva bientôt réduit au point de ne savoir de quel bois faire flèche.
Mourant de faim, il ne vit d’autre ressource que de renoncer à l’objet cause de sa perte, de fuir le péril et de passer en Angleterre.
Les adieux furent assez gais ; on se sépara à l’amiable, et l’amante prit aussi son parti de bonne grâce.
Elle se réfugia dans le taudis de sa mère qui logeait alors rue de Bourbon, et se tirait de son côté d’affaire comme elle pouvait. Elle faisait des ménages, elle gardait les malades, mais sa ressource la plus sûre et la plus abondante consistait en des stations nocturnes qu’elle faisait au Palais-Royal, aux Tuileries, sur les boulevards et autres promenades.
Il n’est que Paris pour en trouver de cette espèce et il faut connaître cette capitale pour entendre ce que cela veut dire.
Nous allons l’expliquer le plus décemment qu’il sera possible.
Il est dans ce pays des femmes qui, soit à raison de leur âge ou de leur état, ou d’une sorte d’honnêteté à laquelle elles n’ont pas renoncé, n’osent afficher ouvertement le libertinage.
Pressées cependant par l’indigence ou pour se donner un peu d’aisance, elles profitent de l’obscurité de la nuit, elles se rendent aux jardins publics, enveloppées encore dans de vastes « Thérèses », elles y sont comme au bal ; elles agacent les hommes impunément, et déguisant leur voix, elles jouissent de la plus entière liberté de l’incognito. Mais il leur arrive parfois de bien drôles aventures. On va en juger tout à l’heure…
D’un autre côté, il est des paillards honteux, des gens mariés, des débauchés d’un genre particulier, des ecclésiastiques timides, des moines attentifs à ménager leur robe, qui recherchent ces bonnes fortunes.
C’est même pour certains amateurs la rocambole du plaisir, et quoiqu’ils n’ignorent pas que la plupart de ces belles de nuit ne seraient pas présentables au grand jour, ils aiment à se laisser aller aux erreurs d’une illusion mensongère, et à suppléer par l’imagination à la réalité ; ce qu’ils ne pourraient faire si une connaissance intuitive de l’objet les empêchait de s’y livrer.
À la faveur, au contraire, d’un léger crépuscule, d’une lueur incertaine, les divers défauts s’éclipsent, tout ce qui porte les attributs du sexe s’embellit et acquiert le droit de plaire ; les grâces surannées reprennent leur fraîcheur, la matrone la plus hideuse trouve encore à trafiquer de sa laideur.
Ces femmes aident autant qu’elles peuvent à la méprise par des toilettes préparatoires ; elles quittent leurs haillons, elles se parfument, elles remplissent les rides de la vieillesse avec des pommades ; elles blanchissent, elles adoucissent leur peau noire et tannée ; elles endossent une robe de taffetas et se donnent tout l’extérieur de nymphes fraîches et charmantes.
Il se trouve cependant dans le nombre quelques honnêtes femmes, les unes guidées par une curiosité indiscrète et folle, les autres douées d’un tempérament libertin qui leur fait rechercher des plaisirs furtifs.
La mère de Mlle Lançon n’était pas décrépite, puisque c’était une femme de quarante à quarante-cinq ans. Elle n’était pas laide, elle avait même été bien, et n’était point mal encore.
Sa figure n’avait rien de tendre ni de délicat, c’était une de ces bonnes dames dont les traits rudes et bien prononcés devaient plaire aux libertins hardis. Son genre de vie avait encore rendurci ses charmes qui ne pouvaient bien se démêler qu’à l’œil d’un connaisseur exercé. Ils avaient donc plutôt besoin d’être discutés au grand jour qu’ensevelis dans une ombre officieuse.
Mais cette femme ne voulait point déroger à la vie bourgeoise qu’elle menait, ni se faire exclure, en affichant le scandale, des coteries qu’elle s’était formées dans le quartier.
Elle avait recours à ces excursions uniquement comme à un supplément du double métier qu’elle remplissait tour à tour de garde-malade et de chambrière.
Depuis que sa fille était avec elle, elle l’avait initiée au même ministère.
Toutes deux, dans la belle saison, sortaient ainsi le soir, sous prétexte d’aller se promener, et revenaient avec plus ou moins de bénéfice.
Une reconnaissance que fit la mère, aux Tuileries, plus heureuse que celle que la fille avait faite chez la dame Gourdan, a été probablement l’origine de la fortune de la jeune personne, par la chaîne d’événements auxquels elle a donné lieu.
Une belle soirée qu’elles sont assises au pied d’un arbre et interrogent les passants, un quidam, assez bien mis, paraît écouter les propos de nos sirènes et s’y laisser séduire ; il s’approche, et après avoir causé avec elles quelques instants, donne soudain un coup de sifflet, les arrête de la part du roi et veut les conduire chez M. Bontems, le gouverneur du château, qui a la police de cette enceinte royale.
Les malheureuses reconnaissent trop tard leur erreur.
C’est un suisse du jardin qui, ainsi travesti bourgeoisement, faisait sa ronde et espionnait les femmes, car malgré l’extrême licence qui régnait dans ces lieux, on donnait les ordres les plus sévères pour les réprimer et les filles qu’on surprenait en flagrant délit étaient envoyées à l’hôpital.
Mais cette inspection, sans arrêter le scandale, tournait uniquement au profit des gagés pour cette police.
Ils ne l’exerçaient que pour rançonner les accusés et se faire un bénéfice considérable.
Par une circonstance très fâcheuse, Mme Lançon et sa fille se trouvaient sans avoir le sol.
Deux recors étaient accourus au signal et, malgré leurs prières et leurs larmes, on conduisait les deux femmes au Palais.
Un hasard heureux avait rendu témoin de la capture un abbé qui se promenait aux environs, cherchait fortune, et avait sans doute jeté son dévolu sur ces nymphes.
Un intérêt secret, une sorte de sympathie, un pressentiment vif et inquiet le porte à les suivre, à les examiner au clair de lune qu’il faisait ce soir-là.
Il reconnaît la mère, s’approche du suisse et lui déclare adroitement que ses femmes sont ses parentes, qu’il en répond, qu’on peut s’en fier à sa robe, qu’il ne voudrait point autoriser le vice, mais qu’il est juste de le récompenser de son zèle.
Il lui glisse en même temps un écu de six francs dans la main et cet argument éloquent eut son effet.
Quelle joie ! Quels remerciements de la part des prisonnières ! Elles se jettent au cou de l’inconnu.
Celui-ci leur demande pour toute récompense de lui donner à souper. On juge qu’elles acceptèrent avec grand plaisir la proposition.
Il les embarque dans un fiacre et les voilà rendus chez Mme Lançon. La chandelle allumée, l’abbé reprend son ton de voix ordinaire, se met en face de la lumière et demande à la mère si elle le remet.
— Ah ! chien de moine, s’écrie-t-elle, comme te voilà travesti ! Qui diable se serait imaginé de te rencontrer dans cet accoutrement ! D’où sors-tu ? Que fais-tu ? Que deviens-tu ? Ma fille, embrassez votre oncle.
En effet, c’était l’abbé Gomart, ce Picpus dont nous avons parlé ci-devant sous le nom de Père Ange.
On n’eut point de cesse qu’il n’eût raconté son histoire.
— Elle n’est pas longue, reprit-il, la voici en deux mots : « Depuis nos tracasseries à Courbevoie de la part de la Frédéric, du scandale qu’elle occasionna au point, comme vous le savez , de me faire changer de couvent par les supérieurs et de me faire reléguer au loin, mon froc m’était devenu insupportable et je songeai sérieusement à sortir de cet enfer.
« Ce n’était point aisé. En apostasiant, il fallait le faire impunément d’abord et passer en pays étranger. Comment y vivre et m’y soutenir ?
« J’imaginai un expédient plus lent, mais plus sûr, et sans aucun inconvénient. Vous savez ou vous ne savez pas que, suivant la discipline ecclésiastique, lorsqu’on est profès dans un ordre religieux, on ne peut le quitter que pour passer dans un autre plus austère.
« Ce fut la tournure que je pris.
« J’affectai pendant quelque temps le repentir le plus amer de mes fredaines ; ensuite, je fus trouver notre gardien, je lui témoignai mes anxiétés, mes remords, et lui déclarai que ma conscience ne serait pas tranquille que je n’eusse expié tant d’iniquités par une pénitence encore plus douloureuse et plus exemplaire ; que j’avais la vocation la plus décidée pour aller à la Trappe, que je le suppliais d’en écrire au général et de me faire obtenir du pape la permission nécessaire.
« Je mis tant d’ardeur et de pathétique à cette prière qu’il fut ma dupe.
« Il me félicita de la grâce qui opérait en moi un si merveilleux changement et, me témoignant son regret de perdre un sujet appelé à la sainteté la plus sublime, il ajouta qu’il allait faire tout ce qui dépendrait de lui pour concourir à remplir les vues du ciel sur moi.
« Alors, j’obtins facilement ce que je demandais et ma translation à la Trappe s’effectua au bout de quelques mois.
« L’abbé était prévenu des motifs surhumains qui m’appelaient à ce monastère.
« Je fus traité avec la plus grande distinction et l’on me regarda comme un élu de Dieu.
« Je redoublai d’hypocrisie : ce genre de vie me facilita l’exécution de mon projet.
« Je maigris bientôt à vue d’œil, je commençai à tousser, ma toux redoubla peu à peu insensiblement.
« Je faisais retentir ma cellule, l’église et le couvent de mes quintes convulsives. Je m’excoriai les gencives et je crachai du sang.
« Le Père abbé s’aperçut de mon état et je jouai si bien mon rôle qu’il entra dans les vues que je voulais lui suggérer.
« Il me dit que je ne pouvais continuer à vivre sous sa règle, que j’étais visiblement attaqué de la poitrine, que Dieu n’exigeait point qu’on se tuât pour son service, qu’il était nécessaire de réparer ma santé et qu’il me l’ordonnait.
« C’était là où je l’attendais.
« Je parus désespéré de la cruelle annonce qu’il me portait, j’avouai que je me trouvais très mal et que cela augmentait ma joie par l’espérance de mourir bientôt.
« Sur quoi il me répliqua que je le faisais frémir, que je ferais un grand crime en m’opiniâtrant à devenir ainsi homicide de moi-même et qu’il exigeait, pour dernier acte de soumission, que je me retirasse.
« — Mais, m’écriai-je, je suis dans un état de dépérissement et de marasme où je ne dois pas plus espérer de me rétablir sous la règle de saint François que sous celle de saint Bruno ; je périrai, grâces au Ciel, dans un froc comme sous un cilice ; ainsi, mourir pour mourir, mon vénérable abbé, souffrez que je rende l’âme sous vos yeux, en continuant de m’édifier de vos saints exemples.
« — Vraiment, mon cher frère, reprit-il, ce n’est pas ce que je prétends. Vous ne pouvez rentrer dans votre ordre : je vais vous donner une lettre pour Monseigneur l’archevêque de Paris, ce digne prélat que je connais beaucoup ; je lui rendrai compte des motifs honorables qui occasionnent votre renvoi de cette maison ainsi que de l’impossibilité où vous êtes actuellement de rentrer sous aucune règle monastique ; mais je lui suggérerai le genre d’utilité dont vous pouvez lui être dans le ministère apostolique pendant que vous rétablirez votre santé.
« Le bonheur que vous avez d’être prêtre vous mettra dans le cas de travailler à la vigne du Seigneur sous les ordres de ce grand archevêque. »
« Je pleurai abondamment ; j’embrassai le vénérable abbé, je parus me résigner avec le plus grand désespoir aux ordres du Ciel que je recevais par sa bouche ; et, muni de sa recommandation auprès de M. de Beaumont, je suis venu à Paris : je me suis présenté à lui dans l’état de macération où il convenait d’être encore ; et il m’a placé en qualité de prêtre habitué sur la paroisse de Saint-Eustache.
« Cet état n’est ni glorieux ni lucratif, mais il vaut mieux que celui de moine et l’on peut trouver des débouchés.
« Je n’ai pas tardé à reprendre l’embonpoint que vous me voyez. Je me suis impatronisé chez une vieille folle de la paroisse, à qui j’ai donné dans l’œil ; et tout en desservant sa chapelle à la Courneuve où elle a un très beau château, je lui suis, entre nous, très utile.
« Je veux vous présenter à elle ; elle aime à prendre avec elle de jeunes personnes ; j’espère que ma nièce lui plaira et qu’elle s’en chargera.
« Laissez-moi faire, vous aurez des nouvelles avant peu. »
Cet espoir jeta de la gaieté dans le reste du souper ; la petite personne fit des châteaux en Espagne, qui ne se sont pas trouvés si mal fondés ; et l’on se quitta, en attendant que l’abbé Gomart eût fait jouer les mines pour la réussite de ce projet.
Voici comment il s’y prit.
La folle dont il est question ici était la vieille La Garde, veuve d’un fermier-général fort riche et très renommée effectivement dans Paris par ses bizarreries et ses extravagances[11]
Un soir que l’abbé Gomart était venu coucher à la Courneuve pour dire la messe le lendemain, que cette bonne dame était seule et qu’il savait qu’elle le serait encore le jour suivant, il lui demanda sans affectation son agrément pour remplir ses fonctions d’aumônier de meilleure heure.
Il dit que sa belle-sœur et sa nièce devaient venir et qu’il serait bien aise d’avoir une matinée à lui pour les promener.
Mme La Garde y consentit à condition qu’il les lui présenterait, elle témoigna envie de les voir.
La distance est très courte de cette campagne à Paris : il fit savoir à ces femmes ce qu’il avait arrangé pour le lendemain, et les exhorta à se rendre à une heure prescrite.
Ce qu’il avait imaginé réussit au gré de ses désirs.
Mlle Lançon plut singulièrement à la dame du lieu et elle lui proposa de rester avec elle.
La jeune personne dit qu’elle s’en rapportait à sa mère, celle-ci à M. l’abbé qui était le conseil de la famille ; et M. l’abbé décida qu’on ne pouvait trop remercier Madame de ses bontés et qu’il fallait en profiter.
Ici commence, à proprement parler, une nouvelle carrière pour Mlle Lançon qu’on avait présentée sous son véritable nom de Vaubernier, et qu’elle va porter désormais.
Sa qualité de complaisante de la riche veuve la faisait admettre à sa table, au cercle et à toutes les sociétés de Mme de la Garde ; elle vit ainsi bonne compagnie, non pour se former des mœurs plus honnêtes, mais pour se décrasser, pour se donner un meilleur ton, prendre plus d’airs de coquetterie, et se styler mieux à l’art de plaire et de séduire.
C’est ce qu’elle acquit parfaitement.
En vain la calomnie a prétendu qu’elle s’échappait le plus qu’elle pouvait pour aller jouer avec les laquais.
Mlle de Saint-Germain, qui était contemporaine de cette jeune personne et presque dans les mêmes fonctions puisqu’elle était demoiselle de compagnie de Mme de la Garde, nie le fait et lui rend justice là-dessus.
Elle portait ses vues plus haut. Sa maîtresse avait deux fils, dont l’un fermier-général et l’autre maître des requêtes.
Elle chercha à donner dans l’œil de l’un ou de l’autre et réussit à souhait ; car elle les enlaça tous deux : c’est ce qui la perdit.
Il en résulta une jalousie entre les frères qui occasionna bientôt celle de la mère.
Celle-ci passait pour avoir un goût décidé en faveur de la demoiselle Vaubernier.
Elle la comblait de présents, elle lui donnait des robes de toutes les saisons ; elle se plaisait à la parer. Quelquefois, lorsqu’elles étaient devant le miroir ensemble, elle vantait la beauté de sa favorite ; elle lui disait qu’elle était un morceau du roi, puis, en se comparant avec elle, elle se trouvait à elle-même plus de noblesse dans la figure, plus de beauté vraie et durable.
C’est ainsi qu’elle assimilait par un amour-propre trop fréquent, quoique toujours inconcevable, ses traits usés, sexagénaires, aux grâces neuves et fraîches d’une enfant de dix-neuf à vingt ans.
Du reste, elle l’embrassait, la cajolait, la caressait comme sa fille.
Cependant, Mlle Vaubernier cherchait à captiver le cœur des enfants de cette dame.
Il faut convenir que le maître des requêtes, comme le moins laid et le moins âgé, était le plus agréé ; mais comme il ne pouvait lui faire assidument sa cour, l’aîné trouvait des intervalles et en profitait.
Elle les ménageait l’un et l’autre le mieux qu’elle pouvait et par ce manège trop heureux d’une coquette, peut-être les eût-elle tenus dans l’esclavage ensemble, si la mère n’eût été plus intraitable, ou plutôt si la cupidité des subalternes n’eût allumé la jalousie de leur maîtresse.
Les femmes de chambre étaient envieuses de la nouvelle favorite de Madame ; elles se regardaient comme frustrées de tous les cadeaux qu’elle lui faisait ; c’était autant de larcins qu’elles lui reprochaient ; elles profitèrent adroitement des circonstances pour la dénigrer et l’expulser.
Elles ne laissèrent pas ignorer à la mère la passion que ses enfants avaient pour Mlle Vaubernier, et la complaisance criminelle avec laquelle celle-ci passait pour agréer ce double hommage.
Peut-être exagérèrent-elles le prétendu libertinage de cette jeune personne, et ont-elles ainsi donné lieu aux bruits accrédités de ses familiarités avec la valetaille de la maison.
La vieille La Garde, ayant vérifié par elle-même une partie de ce qu’on lui disait, chanta pouille à ses fils et renvoya Mlle Vaubernier.
La voilà donc retournée encore une fois avec sa mère ; car par une vilenie des deux La Garde, aucun ne voulut s’en charger et l’entretenir.
Cela parut d’autant plus dur à la jeune personne que cet asile la dégoûtait fort.
Sa mère s’était remariée à un nommé Rançon, à qui la bienfaitrice de sa fille avait fait avoir une place de commis aux barrières, ce qui fournissait de quoi subsister, mais n’en rendait pas la maison plus opulente.
Cependant le goût de Mlle Vaubernier s’était excité et développé par l’exemple ; il ne pouvait se satisfaire dans l’état très médiocre du beau-père.
Elle songea sérieusement à s’en tirer et cela ne tarda pas, grâce à ses charmes et à sa jeunesse.
Près de sa mère, qui demeurait toujours rue de Bourbon, était une maison de jeu que tenait la marquise de Quesnay.
L’usage de ces femmes, pour achalander leur tripot, était de louer de jolies personnes qui venaient en quelque sorte le parer, s’y donner en spectacle et amorcer les dupes.
La marquise jugea Mlle Vaubernier très propre au service qu’elle en voulait tirer : elle l’attira chez elle, lui fit ses propositions et la jeune coquette, y trouvant doublement son avantage, par l’espoir d’y faire des conquêtes pour son propre compte, les accepta de grand cœur.
Parmi les joueurs qui fréquentaient dans cette maison était un M. du Barry, qui se faisait appeler comte, suivant la liberté que prenaient alors quantité de gentilshommes en France, et même quantité de gens qui ne l’étaient point, de se donner ainsi de leur bonne grâce un titre qu’ils ne tenaient point de leur naissance ou de la grâce du roi[12].
Le prétendu comte n’a pas l’extérieur séduisant : il est d’une figure très ordinaire, mais c’est un intrigant de premier ordre, un chevalier d’industrie qui, sans la moindre fortune, se soutenait à Paris, faisait figure, donnait dans le luxe coûteux de l’entretien des filles, et en avait toujours quelqu’une à sa suite.
C’est de cette source de perdition et de ruine qu’il tirait, au contraire, de quoi fournir à ses dépenses et se faufiler parmi les plus grands seigneurs.
On sent aisément quel genre de commerce il faisait.
Mlle Vaubernier lui parut une excellente acquisition pour remplir ses vues.
C’était alors une nymphe toute fraîche, qui n’était point connue dans l’ordre des courtisanes, et dont la figure délicieuse et les grâces folâtres devaient, à coup sûr, faire tourner une multitude de têtes.
Il chercha donc à cultiver la jeune personne et à l’éblouir par les promesses les plus magnifiques.
Il lui fit l’énumération des filles qui avaient avancé sous ses auspices, s’étaient illustrées et étaient alors citées comme du plus grand ton. Il a de l’esprit, il est insinuant, et les exemples qu’il rapportait étaient des motifs puissants pour persuader.
Mlle Vaubernier, ivre déjà de la fortune qu’il lui promettait, accepta ses propositions.
Il renvoya une maîtresse favorite qu’il avait nommée Adélaïde, qui logeait avec lui et élevait une fille dont il était le père ; il les plaça dans son voisinage et, malgré les réclamations de l’expulsée, installa chez lui la nouvelle venue.
Il commença par l’aimer tendrement, et quand elle lui fut devenue indifférente, qu’il se fut mis à l’abri de toute espèce de jalousie, il ouvrit sa maison comme à l’ordinaire, sous prétexte d’assemblées de jeu, et exposa aux yeux des gens de la cour qui venaient chez lui l’acquisition précieuse dont il se félicitait, et dont il reçut un applaudissement général.
Tous les grands lui faisaient la cour. Nous ne pouvons donner la liste des gens illustres auxquels M. du Barry a communiqué un trésor dont il se réservait toujours adroitement la propriété.
Ces marchés secrets n’ont qu’une publicité vague, sans qu’on puisse assigner exactement les copartageants.
Il est constant, d’ailleurs, qu’outre les seigneurs, M. du Barry ne refusait pas les matadors de la finance en état de payer ses services et en état de les acheter au poids de l’or.
C’est ainsi que le sieur Radix de Sainte-Foix, trésorier général de la marine, eut la douce satisfaction de posséder cette beauté, avantage qui ne lui a pas été inutile, par la suite, comme on le verra plus loin.
Une chose étonnante, sans doute, c’est que, parmi tant de conquêtes, Mlle Vaubernier n’en ait conservé aucune, et soit constamment restée en la possession du comte.
On ne peut l’attribuer qu’à la dextérité de celui-ci, car on savait qu’elle n’était pas heureuse avec cet amant impérieux.
Les voisins ont été souvent témoins de scènes très violentes et l’on rapporte avoir vu une fois cette malheureuse victime en peignoir, les yeux en larmes, jetant les hauts cris et voulant dans son désespoir se précipiter par la fenêtre.
Plusieurs causes ont, sans doute, contribué à l’engager à rester avec M. du Barry.
1° La sorte de crainte où elle était d’un homme qu’elle regardait comme son père, à qui elle devait toute son existence, et dont le caractère violent l’intimidait.
2° L’existence douce et agréable qu’elle y menait, vivant dans la plus grande aisance, nageant dans les plaisirs, et surtout pouvant satisfaire cette magnificence des habillements, ce goût de la parure qui la dominait si fort.
3° La facilité qu’avaient les soupirants d’entrer en relations avec la dame, devait les porter à sacrifier aisément une somme quelconque, au prix de laquelle ils obtenaient le vrai but de leurs désirs sans avoir toutes les charges, tous les embarras d’une maîtresse à entretenir.
Enfin, le soin qu’avait M. du Barry d’écarter de la jeune personne les amoureux qui pouvaient lui enflammer le cœur et la concentrer tellement dans un objet qu’elle devînt incapable de suivre sa destination et de se prêter, à l’heure et à la minute, aux divers arrangements qu’il pouvait faire à son égard.
Ainsi Mlle Vaubernier paraissait devoir être encore longtemps entre les mains de cet instituteur, si son heureuse étoile ne l’en eût fait sortir pour remplir ses hautes destinées, ou plutôt, si le comte n’eût jugé à propos d’en risquer le sacrifice et de hasarder le tout pour le tout ; car il est certain qu’il jouait gros jeu, comme on en jugera par les circonstances.
En 1768, au printemps, le comte du Barry rencontra le sieur Lebel, un des premiers valets de chambre du roi, le plus initié dans la confiance de Sa Majesté, relativement à ses plaisirs secrets, et qui était spécialement chargé de « recruter » pour remplir le « Parc-aux-Cerfs »[13]
On appelait de ce nom un quartier de Versailles où Mme la marquise de Pompadour avait établi une espèce de dépôt pour y loger les jeunes filles qu’on était sans cesse occupé à chercher dans Paris et que cette dame mettait dans les bras de son auguste amant.
Elle se conservait ainsi, par cette surintendance, le cœur du monarque, et tout l’honorifique d’une maîtresse en titre.
On ne saurait compter la multitude de créatures qui ont ainsi passé dans cette espèce de ménagerie, où chacune attendait son tour qui, souvent, ne venait point, ou ne consistait que dans de légères privautés ou n’était jamais long, tant en raison du dégoût du monarque que des craintes de la sultane principale.
Elle avait grand soin de faire disparaître celles que leur caractère, leur esprit ou l’attachement du maître pouvaient rendre redoutables.
Mais d’avoir entrée dans ce sérail était, comme de raison, un droit à des bienfaits particuliers.
On mariait communément ces filles avec une dot de 200 000 livres et on les envoyait dans le fond de quelque province éloignée.
Quelques-unes restaient à Paris, à raison d’une faveur particulière, telles que Mme Gianbonne, qui avait épousé un banquier ; Mme David, femme d’un commis avancé dans les vivres ; Mme Le Normant, la première de toutes que Sa Majesté ait honorée de son amitié depuis qu’Elle s’était retirée du lit de Mme de Pompadour, et connue alors sous le nom de Mlle Morfi, qui acquit par la suite la plus grande considération pour avoir donné sa fille en mariage au neveu de l’abbé Terray ; Mlle Selin, Bretonne, fille de condition, qui a mieux aimé rester au couvent, et à qui on a fait un sort distingué, et tant d’autres dont l’énumération est inutile ici.
Par cet exposé, il est aisé d’induire combien un tel établissement devait être dispendieux, non seulement à raison de ces jeunes nymphes dont il en sortait bien, calcul fait, une par semaine du sérail, ce qui fait déjà un objet de plus de dix millions par an, mais aussi et surtout par rapport aux chefs et aux subalternes de toute espèce établis pour leur découverte ainsi qu’aux frais pour les décrasser, les approprier, les ajuster, les décorer, les mettre en état, en un mot, de séduire autant par leur élégance extérieure que par leurs charmes naturels, et si l’on ajoute à ces objets principaux de dépenses le gaspillage, on y trouvera une source intarissable du trésor public sous ce nom vague et abusif d’« acquis du comptant ».
Depuis les pertes successives que le roi avait éprouvées, Sa Majesté avait fait vider le Parc-aux-Cerfs pour se livrer tout entière à sa douleur.
L’âge qui avançait et la facilité qu’a un grand prince de satisfaire ses passions avaient très amorti celle des femmes chez lui.
Mais ce besoin, en diminuant, existait encore, et les courtisans jugèrent, d’ailleurs, nécessaire de distraire Sa Majesté du spectacle long et douloureux que lui offrait alors la maladie de la reine.
Les médecins firent entendre au roi qu’il était dangereux de se sevrer aussi brusquement de tout plaisir.
Il faut que le monarque ait approuvé la consultation puisque, malgré son chagrin de l’état et de la perte de sa compagne, ainsi qu’il qualifie la reine dans sa lettre à l’archevêque pour l’instruire de cette mort, il chargea le sieur Lebel de le pourvoir en cette partie.
Ce serviteur, très zélé, faisait souvent les recherches par lui-même, pour mieux servir Sa Majesté.
C’est dans un de ces jours de chasse qu’il s’offrit au comte du Barry, tout essoufflé et fatigué de ses perquisitions.
Celui-ci, qui avait le nez fin en pareille matière et qui, d’ailleurs, était connu du valet de chambre pour un homme qui pouvait lui être utile, n’eut pas de peine à le faire jaser.
Lebel lui témoigna donc son chagrin de n’avoir rien trouvé dans toutes ses courses qui pût convenir à son maître.
— N’est-ce que cela, lui dit le comte impudent ; j’ai votre affaire ; vous savez que je ne manque pas de goût. Fiez-vous en à moi ; venez dîner chez votre serviteur et dites que je suis un coquin si je ne vous présente pas la plus jolie femme, la plus fraîche, la plus séduisante, un vrai morceau de roi[14].
Le pourvoyeur du monarque, enchanté d’un propos aussi consolant, l’embrasse et lui promet de l’aller trouver à l’heure convenue.
M. du Barry n’a rien de plus pressé que de retourner à la maison et de faire mettre dans tous ses atours Mlle Lange (c’était le nom que Mlle Vaubernier portait depuis qu’elle était avec lui, suivant l’usage des courtisanes de prendre ainsi un nom de guerre lorsqu’elles entrent et qu’elles s’affichent ainsi dans le monde).
Il lui apprend le rôle qu’elle doit jouer, la berçant d’avance d’un espoir qu’il devait regarder comme chimérique et qui s’est pourtant réalisé.
Il lui fait entrevoir ses hautes destinées : il lui déclare qu’il n’est pas question de paraître simplement à Versailles et d’y satisfaire incognito les plaisirs du roi, qu’il veut la rendre maîtresse en titre et lui faire remplacer Mme de Pompadour ; qu’il faut, à cet effet, qu’elle passe auprès du sieur Lebel, qui va venir, pour sa belle-sœur, comme si elle eût réellement épousé le gros du Barry, qu’elle soutienne bien ce personnage en déployant cependant sa coquetterie et ses grâces, qu’elle lui laisse le soin du reste et que tout ira bien.
Mlle Lange, par plaisanterie, avait déjà pris plusieurs fois le titre de comtesse du Barry : c’était alors un usage assez répandu parmi les filles entretenues de se qualifier ainsi des titres de leurs amants.
Elle n’eut pas beaucoup de peine à faire ce personnage vis-à-vis du sieur Lebel qui, émerveillé de la figure de la jeune personne, de son enjouement, de son regard lascif, de ses propos assortis, sentit bientôt rajeunir chez lui le vieil homme et conçut par son expérience quel heureux effet une pareille femme devait opérer sur son maître.
Le dîner fut des plus gais.
Le sieur du Barry profita de l’enthousiasme du valet de chambre pour lui faire sentir que sa belle-sœur ne pouvait être proposée au roi comme les grisettes de toute espèce qu’on lui présentait et qu’on renvoyait ensuite sans aucune difficulté, que c’était une femme de qualité qui se trouverait sans doute très honorée de la couche d’un prince, aussi grand roi qu’amant désirable, mais qui ambitionnait encore plus la conquête de son cœur et qui n’en était pas indigne par l’attachement qu’elle se sentait déjà pour sa personne sacrée, attachement qui ne pouvait qu’augmenter dans une intimité plus grande.
Le Bonneau du jour était trop épris pour ne pas convenir de cette vérité et pour ne pas se prêter à tous les arrangements qui parurent nécessaires.
Il fut décidé, dès ce moment, que la prétendue comtesse serait un morceau sacré ; que le sieur Lebel rendrait compte au monarque de ce qu’il avait vu, qu’il représenterait à Sa Majesté le désir que la femme en question avait de lui plaire ; le dévouement entier de son mari aux volontés du souverain, et le bonheur auquel ce couple fidèle aspirait de concourir à ses plaisirs ; mais que cette beauté, se flattant d’avoir par devers elle de quoi lui prouver longtemps son amour, avait droit d’attendre un retour pareil de son auguste amant, et l’exclusion générale de toutes autres concurrentes.
Les courtisans malins ont prétendu que, d’après cette conversation, on avait permis à l’ambassadeur de prendre possession de la future au nom de Sa Majesté.
D’autres veulent que, plus adroitement, on lui ait fait entrevoir la possibilité d’y réussir s’il remplissait bien sa mission.
Quoi qu’il en soit, comme il était fort épris lui-même, il mit dans son récit au roi tant de chaleur et d’énergie, qu’il excita puissamment l’amour du prince ; mais pour mieux l’enflammer encore, et avant que Sa Majesté prît aucun engagement, il lui proposa de lui faire voir l’objet sans que la personne en fût instruite, et de mettre ainsi Sa Majesté en état de juger par Elle-même.
Le valet de chambre avait une petite maison arrangée pour cela, où il invita la comtesse à souper.
Il y a apparence que celle-ci était prévenue du témoin secret qu’elle devait avoir.
La compagnie fut assortie à la scène qu’il était question de jouer et le repas fut si voluptueux que le monarque ne put y tenir.
Dès la nuit même, il fit venir Mlle Lange.
Lebel, s’apercevant du goût décidé que son maître prenait peu à peu pour Mlle Lange et que les choses allaient beaucoup plus loin qu’il n’avait cru, se repentit de s’être prêté à la manœuvre du comte, d’autant plus qu’il n’était pas à ignorer ce qu’il en était réellement.
Il crut donc de son devoir, avant que la favorite fût plus en pied, de se jeter aux genoux du roi, de lui déclarer comment il avait fait la découverte de cette beauté, qu’il avait été surpris, qu’elle n’était rien moins qu’une femme de qualité et qu’elle n’était pas même mariée.
— Tant pis, s’écria le roi, suivant la tradition la plus reçue chez les courtisans, tant pis ! Qu’on la marie promptement pour qu’on me mette dans l’impuissance de faire quelque sottise.
On ajoute que le conseiller Bonneau voulut alors entrer dans plus de détails, mais qu’un regard sévère du maître l’obligea de se taire.
On veut que, frappé de douleur d’avoir produit une pareille créature et envisageant les suites que pouvait entraîner une passion aussi violente dans un prince qui approchait de la vieillesse, ce serviteur zélé en conçut un chagrin qui l’a mené au tombeau.
D’autres prétendent que, pour prévenir les révélations indiscrètes qu’il pourrait faire, on a accéléré ses jours et qu’il est mort empoisonné.
Quoi qu’il en soit, le propos du roi rehaussa merveilleusement les espérances du comte du Barry pour le distinguer de ses frères.
Il en avait un, que nous nommerons le gros du Barry, une espèce de sac à vin, un pourceau, se vautrant le jour et la nuit dans les plus sales débauches.
Il fut décidé que ce serait lui auquel on marierait Mlle Lange.
Il était prévenu d’avance, et l’on n’eût pas de peine à le déterminer en lui faisant entendre que cette facilité de sa part lui donnerait celle de mener plus librement le genre de vie qui lui convenait et lui procurerait tout l’argent dont il aurait besoin.
Cet espoir aurait pu corrompre une âme moins vile.
Il subit la cérémonie et le mariage fut fait à la paroisse de Saint-Laurent, le 1er septembre 1768.
C’était le notaire Le Pot, d’Auteuil, qui passa le contrat : il ne savait pas encore quelle était la haute destinée de la beauté dont il formait l’alliance civile ; mais, frappé de ses charmes et de ses grâces, il voulut jouir du privilège usité parmi ses confrères en pareil cas ; il s’avança galamment pour embrasser la jeune personne ; celle-ci, non prévenue, fit la résistance que prescrit la pudeur dans toute autre, et que le rôle qu’elle jouait depuis quelque temps l’autorisait bien mieux à montrer.
Son beau-frère futur l’engagea à permettre à l’officier public de lui effleurer les joues, puis, s’adressant à lui :
— Souvenez-vous bien, Monsieur, lui dit-il, de cette faveur, car c’est la dernière que vous recevrez de Madame.
L’auguste amant fut enchanté d’apprendre que la cérémonie fût faite.
Il parut se livrer avec plus de confiance à la nouvelle comtesse et, chaque jour, sa passion, au lieu de diminuer, augmenta tellement que les du Barry ouvrirent leur cœur à la plus vaste ambition.
Mais il était question de bien diriger la favorite et ce plan exigeait beaucoup d’adresse et de circonspection.
Celle-ci n’avait aucun esprit, surtout rien de celui d’intrigue qu’exigeait sa position.
On a vu, par le cours de ses aventures, jusqu’au moment de son élévation, qu’elle était dénuée de ce manège qu’ont communément les courtisanes et qui leur sert si bien à attraper les hommes.
Comme elle n’était ni intéressée, ni ambitieuse, elle n’était pas mue par les ressorts puissants de ces deux passions, si énergiques dans les âmes les plus communes, car la nouvelle comtesse apporta dans le rôle qu’elle entreprenait une qualité peut-être meilleure : c’est une sorte de bon sens pour adopter les avis qu’on lui donnait, les faire valoir, en profiter ; en un mot, une docilité merveilleuse aux conseils de son beau-frère, dont le succès, dans le projet qu’il avait formé, lui assurait plus que jamais la confiance de sa belle-sœur.
Le point de difficulté était seulement alors de dérober aux yeux des courtisans le fil secret qui conduisait la favorite ; car, outre qu’une assiduité trop grande de la part de du Barry auprès d’elle pouvait être suspecte au monarque même, c’est qu’elle donnait prise à la malignité des courtisans et qu’une expulsion subite de ce conseil mettait la favorite à découvert et dans le cas de faire beaucoup de sottises.
Le comte du Barry imagina donc un plan de conduite qu’on peut regarder comme un chef-d’œuvre de politique en ce genre.
Ce fut de paraître abandonner absolument sa belle-sœur à ses brillants destins et de ne point se montrer à la cour ; mais, en même temps, il mit auprès d’elle Mlle du Barry, sa sœur, qu’il jugea très propre à l’emploi qu’il voulait lui confier. Celle-ci était trop laide, en effet, pour donner la moindre jalousie à la comtesse, pour se livrer même à des intrigues amoureuses qui pourraient la détourner de son objet principal.
Elle avait d’ailleurs, de l’esprit : c’était une virtuose qui avait fait preuve de talent littéraire, et dont on lisait dans le Mercure une lettre imprimée.
Elle était insinuante et ne tarda pas à maîtriser la favorite, ce qui était essentiel.
Il s’établit ainsi une circulation continuelle du frère à la sœur, et de celle-ci à la comtesse ; et de même de la comtesse à Mlle du Barry et de la sœur au frère.
De jeunes confidents stylés par le comte étaient continuellement sur la route de Versailles et portaient les ordres, verbalement ou par écrit, suivant les circonstances.
Les messages étaient multipliés au besoin et la favorite était, par-là, dirigée à la minute.
Quelquefois, elle faisait de petits voyages à Paris où, n’ayant pas de maison, elle logeait chez son beau-frère et y puisait des instructions générales qu’il ne s’agissait plus que d’appliquer à des cas particuliers.
Malgré ces précautions si sages, si multipliées, si circonstanciées, il sera bien étonnant, sans doute, qu’une fille de naissance obscure, mal éduquée, n’ayant vu, en quelque sorte, que mauvaise compagnie, n’ayant point d’aptitude par elle-même à l’intrigue, ait pu se conserver pendant l’année qui s’écoula de sa première entrevue avec le roi jusqu’au jour de sa présentation sans donner prise sur elle par quelque inconduite, soit par des indiscrétions, soit par des propos qui eussent prêté au ridicule.
Il était d’autant plus nécessaire pour elle de se maintenir dans une grande circonspection qu’elle avait contre elle la cabale la plus formidable de la cour, celle des Choiseul.
À ce nom seul, on est confondu d’étonnement quand on envisage comment la chance a tourné, et quelle suite de révolutions s’est succédée rapidement par un agent aussi vil, aussi faible en apparence, et qui semblait devoir se briser comme le verre sous la main d’un ministre tout-puissant.
En effet, jamais Richelieu n’eut peut-être plus d’ascendant sur l’esprit de Louis XIII que M. le duc de Choiseul n’en avait acquis sur celui de son maître.
Depuis la paix, il s’était insinué dans sa confiance plus qu’auparavant.
L’art prodigieux de ce ministre pour l’intrigue le faisait regarder par le roi comme un grand politique, et la persuasion où était Sa Majesté que c’était lui qui, par ses négociations, tenait les ennemis naturels de la France divisés et hors d’état de l’inquiéter, le lui rendait plus nécessaire que jamais en ce qu’Elle le croyait le seul homme capable d’opérer la conservation d’une paix si désirée et l’unique objet des vœux du monarque.
Il avait, d’ailleurs, un travail bref, leste et facile, qui favorisait merveilleusement la paresse de celui-ci.
En lui rendant compte des plus grandes affaires, il ne lui parlait que de spectacles et de plaisirs.
Indépendamment de ces motifs d’agrément, d’utilité ou plutôt de nécessité, qui semblaient devoir rendre M. le duc de Choiseul inébranlable sous le règne d’un prince qui, en vieillissant, ne pouvait que devenir plus faible et plus subjugué, ce seigneur avait une grande considération par lui-même.
Il était d’une naissance illustre, allié à plusieurs maisons souveraines, et surtout à celle de Lorraine, ce qui lui valait la protection intime de la cour de Vienne.
Son pacte de famille l’avait rendu cher aux différentes branches de la maison de Bourbon, et sa guerre ouverte contre les Jésuites le rendait particulièrement précieux aux rois d’Espagne et de Portugal.
Enfin au dedans de la France, il avait un parti immense.
Toutes les places étaient remplies de ses créatures ; la moitié des princes du sang le craignait ; l’autre lui était attachée par les liens du plaisir et de l’amitié.
Les du Barry, effrayés d’abord d’un pareil ennemi, cherchèrent à le gagner et à le mettre dans leurs intérêts.
Ce seigneur était galant et voluptueux.
On prétend que le beau-frère fit entendre à la comtesse qu’il fallait mettre tous ses charmes en avant contre lui et que, si la haine de celui-ci est montée à son comble, c’est qu’elle les a vus méprisés par ce superbe adversaire qui, ne croyant rien avoir à redouter d’une femme aussi vile, la traita avec la plus grande hauteur. Mais ce qui contribua vraisemblablement à ouvrir une guerre implacable entre les deux cabales, ce fut la rivalité de la duchesse de Gramont, sœur du ministre.
Cette femme, plus haute, plus impérieuse, plus intrigante que son frère, s’il est possible, avait jeté le grappin sur celui-ci et l’avait subjugué au point d’en faire tout ce qu’elle voulait.
Leur intimité avait donné lieu, même, à la malignité des courtisans de s’exercer.
Quoi qu’il en soit, c’était une femme de cour, dans toute la valeur du terme, c’est-à-dire décidée, impudente, dévergondée, et ne regardant les mœurs que comme faites pour le peuple.
Elle n’était plus jeune et sa figure n’était rien moins que séduisante.
Elle s’était imaginé malgré cela pouvoir plaire au roi.
Profitant de son rang et de la faveur de son frère, elle s’était initiée aux petits appartements et aux plaisirs secrets de Sa Majesté.
Comme il ne se trouvait, depuis la mort de Mme de Pompadour, aucune femme en état de balancer ses menées à cet égard, elle avait profité de la connaissance du caractère bon et facile du roi, de sa faiblesse pour le sexe et de sa pente à se laisser entraîner au plaisir le plus présent, pour le séduire presque malgré lui. C’était, du moins, l’opinion la plus accréditée dans Versailles.
Mais comme ce commerce n’était que l’effet de la commodité, que chaque fois, pour ainsi dire, elle obsédait le monarque, elle fut aussitôt rejetée dès qu’un objet plus propre à faire naître l’amour vint réveiller les sens engourdis de celui-ci et chatouiller son cœur.
Une pareille injure ne se pardonne pas parmi le sexe le plus ordinaire.
Qu’on juge si une femme de qualité, dévorée d’ambition, qui se voyait tout à coup frustrée du rôle qu’elle comptait jouer, dût être furieuse.
La vengeance lui fit perdre la tête entièrement et, sans prévoir ce qui pouvait en résulter de funeste, elle profita de son empire sur le ministre, son frère, pour l’engager dans sa querelle et le rendre sourd à toutes les propositions qu’il recevrait de l’autre parti.
C’est à cette rage effrénée qu’il faut promptement remonter pour trouver la première cause de la chute des Choiseul.
Les du Barry ayant vu qu’il n’y avait aucune conciliation à faire avec eux, qu’il fallait travailler à les culbuter ou se résoudre à l’être par eux, se déterminèrent au premier parti et trouvèrent bientôt dans le chancelier Maupeou un homme propre à les seconder.
Mais ne prématurons pas les événements.
La duchesse de Gramont dans son plan de vengeance, crut que la meilleure manière de réussir était de révéler les turpitudes de la nouvelle favorite, de les exagérer même, et de la rendre si vile que le monarque eût enfin honte d’un goût si dépravé.
Il était plus adroit de ne pas le faire soi-même, ce qui aurait pu ne pas réussir, cela aurait eu l’air d’une récrimination, toujours suspecte de la part d’une maîtresse délaissée.
Son frère fut assez fin pour ne pas se charger d’avertir le prince et tous deux convinrent qu’il valait beaucoup mieux qu’il fût instruit par le cri public qui, plus lentement sans doute, mais tôt ou tard lui parviendrait.
Ils profitèrent de la puissance du ministre pour répandre par toutes les voies possibles le bruit des nouvelles amours du roi.
Ils envoyèrent des émissaires dans toutes les sociétés, qui en rapportèrent les détails ; et, après avoir eu par le canal de la police l’histoire de la vie de Mlle Lange, on la chargea de quelques anecdotes propres à la rendre plus ridicule et plus méprisable, et l’on en vint jusqu’à la faire chansonner dans les rues de la capitale et dans les provinces.
Voici comme on en parlait, la première fois, dans des bulletins de nouvelles qui couraient Paris et ne pouvaient guère être inconnus de M. de Sartine qui en plaisantait encore lui-même :
3 septembre 1768. – « Il a paru à Compiègne une comtesse du Barry qui a fait grand bruit par sa figure.
« On dit qu’elle plaît à la cour et que le roi l’a très bien accueillie.
« Sa beauté et cette prompte célébrité ont excité les recherches de beaucoup de gens.
« On a voulu remonter à l’origine de cette femme et, si l’on en croit ce qu’on dit en public, elle est d’une naissance très ignoble ; elle est parvenue par des voies peu honnêtes et toute sa vie est un tissu d’infamies.
« Un certain du Barry, qui se prétend des Barimore d’Angleterre, et qui l’a fait épouser son frère, est l’instigateur de cette nouvelle maîtresse.
« On prétend que le goût et l’intelligence de cet aventurier dans le détail des plaisirs le font aspirer à la confiance du roi pour les amusements de Sa Majesté, et qu’il succédera au sieur Lebel en cette partie. »
On conçoit qu’il était difficile qu’on eût répandu un pareil bulletin dans Paris, si le gazetier n’avait été excité sous mains par un protecteur puissant.
Il ajoutait dans un autre, en date du 15 octobre 1768 :
« Depuis quelque temps, il court ici une chanson intitulée : La Bourbonnaise, qui a été répandue avec une rapidité peu commune ; quoique les paroles en soient fort plates, et que l’air en soit on ne peut plus niais, elle est parvenue aux extrémités de la France et se chante jusque dans les villages.
« On ne peut se transplanter nulle part sans l’entendre ; les gens qui raffinent sur tout ont prétendu que c’était un vaudeville satirique sur une certaine fille de rien, parvenue de l’état le plus crapuleux à jouer un rôle et à faire une sorte de figure à la cour.
« Il est certain qu’on ne peut s’empêcher de remarquer dans l’affectation à la divulguer si généralement une intention décidée de jeter un ridicule odieux sur celle qu’elle regarde.
« Les gens à anecdotes n’ont pas manqué de la recueillir et d’en grossir leurs portefeuilles avec tous les commentaires nécessaires à son intelligence et capables de la rendre précieuse pour la postérité. » Enfin, il disait dans un troisième du 16 novembre 1768 :
« La Bourbonnaise est une chanson répandue dans toute la France.
« Sous les paroles plates et triviales de ce vaudeville, les courtisans malins découvrent une allégorie relative à une créature qui, du rang le plus bas et de la fange de la débauche, est parvenue à être célèbre et à occuper d’elle et la ville et la cour.
« On ne saurait mieux rendre l’avilissement dans lequel est tombé le contrôleur-général Laverdy depuis sa chute, que par l’association que le public semble en faire avec cette femme perdue en le chansonnant avec elle. »
Il cite ensuite un couplet fait effectivement contre ce ministre sur l’air de la Bourbonnaise.
Voici cette chanson originale, qui a donné lieu à une multitude d’autres.
L’approbation de M. de Sartine est du 16 janvier 1768, le temps où précisément Mlle Lange venait d’être produite au roi à la sourdine.
CHANSON NOUVELLE
Air : De la Bourbonnaise.
La Bourbonnaise
Arrivant à Paris
A gagné des louis,
La Bourbonnaise
A gagné des louis
Chez un marquis.
Pour apanage
Elle avait la beauté
Elle avait la beauté
Pour apanage
Mais ce petit trésor
Lui vaut de l’or.
Étant servante
Chez un riche seigneur
Elle fit son bonheur
Quoique servante
Elle fit son bonheur
Par son humeur.
Toujours facile
Aux discours d’un amant
Ce seigneur la voyant
Toujours facile
Prodiguait les présents
De temps en temps
De bonnes rentes
Il lui fit un contrat,
Il lui fit un contrat,
De bonnes rentes,
Elle est dans la maison
Sur le bon ton.
De paysanne
Elle est dame à présent,
Elle est dame à présent,
Mais grosse dame
Porte des falbalas
Du haut en bas.
En équipage.
Elle roule grand train
Elle roule grand train,
En équipage,
Et préfère Paris
À son pays.
Elle est allée.
Se faire voir en cour,
Se faire voir en cour,
Elle est allée,
On dit qu’elle a, ma foi !
Plu même au Roi !
Filles gentilles
Ne désespérez pas,
Quand on a des appas,
Qu’on est gentille,
On trouve tôt ou tard
Pareil hasard.
Comment eût-on trouvé une application aussi heureuse à faire à l’histoire de notre héroïne, si cette romance n’eût été faite à dessein ?
Il faut convenir, cependant, que le huitième couplet, qui la caractérise le mieux, ne se trouve pas dans les recueils imprimés et qu’il a été vraisemblablement composé après coup.
Quoi qu’il en soit, on fit d’autres chansons qui n’étaient pas équivoques et qui, sans courir les rues, furent très répandues.
Voici la plus naïve et la plus piquante en même temps :
AUTRE CHANSON.
Air : de la Bourbonnaise.
Quelle merveille !
Une fille de rien,
Une fille de rien,
Quelle merveille !
Donne au Roi de l’amour,
Est à la cour.
Elle est gentille,
Elle a les yeux fripons ;
Elle a les yeux fripons ;
Elle est gentille ;
Elle excite avec art
Un vieux paillard
En maison bonne
Elle a pris des leçons
Elle a pris des leçons
En maison bonne,
Chez Gourdan, chez Brisson,
Elle en sait long.
Il courut aussi des quolibets de toute espèce.
On dit que Mme la comtesse du Barry était la meilleure trotteuse de Paris, parce qu’elle n’avait fait qu’un saut du Pont-Neuf au Trône.
Le Pont-Neuf était alors un quartier de Paris où il y avait beaucoup de filles galantes, et le Trône était une barrière éloignée à l’entrée du faubourg Saint-Antoine.
On peut juger par ces plates turlupinades que se permettait assez publiquement la plus vile canaille, à quel point de licence on s’exprimait impunément sur la nouvelle maîtresse.
Il n’y eut pas jusqu’à M. de Voltaire qui, pour faire la cour aux Choiseul, dont il était le très humble serviteur, ne s’égayât à cette occasion.
Il se permit un conte, pour le moins très indécent, qui, de ce temps-là même, était très rare et l’est devenu beaucoup plus depuis. Il était intitulé : L’Apothéose du roi Pétaud.
Indépendamment de ces écrits qui tendaient à recueillir généralement tout ce qui pouvait avilir davantage le goût du roi, et lui faire honte à lui-même de ses nouvelles amours, les Choiseul animaient la famille royale et voulaient exciter une fermentation telle que Sa Majesté se trouvât forcée, du moins par son désir de maintenir la paix parmi elle, de laisser la comtesse dans l’état d’obscurité où elle était encore et de n’oser la faire présenter.
La présentation à la cour est un point d’autant plus essentiel, en France, pour une maîtresse de monarque, que faute de ce cérémonial, elle n’y peut obtenir aucune place, elle n’y est jamais que précairement, et elle est dans le cas d’être expulsée d’un moment à l’autre, sans prétendre aux dédommagements dont une faveur déclarée la rend au moins susceptible, si elle ne la met pas à l’abri d’une disgrâce qui peut survenir tôt ou tard.
En un mot, Mme du Barry n’avait d’autre distinction avec les femmes du Parc-aux-Cerfs que d’être clandestinement des voyages et de fixer plus constamment la passion de son auguste amant.
Elle avait été logée dans le château de Fontainebleau pendant tout le séjour de Sa Majesté dans cette ville : elle devait se flatter de posséder exclusivement le cœur et la couche du monarque, mais elle ne montait point dans ses carrosses ; elle ne pouvait manger avec lui en public, elle n’aurait osé se montrer chez le Dauphin, chez ses frères, chez Mesdames.
Les ministres politiques auraient, sans doute, eu beaucoup d’égard pour ses recommandations, mais étant censés ignorer son existence, ils auraient pu la méconnaître et la refuser sans inconvénient.
Elle ne recevait aucune visite d’étiquette des grands, des ambassadeurs, et la présentation la faisait jouir de toutes ces prérogatives, les unes dues, les autres accordées par l’adulation, et passées presque en usage et en loi.
Il était donc bien naturel qu’elle aspirât à faire ce premier pas vers les honneurs ; et c’est ce que la cabale adverse voulait empêcher.
Voici ce qu’on lisait dans les Nouvelles dont nous avons déjà parlé :
« Du 12 novembre 1768. – On regarde déjà comme décidé que Mme la comtesse du Barry ne sera point présentée.
« La figure charmante de cette jeune mariée avait attiré les regards de tous les courtisans, et le roi paraissait vouloir augmenter le nombre des beautés de la cour.
« Des impressions fâcheuses données à Mesdames sur l’origine et les premières années de cette nouvelle comtesse, les ont engagées à supplier le roi de ne point permettre qu’elle parût sous leurs yeux.
« Sa Majesté a cru devoir céder à ces représentations et cherche à dédommager Mme du Barry d’une telle mortification par toutes sortes d’égards et de bontés.
« Elle est logée à Versailles, dans l’appartement du sieur Lebel, le premier valet de chambre (qui l’a présentée au roi).
« Cette vaine cérémonie occasionnait beaucoup de rumeur à la cour et l’on croit que la jalousie des femmes à prétention qui craignaient, avec raison, d’être éclipsées par la divine présentée, n’a pas peu contribué à exciter le soulèvement général contre elle.
« Les ministres avaient pris parti dans cette affaire, devenue très importante pour eux… »
Cet article adroit et plein de malice ne pouvait être suggéré que par des gens du parti contraire.
Cependant, en peu de jours, la chance tourna, ou, pour mieux dire, on s’exprimait d’un ton plus douteux, et avec autant d’honnêteté, on ne cherchait pas moins à la rendre odieuse tour à tour et ridicule, soit en annonçant les révolutions qu’elle devait opérer et qui ne pouvaient paraître que funestes aux créatures de Choiseul ou aux gens prévenus en faveur de son ministère, soit en la dépeignant sous des couleurs qui l’auraient rendue impropre au rôle qu’on lui destinait.
On disait dans un article du 28 décembre : « … Mme la comtesse du Barry continue à mériter l’attention de la cour et de la ville.
« On parle de nouveau de la fixer à la première et de la présenter.
« Il y a des paris ouverts à Versailles, pour ou contre.
« Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’il y aura un grand changement dans le ministère si elle parvient à cet honneur.
« L’éloignement que M. le duc de Choiseul a témoigné hautement pour elle ne lui permettait point de rester en place.
« Elle a de son côté MM. Bertin, dévots, qui regarderaient comme une bonne œuvre, n’importe par quelle voie, l’expulsion du premier. Ils l’estiment très irréligieux et ils redoutent son esprit tranchant et décidé, principalement sur toutes les matières ecclésiastiques.
« Quant à Mme du Barry, on débite qu’elle s’ennuie à la cour, que toute cette gêne ne va point à son caractère libre et folâtre, et que ce n’est qu’une machine dont se servent les hommes ambitieux pour parvenir à leurs fins. »
Peu de jours après, le même journaliste baissait encore plus le ton ; il devenait même louangeur.
On en jugera par l’article suivant, du 31 décembre de la même année : « Le bruit général de Versailles est que Mme la comtesse du Barry sera présentée le 3 du mois prochain. On cite d’elle un trait qui fait infiniment d’honneur à son cœur et caractérise sa modestie dans l’élévation où elle se voit portée comme malgré elle.
« Cette comtesse a envoyé chercher, il y a quelques jours, M. Billard-Dumouceaux, ancien payeur des rentes.
« Le vieillard, fort étonné de l’invitation, s’y est rendu doutant qu’elle pût le concerner.
« Il a été enchanté de l’honnêteté, de la politesse, de la gaîté même avec laquelle on l’a reçu.
« Cette dame, après s’être plu à le questionner beaucoup sur une petite fille dont il avait été le parrain depuis vingt-quatre à vingt-cinq ans, l’avait blâmé sur son indifférence et sur l’oubli parfait où il semblait être d’elle et de l’événement, lui a montré l’extrait baptistaire qui constatait le fait, et lui a déclaré qu’elle était cette filleule, qu’avec sa mère, le regardant comme ce qu’elle avait de plus cher au monde, elle était bien aise de renouveler connaissance avec lui, de le cultiver et de se trouver à portée de lui témoigner sa gratitude et son attachement.
« M. Dumouceaux, émerveillé de tout cela, ne put s’empêcher de publier ce beau trait, qui passe aujourd’hui pour constant dans Paris. »
Une anecdote particulière, mais fondée par un fait, fit connaître à la cour combien Mme la comtesse du Barry acquérait de consistance et quel intérêt vif le roi prenait à elle.
Sa Majesté, qui l’avait tenue écartée jusque-là du château, la fit installer dans l’appartement qu’occupait la feue marquise de Pompadour, et qui était devenu en partie celui du gouverneur.
M. le comte de Noailles crut devoir faire quelques représentations sur le dérangement qu’occasionnerait dans ses fonctions un déplacement de cette espèce.
Il s’y hasarda, mais sans succès, et ce seigneur, ayant trop insisté dans l’excès de son zèle, fut à la veille de perdre les bonnes grâces du roi. Heureusement, il voulut bien excuser cette ardeur trop grande du gouverneur pour son service auprès de sa personne.
On ne douta plus que la favorite ne fût présentée incessamment.
Il se faisait journellement des paris pour ou contre, et ceux qui avaient perdu demandaient leur revanche, dans l’espoir de jongler mieux une autre fois.
Entre autres jours, le mercredi 25 janvier avait été annoncé comme le terme de cette époque heureuse pour la comtesse.
Le bruit de cette nouvelle était si général et si accrédité, qu’une foule de curieux s’était rendue en poste à Versailles pour assister à la cérémonie.
Ils furent frustrés dans leur espoir : on dit que Mme la comtesse de Béarn, qui était chargée de cette fonction, s’était trouvée incommodée.
Les partisans des du Barry prétendirent que le comte Jean (c’est ainsi qu’on a désigné depuis le beau-frère) avait demandé, avant que sa belle-sœur reçût ses honneurs, à dissiper les nuages qu’on élevait sur leur famille, à bien constater sa naissance et sa noblesse, qu’en conséquence on avait fait venir ses papiers d’Angleterre où se trouvait une généalogie très établie qui prouvait son extraction de l’illustre maison de Barimore.
Cependant le public gratifiait déjà Mme du Barry de plusieurs belles terres.
Les uns lui faisaient acheter celle de la Selle, auprès de Saint-Germain-en-Laye, appartenant ci-devant au sieur Roussel, fermier-général, qui la lui vendait 80 000 livres.
D’autres lui donnaient la principauté de Lux, venant de la maison de Luxembourg, et fondaient cette acquisition moins sur la valeur réelle que sur la qualité brillante de princesse qu’elle en devait porter.
Une faveur particulière que reçut dans ce temps-là la comtesse de Béarn, qu’on annonçait pour la marraine à la cour de la future présentée, confirma le rôle qu’elle devait jouer.
Son fils, le vicomte de Béarn, qui sortait d’être page chez le roi et l’intime ami du fils du comte Jean, alors page aussi de Sa Majesté et connu depuis sous le nom du vicomte Adolphe, entra dans les carabiniers et fut présenté peu après à Sa Majesté.
Le monarque l’accueillit de la façon la plus flatteuse ; il le fit monter sur-le-champ dans ses carrosses et, dès lors, il fut admis à toutes les parties de plaisir des petits appartements.
Il a été constaté depuis, ce dont les fins politiques se doutaient alors, que le retard de la présentation de Mme la comtesse du Barry ne provenait que de la bonté du roi qui ne voulait pas faire d’éclat vis-à-vis de sa famille et attendait qu’elle fût disposée à l’événement.
Il n’ignorait pas qu’on excitait sous mains Mesdames à rejeter une telle présentation.
En conséquence, il chargea le duc de la Vauguyon de faire part à Madame Adélaïde des projets de Sa Majesté et d’engager la princesse à se conformer aux vues de son auguste père.
La négociation ne réussit pas aussi promptement que le désirait le monarque.
Les Choiseul, toujours en crédit, excitaient les princesses à tenir ferme, et pour les mieux révolter, exagéraient encore à leurs yeux la bassesse de l’extraction de la favorite, la dépravation de ses mœurs particulières et le scandale de sa vie publique.
Pour mieux confirmer leur répugnance, comme on ne pouvait mettre sous leurs yeux les chansons grossières qu’on avait faites sur la comtesse et que cette façon de diffamer en vaudevilles est cependant la plus sanglante, la plus sûre et la plus indélébile, ils firent faire des couplets qui disaient la même chose, mais par une tournure ingénieuse, délicate et qui, conséquemment, n’en était que plus cruelle et plus perfide.
La satire y prenait le ton des grâces et s’embellissait de leur parure, ce qui, indépendamment du point historique qu’ils constatent, les rend précieux par leur mérite intrinsèque.
Ils sont sur l’air : Vous qui vous moquez par vos ris.
Lisette, ta beauté séduit
Et charme tout le monde
En vain la Duchesse en rougit
Et la Princesse en gronde ;
Chacun sait que Vénus naquit
De l’écume de l’onde.
En vit-elle moins tous les Dieux
Lui rendre un juste hommage,
Et Pâris, ce berger fameux
Lui donner l’avantage
Même sur la Reine des Cieux
Et Minerve la sage ?
Dans le sérail du Grand Seigneur
Quelle est la favorite ?
C’est la plus belle au gré du cœur
Du maître qui l’habite,
C’est le seul titre en sa faveur
Et c’est le vrai mérite.
Au surplus, cette tournure, bien loin de perdre Mme du Barry, ou de lui nuire, comme le croyaient ses ennemis, ne fit qu’accroître pour elle l’ardeur de son amant.
On sait qu’en général, les passions se fortifient par la contrariété et celle des vieillards en prennent encore mieux un caractère d’opiniâtreté.
C’est ce qu’il fut aisé de juger par la conduite du monarque.
Ce prince, voulant rapprocher de lui davantage la favorite, fit donner à Madame Adélaïde l’appartement de la feue Dauphine et plaça Mme du Barry dans celui de la princesse[15].
Cet arrangement était nécessaire aux plaisirs du roi pour jouir plus facilement et aussitôt qu’il le voudrait des charmes secrets de sa maîtresse.
Il s’inquiéta peu de gêner Mesdames, qui se trouvèrent ainsi séparées de leur sœur et acquirent une nouvelle voisine qu’elles détestaient de plus en plus.
Les négociateurs de cette translation leur firent entendre que, si elles aimaient véritablement leur auguste père, il fallait, sans bouder, sacrifier tout à sa satisfaction.
Mais de toutes ces tracasseries particulières des Choiseul, de leur acharnement constant à se déchaîner contre la nouvelle venue, à la décrier, à répandre sur son compte les plus scandaleuses anecdotes, les propos les plus vils et les plus infâmes, il en résulta pour les du Barry la nécessité, non seulement de se mettre en défense, mais encore d’attaquer leurs formidables ennemis et, ne pouvant le faire ouvertement, de les miner en détail et à la sourdine.
Ce genre de perfidie politique, de méchanceté réfléchie, lente et profonde, n’était pas dans le caractère d’une femme jeune, jolie, étourdie, franche et accoutumée à dire tout ce qui lui passait par la tête et à quelque prix que ce fût.
La comtesse donc ne dissimula pas la haine qu’elle portait à des ennemis qui la provoquaient sans ménagement ; mais substituant la plaisanterie au fiel de ces sortes d’animosités, elle ne mit que de l’enjouement où les autres mettaient de la fureur.
On se rappelle que, dans ces temps-là, par un jeu qui ne paraissait que puéril, et qui cependant pronostiquait les grands événements subséquents, la favorite prenait souvent deux oranges : elle les serrait dans chacune de ses mains et, les jetant en l’air, s’écriait en riant : Saute, Choiseul saute, Praslin.
Un critique gai, entrant dans la même tournure d’esprit, dépeignit dans une épigramme grivoise la révolution qu’allait opérer, chez les courtisans, le changement de faveur.
On dit que Choiseul et Barri
Animaux très antipathiques
Partagent la cour aujourd’hui
Et suspendent les vœux de tous nos politiques ;
Il faut opter des deux.
C’est le tout pour le tout,
Car de leur sort dépend le nôtre.
Cette révolution ne s’opérait qu’insensiblement.
Le grand crédit du ministre, ce colosse de puissance, pareil à un chêne altier qui, de sa tête, semblait toucher les cieux et de ses racines profondes pénétrer aux enfers, contenait encore ceux mêmes qui désiraient le plus son abaissement.
Aucune femme n’osait se charger de la présentation de Mme du Barry, et la comtesse de Béarn, qui s’était d’abord décidée à le faire, était arrêtée par les suites qu’on lui faisait envisager.
Cependant, comme elle s’y était engagée, elle prétextait une entorse et restait chez elle, le pied sur sa chaise longue.
Alors le comte Jean, moteur de toute l’intrigue, et qui sentait combien il était nécessaire de lier le roi par un acte de reconnaissance authentique, se retourna d’une autre façon. Il déterra une Mme d’Alogny qui, dans le cas de paraître à la cour, ne s’y était pas montrée, dont la réputation même n’était pas bien pure à Paris. Il n’eut pas de peine à l’éblouir de ses belles promesses : elle se fit présenter et passa pour devoir suppléer aux fonctions de Mme de Béarn.
Le but de cette cérémonie était si répandu que Madame Adélaïde, dit-on, piquée du rôle que Mme d’Alogny se proposait de lui faire jouer, lorsqu’elle lui fut amenée, et qu’elle se mit à genoux pour chercher à baiser, conformément à l’étiquette, le bas de sa robe, loin de la relever et de lui donner la main, suivant l’usage, la laissa dans cette posture humiliante.
La présentation future passa pour d’autant moins équivoque que M. le marquis de Marigny fit donner, vers le même temps, des ordres aux contrôleurs des différentes maisons royales, comme Marly, Choisy, Bellevue, etc., de remettre les appartements de feue Mme la marquise de Pompadour comme ils étaient et d’en rétablir toutes les communications avec ceux du roi.
On en conclut que Mme du Barry serait des petits voyages dont la saison approchait, et où il ne va que des femmes présentées et nommées par Sa Majesté.
Cette cérémonie devenait donc instante.
Cependant, depuis la présentation de Mme d’Alogny, la seconde marraine désignée, il s’était écoulé encore près d’un mois ; ce qui ranimait l’espoir du parti contraire et lui faisait penser que Sa Majesté, toujours perplexe, n’oserait se déterminer à un acte d’éclat contre sa famille.
Différentes présentations qu’il y eut dans cet intervalle fortifièrent leurs conjectures et les paris pour ou contre se multiplièrent.
Le comte du Barry fit enfin employer à sa belle-sœur la dernière ressource, qui devait être la plus efficace.
Elle se jeta en larmes aux pieds de son amant : elle le conjura par toute la passion qu’il lui témoignait de ne point la laisser en butte aux propos injurieux de ses ennemis, de les faire taire en annonçant ses bontés pour elle d’une manière solennelle, en la prenant ainsi sous sa sauvegarde royale.
Cette scène, jouée avec tout le pathétique possible, réussit.
Plusieurs messagers, envoyés de Versailles le 22 avril au soir, annoncèrent que Mme du Barry venait d’être présentée au retour de la chasse ; ce qui occasionna bientôt un cancan prodigieux dans Paris.
On assura que tous les ministres étrangers devaient envoyer, dans la nuit même, des courriers à leurs cours respectives pour y apprendre cette importante nouvelle.
Comme on ne peut jamais mieux fixer les faits que par le témoignage des contemporains, et que, dans les récits de cette espèce, où tant de gens sont intéressés à altérer la vérité, le premier cri public est toujours le meilleur, le plus véridique et le plus propre à constater la sensation qu’ils produisent, voici ce qu’on en disait dans les Nouvelles déjà citées, en date du 25 avril, c’est-à-dire trois jours après la présentation :
« Sa Majesté, fort embarrassée sur la présentation de Mme la comtesse du Barry, ne s’y est déterminée que d’après les instances réitérées de cette dame, qui a regardé comme injurieuse la suspension d’une cérémonie annoncée depuis longtemps avec tant d’éclat et dont avaient retenti même les gazettes étrangères. Elle a été touchée de sa douleur et de ses prières, et a pris à cet égard une résolution irrévocable.
« En conséquence, le vendredi soir 21, en revenant de la chasse, le roi annonça qu’il y aurait une présentation le lendemain, qu’elle serait unique, que c’était une présentation dont il était question depuis longtemps. Enfin, il déclara que ce serait celle de Mme du Barry.
« Le soir, un bijoutier apporta pour cent mille francs de diamants à cette dame.
« Le lendemain, l’affluence fut si grande qu’on la jugea plus nombreuse que celle occasionnée précédemment par le mariage de M. le duc de Chartres, au point que le monarque, étonné de ce déluge de spectateurs, demanda si le feu était au château.
« Mme du Barry a été fort bien reçue de Mesdames, et même avec des grâces particulières. Le lendemain, dimanche, elle a assisté à leur dîner. Tous les spectateurs ont admiré la noblesse de son maintien et l’aisance de ses attitudes. Ce rôle de femme de cour est ordinairement étranger les premiers jours qu’on le joue, et Mme du Barry l’a rempli comme si elle y eût été habituée depuis longtemps.
« Depuis lors, Mme du Barry donne des soupers où elle invite tous les grands de la cour et les ministres. Au bas de l’invitation, on assure qu’on y lit : « Sa Majesté m’honorera de sa présence. »
Ce fut Mme la comtesse de Béarn qui fit la présentation.
Il passa pour constant alors qu’elle reçut une gratification de cent mille francs pour cette complaisance.
DEUXIÈME PARTIE
Plus un homme a été contraint dans ses désirs, plus, lorsqu’il a rompu la barrière qui s’y opposait, on le voit s’élancer au-delà du but qu’il s’était proposé.
C’est ainsi que Louis XV après avoir, durant une année entière, sacrifié à l’amitié qu’il avait pour ses filles, à l’opinion publique, maîtresse même des rois, et peut-être au sentiment intime de l’honnêteté qui n’était point encore effacé de son cœur, le désir de voir Mme du Barry au rang des dames de la cour, n’eût pas plus tôt foulé aux pieds toutes les convenances pour la présentation de sa maîtresse, qu’il sembla oublier tout à coup les raisons qui l’avaient retardée et voulut, dès l’instant, que la comtesse parût en public avec la famille royale.
Mme du Barry, sans autre orgueil que celui de la beauté, jouissait du plaisir d’effacer par ses charmes et par l’élégante magnificence de sa parure, tout ce qui était à la cour.
Elle fit plus : elle fit adopter ses modes, surtout pour la coiffure ; ses beaux cheveux n’étaient point contenus, comme on les portait avant elle, par une frisure aussi opposée à la nature que désagréable à l’œil.
La comtesse osa, avec un habit de cour, se montrer avec un chignon flottant et avec des boucles qui, ne paraissant rien devoir à l’art et tombant négligemment sur son cou, en relevaient la blancheur. Les vieilles femmes qui n’avaient plus que quelques cheveux gris crièrent au scandale ; les jeunes imitèrent la favorite et furent plus jolies.
De la cour à la ville, les modes passaient rapidement ; et à compter de cette époque, on vit fuir des toilettes cet apprêt, ce guindé nuisible aux grâces, mais qui pouvaient quelquefois servir de garde à la vertu ; enfin, c’est à cette époque que l’on cessa de pouvoir distinguer, comme on l’avait fait autrefois, par la seule manière d’être mise, la courtisane de la femme honnête.
Cette révolution ne laissa pas douter de l’influence que le nouveau choix du monarque aurait sur les mœurs.
Cependant, les deux factions s’agitaient et cherchaient tous les moyens de se culbuter. Richelieu et Choiseul en étaient les chefs.
Mais le premier, plus homme de plaisir que d’État, n’aurait peut-être pas eu la patience nécessaire pour miner sourdement un ennemi aussi puissant que le duc de Choiseul s’il ne s’était associé à son parent, le duc d’Aiguillon, que nous verrons bientôt jouer un rôle important dans le système politique.
Le duc de Richelieu engagea son cousin à être un des premiers à faire sa cour à Mme du Barry, ainsi que la duchesse sa femme, et ce qui est à remarquer en faveur des qualités du cœur de celle dont j’écris l’histoire, c’est qu’elle ne dut pas à sa seule faveur l’amitié de M. et Mme d’Aiguillon, car ils lui conservèrent l’attachement le plus sincère, même après la mort du roi.
M. de Choiseul, persuadé que rien ne pouvait ébranler sa puissance, ne ployait point le genou devant la nouvelle idole et empêchait tout son parti de lui rendre hommage ; de sorte qu’il y avait une scission marquée, qui rendait la cour fort désagréable. Louis XV espérait qu’un voyage à Marly, en tempérant la rigueur de l’étiquette, mettrait plus de rapprochement entre l’objet de ses plus chères affections et ceux de ses courtisans qu’il estimait le plus.
Louis XIV avait fait construire Marly pour s’y reposer de la grandeur. Ce séjour enchanté semblait être l’asile des plaisirs ; et malgré l’emblème du soleil que la vanité du monarque avait voulu conserver, même dans ce lieu champêtre, dont les douze pavillons représentaient les douze mois du père de la nature, il y réunissait tout ce qui peut charmer : des eaux moins imposantes que celles de Versailles, mais bien plus limpides, des statues d’une taille moins élevée et néanmoins tout aussi belles, mais surtout des fleurs, dont le parfum embaumait l’air ; enfin, rien de grand, de magnifique, mais tout gracieux, aimable, comme le printemps ; aussi était-ce dans cette saison que le roi se rendait à Marly et s’y faisait accompagner par ceux qu’il nommait : c’était une faveur distinguée que d’être du voyage.
Cette année, le roi s’étudie à mettre sur la liste toutes les femmes qu’il voulait forcer à aimer sa maîtresse.
En la voyant de plus près, il se flattait qu’elles rendraient justice aux qualités gracieuses de son cœur. Hélas ! Comment Louis XV, né au milieu des courtisans, n’avait-il pas connu leur âme, comment ne savait-il pas qu’insensibles à tout, il n’est pour eux ni vices ni vertus ; qu’ils ne connaissent que ce qui peut leur nuire ou servir à leur agrandissement ; et qu’une fois prononcés dans un parti, il faut qu’ils se fassent écraser pour lui ou qu’ils terrassent leurs adversaires !
Louis n’eut point la satisfaction qu’il se promettait à Marly. En vain il avait témoigné sa tendre affection pour la comtesse, en la logeant dans son même pavillon ; les dames ne lui firent pas un accueil plus favorable, si on peut en excepter Mme de Béarn et Mme d’Alogny. Toutes s’écartaient de la favorite : le jeu même ne pouvait les réunir.
Parmi les seigneurs, ceux qui avaient le plus de passion pour cet amusement se dispensaient de tailler au pharaon, sous des prétextes frivoles. Tout le monde s’ennuyait et le roi, mécontent, abrégea un voyage qui avait peu répondu à ses désirs.
De retour à Versailles, la favorite, sûre d’être adorée, se permettait quelques heures d’absence pour venir incognito à Paris, chez son beau-frère, qui demeurait encore rue des Petits-Champs.
Ce fut dans une de ces courses qu’il lui arriva, à ce qu’on assure, une scène assez plaisante avec le comte de Coigny qui venait de Corse, où il avait fait une campagne.
Avant son départ, il avait vu la comtesse, alors Mlle Lange, et ses charmes avaient fait une forte impression sur lui.
Le Mentor de notre belle l’avait écarté avec soin comme un des hommes les plus dangereux, et son goût contrarié était presque devenu une passion.
Il arrive donc à son débotté rue des Petits-Champs, dans l’espoir d’être plus heureux qu’avant son départ.
Le hasard, comme nous l’avons dit, y avait fait trouver la favorite dont il ignorait absolument la brillante fortune.
Il l’aborde assez lestement et est surpris de l’air imposant avec lequel on reçoit ses premières avances.
— Qui vous rend donc si cruelle ? dit en riant le comte.
Mme du Barry, voulant s’amuser à ses dépens, répond avec un très grand sérieux :
— Vous ne savez donc pas que je suis mariée ?
— Mariée ! Et à qui ?
— À M. du Barry.
— Au Roué ?
C’était le surnom du grand du Barry parmi les grands scélérats de la cour.
— Non, il n’était pas veuf.
— À quel du Barry ?
— À son frère.
— Quelle folie !
Si ce n’est pour rendre plus piquants les plaisirs, on sait, en effet, que rien ne plaît tant à l’amour que lorsqu’il peut faire quelque niche à son frère, et sûrement du Barry n’a pas de brevet d’exemption.
En prononçant ces mots, il devenait entreprenant. Mme du Barry se lève, sonne, annonce que M. le comte demande ses gens, le reconduit jusqu’à la porte du salon, en lui disant :
— On vous verra à Versailles ?
Il comprit alors et la raison du mariage et celle de la réserve de Mme du Barry.
Rentré chez lui, il s’en informa et apprit qu’en effet Mlle Lange, à présent comtesse du Barry, était maîtresse déclarée.
Il lui écrivit aussitôt la lettre la plus respectueuse et la plus repentante.
Mme du Barry le fit assurer qu’elle lui pardonnait et, depuis, elle ne lui a témoigné que de la bienveillance.
Ce fut aussi vers ce temps qu’elle fit une visite à Mme de la Garde, où elle fut reçue avec des égards qu’on ne s’imaginait pas, à la Courneuve, lui devoir un jour.
Elle témoigna sa reconnaissance à la vieille dame, son amitié aux deux fils, et s’empressa, tout le temps de sa faveur, de leur rendre service.
Ses succès à la ville avaient peu d’importance.
C’étaient ceux de la cour qui fixaient l’opinion publique.
Le roi, plus épris que jamais, voulut donner à son amie un souper à Bellevue, où il espérait réconcilier sa maîtresse avec le ministre, dont le travail facile lui convenait le mieux ; et sans Mme de Gramont, il n’est pas douteux que cela ne fût arrivé : d’autant que M. le duc de Choiseul ne pouvait ignorer que c’était à la sollicitation de Mme du Barry que son frère, le comte de Stainville, avait dû la survivance du gouvernement de Strasbourg qu’avait le vieux maréchal de Balincourt.
Cette manière de se venger de ses ennemis était faite pour ramener l’âme fière et élevée du duc : et sans l’envie qui dévorait sa sœur, le ministre eût pu, sans bassesse, devenir l’ami de la favorite.
On doutera moins de ce que nous avançons, en lisant ce paragraphe du Bulletin de Paris :
« M. de Choiseul s’était rendu à Bellevue, où tout dut lui faire pressentir sa disgrâce s’il ne réussissait pas à plaire, non aux du Barry, mais à l’amante chérie de son maître.
« On a ramassé avec le plus grand soin les détails du fameux souper de jeudi, si important par les suites qu’il peut avoir, et le thermomètre véritable dont les courtisans partiront du chaud ou du froid à mettre dans leurs assiduités respectives.
« On raconte que Mme la maréchale de Mirepoix et Mme de Flavacourt se promenaient dans les jardins de Bellevue, lorsque M. le duc de Choiseul est entré avec sa suite et a formé un groupe opposé à celui-là ; que les arrivants tournaient à droite ou à gauche suivant leur inclination et grossissaient l’un des deux partis ; qu’on ne s’épargnait les sarcasmes d’aucune part lorsque le roi a paru ; que Sa Majesté est allée à Mme du Barry, lui a dit mille choses gracieuses, s’est félicitée de la posséder pour la première fois dans ce beau lieu, s’est offerte à lui en faire voir tous les détails ; que dans cet intervalle, M. le duc de Choiseul restait à l’écart avec sa compagnie qui diminuait à mesure, au point qu’il se promenait tout seul ; que, lorsque l’heure du souper était arrivée, le roi avait fait placer la favorite à côté de lui, en faisant mettre de l’autre M. le comte de la Marche, comme ayant de l’amitié pour cette dame, a-t-il ajouté, et il a déclaré que le reste se placerait comme il voudrait ; que le souper avait été fort gai de la part du roi et du grand nombre des convives, mais que le duc de Choiseul n’avait pas déployé cette sérénité qu’il porte d’ordinaire dans les fêtes ; qu’il s’était concerté avec ses voisins ; que la comtesse s’y était comportée avec la même aisance qu’elle avait déjà eue lors de sa présentation ; qu’elle avait fait briller autant d’esprit que de grâce et de légèreté ; qu’après souper, le roi avait annoncé le jeu et avait demandé un « vingt et un » pour Mme du Barry, jeu qu’elle aime beaucoup ; que Mme de Flavacourt s’était écriée qu’elle en serait ; M. le maréchal de Richelieu aussi, en ajoutant qu’il était tout entier à Mme du Barry ; que le roi avait fait un whist dont M. le duc de Choiseul avait été, suivant l’usage ; que le lendemain, Sa Majesté s’étant habillée, avait été avec son capitaine des gardes et son premier gentilhomme à la toilette de Mme du Barry, où cet auguste amant était resté une heure ; que le jeune du Barry, neveu de la comtesse, sorti depuis quelque temps des pages de la chambre du roi, avait eu l’honneur d’être de ce souper. »
M. de Choiseul partit peu de jours après pour Chanteloup ; ce qui fit croire que l’instant de sa disgrâce était arrivé. Mais ce n’était encore, de la part de ce ministre, qu’une coquetterie pour se faire désirer du roi ; en effet, à son retour, il fut très bien reçu, parce que Louis XV espérait toujours réunir les partis.
Le chancelier Maupeou voulait, au contraire, tout brouiller.
Il avait tout lieu de croire que M. de Choiseul s’opposerait au plan formé dès ce temps de détruire les Parlements.
Il fallait donc culbuter le ministre et en avoir un à sa disposition.
La retraite du maréchal d’Estrées, qui laissait une place vacante dans le conseil avait occupé les esprits. Richelieu voulait l’avoir ; le roi ne le refusa pas, mais ne le nomma pas sur-le-champ, ce qui piqua son excessif orgueil.
Il bouda comme un enfant, et, pour le consoler, Mme du Barry obtint l’entrée du conseil au duc d’Aiguillon.
Dès ce moment, le chancelier s’attacha à lui comme à l’homme qui pouvait le seconder, et qui serait toujours prêt à s’emparer du portefeuille quand on pourrait déterminer le roi à l’ôter au duc de Choiseul. Le chancelier fut encore plus assidu à faire sa cour à sa belle cousine, car il avait trouvé, on ne sait comment, qu’il était parent de la maîtresse du roi. Il se plaisait à faire tout ce qu’elle désirait.
Celle-ci, suivant la pente naturelle de son caractère, employait son crédit sur le chef suprême de la justice à obtenir la grâce des infortunés qu’une loi trop sévère condamnait à périr.
Tel fut le trait d’une malheureuse jeune fille de la paroisse de Liancourt, qu’un homme engagé par des liens sacrés avait rendue mère.
Soit remords, soit événement naturel, cet homme mourut avant que celle qu’il avait séduite eût donné la vie à l’être qu’elle portait dans son sein ; elle en conçut un tel chagrin, qu’elle accoucha peu de temps après d’un enfant mort.
Elle n’avait point fait de déclaration : la loi était formelle ; il fallait qu’elle pérît d’une mort infâme.
Un mousquetaire noir, nommé M. de Mandeville, se trouvait à Liancourt au moment où on vint apprendre aux parents de cette infortunée l’arrêt prononcé contre elle.
M. de Mandeville les console, et sans perdre un instant, part pour Versailles, demande à parler à Mme du Barry qui avait beaucoup de monde chez elle, et lui explique la situation de cette malheureuse paysanne.
La favorite en est vivement émue et écrit sur-le-champ, de sa main, une lettre au chancelier dont les spectateurs demandèrent copie.
La voici telle qu’elle sortit de la plume de cette femme, qu’on a toujours crue incapable d’un bon sentiment.
Nous laissons au lecteur le plaisir d’en juger :
« Monsieur le Chancelier,
« Je n’entends rien à vos lois, mais elles sont injustes et barbares ; elles sont contraires à la politique, à la raison, à l’humanité, si elles font perdre à une pauvre fille accouchée d’un enfant mort sans l’avoir déclaré. Suivant le mémoire ci-joint, la suppliante est dans ce cas : il paraît qu’elle n’est condamnée que pour avoir ignoré la règle, ou pour ne pas s’y être conformée par une pudeur très naturelle. Je renvoie l’examen de cette affaire à votre équité, mais cette infortunée mérite l’indulgence ; je vous demande au moins une commutation de peine ; votre sensibilité vous dictera le reste.
« J’ai l’honneur d’être, etc… »
M. de Mandeville porta lui-même la lettre au chancelier, qui ordonna un sursis, et Mme du Barry obtint du roi la grâce de cette malheureuse.
C’eût été à ces actes de bienveillance que celle dont nous écrivons l’histoire eût borné son empire, si on l’eût laissée maîtresse de sa destinée. Mais Richelieu, d’Aiguillon et Maupeou en avaient ordonné autrement ; le premier caressait encore le duc de Choiseul jusqu’à ce qu’il fût certain de sa disgrâce.
Cette conduite donna lieu de faire circuler une anecdote qui peut n’être qu’un apologue, mais elle peint si bien le génie des courtisans qu’on ne nous saura pas mauvais gré de la rapporter.
C’était le second voyage de Mme du Barry à Marly, où l’on se conduisait avec beaucoup plus d’égards avec la comtesse que dans celui de l’année d’avant.
On assurait même que M. de Choiseul avait eu avec la favorite une conférence de plus de trois heures.
Nous avons déjà dit que Marly était composé de pavillons séparés les uns des autres, de sorte que l’on était exposé à être mouillé quand il faisait mauvais temps lorsqu’on voulait communiquer d’un pavillon à l’autre.
Un dimanche qu’il pleuvait, M. le duc de Richelieu, muni d’un parapluie, allait à la messe du roi ; il y rencontre M. le duc de Choiseul qui n’en avait point et avait été surpris par l’orage ; il offrit à celui-ci le secours du sien.
Le ministre dit en riant au maréchal :
— Que penseront les courtisans en nous voyant ainsi accouplés ?
— Que nous sommes deux têtes dans le même bonnet, répondit M. de Richelieu.
Arrivés à la chapelle, ces deux seigneurs se séparèrent.
Le temps se raccommode et, lorsqu’il est question de sortir, le premier fait signe à l’autre qu’il le remercie de ses soins, qu’il fait beau et qu’il va aller de son côté.
Ce dernier lui crie :
— Vous avez raison, Monsieur le duc, le temps est serein actuellement, vous n’avez pas besoin de moi, mais s’il survient quelque orage, comptez sur moi, je suis toujours à vous…
Il y eut un voyage à Saint-Hubert, où le roi alla observer le passage de Vénus sur le soleil, phénomène qui occupait alors l’Académie des sciences.
Ce prince, ami de tous les arts, et initié à leurs spéculations les plus sublimes, voulut, en cette occasion, appliquer au télescope les beaux yeux de sa nouvelle maîtresse.
Il lui avait donné quelques leçons d’astronomie, capables de lui rendre le phénomène intéressant. C’est ce qui fournit matière à l’enthousiasme d’un poète.
Il s’adresse ainsi aux seigneurs qui accompagnaient Sa Majesté en ce lieu et observaient avec elle :
Que nous diront ce télescope
Cette Vénus et ce soleil ?
Amis, sans ce vain appareil
Cherchons un plus sûr horoscope.
En ces délicieux jardins
Brillent nos astres véritables ;
C’est dans leurs regards adorables
Que nous trouverons nos destins.
L’armistice entre les deux partis rendit plus de gaieté à la cour. Le roi, qu’un chagrin dévorant poursuivait depuis la mort de son fils, espérait, en changeant de place, échapper aux tourments qui le déchiraient, que le temps seul et l’excès de voluptés purent assoupir.
En quittant Marly, on fut à Choisy. Mesdames n’étant plus des petits voyages, on en bannit l’étiquette, et tout, jusqu’aux spectacles, se ressentit de la liberté que la comtesse introduisait dans les usages.
Des farces plus que gaies remplacèrent la bonne comédie et nous inondèrent de ces pièces qui naissent et meurent en un jour, et dont les succès éphémères sont parvenus à nous ôter jusqu’au sentiment de nos chefs-d’œuvre théâtraux. Mais qu’importait aux auteurs de ce temps ? Ils faisaient rire le roi, moins peut-être, il est vrai, par la gaieté qu’ils lui inspiraient que par celle que lui communiquait sa maîtresse, dont le goût pour les productions de ce genre était très décidé.
Ce fut à ce voyage que le roi, ayant attendu la comtesse très longtemps pour se mettre à table, la fit prier de venir sans achever sa toilette. Elle vint effectivement en peignoir, et ses cheveux bouclés d’un seul côté.
— Vous l’avez voulu, dit-elle au roi.
— Sûrement, il est tard et vous auriez été plus d’une heure, sans néanmoins rien ajouter à vos charmes. N’est-il pas vrai, dit-il à M. de Villequier, qui était du dîner, que Madame est charmante dans ce désordre ?
Et l’on pense bien que, non seulement le duc à qui le roi adressait la parole, mais tous les convives, se récrièrent pour dire que Sa Majesté avait raison.
On se mit à table : Mme du Barry se plaça, comme elle avait coutume, auprès du roi. Mais au commencement du dîner, elle ne pensa qu’à un superbe petit chien qu’on lui avait apporté le matin et qui était sur ses genoux.
Elle le fit manger et boire dans son assiette et s’en amusa très longtemps.
Le roi, voyant que sa maîtresse était très occupée de son chien, se mit à causer avec le duc de Richelieu ; la conversation entre deux hommes de beaucoup d’esprit ne pouvait qu’être intéressante, et Sa Majesté oublia un instant et la favorite et son joli chien pour parler des grands intérêts de l’Europe.
Au moment où le monarque était le plus animé dans sa conversation, l’épagneul sauta sur la table et, se mettant sur ses pattes de derrière, fit à sa maîtresse une révérence avec des grâces qui l’enchantèrent. Ce n’était pas assez pour elle de l’admirer ; il fallait que son auguste amant partageât la joie qu’elle avait de posséder un si charmant animal. Elle l’appelle pour qu’il le voie, mais inutilement.
La politique l’emporte sur Bijou et Louis ne peut quitter le cabinet de Saint-Pétersbourg pour un petit chien d’Espagne.
Cependant la comtesse s’impatientait de la distraction du monarque, et le tirant fortement par le bras : « Regardez donc, dit-elle, regardez donc ! »
Le roi regarda enfin et n’eut point l’air fâché que son amie interrompît une conversation intéressante pour lui faire voir les gentillesses de Bijou.
Quelques personnes, qui avaient obtenu la permission d’assister à ce dîner, furent choquées de cet excès de liberté.
Le roi ne mangeait pas alors en public, et il trouvait bon que Mme du Barry vînt dîner en peignoir ; comment n’aurait-elle pu penser que celui qui la traitait avec tant de bonté et qui passait toutes les nuits dans ses bras n’était pas son égal ! Il y avait bien plus de philosophie à le traiter comme tel qu’à n’être pour lui qu’une esclave du sérail. Il fallait que Louis choisît une autre maîtresse ou qu’il trouvât bon les manières franches et libres de celle-ci.
Il est bien à présumer qu’il la trouvait bien et très bien, telle qu’elle était, puisque, chaque jour, il lui donnait des preuves publiques de son amour.
Un de ces riens, si précieux entre les amants, fit une anecdote que recueillirent avec avidité les courtisans.
Sa Majesté ayant laissé tomber son étui, Mme du Barry le ramassa avec empressement et le lui présenta en mettant un genou en terre.
Mais le monarque, se précipitant lui-même à ses pieds, lui dit : « Madame, c’est à moi à prendre cette posture, et pour toute la vie. » Galanterie digne de la vieille cour et bien opposée au ton leste dont nos petits-maîtres traitent aujourd’hui les femmes.
Cependant Mme du Barry pouvait-elle, malgré ce que lui disait le roi, ne pas prendre quelquefois l’attitude de suppliante ? Ne savait-elle pas qu’elle était sûre de tout obtenir en embrassant les genoux de celui qui, malgré la grandeur de son sang, ne dédaignait pas de paraître aux siens ?
Elle en fit l’expérience peu de jours après.
La cour était encore à Choisy lorsque Mme de Moyan et Mme la baronne Deldorf vinrent implorer la bonté du roi pour le comte et la comtesse de Louerme, dont elles étaient fille et bru.
Ils avaient été condamnés à avoir la tête tranchée pour rébellion à la justice et rien ne pouvait les sauver que la volonté du roi.
Aussi leurs enfants s’étaient jetés aux pieds du monarque qui demeurait inflexible, quand la belle comtesse, touchée de leur malheur, s’y précipita aussi en déclarant qu’elle ne se relèverait point que Sa Majesté eût accordé ce qu’elle demandait.
Le roi, ému, la releva en s’écriant :
— Madame, je suis enchanté que la première faveur pour laquelle vous me forcez soit un acte de justice.
Compiègne vit aussi Mme du Barry dans tout son éclat.
Ce n’était plus, comme le dernier voyage, la belle Lange, qu’on savait à peine exister dans le château, c’était une grande dame, l’amie, la confidente de son roi, qui, sans hauteur et sans morgue, paraissait au milieu de la cour comme si elle y avait passé sa vie.
Un camp qui s’était formé entre la ville et la forêt présentait un spectacle nouveau pour la favorite.
Elle y parut comme Armide dans celui de Bouillon ; et combien de nos jeunes militaires auraient voulu mériter qu’elle les fît conduire dans les jardins enchantés ! Tous eurent à se louer de son affabilité et de son extrême politesse.
Mais le régiment de Beauce fut particulièrement comblé de ses faveurs.
Le beau-frère de la comtesse, dont nous avons parlé au commencement de cette étude, et qui était connu sous le nom de « l’Honnête Homme », était capitaine dans ce corps qui vint camper à Royal-Lieu.
Mme du Barry donna un repas splendide à tous les officiers et fit faire une abondante distribution aux soldats.
M. le comte de la Tour du Pin ne put se dispenser de faire rendre à la favorite les honneurs militaires. On pense bien que M. de Choiseul, ministre de la guerre, le trouva très mauvais.
Il s’en expliqua ouvertement, mais son étoile pâlissait et M. de la Tour du Pin imagina qu’il valait mieux ménager la favorite, dont le crédit allait toujours croissant, qu’un ministre dont il était aisé de prévoir la disgrâce.
Aussi, beaucoup de femmes de la cour se rapprochaient de la comtesse.
On n’en comptait que trois qui s’étaient constamment refusées à lui rendre les plus simples devoirs de la société : Mmes de Gramont, de Brionne et d’Egmont ; toutes les autres dissimulaient au moins leur mécontentement.
Aussi la comtesse, se voyant une cour nombreuse, pensa qu’elle ne devait plus abuser de la complaisance de Mme de Béarn et lui écrivit la lettre suivante :
LETTRE DE Mme LA COMTESSE DU BARRY
À Mme LA COMTESSE DE BÉARN
« Je ne saurais assez vous remercier, Madame, de vos bontés, de votre complaisance, de votre assiduité. Je croirais en abuser si je ne vous rendais à la liberté que vous aimez et dont vous vous privez depuis longtemps en ma faveur. Ce serait, enfin, trop exiger de votre amitié.
« Vous m’avez fait part plusieurs fois du dégoût que vous éprouviez dans un pays pour lequel vous étiez plus faite que moi, et où cependant nous avons, en quelque sorte, débuté ensemble.
« Vous avez des affaires qui vous rappellent à Paris. Le voyage fini, je vous demande en grâce de ne plus vous gêner. Allez au Luxembourg y vaquer ; abandonnez-moi au tourbillon de Versailles : soyez persuadée que je ne vous oublierai jamais. »
Si les femmes se soumettaient par respect aux volontés du roi, les hommes renchérissaient sur elles par la plus basse adulation.
On a su de quelle manière le pauvre petit duc de Gesvres s’inscrivit un jour qu’il ne l’avait pas trouvée : Le Sapajou de Mme la comtesse est venu pour lui rendre ses hommages. Il était bossu par derrière et par devant, et n’avait pas quatre pieds de haut.
Le pauvre infortuné, honteux de sa propre faiblesse, adulait toujours lâchement ceux qui avaient la puissance.
Il se ravalait jusqu’à la condition des bêtes pour plaire à la maîtresse du roi qui, au moins, ne lui fit aucun mal ; mais il flatta, nourrit, paya les monstres révolutionnaires qui, sans pitié pour un être dont la vie était presque éteinte, eurent la cruauté de le porter sur leur infernale machine qu’ils firent relever deux fois sur cet infortuné dont la nature semblait avoir mis la tête à couvert de leur hache homicide.
Le roi, avant d’aller à Compiègne, avait été à Chantilly, chez le prince de Condé, qui venait d’embellir ce lieu charmant d’un jardin anglais que Mesdames désiraient voir ; ainsi la favorite ne fut point du nombre des dames qui accompagnaient la famille royale.
— On assure cependant que Louis XV pouvait si peu se passer de sa maîtresse qu’il la supplia de venir incognito passer les nuits avec lui.
M. le prince de Condé l’ayant appris, résolut de dédommager Sa Majesté de cette contrainte, en le priant de lui faire l’honneur de venir à Chantilly au retour de Compiègne, sans Mesdames.
Alors Mme du Barry fut reçue par le petit-neveu d’Henri IV, comme il eût voulu qu’on reçût Gabrielle.
Tout prit un caractère de fêtes et de plaisirs, plus vifs que pendant le séjour du roi et de sa famille.
Mme du Barry suivit toutes les chasses en calèche ; l’on se portait en foule dans la forêt pour l’admirer.
C’était Diane suivant Endymion, non, sa physionomie douce et voluptueuse ne pouvait avoir le caractère de cette fière déesse, et sous quelque habit qu’elle se fît voir, on ne pouvait jamais la prendre que pour la mère des Amours.
M. de Condé, en courtisan habile, prouva à Louis XV qu’il avait réservé, pour le temps que Mme du Barry passerait chez lui, mille plaisirs dont on n’avait pas eu d’idée dans le premier voyage. Aussi Mme du Barry fut-elle enchantée de Chantilly, qu’il semblait, en effet, que la nature avait disposé pour que l’art en formât le plus beau et surtout le plus gracieux séjour des environs de Paris.
Tous les deux ans, à la fête de la Saint-Louis, que nos artistes distingués avaient pris pour patron, sans trop en savoir la raison, car ce roi célèbre par sa piété, sa valeur et sa sagesse, a peu protégé les beaux-arts, que l’ignorance de son siècle avait fait disparaître de dessus la terre ; mais, enfin, n’importe, la Saint-Louis était la fête des Académies, comme celle de nos rois, et tous les deux ans, dis-je, à cette époque, on faisait une exposition de tableaux telle qu’elle a encore lieu à présent.
Le public y jugeait les talents des peintres et des sculpteurs, et l’affluence des connaisseurs ou de ceux qui se croient tels était si grande qu’on pouvait à peine entrer dans le salon.
En conséquence, lorsque la famille royale venait admirer ou critiquer les ouvrages exposés, on faisait sortir tous ceux qui y étaient pour que ces augustes personnes ne fussent point exposées aux incommodités de la foule.
Mme de Pompadour, comme sœur du surintendant des bâtiments, jouissait des mêmes prérogatives, et l’on persuada aux artistes qu’ils devaient suivre, pour Mme du Barry, le même cérémonial que pour la dernière maîtresse.
Elle ne trouva donc, à son arrivée dans le salon, que des artistes empressés à briguer un mot, un regard de l’amie du roi.
Le public murmura d’avoir été privé plusieurs heures de l’exposition pour elle et l’en accusèrent, quoiqu’elle n’en eût aucune connaissance.
Elle parla avec grâce et aménité aux artistes, et les favoris des Muses n’eurent qu’à se louer d’elle.
Un d’eux avait essayé deux fois de rendre ses traits, enchanteurs, et ces deux portraits se trouvaient, cette année-là, au Salon[16].
M. Drouais, qui avait fait un si beau portrait en pied de Mme de Pompadour, avait assez mal réussi dans ceux en buste de la comtesse : dans l’un, elle était peinte en robe blanche avec une simple guirlande de fleurs ; dans l’autre, en habit d’amazone gris, la veste décolletée, avec une espèce de fraise.
Dans tous les deux, il n’avait point saisi la physionomie de celle qu’il avait voulu peindre.
Il n’avait point donné à son regard cette expression de franchise qui la caractérisait : voulant la rendre gracieuse, il l’avait fait minauder et, ne connaissant pas assez les beautés de l’antique, il n’avait fait qu’une petite-maîtresse de celle dont Phidias aurait saisi avec enthousiasme les traits pour représenter une divinité.
Ce qui était assez extraordinaire, c’est que les deux portraits ne se ressemblaient pas.
Cependant, on fit des vers à la louange du peintre et du modèle.
Je ne donnerai que ceux-ci :
VERS À Mme LA COMTESSE DU BARRY.
Sur ton double portrait le spectateur perplexe,
Charmante du Barry, veut t’admirer partout ;
À ses yeux changes-tu de sexe,
Il ne fait que changer de goût ;
S’il te voit en femme, dans l’âme
D’être homme il sent tout le plaisir,
Tu deviens homme, et d’être femme
Soudain il aurait le désir.
AUTRES SUR LE MÊME SUJET.
Quel est cet Adonis aux regards enchanteurs ?
Quelle est cette beauté qui me frappe et m’entraîne ?
Là c’est l’Amour qui soumet tous les cœurs.
C’est Flor ici qui les enchaîne.
Par M. BRIZARD
SUR LE MÊME SUJET.
Quels yeux ! que d’attraits ! qu’elle est belle !
Est-ce une divinité ?
Non, c’est une simple mortelle
Qui le dispute à la beauté.
Entre nous, qui décidera,
Beau cavalier, aimable Flore,
L’Olympe jaloux se taira
Et l’univers, surpris, admire et doute encore.
Par M. du B…
Tandis que les arts s’empressaient à célébrer l’empire de la favorite, la cabale anti-Choiseul se disposait à en profiter.
Déjà d’Aiguillon était ancré dans ses bonnes grâces, de manière à ne pas craindre de les perdre ; et le Français qui alors était gai et chantait tout, répéta avec malignité le couplet suivant, sur l’air : Vive le vin ! Vive l’amour !
Vive le Roi ! vive l’Amour !
Que ce refrain soit, nuit et jour,
Ma devise la plus chérie !
En vain les serpents de l’envie
Sifflent autour de mes rideaux,
L’Amour lui-même assure mon repos,
Et dans ses bras je la défie.
Ce fut peu de temps après que la belle comtesse donna à M. Bouret, fermier général, la satisfaction de la posséder dans un pavillon qu’il avait construit dans la forêt, près de Croix-Fontaine.
Ce pavillon, élevé par l’amitié d’un sujet pour son souverain, avait plusieurs fois reçu le monarque et Mme de Pompadour.
Là, Louis XV traitait presque d’égal à égal le financier dont il estimait les qualités aimables.
La mort de Mme de Pompadour ne suspendit point les marques de bonté du souverain, et il trouva très bon que Mme du Barry vînt aussi chez celui qu’il regardait comme son ami.
Voici la relation de ce qui se passa dans cette journée, rapportée au Bulletin de Paris :
« Le 28 septembre 1769, Sa Majesté, avant d’aller chasser dans la forêt de Sénart, est allée au pavillon du roi, elle est arrivée à plus de midi et est partie avant une heure.
« On a remarqué qu’elle a paru inquiète et soucieuse. Mme la comtesse du Barry ne s’y est rendue qu’à près de deux heures, avec beaucoup de dames de la cour, entre autres Mme la maréchale de Mirepoix, Mme la duchesse de Montmorency, Mme la duchesse de Valentinois, Mme la comtesse de l’Hôpital, etc., ainsi que beaucoup de seigneurs qui l’accompagnaient.
« Le sieur Bouret a conduit cette dame dans tout le château, elle en a été enchantée.
« Il y a eu, ensuite, un dîner splendide : le repas fini, la favorite est montée en voiture avec les dames et a assisté à la défaite d’un cerf qu’on a pris sous Croix-Fontaine et dont Sa Majesté lui a présenté le pied.
« Un second cerf a été forcé de la manière la plus curieuse et la plus rare.
« Après tous les détails capables d’amuser les spectateurs et de varier une semblable scène, on eût dit qu’il était exercé à toutes ces manœuvres différentes. Outre la cour très nombreuse, la beauté du jour avait attiré un monde étonnant du voisinage.
« On s’attendait à quelque galanterie particulière du sieur Bouret, dont le génie est plein de ressources pour de pareilles fêtes, et il n’a pas manqué de remplir l’attente des curieux.
« On a trouvé une Vénus à Croix-Fontaine, modelée d’après celle de Coustou, pour le roi de Prusse.
« L’adroit courtisan y avait fait adapter une tête sculptée d’après celle de Mme du Barry, et en a présenté le coup d’œil à Sa Majesté, flattée de la manière dont on divinisait son goût.
« Mme du Barry était, à cette chasse, précisément dans le même habillement d’homme sous lequel elle est représentée au Salon, mais infiniment plus leste et plus séduisante. »
On cherchait toujours à juger par les événements présents de ceux qu’on devait attendre ; et l’on commençait à conjecturer la disgrâce de M. de Choiseul lorsqu’on sut qu’il n’avait pu obtenir, pour un parent de son nom, la place de commandant des chevau-légers que Mme du Barry fit donner à M. le duc d’Aiguillon.
Cette grâce et l’assiduité du duc chez la favorite donnèrent lieu à maints propos : cependant, on assure que le ministre, persuadé que le crédit de la favorite était devenu inébranlable, chercha à se rapprocher d’elle par des moyens détournés ; et l’on prétend que ce fut un poète entièrement dévoué à la maison de Choiseul qui fit ces vers :
À MADAME LA COMTESSE DU BARRY, À L’OCCASION DE SA DIVISION AVEC M. LE DUC DE CHOISEUL.
Déesse des plaisirs, tendre mère des Grâces,
Pourquoi veux-tu mêler aux fêtes de Paphos
Les noirs soupçons, les honteuses disgrâces ?
Ah ! pourquoi méditer la perte d’un héros ?
Ulysse est cher à la patrie
Il est l’appui d’Agamemnon,
Sa politique active et son vaste génie
Enchaînent la valeur de la fière Ilion.
Soumets les Dieux à ton empire,
Vénus sur tous les cœurs règne par sa beauté.
Cueille dans un riant délire
Les roses de la volupté,
Mais à nos yeux daigne sourire,
Et rend le calme à Neptune agité.
Ulysse, ce mortel aux Troyens formidable,
Que tu poursuis dans ton courroux
Pour la beauté n’est redoutable
Qu’en soupirant à ses genoux.
Il paraît que cette cajolerie était venue trop tard : l’antipathie de Mme du Barry allait toujours croissant : on sait qu’elle ne se gênait pas pour l’exprimer.
Le hasard lui avait procuré un cuisinier qui ressemblait d’une manière très frappante au duc de Choiseul.
Soit que cette ressemblance déplût à la maîtresse du roi, soit que cet homme eût mérité de perdre sa place, il sortit de chez la comtesse qui dit au roi : « Sire, j’ai renvoyé mon Choiseul ; quand renverrez-vous le vôtre ? »
M. de Lauraguais, connu pour ses scientifiques folies, son amour pour Mlle Sophie Arnould, son esprit, son anglomanie, son originalité, trouva très plaisant de choisir une maîtresse parmi les dernières des femmes qu’un sort cruel a vouées à l’infamie, en croyant ne suivre que les routes fleuries du plaisir, et après l’avoir fait habiller superbement, il la conduisit dans une maison délicieuse où il la combla de biens, mais à condition qu’elle quitterait son nom et qu’elle prendrait celui de comtesse du Tonneau.
Cette allusion était trop forte pour ne pas attirer l’attention du lieutenant de police.
Il en rendit compte au roi, qui fit donner ordre au comte de passer en Angleterre.
La pauvre comtesse de nouvelle création reprit son premier état, mais le public n’avait pas moins ri de cette comédie dont les acteurs eurent tous les sujets de se repentir.
La crainte que quelques scènes de ce genre ne se répétassent fit mettre beaucoup de sévérité pour éloigner ces sortes de femmes des lieux que la cour habitait, et jamais du temps de la feue reine on n’avait eu une aussi grande exactitude à les écarter.
Mais si le roi s’occupait à ne point laisser avilir l’objet de ses affections, il pensait peu à lui assurer un sort indépendant par la fortune.
Elle n’avait encore eu que la moitié d’une charge de fermier-général, le gendre de M. Andouillet, premier chirurgien du roi, avait l’autre. Jamais elle ne demanda rien à Sa Majesté pour elle-même.
L’anecdote des « loges de Nantes » en est une preuve.
C’est ainsi que la rapporte le Bulletin de Paris, du 1er janvier 1770 :
« Le premier de l’an, Mme du Barry entra chez le roi, fort gaie, et en lui disant qu’elle venait lui demander ses étrennes, savoir les « loges de Nantes », objet d’environ 40.000 livres de rentes, qu’avait feue Mme la duchesse de Lauraguais : elle ajouta que c’était pour sa bonne amie, Mme la maréchale de Mirepoix.
« Le roi sourit et lui répondit :
« — Je suis fâché de ne pouvoir vous accorder cette grâce ; j’ai disposé de l’objet.
« La belle comtesse de faire la boudeuse et de répliquer :
« — Eh bien ! voilà la quatrième faveur que je sollicite et que vous me refusez ; le diable m’emporte si je vous importune désormais.
« — C’est bouder de bonne heure, reprit Sa Majesté, vous commencez bien mal l’année !
« — Et vous, bien plus mal, continue la favorite en redoublant d’humeur.
« — Votre reproche ne me fera pourtant pas changer, dit son auguste amant en la regardant tendrement ; il ne fait que me confirmer dans ma résolution : il est beau à vous de montrer autant de chaleur pour votre amie ; mais encore un coup, il n’y a plus rien à faire, ce cadeau est promis, et voulez-vous savoir à qui, Madame ? C’est à vous : ce sont les étrennes que je vous ai réservées.
« Il l’embrassa en même temps. »
Mme du Barry n’eut rien de plus pressé que de publier le bienfait du monarque et le procédé galant et spirituel qui l’avait accompagné.
Les courtisans, de leur côté, exaltèrent un emportement peu respectueux, mais qui caractérisait l’âme franche, ouverte et généreuse de la comtesse.
Autant Mme du Barry était amie tendre et sincère, autant elle avait horreur de l’ingratitude et de la perfidie.
Aussi le marqua-t-elle de la manière la plus forte à M. de Villeroi, dont les assiduités chez la favorite paraissaient étranges.
Mme du Barry, qui les croyait dictées par l’attachement, traitait le duc à merveille et s’empressait à lui rendre tous les services qui dépendaient d’elle lorsqu’elle s’aperçut que Sophie, l’une de ses femmes de chambre, avait prodigieusement engraissé depuis quelques mois.
Elle l’interroge : celle-ci assure qu’elle ne sait pas d’où lui vient cet embonpoint dont on prétend que M. de Villeroi était cause, et deux jours après, Mme du Barry apprend que cette femme est sortie de chez elle et qu’elle est dans un charmant appartement où elle reçoit les soins du duc.
Mme du Barry, naturellement indulgente, feignit de ne rien savoir ; mais étonnée de ce que M. de Villeroi ne vînt plus chez elle, elle en parla à quelques bons amis de la cour.
Ceux-ci saisirent l’occasion de faire perdre au duc les bonnes grâces de la favorite et lui dirent : « Madame la comtesse ne sait donc pas que M. de Villeroi répondait aux amis des Choiseul qui le blâmaient de ses assiduités chez elle et le tournaient en ridicule sur la cour basse et servile qu’il lui faisait :
« — Ce n’est pas pour elle, dont je me soucie fort peu, « mais bien pour la jolie Sophie que je ne puis voir que chez elle ; comme autrefois Louis XIV avec Mlle Henriette, qui ne s’apercevait pas que les hommages étaient pour une de ses filles d’honneur, Sophie est pour moi ce que La Vallière était pour le monarque. »
Mme du Barry, indignée d’une conduite aussi basse et révoltée de l’ingratitude de ce courtisan, le lui fit sentir avec beaucoup de hauteur.
M. de Villeroi se cru perdu et employa toute sorte de bassesses pour rentrer en grâce, mais inutilement.
Elle fut inflexible et elle se conduisit avec une dignité et une fermeté qui lui firent beaucoup d’honneur.
Une grande époque approchait, et les courtisans, avides d’intrigues comme les autres hommes le sont de repos, voyaient avec transport l’arrivée d’une archiduchesse en France, afin d’avoir un nouveau point d’appui pour leurs spéculations politiques : c’était le moment de savoir lequel des deux partis triompherait, et Choiseul était perdu si la jeune Dauphine n’éclipsait pas la favorite.
Il fallait que le roi s’expliquât. Se livrerait-il aux charmes de la paternité ? et en acquérant une fille charmante, manquerait-il à ce qu’il lui devait en faisant paraître sa maîtresse aux noces de son petit-fils ? Quelle moralité pouvait permettre un semblable oubli de toutes les convenances ?
C’est non seulement l’éclat d’un grand nom qui ne doit pas être compromis avec celui d’une femme d’une caste aussi inférieure, mais c’est la jeunesse, l’innocence de la femme de son petit-fils qui devaient être sacrées pour son aïeul.
Comment consentirait-il à colorer les joues de la compagne de l’héritier du trône du vif incarnat de la pudeur étonnée, lorsqu’elle saura quel rôle Mme du Barry joue à la cour ?
Que dirait-on d’un particulier qui aurait un semblable tort dans l’intérieur de sa famille ? Quelle mère consentirait à ce que sa fille fût la compagne de la maîtresse de l’aïeul de son époux ?
Le ridicule serait au moins l’arme que l’on emploierait pour détruire un pareil scandale et un roi ne serait pas exempt ? La gloire qui l’environne n’éclaire-t-elle pas ses fautes et ne les rend-elle pas plus inexcusables ? Car celui qui fait tout ce qu’il veut est bien coupable de ne pas vouloir toujours le bien, qui lui est si facile et qui seul conduit au bonheur.
On crut donc que le roi sentirait la nécessité d’éloigner, au moins pendant quelque temps, l’objet de sa passion pour ne pas se montrer aux fêtes du mariage avec la comtesse.
On assure qu’elle-même en reçut le conseil, soit qu’il fût dicté par l’amour de la vertu, soit que ce fussent les Choiseul qui espérassent profiter de son absence pour l’éloigner à jamais.
Le duc de Richelieu, ayant su que l’on voulait persuader à Mme du Barry d’obtenir du roi la permission d’aller aux eaux au moment de l’arrivée de Mme la Dauphine, l’en détourna par toutes les raisons pour la convaincre.
La comtesse en avait une pour rester, dont on ne peut pas douter d’après son caractère : c’était de se montrer aux yeux de toute la France qui, sûrement, se porterait en foule à Versailles pour voir la jeune Dauphine.
Elle était sûre de paraître avec éclat et, mettant peu d’importance aux propos des curieux, elle se plaisait d’avance à recueillir les éloges que l’on ne pouvait se défendre de donner à sa beauté ; il fut donc convenu qu’elle resterait et serait des fêtes.
Le roi, soit pour se débarrasser de l’impression du premier moment, soit pour ne pas se passer d’elle une seule soirée, voulut qu’elle vînt à la Muette au-devant de la princesse et elle eut l’honneur de souper avec elle et la famille royale.
D’ailleurs, ce qu’un roi entraîné par l’amour et l’attrait du plaisir exige ici de sa propre famille, nous verrons peu d’années après les apôtres de la licence et du meurtre le prescrire aux plus grands seigneurs du royaume : et il faut en convenir, tout inconvenable que pouvait être le souper de la Muette, il était bien préférable aux banquets civiques.
Jamais femme n’avait eu plus d’affabilité ; aussi fut-elle très aimable avec les dames qui étaient venues au-devant d’elle, sans en excepter Mme du Barry.
On assure même que le roi, lui ayant demandé ce qu’elle pensait de la comtesse, la princesse répondit avec une ingénuité et une vivacité qui enchanta Sa Majesté : « Charmante, papa, adorable. »
Elle ne pouvait flatter plus sensiblement le roi : aussi en sut-il un gré infini à sa petite bru.
Ce début déconcerta ceux qui s’étaient persuadés que la fille des Césars mettrait avec la favorite une hauteur qui la forcerait à s’éloigner des fêtes publiques.
Il paraît cependant qu’elles furent assez longtemps inutiles : car au premier voyage de Compiègne où se trouva Mme la Dauphine, celle-ci ayant invité le roi à souper, il y vint avec Mme du Barry.
La princesse alla au-devant du roi qui donnait la main à sa maîtresse et, en l’embrassant, elle lui dit :
— Ah ! papa, je ne vous avais demandé qu’une grâce et vous m’en accordez deux[17].
Hélas ! ce calme dura peu, et Louis ne jouit pas longtemps du bonheur de voir sa famille traiter avec bonté celle qui lui devenait chaque jour plus chère.
La guerre se ralluma entre les factions ; une intrigue de coulisse en fut le signal.
La Comédie-Française était alors parvenue à un degré de perfection qui mettait notre théâtre au-dessus de tous ceux de l’Europe, comme nos auteurs dramatiques l’emportent sur ceux des autres nations.
Il possédait deux actrices que rien n’a pu remplacer : Mlles Duménil et Clairon. Il serait impossible de peindre les plaisirs qu’elles faisaient éprouver.
Qu’il nous suffise donc de dire que l’une devait tout à la nature et que l’autre avait ajouté aux dons qu’elle en avait reçus tout ce que l’art peut inventer pour la perfectionner.
Qui ne frissonnait et ne croyait pas ressentir le froid du couteau sacré, lorsque Mlle Duménil prononçait ces vers de Racine :
Un prêtre environné d’une foule cruelle
Portera sur ma fille une main criminelle.
Mais qui n’était pas transporté dans une sphère au-delà des choses connues lorsque Mlle Clairon peignait sur la scène l’amour, les fureurs, les caprices sanguinaires d’Hermione ?
Quelle profonde étude du cœur humain il avait fallu pour rendre toutes les beautés de ce rôle ?
Nos anciens comédiens sentaient tellement l’impossibilité de trouver une autre actrice pour le remplir qu’après la retraite de Mlle Clairon, ils furent un temps infini à donner Andromaque.
« Il y a à présumer que les spectateurs sont devenus moins difficiles, dit un critique du temps, ou que les talents ont germé avec une prodigieuse vitesse, car, à présent, on voit sans cesse cette magnifique pièce affichée.
« Je ne puis juger de quelle manière elle est représentée, ne l’ayant pas vu jouer depuis la retraite de cette célèbre actrice ; d’autres m’ayant donné assez la mesure du talent de nos comédiens actuels pour ne pas me presser de perdre l’impression que je conserve de la veuve d’Hector et de son impitoyable rivale.
« Soit que mon goût, plus sûr que celui des Aristarques modernes, ou que cette illusion qui accompagne toutes les jouissances de la jeunesse et y prête un charme inconnu soit cause de la différence que j’éprouve, il n’en est pas moins vrai que Mlles Duménil et Clairon étaient des actrices supérieures. »
Mais comme rien n’atteint au dernier terme du beau dans ce monde sublunaire, ces deux femmes célèbres, loin de perfection possible, eurent entre elles ces querelles puériles qui ne devraient exister que parmi les êtres médiocres.
Mlle Clairon, fière, et du caractère le plus indépendant, ne put supporter les injustices que la cabale exerçait contre elle.
Le malheur de Dubois, qui fut traité dans le XVIIIe siècle par les tribunaux comme il aurait pu l’être dans les temps de la plus profonde ignorance, affecta sensiblement Mlle Clairon.
Elle voulut que l’on fît réhabiliter Dubois, ou qu’il cessât d’être de la troupe ; on ne voulut ni l’un ni l’autre, et Mlle Clairon se retira.
C’est une douce habitude que celle de la louange : et qui a été enivré de son encens peut difficilement s’en passer ; aussi, malgré les rares qualités de Mlle Clairon, les sentiments d’estime et d’amitié qui l’avaient suivie dans la retraite, elle n’oubliait point l’impression qu’elle éprouvait lorsqu’en arrivant en scène, un applaudissement général l’empêchait, pendant plusieurs minutes, de s’exprimer ; et ses amis, voyant qu’elle avait encore besoin des hommages publics, l’engagèrent à profiter des fêtes du mariage de M. le Dauphin pour reparaître sur la scène. Mais ce qui est bien extraordinaire, c’est qu’elle obtint, par le crédit de M. le duc de Choiseul, de jouer Athalie, rôle qui était de l’emploi de Mlle Duménil.
Le public était accoutumé à l’applaudir dans ce rôle qui, cependant, il faut en convenir, demandait une expression de noblesse que Mlle Duménil n’avait pas et un art que cette actrice dédaignait ; cependant, soit prévention, soit que Mlle Clairon eût perdu dans la retraite cette habitude si nécessaire pour avoir de grands succès, elle n’en eut qu’un médiocre.
La favorite qui ne l’aimait pas, par la seule raison que M. le duc de Choiseul et sa sœur appréciaient ses rares talents, ne contribua pas peu à ce désagrément auquel cette actrice fut très sensible ; et Mlle du Barry, pour prouver qu’elle était en tout contraire au duc, fit venir Mlle Duménil, l’engagea à jouer dans Sémiramis et lui fit présent d’un habit magnifique, digne de la reine de Babylone.
Ces tracasseries avaient peu d’importance et n’auraient pas amené une rupture entre le roi et son ministre ; elles servaient d’aliment à la haine, mais n’en marquaient pas toute la force.
Un événement dont toute la politique de Maupeou sut tirer parti servit enfin à terrasser le colosse. Ce fut réellement, comme dans la vision de Daniel, la pierre détachée de la montagne.
M. le duc d’Aiguillon avait été commandant de la province de Bretagne et, sans entrer dans les détails qui ne conviennent pas à cette étude, il suffit de savoir qu’ayant blessé la liberté dont les Bretons se flattaient de jouir sous le pouvoir monarchique, il fut accusé par M. de la Chalotais, avocat-général du Parlement de Rennes.
On répondit à ses réquisitoires par un de ces coups de puissance arbitraire, hélas ! trop fréquents dans tous les gouvernements dont la force était le principal ressort.
Le Parlement de Bretagne, offensé dans un de ses membres, osa mettre en jugement le commandant pour le roi, et M. le duc d’Aiguillon, au moment où il rendait les premiers soins à Mme du Barry, était dans les alarmes que lui causait un procès qu’il ne se flattait pas de gagner, car sa conscience lui disait mieux que ses accusateurs les torts qu’il avait à se reprocher.
Le chancelier chercha à tirer de la position désagréable du duc un moyen d’embarrasser les magistrats qu’il avait résolu de perdre.
Personne n’était dans sa confidence, pas même celui qui y paraissait le plus intéressé ; et voici comment il s’y prit :
Il excita, par des agents qui lui étaient dévoués, le Parlement de Rennes contre M. d’Aiguillon.
La procédure se conduisait si vivement qu’il y avait tout à craindre pour la tête du duc.
Celui-ci ne put s’empêcher de trembler et, dans l’instant de ses plus vives alarmes, il chercha à pénétrer les intentions du chancelier à son égard. Ce magistrat ne lui dissimula pas son danger et l’impossibilité ou il était de le servir tant que l’affaire resterait en Bretagne.
Tout le monde connaissait l’inflexible probité des Bretons, qu’il n’y avait nul espoir de corrompre ; au contraire, si le procès s’instruisait à Paris, il y aurait bien plus de ressources.
« — D’ailleurs, ajouta le magistrat suprême, je suis étonné que vous ayez consenti à être jugé par une autre cour que celle de Paris, et je ne vois pas d’autre moyen que celui d’évoquer l’affaire au Parlement de Paris.
« — Servez-vous de l’amitié de la comtesse pour obtenir du roi d’être jugé par les princes du sang et des pairs. »
M. le duc d’Aiguillon crut voir son salut dans cette idée.
Il remercia le chancelier et, dès le soir, il parla à la comtesse du besoin qu’il avait de son crédit auprès du roi.
Mme du Barry, qui ne voyait dans cette démarche que le plaisir d’obliger un homme qui avait de l’amitié pour elle, lui promit tout ce qu’il voulut.
Elle en parla à Sa Majesté.
Le roi, fort instruit des droits des pairs, trouva que la demande du duc était juste.
L’affaire fut évoquée à Paris et on recommença l’instruction du procès.
La capitale avait les yeux ouverts sur la conduite des magistrats. M. d’Aiguillon était jugé dans l’opinion publique et l’opinion publique influait extrêmement sur celle des membres du Parlement de Paris, qui était connu pour juger autant les personnes que les choses.
Il parut que M. d’Aiguillon avait inutilement changé de juges, et qu’il n’avait pas plus d’indulgence à attendre à Paris qu’à Rennes.
Ses alarmes croissaient à chaque séance, et Mme d’Aiguillon ne pouvait pas cacher à sa belle amie la profonde douleur que le danger de son mari lui causait.
Celle-ci, bonne, sensible, et ne comprenant rien à tout ce dont le duc était accusé, avait le plus vif désir de le sauver : mais comment y parvenir ?
C’est encore le chancelier qui en donna le moyen : moyen dont il était certain de tirer pour lui-même un extrême avantage, en mettant les magistrats entre leur conscience et leur intérêt.
Il fallait qu’ils fussent perdus, ou en résistant au roi ou en trahissant leurs devoirs, ce qui alors leur aurait ôté toute considération publique.
Le roi était fatigué depuis longtemps de ce procès dont il calculait l’issue avec inquiétude, car, enfin, en jugeant avec sévérité celui qui avait été chargé de ses ordres, n’était-ce pas affaiblir l’autorité ? et ne savait-il pas ce que son petit-fils, l’infortuné Louis XVI, n’a jamais voulu imaginer, que lorsque les peuples commencent à discuter les bornes où doit s’arrêter la puissance royale, ils cherchent à l’anéantir ?
Il fut donc très facile au chancelier, appuyé des douces prières de la comtesse, d’engager Sa Majesté à défendre au Parlement de s’occuper de l’affaire du duc d’Aiguillon.
Les magistrats répondirent avec respect que, le pouvoir judiciaire leur étant confié, toutes les fois qu’un grand délit leur était dénoncé, il fallait qu’ils le jugeassent soit pour absoudre, soit pour punir le coupable.
Ce langage, d’accord avec les principes, ne pouvait être réfuté par aucun argument raisonnable.
Il fallait, ou abandonner le duc au hasard du procès, ou le terminer par un de ces coups d’autorité que le roi répétait trop souvent et dont la suite a été d’ébranler le trône, loin de le raffermir.
Louis XV tint un lit de justice où il dit, par l’organe de son chancelier, qu’il regardait M. d’Aiguillon comme justifié et qu’il ne voulait plus qu’on s’occupât de ce procès, dont il ordonna qu’on lui rendît toutes les pièces.
M. de Choiseul ne fut point consulté : il se serait opposé à cette violation des principes. Il savait aussi bien qu’un autre que les Parlements étaient loin d’être les représentants du peuple, comme ils voulaient quelquefois le croire, mais il savait aussi qu’un État était perdu dès que les pouvoirs se confondent ; et aussi quelque absurdes que fussent les prétentions des Parlements, lorsqu’ils se disaient pouvoir législatif, ils n’en étaient pas moins respectables comme revêtus de l’autorité de juger.
C’était donc, comme je l’ai dit, blesser tout principe que de les troubler dans cette auguste fonction ; le roi n’en avait pas le droit ; il devait laisser juger et faire grâce ensuite.
Mais le duc d’Aiguillon regrettait plus la perte de sa réputation que celle de sa vie ; et ce qu’il voulait, c’est qu’on ne fût pas instruit des débats de ce procès ; ce qu’il obtint par la volonté du roi ; mais elle n’eut pas, dans le public, l’effet qu’on en espérait ; et M. le duc de Brissac, connu par sa vieille loyauté, disait en parlant à ses amis de cette affaire : « Mme la comtesse du Barry a sauvé la tête de M. le duc d’Aiguillon, mais elle lui a tordu le cou. »
Plusieurs épigrammes rendirent la même idée, entre autres celle-ci :
Oublions jusqu’à la trace
De mon procès suspendu,
Avec des lettres de grâce
On ne peut être pendu.
Je triomphe de l’envie,
Je jouis de la faveur,
Grâces aux soins d’une amie,
J’en suis quitte pour l’honneur.
Cependant, M. d’Aiguillon était pénétré de reconnaissance des bontés de la comtesse, et, pour la lui témoigner, il fit faire un vis-à-vis aux armes des du Barry avec le fameux cri de guerre : « Boutez en avant ».
On avait joint tous les emblèmes de l’amour heureux, environnés de guirlandes de fleurs de Burgos.
Enfin, on assure que cette voiture avait coûté 52.000 livres et que jamais la magnificence et le goût ne s’étaient réunis avec autant de succès que dans ce vis-à-vis dont cependant la comtesse ne s’est point servie, sans qu’il ait été possible de savoir la raison de ce caprice.
Quelques-uns croient que ce fut la volonté du roi qui s’y opposa ; d’autres, qu’on lui avait fait parvenir d’une manière indirecte un couplet très mordant que voici :
— Pourquoi ce brillant vis-à-vis ?
Est-ce le char d’une déesse
Ou de quelque jeune princesse ?
S’écriait un badaud surpris.
— Non, de la foule curieuse,
Lui répond un caustique, non,
C’est le char de la blanchisseuse
De cet infâme… d’Aiguillon.
Et il est à présumer que ce fut assez pour que la comtesse ne voulût pas s’exposer, en paraissant dans cette voiture, à entendre répéter ces tristes vérités.
Mme de Pompadour en eût fait chercher l’auteur : des agents trop habiles l’eussent trouvé et le malheureux aurait langui jusqu’à sa mort dans les fers ; Mme du Barry se contenta de se priver du plaisir de se servir de la plus belle voiture qu’on eût faite jusqu’alors.
Dès que la favorite eut été entraînée par ces grands mouvements politiques, elle s’y abandonna ; et, se persuadant réellement que les intérêts du chancelier étaient pour elle des intérêts de famille, elle crut devoir soutenir de tout son crédit ses opérations.
Cependant elle se donnait pour ennemis, non seulement tous les magistrats qui firent cause commune avec le Parlement de Paris, mais encore toute cette nuée d’avocats, procureurs, clercs, huissiers, qui, tous, étaient à mourir de faim dès que les juges cessaient leurs fonctions.
Aussi fut-on inondé de pamphlets : ils étaient de mille façons différentes.
On emprunta même celle de la prière que le législateur des chrétiens leur a prescrite :
« Notre père qui êtes à Versailles, votre nom soit glorifié, votre règne est ébranlé, votre volonté n’est pas plus exécutée sur la terre que dans le ciel. Rendez-nous notre pain quotidien que vous nous avez ôté. Pardonnez à vos Parlements qui ont soutenu vos intérêts comme vous pardonnez à vos ministres qui les ont vendus. Ne succombez plus aux tentations de du Barry, mais délivrez-nous du diable de chancelier. Ainsi soit-il[18]. »
On n’eut pas de peine à persuader à Mme du Barry que ces traits satiriques étaient forgés par les amis de Choiseul et qu’il fallait qu’elle obtînt son renvoi ou qu’il finirait par la perdre.
Ce fut alors que, quittant ce ton léger et frivole qui l’avait jusqu’alors caractérisée, elle s’instruisit des grands intérêts des nations et en parla avec grâce et persévérance, jusqu’à ce qu’elle eût persuadé au roi que M. de Choiseul avait des raisons particulières de conserver les Parlements.
Un homme que d’Aiguillon consultait en secret avait fait un ouvrage intéressant sur les prétentions aristocratiques des grands seigneurs. M. d’Aiguillon en avait fait faire un extrait qu’il avait engagé la favorite à parcourir et dont elle avait retenu quelques phrases marquantes, entre autres celle-ci :
« Il ne paraît pas douteux à ceux qui ont été instruits des débats qui avaient lieu du temps de la Ligue, que les grands seigneurs avaient le projet de faire de la France une république aristocratique. Or, rien n’y donne plus de facilité que les ressorts étendus des Parlements. Il ne faut plus qu’un chef dans chaque province. Les peuples jugés par les mêmes hommes s’aperçoivent à peine du changement de gouvernement et la France déchirée ne sentira ses plaintes que lorsqu’il ne sera plus temps d’y remédier.
. . . . . . . . . . .
« Les vieux corps ont de vieux préjugés ; il est indispensable, pour anéantir les uns, de détruire les autres.
. . . . . . . . . . .
« M. de Choiseul et tout ce qui tient à lui voudrait bien restreindre les rois de France au faible pouvoir des enfants de Clovis, et ils trouveront fort bon d’avoir chacun leur part de souveraineté.
. . . . . . . . . . .
« Si le roi faiblit, on demandera les États généraux et la France est perdue. »
On pense bien qu’il importait peu que ce fussent là réellement les projets du ministre ; il fallait seulement le faire croire au roi, et qui pouvait mieux le lui persuader que celle dans le sein de laquelle il venait répandre ses chagrins et qui, seule, pouvait les adoucir !
Souvent elle passait tout à coup de ces importantes réflexions à des plaisanteries qui ôtaient au roi jusqu’au souvenir de ses peines.
Le chancelier, malgré la gravité de son état, se prêtait à tout ce qui pouvait plaire à la favorite.
On assure qu’un jour, Louis XV étant chez sa maîtresse, on proposa un colin-maillard et ce fut M. de Maupeou qui, en simarre, fut le premier à se laisser bander les yeux.
Une autre fois, un véritable jeu d’enfant donna lieu à une scène comique, où le premier magistrat du royaume voulut bien jouer un rôle.
Il dînait avec sa belle cousine et beaucoup d’amis de la favorite. On servit un pâté dont elle savait le secret ; en l’ouvrant, il en sortit une nuée de hannetons qui volèrent sur tous les convives.
Mme du Barry avait auprès d’elle Zamor, son petit nègre, qu’elle faisait élever avec soin et qu’elle comblait de bontés.
Ce Zamor qui depuis… mais alors il aimait sa maîtresse.
Zamor donc, voyant peut-être pour la première fois ce nombre d’insectes, dont le bourdonnement l’amuse et l’étonne, veut les attraper, court après et les prend partout où il les trouve.
Son âge excuse son audace, et sa petite main noire se glisse sous les fichus des dames, qui les redoutent moins que les pattes des hannetons ; mais c’est dans l’énorme perruque du chancelier qu’il s’en est réfugié un plus grand nombre.
Zamor, encouragé par un coup d’œil de sa maîtresse, grimpe sur les épaules de M. de Maupeou et se met à fourrager dans les boucles qui servent de repaire aux hannetons, mais leurs pattes crochues s’embarrassent dans les cheveux et l’enfant de Chanaan ne peut les prendre avec vivacité.
Alors, sans aucun respect pour la perruque d’un chancelier, il l’enlève de dessus sa tête, et l’emporte avec tous les hannetons pour les ôter à loisir.
Tous les convives riaient aux éclats, et le magistrat prit sa part de la gaieté que sa tête rasée inspirait à la société.
Dès le soir, cette anecdote fut sue de toute la cour.
Les honnêtes gens s’affligèrent de voir à quel degré l’homme qui, par son état, devait avoir les mœurs les plus graves, se laissait ainsi avilir au point de n’être, pour la favorite, qu’un bouffon en simarre.
D’autres y trouvèrent la preuve de l’immense crédit d’une femme qui pouvait risquer de semblables plaisanteries, et ne doutèrent point que M. de Maupeou ne s’y prêtât que pour la faire servir à ses desseins.
Mme de Gramont en parla chez Mme la Dauphine qui, elle-même, aurait ri d’aussi bon cœur que la comtesse si elle avait été témoin de cette aventure, mais elle n’y vit qu’une extrême inconvenance parce qu’elle commençait à avoir des reproches importants à faire à Mme du Barry.
Cette dernière s’était permis des propos très lestes contre la princesse : c’est la seule faute que l’on puisse lui reprocher, mais elle fut grave, parce qu’elle sépara entièrement le roi de sa famille.
C’étaient bien là ce que voulaient MM. de Richelieu, d’Aiguillon et de Maupeou : car il était bien certain que si on avait laissé prendre à Mme la Dauphine tout l’ascendant qu’elle eût dû nécessairement avoir sur le roi, jamais M. de Choiseul, qu’elle regardait comme son bienfaiteur, n’eût été exilé.
Il fallait donc brouiller la petite bru du roi avec la maîtresse, et on en trouva le meilleur moyen en excitant la jalousie de cette dernière contre la jeune princesse et, dès qu’on lui eût persuadé que le roi trouvait Mme la Dauphine charmante, il n’en fallut pas davantage pour qu’elle cherchât à dissimuler l’effet de ses charmes en critiquant ses traits qui n’étaient pas aussi réguliers que les siens.
Ses observations critiques furent rendues et envenimées, et Mme la Dauphine n’eût pas été femme si elle les eût pardonnées.
Mais n’anticipons pas sur les événements et suivons les détails, peut-être minutieux, des circonstances de la vie d’une femme qui semblait avoir été mise à la cour pour faire sans cesse des actions opposées à son caractère, le meilleur et le plus sensible qui fût jamais.
Trop heureuse quand elle pouvait s’y livrer sans contrainte !
On se rappelle cette Adélaïde si malheureuse et que du Barry avait chassée de chez lui pour y recevoir la belle Lange.
Depuis deux ans, elle languissait dans la misère.
Mme du Barry l’apprend, l’engage à lui confier son sort, la traite avec amitié et confiance et, enfin, la marie avec M. Langibeau, à qui elle fit donner pour dot une place de dix mille livres.
Le roi, pour qui rien de ce qui intéressait son amie n’était indifférent, voulut partager ses sentiments de bienveillance pour Adélaïde, à qui il donna en présent de noces vingt-cinq mille francs et de très beaux diamants.
Tant de preuves répétées de l’ascendant de Mme du Barry sur son auguste amant n’ôtaient pas encore à la faction Choiseul l’espoir de la supplanter.
Le fils du marquis de Choiseul venait d’épouser Mlle de Rabi, créole, réunissant à la figure la plus séduisante les talents et les grâces qui la rendaient la femme la plus accomplie de la cour ; on s’attendait qu’à sa présentation, elle fixerait les regards du monarque ; mais au grand étonnement de tous les courtisans, il n’y fit aucune attention et son cœur, tout entier à la comtesse, ne lui laissait pas apercevoir des charmes dont autrefois il eût été si épris.
Cette dernière tentative ayant manqué, il le resta plus aucun espoir de détacher le roi des fers de Mme du Barry qui lui devenait chaque jour plus chère.
Ce fut au voyage de Fontainebleau, en 1770 que la favorite mit le moins de ménagements pour prouver qu’elle croyait n’avoir plus de degrés à franchir entre elle et le rang suprême.
Le régiment du roi vint camper à cette époque auprès de Fontainebleau, où le roi le passa en revue.
Mme du Barry s’y montra, ayant dans son carrosse la duchesse de Valentinois et la marquise de Montmorency.
M. le comte du Châtelet, colonel-commandant, donna le soir, dans sa tente, un dîner-souper où ces dames furent invitées.
Mme du Barry était assise à côté de Sa Majesté et remplaça Mme la Dauphine qu’on avait annoncée devoir y être, mais qui n’y assista pas.
Ce fut le premier schisme d’éclat qu’elle fit avec la favorite Le duc de Choiseul, outré de rage, prétexta une indisposition pour ne pas se trouver à cette revue et au repas.
Les tracasseries de la cour et des Parlements subsistaient toujours et semblaient devenir de jour en jour plus sérieuses ; mais on n’osait porter les derniers coups tant que M. de Choiseul était en place.
Déjà, plus d’une fois, on avait tenté de faire signer au roi sa lettre de renvoi, sans pouvoir l’y déterminer ; enfin, on lui persuada que la sœur du ministre, sous prétexte d’aller aux eaux, avait parcouru les différentes villes du Parlement pour engager ceux des provinces à faire cause commune avec celui de Paris ; et tant que ce ministre gouvernerait en son nom, il était impossible, disait-on au roi, de réduire la magistrature, forte d’un tel appui.
Enfin, la fatale lettre fut signée ; mais soit qu’un mouvement passager de colère eût conduit la main du monarque, soit qu’il eût fallu troubler sa raison par des liqueurs enivrantes pour le déterminer à se séparer d’un homme qui était depuis longtemps l’âme de ses conseils, il emportait la lettre avec lui, et le lendemain matin, lorsque le sommeil lui avait rendu ses pensées habituelles, il la déchirait ; enfin, le 24 décembre, elle fut irrévocablement expédiée et fut signifiée à onze heures du matin. Elle était conçue en ces termes :
« Mon cousin,
« Le mécontentement que me causent vos services me force à vous exiler à Chanteloup, où vous vous rendrez dans vingt-quatre heures.
« Je vous aurais envoyé beaucoup plus loin si ce n’était l’estime particulière que j’ai pour Mme la duchesse de Choiseul, dont la santé m’est fort intéressante. Prenez garde que votre conduite ne me fasse prendre un autre parti. Sur ce, je prie Dieu, mon cousin, qu’il vous ait en sa sainte garde[19].
La présence du duc de la Vrillière, qui apporta cet ordre à M. de Choiseul, fut encore une circonstance plus mortifiante pour lui, puisque ce ministre, oncle du duc d’Aiguillon, ne pouvait qu’être intérieurement satisfait de sa commission.
Aussi ne fut-il pas dupe du compliment de condoléance de son confrère, et il lui répondit : « Monsieur le duc, je suis persuadé de tout le plaisir que vous avez à m’apporter une telle nouvelle. »
Le duc de Praslin, qui était à Paris, malade de la goutte remontée dans la tête, reçut le même jour une lettre de cachet, beaucoup plus courte et plus méprisante : « Je n’ai plus besoin de vos services et je vous exile dans votre terre de Praslin, où vous vous rendrez dans les vingt-quatre heures. »
Ces ministres une fois partis de la cour, l’affaire du Parlement ne fut pas longue, et le 22 janvier toute la compagnie fut exilée.
La douleur et la rage dictèrent à une des victimes de ce grand événement politique ce couplet qui aurait dû faire une profonde impression sur le monarque si ses chagrins domestiques n’avaient pas émoussé sa sensibilité :
Le bien-aimé de l’almanach
N’est pas le bien-aimé de France.
Il fait tout ab hoc et ab hac,
Le bien-aimé de l’almanach.
Il met dans le même sac
Et la Justice et la Finance.
Le renvoi de M. de Choiseul laissait presque tout le ministère à l’abandon ; du moins, les trois départements les plus importants : les affaires étrangères, la guerre et la marine.
M. d’Aiguillon avait espéré s’emparer de ce dernier ; mais ses amis lui firent envisager que ses ennemis étaient trop envenimés contre lui et qu’il y avait tout à craindre de la fermentation des États de Bretagne qui soutenaient, avec la fermeté bretonne, la magistrature outragée par les opérations de M. de Maupeou, auxquelles on n’ignorait pas que M. d’Aiguillon avait contribué de tout son pouvoir.
Il fallait cependant donner le portefeuille à quelqu’un à qui on pût le reprendre.
L’abbé Terray qui, de conseiller au Parlement, était devenu contrôleur-général, parut l’homme qui convenait le mieux aux intérêts du duc.
Il ne doutait qu’il ne lui rendît le ministère de la marine dès qu’il le désirerait, celui des finances étant bien suffisant pour occuper un seul homme.
Peut-être l’abbé n’eût pas mieux demandé de garder l’un et l’autre ; sa tête ministérielle, car on ne peut sans injustice lui refuser de grands talents, lui faisait imaginer qu’il pourrait aisément régir l’un et l’autre.
Il accepta donc par intérim, avec espoir de confirmation.
Il en coûta quelques millions à la France pour tâcher de l’obtenir, et il n’y réussit pas.
Pour entendre ceci, il faut reparler encore de du Barry qui, détesté de sa belle-sœur, n’en avait pas moins sur elle l’ascendant d’un créateur sur son ouvrage ; et pour l’empêcher de se mêler des intrigues de la cour qu’elle était parvenue à entendre beaucoup mieux que lui, elle lui faisait donner tout l’argent dont il avait besoin, et l’on sait ce que le jeu peut en absorber.
L’abbé Terray, pour faire sa cour à la comtesse, s’empressait à la délivrer des importunités de son beau-frère en lui donnant ce qu’il demandait, et il espérait par là non seulement se soutenir dans les finances, mais, comme nous l’avons dit, garder la marine.
La guerre fut donnée à M. de Monteynard, ami de M. le prince de Condé, à qui il avait promis de le faire nommer grand-maître de l’artillerie.
Le roi se réserva la signature pour le ministère des affaires étrangères.
N’était-ce pas convenir tacitement qu’il n’avait trouvé personne pour remplacer M. de Choiseul ? Et cependant, on éloignait avec soin tout ce qui pouvait le rappeler ou même entretenir ses relations avec les affaires.
M. le baron de Breteuil, nommé à l’ambassade de Vienne par le dernier ministre dont il était l’ami et la créature, avait déjà fait partir ses équipages lorsque le duc de la Vrillière le fit prier de passer chez la comtesse du Barry, qui lui dit que sa destination était changée et que c’était à Naples que le roi le nommait ambassadeur, et ainsi on rendait inutiles les rares talents de ce négociateur en le confinant dans une cour alors très secondaire, dans la crainte qu’il ne réveillât l’intérêt de celle de Vienne pour le ministre disgracié.
On envoya à sa place le prince Louis de Rohan, qui n’avait d’autre mérite que celui qui constitue l’homme aimable, et il ne put s’opposer au démembrement de la Pologne, qui servait aux projets ambitieux de l’impératrice-reine.
Ainsi les malheurs dont cette république fut accablée eurent pour cause la haine de Mme du Barry contre M. de Choiseul.
Oh ! Madame Gomart, lorsque vous donnâtes naissance à cette jolie enfant, vous imaginiez-vous que ce serait elle un jour qui ferait les destins de l’Europe ? et elle-même y fit-elle jamais réflexion ?
Cependant, on s’employait sans relâche à l’affermissement des plans du chancelier.
Déjà le fameux Parlement de 1771, ainsi appelé parce que ce fut en cette année qu’il fut organisé, avait remplacé les respectables magistrats qui languissaient dans l’exil.
Ces juges de nouvelle création étaient couverts du mépris public ; mais comme la plupart l’avaient affronté depuis de longues années, ils y étaient peu sensibles.
On employait contre eux l’arme du ridicule, la plus terrible en France. La Correspondance, ouvrage que l’on a comparé aux Lettres Provinciales pour les grâces du style et le sel attique que l’on rencontre à chaque phrase, eût dû leur faire sentir que jamais ils ne pourraient obtenir la considération publique, si nécessaire aux magistrats. « Mais ils savaient l’argent qu’on leur donnait, c’était assez. »
S’ils se croyaient affermis sur les lis, M. de Maupeou avait assez d’esprit pour ne pas sentir que sa besogne ne se soutiendrait jamais s’il ne parvenait à avoir d’autres hommes pour remplir d’aussi augustes fonctions ; et il se flattait toujours que l’excès des maux dont il accablait les anciens Parlements en déterminerait au moins la moitié à accepter les nouvelles places de judicature.
Pour cela, il était essentiel de ne rien relâcher de la rigueur de la loi, et il savait aussi que le roi avait peine à suivre longtemps la même marche ; il craignait qu’instruit enfin du mépris dont on accablait le Parlement Maupeou, on ne le perdît un jour avec ses créatures.
Il fallait donc entretenir la haine du monarque contre les anciens magistrats, et le chancelier eut recours à un moyen qui lui réussit.
Il fit présent à Mme du Barry du portrait de Charles Ier, roi d’Angleterre, peint par Van Dyck, comme d’un tableau de famille, il fut placé à côté de celui du roi dans le boudoir de la comtesse, à qui l’on recommanda, toutes les fois qu’elle verrait le roi touché de la situation des hommes dont le crime était de s’être immolés au respect dû aux lois, de lui faire jeter un coup d’œil sur le portrait de l’infortuné Charles Ier et de lui dire : « Voilà celui que son Parlement fit périr. »
Ces mots avaient une grande force ; lorsque Mme du Barry les prononçait, elle était bien loin de penser que c’était sa propre cause qu’elle plaidait !
Il est cependant bien certain que si Louis XVI n’eût rappelé les Parlements, il n’y eût point eu d’États généraux et, par conséquent, que Mme du Barry n’eût pas porté sa tête sur l’échafaud.
Mais que ces scènes sanglantes dont on voulait effrayer le roi étaient loin de la pensée de ceux qui n’en supposaient pas même la possibilité. Semblables aux enfants qui, au milieu de la nuit, dans un chemin inconnu, effraient leurs compagnons, par des spectres et des bruits de chaînes, qu’ils ne voient ni n’entendent, les frappent de terreur panique, les empêchent de s’occuper des dangers réels qui les environnent, tombent avec dans les précipices que la prudence leur aurait fait éviter.
L’explication est facile à saisir et M. de Maupeou, en terminant sa vie par une mort violente, ne l’a que trop donnée.
Nous ne rapporterons pas les couplets infâmes que l’on publiait alors contre la favorite et ses amis ; malheur à ceux qui gâtent la meilleure cause par des injures ![20]
On se rend méprisable en joignant à des plaintes, peut-être justes, des expressions dont rougit la pudeur, et c’est ce que faisaient tous les chansonniers de ce temps.
Le ministre de la guerre, voulant consoler la comtesse du chagrin que ces pamphlets lui causaient, nomma le chevalier du Barry, dont nous avons parlé lorsqu’il était capitaine au régiment de Beauce, colonel-lieutenant du régiment de la reine ; pour y parvenir, on fit M. de Toumi maréchal-de-camp, quoique ce ne fût pas son rang.
Tant de faveur fit croire à Mme du Barry qu’elle pouvait prétendre à tout nommer, et la disgrâce de M. de Choiseul ayant entraîné celle de l’évêque d’Orléans, qui avait la feuille des bénéfices, elle la demanda pour M. de Senlis, premier aumônier du roi.
Un grand nom, une figure céleste, un caractère doux et affable le faisaient chérir, surtout d’un sexe qui tient beaucoup aux avantages extérieurs, et ces qualités persuadèrent à la favorite que le roi ne pouvait faire un meilleur choix.
Mais Sa Majesté qui, au milieu des plaisirs défendus auxquels elle se livrait, conservait un grand respect pour la religion, craignait d’être influencé par sa maîtresse dans un choix où la conscience pouvait être intéressée, et M. de Roquelaure n’eut point la feuille.
Il s’en consola facilement, et le charme que son amabilité répandait autour de lui parut préférable à l’adulation que ce pouvoir lui aurait donné.
Il a passé tranquillement au milieu des tracasseries de la cour, des orages révolutionnaires, et dans les derniers arrangements pris entre le gouvernement français et le pape, il a été nommé à l’archevêché de Malines où il fut aimé comme il l’était à Senlis.
Le roi, pour dédommager Mme du Barry de n’avoir pu donner la feuille à sa sollicitation, la laissa disposer du département de la marine, qu’enfin l’abbé Terray sentit ne pouvoir garder avec le contrôle général.
Ce fut à M. Bourgeois de Boisne qu’il fut confié, et ce choix prouve encore ce que nous avons dit plus haut : que c’était le parti jésuitique qui influençait la comtesse, car M. de Boisne et toute sa famille étaient entièrement dévoués aux disciples de saint Ignace.
Une anecdote que le Bulletin de Paris rapporte, prouva que la comtesse ne se regardait point comme étrangère aux affaires les plus importantes de l’État.
Mme du Barry ayant rencontré M. de Nivernais, l’un des pairs protestants, l’arrêta et, après lui avoir fait des reproches sur sa conduite en cette circonstance, elle ajouta :
— Monsieur le duc, il faut espérer que vous vous départirez de cette opposition, car vous l’avez entendu : le roi a dit qu’il ne changerait jamais.
— Oui, Madame, mais il vous regardait, répartit le duc de Nivernais, se tirant ainsi par une réponse galante et spirituelle d’une interpellation délicate et embarrassante.
Quelques chagrins personnels, cependant, vinrent troubler la sérénité des beaux jours de la comtesse. Son mari, entendant parler du luxe de son frère, de l’avancement du chevalier et de celui de son neveu, crut enfin pouvoir venir prendre sa part de tant de faveurs ; et, au moment où il était le moins attendu, on le vit arriver à Paris.
Une autre femme que Mme du Barry eût obtenu contre lui une lettre de cachet, et il aurait été pleurer dans quelque château-fort l’imprudence qu’il avait eue de vouloir jouer le rôle d’époux de la maîtresse d’un roi. Mme du Barry se contenta de lui interdire sa présence et de lui faire donner l’argent nécessaire pour vivre à Paris d’une manière agréable.
Malgré tout ce qu’on a pu dire des du Barry, ils étaient encore plus modestes que beaucoup d’autres ne l’auraient été à leur place ; et nous avons vu des révolutionnaires afficher une bien autre insolence dans leur sanglante fortune : nous les avons vus habiter sans pudeur les palais de leurs victimes ; tandis que du Barry vint se loger dans un appartement très simple, au second de la maison qu’occupait M. de Selle, trésorier de la marine, rue Ventadour, et là il avait avec lui une jeune personne d’une fort jolie figure, mise sans aucune magnificence.
Elle passait tout le jour à travailler, excepté lorsqu’il la faisait sortir avec lui, à cheval ou en voiture.
C’était là le seul luxe qu’on eût à lui reprocher.
Un attelage de six chevaux soupe au lait, à crins noirs, avait pu être destiné au roi par son extrême beauté, plusieurs autres, non moins beaux, remplissaient ses écuries.
Il paraît que c’était son goût dominant.
Mais avec cent mille francs on a bien des chevaux, et qu’est-ce que cent mille francs pour le mari de la maîtresse d’un roi !
Soit qu’il fût désagréable à Mme du Barry de l’avoir si près d’elle, soit qu’elle s’occupât plus que jamais du projet de divorce, elle lui fit persuader par Mlle Chonchon, qui allait souvent le voir, de repartir pour Toulouse ; ce qu’il fit enfin.
Mais de retour dans son pays, il s’avisa de prendre parti dans les troubles que les affaires du Parlement excitaient en Languedoc, et crut laver la honte du rôle qu’il avait joué en épousant Mlle Lange lorsqu’on saurait qu’il était chef d’un parti contre la cour.
Mais ce parti fut bientôt dissipé et on ne fit grâce au comte Guillaume qu’à la condition qu’il serait plus circonspect à l’avenir.
Ces tracasseries, celles que la conduite méprisable du grand du Barry attirait à la comtesse, lui auraient fait désirer de ne plus appartenir à cette famille, quand bien même le divorce ne lui aurait pas donné de plus hautes pensées.
L’espoir de l’obtenir du pape n’avait pas peu contribué à donner à la favorite plus d’ardeur pour la destruction du Parlement, parce qu’on lui avait persuadé que cette compagnie ne voudrait point donner sa sanction à la bulle du pape qui briserait son mariage avec le comte du Barry.
Une fois délivrée de cet obstacle, elle fit suivre à la cour de Rome un projet qui lui importait autant.
Si son mariage était rompu, elle ne pouvait douter qu’elle obtînt au moins le sort de Mme de Maintenon.
N’était-elle pas bien plus jeune et aussi belle qu’elle, et le roi n’était-il pas infiniment plus amoureux et beaucoup plus âgé ? Que de raisons pour croire à la réussite de ce rêve dont ses amis l’entretenaient sans cesse, sans avoir dessein de la servir dans ce projet dont ils connaissaient bien toute la difficulté ?
Mais c’était leur secret et elle les croyait de la meilleure foi du monde, surtout lorsqu’ils firent circuler l’anecdote suivante :
« Simon Sommer, charpentier à Landau, s’est marié au mois de mai 1761 à Elisabeth Ultine, fille du village d’Obersbach.
« Ce malheureux, quoique âgé de vingt-deux ans seulement et d’une figure agréable, fut six mois à éprouver des refus de la part de sa moitié, jeune et jolie, avant de jouir de ses droits.
« À peine eut-elle consenti à devenir la femme de son mari qu’elle parut vouloir être celle de tout le monde.
« Au bout de trois ans d’une vie scandaleuse, elle s’attacha à un sergent du régiment de Lokmann-Suisse, avec qui elle a déserté. Tous deux se sont retirés en Prusse.
« On est en état de prouver qu’ils ont contracté un mariage en forme. Sommer n’a conservé du sien qu’un enfant.
« Il n’a que trente et un ans, il est bien constitué, il est vigoureux : que doit-il faire ? Sera-t-il réduit à maudire le reste de ses jours les présents de la nature ? ou cherchera-t-il dans le libertinage des ressources que permet la politique mais que la religion défend ? En un mot, placé entre le crime et le désespoir, comment se dérobera-t-il à cette cruelle alternative ? »
Le consultant cite encore des États où le divorce est permis ; il s’appuie sur différents passages de l’Écriture qui sont favorables à sa demande ; il réfute, il commente, il interprète ceux qui lui sont contraires.
Il a recours aux Pères de l’Église, d’où il tire aussi des autorités ; il prétend que, des conciles même, on peut inférer des inductions lumineuses sur cette question, et il trouve des décisions de quelques-uns absolument concluantes pour lui.
Il continue par établir que le divorce n’est contraire ni à la loi des juifs ni au christianisme ; qu’il ne choque ni l’Ancien ni le Nouveau Testament, que la primitive Église n’a jamais balancé à permettre la dissolution des mauvais mariages sur cet objet ; que jusqu’au Xe siècle, la même façon de penser s’est perpétuée chez tous les législateurs catholiques.
Il finit par les raisons qui doivent autoriser le divorce, la meilleure manière de le supprimer étant de le permettre.
Tel est l’extrait du mémoire du prétendu charpentier, qui n’est qu’une analyse lui-même du Cri de l’honnête homme, ouvrage publié environ deux ans et demi avant, et composé par le premier magistrat d’une ville de province de second ordre qui, obligé de se séparer de sa femme à cause de ses débordements, se livra à beaucoup de recherches sur cette matière et en fit part au public de son temps.
Le sieur Linguet, dans sa consultation, discute d’abord si le divorce peut être légitimement permis ; et il regarde l’opinion de l’indissolubilité des mariages seulement comme un article de discipline qui peut être changé ou modifié par l’Église. Il décide qu’elle pourrait faire revivre aujourd’hui les règlements sur le mariage qui ont été en vigueur dans les premiers siècles et que la puissance laïque qui promulguerait des lois d’après ces principes le ferait en toute sûreté de conscience.
Il demande ensuite à qui Simon Sommer doit s’adresser pour se remarier du vivant de sa femme.
C’est au pape à qui il exposera, dans une requête, sa situation et ses besoins. C’est devant Sa Sainteté que se sont pourvus, en pareil cas, ceux qui y étaient réduits, presque tous, à la vérité, des princes ; mais la qualité d’homme et la singularité du charpentier de Landau toucheront le Saint-Père, à ce qu’espère l’orateur.
S’il obtient une bulle, il se retirera devant le roi pour en obtenir la ratification, et cette dérogation particulière pourrait peut-être, par la suite, devenir une loi générale quand un examen réfléchi en aura fait connaître tous les avantages.
Les soupçons du public sur ce mémoire en faveur du charpentier de Landau, qui demandait ainsi à être autorisé au divorce et à pouvoir se remarier, étaient assez raisonnablement fondés : 1° En ce qu’on ne voyait aucune procédure commencée, aucun tribunal devant qui fût portée l’affaire ; 2° En ce qu’il n’est guère vraisemblable qu’un artisan élevât une question de cette importance ; 3° En ce qu’on savait que trois grands personnages de la cour étaient dans le cas de solliciter cette grâce ; 4° Enfin, en ce que l’avocat étant un homme attaché à eux, on présumait plus vraisemblablement que c’était une de ces causes fictives comme on en trouve dans tous les jurisconsultes, proposés sous des noms opposés.
On assurait que l’on voulait la faire servir à obtenir la loi politique dont les philosophes parlaient sans cesse comme utile aux mœurs.
Il y avait trois personnes intéressées à son établissement : Mme du Barry, Mme de Langeac, maîtresse du duc de la Vrillière, et M. le comte de la Marche, resté du parti de la cour tandis que tous les princes du sang avaient suivi celui des pairs.
Quelqu’un en a dit la véritable raison : c’est que son père s’était montré défenseur des droits des Parlements et cela suffisait pour que le comte de la Marche leur fût contraire ; mais, enfin, il n’en était pas moins vrai que n’ayant jamais pu vivre avec sa femme, il eût souhaité briser les nœuds qui le gênaient, et qu’il pressait le cardinal de Bernis, le chargé d’affaires à Rome, d’obtenir de cette cour la loi qu’il désirait.
Mais on assure que le cardinal, qui en sentait toutes les conséquences, ne fit rien pour hâter cette négociation.
Ces projets, qui ne pouvaient être ignorés de la famille royale, ajoutaient à la haine qu’elle portait à la favorite.
Deux jeunes princesses de la maison de Sardaigne avaient épousé les deux frères du Dauphin. Elles n’avaient avec la maîtresse de leur aïeul d’autres rapports que ceux qu’elles ne pouvaient se dispenser d’avoir, d’après les volontés du roi.
Mais lorsque les enfants de Louis pouvaient marquer à la favorite leur mépris pour elle, ils n’en laissaient jamais échapper l’occasion.
M. le Dauphin, ayant dès sa jeunesse les vertus et les défauts qui ont causé sa perte, était incapable de dissimuler son opinion sur Mme du Barry et sur tout ce qui l’entourait.
Ayant su que la comtesse avait porté l’oubli des convenances au point de solliciter pour son neveu, le vicomte du Barry, la place de premier écuyer de l’héritier du trône, indigné, il dit avec son énergie accoutumée : « Qu’il ne s’approche pas de moi, car je lui donnerais ma botte sur la joue ! »
Le roi, l’ayant su, dit à sa maîtresse, en lui refusant sa demande : « Qu’on y prenne garde, M. le Dauphin serait homme à le faire comme il le dit », et pour ne point offenser son petit-fils ni désobliger son amie, il ne nomma personne.
C’était ainsi que Louis XV se tirait d’affaire quand il trouvait des partis opposés.
Il ne contentait ni ne mécontentait ni l’un ni l’autre. Cependant la bonté du caractère de la comtesse se soutenait au milieu des tracasseries de la cour : on assure que ce fut elle qui décida le roi à faire un traitement magnifique au duc de Choiseul auquel, depuis sa disgrâce, on n’avait rien disputé.
Les poètes ne manquèrent pas de célébrer la générosité de la comtesse, et voici comme l’un d’eux l’exprime :
Chacun doutait en vous voyant si belle
Si vous étiez ou femme ou déité ;
Mais c’est trop sûr : votre rare bonté
N’est pas l’effort d’une simple mortelle,
Quoiqu’ait jadis écrit en certain lieu
Un Roi Prophète, en sa sainte démence,
Quoiqu’un poète en ait dit, la vengeance
N’est que d’un homme, et le pardon d’un Dieu !
Aucun événement important ne signala les deux dernières années de Louis XV. Elles ressemblèrent à ces temps précurseurs des plus violents orages, où la nature semble engourdie par une cause inconnue.
Un ciel grisâtre paraît à peine supporter le poids des nuées que les vents n’agitent pas encore, et cette immobilité trompe le voyageur qui sort sans crainte de son toit hospitalier sans prévoir que ce calme est le prélude des plus terribles tempêtes.
Au reste, l’habitude faisait obéir, et cependant on n’avait ni l’énergie de la résistance, ni la soumission du respect.
On murmurait, on se plaignait, mais on ne faisait rien pour secouer les chaînes dont les favoris de la comtesse chargeaient non seulement l’État, mais le roi lui-même qui n’était plus maître de sa propre volonté.
Rapporterons-nous l’anecdote de Mme de R… qui fut, dit-on, si vivement outragée par la favorite, s’y croyant autorisée par un mot dit par le roi ? Non, nous ne réveillerons pas la profonde indignation que cette dame dut éprouver ; il vaut mieux amuser le lecteur d’une espièglerie que Mme la Dauphine fit à la comtesse.
Elle sut que la favorite avait commandé à un joaillier un bec de diamants de la plus belle espèce possible.
Avertie du jour où l’artiste doit l’apporter, elle le fait guetter : on lui enjoint de venir chez la princesse sur-le-champ, sans lui laisser le temps de se rendre aux ordres de la première.
Mme la Dauphine semble ignorer parfaitement le sujet du voyage de l’ouvrier ; elle lui propose de lui faire un bec en diamants, le plus riche, le plus élégant qu’il puisse inventer ou fournir.
Il répond à la demande de la princesse avec tout le zèle qu’il doit témoigner, et pour le mieux exprimer, il lui offre un modèle dans le bijou qu’il apportait.
Mme la Dauphine l’admire, se le fait ajuster par ses dames, trouve qu’il lui sied très bien et déclare qu’elle veut le garder.
Le marchand est intrigué : elle s’aperçoit de son inquiétude, en veut savoir la raison ; il est forcé de l’avouer. La princesse le rassure, lui répond qu’elle prend la chose sur elle.
Elle va dans cet état chez le grand-papa, elle demande à Sa Majesté comment elle la trouve ; elle lui fait surtout remarquer le bec en diamants et désire savoir son avis.
Le roi le décide superbe.
Alors elle lui conte le tour qu’elle joue à Mme du Barry ; il en rit et va lui-même turlupiner la comtesse.
Depuis longtemps on s’occupait du mariage du vicomte Adolphe du Barry, l’unique héritier du comte Jean, autrement dit le grand du Barry.
Il fut enfin arrêté avec Mlle de Tournon, fille de qualité, alliée à tout ce qu’il y avait de plus illustre en France, mais très pauvre.
On assure toutefois que M. le prince de Soubise, dont elle était parente, fut un des premiers à solliciter cette alliance qui en formait une entre la famille du Barry et la maison de Condé, la mère de M. le duc de Bourbon étant fille du prince de Soubise ; ce qui rendait l’affaire assez difficile, parce que le grand-maître s’opposait au mariage.
On assure que l’acquittement de ses dettes, qui se montaient à un million cinq cent mille livres et la promesse de l’entrée au conseil, le décidèrent.
Le dernier article ne fut point exécuté.
Rien n’était plus beau que Mlle de Tournon : aussi voulut-on donner à la comtesse du Barry des inquiétudes et lui faire craindre dans sa nièce une rivale redoutable.
Elle ne fit qu’en rire et dit :
— Si Mlle de Tournon devenait la maîtresse du roi, une fois mariée au vicomte, au moins la place ne sortirait pas de la famille.
Le mariage n’en fut pas moins brillant et les présents magnifiques. On voulait profiter de cette grande alliance pour raccommoder la favorite avec la famille royale.
Il devait y avoir un souper de famille, dans les petits appartements, avec la comtesse et la nouvelle mariée ; Mme de Narbonne, dame d’atours de Madame Adélaïde, et qui avait toute la confiance de cette princesse, l’avait déterminée à s’y trouver comme le moyen de rendre à la fille de Louis XV un crédit que son éloignement de Sa Majesté diminuait chaque jour.
Madame Adélaïde, déterminée à cette résolution, eut bientôt persuadé à ses sœurs d’être du souper.
Mmes de Provence, d’Artois et Mme la Dauphine le promirent aussi, lorsque M. le Dauphin l’ayant appris, se mit en colère et dit que Mme la Dauphine n’était pas faite pour manger avec une p... et qu’il ne le souffrirait jamais.
Nous demandons pardon d’avoir même mis cette lettre initiale, mais elle peint la grossière vertu du dernier et du plus malheureux de nos rois, et nous ne pouvions adoucir l’expression sans dénaturer son caractère.
Il en est de même de cette anecdote sur le conseil de guerre qui jugea MM. de Bellegarde et de Monthieu, lesquels furent innocentés quelques années après.
M. de Choiseul se trouvait compromis dans l’affaire. Il faut rendre l’anecdote telle qu’elle est pour juger ce qu’étaient alors les grands du royaume.
« M. le duc de Gontaut, revenu depuis peu de Chanteloup, où il était allé voir le duc de Choiseul, son beau-frère, n’a pas manqué de rendre, en arrivant, ses hommages à Mme du Barry.
« Celle-ci lui a demandé des nouvelles de l’exilé.
« — Car, s’est-elle écriée avec ses grâces ordinaires, je n’ai jamais été son ennemie personnelle, quoiqu’il l’ait cru ; je me sentais même disposée à être son amie, s’il l’eût voulu.
« M. de Gontaut, ayant satisfait à ces premières questions, la comtesse en fait une autre : elle ajoute :
« — Que pense-t-il du conseil de guerre des Invalides ?
« Le seigneur s’excuse sur ce qu’il ne pouvait répéter ce qu’avait dit M. de Choiseul.
« — Mais pourquoi donc ? il n’y a pas de secret pour moi.
« — Je ne le puis absolument.
« — Vous l’a-t-il donné sous le sceau de la confession ?
« — Point du tout.
« — Cela étant, je veux que vous me l’appreniez.
« — Madame, cela n’est pas possible, je ne puis vous manquer de respect à ce point-là.
« — N’est-ce que cela ? ne vous gênez pas, dites toujours.
« — Vous me l’ordonnez donc, Madame ?
« — Oui.
« — Eh bien ! Madame, il a dit qu’il s’en f…
« Et la comtesse de se tenir les côtes de rire.
« Le roi arrive et la trouve en gaieté.
« — Ah ! sire, si vous saviez comme Choiseul s’exprime sur le conseil de guerre des Invalides ; il est toujours le même.
« Sa Majesté, empressée, veut savoir ce dont il s’agit.
« — Sire, il a dit qu’il s’en f…
« — Et vous, Madame ? répond le monarque.
« — Et moi aussi.
« — Nous sommes donc trois, s’écrie le roi. »
Cette anecdote, répétée par M. de Gontaut, amusa beaucoup les courtisans. On voit avec quelle aimable gaieté se traitaient en France les affaires les plus graves et quel était l’esprit du gouvernement, depuis qu’aucun corps ne pouvait réveiller le prince et lui mettre sous les yeux les lois et les formes sagement établies.
Mme du Barry faisait et défaisait les ministres, et exigeait qu’ils vinssent travailler chez elle avec le roi. M. d’Aranda, ambassadeur d’Espagne, fut le seul diplomate qui ne s’y prêtât jamais.
Aussi ne fut-il pas nommé cordon bleu à la promotion, quoique le roi de France l’eût promis à celui d’Espagne, et, pour ne point se faire de guerre, Sa Majesté n’en nomma aucun autre.
Cependant, il n’est pas de beaux jours sans nuages : et Mme du Barry redoutait qu’un accès de dévotion ne lui enlevât le cœur de son auguste amant.
Les dévots cherchaient à concilier pour le monarque le plaisir et la vertu, et ils avaient, en conséquence, formé le projet de le marier avec Mme la princesse de Lamballe.
Mme du Barry eut la maladresse d’en parler la première au roi, qui lui dit : « Je pourrais plus mal faire. »
Ce mot fut un coup de poignard pour l’amie de Louis XV qui, oubliant qu’un roi ne se traite pas toujours comme un simple particulier, lui montra son chagrin en le boudant.
Sa Majesté, peut-être occupée en ce moment des charmes de la princesse, parut peu sensible au refus de sa maîtresse, et se retira aussitôt dans son appartement où les amis de la comtesse l’engagèrent à l’aller trouver, une nuit pouvant amener des réflexions dont elle aurait lieu de se repentir.
Le roi, touché de la démarche de celle qu’il aimait, oublia bientôt dans ses bras tout projet de réforme ; mais tous les ans, à Pâques, les scrupules venaient troubler ses plaisirs.
Madame Louise qui ne s’était faite Carmélite que dans l’espoir qu’un tel sacrifice lui mériterait du Ciel le bonheur de voir son père rentrer dans les voies du salut, ne manquait jamais, dans la semaine sainte, de lui demander, les larmes aux yeux, de se réconcilier avec l’Église.
Le roi n’y était pas insensible ; mais la quinzaine passée, il ne s’en souvenait plus.
Le mariage du vicomte du Barry avec Mlle de Tournon fut bientôt suivi de celui du colonel du régiment de la reine avec Mlle de Fumel, d’une maison ancienne, et, ce qui est plus extraordinaire, elle était très riche ; le père lui assura soixante mille livres de rente. Le roi fit nommer M. du Barry capitaine des Suisses de M. le comte d’Artois, et sa femme dut être dame pour accompagner Mme d’Artois.
La jeune personne n’en voyait pas moins, avec une vive douleur, qu’elle allait porter un nom généralement méprisé, mais ses parents, qui pouvaient tout espérer de la faveur de la comtesse, la sacrifièrent à leur ambition.
Dans l’ivresse de cette faveur, on admirait comment Mme du Barry ne perdait point les sentiments de la nature et n’oubliait rien de ce qu’elle devait à sa mère.
Celle-ci était dans le couvent de Sainte-Élisabeth, sous le nom de Mme de Mourable[21], que l’adulation commençait à faire précéder du titre de marquise.
Il faut avouer qu’elle n’en avait ni le jeu, ni le langage, ni les manières.
Dans les commencements, les du Barry, à l’insu de la comtesse, avaient cherché à l’expulser de Paris ; mais sa fermeté lui ayant fait supporter cette persécution, elle vivait avec beaucoup d’aisance dans son couvent.
Elle avait un carrosse, une maison de plaisance et acquérait une sorte de considération. On était édifié de la piété filiale avec laquelle Mme du Barry venait constamment rendre ses devoirs à sa mère, presque tous les quinze jours.
Elle passait une partie de la journée avec elle et s’informait avec une tendre sollicitude de tout ce qu’elle pouvait désirer.
Les religieuses entouraient la favorite, la flattaient et plusieurs d’entre elles obtinrent des grâces pour leurs parents.
Mme du Barry se rappelait-elle alors la pauvre petite Marie que l’argent de M. Dumouceaux et le crédit de M. Billard ne purent faire rester à Sainte-Aure ? Quel changement !
Malgré cette puissance et les moyens que la favorite aurait eus de s’enrichir, elle ne fit aucune acquisition importante. Le château de Luciennes fut sa seule propriété[22].
Il avait appartenu à Mme la comtesse de Toulouse. M. le duc de Penthièvre, à la mort de son fils, l’avait vendu, ne pouvant se résoudre à revoir des lieux où il avait perdu ce qui lui était si cher.
Mme du Barry l’acheta, et voulant y recevoir le roi, elle fit bâtir, sur les dessins de M. Ledoux, architecte, un pavillon où les plus habiles artistes et ouvriers furent employés.
Mais ce pavillon, qui a coûté infiniment d’argent, était trop peu considérable pour la maîtresse d’un grand roi et trop magnifique pour un particulier.
Ce contraste donnait l’idée d’une petite maison ; ce qui prouve qu’on oublie difficilement ses premières habitudes.
Luciennes eut un gouverneur, et ce gouverneur fut Zamor, le nègre favori, à qui le roi donna ce gouvernement avec six cents livres d’appointements.
Ce qui divertit le plus la favorite, c’est que son cher cousin le chancelier, avec qui M. d’Aiguillon était parvenu à la brouiller, fut obligé de sceller le brevet que le roi avait fait expédier.
Sa Majesté se doutait-elle que cet enfant chéri de sa maîtresse et qu’elle honorait de bontés particulières, serait un jour l’infâme dénonciateur de sa bienfaitrice ?
De semblables pensées ne se présentaient pas même alors dans l’ordre des probabilités, et il n’y a eu que les dernières années du siècle qui aient pu les rendre probables.
La maison de Mme du Barry était devenue si considérable qu’il fallait bien qu’elle fût logée dans la ville. Le château n’aurait pu la contenir avec celle des princes de la maison royale. Sous prétexte de faire construire des écuries, on lui bâtit un hôtel magnifique dont le plan la séduisit tellement qu’elle en fit presser la bâtisse avec une telle vivacité qu’elle fut finie à son retour de Fontainebleau.
Elle y eut des officiers, à l’instar des princesses, et même un aumônier ; car les ecclésiastiques tonnent contre les désordres, il est vrai, mais il s’en trouve toujours parmi eux de disposés à profiter des moyens de fortune que ces mêmes désordres leur présentent.
Les artistes se glorifiaient aussi de sa protection.
Mme la Dauphine honorait les talents de M. le chevalier Gluck, qu’elle avait fait venir de Vienne. Ce génie sublime avait créé des accents pour la langue la moins musicale de l’Europe et Iphigénie fit une révolution dans le goût.
La favorite, pour le seul plaisir d’être d’un avis opposé à celui de Mme la Dauphine, se piqua de rivalité avec cette princesse et envoya une somme considérable au signor Piccini, pour l’engager à quitter l’Italie et venir composer des opéras en France.
De là vinrent ces querelles interminables entre les gluckistes et les piccinistes, qui en précédèrent de bien plus graves.
N’eût-il pas mieux valu jouir tranquillement des plaisirs que les travaux de ces hommes célèbres promettaient aux vrais amateurs que de cabaler contre eux ?
Mais le Français était las de l’inaction où la paix le tenait depuis si longtemps et, n’ayant pas d’autres occasions d’exercer son humeur inquiète, ce fut la marquise qui l’occupa longtemps.
Que l’on s’y connût ou non, il fallait que l’on fût admirateur ou détracteur de l’un de ces compositeurs, selon les relations que l’on avait avec ceux qui les protégeaient.
Cet esprit de futilité allait toujours croissant : les dépenses augmentaient et les ressources épuisées ne pouvaient plus être que des impôts que le Parlement d’alors enregistrait sans remontrances.
On accusait Mme du Barry des maux du peuple, parce que le Français voulait toujours trouver dans la conduite de ceux qui environnaient le monarque la cause de ses fautes.
Cependant, elle n’avait pas accumulé sur elle des richesses considérables.
Luciennes, sa maison dans les avenues, des diamants et 100.000 livres de rente viagère : c’était tout ce qu’elle possédait.
Sûre d’être toujours aimée du monarque, elle n’avait jamais pensé à s’assurer un sort brillant dans sa disgrâce qu’elle ne supposait pas possible, et l’âge du roi, loin encore de la décrépitude, lui faisait envisager une longue carrière dans le poste qu’elle occupait.
Il est vrai que Madame Louise employait toute son éloquence pour ramener le roi aux sentiments de religion, et depuis que Maupeou était brouillé avec la favorite, il allait communier à Saint-Denis avec l’auguste Carmélite pour, disait-il à la princesse, obtenir la conversion du roi.
On permit ou plutôt on conseilla à l’abbé de Beauvais de parler en chaire, avec la dernière liberté, des désordres de la cour.
Sa Majesté, ne voulant rien voir de personnel dans le sermon, dit en sortant à M. de Richelieu :
— Monsieur le duc, le prédicateur a jeté bien des pierres dans votre jardin.
— Oui, Sire, et d’une manière si forte qu’elles ont rejailli dans le parc de Versailles.
Mais le sermon du jeudi saint frappa des coups plus sensibles : l’abbé de Beauvais parut inspiré par l’esprit prophétique ; il osa fixer le temps des jours du roi, comme Jonas avait marqué celui de la destruction de Ninive.
— Encore quarante jours, s’écria-t-il en regardant le monarque, et vous paraîtrez devant Dieu pour être jugé selon vos œuvres !
Louis XV, frappé de cette prédiction qui ne s’est que trop accomplie, parut infiniment triste.
Mme du Barry, désolée que l’on vînt réveiller le remords dans l’âme de son amant, l’engageait à punir la liberté de l’orateur.
— Non, dit le roi, « il fait son métier ». Et il lui donna l’évêché de Senez.
Un événement douloureux vint encore ajouter à la teinte sombre qui voilait toutes les pensées de Louis XV : ce fut la mort de M. de Chauvelin, ministre d’État. Il était de son âge et son ami.
Un soir qu’il était appuyé sur le dos du fauteuil du roi, jouant au piquet avec sa maîtresse, celle-ci lève les yeux et dit :
— Monsieur de Chauvelin, quelle grimace vous faites !
Le roi se retourne et voit tomber à ses pieds cet infortuné que la mort avait frappé.
Toutes ces circonstances, jointes au chagrin que le roi éprouvait de la froideur de ses enfants à son égard, semblaient devoir faire craindre à Mme du Barry que son règne fût passé.
Ses amis lui conseillèrent de redoubler de complaisance et de soins pour éloigner du roi ses douloureuses pensées.
Elle écrivait à sa mère pour lui faire part de ses inquiétudes :
LETTRE DE Mme DU BARRY
À LA MARQUISE DE MONTRABLE
« Je ne pourrai, ma chère maman, vous aller voir demain, comme je vous l’avais promis.
« La situation du roi ne me permet pas de le quitter.
« Depuis la mort du marquis de Chauvelin et celle du maréchal d’Armentières, il est d’une mélancolie qui m’inquiète beaucoup ; elle a encore été augmentée par ce maudit sermon de l’abbé de Beauvais, dont il n’a pas tenu à moi que Sa Majesté n’ait puni l’insolence.
« Je viens de proposer un voyage à Trianon.
« Nous nous efforcerons de rétablir la tranquillité dans l’esprit du roi et de lui rendre un peu de gaieté.
« Je-vous verrai, ma chère maman, aussitôt que je le pourrai. Vous savez tout le plaisir que j’ai à vous renouveler les assurances de mon parfait attachement.
« Comtesse DU BARRY. »
Le voyage de Trianon eut lieu et tout fut employé pour rappeler les plaisirs qu’une austère morale avait effarouchés.
On assure même que d’obscures amours charmèrent un instant les remords du roi, et que la fille d’un menuisier, à peine à son adolescence, sut rappeler encore au monarque les plus beaux jours de sa jeunesse ; mais ces plaisirs, semblables au poison qu’une main ennemie aurait mêlé dans un breuvage délicieux, porta dans le sein du monarque le germe d’une maladie terrible qui le conduisit au tombeau[23].
Cette enfant était attaquée de la petite vérole, quoique rien ne l’annonçât ; elle ne l’en communiqua pas moins à Louis XV et, dès le soir, le prince se trouva très souffrant sans qu’on pût savoir quelle était sa maladie.
Mme du Barry voulut qu’il restât à Trianon, mais M. de la Martinière, premier chirurgien, en qui le roi avait toute confiance, voulut absolument qu’il fût transporté à Versailles, et dès le lendemain, on ne douta plus que ce ne fût la petite vérole.
D’ailleurs, la fille du menuisier était attaquée de cette maladie et en mourut le troisième jour.
On se garda bien d’instruire le roi et on lui cacha le danger dont il était menacé.
Mme du Barry fit part, en ces termes, à Mme de Montrable de ses vives inquiétudes :
« Le roi, ma chère maman, a bien décidément la petite vérole.
« J’avais fait l’impossible pour l’engager à rester à Trianon ; mais la Martinière, profitant de l’ascendant que lui donnait la faiblesse de ce prince, l’a déterminé à retourner à Versailles.
« Je ne quitte pas le chevet de son lit.
« Son état ne me paraît pas encore dangereux, parce qu’il n’est pas affecté.
« Mais à son âge, les choses peuvent changer d’un instant à l’autre, surtout dans une maladie de cette nature.
« J’ai eu le bonheur de lui inspirer de la confiance dans Bordeu, mon médecin ; c’est lui qui le soigne en chef avec Le Monnier.
« On voulait d’abord le faire administrer ; j’avais le plus grand intérêt que cela ne fût pas ; Bordeu s’y est opposé fortement, et il a eu le bonheur de l’empêcher, disant que cet appareil devenait souvent funeste aux malades.
« Adieu, ma chère maman, je vous quitte pour retourner auprès du roi.
« Comtesse DU BARRY. »
Il y avait un usage immémorial à la cour, c’est qu’aussitôt qu’un des membres de la famille royale était attaqué de la petite vérole, il était administré.
On s’occupa donc d’en parler au roi.
Mais chacun tremblait de lui porter ces tristes paroles.
De tous les enfants de France, Mesdames, filles du roi, furent les seules qui approchèrent du lit de leur auguste père.
Toutes les autres personnes de la famille fuyaient la contagion, et l’on ne voyait dans la chambre de Louis XV que ses filles et sa maîtresse : étrange rapprochement qui faisait souffrir cruellement les princesses.
Mais elles renfermaient dans leur cœur la douleur qu’elles éprouvaient de partager les soins d’une tête si chère avec une femme qu’elles détestaient, et on leur rendra cette justice que rien ne le rappela au monarque.
Aussi le roi, touché de la tendresse de ses filles et des égards qu’elles voulaient bien témoigner pour l’amour de lui à l’objet de ses affections, prit de lui-même un parti qui étonna extrêmement tous ceux qui étaient auprès de lui ; et, saisissant un moment où la comtesse était passée dans son appartement, il appela un de ses plus fidèles serviteurs et lui dit :
— Je n’ai point envie qu’on me fasse ici renouveler la scène de Metz : qu’on dise à Mme la duchesse d’Aiguillon qu’elle me fera plaisir d’emmener Mme du Barry.
Celle-ci écrivit sur-le-champ à sa mère :
À LA MARQUISE DE MONTRABLE
« Le coup vient d’être porté, ma chère maman, le roi, se sentant fort mal, a fait dire à Mme la duchesse d’Aiguillon qu’elle lui ferait plaisir de m’emmener chez elle.
« En conséquence, nous venons de partir pour Rueil d’où je vous écris.
« Sa Majesté, avant de recevoir le viatique, a déclaré, par l’organe de son grand aumônier, qu’elle était fâchée d’avoir donné du scandale à ses sujets, qu’elle ne voulait vivre désormais que pour le soutien de la foi, de la religion et le bonheur de ses peuples.
« Les promesses d’un mourant ne doivent pas inquiéter : ils sont tous les mêmes, jusqu’à ce qu’ils soient revenus en santé.
« Si le roi a ce bonheur, je suis persuadée que ma situation ne changera pas.
« Adieu, ma chère maman.
« Comtesse DU BARRY. »
« P.S. – Comme j’allais faire partir cette lettre, j’apprends que l’état du malade est moins dangereux. »
On voit, dans cette lettre, la cause de la tranquillité que la comtesse montra dans ce grand changement ; elle le supportait avec constance, parce qu’elle n’y croyait pas.
D’ailleurs, on assure que son attachement pour le roi ne lui permettant plus de rester éloignée de son amant, elle venait toutes les nuits à Versailles, et des personnes de l’intérieur du service ont affirmé qu’ils voyaient venir une femme voilée qui se promenait dans les corridors et à qui le premier valet de chambre de service venait apporter des nouvelles du roi.
Ils ne virent jamais ses traits, mais ils furent persuadés, par la ressemblance de la taille et la manière de marcher de cette femme, que c’était Mme du Barry.
Et, en effet, quelle autre eût été obligée de cacher le tendre intérêt que la situation du roi inspirait à tous ceux qui avaient le bonheur de le voir familièrement ?
Certains assurèrent que Mme du Barry était peu affligée de l’état du monarque et prétendirent qu’elle n’était occupée que d’elle dans ces moments où, n’eût-elle eu aucune tendresse pour le roi, il eût été cependant simple qu’elle fût inquiète de son sort à venir. Nous avons donc peine à croire qu’elle porta la recherche de la mollesse dans cet instant au point d’envoyer chercher son coucher à Luciennes, ne trouvant pas les lits du château de Rueil assez bons.
Mme du Barry aimait le roi : on n’en peut douter ; elle en était éperdument aimée.
Quelle est la femme qui renonce sans regret à ce double sentiment ?
Et si l’on ajoute à cette jouissance du cœur toutes celles que l’orgueil peut donner, on sentira qu’il était impossible que Mme du Barry ne fût pas profondément affectée du danger de son amant.
Les jours qu’elle passa à Rueil auraient cependant été bien plus douloureux sans les soins affectueux de M. et Mme d’Aiguillon, qui justifièrent l’attachement qu’ils avaient témoigné à la maîtresse du roi, puisqu’ils le lui conservaient au moment où elle allait tout perdre.
Ils ne furent pas les seuls qui lui marquèrent la part qu’ils prenaient à sa douleur, et ce furent, à coup sûr, les plus honnêtes gens de la cour ; car la reconnaissance est un sentiment qui n’habite que les cœurs vertueux.
Dès que Mme du Barry se fut retirée de la cour, le clergé s’empara du roi et tout se passa avec la décence que Louis XV avait toujours mise dans ses actions.
Mesdames ne le quittèrent pas d’un instant et ce fut dans leurs bras qu’il expira, pleuré, comme un ami sincère, de tout son service, parce qu’il était le meilleur des maîtres.
Mme du Barry n’apprit son malheur qu’en recevant la lettre de cachet qui l’exilait à Pont-aux-Dames, près de Meaux ; et elle en fit part à sa mère comme à la personne qui devait y prendre le plus de part :
À LA MARQUISE DE MONTRABLE
« C’en est fait, ma chère maman, le roi n’est plus. C’est ce vilain duc de la Vrillière qui est venu me l’annoncer en me signifiant une lettre de cachet pour me rendre au couvent de Pont-aux-Dames, près de Meaux.
« Je l’ai traité avec la plus grande hauteur.
« Cet insolent, qui rampait hier devant moi, semble aujourd’hui triompher de ma disgrâce.
« Je suis indignée de la retraite à laquelle je suis condamnée, et plus encore de la manière dont je dois y vivre.
« On ne me permet d’avoir qu’une seule femme de chambre ; il m’est défendu de voir personne et d’envoyer ou recevoir aucune lettre que la supérieure ne l’ait visée.
« Je viens d’envoyer chercher mon homme d’affaires ; je lui donnerai des ordres dont il vous rendra compte.
« Veillez, je vous prie, à ce qu’il les exécute et que l’on ne me pille que le moins possible.
« Je vous écrirai, si je le puis, dès que je serai arrivée dans cette prison.
« Adieu, ma chère maman, j’ai tant d’arrangements à prendre et je suis si en colère que je crains de partir sans avoir pu songer à rien.
« Comtesse DU BARRY. »
Les ordres de Louis XVI étaient si précis pour le départ de Mme du Barry, qu’il n’y eut pas moyen de les différer : et dès le même moment, elle monta en voiture avec une seule femme de chambre, tel que l’avait décidé le nouveau roi, et se rendit au Pont-aux-Dames.
LIVRE II
DE L’EXIL À L’ÉCHAFAUD
PREMIÈRE PARTIE – L’EXIL
Trianon était au printemps un adorable séjour. Chaque année, dès que pointaient les premiers lilas, Louis XV, depuis qu’il y avait fait construire par Gabriel le petit pavillon bordant le jardin botanique de M. de Jussieu, aimait avant le voyage de Marly à y passer quelques journées. Les bruits de la ville et du château expiraient au rideau d’arbres qui, au couchant, voilait la plaine Saint-Antoine et les jardins savamment ordonnés par Le Nôtre.
Le Petit Trianon, que Marie-Antoinette modela plus tard au gré de son caprice, qu’elle devait imprégner si fortement de sa grâce puérile et tendre qu’il traîne encore dans les jardins comme un parfum de la souveraine, que son ombre semble errer autour des bosquets et le cristal des eaux garder le reflet de son visage, n’avait point alors ce charme apprêté d’idylle, auquel se mêle pour nous un peu de la poétique tristesse des jolies choses mortes.
Trianon ne se parait guère que de grâces naturelles et Louis XV, qui ignorait le goût des paysanneries enrubannées, souvent las du cérémonial de la cour, se plaisait à y déposer le fardeau du pouvoir. Le roi n’aimant que les plaisirs à portée des lèvres, en avait fait une manière de « petite maison » où l’on soupait, à l’ordinaire, avec cette gaieté et cet abandon qu’autorise la compagnie d’une maîtresse et de quelques familiers spirituels et galants.
C’est à Trianon, le mardi 27 avril, à 5 heures du soir, que Louis XV sentit les premières atteintes du mal qui devait l’emporter. On crut d’abord à une indisposition passagère, puis, l’état d’extrême lassitude du roi se prolongeant, on le persuada le lendemain vers 4 heures de revenir à Versailles. Le jeudi, la fièvre s’étant déclarée, Lemonnier, premier médecin en exercice, eut avec La Martinière et Bouvard une consultation à laquelle assista Bordeu, médecin de Mme du Barry : on résolut de pratiquer la saignée. Louis XV était dans un état de prostration si absolu que les visites du Dauphin, de Mesdames et des princes ne l’en tirèrent point. Sur le soir, M. de la Borde, premier valet de chambre du roi, conduisit la comtesse du Barry au chevet du malade qui « ne montra nul plaisir de la voir ». (Besenval.)
La favorite se retira en sanglotant. Dès cet instant, elle se devina menacée. Car telle était la destinée de Mme du Barry, maîtresse de naissance obscure et choisie par le roi dans la foule anonyme, qu’elle ne tenait à rien ni à personne. Elle tirait tout du seul amour du prince, fortune, crédit, et son existence même : cet amour évanoui, elle retombait au néant, devenait une pauvre chose importune à ses alliés de la veille, le parti jésuite pour qui elle n’était qu’un instrument, livrée à des ennemis qui depuis des mois surveillaient d’un œil d’espoir les indispositions et les syncopes du souverain, à cette faction Choiseul, aigrie par la disgrâce, et qui depuis cinq ans grondait dans l’ombre autour d’elle. Sachant le roi faible devant la souffrance, prompt à l’effroi, tremblant à l’idée seule de la mort et prêt à tout sacrifier à son salut, sans doute songeait-elle à la triste comédie de Metz, à cette altière duchesse honteusement chassée.
Le vendredi, l’éruption commencée, la Faculté se prononça : le roi était atteint de variole confluente. Dès cet instant, l’appartement de Louis XV fut condamné, il fut interdit au Dauphin, à ses frères, à Marie-Antoinette même d’en franchir le seuil. Mesdames, filles du roi, s’installèrent auprès de leur père pour ne le plus quitter. Mme du Barry devenait, dans le grand désarroi de Versailles, une étrangère oubliée, et si on ne chassait pas « l’infâme », c’est que Louis XV n’était point encore condamné. Même le lundi soir, 3 mai, l’éruption achevée, les premiers boutons commençant à blanchir, la fièvre tombée, on crut à une guérison. Sans doute, et avant même que Bordeu ait pu l’en aviser, la favorite le comprit-elle aux sourires et aux courbettes des courtisans à nouveau empressés à lui plaire. Dans la soirée du lendemain la fièvre reparut, accompagnée cette fois de courts instants de délire, et les médecins connurent qu’il n’y avait plus d’espoir. Le cardinal de la Roche-Aymon, grand-aumônier de France, fut mandé auprès de Louis XV et chargé de lui apprendre la vérité. Le moral du roi, qui se croyait attaqué seulement d’érysipèle boutonneux, excellent jusque-là, changea dès qu’il se sut atteint de la variole, et il fallut sans doute peu d’efforts pour obtenir de lui le renvoi de sa maîtresse. Le mercredi, à 4 heures de l’après-midi, Mme du Barry quittait Versailles : la duchesse d’Aiguillon qui possédait une maison de campagne à Rueil la prit dans sa voiture et l’y conduisit (lettre du comte de Mercy-Argenteau à Marie-Thérèse). Elle s’en fut sans scène, sans cris, muette et toute en larmes, pleurant comme pleurent les enfants qui ont de gros chagrins silencieux.
Mme du Barry vécut à Rueil de douloureuses journées. Les nouvelles de la santé de Louis XV qui lui parvinrent d’abord permettaient d’espérer encore : elle donna l’ordre qu’on apportât de Louveciennes des meubles et les menus objets qu’elle aimait, cela dit assez qu’elle songeait à une installation de quelque durée. Brusquement, dans la journée du dimanche 9 mai, elle apprit que l’état du roi empirait : bien que faible, il gardait une entière connaissance, parlait de sa fin prochaine, et, sur le soir, réclama les derniers sacrements. Le lendemain, à peu près à l’heure où expirait Louis XV, Mme du Barry recevait la lettre de cachet qui l’exilait au couvent de Pont-aux-Dames. Sur l’ordre du roi, elle y devait être enfermée « sans communiquer avec quiconque, pour cette raison qu’elle avait le secret de l’État ».
Le couvent de Pont-aux-Dames, près de Crécy-en-Brie, au diocèse de Meaux, était une abbaye d’une genre assez particulier, moitié geôle, moitié couvent : prison, où les femmes d’un certain rang étaient expédiées sur lettre de cachet, et relevant à ce titre, tout comme la Bastille, de la lieutenance de police, fort ancien couvent de bénédictines, dont les bâtiments, quelques-uns vieux de quatre cents ans, étaient en fort piteux état[24] : rien n’y pouvait faire oublier à Mme du Barry les splendeurs de Versailles.
Quand elle y parvint, sous garde fidèle, probablement le 12 ou 13 mai, elle dut être tristement impressionnée par les grands murs nus du couvent. Dans la campagne, le printemps mettait ses frondaisons neuves et la gaieté de pépiements d’oiseaux, c’était l’heure où dans la nature entière semble sourdre, avec la sève nouvelle, une griserie de vie et de liberté. Mme du Barry, hier encore favorite adulée, aujourd’hui déchue, franchissait en prisonnière le seuil d’une triste maison. Le portail du couvent donnait accès dans une vaste cour d’entrée ceinturée de bâtiments d’aspect lamentable, granges, pressoirs, bûcher et antique chapelle ; au fond de cette première cour, et une grille franchie, s’ouvrait la cour abbatiale que fermaient sur trois côtés les cloîtres, la salle capitulaire et ce qu’on dénommait prétentieusement le palais de l’abbesse. Mme du Barry fut reçue, avec une réserve polie, par Très Révérende dame Gabrielle de la Roche de Fontenille, entourée de ses trente dames de chœur ou professes, dont les guimpes et les robes blanches, en dépit de la sévérité de voiles noirs et de scapulaires tombant jusqu’aux pieds, frémirent peut-être de curiosité à la vue de la belle impure. Dans l’épanouissement de ses trente ans, ses yeux bleus fussent-ils rougis de larmes, Mme du Barry demeurait adorable. Les religieuses furent surtout séduites par sa douceur et cet air d’infinie tristesse qui donnait un charme nouveau à sa beauté. Sans doute, quand on lui indiqua le pauvre pavillon, défendu par une grille, qui devait être désormais sa demeure, si ses larmes coulèrent, trouva-t-elle des âmes tendres pour compatir à ses peines.
Prisonnière, Mme du Barry connut d’autres amertumes, car il ne suffisait pas à Marie-Antoinette que « la créature fût mise au couvent », elle exigeait encore « que tout ce qui portait ce nom du scandale fût chassé de la cour ». Chon, le Roué ne durent qu’à la fuite d’échapper à des lettres de cachet, le vicomte du Barry et sa femme, Mlle de Tournon, encore qu’alliés aux Soubise, et bien que Louis XV et Marie-Antoinette eussent signé à leur contrat, furent exilés. Pis encore, l’ancienne favorite se vit reniée, Guillaume du Barry et Mlle de Fumel sa femme, eurent le front de demander et obtinrent de changer de nom. En dépit de la bienveillance que lui marquaient les religieuses, la solitude parut affreuse à Mme du Barry, car tous et sa mère même se virent refuser l’autorisation d’aller la visiter au couvent.
Avec le temps, il y eut des accommodements. D’Aiguillon, Maupeou, Terray étaient en disgrâce, mais M. de Maurepas, le nouveau ministre, était l’oncle de Mme d’Aiguillon, mais des amis sincères, comme le prince de Ligne et le duc de Cossé-Brissac, osaient intervenir en faveur de la prisonnière, et M. de la Borde, passé au service de Louis XVI comme premier valet de chambre, lui gardait ses bons offices.
La sévérité première se relâcha : Mme du Barry fut autorisée à se promener dans les jardins, à l’ombre des grands marronniers de l’abbaye ; elle n’avait eu jusque-là d’autre serviteur qu’une femme de chambre, on lui concéda le droit d’avoir un cuisinier et une fille de service ; enfin quelques personnes, Montvallier son intendant, puis son joaillier, vinrent conférer avec elle de ses affaires, alors fort embarrassées. L’abbesse, qui rend compte au lieutenant de police de la conduite de Mme du Barry, parle d’elle en bons termes : elle loue l’ancienne favorite d’avoir gardé son inaltérable douceur, elle semble surprise qu’elle soit pieuse et n’en reporte pas tout le mérite à ces excellentes religieuses de Sainte-Aure qui jadis déposèrent dans ce cœur, égaré par le monde, la bonne semence de la religion.
À l’automne, Pont-au-Dames est humide et froid, la santé de la prisonnière est mauvaise, ne pourrait-on permettre à Mme du Barry quelques sorties ? On permet.
Les mois succèdent aux mois : Mme du Barry a maintenant une demi-liberté et grâce aux meubles apportés de Louveciennes, une installation presque coquette. Mais bien que sa vie soit moins triste, que des cadeaux lui aient décidément gagné le cœur des religieuses, elle n’en sollicite pas moins la permission de quitter Pont-aux-Dames. Elle est enfin autorisée à acheter le château de Saint-Vrain, près Montlhéry. Le contrat de vente est du 9 avril 1775 ; dans sa hâte elle s’y installe huit jours plus tard. Mme du Barry n’est plus dès lors prisonnière, elle n’est qu’exilée de la cour.
Lentement, elle se reprend à aimer la vie, à goûter aux plaisirs du monde, et, durant l’été, reçoit à Saint-Vrain ses amis de jadis. Elle a trente-deux ans, qui est un âge où l’on ne renonce point, elle est toujours belle, l’ovale de son visage demeure aussi parfait, son teint aussi éclatant, le dessin de sa bouche aussi pur, et, sous ses cheveux blonds, ses yeux bleus, qu’avivent des sourcils et des cils châtains, gardent tout leur éclat : un signe, posé au-dessous de l’œil gauche ainsi qu’une mouche, donne toujours du piquant à sa beauté[25]. Tel est le sentiment du vicomte de Langle, fort aimable officier, demeuré galant malgré la cinquantaine, qui fait sa cour et qu’on écoute peut-être.
Dès le printemps, Chon, traînant après soi son amant le marquis de Fauga, est venue rejoindre Mme du Barry. Saint-Vrain n’est plus un triste séjour, on y cause, on y chante, on y joue, on y donne même la comédie. Mais rien ne fait oublier à l’ancienne favorite sa chère maison de Louveciennes si pleine de souvenirs, et le court séjour qu’on lui permet d’y faire à l’automne ne fait qu’augmenter son désir d’y vivre. Louis XVI cède enfin, et, dans les premiers jours de novembre 1776, elle s’y installe à petit bruit. Elle a l’ordre de s’y laisser oublier. Sa vie devient modeste et cachée, mais il ne dépend pas d’elle qu’on y vienne rendre hommage à sa beauté. Marie-Antoinette n’en prend ombrage que quand le visiteur est son propre frère, Joseph II d’Autriche. Mais M. le comte de Falkenstein, nom sous lequel l’empereur voyage incognito, n’a que faire des bouderies de la reine, il lui plaît visiter Louveciennes et saluer Mme du Barry, il en agit à sa guise. Et la favorite, dans cette maison qui est sienne, où elle a jadis reçu Louis XV en souveraine, rendue timide par le malheur, se montre bien humble, toute rougissante et confuse : comme elle hésite à prendre le bras que le comte lui offre pour visiter les jardins, il a ce mot charmant qu’on redit à Versailles : « Ne faites point de difficulté, Madame, la beauté, est toujours reine. »
Il semble que Mme du Barry, après bien des traverses, touche au port.
Mais comme si, à l’automne de la vie, elle eût dû expier les joies, même les plus innocentes de son printemps, elle ne connut dès lors que des deuils et des peines que n’adoucissent que des joies précaires. La mort vint la frapper dans une de ses affections ; les plus vives et la plus pure.
Son neveu, Adolphe du Barry, qu’elle avait élevé, doté, marié, avait dû aux charmes de son naturel d’échapper au mépris qui s’attachait à tous ceux qui, de près ou de loin, touchaient à la favorite. Des eaux de Spa où il avait accompagné sa femme, il était, au début de l’hiver, parti pour Bath. Il y menait, au « Croissant Royal », une vie fastueuse. Les fêtes, les soupers se succédaient ; il donnait au jeu, qui était son péché mignon, de longues heures. Un soir, pour une sotte querelle, il fut convenu qu’un duel à outrance aurait lieu entre le vicomte du Barry et le comte Rice.
On partit en poste au milieu de la nuit pour Claverton, où les rencontres avaient lieu d’ordinaire. Dès que l’aube parut, les adversaires furent mis en présence, armés chacun de leur épée et de deux pistolets. La balle du vicomte du Barry, qui tira le premier, traversa la cuisse de son adversaire ; mais le comte Rice riposta aussitôt par deux coups de feu. Atteint en pleine poitrine, le vicomte du Barry battit l’air un instant et tomba. Il était mort.
Pendant deux jours son corps resta sur place, excitant la curiosité publique. On se décida enfin à l’inhumer dans le petit cimetière tout fleuri de Bashampton.
Sur la dalle funéraire, toute rongée de mousse, on lit encore aujourd’hui :
HERE REST THE REMAINS OF
JOHN BAPTISTE VISCOUNT DU BARRY
OBIIT 18 NOVEMBER 1778.
Tous les amis de Mme du Barry s’empressèrent autour d’elle.
Les lettres de condoléances, les consolations que d’aucuns lui portèrent furent impuissantes à adoucir son chagrin.
Sa douleur dut augmenter encore quand elle vit la jeune veuve de son neveu, les yeux secs et sans le moindre trouble, rentrer en France. On chuchotait que, maîtresse du comte Rice, elle avait été la cause de la rencontre et que ses légèretés avaient amené la mort de son mari. On la vit, au reste, non sans scandale, quitter le deuil presque aussitôt, abandonner le nom de du Barry pour reprendre son nom de jeune fille et, dès qu’elle le put, reparaître à la cour[26].
Les seules consolations qui rattachèrent encore Mme du Barry à l’existence furent celles qui lui vinrent du comte Seymour qui, à ce moment, entra dans sa vie.
Leurs amours avaient débuté par des relations de voisinage ; le comte Henry Seymour habitait alors entre Pont-Marly et Louveciennes un petit château, Prunay, élégante demeure entourée d’un grand parc d’où la vue s’étendait au loin sur Saint-Germain-en-Laye et Paris. C’est là que, veuf, et ses filles mariées, il était venu achever une vie qui n’avait pas été sans éclat. Le comte Seymour, malgré ses cinquante ans, était encore pour plaire : il avait été très beau, de cette beauté particulière à la maison Seymour : le front large, les yeux bleus, de taille élevée et svelte. L’élégance de ses manières, des allures de grand seigneur en avaient fait un homme à bonnes fortunes.
Depuis qu’il était installé à Prunay, il n’était question que de lui dans le voisinage. Aussi bien avait-il su se rendre populaire en ouvrant chaque dimanche son parc au public, en faisant danser les paysans dans les salons de verdure qui étaient une des beautés de ses jardins[27]. Il y a quelque trente ans, le souvenir du comte Seymour vivait encore, et il se trouvait de vieilles gens pour conter comment leurs mères s’étaient follement amusées jadis dans le parc du grand seigneur anglais. (Vatel.) Dès la première visite que fit le comte Seymour à Mme du Barry, des liens se créèrent entre eux, qui étaient mieux que des relations de voisin aimable à jolie châtelaine. Le comte parut séduisant, il fut ému par le charme qui émanait encore de la favorite.
Mme du Barry, qui approchait de la quarantaine, se laissa prendre à la cour discrète qui lui fut faite, et presque aussitôt, avec les ardeurs d’une beauté sur le retour, s’éprit follement du comte Seymour. Ce ne fut plus, dès lors, entre Louveciennes et Prunay, qu’un va-et-vient perpétuel de visites : le comte Seymour occupa toute la vie de Mme du Barry. De ne l’avoir point chaque jour et presque à chaque minute auprès d’elle, devint pour elle une souffrance.
Ce fut entre les deux amants une correspondance continue, billets amoureux où l’on sent Mme du Barry redevenue jeune et pleine d’enthousiasme. Elle a des mots exquis pour peindre sa tendresse :
« Mon cœur est à vous sans partage, écrit-elle, je vous aime, vous le répète, et je crois être heureuse, je suis à vous. »
Et un autre jour où les deux amoureux ne s’étaient point rencontrés, elle griffonnait à la hâte ces quelques lignes :
« Mon Dieu ! mon tendre ami, que les jours qui suivent ceux que j’ai le bonheur de passer avec vous sont tristes, et avec quelle joie je vois arriver le moment qui doit vous rapprocher de moi !
« Je pense à vous et n’ai d’autre regret que de ne pouvoir vous le redire à chaque instant. »
Mais ces amours n’étaient pas sans traverses et sans alarmes. L’ancienne courtisane devenue simplement une femme, et qui aimait passionnément, connut, avec les douceurs, les jalousies et les amertumes des passions sincères.
Mme du Barry eut, quand vint l’heure de la rupture, cette sensation horrible pour une femme qui a été belle, et aux pieds de qui tous les hommes se sont prosternés, d’aimer encore et de n’être plus aimée. Elle fit taire son orgueil, s’humilia, donna le spectacle de ses larmes, luttant pour son amour ; puis, enfin, quand elle connut qu’il n’y avait plus d’espoir, qu’il ne suffit point d’aimer pour être aimée, elle retrouva pour rompre sa dignité de grande dame.
La dernière de ses lettres, écrite après une journée de larmes et où l’on sent saigner son cœur, est pleine d’émotion contenue :
« Il est inutile de vous parler de ma tendresse, vous la connaissez ; mais ce que vous ne connaissez pas, ce sont mes peines, c’est avec regret que je vous en parle, c’est pour la dernière fois… Ma tête est bien, mon cœur souffre. Mais avec beaucoup d’attention et de courage, je parviendrai à le dompter : l’ouvrage est douloureux, mais il est nécessaire, c’est le dernier sacrifice qu’il me reste à lui faire.
« Mon cœur lui a fait tous les autres, c’est à ma raison à lui faire celui-ci.
« Adieu… »[28].
Un soir, de la terrasse de Louveciennes où dans la fraîcheur d’une nuit de juin elle regardait au loin le jeu mouvant des ombres, une grande lueur apparut sur Paris, des flammes montèrent vers le ciel quelques heures, puis s’éteignirent. Elle sut le lendemain que le feu avait anéanti l’Opéra.
Si elle avait été d’âme philosophe, faisant un retour sur elle-même, cet incendie l’eût fait songer sans doute à cette flambée d’amour, qui venait quelques instants d’illuminer sa vie.
Mme du Barry vécut dès lors à Louveciennes, dans la retraite, à peine visitée par quelques étrangers de distinction auxquels elle ne croyait pas devoir interdire sa porte, et par quelques vieux amis qui lui étaient restés fidèles. À l’été et comme pour endormir son chagrin, elle fut rendre visite à son beau-frère, qui tenait alors garnison à Bayeux.
Les officiers du régiment de Condé, dans lequel il servait, organisèrent une série de spectacles militaires qui purent donner un moment l’illusion à Mme du Barry qu’elle était toujours la favorite pour le plaisir de qui la vie des camps se transformait, devenait une occasion de spectacles et de fêtes.
À un bal fort brillant donné à l’Hôtel de Faudoas, toute la noblesse de la province, venue par curiosité plus que par sympathie, rendit hommage à la grâce toujours jeune et à la distinction de la comtesse.
Elle s’y montra ce qu’elle était toujours, accueillante et bonne ; elle trouva pour chacun le mot aimable qu’il fallait dire.
À peine remarqua-t-on que la gaieté qui lui était jadis ordinaire avait fait place à une sorte de mélancolie résignée.
De Bayeux, elle repartait pour Louveciennes où elle s’enferma de nouveau.
L’hiver venu ajoutait ses tristesses à celles qui emplissaient déjà le cœur de Mme du Barry.
C’est le moment où le duc de Brissac vint s’installer chez elle.
Ils étaient liés dès longtemps d’une étroite amitié que les infortunes de Mme du Barry, les soucis et les charges de cour du duc de Brissac n’avaient pu altérer.
Quinze ans plus tôt, ils habitaient au château de Versailles deux appartements voisins ; depuis lors, bien des événements avaient eu lieu, mais l’ancien capitaine n’avait pas oublié la protection affectueuse de la favorite.
Il lui était resté fidèle après sa disgrâce, et il semble que M. de Brissac avait tenu à lui marquer plus d’affection dans le temps même où tombait le crédit de la comtesse. Elle l’avait retrouvé, ami ingénieux et fidèle quand les malheurs étaient venus la visiter, elle l’avait vu s’éloignant, au contraire, avec discrétion, dès que la fortune semblait vouloir de nouveau lui sourire.
Quand elle fut tout à fait seule, il lui demanda de s’installer à Louveciennes à ses côtés. Mme du Barry, sensible à une affection aussi délicate accepta, et lentement de la tendresse se mêla à leur amitié. Tout en respectant les convenances du monde, M. de Brissac vécut presque constamment à Louveciennes. Ce fut en vain que les nouvelles à la main et toutes les gazettes s’efforcèrent de rendre publique leur liaison.
Ils n’en firent point cas, se bornant à fermer leur demeure aux importuns.
De loin en loin, et pour obéir aux sollicitations pressantes d’amis, elle acceptait de dîner chez l’un d’eux ; c’était une invitée charmante et qui, si elle l’eût voulut eût été de toutes les fêtes, tant elle mettait de grâce et d’esprit dans ses propos.
Jeune encore, elle parlait du passé, du Versailles de Louis XV avec une bonne grâce souriante d’aïeule.
Qu’on en juge par ce récit d’un dîner qui lui fut offert par le comte de Pilos, et qu’elle n’accepta qu’à la condition qu’il eût lieu entre intimes.
L’introducteur des ambassadeurs, le comte de Dufort-Cheverny, en avait gardé un tel souvenir qu’il tint à le noter sur ses tablettes.
« Il gelait à pierre fendre, écrit-il.
« Elle arriva en carrosses à six chevaux, seule, entra avec aisance et noblesse.
« Elle était grande, extrêmement bien faite, et était une très jolie femme de toutes les manières.
« Au bout d’un quart d’heure, elle fut aussi à son aise avec nous que nous le fûmes avec elle.
« Ma femme était seule de femme avec elle.
« Toutes les attentions de Mme du Barry furent pour ma femme et pour le maître de la maison ; elle fut aussi caressante et aimable pour tout le monde.
« Le président de Salaberry et le chevalier de Pontgibaud, son neveu, y étaient ainsi que plusieurs autres ; elle fit les frais de la conversation, elle parla de Luciennes ; nous savions que c’était un endroit délicieux, tant pour le luxe et la magnificence que pour le goût.
« Elle nous invita à venir le voir et à venir dîner avec elle.
« Nous n’acceptâmes la partie qu’indéfiniment.
« Son joli visage était un peu échauffé.
« Elle nous dit qu’elle prenait un bain froid tous les jours.
Elle nous fit voir que sous une longue pelisse fourrée elle n’avait que sa chemise et un manteau de lit très léger.
« Elle portait tout avec une si grande magnificence, reste de son ancienne splendeur, que je n’ai jamais vu de batiste plus belle.
« Le dîner fut charmant, elle en fit tous les frais.
« Elle nous conta cent histoires de Versailles, toutes arrangées à sa manière, et elle était fort intéressante à entendre.
« Apercevant la croix de Cincinnatus à Pontgibaud, voici ce qu’elle nous conta : « – Dans le temps que j’étais à Versailles, mon nom faisait une grande impression : j’avais six laquais qu’on appelait valets de pied, les plus beaux qu’on avait pu trouver ; mais c’étaient les domestiques les plus indisciplinés, les plus tapageurs qui aient existé.
« Celui qui menait les autres en fit tant qu’il sentit bien que je serais obligée de le renvoyer.
« C’était au commencement de la guerre d’Amérique. Il vient me trouver et me demande des lettres de recommandation ; je les lui donne et il part, la bourse bien garnie, et moi trop heureuse d’en être débarrassée.
« Il y a un an, il entre chez moi et se présente avec la croix de Cincinnatus. »
« Cette histoire fit rire tout le monde, excepté le chevalier de Pontgibaud.
« La conversation après dîner fut plus sérieuse.
« Je la mis sur la voie de plusieurs choses qui avaient trait à elle.
« Elle fut d’une franchise charmante à l’égard du duc de Choiseul, elle montra du regret de n’avoir pas eu son amitié ; elle nous conta tous les frais qu’elle avait faits pour l’obtenir, et elle nous dit que sans sa sœur, la duchesse de Gramont, elle en serait venue à bout, ne se plaignant de personne et ne disant aucune méchanceté.
« Je lui rappelai certaines anecdotes que je tenais de La Borde, premier valet de chambre du roi, qui lui était fort attaché.
« Dans cette circonstance, j’avais fait des démarches très vives pour obtenir à Rousseau la place de receveur de ville que Buffault avait eue de préférence.
« Elle me rendit raison de tout, m’expliqua ce qui l’avait engagée à refuser cette proposition et finit par me dire : »
« — Pourquoi n’êtes-vous pas venu me trouver ?
« — J’en avais chargé La Borde.
« — Croyez-vous que dans la place que j’avais, je dusse effrayer un galant homme ? Je ne voulais qu’obliger tout le monde.
« Ah ! si M. de Choiseul avait voulu me connaître et ne pas se livrer aux conseils des gens intéressés, il serait resté en place et il m’en serait rejailli quelques bons conseils ; au lieu que j’ai été obligée de me livrer à tous gens qui avaient intérêt à nous perdre et le roi ne s’en est pas trouvé mieux. »
« À six heures, elle nous quitta aussi lestement qu’elle était arrivée, nous laissant l’impression qu’elle avait eu le bon esprit de rester dans un état mitoyen avec une bonhomie sans exemple, qu’elle avait dû être une maîtresse charmante, et notre étonnement cessa sur le rôle qu’elle avait joué vis-à-vis d’un homme de soixante-quatre ans, blasé sur tous les plaisirs. »
Quelques amies, la belle Mme de Souza, la marquise de Brunoy, Mme Vigée-Lebrun, alors dans tout l’éclat de son talent, vinrent seules désormais troubler quelquefois la solitude de Louveciennes.
Mme Vigée-Lebrun, qui y passa plusieurs mois, a retracé dans ses souvenirs la vie qu’on y menait alors.
« Mme du Barry avait passé la quarantaine.
« Elle était grande, sans l’être trop : elle avait de l’embonpoint, la gorge un peu forte, mais fort belle, son visage était encore charmant, ses traits réguliers et gracieux ; ses cheveux étaient cendrés et bouclés comme ceux d’un enfant ; son teint seul commençait à se gâter.
« Elle m’établit dans un corps de logis, situé derrière la machine de Marly, dont le bruit lamentable m’ennuyait fort.
« Sous mon appartement se trouvait une galerie fort peu soignée, dans laquelle étaient placés sans ordre des bustes, des vases, des colonnes, des marbres les plus rares et une quantité d’autres objets précieux ; en sorte qu’on aurait pu se croire chez la maîtresse de plusieurs souverains qui, tous, l’auraient enrichie de leurs dons.
« Ces restes de magnificence contrastaient avec la simplicité qu’avait adoptée la maîtresse de la maison et dans sa toilette et dans sa façon de vivre.
« L’été comme l’hiver, Mme du Barry ne portait plus que des robes-peignoirs de percale ou de mousseline blanche, et tous les jours, quelque temps qu’il fît, elle se promenait dans son parc ou dehors, sans qu’il en résultât aucun inconvénient pour elle, tant le séjour de la campagne avait rendu sa santé robuste.
« Elle n’avait conservé aucune relation avec la nombreuse cour qui l’avait entourée.
« Je ne sais pourquoi les ambassadeurs de Tippoo-Sahib se crurent obligés d’aller visiter l’ancienne maîtresse de Louis XV.
« Non seulement ils vinrent à Louveciennes, mais ils apportèrent des présents à Mme du Barry, entre autres des pièces de mousseline, très richement brodées en or ; elle m’en donna une superbe, à fleurs larges et détachées dont les couleurs et l’or sont parfaitement nuancés. Le soir, nous étions le plus souvent seules, au coin du feu, Mme du Barry et moi.
« Elle me parlait quelquefois de Louis XV et de sa cour, toujours avec le plus grand respect pour l’un et les plus grands ménagements pour l’autre.
« Mais elle évitait tous les détails ; il était même évident qu’elle préférait s’abstenir de ce sujet d’entretien en sorte qu’habituellement sa conversation était assez nulle.
« Au reste, elle se montrait aussi bonne femme par ses actions que par ses paroles, et elle faisait beaucoup de bien à Louveciennes où tous les pauvres étaient secourus par elle.
« Nous allions souvent ensemble visiter quelques malheureuses et je me rappelle la sainte colère où je la vis un jour chez une femme accouchée qui manquait de tout.
« — Comment, disait Mme du Barry, vous n’avez eu ni linge, ni vin, ni bouillon.
« — Hélas ! rien, Madame.
« Aussitôt nous rentrons au château ; Mme du Barry fait venir sa femme de charge et d’autres domestiques, qui n’avaient pas exécuté ses ordres.
« Je ne puis vous dire dans quelle fureur elle se mit contre eux, tout en faisant faire devant elle un paquet de linge qu’elle leur fit porter à l’instant même avec du bouillon et du vin de Bordeaux.
« Tous les jours, après le dîner, nous allions prendre le café dans un pavillon renommé pour le goût et la richesse de ses ornements.
« La première fois que Mme du Barry me le fit voir, elle me dit :
« — C’est dans cette salle que Louis XV me faisait l’honneur de venir dîner.
« Il y avait au-dessus une tribune pour les musiciens qui chantaient pendant le repas. »
« Le salon était ravissant ; outre qu’on y jouit de la plus belle vue du monde, les cheminées, les portes, tout était du travail le plus précieux ; les serrures même pouvaient être admirées comme des chefs-d’œuvre d’orfèvrerie, et les meubles étaient d’une richesse, d’une élégance au-dessus de toute description.
« Ce n’était plus Louis XV alors qui s’étendait sur ces magnifiques canapés, c’était le duc de Brissac, et nous l’y laissions souvent parce qu’il aimait à faire la sieste.
« Le duc de Brissac vivait comme établi à Louveciennes ; mais rien dans ses manières et dans celles de Mme du Barry ne pouvait laisser soupçonner qu’il fût plus que l’ami de la maîtresse du château. »
Mme Vigée-Lebrun, par une discrétion qui s’explique, n’a voulu voir en M. de Brissac qu’un ami de Mme du Barry.
Il est assuré qu’un sentiment plus vif les unissait.
La haute taille de M. de Cossé-Brissac, la belle figure qu’il faisait par le monde, son urbanité, eussent suffi à le rendre aimable.
Mais ce grand seigneur avait encore marqué à Mme du Barry, en toute occasion, le plus inaltérable attachement.
En réalité, ce fut de l’amour que cette tendre amitié faite de respect mutuel, de goûts pareils qui faisaient que chacun goûtait la vie commune.
Ils étaient l’un et l’autre au déclin de la vie, à l’heure où l’on sent le besoin, une femme, de rencontrer un bras d’homme auquel s’appuyer, un homme, de trouver une confidente à qui raconter son passé.
Ils mirent tout en commun : affections et ambitions, et l’on vit Mme du Barry suivre d’un œil attentif les événements politiques.
Elle qui, jadis, au temps où on la disait si puissante, n’avait pris que malgré elle, et dans la mesure où il lui importait de défendre son crédit toujours attaqué et parfois menacé, une part aux affaires, souhaita de tout cœur voir se réaliser les ambitions du duc de Brissac.
C’était l’heure où la monarchie demandait aux assemblées provinciales de sauver la société française d’une irrémédiable décadence.
M. de Brissac avait sollicité le poste de président de l’assemblée d’Anjou.
Il en fut écarté, moins sans doute pour son libéralisme qu’à cause de ses relations avec Mme du Barry pour laquelle l’entourage de la reine avait gardé un puéril ressentiment.
Bien que son absence eût été courte, M. de Brissac multiplia les lettres à son amie et, dans ces lettres, ce qui revient sans cesse, c’est moins encore l’amertume de son échec que l’ennui d’être éloigné de son « cher cœur » sans lequel la vie semble n’être pour lui que peu digne d’être vécue.
Mme du Barry pouvait consacrer chaque jour plusieurs heures à lire le volumineux journal que, par chaque courrier, lui adressait son ami.
C’était un aimable verbiage où il l’entretenait de mille choses, mais où se marque un souci constant de la santé de la comtesse.
C’était pendant l’été de 1787, durant lequel Mme du Barry connut les premières atteintes de l’âge.
En vain le duc lui répétait-il que l’embonpoint qui lui venait lui seyait à merveille, elle assistait avec tristesse au déclin de sa beauté, craignant qu’à son tour le duc ne la trouvât laide, souci de tant d’amoureuses et qui aiment l’amour quand, depuis longtemps déjà, leur jeunesse s’est envolée.
Et puis, l’absence du duc lui semblait interminable. Louveciennes lui paraissait vide et les promenades du jardin, exquises quand elles étaient faites à deux, la remplissaient d’ennui.
Aussi quelle fut la joie de la comtesse quand elle reçut, une après-midi, une lettre timbrée aux armes de Brissac, de sable, à trois fasces denchées :
« Mille amours, mille remerciements, cher cœur : ce soir, je serai près de vous ; oui, c’est mon bonheur d’être aimé de vous, je vous baise mille fois.
« Je vous aime et pour toujours, il n’y a rien qui puisse toucher mon cœur que vous. »
À peine le duc de Brissac était-il venu reprendre à Louveciennes la vie de calme et de douceur qui l’enchantait, qu’il eut à s’efforcer de calmer le chagrin de Mme du Barry.
Deux morts, survenues à quelques semaines l’une de l’autre, l’atteignirent profondément.
Le duc d’Aiguillon, un de ses plus anciens amis, s’éteignit d’une maladie de langueur dans son hôtel de la rue de l’Université.
Depuis plusieurs mois, il n’était plus que l’ombre de lui-même.
On avait dû contremander une fête qu’il comptait donner à Mme du Barry dans son château de Guyenne.
Tout était prêt et Mme du Barry se disposait à partir quand on jugea que l’état du duc d’Aiguillon ne permettait point un tel déplacement.
Elle dut se borner à l’aller voir et à porter au chevet de son ami la grâce émue de son sourire.
À peine retrouvait-il, lorsqu’elle le venait voir, une ombre de vie ; ses forces déclinaient lentement ; il mourut doucement un soir.
Mme du Barry le pleura : n’était-il pas lié dans son souvenir à ses années heureuses ? Leur chute n’avait-elle pas été commune ?
Et peut-être inconsciemment était-ce un peu sur elle-même qu’elle pleurait.
Deux mois plus tard, Mme de Montrabé mourut à son tour.
Retirée depuis longtemps déjà à Villiers-sur-Orge, petit hameau voisin de Corbeil, elle y vivait entourée de soins affectueux par son dernier mari, comblée de libéralités par Mme du Barry, achevant une existence mêlée de traverses et bénissant sans doute cette inaltérable bonté de l’ancienne favorite qui lui avait, après une vie orageuse, assuré des années tranquilles et un foyer où achever paisiblement ses jours.
Mais déjà sonnaient les premières heures de la Révolution. La Bastille était prise et le peuple maître de la rue. Quelques mois encore et les journées d’octobre faisaient de la reine et du roi les prisonniers de la Révolution.
DEUXIÈME PARTIE – L’ÉCHAFAUD
Aux maux que la République commençait à faire éprouver, ceux d’une fortune dérangée se firent sentir à la comtesse du Barry[29]. Elle voulut faire revendre une partie de ses diamants pour payer ses créanciers.
Ce fut à M. Vandenyver, banquier, de qui nous aurons malheureusement trop à reparler, qu’elle s’adressa pour s’en défaire, et voici la réponse de cet homme aussi estimable qu’il fut malheureux :
Madame la comtesse,
« J’ai l’honneur de vous informer qu’on me mande d’Amsterdam qu’après beaucoup de recherches pour trouver des acquéreurs de vos diamants, il paraît qu’il faudra attendre les occasions de mariage et qu’après on estime obtenir les prix ci-après :
|
Six mille livres pour la paire de girandoles, ci |
6.000 |
|
Quinze mille pour la bague, ci |
15.000 |
|
Six mille pour la pendeloque, ci |
6.000 |
|
Huit mille pour les brillants Nos 12 et 7 chacun, ci |
16.000 |
|
Six mille pour le No 6, ci |
6.000 |
|
Cinq mille pour les Nos 3, 4, 9, chacun, ci |
15.000 |
|
Quatre mille pour les Nos 8, 10,11, ci |
12.000 |
|
Trois mille pour le numéro 12, ci |
3.000 |
|
Total : |
79.000 |
« J’estime qu’il est convenable de profiter de ces offres si l’on peut parvenir à les réaliser, car en Hollande comme en Angleterre, les diamants sont hors de mode et diminuent de prix à mesure qu’il s’en présente à vendre ; je vous serai donc obligé de me mander vos intentions à cet égard.
« La tournure que prend, depuis quelque temps, la valeur des actions de la Caisse d’Escompte, est aussi fâcheuse que celle des diamants ; cependant, pour que vous ne perdiez pas le petit bénéfice qu’on peut avoir en faisant l’appel de 1.600 livres, j’ai fait ce paiement hier sur vos 70 actions que vous m’avez déléguées et vendu les 70 demi-actions à 1.649 livres, de façon qu’en déduisant les frais, cela vous produira un bénéfice d’environ 2.800 livres, dont je vous fournirai le décompte.
« J’ai l’honneur d’être, Madame la comtesse, votre très humble et très obéissant serviteur.
« VANDENYVER père. »
Un vol considérable fit sentir à Mme du Barry, enfant gâtée de la fortune, que la capricieuse déité l’avait abandonnée.
La nuit du 10 au 11 janvier 1791, on profita d’un voyage que Mme du Barry fit à Paris pour lui enlever tous ses bijoux et diamants, qui devaient s’élever à des sommes immenses.
On a déjà vu que l’intention de Mme du Barry avait été d’en vendre une partie pour acquitter ses dettes, car on ne peut pas dissimuler que Mme du Barry en eût, quoiqu’elle possédât 200.000 livres de rente, ce qui eût dû être bien suffisant si elle n’eût été entourée de gens qui avaient intérêt à la piller.
Née sans fortune et parvenue à la plus brillante, Mme du Barry n’avait point appris à connaître le prix de l’argent, ce qu’on ne sait jamais que dans une honnête médiocrité.
Aussi voit-on beaucoup plus de gens très riches se ruiner que de ceux qui, ayant reçu de leur père l’honnête nécessaire, trouvent dans leur économie des ressources dont une grande fortune ne donne pas même l’idée.
Ce vol fut donc un extrême malheur pour la comtesse, et elle fit les plus grandes diligences pour le recouvrer.
Il paraît qu’elle avait des amis à la mairie et qu’on la servit très chaudement.
Nous rapporterons la lettre de M. Perron, administrateur de police ; elle contient encore des égards qui, bientôt, n’existeront plus parmi les gouvernants et encore moins parmi leurs agents :
« Je présente à Mme la comtesse du Barry l’assurance de mon respect ainsi que le vif intérêt que je prends à son accident. M. d’Angremont, chef du bureau militaire de l’Hôtel de Ville, à qui j’ai communiqué les renseignements que Mme du Barry m’a adressés, m’a témoigné le plus grand désir de joindre ses bons offices aux nôtres pour les perquisitions à faire et il a désiré prendre lui-même quelques informations sur les lieux. Mme du Barry peut avoir en M. d’Angremont toute la confiance que méritent, comme lui, tous les citoyens amis de l’ordre et de la tranquillité publique.
« PERRON,
« Administrateur de la police. »
« Hôtel de la Marine, 14 janvier 1791. »
Le résultat de la mission du sieur d’Angremont fut l’arrestation (de concert avec la municipalité) du Suisse préposé à la garde de la maison pendant la nuit.
Pendant que les voleurs dépouillaient Mme du Barry, les journaux démocrates cherchaient à la couvrir de boue.
Voici, à cet égard, comment s’expliquait sur son compte, à cette époque, un de ces politiques[30] :
« Depuis la Révolution, la dame du Barry n’a cessé d’employer tout l’ascendant que lui donnent de grandes richesses, acquises on sait comme, à faire régner la mésintelligence entre les habitants des environs de Luciennes et les Suisses de Courbevoie. Ses menées sourdes, concertées avec les principaux officiers, n’ont pas eu le succès désiré, tout au contraire, on est prévenu si peu favorablement sur le compte de la maîtresse du château de Luciennes, qu’on ne craint pas d’élever des doutes sur la réalité du vol de ses diamants. La réduction considérable dont les revenus de ladite dame sont menacés lui a fait naître l’idée, dit-on, de se rendre intéressante en se donnant pour victime d’un événement fâcheux, et en se procurant un titre à l’indulgence de l’inexorable Assemblée Nationale.
« Quoi qu’il en soit, sa conduite, dans la position où elle s’annonce, n’est guère propre à la faire plaindre. Ladite dame donnait des appointements fort honnêtes à un soldat suisse pour lui servir comme concierge à Luciennes. Le gardien actuel est un jeune homme de dix-huit ans, d’une figure aimable, et très honnête. À la nouvelle de l’enlèvement de ses pierreries, la première démarche de la maîtresse du château est de se transporter dans une voiture à quatre chevaux chez le commandant des Suisses, à Courbevoie ; elle en obtient sans peine cinquante grenadiers qui viennent aussitôt, mais à regret, s’emparer de la personne du jeune Suisse, estimé généralement et chéri de tous ses camarades. Il est conduit dans les prisons de Rueil, où les ordres sont en même temps donnés de le mettre aux fers dans le plus noir des cachots.
« Nous tenons ces faits de la bouche d’un Suisse de Courbevoie, jeune homme candide, qui nous apprend en même temps que toute la compagnie du détenu, quitte des devoirs de discipline militaire, se propose de prendre à partie la dame du Barry et de lui demander raison en justice de la violence exercée sur sa sollicitation sur la personne d’un soldat tout au plus soupçonné.
« Le vol des diamants de Golconde ne justifierait pas cette atteinte portée aux Droits de l’Homme et du Citoyen : et, d’ailleurs, est-il délit assez grave pour être mis aux fers sur le simple soupçon d’une femme fière encore d’avoir été un moment la première des courtisanes de l’empire ! »
Un autre journal[31], plus au fait des événements, rendit compte de cette arrestation dans les termes suivants :
« La municipalité de Luciennes a fait emprisonner un soldat, gardien de la maison pillée (celle de Mme du Barry) ; ce soldat, interrogé par ses officiers, avoue que des particuliers, qu’il ne connaît pas, l’ont enivré dans un cabaret.
« Cet aveu laisse présumer que ces gens étaient les brigands qui méditaient l’entreprise.
« On n’a que ce faible éclaircissement sur le vol de Luciennes. »
Sous la date du 30 janvier, on trouve dans le même journal la note dont la teneur suit :
« Mme du Barry ne néglige rien pour retrouver ses diamants ; elle consulte même les devins qu’elle reconnaît n’être pas sorciers.
« Le bruit injurieux s’est répandu qu’elle augmentait la valeur de son vol, afin d’arranger plus aisément ses affaires.
« Cette rumeur est d’autant plus injuste qu’indépendamment de la bienfaisance de Mme du Barry, son exactitude à satisfaire autant qu’elle peut à ses engagements est connue. »
Le 18 février, Mme du Barry apprit que ses voleurs étaient arrêtés et ses diamants retrouvés.
Voici comment on rapportait le fait dans un journal anglais[32] :
« La manière dont ont été découverts les voleurs de Mme du Barry prouve qu’ils sont des brigands assez médiocres.
« Arrivés à Londres au nombre de cinq, dans une auberge de la Cité, ces messieurs demandèrent une seule chambre, ce qui parut étonnant.
« Ils commandèrent ensuite un bon dîner et, comme leur équipage n’en imposait pas, ils dirent à l’hôte que leur argent n’était pas encore converti, mais que le lendemain ils en auraient abondamment.
« Cette confidence faite, ils allèrent chez le sieur Simon, riche lapidaire et lui proposèrent plusieurs diamants d’un grand prix, en lui demandant à peu près le sixième de leur valeur.
« Le lapidaire acheta d’abord cette partie, qu’il eut pour 1.500 livres sterling.
« Il s’informa de ces particuliers, s’ils n’en avaient pas davantage et, sur leur réponse affirmative, il alla prévenir le lord-maire.
« Ce magistrat fit enlever toute la bande, ils furent fouillés et, quoi qu’ils se fussent hâtés de jeter au feu de gros diamants, la partie la plus importante de leur vol est en sûreté.
« Celui de ces bandits qui faisait le rôle d’interprète est un Anglais, déjà très connu pour un grand nombre de brigandages. »
Ce fut à ces indices, qui comblèrent d’abord de joie Mme du Barry, que l’on peut rapporter les malheurs dont elle fut par la suite accablée.
Ils l’enflammèrent du désir de se remettre en possession de ses trésors ; et cette démarche, qui n’avait rien que de très simple, fut envenimée par des gens qui se plurent à la déchirer, quelques-uns dans l’espoir de se gorger de ces mêmes richesses.
Adieu, paix, tranquillité ! Quatre voyages en Angleterre dans un temps où tout était difficile, les ennuis d’une procédure, ne furent que les préludes des peines qui l’attendaient à son retour en France, où nous allons la voir succomber sous les traits acérés de la trahison et de l’ingratitude.
Mme du Barry ne perdit pas un moment pour se rendre à Londres, où on lui représenta ses diamants.
Elle les reconnut et l’affirma par serment.
Mais comme la procédure ne pouvait se terminer aussi promptement qu’elle l’aurait désiré, elle repartit pour Paris et laissa ses diamants en dépôt chez MM. Hamerleys et Morland, banquiers, scellés de son cachet et de celui de la maison où ils restaient.
Mais bientôt on la rappela à Londres et, ayant un peu d’argent et ne voulant pas s’en charger, elle demanda à M. Vandenyver une lettre de créance pour Londres.
Ce banquier écrivit la lettre datée de Paris, le 2 avril 1791 :
« Messieurs,
« La présente vous sera remise par Mme la comtesse du Barry, qui va partir pour votre ville et dont la notoriété publique vous a sans doute instruits. Nous vous prions très instamment, Messieurs, de lui rendre tous les services et bons offices qui dépendront de vous : nous les regarderons comme reçus par nous-mêmes et vous en aurons la plus grande obligation.
« Nous vous prions aussi de fournir à Mme la comtesse tout l’argent qu’elle pourra vous demander sur ses reconnaissances, pour notre compte et devons en prévaloir sur vous par appoint.
« Nous avons l’honneur d’être, avec considération, vos très humbles serviteurs.
« VANDENYVER frères et Cie. »
Le premier voyage de la comtesse avait été sans aucune précaution ; elle avait couru après ses bijoux comme un enfant après des hochets qu’on lui aurait enlevés.
Non seulement elle n’avait point de lettre de crédit, mais même point de passeport et, à Boulogne, elle pensa être arrêtée.
Aussi, dans le second voyage, elle se soumit à la forme que l’on exigeait alors et obtint un passeport.
Ce voyage fut plus long.
Mme du Barry passa trente-huit jours à Londres et elle rencontra plusieurs de nos fugitifs, entre autres M. de Calonne, dont elle se serait tout aussi bien accommodée dans le temps de sa grandeur, pour ministre, que de l’abbé Terray : aussi le vit-elle avec plaisir.
C’était un homme très aimable et qui ne pouvait être insensible au sourire de la beauté. Aussi fit-il mille accueils à la belle comtesse ; il aurait désiré qu’elle se fixât à Londres, d’autant que les nuages révolutionnaires s’amassaient sur la France.
Nous ne pouvons résister à rapporter une lettre écrite alors par Mme du Barry à son valet de chambre, nommé Morin. Elle nous paraît une preuve de ce que nous avons dit déjà du caractère de la comtesse. Dans les moments les plus importants de sa vie, des bagatelles d’enfant l’occupent et des confitures plus ou moins cuites sont, pour elle, un objet qu’elle traite aussi sérieusement que celui d’un vol de plusieurs millions.
« Morin ira, dit-elle dans une lettre, chez MM. le maire, le commandant général, le juge de paix, pour les remercier de ma part et leur dire que je compte sur leur zèle : j’espère que, de concert avec mes gens, ils défendront les restes de mes propriétés si elles étaient attaquées par des brigands ; je me flatte qu’on ne sera pas obligé d’en venir à cette extrémité et que la paix et la tranquillité renaîtront ; je suis déjà assez malheureuse d’être éloignée de ma maison et d’être dans un pays qui, quoi qu’on en dise, ne valait pas la France avant les troubles qui l’agitent.
« J’approuve le parti que Morin veut prendre pour mettre mes effets à l’abri du pillage ; il consultera M. le duc, mais il faudra bien prendre garde que personne ne s’en doute. Je ne sais pas pourquoi Maisieu veut toujours être un homme ridicule ; ce n’est que par sang-froid qu’on peut se servir mutuellement et rendre les efforts des méchants inutiles. J’avais fait dire à Pison d’aller à Luciennes pour aider Salanave à faire les confitures pour la fourniture de la maison : je ne sais pourquoi il n’y a pas été ; car je ne trouve pas qu’on les fasse bien chez moi : elles sont toujours trop cuites.
« Morin dira à Mme Roussel de mettre toutes les dentelles qui sont dans l’armoire de la chapelle dans une malle, à l’abri de toute espèce d’attaque, ainsi que ce qui est susceptible d’être volé ou brûlé. Je vois avec peine que je resterai encore ici jusqu’au 15 août, parce que les coquins de voleurs ne seront jugés qu’à la fin de ce mois.
« La comtesse DU BARRY. »
« Londres, le 5 juillet. »
Rien ne finissant encore à Londres, Mme du Barry revint à Paris et à Luciennes, où elle voyait M. de Brissac dans tous les instants que son service lui laissait de libre, car on sait que le duc était commandant de la garde constitutionnelle du roi.
M. de Maussabré, gentilhomme de l’Anjou, avait été page du gouverneur de Paris et il était devenu son aide-de-camp.
C’était un jeune homme d’une figure charmante et d’une douceur qui le faisait chérir de tous ceux qui le connaissaient.
Son attachement pour le duc l’avait rendu l’ami sincère de Mme du Barry, et ce fut lui qui vint lui faire part du rapport de Bazire[33] à la Convention, le 28 mai 1792, où il s’exprime en ces termes :
« Une grande partie de la garde du roi a été remplie sans les formes prescrites par la Constitution. Les uns n’ont pas le temps de service requis, les autres n’avaient pas prêté serment avant leur nomination ; parmi eux, on voit encore d’ancien gardes-du-corps, des Chiffonnistes d’Arles, des enfants d’émigrés, etc. »
L’orateur ajoute quelques anecdotes tendant à prouver que l’esprit de cette garde n’est point constitutionnel. Dans le cours de la discussion, M. Couthon s’écrie :
« Voici le moment où l’Assemblée doit s’élever au niveau de ses augustes fonctions, la surface de l’empire s’est couverte de conspirations, mais où est leur foyer ? Là, au château des Tuileries. La garde du roi n’est qu’une horde de brigands. Je propose de mettre en accusation MM. de Brissac, de Pont-l’Abbé et d’Hervilly, chefs de cette garde. »
Après une heure de la discussion la plus orageuse, M. Guadet propose et l’Assemblée adopte le projet de décret suivant : 1° que la garde du roi était licenciée ; 2° qu’elle serait incessamment renouvelée conformément aux lois ; 3° que le service du roi serait fait par la garde nationale jusqu’à la nouvelle organisation de celle licenciée.
Voici, à cet égard, comment s’exprime le rédacteur de la Gazette de Paris[34] : « Jamais plus d’atrocités, de calomnies, d’attentats, d’infractions de toutes les lois divines et humaines n’ont été rassemblés dans un même jour. M. le duc de Brissac mis en état d’arrestation : hier mercredi, à six heures, ce loyal chevalier a été conduit à Orléans. Des groupes d’individus ont suivi longtemps, sa voiture en hurlant constitutionnellement. Un jour, l’histoire demandera comment on pouvait être assez impudemment injuste pour condamner aux fers un chevalier sans reproches, avant d’avoir écouté sa défense, avant même d’avoir constaté son délit.
« Les gardes constitutionnels proscrits par le nouveau décret sont partis au milieu des imprécations d’une populace effrénée. Leur situation était si cruelle que des larmes ont coulé des yeux de beaucoup de spectateurs.
« La garde nationale a servi de bouclier à ces gardes, dont le crime était de rendre le souverain trop inaccessible au poignard des régicides.
« La gendarmerie nationale a partagé l’honneur de couvrir de ses rangs hérissés de baïonnettes ces proscrits. »
Quelques jours après l’arrestation de M. de Brissac, Mme du Barry eut la visite d’un détachement de fédérés marseillais.
Après les avoir fait rafraîchir, ces messieurs fouillèrent les appartements. Ayant aperçu une porte fermée, ils en demandèrent la clef.
Sur la réponse de Mme du Barry que cette porte était condamnée, ils la firent ouvrir par un serrurier et trouvèrent l’infortuné jeune Maussabré, aide-de-camp de M. de Brissac, que son amie avait cherché à dérober aux farouches regards des Marseillais.
Qu’on juge de la douleur de la comtesse quand elle vit ce malheureux jeune homme tomber dans les mains des assassins !
Mme du Barry employa inutilement en sa faveur les supplications, les prières.
Il fut entraîné à Paris et enfermé dans l’Abbaye, où il périt avec les malheureuses victimes qui y étaient renfermées.
Le 6 septembre 1792, les prisonniers d’Orléans furent ramenés à Versailles.
Quelques-uns des monstres qui avaient déjà effrayé la France se rendirent à Versailles.
Ils ne trouvèrent que trop de facilité dans cette ville pour exécuter le barbare projet qu’ils méditaient.
Bientôt une horde de cannibales se porte au-devant des voitures ramenant les prisonniers, et leur ferment l’entrée de la grille de l’Orangerie.
Tout l’appareil révolutionnaire les accompagnait, et ceux que le plus impérieux devoir obligeait de défendre ces infortunés aux dépens de leurs jours, se laissent saisir d’une honteuse frayeur et les abandonnent à leurs meurtriers.
Alors commence une de ces scènes d’horreur que les révolutions ne présentent que trop souvent à la postérité.
Presque tous les prisonniers défendirent leur vie et ne furent accablés que par le nombre, mais aucun ne mit plus d’énergie et de vrai courage que M. de Brissac.
Armé d’un couteau à la d’Estain, il s’en servit avec un sang-froid qui rendit ses coups redoutables aux assassins, et ce ne fut qu’après avoir épuisé la dernière goutte du sang que ses ancêtres illustres lui avaient transmis qu’il cessa de combattre[35].
Après avoir perdu un ami si cher, Mme du Barry, isolée dans son pavillon de Luciennes, ne devait plus regarder la vie que comme un séjour douloureux. Elle partit de nouveau pour l’Angleterre.
Elle y resta jusqu’au 1er mars 1793.
Pendant que Mme du Barry était en Angleterre, le démon révolutionnaire avait érigé un club à Louveciennes. Ce club ne manqua pas de diriger toutes les intrigues contre la maîtresse de Louis XV. On l’accusa d’émigration et c’est, selon toute apparence, pour se mettre à l’abri de cette dénonciation qu’elle avait écrit la note que l’on a trouvée après sa mort : « J’ai été volée la nuit du 10 au 11 janvier 1791 ; j’ai reçu un courrier de Londres, le 15 février, qui m’annonçait que les voleurs de mes effets étaient arrêtés. Je suis partie le lendemain 16. Je me suis embarquée à Boulogne le dimanche 20 et suis restée à Londres jusqu’au 1er mars que j’en suis partie pour me rendre à Luciennes où je suis arrivée le vendredi 4. Je partis de Paris le 4 avril et arrivai à Londres le 9 ; j’y suis restée trente-huit jours, c’est-à-dire jusqu’au 18 mai que je suis repartie. Je suis arrivée chez moi le samedi 21 et ai été obligée de repartir pour Londres le lundi 23, ayant reçu un courrier la nuit de mon arrivée qui m’annonçait que ma présence était absolument nécessaire à Londres où j’ai resté jusqu’au 25 août, que je suis revenue, et depuis ce temps, je suis restée à Luciennes jusqu’au 14 octobre 1792 que je suis repartie pour Londres munie de passeports et de lettres du ministre des Affaires étrangères ; j’y suis arrivée le 22, et mon procès ayant été jugé le 27 février dernier, jour du terme du tribunal, je suis repartie de Londres le 3 mars et suis arrivée à Calais le 5 où j’ai été retenue jusqu’au 18 pour attendre de nouveaux passeports de la municipalité de Calais, et le certificat de résidence que j’y ai faite. – Luciennes, ce 19 mai 1793. »
Après les journées des 31 mai, 1er et 2 juin, les ennemis de Mme du Barry continuèrent à la dénoncer comme tenant chez elle des conciliabules contre-révolutionnaires ; enfin, les clubistes nommèrent une députation pour l’aller dénoncer à Paris au Comité de sûreté générale. Au bout de quelques jours, Mme du Barry, qui ne cessait de faire suivre cette affaire, fut instruite que le Comité, après avoir délibéré, l’avait renvoyée par devant les administrateurs du département de Seine-et-Oise.
De retour en France, l’ancienne favorite eût pu échapper aux horreurs révolutionnaires si le Ciel n’eût permis que des hommes pervers eussent tramé sa perte.
Un intrigant forcené, nommé Greive, lequel était venu depuis quelque temps demeurer à Luciennes, dans l’intention de s’approprier une partie de la fortune de Mme du Barry, soit en obtenant d’elle une somme considérable pour acheter son silence dans le club qu’il s’était empressé de former dès son arrivée, soit, dans le cas contraire, en recevant des comités de gouvernement une récompense en la faisant arrêter.
Mme du Barry apprit bientôt que Zamor et Salanave étaient membres du nouveau club.
L’un était ce nègre qu’elle avait fait élever et soigner comme son fils, qu’elle avait comblé de biens.
L’autre avait été, quelque temps auparavant, à son service et elle l’avait renvoyé pour cause d’infidélité.
Greive avait réussi à s’associer ces deux hommes, et il sut par eux quelles étaient les personnes qui venaient le plus souvent chez Mme du Barry, ainsi que ceux qui, étant à son service, lui étaient particulièrement attachés.
Les clubistes, au nombre à peu près de quarante, étaient pour la plupart des êtres immoraux.
Plusieurs d’entre eux s’étaient rendus, en septembre, à Versailles, pour coopérer au massacre des malheureux prisonniers d’Orléans.
On les vit revenir le même jour à Luciennes, ivres de vin et de sang, portant une tête par les cheveux, qu’ils présentèrent à Mme du Barry.
Celui qui en était porteur dit à la du Barry :
— Tiens… voilà la tête de ton amant…
Puis il la jeta sur une des tables du pavillon.
Après cette horrible harangue, que les vociférations accompagnaient, Mme du Barry, tremblante à l’aspect de ce sanglant trophée, détourne les yeux et ne cherche point à démêler si ces restes sanglants sont ceux de son ami, qu’on assure que ces malheureux avaient confondus avec ceux d’une autre victime[36].
Mme du Barry, pendant son séjour à Londres, avait eu occasion de connaître le nommé Blache qui, sous prétexte de donner des leçons de langue française, n’était rien autre qu’un agent des comités du gouvernement pour espionner la conduite des Français émigrés en ce pays.
Le gouvernement anglais, qui s’était douté de sa mission, lui avait intimé l’ordre de repasser promptement en France, ce qu’il avait été forcé d’exécuter.
De retour à Paris, il avait continué d’être attaché au Comité de sûreté générale.
Dans le cours de ses missions, il fut à Luciennes.
Mme du Barry lui fit une très bonne réception et l’engagea à loger chez elle, ce qu’il accepta.
Blache et Greive eurent bientôt fait connaissance, car les méchants ne tardent pas à s’unir contre les bons.
Ce dernier, ayant rédigé et fait signer par les membres du club une pétition pour obtenir le décret du 2 juin, afin d’avoir par ce moyen occasion de se saisir de la personne de Mme du Barry, se rendit avec Blache à Versailles, auprès du département auquel ils présentèrent la lettre que voici :
« Les bons citoyens de Luciennes nous ont députés vers vous pour éveiller votre attention sur les périls de la patrie, et vous faire part des motifs de leurs inquiétudes. Nous sommes entourés d’ennemis ; notre ville, notre voisinage, le département entier en fourmille. Rien de nuisible n’échappe à la rage concentrée de nos ennemis. Faites donc mettre à exécution prompte et universelle vos décrets. Nos bras et nos cœurs sont dévoués à la chose publique.
« Fait à Luciennes, le 26 juin 1793. »
(Signé de trente-deux citoyens.)
La députation, après la lecture de cette adresse, donne des ordres rapides.
Le lendemain 27, Greive, Blache, Salanave convoquèrent la commune à l’effet de procéder à une liste de ceux qu’il fallait commencer par mettre en état d’arrestation.
Il fut convenu d’arrêter Mme du Barry et les personnes qui lui étaient attachées.
Ayant eu avis au château de ce qui se passait, Mme du Barry envoya sur-le-champ Morin, son valet de chambre, avec le ci-devant chevalier Labondie, afin de voir quelques membres des administrations supérieures et de plaider sa cause auprès d’eux.
Greive, accompagné du maire Ledoux et de municipaux (qui tous étaient membres du club), se rendirent au château, afin de mettre à exécution le décret que nous venons de citer, lorsque sur le soir, au moment où ils se disposaient à emmener Mme du Barry, arriva le citoyen Boileau, membre du district.
Il fit sur-le-champ assembler la municipalité, à laquelle il fit une verte mercuriale pour avoir précipité l’exécution de la loi que, ajouta-t-il, « nous allions vous envoyer avec des restrictions et des modifications ».
Les municipaux, désespérés de voir leur proie leur échapper, disputèrent avec le membre du district qui reconduisit Mme du Barry à son pavillon.
Greive rédigea alors une autre pétition qu’il fit signer, comme la première, par ses affiliés, dont un grand nombre avaient maintes et maintes fois reçu les bienfaits de Mme du Barry.
Enfin, le 3 juillet, ayant engagé le maire Ledoux et les officiers municipaux à se rendre avec lui à la barre de la Convention, il y fit lecture de la pièce suivante, que l’on peut regarder comme un chef-d’œuvre d’astuce et de perfidie :
« Citoyens représentants du peuple,
« Les braves Sans-Culottes, accompagnés du maire et des officiers municipaux de la commune de Luciennes, département de Seine-et-Oise, se présentent devant vous pour vous assurer de leur attachement jusqu’à la mort à la République une et indivisible, de leur adhésion à tous les décrets sages, bienfaisants et populaires que vous avez rendus depuis l’immortelle insurrection du 31 mai et jours suivants, qui, en éloignant de votre sein les plus dangereux ennemis de la patrie, a laissé libre cours aux délibérations des sauveurs de la République.
« Nous sentons comme vous, courageux députés de la Montagne, qui avez fait tomber la tête du tyran, que le combat que nous livrent nos ennemis extérieurs et intérieurs, les égoïstes, les intrigants de toute espèce, est un combat à mort. Aussi, nous n’avons pas été plus tôt instruits de l’audace avec laquelle la horde des scélérats fanatiques et royaux avait menacé le département de Seine-et-Oise, que nous avons volé immédiatement vers vos administrateurs. Nous avons commencé nos opérations par l’arrestation d’une femme trop célèbre dans les fastes de notre histoire monarchique… C’est dans douze châteaux (car il y en a encore, des châteaux), que Brissac a commencé et continue ses projets liberticides.
. . . . . . . . . . .
« Citoyens représentants, c’est en exécution de la lettre et de l’esprit de votre décret que nous avons mis en état d’arrestation la citoyenne se disant comtesse du Barry, sa nièce, fille d’un émigré, et ceux de ses domestiques notoirement suspects d’aristocratie et d’incivisme. »
. . . . . . . . . . .
Le président répondit aux députés de Luciennes :
« Citoyens,
« La Convention nationale applaudit aux nouvelles preuves que vient de donner la commune de Luciennes… La Convention est persuadée que tous continueront à donner de nouveaux exemples de votre dévouement à la chose publique et vous invite aux honneurs de la séance. »
Greive et ses dignes acolytes, de retour à Luciennes, forts de l’approbation de la Convention, se hâtèrent de conduire Mme du Barry et les autres personnes arrêtées à Versailles, près le département, afin qu’elles fussent reléguées dans la maison d’arrêt.
Gouzon, comme procureur-général syndic, leur représenta que leur démarche était inconsidérée, qu’ils opéraient de leur chef et contre le vœu des dix-neuf vingtièmes des habitants de Luciennes ; que les faits allégués par eux contre Mme du Barry étaient ou exagérés ou dénués de preuves.
Les terroristes, terrassés par ces excellentes raisons, ne savaient trop que dire, la plupart n’étant que des mannequins que Greive, Blache et Salanave faisaient agir à leur volonté.
Un seul d’entre eux, nommé Allain, plus astucieux que les autres, répondit au procureur-général syndic :
— Nous ne vous craignons pas, nous exécutons la loi.
Mme du Barry, instruite des faits articulés contre elle dans l’adresse présentée au nom des habitants de Luciennes, se hâta d’en rédiger une qui fut promptement couverte par les signatures des notables et probes du lieu.
La pétition ayant été présentée le 6 juillet, fut renvoyée au Comité de sûreté générale.
Après avoir délibéré sur la pétition, le Comité fit droit à la demande de Mme du Barry, en renvoyant devant le département la suite de cette affaire.
Cette administration, convaincue de l’innocence de Mme du Barry, arrêta qu’elle serait renvoyée chez elle et les autres mis en liberté.
Greive, désespéré de n’avoir pu réussir dans ses projets, rédigea et fit imprimer un libelle diffamatoire contre Mme du Barry, le Comité de sûreté générale et le département.
Cet écrit fut distribué par lui à ses affiliés[37].
Mme du Barry, qui avait quelqu’un au club pour lui rendre compte de ce qui se passait, apprit bientôt l’existence de cet écrit et s’en procura un exemplaire.
Ayant remarqué que Zamor, qui était chez elle depuis plus de vingt ans n’avait point été arrêté comme les autres domestiques lorsqu’elle fut conduite à Versailles, elle se douta que ce ne pouvait être que lui qui avait fourni les détails de ce qui se passait dans l’intérieur de sa maison. En conséquence, elle le fit monter dans son cabinet et lui tint ce discours :
« — Zamor, est-ce vrai que vous fréquentiez cet étranger qui n’est venu s’établir dans ce pays que pour y vexer les propriétaires qui y demeurent, ayant fondé pour cet effet un club composé en majeure partie de gens tarés, intrigants et fourbes, qui ne se font aucun scrupule de s’emparer d’une partie de la fortune de ceux qu’ils parviennent à faire incarcérer d’après leurs dénonciations perfides et mensongères, qui ne rougissent pas de se nommer les uns les autres : maires, officiers municipaux, gardiens de scellés, etc… »
Zamor, ayant renoncé à tout principe d’honneur et de reconnaissance, loin d’être embarrassé par ces interrogations qui eussent dû le faire rougir, répondit avec une extrême audace :
— Madame, il est très vrai que je fréquente Greive, parce que c’est un bon patriote, un ancien ami de Marat, qui a fondé ici la Société populaire, dont je me fais gloire d’être membre, ainsi que votre ci-devant jardinier Frémont, votre ex-chef d’office Salanave et autres bons citoyens.
— Eh bien ! répliqua Mme du Barry, je vous donne trois jours pour sortir de ma maison.
Ce qui fut exécuté par Zamor, qui oublia tout ce qu’il devait à celle qui avait daigné prendre soin de son enfance, l’avait fait élever comme son propre fils et qui avait sollicité pour lui les bontés de son auguste amant.
C’est en perçant le sein qui l’avait réchauffé qu’il paya ses bontés : et, semblable aux affreux reptiles que nourrit sa brûlante patrie, il enlaça dans ses replis tortueux sa bienfaitrice.
À peine sorti de chez elle, il va trouver ses perfides amis, Greive, Blache et Salanave, pour les instruire de ce qui s’était passé…
Mme du Barry, en mettant hors de chez elle Zamor, avait pensé se débarrasser d’un espion domestique ; mais, au contraire, elle n’avait fait, en cette occasion, que renforcer le parti de ses ennemis en renvoyant parmi eux cet énergumène qui, dès ce moment, lui jura une haine implacable.
Greive, qui ne perdait pas de vue l’objet principal de ses dé-sirs, ne cessait de déclamer contre Mme du Barry à la Société populaire ; en cela, il était vivement secondé par Zamor.
Mme du Barry, instruite de son côté que l’orage grossissait contre elle et que le décret du 2 juin était le grand cheval de bataille de ses ennemis, écrivit sur-le-champ la lettre suivante :
La citoyenne du Barry
aux citoyens administrateurs du département de Versailles.
« Jusqu’ici, citoyens, des agitateurs avaient fait de vains efforts pour troubler ma tranquillité, j’avais à leur opposer ma conscience à votre équité, bien convaincue que j’avais en elle un rempart assuré contre leur malveillance ; ils ont imaginé d’autres moyens pour me tourmenter, mais ils seront impuissants puisque ma cause vous est soumise.
« Quand je n’ai eu à repousser qu’une dénonciation dont la loi vous attribuait la connaissance et qui paraissait ne pas devoir sortir des limites de votre ressort, et n’avoir d’autre suite que votre décision, je n’ai pas cru devoir joindre vos instances à ma pétition et troubler votre attention d’objets importants pour la fixer sur une affaire qui m’était personnelle ; mais aujourd’hui, la dénonciation a pris un caractère de gravité et de publicité qui m’imposait la loi de repousser promptement la calomnie.
« La malveillance de mes dénonciateurs s’est accrue à un tel point que j’ai tout à craindre d’eux ; enfin, je suis sous les liens d’un décret qui me condamne à une privation totale et qui doit fixer sur moi l’opinion générale : je suis donc dans le cas de solliciter de votre zèle la plus prompte expédition.
« J’ose ajouter, citoyens, que l’humanité vous en fait un devoir : de si puissants motifs en ajoutant à mon estime ne diminueront rien à ma reconnaissance.
« Je ne veux pas abuser de vos moments en vous exposant tous mes motifs de crainte : j’en ferai part au commissaire que vous jugerez à propos de nommer et qui vous fera connaître, dans son rapport, que j’ai mérité que vous veniez à mon secours. »
Au reçu de cette lettre, le directeur du département nomma le citoyen Lavallerie pour se rendre à Luciennes, à l’effet d’y recevoir la déclaration de Mme du Barry.
Après s’être concertés ensemble, il lui conseilla, voyant le danger qu’elle courait dans Luciennes, de se retirer à Versailles, sous les yeux du département.
Mme du Barry fit alors confidence à l’administration que toutes ses richesses, consistant en numéraire, argenterie et bijoux, étaient cachés dans différents endroits de sa maison, ce que les clubistes n’ignoraient pas, attendu qu’ils avaient été informés de ces faits par les nommés Salanave et Zamor ; que les malveillants étant, les uns officiers municipaux, les autres gardes nationaux, ne manqueraient pas de prétexte de fouiller son château si elle s’absentait ; qu’elle était également instruite qu’une femme, nommée la veuve Cottet, leur rendait compte de tout ce qui se passait chez elle et qu’en conséquence, il lui était impossible de rien enlever sans qu’ils en fussent instruits.
Le lendemain de cette conversation, Mme du Barry voulait aller demeurer à Versailles, pour se soustraire à l’œil vigilant des patriotes de Luciennes ; une furie, nommée Renault, se rendit au château pour s’informer si le fait était vrai.
Mme du Barry, entendant du bruit dans ses appartements, demanda à une de ses femmes de chambre quelle était donc la personne qui parlait si haut.
— C’est une femme, répondit la Renault qui entendit Mme du Barry faire la demande, qui était avant toi dans ce pays-ci et qui y sera encore après, entends-tu ?...
Le même jour, au club, à la séance du soir, il fut arrêté qu’il serait envoyé une députation à Versailles pour y dénoncer d’avance Mme du Barry auprès du comité révolutionnaire de cette commune, tandis que Blache, en sa qualité d’agent du Comité de sûreté générale, la dénoncerait de nouveau à Paris auprès dudit Comité dont les membres venaient d’être renouvelés.
La députation arriva à Versailles, se rendit au lieu des séances du Comité dont Zamor connaissait plusieurs membres.
Après avoir discuté le pour et le contre dans cette affaire, il fut convenu qu’il serait fait une pétition au Comité de sûreté générale, afin d’en obtenir une extension de pouvoirs qui empêchât le département de se mêler des arrestations ; d’un autre côté, que l’on dénoncerait trois membres de ce même département, notamment Lavallerie, protecteur de Mme du Barry.
Greive, ayant rédigé en conséquence une pétition, la fit signer aux membres du comité qui, le même jour, l’ayant fait passer à Paris à sa destination, reçurent sur-le-champ la plénitude de pouvoirs qu’ils demandaient.
Le département avait écrit au ministre des affaires étrangères à l’effet d’obtenir de lui la traduction des certificats qui avaient été délivrés à Londres à Mme du Barry.
Le ministre répondit qu’il n’avait pas vu sans étonnement que, dans ces actes, « on eût donné à ladite dame le titre de comtesse ». Ayant été instruite de ce fait, elle écrivit sur-le-champ à l’un des administrateurs la lettre suivante :
« Je viens d’être instruite, citoyen, que le ministre des affaires étrangères, en faisant passer à l’administration du département la traduction des certificats qui m’ont été délivrés à Londres, lui a observé qu’il n’avait pas vu sans étonnement que, dans ces actes, on m’eût donné le titre de comtesse ; je n’en suis pas moins étonnée que lui, et si j’avais eu connaissance de la forme dans laquelle ces certificats ont été expédiés, je n’aurais pas laissé subsister un titre qui blesse les lois de mon pays, lois auxquelles je resterai invariablement attachée ; je n’ai absolument aucune connaissance de la langue anglaise ; j’ai dû me fier à un Anglais pour la poursuite de mon procès et cette inadvertance a pu lui échapper facilement puisqu’il m’avait précédemment connue sous ce titre, qui n’était pas alors prohibé, qu’il a intenté et suivi l’action dont il était chargé ; ainsi, je n’ai en aucune manière participé à une erreur que je désavoue et contre laquelle je suis en droit, j’espère, de réclamer.
« J’espère que cette explication ne laissera aucun doute à l’administration sur la pureté de mes intentions et ma soumission aux lois ; je vous prie, citoyen, de vouloir bien la lui remettre sous les yeux et l’engager à ne pas différer sa décision dans une affaire qui me tient depuis longtemps en souffrance.
« Partagez avec tous ses membres les sentiments de mon estime et de ma reconnaissance.
« DU BARRY. »
Au milieu des angoisses que souffrait Mme du Barry, elle recevait encore quelques légères consolations. Les chevaliers d’Escourt et Labondie[38] ne la quittèrent pas et cherchèrent à la distraire de ses douleurs physiques et morales par la lecture des ouvrages relatifs à la Révolution écrits dans les bons principes (et dont un grand nombre a depuis été retrouvé chez elle).
L’amour reconnaissait encore son empire et, lorsque des scélérats cherchaient à faire tomber cette tête dont le malheur n’avait pu effacer les grâces, un de ses anciens chevaliers lui rendait hommage. On peut en juger par cette lettre à Mme du Barry, écrite par Louis-Antoine-Auguste de Rohan-Chabot, lieutenant-général :
« Je vous envoie, ma chère et tendre amie, le tableau que vous avez désiré, triste et funèbre présent, mais je le respecte autant que vous-même.
« J’ai envoyé chercher les trois portraits de vous : ils sont ici.
« J’ai gardé un des petits : c’est l’original de celui qui est habillé avec une chenille ou peignoir blanc, et coiffé d’un chapeau avec une plume ; le second est une copie de celui dont la tête n’est pas finie, mais dont l’habillement n’est qu’esquissé.
« Ils ne sont encadrés ni l’un ni l’autre ; le grand de Mme Lebrun est délicieux et d’une ressemblance ravissante, il est parlant et d’un agrément infini.
« Celui commencé par Letellier n’est qu’un crayonné, et la tête n’est à peine qu’une ébauche qui pourra devenir ressemblante ; je l’ai fait reporter chez le peintre.
« Quant à votre grand portrait et a la copie de celui que je garde, dites-moi, chère amie, si vous voulez que je vous les envoie, ou si je dois les faire reporter où ils étaient ; enfin, quelle destination vous voulez en faire.
« Je ne désire plus que d’en avoir un que je puisse porter sur moi et qui ne me quitte jamais.
« Venez donc, cher amour, passer douze jours ici ; venez dîner chez moi ; venez me procurer quelques instants de bonheur, il n’en est plus qu’avec vous ; venez voir un mortel qui vous aime au-delà de tout, jusqu’au dernier moment de sa vie ; je baise mille fois le portrait de la plus charmante des femmes qu’il y ait au monde, et dont le cœur, si noble et si bon, mérite un attachement éternel. »
Il paraît, par la date de cette lettre, qu’elle précéda de peu de temps les derniers efforts de Greive et de Zamor, et qu’ainsi les derniers accents d’un amant aussi tendre que respectueux se confondaient, pour cette infortunée, avec les horribles imprécations des scélérats qui la conduisirent à l’échafaud.
Greive était parvenu, je ne sais comment, à se procurer une copie d’un état des sommes payées pour le compte de Mme du Barry par Beaujon, banquier de la cour, à différentes personnes (état remis par Mme du Barry à Monvalier, son intendant, pour le revoir et le mettre en ordre). Greive s’empressa de le porter au Comité de sûreté générale de la Convention, pour donner aux membres qui la composaient la preuve qu’elle avait dilapidé le trésor de l’État.
En jetant les yeux sur cet état, on sera, il est vrai, effrayé du total, qui passe six millions de livres ; mais on observera que c’est durant six années et que le roi, qui donnait, un million par an à sa maîtresse, faisait moins pour elle qu’un fermier-général, qui payait les faveurs d’une danseuse plus de 100.000 livres.
Car, enfin, les rois de France, outre les revenus de l’État, avaient de grandes propriétés, et ils pouvaient disposer de revenus suivant leur fantaisie, malgré tout ce qu’on a dit et écrit à ce sujet.
Greive, à force de tourmenter les membres du comité, en obtint enfin l’ordre d’arrêter Mme du Barry. Il se rendit sur-le-champ à Louveciennes le dimanche 22 septembre, vers les huit heures du matin, accompagné de deux gendarmes de service près des tribunaux, du maire, de plusieurs officiers municipaux et du juge de paix.
Arrivé au château, il intime à Mme du Barry l’ordre dont il est porteur et ordonne au juge de paix de mettre les scellés sur les armoires, commodes, secrétaires, etc., ce qui, ayant été exécuté, il fait une liasse des papiers qu’il trouve, puis donnant le bras à Mme du Barry, il la fait monter dans une voiture publique appelée guinguette, qu’il avait amenée pour cet effet ; les gendarmes et lui-même y montent aussi.
En passant sous la machine de Marly, Greive apprit que le cabriolet du chevalier d’Escourt était dans cet endroit. Il fit descendre Mme du Barry de la guinguette et la plaça dans le cabriolet, à côté de lui ; les gendarmes restèrent dans la voiture.
On ne peut attribuer à l’humanité ce changement dans les dispositions de Greive, à qui on pourrait appliquer, comme à Bèse, les deux vers suivants de la Henriade :
Il eût cru faire un crime et trahir Médicis
Si du moindre remords il se sentait surpris.
Il faut donc être bien persuadé que s’il fit monter la comtesse dans une voiture plus commode, ce n’était point pour qu’elle fût moins mal, mais pour trouver un prétexte d’être seul avec elle, espérant peut-être l’engager à acheter encore la vie et la liberté.
Mais soit que Mme du Barry eût été comme étourdie de ce coup funeste, soit qu’elle eût trop d’horreur pour Greive, elle n’employa aucun moyen pour le gagner ; on assure même que, pendant la route, Mme du Barry ne dit pas un mot à son persécuteur.
Arrivée à Paris, elle fut déposée provisoirement dans la maison d’arrêt dite de Sainte-Pélagie, et ses papiers portés au Comité de sûreté générale.
Instruit que Mme du Barry, pour se distraire, s’occupait dans sa prison à lire les feuilles périodiques, il fit insérer dans plusieurs « que Mme du Barry avait été mise en liberté et ses biens confisqués au profit de la Nation ».
Cette annonce mensongère ranima le courage de Mme du Barry : elle se flattait qu’on lui ferait une pension alimentaire assez honnête pour finir ses jours tranquillement et être préservée des horreurs du besoin.
Greive apprit que Salanave venait d’être nommé membre du Comité révolutionnaire de Versailles, par les représentants du peuple en mission dans le département de Seine-et-Oise.
Il s’y rendit promptement et ils composèrent un procès-verbal qui prouve combien était adroit le rédacteur de cette pièce.
À l’en croire, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible.
Il approuve les opérations de ses affiliés, leur distribue des louanges jusqu’à satiété ; il remet entre les mains des assassins de la propriétaire du champêtre asile de Louveciennes, la totalité de son immense fortune ; il livre un lieu plus riche, en réalité, que le palais des Féeries à la garde d’un tas de calomniateurs et de pillards.
Les habitants de Louveciennes, qui avaient signé la première pétition, en firent une nouvelle au Comité de sûreté générale, pour obtenir la liberté de Mme du Barry.
Greive, instruit de cette démarche, ne manqua pas de se rendre à Paris, auprès des membres dudit Comité. Là, il apprit que les papiers de Mme du Barry avaient été remis entre les mains du nommé Héron pour les examiner et en faire ensuite un rapport au Comité.
Greive se transporta sur-le-champ dans le bureau de M. Héron, souhaitant avoir son avis sur l’état de l’affaire, de Mme du Barry.
Ayant vu l’embarras où était Héron pour inculper de crimes Mme du Barry, il se chargea lui-même de cette besogne et rédigea un tissu de mensonges qu’il intitula :
« Acte d’accusation. »
Il le remit à Héron qui eut la faiblesse d’en faire un rapport au Comité qui prit un arrêté.
Enfin, ces scélérats en étaient venus à leurs fins.
Mme du Barry fut interrogée par des juges qui ne cherchaient que des coupables.
La simplicité, la précision et la dignité des réponses de l’ancienne favorite donnent un poignant intérêt à cet interrogatoire.
INTERROGATOIRE SECRET SUBI PAR JEANNE VAUBERNIER, FEMME DU BARRY
« Ce jourd’hui, deuxième jour de frimaire, l’an II de la République, une heure de relevée, nous René-François Dumas, vice-président du tribunal révolutionnaire établi à Paris par la loi du 10 mars 1793, sans recours au tribunal de cassation, et encore en vertu des pouvoirs délégués au tribunal par la loi du 5 avril de la même année, assisté de Jacques Goujon, commis-greffier du tribunal, en l’une des salles de l’auditoire au Palais et en présence de l’accusateur public, avons fait amener de la maison d’arrêt dite Pélagie la nommée du Barry, à laquelle nous avons demandé ses noms, âge et profession, lieu de naissance et demeure.
« A répondu se nommer Jeanne Vaubernier, femme du Barry, âgée de quarante-deux ans, vivant de ses revenus, native de Vaucouleurs, ci-devant Lorraine, demeurant ordinairement à Louveciennes, département de Seine-et-Oise.
« D. – À quelle époque avez-vous commencé à être présentée à la cour ?
« R. – En 1769 ; j’y suis demeurée jusqu’en 1774.
« D. – Comment et sur quels ordres les sommes que vous avez dépensées dans cet intervalle vous étaient-elles payées ?
« R. – Sur des ordres particuliers que Louis XV donnait pour chaque paiement. Beaujon, banquier de la cour, est le seul qui m’ait fait des paiements. Il en avait reçu l’ordre de Bertin, ministre, qui l’avait chargé d’acquitter toutes les dépenses de ma maison sur des bons signés de moi.
« D. – N’avez-vous pas usé de votre position pour solliciter et faire accorder à vos protégés les emplois les plus importants de l’État ?
« R. – J’ai influencé et déterminé quelquefois le roi dans les choix qu’il a faits.
« D. – N’avez-vous pas sollicité et obtenu pour certains de vos protégés des pensions et des gratifications ?
« R. – Quelquefois ; mais je ne m’en rappelle pas assez pour pouvoir en donner les détails.
« D. – Depuis 1774, avez-vous eu des rapports avec la cour de Louis XVI ?
« R. – Je n’ai eu d’autre rapport immédiat sinon qu’à cette époque, devant une somme de deux millions sept cent mille livres, je fis au roi la demande de payer la dette ; mais ma demande étant restée sans réponse, je me déterminai, en 1782, à solliciter pour que des contrats de rente à 4 p. 100, à moi appartenant, me fussent, à concurrence d’un million, échangés contre des espèces, ce qui, m’ayant été accordé, avec ce million et le produit d’une partie de bijoux, vaisselle et tableaux que je vendis au roi, j’acquittai une partie de ma dette, dont il me reste encore à ce moment deux cent cinquante mille livres à payer.
« D. – Comment, n’ayant pu acquitter vos dettes en épuisant vos ressources, avez-vous pu suffire à faire face aux dépenses que vous avez faites depuis ?
« R. – Mes dépenses n’ont point été considérables ; il m’est resté quatre-vingt-dix mille livres de rentes viagères, placées sur l’Hôtel de Ville de Paris, dont les capitaux me proviennent des largesses de Louis XV.
« D. – Quelle était, en 1774, la valeur de votre mobilier, en bijoux, diamants, tableaux et meubles ?
« R. – Je n’en sais rien. J’ai évalué à 1.500.000 livres les diamants qui m’ont été volés en 1791, lesquels diamants n’étaient qu’une partie de ceux que j’avais possédés.
« D. – Depuis la Révolution, n’avez-vous pas conservé des rapports et des liaisons avec des personnes qui étaient attachées à la ci-devant cour ?
« R. – J’ai vu chez moi des personnes qui étaient attachées à cette cour, notamment MM. de Brissac, Beauvau et autres.
« D. – N’avez-vous pas reçu chez vous des émigrés rentrés ?
« R. – Non.
« D. – Je vous observe que vous avez donné asile à Laroche-Fontenille, prêtre émigré et agent des ennemis de la République.
« R. – Il a occupé une chambre dans ma maison, depuis le mois de juin 1792 jusqu’au mois de septembre suivant ; j’ignorais absolument qu’il eût émigré ni qu’il eût aucune intelligence avec les ennemis de la République.
« D. – N’avez-vous pas eu des correspondances avec Calonne et sa femme ?
« R. – Non. Je crois seulement avoir reçu de Mme de Calonne une lettre à laquelle je n’ai point répondu.
« D. – N’avez-vous pas fait plusieurs voyages en Angleterre ?
« R. – J’y ai fait quatre voyages.
« D. – Quelles étaient les causes desdits voyages ?
« R. – De suivre un procès relatif au vol de mes diamants qui m’avait été fait.
« D. – Quelles sont les époques de votre retour en France ?
« R. – Le premier voyage, je partis le 17 février 1791 et suis rentrée le 2 mars suivant. Le second, je suis partie le 4 avril et rentrée le 12 suivant. Le troisième, le 14 du même mois et suis revenue le 14 août suivant. Enfin, le quatrième et dernier, je suis partie le 14 octobre et suis rentrée le 4 mars dernier. J’ai fait les trois premiers voyages avec des passeports de la mairie de Paris et du ministre Montmorin ; pour le quatrième, j’avais un passeport de la municipalité de Louveciennes, visé par l’administration de Seine-et-Oise.
« D. – Vous deviez avoir connaissance des lois contre les émigrés ; pourquoi ne vous y êtes-vous pas conformée ?
« R. – J’en avais connaissance par les papiers publics et par une lettre de mon banquier ; mais j’ai pensé qu’elles ne pouvaient m’être applicables puisque j’étais partie pour affaire, munie de passeports en règle.
« D. – Avez-vous pris la peine d’examiner la loi sur les émigrés lorsqu’elle vous a été connue ?
« R. – Je m’en suis référée à mes gens, qui m’ont dit qu’à raison de mes passeports, la loi ne pouvait m’atteindre.
« D. – Avez-vous fréquenté, à Londres, les émigrés français ? Quels sont ceux que vous y avez vus particulièrement ?
« R. – J’y ai vu quelquefois M. de Crussol et sa femme, le prince de Poix, M. et Mme de Calonne et Frondeville, ci-devant président au Parlement de Rouen.
« D. – N’avez-vous pas fourni à ces émigrés français différentes sommes ?
« R. – J’ai remis à Frondeville vingt-deux guinées et il me les a rendues dans les vingt-quatre heures.
« D. – Quelle disposition avez-vous faite de cent trente-quatre guinées que vous avez dû toucher à Londres ?
« R. – J’ai chargé ce ci-devant évêque de Dombes, Chauvigny, et la dame de Crussol d’en toucher chacun quarante-cinq et un Anglais d’en toucher le restant ; ledit évêque et la dame Crussol devaient faire passer à mon banquier lesdites sommes ; j’ignore si elles lui sont parvenues, n’en ayant point entendu parler depuis.
« D. – Je vous observe que votre réponse ne se concilie pas avec le dessein de vous faire rendre ces sommes par simple commission. Il paraît, au contraire, que c’était un don ou prêt.
« R. – Lorsque j’ai fait cette disposition, c’était pour obtenir plus facilement le paiement, attendu que j’avais déclaré à ma débitrice que je devais à la dame Crussol et à M. l’évêque Chauvigny les sommes qu’ils devaient toucher.
« D. – Avez-vous retiré des reçus desdites sommes ?
« R. – J’en ai un de la dame Crussol, mais je ne crois pas en avoir reçu de M. de Chauvigny.
« D. – Qui sont ceux qui vous ont fourni de l’argent pour vos différents voyages à Londres ?
« R. – M. Vandenyver, mon banquier.
« D. – Quelles sont les sommes qu’il vous a remises ?
« R. – Une lettre de crédit de six mille livres sterling lors de mon premier voyage.
« Pour le second, une lettre de cinquante mille livres sterling que Vandenyver avait en mains de sûreté, équivalentes aux avances qu’il faisait, étant dépositaire d’actions de la Caisse d’Escompte, que j’avais acquises avec le produit du remboursement des contrats à concurrence d’un million dont j’ai parlé dans mes réponses précédentes.
« D. – Je vous observe que vous avez déclaré que ce million avait été employé par vous à acquitter vos dettes ; – conséquemment aucune partie de cette somme ne pouvait rester à votre disposition.
« R. – Tout n’a pas été employé à l’acquit de mes dettes ; Vandenyver a en dépôt, à moi, des actions de la Caisse d’Escompte dans la concurrence de quatre à cinq cent mille livres.
« Je ne sais ce qui lui en reste, n’ayant point réglé mon compte avec lui.
« D. – N’avez-vous pas eu dessein, étant à Londres, de placer une somme deux cent mille livres ?
« R. – Étant à Londres, j’ai placé deux cent mille livres à la disposition de M. de Rohan-Chabot, moyennant des hypothèques.
« D. – Je vous observe que ce même prêt a dû être fait au ci-devant évêque de Rouen.
« R. – J’ignore comment Vandenyver a pu me parler d’un homme que je ne connaissais pas ; au surplus, les dispositions au placement desdites deux cent mille livres ont dû être trouvées chez moi.
« D. – Comment se fait-il qu’étant à Londres, vous ayez fait retirer des mains de Vandenyver une somme de deux cent mille livres et que vous ayez employé, dans ce prétendu placement, des personnes autres que celles qui faisaient ordinairement vos affaires ?
« R. – Je me suis servie de M. d’Escourt, ci-devant militaire, parce que ce fut lui qui m’écrivit à Londres pour me proposer ce placement.
« D. – Pourquoi avez-vous entretenu des correspondances avec les ennemis de la Révolution ?
« R. – Je n’en ai point entretenu avec de telles personnes.
« D. – Je vous observe qu’il existe de vous une correspondance avec des émigrés, qui sont les ennemis du peuple français, et avec les conspirateurs de l’intérieur.
« R. – J’ai reçu quelques lettres, mais je n’en ai écrit aucune aux émigrés.
« D. – N’avez-vous pas été chargée de faire parvenir à des personnes que vous connaissiez des lettres sans adresses ?
« R. – J’ai été chargée par M. d’Angivilliers, lors de mon second voyage à Londres, de remettre à Mme de Calonne une lettre qu’elle a déployée et qui est restée dans ses papiers.
« D. – Comment vous êtes-vous procuré deux lettres signées « Custine », chargé d’affaires à Berlin ?
« R. – Je n’en sais rien : je crois les avoir emportées de l’hôtel de Brissac, où elles étaient sur le bureau ; j’ignore qui les avait déposées.
« D. – Je vous observe que le prétendu procès que vous dites avoir déterminé vos voyages en Angleterre n’en était que le prétexte : il paraît, au contraire, que vous y avez été chargée d’entretenir des intelligences avec les ennemis de la République.
« R. – Je n’ai eu aucune intelligence de cette nature.
« D. – Je vous interpelle de déclarer avec vérité si vos voyages à Londres n’avaient pas pour objet une mission secrète et des intelligences avec nos ennemis ou avec la cour de Londres, et si notamment, dans votre dernier voyage, vous n’avez point su que votre séjour à Londres avait le caractère de l’émigration ? Enfin, n’avez-vous pas entretenu des correspondances avec les ennemis de la liberté et ne leur avez-vous pas prêté des secours d’argent ou d’autres ?
« R. – Non.
« D. – Avez-vous un défenseur ?
« R. – J’ai fait choix des citoyens Delainville et Lafleuterie.
« Lecture faite du présent interrogatoire, a dit que ses réponses contenaient vérité, qu’elle y persistait et a signé avec nous, l’accusateur public et le greffier.
« Dumas, Jeanne Vaubernier du Barry
A.-G. Fouquier, Goujon. »
Mme du Barry, pendant son séjour à la Conciergerie, logea dans la même chambre que la reine avait occupée.
Lorsque cette princesse vint à la cour de France, que son premier coup d’œil sur Mme du Barry fut de bienveillance, qu’ensuite des propos inconsidérés de la favorite changèrent cette disposition favorable en haine de la part de Marie-Antoinette, elles étaient loin l’une et l’autre d’imaginer qu’un même sort les attendait, que l’une viendrait habiter dans une affreuse prison la chambre dont l’autre avait été arrachée pour être conduite au supplice.
La femme Richard, épouse du concierge, eut pour Mme du Barry les attentions les plus affectueuses.
Ayant envoyé, à sa demande, une personne de Louveciennes pour savoir l’état des choses et ce qui se passait, elle apprit que M. Lavallerie, désespéré de l’injustice qui se commettait envers elle, s’était jeté dans la Seine, au pont de Marly ; que le château et le pavillon étaient à la disposition de Greive ; des cartons dans lesquels étaient des dentelles d’un grand prix disparaissaient tous les jours, pendant que les hommes de garde mettaient la cave à contribution ; que Zamor, naguère expulsé de la maison, y était absolument en maître ; et mille détails affligeants qui portaient dans l’âme de Mme du Barry de plus grands troubles.
L’accusateur public, sachant que l’acte d’accusation était rédigé, fit venir Greive et lui en donna lecture. Il fut adopté après quelques légères modifications, ainsi qu’une liste de témoins à entendre que Greive avait faite.
Héron fut également consulté pour ce qui concernait M. Vandenyver.
Le 13 frimaire, l’acte fut lu et adopté à la Chambre du conseil.
Le 16, les accusés étaient amenés à l’audience et interrogés par le vice-président, ainsi qu’il suit :
« D. – Vous, accusée, qui êtes assise au fauteuil, quels sont vos nom, âge, profession, lieu de naissance et demeure ?
« R. – Jeanne Vaubernier, âgée de quarante-deux ans, née à Vaucouleurs, vivant de mes revenus, demeurant ordinairement à Louveciennes.
« D. – N’êtes-vous pas la femme du ci-devant comte du Barry ?
« R. – Nous sommes séparés de droit.
« D. – Second accusé, votre nom ?
« R. – Jean-Baptiste Vandenyver, âgé de soixante-six ans, banquier hollandais, né à Amsterdam, demeurant à Paris, 24, rue Vivienne. »
Le troisième accusé a dit se nommer Edme Vandenyver, âgé de trente-deux ans, et le quatrième Antoine Vandenyver, vingt-neuf ans, demeurant à Paris, chez son père.
Le vice-président : « – Accusée, soyez attentifs, on va donner lecture de l’acte d’accusation dressé contre vous. »
Et le greffier fit lecture de l’acte.
L’on procéda à l’audition des témoins.
« Georges Greive, âgé de quarante-cinq ans, homme de lettres, dépose « qu’il est à sa connaissance que l’accusée du Barry a empêché le recrutement à Louveciennes, qu’il a trouvé dans la nuit du 22 septembre dernier, jour de son arrestation, une quantité considérable d’argenterie, dans un endroit servant à recevoir les outils du jardinier et vers un grand chemin le fameux service d’or ; et, dans un autre endroit, enfouis des louis, des écus de six livres ; plus des bronzes, le buste de Louis XV, etc. ; que décadi dernier, il a trouvé dans un tas de fumier une quantité de pierreries, de l’or et de l’argent, et, depuis peu de jours, les portraits du régent et d’Anne d’Autriche, etc.
« Observe le déposant que Fournier, juge de paix du canton, a dressé procès-verbal des objets qui ont été trouvés.
« Dans les jardins, il a découvert un gland servant à un cordon de montre ; il ajoute que Forth, espion anglais, est venu à Paris en 1777 pour suivre les opérations de Franklin.
« Il faisait des voyages de Paris à Londres et de Londres à Paris.
« Il a été récompensé des mouvements qu’il s’était donnés dans la guerre d’Amérique par une pension considérable.
« Nous avons trouvé dans les papiers de l’accusé une lettre qui indique la signature rayée de Forth.
« Je l’ai vu fréquenter l’accusée qui, ayant plusieurs domiciles à Paris, y recevait des émigrés ou des partisans de ceux-ci.
« À l’égard des diamants de 1791, l’opinion générale, dans Louveciennes, est que le vol était prétendu.
« Le vice-président à l’accusée. – Avez-vous reçu chez vous Forth ?
« R. – Oui.
« D. – Vous avez déclaré dans votre premier interrogatoire que, lors de votre retour en mars 1793, votre procès était fini ; or, je vous demande pourquoi le certificat portait qu’il y avait nécessité que vous retournassiez en Angleterre ?
« R. – C’était pour recevoir mes diamants et payer les frais.
« Le témoin ajoute que l’accusée en a imposé à la Convention, afin d’obtenir une permission d’aller en Angleterre en prétendant que ses bijoux, soi-disant volés, étaient le seul gage de ses créanciers, tandis qu’elle possédait des trésors immenses : 150.000 livres de rentes sur l’Hôtel de Ville de Paris ; cent quatre-vingt-dix actions de la Caisse d’Escompte, de la valeur de sept à huit cent mille livres, des diamants, des pierres précieuses, etc. »
On entend un autre témoin.
« Xavier Audouin, adjoint au ministre de la guerre, dépose que quelques jours après le 10 août 1793, parcourant avec la force armée la forêt de Saint-Germain-en-Laye, il fut averti que le château de Louveciennes était rempli de ci-devant seigneurs de la cour.
« S’y étant transporté, l’accusée leur fit donner des rafraîchissements et leur dit n’avoir personne chez elle ; que lui ayant demandé ce que contenait une chambre dont la porte était fermée, elle répondit que c’était du linge sale, qu’elle ne savait où était la clef.
« Ses tergiversations ayant paru suspectes, on fit ouvrir la porte de ladite chambre, dans laquelle on trouva couché un jeune homme nommé Maussabré ; que l’accusée prit un grand intérêt à ce jeune homme ; voyant que l’on était décidé à le conduire à Paris, elle offrit sa voiture pour l’y transporter ; elle parut même attendrie lorsque ce Maussabré se mit à dire : « Que si on l’envoyait à Paris, il serait massacré. »
« Depuis, il s’est présenté plusieurs fois chez lui un certain chevalier d’Escourt pour obtenir la liberté dudit Maussabré, ce à quoi il ne voulut pas consentir, attendu que ce particulier, lorsqu’il fut arrêté chez l’accusée, ne s’était muni d’aucune pièce qui indiquât qu’il fût patriote. »
On continue l’audition.
« Jean-Baptiste Blache, commissaire du Comité de sûreté générale, dépose avoir vu l’accusée lors de son premier voyage à Londres, le lendemain de son arrivée, montée avec le nommé Forth, espion anglais, qui, lors de la guerre d’Amérique, vint à Paris avec milady Barymore pour la prostituer au comte d’Artois et à d’Orléans, à la seule fin de faire, par ce canal, former une division entre la France et l’Amérique ; que, de leur compagnie, était un homme d’un certain âge, qu’on lui a dit se nommer de Pons, ex-Constituant ; que, dans ce premier voyage, l’accusée prit un logement chez un Français nommé Grenier.
« Le second voyage de l’accusée se fit encore à Londres, peu de temps après son retour en France. Elle fut logée dans « Marguerite Street Oxford ». Là, elle recevait tous les émigrés de la haute classe, notamment la femme Calonne.
« Lors de son troisième voyage, l’accusée fut rendre visite au citoyen Saint-Far, frère putatif de d’Orléans, qui venait de louer un hôtel garni à « Boulton Street Barks Square » pour Bouillé. Comme ce dernier n’arrivait point, cet hôtel fut cédé par Saint-Far à l’accusée.
« Au mois de janvier 1793, l’accusée, après la mort de Capet, prit le deuil avec le plus grand faste anglais ; elle fut à tous les services célébrés dans les chapelles des puissances ennemies de la République.
« Observe le déclarant que, forcé de quitter l’Angleterre par ordre arbitraire du roi, il repassa en France ; qu’ayant été chargé par le Comité de sûreté générale de plusieurs opérations importantes, lesquelles lui suscitèrent différents voyages à Louveciennes, invité de la part de l’accusée à prendre un gîte chez elle, il accepta.
« Causant avec elle, il lui parla des voyages qu’elle avait faits à Londres et des personnes qu’elle avait fréquentées, ajoutant qu’il savait qu’elle avait entretenu des correspondances criminelles avec elles, à quoi l’accusée lui avait répondu : « Oui, c’est vrai… Mais je n’entretins avec eux que des liaisons et rien de plus. »
« Que le déposant lui mit sous les yeux la loi du mois de mars, qui punit de mort tout particulier qui a des correspondances directes ou indirectes avec les ennemis de la République ; que, le lendemain, l’accusée fit servir un déjeuner aux officiers municipaux de Louveciennes où il fut invité à se rendre ; que l’accusée ayant fortement poussé ces officiers de déclarer pourquoi ils avaient arrêté le nommé Labondie, ceux-ci ayant déclaré qu’ils ne le connaissaient pas, l’accusée et son valet de chambre les invitèrent à consigner cette déclaration dans une lettre qui fut écrite par lui, déposant, et signée par lesdits officiers municipaux. Le soir même, Labondie sortit de prison.
« Que Salanave, chef d’office de l’accusée, ayant raconté à lui déposant, ce qu’était Labondie et lui ayant dit qu’il était un ci-devant qui avait été commissaire de la marine à Rochefort, dont les parents étaient émigrés, qu’il était venu de ce dernier endroit vraisemblablement avec un faux passeport, lequel était visé à Paris par la municipalité, un mois avant la date de Rochefort, il y avait tout lieu de croire qu’il était mal intentionné.
« Ajoute le déposant que s’étant de nouveau rendu à Louveciennes, l’accusée l’envoya chercher ; s’y étant transporté, il y trouva la Rohan-Rochefort qui lui dit qu’elle était bien aise de le voir. « Mon fils Charles, ajouta-t-elle, vous aime beaucoup. »
« — J’en suis fâché, Madame, lui répondis-je, votre fils est un faux patriote ! Souvenez-nous qu’il souffre qu’on l’appelle prince et qu’il vous qualifie de princesse.
« — Oui, répondit-elle… mais c’est une plaisanterie que nous faisons ensemble.
« — Des gens comme vous, Madame, objectai-je, ne plaisantent pas avec des titres que vous avez portés, et, quand il n’y a plus de rois, il n’y a plus de princes. »
Le vice-président demande à l’accusée :
« — Qu’avez-vous à répondre à la déclaration du témoin ?
« L’accusée. – J’ai à répondre que j’ai effectivement vu à Londres Mmes Calonne et Mortemart, mais toutes nos relations se bornaient au ton de l’amitié.
« D. – Avez-vous porté à Londres le deuil de Capet ?
« R. – J’ai porté une robe noire parce que je n’en avais emporté aucune d’autre couleur.
« D. – Avez-vous sollicité l’élargissement de Labondie ?
« R. – Je l’ai sollicité parce qu’il avait été arrêté chez moi comme suspect. »
On entend un autre témoin.
« Louis-Marguerite-Bernard Escourt, ancien capitaine de cavalerie, actuellement détenu à la Force, déclare connaître Mme du Barry, ainsi que Vandenyver père et l’aîné des fils.
« Il y a environ deux ans qu’il a fait connaissance de l’accusée, mais il a été rarement chez elle.
« Elle lui écrivit de Londres de lui servir de procureur fondé et d’aller chercher 200 000 livres chez Vandenyver, qui les a prêtées à Rohan-Chabot, alors logé rue de Seine. »
Dumas à l’accusé Vandenyver :
« — Étiez-vous convenu avec votre coaccusée du Barry que vous lui avanceriez 200 000 livres ?
« L’accusé. – Oui.
« D. – Depuis quelle époque ?
« R. – Le mois de novembre 1792.
« D. – Le témoin vous a-t-il dit que cette somme était destinée à Rohan-Chabot ?
« R. – Je crois qu’il me l’a dit.
« D. – Mais vous ne deviez pas ignorer les lois qui défendent de disposer d’aucun fonds appartenant aux émigrés ; or, la du Barry était alors à Londres.
« R. – C’est juste, mais elle avait un passeport pour y aller. »
L’audition se poursuit.
« François Salanave, ci-devant officier chez l’accusée, actuellement employé au Comité de surveillance de Versailles, dépose avoir vu venir chez la du Barry : Lavaupalière, Brissac, Labondie, d’Escourt, le ci-devant marquis Donnissan, l’ex-vicomte de Pons, la ci-devant marquise de Brunoy, la ci-devant duchesse de Brancas, avec laquelle elle a fait le voyage de Londres et qui, depuis, y est restée.
« Ajoute qu’en sa qualité de patriote, il était mal vu par les autres domestiques de la maison, qui étaient aristocrates et qui l’ont même desservi dans l’esprit de l’accusée qui l’a renvoyé de chez elle.
« L’accusée. – J’ai à dire sur cette déposition que la dame de Brancas n’a point émigré ; au contraire, elle a même été de retour en France plus tôt que moi. Quant au témoin, je ne l’ai pas mis à la porte pour ses opinions, mais à cause d’une infinité de porcelaines qui disparaissaient journellement de chez moi. »
Un autre témoin est entendu :
C’est Louis-Benoit Zamor, âgé de trente et un ans, né au Bengale, dans l’Inde, employé au Comité de salut de Versailles.
« Déclare avoir été élevé chez la du Barry depuis l’âge de dix ans, qu’il fut amené en France par un capitaine de navire ; que voyant les journaux patriotes parler souvent d’elle d’une manière un peu leste, il lui avait conseillé de faire le sacrifice d’une partie de sa fortune envers la nation pour conserver l’autre ; que l’accusée, bien loin de prendre en considération ses sages avis, continua de recevoir chez elle des aristocrates, ce qu’il jugea en les voyant applaudir les échecs des armées de la République ; qu’il fit de nouveau, à ce sujet, des observations à l’accusée qui ne daigna pas même avoir l’air d’y faire attention.
« Au contraire, ajoute Zamor, ayant appris que je fréquentais un ancien ami de Franklin et de Marat, et que j’étais très lié avec les patriotes Blache, Salanave, Frémont et un très grand nombre d’autres, elle se permit de dire avec un ton impérieux qu’elle ne me donnait que trois jours pour sortir de sa maison.
« L’accusée. – Il est faux que je recevais chez moi des aristocrates ; quant aux avis que le témoin dit m’avoir donnés, je n’en avais point à recevoir de lui.
« À l’égard de son expulsion, elle a eu lieu rapport aux fréquentations des personnes qu’il vient de nommer. »
Jean Thénot, instituteur à Luciennes, dépose avoir servi pendant cinq ans l’accusée en qualité de domestique et lui avoir entendu dire, en 1789, à l’époque de la mort de Foulon et de Berthier, que le peuple était « un tas de misérables et de scélérats ».
« L’accusée. – Le fait est faux. C’est une affreuse perfidie. »
Plusieurs témoins sont successivement entendus. Henriette Briard, femme Couture, dépose être depuis vingt-trois ans au service de l’accusée et l’avoir accompagnée dans ses voyages à Londres.
Marie-Anne Labitte, tapissière à Louveciennes, déclare qu’il est à sa connaissance que lors de l’arrestation de Brissac, l’accusée passa la nuit à brûler des papiers.
« L’accusée. – Je n’ai brûlé aucun papier. »
Après un nouvel interrogatoire de Vandenyver, le vice-président Dumas prononce son résumé :
« Citoyens jurés, dit-il, vous avez prononcé sur les complots de l’épouse du dernier tyran des Français, vous avez à prononcer en ce moment sur les conspirations de la courtisane de son prédécesseur.
« Vous voyez devant vous cette Laïs célèbre par la dissolution de ses mœurs, la publicité et l’éclat de ses débauches, à qui le libertinage seul avait fait partager les destinées du despote qui a sacrifié les trésors et le sang des peuples à ses honteux plaisirs.
« Le scandale et l’opprobre de son élévation, la turpitude et la honte de son infâme prostitution, ne sont pas ce qui doit fixer votre attention.
« Vous avez à décider si cette Messaline, née parmi le peuple, enrichie des dépouilles du peuple qui payait l’opprobre de ses mœurs, descendue par la mort du tyran du rang où le crime l’avait placée, a conspiré contre la liberté et la souveraineté du peuple.
« Après avoir été la complice et l’instrument du libertinage des rois, elle est devenue l’agent des conspirateurs, des tyrans, des nobles, des prêtres contre la République.
« Les débats, citoyens jurés, ont déjà jeté sur cette conspiration le plus grand jour. Vous avez dû saisir le trait de lumière que les dépositions des témoins et ses pièces ont fourni sur le vaste complot, sur cette conjuration exécrable dont les annales des peuples ne fournissent point d’exemple. Et jamais affaire plus importante ne s’est présentée à votre décision puisqu’elle vous offre, en quelque sorte, le nœud principal des trames de Pitt et de tous ses complices contre la France. Il convient donc de remettre sous vos yeux les détails de cette conspiration et la part qu’y ont prise la courtisane du despote et ses complices.
« Tel est, citoyens jurés, le résultat des débats qui ont eu lieu : c’est à vous de les peser dans votre sagesse.
« Vous voyez que royalistes, fédéralistes, toutes factions divisées en apparence, ont le même centre, le même objet, le même but. La guerre extérieure, celle de Vendée, les troubles du Midi, l’insurrection départementale du Calvados, tout a le même principe, le même chef, d’Artois… Pétion…
« L’infâme conspiratrice qui est devant vous pouvait, au sein de l’opulence acquise par ses honteuses débauches, vivre heureuse dans une patrie qui paraissait avoir enseveli avec le tyran le souvenir de sa prostitution.
« Mais la liberté du peuple a été un crime à ses yeux : il fallait qu’il fût esclave, qu’il rampât sous les maîtres et que le plus pur de la substance du peuple fût consacré à payer ses plaisirs. »
Le vice-président Dumas pose ensuite les questions.
Les jurés et les accusés se retirent.
Après avoir été environ cinq quarts d’heure aux opinions, les jurés rentrent à l’audience et font leurs déclarations après lesquelles les accusés ayant été ramenés, le jugement suivant est intervenu après que l’accusateur public a été entendu :
JUGEMENT
« Le tribunal, d’après la déclaration du juré de jugement faite à haute voix, portant qu’il a été pratiqué des machinations et entretenu des intelligences avec les ennemis de l’État et leurs agents pour les engager à commettre des hostilités, leur indiquer et favoriser les moyens de les entreprendre, et diriger contre la France, notamment en faisant à l’étranger, sous des prétextes préparés, divers voyages pour concerter ces plans hostiles avec ces ennemis, en leur fournissant, à eux ou à leurs agents, des secours en argent ;
« Que Jeanne Vaubernier, femme du Barry, demeurant à Louveciennes, ci-devant courtisane, est convaincue d’être l’un des auteurs ou complices de ces machinations ou intelligences ;
« Ouï l’accusateur public en ses conclusions sur l’application de la loi ;
« Condamne ladite JEANNE VAUBERNIER, femme DU BARRY, lesdits Jean-Baptiste VANDENYVER, Edme-Jean-Baptiste VANDENYVER et Antoine-Augustin VANDENYVER à la PEINE DE MORT, conformément à l’article 1er de la première section du Titre premier de la deuxième partie du Code pénal, dont il a été fait lecture et laquelle est ainsi conçue : « Quiconque sera convaincu d’avoir pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou avec leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités ou pour leur indiquer les moyens d’entreprendre la guerre contre la France, sera puni de mort, soit que ces machinations ou intelligences aient été ou non suivies d’hostilités. »
« Déclare les biens desdits femme du Barry, Jean-Baptiste, Edme-Jean-Baptiste et Antoine-Augustin Vandenyver acquis au profit de la République, conformément à l’article 2 du Titre II de la loi du 10 mars 1793, dont il a été fait lecture, lequel est ainsi conçu :
« Les biens de ceux qui seront condamnés à la peine de mort seront acquis à la République, et il sera pourvu à la subsistance des veuves et des enfants s’ils n’ont pas de biens ailleurs. »
« Ordonne qu’à la diligence de l’accusateur public, le présent jugement sera exécuté dans les vingt-quatre heures sur la place de la Révolution de cette ville, imprimé et affiché dans toute la République.
« Fait et jugé en audience publique, le 17 frimaire an deuxième de la République. »
Dumas ayant ensuite ordonné aux gendarmes d’emmener les condamnés, Mme du Barry, voyant les principaux témoins entendus contre elle et présents à l’audience à ce moment se frotter les mains pendant le prononcé ci-dessus pour marquer la satisfaction qu’ils avaient de la voir condamnée à mort, se trouva tellement faible qu’elle ne pouvait se soutenir ; deux gendarmes la prirent par-dessous les bras pour la reconduire en prison.
L’effroi de la mort avait fait une telle impression sur Mme du Barry que, ne sachant comment échapper au supplice, elle employa un moyen qui ne la sauva pas et entraîna dans sa perte ses plus fidèles amis.
Elle imagina qu’en déclarant exactement tout ce qu’elle avait cru devoir dérober à la rapacité des brigands, on lui ferait grâce ; mais, hélas ! elle ne put triompher de la cruauté de ses ennemis, qu’elle eût bien mieux fait d’acheter que de leur apprendre aussi indiscrètement des secrets qu’on ne peut se dissimuler que la reconnaissance et l’amitié eussent dû faire garder à la comtesse : mais, je le répète, la mort était pour elle ce qu’elle imaginait de plus horrible, et rien de ce qui pouvait l’y soustraire ne se présentait à son imagination effrayée comme un mal.
Pendant que Mme du Barry faisait sa déclaration, Greive et plusieurs autres témoins entendus au procès étaient à déjeuner avec Héron à la buvette intérieure du tribunal, et s’exprimaient ainsi sur les condamnés : « En attendant, disaient-ils, de voir cette dame et ces messieurs dans le panier aux œufs rouges », et autres effroyables plaisanteries.
À peine Mme du Barry vit-elle la fatale voiture qui devait la conduire, ainsi que MM. Vandenyver et Noël, au lieu du supplice, que la fermeté qu’elle avait paru conserver jusqu’à ce moment l’abandonna, et la mort la marquant de son doigt redoutable effaça avant son heure dernière les roses de son teint.
Déjà la pâleur s’étend sur ses traits et la rend méconnaissable à ceux qui, peu de mois avant, admiraient encore l’éclat de sa beauté.
Une foule immense s’était placée sur la route, plutôt par curiosité que par haine ; cette multitude, qui se pressait sur les traces de son horrible char, semblait lui faire un devoir de suivre l’exemple que tant d’autres femmes avaient donné avant elle.
Mme du Barry aurait dû, comme ces illustres victimes, paraître s’élancer avec joie au-devant d’un trépas dont la cause était glorieuse, et au moins ravir aux tyrans qui désolaient alors la France le plaisir qu’ils trouvaient à s’abreuver de sang et de larmes.
Mais celle qui n’avait jamais pensé que le terme fatal ne peut s’éviter et que le travail de toute la vie est d’apprendre à mourir, ne put supporter l’aspect de la mort qui, il est vrai, se présentait à elle sous la forme la plus effrayante.
Aussi les soupirs qu’elle ne pouvait étouffer, ces regards éteints qu’elle laissait errer sur ce qui l’entourait, tout prouvait qu’elle sentait les douleurs de l’agonie.
En vain, MM. Vandenyver, qui lui avaient des obligations et dont, en échange, elle avait reçu des services, la suppliaient de rappeler ce qu’elle pouvait avoir de constance pour supporter un mal inévitable ; leur ancienne amitié pour la comtesse, la confiance que leurs qualités estimables devaient lui donner de leurs discours, rien, rien ne put lui faire surmonter les regrets qu’elle éprouvait, en pensant que dans une heure elle ne serait plus ; et c’est avec une peine extrême qu’elle retenait les larmes qui bordaient ses paupières.
En vain Noël, conventionnel, que l’on traînait au supplice comme ayant, disait-on, conspiré, l’engageait à quitter avec tranquillité une vie qui ne pouvait être heureuse tant que la terreur planerait sur l’empire ; elle n’entendait qu’un vain bruit et les paroles les plus éloquentes n’atteignaient point ses pensées lorsque, tout à coup, arrivée à la barrière des Sergents, elle leva les yeux et aperçut le balcon de la maison de Mme Bertin, où toutes ses ouvrières s’étaient placées pour voir encore une fois Mme du Barry.
Soit que la réunion de ces jeunes filles lui rappelât son premier état, où, si elle fût demeurée, elle eût été à l’abri de la hache révolutionnaire, soit qu’elle regrettât presque autant les délicieuses parures qui sortaient des mains de ces jeunes filles, elle se mit à jeter les hauts cris.
Les pauvres petites en furent si touchées qu’elles se retirèrent avec précipitation, ne pouvant supporter le spectacle du malheur de celle dont l’étonnante fortune avait été plus d’une fois le rêve brillant de leur imagination.
Quoi qu’il en soit, la douleur de la comtesse avait un caractère si déchirant que l’officier de gendarmerie, craignant que le peuple, dont on doit toujours appréhender les caprices, après avoir tranquillement laissé conduire le roi et la reine au supplice, ne s’ameutât pour sauver la maîtresse de Louis XV, ordonna de hâter la marche des condamnés, donnant à la crainte d’une révolte ce qu’on n’accordait pas à la pitié pour les infortunés que l’on conduisait ordinairement à l’échafaud au petit pas, pour qu’ils servissent plus longtemps de spectacle au peuple.
Enfin, arrivée sur la place de la Révolution, on la fit descendre la première.
On assure alors que sa douleur devint si vive que sa raison en fut altérée et qu’elle s’écria, en se voyant dans les mains du bourreau :
— À moi ! À moi !
Puis, revenant à elle, elle s’adressa à l’exécuteur avec cette voix douce et persuasive qui n’avait jamais été refusée et lui dit :
— Encore un moment, Monsieur, je vous en prie !
Mais, sourd comme l’affreuse déité dont il était le ministre, il ne paraît pas entendre les mots que sa belle bouche lui adresse : il saisit l’infortunée du Barry et, sans pitié pour les formes enchanteresses qui conservaient leurs délicieux contours, il la jette sur l’affreuse bascule, et cette tête, que sa beauté avait placée si près du trône, tombe sous la hache qui avait terminé le sort de notre dernier roi et de son auguste épouse.
Ainsi, tout nous conduit où le destin a marqué le but de la carrière.
Il nous était, il est vrai, libre d’éviter les routes dangereuses, mais il était écrit que nous ne les éviterions pas.
Et ainsi nous avons vu la jeune Vaubernier, dans son adolescence, parcourir les sentiers fleuris de la volupté ; dans sa jeunesse, suivre les routes tortueuses de la politique ; dans l’âge mûr, goûter les charmes de l’amitié dans une retraite délicieuse, la quitter pour recouvrer une partie d’une immense fortune, et, par cette imprudence, donner un prétexte plausible aux brigands sanguinaires qui gouvernaient alors sa patrie, de l’assassiner juridiquement pour s’emparer de ses trésors ; mais tout était prévu, et rien, non, rien ne pouvait retarder d’un instant celui où cette belle femme devait terminer son sort.
On assure que Curtius, connu par la perfection avec laquelle il modelait en cire coloriée, obtint la permission de conserver par ce procédé les traits de Mme du Barry et que ce fut dans le cimetière même de la Madeleine qu’il exécuta ce projet.
Nous ne croyons pas, cependant, que ce portrait puisse être fort ressemblant ; la contraction des muscles dans la surprise ou la colère change entièrement les traits ; à bien plus forte raison les convulsions de la mort, et d’une mort aussi violente, doivent-elles détruire tout ce qui caractérisait la physionomie dans le calme des passions ou dans le repos du bonheur.
Mais il n’en est pas moins précieux par la célébrité de celle qu’il représente, même imparfaitement.
Lorsque Curtius eut terminé son travail, on réunit cette tête aux restes infortunés de Mme du Barry et on l’enterra à deux toises de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de Louis-Philippe-Joseph d’Orléans, de Charlotte Corday, d’Adam Lux, de Vergniaud, de la femme Roland, de Claude Fauchet, du maire Bailly, du jeune Cirey, député, de Laverdy, de Rabaud-Saint-Etienne, Kersaint, etc., etc.
Immédiatement après l’exécution, Greive se rendit en voiture à Louveciennes.
Y étant arrivé, il raconta à ses complices ce dont il avait été témoin.
— Je n’ai jamais tant ri, dit-il, qu’aujourd’hui, en voyant les grimaces que faisait cette belle… pour mourir.
Puis il ajouta :
— Escourt, Morin et Labondie ne vont pas tarder à faire les leurs ; Fouquier, accusateur public, me l’a promis.
Ce que ce scélérat avait osé prédire arriva.
Les amis de Mme du Barry et son fidèle serviteur la suivirent dans la tombe.
Nous terminons donc ici ces Mémoires, heureux si nous avons rempli le but que nous nous sommes proposé, en prouvant par le récit exact des différentes circonstances où Mme du Barry s’est trouvée, que ses qualités précieuses eussent dû lui mériter l’indulgence de ses contemporains comme elles lui avaient assuré l’amitié de tous ceux qui avaient été à portée de juger son cœur !…
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
Adresse du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Mars 2024
—
— Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : Pierre-YvesC, PatriceC, FrançoisM, Coolmicro.
— Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
— Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l’original. Nous rappelons que c’est un travail d’amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.