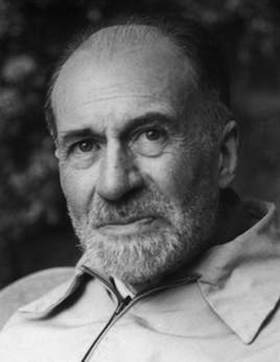
Henri Pourrat
GASPARD DES MONTAGNES
Tome I
LE CHÂTEAU DES SEPT PORTES
OU
LES ENFANCES DE GASPARD
Les vaillances, farces et gentillesses
de Gaspard des Montagnes
(1922)
PROLOGUE
La vieille dit :
La vieille dit : Il n’y a plus rien ; on ne voit rien, ne conte rien :
Il y avait des choses jadis ! et ce semblait alors tout simple.
Car la montagne de chez nous c’était comme dans les complaintes,
Un pays sauvage, écarté, dont le vent battait les sapins,
Et des histoires arrivaient vingt fois l’an, qu’on n’expliquait point.
Le diable en ces cantons perdus y mettait peut-être la main :
Il en fait tant qu’il peut.
La vieille Marie contait et contait,
Assise dos rond près de sa fenêtre.
Il pleuvait sur Zol et l’oiseau du hêtre
En çà du verger plein d’ombre chantait…
Les crimes des bois et ceux des domaines,
Les loups, les lutins et tous les secrets,
Ceux des pierres-fées et ceux des fontaines,
Les gueux complotant dans les cabarets…
La cloche tintait sur Ambert des chênes,
La vielle sonnait au joyeux Chambon…
Garçons haut guêtrés, vieux à cheveux longs,
Devisaient sous l’orme ou jouaient aux quilles.
Ces bourrées, les soirs, pour les jolies filles,
Ces noces, trois jours à boire et manger !
Les fêtes, les morts, les vies, tant à dire,
Ceux-là qui s’aimaient, ceux-là qui partirent,
Et tant à songer ! et tant à songer !
Ils disent qu’il n’y a plus de diable : et pardi ! puisqu’ils le sont tous !
Les cornes seules manqueraient : encor les portent-ils tout doux…
Mais si le diable n’en fit tant, le mauvais monde en fit beaucoup,
L’hôte en son auberge sanglante, et le mendiant au carrefour,
Et tous ! voleurs, jeteux de sort, déserteurs, brigands de grand’route,
Car toujours l’écume surnage alors que la marmite bout,
Me disait mon pauvre oncle.
La vieille Marie contait et contait,
Sans souci du fil, comme il lui chantait,
Mais c’est la mémoire de notre Auvergne,
Son trésor secret, quelle nous rendait.
… Je ne puis ouïr au pré sous les vergnes
Crier Bêquebois, le rouge pivert
Qui vole en plongeant s’agripper à l’aune,
Ni sentir le goût amèrement vert,
Menthe, terre et foin, des pâtis d’automne,
Sans qu’il me souvienne d’un morne vent,
D’un val enfoncé sous les branches d’ombre
Où le château gris fait face au levant,
D’un visage doux et de beaux yeux sombres…
Et comme un regard à bout d’horizon
Vers le songe errant aux nues entraînées,
Le cœur s’en va loin, loin dans les années,
Vers ce vieux château, château des chansons.
Il se peut qu’on ait embelli les gentillesses de Gaspard
Et qu’on lui prête plus d’un tour qui vint au vrai des camarades,
Tant en firent ces braves cœurs au plein soleil de la campagne.
Mais les histoires des guerriers, des rois, du monde d’autrefois,
Sont-elles sur un autre pied que ces vieilles rubriques-là ?
Certes, si Gaspard n’a tout fait, il l’eût pu faire, et davantage,
Puisqu’il a sa légende.
La vieille Marie contait et contait…
Quand le temps est bas, que les bois des rampes
Sont noirs, pleins de bruit, sur le Mont-Raudet,
Tends le rideau rouge, allume la lampe,
Et serrez-vous tous devant les landiers.
C’est qu’il va neiger cette nuit sans faute :
Dehors la montagne est si sombre et haute,
Et les chaumes gris si seuls à mi-côte,
Comme à l’ancien temps, temps des margandiers…
Mais ici le feu peint d’or les visages,
Entre le lit-coffre et l’horloge à poids.
Leurs ombres remuent sur le mur de bois
Où rougeoient collées de vieilles images ;
Ha, comme le cœur bat étrangement
Dans la salle basse à suivre ces dires,
D’amitié, de peur, d’un autre tourment.
Et pour n’y céder, alors, il faut rire.
Temps d’amitié, temps des chansons, des rosiers blancs devant les portes ;
Je chantais tout le long du jour, même en mordant dans le chanteau !
Chanter ? danser ? Filles et gars à présent se tournent le dos.
Mais ces demoiselles, aussi ! chignons montés, bottines hautes,
Comme si ayant les talons trop courts de nature, les pauvres
Craignaient de choir à la renverse… Allons, je ne dis mot de trop.
Et gai ! trotte qui danse !
PREMIÈRE VEILLÉE
PREMIÈRE PAUSE
Les frères Grange de Chenerailles, le Matelot et l’Américain. – La maison au milieu des bois. – C’était, dit la vieille, au temps du grand Napoléon, et quand on commença de faire la guerre en Espagne. Anciennement les Espagnols venaient avec des mules chercher en nos pays les pierres d’évêque, ces pierres violettes qu’on trouve dans les mines du Vernet-la-Varenne. De mémoire d’homme ce trafic avait lieu. Une année, même, comme ces marchands avaient été arrêtés et dépouillés sur les chemins, les gens du Vernet s’offrirent à travailler pour eux aux carrières sur parole, les nourrirent et leur avancèrent au départ ce qu’il fallait pour la route. Les Espagnols surent reconnaître un procédé qui partait de si franc courage et firent passer fort exactement les sommes dues à ces pauvres gens qui n’avaient que la peine de leurs bras pour vivre.
Puis des Auvergnats avaient continué cette branche de commerce.
Un nommé Grange, qui habitait Chenerailles, dans la paroisse de Doranges, faisait une fois l’an le voyage de Catalogne. Mais il se vit alors contraint d’y renoncer : d’abord parce que cela ne valait rien pour un Français de se promener sur ces catalans de chemins ; ensuite parce que ses pierres d’Auvergne n’y étaient plus de défaite.
Surtout pour cela. Jean-Pierre Grange était un homme épais de charnure et d’os, gros de traits, avec des oreilles cramoisies aux ourlets craqués d’engelures, qui ne craignait guère les dangers lorsqu’il s’agissait de grossir son quantième. Il passait pour un particulier rude, ayant la colère chaude, et violent alors dans ses emportements. Les favoris noirs, surnommés en ce temps-là nageoires, qui lui mangeaient la face, faisaient peut-être la moitié de sa réputation.
En tout cas, un Auvergnat renforcé, au crâne droit de pente, derrière, jusqu’à la nuque en bourrelet, aux joues hautes en couleurs, fouettées, vergetées d’une résille de sang, qui disaient assez les bons dîners d’auberge. Mais par-dessus ce vermeil, le hâle avait tanné son cuir, Grange ayant voyagé dans les pays du soleil. De ses navigations, il avait même rapporté l’habitude de fumer comme les gens de marine.
Ambert était alors une ville assez marchande où l’on fabriquait de l’étamine à pavillons pour flammes et banderolles de vaisseau, de la toile à voiles, des lacets et des rubans de fil, des jarretières, des galons, des épingles, du papier, des jeux de cartes. Jean-Pierre Grange trafiquait au loin de tout cela comme des pierres d’évêque et achetait à la foire de Beaucaire, selon l’occasion, des faïences ou des indiennes à revendre en demi-gros.
En somme, moins marchand que commissionnaire. Il n’avait jamais cessé d’habiter le domaine de Chenerailles au milieu des bois, et sa mise, hormis le gilet carré de velours à raies jaunes et brunes, tenait encore du paysan : la culotte et la veste en gros drap bleu, puis, en temps de froidures, le surtout de burelle grise. Avec cela de vieilles guêtres en fort coutil, éraillées par les ronces, et, pendant à son poignet, le bâton d’épine qu’il avait lui-même moucheté au feu. (En soufflant par un tuyau de pipe, on darde la flamme d’une chandelle et on lui fait mordre le bois.)
Ces Grange s’étaient poussés petit à petit. Le dicton ne court pas d’hier :
La meilleure maison d’Auvargne
L’est devenue par l’épargne.
Le grand-père avait été un simple paysan sans grands moyens qui, à force de se lever tôt, de se coucher tard et de se plaindre même un verre de vin, avait empilé écu sur écu.
Le père était « entré gendre » chez un marchand de bois à Chenerailles, c’est-à-dire qu’il avait pris la suite. Il y a, dans ces forêts, les plus beaux sapins du monde, hauts de cent pieds et aussi droits qu’un jonc. La marine du Roi se réservait par privilège ceux qui étaient à sa convenance comme mât de navire. On les faisait charroyer jusqu’à l’endroit où la Dore se trouvait flottable, et vogue le train pour les ports de l’Océan.
Celui-là avait mis de la paille dans ses sabots. Mais les fils mirent du foin dans leurs bottes. L’aîné, Jérôme, partit pour les îles de l’Amérique et y réussit si bien qu’il s’associa le cadet, Jean-Pierre, lequel devait, du pays, lui envoyer des marchandises.
Jean-Pierre s’était marié presque richement à Saint-Amand Roche-Savine. Il traversa la révolution et les temps calamiteux qui suivirent sans faire une grande fortune, – il n’avait pour cela pas assez d’éveil, de hardiesse d’esprit, – mais aussi sans misère. Il acheta par-ci par-là quelques biens nationaux, deux ou trois bois d’émigrés, pour s’arrondir ; en y allant retenu.
L’aîné, là-bas, à Saint-Domingue ou à la Guadeloupe, avait eu la dent plus longue. Un de ces Auvergnats qui savent crocher dans le morceau, ne plus lâcher et avoir encore l’œil et la dent prêts à ce qui pourrait venir. Comme ce Tourlonias qui partit de Marat bien petit compagnon, colporteur, marchand de rubans de fil : à Rome, le gaillard trouva moyen d’entrer dans les affaires, acheta des terrains, dessécha des marais, devint riche à millions, riche à mort, prince Torlonia et l’un des puissants de ce monde. Et ces Torlonia ont tenu à demeurer en bonnes relations avec les Tourlonias d’Auvergne. Celui qui voudrait douter de la vérité de ces faits, s’il a quelque amour pour la vérité, n’a qu’à s’en informer auprès d’un des arrière-neveux, le marchand de fromages qui habite au foirail d’Ambert et touche si bien de la vielle.
Jérôme Grange ne revint à Chenerailles qu’après la mort du père, pour le partage. Il voulut que la maison restât indivise. Les bois allaient à Jean-Pierre, qui, à cause de la guerre, préféra les faire valoir et renoncer à son état de marchand. Il eut à payer à son frère une bonne somme dont il s’acquitta pour une part en écus de six livres et en napoléons neufs, pour l’autre en effets de commerce. Des effets qu’il avait en porte feuille mais que l’Américain n’accepta qu’en prenant un escompte de huit du cent, au moins.
Ces règlements se conclurent pourtant sans grandes contestations. Et Jérôme Grange dicta devant quatre témoins, chez le notaire d’Ambert où se faisaient leurs affaires, un testament par lequel il léguait son avoir à ses nièces, – Anne-Marie attrapait ses quatorze ans, l’autre, Pauline, était toute jeunette. Il disait qu’on ne sait ni qui vit ni qui meurt, et qu’en ce climat des Îles, un homme est vite emballé. Peut-être, étant dur et colère plus encore que son frère, s’était-il trouvé des ennemis. Et il savait qu’au milieu de ces nègres, avec une poignée d’herbes ou une pincée de drogue, on fait tout doux lever les jambes à qui vous gêne.
Jérôme Grange devait avoir déjà la puce à l’oreille, mais il n’en soufflait mot. C’était un grand maigre, sec comme un échalas, jaune de teint jusque dans le blanc des yeux, et qui demeurait secret, fermé, bouclé, cadenassé. Pour le testament, il déclara sans plus au notaire : « Voilà. Si j’ai deux cent mille francs, chacune des petites en aura cent mille. Et si c’est deux millions, eh bien ! un million chacune. »
Jean-Pierre, – qu’on appelait parfois le Matelot et à l’ordinaire Grange, bien que ce nom revînt plutôt à l’aîné, mais quoi, c’était le jeune qui était resté au pays, – aurait mis plus d’ostentation en son fait. Un jour, dans une auberge d’Arlanc, il dit qu’il ne se laisserait pas couper le cou pour trente mille écus. Et il se flattait à l’occasion que, lorsque ses filles se marieraient, il leur ferait un chemin de la mairie à l’église en pièces de cent sous.
Tout se sait. Le partage, l’escompte à huit du cent, et surtout le testament avec le mot de Jérôme Grange sur les deux millions, il ne faut pas demander si cela fit gloser. On en parla jusque dans les diligences sur les routes de Clermont et du Puy. On tenait l’Américain pour cousu d’or. On contait qu’outre ce que lui rapportait son négoce, il amassait des mille et des mille, étant en secret bailleur de fonds d’un particulier du Velay qui faisait la banque à Saint-Domingue. Les envieux ne manquent pas, Dieu sait, à qui réussit dans ses affaires. Si l’on ne dit rien alors de la probité des Grange, c’est qu’il n’y avait rien à en dire.
Jérôme demeura trois mois à Chenerailles, puis repartit pour les Îles. Jean-Pierre resta seul sur le domaine avec sa femme et ses petites, sans parler des servantes et du valet. Ils habitaient un long, vieux, triste bâtiment, plutôt métairie que maison de maître, qu’on surnommait la maison des sept portes. Toute de granit sans mortier, couverte d’un toit soutenu par des potences, elle était flanquée d’un escalier de pierre, crevassé, aux degrés creusés d’usure, qu’encadrait une rampe d’un pied de large à fougères et gueules de loup. En bas, les étables, la remise, les loges à porcs, la grange ; à l’étage, les greniers, la fenière, le logis. Posées en balcon sur des perches, devant les fenêtres, des planches embrunies où séchaient des pignoles, des pommes de pin, laissaient à la bâtisse une figure paysanne.
Au milieu des bois, le chemin tombait dans une clairière où des roches saillaient comme des dos de vaches couchées à ruminer cette pauvre herbe. À l’autre bout, on voyait la maison entourée de hangars, de chars, de fagotiers, de brasses de bois empilées sous des tignasses de genêts secs. Le coin demeurait passablement désert. Un chat-huant miaulait, une buse criait. Et toujours, comme le bruit au cœur du bois d’un torrent dévalant, le vent roulait et sifflait, là-bas, dans la ramée noire des sapins qui, sous le ciel de frimas, houlaient comme un champ de seigle.
Ce fut en cette maison des sept portes qu’advint, vers Pâques, l’aventure terrible d’où s’ensuivirent tant de malheurs.
DEUXIÈME PAUSE
Les forêts de ces quartiers-là. – L’aventure de la vieille servante. – La louée au Pialou d’Arlanc. – Comment on était forcé de laisser seuls le valet et la petite. – Elles n’ont rien de trop gai, les forêts qui s’en vont sur ces hauts plateaux du côté de la Chaise-Dieu. Des sapins, des sapins, des sapins, jamais une âme. Les chemins sablonneux s’enfoncent de chambre obscure en chambre obscure, parmi la mousse et la fougère, sous ces grandes rames balançantes. Les grappes du sureau rouge tirent l’œil, ou bien quelque pied de digitale pourprée. Il y a des endroits où le soleil semble n’avoir point percé depuis des mondes d’années : c’est sombre, c’est noir, c’est la mort. Une forêt comme celle de la complainte de sainte Geneviève de Brabant, où des ermites peuvent vivre solitaires et qu’on imagine pleine de loups, de renards, de blaireaux. À dix pas, sait-on ce qui se cache derrière ces fûts gris des arbres où la résine met des traînées de suif ? Tout remue, mais remue à peine. Tout est silence, mais un silence traversé de vingt bruits menus ? Une belette qui se sauve, un souffle de vent dans la feuille des houx, une fontaine qui s’égoutte derrière la roche. Et lorsque le sentier monte en tournant sous le couvert, à travers les masses de pierres détachées dans le désordre des sapins penchés sur leurs nœuds de racines, on croirait aller vers des cavernes de faux monnayeurs et de brigands. Pas une âme, et pourtant ce semble que quelqu’un soit tapi par là en embuscade. Il faut avoir l’esprit bien fort pour ne pas se laisser gagner par la peur.
Or, ceux qui sont nés dans ces cantons les préfèrent aux plus beaux endroits de la terre. Jérôme Grange entendait bien y revenir sitôt fortune faite, et son cadet n’avait jamais quitté sans regret ces pays, même pour ceux où il y a des fleurs et des oranges aux arbres, et du soleil en tout temps dans le ciel. C’était son goût de voir pousser ses sapins et de jardiner dans ces bois, élaguant, plantant, faisant abattre les arbres qui dépérissent et gênent la croissance des voisins, comme une dame peut jardiner en son jardin bouquetier. Ceux qui ne connaissent point cette vie de propriétaire forestier ne peuvent dire quel plaisir et quel bien c’est là. « S’il n’y a point de bois là-haut, tenez, pauvre, déclarait un jour le garde de Doranges, je dis que M. Ambroise, le monsieur du domaine de la Roche, quitte le Paradis pour revenir dans les siens. »
Et certainement, Grange n’aurait jamais déserté Chenerailles sans le malheur de son Anne-Marie.
Les Grange avaient deux servantes. La vieille, une bonne femme dans les soixante-quinze ans, vers la mi-février, tomba soudainement malade.
Un soir, comme elle était allée au bourg et revenait à travers bois, s’abattit sur le pays une sorte de brouillard. Elle marchait vite, tête basse à la bise, disant le chapelet sous sa grande cape de serge rapiécée, quand, devinant quelque chose devant elle, elle releva les yeux : une forme humaine était là, debout et droite dans la sente, et cette forme lui tendait la main, si bien qu’elle, tout étourdie, avança pareillement la sienne. Mais alors le fantôme se changea en un poulain rouge qui partit au galop sous les arbres.
Ce fut du moins ce que rapporta la vieille. Après cela, sans plus savoir où elle en était, elle s’était sauvée droit devant elle, s’entravant dans ses sabots. Le brouillard l’avait égarée et elle n’était rentrée qu’à la nuit, trempée de sueur, ne tenant plus sur ses jambes.
Le lendemain, elle tremblait la fièvre et gémissait, recroquevillée entre ses linceuls.
La maîtresse était une femme toute de cœur sous des dehors silencieux, paisibles ; des yeux lents, mais qui allaient droit, la bouche un peu triste et bonne, la joue large, plate, et le bas de la figure bien établi. En un mot, un air de calme qui gardait quelque chose de dignement paysan. Elle était, d’ailleurs, mise comme une riche fermière de la montagne, portant le fichu en pointe sur le corsage roidement gainé, et la robe à grosses fronces, relevée en semaine dans ses poches pour mieux vaquer à la besogne.
Tout de suite, elle profita de ce que Grange allait à Saint-Amand où l’appelait une vente de coupe pour lui confier Pauline, leur plus jeune.
— Écoutez ; notre cousine Domaize m’a souvent demandé de les lui envoyer toutes deux passer quelques jours avec ses enfants, mais je garde Anne-Marie qui m’aidera. J’irai chercher la petite sans faute avant le carême, de peur qu’elle n’embarrasse. Dites-le bien à la cousine, Grange, et remerciez-la tant que vous pourrez.
Les choses ainsi arrangées, elle ne quitta plus sa servante ni jour ni nuit. On essaya de combattre la pleurésie par des tisanes de bourrache. Le curé de Doranges recommanda la vieille au prône, comme on le faisait pour les malades. On alla même quérir un médecin à la Chaise-Dieu. Mais rien n’y put et la pauvre trépassa le sixième jour.
L’autre servante, une jeunesse qui n’avait en tête que la danse et les assemblées, avait déjà pris de l’ennui à Chenerailles. Après cette mort et l’histoire qu’avait faite la vieille de sa rencontre dans le bois, elle ne serait pas demeurée pour un gage de peut-être cent francs par an ! La maîtresse eut beau lui représenter que la pauvre Toinon n’avait parlé que dans la fièvre, et qu’on est sujet à d’étranges illusions au milieu de la brume, cette follasse ne voulut rien savoir. Sans même attendre huit jours, elle fit son baluchon et déguerpit.
Cependant, le carême, qui était fort bas cette année-là, arrivait. Les Grange se trouvèrent en peine. Elle, il fallait qu’elle allât à Saint-Amand reprendre la petite. Pour rien au monde elle n’aurait voulu paraître sans-gêne à la cousine Domaize. Un moment, elle eut l’idée de s’excuser par un mot de lettre en priant son cousin Gaspard, dont les parents étaient aubergistes au même lieu de Saint-Amand, de lui ramener la Pauline. Mais elle n’osa, et s’en repentit plus de quatre fois par la suite.
Quant à Grange, il avait affaire à Ambert, un rendez-vous pris pour un marché de bois qu’il ne pouvait remettre. Il comptait passer en ville avec sa femme et Pauline le dimanche des brandons, où l’on mange les soupes dorées et où l’on saute les fougats, qui sont de beaux grands feux de joie, fait de fagots et de monceaux d’épines.
Le lendemain, on serait à Arlanc pour la foire de la louée, qui tombe, sauf erreur, le lundi après les Cendres. Ce jour-là, ceux qui veulent entrer en condition viennent sur la place. On y voit les solides filles au teint chargé en rouge, assises, une fleur au corsage, qu’elles ôtent dès qu’elles se sont gagées ; les petits bergers avec leur bâton ; les garçons plus forts qui sont pour aller labourer en champs ; ceux de la plaine, beaux morceaux de « drôles » bien bâtis, et ceux de la montagne, les Chiveirans de Valcivières, bruns, noueux, trapus, mal fichus quelque peu. Ils sont tous là, attendant un maître, d’un air à la fois avantageux et gauche. La bure grise, couleur de brebis, près de la rase bleue et du cadi couleur de feuille morte. Tout le tapage des marchés qui se font dans le brouhaha des grosses voix et le piétinement des sabots. Les gens qui se retrouvent et s’écrient ; ceux qui se tapent dans les mains pour conclure et vont ensemble boire bouteille. Le pêle-mêle des larges feutres où s’ouvre un chemin l’homme qui s’en retourne, tirant sa vache par la corde…
Pas un valet mécontent de sa place qui n’eût marmonné : « Vienne le printemps, j’irai me louer au Pialou d’Arlanc ! » C’était comme la Saint-Robert à la Chaise-Dieu, la grande foire des gens à gages avant la reprise des travaux champêtres. Car, autrefois, on n’allait guère à maître que pour la belle saison : il y avait peu de bonnes maisons qui gardassent un domestique tout l’hiver.
Les Grange pensaient arrêter une seule servante. La vieille, on ne l’eût pas congédiée, elle était depuis toujours dans la famille, mais son travail, Anne-Marie le ferait bien. Et, partant de Chenerailles le vendredi dans l’après-dînée, on pourrait être de retour le lundi à la même heure.
Ainsi Anne-Marie resterait trois jours à la maison, seule avec le valet : un nommé Annet Chalaron, – on l’appelait le Nanne, – qui touchait à la quarantaine, bien brave, bien honnête, seulement sans plus de biais que ses vaches. Il suffisait de le voir, avec son allure démanchée, comme si ses quatre membres avaient du jeu, et, champêtre, placide, sa face à la peau luisante tendue sur des os durs ; les yeux un rien ahuris, et la bouche entr’ouverte, de ses lèvres gercées, à la façon des pitauds de campagne. Il menait sa besogne, s’entendait au trafic des champs, mais, sorti de là…
La mère s’arrêtait au milieu de l’ouvrage, et, les mains l’une dans l’autre, repassait ces choses dans sa tête. Oui, c’était forcé de laisser Anne-Marie à Chenerailles trois jours durant. Au bout du compte, la petite ne risquait rien, rien du tout. Les portes bien barrées… le valet ici… Il ne fallait pas se faire des idées pour quelques contes de vieilles femmes qui parlaient mal des bois d’alentour.
TROISIÈME PAUSE
Histoires arrivées dans ces bois sauvages. – La lettre que remit un colporteur. – Le départ du père et de la mère. – Ces bois avaient pris un mauvais renom depuis quelques mois, et c’était ce qui tourmentait la mère.
De tout temps, ils avaient fait conter des histoires étranges devant le feu. Une fois, disait le père de Grange, des scieurs de long campaient en forêt près de la lisière, dans une grange en ruines. Chaque soir, de leur lit de feuilles, ces gens entendaient un bruit rouler dans les airs au-dessus de leurs têtes. Mais un bruit, comme d’une meute de chiens hurlant en trombe derrière un lièvre, les cris des chasseurs, un cliquetis, un hourvari, une tempête de galopade, d’abois, de voix entremêlées, tout cela filant un train d’enfer : la chasse royale, en un mot. Et tous les soirs, ou plutôt toutes les nuits. Ils n’avaient pas peur ; cependant ils n’étaient pas autrement joyeux.
À la fin, un jeune, qui avait du sang, dit à ses compagnons :
— Comment le prenez-vous, vous autres ? Moi, j’en ai mon sac. Ce soir, oui, ce soir, pas plus tard que ce soir, je saurai de quoi il retourne.
Il va au bourg ; il y fait provision d’un fusil tout chargé ; la nuit tombée, il se poste à trois pas devant la grange. Quand la diablerie passe au-dessus de lui par le milieu de l’air, il épaule sans trembler et lâche droit dessus son coup de feu.
Et de rentrer dans la grange, et de crâner devant les camarades :
— J’ai fait ma chasse, moi aussi. Ô sacré bon sang de sort ! Si je n’ai pas tué quelque chose !…
Tout d’un coup, la porte s’ouvre, comme enfoncée par l’ouragan ; une voix crie de dans le noir : « Tiens ! Voilà ta chasse ! » et une jambe nue d’homme, ou de femme, on n’a jamais pu savoir, s’abat au beau milieu des scieurs de long. Quand ils crurent regarder cette jambe, – ils eurent à reprendre leurs esprits sur le moment, – plus rien, pas plus de viande que sur ce plancher.
La chasse royale, tant de gens de bonne foi et de bon sens l’ont entendue qu’il est difficile de la nier tout net. Jérôme Grange disait que ce pouvait être les oiseaux de nuit qui, contre leur habitude, s’attroupaient, – de même que les chiens de village courent parfois en bande, comme des loups, – et, pris de folie, menaient à corps perdu leur sabbat.
Mais en ces forêts, on en entendait bien d’autres. Parfois le bruit d’une branche sous la cognée tombant d’ahan, son craquement, sa dégringolade et son fracas à terre. Ou bien un tapage à croire que tous les arbres s’abattaient à la file…
Il arrivait encore qu’un coin de futaie fût illuminé par une lueur diabolique. On apercevait des feux tels que les langues de flamme dépassaient la pointe des sapins. Pour aller aux foires de la Chaise-Dieu il faut traverser ces bois solitaires, et c’était les soirs, au retour, qu’on voyait les fantasmagories : des rondes de revenants autour de ces fougats, des danses affreuses.
Un jour, la mère du curé de Fayet-Ronnaye passait en carriole avec son filleul. Ils avisent, venant à eux sur le chemin, quelque chose de bas, de carré, de noir, ressemblant assez à un cercueil qui aurait roulé tout seul. Le garçon tire sur les guides et prend sa droite. Quand la chose est pour les croiser, elle s’efface soudainement.
— Tu as vu ?
— Eh bien, oui, marraine, mais je ne te le disais pas pour ne pas t’effrayer.
C’est le cheval du maire, un autre soir, qui se cabre au carrefour et demeure planté sur les pieds de derrière. Il y avait un fantôme, un grand fantôme muet devant lui… Enfin, à un fort coup de fouet, ce semblant s’évanouit et le cheval repart à fond de train.
Pour croire il faut voir. – Peut-être aussi que pour voir il faut croire ? – Reste que les gens de ce canton, lorsqu’ils sont en confiance, avouent que ces histoires, ou d’autres pareilles, sont arrivées au petit de leur mère.
Mais cette année-là on commençait de penser qu’outre les revenants, les lutins, les démons, il devait y avoir du mauvais monde dans le pays. Et tant on redoutait de s’attirer des ennuis, on ne disait cela qu’à voix de confesse. Les gens n’étaient pas bien courageux sur ce point. Ils tenaient que pour faire du loup une bonne bête, le mieux est encore de souvent lui faire fête. C’est qu’en ces pays où les gendarmes ne se seraient montrés que le lendemain, un coup de fusil peut s’attraper trop aisément. La balle arrive, et cherchez l’homme entre les buissons. Ni vu ni connu, je t’embrouille. Sans parler du feu. Car, pour ruiner alors même un homme riche, il suffisait de battre le briquet derrière sa grange à paille.
On pensait donc que des brigands hantaient ces forêts. Quand cette rumeur lui était venue aux oreilles, Grange avait déclaré qu’il ne croyait pas plus aux lutins qu’aux brigands et aux brigands qu’aux lutins. Que tout cela n’était que bavardage de veillées. Qu’au demeurant, il avait toujours dans ses goussets ses pistolets et au manteau de la cheminée son fusil chargé de chevrotines. Et qu’il ferait les choses grandement, le jour où qui que ce fût, malandrin, loup-garou, lui voudrait jouer un méchant tour.
Peut-être n’avait-il pas l’esprit si en repos, mais il se serait senti humilié d’en rien laisser paraître.
Le matin du vendredi où Grange et sa femme devaient aller chercher Pauline, le valet s’en fut fagoter de bonne heure. Dans le bois, près d’une fontaine, il se vit abordé par un homme avec un emplâtre noir sur l’œil, une sorte de colporteur coiffé d’un bonnet fourré, vêtu d’une méchante jaquette de futaine et du pantalon à l’avenant, qui voulait savoir s’il était bien dans le chemin de Chenerailles. Le valet s’enquit. L’autre, lui montrant une lettre, dit qu’un prêtre l’avait chargé de la remettre au domestique d’un sieur Grange, et le Nanne, alors, de se faire connaître, en s’étonnant de la rencontre.
Le colporteur lui tendit le papier, mais ne voulut pas le suivre jusqu’à la maison, où on lui eût trempé une soupe. « C’est bien parce que ce curé m’a promis une pièce de douze sous, la commission faite. Et puis on veut rendre service au monde… J’ai mangé un morceau là-bas, près de la mare, merci. Un verre de vin, oui, bien sûr, mais ce sera pour la revoyance. »
Ainsi, dans le moment, l’homme reprit son chemin et disparut.
Le Nanne revint fort en peine de ce que pouvait contenir le mot d’écrit car il ne savait lire un peu que la lettre de moule.
Il se trouva que c’était une missive du curé de sa paroisse. Ce curé l’avertissait que son père était à l’article de la mort, et que s’il voulait le revoir, il lui fallait venir en toute hâte.
Il n’y avait pas à balancer. Le Nanne ne prit que le temps de s’habiller de ses dimanches, de se tailler un chanteau de pain, et de décrocher son bâton derrière la porte.
On pourrait gager que si sa femme ne lui eût alors rien dit, Grange ne se fût pas si vite mis en route.
Mais lui faisant un clin d’yeux, elle l’attira sur le palier au haut de l’escalier de pierre.
— Grange, vous ne voulez pas que nous partions tous deux et qu’Anne-Marie reste…
— Voilà les ora pro nobis qui commencent, coupa-t-il. Comme si je n’avais pas assez à calculer.
— Ha ! Grange, ces bois font mal parler d’eux, et pensez-y, s’il arrivait quelque chose comment nous le pardonnerions-nous ?
— Que veux-tu qu’il lui arrive ? Les portes sont solides… Il faut en faire une vraie femme de domaine, continua-t-il en se montant, non pas une mijaurée qui a des vapeurs. Tu serais là à la soigner comme le lait sur le feu. Nos bois, nos bois, j’y ai assez navigué, Dieu merci, sans jamais y voir barbe de brigand. Pour un porte-besace qui les traverse tous les trente-six du mois !… On fait toujours le loup plus gros qu’il n’est, la mère.
Elle restait devant lui, tranquille, avec son air un peu triste et soucieux. Elle ne sonnait mot, mais ne bougeait pas, comme si la même pensée ne cessait de l’occuper.
— Je resterai, finit-elle par dire, puisque vous avez ces affaires qui vous appellent.
Grange s’emporta. Elle manquerait donc de parole à la cousine ? Ne pas même aller la remercier d’avoir gardé la petite ! Non ! On les prendrait pour des tourlauds, grossiers comme du pain d’orge, et on aurait raison.
Il s’encolérait en parlant, ses gros yeux tout ronds sous le buisson de ses sourcils. Elle tira doucement la porte, pour que Anne-Marie n’entendit rien, et continua d’écouter sans s’émouvoir, faite depuis longtemps à l’humeur de son homme. Comme les femmes bien morigénées de ce temps, elle l’aimait et respectait de cœur entier, ne l’ayant en moindre révérence que la fleur de souci le soleil, ouvrant ses fleurons quand il reluit, virant pour le suivre en son cours et les fermant à la perte de sa présence. Elle aurait regardé comme un péché mortel d’avoir une autre volonté que sa volonté, et il fallait qu’elle fût bien tourmentée à part soi pour en tant dire en cet instant.
— Il suffit, Grange, nous partirons tous deux. Laissez-moi seulement aller au bourg demander à la nièce de monsieur le curé et à sa petite de venir passer les trois jours avec Anne-Marie pour la désennuyer. Elles ne me le refuseront pas.
— Si tu y tiens, fit-il en haussant une épaule. J’aurais pourtant voulu que nous mangions de bonne heure de façon à partir sur le midi.
Il était comme cela, bourru et rebours avec les siens, plus gracieux avec les étrangers. Au fond, cette idée d’une compagnie à Anne-Marie lui allait fort ; il en était soulagé sans le dire, car ses deux filles et sa femme étaient tout pour lui. Mais loin de les mignoter, il leur grommelait toujours quelque parole sans bonne grâce. Lorsque Anne-Marie, Pauline, venaient le rejoindre au bois où il travaillait avec le Nanne, un sourire d’aise lui épanouissait la face ; cependant, tout au plus s’il faisait : « En voilà une qui manquait à notre bonheur ! »
Il avait comme cela quelques plaisanteries éternellement les mêmes, des sornettes d’almanach qu’il répétait à l’occasion. Vers la Saint-Michel, aux premières neiges sur les crêtes : « Ah ! ah ! c’est pour nous faire voir que les rats ne l’ont pas toute mangée. » Ou bien encore : « Elle est de la même couleur que celle de cet antan. » Et quand il mangeait le lard sur le pain, à la paysanne, une lichette contre son pouce pour ne pas le graisser, la dernière bouchée avalée : « J’ai mangé l’assiette et tout », ne manquait-il jamais de déclarer à ses bûcherons, en se levant et fermant son couteau.
Parce qu’il avait ainsi le mot pour rire, les gens disaient qu’il n’était pas fier. Ils plaisantaient avec lui, mais plutôt par flatterie, sans trop s’en douter, que parce qu’ils se sentaient là en humeur joyeuse.
Sa femme revint du bourg contrariée au possible. La nièce de monsieur le curé avait un rhumatisme. Sa fille Zulime s’était fait prier… Enfin il était entendu qu’Anne-Marie irait la chercher dans l’après-midi : elles mangeraient et coucheraient ensemble, gouverneraient tout à leur plaisir.
On appela Anne-Marie et on lui dit la chose. Elle rougit un peu, – elle était assez finette pour se douter de l’inquiétude des siens, – et elle parut avoir l’esprit en repos. Sa mère, alors, lui recommanda de tout clore soigneusement, à cause, ajouta-t-elle, des bêtes sauvages qui pourraient venir du bois. Anne-Marie, si elle avait de la crainte, n’en fit pas montre. C’était forcé que ses parents s’absentassent tous les deux, et si elle tenait de son père une certaine roideur de caractère, de sa mère elle avait la soumission qui fait accepter et même aimer ce qui ne saurait être autrement.
Sur les deux heures de relevée, les Grange montèrent sur leur mulet, elle en croupe arrangeant ses jupes, lui fouaillant déjà la bête de la bride. Et ils se mirent en route, pressés d’être de retour.
QUATRIÈME PAUSE
La rencontre des Grange au retour avec le valet. – Anne-Marie et son amie. – La lâcheté de Zulime. – Le lundi, sur le midi, Grange, qui revenait avec sa femme et la petite Pauline, s’entendit héler dans le bois par son valet, qui rentrait aussi à Chenerailles. Le Nanne marchait dégingandé, de ses longues pattes d’araignée, mais tout plan-plan, et n’avait point la contenance d’un homme qui vient de perdre son père.
— Mon père ? Santé de cheval et jambes de lièvre ! Il a quatre-vingts ans sonnés et je l’ai trouvé qui arrachait des genêts sur la côte. Pour l’ouvrage, il ne se bougerait pas devant un jeune… Le joli oiseau qui me porta cette lettre, s’il me tombe jamais sous la patte, je lui travaillerai le casaquin d’une façon dont il se souviendra.
En apprenant que la lettre était fausse et supposée tout exprès, Grange changea de visage. À ce moment, comme ils approchaient du domaine, une bête se sauva du fort d’un buisson, faisant faire un écart à la mule. Le valet se baissa pour jeter un coup d’œil et avisa sous cette épine un chien crevé.
— Oh ! mon Dieu ! c’est la pauvre Trompette… Il y a un malheur par ici, dit-il comme pour soi, sourdement.
Sans doute avait-on jeté quelque boulette sur le chemin ; et la chienne en revenant du bourg avec Anne-Marie et Zulime avait été empoisonnée raide. Ils se sentirent tout froids.
— Écoutez, maître, je n’ai pas pu me remettre en route le samedi, j’avais un talon emporté après cette diablesse de trotte. Et puis chez moi on a voulu me garder pour le dimanche…
— S’il est arrivé quelque chose, ce sera par ta faute, sacré gueux que tu es, cria Grange. Je te réponds que nous aurons un fameux compte à régler tous les deux !
Sans rien comprendre à ce qui se passait, la petite Pauline fondit en larmes.
— Vite, Grange, vite à la maison, murmura la mère qui avait plus de sens qu’eux tous. Et elle donna un coup de talon dans le ventre de la mule.
Mais quand, deux minutes après, elle vit une mare rouge sous la porte de l’écurie, elle se sentit comme si elle allait tomber en faiblesse. Sans que ses yeux quittassent ce sang, elle se laissa couler à terre, et elle, la silencieuse, la soumise, elle eut là un mot terrible : « Si c’est le sien, Grange, de ma vie je ne vous reparle. »
Tout était clos, bouclé ; et cogne à la porte, que cogneras-tu ! Rien ne bougeait dans la maison non plus que si la mort y eût passé…
Après le départ des siens, Anne-Marie était allée au bourg quérir son amie Zulime.
Elle pensait avoir bien fermé la porte derrière elle. Mais sur les sept, par malheur, elle en avait oublié une. Si elle avait su, la pauvre petite, ce qu’il lui en coûterait ! Si l’on savait toute la peine qu’on aura dans sa vie, et parfois pour rien, pour trois secondes d’absence… Quel pays que cette terre ! La porte de l’écurie, donc, resta ouverte, et l’histoire d’Anne-Marie Grange commença.
C’était une de ces après-midi de mars, qui, parce que les jours sont plus longs, l’air plus doux, sentent je ne sais quoi de la saison nouvelle. De petites araignées courent sur la terre jaune entre les champs de seigle vert. Un soleil clair réjouit les os et le saule chatonne dans la haie où le verdier, la mésange, la fauvette mènent leur guilleri. Ces premiers chants si forts et si purs, les monts bleus comme des fleurs dans l’éloignement, le vent et la lumière qui passent ensemble en poussant quelques caravanes de nuages, tout apporte une promesse de liberté.
Les deux petites revenaient, chantant la chanson des mariniers et de la fille du prince. Le chien trottait, sautait, virait autour d’elles, faisait dix fois le chemin.
C’est la fille d’un prince,
Trop matin s’est levée…
Trop matin s’est levée,
Sur le bord de l’île,
Trop matin s’est levée,
Sur le bord de l’eau
Tout auprès du vaisseau.
Elles aimaient cet air qui traîne par la campagne. Des idées leur venaient qui leur enchantaient la tête : sur une colline semée de buissons, un vieux château aux corridors de pierre grise, et de la tour une jeune princesse belle comme le jour, blanche comme la neige, qui regarde au loin sur la mer… Elles se tenaient par la main, et balançant les bras s’en allaient chantant à plaisir de gorge :
’Le s’est mise en fenêtre
Pour se voir habiller…
Pour se voir habiller
Sur le bord de l’île,
Pour se voir habiller
Sur le bord de l’eau,
Tout auprès du vaisseau.
Voit venir une barque,
Trente soldats dedans…
Avant d’entrer, Anne-Marie, prise peut-être d’un demi-ressouvenir, voulut visiter les sept portes. Elle les trouva toutes closes. Zulime et elle montèrent les degrés de pierre, riant, babillant, s’installèrent dans la maison, redescendirent panser les vaches, revinrent allumer le feu. La mère avait laissé, pour affriander Zulime, un pot de miel, de la crème, des noisettes…
Et elles deux de voltiger, de verbiager, comme des linottes au soir dans un tilleul. L’idée d’être maîtresses de tout les transportait. « Tu verras, nous ferons une farinade, je sais que tu l’aimes. Il y a de la fleur d’orange que le père a rapportée de Marseille… Nous mangerons là devant le feu, sur nos genoux, et nous nous mettrons dans le même lit, ce soir. » Puis, laissant la louche dans la seille de lait et leurs écuelles demi-remplies, elles couraient, tracassaient par la salle, ouvraient les armoires, mettaient le nez partout. Et, haussées sur leurs pointes, elles regardaient sans oser y porter la main ces curiosités des Grandes Indes : coquillages, colliers de graines, plumes d’oiseaux de toutes couleurs. Après quoi de revenir à leur laitage en sautant et chantant. Au fond de ce train, qui sait s’il n’y avait pas quelque besoin de s’étourdir ?
Cependant, Anne-Marie qui s’amusait à lancer son dé en l’air pour le rattraper dans ses mains, le manqua, et ce dé roula jusqu’au lit-placard où toutes deux devaient coucher. Zulime, qui était proche du lit, voulut le ramasser. Et alors, alors…
Elle se releva lentement, blanche comme un linge. Si bien qu’Anne-Marie qui se tournait vers elle, étonnée qu’elle ne jabotât plus, se sentit prise d’effroi.
— Qu’est-ce qu’il y a, Zulime ? Mais qu’est-ce qu’il y a ?
L’autre, sans répondre, tremblait ainsi qu’un jonc dans l’eau.
— Je me sens comme malade…
Il faut croire qu’elle avait la tête perdue. C’était jeunet, sans vice ni vertu, sans idée de grand’chose. Un tendron blondin, fadasse, qui faisait penser à un gâteau mal cuit. Et, de vers le père, une famille de pulmoniques. Tout de même elle fut trop lâche et trop faillie de cœur à ce moment-là. Elle n’eut plus qu’une idée en esprit, se sauver… De même qu’une fois sauvée elle s’en tint à ne rien dire, de peur qu’on n’exerçât sur elle quelque vengeance. Son amie, elle l’abandonna comme si elle l’avait vendue pour de l’argent.
Une minute peut-être passa ainsi dans un silence à faire peur.
— Veux-tu de la fleur d’orange sur une pierre de sucre ? – Le sucre alors valait six francs la livre et la journée d’homme dix sous. – Ou bien, attends, il y a de l’eau de la reine d’Hongrie dans l’armoire.
Zulime, les jambes molles, tirait vers la porte.
— Je suis malade, je te dis. Qu’est-ce que tu ferais cette nuit s’il fallait me soigner ? Oh ! je ne peux pas coucher ; je veux m’en aller, je veux retourner à la cure.
Il n’y avait pas à essayer de la raisonner. Anne-Marie la suit pour lui faire un bout de conduite. Mais à peine sur le palier, l’autre dévale les degrés comme une folle et prend ses jambes à son cou.
CINQUIÈME PAUSE
La nuit terrible d’Anne-Marie Grange. – La nuit tombait. Le vent s’élevait dans les sapins. Ce bruit des bois, ces ombres, cet abandon qui serrait le cœur, tout cela ne faisait pas trop bien entre chien et loup. La petite pensait à ses père et mère, qu’elle était seule, sans secours d’aucune sorte, – car décidément la chienne ne rentrait pas au logis, – et les histoires qu’elle avait ouï conter de ces bois lui revenaient à l’imaginative.
Une peur la liait en tous ses mouvements. Elle avait essayé de manger : les bouchées ne passaient pas. Alors, laissant là le souper sur un coin de table, sans faire sa prière à genoux, sans réunir les braises et les couvrir de cendre comme la ménagère a coutume pour trouver à l’aube un reste de feu, elle s’est couchée dans le lit-coffre.
Mais couchée, elle n’a pu ni prier, ni dormir. Le frisson de la petite mort la tenait éveillée. Des imaginations effrayantes qui se suivaient comme en un cauchemar. Elle n’osait pas seulement se tourner entre ses toiles, bien que rien ne bougeât dans la maison. La chandelle était éteinte, – ç’aurait été trop de dépense, – et son odeur de suif traînait encore. Mais pour ne pas se trouver dans le noir, Anne-Marie avait remis du bois dans la cheminée. Le bois à Chenerailles ne coûtait rien.
Le lit gîtait en un placard ouvert dans la cloison de planches, comme cela se pratique en montagne. D’entre ses rideaux rouges, la petite voyait les lueurs du feu agiter de grandes ombres ; celles de deux escabelles au coin du foyer, celles de la table, des bancs massifs. Ces ombres s’allongeaient et se perdaient dans la salle, où quelque flamme, par les luisants qu’elle y mettait, montrait les cruches vernissées, l’armoire et son rouet dessus. Là-bas, la porte du cabinet où le père serrait ses papiers s’ouvrait comme un trou. Parfois au-dessous, dans l’étable, une vache faisait tinter sa chaîne. Puis plus rien que l’horloge qui battait lentement, lentement, à croire que cette nuit ne prendrait jamais fin.
Il pouvait être onze heures quand Anne-Marie entendit quelqu’un sortir en rampant de sous le lit, de l’endroit, là, où l’on met les sabots. Crier ! ç’aurait bien servi en un lieu si écarté ! Quand elle l’aurait voulu, d’ailleurs, elle ne l’aurait pu tant la peur lui serrait la gorge. À peine si elle vit se dresser un homme qui lui parut énorme et tout de noir. Elle ferma les yeux, faisant celle qui dort.
L’homme alla à la cheminée allumer la chandelle. Il revint au lit, écarta d’un bras le rideau et se pencha sur Anne-Marie. Peut-être fut-il sa dupe en la croyant endormie. Plutôt il la devina terrifiée et comme morte. Mais de peur qu’elle ne regardât entre les cils et ne le reconnût quelque jour, lui et ceux qui allaient venir, il fit tomber quelques gouttes de suif sur ses yeux, pour les lui couler, dit-on ; c’est-à-dire sans doute pour lui clore les paupières. Toujours est-il qu’ainsi s’est racontée l’histoire.
La chose faite, sans plus se soucier de la petite, il se met en devoir de fureter partout, mais comme à la volée. Puis il passe dans le cabinet, emportant la lumière. Anne-Marie l’entendit qui forçait un secrétaire, jetait bas les tiroirs, remuait des papiers. Il y fut bien un gros quart d’heure à examiner les paperasses une à une. Il revint, fit deux tours parmi la salle, s’arrêtant souvent. Même il donnait des coups contre le mur, sondait les cloisons… Enfin il ouvrit une fenêtre, et d’un petit sifflet d’argent siffla dans la nuit pour appeler ses apôtres.
Un moment passe. Ne voyant arriver personne, il descend et sort par la porte de l’écurie pour presser son monde.
Alors, je ne sais ce qui vient sur Anne-Marie, son bon ange peut-être qui lui donne assistance, la voilà qui reprend cœur. En coiffe de nuit et sans bas, elle se lève, suit l’homme par derrière. Et quand elle le voit hors de l’écurie, elle se jette sur cette maudite porte, la pousse, met la barre, le tout en l’espace d’un clin d’œil. L’autre, au bruit, fait volte-face, pour se voir, selon le mot d’ici, fermé dehors.
— Ha, la garce !
Il avait fondu sur la porte et la secouait. Mais elle était en cœur de chêne, aussi solide que celle d’une prison. Le brigand soufflait derrière, mâchonnant des injures.
— Allons, fit-il d’une voix plus ronde et qu’il déguisait, tu pouvais bien jouer l’endormie, petite masque ! Laisse-moi reprendre mon couteau que j’ai oublié sur la table. Je jure ma foi de ne te faire aucun mal et de ressortir dans la minute.
Elle, elle riait toute seule derrière les vantaux.
Ce couteau, en passant, elle l’avait pris. Emmanché d’une corne de cerf proprement travaillée, c’était un couteau de chasse d’Allemagne ; au flanc de la gaine s’en trouvait encore un plus petit, et une fourchette à deux dents.
Anne-Marie avait tiré le coutelas ; elle considérait sa lame luisante, bleuie vers la garde et ornée d’entrelacs dorés. Il n’avait tenu presque à rien qu’elle n’eût le cou coupé de ce bel acier-là ! Aussi respirait-elle à pleine poitrine. Un contentement l’enlevait, elle aurait voulu sauter, crier et rire.
— Eh bien, je l’ai là, votre couteau. Passez la main sous la porte.
Une main blanche, autant qu’on pouvait voir, avec deux bagues, main de monsieur, qui tâtait dans la poussière, les fétus… Anne-Marie se saisit du coutelas et en décharge un coup qui tranche le petit doigt et à moitié les deux autres. Quand elle avait vu la main, une pensée de malice et de vengeance s’était emparé de son cœur. Et elle avait suivi cette pensée, manquant ainsi à la loi de Dieu qui veut que nous pardonnions les offenses à nous faites.
Le brigand a poussé un tel cri qu’on a pu l’entendre de Doranges et que son monde, qui arrivait enfin, s’est précipité à son secours. Ils l’ont trouvé à demi-pâmé, le sang lui pissant des doigts comme d’une fontaine, et ils ont eu assez à faire d’y donner remède. Cinq, six, ils pouvaient être. La plupart portaient des sabots et parlaient patois d’une grosse voix roulante de paysan ; mais un ou deux avaient un ton plus rauque, brûlé par le rogomme, et leur accent n’était point de nos cantons. Il devait y avoir un monsieur ; il commandait en jurant ; ses bottes craquaient…
Ils finirent par emporter l’autre dans le bois, avec sa main coupée, et le soignèrent s’ils voulurent. Mais comme ils partaient, l’homme en noir jeta à Anne-Marie, et de façon à faire trembler : « Ton temps viendra ! Je jure de te faire crier pitié quelque jour ! »
On peut penser qu’elle ne ferma guère l’œil cette nuit-là.
Le lendemain, la frayeur la reprit presque aussi forte. Il lui semblait à tout instant voir un homme sortir de sous le lit ou de ce coin derrière l’horloge. Elle n’ouvrait pas une porte sans trembler et suer la peur. La nuit venue, elle alluma tous les luminaires qu’elle put trouver et ne cessa de circuler de chambre en chambre. Même elle jeta du buis bénit dans le feu, comme on fait quand le tonnerre gronde et qu’on craint la foudre. Elle attendit le grand jour pour aller dormir un moment, enveloppée de sa cape de bergère, dans la crèche des vaches.
Et puis, ces vaches, c’est qu’il s’agissait de les mener boire ! L’idée de débarrer la porte faisait transir Anne-Marie. Les pauvres bêtes cependant meuglaient. C’est péché de laisser pâtir le bétail. Que dirait le père ? Anne-Marie demeura bien là deux heures, assise sur un plot, un tabouret à trois pieds, avant de les conduire à la fontaine. Elle même souffrait la soif, car depuis la veille elle avait bu si souvent que la grosse cruche à eau se trouvait vide. S’il n’avait pourtant été question que d’elle…
Puis elle pensa qu’il faut passer partout dans la vie. La fontaine fluait à cinq pas devant la porte. Mais les vaches ramenées et la barre remise, Dieu sait si elle se sentit délivrée… Ces trois jours, mener boire le bestiau fut un rude supplice.
M. le curé, surpris des allures de Zulime et aussi de n’avoir point vue Anne-Marie à la messe, le dimanche, vint sur le soir. Mais la petite avait ouï parler d’assassins qui se déguisent en prêtre, et enfermée à nouveau, reconnaissant mal d’ailleurs le curé d’en haut, à travers les bouillons de ces vitres vertes, elle s’entêta à ne lui point ouvrir.
Elle suivit encore dans la nuit du dimanche au lundi son même train d’allées et venues et de lumières. Personne au demeurant ne se montra. Les brigands devaient croire les gens du bourg avertis et faisant bonne garde autour de la maison.
SIXIÈME PAUSE
La promesse du père. – Les margandiers, les paysans et les messieurs des bois. – La consultation de Gaspard des Montagnes. – Anne-Marie, de la fenêtre, avisa bien Pauline et la mule, mais ses parents, elle ne pouvait les voir au haut de l’escalier : elle n’ouvrit que lorsqu’elle fut sûre à leur voix de les avoir là en personne.
Quelle minute ce fût.
La peur tenait encore si fort la petite qu’elle ne pouvait parler et s’attachait à la poitrine de sa mère. Il lui fallut prendre sur soi pour raconter tout point par point. En la retrouvant dans cet état, le père fut aux cent coups. Des larmes lui roulaient dans les yeux, qui tombaient sur ses favoris, sur sa grosse moustache. Anne-Marie n’eut pas un mot pour leur reprocher de l’avoir laissée seule, mais l’histoire en disait assez d’elle-même. Grange demeurait pourpre, travaillé de remords et de fureur, et d’une sorte de honte… Et quand il eut compris comme la menace du monsieur taraudait l’esprit de la petite, il lui promit, lui jura la main levée qu’il ne la quitterait jamais plus d’un pas ni d’une minute jusqu’à son mariage. Et que s’il était un jour forcé de voyager, il la ferait suivre.
Les gendarmes, grandes bottes, grand sabre, grand chapeau, vinrent avec leurs buffleteries et leurs aiguillettes, qui les font appeler les « jambalhados », les hommes à jarretières, par les paysans. Ils firent, comme on l’imagine, de bonne besogne en tel appareil au milieu de ces halliers et bois sauvages. Ils s’escarmouchèrent tant qu’ils purent, pour ne trouver que deux mendiants à conduire dans les prisons d’Ambert : l’un idiot, l’autre tout maléficié, tout rogneux, avec du mal sur la figure, des croûtes comme un chien.
Les brigands, ils pouvaient avoir filé aussi bien côté de matin que côté de soir, côté de jour que côté de nuit, s’être rembûchés dans les forêts de Saint-Germain-l’Herm ou dans celles de la Chaise-Dieu, à moins que ce ne fût dans celles de Craponne, voire dans les Bois-Noirs du Forez, du côté de Noirétable et de Chabreloche. Autant eût valu chercher des épingles dans le foin ou des puces dans la paille.
Impossible de tirer des gens un seul mot : ils ne savaient rien, ils n’avaient rien vu, ils ne croyaient pas… D’abord les paysans n’aimaient guère les gendarmes, les happe-chair, qui poursuivaient les conscrits réfractaires, pas plus que ce qui vient du gouvernement : les employés des droits réunis, les rats de cave, la conscription et les impôts. Ils se sentaient donc peu portés à les renseigner. Puis surtout ils craignaient de s’attirer le mauvais vouloir des brigands et s’en tenaient à ne rien dire.
Chaque pays a bien son monde. Pendant la grande révolution, des troupes de gueusards firent du vilain aux entours d’Ambert et de Viverols. Ils fusillèrent plusieurs personnes, entre autres un nommé Berthoulis, à Dore-l’Église. Ces brigands avaient une ganse blanche à leur chapeau ; ils faisaient contribuer les acquéreurs de biens nationaux, arrêtaient les diligences, enlevaient les recettes du gouvernement, et disaient qu’ils étaient pour le Roi. Cela colorait tant soit peu les exploits de ces jolis et dignes personnages. Mais ils auraient été pour le diable s’ils avaient cru par là se faire une pistole de plus. Et le pays en fut-il jamais complètement désengeancé ?
De ces scélérats, quelques-uns, margandiers, ferlampiers, faux-saulniers, et autres de même farine, avaient leurs quartiers en de certaines auberges dont les hôtes ne valaient pas mieux qu’eux. En un besoin ils se terraient dans des caches souterraines, vivaient dans les bois comme des loups, dans les rochers comme des blaireaux.
Mais la plupart des brigands ne l’étaient que d’occasion : porte-balle, petits marchands de fil et d’almanachs, vendeurs de complaintes, traine-besace, de ces mendiants qui roulent sur les routes et couchent dans les meules. Autant de paroissiens qui, passant de ferme en ferme, se trouvaient au courant des nouvelles et à même de préparer les coups.
Enfin des paysans sans un liard et sans une motte de glèbe. Du mauvais monde, on en ferait une danse plus grande que du bon, car la pauvreté contraint les hommes à être méchants. On dit que la conscience des paysans est chaponnée et ne piaule pas bien haut. Mais allez parler de moralité à des créatures qui ont les boyaux vides devant la huche à pain vide. Le paradis pour ceux-là, c’était simplement de se remplir le ventre. Les années de famine, quand les gens étaient misérables comme des chiens, comment ne seraient-ils pas tombés dans le crime et les brigandages ? Qu’il s’en commettait au fond des campagnes où les juges n’allaient pas fourrer le nez toutes les fois !
Ce monde ne forma jamais véritablement une bande. Selon le lieu et la besogne, les maîtres faisaient avertir tel et tel. On chuchotait que des bourgeois, des messieurs, menaient les affaires. Sans ceux-là, la racaille n’eût pas pesé bien lourd. Quels messieurs ? C’était ce que les plus fins ne démêlaient pas encore.
Si quelque jour, ruminait Grange, j’en rencontre un aux doigts coupés, trois doigts de la main gauche, – il traçait une ligne sur ses propres doigts, – j’aurai des éclaircissements à lui demander entre quatre-z-yeux.
Il se nourrissait de cette idée, la remâchait longtemps : l’homme était gaucher, Anne-Marie en avait fait la remarque, et d’ailleurs c’était bien la main gauche qu’il avait passée sous la porte. Grange interrogeait la petite. Au vrai, elle n’avait guère qu’entrevu ce bourgeois : il lui avait paru grand, large, un fort homme. À force d’y songer, elle mêlait des imaginations à son incertain souvenir : le personnage avait un mouchoir rouge noué autour de la tête, – son chapeau l’eût gêné sous le lit, – et devait porter toute sa barbe…
Anne-Marie et son père finissaient par le voir. Même ils auraient donné ses enseignes.
Il était venu probablement deux bourgeois à Chenerailles, et les brigands étaient six de bon compte à leur obéir. Pour avoir recruté une telle troupe, on avait donc comploté non seulement de piller la maison, mais encore de la fouiller de fond en comble ? Grange sentait le besoin de consulter un finaud qui lui éclaircît la vue. Et quand Gaspard des Montagnes vint de Saint-Amand, aussitôt l’affaire sue, pour leur offrir ses services et ceux de la parenté, il ne put se tenir d’en raisonner avec lui, bien que se trouvant un peu humilié de demander aide et conseil à ce garçon qui allait sur ses dix-sept ans.
Il l’emmena dans le cabinet où l’on descendait par trois marches. Deux images de saints bariolées de rouge et de bleu, étaient collées sur la porte. Des sacs de blé debout, au fond, s’appuyaient contre la muraille. Au-dessus pendaient quelques brides hors d’usage, et dans son étui de cuir une hachette à marquer les arbres. Le secrétaire était dans l’angle, près de la fenêtre.
— Tu vois : le meuble une fois forcé, il a bouleversé les papiers et secoué mes registres que j’ai trouvés sur le plancher, ouverts à plat. Il y avait là une douzaine d’écus de six livres, eh bien, il n’a pris que ce portefeuille de cuir à fermoir, qu’il a déchiré, et qu’il a porté à côté pour examiner des effets de commerce et des corps de billet qu’on m’avait souscrits. Tout bien vu, il n’a rien emporté. Tu me diras qu’il allait revenir avec son monde ; mais alors il lui fallait partager avec eux, au moins les écus. Il cherchait autre chose. Si je sais quoi, le diable m’emporte.
Gaspard écoutait, assis de coin sur sa chaise, la tête en avant : et ce gars remuant comme un chien de berger, on le sentait là posé seulement, prêt à se lever en pied, à s’activer tant que le jour serait long. Quel entrain, quelle vivacité, quel feu dans les prunelles ! C’était une diablerie qui lui sortait par les yeux.
— Oui… La cousine Anne-Marie l’a entendu qui sondait les murs. Il ne pouvait pourtant pas penser que vous y avez caché quelque somme. On sait que pour payer votre frère vous lui avez remis même des napoléons neufs ; sans parler des effets qu’il a escomptés si haut que vous les auriez gardés sûrement si vous aviez eu encore de l’argent chez vous.
— Eh oui, mon garçon, jamais de fonds chez moi, d’ailleurs. Quand j’en ai dont je puis disposer, je les place en première hypothèque, à six pour cent. Ça vaut bien une inscription sur le Grand-Livre, à condition de ne pas prêter plus de la moitié de l’estimation, et de prendre ses sûretés sur les droits de la femme. Je sais mener ma barque, c’est connu de tout le monde.
Il était content de faire le gros, le bourgeois, devant Gaspard, et s’approuvait à petits coups de menton.
— Alors ? l’homme cherchait – quoi ? A-t-il pu croire que votre frère avait caché ici des valeurs ou quelque papier de conséquence ?
— Jérôme n’a rien apporté ni caché, que je sache…
Grange s’interrompit, songeant à une certaine après-dînée où l’Américain s’était arrangé pour rester seul au logis, ce qui lui avait, à lui, semblé singulier. Il s’en tut, parce qu’entrer en cette supposition ne lui agréait guère. L’idée ne fit que lui traverser la cervelle.
En cette minute ils avaient brûlé, comme on dit, au jeu des cachettes. Mais rien alors ne marquait à ce nez fin de Gaspard qu’il était sur la voie. Et quelle folie de penser qu’on peut par le raisonnement imaginer et expliquer les faits et gestes d’un homme, c’est-à-dire des actes qui sont le plus souvent sans raison ! Le gars fournit une ou deux autres explications sans y tenir beaucoup… Puis il ne causait plus. Il balança deux fois la tête, et se leva en mettant la main sur la manche de Grange.
— Nous ne savons rien, pauvre cousin, mais je ne vois là que quelque commencement. Tenez, délogez d’ici. J’entrevois des choses, oui, et je crains que vous n’ayez par la suite pas mal d’affaires avec ces gueux… En tout cas, mandez ce qui vient de se passer au cousin Jérôme.
Il avait parlé net, la face résolue. Une sorte d’esprit de guerre, comme une chanson, l’enlevait à soi-même. Peut-être ne prévoyait-il des histoires que parce que, sans les souhaiter à sa parenté, il les désirait de tout son sang rouge et bouillant.
Lorsqu’ils furent sortis du cabinet, Gaspard ne s’inquiéta plus que de sa cousine Anne-Marie. Cette bouche lente à sourire, ces yeux encore effarés, ces joues pâlies, lui faisaient mal comme un coup sur le cœur.
— Si je ne la vois pas rire avant la fin de la soirée, je ne vaux pas les quatre fers d’un chien.
Il fit tant que le lendemain, lorsqu’il repartit pour Saint-Amand, la petite avait je ne sais quel étincelant de jeunesse, de gaieté, sur la figure, et devint toute rose à la minute des embrassades.
DEUXIÈME VEILLÉE
PREMIÈRE PAUSE
Le pays de Sumontargues. – Naissance et baptême de Gaspard. – Les missionnaires, le jovial abbé Gonet. – Les écoles de Gaspard, ses mœurs et conditions. – Gaspard était natif de Sumontargues, qui est un joli endroit dans les monts du Livradois, à trois lieues d’Ambert, côté de soir. Terroir pauvre et climat rude. Là-haut, on pousse la neige huit mois de l’année avec son ventre. Les épaisses maisons de pierre rougeâtre n’ouvrent que de petites fenêtres en largeur, à barreaux de fer, sous leur capuchon de chaume ébourré par le vent. Parmi les jardinets de choux verts et de framboisiers dans leurs parapets de granit, le village est assis en belle vue, au-dessus du bourg de Champétières ; et sur ces découverts, le grand air court, toujours vif et brillant, comme l’eau de roche qui saute de partout.
Les gens y vivaient de cette eau fraîche et de l’amour du bon Dieu, se sustentant pour le reste assez maigrement de raves, de lard et de tourtes de seigle. Lorsqu’ils avaient quelqu’un à dîner, la chose est véritable, ils servaient au dessert des carottes crues comme régal et friandise. Et aurait-on même trouvé une assiette dans le village ? On ne mangeait alors que dans des écuelles ou sur des tranches de pain bis.
Le pays, tout de prairies et de forêts, est plus propre au pâturage qu’au labourage. À peine de pauvres coins de terre épaulés par des talus de fougères qu’ombragent quelques merisiers. Là-haut, on fane on moissonne, on cueille et l’on sème presque tout d’un temps, en août-septembre.
Que n’y a-t-il un pape né dans l’endroit ? Il aurait fait pour Sumontargues ce qu’un autre fit pour le Limousin, ce Clément VI dont on voit le tombeau dans l’église de la Chaise-Dieu.
Comme dès son élévation, une députation de ses compatriotes venait lui témoigner leur joie et le supplier d’user de son pouvoir afin qu’il y eût désormais chez eux deux récoltes par an, il le leur accorda volontiers, et voulut, pour une plus grande marque de son affection, que leurs années comptassent vingt-quatre mois.
Ce resterait le vrai moyen de lever deux fois l’an foins et blés à Sumontargues. Mais on attend encore qu’il y fleurisse un pape.
Les parents de Gaspard étaient de bons chrétiens à qui les écus ne faisaient pas trop la guerre, mais aimant l’honneur, bien apparentés aux Grange, aux Domaize, – ils doivent avoir encore des arrière-cousins par là-haut, – bref, une de ces anciennes familles de montagne avec beaucoup d’accointe au loin, bien famée et de bon renom.
Gaspard naquit le beau jour du lundi de Pâques, où les anciens Ambertois allaient s’égayer et manger des œufs rouges dans les verts prés de Roddes, près de la fontaine d’eau piquante.
On conte que sa mère rêva durant la grossesse qu’elle mettait au monde un enfant habillé de bleu, que des loups venaient le lui enlever et qu’il s’escrimait si bien de son bâton qu’il les assommait sur la place.
Au moment même qu’il naissait, le feu prit à la maison. Dans le remue-ménage, on renversa sur l’enfançon un pot de crème, et la voisine qui l’emportait au dehors le laissa choir sur les pâquerettes du coudert, – ainsi appelle-t-on chez-nous une pelouse. Ce qui fit augurer qu’il serait la crème et la fleur, la lumière et le feu de tous les garçons de l’Auvergne.
On nota aussi qu’il se prit à rire dès qu’il fut au monde, contre l’ordinaire des enfants qui ne rient point avant le quarantième jour.
Les temps étaient durs, pourtant. C’était au plus fort de la grande révolution, trois ou quatre ans après l’année de la grande peur.
Car tout commença par la grande peur au mois de juillet. Chacun alla se cacher dans les bois en criant : « Voilà les brigands ! voilà l’ennemi ! » L’un disait qu’ils arrivaient du Velay, l’autre de la Limagne, brûlant les moissons et massacrant le monde. Jamais personne ne put les voir. Ensuite on cria : « Illuminez ! »
Alors vogue la galère ! Ce fut la révolution, c’est-à-dire le temps où le blé monta à neuf francs le quarton, et le sel à dix-neuf sous la livre, du sel tout noir qu’on allait acheter au Mas de Saint-Ferréol.
Quand Gaspard naquit, on en était à pourchasser les prêtres. Et dur, et dru. Le pauvre abbé Gonet, qui est célèbre dans les quartiers de Viverols et de Saint-Anthème, l’échappa belle plus d’une fois. Un certain jour, les gendarmes le traquaient de si près qu’il se vit perdu. C’était vers la Chaulme, au creux de l’Oule, où le ruisseau choit dans un précipice. Que fit le meunier, bonnes gens ? Il détourna l’eau. Il dit à l’abbé de se blottir dans le creux même, contre la roche. Et puis il rend au ruisseau son cours. Les gendarmes n’eurent jamais le nez d’aller chercher derrière la chute.
Le calice d’étain de l’abbé Gonet est conservé dans le musée de M. Hector Granet, à Viverols. C’est d’ailleurs à côté de ce musée que se dresse une chapelle où M. Hector conserve son propre père dans l’alcool et va parfois jouer sur l’accordéon les bourrées qu’aimait le défunt. Les journaux en ont parlé, et pour une fois ils ne mentaient pas.
Un drôle d’endroit que ce monde !
L’histoire de Gaspard le dit assez, avec ses aventures de toutes les paroisses, celles-là faites pour faire pleurer, celles-là faites pour faire rire. Car malgré des terreurs et des peines on savait s’amuser, alors ! Il avait lui, ce mot que « la vie sans les farces et les jolis tours est comme un voyage sans auberges ».
Qui ne serait du même avis que l’Amable de Riom, quand au soir, devant son échoppe, après en avoir conté de toutes couleurs aux voisins, il répétait en prenant sa prise :
— Allez, rire, c’est encore ce qui coûte le moins et ce qui contente le plus !
Est-ce qu’il n’y avait pas autrefois plus de joie dans la vie ? Peut-être parce qu’on la prenait plus vigoureusement.
Ainsi ces missionnaires : des intrépides, mariant, baptisant, apportant des consolations aux malades, aux mourants, et sans rien craindre, se mettant chaque jour en hasard. Mais aussi quelle énergie gaillarde. Ce même abbé Gonet, devenu curé sous l’Empire, avait gardé la détestable habitude de s’emporter et de sacrer un peu trop haut. Son vicaire s’en scandalisait. Un jour même, comme ronflaient les tonnerres de nom de sort, le jeune ecclésiastique alla jusqu’à marmonner je ne sais quoi, de mauvais prêtres qui déshonoraient la robe et qui ne pouvaient avoir la foi, puisqu’ils juraient comme des mécréants.
L’abbé, qui l’entendait, bondit.
— Ha, la foi, tu ne sais pas si je l’ai ? Eh bien, approche un peu, le jeune homme, regarde par ici, – il tapait de sa main sur le bas de son dos, – je vais t’en faire éclater les marques, de ma foi !
Et de retrousser sa soutane, de se déboutonner, de baisser sa culotte. Puis, se tournant, il montre au vicaire ahuri les cicatrices de deux ou trois balles reçues dans le fondement alors que les gendarmes le pourchassaient en l’an deux de l’Indivisible…
Gaspard fut baptisé par un de ces réfractaires qui était assez proche parent des Grange et dont lui-même se trouvait petit-cousin.
La cérémonie à peine finie, on vint dire que la maison était cernée par les habillés de travers, autre surnom des gendarmes. Le père n’eut que le temps d’enterrer le prêtre sous un tas de pierraille, dans la cour, en plaçant sur lui une roue de charrette, pour qu’il respirât par le moyeu. Ceux qui le cherchaient lui marchèrent dessus deux ou trois fois.
On ne sait rien de plus de ce baptême ni de ceux qui tinrent Gaspard sur les fonts, sinon qu’ils étaient dignes de lui rendre cet office, car, comme le dicton le porte :
De par les pieds ou de par l’échine
On ressemble au parrain ou à la méchine,
à la marraine.
Gaspard était encore enfant de mamelle quand ses parents héritèrent d’un oncle une auberge assez achalandée sise au lieu de Saint-Amand Roche-Savine. Or, comme Gaspard à Saint-Amand parlait toujours de son endroit, on lui fit porter le surnom de Gaspard de Sumontargues. Surnom qui devint Gaspard des Montagnes, quand il fut connu comme le loup blanc par tout le bas pays d’Auvergne.
Durant son enfance, Gaspard fit cent choses rares qui seraient trop longues à conter. Ainsi que les drôles du bourg, il apprit ses « heures de trois sous », c’est-à-dire sa croix de par Dieu, c’est-à-dire son abécédaire ; il apprit surtout à prendre à la main des truites dans le ruisseau, à courir de son pied leste aussi vite que le lièvre, à grimper en un tournemain à la cime d’un sapin de quinze toises, et à lancer si roide et si loin les cailloux, que, comme dit l’autre, il vous eût à cinquante pas massacré le nez au milieu du visage, si c’eût été votre bon plaisir.
Quand ses parents eurent des écus, ils voulurent se faire honneur du petit qui brillait déjà comme un soleil entre ses frères et camarades. On délibéra d’en faire un juge de paix ou un docteur en médecine, et on l’envoya dans les écoles.
Était-ce au bon collège d’Ambert ? Était-ce à Billom, au grand collège des Jésuites ? Toujours est-il qu’il sut vite autant de latin qu’un cardinal, tant ses esprits étaient éveillés. Trop éveillés, car le voilà, lui, vif comme un poisson dans l’eau, à sécher d’ennui sur les bancs de la classe. Lorsqu’il lui fallait après quelque diablerie tendre les doigts aux coups de férule, il se tenait à quatre pour ne pas sauter à la perruque de son régent et faire tout voler par le collège. Et puis il regrettait trop sa montagne, la forêt de la fraise et de la framboise, le ruisseau de la truite et de l’écrevisse, le vent, l’espace devant cette vue tout là-bas, sur les monts d’Or, les monts Dôme, la liberté, la belle liberté. Bientôt, laissant là l’ambition qui n’était pas son fait, il s’en revint chez son père où il y avait assez de travail pour qu’il pût s’occuper avec contentement.
Aux champs, la fauchaison, la moisson, les semailles ; au bois les arbres à planter, à marquer, à abattre, à charroyer au compte de son père et des propriétaires voisins ; à l’auberge les chevaux à panser, à étriller, à mener boire ; donner la paille et l’avoine. Et le roulage, les charrois, le vin qu’on allait chercher en Limagne, voire parfois en Languedoc.
Gaspard n’avait encore seize ans d’âge qu’il s’entendait à tout, sans avoir le même goût pour toutes choses. Au demeurant vigoureux, bien construit de ses membres, bâti à chaux et à sable.
Imaginez-le droit sur jambes, habillé à l’ordinaire de serge bleue, la veste courte aux longs revers boutonnés par des boutons d’os, avec de petites basques à grandes poches où mettre une demi-douzaine d’échaudés, les brayes à pont, les hautes guêtres serrées au genou de jarretières teintes en écarlate. La façon belle dans ce simple habit paysan, agréable de mine sous le chapeau à vastes ailes, tel à peu près qu’en portent les marchands de choux d’Olliergues.
Gaspard avait une face ferme et vive, aux os larges qui faisaient comme des pans sous la peau où le sang frais coulait vermeil. Un peu rouge au visage, peut-être, mais les dents blanches et les yeux, de vrais yeux d’Auvergnat, si perçants, si brillants, si vrillants, qu’on les eût pris pour des yeux de basilic. À eux seuls, ces yeux faisaient comprendre le mot d’une bonne femme de Mirefleurs :
« Gaspard plus doux que les doux et plus coquin que les coquins. »
Tant que je vivrai, il ne me sortira pas de la vue. Ma pauvre grand’tante me l’a dépeint si souvent ! Moi, curieuse comme une javotte, je la questionnais. Et elle, peut-être bien qu’elle en avait été un brin amoureuse dans son jeune temps, la pauvre.
Est-ce qu’il n’avait pas tout pour tourner la tête aux jeunesses ? Surtout cet air, en toute sa personne, d’entrain et de vaillance. Malgré le diable et ses cornes, quoi qu’il arrivât, on le sentait, eh bien ! il saurait toujours rire. Cœur plus gai ne s’est jamais trouvé en la chrétienté.
C’est belle chose, cela, dans un homme, quand sous le courage riant est le vouloir solide. Et il y était bien. Une fois décidé, Gaspard ne voulait plus rien savoir : il allait à son affaire droit devant.
Certainement son histoire a pris avec les années quelque teinte de fantastique. Mais en souhaitant qu’on y trouve plaisir et exemple de bien faire, je la réciterai au plus près du naturel, de façon qu’on n’ait pas souvent à en rabattre. On dit en proverbe commun : « Tous ont bien ce qui achète, il faut avoir ce qui paye. » Lui, il avait ce qui paye et tout est là.
DEUXIÈME PAUSE
Le village de Champétières. – Plampougnis le menuisier. – La reboule et la bourrée sur la route. – La cadenette de fer. – Le premier feu dans la maison neuve. – Gaspard donc pouvait avoir dix-sept ans lorsque son père l’envoya à Champétières aider le cousin Grange qui avait décidé de s’y établir. Car Grange voyait que ses trois femmes prenaient de l’ennui dans les bois de Chenerailles et entraient en frayeur pour un rien depuis l’aventure.
Champétières-des-Vallons est un assez gros village dans un fond, en pays riant, verdoyant, à côté de Saint-Ferréol-des-Côtes, qui se trouve sur une croupe en pleine hauteur. C’est encore la montagne, au-dessous de Sumontargues, mais l’air y est plus doux et le soleil plus chaud. On y voit des vignes sur les murs et des raisins sur les vignes. Quant à voir ces raisins vermeils, pourquoi ce ne pourrait-il arriver, quelque année, avec la permission de Dieu ?
N’importe, la guirlande d’un cep et de ses pampres verts réjouit l’œil sur un mur et cela donne idée d’être en un bon endroit.
Le dimanche de la seconde fête de Pâques, les Grange étaient donc venus camper dans un vieux logis que la mère avait hérité d’une tante proche l’église. Et Grange commença de faire bâtir au haut du bourg une maison à la mode bourgeoise, de pierres de taille massives et jointoyées à peine, parce qu’alors la chaux qu’il fallait faire venir à dos de mulet était terriblement chère.
Aux environs de la Saint-Michel, voulant s’installer avant la mauvaise saison, il pressa les ouvriers et fit prier Gaspard de descendre les aider. Lui-même, poussant la varlope ou maniant l’herminette, travaillait tant à la menuiserie qu’à la charpente.
Gaspard ne se contentait pas de savoir la théorie : il avait la main, comme on dit, qu’il s’agît d’enter un cerisier, de dresser un cheval ou d’arranger une horloge. Si habile de ses doigts qu’il ferait des yeux à un chat, déclarait la cousine Grange qui le voyait toujours avec plaisir. Bon menuisier, notamment, calant en deux coups le valet de banc et n’en mettant jamais plus de trois pour enfoncer un clou.
Afin de pousser la besogne et aussi parce qu’il sentait mitonner sourdement certaines affaires, il avait amené avec lui un garçon de même âge, charpentier de son état, qu’on appelait Plampougnis.
Plampougnis, qui est le nom du Petit Poucet d’Auvergne, signifie petite pièce, poignée, de chose qu’on tient toute dans la main. Or, il s’appliquait à un grand frisé haut et large comme un garde-habits, membru comme un chêne, et qui ne connaissait pas sa force. Garçon de la pâte du bon Dieu, au demeurant, fidèle, bon compagnon, franc du collier, toujours content du sien. On le sentait bien tel à le voir seulement au travail : l’ouvrage lui fuyait au-devant tandis qu’il chantait :
Oh ! malheur aux garçons qui n’ont point de maîtresse !
Moi j’en ai-z-une à quatre lieues d’ici :
Je vais la voir à mon plaisi.
Des fraisilles de sapin s’accrochaient à sa poitrine velue sur quoi bâillait sa chemise ; il essuyait d’une main son bon visage délibéré, et sa voix repartait, battant les murs :
Ma mère, apportez-moi mon habit de soie rose,
Et mon chapeau, qu’il soit d’argent bordé,
Je veux ma mie aller trouver.
Grâce à ce compagnon de renfort, la maison se trouva prête à être habitée quelques jours avant la Toussaint.
Un matin, on cloua au pignon un drapeau et un bouquet de fleurs. Le curé vint bénir la bâtisse ; on dit un Pater, un Ave et un Credo à deux genoux, puis le maître trinqua avec chaque ouvrier. Ce fut la reboule, la fête qu’on fait, le toit posé, à toute maison neuve.
Grange régala son monde : un dîner où chacun eut sa serviette blanche, luxe dont on parla. À Saint-Anthème, quand on s’attable dans une auberge, la servante vient, jette l’œil sous la table, dit à l’hôtesse :
— L’a de bottis !
Il a des bottes, donc il a droit au linge. Mais si l’on est en éclots, va te faire lanlaire. Il n’y a de serviettes que pour ceux qui sont chaussés de cuir ou qui portent soutane.
Oui, un dîner qui se fit appeler monsieur ! Pas seulement de ces gros plats de truands comme on en voit dans les noces, la pièce de mouton cuite au four sur un lit de pommes de terre croustillantes : mais chacun sa grive dans les feuilles de vigne ; et la fine andouillette, et le civet de lièvre, et la tourte aux confitures grande comme une roue de char.
Les hommes dînèrent assis, servis par les femmes, qui, en ce vieux temps, demeuraient debout, l’assiette ou l’écuelle à la main. Les vieilles même ne se mettaient point à table, elles restaient sur leur tabouret, au coin du feu, tandis que les jeunes vaquaient ou mangeaient leur part sur le seuil.
Ils étaient là quelques-uns de bien endentés. Mais pas un n’approchait du Plampougnis. Plampougnis avait son renom. Aux noces, quand il avait fini, on pouvait encore lui approcher un bon gigot. Une fois, le métayer des Chapioux mariait sa fille. Le repas se faisait à l’auberge. On apporte sur la table une poitrine de veau farcie tout entière. Le métayer, pour l’honorer, prie le maître de découper les viandes. Bon. Le monsieur commence par partager la poitrine en deux, et, embarrassé, pose la plus grosse moitié dans l’assiette du gars qui lui faisait face.
— Oh ! monsieur, c’en fait bien un peu !
Saboulé, le maître, l’envisage, voit que mon Plampougnis estime naïvement qu’on lui donne ce morceau de je ne sais combien de livres pesant pour sa part ; et alors :
— Mais non, va ! Il y a des os. Il te faut ça à toi !
Ma foi, le garçon prit son couteau et vous mit bravement la viande à l’abri. Celui-là ne lui avait pas volé son argent qui lui avait appris le métier.
La dernière rasade avalée, on sortit pour danser sur la route. Les sabots claquaient, Dieu sait, sur la terre sèche : un train, un tapage à assourdir un meunier.
Comme il n’y avait là ni vielle ni musette, on dansa aux chansons. Les gens gais ne sont jamais embarrassés de rien. À la fête de Valeyre, pour ne pas perdre une minute, une voisine doublait le ménétrier, et lors des pauses où il vidait chopine, elle ramageait, accoudée à la table, un mouchoir sous le coude et la joue dans la paume : « Et ra hagnagna, tideli, tidelidelette, et ra hagnagna, tideli, tidelidela ! »
Là, c’était la petite Pauline qui chantait d’une voix tintante. Elle s’accompagnait en battant des mains, pour marquer la cadence, et tous de bondir, de tourner, de baller, de s’en donner à la joie de leur cœur.
— Allons, tant que la fumée du vin dure !
Gaspard fit danser Anne-Marie. Mais après deux bourrées, elle préféra s’asseoir dans un petit pré de serpolet qui surplombait la route. Elle s’installa sur un quartier de pierre ; Gaspard vint la rejoindre, et resta accoté à un vieux pin tors qui leur donnait son ombrage. C’était une de ces belles journées d’arrière-saison où le temps est à la fois bleu et doré. On voyait un pan de la plaine, au bout du vallon, et la montagne du Forez avec une ou deux fumées de fanes qui montaient en filets vers les bruyères des crêtes.
Pauline chantait cette bourrée qui dit :
Que je fusse mariée,
Mariée à mon plaisi,
Passerais la matinée
Aux côtés de mon ami.
Gaspard, les yeux au loin, songeait à Anne-Marie, heureux d’être là vers elle, heureux surtout de l’avoir vue gaie à nouveau en ce jour de gaieté. Lui, qu’une fougue du sang endiablait près des autres filles, et qui n’avait plus de bon sens alors, leur disait des bêtises, les embrassait de force et les rendait pour un soir aussi déchaînées que lui, il se sentait un cœur nouveau près de sa cousine.
Il sourit longuement pour soi seul. Anne-Marie, cette petite figure claire sur laquelle il y avait toujours une douceur, et ses yeux couleur de noisette, si parlants même quand la figure se refusait à rien dire… Anne-Marie… Et il sentait contre la jambe la chaleur de sa jambe à elle, et il n’avait qu’à tourner les yeux pour la voir.
Il les tourna lentement vers la petite qui ne sonnait mot, les mains l’une dans l’autre au creux de son tablier. Et lui qui se la figurait rose d’avoir dansé, un peu lasse et souriante, il la vit pâle, absente, une larme déroulant sur sa joue, puis une autre, une autre, une autre, fil à fil.
Il en fut si saisi qu’il en eut le souffle coupé comme s’il entrait dans un étang. De toute une minute il ne bougea. Un élan pourtant l’emportait. La folie du grand repas et de la danse, les chansons, l’amitié pour sa cousine, tout cela, tout cela, jamais il ne s’était senti le cœur à la fois si gai, si triste. Il se laissa glisser près d’Anne-Marie, lui prit la main.
— Écoute, cousine, fie-toi en moi. Je ne sais pas ce que je pourrai faire, mais je saurai, je ferai. Crois-tu que je sois venu ici pour faire la belle jambe dans le bourg ? Vous êtes de ma parenté, vous ?… Tiens, je n’aurais plus l’esprit en repos que tu ne m’aies dit ton ennui.
Elle ne répondit rien, d’abord. Sa poitrine se soulevait, s’abaissait vite. Gaspard parlait avec un tel sentiment de cœur qu’elle le regarda, d’un regard chaud d’amitié qui allait vers lui comme une rayée de soleil. Puis elle se prit à sourire, mais le pauvre sourire :
— Il y a que je suis poltronne, et voilà tout… J’ai peur, ajouta-t-elle d’une voix changée, pressant du bout de ses doigts la main de son cousin. Cette fête m’a rappelé la menace du mauvais homme. Alors, je voyais ce bois, là, et je pensais qu’il pouvait y être à guetter, et m’envoyer une balle de plomb dans le corps avant que personne l’ait seulement aperçu… Ah ! vois-tu, ce n’est pas une vie de craindre toujours.
Sans faire cas de rien, Gaspard s’était placé du côté du bois. Elle ne s’en avisa pas : elle était toute à s’expliquer, pour qu’il ne la crût pas déraisonnée. Maintenant qu’elle avait vu le cousin chez eux, si vaillant et en train, à part elle, comme elle aurait aimé vivre au plein soleil, dans la joie de sa jeunesse. Mais jamais elle ne pourrait. Elle savait tout par avance.
— Si tu l’avais entendu ! Je suis sûre qu’un jour il me fera crier pitié, comme il l’a promis…
Et dès qu’elle y repensait, elle n’avait aucun courage.
Elle disait ces choses si naïvement que Gaspard en eut un moment le même sentiment qu’elle. Pour la première fois il comprenait le malheur, les souffrances, tant de gens qui sont malheureux, tant d’angoisses, et tant de méchanceté aussi, il lui sembla voir cela d’une vue. Les peines qui tombent parfois sur la vie, la chavirent toute et font qu’on n’a plus de goût à rien… Anne-Marie avait-elle changé en six mois ! Que ce puisse devenir cela, la vie, cette tristesse, ce sentiment d’être si misérable. Est-ce qu’une entente de tous ne devrait pas mettre les choses sur un autre pied, et venir à bout du mal ?
Une colère le montait. Il s’en voulait maintenant de ce qui lui bouleversait le cœur, et se reprochait d’avoir devant une femme comme une envie de pleurer.
Il s’était mis debout et tendit pour l’aider la main à Anne-Marie. La fraîcheur tombait au coucher du soleil et le serein commençait de mouiller l’herbe. On entendait cliqueter les feuilles jaunes au haut des peupliers du moulin. Des bourres de brouillard traînaient dans les fonds sur les pacages. Le soir était tranquille…
Comme Anne-Marie lui avait parlé avec ouverture et confiance ! Il tâchait de la rassurer : ces idées ! mais le maître des brigands, vu le commerce qu’il menait, était-il seulement en vie à cette heure ? Et puis on saurait bien veiller à tout.
Le ton plus encore que la chanson rendit cœur à la petite. C’était une crainte sans raison qui la déconfortait, et non tant le souvenir du monsieur. Elle sourit d’un vrai sourire et parut délivrée enfin.
Un désir de se battre, de se dévouer pour elle, brûlait le garçon.
— C’est promis, cousine, lança-t-il en riant. Je te promets ici, sous ce pin, d’être à ton service. Faisons la cadenette de fer.
Comme deux enfants, ils s’accrochèrent l’un l’autre la main par le petit doigt, serrant et tirant fort, puis s’arrachant chacun un cheveu, l’envoyèrent du souffle voler au vent.
Ils avaient mis malgré tout un sérieux dans leur comportement et revinrent ensemble sans plus parler vers la maison neuve. Près de la fontaine, Anne-Marie posa la main sur l’épaule de Gaspard comme pour l’attirer à elle. Leurs têtes se touchaient presque. Elle lui chuchota un « merci », et, vite, lui fit un petit baiser sur la joue. Ses lèvres étaient chaudes comme un perdreau dans sa plume. Et ce fut ce baiser-là qui décida de leur sort.
La reboule était finie. Déjà tombait la nuit tôt venue de l’arrière-saison. Tous étaient rentrés dans la grande salle, et, n’y ayant point encore leurs habitudes, se tenaient là sans savoir que faire de leur corps. La mère dit que l’air fraîchissait. Elle alla prendre des bourrées de genêt sec et en fit une flambée. Grange, après vingt remarques sur le bon agencement des aîtres et dix comparaisons de cette maison à celle de Chenerailles, à l’avantage de celle-là, – car il aimait s’attirer des compliments, – s’assit devant la flamme.
Il se chauffait les jambes en fourgonnant le fagot d’un bâton, quand il se souvint que meurt dans l’année celui qui allume le premier feu dans une maison neuve. La même pensée vint-elle aux autres ou l’humeur du maître fit-elle tache d’huile ? Toujours est-il que, Gaspard étant sorti, avait-il dit, pour poser des collets, chacun s’assombrit et la veillée se passa fort tristement.
TROISIÈME PAUSE
La Bête-Noire et ses déplaisances. – Le Guillaume de Montfanon. – Six-Mions la canaille. – Le hourvari de la foire de Chignat. – À quatre ou cinq jours de là, Gaspard travaillait au galetas avec Grange. Ils aménageaient un charnier à l’aspect du nord. On entendait à l’étage Plampougnis menuiser en chantant comme un orgue.
Le gros du travail était fini, mais on trouvait toujours à s’occuper. Ainsi, au-dessous de la porte, – comme c’est la mode chez le monde riche de campagne, – Gaspard avait fait de l’imposte une volière peuplée de chardonnerets qui égayait la maison.
Au jardin se voyaient un cabinet de verdure et un méridien qui marquait l’heure au soleil. Toutes curiosités où gît plus de minutie que de dépense et qui donnaient de l’admiration aux gens du bourg.
… Un soleil jaune entrait en biseau jusqu’au fond du galetas et faisait poudroyer l’air. Dans un coin, un tas de babios, de pignoles, sentait bon la montagne. Gaspard enfonçait des clous et exposait au cousin, à travers pauses, qu’on pourrait avoir un écureuil qui tournerait sa roue dans une jolie cage peinte.
Grange laissait dire. Il semblait mal luné, inquiet, sourcilleux.
— Tu te donnes de la peine, mon pauvre garçon, fit-il enfin, retirant les pointes qu’il serrait entre ses lèvres. Mais, vois-tu, le malheur ne s’écartera plus de chez nous. Il y a du malheur dans l’air.
— Et pourquoi diable ces idées ?
— Parce que.
Il ne voulut point dire que la nuit il avait entendu le chavanieu, l’oiseau de la mort, chanter sur le toit. Au bout du compte il y croyait sans y croire. Il avançait même qu’il n’y croyait pas, tout en citant force exemples de ce présage ayant eu son effet bientôt.
— C’est, reprit-il, que je n’aime guère cette nouvelle histoire d’une galipote…
La Galipote, qu’on appelle encore la Bête-Noire, personne ne sait trop quelle bête c’est là. Une sorte de loup-garou qu’on n’est jamais arrivé à voir de façon à le détailler…
Depuis le jour de la reboule, une de ces saletés courait le pays. Les gens essayaient bien de lui mettre les chiens derrière, mais point de nouvelles : la queue sous le ventre, ces labris se rencoignaient contre leurs maîtres. Champétières en était c’en dessus dessous. Au moindre rien dehors, vite tout le monde sur pied. De chez soi, sans oser sortir, on cherchait à voir passer la Bête-Noire. Mais elle ne prenait sa course qu’à la nuit et suivait toujours l’ombre : à peine si l’on entr’apercevait une forme détalant, sans jambes et sans tête.
Le soir, quand elle a trait les vaches, la ménagère met le pot de lait dans l’eau froide pour que la crème monte. Or, chaque soir, au moulin, la galipote prenait le lait qui rafraîchissait dans un bac de bois près de la fontaine et le versait par terre tout autour. Gaspard avait dit au meunier : « Tu ne peux donc pas charger ton fusil de gros sel et veiller une nuit ou deux pour dire deux mots à cette dessalée-là ? » Mais l’homme croyait que les balles mêmes, à moins qu’elles ne fussent bénites, s’applatissaient comme un écu sur la peau de la galipote. Il y passerait trois et dix nuits, il n’y gagnerait que de se morfondre : car, la galipote, il n’est point donné de l’attraper ; on peut la voir galoper, non pas la saisir.
— À ton aise, mon bel ami.
Et Gaspard ne s’était pas soucié outre mesure de ce lait renversé ni de ces chiens qui prenaient peur.
— Vous êtes bon ! dit-il à Grange. Des cassements de tête parce que quelque galapiat s’amuse à galampiner de nuit ? Tout ça va à de petites voleries ou déplaisances. Et puis après ? Laissez-là courir, li lon la, la galipote !
— Mais qu’elle ne nous coure pas dessus… J’aurai toujours quelque démon à ma queue, désormais, fit-il d’un air sombre, en donnant du poing sur l’établi. Et cette bête noire, je sais qui c’est : une canaille qui tient à la bande des grands bois…
À quoi Gaspard répondit qu’il avait causé avec des personnes de sens : selon le bruit commun, sous la peau de la galipote, il n’y avait que le Guillaume de Montfanon.
Quel pèlerin que celui-là. Une espèce de bonhomme à nez rouge, sec, déplumé, éveillé : et toujours habillé de serge couleur d’amadou. Ce grand traîne-diable avait été un temps berger de la paroisse et les petits enfants lui chantaient de loin :
Guillaume,
Habillé de jaune,
Prends ta corne
Et va-t’en clore !
Mais il ne faudrait pas croire que ce fût un niais, un badin, un arlequin de faïence. Ah ! que non pas. Son œil d’écureuil et sa mine malicieuse comme celle d’un vieux singe en disaient long. La délectation du Guillaume, c’était les procès. Un plaideur enragé, perdant le boire et le manger pour la procédure. Il avait eu cette chance après ses années de berger de faire un gros héritage. Misère de lui ! Prés, terres et bois, tout passait en gribouillages d’huissier, d’avoué, de notaire.
Quel pèlerin, encore une fois ! Une imagination, un manège ! Les idées lui venaient comme les petarelles au derrière d’une chèvre, sauf votre respect. Et des idées qu’on n’aurait jamais trouvées sous le chapeau d’un autre paysan. Ainsi il avait à lui six biquettes : ne leur fit-il pas fabriquer un joug pour aller chercher son foin en un pré pendant comme un toit de chaume et où des vaches n’auraient jamais pu tenir sur pied ? Mais il en avait fait des sept couleurs ! Cependant on ne le regardait ni comme traître, ni comme méchant homme.
— Si c’était le Guillaume, poussa Grange, je ne m’en tracasserais guère. Mais certains en donnent le paquet aux Six-Mions de la Côte. Une franche canaille, celui-là. Il m’en veut à mort et je jurerais qu’il a des accointances avec les brigands. Voilà pourquoi ce mystère de galipote me tarabuste la cervelle.
Grange rapporta ce qu’il avait ouï conter dans une auberge à Notre-Dame de Mons par un nommé Chouvet, de Villecourty. Étant allé à la ramée dans les bois, ce Chouvet s’était couché derrière un buisson pour faire sa méridienne. De là il avait surpris le propos du Six-Mions de la Côte et de deux apôtres de mauvaise mine, qui paraissaient tous trois camarades comme cochons. Il en avait assez entendu pour comprendre que ces gueux vivaient de volerie et même de pis à la rencontre. Pour comprendre aussi qu’il n’y aurait pas à rire pour tout le monde dans le pays dorénavant.
Mais Chouvet, bien qu’à moitié fiolé, s’était tu sur ces mots. Grange avait payé chopine. L’autre, méfiant, de nier alors toute la chose.
Grange avait de quoi s’inquiéter, étant à couteau tiré avec le Six-Mions. Une vieille haine entre les familles qui se trouvaient brouillées comme si le diable y eût mis la main. Le père, qui s’appelait Clavières, dit le Six-Mions, n’était pas en parfaite odeur à Ambert où il fabriquait des lacets et des ganses. Il passait plus de temps à la taverne qu’à la fabrique. Les huissiers venaient le voir, tout un fagot de dettes. Il finit par vendre de la marchandise à faux métrage. Grange commerçait avec lui. Ses chalands en Provence crurent qu’il avait voulu les tromper et lui firent des reproches peu agréables. Outré de colère, il porta plainte contre le Six-Mions. Banqueroute frauduleuse, prison, exposition sur le Pontel, au pilori avec un écriteau. Après cela, les deux hommes se seraient mangé les foies.
Ce Six-Mions était mort ; et le fils, d’avatar en avatar, ayant épousé une paysanne, était venu vivre sur le petit bien de sa femme à Champétières.
— Ma foi, conclut Gaspard qui s’était laissé mettre au fait comme s’il ne l’avait été déjà, il faut prier Dieu que cette histoire de galipote tourne au profit des gens de bien. Mais croyez-moi : le Six-Mions, ce n’est pas de ces vaillants, vaillants. S’il souhaite de vous faire enrager, il s’en tiendra à de mauvaises farces, car il sait qu’autrement il lui en cuirait. J’en suis si sûr que je gagerais ma tête.
— Enfin, dit Grange, je ne suis point content de le sentir rôder de la sorte. Dès que le soir tombe, je ne veux plus quitter Anne-Marie de l’œil. La mère aussi n’est pas tranquille. Elle me rappelait cette nuit qu’un malheur ne vient jamais seul.
Mais à quoi sert de se donner tant de garde ? Quand le malheur nous en veut, il arrive du côté qu’on l’attendait le moins.
Gaspard voyait bien qu’il convenait de se méfier du Six-Mions. Le personnage n’était pas seulement fripon comme la chouette et voleur à voler sur l’autel quand le curé y aurait été, mais encore, quoique lâche, gredin redoutable. Il avait, par un tour de son sac, provoqué de sinistres accidents à la dernière foire aux chevaux de Chignat. Cette foire se tient en un pré joignant la route. Subtilement, leur promenant certaine peau de loup sous les naseaux, le Six-Mions avait fait entrer les bêtes en une épouvante panique. Tirant au renard, se cabrant, ruant, rompant leur licol, faisant feu des quatre pieds, renversant et piétinant les gens, ces chevaux s’étaient lancés follement à travers champs comme si le loup même était à leurs trousses. Un hourvari qu’on ne peut dire. Le Six-Mions et ses compères en profitèrent pour dévaliser le monde dans la presse et faire main basse sur tout ce qui traîna. Quant aux épaules déboîtées, côtes cassées, bras rompus et autres malheurs qui arrivèrent de leur chef, ils ne s’en souciaient pas plus que de leur première culotte…
Au demeurant, qui l’eût vu au coin d’un bois avec sa mine de réprouvé et son cou tordu, eût pris plutôt son couteau que son chapelet. Il avait un garçon qui allait sur ses treize ans, mais dont les doigts étaient déjà pareils aux siens et faits comme le crochet d’une romaine. Tous deux sans champ de blé sachant avoir du pain, sans noyer de l’huile, sans bois des bûches et des fagots. Il suffit de se lever matin et que les voisins en aient.
Ce gamin, c’était un rousseau assez malingre à qui l’on devinait du venin dans le corps quand il levait comme une vipère sa mauvaise petite figure pointue couleur de noix sèche.
QUATRIÈME PAUSE
Histoire du curé trop friand qui fut guéri de sa paralysie par les voleurs de moutons. – Ha ! je ne puis entendre parler de noix, que je ne me sente le cœur tout gai. Car cela me rappelle ce qui advint au bon curé de Champétières par la faute des deux Six-Mions. Par leur faute, mais il leur dut une fière chandelle. Ces deux larrons firent plus pour lui que tous les docteurs en médecine de la Haute et Basse-Auvergne, le délivrant d’une paralysie à laquelle ces messieurs n’avaient pu porter autre secours que de la baptiser d’un nom latin.
Le curé de Champétières avait eu quelque beau soir un coup de sang qui l’avait laissé quasiment paralysé. Disons tout : il était devenu trop gras et trop puissant à force d’aimer les bons morceaux. Le boudin surtout l’affriandait, et c’était un de ses ennuis de n’en pouvoir-manger qu’au temps où l’on saigne l’habillé de soie.
Un jour qu’il s’en complaignait devant le Guillaume de Montfanon : « Comment, monsieur le curé, lui dit ce braque, vous vous embarrassez de si peu ? » Et il lui enseigna un expédient qui ne pouvait venir qu’en pareille cervelle.
— Au lieu de saigner votre cochon, parlant par respect, en gros et d’une fois, hé ! saignez-le-moi en détail. Vous n’avez qu’à lui couper un bout de queue chaque fois que la fantaisie vous prendra de manger du boudin.
M. le curé, s’applaudissait de l’idée, de saigner désormais son porc toutes les quinzaines. Un seul point demeurait embarrassant. Chaque famille, lorsqu’elle tuait le sien, pour faire une honnêteté à son pasteur, lui envoyait des cochonnailles dans une assiette recouverte d’une crépine et enveloppée d’une serviette blanche. Ordinairement, c’était une gogue, c’est-à-dire quelques aunes de boudin et de saucisse, qui, coupées en morceaux et fricassées avec des pommes de terre, composent un mets fort en renom. Or, M. le curé devait rendre les politesses, on est sévère en diable sur ce chapitre, à la campagne. Mais comme il ne se décidait à tuer tout de bon son cochon, – sauf votre respect, – que le dernier du bourg, la bête entière passerait donc en politesses rendues.
Ma fine, il y avait de quoi songer. Le bon curé se gratta un peu la tête, et, le dimanche suivant, montant en chaire pour le prône, il fit deux mots de prédication à la paroisse.
— Mes frères, dit-il, tous les boudins sont boudins et toutes les gogues sont gogues. À rien ne sert que Pierre donne une gogue à Paul pour que Paul par après rende une gogue à Pierre. Croyez-moi, monde de Champétières, toutes les gogues sont gogues et que dorénavant chacun garde sa gogue !…
Seulement ce pouvait bien être pour tant de gogues cette année-là que M. le prédicateur avait eu son coup de sang et se trouvait à cette heure quasi paralytique.
Après tout il était bon homme et le péché de gourmandise avait reçu plus que son châtiment. Mais ce ne furent pas les médecins qui lui procurèrent sa cure. Voici comme elle s’opéra :
Certain soir, entre chien et loup, le Six-Mions dit à son garçon, dont il faisait pour lors l’apprentissage, qu’il voulait l’emmener voler un mouton au domaine du Bouis. Il lui montre comment s’entortiller les pieds de paille et de chiffons, et tous deux partent, qui en sabots, qui chaussé à la muette.
Les ouailles étaient dans leur parc, de l’autre côté du bourg. Arrivés au cimetière, le père dit au fils :
— En avant, portez armes ! Je t’attends là. Tu dois savoir assez de la vieille danse, il s’en va temps que tu travailles seul. Surtout tâche de le choisir bien gros.
Mon Six-Mions se met à califourchon sur la murette, et le voilà à croquer les noix du grand noyer pour passer le temps. Autrefois on plantait souvent dans les cimetières quelque noyer dont l’huile servait au luminaire de l’église. Celui-là était fort gros, contourné, couvert de mousse, et abattait ses branches jusqu’aux croix de bois dans les rosiers de mille-feuilles. À couvert sous le branchage et enfourché sur le mur comme un meunier sur son âne, le Six-Mions, donc, qui n’avait pas l’imagination délicate, épluchait ces noix de cimetière et vous les mangeait très bien. Et brimbalant les jambes, donnant de ses sabots contre les pierres, il prenait plaisir à faire craquer les coques.
Le sacristain qui venait de sonner l’Angélus, ayant fermé l’église, traversait le champ des trépassés pour rentrer chez lui. Il entend ce bruit, manque d’en laisser choir ses clefs, court jusqu’à la cure sans prendre vent.
— Ha ! pauvre monsieur le curé ! Les diables sont dans le cimetière qui croquent les os des morts !
Le curé qui lisait ses Heures devant le feu de la cuisine commence par lever les épaules : « Allons, tu auras trop pinté dans la soirée. Tu as sonné avec les parents de la Treize-Langues, pour son bout de l’an, et vous avez dû boire tous comme des sonneurs. Ou alors tu rêves et tu n’es pas bien sage. » Mais l’autre de jurer ses grands dieux. Il avait bien entendu ce qu’il avait entendu peut-être !
— Monsieur le curé, vous ne voulez pas y croire ? Vous y viendrez voir avec moi ! Ah ! j’ai rêvé ? Ah, je ne suis pas trop sage ? Je vous y porterai plutôt sur mon dos.
Car le pauvre curé ne pouvait guère marcher vu sa paralysie. Bien qu’il fût gras comme une taupe, l’autre vous le charge sur son échine, ainsi que ces vieilles que l’on voit porter en le retenant des deux mains un fagot de ramée.
Les voilà le long de la murette. Le Six-Mions épluchait toujours des noix sous son gros arbre.
— Les entendez-vous ! Je vous dis que tous les diables sont là qui fracassent les os des défunts dans leurs mandibules…
Diantre. M. le curé commençait de regretter le coin de son feu. Cependant : « Va toujours, dit-il à son bedeau, que nous les voyions d’un peu près. » Le chasse-chien donc avance encore, mais d’un pas de procession.
Ils n’apercevaient rien, d’abord parce qu’il faisait noir comme dans un four, le Six-Mions ayant su choisir sa nuitée, ensuite à cause des branches retombantes qui leur cachaient ce brave mangeur de noix. Lui ne les avisa que quand ils furent quasiment sous le noyer. Et croyant à son honnête homme de fils qui revenait chargé du mouton : « Ha diable ! À la bonne heure ! C’en est un bien gras que tu m’apportes ! »
À ces mots dans le noir, tout proches, mais tombant ils ne savaient d’où, les deux autres se voient entre les mains des démons prêts à ne faire d’eux, tripes et boyaux, qu’une seule bouchée. Le sacristain décharge le curé par terre plus rudement qu’il n’eût convenu et détale si roide que le plus vite des diablotins ne l’eût pas rattrapé à la course. Quant au curé, par un effet que les médecins expliqueront s’ils veulent, la peur lui rendit ses jambes et l’on croit qu’il ne fila guère moins bon train que son bedeau.
Voilà comment les Six-Mions firent une grande et belle cure qui aurait honoré bien des docteurs. Mais étant gens sans bruit, ils ne songèrent même pas à en tirer gloire.
CINQUIÈME PAUSE
Les sorcelleries de Gaspard. – Le grand sabbat sur le Puy-de-Dôme. – Les amitiés d’Anne-Marie. – Les vaches maléficiées. – Gaspard et Plampougnis avaient dû retourner chez eux où le travail pressait. Cependant, à Champétières, la galipote courait toujours le pays. Au lavoir, à la fontaine, au pas des portes, en mangeant la soupe, à la sortie de la messe sur la place le dimanche, on ne parlait d’autre affaire. Les dires de Chouvet s’étaient colportés. On croyait qu’on verrait des choses étranges.
Un jeudi, sur les trois heures, Gaspard reçut un mot de lettre par lequel le cousin lui mandait de venir le plus tôt qu’il pourrait, qu’on avait jeté un sort sur son bétail.
Le garçon s’attendait à quelque mystère de cet ordre. Ce billet lu, il se sentit du vif-argent dans les veines. Qu’est-ce que c’est que cette manigance ? On va bien voir ! Incontinent il passe dire deux mots d’adieu à Plampougnis, et le voilà parti par les raccourcis des bois.
Sur le chemin il songeait au Six-Mions et ne cessait de se demander ce qu’il pouvait bien y avoir au fond du sac. Sans doute on avait barré les vaches du cousin. Lui-même il connaissait un secret : on met de l’herbe de lys dans un pot plein de lait qu’on recouvre d’une peau de vache blanche ; toutes les bêtes des environs perdent leur lait. La chose serait, paraît-il, fort éprouvée, mais Gaspard n’y ajoutait point de foi. Trop franc et trop brave d’ailleurs pour perpétrer de pareilles sorcelleries.
Quant à ce qui est d’en savoir, il en savait plus d’une. À la foire de la Saint-André d’Ambert, il avait acheté un de ces mauvais livres à un marchand d’almanachs. Par curiosité, pour connaître les plus galants de ces tours. Un soir, aux fenaisons suivantes, voyant un char de foin monter, tout cahotant, dans un mauvais chemin, escorté de garçons qui l’arc-boutaient de leurs fourches, il lui vint en fantaisie de le faire verser par tel secret qu’enseignait le livre. Et il le fit. Et le char versa.
Du joli travail. Gaspard aida à tout relever. Puis, rentré chez lui, il prit le grimoire et le jeta au feu.
Mais il savait assez de magie pour éberluer les gens, ou bien à l’occasion pour rendre service à son prochain sans engager son âme. Un dimanche, à l’auberge, il paria chopine qu’il prendrait dans sa main nue une poignée de charbons ardents et ferait le tour de la salle. De fait il les prit dans la cheminée comme si c’eût été des noix fraîches sans avoir la main offensée par le feu. Seulement il ne dit pas qu’il avait eu soin de se frotter auparavant d’une mixture de blanc d’œuf et d’alun.
Un autre jour, il paria d’attraper des douzaines d’oiseaux à la main, et vous les attrapa parfaitement en leur jetant des graines trempées dans de la lie de vin arrosée de jus de ciguë.
Ces badinages parurent au-dessus de nature et Gaspard en garda du renom.
Dans le vieux, vieux temps, les sorciers étaient si épais qu’on n’aurait pu les dénicher. Le village de l’Imberdis surtout passait pour leur coin dans notre montagne. Il fallait bien qu’il y en eût, puisqu’on les excommuniait au prône chaque dimanche.
On raconte que dans la nuit de la Saint-Jean d’été, les sorciers, les jeteurs de sort, les magiciens tenaient une grande réunion sur la cime du Puy-de-Dôme. Même on y fit bâtir une chapelle dédiée à S. Barnabé pour sanctifier le lieu. Ils arrivaient là, de bien loin, de l’Auvergne, du Limousin, de la Marche, du Velay, du Vivarais, du Gévaudan, voire du Languedoc. Car ils n’avaient qu’à enfourcher leur balai de bouleau pour être rendus en un clin d’œil dans les vents de la nuit.
Leur maître, c’était Satan, qui avait la figure d’un bouc. Il les recevait au milieu d’un rond tracé sur le gazon au sommet de la montagne. Chacun venait allumer sa chandelle à une chandelle noire qu’il portait sur les cornes et dévotieusement lui baiser la fesse. Pour commencer le sabbat, le diable disait la messe à sa façon, avec une tranche de rave en guise d’hostie.
Chaque sorcier ou sorcière avait fait serment de renier N.-S. et de causer toutes sortes de maléfices, comme de tuer, d’empoisonner, d’attirer les orages. Il venait là rendre compte de son année ; et le diable distribuait les métiers de sorcellerie pour leur année nouvelle, faisant largesse de charmes contre le feu, les loups, les bêtes sauvages, et soufflant sur ses suppôts pour leur donner le pouvoir de prédire l’avenir.
La montagne est si haute qu’on dit :
Si Dôme était sur Dôme
On verrait les portes de Rome.
Qu’on imagine dans cette nuit de la Saint-Jean, où le crépuscule du soir rejoint presque celui du matin, le grouillement de cette foule parmi les vents blafards, là-haut, d’où l’on domine, si bas au-dessous, une infinité de villages, de forêts et de campagnes. Assis sur l’herbe rase les sorciers faisaient un repas de pain, de vin et de fromage, où ils mettaient en commun leurs provisions comme pour signifier qu’ils étaient tous frères. Puis jusqu’à l’heure où l’air de pâle devient rouge, ces belles et dignes cérémonies se continuaient par des débordements, des horreurs, des lubricités, qui ne vaudraient rien à être retracés.
C’était cela le grand sabbat. Il y en avait de petits les mercredis et vendredis. Que si quelque pauvre voyageur avait le malheur de tomber au milieu, il courait grand hasard de ne jamais reparaître. Il fallait qu’il y perdît ou la vie ou son âme, car, ou bien on l’égorgeait, ou bien on l’obligeait à faire le pacte avec le démon en le jurant sur un livre noir.
Toutes ces choses sont si vieilles qu’on n’oserait les donner pour matières de bréviaire. Cependant encore aujourd’hui il est de tradition que les bergers montent à la Saint-Jean sur la plus haute montagne pour voir danser le soleil, qui danse, ce jour-là, à son lever, ne sachant s’il doit aller à droite ou à gauche. Certainement beaucoup en ces cantons écartés sont longtemps demeurés païens et magiciens dans le secret de leur cœur.
Cependant Gaspard faisait chemin. Il y mettait de la diligence parce que l’affaire l’attirait, et aussi pour revoir cette Anne-Marie dont l’idée ne le quittait guère. La cousine Grange avait raison de dire qu’un cheveu de ce qu’on aime tire plus que quatre bœufs.
La petite, elle, était autre, depuis le jour de la reboule. Elle se sentait à la fois plus amie de tout le monde, et seule à cause d’une chanson dans sa tête. Mais seule en un monde où tout lui parlait, le chamaillis des chardonnerets dans leur cage, les dernières roses mousseuses au jardin, le verger à midi, plein de rayons à travers les pruniers qui perdaient leurs feuilles… Rien qui ne lui parût changé et neuf. Une joie l’enlevait à elle-même, celle de certains réveils d’enfance, quand tinte une cloche, un peu loin, et que le rideau blanc éclate de soleil. Elle courait, trottait partout en vrai perdreau ; elle aurait volé. Et si elle ne montait pas vingt fois le jour dans la chambre des parents se regarder au petit miroir, elle n’y montait pas une. Elle dépensait là-haut des quarts d’heure à se mirer, en se demandant si son cousin voudrait d’elle, plus tard.
D’un jeu de cartes, dépareillé sans craindre la colère du père, elle avait tiré un valet qui lui parut ressembler à Gaspard, et une dame qui fut censée elle-même. Elle biffa leurs noms, écrivit celui de Gaspard sur le valet, et glissa les deux figures face à face à la même page d’un livre en se disant que son cousin et elle s’embrassaient chaque fois qu’elle refermait le volume.
Puis elle allait au verger cueillir une pomme. Il s’agissait de la peler en rond, d’un seul tenant ; elle jetait ensuite la pelure derrière son épaule : de quelque façon que le ruban fût disposé par terre, Anne-Marie voyait un G à tout coup. Le nom de son mari commencerait donc par un G.
… Le garçon fut à Champétières à la nuit et tomba dans la salle comme une bombe, questionnant, s’informant, demandant des nouvelles. On ne l’attendait pas sitôt, et on fut touché de le voir arriver sans aucun retardement.
— Si, dit Grange, je t’ai envoyé ce mot, c’est qu’on a jeté un sort sur mes vaches. Tu sais que je n’entre pas facilement dans des créances et opinions fantasques ? Mais voilà bien trois jours qu’elles ne veulent plus manger ni foin ni raves. On aurait cru hier au soir qu’elles allaient reprendre appétit. Ce matin, nous les avons lâchées ; le Nanne me dit qu’elles n’ont pas touché à l’herbe, et depuis, rien sous la dent. Plût à Dieu que par quelque effet de magie blanche ou noire tu pusses me lever ce sort. Ô sacré tonnerre ! continua-t-il en s’emportant, comme je te le disais, j’aurai donc toujours quelque loup-garou derrière moi !
— La, la, coupa Gaspard, d’un rien peut-être, vous en faites aussitôt une affaire à désespérer de Dieu. Allons à l’étable, nous y mettrons l’œil si avant que nous éclaircirons bien des choses.
Le Nanne pansait les bêtes. C’était sûrement le bétail le mieux tenu du pays, de brave bétail ! Les crèches étaient pleines de foin vert ; mais les vaches, après avoir fait mine de manger, renonçaient à rien avaler, et meuglant, tendant le mufle, se démenaient d’impatience ou bien se couchaient sur leur litière. On leur avait présenté du trèfle, des raves coupées en morceaux ; même on leur avait fait de la buvée, de la soupe de choux verts et de son bouillis dans l’eau avec du petit-lait, comme dans les burons de la montagne. Rien ne leur avait dit.
Gaspard en regarde une, deux, trois, puis fait le tour de l’étable en envisageant tout sans voir quoi que ce soit qui lui donne à penser. Il y avait un rameau de buis bénit fiché dans la fente d’une solive. Les aiguillons rangés sur des clous au-dessus de la porte, les mangeoires, les cloisons de planches, les guichets de bois par où de la fenière on pousse le fourrage, tout était selon l’ordinaire. « Vous êtes sûr qu’on n’a rien caché… qu’on n’a pas jeté quelque drogue par là ?… » Il humait cet air chaud de l’étable qui sent le lait et la litière, mais aussi une bonne odeur de vache, de foin.
Les deux hommes dirent qu’ils avaient fait la visite avec la plus exacte minutie…
La lanterne pendue aux solives basses balançait, et des ombres avançaient, reculaient entre les poteaux. Les flancs des bêtes luisaient et on leur voyait un si beau poil qu’on ne pouvait les croire malades. Au demeurant, elles n’avaient pas la gorge enflammée et ne tremblaient pas la fièvre. Pourquoi diable pas une ne mangeait-elle ?
— Ha, mais ! quelque antéchrist se mêle du mystère, dit Gaspard.
SIXIÈME PAUSE
Histoire d’un sort jeté sur les vaches d’un domaine. – Comment Gaspard délivra les vaches de Grange. – « Voilà, dit le Nanne, vingt ans de cela, j’étais loué dans un grand domaine près de Saint-Alyre ; il y eut une maladie sur notre bétail. En quinze jours, douze bêtes à mettre dans la fosse. On ne riait plus. Le maître fit venir un guérisseur d’Arlanc, puis un d’Ambert ; il lui en coûta bon, et ça n’y changea rien. Il se levait à quatre heures du matin pour faire les remèdes, les préparer lui-même, parce qu’il ne voulait se fier à personne. Rien n’y pouvait. Aujourd’hui une vache, demain l’autre…
» Enfin, bien qu’on fût en novembre, il s’embarque pour Saint-Germain l’Herm, où des gens, à ce qu’on disait, avaient eu la même épidémie sur leur bétail et ne s’en étaient sortis qu’en faisant venir un sorcier du Bourbonnais.
» Je l’accompagnai. Sur la route, nous trouvons l’abbé Bonnepoche. La neige tombait à grosses pattes. Il nous demande où nous allons par ce joli temps. Le maître le lui dit.
» — Mais en avez-vous parlé à votre curé ?
» — Non… j’ai fait dire quelques messes.
» — Avez-vous fait bénir l’étable ? Allez trouver Monsieur le curé.
» — Eh bien ! de ce pas.
» Le curé vient. La maladie durait depuis trois semaines. Il bénit, mais il fit aussi une prière passablement longue. Nous entendions : « Satanas ! Satanas !… »
» Tout fut fini du coup, plus une bête ne mourut.
» C’était un certain homme qui avait jeté un sort, un nommé Clavières, qui sortait de prison pour avoir fait des faux quand il vint s’installer à Saint-Alyre. Le frère de mon maître y était maire, en ce temps-là. L’histoire est donc moins vieille que je ne pensais ; il doit y avoir seize ou dix-huit ans… Ce Clavières alla lui demander un papier, un certificat de civisme. Le frère de mon maître dit que ça ne se pouvait, que le particulier était trop nouveau dans la commune. Et comme ses propriétés étaient trop loin, – au bout du pays, – l’autre, qui lui en voulait à mort fit tomber le mauvais sort sur celles de mon maître, lesquelles se trouvaient voisines de sa masure.
» Cet homme aurait désiré prendre l’état de panseur de bêtes. Il disait à qui voulait l’entendre : « C’est un sort qu’on a jeté. Si j’y vais, je l’enlèverai. »
» Comme la maîtresse en avait peur, et n’aurait pas aimé le voir entrer dans la maison, j’allai lui dire de la part du maître de venir chez la métayère. Il y vint. Je me rappelle qu’il avait un vieux chapeau rond et une limousine à raies noires et blanches. Il nous dit :
— « C’est un mauvais sort. L’individu qui l’a jeté, je vous le ferai voir. »
» Le maître lui répondit :
— « Je ne veux pas le voir. Il suffit. Puisque vous dites maintenant que vous ne pouvez pas enlever ce sort… »
» Ce Clavières avait donné deux ou trois petites fioles, mais plutôt que de se servir de ses remèdes, on les jeta. Puis enfin le maître partit pour Saint-Germain et rencontra l’abbé Bonnepoche… »
— Mais, s’écria Grange, s’avisant soudain de la chose, et le feu lui sauta au visage, tu dis Clavières, et qu’il avait fait des faux ? Mais ce devait être le père du Six-Mions ! Qu’est-ce que je pensais ? Hein ! Gaspard, est-ce que je ne mettais pas le doigt dessus ?
Le voilà à questionner le valet, et tous deux à se perdre dans des confusions de noms, des bouts de souvenirs, des recherches…
Gaspard les écoutait en mangeant un quignon de pain qu’il avait tiré de sa poche.
— Ça va bien ! finit-il par faire. Que ce soit son père, son oncle ou le cousin de sa belle-sœur, voilà qui ne desserrera pas le gosier de ces pauvres vaches. Nous serions là à caqueter sans pondre ! Demain, au jour, nous regarderons tout de plus près et nous consulterons ensemble. Venez, en attendant, la soupe nous ouvrira peut-être les idées.
À la porte, cependant, il arrêta le Nanne par le bras, le regardant droit aux yeux et lui dit que la chose était de conséquence. Qu’il fallait donc qu’il leur confessât tout, même s’il avait à se reprocher quelque faute. On lui promettait – et Grange s’y engagea d’un signe de tête – de tirer le rideau sur ses torts. Mais qu’il racontât tout. Et d’abord, était-il bien sûr que personne n’était entré dans l’étable ?
Il en était sûr. Il avait toujours couché dans le cabinet, près des vaches, où couche d’ordinaire le valet, et n’avait jamais rien entendu. Une nuit, le chien avait aboyé près de la lucarne… ce devait être un chat qui ratounait. En tout cas, personne n’avait pu mettre le pied ici.
— Et le jour où le mal a pris les vaches, es-tu aussi sûr que personne n’avait pu les approcher ?
Le Nanne rougit comme un enfant. Depuis qu’Anne-Marie ne sortait plus seule, c’était lui qui gardait les bêtes dans une combe au flanc d’un bois. Ce matin-là il avait voulu réparer une barrière et, ma foi, un moment, tout à sa besogne, il ne s’était plus inquiété du troupeau ; les vaches étaient entrées sous bois, où l’herbe était moins dure ; il y avait envoyé le chien, qui les avait ramenées tout de suite. Que quelqu’un fût là, sous le couvert, pour tourmenter les bêtes, ce n’était guère à croire.
Grange allait se mettre en fougue :
— Et voilà comme tu fais arriver des malheurs…
Gaspard lui posa la main sur le bras et lui signifia du regard d’avoir à se contenir. Bien qu’il fût à peine un jeune homme, il se trouvait avoir pris la gouverne, parce qu’il avait l’esprit plus clair et plus vaillant, plus en éveil.
Mais ce matin, le bétail recommençait de manger. Depuis, il avait dû se passer quelque chose en champs.
— Certainement, tu n’as pas eu tes vaches tout le temps sous les yeux ?
Le Nanne, rouge comme une cenelle de buisson, l’air malheureux, se dandinait d’un pied sur l’autre devant le garçon qui l’exhortait à tout confesser. On ne lui garderait pas rigueur d’un manquement, et cacher là la moindre particularité de l’affaire, ce ne serait pas tenir l’intérêt de son maître.
À la fin il se décida :
— Ha ! ça n’a pas grand’chose à y voir… Il y avait une fille, un peu plus bas, qui gaulait ses noyers. Comme tout le monde aurait fait, je lui ai parlé de loin, quelques mots, moitié honnêteté, moitié sornette…
— Oui, et puis, pour gagner ses bonnes grâces, tu es allé l’aider à gauler les noix ?… Tu es resté là un grand moment ?… Pas bien grand ? enfin, qui ne t’a pas semblé bien grand… Et puis, quand tu es retourné au troupeau, tu l’as retrouvé dans le bois, tout ainsi que l’autre jour.
Le Nanne faisait : « Ma foi !… » en donnant de côté des coups de tête qu’accompagnaient de petits haussements d’épaule. En même temps il reculait pas par pas jusqu’à la cloison, voyant les yeux de Grange flamber de fine fureur. D’un coup le maître éclata : il allait se jeter sur son valet. Gaspard n’eut que le temps de le prendre à bras-le-corps :
— Tonnerre de tonnerre ! C’est comme ça que tu garderas mes vaches !… Lâche-moi, toi !… Approche, joli cœur, approche, que je te donne un tour de peigne !
— Pardonnez-lui, cousin, il n’est si bon cheval qui ne bronche…
— Mais un double cheval pareil… Lâche-moi, je te dis, Gaspard !
— Allons, remettez-vous. Vous avez promis de ne rien lui dire.
— Ho ! il faut avoir tété du lait de bonne mère pour ne point se fâcher. Qui maltraite le bétail maltraite les maîtres.
La colère de Grange montait telle qu’une soupe au lait et ne durait guère. D’ailleurs, Gaspard ne le laissa pas la remettre sur le feu. Les pauvres vaches, durant ces propos, piétinaient comme sous les mouches et mugissaient en avançant le cou pour demander du secours aux trois hommes, Une vraie pitié. Le garçon pensa un peu à ce qu’il venait d’entendre, huma l’air à nouveau comme s’il y démêlait un fumet qui ne fût point de mise, puis alla détacher une bête de la crèche. Anne-Marie, qui s’était glissée dans l’étable, vint lui tenir la lanterne de tout près, tandis qu’il écartait les mâchoires et flairait la langue de la bête.
— Ça va bien. Vos vaches, vous les verrez taper sur le foin dans cinq minutes ! Anne-Marie, va seulement me quérir du sel et du vinaigre.
De ce vinaigre, il leur lava parfaitement la langue qu’un malfaisant, comme il venait de s’en apercevoir, leur avait frotté d’un oignon. Les vaches abominent tellement l’oignon qu’elles seraient mortes de faim plutôt que de rien avaler. Une fois débarrassées de ce goût, ah ! merci de moi ! comme elles se jetèrent sur le foin, sur les raves, sur la soupe de choux verts. Ce fut plaisir de les voir briber.
Grange avait le sang aux joues, tour à tour de colère et de contentement. Il jurait sa foi que le Six-Mions s’était caché dans le bois pour lui faire cette canaillerie. Un lâche pareil ! Tourmenter de pauvres bêtes, est-ce que ce pouvait être le passe-temps d’un chrétien ?
— Nous en saurons le fin mot, fit Gaspard, à qui son succès chauffait agréablement le cœur. Avec votre permission, j’écris un bout de lettre au Plampougnis pour lui mander de venir me joindre. Nous dirons à nous deux quatre paroles à cette galipote. Il faut que l’histoire finisse.
— Tout ce que tu voudras, fiston… La maison est tienne ; tu n’as qu’à parler.
Le cousin n’avait jamais été autant dans ses bonnes. En rentrant dans la salle, sans même vouloir attendre la soupe, il cria à sa femme de donner la bouteille de ratafia de cerises et deux petits verres.
— Allons ! apportes-en un pour le Nanne aussi…
TROISIÈME VEILLÉE
PREMIÈRE PAUSE
La médaille bénite. – Les postes de lièvre et l’affût la nuit dans les bois. – La lutte du Plampougnis et de la Bête-Noire. – Ce même soir, Gaspard alla faire un tour dans le bourg pour prendre langue.
Les uns mettaient tout sur le dos du Guillaume de Montfanon ; quelques autres sur celui du Six-Mions de la Côte. Toujours est-il que la bête continuait de mener son train par voies et par champs. Ceux qui passaient pour entendus en ces matières disaient que, d’après son marché, il lui fallait courir dans sa nuit sept paroisses.
Toutefois, il était certains coins, carrefours, vallons ou fontaines, qu’elle hantait de préférence. De ces coins qui ont mauvais renom, tels que sur le plateau d’Échandelys, cette Croix des Trois-Croix qui voit souvent rôder des loups-garous. Entre la Fougère et la Faye, encore, le ravin des Couleires où lesdits loups-garous tiennent l’assemblée autour d’un grand feu. Et certains paysans, rentrant chez eux de nuit, ont bien vu une tête de cheval en flammes dévaler en roulant la pente de cette ravine.
Gaspard en écoutant tous ces dits se faisait une petite promesse…
La veille de la Toussaint, sur les quatre heures, il vint rejoindre au jardin Plampougnis, qu’il cherchait. Et, dès qu’il l’aperçut :
— Eh bien !… ce soir ! lui lança-t-il.
Il pelotonnait une cordelette, qu’il fourra dans sa poche. Alors seulement il avisa Anne-Marie qui se relevait derrière une planche de choux, tenant des pieds de céleri dans ses mains pleines de terre. Elle et lui se considérèrent un instant avec une pointe d’embarras.
— Oh ! Gaspard, fit-elle, regarde ta veste : elle se découd à l’entournure… Donne-la moi : je vais y faire un point pour demain, jour de fête.
Il fallut qu’il la donnât, bien qu’il ne vît pas trop où la couture lâchait.
Cinq minutes après, il revint la quérir.
Pour profiter d’un reste de jour, Anne-Marie cousait dans ce bout de hangar à demi-clos de planches où le père avait son établi :
— Voilà, dit-elle vite, ne grogne pas, tiens !
Gaspard prit sa défroque, – elle était de bure bleue, quelque peu reprisée aux coudes, – mais au lieu de l’enfiler, il se mit à en palper les doublures. Tout de suite, il sentit sous son pouce quelque chose de rond comme une piécette. Il releva les yeux sur sa cousine, et ils virent qu’ils s’étaient devinés.
— Je me suis bien doutée, dit-elle…
— Et moi aussi, je me suis douté, dit-il.
Il tâtait la médaille bénite qu’elle venait de coudre là, ayant compris qu’il irait chasser la Bête-Noire. Les joues d’Anne-Marie avaient pris un tel éclat de jeunesse que le vent semblait lui avoir fleuri la mine. Gaspard se sentit si attendri et si aise qu’il en fut transporté. Sans autre façon, il l’embrassa, et le revoilà lui souriant, lui riant, la regardant comme s’il voulait apprendre sa figure par cœur…
… Par la petite allée bordée de fraisiers et d’oseille, il allait, si allègre dans ses souliers que la terre ne le portait pas. Pour rien, pour se donner du jeu, tout d’un coup, il sauta par-dessus la haie, comme un loup, et s’en fut à travers pré vers le bois-bocage. Il aurait passé dans le feu pour sa cousine : « Si je la prenais en amitié, songeait-il, vrai, je ne me sentirais plus ! »
Après la soupe, par un demi-clair de lune, ils sortirent, Plampougnis et lui.
Il avait eu la pensée d’écrire aussi à Jeuselou du Dimanche ; mais Jeuselou était de petit tempérament et peu propre à la lutte ; tandis que Plampougnis, à dix-huit ans, ne craignait guère d’hommes, collet à collet.
L’arrière-saison, cette année-là, était belle, le temps doux. Gaspard et le camarade allèrent se tapir à cinq cents pas l’un de l’autre, chacun en un poste de lièvre. Parce que chez nous, on chasse ordinairement la lièvre, comme on dit, à trois ou quatre… Quand le chien a empaumé la voie, on le laisse se débrouiller seul et chacun court prendre un de ces postes que savent bien les gens du pays, un carrefour, une croisée de sentiers, bref, un point qui commande plusieurs passages. Comme le lièvre suit toujours les chemins, on l’attend là à l’affût.
Ces deux garçons, donc, qui n’avaient rien à apprendre, se postent en des lieux où ils avaient chance de toper la Bête-Noire. En travers des sentes, à un demi-pied de terre, ils tendent un fil d’archal d’un arbre à l’autre. Puis, les voilà blottis de façon à ne pas manquer le gibier, vu que la galipote devait prendre ses sûretés et avoir toutes les ruses : quand on sème des épines, on ne va pas sans sabots.
Une singulière chose d’être la nuit à épier dans ces bois mal hantés. On s’y sent comme guetté : ces roches, ces fougères, ces souches biscornues peuvent chacune cacher un homme. Un cri d’oiseau, le passage d’une bête, et même ce silence fait de froissements de feuilles, tout parle d’embûches. L’imagination travaille sur ces petits bruits inexplicables. À la lumière de la lune, on croit apercevoir dans cette corne de taillis un homme enfroqué dans sa limousine et le chapeau sur les yeux. Lorsqu’on l’a vu, impossible de ne plus le voir : on distingue jusqu’à ses boutonnières ; et impossible de revoir la masse de feuillage qu’on a réellement devant soi. Ou bien, c’est contre ce sapin aux branches étalées bas sur une traînée de champignons… ou bien encore dans ce bouquet de frênes au bord de la sente…
Plampougnis se serait embarqué gaillardement dans les hasards. Gaspard, lui, trois ou quatre autres, n’avaient que trop de goût à faire les aventuriers et les chevaux échappés. Le gars aurait su trois malandrins dans ce hallier, c’est sans frayeur qu’il aurait retroussé ses manches : et hardi petit, mon ami !
Mais au milieu de ces faux-semblants et de cet incertain chuchotis de la nuit, un malaise, à la longue, embrouillait les idées. Non pas une peur : un malaise. Il faut bien que le langage de ces bois dans l’ombre de minuit parle aux imaginations, puisque tant de contes rapportent les aventures que les gens ont cru leur être arrivées ainsi, alors qu’ils faisaient route seuls sous la ramée, en revenant de foire. Plampougnis se secouait de temps à autre, mais une gêne descendait sur lui, lui pesait sur les membres. Il lui semblait que quelque créature était là, derrière, qui allait le prendre par les reins…
Depuis deux heures peut-être il se tenait accroupi, guettant de tout son sens, quand soudainement la chose arriva : la Bête-Noire qui passe à le frôler et trébuche dans le fil d’archal… Mon Plampougnis qui saute dessus, l’agrafe, la renverse dans le chemin cul par-dessus tête.
L’autre, ceinturée, se débattait à grands coups comme un brochet qu’on tire hors de l’eau. Et de se secouer, et de ruer, et de se rouler tous deux en écrasant les genêts de la sente. La bête grinçait des dents pour donner de l’épouvante au garçon. Mais lui, sans s’étonner, crochait dur. À la fin, il vient à bout de la coucher sous ses genoux, et, pour la voir nez à nez, se met en devoir de lui arracher sa peau.
Rien de plus coriace que peau de loup-garou. Je me suis laissé conter que quand un nommé Planevialle de Sauxillanges mourut, ses héritiers trouvèrent dans son coffre à habits une de ces dépouilles. Ils décidèrent de la brûler, de peur de scandale, et la jetèrent dans un four. Qu’en advint-il ? Il en advint que le four éclata comme si on y avait jeté un sac de poudre de mine ; et l’on entendit le pet de deux lieues de loin.
Plampougnis, donc, s’y retournait les ongles sans lâcher la galipote, qui continuait de se démener telle qu’un diable dans l’eau bénite :
— Je ne te laisserai pas aller… que je ne sache ton nom…
— Tire-toi de là, marmonnait l’autre, haletant à la façon d’un bœuf qu’on égorge. Ce que tu fais… tu le paieras cher… Il y en a d’autres… plus forts que moi… derrière moi.
Plampougnis n’était pas garçon à se laisser pousser par des menaces. Et la galipote étouffait. Il a bien fallu qu’elle parle. Elle a dit son nom. Elle a dit :
— Je suis le Guillaume de Montfanon, puisque tu veux le savoir.
Or, Plampougnis l’avait déjà compris et reconnut le particulier à sa voix.
La galipote venait à peine de se confesser que, profitant de ce que le gars lui donnait un peu de relâche, elle lui fait traîtreusement lâcher prise. Plampougnis la sent glisser telle qu’une anguille et ne la voit que sauter dans les genêts, où elle disparaît comme si la terre l’avait bue.
Un peu camus, il revint ramasser son chapeau, puis s’étira en faisant craquer ses jointures. Gaspard arrivait tout juste, au grand galop, ayant entendu les cris d’appel. Plampougnis lui conta ce qui venait de se passer, sans aucune gloriole, car si quelqu’un n’était point glorieux, c’était ce bon grand frisé-là. Il s’accusait fort d’avoir, par naïveté, lâché la galipote. Mais enfin il avait reconnu le Guillaume de Montfanon.
Eh bien ! on savait ce qu’on voulait savoir.
… Ils touchaient aux premières maisons du bourg, quand d’un bois, sur la gauche, ils entendirent un éclat de rire perçant, haut, moqueur, assez pareil au cri de l’écureuil, qui est moitié rire, moitié hennissement, comme si le loup-garou eût voulu se gausser d’eux.
— Ris tant que tu voudras. Mais ne t’avise pas de recommencer le jeu, parce que si tu t’y fais rattraper, tu passeras mal ton temps, le Guillaume.
DEUXIÈME PAUSE
La soirée de la Toussaint. – Le Six-Mions possédé du démon. – Histoires d’enfants vendus au diable. – Le lendemain, à la sortie de la grand’messe, Gaspard fit nouvelle aux gens de la galipote :
— Pas besoin d’en avoir peur, ce n’est que le Guillaume. Plampougnis lui a serré les côtes, cette nuit.
Des vieux branlaient le chef : les loups-garous ont des secrets pour changer leur voix, ou, qui sait, un pouvoir de donner des illusions aux personnes. Communément, on penchait à croire que quelqu’un de plus mauvais que le braque habillé de jaune avait part à la manigance.
Dans toutes les maisons, ce jour-là, on ne s’entretint d’autre chose. Après les vêpres, on en causait chez Grange avec une parente venue visiter la nouvelle demeure.
C’était la nièce du prêtre qui avait baptisé Gaspard. Cet homme saint et d’un grand âge, ayant dû renoncer à prêcher des missions, habitait maintenant le bourg de Marsac.
Il y travaillait à empêcher les procès, à étouffer les haines, à réconcilier les familles, et y donnait, en patois, des sermons tout simples, tout populaires, qui changeaient les cœurs.
Il était extrêmement vénéré et sur lui couraient des histoires étranges.
Étant de Champétières, sa nièce y connaissait la carte et les gens. Quand on lui eut conté les déportements de la galipote et la dernière nuit des deux garçons, elle serra les lèvres. Puis :
— C’est le Six-Mions avec son cou tordu, je vous dis. Mon oncle me reprocherait de faire des jugements téméraires. Il n’aime d’ailleurs pas qu’on parle de ces choses. Mais je sais bien que, dans un temps, il se conta à Saint-Alyre que le père du Six-Mions l’avait vendu au diable. Leur maison, là-bas, était devenue comme hantée ; on entendait des coups dans les murs et tout dansait autour de ce gamin. Ne pensez pas que ce soit des fariboles : je l’ai vu de mes yeux et ce n’était pas joli à voir. Un frisson vous courait dans les cheveux, on se demandait s’il ne passait pas un coup de folie. Les chaudrons, les écuelles sur la pierre d’évier, les outils, même, pendus sous l’escalier, quand le petit était là, tout entrait en danse ou volait à travers la salle, comme lancé par des mains invisibles. Il fallait qu’il eût un démon dans le corps…
« Aussi bien le père, ajoutait la cousine, était homme à se donner au diable, poil et tout, pour de l’argent. Déjà, avant d’avoir fait quinquenelle, il passait le plus clair de son temps entre les cartes et la bouteille ; pour ouïr sonner quelques écus dans son gousset, il aurait bien vendu sa marmaille au Malin. Ce n’était point la religion qui l’embarrassait, il se sentait certainement plus de soif que de dévotion. Même, on devait dire quelque messe le samedi pour lui, car il ne mettait jamais les pieds à l’église le dimanche.
« Un jour de Pâques, comme il se tenait sur la porte de sa fabrique de lacets, fumant une pipette de tabac, la voisine lui dit en passant :
— Ô païen que vous êtes ! vous n’allez donc pas à l’église ?
— Qui y est ? fit-il sans s’émouvoir.
— Pardi ! tout le monde !…
— Ils y sont assez, alors…
« Et il continua d’envoyer au soleil les bouffées de sa pipe.
» Le diable avait de quoi faire dans cette famille et dut acheter le petit à bon compte. »
Des cas de possession, on en aurait jadis cité des douzaines.
Il y a bien l’histoire de ce garçon dont les parents habitaient certaine grande maison isolée, pas très loin de Chenerailles, sur la route de la Chaise-Dieu. Je la savais, mais ne me la rappelle plus trop… L’enfant allait sur ses quinze ans quand le père fit on ne sait quel pacte avec le diable. Satan ne prend que ce qu’on lui donne, mais lorsqu’il l’a pris, comment lui faire quitter prise ? Dès que ce garçon se trouvait seul, il ne se trouvait plus seul. Un monsieur arrivait dans la maison, commandait, se faisait servir, maintenant fais ci, fais ça maintenant… Je crois que le démon ligota ce garçon au fond de la forêt, une certaine fois : des choses terribles…
C’était ces histoires mêmes qu’on contait chez Grange, serrés autour du feu où les marrons cuisaient sous la cendre : les marrons de la Toussaint qu’on mange en buvant du vin blanc.
Gaspard aimait les soirées pour l’agrément d’être près d’Anne-Marie. Le quinquet faisait luire selon leurs bosses les grosses nattes de la petite. Elle tricotait, la tête inclinée, et sur ce visage, plus doux qu’une oraison, mais, comme celui de la mère, net et de traits calmes, on pouvait lire ce qui passait par le cœur. On : Gaspard, qui ne la quittait guère de l’œil et devinait à un rien, au pli de sa bouche, que tel propos attristait Anne-Marie en lui rappelant la nuit de Chenerailles. Il plaçait alors quelque historiette qui emmenait la petite vers un autre pays. Ensuite, elle y faisait réflexion, comprenait, le remerciait d’un sourire. Sans avoir à se l’entre-dire, ils se sentaient en amitié mutuelle. Gaspard, en lui rendant son sourire, rayonnait à percer le nuage.
La mère l’envisageait, démêlait les choses et lui savait gré d’égayer Anne-Marie. Elle avait une faveur d’esprit pour lui : d’abord parce qu’il était de sa parenté à elle, ensuite parce qu’elle le voyait tout cœur, tout vaillance, tout brave honnêteté de Dieu.
… Ce soir-là on n’avait pas allumé encore. Dehors il faisait un vrai temps de jour des Morts, gris et bas. Une petite neige poudroyait lentement en miettes, sur les prés désolés, couleur de chanvre. Derrière les vitres passaient comme des fantômes, les gens qui, la visite faite au cimetière, s’en retournaient dans leurs villages. Les flammes rouges de la cheminée commençaient de marquer des ombres. Là, ce feu, ces châtaignes mangées ensemble, ces escabelles, ces meubles usés, embrunis, mettaient un vieux charme tranquille. Ils ne se doutaient guère, les pauvres, qu’avant la nuit, le malheur prendrait tout pour soi…
— Au Fouet de la Chapelle, dit la mère, un homme devait avoir vendu sa fille… Le diable la tourmentait et la forçait à insulter les prêtres qui passaient devant la porte.
Elle se riait de tous les missionnaires qu’on faisait venir pour la délivrer, et elle révélait leurs manquements : « Toi, tu as fait ci et ça ! Je ne crains qu’un seul de vous. Il n’y en a qu’un que je craigne ! »
À la fin vint celui-là même. Elle ne trouva rien à lui reprocher, sinon : « Toi, un soir tu as volé une grappe de raisin et une épingle à une femme. – C’est vrai, seulement, j’ai mis deux sous à la place. »
Ce missionnaire dit une messe. Pendant l’élévation, cette fille fut enlevée en l’air par trois fois sans que quatre hommes qui se cramponnaient à elle pussent la retenir… Après quoi on lui chassa le diable du corps…
La cousine rappelait l’histoire d’un pauvre homme des Issarts de Marsac. L’année n’était pas bonne et le malheureux s’était loué du côté de Lezoux pour peigner le chanvre. Un jour qu’il se plaignait de sa misère, un monsieur se présente : « Vends-moi ce qui est derrière ta porte : je te donne autant d’argent que tu en saurais désirer. »
Que pouvait-il y avoir, sinon le balai ? Topez là. On convient qu’à tel jour le monsieur aura liberté de prendre ce qu’il achète ainsi. Quelque temps passe. Cependant l’idée de cette vente travaillait le peigneur de chanvre. Il envoya un mot d’écrit à sa femme : « Mande-moi ce qu’il y avait à midi, le premier dimanche du mois, derrière notre porte. » La femme lui fait réponse que c’était le petit, qu’elle y avait mis en pénitence…
Au jour dit, l’enfant, une frénésie l’a pris, qui le transportait sur les ruisseaux. Le démon, par bonheur, ne pouvait l’emporter, parce qu’à défaut du père, le parrain se trouvait dans la maison. On alla consulter l’ancien curé de Marsac ; il fit bénir des scapulaires. Mais le jour où il a délivré le petit, – l’a didemounio, dédémoné, – il est tombé tant de pluie, de grêle et de tonnerre, que la tempête nettoyait tout dans la montagne…
L’heure venait pour la cousine de regagner Marsac, et la mère voulut lui faire un bout de conduite. Les adieux donnés : « Ne t’attarde point, poussa Grange, la nuit sera bientôt là. » Et il resta près des petites, au coin du feu, avec Gaspard et les gens de la maison.
— Je me suis laissé dire, fit une servante, que c’est votre cousin le missionnaire qui a délivré cette possédée de la Chapelle.
— Notre cousin, avança Grange avec un air de taire des choses, peut bien avoir puissance sur le diable. Sans parler des mérites qu’il a acquis, il est à cela des raisons…
Mais il en revenait à la galipote : ce ne pouvait être que le Six-Mions, ce tison d’enfer. Le Nanne et les servantes, alors, d’abonder dans son sens. Gaspard seul, ne voulant pas que le Plampougnis eut été joué, restait d’un autre sentiment. Ayant la tête près du bonnet, en bon Auvergnat, il se sentait un peu piqué. D’ailleurs, il comprenait qu’il fallait se méfier du Six-Mions. Le chenapan ne s’en prendrait plus seulement au bétail s’il se sentait poussé ou soutenu. Qu’imaginerait-il bien dans sa malicieuse couardise ? « Il faut, se dit Gaspard, que la nuit prochaine je sache, sans plus pouvoir en douter, de quoi il retourne. » Ce qu’il se mettait ainsi dans la tête y était si bien mis que n’y aurait rien pu homme né de mère. Il ajouta tout haut :
— Ça va bien. On accrochera la bête, pour peu qu’elle reparaisse. Si c’est le diable, je le secoue à lui faire tomber les cornes. Si c’est le Guillaume ou encore le Six-Mions, je te l’écorche comme un S. Barthélemy.
Un silence s’établit.
— Votre mère ne devait pas s’arrêter, bougonna Grange, mais avec cette bonne langue de cousine… Deux femmes, comme on dit, et une chèvre noire, suffisent à tenir la foire. Voilà déjà qu’il ne fait plus trop clair.
Il alla jeter un coup d’œil sur le pas de la porte et revint s’asseoir, la face mécontente. La petite Pauline, plus fine qu’une fée, voulut rompre les chiens. Elle demanda à Gaspard pourquoi l’on parle toujours d’écorcher quelqu’un comme un S. Barthélemy ?
— Ah ! un conte qu’on fait chez nous, à Saint-Amand Roche-Savine…
Elle voulut qu’il le narrât, et il s’y accorda, puisqu’il fallait quelque entretien pour passer la soirée.
TROISIÈME PAUSE
Histoire de S. Barthélemy qui délivra par astuce un enfant vendu au diable et se tira lui-même, par une cruelle pénitence, des griffes du Malin. – Il y avait une fois un homme père d’une troupe d’enfants, peut-être dix, peut-être douze. Vint une année calamiteuse et il se vit un matin sans un liard dans sa bourse, sans un croûton dans le tiroir de la table.
Je dis sans un croûton, et les petits pleurant de faim devant le feu. Un tel ennui a pris cet homme qu’il a délibéré d’aller se pendre. Pour en finir et du moins ne pas voir mourir ses enfants qui lui demandaient à manger.
Il emprunte une corde à sa voisine, et, la corde sur l’épaule, s’enfonce au milieu des bois, cherchant quelque gros arbre ramé propre à son dessein. Enfin, en un lieu fort sombre et solitaire, il avise un fayard trapu, noueux, avec des branches s’étendant comme des bras sous le noir de l’ombrage. À la plus forte il attache la corde. Puis, devant le nœud coulant qui se balançait, il s’assoit sur l’herbette et se met à pleurer avant de faire le saut. Car il songeait à d’autres années, à son propre sort, au sort qu’il laissait à son monde, et tout cela lui crevait le cœur.
Comme il s’abîmait dans ces pensées de désespoir, un grand monsieur s’est présenté à lui, qui lui a demandé ce qu’il avait pour être aux sanglots de la sorte. Le pauvre homme n’était pas en termes de faire le honteux : il a dit, ma foi, ses raisons : la maison pleine d’enfants, la planche sans un pain, la faim tordant les boyaux de ses petits, et lui préférant s’étrangler que de vivre plus longtemps des jours pareils.
— Mais s’étrangler, a fait le monsieur, l’idée me paraît un peu bien rude. Je connais quelqu’un qui vous remettrait de bonne grâce autant d’argent que vous en pourriez souhaiter.
— Et qui ça ?
— Eh ! celui qui vous parle, sans chercher plus loin.
Il suffisait que l’homme fît abandon de son enfant le plus jeune. Au demeurant, il ne le livrerait au monsieur que lorsque le petit, qui allait sur ses six mois, aurait sept ans d’âge.
L’homme a bien deviné à quel personnage il avait affaire. Il restait là, assis sous l’ombrage, le nez vers l’herbe, les mains tombantes entre les genoux. Mais quoi ? il fallait, comme on dit, passer par le pont ou par l’eau. Et six ans et demi, on croit n’en voir jamais la fin. Allons : au lieu de mourir de malemort et de laisser femme et enfants mourir de malefaim, mieux valait faire marché du plus jeune.
Le monsieur, alors, l’a prié de signer le billet et lui a compté autant d’argent qu’il en a voulu.
Revenu à son village, l’homme n’a pas soufflé mot de la vente à sa femme. « J’ai fait rencontre d’une bonne personne qui m’a bien débarrassé. » Voilà tout.
Mais une semaine, un mois, un an poussant l’autre, le temps passe sans qu’on sache comment. Le petit garçon approchait de sa septième année, et il commençait de s’apercevoir que quand il allait à l’école, toujours quelque chose derrière lui lui jetait des pierres. Un soir, il en parle. Le père se trouble, étouffe, sort pour se remettre, et se voit contraint de tout confesser à la mère qui ignorait encore le marché passé dans le bois.
Or, il était entendu qu’il amènerait son enfant en forêt, sur la mi-nuit, à l’endroit où avait eu lieu la rencontre. C’était là, sous le gros fayard, qu’il devait en faire livraison au monsieur.
Au jour dit, donc, il prend le petit garçon par la main, et part avec lui pour les bois, si déconforté qu’il ne voyait plus à se conduire.
Comme ils marchaient à l’aventure, ils aperçurent de loin entre les arbres un grand feu flambant. Un homme, devant la flamme, travaillait à creuser des sabots. Le père et lui se connaissaient.
— Hé ! bonjour, toi, ou plutôt bonne nuit !
— Bonne nuit, Barthélemy.
— Tu dis ça, pauvre ami, d’un ton de de profundis. Et que diable viens-tu faire dans le bois à pareille heure ?
— Ce que j’y viens faire ? Ha ! je suis, tiens, dans un ennui qui me coupe bras et jambes. Tu vois le petit ? Eh bien, je l’ai vendu au diable.
Le sabotier d’envisager l’homme en sifflant entre ses dents :
— Tu as fait là un joli coup ! Ce beau petit garçon… Hé, bougre de bougre, reprit-il, on peut toujours essayer. L’autre est malin, mais le petit de ma mère n’est pas tellement bête. Il faut te dire que je suis son sabotier : oui, je travaille pour le diable, je lui fais des sabots. Il doit venir me voir tout à l’heure ; ainsi laisse-moi le petit et retourne-t’en chez toi.
L’homme avait grand’peur qu’il ne lui arrivât malencontre s’il n’allait sous le fayard. Cependant, Barthélemy lui a parlé rondement et s’en est fait écouter.
Il le perdait tout juste de vue quand, d’un autre côté, il aperçut pointer le pied-fourchu.
Vite de cacher le petit sous un tas de copeaux, d’écorces, de retaillures. Dans la minute le diable arrivait.
— Eh bien, Barthélemy, fit-il en guise de bonjour, on travaille ?
— On travaille beaucoup, mais on ne gagne guère. On ne gagne pas l’eau qu’on boit.
— Comment, tu n’es pas content ?
— Que non, je ne suis pas content. Et si vous n’élevez vos prix, je ne veux plus faire de sabots pour vous.
— Je te paie assez raisonnablement, ce me semble. Voyons, cette augmentation, à quoi cela irait-il ?
— Je ne suis pas mauvais bougre : je ne demande que ce tas de débris et tout ce qui s’y peut trouver.
— Passe pour ça. Je te le donne.
— Bon, vous me le donnez : vous êtes le maître, entendu ; mais vous n’êtes pas le seul. J’aime les comptes en règle. Signez-moi un bout de papier qui fasse foi de la chose.
Le diable délivre le papier sans faire difficulté aucune. Barthélemy l’examine, le serre, se tourne vers le tas de copeaux : « Eh bien ! sors, petit, tu es à moi, maintenant. »
L’autre n’a pas été qu’un peu estomaqué, voyant apparaître l’enfant au milieu des retaillures.
— Barthélemy, tu m’as joué le tour. Mais si nous n’avons pas le marmot nous t’aurons bien, ma vieille canaille. Rappelle-toi tout ce que tu n’as pas fait en ta chienne de vie… Quant au petit, il n’est pas encore libre. Il faut qu’il me suive jusqu’à la porte de l’enfer chercher sa quittance.
Le sabotier dit deux mots au petit garçon, de bouche à oreille. « Et n’aie pas peur ; suis ce monsieur, il ne te peut plus rien. Je reste là à t’attendre. »
Quand les confrères diables ont vu arriver l’autre avec l’enfant à la porte de l’enfer, et de sauter, et de crier, et de gambader ! Ah ! ils en auraient dansé en corde.
— C’est bon, il n’y a pas tant à rire. Je l’amène, mais il s’en retourne. Ce farceur de Barthélemy nous en a joué une. Enfin, je le lui ai dit tout chaud : s’il nous a filouté la viande fraîche, nous nous paierons sur sa carcasse.
— Hé, a avancé un des confrères diables, est-on si sûr de l’avoir au bout du compte ? Tant qu’il est vivant, il peut faire pénitence. Supposez qu’il se laisse écorcher tout vif : il ferait encore un grand saint.
Puis on a baillé sa quittance au petit garçon, – puissiez-vous pour vos péchés ne jamais voir l’enfer d’aussi près que lui, – et il n’a eu qu’à s’en revenir.
Barthélemy, qui savait le chemin, était allé à son devant. Mais j’ai oublié de conter qu’il avait recommandé au petit de garder mémoire de tout ce que diraient les diables.
Il s’en enquit au retour et sut de point en point leur propos. Notamment ce qu’avait dit un des démons : que si Barthélemy se laissait écorcher vif, il pourrait encore faire un des plus grands saints du calendrier.
Barthélemy a rêvé un peu à soi, le front dans la main :
— Eh bien, j’en aurai le courage ! Je sais trop comment j’ai passé ma chienne de vie, mes ribotes et le reste, et que j’appartenais au démon. Mais je vais chercher un homme, un gaillard à tous crins qui ne s’étonne de rien et consente à m’écorcher, hardi, là, sur la chaude.
Il a reconduit le petit garçon chez son père. Puis il est allé, oui, se faire dépouiller de ce pas. Et il s’était mis en un courage tel qu’il arrachait lui-même sa peau.
Un homme du Fournet l’a figuré ainsi, tirant sa peau et tenant un couteau, en une belle statue de bois qu’on peut voir dans l’église de Saint-Amand Roche-Savine. Car il fit un grand saint, S. Barthélemy, patron des sabotiers et protecteur de la paroisse de Saint-Amand, laquelle le fête au dimanche qui vient après le vingt-quatrième d’août.
QUATRIÈME PAUSE
Le grand malheur des pauvres Grange dans la nuit des Trépassés. – La nuit, cependant, était venue, cette nuit de la Toussaint, qui passe pour la plus noire de l’année. Les cloches recommençaient de sonner le glas des trépassés et sonneraient de ce branle jusqu’à l’aube. Leurs coups de battant caverneux s’abattaient du clocher, grondant, s’élargissant, faisant rebrongir tout le village. Et le vent s’était levé, comme il arrive cette nuit-là. Il sifflait sous les portes, il miaulait par les cheminées ; et loin, d’entre les sapins des bois, c’était avec lui les âmes en peine qui gémissaient dans la montagne.
Au dehors le noir, la tourmente, ce bruit qui semblait ne devoir finir jamais plus. On se sentait oublié là, dans cette maison au fond du vallon, et près d’être emporté par la tempête qui battait les bosses des forêts écrasantes à l’entour.
La mère ne rentrait pas : cette même idée pesait sur tous. On ne disait mot. Tandis que le vacarme roulait par les airs, c’était dans cette salle un silence inquiet. Sur son tabouret, Grange tendait les paumes à la flamme et la regardait comme s’il suivait en ces ressauts les pensées de sa tête.
Gaspard fit signe au Nanne, assis à côté, sur le coffre à sel, et l’autre alla quérir la lanterne de corne.
Il allumait un brin de chènevottes, quand il resta là, courbé vers le feu, tournant le cou, tandis que chacun se figeait pour tendre l’oreille. Un bruit tel que d’un fort soupir et de quelqu’un tâtonnant sur le seuil…
La porte s’ouvrit, on vit la mère. Mais, vrai Dieu, dans quel état ! Plus pâle que cire d’église, le visage défait, point reconnaissable : une maladie de quinze jours ne l’aurait pas tant changée. Elle se laissa tomber sur une chaise basse plutôt qu’elle ne s’assit. Le cœur lui sautait dans la poitrine comme une bête dans un sac.
Je laisse à imaginer l’effet d’une rentrée pareille : l’un qui s’empresse sans pouvoir parler, l’autre qui demeure cloué sur place et s’effare et questionne… Anne-Marie fut la première à se retrouver : on s’agitait encore au hasard qu’elle assistait sa mère, lui donnait un verre d’eau où fondait une pierre de sucre. Et la mère, tout en buvant, essayait de dire…
Elle avait accompagné assez loin, en causant, la cousine de Marsac. Si bien qu’il faisait nuit lorsqu’elle rentra dans le bourg. Arrivée proche de la fontaine, soudainement, une masse comme d’une personne lui avait sauté sur le dos, passé les bras autour du cou, et des deux jambes serré la taille. Mais une masse lourde, lourde, si lourde… Nul moyen de crier ni de s’en débarrasser. Elle l’avait portée pendante à ses épaules jusqu’à cette place où est la croix de mission. Là, la galipote s’était laissée couler à terre et avait disparu…
La mère parlait encore quand le tremblement la reprit. Elle avait eu le cœur décroché. La fièvre vint, et tout de suite, une fatigue à faire croire que la pauvre allait passer. On fut obligé de la coucher en hâte dans un des lits-placards de la salle.
Un moment après, autre fatigue encore plus grande, dont on eut bien de la peine à la faire revenir.
Le Nanne courut chercher le curé qui entendit la malade en confession. Puis, le mal empirant, il revint passé minuit avec les saintes huiles et l’administra. Les cloches sonnaient toujours à branle, et toujours la tourmente.
Ah ! ce que fut cette nuit ! Les hommes plantés sur leurs pieds qui ne savaient que faire pour se rendre utiles, et tout juste bons à embarrasser le passage ; les servantes affolées qui pleuraient et jetaient les hauts cris ; le médecin qui n’arrivait pas, – on avait pourtant dépêché Gaspard à cheval… Le trouble, les sanglots, les hauts et les bas de l’espérance, les exhortations de la mère à ses filles, ses adieux à elles et à Grange, tout cela retournait le cœur. Des heures pareilles mûrissent une enfant de quinze ans.
La mère avait demandé pardon à tous, et aux domestiques mêmement, des torts qu’elle pouvait avoir faits et des impatiences qu’elle avait données. Mais la pauvre, avait-elle à demander pardon, puisque pas un ne l’avait jamais vue hors de son devoir ? Grange, le visage en feu et mouillé de larmes, tenait sa main. Il voulait parler : les paroles lui séchaient à la gorge. Et elle le suppliait de se remettre, de songer qu’il faut nous résoudre à ce qu’il plaît à Dieu de faire de nous, car sachant qu’il fait tout, on doit aimer tout ce qu’il fait… Lui, secouait la tête comme s’il ne voulait rien entendre…
La mère rappela d’un signe Anne-Marie. Elle était épuisée et ne faisait plus que chuchoter : son visage se creusait, devenait vert comme celui d’une noyée de deux jours.
— Ma pauvre petite, tu vois que je vais vous laisser… Tu es l’aînée, ce sera toi la femme de maison. Tu feras dire les soirs la prière aux domestiques, tu veilleras au linge, aux habits, aux provisions, comme je te le montrais, et à la bonne conduite de tout. Il te faudra ne plus penser à toi, mon Anne-Marie, mais à ton père et à ta sœur. Je te les laisse, c’est toi qui me remplaces, je m’en vais tranquille. Sans cette pensée je me tourmenterais trop et ne penserais pas à Dieu comme il faudrait. Veille bien sur tous deux, sur Pauline et sur ton père. Ho, mes petites, mes pauvres petites…
Elles, retenant leurs cris et ne pleurant que par reprises, se montraient entendues à la soigner comme de vraies femmes. Néanmoins la vie baissait. Soudain la mère tenta de se dresser sur son séant : elle demanda Gaspard dans un souffle ; – il était à Ambert, pendu aux sonnettes des médecins sans pouvoir en décider un à le suivre par une nuit pareille. Elle parut alors vouloir recommander quelque chose à Grange, mais on ne put savoir quelle idée lui était venue.
Puis elle se trouva si mal qu’il fallut dire les prières des agonisants :
Rendez-vous propice, pardonnez-lui, Seigneur,
Rendez-vous propice, secourez-la, Seigneur…
C’est à ce moment que Gaspard arriva avec le médecin ; et lui fondu de sueur, tout fumant, l’air égaré comme s’il venait de se battre. Mais la mère n’avait plus sa connaissance.
Un instant elle respira très fort, dans l’angoisse ; et ses yeux, des yeux de visionnaire : elle fit le geste de s’accrocher à une épaule, d’appeler au secours, et on crut l’entendre balbutier : « Ah ! mon Dieu ! Gaspard qui n’est pas là ! » Qu’avait-elle vu de l’avenir en cette minute où elle était sur le bord de l’éternité ? Plus d’un devait se le demander dans les années qui suivirent…
Elle rendit l’âme au point du jour, comme cessaient de battre les cloches.
CINQUIÈME PAUSE
La douleur de Jean-Pierre Grange. – L’enterrement. – Les seboutures. – La parenté. – Les allures secrètes du maître. – Cette mort mit Grange dans un chagrin désespéré. Sa femme et lui faisaient le plus bel assortiment d’eau et de feu que l’on pût voir : elle, une vraie maîtresse de domaine, mais avec de la bonté à revendre, à prêter et à donner, toujours tranquille, soumise, le parler doux comme une religieuse ; lui, bon homme aussi, seulement d’un autre biais, plutôt bougon, contredisant, violent, aimant la dispute. Il en prisait d’autant mieux sa femme et l’aimait plus que le cœur qu’il portait.
Après cette mort, il faisait pitié : il ne pleurait pas, la face sombre, les yeux creux, mais on le sentait outré de douleur. Une vraie âme damnée. Comme si, possédé par un cauchemar où il n’entendait rien, il roulait une seule pensée noire dans sa tête. Tandis qu’on ajustait en haut la pauvre morte, il allait et venait dans la salle, de l’évier au feu. Le Nanne l’entendit deux ou trois fois qui disait en levant la main vers les solives : « Ce sera quitte ou double. »
Il laissait tout arranger dans la maison, voiler les miroirs, et arrêter l’horloge, et dans le jardin mettre le deuil aux ruches, sans se mêler de donner aucun ordre. Il fallait qu’il fût bien enfoncé dans ses pensées, lui qui tenait toujours à ce que fût fait tout ce qui devait se faire aux yeux des gens, et était même homme d’un peu d’ostentation en cela. Puis il s’enferma pour travailler avec Gaspard à la caisse de sa pauvre défunte, tandis que les hommes de la parenté allaient creuser la fosse et sonner les cloches.
Le troisième jour ce fut l’enterrement. Quelques parents avaient fait le voyage : un ancien adjudant de bataillon à l’armée du Rhin, qui était manchot et qui avait un bureau de tabac et de poudre à Rochefort-Montagne : deux vieilles filles qui tenaient ménage avec un frère juge de paix à Saint-Germain-l’Herm, vrais fagots de laideur, de dévotion et d’avarice. Un receveur des tailles, en retraite à Maringues, perclus de rhumatismes, avait envoyé son épouse, une grande femme sèche comme une chèvre.
Les père et mère de Gaspard aussi étaient venus ; et le cousin Barthaut, le maître d’école du Monestier ; et Mme Domaize, la cousine de Saint-Amand, bonne personne de pâte molle, toujours gémissante, geignante, malade à l’entendre treize mois de l’année sur douze, ayant la terreur des courants d’air et traînant partout sa chaufferette, jusque dans sa vieille carriole d’osier. Les chaufferettes étaient de terre, alors ; un jour la sienne se brisa, mit le feu à la voiture, et Mme Domaize ne s’en aperçut que quand ses jupons flambèrent. Elle resta bien trois mois sans pouvoir sortir.
L’église fut trop petite pour tout le monde. Quelle presse de gens de campagne : femmes en cotte à gros plis et corsage en corps de jupe égrenant le chapelet accroupies sur les bancs : hommes debout, bras croisés, tenant le grand chapeau appuyé contre la poitrine. L’offrande dura jusqu’après la communion. Chacun en défilant regardait Grange. Il avait une telle face, – et ses yeux, deux tisons ! – qu’on chuchotait : on ne savait à quoi s’attendre, après ce qui s’était passé dans la nuit de la Toussaint.
Il était venu des mendiants de toutes les paroisses, des vieilles qui avaient le gros-cou, des idiots jaunes comme de la chandelle, à longs cheveux raides, des estropiés couverts d’ulcères, un monde dépenaillé, souffreteux, laissant voir des coins de peau grise ou des chemises de chanvre rouillé sous ses guenilles. Ce peuple s’était mis en tas en attendant les aumônes, et il en sortait une odeur d’échauffé, de faguenas, de graisse…
Là-dedans se trouvaient quelques gueux d’un air si effroyable que Gaspard s’arrangea durant cette journée pour ne pas quitter Anne-Marie d’une semelle. La pauvre revint d’ailleurs du cimetière assommée, ne connaissant plus sa main droite de sa main gauche. Et par moments encore ces hauts gémissements qui échappent, et, coupées de sanglots, ces paroles dites dans le mouchoir…
Après, ce fut ce grand repas des funérailles qu’on appelle les « seboutures ». Dans les bonnes maisons on tenait table ouverte, et dès qu’ils apprenaient un décès par là autour, les gens se promettaient ces sépultures où s’empiffrer, et pinter, et s’en donner jusqu’à la garde. On avait ainsi affaire à du monde guère moins grossier et dégoûtant que les misérables qui venaient « à la donne ». Quelquefois la beuverie allait trop loin et tournait mal.
Chez les paysans, on invitait la parenté et les porteurs. Tous en profitaient pour manger leur pleine peau et boire d’autant. Le plus souvent, on consolait si bien le veuf ou la veuve qu’à la fin du repas il acceptait l’idée de quelque remariage, moins de deux heures après les cris que les convenances demandaient devant la fosse.
Et qu’on ne s’en scandalise point : un paysan qui reste veuf avec du bétail et des enfants n’est-il pas contraint de se remarier sans tarder ? Enfin, c’était dans les habitudes. Si bien qu’on fait ce conte d’une veuve aux seboutures de son homme qui, comme le voisin lui disait : « Prenez patience, pauvre femme, » répondit bonnement : « Je le prendrais volontiers, mais croyez-vous qu’il me veuille ? » Car elle songeait au tailleur du bourg qui avait nom Patience…
Chez Grange il y eut une grande tablée de monde, mais tous y allèrent retenu, consternés par un accident aussi sinistre. Quelques-uns auraient parlé de la Bête-Noire. Aux premiers mots Grange releva le front et les regarda d’un air de vouloir leur faire avaler leur langue.
Le repas se passa donc dans le silence. Vers la fin, on s’entretint à mi-voix des vertus et mérites de la pauvre défunte.
— Elle n’a jamais eu une fantaisie ni cherché une commodité, disait Mme Domaize, tant elle s’oubliait pour les autres. On irait loin pour trouver une femme qui ait mieux mené son ménage et sa maison.
— Hiver comme été, disait la cousine de Marsac, je ne lui ai pas vu perdre un seul moment. Ha, personne n’aura su mieux qu’elle ce que c’était que le travail.
— Elle n’a de sa vie méfait à quiconque. Et si bonne que pas un pauvre ne pourrait dire avoir passé devant sa porte sans qu’elle l’arrêtât.
— Oui, elle, le malheur des autres lui ôtait l’appétit.
— Dieu ait son âme et me fasse la grâce de mourir d’une aussi bonne mort.
— Il ne faudrait pas la pleurer, elle est mieux que nous ne sommes, elle est au milieu des âmes bienheureuses.
— C’est le dimanche qui ne finit pas qui est venu pour elle…
Grange se taisait. Il n’entendait rien, il ne voyait rien, la tête dans un sac. On dut le secouer par le bras lorsque les hommes quittèrent leurs chapeaux et se levèrent, tandis que les femmes se mettaient à genoux pour écouter le vieux cousin prêtre, qui se trouvait le personnage le plus considérable, dire un de profundis, à quoi tous répondirent : Requiescat in pace. Les yeux secs, pleins d’un feu dur, il se tenait là, comme impatient de la compagnie. Le vieux missionnaire sut lui parler de cœur avec tant de simple charité que les larmes vinrent à tous. Mais Grange qui étouffait, les épaules secouées et les yeux toujours secs, pressa la main du prêtre entre les siennes, tourna les talons et s’échappa brusquement.
Les parents, ne se voyant pas retenus, partirent alors, plusieurs assez froissés, ainsi Mme Domaize.
Grange avait barré sur soi la porte de l’écurie, et durant plus d’une heure il y fit quelque besogne qu’on ne put savoir. Puis il appela le Nanne et lui remettant un petit paquet, lui parla à l’oreille. Le valet s’en fut de suite heurter à la porte de la cure. Un moment après il rapporta le paquet au maître qui fit signe que tout était bien, et lui redit d’un mot de ne parler de la chose à qui que ce fût.
Cela d’un ton si absolu qu’il aurait fallu être bien osé pour questionner maître ou domestique.
Personne non plus n’osa élever la voix lorsque Grange sur le soir commanda à son monde d’aller prier au cimetière. « Mes petites, c’est la première nuit que votre pauvre mère va passer dans la terre : faites un bout d’oraison sur sa tombe. Gaspard vous suivra ; tous ceux de la maison voudront vous suivre aussi. »
Une fois seul, il décrocha son fusil et sortit par une porte de jardin qui répondait sur les champs. Le vent poussait au ciel un ramas de nuées noires et chantait vêpres dans les bois de la côte. La nuit venait.
SIXIÈME PAUSE
Le coup de fusil. – La fin de la galipote et la diablerie qui s’ensuivit. – Comme ils sortaient du cimetière, ils entendirent un fort coup de fusil, tiré assez proche, puis la voix de Grange qui criait : « Ha, foutu gredin ! tu en tiens ! Homme ou loup-garou, je jure qu’il en tient ! »
Dans la minute le bourg fut sur pied : remue-ménage de portes battant, de sabots claquant sur les degrés ; gens sortant, gens rentrant, gens s’entr’appelant, cris de femmes à leur fenêtre demandant ce qu’il y a.
Grange, son fusil au poing, jurait qu’il venait d’envoyer deux balles dans la peau de la Bête-Noire. S’y glissant par derrière, il s’était embusqué dans son ancien bâtiment en bordure de la route ; et, guettant la bête au passage, il avait lâché son coup de feu sur elle.
Deux balles bénites par le curé du bourg, et deux balles de bronze ! Lui, Grange, avait fait fondre dans l’après-dînée les grelots de sa mule. La galipote en tenait à cette heure !
Hommes et femmes se démenaient dans l’odeur de la poudre et la fumée blanche qui flottait encore sur la route. « Mon Dieu Seigneur ! faut-il voir des choses pareilles, à présent, dans la vie du monde ? » Des vieilles arrivaient à petits pas cassés, une main à la hanche, l’autre appuyant sur un bâton ; des garçons qui tenaient des fusils ou des fourches ; des ménagères abritant des doigts une chandelle qui faisait brouillard jaune, et l’on voyait une joue de jeune fille, ou une tête de vieux à cheveux blancs tombants. Tout ce peuple allant, venant, parlant, tâchant de se faire conter les choses.
On cherchait des traces de sang ; mais s’il y en avait eu, les sabots les avaient déjà effacées dans la boue. Grange assurait que la bête en tenait : force lui était pourtant de reconnaître qu’il ne l’avait point vue faire le plongeon. Et les gens, eux, n’avaient rien vu du tout.
Le lendemain, le bruit commença de courir que le Six-Mions s’était mis au lit. Tout se sait dans un petit endroit. Chacun y vit dans une lanterne. Pour le faire court, ce Six-Mions mourut le septième jour ensuivant, qui fut le jour de la Saint-Martin. Il demeura la semaine entière à la mort sans arriver à mourir. Même Grange apprit dans le temps que ce fut affreux, les dernières heures, et que, pour que le Six-Mions trépassât, on dut lui mettre un joug, un joug de bœufs sur la tête…
Dès lors, plus de galipote dans le pays. Cependant, tout n’a pas été fini par là. Le Six-Mions demeurait hors du bourg, dans un vieux chazard, une bâtisse tombant en ruines, lézardée, branlante, avec son garçon, dont on sait le naturel et les comportements, et son épouse qu’on appelait la Bigue.
Cette Bigue n’était pas mauvaise personne : un quart de femme, blanche comme un navet, avec une face de carême ; en un mot de ce monde ni lard ni chou dont il n’y a grand’chose à dire. Elle regretta son homme à peu près comme l’honnêteté le veut, ni plus, ni moins, sans faire sa charge de le pleurer. Personne ne le lui reprocha : regretter ce gueux de rafataille, alors qu’il les lui avait toutes fait voir ?
Le beau, c’est qu’une fois mort et enterré, il lui en fit voir bien d’autres. La grande diablerie commença. Dans la maison, un sabbat sempiternel : tapage en bas, tapage en haut, et je ne sais quoi comme des chandelles à toutes les fenêtres. Quand la Bigue rentrait, elle s’enfermait à double tour tant elle avait de peur : l’autre, soyez tranquille, trouvait bien moyen d’ouvrir. Si elle sortait, elle bouclait les portes derrière elle ; mais pour les voir grandes ouvertes à son retour.
La Bigue a ainsi enduré tout ce qui se peut imaginer. Les nuits, un train d’enfer : des montées, des descentes dans l’escalier, avec un coup à chaque marche, comme une boule qui déroule, et tout…
À la fin, – Gaspard le sut par une voisine, – elle fut demander à l’ensuaireuse du bourg de venir coucher avec elle. Les ensuaireuses étaient celles qui cousaient les défunts dans leur linceul, car on les cousait alors ; elles entendaient des bruits qu’elles comprenaient en veillant le mort ; elles savaient dire s’il voulait des messes…
Mais celle-là refusa tout net et tout plat de coucher dans la maison du Six-Mions.
La Bigue s’adressa alors à une vieille fille qui avait le renom de ne rien craindre. Cette fille, on l’appelait la Sargounelle : une grande chabraque qui vous chargeait gaillardement un sac de blé sur son dos et qui vous eût bu bouteille de tafia aussi lestement que chopine de piquette. Elle fut commissionnaire de Champétières, en un temps, et c’est elle-même par la suite qui conta cela à Mme Domaize.
La Bigue lui dit :
— Écoutez, tant que vous n’entendrez que du potin, ne bougez pas. Mais quand vous l’entendrez, lui, entrer dans la chambre, vous lui demanderez ce qu’il veut. S’il vient de la part du bon Dieu, de parler, et s’il vient de la part du diable, de se retirer.
La Sargounelle répond que c’est compris et se couche sans autre mystère. Bon. Dans la nuit, comme à l’ordinaire, le bruit commence. Puis ça s’approche, s’approche, monte dans la chambre. On apercevait une ombre devant le lit, mais impossible d’en entrevoir la forme. Il en venait un souffle, fffffffffffff… comme d’une chose qui fait du vent, non point comme de quelqu’un qui respire…
Sans trop s’émouvoir de ce semblant noir debout dans le noir, la Sargounelle a demandé au fantôme ce qu’il voulait, ainsi que la Bigue lui avait dit de le faire. Une sorte de voix lui a répondu : « Pas à vous. Je ne m’adresse pas à vous. »
La Bigue a fait dire des messes. Mais elle ne dut guère tarder à quitter l’endroit. Elle mourut trois ou quatre ans après à Saint-Dier d’Auvergne.
Quant au garçon, il partit avec elle. Avant de quitter le pays, il dit à qui voulut l’entendre que pour son père et son grand-père il n’oublierait jamais le sieur Grange. Qu’il avait du temps devant lui, et que s’il ne se payait pas sur le Matelot, il se paierait sur ses deux filles.
Puis Gaspard, qui s’efforçait d’en avoir des nouvelles, apprit qu’il menait une vie de vaurien et qu’il avait été éreinté de coups par un traiteur d’Issoire, lequel l’avait trouvé dans sa cave, au milieu des bouteilles.
Pour en finir avec la maison du Six-Mions, personne de longtemps ne voulut la louer. À la longue, un nommé Menadier se trouva qui prit ce qu’on racontait pour des fariboles de femme. Mais il a bel et bien entendu les bruits, de sorte qu’il ne tarda guère à vider les lieux ; avec ce malheur pour lui que sa fille tomba dangereusement malade de la frayeur qu’elle avait eue et fut des mois à s’en remettre.
QUATRIÈME VEILLÉE
PREMIÈRE PAUSE
Le château de Roche-Savine avec l’histoire de son ogresse et le château des Escures, son assiette, ses ruines, les réparations de Grange. – Après son malheur, Grange prit la maison neuve en dégoût. Comme il avait quitté Chenerailles pour Champétières, il quitta Champétières pour le château des Escures.
Gaspard voyait de loin les choses. Ce fut lui qui parla de ce domaine qu’on pourrait acheter à bon compte. Le cousin serait là clos chez soi, dans une maison de pierre facile à garder du feu et des brigandages, à quelques minutes du Monestier, – et le magister, le Barthaut, s’offrait à venir apprendre le rudiment à Pauline, – plus proche encore de Saint-Amand, où l’on aurait la cousine Domaize pour s’occuper des deux petites. Puis Saint-Amand étant relais de poste, une brigade de gendarmerie y tenait garnison, sain voisinage pour quelqu’un qui avait des affaires avec les chenapans d’alentour.
Dans les calculs de Grange entra sûrement la gloriole de faire d’un château sa demeurance.
Ce château est assis sur un éperon regardant le levant, – aspect plus salutaire que tout autre, – au pied même de la montagne de Roche-Savine. On tient que, dans le vieux temps, ce furent les écuries du grand et puissant château fort bâti sur la cime et dont les ruines mêmes ne sont plus que monceaux de pierres écroulées, où se quillent quelques genièvres pointus répandant au soleil une excellente odeur. Des chèvres font dérouler les cailloux en grimpant pour brouter les œillets sauvages ; les lézards zigzaguent, les criquets s’envolent, mais c’est toujours une paix, un charme fait d’étendue, de grand air, de silence. De là, l’on a la vue longue vers les quartiers de Thiers, dont on aperçoit les maisons en escalier comme des grains de sel fin ; et tout le ruban de ces monts dont les ondes s’enfoncent vers le Nord, tachetées de bleu plus sombre à la fois par les forêts et l’ombre des nuages passant.
On récite qu’autrefois la dame de ce haut château était une ogresse qui mangeait les enfants comme on fait des agneaux ou des cabris. Ah ! dans des temps anciens, aux temps peut-être où S. Joseph était encore garçon…
Toujours est-il que cette terrible personne étant un jour devant une étable entendit bronler une vache. Et cette vache poussait ses meuglements d’une voix si désolée, que l’ogresse questionna la métayère. « Ha ! madame, répondit la paysanne, c’est parce que nous venons de lui enlever son veau. » La dame passa son chemin ; mais elle pensait en soi-même : « Si cette bête, qui n’a pas de connaissance, entre en tel désespoir parce qu’on lui a pris son petit, qu’est-ce donc de ces femmes, qui ont une âme baptisée, à qui je prends leur enfant ? »
De ce jour, ç’a été fini pour elle de manger les enfants du monde.
C’est au pied de ce puy de Roche-Savine, dans le château des Escures, qu’est née, voilà quelque trois siècles, Antoinette Micolon, qui fonda « le couvent fermé » des Ursulines d’Ambert et qui mourut en odeur de sainteté, cloîtrée à Arlanc-le-Bourg.
Pays toujours venté, souvent dans le brouillard et le nuage. Des sapins sur les pentes, serrés comme une toison de velours frisé ; des pacages mouillés que crèvent de rondes roches grises ; des prés de bure rase, en creux, en bosses. Plus de noyers, mais de gros merisiers à petites merises d’une saveur non pareille, d’amples fayards pleins de vent, des alisiers que la bise argente en en retroussant la feuille. Les maisons sont longues et basses, tout de pierre, le toit même chargé de grosses pierres à cause des tourmentes ; et des brasses de bois et des tas de fagots en masse, à l’entour ; parce qu’en hiver, ici, le feu est la moitié de la vie de l’homme. Tout a dans ces cantons un air de montagne, rude, pauvre et fort.
Mais les Escures sont agréables à habiter, étant en bonne exposition et en lieu accommodé d’eau et de bois, avec la santé de l’air. Quel air on respire là, plus net, plus brillant que celui des fonds, comme ces fleurs des hauteurs sont plus fines que celles des plaines. Et l’on se trouve, pour corriger la solitude de la campagne, près d’une bonne et profitable route, la grand’route de Lyon à Clermont. Un chemin d’ailleurs mène en dix minutes et pas même au bourg de Saint-Amand, qui était alors, comme le dicton le portait, habité par plusieurs familles bourgeoises :
Saint-Amand,
Petite ville, grands gourmands.
Aux abords du château, ce chemin court par la fougère à mi-flanc de la pente ; des sorbiers contournés en font une verte allée qui passe devant la métairie pour aboutir au grand portail.
Les Escures formaient un carré long que le parapet du jardin partageait suivant la longueur. On entrait dans une cour gazonnée où quelques cormiers et pruniers poussaient contre le mur d’enceinte. La maison de maître, qui se présentait de flanc, était construite en dés bien appareillés de granit gris rongés par l’âge, avec deux tourelles accrochées ainsi que des hottes aux angles de la façade. Les fenêtres de l’étage ouvraient de grands carrés à croisillons moulurés ; certaines restaient surmontées de corbeaux ; celles du rez-de-chaussée portaient des grilles de fer ; deux ou trois, même, avaient été bouchées de maçonnerie. Sur le derrière, la maison finissait plus grossièrement, en grange, à demi-appuyée à la pente ou la flanquaient des tours de pierres sèches.
Ainsi, couverte des tuiles creuses du pays, avec ses joints fourrés d’herbe, ses blocs ébréchés, ses degrés creusés par les gouttières devant les portes en ogive, elle gardait quelque air montagnard et rustique.
Une seconde cour la séparait des écuries qui se faisaient face, vastes et voûtées comme des églises : un fameux travail de l’ancien temps qu’on va voir encore par curiosité. À l’étage s’ouvraient des porches arrondis où des rampes de terre devaient mener autrefois.
Les Escures avaient été vendues sous la Révolution ; on ne saurait plus dire à qui cela appartenait au juste. Lorsque Grange acheta son nouveau château des sept portes, – ainsi l’appelait Gaspard, et le nom même dit pourquoi, – tout était délabré. Dans les dernières cours, pleines de chardons, de choux d’âne, restaient seuls debout des chaînes d’angle et des pans de muraille où les noisetiers sauvages avaient pris racine. La fouine y gîtait sous la ronce.
Grange qui aimait l’ordre, les choses faites par compas, rajusta tout du mieux possible. Il ne fallait pas songer à relever les ruines, mais on débroussailla les murs, on rescella les grilles, on rendit le logis habitable, allant jusqu’à peindre en vert, pour que ce fût plus beau, les basses portes aux ferrures bizarres. Avec son goût pour la netteté, Grange se sentait contrarié de ne pouvoir entretenir les cours et les chemins intérieurs continuellement désherbés. Mais il eût fallu un journalier à dix sous par jour rien que pour cela, et c’est toujours péché que de dépenser de l’argent en pompe de pur luxe. Puis il ne faut pas se montrer trop d’un coup. Les bourgeois de Saint-Amand trouvaient déjà à redire, voyant le Matelot dépenser tant d’argent à son installation, qui n’était qu’un paysan somme toute.
DEUXIÈME PAUSE
La tristesse d’Anne-Marie. – Ses besognes. – Ses peurs. – Mme Domaize. – Anne-Marie et son cousin. – Un esprit de gaieté aurait sans doute repris le dessus chez Anne-Marie, triste pourtant et tournée à la réflexion depuis sa nuit dans la maison seule. Mais cette mort de sa pauvre mère, que le père regardait comme une suite de l’affaire de Chenerailles, et la vengeance qu’il en avait tirée en tuant le Six-Mions, avaient enfoncé plus avant la petite dans l’effroi et la tristesse. Gaspard à sa façon, le vieux missionnaire à la sienne, lui avaient bien relevé le courage. Seulement, le père était comme tous les hommes : il ne savait pas trop faire. Il avait des mots maladroits. Puis il affichait les précautions qu’il prenait, pensant rassurer sa fille, et c’était tout au rebours. La peine et la peur pesaient ensemble sur le cœur d’Anne-Marie. Bien des fois, elle n’eut pas assez de la journée pour pleurer les larmes de son corps. Même elle en arrivait à se croire fautive, elle, la première cause du malheur de sa pauvre maman.
L’idée d’habiter un château l’avait effarée d’abord. Cependant l’endroit lui plut par ce qu’il gardait de champêtre, le trèfle et le plantain mangeant les cours et les bouvreuils frétillant à l’entour des sureaux. C’était plaisant aussi, cette eau de roche dévalant à bouillons de la montagne, la belle et claire eau courante, trépillante, jasante, qui semble vous tenir compagnie. Et ces salles du logis étaient agréables, surtout au matin, quand le soleil y entrait à longs rais.
On avait devant soi le jardin en terrasses qu’épaulaient des murs de granit. De là on dominait le déroulement des pacages. Le vallon se creusait entre ses croupes et les arbres du ruisseau faisaient leur couleuvre au bas-fond. À main droite rien que les pentes de sapins. À main gauche, c’était des prés, de pauvres champs, les blancs lacets du grand chemin sous le Monestier, et des friches montueuses couronnées de bois en chenille. Là-bas, au bout du val, par delà la plaine d’Ambert, les monts du Forez se levaient comme un talus aux gradins ravinés, que le temps faisait, et les heures, d’un bleu de campanule ou d’un bleu d’aconit.
Anne-Marie, il lui fallait là être femme de domaine et s’occuper de tout : lever le miel des ruches au jardin et mettre couver les poules à la basse-cour, faire boulanger le pain de la semaine, battre le beurre et cailler les fromages, et les préparer, et les ranger au cellier, et voir si les pommes de terre de la cave ne germaient point, si au charnier le lard ne rancissait pas… Encore que ce fût une marque de bon ménage de ne jamais tâter le lard que jaune et ranci, parce qu’on tenait à avoir des provisions bien amples, comme pour deux ans, et que, naturellement, on mangeait en premier lieu celles de plus vieille date.
On tuait deux, voire trois cochons pour l’année, fête et festin où l’on invitait tous les cousins, cousines. Mais quel remue-ménage, la graisse à fondre, le salé à arranger dans les jarres de grès, le boudin, les andouilles, les saucissons à faire. La maison était c’en dessus dessous, à peu près comme lors de ces grandes lessives deux fois l’an, qui duraient bien huit jours. Les têtes des servantes leur en tournaient.
Anne-Marie veillait à tout, à tout : comme à faire presser les noix pour avoir de l’huile, à donner la laine et le chanvre à filer, et même à préparer des remèdes, le millepertuis pour les maux d’yeux et les pétales de lis pour les brûlures. Dans un domaine de campagne on ne devait que vendre, jamais rien acheter, sauf du sel et des outils de fer. La petite s’attachait en ce ménage à faire comme faisait la mère, autant qu’il était en elle.
Tant de besognes l’empêchaient de trop penser à son malheur. À 15 ou 16 ans, d’ailleurs, l’enfant perce malgré tout. Anne-Marie par moments avait des regains de gaieté, un entrain de petite fille, de jolis cris d’aronde.
Mais vite ceci ou cela la ramenait à ses pensements.
De trois côtés, des chemins entouraient les Escures. Devant le portail de pierre sculptée qu’abritait un vieux tilleul, l’allée venue du bourg fourchait : par ici descendant roide vers les villages du vallon, par là ceinturant à demi le domaine pour filer entre deux étangs carrés comme des dalles, et s’enfoncer dans les bois.
Un soir qu’Anne-Marie était allée jusqu’à la lisière voir pourquoi la servante ne ramenait pas les vaches, et qu’elle restait sur le chemin, prêtant l’oreille, elle eut soudain ce sentiment que quelqu’un la surveillait. Elle passa le regard autour d’elle, et crut voir alors à vingt pas une tête penchée derrière un sapin. Si jeunette, elle fut vaillante. Se souvenant de ce que lui avait dit le vieux prêtre, de penser en toute rencontre que Dieu était présent et que rien n’arriverait sans son congé, elle prit sa résolution et alla droit à l’arbre. Mais elle eut à contourner un creux où l’eau coulait à petit bruit sur l’herbe. Quand elle se trouva de l’autre côté, le quelqu’un n’y était plus.
Aussi, lorsque de sa fenêtre elle regardait les abords de ce bois sauvage, elle se demandait si elle voyait là-bas un homme accroupi aux aguets, ou bien une motte, une souche, quelque grosse racine rampant à fleur de sol. Alors lui revenait en mémoire la nuit du malheur de sa vie, avec le cri du brigand qu’on emportait au cœur de la forêt : « Ton temps viendra !… »
Ces frayeurs, elle n’aurait pu les confier à son père et n’aurait su au vieux prêtre. Quant à la cousine Domaize, elle ne cessait de conter ses malaises et tournements de tête que pour ranimer les braises de son chauffe-pied du bout de ses ciseaux. Parfois pourtant, elle venait à parler de la famille, du côté de la pauvre mère d’Anne-Marie, et s’espaçait alors, Dieu sait, sur le lignage et les cousinages. Elle savait non point seulement tous les prénoms des cousins jusqu’au douzième degré, mais encore comment on les aurait prénommés s’ils eussent été d’un autre sexe, et pourquoi. Elle plaçait de bizarres petites histoires ayant trait à ces personnes, sur qui elle portait des jugements retenus, aussitôt adoucis de restrictions. De là, elle passait aux parents par alliance, et toutes les tribus du canton défilaient.
C’était ce que Mme Domaize appelait : faire connaître la famille. Elle joignait à ces propos quelques admonitions touchant les comportements d’une jeune fille de bon maintien, et elle se félicitait à part soi d’élever ainsi la fille de Jean-Pierre Grange du rang de campagnarde à celui de demoiselle.
De la grande salle à boiseries grises, mal planchéiée et toujours glaciale, on voyait la pluie assombrir le jardin étouffé sous les branches…
Il n’y avait qu’un ami à qui Anne-Marie pût confesser ses peines.
D’abord elle ne voulait rien dire ; elle n’avait rien à dire : des idées, rien, des imaginations… Et puis on se laisse aller à parler : on lit sur le visage de l’autre, dans ses yeux, qu’il vous suit, qu’il est de moitié dans vos esprits et sentiments ; on n’est plus seule ; les regards s’engagent. Celle qui ne s’est jamais confiée de cœur à un ami ne sait pas quel bien c’est.
Gaspard à présent sans Anne-Marie n’était plus qu’un corps sans âme. Par la bise, par le hâle, il arrivait aux Escures frais comme giroflée, toujours de bonne volonté, toujours de belle humeur. Aurait-on pu lui cacher ses ennuis ?
Le soir même du jour de l’homme derrière l’arbre, Anne-Marie lui conta le moment qu’elle avait passé au bord du bois. Elle était debout, près de la table, la tourte appuyée de champ contre sa poitrine, taillant des lichettes dans les écuelles brunes…
Deux, trois ans après, loin sur de tristes routes, pensant à elle, Gaspard la revoyait ainsi : debout, craintive, lui souriant et le regardant jusque dans l’âme pour voir si en la rassurant il était bien sincère. Cet air qu’elle avait, la lumière de sa joue, de ses yeux couleur de noisette, et lui qui se sentait comme fou de l’embrasser…
À cause d’une servante qui étendait du linge sur des cordes entre les poiriers du jardin, elle parlait presque bas. Et parfois il ne la comprenait plus, quand les paons perchés sur le parapet criaient pour annoncer la pluie.
Grange avait acheté ce couple de paons afin de distraire Anne-Marie et de lui faire plaisir, voyant qu’elle avait parfois ce qu’il appelait des vapeurs noires. Mais quand Gaspard était là, qu’il la regardait, c’était comme si du soleil coulait dans le cœur de la petite.
Sa Toussaint de Champétières l’avait bien changée. Le souci de voir Gaspard devenir son mari lui semblait maintenant des enfantillages à quoi elle ne devait plus s’arrêter. Les choses se présentaient autrement, plus proches de la vie telle quelle. Gaspard, eh bien, c’était son cousin, son ami et son compagnon.
Le garçon, lui, auprès d’Anne-Marie, furieux d’un désir de bataille, se demandait s’il mettrait jamais la main sur l’homme en noir. Peut-être de ce scélérat ne restait-il que quelques ossements blanchis sous les fourmis en un coin de forêt perdue. Mais s’il était debout, un brigand – et un monsieur – qui a délibéré de se venger, dort mal la nuit tant qu’il n’est pas arrivé à ses fins.
Quant à ce que la petite croyait avoir vu, qu’en fallait-il penser au bout du compte ? Des bruits couraient… Gaspard s’était mis aux champs pour relever les traces de quelques estafiers qu’on disait terrés par là, et il se promettait d’être toujours sur l’œil. Ce que cela ferait, il ne le savait pas. Le château des Escures avait sept portes et de tous les côtés il pouvait arriver des choses.
Au demeurant, nargue du souci. Ah ! qu’ils y viennent ! Ils trouveraient à qui parler. Gaspard se sentait sûr de ses amis en toute rencontre : alors il se laissait emporter par la folie de rire, du soleil et de la jeunesse.
TROISIÈME PAUSE
Les journaliers. – Les bois de la Montagne et comment on les fait valoir. – L’alerte de ce jour de brouillard sur le plateau. – Anne-Marie se levait la première aux Escures pour que le père mangeât sa soupe chaude avant de sortir en champs.
Dans les domaines, le maître donnait au soir les ordres au maître-valet, et l’autre au matin distribuait la besogne à son monde. Mais Grange était trop vétilleux pour en user ainsi, et trop absolu. Puis, peut-être que le Nanne, qui n’en craignait pas pour l’ouvrage, n’aurait pas su régler tout dans la maison.
Grange mangeait assis, tassé, courbé sur la table à la manière des paysans, et comme eux il rattrapait le long de son menton, d’un coup de cuillère, la soupe qui découlait. Tout en piochant dans l’écuelle à oreilles pleine de côtes de choux et de pommes de terre fumantes, il assignait à chacun sa tâche. Les valets, les journaliers, se tenaient là dans leurs vestes et leurs brayes rapetassées de pièces de toutes les paroisses, quasi sans forme ni couleur. Leurs mains lourdes pendaient embarrassées d’être vides, et ils parlaient à l’auvergnate, sans grand souci de déférence. « Eh bien ! Grange, qu’est-ce que je fais aujourd’hui ? Est-ce que je continue à épierrer le champ aux Sardières ? Ou si je vais à Sagne-Rouge semer le trèfle ? Il s’en ferait temps… Maintenant, moi je dis ça… ici ou là ça m’est égal, vous n’avez qu’à dire, mais dites-le. »
Et Grange envoyait l’un verser une éteule, l’autre donner un nouveau labour à la jachère, l’autre refaire les rases, les rigoles.
Un homme gagnait dix sous à battre des gerbes tant que le jour durait. On travaillait peut-être avec plus de cœur qu’aujourd’hui, mais les fêtes étaient nombreuses, on se donnait davantage de relâche. Un garçon proposait aux amis d’aller jouer aux quilles, au lieu de battre en grange, et si ça leur chantait, les voilà du matin au soir à lancer la boule sous l’ormeau de la place. À cette heure on s’en scandaliserait, sans comprendre que le monde est devenu plus méchant précisément parce qu’on ne sait plus chanter, rire et boire, et qu’il ne s’agit plus que de gagner de l’argent encore et toujours.
Le soir, Grange marquait dans le livre de raison ce qui lui paraissait notable : « J’ai fait refaire le mur de pierre au bas du pré de Prat-Long : il a fallu douze journées d’homme à douze sous… »
Mais plus encore que de ses champs il aimait s’occuper de ses bois.
Remontant la pente, un peuple de sapins hérissés aux fûts gris d’argent, aux branches mangées de lichens et pendant en grosses pattes. Dès l’entrée, les fougères, les framboisiers, les bouleaux faisaient comme des caches. Une fraîcheur de cave tombait sur les épaules. La vue ne passait guère avant, arrêtée par la rencontre de ces arbres confusément poussés, là épais et drus, étagés par touffes, là égaillés parmi la ramée plate des jeunes fayards. Dans ces bois aux mousses gonflées d’eau, on entendait partout des gouttes pleurer aux ornières de terre noire creusées par les troncs que traînaient les bœufs au bout d’une chaîne. Des joncs bordaient la sente. Impossible de s’écarter à cause des fondis et des ronciers. Les bestiaux ne pacageaient que dans les prés-clairières. On voyait çà et là quelques fagots rouges appuyés à un arbre…
Plus haut, en lieu pendant, comment exploiter ? Les vents du printemps et de l’arrière-saison abattaient en long, en travers, de vieux sapins barbus qui pourrissaient sur place, serrant des paquets de terre entre leurs racines. Des sources glougloutaient, dégoulinaient. Il fallait sauter d’un endroit à l’autre, et pas une motte qui ne tremblât dans l’eau noire mélangée d’herbe. Un busard criait, qu’on voyait, en levant le nez, tourner en rond sous le nuage. Était-ce la senteur mouillée des mousses, ou ces dédales entrevus ? Le frisson de la petite mort vous courait dans le dos. Comme on se sentait là dépourvu, sans avertissement ni défense…
Anne-Marie n’allait pas dire ces pensées à son père, qui dans l’année passée à Champétières avait déjà pris du regret de ces bois. Mais les soirs, par temps couvert, quand le vent chasse au loup, poussant des hauteurs de Virennes des nuées lourdes comme des outres, que ces montagnes se rapprochent et se font plus hautes, pareilles à celles de la Bête du Gévaudan, on ne sait quelle menace accable le corps sinon l’esprit.
Et pourtant Anne-Marie n’était plus aussi peureuse. Quand le père allait en forêt, il ne lui en coûtait pas de le suivre. Étant fort entendu à ce ménage, Grange commençait à tirer de grands deniers de ses bois. Il savait reconnaître quels sont les arbres vieux et langoureux qui ne grossiront plus et empêchent leurs voisins de croître, et voyait du premier coup d’œil, parmi ceux-là trop pressés qui cherchaient la faveur du soleil, quels abatages il convenait de pratiquer. Au reste, il connaissait les temps propres à la coupe pour que le bois ne soit attaqué de la vermoulure : c’est ordinairement quand la lune entre en décours, et selon le dicton des bûcherons :
Beu d’épino
Luno fino,
Beu de felho
Luno velho,
bois d’épine, lune fine, bois de feuille, lune vieille.
Peu à peu, ses quartiers les moins difficiles d’accès, ceux des Escures, de la Souderie, des Fayes, furent tenus comme un jardin. On n’y aurait pas vu une branche morte. C’était son goût d’aménager les bois, d’en faire son bien, arrangé à son idée. Il allait lui-même avec une perche à crochet émonder, assavoir ôter le mort et le rompu, et élaguer, assavoir couper les branches inutiles et nuisantes empêchant l’arbre d’avoir bonne grâce. Il déplantait de ses mains les jeunes plants semés à l’aventure pour les replanter dans les endroits dégarnis. Et il se faisait aider par les petites. Même il habituait Anne-Marie à cuber les arbres à vue d’œil.
Ainsi, et comme ses bois rapportaient de bonnes sommes, lui qui était sujet à l’argent, voyait son chagrin perdre de mois en mois ce qu’il avait de plus noir.
Avant de déloger, par ces matins gris qui avaient un goût de brouillard, il prenait encore deux doigts de vin et un peu de pain de peur que l’estomac vide n’attirât le mauvais air de la saison. Puis, les pistolets dans les goussets, la grosse canne d’épine à la main, en route avec Anne-Marie et parfois Pauline. On allait au bois des Fayes marquer des arbres à jeter bas ; ou bien veiller aux charrois sur la hauteur du côté de Virennes.
Il faisait du vent et l’on se voyait par instants au milieu de grisailles de brume qui passaient vite. Les branches étaient trempées sans qu’il eût plu et la moustache du père pleine de gouttelettes. Là-bas sous la nue qui traînait en franges, couleur de ces bourres au tronc des sapins, un pâle éclairage faisait les monts du Forez blancs comme après quelque neige. Les lointains paraissaient à des lieues. On ne reconnaissait quasi pas le pays. L’air fumeux mettait une faim, presque une inquiétude au creux de la poitrine…
Ce fut un de ces matins-là, aux entours de la Croix de septembre, qu’Anne-Marie vit véritablement deux hommes se couler derrière les arbres. Dans le moment on entendit des cris de chouette qui se répondaient et des craquements de branches mortes sous des sabots. La petite devina à la contenance du père qu’il devenait inquiet.
Sur ce plateau, le brouillard arrivait par bouffées cardées, déchirées, poussées de biais dans une bise qui gelait les os et empêchait d’avancer. Le nuage semblait s’élever, on s’en croyait sorti, puis une demi-minute après, on n’y voyait plus à cinq pas. Rien que ce gris mouvant, se défaisant, ou s’épaississant, passant en hauts fantômes de fumée qui se dépassaient, dans une poursuite de folie à quoi ce silence ouaté prêtait quelque chose d’un cauchemar. Et les méchants bruits continuaient, par intervalles, venus maintenant de là, maintenant d’ici. Une ou deux fois le père avait obliqué, à cause d’eux, et l’on n’était plus trop sûr du chemin.
À main droite, tout à coup, Anne-Marie aperçut trois ombres. Le père leva brusquement le bras pour faire glisser au poignet le cordon de son bâton et plongea les mains dans ses goussets en criant : « Ici, ma petite ! »
— Oh ! cousin, c’est vous ?
Grange, qui armait ses pistolets, reconnut alors Gaspard, Plampougnis et Jeuselou du Dimanche.
— Té, vous !… Et qu’est-ce que vous fichez par là ? Avec vos cris et vos manières, vous vous faites prendre pour de mauvais drôles : j’allais peut-être vous envoyer dans l’estomac quelque dragée dure à digérer, les fistons.
— Essayez donc de tirer, fit Gaspard d’un air mécontent. Si le brouillard n’a pas détrempé vos amorces !… Par ce temps, enveloppez-moi serré vos pistolets d’un mouchoir, un autre coup… Ça va bien, nous descendrons avec vous aux Escures pour y prendre un air de feu.
— Tout ça ne me dit pas pourquoi vous étiez là à droguer ? enchaîna Grange au bout d’une minute.
— Vous êtes bien curieux, et Jeuselou riait. C’est vrai que nous étions dans vos bois… Eh bien… nous cherchions à déloger quelques gros oiseaux qui doivent loger par ici, des hiboux, des chats-huants, pour faire nos farces…
Anne-Marie vit son cousin regarder Jeuselou comme pour lui signifier de taire sa langue. Et par l’entre-bâillement de la blouse, elle aperçut la crosse d’un pistolet sortant d’une poche de la veste. On s’arrêta pour s’orienter. Gaspard prêtait l’oreille. Le silence passait seul avec le vent et le brouillard.
Ensuite le garçon redevint de belle humeur et tint vraiment compagnie à Anne-Marie. Mais tout en se donnant carrière, il marchait à côté d’elle, coude à coude ; et sans faire cas de rien, il avait des yeux tout autour de la tête.
Aux Escures, ce fut à peine si les trois gars vidèrent un verre de vin ; ils repartirent dans l’instant. La petite qui avait grimpé au grenier, observa qu’au lieu de prendre le chemin du bourg, ils reprenaient celui du bois et remontaient là-haut sur le plateau.
QUATRIÈME PAUSE
Jeuselou du Dimanche. – Les faits et gestes de ces garçons. – Valentin Verdier. – On n’a jamais su trop exactement comment Gaspard avait eu la puce à l’oreille. Peut-être par des bavardages de mendiants ou des racontars de cabaret. Il faut dire qu’il se trouvait bien placé : l’auberge de son père étant un relais de poste, par les conducteurs et les postillons, par les rouliers, les voyageurs, les buveurs, il apprenait les nouvelles de quinze lieues à l’entour. À dater du jour où il se mit cela dans la fantaisie, plus rien ne lui échappa : on ne cassa plus une écuelle, on ne marcha plus sur la patte d’un chien, qu’il ne le sût.
Il avait aussi pour lui donner des avis ce drôle de corps qu’on appelait Jeuselou du Dimanche. Jeuselou était venu de Limagne avec son oncle et faisait comme lui le coquetier ou coquassier, leveur d’œufs et de beurre, marchand de prunes, de poires, de châtaignes, qu’il allait acheter de chaumière en chaumière et revendait devant l’église après vêpres. De la sorte, il patrouillait jusque dans le fond des campagnes, et comme ce n’était jamais sans ses yeux ni ses oreilles, rien n’y arrivait ou ne s’y disait qu’il n’en fit son profit à l’occasion.
À la mode des gens de Limagne, il était vêtu de rase blanche avec des grègues bouffantes, et dans ce blanc, ce garçon long comme un jour sans pain, maigre d’ailleurs comme un carême, se laissait voir de plus de deux lieues.
Qui l’avait une fois vue ne pouvait oublier cette figure singulière, aux yeux clairets, et tachetée de rousseurs ainsi qu’un œuf de caille. Il y avait un don dans cette famille, don de musique, de chansons et de contes. Quand il prenait sa vielle, celui-là, et qu’il en sonnait, on se sentait des fourmis aux jarrets et les doigts de pied marquaient d’eux-mêmes la cadence. Rien n’y eût fait : l’élan vous dressait, vous jetait dans la danse avec les autres. Un drôle de corps en vérité, maintenant endormi, perdu, avec un regard qui s’en allait entre ciel et terre, maintenant vif, éveillé, éclatant d’esprit dès qu’il ouvrait la bouche, et plus fin que le renard.
Ce fut sans doute Jeuselou qui ouït parler du train fait par trois hommes dans une auberge d’Échandelys où ils avaient voulu forcer une fille. Il n’y aurait pas prêté autre attention, quand on lui dit qu’un de ces estafiers portait un bandeau noir sur l’œil. Cela le fit souvenir incontinent du colporteur qui avait remis une lettre au valet des Grange dans le bois de Chenerailles.
Le lendemain, qui était un dimanche, il vint à Saint-Amand trouver Gaspard avant la première messe. Ils furent vus tous deux un peu plus tard sur la route d’Échandelys. Un gamin apporta le même soir des lettres à Plampougnis et à Valentin Verdier. Valentin partit aussitôt sur la jument de son père. On remarqua qu’auparavant il essaya des pistolets dans son jardin. Au bout de deux jours, trois de ces garçons revinrent sans Gaspard. Ils dirent chez lui de ne pas s’inquiéter, que Gaspard faisait savoir qu’il serait peut-être forcé d’aller jusqu’à Brioude pour rendre service à un maquignon de ses amis, mais qu’il rentrerait à la fin de la semaine. Leurs habits étaient pleins d’épines, d’aiguilles de pin, de toiles d’araignée comme s’ils avaient couché dans les bois. Plampougnis retourna à son atelier, s’allongea sur les copeaux et dormit là d’affilée vingt-quatre heures.
Or le jeudi, de grand matin, Gaspard arriva si en hâte qu’il ne prit que le temps de dire deux mots à Plampougnis. Jeuselou courut d’un saut chez un voisin qui avait un pistolet de cavalerie et le lui emprunta. Puis tous trois s’en allèrent grand train du côté de Virennes, sans manger la soupe, chacun mordant à même son chanteau, à travers champs. Ce fut environ deux heures après qu’ils rencontrèrent Grange et sa fille…
… Des Escures, ils remontèrent dans les bois et poussèrent jusque vers Fournols, où un berger leur parla à la nuit tombante. À ce moment Valentin Verdier qui se trouvait à la chasse, le matin, quand Gaspard avait passé, les avait rejoints. Ils étaient tous trois à pied et lui à cheval.
C’était sa vie à Valentin, d’avoir un cheval entre les jambes ; il s’engagea, l’année d’après, dans les chasseurs de France.
D’ailleurs, à pied ou monté, d’une taille très bien prise, le regard vif, la jambe belle. Dans un millier on n’en aurait pas trouvé deux aussi bien corporés, ni d’aussi fière mine.
Là donc, près d’un pont, ils questionnèrent ce berger sur les gens qu’il pouvait avoir vus, se concertèrent, puis, comme le brouillard, qui s’était un peu élevé dans le milieu du jour, revenait, ils s’en retournèrent tous quatre à Saint-Amand.
Sous couleur de chasser, ils battirent terriblement les bois jusqu’au dimanche. Et si l’on avait aperçu par là quelques chiens de visages, on ne les revit certes plus, et de longtemps.
Une chose tracassait Gaspard : que de là-bas, de la Guadeloupe, de Saint-Domingue, Jérôme Grange n’eût pas répondu à son frère qui lui avait demandé, sur les instances du garçon, si d’aventure quelque papier n’était pas caché dans la maison de Chenerailles. On avait bien reçu deux lettres des Îles : mais l’Américain écrivait comme si on habitait toujours le domaine du père et qu’aucune des missives qu’on lui avait envoyées ne lui fût parvenue. Gaspard aurait aimé savoir à quoi s’en tenir. Vingt fois le jour, il se demandait si les idées qu’il se faisait se trouvaient justes.
Maintenant plus que jamais il se promettait d’avoir l’œil à tout. En tout cas il savait ceci : qu’il n’aurait pas besoin d’aller cogner à treize portes s’il avait besoin de douze paires de bras. À quatre ou cinq amis, d’ailleurs, quand on est tous ensemble comme les doigts de la main, on fait déjà de bonne besogne.
CINQUIÈME PAUSE
Les amis. – Les amours aux champs. – Les passe-temps du dimanche. – Histoire du jaloux de Sumontargues et du curé de Notre-Dame de Mons. – La police de Gaspard. – Tout ce qu’ils firent derrière Gaspard, ces amis, en ces vives années ! Jeunets encore, alors, mais aussi vaillants et joyeux qu’ils furent jamais, et gentils comme un cœur. Quand il le fallait, on savait, eh bien, fleureter, gaudir, vider la bouteille, et quand il le fallait, on savait pousser droit. Ô folie de la jeunesse qui fait fringuer de joie, qui jette aux folâtreries, à cent farces fantasques. À cent hasards, aussi, étant générosité et hardi courage.
On courait les foires, les fêtes, les assemblées, on était partout bien vus et bien voulus des filles, et volontiers on leur faisait compagnie. Mais ce vieux temps gai était un temps honnête. La propre nièce de Gaspard disait souvent n’avoir connu en ces jours qu’une seule fille ayant tourné mal dans la paroisse.
Les amours aux champs se font sans beaux semblants ni beaux discours. Pour un Auvergnat, c’est bien assez se déclarer, si l’on cueille au bois des airelles, que d’en faire un gros bouquet et de l’envoyer par la figure de la fille : « Tiens, la Marie ! » Et il s’en va. Ou bien c’est des perons, des petites poires vertes, qu’il achète le dimanche sur la place, et qu’il jette à cette Marie, nouées dans son mouchoir. Quelques bourrades de çà de là en riant… Puis s’il la rencontre gardant ses vaches, il la prend par l’épaule… La fille n’ayez peur, sait bien, vli vlan ! d’un revire-marion essuyer le bec de son galant quand il le faut. Ces paysannes-là, depuis l’enfance elles ont tout vu du même œil ; elles ont mené la vache au taureau comme elles ont fait les autres besognes de la ferme, et si elles ont entendu maintes plaisanteries d’une grossièreté à faire frémir, c’était dit plutôt par joyeuseté que par idée de mal. Elles gardent donc leur naturel fruste et chaste. Et elles voient au demeurant que les garçons restent de grands fous auprès de qui les enfants paraissent raisonnables. Si l’on n’avait pas plus de bon sens qu’eux !
Lorsque cela arrivait, car on sait trop que tout arrive, le curé de l’endroit faisait un mariage, et voilà tout. Les filles se laissaient bien courtiser à la rustique. Le point, c’était de se montrer affectionnée à un seul galant. Dans le bourg, quand les garçons venaient par trois ou quatre chercher leurs bonnes amies pour les mener à quelque fête des environs, la mère criait du pas de la porte : « Et surtout, dansez bien avec eux autres ! » Elle voulait dire de ne pas lier connaissance avec de nouveaux gars, et, pour se l’attacher de cœur, de faire preuve à leur cavalier d’une fidélité constante.
On partait ensemble, joyeusement, et les gars de s’en donner, et de raconter tant de bêtises, qu’il fallait bien rire, par force. Ces amis de Gaspard, aussi forts et drus et solides que les vachers de la montagne, étaient quelque peu mieux appris : ils savaient pousser les beaux sentiments près de ces jeunesses.
Blanches comme neige, droites comme un jonc,
La bouche vermeille, fossette au menton…
Bien des petits cœurs qui battaient sous la croix d’or ne savaient pas toujours se défendre des amours qu’on leur portait. Et vogue la galère, on s’aimait de cette ancienne façon gentille, pareille à ces fleurs de parterre, les juliennes, les passe-velours et les cœurs de Marie qu’on ne cultive plus.
Il y avait les pèlerinages, les jeux, les danses, sans parler des parties de quilles devant les cabarets et des charivaris quand se remariait quelque vieux, quelque veuve. Mais cela ne suffisait point à ces garçons que le sang tourmentait. Le samedi, Gaspard venait faire un tour dans l’atelier de Plampougnis et s’asseyait sur l’appui de la fenêtre.
— Alors demain ? – Eh bien ! si on allait au Monestier ? – Il n’y en a que cinq ou six, on les connaît comme le fond de sa poche. – À Saint-Ferréol, alors ? – Tu sais bien leur curé : il est toujours sur la place, il arrête tout.
— Et où alors ? À Ambert, c’est trop loin, c’est trop ville… – À Cunlhat, té ! – C’est loin, bougre. Trois lieues par les coursières… – Ha, écoute, si tu ne veux pas te donner un peu de mal. Là, il y en a qui valent la peine, tu sais…
— Allons, entendu. Nous passerons par La Guillerie, donner le bonjour à Gachon.
Le lendemain, ils partaient de leur pied leste. Arrivés à Cunlhat, on faisait le tour des auberges. Dans celle-là il y avait des filles. Ou bien le devant de porte était encombré. Finalement, on choisissait celle d’où partaient le plus de cris. On entrait, en faisant les fendants, on appelait l’hôte à grands coups de trique sur les tables de cerisier, et si les garçons du pays commandaient une chopine, on en commandait deux, en criant deux fois plus fort. Les autres, là, qui buvaient dans le fond noir du cabaret, tapant du poing, causant en patois à tue-tête, et flanquant des coups de pied aux chiens qui se faufilaient sous les tables, relevaient le front.
— Hé, faites donc pas tant de bruit, goulands de Saint-Amand !
— Du bruit ? On en fera tant qu’on voudra !…
— Ça, c’est à voir !
— C’est tout vu. Toi, tu voudrais nous en empêcher ? Tiens, amène-toi, sans tant tourner ! Viens, sors dehors !
Allez-y ! On mettait bas la veste, on s’empoignait… Oh ! mes amis ! quelles batailles ! Se battre était le grand passe-temps des garçons ; dans le Cantal aussi, comme je l’ai bellement entendu conter un jour par quelqu’un de la Buge de Lavigerie, et qui sait conter, Gandilhon Gens-d’Armes. Et il ne s’agit point de ces disputes d’après jeux, quand on s’envoyait quilles et boules par la caboche ; non plus de ces rencontres terribles entre garçons de deux villages, dont les nouvelles couraient la montagne : « Les blés en étaient tout rouges… Les gendarmes y montèrent… » Là, c’était les parties qu’on faisait pour se décarêmer, parce qu’on se sentait du sang sous les ongles, parce que le corps avait besoin de ces secouées-là. Après on enfilait la veste, et souvent on vidait chopine avec l’autre. Et on rentrait le soir éreinté, échiné, mais content d’avoir bien employé son dimanche.
Gaspard et Plampougnis y gagnèrent une fameuse réputation par les cantons du voisinage. Dans les foires, les fêtes, parfois, quelque bon mâle les accostait :
— Dis donc, toi, on m’a dit que tu n’étais pas manchot. Je voudrais bien t’essayer.
— Hé, laisse-moi tranquille.
— Non, non, j’en ai pas trouvé beaucoup pour me mettre le cul par terre.
Eh bien, il en trouvait un, et ça ne traînait pas.
C’est triste à dire, mais il n’y a rien de tel que la force des poings pour élever un homme en renom.
À Sumontargues, où naquit Gaspard, on voit dans les bois une pierre en forme de table qu’on appelle le Rendez-vous des fées. Un certain homme nommé Jean Pacros, à qui ce mot de rendez-vous trottait par la tête, quand il voyait des cailloux posés sur cette pierre, se pourpensait qu’on les avait mis là pour sa femme. Il rentrait chez lui le chapeau en bataille, et de la porte commençait le sabbat :
— Ah ! tu crois que je n’avise pas les rendez-vous que tes galants te donnent ? Va voir là-haut si les cailloux y sont encore, traînée, gabion, femelle, guenippe ! Je les ai joliment foutus au diable ! Et si jamais je te trouve avec ton joli-cœur, je ferai quatre morceaux de vous deux. Mais tiens, en attendant !…
Et de tomber sur la malheureuse et de la tabasser comme plâtre. Elle, il n’y avait pas à lui faire le plus petit reproche, elle ne sortait de la maison et ne parlait à homme qui vive. Seulement, lui, voilà, c’était un jaloux.
Des malavisés de village, voyant ce, s’amusèrent à poser des cailloux sur le Rendez-vous des fées et à monter le coup au mari, à l’auberge. Ce pauvre Jean Pacros faillit en devenir imbécile. Un jour, comme il sortait, laissant sa femme sous clef, il trouve sur son chemin une carte, un roi de cœur :
— Y a du nouveau à la maison !
Il revient chez lui avec une telle figure que la pauvre qui était montée à l’étage pour pouvoir jeter un chaudron d’eau sale par la fenêtre, éperdue, lui lâche ce chaudron sur la calebasse :
— Je savais bien qu’il y avait du nouveau !
Gaspard se grattait l’oreille, car la femme était parente d’un sien oncle. Mais s’il s’en mêlait, le ménage irait de mal en pis. Or, il apprit que ces tristes farceurs faisaient maintenant porter leurs contes à Jean Pacros sur le curé de Notre-Dame-de-Mons. Ah ! ça va bien !
Ce curé était un gaillard carré, ramassé, plutôt bas sur jambes et roux comme le chien de S. Roch. Le dimanche ensuivant, après vêpres, il dévale à Sumontargues, entre dans l’auberge, les regarde tous tout droit.
— Écoutez quatre mots : on a dit ci et ça… (Il ne prit pas des gants, mais répéta le propos tout cru). C’est des menteries abominables ! Il n’y en a pas un ici qui ne le sache, si ce n’est ce détraqué de cervelle, fit-il en montrant Jean Pacros. Eh bien, ça ne me va nullement. Je vous en avertis : si quelqu’un en lève encore la langue, je le calotterai, oui, vous m’entendez bien : je le calotterai comme un gamin.
— Ho-ho ! calotter… – S’il croit fermer la bouche au monde, cet autre en jupons ! – Les curés sont faits pour confesser les gens et non pas pour les empêcher de parler !
— Quoi ? fit-il en s’approchant et en les dévisageant, c’est toi qui en veux, c’est toi, là ? Et il pointait le doigt vers un bûcheron taillé comme une tour qui passait pour un terrible tombeur. Allez, hardi, debout. Viens voir ici ce que j’ai au bout de la manche. Faites place, vous autres.
Il quitte sa soutane en deux temps, ne garde que sa culotte. Jean Pacros voulut s’en mêler.
— Toi, tu as seulement besoin qu’on te rafraîchisse les idées, pauvre foutraque. Tu ne vois donc pas que ces nigauds font de toi leur passe-temps ?
Il vous l’empoigne par le fond des brayes et va le plaquer dans l’abreuvoir de la place. Puis il revient au bûcheron, l’accroche, le ceinture, le pile, le pille, le pétrit, le roule, le met en boule en un tournemain, le soulève, l’emporte, et le dépose dehors comme un ballot de linge sale.
Après ça, les gens se seraient mis à genoux devant lui. Et au bout de quatre ou cinq ans on le regardait comme un saint, tant il est vrai qu’un homme qu’on admire a toutes les vertus. Ne fût-il que vaillant, on le voit aussi bon, doux, franc, généreux, libéral, avisé, fidèle, et tout.
Gaspard et ses amis, s’ils ne le firent par calcul, n’auraient pu mieux faire que d’acquérir un tel renom de force… Ils furent bientôt les rois du pays, et le beau de leur royauté, c’est qu’ils ne s’en servirent jamais pour fouler personne.
D’abord Gaspard ne songeait qu’à garder sa cousine de tout mal. Il avait mis les choses sur un tel pied qu’il n’était peut-être pas une créature humaine que lui ne connût à plus d’un jour de marche des Escures. Dans les villages, tout se sait. On sait sur le bout du doigt les tenants et les aboutissants d’un chacun. La première chose que fait un paysan qui a un nouveau voisin, c’est de se renseigner sur lui par le menu, pour pouvoir lui dire au jour de la dispute qui ne viendra peut-être pas, mais qu’il est sage de prévoir :
— On te connaît bien ! Ton père a fait ci et ça, et ton grand-oncle fut fermé en prison pour telle et telle chose ! Famille de voleurs !
Ou famille de fous ! et le reste…
Ces quatre ou cinq amis firent donc registre des gens qu’il y avait à tenir à l’œil. Les plus douteux autour de chez Grange, Gaspard vint à bout d’en débarrasser le plancher sans faire carillon. Quand quelque mauvais bougre avait des accointances suspectes, le garçon le recommandait au prône : au bout de quelques semaines, l’autre comprenait que le meilleur était de faire ses trois paquets et de quitter le pays.
Quand certains ne voulaient pas entendre le français et tournaient de trop près autour des Escures, ma foi, cela allait loin. Trois ou quatre fois, il y eut dans les bois des affaires qui restèrent assez couvertes, notamment une sorte de guet-apens, vers Tirevache, où le Plampougnis faillit laisser sa peau. Il revint chez lui tout saigneux et s’en tint à parler d’une roche qui lui avait déroulé dessus du haut d’une côte. Qui avait poussé la pierre, l’histoire ne le dit pas. Mais on conta que cinq jours plus tard, le menuisier, Gaspard et un autre allèrent prendre leur vengeance dans une maison de mauvais renom au Pont du Merle, et la prirent large.
Finalement, quelques mois après que le Matelot fut établi aux Escures, Gaspard estimait que nul mal ne pouvait venir aux Grange de qui que ce fut dans le pays. Et, d’autre part, il était sûr que si quelque figure étrangère se montrait, il en serait averti dans la journée même. Il demeurait donc à peu près hors de crainte. Mais il se disait à part soi : Nous mangeons notre pain blanc le premier. Le monsieur de Chenerailles ne bougera pas tant qu’il n’aura pas appris, lui qui était gaucher, à se bien servir de sa main droite. Nous devons avoir encore quelques mois de bon. Gare la suite ! À moins que le particulier ne soit mort…
SIXIÈME PAUSE
Les après-dînées des métairies. – L’orage au moulin de Martial. – Les amours du Jeuselou et de la Marguerite. – Grange devait une fière chandelle à ces garçons et ne s’en doutait guère. Il n’avait rien démêlé à leur commerce ; seulement, de semaine en semaine, dans cette tranquillité des Escures il se faisait plus tranquille. « Les gendarmes ont du bon, se disait-il quelquefois, les soirs ; leur voisinage a ses agréments. »
Il était offusqué qu’Anne-Marie fût triste à certains jours. Puisqu’il la gardait, pensait-il, de tout mal, elle aurait dû se garder de tout ennui. Il lui disait d’aller chez la cousine Domaize se divertir avec les enfants. Mais ces enfants, Hortense qui avait l’âge de Pauline et Jean deux ou trois ans de plus, ils ne faisaient guère une compagnie pour la petite. Par bonheur, souvent venaient les prendre Gaspard, Jeuselou, Valentin et d’autres, et leurs sœurs, ceux, celles, qui avaient été du même catéchisme et avaient fait ensemble la première communion. Aurait-on bien pu vivre sans soleil au milieu de cette jeunesse ? Ces quelques mois de ses quinze et seize ans furent à peu près le seul bon temps de la pauvre Anne-Marie.
Ha ! ce feu dans les yeux des jeunes filles, alors qu’il ne dit que la vivacité, la gaieté, le désir qui ne sait même pas ce qu’il désire ; cet éclat de vie sur les joues en fleur, le sang si frais aux cols nus : celle-là qui pour avoir couru renverse la tête avec un soupir, le joli geste de celle-ci qui dégage son front des mèches retombantes, les rires repartant sans raison, les cris, les poursuites, toute la diablerie naïve des amours avant dix-sept ans.
On se retrouvait dans ces vergers des vieilles métairies où de hautes herbes noires montent toucher les basses branches des cognassiers en parasol. Le soleil, à côté de ces retraites, le soleil et les abeilles ronflaient dans la lumière ; une paix, un bonheur… et que les reines-claudes étaient bonnes, à demi-sucées par les guêpes, chaudes, confites, sucrées… Jean Domaize installait des traquenards pour les chardonnerets au milieu du feuillage. On cherchait ces nids pleins d’œufs que les poules font parfois en cachette de la métayère. C’était de petites fêtes pour la fenaison, la tonte des moutons, le gaulage des noix, la cueillette des pommes. Des parties sous les vergnes au bord de ces ruisseaux si froids, si vifs dans leurs pierres brunes : les écrevisses qu’on pêchait à la balance ou les truites qu’on harponnait à la fourchette…
Le Plampougnis, fort comme un avant-train, soulevait les roches, pour que Gaspard pût plonger le bras dans ces trous d’où le poisson se darde et file, zigzaguant en éclair. Au besoin, il portait ainsi qu’un S. Christophe les demoiselles à l’autre bord et remuait un tronc d’arbre comme un fétu. Toujours aussi cordial que cette odeur de bois frais, de menuiserie qu’il gardait sur lui.
Dans ses recommandations dernières, la mère avait dit aux petites de bien prendre garde à souhaiter la fête du père à chaque Saint-Jean, en lui offrant quelque ouvrage de leur main comme elle le leur avait appris et comme il se doit dans les bonnes familles. Cette année-là, Grange voulut qu’on allât tous en bande s’amuser dans la campagne.
On avait emporté des saucissons, du pâté de lièvre, des couronnes au beurre et une petite outre de vin de Beaujolais. Le repas dura longtemps à l’ombre des frênes où bourdonnaient des mouches bleues. Puis on se mit à pêcher des écrevisses, qu’on appâtait de grenouilles coupées en morceaux. Bientôt, elles grouillèrent par douzaines au fond du sac, avec ce bruit de gravier remué dans l’eau qu’elles mènent. On comptait en prendre surtout une fois la nuit tombée, à la lumière des torches.
Cependant, le temps s’était chargé. Comme on s’en avisait, un bruit s’éleva, courut dans les bois, puis coups de tonnerre sur coups de tonnerre ! La tempête éclate, une tempête comme on dit qu’il s’en lève quand on jette des pierres dans le lac Pavin. L’eau de tomber à croire qu’on la versait à pleins seaux. Et, les provisions ramassées à la diable, voilà tout le monde en fuite.
Ils étaient dans un fond, à cinq minutes à peu près du moulin de Martial, vers les villages de Barbaliche et Losfournet. Quand ils arrivèrent au moulin, on aurait pu tordre leurs habillements comme du linge de lessive. La grande roue ne tournait pas et tout eût paru abandonné si l’on n’eût vu briller une petite lumière par la fenêtre à gros barreaux.
Gaspard, qui avait pris les devants, heurtait du poing la porte. Une femme vint enfin parlementer. On la devinait effrayée par cette troupe qui piétinait devant sa maison, ne comprenant pas ce que ces gens faisaient là, défiante, hésitante, discutant avec une autre plus jeune avant de se décider à tourner la clef de son huis.
Le meunier était mort à l’arrière-saison, laissant sa femme et sa fille sans un écu vaillant. Elles avaient, la vieille du moins, la méfiance des pauvres qui sont toujours dans le malheur. Grange et les siens entrés, la bonne femme s’activait, brisait des bourrées sur son genou pour les mettre au feu, mais encore craintive, sans un mot, tout en regardant de coin ces gens que le lumignon éclairait mal. Avait-elle bien affaire, comme ils l’avaient dit, au monde des Escures ?
La fille, une jeunesse fraîche comme une feuille de mai, avec on ne savait quoi de clair en toute la personne, pouvait avoir l’âge d’Anne-Marie Grange. Elle était blonde, mais blonde par merveille, du soleil aux cheveux. La pauvre aurait voulu assez faire pour ces gens réfugiés chez elle. Mais elle n’osait, et puis tout manquait : c’était la misère, la vraie misère, dans cette maison.
La meunière et sa petite vivaient comme elles pouvaient, de leur quenouille, de quelques coins de terre, des fagots faits dans les bois.
Il n’y avait pas deux minutes que Grange et les siens étaient là lorsqu’on cogna de nouveau à la porte. Gaspard va ouvrir, et, trempé comme une soupe, entre, tout à fait en voisin, devinez qui ? Jeuselou du Dimanche, que l’on croyait en train de faire son trafic du côté d’Auzelles.
Il fut ébahi, les Grange encore plus et tout autant la meunière et sa petite, voyant Jeuselou, leur connaissance, trouver en ces gens ces bons grands amis. Mises en confiance du coup, elles ne savaient plus qu’imaginer pour servir leurs hôtes, les aider à se changer, à se mettre à l’aise. Les garçons s’en furent dans la grange avec les vieux habits du meunier. Les demoiselles se déshabillèrent et se séchèrent devant le feu. Marguerite avait été quérir toutes ses chemises. La mère en prenait une, tortillait le col, la faisait tourner au-dessus d’une poignée de paille en flamme, et quand la chemise se ballonnait comme une cloche : « Là, pauvre m’amie, passez-moi ça tout chaud ! »
On s’habilla de vieilles choses, trop longues, trop courtes, à ne pas se reconnaître. S’amusa-t-on ! Et puis le souper, les écrevisses que Gaspard fit cuire lui-même dans un court-bouillon à s’en lécher les doigts ; et puis le retour aux étoiles… Soixante ans après, Hortense Domaize parlait encore du jour où l’on fut surpris par l’orage au moulin de Martial.
Voici comment Jeuselou et la petite meunière s’étaient pris d’amitié.
Il ne la connaissait guère, encore, quand un lundi de Fête-Dieu, qui est la grande foire d’Ambert, il aperçut cette Marguerite debout, les nattes défaites, près d’un particulier qui achetait les cheveux. L’homme marchandait en patois, étourdissant la pauvrette de son remue-ménage. Il ne voulait lui donner qu’un écu de trois livres et un coupon de cotonnade où tailler une robe. Elle, elle n’osait demander davantage, mais entendait se faire payer tout en argent blanc, sans doute parce qu’on avait encore des créanciers à satisfaire.
Jeuselou s’approcha. La petite, enfin, tombait d’accord avec le marchand. Elle réservait deux touffes de cheveux, juste de quoi se coiffer en bandeaux, sans qu’il parût sous le bonnet qu’on l’avait tondue. Pour les garer des grands ciseaux de l’homme, elle ramenait ces mèches sur sa figure et les tenait mordues dans les coins de sa bouche.
À cette minute, elle avisa Jeuselou et devint rouge comme une cerise.
— Une minute, Marguerite, écoute. Je sais quelqu’un qui te donnera deux fois plus de tes cheveux.
— Si tu dis vrai… fit la petite en hésitant, le regardant de ces yeux qu’elle avait aussi bleus qu’un ciel de Pâques et grands ouverts, comme s’ils parlaient de naïveté, de gentillesse. Et qui ça ?
— Et moi-même, à ton joli commandement.
— Je te savais seulement leveur de beurre ?… Mes cheveux, je ne les vendrais pas à un autre du bourg qui en ferait peut-être une dérision, mais vois, je me fie à toi de bon courage.
Il détortilla le lacet de sa bourse, compta les écus promis et en donna un à l’homme qui grognait de voir aller sur son marché. Puis, empoignant les grands ciseaux, il coupa sur cette tête blonde une petite boucle qu’il plia dans un papier blanc.
— Je couperai le demeurant une autre fois. Mais n’oublie pas que ces cheveux sont miens : tu n’as plus droit de les vendre.
Elle fut si saisie, elle eut le cœur si plein que les larmes lui montèrent aux yeux. Dieu la pardonne, la pauvre petite ! Prenant Jeuselou par la main, elle lui donna un petit baiser sur la joue. Puis la voilà toute rouge de confusion, de joie, et lui, soudain, aussi rouge qu’elle. Comment ne se seraient-ils pas rendus amoureux l’un de l’autre ?
De ce jour, Jeuselou ne jura plus que par Marguerite. Et jamais il ne se sut aussi bon gré de quelque autre chose qu’il ait faite que de cet achat de cheveux.
On retourna souvent vers le moulin de Martial pêcher aux écrevisses. La mère avait acheté une vache. Anne-Marie allait avec Marguerite enlever la crème de dessus les pots de lait, dans l’eau froide de la fontaine.
Ou bien c’était Marguerite qu’on invitait aux Escures. On faisait la partie d’aller tous cueillir des framboises dans le bois, ou couper des gaules de noisetier pour ramer les pois du jardin. Gaspard était d’une belle humeur à quoi rien ne résistait, je dis rien, pas même les ennuis ou les peurs d’Anne-Marie. Et si quelques craintes travaillaient l’esprit du garçon, il n’en laissait rien voir.
CINQUIÈME VEILLÉE
PREMIÈRE PAUSE
Le domaine. – La Poule-Courte. – Les écoles. – Barthaut le magister. – À toutes les parties, Anne-Marie préférait les après-dînées passées à coudre devant la porte, les pieds aux barreaux du tabouret.
Le chaud du jour tombé, on sortait avec le père et Pauline, et souvent Gaspard. On montait du côté de Roche-Savine, et on s’asseyait sous un gros arbre d’où l’on prenait plaisir à regarder la récolte. Le père allait voir de plus près quelque pièce d’avoine. Les champs s’étageaient sur la pente, relevés par des talus où s’enracinaient dans la fougère de gros merisiers crevassés de gomme. Pauline voulait grimper à l’arbre pour les merises noires qui brillaient là-haut comme du jais : et on le lui défendait parce que les branches sont trop cassantes. Alors elle ramassait les fruits tombés qui se ridaient sur la friche jaunie.
Les bons moments !… Gaspard était encore un enfant, plus enfant qu’Anne-Marie en un sens. Il s’asseyait à un pas d’elle, qui tricotait, le nez baissé, et il considérait les moissons et les terres. C’était le Nanne, là-bas, qui brisait les mottes au milieu d’un lopin. Des vaches rouges paissaient par les pacages. Le meunier qui poussait un âne chargé de sacs, – on l’aurait reconnu à son geste, – touchait son chapeau devant la croix de granit. La diligence roulait dans la poudre de la route, toute sonnante de grelots avec son postillon jouant de la corne. Il y avait du bonheur sur le pays.
Le regard de Gaspard allait à la petite, qui le sentait, et, relevant le visage, lui souriait longuement.
— Tiens, regarde : encore la Dorothée sur le chemin de chez vous. Ha malheur ! on ne voit plus qu’elle !
Cette nommée Dorothée, dite la Poule-Courte, semblait une grosse petite boule de femme, plus faite pour rouler que pour courir, car en elle tout était rond, sauf la voix aigre et le nez pointu. Avec ce nez fouineur et ses lunettes bleutées, elle représentait au naturel la dévote du dicton, la menette aux quatre petits yeux bleus qui regarde par les pertuis.
— Que diable veut-elle ? Elle ne manquera pas de prétexte : des boutures, des graines, un remède… Ou bien quelque lettre à lui écrire. Eh non, pas une lettre, elle se pose trop en savante dans le village. Sais-tu qu’elle travaille à faire renvoyer le Barthaut pour tenir l’école en ses lieu et place ? Ne me laisse pas ce serpent à lunettes tourner autour du domaine.
Ce que Gaspard ne disait pas, c’était que si la Poule-Courte intriguait ainsi, elle devait avoir quelque idée de derrière la tête.
Le cousin Barthélemy, l’eicoulère, le maître d’école du Monestier, venait tous les jours aux Escures apprendre l’abécédaire à Pauline, lui faisant de beaux modèles en lettres moulées, auxquels elle dut d’ailleurs d’avoir une écriture comme une enfilée de perles. Le Barthaut écarté du pays, ma Dorothée le remplaçait au château, avançait un pied, en prenait quatre, embobinait Grange, et, fin finale, l’amenait à convoler en justes noces.
Par malheur, Grange était parfaitement homme à se laisser faire et à tourner comme un toton entre les mains de celle qui flatterait ses airs absolus. La chose était à craindre. On devait même s’apercevoir trop tard qu’on ne l’avait pas assez crainte.
Anne-Marie, étant d’esprit fort délié, ne tarda pourtant guère à deviner la Poule-Courte. Elle et Gaspard se comprirent sans avoir besoin de se parler. Ces deux-là ! ils se lisaient dans le cœur comme dans un livre.
Impossible de fermer à Dorothée la porte des Escures, car l’usage voulait qu’un chacun pût venir dans les domaines demander de menus services. En bien des cas, les maîtres étaient seuls à se débrouiller au milieu des paysans. Ainsi les demoiselles servaient d’écrivain public aux gens de l’endroit, pour les missives, pour les actes sous seing privé… Elles tâchaient d’instruire un peu leurs servantes ; elles les faisaient épeler les soirs, dans le paroissien imprimé fort gros.
C’était le père qui avait montré ses lettres à Anne-Marie. L’hiver, dans la grange, il aidait ses journaliers à battre les gerbes de blé ; puis, lorsqu’il était las, il s’asseyait sur une botte de paille et appelait la petite… Après quoi le vieux prêtre de Marsac l’avait gardée près de soi plusieurs mois afin de lui donner un peu de lecture.
On était souvent instruit par ses seuls parents, à la campagne. Le défunt M. Domaize n’alla jamais dans les collèges et n’eut pour précepteur que son aïeul : or on le rencontrait par les chemins, le nez dans un petit livre de grec qu’il appelait son Homère et qu’il lisait à même, comme un prêtre fait son livre d’heures.
Barthélemy, le magister, n’était pas de ces savants jusqu’aux dents, mais quel cœur il avait ! Tout bonté, tout simplesse. Puisqu’on ne pouvait chasser la Poule-Courte, il fallait d’abord l’empêcher de triompher du Barthaut. Et à qui connaissait ce pauvre bon oncle, l’être le plus naïf qui ait jamais paru en ce bas monde, ce ne paraissait pas facile.
Or, imaginez un homme un peu voûté, dans un habit de rase brune, chauve avec quelques cheveux follets voltigeant sur son crâne, des joues rentrées, et, chevauchant un long nez en bosse, des besicles à monture de cuivre, derrière quoi l’on voyait des yeux marrons, tranquilles et bons. Des yeux d’enfant.
Et par-dessus tout, une certaine touche de naïveté affectueuse ; mais d’une naïveté à accepter pour de la bonne viande les contes qu’il plaisait à Pierre et à Paul de lui faire : sauf que le mal ne lui entrait pas dans la tête. La malice, il ne l’imaginait même pas.
Entendu : Bon et bête commencent par la même lettre, Trop de bonté vaut bêtise, et Qui est bête n’est pas sans tare. On pourrait en défiler tout un chapelet. Il faut pourtant comprendre qu’il n’y avait pas proprement bêtise en son fait, et sottise encore moins, mais simplesse. Et si peu de méchanceté qu’on se sentait contraint de l’aimer.
Le père du Barthaut n’avait que la peine de ses bras pour gagner sa vie. Aussi loua-t-il le petit dès qu’il fut en âge de mener des moutons dans les champs. Un matin, du pâtis où il gardait ses bêtes, le pastoureau vit passer sur le chemin un homme qui avait la façon de savoir lire. Il courut après lui et lui demanda bien honnêtement d’écrire les trois premières lettres de l’A.B.C. sur sa ceinture, lui offrant tout le pain de son dîner pour la peine. L’homme s’y accorda. Et le gars, en allant par les champs derrière ses moutons, s’imprima ces lettres dans la mémoire. Les lettres ensuivantes, il se les fit écrire peu à peu par d’autres voyageurs, et comme cela tant qu’il y en eut. Puis il acheta à un porte-balle deux de ces petits livres bleus qu’on vendait autrefois dans les campagnes : le Trésor des Laboureurs et l’Histoire des Quatre Fils Aymon. Une bonne femme lui fit présent aussi d’un Nouveau Parfoit Maréchal, qui avait appartenu à son défunt mari, en son vivant forgeron au bourg de Condat-lès-Montboissier.
Ceux qui passaient par la lande où il pacageait, voyaient de loin le garçon un livre au poing au milieu de ses ouailles. Il en eut tel renom et bruit qu’un beau jour les gens du Monestier, piqués de n’avoir pas un maître d’école comme ceux des autres villages, demandèrent à Barthélemy de leur en tenir lieu. Son office, désormais, fut d’apprendre aux enfants à lire, écrire et chiffrer, de balayer l’église, d’en chasser les chiens et de chanter au lutrin, bref, d’être à la fois le magister et le sacristain de la paroisse.
Mais quoi ! toujours aussi simplet, aussi candide que quand il était bergerot dans les pâtis, comme S. Lubin, avec ses lettres marquées sur sa ceinture.
Des années, des années, tout alla pour lui des quatre roues. Au Monestier, chacun chantait ses louanges et l’on se revengeait de l’affront d’autrefois en disant que de quatre lieues à l’entour on ne trouverait pas un aussi brave maître d’école. Cependant, il faut toujours que le diable s’en mêle. Les Grange étaient depuis quelques mois aux Escures quand la Poule-Courte commença sa petite guerre. Elle en raconta tant aux gens des autres bourgs que, par esprit de raillerie, ils entreprirent alors sur Barthélemy ceux du Monestier et les chinèrent à pleins tabliers dans les fêtes et foires.
— Et votre Barthaut, qu’en faites-vous ? Mène-t-il vos petits en champs ou vos moutons à l’école ? S’il en est toujours à enseigner vos drôles, les malheureux ramasseront la tête grosse comme des ouailles qu’on tient dans l’étable.
— Dites, si on les mettait tous dans un parc, votre eicoulère et ses moutons, savez-vous qui en sortirait le premier ? Eh bien, ce serait une bête.
Et force autres traits de gaudisserie.
Les choses en étaient là lorsque advint au pauvre Barthélemy une mésaventure qui faillit faire chavirer son sort.
DEUXIÈME PAUSE
L’histoire du sufficit. – Ce devait être peu avant le jour de l’orage sous le moulin. Monseigneur faisait sa tournée pastorale. Il allait à Ambert où tous les curés des environs l’attendaient pour la confirmation, quand sur le grand chemin, au lieu dit Chez-Servy, une roue de son carrosse se rompit. Les chemins d’alors n’étaient pas ferrés et unis comme ceux de maintenant : des bourbiers où l’on enfonçait jusqu’au moyeu et des pointes de rochers à s’y rompre le col.
On alla quérir le charron du Monestier. Le temps passa, midi approchait ; il fallut que Monseigneur montât pour y dîner au village qui dominait sur la butte.
M. le curé se trouvait à Ambert pour la cérémonie. Monseigneur arrivant ainsi, c’était pour la servante le feu à la cure. Elle court toute effarée chercher le magister. Mon Barthélemy vint dans un grand trouble, toucha la main que le prélat lui présentait, ignorant, bonnes gens, qu’il lui fallait baiser l’anneau, – il ne voit pas souvent des évêques, le bonhomme, fit Monseigneur à son grand vicaire, – mais tourna son compliment de si naïve façon qu’il lui fut souri très indulgemment.
— Ne soyez point en soin. Je suis plus que satisfait d’un si bon accueil. Pourriez-vous seulement nous faire préparer un frugal repas ?
Barthélemy salue, s’en va conférer avec la gouvernante plus effarée que jamais à l’idée de préparer le dîner de Monseigneur. On décide de faire appel aux talents de la Poule-Courte, qui demeurait porte à porte.
Elle arrive, pointant un bout de nez fouineur au mitan de sa face de pleine lune, et prenant de l’importance, calcule toutes choses. Finalement, elle propose de faire sauter une omelette, de rôtir un poulet, d’ajouter à cela un fromage de chèvre, et pour le fruit, des poires tapées et des noix sèches. Barthélemy va en porter les paroles au prélat.
— Mais cela va, cela va très bien. Une omelette, un poulet, du fromage, des noix et sufficit.
— Et ? Monseigneur, plaît-il ?
— Et sufficit, répète Monseigneur avec un sourire.
Le magister de faire un salut bien profond et de retourner à la cuisine.
— Quoi ? qu’est-ce qu’il y a ? Monseigneur n’est peut-être pas content ?
— Il est content, pauvre Dorothée, seulement il demande encore du sufficit.
— C’est plus d’une fois que j’ai préparé des dîners d’évêques, de marquis et même de maréchaux des logis en chef, dans de grandes maisons où je faisais une telle cuisine que les voisins se nourrissaient en léchant les murs. Jamais, au grand jamais, personne ne m’a demandé du sufficit. Au demeurant, c’est du latin, cela : les femmes n’ont pas à mordre au latin. Ça vous regarde, Barthaut : allez me quérir ce sufficit ; je l’accommoderai, en sauce ou autrement, si bien que rien plus.
Barthélemy ne savait déguiser nulle chose, même quand il y allait de son intérêt. Il confessa ignorer tout du latin, ce qui le fit mépriser de la Poule-Courte. Celle-ci le poussa hors de « sa » cuisine, lui répétant qu’il eût à satisfaire Monseigneur.
Le pauvre maître d’école sortit sur le coudert en se vouant à tous les saints du paradis. Enfin, il eut une inspiration : « Gaspard sait le latin comme celui qui l’a fait, il me tirera de peine ! » Un des gamins qui jouaient au saute-l’âne sur la place part tout courant pour le bourg de Saint-Amand, lequel n’est pas à trois quarts de lieue du Monestier par la traverse.
Gaspard arrivé, le magister lui déduit la chose sur le coudert même, le regardant avec les yeux qu’on fait à un homme qui tient votre salut dans sa manche.
— Quoi, c’est là que le bât vous blesse ? C’est pour ça que vous me faites venir si grand train de chez moi où j’ai laissé les pois au lard sur la table ? Un sufficit ? Sachez que c’est une queue d’âne, et ne m’en tarabustez plus la cervelle.
— Une queue d’âne, mon enfant ? Monseigneur peut-il avoir affaire d’une queue d’âne ? Comment veux-tu ?…
— Que vous êtes bon ! Est-ce à vous de savoir le pourquoi de la chose ? Il doit vous suffire que Monseigneur l’ait demandé. La soumission, l’obéissance ne sont-elles pas de toutes les vertus les plus recommandables ? Je me doute qu’il veut justement voir si vous lui obéirez sans réflexion.
Sur ce chapitre il prêcha si bien que bientôt le magister s’inquiéta seulement de se procurer la queue requise.
— Hé, n’y a-t-il pas là l’anichon gris de la Poule-Courte ? Tandis qu’elle fricote je m’occupe de la bourrique. Puis vous mettez le sufficit dans un grand plat de faïence à fleurs, le plus beau que vous puissiez trouver, vous l’apportez vous-même sur la fin du repas, couvert d’une serviette blanche, et voilà Monseigneur content de son bedeau !
Tout alla de la sorte. On dressa le couvert fort proprement dans la salle à manger dont les fenêtres donnaient sur la verte vallée d’Ambert, pays d’agréable représentation où la Dore fait cent tours parmi les prairies et les bocages au pied des belles montagnes. L’omelette était dure comme une couverture doublée ; le poulet, un coq d’assez mauvaise vie, pour avoir trop couru sur la place, coriace comme un vieux corbeau. Monseigneur achevait de casser quelques noix poudreuses quand Barthélemy apporta le plat qu’il découvrit avec une révérence.
— Qu’est-ce là ? demanda Monseigneur en considérant la queue d’âne.
— C’est le sufficit, Monseigneur. Votre Grandeur me pardonnera si la queue n’est pas plus grosse : il n’y a pas beaucoup d’ânes en nos petits pays.
Ce disant, le pauvre regardait humblement du côté du grand vicaire, lequel sautait tout cramoisi sur sa chaise ; sans doute parce que le sufficit n’était pas de ces beaux, de ces grands… Mais Monseigneur, devinant la simplicité du bonhomme apaisa d’un geste son compagnon. Il fit asseoir le Barthaut près de lui et le confessa si finement que le pauvre déballa tout le paquet. Et quand Monseigneur se leva pour partir, il se dit charmé de ce naïf entretien.
— Vous ne savez pas le latin, mais ne regrettez pas de n’avoir point cette science. Je vous donne ma bénédiction de grand cœur, et de retour à Clermont, je vous enverrai un petit souvenir.
De fait, un mois après, Barthélemy reçut un ballot par le roulage. Et quand l’ayant ouvert il y trouva des livres, – il avait dit à Monseigneur son goût pour la lecture, – il fut le plus surpris et le plus ravi des hommes.
TROISIÈME PAUSE
Mœurs et conditions de la Poule-Courte. – Tout eût été pour le mieux si la Poule-Courte n’avait jeté les hauts cris en retrouvant son anichon sans plus de queue qu’un bouledogue. Cela faillit faire du vilain, le magister s’étant accusé du méfait. Elle se radoucit, toutefois, contente qu’elle était de serrer dans son boursicot le napoléon que Monseigneur avait laissé pour le sufficit. Mais n’étant pas portée de bon vouloir envers Barthélemy, – puisqu’elle désirait instruire et régenter à sa place la petite Pauline Grange, – elle en retint d’abord qu’il ignorait le latin, ensuite qu’il avait voulu lui faire affront en coupant la queue de son âne.
Certainement, pour trop aimer les farces, Gaspard en fit une assez méchante, ce jour-là, au bourriquot qui n’en pouvait mais. Enfin, qu’on songe au bien et qu’on laisse le mal.
Il en eut regret quand il vit que le tour porterait tort à ce pauvre Barthaut si quelqu’un relevait la bévue. Par bonheur, les voisins n’eurent pas le moindre vent du sufficit.
On peut dire par bonheur, car on en a le droit. La Poule-Courte avait si bien attaché le grelot, dans son désir de supplanter le bonhomme aux Escures, qu’on commençait à parler de prendre un autre magister.
Lorsqu’elle se mettait sur le compte de quelqu’un avec ses commères, Dieu sait s’il faisait bon passer par leurs langues ! Pour avoir des souliers de bon usage, selon le mot de chez nous, il faut en faire l’empeigne en rancune de prêtre et la semelle en langue de béate, vu que l’un et l’autre jamais ne s’usent. Tant y a que la Dorothée ne laissait pas la sienne sous le traversin en se levant.
En son jeune âge, elle n’avait pu jeter le grappin sur un mari. Mais, et c’est une religieuse qui me le disait, quand une fille entend se marier, rien ne saurait la tenir : elle prendrait plutôt un chien coiffé que de rester demoiselle. Comme le chante la prière des filles de Craponne :
Ô Jeusé !
Un petit ou un vé,
Ma qu’aye un chapé !
Ô S. Joseph ! un petit ou un vieux, suffit qu’il porte chapeau !
La Dorothée fit tant des pieds et des mains, des ongles et des dents, qu’elle se fit épouser d’un honnête menuisier du bourg. À coup sûr, cet homme avait tété du lait de bonne mère puisqu’il ne devint pas promptement enragé en sa compagnie. Mais, le pauvre, patient comme les pierres du chemin ! La Poule-Courte avait pris l’habitude, plus pour l’emmalicer que par dévotion vraie, d’aller faire à l’église des séances qui n’en finissaient plus. Les plaintes de son mari et les remontrances de son curé, – qui lui représentait que le devoir d’une bonne femme est en premier lieu de gouverner sa maison, – faisaient qu’elle s’y entêtait davantage. Un jour, on vit le menuisier entrer par le porche. D’une main il portait une marmite, de l’autre un seau où nageaient des légumes tels que choux verts, raves et pastenades. Il posa seau et marmite à côté de son épouse en oraison et lui dit doucettement :
— Vois, m’amie, je ne t’empêche pas de venir à l’église, mais au moins, fais-y ma soupe !
Dites, j’en connais plus d’une, et vous en connaissez par là aussi bien que moi, qui voudraient avoir un mari d’aussi bon naturel. Voilà l’homme que la Poule-Courte faisait enrager tout son saoul.
Quand elle avait quelque prise avec lui, c’était merveille de l’ouïr, cette langue de vipère. Elle lui défilait tous ses torts et malheurs, depuis un grand oncle qui avait failli aller aux galères pour un quarteron de pommes volées, jusqu’à sa ribote de la veille au soir, à cet ivrogne, ce bambocheur, mangeur de maison et faiseur de dettes, ce porc de glands, bon à tout dévorer dans un ménage ! Et ce train pour un verre de vin bu avec les compagnons. Que si, à bout de patience, il lui caressait le museau d’une mornifle, ah ! merci de moi ! que lui fallait-il entendre ! Il n’avait qu’à la festoyer ainsi d’un ou deux camouflets, la vigile des fêtes : ses péchés lui étaient dits sans que pas un fût oublié, et certainement il n’avait plus besoin de faire son examen pour aller à confesse.
De fâcherie ou autrement, le menuisier mourut, et ses années de mariage durent lui être comptées là-haut sur son temps de purgatoire. Dorothée descendit demeurer à Ambert, où elle avait un frère, et y fit la veuve avec beaucoup d’ostentation, ne parlant jamais de son pauvre défunt sans force soupirs et gémissements.
Elle habitait une maisonnette d’un simple rez-de-chaussée, adossée au mur de l’hospice. Par une veillée d’hiver, comme elle était devant ses tisons et poussait pour édifier deux autres béates, ses commères, des lamentations capables d’empêcher le quartier de dormir : – « Ah ! pauvre Michel, je ne te verrai plus ! Ah ! reviens, pauvre Michel, reviens chercher ta Dorothée », – tout d’un coup, ho ! petits, mes amis ! dans la cheminée, un cri effroyable, une masse noire qui dégringole sur les braises, et au milieu d’une odeur de roussi, d’un nuage de fumée et de cendre, un énorme oiseau qui saute au visage de la Poule-Courte… Les deux béates courent peut-être encore. La Dorothée, elle, chut sur le plancher de tout de son long, croyant qu’à ses appels son mari défunt ou quelque diable d’enfer venait véritablement l’enlever.
Or, c’était le paon de l’hospice. Peut-être avait-il pris les cris de la veuve pour ceux de sa paonne. Du jardin, il s’était venu percher sur la planche servant de toit à la cheminée. Et cette planche avait basculé. De là toute l’affaire. Avant qu’elle fût éclaircie, il y eut de beaux hurlements.
Dorothée en garda rancune à la ville et regagna le bourg, – c’était à peu près au temps où Grange achetait son domaine. Mais au Monestier elle fit dès lors état de ce séjour, signalant la considération que le monde comme il faut avait pour elle. « C’est moi que j’étais celle qui lavillait les abbés ! » disait-elle en gonflant le cou, parce qu’on l’avait prise une fois pour laver les aubes et les surplis de la cure. Elle se serait mise volontiers sur le pied de tout régenter dans l’endroit et aurait voulu fréquenter dans les familles riches.
Le curé du Monestier ne vit pas son retour sans un tremblement, connaissant la Dorothée pour une de celles qui trouvent à redire sur tout et qui, selon le dicton, corrigeraient le Magnificat.
De fait, elle n’était pas là de huit jours qu’elle se mit en tête de reprendre le pauvre desservant, qui confessait mal, et surtout qui disait trop vitement la messe. La voilà clabaudant partout, déclarant qu’il fallait écrire à Monseigneur, et finalement un jeudi, jour de marché, allant à Ambert porter ses plaintes à M. l’archiprêtre. Le curé du Monestier disait l’office d’un tel train qu’elle n’était qu’au Lavabo qu’il était déjà au Sanctus.
— Au Lavabo ? fit M. l’archiprêtre envisageant la Dorothée qui n’était pas toujours fort nette de sa personne, eh bien, restez-y, ma bonne femme, restez-y.
Ils avaient, les desservants de ce temps-là, quelque peine à contenter leurs paroissiens. Ceux-ci, en vrais glorieux, étaient toujours tentés de ne pas les juger assez relevés. Et pourtant, ha, ils avaient besoin de grands docteurs, étant eux-mêmes juste assez doctes pour connaître leur pied de leur sabot.
Une fois, le monde de Vertaizon s’avisa de trouver mauvais que le curé n’amenât tant seulement jamais ce mot de Vertaizon dans les prières à l’église, et pas même le jour de la vogue. Lui, en habile et bon clerc sut bien se tirer de ce pas difficile. À chaque fête du bourg il fit dorénavant chanter le verset : Avertes undique mala. C’est du latin. Ça veut dire : À Vertaizon, toute espèce de maux ; ou quelque chose d’approchant.
Mais si l’on enfilait ces contes, l’un suivrait l’autre et ce serait trop s’écarter du grand chemin. Revenons à Dorothée, à Barthélemy et aux Grange.
Quand la Poule-Courte eut médit du curé en cent façons, voyant qu’elle n’y gagnait rien, elle jugea meilleur de se déchaîner contre le magister. Ceux qui savent les dessous des cartes, content qu’elle le guigna pour époux, car la Dorothée pouvait ressentir les aiguillons de la chair et l’on prétendait qu’en sa belle jeunesse elle avait eu certaines aventures… Elle s’était d’ailleurs mise bien au-dessus de ces petits bruits. Reste que mon Barthaut, simple et fin comme un enfant, qu’il démêlât ou non la chose, sut éviter les panneaux tendus et garder sa liberté.
Mais de là une aigreur bien conditionnée contre le bonhomme.
— Est-ce que ce n’est pas une honte pour l’endroit un pédagogue pareil ? Ce joli chantre en sabots ! Au moins s’il portait des souliers à boucle, comme il se doit quand on est un peu d’église ! Je vous dis que ses moutons de jadis en savent plus que lui. Ha, vous autres ! Les gens se riraient bien de nous s’ils connaissaient notre misère.
— Vous devriez l’épouser, tenez, la Poule-Courte, glissait le maréchal. Vos besicles iraient bien avec les siennes. Il vous naîtrait de petits porteurs de lunettes qui se pousseraient dans le monde. Je veux que vous ne soyez pas tout à fait du même naturel, mais c’est ce qu’il faut dans un ménage : huile et vinaigre font la bonne salade.
— Il suffit, pauvre Antoine. J’ai trop compris à quoi allaient certaines petites manières de tourner autour de moi. Mais si jamais j’avais voulu me laisser tirer de mon veuvage, j’aurais trouvé d’autres galants que ce jacquot en habit de rase brune, comme un rémouleur, plus fait pour être berger de moutons que maître d’enfants baptisés.
Gaspard l’avait vue venir de loin avec ses gros sabots, la Poule-Courte. D’abord il ne fut pas surpris que, curieuse comme une marmotte et aimant se mêler de tout, elle se faufilât aux Escures et cherchât à s’y établir. Le oui comme le non, le blanc comme le noir, tout lui était bon à revenir y montrer sa mine de fouine. Mais pourquoi se requinquait-elle de la sorte, maintenant, portant un magnifique châle jaune à palmettes et un chapeau de paille noire sur son bonnet du pays, oui, pourquoi tâchait-elle de faire, plus qu’il ne lui appartenait, la femme de la ville ? Tout cela ne valait rien.
En attendant, la Dorothée menait sa bataille contre Barthélemy et la menait tambour battant, ayant ouï dire par Mme Domaize qu’on mettrait l’an prochain Pauline au grand couvent fermé d’Ambert.
QUATRIÈME PAUSE
La manière nouvelle d’apprendre le latin. – Le conte du curé au trop fin langage. – Le soir même du passage de Monseigneur, ayant ainsi appris que le Barthaut ignorait le latin, elle alla sur la chaude en faire bruit au pas des portes.
— Croyez-vous ? Il a fallu qu’il envoie chercher dare-dare Gaspard des Montagnes. Il n’entendait même pas ce que désirait Monseigneur. Si c’est pas une honte !
Les gens connaissaient la Poule-Courte et son crédit n’allait pas loin. Néanmoins, ce rabâchage faisait impression sur les cervelles. On répétait communément que le Barthaut n’était pas assez savant pour instruire la jeunesse : bon chrétien, bon voisin, homme de la pâte du bon Dieu, mais en son état, cela suffisait-il ?
Ces dires revenaient aux oreilles du bonhomme et le tourmentaient de cruelle façon. Un beau soir, n’y tenant plus, il s’en fut à Saint-Amand afin de consulter Gaspard.
Il le trouva dans l’écurie, sous la grange, au fond de la cour dorée de soleil. Il fallait voir si tout était bien tenu, les bêtes étrillées, luisantes, les harnachements cirés, accrochés au mur, licous, brides, sur-dos, croupières, ventrières, et les housses, et les colliers garnis de leurs clochettes, de leurs franges, de leurs bouffettes de laine bleue. La paille sentait bon, tout était tranquille et chaud, Gaspard pansait les chevaux de son père. Il chantait la Youyette, la chemise ouverte, le chapeau sur la nuque ; il chantait, mais à tue-tête, d’une certaine façon débridée qu’il avait lorsque la colère commençait à lui chauffer le sang.
C’est que, tout en s’activant, il songeait à la Poule-Courte. Trottant de côté comme un chien qui revient de vêpres, chaque soir maintenant on voyait la menette sur le chemin des Escures. Elle s’efforçait d’apprendre les affaires et secrets des Grange en se rendant une familière du logis. Et cependant, bien que plus sotte qu’un panier percé, elle poussait avec astuce ses travaux d’approche. Sous les armes, en châle jaune et trimballant un cabas de tapisserie, elle allait supplier Grange de l’éclairer par ses conseils. C’était des affaires, des règlements d’héritage traînant depuis la mort de son défunt : « Ce pauvre Michel, soupirait-elle, je peux bien vous le dire, à vous, il ne m’avait pas rendue trop heureuse… » C’était des réparations à faire faire à sa bicoque, et elle ne savait pas si elle devait continuer de demeurer au Monestier ou retourner vivre à Ambert…
Elle consultait Grange avec révérence. Dans le cabinet joignant la cuisine, assise dans un fauteuil de vieille basane rouge, son cabas sur les genoux, elle l’écoutait la bouche entr’ouverte, comme pour boire sa parole, se récriait sur sa judiciaire et sa sagesse. En un mot, cent grimaces, mais qui avaient leur effet, tant un homme a les yeux bouchés quand on lui flatte la vue.
Avec une personne de condition plus relevée que la Dorothée, Grange se fût trouvé à la gêne. Elle, au contraire, lui agréait, parce qu’il avait le sentiment à la fois de rester maître et monsieur pour elle, et de la voir dame pour les autres. Ce mariage pouvait se faire, son orgueil serait ainsi satisfait doublement.
Il y pensait, le soir, en fumant sa petite pipe, à califourchon sur une chaise.
Anne-Marie n’aurait su parler de cela à Gaspard. Quand le garçon, qui n’avait pas pris la Poule-Courte assez au sérieux, comprit, brusquement, où en étaient les choses, il s’envoya un coup de poing derrière la tête. Il allait temps de rabattre le zèle de la béate, mais comment s’y prendre ?
Lorsque le Barthaut vint le trouver, cela le tracassait autrement que la petite guerre entre le bonhomme et sa voisine. Certainement cette affaire se rattachait à l’autre. Néanmoins, le magister tombait plutôt mal.
Gaspard demanda à son oncle Barthélemy, – il l’appelait ainsi par gentillesse, – quel bon vent l’amenait et le fit asseoir sur le coffre à avoine. L’oncle le tira plus près de lui pour lui parler à voix de confesse, comme si les chevaux avaient pu les entendre.
— Écoute, pauvre petit, tu m’as tiré d’un gros embarras le jour où Monseigneur a passé. Je t’en demeure bien reconnaissant. Aujourd’hui, tu pourrais me rendre un encore plus grand service. Dis, mon petit, apprends-moi le latin ? Du moins, apprends-m’en des bribes pour que je l’écorche et que j’en place quelques mots, à la mode nouvelle, devant les gens. Sans cela, les choses tournent si mal pour moi qu’ils ne me garderont pas comme maître d’école.
— Hé ! laissez, dit Gaspard, laissez faire. Le diable m’emporte ! Je veux vous apprendre à dégoiser du latin tout un jour s’il vous chante. Attendez seulement que j’aie fini la besogne. Dans une heure je vous mettrai à même de discourir en us et en um autant que les quatre Facultés. Marquise, veux-tu ! Ah ! Tonnerre de bougre !
Mon Barthélemy, un poids de moins sur le cœur, reste assis là, les mains à plat aux genoux, cependant que Gaspard achevait de bouchonner ses bêtes et revenait à sa chanson plus furieusement que jamais :
Mais la Youyette, elle est encor trop jeune,
Mais la Youyette, elle est encor trop jeune,
Faites l’amour en attendant
Que la Youyette elle ait vingt ans !
— Voilà, l’oncle. Et maintenant venez faire un tour. Je ne vous demande autre chose que de bien regarder de vos yeux. C’est une manière d’apprendre le latin toute nouvelle, mais vous verrez qu’elle est aisée, belle, et de grand profit.
Ils descendent la côte par le grand chemin. Il y avait dans le ruisseau un âne mort au ventre ballonné, et quand ils passèrent sur le pont leur arriva une odeur fort sauvage. Ils remontent du côté de Pierre-Blanche. Une femme qui venait de boulanger, raclait sa maie avec un vieux couteau. Le chien s’était couché là près, et reniflant, faisant claquer ses dents, chassait ses puces en conscience.
Un peu plus loin, en longeant un verger, ils virent un trou qu’une latte arrachée ouvrait dans la palissade. Un gamin s’y était coulé, et, juché à la fourche d’un arbre, il cueillait de chaque main des pommes dont il bourrait le devant de sa chemise.
Sur ce, ils s’en revinrent.
— Eh bien, dites-moi un peu ce que nous avons vu ?
— Rien, pauvre petit, ou si peu de chose… D’abord cet âne mort, au pont, tu sais, qui sentait si mauvais…
— Bon. Je dis : l’âne mort, pont puant.
— Cette femme qui raclait sa maie…
— Racle la maie.
— Et le chien qui mordait ses puces…
— Mord ses puces.
— Puis quoi ? Ce lattis troué, le voleur de pommes…
— Latte ôtée, gare aux pommes. Ça va bien, mon oncle : déclamez seulement avec moi :
Lanemor pompuan raclelamé morcèpus
Latoté garopum !
N’est-ce simple comme bonjour ? Il n’est que de jeter les yeux autour de soi, puis de débiter d’un trait ce qu’on a vu. Cela donne aux oreilles des écoutants plus que ne ferait page de bréviaire.
Barthélemy prit sans lâcher trois prises de tabac. Il s’agitait comme si des fourmis lui couraient dans le dos.
— Tiens, pauvre Gaspard, dit-il à la fin, j’y renonce. Ce serait peut-être bien tromper le monde, et je n’en aurais pas le front. Au demeurant…
Gaspard haussa l’épaule. À cette heure il voyait ce qu’il avait à faire contre la Poule-Courte, sa colère était tombée et il jugeait stupides ses fariboles de tantôt.
— L’autre mardi, fit-il, j’étais chez ma cousine Domaize ; elle vient dans le jardin. L’oncle de Jeuselou buttait les céleris. Tout d’un coup il se tourne : « Madame, appelez votre garçon, monsieur Jean. Il apprend le latin au collège d’Ambert ? Je verrai, moi, s’il en sait… Ha, monsieur Jean, qu’est-ce que ça veut dire : « Tornibus libobum ? – Hé, mais ! père Étienne, ce n’est pas du latin ! – Ah ! c’est pas du latin ? Eh bien ! si c’est pas du latin pour vous, c’est du latin pour moi ! » Croyez-m’en, mon oncle, celui que je vous apprends, c’en sera toujours pour le monde du Monestier. Ils sont trop bêtes, non… avec leur Poule-Courte.
— Vois-tu, ce n’est plus à mon âge qu’on a les intelligences assez promptes… Ha, je serai peut-être plus heureux berger dans les champs. Je me sens seulement le cœur lourd à l’idée de ne plus montrer ses lettres à la petite Pauline, de ne plus voir cette Anne-Marie, qui est toute bonne. Si c’est une faiblesse, que Dieu me la pardonne et que tout aille selon son vouloir.
Le gars en eut je ne sais quel picotement au cœur. Il posa sa main sur la manche du bonhomme :
— Ça va bien ! mon oncle, ceux qui veulent vous faire des misères y perdront leurs peines.
Le lendemain dimanche, Gaspard mit sa veste sous son bras, et s’en fut au Monestier de son pied leste. Le soleil était chaud, mais un petit vent frais ventilait la feuille. On sortait de vêpres et on s’attardait sur la place gazonnée devant l’église. Des oiseaux faisaient tout un piaulis dans les sorbiers. On était là sur une terrasse, haut au bord de cette longue vallée enfoncée du Livradois.
Les garçons jouaient aux quilles, et la boule montait en l’air comme une bombe. Des vieux regardaient, appuyés sur leurs bâtons. On entendait les hommes dans l’auberge. Quelques vieilles étaient venues s’asseoir sur les troncs d’arbres couchés parmi les graterons et les choux d’âne.
C’était plus joli à voir que les gens d’aujourd’hui, ces paysans habillés de bure bleue, un bleu couleur du temps, tirant un peu sur le vert, une couleur réveillée qui plaisait à l’œil. Les hommes à chapeau large comme une roue de char et hautes guêtres pour empêcher la terre d’entrer dans les sabots ; les femmes en capote de paille à rubans de velours, en corsage plat et jupe à gros plis relevée sur les cotillons rayés de rouge.
Ce peuple parmi l’herbe, sous les grappes de sorbiers, le grand air, la belle vue longue, tout ici rafraîchissait le sang.
Les garçons firent fête à Gaspard. En avant les parties de quilles. Et pensez qu’on n’oubliait pas de chopiner. La bouteille n’était pas loin, dans un coin d’ombre sur un degré du porche. Tope et trinque ! À la tienne, Étienne ! Jamais plus nous ne boirons si jeunes.
Gaspard cependant, sans enfoncer rien, avait commencé de parler du magister, de sa grande bonté et honnêteté. Et prenant sa langue des dimanches, il remontrait doucement qu’on ne trouverait jamais un meilleur homme pour enseigner les petits du village. Si le Barthaut n’avait pas toujours du latin en bouche, c’était par une sage modestie. Il savait bien que cela porte malencontre d’user d’un trop fin langage pour s’en faire accroire à l’endroit des gens simples.
Les filles qui allaient à l’eau avec leur cruche s’arrêtaient pour écouter ces propos. De sorte que Gaspard en prit occasion de narrer le conte qui s’ensuit.
Il n’y a pas longtemps, dans un bourg dont j’ai oublié le nom, du côté de Tauves, un curé loua un garçon de campagne, tout uni, tout champêtre. Ce garçon ne savait que ses besognes et n’avait jamais parlé d’autre langue que celle de sa pauvre mère.
Au jour dit, il arrive à la cure pour entrer en condition. Comme il traversait la cour, un petit épagneul venant japper et frétiller autour de lui :
— Vous avez bien un trop joli petit chien, monsieur le curé.
— Mon pauvre ami, que tu es simple. On n’appelle pas ça un chien, on l’appelle un badailleras-tu.
Bigre, il fait bon s’instruire. Les voilà dans la cuisine, où près des landiers, ronronnait un minet de bonne façon.
— Ha, monsieur le curé, vous avez bien un trop joli petit chat.
— Un chat ? Eh non, ça s’appelle un cacherat.
Le garçon pose son baluchon, tout éplapourdi. Mais ce fut bien pis quand, en lui montrant les aîtres, le curé lui apprit pour toutes choses des noms nouveaux, voire pour l’eau, qui devenait du saintésil, et le feu du brisebois.
— Tâche de te mettre ces noms dans la tête, dit le curé, et ne te sers jamais des autres qui sont trop rustiques.
Voilà le bel air. Le pauvre valet s’y rompait la cervelle. Mais enfin, ric à rac, il vint à bout de posséder ce jargon du diable.
Un matin, on le vit sortir de la cure comme un fou, tandis que la servante était à l’église :
— Badailleras-tu et cacherat se sont battus ! Badailleras-tu a foutu cacherat dans le brisebois. Cacherat a apporté du brisebois sous le reposian du parpignan, le parpignan se brûle ! Bandelibande, sortez de la sainte-pérugine ! Arrivez-tous ! Vite, du saintésil ! Le parpignan se brûle ! !
Ah ! malheur et va te faire pendre ! Les voisins entendaient bien, mais ne comprenaient goutte. Qui eût pu, sans se donner au diable, comprendre que le chien ayant jeté le chat dans le feu, le chat avait apporté des bluettes sous le lit et que le curé était en train de se rôtir ! Les gens, au lieu d’accourir avec de l’eau, barrèrent leurs portes. Ils se contentèrent de regarder par les fenêtres ce garçon qui avait perdu le sens.
Et le curé se rôtit tout à son aise, pour avoir voulu que son domestique parlât autrement que les bons chrétiens.
Son conte fait, Gaspard mit le propos sur autre chose. Mais il trouva moyen dans la soirée de revenir sur Barthélemy et sa brave honnêteté de Dieu. Selon le mot du pays, les vaches qui fouettent tant l’air de la queue, ce ne sont pas celles qui ont le plus de lait. Monseigneur, qui avait meilleur nez que quelques béates de par là, avait fait grand état du magister. Même il lui avait envoyé un ballot de livres que lui, Gaspard, avait vu de ses yeux.
Cela imposa. Surtout les gens du Monestier étaient contents de pouvoir répondre aux quolibets et brocarder ceux qui feraient cas d’un langage autre que celui de leur pauvre maman.
Voilà comment roule ce monde. Des raisons bien déduites n’y auraient rien pu : des badineries de village en firent l’affaire.
CINQUIÈME PAUSE
Les manigances de la Poule-Courte. – La farce du panier. – C’était bien de rétablir le Barthaut dans l’esprit des gens. Ce serait mieux de mettre bon ordre aux manigances de la Poule-Courte. Pourvu qu’il ne fût pas déjà trop tard…
Toute dinde qu’était Dorothée, elle avait admirablement compris le Matelot et vu comment mener l’affaire.
Grange, malgré ses allures entières, hésitait, n’osait se décider seul, ne savait que résoudre par crainte du qu’en dira-t-on. S’il n’avait songé au charivari qu’on viendrait faire à ces épousailles d’un veuf et d’une veuve, il se fût peut-être déclaré déjà.
La Dorothée imagina d’aller trouver Mme Domaize, sous couleur de l’engager à remarier Grange. Si cette pauvre dame n’était pas tellement souffrante, n’est-ce pas, elle se rendrait plus souvent aux Escures. Et alors elle constaterait, ainsi que Dorothée le constatait tous les jours en gémissant, combien le manque d’une femme s’y faisait sentir. Cette petite Anne-Marie se donnait assez de mal, mais pouvait-elle mener une maison ? D’ailleurs, la pauvre enfant aurait eu besoin d’une mère. Elle était à un âge… Sans vraiment mal faire, elle pouvait se comporter de telle sorte qu’il devint malaisé de la bien marier plus tard. Et puis il fallait tout dire. On sait, n’est-ce pas, ce que sont les hommes. Si M. Grange, un de ces matins, prenait pour servante quelque fille trop délurée et se remariait derrière l’église ? Ça s’était vu, et ça se voyait, hélas ! tous les jours. Quel exemple pour les petites, et quel scandale dans le pays ! Voilà pourquoi Dorothée avait cru pouvoir parler dans l’intérêt même de la famille, une famille si bonne, si ancienne, si honorable… Mme Domaize ferait vraiment œuvre pie en cherchant dans le canton quelque créature dévote, de bonnes mœurs et de bonnes manières. Par exemple une pieuse veuve sans enfants, – afin qu’elle en devînt mieux la mère des deux petites, – sachant gouverner une maison, cuisinant comme une bourgeoise et ayant assez de savoir pour instruire Pauline, qu’il n’était point convenable de laisser aux mains d’un homme. Tout en désespérant de la trouver, la Dorothée se mettrait en quête d’une telle personne. Elle s’intéressait si fort à ce pauvre M. Grange et à ses deux pauvres agneaux de filles !
Cette homélie ne fut pas sans impressionner Mme Domaize, excellente femme de tête assez faible, qui craignit, en effet, que Jean-Pierre Grange ne prît quelque servante-maîtresse. Elle était trop indolente pour négocier le mariage ; mais voyant la dévote Dorothée d’un œil favorable, elle prêta la main à ses intrigues ; ou du moins la laissa se prévaloir d’une approbation que l’autre fit sonner bien haut.
Les choses étaient si avancées qu’il suffisait peut-être pour tout décider d’une démarche de Mme Domaize aux Escures. Vraiment il ne tenait plus qu’à une journée où la cousine fût sans migraine et trouvât le temps à souhait : Anne-Marie aurait la Poule-Courte pour marâtre.
Gaspard ne cessait de rôder autour du Monestier. Depuis ces nouvelles, il n’avait pas une minute de repos.
Cependant la béate avait compris qu’on se trouvait sous une autre lune. Le vent n’était plus aux diatribes contre le Barthaut. D’ailleurs, toute à sa grande affaire, elle ne songeait plus à vilipender le bon oncle.
— Eh bien, fit Gaspard, qui avait poussé jusque chez lui, cette vieille toupie ne vous fait plus de misères ?
— M’en a-t-elle jamais fait, pauvre petit ? Si je m’en suis plaint, ç’a été par impatience. Aujourd’hui je ne pourrais pas m’en plaindre raisonnablement.
Ce « raisonnablement » sonna mal à l’oreille du garçon. La menette avait dû trouver quelque manière subtile de faire enrager le bonhomme. Mais bien qu’il prît la peine de le tourner et retourner trois quarts d’heure durant, Gaspard n’en put rien tirer.
Avant de regagner Saint-Amand, il alla, pour ses raisons, donner le bonsoir à la cure.
Le curé lisait son bréviaire au fond du jardin, dans un cabinet de capucines. On causa.
— Vois-tu, la Dorothée roule toute la soirée au bourg, aux Escures, dans les familles bourgeoises. Elle ne va à l’église ici que sur le tard et quand le Barthaut arrive, elle refuse de déloger. Mon pauvre Barthaut y retourne trois, quatre fois avant de me rapporter les clefs, à son grand désespoir, lui qui aimerait se coucher comme les poules.
— De quoi vous ébahissez-vous, monsieur le curé ? Elle fait prière double. Dans la chapelle de S. Michel, au Pontel d’Ambert, elle mettait toujours deux cierges, l’un au saint l’autre au diable, disant que les amis sont nécessaires partout.
— Ha, ha, ha, fit le curé. Non, mais je crois qu’elle s’endort sur son banc, plutôt. Entre nous, elle vient parfois à l’église alors qu’elle est dans d’autres vignes que celles du Seigneur.
Gaspard rêva une minute. Le bon curé lui vit un tel air de malice et de diablerie qu’il s’écria :
— Encore une farce ? Au moins, qu’elle ne soit pas trop carabinée, chenapan !
— Moi, des farces ?… Ah ! pauvre monsieur le curé ! Mais je vous aurais bien de l’obligation si vous me prêtiez le grand panier que je vois sous votre hangar.
C’était une sorte de corbeille où l’on mettait les noix à l’arrière-saison.
En prenant congé, Gaspard ajouta que le lendemain, de grand matin, Plampougnis, Jeuselou et lui arrangeraient dans l’église quelques petites choses.
De fait ils vinrent quasi avant que les cheminées fussent sur les toits.
Ce soir-là, le curé dit au Barthaut qu’il n’eût pas à s’inquiéter de fermer les portes, que quelqu’un s’en chargeait.
Sa soupe mangée, la Dorothée arriva à l’église, portant sa chaufferette, et s’installa dans son banc. C’était la vérité qu’elle ne craignait pas de boire à huis clos un bon coup, et même deux ou trois bons coups. Or, il avait fait chaud ce jour-là : ma pauvre Poule-Courte avait tiré un pichet et se trouvait quelque peu dans les fumées du vin. Aussitôt assise, sa tête de tomber et de retomber comme si elle sonnait les cloches, et finalement elle s’assoupit.
Il pouvait être neuf heures sonnées quand elle fut suavement réveillée par je ne sais quelle musique d’anges ou d’esprits bienheureux. Elle se leva, trébuchant un brin, écouta, la bouche ouverte comme un sabot qui n’est pas à son pied, et ouït une voix qui chantait en l’air bien mélodieusement :
Dorothée, ma bien-aimée,
Au ciel je veux t’emmener !
Elle s’approcha pas par pas et vit descendre tout doux une corbeille de fleurs et de mousse si jolie que rien plus ! Alors la voix reprit d’en haut :
Dorothée, ma bien-aimée,
Mets le pied dans le panier !
À peine l’avait-elle mis que :
Dorothée, ma bien-aimée,
Assieds-toi dans le panier !
Si ronde, et faite comme une tonne, la chose ne lui fut point facile. La corbeille gémissait, s’élargissait… Enfin la Poule-Courte s’accroupit en boule, arrangeant ses jupes sous soi. Et incontinent, mollement enlevée, monte en balançant dans les airs.
Dorothée, ma bien-aimée,
Monte au ciel dans le panier !
Ô la bénédiction ! Pas un instant elle ne fit doute que ses mérites ne lui eussent valu cette grâce. La corbeille monte, monte avec ma Poule-Courte au septième ciel, – que ce fût trop pour elle, elle ne l’estimait pas, loin de là, – monte à toucher la voûte.
Gaspard alors dans le clocher noue les cordes, les cordes des cloches, à quoi la machine était suspendue, cependant que Jeuselou joue sur sa vielle un dernier petit air guilleret, sautillant. Puis bonne nuit, bergère ma blonde ! et les trois garçons redescendent du ciel sans autre cérémonie.
Si le temps ne dura pas à la Poule-Courte, au cours de cette nuitée-là, dans son panier qui craquait, il y a apparence qu’il ne lui dura jamais, en quelque occasion que ce fût.
Au matin, le curé vint dire sa messe. Il n’avait point encore pris l’eau bénite qu’il s’entend appeler d’une voix suffoquée :
— Monsieur le curé, descendez, descendez-moi ! Je suis morte si vous ne faites diligence !
Il avance de trois pas, regarde de droite, de gauche… Enfin, levant le nez, il avise là-haut ma Dorothée qui avançait sous la voûte une tête couleur de pivoine.
Il courut chercher le Barthaut, et à eux deux ils dévalèrent la corbeille. Aussitôt à terre, la Dorothée en sortit, roula jusque chez elle sans autre parole, ferma l’huis sur soi et ne fut vue de trois jours.
SIXIÈME PAUSE
Histoire grasse de la Poule-Courte, qui faillit périr en répandant ses entrailles. – Et Gaspard ne s’en tint pas là.
La farce fut tambourinée par les postillons et les rouliers de Saint-Dier à Saint-Anthème, de Craponne à Courpière. Sur vingt lieues de pays on brocarda la Poule-Courte.
Cela devait produire peu à peu l’effet que le gars avait désiré. Mais en attendant, il était dans ses petits souliers, craignant à tout moment d’entendre annoncer le mariage. Il s’agissait d’aller vite et de redoubler sur la béate.
Gaspard servait sa cousine à pieds baisés : on peut croire que, puisqu’il s’agissait de ce service, il entreprit la Dorothée de façon à ne lui laisser aucun répit.
Combien de malices et de tours ils perpétrèrent alors, lui, Jeuselou, Plampougnis et les autres, qu’ils puisèrent dans leur fonds de matoiserie et d’entrain ! Des farces un peu bien grosses, certains coups, mais les flambées de rire purifiaient tout en ces vieilles années, comme ces fougats qu’on allume au dimanche de la Quadragésime pour chasser le mauvais air de la saison.
Quatre faiseurs d’almanachs écrivant six mois de temps la nuit et le jour n’en rapporteraient pas la moitié de la moitié.
Ces garçons étaient sûrs ainsi de ne point perdre leurs peines : la Poule-Courte, d’heure en heure, acquérait un renom tel qu’on ne la verrait plus passer sans rire et que les galopins lui courraient sus dans le bourg. Or Grange avait trop d’amour-propre pour que l’idée lui vînt d’épouser une femme qui lui apporterait semblable dot.
Autrement on n’aurait jamais pu contraindre la Dorothée à perdre toute envie de convoler avec M. Grange. Vouloir laver la tête d’une mule est pour perdre son savon. Il y avait cinquante ans que la Poule-Courte avait commencé d’être sotte, et, depuis, sa sottise ne lui avait jamais passé : elle faisait couche avec sa graisse et tout glissait là-dessus comme sur l’aile d’un canard.
Pour se venger, car elle avait la méchanceté chevillée dans le corps, tout ce que Dorothée put imaginer, ce fut de faire choix et élection à certaines fins du devant de porte de Barthélemy. Chaque soir, la nuit venue, elle s’y rendait en tapinois et y faisait ce que le roi lui-même ne peut faire faire par quelque autre.
Voici une de ces histoires du temps qu’on se mouchait sur sa manche et qu’on n’avait pas le nez de jouer les dégoûtés. Cette joyeuseté, cette grosse gaieté, ne témoignent-elles pas d’une certaine facilité de cœur ? Elles étaient le contraire même de la perversion et comme la marque d’une honnête naïveté de naturel.
Quoi qu’il en soit, dans les farces d’alors, la viande sans os, – vous m’entendez assez, – tenait beaucoup de place. Ces histoires ne sentent pas trop bon d’elles-mêmes, mais quoi, elles sont telles, et les laisser de côté ne serait pas pour donner une idée du vieux temps.
Il n’y avait guère de lieux d’aisances au village. Ou plutôt, il y en avait beaucoup, au coin des rues. Comme le déclarait la pauvre femme à qui son confesseur venait de donner pour pénitence une dizaine de chapelet à dire à sa commodité : « C’est que, de commodités, mon père, nous n’en avons point : nous le faisons à l’égaillée. »
La, la. La Poule-Courte, donc, se recueillait chaque soir dans un recoin devant la porte du Barthaut qui prenait la chose en patience.
Il en revint quelque bruit à Gaspard, qui, un certain samedi, à la nuit tombante, entra chez le magister. Il tira une bête de dessous sa veste, et, la tenant par les oreilles, la fit admirer pour un lièvre à son oncle.
— J’aurais cru à un lapin, dit Barthélemy en chaussant ses besicles, et même à un des lapins de Dorothée. – La Poule-Courte, en effet, avait un clapier de trois lapins : c’était, avec son cabas de tapisserie et son châle jaune d’or, une de ses manières de faire la grosse ; car on ne voyait guère de lapins, alors, chez les paysans. – Un lièvre ? Mais, petit, la bête a du blanc sur le dos ? – C’est un lièvre comme il y en a maintenant, répondit Gaspard. Je veux vous régaler, mon oncle. Demain vous invitez monsieur le curé ; et moi de cette bête et d’un écureuil, je vous fais un civet de lièvre dont nous nous lécherons les cinq doigts et le pouce… À propos, et la Poule-Courte, vient-elle toujours le soir ? Pauvre femme ! Elle a peut-être un dérangement de corps ?
Il écorchait déjà, vidait son gibier. Il mit de côté les entrailles et demanda à Barthélemy d’aller chercher la pelle du jardin. La porte resta tant soit peu entre-bâillée, qui donnait sur la rue.
À son heure, tout bellement, la Dorothée s’en vint. Elle affectionnait maintenant ce coin, derrière le chevet de l’église, tout à ses aisances, tranquille, sous un toit en auvent.
Elle se relevait, non sans un fort soupir, et ravalait ses cottes avant de regagner son logis, quand elle se retourna pour jeter un petit coup d’œil. C’était son habitude, et la lune, précisément, donnait ce soir-là.
Mais alors elle vit sur le pavé quelque chose à quoi elle s’attendait si peu, quelque chose de tant effroyable pour elle qu’elle poussa un cri à faire accourir tout le village.
— Ha ! les boyaux qui me sont sortis !
La pelle avait fait son office. À terre rien d’autre qu’un paquet de boyaux tout frais, tout saigneux… Cette idée lui traversa la tête ainsi qu’un éclair : il lui en prenait comme à cet empereur païen de la Vie des Saints, qui, étant allé là où l’appelaient les besoins de nature, périt misérablement en répandant ses entrailles.
Elle ne put dire autre chose et chut sur le pavé privée de sentiment. Gaspard eut la charité de prendre un grand seau d’eau froide et de le lui envoyer en gerbe dans le nez. Un si brave remède la remit à peine. Ses commères eurent à l’emporter et à la coucher fumante de peur. Elle demeura au lit je ne sais combien de temps, s’attendant à rendre l’âme à toute minute.
Quand elle se releva, elle eut cette fâcherie de voir que le plus gros de ses lapins manquait au clapier. – Monsieur le curé, d’ailleurs, s’en régala, lui, troisième, et le baptisa innocemment lièvre, l’écureuil ayant donné au civet un agréable fumet sauvage. – Mais entre la disparition de ce lapin et l’apparition sur le pavé de ce paquet d’entrailles, la Poule-Courte jamais n’entrevit aucun rapport.
SIXIÈME VEILLÉE
PREMIÈRE PAUSE
Le monsieur des Escures. – Les disputes de Grange et de Gaspard. – Grange entendit faire de telles risées de la Poule-Courte qu’il lui tourna carrément le dos.
Depuis la mort de sa pauvre femme, il était devenu plus bourru, plus rebours, plus hargneux. Comme s’il avait perdu de sa décision et de son goût au travail.
Dans sa première peine, Anne-Marie avait su le pousser à des choses qui l’avaient distrait en lui contentant la fantaisie. Puis lorsque la Dorothée entreprit ses intrigues, la petite fit tout pour que le père s’attachât à embellir les Escures. Elle n’aurait même pas osé lui laisser deviner qu’elle avait en horreur l’idée d’un tel remariage. Seulement elle eut cette rouerie de l’engager doucement à « se montrer » de plus en plus, à prendre rang de bourgeois, avec la pensée secrète de l’éloigner ainsi de la Poule-Courte. Elle n’en pouvait pas prévoir les conséquences…
Grange avait tracé à nouveau le jardin, arrangé un colombier, une volière et autres semblables gentillesses. Trois viviers en gradins se trouvaient entre les bois et le château : il les fit curer et repeupler. Il eut dans sa pépinière des pins d’une essence inconnue à Saint-Amand, et planta sur les terrasses des arbres rares qui lui venaient par son frère des îles d’Amérique.
Quant au logis on en avait embelli les chambres. Elles étaient maintenant toutes gaies de couleurs : celle-ci tendue d’un papier qui faisait voir au naturel la mer et des vaisseaux, des montagnes pleines de cascades, de lianes, de perroquets ; cette autre montrant des chasses indiennes… ou bien c’était la vie des planteurs, des nègres cultivant les plantations, les cases sous des arbres ou pendaient des courges violettes… Et de beaux meubles d’acajou, roides, ornés de têtes de lion en bronze. Il y eut un salon de compagnie avec ses chaises-rotondes de velours jaune, qui fit sensation à dix lieues à l’entour.
Un vieil oncle de Blanval, qui tout enfant avait connu Grange, n’en parlait jamais sans dire en hochant le chef : « Il était opulent, cet homme ! » Et le vieux avait une façon de prononcer ce mot, opulent, comme s’il en avait plein la bouche, qui vraiment peignait le monsieur des Escures.
Car Grange en était à se sentir plus monsieur qu’homme de campagne. Il prenait sa volée, tout en croyant de bonne foi ne travailler à ces embellissements que pour tirer Anne-Marie d’un ennui qui la laissait pâlotte. Il l’obligeait à relever sa mise, à porter au col, tant en semaine que le dimanche, le saint-esprit d’or rouge enrichi de grenats qui venait de la pauvre mère. Il lui avait fait remplacer le mouchoir qui lui servait de fichu par une collerette. Il voulait qu’elle s’habillât comme à la ville, d’une robe à taille haute, dentelée dans le bas, et portât des souliers de prunelle à rubans entre-croisés sur le cou-de-pied.
Anne-Marie obéissait sans y prendre autrement plaisir, et ainsi vêtue, ses nattes roulées en chignon à la mode, avec sa figure nette et calme de sainte Vierge, elle avait plus de tournure que pas une demoiselle du pays.
Ce changement d’habits avait mis quelque peine au cœur de Gaspard. Encore qu’il regardât comme parfait tout ce que faisait sa cousine, il l’entreprit là-dessus. Surtout il entreprit Grange, lui disant qu’il vaudrait mieux voir Anne-Marie mise comme les filles de par là et allant s’égayer dans les métairies avec un peu plus de belle humeur en elle.
Le temps avait passé des parties de pêche, des cueillettes. Et Gaspard le sentait bien. Il n’osait plus faire à sa cousine des présents d’enfants, tels que raisins, noisettes, pommes, qu’on offre non tant pour la chose que pour l’amitié. Des foires, il ne se permettait plus de rien rapporter, alors qu’autrefois c’était toujours quelque étrenne, comme vous diriez d’un collier de perles bleues ou de serins de Hollande dans leur cage. Pourtant, si elle le lui avait demandé, il aurait fait de la fausse monnaie pour cette Anne-Marie. Rien que de la voir, son cœur était plein. Ah ! quand il rencontrait ses regards, des regards vrais, vivants, ceux d’une âme dans de beaux yeux pleins de lumière… Comment n’eût-il pas souffert de la surprendre certains soirs assise à la fenêtre dans cette contenance toujours songeuse et un peu triste ? Il semblait qu’elle regardât venir quelque malheur déjà en route. Une angoisse serrait le cou de Gaspard. Sans qu’aucun pressentiment le travaillât d’ailleurs, il se disait seulement que le temps approchait où le monsieur de Chenerailles ferait parler de lui. Le fils du Six-Mions ne devait être encore qu’un gamin…
Mais à quoi bon s’abandonner à des pensements de tristesse ? Tout étant fait de ce qu’on pouvait faire, il ne fallait plus qu’avoir bon courage. Anne-Marie aurait dû continuer de s’égayer avec ses amis et de vivre à leur brave façon campagnarde…
Il parla à Grange, qui, se piquant, le prit assez mal : sa fille s’habillerait comme bon lui semblerait, à lui Grange, même si cela devait faire crier quelques envieux. Anne-Marie, Dieu merci, aurait de quoi s’acheter des robes de demoiselle, et ceux que cela gênerait…
À peine eût-il lâché ces mots qu’il vit bien qu’il avait blessé Gaspard. Et il n’aurait pas voulu se montrer méconnaissant des services rendus. L’autre, qui était sensible aux mouches, se rebéquait déjà. Grange tâcha d’arranger la chose : Anne-Marie n’était plus une enfant : il n’était pas bien convenant qu’elle allât aux assemblées, n’ayant plus sa mère. D’ailleurs il avait fait promesse de ne jamais la quitter, il ne pouvait l’y laisser aller sans lui. Et cela prêterait à rire de voir un homme au milieu des amusements de la jeunesse.
C’est que personne autrefois n’osait s’écarter de la ligne que devaient suivre ceux de sa condition et de son âge. Dieu sait si une femme mariée qui eût encore dansé eût fait parler d’elle. Pour rien au monde un homme n’aurait pris le balai ou fait son lit. Et il serait mort de soif plutôt que d’aller lui-même chercher de l’eau à la fontaine, ce qui n’appartenait qu’aux créatures en jupon. Chacun savait comment il avait à se régler en ses habits, en ses manières ; et cela selon le sentiment commun, un sentiment très fort qu’on ne se risquait pas à choquer. La coutume régentait tout plus étroitement qu’aujourd’hui.
Grange pourtant comprenait qu’il n’avait pas raison de retirer son Anne-Marie de la compagnie de la jeunesse pour lui faire fréquenter au bourg Mme Domaize, si peu gaie, et Hortense, encore petite fille. Ou bien des dames rechignées dont le passe-temps était de fabriquer des objets en verre filé, des petits canards, des chandeliers en verre bleu, qu’elles mettaient sous un globe avec leur couronne de fleurs d’orange. On les trouvait dans leurs salons bas de plafond qui sentaient le renfermé ; on échangeait des recettes de cuisine, ou bien on causait des familles, des fortunes : on faisait des parties de loto, de jeu de l’oie, de reversi avec des fèves en guise de jetons.
Aider la Marguerite en temps de fenaisons eût certes donné à Anne-Marie plus de couleurs. Mais cela eût moins flatté Grange. C’est pourquoi, se sentant dans son tort devant Gaspard, il poussait son plaidoyer, bouffi de colère comme un coq d’Inde : au bout du compte, il savait qu’il n’empêcherait jamais les gens de crier par jalousie… Il allait recommencer ; il se contenta de lever les épaules et de planter le garçon là.
Pour se rendre sa bonne conscience, il emmenait souvent Anne-Marie dans les bois.
Il allait y avoir deux ans qu’ils habitaient les Escures, trois ans depuis la nuit de Chenerailles. Grange se sentait rassuré, maintenant. Toutefois, depuis les premiers jours de mars, il revenait de mauvais bruits du côté de la Chaise-Dieu. Des rouliers s’étaient vus arrêter à main armée près du pont du Merle. Et dans les mêmes parages, un voyageur avait disparu. On avait retrouvé son portemanteau éventré sur la route…
DEUXIÈME PAUSE
La vie des domaines. – La lettre de l’Américain. – Les trois hommes dans la vieille maison. – Le voyage de Grange à Chenerailles. – Anne-Marie, comme son père, comme Gaspard, se disait tantôt qu’il ne fallait plus tenir compte de la menace du monsieur ; tantôt qu’elle aurait son effet quand on s’y attendrait le moins. Son jugement faisait aussi des sautes selon la pluie et le soleil. Elle était toute portée à croire, ces soirs, où avant quelque pluie à verse, des paquets de suie dégringolaient dans la cheminée, et les oies criaient, battaient des ailes près des étangs, tandis que la montagne se rapprochait, d’un bleu quasi noir au bout des pacages. Puis elle ne croyait plus, un matin où le vent sentait bon la fleur de saule, alors que quelque petite, assise contre la haie d’épine blanche, tricote derrière la métairie, gardant ses vaches qui sautent et s’escarmouchent, car c’est la première fois qu’on les mène à l’herbe, passé le long hiver !
Aux Escures, la vie suivait le branle des saisons et rien n’arrivait dont on eût à faire remarque. Anne-Marie avait ses peines qu’elle ne s’avouait pas bien à elle-même. Des soirs, elle songeait à son père, à ses propres jours, à ce changement venu dans leur manière de vivre, à son cousin. Peut-être voyait-elle les choses tourner comme elle n’eût pas aimé qu’elles tournassent. Mais, quand on est jeune, on espère tellement de la vie.
Elle n’aurait pu se dire heureuse en ce temps, et plus tard il lui sembla qu’il avait été le meilleur de son âge.
C’était l’existence tranquille des domaines. Les vieux domaines bien posés sur les hauteurs, abrités par les bois, en bon air et belle vue devant des campagnes riantes de prés-vergers, d’herbages et d’eaux vives. Le soleil les éclairait dès son lever. Il entrait dans la chambre tendue de perse à fleurettes jaunes et bleues. On s’éveillait pour une journée toute d’or. Les pigeons roucoulaient dans le pigeonnier, et déjà se perchaient sur le bord des tuiles.
Le dimanche, parfois, dès cinq heures, Marguerite, qui arrivait pour la première messe du bourg, surprenait Anne-Marie encore couchée. Elle l’embrassait comme une sœur, à pleins bras. Quelle chose bonne c’est que le cœur dans la jeunesse ! Les conditions étaient plus marquées, alors : en revanche, il y avait plus de familiarité entre toutes gens.
Marguerite faisait reproche à Anne-Marie de venir moins au moulin de Martial. Mais Anne-Marie était tenue de si court, maintenant, par tout ce qu’il y avait à faire dans la maison…
Un jour, vers la fin de mai, le mardi après la Pentecôte, on reçut enfin une lettre de l’oncle Jérôme. Celle qu’on lui avait écrite annonçant qu’on venait habiter les Escures avait dû se perdre comme les autres. Il disait en effet être resté près de deux ans sans nouvelles, parce que les croisières anglaises avaient arrêté plusieurs fois la malle de France. Les dernières lettres reçues, il ne les avait donc pas très bien comprises. Il demandait si l’on avait quitté tout de bon Chenerailles : cela le contrarierait plutôt à cause d’un papier laissé dans une cachette. Il craignait d’avoir eu la langue trop longue, à Bordeaux, avant de s’embarquer, dans une discussion avec certains personnages. Au demeurant, il n’en pouvait marquer davantage par écrit et priait qu’on le renseignât, qu’on lui marquât surtout si des voleurs avaient fouillé la maison de Chenerailles, auquel cas il prendrait ses mesures : peu importait le papier qui pouvait se remplacer, à condition que lui, Jérôme, fût averti.
Grange se ressouvint des suppositions de Gaspard, et savoir s’il ne lui en voulut pas d’avoir deviné les choses. En tout cas, il s’emporta contre l’Américain, qui avait bien besoin de leur chercher des histoires, et pendant plus de huit jours refusa d’aller faire un tour à Chenerailles. Puis son cheval eut le farcin. Puis lui-même fut appelé pour affaires à Ambert. Et c’est là, dans la seconde quinzaine de juin, qu’un beau soir on lui débita chez un marchand quincailler une histoire passablement déconcertante.
Un homme des environs de Doranges, sortant de chez lui avant le point du jour pour se rendre au bourg d’Arlanc, avait aperçu de loin une lumière aux fenêtres de Chenerailles. Intrigué comme on peut le penser, puisqu’il savait la maison vide, il était allé voir et n’avait eu que le temps de se jeter à plat ventre derrière un buisson. Trois hommes avaient passé près de lui à le toucher, dont un, assurait-il, était un bourgeois d’Ambert qu’il connaissait positivement. « C’était lui ou le diable dans sa peau. » Mais de nom, le paysan n’en avait jamais voulu dire. Dieu sait si depuis les langues marchaient en ville ! Cependant on ne savait du tout sur qui faire porter le soupçon, même de bouche à oreille.
Cette histoire saboula Grange. Dès le lendemain, après avoir demandé aux gendarmes de veiller autour des Escures et à la cousine Domaize d’y demeurer le temps de son absence, il partit pour Chenerailles. La maison visitée avec minutie, il relève une tache de suif sur l’escabelle et s’aperçoit qu’on a décloué certaines planches de la cloison. Cela pouvait avoir été fait d’hier, comme cela pouvait dater de plusieurs mois. Grange était venu maintes fois en son ancien logis, mais il n’y avait jamais regardé d’aussi près.
Il fallait chercher l’homme de l’histoire. Et voilà qui n’était point facile. Qui avait entendu conter le fait au Pialou, qui dans une auberge… Chacun se défiait et se défilait. Grange, la face rouge, allumée, courait partout et cognait du poing sur les tables.
Au bout de deux jours, il apprit par le curé de Doranges qu’il devait s’adresser à un appelé Feneyrol, tenant ménage avec son beau-frère, sa sœur et sa nièce, au moulin de la Graine.
— Je crois, conclut le curé, qu’il a véritablement vu quelque chose. Seulement, il a pris peur et vous n’en tirerez rien. Il a dit à ma gouvernante : « Oui, c’était un monsieur de la ville, mais quand on me couperait en petits morceaux, je ne le déclarerais jamais. Il a des parents qui se revengeraient sur moi. »
Grange alla sur la chaude au moulin. Ce fut la meunière, la sœur de ce Feneyrol, qui le reçut. Elle parut embarrassée. Elle ne savait pas bien ce que son frère avait pu conter : un verre de vin suffisait à donner dans la tête de ce pauvre Louis ; il ne fallait pas prendre tous ses dires au sérieux. Du reste, elle, elle n’avait pas à être mêlée à cette affaire… Son frère ? Il était allé travailler du côté de Saint-Paulien, dans le département de la Haute-Loire.
Grange prit feu, menaça, puis étala quatre écus sur sa paume. Un peu tard, car il avait eu le tort de parler des gendarmes. La femme, d’un air stupide, se contenta de répéter les mêmes bouts de phrase.
Ce temps durant, Gaspard faisait le roulage sur les routes de Limagne : un chargement de poteries à prendre à Lezoux, puis un de vin et d’eau-de-vie à Vic-le-Comte. Dès qu’il fut de retour, Anne-Marie et Mme Domaize le mirent au fait. Il leva une épaule, questionna un peu, comme par politesse, parla de son voyage, des récoltes ; puis donna le bonsoir, avançant la main, du seuil, pour s’assurer qu’il tombait des gouttes…
Mais, en s’en allant dans l’allée de sorbiers, il s’arrêtait tous les dix pas.
Il savait que tout allait recommencer. Ou commencer, pour mieux dire… Le point serait de gagner l’automne sans accident sinistre. Après, il croyait voir qu’on serait hors de peine.
En attendant, se mettre tout de suite aux champs pour devancer et contrecarrer ces mauvais bougres…
Ah ! si, malgré leur pique, Grange avait eu le nez d’emmener Gaspard à Chenerailles !
Mais c’est sans doute une sottise de penser après l’événement que les choses auraient pu tourner autrement qu’elles tournèrent.
TROISIÈME PAUSE
L’assassinat du pauvre Carcaille. – Grange revint furieux. Quinze jours passèrent. Gaspard et ses amis étaient toujours en mouvement, maintenant l’un ici, maintenant l’autre là. Le bruit courait que Feneyrol avait fait retour au moulin de la Graine. On disait dans le pays qu’il allait y avoir du changement, que les gendarmes monteraient à Doranges et que Carcaille parlerait. – Ce Feneyrol, on l’appelait ordinairement Carcaille ; les gens étaient grands donneurs de surnoms ; aussi bien, ils n’auraient pu, sans ces sobriquets, démêler les branches des familles.
Un matin, Gaspard cirait ses souliers, le pied à la borne du portail, quand arriva la diligence. Avant même de sauter à bas de son cheval, à ceux qui attendaient au relais, gendarmes, voyageurs, paysans arrêtés par curiosité, gens de l’auberge, le postillon cria précipitamment :
— Le pauvre Carcaille ne dira jamais rien ! Ils l’ont tué hier au soir.
Le bruit que fit cet assassinat n’est pas croyable. Toutes les brigades de gendarmerie furent sur les dents durant huit jours. Le procureur impérial envoyait ordre sur ordre.
On appela Grange trois fois à Ambert pour l’entendre en déposition.
Le beau-frère et la sœur de Carcaille, saisis de peur, étaient venus habiter la ville avec leur petite. L’homme travaillait comme meunier chez un nommé Martin, au grand moulin de Chinard qui se trouvait sur la place Saint-Jean, devant l’église.
Ce Martin était un cousin des Grange, peut-être aussi de Gaspard. Or Gaspard, qui se mordait les poings de n’être allé voir à temps le malheureux Carcaille, se donnait tellement à l’affaire qu’il en perdait le boire et le manger. Il s’y prit si bien au moulin, cajolant la petite, faisant la causette avec la femme, payant chopine à l’homme sans témoigner de curiosité, qu’un soir on lui fit le récit de tout ce qui s’était passé là-bas.
— C’est la vérité vraie, dit la femme, que mon pauvre frère a vu, caché derrière un buisson, les gens qui sortaient de la maison de M. Grange. Il était parti pour aller au bourg d’Arlanc. Une demi-heure après, nous étions encore couchés, mon mari et moi, nous le voyons revenir avec une figure renversée. « Eh bien, je viens d’en voir une fameuse ! » Il nous raconte la chose ; que ces hommes étaient trois, qu’il n’en avait connu qu’un seul, mais qu’il l’avait bien connu. « Un monsieur de la ville d’Ambert, j’en suis sûr ! C’était lui ou bien le diable dans sa peau. » Nous n’osions pas demander le nom. Il nous dit qu’il aimait mieux ne le déclarer à personne. On était là à penser à ces brigands qui étaient venus la nuit où la petite de M. Grange se trouvait seule…
» Quand il fit grand jour, mon frère, qui mangeait un bout de pain et de fromage sur le coin de la table, se leva : « Tant pis, je m’en vais. Il n’y a pas de vin ici, j’ai besoin de boire du vin pour me remettre. Je vais à Arlanc. Vous autres, n’en levez pas la langue. »
» Mais lui ne fut pas si sage. Quand il eut un peu bu, là-bas, avec des amis, il ne sut pas tenir la sienne. Pour le nom, toutefois, je suis sûre qu’il ne le dit jamais à personne, sûre, sûre. « On me couperait en petits morceaux, faisait-il, que je ne le dirais pas ! »
» En huit jours, l’histoire fut dans toutes les bouches. Le mystère de ce bourgeois d’Ambert trottait dans les cervelles. Un soir, M. Grange vint me trouver, parla des gendarmes, m’offrit de l’argent. Moi, je ne savais rien. Mon frère commençait de prendre peur. Il se repentait d’avoir bavardé et voulait quitter l’endroit. Il partit le lendemain pour le château de Berbezit. Quelques jours après, dans une foire, à la Chaise-Dieu, un bossu lui lut dans la main et lui prédit qu’il aurait du malheur : « Vous avez trop jaboté. On vous fera comme au monsieur de je ne sais plus quel domaine, qu’on a tué d’un coup de fusil à travers son portail. »
» Mon pauvre frère se laissa aller à boire. Le soir, le voilà qui prend peur de plus belle et s’en revient chez nous.
» Le samedi, jour du malheur, nous étions invités de noce à Doranges, tous trois, mon mari, moi, la petite. La petite ne put pas y aller à cause d’un pied qu’elle s’était écorché. Elle resta là, près de son pauvre tonton.
» Sur les sept heures, ils étaient assis tous deux au coin de la cheminée, on toqua à la vitre. Ils virent un homme coiffé d’un chapeau troué, qui se tenait un mouchoir sur la figure, comme s’il avait mal aux dents, et derrière lui, deux autres. Ils montraient leurs pipes en demandant du feu pour les allumer.
» Mon pauvre frère dut les reconnaître. Il se dressa sur ses pieds, perdit toute couleur de vie, et leur cria : Non ! Puis il dit en patois : « Veti ma mouort ! » Voici ma mort. Il y avait des barreaux à la fenêtre. Ces trois brigands s’attaquèrent à la porte avec un tronc de pin et l’enfoncèrent. Les jambes de mon frère ne le portaient plus. Il crut se sauver par l’étable : ils lui coururent après comme des chiens enragés, ils le rejoignirent, le terrassèrent, le blessèrent à mort de deux coups de fusil. Lui criait : Grâce ! Pardon !… Puis après, des hurlements affreux.
» Je les entendis, dans le bois. Nous avions promis de rentrer avant la nuit. Je me rappelle que je les pris pour les cris d’une bête. « Oh ! le vilain chien ! on dirait qu’il annonce la mort de quelqu’un !… » Mon mari se sentait un peu du bon dîner qu’il avait fait. Je le laisse en arrière, et alors, de loin, je vois la porte pendant, à moitié dégondée, et la chienne devant, qui tremblait de toute sa peau. « Viens vite ! Il y a un malheur de fait chez nous ! »
» Puis j’avise le corps de mon pauvre frère, près d’un fagotier, à vingt pas de la maison. Ce sont des moments, cela ! J’étais là, les esprits en campagne, des battements partout… Je me demande comment j’ai pu entrer chez nous. La petite s’était cachée en haut, au galetas, et elle qui n’a douze ans entiers, elle avait eu cette force de tirer à soi l’échelle, une échelle qui pèse plus qu’elle certainement. Dans la peur on ne se connaît plus…
» Elle m’a raconté, après, avoir vu de la lucarne les brigands achever son pauvre tonton à coups de crosse. Comme il avait une alliance au doigt, – parce qu’il avait été marié, sa femme est morte, – ils lui ont encore brisé et déchiqueté le doigt pour en arracher l’anneau. C’est le grand à nez rouge qui a fait cela. Les deux autres gagnèrent tout de suite le bois : celui que j’appelle le monsieur, bien qu’il n’eût qu’un chapeau troué, une méchante veste et un pantalon brun, et un bandeau noir sur l’œil qui avait l’air d’un revenu des galères. Le nez rouge les a suivis en leur criant : « Il est si bien mort qu’il n’y a plus qu’à le mettre en morceaux et à le saler ! »
» Il avait aussi crié en patois, mais pas en patois d’ici, à une vieille de Scis qui arrivait comme ils enfonçaient la porte : « Sauvez-vous ! vous serviriez de témoin ! » Et elle s’était sauvée en quittant ses sabots pour courir plus vite.
» Mon mari n’osait pas… Il aurait autant aimé ne rien dire. Mais je retournai à Doranges le même soir pour qu’on fît venir la justice. C’était mon frère, je le devais. J’ai tout dit au juge. J’irai voir sauter la tête des trois brigands, je veux être la première, devant tout le monde, le jour qu’on les déguillotinera. Ils sont peut-être fins et très fins, – on n’a rien trouvé devant chez nous qu’un morceau d’amadou, – mais la justice a la barbe plus fine qu’eux. Quand bien il y aurait un bourgeois dans ce crime, si je le connaissais, j’aurais dans l’idée de le dénoncer, parce que c’est un trop grand malheur. Mon pauvre frère, qui n’avait jamais fait tort à personne, avec qui je n’avais jamais eu un mot, ni mon homme non plus, même au moment de nos partages, et qui aimait tant la petite… En passant par les rues, je vois les bourgeois de la ville : dire que c’est un de ceux-là qui a massacré le pauvre Louis… L’effet que cela fait… Tenez, tous trois, nous n’avons plus de goût à rien, ni de courage. Ce malheur nous a pliés en deux. »
La justice piétinait. Gaspard ne voulait pas que Grange s’en reposât sur elle. Il disait, comme on le dit à la campagne, que s’il y avait un monsieur dans l’affaire, l’instruction tournerait court. Les grosses mouches passent à travers la toile, les petites seules y demeurent. Si quelque personnage d’Ambert est soupçonné, ses parents le soutiendront, il aura des hommes de loi de son bord pour le conseiller, et volontiers la justice se fourvoiera.
De fait, on se soutenait terriblement dans les familles et coteries bourgeoises. On s’y détestait, souvent, entre soi, mais à l’occasion d’un procès, d’une élection, ou s’il survenait quelque affaire de conséquence, on se donnait le mot, tous faisaient bloc autour du parent qu’il fallait appuyer. Alors que ce parent était parfois haï de tout son cousinage. Mais c’était pour la famille.
Gaspard eût aimé avoir au moins des soupçons, pour mettre Grange, ou mieux Anne-Marie, en garde contre telle ou telle personne. Restait qu’à Ambert, bourgeois ou non, nul homme n’avait trois doigts de tranchés à la main gauche. Cela n’aurait pu se cacher. Il s’ensuivait que le monsieur vu par Feneyrol à Chenerailles n’était pas celui qui avait jadis menacé Anne-Marie. Et l’un comme l’autre demeuraient inconnus.
Un mois avait coulé sans apporter du nouveau à l’enquête, et Gaspard qui n’avait pas espéré grand’chose de la justice n’en espérait plus rien du tout. Par malheur, ce qu’il avait pu apprendre ne le menait pas beaucoup plus loin.
Sa seule ressource était de retrouver l’homme au bandeau, celui bien sûr qui avait parlé au Nanne dans le bois et qu’eux-mêmes avaient pourchassé l’an dernier du côté de Fournols. D’après les dires d’une vieille, Gaspard supposait que le pistolet parlait le patois du Vivarais ou du Gévaudan. Allez donc le rechercher à de telles enseignes, alors que cet emplâtre à l’œil n’était sans doute qu’une façon de se masquer le visage…
Il s’agissait au demeurant de pousser les bandits de si près qu’ils n’eussent pas un moment pour faire leurs farces. Encore deux mois, et Gaspard supposait qu’on pourrait vivre plus tranquille. D’abord les autres sauraient que l’Américain ayant pris ses sûretés, il leur fallait aller fureter ailleurs. Ensuite Jérôme Grange aurait renseigné son frère sur les gens à qui il avait eu affaire à Bordeaux.
Le tout était de gagner un peu de temps en jouant le jeu plus serré que jamais.
QUATRIÈME PAUSE
Les terreurs et les silences d’Anne-Marie. – L’homme vu la nuit de grand’lune. – Cet assassinat de Carcaille, on essaya bien de le cacher à Anne-Marie. Mais aurait-on pu empêcher la Poule-Courte de colporter une telle nouvelle ? Elle en grillait ; elle se sentait les pieds sur la braise. D’ailleurs, si les servantes n’avaient point parlé, ç’aurait été les dames du bourg.
Après cela, Anne-Marie se crut perdue. Elle passa huit jours dans le noir le plus noir. Son courage, à ce moment-là, n’allait plus qu’à ne rien laisser voir de ses affres. Si Gaspard était venu, elle se serait prise à pleurer et l’aurait serré des deux bras en lui disant tout pour ne plus tant sentir sa peur. À son père, elle ne pouvait se confier ainsi. Elle se répétait qu’elle ne devait lui parler de rien, pour ne pas lui donner du tourment. Tant d’ennui déjà n’était venu que d’elle. D’autre part, n’avait-elle pas promis à sa pauvre maman de tout faire pour eux deux, lui et Pauline ? Elle prenait donc le parti de se taire. Au fond, c’était parler qui lui eut coûté. De certaines colères où elle avait vu entrer son père, parfois, elle gardait une habitude de silence, de retraite et de recul devant lui.
Cependant, lorsque Gaspard n’était point sur les routes à faire des charrois, il courait d’Ambert à la Chaise-Dieu, à Brioude. On ne le voyait plus aux Escures, où Anne-Marie restait seule avec sa peur.
Ces pensées par les après-midi de pluie, tête basse sur les torchons qu’on ourle. Le chéneau se dégorge par une gargouille à l’angle du toit, et l’eau choit avec un glou-glou hoquetant, si triste, à la longue… L’averse bat les feuillages du jardin ; des gouttes de partout tombent dans les mares clapotantes, et tout ruisselle à des lieues dans la campagne grise, jusque par delà ces monts du Forez, plats là-bas comme un mur ruineux. On s’engourdirait en ce bruit roulant, de si loin venu. Si l’on pouvait partir ainsi dans la pluie ! ce serait comme dormir, presque : on ne sentirait plus cette lourdeur dans la tête, cette idée qui ne vous lâche pas une minute… C’est dur de savoir qu’on va mourir. Et il faudra voir l’homme, l’air effroyable qu’il aura ; et ses mains, et le couteau…
Il pleut à plein temps : par une porte entrebâillée, on entend au haut de l’escalier comme un ronflement sous les combles. La maison est vide ; cependant il y a par instants des craquements inexplicables. On dirait que quelqu’un marche dans la chambre verte. La peur gèle le sang d’Anne-Marie. Elle ne voudrait pas se retourner de peur de voir un homme apparaître au bas des degrés.
Un dimanche, – elle en avait depuis deux jours le sentiment : des bruits, je ne sais quoi, enfin le sentiment d’une présence dans la maison, – elle se dit qu’elle ne rêvait pas, qu’un brigand était caché dans les Escures mêmes. L’enclos était si vaste. Il avait bien pu s’y glisser et comment le trouver, dans le foin ou entre les bottes de paille de ces granges ? Tant de caches. Anne-Marie avait remarqué que les chiens aboyaient ou grognaient sans qu’on sût pourquoi. Mais en revenant de vêpres elle trouva ouverte la porte du charnier qu’elle était sûre d’avoir fermée le matin. Pour rien au monde, elle ne serait allée dans les chambres.
Elle en séchait de frayeur et son esprit se serait dérangé si le vieux prêtre de Marsac, craignant que l’assassinat de Carcaille n’eût fait impression sur elle, n’était venu passer trois jours aux Escures. Il l’apaisa, voulut visiter minutieusement les bâtiments avec elle et le Nanne, et lui releva si bien le cœur que, quand il partit, elle doutait de ce dont elle avait été certaine la semaine précédente.
On ne sut jamais si un homme s’était véritablement caché dans le domaine. Mais Anne-Marie devait bientôt voir, voir de ses yeux, ce qu’elle n’avait peut-être fait qu’imaginer.
Une nuit du mois d’août qu’elle était couchée et qu’elle ne pouvait dormir, elle écoutait deux crapauds chanter goutte à goutte au vieux mur du jardin sous les fougères. C’était nuit de grand’lune, une lune sereine comme de l’argent poli ; sa coulée luisante entrait de biais dans la chambre. Au dehors, on voyait des cimes d’arbres et les bosses bleues des collines.
Les crapauds, soudainement, cessèrent tous deux de flûter. Un caillou déroula du mur. Anne-Marie se leva et s’approcha de la fenêtre en restant dans l’ombre. Debout, elle regardait le portail, le gros tilleul, la terrasse. Un peu plus bas, une tête se montra à la crête de la muraille, puis l’homme se hissa sur les poignets et sauta à terre sans bruit. Sous le sureau du bout de l’allée, il arrangea le mouchoir sombre qui entourait sa tête, et cela fait, collé contre le tronc de l’arbre, ne bougea plus ni pied ni main. Il tournait seulement le visage de droite, de gauche, et examinait le château aussi curieusement que s’il désirait l’acheter. À coup sûr il savait où logeait Anne-Marie, puisque c’était à sa fenêtre qu’il revenait toujours.
Eh bien, le cœur lui battait moins qu’elle n’eût pensé si on lui eût, la veille, parlé de cette visite. Une curiosité la mordait trop fort. Elle tenait les yeux fichés sur l’homme, mais sans presque rien voir dans ce noir entre les branches du sureau : à peine le blanc d’un visage et quelques mouvements de cette forme… Dire que c’était lui, là, coiffé d’un mouchoir comme à Chenerailles, dire qu’il était là, à dix pas, avec quelles idées en tête ?
Il ne pouvait apercevoir Anne-Marie dans l’ombre de la chambre. Il fallait aller chercher le père qui dormait à côté, la porte ouverte.
Cependant la petite ne bougeait point. Elle savait que la première chose que son père ferait serait d’empoigner un fusil et de loger deux balles dans l’estomac de ce curieux. Or, même si c’était là l’homme de Chenerailles, tirer sur un chrétien comme sur un chien enragé… Il pouvait se repentir avant de commettre un crime et sauver son âme que le coup de fusil expédierait en enfer. C’est une trop terrible chose que d’arracher ainsi sa part d’éternité à une créature.
Quelle folie de ne s’en être débarrassée à cette heure, alors qu’elle n’avait qu’un mot à dire, un simple mot ! Mais elle gardait comme un remords le souvenir du coup de coutelas déchargé en trahison sur les doigts de ce même homme. Il lui sembla, à la pauvre petite, qu’elle rachetait sa faute en se défendant là d’aller avertir son père.
C’était se montrer trop bon chrétien ? Dieu veuille qu’on ait plus souvent à faire aux gens pareil reproche. Elle préféra courir son risque plutôt que de donner avantage au diable. Une fois par hasard sur cette terre, ce fut chez une enfant toute pure de cœur l’oubli de soi-même : une idée d’extrême charité surmontant la terreur. Et c’est beau plus encore que c’est étrange et rare.
Le monsieur ne remuait point. Sans doute ne voulait-il que considérer les aîtres. Il pouvait s’en rendre compte, au demeurant : en cette demeure de pierre les portes étaient solides, les fenêtres grillées, et il n’y avait pas à tenter grand’chose, au moins ce soir-là.
Se décidant, il se faufila contre la muraille. Elle le revit enjambant le chaperon. Il disparut.
Puis les crapauds recommencèrent de chanter, comme une source perdue dont les gouttes tintent dans la nuit. Un souffle de vent s’en alla d’arbre en arbre du côté du ruisseau. Quelque nuage aux bords éclatants jetait brusquement son ombre en passant sur la lune. Un chien aboyait dans une cour de ferme. De toute cette nuitée-là, Anne-Marie ne put dormir.
CINQUIÈME PAUSE
Les bûcherons dans la forêt de Virennes. – Le lendemain au matin, elle grava de son petit couteau une croix sur l’arbre tordu qu’elle appelait déjà le sureau de l’homme.
L’angoisse l’oppressait tellement qu’elle comptait écrire un mot à son cousin, – Dieu fasse qu’il fût au bourg ! Pourquoi ne lui avait-elle rien dit quand elle croyait un homme caché dans le domaine ?
Ah ! il aurait bien su la garder de tout mal. Mais elle avait craint de s’être déjà mal comportée en lui contant les dernières affaires sans savoir si le père le trouverait bon.
Et elle n’eut pas le temps de faire sa lettre. Sa canne d’épine pendue au poignet, essuyant d’un revers de main la goutte de vin rouge qui tremblait à sa moustache, le père l’appelait avec impatience.
Il fallut partir pour les bois. Anne-Marie ne vivait plus. Il lui semblait que quelque chose d’affreux était en suspens. La journée ne se passerait pas sans un malheur. Comment dire maintenant ce qu’elle avait vu cette nuit ? Elle tremblait comme la feuille à l’idée de la colère où le père entrerait. Ne pas l’avoir réveillé ? Quand l’autre était là ! Quand on tenait pareille occasion de lui laver la tête avec du plomb de calibre !
La journée commençait d’être lourde. Entre les sapins on voyait un ciel trouble, à queues de cheval. Les écorces sentaient fort et par places montait cette odeur aigre, comme de vinaigre, de résine, de bois pourri, qui dort en certaines retraites des bois. L’air était plein de senteurs ainsi que quand il va faire de l’orage. Pas un souffle sous le couvert. Ce calme dormait, loin, loin, gênant comme dans un village à l’abandon. On n’entendait que le pivert toquer à coups de bec contre un tronc et s’envoler en criant.
Grange disait à la petite de prendre garde au soleil. Mais il y avait là de vieux coins noirs où elle était aussi au frais, pensait-il, que dans la salle basse du château. Il se sentait seulement impatienté de la voir tricoter à la manière d’une paysanne.
On était monté sur le plateau, vers Virennes. Les bûcherons, en corps de chemise, le feutre en arrière pour dégager le front, faisaient leur travail. La cognée volait tout doux, comme sans effort, et peu à peu entaillait le fût si proprement qu’on l’eût dit ouvert à la scie. Puis, à genoux, poussant, tirant, ils maniaient le passepartout dont les dents mordaient dans le bois frais. Les mouches devenues mauvaises s’irritaient autour de ces bras tatoués de signes bleus, autour des têtes suantes. Le père disait où devait tomber l’arbre et surveillait la besogne, les sourcils rejoints. « Là, là, assez ! Reprends la hache maintenant. » Un craquement… Gare dessous ! On se rassemblait autour du pied. L’arbre tremblait, penchait, à peine, un peu, un peu plus, des branches là-haut dégringolaient, arrachées à des voisins ; puis le sapin partait, en pivotant, parfois, et, le bruit s’enflant, s’enflant, s’abattait tout rebondissant en ébranlant la place. Après, quelque petit arbre se couchait encore, entraîné dans sa chute. Et du brouillis des branches sur la terre écorchée venait un goût sauvage.
C’est beau à voir abattre, ces sapins plus hauts que des clochers. Anne-Marie aimait demeurer près de ces forts hommes qui menaient la besogne sans guère parler, avec de bonnes figures rouges sous les grands feutres. Elle s’asseyait pour tricoter au milieu des scies, des haches, des cabas d’où sortaient des bouteilles. Sa peur, elle l’oubliait presque et savait seulement qu’elle la retrouverait tantôt. Une résignation d’ailleurs lui était venue. Rien n’arriverait sans que Dieu ne l’eût permis. Sa pauvre mère était là, présente, qui la protégeait.
Pour beaucoup, bien sûr, la religion n’était guère qu’une chose d’habitude et de bouche, signes de croix, génuflexions et marmottements de prières. Mais la mère était d’une de ces vieilles familles de la montagne où le sentiment chrétien passait vraiment dans la vie ; où l’on avait coutume d’offrir son ouvrage à Dieu en le commençant ; de penser, si quelque braise vous brûlait les doigts en nettoyant le four, aux pauvres âmes du Purgatoire, et de dire un de profundis pour elles. Elle avait élevé la petite dans ces grandes mœurs. Et aujourd’hui, Anne-Marie, que cette idée travaillait, de la mort pouvant tomber sur elle comme la foudre, retrouvait un peu de paix à vivre ainsi en société avec Dieu.
Midi venu, Grange voulut aller s’asseoir pour manger au Chei de l’Ermite, qui n’était qu’à deux pas.
C’est au milieu de la forêt un rocher à l’aspect de bise creusé à la forme et figure d’un corps d’homme. Dans ces bois de Virennes vivait, ce dit-on, un ermite qui se sustentait l’été d’airelles et l’hiver de racines d’arbres. N’est-ce pas le fait d’un grand saint de s’en tenir à pareil vivre ? Il faisait là sa solitude, et si d’aventure des sorciers de l’Imberdis, qui a passé longtemps pour un repaire de jeteurs de sort, venaient l’y troubler, il les chassait à grands coups de rosaire.
On eut quelque peine à découvrir la roche-sépulcre. Au demeurant, – qui dira pourquoi ? – c’est toujours malaisé, même alors qu’on sait où elle se trouve.
… Le repas pris, Grange força la petite à boire un verre de vin des Canaries. Elle était assise, adossée au rocher. Sa nuit blanche, ce temps lourd, elle laissa aller la tête et s’assoupit sans s’en apercevoir.
Le père se sentait de bonne humeur. Un moment il la regarda dormir. Comme elle était diligente et soigneuse, elle avait déjà rangé les restes du dîner dans le cabas. Seul le coutelas d’Allemagne, celui de l’homme de Chenerailles, était resté là sur la mousse. Grange aimait l’emporter lorsqu’on devait manger dans les bois, à cause de la fourchette et du couteau de la gaine. Il le trouvait riche et commode et ne s’était jamais aperçu que la petite n’avait guère plaisir à s’en servir, pour tout ce qu’il lui rappelait.
Qu’elle dormait donc de bon cœur ! Il y avait d’ailleurs un tel silence dans ce coin de forêt qu’on n’y sentait pas monter l’orage s’amassant là-bas du côté de Saint-Germain-l’Herm. On entendait seulement la cognée des bûcherons. Ne pas aller les gouverner, se disait Grange, c’était laisser écraser deux ou trois jeunes sapins de belle venue.
Il ne put se résoudre à éveiller Anne-Marie. Son monde était là, pas même à un jet de pierre. Qu’y avait-il à craindre ? En trois pas et un saut, il rejoignait la petite. À la fin, il n’y tint plus : il se mit lentement sur pied et s’éloigna entre les arbres.
SIXIÈME PAUSE
Le somme au Chei de l’Ermite. – L’orage. – L’attente. – Et alors arriva ce qui devait arriver.
L’homme de la nuit écarta des feuilles, avança la tête. Puis, sans plus de bruit qu’une mouche qui marche sur un carreau, il se coula de sapin en sapin. Il se coula jusqu’à son couteau de chasse, qui traînait là, s’en saisit, le tira de sa gaine. À ce moment, il regarda la jeune fille.
Elle dormait, la tête versée sur l’épaule, et des boucles tombaient contre sa joue à laquelle ce peu de vin des Canaries avait donné des couleurs. Une enfant, rien qu’une enfant. Sous le fichu en pointe, sa poitrine se soulevait à peine. Au fond de ces grands bois, endormie contre ce rocher près d’un pied de digitale, on l’eût prise à la voir pour une petite reine des chansons. Les vieilles gens et ceux qui savent les secrets de ce monde auraient bien compris qu’elle avait trop de beauté pour que son sort fût jamais heureux.
Elle dormait sans un mouvement, et la tête ainsi penchée, offrait ce cou nu et pur comme si elle le tendait au couteau. Était-ce possible de la voir sans se sentir le cœur ému d’amitié ?
Enfoncer la lame sous l’oreille, entre la nuque et le menton. Puis la coucher sur la roche, dans le creux même du corps mort. Les autres l’y trouveraient avec ce couteau dans le cou…
Mais maintenant l’homme la regardait… Si ç’avait été de la compassion qui lui eût passé par le cœur !… Ha, c’était bien pis. Et qu’il eût mieux valu qu’il la tuât là tout de suite.
Il demeurait debout devant elle sans se soucier de Grange ni de ses bûcherons, aussi tranquille que s’il assistait à la grand’messe. Son œil ne quittait point Anne-Marie et se faisait fixe, fixe, à mesure qu’il suivait une idée soufflée par le diable.
En sursaut la petite s’éveilla. Elle regardait sa main qu’elle sentait meurtrie. Une pierre roula de sa robe. Qui venait de la lui lancer ? Personne à l’entour…
Elle reconnut, arrivant de la clairière, la voix de son père, les bruits du travail. Elle était tout à fait réveillée.
Alors elle vit, dans cette mousse sombre tout en étoiles, – de cette belle mousse épaisse qu’on cherche pour en faire des couronnes à la Toussaint, – deux marques comme des pas dans un pré mouillé, les marques des semelles d’un homme resté là debout longtemps. Deux brins d’herbe se décollaient, se relevaient…
En même temps elle pensa au couteau de chasse, avec cette idée qu’elle allait le serrer dans le cabas lorsqu’elle s’était endormie. Et ce couteau qui devait se trouver près d’elle, il n’y était plus.
Le cœur lui battait avec une violence douloureuse : c’était comme des éclairs qui passaient devant ses yeux. Il ne lui vint même pas à l’esprit que son père pouvait avoir emporté le coutelas : elle savait tout. L’homme était là derrière quelque buisson, il avait pris le couteau, puis il lui avait jeté cette pierre sur la main. Sans doute il la regardait.
À travers des sureaux il lui sembla entrevoir une forme. Mais les feuilles partout arrêtaient la vue, et, soudainement, d’un nuage montant tomba une grande ombre.
Anne-Marie avait repris son air de calme quand elle rejoignit le père. Des coups de vent passaient sur les têtes d’arbre et des roulements approchaient, grossissaient, l’un n’attendant plus l’autre. Les bûcherons se hâtaient d’abattre un sapin à demi scié, s’essuyant le front d’un revers de bras, tandis que d’autres ramassaient cabas et haches et enfilaient leur veste.
Le bois se faisait noir. Une rafale s’éleva furieusement, meuglant comme un taureau dans la futaie qui se démenait toute. Le tonnerre déchargeait déjà ses tombereaux de boulets qui rebondissaient à n’en plus finir avant de s’écraser dans les fonds.
On partait en grand’hâte, courant, s’entr’appelant, quand on vit de loin arriver la pluie par lames glissant comme le vent. Elle tombait à pleins seaux. C’était un bruit, dans la forêt, un énorme dévalement grondant, et cela s’accordait bien avec les pensées qu’Anne-Marie roulait en sa tête, comme un ruisseau en crue les pierres qu’il charrie. Elle s’y laissait emporter et descendait dans ces grands abats de pluie, dans ces vacarmes des sapins, dans cette canonnade à gros ressauts du tonnerre, songeant, ainsi que la nuit dans les songes, à l’homme, à Gaspard.
Gaspard, ce je ne sais quoi de jeune, de brave, de bon, en toute sa personne, sa face claire et riante, couleur de flamme… Elle le revoyait sous un châtaignier, dans sa petite veste bleue et ses longues guêtres, appuyé de côté sur son bâton. Et le soir de la reboule à Champétières, comme il lui avait pris la main, et comme ses yeux brillaient… Cousin, cousin, ce serait si bon d’être toujours tous deux, l’un proche de l’autre. Près de toi, je n’aurais jamais plus de peur.
Cette bourrée que chantait alors Pauline revenait à Anne-Marie comme un refrain dans la fièvre et ne la lâchait plus :
Que je fusse mariée,
Mariée à mon plaisi,
Passerais la matinée
Aux côtés de mon ami.
L’air dansant et triste chantait toujours, tandis qu’elle descendait, les souliers clapotants d’eau, par le chemin tourné en ruisseau, couverte d’un sac qu’un des hommes lui avait donné en guise de capuchon, mais sans plus se soucier de s’abriter, maintenant, à travers l’orage qui redoublait.
Comme elle raconterait tout à Gaspard, et ce soir même ! Mais qu’il ne fut pas trop tard, déjà ! Lui la sauverait. Et puis il ne s’agissait pas de cela : il s’agissait de ne rien garder de caché pour lui, d’être tous deux un même cœur.
… On rentra aux Escures plus trempés que des rats de rivière. Il fallut se changer, se réchauffer. Le père fit du vin chaud à la cannelle.
Ce ne fut qu’à une semaine de là qu’il chercha le couteau de chasse. Il crut qu’on l’avait perdu lors de cette fuite à travers bois sous la pluie battante et ne grogna pas trop.
Gaspard se trouvait à Brioude le jour qu’Anne-Marie s’endormit au Chei de l’Ermite et ne devait rentrer que sur la fin de la semaine.
Ces soirs d’attente, abandonnant son travail, avant d’allumer le chalet, la petite rêvait qu’elle se confiait toute à son cousin. « Je lui raconterai comme j’ai eu des misères et que même je ne voulais pas les lui dire… » Alors la reprenaient ses gaietés de naguère, quand Gaspard la taquinait, la câlinait. Son imagination allait, entrait en d’autres temps heureux. Elle suivait ces rêves, souriant d’elle-même, d’abord. Puis c’était à ces rêves qu’elle souriait jusqu’à la minute où elle se levait, réveillée, prise de trouble. Elle allait à la fenêtre, la joue brûlante de honte, s’appuyer à la vitre et regarder les sapinières que le vent rudoyait de l’autre côté de la lande aux gentianes.
Maintenant elle n’embrassait plus Gaspard, bien qu’en ce temps-là on s’embrassât comme on se presse aujourd’hui la main. Elle n’aurait pu, elle ne savait pourquoi. Le sang lui battait dans la gorge. Elle voyait le cou de Gaspard, nerveux, rond, et, de brun, blondissant jusqu’à devenir tout blanc près de l’ouverture de la chemise. Il lui prenait des idées étranges. Et elle songeait davantage à cette solitude… Ah ! elle savait bien que cette solitude n’était pas : il lui suffisait de laisser ses regards s’engager dans ceux de son cousin. Mais c’était la bonne amitié, cela, se disait-elle, la parenté ? Leurs sorts tourneraient-ils de façon qu’ils pussent vivre l’un près de l’autre ? Gaspard irait de son côté, et elle…
Elle ne pouvait prévoir que des jours sombres tant le malheur lui avait donné son pli.
En attendant, comme il lui tardait que son cousin revint !
Il revint. Elle le revit un matin de bonne heure. Elle était dans la première cour, celle des pruniers, qui jetait du grain à la poulaille. Elle posa l’écuelle sur le bassoir de la fenêtre et lui sourit. Ils causèrent un instant des couvées, d’un putois qui avait saigné plusieurs gelines chez le métayer. Anne-Marie regardait Gaspard toujours avec le même sourire. Il y eut un petit silence. Les coups de bec des poules sonnaient mat comme une averse. Puis elle dit :
— Tu ne vas pas donner le bonjour au père ? Il est avec Pauline dans la maison.
Et elle l’accompagna sans plus parler, raclant aux pierres en passant son sabot où restaient collées des pailles.
… Souvent, durant la semaine qui suivit, assise à coudre dans la salle basse pleine de soleil, elle repensa au jour de l’orage. Du portail un char sortait en grinçant. Les oies cancannaient, s’en allant vers le ruisseau, et les premières feuilles sèches roulaient avec un bruit de papier froissé le long des murs. Ou bien un fruit tombait, d’un de ces pruniers bleus de prunes. Une tranquillité dormait sur les pentes autour des métairies, malgré, par là-bas, le coup de fusil d’un chasseur. Les araires de bois geignaient, fieulaient comme des flûtes, et les couplets des laboureurs se répondaient d’une colline à l’autre. Douceur de la pleine matinée, en fin septembre, aux terrasses du jardin devant la campagne montueuse.
Puisque l’homme ne l’avait pas tuée lorsqu’il avait si beau faire, peut-être la laisserait-il désormais en repos ?
Elle l’aurait pu croire, par ces matins d’arrière-saison si bons dans les domaines ; mais elle ne le croyait pas. Elle se rappelait la pierre que l’homme avait lancée. Elle avait bien compris que rien n’était fini. Et puisqu’il ne l’avait pas tuée, que lui voulait-il ?
La mort de la mère fut un grand malheur dans cette maison. Si elle était demeurée sur terre, elle aurait empêché bien des choses. Mais le sort est le sort.
Anne-Marie avait eu scrupule de dire à Gaspard ce qu’elle n’avait pas dit à son père. Depuis qu’il s’était mis sur le pied d’un bourgeois de campagne le père ne faisait plus autant d’accueil au cousin. Et Anne-Marie devait se comporter de façon à lui complaire sans qu’il eût besoin d’en toucher mot. Elle le devait, même si elle en souffrait dans son cœur.
Maintenant, elle eût désiré quelque tentative du monsieur, quelque fait de brigandage. Gaspard était là, on appellerait tout de suite Gaspard au secours… Elle croyait à son cousin comme à ses reliques.
Le matin où Anne-Marie fut sur le point de parler, dans la cour, le garçon revenait de Brioude, et rayonnant à fondre les brumes. Il se sentait du vif-argent dans les veines. Sans s’attarder aux Escures, envoyant parfois d’un moulinet de son bâton quelque caillou voler par-dessus les sorbiers, il regagnait le bourg en sifflant la Youyette, quand sous le bois des Fourches il rencontra Jeuselou du Dimanche.
L’autre, rien qu’à voir le camarade, comprit qu’il y avait du bon tabac. Gaspard lui coiffa l’épaule, et, d’une voix basse, vive, chaude : « Si on les empaumait, tout de même, ce coup-ci !… Va, j’ai entendu chanter de jolis oiseaux dans la forêt de Javaugues. Nous irons tous de lundi en huit à un endroit que je sais et je crois qu’il y aura beau jeu, comme on dit, si la corde ne se rompt. »
SEPTIÈME VEILLÉE
PREMIÈRE PAUSE
La grande levée. – Le brave Ambertois. – Le malheur de tomber au sort. – Environ ce temps arriva comme une bombe l’ordre d’opérer une levée de trois cent mille hommes.
Les grandes guerres du grand Napoléon ! Il a fait abîmer bien du monde et on l’aimait quand même : arrangez ça !
Jusqu’aux années où le deuil et les misères abattirent les courages, on partit soldat le chapeau sur l’oreille en portant beau par les chemins. Ces conscrits n’étaient pas toujours joyeux de quitter ce qui faisait leur vie : le pays et les bonnes amies, les besognes et les amusements. La plupart n’entendaient point chercher prouesse. Ils avaient toujours vaqué assez près de la maison pour ouïr, comme on dit, peter l’anse de la marmite. Du champ où l’on piochait, on pouvait voir le toit de tuiles bordé de ses grosses pierres, le four, la fontaine avec son bac de bois et le sapin planté près de l’étable. Un matin les gendarmes venaient dire qu’on était de la réquisition : il fallait trousser son paquet et suivre les autres recrues se faire casser les os, Dieu sait où, au diable au vert…
Enfin ! On buvait un verre en jetant la dernière goutte par-dessus son épaule, et on se sentait bientôt prêt à y aller de franc-jeu. Il y a toujours un soldat dans la peau d’un Auvergnat.
Ils ne partaient pas en chantant la Marseillaise. Que non. Leur chanson disait :
Le maire et le sous-préfet
N’en sont de jolis cadets :
Ils nous font tirer au sort,
Tirer au sort, tirer au sort,
Ah, ah, ah ! tirer au sort,
Pour nous conduir-z-à la mort !
Et puis, au tournant, tendant la guêtre dans la poussière, ils reprenaient déjà :
Ah ! que j’aurai du bonheur
De servir notre empereur !
J’aurai soin de mes habits,
De mes habits, de mes habits,
Ah, ah, ah ! de mes habits,
D’ma giberne et d’mon fusil !
Sait-on comment s’y prit pour commencer un Ambertois qui se poussa gaillardement ensuite, dans les guerres de l’Empire ? Fût-ce le major Dumeil, un fameux qui conquit un grade à chaque campagne ? Fût-ce Rouvet, dit l’Intrépide Rouvet pour être monté le premier à l’assaut de Saint-Jean-d’Acre et avoir reçu des mains de Napoléon un fusil d’honneur à garniture d’argent ?
Le gaillard déserta trois fois avant d’avoir vu l’ennemi. Il ne voulait rien savoir de ce hourvari et n’avait qu’une idée en tête : retourner chez son père retrouver son écuelle et sa bêche. Sans doute la prévôté le ramassait, n’entendait goutte à son patois, et le ramenait chaque coup à son corps comme égaré.
Arrive la première bataille. Quand il voit commencer la danse, il grimpe dans un arbre, s’y poste et crie aux camarades :
— Hé, vautris ! vous beilarés gardo de tira per ati, que cé a quaucu ! « Hé, vous autres, vous vous donnerez garde de tirer par ici, qu’il y a quelqu’un ! »
Et les coups de fusil de rouler, et les coups de canon, en feux de file de tonnerre du diable dans des rubans de nuages ronds où l’on ne se voyait plus. « Colonne à distance entière, face à gauche ! » On était chargé par des chevau-légers tout verts, puis par des uhlans tout rouges. Dans les moments de répit on tirait de sa poche un morceau de pain de munition… Le sabbat reprenait à croire que s’écroulaient ciel et terre… Lui sans s’étonner resta juché dans son branchage tant que l’affaire dura. De là-haut il déchirait la cartouche et faisait feu sur l’Autrichien comme il eût fait au pays sur un lièvre. À la fin les Français eurent la journée. On lui cria de descendre, mais point de nouvelles. Il fallut lui corner et recorner que tout était fini, bien fini, archi-fini, qu’on était vainqueur : alors il se décida à dévaler de son arbre.
— Co i ma co, na batalho ? N’en tournaren be fare ! « C’est que ça, une bataille ? On en fera bien d’autres ! »
Il n’en manquait pas qui s’en donnaient comme une chèvre dans un pré. Ce n’a pas grand’chose de beau, la guerre. Mais au combat, ceux-là pétaient du feu et faisaient rage sur les pandours, les kaiserlicks et le diable.
En attendant, les gas qui étaient tombés au sort avaient plutôt triste mine. Qu’on imagine ce que c’était, tirer un mauvais numéro ! Sept ans loin du pays, de la vie et de tout. Une désolation dans les familles, un vrai malheur. La chanson le dit, du conscrit qui veut cacher sa malechance à sa tendre amie, mais la fait savoir à sa parenté :
Si ma mie vient demander
L’numéro que j’ai porté,
Vous lui direz qu’son amant,
Que son amant, que son amant,
Ah, ah, ah ! que son amant
A tiré l’numéro cent.
Si ma tant’vient demander
L’numéro que j’ai porté
Vous lui direz qu’son neveu
Que son neveu, que son neveu,
Ah, ah, ah ! que son neveu
A tiré l’numéro deux.
Beaucoup donc tentaient par tous les moyens de ne pas partir. Certains se disaient sourds ou se prétendaient fous. D’autres, plus malins, usaient de cent tours de maquignon : comme de se faire piquer les jambes par les abeilles, puis de se les frotter à l’eau-de-vie et de marcher toute une nuit pour paraître avoir des varices.
À cette époque, des réfractaires commençaient de chercher une retraite dans les forêts de Pierre-sur-Haute et de l’Ermitage, ainsi que jadis les margandiers de Mandrin. Des gens connaissant bien la contrée pouvaient sur ces crêtes d’où l’on a tant de vue se moquer des gendarmes. Les paysans leur apportaient dans les cachettes des rochers des tourtes de pain, un peu de lard ou de fromage, et les avertissaient de tous les mouvements de la troupe.
On avait là-haut la vie dure. Mais quand on entendait avant tout demeurer au pays…
DEUXIÈME PAUSE
Le damné de Sauret-Besserve. – Le dîner des conscrits. – Leur départ. – D’avance, pour avoir bonne main au beau jour du tirage, nombre de garçons visitaient des sorciers qui prétendaient donner des charmes, – donner ? entendez vendre, et bien cher. Le Vacher chez Dubois, de Gioux, était fameux dans les cantons de Pontgibaud et Rochefort-Montagne.
À Sauret-Besserve, qui est un assez gros village sur la Sioule, les jeunes gens avaient coutume d’aller en bande « se faire consulter » chez le sorcier. En bande, mais ni plus ni moins de treize ; et on s’arrangeait pour qu’il y eût dans la cour douze dindes et un dindon. Les treize garçons passaient devant le sorcier en tirant chacun un numéro. Qui en attrapait un bon serait heureux sur terre…
Cependant, sur les treize, d’obligation se trouvait un damné. Pour le connaître, – c’était là l’affreux, – le sorcier les faisait ranger tous dans sa cour. Les douze dindes alors de faire la roue ; et tout d’un coup le dindon sautait après l’un des drôles pour lui mordre le petit doigt. Le pauvre misérable en était si désespéré qu’il se sauvait dans les bois et souvent devenait fou.
Cette année-là, le prétendu damné, hors de sens, détala vers la forêt et grimpa se blottir dans un fayard. À peine y était-il qu’il sauta à terre, et se figurant les gendarmes à sa poursuite, – vous connaissez le mot du pays : il se serait caché dans un four, – il s’enfuit en effet chez un boulanger et le supplia de lui ouvrir son four quelque chaud qu’il fût. « Mais, malheureux, tu t’y cuiras, je ne viens que de sortir le pain ! » Rien n’y put. Ce garçon s’y enfonce. Dans le moment il en ressort, file vers les rochers de la Sioule, monte à la cime du plus haut, toujours comme s’il était pourchassé, et de là se précipite dans la rivière.
Son bonnet, – il était coiffé d’un bonnet de laine rouge, – flotta sur l’eau, puis s’enfonça aussi.
On dit qu’à la place où ce garçon se perdit poussa un buisson que montrent les gens de Sauret-Besserve.
Gaspard ne donnait guère dans ces diableries-là. Le départ, d’ailleurs, fut soudain. Il restait cinq jours du dimanche au jeudi. Après la messe, le Barthaut, qui venait d’apprendre la nouvelle, entra dans la cour de l’auberge pour donner le bonjour au garçon. Souriant timidement, comme un homme qui ne sait à quoi s’attendre, il lui demanda s’il avait graissé ses bottes. Il le regardait par-dessus ses besicles en tortillant la queue de rat de sa tabatière.
— Ah ! mon pauvre oncle ! mes bottes, à moi, sont toujours graissées… Oui, c’est jeudi qu’on prend son chemin par bout. À condition d’être encore d’aplomb sur ses jambes… Mais n’est-ce pas qu’il faut aller voir un peu le train de ce monde dans les empires et les royaumes ?... Prenez garde, vous laissez tomber votre tabac.
Il le quitta pour aller faire de l’eau contre le mur de l’écurie.
Gaspard devait partir avec les camarades : Plampougnis, – Jeuselou, de petit tempérament, était exempté, – Cadet Marcepoil, Pierre Ampeau, d’autres encore et le pauvre François Delolme qu’un boulet de canon coupa en deux aux champs de Lutzen.
Sans parler de son ami Valentin Verdier, Gaspard avait déjà deux frères au régiment : Benoni Corps-de-Bœuf et le dragon Baptiste, qui s’était engagé pour sept ans le lendemain d’un dimanche des brandons : parce que sa mère n’avait pas voulu, ce dimanche-là, lui faire des « soupes dorées », comme c’est la coutume des bons chrétiens. Il entra donc aux dragons et tâta plus souvent des soupes aux coups de sabre que de ces tranches de pain trempées dans du jaune d’œuf et frites à la poêle. Mais quoi ? il l’avait voulu et n’allait pas geindre devant le vin tiré !
Puis c’est belle chose à un jeune homme de faire quelques vaillances au temps de sa jeunesse.
Ce dimanche, donc, ils dînèrent, tous les conscrits, à l’auberge, pour le plaisir de manger une poitrine de veau farcie et de chopiner une dernière fois ensemble. Débauche bien permise, quand il y a des chances pour qu’on aille, chacun de son côté, se faire esquinter le tempérament.
Le chapeau en bataille, criant, s’appelant, déjà un peu partis, ils avaient monté l’escalier sombre qui sentait la futaille et la cuisine. Et ils s’asseyaient, sur les bancs de chaque côté de la longue table, tirant tout de suite leur couteau de leur poche pour l’aiguiser contre la fourchette de fer. La salle était grande, grande, avec un lit à courtines de serge et un tas de fagots dans un coin. Elle leur rappelait d’anciennes bombances, des noces, les fêtes du bourg. Alors, entre les plats, lourds et bondissants, bras ballants le long du corps, de biais, comme un faucheur, ils dansaient à quatre la bourrée. Sans parler, ils avançaient, reculaient, s’entre-croisaient, tandis que les autres chantaient en battant des mains. Et les coups de talon, qui, quand il le fallait, roulaient menu comme baguettes sur tambour, sonnant au plancher, ébranlaient l’auberge. Dans la poussière, la vieille salle toute de bois tanné, semblait chavirer comme un homme saoul. Puis on entendait à nouveau des chiens faire craquer des os sous les tables.
Sans doute qu’ils pendirent aux solives des bouteilles enguirlandées des rubans du tirage, pour les vider entre camarades quand on se retrouverait au pays, comme font encore les conscrits d’Auvergne. Tant y a qu’on cassa bien la croûte. Et des chansons à fendre la muraille ! À la fin, chacun but six coups de chaque main et l’on se donna rendez-vous au jeudi ensuivant. Ils devaient descendre tous à Ambert, d’où un sergent les emmènerait vers leurs dépôts.
Le soir, Gaspard, Plampougnis, Jeuselou et deux de leurs amis disparurent. Dès le lendemain on commença de chuchoter. On disait qu’ils s’étaient donné leur congé eux-mêmes, marqué sur la semelle de leurs souliers ; que la force armée viendrait loger chez leurs parents jusqu’à ce qu’ils se fussent rendus soldats. Un voiturier les avait vus du côté de Saint-Vert… Mais pourquoi Jeuselou les avait-il suivis ? La Marguerite du moulin de Martial était tellement dans l’ennui qu’elle en prenait les pâles couleurs…
Puis le mercredi, au coucher du soleil, ils reparurent, une brindille d’herbe à la bouche. Ils étaient tout gris de poussière, et traînaient quelque peu le soulier, mais au demeurant sains comme l’œil. Ils se contentèrent de lever l’épaule en apprenant les bavardages du bourg.
Le jeudi arrivé, les adieux se firent non sans force pleurs, souhaits et embrassades. Cette belle et leste jeunesse voulait prendre les choses bravement ; mais plus d’un se sentit plein de larmes quand sa jolie amie lui roula les bras autour du cou pour l’embrasser une dernière fois.
Ils se mirent en route à la tombée de la nuit. Leur parenté les accompagna jusqu’à la sortie du bourg ; et puis il fallut se séparer. Les recrues, leur baluchon sur l’épaule dans un mouchoir à carreaux, montèrent vers le bois des Fourches.
La plupart étaient en sabots, avec des chemises de chanvre roux sous leurs épaisses vestes mangées des pluies et du soleil. Et voyez ! c’étaient les plus pauvres, ceux qui n’avaient ni bissac ni gourde, les plus paysans, ceux dont les longs cheveux noirs retombaient jusque sur les collets crasseux, qui paraissaient le plus regretter le pays. Mais d’autres, des garçons à souliers et à linge de grosse toile, avaient aussi les yeux rouges et ne marchaient qu’à contrecœur. Tous les dix pas, celui-ci, celui-là, se retournait pour regarder les cousines sur la route entre ces dernières vieilles maisons délabrées, ou bien les fumées des toits et le clocher de la paroisse. La bise soufflait frisquette sous un ciel gris de brouillards passant.
Ils ne parlaient guère encore. Gaspard fit halte :
— J’ai bien oublié d’aller prendre les deux écus de la Toinon des Chapioux. C’est pour les remettre à son garçon qui tient garnison là où est mon dépôt, à Mayence, département du Mont-Tonnerre. J’ai promis, c’est promis. Passez premiers, chers camarades, je vous rattraperai par la traverse.
TROISIÈME PAUSE
Le bois des Fourches. – Les endroits défortunés. – La fontaine de Malagoût. – Quand Gaspard remontant des Chapioux à travers prés arriva au haut de la côte, la troupe se trouvait hors de vue. La nuit d’ailleurs était tombée. « Je vais couper tout droit en pressant le pas. » Et sans plus y penser il est entré sous les arbres.
Le bois des Fourches porte ce nom peut-être simplement parce qu’il est à la fourche des routes, entre trois chemins : le grand chemin, celui qui en part pour monter à Fournols, et celui qui coupant les deux autres va des Escures au bourg de Saint-Amand.
Ou peut-être, comme les vieux l’attestent, parce que là se trouvaient les fourches de justice, les potences où les seigneurs de Roche-Savine faisaient pendre le monde dont le nez leur déplaisait. (On les a démolies à la grande révolution et on en a même porté les pierres au bourg.)
Il n’importe. Le point, c’est que le bois des Fourches, – où du reste on arrêtait parfois à main armée, – avait une réputation fort maléfique. On en pouvait conter ce qu’on conte de quelque autre forêt en mauvaise odeur dans la montagne : qu’un jour le diable se promenant par là avec le vent son compère pour lui tenir compagnie, « j’ai, dit le diable, affaire céans ; tandis que j’y vaque, demeure ici à m’attendre ». Et il entra dans le bois. Depuis il n’en est plus sorti et le vent continue de faire son métier de vent tout à l’entour.
Il le fait en cet endroit, souffle que souffleras-tu ! et même le Guillaume de Montfanon, – mais c’était un farceur, – voulait que le bois eût pris son nom de ce que le vent s’y démène toujours de façon à relever les jupes et à faire voir les jambes jusqu’à la fourche.
Tant y a que ceux qui s’y étaient aventurés de nuit avaient vu de loin briller une lumière, et, chose plus singulière, une lumière qui changeait à tout moment de couleur, maintenant bleue, maintenant verte, maintenant jaune…
La Dorothée en faisait de grands contes. Et certain soir que Grange accompagnait Barthaut jusqu’au grand chemin après une veillée, ils avaient parfaitement vu tous deux cette fameuse lumière à travers les arbres. Ce dicton courait donc qu’il ne fallait pas aller aux noces sans couteau, ni passer devant le bois des Fourches sans porte-respect. On aurait cherché le détour à deux heures de marche plutôt que de traverser ce méchant coin.
Il est des endroits de maléfice où, comme si le lieu le portait, arrivent de tristes accidents. Il semble que de mauvais esprits s’occupent là à guetter leur avantage. Le monde de campagne a toujours tenu cela pour certain et évité ces endroits qu’on dit défortunés. « Co ne vau re de passa per ati », ça ne vaut rien de passer par là, font les vieux dans les veillées en branlant le front.
Les gens de Thiolières n’ont aucune joie à se trouver la nuit près de la fontaine d’Acelu, ou sur le pont du torrent vers Picquolagne. De l’autre côté de la vallée, non loin des sapins et des antiques tours rondes du Bouchet, c’est le vallon de Rochelie où, à minuit, on court fortune de voir le pied-fourchu. On parle aussi de certaines pierres de la montagne entre Valcivières et Saint-Anthème : Le Pialou, la Pierre Basane, une singulière roche noire, toute seule sur ces pâturages battus des vents… Mais je n’ai jamais eu la curiosité d’aller faire un tour dans ces quartiers-là…
Dans le Forez est en renom une fontaine qu’on nomme la fontaine de Malagoût.
Un soir de dimanche, à l’auberge, comme un garçon faisait le fendant, quelque buveur lui dit avec un clin d’yeux : « Oui, oui, je gage que tu n’irais pas là-bas crier trois fois de suite : Je suis à la fontaine de Malagoût ! – Moi ? que gages-tu ? – Gageons bouteille. – Eh bien commençons par la boire, nous verrons qui la paiera ! » On tope, on trinque ; puis le vantard se met debout, serre sa ceinture, plante son chapeau sur l’oreille. L’hôtesse le tira vers la muraille : « Tu ferais mieux de payer la bouteille et de te tenir en repos. Mais si tu veux y aller, emporte au moins le chat noir sous ta veste ! » Pour que le mauvais passe d’abord sa rage sur la bête, comme le savent bien ceux qui vont appeler le diable au carrefour.
C’était une nuit de tourmente où tous les vents se battaient, tandis que les nuées filaient dans le noir par le milieu de l’air. Le garçon ne vit quoi que ce fût auprès de la fontaine. Seulement, quand il eut crié trois fois, il entendit une voix, venue de sous terre, ou d’en haut parmi l’ombre, lui crier à son tour : « Sans ton confrère chat, je te tiendrais compagnie à la fontaine de Malagoût ! »
Il n’en fut rien de plus, et le gars s’en revint à l’auberge. Mais, comme s’il avait eu les sangs tournés, il tomba mort sur le pas même de la porte.
On ne sait point tout ce qu’il y a. Et le plus simple de beaucoup est d’éviter ces endroits défortunés. À la fin chacun, par coutume, prend la détourne.
C’était sans y songer, dans son désir de couper au plus court, que Gaspard était entré dans le bois des Fourches. Il avait enjambé le fossé et escaladé le talus quand la chose lui revint à l’esprit. Ma foi, il aurait tout autant aimé se trouver sur la chaussée, oui, d’aplomb dans ses souliers et prêt à voir venir… Lorsque, ayant tant et tant entendu conter de faits étranges, on a toujours vu les gens se comporter selon les enseignements de ces histoires, il faut avoir la tête bien solide pour agir autrement que tout le monde.
— Qu’est-ce que tu feras, maintenant ? Allons, ça va bien. Si le diable veut t’avaler, tu te mettras en travers.
Gaspard avait senti qu’il y aurait de la lâcheté à sortir du bois. Et pourquoi ne viendrait-il pas à bout, si quelque sinistre créature rôdait par là, d’en désengeancer le lieu ? L’idée s’enfonçait dans son crâne d’Auvergnat. Ses amis et lui s’étaient plus inquiétés des mauvaises gens que des endroits défortunés. Précisément c’était chose à voir. Quand il lui faudrait patrouiller partout, et y demeurer la nuit entière, il saurait le fin mot de la diablerie.
Il ouvrit son couteau et le laissa tout ouvert dans la poche de sa veste. Puis remontant des deux mains ses brayes, il se mit à rire en murmurant pour soi : Sés un lapien subre le terrain ! Je suis un lapin sur le terrain ! mot qu’un vieil oncle surnommé le Lapienchou, avait si souvent en bouche que cela lui valait son sobriquet.
Un autre ne se fût pas senti trop à l’aise. Pas un bruit en ce coin désert ; puis tout soudain, faisant croire au pistolet qu’arme un homme en embuscade, le craquement d’une pomme de pin qui s’ouvre. Ou bien l’appel d’un grand-duc – ho, ho, ho ! – tel qu’on se retourne, prêt à jurer que quelqu’un vous hèle. Ou bien encore un froissis dans les genêts, comme si des brigands tapis les écartaient pour sortir. Ce silence traître des bois qui semble toujours sur le point d’éclater en un terrifiant vacarme… Le désordre des roches et des broussailles dans le noir, et les caprices de ces sentiers de hasard sous les branches tortes…
Mais Gaspard serrait à plein poing son bâton, un joli pied d’alisier, souple, nerveux, noueux, bien en main, et il ne se sentait pas froid au cœur.
QUATRIÈME PAUSE
La lumière qui changeait de couleur. – La confession du Bourreau des Chèvres. – Assez loin à travers les arbres, il aperçut une lumière blanche, puis jaune, puis bleue…
Il s’arrêta, attacha son baluchon en bandoulière, de façon à n’être point gêné aux entournures, et marcha droit sur la chose.
Là-bas la lumière changeait de couleur cinq, six fois en une minute ; c’était en vérité plutôt étrange. Gaspard maintenant rampait sur la mousse, et un aussi fin chasseur n’avait pas grand’peine à avancer sans se démasquer ni se faire entendre.
Tout à coup il se releva, se lança comme un loup. Avant que l’autre eût seulement bougé, il tombait sur les épaules d’un homme allongé là tel qu’un moissonneur faisant la méridienne. Au mitan d’une place ronde, la place toute d’aiguilles rousses d’un fagotier, ce particulier, le bras en l’air, levait une lanterne à verres de couleur, et comme font, font, font, les petites marionnettes, la faisait tourner de droite, de gauche, de gauche, de droite…
De surprise, quand Gaspard s’abat sur lui, le voilà qui crie comme un blaireau, lâche son luminaire, qui s’éteint, et tâche à se dégager. Mais il n’était pas de taille ; tout de suite il comprit qu’il ne tenait pas le bon bout.
La lanterne avait roulé par terre. Gaspard battit du feu et ralluma la chandelle, pensant qu’on en serait mieux pour causer. Il avait déjà reconnu un certain Mathieu Jaladis, dit le Breléqué, dit le Bourreau des Chèvres, qui était quelque peu boucher et tenait un petit cabaret dans le bourg. Ce Breléqué avait quatre enfants sur les bras et peut-être pas autant de pistoles en bourse. Il ne passait point pour plus mauvais qu’un autre : la face longue, couleur de rave, le poil rare, – quelques crins noirs tombant de chaque côté de la bouche rejoindre une pauvre barbe, – c’était un grand, maigre comme un coucou, qu’on voyait sur sa porte, les mains aux poches, avec un air de chien battu.
— Bien le bonsoir, Breléqué, dit Gaspard le tenant toujours sous lui. Alors, tu te donnes tes jolis passe-temps dans ce bois ? Mais tu te morfondras à prendre le frais au serein ?
L’autre soufflait comme un âne sur sa fin. Et tellement attrapé qu’il ne savait que répondre. Ayant reconnu le garçon à sa voix, il se remit pourtant un peu.
— Écoute, marmonna-t-il, écoute, Gaspard, tu aurais tort de te mêler de la chose. Passe ton chemin, tiens, et n’en lâche pas mot. Ce que je fais, je le fais pour d’autres. Moi je ne suis rien, mais il y en a qui me font marcher.
— Ha ! dit Gaspard, c’est par là que le vent souffle ? À Champétières, on nous a déjà chanté quelque couplet de cette chanson. Va toujours, si ce n’est que la crainte de me voir arriver du malheur qui t’arrête.
Le Breléqué, à l’ouïr parler si paisiblement, crut que Gaspard saignait déjà du nez. Il en prit avantage et força le ton.
— Relève-toi, mon garçon, allons, vite. Laisse-moi à mon travail. Je vais te dire pour ta gouverne : il t’en cuirait d’ici peu.
De fait, Gaspard se releva, mais ce fut pour empoigner le Breléqué par un bras et le mettre sur pied en le secouant comme un prunier.
— Tu viens de parler plutôt à ta perte qu’à ton profit, mon brave porte-falot ! Voyez le pénitent et s’il ne ferait pas bien avec sa belle lanterne à la procession du Jeudi-Saint ! Mais tu t’en es assez moqué, de la procession. Ah ! tu veux continuer à en faire voir au monde de toutes les couleurs dans le bois des Fourches ? Oui, je vais te laisser à ton travail, comme tu dis si gentiment !
Gaspard se montait en parlant, car il se sentait des bouillons de la jeunesse. La face lui flambait de fine fureur. Peu s’en fallut que sans autre discours il n’époussetât de sa trique le dos du Bourreau des Chèvres.
— Mais qu’est-ce que tu fais là, galapiat, qu’est-ce que tu fabriques ? Et qu’est-ce qui me retient de te tricoter les côtes ? Appelle tes camarades, s’ils sont dans ces quartiers. Je les crains comme l’hiver d’antan.
Le malheureux Breléqué tremblait plus qu’un criminel. Il s’assit par terre, ses jambes manquant sous lui ; et Gaspard s’assit aussi, son gourdin en travers des genoux.
— Pour t’ouvrir les idées, regarde un peu ce bâton. Il faut tout résolument que tu me dises et ce que tu trafiques ici, et qui t’a obligé d’y faire ce commerce.
Baissant le ton comme si quelqu’un dans le voisinage avait pu l’entendre, le Breléqué ne parlait qu’à contre-cœur d’abord.
Un soir qu’il revenait d’Ambert, le soir de la foire du Mercredi-Saint, l’autre année, il avait été arrêté par trois hommes. Ou plutôt c’était lui, qui, ayant bu, s’était jeté dans leurs jambes à l’entrée du bois des Fourches. Le plus vieux, qui avait un carrick à trois collets, voulait le tuer. Mais un autre avait pris ce vieux par l’épaule en lui disant : « Non, il est du bourg, écoute… » Finalement, lui qui n’avait plus une goutte de sang dans les veines, s’était vu laisser la vie à une condition : celle de venir faire dans le bois cette manigance de la lanterne. Et il eut à le jurer en étendant la main sur deux couteaux mis en croix.
— J’aurais juré ce qu’ils m’auraient demandé, pauvre Gaspard. J’avais le canon d’un pistolet sous l’oreille, et il fallait voir les yeux de ceux qui me parlaient…
La chose à la longue lui avait pourtant semblé trop ingrate. Aux entours de Notre-Dame d’août, lui et les siens étaient allés s’établir à Ambert. Il avait ouvert un cabaret au tournant de la rue des Chazeaux, dans une maison où l’on descendait par trois marches.
Une semaine après, comme il allait fermer, sur les neuf heures, il vit entrer trois hommes…
Le Breléqué, phrase à phrase se lâchait un peu. Il dépeignait de son mieux ceux à qui il avait eu affaire.
Ces trois donc étaient d’abordée tombés sur lui pour lui ficeler pieds et mains devant sa femme et ses enfants. Puis ils l’avaient couché sur une des tables et lui avaient piqué le couteau sur la gorge. Ils disaient qu’il s’était lui-même condamné à la mort par son serment et qu’on allait le saigner, lui prendre le sang comme à un cochon.
Et ils avaient traîné là un baquet trouvé dans la cuisine.
La femme avait voulu se jeter dehors en criant et un autre homme était entré, qui devait faire le guet dans la rue. Un tumulte étouffé, une confusion, une bousculade… Un des petits poussant les hauts cris, le monsieur l’avait envoyé d’un coup de pied rouler dans la souillarde.
Lui, Jaladis, avait retrouvé tout juste assez de voix pour demander de grands pardons, avec tant de supplications, de promesses, que le bourgeois lui avait accordé sa grâce. Mais pour qu’il eût ses raisons de garder la chose en mémoire, comme ils dirent, ils le rouèrent de coups de plat de sabre et ne le laissèrent qu’en lui adressant les menaces les plus terribles. S’il ne retournait point à Saint-Amand et ne reprenait pas son trafic dans le bois, la mort sans rémission.
Le malheureux ne racontait son histoire qu’en jetant sans cesse le regard par-dessus son épaule. On eût dit qu’il s’attendait à voir surgir le monsieur prêt à l’égorger.
— Allons, il ne faut pas que les boyaux te gargouillent. Et tu passais les nuits ici, à ce travail ?
— Non… Je pendais la lanterne à une branche… Je laissais assez de chandelle pour qu’elle brûlât jusqu’au jour. Ils m’avaient promis une somme, ils ne m’ont jamais rien donné…
— Je ne sais ce qui me retient d’aller publier partout l’histoire à ton infamie, dit Gaspard. Si, je le sais : c’est la pensée de tes enfants. Écoute, ce soir je conterai à Ambert ce que j’ai vu dans le bois des Fourches, sans toutefois te nommer en considération de tes petits. Maintenant, je suis gentil, bon garçon et tout ça, mais si jamais la diablerie recommence, nous aurons un mot à nous dire, nous deux. D’ailleurs j’écrirai ton nom en toutes lettres à un ami pour qu’il t’ait à l’œil.
— Alors je te remercie, Gaspard, fit tristement le Breléqué. Seulement, vois-tu, que tu me nommes ou non… Si tu crois que je peux rester dans le pays, à présent, tu n’as guère idée de ceux à qui j’ai affaire. Pour qu’il m’en prenne comme à Carcaille… Il y a sûrement des bourgeois, deux, trois, peut-être plus ; je jure sur mon salut que si j’en savais davantage, leurs enseignes, leurs noms, je te le dirais. Depuis longtemps l’idée de partir me travaille. J’irai chiffonnier dans la Bourgogne. Chiffonnier, c’est une partie ou mes petits pourront m’aider. Je rentre, on fait le paquet, et avant le jour on met la clef sous la porte.
CINQUIÈME PAUSE
Les brigands et leurs desseins. – La Pierre-Couverte. – M. Maignet, un des quatre maîtres de la France. Lorsque Gaspard se retrouva sur la route, un grand moment avait passé, comme il le connut aux étoiles. Il n’y avait plus d’espoir qu’il rejoignît les camarades. Mais il préférait marcher seul pour rêver à tout cela.
Les particuliers du bois, pardi, c’étaient eux, ceux de Chenerailles. On sait bien que souvent des personnes tâchent de donner mauvais renom à une maison ou à un coin de terre, afin de l’avoir à meilleur compte. Gaspard avait entendu narrer de semblables histoires, avec des manigances aussi enfantines, des tours aussi extravagants que celui de la lanterne à vitres de couleur. Seulement les canailles n’avaient pas monté ce coup pour acheter le bois des Fourches : pour en faire leur repaire, oui, d’où commander les routes et surtout le domaine des Escures… Avoir tyrannisé ce Jaladis de façon si infâme !… Il eût fait fièrement bon s’en mêler, achever de comprendre les affaires, puis, tonnerre de Dieu ! leur renfoncer leurs desseins dans le ventre.
Le sang lui bouillait encore, et il allait grand train, avec une sorte de fureur, sur la route où ses souliers ferrés arrachaient aux cailloux des étincelles. Tant de choses apprises dans ses courses s’éclairaient l’une par l’autre, se rejoignaient en cette minute où les idées couraient dans sa cervelle comme une rivière débordée. Dire que trois semaines encore, et lui, Gaspard, savait tout ! S’il avait seulement pu lire la réponse de l’Américain…
Il fallait partir. Heureusement il partait l’esprit en repos. Dans les auberges, en passant la main sous le menton des servantes et en buvant et gaudissant pour faire dire de soi qu’on est étourdi comme le premier coup de matines, on vient à bout d’apprendre bien des choses. Gaspard avait des accointances notamment en un certain cabaret près de Brioude : il y avait découvert le rendez-vous de la bande dans une forêt pour le lundi. Cette fois on avait cru pouvoir enfin parler du pays aux messieurs des bois et à leur troupe. Eh bien, au dernier moment le rendez-vous avait été contremandé, – de sorte que les amis avaient fait là-bas voyage blanc. Le monsieur venait de partir brusquement, sans doute pour avoir reçu des Îles quelques nouvelles concernant Jérôme Grange. Et par un certain colporteur il avait fait avertir ses fantassins d’avoir à le rejoindre sur les routes du Languedoc.
Tant pis, et tant mieux, car du moins Gaspard savait à n’en pouvoir douter qu’ils étaient tous allés à d’autres besognes.
Désormais ce serait à l’Américain de se tenir en garde. Tant que les garçons de Saint-Amand avaient demeuré là, les brigands qui, du bois des Fourches, avaient sûrement eu dessein de préparer les pires attentats, ne s’y étaient même pas frottés.
Cependant il fallait partir, pour ne revenir qu’à Pâques ou à la Trinité. Quand reverra-t-on ce grand chemin aux sorbiers pleins de grappes rouges, ces fontaines fluant devant les fermes de granit sombre où l’on entend remuer des chaînes dans l’étable ? Le chien glisse son museau sous la porte pour aboyer parce que quelqu’un passe…
Le vent sent les fagotiers de pin mouillés, les feux d’herbes, les fougères d’automne. On le respire avec un sentiment étrange, comme si l’on se trouvait déjà hors de la montagne. Les Escures sont loin derrière, maintenant, au haut bout de ce vallon qui s’enfonce suivant la route. Sous la dévalée des prés, dans les ombrages noirs des vergnes, leur ruisseau fait son bruit, fait son bruit…
Le garçon était arrivé à Pierre-Couverte, un énorme pan de pierre brute sur quatre autres au milieu d’une jachère d’herbes folles et de clochettes bleues. On dit que la Sainte-Vierge bâtit elle-même cette chapelle un jour de tourmente, pour allaiter le petit Jésus. Elle portait une pierre dans chaque poche de son devantier et la grosse comme une tourte sur sa tête. Toujours est-il que comme on essayait une fois de démolir cet assemblage, il fallut bien y renoncer tant il tomba de grêle et de foudre.
On dit assez de choses : que la pierre pèse sur un crapaud qui de son dos toutes les nuits la soulève…
Gaspard en passant se rappelait ce conte, et il se sentait sur le cœur une masse plus lourde que la Pierre-Couverte même…
Il pâlit soudain comme un alisier dont le vent retourne la feuille. La menace, la menace du brigand, voilà ce qu’il oubliait trop. Anne-Marie qui avait entendu ce cri ne s’en souvenait pas sans terreur. L’accent lui en était resté dans l’oreille. Le monsieur avait pour l’instant d’autres affaires à suivre dans les Îles. Bon. Mais un jour il reviendrait se venger. Quand ce ne serait que pour imposer, pour son monde.
Que l’autre vînt à bout de dépouiller l’Américain, ce qui serait en somme dépouiller les Grange, Gaspard ne s’en inquiétait guère : Anne-Marie n’avait pas tellement besoin d’être riche. Mais cela…
Qui garderait maintenant la petite ? Ah Dieu ! ne pouvoir demeurer ici son cousin tout de bon, celui qui l’eût toujours assistée sûrement.
Le vieux prêtre de Marsac, autrement avisé et éclairé que Grange, ne laisserait pas Anne-Marie s’engager en quelque fatale embûche. Seulement, il était si vieux…
Du pauvre Barthaut, rien à attendre. Restait Jeuselou, de petite santé, ce mange-raves de Limagne, et trois jours sur quatre envolé dans ses songeries. N’importe : on pouvait s’assurer sur son courage. Gaspard en avait parlé à la petite : « Comptez sur Jeuselou, je vous le donne comme bon. »
C’était à lui que le gars écrirait, ainsi qu’il l’avait déclaré au Breléqué, l’histoire du bois des Fourches. Il écrirait bien aussi aux juges, mais ce ne servirait de grand’chose, si ce n’était à brouiller du papier. Car, à supposer qu’ils ne fussent pas compères et compagnie, ces bourgeois de la justice et les messieurs des bois devaient se tenir par les alliances de famille. On savait trop comment tout roulait en une petite ville écartée telle qu’Ambert.
Du Grand-Tournant, on commence de découvrir la vallée depuis les hauteurs de la Chaise-Dieu à main droite jusqu’à celles de Thiers à main gauche. Gaspard avait enfilé le raccourci longeant le domaine du fameux Maignet, Maignet qui fut un moment, disaient les gens, avec Robespierre, Couthon et Javogues, un des quatre maîtres de la France. Maignet, la terreur du Midi, qui fit guillotiner on ne sait combien de femmes et de prêtres à Orange ; qui fit brûler et raser la ville de Bédoin, en massacrant les habitants, simplement parce que des inconnus y avaient jeté bas l’arbre de la Liberté. Et il assistait aux fusillades, empanaché de tricolore, tandis que la déesse Raison et ses suivantes farandolaient devant lui.
Dans ces quartiers, vers Marseille, il ne ferait pas bon pour un voyageur dire qu’il est du pays de cet homme de sang : on le prendrait à coups de pierres.
M. Maignet avait là, à Meydat, sa métairie et sa maison des champs. Celle-ci était crépie de rouge, ce qui impressionnait, et on la disait peinte à l’intérieur de guillotines. Au vrai, ces peintures en blanc et gris aux cloisons des chambres rustiques, c’était, suivant la mode de l’Empire, des déesses des Romains, moitié bornes moitié femmes, portant sur leurs têtes des corbeilles d’épis et de grappes. Mais le monde aime embellir les choses.
Gaspard regardait ce carré de bâtiments sur un replain où les noyers gros comme des meules jetaient de l’ombre et de la fraîcheur. Le pavillon avait un méridien, un cadran solaire ; des degrés de pierre moulurée menaient au jardin bouquetier orné de buis en boule sous les arbres à fruits. Quelle paix là, les soirs, quand la campagne embaume les fenaisons de la Saint-Jean, devant cette grande vallée de prairies, de chênaies et d’eaux courantes, alors qu’en face les montagnes du Forez s’allongent têtes arquées et courbes échines, comme des vaches au pâturage… Une fois, M. Maignet, en pantalon de molleton blanc, vêtu d’une redingote vert-bouteille un peu usée qu’il ne devait plus mettre qu’à Meydat, était assis près du portail à lire un petit livre. Ses deux demoiselles jouaient aux grâces sur le coudert.
Pour être allé à la foire de Beaucaire, Gaspard savait les horreurs et cruautés à quoi Maignet s’était livré là-bas. Or cet homme tombé naguère dans de si grands crimes, était maintenant considéré, riche, maire de la ville, à tu et à toi avec tous les matadors, presque aussi bien vu des blancs que des rouges. Et voilà le train de ce monde.
Le bourgeois d’Ambert avait tué le pauvre Carcaille et échappait à la justice. Si les messieurs des bois avaient la précaution de ne pas inquiéter les gens tout en se ménageant des amitiés, ils étaient maîtres de la campagne et n’avaient plus qu’à courir. La loi, c’était la police et les juges, c’est-à-dire pour eux des particuliers de leur bord. Il n’y a pas de justice en ce monde. Mais on en sent terriblement le besoin dans son cœur.
SIXIÈME PAUSE
Le pays. – Le changement. – Le cœur que Gaspard se sentait ce soir-là. – Soudain la lune se haussa sur les monts à la crête d’une longue lande. Nue et luisante à merveille, elle montait, au-dessus des cimes de gazon, d’un argent tel, si pur, si net d’éclat, qu’elle réjouissait tout l’être ainsi qu’une fontaine dans les chaleurs de l’été.
Sous ce lait de lumière les traits de la campagne apparurent, comme ceux d’une jeune paysanne, lorsqu’elle relève sur sa coiffe blanche le voile de deuil qui lui tombait devant la face.
Dans la vallée, la vieille petite ville serrait ses toits autour de son clocher carré et ouvragé. Des chemins bordés de buissons s’en allaient à travers les landes, leurs montées, leurs descentes, vers des métairies cachées parmi la feuille. Les tournants d’eau de la Dore miraillaient sous leurs grands chênes. On voyait tous les creux, tous les renflements des côtes : les villages égrenés au pied de la montagne, chacun au débouché d’une combe ; les hameaux de sombre pierraille, à auvents et balcons de bois haut accrochés aux pentes sous les forêts en quartiers d’ombre, les hameaux anciens où le vent miaule autour des masures crevées et des escaliers de granit pleins d’herbe, ruinant les parapets des tristes petits jardins ombragés d’un cognassier noir. Et là-haut c’était en longs vallons les communaux où l’été on mène les vaches prendre du pays, les auberges trapues des cols avec leurs vues sur de pâles étendues bleues comme des fumées lointaines…
La nuit était plus fraîche qu’une source sous cette lune. On retrouvait chaque endroit dont on savait le nom, chaque chemin, les routes du roulage, les bourgs des foires et des fêtes. Ha, Gaspard n’aurait pu dire, mais toute sa vie lui revenait dans le cœur. Le pays, l’Auvergne ! Qu’était-ce qui lui gonflait là la poitrine, qui l’enlevait à lui-même, comme au matin le vent de la montagne, quand la calandre chante en l’air, au gris de la nuée entraînée, et qu’on entrevoit à vingt lieues les monts d’Or, les monts Dôme…
Il serrait son bâton dans sa main et repensait au petit pré de serpolet où, de même, un mouvement de cœur l’avait emporté et donné à sa cousine. De sa vie il n’oublierait les yeux, ces yeux châtains, qu’elle avait ce soir-là.
Et peut-être qu’il ne la reverrait jamais, jamais plus.
Mais partir, après tout ! Oui, un changement, jouer plus largement sa chance. À supposer que cette existence eût continué, qu’y aurait-il eu entre Saint-Amand et les Escures ? Quand on connaissait le Matelot…
Puis il fallait partir parce qu’il le fallait. Et tant mieux pour le changement.
Mais cette petite, si jolie et si bonne de cœur, dans quels hasards la laissait-il, elle qui serait riche peut-être à des cent milliers de francs, sous la gouverne de son jeannot de père ? Qui sait si elle n’aurait pas faute d’un ami vrai, un jour ?
Lui, il serait sur les routes de Prusse ou de Pologne, pour ne pas dire sous trois pieds de terre avec un biscaïen dans le corps. Il ne pouvait plus rien pour elle. Et si de loin il la savait malheureuse, d’autres à ses côtés qu’il ne connaîtrait pas ? Mon Dieu, ceux-là qui s’aiment et que la vie sépare…
On s’était pourtant fait une promesse, à Champétières, sous le vieux pin. Avec tant de confiance et d’ouverture, alors… Voilà la vie : sans qu’on sache comment, rien ne tient, rien ne demeure. Il était dit que cela ne se pouvait, non.
Du moins, la promesse, il l’aurait tenue. Tantôt, avant la soupe et le coucher sur les bottes de paille, il ferait encore la lettre à Jeuselou. Pour le reste, à la grâce de Dieu.
Peut-être qu’un matin, quand il faudrait, il reviendrait tout poudreux par cette même route, coiffé du bonnet militaire, son congé suspendu au côté dans un tube de fer-blanc : le soldat qui ramasse au fossé une pomme jaune, l’essuie de sa manche, y mord, et retrouve là le goût de son pays.
Ou peut-être qu’il serait mort aux champs de l’honneur. Les guerres, c’est un destin.
En tout cas l’enfance était finie : un autre temps commençait dès ce soir.
De Meydat la coursière dévale roide. Gaspard descendait par ce sentier raviné comme un torrent sans se soucier des pierres roulantes. Les lumières de la ville clignotaient là-bas au bout de ses souliers. Toutes ces idées lui montaient le courage. Une fougue l’aurait jeté à la bataille et il tenait le gourdin de biais dans sa poigne. Puisqu’il était soldat, il ferait les choses grandement : « Je me paierai sur les cosaques et les kaiserlicks. »
Cependant il se sentait le cœur si plein, si triste. Un de ces moments qu’on ne peut raconter, et qui sont sans doute les grands moments de la vie.
La pensée d’Anne-Marie lui faisait mal. C’était ce matin qu’il lui avait dit adieu. Elle était dans la salle basse assise à coudre près d’un petit bouquet de reines-marguerites et de résédas. Elle s’était levée, le plat de la main appuyé sur la table… Cette figure bien dessinée, nette de carre, qu’elle était donc douce, quel air de douceur elle gardait toujours… mais ses yeux, aussi, si parlants, si vivants…
Ils s’étaient embrassés tous deux avec un grand tremblement de cœur.
Et songeant à sa cousine il ne songeait à rien de plus.
FIN
DES ENFANCES DE GASPARD.
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Août 2022
—
— Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : Jean-Luc, FrançoiseS, MarcD, Coolmicro.
— Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
— Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l’original. Nous rappelons que c’est un travail d’amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.