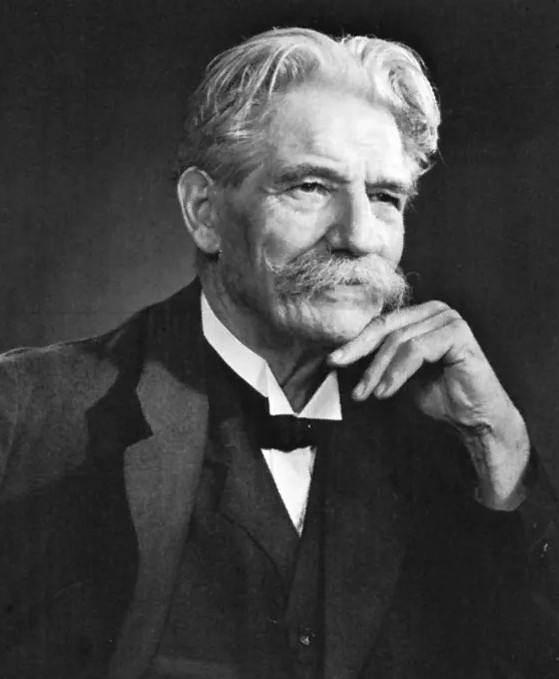
Albert Schweitzer
HISTOIRES
DE LA FORÊT VIERGE
1952
Ebooks libres et gratuits
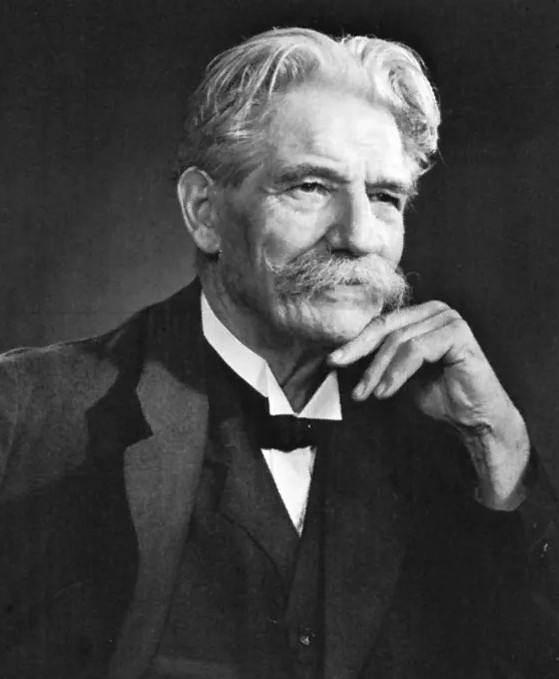
Albert Schweitzer
HISTOIRES
DE LA FORÊT VIERGE
1952
Ebooks libres et gratuits
Table des matières
I SUR LES TRACES DE TRADER HORN
III CE QUI DIFFÈRE CHEZ LES UNS ET CHEZ LES AUTRES
V L’HÔPITAL DE LA FORÊT VIERGE
VII OJEMBO, MAÎTRE D’ÉCOLE DANS LA FORÊT VIERGE
VIII REMARQUES SUR LE CARACTÈRE DES INDIGÈNES
À propos de cette édition électronique
En 1913 j’ai fondé à Lambaréné un hôpital pour apporter aux indigènes de cette région un secours médical. Lambaréné est situé au Gabon (Afrique Équatoriale Française) sur l’Ogooué qui se jette, à environ 280 kilomètres d’ici, dans l’Océan Atlantique.
L’hôpital se trouve sur un bras de l’Ogooué, au milieu de la forêt vierge qui recouvre la plus grande partie du Gabon. Elle contient beaucoup de bois d’okoumé qui constitue le principal article d’exportation de la colonie. Réunies en grands radeaux, les billes d’okoumé sont amenées sur le fleuve jusqu’à la baie de Port Gentil, où elles sont embarquées pour l’Europe.
Mon hôpital est une œuvre philanthropique. Les malades y sont soignés gratuitement. Au cours de ses 25 années d’existence, il s’est fait connaître très loin. J’ai continuellement dû ajouter de nouvelles constructions à celles qui existaient déjà. À présent, je suis en état d’hospitaliser 300 malades noirs et 20 malades blancs.
Nous sommes 4 médecins et 10 infirmières européennes, et nous suffisons à peine à la tâche. Cinq infirmières sont affectées au service médical, les cinq autres sont chargées des travaux du ménage, du jardin et de la plantation.
Dans mon livre « À l’orée de la forêt vierge » (Paris, Rieder) j’ai rapporté les événements et les impressions de mon premier séjour ici.
Lambaréné.
ALBERT SCHWEITZER.
La maison dans laquelle j’écris ces récits se dresse sur une petite colline au bord de l’Ogooué en amont de Lambaréné, appelée Adolinanongo, ce qui signifie : « Celui qui regarde par delà les tribus. » Elle mérite bien ce nom. D’ici le regard embrasse le fleuve, qui à cet endroit se divise en deux bras, et les îles vertes qu’il entoure de ses eaux. Au delà des villages qui bordent ses rives, s’étend la chaîne de montagnes bleues, que longe, en venant du Sud, son grand affluent, la N’Gounié. Sur cette large colline était situé le grand village du roi des galoas qui s’appelait N’Kombé, ce qui veut dire le soleil. En bas, sur la rive, se trouvait la factorerie de la maison anglaise Hatton et Cookson, qui jouissait alors de la protection de ce roi-soleil.
Tel était Adolinanongo vers 1874, quand la maison Hatton et Cookson envoya comme aide à Mr. Gibson, chef de la factorerie, un jeune homme de Liverpool qui avait travaillé auparavant quelque temps dans la factorerie principale de Libreville.
Retiré à la fin de ses jours à Johannesburg, cet ancien agent de la factorerie d’Adolinanongo, sur les conseils et avec l’aide de Mrs. Ethelreda Lewis, écrivain sud-africain, devait nous donner ses souvenirs de cette époque sous le pseudonyme d’Alfred Aloysius Horn. John Galsworthy, enthousiasmé par ce récit si vivant et par l’attrait des réflexions philosophiques qui l’accompagnaient, écrivit la préface du livre, qui devint bientôt célèbre[1].
Dans sa jeunesse, Trader Horn habitait donc à l’endroit même où s’élève aujourd’hui mon hôpital. C’est d’Adolinanongo qu’il partait pour ses expéditions. C’est ici qu’il se querellait avec son chef, Mr. Gibson, auquel il reprochait son manque d’initiative, et c’est encore ici qu’il rencontra Savorgnan de Brazza au début des années quatre-vingts. Celui-ci le persuada de tenter la création de factoreries dans les territoires en amont, qu’il traversait lui-même dans sa marche vers le Congo.
Dans sa carrière coloniale, Trader Horn a connu diverses contrées de l’Afrique. Il a également séjourné dans d’autres continents. Mais plus tard, le souvenir des années passées parmi les primitifs dans la forêt encore vierge du Gabon effaça celui des époques postérieures. D’autres Africains aussi ont subi le charme particulier du Gabon.
Trader Horn, pour lui laisser son pseudonyme, a vécu ici de 1874 environ jusque vers 1884. Cela ressort des événements et des personnes dont il fait mention.
La région de l’Ogooué fut visitée dans ces temps-là par Alfred Marche et par de Brazza. Marche séjourna ici au cours de deux expéditions (1872 à 1874 et 1875 à 1877) ; de Brazza vint plusieurs fois à Lambaréné entre 1875 et 1887. C’est d’ici qu’il partit à la recherche d’une voie praticable pour accéder au Congo par l’Ogooué.
Des missionnaires protestants d’une société américaine travaillèrent sur les rives de l’Ogooué à partir de 1874. La mission catholique de Lambaréné fut fondée en 1881.
Les notes publiées par Marche, de Brazza et quelques-uns des missionnaires américains, ainsi que les souvenirs de cette époque, qu’on retrouve présents à la mémoire de quelques vieux indigènes, permettent de contrôler l’exactitude des récits de Trader Horn.
Tandis que son chef, Mr. Gibson, a laissé dans le pays un souvenir encore vivant, quelques anciens seulement se rappellent son subordonné de jadis. Le peu qu’ils sachent encore de lui, c’est qu’il était très jeune, qu’il voulait faire des affaires suivant une conception qui lui était personnelle et que cela amenait continuellement des palabres avec Mr. Gibson, qu’il était très vif de tempérament et qu’il faisait largement honneur au rhum et à toutes les bonnes eaux-de-vie.
Dans plusieurs passages de son récit, Trader Horn laisse deviner qu’il a mêlé des fictions à ses souvenirs. C’est ainsi qu’il a inventé le conte de la prêtresse Lola, qui, fille d’européen, vivait dans un sanctuaire indigène, fut enlevée par Trader Horn et épousa un de ses camarades de classe de Liverpool, un richissime péruvien qui, informé par Trader Horn de sa beauté, était venu en Afrique.
Il n’y eut jamais dans ce pays une institution analogue à celle des Vestales. On sent vraiment le malin plaisir que prit le brave vieux à mystifier ses lecteurs crédules par ce récit mélodramatique. L’ensemble de son livre s’en trouve défiguré.
Quand il s’agit de ses rencontres avec les animaux sauvages, Trader Horn semble aussi donner parfois libre cours à sa fantaisie. Des détails qu’il donne sur leurs habitudes et leurs genres de vie ne correspondent pas toujours à la réalité.
Les léopards, les éléphants, les hippopotames, les buffles, les crocodiles, les pythons, les chimpanzés et les gorilles se rencontrent aujourd’hui en aussi grand nombre qu’à cette époque-là. Au fond, ils mènent une existence plus tranquille qu’autrefois, parce que les indigènes les chassent moins. La population a diminué et les noirs n’ont plus autant de loisirs que jadis. Il leur manque aussi l’expérience de leurs ancêtres.
L’opinion, souvent reproduite dans les journaux, que les jours des éléphants et des gorilles sont comptés, ne vaut en tout cas pas pour notre région. Au Gabon, les éléphants sont tellement nombreux que les indigènes ne savent pas comment protéger leurs plantations contre ces géants amateurs de bananes. De même les gorilles abondent dans nos forêts.
Les descriptions du pays et des habitants faites par Trader Horn sont exactes, sauf quelques détails sans importance. Qu’il ait conservé après tant d’années un souvenir si net de la géographie de la contrée, des noms des localités et des personnes, est la preuve d’une mémoire vraiment remarquable.
Il relate ses faits et gestes de traitant d’une manière très objective. Un examen de ses entreprises, quand on connaît le pays et le milieu, révèle qu’il fut non seulement plein d’initiative, mais aussi éminemment capable. Quand par exemple, au retour d’un voyage d’exploration dans le pays de la haute N’Gounié, il essaya de convaincre son chef qu’il fallait transporter les marchandises de cette région vers la mer non par la voie si tentante de l’Ogooué, mais par la route de terre plus directe, il exprima une opinion dont le bien-fondé a toujours été reconnu à nouveau.
Sa clairvoyance se montre aussi dans le fait que dès le moment où, grâce à l’intervention de de Brazza, la domination des blancs sur le pays commença à devenir effective, il songea à libérer le commerce de la dépendance dans laquelle il se trouvait vis-à-vis des chefs indigènes. Il réclama la liberté de navigation sur le fleuve et voulut fonder plus à l’intérieur des factoreries dirigées par des blancs, pour pouvoir acheter les produits directement aux indigènes sans dépendre des traitants noirs qui jusqu’alors pourvoyaient les maisons de commerce de Lambaréné et en tiraient un bénéfice exagéré.
Il réalisa ce plan sur l’île d’Osangué – Trader Horn écrit Isangué – située à 150 kilomètres en amont de Lambaréné en face de l’endroit où s’élève aujourd’hui N’Djolé, et il ne se laissa pas troubler par le conflit avec un chef indigène, conflit dans lequel il fut entraîné à la suite de cette création.
Il semble avoir entrepris cette affaire à ses propres risques. En tout cas, il acheta l’île en son propre nom, et non à celui de sa maison. Une pareille indépendance des agents n’était pas chose rare dans le trafic colonial de jadis. Trader Horn resta néanmoins au service de sa maison. Par elle il se procurait les objets de troc ; il lui vendait les produits obtenus en échange.
Le libre trafic entraînait un danger, auquel Trader Horn, il est vrai, ne fit pas encore attention. Aussi longtemps que les marchandises passaient de tribu en tribu et qu’il n’y avait pas de trafic direct, les indigènes étaient assez bien protégés contre la propagation des maladies. Mais du moment où des porteurs recrutés dans des contrées lointaines pénétrèrent en compagnie des blancs de la côte vers l’intérieur du pays, l’apparition de maladies auparavant inconnues dans la région de l’Ogooué ne fut plus qu’une question de temps. En 1876, donc à l’époque de Trader Horn, la petite vérole fit son apparition dans le Haut-Ogooué comme nous l’apprenons par les récits de Marche. En 1886, après le départ de Trader Horn, une épidémie de petite vérole sur le cours inférieur enleva, d’après ce que les vieillards m’ont raconté, presque la moitié de la population. Plus tard des porteurs, recrutés parmi les tribus qui habitaient sur la côte en direction du Congo, importèrent la maladie du sommeil. Celle-ci malheureusement, ne pouvait pas être combattue par la vaccination de la population, comme la petite vérole.
Trader Horn n’est pas retourné au poste si intéressant de Lambaréné. Les difficultés qui s’étaient élevées entre Mr. Gibson et son agent si entreprenant et si volontaire en étaient probablement la cause.
***
Le Pionnier, un des vapeurs de la maison Hatton et Cookson, avec lequel Trader Horn fit maints voyages sur le fleuve et sur la mer entre Cap Lopez et Libreville, avait appartenu à l’origine, comme il le dit lui-même, à Livingstone. Celui-ci avait reçu ce navire à aubes, de dimensions assez respectables, en 1861, du gouvernement anglais pour ses voyages sur le Zambèze. Mais à cause de son tirant d’eau de plus d’un mètre et demi, il ne put être utilisé sur ce fleuve, et après avoir changé de propriétaire plusieurs fois, et avoir été ramené entre temps à Liverpool, il fut acheté par la maison Hatton et Cookson et envoyé sur l’Ogooué, où il resta en service pendant de longues années. Ce fut sur le Pionnier que le premier missionnaire américain, le docteur Nassau, remonta les fleuves en 1874.
Ainsi un bateau appelé le Pionnier se trouve être le trait d’union entre deux pionniers aussi différents que l’étaient Livingstone et Trader Horn. Quel dut être le chagrin de Livingstone quand il fut obligé de se rendre à l’évidence que le vapeur tant désiré n’était d’aucune utilité pour lui. Je n’ai jamais compris que connaissant les inconvénients du Zambèze et de ses bancs de sable, il n’ait pas insisté davantage pour obtenir un bateau d’un tirant d’eau mieux approprié.
***
À cette époque, le commerce du Gabon était partagé entre les deux firmes mondiales Hatton et Cookson de Liverpool et Karl Woermann de Hambourg. Les autres avaient moins d’importance. Les deux maisons vivaient en bonne intelligence, ce qui n’était pas difficile, si l’on considère que les affaires y étaient aisées. Avant l’arrivée de Trader Horn, la factorerie allemande était aussi établie à Adolinanongo, dans le voisinage de l’anglaise. Plus tard, elle fut transférée sur l’île d’en face, dite la Grande, située entre les deux bras du fleuve. Trader Horn, qui s’était lié avec le chef de l’établissement Woermann, M. Schiff, homme d’un certain âge déjà, s’efforça de maintenir les bonnes relations entre les deux maisons.
Lambaréné était alors le poste le plus avancé pour les deux entreprises. Les principaux articles recherchés à cette époque étaient l’ivoire, le caoutchouc, l’ébène et le padouck (bois de corail).
Le caoutchouc donnait les plus gros bénéfices. C’était aussi le produit le plus demandé. À cette époque, les plantations d’hévéas n’existant pas encore, le caoutchouc était obtenu en saignant les lianes de la forêt vierge. Cette récolte comportait un travail pénible. Pendant des semaines, les indigènes qui s’y adonnaient devaient vivre dans la forêt et ses marécages, souffrir de la faim (parce que, loin de leurs plantations, ils ne pouvaient se procurer des vivres que difficilement) et supporter les tortures que leur infligeaient les insectes de toute espèce. Ils étalaient le suc extrait de la liane sur leur peau pour le faire coaguler. Pour augmenter autant que possible le rendement, ils coupaient les lianes et les saignaient à blanc au lieu de les inciser seulement pour faire écouler le suc, méthode moins productive mais qui eût conservé la plante. C’était une vraie déprédation. Avec le temps, il fallait pénétrer toujours plus en avant dans la forêt pour trouver les précieuses lianes. Et comme la demande de caoutchouc allait en croissant, une pression fut exercée sur la population de l’Afrique équatoriale pour l’amener à en fournir des quantités suffisantes. Ainsi le caoutchouc devint le malheur des indigènes jusqu’au moment où peu à peu les immenses plantations créées dans les Indes Néerlandaises et ailleurs commencèrent à produire.
Lorsque, en 1913 j’arrivai dans le pays, le caoutchouc ne jouait déjà plus le rôle prépondérant qu’il occupait auparavant. De nos jours, le caoutchouc de cueillette est à peine demandé et exporté ; le caoutchouc de plantation l’a complètement remplacé. La jeune génération d’indigènes ne connaît plus que par ouï-dire la misère dans laquelle il avait plongé les noirs il y a quelques dizaines d’années. Les lianes qui ont repoussé entre temps dans la forêt n’ont plus à craindre la serpette.
Quant à l’ivoire, il fallait déjà à cette époque aller le chercher loin à l’intérieur, les réserves des régions maritimes étant épuisées.
Le magnifique bois de padouck, de couleur rouge-vif, qu’on appelle ici Oïngo, est assez commun dans le pays de l’Ogooué ainsi que l’ébène. C’est à grand-peine qu’on transporte les bûches de l’un et l’autre à travers la forêt jusqu’aux pirogues sur lesquelles elles sont chargées. Le padouck n’était alors pas seulement estimé comme bois d’ébénisterie ; on en extrayait aussi un colorant rouge très recherché.
Ici, nous essayons de réduire dans la mesure du possible l’emploi du padouck, qui est payé si cher en Europe, parce qu’il est difficile à travailler. S’il y a beaucoup de padouck dans les charpentes de plusieurs constructions de mon hôpital, la raison en est non dans mon attachement pour des essences précieuses, mais dans l’impossibilité d’avoir pu me procurer d’autres bois durs. Mon ami Mr. Airth, directeur d’une scierie au lac Gomé, auquel j’avais commandé des chevrons en bois dur, me priait avec force excuses de me contenter de padouck, parce que pour le moment il n’avait pas d’autre bois disponible. Il me fit aussi une réduction de prix pour ce bois précieux par rapport au bois dur ordinaire. De mon côté, je dus donner beaucoup de bonnes paroles et une gratification à mon charpentier noir Monenzali pour le dédommager de la peine d’enfoncer des clous et de percer des trous dans ce bois vraiment trop dur et détesté par lui.
L’huile et les noix de palme ne jouaient alors aucun rôle dans le commerce de ce pays. Par contre, à l’embouchure du Niger et dans la baie de Libreville les navires chargeaient déjà de l’huile de palme. Vers la fin du siècle seulement, on commença à établir des plantations de café et de cacao dans la région de l’Ogooué. Le bois d’okoumé, qui constitue aujourd’hui la principale exportation du Gabon (on en charge environ 300.000 tonnes par an) fut coupé seulement à partir de 1905 environ. À l’époque de Trader Horn, on ne fit aucune attention à ce bois demi-dur, dans lequel les indigènes taillaient leurs pirogues. On s’intéressait uniquement au bois précieux.
***
Les administrateurs coloniaux dans ces temps-là ne faisaient que passer dans la région de l’Ogooué. Le pays dépendait de la base navale établie à Libreville. Quand les plaintes au sujet des pillages de bateaux et de factoreries exigeaient l’intervention des autorités, les officiers de marine ne pouvaient guère faire plus qu’envoyer de temps en temps quelques petites canonnières remonter le fleuve, pour bombarder les villages en question. Encore ce moyen n’était applicable que par eaux assez hautes, c’est-à-dire seulement pendant quelques mois de l’année. Pendant la saison sèche, les indigènes n’avaient rien à craindre de ces sanctions.
Un vieillard, qui est en ce moment à mon hôpital, me raconte avoir assisté comme enfant au bombardement de son village par une canonnière.
Au fond, les négociants européens ne pouvaient compter que sur eux-mêmes, ce qui ressort aussi des relations de Trader Horn. Ils avaient à payer des redevances régulières aux chefs indigènes. Dans les guerres perpétuelles entre les tribus, ils devaient essayer de garder la neutralité ou de prendre le parti du vainqueur présumé.
Les missionnaires américains de leur côté nous confirment combien les blancs étaient alors sous la dépendance des chefs indigènes et combien l’insécurité était grande. Avant d’entreprendre une tournée d’évangélisation, ils devaient demander l’autorisation aux chefs dont ils désiraient traverser le territoire, et leur payer ce qu’ils exigeaient. Ils érigèrent leur première station près de Lambaréné sur une colline escarpée pour mieux se garantir d’un pillage par les indigènes. On voit encore aujourd’hui dans la forêt au-dessus de la station actuelle les piliers en béton de cette construction.
Trader Horn écrit qu’au cours de ses expéditions il considérait les îles et les bancs de sable comme les seuls lieux de campement sûrs, et il savait bien pourquoi. Pendant les troubles qui éclatèrent à Adolinanongo en 1874, après la mort du roi-soleil, l’explorateur Marche et M. Walker, l’agent de la maison Woermann, durent entourer la factorerie de palissades pour se défendre contre les indigènes.
Pour maintenir le poste qu’à l’instigation de de Brazza il avait fondé en amont sur l’île Osangué en face de N’Djolé, Trader Horn fut obligé de livrer un combat sanglant contre un chef, qui avait intercepté ses transports remontant le fleuve et qui se préparait même à l’attaquer dans son île. Le chef se sentit lésé par la création de cette station nouvelle. Par elle il perdait un grand bénéfice. Jusqu’alors, il prélevait des droits sur les marchandises qui traversaient son territoire en remontant le fleuve.
Mr. Gibson n’était pas d’avis d’entrer en conflit avec les tribus de l’amont. Quand le chef indigène eut capturé les pirogues chargées de marchandises, il entra immédiatement en négociations avec lui, sans savoir que celui-ci préparait une attaque contre son agent, et il conclut avec lui une transaction selon laquelle les pirogues, les marchandises et l’équipage prisonnier seraient restitués, tandis que la maison Hatton et Cookson de son côté s’engageait à rappeler son agent. Mais, fort de sa victoire, Trader Horn put se dispenser d’exécuter l’accord conclu par son chef, et il put trafiquer malgré lui sur l’Ogooué supérieur.
Plus tard, il dira, encore plein de rancune, à Mrs. Ethelreda Lewis : « Ce Gibson appartenait à cette catégorie d’hommes que la nature n’a pas créés pour le trafic fluvial. »
La grande insécurité qui régnait sur l’Ogooué du temps de Trader Horn avait sa cause surtout dans l’avance, en direction de la côte, des pahouins, appelés aussi fans. Ces anthropophages de l’intérieur exerçaient une pression sur les tribus qu’ils rencontraient dans leur migration. Les anciennes populations avaient une grande peur de ces envahisseurs féroces. Vers le milieu des années quatre-vingts, les galoas, pour être mieux protégés contre les pahouins, quittèrent Adolinanongo et s’établirent sur la Grande Île d’en face. Un peu plus tôt déjà, la maison Hatton et Cookson avait transféré sa factorerie au même endroit. La cause de ce déménagement était très probablement que le grand village galoa d’Adolinanongo avait perdu de son importance par suite des troubles qui éclatèrent après la mort du roi-soleil, et que le trafic se détournait de plus en plus vers la Grande Île.
Le transfert était déjà terminé quand Trader Horn revint de sa grande expédition qu’il faut placer probablement en 1883. La nouvelle maison, dont il loue dans ses mémoires la construction solide et l’aménagement pratique, était encore debout il y a quelques années. Elle reposait sur des pilotis en bois dur de deux mètres de haut ; le toit était couvert de feuilles de raphia.
L’intervention des blancs seule empêcha la population autochtone de l’Ogooué d’être anéantie par les pahouins. Les anciennes tribus, qui continuaient leurs guerres fratricides malgré le péril qui les menaçait toutes, n’auraient pas pu se défendre par leurs propres forces.
Quand les indigènes autochtones manifestent leur mécontentement d’être dominés par les blancs, je leur réponds que sans nous ils n’existeraient plus, soit qu’ils auraient achevé de s’entretuer ou qu’ils aient fini dans la marmite des pahouins. Ils ne peuvent rien répliquer à cet argument. En général, malgré les nombreux et graves méfaits dont les blancs se sont rendus coupables dans leur œuvre de colonisation sur toute la terre, ils peuvent pourtant faire valoir qu’ils ont apporté la paix aux peuples soumis, dans la mesure où ils mirent fin aux guerres insensées qui sévissaient sans cesse parmi eux. Ce bienfait, je peux l’estimer à sa juste valeur quand je me représente la situation telle qu’elle était ici du temps de Trader Horn.
***
Le commerce de cette époque était un simple troc. En échange de l’ivoire, du caoutchouc, de l’ébène et du padouck, les indigènes recevaient du sel, de l’eau-de-vie, des fusils, de la poudre et du plomb, des marmites, divers ustensiles, des cotonnades et de la pacotille. Les fûts dans lesquels le caoutchouc était envoyé en Europe revenaient remplis de vieux uniformes.
Le sel était un article très demandé, car à l’intérieur on n’en trouvait pas du tout. Les indigènes rehaussaient le goût de leurs aliments avec du sel de potasse qu’ils préparaient en calcinant les feuilles charnues de certaines plantes des marais. Avant l’arrivée des blancs, les habitants de la côte faisaient avec l’intérieur un commerce lucratif avec le sel, qu’ils extrayaient de la mer. Ce sel fut remplacé peu à peu par celui que les blancs importaient dans des sacs, et les habitants de la côte perdirent leur bénéfice. Pour garder le contrôle du commerce du sel, et par là le contrôle du commerce tout court, ils firent tout leur possible pour effrayer les blancs et pour les empêcher de pénétrer vers l’intérieur. Le résultat fut que les négociants blancs, qui fréquentaient depuis longtemps la côte près de l’embouchure de l’Ogooué, connue dès la fin du 15e siècle, ne remontèrent pourtant le fleuve qu’aux environs de 1870.
Encore aujourd’hui le sel est la monnaie d’échange la plus cotée à l’intérieur. L’argent n’est d’aucune utilité aux habitants de ces contrées, où la factorerie la plus proche est éloignée de plusieurs étapes.
Trader Horn donne en toute naïveté des indications très significatives sur le rôle que le rhum de traite et l’eau-de-vie jouaient alors dans le pays. À son chef, qui s’étonnait qu’il ait pu, sans faire usage de ses armes, pousser si loin en avant l’exploration des routes commerciales dans une région inconnue, habitée par des tribus réputées guerrières, il répondit que la bouteille avait été son arme principale. L’île en amont, sur laquelle il voulait fonder une factorerie, lui fut attribuée à titre définitif au prix d’une bouteille de gin par le chef auquel elle avait appartenu. Quand il était satisfait de ses pagayeurs il leur faisait distribuer du rhum le soir.
Personne ici, ni sur toute la côte occidentale de l’Afrique, ne se souciait du sort qui attendait les hommes qu’on habituait à s’enivrer continuellement de rhum et d’eau-de-vie. Les négociants ne connaissaient qu’un seul souci : se faire livrer autant de produits que possible par les indigènes. Peu à peu seulement les blancs comprirent que l’alcool signifiait la ruine de la population et par conséquent aussi celle du pays et du commerce. En 1913 – j’ai assisté moi-même à cet épisode – tous les européens s’unirent pour demander que la vente du rhum et de l’eau-de-vie aux indigènes fût interdite. Ils l’obtinrent, mais non sans peine. Ce fut un grand progrès. Une grande société de commerce, qui détenait un véritable monopole dans le Haut-Ogooué, avait interdit dès la fin des années quatre-vingt-dix le rhum et l’eau-de-vie sur ses territoires et avait obtenu les meilleurs résultats.
À l’époque de Trader Horn, on fournissait en grande quantité aussi des fusils et des munitions aux indigènes, sans se soucier des conséquences. Si les guerres que les tribus menaient les unes contre les autres troublaient le commerce, elles le stimulaient aussi, parce qu’elles augmentaient la demande de fusils et de munitions.
Peu à peu l’administration devint assez puissante pour pouvoir songer à faire régner la paix et l’ordre dans le pays. Elle se trouva alors, comme d’ailleurs dans toutes les colonies africaines, dans une situation extrêmement difficile du fait que les indigènes disposaient de tant de fusils. Il fallut des années et des années avant qu’elle n’obtînt que les indigènes livrassent leurs armes et qu’ils se résignassent à ce que les fusils leur soient concédés en nombre limité, et pour la chasse seulement.
***
Du temps de Trader Horn, le commerce des esclaves était ici encore très actif. Il est vrai qu’il ne florissait plus comme autrefois, parce qu’on n’exportait plus guère d’esclaves au delà de l’océan. Mais à l’intérieur, la demande subsistait.
La traite des noirs subit un premier recul vers 1830, quand la France et l’Angleterre s’entendirent pour entretenir des croiseurs sur la côte occidentale de l’Afrique afin de combattre la traite. Mais la côte à surveiller était si étendue que l’exportation, quoique très entravée, était loin d’être supprimée. Vers le milieu du siècle, la France et l’Angleterre disposaient de 52 croiseurs pour surveiller la côte. Ce n’était pas beaucoup, si l’on considère que le secteur de surveillance s’étendait sur 4.000 milles marins, et offrait d’excellents refuges aux négriers.
Quoique la base navale fondée en 1843 dans la baie du Gabon fût à quelques heures de traversée seulement au Nord du Cap Lopez et de l’embouchure de l’Ogooué, des esclaves étaient embarqués à ce dernier endroit jusque vers 1870, sinon encore plus tard. À la fin, il est vrai, leur embarquement se faisait clandestinement. Dans les derniers temps, ils étaient dirigés, d’après ce que me disaient les vieux, sur certaines petites îles de la côte occidentale de l’Afrique qui en avaient besoin pour leurs plantations. « Cap Lopez et l’embouchure du fleuve sont habités par les Ouroungous, qui sont des pirates et des négriers », lit-on chez Trader Horn.
La base navale de la baie du Gabon reçut le nom de Libreville, parce qu’en 1849 les esclaves d’un négrier pris dans le voisinage y furent établis.
Cap Lopez a été autrefois un des plus importants centres d’exportation d’esclaves de la côte. Nous sommes renseignés sur la façon dont le commerce se pratiquait encore vers le milieu du 19e siècle par l’explorateur américain Paul Du Chaillu, qui séjourna dans la région à cette époque. Il y vit encore toute une série de constructions pour le logement des esclaves destinés à l’Amérique. Les hommes étaient enchaînés six par six. Ils étaient attachés par des carcans, et tous ensemble ils pouvaient par conséquent se mouvoir librement et même travailler à l’intérieur des palissades entourant les constructions. Un pareil enclos à esclaves était appelé barracon par les Portugais, qui formaient la majorité des marchands d’esclaves de la région. C’est d’un barracon situé autrefois aux environs de Libreville que dérive le nom de la station missionnaire protestante de Baraka, fondée en 1842 sur ce terrain.
Du Chaillu, au cours de ses excursions dans la région du Cap Lopez, rencontra de véritables monticules d’ossements, provenant de corps d’esclaves morts, qu’au cours des temps on avait entassés par milliers. Ceux qui connaissaient bien la contrée du Cap Lopez ont été frappés par les grandes étendues de forêt relativement jeune qu’on y rencontre. Cette forêt s’est reconstituée sur des espaces qui, au dix-huitième siècle et dans la première moitié du dix-neuvième siècle, avaient été défrichés et transformés en plantations pour fournir les vivres que nécessitait l’entretien des nombreux esclaves.
Du Chaillu rapporte que pour un jeune esclave remis en sa présence, le traitant portugais donna un tonneau de rhum, quelques mètres de cotonnade et en plus un certain nombre de perles de verroterie. Pour une jeune femme on payait : un fusil, une grande marmite en cuivre, soixante mètres de cotonnade, deux pièces de fer, deux matchettes, deux miroirs, deux limes, deux assiettes, deux verrous, un tonnelet de poudre, quelques perles et un peu de tabac. Tels étaient les prix sur la côte. À l’intérieur, les esclaves étaient bien meilleur marché. Un jeune homme coûtait quatre livres de sel, une marmite en cuivre, quelques mètres de cotonnade et quelques perles de verroterie.
Du Chaillu eut aussi l’occasion d’assister à un embarquement d’esclaves. Un jour, un brick d’environ 170 tonnes entra dans la baie. L’embarquement de 600 esclaves commença aussitôt. Il eut lieu dans des pirogues énormes ; dans chacune 6 pagayeurs et environ 60 esclaves trouvaient place. Deux heures après son entrée, le brick mit de nouveau à la voile. Il était pressé parce qu’il ne voulait pas être surpris par un croiseur.
Le désespoir des esclaves était porté à son comble par la croyance, dont parle aussi Du Chaillu, qu’ils étaient transportés dans les pays lointains, au delà des mers, pour être tués et mangés par les blancs. J’ai souvent entendu dire par de vieilles gens de la contrée que les noirs croyaient autrefois que la viande en conserve provenait d’esclaves abattus.
Cap Lopez fournissait principalement le Brésil et Cuba. Les Portugais se plaignirent à Du Chaillu, que les affaires ne marchaient plus, pas tant du fait que la surveillance de la côte les avait rendues difficiles, mais surtout parce que le Brésil avait réduit l’importation d’esclaves, de peur que les nombreux noirs ne puissent constituer un danger pour les blancs. Seul Cuba était encore un bon client. Quand l’esclavage fut supprimé aux États-Unis après la guerre de sécession (1861-1865), les négriers africains durent renoncer peu à peu à leur métier.
Mais à la même époque existait encore dans la région de l’Ogooué un trafic d’esclaves purement intérieur, dirigé de l’arrière-pays vers la côte ; nous le savons par les relations de Marche et de de Brazza et par les mémoires de Trader Horn.
La population autochtone des régions côtières était accoutumée depuis toujours à employer des esclaves pour les travaux de plantation. En particulier, les familles qui depuis des générations vivaient du commerce considéraient le travail physique comme étant au-dessous de leur dignité. Encore aujourd’hui un noir révèle sa prétention d’appartenir à une caste supérieure par son refus de pagayer avec les autres dans la pirogue. Quand un de mes infirmiers indigènes m’accompagne dans une course en pirogue, j’ai toutes les peines du monde à le persuader qu’il ne déchoit point en maniant une pagaye.
L’exploitation du caoutchouc dans le Gabon eut pour conséquence d’activer le commerce des esclaves. On en avait alors besoin non seulement pour la culture des plantations, mais aussi pour la récolte du caoutchouc. Quand des explorateurs ou des commerçants blancs entreprenaient des expéditions vers l’intérieur, les pagayeurs s’offraient en grand nombre. Ceux-ci profitaient de cette occasion pour acheter des esclaves à bon marché dans les pays d’amont, et pour les ramener en aval sous la protection des blancs, sans payer aux chefs dont ils traversaient les territoires les redevances qui leur étaient dues d’ordinaire.
À l’intérieur, les esclaves étaient d’habitude troqués contre du sel. À l’idée d’arriver dans un pays où il y avait du sel, beaucoup d’entre eux oubliaient la tristesse que leur causaient l’abandon du pays natal et la séparation d’avec leur famille. Trader Horn raconte qu’il rencontra un jour sur la N’Gounié quelques grandes pirogues chargées d’esclaves, qui avaient l’air tout à fait contents dans l’espoir de recevoir du sel et du poisson salé sur la côte. Mais pour un grand nombre d’entre eux ce départ forcé vers l’inconnu restait une souffrance.
Parmi les esclaves il y en avait beaucoup qui avaient été vendus par leur tribu pour avoir commis des escroqueries ou parce qu’ils étaient accusés d’avoir nui aux autres par des pratiques magiques. Les membres d’une même famille étaient presque toujours séparés. Souvent aussi, les parents, quand ils avaient un certain âge, étaient noyés et les enfants seuls emmenés.
Des anciens m’ont raconté que les indigènes de certaines régions de l’intérieur vendaient leurs enfants en esclavage, pas tant pour y gagner, mais pour les envoyer dans un pays où ils auraient à manger à leur faim. L’Afrique équatoriale ne possédait à l’origine, comme je l’ai aussi exposé dans mon livre « À l’orée de la forêt vierge », aucun arbre fruitier ni aucune plante comestible. Le bananier, le manioc, l’igname, la patate et le palmier à huile ne sont pas originaires de l’Afrique, mais ont été introduits des Antilles par les Portugais. Dans les régions de l’intérieur, où ces cultures vivrières étaient encore inconnues, les indigènes n’avaient pour aliments, outre les produits de la chasse et de la pêche, que certaines racines et les fruits de quelques arbres de la forêt. Si la chasse et la pêche étaient insuffisantes, c’était la famine, ce qui arrivait fréquemment. Aux habitants de ces pays dévastés par la famine, qui étaient situés principalement dans la région des sources de N’Gounié, le pays d’en bas avec ses plantations, sans parler du sel, apparaissait comme un paradis, dans lequel ils souhaitaient savoir leurs enfants. Venant de ces régions, arrivent aussi dans mon hôpital des malades appartenant à la catégorie des mangeurs de terre. Poussés par la faim, ils avaient pris dans l’enfance l’habitude de manger de la terre, et ils l’avaient gardée alors même qu’ils trouvaient une nourriture suffisante.
***
En général, chez l’indigène l’esclave n’avait pas la vie trop mauvaise. S’il faisait son travail, on le laissait en paix ; si le maître en était content il lui donnait la possibilité de se marier ; les enfants issus de ces unions lui appartenaient naturellement. Beaucoup de femmes esclaves se mariaient dans la famille de leur maître. Cependant il ne faut pas non plus se représenter la situation de ces esclaves domestiques sous des couleurs trop idylliques, comme on le fait parfois. Leur maître pouvait les traiter selon son bon plaisir, exercer sa cruauté sur eux et les tuer.
Quand un chef mourait, un certain nombre de ses esclaves était sacrifié en son honneur. Nous savons par Du Chaillu que cette coutume était encore très répandue au Gabon vers le milieu du siècle dernier. Il cite, comme un fait tout à fait exceptionnel, que Will Glass, membre d’une famille de chefs des environs de Libreville, interdit expressément sur son lit de mort que ses esclaves subissent ce sort. Sous l’influence des missionnaires américains, il s’était élevé au-dessus des opinions traditionnelles.
L’initiative de l’application des mesures tendant à supprimer l’esclavage au Gabon revient à de Brazza. Pendant son premier séjour (1875-1878), il se contenta, par mesure de précaution, de racheter les esclaves qui demandaient à être libérés. Il lui importait avant tout de proclamer le principe que pour le noir aussi la liberté était un bien inaliénable. Il procéda aux premiers rachats à Lopé, sur le Haut-Ogooué, où un marché d’esclaves se tenait à côté de son campement. Il fit annoncer aux esclaves prêts à être embarqués dans les pirogues pour descendre le fleuve qu’il rachèterait ceux d’entre eux qui le demanderaient. Dix-huit seulement se présentèrent, et ceux-ci s’imaginaient être devenus désormais les esclaves des blancs. Peu à peu seulement ils comprirent qu’ils étaient libres. Par la suite, de Brazza parvint à constituer une bonne partie de son équipage avec des esclaves libérés ; mais beaucoup d’entre eux lui donnaient bien peu de satisfaction. Il en parle dans ses lettres.
Après son second voyage (1880-1882), de Brazza revint dans le pays en 1883 pour plusieurs années. Il avait alors pour mission, non seulement d’entreprendre de nouvelles expéditions, mais aussi d’organiser l’administration.
À partir de ce moment, il prit des mesures plus énergiques contre l’esclavage. Tous les esclaves qui le demandaient devaient être affranchis par leurs maîtres, soit pour retourner dans leur pays natal, soit pour suivre de Brazza et s’établir dans les villages qu’il avait l’intention de fonder.
Cette fois encore le succès ne fut pas considérable. Le chef Apaqué, qui habitait en amont de Lambaréné, raconta d’une mine satisfaite à son ami Trader Horn, que de Brazza avait passé récemment une nuit chez lui et lui avait demandé de lui céder les esclaves qui voudraient le suivre. Mais quoique lui, Apaqué, se fût déclaré d’accord et en eût informé les esclaves réunis à la hâte, aucun d’entre eux n’avait manifesté l’intention de le quitter.
Dans la région de Lambaréné, une pression fut parfois exercée sur les esclaves pour les faire partir. Il arriva même, d’après ce que m’ont raconté de vieux indigènes, qu’ils furent purement et simplement enlevés à leurs maîtres, comme ce fut le cas des 120 esclaves qui appartenaient aux héritiers du roi-soleil d’Adolinanongo. Beaucoup de ces esclaves se retiraient dans la forêt, et plus tard, quand la question de leur émancipation n’était plus à l’ordre du jour, ils rejoignaient leurs maîtres. Même des affranchis, qui étaient retournés dans leur pays situé à l’intérieur revinrent ensuite. Ils se sentaient plus chez eux auprès de leurs maîtres que dans leur famille qu’ils avaient revue. Ils ne voulaient pas non plus se passer des avantages de la civilisation dont ils avaient fait connaissance dans le Bas-Ogooué.
Dans les régions qui n’étaient pas situées au voisinage du fleuve ou des grandes voies de communication, l’autorité de l’administration, d’après des informations que je tiens des anciens, était à cette époque encore si peu assurée, qu’elle ne pouvait s’occuper efficacement de l’affranchissement des esclaves. Dans la mesure où l’administration s’organisait, elle put cependant empêcher leur vente et leur transport et mener ainsi avec succès la lutte pour l’abolition de cette pratique.
Quand j’arrivai dans le pays en 1913, beaucoup d’indigènes y vivaient encore comme esclaves. Légalement, ils étaient libres. Mais ils ne faisaient aucun usage de leur liberté. Ils restaient auprès de leurs maîtres et les servaient sans salaire, parce qu’ils étaient habitués à cette existence et ne croyaient pas pouvoir s’en créer une meilleure. L’idée de l’employé salarié, qui n’avait jamais existé auparavant dans ce pays, ne pénétrait que lentement parmi les indigènes. L’administration ne pouvait rien faire contre cet esclavage inavoué et volontaire, et elle n’y avait aucun intérêt. On reconnaissait ces étrangers aux contrastes que présentaient les traits de leur visage et la nuance particulière de leur peau avec ceux des autochtones.
Pendant mon premier séjour une femme indigène, qui paraissait être assez fortunée arriva à mon hôpital accompagnée de quatre hommes encore assez jeunes. Elle les présenta comme ses serviteurs. En réalité, c’étaient ses esclaves. Le lendemain, je la rencontrai au bord de la forêt en train de ramasser du bois pour faire son feu. À ma question, pourquoi elle était obligée de chercher elle-même son bois, puisqu’elle avait amené quatre esclaves, elle répondit en souriant : « Avoir des esclaves ne signifie pas être bien servi. »
Un jour, pendant qu’un noir jovial et déjà âgé était en traitement à mon hôpital, un autre indigène vint me trouver et me demanda si je ne voulais pas garder cet homme à mon service ; il me le céderait comme travailleur à des conditions avantageuses. Je n’aurais qu’à le nourrir sans le payer. En réponse à mon étonnement et à mes questions il me raconta qu’il avait hérité de cet homme comme esclave de son père, qu’il était assez adroit et pas trop paresseux, mais qu’il jouait tous les tours possibles. Attendu que, selon le droit en vigueur chez les indigènes, le maître était tenu pour responsable de tous les méfaits commis par son esclave, il avait dû payer déjà bon nombre d’amendes et de dommages et intérêts pour lui. Il lui avait déjà souvent offert la liberté, mais l’autre ne l’avait pas acceptée sachant bien qu’il serait alors obligé de porter lui-même les frais de ses méfaits. Pour cette raison, il me l’offrait. « Tu sauras bien le mettre au pas », me dit-il. Malheureusement, je dus lui répondre que moi non plus je n’étais pas assez riche pour posséder un esclave aussi ruineux.
Au cours des temps, les anciens esclaves se sont fondus entièrement par mariage et par adoption dans la population autochtone. J’ai connu des chefs de village qui étaient fils d’esclaves ou qui avaient été esclaves eux-mêmes.
L’idée de l’ouvrier salarié a maintenant pénétré parmi la population. Pourtant, il y a encore bien des noirs qui n’exigent point de salaire, mais qui sont prêts à servir un maître qu’ils ont choisi eux-mêmes, et à travailler sur sa plantation en échange de l’habillement, du logement et d’une nourriture abondante, tout cela dans l’attente qu’un jour il leur achètera une femme. On rencontre ces âmes simples sur des plantations isolées en brousse. Les deux parties tirent un profit égal de ce système.
***
Pendant quarante ans, à l’écart des événements et des changements qui survinrent dans le pays, Adolinanongo restait abandonné. La forêt et la brousse reprirent possession du sol.
Enfin, en 1923, un exploitant forestier s’établit sur la partie de la colline tournée vers l’amont. À la fin de 1925, je commençai à défricher l’extrémité en aval. Sur le terrain de la mission protestante où s’élevait auparavant mon hôpital, la place qu’on pouvait mettre à ma disposition n’était pas suffisamment grande pour me permettre de construire dans la mesure nécessitée par l’affluence toujours croissante des malades. Pendant que Trader Horn écrivait ses mémoires à Johannesburg, une case après l’autre s’élevait à Adolinanongo. En janvier 1927, le nouvel hôpital était suffisamment avancé pour que nous puissions nous y installer avec nos malades.
De la bonne terre noire, telle que j’en avais besoin pour le jardin, se trouvait en quantité aux bords de l’ancien village, aux endroits où pendant de longues années les femmes d’Adolinanongo avaient jeté les décombres. En creusant le sol, nous trouvâmes de lourds bracelets et des anneaux de cheville en bronze, vestiges de générations passées.
Quand un vapeur fluvial se dirige vers notre rive et annonce par un coup de sirène son intention d’accoster, je pense bien souvent au jeune Trader Horn, qui, au retour d’un voyage, dirigeait le Pionnier vers cette colline, et qui avant moi se sentait chez lui à Adolinanongo. S’il revenait, il trouverait la nature inchangée. Toujours, les crocodiles dorment, la gueule ouverte, sur les bancs de sable et sur les troncs d’arbres le long des rives. Toujours, les pélicans décrivent leurs orbes dans les airs. Toujours, la forêt impénétrable, d’un vert magnifique, recouvre les îles et les bords du fleuve et se mire dans ses eaux brunes.
Au cours d’une exploration de l’Ogooué supérieur, de Brazza fit descendre à M. N’Djolé une équipe de pagayeurs, composée d’indigènes originaires de l’intérieur du pays, pour en ramener différentes marchandises. Il profita de l’occasion pour leur faire toucher leur salaire en nature. En leur présence, il écrivit une lettre à l’agent de la factorerie et leur annonça que celui-ci leur remettrait tant et tant de fusils, de barils de poudre, de haches, de matchettes, de sacs de sel et tant et tant de mètres de cotonnades. « Le fera-t-il réellement », demandèrent ses hommes, un peu incrédules. « Il le fera, dès que vous lui aurez remis le papier », répondit de Brazza.
C’est ce qui arriva. L’européen de la factorerie de N’Djolé, ayant reçu le papier, le regarda quelque temps. Puis, sans poser la moindre question aux pagayeurs, il fit apporter par ses magasiniers tant et tant de fusils, de barils de poudre, de haches, de matchettes, de sacs de sel et tant et tant de mètres de cotonnades. C’était exactement les quantités auxquelles ils avaient droit.
Peu de temps après, un chef indigène de l’intérieur fit parvenir un message aux missionnaires de Lambaréné les priant de lui envoyer un catéchiste. Lui et sa tribu désireraient entendre la parole de Dieu et apprendre à lire et à écrire. Le catéchiste vint et commença par les instruire dans l’histoire sainte, leur apprendre le B-A = Ba et leur faire tracer des lettres sur l’ardoise. Mais bientôt le zèle de ses élèves se ralentit. « Ce n’est pas cela », lui dirent-ils. « Tu ne dois pas nous faire griffonner quelque chose sur l’ardoise, mais nous apprendre la façon dont il faut écrire sur un papier, pour que l’homme de la factorerie de N’Djolé soit obligé de nous donner des marchandises. » À leurs yeux, l’écriture était une sorte de sorcellerie.
***
Pendant leur première grande exploration des régions avoisinant le Congo, des missionnaires protestants avaient emmené deux de leurs boys des environs de Lambaréné qui à la station missionnaire avaient appris à lire et à écrire. Un soir, quand on eut monté les tentes sur un banc de sable, ils envoyèrent un des boys à l’autre extrémité du banc, hors de portée de la voix. Ils expliquèrent ensuite aux primitifs de l’intérieur, engagés par eux comme pagayeurs, que ce boy, à son retour, saurait répéter ce qui avait été dit, sans l’avoir entendu. Avant de le rappeler, le second boy traça des caractères dans le sable. Quand l’autre fut revenu et qu’après avoir jeté un coup d’œil par terre il eut dit exactement de quoi on avait parlé pendant son absence, l’étonnement des primitifs ne connut plus de bornes. Il fallut répéter l’expérience toujours à nouveau. À l’arrivée dans les villages, les pagayeurs narraient la chose aux habitants, et ceux-ci à leur tour voulaient assister à la démonstration.
À cette expédition, les boys avaient emporté un accordéon. En échange de celui-ci des indigènes leur offrirent quatre pointes d’ivoire, chacune de la taille d’un homme.
***
À cette époque un catéchiste indigène, déjà âgé, exerçait son ministère dans la région de la N’Gounié. Sa tâche n’était pas facile. Les cœurs étaient endurcis. Il se chagrinait surtout de ce que des jeunes gens interrompaient souvent ses récits d’histoire sainte et prétendaient que personne ne pouvait savoir s’ils étaient vrais, parce que personne n’y avait assisté.
Voilà qu’un jour le missionnaire remonta le fleuve et apporta une lanterne magique. La nuit venue, Abraham, Isaac et Jacob, David et Goliath, Salomon, Jésus et ses disciples défilèrent en images coloriées sur un drap tendu, devant une case qui servait d’écran. Tout à coup, la voix du catéchiste se fit entendre dans le silence qui régnait. « Voilà, jeunes vauriens, vous avez toujours dit : ce n’est pas vrai, ce que le vieux raconte. Mais maintenant vous le voyez de vos propres yeux. Qui osera prétendre que ce n’est pas vrai ? » Le brave vieux était persuadé que dans les images projetées par la lanterne les événements du passé avaient été fixés tels qu’ils s’étaient déroulés effectivement.
Dans les premiers temps de mon séjour ici, le missionnaire de Lambaréné présenta aux fidèles, qui étaient venus à la station pour fêter la semaine sainte, l’histoire de la Passion avec une lanterne magique. Quand Judas apparut pour la première fois sur l’écran au milieu des autres disciples, des cris partirent du fond : « Attention, il va te trahir. » Quand, à Gethsemané, il baisa la joue du Seigneur, les spectateurs ne purent plus se maîtriser. Ils se levèrent, montrèrent le poing et proférèrent à l’envie des injures et des menaces. Le missionnaire dut les calmer avant de pouvoir continuer la séance.
L’identité entre l’image et la réalité est toute naturelle pour le primitif. Nous sourions de leur naïveté. Mais n’est-ce pas quelque chose d’inouï et de dangereux, que les hommes en soient arrivés à jouer avec la réalité et à faire entrer la fiction et l’artifice en concurrence avec elle ? N’en avons-nous pas subi une diminution de notre sensibilité pour ce qui est vrai ? Ne faut-il pas expliquer certains aspects inquiétants de la mentalité de l’homme moderne par le fait qu’il ne sait plus distinguer entre la réalité vraie et la réalité artificielle ? À partir du moment où l’homme perd la conception naïve que toute image est nécessairement la reproduction d’une réalité, il entre dans la voie d’un progrès générateur de dangers. Il ne peut avancer sans faillir sur cette voie que s’il acquiert, à la place de la naïveté perdue irrémédiablement une autre, supérieure et d’ordre spirituel. Nous devenons hommes dans le sens le plus élevé par l’acquisition d’une simplicité profonde qui est la plus haute sagesse.
***
Cette autre histoire se passa également dans la région de la N’Gounié. Un blanc avait espéré étonner les indigènes par la mise en marche d’un gramophone. Mais l’expérience tourna autrement qu’il ne l’avait prévu. À peine les gens eurent-ils entendu des voix sortir du pavillon, qu’ils furent en proie à une agitation extrême, brisèrent l’appareil et attaquèrent le blanc, qui ne dut son salut qu’à une fuite précipitée. Ils avaient cru entendre les voix des esprits de leurs ancêtres, que le blanc aurait emprisonnées par un sortilège dans la boîte.
Depuis cette époque, les noirs se sont familiarisés avec le gramophone. Il n’y a presque pas de village dans les environs d’où quelque gramophone n’envoie sa voix criarde dans la forêt.
Quant à savoir comment des voix et de la musique peuvent sortir de l’appareil, les indigènes ne s’en soucient pas. Pour eux, cela fait partie des nombreuses choses incompréhensibles dont les blancs sont capables. « Le blanc, il est malin », disait mon infirmier Joseph, quand il était question de machines et autres inventions.
***
Quel ne fut pas l’étonnement des primitifs aux premiers temps de la colonisation, quand ils virent arriver des blancs pour ramasser des pierres et les emporter. Un de ces blancs dut quitter la région du Haut-Ogooué, parce que les indigènes refusaient de lui fournir des vivres ainsi qu’à ses porteurs. Ils le croyaient possédé par un démon et ils n’eurent de cesse qu’ils furent débarrassés de cet être inquiétant.
Les porteurs d’un géologue qui explorait une région au Sud de Lambaréné lui jouèrent un bien mauvais tour. Ils n’arrivaient vraiment pas à comprendre pourquoi ils peineraient par cette chaleur sous la charge des pierres que celui-ci entassait dans ses caisses pour les faire transporter par monts et par vaux jusqu’à la mer, comme s’il n’y en avait pas sur la côte. Ils ouvrirent donc nuitamment les caisses, les vidèrent et continuèrent allègrement leur marche sous le fardeau devenu léger. Avant d’arriver à la mer, ils les remplirent avec des pierres ramassées au bord de la piste. On dit qu’en Afrique les géologues ont été victimes de surprises pareilles plus d’une fois et à plus d’un endroit, avant qu’ils n’aient pris les mesures nécessaires pour empêcher qu’elles ne se reproduisent.
***
Nombreuses sont les histoires qui circulent ici sur la malice des porteurs et des pagayeurs. Je tiens celle qui suit d’un européen qui, il y a des années, gérait au nom d’une société de commerce une factorerie sur le Haut-Ogooué, située juste en amont d’une série de rapides. À maintes reprises des pirogues qui remontaient le fleuve chargées de marchandises chaviraient devant ses yeux dans les remous. Quand les noirs qui avaient sauvé de justesse leur vie dans l’accident se lamentaient d’avoir perdu à cette occasion nattes, couvertures, moustiquaires et marmites, il les dédommageait, trop heureux qu’il n’y eût pas à déplorer des pertes de vies humaines.
Mais il ne se montra généreux que pendant quelque temps. L’accident se répéta si souvent qu’il reçut un blâme de sa direction, parce qu’évidemment il n’avait pas la main très heureuse dans le choix des équipes de pagayeurs. Mais il ne pouvait pas y avoir de doute que les pirogues chaviraient réellement et que l’accident n’était pas provoqué pour cacher le manque de caisses qui auraient été volées. De sa factorerie, le blanc pouvait voir les pagayeurs lutter contre les remous et, à l’aide de sa jumelle, constater le nombre des caisses que contenait la pirogue. Celui-ci concordait toujours avec le bordereau qu’il recevait de la factorerie située en aval.
Après quelque temps le bruit lui parvint que dans certains villages en aval les femmes se pavanaient dans des pagnes neufs, possédaient des marmites et des matchettes neuves et se pommadaient abondamment les cheveux. Cela lui donna à réfléchir, parce que les habitants de ces villages, qui pouvaient se procurer ces objets par son seul intermédiaire n’avaient presque rien acheté ces derniers temps. D’autre part il fut frappé par le fait qu’à chaque accident toutes les caisses avaient coulé sans exception, et il y en avait cependant qui par la nature de leur contenu n’étaient pas obligées d’aller au fond. Il engagea donc quelques mouchards, stimulés par la promesse d’une belle prime, pour découvrir s’il n’y avait pas une relation entre cette aisance inexplicable et les malheurs qui arrivaient à ses pirogues. Elle existait effectivement. Au voisinage de ces villages, les pagayeurs vidaient de temps en temps le contenu des caisses d’une pirogue et remplaçaient les marchandises par des pierres. Ainsi le blanc pouvait constater, avant que la pirogue ne chavirât dans les tourbillons (grâce à quelques fausses manœuvres), que le nombre des caisses y était. Quand les équipes eurent été punies sévèrement et que désormais toutes les pertes causées par des accidents de pirogues furent déduites de leur paye, ils réussirent sans doute à se procurer des fétiches suffisamment efficaces. Car à partir de ce moment, toutes les pirogues passèrent les rapides sans encombre.
Au cours d’un voyage en pirogue, il m’arrive qu’en conversant avec les pagayeurs ceux-ci me demandent de leur parler des différences entre le pays des blancs et le leur. J’ai l’habitude de les entretenir alors de trois choses qui sous ce rapport sont les plus caractéristiques. Ceux qui font partie de mon personnel ont déjà assisté l’une ou l’autre fois à ces causeries. Mais ils veulent entendre toujours à nouveau les histoires bien connues, pour avoir l’occasion de manifester une fois de plus leur étonnement et de faire des observations.
En premier lieu, je leur apprends qu’en Europe il y a des incendies de forêt. C’est une chose que nos indigènes ne peuvent se représenter. Ici, il fait si humide, même pendant la saison sèche, que jamais, au grand jamais, la forêt ne peut prendre feu, même si l’on faisait tout pour l’allumer. Les indigènes ne réussissent même pas à brûler les arbres qu’ils ont coupés pendant la saison sèche en vue de faire leurs plantations, et qu’ils ont laissés reposer de longs mois pour permettre au bois de sécher. Les petites branches seulement et celles de dimensions moyennes sont consumées par les flammes. Mais les troncs et les branches sont calcinés à l’extérieur seulement et gisent en désordre dans la plantation. Dans nos scieries, le propriétaire et les employés fument à l’envie et vident leurs pipes encore brûlantes dans la sciure. Celle-ci est si humide qu’il ne peut être question d’un danger d’incendie. Comment peut-on se représenter dans ces conditions qu’en Europe le feu se déclare dans la forêt à la suite d’une allumette enflammée qu’on a laissé tomber malencontreusement ?
***
Enfin, mes hommes ont fini d’échanger toutes les réflexions que provoque ce fait extraordinaire. Alors, je raconte en second lieu qu’en Europe il y a des gens qui rament pour leur plaisir. Sur cela d’abord un rire inextinguible, ensuite les questions fusent. « Qui leur ordonne de pagayer ? » « Personne. » « Il faut pourtant que quelqu’un leur donne un cadeau pour qu’ils le fassent. » « Non, ils le font entièrement de leur propre gré et sans rémunération et souvent ils rament jusqu’à complet épuisement. »
Les réflexions sur ce second cas n’en finissent plus. Ici aussi il arrive que les équipes de deux pirogues, qui remontent ou descendent ensemble le fleuve fassent la course. Mais qu’il y ait des gens qui montent en pirogue sans vouloir faire un voyage, ou sans être obligés de transporter des marchandises, rien que pour pagayer, et qui passent leurs loisirs à s’exercer à pagayer, cela dépasse l’entendement de nos noirs. Je n’essaye pas de leur faire comprendre ce qu’est le sport. Les conditions de leur existence les amènent si souvent à exercer leur force musculaire et à se donner du mouvement plus qu’ils ne le voudraient, qu’ils n’arrivent pas à comprendre, comment des gens puissent le faire sans y être obligés.
***
En dernier lieu, je leur apprends qu’en Europe un homme peut se marier sans avoir à acheter sa femme. De tous les côtés on me répond que cela ne peut être vrai, que le docteur se moque des pauvres noirs pour son plaisir.
Ici, les femmes sont un objet de valeur. Dès la naissance d’une fille, sa famille fait entrer en compte le capital qu’elle représente. Ce point de vue est familier aux indigènes dès leur jeunesse. Le boy d’une dame européenne qui avait accouché de jumelles dans mon hôpital, quand on lui montra les bébés dit au père : « Maintenant, tu es riche. »
Toute la vie du noir est dominée par les affaires d’argent occasionnées par le mariage. Dès l’âge de seize ans, il cherche à amasser les moyens d’acheter une femme. Dans ce but, il doit souvent se résigner à quitter son village et à prendre un emploi quelque part chez un blanc.
Actuellement, une femme vaut ici en moyenne de 1.500 à 2.500 francs. Ce prix dépasse ce qu’un indigène peut mettre de côté en quelques années de travail, surtout qu’il ne sait pas économiser. Il se marie donc en prenant la femme à crédit. Son père, ou si celui-ci n’est plus en vie, un frère aîné doit l’aider à faire le premier versement et donner sa garantie pour les suivants.
Pour être sûr d’avoir une femme pour leur fils, les parents commencent à faire des versements pour des filles âgées de quelques ans à peine. Juste au moment où j’écris ces lignes, un infirmier indigène nouvellement engagé vient me trouver et me prie de lui avancer une somme considérable sur son salaire pour l’achat d’une femme. Il ressort de l’entretien qui s’engage que la fille est âgée de 9 ans. Auparavant déjà, il avait payé une certaine somme pour elle. S’il ne peut continuer les versements, elle sera attribuée à un autre. Lui-même aura alors toutes les peines du monde à obtenir le remboursement de tout ou même partie des sommes déjà engagées.
Le malheur est qu’au moment du mariage le mari n’arrive pas à faire fixer de façon définitive le prix global, ni à obtenir des précisions sur les modalités concernant les versements ultérieurs. C’est le début d’un chantage que la famille de la femme exerce pendant de nombreuses années. Le père de la jeune femme et les parents du côté paternel n’ont pas grand’chose à dire en cette affaire. La femme appartient à sa mère et aux frères de celle-ci. Ce sont eux qui reçoivent la plus grande partie de l’argent.
Pendant que la vie conjugale du jeune couple se déroule dans les meilleurs termes, voilà qu’arrive un message de la famille, disant que le mari est en retard avec ses versements et qu’il doit payer telle somme à une date fixée, faute de quoi la femme lui sera reprise. Le mari va alors voir tous ses amis et connaissances pour emprunter de droite et de gauche l’argent nécessaire. A-t-il pris du service chez un blanc, il lui demande avec de grandes lamentations une avance qui équivaut généralement à plusieurs mois de sa paye. Le blanc est-il novice, il se laisse fléchir et cède à la demande, très souvent avec ce résultat que le noir quitte ensuite son service pour ne pas être obligé de rembourser l’avance par son travail. Quand un de mes infirmiers montre pendant des jours une mine renfrognée et a l’esprit absent, je sais qu’il va venir me trouver pour demander une avance dont il a besoin pour garder sa femme.
Si l’homme arrive à faire le versement exigé, il jouit de la paix pour quelque temps. Mais s’il ne peut réunir la somme, sa femme lui est enlevée, jusqu’à ce qu’il puisse payer. Cela se passe en général de la façon suivante : la femme est allée au fleuve pour puiser l’eau et elle ne revient pas. Des hommes l’y ont attendue, l’ont fait monter dans leur pirogue et sont partis.
Je me souviens encore quelle fut à mes débuts mon émotion, quand un matin, en arrivant à l’hôpital, j’appris qu’on avait volé une femme à son mari. J’ouvris une enquête, j’interrogeai le mari, je recherchai des témoins et j’essayai de découvrir l’auteur probable du crime, pour quelle raison il l’avait enlevée et où il avait bien pu la conduire. Mais au cours de mon enquête j’eus l’impression que les gens prenaient cette affaire beaucoup moins au tragique que moi et ne se faisaient pas trop de soucis sur le sort de la victime. Depuis cette époque, bien des femmes ont été volées dans mon hôpital. Mais je n’ouvre plus d’enquêtes sur ces cas. Je me contente d’exprimer avec compassion au mari mes regrets de le voir obligé de réunir péniblement de l’argent.
La vérité exige que j’ajoute que, dans la plupart des cas, la famille de la femme n’arriverait pas à se faire payer, si elle ne procédait pas de cette façon. Un des journaliers de l’hôpital, un sujet vraiment sympathique, vint un jour en pleurant m’annoncer que des hommes méchants étaient venus lui ravir sa femme. Sur le point de partager son indignation, je posai pourtant la question jusqu’à quel point il était en règle dans les payements dus à la famille. Voilà que j’appris qu’après avoir fait le premier versement, il avait quitté secrètement, avec son épouse, son village, très loin d’ici, et était venu à Lambaréné, et que pendant cinq ans il n’avait pas donné signe de vie à ses créanciers. Mais son indignation, que les parents eussent enfin découvert sa trace et essayé par le procédé habituel de l’obliger à payer les termes échus, était tout à fait sincère.
Le mari dont la femme a disparu sait immédiatement où il doit la chercher. Tôt ou tard, il quitte son travail et, muni de la somme nécessaire, il entreprend le voyage vers le village de la disparue. Après quelque temps il retourne avec elle, pour mener à ses côtés une vie heureuse jusqu’à ce que le versement suivant soit exigé.
S’il y a des enfants, ils sont enlevés en même temps que la femme. Car d’après le droit en vigueur chez les primitifs, les enfants n’appartiennent pas au père, mais à la mère et aux frères et oncles de celle-ci.
***
Une curieuse histoire m’est arrivée au sujet de l’enlèvement de la femme d’un petit chef indigène qui était venu à l’hôpital pour faire soigner une blessure. Quand la femme eut disparu, il voulut me rendre responsable, parce que la chose s’était passée sur mon terrain. Il réclama une indemnité proportionnée à la valeur de la femme. D’abord je ne pris pas sa réclamation au sérieux. Mais ensuite je me sentis néanmoins un peu mal à l’aise, parce que plusieurs fois par jour il me barrait le chemin et exigeait son indemnité sur un ton de plus en plus menaçant. Je n’avais aucune envie de m’attirer la haine d’un sauvage de son espèce.
Voilà qu’un matin il vint tout rayonnant à ma rencontre. L’affaire était liquidée ; il avait retrouvé sa femme. Les parents qui l’avaient volée l’avaient emmenée vers l’amont. Au cours de leur voyage, ils passèrent la nuit dans un village où le mari avait des amis. Ceux-ci ne tardèrent pas à comprendre le fond de l’affaire. À leur tour, ils volèrent la femme, lui firent descendre le fleuve, et au petit matin la jetèrent ligotée comme un paquet bien ficelé, sur la berge de l’hôpital, où le mari en prit livraison. Il détacha ses liens et la vie commune recommença comme si rien ne s’était passé.
***
Quand la famille envoie à la femme l’ordre de retourner auprès d’elle, parce qu’un des versements n’a pas été effectué, celle-ci s’incline immédiatement, même si elle aime son mari et regrette de devoir le quitter. Elle ne se défend pas contre les ravisseurs. Les droits que la famille exerce sur elle lui paraissent tout naturels.
Même quand le prix a été payé entièrement, la famille garde le droit de recueillir la femme, si elle est maltraitée par son mari, et de la retenir jusqu’à ce que celui-ci se soit présenté devant les oncles et les frères pour se justifier et qu’il ait payé l’amende imposée par eux.
Chez les primitifs, les droits de la femme, quoiqu’elle soit vendue au mari, sont mieux sauvegardés que dans la législation des peuples civilisés. Jamais elle ne cesse d’être sous la protection de sa famille.
Le divorce est possible, mais il est rendu difficile pour la femme par l’obligation imposée dans ce cas à sa famille de rembourser au mari tout l’argent qu’il a versé pour elle au cours des années. Comme les frères et les oncles ont dépensé depuis longtemps leur quote-part, il est en général si difficile de réunir la somme nécessaire, que le divorce n’a pas lieu. Je connais cependant des cas où les proches se sont cotisés, en s’imposant de grands sacrifices, pour permettre à une parente de se séparer d’un mari qui la rendait malheureuse.
Dans le cas où un nouveau prétendant à la main de la femme se présente aussitôt, c’est lui qui doit rembourser le mari, si celui-ci accepte le divorce. Mais il faut qu’il paye la somme entière en une fois, les versements échelonnés n’étant admis dans ce cas.
Il est rare que le mari demande le divorce. En le faisant, il risque de perdre l’argent payé pour la femme. Même s’il peut prouver que les torts sont du côté de celle-ci, et qu’au cours d’une longue palabre la restitution partielle du prix d’achat lui a été accordée, il n’est pourtant pas encore sûr de l’obtenir. Il ne dispose d’aucun gage qui lui permette d’exercer une pression sur les débiteurs. Les chances d’être jamais remboursé même en partie sont donc faibles.
Les femmes des indigènes profitent largement du droit de pouvoir se retirer à tout moment dans leur famille. Le tiers de l’année, sinon plus, mes infirmiers sont en veuvage temporaire. La femme emmène les petits enfants ; les grands, elle les laisse au mari. Aussi longtemps que la femme est absente, mes infirmiers doivent faire leur cuisine eux-mêmes. La conséquence en est qu’ils sont de mauvaise humeur et négligents dans le service. Si je leur dis que je ne comprends pas qu’ils se laissent faire ainsi, ils haussent les épaules et répondent simplement : « C’est comme cela chez nous. » Ils savent que la révolte ne servirait à rien.
Malgré les discussions interminables entre le mari et la famille de sa femme, dans lesquelles celle-ci doit prendre forcément le parti des siens, les unions dans ce pays, dans la mesure où je peux en juger, sont encore assez heureuses.
Quand j’affirme que chez les blancs un homme peut se marier sans pour cela être obligé de se laisser exploiter et tyranniser pendant de longues années par la famille de la femme, cela paraît à mes noirs la plus invraisemblable des histoires. Que, le cas échéant, le mari puisse encore recevoir de l’argent de la part de la famille de sa femme, je n’ose même pas le mentionner, parce que j’y gagnerais la renommée d’être un menteur.
L’idée du tabou joue dans la vie du primitif un rôle de premier plan. Ce mot signifie l’interdiction de certaines choses ou de certains gestes, parce qu’ils entraîneraient le malheur et la mort. L’origine de l’idée du tabou est obscure.
Il y a des tabous valables pour tous sans distinction, et d’autres qui s’imposent seulement aux individus qui en sont frappés. Parmi les tabous d’ordre général, ceux qui doivent être observés par le mari dont la femme est enceinte jouent un grand rôle. Chez les pahouins, il lui est interdit de manger de la viande faisandée (quoique par ailleurs les indigènes consomment sans dégoût et sans dommage de la viande qui commence à entrer en putréfaction), de toucher un caméléon, de combler un trou dans la terre, d’enfoncer des clous, d’assister à la mort d’un être humain ou d’un animal, d’avoir à faire quoi que ce soit avec un cadavre, d’enjamber une procession de fourmis guerrières…
Au début de mon premier séjour j’étais choqué et fâché, parce que dans l’hôpital il y avait des hommes qui aux enterrements refusaient absolument d’aider à porter le cadavre. Par des promesses ou par des menaces je voulais les obliger à le faire, quand c’était leur tour. Il arrivait alors que des hommes se jetaient à mes genoux et me suppliaient de les en dispenser. Depuis que j’ai compris dans quel conflit moral je les plaçais par mes exigences, je n’emploie plus que des volontaires comme porteurs ; ils reçoivent une gratification pour ce service.
Les tabous particuliers qui n’ont de valeur que pour tel ou tel individu sont annoncés par le père à la naissance de l’enfant. D’après l’opinion des indigènes, celui-ci par cette déclaration n’exprime pas une obligation qu’il impose de lui-même à l’enfant, mais il fait connaître simplement, grâce à une révélation faite à lui par les esprits des ancêtres, ce que l’enfant doit éviter pour se mettre à l’abri d’une mort prématurée.
L’enfant est informé des tabous qui le concernent, quand il a grandi suffisamment pour savoir compter les cinq doigts de la main. Ceux qu’il ne pourrait pas encore comprendre à cet âge lui sont révélés quand il a acquis l’entendement nécessaire.
Il n’y a rien dans la vie de l’homme qui ne puisse devenir l’objet d’un tabou. Dans la région de Samkita il y avait une femme pour laquelle le tabou consistait dans l’interdiction d’utiliser un balai, et l’obligation de le remplacer par ses mains. Un garçon avait pour tabou qu’il ne devait pas recevoir de coup sur l’épaule droite. Un jour, que son maître lui donna une légère tape, parce qu’il était négligent dans son travail, il l’en remercia à sa grande surprise. Quand le blanc s’enquit de la raison de cette conduite étrange, le garçon lui répondit : « Je te remercie de m’avoir frappé sur l’épaule gauche. Que serait-il advenu, si, c’eût été la droite ! »
Le tabou fut la cause d’une histoire tragique qui se passa à Samkita pendant mon premier séjour. Un des élèves de l’école missionnaire avait pour tabou l’interdiction de manger des bananes. Il devait même se garder de toucher à un mets préparé dans une marmite où l’on venait de faire cuire des bananes. Un jour, ses camarades lui annoncèrent que le poisson qu’il mangeait sortait d’une marmite contenant encore quelques restes de bananes. Aussitôt, il fût pris de convulsions et mourut en quelques heures. Un missionnaire qui avait assisté à cet événement mystérieux m’en fit la description.
***
Il y a des femmes qui ont pour tabou que, dans le cas où leur premier-né serait un garçon, elles ou l’enfant doivent mourir. Une de ces femmes, à son premier accouchement, donna le jour à une fille. Mais de l’avis des commères qui entendirent son premier cri, cette fille aurait crié comme un garçon. Je n’ai pas pu savoir sur quels indices les femmes se basaient pour établir cette différence entre les cris des nouveau-nés. Sur la foi de ces commérages, la mère crut qu’elle avait effectivement mis au monde un garçon qui ensuite seulement avait été changé en fille. Tous les efforts de persuasion pour la détourner de cette idée fixe restèrent vains. Selon sa conviction, elle ou son enfant devait mourir. Elle choisit la mort pour elle-même. À partir de ce moment, elle dépérit à vue d’œil. Quand elle fut amenée à l’hôpital, elle était déjà squelettique. Elle mourut quelques jours après. Autant que nous pûmes le constater, sa maladie était d’origine uniquement psychique.
Que des indigènes meurent à la suite d’une violation de leur tabou, ceci provient sans doute du fait qu’ils sont dominés par la croyance aux tabous à un degré tel qu’ils sont soumis à des chocs psychiques dont nous ne pouvons pas concevoir la violence.
Un blanc qui jouit de la confiance des indigènes peut dans ces circonstances obtenir des résultats par son ascendant moral. M. Lavignotte, le directeur de la plantation de la mission protestante à Samkita, qui est un des meilleurs connaisseurs des pahouins et qui m’a fourni les éléments de plusieurs récits de ce chapitre, est intervenu avec succès dans quelques cas de violation de tabou.
Une femme de Samkita qui avait pour tabou de ne pas devoir recevoir de coups dans le dos en reçut un au cours d’une rixe entre femmes. Immédiatement elle tomba en convulsions, qui affectèrent aussi les organes respiratoires. M. Lavignotte, appelé à la hâte, lui prit la main et lui ordonna de respirer, et sur son ordre elle y réussit. Mais à peine voulait-il la quitter, qu’elle fut reprise par les suffocations. Quand il fut resté quelque temps auprès d’elle, qu’il eut prié avec elle et lui eut parlé longuement et avec insistance, elle surmonta l’idée fixe qui l’oppressait et les convulsions cessèrent peu à peu. Les jours suivants elle eut encore quelques rechutes qui nécessitèrent l’intervention de M. Lavignotte.
***
Pendant un certain temps nous n’eûmes pas l’occasion d’observer des cas de violation de tabou à l’hôpital. Récemment pourtant quelques-uns nous arrivèrent.
Un jeune homme avait pour tabou qu’il devait mourir s’il voyait couler son sang. Il fut blessé par un hippopotame et amené à l’hôpital. La blessure était assez grave et il avait perdu beaucoup de sang. Néanmoins son état n’était pas alarmant. Nous fûmes seulement frappés par son état extraordinairement apathique. Nous priâmes la mère de se prêter à une transfusion de sang. Elle y consentit, mais fit observer en même temps que rien ne pourrait sauver son fils, son tabou le condamnant à mourir. Quarante-huit heures plus tard, il succomba sans que nous puissions attribuer la mort aux blessures reçues.
Un indigène, qui s’était converti au christianisme, avait depuis sa naissance pour tabou l’interdiction de recevoir un choc sur la tête. Quand il vint à Lambaréné pour fêter Noël à la station missionnaire, la vieille petite case en bambou qui lui servait d’abri commun avec quelques autres indigènes s’effondra. Dans sa chute, un bambou lui frôla la tête. Le choc avait été si léger qu’il n’avait laissé la moindre trace, comme nous pûmes le constater par la suite. Pour un autre homme, il n’aurait eu aucune conséquence. Mais celui-ci s’évanouit aussitôt et fut pris de convulsions tétaniformes. Il nous fut amené. À notre étonnement, nous dûmes constater que le traitement que nous appliquions contre les convulsions avait très peu d’effet. Un pahouin, qui avait accompagné le malade, vint alors vers nous et nous dit : « Sans doute pouvez-vous guérir beaucoup de maladies avec vos médicaments européens. Mais pour cet homme, vous ne pouvez rien faire. Dans un cas de ce genre, il faut employer la sorcellerie. Donnez-moi le malade. Dans la forêt je le traiterai à ma façon. » Nous refusâmes naturellement cette proposition. Mais dans la nuit, le pahouin revint secrètement avec quelques indigènes, emporta le malade et disparut avec lui dans la forêt.
Quelque temps plus tard, nous eûmes l’occasion de revoir cet homme. Il se portait bien, mais il avait perdu tout souvenir de ce qui lui était arrivé. Quand nous interrogeâmes le pahouin sur ce qu’il avait fait avec le malade, il nous apprit seulement qu’il avait sacrifié un coq blanc sur son corps et l’avait aspergé du sang en récitant de vieilles incantations. Lui a-t-il donné un extrait de plantes capable d’arrêter les convulsions ? L’a-t-il influencé psychiquement ? Les deux éventualités sont difficiles à admettre, si l’on considère que le malade était sans connaissance et ne pouvait donc ni avaler ni comprendre.
Dans un autre cas récent, il s’agissait d’un homme qui de son père avait reçu comme tabou qu’il devait, pour ne pas mourir jeune, avoir une nombreuse progéniture. Il était marié depuis quelques années et avait trois enfants. Dernièrement, son père vint pour le voir et pour lui rappeler son tabou. À peine eut-il fini de parler – il nous l’a raconté lui-même – que son fils s’évanouit et tomba. Aussitôt il fut pris de convulsions. On le garda quelques jours dans le village et on nous l’amena ensuite. Il présentait à peu près les mêmes symptômes que ceux que nous avions pu observer chez l’homme qui avait été touché à la tête par un bambou. Avec lui aussi, nous dûmes constater que les médicaments destinés à arrêter les convulsions restaient inefficaces. Il mourut peu après.
Il nous est arrivé deux fois que des malades qui avaient pour tabou qu’ils ne devaient être piqués ni par une épine, ni par une aiguille, tombèrent en syncope à la suite d’une injection sous-cutanée que nous leur fîmes au cours d’un traitement. Dans un de ces cas, une défaillance du cœur nous fit craindre le pire.
***
La femme qui avait pour tabou l’interdiction de toucher un balai et qui en souffrait beaucoup en fut délivrée par monsieur Lavignotte.
Dans un petit traité sur les conceptions des pahouins, celui-ci raconte l’histoire de la guérison de Nyingone. Cette femme avait pour tabou qu’elle ne devait jamais voir son image réfléchie ni par un miroir ni par un métal ni par l’eau. Devait-elle, en revenant de la plantation avec un fardeau sur les épaules, franchir un ruisseau sur un tronc d’arbres placé en travers, elle ne pouvait pas regarder à ses pieds, comme il l’aurait fallu pour avancer avec assurance. Elle aurait pu par mégarde apercevoir son image se refléter dans l’eau. Si par malheur cela lui arrivait, elle s’évanouissait aussitôt et tombait à l’eau. Pour cette raison, plusieurs fois on avait été obligé de venir à son secours. Profondément désespérée de tout ce qu’elle endurait par ce tabou, elle vint trouver monsieur Lavignotte. « Ce tabou », lui dit-elle, « a un pouvoir terrifiant. Je ne peux pas ne pas le craindre. Mais je sais que Dieu, que vous connaissez et que vous annoncez, est plus puissant que le mauvais esprit qui est l’auteur de nos croyances. Pour cette raison, j’espère, grâce à ton aide, me débarrasser de mon tabou. Quand tu auras prié avec moi, je retournerai sans crainte le miroir que j’ai à la main et je m’y regarderai. »
Après la prière, elle eut le courage de faire comme elle avait dit. Longtemps elle se contempla dans la glace, rayonnant de bonheur, émerveillée qu’il ne lui arrivât rien. Quand enfin elle en détacha les yeux, elle dit à monsieur Lavignotte : « Et dire que je ne savais pas combien je suis belle »…
***
Une autre cause de tourments pour les indigènes réside dans leur croyance que la malédiction proférée par un homme contre un autre est agissante et qu’il y a des hommes qui ont le pouvoir de nuire aux autres par des pratiques magiques.
La malédiction paternelle notamment est considérée comme douée d’une force particulière. Une jeune femme avait refusé d’épouser, malgré l’ordre de son père, à la place de l’homme qui lui était destiné depuis sa jeunesse, un autre qui offrait pour elle un prix plus élevé. Le père, qui aurait eu besoin de cet argent pour payer ses dettes, la maudit alors et dit qu’après son mariage avec l’autre homme elle ou l’enfant qu’elle aurait de lui devait mourir. Elle accoucha d’un garçon bien portant. Pour lui conserver la vie, elle choisit de mourir elle-même. Comme dans le cas, rapporté plus haut, de la femme que son tabou avait placée devant la même alternative et qui avait pris la même résolution, elle mourut d’une mort mystérieuse par dépérissement. L’enfant nous fut amené pour être élevé chez nous au biberon. C’est de cette façon que j’eus connaissance de ce qui s’était passé.
Il y a quelques années, un missionnaire d’ici fit l’expérience qu’on pouvait aussi charger un homme d’une malédiction sans le vouloir. Il se vit obligé, comme il lui arrivait souvent, de blâmer un des grands élèves de l’école missionnaire à cause de sa malveillance envers les autres garçons. Dans sa mauvaise humeur il laissa échapper : « Tu auras toujours mauvais caractère. » Quelques années plus tard, son ancien élève vint le trouver et se plaignit que la malédiction prononcée contre lui l’avait rendu malheureux. Il dit qu’il n’avait plus le courage ni la force de vouloir devenir un autre homme, parce qu’il sentait bien que cela lui était rendu impossible. Le missionnaire, très étonné, lui demanda comment il avait pu le charger d’une malédiction. L’indigène lui rappela sa parole d’autrefois. Quand le missionnaire lui expliqua que ces mots n’étaient aucunement une malédiction, mais rien qu’un propos arraché par la mauvaise humeur, et qu’au contraire il avait toujours souhaité que son élève changeât de caractère, il devint tout joyeux. « À présent, je peux vraiment devenir un autre homme », dit-il au départ.
***
De même que la malédiction, la bénédiction, aux yeux des indigènes, est une force. Cette croyance les amène à chercher à mettre un enfant, par le nom qu’ils lui donnent, en rapport avec une personne dont ils espèrent une bénédiction pour lui. C’est le sens de la coutume de donner aux enfants non seulement le prénom, mais le nom complet d’un missionnaire ou d’un fonctionnaire en renom.
Pour obtenir sa pleine efficacité, l’autorisation de nommer l’enfant du nom d’un tiers doit être sollicitée et obtenue. Elle est alors considérée comme spontanément consentie et s’assimile à une véritable bénédiction.
Une femme qui avait accouché à l’hôpital me demande la permission d’appeler son garçon Docteur Albert. L’infirmier Dominique a nommé deux de ses filles d’après deux infirmières européennes Mademoiselle Mathilde et Mademoiselle Emma, et non Mathilde et Emma tout court.
Le jardinier d’un exploitant forestier de la contrée s’appelle Saint Vincent de Paul.
La grande épicerie parisienne Félix Potin expédie beaucoup de vivres et de conserves au Gabon. Du fait que ce nom figure sur tant de caisses, les indigènes considèrent Monsieur Félix Potin comme un des hommes les plus riches et les plus puissants d’Europe. Fréquemment, ils donnent ce nom à leurs garçons pour qu’il leur porte bonheur.
Il arrive aussi qu’on choisisse le nom en vue d’annihiler un tabou ou une influence néfaste. Si à l’hôpital nous rencontrons des filles portant des noms de garçon et des garçons portant des noms de fille, nous savons bien que le nom n’a pas été choisi par caprice, mais pour de bonnes raisons. La mère était frappée du tabou que son premier enfant devait mourir, si c’était un garçon. Elle donna donc à l’enfant qui était un garçon un nom de fille pour tourner le tabou. Ou bien une malédiction frappait l’enfant attendu, au cas où ce serait une fille. La mère lui donna donc un nom de garçon.
Une femme que je connais avait perdu plusieurs filles en bas âge. Elle attribua ces décès à un mauvais esprit à qui sa famille était soumise. Quand elle accoucha de nouveau, elle s’écria au moment de la naissance : « Quel beau garçon ! » Quoique le nouveau-né fût précisément une fille, elle lui donna un nom de garçon et agit en toute chose comme si c’en était un. Elle voulut tromper de cette façon le mauvais esprit qui, à son avis, ne visait que les filles. Effectivement, cet enfant resta en bonne santé, grandit et devint une belle fille.
En 1935, nous découvrîmes un nom qui n’avait rien à voir avec les tabous et la magie. Une mère arriva à l’hôpital avec sa fille. Au médecin qui lui demanda le nom de la petite malade pour l’inscrire sur la fiche médicale, elle répondit qu’elle s’appelait la crise. Stupéfait, le médecin répéta la question. « Elle s’appelle la crise », confirma la mère, « parce qu’elle est née au moment où la crise commença. Alors nous lui avons donné ce nom. »
***
Le refus des femmes noires de nourrir avec leur propre enfant un autre dont la mère est morte, malgré toute la pitié qu’elles peuvent avoir pour lui, doit être attribué aux superstitions. Elles craignent en effet, en prenant la place de la mère défunte auprès de l’orphelin, de transposer sur elles le pouvoir maléfique qui a provoqué la mort de celle-ci.
La situation des nourrissons orphelins est désespérée dans ce pays, parce que, dans la forêt vierge du Gabon, les vaches ne peuvent vivre à cause de la mouche tsé-tsé. On ne rencontre de chèvres qu’en très petit nombre. Encore ne donnent-elles du lait qu’en très petite quantité, parce qu’elles appartiennent à une race dégénérée et ne trouvent qu’une nourriture de mauvaise qualité. Souvent même, elles n’ont pas de quoi allaiter leurs petits.
Puisque les nourrissons après la mort de leur mère étaient fatalement perdus, on les enterrait jadis vivants avec celle-ci.
Maintenant que les européens sont dans le pays et qu’ils ont dans leurs cuisines du lait condensé arrivé d’Europe, les indigènes leur apportent des orphelins. À l’hôpital, nous avons constamment huit ou dix, sinon plus, de ces pauvres petits, que nous élevons au biberon.
Si son village natal est très éloigné de l’hôpital, l’enfant arrive chez nous à l’état de squelette recouvert de peau. L’un d’eux avait été huit jours en route et n’avait reçu pendant ce temps pour toute nourriture que des bananes, du jus de canne à sucre et de l’eau. Ce fut un miracle que nous ayons pu le sauver.
Nous gardons ces enfants trois ans, jusqu’à ce qu’ils soient en état de supporter le manioc et les bananes, les seuls vivres dont on dispose au village, et qu’ils n’aient plus besoin ni de lait ni de bouillies. Les femmes indigènes aussi donnent le sein à leurs enfants durant trois ans.
Le jour où la famille arrive pour reprendre l’enfant est une journée de larmes pour l’infirmière qui l’a soigné et qui l’a pris en affection. Elle, qui l’avait tenu si propre, frémit à l’idée de le laisser revenir au village, où il rampera par terre dans la saleté des cases. Elle essaye de faire valoir qu’il n’est pas encore assez vigoureux pour pouvoir se passer de la bouillie qu’il reçoit chez nous. Parfois, touché par ses larmes, je me laisse entraîner à l’approuver et à insister auprès de la famille pour qu’elle nous laisse l’enfant encore quelques mois. Je ne manque pas de renforcer mes arguments par un cadeau.
La solution la plus simple du problème des nourrissons orphelins serait l’élevage d’une bonne race de chèvres dans les villages, puisque les vaches ne peuvent subsister ici. Mais élever des chèvres dans la forêt vierge est une entreprise bien difficile. Je le sais par expérience. J’ai un troupeau de chèvres pour réduire la dépense considérable qu’exige la fourniture du lait qu’il faut faire venir d’Europe, pour tous les enfants qui sont élevés au biberon chez nous. Mais ici, on ne peut tenir les chèvres dans la bergerie que pour la nuit. Dans la journée, elles y périraient par suite de la chaleur. Il faut donc les laisser en liberté du matin au soir. Beaucoup d’animaux succombent alors, parce qu’ils ont brouté des plantes vénéneuses. Beaucoup aussi meurent de la gale. Pour les en préserver, il faut des soins constants et attentifs. Chaque matin, en les laissant sortir de la bergerie il faut examiner toutes les bêtes l’une après l’autre pour commencer le traitement dès la première apparition d’une tache suspecte. Pour ces raisons l’élevage de troupeau de chèvres par les indigènes ne me paraît guère possible dans ce pays. Ils ne prennent pas la peine de soigner les bêtes comme il faudrait ; ils n’ont pas non plus les connaissances et les ressources nécessaires. Si un animal tombe malade, ils le tuent pour le manger.
Reste donc l’autre possibilité : affranchir les femmes des idées superstitieuses qui les empêchent de nourrir les enfants qui ont perdu leur mère. Mais ceci aussi est extrêmement difficile. Dans notre hôpital, nous avons quelques fois réussi à persuader une femme d’allaiter un nourrisson orphelin. Les femmes de nos infirmiers Dominique et N’Yama donnèrent les premières le bon exemple. Mais le plus souvent, nos prières restaient vaines. Pour faire cet acte de charité pour le pauvre petit être, il ne suffit pas que la femme indigène s’élève au-dessus des idées superstitieuses : il lui faut aussi le courage et la force de braver sa famille qui vit encore dans ces préjugés et qui lui reproche d’exposer son enfant au danger. Nous avons vu plus d’une fois qu’après avoir essayé d’allaiter un orphelin, elles ont dû y renoncer pour ce motif.
À notre hôpital, une dame européenne mit au monde un enfant qui était si faible qu’il ne pouvait être sauvé que par du lait de femme. Comme la mère ne pouvait lui en donner, nous essayâmes de persuader une indigène qui avait accouché en même temps à l’hôpital de nourrir ce petit avec son enfant à elle. Mue par la pitié et aussi par l’appât d’une belle récompense, elle y consentit. Mais son mari ne voulut pas le lui permettre. Quoique la mère de l’enfant blanc fût encore en vie, il s’opposa à ce que sa femme enfreignît le principe de ne jamais nourrir un enfant étranger. Comme elle passa outre, il la maltraita et l’obligea à quitter avec lui l’hôpital nuitamment.
L’indigène qui désire acquérir des forces magiques se rend auprès d’un féticheur. Celui-ci lui enseigne les connaissances nécessaires et lui fait parcourir toute une série d’initiations.
Tout grand fétiche nécessite à la base de sa préparation le sacrifice d’une vie humaine. Combien d’hommes ont dû être sacrifiés autrefois dans ce pays pour fournir des fétiches aux chasseurs d’éléphants ! Aujourd’hui encore, il y a des indigènes qui commettent des assassinats dans ce but. Dans les grands fétiches que j’ai pu examiner, parce que des chrétiens les avaient remis aux missionnaires, il y avait toujours un fragment de crâne humain.
Il n’est pas rare que le sorcier révèle à l’homme qui veut se procurer un fétiche, qu’il doit à cet effet tuer un proche parent. Il ajoute d’ordinaire que le demandeur doit mourir lui-même, s’il ne commet pas l’assassinat. Il y a quelques années, un jeune homme se rendit dans son village natal avec l’intention de tuer son père pour se procurer un fétiche. Le père devina pour quelle raison le fils était venu. La nuit, il se leva et cria par le village : « Il y a quelqu’un parmi nous qui veut me tuer. Mais ici il y a quelqu’un qui est plus fort que lui. » Le lendemain, le fils s’enfuit à une station missionnaire. Peu de temps après il mourut.
Un autre jeune homme désirait devenir pilote sur un vapeur fluvial. Avec sa mentalité de primitif il croyait qu’il ne suffisait pas de servir quelque temps comme matelot et de devenir ensuite un bon aide-pilote, mais, qu’il fallait encore un fétiche approprié. Pour celui-ci, il fut exigé qu’il tuât sa mère. Ne pouvant s’y résoudre, il comprit qu’il ne lui restait plus qu’à mourir lui-même. Effectivement, il dépérit. Avant de mourir, il avoua son projet à sa mère.
***
L’atroce histoire d’un sorcier qui, sans le vouloir, provoqua par ses envoûtements sa propre mort, fut racontée à M. Lavignotte par un vieux pahouin.
Un homme très laid et très méchant ne pouvait pas trouver femme. Les oncles et les frères aînés – le père était déjà mort –, refusaient de lui en acheter, parce qu’ils ne l’aimaient pas. Très aigri par ce mépris, il s’adonna à la sorcellerie. Il n’hésita même pas à empoisonner quelques membres de sa famille. Mais il sut détourner les soupçons sur d’autres. Ainsi il ruina toute la famille sans qu’on pût lui prouver quoique ce fût, sans même qu’on pût supposer qu’il en était l’auteur. Finalement il se débarrassa aussi d’un de ses frères par le poison.
Quand la période de deuil fut passée, la famille se réunit pour décider à qui appartiendrait désormais la femme du défunt. On laissa à la femme le choix entre les frères survivants et elle déclara qu’elle aimait celui qui était si laid et qu’elle voulait devenir sa femme. Celui-ci s’en réjouit autant qu’il s’en étonna. Il avait ainsi acquis une femme pour laquelle il n’avait rien à débourser, parce qu’elle appartenait déjà à la famille. Elle lui fut très dévouée et il vécut très heureux avec elle.
Après quelque temps, elle lui demanda la permission d’aller voir un de ses frères malade dans un village éloigné et de le soigner. Quand elle revint auprès de son mari après une courte absence, elle lui dit qu’elle l’aimait tellement qu’elle n’avait pas supporté une plus longue séparation. En même temps, elle le pria de préparer un grand fétiche contre celui qui était l’auteur de la maladie de son frère.
L’homme, qui avait pleine confiance en sa femme, lui révéla le secret qu’il lui avait caché jusqu’alors et lui avoua qu’il avait en effet acquis de grandes forces magiques. Il la pria de lui procurer une parcelle quelconque du corps de l’homme qu’elle considérait comme l’auteur de la maladie de son frère. Elle lui remit quelques cheveux comme provenant de celui-ci.
En effet, pour préparer un fétiche efficace contre un homme, un des ingrédients essentiels, selon la croyance des primitifs, est une parcelle de son corps, si petite soit-elle. Par crainte qu’ils ne soient livrés à un sorcier pour un mauvais usage, les primitifs ramassent soigneusement, afin de les détruire, tous les déchets qui tombent quand ils se coupent les cheveux et les ongles. L’envoûtement pratiqué sur une petite parcelle du corps étend son effet sur l’homme tout entier, telle est leur croyance.
Avec les cheveux remis par la femme, le mari prépara l’envoûtement, en procédant de la façon suivante. Il mit les cheveux et une mixture préparée selon les prescriptions rituelles dans une grande coquille d’escargot et les plaça sur un feu. Le fétiche devenait efficace, si le liquide se mettait à bouillonner, et, débordant la coquille, éteignait le feu. Par ce procédé, la vie de l’homme envoûté devait s’éteindre comme ce feu.
L’envoûtement échoua plusieurs fois, parce que sous l’effet de la chaleur les coquilles éclatèrent, avant que le liquide ne se mît à bouillir. Le sorcier en fut très étonné, et fit à sa femme la remarque que l’autre homme devait posséder lui aussi une grande force magique. Enfin, à la neuvième tentative, la coquille resta intacte, le liquide se mit à bouillir, déborda et amena l’extinction du feu. Triomphalement, le sorcier annonça à sa femme que c’en était fait de la vie de l’homme dont elle souhaitait la mort. Ensuite il but et mangea et il se coucha. Au cours de la nuit, il se sentit tout à coup en proie à une grande agitation et mourut le lendemain.
Quand la période de deuil fut passée, la femme convoqua les membres de la famille et leur dit : « J’ai tué votre frère. Il était responsable de la mort de mon premier mari, que j’avais tant aimé. Je savais qu’il l’avait empoisonné. Pour me venger, je devins la femme de l’assassin, car je le soupçonnais d’être un grand sorcier. Je gagnai sa faveur et sa confiance et j’en profitai pour lui faire préparer un fétiche contre lui-même. Les cheveux que je lui avais donnés étaient les siens propres. De cette façon, j’ai tué un homme des vôtres. Je suis entièrement en votre pouvoir. Faites de moi ce qu’il vous plaira. »
Les membres de la famille lui répondirent : « Tu as tué un homme de notre sang. Mais en même temps, tu nous as délivrés d’un méchant sorcier. Tu es libre, tu peux habiter parmi nous, ou, si tu préfères, retourner dans ton village. »
Jusqu’à ce moment, la femme faisait partie de la famille seulement par son mariage. Elle n’était pas libre. Après la mort de son deuxième mari, les membres de la famille auraient pu l’attribuer de nouveau à un autre homme. En renonçant à ce droit et en laissant la femme disposer d’elle-même, ils firent preuve d’une grande bienveillance à son égard.
Naturellement, le sorcier n’était pas mort des suites de son propre envoûtement, mais d’un poison que sa femme lui avait administré après cette cérémonie. Mais elle lui fit faire l’envoûtement contre lui-même pour être sûre que le poison produirait son effet aussi contre un homme doté de forces surnaturelles. Sans cela, elle n’aurait pas osé commettre cet attentat contre lui.
***
Tandis que nous attribuons la mort d’un homme à une cause naturelle, les indigènes sont enclins à en chercher l’explication dans un sortilège pratiqué contre lui. Pour cette raison, très souvent la famille du défunt se croit obligée de rechercher, le mort à peine enterré, le ou les auteurs du sortilège dont il aurait été la victime. À cet effet, elle s’adresse à un féticheur, auquel elle prête le pouvoir de découvrir les coupables. Ceux qu’il désigne, il les oblige à boire un breuvage auquel il a mêlé du poison. Si celui-ci produit son effet sur eux, ils sont jugés coupables. Même s’ils s’en remettent on les fait mourir. C’est parce qu’on a recours si souvent aux services des féticheurs en cas de décès et que chacun est alors à leur merci, que ceux-ci ont un si grand pouvoir sur les indigènes. Dans le livre relatant ses voyages à travers les régions au sud de l’Ogooué paru en 1861, Du Chaillu nous fait la description d’un procès de ce genre, tel qu’il se déroulait à cette époque-là[2].
Dans le village de Goumbi il trouva son ami M’Pomo, un indigène encore assez jeune, à l’agonie. Les habitants le prièrent d’user de ses médicaments pour le sauver, mais il dut leur déclarer que tout espoir était perdu. Le jour même de l’enterrement, les parents commencèrent à agiter la question des auteurs éventuels de cette mort. Ils n’admettaient pas que ce jeune homme, qui quelques semaines auparavant était encore en pleine santé, eût pu mourir autrement que par suite de pratiques magiques. Ils firent venir un grand féticheur de l’intérieur. Durant deux jours et deux nuits, celui-ci pratiqua toutes sortes de cérémonies. Le troisième jour, quand il vit que les esprits étaient montés au plus haut degré d’effervescence, et que tous, hommes et femmes, jeunes et vieux ne respiraient plus que vengeance contre les sorciers supposés, il les réunit sur la place du village pour leur révéler enfin les noms des coupables. En vain Du Chaillu tenta d’arrêter les événements horribles qui se préparaient. Ses paroles n’eurent aucun effet sur les habitants, qui auparavant avaient pourtant reconnu son autorité et accepté ses conseils. Il dut se résigner à rester spectateur impuissant et désolé des scènes horribles qui allaient se dérouler.
Sur un signe du féticheur, la foule hurlante et frémissante devint tout à coup immobile et muette. Dans le profond silence, sa voix stridente se fit entendre : « Dans la case que voici il y a une femme très noire : c’est elle qui a ensorcelé M’Pomo. » Aussitôt, la foule se rua vers cette case. On saisit une jeune fille, nommée Okandaga, sœur d’Adouma, le fidèle serviteur de Du Chaillu. On l’entraîna au bord de l’eau et on la ligota. Quand son regard rencontra Du Chaillu, elle cria désespérément : « Chally, Chally, ne me laisse pas mourir. » Il détourna la tête d’émotion. Un instant, il pensa se jeter au milieu de la foule et à lui arracher sa victime ; mais aussitôt, il dut renoncer à ce projet désespéré. Versant de chaudes larmes d’être réduit à l’impuissance, il se cacha derrière un arbre.
À nouveau, sur un appel du féticheur, le silence se fit. Pour la seconde fois, sa voix se fit entendre : « Dans cette autre case, il y a une vieille femme : celle-ci aussi a ensorcelé M’Pomo. » De nouveau, la foule se précipita dans la direction indiquée, et s’empara d’une respectable vieille femme, une parente de Quenzéga, le grand chef de cette région. Elle toisa fièrement ses agresseurs. « Je boirai le breuvage, » leur dit-elle, « mais si je n’en meurs pas, malheur à ceux qui m’ont accusée. » À son tour, elle fut entraînée vers le fleuve et ligotée.
Pour la troisième fois, le silence s’établit. Pour la troisième fois, le glapissement du féticheur se fit entendre : « Une femme avec six enfants habite dans une plantation en direction du soleil levant : celle-ci encore a ensorcelé M’Pomo. » De nouveau, la foule se rua dans la direction indiquée et ramena une esclave de Quenzéga, qui jouissait d’une grande considération et était aussi connue de Du Chaillu.
Le féticheur s’approcha alors des femmes ligotées et expliqua à la foule pourquoi elles avaient fait des sortilèges contre M’Pomo. Okandaga lui avait gardé rancune de ce que quelques semaines auparavant il avait refusé de lui donner du sel dont on manquait alors. La parente de Quenzéga l’avait pris en haine, parce qu’il avait des enfants, tandis qu’elle était stérile. L’esclave lui avait demandé un miroir qu’il lui avait refusé ; pour cette raison elle avait voulu le faire périr. Chacune de ces accusations fut accompagnée des imprécations sauvages de l’assistance. Les parents des accusées élevèrent la voix avec les autres, car chacun dut craindre que sa tiédeur, dans l’exaltation générale, ne le rendît suspect à son tour.
Aussitôt, les trois femmes furent traînées dans l’une des grandes pirogues accostées près de la rive, où montèrent également le féticheur et quelques hommes armés. La foule se tenait sur la berge. Aux sons du tam-tam le féticheur prépara le breuvage de l’ordalie. Quabi, le frère aîné du défunt, présenta la coupe aux malheureuses femmes. La foule s’écria : « Si elles sont des sorcières, que le breuvage les tue ! Si elles sont innocentes, qu’il ne leur fasse point de mal ! » Toutes les trois s’affaissèrent après avoir bu. Chacune fut immédiatement décapitée. Quand la troisième fut exécutée, les hommes armés se précipitèrent sur les cadavres. Les ayant taillés en morceaux, ils les jetèrent au fleuve. Cela fait, les gens s’en retournèrent à leurs cases. Un silence lugubre régna sur tout le village. À plusieurs reprises déjà des habitants avaient été sacrifiés de cette manière au cours des dernières années.
Dans la soirée, Adouma, le serviteur de Du Chaillu, vint le trouver en secret. Il souffrait atrocement d’avoir été forcé non seulement d’assister au supplice de sa sœur, mais encore de vociférer en chœur avec les autres. Son maître essaya de le calmer. Il lui parla de Dieu, qui réprouve toute cruauté. « Oh Chally », dit le pauvre indigène, « quand tu seras rentré dans ton pays dis aux habitants de là-bas qu’ils nous envoient des hommes pour nous enseigner, à nous pauvres noirs ignorants les paroles sorties de la bouche de Dieu. »
***
Aujourd’hui, les féticheurs ne peuvent plus exercer leur pouvoir publiquement. Mais comme les anciennes croyances jouissent toujours d’un certain crédit auprès des indigènes, il arrive encore assez souvent que des gens soient accusés d’avoir provoqué un décès par des sortilèges. Cependant ces procès, où le féticheur continue à jouer son rôle néfaste, ne se font plus que secrètement. La pauvre victime de cette effroyable superstition n’est plus assassinée purement et simplement. On l’empoisonne, ou on lui fait perdre la vie dans un accident savamment machiné.
À mon hôpital je me fais un devoir d’expliquer à la famille qui est venue accompagner le malade, la cause du décès survenu. Mais je ne peux pas me bercer de l’illusion qu’ils ajoutent toujours foi à mes dires. Surtout s’il s’agit d’un décès imprévu, ils ne renoncent pas toujours à rechercher l’auteur du sortilège.
Du début de mon activité dans ce pays, je garde le souvenir d’un cas particulièrement émouvant. On m’avait amené un homme atteint d’une septicémie qui provenait d’une petite blessure à l’occiput. Dès le début, j’informai les hommes qui l’accompagnaient que la mort était fatale. J’essayai de leur expliquer, aussi bien que je le pus, que l’horrible enflure de la tête et du cou ainsi que l’état misérable du malade avaient pour cause cette petite blessure. Ils m’écoutèrent d’un air absent. Quand la mort fut survenue, ils entourèrent un jeune homme venu avec eux et lui parlèrent avec tous les signes d’une grande agitation. Par mon infirmier, qui avait surpris leur conversation, j’appris qu’ils avaient amené le jeune homme de force, parce qu’ils le rendaient responsable de cette mort. Quelque temps auparavant il avait commis l’imprudence de raconter à un ami qu’en songe il avait traîné cet homme, avec lequel il vivait dans les meilleurs termes, en le tenant par une liane passée autour de son cou. Quand l’homme fut tombé gravement malade, les autres se saisirent de lui et lui annoncèrent qu’il serait tué, si le malade venait à mourir. Par les révélations qui lui avaient échappé, il s’était dénoncé à leurs yeux comme l’ennemi qui en voulait à la vie de l’autre. Le songe même, ils le considéraient comme une sorte d’envoûtement. Quand je sortis et que j’essayai de leur faire abandonner leur superstition et que je les menaçai aussi de les dénoncer à l’administrateur s’ils entreprenaient quelque chose contre ce malheureux, ils nièrent qu’il fût question de le rendre responsable de cette mort. Sur ces entrefaites, je dus me rendre à la salle de consultation pour m’occuper d’un malade. Quand je revins, ils étaient partis avec le cadavre et en emmenant l’accusé. Leur pirogue se trouvait déjà au milieu du fleuve. En les poursuivant je n’avais aucune chance de les rejoindre. Ne connaissant ni leurs noms, ni leur village, je ne pus rien faire contre eux.
***
En exécutant les cérémonies pour découvrir le coupable, le féticheur se laisse guider naturellement par les bruits qu’on lui a rapportés concernant les ennemis éventuels du malade ou du défunt. Souvent aussi, il profite de l’occasion pour se venger de gens qui se sont attiré sa haine. Il n’est pas rare qu’il exerce aussi un chantage. S’il condamne quelqu’un à boire le breuvage de l’ordalie, il s’attend à ce que la famille lui fasse des offres en secret pour l’amener à n’y mettre aucun poison.
Mais en beaucoup de cas les féticheurs, dans leurs abominables pratiques, sont de bonne foi et convaincus de pouvoir désigner le coupable en vertu des connaissances secrètes qu’ils détiennent. Si à l’occasion ils ne dédaignent pas la tromperie, ils ne sont cependant pas seulement des imposteurs.
À la suite des initiations par lesquelles ils ont passé, ils sont persuadés d’être détenteurs d’un pouvoir surnaturel qu’ils pensent ensuite utiliser dans leurs cérémonies.
Il est très difficile d’entraver l’activité des féticheurs, par le fait que d’ordinaire on ne connaît pas leur identité. Le féticheur aujourd’hui ne se produit pas en public, mais agit en secret. Ceux qui ont besoin de ses services vont le consulter de nuit. Ils se gardent de parler de lui. En dévoilant ce qui doit rester secret, ils doivent s’attendre à le payer tôt ou tard de leur vie. Aussi longtemps que les indigènes restent sous l’emprise de la superstition, la position des féticheurs est inébranlable.
***
Récemment encore, j’eus l’occasion de faire l’expérience combien les indigènes sont toujours dominés par la crainte de sorcellerie. Une femme devait subir une petite intervention chirurgicale ne comportant aucun risque. Au moment de se rendre à la salle d’opération, elle fut au désespoir et voulut s’enfuir. Son mari nous supplia de ne rien entreprendre et ne se laissa pas calmer par les discours que je lui fis. Vu la facilité avec laquelle les indigènes se prêtent d’ordinaire aux opérations, l’attitude de ce couple me parut si étonnante, que je lui soupçonnai des raisons cachées. Au cours d’un long entretien avec le mari, j’appris enfin le motif de leur crainte. Deux hommes, dit-il, qui leur voulaient du mal, avaient ensorcelé la femme, de sorte qu’elle devait mourir, dès qu’un couteau aurait pris contact avec sa chair. Nous eûmes beaucoup de peine à décider la pauvre créature à néanmoins accepter l’intervention chirurgicale. Quelques jours après, elle était guérie et put rentrer chez elle.
Les indigènes qui viennent à l’hôpital pour se faire soigner sont souvent hantés par des pensées dont nous ne soupçonnons rien. Par suite d’un tabou, d’une malédiction ou d’un sortilège, ils sont dans une détresse dont nous ne nous rendons pas compte. Dans bien des cas ce n’est pas tant l’espoir de trouver l’aide du médecin qui les a amenés ici, que le besoin de gagner un asile, où les puissances démoniaques n’aient plus de pouvoir. Car les indigènes, même ceux qui sont encore complètement imbus des idées ancestrales inclinent à croire que sur le terrain de la mission et de notre hôpital, les tabous, les malédictions et les sortilèges restent sans effet.
Il n’est pas rare que ceux qui craignent d’être soupçonnés d’avoir été les auteurs de sortilèges, dans le cas d’un décès, insistent pour que le malade soit amené à l’hôpital. D’ordinaire, ils accompagnent la famille. Même si le malade devait mourir chez nous, ils peuvent alléguer que ce n’était pas par suite d’un envoûtement dont on aurait pu les accuser, du fait qu’ici il serait resté inefficace. Naturellement, ces gens ne nous disent pas la véritable raison pour laquelle ils ont accompagné le malade. Mais parfois nous l’apprenons par des voies détournées.
Nous déplorons que nos malades puissent si rarement se résoudre à nous révéler leur état moral. S’ils le faisaient plus souvent, dans beaucoup de cas nous serions mieux à même de les aider. La psychothérapie comme complément du traitement médical est souvent encore plus nécessaire pour le primitif que pour l’européen.
***
Les jumeaux sont tout particulièrement l’objet d’idées superstitieuses. Généralement leur naissance est considérée comme un événement de mauvais augure pour la famille et pour le village. Certaines tribus indigènes avaient la coutume de les tuer immédiatement. Autrement, croyait-on, la mère devait mourir, ou, si elle restait en vie, ne pouvait plus mettre au monde d’autres enfants. On admettait également qu’elle pourrait être une cause de malheur pour le village.
Chez les tribus qui leur faisaient grâce de la vie, les jumeaux étaient considérés comme menacés particulièrement par les mauvais esprits. Pour se protéger contre eux, ils devaient observer beaucoup de prescriptions qui ne s’appliquaient pas au commun des hommes.
Chez les galoas, population autochtone de la région de Lambaréné, encore aujourd’hui les jumeaux doivent se distinguer comme tels par leurs noms. Ils portent donc tous et toujours les mêmes noms : l’aîné, que ce soit un garçon ou une fille, s’appelle Nora, le puîné Yéno. Après l’accouchement, la mère est l’objet de beaucoup de cérémonies et pendant un temps assez long, elle ne doit pas quitter sa case, celle-ci lui offrant une certaine protection contre les mauvais esprits dont elle est menacée par suite de la naissance des jumeaux.
Dès que les enfants sont en état de marcher et de ce fait ne se tiennent plus continuellement dans la case, de nouveau de grandes cérémonies sont organisées, pour les protéger contre les mauvais esprits qui à présent leur deviennent encore plus dangereux. Ces cérémonies occasionnent de grandes dépenses aux parents. Ils sont obligés d’entretenir pendant plusieurs jours la famille et la foule des amis qui sont venus y assister. La mère doit bien veiller à traiter les deux enfants rigoureusement de la même manière, jusque dans les derniers détails. La nuit, par exemple, elle ne peut pas les coucher n’importe comment, mais elle doit s’étendre entre les deux sur le dos et dormir dans cette position. Elle doit aussi veiller à donner aux deux la même nourriture et à les habiller de façon identique. Les visiteurs qui leur apportent des cadeaux ne peuvent pas donner ceci à l’un et cela à l’autre, mais les cadeaux doivent être semblables.
Il n’est pas permis aux deux enfants de se marier à des époques différentes. Leurs noces doivent être célébrées le même jour. La chose se complique encore, si les jumeaux sont de sexe différent. Si ceux-ci ne se marient pas en même temps, celui qui est resté célibataire doit renoncer, là où la coutume est encore strictement observée, à jamais conclure une union. Il n’est pas libre de se marier plus tard que l’autre.
En cas de décès de l’un des jumeaux, l’autre ne doit ni voir le cadavre, ni assister à l’enterrement. Il est obligé de s’enfermer pendant quelque temps dans sa case. Ensuite il doit se soumettre à une nouvelle série de cérémonies pour pouvoir rester en vie. Au fond, on considère qu’il est mort et a été enterré en même temps que l’autre. Toutes les idées et les coutumes concernant les jumeaux sont donc basées sur la conception qu’ils ne forment qu’une seule et même personne.
Chez les pahouins, restés plus fidèles aux conceptions primitives, cette idée se manifeste encore plus nettement. Quand un des jumeaux est malade, ce n’est pas lui qui est soigné, mais son frère. Je connais un cas où un petit jumeau mourut de paludisme, du fait que ce ne fut pas lui qui reçut la quinine que lui destinait la femme du missionnaire : sa mère l’administra à son frère.
Dans la région de Samkita, il y avait une femme qui rendait la vie dure à son mari, parce qu’elle était toujours préoccupée de la santé de son frère jumeau, qui vivait dans un autre village. Avait-elle mal à la tête, elle l’interprétait comme un signe que celui-ci était tombé malade, et elle demandait à son mari de pouvoir se rendre auprès de lui, pour apprendre de quels remèdes il avait besoin et pour les absorber à sa place. À la fin, le mari ne put faire autrement que de consentir au divorce qu’elle demandait afin de pouvoir vivre dans le village de son frère.
Si dans le village où il y a des jumeaux survient un décès, ceux-ci doivent se cacher dans leur case et subir ensuite des cérémonies destinées à les protéger contre les mauvais esprits dont l’activité s’est signalée par cette mort.
En cas de décès de l’un des jumeaux, de grandes cérémonies sont nécessaires pour séparer le survivant du mort, avec lequel il avait formé auparavant un seul individu, et pour lui permettre de mener une existence propre pour le reste de ses jours. D’après les croyances des pahouins ils mourraient aussitôt, si ces conditions n’étaient pas remplies. Les féticheurs ont naturellement intérêt à maintenir ces coutumes. La célébration de ces rites est pour eux une source de revenus.
Parce que les jumeaux n’ont pas une personnalité propre et complète, les pahouins ne les considèrent pas comme des gens normaux. Ils leur accordent pour cette raison une plus grande indulgence qu’aux autres hommes. On admet généralement que par leur nature même les jumeaux aient mauvais caractère, sans les en tenir responsables. Si quelqu’un a le tempérament colérique, il est d’usage de lui demander s’il est un jumeau. Répond-il par l’affirmative, il en est excusé. La coutume veut que chacun supporte avec patience les caprices des jumeaux.
Chez les pahouins, et aussi chez d’autres tribus, il est interdit aux jumeaux de regarder l’arc-en-ciel. Celui-ci est considéré comme un signe de malheur. Se montre-t-il au ciel, tout le village est saisi de peur. Les jumeaux étant considérés comme capables d’attirer des malheurs sur eux-mêmes et sur leur entourage, doivent se cacher devant lui. Autrefois il arrivait que des jumeaux nouveau-nés fussent tués sur l’ordre des féticheurs, pour prévenir le malheur qu’un arc-en-ciel pouvait porter au village. Chez les tribus de l’intérieur, où l’autorité des conceptions primitives n’est encore guère ébranlée, la mère, de nos jours même, n’est pas sans devoir craindre pour la vie de ses petits jumeaux à l’apparition d’un arc-en-ciel, comme aussi aux éclipses solaires et lunaires.
***
Celui qui a connu tant soit peu les idées qui déterminent le monde des primitifs et qui sait quelque chose de l’angoisse dans laquelle peuvent vivre des hommes pour qui les tabous, les malédictions et la sorcellerie sont des réalités efficaces, celui-ci ne peut plus douter un instant que notre devoir est de chercher à les libérer de leur superstition. Tous ceux qui livrent ce combat savent combien il est dur à mener. Ces idées ont des racines si profondes dans les traditions des primitifs et dans leur conception des choses, qu’elles sont difficiles à extirper.
Les indigènes voient une preuve de la vérité de leurs idées dans le fait qu’il existe toujours des personnes qui succombent à la suite d’une infraction à leur tabou, d’une malédiction lancée contre elles ou d’un envoûtement auquel elles se sentaient soumises. Ce raisonnement n’est pas facile à réfuter, car il est malaisé de leur faire comprendre que dans ces cas il s’agit d’événements conditionnés par la vie psychique.
Les indigènes qui nous affirment de bonne foi qu’ils se sont élevés au-dessus de ces conceptions, en réalité ne s’en sont pas toujours complètement débarrassés. Elles existent quelque part dans leur subconscient et peuvent se ranimer au moindre incident.
Dans notre lutte pour l’émancipation morale des indigènes, le réveil des superstitions en Europe nous place dans une situation tragique. Les indigènes y trouvent une justification de leur attitude inattendue. Ceux d’entre eux qui savent lire apprennent par les journaux qu’il y a aussi des blancs qui croient à l’existence de forces surnaturelles que les hommes peuvent s’asservir. Ils répandent cette nouvelle autour d’eux et nous interrogent à ce sujet.
Les indigènes sont en outre mis en contact avec les nouvelles superstitions d’outre-mer par des européens qui en font un métier et qui par des prospectus envoyés par la poste leur offrent leurs services de voyants, d’astrologues ou de fabricants de talismans. Par la quantité de lettres de cette espèce reçues par mes infirmiers indigènes, je peux me rendre compte dans quelle mesure se pratique cette exploitation. Je suis persuadé que chacun de mes infirmiers a envoyé plus d’une fois son salaire de tout un mois en Europe pour obtenir de quelque astrologue son horoscope, un talisman ou un renseignement. Autrefois, ils venaient me prier de me charger à leur place de l’envoi des fonds. Comme j’essayais de les détourner de dépenses aussi stupides, ils le font maintenant en cachette.
Un de mes infirmiers, qui ne sait ni le jour ni l’année de sa naissance, fit parvenir à l’astrologue, en même temps que le mandat, quelques-uns de ses cheveux, pour qu’à leur aide il pût établir son horoscope.
Récemment encore, un infirmier m’apporta une page dactylographiée dans laquelle un astrologue européen lui annonçait qu’à l’heure de sa méditation il s’était senti obligé de s’occuper spécialement de sa personne, qu’il avait découvert quelque chose de très important pour lui et qu’il était prêt à le lui révéler contre envoi de 50 francs. L’indigène était devant moi, tremblant d’orgueil et visiblement ému qu’un blanc vivant si loin et complètement inconnu de lui lui manifestât tant d’intérêt. J’essayai de lui expliquer que cet homme était un exploiteur, qui avait envoyé la même lettre à tant et tant d’autres indigènes et que l’argent seul lui importait. Mais il ne put le comprendre. Il crut que je lui enviais l’honneur qui lui était fait et le bonheur qui l’attendait. Je suis persuadé qu’il a quand même envoyé la somme demandée et a reçu en échange une lettre avec quelques phrases astrologiques, qui lui sont restées complètement sibyllines.
Le jeu frivole des idées superstitieuses auquel on se livre en Europe constitue une grave menace pour la considération morale dont les blancs devraient jouir parmi les indigènes.
Pendant mon premier séjour ici, je fis venir d’Europe pour un brave vieux catéchiste de la mission protestante qui avait perdu toutes ses dents, un dentier d’après l’empreinte qu’avait prise, avant mon arrivée, un missionnaire de Lambaréné. Le dentiste qui l’avait fait eut la bonté de facturer seulement la valeur des matériaux employés. De cette façon, le bon vieux eut un dentier qui ne lui revenait pas cher et qui lui allait assez bien. Mais quelque temps après, il vint me trouver et me réclama son argent. J’examinai le dentier et je ne trouvai rien à corriger. Il allait bien et il n’y avait pas de points douloureux. Non sans étonnement, je lui demandai de quoi il avait à se plaindre. Il me répondit : « Les nouvelles dents ne tiennent pas aussi solidement que les anciennes. » Pendant des mois il m’a poursuivi de ses doléances voulant à tout prix se voir rembourser son argent.
***
Chez une jeune fille nous étions obligés de pratiquer l’énucléation d’un œil. Après quelque temps, nous le remplaçâmes par un œil artificiel, que nous avions fait venir d’Europe. L’enfant s’y habitua rapidement. Le père et la mère, qui l’avaient accompagnée chez nous, manifestèrent une grande joie, parce que leur fille n’était plus défigurée par l’absence d’un œil. Leur reconnaissance envers nous venait aussi de ce qu’ils pouvaient de nouveau exiger le prix fort pour son mariage. Quand ils furent sur le point de partir avec l’enfant, la mère prit à part un des médecins et lui dit : « Docteur, dis-moi encore une chose. Quand l’enfant pourra-t-elle voir avec son nouvel œil ? »
***
Un malade blanc avait passé plusieurs semaines à notre hôpital. Quand il fut parti, on constata que le thermomètre médical avait disparu de sa chambre. Nous nous demandions si, par mégarde, il l’avait emporté dans ses bagages ou si son boy l’avait jeté, de peur que nous ne nous apercevions qu’il s’était cassé entre ses mains. Il faut savoir que chaque blanc se fait accompagner à l’hôpital par son boy, qui le sert et fait aussi sa chambre.
Trois semaines plus tard, je rencontrai le blanc sur l’autre rive du fleuve, à Lambaréné. « J’ai quelque chose à vous rendre », dit-il, et il tira le thermomètre de sa cantine. Ensuite il me raconta l’histoire de sa disparition. Quand il fut rentré, le boy lui dit le soir : « Monsieur, n’oublie pas de prendre sous le bras le bon médicament, pour que tu restes en bonne santé. » « Que veux-tu dire ? » « Le médicament en verre, qui brille si bien. » « Ah », dit le blanc, le thermomètre : mais je n’en ai pas ici. » « Si », dit le boy, « nous en avons un », et fièrement il sortit le thermomètre de son étui. Plein de sollicitude pour son maître il l’avait emporté secrètement.
***
Chez une femme indigène qui était encore une vraie primitive nous avions fait l’opération de la cataracte. Le lendemain, quand la malade se sentit des élancements dans l’œil, elle descendit au fleuve plusieurs fois dans le courant de la nuit, pour le rafraîchir avec de l’eau. À la fin, nous fûmes obligés de mettre un gardien pour l’en empêcher. Malgré ces lavages contre-indiqués, l’œil guérit bien.
Voilà qu’arriva le moment d’enlever le pansement et de faire le premier contrôle de l’acuité visuelle. Le médecin qui l’avait opérée fit quelques gestes de la main et demanda à la malade si elle la voyait. Pas de réponse. Elle ne voulut pas non plus compter les doigts de la main qu’on lui mit sous les yeux. Quoi qu’on fît, il n’y avait pas moyen d’obtenir une réponse. Quand à la fin le médecin, un peu décontenancé, mais aussi irrité, car il s’était aperçu que la malade voyait quelque chose, lui demanda pourquoi elle ne donnait aucune des indications demandées, la femme répondit d’un ton maussade : « Tu m’as opérée. Tu dois donc savoir si je vois et comment je vois. »
Plus gentille fut la conduite d’un vieillard, venu de l’intérieur, qui avait également été opéré de la cataracte. La veille de son départ, il manifesta sa joie et son bonheur d’avoir recouvré la vue et sa reconnaissance envers le médecin par une danse solennelle à travers l’hôpital. Ce fut un spectacle vraiment émouvant.
***
Un homme, nommé Ebang Eï, était chez nous avec une énorme hernie que le docteur avait déclarée inopérable, lors d’une première intervention. Voilà qu’il était revenu et nous importunait sans cesse, pour que l’opération fût reprise. Nous avions beau lui représenter avec insistance le danger qu’elle pouvait comporter, il pria et insista tant et si bien que finalement nous nous décidâmes à la faire. Fou de joie, il parcourut l’hôpital et annonça dans toutes les cases qu’il allait être opéré à nouveau. La veille du jour tant attendu, il fleurit la couchette qu’il devait occuper dans la salle des opérés, une fois l’intervention terminée. Celle-ci réussit pleinement.
***
Une femme était couchée sur la table d’opération en train de recevoir les injections pour l’anesthésie locale. Le docteur, suivant la louable habitude des chirurgiens, entama avec elle une conversation, pour détourner son attention et lui donner un peu de courage. Mais elle ne fit guère attention à ses discours et à ses questions. Comme il continuait néanmoins, elle lui coupa la parole : « Ce n’est pas le moment de bavarder. Dépêche-toi de couper. »
***
Après une opération délicate, on était très inquiet sur l’état de la malade. Trois fois pendant la nuit le médecin qui l’avait opérée s’approcha de sa couchette sur la pointe des pieds et souleva la moustiquaire pour tâter le pouls et écouter la respiration. Trois fois, l’infirmière arriva à son tour pour faire les mêmes gestes. Le lendemain matin, quand on demanda à la malade comment elle se portait, elle répondit d’une voix maussade : « J’aurais bien dormi, si l’on m’avait laissée tranquille. »
***
Les opérés nous causent constamment de graves soucis, parce qu’ils n’observent pas les prescriptions que nous leur donnons. Si l’envie les prend, ils vont se baigner dans le fleuve le lendemain d’une opération, sans se soucier de mouiller et de souiller leur pansement. Cet homme qui, après une suture d’intestin, devait s’abstenir momentanément de toute nourriture, absorbe le lendemain de l’opération, fatigué par la longueur du jeûne, un repas abondant qu’il a fait préparer en cachette par sa femme. Souvent aussi, les opérés cèdent à la tentation de passer le doigt sous le pansement pour toucher la plaie, et risquent par là de l’infecter. Ce n’est vraiment pas facile d’être le chirurgien des primitifs.
Nous constatons avec étonnement que ces folies dangereuses n’ont pas toujours les conséquences fatales qu’on aurait cru devoir redouter. Contre toute attente, même des malades qui le lendemain d’une suture d’intestin n’ont pas pu résister à la tentation de boire et de manger n’ont pas succombé dans certains cas.
***
Les malades nous arrivent en pirogue. Ils ne viennent donc pas seuls, mais accompagnés de parents ou d’amis, qui leur servaient de pagayeurs et qui restent avec eux à l’hôpital, pour les ramener au village après leur guérison.
Un hôpital dans la forêt vierge diffère donc d’un hôpital européen. Il n’héberge pas seulement des malades, mais aussi des gens bien portants.
À l’hôpital, nos malades tiennent à mener la même vie que chez eux. J’ai donc construit un grand village formé de cases en tôle ondulée. À la place des lits, il y a des couchettes faites de planches. Les malades occupent les couchettes. Leurs compagnons dorment sur des nattes en raphia qu’ils étendent par terre. Le médecin entrant de nuit dans une case pour voir un malade se voit obligé d’enjamber des corps qu’il trouve sur son chemin.
Dans notre hôpital nous ne faisons pas la cuisine pour les malades indigènes. Ceux-ci se préparent leurs aliments eux-mêmes. Pour ceux qui sont alités, les gens venus avec eux se chargent de cette besogne. Chaque jour, nous distribuons aux malades et à leurs compagnons des bananes, du manioc, du sel, du riz (que nous faisons venir d’Europe) et de l’huile que nous préparons avec les noix de palme, récoltées dans notre plantation. Deux ou trois fois par semaine, ils reçoivent de la morue, que nous fournissent les grandes pêcheries maritimes de Port Étienne sur la côte de Mauritanie. Ce poisson importé, que nous achetons aux factoreries de Lambaréné, me revient meilleur marché que celui que je pourrais faire prendre dans l’Ogooué par des pêcheurs indigènes. Dans ce fleuve et dans ses affluents, la pêche n’est abondante qu’aux basses eaux durant les quelques semaines de la saison sèche. À la saison des pluies, quand la pêche au filet et au trémail n’est pas possible, elle ne rend guère.
Chaque matin, un marché se tient à l’hôpital. Les indigènes des villages avoisinants apportent du manioc et des bananes. Une infirmière est occupée à marchander avec eux deux heures durant pour faire les provisions dont nous avons besoin.
À dix heures et demie, l’infirmière fait annoncer par une sonnerie de clairon que la distribution des vivres va commencer. Elle la fait derrière un guichet devant lequel défilent les malades et leurs compagnons. Pour recevoir sa ration, chacun est obligé de présenter au préalable à l’infirmière le carton sur lequel se trouvent inscrits son nom et son numéro d’ordre. Sur sa liste, celle-ci marque qu’il a touché sa part pour ce jour. Sans cette précaution, il arriverait que le même malade se présentât deux fois devant le guichet, dans l’espoir de ne pas être reconnu et de recevoir encore une ration. Le carton en question est remis aux indigènes au moment de leur entrée à l’hôpital. D’ordinaire ils le portent avec une ficelle autour du cou, ou l’attachent soit à leur pagne soit à leurs cheveux.
Les bananes que nous distribuons ne sont pas les bananes douces qui se trouvent aussi sur les marchés d’Europe, mais de grandes bananes qui ne se consomment que cuites. Les indigènes préfèrent celles-ci, parce qu’elles sont plus nourrissantes que les autres. Nos malades reçoivent des bananes douces seulement en supplément, quand nous sommes obligés de les nourrir exclusivement de riz. Cela se produit, quand les villages ne nous livrent pas de vivres, parce que les plantations ont été dévastées par les éléphants, ce qui arrive assez souvent.
Les malades et leurs compagnons ont la permission de cueillir à volonté dans la plantation de l’hôpital des noix de palme, des bananes douces, des fruits de l’arbre à pain, des citrons, des mangues et des papayes. Ainsi nous avons la certitude qu’alors même que nous sommes obligés de les nourrir de riz ils reçoivent néanmoins suffisamment de vitamines. Les papayes en particulier, qui ressemblent par leur forme et par leur goût à de petits melons, constituent un supplément très apprécié. J’ai fait planter des centaines de papayers tout autour de l’hôpital. Par contre, je n’ai aucun intérêt à cultiver du cacao pour les malades. Ils n’en consomment pas. Du café aussi ils ne font aucun cas.
L’infirmière qui distribue les vivres doit donner à ceux qui défilent devant le guichet non seulement leurs propres rations, mais aussi celles des alités. Cela rend sa tâche bien délicate. Elle n’a aucune garantie que la portion donnée aille au destinataire pour lequel elle a été touchée. Il y a des primitifs qui ne se font guère de scrupules à s’approprier la nourriture du malade alité qui leur est confié.
Devant les cases, de nombreux petits feux flambent du matin jusque tard dans la nuit sous des marmites qui reposent sur trois ou quatre pierres.
Le bois dont les indigènes ont besoin pour faire la cuisine ne fait pas défaut. Il se trouve en abondance dans la forêt toute proche. L’eau potable est fournie par deux pompes dans la cour de l’hôpital.
Seule la nourriture des malades qui doivent suivre un régime est préparée par les infirmières.
***
Les cinq infirmières européennes et les dix infirmiers indigènes sont absorbés par le travail dans la salle d’opération, les laboratoires, la salle de consultation, la salle de pansement et la pharmacie. Ils ne peuvent pas s’occuper des habitants des cases autant qu’il le faudrait. Pour les malades alités, nous sommes obligés de compter en partie sur les services que voudront bien leur rendre leurs compagnons. À ceux-ci incombe la tâche de leur procurer l’eau et le bois, de prendre à leur place la ration à la distribution, de leur faire la cuisine, de laver le linge et la vaisselle et de vider les vases.
Arrive-t-il que des indigènes gravement malades se trouvent à l’hôpital sans être accompagnés de parents ou d’amis, nous sommes bien embarrassés. Il s’agit alors de trouver quelqu’un qui veuille bien faire le garde-malade auprès d’eux. Sans doute, il y a suffisamment de convalescents capables de rendre ce service. Si nous en trouvons un qui est de la tribu du malade en question, nous pouvons obtenir par des prières et par la promesse d’une gratification qu’il se déclare disposé à s’occuper de lui. Encore faut-il le surveiller de près, pour qu’il s’acquitte convenablement de ses fonctions.
Ce n’est qu’avec hésitation que nous nous décidons à demander à quelqu’un qui n’est pas de la tribu du malade de lui rendre les services dont il a besoin. Nous savons d’avance de quelle manière il recevra cette proposition. Il ne sert de rien que l’infirmière lui représente tout le bien qu’elle lui a fait, à lui qui était pourtant aussi un étranger pour elle, pour lui faire comprendre qu’à son tour il doive chercher à aider son prochain. Quoi qu’elle dise, la réponse est toujours la même : « Cet homme n’est pas frère pour moi », ce qui signifie qu’il n’appartient pas à la même tribu. Tout en ayant devant les yeux la façon dont nous-mêmes, médecins et infirmières, nous nous dévouons aux indigènes, il ne se départit pas de son indifférence naïve vis-à-vis de l’étranger. Au début, nous étions indignés de ce manque de charité. Maintenant nous nous sommes résignés.
Parfois, mais très rarement, nous avons le bonheur de trouver quelqu’un qui nous comprend et qui fait le bon samaritain à l’égard d’un malade qui lui est étranger.
Notre première question, à l’arrivée d’un malade ou d’un blessé, vise donc à savoir s’il est accompagné ou non. Dans l’affirmative, nous sommes très satisfaits. Mais il n’est pas rare que ceux qui ont amené le malade nous répondent qu’il s’agit d’une personne qui n’a plus de famille, et que ce n’est que par charité qu’ils l’ont conduite à l’hôpital. Nous ne sommes pas à même de contrôler si cette affirmation est exacte. Il se peut que le malade soit quand même un des leurs, mais qu’ils ne veuillent pas faire le sacrifice de rester auprès de lui.
Il arrive aussi que des malades, d’ordinaire de vieilles gens, soient déposés nuitamment sur le terrain de l’hôpital. Au matin, nous les trouvons là. Il n’y a pas moyen de leur faire dire qui ils sont et d’où ils viennent. Si nous arrivons à les guérir, leur famille l’apprend et les fait chercher aussi secrètement qu’elle les avait amenés.
La nouvelle lui parvient-elle que le malade est condamné, elle le laisse mourir chez nous sans se soucier autrement de lui.
Je me souviens du cas d’un pauvre vieux, atteint d’une maladie de cœur, qui arriva ainsi à l’hôpital. Un matin, nous le trouvâmes étendu sur la rive, presque nu, sans couverture et sans moustiquaire. Lui-même se réclama d’une riche parenté qui, d’après ses dires, habitait dans un village situé dans une contrée éloignée. Très prochainement, on viendrait et on apporterait pour lui beaucoup de bananes et de la viande d’hippopotame fumée, et pour moi un grand cadeau. Il reçut de nous une couverture, une moustiquaire et la nourriture et séjourna à l’hôpital plusieurs semaines, jusqu’à sa mort. Pouvant à peine articuler, il parla encore des riches parents qu’il attendait. La dernière joie que je pus lui procurer fut de faire semblant d’ajouter foi à ses paroles. Ainsi encore la veille de sa mort ; je n’oublierai pas le sourire qui éclaira alors son visage.
***
Les malades sont-ils accompagnés de parents qui restent avec eux à l’hôpital, je n’ai en général pas seulement à loger ceux-ci, mais encore à les nourrir.
Beaucoup de nos malades, surtout ceux qui arrivent de l’intérieur, sont si pauvres qu’ils ne possèdent ni couverture ni moustiquaire. Nous en mettons à leur disposition pour le temps qu’ils passent à l’hôpital. Les malades ont besoin d’être pourvus d’une moustiquaire non seulement pour qu’ils ne soient pas incommodés par les moustiques pendant la nuit, mais avant tout pour être garantis contre le paludisme qui, comme l’on sait, se transmet par les piqûres de certains de ces insectes. Assez souvent, des malades s’estimant guéris s’en vont pendant la nuit en emportant la couverture et la moustiquaire comme souvenir de l’hôpital.
Établir qui a droit à la ration ou qui au contraire doit lui-même subvenir à ses besoins, n’est pas toujours facile. En principe, nous ne donnons la nourriture qu’à ceux qui sont venus de loin et qui n’ont pas les moyens de s’acheter des vivres sur place. Si les malades sont originaires de villages des environs, leur famille est tenue de les ravitailler.
Journellement cependant des cas se présentent où nous sommes sollicités d’accorder la ration aussi à des gens qui, d’après nos principes, n’y auraient pas droit. Voici des malades qui jusqu’à présent recevaient des vivres de leur village. Depuis quelques jours, le ravitaillement ne leur est plus arrivé. La raison en est-elle que leur famille n’avait pas de pirogue disponible, ou que les pagayeurs faisaient défaut, ou que les éléphants avaient dévasté la plantation ? Nombreuses sont les causes éventuelles de cet arrêt du ravitaillement qui nous sont fournies, jusqu’à ce qu’à la fin nous nous laissions fléchir et que nous inscrivions le malade sur la liste des ayant droit à la ration. Mais que de fois il arrive qu’il y reste alors définitivement. Si les parents au village ont fait l’expérience que je ne laisse pas mourir de faim les leurs, quand les vivres leur font défaut, ils ne jugent plus nécessaire de s’occuper d’eux.
Un autre cas. Un malade a suffisamment d’argent pour s’acheter des vivres pour un certain temps. Mais voici qu’il se voit obligé de prolonger son séjour à l’hôpital. Son village est beaucoup trop éloigné pour qu’il puisse envoyer un messager aux siens et leur demander de lui faire parvenir de l’argent. Il se voit donc obligé de nous prier de bien vouloir le nourrir. Son état ne nous permet pas de le laisser partir. Que devons-nous faire ? Force nous est d’agréer sa requête et d’avoir foi dans sa promesse que, dans l’avenir, quand il sera de nouveau en état de travailler, il nous remboursera les frais occasionnés par son entretien. Mais peut-être n’était-ce qu’un prétexte et ses moyens n’étaient-ils pas épuisés.
À la suite d’une expérience j’ai choisi pour principe d’être plutôt trop indulgent que trop strict dans des cas de ce genre. Au moment où l’on allait commencer la narcose d’un homme qui devait être opéré, je lui demandai s’il avait bien suivi mes instructions et s’était abstenu de manger. Il me répondit que depuis deux jours lui et sa femme avaient été obligés de jeûner. Les parents de leur village n’avaient plus rien envoyé et il n’avait pas osé m’en parler de peur que je ne mette en doute ses paroles.
***
Puisque je dois loger et nourrir ceux qui ont accompagné un malade, j’exige d’eux qu’ils fournissent du travail dès que celui-ci se trouve en bonne voie et peut se passer de leur présence continuelle. Nous avons besoin de bras pour entretenir la plantation de l’hôpital et pour l’agrandir aux dépens de la forêt, pour cueillir les régimes de noix du palmier à huile, pour jardiner et pour faire les grandes provisions de bois nécessaires à l’hôpital et au ménage. Les hommes susceptibles de fournir du travail figurent sur une liste à l’aide de laquelle chaque matin, une infirmière fait leur appel. Après leur avoir distribué des pelles, des pioches, des râteaux, des haches, des matchettes et des scies, elle les dirige vers le jardin, la plantation et la forêt. Elle les met à la tâche et surveille les travaux. Le soir, à la rentrée, elle doit bien veiller à ce que personne ne se dispense de rendre son outil, soit pour se l’approprier, soit pour éviter la peine de le rapporter.
Autrefois je croyais qu’il fallait un homme pour commander les travailleurs. Mais depuis, j’ai fait l’expérience que la femme blanche a plus d’ascendant sur les primitifs qu’un homme. Par respect pour elle, les indigènes ne se montrent pas rétifs, comme ils le sont si souvent envers l’homme. Ils s’efforcent de lui faire plaisir. L’infirmière chargée de la surveillance des travailleurs est appelée par eux mademoiselle contremaître.
Les femmes indigènes qui sont arrivées avec des malades sont désignées les unes pour travailler comme couturières ou comme laveuses, les autres pour préparer l’huile de palme avec les noix récoltées dans notre plantation. Chaque samedi soir, hommes et femmes reçoivent une gratification correspondant au nombre de journées de travail fournies au courant de la semaine.
***
J’exige également que les indigènes qui viennent rendre visite aux malades soient à ma disposition dans le cas où j’ai besoin d’eux. Un jour, je demandai à un homme que je voyais en conversation avec un malade de nous donner un coup de main dans un travail de construction en cours. Au lieu de m’obéir, il disparut. Le lendemain, le retrouvant à côté du malade, je l’appelai encore et de nouveau il s’éclipsa. Le troisième jour, je lui dis que s’il refusait de nous aider, je lui interdirais l’accès de l’hôpital. Sur quoi il monta dans sa pirogue et partit.
Ennuyé d’avoir chassé le visiteur, qui avait semblé distraire le malade, je m’en excusai auprès de celui-ci. Il me répondit en souriant : « Ne te fais pas de reproches. Cet homme n’était pas un visiteur, mais un créancier. Me sachant couché ici, incapable de lui échapper, il vint jour par jour pour me faire palabre au sujet de ma dette. Tu l’as chassé, je t’en remercie. »
***
L’après-midi du samedi est consacré au grand nettoyage, à l’intérieur et à l’extérieur des cases. Pour cette opération, toutes les femmes qui sont venues accompagner un malade à l’hôpital sont requises. Le commandement de la troupe est confié à la plus jeune des infirmières. Dominique, un des plus anciens infirmiers indigènes, est son adjoint.
Quand les cases, leurs alentours et les rues de l’hôpital ont été nettoyés, on forme des équipes qui, sur le terrain descendant vers le fleuve et celui montant vers la colline, doivent ramasser toutes les bouteilles, boîtes en fer blanc et débris de vaisselle jetés dans l’herbe. Le spectacle rappelle le tableau des glaneuses de Millet.
D’où viennent ces nombreuses boîtes en fer-blanc et ces bouteilles ? Nous donnons aux indigènes des boîtes de lait et des bidons vides dont ils se servent pour toucher leur ration d’huile de palme, pour faire la cuisine et pour boire. Quand ils n’en font plus usage, ils les jettent dans l’herbe, ainsi que les bouteilles dans lesquelles ils conservaient le riz, sans s’en soucier autrement. L’eau de pluie s’accumule dans ces récipients, de sorte qu’ils deviennent des lieux excellents pour l’éclosion des larves de moustiques. La chasse aux boîtes et aux bouteilles qui traînent au voisinage des maisons est donc un des moyens de défense les plus efficaces contre le paludisme.
Comme un chien de berger, Dominique tourne autour du troupeau de femmes, faute de quoi l’infirmière qui commande le grand nettoyage les verrait disparaître l’une après l’autre dans les cases ou entre les bananiers, et risquerait fort de rester seule sur le théâtre des opérations. Les boîtes, les tessons et tous les détritus qu’on a ramassés remplissent plusieurs caisses. On les transporte au fleuve et on les charge dans des pirogues pour aller les verser au milieu du courant. La tombée de la nuit seulement met fin au grand nettoyage.
Les primitifs ne peuvent pas comprendre pourquoi nous tenons tant à la propreté des alentours de nos habitations. Il leur est tout à fait indifférent qu’au cours des années des monceaux de décombres, de vieilles boîtes et des tessons s’accumulent autour de leurs villages. Il est très difficile de les convaincre que ces tas d’immondices sont une des causes principales des fièvres dont ils souffrent, eux et leurs pauvres enfants.
***
L’après-midi du dernier jour de chaque mois est consacré à l’appel de tous les malades et de leurs compagnons. Comme il arrive fréquemment que des indigènes quittent l’hôpital sans nous en informer, il est nécessaire que nous fassions à intervalles réguliers le recensement des personnes effectivement présentes. Cet appel nous donne en outre l’occasion de traiter toutes les questions concernant les malades ou leurs compagnons.
À deux heures, les médecins et les infirmières s’installent autour d’une table dans la salle de consultation, entourés des infirmiers indigènes. Les hospitalisés défilent en entrant par une porte et en sortant par l’autre. Une infirmière a établi d’après des fiches la liste de ceux qui devaient se trouver à l’hôpital et a déjà portés comme présents les malades alités qui ne peuvent se rendre à l’appel. Dans la cour, Dominique a rangé les gens dans l’ordre où ils doivent se présenter. En premier lieu viennent les malades qui nous ont été envoyés des chantiers d’exploitation forestière. Dominique les appelle dans un ordre fixé une fois pour toutes. « Chantier de la C.E.F.A. à Ayem ! Chantier de la C.C.A.E.F. du lac Oguémoué ! Les hommes de la maison Delaquerrière ! Chantier de la maison Polidori de l’Abanga ! Les chantiers de la S.H.O ! Chantier de la maison Madre », et ainsi de suite. Les autres occupants de l’hôpital sont appelés par régions d’origine. « Les hommes de la contrée de Koula-Moutou ! Les hommes du Haut-Ogooué ! Les hommes de la région de N’Djolé ! Les hommes du pays de Sindara ! Les hommes de la rivière Abanga ! Les hommes de la région de Samkita ! Les hommes des grands lacs ! Les hommes du lac Azingo ! Les hommes des lacs N’Kovié et Gomé ! Les hommes des stations de la mission catholique ! Les hommes des stations de la mission protestante ! »
Le défilé de tout ce monde prend plus de trois heures. Toutes les questions qui peuvent se poser au sujet d’un hospitalisé sont traitées sans hâte par les médecins et les infirmières. On discute du diagnostic et du traitement du malade, de son droit à la ration, de la date probable de sa sortie et de la possibilité de le rapatrier.
En défilant, chaque indigène a le droit d’exprimer ses réclamations et ses désirs. Mais chacun doit aussi s’attendre à ce que les infirmières et les infirmiers fassent mention des actes de désobéissance dont il sc serait rendu coupable.
L’heure de l’appel est aussi celle du jugement. Comme telle, elle est redoutée particulièrement des convalescents ainsi que des compagnons des malades. Car les médecins et les infirmières examinent à cette occasion si tel homme ou telle femme est encore complètement absorbé par les soins qu’exige son malade, ou s’il ne pourrait commencer à se rendre utile. De même, on décide si tel ou tel convalescent peut être désigné pour tel ou tel service, en attendant l’occasion d’être rapatrié. L’infirmière préposée aux travailleurs, son calepin à la main, prend des notes. Tantôt, on lui attribue une femme pour la lessive ou la préparation de l’huile de palme, tantôt un homme pour casser les noix de palme, tantôt une femme pour sarcler et arroser le jardin, tantôt, à sa grande joie, des hommes aptes à n’importe quelle besogne, même à l’abatage des arbres. Sur le carton de ceux qui à l’avenir devront se rendre au travail on inscrit que désormais la ration ne leur sera plus donnée par l’infirmière qui la distribue aux malades, mais par celle qui dirige les travailleurs. De cette façon, ils sont placés sous sa dépendance.
Nous veillons à ce que personne ne séjourne à l’hôpital sans y avoir été admis régulièrement, et sans être en possession du carton avec son nom et son numéro. Autrement, nos cases deviendraient un lieu de refuge pour les vagabonds de la contrée.
Par contre, nous hébergeons volontiers, dans la limite des places disponibles, de pauvres invalides et des aveugles qui n’ont plus de famille.
C’est dans mon hôpital qu’André Loëmbé, l’ancien cuisinier de de Brazza, qui avait accompagné son maître en Europe, passa ses dernières années. Tout en souffrant presque continuellement d’asthme, il se rendait utile partout où il pouvait. Sa dernière joie fut d’avoir une chambre à lui seul. Il ne put l’habiter que peu de mois. Vers la fin de l’année 1930, nous perdîmes cet homme si sympathique sous tous les rapports. Sur sa tombe se dresse une croix en ciment avec son nom et une inscription indiquant qu’un fidèle serviteur de de Brazza repose en ce lieu.
***
On m’a souvent demandé si les indigènes éprouvent de la reconnaissance pour le bien que nous leur faisons. Je crois pouvoir l’affirmer.
Une pauvre vieille, atteinte d’une affection cardiaque, ne cessa de répéter à la doctoresse qui passait la nuit à son chevet : « Je suis une pauvre femme noire et pour moi, toi, femme blanche, tu renonces au sommeil. Comment puis-je le comprendre ? Comment te remercier ? »
Le fait que bien souvent des malades quittent l’hôpital sans nous exprimer leur reconnaissance tient en partie à leur timidité. Si nous avons l’occasion de les revoir un jour, la joie qu’ils nous manifestent nous montre qu’ils ne nous ont pas oubliés.
Les actes de reconnaissance, il est vrai, sont rares, et nous ne devons guère y compter. Parfois, un malade guéri se montre disposé à rester encore quelques jours à l’hôpital pour nous aider dans notre besogne. Plus fréquemment, il nous apportera des bananes ou du manioc, si son village n’est pas trop éloigné.
Parmi les plus primitifs de nos malades il s’en trouve cependant qui ne peuvent comprendre que c’est par charité que nous nous dévouons pour eux. Leur naïveté leur fait admettre que nous y sommes obligés de par une rémunération particulièrement avantageuse. En conséquence, ils acceptent tout ce que nous faisons pour eux comme chose toute naturelle.
***
Beaucoup de malades, en particulier parmi ceux qui viennent se faire opérer, nous arrivent de très loin. Certains d’entre eux ont voyagé pendant des semaines et entrent à l’hôpital exténués des fatigues de la route et à moitié morts de faim. Parfois, ils ont besoin de plusieurs semaines de soins avant d’être en état de supporter l’intervention avec quelque chance de succès.
Il nous arrive aussi des gens pour lesquels l’opération est impossible ou sans espoir, et qui ont fait le long déplacement en vain. Combien de difficultés avons-nous alors à leur faire comprendre que nous pouvons bien secourir les autres, mais pas eux. Je me souviens d’un homme qui avait perdu la vue et qui était venu de trois cent cinquante kilomètres, ayant entendu parler de l’opération de la cataracte. Il fallut lui expliquer que dans son cas il ne s’agissait pas d’une cataracte et que nous ne pouvions pas lui rendre la vue. Son désespoir nous a bouleversés.
Ces gens de l’intérieur doivent faire un long voyage à travers les savanes et la forêt, avant d’atteindre le cours d’eau sur lequel ils peuvent descendre en pirogue ou en bateau jusqu’à Lambaréné. Ne possédant eux-mêmes pas d’embarcation, ils sont réduits aux occasions qui peuvent se présenter. Le cas échéant, ils sont forcés d’attendre des semaines jusqu’à ce qu’ils en trouvent une. C’est un mystère pour nous comment ces pauvres étrangers s’arrangent pour ne pas mourir de faim pendant cette attente. La plupart des européens ont la charité d’emmener dans leurs pinasses ou leurs bateaux à vapeur les gens qui se rendent à l’hôpital.
Sont-ils opérés et capables de s’en retourner, le problème de leur rapatriement se pose. Il s’agit de trouver une occasion de les transporter vers l’amont jusqu’à l’endroit où chacun reprendra la route de terre. Pour ne pas manquer celles qui pourraient se présenter, nous nous renseignons auprès du propriétaire ou conducteur de chaque pinasse qui accoste chez nous, afin de savoir le but de son voyage et s’il peut rapatrier quelques-uns des guéris. Naturellement, propriétaires et conducteurs de pinasses ne font pas preuve d’un grand enthousiasme à l’idée d’emmener nos gens et de charger l’embarcation encore plus qu’elle ne l’est déjà. Si nous ne prenons pas l’initiative de les questionner à ce sujet, et si nous ne les prions pas d’accepter ces passagers, ils continuent leur voyage sans rien dire.
Avons-nous découvert une embarcation qui peut rendre ce service, nous dépêchons en toute hâte un infirmier. Agitant une grande sonnette, il parcourt toutes les cases en annonçant à haute voix : « Occasion pour telle direction. Que tous ceux qui veulent en profiter se rendent immédiatement à la salle de consultation ! » Si des malades qui pourraient utiliser cette pinasse sont justement dans la plantation en train de ramasser des noix de palme ou dans la forêt pour chercher du bois, ou quelque part sur la rive en train de pêcher, on les envoie quérir au plus vite.
Dans la salle de consultation, où tout autre travail a cessé pour le moment, nous examinons les gens susceptibles d’être envoyés. Ensuite nous écrivons pour chacun une lettre de recommandation pour les administrateurs dont ils traversent les districts. Pendant ce temps, l’infirmière prépare pour chacun des provisions pour plusieurs jours (riz, manioc, bananes et poissons secs). Chacun reçoit aussi un petit sac de sel. Comme le sel est la monnaie la plus courante dans l’intérieur, il pourra l’échanger contre des aliments. Il en a aussi besoin pour acquitter les droits de passage, s’il doit se faire transporter d’une rive à l’autre d’un fleuve. Les indigènes de l’intérieur ne rendent pas de services gratuits aux étrangers.
En vue du voyage de retour, la plupart des malades ont mis de côté une partie du riz que l’hôpital leur a distribué pour la préparation de leur repas quotidien. Ils le mettent en bouteille et l’emportent ainsi. Ils peuvent se procurer ici autant de bouteilles vides qu’ils en désirent, car elles n’ont aucune valeur. On les trouve en tas derrière les factoreries. Dans l’intérieur, par contre, elles sont un article très demandé et se paient cher. Aussi chaque partant emporte-t-il autant de bouteilles que ses forces le lui permettent. Rarement, les gens de l’intérieur partent sans avoir dans une factorerie fait l’achat d’un parapluie. Sans le sortir de sa gaine de papier, ils l’attachent sur leur baluchon. En dernier lieu, les gens qui doivent partir reçoivent de l’infirmière un sac à riz vide. Ils y entassent leurs provisions. La nuit, il peut leur servir aussi de couverture.
Quand ils ont reçu la lettre de recommandation, les provisions et le sac à riz dans la salle de consultation, on les renvoie dans les cases pour chercher leurs affaires. Mais on ne peut les laisser aller seuls. Chacun est escorté par un infirmier noir, pour qu’il se dépêche et ne s’arrête pas à faire de longs adieux à toutes ses connaissances. Les conducteurs de pinasse sont toujours pressés, mais pour nos primitifs, le temps n’a aucune valeur.
Jusqu’au dernier moment nous sommes dans l’inquiétude que le blanc ne s’impatiente et parte, ou qu’il ne refuse d’emmener tout le monde. Médecins et infirmières font la conversation avec lui, pour détourner son attention. Malgré toute la peine que nous nous donnons, il faut souvent deux heures, pour que tout le monde soit rassemblé et prêt pour le départ. Les médecins et les infirmières sont complètement épuisés d’avoir couru de tous les côtés. Et toujours nous devons craindre que l’opération ne se soit pas faite assez vite et qu’à la prochaine occasion le propriétaire ou le conducteur de la pinasse ne réfléchisse à deux fois avant d’accoster chez nous et de courir le risque de se voir obligé d’emmener des gens et de perdre un temps précieux.
Enfin tout le monde est prêt et se rend à l’embarcadère. Les infirmières et les infirmiers surveillent le cortège, afin qu’il n’y en ait pas qui retardent le départ en faisant un détour par les cases pour prendre une dernière fois congé de leurs connaissances. Quand les partants sont entassés dans la pinasse, nous leur recommandons de ne toucher à rien. Il est arrivé qu’un de ces primitifs se soit amusé à ouvrir le robinet d’essence que l’européen avait fermé pendant une halte. Quand celui-ci voulut remettre en marche, il fut stupéfié de trouver son réservoir vide.
La pinasse se met en route. Les mains noires s’agitent en signe d’adieu. Supporteront-ils tous les fatigues du long voyage et reverront-ils leur village ? Ce souci nous agite, tandis que nous remontons vers l’hôpital, dont la vie était suspendue pendant tout ce temps.
Les européens ont introduit également ici l’usage de mettre des œufs de faïence dans les nids, pour que les poules ne s’aperçoivent pas que ceux qu’elles ont pondus sont enlevés au fur et à mesure. Mais ici il arrive que non seulement les poules, qui sont directement visées, soient trompées par cette supercherie, mais aussi d’autres êtres qui s’intéressent aux œufs.
L’histoire suivante se passa avant mon arrivée. Un missionnaire de Lambaréné partit en tournée avant le lever du jour. Afin d’emporter les œufs que les poules auraient déjà pu pondre, il ouvrit le portillon découpé dans le bas de la porte du poulailler et à l’aveuglette avança la main vers le nid. À sa grande surprise, elle rencontra un objet lisse et froid qui pendait au-dessus du nid et oscillait, quand il le toucha.
En hâte, on chercha une lanterne et la clé de la porte. Quand il ouvrit et laissa pénétrer la lumière dans la pièce, il vit qu’il s’agissait d’un serpent de deux mètres de long, portant dans sa bouche l’œuf de faïence. Il s’était introduit par un trou dans le toit couvert de feuilles de raphia et était resté suspendu au-dessus du nid. Les œufs des poules avaient passé facilement par son gosier. L’œuf artificiel par contre ne s’était pas laissé écraser comme les autres, mais s’était arrêté au fond de la gorge, de sorte qu’il ne put ni l’avaler, ni s’en débarrasser. Victime de la supercherie des blancs, le serpent dut subir sans résistance le coup mortel.
***
Plus tard, dans le même poulailler, ma femme posait l’œuf de faïence dans le nid de ces braves volatiles. Nos deux petits boys, qui étaient aussi amateurs d’œufs, attentaient assez souvent au contenu des nids. Une fois ils les nettoyèrent à fond, si bien que tous les œufs, y compris l’artificiel, avaient disparu. Par cette méprise, leur larcin fut découvert. Naturellement, ils jurèrent leurs grands dieux qu’ils n’avaient absolument rien enlevé, mais qu’il s’agissait d’une paresse de la part des poules.
Le lendemain, ils arrivèrent en courant et tout joyeux pour annoncer que les poules s’étaient remises à pondre. Ils prétendaient avoir vu la grande poule grise originaire d’Europe quittant son nid en y laissant un gros œuf. C’était l’œuf de faïence que les coupables avaient rapporté. D’après leur logique, l’œuf à coquille dure qu’on ne pouvait ni ouvrir ni faire cuire devait provenir de la poule européenne, et les blancs seuls savaient comment le préparer.
***
Upsi aussi, le singe pourtant bien malin, qui volait continuellement des œufs sans se laisser prendre sur le fait, tomba dans le piège à son tour. Un beau matin, je le trouvai assis sur un poteau de la clôture du poulailler, la mine hagarde, et tenant un œuf à la main. Il ne s’enfuit pas, mais resta assis, comme s’il voulait me prendre à témoin de cette chose incompréhensible avec laquelle il était aux prises. Il heurta l’œuf contre le poteau mais ne put le casser. Il le roula entre ses mains mais ne put l’écraser. Rien ne lui servit de le heurter encore plus violemment, de le presser encore plus fort entre les mains, même d’y mettre la dent.
Un moment, il s’arrêta pour reprendre des forces et me regarda, comme s’il voulait me demander si j’y comprenais quelque chose. Je ne pus m’empêcher de rire, quoiqu’il faille éviter de le faire devant un singe agacé, parce qu’il s’en excite plus encore et risque de devenir agressif. Alors il commença à comprendre que son malheur avait une fois de plus l’infamie des hommes pour cause.
Il manifesta son indignation par de méchantes grimaces et des cris rauques. Après avoir exercé sa rage pendant quelque temps encore sur cet œuf de malheur, il le lança dans l’enclos, poussa un dernier grognement dans ma direction, et s’enfuit. Pendant plusieurs jours, j’eus l’impression qu’il m’évitait, parce que j’avais été témoin de sa malchance.
***
Au petit jour, le bruit d’une querelle monte de l’hôpital vers la maison que nous habitons. Nous en apprenons bientôt la cause. Pendant la nuit, un malade s’est approprié la pirogue d’un autre et s’en est allé pêcher au clair de lune. Le propriétaire de la pirogue l’a surpris au retour et réclame tous les poissons pris et, en plus, une forte indemnité en argent pour l’usage de l’embarcation. D’après le droit en vigueur chez les indigènes, ses exigences sont fondées.
L’affaire m’est soumise. De nouveau, comme tant de fois déjà, je dois remplir les fonctions de juge. Je commence par proclamer que sur mon terrain ce n’est pas la coutume indigène qui est en vigueur, mais le droit raisonné des blancs, tel qu’il sera défini par moi. Ensuite je passe à l’examen des faits.
Je constate que les deux parties ont raison et tort en même temps. « Tu es dans ton droit », dis-je au propriétaire de la pirogue, « parce que l’autre aurait dû te demander la permission de la prendre. Mais tu t’es mis dans ton tort par ta négligence et par ta paresse. Tu as été négligent, parce que tu t’es contenté d’enrouler la chaîne de la pirogue autour d’un palmier, au lieu de la cadenasser, comme on doit le faire ici. De cette façon, tu as induit l’autre en tentation d’utiliser ton embarcation. Coupable de paresse, tu l’es du fait que, par un si beau clair de lune, tu as dormi dans ta case, au lieu de profiter de cette bonne occasion pour pêcher toi-même. »
« Quant à toi, qui as pris la pirogue », dis-je à l’autre « tu es dans ton tort, parce que tu as omis de demander la permission du propriétaire. Toutefois tu as l’excuse de ne pas avoir été aussi fainéant que lui et de ne pas avoir voulu laisser passer le clair de lune sans en profiter. »
Sur ces attendus, je prononce le jugement. L’homme qui est allé à la pêche donnera un tiers des poissons au propriétaire de la pirogue à titre d’indemnité ; un tiers, il pourra le garder pour lui-même, parce qu’il s’est donné la peine de les pêcher ; le tiers composé des plus beaux poissons, je l’attribue à l’hôpital, parce que l’affaire s’est passée sur mon terrain et que j’ai dû perdre mon temps à régler la palabre.
***
Une charmante histoire de palabre m’est arrivée de Londres. Sur le bord d’un des lacs de l’Afrique Orientale Anglaise, un jeune fonctionnaire résidait au milieu d’une population encore bien primitive. Il avait à cœur de rendre des sentences conformes à l’esprit du droit indigène.
Il occupait depuis peu de temps encore son poste quand deux femmes arrivèrent devant lui avec deux nourrissons, l’un mort, l’autre vivant, chacune réclamant ce dernier comme son enfant. Le cas se présentait donc comme celui que Salomon avait eu à trancher et le jeune fonctionnaire fut bien content de pouvoir s’inspirer de cet exemple. Il appela donc un de ses soldats indigènes et lui ordonna de partager avec son épée l’enfant vivant et de donner une moitié à chaque femme.
Mais la suite de l’affaire fut tout autre que du temps de Salomon. Au lieu qu’une des femmes implorât le juge de ne pas faire tuer l’enfant, mais de le donner plutôt à l’autre, ici elles jubilèrent toutes deux et s’écrièrent ensemble avec toute l’assistance : « Voilà le bon juge ! En voilà un qui sait bien régler les palabres. »
Le pauvre fonctionnaire fut très ennuyé, ne sachant à laquelle il devait donner l’enfant. Finalement, il s’en tira en l’attribuant à tout hasard à la plus belle des deux.
***
Un jour, un jeune anglais employé dans une maison de commerce de bois arriva dans sa pinasse à l’hôpital, pour y passer la nuit. Quand, le soir, je ne vis plus l’embarcation au débarcadère et que je lui en demandai la raison, il me répondit qu’il avait permis à son mécanicien indigène de la prendre pour aller passer un jour dans son village situé en aval de l’hôpital. Je lui fis observer que dans ce pays on faisait bien d’avoir toujours son embarcation sous les yeux, et que l’indigène aurait aussi bien pu se rendre en pirogue auprès de sa famille.
Le surlendemain la pinasse n’était pas encore de retour. Elle n’arriva pas non plus les jours suivants. Le jeune homme commença alors à s’inquiéter et me pria de lui prêter une pirogue pour se rendre à ce village. Quand il y fut arrivé et qu’il demanda à l’indigène pourquoi il n’était pas revenu, celui-ci donna comme motif que le moteur n’était pas tout à fait en ordre. En montant dans la pinasse, son maître constata qu’il avait été démonté et que les pièces gisaient pêle-mêle dans le fond de la coque.
Voici ce qui s’était passé. Quand l’indigène, très fier, fut arrivé, et qu’il fit admirer le moteur aux gens du village, ils lui demandèrent s’il se risquerait à le démonter entièrement et à le remonter ensuite. Son orgueil lui interdit de répondre par la négative et d’avouer qu’il ne savait rien d’autre que mettre le moteur en marche, comme tant d’indigènes qui s’intitulent mécaniciens dans ce pays. Sous les yeux admiratifs des siens, il démonta donc le moteur dans la mesure où il put le faire, et attendit ensuite les événements à venir avec la sérénité d’âme stoïque dont nos noirs savent faire preuve dans des cas pareils.
Par bonheur, aucune pièce n’avait été égarée, de sorte que l’anglais pût remonter son moteur. Mais désormais il ne lui arrivera plus jamais de mettre l’embarcation à la disposition de son mécanicien.
***
Un exploitant forestier de mes amis transporta dans sa pinasse des travailleurs qu’il venait de recruter dans l’intérieur. Au cours de l’après-midi, une planche au voisinage du tuyau d’échappement mal isolé commença à prendre feu. Quand les indigènes s’en aperçurent, ils furent pris de panique et voulurent se jeter à l’eau, quoiqu’ils ne sussent pas nager, comme tous les gens de l’intérieur. Le blanc eut beaucoup de peine à les calmer.
Il profita de l’occasion pour leur montrer la conduite à suivre en cas d’incendie dans la pinasse. Ils furent instruits que, dès qu’une flamme se montrait quelque part, ils devaient, sans s’effrayer, l’étouffer avec la grande bâche qui était sous le banc avant. Cette bâche était destinée à couvrir le moteur pour le protéger contre la pluie et l’humidité, quand la pinasse était en repos. Pour ne laisser rien au hasard l’européen entraîna les noirs à éteindre avec la bâche des flammes imaginaires.
Quand la nuit tomba, le boy voulut allumer la lanterne pour la placer comme fanal à la proue. Par malheur, il l’avait remplie d’essence à la place de pétrole. Cette erreur n’est pas rare chez les indigènes, parce que les estagnons de pétrole et d’essence qu’on nous fournit ici se ressemblent à s’y méprendre. À peine eut-il approché une allumette, qu’une énorme flamme jaillit de la lanterne. La peur lui enlevant la faculté de réfléchir, il la jeta dans l’avant de la pinasse au lieu de la laisser tomber dans l’eau. Avec beaucoup de sang-froid, croyant qu’il s’agissait encore d’un exercice d’incendie organisé par le blanc, les noirs saisirent la bâche et étouffèrent le feu. Si une planche n’avait pas brûlé auparavant au voisinage du tuyau d’échappement et n’avait pas donné l’occasion d’instruire ces travailleurs tout à fait inexpérimentés, ils auraient tous sauté à l’eau et se seraient noyés.
***
Quand, dans ces derniers temps, la liaison aérienne Congo-France par le Sahara fut inaugurée, les habitants de la forêt vierge virent et entendirent pour la première fois le vol des avions au-dessus de leurs villages. Pris de frayeur, ils demandèrent aux féticheurs la signification de ces apparitions. Ceux-ci, ne voulant pas avouer leur ignorance, en appelèrent sans vergogne à leur imagination.
Un féticheur de l’arrière-pays de Lambaréné annonça, d’après ce que m’ont raconté des blancs de cette région, que dans ce grand oiseau Dieu lui-même descendait sur la terre pour châtier les hommes pour leurs péchés. Il fallait aussi s’attendre maintenant à une nuit ininterrompue d’un mois. Ayant entendu ces prophéties, les gens coururent aux plantations, coupèrent toutes les bananes mûres et demi-mûres, les entassèrent près de leurs cases et y ajoutèrent des estagnons pleins d’eau, pour avoir pendant ces semaines de quoi boire et manger à portée de la main.
Un vieux pahouin donna aux gens de son village comme explication de l’apparition des avions que les blancs se promenaient à présent dans les airs afin de découvrir d’en haut les indigènes qui se cachaient dans la forêt pour ne pas payer l’impôt et ne pas faire de prestations.
***
Chaque courrier apporte une pile de catalogues des grands magasins pour les indigènes. Avec délices, mes infirmiers et leurs amis se plongent dans la contemplation de ces cahiers, où sont reproduits chapeaux, cravates, chemises, cols, chaussures, montres, glaces et tant d’autres objets enviables. Ils en discutent. En fait de souliers, les uns préfèrent le modèle « Apollon », les autres le modèle « Hermès », les uns se prononcent pour la cravate « Spa », les autres pour la cravate « Ostende ». Ils peuvent passer des heures entières à se montrer les illustrations du doigt, à échanger leurs opinions et à imaginer ce qu’ils pourraient bien commander.
L’indigène qui a amassé un peu d’argent succombe très souvent à la tentation de commander par l’intermédiaire de quelque écrivain public un envoi contre remboursement, et de verser l’acompte demandé, en règle générale la moitié de la valeur des objets. Vient le jour où la poste l’avise de l’arrivée du colis. Naturellement, il n’a pas l’argent pour payer le reliquat. S’il ne réussit pas à l’emprunter à sa famille et à ses connaissances dans le délai d’un mois, le colis fait retour à la maison expéditrice. Dans la suite, il recevra de celle-ci un avis qu’après déduction des frais d’envoi et de retour du colis dont il n’a pas pris livraison, il garde un solde créditeur de tant et tant, qu’il pourra utiliser comme acompte pour une nouvelle commande, réduite en proportion.
Chaque bureau de poste de l’Afrique équatoriale doit disposer de la place suffisante pour pouvoir entreposer les nombreux colis qui attendent, souvent en vain, d’être retirés par les indigènes.
***
Les catalogues posent à nos indigènes des rébus qu’ils ne sont pas toujours capables de résoudre. Il y a quelques années, un homme des environs de la station missionnaire de Samkita annonça à toutes ses connaissances qu’il avait découvert dans le catalogue d’un grand magasin des chaussures à un prix incroyablement avantageux. Pendant des semaines il fut l’objet de l’envie générale. Le colis arriva. Il contenait des souliers de poupée.
Un blanc de l’intérieur me raconta qu’un indigène de là-bas avait mobilisé toutes ses connaissances pour qu’ils l’aidassent à transporter un piano. Il avait commandé en Europe un de ces bois chantants, comme la femme de l’administrateur en avait un. Son catalogue en offrait qui étaient bien moins chers qu’on n’aurait supposé. Quand le piano arriva, il put l’emporter tout seul. Il avait commandé un piano-jouet.
Le boy d’un blanc des environs de Lambaréné avait fait venir une lampe qui dans le catalogue l’avait particulièrement frappé. Quelques jours plus tard, il l’apporta à son maître et le pria de lui montrer par où il fallait verser le pétrole. Mais celui-ci ne put le tirer d’embarras, car il s’agissait d’une lampe électrique.
Si le catalogue indique que la chaussure « René » existe dans les pointures 38 à 45, le pauvre indigène risque de commander la pointure 38 à 45. Si à côté de la chemise « Auguste » il y a l’indication « en blanc, en jaune, en rose et en marine », il peut arriver qu’il indique toutes ces couleurs dans la commande d’une seule chemise. Le malheur veut-il que les succursales du magasin dans différentes villes figurent sur la couverture du catalogue, il risque de mettre six villes à la fois sur l’adresse de sa commande.
***
Un des hommes les plus sympathiques et les plus nobles que j’aie connus ici était le missionnaire Rambaud de Samkita. Il exerçait son ministère parmi les pahouins, qu’il désarma par sa bonté. Quoique les indigènes lui fussent très attachés, il leur arriva quand même de lui jouer de mauvais tours.
Un soir, à son habitude, il chanta des cantiques en s’accompagnant sur son harmonium. Quatre indigènes vinrent à passer et écoutèrent devant la porte pleins de recueillement. Quand ils lui demandèrent la permission d’entrer pour entendre les beaux cantiques de plus près, il la leur donna, quoiqu’ils appartinssent à un village voisin dont les habitants avaient une réputation de fripons et de voleurs.
Après quelque temps, deux des auditeurs partirent pendant un cantique. Les autres restèrent et dirent au missionnaire que leurs camarades avaient une course à faire et reviendraient les prendre. Eux deux n’avaient pu se résoudre à partir, parce qu’ils sentaient que leurs cœurs devenaient meilleurs en écoutant ces cantiques. Pour leur faire plaisir, le missionnaire continua à chanter quoiqu’entre temps il se fît tard. Chaque fois qu’il voulut s’arrêter, ils le prièrent de leur chanter encore tel cantique puis tel autre, parce que leur cœur n’était pas encore rassasié.
Enfin, les deux autres revinrent. Quand il eut ajouté encore un cantique pour ceux-ci, les visiteurs prirent congé. Le missionnaire, enchanté que ces hommes, qu’il connaissait par ailleurs comme peu recommandables, eussent fait preuve au moins une fois d’un bon mouvement, alla se coucher.
Le lendemain matin, il constata à sa grande consternation que le magasin de la mission avait été pillé. Des outils, des étoffes, du sel et du tabac que la station avait en magasin pour les troquer contre les vivres nécessaires à l’alimentation des élèves, il n’y avait plus rien. La serrure était intacte. Les voleurs l’avaient donc ouverte avec la clé, qui pendait d’ordinaire à un clou dans la chambre du missionnaire. Les objets volés furent découverts dans le village des quatre hommes, qui avaient écouté les cantiques avec tant de recueillement.
Pendant que le missionnaire chantait, les deux qui étaient ensuite partis avaient décroché du mur derrière son dos la clé du magasin et, tandis qu’il était obligé de continuer à chanter pour les deux autres, ils avaient, avec les gens de leur village, vidé le magasin en toute tranquillité. À leur retour, ils avaient remis la clé à sa place.
***
Dans la région du lac Tchad, où les habitants possèdent des chevaux, ce qui n’est pas le cas chez nous dans la forêt vierge, un fonctionnaire était chargé de remettre à un chef indigène une gratification de cinq cents francs en récompense de services rendus. S’étant acquitté de sa mission, il fit, par simple politesse, quelques remarques flatteuses sur le cheval du chef au moment où celui-ci allait monter en selle. Il apprit alors qu’il s’agissait d’un bon coursier. Là-dessus, encore pour faire plaisir au cavalier, il se mit à parler des courses en Europe et fit la remarque qu’une bête comme la sienne pouvait y gagner un prix de plus de deux mille francs. « Mon cheval », répliqua alors celui-ci, « est donc un plus grand chef que moi. À moi, on donne cinq cents francs, mais lui, il pourrait en obtenir deux mille. »
***
Dans une région de l’intérieur, où les indigènes depuis des générations pratiquent l’islamisme, des jeunes gens se moquèrent d’un vieillard qui était un lecteur assidu du Coran. « Tu dois bientôt le savoir par cœur, ton Coran », lui dirent-ils ; « n’en as-tu pas bientôt assez de lire toujours la même chose ? » « Pour moi, ce n’est pas du tout le même Coran », leur répondit-il. « Comme adolescent, je le comprenais en adolescent, comme homme, je le comprenais en homme, et maintenant comme vieillard, je le comprends en vieillard, parce que j’y découvre toujours des vérités nouvelles pour moi, je ne me lasse pas de le lire. »
Quand j’arrivai pour la première fois à Lambaréné, il y avait sur la station missionnaire un instituteur indigène âgé d’environ trente ans, appelé Ojembo, Ojembo signifie « la mélodie ».
Rarement beau nom fut mieux porté que par cet instituteur noir. Je me sentis tout de suite attiré vers cet homme intelligent, bon et modeste. Il avait quelque chose de si délicat qu’en sa présence on se trouvait presque intimidé.
Sa femme était également sympathique. Et les trois petits garçons, qui peuplaient la case en bambou servant de logement à la famille, étaient remarquablement bien élevés.
Ojembo traduisait mes sermons au culte. Le samedi soir, il venait chez moi pour la répétition. Je lui récitais tout le sermon phrase par phrase, pour voir s’il ne contenait pas de termes qui lui fussent inconnus ou pour lesquels il n’y eût pas d’équivalent dans la langue d’ici. Il faut bien prendre garde de ne pas parler dans le sermon de choses qui n’ont aucun sens pour les indigènes. Toute une série de paraboles de Jésus, il faut soit les laisser de côté, soit les rendre intelligibles par d’autres images, parce que les noirs de l’Ogooué ne savent pas ce que sont une vigne ou un champ de blé.
Vers la fin de la guerre, quand la mission eut des difficultés financières et dut réduire les traitements de son personnel, Ojembo quitta sa place d’instituteur pour se retirer dans son village situé au bord du lac Alombié, perdu dans la forêt. Avec son maigre salaire, lui et les siens avaient déjà auparavant eu de la peine à joindre les deux bouts. Maintenant, il fallait gagner de l’argent pour nourrir la famille. Il avait l’intention d’établir une plantation.
Quand je revins en Afrique, en 1924, je rencontrai Ojembo sur la côte. Avec des hommes de son village il venait de faire descendre un beau radeau d’okoumé et il toucha une forte somme de la maison hollandaise à laquelle il l’avait livré.
« Ojembo, tu as fait du chemin », lui dis-je. « À présent, te voici dans le commerce du bois et sur la meilleure voie pour devenir un homme riche. » « Je ne peux pas me plaindre », répondit-il, avec la modestie qui le caractérisait. À peine eus-je le temps de demander des nouvelles de sa femme et de ses enfants, qu’il dut partir pour assister à la livraison et au cubage du radeau. Moi-même, je dus aller dédouaner mes caisses.
Au fond, je n’étais pas fâché que nous n’ayons pas eu le temps de converser plus longuement. Ojembo, l’exploitant forestier, n’était pour moi plus le même qu’Ojembo, l’instituteur. Sur lui spécialement nous avions tous fondé de grands espoirs pour l’éducation de la jeunesse indigène. Nous avions attendu de lui qu’il montrât aux hommes de sa génération, dont la plupart ne pensaient qu’à se créer une situation grâce aux connaissances acquises à l’école supérieure de la mission, qu’il existait dans la vie des buts plus nobles. Les condisciples qui avaient passé les examens avec lui avaient dédaigné le métier d’instituteur. La perspective de mener une vie pénible avec un misérable traitement et d’avoir à faire du matin au soir à des petits noirs récalcitrants, ne leur avait pas paru tentante. Sans doute, ils savaient combien le manque d’instituteurs indigènes était grand ; sans doute, les missionnaires les avaient priés de placer le bien qu’ils pourraient faire à leurs compatriotes adolescents au-dessus du gain matériel. Mais chacun trouva un autre prétexte pour expliquer qu’il devait maintenant chercher d’abord une place bien rétribuée dans l’administration ou dans le commerce. Celui-ci devait payer les dettes de son frère ; cet autre avait des dettes lui-même ; un troisième voulait s’acheter une femme ; un quatrième avait besoin d’argent pour créer une plantation.
Ojembo seul avait choisi à la place du gain matériel le métier d’éducateur. Et maintenant lui aussi – c’était la faute de la guerre – avait fini par entrer dans le commerce du bois et y était resté. Je ne lui reprochais rien, mais j’en étais attristé.
Assez longtemps, je ne parlai à personne de mes impressions. Je ne voulais pas demander des nouvelles d’Ojembo aux missionnaires de Lambaréné. Mais chaque fois que je passais devant la case près de l’école de garçons d’où il était sorti si souvent pour venir s’entretenir avec moi, j’avais le cœur triste.
Un jour, des missionnaires vinrent à s’entretenir d’Ojembo en ma présence. « Ah oui », dis-je, « en voilà encore un que nous avons perdu, enlevé par le commerce du bois. Celui-ci, je le regrette plus que tous les autres ensemble. » « Perdu pour nous par le commerce du bois », dit un missionnaire, « que voulez-vous dire » ? « Eh bien », répliquai-je, « je l’ai pourtant rencontré à Port Gentil au moment où il livrait un grand radeau qu’il avait coupé avec des hommes de son village. Il m’a dit lui-même qu’il était maintenant dans le commerce du bois. »
« En effet », répondit le missionnaire, « il est dans les bois, mais il n’a pas renoncé pour cela à la vocation d’instruire. Il déploie maintenant une activité éducatrice beaucoup plus importante que du temps où vous le connaissiez à Lambaréné. »
Voici ce que j’appris alors. Quand Ojembo fut retourné dans son village, il persuada les habitants de débrousser tous ensemble une grande étendue de forêt, pour établir une belle plantation de manioc et de bananes. Il s’agit là d’un travail si pénible, que d’ordinaire les indigènes défrichent et mettent en culture tout juste ce qu’il faut pour ne pas mourir de faim. Pour cette raison, les famines ne sont pas rares dans ce pays. L’administration est souvent obligée de mettre des miliciens noirs en garnison dans les villages pour contraindre les habitants à défricher une étendue suffisante de forêt pour établir les plantations.
Mais, dans son village, Ojembo réussit par son opiniâtreté à ce que les habitants persévérassent dans le pénible travail d’abattre les géants de la forêt et qu’ils créassent la place pour une grande plantation. Elle commença à produire quand la guerre fut terminée et que le commerce de bois reprit. Le village avait alors non seulement des vivres en abondance pour ses propres besoins, mais il put fournir des bananes et du manioc aux exploitants forestiers européens pour leurs nombreuses équipes. Par Ojembo, les habitants furent ainsi amenés à travailler méthodiquement et ils connurent l’aisance.
La subsistance du village étant ainsi assurée, Ojembo fonda une école. Il ne pensa pas à solliciter une subvention de l’administration ou de la mission. Lui-même avait maintenant suffisamment pour vivre, et les enfants qui venaient à l’école pouvaient gagner leur nourriture et l’argent nécessaire pour les livres en travaillant dans la plantation pendant leurs heures de loisir. Celle-ci était toujours entretenue et agrandie. À côté des bananes et du manioc, on cultivait aussi le café et le cacao. Ainsi naquit dans cette région une école florissante.
Ojembo fut l’éducateur non seulement des enfants, mais aussi des adultes. Il leur persuada de reconstruire leur village. D’ordinaire, les indigènes habitent dans leurs cases de bambou, jusqu’à ce qu’elles soient pourries et s’écroulent sur eux. Alors ils réunissent à la hâte les matériaux indispensables pour en faire rapidement une autre. Pour réduire le travail, ils la construisent aussi petite que possible. Ojembo les amena à faire du bon travail aussi dans ce domaine. En quelques mois, un village aux cases spacieuses et bien construites remplaça l’ancien.
De loin déjà, me dit-on, ce village se distinguait des autres. Un village indigène ordinaire, on ne le voit que quand on est dedans. La brousse s’avance jusqu’aux cases. C’est déjà un travail bien dur que de défricher la forêt. Aussi les habitants se contentent d’ordinaire d’abattre les arbres sur quelques mètres de distance seulement, au lieu de créer un espace libre suffisant autour du village. Ensuite vient la besogne encore plus fatigante de couper régulièrement la broussaille et les hautes herbes qui repoussent continuellement à la place de la forêt. Tous les mois, il faut se remettre à la tâche. Bien vite, les gens s’en lassent. Que la brousse s’approche jusqu’au village, peu leur importe. Ils ne se soucient pas non plus qu’elle arrête chaque souffle d’air qui pourrait arriver à leurs cases, et que les moustiques qui vivent dans les hautes herbes leur apportent le paludisme. Grâce à l’autorité qu’il avait acquise peu à peu sur les habitants, Ojembo arriva à faire établir par eux un espace libre autour du village et vers le lac.
Certes les adversaires ne manquèrent pas à ce maître d’école qui entreprit de conduire le village. Les paresseux se révoltèrent contre lui. Ils répandirent même la calomnie qu’il obligeait les habitants à travailler pour s’enrichir lui-même. Mais Ojembo vint à bout de ses adversaires. Non qu’aux assemblées du village il les ait réduits au silence par la force de sa parole, car il n’avait pas le don de l’éloquence. Il vainquit par la pureté et la bonté de son caractère.
Quand la situation dans le commerce du bois redevint florissante, Ojembo proposa aux hommes de son village de s’associer pour en profiter. Auparavant déjà, ils avaient coupé du bois en commun. Mais l’exploitation avait toujours été menée sans ordre. Quand il s’agissait d’abattre et de tronçonner les arbres, d’amener les billes dans l’eau et de les réunir en radeau, plus d’un avait abandonné le travail sous les prétextes les plus divers. Beaucoup n’avaient en vue que leur part de l’avance que le commerçant blanc avait dû fournir pour les radeaux promis. Peu leur importait que la livraison se fît ensuite au moment convenu. Dans ces conditions, le bois restait parfois dans la forêt à pourrir, parce qu’il n’était pas amené à temps au fleuve. Si le radeau était livré, il y avait toujours des querelles sur la façon de partager l’argent qu’on en recevait.
Sous la direction d’Ojembo, tout cela changea. Il tint une comptabilité exacte des journées de travail fournies par chacun, des recettes et des dépenses. Chacun était sûr d’être payé en proportion de sa peine. L’ordre remplaça le désordre. On travailla beaucoup mieux et on gagna beaucoup plus.
Peu de temps après avoir entendu parler ainsi de son activité éducatrice, je reçus la visite d’Ojembo, qui vint me saluer à l’hôpital. Pour moi il était redevenu l’Ojembo de jadis. Je lui dis combien je me réjouissais de son œuvre, et j’aurais voulu en apprendre plus de sa propre bouche. Mais il n’y avait pas moyen de lui faire abandonner sa modestie. Une grande pudeur le retenait de parler de lui-même. Je ne pus pas exécuter mon projet d’aller le voir dans son village, situé à 150 kilomètres de Lambaréné, parce que j’étais trop absorbé par mon hôpital.
Mais selon la parole de l’évangile, la ville située sur la hauteur ne peut rester cachée. J’en fis l’expérience en 1927, sur le vapeur qui me ramenait en Europe. Nous étions assis en cercle, quelques exploitants forestiers, un missionnaire et moi-même, et nous parlâmes de ce que nous avions vu et vécu dans le pays de l’Ogooué. Les marchands ne tarissaient pas sur des histoires d’avances qu’ils avaient fournies aux indigènes, sans jamais recevoir le bois promis, de radeaux qu’ils avaient achetés pour apprendre ensuite qu’on les avait vendus en même temps à des concurrents, d’essences sans valeur, qu’ils avaient reçues à la place de celles qui étaient stipulées au contrat.
« Cependant les indigènes ne sont pas tous les mêmes », interrompit l’un d’eux. « J’ai fait la connaissance d’un au moins, en qui on peut avoir une confiance absolue. Il habite dans la région du lac Alombié. Si vous allez chez lui pour conclure un marché, vous êtes sûr de recevoir le bois de la qualité stipulée et à temps. Et tandis qu’ailleurs les indigènes s’ingénient à vous extorquer avance sur avance, celui-ci refuse même celles qui lui sont offertes. Je n’en crus pas mes oreilles, quand je l’entendis me dire que je n’avais rien à payer avant la livraison. »
« Cet indigène s’appelle Ojembo », dit le missionnaire. « En effet, c’est son nom », répondit l’exploitant forestier. À son tour un autre intervint. « Moi aussi j’ai une histoire à raconter au sujet de cet Ojembo. Sur le lac je fus surpris par une tornade dans une pirogue à fond plat. Le vent était contre nous, et nous commençâmes à perdre l’espoir de gagner la rive. Ce n’était plus qu’une question de temps pour notre embarcation, qui se remplissait déjà d’eau, d’être retournée par les vagues. La plupart des indigènes qui étaient avec moi ne savaient pas nager, car ils étaient de l’intérieur. Je ne mis aucun espoir dans les habitants du village. Les indigènes ne sont pas facilement portés à risquer leur vie pour les autres. Et comment auraient-ils pu nous secourir ? C’est seulement dans un grand canot à quille qu’on aurait pu se hasarder sur le lac démonté. Mais aujourd’hui, les indigènes ne possèdent plus des embarcations de ce genre. Ils ne se donnent pas la peine de les tailler. Tout d’un coup, je vis à travers la pluie torrentielle un grand canot quitter la rive et se diriger vers nous. Il nous atteignit juste au moment où nous commencions à couler. Les gens ne se contentèrent pas de nous sauver, mais ils repêchèrent aussi mes caisses. Dans le village, nous reçûmes des effets secs, nous fûmes bien logés et bien nourris. Le chef, qui m’avait emmené dans sa case, fit apporter les caisses et les ouvrit pour faire sécher le contenu. Avez-vous déjà vu quelque chose de pareil au Gabon ? Quand le lendemain je procédai à l’inventaire, absolument rien ne manqua. Mais voici le comble. Quand je fis mes adieux pour continuer le voyage dans ma pirogue, que les indigènes avaient sauvée après la tornade, je remerciai le chef et je lui demandai combien je devais aux habitants du village pour leur peine. Il me répondit qu’ils n’avaient fait que leur devoir d’hommes et de chrétiens et qu’ils ne voulaient rien en échange. Voilà ce qui m’est arrivé avec Ojembo. »
De cette manière, Ojembo est devenu l’éducateur de son village. Son influence s’étend bien au delà. La dernière fois que je le vis, il était très soucieux, parce que les éléphants avaient dévasté à plusieurs reprises les plantations établies par ses gens.
Au cours des années passées parmi les indigènes, j’ai acquis la conviction qu’à côté de certains traits de caractère qui ne sont pas à leur avantage ils ne manquent pas de qualités. Nous sommes tous trop enclins à les juger seulement d’après les ennuis et les déceptions qu’ils nous causent quand ils sont à notre service ou en relations d’affaires avec nous.
Je ne nie point qu’il y en ait beaucoup parmi eux qui soient indisciplinés et nonchalants, que beaucoup d’entre eux également succombent trop facilement à la tentation de s’approprier le bien d’autrui et se laissent entraîner trop fréquemment à nous tromper. Pour leur excuse, je crois devoir ajouter qu’ils ne sont pas encore à leur aise dans la situation de salariés, dans laquelle nous les connaissons d’ordinaire. Ayant grandi dans la liberté, ils viennent chez nous pour gagner de l’argent dans un but déterminé, en général l’achat d’une femme. Servir n’est pas un métier pour eux, mais seulement un épisode dans leur existence d’hommes libres. Le travail sous nos ordres leur est une obligation à laquelle ils se sont soumis pour gagner de l’argent, mais qu’ils cherchent à éluder dans la mesure du possible. L’idéal du fidèle serviteur, tel qu’il s’est formé chez nous autres au cours d’une longue évolution ne leur deviendra familier que peu à peu et dans la mesure où nous saurons prendre un ascendant moral sur eux et les éduquer. Voilà la raison pour laquelle les indigènes qui sont à notre service à l’heure actuelle ont une tendance à ne pas se montrer sous leur meilleur jour. De notre côté, nous ne nous appliquons pas assez à les traiter comme il le faudrait. Savoir manier des serviteurs de cette espèce particulière demande une longue expérience et une grande maîtrise de soi-même. Nous tous, nous sommes toujours tentés de les invectiver beaucoup trop et de nous laisser entraîner à les humilier par des remarques méprisantes. Dans la grande fatigue que nous cause la chaleur déprimante et dans la nervosité que nous donne l’obligation de veiller constamment nous-mêmes aux moindres détails et de nous attendre toujours à des erreurs et à des négligences de nos gens, il nous faut un grand effort pour rester capables non seulement de les commander, mais d’être leurs éducateurs. Néanmoins, combien de fidèles serviteurs n’ai-je pas connus au cours de ces années non seulement parmi mes gens, mais aussi parmi ceux d’autres européens. Le caractère des indigènes ne consiste pas uniquement en défauts et en stupidités, comme on pourrait le croire d’après le dire de voyageurs qui jugent uniquement sur les ennuis que leur ont causés leurs porteurs et leurs pagayeurs.
Pour comprendre vraiment l’indigène, il est indispensable que nous ayons avec lui non seulement des rapports de maître à serviteur, mais aussi d’homme à homme. Il importe de pénétrer à travers l’extérieur plus ou moins étonnant et plus ou moins sympathique qu’il peut nous présenter pour saisir sa véritable nature. Celui qui y a réussi découvre alors des qualités chez l’indigène.
Le noir ne connaît pas le dévouement qui oblige l’homme à secourir son prochain, tel qu’il nous est enseigné depuis notre enfance par l’Ancien et le Nouveau Testament. Comparé à nous autres européens, il est un être presque asocial, aussi longtemps qu’il ne s’agit pas de l’accomplissement des devoirs les plus immédiats commandés par la famille ou la tribu. Il est encore occupé trop exclusivement de lui-même. Par contre, quand il s’agit de supporter des injustices, il fait souvent preuve d’un calme et d’une mansuétude capables de nous surprendre. J’ai l’impression qu’il est moins accessible que nous aux sentiments de colère et de vengeance.
Un exploitant forestier quelque peu nerveux mais foncièrement bon me dit un jour : « Quel bonheur que les indigènes aient meilleur caractère que nous. » Il y a un brin de vérité dans ces paroles. Chacun d’entre nous a déjà été confondu par la manière dont les indigènes supportent notre mauvaise humeur. Ils continuent tranquillement leur travail et se montrent aimables envers nous, comme si nos invectives, qui n’étaient pas sans motifs mais bien exagérées quand même, ne les avaient pas frappés.
Un européen des environs de Samkita était en palabre avec les habitants d’un village situé en aval de son établissement. Ne pouvant obtenir d’eux la satisfaction qu’il demandait, il décida de porter plainte contre eux auprès du chef de district à Lambaréné. En partant pour ce voyage, il n’avait pas fait attention à une tornade qui se préparait, et fut surpris par elle en amont du village de ses adversaires. Cramponné avec ses hommes à la pirogue chavirée, il passa devant le village. Entendant leurs appels, les habitants se portèrent à leur secours, malgré les dangers de la tornade et n’ignorant pas de qui il s’agissait. Ils ne sauvèrent pas seulement les hommes, mais repêchèrent aussi toute une partie du chargement. Quoiqu’ils sussent bien dans quel but le blanc avait voulu descendre à Lambaréné, ils ne mentionnèrent d’aucune façon qu’au cours de ce voyage il s’était trouvé obligé de faire appel au secours des hommes contre lesquels il avait voulu porter plainte.
Je connais d’autres exemples où les indigènes ont fait preuve de délicatesse. Envers moi-même, ils l’ont fait parfois d’une manière qui m’a étonné. Le tact naturel, bien des indigènes, même parmi les plus primitifs, le possèdent.
Je m’étonne également des idées et des sentiments que je surprends chez les noirs. Leur esprit est occupé des problèmes de l’existence humaine, même s’ils nous en parlent rarement. Mais si les circonstances les amènent à s’ouvrir à nous, ils nous révèlent parfois une vie intérieure et une spiritualité que nous n’avions pas soupçonnées. J’ai eu avec des indigènes des entretiens qui m’ont impressionné. Des médecins et des infirmières de mon hôpital et des européens de ma connaissance ont fait la même expérience.
D’après ce que j’ai vécu durant mon long séjour au Gabon avec l’indigène, je ne doute donc pas que quiconque se donne la peine de chercher à découvrir sa véritable personnalité est amené à le respecter et à l’estimer.
***
Les indigènes qui ont fréquenté l’école et qui n’étaient pas parmi les tout derniers jugent d’ordinaire au-dessous de leur dignité les travaux du cultivateur ou de l’artisan. Leur ambition est d’acquérir les connaissances nécessaires pour siéger, vêtus de blanc, dans un bureau de l’administration, ou pour se tenir comme vendeur derrière le comptoir d’une factorerie.
Sans doute, l’administration et les commerçants ont besoin d’indigènes qui possèdent une bonne instruction. Mais c’est un réel danger pour l’avenir de la colonie que les noirs qui sortent des écoles inclinent à mésestimer l’agriculture et l’artisanat.
Ce n’est pas en apprenant à lire et à écrire que les indigènes accèdent à la civilisation, mais par l’agriculture et les métiers. Quand nous lisons dans les journaux que l’Afrique s’ouvre à la civilisation par le fait qu’une nouvelle voie ferrée a été inaugurée, ou qu’une route pour automobiles relie à présent tel endroit à tel autre, ou encore qu’une nouvelle ligne aérienne fut créée, nous, qui sommes sur place, nous faisons des réserves. Sans doute tout cela contribue au développement de la colonie. Mais l’avenir de la civilisation dépend ici essentiellement des progrès que feront les indigènes dans le domaine matériel, intellectuel et moral.
Plus encore que d’instituteurs, qui leur inculquent le savoir, les indigènes ont besoin de cultivateurs et d’artisans, qui les initient aux travaux manuels. Aucun indigène ne devrait fréquenter les écoles sans apprendre en même temps un métier. Amener les noirs à s’adonner à la culture de la terre et aux métiers, tel est le grand problème qui se pose pour toutes les colonies africaines et qui est si difficile à résoudre.
Ce n’est pas un des moindres mérites des missions chrétiennes que de posséder sur leurs stations des artisans pour éduquer les indigènes. Ce sont des charpentiers et des maçons indigènes, formés sur les stations missionnaires, qui m’ont permis de construire mon hôpital.
Nous tous, qui vivons aux colonies, nous devons user de toute notre influence pour mettre l’agriculture et les métiers en honneur auprès des indigènes. Mais il n’est pas facile de convaincre les jeunes gens qui sortent des écoles que le travail au bureau ou à la factorerie n’est pas le seul qui soit indiqué pour eux.
La mentalité que nous avons à combattre se manifeste de façon typique dans deux histoires que j’ai vécues.
Il y a quelques années, j’avais entrepris pendant la saison sèche la construction d’un nouveau bâtiment. Mais les pluies arrivèrent plus tôt que nous ne les avions attendues. Il s’agissait donc de mettre au plus vite à l’abri dans un hangar les planches et les chevrons que nous pouvions auparavant laisser dehors. Moi-même, je peinai à en porter avec deux noirs, les seuls aides dont je disposais à ce moment. Apercevant un indigène habillé de blanc assis à côté d’un malade qu’il était venu visiter, je l’invitai à venir nous donner un coup de main. « Je suis un intellectuel et je ne porte pas de bois », fut sa réponse. « Tu as de la chance », répliquai-je, « moi aussi, je voulais devenir un intellectuel, mais je n’y ai pas réussi. » Je ne pus le décider à nous aider.
Un jour que j’étais sur le point de partir en congé pour l’Europe, un indigène de ma connaissance, magasinier d’une maison de commerce de Lambaréné, vint me prier d’emmener son fils âgé de douze ans pour le mettre à l’école chez les blancs. Je connaissais son fils comme un garçon brave et intelligent, et je promis au père de le faire venir en Europe quand il serait plus âgé. « Laisse ton garçon d’abord terminer l’école de la mission », lui dis-je, « et faire ensuite son apprentissage comme charpentier et aussi comme serrurier chez les missionnaires artisans. Alors, il pourra m’accompagner en Europe où je le confierai aux meilleurs des maîtres. En même temps il pourra apprendre à ressemeler les chaussures, puisque personne dans toute la région de Lambaréné ne s’entend à ce travail pourtant bien rémunérateur. À son retour d’Europe, il pourra s’établir ici et gagner largement. »
L’indigène secoua la tête. « Ce n’est pas ce que je voulais », dit-il. « Quels projets avais-tu donc pour ton fils ? » lui demandai-je. « Je voulais qu’en Europe tu le mettes à l’école pour qu’il puisse devenir journaliste ou avocat. »
Un indigène passablement instruit et déjà âgé dit à une de mes infirmières : « Si jamais je reviens au monde, je veux devenir professeur de philosophie, et écrire des livres. »
J’ai constaté que les indigènes inclinent à considérer les blancs qui font du travail manuel comme des blancs de condition inférieure. À leurs yeux, les matelots sont des parias, parce que leur métier peut les obliger à manier des caisses, travail qui en colonie échoit d’ordinaire à l’indigène. C’est ainsi que les hommes d’une équipe de travailleurs qui trouvaient que je leur en demandais trop me dirent : « Tu nous traites comme des matelots. »
En Europe on dit « travailler comme un nègre », chez les noirs cela s’appelle « travailler comme un matelot. »
Le directeur d’une grande maison de commerce et sa femme emmenèrent leur boy Boussougou, quand ils partirent pour un assez long congé en Europe. Le soir, en arrivant à l’hôtel, à Bordeaux, ils lui dirent que le lendemain matin il avait à descendre de la mansarde où il était logé, pour faire son service dans la chambre de ses maîtres au premier étage.
Pour lui montrer sa mansarde, le maître prit l’ascenseur avec lui. Quand celui-ci se mit en marche, le boy eut peur, se jeta aux pieds du blanc, saisit ses genoux et gémit : « Aie pitié de moi, monsieur, aie pitié ! » Le maître le calma et lui expliqua que l’ascenseur était une grande caisse qui montait et descendait les escaliers à la place des hommes, pour leur épargner la peine de le faire eux-mêmes. L’ayant conduit dans sa chambre, il lui recommanda une dernière fois de se présenter sans faute à huit heures au premier étage.
Le lendemain matin, il l’attendit en vain. Un garçon qu’il dépêcha le quérir revint et dit que le noir était assis en haut de l’escalier et refusait de descendre.
Le maître dut donc monter lui-même. « Pourquoi n’es-tu pas venu ? » lui demanda-t-il rudement. « Monsieur, j’attends la caisse qui doit me faire descendre l’escalier. »
***
De Bordeaux on se rendit à la campagne. Ce brave Boussougou, que les hôtes connaissaient déjà par lettres, eut une jolie petite chambre avec un grand lit. « Sais-tu comment on se couche dans ce lit ? » lui demanda son maître en lui montrant la chambre. Mais l’orgueil du boy ne lui permit pas de laisser supposer qu’il avait besoin d’un enseignement à ce sujet. Le lendemain matin, le maître le trouva couché entre le sommier et le matelas.
***
Un jour que Boussougou portait un sac de haricots à travers la rue, le sac s’ouvrit. Pendant qu’il était en train de ramasser le contenu, une dame amie de la famille vint à passer et se mit à l’aider. Sur ce, Boussougou s’arrêta et la laissa faire toute seule. Quand tous les haricots furent de nouveau dans le sac, il lui donna une petite pièce. « Voilà cadeau pour toi. » Dans sa mentalité de primitif, il n’avait pu s’expliquer l’empressement que la dame avait mis à l’aider autrement que par le désir d’être tant soit peu rétribuée.
***
Au début de l’automne, toute la maison fut réveillée un matin par les cris du boy. Le maître se précipita dans sa chambre et le trouva couché, gémissant qu’il allait mourir. Avec cela, il avait bonne mine et le pouls était tout à fait normal. « Qu’as-tu donc », lui demanda le maître », « que signifient ces cris ? » « Monsieur il y a le feu dans mon intérieur. » Sa peau était pourtant fraîche au toucher. « Tu n’as pas de fièvre, lève-toi donc ! » répondit le maître. « Je ne peux pas, monsieur. Oh, le feu, le feu ! Ne vois-tu pas la fumée qui sort de ma bouche ? » Sous l’équateur le boy n’avait jamais vu la buée formée par sa respiration. Durant le voyage d’été, il n’en avait pas eu l’occasion non plus. Il fut donc saisi d’effroi quand il vit, par ce matin d’automne, une fumée sortir de sa bouche. En vain son maître essaya de lui expliquer le phénomène, et de le calmer en lui montrant qu’il se produisait également chez lui.
Finalement, on le tira hors du lit, et on le mena dans la cour. Seule la vue des chevaux, qui à l’abreuvoir rejetaient de grandes volutes de buée par les naseaux, sans paraître incommodés le moins du monde, calma peu à peu sa peur.
***
Deux exploitants forestiers qui se rendaient ensemble en Europe y emmenèrent leurs boys. Ceux-ci s’habituèrent assez bien à leur nouvelle existence et, vêtus à l’européenne, se conduisirent de façon à faire oublier ce qu’ils avaient été auparavant.
Vint le retour, que leurs maîtres accomplirent encore en commun. Pour réduire le nombre des bagages à enregistrer, ils emportèrent une telle quantité de colis à main, que les filets du compartiment de troisième dans lequel devaient monter les boys furent complètement remplis de ce qu’ils n’avaient pu caser dans leur compartiment de première.
Les deux messieurs n’étaient pas très rassurés sur la tournure que prendraient les événements dans le cas où un voyageur, pour placer ses bagages dans le compartiment en question, s’adresserait au contrôleur. Ils jugèrent donc prudent de se retirer dans le wagon des premières et de laisser venir les choses.
Il ne resta pas une place libre dans leur compartiment. Il en fut de même pour toutes les voitures, autant qu’ils purent s’en rendre compte. Le train qu’ils prenaient était le dernier qui arrivait à Bordeaux pour le départ du bateau à destination de l’Afrique occidentale et équatoriale.
De loin, ils virent les deux boys devant leur compartiment, sans être dérangés le moins du monde. Personne ne vint avec le contrôleur exiger de la place pour des bagages. Au dernier moment, un des maîtres se risqua à approcher de la voiture pour élucider la cause de ce fait inexplicable. Les boys, vêtus de leurs manteaux gris et le melon repoussé sur la nuque, se tenaient devant leur compartiment. Dès que quelqu’un faisait mine d’approcher, ils disaient en montrant les dents et en roulant les yeux : « Ceci case pour nous ». Avant d’avoir remis le pied sur le bateau, ils étaient redevenus les primitifs qu’ils étaient auparavant. Personne n’eut envie de partager leur compartiment. Quand le train se mit en marche, les boys s’étendirent sur les banquettes et dormirent jusqu’à Bordeaux, tandis que leurs maîtres passèrent la nuit assis dans un compartiment de première bondé.
***
Un planteur qui habite en amont de Samkita avait emmené en Europe son fidèle cuisinier N’Géma, que je connaissais bien. Celui-ci lui rendit de bons services pendant le congé.
Le premier soir après leur retour, les amis de N’Géma se réunirent devant la cuisine, pour l’entendre parler de l’Europe. Son maître, qui comprenait bien la langue indigène, éteignit la lampe de la véranda et écouta dans l’ombre. N’Géma décrivit le voyage sur le grand vapeur, la tempête sur la mer, le trajet en chemin de fer, les grandes cases des blancs, les magnifiques plantations qu’on n’a pas besoin de défendre contre les éléphants. Il parla ensuite des forêts d’Europe, dans lesquelles on peut se promener sans être obligé de se frayer le chemin à coups de matchette, des plantations où poussent la farine et le vin, des villages qui comptent un si grand nombre d’habitants qu’ils ne se connaissent pas tous par leur nom, et de bien d’autres choses encore. Chaque fois, les auditeurs ponctuèrent ses récits de ah et de oh admiratifs et demandèrent à en entendre davantage. Alors il leur parla des sous-marins et des avions. Mais la chose la plus étonnante, il l’avait réservée pour la fin. « En Europe, les gens travaillent d’eux-mêmes. Pas besoin qu’il y ait quelqu’un à côté pour taper dessus ! »
***
Deux boys qui avaient accompagné leur maître, un exploitant forestier, dans sa propriété en Europe, durent également à leur retour faire à leurs amis le récit de ce qu’ils avaient vu. Le plus étonnant à leur avis était qu’en Europe les animaux eux-mêmes travaillaient. Cette nouvelle provoqua une grande curiosité. Pour la satisfaire, ils furent obligés de décrire à plusieurs reprises comment, après avoir quitté le navire, ils montèrent dans une grande voiture, attelée de deux animaux plus grands que des buffles, et comment le blanc appela ces animaux par leur nom et leur parla comme à des hommes, sur quoi tantôt ils allaient lentement, tantôt vite, tantôt s’arrêtaient. Comme leurs auditeurs n’avaient jamais vu de chevaux, il ne fut pas facile aux boys de leur décrire ces animaux. L’explication du travail des bœufs traînant la charrue leur causa également de grandes difficultés.
***
Dans tous les récits d’indigènes revenus d’Europe j’ai constaté sans exception que c’est la culture du sol qui leur produit la plus grande impression, non le chemin de fer, non les avions, non les sous-marins. Je fais moi-même une expérience analogue à chaque retour. La grande ville, l’hôtel, le chemin de fer, tout cela me redevient rapidement familier. Mais traverser ensuite la campagne où les champs succèdent aux champs est une vision si inaccoutumée et en même temps si grandiose, que j’en suis ému jusqu’au plus profond de moi-même.
En Europe, l’homme est le maître du sol. Dans la forêt vierge de l’Afrique équatoriale, il est un être qui à grand’peine arrache un lopin de terre à la nature pour la cultiver. La plantation reste entourée par la forêt, qui tôt ou tard l’absorbera à nouveau…
FIN
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Juin 2019.
—
— Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : YvetteT, PatriceC, Jean-Luc, FrançoiseS, Coolmicro.
— Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
— Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l’original. Nous rappelons que c’est un travail d’amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.
[1] Aloysius Horn : Trader Horn, librairie Stock. Trader Horn écrit Adanimamongo. L’explorateur Alfred Marche qui séjourna ici à plusieurs reprises entre 1872 et 1877 rend le nom par Adanlinanlango. Adolinanongo est la seule correcte.
[2] Paul Du Chaillu, Explorations and Adventures in Equatorial Africa. London, 1861. Édition française : Voyages et aventures dans l’Afrique équatoriale, Paris, Michel Lévy, 1863.